
Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale (1917-19)
2 vols in 1
 |
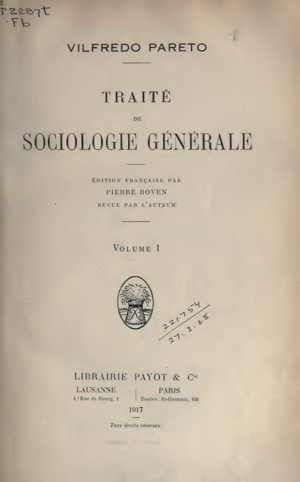 |
| Vilfredo Pareto (1848-1923) |
[Created: 31 Aug. 2022]
[Updated: May 2, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. 2 Volumes. (Paris: Librairie Payot, 1917, 1919).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Pareto/1917-TraiteSocGen/TSG-2vols-in1.html
This edition is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub. [See below for details.]
This book is part of a collection of works by Vilfredo Pareto (1848-1923).
Editor's Introduction
This work was originally published in two volumes, firstly in Italian in 1916, and then in a revised edition in French in 1917. It was later translated into English in 1935.
1. Vilfredo Pareto, Trattato di sociologia generale (Firenze : G. Barbera, 1916). 2 vols.
2. Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale. Édition française par Pierre Boven. Revue par l’auteur. Volume I (Paris: Librairie Payot, 1917). Volume II (Paris: Librairie Payot, 1919).
- vol. 1 facs. PDF; eBook formats: HTML, PDF, and ePub
- vol. 2 facs. PDF; eBook formats: HTML, PDF, and ePub
- "Two volumes in One" in eBook formats: HTML, PDF, and ePub
3. Vilfredo Pareto, The Mind and Society: A Treatise on General Sociology. Edited by Arthur Livingston. Translated by Andrew Bongiorno and Arthur Livingston, with the advice and active cooperation of James Harvey Rogers. (New York: Harcourt, Brace, 1935; New York: Dover Publications, 1963).
Editor's Note
I have put this work online in a version which tries to preserve the original format of the book as much as possible. The version here combines boyth volumes with all the Notes and ancillary pieces into one very large file (6.5 MB) with some slight reorganisation on my part. I have had to make some decisions about how best to display the text, as well as make some compromises in putting this text online. I have:
- added a gap between the numbered sections into order to break up what is a massive amount of text
- chose not to insert the original page numbers, as is my usual practice, because of the sheer number of pages (1,761 plus various "tables" and other material). I think the numbered sections (some 2,612) is an adequate substitute for the purposes of scholalry citation. I have also provided a facsimile PDF version of the text if readers wish to examine individual pages.
- moved all the footnotes to the end since there were so many very long footnotes which ran on for a couple of pages in some instances.
- decided not to link the endnotes to their reference numbers in the text as I did not have the time or the resources to do this by hand for some 1,785 (as I do not know how to do this programmatically)
- chose to render the very many Greek quotes (some 540) as screenshot images instead of transcribing them into text
Table des matières
TABLE DES CHAPITRES - DEUXIÈME VOLUME
Les chapitres
- Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64
- Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149
- Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204
- Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632),vol. 1, pp. 205-344
- Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841),vol. 1, pp. 345-449
- Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), vol. 1, pp. 450-577
- Chapitre VII. – Les résidus (suite) Examen des IIIe et IVe classes. (§1089 à §1206), vol. 1, pp. 578-648
- Chapitre VIII. – Les résidus (suite) Examen des Ve - et VIe classes. (§1207 à §1396),vol. 1, pp. 649-784
- Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886
- Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe.(§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009
- Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305
- Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600
- Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761
Notes ajoutées par l’auteur à l’édition françaises, vol. 2, p. 1763
Les Notes
- Notes du Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64
- Notes du Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149
- Notes du Chapitre III. – Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204
- Notes du Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632), vol. 1, pp. 205-344
- Notes du Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841), vol. 1, pp. 345-449
- Notes du Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), pp. vol. 1, 450-577
- Notes du Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) Examen des IIIe et IVe classes. vol. 1, pp. 578-648
- Notes du Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) Examen des Ve - et VIe classes. vol. 1, pp. 649-784
- Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886
- Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009
- Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305
- Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600
- Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761
Les Tables analytique, des auteurs, et des ouvrages cités
- Table analytique des matières contenues dans les deux volumes, vol. 1, pp. ix-xxx
- Table des auteurs et des ouvrages cités (dans le premier volume), vol. 1, pp. xxxi-xlix
- Table des auteurs et des ouvrages cités dans le second volume de l’édition française depuis la parution du premier volume, vol. 2, p. ix
A Madame JANE REGIS
Hommage de Vilfredo Pareto
TABLE DES CHAPITRES (vol. 1)↩
Les chiffres arabes indiquent les pages.
PREMIER VOLUME
Chapitre I. – Préliminaires (§1 à §144) ... 1
Énoncé des règles suivies dans cet ouvrage. - Les sciences logico-expérimentales et les sciences non- logico-expérimentales. - Leurs différences. - Le domaine expérimental est absolument distinct et séparé du domaine non-expérimental. - Dans cet ouvrage, nous entendons demeurer exclusivement dans le domaine expérimental. - Notre étude est essentiellement contingente, et toutes nos propositions doivent être entendues avec cette restriction : dans les limites du temps, de l'espace et de l'expérience à nous connus. - Cette étude est un perpétuel devenir ; elle procède par approximations successives, et n'a nullement pour but d'obtenir la certitude, le nécessaire, l'absolu. - Considérations sur le langage des sciences logico-expérimentales, des sciences non logico-expérimentales, sur le langage vulgaire. - Définition de divers termes dont nous faisons usage dans cet ouvrage. - Les définitions sont de simples étiquettes pour désigner les choses. - Les noms ainsi définis pourraient être remplacés par de simples lettres de l'alphabet.
Chapitre II. – Les actions non-logiques (§145 à §248) ... 64
Définition et classification des actions logiques et des actions non-logiques. - Comment celles-ci sont parfois capables d'atteindre très bien un but qui pourrait être logique. - Les actions non-logiques chez les animaux. - Les actions non-logiques chez les hommes. - La formation du langage humain. - Chez les hommes, les actions non-logiques sont en partie manifestées par le langage. - La théologie et le culte. - Les théories et les faits dont elles sont issues. -Différence d'intensité, chez des peuples différents, des forces qui unissent certaines tendances non-logiques, et des forces qui poussent à innover. - Exemple des peuples romain et athénien, anglais et français. - Pouvoir occulte que les mots semblent avoir sur les choses ; type extrême des théories théologiques et métaphysiques. - Dans les manifestations des actions non-logiques, il y a une partie presque constante et une partie très variable. - Exemple des orages provoqués ou conjurés. - Les interprétations s'adaptent aux tendances non-logiques du peuple. - L'évolution est multiple. - Premier aperçu de la nécessité de distinguer entièrement la vérité logico-expérimentale d'une doctrine, de son utilité sociale, ou d'autres utilités. - Forme logique donnée par les hommes aux actions non-logiques.
Chapitre III.– Les actions non-logiques dans l'histoire des doctrines (§249 à §367) ... 150
Si les actions non-logiques ont autant d'importance qu'il est dit au chapitre précédent, comment se fait-il que les hommes éminents qui ont étudié les sociétés humaines ne s'en soient pas aperçus ? - Le présent chapitre fait voir qu'ils s'en sont aperçus ; souvent ils en ont tenu compte implicitement ; souvent ils en ont parlé sous d'autres noms, sans en faire la théorie ; souvent ils n'ont considéré que des cas particuliers, sans s'élever au cas général. - Exemples de divers auteurs. - Comment l'imperfection scientifique du langage vulgaire contribue à étendre les interprétations logiques d'actions non-logiques. -Exemples. - Les hommes ont une tendance à éliminer la considération des actions non-logiques, qui sont, de ce fait, recouvertes d'un vernis logique ou autre. - Classification des moyens employés pour atteindre ce but. - Examen des différents genres. - Comment les hommes pratiques considèrent les actions non-logiques.
Chapitre IV. – Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632) ... 205
Les termes courants de religion, de droit, de morale, etc., correspondent-ils à quelque chose de précis ? - Examen du terme religion. - Examen des termes : droit naturel, droit des gens. - La droite raison, le juste, l'honnête, etc. - Les doctrines types et les déviations. - Les matériaux des théories et les liens par lesquels ils sont unis. - Exemples divers. - Comment la sociologie fait usage des faits. - L'inconnu doit être expliqué par le connu, le présent sert à expliquer le passé, et, d'une manière subordonnée, le passé sert aussi à expliquer le présent. - La probabilité des conclusions. - Classification des propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale, ou qui la négligent. - Examen des genres de la catégorie dans laquelle les êtres abstraits sont connus indépendamment de l'expérience.
Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841) ... 345
Comment, une théorie étant donnée, on remonte aux faits dont elle peut tirer son origine. - Examen de la catégorie de théories dans laquelle les entités abstraites reçoivent explicitement une origine étrangère à l'expérience. - Résumé des résultats obtenus par l'induction. - Les principaux consistent en ce que, dans les théories non logico-expérimentales (c), il y a une partie peu variable (a) et une partie très variable (b) ; la première est le principe qui existe dans l'esprit de l'homme ; la seconde est constituée par les explications données de ce principe et des actes dont il procède. - Éclaircissements et exemples divers. - Dans les théories qui ajoutent quelque chose à l'expérience, il arrive souvent que les prémisses sont au moins partiellement implicites ; ces prémisses constituent une partie très importante du raisonnement. - Comment de certains principes arbitraires (a) on s'est efforcé de tirer des doctrines (c). - Exemples divers.
Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088) ... 450
Si l'on suivait la méthode déductive, ce chapitre devrait figurer en tête de l'ouvrage. - Ressemblances et différences, quant aux parties (a) et (b), entre les sciences logico-expérimentales et les sciences non logico- expérimentales. - La partie (a) correspond à certains instincts, mais ne les embrasse pas tous ; en outre, pour déterminer les formes sociales, il faut ajouter les intérêts. Aspect objectif et aspect subjectif des théories. - Exemples de la méthode à suivre pour séparer (a) de (b). - On donne des noms (arbitraires) aux choses (a), (b) et (c), simplement pour faciliter l'exposé. - Les choses (a) sont appelées résidus, les choses (b) dérivations, les choses (c) dérivées. - Correspondant aux instincts, les résidus manquent de précision. - Analogie entre notre étude des phénomènes sociaux et celle de la philologie. - Cette analogie provient du fait que le langage est un des phénomènes sociaux. - Classification des résidus. - Examen des résidus de la Ie et de la IIe classes.
Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) ... 578
Examen des IIIe et IVe classes.
Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) ... 649
Examen des Ve - et VIe classes.
TABLE DES CHAPITRES↩
DEUXIÈME VOLUME
Chapitre IX. – Les dÉrivations (§1397 à §1542) ... 785
Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus). - Comment les dérivations se développent. - Les dérivations constituent le matériel employé tant dans les recherches non logico- expérimentales que dans les recherches logico-expérimentales ; mais les premières supposent aux dérivations le pouvoir d'agir directement sur la constitution sociale, tandis que les secondes les tiennent uniquement pour des manifestations des forces ainsi agissantes ; elles recherchent, par conséquent, les forces auxquelles correspondent, plus ou moins rigoureusement, les dérivations. - La part que nous attribuons ici au sentiment a été reconnue, bien qu'assez peu distinctement, par plusieurs des auteurs qui ont étudié les sociétés humaines. - La logique des sentiments. - La démonstration des dérivations n'est très souvent pas le motif qui les fait accepter. - Classification des dérivations. - Examen des I-, IIe et IIIe classes.
Chapitre X – Les dÉrivations (suite) (§1543 à §1686) ... 887
Examen de la IVe classe.
Chapitre XI. – PropriÉtÉs des rÉsidus et des dÉrivations (§1687 à §2059) ... 1010
Deux problèmes se posent : Comment agissent les résidus et les dérivations ? Dans quel rapport cette action se trouve-t-elle avec l'utilité sociale ? - Les raisonnements vulgaires soutiennent que les dérivations sont la cause des actions humaines, et parfois aussi des sentiments ; tandis que fort souvent les dérivations sont au contraire un effet des sentiments et des actions. - Les résidus en rapport avec les êtres concrets auxquels ils appartiennent. - Répartition et changements dans l'ensemble d'une société. - Les classes des résidus sont peu variables, les genres en sont beaucoup plus variables. - Formes et oscillations du phénomène. -Rapport entre les résidus et les conditions de la vie. - Action réciproque des résidus et des dérivations. - Influence des résidus sur les résidus. Influence des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments. Influence des dérivations sur les résidus. - Considération des différentes classes sociales. - Les grands journaux. - Souvent nous nous imaginons que les dérivations sont transformées en résidus, tandis que c'est le contraire qui se produit. - Influence des dérivations sur les dérivations. - Rapport des résidus et des dérivations avec les autres faits sociaux. - Comment le désaccord entre les résidus et les principes logico-expérimentaux agit sur les conclusions. - Exemples. - Dans les matières non logico-expérimentales, le fait de raisonner en toute rigueur logique peut conduire à des conclusions ne concordant pas avec les faits, et le fait de raisonner avec une logique très défectueuse, en se laissant guider par le sentiment, peut conduire à des conclusions qui se rapprochent beaucoup plus des faits. - Différences entre la pratique et la théorie. - Comment des dérivations indéterminées s'adaptent à certaines fins (buts). - Exemples. - Mesures prises pour atteindre un but. - L'action exercée sur les dérivations a d'habitude peu ou point d'efficacité pour modifier les résidus. - Comment les mesures sociales sont acceptées. - Les mythes et, en général, les fins idéales. - Les fins idéales et leurs rapports avec les autres faits sociaux. - Classification des problèmes auxquels donnent lieu ces rapports. - Examen de ces problèmes. - Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait de réaliser son propre bonheur. - Classification des solutions de ce problème. - Examen de ces solutions. - L'étude ainsi accomplie fournit un exemple de la vanité expérimentale de certaines doctrines fondées sur une prétendue grande utilité sociale. - Propagation des résidus. - Propagation des dérivations. - Les intérêts. - Le phénomène économique. - L'économie pure. - L'économie appliquée. - Plutôt que de déduire les théories de l'économie, il faut y faire des adjonctions. - Hétérogénéité sociale et circulation entre les diverses parties de la société. - Les élites de la population et leur circulation. - La classe supérieure et la classe inférieure, en général.
Chapitre XII. – Forme gÉnÉrale de la sociÉtÉ (§2060 à §2411) ... 1306
Les éléments et leurs catégories. - L'état d'équilibre. - Organisation du système social. - Composition des résidus et des dérivations. - Divers genres de mutuelle dépendance. - Comment on en peut tenir compte en sociologie. - Les propriétés du système social. - L'utilité et ses différents genres. - Maximum d'utilité d'un individu ou d'une collectivité. - Maximum d'utilité pour une collectivité. - Résidus et dérivations en rapport avec l'utilité. - Presque tous les raisonnements dont on use en matière sociale sont des dérivations. - Exemples. - Composition des utilités, des résidus et des dérivations. - L'histoire. - L'emploi de la force dans la société. - La classe gouvernante et la classe gouvernée en rapport avec l'emploi de la ruse et l'emploi de la force. - Comment la classe gouvernante s'efforce d'organiser sa défense. - La stabilité et la variabilité des sociétés. - Les cycles de mutuelle dépendance des phénomènes sociaux. - Le protectionnisme. - Divers genres de capitalistes. - Les spéculateurs et les rentiers. - Le régime politique. - La démocratie. - L'influence des gouvernements est d'autant plus efficace qu'ils savent mieux se servir des résidus existants ; elle est très souvent vaine, lorsqu'ils s'efforcent de les modifier. - Le consentement et la force sont le fondement des gouvernements. - Les gouvernements modernes. - La ploutocratie démagogique. - Dépenses pour consolider les divers régimes politiques. - Les partis politiques. - Les diverses proportions des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe chez les gouvernants et chez les gouvernés. - Les résultats économiques des différents régimes politiques. - Gouvernements qui font usage principalement de la force. - Gouvernements qui font usage principalement de la ruse. - Combinaisons de divers types. - Périodes économiques et périodes sociales. - Forme ondulatoire des phénomènes. - Oscillations des dérivations en rapport avec les oscillations sociales. - Erreurs habituelles qu'on commet en voulant les provoquer à dessein. - Mutuelle dépendance des oscillations. - Exemples. - L'ensemble social.
Chapitre XIII. – L’Équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612)... 1601
La proportion des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe, considérée comme l'un des facteurs principaux de l'équilibre social. - Indices de l'utilité sociale. - Exemples divers. - L'équilibre des diverses couches sociales. - Comment les moyens employés pour le conserver agissent sur la proportion des résidus de la Ie classe et de la IIe, par conséquent sur l'équilibre social. - Exemples divers. - Étude de l'évolution sociale à Rome. - Analogies avec l'évolution de nos sociétés. - Comment la souplesse et la cristallisation des sociétés sont des phénomènes qui se succèdent mutuellement. - C'est là un cas particulier de la loi générale des phénomènes sociaux, qui ont une forme, ondulatoire.
[1]
Chapitre I↩
Préliminaires [(§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64]
§ 1. La société humaine est l'objet de nombreuses études. Les unes portent des noms spéciaux ; ainsi le droit, l'histoire, l'économie politique, l'histoire des religions, etc. D'autres embrassent des matières encore confuses, dont la synthèse avec celles qui sont déjà distinctes, vise à étudier la société humaine en général.
On peut donner à ce groupe d'études le nom de Sociologie.
§ 2. Une telle définition est très imparfaite. On pourrait peut-être l'améliorer, mais pas beaucoup ; car enfin, nous n'avons une définition rigoureuse d'aucune science ; pas même des diverses disciplines mathématiques ; et l'on ne peut en avoir, parce que c'est seulement à notre usage que nous divisons en différentes parties l'objet de notre connaissance, et qu'une telle division est artificielle et varie avec le temps. Qui peut dire où sont les limites entre la chimie et la physique, entre la physique et la mécanique ? Que devons-nous faire de la thermodynamique ? La mettrons-nous avec la physique ? Elle n'y serait pas trop mal. Préférons-nous lui faire une place dans la mécanique ? Elle n'y serait pas étrangère; et s'il nous plaît d'en faire une science distincte, personne ne pourra nous le reprocher. Mais, au lieu de perdre du temps à trouver sa place, ne vaudrait-il pas mieux étudier les faits dont elle s'occupe ? Laissons là les noms ; regardons aux choses.
De même, nous avons mieux à faire que perdre notre temps à chercher si la sociologie est ou n'est pas une science autonome ; si elle est autre chose que la philosophie de l'histoire sous un autre nom, ou à raisonner longuement sur les méthodes à suivre dans son étude. Occupons-nous de chercher les relations entre les faits sociaux, et laissons donner à cette étude le nom qu'on voudra. Peu importe la méthode par laquelle on acquerra la connaissance de ces relations. Le but seul nous importe [Voir Addition A1 par l’auteur] ; peu et même pas du tout les moyens qu permettent de l'atteindre.
§ 3. À propos de la définition de la sociologie, nous avons dû indiquer certaines normes que nous voulons suivre. Nous pourrions faire de même pour d'autres sujets, au fur et à mesure que l'opportunité s'en présenterait, ou bien nous pourrions exposer ces normes une fois pour toutes, dans un chapitre spécial qui servirait d'introduction à notre étude. Chacun de ces procédés a ses avantages et ses défauts. Ici, nous préférons employer le second [FN: § 3-1] .
Plusieurs sujets, très brièvement esquissés dans ce chapitre, seront développés dans la suite de l'ouvrage, où l'on trouvera les preuves de certaines propositions que nous avons ici simplement énoncées.
§ 4. Un auteur peut exposer de deux manières bien distinctes les principes qu'il veut suivre : 1° il peut demander que ces principes soient acceptés comme vérités démontrées ; si cela est admis, toutes leurs conséquences logiques seront tenues pour démontrées ; 2° il peut donner ces principes comme simple indication d'une voie parmi celles qu'il pourrait suivre ; dans ce cas, aucune de leurs conséquences logiques n'est démontrée, au point de vue concret ; elles ne sont qu'hypothétiques, tout autant que les prémisses dont on les tire. Aussi devra-t-on s'abstenir de faire usage de ces déductions et chercher les relations directement entre les faits.
Voyons un exemple. Supposons qu'on vous présente le postulat d'Euclide comme un théorème. Vous ne pouvez pas l'accepter sans discussion ; parce que si vous admettez le théo- rème, toute la géométrie euclidienne est démontrée, et vous ne pouvez plus rien lui opposer. Mais supposons qu'au contraire on vous donne le postulat comme une hypothèse ; vous ne serez pas obligé de la discuter. Libre au géomètre d'en tirer les conséquences logiques. Si elles sont d'accord avec les faits concrets, vous les accepterez, et si elles ne vous paraissent pas d'accord, vous les repousserez : votre liberté de choix n'est pas liée par une concession préliminaire. Ceci admis, il y a des géométries non euclidiennes que vous pouvez étudier sans lier en rien votre liberté de choix dans le domaine concret.
Notons que si les géomètres s'étaient butés à vouloir décider, avant de poursuivre leurs études, si oui ou non le postulat d'Euclide correspond à la réalité concrète, aujourd'hui la géométrie n'existerait même pas.
Cette observation est générale. Toutes les sciences ont progressé, quand les hommes, au lieu de disputer sur les principes, ont discuté les résultats. La mécanique céleste s'est const- ituée avec l'hypothèse de la loi d'attraction universelle. Aujourd'hui, on doute que l'attraction soit bien ce qu'on pensait ; mais quand même une nouvelle opinion serait acceptée, grâce à des observations nouvelles et meilleures, les résultats auxquels arrive la mécanique céleste subsisteraient toujours ; il n'y aurait qu'à y faire des retouches et des adjonctions.
§ 5. Instruits par l'expérience, nous voulons essayer d'employer, dans l'étude de la sociologie, les moyens qui furent si utiles dans celle des autres sciences. Par conséquent nous n'établissons aucun dogme, comme prémisse de notre étude, et l'exposé de nos principes n'est qu'une indication de la voie que nous voulons suivre, parmi les nombreuses qu'on pourrait choisir. C'est pourquoi, en nous accompagnant sur celle-là, on ne renonce nullement à en suivre une autre.
Dès les premières pages d'un traité de géométrie, l'auteur doit dire au lecteur s'il se propose d'exposer la géométrie euclidienne ou, par exemple, la géométrie de Lobatschewsky; mais ce n'est qu'un simple avertissement, et, s'il expose la géométrie de Lobatschewsky, cela ne veut pas dire qu'il nie la valeur des autres. C'est dans ce sens, et pas autrement, qu'on doit entendre l'exposé que nous faisons ici de nos principes.
§ 6. Jusqu'ici, la sociologie a été presque toujours présentée dogmatiquement. Le nom de positive, donné par Comte à sa philosophie, ne doit pas nous induire en erreur : sa sociologie est tout aussi dogmatique que le Discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Ce sont des religions différentes, mais enfin des religions ; et l'on en trouve du même genre, dans les œuvres de Spencer, de De Graef, de Letourneau et d'une infinité d'autres auteurs.
De sa nature la foi est exclusive. Celui qui croit posséder la vérité absolue ne peut admettre qu'il y ait d'autres vérités dans le monde. C'est pourquoi le chrétien fervent et le « libre penseur » combatif sont et doivent être intolérants. Ainsi, pour qui a la foi, une seule voie est bonne ; toutes les autres sont mauvaises. Le musulman ne voudra pas prêter serment sur l'Évangile ni le chrétien sur le Coran ; mais celui qui n'a aucune foi prêtera serment sur un livre ou sur un antre, et même sur le Contrat social de Rousseau, pour peu que cela puisse faire plaisir aux croyants humanitaires ; il ne refuserait pas non plus de prêter serment sur le Décaméron de Boccace, ne serait-ce que pour voir la mine que ferait M. Bérenger et les croyants de la religion de cet excellent monsieur.
Nous n'estimons point inutiles des sociologies qui procèdent de certains principes dogma- tiques ; de même que nous ne croyons nullement inutiles les géométries de Lobatschewsky ou de Riemann ; nous demandons seulement à ces sociologies d'employer des prémisses et des raisonnements aussi clairs que possible.
Nous sommes riches de sociologies humanitaires, telles étant presque toutes celles qui se publient maintenant. Nous ne manquons pas de sociologies métaphysiques, et parmi elles il faut ranger toutes les positivistes et toutes les humanitaires. Nous avons un certain nombre de sociologies chrétiennes, catholiques ou autres. Qu'on nous permette, sans vouloir faire tort à toutes ces estimables sociologies, d'en exposer ici une exclusivement expérimentale, comme la chimie, la physique et d'autres sciences du même genre [FN: § 6-1] .
Par conséquent, dans la suite, nous entendons prendre pour seuls guides l'expérience et l'observation.
Par abréviation, nous nommerons l'expérience seule, là où elle ne s'oppose pas à l'obser- vation. Ainsi, quand nous dirons qu'une chose nous est rendue manifeste par l'expérience, on devra sous-entendre : et par l'observation ; et quand nous parlerons de sciences expéri- mentales, il faudra comprendre : et d'observation ; et ainsi de suite.
§ 7. Dans une collectivité donnée, certaines propositions descriptives, préceptives ou autres ont cours ; par exemple : « La jeunesse est imprudente. – Tu ne convoiteras pas le bien ni la femme de ton prochain. – Sache épargner, si tu ne veux pas être un jour dans la misère. – Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De telles propositions, unies par un lien logique ou pseudo-logique et jointes à des narrations de divers genres, constituent des théories, des théologies, des cosmogonies, des métaphysiques, etc.
Toutes ces propositions et théories sont des faits expérimentaux, tant qu'on les considère de l'extérieur, sans en chercher le mérite intrinsèque, notion qui a son origine dans la foi ; et nous devons les considérer et les étudier comme des faits expérimentaux.
§ 8. Une telle étude est très utile à la sociologie, parce qu'une grande partie de ces propositions et de ces théories donne l'image de l'activité sociale. Souvent même, elles seules nous permettent d'avoir connaissance des forces qui agissent sur la société, c'est-à-dire des dispositions et des inclinations des hommes. C'est pourquoi nous nous en occuperons ici longuement.
D'abord nous devons nous efforcer de classer ces propositions et ces théories, puisque cette opération est presque indispensable pour bien connaître un grand nombre d'objets variés [FN: § 8-1] .
Pour ne pas répéter chaque fois : propositions et théories, nous ne nommerons dorénavant que ces dernières ; mais ce que nous dirons de celles-ci vaudra aussi pour celles-là, sauf indication contraire.
§ 9. Pour l'homme qui se laisse guider principalement par le sentiment, pour le croyant, il y a d'ordinaire deux seules classes de théories : celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Ces termes restent vagues ; on les sent plus qu'on ne les comprend.
§ 10. On groupe souvent ces trois axiomes : 1° Tout honnête homme, tout être intelligent doit accepter les propositions vraies et repousser les fausses ; celui qui ne le fait pas n'est pas honnête ou pas raisonnable. Les théories ont donc un caractère absolu, indépendant des sujets qui les produisent ou les acceptent. 2° Toute théorie vraie est aussi utile et vice versa. Par conséquent, lorsqu'on a démontré qu'une théorie est vraie, son étude est épuisée ; il n'y a pas besoin de rechercher si elle est utile ou nuisible. 3° On n'admet en aucune façon qu'une théorie puisse être utile pour certaines classes sociales et nuisible pour d'autres. Mais cet axiome est moderne, et beaucoup le repoussent, sans trop oser manifester leur opinion.
§ 11. Si à ces assertions nous en opposions d'autres, contraires, nous raisonnerions également a priori ; et toutes auraient, au point de vue expérimental, la même valeur, qui est zéro. Si nous voulons rester dans le domaine de l'expérience, il nous faut rechercher d'abord si les termes adoptés dans les assertions précédentes correspondent à quelque chose d'expérimental ; et, ensuite, si ces assertions sont vérifiées oui ou non par les faits. Mais, pour cela, il faut nécessairement admettre qu'on puisse répondre oui ou non ; parce qu'il est évident que si nous excluons a priori l'une de ces deux possibilités, nous résolvons ainsi a priori le problème que nous nous sommes proposé, au lieu d'en laisser, comme nous disions, la solution à l'expérience.
§ 12. Tâchons donc de classer ces théories, en suivant la même méthode que si nous avions à classer des insectes, des plantes, des roches.
Nous voyons immédiatement qu'une théorie n'est pas un ensemble homogène, comme serait un de ces corps que la chimie appelle simples ; mais qu'elle ressemble plutôt à une roche, dans la composition de laquelle entrent plusieurs corps simples.
On trouve, dans une théorie, des parties descriptives, des affirmations axiomatiques, l'intervention d'êtres concrets ou abstraits, réels ou imaginaires. Tout cela constitue en quelque sorte les matériaux de cette théorie. On y trouve aussi des raisonnements logiques ou pseudo-logiques, un appel au sentiment, des développements pathétiques, l'intervention d'éléments éthiques, religieux, etc. Tout cela donne en somme la façon dont on met en œuvre les matériaux, pour construire l'édifice qu'on appelle une théorie.
En attendant, voilà déjà un aspect sous lequel on peut considérer les théories. Pour le moment, il nous suffit de l'avoir indiqué; nous en traiterons plus loin tout au long, au chapitre IV (§ 467).
§ 13. Supposons une théorie construite de la façon indiquée tout à l'heure ; c'est un des objets de notre classification. Nous pouvons la considérer sous divers aspects.
l° Aspect objectif. On peut envisager la théorie indépendamment de celui qui l'a produite et de celui qui l'accepte ; disons objectivement, mais sans donner à ce terme aucune signifi- cation métaphysique.
Pour tenir compte de toutes les combinaisons possibles entre la nature des matériaux et celle de leur lien, on devra distinguer les classes et les sous-classes suivantes :
CLASSE 1. Éléments expérimentaux :
(I a).Lien logique;
(I b). Lien non-logique;
CLASSE II. Éléments non-expérimentaux :
(II a). Lien logique;
(II b). Lien non-logique.
Les sous-classes (I b) et (II b) renferment des sophismes de logique ou des raisonnements artificieux tendant à induire en erreur. Dans l'étude que nous faisons maintenant, elles sont souvent de bien moindre importance que les sous-classes (I a) et (II a).
La sous-classe (I a) comprend toutes les sciences expérimentales ; nous l'appellerons logico-expérimentale. On peut y distinguer deux autres genres.
(I a 1) comprend le type rigoureusement pur, soit uniquement des éléments expérimen- taux et un lien logique. Les abstractions et principes généraux qu'on y emploie sont tirés exclusivement de l'expérience et y sont subordonnés (§ 63).
(I a 2) comprend une déviation du type, qui nous rapproche de (II). Les éléments sont explicitement expérimentaux et le lien logique ; mais les abstractions, les principes généraux reçoivent implicitement ou explicitement une valeur qui dépasse l'expérience.
Ce genre pourrait être appelé de transition. On en pourrait considérer d'autres semblables, mais ils n'ont pas l'importance de celui-ci.
La classification qui vient d'être faite, comme toutes celles qu'on peut imaginer, dépend de nos connaissances. Un homme qui tient pour expérimentaux certains éléments qu'un autre n'estime pas tels, placera dans la classe I une proposition que l'autre mettra dans la classe II Celui qui croit employer la logique et se trompe, rangera parmi les propositions logiques une proposition qu'un autre, ayant aperçu l'erreur, mettra parmi les non-logiques.
C'est une classification des types de théories que nous venons de faire. En réalité, une théorie donnée peut-être constituée d'un mélange de ces types. C'est-à-dire qu'une théorie donnée pourra contenir des parties expérimentales, des parties non-expérimentales, des parties logiques et des parties non-logiques [FN: § 13-1] .
2° Aspect subjectif. On peut considérer les théories par rapport à qui les produit et à qui les accepte ; et par conséquent nous aurons à envisager les aspects subjectifs suivants :
a) Raisons pour lesquelles une théorie donnée est produite par un homme donné. Pourquoi un homme donné affirme-t-il que A est égal à B ? Vice versa : s'il affirme cela, par quels mobiles est-il poussé ?
b) Raisons pour lesquelles un homme donné accepte une théorie donnée. Pourquoi un homme donné accepte-t-il l'assertion: A est égal à B ? Vice versa : s'il admet cette assertion, par quels mobiles est-il poussé ?
Ces questions s'étendent des individus aux collectivités.
3° Aspect de l'utilité. Il est bon de ne pas confondre la théorie et l'état d'esprit, les senti- ments qu'elle manifeste. Certains hommes produisent une théorie parce qu'ils ont certains sentiments ; puis cette théorie agit à son tour sur ces hommes ou sur d'autres, de manière à provoquer, renforcer, modifier certains sentiments.
1) Les sentiments exprimés par une théorie sont utiles ou nuisibles :
(I a)à celui qui la produit ;
(I b)à celui qui l'admet ;
II) Une théorie donnée est utile ou nuisible
(II a)à celui qui la produit ;
(II b)à celui qui l'admet.
Ces considérations s'étendent aussi aux collectivités.
Nous pouvons donc dire que nous considérerons les propositions et les théories sous l'aspect objectif, subjectif, de l'utilité individuelle ou sociale ; seulement le sens de ces termes ne doit pas être tiré de leur étymologie ni de leur acception vulgaire, mais exclusivement des définitions données dans le texte (§ 119).
§ 14. En résumé, soit, par exemple, la proposition: A égale B. Nous avons à répondre aux questions suivantes :
1° Aspect objectif. Cette proposition est-elle ou non d'accord avec l'expérience ?
2° Aspect subjectif. Pourquoi certains hommes disent-ils que A est égal à B ? Pourquoi d'autres hommes le croient-ils ?
3° Aspect de l'utilité. Quelle utilité ont les sentiments exprimés par la proposition : A égale B, pour qui l'énonce ? pour qui l'admet ? Quelle utilité a la théorie elle-même, d'après laquelle A égale B, pour qui l'émet ? pour qui l'accepte ?
Dans un cas extrême, on répond oui à la première question, et l'on ajoute pour les autres : « Les hommes disent, croient que A égale B, parce que c'est vrai ; les sentiments exprimés de cette façon sont utiles parce qu'ils sont vrais ; la théorie elle-même est utile parce qu'elle est vraie. »
Dans ce cas extrême, on trouve des propositions de la science logico-expérimentale, et alors vrai signifie d'accord avec l'expérience. Mais il s'y trouve aussi des propositions qui n'appartiennent en rien à la science logico-expérimentale; et, dans ce cas, vrai ne veut pas dire d'accord avec l'expérience, mais exprime tout autre chose : très souvent un simple accord avec les sentiments de celui qui défend cette thèse.
Nous verrons par l'étude expérimentale qui sera développée dans les chapitres suivants, que les faits sociaux présentent fréquemment les cas que voici : a) propositions d'accord avec l'expérience, énoncées et admises par accord avec les sentiments, lesquels sont utiles ou nuisibles aux individus, à la société ; b) propositions d'accord avec l'expérience, repoussées parce qu'en désaccord avec les sentiments, lesquels, s'ils étaient admis, seraient nuisibles à la société ; c) propositions qui ne sont pas d'accord avec l'expérience, énoncées et admises par accord de sentiments, lesquels sont utiles, parfois très utiles à la société ; d) propositions qui ne sont pas d'accord avec l'expérience, énoncées et acceptées par accord de sentiments, lesquels sont utiles à certains individus, nuisibles à d'autres, utiles ou nuisibles à la société.
De tout cela, nous ne pouvons rien savoir a priori ; nous demanderons à l'expérience de nous instruire.
§ 15. Après avoir classé les objets, il convient de les étudier ; ce sera le but des chapitres suivants. Dans les chapitres IV et V, nous considérerons particulièrement l'aspect de l'accord des théories avec l'observation et l'expérience ; dans les chapitres VI, VII et VIII, nous étudierons les sentiments dont procèdent ces théories ; dans les chapitres IX et X, nous traiterons de la manière dont ils se manifestent ; dans le chapitre XI, nous étudierons les propriétés des éléments théoriques ainsi trouvés ; et finalement, nous verrons aux chapitres XII et XIII, les effets sociaux des éléments dont nous avons vu les manifestations dans les théories, et nous aurons une idée approximative de la forme des sociétés ; ce qui est justement le but que nous visons et vers lequel nous nous serons acheminés dans les chapitres précédents.
On pourra, dans un autre ouvrage, continuer l'étude entreprise ici, et chercher les formes particulières des divers phénomènes sociaux dont nous avons trouvé la forme générale.
§ 16. Sous l'aspect objectif, nous avons divisé (§ 13) les propositions ou les théories en deux grandes classes, dont la première ne sort en aucune façon du domaine expérimental, tandis que l'autre dépasse en quelque sorte les limites de ce domaine [FN: § 16-1] . Il est essentiel, si l'on veut raisonner avec un peu de rigueur, de les maintenir bien distinctes, parce qu'au fond ce sont des choses hétérogènes que l'on ne doit jamais confondre en aucune façon, et qui ne peuvent pas même être comparées [FN: § 16-2] .
Chacune de ces classes a sa manière propre de raisonner et, en général, son critère particulier, qui la divise en deux catégories ; l’une desquelles comprend les propositions qui sont d'accord logiquement avec le critère choisi, et qui sont dites « vraies » ; l'autre qui embrasse les propositions que l'on ne peut accorder avec un tel critère, et qui sont dites « fausses » Ces termes « vraies » et « fausses » sont donc en dépendance étroite avec le critère choisi. Si l'on voulait leur donner un sens absolu, on sortirait du domaine logico- expérimental, pour entrer dans le domaine métaphysique.
Le critère de « vérité » de la première classe de propositions est tiré uniquement de l'expérience et de l'observation ; le critère de « vérité » de la seconde classe est en dehors de l'expérience objective ; on peut le trouver dans une révélation divine, dans les conceptions que, dit-on, l'esprit humain tire de lui-même, sans le secours de l'expérience objective, du consentement universel des hommes, etc.
Il ne faut jamais disputer sur les mots. Si donc il plaît à quelqu'un de donner une autre signification aux termes « vérité » et « science », nous n'y verrons pour notre part aucune difficulté ; il nous suffit qu'il fasse connaître clairement le sens qu'il entend donner aux termes adoptés, et surtout son critère de « vérité ».
§ 17. Si ce critère n'est pas indiqué, il est inutile de poursuivre la conversation, qui se perdrait en bavardages ; comme il est inutile que les avocats plaident, s'il n'y a pas un juge qui les écoute. Si quelqu'un dit: « A a la propriété B », avant de poursuivre la discussion, il convient de savoir qui jugera le procès entre cette personne et une autre qui soutient : « A n'a pas la propriété B ». Si elles tombent d'accord pour que l'expérience objective soit juge, celle- ci décidera si A a ou non la propriété B. Nous sommes alors dans le domaine de la science logico-expérimentale. Le lecteur voudra bien retenir que, dans cet ouvrage, j'entends absolument y rester, et que je refuse à tout prix d'en sortir ; par conséquent, s'il lui plaît d'avoir un autre juge qui ne soit pas l'expérience objective, il fera bien d'abandonner la lecture de ce livre, comme il cesserait de suivre à un procès, quand il en aurait récusé le juge.
§ 18. Si ceux qui disputent sur les propositions indiquées veulent un autre juge qui ne soit pas l'expérience objective, ils feront bien de déclarer quel est ce juge, et de le dire, si possi- ble, d'une façon claire ; ce qui leur arrive rarement. Ici, nous nous abstiendrons de nous mêler de discuter la nature de ces propositions. Nous n'en parlerons qu'extrinsèquement, comme de faits sociaux dont nous devons tenir compte.
§ 19. En général, les métaphysiciens appellent science la connaissance de l'essence des choses, des principes. Si nous admettons, pour un moment, cette définition, nous dirons que le présent ouvrage n'est en rien scientifique. Non seulement nous nous abstenons d'indiquer les essences et les principes, mais encore nous ne savons même pas ce que ces termes veulent dire (§ 530).
Vera [FN: § 19-1]dit : « (p. 78) La notion de science et la notion de science absolue sont insépa- rables... (p. 80). Or s'il y a une science absolue, elle n'est et ne peut être que la philosophie. Et ainsi la philosophie est le fond commun de toutes les sciences, et comme l'intelligence commune de toutes les intelligences ». Nous ne voulons rien avoir à faire ici avec une telle science, ni de près ni de loin ; « (p. 84) l'absolu ou l'essence, et l'unité ou les rapports nécessaires des êtres, voilà les deux premières conditions de la science. » Toutes deux sont étrangères à nos recherches ; nous ne comprenons même pas ce que c'est. Nous cherchons les rapports entre les choses, dans les limites d'espace et de temps à nous connus, et nous les demandons à l'expérience et à l'observation. « (p. 85) La philosophie est à la fois une explication et une création. » Nous ne savons pas et nous ne voulons pas expliquer, au sens de Vera, et encore moins créer.
« (p. 88) La science qui connaît l'absolu, et qui saisit la raison intime des choses, sait comment et pourquoi les événements et les êtres sont engendrés [nous, nous ne le savons pas] et non seulement elle le sait, mais elle les engendre d'une certaine façon elle-même, et les engendre par cela même qu'elle saisit l'absolu. Et en effet, ou il faut nier la science, ou il faut admettre qu'il y a (p. 89) un point où la connaissance et l'être, la pensée et son objet coïncident et se confondent ; et la science de l'absolu qui se produirait en dehors de l'absolu, et qui n'atteindrait pas sa nature réelle et intime ne serait pas la science de l'absolu, ou, pour mieux dire, elle ne serait pas la science. »
§ 20. Parfaitement ; je suis là-dessus d'accord avec Vera. Si la science doit être ce qu'ex- priment ces termes aussi admirables qu'incompréhensibles pour moi, ici je ne m'occupe pas de science.
Je m'intéresse au contraire à une autre chose, que définit très bien Vera, dans un cas particulier, quand il dit : « (p. 214, note). En général, la mécanique n'est qu'un mélange de données de l'expérience et de formules mathématiques. » On pourrait dire, pour être plus général: « Un mélange de données expérimentales et de déductions logiques de celles-ci. » Le lecteur me permettra d'appeler cela, pour un moment, non-science. Vera et Hegel ont raison de dire que les théories de Newton ne sont pas de la science, mais sont au contraire de la non-science. Quant à moi, je veux justement m'occuper ici de non-science, et je désire construire la sociologie sur le modèle de la mécanique céleste, de la physique, de la chimie et d'autres semblables non-sciences, laissant entièrement de côté les sciences ou la science des métaphysiciens (§ 503 (1), 514 (2)).
§ 21. Un lecteur pourrait observer : « Ceci admis, pourquoi, dans la suite de cet ouvrage, parlez-vous constamment de science, en donnant à ce mot le sens de non-science ? Auriez- vous peut-être l'intention de revendiquer ainsi pour votre non-science, l'autorité qui est l'apanage de la science seule ?»
Je répondrais que si le mot science avait généralement la signification que lui donnent les métaphysiciens, je me serais rigoureusement abstenu d'employer le nom, puisque je repousse la chose ; mais il n'en est pas ainsi, et beaucoup, beaucoup de gens appellent sciences la mécanique céleste, la physique, la chimie, etc.; et les appeler non-sciences ou user de quelque autre mot semblable, serait, je le crains, tout simplement ridicule. Mais si, d'autre part, quelqu'un pouvait en douter, qu'il ajoute un non partout où, dans cet ouvrage, il trouvera les mots science, scientifique ; il verra que le raisonnement reste le même, parce que c'est un raisonnement qui porte sur des choses et non sur des mots (§ 119).
§ 22. Tandis que la métaphysique descend des principes absolus aux cas concrets, la science expérimentale remonte des cas concrets, non pas à des principes absolus, qui pour elle n'existent pas, mais seulement à des principes généraux que l'on fait ensuite dépendre d'autres, plus généraux, et ainsi de suite indéfiniment. Un tel procédé, mal compris par qui a l'habitude des raisonnements métaphysiques, a donné lieu à plusieurs interprétations erronées.
§ 23. Notons seulement, en passant, le préjugé que, pour connaître une chose, il convient d'en connaître l'essence. Tout au contraire, la science expérimentale part de la connaissance des choses, pour remonter, sinon à l'essence qui, pour elle, est une entité inconnue, du moins aux principes généraux (§ 19 et sv.).
Un autre préjugé, en partie semblable au précédent, règne aujourd'hui en économie et en sociologie ; il consiste à croire qu'on ne peut acquérir la connaissance d'un phénomène, qu'en recherchant son « origine » [FN: § 23-1](§ 93, 346).
§ 24. Sous une forme atténuée, le préjugé qui impose la connaissance de l' « essence », vise à démontrer les faits particuliers au moyen du principe général, au lieu de déduire celui- ci de ceux-là. On confond ainsi la démonstration du fait avec la démonstration de ses causes.
Par exemple, de certaines observations, nous concluons à l'existence d'un fait A, et de plus nous en indiquons comme causes probables: B, C, D,... On démontre que ces causes ne sont pas efficaces, et l'on en conclut que A n'existe pas. Cette démonstration serait pleinement convaincante, si l'on avait déduit l'existence de B, C, D,... de l'expérience, et si l'on en avait conclu à l'existence de A ; elle n'a pas la moindre force probante, si, au contraire, l'observation a donné directement A.
§ 25. La difficulté que beaucoup de gens éprouvent, à faire l'analyse d'un phénomène et à en étudier séparément les différentes parties, est aussi en relation avec un tel préjugé. Nous devrons souvent revenir sur ce chapitre ; qu'il nous suffise de noter ici que beaucoup de personnes n'admettront pas les distinctions faites au § 13 ; et que si d'autres les admettent théoriquement, elles les démentiront bientôt dans leur raisonnement pratique (§ 31, 32, 817).
§ 26. Pour qui possède une foi vive, les divers caractères des théories indiquées au § 13 se réduisent souvent à un seul. Le croyant cherche seulement si la proposition est vraie ou n'est pas vraie. Que signifie exactement ce terme vrai ? Personne ne le sait ; le croyant moins que tout autre. En gros, le sens de cette expression paraît être celui d'un accord avec les sentiments du croyant ; mais cela n'est perceptible qu'à celui qui juge la croyance, de l'extérieur, à celui qui lui est étranger ; non pas au croyant lui-même. D'habitude, il repousse et tient presque pour offense un tel caractère subjectif d'une croyance, que lui estime au contraire absolument vraie. C'est aussi pourquoi il refuse de séparer le terme vrai du sens qu'il lui donne, et pourquoi il parle volontiers d'une vérité différente de la vérité expéri- mentale et supérieure à elle. Nous aurons à nous entretenir longuement de ce sujet, dans les chapitres suivants.
§ 27. Il est inutile de s'adonner à de semblables discussions ; elles ne peuvent être que vaines et oiseuses, tant qu'on ne sait à quoi correspondent précisément les termes adoptés, et tant qu'un critère, un juge pour trancher le litige font défaut (§ 17 et sv.).
Ce critère, ce juge, est-ce l'observation et l'expérience ou quelque chose d'autre ? Il convient de bien fixer ce point, avant de passer outre.
Si vous avez toute liberté, vous pouvez choisir entre deux juges celui que vous préférez, pour prononcer sur votre cas ; mais vous ne pouvez les choisir tous deux en même temps, si vous n'êtes pas certain tout d'abord qu'ils auront une seule opinion et une seule volonté.
§ 28. Les métaphysiciens en ont la certitude a priori, parce que le critère non-expéri- mental jouit auprès d'eux d'une telle autorité et d'un si grand pouvoir, qu'il domine l'autre ; lequel doit nécessairement s'accorder avec lui ; et, pour un motif semblable, les théologiens sont sûrs que les deux critères ne peuvent jamais être en désaccord. Nous, moins éclairés, ne possédons pas de si grandes lumières a priori ;. car nous ignorons entièrement ce qui doit être et nous cherchons seulement ce qui est. Aussi devons-nous nous contenter d'un seul juge.
§ 29. Ajoutons qu'à notre avis, la logique même ne donne pas de conséquences néces- saires, hormis de simples tautologies ; et qu'elle tire son efficacité de la seule expérience (§ 97). Mais ce n'est pas ici le lieu de traiter ce sujet ; nous y avons fait allusion seulement pour éviter des équivoques.
§ 30. L'esprit de l'homme est synthétique ; seule, l'habitude du raisonnement scientifique permet à quelques personnes de séparer par l'analyse les parties d'un tout (§ 25). Les, femmes spécialement et, parmi les hommes, les moins cultivés, éprouvent souvent une difficulté invincible à considérer indépendamment l'un de l'autre, les divers aspects d'une chose. Qui veut s'en persuader n'a qu'à faire une expérience très simple : lire en société un fait de chronique d'un journal ; puis essayer de parler des différents aspects sous lesquels on peut l'envisager, en les passant en revue l'un après l'autre. Il verra qu'il n'est pas suivi par ceux qui l'écoutent, et qu'ils en reviennent sans cesse à considérer tous les aspects en même temps.
§ 31. De cette tendance de l'esprit humain, résulte, pour l'homme qui émet une propo- sition et pour celui qui l'écoute, une grande difficulté à tenir séparés les deux critères, expérimental et non-expérimental ; tandis qu'une force invincible pousse la majorité des hommes à les confondre. Un très grand nombre de faits fort importants pour la sociologie, trouvent ainsi leur explication, comme nous le verrons mieux dans la suite.
§ 32. Dans les sciences naturelles, on a fini par comprendre la nécessité de l'analyse, – pour l'étude des différentes parties du phénomène concret, – suivie de la synthèse, afin de revenir de la théorie au fait concret. Dans les sciences sociales, beaucoup n'ont pas encore compris cela.
§ 33. De là vient l'erreur très commune qui consiste à nier la vérité d'une théorie, parce qu'elle n'explique pas toutes les parties d'un fait concret ; et, sous une autre forme, la même erreur, consistant à vouloir englober dans une seule, toutes les autres théories analogues et même étrangères.
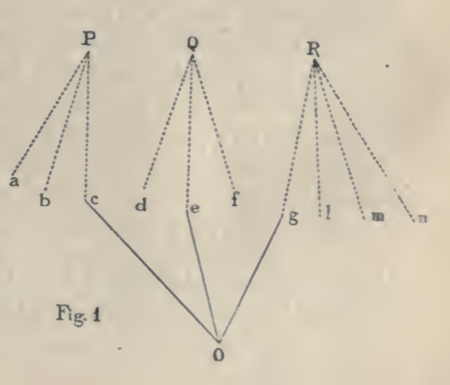
Figure 1
Soit O, un phénomène concret (Fig. 1). Séparons-y, par analyse, divers faits : c, e, g,... Le fait c et ceux qui lui sont analogues, c'est-à-dire a, b,... sont unis par une certaine théorie ils dépendent d'un principe général P. Semblablement e et les faits analogues à e, c'est-à-dire d, f,... donnent une autre théorie Q ; et les faits g, 1, m, n,... donnent une autre théorie R ; et ainsi de suite. Ces théories sont étudiées séparément ; puis, pour connaître le fait concret O, on réunit les résultats c, e, g,... des théories. À l'analyse, on fait suivre la synthèse.
Les personnes qui ne comprennent pas cela disent : « O ne contient pas seulement e, mais aussi c ; donc la théorie Q doit aussi renfermer c ». La conclusion est erronée ; il faut dire, et c'est la seule conclusion juste : « ... donc la théorie Q nous donne seulement une partie du phénomène O ».
§ 34. Exemple. Soit Q, la théorie de l'économie politique. Un phénomène concret O n'a pas seulement une partie économique e, mais aussi d'autres parties sociologiques, c, g,... C'est une erreur de vouloir englober dans l'économie politique les parties sociologiques C, g,..., comme l'ont fait beaucoup de gens ; la seule conclusion exacte à tirer de ce fait, est qu'il convient d'ajouter – ajouter, dis-je, et non substituer – aux théories économiques qui donnent e, d'autres théories qui donnent c, g,...
§ 35. En économie politique aussi, il faut ajouter, non substituer, les théories de l'économieappliquéeàcellesdel'économiepureoumathématique.L'économie mathématique a pour but principal de mettre en lumière la mutuelle dépendance des phénomènes économiques ; et, jusqu'à présent, on ne connaît aucune autre manière d'atteindre ce but [FN: § 35-1] .
§ 36. Voici l'un de ces nombreux individus qui ont le malheur de discourir sur des choses qu'ils ne comprennent pas ; il découvre – voyez quel génie ! – que l'économie pure n'est pas l'économie appliquée, et conclut, non pas qu'il faut y ajouter quelque chose pour connaître les phénomènes concrets, mais qu'il faut y substituer sa phraséologie. Eh ! brave homme, l'économie mathématique arrive au moins à nous faire connaître, en gros, comment opère la mutuelle dépendance des phénomènes économiques, tandis que ton galimatias ne nous apprend rien du tout !
§ 37. Voici un autre merveilleux esprit, qui veut substituer la psychologie à l'économie politique, parce que beaucoup de phénomènes économiques dépendent de la volonté de l'homme. Pourquoi donc s'arrête-t-il là et n'y substitue-t-il la géographie et même l'astronomie ? Car enfin le phénomène économique dépend aussi des mers, des continents, des fleuves et principalement du soleil qui féconde
La terre, inépuisable et suprême matrice.(V.H.)
Il est des gens qui donnent à ces élucubrations le nom d'Économie positive ; ils ont au moins le mérite d'amuser leur lecteur.
§ 38. Passant à un sujet plus sérieux, nous observerons que beaucoup d'économistes ont eu la tendance d'englober dans la théorie de la valeur, n'importe quelle théorie économique [FN: § 38-1] . À la vérité, presque tous les phénomènes économiques se manifestent par la valeur ; mais on doit seulement en conclure qu'en séparant les diverses parties de ces phénomènes, nous trouverons la théorie de la valeur, et non pas que l'on doit englober les autres parties dans cette théorie. On va encore plus loin, et la valeur devient la porte par laquelle ou veut que la sociologie fasse irruption en économie politique. Dieu merci, on s'en tient là ; bien d'autres choses pourraient passer par cette porte. Au moyen de la psychologie, on pourrait expliquer comment et pourquoi une chose, réelle ou imaginaire, vau t; puis la physiologie viendrait au secours de la psychologie. Pourquoi n’y ferait-on pas entrer aussi un peu de biologie, qui expliquerait les conditions fondamentales de la physiologie ? N'y mettrons-nous pas un peu de mathématiques ? car enfin, dans une équation, le premier membre vaut le second ; fourrons donc aussi la théorie des équations dans celle de la valeur. On peut continuer ainsi à l'infini.
Dans tout cela, il y a de vrai que le phénomène concret est très compliqué et peut être considéré comme formé de nombreuses parties A, B, C,... L'expérience montre que pour en acquérir la connaissance, la meilleure manière est de séparer les parties A, B, C,... et de les étudier une à une ; puis de les réunir de nouveau pour avoir ainsi la théorie du phénomène complexe (§ 2010 et Sv.). C'est ce que fait la science logico-expérimentale ; mais celui qui n'en a pas l'habitude va au hasard, passe de A à B, de B à C et ainsi de suite ; à chaque instant, il retourne en arrière, se trompe, et donne dans le galimatias ; quand il étudie A, il pense à B, et quand il étudie B, il pense à autre chose. Pire encore si quelqu'un étudie A ; il s'interrompt pour discourir sur B, et quand ou lui répond sur B, il discourt sur C ; il passe du coq à l'âne, barbote, parle hors de propos, et ne démontre qu'une chose : son ignorance complète de toute méthode scientifique.
§ 39. Ceux qui nient le caractère scientifique de l'économie politique montrent qu'elle ne suffit pas à expliquer les phénomènes concrets. Ils en tirent la conclusion qu'on doit l'exclure de l'explication de tels phénomènes ; tandis qu'au contraire la conclusion rigoureuse serait qu'il faut y ajouter d'autres théories. En raisonnant comme ces personnes, on devrait dire qu'il faut exclure la chimie de l'explication des phénomènes de l'agriculture, parce qu'elle seule ne suffit pas à les expliquer entièrement. On devrait aussi exclure des écoles d'ingénieurs, la mécanique rationnelle, qui est à la mécanique pratique, à peu près ce que l'économie pure est à l'économie appliquée.
§ 40. Il est très difficile et presque impossible d'obtenir que l'on sépare la simple connaissance des uniformités de la société, de l'action qui a pour but de les modifier. Si quelqu'un s'occupe uniquement de connaître ce qui existe, on veut à tout prix qu'il ait quand même un but pratique ; on s'efforce de le trouver ; et, puisqu'il n'y en a pas, on finit par l'inventer.
§ 41. Il est aussi très difficile d'obtenir qu'on n'aille pas au delà de l'expression de la pensée d'un auteur, et qu’aux propositions exprimées par lui on n'en ajoute pas d'implicites, qu'il n'a jamais eues en vue (§ 73 et sv., 311). Si vous remarquez un défaut à une chose A, on entend que vous blâmez la chose en son entier ; si vous y notez un avantage, on comprend que vous la louez dans son ensemble. Il paraît étrange que vous en signaliez les défauts, si vous ne voulez pas la blâmer dans son ensemble ; ou les qualités, si vous ne l'estimez pas digne de louange en son entier. Cela serait raisonnable, au moins en partie, pour un discours de propagande, car il n'appartient pas à l'avocat d'accuser son propre client ; mais la déduction n'est pas juste, quand on veut la tirer d'une simple description ou d'une recherche d'uniformités. À la rigueur, ce serait admissible, dans un raisonnement non pas logico- expérimental, mais par accord de sentiments (§ 514). En effet, celui qui suit une telle métho- de doit, pour obtenir l'approbation du sentiment d'autrui, exprimer le sien propre ; et, s'il ne le fait pas explicitement, on peut supposer qu'il le fait implicitement. Mais celui qui raisonne objectivement, selon la méthode logico-expérimentale, n'a pas à exprimer son propre sentiment, ni explicitement ni implicitement.
§ 42. Quant aux preuves, celui qui affirme une proposition ou une théorie logico- expérimentale (§ 13-I a) recourt à l'observation, à l'expérience, à leurs déductions logiques ; mais celui qui affirme une proposition ou une théorie non logico-expérimentale ne peut compter que sur le consentement spontané de l'esprit d'autrui, et sur les déductions plus ou moins logiques qu'il peut tirer des principes qui ont cours. En somme, il prêche plus qu'il ne démontre. Toutefois, cela n'est généralement pas admis par ceux qui font usage des théories non logico-expérimentales ; ils s'imaginent donner des preuves du même genre que celles dont on use pour les théories logico-expérimentales ; et, dans ces raisonnements pseudo- expérimentaux, ils profitent beaucoup de l'indétermination du langage vulgaire.
Quand il s'agit de persuader autrui, les preuves n'ont de valeur que pour qui est familier avec le raisonnement logico-expérimental. L'autorité a une grande part, même dans les propositions logico-expérimentales, bien qu'elle n'y ait aucunement la valeur d'une preuve. L'accord des sentiments, les passions, l'indétermination des termes ont une grande valeur dans tout ce qui n'est pas raisonnement logico-expérimental (§ 514).
§ 43. Quant aux preuves, l'expérience ne peut rien contre la foi ni la foi contre l'expérience ; de sorte que chacune a son domaine propre. Si Paul n'est pas croyant et nie que Dieu créa le ciel et la terre, et que vous lui opposiez l'autorité de la Bible, vous aurez donné un beau coup de sabre dans l'eau ; parce que Paul niera l'autorité de la Bible, et tout votre raisonnement tombera. Substituer l'autorité de l'expérience chrétienne à celle de la Bible serait un puéril expédient, parce que Paul répliquera que sa propre expérience ne l'engage pas le moins du monde à être d'accord avec vous ; et si vous lui répondez que celle-ci n'est pas chrétienne, vous aurez fait un superbe raisonnement en cercle. Il est en effet certain que si, seule est chrétienne l'expérience qui conduit à des résultats donnés, on en peut incontes- tablement déduire que l'expérience chrétienne conduit à ces résultats ; mais avec cela nous n'apprenons rien du tout.
§ 44. Qui affirme une proposition logico-expérimentale (§ 13-1 a) peut placer son contradicteur dans l'alternative ou d'accepter cette affirmation pour vraie, ou de refuser créance à l'expérience et à la logique. Si quelqu'un prenait ce dernier parti, il serait dans la situation de Paul dont nous parlions tout à l'heure, et vous n'auriez aucun moyen de le persuader.
§ 45. On voit donc que, si nous excluons comme toujours le raisonnement sophistique et de mauvaise foi, la différence, au point de vue de la force probante, entre les théories logico- expérimentales (I a) et celles qui ne le sont pas, consiste principalement en ce que, à notre époque et dans nos pays, il est plus facile de trouver quelqu'un qui refuse de croire au Coran, à l'Évangile, à l'expérience chrétienne, intime, humanitaire, rationnelle – on l'appellera comme on voudra, – à l'impératif catégorique, aux dogmes du positivisme, du nationalisme, du pacifisme ou à une infinité d'autres semblables, qu'à la logique et à l'expérience. En d'autres temps et dans d'autres pays, il en peut être autrement.
§ 46. Gardons-nous de vouloir, en aucune façon, comme le fait une certaine méta- physique matérialiste, doter la logique et l'expérience d'une force et d'une dignité supérieures à celle des dogmes acceptés par le sentiment. Notre but est de distinguer, non de comparer et surtout pas de juger des mérites et des vertus de ceux-ci et de celles-là (§ 69).
§ 47. Gardons-nous aussi de faire rentrer par la fenêtre, la certitude que nous avons chassée par la porte. Nous n'affirmons pas que la preuve logico-expérimentale soit supérieure à l'autre, qu'elle doive lui être préférée ; nous disons seulement, – ce qui est très différent, – qu'elle est la seule à employer par qui ne veut sortir du champ logico-expérimental. C'est même d'ailleurs une tautologie. Il serait donc inutile de l'exprimer, si une telle proposition n'était oubliée à tout instant par qui confond l'expérience et la foi, le raisonnement et le sentiment.
§ 48. Le cas extrême de celui qui dénie toute force probante à toute expérience, à tout raisonnement logique, est très rare. On peut taire, négliger, éviter par différents artifices les considérations logico-expérimentales ; mais il est difficile d'en faire entièrement abstraction; c'est pourquoi on essaye presque toujours de démontrer les théories qui ne sont ni objectives ni expérimentales, à l'aide de preuves pseudo-expérimentales et pseudo-logiques.
§ 49. Toutes les religions ont des preuves de ce genre, auxquelles on ajoute volontiers celles de l'utilité pour l'individu et la société. Et quand une religion se substitue à une autre, elle cherche à faire croire que ses preuves expérimentales sont meilleures que celles dont la religion vaincue peut se prévaloir. Les miracles chrétiens étaient, nous dit-on, certainement beaucoup plus concluants que ceux des païens, et aujourd'hui les preuves scientifiques du solidarisme et de l'humanitarisme sont incontestablement meilleures que les miracles chré- tiens. Pourtant celui qui étudie ces faits sans le secours de la foi ne les trouve pas très différents, et leur assigne exactement la même valeur scientifique, c'est-à-dire zéro.
Nous devons croire qu'à la bataille de Trasimène, la défaite des Romains fut causée par la négligence impie du consul Flaminius, à l'égard des présages envoyés par les dieux. Le consul et son cheval tombèrent devant la statue de Jupiter Stator ; les poulets sacrés refusèrent la nourriture ; enfin, l'on ne pouvait plus arracher de terre les enseignes [FN: § 49-1] . Nous tiendrons aussi pour certain, – davantage ou moins ? je ne sais – que les croisés durent leur victoire d'Antioche à la protection céleste, dont le signe concret fut la sainte lance [FN: § 49-2] . Il est de même certain, voire très certain, puisque c'est affirmé par une religion meilleure et plus récente, que Louis XVI de France perdit le trône et la vie uniquement par son manque d'amour envers son cher et bon peuple. Le dieu humanitaire de la démocratie ne laisse jamais de telles offenses impunies.
§ 50. Prenons garde que la science expérimentale n'a pas de dogmes, et que par consé- quent les faits expérimentaux ne peuvent s'expliquer que par l'expérience. Si l'on observait le contraire, cette science accepterait ces solutions comme elle accepte tout autre fait d'obser- vation. En effet, elle admet que l'invention peut parfois profiter de principes non-expérimen- taux, et cela parce qu'une telle proposition est d'accord avec les résultats de l'expérience [FN: § 50-1] .
Quant à la démonstration, l'histoire des connaissances humaines met clairement en lumière la faillite de toutes les tentatives d'expliquer les faits naturels, grâce à des proposi- tions découlant de principes religieux ou métaphysiques. Aujourd'hui, de telles recherches sont entièrement abandonnées en astronomie, en géologie, en physiologie et en toute autre science semblable. S'il en reste des traces dans la sociologie et dans ses branches : le droit, l'économie, la morale et autres, cela vient de ce que ces études n'ont pas encore atteint l'état exclusivement scientifique [FN: § 50-2] .
§ 51. Une des dernières tentatives, faites pour soumettre l'expérience à la métaphysique, est celle de Hegel avec sa Philosophie de la Nature ; laquelle, à vrai dire, atteint et dépasse les limites de la plus comique absurdité [FN: § 51-1] .
§ 52. D'autre part, on commence de nos jours à refuser de croire aux dogmes qui usurpent le caractère de la science expérimentale.
Les sectaires de la religion humanitaire ont coutume d'opposer les théories certaines de la science aux fables de la religion qu'ils combattent ; mais cette certitude n'est rien d'autre qu'un de leurs préjugés. Les théories scientifiques sont de simples hypothèses, qui vivent tant qu'elles sont d'accord avec les faits, et qui meurent et disparaissent quand de nouvelles études détruisent cet accord. D'autres leur sont alors substituées, auxquelles est réservé le même sort (§ 15).
§ 53. Supposons qu'un certain nombre de faits soient donnés. Le problème d'en trouver la théorie n'a pas une solution unique. Il peut y avoir différentes théories qui satisfassent également bien aux données du problème, et parmi elles le choix peut être quelquefois suggéré par des motifs subjectifs, comme serait celui d'une plus grande simplicité (§ 64).
§ 54. Dans les théories logico-expérimentales (I a) comme dans celles qui ne le sont pas, il existe certaines propositions générales, dites principes, dont on déduit logiquement des conséquences qui constituent les théories. La nature de tels principes diffère entièrement dans ces deux genres de théories.
§ 55. Dans les théories logico-expérimentales (I a), les principes ne sont autre chose que certaines propositions abstraites, dans lesquelles sont condensés les caractères communs de nombreux faits ; ces caractères dépendent des faits et non ceux-ci de ceux-là; ils ne les dominent pas, mais leur sont soumis ; ou les accepte comme hypothèses, pour autant et tant qu'ils concordent avec les faits ; on les rejette sitôt qu'ils s'en éloignent (§ 63).
§ 56. Au contraire, dans les théories non logico-expérimentales, nous trouvons épars des principes qui sont admis a priori, indépendamment de l'expérience qu'ils dominent. Ils ne dépendent pas des faits, mais les régissent ; ils ne leur sont pas assujettis, mais les commandent. On les accepte sans s'inquiéter des faits, qui doivent nécessairement s'accorder avec les déductions tirées des principes ; et quand ils paraissent ne pas être d'accord, on essaie divers raisonnements, jusqu'à ce qu'il s'en trouve un qui rétablisse l'accord ; lequel ne saurait jamais faire défaut.
§ 57. Chronologiquement, l'ordre de nombreuses théories est l'inverse de celui indiqué au § 13 ; c'est-à-dire que les théories non-logico-expérimentales précèdent souvent les autres (I a).
§ 58. Dans les théories non logico-expérimentales, la subordination des faits aux prin- cipes se manifeste de plusieurs façons :
1° On est tellement sûr des principes dont on part, que l'on ne s'occupe même pas de rechercher si leurs conséquences sont d'accord avec l'expérience. L'accord doit exister, et l'expérience, véritable servante, ne peut pas, ne doit pas se révolter contre sa maîtresse [FN: § 58-1] . Cet état s'observe spécialement quand les propositions logico-expérimentales tentent d'envahir le domaine des théories non-logico-expérimentales.
2° Une telle invasion se poursuivant, le progrès des sciences expérimentales finit par les affranchir de la servitude à laquelle elles étaient soumises ; on leur concède une certaine autonomie; il leur est permis de vérifier les déductions tirées des principes généraux ; mais on affirme que cette vérification aboutit toujours à confirmer les dits principes ; s'il semble qu'elle n'y aboutit pas, la casuistique vient à la rescousse pour établir l'accord désiré.
3° Quand enfin cette manière de maintenir la domination des principes généraux vient, elle aussi, à faire défaut, on se résigne à permettre aux sciences expérimentales de jouir de l'indépendance qu'elles ont conquise ; mais on affirme que leur domaine est quelque chose d'inférieur, puisqu'elles visent au relatif, au particulier ; tandis que les principes philoso- phiques visent à l'absolu, à l'universel.
§ 59. On ne sort pas du champ expérimental, ni par conséquent du domaine des théories logico-expérimentales (I a), en faisant usage d'hypothèses, employées uniquement comme moyen de déduction, et toujours subordonnées aux vérifications de l'expérience. On en sortirait, si ces hypothèses jouaient le rôle de raison démonstrative, indépendamment des vérifications expérimentales. Par exemple, l'hypothèse de la gravitation universelle ne nous fait pas sortir du champ expérimental, si, comme le fait la mécanique céleste moderne, nous entendons toujours soumettre ses déductions à l'expérience. Elle nous en ferait sortir, si nous déclarions qu'elle est une propriété essentielle de la matière, et que par conséquent les mouvements des astres doivent nécessairement se produire selon les déductions de cette hypothèse.
Cela n'a pas été compris de ceux qui, comme A. Comte, voulaient exclure de la science l'hypothèse de l'éther lumineux. Cette hypothèse et d'autres semblables ne doivent pas être jugées d'une façon intrinsèque, mais extrinsèque ; c'est-à-dire en observant si et jusqu'où leurs conséquences concordent avec les faits.
§ 60. Quand un très grand nombre de conséquences d'une hypothèse ont été vérifiées par l'expérience, il devient extrêmement probable qu'une nouvelle conséquence le sera aussi ; donc, en ce cas, les deux genres d'hypothèses notées aux § § 55-56 tendent à se confondre ; et, pratiquement, on est poussé à admettre la nouvelle conséquence sans la vérifier. Cela expli- que la confusion qui se produit dans l'esprit de beaucoup de gens, entre l'hypothèse soumise à l'expérience et celle qui la domine. Toujours pratiquement, il y a des cas où l'on peut accepter sans discussion les conséquences de certaines hypothèses. Par exemple, on met en doute, aujourd'hui, divers principes de la mécanique rationnelle, au moins pour des vitesses beaucoup plus grandes que celles qu'on observe en pratique ; mais il est manifeste que l'ingé- nieur constructeur de machines peut, sans le moindre danger d'erreur, continuer à admettre ces principes, puisque les vitesses des pièces de ses machines sont certainement bien éloignées de celles qui exigeraient un changement des principes de la dynamique.
§ 61. En économie pure, l'hypothèse de l'ophélimité reste expérimentale, tant que ses conséquences sont vérifiables par les faits ; il n'en serait plus ainsi si une telle dépendance venait à cesser. C'est ce que Walras n'a pas compris pour la valeur d'échange [FN: § 61-1]. Si nous nous passons de l'hypothèse d'ophélimité, ce qui est possible moyennant l'observation des courbes d'indifférence ou grâce à d'autres procédés semblables, nous nous soustrayons aussi à la nécessité de vérifier expérimentalement les conséquences d'une hypothèse qui disparaît.
§ 62. De même, l'hypothèse de la valeur demeure expérimentale, si, par valeur, on entend un fait dont les conséquences sont vérifiables expérimentalement ; elle cesse de l'être, quand ce mot désigne une entité métaphysique qui devrait dominer les vérifications expéri- mentales [FN: § 62-1](§ 104).
§ 63. Nous l'avons déjà dit : si l'on veut conserver rigoureusement leur caractère aux sciences logico-expérimentales, il faut envisager ce qu'on appelle des principes généraux (§ 55), comme de simples hypothèses ayant pour but de nous faire connaître une synthèse de faits, de les relier par une théorie, de les résumer. Les théories, leurs principes, leurs déduc- tions, sont entièrement subordonnés aux faits, et n'ont d'autre critère de vérité que de bien les représenter.
Ainsi est renversé le rapport qui, dans les théories non-logico-expérimentales (§ 13-II), unit les faits aux principes généraux ; mais l'esprit humain a une si grande inclination pour ce dernier genre de théories, que l'on vit souvent les principes généraux régner de nouveau dans celles qui avaient la prétention d'être rangées parmi les logico-expérimentales (I a). On admit que les principes avaient une existence presque indépendante ; qu'il y avait une seule théorie vraie et une infinité de fausses ; que l'expérience pouvait bien nous faire connaître quelle était la vraie, mais qu'elle-même devait ensuite s'y soumettre. Enfin, les principes généraux, sou- verains de par le droit divin dans les théories non-logico-expérimentales (§ 17), devinrent souverains par élection, mais souverains quand même, dans les théories logico-expéri- mentales (I a).
On obtient ainsi les deux sous-classes indiquées au § 13 ; mais il convient d'observer que souvent leurs caractères sont implicites plutôt qu'explicites; c'est-à-dire qu'on admet les principes généraux sans déclarer explicitement de quelle manière on les envisage.
§ 64. Le continuel progrès des sciences expérimentales amena de même la destruction de cette souveraineté élective, et nous conduisit ainsi aux théories rigoureusement logico- expérimentales (I a 1), dans lesquelles les principes généraux ne sont que des abstractions créées pour représenter les faits ; tandis qu'on admet qu'il peut y avoir différentes théories également vraies (§ 53), en ce sens qu'elles donnent une image également bonne des faits, et que parmi elles, le choix est arbitraire, entre certaines limites. En un mot, on peut dire que nous atteignons la limite extrême du nominalisme, pourvu qu'on dépouille ce terme de ses accessoires métaphysiques.
§ 65. Ayant résolu de ne pas sortir du champ logico-expérimental, nous n'avons pas à résoudre le problème métaphysique du nominalisme et du réalisme [FN: § 65-1]; c'est-à-dire que nous ne croyons pas devoir décider si l'individu seul existe, ou si c'est l'espèce seule, (§ 1651) vu d'ailleurs que la signification précise de ce terme exister ne nous est pas suffisamment connu. Nous entendons étudier les choses, par conséquent les individus, et considérer les espèces comme des agrégats de choses plus ou moins semblables, et formés par nous en vue d'atteindre certains buts. Nous ne voulons pas pousser plus loin dans nos études ; libre à d'autres de poursuivre au delà des bornes auxquelles nous nous arrêtons.
§ 66. Notez qu'étudier les individus ne veut pas dire que l’on doit considérer plusieurs de ceux-ci mis ensemble, comme une simple somme ; ils forment un composé, lequel, à l'égal des composés chimiques, peut avoir des propriétés qui ne sont pas la somme des propriétés des composants.
§ 67. Que le principe substitué à l'expérience ou l'observation soit théologique, méta- physique ou pseudo-expérimental, cela peut avoir une grande importance à certains points de vue, mais n'en a aucune sous l'aspect considéré maintenant, de sciences logico-expérimen- tales. Saint Augustin nie qu'il y ait des antipodes, parce que l'Écriture Sainte n'en fait pas mention [FN: § 67-1] . En général, les Pères de l'Église trouvent dans les Écritures, le critère de toute vérité, même expérimentale. Les métaphysiciens les tournent en dérision, et aux principes théologiques en substituent d'autres qui sont tout aussi étrangers à l'expérience. Des savants postérieurs à Newton, oubliant qu'il avait seulement affirmé que les corps célestes se mouvaient comme s'ils s'attiraient suivant une certaine loi, envisagèrent celle-ci comme un principe absolu, découvert par l'esprit humain, vérifié par l'expérience, et auquel devait être soumise toute la création pour l'éternité. Mais récemment, les principes de la mécanique subirent une critique sévère, et l'on en vint à conclure que seuls subsistaient les faits et les équations qui les représentent. Le simple fait, observe judicieusement Poincaré, que certains phénomènes comportent une explication mécanique, implique qu'ils en admettent une infinité.
§ 68. Insensiblement, toutes les sciences naturelles acheminent plus ou moins leurs études vers le type logico-expérimental (I a 1); et nous devons déclarer ici que notre intention est d'étudier la sociologie de cette manière, c'est-à-dire en nous efforçant de la ramener à ce type (§ 6, 486, 514 [FN: § 1] ).
§ 69. La voie que nous voulons suivre, dans cet ouvrage, est donc la suivante :
1° Nous n'entendons nous occuper en aucune façon de la vérité intrinsèque de n'importe quelle religion, foi, croyance métaphysique, morale ou autre. Ce n'est pas que nous soyons imbu du moindre mépris pour ces choses, mais seulement qu'elles sortent des limites où nous désirons rester. Les religions, croyances, etc., nous les considérons seulement de l'extérieur, pour autant qu'elles sont des faits sociaux, à l'exclusion de leur valeur intrinsèque. La proposition : « A doit [FN: § 69-1]être égal à B, en vertu de quelque principe supérieur à l'expérience », échappe donc entièrement à notre examen (§ 46) ; mais nous étudions comment une telle croyance est née, s'est développée et dans quelle relation elle se trouve avec les autres faits sociaux.
2° Le domaine où nous travaillons est donc exclusivement celui de l'expérience et de l'observation. Nous employons ces termes au sens qu'ils ont dans les sciences naturelles, comme l'astronomie, la chimie, la physiologie, etc.; et non pour indiquer ce qu'on entend par : expérience intime, chrétienne, qui, changeant à peine de nom, ressuscite tout bonnement l’auto-observation des anciens métaphysiciens. Nous considérons cette auto-observation seulement comme un fait externe ; nous l'étudions donc comme tel, non comme un sentiment qui nous est propre.
3° N'envahissant pas le domaine d'autrui, nous n'admettons pas qu'on envahisse le nôtre [FN: § 69-2] . Nous estimons déraisonnable et vain d'opposer l'expérience aux principes qui la dépassent ; mais nous repoussons également la suzeraineté de ces principes sur l'expérience. [Voir Addition A2 par l’auteur]
4° Nous partons des faits, pour composer des théories, et nous tâchons toujours de nous éloigner le moins possible de ces faits. Nous ignorons ce qu'est l'essence des choses (§ 19, 91, 530), et n'en avons cure, parce qu'une telle étude sort de notre domaine (§ 91), Nous recher- chons les uniformités présentées par les faits, et leur donnons aussi le nom de lois [FN: § 69-3]; mais ces faits ne sont pas soumis à ces dernières. au contraire. Les lois ne sont pas nécessaires (§ 29) ; ce sont des hypothèses qui servent à résumer un nombre plus ou moins grand de faits, et durent tant qu'on ne leur en substitue pas de meilleures.
5° Toutes nos recherches sont donc contingentes, relatives, et donnent des résultats qui ne sont que plus ou moins probables, tout au plus très probables. Il semble bien que l'espace dans lequel nous vivons soit à trois dimensions ; mais si quelqu'un disait qu'un jour le soleil nous emportera avec ses planètes dans un espace à quatre dimensions, nous ne répondrions ni oui ni non. Quand on nous présentera des preuves expérimentales d'une telle affirmation, nous les examinerons ; mais tant que ces preuves font défaut, la question ne nous intéresse pas. Toutes nos propositions, y compris celles de pure logique, doivent être entendues avec la restriction dans les limites du temps et de l'expérience à nous connus (§ 97).
6° Nous raisonnons exclusivement sur les choses et non sur les sentiments que leurs noms éveillent en nous. Ces sentiments, nous les étudions comme de simples faits extérieurs. Aussi refusons-nous, par exemple, de discuter si un acte A est juste ou n'est pas juste, moral ou immoral, si l'on n'a pas bien mis d'abord en lumière les choses auxquelles on veut faire correspondre ces termes. Mais nous étudierons comme un fait extérieur ce que les hommes d'un pays donné, appartenant à une classe sociale donnée, à une époque donnée, entendaient exprimer, quand ils affirmaient que A était un acte juste ou moral ; nous verrons par quels mobiles ils étaient poussés, et comment les principaux de ceux-ci opérèrent souvent à leur insu ; nous chercherons à connaître les relations existant entre ces hommes et d'autres faits sociaux. Nous repoussons les raisonnements qui emploient des termes manquant de précision (§ 486), parce qu'on ne peut tirer de prémisses imprécises que des conséquences imprécises [FN: § 69-4]. Mais nous étudierons ces raisonnements comme des faits sociaux, et nous aurons même à résoudre un problème singulier : trouver comment de prémisses entièrement en dehors de la réalité, sont tirées des conclusions qui ne s'en éloignent pas trop (chap. XI).
7° Nous cherchons les preuves de nos propositions seulement dans l'expérience et l'observation, ainsi que leurs conséquences logiques, en excluant toute preuve par accord de sentiments, par évidence interne ou dictée par la conscience.
8° Aussi emploierons-nous uniquement des mots correspondant à des choses et mettrons- nous tout notre soin, tout notre zèle, à leur donner une signification aussi précise que possible (§ 108).
9° Nous procédons par approximations successives ; c'est-à-dire en considérant d'abord le phénomène dans son ensemble, négligeant volontairement les détails dont nous tiendrons compte dans les approximations suivantes (§ 540) [FN: § 69-5] .
§ 70. Nous n'entendons pas le moins du monde affirmer que notre méthode soit meilleure que les autres; le terme meilleur n'ayant ici du reste aucun sens. Il n'y a pas de comparaison possible entre des théories entièrement contingentes et d'autres qui admettent l'absolu ; ce sont des choses hétérogènes qui demeurent toujours distinctes (§ 15).
Si quelqu'un veut partir de certains principes théologiques ou métaphysiques, ou bien comme font les contemporains, du « progrès démocratique », pour composer une sociologie, nous ne disputerons pas avec lui et ne dirons certainement aucun mal de son œuvre. Le conflit ne deviendra inévitable que du moment où, au nom de ces principes, on voudra nous imposer quelque résultat tombant dans le domaine de l'expérience et de l'observation.
Pour reprendre l'exemple précédent, quand Saint Augustin affirme que l'Écriture est inspirée par Dieu, nous n'avons rien à objecter à cette proposition, que du reste nous ne comprenons pas bien [FN: § 70-1]; mais quand il veut trouver dans ce livre la preuve qu'il n'y a pas d'antipodes (§ 485), nous n'avons que faire de ses raisons, puisque cette question appartient à l'expérience et à l'observation.
§ 71. Nous nous mouvons dans un champ restreint ; dans celui de l'expérience et de l'observation, sans nier qu'il y en ait d'autres, mais avec la volonté bien arrêtée de ne pas nous en occuper ici. Notre but est de découvrir des théories qui représentent les faits de l'expérience et de l'observation (§ 486), et, dans le présent ouvrage, nous refusons de pousser plus loin. Si quelqu'un en éprouve le désir, s'il veut voyager hors du domaine logico- expérimental, qu'il se cherche une autre compagnie et abandonne la nôtre ; elle ne saurait lui convenir.
§ 72. Nous différons entièrement de beaucoup de ceux qui suivent une voie analogue à la nôtre ; car loin de nier l'utilité sociale d'autres théories, nous croyons même qu'elles peuvent être très profitables. Associer l'utilité sociale d'une théorie à sa vérité expérimentale est justement un de ces principes a priori que nous repoussons (§ 14). Ces deux choses sont-elles ou non toujours unies ? À cette question l'on ne peut répondre que par l'observation des faits ; et dans la suite on trouvera la preuve qu'en certains cas, elles peuvent être entièrement indépendantes.
§ 73. Je prie donc le lecteur d'avoir toujours présent à l'esprit que là où j'affirme l'absurdité d'une doctrine, je n'entends pas le moins du monde soutenir implicitement qu'elle est nuisible à la société ; au contraire, elle peut lui être très profitable. Vice versa, où j'affirme l'utilité d'une théorie pour la société, je ne veux pas du tout insinuer qu'elle est expérimen- talement vraie. En somme, une même doctrine peut être rejetée au point de vue expérimental et admise au point de vue de l'utilité sociale, et vice versa.
§ 74. Puisque nous en sommes aux conventions, j'ajouterai que, plus généralement, quand je fais allusion à quelque effet nuisible d'une chose A, même s'il est très grand, je n'entends pas du tout certifier ainsi que cette chose soit, dans son ensemble, nuisible à la société ; parce qu'il peut y avoir des effets avantageux qui surpassent les nuisibles. Et vice versa, quand je parle d'un effet avantageux de A, même s'il est très considérable, mon intention n'est en aucune manière de prétendre que, dans son ensemble, A soit profitable à la société.
§ 75. Cet avertissement était indispensable, parce qu'en général beaucoup d'auteurs qui s'occupent de sociologie, ayant un but de propagande, un idéal à défendre, blâment seulement les choses qu'ils tiennent pour mauvaises dans leur ensemble, et louent celles qu'ils jugent bonnes. En outre, comme ils emploient plus ou moins le raisonnement par accord de senti- ments (41, 514), ils sont poussés à manifester le leur, pour obtenir l'approbation d'autrui ; ils ne considèrent pas les faits d'un œil absolument indifférent, mais aiment ou détestent et manifestent les sentiments qui les inspirent. Le lecteur accoutumé à cette façon de procéder et de s'exprimer, pense avec raison que quand l'auteur dit du mal d'une chose, en note certains défauts, cela signifie qu'il l'estime mauvaise dans son ensemble et qu'il est mal disposé envers elle ; tandis que, s'il en dit du bien, y remarque diverses bonnes qualités, divers avantages, cela veut dire qu'il la tient pour bonne dans son ensemble et qu'il est bien disposé à son égard. J'estime donc de mon devoir d'avertir le lecteur qu'une telle règle n'est pas applicable à ce livre ; je devrai d'ailleurs le rappeler souvent (§ 311). Je ne raisonne ici qu'ob- jectivement et analytiquement, selon la méthode logico-expérimentale. Je n'ai pas à mani- fester les sentiments que je puis avoir [FN: § 75-1], et le jugement objectif porté sur une partie d'une chose n'entraîne nullement un jugement analogue sur cette chose, considérée dans son ensemble.
§ 76. Celui qui veut persuader autrui, en matière de science expérimentale, expose principalement, ou mieux exclusivement, des faits et des déductions logiques de faits (§ 42). Celui qui veut persuader autrui, en ce qu'on appelle la science sociale, s'adresse principale- ment aux sentiments et ajoute des considérations de faits et des déductions logiques. C'est ainsi qu'il doit procéder, s'il veut que sa parole porte ; car, en négligeant les sentiments, il persuaderait bien peu de gens ; il ne se ferait pas même écouter ; tandis que s'il sait exciter les sentiments avec habileté, il passera pour éloquent (514). Cette question, rapidement effleurée ici, se rattache à l'étude de l'aspect objectif des théories (§ 13), et sera amplement développée dans la suite.
§ 77. L'économie politique ayant été jusqu'à présent une doctrine pratique, qui tendait à persuader les hommes d'agir d'une certaine façon, elle ne pouvait négliger de faire aussi appel au sentiment ; et, de fait, c'est ce qui arriva. Elle est restée une éthique à laquelle on ajoutait, en proportion plus ou moins grande, des narrations de faits et des expositions de leurs conséquences logiques. Cela se voit très bien dans les œuvres de Bastiat, et aussi dans presque tous les autres ouvrages d'économie politique, y compris ceux de l'école historique, qui sont souvent plus métaphysiques et sentimentaux que les autres.
Voici deux simples exemples de prévisions déduites des lois scientifiques de l'économie et de la sociologie. Le premier volume du Cours fut publié en 1896, mais écrit en 1895, d'après des documents statistiques n'allant pas au delà de 1894.
1° Contrairement à l'opinion des éthiques, historiens ou non, et des sentimentaux anti- malthusiens, j'écrivais alors, au sujet des augmentations de population [FN: § 77-1]: « Nous devons donc conclure que nous observons à notre époque des accroissements qui n'ont pu exister par le passé et qui ne pourront continuer d'exister à l'avenir. » Je citais, à ce propos, l'exemple de l'Angleterre et de l'Allemagne. Dans le premier de ces pays, on voyait déjà des signes de ralentissement de l'accroissement ; non dans le second, pour lequel on n'aurait alors rien pu conclure empiriquement ; mais aujourd'hui tous deux sont dans une période de décroissance [FN: § 77-2].
2° Spécialement pour l'Angleterre, après avoir trouvé la loi d'accroissement de la population, de 1801 à 1891, je concluais qu'elle ne pouvait continuer à croître dans cette proportion ; effectivement la raison d'accroissement a diminué [FN: § 77-3].
3° « Certains progrès des idées socialistes en Angleterre sont probablement l'effet de l'augmentation des obstacles économiques à l'accroissement de la population. [FN: § 77-4] » On l'a vu mieux encore, de nos jours, puisque le progrès du socialisme, en Angleterre, a eu lieu tandis qu'on observait un recul dans les autres pays d'Europe.
4° Nous verrons au chapitre XII la vérification d'une loi sociologique admise dans les Systèmes socialistes.
5° Le second volume du Cours a été publié en 1897. C'était alors pour beaucoup de gens un article de foi, que l'évolution sociale se faisait de telle sorte que les riches devenaient toujours plus riches et les pauvres plus pauvres. Contrairement à cette opinion sentimentale, la loi de la répartition des revenus conduit à la proposition [FN: § 77-5]que « si le total des revenus augmente par rapport à la population, il faut nécessairement : ou que le revenu minimum augmente ou que l'inégalité des revenus diminue, ou que ces deux effets se produisent simultanément. » De 1897 à 1911, le total des revenus a crû par rapport à la population, et l'on a eu effectivement une augmentation du revenu minimum et une diminution de l'inégalité des revenus [FN: § 77-6] .
Nous avons encore une contre-preuve dans le fait que les parties en défaut du Cours sont celles où le sentiment s'est introduit. La critique en a été faite dans la Préface du Manuale [FN: § 77-7], où les erreurs ont été relevées.
§ 78. On accepte souvent une proposition qu'on entend énoncer, uniquement parce qu'on la trouve d'accord avec ses sentiments ; c'est même en général de cette façon qu'elle paraît la plus évidente. Dans beaucoup de cas, il est bien qu'il en soit ainsi, au point de vue de l'utilité sociale ; mais au point de vue de la science expérimentale, l'accord d'une proposition avec certains sentiments n'a que peu et souvent point de valeur. Nous en donnerons de nombreux exemples.
§ 79. Puisque nous voulons ici nous placer exclusivement dans le domaine expérimental, nous nous efforcerons de ne recourir en aucune manière aux sentiments du lecteur, mais d'exposer simplement des faits et leurs conséquences. De là le grand nombre de citations qu'on trouvera dans ce livre ; elles ont justement pour but de donner au lecteur une impression des faits et de lui soumettre nos preuves.
§ 80. Quand on écrit une œuvre littéraire ou que l'on s'adresse d'une manière quelconque aux sentiments, il faut, tout en tenant compte de ceux-ci, faire des distinctions entre les faits que l'on cite ; car ils ne conviennent pas tous à la dignité de l'élocution, de la rhétorique ou de l'histoire. Il y a une aristocratie de faits dont l’usage est toujours louable ; il y a une classe moyenne de faits dont l'emploi est indifférent ; il y a une basse classe de faits dont l'usage est inconvenant et blâmable. C'est ainsi qu'il est agréable à celui qui aime collectionner des insectes, d'attraper des papillons aux couleurs voyantes; il lui est indifférent de capturer des mouches et des guêpes ; il lui répugne de mettre la main sur les insectes qui vivent dans les excréments ou d'autres ordures. Le naturaliste ne fait pas ces distinctions ; nous n'en ferons pas non plus pour la science sociale (§ 895).
§ 81. Nous accueillons tous les faits, quels qu'ils soient, pourvu que, directement ou indirectement, ils puissent nous conduire à la découverte d'une uniformité. Même un raisonnement absurde et stupide est un fait ; et, s'il est admis par un grand nombre de personnes, il devient un fait important pour la sociologie. Les croyances, quelles qu'elles soient, sont aussi des faits, et leur importance est en rapport non avec leur mérite intrinsèque, mais bien avec le nombre plus ou moins grand de gens qui les professent. Elles servent aussi à exprimer les sentiments de ces individus; or ces sentiments sont parmi les principaux facteurs qu'étudie la sociologie (§ 69).
§ 82. Il sera bon que le lecteur s'en souvienne, quand il trouvera cités ici des faits qui, à première vue, peuvent paraître insignifiants ou puérils. Des fables, des légendes, des inventions de magie ou de théologie peuvent souvent être tenues pour choses vaines et ridicules ; elles le sont, en effet, intrinsèquement ; mais elles peuvent être, au contraire, éminemment utiles comme moyens de connaître les idées et les sentiments des hommes. De même, le psychiatre observe les délires du dément, non pour leur valeur intrinsèque, mais vu leur importance comme symptôme de la maladie.
§ 83. La voie qui doit mener aux uniformités cherchées peut parfois être longue ; mais si c'est le cas dans cet ouvrage, le lecteur observera que la seule raison en est l'impossibilité où je me suis trouvé jusqu'à présent, d'en trouver une plus courte ; et si quelqu'un en découvre une, tant mieux ; je quitterai immédiatement la vieille route pour la nouvelle ; mais, en attendant, il me paraît utile de continuer à suivre la seule qui existe encore.
§ 84. Quand on cherche à éveiller ou à fortifier certains sentiments chez les hommes, on doit citer les faits favorables à ces sentiments et taire ceux qui les offusquent. Quand, au contraire, on ne recherche que les uniformités, il ne faut taire aucun fait capable d'en permettre la découverte d'une manière ou d'une autre ; et comme c'est justement le but de cet ouvrage, je refuse absolument de considérer dans les faits autre chose que leur valeur logico- expérimentale.
§ 85. Une seule concession m'est possible ; et à vrai dire, c'est plutôt un effort pour être plus clair, en tâchant de soulever le voile de sentiments qui pourrait gêner la vue du lecteur ; je choisirai entre un grand nombre de faits, ceux qui paraissent pouvoir le moins agir sur le sentiment. Ainsi, quand je trouve des faits d'égale importance expérimentale, appartenant les uns au passé, les autres au présent, je préfère ceux du passé ; c'est pourquoi le lecteur trouvera beaucoup de citations des auteurs grecs et latins. De même, en présence de faits d'égale valeur expérimentale, se rapportant les uns à des religions aujourd’hui éteintes, les autres à des religions encore existantes, je préfère les premiers.
Mais préférer une chose ne signifie pas en faire un usage exclusif ; et je suis contraint, dans beaucoup de cas, de citer des faits du présent ou de religions existantes, soit parce que je n'en ai pas d'autres d'égale valeur expérimentale, soit pour démontrer la continuité de certains phénomènes, du passé au présent. J’entends garder là-dessus entière liberté d'écrire ; comme je la garde contre le mauvais vouloir des inquisiteurs modernes de la vertu, dont je ne me soucie en aucune façon [FN: § 85-1] .
§ 86. L'auteur qui expose certaines théories désire généralement que chacun les admette et les fasse siennes ; car en lui, le rôle du chercheur de vérités expérimentales et celui de l'apôtre se confondent. Dans ce livre, je les sépare entièrement ; je retiens le premier, j'exclus le second. J'ai dit et je répète que mon unique but est la recherche des uniformités (lois) sociales ; j'ajoute que j'expose ici les résultats de cette recherche, car j'estime que, vu le nombre restreint de lecteurs que peut avoir ce livre et la culture scientifique qu'elle leur suppose [FN: § 86-1] , un tel exposé ne peut faire de mal ; mais je m'en abstiendrais, si je pouvais raisonnablement croire que cet ouvrage deviendrait un livre de culture populaire (§ 14, 1403).
§ 87. J'écrivais déjà dans le Manuel : « (p. 2)... 3° L'auteur peut se proposer uniquement de rechercher les uniformités que (p. 3) présentent les phénomènes, c'est-à-dire leurs lois (§ 4), sans avoir en vue aucune utilité pratique directe, sans se préoccuper en aucune manière de donner des recettes ou des préceptes, sans rechercher même le bonheur, l'utilité ou le bien- être de l'humanité ou d'une de ses parties. Le but est dans ce cas exclusivement scientifique ; on veut connaître, savoir sans plus. Je dois avertir le lecteur que je me propose, dans ce Manuel, exclusivement ce troisième objet. Ce n'est pas que je déprécie les deux autres ; j'entends simplement distinguer, séparer les méthodes et indiquer celle qui sera adoptée dans ce livre. » Cela me semble clair, et j'avoue que je ne saurais l'être davantage. Il s'est toutefois trouvé quelqu'un pour croire que je manifestais l'intention de réformer le monde, et même pour me comparer à Fourier [FN: § 87-1] !
§ 88. Cette façon d'étudier les sciences sociales n'est généralement pas comprise des économistes littéraires ; ce qui s'explique par leur tour d'esprit ; en outre, ils parlent souvent de livres ou d'autres écrits qu'ils ne connaissent que de seconde main ou qu'ils n'ont pas lus avec le soin nécessaire pour les comprendre. Enfin, quand on a toujours eu et qu'on persiste à avoir des visées pratiques, on se persuade difficilement que d’autres puissent avoir un but exclusivement scientifique ; ou, si on le comprend momentanément, on l'oublie aussitôt. J'ai donc peu d'espoir que les explications données dans ce chapitre réussissent à empêcher qu'on m'attribue des théories qui me sont étrangères, comme ne l'ont pas évité d'autres explications analogues, répétées à satiété ; mais je crois bien faire en suivant la maxime : fais ce que dois, advienne que pourra. J'ai seulement à m'excuser auprès du lecteur, de certaines répétitions, qui n'ont pas d'autre raison que celle indiquée plus haut, et qui peuvent paraître superflues – elles le sont effectivement – à qui veut bien lire ce livre avec un peu d'attention.
§ 89. Il n'y a pas lieu d'ajouter ici d'autres détails sur la façon dont j'envisage les théories économiques [FN: § 89-1] . Le lecteur trouvera d'excellents et amples développements dans les ouvrages cités de MM. Sensini et Boven.
§ 90. Nous avons vu (§ § 13 et 63) que la sous-classe (I a) des théories logico-expé- rimentales se divisait en deux genres, dans l'un desquels les principes généraux sont de simples abstractions de faits expérimentaux, tandis que dans l'autre ils tendent plus ou moins explicitement à avoir une existence propre, ne dépendant pas étroitement d'une simple abstraction des faits. Ces deux genres portent souvent les noms de méthode inductive et de méthode déductive. Mais cela n'est pas précis ; et ces genres diffèrent moins par la méthode que par le critère de vérité de leurs propositions et de leurs théories ; que celles-ci, dans le type rigoureux (I a 1), soient induites ou déduites, ou obtenues par un mélange d'inductions et de déductions, elles dépendent toujours de l'expérience, tandis que dans la déviation du type (I a 2), elles tendent explicitement à dominer l'expérience.
Quand un principe général est vérifié par un très grand nombre de faits, tel, par exemple, le principe de la géométrie euclidienne ou celui de la gravitation universelle, les deux genres indiqués tout à l'heure sont peu distincts, puisqu'en somme on peut souvent se borner à présumer la vérification expérimentale.
§ 91. Quand l'écart est grand entre les deux genres dont nous venons de parler, une différence apparaît, que l'on voit mieux encore, lorsqu'on l'observe entre les théories logico- expérimentales et celles qui ne le sont pas. Dans les premières, on procède graduellement, en allant des faits à certaines abstractions ; de celles-ci à d'autres plus générales, et l'on est d'autant plus prudent et réservé que l'on s'éloigne de l'expérience directe. Dans les secondes, on fait délibérément un saut, aussi grand que possible, loin de l'expérience directe, et l'on est d'autant plus tranquille et hardi qu'on s'en éloigne davantage. On veut connaître l'essence des choses ; recherche que l'on tient seule pour digne de la science ; tandis qu'on appelle empirisme l'expérience directe et ses inductions, et qu'on en fait peu de cas (§ 530).
§ 92. Ainsi, pour constituer une chimie selon cette dernière méthode, il faut d'abord savoir ce qu'est la matière ; et comme conséquences de cette notion, ou déduit les propriétés chimiques. Au contraire, le chimiste moderne, suivant en cela la voie et les procédés des sciences logico-expérimentales, étudie directement les propriétés chimiques dont il tire d'autres propriétés ou des abstractions toujours plus générales.
Les anciens croyaient étudier l'astronomie en imaginant des cosmogonies ; les modernes, au contraire, étudient directement les mouvements des astres, et s'arrêtent sitôt qu'ils ont découvert les uniformités de ces mouvements. Newton trouva qu'une certaine hypothèse, dite de la gravitation universelle, suffit à faire connaître les équations qui déterminent le mouve- ment des astres. Mais qu'est-ce que là gravitation ? Ni le savant ni ceux qui lui succédèrent dans l'étude de la mécanique céleste ne se cassèrent la tête à cette question subtile. Non que le problème ne mérite l'attention ; mais la mécanique céleste n'a pas à le résoudre ; peu importe la manière dont elle obtient ses équations, pourvu que celles-ci restent vérifiées.
§ 93. Un fait digne de remarque est que certaines erreurs, abandonnées depuis longtemps par les sciences les plus avancées, se répètent aujourd'hui dans des sciences moins développées. C'est ainsi que la doctrine de l'évolution joua, à l'égard de la sociologie, un rôle semblable à celui qu'eut autrefois la cosmogonie. On estima que pour découvrir les uniformités qui existent dans les phénomènes sociaux, il n'y avait d'autre moyen que la connaissance de l'histoire de ces phénomènes, et la recherche de leurs origines (§ 23,346).
§ 94. Pour les théories que nous avons à construire ici, nous ne pouvons éviter de remonter jusqu'à la distinction entre le phénomène objectif et le phénomène subjectif ; mais nous n'avons pas besoin d'aller au delà et de résoudre le problème de la « réalité du monde extérieur », à supposer toutefois que ce problème ait un sens précis (§ 149).
§ 95. Qu'on réponde comme on voudra à la question posée, ces deux grandes catégories de phénomènes n'en subsisteront pas moins, et devront recevoir des noms différents. Il se peut qu'une feuille de papier portant une vignette quelconque, et un billet authentique de la Banque d'Angleterre soient tous deux des concepts ; mais si, après avoir déjeuné dans un restaurant de Londres, vous essayez de payer votre hôte avec le premier de ces concepts, vous ne tarderez pas à vous apercevoir que, de celui-là en naîtront d'autres. Et tout d'abord, vous aurez le concept d'un policeman ; celui-ci, qu'il ait une réalité objective ou non, vous soumettra, quoi qu'il en soit, aux concepts d'un juge ; lequel vous donnera le concept d'un lieu bien fermé, où vous ferez connaissance avec le concept que les Anglais appellent hard labour, et qui est loin d'être agréable. Vous vous apercevrez ainsi que ces deux feuilles de papier appartiennent certainement à deux catégories bien distinctes ; car les faits, ou si vous voulez les concepts qui en découlent, sont différents.
De même, quand nous affirmons que, pour connaître les propriétés de l'anhydride sulfureux, il faut recourir à l'expérience, et qu'il ne sert à rien de le remplacer par les concepts du soufre et de l'oxygène, comme le voudrait la métaphysique hégélienne, nous n'entendons nullement opposer le monde extérieur au monde intérieur, la réalité objective à la réalité subjective, etc. Pour nous servir du langage qui n'admet d'existence que celle de l'idée, nous exprimerons la même proposition, en disant que pour avoir le concept de l'anhydride sulfureux, il ne suffit pas de posséder ceux du soufre et de l'oxygène, puis de méditer sur ce thème. On pourrait se livrer à cet exercice pendant des siècles et des siècles, sans acquérir pour cela des concepts de l'anhydride sulfureux qui soient d'accord avec les concepts des expériences chimiques. Les philosophes anciens crurent pouvoir suppléer de cette manière à l'observation et à l'expérience ; mais ils se trompèrent complètement. On apprend la chimie dans les laboratoires, et non par des méditations philosophiques, fussent-elles hégéliennes (§ 14). Pour avoir le concept ou les concepts de l'anhydride sulfureux, il faut posséder les nombreux concepts que l'on acquiert par celui nommé aussi l'expérience, en faisant brûler le soufre dans l'oxygène et dans l'air ; il faut encore le concept d'un vase de verre, où l'on recueillera le concept de l'anhydride sulfureux, et ainsi de suite ; on unira tous ces concepts dont on tirera celui des propriétés de l'anhydride sulfureux.
Cette façon de s'exprimer serait prolixe, ennuyeuse, ridicule ; et c'est seulement pour éviter ces défauts, que nous faisons usage des termes : subjectif et objectif. Étant donné le but logico-expérimental auquel nous tendons exclusivement, cette façon de nous exprimer nous suffit.
§ 96. Pour le même motif, il nous suffit de reconnaître que les faits sociaux révèlent certaines uniformités, et qu'il existe entre celles-ci des liens de mutuelle dépendance. Nous n'avons pas à nous occuper de savoir si et comment tel ou tel résultat que nous fournit l'observation peut se concilier avec ce qu'on appelle « le libre arbitre », si toutefois cette expression a un sens. De tels problèmes sortent de notre étude.
§ 97. Nous ne cherchons pas davantage si les lois scientifiques ont un caractère de « nécessité » (§ 528). L'observation ni l'expérience ne peuvent rien nous enseigner là-dessus ; elles nous font seulement connaître certaines uniformités, et encore uniquement dans les limites de temps et d'espace sur lesquelles portent ces observations et ces expériences. Donc, toute loi scientifique est soumise à cette restriction, et si, pour être bref, on néglige de la rappeler, il faut cependant toujours sous-entendre la condition suivante, dans l'énoncé de toute loi scientifique : dans les limites de temps et d'espace à nous connus (§ 69-6°).
Nous restons de même étrangers aux discussions sur la nécessité de la conclusion du syllogisme. Par exemple, le syllogisme des traités de logique : « Tout homme est mortel ; – Socrate est un homme ; – donc Socrate est mortel », doit, au point de vue expérimental, s'énoncer de cette façon: « Tous les hommes dont nous avons pu avoir connaissance sont morts ; – les caractères, à nous connus, de Socrate le placent dans la catégorie de ces hommes ; – donc il est très probable que Socrate est mortel. » Cette probabilité s'accroît dans de très grandes proportions, pour d'autres circonstances dont nous traiterons plus loin (§ 531, 556) ; et c'est pourquoi elle est beaucoup plus grande, énormément plus grande que celle du syllogisme suivant, que l'on pouvait faire avant la découverte de l'Australie. « Tous les cygnes dont nous avons pu avoir connaissance sont blancs ; – un oiseau qui a tous les caractères du cygne, mais dont on ignore la couleur, doit être rangé dans la catégorie des cygnes ; – donc cet oiseau sera probablement blanc. » (§ 526) Celui qui raisonne sur les essences peut, en certains cas, substituer la certitude à une très grande probabilité ; quant à nous, ignorant les essences, nous perdons la certitude.
§ 98. Affirmer, comme le font certaines personnes, que le miracle est impossible parce qu'il serait contraire à la constance reconnue des lois naturelles, c'est faire un raisonnement en cercle, et donner pour preuve d'une assertion, cette assertion même. Si l'on pouvait prouver le miracle, on détruirait en même temps cette constance des lois naturelles. La preuve d'un tel fait constitue donc seule le nœud de la question. Il faut d'ailleurs ajouter que cette preuve devra subir une critique d'autant plus sévère, qu'elle nous fera sortir davantage du cercle des faits que nous connaissons.
Si quelqu'un affirmait que le soleil conduira un jour son système planétaire en un lieu où les lois de la chimie, de la physique, de la mécanique seront autres que celles qui nous sont aujourd'hui connues, nous n'aurions rien à objecter ; nous rappellerions seulement que le fardeau de la preuve incombe à celui qui fait cette assertion.
Comme nous l'avons déjà dit (§ 29), nous ne faisons pas d'exception ; même pour les lois de la logique.
§ 99. Les lois scientifiques ne sont donc pour nous autre chose que des uniformités expérimentales (§ 69-411). à ce point de vue, il n'y a pas la moindre différence entre les lois de l'économie politique ou de la sociologie et celles des autres sciences. Les différences qui existent sont d'un tout autre genre. Elles résident surtout dans l'entrelacement plus ou moins grand des effets des différentes lois. La mécanique céleste a la chance de pouvoir étudier les effets d'une seule loi (uniformité) ; mais cela n'est pas tout, parce que ces effets pourraient être tels qu'ils permettraient difficilement la découverte de l'uniformité qu'ils présentent ; or, par une autre chance très heureuse, il se trouve que la masse du soleil est beaucoup plus grande que celle des planètes ; aussi découvre-t-on l'uniformité sous une forme simple, bien que non rigoureusement exacte, en supposant que les planètes se meuvent autour d'un soleil immobile et en rectifiant ensuite l'erreur commise dans cette première approximation. Au chapitre XII, nous verrons quelque chose d'un peu ressemblant pour la sociologie.
La chimie, la physique, la mécanique ont de même souvent à étudier des lois isolément, ou du moins peuvent en séparer artificiellement les effets [FN: § 99-1]; pourtant, en certains cas, apparaissent déjà des entrelacements difficiles à débrouiller ; leur nombre croît, en biologie, en géologie et plus que jamais en météorologie ; c'est aussi le cas des sciences sociales.
§ 100. Un autre caractère distinctif des lois scientifiques est le fait de pouvoir ou non en isoler les effets, grâce à l'expérience, qui s'oppose ici à l'observation. Certaines sciences, comme la chimie, la physique, la mécanique, la biologie, peuvent faire et font très largement usage de l'expérience ; d'autres y parviennent dans une moindre mesure ; d'autres encore peu ou pas du tout, comme les sciences sociales ; d'autres enfin ne s'en servent absolument pas ; ainsi la mécanique céleste, tout au moins en ce qui concerne les mouvements des astres.
§ 101. Ni les lois économiques et sociologiques, ni les autres lois scientifiques ne souffrent proprement d'exceptions [FN: § 101-1] . Parler d'une uniformité non uniforme n'a aucun sens. Le phénomène auquel on donne communément le nom d'exception à une loi est en réalité la superposition de l'effet d'une autre loi à celui de la première. À ce point de vue, toutes les lois scientifiques, y compris les mathématiques, souffrent des exceptions. Tous les corps qui sont à la surface du sol sont attirés vers le centre de la terre ; mais une plume emportée par le vent s'en éloigne ; un ballon plein d'hydrogène s'élève dans les airs.
La principale difficulté qu'on rencontre dans l'étude d'un très grand nombre de sciences, consiste précisément à trouver le moyen de dévider cet écheveau, formé par l'entrelacement d'uniformités nombreuses et variées.
§ 102. Dans ce but, il est souvent utile de considérer, non les phénomènes observés, mais des phénomènes moyens, où les effets de certaines uniformités sont atténués, tandis que ceux d'autres phénomènes sont accentués. Ainsi, nous ne pouvons savoir quelle sera, par exemple, la température du 10 juin de l'année prochaine ; mais nous pouvons connaître à peu près quelle sera la température moyenne du mois de juin, et mieux encore la température moyenne d'un trimestre, pour quelques années. Personne ne peut savoir si Jacques vivra ou mourra l'an prochain ; mais nous pouvons savoir à peu près combien de personnes mourront, sur cent mille ayant le même âge que Jacques. Qui dira si un certain grain, semé par l'agriculteur, germera et produira quelque chose ? Mais nous pouvons prévoir avec une certaine probabilité quel sera le produit d'un hectare de terrain semé de grain, et mieux, encore quelle sera la moyenne de ce produit, pour un certain nombre d'années.
§ 103. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que ces moyennes sont en partie arbitraires, et que nous les formons pour notre usage. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas tomber dans l'erreur de les considérer comme quelque chose d’objectif, ayant une existence indépen- dante des faits. Nous les trouvons souvent sous un autre nom, comme entités métaphysiques dont les auteurs se prévalent pour trouver quelque chose de constant dans des faits variables.
§ 104. Par exemple, en économie politique, nous voyons que les prix des marchandises, en gros sont variables presque à chaque vente-achat ; mais, pour édifier une théorie, nous voulons avoir quelque chose de moins variable, de plus, constant. Pour procéder scientifi- quement, on considère certaines moyennes ; on fait certaines interpolations [FN: § 104-1] . Pour procéder selon la métaphysique, on considère une entité appelée valeur, qui serait une espèce de cause constante des prix variables. Cette seconde manière de raisonner induit facilement en erreur, parce qu'elle enlève à la moyenne les caractères que lui donne la science, pour en prendre d'autres entièrement imaginaires (§ 62). Nous n'adressons d'ailleurs de ce fait aucun blâme aux premiers économistes, qui employèrent le terme valeur ; et ce fut déjà un notable progrès, quand on distingua la valeur d'échange de la valeur d'usage.
De la conception de valeur d'usage, un nouveau progrès fit naître l'idée beaucoup plus précise de l'utilité finale ; et c'est ainsi que de fil en aiguille, on en vint aux théories générales de l'équilibre économique. Ce développement n'a rien de singulier, car c'est celui de toutes les sciences naturelles (§ 69-3, 106). Mais de même qu'on ne peut plus étudier aujourd'hui la mécanique céleste dans les œuvres de Ptolémée ni même dans celles de Kepler, on ne peut plus étudier l'économie politique au moyen du concept vague de valeur [FN: § 104-2].
§ 105. Dans une première approximation, nous pouvons nous contenter de savoir qu'on a éliminé tant bien que mal certains effets de peu d'importance, comparativement à d'autres qui en ont une plus grande. Mais il est bon de donner, sitôt que possible, quelque précision à ces termes peu, plus grande, et de savoir à peu près ce qu'on a éliminé et ce qu'on a conservé. Mieux encore, si l'on arrive à connaître les limites des différences qui existent entre le phénomène réel (les faits) et l'image que nous en obtenons par ces moyennes ou ces théories.
Par exemple, en mathématique, il est déjà utile de savoir que 22/7 est une valeur approchée du rapport de la circonférence au diamètre. C'est encore mieux, quand on sait qu'elle est plus grande que ce rapport ; mieux encore, lorsqu'on apprend que l'erreur est inférieure à 0,015 ; ou quand on trouve que le dit rapport est compris entre 22/7 et 333/106.
Il est bon de savoir que les prix ne sont pas des nombres qui varient au hasard ; il est mieux de se rendre compte qu'ils ont quelque relation avec les goûts des hommes et les obstacles qui s'opposent à l'acquisition des marchandises ; mieux encore d'avoir une idée de ces relations, et toujours mieux de préciser cette idée, et d'arriver à saisir l'importance relative du phénomène dont la théorie est l'image, et de ceux qu'elle néglige.
§ 106. On ne peut connaître un phénomène concret dans tous ses détails ; il y a toujours un résidu, qui apparaît même parfois matériellement [FN: § 106-1] . Nous ne pouvons avoir que des idées approximatives des phénomènes concrets. Une théorie ne peut jamais figurer tous les détails des phénomènes ; aussi les divergences sont-elles inévitables, et ne reste-t-il qu'à les réduire au minimum. À ce point de vue aussi, nous sommes ramenés à la considération des approxi- mations successives. La science est un continuel devenir ; ce qui signifie que perpétuellement une théorie est suivie d'une autre, plus proche de la réalité. La théorie d'hier est aujourd'hui perfectionnée ; celle d’aujourd’hui le sera demain ; celle de demain le sera après-demain, et ainsi de suite. Chaque page de l'histoire des sciences le dit, et rien ne permet de supposer qu'elles ne continueront pas à le dire fort longtemps.
Puisque aucune théorie ne s'impose absolument, nous préférerons, dans le choix qui se présente à nous, celle qui, s'écartant le moins des faits du passé, nous permet de mieux prévoir ceux de l'avenir, et en embrasse le plus grand nombre.
§ 107. En astronomie, par exemple, la théorie des épicycles, que certains, poussés par le sentiment, cherchent à réhabiliter, satisfait à la condition de bien représenter les faits du passé, tels qu'ils nous sont connus. En multipliant autant qu'il est nécessaire le nombre des épicycles, on peut donner l'image de tout mouvement des astres, révélé par l'observation ; mais on ne peut prévoir, ou du moins aussi bien prévoir les mouvements futurs, qu'avec la théorie de la gravitation. En outre, cette dernière, grâce aux lois générales de la mécanique, s'étend à un nombre de faits plus considérable. Elle est donc préférable, comme on le juge en fait, à la théorie des épicycles. Mais le choix a lieu pour ces motifs ou d'autres semblables, et non pour des considérations métaphysiques sur l'essence des choses.
§ 108. Les faits au milieu desquels nous vivons agissent sur nous ; en sorte que notre esprit prend une certaine tournure, qui ne peut guère contraster avec ces faits. Les modes et les formes du langage procèdent de cet état psychique [FN: § 108-1] . Aussi la connaissance de l'esprit humain et du langage peut-elle apporter quelque lumière dans celle des faits extérieurs ; mais cette lumière est fort peu de chose, et dès qu'une science a fait quelque progrès, l'emploi de cette méthode lui procure plus d'erreurs que de vérités (§ 113 et sv.).
Les termes du langage ordinaire manquent de précision ; il n'en peut être autrement, vu que la précision appartient à la rigueur scientifique seule.
Tout raisonnement qui, comme ceux de la métaphysique, se fonde sur les sentiments, est forcé d'adopter des termes dépourvus de précision ; car les sentiments n'en ont pas, et le nom ne peut être plus précis que la chose. En outre, ces raisonnements profitent du manque de précision du langage ordinaire, pour masquer leur faiblesse logique, et pour persuader (§ 109). Au contraire, les raisonnements logico-expérimentaux, qui ont leur fondement dans l'observation objective, sont amenés à ne se servir des termes que pour désigner les choses ; et par conséquent à les choisir de manière à éviter toute ambiguïté ; à les rendre aussi précis que possible. Ces raisonnements engendrent d'ailleurs un langage technique spécial, qui leur permet d'échapper ainsi à l'indétermination du parler courant. Nous l'avons dit déjà (§ 69-8°) : notre intention étant de n'employer que le raisonnement logico-expérimental, nous mettrons tout notre soin à n'user que de mots aussi précis que possible, bien déterminés, et corres- pondant à des choses, sans équivoques ni ambiguïtés (§ 119), ou mieux, avec la plus petite erreur possible.
Il faut remarquer ici que le mot désigne un concept et que celui-ci peut correspondre ou non à une chose. Mais quand cette correspondance existe, elle ne peut être parfaite ; d'où il résulte que si le mot correspond à une chose, il ne peut jamais y correspondre précisément, d'une façon absolue. Il s'agit au contraire de plus ou de moins. Non seulement on ne trouve pas, dans la réalité concrète, les entités géométriques telles que la ligne droite, le cercle, etc., mais pas même les corps chimiques absolument purs, ni les espèces dont traitent les zoologistes et les botanistes, ni un corps particulier désigné par un nom ; car il faudrait indiquer aussi à quel moment on le considère : un morceau de fer ne reste pas identique à lui- même, quand change la température, l'état électrique, etc. En somme, la science logico- expérimentale ne connaît pas l'absolu ; aussi doit-on toujours attribuer une valeur contingente aux propositions que le langage courant nous présente avec une teinte d'absolu ; il faut de même substituer généralement des différences quantitatives, où le langage ordinaire met des différences qualitatives (§ 143[FN: § 1] ). Quand on s'est bien entendu sur ce point, toute équivoque est impossible ; et vouloir s'exprimer en toute rigueur donnerait lieu à des longueurs aussi inutiles que pédantes.
Nous dirons, par conséquent, que l'on sort entièrement du domaine expérimental, quand on raisonne sur des mots qui ne correspondent à rien dans ce domaine ; et que l'on en sort partiellement, quand on raisonne sur des mots dont le sens est indéterminé, et qui, en partie seulement, correspondent à des objets de ce domaine (chapitre X). On doit entendre cette proposition, en ce sens que si les mots présentent le minimum d'indétermination, corres- pondant à l'état actuel de la science, on s'éloigne si peu du domaine expérimental, que cette déviation est négligeable. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de corps chimiques absolument purs, les lois de la chimie sont valables avec une très grande approximation pour les corps que nos instruments d'analyse nous donnent comme purs.
§ 109. Le plus grand nombre des hommes emploie le langage vulgaire ; quelques hom- mes de science se servent du langage scientifique, chacun dans sa spécialité, hors de laquelle ils raisonnent souvent aussi mal et même plus mal que les gens du monde.
Deux genres de motifs poussent les hommes à tirer leur science du langage ordinaire. Le premier est qu'ils supposent qu'à tout mot doit nécessairement correspondre une chose. C'est la raison pour laquelle le mot finit par sembler être tout, et parfois même assume des propriétés mystérieuses. Le second est la grande facilité que l'on a de constituer ainsi la « science », chacun trouvant en lui-même tout ce qu'il faut pour cela, sans qu'il soit besoin de recherches longues, difficiles et fastidieuses.
Il est plus aisé de discourir sur les antipodes que d'aller voir s'il y en a réellement ; il est beaucoup plus expéditif de méditer sur le « principe » du « feu » ou celui de l' « humide », que de se livrer à toutes les observations dont se compose la géologie ; il est plus commode de méditer sur le « droit naturel », que d'étudier les législations des différents pays, à des époques diverses ; il est beaucoup moins difficile d'ergoter sur la valeur, de rechercher quand et dans quel cas, on dit qu' « une chose vaut », que d'étudier et de comprendre les lois de l'équilibre économique.
Quand on tient compte de tous ces faits, on conçoit que l'histoire des sciences jusqu'à nos jours, soit en somme l'histoire de la bataille que la méthode expérimentale a dû engager et continue à soutenir contre la méthode de l'auto-observation, des recherches sur les expres- sions du langage et l'étymologie. Cette dernière méthode, vaincue et défaite sur un point, reparaît sur un autre. Quand elle ne peut combattre ouvertement, elle se dissimule, et finit par s'insinuer sous des formes trompeuses, dans le camp de l'adversaire.
§ 110. De nos jours, ce procédé est en grande partie banni des sciences physiques, dont le progrès dépend de cette exclusion ; mais il règne encore en économie politique et plus que jamais en sociologie ; et pourtant il est indispensable que ces disciplines suivent l'exemple donné par les sciences physiques, si elles veulent progresser (§ 118).
§ 111. La croyance, que l'on pouvait connaître les faits de l'univers et leurs relations, grâce à l'auto-observation de l'esprit humain, était générale en d'autres temps et reste le fondement de la métaphysique, laquelle cherche hors de l'expérience un critère de vérité. De nos jours, elle se manifeste pleinement dans les délires de la Philosophie de la nature de Hegel. Inutile d'ajouter qu'avec cette méthode, les hommes ne sont jamais parvenus à connaître la moindre uniformité des faits naturels (§ 50,484).
§ 112. Le positivisme de Herbert Spencer est tout simplement une métaphysique. D'un côté, cet auteur affirme la contingence de toute connaissance ; de l'autre, il disserte sur les relations que ces connaissances ont avec la « réalité absolue » [FN: § 112-1]; et tandis qu'il affirme l'existence de l'inconnaissable, il veut, par une plaisante contradiction, en connaître au moins quelque chose [FN: § 112-2] .
§ 113. Dans les affaires pratiques dont nous nous occupons journellement, nous ne pouvons certes pas raisonner avec la méthode et la rigueur des sciences logico- expérimentales (§ 108, § 109) ; c'est pourquoi nous sommes enclins à donner une grande importance aux mots. Une chose à laquelle on donne un nom se trouve, par ce seul fait, assimilée à une classe d'objets dont les caractères sont connus, et le deviennent par consé- quent aussi pour cette chose. En outre, et c'est le plus important, comme on la considère avec les sentiments suscités par le mot, il lui est profitable d'avoir un nom qui suscite des sentiments propices, et nuisible d'en porter un auquel s'attachent des sentiments défavorables. On trouvera de nombreux exemples de tels faits, dans la suite de cet ouvrage.
Dans la vie pratique, il serait difficile, voire impossible, de faire autrement. On ne peut remonter jusqu'aux origines et mettre tout en doute, à propos des innombrables questions qui surgissent à chaque pas. Quand on reconnaît qu'un chapeau est la propriété d'un homme, cela suffit ; il le met sur sa tête et s'en va. On ne peut pas, avant de le lui laisser prendre, discuter sur ce qu'est réellement la propriété, et résoudre la question de la propriété individuelle, collective, ou un autre problème du même genre. Dans les pays civilisés, les législations civiles et pénales ont une terminologie précise ; par conséquent, pour juger un acte, il faut savoir comment le désigner. Le langage ordinaire possède un très grand nombre de maximes qui, sauf la précision dont elles sont généralement dépourvues, présentent une analogie complète avec les articles de loi ; c'est pourquoi le mot par lequel on désigne un acte ou une chose a, pour ces maximes aussi, une grande importance. Le législateur emploie les termes dans le sens qu'ils ont habituellement parmi les gens auxquels il donne des lois. Il n'a pas besoin d'attendre que les hommes de science soient d'accord sur la définition du terme religion, pour édicter des prescriptions sur les offenses à la religion, sur la liberté religieuse, etc. On disserte couramment d'une infinité de choses, sans les connaître avec précision. La vie pratique se contente de l'à peu près, tandis que la science recherche l'exactitude.
Nous avons des théorèmes qui sont d'accord avec les faits, dans les limites de cet à peu près, pourvu qu'on ne les applique pas hors du domaine quelquefois très restreint, dans lequel ils peuvent être valables. Le langage vulgaire les cristallise et les conserve ; c'est là que nous pouvons donc les retrouver et en tirer parti ; mais toujours avec la restriction que, s'ils sont grossièrement approximatifs et vrais entre certaines limites, qui d'ailleurs nous restent généralement inconnues, ils deviennent faux hors de ces limites (chap. XI). Ces théorèmes portent plus sur les mots que sur les choses. Nous pouvons donc conclure que, dans la vie pratique, pour persuader autrui, et souvent aux tout premiers débuts des sciences, les mots sont de grand poids, et qu'en discuter n'est pas perdre son temps.
§ 114. On doit tirer des conclusions diamétralement opposées, quand il s'agit des recherches de la science expérimentale, puisque ces dernières, concernant exclusivement les choses, ne peuvent retirer aucun profit des mots eux-mêmes. Elles peuvent au contraire y trouver grand dommage, soit à cause des sentiments que suscitent les mots, soit parce qu'un mot lui-même peut tromper sur la réalité de la chose qu'il est censé représenter (§ 366), et introduire ainsi dans le domaine expérimental, des entités imaginaires, comme celles de la métaphysique ou de la théologie, soit enfin parce que les raisonnements sur les mots sont, en général, fortement dépourvus de précision.
§ 115. C'est pourquoi les sciences les plus avancées ont leur langage propre, soit parce qu'elles adoptent de nouveaux mots, soit parce que, conservant ceux du langage vulgaire, elles leur donnent une signification spéciale. Par exemple, l'eau de la chimie, la lumière de la physique, la vitesse de la mécanique ont une signification toute différente de celle que leur donne le langage courant.
§ 116. On peut souvent employer un moyen simple, pour découvrir si un raisonnement est du genre de ceux qui font appel au sentiment ou aux notions plus ou moins précises dont abonde le langage ordinaire, ou bien s'il est du genre de ceux qui appartiennent à la science expérimentale. Il suffit de substituer dans ce raisonnement, de simples lettres, a, b, c,... aux termes techniques qui y sont adoptés. Si le raisonnement perd ainsi toute sa force, il appartient au premier genre ; s'il la conserve, il appartient au second (§ 642).
§ 117. Comme d'autres sciences, l'économie politique commença par employer les mots du langage vulgaire ; mais elle s'efforça de leur donner un peu plus de précision ; de cette manière, elle s'enrichit de toute l'expérience accumulée dans le langage ordinaire ; ce qui n'était pas indifférent, car les opérations économiques occupent une grande partie de l'activité humaine. Puis, au fur et à mesure que l'économie politique progressait, cet avantage diminua, tandis qu'augmentaient les conséquences fâcheuses entraînées par l'emploi de ces mots. Avec beaucoup de raison, Jevons déjà renonça au terme valeur, dont la signification étirée en tous sens et rendue multiple, avait fini par disparaître (§ 62-1) ; il proposa un nouveau terme: la raison d'échange, et y attacha un sens précis (§ 387).
§ 118. Les économistes littéraires ne le suivirent pas dans cette voie ; aujourd'hui encore, ils se complaisent à rechercher ce qu'est la valeur, le capital, etc. On n'arrive pas à leur mettre dans la tête que les choses sont tout et les mots rien. Libre à eux de donner les noms de valeur et de capital aux choses qu'ils voudront, pourvu qu'ils aient l'obligeance de nous les indiquer d'une manière précise ; malheureusement ils ne le font pas, du moins en général. Si leurs raisonnements appartenaient à la science expérimentale, ils subsisteraient, alors même qu'on changerait les noms de valeur et de capital, puisque les choses demeureraient ; or, c'est uniquement de celles-là que s'occupe la science expérimentale [FN: § 118-1] ; mais comme leurs raisonnements sont au contraire avant tout de pure rhétorique, ils sont sous la dépendance étroite des mots aptes à susciter les sentiments capables de persuader l'auditeur ; voilà justement pourquoi les mots ont une si grande importance pour les économistes littéraires, tandis que les choses en ont peu.
Celui qui cherche « ce qu'est le capital, ce qu'est la valeur, ce qu'est la rente, etc. », montre par cela seul qu'il donne la première place au mot, la seconde à la chose. Le mot capital, par exemple, existe certainement pour lui ; il se demande ce qu'il représente et s'efforce de le trouver. On pourrait justifier ce procédé, de la manière suivante : « Il existe une chose inconnue dont l'influence sur le langage fait naître le mot capital ; puisque le langage ordinaire est la copie exacte des choses qu'il représente, en étudiant le mot, nous pourrons connaître la chose, et en recherchant ce qu'est le « capital », nous découvrirons cette chose inconnue ». Le défaut de cette justification gît dans la proposition soulignée, qui est fausse. Si l'on veut s'en persuader encore mieux, on n'a qu'à substituer au terme capital, un terme scientifique, par exemple l'eau, et voir si, en cherchant avec autant de soin qu'on voudra, ce « qu'on appelle eau », on pourra jamais arriver à connaître les propriétés du corps chimiquement pur, qu'on appelle l'eau.
En science, on suit une voie opposée à celle-là ; c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord de la chose, et qu'ensuite ou lui cherche un nom [FN: § 118-2] . On commence par considérer le corps formé par la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène, puis l'on pense à le baptiser. Puisque ce corps se trouve en grande quantité dans la chose mal définie que le langage vulgaire appelle l'eau, on le nomme aussi l'eau ; mais ou aurait tout aussi bien pu le nommer autrement, par exemple Lavoisier, ce qui ne changerait rien à la chimie. On dirait simplement que la mer et les fleuves contiennent une grande quantité de Lavoisier. Économistes et sociologues littéraires n'y comprennent rien, parce que l'habitude d'esprit et la culture nécessaires leur font défaut.
§ 119. Nous entendons nous en tenir ici étroitement à la méthode logico-expérimentale (§ 108), et raisonner exclusivement sur des choses ; aussi n'attachons-nous aucune importance aux mots. Ils ne sont que de simples étiquettes pour désigner les choses; nous disons donc : « Nous appellerons cette chose A », ou, si l'on veut : « Il nous plaît de l'appeler A »; et non pas, ce qui est bien différent : « Cette chose, c'est A ». La première proposition est une définition qui dépend de notre arbitraire ; la seconde est un théorème qu'il convient de démontrer ; mais il faut auparavant savoir ce qu'est précisément A (§ 963).
Pour éviter le danger toujours imminent dans les sciences sociales, de voir quelqu'un chercher le sens des mots, non dans la définition objective qui en est donnée, mais dans l'usage courant ou dans l'étymologie, nous aurions volontiers substitué aux mots étiquettes, des numéros d'ordre ou des lettres de l'alphabet, a. b..., comme nous l'avons fait parfois (§ 798), au moins pour une partie du raisonnement ; mais nous y avons renoncé par crainte que le raisonnement n'en devienne ainsi trop ennuyeux et obscur. C'est pourquoi nous avons suivi l'usage du chimiste qui continue, par exemple, à se servir du mot eau, en lui donnant un sens précis [FN: § 119-1]; nous emploierons aussi les termes du langage vulgaire, en indiquant avec précision les choses qu'ils doivent représenter. Nous prions donc le lecteur de s'en tenir rigoureusement à ces définitions, et de ne jamais chercher à deviner par l'étymologie ou les acceptions du langage courant, le sens des termes techniques dont nous faisons usage. C'est ainsi qu'il trouvera les termes résidus et dérivations (§ 868) ; s'il désire savoir ce qu'ils signifient, il doit s'en rapporter exclusivement aux définitions que nous en donnons, et prendre garde qu'en cherchant au contraire cette signification dans l'étymologie ou le langage ordinaire, il trouverait certainement des choses très différentes de celles dont nous voulons parler. Si quelqu'un ne trouve pas ces termes de son goût, qu'il les remplace par d'autres, à sa guise. Il verra qu'en substituant aux termes résidus, dérivations, les siens propres, et mieux des lettres alphabétiques ou des numéros d'ordre, tous les raisonnements où figurent ces expressions subsistent tels quels.
Le lecteur auquel ces explications paraîtront superflues voudra bien prendre patience. Mon excuse est que des développements semblables, donnés et répétés nombre de fois pour l'ophélimité, n'ont pas empêché des économistes littéraires d'en chercher le sens dans l'étymologie ; tandis que d'autres, qui devaient certainement avoir beaucoup de temps à per- dre, examinaient si le nom de désidérabilité [FN: § 119-2] ne conviendrait pas mieux ; et, pour mettre fin à ces ergotages, il n'a même pas suffi de montrer qu'on pouvait aussi se passer de l'ophélimité ou de tout autre terme semblable, dans l'exposé des théories de l'économie politique [FN: § 119-3] .
§ 120. J'emploierai dans cet ouvrage quelques termes usités en mécanique, et cela pour les motifs indiqués tout à l'heure. Il convient donc que j'explique au lecteur dans quel sens précis je les prendrai.
§ 121. Soient certaines choses A, B, C,… qui ont le pouvoir d'agir sur le phénomène économique et social. Nous pouvons considérer le phénomène à un moment où l'action de ces choses n'est pas encore épuisée, ou bien quand elle a produit tout son effet. Soit, par exemple A, le désir qu'un homme éprouve de boire du vin ; B, la crainte qu'il a de nuire à sa santé. Cet homme boit un verre de vin, puis un second, et s'arrête parce qu'après ce second verre, la crainte s'oppose victorieusement au désir. Après le premier verre, le phénomène n'est pas achevé ; le désir agit encore efficacement malgré la crainte ; et pourtant cette dernière n'a pas non plus produit tout son effet, parce qu'elle n'a pas encore empêché le désir de faire boire du vin à cet homme. Quand nous considérons un phénomène, il est manifeste qu'il faut dire si nous l'envisageons lorsque les choses A, B n'ont pas encore produit tout leur effet, ou bien après qu'elles ont achevé d'agir.
En mécanique, il existe un phénomène analogue – le lecteur prendra garde que je dis analogue et non identique ; – c'est celui de deux forces qui agissent sur un point matériel. Au lieu de parler de choses A, B qui ont le pouvoir d'agir sur le phénomène économique ou social, on peut aussi, pour simplifier, traiter de forces A et B.
§ 122. L'état intermédiaire, dans lequel l'individu, ayant bu un premier verre de vin, se dispose à en boire un second, c'est-à-dire dans lequel l'action de A et de B n'est pas encore achevée, s'exprime en mécanique, en disant que l'équilibre n'est pas encore atteint. L'état dans lequel le désir et la crainte ont produit leur effet de telle manière que notre homme ne boit plus de vin, s'exprime en mécanique, en disant que l'équilibre est atteint. On peut, par analogie – non par identité – employer aussi ce terme d'équilibre, pour le phénomène économique ou social.
§ 123. Mais une analogie n'est pas une définition ; et nous en contenter, pour indiquer le sens de l'équilibre économique ou social, serait nous exposer volontairement à des erreurs aussi nombreuses que faciles. Il faut donc donner une définition précise de cet équilibre économique ou social. Le lecteur la trouvera au chapitre XII.
§ 124. En maintenant cette définition, on peut changer comme on veut le mot équilibre ; les raisonnements restent les mêmes. Par exemple, au lieu d'appeler A et B forces, ou pourrait leur donner le nom de choses agissantes ou bien encore de choses (1) ; au lieu d'équilibre, on pourrait désigner l'état défini tout à l'heure par ![]() ou bien encore par état X ; et tous les raisonnements où figurent les termes forces et équilibres subsisteraient tels quels.
ou bien encore par état X ; et tous les raisonnements où figurent les termes forces et équilibres subsisteraient tels quels.
§ 125. C'est donc une grande erreur que de dire, comme l'a fait certain auteur, que quand je traite d'équilibre, je parle d'un état qui me paraît meilleur qu'un autre, parce que l'équilibre est meilleur que le manque d'équilibre !
§ 126. On peut employer par analogie d'autres termes de la mécanique, en économie et en sociologie. Considérons une société dans laquelle existe la propriété privée. Nous pouvons nous proposer d'étudier les formes possibles de cette société, en maintenant la condition de l'existence de la propriété privée. De même, d'autres relations existant entre les phénomènes nous donnent d'autres conditions que l'on peut supposer respectées ou non. Il existe, en mécanique, des phénomènes analogues, et ces conditions se nomment liaisons. Par analogie, nous pouvons nous servir de ce terme en économie politique ou en sociologie. Il serait d'ailleurs inutile de le faire, et mieux vaudrait ne pas employer le mot liaisons, s'il n'y avait pas d'autres analogies.
§ 127. Considérons un système de points matériels, réunis par certains liens, et sur lequel agissent certaines forces A, B, C,... Les positions successives des points seront déterminées par les forces, dans la mesure compatible avec les liaisons. Supposons une collectivité d'indi- vidus. On y trouve certaines conditions, comme la propriété privée, la liberté ou l'esclavage, des connaissances techniques, des richesses, des connaissances scientifiques, une religion, etc. ; en outre, certains désirs, certains intérêts, certains préjugés des hommes, etc. On peut supposer que les états successifs de cette collectivité sont déterminés par l'action de ces éléments et dans la mesure compatible avec les conditions posées.
§ 128. Nous pourrons donc, par analogie – non par identité – appeler cette collectivité un système social ou un système économique, et dire que certaines forces agissent sur lui, qui déterminent les positions des points du système, compatibles avec les liens. L'emploi de ces termes n'a d'autre motif que la brièveté, et, comme toujours, on peut leur en substituer d'autres, à volonté.
§ 129. En mécanique, le passage d'un état à un autre s'appelle mouvement. On peut user du même terme en sociologie. Si, en mécanique, nous supposons donnés les liens et les forces, les mouvements du système sont déterminés ; de même, si nous supposons donnés, en sociologie, les conditions et les facteurs agissants, les différents états successifs de la collec- tivité sont déterminés. De tels mouvements sont dits réels, en mécanique ; on peut aussi leur donner ce nom en sociologie.
§ 130. Si, dans un but de recherche, nous supprimons, par hypothèse, un lien en méca- nique, une condition en sociologie, le système mécanique pourra être affecté d'autres mouvements que les réels, et la collectivité sociologique pourra présenter des états différents de ceux qu'on observe en réalité ; ces mouvements sont appelés virtuels, en mécanique, et peuvent porter le même nom en sociologie. Par exemple, rechercher comment serait la société, si la propriété privée venait à y être supprimée, constitue une étude de mouvements virtuels.
§ 131. On peut réunir les liaisons et les forces du système social ; et si nous donnons à cet ensemble le nom de conditions [FN: § 131-1] , la théorie qui porte le nom de déterminisme s'exprimera en disant que l'état du système est entièrement déterminé par les conditions, et que, par conséquent, cet état ne peut changer qu'avec les conditions.
§ 132. La science n'a pas de dogmes ; elle ne doit et ne peut donc pas admettre le déter- minisme a priori ; et, quand elle l'admet, ce ne doit être, comme toujours, que dans les limites de l'espace et du temps considérés. Cela posé, l'expérience nous enseigne qu'en des cas très nombreux, les phénomènes sociaux paraissent justement être déterminés par les conditions, et qu'ils ne changent qu'avec celles-ci ; aussi admet-on le déterminisme pour ces cas, mais sans nier le moins du monde qu'il en puisse être d'autres, où il ne soit pas admissible. [Voir Addition A3 par l’auteur]
§ 133. En nous plaçant dans l'hypothèse du déterminisme, nous avons à résoudre un problème qui se présente à chaque instant, sous différentes formes, en sociologie et dans l'histoire. D'après le déterminisme, tout ce qui arrive ne saurait être autrement ; les termes possible, impossible, du langage ordinaire n'ont donc aucun sens, puisque n'est possible que ce qui arrive, impossible que ce qui n'arrive pas. Nous ne voulons pas discuter sur les mots ; par conséquent, si quelqu'un trouve bon de supprimer ces termes, supprimons les pour le contenter ; mais, cela fait, les choses différentes qu'ils désignaient n'en subsistent pas moins, et nous devrons leur trouver d'autres noms.
Paul n'a pas déjeuné hier. On dit couramment qu'il était possible qu'il déjeunât. Il ne s'est pas coupé la tête ; mais il était impossible qu'il se la coupât, puis se la remît sur les épaules avec un peu de colle forte et fût aujourd'hui encore vivant et en bonne santé. Il est bien entendu qu'au point de vue du déterminisme, les deux faits sont également impossibles ; d'autre part, il est évident qu'ils ont tous deux des caractères distincts, et qu'il est indispensable de pouvoir séparer les genres différents auxquels ils appartiennent. Appelons pour un moment (I) le premier genre de faits, (II) le second. Nous voyons immédiatement que la différence entre (I) et (II) consiste en ce qu'on a vu déjà des faits semblables à (I), et que l'on n'a jamais vu de faits semblables à (II).
§ 134. Pour être plus précis, nous dirons que dans l'un et l'autre cas, on traite de mouve- ments virtuels, et qu'en les déclarant tous deux impossibles, le déterminisme leur assigne simplement le caractère de mouvements virtuels, par opposition aux mouvements réels. Mais il y a plusieurs genres de mouvements virtuels. L'un d'eux apparaît, quand on supprime, par hypothèse, quelque liaison qui ne faisait pas défaut lorsqu'on a observé le mouvement réel considéré, mais dont on a constaté l'absence, en d'autres occasions où l'on a remarqué un mouvement réel égal au mouvement virtuel que l'on vient d'indiquer. Celui-ci fait donc partie du genre que nous avons nommé (I), et que le langage courant appelle : des choses possibles. Il est un autre genre de mouvements virtuels. On les observe seulement quand on supprime, par hypothèse, une liaison dont on n'a jamais constaté le défaut ; par conséquent, ils sont tels qu'on n'a jamais observé de mouvements réels qui leur fussent égaux. Nous avons ainsi le genre que nous avons appelé (II), et que le langage courant appelle : des choses impossibles.
Maintenant que nous avons défini avec précision les choses auxquelles correspondent ces termes possible et impossible, il n'y a aucun inconvénient à les employer aussi dans l'hypothèse du déterminisme.
§ 135. À quoi peut bien servir l'étude des mouvements virtuels, s'ils sont en dehors de la réalité, et si les mouvements réels seuls se produisent ? On peut entreprendre une telle étude pour deux motifs : 1° Si nous considérons des mouvements virtuels, qui n'ont pu être classés parmi les réels, à cause de certaines liaisons dont la présence a été observée en d'autres occasions, autrement dit, quand on considère des mouvements qui se présentent comme virtuels dans un cas et réels dans un autre, leur étude peut servir à prévoir ce que seront des mouvements réels. De ce genre sont les prévisions faites sur les effets d'une loi ou de tout autre mesure sociale. 2° La considération des mouvements virtuels peut servir à trouver les caractères et les propriétés d'un certain état social.
§ 136. Dire : « A détermine B », ou bien : « sans A, B manquerait », exprime le même fait, dans le premier cas, sous forme de propriété de A, dans le second, sous forme de mouve- ments virtuels. Dire: « dans cet état, la société obtient le maximum de A » ou bien : « si la société s'éloigne de l'état considéré, A diminue », exprime le même fait ; dans le premier cas, sous forme de propriété de cet état ; dans le second, sous forme de mouvements virtuels.
§ 137. Dans l'étude des sciences sociales, il convient de n'avoir recours à la considération des mouvements virtuels qu'avec beaucoup de précaution, parce que nous ignorons très souvent quels seraient les effets de la suppression d'une condition ou d'une liaison. Quand on dit, par exemple : «Si l'empereur Julien avait régné longtemps, la religion chrétienne n'aurait pas duré », on suppose que la mort seule de Julien donna la victoire au christianisme ; et quand on répond : « Si l'empereur Julien avait régné longtemps, il aurait pu retarder, mais non empêcher le triomphe du christianisme », on suppose l'existence d'autres conditions qui assuraient cette victoire. En général, les propositions de cette seconde catégorie se vérifient plus souvent que celles de la première ; c'est à-dire que très souvent le développement social est déterminé par l'ensemble d'un grand nombre de conditions, et qu'en supprimer une ne modifie la marche du phénomène que dans une faible mesure.
§ 138. Ajoutons que les conditions ne sont pas indépendantes ; beaucoup agissent les unes sur les autres. Ce n'est pas tout. Les effets de ces conditions agissent à leur tour sur les conditions elles-mêmes. En somme, les faits sociaux, c'est-à-dire conditions et effets, sont mutuellement dépendants ; une modification de l'un se répercute sur une partie plus ou moins grande des autres, avec une intensité plus ou moins forte.
§ 139. Aussi ne compose-t-on que des romans, quand on essaie de refaire l'histoire, en cherchant à deviner ce qui serait arrivé, si un certain fait n'avait pas eu lieu. Nous n'avons aucun moyen de connaître toutes les modifications qu'aurait apportées l'hypothèse choisie ; par conséquent, nous ne savons rien de ce qui serait advenu, si elle s'était réalisée. Que se serait-il passé, si Napoléon 1er avait été victorieux à Waterloo ? On ne peut donner qu'une seule réponse : « Nous n'en savons rien ».
§ 140. Il est possible d'acquérir quelques connaissances, en limitant les recherches à des effets tout proches, dans un domaine très restreint. Le progrès de la science sociale aura justement pour effet de reculer peu à peu ces frontières si rapprochées. Chaque fois que nous réussissons à découvrir, dans les faits sociaux, une relation jusqu'alors inconnue, nous devenons plus à même de connaître les effets de certaines modifications dans l'état social ; et, en suivant cette voie, nous faisons un nouveau pas, si petit qu'il soit, vers la connaissance du développement probable des faits sociaux.
C'est pourquoi l'on ne peut qualifier d'inutile aucune étude ayant pour but de trouver une uniformité dans les relations des faits sociaux entre eux. Elle peut l'être aujourd'hui, même dans un avenir prochain ; mais nous ne pouvons savoir si un jour ne viendra pas où, jointe à d'autres, elle permettra de prévoir le développement social probable.
§ 141. Le phénomène social étant très complexe, grandes sont les difficultés inhérentes à la recherche de ses uniformités ; elles croissent outre mesure et deviennent insurmontables, quand on s'adonne à cette étude, non dans le seul et unique but de découvrir ces uniformités, mais avec l'intention avouée ou masquée par le sentiment, de confirmer un principe, une doctrine, un article de foi ; c'est à cause de tels obstacles que les sciences sociales sont encore si arriérées.
§ 142. Il n'existe pas d'homme qui ne subisse l'influence des sentiments, qui soit entièrement dépourvu de préjugés et d'une foi quelconque. S'il fallait à tout prix satisfaire à ces conditions, pour se livrer à une étude profitable des sciences sociales, autant vaudrait dire que cette étude est impossible. Mais l'expérience montre que l'homme peut se dédoubler en une certaine mesure, et, quand il étudie un sujet, faire abstraction, au moins en partie, de ses sentiments, de ses préjugés, de sa foi, quitte à s'y livrer ensuite, quand il abandonne son étude. C'était, par exemple, le cas de Pasteur qui, hors de son laboratoire, se montrait fervent catholique, et dans son laboratoire, employait exclusivement la méthode expérimentale. On pourrait encore citer avant lui Newton, qui, certes, usait de méthodes bien différentes, quand il rédigeait ses commentaires sur l'Apocalypse et quand il écrivait ses Principia.
§ 143. Un tel dédoublement est beaucoup plus facile dans les sciences naturelles que dans les sciences sociales. Il est aisé d'étudier les fourmis avec l'indifférence sceptique de la science expérimentale ; il est beaucoup plus difficile d'envisager les hommes de cette façon. Toutefois, s'il est impossible d'y arriver entièrement, on peut du moins tâcher d'y réussir en partie, en réduisant au minimum l'influence et le pouvoir des sentiments, des préjugés, de la foi. C'est à ce prix seulement que les sciences sociales peuvent progresser.
§ 144. Les faits sociaux sont les éléments de notre étude. Nous tâcherons tout d'abord de les classer, ayant en vue le seul et unique but que nous indiquons, c'est-à-dire la découverte des uniformités (lois), des rapports qui existent entre ces faits. En groupant ainsi des faits semblables, l'induction fera ressortir quelques-unes de ces uniformités, et quand nous nous serons suffisamment avancés dans cette voie, avant tout inductive, nous en suivrons une autre, où la déduction aura plus d'importance. Nous vérifierons ainsi les uniformités aux- quelles nous avait conduits la méthode inductive ; nous leur donnerons une forme moins empirique, plus théorique ; nous en tirerons les conséquences et verrons comment elles représentent le phénomène social.
En général, on étudie des choses qui varient par degrés insensibles ; et plus la représen- tation qu'on s'en fait approche de la réalité, plus elle tend à devenir quantitative. On exprime souvent ce fait, en disant qu'en se perfectionnant, les sciences tendent à devenir quantitatives. Cette étude est beaucoup plus difficile que celle des différences simplement qualitatives [FN: § 144-1]; et le premier progrès qu'on réalise consiste justement en une grossière approximation quanti- tative. Il est facile de distinguer le jour de la nuit, avec une certaine approximation. Bien qu'il n'y ait pas à proprement parler d'instant précis auquel le premier cesse et la seconde commence, on peut toutefois dire, d'une façon générale, qu'il y a là une différence de qualités. Il est plus difficile de diviser ces espaces de temps en parties définies. On y arrive, avec une très grossière approximation, quand on dit : « peu après le lever du soleil, vers midi, etc. »; et tant bien que mal, plutôt mal que bien, en divisant la nuit en veilles. Quand on eut les horloges, on put obtenir une mesure quantitative du temps, dont la précision augmenta avec celle des horloges, et devint très précise avec les chronomètres. Longtemps les hommes se contentèrent de savoir que la mortalité était plus grande chez les vieillards que chez les jeunes gens, sans que l'on sût, comme il arrive généralement, le point précis où finissait la jeunesse et où commençait la vieillesse. Puis on apprit quelque chose de plus ; on eut ensuite des tables de mortalité très imparfaites, puis meilleures, aujourd'hui passables et qui chaque jour deviennent plus parfaites.
Longtemps l'économie politique fut presque entièrement qualitative ; puis avec l'écono- mie pure, elle devint quantitative, au moins théoriquement. Nous tâcherons donc de réaliser, en sociologie aussi, un semblable progrès, et de substituer autant que possible des consi- dérations quantitatives aux considérations qualitatives ; car, bien qu'imparfaites, voire très imparfaites, les premières valent du moins toujours un peu mieux que les secondes. Nous ferons ce que nous pourrons; d'autres ensuite feront mieux. Ainsi progresse la science.
Dans cet ouvrage, nous nous contenterons d'une représentation très générale, semblable à celle qui assigne à la terre la forme d'un sphéroïde ; c'est pourquoi notre livre porte le nom de Sociologie générale. Les détails resteront à étudier, comme on dessine les océans, les continents et les montagnes sur le sphéroïde terrestre ; ce qui constituera une étude de sociologie spéciale. Toutefois nous devrons examiner en passant quelques-uns de ces détails, parce que nous les rencontrerons sur la route que nous aurons à parcourir pour arriver à la connaissance du phénomène général.
[64]
Chapitre II↩
Les actions non-logiques. [(§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149]
§ 145. Au chapitre précédent, nous avons exprimé les conditions que nous nous imposions en écrivant cet ouvrage, et indiqué dans quel domaine nous voulions demeurer. Maintenant nous allons étudier les actions humaines, l'état d'esprit auquel elles correspondent et les façons dont il se manifeste ; cela pour arriver finalement à notre but, qui est la connaissance des formes sociales.
Nous suivons la méthode inductive, écartant toute opinion préconçue et toute idée a priori. En présence des faits, nous les décrivons, les classons, étudions leurs propriétés, et cherchons à découvrir quelque uniformité (loi) dans leurs relations.
Dans ce chapitre, nous commencerons par nous occuper d'une distinction fondamentale des actions [FN: § 145-1] .
§ 146. C'est notre premier pas dans la voie de l'induction. Si, par exemple, nous trouvons que toutes les actions humaines correspondent aux théories logico-expérimentales, ou encore que ces actions sont les plus importantes, les autres devant être considérées comme des déviations d'un type normal, comme des phénomènes de pathologie sociale, il est manifeste que notre voie divergerait entièrement de celle qu'il conviendrait de suivre, si, au contraire, un grand nombre d'actions humaines, parmi les plus importantes, correspondent aux théories qui ne sont pas logico-expérimentales.
§ 147. Étudions donc les actions au point de vue du caractère logico-expérimental. Dans ce but, nous devons tout d'abord tâcher de les classer ; et pour le faire, nous nous proposons de suivre les principes de la classification dite naturelle, en botanique et en zoologie, d'après laquelle on groupe les objets ayant un ensemble de caractères semblables. C'est ainsi qu'en botanique la classification de Tournefort a été abandonnée avec raison. Elle divisait les plantes en « herbes » et en « arbres », séparant ainsi des végétaux qui sont au contraire fort semblables. La méthode dite naturelle, que l'on suit maintenant, élimine toute division de ce genre, prend pour critère l'ensemble des caractères des végétaux, réunit ceux qui sont semblables, sépare ceux qui différent. Nous allons tâcher de trouver des divisions analogues pour les actions humaines.
§ 148. Ce ne sont pas les actions concrètes, que nous avons à classer, mais leurs éléments. De même, le chimiste classe les corps simples et leurs combinaisons, alors que dans la nature on trouve des mélanges de ces combinaisons. Les actions concrètes sont synthétiques ; elles proviennent de mélanges, en proportions variables, des éléments que nous avons à classer.
§ 149. Tout phénomène social peut être envisagé sous deux aspects, c'est-à-dire comme il est en réalité ou tel qu'il se présente à l'esprit de certains hommes. Nous appellerons le premier aspect : objectif, le second : subjectif (§ 94 et sv.). Cette division est nécessaire, parce que nous ne pouvons mettre dans une même classe, par exemple, les opérations que le chimiste exécute dans son laboratoire, et celles de l'individu qui s'adonne à la magie, les actions qu'accomplissaient les marins grecs, ramant pour chasser leur navire sur l'eau, et les sacrifices qu'ils offraient à Poséidon pour obtenir une navigation propice. À Rome, la loi des XII Tables punissait celui qui opérait des sortilèges contre les moissons. Nous voulons distinguer cette action de celle qui consiste à incendier les moissons.
Les noms donnés à ces deux classes ne doivent pas nous induire en erreur. En réalité, elles sont toutes les deux subjectives ; parce que toute connaissance humaine est subjective. Elles se distinguent, non par une différence de nature, mais par une somme plus ou moins grande de connaissances des faits. Nous savons – ou croyons savoir – que les sacrifices à Poséidon n'ont aucune influence sur la navigation. Nous les séparons donc d'autres actions qui, d'après nos connaissances, peuvent avoir une influence sur la navigation. Si l'on venait à découvrir, un jour, que nous nous trompons, et que les sacrifices à Poséidon sont très utiles pour obtenir une navigation favorable, il faudrait replacer ces sacrifices parmi les autres actions qui ont ce caractère. À vrai dire, tout cela n'est qu'un pléonasme et revient à affirmer que l'individu qui établit une classification, la fait d'après les connaissances qu'il possède. On ne comprend pas comment il pourrait en être autrement.
§ 150. Il y a des actions qui sont des moyens appropriés au but, et qui s'unissent logiquement à ce but. Il en est d'autres auxquelles ce caractère fait défaut. Ces deux classes d'actions sont très différentes, suivant qu'on les considère sous leur aspect objectif ou sous leur aspect subjectif. Sous ce dernier aspect, presque toutes les actions humaines font partie de la première classe. Pour les marins grecs, les sacrifices à Poséidon et l'action de ramer étaient des moyens également logiques de naviguer.
Il convient de donner des noms à ces classes d'actions, afin d'éviter des longueurs qui deviendraient fastidieuses. Comme nous l'avons dit déjà aux § 116 et sv., il vaudrait peut-être mieux se servir de noms qui n'aient par eux-mêmes aucun sens, par exemple des lettres de l'alphabet. D'autre part, un tel procédé nuirait à la clarté de l'exposition. Il faut donc se résigner à employer les termes du langage commun ; mais le lecteur voudra bien se souvenir que ces noms – ou leurs étymologies – ne servent à rien, si l'on veut savoir ce qu'ils désignent. Ces classes doivent être étudiées directement, et leur nom n'est qu'une étiquette quelconque servant à les indiquer (§ 119). Cela dit une fois pour toutes, nous appellerons « actions logiques », les opérations qui sont logiquement unies à leur but, non seulement par rapport au sujet qui accomplit ces opérations, mais encore pour ceux qui ont des connaissances plus étendues ; c'est-à-dire les actions ayant subjectivement et objectivement le sens expliqué plus haut. Les autres actions seront dites « non-logiques »; ce qui ne signifie pas illogiques. Cette classe se divisera en différents genres.
§ 151. Il convient de donner un tableau synoptique de cette classification.
| GENRE ET ESPÈCES | LES ACTIONS ONT-ELLES UNE FIN LOGIQUE? | |
| Objectivement | Subjectivement | |
| Ie CLASSE - Actions logiques. Le but objectif est identique au but subjectif. |
||
| Oui | Oui | |
| IIe CLASSE Actions non-logiques. Le but objectif est identique au but subjectif. |
||
| 1er genre ... | Non | Non |
| 2d genre ... | Non | Oui |
| 3e genre ... | Oui | Non |
| 4e genre ... | Oui | Oui |
| ESPÈCES DU 3e ET DU 4e GENRES | ||
| 3α, 4α ... | Le sujet accepterait le but objectif, s'il le connaissait. | |
| 3β, 4β ... | Le sujet n'accepterait pas le but objectif, s'il le connaissait. | |
Le but dont nous parlons ici est un but direct ; la considération d'un but indirect est exclue. Le but objectif est un but réel, rentrant dans le domaine de l'observation et de l'expérience, et non un but imaginaire, étranger à ce domaine, et qui pourrait être au contraire un but subjectif.
§ 152. Les actions logiques sont très nombreuses chez les peuples civilisés. Les travaux artistiques et scientifiques appartiennent à cette classe, au moins en ce qui concerne les personnes qui connaissent ces deux disciplines. Pour les exécuteurs matériels de ces travaux, qui ne font qu'accomplir les ordres de leurs chefs, ce sont des actions de la 2e classe, 4e genre. Les actions étudiées par l'économie politique appartiennent, elles aussi, en très grande partie, à cette classe. On doit y ranger, en outre, un certain nombre d'opérations militaires, politiques, juridiques, etc.
§ 153. Voilà que l'induction nous amène à reconnaître que les actions non-logiques ont une grande part dans le phénomène social. Donc, procédons à leur étude ; et, ce faisant, nous aurons à effleurer, dans ce chapitre, certains sujets que nous traiterons plus à fond, dans la suite de notre ouvrage, pour revenir enfin sur les questions indiquées ici.
§ 154. Tout d'abord, pour mieux connaître ces actions non-logiques, voyons quelques exemples ; beaucoup d'autres trouveront d'ailleurs leur place dans les chapitres suivants. Voici des exemples d'actions de la 2e classe.
Le 1er et le 3e genres, qui n'ont pas de but subjectif, sont très peu importants pour la race humaine. Les hommes ont une tendance très prononcée à donner un vernis logique à leurs actions ; celles-ci rentrent donc presque toutes dans le 2e et le 4e genres. Beaucoup d'actions imposées par la politesse ou la coutume pourraient appartenir au 1er genre. Mais très souvent les hommes invoquent un motif quelconque, pour justifier leurs actions ; ce qui les fait passer dans le 2e genre.
Si nous laissons de côté le motif indirect, résultant du fait que l'homme qui s'écarte des usages communs est blâmé et mal vu, nous trouvons quelques actions à placer dans le 1er et le 3e genres. Hésiode dit : « N'urine pas à l'embouchure d'un fleuve qui se jette dans la mer ni dans une fontaine. Il faut l'éviter. N'y soulage pas ton ventre ; cela vaut mieux [FN: § 154-1]. » Le précepte de ne pas souiller les fleuves à leur embouchure appartient au 1er genre. On ne voit aucun but objectif ni subjectif à l'action d'éviter cette souillure. Le précepte de ne pas souiller les fontaines appartient au 3e genre. Il a un but objectif qu'Hésiode ne pouvait connaître, mais que les modernes connaissent : c'est le fait d'éviter la diffusion de certaines maladies.
Il est probable qu'il existe, chez les sauvages et les barbares, plusieurs actions du 1er, et du 3e genres ; mais les voyageurs, voulant coûte que coûte connaître la cause des actions qu'ils observent, finissent par obtenir, d'une manière ou d'une autre, quelque réponse qui les fait passer dans le 2e et le 4e genres.
§ 155. Chez les animaux, pour autant que nous admettions leur absence de raisonnement, presque toutes les actions dites instinctives prennent place dans le 3e genre ; quelques-unes peuvent aussi rentrer dans le 1er.
Le 3e genre est le type pur des actions non-logiques. Leur étude chez les animaux nous aidera à comprendre ces actions chez les hommes. À propos des insectes appelés euménides, Émile Blanchard [FN: § 155-1] dit qu'à l'instar d'autres hyménoptères, ils vont (p. 71)
« pomper le miel dans le nectaire des fleurs, quand ils sont adultes, mais leurs larves ne vivent que de proie vivante ; et cependant, aussi bien que celles des Guêpes et des Abeilles, elles sont apodes, incapables de se nourrir ; elles périraient bientôt, si elles étaient abandonnées à elles-mêmes. D'après cela, on devine ce qui arrive ; c'est la mère qui doit procurer la nourriture à ses petits. Cette industrieuse femelle, qui ne vit que du suc des fleurs, va faire la guerre aux insectes pour assurer l'existence de sa progéniture. Presque toujours l'Hyménoptère s'attaque à une espèce particulière pour en approvisionner son nid ; il sait parfaitement trouver ceux qui nous paraissent bien rares, quand nous les cherchons. La femelle pique ses victimes avec son aiguillon et les emporte à son nid. L'insecte ainsi blessé ne meurt pas immédiatement, il demeure plongé dans un état d'engourdissement complet, qui le rend incapable de se mouvoir et surtout de se défendre. Les larves, qui éclosent auprès de ces provisions péniblement amassées par leur mère, trouvent à leur portée une nourriture convenable, en quantité suffisante pour toute la durée de leur existence à l'état de larve. Rien n'est plus surprenant que cette admirable prévoyance sans doute tout instinctive de chaque femelle, qui, au moment de pondre ses œufs, prépare la nourriture de ses larves, qu'elle ne verra jamais ; déjà elle aura cessé de vivre, quand celles-ci viendront à éclore. »
D'autres hyménoptères, les cerceris, s'attaquent aux coléoptères. L'action subjectivement non-logique est ici d'une merveilleuse logique objective. Laissons parler Fabre [FN: § 155-2]. Il observe que, pour paralyser sa proie, l'hyménoptère doit trouver des coléoptères chez lesquels les trois ganglions thoraciques sont très rapprochés, contigus, ou chez lesquels les deux derniers sont soudés ensemble « (p. 72) Voilà vraiment la proie qu'il faut aux Cerceris. Ces coléoptères à centres moteurs rapprochés jusqu'à se toucher, assemblés même en une masse commune et de la sorte solidaires l'un de l'autre, seront à l'instant même paralysés d'un seul coup d'aiguillon ; ou bien, s'il faut plusieurs coups de lancette, les ganglions à piquer seront tous là, du moins, réunis sous la pointe du dard. » Et plus loin :
« (p. 73) Parmi le nombre immense de Coléoptères sur lesquels sembleraient pouvoir se porter les déprédations des Cerceris, deux groupes seulement, les Charançons et les Buprestes, remplissent les conditions indispensables. Ils vivent loin de l'infection et de l'ordure, objets peut-être de répugnances invincibles pour le délicat chasseur ; ils ont dans leurs nombreux représentants les tailles les plus variées, proportionnées à la taille des divers ravisseurs, qui peuvent ainsi choisir à leur convenance ; ils sont beaucoup plus que tous les autres vulnérables au seul point où l'aiguillon de l'Hyménoptère puisse pénétrer avec succès, car en ce point se pressent, tous aisément accessibles au dard, les centres moteurs des pattes et des ailes. En ce point, pour les Charançons, les trois ganglions thoraciques sont très rapprochés, les deux derniers même sont contigus ; en ce même point, pour les Buprestes, le second et le troisième sont confondus en une seule et grosse masse, à peu de distance du premier. Et ce sont précisément des Buprestes et des Charançons que nous voyons chasser, à l'exclusion absolue de tout autre gibier, par les huit espèces de Cerceris dont l'approvisionnement en Coléoptères est constaté ! »
§ 156. D'un autre côté, une partie des actions des animaux révèle une espèce de raisonnement, ou mieux d'adaptation des moyens au but, quand les circonstances changent. Fabre, que nous citons abondamment, parce que c'est l'auteur qui a le mieux étudié ces questions, dit [FN: § 156-1]: « (p. 165) Pour l'instinct rien n'est difficile, tant que l'acte ne sort pas de l'immuable (p. 166) cycle dévolu à l'animal : pour l'instinct aussi rien n'est facile si l'acte doit s'écarter des voies habituellement suivies. L'insecte qui nous émerveille, qui nous épouvante de sa haute lucidité, un instant après, en face du fait le plus simple mais étranger à sa pratique ordinaire, nous étonne par sa stupidité. » Et plus loin [FN: § 156-2]:
« (p. 65) Dans la psychique de l'insecte, deux domaines, fort différents, sont à distinguer. L'un est l'instinct proprement dit (p. 66), l'impulsion inconsciente qui préside à ce que l'animal accomplit de plus merveilleux dans son industrie... C'est lui, et rien que lui, qui fait construire pour une famille ignorée de la mère, qui conseille des provisions destinées à l'inconnu, qui dirige le dard vers le centre nerveux de la proie... en vue de la bonne conservation des vivres... Mais avec sa rigide science qui s'ignore, l'instinct (p. 67) pur, s'il était seul, laisserait l'insecte désarmé, dans le perpétuel conflit des circonstances... un guide est nécessaire pour rechercher, accepter, refuser, choisir, préférer ceci, ne faire cas de cela, tirer enfin parti de ce que l'occasion peut offrir d'utilisable. Ce guide, l'insecte le possède certes, à un degré même très évident. C'est le second domaine de sa psychique. Là, il est conscient et perfectible par l'expérience. N'osant appeler cette aptitude rudimentaire intelligence, titre trop élevé pour elle, je l'appellerai discernement. »
§ 157. Qualitativement (§ 143-3] ), les phénomènes sont à peu près les mêmes pour l'homme ; mais quantitativement, le champ des actions logiques, très restreint chez l'animal, devient extrêmement étendu chez l'homme. Cependant, un très grand nombre d'actions humaines, même aujourd'hui chez les peuples civilisés, sont accomplies instinctivement, mécaniquement, sous l'empire de l'habitude. On l'observe encore mieux dans le passé et chez les peuples moins avancés. Il y a des cas où l'on observe que l'efficacité de certains actes du culte est admise instinctivement, et non comme conséquence logique de la religion qui professe ce culte (§ 952).
Fabre dit [FN: § 157-1]:
« (p. 174) Les divers actes instinctifs des insectes sont donc fatalement liés l'un à l'autre. Parce que telle chose vient de se faire, telle autre doit inévitablement se faire pour compléter la première ou pour préparer les voies à son complément [c'est le cas de nombreuses actions humaines] ; et les deux actes sont dans une telle dépendance l'un de l'autre, que l'exécution du premier entraîne celle du second, lors même que, par des circonstances fortuites, le second soit devenu non seulement inopportun, mais quelquefois même contraire aux intérêts de l'animal. »
Mais la logique, qui prend une si grande importance chez l'homme, apparaît en germe chez l'animal. Après avoir raconté comment il déroutait certains insectes qui s'obstinaient à exécuter des actes inutiles, Fabre ajoute:
« (p. 176) Rappelons ici que le Sphex à ailes jaunes ne se laisse pas toujours duper dans ce jeu qui consiste à lui reculer le grillon. Il y a chez lui des tribus d'élite, des familles à forte tête, qui, après quelques échecs, reconnaissent les malices de l'opérateur et savent les (p. 177) déjouer. Mais ces révolutionnaires, aptes au progrès, sont le petit nombre ; les autres, conservateurs entêtés des vieux us et coutumes, sont la majorité, la foule. »
Il est utile que le lecteur retienne cette observation ; parce que ce contraste entre la tendance aux combinaisons, laquelle innove, et la tendance à la permanence des agrégats de sensations, laquelle conserve, pourrait nous mettre sur la voie de l'explication d'un grand nombre de faits des sociétés humaines (chap. XII).
§ 158. La formation du langage humain n'est pas moins merveilleuse que les actions instinctives des insectes. Il serait absurde de prétendre que la théorie grammaticale ait précédé la pratique du langage. Elle l'a certainement suivi ; et c'est sans en avoir conscience, que les hommes ont créé de subtiles théories grammaticales. Prenons comme exemple la langue grecque. Si l'on voulait remonter plus haut, à quelque idiome indo-européen dont on ferait dériver le grec, nos observations se vérifieraient a fortiori, parce que les abstractions grammaticales deviendraient de moins en moins probables. On ne saurait admettre que les Grecs se soient réunis, un beau jour, pour décréter la conjugaison de leurs verbes. L'usage seul en a fait un chef-d'œuvre. Nous savons que les Attiques avaient l'augment, signe du passé des temps historiques, et que, par une nuance fort délicate, ils distinguaient, outre l'augment syllabique, l'augment temporel, qui consiste dans l'allongement de la voyelle initiale. La conception de l'aoriste et son rôle dans la syntaxe sont une invention qui ferait honneur au logicien le plus expert. Les nombreuses formes du verbe et la précision de leur rôle dans la syntaxe constituent un tout admirable [FN: § 158-1].
§ 159. À Rome, le général revêtu de l'imperium doit, avant de quitter la ville, prendre les auspices au Capitole. Il ne peut le faire qu'à Rome. Il est impossible d'admettre que cette disposition eût, à l'origine, le but politique qu'elle a fini par atteindre [FN: § 159-1] .
« (p. 114) Tandis qu'il dépendait exclusivement de la volonté des comices de prolonger les imperia qui existaient, il ne pouvait en être établi de nouveaux comportant la plénitude du commandement militaire qu'avec la prise des auspices au Capitole, par conséquent avec un acte accompli dans la sphère de la compétence urbaine... et en en organisant une en dehors de la constitution, on aurait franchi les bornes qui s'imposaient même aux comices du peuple souverain. Il n'y a guère de barrière constitutionnelle qui ait aussi longtemps résisté que la garantie qu'on avait trouvée là, dans ces auspices du général, contre les pouvoirs militaires extraordinaires, mais cette prescription a fini par être elle-même écartée ou plutôt tournée. À l'époque récente, on annexait, par une fiction de droit, à la ville de Rome, comme s'il avait été situé dans le pomerium, un morceau de terrain quelconque situé hors de la ville, et on y (p. 115) accomplissait l'auspicium requis. »
Plus tard, Sulla non seulement abolit cette garantie des auspices, mais la rendit même impossible, grâce à une disposition par laquelle il obligeait le magistrat à ne prendre le commandement qu'à l'expiration de son année de fonctions ; c'est-à-dire quand il ne pouvait plus prendre les auspices de Rome. Le conservateur Sulla n'avait évidemment pas l'intention de préparer ainsi la destruction de sa constitution ; de même qu'en sanctionnant l'obligation de prendre les auspices dans la capitale, on n'avait pas en vue de prévenir les attaques à la constitution républicaine. En réalité, nous avons, dans ce dernier cas, une action non-logique 4 α; et, dans le cas de Sulla, une action 4 β. Dans le phénomène économique, un fait est remarquable : dans un état de libre concurrence, les entrepreneurs accomplissent en partie des actions non-logiques 4 β: c'est-à-dire des actions dont la fin objective n'est pas égale à la fin subjective [FN: § 159-2] . Au contraire, si certaines de ces entreprises jouissent d'un monopole, ces actions deviennent logiques.
§ 160. Il y a une autre différence très importante entre les actions des hommes et celles des animaux : nous n'observons pas les actions des hommes seulement de l'extérieur, comme nous observons celles des animaux. Souvent nous ne connaissons les premières que par les appréciations qu'en donnent les hommes, par l'impression qu'elles font sur eux, par les motifs qu'il leur plait d'imaginer on d'attribuer comme causes à ces actions. C'est pourquoi les actions qui appartiendraient au 1er et au 3e genres, passent dans le 2e et le 4e.
Quand d'autres actions ne sont pas ajoutées aux opérations magiques, ces dernières appartiennent au 2e genre. Les sacrifices des Grecs et des Romains doivent en faire partie, du moins dès qu'on ne croit plus à la réalité de leurs dieux. Hésiode veut qu'on ne traverse jamais un fleuve sans avoir prié et s'y être lavé les mains. Ce serait là une action du 1er genre ; mais il ajoute que les dieux punissent celui qui traverse un fleuve sans se laver les mains [FN: § 160-1] . L'action passe ainsi dans le 2e genre.
Ce procédé est habituel et très répandu. Hésiode dit qu'il ne faut pas semer le treizième jour du mois, mais que ce jour est excellent pour planter [FN: § 160-2] . Il donne encore un très grand nombre de préceptes semblables. Ces actions appartiennent au 2e genre. À Rome, l'augure qui avait observé les signes célestes, pouvait renvoyer les comices à un autre jour [FN: § 160-3] . Vers la fin de la République, quand on ne croyait plus à la science augurale, celle-ci donnait lieu à des actions logiques. C'était un moyen d'atteindre un résultat désiré. Mais quand on croyait encore à la science augurale, elle engendrait des actions du 4e genre, se rattachant à l'espèce 4 α, pour les augures qui, avec l'aide des dieux, empêchaient ainsi une délibération, à leurs yeux funeste au peuple romain.
En général, ces actions correspondent, très imparfaitement c'est vrai, aux précautions prises aujourd'hui pour éviter les décisions hâtives d'une assemblée : exigence de deux ou trois délibérations consécutives, accord de deux assemblées, etc. Il se trouve ainsi que les actions des augures appartenaient souvent à l'espèce 4 α 318..
La majeure partie des actes politiques procédant de la tradition, de la prétendue mission d'un peuple ou d'un homme, appartiennent au 4e genre. Le roi de Prusse, Guillaume 1er, et l'empereur des Français, Napoléon III, se considéraient tous deux comme des hommes « providentiels ». Mais le premier croyait que sa mission était de faire le bien et la grandeur de son pays ; tandis que le second pensait être destiné à faire le bien de l'humanité. Le premier accomplit des actions de l'espèce 4 α; le second, de l'espèce 4 β.
Les hommes se donnent ordinairement certaines règles générales (morale, coutume, droit) dont dérive un nombre plus ou moins grand d'actions 4 α 321.et aussi d'actions 4 β.
§ 161. Les actions logiques sont, au moins dans leur partie principale, le résultat d'un raisonnement ; les actions non-logiques proviennent principalement d'un certain état psychique : sentiments, subconscience, etc. C'est à la psychologie à s'occuper de cet état psychique. Dans notre étude, nous partons de cet état de fait, sans vouloir remonter plus haut.
§ 162. Pour les animaux (fig. 2), supposons que les actes B, qui sont les seuls que nous puissions observer, soient unis à un état psychique hypothétique A (I). Chez les hommes, cet état psychique ne se manifeste pas seulement par des actes B, mais aussi par des expressions C, de sentiments, qui se développent souvent en théories morales, religieuses et autres. La tendance très marquée qu'ont les hommes à prendre les actions non-logiques pour des actions logiques, les porte à croire que B est un effet de la « cause » C. On établit de la sorte une relation directe CB, au lieu de la relation indirecte qui résulte des deux rapports AB, AC.
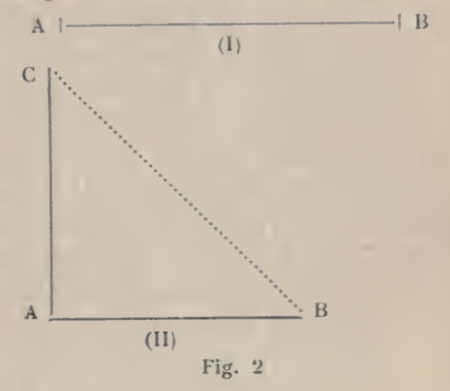
Figure 2
Parfois la relation CB existe véritablement ; mais cela n'arrive pas si souvent qu'on le croit. Le même sentiment qui pousse les hommes à s'abstenir de faire une action B (relation AB), les pousse à créer une théorie C (relation AC). L'un a, par exemple, horreur de l'homicide B et s'en abstiendra ; mais il dira que les dieux punissent l'homicide ; ce qui constitue une théorie C.
§ 163. Il s'agit ici non seulement de relations qualitatives (143-1), mais aussi de relations quantitatives. Supposons pour un moment une force donnée, qui pousse un homme à exécuter l'action B ; elle a un indice égal à 10. L'individu accomplit ou non cette action B, suivant que les forces qui agissent pour l'en empêcher ont un indice inférieur ou supérieur à 10. Nous aurons alors les cas suivants : 1° La force de la liaison AB a un indice supérieur à 10. Dans ce cas, elle suffit pour empêcher l'homme d'accomplir l'action. Si la liaison CB existe, elle est superflue. 2° La force de la liaison CB, si elle existe, a un indice supérieur à 10. Dans ce cas, elle suffit à empêcher l'action B, même si la force AB est égale à zéro. 3° La force résultant de la liaison AB a, par exemple, un indice égal à 4 ; celle résultant de la liaison CB, un indice égal à 7. La somme des indices est 11 : l'action ne sera pas exécutée. La force résultant de la liaison AB a un indice égal à 2 ; l'autre force conserve l'indice 7 ; la somme est 9 : l'action sera exécutée.
Par exemple, la liaison AB représente la répugnance qu'éprouve un individu à accomplir l'action B ; AC représente la théorie d'après laquelle les dieux punissent celui qui exécute l'action B. Il y aura des gens qui s'abstiendront de B par simple répugnance (1er cas). Il y en aura d'autres qui s'en abstiendront uniquement parce qu'ils craignent la punition des dieux (2e cas). Il y en aura aussi qui s'en abstiendront pour ces deux causes ensemble (3e cas).
§ 164. Les propositions suivantes sont donc fausses, étant trop absolues : « La disposition naturelle à faire le bien suffit pour empêcher les hommes de faire le mal. La menace des châtiments éternels suffit à empêcher les hommes de faire le mal. La morale est indépendante de la religion. La morale est une dépendance nécessaire de la religion. »
Supposons que C soit une sanction édictée par la loi. Le même sentiment qui pousse les hommes à craindre cette sanction, les retient d'accomplir l'action B. Chez quelques-uns, la répugnance pour B suffit à les empêcher d'exécuter cette action; chez d'autres, c'est la crainte de la sanction C ; chez d'autres encore, ce sont ces deux causes réunies.
§ 165. Les relations que nous avons envisagées entre A, B, C sont élémentaires, mais sont bien loin d'être les seules. Tout d'abord, l'existence de la théorie C réagit sur l'état psychique A, et contribue souvent à le renforcer. Elle agit ainsi sur B en suivant la voie C A B. D'autre part, l'abstention B de faire certains actes réagit sur l'état psychique A, et par conséquent sur la théorie C, en suivant la voie B A C. Puis l'action de C sur B agit sur A et revient ainsi en C. Supposons, par exemple, qu'une sanction C soit jugée excessive pour un délit B. L'application de cette sanction (CB) modifie l'état psychique A, et par l'effet de cette modification, la sanction C est remplacée par une autre moins sévère. Un changement qui vient à se produire dans un état psychique, se manifeste d'abord par une augmentation de certains délits B. Cette augmentation produit une modification de l'état psychique A ; modification qui se traduit par un changement de C.
On peut, jusqu'à un certain point, assimiler le culte d'une religion à B ; sa théologie à C. Toutes deux proviennent d'un certain état psychique A.
§ 166. Considérons certaines actions D (fig. 3), dépendant de cet état psychique A. Le culte B n'agit pas directement sur D, mais sur A et ainsi sur D ; il agit de même aussi sur C, et vice versa, C agit sur B. Il peut aussi y avoir une action directe CD. L'action de la théologie C sur A est ordinairement assez faible ; par conséquent, très faible aussi sur D, puisque l'action CD est de même généralement faible. On commet donc en général une grave erreur, quand on suppose que la théologie C est la cause des actions D. La proposition qu'on émet souvent : « Ce peuple agit ainsi parce qu'il croit cela », est rarement vraie ; elle est presque toujours erronée. La proposition inverse : « Le peuple croit cela parce qu'il agit ainsi », renferme généralement une plus grande somme de vérité ; mais elle est trop absolue et a sa part d'erreur. Il est vrai que les croyances et les actions ne sont pas indépendantes ; mais leur dépendance consiste à être deux branches d'un même arbre (§ 267). Ce sujet sera amplement développé au chapitre XI.
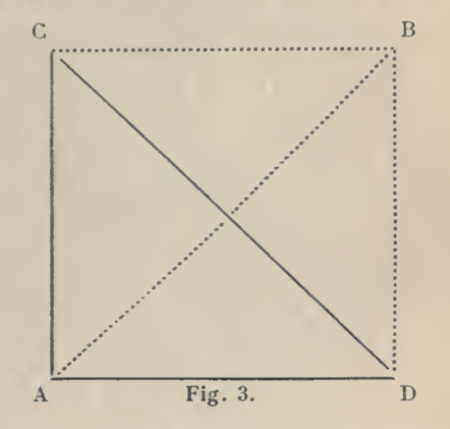
Figure 3
§ 167. Avant l'invasion des dieux de la Grèce, l'ancienne religion romaine n'avait pas de théologie C ; elle se réduisait à un culte B. Mais ce culte B, réagissant sur A, influait fortement sur les actions D du peuple romain. Il y a plus. Quand le rapport direct BD existe, il se présente à nous, modernes, comme manifestement absurde. Mais le rapport BAD pouvait au contraire être en certains cas très raisonnable et utile au peuple romain. En général, la théologie C a sur D une influence directe encore plus faible que sur A. C'est donc une grave erreur que de vouloir estimer la valeur sociale d'une religion, en considérant uniquement la valeur logique et raisonnable de sa théologie (§ 14). Sans doute, si cette dernière devient absurde au point d’agir fortement sur A, de ce fait elle agira fortement aussi sur D. Mais ce cas se présente rarement : ce n'est guère qu'après une modification de l'état psychique A, qu'il arrive aux hommes d'apercevoir certaines absurdités, qui leur avaient tout d'abord entièrement échappé.
Ces observations s'appliquent à toute espèce de théories [FN: § 167-1] . Par exemple, C est la théorie du libre échange ; D est l’adoption pratique du libre échange dans un pays ; A est un état psychique résultant en grande partie des intérêts économiques, politiques, sociaux, des individus et des circonstances dans lesquelles ils vivent. Le rapport direct entre C et D est généralement très faible. Agir sur C pour modifier D ne conduit qu’à des résultats insignifiants. Au contraire, une modification de A peut se répercuter sur C et sur D. On les verra donc changer en même temps, et un observateur superficiel pourra croire que D a été modifié par le changement de C ; mais une étude plus profonde montrera que D et C ne dépendent pas directement l'un de l'autre, mais que tous deux dépendent d'une cause commune A.
§ 168. Les discussions théoriques C ne sont donc pas directement très utiles pour modifier D ; indirectement, elles peuvent être utiles pour modifier A. Mais pour y arriver, il faut recourir aux sentiments beaucoup plus qu'à la logique et aux résultats de l'expérience. Nous exprimerons ce fait d'une manière incorrecte, parce que trop absolue, mais frappante, en disant que, pour agir sur les hommes, les raisonnements ont besoin de se transformer en sentiments.
En Angleterre, de nos jours, la pratique du libre échange B (fig. 3), suivie durant de longues années, a réagi sur l'état A (intérêts, etc.), et renforcé par conséquent cet état psychique ; elle s'est ainsi opposée à l'introduction du protectionnisme. Ce n'est donc pas du tout le fait de la théorie C du libre échange. Maintenant d'autres faits, tels que les nécessités croissantes du fisc, viennent à leur tour modifier A. Ces modifications pourront amener un changement de B et imposer le protectionnisme. En même temps, on verra se modifier C et se développer des théories favorables au nouvel état de choses.
Une théorie C a des conséquences logiques ; un certain nombre de celles-ci se trouvent en B ; d'autres ne s'y trouvent pas. Cela ne pourrait arriver si B était la conséquence directe de C. En ce cas, toutes les conséquences logiques devraient se trouver sans exception en B. Mais comme C et B sont simplement les conséquences d'un certain état psychique A, rien n'exige qu'il y ait entre eux parfaite correspondance logique. Nous ferons donc toujours fausse route, quand nous croirons pouvoir déduire B de C, en établissant cette correspondance. Il faudrait partir de C pour connaître A et en savoir déduire ensuite B. Ici se présentent des difficultés très graves ; et, par malheur, ce n'est qu'en les surmontant qu'on peut espérer acquérir une connaissance scientifique des phénomènes sociaux.
§ 169. Nous ne connaissons pas directement A, mais certaines manifestations de A, telles que C et B, et nous devons remonter de celles-ci vers A. Les difficultés augmentent, parce que si B est susceptible d'observation exacte, C est presque toujours exprimé d'une manière douteuse et sans la moindre précision.
§ 170. Le cas que nous considérons est celui d'une interprétation populaire ou du moins appartenant à une collectivité nombreuse. Un cas semblable sur certains points, mais différent sur beaucoup d'autres, est celui dans lequel C représente une théorie construite par des hommes de science. Quand le raisonnement n'est pas froidement scientifique, C est modifié par l'état psychique des hommes de science qui construisent la théorie. S'ils font partie de la collectivité qui a exécuté les actes B, leur état psychique a quelque chose de commun avec celui des membres de cette collectivité, excepté des cas très rares d'hommes qui s'éloignent des chemins battus. A agit par conséquent sur C. Voilà ce que cet exemple peut avoir de commun avec le précédent.
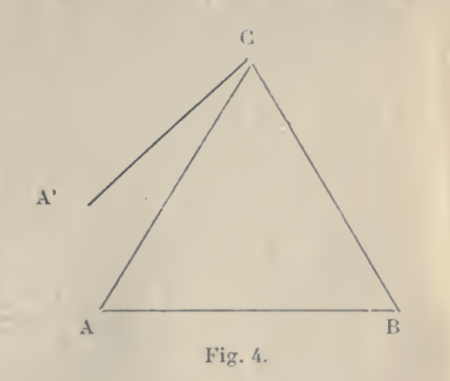
Figure 4
Si les hommes de science font la théorie d'actes accomplis par des hommes qui appartiennent à des collectivités complètement différentes de celle dont ils font partie, soit qu'il s'agisse d'un pays étranger ou d'une civilisation très différente, soit qu'il s'agisse de faits historiques remontant à un lointain passé, l'état psychique A ’ de ces hommes de science n'est pas identique à A ; il peut en différer plus ou moins, être même tout à fait différent, dans certains cas particuliers. Or, c'est cet état psychique qui influe sur C ; par conséquent A ne peut agir sur C que peu ou pas du tout.
Si nous négligeons cette influence de A ou de A ’, nous nous trouvons dans le cas des interprétations purement théoriques des faits B. Si C est un principe rigoureux, précis, s’il est uni à B par un raisonnement logique, sans équivoque d'aucune sorte, nous avons des interprétations scientifiques.
§ 171. Mais la catégorie que nous examinons en renferme d'autres. C peut être un principe douteux, manquant de précision et parfois même de sens expérimental. Il peut, en outre, être uni à B par des raisonnements sans consistance logique, procédant par analogie, faisant appel au sentiment et se perdant en divagations nébuleuses. Nous avons alors des théories de peu ou de point de valeur logico-expérimentale, bien qu'elles puissent avoir une grande valeur sociale (§ 14). Elles sont fort nombreuses, et nous aurons à nous en occuper longuement. Nous touchons ici par induction de nombreux points que nous ne dépasserons pas ; mais nous poursuivrons notre route dans les chapitres suivants, et nous étudierons alors en détail ce que nous effleurons maintenant.
§ 172. Revenons au cas de la figure 3 ; et pour nous familiariser avec cette matière qui n'est rien moins que facile, laissons de côté les abstractions ; examinons un cas concret. De cette manière, nous serons amenés à certaines inductions qui naissent spontanément de l'exposition des faits ; puis nous reviendrons au cas général, et nous continuerons l'étude que nous n'avons fait qu'ébaucher.
Un état psychique très important est celui qui établit et maintient certains rapports entre des sensations ou des faits, par l'intermédiaire d'autres sensations P, Q, R,... Ces sensations peuvent être successives ; c'est probablement une des manières dont se manifeste l'instinct des animaux. Elles peuvent être simultanées ou du moins considérées comme telles, et leur union constitue l'une des forces principales de l'équilibre social.
Ne donnons aucun nom à cet état psychique, pour éviter, si possible, qu'on ne veuille tirer du mot le sens de la chose (§ 119), et continuons à désigner cet état simplement par la lettre A, comme nous avons fait pour un état psychique en général. Il ne faut pas envisager seulement un état statique ; il faut encore considérer un état dynamique. Il est en effet très important de savoir comment se transforme la partie fondamentale des institutions d'un peuple. 1° Elle peut ne changer que difficilement, lentement, avoir une tendance marquée à se conserver identique. 2° Elle peut changer facilement, dans une mesure appréciable, mais de diverses manières ; c'est-à-dire : α 345.) la forme change aussi facilement que le fond : à nouveau fond, nouvelle forme ; les sensations P, Q, R,... peuvent être séparées facilement, soit parce que la force x qui les unit est faible, soit parce qu'étant considérable, elle est vaincue par une autre force encore plus puissante ; β) le fond change plus facilement que la forme : à nouveau fond, forme ancienne. Les sensations P, Q, R,... se séparent difficilement, soit parce que la force x qui les unit est plus considérable, soit parce qu'étant faible, elle n'entre en lutte avec aucune autre force notable.
Les sensations P, Q, R,... peuvent naître de certaines choses et apparaître ensuite à l'individu comme des abstractions de ces choses, des principes, des maximes, des préceptes, etc. Elles constituent un agrégat. L'étude de la persistance de cet agrégat donnera lieu à de longues et importantes considérations, qui seront développées au chapitre VI, quand nous aurons poussé l'induction assez loin pour pouvoir y substituer la déduction. Pour le moment, il serait prématuré de nous y arrêter longuement.
§ 173. Un observateur superficiel pourra confondre le cas (2 β) avec le premier. Mais il y a, en réalité, des différences radicales entre elles. Les peuples qu'on appelle conservateurs peuvent l'être seulement quant à la forme (cas 2 β), ou bien quant au fond (cas 1). Les peuples dits formalistes peuvent conserver la forme et le fond (cas 1), ou conserver seulement la forme (cas 2 β). Les peuples dont on dit qu'ils se sont cristallisés dans un certain état se rattachent au 1er cas.
§ 174. Quand la force x est très considérable et que la force y qui pousse à innover est très faible ou nulle, nous avons les phénomènes de l'instinct des animaux ; nous nous rapprochons de Sparte, cristallisée dans ses institutions. Quand x est forte, mais que y est également importante, et que les innovations se produisent dans le fond tout en respectant la forme, nous avons un état semblable à celui de Rome ancienne. On s'efforce de changer les institutions en dérangeant le moins possible les unions P, Q, R,... On y parvient en laissant subsister dans la forme, les rapports P, Q, R,... À ce point de vue, on peut considérer le peuple romain comme formaliste, à une certaine époque de son histoire, et l'on peut faire la même observation pour le peuple anglais. La répugnance qu'éprouvent ces deux peuples à innover les rapports formels P, Q, R,... permet aussi de les appeler conservateurs ; mais si l'on fixe son attention sur le fond, on s'apercevra que loin de le conserver, ils le transforment. Chez l'ancien peuple athénien comme chez le peuple français moderne, x est relativement faible. Il est difficile d'affirmer que y était plus intense chez les Athéniens que chez les Romains, chez les Français que chez les Anglais du XVIIe au XIXe siècle. Si les effets se manifestent sous une forme différente, cela dépend plutôt du degré de vigueur de x que de y.
Supposons que chez deux peuples y soit identique et x différente. Quand il innove, le peuple chez lequel x est faible fait table rase des rapports P, Q, R,... et leur en substitue d'autres ; le peuple chez lequel x est intense laisse subsister autant que possible ces rapports, et modifie la signification de P, Q, R.... En outre, on trouvera des survivances moins importantes chez le premier peuple que chez le second. Puisque x est faible, rien n'empêche la disparition des rapports P, Q, R,. regardés comme inutiles ; mais quand x est forte, on les conservera même si on les juge inutiles.
Nous obtenons ces inductions grâce à l'observation des manifestations de l'état psychique A. Pour Rome, les faits abondent. D'abord la religion. Il n'y a plus aucun doute : 1° qu'aux premiers temps de Rome, la mythologie n'existait pas ou était extrêmement pauvre ; 2° que la mythologie classique de Rome n'est, en grande partie, autre chose qu'une forme grecque donnée aux dieux romains, ou une invasion de divinités étrangères. L'ancienne religion romaine consistait essentiellement dans l'association de certaines pratiques religieuses avec les faits et gestes de la vie courante ; c'était le type des associations P, Q, R,. Cicéron put dire [FN: § 174-1]que « toute la religion du peuple romain se divise en culte et en auspices (§ 361), auxquels se sont ajoutées ensuite les prédictions, qui tirent leur origine des explications des présages et des prodiges, données par les interprètes de la Sibylle et les aruspices ».
§ 175. On peut observer de notre temps aussi des types nombreux et variés d'associations P, Q, R,… E. Deschamps [FN: § 175-1]dit, par exemple, qu'à Ceylan, « dans tous les actes de la vie de l'indigène l'astrologue joue son rôle ; on ne saurait rien entreprendre sans son avis et – ajoute-t-il –je me suis souvent vu refuser les moindres services parce que l'astrologue n'avait pas été consulté sur le jour et l'heure favorable pour me les accorder ». Quand on veut défricher et cultiver un terrain, on consulte d'abord l'astrologue, auquel on offre des feuilles de bétel et des noix d'arec [FN: § 175-2]. « (p. 159) Si la prédiction est favorable, les feuilles de bétel et les noix d'arec lui sont renouvelées, un certain jour, et une « heure heureuse » (nakata ) est choisie pour commencer à couper les arbres et les arbustes. Le jour fixé les cultivateurs de la terre déterminée, après avoir pris part au repas de gâteaux et de riz au lait préparés pour cette occasion, sortent, le visage tourné dans la direction propice dénoncée par l'astrologue. Si un lézard de maison vient à crier au moment où ils sortent, ou si, en route, ils rencontrent quelque objet de mauvaise augure, telle une personne portant du bois mort ou des armes blessantes, un serpent-rat en travers du sentier ou un pivert des bois, ils abandonnent la culture de cette terre ou, le plus souvent, n'y vont pas ce jour-là et décident de repartir à une autre nakata. D'un autre côté, s'ils rencontrent des choses agréables, telles qu'une vache à lait ou une femme qui allaite, ils poursuivent avec bonheur et confiance. Quand ils arrivent à la terre, l'heure favorable est attendue. » On met feu aux arbres et aux broussailles. « (p. 160) Laissant quinze ou vingt jours à la terre pour refroidir, une autre nakata est fixée pour le nettoyage complet de la terre... (p. 161) un homme, à une nakata ordonnée par le même astrologue, sème la première poignée de riz comme prélude... » Les oiseaux et la pluie peuvent porter préjudice à la semence. « (p. 161) Pour éloigner ces méfaits, un kéma ou charme appelé nava-nilla (« neuf herbes ? ») est préparé... Si ce kéma se montre inefficace, une espèce particulière d'huile est distillée pour un autre charme... (p. 162) Au temps du sarclage, on a encore recours au même astrologue, qui doit fixer une heure heureuse pour commencer le travail... Quand la saison de la floraison est passée, a lieu la cérémonie de l'aspersion des cinq sortes de laits ». On continue de la même manière pour toutes les opérations successives, jusqu'à ce qu'enfin le riz soit récolté et mis en magasin.
§ 176. On trouve plus ou moins de pratiques semblables, aux origines de l'histoire de tous les peuples [FN: § 176-1]. Les différences sont de quantité, non de qualité. Preller [FN: § 176-2] observe qu'à Rome, à côté du monde des dieux, il y avait une famille d'esprits et de génies. « (p. 65) Tous les phénomènes, toutes les actions qui s'y passent, dans la nature comme dans l'humanité, depuis la naissance jusqu'à la mort, toutes les vicissitudes de la vie et de l'activité humaine, tous les rapports des citoyens entre eux, toutes les entreprises, etc., sont du ressort de ces petits dieux. Ils ne doivent même leur existence qu'à ces mille relations sociales auxquelles ils peuvent s'identifier. » C'étaient, à l'origine, de simples associations d'idées, comme celles que nous trouvons dans le fétichisme, et qui produisirent des agrégats auxquels on donna le nom de divinité ou un autre semblable. Pline [FN: § 176-3]observe justement que le nombre de ces dieux est plus grand que celui des hommes. Quand se développa la tendance à donner un vernis logique aux actions non-logiques, on voulut expliquer pourquoi certains actes s'associent à certains autres, et l'on fit alors remonter les actes du culte à un grand nombre de dieux ; ou bien l'on s'imagina que ces actes étaient la manifestation d'un culte des forces de la nature ou de diverses abstractions.
En réalité, nous avons là un cas semblable à celui du § 175. Par suite de certaines associations d'idées et d'actes, l'état psychique A des Romains (fig. 2) a eu pour conséquence les actes du culte B. Plus tard et en certains cas à cette même époque, cet état psychique s'est manifesté par la considération C, d'abstractions, de forces de la nature, d'attributs de certaines divinités, etc.; puis, de l'existence concomitante de B et de C, on a conclu, mais à tort le plus souvent, que B était conséquence de C.
§ 177. L'interprétation qui voit dans les actes du culte une conséquence de l'adoration de certaines abstractions, qu'elles soient considérées comme des « forces de la nature » ou autrement, est la moins admissible, et doit être absolument rejetée [FN: § 177-1] (§ 158, § 996). Des preuves innombrables démontrent que les hommes procèdent généralement du concret à l'abstrait, et non de l'abstrait au concret [FN: § 177-2] . La faculté d'abstraction se développe avec la civilisation ; elle est très faible chez les peuples barbares. Les théories qui la supposent développée aux origines de la société sont gravement suspectes d'erreur. Les anciens Romains, encore incultes, n'avaient certainement pas une puissance d'abstraction assez développée pour découvrir la manifestation d'une force naturelle, sous chaque fait concret souvent même tout à fait insignifiant. Si cette force d'abstraction avait existé, elle aurait laissé quelque trace dans la langue. Les Grecs, à l'origine, ne la possédaient probablement pas plus que les Romains; mais ils l'acquirent de bonne heure, et lui donnèrent un développement considérable ; aussi leur langue en garde-t-elle une profonde empreinte. Grâce à l'article, ils peuvent substantifier un adjectif, un participe, une proposition entière. Les Latins, ne connaissant pas l'article, ne pouvaient avoir recours à ce moyen, mais en auraient trouvé certainement un autre, s'ils en avaient éprouvé le besoin. Au contraire, c'est un fait bien connu, que la faculté d'employer les adjectifs substantivement est beaucoup plus restreinte en latin qu'en grec et même qu'en français [FN: § 177-3].
Il est probable qu'il y a de l'exagération dans ce que rapporte Saint Augustin [FN: § 177-4], à propos de la multitude des « dieux » romains ; cependant, même si l'on fait une large part à l'exagération, il reste un grand nombre de dieux qui paraissent n'avoir été créés que pour expliquer logiquement l'association de certains actes avec certains autres. En parlant de la conception de l'homme, Varron fait l'énumération des dieux, dit Saint Augustin [FN: § 177-4] . Il commence par Janus, et, passant successivement en revue toutes les divinités qui prennent soin de l'homme, jusqu'à son extrême vieillesse, il clôt la liste par Nenia, qui n'est autre chose que le chant lugubre dont on accompagne les funérailles des vieillards. D'autre part, il énumère des divinités dont le rôle ne concerne pas directement la personne de l'homme, mais les choses qu'il emploie : vivres, vêtements, etc.
§ 178. Gaston Boissier [FN: § 178-1]dit à ce propos : « (p. 5) Ce qui frappe d'abord, c'est de voir combien tous ces dieux sont peu vivants. On n'a pas pris la peine de leur faire une légende, ils n'ont pas d'histoire. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'il faut les prier à un certain moment et qu'ils peuvent alors rendre service. Ce moment passé, on les oublie. Ils ne possèdent pas de nom véritable ; celui qu'on leur donne ne les désigne pas eux-mêmes, il indique seulement les fonctions qu'ils remplissent ». Les faits sont exacts ; l'exposé en est légèrement erroné, parce que l'auteur se place au point de vue des actions logiques. Ces dieux n'étaient pas seulement peu vivants ; ils ne l'étaient pas du tout. Autrefois, c'étaient de simples associations d'actes et d'idées ; ce n'est qu'à une époque relativement moderne qu'ils sont devenus des dieux. (§ 955) « Tout ce qu'on sait d'eux » est ce qu'il suffit de savoir pour ces associations d'actes et d'idées. Quand on dit qu'il faut « les prier » à un certain moment, on donne un nom nouveau à un concept ancien. On s'exprimerait mieux en disant qu'on les invoque, et mieux encore en disant qu'on fait intervenir certaines paroles. Quand, pour empêcher un scorpion de piquer, on prononce le nombre deux (§ 182), dira-t-on qu'on prie le nombre deux, qu'on l'invoque ? Est-il étonnant qu'il n'ait pas une légende, une histoire ?
§ 179. Dans l'Odyssée (X, 304-305), Hermès donne à Ulysse une plante qui doit le préserver des maléfices de Circé. « Elle est noire dans sa racine et semblable au lait, dans sa fleur. Les dieux l'appellent moly. Il est difficile aux mortels de l'arracher ; mais les dieux sont tout-puissants ».
Nous avons là un type pur d'actions non-logiques. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une opération magique, grâce à laquelle on contraint un dieu d'agir ; car, au contraire, ici c'est un dieu qui donne la plante à l'homme. On n'allègue aucun motif pour expliquer l'action de la plante. Supposons qu'au lieu d'une fiction poétique, il s'agisse d'une plante réelle, employée en vue d'un but réel. Une association d'idées se formerait entre cette plante et Hermès, et l'on tenterait de nombreuses explications logiques. On verrait dans cette plante un procédé pour contraindre Hermès à intervenir ; ce qui est une véritable opération magique. Ou bien on y verrait une manière d'invoquer Hermès ; ou encore une forme d'Hermès ; ou l'un des noms d'Hermès; ou une façon de reconnaître les « forces de la nature ». Homère désigne cette plante par l'expression [mots grecs], qu'on peut traduire par remède salutaire. N'est-il pas évident, dira-t-on, qu'il s'agit ici des forces naturelles qu'on invoque pour empêcher les funestes effets des poisons ? Et toute la végétation qu'on peut trouver dans Homère y passerait [FN: § 179-1].
§ 180. L'homme a une si forte tendance à ajouter des développements logiques aux actions non-logiques, que tout lui sert de prétexte pour s'adonner à cette chère occupation. Il y a eu probablement de nombreuses associations d'idées et d'actes, en Grèce comme à Rome ; mais en Grèce, une grande partie a disparu plus tôt qu'à Rome. L'anthropomorphisme grec a transformé de simples associations d'idées et d'actes en attributs divins. Gaston Boissier dit [FN: § 180-1]:
« (p. 4) Sans doute on a éprouvé dans d'autres pays le besoin de mettre les principaux actes de la vie sous la protection divine, mais d'ordinaire on choisit pour cet office des dieux connus puissants, éprouvés, afin d'être sûr que leur concours sera efficace. C'est la grande Athéné, c'est le sage Hermès qu'on invoque en Grèce, pour que l'enfant devienne habile et savant. À Rome on a préféré des dieux spéciaux, créés pour cette circonstance même et qui n'ont pas d'autre usage ».
Les faits sont exacts ; mais l'exposé est complètement erroné ; toujours parce que l'auteur voit les faits sous l'aspect d'actions logiques. Il s'exprime comme celui qui, voulant expliquer les déclinaisons de la grammaire latine, dirait: « Sans doute on a éprouvé, dans d'autres pays, le besoin de distinguer le rôle des substantifs et des adjectifs dans la proposition, mais d'ordinaire on choisit pour cet office des prépositions, etc. » Non, les peuples n'ont pas choisi leurs dieux, pas plus que les formes grammaticales de leur langue. Les Athéniens n'ont pas délibéré pour savoir s'ils devaient mettre l'enfant sous la protection d'Hermès et d'Athéna, pas plus que les Romains n'ont choisi pour cet office, après mûre réflexion, Vaticanus, Fabulinus, Educa, Potina, etc.
§ 181. Peut-être observons-nous simplement, en Grèce, un état postérieur à celui qu'on remarque à Rome, dans l'évolution qui fait passer du concret à l'abstrait, du non-logique au logique ; peut-être l'évolution a-t-elle été différente dans les deux pays ? Le manque de documents ne nous permet pas de l'établir avec certitude. En tout cas – et c'est ce qui nous importe dans l'étude que nous faisons ici – à l'époque historiqué, les stades de l'évolution sont différents à Athènes et à Rome.
§ 182. Une très remarquable persistance des associations d'idées et d'actes est celle qui semble accorder un pouvoir occulte aux mots sur les choses [FN: § 182-1] .
Même à une époque aussi récente que celle de Pline le Naturaliste, on pouvait lire [FN: § 182-2]:
« Au sujet des remèdes fournis par l'homme, il s'élève d'abord une grande question toujours pendante : les paroles et les charmes magiques ont-ils quelque puissance ? S'ils en ont, il conviendra de les rapporter à l'homme. Consultés en particulier, les gens les plus sages n'en croient rien ; et cependant, en masse, les actes de tous les instants impliquent, sans qu'on s'en aperçoive, la croyance à cette puissance [FN: § 182-3] . [Pline se montre ici excellent observateur, et décrit très bien une action non-logique.] Ainsi, on pense que sans une formule de prière, il serait inutile d'immoler des victimes, et que les dieux ne pourraient être convenablement consultés [FN: § 182-4] . De plus, il y a des paroles diverses, les unes d'impétration, les autres de dépulsion (Littré), d'autres de recommandation [FN: § 182-5]. Nous avons vu que des personnes revêtues de magistratures souveraines ont prononcé des formules déterminées : pour n'omettre ou ne transposer aucun mot, un homme prononce la formule qu'il lit sur le rituel, un autre est préposé pour suivre toutes les paroles, un autre est chargé de faire observer le silence, un musicien joue de la flûte pour qu'aucune autre parole ne soit entendue ; et ces deux faits remarquables sont consignés, à savoir : que toutes les fois qu'un sacrifice a été troublé par des imprécations, ou que la prière a été mal récitée, aussitôt le lobe du foie ou le cœur de la victime a disparu ou a été doublé, sans que la victime ait bougé. On conserve encore, comme un témoignage immense, la formule que les Décius, père et fils, prononcèrent en se dévouant [FN: § 182-6] . On a la prière récitée par la vestale Tuccia, lorsque, accusée d'inceste, elle porta de l'eau dans un crible, l'an de Rome 609. Un homme et une femme, Grecs d'origine ou de quelqu'une des autres nations avec qui nous étions alors en guerre, ont été enterrés vivants dans le marché aux bœufs ; et cela s'est vu même de notre temps. La prière usitée dans ce sacrifice, laquelle est récitée d'abord par le chef du collège des Quindécemvirs, arrachera certainement à celui qui la lira l'aveu de la puissance de ces formules, puissance confirmée par huit cent trente ans de succès. Aujourd'hui, nous croyons que nos vestales retiennent sur place, par une simple prière, les esclaves fugitifs qui ne sont point encore sortis de Rome. Si l'on admet cela, si l'on pense que les dieux exaucent quelques prières ou se laissent ébranler par ces formules, il faut concéder le tout [FN: § 182-7] . »
Pline continue en invoquant la conscience, – non pas la raison ; c'est-à-dire qu'il met fort bien en lumière le caractère non-logique des actions.
« (5,1) Pour confirmer ce qui vient d'être dit, je veux en appeler au sentiment intime de chacun. Pourquoi, en effet, nous souhaitons-nous réciproquement une heureuse année au premier jour de l'an ? Pourquoi, dans les purifications publiques, choisit-on pour conduire les victimes des gens porteurs de noms heureux ?... Pourquoi croyons-nous que les nombres impairs ont pour toute chose plus de vertu [FN: § 182-8] , vertu qui se reconnaît dans les fièvres à l'observation des jours ?... Attale (Philométor) assure que si en voyant un scorpion on dit deux, [Voir Addition A4 par l’auteur] l'insecte s'arrête, et ne pique point [FN: § 182-9] . »
§ 183. Ces actes, grâce auxquels les mots agissent sur les choses, appartiennent à ce genre d'opérations que le langage courant désigne d'une manière peu précise, par le terme d'opérations magiques. Un type extrême est celui de certaines paroles et de certains actes qui, par une vertu inconnue, ont le pouvoir de produire certains effets. Puis, une première couche de vernis logique explique ce pouvoir par l'intervention d'êtres supérieurs, de dieux. En suivant cette voie, on atteint l'autre extrême, qui est celui d'actes entièrement logiques ; par exemple, la croyance qu'on avait, au moyen-âge, que l'être humain qui vendait son âme à Satan acquérait le pouvoir de nuire à autrui.
Quand on ne conçoit que des actions logiques, et qu'on rencontre des phénomènes semblables à ceux de tout à l'heure, on les omet, on les dédaigne, on les considère comme des états pathologiques et l'on passe outre sans plus s'en préoccuper. Mais quand on sait quel rôle jouent les actions non-logiques, dans la vie sociale, on s’astreint à les étudier aussi avec soin.
Le lecteur observera qu'en ce cas comme en d'autres, notre induction atteint le seuil de certaines études que nous devrons ensuite reprendre longuement. Dans ce chapitre-ci, nous marcherons encore à tâtons, en cherchant à découvrir la voie qui nous permettra de trouver la forme et la nature de la société humaine.
§ 184. Supposons qu'on ne connaisse que les faits qui font dépendre le succès des opérations magiques, de l'intervention du démon. Nous pourrions accepter comme vraie l'interprétation logique, et dire : « Les hommes croient à l'efficacité des opérations magiques, parce qu'ils croient au démon. » Cette conclusion ne serait pas modifiée profondément par la connaissance d'autres faits qui substitueraient une divinité quelconque au démon. Mais elle est réduite à néant, si nous connaissons des faits absolument indépendants de toute intervention divine. Nous voyons alors que, dans ces phénomènes, l'important consiste en actions non-logiques qui unissent certaines paroles, certaines invocations, certaines pratiques, à des effets désirés [FN: § 184-1] , et que l'intervention des dieux, des démons, des esprits, etc., n'est que la forme logique donnée à ces faits. Nous avons de nouveau un des nombreux faits envisagés au § 162. La forme logique sert à unir C à B.
Notons que, le fond restant intact, plusieurs formes peuvent coexister chez un même individu, sans que ce dernier ait conscience de la part qui revient à chacune. La magicienne de Théocrite compte sur l'intervention des dieux et sur l'efficacité des pratiques magiques, sans bien distinguer comment agissent ces deux puissances. Elle demande à Hécate de rendre les philtres qu'elle a préparés pires que ceux de Circé, de Médée ou de la blonde Périmède [FN: § 184-2]. Si elle ne comptait que sur l'intervention de la divinité, il serait plus simple qu'elle lui demandât directement le résultat qu'elle attend des philtres. Quand elle répète le refrain: « [mot grec] [Oiseau magique], attire cet homme vers ma demeure », elle a évidemment en vue un certain rapport occulte entre l'oiseau magique et l'effet désiré.
Les gens crurent pendant des siècles et des siècles à de semblables fables, présentées sous des formes diverses, et même aujourd'hui, il y a des gens qui les prennent au sérieux. Seulement, depuis deux ou trois siècles, le nombre s'est accru, des gens qui en rient comme en riait déjà Lucien [FN: § 184-3]. Mais les faits du spiritisme, de la télépathie, de la Christian science (§ 1965-1] ) et autres semblables suffisent à faire voir quel empire ont encore ces sentiments et d'autres analogues.
§ 185. « Ton bœuf ne mourrait pas si tu n'avais un mauvais voisin [FN: § 185-1]», dit Hésiode ; mais il n'explique pas comment ce fait a lieu. Les lois des XII Tables parlent de « celui qui jettera un sortilège contre les moissons... » [FN: § 185-2]et de « celui qui prononcera un maléfice... », mais sans expliquer en quoi consistent exactement ces opérations. Cette forme d'actions non-logiques subsista pourtant à travers les siècles, et se manifeste encore de nos jours par la foi aux amulettes. Dans le Napolitain, nombreux sont ceux qui portent une corne de corail suspendue à leur chaîne de montre, pour se préserver du mauvais œil. Beaucoup de joueurs possèdent des amulettes ou exécutent certains actes qu'ils estiment capables de les faire gagner [FN: § 185-3] .
§ 186. Bornons-nous à examiner une seule des actions non-logiques : celle de provoquer ou d'empêcher les orages et de détruire ou de préserver les récoltes. Laissons de côté ce qui se rapporte à des pays étrangers au monde gréco-latin, pour éviter le doute qui règne, quand on prend au hasard les faits un peu partout, et qu'on les réunit artificiellement. Nous étudierons simplement un phénomène et ses variétés, dans le monde gréco-latin, en citant quelques faits étrangers.
Justement parce qu'ils n'excitent plus les sentiments, qui troubleraient l'œuvre objective que nous voulons accomplir, nous choisirons comme premier exemple une catégorie de faits qui, aujourd'hui du moins, ont peu d'importance sociale. Ces sentiments sont les pires ennemis que rencontre l'étude scientifique de la sociologie. Malheureusement, nous ne réussirons pas toujours à les éviter complètement. Il faudra que le lecteur lui-même s'efforce d'éloigner cette cause d'erreur.
La méthode que nous suivons pour la catégorie de faits que nous étudions maintenant est identique à celle que nous emploierons pour d'autres catégories semblables. Les phénomènes de cette catégorie constituent une famille naturelle, semblable à celle des papilionacées en botanique. On peut facilement les reconnaître et les grouper. Leur nombre est considérable ; aussi nous est-il impossible de les rappeler tous ; mais nous parlerons au moins des types principaux.
§ 187. Nous avons beaucoup de cas dans lesquels des gens croient pouvoir susciter ou éloigner des ouragans, grâce à certaines pratiques. Parfois on ne sait pas comment se produit cet effet, qu'on présente comme donné par l'observation ; d'autrefois, on expose des soi-disant motifs, et l'on tient l'effet pour une conséquence théoriquement explicable de l'action de certaines forces. En général, ou suppose que les phénomènes météorologiques sont placés sous la dépendance de certaines pratiques, soit directement, soit indirectement, grâce à l'intervention de puissances supérieures.
§ 188. Pallas donne des préceptes sans commentaires. Columelle ajoute un brin d'interprétation logique, en disant que l'usage et l'expérience en ont enseigné l'efficacité [FN: § 188-1]. Longtemps auparavant, selon Diogène Laërce (VIII, 59), Empédocle se vantait de commander à la pluie et aux vents. D'après Timée (loc. cit. 60), un jour que les vents soufflaient avec violence et menaçaient de détruire les récoltes, il fit faire des outres de peau d'âne et les envoya porter sur les montagnes. De cette manière, les vents, emprisonnés dans ces outres, cessèrent de souffler. Suidas rend cette interprétation un peu moins absurde, en disant qu'Empédocle plaça des peaux d'âne tout autour de la ville. Plutarque (adv. Colot.) donne des interprétations moins invraisemblables, bien que toujours telles, lorsqu'il dit qu'Empédocle a délivré une contrée de la stérilité et de la peste, en fermant les gorges des montagnes, par lesquelles les vents soufflaient dans la plaine. Il répète à peu près la même chose ailleurs (De curios.), mais seulement à propos de la peste. Clément d'Alexandrie [FN: § 188-2] dit qu'Empédocle fit cesser un vent qui rendait les habitants malades et les femmes stériles ; et là paraît un élément nouveau, puisque ce fait serait une contrefaçon faite par les Grecs, des miracles israélites ; ce qui nous donne ainsi une interprétation théologique.
§ 189. Il est évident que nous avons là comme un tronc duquel partent de nombreuses ramifications : un élément constant et beaucoup d'interprétations différentes. Le tronc, l'élément constant est la croyance qu'Empédocle a empêché les vents de nuire à une contrée ; les ramifications, les interprétations sont les conceptions différentes de la manière dont cet effet s'est produit ; naturellement elles dépendent des inclinations des auteurs dont elles émanent. L'homme pratique se met à la recherche de raisons pseudo-expérimentales ; le théologien, de causes théologiques.
Dans Pausanias, on trouve pêle-mêle les explications pseudo-expérimentales, magiques, théologiques. Notre auteur écrit, à propos d'une statue d'Athéna Anémotide, élevée à Mothone (IV, 35) : « On dit que c'est Diomède qui éleva la statue et donna un nom à la déesse. Les vents les plus violents, soufflant hors de saison, dévastaient la contrée. Diomède adressa des prières à Athéna ; dès lors, la terre ne subit plus aucun dommage des vents. » Ailleurs (II, 12): «. Au pied de la colline (puisque le temple a été édifié au sommet), se trouve l'autel des vents, sur lequel, une nuit chaque année, le prêtre sacrifie aux vents. Il accomplit aussi d'autres cérémonies secrètes, dans quatre fosses, afin d'apaiser la fureur des vents ; il chante encore des paroles magiques qui viennent, dit-on, de Médée. » Plus loin (II, 34) : « Je relève encore, chez les Métaniens, ce fait qui m'étonne beaucoup. Le siroco, soufflant du golfe de Saronique sur les vignes qui bourgeonnent, en dessèche les boutons. Aussi, dès que le vent se lève, deux hommes, après avoir dépecé un coq entièrement blanc, courent autour des vignes, chacun portant une moitié du coq ; arrivés au lieu dont ils sont partis, ils les enterrent. Tel est le procédé que ces gens ont découvert. »
Mais il y a mieux encore. Quand les tempêtes abîmaient les moissons, on punissait ceux qui étaient chargés de les éloigner (§ 194).
Pomponius Mela [FN: § 189-1] parle de neuf vierges qui habitaient l'île de Séna et qui pouvaient, par leurs chants, déchaîner la mer et les vents. [Voir Addition A5 par l’auteur]
§ 190. De ce noyau d'interprétations des actions non-logiques, se détache une ramification qui aboutit à la divinisation des tempêtes. Cicéron (De nat. deor., III, 20, 51) fait objecter par Cotta à Balbus que le ciel, les astres et les phénomènes météorologiques multiplient le nombre des dieux. Ici, ce cas reste isolé ; ailleurs il se subdivise et donne lieu à de nombreuses interprétations, à des personnifications, à des explications [FN: § 190-1]. [Voir Addition A6 par l’auteur]
§ 191. Commander aux vents et aux tempêtes devient un signe de puissance intellectuelle ou spirituelle, comme chez Empédocle, ou de divinité comme chez le Christ, quand il fait taire la tempête [FN: § 191-1] . Les magiciens, les sorciers manifestent ainsi leur pouvoir ; et l'anthropomorphisme grec connaît les maîtres des vents, des tempêtes, de la mer.
§ 192. On sacrifiait aux vents. Le sacrifice n'est qu'un développement logique d'une action magique semblable à celle dont nous avons parlé tout à l'heure, à propos du coq blanc. Il suffit, en effet, pour transformer cette action en sacrifice, d'ajouter que le dépeçage du coq blanc est un sacrifice à une divinité. Virgile [FN: § 192-1] fait sacrifier une brebis noire à la Tempête, une blanche au Zéphyr favorable. Remarquez les éléments de cette opération : 1° Élément principal : l'idée que moyennant certains actes on peut agir sur la tempête et sur les vents ; 2° Élément secondaire : explication logique de ces actes, grâce à l'intervention d'une entité imaginaire (personnification du vent, divinité, etc.); 3° Élément encore plus accessoire : détermination des actes, au moyen de certaines ressemblances entre la brebis noire et la tempête, la brebis blanche et le vent favorable.
§ 193. Les vents protégèrent les Grecs contre l'invasion perse et, pour les remercier, les Delphiens leur élevèrent un autel à Tia [FN: § 193-1] . On sait que Borée, gendre des Athéniens [FN: § 193-2]par son mariage avec Orestie, fille d'Érechthée, dispersa la flotte perse, et mérita ainsi l'autel que les Athéniens lui élevèrent au bord de 1'Ilyssus. Cet excellent Borée protégeait aussi d'autres gens que les Athéniens. Il détruisit, la flotte de Denys, qui avait pris la mer pour attaquer les Tyriens [FN: § 193-3] . « C'est pourquoi les Tyriens sacrifièrent à Borée, décrétèrent que le vent était citoyen [de la ville], lui réservèrent une maison et un champ, et célèbrent chaque année une fête en son honneur. » Il sauva aussi les Mégalopolitains assiégés par les Lacédémoniens ; aussi les premiers lui sacrifient-ils chaque année, et l'honorent-ils autant que tout autre dieu [FN: § 193-4] .
Les Mages de la Perse connaissaient, eux aussi, l'art d'apaiser les vents. À propos de la tempête suscitée par Borée pour venir en aide aux Athéniens, et qui infligea de graves dommages à la flotte perse, Hérodote dit : « La tempête sévit trois jours. À la fin, lorsque les Mages eurent sacrifié des victimes et conjuré les vents par la magie, et qu'ils eurent en outre sacrifié à Thétis et aux Néréides, les vents tombèrent le quatrième jour, si ce n'est spontanément. » Ce doute d'Hérodote est remarquable [FN: § 193-5] .
§ 194. On trouve souvent chez les auteurs anciens l'idée que la magie peut susciter la pluie, la tempête et le vent [FN: § 194-1]. Sénèque traite longuement des causes des phénomènes météorologiques, et se moque des opérations magiques [FN: § 194-2] . Il n'admet pas la prévision du temps par l'observation ; ce n'est pour lui qu'un préparatif aux pratiques suivies pour éloigner le mauvais temps. Il raconte qu'à Kléones, il y a des officiers publics appelés observateurs de la grêle. Sitôt qu'ils annonçaient l'approche de l'ouragan, les habitants couraient au temple et sacrifiaient, qui un agneau, qui un poulet ; et les nuages s'en allaient ailleurs. Celui qui n'avait rien à sacrifier se piquait le doigt et versait un peu de sang. «(7) On a cherché la raison de ce phénomène. Les uns, comme il convient à des hommes très savants, nient qu'il soit possible de marchander avec la grêle et de se racheter de la tempête moyennant de petites offrandes, bien que les offrandes fléchissent les dieux mêmes. D'autres supposent qu'il y a dans le sang quelque force capable d'éloigner les nuages. Mais comment, dans une si petite goutte de sang, peut-il y avoir une force assez grande pour agir là-haut et influencer les nuages ? Combien il valait mieux dire : C'est un mensonge et une fable ! Mais à Kléones, on punissait ceux auxquels était confié le soin de prévoir les tempêtes, lorsque, par leur négligence, les vignes étaient frappées et les moissons abattues. Chez nous, les XII Tables défendent qu'on prononce des incantations contre les récoltes d'autrui. L'antiquité inculte croyait que les chants magiques attiraient les nuages et les éloignaient ; ce qui est si clairement impossible, qu'il est inutile d'entrer dans une école philosophique pour l'apprendre ». Mais peu d'auteurs font preuve du scepticisme de Sénèque ; aussi avons-nous une longue suite de légendes sur les orages et les vents, qui persiste jusqu'à une époque voisine de la nôtre.
§ 195. Les légions romaines conduites par Marc-Aurèle contre les Quades, eurent à souffrir du manque d'eau ; mais un ouragan survint entre temps pour les rafraîchir. Le fait semble certain. Nous n'avons pas à rechercher ici si la légion Fulminée tira son nom de cet ouragan ; cela ne nous importe nullement pour le but que nous voulons atteindre. Et si même l'histoire de l'ouragan n'était pas vraie, l'exemple nous servirait comme avant, puisque nous traitons non du fait lui-même, mais des sentiments manifestés par les histoires, vraies ou fausses, que nous en possédons.
On veut expliquer le comment et le pourquoi de cet ouragan ; et chacun le fait suivant ses sentiments, ses inclinations. Ce peut être l'effet d'opérations magiques. On connaît même le nom du sorcier. Dans ces cas, l'extrême précision ne coûte pas cher. Suidas [FN: § 195-1]l'appelle Arnouphis: « Philosophe égyptien qui, se trouvant avec l'empereur des Romains, Marc-Aurèle, le philosophe, quand les Romains souffraient de la soif, fit immédiatement rassembler des nuages noirs et tomber une forte pluie, accompagnée de tonnerres et de fréquents éclairs ; et cela, il le fit avec sa science. D'autres disent que ce prodige fut accompli par Julien le Chaldéen ». Les dieux païens peuvent bien intervenir. Sinon à quoi passeraient-ils leur temps dans le monde ? Dion Cassius (LXXI, 8) dit que les Romains, serrés de près par les Quades, souffraient terriblement de la chaleur et de la soif ; « tout d'un coup de nombreux nuages se rassemblèrent, et, non sans l'intervention divine, une grosse pluie s'abattit avec violence. Donc, on raconte qu'un magicien égyptien du nom d'Arnouphis, qui se trouvait avec Marc, invoqua par la magie plusieurs divinités [FN: § 195-2]et principalement Hermès Aérien ; il fit, par ce moyen, tomber la pluie. » Claudien [FN: § 195-3] croit que l'ennemi fut mis en fuite par une pluie de feu. Pour quelle raison ? Les pratiques magiques ou la faveur de Jupiter Tonnant. Capitolinus [FN: § 195-4]sait que Marc-Antonin « dirigea par ses prières le feu du ciel contre les machines de guerre des ennemis, et obtint la pluie pour ses soldats qui souffraient de la soif ».
Ce fait de la tempête qui, par la puissance de la magie ou la sympathie divine, favorise un des belligérants, se rencontre dans des pays lointains et des conditions telles que tout soupçon d'imitation est exclu [FN: § 195-5].
Chez Lampride [FN: § 195-6] , le fait se transforme de nouveau et revêt un autre aspect. Marc-Antonin avait réussi, par certains procédés magiques, à rendre les Marcomans amis des Romains ; on ne veut pas révéler ces procédés à Héliogabale, par crainte qu'il ne veuille susciter une nouvelle guerre. Finalement, les chrétiens revendiquent le miracle pour leur Dieu. Après le passage de Dion Cassius que nous venons de citer, Sifilinus [FN: § 195-7]ajoute que cet écrivain induit en erreur son lecteur, volontairement ou involontairement, mais plutôt volontairement. Il n'ignorait pas en effet l'existence de la légion Fulminante [ou Fulminée ], à laquelle l'armée dut son salut, et non au magicien Arnouphis. Voici la vérité. Marc-Aurèle avait une légion composée entièrement de chrétiens. Pendant le combat, le préfet du Prétoire vint dire à Marc-Aurèle que les chrétiens pouvaient tout obtenir par leurs prières, et qu'il y avait une légion chrétienne dans l'armée. « Marc ayant donc entendu cela, leur demanda de prier leur Dieu. Quand ils l'eurent fait, Dieu les exauça incontinent, et frappa les ennemis de la foudre, tandis qu'il réconforta les Romains par la pluie. » Sifilinus ajoute encore qu'il existe, à ce qu'on dit, une lettre de Marc-Antonin, sur ce fait. D'autres auteurs font aussi allusion à cette lettre, inventée par des gens plus pieux que véridiques ; et l'on va même jusqu'à nous en donner le texte authentique, dans les œuvres de Saint Justin martyr [FN: § 195 note 8].
§ 196. Ainsi croît et embellit la légende, qui approche du roman ; mais les enjolivures extérieures n'augmentent pas seules : les idées fondamentales se multiplient aussi. Le noyau est un concept mécanique ; [Voir Addition A7 par l’auteur] c'est-à-dire qu'on prononce certaines paroles, on fait certaines opérations, et la pluie tombe. Puis vient le besoin d'expliquer ce prodige. La première explication suppose l'action d'êtres surnaturels. Mais on éprouve aussi le besoin d'expliquer leur intervention, et voilà une seconde explication. Celle-ci se subdivise à son tour suivant les motifs que l'on suppose à cette intervention. Parmi ceux-ci apparaît principalement le motif éthique. On introduit ainsi un nouveau concept qui manquait entièrement à l'opération magique. Le nouveau concept élargit à son tour l'action. La pluie était le but de l'opération magique ; elle devient le moyen par lequel la puissance divine récompense ses protégés et frappe leurs ennemis ; ensuite, c'est aussi le moyen de récompenser la foi et la vertu. Enfin, du cas particulier, on passe au général. On ne traite plus d'un fait isolé, mais de faits multiples, d'après une norme commune. Ce passage s'effectue déjà dans Tertullien [FN: § 196-1] . Après avoir rappelé le fait de la pluie obtenue par les soldats de Marc-Aurèle, il ajoute : « Combien de fois n'avons-nous pas fait cesser la sécheresse par nos prières et nos jeûnes ? »
On pourrait rapporter d'autres faits analogues, qui montrent que les sentiments dont ils proviennent sont très communs dans la race humaine [FN: § 196 note 2|. [Voir Addition A8 par l’auteur]
§ 197. Chez les auteurs chrétiens, il est naturel que les explications logiques de la loi générale des tempêtes aboutissent au démon. Clément d'Alexandrie [FN: § 197-1]nous apprend que les mauvais anges jouent un rôle dans les tempêtes et autres semblables calamités (§ 188 note 2). Mais prenons garde que c'est là une adjonction servant d'explication au noyau principal ; c'est-à-dire à la croyance que, moyennant certaines pratiques, on peut agir sur les tempêtes et sur d'autres calamités semblables[FN: § 197-2]. [Voir Addition A9 par l’auteur]
Pour faire triompher ses interprétations, le christianisme victorieux eut à lutter d'abord avec les anciennes pratiques païennes [FN: § 197-3], puis avec la magie, qui continua une partie de ces pratiques et en imagina de nouvelles ; car on avait grand besoin d'éviter les ouragans, et la croyance était tenace, qu'il y avait des procédés pour cela. Aussi, d'une façon ou d'une autre, on pourvoyait au besoin et l'on satisfaisait la croyance.
§ 198. Au moyen âge, on appelait Tempestarii ceux qui avaient ce pouvoir. Les lois même s'occupent d'eux. Toutefois l'Église n'admit pas de plein gré ce pouvoir de provoquer les tempêtes. Le concile de Braga, en 563, anathématise quiconque enseigne que le diable peut provoquer le tonnerre, les éclairs, la tempête et la sécheresse. Un décret célèbre dénie toute réalité aux imaginations des sorcières [FN: § 198-1]. Saint Agobard écrivit un livre entier Contre la sotte opinion du vulgaire sur la grêle et les tonnerres. Il dit [FN: § 198-2] « (1) Dans cette contrée, presque tout le monde, nobles et vilains, citadins et campagnards, jeunes et vieux, croient que les hommes peuvent provoquer la grêle et les tonnerres selon leur volonté. Aussi s'écrient-ils, sitôt qu'ils entendent le tonnerre et voient des éclairs : « C'est une brise lévatice ». Interrogés sur ce qu'est la « brise lévatice », ils affirment, les uns avec réserve et comme s'ils en avaient du remords, d'autres avec l'assurance habituelle des ignorants, que la brise est levée par les sortilèges d'hommes appelés Tempestarii, et que c'est pour cela qu'ils disent la brise lévatice... (2) Nous vîmes et nous entendîmes beaucoup de gens atteints d'une si grande folie, et mis hors de sens par une si grande sottise, qu'ils croient et disent qu'il est une certaine contrée qu'ils nomment Magonie, dont viennent, par-dessus les nuages, des navires qui y rapportent les moissons que fauche la grêle et qu'abat la tempête ; les Tempestarii sont payés par ces navigateurs aériens qui reçoivent le blé et les autres récoltes. Nous avons vu beaucoup d'hommes, aveuglés par une si grande sottise, qu'ils croyaient cela possible, et montraient dans une assemblée quatre personnes chargées de chaînes, soit trois hommes et une femme, soi-disant tombés de ces navires. Après les avoir gardés enchaînés quelques jours, enfin, quand l'assemblée fut réunie, ainsi que je l'ai dit, on les exhiba en notre présence, comme s'ils devaient être lapidés. Toutefois, après de nombreuses explications, la vérité l'emporta, et les exhibiteurs mêmes restèrent, suivant l'expression du prophète, confondus comme le voleur pris sur le fait. » En citant l'Écriture Sainte, Saint Agobard démontre l'erreur de la croyance d'après laquelle la grêle et le tonnerre sont soumis au caprice de l'homme. En citant aussi l'Écriture Sainte, d'autres démontreront au contraire que cette croyance mérite l'attention. De tout temps, on a trouvé dans la Bible des preuves contradictoires.
§ 199. Les doctrines qui admettaient le pouvoir des sorcières étaient suspectes à l'Église pour deux motifs. Tout d'abord, elles apparaissaient comme une réminiscence du paganisme, aux dieux duquel on assimilait les démons ; ensuite, elles prenaient une teinte de manichéisme, en opposant le principe du mal au principe du bien. Mais, sous la pression des croyances populaires par lesquelles se manifestait l'action non-logique des pratiques magiques, l'Église finit par subir ce qu'elle ne pouvait empêcher, et trouva sans peine une interprétation qui satisfaisait le préjugé populaire, sans heurter les principes de la théologie catholique. En somme, que voulait-elle ? Que le principe du mal fût soumis au principe du bien. C'est bientôt fait. Nous dirons, il est vrai, que la magie est œuvre du diable, mais nous ajouterons : avec la permission de Dieu. Cette doctrine demeurera définitivement celle de l'Église catholique.
§ 200. Les préjugés populaires pesaient non seulement sur l'Église, mais aussi sur les gouvernements; et les gouvernements, sans trop se soucier d'interprétations logiques, procédaient au châtiment de toute sorte de sorciers, y compris les Tempestarii [FN: § 200-1].
§ 201. Quand existe un certain état de faits et de croyances, il est rare qu'il ne se trouve personne pour tâcher d'en profiter; aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner si les particuliers, les gouvernements et l'Église s'efforcèrent de tirer parti des croyances à la sorcellerie. Saint Agobard rapporte qu'on payait un tribut aux Tempestarii [FN: § 201-1] ; et Charlemagne recommande à ses sujets de payer régulièrement les dîmes à l'Église, pour sauver les moissons[FN: § 201-2].
§ 202. Au moyen âge et dans les siècles suivants, les accusations de provoquer des tempêtes et de détruire les moissons surabondent contre les sorciers. Pendant nombre de siècles, les hommes vécurent dans la terreur du démon. Quand ils en parlaient, ils semblaient frappés d'aliénation mentale et, à l'instar des gens déséquilibrés, semaient des morts et des ruines.
§ 203. Le Malleus maleficarum résume bien la doctrine en cours au XVe siècle elle datait d'un siècle environ, et persista près d'un siècle encore [FN: § 203-1] .
« Les démons et leurs disciples peuvent produire les maléfices des tonnerres, des grêles et des tempêtes, ayant reçu ce pouvoir de Dieu, et par sa permission. Cela est prouvé par l'Écriture Sainte, Job, 1 et 2... Saint Thomas, dans une note sur Job, s'exprime ainsi : « Il est nécessaire de reconnaître qu'avec la permission de Dieu, les démons peuvent produire des perturbations dans l'air, susciter des tempêtes et faire tomber le feu du ciel. Bien que pour prendre des formes, la nature corporelle n'obéisse à la volonté ni des bons ni des mauvais anges, mais seulement à Dieu créateur, toutefois, pour le mouvement local, elle est capable d'obéir à la nature spirituelle. Cela se voit chez les hommes, car, sous le seul empire de la volonté, qui est subjective dans l'âme, ils meuvent leurs membres, pour leur faire accomplir les œuvres imposées par la volonté. Donc, par force naturelle, non seulement les bons, mais aussi les mauvais anges, si Dieu ne le défend pas, peuvent faire toutes les choses susceptibles d'être produites par le seul mouvement local ».
Cette dissertation sur le pouvoir des démons continue, et l'on en donne enfin un exemple. Dans le Fourmilier, on raconte que, mis en prison par le juge, un individu auquel on demandait comment les sorciers procédaient pour susciter la grêle et les tempêtes, et si cela leur était facile, répondit : « Nous suscitons facilement la grêle, mais nous ne pouvons pas nuire selon notre volonté, à cause de la protection des bons anges ». Il ajouta:
« Nous pouvons nuire seulement à ceux qui sont privés de l'aide de Dieu, mais nous ne pouvons pas nuire à ceux qui s'aident du signe de la croix. La façon dont nous agissons est la suivante. D'abord, par des paroles magiques sur les champs, nous implorons le prince de tous les démons, afin qu'il nous envoie quelqu'un des siens, qui frappe là où nous indiquons. Ensuite, pour avoir la grâce de ce démon, nous lui immolons un poulet noir dans un carrefour, et, le lançant en l'air, il est pris par le démon, qui obéit et qui aussitôt excite la tempête et fait tomber la grêle et le tonnerre, cependant pas toujours là où nous avons indiqué, mais selon la permission de Dieu ».
L'auteur continue et rapporte d'autres cas aussi certains qu'admirables. Nous parlerons brièvement d'un seul d'entre eux, raconté dans une autre partie de l'ouvrage.
Les filles des sorcières opèrent souvent comme leur mère [FN: § 203-2] . « Ainsi, il peut arriver, et l'on a souvent observé, qu'une enfant impubère de 8 ou 10 ans a suscité des tempêtes et fait tomber la grêle ». Et l'auteur en rapporte un exemple: « En Souabe, un paysan, avec sa fille de 8 ans à peine, se désolait en voyant les moissons dans les champs, et la sécheresse de la terre lui faisait penser à la pluie ; il la désirait, disant : Eh ! Quand viendra la pluie,? L'enfant, entendant les paroles du père, dit, en la simplicité de son âme : Père, si tu désires la pluie, je la ferai vite venir. Et le père : Comment, tu sais faire venir la pluie ? L'enfant répondit : Certes ; et non seulement je sais susciter la pluie, mais aussi la grêle et les tempêtes. Le père : Qui te l'a enseigné ? Ma mère, répondit-elle ; mais elle m'a défendu de l'enseigner à d'autres ». Le dialogue continue ; enfin le père conduit l'enfant à un torrent :
« Fais – lui dit-il – mais seulement sur notre champ. Alors l'enfant mit la main dans l'eau et, au nom de son maître, selon les enseignements de sa mère, la remua. Et voilà que la pluie tombe seulement sur le champ indiqué. Voyant cela, le père dit : Fais tomber la grêle, mais seulement sur un de nos champs. L'enfant ayant de nouveau fait cela, le père, persuadé par ces expériences, accusa sa femme devant le juge. Emprisonnée et convaincue [de son crime], elle fut brûlée. La fille, rebaptisée et consacrée à Dieu, ne put plus opérer ».
Bien que Delrio cite le Malleus à côté d'un autre auteur, il rapporte ce récit avec des circonstances quelque peu différentes, spécialement au sujet de la manière dont la pluie est obtenue [FN: § 203-3]. [Voir Addition A10 par l’auteur] Nous surprenons ici la formation de ces légendes. Il est probable que tout n'est pas inventé. Il existe vraisemblablement un fait, qui est amplifié, commenté, expliqué, et dont naît, comme d'une petite semence, une abondante moisson d'inventions fantastiques et bizarres.
§ 204. Martin Delrio [FN: § 204-1] donne une longue liste d'écrivains d'une très grande autorité qui prétendent que les sorciers peuvent provoquer la grêle et les tempêtes. Il dit que si l'on y ajoute l'autorité de l'Écriture Sainte et certains exemples pratiques dont témoignent des personnes tout à fait dignes de foi, il y a certainement des faits capables de vaincre l'incrédulité la plus tenace.
§ 205. Godelmann [FN: § 205-1]nous enseigne diverses façons dont les sorcières, instruites par le démon, peuvent susciter la grêle. « Elles jettent un caillou derrière elles, du côté du couchant ; quelquefois, elles jettent en l'air le sable des torrents ; souvent elles plongent un balai dans l'eau et le secouent vers le ciel ; ou bien, ayant creusé une petite fosse, et mis de l'urine ou de l'eau dedans, elles la remuent avec le doigt ; ensuite elles font bouillir des poils de porc dans une marmite ; parfois, elles placent des poutres ou des morceaux de bois en travers du rivage ». C'est ainsi qu'elles font croire que la grêle arrive grâce à leurs opérations, tandis qu'elle est l'œuvre du démon, avec la permission de Dieu.
§ 206. Wier [FN: § 206-1] dénie tout pouvoir aux sorcières, mais non à l'œuvre diabolique accomplie avec la permission de Dieu ; et c'était l'interprétation par laquelle il cherchait à sauver ces pauvres femmes qu'on voulait envoyer au bûcher. Elle pouvait être crue de celui qui la donnait, et pouvait être imposée par des temps où les coutumes et les lois refusaient la liberté aux manifestations de la pensée. Peu de gens se risquaient aussi loin que Tartarotti, qui met les succès de la sorcellerie au compte des forces naturelles, et ne laisse au démon que le mérite de les prévoir [FN: § 206-2], suivant en cela une doctrine qui existait depuis des siècles, dans l'Église chrétienne (§ 213). Mais il invoque aussi l'autorité de l'Écriture, et flatte prudemment la Sainte Inquisition Romaine, en écrivant :
« (p. 63) Et je ne pourrais me dispenser ici, sans tomber dans une injustice grave, de rendre hommage au très vénérable et très prudent Tribunal de la Sainte Inquisition Romaine ; lequel se dirige en cette matière avec tant de modération et de prudence, qu'il montre bien l'esprit qui l'anime et le gouverne, et combien les plaintes et les injures que lui jettent les hérétiques sont injustes et sans consistance ».
§ 207. De notre temps, on peut dire ce qu'on veut des sorcières, mais non du péché charnel ; et de même qu'autrefois, par conviction ou pour complaire à des gens qu'à ce point de vue on peut seulement qualifier d'ignorants et de fanatiques, les gouvernements persécutaient ceux qui parlaient librement de la Bible, aujourd'hui, nos gouvernements persécutent, pour de semblables motifs, ceux qui traitent librement de l'acte sexuel. Lucrèce pouvait écrire en toute liberté sur la religion des dieux comme sur la religion sexuelle.
§ 208. Comme d'habitude, autrefois et aujourd'hui, l'hérétique est traité de malfaiteur. Quand on lit ce qu'écrit Bodin [FN: § 208-1]contre Wier, on croit entendre ce que dit aujourd'hui M. Bérenger ou ses adeptes, contre ceux qui ont l'esprit moins étroit qu'eux.
§ 209. Parlons d'une autre analogie, qui met en lumière la nature des actions non-logiques. Comme nous l'avons déjà noté (§ 199), les interprétations durent s'adapter aux préjugés populaires ; et cela eut lien aussi pour les lois et les procédures pénales. Dans un très grand nombre de procès de sorcellerie, on peut constater que la voix publique dénonce les sorciers ; la fureur publique les attaque, les persécute et contraint l'autorité publique à intervenir. Voici un exemple parmi tous ceux qu'on pourrait citer [FN: § 209-1]:
En 1546, dans la baronnie de Viry, une certaine Marguerite Moral, femme de Jean Girard, se plaint auprès du châtelain de la baronnie, parce que certaines femmes l'ont attaquée et battue, en l'appelant sorcière (hyrige ). Le châtelain procède contre les dénoncées, entend plusieurs témoins dont il apprend que Marguerite est accusée d'avoir causé la mort de certains enfants. Donc, exactement comme on le ferait encore aujourd'hui, il recherche si les faits imputés à Marguerite sont vrais ; et celle-ci, de plaignante, devient accusée. L'accusation s'étend ensuite au mari de Marguerite. De nombreux témoins déposent que les enfants sont morts, croit-on, du fait de Marguerite. Ensuite, par la torture, on lui fait dire ce qu'on veut, ainsi qu'à son mari. Ils avouent l'intervention du diable, comme ils auraient avoué avoir administré du poison, comme ils auraient avoué tout ce qu'on aurait voulu d'autre. Ils sont condamnés au bûcher et brûlés.
§ 210. Les interprétations jouent ici un rôle très accessoire. La partie principale est constituée par l'idée que l'on peut donner la mort d'une manière mystérieuse ; et cette conception agit principalement sur l'esprit du peuple. Les juges l'admettent aussi ; mais sans l'autre préjugé, que l'on peut obtenir la vérité par la torture, il est impossible de prévoir quelle issue aurait eue le procès. Enfin, il apparaît clairement que c'est l'opinion publique qui pousse les juges, et que, sans son intervention, ils ne se seraient pas émus. De même, nos gouvernements n'ont pris des mesures contre l'hérésie sexuelle, qu'après y avoir été sollicités depuis longtemps par les esprits étroits qui s'assemblent dans les sociétés pour la morale, et dans les congrès contre la pornographie ; et les législateurs, comme aussi les juges, ne cèdent souvent qu'à contre-cœur, et tâchent d'atténuer au moins les fureurs hystériques des vertuistes.
§ 211. Jusqu'au XVIIIe siècle, on continua à condamner les sorcières, et les gouvernements comme l'Église secondaient en cela le préjugé populaire, et, de cette façon, contribuaient à le fortifier, mais n'en étaient certainement pas les auteurs.
Loin d'avoir imposé, à l'origine, la croyance en ces actions non-logiques, l'Église l'a, au contraire, subie en lui cherchant des interprétations logiques ; et ce n'est que plus tard qu'elle l'a entièrement acceptée, avec le correctif de ces interprétations.
Un auteur qu'on ne peut suspecter de partialité envers l'Église catholique dit [FN: § 211-1]
« (p. 522) Un fait nous montre combien l'Église, au XIIIe siècle, prêtait encore peu d'attention à la magie. Quand l'Inquisition fut organisée, cette catégorie de crimes resta longtemps distraite de sa juridiction. En 1248 le concile de Valence... ordonna de livrer les magiciens aux évêques qui les emprisonneront ou les puniront de quelque autre manière. Ensuite, pendant une soixantaine d'années, la question fut agitée dans divers conciles... En 1310, notamment le concile de Trèves, qui énumère avec grand soin les arts réprouvés, ordonne bien aux prêtres paroissiaux de prohiber ces coupables pratiques ; mais il ne fixe aucun châtiment, en cas de désobéissance, que le retrait des sacrements, suivi, à l'égard des criminels endurcis, de l'excommunication et des autres sanctions légales dont disposent les Ordinaires épiscopaux. C'est là en vérité une mansuétude presque inexplicable. D'ailleurs l'Église était portée à se montrer plus sensée que le peuple, comme le prouve un incident qui se passa, en 1279, à Ruffach, en Alsace. Une Dominicaine était accusée d'avoir baptisé une figurine de cire, à la façon des magiciennes qui veulent faire périr un ennemi ou gagner le cœur d'un amant. Les paysans la traînèrent dans un champ et l'auraient brûlée vive, si des moines n'étaient venus la délivrer. » Et plus loin : « (p. 523) Ainsi jusque fort avant dans le XIVe siècle, l'Église se montra disposée à traiter avec une singulière indulgence les pratiques vulgaires de la sorcellerie et de la magie ».
§ 212. Elle est donc fausse, l'idée de ceux qui, voyant partout des actions logiques, rendent la théologie catholique responsable des procès de sorcellerie. Remarquons plutôt, en passant, qu'ils furent aussi nombreux chez les protestants que chez les catholiques [FN: § 212-1] et que la croyance à la magie existe de tout temps et chez tous les peuples. Les interprétations sont soumises aux faits et ne les dominent pas. D'autres personnes, comme Michelet, trouvent dans la féodalité la cause de la sorcellerie. Mais où était la féodalité, quand, à Rome, les XII Tables parlaient de ceux qui enchantaient les moissons ? quand on croyait aux sorcières thessaliennes ? quand on accusait Apulée de s'être fait aimer, grâce à des opérations magiques, de la femme qu'il épousa, et dans une infinité d'autres cas du même genre ? Ici, nous avons simplement une interprétation semblable à celle des chrétiens ; mais le « grand ennemi » a changé de nom : au lieu de Satan, il s'appelle féodalité.
§ 213. Revenons aux interprétations chrétiennes. Même si l'on admettait que le démon n'avait pas le pouvoir de faire naître les tempêtes, on n'était pas contraint pour cela de le chasser entièrement de ces phénomènes. On avait un moyen de le faire intervenir d'une autre façon, en disant qu'il les prévoyait et pouvait ainsi les annoncer. On trouve cette explication dès les premiers temps du christianisme jusqu'à nos jours.
En somme, on admet que les démons ont un corps aérien, se meuvent très rapidement, possèdent une longue expérience, parce qu'ils sont immortels, peuvent par conséquent savoir et prédire nombre de choses, sans compter qu'ils prédisent souvent ce qu'eux-mêmes feront [FN: § 213-1].
Reste à expliquer comment certaines pratiques peuvent bien attirer les dé mons. N'ayez pas peur ! Des explications, il y en aura autant qu'on voudra. Saint Augustin nous dit que les démons sont attirés « non par la nourriture, comme les animaux, mais comme des esprits, par des signes correspondant à leur affection, par divers genres de pierres, d'herbes, de bois, d'animaux, de chants, de rites ». De sa grande autorité, Saint Thomas confirme cette opinion [FN: § 213-2] .
§ 214. Dès les premiers temps des interprétations à propos de démons, une grave question se posa : celle de savoir si aux sortilèges mal intentionnés on pouvait opposer les sortilèges bien intentionnés. Constantin l'admet ; mais Godefroy reprend cet empereur, dans son commentaire, parce que, dit-il, on ne saurait faire de mauvaises choses, pour en provoquer de bonnes [FN: § 214-1]. Telle fut aussi la doctrine de l'Église.
§ 215. D'autre part, on ne manque pas de nombreux remèdes licites, outre les exorcismes et les exercices spirituels ; et tous les démonologues en dissertent longuement. Par exemple, le Malleus nous enseigne que [FN: § 215 note 1| :
« Contre la grêle et les tempêtes, outre le signe de la croix, comme il est dit, on emploie le remède suivant. On jette au feu trois grains de grêle, sous l'invocation de la très sainte Trinité ; on y ajoute l'oraison dominicale, avec la salutation angélique, deux ou trois fois, plus le verset de Jean : In principio erat 431.Verbum, en faisant le signe de la croix de tous côtés contre la tempête, devant et derrière, et en se tournant dans toutes les directions de la terre. Alors, après avoir enfin récité trois fois : Verbum caro factum est, et répété trois fois ensuite les paroles de l'Évangile, on dit : Que cette tempête fuie. Elle cessera immédiatement, si elle est produite par maléfice. Ces faits sont considérés comme des expériences très véridiques et non suspectes. Mais si l'on jette les grains [de grêle] au feu, sans invoquer le nom divin, on estime que c'est une superstition. Si l'on dit : Sans les grains, ne peut-on faire cesser la tempête ? On répond: Certainement, avec d'autres paroles sacrées. En jetant les grains, on veut molester le diable, tandis que, grâce à l'invocation de la très sainte Trinité, on entreprend de détruire son œuvre. On jette les grains plutôt dans le feu que dans l'eau, parce que plus vite ils se fondent, plus vite aussi l'œuvre du diable est détruite ; toutefois, l'effet est remis à la volonté divine ».
Suivent d'autres fantasmagories sur la manière dont on peut faire tomber la grêle, et sur le moyen de la repousser. Delrio fournit une infinité de remèdes naturels, surnaturels, licites, illicites, par lesquels on peut éloigner les maux de la sorcellerie.
§ 216. Nous pouvons nous arrêter ici, non que la matière fasse défaut ; elle pourrait au contraire remplir plusieurs gros volumes ; mais ce que nous avons dit jusqu'à présent suffit à nous faire connaître les caractères essentiels de la famille de faits que nous avons examinés, de même qu'un certain nombre de plantes suffisent à faire connaître les caractères de la famille des papilionacées.
Nous aurons à faire de nombreuses autres études semblables à celle-ci, c'est-à-dire que nous aurons à examiner de nombreuses familles de faits, pour trouver en chacune les parties constantes et les parties variables, et les classer ensuite, en les divisant en ordres, classes, genres, espèces, encore comme fait précisément le botaniste.
Dans cette étude, nous avons estimé profitable de présenter au lecteur, à titre d'exemple, une partie pas très grande, il est vrai, mais pourtant notable, des faits que nous avons étudiés pour en tirer nos conclusions. Mais l'espace nous manque pour continuer à le faire dans toutes les autres études analogues ; et le lecteur voudra bien se rappeler que nous lui soumettons seulement une petite partie, et souvent une infime partie des faits qui nous servirent dans les inductions que nous lui présentons.
§ 217. De l'étude précédente, on déduit clairement les caractères. suivants (§ 514-3) :
1° Il existe un noyau non-logique formé simplement par l'union de certains actes, de certaines paroles, qui ont des effets, déterminés, tels qu'un ouragan ou la destruction d'une récolte.
2° De ces noyaux partent de nombreuses ramifications d'interprétations logiques. Il est impossible de ne pas reconnaître qu'en général les interprétations ne sont imaginées que pour rendre compte du fait que les tempêtes sont provoquées ou conjurées, les récoltes détruites ou préservées. On observe seulement d'une manière tout à fait exceptionnelle le phénomène opposé, c'est-à-dire celui d'après lequel ce serait la théorie logique qui aurait conduit à la croyance aux faits.
Ces interprétations ne sont pas toujours clairement distinctes elles s'entrelacent souvent sans que la personne qui les écoute sache avec précision quelle part revient à chacune.
3° Les interprétations logiques assument les formes les plus en usage au temps où elles se produisent. On pourrait les comparer aux costumes que portent les hommes du temps.
4° Cette évolution n'est pas du tout directe, comme celle de la figure 5, mais a la forme que représente la figure 6. L'action purement non-logique ne s'est pas transformée en une action à forme logique ; elle subsiste en même temps que les autres actions qui en dérivent.
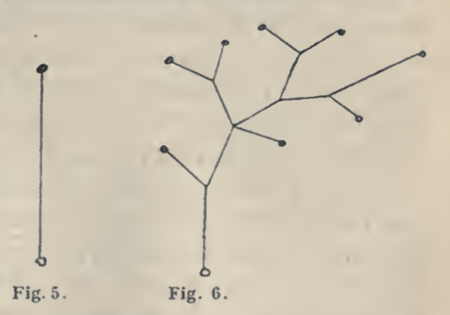
Figure 5 : Figure 6
On ne peut déterminer la façon dont s'est produite cette transformation, en cherchant à fixer, par exemple, que de la simple association d'actes et de faits [fétichisme], on ait passé à une interprétation théologique, puis à une interprétation métaphysique, et enfin à une interprétation positiviste. Cette succession chronologique n'existe pas. Les interprétations que l'on pourrait appeler fétichistes, magiques, expérimentales ou pseudo-expérimentales, se confondent d'ailleurs souvent, sans qu'il soit possible de les distinguer, et sans que très probablement celui qui les accepte puisse les distinguer. Il sait que certains actes doivent avoir pour conséquence certains faits, et ne se préoccupe pas beaucoup de savoir comment cela arrive.
5° Certainement, à la longue, le degré d'instruction des hommes en général influe sur le phénomène ; mais il n'y a pas de relation constante. Les Romains ne brûlaient ni sorciers ni magiciennes ; et pourtant leur développement scientifique était sans aucun doute moindre que celui des Italiens, des Français, des Allemands, etc. du XVIIe siècle, qui faisaient mourir en grand nombre tant celles-ci que ceux-là. C'est ainsi que vers la fin du XIIe siècle et le commencement du XIIIe, ces malheureux n'étaient pas du tout persécutés. Toutefois, il est incontestable que le développement intellectuel et scientifique de ce temps était de beaucoup inférieur à celui du XVIIe siècle.
6° Ce n'est pas par un artifice logique, que l'Église, les gouvernements ou d'autres personnes ont imposé la croyance en ces actions non-logiques ; c'est au contraire ces actions non-logiques qui ont imposé les artifices logiques, pour leur explication. Ce qui n'empêche pas qu'à leur tour, ces artifices aient pu renforcer la croyance dans les actions non-logiques, et même la faire naître là où elle n'existait pas.
Cette dernière induction nous prépare à comprendre comment des phénomènes analogues peuvent avoir lieu, et comment nous nous trompons quand, ne connaissant les actions non logiques que par leur vernis logique, nous donnons à ce vernis une importance qu'il n'a pas.
§ 218. Dans tous les faits que nous avons vus à propos des tempêtes, il y a quelque chose de commun, de constant : c'est le sentiment que, par certains moyens, on peut agir sur les tempêtes. Il y a en outre une partie mobile, variable : c'est justement ces moyens et leur raison d'être.
La première partie est évidemment la plus importante. Quand elle existe, les hommes découvrent la seconde sans trop de peine. Il se pourrait donc que pour la détermination de la forme sociale, les parties semblables à celles dont nous venons de noter la constance, aient une importance plus grande que d'autres. Pour le moment, nous ne pouvons rien décider. L'induction nous révèle seulement, une voie qu'il faut essayer.
Comme il arrive souvent avec la méthode inductive, nous avons, trouvé non seulement ce que nous cherchions, mais encore autre chose que nous ne cherchions pas.
Nous voulions savoir comment les actions non-logiques prennent une forme logique ; et, en considérant un cas spécial, nous avons vu comment cela se produisait. Mais nous avons vu en outre comment ces phénomènes ont une partie constante ou presque constante et une autre partie très variable. La science recherche justement les parties constantes des phénomènes, pour arriver à la connaissance des uniformités. Nous devrons donc étudier spécialement ces parties, et le ferons aux chapitres suivants (§ 182-1).
§ 219. En attendant, d'autres inductions surgissent à notre esprit, non pas encore comme certaines, parce qu'elles résultent de trop peu de faits, mais plutôt comme des propositions à vérifier en élargissant le champ de nos investigations :
1° Si, pour un moment, nous envisageons les faits exclusivement sous l'aspect logico-expérimental, l'œuvre de l'Église, à l'égard de la magie, est tout simplement absurde ; et toutes ces histoires de démons sont ridiculement puériles. Ceci posé, il y a des gens qui, de ces prémisses, tirent la conclusion que la religion de l'Église est aussi absurde, et qu'elle est par conséquent nuisible à la société. Pouvons-nous accepter cette opinion ?
Remarquons tout d'abord que le raisonnement s'applique non seulement à la religion catholique, mais à toutes les autres religions, même à toutes les métaphysiques ; en un mot, à tout ce qui n'est pas science logico-expérimentale. Or, il est impossible d'admettre cette conclusion, et de considérer comme absurde la majeure partie de la vie des sociétés humaines jusqu'à nos jours. Prenons garde ensuite que si tout ce qui n'est pas logique est nuisible à la société et par conséquent aussi à l'individu, il ne devrait pas y avoir des cas comme ceux observés chez les animaux, et comme d'autres que nous verrous chez les hommes, où certaines actions non-logiques sont au contraire utiles et même très utiles.
Les conclusions étant erronées, le raisonnement doit l'être aussi où est l'erreur ?
Les syllogismes complets seraient: a) Toute doctrine qui contient une partie absurde est absurde ; la doctrine de l'Église contient une partie absurde : celle qui a trait à la magie ; donc, etc. b) Toute doctrine qui n'est pas logico-expérimentale est nuisible à la société la doctrine de l'Eglise n'est pas logico-expérimentale, donc, etc.
Les propositions qui probablement vicient le raisonnement qui précède sont : a) toute doctrine qui contient une partie absurde est absurde ; b) toute doctrine qui n'est pas logico-expérimentale est nuisible à la société.
Il nous faut donc les examiner de près, et voir si elles concordent avec les faits ou les contredisent. Mais pour cela, il faut tout d'abord avoir une théorie des doctrines et de leur influence sur les individus et sur la société ; et c'est ce dont nous devrons nous occuper dans les chapitres suivants (§ 14).
2° Des questions analogues à celles qui se posent maintenant pour les doctrines surgissent aussi à propos des hommes.
Si nous considérons leur œuvre sous l'aspect logico-expérimental, nous ne trouvons pas d'autre nom que celui de sot pour qualifier un auteur qui écrit les énormes sottises exposées par Bodin dans sa Démonomanie. Et si nous considérons cette œuvre au point de vue du bien ou du mal causé à autrui, le vocabulaire ne renferme que des termes synonymes de malfaiteur et de criminel, pour désigner ceux qui, grâce à de pareilles insanités, ont infligé des souffrances si terribles à tant de gens et même la mort à un grand nombre.
Mais nous ne tardons pas à nous apercevoir que nous appliquons ainsi au tout, ce qui en réalité se rapporte seulement à la partie. Une infinité d'exemples montrent qu'un homme peut être déraisonnable en certaines choses, raisonnable en d'autres ; malhonnête dans certains de ses actes, honnête en d'autres.
De ce contraste résultent deux erreurs de même origine, en apparence opposées. Les propositions suivantes sont également fausses : « Bodin a dit des insanités et a fait tort à autrui ; donc c'est un sot et un coupable. – Bodin était un homme intelligent et honnête ; donc ce qu'il écrit dans sa Démonomanie est sensé, et l'œuvre qu'il a accomplie est honnête ».
Nous voyons ainsi qu'il nous est impossible de juger de la valeur logico-expérimentale et de l'utilité des doctrines, par la considération facile de l'autorité de leur auteur, et qu'il faut au contraire suivre la voie ardue et difficile de leur étude directe. Nous voilà de nouveau amenés à la conclusion que nous avons tirée de l'examen des doctrines elles-mêmes (§ 1434 et sv.).
Nous parlerons amplement de tout cela plus loin. Pour le moment, continuons à nous occuper des actions non-logiques.
§ 220. La forme logique donnée par les Romains à leurs relations avec les dieux est digne de remarque. C'est en général celle d'un contrat clair et précis, qui doit être interprété d'après les règles du droit. Si l'on s'arrêtait à cet aspect, on découvrirait dans ces faits une simple manifestation de ce qu'on appelle l'esprit juridique des Romains. Mais on observe des faits semblables chez tous les peuples. Même de nos jours, la bonne femme qui promet une petite obole à Saint Antoine de Padoue, s'il lui fait retrouver un objet perdu, agit envers lui précisément comme les Romains envers leurs dieux. Ce qui distingue les Romains, c'est la richesse et la précision des détails ; c'est la forme qui l'emporte sur le fond ; c'est, en un mot, la force de cohésion des actes entre eux. Nous voyons ainsi une manifestation de l'état psychique de ce peuple.
§ 221. L'Athénien Platon ne se préoccupe pas de ces associations d'idées et de faits, qui empêchent de séparer logiquement ces derniers. Dans l'Euthyphron, il s'indigne de ce qu'on puisse supposer que la sainteté soit la science de demander aux dieux [FN: § 221-1] . Au contraire, pour les Romains, surtout pour l'homme d'État romain, c'est là toute la science des relations entre les dieux et les hommes. Cette science est difficile. Tout d'abord, il faut savoir à quelle divinité l'on doit s'adresser, dans une conjoncture donnée, puis connaître exactement son nom ; et comme il pourrait y avoir des doutes à ce propos, on a des formules pour lever la difficulté [FN: § 221-2] ; par exemple: « lupiter optime, maxime, sive quo alio nomine te appellari volueris ».
§ 222. Aulu-Gelle [FN: § 222-1]observe qu'on ignore quelle divinité il faut invoquer en cas de tremblement de terre. Voilà un embarras très grave. C'est pourquoi « les anciens Romains, qui étaient fort exacts, et prudents dans tous les devoirs de la vie et spécialement en ce qui regarde la religion et les dieux immortels, édictaient des cérémonies publiques, quand ils avaient connaissance d'un tremblement de terre ; mais ils s'abstenaient de nommer – comme c'était leur coutume – le dieu en l'honneur duquel on célébrait ces fêtes, afin qu'en nommant un dieu pour un autre, il ne leur arrivât pas de compromettre le peuple par un faux culte ».
§ 223. Quand on offre du vin à une divinité, il faut dire « Accepte ce vin que j'ai dans les mains [FN: § 223-1]». On ajoute ces derniers mots, pour éviter une erreur possible, et pour qu'il n'arrive pas de consacrer à la divinité, sans le vouloir, tout le vin qui se trouve dans la cave. « Dans la doctrine des augures, existe le principe que les imprécations et les auspices, quels qu'ils soient, sont privés de valeur pour ceux qui, au début d'une entreprise quelconque, déclarent n'y attacher aucune importance ; c'est un des plus grands bienfaits de la bonté, divine [FN: § 223-2]». Tout cela semble absurde et ridicule, si l'on veut argumenter logiquement sur le fond, mais devient au contraire raisonnable, si l'on prend certaines associations d'actes et d'idées comme prémisses. N'est-il pas évident que si l'on évite réellement la piqûre d'un scorpion en prononçant le nombre deux (§ 182), il est nécessaire de savoir d'abord avec précision s'il s'agit vraiment d'un scorpion, quand on rencontre un insecte et qu'on en veut éviter la piqûre ? Si c'est l'acte qui a plus de valeur que n'importe quoi d'autre, il est clair que, quand on offre du vin à la divinité, il faut exécuter exactement l'acte fixé, et non un autre. Mais quelle que soit la valeur de ces raisonnements, ils n'ont été faits qu'a posteriori, pour justifier des actions non-logiques.
§ 224. La divination ne différait pas moins que la religion, à Rome et à Athènes, et les différences se manifestaient dans le même sens. À Rome [FN: § 224-1] , la divination consistait en
« (p. 176) une simple demande, toujours la même, et visant uniquement le présent ou l'avenir immédiat qui le suit. Cette demande pourrait se formuler ainsi : « les dieux ont-ils pour agréable, oui ou non, l'action que va faire le consultant ou qui va se faire sous ses auspices ?» Elle ne pose que cette alternative et n'accepte que des signes positifs ou des signes négatifs... Quant aux méthodes divinatoires réglementées par le rituel augural, elles étaient aussi simples et aussi peu nombreuses que possible. L'observation des oiseaux en faisait le fond et serait restée l'unique source des auspices si le prestige de l'art fulgural des Toscans n'avait décidé les Romains à observer le ciel, et même à attribuer au signe mystérieux de la foudre une énergie supérieure. La divination officielle ne connaissait ni les oracles ou sorts, ni l'inspection des entrailles, elle se refusait à entrer dans la discussion et l'appréciation des signes fortuits, n'en tenant compte que s'ils survenaient dans la prise des auspices ; à plus forte raison s'abstenait-elle d'interpréter les prodiges ».
§ 225. Ce que les Romains ne pouvaient trouver chez eux, ils le demandèrent à la Grèce et à l'Étrurie, où l'imagination, plus libre, créait de nouvelles formes de divination. L'importance donnée à la simple association d'actes et d'idées explique une des règles les plus extraordinaires de la divination romaine : celle qui donne à l'auspice inventé la même efficacité qu'à l'auspice réellement observé.
« (p. 202) L'auspiciant pouvait... se contenter du premier signe, s'il était favorable, ou laisser passer les indices fâcheux pour en attendre de meilleurs. Il pouvait encore, ce qui était plus sûr et devint l'usage ordinaire, se faire annoncer par l'augure assistant que les oiseaux attendus volaient ou chantaient dans les conditions requises. Cette annonce (renuntiatio ) faite suivant une formule sacramentelle, créait un auspice ominal, équivalent pour celui qui l'entendait à l'auspice réel » [FN: § 225-1].
§ 226.Les Romains arrangeaient le fond suivant leur convenance, tout en respectant la forme, ou plutôt certaines associations d'idées et d'actes. Les Athéniens modifiaient le fond et la forme. Il répugnait aux Spartiates de changer l'une et l'autre.
Avant la bataille de Marathon, les Athéniens envoyèrent demander des secours à Sparte [FN: § 226-1]
« (p. 189) Les autorités spartiates s'empressèrent de promettre leur aide, mais, par malheur, c'était alors le neuvième jour de la lune. Une (p. 190) ancienne loi, ou un ancien usage, leur défendait de marcher, ce mois-là du moins, pendant le dernier quartier avant la pleine lune ; mais après la pleine lune, ils s'engagèrent à marcher sans délai. Un retard de cinq jours à ce moment critique pouvait être la ruine totale de la ville en danger ; cependant la raison alléguée ne paraît pas avoir été un prétexte de la part des Spartiates. Ce n'était qu'un attachement opiniâtre et aveugle à une ancienne habitude, ténacité que nous verrons diminuer, sinon disparaître complètement, à mesure que nous avancerons dans leur histoire ».
Les Athéniens auraient changé le fond et la forme. Les Romains modifiaient le fond en respectant la forme. Pour déclarer la guerre, le fécial devait jeter un dard sur le territoire ennemi. Comment faire pour accomplir ce rite et déclarer ainsi la guerre à Pyrrhus, dont les états étaient si éloignés de Rome ? Rien de plus simple. Les Romains avaient capturé un soldat de Pyrrhus. Ils lui firent acquérir un petit terrain, au cirque de Flaminius ; et c'est là que le fécial jeta le dard. L'association d'idées du peuple romain, entre le jet du dard et une guerre juste, était ainsi respectée [FN: § 226-2].
§ 227. On rencontre, dans le vieux droit romain, les mêmes caractères que nous avons relevés dans la religion et dans la divination ; ce qui renforce l'impression qu'il s'agit d'une qualité intrinsèque de l'esprit romain ; qualité qui se manifeste dans les différentes branches de l'activité humaine. Dans le droit comme dans la religion et dans la divination, il y a encore des différences de qualité, que nous aurons à examiner, en comparant Athènes à Rome [FN: § 227-1]
« (p. 134) Le mot, soit écrit, soit solennellement exprimé (la formule), apparaît aux peuples enfants comme quelque chose de mystérieux, et la foi naïve lui attribue une force surnaturelle. Nulle part cette foi au mot ne fut plus robuste que dans la Rome ancienne. Le culte du mot pénètre tous les rapports de la vie publique et de la vie privée, de la religion, des usages et du droit. Pour le Romain ancien, le mot est une puissance ; il lie et délie. S'il ne transporte pas des montagnes, il a du moins le pouvoir de déplacer les moissons d'un champ sur un champ appartenant à autrui ; il est assez puissant pour évoquer (p. 135) les divinités (devocare ), et pour leur faire abandonner la ville assiégée (evocatio deorum ) ».
lhering n'a raison qu'en partie ; ce ne sont pas seulement les paroles qui ont ce pouvoir, mais les paroles et les actes. D'une façon plus générale encore, ce sont certaines associations de paroles, d'actes, d'effets, qui persistent et ne se disjoignent pas facilement. Dans l'exemple cité tant de fois, de Gaius, où l'on voit un demandeur perdre sa cause parce qu'il avait appelé par leur nom ses vignes, qu'il aurait dû nommer arbres, tel étant le terme employé dans la loi des XII Tables, on ne peut découvrir aucun pouvoir aux paroles. Il s'était simplement formé certaines associations d'idées, que les Romains répugnaient à disjoindre. Ce peuple développait son droit, tout en respectant ces associations. On créait un droit nouveau, en conservant la forme des actions de la loi.
« (p. 104) [FN: § 227-2]La théorie des modes volontaires d'acquisition était, dans le droit romain, bien différente de ce qu'elle a été dans le droit attique. Il existait, en effet, à Rome, des modes solennels d'acquisition, à savoir la mancipatio et l’in iure cessio, ayant par eux-mêmes une vertu translative, indépendamment de toute tradition. Or, à Athènes, on ne rencontre rien de semblable. Si, dans quelques autres cités de la Grèce, la vente est accompagnée de formalités rappelant celles de la mancipation, elle est, dans le droit attique, un contrat purement consensuel et translatif ipso iure de la (p. 105) propriété inter partes. D'un autre côté, la tradition qui joue un si grand rôle à Rome comme mode de translation de la propriété, n'a, dans le droit attique, que la valeur d'un simple fait. Elle y est dépourvue de toute qualité translative, et n'apparaît que comme un simple moyen d'exécution des obligations ; l'acquisition de la propriété étant déjà antérieurement réalisée par l'effet de la convention ».
Le droit attique, lui non plus, n'a pas subordonné la perfection du contrat à l'observation de certaines formes solennelles. La loi athénienne n'exigeait, d'autre part, aucune des formalités que l'on voit être pratiquées ailleurs, comme la présence d'un magistrat, l'intervention des -voisins, les sacrifices, etc. La vente avait lieu par le seul fait de l'échange des consentements, même sans que la présence de témoins ou la stipulation d'un acte écrit fussent nécessaires.
§ 228. Mais le caractère le plus remarquable du vieux droit romain n'est pas la fidélité à la lettre, à la forme, mais bien le progrès qu'il accomplit, tout en respectant les associations d'idées. Ihering l'a assez bien reconnu, quoiqu'il considère un autre aspect. Après avoir cité plusieurs cas dans lesquels il semblait que les jurisconsultes anciens eussent sacrifié le sens à l'expression littérale (loc. cit.), il ajoute : « (p. 151) Ces exemples semblent mettre hors de doute que la jurisprudence ancienne, dans l'interprétation des lois, s'en est rigoureusement tenue au mot. À mon avis cependant, il faut absolument rejeter cette opinion. Pour nous en convaincre, nous allons énumérer une série de cas dans lesquels la jurisprudence s'est incontestablement écartée du mot ».
Le vieux droit romain était tout forme et mécanisme, et réduisait au minimum l'arbitraire des parties et du magistrat. Les actions de la loi ressemblaient à un moulin : on mettait le grain d'un côté; de l'autre sortait la farine.
Girard dit [FN: § 228-1]:
« (p. 973)... il est nécessaire de bien comprendre le rôle du magistrat. Il ne juge pas. Ce serait presque exagérer de dire qu'il organise l'instance. Il donne simplement par son concours une sorte d'authenticité indispensable aux actes des parties, spécialement à ceux du demandeur. Comme dans la procédure extrajudiciaire, c'est le demandeur qui réalise son droit en accomplissant la legis actio... (p. 974). Quant au magistrat, son rôle est un rôle d'assistant, sinon purement passif, au moins à peu près mécanique [FN: § 228-2] . Il doit être là, prononcer les paroles que la loi lui ordonne de prononcer. Mais c'est à peu près tout. Il ne peut ni accorder l'action, quand la loi ne l'accorde pas, ni, à notre sens, la refuser (denegare legis actionem ), quand la loi la donne [FN: § 228-3] , et, s'il y a un procès, ce n'est pas lui qui le juge... l'instance organisée in iure devant le magistrat est tranchée in iudicio par une autorité différente. La tâche du magistrat finit par la nomination du juge, faite encore beaucoup plus par les parties que par lui-même ».
§ 229. Nous pourrions continuer cet exposé, parce que dans toutes les parties du droit romain, on peut découvrir la manifestation de cet état psychique qui accepte le progrès tout en respectant les associations d'idées. Après avoir vu cela dans le système de la legis actio, nous en rencontrerions des traces dans le système formulaire. Nous le verrions dominer toute la matière des fictions. Ces dernières se retrouvent chez presque tous les peuples, à une certaine époque de leur histoire ; mais, dans la Rome antique comme dans l'Angleterre moderne, leur développement et leur persistance sont remarquables.
§ 230. Dans les manifestations de la vie politique, nous trouvons des phénomènes semblables à ceux que nous venons d'observer. Par l'effet d'une évolution commune à la majeure partie des villes grecques et latines, le roi a été remplacé par de nouveaux magistrats, à Athènes comme à Sparte et à Rome [FN: § 230-1], mais à Athènes, on change complètement le fond et la forme. À Sparte, le changement de l'une et de l'autre a été moindre. À Rome, il a été notable dans le fond, moindre dans la forme.
Pour conserver certaines associations d'idées et d'actes, à Athènes, les fonctions sacerdotales du roi passèrent à l'archonte-roi, et à Rome, elles passèrent au rex sacrorum ; mais ni l'un ni l'autre de ces deux personnages n'ont d'importance politique. Sous cet aspect, à Athènes, le roi disparaît complètement ; à Sparte, il subsiste partiellement ; à Rome, il se transforme avec les moindres changements possibles dans la forme. La magistrature suprême devient annuelle et se dédouble entre deux consuls [FN: § 230-2] qui sont égaux, chacun pouvant agir isolément, chacun pouvant arrêter l'action de l'autre. « (p. 246) [FN: § 230-3]La constitution réservait aux consuls le droit de compléter leur collège, en particulier en cas de guerre, par l'adjonction d'un troisième membre ayant un droit plus fort, d'un dictateur. Et à la vérité l'élection populaire n'est intervenue pour la dictature que tardivement et à titre isolé. Le dictateur est nommé (p. 247) par l'un des consuls, comme le roi l'était probablement autrefois par l'interroi cette nomination royale n'a qu'une barrière, c'est que les consuls et leurs collègues les préteurs restent en fonction à côté du dictateur, bien qu'en cas de conflit ils s'inclinent devant le dictateur ».
§ 231. Dans la constitution romaine, il est plus que singulier que les hauts magistrats, bien qu'ils soient en réalité nommés par les comices, paraissaient l'être par leurs prédécesseurs.
« (p. 116) [FN: § 231-1]L'élection populaire la plus ancienne n'était pas un choix librement exercé parmi les personnes capables ; elle a été probablement liée à l'origine par le droit de proposition du magistrat qui dirigeait le vote. Il est vraisemblable qu'à l'origine la plus ancienne, on soumettait au peuple juste autant de noms qu'il y avait de personnes à élire et que, dans le principe, les votants ne pouvaient qu'accepter ou repousser purement et simplement la personne proposée tout comme la loi proposée ».
Même aux temps plus récents de la république, le magistrat qui dirige la votation peut agréer une candidature (nomen accipere ), ou la refuser (nomen non accipere). En conséquence, il faut aussi que le magistrat qui préside à la votation consente à ( renuntiare » l'élu [FN: § 231-2], et s'il s'y refuse, personne ne peut l'y contraindre.
§ 232. À Athènes, nous ne trouvons rien de tout cela. Il y avait bien un examen, pour juger si les archontes, magistrats désignés par le sort, les stratèges, magistrats élus, et les sénateurs étaient aptes à exercer leur charge. Mais c'est une espèce de vérification des pouvoirs très différente de la renuntiatio. Athènes accorde la forme et le fond. À Rome, on passa de la royauté à la république, en divisant les fonctions des magistrats ; on revint au principat, en les concentrant de nouveau. Dans les innombrables transformations constitutionnelles qui ont eu lieu entre ces deux limites extrêmes, on a conservé autant que possible la forme, tout en modifiant le fond.
§ 233. Vers la fin de sa vie, César parut vouloir se soustraire à cette règle. Un peuple comme celui d'Athènes n'aurait rien vu là que de très raisonnable. Les quelques Romains qui étaient encore imbus des vieilles conceptions, furent indignés de cette dissociation d'idées et d'actes, qu'on voulait opérer. C'est seulement en prenant la partie pour le tout, qu'on a pu dire que ce furent les honneurs excessifs que César s'était fait décerner, qui occasionnèrent sa ruine [FN: § 233-1] . Ces honneurs étaient seulement une partie d'un ensemble de faits qui indisposaient les citoyens romains, dont l'état psychique était encore celui de leurs ancêtres. Auguste sut mieux respecter les traditions. Dans l'inscription d'Ancyre, il ment effrontément, quand il dit [FN: § 233-2] : « Dans mes sixième et septième consulats, après avoir éteint les guerres civiles, j'ai restitué au Sénat et au peuple romain les pouvoirs que j'avais reçus du consentement universel. En reconnaissance, un sénatus-consulte m'a donné le nom d'Auguste... Car, bien que je fusse au-dessus de tous par les honneurs, je n'avais pas de pouvoirs plus étendus que mes collègues ». Velleius Paterculus, qui décerne les plus grandes louanges à Auguste et à Tibère, dit qu'Auguste rendit aux lois leur force, aux juges leur autorité, au Sénat sa majesté, aux magistrats leur pouvoir [FN: § 233-3] .
§ 234. Sous l'empire, il y a encore des consuls et des tribuns ; mais ce ne sont plus que de vains noms. Il y a de même, encore sous Auguste, des comices pour l'élection des magistrats ; et, ce qui est plus surprenant et démontre encore mieux l'affection des Romains pour certaines formes, on trouve, jusque sous Vespasien, une loi votée par les comices pour investir le prince, du pouvoir ! À ne juger les choses que superficiellement, on trouve qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de temps à perdre, pour jouer de semblables comédies.
« (p. 150) [FN: § 234-1]La puissance tribunicienne a été conférée de la même façon à Auguste en 718, et ensuite à ses successeurs ; à la suite de la décision du Sénat, un magistrat, probablement un des consuls en fonction, présentait la rogation déterminant à la fois les pouvoirs et la personne du prince, aux comices... (p. 151) en sorte que le Sénat et le peuple concouraient l'un et l'autre à cet acte... La forme était donc celle dans laquelle des magistrats extraordinaires ont été institués sous la république par une loi spéciale et par une élection populaire... (p. 152) Le transfert des élections des comices au Sénat, opéré en l'an 14 après J. C., ne changea rien quant aux comices impériaux, car ce transfert ne concernait que la nomination des magistrats ordinaires, mais il était étranger à celle des magistrats théoriquement extraordinaires ».
§ 235. On découvre là l'inanité de certains motifs logiques, que les hommes donnent à leurs actions. C'est sérieusement, sans jouer sur les mots, que les jurisconsultes nous disent que « l'on n'a jamais douté que la volonté du prince n'obtînt force de loi, puisque l'empereur reçoit lui-même l'empire d'une loi [FN: § 235-1] ». À la vérité, la force des prétoriens et des légions comptait aussi pour quelque chose ! Dans la légende, une simple femme raisonnait mieux que le grave Ulpien, quand elle disait à Caracalla : « Ne sais-tu pas qu'il convient à un empereur de faire des lois et non d'en recevoir [FN: § 235-2] ? »
§ 236. On a déjà observé que les Grecs n'ont pas de terme qui corresponde exactement au mot « religio ». Sans vouloir entrer dans des discussions étymologiques, qui seraient d'ailleurs de minime utilité, nous nous bornerons à observer que, même à l'époque classique, un des sens de « religio » est indubitablement celui de soins minutieux, scrupuleux, diligents [FN: § 236-1]. C'est un état d'esprit par lequel s'établissent certains liens qui s'imposent fortement à la conscience. Si donc on voulait absolument choisir un terme, parmi ceux qui existent, pour exprimer l'état psychique dont nous avons parlé précédemment, celui qui semblerait le plus topique, sans être toutefois parfaitement exact, serait le terme « religio ». Cependant, même si on lui conservait la forme latine, on n'éviterait pas, soit à cause de la ressemblance avec le terme français « religion », soit en raison d'autres sens que possède le terme latin, qu'on ne le prît dans une acception tout à fait différente de celle que nous voulons lui attribuer. L'expérience nous enseigne qu'il n'est pas de précaution suffisante, pour éviter qu'un terme ne soit pris dans son sens courant et sans tenir compte de la définition qu'en a donné l'auteur, si explicite et claire qu'elle soit.
§ 237. Une anecdote racontée par Tite-Live [FN: § 237-1]met bien en relief l'attachement scrupuleux aux liens, attachement qui l'emporte sur tout autre sentiment. Quelques soldats qui ne voulaient pas obéir aux consuls, commencèrent par examiner si, en tuant les consuls, ils se délieraient du serment qu'ils leur avaient prêté. Mais ensuite ils se persuadèrent qu'un délit ne pourrait annuler un engagement sacré, et recoururent à une espèce de grève. Peu importe que ce soit de l'histoire ou de la fable. Si c'est une fable, celui qui l'a inventée savait que ceux qui l'entendraient raconter trouveraient très naturel qu'on examinât si tuer la personne à laquelle on a prêté serment, est un moyen de se délier ; et qu'on pouvait se décider pour la négative, non par répugnance pour l'homicide en lui-même, mais parce qu'il ne serait pas un moyen valable de se délier du serment. Toute cette discussion sur la manière d'éviter les conséquences d'un serment appartient à la « religio », dans le sens indiqué.
§ 238. C'est comme des manifestations de cette même « religio », que nous devons considérer les innombrables faits qui nous montrent les Romains précis, exacts, scrupuleux, aimant l'ordre et la régularité jusqu'à l'excès, dans toute leur vie privée. C'est ainsi que tout chef de famille avait un journal dans lequel il notait non seulement les recettes et les dépenses, mais tous les faits d'une certaine importance, qui avaient lieu dans la famille: quelque chose de semblable à un journal de comptabilité commerciale, que la loi impose, en France et ailleurs, aux commerçants [FN: § 238-1], mais où l'on ajoutait des faits étrangers à la simple administration du patrimoine.
§ 239. Il semblerait que la religion des Grecs, où la raison et l'imagination jouent le rôle principal, aurait dû être plus morale que celle des Romains, qui se réduisait à une série de fictions, dans lesquelles la raison n'a aucune part. Ce fut pourtant le contraire [FN: § 239-1] . Ne nous arrêtons pas aux aventures scandaleuses des dieux. Voyons la religion dans son action sur les actes de la vie journalière. Pour les Romains, les actes extérieurs du culte sont tout, l'intention rien. Les Grecs, eux aussi, ont connu un semblable état, à une époque archaïque. L'homicide s'expiait moyennant une cérémonie tout extérieure. Mais ils dépassèrent, ou pour mieux dire, leurs penseurs dépassèrent bientôt cette morale matérialiste et formaliste. « De même qu'il n'y a pas de remède à la perte de la virginité – dira Eschyle [FN: § 239-2] – tous les fleuves réunis ensemble ne réussiraient pas à purifier les mains tachées de sang, de l'homicide ». À une si grande délicatesse de sentiment doit certainement correspondre une grande rectitude dans les actions. Pourtant on observe le contraire. Rome finit par devenir aussi peu morale que la Grèce ; mais, à l'origine, et à une époque récente comme celle des Scipions, Polybe [FN: § 239-3]pouvait dire :
« Ainsi, sans parler d'autre chose, si l'on confie un seul talent à ceux qui ont, chez les Grecs, la manipulation des deniers publics, quand même ils ont dix cautions, dix sceaux et un nombre double de témoins, ils ne respectent pas la foi jurée ; tandis que chez les Romains, ceux qui, comme magistrats ou ambassadeurs, disposent de sommes considérables, respectent la parole donnée, à cause de leur serment [FN: § 239-4]».
Les poulets sacrés pouvaient bien être ridicules ; mais ils ne causèrent jamais aux armées romaines un désastre comparable à celui qu'eut à subir l'armée athénienne, en Sicile, par la faute de ses devins.
§ 240. Rome n'eut pas de procès pour impiété à comparer à ceux pour [mot grec] à Athènes, et beaucoup moins aux innombrables procès religieux dont le christianisme affligea l'humanité. Si Anaxagore avait vécu à Rome, il aurait pu affirmer tant qu'il l'aurait voulu que le soleil était un bloc incandescent, sans que personne se souciât de ses propos [FN: § 240-1]. Quand, en l'année 155 avant J. C., les Athéniens envoyèrent à Rome une ambassade composée de trois philosophes. Critolaos, Diogène et Carnéade, les philhellènes de Rome admirèrent fort l'éloquence captieuse de ce dernier ; mais Caton le Censeur, représentant l'esprit des vieux Romains, trouvait plus que suspects tous ces discours subtils, et demanda au Sénat de terminer au plus tôt l'affaire qui avait amené ces ambassadeurs à Rome : « afin qu'ils retournassent disserter dans leurs écoles devant les enfants grecs, et que les jeunes Romains écoutassent comme avant les magistrats et les lois [FN: § 240-2]».
Notez bien que Caton ne veut pas le moins du monde discuter les doctrines de Carnéade ; il ne s'inquiète en aucune façon de savoir si elles procèdent ou non de bonne logique ; il les juge extérieurement. Toutes ces argumentations captieuses lui paraissent n'avoir aucune valeur, et il croit inutile et dangereux pour les jeunes Romains de les écouter.
Grand aurait été l'étonnement de Caton, s'il avait su qu'un jour, les hommes répandraient leur sang pour affirmer ou nier la consubstantialité du Verbe ou de la seconde personne de la Trinité [FN: § 240-3]; et c'eût été bien à raison qu'il aurait remercié Iupiter optimus maximus, d'avoir préservé les Romains d'une semblable folie ; laquelle pourtant, en certains cas, recouvrait un fond raisonnable.
§ 241. Le droit athénien, essentiellement logique, qui se proposait de résoudre les questions dans leur ensemble, et qui n'était pas embarrassé d'un vain formalisme, ni de fictions trop nombreuses, devrait être de beaucoup supérieur au droit romain. Et cependant, c'est juste le contraire.
« (p. 75) [FN: § 241-1]L'intellect grec, avec toute sa mobilité et son élasticité, était entièrement incapable de se confiner lui-même dans le vêtement d'une formule légale ; et si nous pouvons en juger par les tribunaux populaires d'Athènes, dont nous avons une connaissance certaine, les tribunaux grecs montrèrent une forte tendance à confondre la loi et le fait (p. 76). De cette manière, un système de jurisprudence durable n'était pas possible. Un peuple qui n'avait jamais aucune répugnance à modifier les règles du droit écrit, chaque fois qu'elles étaient un obstacle sur la voie de la réalisation d'un idéal de perfection, dans des décisions de cas particuliers, ce peuple, s'il léguait un corps de principes juridiques à la postérité, ne pouvait lui en laisser qu'un, formé des conceptions du juste et de l'injuste, tels qu'on désirait les voir triompher en ce temps ».
Jusque-là, nous sommes d'accord avec Sumner Maine ; mais nous ne pouvons partager son avis, quand il attribue la perfection du droit romain à la théorie que les Romains avaient du droit naturel. Cette théorie est venue s'ajouter, à une époque relativement récente, au vieux fond du droit romain. Ihering serre de plus près le problème. La description du phénomène est excellente ; quant à ses causes, ce qu'il appelle « la logique rigoureuse de l'esprit conservateur » n'est pas autre chose que l'état psychique dont nous avons parlé précédemment, combiné avec des déductions logiques et pratiques, qui apportent les moindres modifications possibles à certaines associations d'idées et d'actes.
Nous reproduisons le passage de Ihering [FN: § 241-2] , en mettant entre parenthèses les modifications que nous croyons opportun d'y faire:
« (p. 328) Si la science juridique romaine a trouvé tout fait un droit simple et logique, elle le doit moralement au peuple romain antique qui, malgré son esprit de liberté, s'était laissé imposer pendant des siècles le joug d'une logique impitoyable [des conséquences logiques des associations d'idées et d'actes, qu'on voulait respecter ]... Ce que nous venons de dire se manifeste dans la manière particulière des Romains, si familière à tous ceux qui connaissent le droit romain, de concilier la logique gênante [certaines associations d'idées et d'actes ] avec le besoin de la pratique, au moyen d'artifices, de toute espèce : actes apparents, moyens détournés, fictions. L'aversion morale des Romains pour toute violation d'un principe une fois reconnu [résultant des associations d'idées et d'actes ], stimule et presse, en quelque sorte, leur intelligence à déployer toute sa sagacité, afin de découvrir les voies et les moyens pour opérer cette conciliation de la logique et de la nécessité pratique. La nécessité rend inventif... (p. 329) La seconde qualité nationale des Romains, que nous avons nommée plus haut, leur esprit conservateur [conservateur de la forme, innovateur du fond ], exerça exactement la même influence, et fut, elle aussi, un puissant levier pour leur génie inventif juridique. Concilier les nécessités du présent avec les traditions du passé, rendre justice aux premières sans rompre, ni dans la forme ni dans le fond, avec les principes traditionnels du passé, discipliner le commerce juridique, conduire la force progressive du droit dans sa véritable voie, telle fut pendant des siècles, à Rome, la mission véritablement noble et patriotique de la science juridique [laissons de côté la mission, la noblesse et le patriotisme ]. Elle grandit en proportion des difficultés qu'elle rencontra ».
§ 242. Quant à la politique, il y a mieux encore. C'est le cas de se demander comment a jamais pu fonctionner un système si absurde, au point de vue logique. Ces magistrats, égaux en droits, tels que les deux consuls et les deux censeurs ; ces tribuns qui peuvent arrêter toute la vie juridique et politique ; ces comices avec les complications des auspices ; ce Sénat sans attributions bien déterminées ; tout cela semble constituer les organes d'une machine difforme, qui n'a jamais pu fonctionner. Et pourtant elle a été en action pendant des siècles et des siècles, et a donné à Rome la domination du monde méditerranéen ; et quand elle s'est détraquée, c'est arrivé parce qu'elle était employée par un peuple nouveau qui n'avait plus la « religio » de l'ancien (§ 247). Grâce aux liaisons (sens mécanique) des actions non-logiques, et grâce à des forces innovatrices, Rome a su concilier la discipline avec la liberté, et s'est tenue dans un juste milieu entre Athènes et Sparte.
§ 243. Le discours que Thucydide [FN: § 243-1]attribue à Périclès et celui de Cicéron sur la réponse des aruspices, forment un contraste qui frappe.
L'Athénien parle comme un homme moderne. La prospérité d'Athènes est due à la démocratie, à de justes lois, au bon sens des citoyens, à leur courage. Ces qualités des Athéniens font qu'Athènes est supérieure aux autres cités de la Grèce.
Le Romain loue beaucoup moins la science et le courage de ses concitoyens [FN: § 243-2] :
« Quel que soit l'amour que nous ayons pour nous-mêmes, Pères Conscrits, nous n'avons été supérieurs ni aux Espagnols par le nombre, ni aux Gaulois par la force, ni aux Carthaginois par la ruse, ni aux Grecs par les arts, ni aux Italiens eux-mêmes et aux Latins par le bon sens naturel de notre pays. Mais, nous avons vaincu tous les peuples et toutes les nations par la piété et par la religion, et aussi par la sagesse qui nous a fait reconnaître que tout est dirigé et gouverné par les dieux immortels ». Il semble que ce soit là le langage du préjugé ; et c'est, au contraire, celui de la raison, surtout si l'on prend le mot « religion » au sens que nous avons indiqué. La cause de la prospérité des Romains fut un certain nombre de liaisons, de « religiones », qui conservaient la discipline à ce peuple. Il est vrai que Cicéron ne l'entendait pas ainsi ; il se proposait de parler de la puissance des dieux immortels ; mais le concept de la règle, des liaisons, ne manquait pas chez lui. Il a commencé par louer la sagesse des ancêtres, « qui ont pensé que les rites sacrés et les cérémonies regardent les pontifes ; les présages heureux, les augures ; que les antiques prédictions d'Apollon sont contenues dans les livres sybillins, et que l'explication des prodiges appartient à la doctrine des Étrusques [FN: § 243-3]».
C'est là une conception vraiment toute romaine de l'ordre et de la régularité.
§ 244. Parmi les peuples modernes, les Anglais ressemblent plus que tout autre peuple aux Romains, pour l'état psychique [FN: § 244-1] , du moins jusque vers la fin du XIXe siècle. Leur droit est encore plein de fictions. Leur organisation politique conserve les mêmes noms, les mêmes formes arriérées, tandis que le fond change continuellement. Il y a encore un roi en Angleterre, comme au temps des Plantagenets, des Tudors, des Stuarts ; mais il a fini par avoir moins d'autorité, moins de pouvoir que le président de la république des États-Unis d'Amérique. Sous Charles 1er, on voit éclater une guerre civile que le roi, dans son parlement, faisait au roi, dans son camp. Jammais les Romains n.avaient imaginé une aussi ingénieuse fiction.
Aujourd'hui encore, les cérémonies pour l'ouverture du parlement sont archaïques au point de paraître comiques. On voit arriver aux Communes un grave personnage, appelé the gentleman usher of the black rod, qui les invite à se présenter à la Chambre des Lords, pour entendre le discours du trône. Les députés vont à la Chambre des Lords, puis retournent à leur place, où le speaker leur raconte avec le plus grand sérieux ce qu'ils ont entendu aussi bien que lui. Il faut immédiatement donner lecture d'un bill, seulement pour la forme, afin de sauvegarder le droit du parlement, de discuter en premier les affaires, sans examiner les motifs de la convocation.
Cette organisation politique s'adapte aux besoins du peuple anglais, comme l'organisation politique de l'ancienne Rome s'adaptait aux besoins du peuple romain ; et tous les peuples modernes ont cherché à la copier plus ou moins fidèlement, Cette organisation a permis à l'Angleterre de rester victorieuse dans les guerres de Napoléon 1er, et assura aux Anglais une liberté plus grande que celle dont jouirent la plupart des peuples européens. Tout cela tend maintenant à se modifier, grâce à des coutumes et des habitudes nouvelles, qui semblent prendre pied en Angleterre.
§ 245. Dans l'exposé fait jusqu'ici, nous avons dû nous servir des termes du langage ordinaire, qui, de leur nature, sont peu rigoureux. Pour le moment, nous ne nous occuperons que des termes: Athéniens, Romains, etc., employés plus haut.
Que représentaient précisément ces termes ? Certainement, pour les peuples antiques, ils ne représentaient que les citoyens, tandis que les esclaves, les pérégrins étaient exclus. Mais nos propositions s'appliquent-elles vraiment à tous les citoyens ? De certains faits, de certains actes, de certaines lois ou coutumes, nous avons déduit l'état psychique de ceux qui exécutèrent ces faits et ces actes, qui acceptaient ces lois et ces coutumes. C'est légitime ; mais dire que ceux-ci constituaient la totalité ou même la majorité numérique de la nation, ne le serait pas du tout.
§ 246. Tout peuple est gouverné par une élite [FN: § 246-1] et, pour être exact, nous devons dire que c'est justement l'état psychique de cette élite que nous avons observé. Tout au plus pouvons-nous ajouter que l'impulsion qu'elle a donnée était admise par le reste de la population.
Une élite peut se modifier par le changement des hommes qui la composent, ou de leurs descendants, ou aussi par l'infiltration d'éléments étrangers, qui peuvent provenir de la nation elle-même ou d'une autre. À Athènes, quand seuls les fils des citoyens athéniens étaient citoyens, l'élite a pu se modifier uniquement parce que ses membres changeaient, ou qu'elle en recevait d'autres du corps des citoyens athéniens.
§ 247. À Rome, non seulement on peut observer des changements analogues, mais il y a aussi une infiltration de peuples étrangers, soit de Latins et d'Italiens, par l'extension du droit de cité, soit de toutes sortes de peuples, même barbares, grâce aux affranchis et à leurs descendants. P. Scipion Émilien pouvait déjà dire aux individus composant la plèbe qui se livrait à un tumulte, qu'ils n'étaient pas même Italiens [FN: § 247-1] . Nous devons donc nous tenir en garde contre des conclusions hâtives qu'on pourrait tirer des exemples que nous avons cités. Nous avons bien trouvé les caractères de certaines élites ; mais nous n'avons pas résolu le problème de leur composition.
§ 248. Ces considérations nous conduisent à la limite au delà de laquelle on pénètre dans une matière d'une nature différente de celle dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent. Il serait prématuré de pousser plus avant, et dangereux de le faire sans avoir terminé d'abord l'étude commencée. Revenons-y donc. L'excursion de tout à l'heure était nécessaire, pour nous faire connaître au moins l'existence de cette autre matière. Nous l'étudierons dans les derniers chapitres.
[150]
Chapitre III↩
Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines [(§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204]
§ 249. Outre certaines inductions accessoires, l'étude accomplie au chapitre précédent nous a fait connaître les faits suivants :
1° L'existence et l'importance des actions non-logiques. Cela est contraire à beaucoup de théories sociologiques, qui dédaignent ou négligent les actions non-logiques, ou leur donnent peu d'importance, en s'efforçant de rendre toutes les actions logiques. La voie à suivre pour étudier les actions des hommes en relation avec l'équilibre social sera différente, suivant qu'on donnera une importance plus grande aux actions non-logiques ou aux actions logiques. Il faut donc maintenant que nous pénétrions dans cette matière.
2° Les actions non-logiques sont généralement considérées au point de vue logique par ceux qui les accomplissent ou par ceux qui en traitent, qui en font la théorie. De là la nécessité d'une opération de prime importance pour notre étude, laquelle tend à lever ces voiles et à retrouver les choses qu'ils dissimulent. C'est aussi contraire à beaucoup de théories qui s'arrêtent aux voiles, non tenus pour tels, mais pris pour la partie fondamentale des actions. Nous devons examiner ces théories ; parce que si nous les trouvions vraies – c'est-à-dire d'accord avec l'expérience, – nous devrions prendre une tout autre voie que celle qu'il conviendrait de suivre, si nous reconnaissions que la partie fondamentale est au contraire la chose voilée.
3° La vérité expérimentale d'une théorie et son utilité sociale sont des choses différentes. Une théorie expérimentalement vraie peut être utile – ou nuisible – à la société, comme aussi une théorie expérimentalement fausse. Un très grand nombre de personnes le nient. Il ne faut donc pas nous contenter des quelques aperçus du chapitre précédent, et moins que jamais de la simple affirmation du § 34 ; mais nous devons voir si l'observation des faits confirme ou dément l'induction faite (§ 14).
4° Il existe des différences entre les hommes, ou, si l'on envisage les choses en gros, entre les classes sociales, à propos des actions logiques et non-logiques. Il existe aussi des différences entre les degrés d'utilité que les théories expérimentalement vraies ou fausses et les sentiments manifestés par les actions non-logiques, peuvent avoir pour ces individus ou ces classes. Beaucoup nient cette différence, qui excite même l'indignation d'un assez grand nombre de gens. Il sera, par conséquent, nécessaire de poursuivre l'étude à peine commencée sur cette matière, et de bien voir ce que nous disent les faits.
§ 250. En attendant, l'étude qui vient d'être faite nous donne déjà une idée, superficielle c'est entendu, des réponses à faire aux questions effleurées aux § 13 et 14, et nous voyons que certaines distinctions faites dans ces paragraphes ne sont pas seulement hypothétiques, mais correspondent à la réalité.
§ 251. Dans le présent chapitre, nous nous occuperons surtout de déceler les actions non-logiques, dans les théories ou les descriptions des faits sociaux, données par différents auteurs ; de cette manière, nous acquerrons aussi une idée approximative des voiles qui cachent ces actions non-logiques.
§ 252. Si vraiment les actions non-logiques ont l'importance suggérée par l'induction du chapitre précédent, il serait étrange, en vérité, que les hommes intelligents qui se sont occupés de l'étude des sociétés humaines n'y eussent prêté aucune attention. Ils peuvent les avoir entrevues, distraits par des préjugés, détournés par des théories erronées ; mais il est difficile de croire qu'ils n'aient réellement rien vu de ce que nous trouvons maintenant si important. Cherchons donc ce qui en est.
§ 253. Pour cela, il faut envisager les choses d'une façon encore plus générale ; c'est-à-dire chercher comment la réalité se trouve transformée dans les théories et narrations qu'en donnent les auteurs. Nous avons une image sur un miroir courbe, et nous voulons retrouver la forme de l'objet, altérée par le miroir. Pour le moment, laissons de côté les cas les plus simples, par exemple des auteurs qui reconnaissent que les actions des hommes dépendent, au moins en partie, du territoire où ils vivent, du climat, de la race, des occupations, des inclinations. Il est manifeste que l'action déterminée par ces causes n'est pas le fruit du raisonnement pur, mais que c'est une action non-logique. Et pourtant, les auteurs mêmes qui ont admis ces causes ne s'en rendent souvent pas compte. Il y aurait donc chez eux une contradiction; mais parfois elle disparaît, car lorsqu'ils admettent ces causes, les auteurs étudient ce qui est ; quand ils veulent que toutes les actions soient logiques, ils étudient ce qui, d'après eux, devrait être. Ils passent d'une étude scientifique à un prêche.
§ 254. Abordons des cas moins simples, et commençons par ceux dans lesquels il est plus facile de reconnaître la vérité expérimentale, sous des expressions imparfaites et en partie erronées, pour procéder ensuite à l'étude d'autres cas, dans lesquels cette recherche est plus difficile.
Voici par exemple un livre: La Cité Antique, de Fustel de Coulanges. Nous y lisons : « (p. 73) De toutes ces croyances, de tous ces usages, de toutes ces lois, il résulte clairement que c'est la religion domestique qui a appris à l'homme à s'approprier la terre, et qui lui a assuré son droit sur elle ». Mais il est vraiment singulier que la religion domestique ait précédé la possession du sol. L'auteur n'en donne aucune preuve. Il se pourrait aussi que ce fût le contraire, ou que la religion et la possession se fussent développées ensemble. Il est manifeste que l'auteur a l'idée préconçue que la possession doit avoir une cause. Ceci posé, il la cherche et la trouve dans la religion. Ainsi, posséder devient une action logique, déduite, de la religion qui, à son tour, pourra se déduire logiquement de quelque autre chose.
Par une circonstance singulière, notre auteur nous donne ici, lui-même, la rectification que nous devons apporter. Il avait écrit un peu plus haut : « (p. 63) Il y a trois choses que, dès l'âge le plus ancien, on trouve fondées et solidement établies dans ces sociétés grecques et italiennes : la religion domestique, la famille, le droit de propriété ; trois choses qui ont eu entre elles, à l'origine, un rapport manifeste, et qui paraissent avoir été inséparables ».
Comment l'auteur n'a-t-il pas vu que ces deux passages étaient en contradiction ? Si trois choses A, B, C, sont « inséparables », l'une d'elles, par exemple A, ne peut en produire une autre, par exemple 2; car si A produit B, cela veut dire qu'elle en était alors séparée.
Il faut donc nécessairement faire un choix entre ces deux propositions du même auteur. Si nous voulons conserver la première, il convient d'éliminer la seconde ou vice-versa. Or, nous devons adopter ce dernier choix, c'est-à-dire éliminer la proposition qui place la religion et la propriété dans une relation de cause à effet, et conserver la proposition qui met ces choses en relation de mutuelle dépendance (§ 996). Les mêmes faits, cités par Fustel de Coulanges, nous imposent ce choix. Quand il écrit : « (p. 64) Et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupée autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-même », spontanément surgit l'observation : « Oui, pourvu que ce soit possible ». Supposons un état social, tel que la famille ne puisse se fixer au sol, et, dans ce cas, ce sera la religion qui devra se modifier. Il est manifeste qu'il y a eu une série d'actions et de réactions, sans qu'on puisse déterminer comment elles ont commencé. Le fait qu'il est arrivé à certains hommes de vivre en familles séparées et fixées au sol, a eu comme manifestation une certaine forme de religion ; laquelle, à son tour, a contribué à maintenir les familles séparées et fixées au sol.
§ 255. Nous découvrons, dans le cas présent, un exemple d'une erreur très générale, qui consiste à substituer des relations de cause à effet à des relations de mutuelle dépendance (§ 137). Cette erreur en produit une autre, en plaçant dans la classe des actions logiques, l'effet que l'on prend à tort pour une conséquence logique de la cause.
§ 256. Quand Polybe nous donnera la religion comme une des causes de la puissance romaine, nous accepterons cette remarque, qui a une grande valeur ; mais nous repousserons l'explication logique qu'il donne du fait (§ 313-1] ).
Dans l'Ancient Law de Sumner Maine, nous trouvons un autre exemple, semblable à celui de Fustel de Coulanges. Sumner Maine observe que les sociétés antiques étaient constituées par des familles. C'est une donnée de fait que nous ne voulons pas discuter [FN: § 256-1] . De là, il tire la conséquence que le droit antique était adapté (adjusted) [FN: § 256-2] « (p. 126) à un système de petites corporations indépendantes ». Cela aussi est bien ; les institutions s'adaptent à l'état de choses. Mais plus loin, voici que le concept des actions logiques s'insinue en tapinois[FN: § 256-3]. « (p. 183) Les hommes sont considérés et traités non comme individus, mais toujours comme parties d'un groupe spécial ». Il serait plus précis de dire que telle est la réalité, et que, par conséquent, le droit se développe comme s'ils étaient considérés et traités comme parties d'un groupe spécial.
Avant cette dernière observation, l'intromission des actions logiques est plus manifeste. Après le passage que nous avons cité, où l'on observait que la société antique était composée de petites corporations indépendantes, l'auteur ajoute [FN: § 256-4]: « (p. 126) Les corporations ne meurent jamais, et par conséquent le droit primitif considère les entités dont il s'occupe, c'est-à-dire les groupes patriarcaux de familles, comme perpétuels et inextinguibles ». De là, Sumner Maine tire comme conséquence l'institution de la transmission, au décès, de 1'universitas iuris, que nous trouvons dans le droit romain. Cela peut bien être d'accord avec une analyse logique postérieure, d'actions non-logiques antérieures, mais ne représente pas précisément les faits. Pour nous en approcher, il faut intervertir quelques termes des observations précédentes. La succession de l'universitas iuris ne procède pas du concept d'une corporation qui ne s'éteint jamais ; c'est au contraire celui-ci qui procède de celle-là. Une famille ou un autre groupe ethnique occupait un terrain, avait des troupeaux, etc. Le fait de la perpétuité de l'occupation, de la possession, est, suivant toute probabilité, antérieur à tout concept abstrait, et à tout concept de droit de succession, puisque nous le voyons même chez les animaux. Les grands félins occupent un certain territoire de chasse, qui demeure propre à la famille, si l'homme ne vient pas la déranger[FN: § 256-5] . La fourmilière est perpétuelle ; et il ne paraît pas probable que les fourmis aient le concept de la corporation ni celui de la succession. Chez l'homme, au contraire, le fait engendra le concept. Puis, l'homme étant un animal logique, il voulut trouver le pourquoi du fait ; et parmi toutes les explications qu'il imagina, il peut bien y avoir eu aussi celle que donne Sumner Maine.
Cet auteur est l'un de ceux qui ont le mieux montré la différence qui existe entre le droit-fait et le droit-théorie ; et pourtant il l'oublie à chaque instant, tellement est ancrée l'idée qui fait voir partout des actions logiques. Le droit-fait est constitué par un ensemble d'actions non-logiques qui se répètent régulièrement. Le droit-théorie comprend deux parties, soit 1° une analyse logique – ou pseudo-logique ou même imaginaire – de ces actions non-logiques ; 2° des conséquences des principes que cette analyse a déduits. Le droit-fait n'est pas seulement primitif ; il vit à côté du droit-théorie, s'insinue à la dérobée dans la jurisprudence et la modifie ; puis vient un jour où l'on fait la théorie de ces modifications ; la chenille devient papillon ; le droit-théorie possède un nouveau chapitre.
§ 257. Quand Duruy [FN: § 257-1]écrit, à propos de l'assassinat de César : « (p. 411) Depuis la fondation de la république, l'aristocratie romaine avait adroitement nourri dans le peuple l'horreur pour le nom de roi », nous reconnaissons aussitôt le vernis logique des actions non-logiques. Et quand ensuite notre auteur ajoutera : « (p. 411) Si la solution monarchique répondait aux besoins du temps, il était à peu près inévitable que le premier monarque payerait de sa vie sa royauté, comme notre Henri IV a payé de la sienne sa couronne », nous verrons bientôt dans les « besoins du temps », une de ces bonnes fictions que l'on veut nous donner pour quelque chose de concret ; et quant à la loi suivant laquelle les premiers monarques de chaque dynastie doivent être assassinés, comme l'histoire ne nous en donne pas la preuve expérimentale, nous y verrons une simple réminiscence du fatum, et nous l'enverrons tenir compagnie aux nombreux et fantaisistes produits semblables de l'imagination.
§ 258. Nous éliminerons de l'histoire, sans chercher à les interpréter, les prodiges que Suétone n'oublie jamais de raconter, à l'occasion de la naissance ou de la mort des empereurs ; parce que nous verrons combien cette voie serait trompeuse (§ 672 et sv.); et nous retiendrons seulement les faits qui sont ou du moins paraissent être historiques. Nous en ferons autant dans tout autre cas semblable, par exemple pour les histoires des Croisades.
Mais il faut prendre garde ici que nous sommes engagés sur une voie dangereuse ; et nous verrons que si l'on prenait comme règle absolue de diviser un récit en deux parties, l'une miraculeuse, incroyable, que l'on rejette, et une autre, naturelle, croyable, que l'on conserve, on irait certainement au devant de très grosses erreurs (§ 674). Il faut que la partie que l'on accepte ait des probabilités extrinsèques de vérité, soit à cause des qualités connues de l'auteur, soit par l'accord d'autres témoignages.
§ 259. Nous ne pouvons rien tirer d'historique de la légende. Mais nous pouvons en déduire quelque chose, et souvent beaucoup, quant à l'état psychique des hommes qui l'ont créée ou acceptée. Or notre étude a justement la connaissance de ces états psychiques pour fondement. Aussi nous arrivera-t-il souvent de citer des faits sans rechercher s'ils sont historiques ou légendaires ; car, pour ce que nous en voulons tirer, ils nous servent également bien, dans l'un et l'autre cas ; quelquefois même, les faits légendaires nous sont plus utiles que les faits historiques.
§ 260. L'interprétation logique d'actions non-logiques devient à son tour une cause d'actions logiques, et quelquefois même d'actions non-logiques. On doit par conséquent l'envisager aussi, pour déterminer l'équilibre social. À ce point de vue, l'interprétation du vulgaire a généralement plus d'importance que celle des théoriciens. Pour étudier l'équilibre social, il importe beaucoup plus de savoir ce que le vulgaire entend par vertu, que de connaître ce qu'en pensent les philosophes.
§ 261. Il y a fort peu d'auteurs qui omettent entièrement d'envisager les actions non-logiques. Elles apparaissent généralement dans la considération de certaines inclinations naturelles, que, bon gré mal gré, l'auteur doit pourtant reconnaître aux hommes. Mais l'éclipse des actions logiques dure peu : chassées ici, elles reparaissent là. On réduit ces inclinations au minimum, et l'on suppose que les hommes en tirent des conséquences logiques et agissent d'après elles.
§ 262. Cela d'une façon générale ; mais en particulier les théoriciens ont de plus un autre motif, très puissant, pour substituer les actions logiques aux non-logiques. Si nous supposons que certaines actions sont logiques, il devient beaucoup plus facile d'en faire la théorie, que si nous les supposons non-logiques ; car chacun de nous a dans son propre esprit l'instrument qui fait les déductions logiques ; aussi n'a-t-il pas besoin d'autre chose ; tandis que pour les actions non-logiques, il faut recourir à l'observation de nombreux faits, étendre en outre les recherches dans l'espace et dans le temps, et prendre garde de n'être pas induit en erreur par des documents imparfaits. En somme, c'est un travail long et difficile, que doit accomplir celui qui veut édifier une théorie, pour trouver en dehors de lui les matériaux que son esprit lui offrait directement par le secours de la logique seule, dans le cas des actions logiques.
§ 263. Si l'économie politique est beaucoup plus avancée que la sociologie, cela dépend en grande partie du fait qu'elle étudie des actions logiques [FN: § 263-1] . Elle aurait été dès le début une science très bien constituée, si elle n'avait rencontré un grave obstacle dans le fait que les phénomènes étudiés étaient mutuellement dépendants, alors que les personnes qui s'adonnaient à cette étude étaient incapables de suivre l'unique voie qui nous soit connue, pour tenir compte de la dépendance mutuelle. L'obstacle indiqué fut surmonté, au moins en partie, quand on employa la mathématique dans l'étude des phénomènes économiques ; et l'on constitua de cette manière une science, c'est-à-dire l'économie mathématique, qui peut aller de pair avec d'autres sciences naturelles. [Voir Addition A11 par l’auteur]
§ 264. D'autres motifs agissent pour éloigner les théoriciens, du champ des actions non-logiques, et pour les refouler dans celui des actions logiques. La majeure partie de ces théoriciens ne se contentent pas d'étudier ce qui est, mais veulent savoir, et surtout enseigner à autrui ce qui devrait être. Dans cette dernière recherche, la logique est pour eux souveraine ; et sitôt qu'ils ont reconnu l'existence des actions non-logiques, au lieu de suivre la voie sur laquelle ils se sont engagés, ils dévient, souvent paraissent oublier ces actions non-logiques, généralement les négligent et suivent la voie qui conduit aux actions logiques.
§ 265. On élimine de même les actions non-logiques, en les considérant, – à l'ordinaire sans le dire explicitement, – comme une chose blâmable ou pour le moins hors de propos, et qui ne devrait pas se voir dans une société bien policée. On les considère, par exemple, comme des superstitions qui doivent être extirpées par l'usage de la raison. Personne, en pratique, n'agit comme s'il croyait que le physique et le moral d'un homme n'avaient au moins une part dans la détermination de ses actes. Mais quand on fait une théorie, on admetvolontiers que l'homme doit être mu seulement par la raison, et l'on ferme volontairement les yeux sur ce que la pratique journalière vous enseigne.
§ 266. L'imperfection scientifique du langage ordinaire contribue aussi à élargir les interprétations logiques d'actions non-logiques.
§ 267. Elle n'est pas étrangère à la confusion que l'on a coutume de faire, quand on prend deux phénomènes comme cause et effet, seulement parce qu'on les rencontre ensemble. Nous avons déjà fait allusion à cette erreur (§ 16) ; mais il faut maintenant que nous pénétrions un peu plus avant dans son étude, car elle n'est pas de menue importance pour la sociologie.
Soit comme au § 166, C, une croyance, D, certaines actions. Au lieu de dire simplement : « Certains hommes font D et croient C », le langage ordinaire ajoute quelque chose, en exprimant que « certains hommes font D, parce qu'ils croient C ». Prise dans son sens rigoureux, cette proposition est souvent fausse ; et la proposition suivante l'est moins souvent : « Certains hommes croient C, parce qu'ils font D ». Mais il y a aussi de nombreux cas dans lesquels on peut dire seulement : «Certains hommes font D et croient C ».
On peut aussi faire disparaître la rigueur logique du terme parce que, employé dans la première des trois propositions précédentes, en excluant qu'il établisse, dans cette proposition, un rapport de cause à effet entre C et D ; on dira donc : « Nous pouvons admettre que certains hommes font D, parce qu'ils ont une croyance C, par laquelle se manifestent justement les sentiments qui les poussent à faire D » ; c'est-à-dire, en se rapportant à la fig. 3, parce qu'ils ont un état psychique A, manifesté par C. Sous cette forme, la proposition approche beaucoup de la vérité, comme nous avons vu au § 166.
§ 268. La figure 3 peut se décomposer en trois autres :
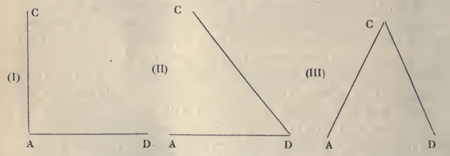
Figure 7
(I) L'état psychique A produit la croyance C et les actes D, qui n'ont entre eux aucun rapport direct. C'est le cas indiqué par la troisième des propositions formulées.
(II) L'état psychique A fait naître les actions D, et tous deux produisent la croyance C. C'est le cas indiqué par la seconde des trois propositions.
(III) L'état psychique A fait naître la croyance C, qui est cause des actions D. C'est le cas indiqué par la première des trois propositions.
§ 269. Bien que le cas (III) ne soit pas le seul ni le plus fréquent, les hommes inclinent à le croire général, et à le confondre avec les ras (I) et (II), dont ils ne veulent tenir compte que peu ou pas du tout. Le langage courant favorise l'erreur par son défaut de précision, parce qu'on énonce explicitement le cas (III), tandis que sans s'en apercevoir, on pense aussi aux cas (I) et (II). Ensuite il arrive souvent qu'on a des mélanges de ces trois cas, en proportions variées.
§ 270. Voyons maintenant des exemples concrets de raisonnements de divers auteurs. Dans sa Politique, Aristote commence ainsi [FN: § 270-1]: « Comme nous voyons que toute cité est une société, et que toute société est constituée en vue de quelque bien, (puisque tous agissent pour accomplir ce qui leur paraît bien), il est manifeste que toutes les sociétés recherchent quelque bien... ». Ici nous sommes entièrement dans le domaine des actions logiques : de propos délibéré et en vue d'accomplir un certain bien, les hommes ont constitué la société qui s'appelle cité. Il semblerait donc qu'Aristote va tomber dans les absurdités du contrat social ; mais il n'en est rien ; il dévie aussitôt ; et le principe qu'il a posé tout à l'heure lui servira à rechercher ce que doit être une cité, plutôt qu'à étudier ce qu'elle est.
§ 271. À peine Aristote a-t-il énoncé son principe d'une association en vue d'un certain bien, qu'il le met de côté et nous propose une autre origine de la société. D'abord, il remarque la nécessité de l'union des sexes, et observe très bien que « cela n'a pas lieu par choix volontaire [FN: § 271-1]». Nous entrons ainsi manifestement dans le domaine des actions non-logiques. Il continue en disant: « (I, 1, 4) la Nature a fait certains êtres pour commander et d'autres pour obéir ». La Nature a distingué parmi les Grecs la femme et l'esclave ; elle ne l'a pas fait parmi les Barbares, parce que chez eux la Nature n'a pas fait d'êtres pour commander. Nous restons donc dans le domaine des actions non-logiques, et nous y sommes toujours, quand l'auteur nous dit que les deux associations du maître et de l'esclave, du mari et de la femme, sont le fondement de la famille ; quand il remarque ensuite que le village est constitué de plusieurs familles ; quand il poursuit en observant que plusieurs villages forment un État ; et quand il conclut finalement en ces termes explicites : « Donc toute cité vient de la Nature, de même que les premières associations [FN: § 271-2]».
Il est impossible de mentionner plus clairement des actions non-logiques.
§ 272. Mais si la cité vient de la Nature, elle ne vient pas de la volonté arrêtée des citoyens qui s'associent en vue d'un certain bien. Il y a ici contradiction entre le principe posé tout d'abord et la conclusion à laquelle on arrive. [Voir Addition A12 par l’auteur] Nous ne pouvons savoir comment Aristote est tombé dans cette contradiction ; mais qui voudrait la reproduire n'aurait qu'à procéder ainsi. Qu'il pense d'abord exclusivement à l'idée de cité ou d'État : il s'établira facilement une relation avec l'idée d'association, et entre celle-ci et l'idée d'un groupement volontaire d'hommes. On obtient ainsi le premier principe. Puis, qu'il pense aux nombreuses idées suggérées par les faits qu'on observe dans une cité ou dans un État, soit à la famille, aux maîtres et aux esclaves, etc.; le propos délibéré ne s'ajustera pas à ces idées, qui suggéreront au contraire celle de quelque chose qui se développe naturellement. Nous aurons ainsi la seconde description d'Aristote.
§ 273. Il fait tomber la contradiction, grâce à la métaphysique, qui ne refuse jamais son secours dans ces cas désespérés. Reconnaissant les actions non-logiques, il dit: « (I, 1, 13) Il est donc manifeste que la cité vient de la Nature, et qu'elle s'impose à l'homme.. C'est par conséquent de la Nature que vient chez tous la tendance à cette association. Aussi le premier qui l'institua fut-il cause d'un très grand bien ». Il y a donc la tendance donnée par la Nature ; mais il faut en outre qu'un homme institue la cité. À l'action non-logique, on superpose une action logique (§ 306-I β) ; et cela ne peut manquer, parce que, dit Aristote, la Nature ne fait rien en vain [FN: § 273-1] . Remercions donc cette excellente dame Nature, qui sait tirer d'embarras les philosophes avec tant d'à-propos.
§ 274. En séparant les Grecs des Barbares, au moyen de sa théorie célèbre de l'esclavage naturel, Aristote recourt au concept des actions non-logiques. Il est entre autres manifeste que la logique étant la même pour les Grecs et pour les Barbares, si toutes les actions étaient logiques, il ne pourrait y avoir aucune différence entre ces nations. Ce n'est pas tout. En bon observateur qu'il est, Aristote remarque aussi des différences parmi les citoyens. À propos des formes de la démocratie, il dit: « (VI, 2, 1) Le meilleur peuple est celui des agriculteurs ; par conséquent, on peut instituer la démocratie là où le peuple vit de l'agriculture et de l'élevage des troupeaux ». Il répète : « (VI, 2, 7) Après les agriculteurs, le meilleur peuple est celui des bergers, qui vit de ses bestiaux... Les autres agrégats dont sont constituées les autres démocraties sont très inférieurs ». Voilà donc des classes bien distinctes de citoyens, et presque une ébauche du matérialisme économique.
Il n'y a pas de motif pour nous arrêter là. Si nous poursuivons, nous voyons qu'en général les actions des hommes dépendent du tempérament de ces hommes et de leurs occupations.
Cicéron [FN: § 274-1]attribue aux ancêtres des Romains de son temps le mérite d'avoir su que « les coutumes des hommes procèdent moins de la race et de l'origine, que de ces éléments fournis aux habitudes ordinaires par la nature même des lieux, et dont nous tirons vie et subsistance. Les Carthaginois étaient déloyaux et menteurs, non par inclination, mais de par la nature du pays, dont le port et les relations avec de nombreux marchands et étrangers les poussaient à chercher des bénéfices en trompant autrui. Les montagnards liguriens sont rudes et agrestes... Les Campaniens sont toujours fiers, à cause de la fertilité de leur pays, de l'abondance de leurs moissons, de la salubrité, de l'étendue, de la beauté de leur cité ».
§ 275. Dans la Rhétorique [FN: § 275-1], Aristote fait une analyse restée célèbre, des caractères de l'homme à ses divers âges ; c'est-à-dire de l'adolescent, de l'homme fait, du vieillard. Il pousse encore plus loin l'analyse, en examinant l'effet de la noblesse, de la richesse, du pouvoir, sur les coutumes ; et toute cette étude est fort bien menée à terme. Mais ainsi l'auteur se trouve évidemment dans le domaine des actions non-logiques [FN: § 275-2].
§ 276. Il y a même l'idée de l'évolution. Dans la Politique II, 5, 12), Aristote observe que les ancêtres des Grecs ressemblaient probablement aux hommes vulgaires et ignorants qui existaient parmi ses contemporains.
§ 277. Si Aristote avait suivi la voie qu'il avait partiellement si bien parcourue, nous aurions eu, dès son époque, une sociologie scientifique. Pourquoi donc ne l'a-t-il pas fait? Il y a eu peut-être à cela de nombreux motifs; mais il paraît probable que parmi les principaux, se trouve ce besoin d'applications pratiques prématurées, qui s'oppose toujours au progrès de la science ; sans compter la manie de prêcher aux gens ce qu'ils doivent faire, préoccupation d'ailleurs plus qu'inutile, au lieu d'étudier ce qu'ils font. L'Histoire des Animaux échappe à ces causes d'erreurs ; et c'est peut-être pour cela qu'elle est scientifiquement très supérieure à la Politique.
§ 278. Il paraît étrange de trouver quelque vestige des actions non-logiques chez un rêveur comme Platon ; et pourtant c'est un fait certain. On voit apparaître cette idée dans les motifs qu'allègue Platon pour fonder sa colonie loin de la mer [FN: § 278-1] . Le fait d'en être voisin commence par être doux, mais finit par être amer à une cité ; « car la ville, se remplissant de commerce et de trafic, engendre des coutumes déloyales et instables et des esprits trompeurs ».
On trouve en outre les actions non-logiques dans l'apologue de Platon, bien connu, sur les races d'hommes. Le dieu qui a créé les hommes a mis de l'or dans la composition de ceux qui sont aptes à gouverner, de l'argent dans la composition des gardiens de la république (c'est-à-dire des guerriers), du fer dans la composition de ceux qui s'occupent d'agriculture et d'autres travaux.
Platon a aussi une vague idée de la circulation des élites. Il sait qu'il peut arriver que des hommes de la race d'argent naissent de la race d'or, et vice versa, et qu'il peut en être de même pour les autres races [FN: § 275-2] .
§ 279. Ceci posé, si l'on veut rester dans le domaine scientifique, il convient de rechercher quels seront les caractères, quelle sera l'évolution d'une collectivité constituée par diverses races d'hommes qui ne se reproduisent pas précisément avec les mêmes caractères, et qui peuvent se mélanger. On travaillerait ainsi à constituer la science des sociétés. Mais Platon a un tout autre but : il s'inquiète peu de ce qui est, et emploie tout son effort intellectuel à trouver ce qui doit être. Les actions non-logiques disparaissent alors, et la fantaisie de l'auteur se donne libre cours avec les actions logiques, qu'il invente en masse. Voilà notre philosophe qui institue à peu de frais des magistrats chargés de remettre à la place qu'il aurait dû occuper celui qui, dans une race, naîtrait avec des caractères différents de ceux de ses parents ; le voilà qui se met à édicter des lois pour maintenir et modifier les mœurs ; le voilà, en somme, qui abandonne la modeste tâche de la science pour s'élever aux régions sublimes de la création.
§ 280. Les controverses sur cette question : « la vertu peut-elle être enseignée ? » nous révèlent aussi une conception vague des actions non-logiques. D'après les documents que nous connaissons, il paraîtrait que Socrate estimait que la « vertu » est une « science », et qu'il laissait par conséquent peu de place aux actions non-logiques [FN: § 280-1]. Platon et Aristote abandonnent cette attitude extrême. Ils pensent qu'une certaine inclination naturelle est nécessaire à la « vertu ». Mais sitôt que cette disposition naturelle est supposée, nous rentrons dans le domaine de la logique, qui est chargée d'en tirer les conséquences nécessaires ; lesquelles donnent leur forme aux actions humaines. Ces controverses ressemblent sur certains points à celles qui eurent lieu, longtemps après, sur la grâce efficace et la grâce non efficace.
§ 281. Le procédé de Platon et d'Aristote, dans les controverses sur l'enseignement de la « vertu », est général. Suivant ce procédé, on attribue aux actions non-logiques un rôle qu'il serait absurde de nier ; mais aussitôt on le rejette en revenant aux conséquences logiques. En outre, divisant en « bonnes » et « mauvaises » ces inclinations qu'on a été forcé d'admettre, on trouve moyen de conserver seulement celles qui se plient à son système logique, et d'éliminer les autres.
§ 282. Saint Thomas [FN: § 282-1]essaie aussi de louvoyer entre la nécessité d'admettre certaines inclinations non-logiques et son grand désir de donner plein pouvoir à la raison ; entre le déterminisme des actions non-logiques et la doctrine du libre arbitre, dans les actions logiques. Il dit que « la vertu est une bonne qualité ou habitude de l'esprit, grâce à laquelle on vit dans le droit chemin, dont personne n'use à tort, et que Dieu suscite en nous, sans nous ». On fait la part des actions non-logiques, en considérant la vertu comme une « habitude de l'esprit » ; et de même en disant que Dieu la suscite en nous, sans nous. Mais, par cette intervention divine, on fait disparaître l'incertitude de la fin des actions non-logiques, lesquelles deviennent logiques selon les desseins de Dieu, et par conséquent aussi pour les théologiens, qui ont le bonheur de connaître ces desseins. D'autres emploient la Nature, dans le même but et toujours avec le même effet. L'homme agit selon certaines inclinations ; voilà la partie des actions non-logiques réduite au minimum, parce que les actions sont supposées conséquences logiques des inclinations ; et l'on fait même disparaître cette infime partie, comme par un tour de passe-passe ; car ces inclinations sont supposées données, produites par une entité (Dieu, Nature ou autre), qui agit logiquement (§ 306 I β). De sorte que si ceux qui accomplissent les actions peuvent croire parfois exécuter des actions non-logiques, celui qui connaît les desseins ou le procédé logique de l'entité plus haut nommée, – et tous les philosophes, les sociologues, etc., ont ce privilège – celui-là sait que toutes les actions sont logiques.
§ 283. La controverse entre Herbert Spencer et Auguste Comte nous donne l'occasion de présenter quelques observations sur les actions non-logiques.
§ 284. Dans son Cours de Philosophie positive [FN: § 284-1], Auguste Comte paraît être décidément favorable à la prédominance des actions logiques. Il voit dans la philosophie positive « (p. 26) la seule base solide de la réorganisation sociale qui doit terminer l'état de crise dans lequel se trouvent depuis si longtemps les nations civilisées ». C'est donc une théorie qui doit réorganiser le monde. Comment cela aura-t-il lieu ?
« (p. 26) * Ce n'est pas aux lecteurs de cet ouvrage que je croirai jamais devoir prouver que les idées gouvernent et bouleversent le monde, ou, en d'autres termes, que tout le mécanisme social repose finalement sur des opinions. Ils savent surtout que la grande crise politique et morale des sociétés actuelles tient, en dernière analyse, à l'anarchie intellectuelle.* Notre mal le plus grave consiste, en effet, dans cette profonde divergence qui existe maintenant entre tous les esprits relativement à toutes les maximes fondamentales dont la fixité est la première condition d'un véritable ordre social. Tant que les intelligences individuelles n'auront pas adhéré par un assentiment unanime à un certain nombre d'idées générales, capables de former une doctrine sociale commune, on ne peut se dissimuler que l'état des nations restera, de toute nécessité, essentiellement révolutionnaire... Il est également certain que si cette réunion des esprits dans une même communion de principes peut une fois être obtenue, les institutions convenables en découleront nécessairement... ».
§ 285. Après avoir cité le passage que nous avons placé entre deux astérisques (*), Herbert Spencer [FN: § 285-1]expose une théorie d'actions non-logiques agissant exclusivement sur la société.
« (p. 115) Les idées ne gouvernent ni ne bouleversent le monde : le monde est gouverné ou bouleversé par les sentiments auxquels les idées servent seulement de guides. Le mécanisme social ne repose pas finalement sur des opinions, mais presque entièrement sur le caractère. Ce n'est (p. 116) pas l'anarchie intellectuelle, mais l'antagonisme moral, qui est la cause des crises politiques. Tous les phénomènes sociaux sont produits par l'ensemble des sentiments et des croyances humaines... Dans la pratique, le caractère national et l'état social déterminent les idées qui doivent avoir cours ; ce ne sont point (p. 117) les idées qui ont cours qui déterminent l'état social et le caractère national. La modification de la nature morale des hommes, produite graduellement par l'action continue de la discipline de la vie sociale, est la principale cause immédiate du progrès des sociétés » (Statique sociale, ch. XXX).
§ 286. Suit un fait singulier : c'est que ces auteurs échangent réciproquement leurs positions. Dans le Système de politique positive, A. Comte se décide à faire prévaloir le sentiment ; et, sur ce point, il s'exprime très clairement. « (p. 5) [FN: § 286-1]Quoique j'aie toujours proclamé l'universelle prépondérance du sentiment, je devais jusqu'ici fixer principalement l'attention sur l'intelligence et l'activité, qui prévalent en sociologie. Mais leur essor décisif ayant maintenant amené l'époque de leur vraie systématisation, cette destination finale conduit à faire explicitement dominer le sentiment, domaine essentiel de la morale ».
L'auteur s'éloigne quelque peu de la vérité, quand il affirme « avoir toujours proclamé l'universelle prépondérance du sentiment ». Dans le Cours de Philosophie positive, on ne trouve pas cette prépondérance ; et ce sont bien les idées qui occupent la première place. Mais A. Comte a changé d'opinion [FN: § 286-2] ; il a commencé par considérer les théories existantes, auxquelles il voulait en substituer d'autres de sa confection ; et alors, dans cette lutte des idées, les siennes l'emportaient naturellement, et ce sont elles qui devaient donner une vie nouvelle au monde. Avec le temps, A. Comte est devenu prophète. La lutte des idées est terminée. Il se figure avoir vaincu définitivement. Désormais il dicte le dogme, prononce ex cathedra ; il est donc naturel que seuls subsistent les sentiments, ses sentiments.
§ 287. En outre, A. Comte a commencé par espérer convertir les hommes, et naturellement le moyen d'y arriver était alors les idées. Mais il a fini par n'avoir d'autre espoir que celui d'une religion imposée, même par le tsar Nicolas, même par le Sultan ou tout au moins par Louis-Napoléon, qui aurait dû se contenter de n'être qu'un dictateur au service du positivisme [FN: § 287-1]. Là domine le sentiment, et l'on ne peut dire que « les idées gouvernent et bouleversent le monde ». Il serait absurde de supposer que A. Comte s'adressait au tsar, à Reschid pacha ou à Louis-Napoléon, pour les engager à prêcher les idées aux gens.
On pourrait seulement objecter que les idées de A. Comte déterminent la religion qui devrait ensuite être imposée aux hommes, et que, de cette manière, les idées auraient « bouleversé le monde », si le tsar, le Sultan, Louis-Napoléon ou quelque despote bien intentionné, avait voulu se charger d'imposer le positivisme de A. Comte. Mais cette signification n'est pas du tout celle des assertions du Cours de Philosophie positive.
§ 288. A. Comte reconnaît et exagère même beaucoup l'influence sociale du culte et la valeur qu'il a dans l'éducation ; ce qui n'est autre chose qu'un cas particulier de la valeur des actions non-logiques. Si A. Comte avait pu se résigner à n'être qu'un homme de science, il aurait pu écrire un livre excellent sur cette valeur du culte, et nous enseigner beaucoup de choses ; mais il voulait être le prophète d'une religion nouvelle. Au lieu d'étudier les effets des cultes qui ont existé ou qui existent, il en veut créer un nouveau ; ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous n'avons ainsi qu'un nouvel exemple des dommages causés à la science par la manie des applications pratiques.
§ 289. D'autre part, après avoir admis, trop exclusivement aussi, l'influence des actions non-logiques, H. Spencer les élimine entièrement par le procédé général que nous avons exposé au § 261. Il dit : « (52) [FN: § 289-1]Nous devons partir du postulat que les idées primitives sont naturelles, et, dans les conditions où elles se produisent, rationnelles ». Voici que la logique, chassée par la porte, rentre parla fenêtre. « Dans notre enfance, on nous a appris que la nature humaine est partout la même... Il faut rejeter cette erreur et y substituer le principe que les lois de la pensée sont partout les mêmes, et que, en admettant qu'il connaisse les données de ces conclusions, l'homme primitif tire des conclusions raisonnables » [FN: § 289-2] .
§ 290. Si l'on admet cela, H. Spencer se donne tort à lui-même dans sa controverse avec A. Comte. Si les hommes tirent toujours des conclusions logiques des données dont ils disposent, et s'ils agissent ensuite suivant ces conclusions, il ne reste plus que des actions logiques ; et ce sont alors « les idées qui gouvernent et bouleversent le monde ». Il n'y a plus de place pour les sentiments, auxquels H. Spencer voulait attribuer ce pouvoir ; ils ne peuvent en aucune façon s'introduire dans un ensemble complet, constitué par des faits expérimentaux, même mal observés, et par les conséquences logiques qu'on en tire.
§ 291. Le principe posé par H. Spencer rend les études sociologiques très faciles ; spécialement s'il est uni à deux autres principes du même auteur : celui de l'unité d'évolution et celui de l'identité ou de la quasi-identité des sauvages contemporains et des hommes primitifs (§ 728, 731). Les récits d'un voyageur, plus ou moins authentiques, plus ou moins bien interprétés, nous font connaître les données dont disposait l'homme primitif ; et quand ils font défaut, notre imagination supplée ; ne pouvant obtenir le vrai, elle trouve le vraisemblable. Maintenant nous avons tout ce qu'il faut pour constituer la sociologie, puisqu'il nous suffit de tirer simplement les conséquences logiques de ces données, sans perdre notre temps à des recherches historiques, longues et difficiles.
§ 292. C'est ainsi que procède H. Spencer, par exemple pour découvrir l'origine et l'évolution de la religion. L'homme primitif nous apparaît comme un homme de science moderne, qui, dans son laboratoire, travaille à construire une théorie. L'homme primitif ne dispose que de matériaux imparfaits ; c'est pourquoi, malgré ses raisonnements rigoureusement logiques, il n'en peut tirer que des conclusions imparfaites. Mais il a des concepts philosophiques fort subtils. Par exemple, H. Spencer donne comme « une idée primitive », « que toute propriété caractéristique d'un agrégat est inhérente à chacune de ses parties intégrantes » (Sociol., 154).
Qui veut connaître la valeur de cette théorie n'a qu'à répéter cette proposition à une personne d'entre les moins cultivées de notre société ; il verra immédiatement qu'elle ne comprend même pas ce qu'on veut lui dire. Et pourtant H. Spencer prétend qu'elle tire des conclusions logiques de cette proposition qu'elle ne comprend pas. « (154, p. 417) L'âme, présente dans le cadavre de l'homme mort conservé tout entier, est aussi présente dans les parties conservées de son corps. De là la foi aux reliques ». À coup sûr, notre auteur n'en a jamais parlé à quelque bonne femme catholique. La voie qu'il indique pourrait peut-être conduire à la foi aux reliques quelque philosophe épris de logique ; mais elle est entièrement étrangère à la foi populaire.
§ 293. De la sorte, sur quelques points, le procédé adopté par H. Spencer est semblable à celui dont use A. Comte. En général, on peut l'exprimer de la façon suivante. Nous avons deux choses, P et Q, dont il faut tenir compte pour déterminer l'organisation sociale R. On commence par affirmer que la chose Q détermine seule cette organisation ; puis on démontre que P détermine Q. De cette façon, la chose Q est éliminée, et c'est la chose P qui détermine exclusivement l'organisation sociale.
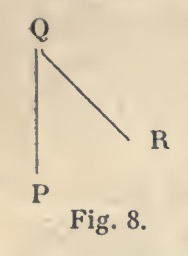
Figure 8
§ 294. Si Q désigne « les idées » et P « les sentiments », nous avons à peu près l'évolution des théories de A. Comte. Si Q désigne « les sentiments » et P « les idées », nous avons, toujours à peu près, l'évolution des théories de H. Spencer.
§ 295. Ce que nous venons d'exposer est confirmé par les observations de John Stuart Mill, à propos de la controverse entre A. Comte et H. Spencer. Il dit : « (p. 109) [FN: § 295-1]Un examen impartial de ce qu'a écrit M. Comte ne fera pas découvrir qu'il ait rien omis de la somme de vérité contenue dans la théorie de Spencer. Il n'aurait pas dit, vraiment (ce que M. Spencer veut apparemment nous faire dire), que les effets qu'on peut historiquement rapporter à la religion, par exemple, n'ont pas été produits par la croyance en Dieu, mais par la vénération et par la crainte qu'il inspirait. Il aurait dit que la vénération et la crainte présupposent la croyance qu'il faut croire en un Dieu avant de pouvoir le craindre ou le vénérer ». Nous retrouvons là le procédé indiqué tout à l'heure. P est la croyance qu'il existe un Dieu ; Q indique les sentiments de crainte et de vénération ; P produit Q, et devient ainsi la cause déterminante des actions.
§ 296. Il paraît absurde à un parfait logicien comme Mill, que l'on puisse éprouver un sentiment de crainte, s'il n'est logiquement déduit d'un sujet capable d'inspirer la crainte. Mill aurait dû se rappeler le vers de Stace [FN: § 296-1]
Primus in orbe deos fecit limor,
et il aurait vu qu'une voie diamétralement opposée à celle qu'il indique est parfaitement concevable [FN: § 3] . Cela posé, quelle est la voie suivie en réalité ? Ou mieux, quelles sont les différentes voies suivies ? C'est aux documents historiques à nous l'enseigner, et nous ne pouvons y substituer notre fantaisie, prendre pour réel ce qui nous paraît vraisemblable. Il faut savoir comment les faits se sont passés et non comment ils auraient dû se dérouler, pour satisfaire un esprit rigoureusement logique [FN: § 296-3] .
§ 297. En d'autres matières, Mill reconnaît très bien le rôle social des actions non-logiques ; mais il retire bientôt, du moins en partie, la concession qu'il a faite ; parce qu'au lieu de continuer à étudier ce qui est, il se met à rechercher ce qui devrait exister. C'est là un procédé général, employé par beaucoup d'auteurs, pour éliminer les actions non-logiques.
§ 298. Par exemple, dans son livre sur la Liberté, Mill écrit : « (p. 103) [FN: § 298-1]les opinions des hommes sur ce qui est louable ou blâmable sont affectées par toutes les causes diverses qui influent sur leurs désirs à propos de la conduite des autres, causes aussi nombreuses que celles qui déterminent leurs désirs sur tout autre sujet. Quelquefois c'est leur raison ; d'autres fois leurs préjugés ou leurs superstitions ; souvent leurs sentiments sociables, pas très rarement leurs penchants antisociaux, leur envie ou leur jalousie, leur arrogance ou leur mépris. Mais le plus souvent l'homme est guidé par son propre intérêt, légitime ou illégitime. Partout où il y a une classe dominante, presque toute la morale publique dérive des intérêts de cette classe ».
À part quelques restrictions, tout cela est bien dit et exprime à peu près les faits. Mill aurait pu continuer dans cette voie ; et puisque son étude portait sur la Liberté, Il aurait pu rechercher dans quelle relation elle se trouvait avec les motifs qu'il attribuait aux actions humaines. Il aurait ainsi fait une découverte ; il aurait vu qu'il procédait d'une façon contradictoire, en tâchant, pour autant que cela lui était possible, de faire passer le pouvoir politique au plus grand nombre, et en défendant une certaine Liberté, qui était incompatible avec les préjugés, les sentiments, les intérêts, etc., de ce plus grand nombre. Cette découverte lui aurait aussi permis de faire une prévision ; ce qui est le but essentiel de la science. Il aurait pu prévoir que la Liberté, telle qu'il la concevait, devait aller en diminuant, parce qu'elle était contraire aux motifs qu'il considérait comme déterminant les désirs de la classe qui était sur le point de devenir dominante.
§ 299. Mais Mill s'occupait moins de ce qui était, que de ce qui devait être. Il nous dit : « (p. 109) Un homme ne peut pas, en bonne justice, être obligé d'agir ou de s'abstenir, parce que ce serait meilleur pour lui, parce que cela le rendrait plus heureux, ou parce que dans l'opinion des autres, ce serait sage ou même juste. Ce sont de bonnes raisons pour lui faire des remontrances, pour raisonner avec lui, pour le convaincre ou pour le supplier, mais non pour le contraindre ou pour lui causer aucun dommage s'il passe outre [FN: § 299-1] ».
Il se peut que ce soit une bonne justice ; mais ce n'est malheureusement pas celle de nos maîtres, qui nous gratifient chaque année de nouvelles lois, précisément pour empêcher de faire ce que Mill disait qu'on devait laisser faire. Son prêche a donc été parfaitement inutile.
§ 300. Chez certains auteurs, la partie des actions non-logiques disparaît entièrement, ou plutôt est considérée seulement comme la partie exceptionnelle du mal. La logique seule constitue un moyen de progrès humain ; elle est synonyme de « bien », de même que tout ce qui n'est pas logique est synonyme de « mal ». Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom de logique. Cette croyance n'a rien à faire avec la science logico-expérimentale : et le culte de la raison peut aller de pair avec un autre culte religieux quelconque, y compris celui des fétiches.
§ 301. Condorcet s'exprime ainsi : « (p. 250) [FN: § 301-1]Ainsi une connaissance générale des droits naturels de l'homme, l'opinion même que ces droits sont inaliénables et imprescriptibles, un vœu fortement prononcé pour la liberté de penser et d'écrire, pour celle du commerce et de l'industrie, pour le soulagement du peuple,... l'indifférence pour les religions, placées enfin au nombre des superstitions ou des inventions politiques, [le pauvre homme ne s'aperçoit pas que son adoration du Progrès est une religion !] la haine de l'hypocrisie et du fanatisme, le mépris des préjugés, le zèle pour la propagation des lumières,... devinrent la profession commune, le symbole de tous ceux qui n'étaient ni machiavélistes ni imbéciles ». L'auteur, qui prêche la tolérance religieuse, ne s'aperçoit pas qu'il donne une preuve d'intolérance, en traitant les dissidents de sa religion du Progrès comme les orthodoxes ont toujours traité les hérétiques. Il est vrai qu'il estime avoir raison et pense que ses adversaires ont tort, parce que sa religion est bonne et la leur mauvaise ; mais c'est justement ce que ceux-ci disent, en intervertissant les termes.
§ 302. Nous trouvons, chez Condorcet et chez d'autres auteurs, ses contemporains, des maximes que répètent aujourd'hui encore les humanitaires fanatiques. Condorcet dit ensuite [FN: § 302-1] : « (p. 292) Toutes les erreurs en politique, en morale, ont pour base des erreurs philosophiques, qui elles-mêmes sont liées à des erreurs physiques. Il n'existe ni un système religieux, ni une extravagance surnaturelle, qui ne soit fondée sur l'ignorance des lois de la nature ». Mais lui-même fait preuve de cette ignorance, quand il veut nous faire avaler des absurdités comme la suivante [FN: § 302-2]: « (p. 345) Quelle est l'habitude vicieuse, l'usage contraire à la bonne foi, quel est même le crime, dont on ne puisse montrer l'origine, la cause première, dans la législation, dans les institutions, dans les préjugés du pays où l'on observe cet usage, cette habitude, où ce crime s'est commis ?» Il conclut enfin : « (p. 346) que la nature lie, par une chaîne indissoluble, la vérité, le bonheur et la vertu ».
§ 303. De semblables idées sont communes parmi les philosophes français de la fin du XVIIIe siècle. Pour eux, tout bien vient de la « raison » ; tout mal, de la « superstition ». D'Holbach [FN: § 303-1] voit dans l'« erreur », la source de tous les maux humains. C'est resté un dogme pour la sacro-sainte religion humanitaire [FN: § 303-2]dont les « intellectuels » sont les prêtres.
§ 304. Tous ces gens ne s'aperçoivent pas que le culte de la Raison, de la Vérité, du Progrès et d'autres entités semblables, fait partie, comme tous les cultes, des actions non-logiques. Il est né, s'est développé et continue à prospérer, pour combattre les autres cultes ; de même que dans la société païenne, les cultes orientaux surgirent par réaction contre le culte polythéiste gréco-romain.
Un même courant d'actions non-logiques se manifestait alors par le taurobole et le criobole, par le culte de Mithra, par l'importance accrue des mystères, par le néoplatonisme, par le mysticisme et finalement par le christianisme, qui devait l'emporter sur les cultes rivaux, tout en leur empruntant beaucoup. De même, vers la fin du XVIIIe siècle et le commencement du XIXe un même courant d'actions non-logiques se manifeste par le théisme des philosophes, les divagations sentimentales de Rousseau, le culte de la Raison, de l'Être suprême, le culte décadaire, la théophilanthropie, dont la religion positiviste de A. Comte n'est en somme qu'un simple rameau, la religion saint-simonienne, la religion pacifiste, et d'autres qui existent encore de notre temps.
Ces considérations font partie d'un ordre beaucoup plus étendu, qui est proprement celui de l'aspect subjectif des théories, indiqué au § 13. C'est-à-dire qu'en général il faut se demander pourquoi et comment les sujets produisent et acceptent certaines théories. En particulier, après avoir déterminé l'un de leurs buts, qui est de donner le caractère logique aux actions qui ne l'ont pas, il faut rechercher par quels moyens on atteint ce but. Au point de vue objectif, l'erreur des raisonnements indiqués tout à l'heure consiste à donner une réponse a priori aux questions du § 14, et à croire qu'il suffit qu'une théorie soit d'accord avec les faits, pour qu'elle soit utile à la société. Il s'y ajoute d'habitude l'erreur de considérer les faits, non pas comme ils sont en réalité, mais tels que se les figure la fantaisie exaltée d'un auteur.
§ 305. L'induction suivie jusqu'à présent nous a fait voir, dans quelques cas particuliers, qu'il existe une tendance à éliminer la considération des actions non-logiques, considération qui s'impose pourtant à l'esprit de qui entreprend de raisonner sur les sociétés humaines ; elle nous montre en outre que la question n'est pas de petite importance. C'est pourquoi nous devons nous en occuper maintenant avec soin et d'une façon générale. Plus loin, au chapitre IX, nous aurons à envisager un sujet plus général encore, soit les raisonnements variables auxquels sont enclins les hommes, poussés par certains de leurs sentiments, et leur manie de recouvrir les actions non-logiques d'un vernis logique.
Cette manière de suivre la méthode inductive fait que le problème particulier se présente à nous avant le problème général ; puis, étudier d'abord le problème particulier a cet inconvénient de nous obliger à répéter des choses que nous exposons ici ; mais d'autre part, l'induction a cet avantage de rendre plus clair et plus aisé le sujet qu'on étudie.
§ 306. Donc, procédons maintenant à l'étude des moyens par lesquels on élimine les actions non-logiques, pour ne conserver que les logiques ; et, comme d'habitude, commençons par classer les objets que nous voulons étudier.
CLASSE A. On suppose que les principes [FN: § 1]des actions non-logiques sont dénués de toute réalité objective (§ 307-318).
Genres.
I. On les néglige entièrement (§ 307-308).
II. On les considère comme des préjugés absurdes (§ 309-311).
III.On les considère comme des artifices (§ 312-318).
CLASSE B. On suppose que les principes des actions non-logiques participent peu ou beaucoup à la réalité objective (§ 319-351).
Genres et sous-genres.
Genre I. La réalité objective est entière et directe (§ 319-338).
(I α) Préceptes avec sanction en partie imaginaire (§ 321-333).
(I β)Intervention d'un dieu personnel ou d'une abstraction personnifiée (332-333).
(I γ ) À la simple intervention considérée dans le sous-genre précédent, on ajoute des légendes et des déductions logiques (§ 334).
(I δ )La réalité est assimilée à une entité métaphysique (§ 335-336).
(I ε)La réalité se trouve dans l'accord des principes avec certains sentiments (§ 337-338).
Genre II. La réalité objective n'est ni entière ni directe. On la trouve indirectement dans des faits qui sont réputés mal observés ou mal connus (§ 339-350).
(II α) On suppose que les hommes font des observations imparfaites, dont ils déduisent logiquement les conséquences (§ 340-346).
(II β)Un mythe est le reflet d'une réalité historique cachée de diverses manières, ou bien une simple imitation (§ 347-349).
(II γ ) Un mythe se compose de deux parties : d'un fait historique et d'une adjonction imaginaire (§ 350).
Genre III. Les principes des actions non-logiques ne sont que des allégories (§ 351-352).
636.
Examinons ces diverses catégories.
§ 307. A-I. On peut négliger entièrement les actions non-logiques comme n'appartenant pas à la réalité. C'est ce que fait le Socrate de Platon [FN: § 307-1] , à propos du culte national. On lui demande ce qu'il pense du rapt d'Orithye, fille d'Erechthée, commis par Borée. Il répond en repoussant d'abord l'interprétation logique des gens qui veulent trouver un fait réel dans le mythe (II γ) ; puis il exprime l'avis que ces recherches sont aussi subtiles qu'inutiles, et s'en remet à la croyance populaire sur ce point. C'est à elle que se référait l'oracle de Delphes [FN: § 307-2], quand il prescrivait comme meilleur moyen d'honorer les dieux, celui de suivre l'usage de la cité à laquelle on appartenait. Il n'entendait pas le moins du monde dire que ces usages correspondaient à des choses irréelles ; mais en fait, c'était comme s'ils avaient été tels, puisqu'ils étaient entièrement soustraits aux vérifications imposées aux faits réels. Il convient d'ajouter que cette façon de considérer les croyances conduit souvent à les envisager comme des actions non-logiques, que l'on ne cherche pas à expliquer, que l'on accepte sans autre, comme elles sont, en cherchant seulement quelles relations elles peuvent avoir avec d'autres faits sociaux. Cette attitude est celle de nombreux hommes d'État, soit ouvertement, soit secrètement.
§ 308. Ainsi, dans l'ouvrage de Cicéron De Natura Deorum, le pontife Cotta sépare l'homme d'État du philosophe. Comme pontife, il proteste qu'il défendra toujours les croyances, le culte, les cérémonies et la religion des ancêtres, et que jamais aucun discours d'homme de science ou d'ignorant ne lui fera changer d'avis. Il est persuadé que Romulus a fondé Rome par les auspices et Numa par le culte [FN: § 308-1] . « Voilà, Balbus, ce que je pense personnellement et comme pontife. Fais donc que je sache ce que tu penses ; car de toi, philosophe, je dois recevoir la religion en vertu de la raison ; tandis que de nos ancêtres, même sans aucune raison, je la dois croire ». Il est ici manifeste que, comme pontife, il se place volontairement en dehors de la réalité logique ; ce qui a pour conséquence ou bien que cette réalité n'existe pas, ou bien qu'elle est du genre des principes des actions non-logiques [FN: § 308-2] .
§ 309. A II. On peut ne prendre garde qu'à la forme des actions non-logiques, et ne la tenant pas pour raisonnable, les considérer comme d'absurdes préjugés, dignes tout au plus d'être étudiés au point de vue pathologique, comme de véritables maladies de la race humaine. Beaucoup d'auteurs ont adopté cette attitude, à l'égard des formalités légales et des formalités politiques, et surtout à l'égard des religions et encore plus des cultes. Telle est encore l'attitude de notre anti-cléricalisme, en face de la religion chrétienne ; ce qui révèle, chez ces sectaires, une grande ignorance, unie à un esprit étroit et incapable de comprendre les phénomènes sociaux.
Nous avons vu déjà, dans les œuvres de Condorcet (§ 301 et sv.) et de D'Holbach (§ 296[FN: § 2] , 303), des types de cette façon de raisonner ; et si c'était utile, on pourrait ajouter beaucoup d'autres citations à celles-ci. Un type extrême se voit dans les dissertations que soutiennent certaines personnes, pour rendre une religion plus scientifique (§ 15), et qui partent de l'idée qu'une religion qui n'est pas scientifique est absurde ou blâmable. C'est ainsi qu'autrefois on chercha à éliminer, par des interprétations subtiles, les parties qu'on estimait non-logiques, dans les légendes et dans le culte des dieux du paganisme. Ainsi procédèrent les protestants, au temps de la Réforme ; aujourd'hui, les protestants libéraux renouvellent leurs efforts en invoquant une pseudo-expérience. Ainsi procèdent les modernistes à l'égard du catholicisme ; ainsi se comportent les radicaux-socialistes, à l'égard du marxisme.
§ 310. Celui qui estime absurdes certaines actions non-logiques, peut avant tout s'en tenir à en considérer le côté ridicule ; et c'est une arme souvent efficace pour combattre la foi qui naît de ces actions. De Lucien à Voltaire, elle fut souvent employée contre les religions existantes. Comme exemple, voyons l'opinion qu'exprime Voltaire, au sujet de la religion romaine.
Dans un article où les erreurs historiques abondent, il dit [FN: § 310-1] :
« (p. 289) Je suppose que (p. 290) César, après avoir conquis l'Égypte, voulant faire fleurir le commerce dans l'empire romain, eût envoyé une ambassade à la Chine... L'empereur Iventi, premier du nom, régnait alors... Après avoir reçu les ambassadeurs de César avec toute la politesse chinoise, il s'informe secrètement, par ses interprètes, des usages, des sciences, et de la religion de ce peuple romain... Il apprend que cette nation entretient à grands frais un collège de prêtres, qui savent au juste le temps où il faut s'embarquer, et où l'on doit donner bataille, par l'inspection du foie d'un bœuf, ou par la manière dont les poulets mangent de l'orge. Cette science sacrée fut apportée autrefois aux Romains par un petit dieu nommé Tagès, qui sortit de terre en Toscane. Ces peuples adorent un dieu unique qu'ils appellent toujours Dieu très grand et très bon. Cependant ils ont bâti un temple à une courtisane nommée Flora, et les bonnes femmes de Rome ont presque toutes chez elles de petits dieux pénates hauts de quatre à cinq pouces. Une de ces petites divinités est la déesse des tétons, l'autre celle des fesses... L'empereur se met à rire : les tribunaux de Nankin pensent d'abord avec lui que les ambassadeurs romains sont des fous ou des imposteurs... mais comme l'empereur est aussi juste que poli, il a des conversations particulières avec les ambassadeurs... On lui avoue que le collège des augures a été établi dans les premiers temps de la barbarie, qu'on a laissé subsister une institution ridicule devenue chère au peuple longtemps grossier, que tous les honnêtes gens se moquent des augures ; que César ne les a jamais consultés ; qu'au rapport d'un très grand homme, nommé Caton, jamais augure n'a pu parler à son camarade sans rire ; et qu'enfin Cicéron, le plus grand orateur et le meilleur philosophe de Rome, vient de faire contre les augures un petit ouvrage intitulé De la divination, dans lequel il livre à un ridicule éternel tous les auspices, toutes les prédictions, et tous les sortilèges dont la terre est infatuée. L'empereur de la Chine a la curiosité de lire ce livre de Cicéron ; ses interprètes le traduisent ; il admire le livre et la république romaine ».
§ 311. Quant à cet ouvrage et à d'autres semblables, il faut prendre garde de ne pas tomber dans l'erreur que nous relevons au sujet des actions non-logiques [FN: § 311-1] . La valeur intrinsèque de ces ouvrages peut être nulle, au point de vue de la vérité expérimentale, et leur valeur polémique très grande. Ce sont là des choses qu'il faut toujours distinguer. Il peut en outre y avoir une certaine valeur intrinsèque, qui a les origines suivantes. Un ensemble d'actions non-logiques peut convenir pour atteindre un but donné, sans que proprement aucune d'elles, séparée des autres, convienne à ce but. Certaines actions ridicules peuvent être éliminées de cet ensemble, sans qu'il devienne moins efficace. Pourtant, en raisonnant ainsi, il faut prendre garde de ne pas répéter le sophisme de l'homme auquel on pouvait enlever tous les cheveux, sans qu'il fût chauve, parce que cela était vrai pour un seul cheveu.
§ 312. A-III. Après avoir posé, comme précédemment, que certaines actions ne sont pas logiques, et voulant toutefois les rendre telles, c'est-à-dire voulant que toute action humaine soit accomplie au nom de la logique, on peut affirmer que l'institution de certaines actions non-logiques est due à des personnes qui voulaient, de cette manière, obtenir leur avantage ou celui de l'État, d'une société donnée, du genre humain. Ainsi, les actions intrinsèquement non-logiques sont transformées en actions logiques, par rapport au but que l'on veut atteindre.
Celui qui suit cette voie à l'égard des actions que l'on estime utiles à la société, s'éloigne du cas extrême indiqué au § 14, dans lequel on affirme que seules, les théories d'accord avec les faits (logico-expérimentales) peuvent être utiles à la société. Il reconnaît qu'il y a des théories qui ne sont pas logico-expérimentales, et sont toutefois utiles à la société ; mais il ne peut se résigner à accepter qu'elles soient nées spontanément des actions non-logiques. Non, toutes les actions doivent être logiques ; donc ces théories sont, elles aussi, le fruit d'actions logiques. Celles-ci ne peuvent avoir les théories pour origine, puisqu'il est reconnu que cette origine n'est pas d'accord avec l'expérience ; mais leur but peut être le même que celui des théories dont l'expérience nous enseigne l'utilité [FN: § 312-1]pour la société. Nous avons donc la solution suivante : « Les théories qui ne sont pas d'accord avec les faits peuvent être utiles à la société, et sont par conséquent logiquement établies pour atteindre ce but ».
On remarquera que si l'on substituait, dans cette proposition, le mot conservées à établies, elle posséderait parfois une partie, grande ou petite, qui serait d'accord avec la réalité (§ 316).
§ 313. L'idée que les actions non-logiques ont été logiquement établies en vue d'un certain but, est admise par un très grand nombre d'auteurs.
Même Polybe [FN: § 313-1], qui est pourtant un auteur d'une grande sagacité, parle de la religion des Romains comme si elle devait son origine à des artifices.
Et pourtant lui-même a reconnu que les Romains sont arrivés à constituer leur république, non par des choix raisonnés, mais en se laissant guider par les événements [FN: § 313-2] .
§ 314. Comme type de cette interprétation, on peut citer la manière dont Montesquieu envisage la religion romaine [FN: § 314-1] . « (p. 179) Ce ne fut ni la crainte, ni la piété, qui établit la religion chez les Romains, mais la nécessité où sont toutes les sociétés d'en avoir une... Je trouve cette différence entre les législateurs romains et ceux des autres peuples, que les premiers firent la religion pour l'État, et les autres l'État pour la religion. Romulus, Tatius et Numa asservirent les dieux à la politique : le culte et les cérémonies qu'ils instituèrent furent trouvés si sages, que, lorsque les rois furent chassés, le joug de la religion fut le seul dont ce peuple, dans sa fureur pour la liberté, n'osa s'affranchir ».
« Quand les législateurs romains établirent la religion, ils ne pensèrent point à la réformation des mœurs, ni à donner des principes de morale,... Ils n'eurent donc d'abord qu'une vue générale, qui était d'inspirer à (p. 180) un peuple qui ne craignait rien, la crainte des dieux, et de se servir de cette crainte pour le conduire à leur fantaisie ».
Plus loin:
« (p. 181) C'était, à la vérité, une chose très-extravagante de faire dépendre le salut de la république de l'appétit sacré d'un poulet, et de la disposition des entrailles des victimes ; mais ceux qui introduisirent ces cérémonies en connaissaient bien le fort et le faible, et ce ne fut que par de bonnes (p. 182) raisons qu'ils péchèrent contre la raison même. Si ce culte avait été plus raisonnable, les gens d'esprit en auraient été la dupe aussi bien que le peuple, et par là on aurait perdu tout l'avantage qu'on en pouvait attendre... ».
§ 315. Il est singulier que Voltaire et Montesquieu aient suivi des voies opposées, mais également erronées, et qu'aucun des deux n'ait pensé à un développement spontané d'actions non-logiques.
§ 316. Le genre d'interprétation que nous examinons ici contient parfois une part de vérité, non quant à l'origine des actions non-logiques, mais à l'égard du but auquel elles peuvent tendre, lorsqu'elles sont devenues usuelles. Alors il est naturel que les gens avisés s'en servent à leurs propres fins, comme ils se servent de n'importe quelle autre force sociale. L'erreur consiste à croire que ces forces aient été créées artificiellement (§ 312) [FN: § 316-1].
Un exemple contemporain fera mieux comprendre le fait. Il y a certainement des charlatans qui tirent avantage du spiritisme ; mais il serait absurde de supposer que seuls les artifices des charlatans aient produit le spiritisme.
§ 317. La théorie de Van Dale, qui ne voit autre chose que des artifices, dans les oracles des Gentils, fait partie de ce genre d'interprétations. Eusèbe oscille entre cette interprétation et celle qui veut que les oracles soient œuvre des démons. De semblables mélanges d'interprétations sont fréquents. Nous reviendrons sur ce sujet.
§ 318. Font encore partie de ce genre les interprétations qui placent les actions non-logiques parmi les conséquences d’une doctrine exotérique, qui sert à masquer une doctrine ésotérique. Ainsi, les actions apparemment non-logiques sont en réalité logiques. Comme exemple, rappelons le suivant, emprunté au Dialogo dei massimi sistemi de Galilée:
« (p. 15) Salviati. Que les Pythagoriciens eussent en très grande estime la science des nombres... je le sais fort bien, et je ne serais pas loin de porter là-dessus le même jugement ; mais que les mystères au nom desquels Pythagore et sa secte avaient en si grande vénération la science des nombres, soient les absurdités dont écrit et parle le vulgaire, je n'y crois en aucune manière ; car je sais au contraire qu'afin que les choses admirables ne fussent pas exposées aux disputes et au mépris de la plèbe, ils condamnaient comme un sacrilège la publication des propriétés les plus cachées des nombres et des quantités incommensurables et irrationnelles qu'ils étudiaient, et prêchaient que celui qui les avait révélées était tourmenté dans l'autre monde. Je pense que certain d'entre eux, pour jeter de la poudre aux yeux de la plèbe, et se débarrasser de ses demandes, lui disait que leurs mystères des nombres étaient ces enfantillages qui se répandirent ensuite parmi le peuple ; cela avec une malice et une perspicacité semblables à celle du jeune homme sagace (p. 16) qui, pour échapper à l'importunité – je ne sais si c'était de sa mère ou de sa femme curieuse, qui l'obsédait pour qu'il lui confiât les secrets du Sénat, – composa cette histoire qui la ridiculisa ensuite, ainsi que beaucoup d'autres femmes, à la grande joie du Sénat ».
Que les Pythagoriciens aient parfois caché leur doctrine, cela paraît certain. Mais il ne semble pas du tout que ce fût le cas pour leurs idées sur la perfection de certains nombres ; et en cela Galilée est dans l'erreur (§ 960 et sv.)
§ 319. (B-I) Ce cas extrême reconnaît la nature des actions non-logiques, et ne devrait donc pas figurer parmi les procédés tendant à faire paraître logiques les actions non-logiques ; mais nous devons le considérer comme un point de départ de beaucoup de ces procédés. C'est donc pour ce motif que nous en traitons maintenant.
On observe ce genre dans les actions religieuses accomplies par qui est animé d'une foi aveugle. Dans ce cas, elles ne diffèrent que peu ou pas du tout des autres actions logiques. Celui qui est persuadé que pour obtenir une bonne navigation, il faut sacrifier à Poséidon et avoir un navire qui ne fasse pas eau, accomplit le sacrifice et aveugle les voies d'eau, exactement de la même façon.
§ 320. Il faut remarquer que ces doctrines s'approchent parfois plus que d'autres des doctrines scientifiques, dont elles ne diffèrent que par une adjonction : celle de la réalité d'un principe imaginaire ; tandis que beaucoup d'autres, outre cette adjonction, diffèrent des doctrines scientifiques par leurs déductions fantaisistes ou dépourvues de toute précision.
§ 321. (B-I α 668.) Ce genre comprend des interprétations obtenues par une adjonction au type simple du précepte sans sanction ou tabou. Le type simple ne fait pas partie du genre, parce qu'il ne repousse pas, mais admet la considération des actions non-logiques ; c'est même justement dans ce type simple qu'elles se voient le mieux.
§ 322. S. Reinach écrit [FN: § 322-1]:
« (p. 1) Un tabou est une interdiction ; un objet tabou ou taboué est un objet interdit. L'interdiction peut porter sur le contact corporel ou sur le contact visuel ; elle peut aussi soustraire l'objet tabou à ce genre particulier de violation qui consiste à le nommer... on trouve des interdictions analogues en Grèce, à Rome et chez un grand nombre de peuples, où on les explique généralement par l'idée que la connaissance d'un nom permettait (p. 2) d'évoquer, dans une intention nocive, la puissance qu'il désigne. Cette explication a pu être vraie à certaines époques, mais n'est sans doute pas primitive ; à l'origine, c'est la sainteté même du nom qui est redoutée, au même titre que le contact d'un objet tabou ».
Reinach a raison d'envisager comme une adjonction la considération du pouvoir que la connaissance du nom donnerait sur la chose ; mais la considération de la sainteté est aussi une adjonction. Bien plus, la majeure partie de ceux qui respectèrent ce tabou ne savaient peut-être pas ce qu'était l'abstraction qu'on appelle sainteté. Pour eux, le tabou est simplement une action non-logique ; c'est la répugnance à toucher, à regarder, à nommer la chose tabou. On cherche ensuite à expliquer, à justifier cette répugnance ; et alors on invente ce pouvoir dont parle Reinach : la sainteté.
Notre auteur continue : « (p. 2) La notion du tabou est plus étroite que celle de l'interdiction. Le premier caractère qui les distingue, c'est que le tabou n'est jamais motivé ». Parfaitement ; voilà bien le caractère des actions non-logiques ; mais c'est justement pourquoi Reinach ne devait pas, dans un cas spécial, motiver le tabou par la considération de la sainteté.
Reinach continue: « (p. 2... ) on énonce la défense en sous-entendant la cause, qui n'est autre que le tabou lui-même, c'est-à-dire l'annonce d'un péril mortel ». Ainsi, il retire la concession qu'il a faite, et veut rentrer dans le domaine des actions logiques.
On ne sous-entend pas la cause. Le tabou consiste dans la répugnance absolue de faire une certaine chose. Si nous en voulons un exemple parmi nos contemporains, regardons certaines personnes sensibles qui, pour rien au monde, ne voudraient égorger un poulet. Là, il n'y a pas de cause ; il y a une répugnance, et cela suffit pour empêcher d'égorger le poulet. Ensuite, on ne sait pas pourquoi Reinach veut que la peine de la transgression du tabou soit toujours un péril mortel. Lui-même donne des exemples du contraire ; tel celui que nous rappellerons tout à l'heure. En continuant son exposé, Reinach rentre de nouveau dans le domaine des actions non-logiques, et observe que « (p. 2) Les tabous qui se sont perpétués dans les civilisations contemporaines sont souvent énoncés avec des motifs à l'appui ; mais ces motifs ont été imaginés à une date relativement récente [on ne saurait mieux dire] et portent le cachet d'idées modernes. Ainsi l'on dira : « Parler bas dans une chambre mortuaire [voilà un tabou dont rien n'indique que la sanction fût un péril mortel], pour ne pas manquer au respect dû à la mort », alors que le tabou primitif consiste à fuir non seulement le contact, mais le voisinage d'un cadavre [les preuves d'un péril mortel font toujours défaut]. Cependant, même aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, on énonce des tabous sans les motiver, ou en se contentant de spécifier le genre d'interdiction : « Ne lève pas la chemise, parce que c'est inconvenant ». Hésiode, dans Les travaux et les jours (v. 725), interdit de lâcher l'eau en se tournant vers le soleil, mais n'allègue pas les motifs de cette défense [type de l'action non-logique] ; la plupart des tabous relatifs aux bienséances se sont transmis de siècle en siècle sans considérants ». Et sans la menace d'un péril mortel !
Ici nous avons envisagé les sanctions du tabou comme un moyen de rendre logiques les actions non-logiques ; plus loin nous les considérerons comme un moyen employé pour persuader d'observer le tabou.
Il convient de mettre avec les tabous d'autres phénomènes semblables, où l'interprétation logique est réduite au minimum.
§ 323. W. Marsden [FN: § 323-1]dit des mahométans de Sumatra: « (p. 100) Plusieurs de ceux qui professent cette religion ne se mettent nullement en peine de ses préceptes, ou même ne les connaissent pas. Un Malais reprochait à un homme du Passumah l'ignorance totale de la religion dans laquelle sa nation était plongée : « Vous honorez – lui disait-il – les tombeaux de vos ancêtres : quelle raison avez-vous de supposer que vos ancêtres peuvent vous donner quelque assistance ? » « Cela peut être vrai –répondit l'autre – mais quelle raison avez-vous vous-même d'attendre l'assistance d'Allah (Dieu) et de Mahomet ? » « N'avez-vous pas lu – répliqua le Malais – ce qui est écrit dans un livre ? N'avez-vous pas entendu parler du Koran ? » L'habitant du Passumah, sentant son infériorité, se soumit à la force de cet argument ». Nous verrons plus loin d'autres cas semblables (§ 1430 et sv.). Ceci est la semence qui germe et donne de copieuses moissons d'interprétations logiques, dont nous trouverons une partie dans les autres sous-genres.
§ 324. Le précepte est semblable au tabou. Le premier peut être donné sans sanction: « Fais cela ». C'est ainsi une simple action non-logique. Déjà quand on dit : « Tu dois faire cela », il y a un petit, quelquefois très petit essai d'explication. Elle est contenue dans le terme Tu dois, qui rappelle l'entité mystérieuse du Devoir. Souvent on ajoute une sanction réelle ou imaginaire, et l'on a des actions effectivement logiques, ou qu'on fait seulement passer pour telles. Par conséquent, seule, une partie des préceptes peut prendre place parmi les choses que nous classons maintenant.
§ 325. En général, on peut distinguer les préceptes de la façon suivante.
(a ) Précepte pur, sans motif ni démonstration. La proposition n'est pas elliptique. On ne donne pas de démonstration, parce qu'il n'y en a pas ou qu'elle n'est pas réclamée. On a ainsi le type pur des actions non-logiques. Mais les hommes ont une telle manie d'explications logiques, qu'habituellement ils en ajoutent une, même si elle est puérile. « Fais cela » est un précepte. Si l'on demande: « Pourquoi dois-je faire cela ? », on répond par exemple: « Parce qu'on fait ainsi [FN: § 325-1]». C'est une adjonction logique de bien peu de valeur, excepté quand la transgression de l'usage emporte une peine : mais, dans ce cas, la peine est le motif logique, et non plus l'usage.
§ 326. (b) La démonstration est elliptique. Il y a une démonstration, valable ou non ; elle a été supprimée, mais peut être rétablie. La proposition n'a que l'apparence d'un précepte. On peut supprimer les termes : tu dois, il faut, ou autres semblables, et ramener le précepte à un théorème expérimental ou pseudo-expérimental, la conséquence étant engendrée par l'action sans intervention étrangère. Le type de ce genre de préceptes est le suivant : « Pour obtenir A, il faut faire B »; ou bien, sous forme négative : « Si l'on ne veut pas A, on ne doit pas faire B ». La première proposition est équivalente à la suivante : « Quand on a fait B, il en résulte A » ; de même pour la seconde.
§ 327. Si A et B sont tous deux des choses réelles, et si vraiment leur lien est logico-expérimental, on a des propositions scientifiques. Elles sont étrangères aux choses que nous classons maintenant. Si le lien n'est pas logico-expérimental, ce sont des propositions pseudo-scientifiques. Une partie sert à rendre logiques des actions non-logiques. Par exemple, si A est une bonne navigation et B, les sacrifices à Poséidon, le lien est imaginaire, et l'action non-logique B est justifiée par ce lien qui l'unit à A. Mais si, au contraire, A est une bonne navigation et B la construction défectueuse du navire, nous avons seulement une proposition scientifique erronée, puisque la construction défectueuse n'est pas une action non-logique [FN: § 327-1] .
§ 328. Si A et B sont tous deux imaginaires, nous sommes entièrement en dehors du domaine expérimental, et nous n'avons pas à parler de ces propositions. – Si A est imaginaire et B une chose réelle' nous avons des actions non-logiques B, justifiées par le prétexte A.
§ 329. (c) La proposition est réellement un précepte, mais on y ajoute une sanction réelle, due à une cause étrangère et réelle. On a ainsi des actions logiques. On fait la chose pour éviter la sanction.
§ 330. (d) La proposition est comme précédemment un précepte, mais la sanction est imaginaire ou imposée par une puissance imaginaire. Nous avons des actions non-logiques, justifiées par cette sanction. De plus amples explications seront données dans la suite (chap. IX).
§ 331. Les termes du langage ordinaire ont rarement un sens bien défini. Le terme sanction peut avoir un sens plus ou moins large. Ici nous l'avons pris dans un sens restreint. Si on voulait le prendre dans un sens large, on pourrait dire que la sanction existe toujours. Par exemple, pour les propositions scientifiques, la sanction pourrait être le plaisir de bien raisonner, le désagrément de raisonner mal. Mais c'est perdre son temps que s'arrêter à de telles subtilités.
§ 332. (B-I β) L'intervention d'un dieu personnel nous donne une adjonction assez simple au tabou ou au précepte pur ; de même une personnification, comme la Nature, dont la volonté impose aux hommes des actions non-logiques, qui sont ainsi logiquement expliquées. La manière dont elles sont imposées demeure parfois obscure. « Un dieu, la Nature veulent que l'on fasse ainsi ». « Et si on ne le faisait pas ? » Cette question demeure sans réponse. Mais souvent, au contraire, on y répond ; et l'on affirme que le dieu, la Nature puniront celui qui trangresse le précepte. Dans ce cas, on a un précepte avec sanction, de l'espèce (d ).
§ 333. Quand les Grecs disaient que « les étrangers et les mendiants viennent de Zeus [FN: § 333-1]», ils manifestaient simplement leur inclination à les bien accueillir, et Zeus n'intervenait que pour donner un vernis logique à cette action, soit que l'on interprétât le bon accueil comme un signe de respect pour Zeus, soit qu’on l'admît comme un moyen d'éviter le châtiment que Zeus réservait à qui transgressait le précepte.
§ 334. (B-I γ). Il est rare que l'adjonction précédente ne se complète pas de nombreuses légendes et déductions logiques. Ces nouvelles adjonctions nous donnent les mythologies et les théologies, qui s'éloignent toujours plus de l'idée des actions non-logiques. Il convient d'observer que les théologies quelque peu développées n'appartiennent qu'à une classe restreinte de personnes ; qu'elles nous font sortir du domaine des interprétations populaires et nous transportent dans celui des interprétations des gens cultivés.
À ce sous-genre appartiennent les interprétations des Pères de l'Église chrétienne, qui estimaient que les dieux païens étaient des démons.
§ 335. (B-I δ). La réalité est attribuée non plus à an dieu personnel ou à une personnification, mais à une abstraction métaphysique. Le vrai, le bien, le beau, la vertu, l'honnête, la morale, le droit naturel, l'humanité, la solidarité, le progrès ou les abstractions contraires ordonnent ou défendent certaines actions, qui deviennent ainsi conséquences logiques de ces abstractions. Nous entrerons plus loin dans les détails (1510 et sv.).
§ 336. Dans les interprétations (B-1 β), le dieu personnel peut infliger un châtiment, parce que telle est sa volonté, et la Nature, comme conséquence spontanée de l'action. L'interprétation est donc passablement logique. Mais les abstractions métaphysiques interviennent au contraire d'une façon peu ou point logique. Si l'on dit à quelqu'un : « Tu dois faire cela, parce que c'est bien », et s'il répond: « Je ne veux pas faire le bien », on reste désarmé, parce que monseigneur le bien ne lance pas la foudre comme Zeus.
De même, les néo-chrétiens conservent le dieu de la Bible, mais le dépouillent de toute arme. Il n'y a guère à plaisanter avec le dieu de la Bible, qui venge durement les transgressions à ses lois [FN: § 336-1], ou avec le dieu de saint Paul, qui est tout aussi redoutable [FN: § 336-2] ; mais les néo-chrétiens, en vertu des abstractions de leur pseudo-expérience, de quoi peuvent-ils bien menacer le mécréant ? de quoi peuvent-ils promettre de récompenser le croyant ? De rien. Les actions qu'ils recommandent sont simplement des actions non-logiques. Cela ne veut pas dire qu'elles ne conviennent pas autant que d'autres, et même mieux que d'autres, à l'individu, à la collectivité. Cela peut être ou non ; mais il est certain que ce ne sont pas des déductions logiques d'un principe, comme sont celles qui concluent à la punition des mécréants et à la récompense des croyants, par la volonté et la puissance divine.
§ 337. (B-I ε). La réalité se trouve dans l'accord des principes avec certains sentiments. Cette façon d'envisager les faits est plutôt implicite qu'explicite. Ainsi, pour certains néo-chrétiens, la réalité de Christ paraît consister dans l'accord de l'idée qu'ils ont de Christ avec certains de leurs sentiments. Ils sortent du domaine objectif, abandonnent entièrement le caractère divin de Christ, et ne paraissent pas s'inquiéter beaucoup de sa réalité historique. Ils se contentent d'affirmer que c'est le type le plus parfait de l'humanité. Ce qui veut dire qu'ils accordent les idées qu'ils ont du Christ et celles du type le plus parfait de l'humanité, d'après leurs sentiments. Lancés sur cette voie, ils finissent par laisser entièrement de côté toute théologie, tout culte, et aboutissent à l'affirmation que « la religion est une vie [FN: § 337-1] ».
§ 338. De cette manière, ils se rapprocheraient de l'idée des actions non-logiques ; mais ils ne s'en séparent pas moins radicalement, parce qu'ils recherchent non pas ce qui est, mais ce qui doit être, et parce qu'ils ôtent à ce devoir le caractère de subordination, (§ 326) qu'on pourrait admettre aussi dans certains cas, et le rendent au contraire absolu, de manière à nous mettre tout à fait en dehors du domaine expérimental. Au fond, leurs théories n'ont d'autre but que de donner une teinte logique à des actions non-logiques.
§ 339. (B-II) La réalité n'est plus directe; c'est-à-dire qu'on n'a plus un dieu, une personnification, une abstraction, etc., dont nous puissions logiquement déduire les actions non-logiques. On admet que celles-ci se sont produites spontanément, par des faits bons ou mauvais, sur des faits plus ou moins bien observés. La différence avec le genre précédent est radicale ; car, tandis que dans le premier on attribue la réalité à des entités extérieures au domaine expérimental, dans ce genre-ci, les entités admises appartiennent à ce domaine. Il n'y a doute que sur le point de savoir si elles ont vraiment été observées, et si l'on en a bien tiré les conséquences admises. « Zeus nous envoie les mendiants » est une interprétation du 1er genre. Je crée une entité, Zeus, que je suppose réelle, et de son existence je tire certaines conséquences. « Celui qui traite bien les mendiants sera heureux » est une interprétation du IIe genre. Je suppose avoir observé que celui qui traita bien les mendiants fut heureux, et j'en tire la conséquence qu'en continuant à le faire, il continuera à être heureux. Je n'ai créé aucune entité. J'envisage des faits réels, et je les combine arbitrairement.
§ 340. (B-II α) Cette manière de raisonner a pour but de rejeter sur les prémisses le défaut logico-expérimental qu'on ne peut nier. Nous avons certaines conclusions qui sont manifestement en contradiction avec la science logico-expérimentale. Nous pouvons l'expliquer en disant que le raisonnement qui les donne n'est pas logique. Ainsi, nous voilà dans le domaine des actions non-logiques. Ou bien nous pouvons admettre que le raisonnement est logique ; mais que, partant de prémisses en contradiction avec la science logico-expérimentale, il conduit à des conclusions où l'on trouve de même cette contradiction ; et de cette façon, nous restons dans le domaine des actions logiques.
Les théories de H. Spencer fournissent le type de ce genre. Nous les avons exposées aux §289 et sv. La part des actions non-logiques est réduite au minimum et peut même disparaître. L'observation de certains faits serait à l'origine de certains phénomènes. On admet que les hommes ont tiré des conséquences de ces observations hypothétiques, en raisonnant à peu près comme nous pouvons raisonner de nos jours ; et l'on obtient ainsi les doctrines de ces hommes et les motifs de leur façon de procéder.
§ 341. Des concepts semblables jouent un rôle, important ou effacé, dans presque toutes les théories qui recherchent « l'origine » des phénomènes sociaux, tels que la « religion », la « morale », le « droit », etc. Les auteurs se résignent à admettre les actions non-logiques, mais ont soin de les refouler autant que possible dans le passé.
§ 342. Il peut y avoir quelque chose de vrai dans ces théories, pour autant qu'elles présentent certains types simples de phénomènes complexes. L'erreur consiste à vouloir déduire le phénomène complexe du type simple ; et, ce qui est pire, à supposer que cette déduction est logique.
§ 343. Négligeons, pour un moment, la complexité des phénomènes sociaux, et supposons que certains phénomènes P que nous observons maintenant aient effectivement une origine A. Si l'évolution se produisait suivant une ligne continue ABCDP, on pourrait, au moins dans une certaine mesure, prendre comme origine ou comme cause du phénomène P l'un des phénomènes intermédiaires B, C,... Si, par exemple, en remontant aussi haut que nos connaissances historiques nous le permettent, ou trouvait un phénomène B, du genre de P, mais beaucoup plus simple, l'erreur de le considérer comme l'origine ou la cause de P, ne serait pas trop grave.
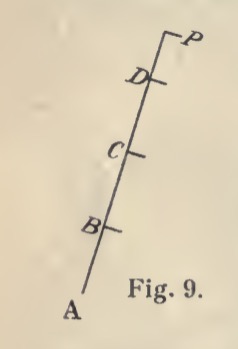
Figure 9
§ 344. Malheureusement, l'hypothèse d'une évolution suivant une ligne continue n'est pas du tout d'accord avec les faits, en ce qui concerne les phénomènes sociaux, et de même pour plusieurs phénomènes biologiques. L'évolution paraît plutôt avoir lieu suivant une ligne à nombreuses branches, comme celle de la fig. 10 ; étant donné toujours qu'on néglige la complexité des phénomènes, qui nous permet difficilement de séparer des autres un phénomène social P (§ 513).
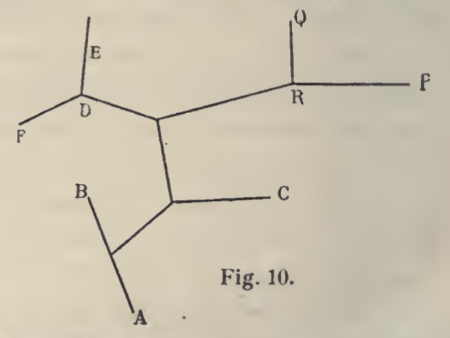
Figure 10
Les faits B, C, D,... de la fig. 9 ne sont plus sur une ligne droite et continue, mais se trouvent aux embranchements ou aux extrémités de certains rameaux ; et l'on ne peut plus supposer, pas même comme hypothèse grossièrement approchée des faits, que C , par exemple, ou E ou un autre fait semblable observé dans le passé, soit l'origine, la cause de P que nous étudions maintenant.
§ 345. Pour citer un fait concret, S. Reinach voit dans les tabous l'« origine » de la religion. Il paraît ainsi se placer dans le cas de la fig. 9. B représenterait les tabous ; P, la religion à l'état actuel. Mais, même en supposant que le phénomène religieux puisse être séparé des autres, nous serions dans le cas de la fig. 10, et les tabous B seraient l'extrémité d'une branche. On ne saurait les donner comme « l'origine » de la religion ; mais on peut les considérer comme un type simple de phénomènes dont les religions C, Q, P sont des types composés. Voilà ce qu'il y a de vrai dans les théories de Reinach. C'est d'ailleurs une chose très importante, parce qu'elle met en lumière le rôle des actions non-logiques dans les phénomènes religieux.
§ 346. Il faut observer que les recherches sur les « origines » des phénomènes sociaux sont souvent conduites à la façon de l'étymologie ancienne [FN: § 346-1] ; c'est-à-dire qu'on suppose, qu'on invente les passages intermédiaires C, D, ... (fig. 9), pour aller de B à P. Souvent et volontiers on cherche comment les faits auraient dû se produire, plutôt que la manière dont ils se sont produits. Dans ce cas, ces investigations sont en dehors de la réalité expérimentale ; mais elles ne furent pas inutiles ; car elles réussirent à faire une brèche aux théories éthiques et a priori qui expliquaient P par des principes imaginaires. Maintenant que cette opération est achevée, elles doivent faire place aux théories purement expérimentales.
§ 347. (B-II β). On laisse de côté l'origine et l'évolution et l'on admet que tout mythe est l'image déformée de quelque chose de réel. De ce genre sont les interprétations connues sous le nom d'évhémérisme, que nous étudierons plus loin (§ 682 et sv., 708). Il est certain qu'il y eut des hommes divinisés. L'erreur consiste d'abord à généraliser un fait particulier, et ensuite à confondre le point B de la fig. 9, avec le point B de la fig. 10 ; c'est-à-dire à croire que par la seule raison qu'un fait est antérieur à un autre dans le temps, il est l'origine de cet autre. Les interprétations de Palaephate, dont nous aurons à parler aussi (§ 661), font de même partie de ce sous-genre.
§ 348. En général, de semblables interprétations sont très faciles. On les obtient en changeant arbitrairement ce qu'il faut, dans le mythe, pour avoir une image réelle. Soit, par exemple, l'hippogriffe d'Astolphe, dans le Roland Furieux. On le placera dans la réalité, en interprétant la fable dans le sens que l'hippogriffe était un cheval très rapide, et que c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il avait des ailes. Dante voit Francesca et son beau-frère, emportés par la bourrasque infernale. On peut interpréter cela en disant que c'est une image de l'amour qui, semblable à un vent violent, emporta les deux amants ; et ainsi de suite. On ne rencontrera jamais la moindre difficulté (§ 661).
§ 349. On peut placer, dans ce sous-genre, les théories qui voient dans les actions non-logiques existant en une société donnée, des imitations d'autres actions non-logiques de sociétés différentes. Ainsi, à vrai dire, on n'élimine pas toutes les actions non-logiques. On en réduit seulement le nombre, en en ramenant plusieurs à l'imitation d'une seule. Plus loin, nous donnerons des exemples de ce genre d'interprétations (§ 733 et Sv.).
§ 350. (B-II γ). Dans ce sous-genre, nous approchons un peu de la réalité. On admet que dans tout mythe la légende a un noyau réel, historique, recouvert par des adjonctions fantaisistes. Il faut les enlever pour retrouver le fond dessous. De nombreux travaux ont été écrits dans cette intention. Il n'y a pas si longtemps que toutes les légendes qui nous sont parvenues de l'antiquité gréco-latine étaient traitées de cette façon. Nous aurons, dans la suite, à nous occuper de plusieurs de ces interprétations (chap. V).
Le sous-genre précédent, II β, est souvent le cas extrême de celui-ci. Dans un mythe, il peut y avoir quelque chose de réel. Ce quelque chose peut être plus ou moins grand. Quand il diminue et disparaît, on a le sous-genre II β.
§ 351. (B-III.) Les principes des actions non-logiques sont des allégories. On croit qu'en réalité ces actions sont logiques, et que, si elles paraissent non-logiques, c'est uniquement parce qu'on prend les allégories à la lettre. À ces conceptions, on peut ajouter celle qui met dans le langage la source de ces erreurs, par l'intermédiaire des allégories. Max Muller [FN: § 351-1]écrit : « (p. 84) Il y a dans Hésiode beaucoup de mythes... où nous n'avons qu'à remplacer le verbe complet par un auxiliaire, pour changer le langage mythique en langage logique. Hésiode appelle [mot Grec] (la Nuit) la mère de [mot Grec] (le Sort), et la sombre [mot Grec] (la Destruction) mère de [mot Grec] (la Mort), de [mot Grec] (le Sommeil) et de la tribu des [mot Grec] (les Rêves)... Employons nos expressions modernes, telles que : « On voit les étoiles quand la nuit approche », « nous dormons », « nous rêvons », « nous mourons », « nous courons des (p. 85) dangers pendant la nuit,.» et nous aurons traduit dans la forme moderne de la pensée et du discours le langage d'Hésiode ».
§ 352. Par conséquent tous les mythes seraient des charades. Il paraît impossible qu'une théorie si manifestement fausse ait eu autant d'adeptes. Les disciples firent encore pire que le maître, et le mythe solaire est devenu une explication commode et universelle de toutes les légendes possibles.
§ 353. CLASSE C. En réalité, dans cette classe, les actions non-logiques ne sont pas interprétées dans le but d'être rendues logiques ; elles sont éliminées ; il ne reste ainsi que des actions logiques. De cette manière, on arrive également à réduire tout à des actions logiques. Ces opinions sont très communes à notre époque, et deviennent même facilement un article de foi pour beaucoup de personnes, qui adorent une puissante déesse qu'elles appellent Science. Bon nombre d'humanitaires appartiennent à cette catégorie.
§ 354. D'autres personnes raisonnent mieux. Après avoir observé, avec raison, combien la science a été utile à la civilisation, elles poussent plus loin, et veulent montrer que tout ce qui n'est pas science ne peut être utile. Comme type de ces théories on peut citer le célèbre raisonnement de Buckle [FN: § 354-1]:
« (p, 199).il est évident que, prenant le monde dans son ensemble, la conduite morale et intellectuelle des hommes est gouvernée par les notions morales et intellectuelles qui dominent à leur époque.Or il suffit d'une connaissance superficielle de l'histoire (p. 200) pour savoir que ce modèle change constamment. Cette extrême mutabilité du modèle ordinaire sur lequel les hommes règlent leurs actions démontre que les conditions dont dépend ce modèle doivent être elles-mêmes très instables : or ces conditions, quelles qu'elles soient, sont évidemment la cause originelle de la conduite intellectuelle et morale de la plus grande partie des hommes. Voici donc une base qui nous permettra de marcher sûrement. Nous savons que la cause principale des actions des hommes est extrêmement variable ; nous n'avons donc qu'à faire passer par cette épreuve toute circonstance que l'on soupçonne d'être cette cause ; et si nous trouvons que ces circonstances ne sont pas très variables, nous devons conclure qu'elles ne sont pas la cause que nous cherchons à découvrir.
« En soumettant à la même épreuve les motifs de la morale, ou les préceptes de ce qu'on appelle l'instinct moral, nous verrons tout de suite combien petite est l'influence que ces motifs ont exercée sur les progrès de la civilisation. Car, sans conteste, l'on ne trouvera rien au monde qui ait subi aussi peu de changement que ces grands dogmes qui composent le système moral. Faire du bien à autrui... (p. 201). Mais si nous comparons cet aspect stationnaire des vérités morales avec l'aspect progressif des vérités intellectuelles, la différence est vraiment surprenante [FN: § 354-2] . Tous les grands systèmes de morale qui ont exercé beaucoup d'influence ont (p. 202) tous été fondamentalement les mêmes ; tous les grands systèmes intellectuels ont été fondamentalement différents... Puisque la civilisation est le produit de causes morales et intellectuelles, et que ce produit change sans cesse, évidemment il ne saurait être régi par l'agent stationnaire ; car, les circonstances ambiantes ne changeant pas, l'agent stationnaire ne peut produire qu'un effet stationnaire. Or il ne reste plus qu'un agent, l'agent intellectuel : il est le moteur réel... ».
§ 355. Ce raisonnement est bon, pourvu qu'on ajoute que toutes les actions des hommes sont des actions logiques, et qu'elles sont la conséquence du principe moral et du principe intellectuel. Mais cette proposition est fausse. 1° Beaucoup d'actions très importantes sont des actions non-logiques. 2°, Ce qu'on désigne sous les noms de : principe moral, principe intellectuel, manque de toute précision, et ne peut servir de prémisse à un raisonnement rigoureux. 3° Le raisonnement de Buckle a le défaut général des raisonnements par élimination, en sociologie ; c'est-à-dire que l'énumération n'est jamais complète [FN: § 355-1] . Ici des choses très importantes ont été omises. Les principes théoriques de la morale peuvent être les mêmes, et les habitudes morales différer de beaucoup. Par exemple, tous les peuples qui professent la morale chrétienne sont loin de la mettre en pratique.
§ 356. Le raisonnement de Buckle réduit à bien peu de chose le rôle des théories morales. En cela, il est d'accord avec les faits. Toutefois, ce qu'on ôte à ces théories ne doit pas être généreusement attribué à un certain « principe intellectuel », mais doit au contraire appartenir aux actions non-logiques, au développement économique, aux nouvelles conditions de communication, etc. Il est vrai qu'une partie doit aussi être attribuée au progrès scientifique, et pourrait par conséquent être acquise à quelque « principe intellectuel » ; mais il y a de la marge entre cette action indirecte, non-logique, et une action directe, produite par les déductions logiques d'un principe donné [FN: § 356-1].
§ 357. Nous ne pousserons pas plus loin l'étude de cette classification spéciale. Elle nous a fait voir qu'on peut décomposer les doctrines existantes en deux parties distinctes, soit certains sentiments et les déductions de ces sentiments. Devant nous s'ouvre ainsi une voie qu'il peut être utile ou inutile de suivre. Nous le verrons dans la suite.
§ 358. Beaucoup d'hommes d'État, beaucoup d'historiens parlent des actions non-logiques sans leur donner ce nom, et sans s'occuper d'en faire la théorie. Pour ne pas allonger outre mesure, citons seulement quelques exemples empruntés aux œuvres de Bayle [FN: § 358-1] . On trouve qu'elles contiennent plusieurs théories des actions non-logiques, et l'on est surpris de lire dans cet auteur des vérités qui, aujourd'hui encore, sont méconnues. C'est ainsi qu'il explique comment « (p. 272)... les opinions ne sont pas la règle des actions »; il répète : « (p. 361) Que l'homme ne règle pas sa vie sur ses opinions... Les Turcs tiennent (p. 362) quelque chose de cette doctrine des Stoïciens [de la fatalité] et outrent extrêmement la matière de la Prédestination. Cependant on les voit fuir le péril tout comme les autres hommes le fuient, et il s'en faut bien qu'ils montent à l'assaut aussi hardiment que les Français qui rie croient point à la Prédestination ». Il n'est pas possible de reconnaître plus clairement l'existence et l'importance des actions non-logiques. Qu'on généralise cette observation particulière, et l'on aura un principe de la théorie des actions non-logiques.
§ 359. Bayle observe encore: « (p. 273) Qu'on ne peut pas dire que ceux qui ne vivent pas selon les maximes de leur religion, ne croient pas qu'il y ait un Dieu ». Il insiste sur le fait :
« (p. 266) Que l'homme n'agit pas selon ses principes. – Que l'homme soit une créature raisonnable tant qu'il vous plaira ; il n'en est pas moins vrai qu'il n'agit presque jamais conséquemment à ses principes [c'est-à-dire que ses actions ne sont pas logiques]. Il a bien la force dans les choses de spéculation, de ne point tirer de mauvaises conséquences, car dans cette sorte de matières il pèche beaucoup plus par la facilité qu'il a de recevoir de faux principes, que par les fausses conclusions qu'il en infère. Mais c'est tout autre chose quand il est question des bonnes mœurs [ce que l'auteur dit de ce cas particulier est vrai en général]. Ne donnant presque jamais dans des faux principes, retenant presque toujours dans sa conscience les idées de l'équité naturelle, il conclut néanmoins toujours à l'avantage de ses désirs déréglés [c'est l'habituelle phraséologie peu précise ; mais le fond est d'accord avec les faits]...(p. 267) le véritable principe des actions de l'homme...n'est autre chose que le tempérament, l'inclination naturelle pour le plaisir, le goût que l'on contracte pour certains objets, le désir de plaire à quelqu'un, une habitude gagnée dans le commerce de ses amis, ou quelque autre disposition qui résulte du fond de notre nature, en quelque pays que l'on naisse [cela contredit ce qui précède et devrait être supprimé], et de quelques connaissances que l'on nous remplisse l'esprit ? »
Voilà qui approche beaucoup des faits. Si nous cherchions à donner une plus grande précision à ce langage, à établir une meilleure classification, ne nous arriverait-il pas de trouver une théorie des actions non-logiques, dont nous voyons toujours plus la grande importance ?
§ 360. Bayle cite, en l'approuvant, un passage de Nicolle [FN: § 360-1]: « (p. 741) Quand il s'agit de passer de la speculation à la pratique, les hommes ne tirent point de consequences ; et c'est une chose étrange comment leur esprit se peut arrester à certaines veritez speculatives sans les pousser aux suites de pratique, qui sont tellement liées avec ces veritez, qu'il semble impossible de les en separer... ».
§ 361. Bayle a très bien vu que « (p. 230)... la religion païenne se contentait d'un culte extérieur » (§ 174); mais il a tort de croire qu'elle « (p. 593) ne servait de rien par rapport aux bonnes mœurs ». Il n'a pas vu que les formalités du culte fortifiaient les actions non-logiques qui donnent les bonnes mœurs.
§ 362. Notre auteur se multiplie pour prouver que l'athéisme est préférable à l'idolâtrie. Pour bien le comprendre, il faut tenir compte du temps auquel il vivait, et des périls qu'il courait. De même qu'il y a maintenant des gens qui font la chasse aux livres « immoraux », il y en avait qui faisaient la chasse aux livres contraires à la religion chrétienne. Bayle frappe la selle, ne pouvant frapper le cheval, et adresse à l'idolâtrie des critiques qui garderaient leur valeur contre d'autres religions. En somme, le raisonnement de Bayle a pour but de prouver que la majeure partie des actions humaines étant des actions non-logiques, la forme de la croyance des hommes importe peu.
§ 363. C'est ce que n'a pas compris Montesquieu, et la réponse qu'il fait à ce qu'il appelle « le paradoxe de Bayle » n'a que peu ou point de valeur. Il résout la question par la question même, en disant: « (p. 404) [FN: § 363-1]Un prince qui aime la religion et qui la craint est un lion qui cède à la main qui le flatte ou à la voix qui l'apaise ; celui qui craint la religion et qui la hait est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent ; celui qui n'a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire et qu'il dévore ». Sous ces déclamations enflées, il y a évidemment l'idée que les hommes agissent logiquement d'après leurs croyances. Mais c'est précisément ce que nie Bayle ! Il fallait donc détruire par de bonnes raisons cette proposition de Bayle, avec laquelle tombait aussi sa théorie. Quant à répéter, sans donner aucune preuve, l'affirmation niée par son adversaire, cela ne sert à rien (§ 368).
§ 364. Restant dans le domaine des actions logiques, Montesquieu dit que : « Quand il serait inutile que les sujets eussent une religion, il ne le serait pas que les princes en eussent (loc. cit.) ». Dans le domaine des actions non-logiques, on arrive à une conclusion entièrement contraire ; car c'est l'usage des combinaisons logiques qui importe le plus à celui qui commande, et le fait d'avoir une règle indépendante de ses connaissances peu nombreuses, à celui qui obéit.
§ 365. Le défaut du raisonnement de Bayle ne consiste nullement en ce que lui reproche Montesquieu, mais se trouve dans un tout autre domaine. Après avoir observé et amplement démontré que l'homme n'agit pas selon les conséquences logiques de ses principes, de ses opinions, et que par conséquent beaucoup d'actions humaines très importantes sont des actions non-logiques, il aurait dû prêter attention à ces actions. Il aurait vu qu'il y en avait de nombreux genres, et aurait dû rechercher si elles sont indépendantes ou agissent les unes sur les autres. Il aurait facilement vu qu'en réalité ce dernier cas se vérifie, et aurait par conséquent observé que l'importance sociale de la religion ne consiste pas du tout dans la valeur logique de ses dogmes, de ses principes, de sa théologie, mais plutôt dans les actions non-logiques qu'elle provoque. Il était justement sur la bonne voie pour atteindre cette conclusion, quand il affirmait qu'« il faut juger une religion d'après le culte qu'elle pratique », et quand il rappelait que la religion païenne se contentait d'un culte extérieur : il s'était approché autant que possible de la vérité expérimentale. Encore un peu, et il la possédait tout entière. Malheureusement il dévie. Au lieu de considérer les actions non-logiques de la religion d'après le rôle social qu'elles peuvent jouer, il se perd en recherches sur leur valeur morale, ou pour mieux dire, sur leur rapport avec ce qu'il lui plaît d'appeler « moral ». De cette façon, nous assistons à un retour offensif des actions logiques, qui reviennent envahir le terrain dont elles avaient été chassées.
À ce point de vue, on pourrait répéter pour Bayle ce que dit Sumner Maine, en parlant de Rousseau [FN: § 365-1]: « (p. 83) Ce fut la première tentative faite pour reconstruire l'édifice de la croyance humaine, après les travaux de démolition commencés par Bayle et par Locke, achevés par Voltaire ». Mais c'est là un exemple de la manière dont on peut exprimer des idées entièrement différentes avec les mêmes mots, grâce à l'indétermination du langage vulgaire. Sumner Maine a en vue non la science, la théorie, mais la pratique. Cela se voit bien par la proposition qui suit immédiatement le passage cité : « et outre la supériorité que toute tentative de construction a toujours sur les œuvres purement destructives... ». Ce n'est pas l'affaire de la théorie, de créer des croyances ; mais seulement d'expliquer celles qui existent, d'en rechercher les uniformités. Bayle fit un grand pas dans ce sens, montra la vanité de certaines interprétations, et indiqua la voie permettant d'en trouver d'autres cadrant mieux avec les faits. Sous cet aspect théorique, son œuvre, bien loin d'être inférieure, est supérieure à celle de Rousseau, autant que l'astronomie de Kepler est supérieure à celle de Cosme Indicopleuste ; et l'on ne peut déplorer qu'une chose : c'est qu'il se soit arrêté trop tôt sur la voie qu'il avait si bien déblayée.
§ 366. Pourquoi en fut-il ainsi ? Ce n'est pas facile à savoir. Ou observe souvent des cas semblables, et il paraît qu'en science il faut souvent détruire avant de construire. Il se peut aussi que Bayle ait été empêché d'exprimer toute sa pensée, par les persécutions religieuses et morales dont était coutumière l'époque où il vivait, et qui pesaient sur le penseur, au point de vue non seulement matériel, mais aussi intellectuel, en le contraignant à revêtir sa pensée de certaines formes.
De même, aujourd'hui, les persécutions et les tracasseries de tout genre de la religion de la vertu sexuelle ont engendré une hypocrisie de langage, et parfois même de pensée, qui s'impose aux auteurs. C'est pourquoi si, dans les siècles futurs, l'expression de la pensée humaine vient à être délivrée de ces liens, comme elle est délivrée aujourd'hui de l'obligation de se soumettre à la Bible, quand on voudra connaître toute la pensée des auteurs de notre temps, on devra tenir compte des voiles dont la recouvrent les préjugés contemporains.
On voit en outre apparaître ici une cause qui réside dans les défectuosités du langage vulgaire employé en science. Si Bayle n'avait pas eu à sa disposition ces termes « religion », « morale », qui paraissent précis et ne le sont pas, il aurait dû raisonner sur des faits, au lieu de raisonner sur des mots, sur des sentiments, sur des fantaisies; et ce faisant, peut-être n'aurait-il pas perdu son chemin (§ 114).
§ 367. Mais ce cas n'est autre chose que le type d'une classe très vaste d'autres faits semblables, où l'on voit que les défectuosités du langage se trouvent en rapport avec les erreurs du raisonnement. Donc, si l'on veut rester dans le domaine logico-expérimental et ne pas divaguer dans celui du sentiment, on doit toujours avoir l'œil sur ce grand ennemi de la science (§ 119).
Dans les questions sociales, les hommes emploient généralement un langage qui les éloigne du domaine logico-expérimental. Qu'y a-t-il de réel dans ce langage ? Nous devons l'étudier pour pouvoir aller de l'avant. C'est à quoi le chapitre suivant sera consacré.
[205]
Chapitre IV↩
Les théories qui dépassent l'expérience. [(§368 à §632),vol. 1,pp. 205-344]
§ 368. Suivons encore la méthode inductive dans ce chapitre.
Il y a des phénomènes auxquels on donne certains noms, dans le langage vulgaire ; il y a des récits, des théories, des doctrines, qui se rapportent à des faits sociaux. Comment devons-nous les comprendre ? Correspondent-ils à quelque chose de précis ? (§ 114.) Peuvent-ils, moyennant quelques modifications opportunes de forme, trouver place parmi les théories logico-expérimentales (§ 13), ou bien doivent ils être rangés parmi les théories non logico-expérimentales ? Même placés parmi celles-ci, correspondent-ils à quelque chose de précis ?
L'étude que nous allons faire s'attache exclusivement à la force logico-expérimentale que certains raisonnements peuvent avoir ou ne pas avoir. De propos délibéré, nous négligeons de rechercher ici quels sentiments ils recouvrent, question dont nous nous occuperons aux chapitres VI à VIII ; de même, quelle est leur force persuasive, question appartenant aux chapitres IX et X ; et pas davantage quelle peut être l'utilité sociale de ces sentiments, et par conséquent de ce qui peut les faire naître, étude à laquelle nous nous livrerons au chapitre XII. Nous n'envisageons ici que l'aspect objectif des théories, indiqué au § 13.
Les phénomènes désignés dans le langage ordinaire par les termes religion, morale, droit, sont d'une grande importance pour la sociologie. Il y a des siècles que les hommes discutent à leur sujet, et ils ne sont même pas encore arrivés à s'entendre sur le sens de ces termes. On en donne un très grand nombre de définitions, et comme celles-ci ne concordent pas, les hommes en sont réduits à désigner des choses différentes par le même nom, ce qui est un excellent moyen de ne pas s'entendre. Quelle est la raison de ce fait ? Allons-nous essayer d'ajouter une nouvelle définition à toutes celles qu'on a déjà données ? ou ne serait-il pas préférable de suivre une autre voie, pour découvrir la nature de ces phénomènes? (§ 117).
§ 369. Nous avons des récits, comme l'Évangile selon saint Jean, que certains prirent autrefois, et que plusieurs prennent aujourd'hui pour un récit historique, tandis que d'autres y voient une simple allégorie, et que d'autres encore estiment que l'allégorie est mêlée à l'histoire ; et il y a des gens qui prétendent avoir une recette pour distinguer les deux choses. Des opinions semblables eurent cours déjà pour les mythes du polythéisme, et le phénomène paraît général. Que devons-nous penser de ces diverses opinions ? Devons-nous en choisir une ? ou quelque autre voie s'ouvre-t-elle devant nous ?
Nous avons d'innombrables théories sur la morale, sur le droit, etc. Si nous en pouvions trouver une qui soit vraie, c'est-à-dire qui soit d'accord avec les faits, notre travail serait rendu plus facile. Et si nous ne pouvons trouver cette théorie, comment devons-nous procéder pour étudier ces phénomènes ?
§ 370. L'induction nous mettra sur la bonne voie pour reconnaître certaines uniformités expérimentales. Si nous réussissons à les trouver, nous procéderons ensuite d'une manière inverse, c'est-à-dire par voie déductive, et nous comparerons les déductions avec les faits. S'ils concordent, nous accepterons les hypothèses faites, c'est-à-dire les principes expérimentaux obtenus par l'induction. S'ils ne concordent pas, nous rejetterons principes et hypothèses (§ 68, 69).
§ 371. Arrêtons-nous un peu à examiner le terme religion. Ce que nous en dirons s'appliquera par analogie aux autres termes de ce genre, tels que morale, droit, etc., dont nous aurons plus tard souvent à nous occuper. Admettre a priori l'existence de la religion, de la morale, du droit, etc., conduit à rechercher la définition de ces choses ; et vice-versa, rechercher cette définition, c'est admettre l'existence des choses que l'on veut définir. Il est très remarquable que toutes les tentatives faites jusqu'à présent, pour trouver ces définitions, ont été vaines.
Avant de poursuivre notre étude, nous devons rappeler la distinction que nous avons faite (§ 129) entre les mouvements réels et les mouvements virtuels. Nous n'étudions maintenant que les mouvements réels, tandis que nous renvoyons à plus tard l'étude des mouvements virtuels. En d'autres termes, nous nous occupons de ce qui existe, sans chercher ce qui devrait exister pour atteindre un but déterminé.
§ 372. Tout d'abord observons qu'il y a généralement une confusion dans l'emploi des mots religion, morale, droit, etc. Non seulement on unit souvent les deux études que nous avons séparées tout à l'heure, mais encore, quand on les sépare et qu'on dit vouloir s'occuper uniquement de la première, on ne distingue pas ou l'on distingue mal deux aspects, ou, pour mieux dire, plusieurs aspects.
§ 373. Il faut, en effet, distinguer la théorie de la pratique. En un temps donné et chez un peuple donné, il existe une religion théorique, une morale théorique, un droit théorique – (nous les réduisons à l'unité par abréviation ; en réalité ils sont en plus grand nombre, même là où il y a apparence d'unité), – et une religion pratique, une morale pratique, un droit pratique – (et là encore, pour être précis, il faut substituer un nombre respectable à l'unité) (§ 464 et sv.) On ne peut nier ces faits ; mais on a l'habitude de les décrire de manière à en diminuer autant que possible l'importance.
§ 374. Continuant à dire de la religion ce qui doit s'étendre aussi à la morale, au droit, etc., nous voyons donc qu'on suppose qu'il y a une certaine religion, – pour le croyant, celle qu'il dit être vraie, – et dont les religions théoriques qu'on observe sont des déviations ; tandis que les religions pratiques sont à leur tour des déviations de ces religions théoriques. Par exemple, il existe un certain théorème de géométrie. Il peut être démontré plus ou moins bien; et l'on a ainsi des déviations théoriques. Il peut être entendu plus ou moins bien ; et l'on a ainsi des déviations pratiques. Mais tout cela n'infirme pas la rigueur du théorème.
§ 375. Si la comparaison était poussée jusqu'au bout, le sens des termes religion, morale, droit, serait aussi précis qu'on peut le désirer. Ces mots représenteraient certains types, qu'on pourrait aussi déduire des faits existants, – ce qu'on ne peut faire pour le théorème de géométrie – en supprimant l'accessoire de ces faits, et en conservant le principal ; ou bien, comme le veulent les évolutionnistes, en cherchant vers quelle limite tendent ces faits.
§ 376. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Chacun est fermement persuadé que sa religion, sa morale, son droit sont les types vrais ; mais il n'a aucun moyen d'en persuader autrui ; il lui manque le secours de l'expérience en général, ou de cette expérience spéciale qui réside dans le raisonnement logique. Dans une controverse entre deux chimistes, il y a un juge : c'est l'expérience. Dans une controverse entre un musulman et un chrétien, qui est juge ? Personne (§ 16 et sv.).
§ 377. De nos jours, certaines personnes ont cru éviter cet écueil, en renonçant au surnaturel. Ces personnes se figurent que la divergence peut résider uniquement dans ce domaine. Elles se trompent, comme se trompèrent autrefois les diverses sectes chrétiennes, en croyant que les divergences pouvaient naître seulement de l'interprétation de l'Écriture Sainte, laquelle était au-dessus de toute discussion.
§ 378. Au point de vue logico-expérimental, on ne gagne rien à substituer des principes métaphysiques aux êtres surnaturels ; car on peut affirmer ou nier ceux-ci comme ceux-là, sans qu'il y ait un juge pour trancher le différend (§ 16 et sv.).
§ 379. Il ne sert à rien d'appeler à l'aide l'indignation publique. Il est certain que lorsque les luthériens disputaient avec les catholiques, celui qui aurait dit que l’Écriture Sainte avait autant de valeur, au point de vue expérimental, que la théogonie d'Hésiode, celui-là aurait soulevé l'indignation générale, voire unanime ou presque, en Europe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, celui qui s'aviserait de mettre en doute le dogme d'après lequel la société a pour unique but le bien « du plus grand nombre », et de contester que le devoir strict de chaque homme est de se sacrifier pour le bien « des petits et des humbles », soulèverait l'indignation publique. Mais les questions scientifiques sont résolues par les faits ; non par l'indignation de quelques-uns, de beaucoup, ni même de tous.
§ 380. De cette manière, nous n'arrivons donc pas à pouvoir donner aux termes un sens bien défini ; et pourtant, c'est la première chose à faire, si l'on veut raisonner utilement sur des faits scientifiques ; tandis que si le même terme est employé avec des sens différents, par les diverses personnes qui en font usage, tout raisonnement rigoureux devient impossible (§ 442, 490, 965).
§ 381. En outre, cette façon de raisonner a le grave défaut de reporter sur les définitions, des controverses qui devraient venir seulement après que, grâce aux définitions, on sait comment désigner avec précision les choses dont on veut traiter (§ 119, 387, 963).
§ 382. Si l'on dit vouloir définir la vraie religion ou la religion type, ou la religion limite, il est manifeste que l'on ne peut abandonner donner cette définition à l'arbitraire de l'adversaire. Elle renferme un théorème : c'est l'affirmation que la chose définie est celle qui correspond à la vérité, au type, à la limite. Tel est le principal motif pour lequel les physiciens ne songent pas à se chamailler au sujet du nom donné aux rayons X ; ni les chimistes, à propos de celui donné au radium ; ni les astronomes, sur le nom donné à l'une des nombreuses petites planètes (excepté les questions d'amour-propre du découvreur) ; tandis qu'on dispute avec tant d'énergie sur la définition qu'on veut donner de la religion (§ 119).
§ 383. Voici, par exemple, S. Reinach qui écrit un livre sous le titre d'Orpheus, Histoire générale des religions, qui serait peut-être mieux nommé -. Histoire générale des religions, vues à la lumière du procès Dreyfus. Il croit que les dogmes de la religion catholique, voire chrétienne, sont faux, tandis que les dogmes de sa religion humanitaire-démocratique sont vrais. Il peut avoir tort ou raison. Nous ne discutons pas ce point, et ne croyons pas que la science expérimentale ait la moindre compétence pour résoudre la question. De toute façon, elle devrait être traitée indépendamment des définitions. Au contraire, Reinach tâche de faire accepter une définition qui lui permette d'atteindre son but.
Ses adversaires puisaient leur force dans la religion catholique. Il veut montrer qu'au fond cette religion ne consiste que dans les tabous des peuples inférieurs. C'est pourquoi il lui est nécessaire d'éliminer, dès la définition, tout ce qui correspond à des concepts intellectuellement supérieurs. Il le fait habilement ; car enfin sa définition [FN: § 383-1] ne s'éloigne pas trop des faits (977). Mais ses propositions, vraies ou fausses, auraient leur place dans un théorème, sujet à controverse de par sa nature, et non dans une définition dont celui qui la donne peut disposer arbitrairement, au moins en partie.
§ 384. D'autre part, voici le P. Lagrange qui croit à la vérité des dogmes catholiques et qui, naturellement, ne peut accepter la définition de Reinach, sous peine de suicide. Il dit [FN: § 384-1]: « (p. 8) M. Reinach semble croire qu'une bonne définition doit s'appliquer à toute l'extension qu'a (p. 9) prise un terme, même par abus ». Au fond, on trouve ici l'idée de religion-type. Quand on s'éloigne du type, on tombe dans l'abus. Mais le P. Lagrange ne prend pas garde que ce qui est pour lui type est abus pour un autre, et vice versa.
Il continue : « (p. 9) Parce qu'on parle, abusivement, – la figure se nomme catachrèse en termes de rhétorique, – de la religion de l'honneur, cette définition doit être contenue dans la définition de la religion en général ». Oui, elle doit y être contenue, si l'on veut définir ce que les hommes appellent religion ; de même que la définition de la conjugaison du verbe irrégulier doit être contenue dans la définition générale de la conjugaison, si l'on vent définir ce que les grammairiens appellent conjugaison ; et il n'y a pas à chercher si c'est la conjugaison régulière ou irrégulière qui est abusive. Non, elle ne doit pas y être contenue si, à l'avance, on a explicitement exclu certains faits ; ce que ne fait pas du tout le P. Lagrange. Je puis dire qu'en latin, les verbes actifs de la première conjugaison forment leur futur en abo, abis, abit, etc., parce qu'en disant verbes actifs de la première conjugaison, j'ai, à l'avance et explicitement, exclu les autres. Mais je ne pourrais en dire autant des verbes en général, puis, quand on me mettrait sous les yeux le verbe lego, qui fait legam, leges... au futur, me tirer d'embarras en disant que c'est là un abus. Je puis dire, bien que cette théorie ne soit peut-être pas juste, qu'à l'origine, les désinences actives des temps principaux des verbes grecs étaient ![]() …, parce que j'ai, à l'avance et explicitement, dit que je m'occupais de l'origine ; ce qui me permet de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant (à tort ou à raison) qu'ils ne sont pas primitifs. Mais je ne pourrais dire d'une façon générale, sans la restriction de l'origine, que les verbes grecs ont cette désinence, et tenter ensuite de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant que c'est un abus.
…, parce que j'ai, à l'avance et explicitement, dit que je m'occupais de l'origine ; ce qui me permet de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant (à tort ou à raison) qu'ils ne sont pas primitifs. Mais je ne pourrais dire d'une façon générale, sans la restriction de l'origine, que les verbes grecs ont cette désinence, et tenter ensuite de rejeter l'exemple des verbes en (oméga), en disant que c'est un abus.
En somme, que veut définir le P. Lagrange ? Ce que les hommes appellent religion (question linguistique) ? ou bien autre chose ? Et dans ce dernier cas, quelle est précisément cette chose ? S'il ne nous le dit pas, nous ne pouvons savoir si sa définition est bonne ou mauvaise.
§ 385. Le P. Lagrange continue : « (p. 9) Et l'on aboutit à cette définition de la religion : un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés. On dirait que c'est une gageure, car, avec une candeur triomphante, M. Reinach note aussitôt que sa définition élimine du concept fondamental de la religion – tout ce qu'on entend généralement comme l'objet propre du sentiment religieux ».
§ 386. Il paraîtrait donc que le P. Lagrange cherche ce qu'on entend généralement par religion. Nous retombons dans une question de linguistique. Mais prenons garde à ce terme généralement, car il est trompeur. Que veut-il dire ? Allons-nous faire une statistique des opinions des hommes ? des vivants ou aussi de ceux qui vécurent aux temps passés ? des Européens ou de tous les hommes qui vivent ou vécurent à la surface du globe ? Allons-nous compter les opinions ou les peser? (§ 594) et dans ce dernier cas, avec quelle balance ? Il semblerait que le P. Lagrange veuille les peser, puisqu'il y en a qu'il appelle abusives. Mais, dans ce cas, prenons bien garde que si c'est lui qui choisit la balance, elle donnera le poids qu'il voudra ; et si c'est un de ses adversaires qui la choisit, elle donnera un poids entièrement différent. Et puis prenons garde qu'outre cette religion générale, il reste des religions particulières. Qu'allons-nous en faire ? Pour les exclure, il faut revenir à la théorie de la religion type.
§ 387. Notre auteur ajoute : « (p. 9) C'est dire que la définition est détestable. Sans doute les logiciens admettent qu'un mot n'a que le sens qu'on lui prête, mais définir un terme reçu à rebours de l'opinion générale c'est un jeu puéril ou un attrape-nigauds ».
Un instant ; est-ce bien sûr ? Par exemple, l'eau des chimistes n'est pas du tout l'eau du vulgaire. L'or des chimistes n'est pas du tout l'or du vulgaire. Pour celui-ci, un louis est en or ; pour le chimiste, il est d'or, mélangé à du cuivre, et présente des traces de nombreux autres corps simples. Ce ne fut pas du tout un « jeu puéril » que définir les corps chimiques, contrairement à « l'opinion générale ». Au contraire, ce fut l'unique moyen d'élever la chimie au rang de science (§ 115). Reinach est donc parfaitement maître de définir la religion « contrairement à l'opinion générale », pourvu que : 1° il donne une définition claire et précise; 2° qu'il ne confonde jamais ce qu'il a défini, avec une autre chose différente qui porte le même nom; 3° qu'il montre que cette nouvelle définition a une utilité compensant le souci de devoir toujours nous rappeler que la religion de Reinach n'est pas la religion des autres gens ; et pour nous ôter ce souci et éviter tout danger de confusion, il serait bon, au lieu d'adopter un terme déjà en usage, qu'il en adoptât un autre (§ 117), et qu'il dît, par exemple : « J'appelle X l'ensemble des scrupules qui font obstacle au libre usage de nos facultés ». Après, mais seulement après (§ 381), pourrait venir un théorème où l'on dirait : « X se trouve dans tout ce que les hommes appellent religion, et pas ailleurs ». On pourrait alors vérifier par les faits si cette proposition est vraie ou fausse (§ 963).
§ 388. C'est ce que nous allons faire, parce que c'est l'unique aspect sous lequel la science expérimentale peut considérer ces questions. Le chimiste nous dit que l'eau est un composé d'hydrogène et d'oxygène. La première des conditions que nous avons posées est satisfaite. La seconde l’est aussi, parce que, dans un traité de chimie, on ne confond jamais l'eau chimiquement pure et l'eau ordinaire. La troisième l'est, parce que l'utilité de savoir précisément quelle est la substance qu'on appelle eau, est évidente (§ 108, 69-3). Puis on nous dit : l'eau chimique constitue la partie principale de l'eau des puits, des lacs, des fleuves, de la mer, de la pluie : toutes substances que le vulgaire appelle eau. Nous vérifions, et nous voyons que c'est vrai. Si l'on ajoutait ensuite que l'eau chimique n'est pas la partie principale des choses auxquelles le vulgaire refuse le nom d'eau, la vérification ne réussirait pas aussi bien, parce que l'eau est la partie principale du vin, de la bière, des sirops, etc.
§ 389. Pour éviter des amphibologies, donnons un nom à la chose définie par Reinach, et appelons-la la religion α. Si la religion α se trouve ensuite être identique à la simple religion, tant mieux pour la théorie de Reinach. Nous ne faisons aucun tort à cette théorie en employant ce nom de religion α, qui est une simple étiquette mise sur la chose pour pouvoir la désigner (§ 119).
§ 390. Il est certain que beaucoup de religions, qui sont et furent celles de millions et de millions d'hommes, comme le polythéisme indo-européen, les religions judéo-chrétiennes et musulmanes, le fétichisme, etc., contiennent la religion α. Mais toutes ces religions que nous venons d'énumérer, excepté, au moins en partie, le fétichisme, contiennent aussi autre chose que nous appellerons religion β (§ 119), et qui, pour employer les termes du P. Lagrange [FN: § 390-1] , est « la croyance à des pouvoirs supérieurs avec lesquels on peut nouer des relations ». Quelle est la partie principale ? la religion α ou la religion β, dans ce que les gens appellent religion ? Pour répondre, il serait nécessaire de savoir ce que veut dire précisément ce terme principale. Quand on comparait l'eau chimique à l'eau des fleuves, principale voulait dire la partie de plus grand poids. Après avoir fait l'analyse chimique de l'eau d'un fleuve, on voit que l'eau chimique est la partie qui, de beaucoup, pèse plus que les autres. Mais comment ferons-nous l'analyse des religions, et comment en pèserons-nous les éléments ?
§ 391. On peut dire : « La partie principale est la croyance à des pouvoirs supérieurs, car les scrupules dont parle Reinach en procèdent logiquement ». À quoi l'on peut répondre : « La partie principale c'est les scrupules, car c'est leur existence qui a engendré chez l'homme la croyance aux pouvoirs supérieurs ». Rappelons-nous les deux propositions : « S'il y a des dieux, il est une divination », et : « S'il est une divination, il y a des dieux [FN: § 391-1]». Prenons garde qu'ici « principale » paraît vouloir dire : « antérieure ». Quand bien même on aurait démontré que la croyance aux pouvoirs supérieurs précéda les scrupules, il n'en résulterait pas du tout qu'à une époque postérieure, les scrupules demeurèrent seuls, et constituèrent la partie la plus active. Si l'on démontrait que les scrupules sont antérieurs, cela n'impliquerait pas qu'ils n'aient pas cédé ensuite la place à la croyance aux pouvoirs supérieurs.
§ 392. Si l'on demande ensuite : « La religion α ou la religion β existent-elles dans tous les phénomènes qui portent le nom de religieux ? » il faut répondre non. D'une part, la religion α est plus répandue que la religion β ; car, sinon dans tout, au moins dans une partie du fétichisme et des tabous, comme aussi dans la libre pensée moderne, dans le positivisme de A. Comte, dans la religion humanitaire, dans les religions métaphysiques, on trouve les scrupules et pas les puissances supérieures, ou du moins elles n'apparaissent pas clairement. Il est vrai que A. Comte finit par en créer de fictives ; mais dans le domaine théorique, elles demeurent toujours telles. Cela prouve seulement que là où l'on trouve les scrupules, il se manifeste aussi une propension à les expliquer par les puissances supérieures.
§ 393. D'autre part, il y a aussi quelques cas où, si l'on réduit la religion β à la croyance en des êtres supérieurs, on peut dire que la religion β existe sans la religion α , ou du moins sans que celle-ci dépende de celle-là. Exemple : la religion des Épicuriens [FN: § 393-1] . Si l'on disait qu'on n'en doit pas tenir compte, parce qu'elle est blâmable, nous répondrions que nous ne cherchons pas comment sont composées les religions louables, mais toutes les croyances qui portent le nom de religion. Et si l'on disait que les Épicuriens avaient aussi des scrupules, nous répondrions que si l'on veut donner cette signification à la religion α , on la trouve partout ; car il n'y a pas et il n'y a pas eu un homme au monde, qui n'ait quelque scrupule, ou qui n'en ait pas eu. Dans ce cas, la religion α ne définirait rien, parce qu'elle définirait tout.
§ 394. Il est une secte bouddhique où l'on ne trouve pas trace de la seconde partie de la définition de la religion β, c'est-à-dire des relations étroites avec les êtres supérieurs ; et même cette partie est formellement exclue. Écoutez plutôt cette conversation entre Guimet et trois théologiens japonais [FN: § 394-1] .
« (p. 337) GUIMET. Je suis venu aujourd'hui dans votre temple pour vous demander des renseignements sur les principes de la religion bouddhique en général et sur ceux de votre secte en particulier * ».
On remarquera que Guimet et beaucoup d'autres personnes appellent religion la chose dont nous parlons ici. Si l'on accepte la thèse du P. Lagrange, on pourrait vouloir exclure cette chose du nombre des religions, en disant qu'elle porte abusivement ce nom. Mais si la simple épithète abus suffit à exclure les faits contraires à une théorie, il est manifeste que toute théorie sera toujours vérifiée par les faits, et qu'il est inutile de perdre son temps à des investigations sur ce point. Rappelons pour la dernière fois que nous cherchons ici les caractères des choses nommées religions, et non de celles qu'il peut plaire à un auteur de désigner par ce nom.
« (p. 338) D. Ma première question porte sur l'origine du ciel, de la terre et de tout ce qui nous entoure. Comment expliquez-vous leur formation d'après le principe de la religion bouddhique ? »
« R. La religion bouddhique attribue l'existence de toute chose à ce qu'elle appelle In-En (Cause-Effet). Chaque chose n'est que la réunion d'atomes, infiniment subtils, et ce sont ces atomes qui, se réunissant les uns aux autres, ont formé les montagnes, les rivières, les plaines, les métaux, les pierres, les plantes et les arbres. L'existence de ces objets découle du rapport naturel de leur In à leur En, absolument comme tous les êtres animés naissent en vertu de leur propre In-En. »
« D. N'y a-t-il donc aucun créateur du ciel, de la terre et de toutes les autres choses ? »
« R. Non. »
« D. Qu'est-ce alors que vous appelez In-En ? »
« R. Aucune chose ne se forme naturellement et de son propre mouvement. C'est toujours le rapport de ceci à cela qui constitue une chose …… »
« (p. 339) D.... Je vous demande maintenant si les actes des hommes dépendent de Dieu. »
« (p. 340) R. Les actes de l'homme sont ses actes propres ; ils ne dépendent en aucune façon de Dieu ».
Où sont les relations avec les êtres supérieurs, que tous admettent, d'après le P. Lagrange ?
« D. Alors, n'admettez-vous pas que Dieu exerce son influence sur l'humanité et nous dirige dans l'accomplissement des divers actes d'invention ou de perfectionnement ? »
« R. La religion bouddhique n'admettant aucun créateur et attribuant tout à l'In-En, déclare par cela même que tout acte de l'homme s'accomplit par sa propre initiative sans aucune intervention de Dieu. »
« D. L'expression de Dieu est impropre. Néanmoins votre religion reconnaît un être supérieur, Amida, qu'elle adore avec vénération et foi. Eh ! bien, la puissance d'Amida n'influe-t-elle pas sur les actes de l'homme ? »
« R. Les différences qui existent entre les hommes au point de vue de leur valeur personnelle et de la valeur de leurs actes, tiennent au plus ou moins d'éducation qu'ils ont reçue, mais ne dépendent pas de la volonté d'Amida. »
……………………………………………………………………………………….
« D. J'admettrai bien que c'est par le travail qu'on augmente ses connaissances... mais en entrant dans le domaine de la morale, de la distinction du bien et du mal, du juste et de l'injuste, ne semble-t-il pas qu'il existe un être supérieur qui récompense ou punit nos actes, de même que le pouvoir social punit les infractions aux règles d'ordre public ? »
« R. Tout bien ou tout mal a pour conséquence un bonheur ou une peine. Cela résulte de l'idée toute naturelle de l'In-Goua (synonyme de In-En) ».
§ 395. Plus loin : « (p. 344) R. Dans la religion bouddhique en général, on parle souvent du succès des demandes adressées à la divinité ; mais notre secte les interdit absolument ».
Si nous voulons maintenir inséparables les deux parties de la définition de la religion β soit la croyance en des êtres supérieurs et la croyance qu'on peut nouer des relations avec eux, nous devrons dire qu'on ne trouve pas la religion β dans les deux qui viennent d'être citées ; et nous ne saurons pas où les ranger, parce qu'elles ne rentrent pas non plus dans la définition de la religion α.
§ 396. Concluons donc que, comme d'habitude, les termes du langage courant ne se prêtent pas à des classifications rigoureuses. La chimie, la physique, la mécanique, etc., n'ont pas été constituées en étudiant les termes du langage vulgaire et en les classant, mais en étudiant et classant les faits. Essayons d'en faire autant pour la sociologie.
§ 397. En attendant, et toujours par induction, nous découvrons ici que les définitions de Reinach et du P. Lagrange sont de natures diverses. Peut-être sans que ces auteurs s'en aperçoivent, tendent-elles à classer des faits différents ; la définition de Reinach : certains états d'âme ; celle du P. Lagrange : les explications qu'on en donne ? Sont-ce là, d'une façon générale, deux ordres de faits qu'il convient de distinguer, de classer, d'étudier ? Nous verrons. Il y a ici une différence de fond, et non de formes du langage ordinaire. Pour le moment, continuons l'étude que nous avons commencée.
§ 398. Les difficultés rencontrées par ceux qui ont essayé de définir le droit et la morale ne sont pas moindres que celles dont est assailli celui qui veut définir la religion. On n'a pas même trouvé moyen de séparer le droit de la morale. À un extrême, nous avons une définition grossièrement empirique. On nous dit que le droit est constitué par les règles qui ont pour sanction les injonctions de l'autorité publique, et que la morale est formée par les règles imposées seulement par la conscience. Cette définition convient très bien aux buts pratiques de l'avocat et du juge, mais n'a pas la moindre valeur scientifique, parce qu'elle prend pour critère des éléments accidentels et variables. Elle est semblable à celle qui, pour classer les oiseaux, prendrait pour critère la couleur des plumes. Un acte passe du droit à la morale ou vice versa, suivant la volonté ou le caprice du législateur, et par conséquent cette classification peut nous faire connaître cette volonté ou ce caprice, et non, comme c'était notre but, la nature des actes, abstraction faite de la manière dont ils peuvent être jugés. Notez en outre que cette classification devient inutile quand, comme cela arriva en des temps reculés, le pouvoir public ne s'entremet pas pour imposer ou appuyer le droit privé. Dans les pays civilisés modernes, il y a une législation écrite ; par conséquent il est facile de savoir si oui ou non un acte quelconque est réglé par la loi. La définition qui vient d'être donnée est donc expérimentale, claire et précise ; mais cela importe peu, car elle ne classe pas les choses que l'on avait en vue.
§ 399. Quand ensuite, on veut au contraire considérer intrinsèquement ces choses, on est conduit à en rechercher l'essence. De cette façon, on abandonne peu à peu le domaine expérimental pour planer dans les nuages de la métaphysique, et l'on tombe dans l'autre extrême où disparaît toute réalité objective.
§ 400. Il y a des gens qui ont la naïveté de l'avouer. Voici, par exemple, Ad. Franck, qui nous dit [FN: § 400-1]: « L'idée du droit, à la considérer en elle-même, indépendamment des applications dont elle est susceptible et des lois plus ou moins justes qui ont été faites en son nom, est une idée de la raison absolument simple et qui échappe par là même à toute définition logique ». Voilà qu'on reconnaît clairement que ce concept appartient à une catégorie qui correspond aux actions non-logiques ; et si quelque autre théorie, comme celle des idées innées, ne vient à notre secours, nous devrons admettre que ce concept varie suivant le temps, les lieux, les individus. Pour le nier, il faut donner à ces « idées simples » une existence objective, comme l'eurent autrefois les dieux de l'Olympe.
Il est des gens qui essaient de combler par des subtilités ingénieuses le fossé qui sépare ces idéologies de la réalité, comme font d'habitude ceux qui tâchent de recouvrir les actions non-logiques, d'un vernis logique. Nous en avons parlé déjà au chapitre III.
§ 401. Un autre bel exemple de discours dépourvus de toute précision est celui des théories sur le droit naturel et sur le droit des gens. De nombreux penseurs ont eu des sentiments qu'ils ont exprimés de leur mieux par ces termes, et se sont ensuite ingéniés à accorder ces sentiments avec les buts pratiques qu'ils voulaient atteindre. Dans cette œuvre, ils ont, comme d'habitude, fait tourner à leur avantage l'emploi de mots indéterminés qui ne correspondent pas à des choses, mais seulement à des sentiments. Nous allons examiner ces raisonnements au point de vue de la correspondance qu'ils peuvent avoir ou non avec la réalité expérimentale. Il ne faut pas transporter dans un autre domaine les conclusions auxquelles nous arriverons ainsi (§ 41). Ce point de vue est indépendant de celui de l'utilité sociale. Il peut arriver qu'une théorie ait cette utilité en certains cas et à certaines époques, sans correspondre à la réalité expérimentale. Le droit naturel est simplement celui qui paraît être le meilleur à qui emploie cette expression. Mais l'on ne peut étaler naïvement la chose en ces termes. Il convient d'user de quelque artifice, d'ajouter quelque raisonnement.
§ 402. Les objections que l'on pourrait faire à qui veut nous enseigner le droit naturel, seraient repoussées de la manière suivante : « Pourquoi dois-je admettre votre opinion ? – Parce qu'elle est conforme à la raison. – Mais moi aussi j'use de la raison, et je pense autrement que vous. – Oui, mais la mienne, c'est la Droite Raison (§ 422 et sv.). – Comment se fait-il que vous ne soyez que quelques-uns à la connaître ? – Nous ne sommes pas quelques-uns ; notre opinion jouit du consentement universel. – Et pourtant il y a des gens qui pensent différemment. – Nous entendons : le consentement des bons et des sages. – Soit. Est-ce vous, les bons et les sages, qui avez inventé ce droit naturel ? – Non, en vérité ; il nous a été enseigné par la Nature, par Dieu ».
§ 403. Les éléments que les défenseurs du -droit naturel mettent en œuvre sont avant tout : la Droite Raison, la Nature et ses appendices : c'est-à-dire la raison naturelle, l'état de nature, la conformité avec la nature ; et ensuite la sociabilité, etc., le consentement de tous les hommes ou d'une partie seulement, la volonté divine.
§ 404. On envisage en particulier deux questions : qui est l'auteur du droit naturel ? comment nous est-il révélé [FN: § 404-1]? Dieu peut être l'auteur du droit naturel, ou directement, ou indirectement, par le moyen de la Droite Raison et de la Nature, ses ministres. La Nature peut être l'origine du droit naturel, ou directement, ou mieux indirectement, en inculquant à l'esprit humain le droit naturel (ou la loi) qui est ensuite découvert par la Droite Raison ou par l'observation de l'opinion générale ou de celle des hommes les plus qualifiés. On peut aussi méditer sur ce que serait l'homme « à l'état de nature »; état qu'à vrai dire personne n'a jamais vu, mais qui n'a pas de mystère pour messieurs les métaphysiciens, tant et si bien que, de cet état à eux très connu, aux autres gens entièrement inconnu, ils tirent la connaissance de ce que nous avons sous les yeux, et que nous pourrions ainsi connaître directement. Enfin, la Droite Raison peut seule imposer l'observation du droit naturel.
§ 405. Le droit naturel peut nous être révélé directement par Dieu, au moyen d'écrits inspirés par lui ; mais c'est un cas peu fréquent. L'observation directe et le consentement de tous les hommes ou d'une partie des hommes, pourraient aussi révéler directement le droit naturel. Mais pratiquement, cette méthode s'emploie peu ou point. Proprement, c'est à la Droite Raison qu'incombe la tâche de nous révéler le droit naturel, soit comme procédant d'elle-même, soit comme tirant son origine de la Nature, de Dieu, ou comme résultant du consentement universel ou d'un consentement plus limité.
§ 406. En somme, on affirme assez généralement que le concept de loi naturelle existe dans l'esprit humain. On ajoute souvent l'indication de l'origine de ce concept ; et l'on ajoute aussi la confirmation du consentement universel, ou des gens les plus qualifiés. D'habitude, presque tous les éléments sont mis en œuvre ensemble, parce qu'il convient de s'aider de la plus grande somme possible de sentiments ; et les divers modes de révélation sont aussi déclarés concordants, toujours pour le même motif.
§ 407. Le raisonnement subjectif procédant par accord de sentiments paraît être le suivant. On s'aperçoit que les lois existantes ne sont pas une production arbitraire, ni entièrement logique ; qu'il y a un substratum qui échappe à l'arbitraire et qui a une existence propre. Cette induction est d'accord avec les faits et devrait être exprimée en disant qu'il y a certains principes d'actions non-logiques, dont les hommes tirent leurs lois. Ces principes d'actions non-logiques (ou résidus, chap. VI) sont en rapport avec toutes les conditions dans lesquelles vivent les hommes, et changeantes avec elles.
§ 408. Mais cette forme de raisonnement, qui met en lumière les caractères relatifs, subjectifs, non-logiques des principes, répugne aux métaphysiciens, aux théologiens et aussi à de très nombreuses personnes qui étudient les faits sociaux. Ils cherchent l'absolu, l'objectif, le logique, et le trouvent toujours, grâce à l'usage de mots indéterminés et de raisonnements défectueux (dérivations, chap. IX). Dans notre cas, les auteurs cherchent l'absolu et l'objectif dans le consentement de beaucoup de gens ou de tous, dans la conformité avec la Nature, dans la volonté divine. Toutes ces choses ou une partie d'entre elles apparaissent à leur esprit comme excellentes, Elles doivent donc s'accorder avec cette autre chose excellente qu'est le droit naturel ; et la logique doit nous donner le lien qui unit celui-ci à celles-là (§ 514). Dans leurs théories, sous les voiles on voit apparaître constamment l'idée de l'opposition entre quelque chose de constant et de bon (droit naturel) et quelque chose de variable et de médiocre (droit positif). C'est de cette opposition que naît principalement leur persuasion et celle de qui les approuve (§ 515).
§ 409. Suivant les préférences de l'auteur, tel ou tel élément occupe la première place. On comprend que les chrétiens ne puissent se passer de Dieu ; mais il est remarquable qu'ils le font intervenir plutôt indirectement que directement. Cela vient peut-être de ce que, chez eux, le métaphysicien s'impose au chrétien. Les métaphysiciens purs se contentent de la Droite Raison.
§ 410. Aristote [FN: § 410-1] donne pour caractéristique du droit naturel le fait qu'il a partout la même force ; ce qui ne veut pas dire qu'il soit partout le même ; car il peut être variable de sa nature (4). Aristote oppose cette considération à ceux qui niaient le droit naturel, parce que le droit des différents peuples est variable (2). Dans la Rhétorique (1, 13, 2), il s'exprime ainsi [FN: § 410-2]: « Je dis que la loi est particulière ou commune. La loi particulière est celle que quelques-uns établissent pour eux-mêmes. Elle peut être écrite ou non. La loi commune est celle qui est selon la Nature, puisqu'il y a un juste et un injuste par nature, que tous devinent sans qu'il y ait eu entre eux communication ni entente ». Ce sont là justement des principes d'actions non-logiques, principes qui existent chez les hommes et varient suivant les conditions au milieu desquelles ils vivent. La théorie d'Aristote paraît donc évidemment attribuer la première place à la Nature. Le consentement universel est une façon de manifester cette origine selon la nature.
§ 411. Ce qui a partout la même force, on ne sait comment le distinguer de ce qui n'a pas cette force. Aristote croit l'expliquer en citant l'exemple de la loi qui prescrit de sacrifier une chèvre à Zeus, et non une brebis. En effet, à première vue, il semble que le caractère arbitraire soit ici patent ; mais une légère modification suffit pour présenter la même prescription avec le caractère de pseudo-universalité, requis pour le droit naturel. Il suffit de dire : « En chaque contrée, on doit suivre les usages du pays. En ce pays, on a l'habitude de sacrifier une chèvre et non une brebis ; donc on doit sacrifier la chèvre ».
§ 412. Il est remarquable que dans un seul et même traité, Cicéron louvoie entre les diverses démonstrations, montrant ainsi que ce ne sont pas les conclusions qui résultent de la démonstration, mais bien qu'on choisit cette dernière de façon à obtenir les premières. Dans le traité des Lois, Cicéron dit : « (I, 6, 20) Je rechercherai l'origine du droit dans la Nature, qui doit nous guider dans toute cette discussion ». Ici, la Nature est invoquée directement ; mais un peu plus haut, elle apparaissait indirectement, et la première place était donnée à la « Raison suprême ». L'auteur dit : « (I, 6, 18) La loi est la Raison suprême, inculquée à notre nature, qui ordonne ce qu'on doit faire, défend le contraire. Quand cette raison est définie et imprimée dans l'esprit de l'homme, c'est la loi... ». (6, 19) Si c'est bien juste, comme il me paraît, c'est de la loi qu'est issu le droit : elle est la force de la nature, l'esprit et la raison du sage ; elle est la règle du juste et de l'injuste ».
§ 413. La divinité manquait à cette énumération de choses parfaites. La voici qui apparaît. « (II, 4, 8) Je vois que l'opinion des plus savants fut que la loi n'est pas imaginée par l'esprit de l'homme ni décrétée par aucun peuple ; mais que c'est quelque chose d'éternel, qui régit tout le monde par la sagesse des prescriptions et des défenses. C'est pourquoi ils disaient que cette première et dernière loi était l'esprit des dieux obligeant ou défendant, avec toute raison. Par conséquent, cette loi que les dieux donnèrent au genre humain est à bon droit louée. C'est donc la raison et l'esprit du sage, capables d'exhorter et de dissuader ».
§ 414. Autre part, la Droite Raison est donnée comme étant la loi ; et puisque la Droite Raison est commune aux dieux et aux hommes, ceux-ci sont en société avec les dieux. C'est bien cela. « (I, 7, 23) Puisque rien n'est meilleur que la raison, et qu'elle existe chez l'homme et chez le dieu, il y a donc une première société de raison de l'homme et du dieu. Mais ceux qui possèdent la raison en commun ont aussi en commun la Droite Raison ; et puisque celle-ci est la loi (quae cum sit lex), nous devons, de par la loi, nous estimer associés aux dieux ».
§ 415. De nouveau, nous revenons à la Nature. « (II, 5, 13) Donc la loi est la distinction du juste et de l'injuste, principe de toute chose, modelée très anciennement sur la Nature ». Cette nature est élastique comme la gomme : on en fait tout ce qu'on veut. « (I, 8, 25) La vertu n'est pas autre chose que la Nature parfaite en elle-même et achevée [FN: § 415 note 1)] ».
§ 416. Il est impossible de lire tout cela sans voir que l'auteur a une idée claire d'une loi qui n'est pas conventionnelle. Il le manifeste en disant: « (I, 10, 28) que le droit a été constitué non d'après une opinion, mais d'après la nature – neque opinione, sed natura constitutum esse ius ». Puis il a des idées confuses au sujet de l'origine et de la nature de cette loi ; il va à tâtons, et cherche tout ce qu'il peut trouver de parfait, pour l'associer à son idée de la loi.
§ 417. Depuis Cicéron, on n'a fait que peu ou point de progrès, et les auteurs qui traitent du droit naturel continuent à combiner les mêmes concepts, de toutes les manières possibles. On n'a fait que substituer le Dieu des chrétiens aux dieux des païens. On ajoute un vernis scientifique, et l'on demande à une pseudo-observation de nous faire connaître la volonté de dame Nature.
§ 418. Les jurisconsultes romains ont souvent placé leurs théories sous la protection d'un certain droit naturel (ius naturae, naturale) commun à tous les hommes et même aux animaux. On a voulu les justifier en observant qu'il existe certains caractères communs aux hommes et aux animaux. Mais ce n'est pas du tout de ces caractères qu'il s'agit. Ils ne jouent en aucune façon le rôle d'un principe de droit, tel que les partisans du droit naturel l'ont en vue : Semblablement, du fait que certains caractères bons ou mauvais du père influent sur la nature de sa descendance, ou a voulu déduire qu'il était juste que les fils fussent punis pour les fautes du père (§ 1965 et sv.). On confond ainsi un état de fait avec un état de « droit » : ce qui arrive avec ce que l'on prescrit devoir arriver. Autre chose est dire : « D'un père syphilitique naît une progéniture qui a certaines maladies », autre chose : « On doit punir le père syphilitique dans le fils, en donnant artificiellement à celui-ci des maladies qu'il n'a pas ».
De même, on a donné le nom de solidarité à la dépendance mutuelle des hommes et des animaux ou des hommes entre eux ; puis, de ce fait, on a voulu déduire une chose entièrement différente, soit un certain droit de solidarité (§ 449, 450).
§ 419. Dans les Institutes de Justinien, on nous dit : « (I, 2) Le droit naturel est celui que la Nature enseigne à tous les êtres vivants ; car ce droit n'est pas propre au genre humain, mais à tous les êtres qui vivent dans le ciel, sur la terre, dans la mer. De là vient l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage ; de là, la procréation et l'éducation des enfants. Nous voyons effectivement que les autres êtres vivants semblent avoir connaissance de ce droit ». Si nous enlevons le voile du sentiment, ce passage est vraiment comique. Il ne suffit pas aux compilateurs des Institutes d'énumérer tous les animaux. Ils insistent afin de dissiper tous les doutes et d'enfler la période : ils parlent de tous les êtres qui vivent dans l'air, sur la terre et dans l'eau. Nous avons ainsi un droit naturel des lombrics, des puces, des poux, des mouches, et aujourd'hui nous pourrions ajouter : des infusoires. Non seulement ce beau droit existe, mais ces animaux le connaissent ; ce qui est certes merveilleux au-delà de toute expression.
§ 420. Comme preuve, on donne le mariage. Chez certaines espèces d'araignées, le mâle saisit le moment auquel la femelle ne le voit pas, pour s'élancer sur elle et s'accoupler ; puis il s'enfuit au plus vite, car si la femelle l'attrape, elle le dévore. Elle est vraiment étrange la manière dont ces animaux connaissent et emploient le droit naturel du mariage !
§ 421. Pour mettre d'accord le droit avec les faits, les compilateurs des Institutes se servent d'un moyen qui est très en usage : ils changent quelque peu le sens des termes. Quand ils disent : hinc descendit maris atque feminae coniugatio (al. coniunctio), quam nos matrimonium appellamus, ils contredisent ce qu'ils avancent plus loin (I 10, 12) : Si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur. Donc, tantôt ils déclarent appeler matrimonium la simple union, comme est celle des animaux, tantôt ils refusent ce nom aux unions qui n'ont pas d'autres caractères donnés. L'une de ces deux propositions doit nécessairement être éliminée, puisqu'elles sont contradictoires. Il convient que ce soit la première, car il est certain que, dans le langage du droit, le matrimonium est quelque chose d'autre que la simple union.
§ 422. Le droit des gens (ius gentium) nous est donné comme imposé par la raison naturelle (naturalis ratio). C'est là une belle entité, à laquelle on peut recourir dans les cas difficiles, et qui sert à démontrer beaucoup de belles choses ! Elle s’appelle aussi la droite raison ![]() , la vraie raison, la juste, l'honnête raison, etc. On ne réussit pas à expliquer comment on peut distinguer la raison qui mérite ces excellentes épithètes, de celle qui en doit être dépourvue ; mais, en somme, la première est toujours celle qui plaît le mieux à l'auteur qui lui donne l'épithète favorable.
, la vraie raison, la juste, l'honnête raison, etc. On ne réussit pas à expliquer comment on peut distinguer la raison qui mérite ces excellentes épithètes, de celle qui en doit être dépourvue ; mais, en somme, la première est toujours celle qui plaît le mieux à l'auteur qui lui donne l'épithète favorable.
§ 423. Paul affirme que A est B ; Jacques le nie. Paul croit démontrer son assertion en ajoutant que la droite raison veut que A soit B. Mais pourquoi la raison de Paul est-elle droite, et pas celle de Jacques ? Qui jugera de cette controverse ? Si Jean survient et dit qu'à son idée c'est la raison de Paul qui est droite, cela prouve seulement que Paul et Jean pensent de même sur ce point. Quel rapport a ce fait avec l'autre, avec celui que A doit être B ? Si, au lieu de Jean, ce sont plusieurs hommes, beaucoup d'hommes, tous les hommes, qui admettent l'avis de Paul, cela continue à n'avoir pas de rapport avec la proposition objective d'après laquelle A est B, excepté le cas où l'on verrait en ce consentement la preuve de cette proposition. Mais si l'on veut raisonner ainsi, il vaut autant et même mieux donner directement ce motif, sans exhiber la droite raison pour la faire disparaître ensuite. Cela au point de vue exclusivement expérimental et logique. Mais pour agir sur le sentiment, l'intervention de la droite raison est utile ; car on suggère que celui qui n'accepte pas la démonstration que l'on veut donner est digne de blâme. Ce procédé est général. Nous en traiterons plus loin (§ 480 et sv.).
§ 424. Nous avons ensuite une élite de jurisconsultes, qui construisirent la théorie du droit naturel et des gens, et qui sont très admirés par ceux qui ont la chance de la comprendre. Tels Grotius, Selden, Pufendorf, Burlamaqui, Vattel, etc. Nous ne pouvons, vu le manque de place, examiner toutes ces définitions ; mais il n'y a pas grand mal, parce qu'elles se ressemblent toutes et sont également indéterminées.
§ 425. Grotius [FN: § 425-1]dit : « Pour commencer par le Droit Naturel, il consiste dans certains principes de la Droite Raison, qui nous font connaître qu'une Action est moralement honnête † ou déshonnête, selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu'elle a avec une Nature Raisonnable * et Sociable ; et par conséquent que Dieu, qui est l'Auteur de la Nature, ordonne ou défend une telle action ».
Pufendorf observe qu'ainsi on raisonne en cercle, car on définit les lois naturelles par ce qui est honnête ; et puis, pour savoir ce qui est honnête, on est contraint de recourir aux lois naturelles [FN: § 425-2](2). Mais Burlamaqui [FN: § 425-3]lave Grotius de cette tache : « (II, 5, 6) Je ne vois point là de cercle ; car, sur cette demande, d'où vient l'honnêteté ou la turpitude naturelle des actions prescrites ou défendues, Grotius ne répond point comme on le fait répondre ; il dira au contraire que cette honnêteté ou cette turpitude vient de la convenance ou de la disconvenance nécessaire de nos actions avec une nature raisonnable et sociable ». C'est toujours la façon de définir une inconnue par une autre inconnue. Des lois naturelles, on nous renvoie à ce qui est honnête ; de ce qui est honnête à la convenance, sans compter cette fameuse nature raisonnable, qu'on ne distingue pas très bien de celle qui ne l'est pas.
§ 426. En attendant, continuons ; et puisqu'on nous a renvoyés à la convenance, voyons si nous réussissons à savoir ce que cela peut bien être. Burlamaqui nous le dit : « (II, 8, 2) Enfin pour la convenance, elle approche beaucoup de l'ordre même. C'est un rapport de conformité entre plusieurs choses, dont l'une est propre par elle-même à la conservation et à la perfection de l'autre, et contribue à la maintenir en un état bon et avantageux ». Donc il paraîtrait que l'honnête est ce qui présente le rapport indiqué tout à l'heure, avec la nature raisonnable et sociable. Le nombre des inconnues croit au lieu de diminuer. Maintenant, outre qu'il nous reste à savoir ce qu'est la nature raisonnable, il nous faut aussi connaître le sens que l'auteur donne aux mots : conservation, perfection, état bon et avantageux.
§ 427. Tout ce brouillamini revient finalement à dire que le droit naturel est ce qui, dans l'esprit de l'auteur, produit des idées analogues à celles qu'engendrent les mots : nature raisonnable, conservation, perfection, état bon et avantageux, qui sont tous essentiellement indéterminés.
Pourquoi donc l'auteur fait-il un si grand détour, et n'emploie-t-il pas sans autre cette forme ? L'induction nous amène ici à envisager un phénomène général, que nous étudierons tout au long au chapitre IX. Pour le moment, continuons à voir en quels rapports ces théories se trouvent avec les faits expérimentaux.
§ 428. Pour Pufendorf [FN: § 428-1] , « (I, 2, 16) la loi naturelle est celle qui convient si invariablement à la nature raisonnable et sociable de l'homme, que sans l'observation de ses normes, il ne pourrait y avoir de société honnête et pacifique dans le genre humain ». Il semblerait qu'il recoure uniquement à l'expérience, et si l'on continuait sur cette voie, la loi naturelle serait simplement celle qui règle les sociétés, de manière à ce qu'elles puissent subsister. Malheureusement, l'expérience nous enseigne que nombreuses sont les sociétés qui subsistent, chacune avec une loi différente ; de sorte que nous ne pouvons savoir laquelle est naturelle, excepté si nous cherchons ce qu'elles ont de commun ; ce qui nous transporte dans un autre domaine [FN: § 428-2].
§ 429. Mais l'auteur ne l'entend certainement pas ainsi. Il chasse sans plus tarder l'expérience, en disant que cette loi peut être découverte avec le seul secours de la raison naturelle, et une simple contemplation de la nature humaine, considérée en général. Et sachez par conséquent que « (I, 3, 1) pour découvrir entièrement et évidemment le caractère distinctif de la loi naturelle,... il suffit d'examiner avec soin la nature et les inclinations de l'homme en général ». Ainsi, nous voilà rejetés en pleine métaphysique, grâce à cette chère Nature ; ce qui nous fait aborder au rivage où habite la Loi fondamentale du droit naturel, qui consiste en ce que « (I, 3,9) chacun doit agir, autant qu'il le peut, pour conserver le bien de la société humaine en général ». Cela nous apprend peu de chose, car la discussion portera maintenant sur ce qu'est ce bien. L'un dira, par exemple : « Le bien d'une société est d'avoir une aristocratie ». Un autre de répliquer : « Le bien de la société, c'est la démocratie ». Comment ferons-nous pour trancher le différend au moyen des principes du droit naturel ? Pufendorf ajoute (I, 3, 11) que « la loi naturelle a Dieu pour auteur ». En vérité, il ne pourrait en être autrement.
§ 430. Burlamaqui s'écarte peu de Pufendorf. Il dit : « (Principes, II, 1, 2) L'on entend par loi naturelle une loi que Dieu impose à tous les hommes, et qu'ils peuvent découvrir et connaître par les seules lumières de leur raison, en considérant avec attention leur nature et leur état ». Ici ont disparu les animaux [FN: § 430-1], qui faisaient si belle figure dans les Institutes de Justinien. Mais une autre entité est apparue : Dieu, sans que l'on sache d'ailleurs si c'est le Dieu des chrétiens, des musulmans ou quelque autre. Dieu a imposé un droit naturel, commun à tous les hommes, qui, d'autre part, n'ont pas le même Dieu. On dirait une énigme.
§ 431. Dans la proposition de Burlamaqui, il y a deux définitions et un théorème. La loi naturelle se définit de deux manières : 1° elle est donnée par Dieu; 2°on peut la connaître au moyen de la raison. Le théorème consiste à affirmer que les deux définitions concordent. On ne voit pas très bien comment ceux qui ont un Dieu différent, et surtout les athées, peuvent marcher tous d'accord. Quant aux résultats auxquels conduit la considération attentive de la nature et de l'état de l'homme, ce sont simplement des choses que l'auteur trouve en accord avec ses sentiments. Il va sans dire que si quelqu'un n'arrive pas à de tels résultats, il doit s'accuser lui-même, et penser qu'il n'a pas su considérer avec une attention suffisante la nature et l'état des hommes. Mais si la personne en question persévérait dans son opinion, et affirmait qu'en considérant attentivement la nature de l'homme et son état, elle arrive à des conclusions différentes, quel sera le critère pour qui voudra savoir quelles conclusions il doit accepter ? (§ 16 et sv.) Dans la considération de la nature, on peut trouver tout ce qu'on veut. L'auteur des Problèmes qu'on attribue à Aristote, y trouve pourquoi l'homme est de tous les êtres vivants celui qui, proportionnellement à son corps, a les yeux les plus rapprochés l'un de l'autre ; il se demande [FN: § 431-1] si : « c'est peut être parce qu'il est plus que les autres selon la nature? »
L'« expérience » des croyants du droit naturel est semblable à l’« expérience du chrétien » moderne. Il n'y a, dans un cas comme dans l'autre, rien qui ressemble à l'expérience des sciences naturelles ; et ce terme expérience ne sert qu'à dissimuler le fait que celui qui l'emploie exprime simplement son opinion et celle de ceux qui pensent comme lui (§ 602).
§ 432. Dans la préface de son traité De officio hominis et civis, Pufendorf résume ses idées, en disant qu'il existe trois sciences distinctes : « le Droit naturel commun à tous les hommes, le Droit civil, qui est et peut être différent dans les divers États, et la Théologie morale... Le Droit naturel prescrit telle ou telle autre chose, parce que la Droite Raison nous la fait juger nécessaire pour conserver la société humaine en général ». Bien entendu, la raison qui ne prescrit pas ce que veut notre auteur n'est pas droite ; et nous ne pouvons savoir si vraiment elle n'est pas telle, tant que nous n'en avons pas une définition claire et précise.
§ 433. Interprétant les idées de Pufendorf, Barbeyrac essaie de donner cette définition [FN: § 433-1] . « De là il paroît par où il faut juger de la droiture de la Raison dans la recherche des fondemens du Droit Naturel ; c'est-à-dire, à quoi l'on connoît qu'une maxime est conforme ou contraire à la droite Raison. Car les maximes de la droite Raison sont des principes vrais, c'est-à-dire, qui s'accordent avec la nature des choses bien examinée, ou qui sont déduits par une juste conséquence de quelque premier principe vrai en lui-même. Ce sont au contraire des maximes de la Raison corrompue, lorsqu'on bâtit sur de faux principes, ou que de principes véritables en eux-mêmes on vient à tirer quelque fausse conséquence ».
§ 434. Sous cette longue dissertation, il n'est pas difficile de reconnaître le principe cher aux métaphysiciens, d'après lequel on peut découvrir les vérités expérimentales grâce à l'auto-observation de l' « esprit humain » (§ 493). Ainsi la droite raison doit nécessairement être d'accord avec l'expérience, avec la « Nature » comme disent ces messieurs.
§ 435. Notre auteur continue [FN: § 435-1]: « Si donc ce que l'on donne pour une maxime de la Loi Naturelle, est effectivement fondé sur la nature des choses, on pourra le regarder à coup sûr comme un principe véritable, et par conséquent comme un principe de la droite Raison : car la nature des choses ne nous fait connaître que ce qui existe réellement... ». S'il suivait la méthode expérimentale, il renverserait cette proposition en disant: « Ce qui existe réellement nous fait connaître la nature des choses ». Mais comme il suit la méthode métaphysique, il ne demande pas ce qui existe réellement, à l'observation des faits, mais bien « à des principes conformes à la nature des choses ». La Droite Raison demeure juge de cette conformité. Par conséquent, nous tournons en cercle : pour connaître la droite raison, on nous renvoie à la nature des choses ; et pour connaître la nature des choses, on nous renvoie à la droite raison.
§ 436. Avec cette belle façon de raisonner, l'auteur peut nous donner à entendre tout ce qu'il veut ; et c'est ainsi que sans trop de peine – dit-il – on arrive à découvrir que le fondement du droit naturel est la sociabilité [FN: § 436-1]. La sociabilité entre toujours dans tous ces systèmes, soit ouvertement, soit dissimulée, parce que leur but est de pousser l'homme à ne pas nuire à autrui, mais au contraire à lui être utile ; et par conséquent, il faut le secours des sentiments dits de sociabilité.
§ 437. Burlamaqui appelle à l'aide d'autres sentiments aussi estimant que plus on en peut avoir de favorables, mieux cela vaut. Parlant à des chrétiens, il appelle leur religion à la rescousse. Aux égoïstes, il veut persuader que l'altruisme est une bonne règle de l'égoïsme (1479 et sv.). Aussi a-t-il trois principes des lois naturelles : « (II, 4, 18) La religion ; l'amour de soi-même ; la sociabilité ou la bienveillance envers les autres hommes ».
§ 438. Le défaut des définitions des entités métaphysiques employées dans l'étude du droit naturel, n'échappe souvent pas aux auteurs, et chacun s'ingénie, hélas ! avec peu de succès, à trouver une meilleure définition.
§ 439. Voici Burlamaqui, qui déclare vouloir employer la méthode expérimentale et dit [FN: § 439-1]: « On parle beaucoup de l'utile, du juste, de l'honnête, de l'ordre et de la convenance ; mais le plus souvent on ne définit point ces différentes notions d'une manière précise... Ce défaut de précision ne peut que laisser dans le discours de la confusion et de l'embarras ; si l'on veut faire naître la lumière, il faut bien distinguer et bien définir ». Bravo ! Écoutons-le donc un peu, lui qui nous donnera des définitions claires et précises. Sachez que « (II, 8, 2) une action utile est celle qui, par elle-même, tend à la conservation et à la perfection de l'homme ». Notez ici l'équivoque de l'impersonnel : l'homme. Si l'on disait d'un homme, on pourrait répondre que ce qui tend à la conservation et à la perfection d'un voleur, c'est de savoir voler avec adresse ; mais on ne peut le dire de l'homme en général. Reste encore à démontrer que ce qui est utile à l'homme en général est aussi utile à l'homme en particulier, puisque c'est à lui que le discours s'adresse. Mais l'auteur ne s'en soucie pas.
Une action est dite honnête, quand elle est considérée comme « conforme aux maximes de la droite raison [comment distinguer la droite raison de celle qui n'est pas droite ?], conforme à la dignité de notre nature [qu'est-ce que cette nouvelle entité ?], méritant par là l'approbation des hommes [et s'il y a des gens qui l'approuvent et d'autres qui la désapprouvent ?], et procurant en conséquence à celui qui la fait, de la considération, de l'estime et de l'honneur [parmi les peuples guerriers, c'est l'apanage de celui qui a tué le plus grand nombre d'ennemis ; parmi les anthropophages, de qui en a mangé le plus] ». On appelle ordre : « la disposition de plusieurs choses, relative à un certain but, et proportionnée à l'effet que l'on veut produire. » Enfin, il y a encore la convenance : « elle approche beaucoup de l'ordre même. C'est un rapport de conformité [qu'est-ce que cette conformité ?] entre plusieurs choses, dont l'une est propre par elle-même à la conservation et à la perfection de l'autre [qu'est-ce que cette perfection ?], et contribue à la maintenir dans un état bon et avantageux » [bon pour qui ? avantageux pour qui ?]. Par exemple, un poison qui ne laisse pas de traces est « propre à la conservation et à la perfection » de qui veut empoisonner son prochain, et le maintient dans un état « bon et avantageux » pour lui ; mais ou ne peut dire qu'il soit « propre à la conservation et à la perfection » de qui est empoisonné, et qu'il le maintienne dans un état « bon et avantageux ». On ne peut donc traiter, dans le sens donné par notre auteur, de la convenance en général, mais il faut dire par rapport à qui, en particulier.
§ 440. Au contraire, l'auteur traite de tout objectivement et comme si ces entités avaient des existences indépendantes (§ 471). De plus, remarquez comment il emploie ses définitions : « (II, 8, 3) Il ne faut donc pas confondre le juste, l'utile et l'honnête,... Mais ces idées, quoique distinctes l'une et l'autre, n'ont cependant rien d'opposé entre elles : ce sont trois relations, qui peuvent toutes convenir et s'appliquer à une seule et même action considérée sous différents égards. Et même, si l'on remonte jusqu'à la première origine, on trouvera qu'elles dérivent toutes d'une source commune, ou d'un seul et même principe, comme trois branches sortent du même tronc. Ce principe général, c'est l'approbation de la raison... ». Était-il vraiment besoin d'un si long détour pour arriver enfin à dame Raison, présentée tant de fois déjà comme la mère du droit naturel ?
§ 441. Vattel laisse de côté la droite raison ; mais nous n'y gagnons pas grand'chose, car un certain bonheur, encore plus inconnu, apparaît à son tour. L'auteur dit [FN: § 441-1]: « (I, p. 39) Le droit naturel est la science des lois de la nature [il se confondrait donc avec la chimie, la physique, l'astronomie, la biologie, etc., qui sont certainement des lois de la nature ? Non, parce que l'auteur change brusquement de route], de ces lois que la nature impose aux hommes, ou auxquelles ils sont soumis par cela même qu'ils sont hommes ; science dont le premier principe (p. 40) est cette vérité de sentiment [que peut bien être cette entité ?], cet axiome incontestable [et si quelque hérétique le contestait ?] : La grande fin de tout être doué d'intelligence et de sentiment est le bonheur ». Mais quel bonheur ? Celui du « destructeur de villes » n'est certainement pas celui des citoyens tués. Celui du voleur n'est pas celui du volé. Il s'agit donc, ici d'un certain bonheur spécial, et l'on ne dit pas en quoi il se distingue de ce qui porte ordinairement ce nom. Ce bonheur spécial s'appelle souvent : vrai bonheur ; mais cet adjectif ne nous fait guère approcher de la réalité expérimentale. Le blâme et les injures contre ceux qui refusent de reconnaître ce bonheur ne servent à rien non plus. « (p. 40) Il n'est point d'homme, quelles que soient ses idées sur l'origine des choses, eût-il même le malheur d'être athée, qui ne doive se soumettre aux lois de la nature. Elles sont nécessaires au commun bonheur des hommes. Celui qui les rejetterait, qui les mépriserait hautement, se déclarerait par cela même l'ennemi du genre humain, et mériterait d'être traité comme tel » (§ 593). Mettre un homme en prison ou le brûler n'est malheureusement pas une démonstration logico-expérimentale.
§ 442. Toutes ces définitions et d'autres semblables ont les caractères suivants : 1° elles emploient des termes indéterminés, qui font naître certains sentiments, mais qui ne correspondent à rien de précis (§ 380, 387, 490); 2° elles définissent l'inconnu par l'inconnu ; 3° elles mélangent des définitions et des théorèmes qu'elles ne démontrent pas ; 4° leur but est en somme d'exciter autant que possible les sentiments, pour amener à un but déjà déterminé la personne à laquelle on s'adresse.
§ 443. Selden [FN: § 443-1]commence par observer que les auteurs qui se sont occupés du droit naturel lui ont assigné quatre origines différentes : l° ce qui est commun à tous les êtres vivants ; 2° ou bien à toutes les nations ou au plus grand nombre d'entre elles ; 3° la raison naturelle et son droit usage ; 4° enfin la Nature, et par conséquent la raison naturelle des ancêtres, c'est-à-dire l'autorité et les préceptes des dieux sacro-saints. Il repousse les trois premières et n'accepte que la quatrième, en la réduisant à la raison naturelle des Hébreux et à l'autorité de leur Dieu.
444. Le Talmud [FN: § 444-1] nous donne de précieux détails sur la façon dont la Loi que Dieu donna a pu être connue par les diverses nations ; et, après tout, ce moyen n'est pas moins croyable que celui de la Droite Raison ; en compensation, il est beaucoup plus sûr ; et Bartenora observe avec raison que de cette manière les nations ne pouvaient s'excuser en disant : « Nous n'avons eu aucun moyen de nous instruire ».
§ 445. Si nous ne prêtons attention qu'à la forme, toutes ces dissertations sur le droit naturel nous apparaissent comme un tas d'absurdités. Si, au contraire, nous négligeons la forme, pour envisager ce qu'elle recouvre, nous trouvons des inclinations et des sentiments qui agissent puissamment pour déterminer la constitution sociale, et qui, par conséquent, méritent une étude attentive. Il ne faut pas accepter les démonstrations données sous cette forme, parce qu'elles sont d'accord avec les sentiments ; ni les repousser, parce qu'elles sont en désaccord manifeste avec la logique et l'expérience. Il faut les considérer comme non existantes (§ 464), et prêter attention aux éléments qu'elles recouvrent, étudier directement ceux-ci, en prenant garde à leurs caractères intrinsèques. L'induction nous oblige donc de nouveau à séparer en deux les doctrines, telles que nous les trouvons exprimées, et nous montre que, de ces deux parties, l'une est beaucoup plus importante que l'autre. Donc, dans la suite de cette étude, nous devrons tâcher de séparer ces deux parties ; et ensuite, de ne pas nous arrêter à l'idée qu'un raisonnement donné n'est pas concluant, est stupide, absurde, mais de rechercher s'il ne manifeste pas des sentiments utiles à la société, et s’il ne les manifeste pas d'une manière capable de persuader beaucoup d'hommes, qui ne seraient pas du tout convaincus par d'excellents raisonnements logico-expérimentaux. Pour le moment, il suffit d'avoir reconnu cette voie qui s'ouvre devant nous. La parcourir est ce qu'il nous reste à accomplir dans la suite de cet ouvrage.
§ 446. Le bon sens d'un homme pratique comme Montaigne [FN: § 446-1] , est une antidote contre l'insanité des auteurs qui divaguent sur le droit naturel, mais ne suffit pas à connaître exactement où gît l'erreur et quels sentiments le raisonnement dissimule.
§ 447. Beaucoup d'autres dissertations sont semblables à celles sur le droit naturel, et naissent toutes du désir de revêtir ce qui est contingent et subjectif, d'une apparence absolue et objective. Voici par exemple les Physiocrates, qui ont certaines idées sur l'organisation des sociétés, sur la constitution politique, sur la liberté du commerce, etc. Ils pourraient en traiter directement, comme d'autres ont fait, au moins en partie ; mais ils préfèrent les déduire d'un « ordre naturel et essentiel des sociétés politiques » imaginaire ; et c'est là précisément le titre de l'œuvre célèbre de Le Mercier de la Rivière [FN: § 447-1] . Nous voilà donc retombés dans les logomachies « (p. 11) Le juste absolu peut être défini un ordre de devoirs et de droits qui sont d'une nécessité physique, et par conséquent absolue. Ainsi l'injuste absolu est tout ce qui se trouve contraire à cet ordre. Le terme d'absolu n'est point ici employé par opposition au relatif ; car ce n'est que dans le relatif que le juste et l'injuste peuvent avoir lieu ; mais ce qui, rigoureusement parlant, n'est qu'un juste relatif devient cependant un juste absolu par rapport à la nécessité absolue où nous sommes de vivre en société ». Puis il y a un certain ordre essentiel, qui est « (p. 29) l'ordre des devoirs et des droits réciproques dont l'établissement est essentiellement nécessaire à la plus grande multiplication possible des productions, afin de procurer au genre humain la plus grande somme possible de bonheur, et la plus grande multiplication possible ». A ce qu'il paraît, c’est très évident, comme aussi le fait que cet ordre naturel est une branche de l'ordre physique. « (p. 38) Si quelqu'un faisoit difficulté de reconnoître l'ordre naturel et essentiel de la société pour une branche de l'ordre physique, je le regarderois comme un aveugle volontaire, et je me garderois bien d'entreprendre de le guérir » (§ 379, 435-1] ). Au fond, l'auteur a une idée qui est d’accord avec l'expérience ; c'est « (p. 38) que l'ordre social n'a rien d'arbitraire » ; mais la démonstration qu'il donne de cette proposition est vraiment fort mauvaise.
§ 448. Comme d'habitude, dans ce genre de dissertations, l'auteur estime que ses idées doivent être acceptées par tout le monde, dès qu'il les a manifestées. (§ 591 et sv.). « (p. 38) La simplicité et l'évidence de cet ordre social sont (p. 39) manifestes pour quiconque veut y faire la plus légère attention ».
Mais voici Mably [FN: § 448-1]qui, malgré beaucoup d'attention, ne demeure pas du tout persuadé de cette évidence, ni de certaines autres auxquelles il est fait allusion dans les deux premières parties de l'ouvrage de Le Mercier de la Rivière. Il dit : « (p. 4) Je vois qu'on y parle beaucoup d'évidence, et il me semble que rien n'y est évident. J'ai lu, j'ai relu ; et loin de voir dissiper mes doutes, je les ai vus se multiplier ». Sur certains points, Mably ne raisonne pas mal du tout ; par exemple, quand il observe qu'on ne peut qualifier une organisation déterminée, de nécessaire aux sociétés, alors qu'on trouve dans le monde concret des sociétés qui s'en passent. Le Mercier de la Rivière démontre (p. 21) la nécessité de la propriété foncière. Mably dit : «(p. 7) Si l'on se contentoit de demander que chaque société eût en corps, une propriété foncière, je n'aurois aucun embarras ; car je vois très-bien qu'il est indispensable qu'une société ait un domaine pour assurer la subsistance des Citoyens ; mais, (p. 8) qu'on regarde comme d'une nécessité et d'une justice absolues, une chose dont les sociétés policées et florissantes se sont passées : voilà ce qui confond ma raison, et bouleverse toutes mes idées ». Laissons de côté, pour un moment, la propriété de la société et dame Justice Absolue que nous ne connaissons pas bien. Le reste du raisonnement est bon. L'auteur cite l'exemple de Sparte, qui n'est guère bien choisi ; car s'il n'y avait pas un genre de propriété foncière, à Sparte, semblable à celle de Rome, il y existait pourtant un certain genre de propriété foncière. Mais l'exemple des Missions du Paraguay est pleinement efficace. «(p. 9.) Il n'y a pas jusqu'aux Jésuites, Monsieur, qui ne vous fassent des objections, et ils se donnent la licence, au Paraguay, de braver impunément la Loi essentielle de votre Ordre naturel ».
Prenons garde que Mably, exactement comme Le Mercier de la Rivière, a une idée préconçue à défendre. Il recourt à l'expérience quand elle lui est favorable, pour défendre la propriété collective qu'il préconise, comme Le Mercier de la Rivière appelait l'ordre naturel à son aide, pour défendre la propriété foncière individuelle. Cela explique pourquoi Mably ne s'aperçoit pas qu'on peut précisément opposer à la première partie de son raisonnement, la même objection qu'il formule dans la seconde. En effet, les peuples nomades n'ont de propriété foncière, ni collective, ni privée.
Mably pourrait répondre que les nomades ne sont pas des «Sociétés policées et florissantes » ; mais s'il s'engageait sur cette voie, il s'exposerait à voir réfuter son exemple du Paraguay, pour un motif identique ; et si Le Mercier de la Rivière voulait bien laisser de côté ses fantaisies sur l'ordre naturel et essentiel, il pourrait démontrer par de bons exemples, que les sociétés les plus civilisées et les plus florissantes furent justement celles où existait la propriété foncière privée. Mais la discussion sortirait ainsi du domaine des sentiments et de la métaphysique, où se promènent souvent nos auteurs, pour passer dans celui de la science logico-expérimentale.
F. Quesnay cite différentes opinions sur le droit naturel, et il trouve qu'il y a dans toutes une part de vérité ; mais [FN: § 448-2] « (p. 42) les philosophes se sont arrêtés au paralogisme, ou argument incomplet, dans leurs recherches sur cette matière importante, qui est le principe naturel de tous les devoirs de l'homme réglés par la raison ». Il complète donc leurs recherches. D'abord il s'occupe de la justice. « (p. 42) Si on me demande ce que c'est que la justice ? Je répondrai que c'est (p. 43) une règle naturelle et souveraine, reconnue par les lumières de la raison [si la « raison » de certains hommes « reconnaît » une règle, et la « raison » de certains autres en reconnaît une qui est différente, comment décide-t-on quelle règle est la bonne ?] qui détermine évidemment ce qui appartient à soi-même ou à un autre ». Ensuite, après de longs développements, il conclut ainsi : « (p. 52) Les hommes réunis en société doivent donc être assujettis à des lois naturelles et à des lois positives. – Les lois naturelles sont ou physiques, ou morales. – On entend ici par lois physiques, le cours réglé de tout évènement (p. 53) physique de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain. On entend ici, par loi morale, la règle de toute action humaine de l'ordre moral, conforme à l'ordre physique évidemment le plus avantageux au genre humain. Ces lois forment ensemble ce qu'on appelle la loi naturelle. Tous les hommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines instituées par l'Être-Suprême [Quesnay augmente ainsi d'une unité le nombre extrêmement considérable des hommes qui ont cru connaître la volonté de cet Être Suprême, et qui, malheureusement, ne s'accordent guère entre eux] ; elles sont immuables et irréfragables, et les meilleures lois possibles... ». C'est un raisonnement en cercle, car si l'on définit la loi naturelle « ce qui est évidemment le plus avantageux au genre humain », il serait difficile de comprendre que « les lois formant ensemble la loi naturelle » ne sont pas « les meilleures lois possibles ». Mais il est vraiment surprenant que ces lois étant « immuables et irréfragables », n'aient pas été découvertes avant Quesnay, et n'aient pas été généralement adoptées après qu'il les a trouvées et fait connaître au genre humain.
§ 449. Notons encore les analogies qui existent entre les théories semblables à celles du droit naturel, et cet autre rêve métaphysique appelé théorie de la solidarité. Dans cette dernière, comme dans l'une des théories du droit naturel, on part – ou mieux : on feint de partir – de l'expérience. La théorie du droit naturel reconnaît un droit commun aux hommes et aux animaux. La théorie de la solidarité va encore plus loin : elle reconnaît une loi de mutuelle dépendance entre les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux [FN: § 449 note 1)]. Si la première est bonne, la seconde est parfaite.
§ 450. Mais messieurs les métaphysiciens s'entendent mal avec l'expérience ; aussi ne tardera-t-elle pas à être bannie d'un côté ou de l'autre. Le droit naturel abandonne les animaux à leur triste sort. La doctrine de la solidarité fait mieux : elle renie son origine, jusqu'à opposer comme contraires la « solidarité-fait » et la « solidarité-devoir [FN: § 450-1] ».
§ 451. Comment trouverons-nous cette dernière ? Après ce que nous avons dit, le lecteur ne peut avoir aucun doute. Mais que font dans le monde la droite raison, la nature, le juste, l'honnête, etc.? De même qu'ils nous ont donné la théorie du droit naturel, ils nous donneront la théorie de la solidarité, et autant d'autres semblables, que de braves auteurs voudront bien imaginer [FN: § 451-1].
§ 452. Trois éléments apparaissent dans les théories que nous venons d'examiner : 1° un élément expérimental, qui fait rarement défaut, mais est souvent plus apparent que réel ; 2° un élément métaphysique, soit extra-expérimental, qui est parfois dissimulé, mais ne fait jamais défaut; 3° un élément théologique, par conséquent soustrait à l'expérience, qu'on trouve dans certaines théories, et qui, en d'autres, fait défaut.
Ces deux derniers éléments sont choisis d'habitude parmi les doctrines qui jouissent du plus grand crédit dans la société où vit l'auteur de la théorie. La théologie ne s'imposait pas, dans l'ancienne société païenne, et par conséquent l'élément théologique fait défaut en beaucoup de théories nées dans cette société. Au contraire, elle ne manque presque jamais dans les théories nées chez les sociétés chrétiennes, où l'on imposait la théologie. Maintenant, la pauvre théologie a été détrônée, et la Science a pris sa place. Toutefois prenons bien garde que ce n'est pas du tout la science expérimentale, mais bien une espèce d'entité métaphysique à laquelle on a donné ce nom.
§ 453. Burlamaqui appelait la religion à son aide (§ 430 et sv.). S'il avait vécu à notre époque, il aurait invoqué la Science. M. L. Bourgeois appelle à son aide la Science [FN: § 453-1]. S'il avait vécu au temps de Burlamaqui, il aurait invoqué la religion. Que le lecteur n'aille pas s'imaginer que cela cause la moindre difficulté à ces hommes éminents. Ils savent où ils en veulent venir, et n'ignorent pas que tout chemin mène à Rome.
§ 454. On comprend que la philosophie chrétienne cherche l'origine du droit naturel dans la volonté de Dieu. Elle pourrait s'en contenter, et l'on aurait une théorie constituée par le seul élément théologique ; mais il est remarquable qu'elle veut s'assurer aussi le secours de l'élément métaphysique et peut-être de l'élément expérimental ; ce qui confirme de nouveau que la forme de semblables théories ne dépend pas tant de leur substance, que des concepts qui sont en faveur dans la société où ils règnent. La majeure partie des hommes répugne à se contenter de la théologie seule ; et pour la persuader, il faut encore obtenir l'appui de la métaphysique et de l'expérience.
§ 455. On nous dit que : « La loi naturelle est directement implantée et inscrite dans le cœur de l'homme par Dieu même, et son but est de diriger l'homme, aspirant à son terme, comme un être libre, capable du bien et du mal [FN: § 455-1]». Que Dieu ait implanté et inscrit la loi naturelle dans le cœur de l'homme, c'est bien ; mais comment la connaîtrons-nous ? Si c'était exclusivement par la révélation, nous aurions une théorie exclusivement théologique ; mais la métaphysique intervient et, à ce qu'il paraît, l'expérience aussi.
§ 456. Saint Paul dit déjà [FN: § 456-1]: « (14) Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; (15) ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs... ». L'expérience pourrait donc la faire retrouver dans le cœur des hommes. Mais on nous avertit que la conscience ayant été corrompue, on ne peut s'y fier exclusivement. « Or, les facultés primordiales de l'homme ayant été affaiblies par le péché, il est naturel que ces conséquences [de la loi naturelle] ne soient jamais déduites dans toute leur perfection par aucun homme et qu'elles le soient souvent d'une manière défectueuse et erronée ; c'est pourquoi les lois humaines, qui ne sont et ne doivent être que des conséquences de la loi naturelle, sont toujours imparfaites, souvent défectueuses et parfois fausses » [FN: § 456-2] .
Nous retrouvons cette loi de nature dans l'ancien droit irlandais, avec des adjonctions d'ecclésiastiques et de savants docteurs irlandais [FN: § 456-3].
§ 457. Saint Thomas distingue : 1° une loi éternelle, existant dans l'esprit de Dieu ; 2° une loi naturelle, existant chez les hommes et participant de la loi éternelle : c'est d'après elle que les hommes discernent le bien et le mal ; 3° une loi trouvée par les hommes, suivant laquelle ils disposent de ce qui est contenu dans la loi naturelle ; enfin une loi divine, par laquelle les hommes sont infailliblement conduits au but surnaturel, qui est l'extrême béatitude [FN: § 457-1] . Madame la Droite Raison est absente, mais nous allons la voir revenir bientôt. Le saint homme nous dit que : « il est certain que toutes les lois sont dérivées de la loi éternelle, pour autant qu'elles participent de la droite raison [FN: § 457-2]».
§ 458. Il est à remarquer que le Décret de Gratien [FN: § 458-1] reproduit à peu près, pour le droit naturel, la définition du droit romain (§ 419) ; ce qui nous ramène à une notion pseudo-expérimentale. Mais la concession n'a pas grande importance, parce qu'il faut toujours rechercher ensuite ce qu'imposent l'Écriture et la tradition catholique.,
§ 459. Quand on désigne la Nature comme origine directe du droit naturel, les concepts issus de celui-ci peuvent prendre place parmi les idées innées, et acquérir ainsi un caractère absolu ; ce qui n'empêche pas de recourir aussi à l'action divine, en la présentant comme créatrice des idées innées.
§ 460. Locke, niant les idées innées, doit par conséquent repousser la théorie d'après laquelle le droit naturel en procède. Mais la science n'y gagne pas grand'chose, et nous retombons dans le royaume de la droite raison. Il dit [FN: § 460-1]: Du fait que je nie l'existence d'aucune loi innée, il serait erroné de conclure que je crois qu'il n'y a autre chose que des lois positives. Ce serait se méprendre absolument sur mon opinion. Il y a une grande différence entre une loi innée et une loi de nature ; entre une vérité inculquée primitivement dans l'âme et une vérité que nous ignorons, mais que nous pouvons arriver à connaître, en usant convenablement des facultés que la nature nous a données ». C'est toujours la méthode métaphysique qui présuppose l'existence d'entités abstraites ; et il est probable que Locke, même s'il avait voulu s'en détacher, en aurait été retenu par l'idée qu'il ne pouvait pas, sans de graves conséquences, changer le point où son raisonnement devait aboutir : l'existence du droit naturel.
§ 461. Grotius pose l'élément métaphysique a priori, l'élément expérimental a posteriori. Barbeyrac [FN: § 461-1] voit combien cette dernière démonstration du droit naturel est faible ; mais au lieu de conclure qu'elle échappe à l'expérience et doit donc être considérée comme scientifiquement inexistante, il a recours à la démonstration métaphysique, et l'estime solide.
§ 462. Hobbes [FN: § 462-1](I, 2, 1) nie que la loi naturelle soit exprimée par le consentement universel, ni même par le seul consentement des nations les plus sages ou les plus civilisées. Il demande judicieusement qui jugera de la sagesse des nations (§ 592). Il ne peut y avoir, suivant lui, d'autre loi de nature que la raison, ni d'autres préceptes de cette loi, que ceux qui montrent le chemin de la paix, si on peut l'obtenir, ou sinon, la manière de se défendre par la guerre. Comme d'habitude, on fait appel ensuite à la religion et à la morale (I, 5. 1). Les lois dites de nature, parce que c'est la raison naturelle qui les prescrit, sont aussi des lois morales, car elles concernent les mœurs, et des lois divines, car c'est Dieu qui en est l'auteur. Par conséquent elles ne peuvent pas être contraires à la parole divine, révélée par l'Écriture Sainte. On le démontre par force belles citations.
§ 463. Épicure cherchait dans le pacte ou contrat la définition de la justice naturelle [FN: § 463-1] . Hobbes en fait l'un des principaux fondements de ses théories, comme aussi Rousseau, avec son célèbre contrat social, comme encore nos solidaristes contemporains ; et tous tirent des conclusions différentes du même principe ; ce qui leur est facile, car ce principe manque de toute signification précise, et leurs propos ne tirent pas leur force de la logique et de l'expérience, mais de l'accord des sentiments. Le défaut de précision entache toutes ces théories et les rend stériles. Au point de vue logico-expérimental, elles ne sont ni vraies ni fausses ; elles ne signifient tout simplement rien (§ 445).
§ 464. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'une religion, d'un droit, etc. ; mais, comme nous l'avons observé déjà (§ 373), on ne peut pas davantage admettre cette unité. Non seulement il existe différentes religions, différentes morales, divers droits, etc., mais encore, quand on peut envisager certains types de ces entités, il faut prendre garde aux déviations que l'on rencontre dans les phénomènes concrets, par rapport à ces types.
Supposons pour un moment, – bien que cela ne soit en général pas vrai, – qu'il existe, au moins dans une collectivité restreinte, un certain type théorique, dont les croyances et les usages pratiques puissent être considérés comme des déviations. Par exemple, là où il y a un code civil, on peut supposer, – bien que cela ne soit pas entièrement vrai, – qu'il n'y a que de simples déviations des normes du code, dans les arrêts des tribunaux, tels qu'ils sont dictés par la jurisprudence qui s'est constituée parallèlement au code et quelquefois contre le code, ou tels qu'ils sont formulés par erreur ou ignorance des magistrats, ou pour d'autres causes.
§ 465. Soit, par hypothèse, une collectivité catholique. Nous pouvons observer trois types de déviations.
1° Le croyant est parfaitement sincère, mais il pèche parce que la chair est faible ; il se repend et déteste son péché. Nous avons une séparation complète entre la théorie et la pratique. C'est le fait qu'expriment ces vers bien connus :
(20) video meliora, proboque ;
877.Deteriora sequor.(OVID., Métam., VII).
La pratique ne tend pas le moins du monde à produire une théorie.
Tous les confesseurs savent qu'à ce propos, il y a de notables différences entre les hommes. Il en est qui retombent souvent et d'autres plus rarement, dans le même péché. Il est évident que deux collectivités ayant exactement la même foi théorique pourront différer pratiquement, suivant qu'il y a dans l'une plus d'hommes de la première espèce que de la seconde.
2° Tel qui est croyant, mais n'est pas très fervent, néglige quelque peu les préceptes de sa religion, et n'éprouve que peu ou point de remords. Il y a là déjà le germe d'une divergence théorique. Certains fidèles sont seulement indifférents : pour eux la déviation théorique est minime. D'autres croient pouvoir compenser dans une certaine mesure leurs manquements religieux ; d'autres ne les considèrent pas même comme tels ; ils discutent, ergotent, font appel à la casuistique. Ainsi apparaissent des déviations théoriques, qui croissent sur la foi orthodoxe comme des plantes parasites. De la sorte, les déviations pratiques sont accompagnées de déviations théoriques qui ne vont pourtant pas jusqu'au schisme.
3° Les divergences théoriques s'accentuent. Le schisme, l'hérésie, la négation partielle ou entière de la théorie-type apparaissent. La déviation, arrivée à ce point, cesse souvent d'être telle, et l'on voit, à proprement parler, surgir un nouveau type de théorie. Prenons garde que, comme d'habitude, on passe par degrés insensibles de l'un à l'autre de ces genres de déviations.
§ 466. Dans l'étude de la sociologie, le fait de négliger ces déviations pour considérer seulement la théorie-type, est la source de nombreuses erreurs. Rien de plus faux qu'apprécier, d'après sa théologie, l'œuvre d'une religion donnée. Si l'on raisonnait par exemple ainsi : « La religion chrétienne impose le pardon des injures ; donc les hommes du moyen-âge, qui étaient de très bons chrétiens, pardonnaient les injures », on s'éloignerait tout à fait de la vérité. Semblable est l'erreur, quand on juge de la valeur sociale d'une morale d'après son expression théorique.
Moindre, mais pourtant toujours notable, est l'erreur, quand on croit que les sentences des tribunaux, dans un pays donné, sont rendues selon la législation écrite [FN: § 466 note 1)]. Les constitutions des empereurs byzantins restaient souvent lettre morte. De nos jours, en France et en Italie, les lois écrites du droit civil peuvent donner une idée au moins approximative de la législation pratique, mais le code pénal et les lois écrites de ce droit ne correspondent pas du tout aux sentences pratiques, et souvent la divergence est énorme [FN: § 466 note 2)|. Quant au droit constitutionnel, il n'y a généralement aucun rapport entre la théorie et la pratique, si ce n'est dans l'esprit de théoriciens aussi nombreux qu'inutiles.
Un fait pratique est conséquence de beaucoup d'autres, dont une partie donnent lieu à des théories, et peuvent par conséquent être connus grâce à ces dernières. Soit, par exemple, une sentence pénale, rendue en suite du verdict d'un jury. Parmi les causes de ce fait, on peut énumérer les suivantes : 1° La législation écrite ; en matière pénale, son rôle est souvent peu important. 2° Les influences politiques ; elles peuvent être grandes, dans certains procès. 3° Les tendances humanitaires des jurés ; elles nous sont connues par les théories humanitaires et par la littérature. 4° Les tendances passionnelles, socialistes, sociales, politiques, etc., des jurés ; toutes manifestées par les théories et par la littérature. 5° L'idée générale, propre à tous les despotismes, fussent-ils royaux, oligarchiques, populaires, que la loi ne lie pas le « souverain », et que celui-ci peut substituer son caprice aux dispositions de la loi. Cette idée aussi nous est connue par les théories. On dit aujourd'hui que la loi doit être vivante, flexible, qu'elle doit s'adapter à la conscience populaire ; et ce sont là autant d'euphémismes pour indiquer qu'elle doit se plier au caprice de celui qui détient le pouvoir. 6° Une infinité d'autres tendances qui, peut-être, n'agissent généralement pas, mais peuvent se trouver prépondérantes chez les douze individus, habituellement peu intelligents, peu cultivés, et de peu d'élévation morale, qui sont appelés à fonctionner comme jurés. 7° Des intérêts particuliers de ces citoyens. 8° Une impression momentanée produite sur eux par quelque fait remarquable. Ainsi, après certains exploits retentissants de brigands, les jurés deviennent plus sévères pendant quelque temps. En résumé, la sentence dépend d'intérêts, de sentiments existant à un moment donné dans la société, de caprices aussi, de cas fortuits, et peu, parfois presque pas du tout, du code et des lois écrites [FN: § 466-3].
Quand tous ces faits sont d'une nature générale et agissent fortement, ils donnent lieu à des théories ; et c'est justement pourquoi nous étudions ces théories, moins pour les connaître directement, que pour arriver, grâce à elles, à la connaissance des tendances dont elles tirent leur origine.
§ 467. Au § 12, nous avons relevé qu'il était nécessaire de distinguer les matériaux d'une théorie, et le lien par lequel ces matériaux étaient unis pour constituer la théorie. Donc, pour une théorie donnée, deux questions générales et deux particulières se posent, soit : Point de vue général : 1°, Quels sont les éléments mis en usage dans les théories ? 2° Par quels liens sont-ils unis ? Point de vue particulier: 1° Quels sont les éléments mis en usage dans une théorie donnée ? (§ 470). 2° Par quels liens sont-ils unis? (§ 519). La réponse à ces questions nous a justement donné la classification des types de théories (§ 13). Maintenant nous devons pénétrer plus à fond dans cette étude à peine effleurée.
§ 468. Notons une analogie. Des questions semblables se posent à propos du langage. La grammaire répond aux questions générales. La morphologie nous fait connaître les éléments du langage, C'est-à-dire les substantifs, les adjectifs, les verbes, etc. La syntaxe nous enseigne comment ils s'unissent. L'analyse grammaticale et l'analyse logique d'un passage répondent aux questions particulières, pour le dit passage. L'analyse grammaticale nous fait connaître les éléments (substantifs, verbes, etc.) employés dans ce passage ; l'analyse logique nous apprend comment ils sont unis et quel sens ils acquièrent par cette union. En continuant à envisager l'analogie, on peut ajouter que la rhétorique s'occupe spécialement de cet écrit, au point de vue subjectif (§ 13).
§ 469. L'analogie s'étend aussi aux relations entre la théorie et la pratique. Celle-là n'est jamais la copie parfaite de celle-ci. La langue est un organisme vivant, même aujourd'hui, dans nos pays où l'on cherche à la fixer en des formes précises, qu'elle rompt à chaque instant, comme les racines des plantes font sauter le rocher dans les fissures duquel elles croissent. En des temps reculés, elle se développait librement, comme les plantes d'une forêt vierge [FN: § 469-1] . Nous n'avons aucune raison de croire qu'il en arrive et en soit arrivé autrement pour les produits semblables de l'activité humaine, qu'on appelle le droit, la morale, la religion ; au contraire, des faits très nombreux nous forcent à admettre qu'ils se sont développés d'une façon analogue à celle de la langue. À une époque reculée, ils se confondaient en une masse unique, comme les mots qui, dans les anciennes inscriptions grecques, sont écrits sans séparations, [Voir Addition A13 par l’auteur] et dont le contact modifie la lettre finale d'un mot et la lettre initiale du mot suivant [FN: § 469-2]. L'opération analytique si simple, consistant à séparer un mot d'un autre, demeure incomplète en sanscrit, s'accomplit en grec à une époque pas très ancienne, et laisse des traces de l'antique union, jusque dans la littérature classique. De même, l'opération analytique consistant à séparer le droit, la morale, la religion, est fortement avancée, bien que non achevée, chez les peuples civilisés modernes ; elle reste encore à exécuter chez les Barbares. Les inscriptions grecques, ainsi que l'histoire des origines gréco-latines, nous présentent la langue, le droit, la morale, la religion, comme une espèce de protoplasma dont, par scission, naissent des parties qui croissent, se différencient, se séparent. Ensuite, étudiant les faits du passé avec les idées d'aujourd'hui, nous donnons corps à des abstractions créées par nous, et nous nous imaginons les trouver dans le passé. Quand nous voyons que les faits s'écartent de ces théories, nous appelons cet écart déviation ; et nous imaginons un droit naturel, dont les droits positifs sont des déviations, de même qu'après avoir établi les conjugaisons des verbes réguliers, on a supposé que les conjugaisons des verbes irréguliers en étaient des déviations. L'étude historique du droit, la grammaire historique de nos langues, ont détruit en ces matières ce bel édifice. Celui qui a été construit pour la sociologie subsiste encore, et sert d'abri aux métaphysiciens. Il est impossible d'étudier expérimentalement l'histoire, et de ne pas voir le caractère contingent du droit et de la morale. Longtemps, la grammaire et le vocabulaire latins furent pour nous ceux de César et de Cicéron. Chez les autres auteurs, on observait des déviations, quand on ne disait pas des erreurs. Le français était la langue des auteurs de l'Académie, et qui parlait autrement tombait dans l’erreur. Or, on a finalement reconnu qu'il n'y pas une grammaire latine, un vocabulaire latin, mais qu'il y en beaucoup, et que si Plaute et Tacite écrivent autrement que Cicéron, il est un peu ridicule que nous prétendions les corriger, comme s'ils étaient de petits écoliers qui n'ont pas su bien écrire le devoir que le maître leur a donné. Jusque dans nos contrées, où le droit est fixé dans les lois, la langue dans les règles grammaticales, pas plus l'évolution de l'un que celle de l'autre ne s'arrête, et l'unité est une abstraction qui disparaît dans le monde concret.
§ 470. Les éléments des théories. Observons avec soin les matériaux avec lesquels on édifie les théories, et nous verrons qu'ils sont de deux espèces bien distinctes. Les théories envisagent certaines choses qui tombent sous le coup de l'observation et de l'expérience objective (§ 13), ou qui peuvent être déduites de ces dernières avec une rigueur logique ; elles en envisagent d'autres, qui dépassent l'observation et l'expérience objectives ; et parmi ces dernières théories, nous plaçons celles qui résultent de l'auto-observation ou de l'expérience subjective (§ 94, 95). Les choses de la première espèce seront dites entités expérimentales ; celles de la seconde, entités non-expérimentales (§ 119). Il ne faut jamais oublier que, comme nous l'avons dit au § 6, nous employons le terme expérimental dans le seul but d'être bref, et non pour désigner l'expérience seule, mais bien l'expérience et l'observation objectives.
§ 471. Prenons bien garde à certaines entités qui paraissent expérimentales et ne le sont pas. De ce genre sont le chaud, le froid, le sec, l'humide, le bas, le haut, et autres termes semblables dont les anciens naturalistes font si grand usage [FN: § 471-1]. Ajoutons-y les atomes d'Épicure, le feu et d'autres semblables entités. Tout le poème de Lucrèce peut paraître expérimental ; il ne l'est pourtant pas, car il raisonne sur des entités qui sont en dehors du domaine expérimental.
Condillac s'exprime bien, quand il dit [FN: § 471-2]: « (p. 137) Lorsque les philosophes se servent de ces mots, être, substance, essence, genre, espèce, il ne faut pas s'imaginer qu'ils n'entendent que certaines collections d'idées simples qui nous viennent par sensation et par réflexion : ils veulent pénétrer plus avant, et voir dans chacun d'eux des réalités spécifiques. Si même nous descendons dans un plus grand détail, et que nous passions en revue les noms des substances, corps, animal, homme, métal, or, argent, etc., tous dévoilent aux yeux des philosophes des êtres cachés au reste des hommes.
» Une preuve qu'ils regardent ces mots comme signes de quelque réalité, c'est que, quoiqu’une substance ait souffert quelque altération, ils ne laissent pas de demander si elle appartient (p. 138) encore à la même espèce à laquelle elle se rapportait avant ce changement : question qui deviendrait superflue s'ils mettaient les notions des substances et celles de leurs espèces dans différentes collections d'idées simples. Lorsqu'ils demandent si de la glace et de la neige sont de l'eau ; si un fœtus monstrueux est un homme ; si Dieu, les esprits, les corps ou même le vide sont des substances [toutes demandes que la science logico-expérimentale tient pour privées de sens, sans réponses, vaines], il est évident que la question n'est pas si ces choses conviennent avec les idées simples rassemblées sous ces mots, eau, homme, substance [ici nous dévions dans la métaphysique ; en réalité, c'est uniquement par l'accord des sentiments que l'on résout ces problèmes] ; elle se résoudrait d'elle-même. Il s'agit de savoir si ces choses renferment certaines essences, certaines réalités qu'on suppose que ces mots, eau, homme, substance, signifient ».
Parfois on reconnaît explicitement que ces êtres sont non-expérimentaux, et l'on tient même que, par ce fait, ils sont revêtus d'une dignité supérieure. Parfois on veut les faire passer pour expérimentaux. D'autres fois encore, celui qui en use louvoie entre l'un et l'autre concept, et souvent aussi n'a pas même une idée claire à leur sujet ; c'est habituellement le cas des hommes politiques et d'autres hommes pratiques, qui recourent à ces êtres pour manifester leurs idées. Tout cela ne change pas la manière dont nous devons considérer ces êtres au point de vue logico-expérimental ; de quelque façon qu'ils soient définis par celui qui les emploie, et même s'ils ne sont pas définis, ils sont et restent en dehors du domaine expérimental. Ensuite, n'oublions pas que nous étudions ici les théories objectivement, et que nous ne recherchons pas quelle a pu être la pensée intime de celui qui les exprime : nous les détachons de leur auteur, et les considérons seules.
§ 472. Entre les deux espèces d'éléments que nous venons de noter, trois genres de combinaisons peuvent avoir lieu : I entités expérimentales avec entités expérimentales ; II entités expérimentales avec entités non-expérimentales ; III entités non-expérimentales avec entités non-expérimentales.
§ 473. Au point de vue dont nous nous occupons ici maintenant, c'est-à-dire au point de vue de l'accord avec l'expérience, il est manifeste que nous ne pouvons envisager que le premier genre de combinaisons, puisque les deux autres échappent à toute vérification expérimentale. Comme nous l'avons relevé (§ 17, 27), dans toute controverse il faut un juge, et l'expérience refuse de trancher les procès faisant partie des genres II et III, indiqués tout à l'heure [FN: § 473-1].
§ 474. Dans le traité qui porte le nom de De Melisso [FN: § 474-1], on attribue cette proposition à un philosophe [FN: § 474-2] : « Dieu, étant partout semblable, doit être sphérique ». Là, on met en rapport une entité non-expérimentale, Dieu, avec une entité expérimentale, la forme sphérique. Aucun critère expérimental ne peut nous permettre de juger de cette assertion ; et pourtant on donne une raison qui paraît expérimentale, pour prouver que Dieu est sphérique : on dit qu'il est unique, absolument semblable à lui-même, qu'il voit et entend de tous côtés [FN: § 474-3] . L'auteur du De Melisso n'est pas convaincu ; il observe que si tout ce qui est de toute part semblable à soi-même devait être sphérique, la céruse, qui est blanche en toutes ses parties, devrait aussi être sphérique ; et il ajoute d'autres raisons semblables. Tout cela échappe évidemment à l'expérience, et si l'on veut rester dans le domaine expérimental, on ne peut donner tort ni raison à l'un quelconque des deux adversaires. Celui qui se rapprochera plus de l'un que de l'autre le fera sous l'impulsion du sentiment ; jamais en vertu d'aucun motif expérimental.
§ 475. Mais voici, dans le même traité, une autre controverse. Xénophane dit que la terre et l'air s'étendent à l'infini, tandis qu'Empédocle le nie [FN: § 475-1] . Là, il n'y a que des entités expérimentales ; l'expérience peut juger et, de fait, elle a rendu son arrêt, qui est favorable à Empédocle.
§ 476. Il faut faire attention au fait que la plus grande partie des théories qui ont eu cours jusqu'à présent sur les sujets sociaux, se rapprochent du genre de théories dans lesquelles entrent des entités non-expérimentales, tout en usurpant la forme et l'apparence de théories expérimentales.
§ 477. Si nous nous plaçons dans le domaine de la logique formelle, abstraction faite de la validité des prémisses, la position la plus forte est celle donnée par les combinaisons du genre III ; puis vient celle donnée par les combinaisons du genre II. Il est manifeste que si, dans la proposition « A est B », les deux termes A et B sont en dehors du domaine expérimental, celui qui veut rester dans ce domaine ne peut rien, absolument rien objecter. Quand saint Thomas affirme qu'un ange parle à un autre ange [FN: § 477-1] , il met en rapport des choses sur lesquelles celui qui s'en tient uniquement à l'expérience n'a rien à dire. On peut faire la même observation, quand le raisonnement s'allonge par l'emploi de la logique, et tire des conséquences variées. Saint Thomas ne se contente pas de son affirmation ; il veut aussi la démontrer et dit : « Puisqu'un ange peut manifester son idée à un autre ange, et puisque celui qui a une idée peut, grâce à sa volonté, la manifester à quelqu'un d'autre, il est clair qu'un ange parle à un autre ». La science expérimentale n'a rien à reprendre à ce raisonnement, qui sort entièrement de son domaine. Beaucoup de raisonnements métaphysiques sont semblables à celui que nous venons de noter, et beaucoup d'autres en diffèrent seulement parce qu'ils empruntent quelque terme se rapportant au monde expérimental.
§ 478. On nous donne la définition suivante : « Tous les êtres capables de quelque degré d'activité, on pourrait dire simplement tous les êtres, puisque l'inertie absolue équivaut au néant ; tous les êtres tendent à une fin, vers laquelle se dirigent tous leurs efforts et toutes leurs facultés. Cette fin, sans laquelle ils n'agiraient pas, c'est-à-dire n'existeraient pas, c'est ce qu'on appelle le bien [FN: § 478-1]». C'est ainsi qu'on définit une chose inconnue et en dehors du domaine expérimental (le bien), par une autre chose encore plus inconnue et de même en dehors du domaine expérimental (la fin); par conséquent, nous devrions rester étrangers à ce raisonnement. Mais, par malheur, on ne s'en tient pas à ces termes, et l'on ne tarde pas à étendre le dit raisonnement au monde expérimental, dans lequel on vient nécessairement se heurter à la science expérimentale.
§ 479. Le premier genre de combinaisons comprend toutes les théories scientifiques, mais en contient aussi d'autres très remarquables, qui sont pseudo-scientifiques ; celles-ci proviennent de l'élimination d'une entité non-expérimentale, admise seulement pour établir entre des entités expérimentales certaines relations qui, autrement, ne seraient pas démontrables. Par exemple, celui qui a donné la définition notée tout à l'heure, du bien, n'a pas le moins du monde l'intention de rester dans les hautes et nuageuses régions d'où il a pris son vol ; il veut tôt ou tard revenir ici-bas, sur la terre de l'expérience, qui a trop d'importance pour être entièrement négligée. De même celui qui veut rester dans le domaine de la science logico-expérimentale, n'a rien à objecter à qui affirme que l'Écriture Sainte est inspirée par Dieu ; mais ceux qui invoquent l'inspiration divine entendent s'en prévaloir ensuite, pour établir certains rapports entre des entités expérimentales ; par exemple, pour affirmer qu'il n'y a pas d'antipodes ; et ces propositions, la science expérimentale doit les juger intrinsèquement, sans se soucier des motifs échappant à l'expérience, en vertu desquels elles sont énoncées. De même encore, la théorie métaphysique de la « solidarité » échappe aux objections de la science logico-expérimentale ; mais ceux qui ont créé cette entité en dehors de l'expérience entendent s'en prévaloir pour établir des rapports entre des entités expérimentales, et principalement pour soutirer de l'argent à leur prochain. Il appartient à la science logico-expérimentale de juger intrinsèquement ces rapports et ces opérations expérimentales, sans se soucier des rêves et des divagations des saints Pères de la religion « solidariste ».
§ 480. Ces cas particuliers sont compris dans la formule générale suivante. Soient deux choses, A et B, qui appartiennent au domaine expérimental, et X, une autre chose, qui n'en fait pas partie. On fait un syllogisme dont X est le moyen terme ; celui-ci disparaît ensuite, et il ne reste qu'une relation entre A et B. Au point de vue expérimental, ni la majeure, ni la mineure, qui constituent le syllogisme, ne peuvent être admises, à cause du terme X, qui échappe à l'expérience ; et par conséquent le rapport entre A et B ne peut pas non plus être admis ni rejeté : il n'est expérimental qu'en apparence. Au contraire, dans la logique des sentiments (§ 1407), dans le raisonnement qui procède par accord de sentiments, le syllogisme peut être bon, et si nous tenons compte de l'indétermination des termes du langage vulgaire, si les sentiments suscités par le mot A concordent avec les sentiments suscités par le mot X, et ceux-ci avec les sentiments suscités par le mot B, il s'ensuit qu'en gros les sentiments suscités par A concordent avec ceux suscités par B.
Plus loin (§ 514), nous examinerons le raisonnement sous cette forme. Maintenant, commençons par l'envisager au point de vue expérimental.
§ 481. Il faut faire bien attention à deux erreurs que l'on peut faire, et qui sont de sens inverses ; c'est-à-dire: 1° admettre le rapport entre A et B, qui naît de ]!élimination de X, en vertu du raisonnement indiqué, sans une vérification exclusivement expérimentale ; 2° si l'on vérifie expérimentalement que ce rapport existe entre A et B, en conclure que, d'après la science expérimentale, X « existe » ; ou bien, si l'on vérifie expérimentalement que le rapport supposé entre A et B n'existe pas, en conclure que, d'après la science expérimentale, X n' « existe » pas (§ 487, 516, 1689).
§ 482. D'autre part, rejeter, au nom de la science expérimentale, le rapport entre A et B, qui provient de l'élimination de X, est un motif en partie formel ; et nous pourrions le négliger, si le rapport entre A et B était vérifié expérimentalement. En fin de compte, c'est là le but de la théorie ; qu'importe le moyen par lequel on l'atteint ?
§ 483. Il faut distinguer ici :
(a) l'étude de ce qui est ; c'est-à-dire des mouvements réels ;
(b) l'étude de ce qui arriverait, sous certaines conditions ; c'est-à-dire des mouvements virtuels ;
(c) l'étude de ce qui doit être.
§ 484. (a) Quant à ce qui est, l'expérience a rendu son arrêt. Les raisonnements du genre envisagé tout à l'heure n'aboutissent presque jamais à des rapports qui soient ensuite vérifiés par les faits (§ 50).
§ 485. Revenons à l'exemple des antipodes, indiqué déjà au § 67. La terre a-t-elle des antipodes ? Le bon sens et la prudence auraient dû conseiller de laisser à l'expérience la tâche de résoudre ce problème. Au contraire, Saint Augustin veut le résoudre par des motifs a priori ; et, après tout, son raisonnement n'est pas plus mauvais que beaucoup d'autres que l'on continue d'admettre aujourd'hui ; il a au moins le mérite d'être intelligible. Notre auteur dit [FN: § 485-1]: « Il n'y a aucune raison de croire que, comme on le conte, il y ait des Antipodes, c'est-à-dire des hommes sur la partie opposée de la terre, où paraît le soleil quand il disparaît sur la nôtre, des hommes qui, de leurs pieds, foulent le côté opposé à nos pas ». Il n'y a pas de preuve historique du fait. La partie de la terre opposée à la nôtre peut être recouverte par l'eau, et par conséquent sans habitants ; et puis, même si elle n'est pas recouverte par l'eau, « il n'est pas du tout nécessaire qu'il s'y trouve des hommes, puisqu’en aucune manière on ne saurait tenir pour trompeuse l'Écriture, dont les récits font foi que, pour le passé, ce qu'elle a prédit s'est accompli ; et que c'est le comble de l'absurdité de dire que quelques hommes, ayant franchi l'immense Océan, ont pu naviguer et parvenir de cette partie-ci de la terre à celle-là ». Ce raisonnement est beau, et, si l'on veut, même excellent ; mais malheureusement il se heurte aux faits ; et beaucoup d'autres semblables, par lesquels on démontrait qu'il n'existait pas, qu'il ne pouvait pas exister d'antipodes, n'ont pas un sort meilleur.
§ 486. Lactance dit [FN: § 486-1] : « Est-il bien possible qu'il se trouve quelqu'un d'assez stupide, pour croire qu'il y a des hommes dont les pieds sont au-dessus de la tête ? ou que [aux Antipodes ] tout ce qui, chez nous, est par terre, là-bas est suspendu à l'envers ? Les moissons et les arbres croîtraient en bas ? La pluie, la neige, la grêle tomberaient en haut sur la terre ? » Ici l'erreur est peut-être, à l'origine, théologique ; mais, dans la forme du moins, elle est métaphysique. Lactance raisonne comme un hégélien. Il trouve, et tous trouveront avec lui, que l'existence des antipodes répugne aux concepts haut, bas, en haut, en bas, tels que nous les avons là où nous vivons. En fait il a raison ; et il est ridicule de se figurer que les hommes marchent la tête en bas et les pieds en haut. D'autre part, celui qui raisonne non sur les concepts, mais sur les choses, celui qui ne considère les noms que comme des étiquettes qui servent à désigner les choses (§ 119), ne tarde pas à voir que, quand on passe du côté de la terre opposé à celui où nous sommes, il faut changer de place les étiquettes, intervertir les étiquettes en bas, en haut ; et de cette manière la croyance aux antipodes cesse d'être ridicule.
Prenons garde que si les erreurs du genre de celles de Lactance ont disparu – ou presque disparu – des sciences naturelles, elles demeurent au contraire très communes dans les sciences sociales, où beaucoup continuent à raisonner comme Lactance. Celui qui ne se soucie pas de voir son raisonnement aboutir à des conclusions ayant avec les faits des rapports de ce genre, n'a qu'à raisonner comme Lactance ou les hégéliens. Celui qui, au contraire, désire arriver autant que possible à des conclusions ayant avec les faits des rapports semblables à ceux que nous voyons dans les sciences physiques, doit s'efforcer de raisonner comme on le fait maintenant dans ces sciences (§ 5, § 69, § 71).
§ 487. Beaucoup se sont fait, et continuent à se faire une arme contre la religion chrétienne, ou, tout au moins contre la religion catholique, des erreurs des Pères au sujet des antipodes ; mais vraiment la religion chrétienne ni la catholique ne sont en rien la cause de ces erreurs. Il suffit, pour le prouver, d'observer que beaucoup de païens donnèrent à la terre une autre forme que la sphérique [FN: § 487-1] , et tournèrent en ridicule ceux qui croyaient aux antipodes [FN: § 487-2] . L'athée Lucrèce ne raisonne pas mieux que Lactance. Il estime absurde l'opinion de ceux qui affirment que la terre se maintient parce que tous les corps tendent au centre. « Mais peux-tu croire – dit-il – que les corps puissent se soutenir d'eux-mêmes, que tous les corps pesants qui sont sous la terre tendent vers le haut et restent ensuite sur la partie opposée de la terre, comme les images que nous voyons ici dans l'eau ? Avec de telles raisons, on soutient que les animaux marchent autour, à la renverse, et qu'ils ne peuvent tomber de la terre dans les lieux inférieurs du ciel, comme nos corps ne peuvent voler dans les régions supérieures du ciel [FN: § 487-3]».
§ 488. On pourrait seulement dire qu'une foi vive, quelle qu'elle soit, non seulement religieuse, mais aussi métaphysique, grâce à l'orgueil qu'engendre la connaissance de l'absolu, éloigne du scepticisme prudent des sciences expérimentales. Mais cette foi est une cause indirecte de l'erreur ; tandis que la cause directe se trouve dans le fait de vouloir raisonner sur des concepts plutôt que sur des faits, et d'employer l'auto-observation au lieu de l'observation objective [FN: § 488-1] .
§ 489. Cosme Indicopleuste, dans sa Topographie chrétienne, est bien amusant. Le 2d prologue a pour titre [FN: § 489-1]: « Topographie chrétienne de tout l'univers, démontrée par l'Écriture Sainte, avec laquelle les chrétiens ne doivent pas être en désaccord ». Dès l'abord, il s'en prend (57 B – Migne 58) « à ceux qui, bien que chrétiens, croient et enseignent, selon les Gentils, que le ciel est sphérique ». Notre auteur a vraiment d'excellentes raisons pour démontrer que la terre n'est pas sphérique. « Comment, avec son poids incalculable, la terre peut-elle être suspendue, rester en l'air, et ne pas tomber [FN: § 489-2]? » Au contraire, nous voyons par l'Écriture Sainte que le monde a la forme d'un four et que la terre est quadrangulaire. Le tabernacle construit par Moïse est l'image du monde. Inutile de relever que l'existence des antipodes est une fable ridicule ; et pour montrer combien elle l'est, l'auteur fait un dessin où, sur un tout petit globe, on voit des hommes très grands, dont l'un a les pieds opposés à ceux de l'autre. (131 D, 132 A – Migne 130) « Au sujet des antipodes, les Saintes Écritures ne permettent ni de dire, ni d'écouter une semblable fable ; puisqu'elles disent (Act. 17,26): Il a fait que toute la race des hommes, issue d'un seul sang, habitât sur toute la face de la terre. Elles ne disent pas : sur toutes les faces, mais sur la face ». À cette raison s'en ajoutent d'autres également très solides.
§ 490. Même des auteurs, au demeurant d'un très grand mérite, lorsqu'ils ont recours au raisonnement métaphysique, ont des théories qui ne valent pas mieux que celles exposées tout à l'heure. Dans le traité De caelo, Aristote démontre longuement que le mouvement du ciel doit être circulaire. Il commence par affirmer que tout mouvement dans l'espace doit être en ligne droite, ou circulaire, ou un mélange de ces deux mouvements (I, 2, 2); il ajoute une autre affirmation, soit que seuls les mouvements en ligne droite et les mouvements circulaires sont simples. Il dit ensuite : « J'appelle corps simples ceux qui ont naturellement en eux-mêmes le principe du mouvement, comme le feu, la terre et d'autres du même genre [FN: § 4]». C'est une définition, et il n'y aurait rien à objecter si elle était claire ; malheureusement elle ne l'est pas. C'est là un défaut qu'on trouve dans toutes les définitions des métaphysiciens, parce qu'ils ont des termes qui ne correspondent à rien de réel. Que peut bien signifier : « avoir naturellement en soi le principe du mouvement » ? Vraiment rien. Ce sont des termes qui agissent uniquement sur le sentiment de l'auditeur.
§ 491. Ces affirmations et définitions qui ne signifient rien servent ensuite à des raisonnements qu'on prétend rigoureux. (I, 2, 5) « Donc, puisqu'il y a un mouvement simple, – et le mouvement circulaire est simple, – puisqu'un corps simple a un mouvement simple, – et un mouvement simple appartient à un corps simple, car s'il était composé, il se mouvrait selon l'élément prépondérant, – il est nécessaire qu'il y ait un corps simple qui, par nature, se meuve circulairement ». À ce beau raisonnement, on ajoute le suivant : « Donc ce mouvement doit nécessairement être le premier. Le parfait, de sa nature, précède l'imparfait ; or le cercle est parfait, tandis que la ligne droite ne l'est pas... Donc si le mouvement primitif est celui du corps qui est le premier dans la nature, et que le mouvement en cercle soit supérieur au mouvement en ligne droite, qui est propre aux corps simples (étant donné que le feu monte en ligne droite et que les corps terrestres descendent vers le milieu), il est nécessaire que le mouvement circulaire appartienne à un corps simple [FN: § 491-1] ». Il est manifeste que ce raisonnement n'a rien d'expérimental ; toute sa force gît dans les sentiments que font naître des termes convenablement choisis, et on l'admet parce que ces sentiments paraissent s'accorder ensemble, ou du moins n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre.
Lancé sur cette voie, on peut trouver ce qu'on veut ; de même qu'en regardant les nuages au ciel, on peut y découvrir toutes sortes d'animaux. C'est ainsi que Platon trouve « divins » le cercle et la sphère [FN: § 491-2] . Pourquoi pas ? Il peut bien le dire ; de même qu'au contraire un étudiant, aux prises avec les problèmes de la trigonométrie sphérique, pourra les trouver « diaboliques ». Ce sont de simples expressions de sentiments, sans aucune correspondance objective.
§ 492. Aristote (De caelo, II, 13, 19) nous apprend comment, selon Anaximandre, on démontrait l'immobilité de la terre. Il n'y a aucun motif pour qu'un corps placé au centre et distant également des extrémités, soit poussé en haut plutôt qu'en bas ou en direction oblique ; et puisqu'il est impossible que le mouvement se produise en même temps de côtés opposés, ce corps doit nécessairement rester immobile. Maintenant voici comment s'exprime un des plus grands savants de notre temps : « Un point en repos ne peut se donner aucun mouvement, puisqu'il ne renferme pas en lui-même de raison pour se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre... La direction du mouvement en ligne droite, suit évidemment de ce qu'il n'y a aucune raison pour que ce point s'écarte plutôt à droite qu'à gauche de sa direction primitive [FN: § 492-1]».
La proposition d'Anaximandre est contredite par l'expérience ; les propositions de Laplace sont confirmées par elle ; dans l'un et l'autre cas, la démonstration est également sans la moindre valeur.
§ 493. On la fait sur le modèle suivant : « Tout ce qui, à moi et aux autres hommes, ne paraît pas pouvoir arriver, n'arrivera certainement pas ; je ne vois aucun motif pour lequel A doive être B ; donc A ne peut être B ». C'est là la méthode habituelle de l'auto-observation (§ 43,69, 111, 434).
§ 494. L'erreur de la démonstration est moins apparente, parce qu'on donne une forme objective à ce qui devrait avoir une forme subjective. Si Laplace avait voulu s'exprimer rigoureusement, au lieu de dire : « il n'y a aucune raison pour que ce point s'écarte plutôt à droite qu'à gauche... », il aurait dû dire : « il ne me semble pas qu'il y ait aucune raison pour que, etc. »; et de cette façon, on aurait pu mieux voir le caractère trompeur de la démonstration. Laplace aurait pu répondre qu'il n'a pas employé cette forme, parce que non seulement lui, mais tous les hommes, ont cette impression. Ainsi apparaît une autre des grandes sources d'erreurs de ce raisonnement. Passons sur le fait qu'il est faux que les choses paraissent ainsi à tous les hommes, puisque le plus grand nombre des hommes n'y a jamais pensé ; mais quand bien même ils y auraient pensé, le consentement unanime des hommes n'ajouterait aucune valeur à la proposition, et n'a aucun pouvoir pour changer en objectif ce qui est subjectif (§ 592).
§ 495. Comme d'habitude, ainsi que nous avons dû souvent le répéter, et que nous devrons le répéter encore, toute précision fait défaut dans des raisonnements de ce genre. Que veut dire qu'un point « ne renferme pas en lui-même de raison pour se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre » ? Et comment fait-on pour savoir si vraiment il n'a en lui-même aucun de ces motifs ? Il n'y a pas d'autre manière que de voir s'il reste immobile. Par conséquent la proposition de Laplace finit par signifier qu'un point est immobile quand il est immobile ; ce qui est aussi vrai qu'inutile à savoir.
§ 496. Quand on dit que la force est la cause du mouvement [FN: § 496-1], on croit affirmer quelque chose, et l'on ne dit rien. On définit une inconnue par une autre inconnue. Et que peut bien être la cause du mouvement ? Il est difficile de trouver une, réponse qui ne soit, en somme, que cette cause est une force ; d'où notre proposition revient à dire que la force c'est la force. La mécanique moderne a exclu de la science de semblables façons de raisonner [FN: § 496-2]. Nous voulons tâcher d'en faire autant en sociologie.
§ 497. Les mouvements naturels, violents, volontaires, jouent un grand rôle dans la philosophie ancienne. Si l'on veut voir combien on peut entasser de non-sens en raisonnant sur ces choses, on n'a qu'à lire le livre X des Lois de Platon. Malheureusement, Aristote se laisse parfois aussi entraîner par des élucubrations semblables, et l'on peut, par conséquent, l'opposer à Galilée, quand celui-ci constituait la physique expérimentale. Pour cette science, l'œuvre de Galilée a sa place dans le passé ; pour la sociologie, une œuvre analogue commence à peine de nos jours.
§ 498. Pour prouver que les astres se meuvent volontairement, Cicéron fait discourir Balbus. Celui-ci commence par observer que, d'après Aristote, tout ce qui se meut est mu par la nature, par la force ou par la volonté ; il continue en recherchant comment se meuvent le soleil, la lune et tous les astres : « Ce qui est mu par la nature est porté ou vers le bas par la pesanteur, ou vers le haut par la légèreté ; tandis que ni l'un ni l'autre cas ne se présente pour les astres, puisqu'ils se meuvent suivant une orbite circulaire ; et l'on ne peut dire qu'une force meuve les astres contrairement à la nature. Quelle force, en effet, serait assez grande ? Il reste donc seulement à admettre que le mouvement des astres est volontaire [FN: § 498-1]».
§ 499. On construit des théories de ce genre en grande quantité, quand on raisonne sur les concepts et sur les mots, au lieu de raisonner sur les faits [FN: § 499-1] . Lorsque ensuite l'erreur devient manifeste, quand on ne peut plus la nier, au lieu d'abandonner la façon de raisonner qui a induit en erreur, on veut obstinément la conserver, et l'on tâche seulement de l'adapter aux résultats de l'expérience.
§ 500. Si celle-ci a fait précédemment connaître le rapport existant entre deux faits expérimentaux, A et B, le théologien ou le métaphysicien arrange ses expressions de manière à reproduire autant que possible ce rapport. Malheureusement, celui qui a l'habitude des raisonnements théologiques ou métaphysiques s'adapte difficilement à la précision des raisonnements scientifiques ; c'est pourquoi le désir de reproduire le rapport expérimental existant entre A et B n'est pas suivi d'un effet proportionnel, et souvent ce rapport apparaît déformé.
§ 501. L'idée que les corps célestes, étant parfaits, devaient se mouvoir suivant des cercles, régna longtemps. Finalement, on reconnut que cette idée est fausse – ou mieux qu'elle n'a pas de sens. On le découvrit par une voie tout à fait différente de celle qu'avait suivie Aristote pour l'établir, c'est-à-dire par la voie empirique suivie par Kepler.
§ 502. Maintenant que les métaphysiciens savent – ou croient savoir – que les planètes se meuvent selon des ellipses dont un des foyers est occupé par le soleil [FN: § 502-1](§ 69-3 ), ils s'efforcent d'atteindre par leurs raisonnements ce résultat qui est – ou mieux qu'ils se figurent être – donné par l'expérience.
Hegel dit : [FN: § 502-2]
« (p. 293, § 270) Le cercle est la ligne courbe où tous les rayons sont égaux, c'est-à-dire il est complètement déterminé par le rayon. C'est une unité qui s'ajoute à elle-même, et c'est là toute sa déterminabilité. Mais dans le mouvement libre, où les déterminations du temps et de l'espace se différencient, et où il s'établit entre ceux-ci un rapport qualitatif, il faut que ce même rapport s'introduise dans l'espace comme une différence qui y produit deux déterminations. Par (p. 294) conséquent, la forme essentielle de la révolution des planètes est l'ellipse ».
§ 503. La démonstration de la troisième loi de Kepler est fort belle [FN: § 503-1]. « (p. 296) Comme racine, le temps n'est qu'une grandeur empirique, et, en tant que qualité, il n'est qu'une unité abstraite [FN: § 503-*]. Comme moment de la totalité développée, il est de plus une unité déterminée, une totalité réfléchie [FN: § 503-**]; il se produit, et en se produisant il ne sort pas de lui-même.[FN: § 503-***] Mais comme il n'a pas de dimensions, en se produisant, il n'atteint qu'à une identité formelle avec lui-même, au carré, et l'espace, au contraire, qui forme le principe positif de la continuité (p. 297) extérieure, [FN: § 503-†] atteint à la dimension de la notion, au cube. Ainsi leur différence primitive subsiste dans leur réalisation. C'est là la troisième loi de Kepler, concernant le rapport des cubes des distances aux carrés des temps... ». Vraiment ? Qui s'en serait jamais douté ? Quelle prodigieuse intelligence doivent avoir ceux qui comprennent cela !
§ 504. Mais il y a mieux. Savez-vous ce qu'est le diamant [FN: § 504-1]? « (p. 21, § 317) Le cristal typique est le diamant, ce produit de la terre, à l'aspect duquel l'œil se réjouit parce qu'il y voit le premier-né de la lumière et de la pesanteur. La lumière est l'identité abstraite et complètement libre. L'air est l'identité des éléments. L'identité subordonnée [FN: § 504-*] est une identité passive pour la lumière, et c'est là la transparence du diamant ». Maintenant que vous avez compris ce qu'est la transparence du diamant, faites bien attention à ce qu'est le métal. « Le métal est, au contraire, opaque, parce qu'en lui l'identité individuelle est concentrée dans une unité plus profonde par une haute pesanteur spécifique [FN: § 504-2] ».
§ 505. Il y a probablement une réminiscence de si profondes conceptions dans le passage suivant d'un philosophe contemporain [FN: § 505-1]« (p. 22) : Qu'est-ce que le mouvement d'un mobile à travers l'espace ? C'est de la mécanique qui se réalise elle-même. Qu'est-ce que la formation d'un cristal au sein de la terre ? C'est de la géométrie qui se rend elle-même visible aux yeux ». On trouve des raisonnements semblables chez tous nos métaphysiciens (§ 1686-2). Depuis longtemps, les Chinois avaient observé l'influence de la lune sur les marées, et en avaient donné une explication qui est digne, en vérité, de la Philosophie de la Nature, de Hegel [FN: § 505-2].
§ 506. Saint Thomas sait pourquoi il y a des corps qui sont transparents et d'autres qui sont opaques [FN: § 506-1]. « Puisque, la lumière étant une qualité du premier altérant, qui est au plus haut point parfait et formel dans les corps, les corps, qui sont au plus haut point formels et mobiles, sont lucides actu, ceux qui sont près d'eux reçoivent la lumière ; ainsi les corps diaphanes ; et ceux qui sont au plus haut point matériels, n'ont pas de lumière dans leur nature et ne sont pas non plus récepteurs de lumière, mais sont opaques. Cela se voit d'une façon manifeste dans les éléments, puisque le feu a la lumière dans sa nature, mais que sa lumière ne nous apparaît que dans une matière étrangère, à cause de sa subtilité. L'air et l'eau sont en vérité moins formels que le feu ; c'est pourquoi ils ne sont que diaphanes. La terre, qui est au plus haut point matérielle, est opaque ». Notre docteur est un grand saint, mais pas un grand physicien.
Les termes juste, équitable, moral, humain, solidaire et autres semblables, qu'on emploie aujourd'hui dans les sciences sociales, sont de même nature que les termes chaud (§ 871), froid, pesant, léger, etc., qu'on employait en d'autres temps dans les sciences naturelles. Ce sont eux qui souvent égarent l'esprit et font croire qu'un raisonnement fantaisiste est un raisonnement expérimental (§ 965).
§ 507. Il est remarquable qu'en étudiant les théories de ses prédécesseurs, Aristote ait vu la cause de leurs erreurs [FN: § 507-1] . « La raison pour laquelle ils virent moins bien les faits courants fut le défaut d'expérience. C'est pourquoi ceux qui ont passé leur vie à observer la nature sont plus à même de faire des hypothèses sur les principes qui peuvent unir un grand nombre de faits ». Si Aristote était resté fidèle au principe qu'il avait si bien posé, il aurait peut-être procuré une anticipation de plusieurs siècles aux connaissances scientifiques de l'humanité.
§ 508. Plus remarquable encore est le cas de Bacon. On a déjà souvent observé qu'il raisonnait fort bien sur la méthode expérimentale, et qu'ensuite il la mettait mal en pratique. Par exemple, il nous avertit que [FN: § 508-1]: « Il n'y a rien de bon, ni en logique, ni en physique, dans les notions suivantes : ni la substance, ni la qualité, ni l'action, ni l'impression, ni même l'être, ne sont de bonnes notions ; encore beaucoup moins : pesant, léger, dense, ténu, humide, sec, génération, corruption, attraction, répulsion, élément, matière, forme et autres semblables ; elles sont toutes fantaisistes et indéterminées ». Mais ensuite il considère les corps [FN: § 3]« comme un ensemble ou union de natures simples »; et il ne lui vient pas à l'idée que ces natures simples ont leur place parmi les « notions » qu'il condamne.
§ 509. Dans ces raisonnements pseudo-expérimentaux, les termes A, B,... qu'on met en rapport, sont habituellement indéterminés. Nous avons vu déjà des amphibologies, dans le raisonnement d'Aristote (§ 491) ; mais ce n'est rien en comparaison de l'absolue indétermination des termes employés par certains métaphysiciens (§ 963)
§ 510. Quand Hegel dit [FN: § 510-1]« (p. 383, § 279) En général, on ne peut pas nier l'influence des comètes. Autrefois je fis jeter les hauts cris à M. Bode en disant que l'expérience montre maintenant que les comètes sont accompagnées (p. 384) d'une bonne vendange, ainsi que cela a eu lieu en 1811 et 1819, et que cette double expérience vaut tout autant, et mieux encore que celles qui concernent le retour des comètes », il énonce une proposition fausse, et fait preuve d'une grande ignorance en mécanique céleste, en supposant que l'uniformité du « retour » des comètes n'est qu'empirique ; mais enfin, il emploie des termes clairs, précis et qui correspondent à des choses concrètes ; c'est même justement pour cela que l'on voit tout de suite la fausseté de sa proposition. Mais le caractère de clarté dans les termes fait ensuite défaut, quand il ajoute : « (p. 384) Ce qui rend bon le vin cométaire, c'est que le processus aqueux abandonne la terre, et amène par là un changement dans l'état de la planète ». Et que peut bien être ce « processus aqueux » qui abandonne notre terre ? Qui l'a jamais vu ou en a jamais entendu parler ?
§ 511. L'indétermination et l'absurde augmentent, quand Hegel dit : « (p. 378) La lune est le cristal sans (p. 379) eau, qui s'efforce de se compléter, et d'apaiser la soif de sa rigidité par notre mer, et qui produit ainsi la marée » (§ 505-2). À la rigueur, on sait ce que veulent dire les termes : cristal, eau, soif, rigidité ; et c'est seulement la manière dont ils sont combinés qui est difficile à saisir. Mais même cette lueur de compréhension disparaît, quand Hegel dit :
« (p. 360, § 276)... la lumière est la pensée simple elle-même, qui existe sous forme de nature. C'est l'entendement dans la nature, ou ce qui revient au même, ce sont les formes de l'entendement qui existent dans la nature [FN: § 511-1] * » ; ou bien : « (p. 365, § 277) La lumière en tant qu'elle constitue l'identité physique universelle, se pose d'abord comme terme différencié, et, par conséquent, comme formant ici un principe distinct et extérieur † dans la matière qualifiée d'après une autre détermination de la notion qui constitue la négation de la lumière, ou l'ombre ** ».
§ 512. Si ces galimatias n'étaient que la conséquence de l'état psychique d'un auteur, il n'y aurait pas lieu de s'en préoccuper plus que des divagations d'une personne qui n'est pas très saine d'esprit ; mais beaucoup de gens les ont admirés, et l'on continue à tenir en grande estime leurs équivalents, en sciences sociales ; c'est pourquoi ils sont dignes d'attention, comme phénomène social important (§ 965).
§ 513. L'état psychique des personnes qui s'imaginaient comprendre de semblables raisonnements, ne diffère pas beaucoup de celui des gens qui croyaient saisir les abstractions mythologiques et théologiques. On a là une nouvelle confirmation du fait que l'évolution n'a pas lieu suivant une ligne continue (§ 344). Les trois états psychiques indiqués tout à l'heure, A, B, C, se suivent de telle sorte qu'on peut les supposer former un ensemble continu ; mais il y a d'autres branches, qui conduisent à des connaissances expérimentales : p, q, r,... ou à d'autres divagations mystiques, théologiques, etc.: M, N,...
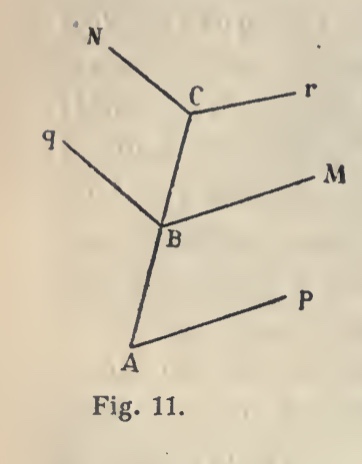
Figure 11
§ 514. Ces considérations nous portent dans le domaine de la logique des sentiments, mentionnée déjà au § 480. Le raisonnement vulgaire confond ensemble les propositions suivantes [FN: § 514-1]:
I. A est égal à X; X est égal à B ; donc A est égal à B.
II. Le nom a de la chose A suscite, chez un homme, des sentiments égaux à ceux suscités par le mot X, et ceux-ci sont égaux aux sentiments suscités par le nom b de la chose B ; donc le nom a suscite des sentiments égaux à ceux suscités par le nom b.
III. Les prémisses sont les mêmes que dans le cas II ; mais la conclusion est : « donc A est égal à B ».
Au point de vue expérimental, la proposition I est d'accord avec l'expérience, si A, X, B sont des choses réelles et bien définies ; et cet accord est d'autant plus rigoureux que les choses A, X, B sont mieux définies ; de même qu'au contraire il peut disparaître, si elles sont mal définies. Si X n'est pas réel, ou, d'une façon générale, si l'une des trois choses A, X, B n'est pas réelle, on ne saurait parler d'accord avec l'expérience (§ 480).
Les sentiments suscités par les mots a, X, b sont des choses réelles ; par conséquent la proposition II est semblable à la proposition I, dans le cas où A, X, B sont réels, et comme elle, elle concorde avec l'expérience. Mais a, X, b sont habituellement assez mal définis ; aussi cet accord est-il d'ordinaire peu rigoureux.
La proposition III n'a aucune valeur logique, puisque dans la conclusion figurent des choses A et B différentes de a et b qui figurent dans les prémisses. Pour qu'elle acquière cette valeur, il ne suffirait pas que A, X, B soient des choses réelles, bien définies : il faudrait de plus que l'accord des concepts a, X, b correspondît précisément au rapport existant entre A, X, B. C'est là justement que gît la différence entre la métaphysique et la science logico-expérimentale : la première admet cet accord a priori ; la seconde le subordonne à la vérification expérimentale [FN: § 514-2].
Dans la logique des sentiments, la proposition III est au fond le type de chaque raisonnement, et passe pour être certainement « vraie ». Ce type peut prendre la forme des divers genres de syllogismes. Par exemple, on peut dire: « Les sentiments que me fait éprouver le mot a sont les mêmes que ceux que me fait éprouver le mot X, qui désigne une classe générale ; et ceux-ci sont les mêmes que ceux que me fait éprouver le mot b: par conséquent, la chose A, correspondant au mot a, a l'attribut B, correspondant au mot b ». Mais on est généralement moins explicite, et, en résumé, le type est : « Les sentiments que me fait éprouver a concordent avec ceux que me fait éprouver X, et ceux-ci concordent avec ceux que me fait éprouver b ; donc A a l'attribut B ». La forme est ensuite celle d'un syllogisme parfaitement logique, et s'obtient en traduisant les propositions précédentes, de la façon suivante. La proposition : « Les sentiments que me fait éprouver a concordent avec ceux que me fait éprouver X », se traduit : « A fait partie de la classe X ». La proposition : « Les sentiments que me fait éprouver X concordent avec ceux que me fait éprouver b », se traduit: « Les X ont l'attribut B ». On conclut donc, sans que la logique formelle puisse rien y reprendre, que « A a l'attribut B ». Ce raisonnement est très employé ; on peut dire qu'il est de règle générale, à l'exception des sciences logico-expérimentales ; il est employé par le vulgaire, et c'est presque le seul qui puisse le persuader. Il domine spécialement dans les matières politiques et sociales [FN: § 514-3] (§ 586 et sv.).
Au point de vue logico-expérimental, les causes d'erreur sont les suivantes : 1° On ne peut admettre expérimentalement les traductions que nous venons d'indiquer, même si A, X, B sont des choses réelles. 2° On ne sait pas à quoi correspondent précisément les termes a, X, b. Le cas le plus favorable à la vérification expérimentale, mais non à la persuasion par voie de sentiment, est celui où ces termes correspondent à des choses réelles, sans trop d'indétermination. Alors les traductions s'adaptent plus ou moins bien à la réalité, et la conclusion est, en gros, vérifiée par l'expérience. Mais la correspondance entre a, X, b et des choses réelles peut être très incertaine ; elle peut même disparaître, si quelqu'une de ces choses cesse d'être réelle. Cela ne se voit pas dans le raisonnement, puisqu'il porte uniquement sur les termes a, X, b, qui persistent même si les choses réelles correspondantes disparaissent. C'est là la plus grande cause d'erreur ; elle vicie tout raisonnement de ce genre. 3° L'accord de certains sentiments avec certains autres, ou celui des premiers avec les seconds, est un rapport indéterminé où toute précision fait entièrement défaut ; par conséquent, les propositions du genre de celles-ci : « Les sentiments que me fait éprouver a s'accordent avec ceux que me fait éprouver X », sont en grande partie arbitraires.
Il faut enfin remarquer que si, dans la logique ordinaire, la conclusion résulte des prémisses, dans la logique des sentiments, ce sont les prémisses qui résultent de la conclusion. C'est-à-dire que celui qui fait le raisonnement, comme celui qui l'accepte, est persuadé préalablement que A a l'attribut B ; puis il veut donner un vernis logique à cette conviction, se met à la recherche de deux prémisses qui justifient cette conclusion, c'est-à-dire des prémisses : « les sentiments que a fait éprouver concordent avec ceux que fait éprouver X ; lesquels concordent ensuite avec ceux que fait éprouver b » ; et il les trouve très facilement, grâce à l'indétermination des termes et du rapport exprimé par le verbe concorder [FN: § 514-4].
§ 515. Donc, contrairement à ce qui a lieu dans le raisonnement logico-expérimental, où les termes sont d'autant meilleurs qu'ils sont mieux déterminés, dans le raisonnement par accord de sentiments, ils sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus indéterminés. C'est ce qui explique l'abondant usage qu'on fait, dans ce raisonnement, des termes comme bon, beau, juste, etc. (§ 408). Plus les concepts qui correspondent à a, X, b sont indéterminés, plus il est facile d'établir par le sentiment l'accord entre le concept de a et celui de X, entre le concept de X et celui de b. Par exemple, si X est le concept de parfait, il est si indéterminé qu'on l'accordera facilement avec d'autres concepts A et B, qu'on a en vue, déterminés ou indéterminés. « Le mouvement des corps célestes est parfait ». Pourquoi pas ? Le sentiment ne met pas en opposition ces deux concepts (§ 491-1 , 1557).
§ 516 Nous voici arrivés par induction, en examinant les faits concrets, au point déjà indiqué d'une façon hypothétique, au § 13 ; autrement dit, nous voyons qu'il y a de nombreux et puissants motifs subjectifs, de sentiment, qui font produire et accepter les théories, indépendamment de leur valeur logico-expérimentale (§ 309). Nous aurons donc à nous occuper longuement de cette matière (chap. IX).
En attendant, notons une autre erreur, déjà rappelée (§ 15, 16), et qu'on observe souvent. Elle provient de ce qu'on transporte hors du domaine logico-expérimental les conclusions qui n'ont de valeur que dans ce domaine. L'élimination d'un terme non expérimental, X, ayant produit un rapport entre les termes expérimentaux A et B, le fait que ce rapport est confirmé ou démenti par l'expérience ne peut en rien servir à prouver ou à rejeter « l'existence » de X. Il n'y a rien de commun entre le monde expérimental et le monde non-expérimental, et l'on ne peut rien conclure de celui-ci à celui-là, ou vice versa.
Longtemps, on a voulu déduire de la Bible des propositions scientifiques ; par exemple, les propositions relatives au mouvement de la terre et des corps célestes ; maintenant, le raisonnement contraire est en vogue ; c'est-à-dire que, de la fausseté de ces propositions scientifiques, on veut déduire la fausseté de la théologie biblique (§ 487). Celui qui veut rester dans le domaine expérimental ne peut pas plus admettre l'une de ces manières de raisonner que l'autre (§ 481). Les erreurs scientifiques de la Bible démontrent seulement que l'on ne doit pas demander à la théologie les rapports qui existent entre les faits expérimentaux ; comme les erreurs scientifiques de Hegel démontrent que pour nous fournir ces rapports, la métaphysique ne vaut pas mieux que la théologie ; et c'est tout ; cela ne peut rien prouver au sujet des doctrines qu'il plaira à la théologie ou à la métaphysique d'établir en dehors du domaine expérimental.
§ 517. (b ) Les recherches sur les mouvements virtuels, quand ceux-ci appartiennent au domaine expérimental, ne sont qu'une manière d'envisager les rapports expérimentaux ; et, par conséquent, les considérations présentées tout à l'heure s'appliquent à elles. Si quelque terme auquel aboutissent les mouvements virtuels est en dehors du domaine expérimental, nous n'avons pas à nous en occuper ici, sauf si l'on tente de revenir à l'expérience, en éliminant ce terme ; et dans ce cas, l'on revient encore aux rapports entre faits expérimentaux.
§ 518. (c ) Il y a enfin la considération de ce qu'on doit faire, ou le précepte (§ 325 et sv.). C'est un genre de rapport qui peut être entièrement en dehors de l'expérience, même quand les termes qui sont mis en rapport sont expérimentaux ; le terme doit, qui ne correspond à aucune réalité concrète, le fait sortir du domaine expérimental [FN: § 518-1] . On peut toujours poser la question : « Et si un homme ne fait pas ce qu'on assure qu'il doit faire, qu'arrivera-t-il ? » Cette question conduit à la considération des mouvements virtuels (b).
§ 519. Liaisons entre les éléments des théories. Abordons maintenant la seconde des questions posées au § 467, et commençons par prendre un exemple. Voyons la chimie, au moment où la théorie atomique était en pleine vigueur. On partait de certaines hypothèses, et l'on arrivait à expliquer les faits chimiques connus, à en prévoir d'inconnus, que l'expérience vérifiait ensuite. Toutes les théories scientifiques sont de ce genre, et possèdent des caractères bien distincts.
§ 520. Mais voici, comme autre exemple, une des nombreuses théories dites morales ; elle a un caractère tout différent. Toute vérification quelconque fait défaut. On cherche comment les choses doivent être, et l'on fait cette étude de manière à trouver entre les choses certains rapports qui existent ou que l'on désirerait voir exister. Supposez un chimiste qui dirait : « C'est un grave inconvénient que le protochlorure de mercure puisse spontanément, à la lumière, se transformer en bichlorure, qui est un violent poison ; donc, je chercherai une théorie chimique telle que cela ne soit pas possible »; et vous aurez un type très répandu de théories morales.
§ 521. Même en dehors de ce type, la différence est notable, entre les théories qui ont les faits pour seuls guides et les théories qui veulent au contraire régler les faits. Comparez, par exemple, la théorie atomique des chimistes modernes et la théorie atomique de Lucrèce. La différence consiste plus dans la nature des recherches que dans la plus ou moins grande vérité expérimentale des données et des conclusions.
§ 522. Autrefois, les théories des faits naturels avaient le caractère des théories morales modernes ; depuis, elles ont entièrement changé de nature, et sont devenues les théories scientifiques modernes. Le traité De caelo d'Aristote peut figurer dans une même classe que les traités de morale modernes ; mais il ne peut être dans la même classe que le traité Philosophiae naturalis principia mathematica de Newton, et encore moins dans la même classe que le Traité de mécanique céleste de Laplace. Si l'on veut lire ces livres à la suite l'un de l'autre, on verra bientôt que celui d'Aristote diffère absolument des autres par la nature même et le but des investigations. Il n'y a pas à rechercher la raison de cette différence dans l'esprit ou les connaissances des auteurs, puisque Newton a écrit sur l'Apocalypse un commentaire qui peut dignement prendre place auprès du traité De caelo d'Aristote.
§ 523. Donc, si nous nous proposons de disposer les théories suivant la nature de leurs démonstrations, nous devrons séparer deux types. Dans l'un, la liaison consiste seulement en conséquences logiques des faits ; dans l'autre, on y ajoute quelque chose qui dépasse l'expérience : un concept : nécessaire, devoir, ou autre semblable. Enfin, pour achever l'opération, il faut aussi considérer les propositions dans lesquelles le lien logique est réduit à peu de chose ou à rien, et qui sont de simples descriptions ou narrations. Nous aurons donc les trois genres suivants :
1° Propositions descriptives.
2° Propositions qui affirment une uniformité expérimentale.
3° Propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale ou la négligent.
§ 524. Les théories scientifiques se composent de propositions du 1er et du 2e genre. Il s'y ajoute quelquefois des propositions du 3e genre, qui peuvent n'être pas nuisibles, si l'adjonction non-expérimentale est superflue, mais qui risquent de porter préjudice au caractère scientifique, si l'adjonction non-expérimentale influe sur les résultats de la théorie. Les théories sociologiques et beaucoup de théories économiques ont fait jusqu'à présent un usage abondant des propositions du 3e genre, qui influaient sur les résultats. Il faut exclure ces propositions, si l'on veut avoir une sociologie et une économie présentant les caractères des sciences logico-expérimentales.
Ici, nous n'avons pas à nous occuper, sinon en passant, des sciences naturelles ; et nous devons diriger principalement notre étude sur les théories qui dépendent des faits sociaux. Procédons donc à l'étude générale des sciences logico-expérimentales en rapport avec les genres notés tout à l'heure.
§ 525. 1er GENRE. Propositions descriptives. Par exemple : J'ai cherché la densité de l'eau pure, sous la pression atmosphérique de 760 m/m de mercure, et j'ai observé qu'il y avait un maximum à la température de 4°. Le mariage romain était d'une seule femme avec un seul homme à la fois. La description peut s'allonger tant qu'on veut ; mais quand elle s'étend un peu, on risque d’y mêler des propositions d'une autre classe. L'homme éprouve une grande difficulté à s'en tenir à la description seule ; il se sent constamment poussé à y ajouter des explications. Dire : Les Grecs accueillaient bien les mendiants, est une description ; mais dire : Les Grecs accueillaient bien les mendiants, parce qu 'ils croyaient qu'ils venaient de Zeus, ajoute une explication à la description. On en reviendrait à une simple description, si l'on disait : Les Grecs accueillaient bien les mendiants, et certains affirmaient qu'on devait le faire parce qu'ils venaient de Zeus (§ 1690-2). Cette distinction peut paraître subtile ; mais elle est d'une grande importance, car dissimuler les explications parmi les descriptions, est un procédé fort usité pour faire admettre des explications qui n'ont pas de fondement logico-expérimental. Ce n'est pas ici le lieu de nous arrêter à chercher jusqu'à quel point est déterminé le terme générique : les Grecs, adopté tout à l'heure.
§ 526. 2e GENRE. Propositions qui affirment une uniformité expérimentale. Dans l'affirmation d'une uniformité, il y a quelque chose de plus que la description de faits passés ; il y a la prévision plus ou moins probable de faits futurs. Si je dis : « Sous la pression de 760 m/m de mercure, l'eau atteint son maximum de densité à la température de 4° », je dis quelque chose de plus que ce que j'exprimais dans la proposition descriptive rappelée naguère : j'affirme que si l'on met de l'eau dans ces conditions, on observera un maximum de densité à 4°. Notez ensuite que la dernière proposition contient quelques affirmations implicites. Elle affirme que seules la pression et la température influent pour déterminer la densité. Si, par exemple, l'état électrique de l'air influait aussi, la proposition descriptive serait incomplète, parce que j'aurais dû noter cet état ; mais la proposition affirmant une uniformité serait fausse, puisque, en faisant une expérience avec un état électrique différent, je ne trouverais pas le maximum à 4°.
§ 527. Au lieu d'un cas hypothétique, voici un cas réel. Si je dis: « J'avais un thermomètre dans de l'eau pure ; j'ai observé qu'à 0° l'eau se solidifiait », ma proposition est incomplète. J'aurais dû noter d'autres circonstances, par exemple la pression atmosphérique. Si je dis : « L'eau pure se solidifie à 0° », et que je ne sous-entende pas certaines conditions, la proposition est fausse. James Thomson a trouvé que, sous la pression de 16,8 atmosphères, l'eau pure se solidifie à la température de – 0°,129. La proposition que nous venons d'énoncer, bien que fausse, prise au pied de la lettre, s'emploie couramment en physique, parce qu'on sous-entend qu'on doit faire l'expérience à la pression atmosphérique usuelle de 760 m/m, de mercure, et sous d'autres conditions bien connues des physiciens. Dans ce cas, l'énoncé de la proposition ne présente pas d'inconvénients ; mais si les conditions sous-entendues n'étaient pas bien déterminées, si elles étaient le moins du monde douteuses, cet énoncé serait à rejeter. C'est justement d'une semblable incertitude que se prévalent ceux qui veulent introduire des conditions qu'ils ne pourraient adopter explicitement.
§ 528. Les métaphysiciens s'imaginent que la science expérimentale a des propositions absolues (§ 97) ; et, de cette hypothèse, ils tirent avec raison la conséquence que, dans la proposition « l'eau se solidifie à 0° », il doit y avoir quelque chose de plus qu'un simple résumé d'expériences, qu'il doit y avoir un principe de nécessité. Mais cet édifice s'écroule, parce que ses fondements ne tiennent pas. La proposition scientifique : « l'eau se solidifie à 0°», indique seulement que cela a été observé jusqu'à présent, et que par conséquent, il est très probable qu'on l'observera à l'avenir (§ 97).
§ 529. Si quelqu'un disait : « Cette proposition ne tient pas compte du lieu où le soleil et ses planètes se trouvent dans l'espace ; il est vrai que jusqu'à présent cela n'a eu aucun effet sur la température de solidification de l'eau ; mais qui vous dit que cela n'en aura aucun à l'avenir ? », nous devrions seulement répondre : « Nous n'en savons rien » ; et nous devrions aussi donner cette réponse à qui affirmerait que le soleil, dans sa course vertigineuse, nous portera un jour dans un espace à quatre dimensions, ou bien en un lieu où les lois de la physique et de la chimie seront changées. Prenons bien garde que toute proposition scientifique doit s'entendre comme si elle était précédée de la condition : « Dans les limites du temps et de l'espace à nous connus » ; en dehors de ces limites, il y a des probabilités tantôt faibles, tantôt très fortes, mais rien de plus (§ 69-6°).
§ 530. Tandis que dans des sciences aussi avancées que la physique et la chimie, il est indispensable de faire ces restrictions, il est singulier qu'il se trouve des gens pour croire qu'elles ne sont pas nécessaires dans une science aussi arriérée que la sociologie. Mais nous ne voulons en aucune façon avoir maille à partir avec ces personnes. Nous les estimons heureuses de connaître l'essence des choses (§ 19), et de savoir les rapports nécessaires des faits ; mais nous ne pouvons nous élever à cette hauteur : nous cherchons uniquement les rapports que nous fait reconnaître l'expérience (§ 69-4°). Si ces braves gens ont raison, cela veut dire que nous trouverons très péniblement, après de longues recherches, ce qui leur a été facilement révélé par la lumière métaphysique. Si les rapports à eux connus sont vraiment nécessaires, il est impossible que nous en puissions trouver d'autres qui soient différents.
§ 531. Les métaphysiciens remarquent encore, d'habitude, qu'une expérience bien faite suffit pour établir une uniformité en chimie ou en physique, et que par conséquent il faut un principe supérieur, qui permette de tirer cette conclusion, laquelle ne résulte certainement pas de nombreux faits, puisqu'elle est tirée d'un seul. Ils se trompent complètement, car les autres nombreux faits existent : ce sont tous les autres, semblables, que l'on a déjà observés. Pourquoi suffit-il d'une seule analyse chimique pour connaître la proportion dans laquelle deux corps simples se combinent en un composé ? Parce que ce fait rentre dans la catégorie des innombrables faits qui nous ont appris l'uniformité des proportions définies. Pourquoi une observation bien faite suffit-elle à connaître le temps qui s'écoule de la conception à la délivrance, pour la femelle d'un mammifère ? Parce que ce fait appartient à la catégorie très nombreuse de ceux qui nous montrent que ce temps est constant (§ 544).
§ 532. C'est justement pourquoi, quand on rattache à tort le fait à une semblable catégorie, la conclusion est erronée. Par exemple, si, de l'observation d'un mâle et d'une femelle de phylloxéra, ou concluait que tous les phylloxéras naissent d'un mâle et d'une femelle, parce qu'on placerait ce cas parmi les innombrables autres, de génération sexuelle, on tomberait dans l'erreur ; car, au contraire, la génération des phylloxéras doit être rangée dans la catégorie des générations où l'on observe la parthénogenèse. Il n'y a aucun principe supérieur qui puisse nous guider ; il n'y a que l'expérience, qui nous enseigne qu'outre les cas de génération sexuelle, il y a les cas de parthénogenèse.
§ 533. Parmi les propositions qui affirment une uniformité, il y a celles qui donnent l'explication expérimentale d'un fait. Cette explication consiste uniquement à mettre en rapport avec d'autres faits celui qu'on veut expliquer. Ainsi, une science, la thermodynamique, explique pourquoi il y a des corps (comme l'eau) dont la température de fusion diminue quand la pression croît, et d'autres pour lesquels, au contraire elle décroît. Cette explication consiste uniquement à mettre cette propriété des corps en rapport d'uniformité avec d'autres propriétés des mêmes corps. Il n'existe pas d'autres explications scientifiques.
§ 534. C'est une façon erronée de s'exprimer que de dire : La mécanique céleste explique le mouvement des corps célestes par la gravitation universelle. La mécanique céleste a fait l'hypothèse que le mouvement des corps célestes satisfait aux équations de la dynamique, et, jusqu'à présent, les positions des corps, calculées de cette façon, se sont trouvées les mêmes que celles observées dans les limites d'erreurs possibles. Tant qu'il en sera ainsi, on tiendra l'hypothèse pour bonne ; si un jour cela n'avait plus lieu, on modifierait l'hypothèse faite.
§ 535. Voyons maintenant comment on peut utiliser les faits en sociologie, et comment on peut en tirer des uniformités. À vrai dire, c'est là le but de tout l'ouvrage : à mesure que nous cherchons et trouvons ces uniformités, nous distinguons les moyens appropriés de ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi, ici, nous n'aurions qu'à renvoyer à tout le reste du livre ; mais il est utile d'avoir une vue générale de la matière et d'en observer les grandes lignes. Tel sera justement le but des considérations suivantes.
§ 536. LES FAITS [FN: § 536-1]. Les faits nous sont connus par différentes sources que la critique historique examine et discute. Nous n'avons pas ici à nous occuper en détail de l'étude qu'elle accomplit ; nous devons seulement fixer notre attention sur certains sujets particuliers qui importent spécialement à la sociologie.
§ 537. LE NOMBRE DES FAITS. Il est évident que plus on en peut recueillir, mieux cela vaut, et qu'on obtiendrait la perfection, si l'on pouvait rassembler tous les faits passés de l'espèce considérée. Mais c'est absolument impossible, et il s'agit donc seulement de plus ou de moins.
Deux obstacles de genre différent s'opposent à ce que nous ayons un grand nombre de faits d'une espèce donnée. Pour l'antiquité, les sources nous en fournissent peu ; pour l'époque moderne, ils sont trop abondants pour être recherchés et cités tous. Les trouver tous serait un gros travail peu profitable ; et quand on les aurait trouvés, aucun éditeur ne voudrait imprimer les gros in-folio qui les contiendraient ; aucun lecteur ne les voudrait lire. À quoi bon, par exemple, rechercher dans tous les pays les récits de toutes les grèves, grandes et petites, et les reproduire par l'imprimerie dans un grand nombre de volumes ?
Pour l'antiquité, le nombre des faits étant peu considérable, l'usage moderne est de citer tous ou presque tous les auteurs qui font allusion au sujet qu'on étudie ; et c'est fort bien : il ne semble pas qu'on puisse faire autrement dans les ouvrages d'érudition. Par exemple, on procède à peu près de cette manière, dans le Manuel des antiquités romaines, de Mommsen et de Marquardt, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, et dans d'autres ouvrages analogues. Parfois, on peut faire cela pour les auteurs du moyen âge, mais on laisse de côté beaucoup de documents restés encore inédits, au fond des archives. Pour les temps modernes, c'est impossible, en raison de l'abondance des matériaux; aussi doit-on faire un choix [FN: § 537-1].
§ 538. L'IMPORTANCE DES FAITS. L'importance des faits compte plus que leur nombre ; un seul fait, bien observé et bien décrit, en vaut un très grand nombre de mal observés et mal décrits [FN: § 538-1] .
L'usage pédant des « bibliographies complètes » est devenu maintenant à la mode. Qui traite un sujet doit citer tous les auteurs en la matière, quelle que soit la valeur de leurs écrits [FN: § 538-2] . D'habitude il les cite, mais ne les lit pas, et les étudie encore moins, ne serait-ce que par manque de temps pour cette entreprise [FN: § 538-3] ; mais il en transcrit les titres dans un bel index, et plus il en met, plus il est admiré des pédants et des gens naïfs. Pour connaître les rapports entre les faits, c'est-à-dire les lois scientifiques, il vaudrait beaucoup mieux étudier, mais bien étudier, les principaux auteurs, et ne pas s'occuper des autres. Même pour connaître l'histoire d'une doctrine, il est inutile de lire tous ceux qui ont écrit sur ce sujet ; il suffit qu'on s'occupe des principaux types. On ne peut vraiment s'empêcher de trouver plaisant qu'une personne fasse une « bibliographie complète » des auteurs qui ont écrit sur la « rente », alors qu'elle ignore entièrement les phénomènes qui ont porté ce nom, et plus encore leurs rapports avec les autres phénomènes économiques.
§ 539. Comme d'habitude, nous sommes tombés dans cet extrême pour en éviter un autre, où l'on raisonnait sans citer des faits ; et entre les deux inconvénients, il vaut mieux, beaucoup mieux, citer trop de faits que n'en citer aucun ; et il est préférable aussi que le nombre des faits cités soit supérieur plutôt qu'inférieur à ce que nécessite la démonstration. Mieux vaut aussi une « bibliographie complète » d'auteurs lus à la hâte, qu'une complète ignorance des auteurs qui ont traité le sujet qu'on veut étudier.
§ 540. Laissant de côté la certitude absolue, qui n'existe pas dans les sciences expérimentales, et traitant seulement d'une probabilité plus ou moins grande, il faut reconnaître que pour beaucoup de faits historiques, elle est petite, pour d'autres grande, pour d'autres encore très grande, au point d'être égale à ce qu'on appelle certitude, dans le langage vulgaire. En ce sens, beaucoup de faits sont certains dans les grandes lignes, incertains dans les détails. Il semble certain, par exemple, que la bataille de Salamine a eu lieu ; mais il n'est pas du tout certain que, dans le détail, tout se soit passé comme le raconte Hérodote ; au contraire, si nous en jugeons par l'analogie avec d'autres récits semblables, il est très probable qu'une partie de ces détails sont erronés ; mais nous ne savons pas lesquels. Même en des temps qui sont plus rapprochés de nous, il y a lieu de faire une observation analogue. Il est certain, par exemple, que la bataille de Waterloo a eu lieu ; mais on dispute encore sur certains points particuliers de ce combat.
En suivant la méthode indiquée au § 547, il est facile de vérifier que lorsqu'on a différentes relations d'un fait, elles divergent souvent dans les détails ; et pour quelques-unes d'entre elles, nous pouvons reconnaître que les détails sont erronés (§ 649); par conséquent, l'interprétation qui les tiendrait pour exacts nous induirait certainement en erreur.
Ici, deux écueils sont à éviter : d'un côté, celui de construire des théories qui aient des faits de ce genre pour fondement principal ; souvent c'est ce qui arrive quand on recherche les origines ; de l'autre, celui de rejeter toute théorie qui ne s'appuie pas sur des faits tout à fait certains, comme semblent maintenant vouloir le faire certains pédants ; car de cette façon on rejetterait tout. Il faut s'en tenir à un juste milieu ; c'est-à-dire construire les théories avec prudence, en appréciant et choisissant les faits; et en user de même avec prudence, c'est-à-dire avoir toujours présent à l'esprit que, dans les meilleures théories, il peut toujours y avoir un peu d'erreur (§ 69-3).
Tout cela n'est pas spécial à la sociologie, mais s'applique à toutes les sciences, même les plus exactes. Celui qui emploie une table de logarithmes à sept décimales doit savoir qu'il ne connaît pas le logarithme au delà de cette limite. Il n'y a pas longtemps, on ne connaissait que grossièrement le poids atomique des corps chimiques ; maintenant, on le connaît avec une certaine exactitude ; mais on n'obtiendra jamais la précision absolue. Depuis le temps de Tycho-Brahé jusqu'à nos jours, les mesures des positions des astres ont toujours été en se perfectionnant ; mais elles étaient encore très imparfaites, au temps de Newton. Est-ce que pour cette raison, pour faire plaisir à quelques pédants, les savants auraient dû s'abstenir de créer les théories de la mécanique céleste ? Bien plus, devraient-ils continuer à s'en abstenir maintenant et toujours, puisqu'on n'a pas ces mesures absolument précises, et qu'on ne les aura jamais ?
Il y a plus. Ce fut une heureuse circonstance pour la création de la mécanique céleste, qu'au temps de Kepler les observations de la planète Mars n'aient pas été trop exactes ; si elles l'avaient été, Kepler n'aurait pas trouvé que la courbe parcourue par la planète était une ellipse, et il n'aurait pas découvert les lois du mouvement planétaire [FN: § 540-1]. Ce fut heureux aussi qu'il se mît à étudier le mouvement de Mars plutôt que celui de la lune, pour lequel les perturbations sont plus grandes.
Ce que fit alors le hasard, la méthode des approximations successives doit le faire maintenant (§ 69-80). À chaque instant, il y a des gens qui reprochent aux théories scientifiques de l'économie ou de la sociologie, de négliger certains détails [FN: § 540-2]. C'est au contraire un mérite. On doit d'abord acquérir une idée générale du phénomène, en négligeant les détails, considérés comme des perturbations ; puis envisager ces détails, en partant des plus importants et en allant successivement vers les moins importants.
§ 541. Supposons avoir un texte ou plusieurs textes d'un auteur. On peut les considérer sous trois aspects ; on peut rechercher : 1° ce que pensait l'auteur, quel était son état psychique, et comment il a été déterminé ; 2° ce que signifie un passage déterminé; 3° comment l'ont compris les hommes d'une collectivité donnée, en un temps déterminé. Au point de vue de l'équilibre social, l'importance va croissant du 1er au 3e aspect. Au point de vue objectif, le 2e est presque seul à considérer, pour autant qu'on peut établir une relation quelque peu précise entre le témoignage qu'il apporte et une réalité objective. Le 1er point de vue est personnel à l'auteur ; le 2e est impersonnel, objectif : on peut envisager le passage indépendamment de celui qui l'a écrit (§ 855); le 3e point de vue est celui des personnes qui prennent connaissance du texte considéré.
1° L'unité n'existe pas toujours dans les idées d'un auteur (§ 1545), non seulement parce qu'elles changent avec le temps, comme on peut le voir dans les Rétractations de saint Augustin et dans tant d'autres cas semblables, mais aussi parce que, spécialement dans les matières touchant le sentiment, des opinions différentes et même contradictoires peuvent se manifester en un même texte, sans que l'auteur s'en aperçoive. Donc, quand on cherche l'opinion unique qu'un auteur avait d'un certain sujet, on peut parfois chercher ce qui n'existe pas. Cette recherche est pourtant aujourd'hui à la mode, et l'on fait des études dites psychologiques sur les auteurs ; études qui ne sont fort souvent qu'un recueil d'anecdotes et de bavardages, dont on tire argument pour des conférences et des livres, fort agréables à de belles dames, qui se figurent ainsi faire une étude scientifique (§ 858, 859). Il est de même à la mode de rechercher pourquoi un auteur a écrit un certain passage ; et si l'on réussit à trouver qu'il l'a fait dans un moment de colère, provoquée par la trahison d'une maîtresse, on croit avoir découvert l'Amérique.
Il est certain que la manière de penser d'un auteur est en rapport avec les sentiments existants dans la collectivité où il vit ; aussi peut-on, en de certaines limites, de l'expression de cette manière de penser, déduire ces sentiments, qui sont les éléments de l'équilibre social. Mais il faut noter que cette opération donne de meilleurs résultats pour les auteurs ordinaires, de peu de talent, que pour les auteurs éminents, de grand talent ; c'est justement par leurs qualités que ceux-ci émergent, se séparent du vulgaire ; et par conséquent ils en reflètent moins bien les idées, les croyances, les sentiments [FN: § 541-1].
2°, Quand nous possédons le texte d'un auteur dont nous pouvons considérer le témoignage, en tout ou en partie, comme digne de foi, nous pouvons interpréter ce texte et en tirer la connaissance de certains faits. Tels sont en somme tous les documents que nous appelons historiques.
3° Outre les faits généralement racontés de cette manière, il y en a d'autres qu'il nous importe de connaître. Nous avons déjà vu, et nous verrons mieux encore dans la suite de cette étude, que les sentiments manifestés par les croyances et les idées des hommes agissent puissamment dans la détermination des phénomènes sociaux. Il en résulte que les sentiments et leurs manifestations sont, pour la sociologie, des faits aussi « importants » que les actions. Par exemple, même si la bataille de Marathon n'avait pas eu lieu, l'idée qu'en avaient les Athéniens reste un « fait » de grande importance pour la forme de la société athénienne. Thucydide nie que, comme le croyaient les gens du peuple d'Athènes, Hipparque fût tyran, lorsque Harmodius et Aristogiton le tuèrent. Mais le fait lui-même a moins d'importance pour la forme de la société athénienne, que l'idée qu'avait de ce fait le peuple d'Athènes ; et, parmi les forces agissant puissamment pour déterminer cette forme, il y avait sans doute le sentiment manifesté par les Athéniens, lorsqu'ils chantaient les louanges d'Harmodius et d'Aristogiton, qui avaient tué le tyran et rendu les Athéniens égaux devant la loi [FN: § 541-2] . On arrive ainsi à la conclusion suivante, qui semble à tort paradoxale : pour déterminer la forme de la société athénienne, il importe beaucoup moins de savoir si vraiment Hipparque était tyran quand il fut tué par Harmodius et Aristogiton, ou même si le fait est entièrement légendaire, que de connaître l'idée des Athéniens sur ce point.
La célèbre oraison funèbre des Athéniens morts à la guerre, que Thucydide met dans la bouche de Périclès, reproduit-elle, ne serait-ce qu'avec une grossière approximation, les paroles vraiment prononcées par Périclès ? Nous ne le savons pas ; et pour l'étude des mœurs athéniennes de ce temps, cela importe peu. Il est manifeste que, selon toute probabilité, Thucydide a composé ce discours en tenant compte de ces mœurs, qu'il connaissait bien. Il serait extraordinaire que, même s'il l'a inventé de toutes pièces, il l'ait composé de manière à choquer des us et coutumes qui lui étaient bien connus, ainsi qu'à tous ceux qui lisaient son œuvre.
Certaines personnes soutiennent maintenant que le Christ est un mythe solaire. Admettons-le pour un moment. Est-ce que cela diminue le rôle énorme qu'a joué le christianisme, ou mieux les sentiments manifestés sous cette forme dans la société européenne ? Sorel dit fort bien [FN: § 541-3]: « (p. 37) Ainsi, pour les stigmates de saint François nous n'avons nul besoin de savoir en quoi consistaient ces plaies ; mais nous devons chercher quelle conception le moyen âge en avait ; c'est cette conception qui a agi dans l'histoire et cette action est indépendante du problème physiologique ».
De même, le texte d'un auteur vaut, pour un temps donné et un pays déterminé, moins par ce que cet auteur a voulu dire, que par ce que les hommes de ce temps et de ce pays comprenaient quand ils lisaient le dit texte [FN: § 541-4] . Il y a une différence radicale entre un texte envisagé comme témoignage de ce qu'a observé ou compris l'auteur, et qu'on utilise dans le but de remonter justement aux choses que cet auteur a observées ou comprises, et un texte considéré comme exerçant une influence sur les individus qui en ont connaissance, et qui est employé pour connaître les idées et les actions de ces individus. Pour un texte envisagé au premier point de vue, il importe beaucoup de connaître ce que l'auteur voulait exprimer ; pour un texte considéré au second point de vue, cette recherche est presque inutile ; il importe au contraire de savoir comment ce texte est compris, même s'il est compris à rebours.
Ce n'est pas l'avis de ceux qui estiment que le texte donne la vérité absolue, et qu'on doit l'entendre seulement dans son vrai sens ; aussi recherchent-ils ce vrai sens, qui est celui qui leur plaît, et blâment-ils les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. [Voir Addition A14 par l’auteur]
§ 542. Les manifestations de la pensée sont des faits aussi bien que les actions des hommes. Les premiers faits sont, en certains cas, plus faciles à connaître avec certitude (avec une très grande probabilité), que les seconds. Il est vrai que l'on peut avoir des doutes sur la correction du texte qui est à notre disposition ; mais, sauf ce doute, nous avons sous les yeux le fait même dont nous voulons nous occuper, et nous n'en parlons pas seulement d'après ce qu'une autre personne nous rapporte. Nous connaissons beaucoup mieux, d'après nos textes, ce que Cicéron dit de certaines actions de Catilina, que ces actions mêmes.
§ 543. Pour les faits historiques ou les indications géographiques, les productions littéraires de fictions, de fables ou autres écrits semblables, ont généralement peu de valeur. Cependant, nous sommes parfois contraints par la rareté des documents à en faire usage pour les temps anciens et mal connus ; mais il faut pour cela beaucoup de prudence. Afin de nous en rendre mieux compte, employons une méthode dont il sera parlé au § 547.
§ 544. Voici un roman de Karr [FN: § 544-1] , où l'on parle de Lausanne, de Montreux, de Genève. D'une manière analogue à ce qui arrive maintenant pour la Grèce ancienne, supposons que dans deux mille ans on n'ait conservé le souvenir de Montreux que dans cet ouvrage, et que les érudits veuillent y découvrir où se trouvait cette ville, par rapport à Lausanne et à Genève. La critique démontre que l'auteur est digne de tout crédit. Il vivait quand Montreux existait ; il demeurait en un pays voisin : la France. Nous savons que les Français cultivés et aisés visitaient presque tous la Suisse ; il est donc très probable que Karr a vu Montreux, et son témoignage doit être considéré comme celui d'un témoin oculaire. D'autre part, il n'avait pas le moindre intérêt à cacher la vérité. On ne peut avoir meilleur témoignage que le sien. Un érudit fouille, étudie, médite, et trouve qu'un personnage de Karr passe par Montreux, pour aller de Lausanne à Genève. Ce pourrait être une faute d'impression, semblable aux erreurs qu'on trouve dans les manuscrits anciens ; mais ce cas est exclu par les indications que donne l'auteur : « (p. 8) Je suis arrivé vers quatre heures à Montreux; c'est un village qui, en venant de Lausanne, est (p. 9) à droite de la route qui côtoie le lac, et à quelques centaines de pas de cette route ; on y monte par un petit chemin hérissé de pierres... ». C'est donc bien la route qui va de Lausanne à Genève, et qui, lorsqu'on vient de Lausanne, a le lac à gauche, les collines à droite. Vient ensuite un autre passage qui confirme le fait et lève tout soupçon d'erreurs ou d'interpolations dans le texte. Le personnage du récit revient de Genève à Lausanne : « (p. 78) Une demi-heure après, les deux amis partirent pour Lausanne. En passant devant Montreux, qui se trouvait à gauche, sur la hauteur, Eugène demanda à y monter un instant... ». Un érudit de ce temps lointain écrira un savant ouvrage, qu'il présentera à quelque très savante académie, et démontrera que Montreux devait être entre Lausanne et Genève ; et qui sait si quelque archéologue, fort de cette indication, ne retrouvera pas les ruines de la localité indiquée ! Et pourtant, s'il est une chose certaine, c'est que Montreux se trouve au delà de Lausanne, pour qui vient de Genève, et qu'en allant de Lausanne à Genève, ou en revenant de Genève à Lausanne, on ne passe pas par Montreux.
Parmi les connaissances que nous avons ou croyons avoir de l'antiquité, plusieurs n'ont certainement pas de meilleur fondement que celui de la déduction tirée du texte de Karr ; et l'erreur certaine de celle-ci nous porte à admettre la possibilité d'erreurs analogues dans celles-là.
§ 545. Les productions purement littéraires, de fictions, de fables et autres écrits semblables, peuvent souvent avoir une grande valeur pour nous faire connaître les sentiments ; et parfois un témoignage indirect de ce genre vaut plus que beaucoup de témoignages directs. Par exemple, dans ses mimïambes, Hérondas nous donne la parodie d'un plaidoyer fait devant un tribunal. L'orateur allègue en substance que si son adversaire a amené du grain dans la cité (ou bien : si lui, orateur, n'en a pas amené), cela ne doit pas lui porter, à lui orateur, préjudice auprès des juges [FN: § 545-1] . Il est par là manifeste que c'était l'opinion commune, que les juges décidaient d'après des motifs de bienveillance ou de malveillance de ce genre, étrangers aux mérites de la cause ; autrement la parodie n'aurait pas de sens. Ce témoignage en vaut un grand nombre d'autres (§ 572).
Beaucoup de romans nous font également connaître les opinions existantes ; celles-ci correspondent souvent à certains faits, et en donnent une idée synthétique, meilleure que celle qu'on pourrait avoir de témoignages directs, nombreux et confus [FN: § 5454-2] . Quand un livre a beaucoup de lecteurs, il est assez probable qu'il se conforme à leurs sentiments, et qu'il peut, par conséquent, servir à les faire connaître [FN: § 545-3]. Pourtant il faut marcher prudemment dans cette voie, parce qu'en courant un peu trop après les interprétations, on risque de tomber en de graves erreurs.
§ 546. LES INTERPRÉTATIONS. Précisément parce que la connaissance directe des faits est très rare, les interprétations sont indispensables ; et qui voudrait absolument s'en passer pourrait aussi se dispenser de s'occuper d'histoire et de sociologie ; mais il faut rechercher quand et jusqu'où l'on peut y avoir recours avec quelque probabilité d'exactitude. Nous devons procéder à cette recherche au moyen de l'expérience, comme pour toutes les recherches de la science expérimentale.
§ 547. Une méthode qui donne en beaucoup de cas de bons résultats, est la suivante. Soit A, un fait du passé dont nous ignorons l'« explication ». Nous l'obtenons au moyen d'une certaine interprétation ; c'est-à-dire que nous mettons A en rapport avec un autre fait, B. Ensuite nous voulons rechercher si ce genre d'interprétation conduit ou non à des résultats probables. Pour cela, si nous réussissons à trouver dans le présent un fait a, semblable à A, uni d'une façon bien connue à un autre fait b, bien connu aussi et semblable à B, nous employons le moyen qui a mis en rapport A et B pour « expliquer » a. Si nous obtenons l'explication effective b, cela est favorable à l'usage de ce moyen ; et s'il nous est possible d'avoir beaucoup d'autres cas semblables, nous pouvons admettre que ce genre d'interprétation donne des résultats assez probables. Mais si, voulant expliquer a, nous ne trouvons pas b, cela seul suffit pour nous faire suspecter ce genre d'interprétation : il présente une exception et peut en avoir d'autres. Si nous en trouvons effectivement un nombre suffisant, les résultats de ce genre d'interprétation n'ont plus en leur faveur qu'une faible probabilité. Nous avons employé souvent déjà cette méthode (§ 544), et nous en userons très abondamment dans le cours de cet ouvrage ; c'est pourquoi nous nous abstenons d'en donner ici des exemples [FN: § 547-1].
§ 548. On doit en général expliquer l'inconnu par le connu ; c'est pourquoi le passé s'explique mieux par le présent, que le présent par le passé, comme l'ont fait la plupart des auteurs, aux débuts de la sociologie, et comme beaucoup continuent à le faire (§ 571).
§ 549. Une certaine interprétation des témoignages est presque toujours nécessaire, parce que celui qui rapporte un fait emploie son langage, en y mettant plus ou moins de ses sentiments ; aussi devons-nous, pour remonter au fait, dépouiller le récit de ces accessoires ; parfois ce sera facile, parfois difficile ; mais il ne faut jamais en oublier la nécessité ou au moins l'utilité. Les voyageurs traduisent selon leurs idées et dans leur langue les idées qu'ils ont entendu exprimer dans la langue des peuples qu'ils ont visités. C'est pourquoi leurs récits s'éloignent souvent plus ou moins de la vérité, et il faut, autant que possible, faire une traduction inverse pour retrouver les idées réelles des peuples dont les voyageurs nous donnent connaissance [FN: § 549-1].
§ 550. De même, dans beaucoup de cas, il est difficile de travailler pour la sociologie sur les traductions, et, quand c'est possible, il faut recourir au texte original. Comme d'habitude, il ne faut pas tomber d'un extrême dans l'autre ; il y a de nombreux cas dans lesquels suffit non seulement une traduction, mais un simple résumé. Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut voir si les conclusions dépendent du sens précis d'un ou de plusieurs termes ; dans ce cas, il est indispensable de recourir à l'original [FN: § 550-1].
§ 551. Les plus grandes difficultés que nous éprouvons à comprendre les faits d'autres peuples ou d'autres temps, proviennent de ce que nous les jugeons avec les habitudes mentales de notre nation et de notre temps. Par exemple, comme nous vivons dans des pays et à une époque où existent des lois écrites dont l'autorité publique impose l'observation, nous saisissons mal l'état des peuples chez lesquels, à nos lois, correspondaient certains usages non écrits, et dont aucune autorité publique n'imposait l'observation [FN: § 551-1]. Grâce à leurs études, les érudits vivent en partie dans le passé ; leur esprit finit par prendre un peu la couleur de ce temps ; aussi peuvent-ils en comprendre les faits mieux que les profanes. De même chez nous, la séparation est complète, en certains cas, entre le fait et le droit ; par exemple entre le fait de la propriété et le droit de propriété. Il y eut des peuples et des temps où le fait se confondait avec le droit ; puis ils se séparèrent peu à peu, par une lente évolution. Il nous est difficile d'avoir une idée claire de l'un de ces états intermédiaires.
§ 552. Mais tout cela est peu de chose en regard des difficultés qui naissent de l'intromission des sentiments, des désirs, de certains intérêts, d'entités étrangères à l'expérience, comme seraient les entités métaphysiques et les théologiques ; et c'est justement la nécessité de ne pas nous contenter de l'apparence, souvent très trompeuse, qu'ils donnent aux faits, et de remonter au contraire à ceux-ci, qui nous guide dans la présente étude, et qui nous oblige à parcourir une voie longue et pénible.
§ 553. LA PROBABILITÉ DES CONCLUSIONS. Nous avons à résoudre pratiquement un problème du genre de ceux que résout le calcul des probabilités, sous le nom de probabilités des causes. Soit, par exemple, une urne contenant 100 boules, dont une partie est blanche, une partie noire ; nous ignorons dans quelle proportion, mais nous savons que toutes les proportions sont a priori également probables. On tire une boule blanche ; il devient ainsi certain que toutes les boules ne sont pas noires ; mais toutes les combinaisons dans lesquelles entre au moins une boule blanche sont possibles. La probabilité que toutes les boules soient blanches est de blanches est de2/101 , par conséquent très petite. La probabilité qu'il y ait au moins 50 boules blanches et de 765/1010 , c'est-à-dire environ 0,75.
Admettons que, suivant une loi hypothétique, toutes les boules devraient être blanches. L'extraction d'une boule blanche signifie la vérification de la loi, dans un cas ; cette vérification donne une probabilité très petite à la loi, soit environ deux centièmes. La probabilité que la loi se vérifie dans un nombre de cas plus grand que celui dans lequel elle ne se vérifie pas, n'est pas très grande non plus, puisqu'elle n'est que d'environ 3/4 .
§ 554. Quand on commença à étudier le calcul des probabilités, on espéra qu'il nous donnerait des normes précises pour trouver la probabilité des causes ; mais cette espérance fut trompeuse, parce que le moyen nous manque d'assimiler les cas pratiques, à l'extraction d'une ou de plusieurs boules d'une urne. Nous ignorons complètement le nombre des boules contenues dans l'urne, et ne savons que peu ou rien de la probabilité a priori des diverses combinaisons. En conséquence, le secours que nous pouvions espérer du calcul des probabilités fait défaut, et il ne nous reste plus qu'à évaluer grossièrement les probabilités avec d'autres considérations.
§ 555. Un cas extrême est celui considéré au § 531. Nous avons une urne qui, très probablement, contient des boules, toutes d'une même couleur. Une extraction suffit pour connaître cette couleur avec une très grande probabilité. Nous savons, par exemple, que très probablement tous les corps simples se combinent suivant des proportions définies. Cette propriété correspond à la propriété des boules d'être d'une même couleur. Une seule expérience suffit pour déterminer la proportion en une certaine espèce de combinaisons ; c'est-à-dire une seule extraction pour déterminer la couleur (§ 97, 531).
§ 556. Quand on peut assimiler un fait A à d'autres faits, il est a priori probable qu'il suit les mêmes lois que ceux-ci ; une seule vérification donne par conséquent une grande probabilité qu'effectivement les lois envisagées s'appliquent aussi à A (§ 531). On procède donc en notant des similitudes et en faisant des vérifications ; et c'est là une des méthodes le plus en usage pour découvrir les lois expérimentales. Ce fut ainsi que Newton, étendant par hypothèse aux corps célestes les lois du mouvement connues pour les corps terrestres, et faisant la vérification du mouvement de la lune autour de la terre, découvrit les lois du mouvement des corps célestes. Ses successeurs continuèrent à faire des vérifications, toutes avec succès, et ainsi ces lois sont aujourd'hui très probables.
Les étymologistes modernes purent observer dans les faits les changements successifs d'un mot du latin populaire, qui s'était transformé en un mot français ou italien moderne ; ils étendirent par similitude aux autres mots les lois supposées qu'ils avaient trouvées, procédèrent à des vérifications, et constituèrent ainsi la science de l'étymologie de ces langues.
Le point difficile est d'établir la similitude, parce qu'il y a toujours en cela plus ou moins d'arbitraire ; et ici comme toujours, il faut avoir recours à l'observation et à l'expérience, qui seules peuvent nous donner des renseignements sûrs. Une des erreurs habituelles des
écrivains anciens était de conclure de la ressemblance des noms à la ressemblance des choses.
§ 557. Les considérations sur la similitude peuvent donner les solutions de quelques problèmes qui paraissent paradoxaux. En voici un. Bertrand dit [FN: § 557-1]: « (p. 90) Un événement incertain n'a-t-il pas toujours une probabilité déterminée connue ou inconnue ? – Il faut se garder de le croire. – Quelle est la probabilité qu'il pleuve demain ? Elle n'existe pas... (p. 91) Le roi de Siam a quarante ans, quelle est la probabilité pour qu'il vive dans dix ans ? Elle est autre pour nous que pour ceux qui ont interrogé son médecin, autre pour le médecin que pour ceux qui ont reçu ses confidences... ». La conséquence serait que la personne qui joue une somme qu'elle gagnera si le roi de Siam meurt dans un an, n'est guidée en rien par la probabilité, puisqu'elle n'existe pas. Jusqu'à un certain point, c'est juste. En effet, celui qui assure sur la vie un homme seul fait un jeu pur et simple. Au contraire, ceux qui, comme les sociétés d'assurance, assurent un grand nombre d'hommes, exécutent une opération financière dépendant du calcul des probabilités. Il est donc vrai que celui qui veut opérer seulement d'après les probabilités, ne peut rien décider au sujet du roi de Siam.
D'autre part, si Bertrand avait été enfermé en prison, et qu'on lui eût dit : « Vous n'en sortirez que quand A ou B mourra ; vous savez uniquement que A a 20 ans et B 60 ; choisissez de la mort duquel vous voulez que votre liberté dépende » ; il est à croire qu'il aurait choisi B préférablement à A. Devrons-nous dire qu'il aurait agi au hasard, sans se préoccuper des probabilités ? En général, si un événement P, pour le cas où il se répéterait, a une plus grande probabilité que Q, dirons-nous que nous agissons au hasard quand, pour qu'une chose nous soit favorable, nous choisissons un certain P, préférablement à Q ? Oui, dirait Bertrand, puisque le choix a lieu une seule fois et ne peut se répéter. « (p. 91) Que le roi de Siam meure ou vive, il est impossible de renouveler l'épreuve ». Mais on peut en renouveler d'autres semblables, soit pour d'autres hommes de l'âge du roi de Siam, soit pour d'autres cas analogues d'événements éventuels.
Supposons que P 1 , et Q 1 , P 2 et Q 2 , P 3 et Q 3,... soient des événements entièrement différents, mais que P1 P2,... soient semblables seulement en ce qu'ils ont une probabilité plus grande que Q1, Q2,...et qu'on puisse renouveler l'épreuve. Ceci dit, je puis poser le problème : « Au cas où le choix entre P1, et Q1, entre P2 et Q2,... ne se renouvellerait pas, ai-je une plus grande probabilité d'obtenir un résultat favorable en choisissant P1 , P2,... ou bien Q1, Q2,... ? » La réponse n'est pas douteuse : il faut choisir P1 , P2 ,.... Il est clair que Bertrand aurait peut-être eu avantage à faire dépendre sa libération de la mort de l'homme de 20 ans, plutôt que de la mort de l'homme de 60 ; mais il est certain que s'il agissait également, dans tous les cas semblables, et si, dans tous les actes de sa vie, il choisissait comme favorable le parti qui serait le moins probable, au cas où l'on pourrait renouveler l'épreuve, il finirait par s'en trouver plus mal que s'il avait fait le contraire.
Bertrand résout différemment le problème. Il existe pour lui des probabilités objectives et des probabilités subjectives. Le type des premières serait une urne contenant un nombre connu de boules blanches et de boules noires, et dont on extrait une boule. Un type des secondes serait justement un fait comme la mort du roi de Siam, qui dépend de circonstances que nous ne connaissons qu'en partie. Bertrand exclut cette seconde probabilité de ses calculs.
§ 558. On en viendrait ainsi à dire qu'autant vaut ne jamais s'occuper de probabilité et agir dans tous les cas à l'aveuglette, au hasard, parce que toutes les probabilités sont subjectives ; et la distinction que voudrait faire Bertrand existe seulement en tant que quantité plus ou moins grande de connaissances.
Bertrand dit [FN: § 558-1]: « (p. 90) Il pleuvra ou il ne pleuvra pas [demain], l'un des deux événements est certain dès à présent, et l'autre impossible. Les forces physiques dont dépend la pluie sont aussi bien déterminées, soumises à des lois aussi précises que celles qui dirigent les planètes. – Oserait-on demander la probabilité pour qu'il y ait éclipse de lune le mois prochain [FN: § 558-2]? »
Eh bien, on peut en dire autant de l'extraction qu'on est en train de faire d'une urne. Les mouvements de celui qui doit extraire la boule sont déterminés comme ceux des planètes ; la différence consiste seulement en ce que nous ne savons pas calculer les premiers et que nous savons calculer les seconds. La régularité de certains mouvements dépend du nombre et du mode d'action des forces ; et ce que nous appelons manifestation du hasard est la manifestation de nombreux effets qui s'entrecroisent. Bertrand, lui-même, en donne une preuve. « (p. XXIV) L'empreinte du hasard [cette expression manque entièrement de précision] est marquée très curieusement quelquefois, dans les nombres déduits des lois les plus précises. Une table de logarithmes en témoigne. Pour 10000 nombres successifs dans les Tables à 10 décimales de Véga, je prends la septième figure du logarithme : rien dans ce choix n'est laissé au hasard. L'Algèbre gouverne tout, une loi inflexible enchaîne tous les chiffres. Si l'on compte cependant les résultats, on aura, à très peu près, sur 10000, 1000 fois le chiffre 0, 1000 fois le chiffre 1 et ainsi des autres ; la formule se conforme aux lois du hasard [entre-croisement des causes]. Vérification faite, sur 10000 logarithmes, le septième chiffre s'est trouvé 990 fois égal à 0, 997 fois à 1, 993 fois à 2, 1012 fois à 4 ». Cela n'aurait pas lieu pour les derniers chiffres d'une table de carrés, qui, non seulement excluent certains nombres, mais encore se succèdent dans un ordre déterminé, qui est le suivant : 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. L'éclipse de lune dont parle Bertrand peut être comparée à ce second phénomène, soit à la détermination du dernier chiffre des carrés ; mais cette comparaison ne tient que si celui qui cherche à prévoir l'éclipse a des notions suffisantes d'astronomie. Pour celui qui en est dépourvu, l'éclipse de lune est un phénomène fortuit dont il ignore les uniformités. Le tirage fait dans une urne peut être comparé au premier phénomène, soit à celui observé à propos du septième chiffre des logarithmes de Véga ; naturellement pour qui a des connaissances d'arithmétique assez étendues ; autrement, quand on ignore ce que sont des carrés et des logarithmes, on ne peut rien prévoir.
§ 559. Si un fait est certain (très probable), s'il est décrit avec une très grande précision, une théorie déduite de ce fait, avec une logique rigoureuse, est aussi certaine (a une très grande probabilité). Souvent les faits sur lesquels la sociologie doit se fonder n'ont pas une très grande probabilité, et en particulier ne sont pas précis ; par conséquent, même en usant d'une logique rigoureuse, la théorie qu'on obtient d'un seul fait est peu probable ; elle l'est encore moins quand, à la logique rigoureuse, on substitue des inductions où les sentiments, le sens commun, les maximes usuelles, etc., jouent un rôle. Pour y remédier, il faut tout d'abord exclure autant que possible ces inductions, puis considérer non pas un, mais autant de faits qu'on peut, d'ailleurs toujours avec discernement, comme nous l'avons dit déjà (§ 538 et sv.).
§ 560. Rien ne contribue à augmenter la probabilité comme la possibilité de faire des vérifications directes, des expériences, au sens propre. Tel est le motif principal de la très grande probabilité des lois de la chimie et de la physique, et aussi des lois de l'astronomie. Dans ce dernier cas, l'expérience consiste à vérifier si les astres occupent réellement le lieu que leur assigne la théorie. Dans une mesure beaucoup moindre, mais toujours assez notable, on accroît la probabilité des lois qui ne sont pas susceptibles de ces vérifications, s'il est possible de montrer au moins qu'elles sont semblables à d'autres, pour lesquelles ces vérifications ont lieu.
§ 561. Le nombre des gens qui, des anciens temps à nos jours, ont affirmé avoir vu des fantômes, est énorme. Si donc les probabilités croissaient uniquement par le nombre des observations, l'existence des fantômes devrait avoir une très grande probabilité. Au contraire, peu de gens y croient aujourd'hui. Pourquoi cela ? Il ne faut pas résoudre la question en invoquant de prétendues lois naturelles qui seraient contredites par l'existence des fantômes ; parce qu'ainsi on tournerait en cercle. Si l'existence des fantômes était démontrée, ces lois ne subsisteraient plus ; elles ne sauraient donc être invoquées pour prouver l'inexistence des fantômes. On ne doit pas dire non plus qu'il faut nier les apparitions de fantômes parce qu'on ne saurait les « expliquer ». Ceux qui croient aux fantômes ou à d'autres choses analogues, répondent fort bien que ni la lumière, ni l'électricité, ni l'affinité, ne se peuvent « expliquer », et que pourtant cela ne nuit pas le moins du monde à la réalité des faits qui passent pour les manifester. La réalité d'un fait ne dépend pas de l' « explication [FN: § 561-1]» qu'on en peut donner.
§ 562. Il y a deux raisons importantes, pour lesquelles nous ne croyons pas à l'existence des fantômes (elle nous paraît fort peu probable).
1° L'expérience directe fait très souvent défaut. Si quelqu'un ne croit pas à la télégraphie sans fil, il n'a qu'à acheter un petit appareil – on en vend même dans les magasins de jouets – et il verra se produire le phénomène de cette télégraphie. Il n'est pas nécessaire qu'il y croie préalablement. Au contraire, s'il veut voir un fantôme, s'il veut invoquer le diable ou procéder à d'autres expériences semblables, il réussira ou ne réussira pas à le voir, suivant les dispositions de son esprit. « Hors d'ici, incrédules ! » dit la thaumaturgie. « Approchez, incrédules ! » dit au contraire la science logico-expérimentale.
2° Il n'y a pas de catégorie de faits à laquelle on puisse assimiler l'apparition des fantômes. Si, par exemple, il était démontré expérimentalement que le diable peut être invoqué, il y aurait certaines probabilités en faveur de l'apparition des fantômes, et vice-versa. Mais malheureusement toutes les catégories analogues à l'apparition des fantômes échappent aux vérifications expérimentales ; donc, pour le moment, l'existence de ces apparitions a une probabilité extrêmement petite.
§ 563. À la suite du cardinal Newman [FN: § 563-1], beaucoup d'auteurs ont donné une grande importance à une accumulation de petites probabilités indépendantes, pour produire en nous une conviction ayant une grande probabilité. Il y a du vrai en cela ; c'est ce que nous avons vu au sujet de l'utilité d'appuyer une théorie sur des faits nombreux et variés ; mais il y a aussi du faux, étant donné qu'on ne tient pas compte du puissant motif de conviction qui naît de la seule possibilité de faire des vérifications.
§ 564. Newman [FN: § 564-1] croit que si un Anglais est convaincu que son pays est une île, c'est seulement grâce à une accumulation de petites probabilités. Non ; il y a un motif bien plus puissant ; c'est la possibilité d'une vérification. Il n'est pas nécessaire que l'individu qui croit l'Angleterre une île ait fait lui-même cette vérification ; il n'est pas nécessaire qu'il connaisse quelqu'un qui l'ait faite ; il suffit qu'il soit possible de la faire, parce qu'on peut alors raisonner ainsi : « Quelle renommée acquerrait celui qui prouverait que l'Angleterre n'est pas une île ! que d'argent il gagnerait avec ses publications ! Si personne n'a jamais fait cela, il faut vraiment croire que c'est impossible ». Supposez qu'un prix de dix millions soit assigné à celui qui découvrirait un loup dans l'île de Wight, et qu'au bout d'un siècle, personne n'ait gagné le prix. On serait sûr sans autre, et spécialement sans l'accumulation de petites probabilités, qu'il n'existe pas de loup dans cette île. Supposez au contraire qu'il y ait la peine de mort pour celui qui dit que l'Angleterre n'est pas une île, et pour qui fait des recherches dans ce sens. Toutes les petites probabilités de Newman n'empêcheraient pas un doute de subsister : l'Angleterre est-elle bien une île ?
§ 565. Les partisans de Newman ont un but. Par cette voie indirecte, ils veulent démontrer la réalité des traditions historiques, et spécialement des traditions religieuses ; mais y croire n'est pas du tout semblable à croire que l'Angleterre est une île ; parce que la possibilité de vérifier, qui existe pour ce fait, manque pour ces traditions. Depuis nombre de siècles jusqu'à nos jours, on sait que l'Angleterre est une île. Il y a cent cinquante ans, on tenait pour vraies, dans l'histoire romaine, bien des choses qui passent aujourd'hui pour de simples légendes ; et si les déductions de Pais sont exactes, nous devrons encore ôter d'autres choses à cette histoire.
§ 566. Pour connaître les mœurs romaines, il n'y a pas d'accumulation de petites probabilités qui vaille la découverte, à Pompéi, d'une chose que tout le monde peut voir et vérifier.
§ 567. Nous avons vu (§ 541) que, suivant Thucydide, beaucoup d'Athéniens étaient dans l'erreur au sujet du meurtre d'Hipparque. Qui sait combien il existe d'autres faits semblables et combien nous tenons pour vrais de faits historiques qui peut-être sont faux ! Mais ce doute ne règne pas quant à l'existence des États américains, même pour qui n'y est pas allé et ne connaît personne qui les ait vus ; parce que la possibilité de la vérification existe, et cela suffit, si l'on tient compte du grand intérêt qu'il y aurait à démontrer l'erreur de l'opinion commune.
§ 568. Il suit de là que, pour juger de la vérité d'une théorie, il est presque indispensable qu'on puisse la combattre librement. Toute restriction, même indirecte, même lointaine, mise à qui veut la contredire, suffit pour en faire douter. Par conséquent, la liberté d'exprimer sa pensée, même quand elle est contraire à l'opinion du plus grand nombre on de tous, même quand elle froisse les sentiments de quelques-uns ou de beaucoup, même quand elle est généralement tenue pour absurde ou criminelle, tourne toujours à l'avantage de la recherche de la vérité objective (accord de la théorie avec les faits). Mais il n'est point ainsi démontré que cette liberté soit toujours favorable à la bonne organisation de la société, à l'augmentation de sa prospérité politique, économique, etc. Cela peut être ; cela peut ne pas être, suivant les cas ; c'est une question qui reste à examiner.
§ 569. Au point de vue de la recherche de la vérité expérimentale d'une doctrine, autant vaut imposer directement cette doctrine que certains principes dont on peut la déduire ainsi que d'autres. Une autorité vous impose de croire que 24 est égal à 20. Il en vient une autre qui dit : « Je suis beaucoup plus libérale ; je vous impose seulement de croire que 5 est égal à 6 ». C'est exactement la même chose ; parce que si 5 est égal à 6, deux nombres égaux multipliés par le même nombre, devant donner des produits égaux, il s'en suit que les produits de 5 et de 6 par 4 doivent être égaux, et qu'ainsi 20 est égal à 24.
§ 570. Au point de vue de la « liberté scientifique », autant vaut donc la religion catholique, qui impose directement la doctrine, que la religion protestante, qui impose seulement de la déduire des Saintes Écritures. Aujourd'hui, le « protestantisme libéral » a cru faire un nouveau pas dans la voie de la « liberté scientifique », en supprimant la croyance à l'inspiration divine de l'Écriture Sainte ; mais la croyance en un certain idéal de perfection subsiste toujours, et cela suffit pour nous chasser hors du domaine logico-expérimental. On ne peut pas non plus faire d'exception pour les dogmes humanitaires, ni pour ceux de la religion sexuelle, si chers à M. Bérenger et à ses intelligents amis. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de liberté scientifique, si l'on ne peut mettre tout en doute, y compris la géométrie euclidienne et l'espace à trois dimensions. Il est ridicule de dire qu'on veut laisser la liberté de la « vérité », non celle de l' « erreur » ; parce que la question à résoudre est justement de savoir où est la « vérité » et où est « l'erreur » ; et l'on ne peut résoudre cette question, si l'on ne peut défendre l' « erreur » et avancer en sa faveur toutes les raisons possibles. C'est seulement après que ces questions ont été bien et dûment réfutées, que le jugement porté sur l'« erreur » se confirme, jusqu'à plus ample informé. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, parce que, pour juger de la «vérité » ou de l'« erreur », elles substituent le critère du sentiment au critère logico-expérimental.
§ 571. La possibilité de faire des vérifications directes, dans le sens qu'on peut faire de nouvelles observations, est aussi un motif pour expliquer les faits du passé par ceux du présent, que nous pouvons observer tout à notre aise (§ 548).
§ 572. On a, par exemple, la proposition suivante : « À Athènes, les considérations politiques et d'intérêt des juges influaient beaucoup sur les jugements en matière d'affaires privées » (§ 545). Nous en avons des preuves directes dans les quelques plaidoyers qui nous sont parvenus. La probabilité de vérité de la proposition croît, grâce à certaines preuves indirectes, comme le seraient celles données par Aristophane et par Hérondas (§ 545-1). Mais elle s'accroît ensuite énormément par la similitude avec ce qui arrive aujourd'hui en Italie et en France. Celui qui douterait encore que la politique a beaucoup d'influence dans les procès des particuliers, peut faire, en une certaine mesure, des expériences. Qu'il lise avec soin les journaux et note les faits où cette influence apparaît ; il en trouvera plusieurs, chaque année, et verra que, pour différentes raisons, on ne peut les connaître tous. Qu'il interroge des gens qui ont la pratique de ces affaires, dans des conditions telles qu'ils soient disposés à dire la vérité, et il verra l'induction directe confirmée par voie indirecte.
§ 573. Autre exemple. Suivant certaines personnes, ceux qui nous racontent des miracles du passé, ou nous donnent des témoignages de faits surnaturels, sont toujours de mauvaise foi. Voyons ce qui arrive dans le présent : faisons des expériences. Parmi nos connaissances, il ne nous sera pas difficile de trouver des personnes que nous savons bien être de parfaite bonne foi, et qui affirment pourtant avoir été en communication avec les esprits. Notre temps est sceptique ; les temps passés étaient crédules. Le fait observé, de la bonne foi, doit donc s'être produit encore plus facilement dans le passé.
§ 574. 3e GENRE. Propositions qui ajoutent quelque chose à 1'uniformité expérimentale ou la négligent. Cherchons la façon dont les principes étrangers à l'expérience influent sur les théories qui, envisagées au point de vue objectif, sont donc celles de la IIe classe (§ 13). Considérons la partie principale du phénomène. Il convient de distinguer le cas (A ), dans lequel l'intervention d'un élément non expérimental est explicite, du cas (B ), où il est au contraire implicite. Nous disons la partie principale du phénomène, parce que, dans les cas concrets, les types peuvent se mélanger. Ici, nous recherchons simplement s'ils ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale ou s'ils la négligent. Nous retrouverons une partie de ces types aux chapitres VIII et IX, et nous étudierons les manières dont, à l'exclusion des déductions logico-expérimentales, on obtient certaines conclusions (§ 1393). Ainsi l'autorité est ici envisagée au point de vue de ce qu'elle ajoute aux uniformités expérimentales, et aux chapitres IX et X elle sera considérée quant à l'usage qu'on en fait pour imposer certaines conclusions. Il en va de même du consentement universel, de celui du plus grand nombre, des meilleurs, etc.
§ 575. Au point de vue que nous envisageons maintenant, nous classerons les types de la façon suivante.
A. Les entités abstraites recherchées sont connues indépendamment de l'expérience. Cette connaissance est supérieure à la connaissance expérimentale (§ 576 à 632).
A –α . On ne donne que peu ou point de place à l'expérience « § 582 à 612).
A – α1. Autorité. Autorité divine, connue par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs hommes. – Autorité d'un ou de plusieurs hommes (§ 583 à 590).
A – α2. Consentements de plusieurs hommes ; ces consentements sont comptés, pesés ; ou bien consentement de l'esprit d'un être abstrait (§ 591 à 612).
A – β. L'existence des abstractions et des principes, reconnue indépendamment de l'expérience, est confirmée par elle d'une façon subsidiaire (§ 613 à 630).
A - γ. On attribue, ou l'on se figure attribuer une grande part à l'expérience, mais elle est toujours subordonnée (§ 631 à 632).
B. Les entités abstraites qu'on recherche ne sont pas explicitement dotées d'une origineétrangèreàl'expérience.Cesontdesimplesabstractionsdéduites arbitrairement de l'expérience ; ou bien elles ont une existence propre, qui, implicitement, peut être non-expérimentale (§ 641 à 796).
B – α . Les mythes, les récits religieux et autres semblables légendes sont des réalités historiques (§ 643 à 661).
B – α 1. Prises à la lettre, sans y rien changer (§ 650 à 660).
B - α 2. Avec de légers et faciles changements dans l'expression littérale (§ 661).
B – β. Les mythes, etc., renferment une part d'histoire, mêlée à une partie non réelle (§ 662 à 680).
B – β 1. Les mythes, etc., ont une origine historique, et le récit a été altéré avec le temps (§ 681 à 691).
B – β 2. Les mythes, etc., sont le produit d'expériences mal interprétées, de déductions fausses de faits réels (§ 692 à 719).
B – β 3. Les faits historiques sont des déviations d'un type, ou constituent une série ayant une limite ou une asymptote (au sens mathématique) (§ 720 à 732).
B – β 4. Les mythes, etc., sont des imitations d'autres mythes semblables. Deux ou plusieurs institutions semblables sont imitées l'une de l'autre (§ 733 à 763).
B - γ. Les mythes, etc., sont entièrement irréels « § 764 à 796).
Dans ce chapitre, nous étudierons la catégorie (A ); dans le suivant, nous nous occuperons de la catégorie (B ).
§576. (A). Les entités abstraites recherchées sont connues indépendamment de l'expérience. Cette connaissance est supérieure à la connaissance expérimentale. C'est en quoi consiste le principal caractère de la classe. Par exemple, si l'on tire de l'expérience le théorème d'après lequel l'évolution est unique, on fait une théorie de la classe I (§ 13). Si on l'admet a priori, on fait une théorie de la classe II. En général, dans ce cas, on ne soustrait pas volontairement ce principe au domaine expérimental ; on l'admet comme évident, et on passe outre. De cette manière, on a une théorie de la classe B. Au contraire, celui qui, par exemple, admet un droit naturel imposé par la naturalis ratio, peut bien recourir ensuite autant qu'il veut à l'expérience, sa théorie reste toujours dans la classe A, parce que la naturalis ratio est au-dessus de l'expérience, qui peut bien en confirmer les arrêts, mais jamais les contredire.
§ 577. À un moment donné, il y a une certaine distance entre le centre de la terre et le centre du soleil. Comme cette distance ne varie pas beaucoup, on peut définir une certaine distance moyenne (caractère arbitraire), et l'appeler distance de la terre au soleil. Il peut être difficile de la trouver, mais il n'y a aucun doute qu'elle existe, et nous pouvons la chercher expérimentalement.
§ 578. Au contraire, si nous cherchons qui est Jupiter, le doute naît que la chose cherchée n'existe pas. Et même si nous cherchons quelle idée les Romains avaient de Jupiter, il se peut que nous cherchions une chose qui n'existe pas ; car cette idée pourrait n'avoir pas été unique. Nous pouvons bien définir, par le procédé employé tout à l'heure, une certaine moyenne d'idées. On pourra ensuite rechercher et découvrir cette entité que nous avons créée plus ou moins arbitrairement (§ 103).
§ 579. La croyance que certaines entités abstraites existent indépendamment de l'expérience, qu'elles ne sont pas le produit d'une abstraction en partie arbitraire, est si invétérée et si évidente dans l'esprit de la plupart des gens, que la grande puissance du sentiment non-logique auquel elle correspond apparaît manifestement ; et nous découvrons déjà l'un des principes qui pourront nous fournir une classification utile des faits sociaux, en rapport avec la détermination de l'équilibre social. En outre, comme cette croyance a fait bon ménage avec le progrès des sociétés humaines, une question se pose : si cette croyance est erronée au point de vue expérimental, ne peut-elle néanmoins être utile dans la pratique de la vie des sociétés ? Pour le moment, nous ne pouvons rien décider à ce propos ; mais nous avons dû faire mention de ce doute, pour qu'on ne croie pas, comme d'habitude, qu'en rejetant cette croyance, au point de vue expérimental, nous entendons aussi la blâmer au point de vue social (§ 72 et sv., 311).
§ 580. Afin de diviser en genres les théories de la catégorie (A ), nous pouvons prendre pour critère les diverses quantités de déductions expérimentales qu'elles renferment, en partant d'un extrême (α ), où il y en a peu ou point, passer par un genre (β ), où l'expérience est mêlée à d'autres considérations, pour arriver à un autre extrême (γ ), où l'on fait dominer les considérations expérimentales, au moins en apparence.
Ici, par expériences (§ 6) nous désignons l'expérience et l'observation directes des personnes qui les rapportent. Quelqu'un pourrait nous dire qu'il fait appel à l'expérience (ou à l'observation), quand il cherche dans la Bible si le fait de toucher l'arche du Seigneur fait mourir les gens, et qu'il accepte ce témoignage sans oser le mettre en doute, le critiquer. Soit ; nous ne voulons pas discuter sur les mots ; seulement, afin de nous entendre, nous avertissons le lecteur que tel n'est pas le sens que nous donnons ici au mot expérience (et observation), qui signifie observer directement ou par l'intermédiaire de témoignages passés au crible, discutés, critiqués, si ceux qui touchent cette arche meurent ou vivent.
§ 581. Les motifs que nous avons d'accepter une opinion sont externes ou internes. Les motifs externes, outre l'expérience rigoureusement scientifique, que nous ne considérons pas ici, sont spécialement l'autorité et le consentement d'autres hommes, soit réel, soit imaginaire, avec l'intervention de l'esprit d'un être abstrait. Nous avons ainsi les deux genres (A - α 1), (A - α 2). Les motifs internes se réduisent à l'accord avec nos sentiments. Ils nous présentent d'abord des phénomènes où l'expérience n'a point part, comme seraient ceux d'une foi vive, qui en vient à proclamer qu'elle croit une chose parce qu'elle est absurde. Nous n'avons pas a nous en occuper ici, puisque nous étudions seulement les façons dont on veut faire apparaître logique ce qui est non-logique. La foi vive dont on vient de parler est non-logique ; mais on ne cherche pas à la donner pour logique. Viennent ensuite d'autres phénomènes où l'expérience peut avoir, ou paraître avoir part.
Dans le cas concret du tabou sans sanction, il y a d'abord un élément prépondérant de foi vive, grâce à laquelle on croit sans chercher de motifs ; puis on y peut voir un germe d'explication logique ; laquelle est purement verbale et se réduit à dire : « On fait ainsi, parce qu'on doit faire ainsi ». À ce point de vue, on peut la mentionner dans la catégorie (A), renvoyant une étude plus complète au chapitre IX, où nous traiterons d'une manière générale des explications que les hommes donnent de leurs actions.
Les motifs internes nous présentent des phénomènes, où l'expérience paraît avoir part ; et l'on a ainsi les genres (A-β) et (A-γ), et en outre un élément principal ou secondaire de la catégorie (B). On obtient un semblant d'expérience, soit en supposant confirmé par elle ce qui est en réalité le produit du sentiment, soit en opérant une confusion entre l'expérience objective et l'expression de nos sentiments. Ce raisonnement, poussé à l'extrême, nous donne l'auto-observation des métaphysiciens, qui prend aujourd'hui le nom d'expérience religieuse des néo-chrétiens. De cette façon, celui qui crée une théorie devient en même temps juge et partie (§ 17). Son sentiment juge la théorie que ce sentiment même a créée, et par conséquent l'accord ne peut être que parfait et l'arrêt favorable (§ 591). Il en va autrement, quand c'est l'expérience objective qui est juge ; elle peut démentir la théorie construite par le sentiment, et cela arrive très souvent. Le juge est distinct de la partie.
§ 582. (A-α). On ne donne que peu ou point de place à l'expérience. C'est en somme le fondement des théologies et des métaphysiques. Le cas extrême est celui, rappelé tout à l'heure, du tabou sans sanction, quand on dit : « On fait ainsi parce qu'on doit faire ainsi ». On ajoute ensuite des développements pseudo-logiques toujours plus abondants, jusqu'à constituer de longues légendes ou de longues élucubrations. Ces développements pseudologiques emploient largement l'autorité et le consentement des hommes, comme moyens de démonstration.
§ 583. (A- α 1). Autorité. Ici nous la considérons seulement comme un moyen de donner un vernis logique aux actions non-logiques et aux sentiments dont elles tirent leur origine. Au chapitre IX, nous en parlerons de nouveau, à un point de vue général.
La révélation divine fait partie de ce sous-genre, pour autant qu'elle n'est pas considérée comme un fait historique (B-α). De même, en font partie : l'injonction divine, la prophétie divine ; car enfin elles ne nous sont communiquées que par des hommes. En y regardant bien, on voit que dans le motif qu'on peut alléguer au sujet de la volonté divine, il y a seulement une explication de l'autorité que l'on accorde à celui qui est réputé interprète de cette volonté [FN: § 583-1]. Les adeptes de Mahomet acceptaient son autorité comme les gens cultivés d'une certaine époque acceptaient l'autorité d'Aristote. Les premiers donnaient pour motif l'inspiration divine ; les seconds, le profond savoir du Stagirite ; et c'étaient là deux explications de même nature. On comprend par conséquent comment, en des temps d'ignorance, les deux explications peuvent s'emmêler, et comment Virgile, admiré comme littérateur, devient Virgile le fameux magicien (§ 668 et sv.).
§ 584. Souvent l'autorité est donnée comme une adjonction à d'autres démonstrations. Dans ce cas, le sens en est à peu près le suivant : « Les faits que nous citons sont si connus, les raisonnements que nous faisons sont tellement persuasifs, qu'ils sont admis par tous, ou du moins par tous ceux qui sont cultivés et intelligents ». Cette manière de raisonner a été très en usage pour démontrer l'existence des sorciers, des fantômes, etc. Nous en parlerons plus loin (§ 1438 et sv.).
§ 585. Le protestant qui accepte sincèrement l'autorité de l'Écriture Sainte, le catholique qui accepte l'autorité du pape prononçant ex cathedra, manifestent le même phénomène sous une forme différente. On le voit également dans le fait de l'humanitaire qui se pâme à la lecture des œuvres de Rousseau ; ou dans celui du socialiste qui jure par Marx et Engels, dont les œuvres renferment tout le savoir humain ; ou bien encore dans celui de l'adorateur de la démocratie, lequel, s'inclinant respectueusement, soumet son jugement et sa volonté aux décisions du suffrage universel ou restreint, et même, ce qui est pis encore, à celles d'assemblées parlementaires, où l'on sait pourtant qu'il ne manque pas de politiciens peu estimables [FN: § 585-1]. Il va sans dire que chacun de ces croyants estime sa croyance raisonnable, les autres absurdes. Celui qui admet l'infaillibilité du suffrage universel, manifesté par des politiciens quelque peu véreux, ne peut contenir son indignation à la seule pensée qu'il est des gens qui admettent l'infaillibilité du pape ; et il demande qu'on leur interdise d'enseigner, parce que leur jugement n'est pas « libre » ; tandis que, à ce qu'il paraît, libre est le jugement de celui qui change d'opinion, non par conviction personnelle, mais pour obéir aux décisions d'une assemblée politique.
§ 586. Quand on s'attache seulement à la force logico-expérimentale des raisonnements, on pourrait croire que ceux qui se fournissent ainsi de postulats devraient au moins les choisir précis et aptes à des déductions rigoureuses. Mais l'expérience a démontré qu'il n'en est pas ainsi ; et cela ne doit pas surprendre les personnes qui ont quelque connaissance de la logique des sentiments (§ 514). Les postulats qui peuvent tout signifier, justement parce qu'ils ne signifient rien de précis, sont excellents pour persuader les gens ; et en effet, on observe qu'on tire de ces postulats des conclusions différentes et parfois entièrement opposées. Souvent aussi les postulats (α 1) se mêlent et se confondent avec les postulats (α 2). La partie logique est souvent meilleure dans (α 1) que dans (α 2).
§ 587. Parmi le très grand nombre d'exemples qu'on pourrait citer de conclusions opposées, tirées du même principe, les suivants suffiront; nous en rencontrerons d'ailleurs constamment (§ 873).
L'eau et le feu étant considérés comme purs et sacrés, les Hindous en déduisaient qu'il faut jeter les cadavres dans le Gange ou les brûler. Les Perses tiraient au contraire la conséquence opposée ; à savoir qu'on ne devait souiller ni l'eau ni le feu, par le contact des cadavres [FN: § 587-1]. Il paraît que dans l'Inde des Védas, l'incinération des cadavres n'était pas la règle absolue ; mais quoi qu'il en soit, l'incinération est restée la manière principale de faire disparaître les cadavres. On dépose le mort sur un bûcher édifié au milieu de trois feux, allumés aux trois feux sacrés du mort (s'il a entretenu ces trois feux), et l'on brûle le cadavre avec certaines cérémonies dont nous n'avons pas à nous occuper ici. « Comme sur la naissance, ainsi veille le feu sur les phases essentielles de la vie de l'Hindou [FN: § 587-2]». Aujourd'hui encore, on brûle les cadavres [FN: § 587-3] . « (p. 92) Aussi-tôt que le bucher est éteint, on répand dessus du lait, et on ramasse les os épargnés par le feu. Ces os sont mis dans des vases, et on les garde jusqu'à ce qu'on trouve une occasion de les faire jetter dans quelques rivières saintes ou dans le Gange ; car les Indiens sont persuadés que tout homme dont on aura jetté les ossemens dans ce fleuve sacré, jouira d'un bonheur infini pendant des millions d'années. Ceux qui demeurent sur ses bords, y jettent même les corps entiers, après avoir souvent accéléré la mort des malades à force de leur en faire boire de l'eau, à laquelle ils attribuent une vertu miraculeuse ».
Hérodote (I 140) parle de l'usage des Perses, ou au moins des Mages, de faire dévorer les cadavres par les chiens. Une épigramme de Dioscoride dit [FN: § 587-4]: « Euphrate, ne brûle pas Philonime, et ne souille pas le feu par mon corps. Je suis Perse et de race perse indigène ; oui, mon maître. Souiller le feu est pour nous une chose grave et plus amère que la mort. Mais enveloppe-moi d'un suaire ; donne-moi à la terre. Ne répands pas d'eau sur le mort : ô mon maître, je vénère aussi les fleuves ». Chardin décrit le cimetière des Guèbres, en Perse, où les cadavres sont exposés aux oiseaux de proie et aux corbeaux [FN: § 587-5]. [Voir Addition A15 par l’auteur]
§ 588. Le défaut de précision des prémisses explique comment on en peut tirer des conclusions différentes, mais n'explique pas pourquoi on les tire ; et, dans des cas nombreux, on reste à se demander si l'autorité est source de la croyance, ou si c'est la croyance, ou mieux les sentiments qui y correspondent, qui sont la source de l'autorité. Dans un autre très grand nombre de cas, il semble qu'il y ait une suite d'actions et de réactions. Certains sentiments induisent à admettre une certaine autorité qui, à son tour, les renforce ou les modifie, et ainsi de suite.
§ 589. L'autorité peut être celle d'un ou de plusieurs hommes ; et quand bien même elle est constatée par l'observation directe, elle ne sort pas du sous-genre (α 1). Mais il faut prendre garde que souvent le consentement de ces hommes ne procède pas de l'observation directe, mais qu'on le présume, en le déduisant de certains sentiments de celui qui l'affirme. Dans ce cas, nous avons un fait du sous-genre (α 2). Cela se produit, par exemple, quand on parle du « consentement universel » ; car il est certain que personne n'a jamais pu s'en assurer auprès de tous les hommes qui ont vécu ou qui vivent sur le globe terrestre ; et il est d'ailleurs certain que le plus grand nombre de ces hommes, la plupart du temps, ne comprendraient pas le moins du monde les questions auxquelles on prétend qu'ils donnent tous la même réponse. On doit donc traduire une affirmation de telle sorte en disant : « Ce qui, selon moi, devrait avoir le consentement universel » ; ou bien : « Ce qui, selon moi, devrait avoir le consentement universel des hommes que j'estime sages, avisés, savants, etc. » ; et ce n'est pas du tout la même chose que l'affirmation précédente.
§ 590. Le principe d'autorité persiste même dans nos sociétés, non seulement chez les ignorants, non seulement en matière de religion et de morale, mais aussi en sciences, dans celles de leurs branches que l'individu n'a pas spécialement étudiées. A. Comte a bien mis le fait en lumière, quoiqu'il en ait ensuite tiré des conséquences erronées.
§ 591. (A-α 2). Consentements de plusieurs hommes ; ces consentements sont comptés, pesés ; ou bien consentement de l'esprit d'un être abstrait. On peut invoquer ces consentements pour montrer que certaines choses sont inconcevables ; par exemple une ligne droite « indéfinie ». C'est le cas de l'abstraction, scientifique ou métaphysique. Nous ne nous en occupons pas ici. Ou bien les consentements peuvent porter sur des propositions dont le contraire est parfaitement concevable ; par exemple l'existence des dieux. C'est de ces consentements que nous avons à traiter ici.
Si le consentement universel ou du plus grand nombre, ou même de quelques-uns, est explicitement invoqué comme témoignage de l'expérience, nous avons les récits de la science expérimentale, ou bien, là où le témoignage échappe à l'expérience, les récits de la catégorie (B). Ici, nous devons nous occuper uniquement des cas dans lesquels le consentement agit par sa vertu propre et se trouve placé au-dessus de l'expérience. Il peut y avoir deux choses étrangères à l'expérience : 1° le fait du consentement; 2° les conséquences du fait.
§ 592. 1° Le fait du consentement. Une statistique pourrait le constater. On interrogerait un certain nombre d'hommes, et l'on prendrait note de leurs réponses. Dans ce cas, le fait serait expérimental. Mais généralement on ne suit pas cette voie : on présume le consentement des hommes, et c'est tout au plus si on le vérifie par quelque vague recherche expérimentale ou pseudo-expérimentale. Notons que là où l'on parle du consentement de tous les hommes, la preuve expérimentale est absolument exclue, même quand tous les hommes se réduit aux hommes vivants, les morts étant laissés de côté, puisqu'il est impossible d'interroger tous les hommes qui vivent sur la terre, et qu'il serait même impossible de faire comprendre à beaucoup d'entre eux les questions auxquelles on demande une réponse. Il en va de même, si l'on parle du plus grand nombre des hommes, même si le nombre total est celui d'un pays restreint.
Pour éviter une semblable difficulté, on a l'habitude d'ajouter des épithètes, et l'on parle du consentement de tous les hommes intelligents, raisonnables, honnêtes (§ 462), ou du plus grand nombre d'entre eux ; puis, directement ou indirectement, on admet dans cette catégorie d'hommes intelligents, honnêtes, raisonnables, seulement ceux qui ont l'opinion qu'on veut gratifier du consentement universel ; et par conséquent l'on démontre par un beau raisonnement en cercle que cette opinion en jouit effectivement.
Pour que le raisonnement ne soit pas en cercle, il serait nécessaire que les qualités requises, chez les hommes dont on veut l'avis, fussent indépendantes du sens de cet avis, et qu'elles ne fussent déterminées que par des considérations générales, telles que celles de la compétence en une certaine matière. Ce serait le cas, par exemple, si l'on demandait l'avis de celui qui travaille la terre, au sujet d'une culture donnée ; l'avis de celui qui a étudié une science, à propos d'une question de cette science, etc. Mais on sort ainsi de notre sujet, pour passer à celui de l'autorité. Afin de supprimer l'inconvénient de ne pouvoir faire une statistique des consentements sans tomber dans l'erreur du raisonnement en cercle, on fait intervenir l'esprit d'un être abstrait. On ne définit pas cet esprit et l'on ne peut le définir ; c'est en somme celui de la personne qui affirme le consentement universel, qu'elle déduit du consentement de son esprit, baptisé du nom d'esprit d'un être abstrait. On a ainsi l'auto-observation des métaphysiciens et de leurs continuateurs néo-chrétiens. Des consentements comptés, qu'il est impossible de connaître, on passe ainsi aux consentements pesés avec certaines balances arbitraires, et l'on en réduit peu à peu le nombre jusqu'à les ramener à celui de la personne qui en a besoin pour démontrer sa théorie (§ 402 et sv., 427). Tout cela nous fait sortir de l'expérience, qui devrait nous faire connaître le prétendu consentement du plus grand nombre des hommes ou de tous les hommes, ou même de certains hommes déterminés par des conditions indépendantes de l'avis demandé.
§ 593. 2° Les conséquences du fait. Plaçons-nous dans l'hypothèse la plus favorable au but que l'on vise, et supposons que le fait du consentement soit présenté avec une certaine probabilité par l'expérience. Comme on l'a dit déjà (§ 591), on laisse ici de côté le cas où l'on en déduit justement l'existence probable de cette expérience. D'habitude, on juge que, par sa vertu propre, le concept manifesté par ce consentement doit nécessairement correspondre à la réalité, et même, selon certains métaphysiciens, qu'il est lui-même la réalité. Même quand on se borne à affirmer une correspondance nécessaire avec la réalité expérimentale, on sort de l'expérience ; car celle-ci ne démontre pas le moins du inonde que, lorsqu'un très grand nombre d'hommes ont une opinion, elle corresponde à la réalité. Au contraire, du soleil qui se plongeait dans l'Océan, aux innombrables opérations magiques, on a l'exemple d'erreurs manifestes qui furent prises pour vérités par un très grand nombre d'hommes. Quand donc on affirme que ce qui est dans l'esprit du plus grand nombre est d'accord avec la réalité, on se soustrait entièrement à l'expérience, et semblable assertion ne peut être crue que pour des motifs non-expérimentaux (§ 42).
Ici de nouveau, le raisonnement en cercle est employé. Si l'on nous objecte qu'un très grand nombre d'hommes ont cru aux sorcières, nous répondrons qu'ils n'étaient pas intelligents ou pas éclairés ; et si l'on nous demande comment on reconnaît les hommes intelligents et éclairés, nous dirons que ce sont ceux qui croient uniquement les choses qui existent en réalité. Après cela, nous pourrons affirmer sans crainte que les idées des personnes intelligentes et éclairées correspondent toujours à la réalité (§ 441)
Si, pour éviter le raisonnement en cercle, on a recours à l'expédient déjà indiqué, quand il s'agissait de reconnaître le fait, autrement dit si l'on envisage le consentement des hommes « compétents », en déterminant cette compétence indépendamment du sens de l'avis qu'on demande, on demeure également en dehors de l'expérience, au cas où l'on affirme que cet avis est toujours d'accord avec la réalité. Tout au contraire, l'expérience démontre que l'avis des hommes « compétents » est souvent tout à fait en désaccord avec la réalité, et l'histoire de la science est l'histoire des erreurs des hommes « compétents ». On ne peut donc employer cet avis que comme indice de concordance d'une théorie donnée avec la réalité, comme apportant à cette théorie une probabilité plus on moins grande, suivant l'état de la science et la compétence de celui qui exprime l'avis ; jamais comme une preuve expérimentale de cette théorie ; preuve qui ne peut être donnée que par l'expérience directe ou indirecte ; et si l'on ne tient pas compte de cela, on sort du domaine expérimental. Le rôle de juge (§ 17), dans les sciences logico-expérimentales, revient à l'expérience ; mais l'on comprend qu'il puisse, en certains cas, être délégué à des hommes « compétents », pourvu qu'ils ne soient pas choisis en vue du sens de la réponse que l'on veut obtenir ; que la question qu'on leur propose soit exprimée avec une clarté suffisante, qu'ils agissent vraiment au nom de l'expérience, et non pour imposer une certaine foi, et qu'enfin leur verdict puisse toujours être déféré à la suprême instance de l'expérience.
§ 594. Quand ensuite on entre dans la voie qui aboutit à cette affirmation que, par sa vertu propre, le concept manifesté par le consentement universel est la réalité, qu'il crée la réalité [FN: § 594-1], on entend habituellement que ce consentement est celui, non pas d'hommes en chair et en os, mais d'un certain homme idéal ; non plus des esprits d'individus particuliers, mais d'une abstraction qui porte le nom d'esprit humain. Et comme le métaphysicien forme cette abstraction selon son bon plaisir, il est compréhensible qu'ensuite, par reconnaissance envers son créateur, elle consente à tout ce qui plaît à celui-ci. De là naissent des formules comme celle-ci: « L'inconcevable n'existe pas », ou cette autre : « Pour connaître une chose, il faut la penser ». La correspondance entre la réalité et les idées de l'esprit abstrait, qui n'est au fond que celui de l'auteur des théories, devient évidente, soit parce que ces idées sont elles-mêmes la réalité, soit parce que, dans le cas où l'on veut faire une petite place à l'expérience, l'esprit créateur de la théorie devient en même temps juge et partie (§ 581).
§ 595. Dans les cas concrets de raisonnements qui invoquent le consentement universel ou celui du plus grand nombre, on sort généralement de l'expérience, des deux façons indiquées ; c'est-à-dire en présumant un consentement qui n'est pas expérimental, et en tirant des déductions qui ne le sont pas davantage. Il faut noter en outre le caractère du défaut de précision qu'on observe dans tous les raisonnements de ce genre. On tait tout ce qui pourrait donner de la précision et de la rigueur à la théorie. On allègue le consentement universel ou celui du plus grand nombre, sans dire comment on l'a obtenu, si les avis ont été comptés ou pesés, comment et pourquoi on le présume. Très souvent, on use de formules indéfinies comme les suivantes : «Tout homme reconnaît... Tout honnête homme admet... Chaque homme intelligent tient pour certain... etc. ». On ferme volontairement les yeux sur les contradictions les plus éclatantes. Par exemple, pour prouver l'existence de Dieu à un athée, on invoque le consentement universel, sans prendre garde que l'existence même de l'athée qu'on veut convaincre ou combattre détruit l'universalité du consentement.
La proposition suivant laquelle les idées d'un certain esprit abstrait (§ 594) doivent nécessairement s'adapter à l'expérience, n'est explicitement formulée que chez quelques métaphysiciens. Habituellement, on l'admet d'une manière implicite ; en affirmant que tout le monde pense que A est B, on insinue, on suggère plus qu'on ne démontre qu'expérimentalement A sera B (§ 493).
§ 596. Tout cela est indéterminé et inconsistant, parce que si c'était déterminé et consistant, on verrait apparaître le vice du raisonnement qu'on veut donner comme logico-expérimental, alors qu'il ne l'est pas. Quand on affirme que les hommes et les animaux ont un certain droit commun, on ne dit pas précisément quelle est la chose à laquelle on donne le nom de droit; si, par les termes hommes, animaux, on veut vraiment indiquer tous les hommes et tous les animaux, ou bien si l'on fait un choix, et comment ; de quelles observations il résulte que les hommes et les animaux indiqués ont en commun la dite chose ; quelles conclusions l'on peut tirer, en science expérimentale, de l'existence, supposée vérifiée, de ce caractère commun aux hommes et aux animaux. Tout cela est et demeure voilé par un nuage, et le discours où figurent ces termes indéfinis agit seulement sur les sentiments.
§ 597. Si l'on envisage les faits intrinsèquement, il peut paraître étrange qu'il y ait eu des hommes cultivés et intelligents, pour se figurer que, de cette façon, ils arriveraient à connaître les uniformités expérimentales ; plus étrange encore qu'ils aient eu tant de disciples, que leurs théories aient été, nous ne disons pas comprises, mais admirées par un très grand nombre d'hommes ; tout à fait étrange qu'il y ait des gens qui s'imaginent comprendre les dissertations sur le « un » et sur le « multiple », des formules comme celle de Gioberti, d'après laquelle l’être crée les existences, des abstractions comme la bonne volonté de Kant [FN: § 597-1]; laquelle (p. 13) « n'est pas telle en vertu de ce qu'elle opère, ou parce qu'elle est propre à atteindre une fin proposée, mais seulement par le vouloir, c'est-à-dire considérée en elle-même ».
§ 598. Mais puisque, loin d'être singuliers, étranges, extraordinaires, de tels faits sont au contraire communs, usités, ordinaires, il devient manifeste qu'ils doivent être l'effet d'une cause puissante et générale, et l'on se demande si nous devons la rechercher, non dans la force des raisonnements, qui est vraiment zéro, mais dans les sentiments que recouvrent ces raisonnements. Si cela était, la partie principale des théories métaphysiques résiderait dans ces sentiments, et non dans les raisonnements. C'est pourquoi celui qui s'arrête à ces derniers et juge la métaphysique par ses théories, n'agit pas autrement que celui qui voudrait juger de la force d'une armée par l'uniforme de ses soldats. Il se pourrait aussi que nous ayons là de nouveau l'un des nombreux cas où des théories erronées ont une utilité sociale ; ce qui profiterait, au moins d'une façon subsidiaire, à la durée des théories ; car l'action des sentiments reste toujours principale. Ce n'est pas ici le lieu de nous occuper de tout cela. Envisageons maintenant les théories, principalement au point de vue de l'accord avec l'expérience. Il nous est déjà arrivé souvent de rechercher comment et pourquoi elles survivent ; nous le verrons mieux encore plus tard (chap. IX et X).
§ 599. La preuve du consentement est souvent dissimulée sous une apparence qui voudrait être et qui n'est pas expérimentale. Cela se produit généralement dans l'auto-observation. L'individu qui fait une expérience sur lui-même entend, bien qu'il ne le dise pas explicitement, qu'elle doit s'appliquer à tous les autres hommes, ou du moins aux hommes qui sont raisonnables, sages, philosophes. Par exemple, Descartes [FN: § 599-1] , expérimentant sur lui-même, commence par estimer fausses toutes les choses qu'il croyait, et ajoute : « Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulois ainsi penser que tout étoit faux, il falloit nécessairement que moi qui le pensois fusse quelque chose ; et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, étoit si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étoient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvois la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchois ». Il résulte à l'évidence de tout le discours, que notre auteur n'a pas pour but de nous exprimer uniquement ses sensations : il veut établir une proposition qui ait de la valeur pour les autres gens aussi. En y regardant bien, on voit qu'il suppose implicitement : 1° que sa proposition: je pense, donc je suis, a aussi un sens pour d'autres que pour lui; 2° que d'autres admettront cette proposition ; 3°, que la proposition ainsi admise sera quelque chose de plus qu'une illusion collective. En outre, il discute avec ceux qui pourraient repousser sa proposition ; preuve évidente qu'à son avis elle doit être acceptée par quiconque comprend et raisonne correctement. C'est la manière de faire habituelle des métaphysiciens : ils ont une idée quelconque, et, parce que la chose leur paraît être ainsi, ils prétendent que tout homme de bon sens doit être de leur avis ; cela passe à leurs yeux pour le consentement de tous les hommes de bon sens, ou d'une belle abstraction qu'ils appellent esprit humain, qu'aucun mortel n'a jamais vue ni ne saisit précisément.
§ 600. Il est souvent utile, pour dissimuler le sophisme, de s'exprimer sous la forme impersonnelle. Sans aller chercher des exemples plus loin, voici comment Descartes s'exprime : « Mais si nous ne savions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vient d'un être parfait et infini, pour claires et distinctes que fussent nos idées, nous n'aurions aucune raison qui nous assurât qu'elles eussent la perfection d'être vraies ». Ici nous indique, sous une forme impersonnelle, les hommes. Mais ces nous ou ces hommes, qui sont-ils ? Descartes devait pourtant savoir que parmi tous les hommes vivant sur le globe terrestre, le plus grand nombre n'avait même pas la plus petite idée de sa proposition ; et que, parmi ceux qui la connaissaient, beaucoup ne la comprenaient en aucune façon, plusieurs la niaient, et un très petit nombre seulement l'acceptaient. Maintenant, reste à savoir pourquoi un homme qui n'appartenait pas à cette dernière catégorie devait admettre la proposition de Descartes ? S'il y avait une preuve expérimentale, on répondrait : « en vertu de cette preuve » (§ 44) ; mais comme il n'y a pas de preuve expérimentale, et qu'il n'y a même pas à parler du consentement, ni universel, ni du plus grand nombre de gens, ni de beaucoup, Descartes et ses disciples en reviennent à dire : « Nous avons raison... parce que nous avons raison ».
§ 601. Spinoza cherche la cause générale et première du mouvement (heureux celui qui sait ce que cela veut dire !). Il observe que nous ne devons rien admettre que nous ne percevions clairement et distinctement [FN: § 601-1]: « (p. 294) comme nous ne devons rien admettre que nous ne percevions clairement et distinctement, et que nous ne connaissons clairement et distinctement aucune autre cause que Dieu (c'est-à-dire le créateur de la Matière), il apparaît manifestement que nulle cause générale autre que Dieu ne doit être admise ». De grâce, qui sont les hommes désignés par le pronom nous ? Certainement pas tous les hommes ; cela pour les motifs indiqués tantôt. Et comme ce ne sont pas tous les hommes, comment faire pour choisir ceux qui auront l'honneur de faire partie de ce nous, et les distinguer des réprouvés qui en seront exclus ? Spinoza voit « clairement et distinctement » Dieu comme cause du mouvement. Il a bien de la chance ! Mais il y a tant de gens qui, non seulement ne voient pas « clairement et distinctement » Dieu comme cause du mouvement, mais qui ne savent même pas ce que peuvent bien être ces entités.
§ 602. On peut répéter ces observations pour un très grand nombre de propositions métaphysiques. Elles s'appliquent aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui « l'expérience du chrétien », qui n'est d'ailleurs, sous un nom nouveau, qu'une chose vieille de bien des siècles, c'est-à-dire l'auto-observation (§ 43, 69, 431).
§ 603. Le raisonnement que nous venons de faire ne concerne qu'une des faces du problème que nous avons à résoudre, au sujet de toutes les propositions semblables à celles que nous venons de noter. Il est incontestable que beaucoup de ces propositions ont été admises par des hommes instruits, intelligents, pondérés ; et si l'on veut rester dans le domaine des actions logiques, on comprend d'autant moins comment ce fait a pu se produire, que l'on démontre plus clairement l'absence de tout fondement logico-expérimental dans ces propositions. Il faut donc chercher la réponse à cette question dans un autre domaine. Ce n'est pas ici le lieu de le faire (§ 598), et il nous suffit, pour le moment, de bien comprendre que nous ne traitons là qu'une face de la question, et peut-être la moins importante au point de vue social.
§ 604. En pratique, il arrive bien rarement qu'on puisse séparer entièrement les sous-genres (α 1) et (α 2). En général, ils sont unis et se prêtent un mutuel appui ; on peut même y ajouter le genre (β). Une chose qu'on admet principalement en raison de l'autorité, se voit ensuite confirmée par l'accord de la « raison » et de l'expérience. Par exemple, l'auto-observation donne un certain principe ; on le voit confirmé par l'autorité de celui qui a fait l'auto-observation, par le consentement d'autrui, obtenu comme nous l'avons vu tout à l'heure, et parfois même grâce à des arguments pseudo-expérimentaux.
§ 605. Nous avons un autre exemple, dans la doctrine catholique. Le concile du Vatican affirme clairement que « Dieu, principe et fin de toute chose, peut certainement être connu par la lumière naturelle de la raison humaine et des choses créées... toutefois il a plu à sa sagesse et à sa bonté de se révéler lui-même et les éternels décrets de sa volonté, au genre humain, d'une manière différente et surnaturelle [FN: § 605-1] ... ». Ainsi (α 1) et (α 2) sont étroitement unis ; unis de manière qu'aucun contraste n'apparaît. On ne demande pas à l'expérience : « La foi peut-elle enseigner une chose et la raison une autre ? La réponse expérimentale serait affirmative, tandis qu'on la veut négative. Le procédé employé pour la démontrer telle est le même que celui usité par toutes les métaphysiques, ou par toutes les croyances qu'on veut imposer sans faire appel à l'expérience : il consiste à affirmer que la réponse doit être négative [FN: § 605-2], et que seule la raison qui marche d'accord avec la foi mérite le nom de raison. Nous avons ainsi une démonstration incontestable, car c'est une simple tautologie.
§ 606. Saint Thomas fait une démonstration qui est au fond celle admise par le concile du Vatican. Elle consiste à proclamer égales à la « vérité » les opérations de la raison et celles de la foi, puis à conclure qu'elles doivent être égales, puisque deux choses égales à une troisième sont égales entre elles [FN: § 606-1].
§ 607. Il est frappant que les Pères de l'Église chrétienne, dans leurs disputes avec les Gentils, cherchent les preuves de leur religion dans son accord avec les principes de la morale et principalement de la morale sexuelle. Si nous oublions pour un moment qu'en dehors du domaine expérimental, la logique est sans objet, et si nous nous laissons guider par elle, il paraîtrait que là où il y a un être tout puissant, une chose est morale, parce qu'il la veut telle, et non qu'au contraire il existe parce qu'il veut ce qui est moral. Mais si, au lieu de la démonstration logique, nous envisageons la force persuasive, nous verrons bientôt que, spécialement dans une dispute avec les Gentils, elle se trouve dans le raisonnement qui subordonne Dieu à la morale. Les Gentils avaient, en commun avec les chrétiens, certains principes moraux ; il convenait par conséquent de partir de ces principes pour les persuader de ce que voulaient les chrétiens (chap. IX et X).
§ 608. Parlant aux Gentils de leurs dieux, Tertullien dit [FN: § 608-1]: « Je veux donc rechercher s'ils (vos dieux) ont mérité d'être élevés au ciel, et non pas mieux d'être précipités au fond du Tartare qui, à ce que vous affirmez, est le lieu des châtiments infernaux ». Il leur rappelle tous les coupables qui y sont tourmentés, et qu'il affirme être égaux aux dieux des Gentils. C'est une démonstration valide et très forte, si elle s'appuie sur les sentiments ; car ceux que nous fait éprouver l'idée d'un être divin, et ceux que nous suggère l'idée d'un coupable, nous répugnent à être associés ; mais la démonstration est de nulle valeur logico-expérimentale ; car si l'on demande : « Pourquoi ceux-ci sont-ils coupables ? » on ne sait que répondre, sauf si l'on dit qu'ils le sont parce qu'ils contreviennent à la volonté divine ; mais voilà qu'ainsi nous aboutissons, comme d'habitude, à une tautologie. On peut le prouver par l'autorité même des docteurs de l'Église. Les auteurs chrétiens reprochaient aux dieux des Gentils leurs fornications. Mais pourquoi la fornication est-elle un délit ou un péché quelconque ? Saint Thomas dit que « si, chez les Gentils, la fornication simple n'était pas réputée illicite, à cause de la corruption de la raison naturelle, les Israélites, instruits par la loi divine, la tenaient pour illicite » [FN: § 608-2] . Donc, si c'est la loi divine qui la révèle illicite, comment peut-elle servir à démontrer que la loi qui la considère comme telle est divine ? De cette manière, on raisonne en cercle.
§ 609. C'est ainsi que raisonnent aujourd'hui les saints Pères de l'Église humanitaire. Ils commencent par appeler bon tout ce qui convient, et mal tout ce qui nuit au plus grand nombre, au peuple, aux prolétaires ; puis ils concluent qu'il est bon d'être utile à ces braves gens, mal de leur nuire.
§ 610. Les chrétiens pouvaient choisir entre deux méthodes pour rejeter les dieux des Gentils ; c'est-à-dire qu'ils pouvaient les considérer comme entièrement imaginaires, ou bien leur assigner une réalité qui eût sa place dans la nouvelle religion. Ils n'avaient pas à en expliquer le concept par les actions non-logiques, non seulement parce que la science était loin d'être assez avancée pour le faire, mais aussi parce que cela aurait porté un coup sérieux aux principes généraux de la foi chrétienne. En fait, les chrétiens suivirent les deux méthodes indiquées tantôt, et de préférence la seconde ; ce qui se comprend aisément, celle-ci s'accordant mieux avec une foi vive et active, qui voit partout l'action de Dieu, des anges, des démons. C'est pourquoi, même en des temps rapprochés du nôtre, le livre de Van Dale, sur les oracles, fut estimé offensant pour la religion chrétienne, et pis encore la paraphrase élégante qu'en fit Fontenelle ; c'est pourquoi, de nos jours, beaucoup de chrétiens ferment les yeux aux impostures du spiritisme et de la télépathie.
Les chrétiens sentaient instinctivement que s'ils n'admettaient pas le surnaturel dans les oracles des Gentils, ils couraient le risque de voir cette théorie appliquée à leurs prophètes, et que l'une des meilleures preuves qu'on estimait pouvoir donner de la vérité de la religion chrétienne aurait été ainsi sérieusement ébranlée. Considérer au contraire les oracles comme l'œuvre des démons avait de grands et puissants avantages. On respectait ainsi le principe commun à la religion des Gentils et à celle des chrétiens, suivant lequel il pouvait y avoir des prophètes et des oracles, et l'on faisait ensuite un triage des bons et des mauvais. Inutile d'ajouter que pour chacun les bons étaient les siens, les mauvais ceux des autres ; œuvre de Dieu, les premiers ; œuvre des démons, les derniers.
Le même fait se répète pour les miracles. Ni les Gentils ni les chrétiens ne niaient que les miracles fussent possibles ; mais chacun estimait les siens vrais, ceux des adversaires faux ; et les chrétiens ajoutaient que le démon singeait les miracles divins. Il ne faut pas oublier que, pendant nombre de siècles, les hommes se sont complus à ces raisonnements, qui, après tout, ne sont pas plus mauvais que tant d'autres aujourd'hui à la mode.
§ 611. De nos jours, une nouvelle croyance, qui conserve le nom de christianisme, veut se substituer au christianisme traditionnel, en repoussant le surnaturel qui, pendant tant de siècles, en fut une des parties principales, et qui se trouve dans l'Évangile [FN: § 611-1]. Elle se manifeste principalement dans le protestantisme dit libéral, et d'une façon secondaire dans le modernisme. De même que le christianisme ancien gardait les traits principaux de la morale païenne, en en modifiant la théologie, et se prévalait précisément de la morale commune pour justifier ce changement, ainsi le néo-christianisme conserve la morale de l'ancien christianisme, en en modifiant la théologie, et en se prévalant de la morale commune, pour justifier ce changement. Si Jupiter a été détrôné par le Dieu des chrétiens, la divinité de Jésus-Christ disparaît maintenant, pour faire place à celle de l'Humanité, et Jésus est révéré seulement parce qu'il représente « l'homme parfait ». Le consentement universel révélé par l'expérience intime du chrétien est l'artisan de cette transformation. Les braves gens qui s'en servent ne s'aperçoivent pas qu'ils ne trouvent dans l'Évangile que ce qu'ils y mettent, et qu'ils pourraient tout aussi bien tirer leurs théories de l'Énéide de Virgile ou de quelque autre livre semblable.
§ 612. Cet excellent Platon a une manière simple, facile, efficace, d'obtenir le consentement universel, ou, si l'on veut, celui des sages : il se le fait accorder par un interlocuteur de ses dialogues, auquel il fait dire ce qu'il veut ; en sorte que ce consentement n'est au fond que celui de Platon, et qu'il est admis sans peine par ceux dont il flatte l'imagination. Quand, par exemple, dans le Théétète, Socrate demande : « Le mouvement n'est-il donc pas une bonne chose pour l'âme et pour le corps, et l'opposé le contraire [FN: § 612-1]? » Platon fait répondre par l'interlocuteur, Théétète : « Il semble ». Mais s'il y avait un autre interlocuteur, il pourrait répondre, au contraire: « Je ne sais, Socrate, ce que tu veux dire par ce galimatias » ; et alors adieu le consentement universel, celui des sages, de la raison humaine, ou tel autre qu'on voudra bien imaginer.
Il faut pourtant observer que Platon ne soumet pas directement ses théories au consentement universel. Au contraire, il paraît dédaigner les jugements d'un grand nombre d'hommes, si ces jugements sont seulement comptés et non pesés [FN: § 612-2]. Le consentement qu'il suppose lui être donné par son interlocuteur représente le consentement d'un esprit abstrait, et ne sert qu'indirectement à constituer la théorie de Platon [FN: § 612-3]; il est comme un bloc de marbre brut, dont Platon saura plus tard former une statue. De cette façon, il atteint le but, qui est de confondre le consentement universel avec celui de l'esprit abstrait, qui n'est après tout que le sien propre.
§ 613. (A-β). L'existence des abstractions et des principes, reconnue indépendamment de l'expérience, est confirmée par elle, d'une façon subsidiaire. Comme nous l'avons vu déjà, il est malaisé d'abandonner entièrement le domaine expérimental, et l'on cherche tôt ou tard à y revenir, parce qu'en fin de compte la pratique de la vie l'emporte sur toute autre chose. Aussi la théologie et la métaphysique ne dédaignent-elles pas entièrement l'expérience, pourvu qu'elle leur soit subordonnée. Elles se complaisent à montrer que leurs déductions pseudo-expérimentales sont vérifiées par les faits ; mais le croyant et le métaphysicien savaient déjà, avant toute investigation expérimentale que cette vérification devait réussir à merveille, parce qu'un principe supérieur ne permettait pas qu'il pût en advenir autrement. Par leurs recherches dépassant la contingence expérimentale, ils satisfont le besoin, vif et même prédominant chez beaucoup, de connaître, moins ce qui a existé ou existe que ce qui devrait, ce qui doit nécessairement exister ; tandis qu'en montrant qu'ils tiennent compte de l'expérience – bien ou mal, cela importe peu – ils évitent le reproche de marcher au rebours du progrès scientifique, ou même du simple bon sens. Mais les faits dont ils tiennent compte sont choisis dans un but déterminé, et n'ont d'autre emploi que de justifier une théorie déjà préconçue dans l'esprit de son auteur ; non pas que celle-ci ait besoin de cette justification, mais uniquement par surabondance de preuves. Parfois, la part de l'expérience est très restreinte ; parfois elle paraît grande ; mais toujours entre ces limites et dans ces conditions. Les doctrines de A. Comte et de Herbert Spencer sont les types de ce dernier cas.
§ 614. Les disciples des auteurs de ces théories les estiment parfaites. Il ne peut en être autrement, parce que leurs connaissances intellectuelles et leurs sentiments sont conformes à ceux de leur maître, et parce que rien ne leur paraît pouvoir être objecté à une doctrine qui, non seulement satisfait l'esprit et les sentiments, mais a de plus l'appui de ces pseudo-vérifications expérimentales.
§ 615. À un point de vue non plus strictement logico-expérimental, mais didactique, et en vue de faire progresser la science, ces doctrines peuvent être utiles. Elles constituent une transition entre les théories qui ont pour unique fondement une foi aveugle, ou même des concepts exclusivement théologiques, métaphysiques, éthiques, et les théories nettement expérimentales [FN: § 615-1]. Des premières aux secondes la distance est trop grande pour pouvoir être franchie d'un saut : il faut un pont. C'est déjà beaucoup d'obtenir que l'homme accorde une petite place à l'expérience, et ne s'en tienne pas exclusivement à ce qu'il trouve ou croit trouver dans sa conscience. Même quand on admet l'expérience seulement comme une vérification a posteriori, un pas très important est ainsi fait ; si important que beaucoup de gens ne l'ont pas encore fait, à commencer par ceux qui croient pouvoir tirer des songes les numéros du loto, jusqu'aux fidèles de l'impératif catégorique.
§ 616. Une fois l'expérience introduite n'importe comment dans l'édifice théologique et métaphysique, celui-ci se désagrège peu à peu, toujours, cela s'entend, en ce qui concerne la partie qui se rattache au monde expérimental, car l'autre est à l'abri des coups de l'expérience. La désagrégation finirait par s'accomplir jusqu'au bout, sans l'intervention d'un fait très important : l'utilité sociale de certaines doctrines expérimentalement fausses. Nous aurons à nous en occuper longuement plus loin (chap. XII); pour l'heure, nous excluons entièrement cette considération, de la matière que nous traitons. Mais cet aperçu était nécessaire pour faire comprendre comment l'édifice théologique et métaphysique a pu tomber en ruine, du moins en grande partie, dans les sciences naturelles, tandis qu'il résistait plus longtemps dans les sciences sociales, et qu'il résistera peut-être toujours dans la pratique sociale. Les hommes en ont tellement besoin, que s'il arrive à l'un de ces édifices de tomber en ruine, aussitôt on en reconstruit un autre avec les mêmes matériaux. C'est ce qui est arrivé à l'égard du positivisme, qui est en somme une des très nombreuses espèces de métaphysique. L'ancienne métaphysique s'éclipsa pour peu de temps, et reparut bientôt sous la forme du positivisme. Maintenant, celui-ci menace ruine à son tour, et, pour le remplacer, on est en train d'élever un autre édifice métaphysique. Le fait se produit parce que les hommes s'obstinent à ne pas vouloir séparer ce qui est d'accord avec l'expérience, de ce qui est utile aux individus ou à la société, et à vouloir diviniser une certaine entité à laquelle ils ont donné le nom de « Vérité ». Soit A, l'une de ces choses utiles à la société. Elle nous est conseillée, imposée par une certaine doctrine ou une foi P, qui n'est pas expérimentale, et qui souvent ne peut l'être, si l'on veut que la plus grande partie des hommes d'un pays donné l'adoptent. Elle domine durant un temps plus ou moins long. Ensuite, si la science expérimentale a ou acquiert quelque crédit, des gens se mettent à affirmer que la doctrine ou la foi doit être d'accord avec l'expérience. Ils y sont poussés, souvent sans s'en apercevoir, par la considération de l'utilité. D'autres gens attaquent cette assertion, la combattent, la tournent en ridicule. Mais comme on ne peut se passer de la chose A, une partie de ces gens substitue simplement à la doctrine ou à la foi P, une autre doctrine, une autre foi Q, qui, elle aussi, est en désaccord avec l'expérience, comme la doctrine ou la foi P. Ainsi les années et les siècles s'écoulent ; les nations, les gouvernements, les coutumes et les façons de vivre passent, et, à chaque instant, de nouvelles théologies métaphysiques surgissent successivement, chacune étant réputée beaucoup plus « vraie »,beaucoup « meilleure » que celles qui la précédèrent. Il se peut qu'en certains cas elles soient effectivement « meilleures », si, par ce terme, on entend plus conformes à l'utilité de la société ; mais plus « vraies », non, si par ce terme on désigne l'accord avec la réalité expérimentale. Il n'y a pas de foi plus scientifique qu'une autre (§ 16). Sous le rapport de la réalité expérimentale, on peut mettre au même rang le polythéisme, le christianisme, qu'il soit catholique, protestant, « libéral », moderniste ou de quelle autre secte on voudra, l'islamisme, les innombrables sectes métaphysiques, y compris les kantiennes, les hégéliennes, les bergsoniennes, et, sans oublier les doctrines positivistes de Comte, de Spencer et de tant d'autres hommes éminents, la foi des solidaristes, des humanitaires, des anticléricaux, des adorateurs du Progrès, et tant d'autres qui ont existé, qui existent, qui existeront, ou qu'on pourrait simplement imaginer. Jupiter optimus maximus échappe aussi bien à l'expérience que le Dieu de la Bible, que le Dieu des chrétiens ou des mahométans, que les abstractions du néo-christianisme, que l'impératif catégorique, que les déesses Vérité, Justice, Humanité, Majorité, que le dieu Peuple, le dieu Progrès et tant d'autres qui peuplent en nombre infini le panthéon des théologiens, des métaphysiciens, des positivistes, des humanitaires ; ce qui n'empêche pas que la croyance en une partie d'entre eux, ou même en tous, ait pu être utile en son temps, ou puisse l'être toujours. Là-dessus, on ne peut rien décider a priori, et il appartient à l'expérience seule de nous instruire.
La métaphysique de l'éthique bourgeoise a été attaquée et démolie par la métaphysique de l'éthique socialiste ; laquelle, à son tour, a eu à subir l'assaut de la métaphysique de l'éthique syndicaliste. De cette lutte, il est resté quelque chose qui nous fait approcher du concept expérimental qu'on peut avoir de ces éthiques ; c'est-à-dire qu'on en a vu plus ou moins distinctement le caractère contingent. En partie parce qu'elle s'appuyait sur la religion, la morale bourgeoise assumait un caractère de vérité absolue, qu'elle a perdu partiellement depuis un siècle, après avoir eu d'heureuses rivales.
§ 617. Dans les sciences naturelles, la désagrégation se poursuit avec de simples oscillations, dues au fait que les hommes qui cultivent ces sciences vivent aussi dans la société, et que les opinions, les croyances, les préjugés de leur société agissent plus ou moins sur eux. L'expérience, qui autrefois avait timidement commencé à poindre dans les sciences naturelles, y est aujourd'hui reine et maîtresse, et en chasse les principes a priori qu'on voudrait lui opposer. Cette liberté de la science nous paraît naturelle, parce que nous vivons en un temps où elle est admise presque partout ; mais il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a à peine deux siècles, et même moins, un savant ne pouvait parler de sa science sans protester qu'il recourait à l'expérience uniquement en ce qui n'était pas matière de foi. Il était alors utile qu'il prît cette position subordonnée, car c'était l'unique moyen d'introduire l'ennemi dans la place forte qui devait plus tard être détruite.
§ 618. Dans les sciences qui ont quelque rapport avec la vie sociale, on n'a pas encore la liberté dont on jouit dans les sciences naturelles. Il est vrai que si l'on excepte la religion sexuelle [FN: § 618-1] , le bras séculier ne frappe plus guère les hérétiques et les mécréants, du moins d'une manière directe ; mais ils sont en butte à l'indignation et à l'hostilité du public, qui veut sauvegarder certains principes ou préjugés ; ce qui est toutefois souvent utile au bien-être social. Indirectement, l'autorité publique fait sentir le poids de son hostilité à ceux qui, même seulement au point de vue scientifique, s'écartent des dogmes du gouvernement existant [FN: § 618-2].
§ 619. La méthode « historique » a ouvert la porte par laquelle l'expérience s'est introduite dans une partie des sciences sociales, dont elle était exclue. Ce fut donc une transition, utile au point de vue exclusivement logico-expérimental, pour rapprocher ces sciences de l'état déjà atteint par les sciences naturelles. La confusion qui existe dans l'esprit de beaucoup de personnes entre la méthode historique et la méthode expérimentale est remarquable [FN: § 619-1]. Quand, ce qui arrive rarement, la première est à l'état pur, et sans mélange de considérations métaphysiques, sentimentales, patriotiques, etc., elle n'est qu'une partie de la seconde : elle a seulement pour but d'étudier une partie des rapports qu'on trouve dans le domaine de celle-ci ; c'est-à-dire qu'elle s'occupe de l'évolution, de la manière dont certains faits succèdent à d'autres ; mais elle néglige les rapports qui existent à un moment donné entre les faits qui se produisent à ce moment et les uniformités auxquelles ils donnent lieu souvent aussi les rapports des faits successifs et leurs uniformités presque toujours les dépendances mutuelles de tous. Quand nous saurons de quelle plante vient le blé, et quelles transformations elle a subies, et que nous connaîtrons aussi l'origine de l'homme et ses transformations, il nous restera à connaître les quantités de blé que l'homme tire d'un hectare de terrain, en un pays et en un temps donnés, et le nombre infini de rapports existant entre cette culture et les faits de la vie humaine. Quand nous connaîtrons l'histoire de la monnaie, cela ne nous apprendra pas son rôle précis dans le phénomène économique, et encore moins la dépendance de l'usage de la monnaie, et des autres faits économiques et sociaux. Quand nous aurons une connaissance parfaite de l'histoire de la chimie, cela pourra nous être utile, mais ne suffira pas à nous faire connaître les propriétés de nouvelles combinaisons (§ 34, 39).618-
À la méthode métaphysique, en économie politique ou en sociologie, il ne faut pas croire que s'oppose la « méthode historique », même si, par un singulier hasard, cette méthode historique est à l'état tout à fait pur. Au contraire, c'est avec la méthode expérimentale que le contraste a lieu.
§ 620. Parmi les vérifications pseudo-expérimentales des théologies, on trouve souvent les prophéties et les miracles [FN: § 620-1].
Il va sans dire que chaque religion n'estime bonnes que ses prophéties, et vrais que ses miracles ; tandis qu'elle tient pour très mauvaises les prophéties et pour faux les miracles des autres religions. Il est inutile d'observer que, même si les faits étaient historiquement vrais – et ce n'est pas le cas – ils ne prouveraient rien, au point de vue logico-expérimental, à l'égard de la partie surnaturelle de la religion. Ce n'est pas dans une démonstration logico-expérimentale [FN: § 620-2] qu'on doit chercher le motif pour lequel les prophéties et les miracles contribuent puissamment à fortifier la foi, même si, pour assurer que les premières se sont vérifiées, on recourt à de prodigieuses subtilités d'interprétation, et si les seconds sont dépourvus de toute preuve historique sérieuse. Ce motif consiste principalement dans l'accroissement d'autorité que ces faits – ou ces fables – procurent aux hommes qui passent pour en être les auteurs.
§ 621. Des miracles, il s'en est toujours fait et il s'en fait toujours, même de notre temps, avec la télépathie et autres opérations semblables. Nous ne manquons pas non plus de prophètes religieux, particulièrement en Amérique et en Angleterre. D'autres, plus modestes, se contentent de deviner l'avenir des personnes qui ont recours à leurs lumières, ou de prévoir certains événements de moindre importance. On peut lire, en quatrième page des journaux italiens, les élucubrations des prophètes qui, mus par une ardente philanthropie, non exempte du soin de leur propre intérêt, font connaître à autrui les numéros du loto aux prochains tirages. Il y a bien une trentaine d'années qu'on lit ces avis, et il se trouve toujours des gens pour croire à ces prophéties ; preuve en soient les dépenses que font ces dignes prophètes pour les insertions dans les journaux ; car si les recettes ne couvraient pas au moins les frais, ils y renonceraient certainement.
§ 622. Songez que nous vivons en un temps quelque peu sceptique, que les prophéties exprimées au moyen des nombres du loto ne souffrent aucune subtilité d'interprétation, qu'entre le moment où la prophétie est faite et celui où elle doit se vérifier, il s'écoule un espace de temps très bref : vous vous rendrez compte alors que si, nonobstant ces circonstances très défavorables, la foi aux prophéties persiste, elle devait à plus forte raison se maintenir vive et forte, en des temps superstitieux, pour des prophéties faites en termes obscurs auxquels on pouvait donner le sens qu'on voulait, et qui étaient à longue échéance.
§ 623. Galluppi écrit, dans sa Théologie naturelle [FN: § 623-1] : (p. 60, § 43) « On doit penser que si Dieu choisit et envoie réellement des hommes pour prêcher aux autres, en son nom, les vérités qu'il leur a immédiatement révélées, il ne manque pas de donner à ces apôtres et envoyés, tous les moyens nécessaires pour démontrer l'authenticité de leur mission [Autorité]. Dieu doit cela à lui-même, aux apôtres qu'il envoie et à ceux auxquels ils sont envoyés [Preuve par conformité de sentiments. Galluppi pensait ainsi, donc cela doit être ainsi]. Mais quels sont ces moyens ? Ce sont les miracles et les prophéties... La prophétie est la prédiction certaine des événements futurs, qui ne peuvent être prévus par les hommes dans les causes naturelles... Dieu peut donc donner à ses apôtres le don de faire des miracles en son nom, et le don de prophétie. Quand donc ceux qui s'annoncent comme apôtres de Dieu manifestent aux hommes des dogmes non contraires aux principes de la droite raison et tendent à la gloire de Dieu et au bonheur des hommes, quand ils font des miracles pour prouver la vérité de la doctrine qu'ils annoncent, ils ont suffisamment prouvé leur mission ; et les hommes auxquels ils s'adressent sont obligés de les accueillir comme divins, et de recevoir les vérités qu'ils leur manifestent ». La droite raison sert ici de défense pour repousser les Gentils, qui ont, eux aussi, des prophéties et des miracles à foison. Mais les leurs sont contraires aux principes de la droite raison, et ceux des chrétiens n'y sont pas contraires. Pourquoi ? Devinez. Plus loin : « (p. 61) Rigoureusement parlant, la prophétie est un miracle ; car c'est une connaissance non naturelle, mais au delà des forces naturelles de l'esprit humain. Toutefois, la prophétie peut se rapporter à des événements très lointains, et le prophète peut n'avoir pas le don des miracles. La prophétie seule n'est donc pas toujours suffisante pour prouver la mission divine. Mais le miracle par lequel un apôtre divin promet aux hommes de prouver sa mission divine, est toujours uni à une certaine prophétie... Les signes de la révélation divine sont donc au nombre de trois : l'un intrinsèque : c'est la vérité et la sainteté de la doctrine qu'elle enseigne [accord avec certains sentiments] ; les deux autres sont extrinsèques [pseudo-expérimentaux] : ce sont les miracles et les prophéties... ».
§ 624. Calvin veut que l'Écriture Sainte renferme en elle-même toute l'évidence de son inspiration divine [FN: § 624-1] ; autrement dit, il paraît recourir exclusivement à la foi ; et s'il restait sur ce terrain, la science expérimentale ne pourrait rien lui objecter au sujet de la partie intrinsèque de sa doctrine. Seulement, à propos de la partie extrinsèque, il faut observer que la doctrine de Calvin ne démontre rien et ne peut être acceptée que par celui qui la professe déjà. Au point de vue expérimental, les affirmations de Calvin ont tout autant de valeur que les négations de l'un quelconque de ses contradicteurs [FN: § 624-2]. Le bon Calvin ne l'entend pas de cette oreille et reprend bientôt ce qu'il avait abandonné [FN: § 624-3]. C'est l'habitude générale des théologiens et des métaphysiciens. Ils quittent le monde expérimental, quand l'expérience encombre la voie qu'ils veulent suivre pour établir leurs croyances ; mais quand ils les ont fixées, ils reviennent au monde expérimental, qui, en fin de compte, leur importe comme à tout autre homme ; et le mépris qu'ils ont affiché n'est qu'un artifice pour éviter des objections auxquelles ils ne sauraient répondre.
§ 625. L'embryon d'expérience que les catholiques trouvaient dans le consentement des Pères de l'Église, gênait Calvin. Il s'en débarrasse en prétendant que chacun doit croire à l'Écriture Sainte, par conviction intime. Et ceux qui n'y croient pas ? Il vous les fait brûler comme le pauvre Servet ; ou bien, s'il ne peut faire autre chose, il les injurie [FN: § 625 note 1)]. Ce peuvent être d'excellents moyens de persuasion, mais leur valeur logico-expérimentale est proprement zéro.
§ 626. Le néo-christianisme semble maintenant vouloir négliger plus ou moins, et peut-être en entier, les éléments extrinsèques, pour ne s'en remettre qu'aux éléments intrinsèques ; ce qui améliorerait beaucoup sa logique si, après être ainsi sorti du domaine expérimental, il ne voulait pas y rentrer en dictant des règles à la vie sociale. De cette façon, toute preuve se réduit à l'accord avec les sentiments de celui qui prêche une certaine doctrine ; mais personne ne nous dit pourquoi ni comment les dissidents doivent l'accepter. En réalité, le succès de cette doctrine est dû à un accord avec les sentiments démocratiques ; elle est le voile dont certaines personnes – un petit nombre – ont plaisir à couvrir ces sentiments.
§ 627. Par ces doctrines, on croit de bonne foi donner, ou quelquefois l'on feint de donner une large part à l'expérience [FN: § 627-1] ; mais, en réalité, on ne fait que passer du genre (α 1) au genre (α 2). On abandonne l'autorité, parce qu'elle semble trop en conflit avec l'expérience. On recourt au consentement intérieur, parce que sa contradiction avec l'expérience apparaît moins ; mais elle n'en est pas moins profonde.
§ 628. Par exemple, après avoir reconnu et mis en lumière les erreurs de la Bible, Piepenbring veut cependant qu'elle renferme une partie divine ; et, pour la distinguer de l'autre, il est contraint de recourir exclusivement au consentement intérieur. Il dit [FN: § 628-1]: « (p. 307) Peut-on distinguer, dans la Bible, les éléments humains des éléments divins, les erreurs humaines de la vérité divine ? Peut-on dire que telle parole ou tel texte biblique est inspiré et que tel autre ne l'est pas? Non. Ce procédé serait bien mécanique et superficiel ; il serait en outre irréalisable... (p. 308). Ce n'est pas dans la lettre morte qu'il faut chercher l'inspiration et la révélation, comme le veut cette doctrine, mais dans l'action directe de l'esprit de Dieu sur les cœurs ». Voilà clairement indiqué le passage de (α 1) à (α 2). L'auteur continue : « (p. 308) Nous venons de présenter comme un fait indéniable que cette partie de l'Écriture renferme des erreurs. Celui qui s'occupera exclusivement de critique sacrée, au lieu de tenter la reconstruction historique de l'enseignement biblique, comme nous l'avons fait, pourra constater des erreurs bien plus nombreuses que celles qui ont été indiquées en passant... Le fait que nous avons avancé est donc pleinement fondé. Mais en voici un autre qui, nous paraît-il, l'est tout autant, c'est que l'élite de la nation israélite – en tête de laquelle se trouvaient les prophètes, les psalmistes, les auteurs sacrés en général – était sous l'influence de l'esprit de Dieu, qui lui communiquait une vie et des lumières supérieures, dont nous trouvons l'expression, la traduction, imparfaite mais réelle, dans l'Ancien Testament ».
§ 629. Il se peut bien que les deux faits soient également certains ; mais il est assuré que les preuves qu'on en peut donner sont de nature essentiellement différente. Du premier fait, c'est-à-dire des erreurs historiques et physiques, on donne des preuves objectives que tous peuvent vérifier. Du second fait, on donne des preuves subjectives ; elles n'ont de valeur que pour les quelques personnes qui ont des sentiments semblables à ceux de l'auteur. N'importe qui peut vérifier que le procédé employé par Jacob pour faire naître des agneaux tachetés ne réussit pas du tout ; et il n'est pas nécessaire d'avoir certains sentiments pour trouver que la zoologie biblique ne concorde pas avec les faits. Au contraire, il y a un très grand nombre de personnes qui ne partagent pas le moins du monde l'admiration de notre auteur pour les prophètes israélites, et qui estiment inférieures les lumières que notre auteur trouve supérieures. Comment faire pour savoir qui a raison ? et même que veut dire, dans ce cas, avoir raison ?
§ 630. Tout cela montre combien est erronée l'idée de ceux qui tiennent ces doctrines et d'autres semblables, pour plus « scientifiques » que des doctrines qui, à l'instar du catholicisme, ont l'autorité pour fondement (§ 16, 517). En réalité, on disserte des diverses manières de recourir à ce qu'on présume être – et qui n'est pas – la « science ». Cette différence est générale, et nous la trouvons dans beaucoup d'autres théories. Quelques-unes demandent une vérification à la réalité historique, et façonnent cette réalité de manière à lui faire signifier ce qu'elles veulent. D'un côté, on peut dire qu'elles reconnaissent la valeur et l'importance de cette réalité historique, puisqu'elles y font appel. D'un autre côté, on peut dire qu'elles la méconnaissent, puisque, même involontairement, sans s'en apercevoir, elles l'interprètent et l'altèrent. D'autres théories laissent de côté les vérifications au moyen de la réalité historique, et s'attaquent seulement à celle de la conscience. D'un côté, on peut dire qu'elles méconnaissent la valeur de cette réalité historique, puisqu'elles ne s'en occupent pas, dans la démonstration de leurs théorèmes. D'un autre côté, on peut dire qu'elles la respectent, puisqu'elles ne se proposent pas de l'interpréter et de l'altérer.
§ 631. (A-γ). On attribue, ou l'on se figure attribuer une grande part à l’expérience, mais elle est toujours subordonnée. Par degrés insensibles, on passe du genre précédent à celui-ci, où l'expérience paraît être souveraine, mais où son pouvoir, semblable à celui des rois constitutionnels, se réduit à peu de chose. Les théories concrètes renferment généralement des parties se rattachant à ces deux classes. Il est souvent malaisé de séparer ces parties, pour cette raison, entre autres, que l'auteur n'indique pas, et fréquemment ne sait lui-même pas, si certains principes par lui adoptés, sont supérieurs à l'expérience ou lui sont subordonnés. Pour ne pas faire deux fois l'examen d'une même théorie, nous parlerons de ce genre (γ) au chapitre suivant, où nous devons justement étudier la classe B.
§ 632. Nous procédons ainsi seulement pour une raison pratique. Cela n'altère pas du tout la valeur théorique du critère de classification. Il pourrait sembler peut-être que le fait d'indiquer explicitement ou, au contraire, implicitement le domaine réservé aux principes étrangers à l'expérience, n'est pas un caractère assez important pour justifier une distinction de classe. Mais il faut observer au contraire que cette circonstance est capitale ; parce que si le dit domaine est indiqué explicitement, la voie de l'expérience est fermée, tandis qu'elle reste ouverte, si le domaine est implicitement donné Par exemple, dans la théorie de la morale, construite par Spencer, il y a des principes a priori ; mais comme ils sont implicites, rien n'empêche qu'en poursuivant sur la même voie, on ne les rectifie, et que l’on arrive, peut-être après un long parcours, à une théorie scientifique. Au contraire, dans la morale que les humanitaires veulent constituer, il y a des principes qui dépassent explicitement l'expérience ; tel celui d'après lequel on doit tout sacrifier au « bien du plus grand nombre ». On ne saurait concevoir comment une proposition de ce genre peut être vérifiée par l'expérience, et celle-ci, par conséquent, ne peut en aucune façon servir à la rectifier. Elle constitue un acte de foi qui nous transporte dans un domaine entièrement différent du domaine expérimental.
[345]
Chapitre V↩
Les théories pseudo-scientifiques [(§633 à §841),vol. 1,pp. 345-449]
§ 633. Il nous reste à étudier les théories de la catégorie (B). C'est la tâche du présent chapitre.
L'intervention des principes non-expérimentaux, qui était manifeste, explicite, dans la catégorie (A), est plus ou moins dissimulée, implicite, dans la catégorie (B). Les théories ne sont pas logico-expérimentales, mais on veut les faire passer pour telles. À la vérité, il y a des cas où elles peuvent le devenir effectivement. Cela aura lieu quand il sera possible de retrancher la partie non-expérimentale, sans trop altérer les résultats de la théorie. Mais si cela n'est pas possible, les théories, même modifiées, ne pourront prendre place parmi les logico-expérimentales.
§ 634. Ici, nous envisageons principalement les théories de la catégorie (B), dans le but d'y séparer la partie logico-expérimentale de la partie qui ne l'est pas. Cette étude est importante à deux points de vue : 1° ces théories correspondent à des faits déformés ; si nous réussissons à séparer la partie logico-expérimentale, nous pourrons retrouver la forme réelle des faits ; 2° si par hasard, dans quelques-unes de ces théories, la partie non logico-expérimentale était accessoire, nous pourrions l'éliminer, et nous aurions une théorie logico-expérimentale.
§ 635. Soit donc le texte d'un récit ou d'une théorie.
Nous pourrons envisager les deux problèmes suivants: 1° à supposer que des déductions métaphysiques, arbitraires, des mythes, des allégories, etc., aient une part, petite ou grande, dans ce texte, est-il possible de remonter du texte aux idées que l'auteur a vraiment voulu exprimer, aux faits qu'il entendait raconter, aux relations logico-expérimentales qu'il a voulu énoncer, et comment faire ? 2° quels procédés peut-on employer pour tirer, grâce à l'emploi de ces déductions métaphysiques arbitraires, de ces mythes, de ces allégories, etc., certaines conclusions auxquelles on veut arriver?
§ 636. Graphiquement, on voit encore mieux la chose.
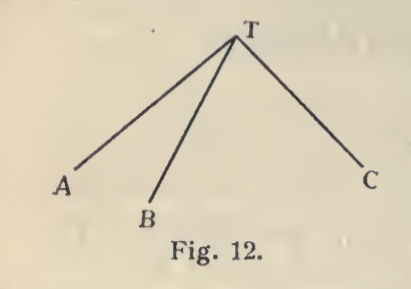
Figure 12
1° On a une théorie T qu'on suppose exprimer certains faits A, un texte qu'on suppose procéder des faits A. Connaissant T, on veut trouver A. Si l'on réussit dans cette entreprise, on parcourra la voie TA, et partant du texte T, on arrivera en A. Mais si, par hasard, l'entreprise échoue, au lieu de A, on trouvera B ; . et l'on croira à tort que B a produit T. L'opération que fait la critique moderne, pour remonter des différents manuscrits existants d'une œuvre, au texte original, est analogue à celle qui de T conduit en A, ou en B. Le texte original est A, et les différents manuscrits constituent le complexe T. 2° De la théorie, du texte T, on veut tirer certaines conclusions C, qui, généralement, sont déjà connues ; et grâce à des déductions qui ne sont pas logico-expérimentales, en partant de T, on arrive en C.
Dans le premier problème, on cherche A ; dans le second problème, on ne cherche pas C, mais bien la voie pour arriver à C. Parfois, on le fait volontairement ; autrement dit, on sait que C n'est pas une conséquence de T, mais on veut le donner pour tel. Nous avons ainsi un artifice, une action logique de celui qui veut persuader autrui d'une chose qu'il sait bien n'être pas vraie. Mais plus souvent, très souvent, la recherche de la voie permettant le passage de T à C, est involontaire. La foi en T et le vif désir d'atteindre C existent dans l'esprit de celui qui se livre à cette étude. Involontairement, ces deux sentiments s'unissent suivant une voie TC. Nous avons ainsi une action non-logique. Celui qui tâche de persuader autrui s'est d'abord persuadé lui-même, et n'use en rien d'artifices. Dans le premier problème, soit quand on cherche A, bien que souvent on emploie aussi l'accord de sentiments, on suppose au moins vouloir se servir de déductions logico-expérimentales, et l'on s'en sert effectivement dans les sciences. La voie TA (ou TB, si l'on se trompe) est donc donnée ou supposée donnée, et l'on cherche A. Dans le second problème, c'est-à-dire quand, volontairement ou involontairement, on cherche la voie TC, bien que souvent on feigne et que très souvent on croie employer la voie logico-expérimentale, en fait on se sert presque toujours de l'accord des sentiments : on cherche la voie TC, qui peut conduire au but C et qui peut être agréable aux gens que l'on veut persuader.
Habituellement, tout cela n'est pas apparent. On ne sépare pas les deux problèmes, et l'on recherche la voie TC avec la ferme conviction qu'on cherche au contraire uniquement A. Comme d'habitude, l'action non-logique se recouvre du vernis de la logique. Par exemple, soit T, le texte de l'Évangile. On peut chercher les faits A dont il tire son origine ; ce serait la tâche de la critique historique. Mais celui qui n'y fait pas appel, ou qui n'y fait pas exclusivement appel, veut tirer de l'Évangile certaines conclusions issues de sa propre morale, ou qu'il a faites siennes d'une manière quelconque ; c'est pourquoi il se sert d'une interprétation TC qui puisse le conduire au but désiré. Il sait à l'avance qu'il doit croire en T et en C. Ces deux termes sont fixes, et il cherche seulement le moyen de les unir.
§ 637. Dans ce chapitre, nous traiterons principalement du premier problème; aux chapitres IX et X, nous traiterons du second. Nous disons principalement et non exclusivement, parce que, dans les cas concrets, les éléments correspondant à ces deux problèmes sont habituellement unis en des proportions variables ; et l'on irait au devant de longues et fastidieuses répétitions, si, lorsqu'on examine un cas concret, on voulait rigoureusement séparer ces éléments, et parler exclusivement d'abord de l'un, puis de l'autre.
§ 638. Dans les sciences logico-expérimentales, on parcourt d'abord la voie AT, en déduisant une théorie des faits ; puis la voie TA, en déduisant de la théorie, des prévisions de faits. Dans les productions littéraires qui s'écartent des sciences logico-expérimentales, on parcourt quelquefois la voie TB, presque toujours la voie TC. En outre, T est habituellement indéterminé, et l'on peut en tirer tout ce qu'on veut. La voie TC a, souvent aussi, peu de rapports avec la logique. En somme, de certains sentiments indéterminés T, on déduit ce qu'on désire, c'est-à-dire C.
§ 639. Quand on parcourt la voie AT, on va de la chose au mot; quand on parcourt TA, TB ou TC, on va du mot à la chose. Le sentiment qui nous pousse à donner pour objectives nos sensations subjectives, agit de manière à nous faire croire qu'en tout cas il doit y avoir quelque objet réel, correspondant à un terme quelconque T du langage, et qu'il suffit par conséquent de savoir le chercher pour le trouver. Par exemple, puisque le terme justice existe, il doit nécessairement exister une chose réelle qui y corresponde ; aussi la cherche-t-on en tout endroit où l'on croit pouvoir la trouver. En réalité, il y a de nombreux termes du langage T qui correspondent seulement à des sentiments d'une ou de plusieurs personnes et non à des choses. Par conséquent, en partant de T, on peut bien trouver ces sentiments, mais non des objets qui n'existent pas [FN: § 639-1].
§ 640. Le phénomène suivant est assez fréquent. Des sentiments A, existant chez beaucoup de gens, on obtient une expression indéterminée T ; puis vient un auteur qui veut déduire de T certaines conclusions C. Précisément à cause de l'indétermination de T, cet auteur en tire ce qu'il veut (§ 514). Il croit ensuite et fait croire aux autres qu'il a obtenu un résultat objectif C. En réalité, il admet C uniquement parce qu'il est d'accord avec ses sentiments A ; et au lieu de suivre ouvertement cette voie directe, il suit la voie indirecte ATC, souvent très longue, pour donner satisfaction au besoin de raisonner, qui existe en lui et chez les autres hommes.
Continuons maintenant l'examen des théories, déjà commencé au chapitre précédent, et voyons si et comment on peut en déduire les faits qu'on les suppose représenter.
§ 641. (B) Les entités abstraites qu'on recherche ne sont pas explicitement dotées d'une origine étrangère à l'expérience. Nous devons nous résigner à voir encore dans cette classe des principes métaphysiques a priori, et nous devons nous contenter d'en réduire le rôle à peu de chose. Si nous voulions les exclure complètement, nous n'aurions rien ou presque rien à mettre dans la classe que nous envisageons, parce que ces principes s'implantent d'une manière ou d'une autre dans les sujets sociaux ; et cela arrive non seulement parce qu'ils correspondent à des sentiments très puissants chez les hommes, mais encore parce qu'on n'étudie jamais ces matières dans le but exclusif de découvrir des uniformités, et qu'on a au contraire le désir de quelque résultat pratique, de quelque propagande, de quelque justification de croyances a priori.
§ 642. Les entités abstraites sont de simples abstractions déduites arbitrairement de l'expérience. C'est là le caractère des sciences expérimentales ; et le signe auquel on reconnaît ces abstractions est qu'on peut s'en passer quand on veut. On peut exposer toute la mécanique céleste, sans faire usage du concept de l'attraction universelle. Comme nous l'avons dit déjà, l'hypothèse, que l'on cherche à vérifier par les faits, est que les corps célestes se meuvent de manière à satisfaire aux équations de la dynamique. On peut exposer toute la mécanique sans faire usage du concept de force ; toute la chimie, sans nommer l'affinité, etc. Quant à l'économie politique, nous avons fait voir qu'on pouvait exposer les théories de l'équilibre économique, sans faire usage de l'ophélimité, ni de la valeur, ni d'autre entité semblable ; de même qu'on pouvait aussi se passer de l'abstraction indiquée par le terme capital (§ 117 et sv.). Quant à la sociologie, dans le présent ouvrage, on peut substituer de simples lettres aux termes actions non-logiques, résidus, dérivations (§ 868), etc., et tout le raisonnement subsistera également, sans la moindre altération. Nous raisonnons sur des choses et non sur des mots ou sur des sentiments suscités par des mots (§ 116 et sv.).
Laissons maintenant de côté ces théories logico-expérimentales, et portons notre attention uniquement sur celles qui, s'en écartant plus ou moins, ont jusqu'ici constitué la science sociale.
§ 643. (B-α) Les mythes, les récits religieux et autres semblables légendes, sont des réalités historiques. C'est la solution la plus simple et aussi la plus facile du problème que nous nous sommes proposé ; c'est-à-dire de remonter d'un texte aux faits qui lui ont donné naissance. Elle peut être acceptée sous l'empire d'une foi vive qui ne raisonne pas, qui se vante de croire même l'absurde. Comme nous l'avons dit déjà (§ 581), nous n'avons pas à nous en occuper. Ou bien elle peut être admise comme tout autre récit historique, et donc comme conséquence d une pseudo-expérience, qui serait une véritable expérience, si le récit était soumis à une sévère critique historique et à toute autre vérification expérimentale nécessaire. Les théories données par cette solution diffèrent des théories de la catégorie (A), en ce que, dans ces dernières, le récit est imposé comme un article de foi par quelque puissance non-expérimentale qui nous est généralement comme grâce à l'autorité d'un homme (§ 583) ; et c'est l'intervention de cette puissance qui procure l' « explication » désirée ; tandis que dans le présent cas (B-α), les théories sont crues grâce à leur évidence pseudo-expérimentale. Au point de vue scientifique, cette distinction est capitale (§ 632). En effet, si un récit nous est donné comme article de foi, cela suffit pour le mettre hors du domaine de la science logico-expérimentale, qui n'a plus à s'en occuper, ni pour l'accepter, ni pour le repousser. Si, au contraire, il nous est donné comme possédant en lui-même son autorité et son évidence, il tombe entièrement dans le domaine de la science logico-expérimentale, et c'est la foi qui n'a plus rien à y voir. Il faut s'empresser d'ajouter que cette distinction est rarement faite par celui qui admet le récit ; et il est bien difficile de savoir s'il le considère seulement comme un récit historique, ou s'il y croit, poussé par d'autres considérations. C'est pourquoi un très grand nombre de cas concrets sont un mélange des théories (A) et (B). Par exemple, l'autorité non-expérimentale de l'auteur du récit fait rarement défaut.
§ 644. Si le texte que nous voulons interpréter était un récit historique, on pourrait effectivement le tenir pour une représentation au moins approchée des faits qu'il exprime (§ 541 et sv.).
§ 645. Pourtant, même dans ce cas, il y a toujours des divergences. Par exemple, le récit d'un fait même très simple reproduit difficilement le fait précis. Les professeurs de droit pénal ont souvent fait cette expérience : un fait se produit en présence des étudiants ; on prie chacun d'eux d'en écrire le récit, et l'on obtient autant de récits légèrement différents qu'il y a de personnes. Vous êtes témoin d'un fait, en compagnie d'un enfant ou avec un adulte doué d'une vive imagination, et vous leur demandez ensuite de vous le raconter. Vous verrez qu'ils y ajoutent toujours quelque chose, et qu'ils donnent aux traits de leur récit une plus grande force que celle de la réalité. La même chose se produit pour celui qui répète une histoire qu'il a entendue (§ 1568).
Il y a plus. Comme il est précisément d'usage courant d'exagérer cette force, celui qui écoute le récit finit par en rabattre. Donc, pour lui donner une impression correspondant à la réalité, il faut employer des termes qui dépassent un peu la vérité. Si, sur dix personnes, vous en voyez neuf qui rient, et si vous voulez faire éprouver à quelqu'un d'autre une impression du fait, correspondant à la réalité, vous direz : « Tout le monde a ri. » Si vous disiez : « La plus grande partie d'entre eux ont ri », l'impression resterait en dessous de la réalité.
§ 646. Pour qu'un récit s'altère, il n'est pas nécessaire qu'il passe de bouche en bouche. Il s'altère même quand il est répété par la même personne. Par exemple, une chose qu'on voulait donner pour grande deviendra toujours plus grande, dans les récits successifs ; une chose petite, toujours plus petite. On augmente la dose, en cédant chaque fois au même sentiment.
§ 647. Nous avons des faits précis, qui montrent combien certaines impressions sont trompeuses. Ainsi les illusions au sujet des citations de certains auteurs, sont singulières. Beaucoup de Français croient citer Molière en disant :
Il est avec le ciel des accommodements [FN: § 647-1] .
« (p. 153) [FN: § 647-2] Le vers est excellent, mais Molière ne l'a pas écrit, l'on a donc tort de le lui prêter. Pour l'obtenir, il faut prendre la substance de deux (p. 154) des siens à l'acte IV, scène V; c'est Tartufe qui parle :
Le ciel défend, de vrai, certains contentements ;
1172.Mais on trouve avec lui des accommodements.
La célèbre phrase de Mirabeau : « Allez dire à votre maître, etc. » n'a jamais été prononcée. Le marquis de Dreux-Brézé a rectifié les faits, à la séance du 10 mars 1833, de la Chambre des Pairs : « (p. 229) Mirabeau dit à mon père : Nous sommes assemblés par la volonté nationale, nous n'en sortirons que par la force. Je demande à M. de Montlosier si cela est exact [FN: § 647-3]».
§ 648. On a observé que souvent un auteur national est cité moins bien par ses concitoyens, qui citent volontiers de mémoire, que par des étrangers, qui se donnent la peine de vérifier la citation dans le texte. Il peut s'être produit quelque chose de semblable pour les auteurs de la Grèce antique qui citent Homère [FN: § 648-1]. Ces citations diffèrent souvent du texte que nous possédons ; ce qui s'explique en grande partie par la diversité des textes que ces auteurs avaient sous les yeux ; mais il n'en reste pas moins des cas où la divergence paraît due au fait qu'ils citaient de mémoire. Les écrivains anciens n'éprouvaient pas le moins du monde le besoin de précision qu'éprouvent une partie au moins des auteurs modernes. Il y a peu de temps encore, beaucoup citaient des passages d'un auteur sans dire où ils se trouvaient, et, qui pis est, ils mentionnaient une opinion qu'ils affirmaient être celle d'un auteur, sans dire où ils l'avaient prise. Encore en 1893, Gomperz écrit un ouvrage étendu, sous le titre de Griechische Denker, dans lequel il n'y a presque aucune citation. On doit tout croire simplement de par son autorité. Il parle comme l'oracle de Delphes. Mais aujourd'hui, dans les ouvrages historiques, l'usage général est différent ; on en a des exemples dans les travaux de Fustel de Coulanges, dans le Manuel des antiquités romaines, de Mommsen et Marquardt, dans l'Histoire romaine, de Pais, et dans de très nombreux autres ouvrages. Le principal souci de l'auteur est d'être aussi précis et objectif que possible, et de donner de ses assertions des démonstrations sérieuses.
§ 649. Les divergences entre les faits et les récits peuvent être petites, insignifiantes, et peuvent aussi croître, se multiplier, s'étendre (§ 540), donnant ainsi naissance à des récits qui s'écartent des faits, au point de n'avoir presque plus rien de commun avec eux. On a de la sorte des histoires fantaisistes, des légendes, des romans, dans lesquels on ne peut plus distinguer si l'on y fait allusion à des faits réels, ni ce que sont ces faits. Même des écrits qui ne passent pas pour légendaires et sont réputés historiques, peuvent s'écarter beaucoup de la réalité, au point de finir par n'avoir plus que bien peu de ressemblance avec elle [FN: § 649-1]. Si nous suivons encore ici la méthode indiquée au § 547, nous trouverons en grande quantité des exemples qui montrent avec quelles précautions il faut accepter des détails de récits qui sont, au demeurant, tout à fait historiques. Voici l'un de ces exemples. En 1192, Conrad, marquis de Tyr, fut assassiné dans cette ville. Ses sujets, qui avaient besoin d'un chef et d'un protecteur, voulurent qu'Isabelle, veuve de Conrad, épousât incontinent Henri, comte de Champagne, bien qu'elle fût enceinte. El'Imad raconte le fait de la façon suivante [FN: § 649-2]:
« (p. 52) La nuit même de l'assassinat, le Comte Henri épousa la princesse veuve du (p. 53) Marquis et consomma son union avec elle, bien qu'elle fût en état de grossesse. Mais dans la religion des Francs, cette circonstance n'est pas un obstacle au mariage, l'enfant étant attribué à la mère. Telle est la règle chez ce peuple de mécréants ».
Si nous ne savions des Francs que ce qui est dit là, nous croirions que chez eux la filiation s'établissait par la mère, et ce peuple irait augmenter le nombre de ceux chez lesquels florissait le matriarcat. Il est probable que plusieurs faits présentés à l'appui de cette théorie n'ont pas plus de fondement que celui-ci.
§ 650. (B-α 1) Les mythes et les récits doivent être pris à la lettre ; On a des types de ce genre dans la foi aveugle avec laquelle si longtemps on accepta les récits de la Bible, considérée comme un simple livre d'histoire. Si on l'envisageait, au contraire, comme un livre inspiré de Dieu, et que l'on trouvât en cette circonstance le motif de croire aux récits historiques qu'elle renferme, on produirait une théorie de la classe III-A. On trouve d'autres types semblables dans les nombreuses légendes de la fondation de Rome et dans d'autres analogues.
§ 651. Durant nombre de siècles, on a pris pour de l'or en barre tout ce qui se trouvait chez quelque auteur ancien. Le fait était d'autant plus croyable que l'écrivain était plus ancien : Magister dixit ». On reste aujourd'hui stupéfait en voyant les fantasmagories qu'on prit longtemps pour de l'histoire ; et ce fait peut servir à illustrer la valeur du consentement universel dont les métaphysiciens se prévalent.
§ 652. On n'est pas moins étonné en voyant des hommes de grand talent accorder crédit à des fables et à des prophéties ; et cela montre combien peu de considération mérite l'autorité, en ces matières. Il paraît incroyable, et c'est pourtant la vérité, que le grand Newton ait pu écrire un livre pour démontrer que les prophéties de l'Apocalypse s'étaient vérifiées [FN: § 652-1], et que de semblables enfantillages aient pu trouver place dans l'esprit de l'homme qui fonda la mécanique céleste. Mais le fait n'est pas isolé ; au contraire, il est fréquent, bien que dans de moindres proportions ; et beaucoup d'hommes raisonnent fort bien en certaines matières et très mal en d'autres, faisant preuve en même temps de sagesse dans les premières et d'inintelligence dans les secondes. Innombrables sont les chronologies commençant au déluge, à l'année de la fondation de Troie, etc. Il faut voir, par exemple, dans les histoires de P. Orose [FN: § 652-2], comment il ramasse toutes les légendes, et les donne, sans le moindre doute, pour des histoires vraies, en leur assignant, par-dessus le marché, une date précise. Pour lui tout est bon, que cela vienne de la Bible ou des mythologies des païens, contre lesquels il écrit pourtant.
§ 653. Nous trouvons jusqu'en 1802 de ces chronologies. En cette année 1802, Larcher, par de longues et savantes dissertations, détermine encore la date d'une infinité d'événements légendaires [FN: § 653-1] . Il y a tout un chapitre pour déterminer exactement l'année où Troie fut prise, et l'auteur dit d'abord : « (p. 290) Je pose en fait actuellement que cette ville a été prise l'an 3,444 de la période julienne, 1,270 ans avant l'ère vulgaire, et je le prouverai dans le chapitre concernant cette époque ».
§ 654. Déjà dans l'antiquité, plus encore au moyen âge et même un peu plus tard, beaucoup de peuples trouvaient leur origine dans les pérégrinations des Troyens. Guillaume Le Breton nous dit sérieusement [FN: § 654-1] : « (p. 184) Comme nous l'avons appris des chroniques d'Eusèbe, d'Idace, de Grégoire de Tours, et de beaucoup d'autres, et du rapport de tous les anciens Hector, fils de Priam, eut un fils appelé Francion. Troïlus, fils de ce même Priam, roi d'Asie, eut, dit-on, aussi un fils nommé Turc. Après la destruction de Troye, (p. 185) la plus grande partie des habitans s'étant échappée, se divisa en deux peuples, dont l'un se choisit pour roi Francion, ce qui lui fit donner le nom de Franc. Les autres nommèrent pour chef Turc, d'où les Turcs tirèrent leur nom ».
§ 655. En 1829, alors que trois éditions de l'ouvrage de Niebuhr avaient déjà été publiées, les saint-simoniens croyaient encore à Numa [FN: § 655-1] .
§ 656. Mais, parmi ceux qui étudiaient les antiquités romaines, il y avait longtemps déjà que dès doutes s'étaient manifestés. Cluvier, en 1624, Perizonius, en 1685, Baufort, en 1738, Charles Lévesque, en 1807, et enfin Niebuhr, en 1811, tendirent peu à peu à montrer la vanité historique des légendes antiques.. Mommsen et enfin Pais en ont définitivement débarrassé l'histoire. Grote avait accompli déjà cette œuvre pour la Grèce.
§ 657. Les hommes ne se résignent pas volontiers à abandonner leurs légendes, et essaient au moins d'en sauver la plus grande partie possible. Le procédé généralement en usage consiste à changer le sens de la partie qu'on ne saurait vraiment pas accepter, afin de lui enlever un caractère d'impossibilité trop frappant.
§ 658. On a de très nombreux exemples de mots transformés en choses ou en propriétés de choses ; et souvent on construit toute une légende sur un seul terme dont on interprète le sens extensivement [FN: § 658-1].
Dans les langues où les noms de choses ont un genre, on personnifie les mâles par des noms masculins, les femelles par des noms féminins (§ 1645 et sv.). Il peut arriver qu'il soit parfois possible de remonter du nom à la chose ; mais il faut prendre bien garde de ne faire cela que si l'on a de bonnes preuves du passage effectué de la chose au nom. Certes, on est très porté, quand on cherche ce que signifie un terme, à l'altérer légèrement, à faire preuve d'ingéniosité, en mettant en lumière des interprétations cachées, et à unir ainsi le nom à une chose ; mais l'expérience du passé montre que, de cette manière, on est presque toujours tombé dans l'erreur (§ 547) ; et même d'autant plus facilement que le talent et l'érudition de l'interprète étaient plus grands. Celui-ci est poussé, justement par ces qualités, à tenter des voies inexplorées. Aller du nom à la chose, c'est parcourir à rebours la voie qui mène de la chose au nom ; et le parcours à rebours peut se faire avec quelque sécurité, seulement quand on a au moins une idée plus ou moins claire de la voie directe. Nous traiterons longuement ce sujet au chapitre IX.
§ 659. Il y a là un phénomène analogue à celui qu'on a observé pour l'étymologie. Les anciens tiraient leurs étymologies de ressemblances des termes, souvent très superficielles, et se trompaient presque toujours. Les modernes n'acceptent aucune étymologie qui n'est pas d'accord avec les lois de la phonétique ; c'est-à-dire qu'ils refusent de parcourir à rebours la voie suivie, s'ils n'ont pas de preuve du parcours suivant la voie directe.
§ 660. Ainsi, nous restons dans le doute quand, de sainte Venise, on veut remonter à Vénus, tant qu'on ne nous donne pas d'autre preuve que la ressemblance des noms ; mais cette dépendance deviendra d'autant plus probable que les preuves qu'on nous donnera du passage direct de Vénus à Venise seront meilleures. C'est justement ce que fait Maury [FN: § 660-1]: « (p. 349) La légende de cette sainte, telle qu'elle est rapportée par Petrus Subertus, dans son ouvrage intitulé De cultu vineæ Domini, telle qu'elle se lit dans un fragment attribué à Luitprand de Crémone, auteur du dixième siècle, et dans la chronique de Dexter, achève de démontrer l'origine païenne et tout aphrodisiaque de cette sainte qu'on chercherait vainement dans les Actes ».
Au contraire, tant que nous n'aurons pas de preuves de la voie directe, nous ne pourrons pas admettre les explications de certains auteurs sur la naissance d'Orion [FN: § 660-2].
§ 661. (B-α 2) Changements légers et faciles dans l'expression littérale. On a le type de ce genre d'interprétations dans le procédé employé par Palæphate, pour expliquer les légendes ; procédé si commode et si aisé, que n'importe qui peut l'employer, sans la moindre difficulté [FN: § 661-1] . Nous l'avons déjà mentionné comme moyen de dissimuler les actions non-logiques (§ 348). On conserve littéralement la légende, mais on change le sens des termes, autant qu'il le faut pour éliminer tout ce qui ne semble pas croyable.
Tout le monde connaît la belle description qu'Hésiode fait du combat entre les dieux descendant de Kronos et les Titans ; et il est évident que l'auteur n'a pas voulu faire autre chose qu'un simple récit. Les dieux eurent pour alliés Briarée, Cottos et Gyas ; chacun de ces derniers avait cent mains et cinquante tètes. Voici comment s'en tire Palæphate [FN: § 661-2]: « On raconte à leur sujet qu'ils avaient cent mains, tout en étant des hommes. Comment ne pas juger cela une absurdité ? Mais voici la vérité. Ils habitaient une ville nommée Cent-mains, située dans la contrée appelée aujourd'hui Orestiade ; aussi les hommes nommaient-ils Cent-mains: Cottos, Briarée et Gyas. Appelés par les dieux, ils chassèrent les Titans, de l'Olympe ».
La fable d'Éole devient facilement de l'histoire [FN: § 661-3] . Éole était un astrologue qui prédit à Ulysse quels vents devaient souffler. On disait que la Chimère était lion devant, dragon derrière et chèvre au milieu. Mais c'est impossible : un lion et une chèvre ne pouvaient avoir des aliments communs. La vérité est que la Chimère était une montagne où se trouvaient un lion sur la partie antérieure, un dragon sur la partie postérieure et des bergers au milieu. Si cette explication ne vous satisfait pas, en voici une autre, donnée par Héraclite [FN: § 661-4]: « La forme de la Chimère est ainsi décrite par Homère : Lion devant, dragon derrière, chèvre au milieu. La vérité aura été la suivante : Une femme qui régnait en un pays avait deux frères, appelés Lion et Dragon : ils lui étaient associés... ». Si l'on veut une autre explication, on la trouvera sans peine.
Diodore de Sicile voit en Ouranos un roi des Atlantes, qui habitaient les rives de l'Océan. Il eut, de plusieurs femmes, quarante-cinq fils, parmi lesquels dix-huit étaient appelés Titans, du nom ![]() , de leur mère. Après leur mort, Ouranos et Titaia furent adorés, celui-ci sous le nom de Ciel, celle-là sous le nom de Terre.
, de leur mère. Après leur mort, Ouranos et Titaia furent adorés, celui-ci sous le nom de Ciel, celle-là sous le nom de Terre.
Encore de nos jours, il s'est trouvé des auteurs qui ont pris au sérieux les interprétations de Palæphate [FN: § 661-5], et l'on en trouve même des traces dans les théories modernes sur l'origine de la famille et sur le totémisme.
§ 662. (B-β) Les mythes, etc., renferment une part d'histoire mêlée à une part non-réelle. C'est là un des genres les plus importants. Les explications qui s'y rattachent étaient autrefois fort en usage, et ne sont pas encore tombées en désuétude. Ce genre a le mérite, aux yeux de beaucoup, de concilier l'amour des légendes avec le désir d'une certaine précision historique ; en outre, et en général, il est commode, parce qu'il permet d'employer un grand nombre de documents écrits, et en particulier parce qu'il supporte facilement qu'on tire de ces documents ce que veut un auteur déterminé. Comme les règles servant à séparer la partie historique de la partie légendaire ne sont rien moins que précises, chacun, le plus souvent sans s'en apercevoir, les interprète selon le but qu'il a en vue.
§ 663. Maintenant, on y ajoute aussi des considérations éthiques et esthétiques. On prétend faire ainsi une histoire « vivante », par opposition à l'histoire « morte », qui serait celle qui vise exclusivement à être d'accord avec les faits [FN: § 663-1]. En somme, ce procédé substitue le produit de l'imagination de l'auteur aux réalités historiques. Au point de vue didactique, il est vrai que cette substitution peut faire naître chez le lecteur une image du passé, laquelle se grave ainsi dans l'esprit, mieux que si l'on employait une autre méthode plus précise. Les dessins des histoires illustrées sont de même utiles aux enfants et à beaucoup d'adultes, pour suppléer par la mémoire visuelle à la mémoire rationnelle. Nous n'avons pas à nous en occuper ici, et nous reviendrons plus loin sur la question de l'histoire (§ 1580 et sv.).
§ 664. Rejetant les fables de la tradition romaine, Niebuhr a voulu en tirer pourtant quelque chose; c'est-à-dire que du genre (α), il nous fait passer au genre (β). Duruy est bien moins scientifique que Niebuhr. Il ne sait vraiment pas se décider à abandonner la tradition, et cherche toute espèce de prétextes pour se rapprocher du genre (α). Il va jusqu'à dire [FN: § 664-1] : « (p. 62) Ce n'est pas que nous voulions rejeter l'existence de Romulus ; seulement les hymnes chantés encore du temps d'Auguste, et qui conservaient la poétique histoire du premier roi de Rome, ne seront pour nous qu'une légende comme en ont tous les vieux peuples... ». Voilà que nous approchons des belles interprétations de Palæphate [FN: § 664-2]. Comment Duruy fait-il pour admettre l'existence historique de Romulus, tandis qu'il reconnaît le caractère légendaire des seuls documents qui nous en ont conservé la mémoire ? Ce ne peut être qu'en vertu du principe non-expérimental, d'après lequel ces légendes ont une origine historique, et au moyen d'une méthode encore moins expérimentale, par laquelle on prétend reconnaître cette origine sous le voile de la légende.
§ 665. À ces affirmations a priori, la science expérimentale ne peut opposer des négations également a priori. Il est nécessaire de rechercher par l'expérience, exclusivement par l'expérience, si la méthode proposée est susceptible, oui ou non, de nous faire trouver la réalité historique sous la légende (§ 547).
§ 666. Pour y arriver, nous avons heureusement une série de faits parallèles : historiques d'une part, légendaires d'autre part. Autrement dit, nous connaissons un fait historique, et nous connaissons la légende à laquelle il a donné naissance. À supposer que l'on connaisse uniquement la légende, nous tâchons d'en tirer le fait historique par une certaine méthode, et nous pouvons vérifier si, de cette manière, nous trouvons vraiment le fait réel ; si oui, la méthode est bonne ; si non, elle ne vaut rien ou presque rien (§ 547).
§ 667. Commençons par observer que la reconstruction du fait historique doit faire plus qu'affirmer l'existence de personnes dont on ignore tout, y compris le nom ; sans quoi cela ne nous apprend vraiment rien. À quoi sert de croire à l'existence de Romulus, comme y croit Duruy, si nous ne savons rien de lui ? Et quel besoin avons-nous de la légende pour avoir cette connaissance ? Les anciens Romains eurent un chef, comme tous les peuples ont eu des chefs. Admettons-le ; c'est même presque certain ; mais pour le savoir, l'analogie suffit, sans que la légende de Romulus soit nécessaire.
Le problème à résoudre est donc le suivant. Étant donnée une légende, avons-nous un moyen d'en séparer une partie historique, aussi petite soit-elle ? Le manque de place ne nous permet pas de traiter ce problème dans toute son ampleur. Voyons au moins un exemple.
§ 668. Virgile est un personnage historique ; d'autre part, c'est aussi un personnage légendaire ; et grâce au beau travail de Comparetti [FN: § 668-1] , nous en connaissons bien la légende, ou mieux les légendes. Voyons si nous pourrions reconstruire l'histoire, quand nous ne connaîtrions que ces légendes.
Comparetti distingue deux ordres de légendes : 1° Virgile dans la tradition littéraire; 2° Virgile dans la légende populaire. C'est seulement de cette dernière partie que nous avons à nous occuper ici. L'idée principale de ces légendes, au moyen âge, est de placer Virgile parmi les magiciens ; et beaucoup de ces légendes n'ont d'autre point de contact avec la réalité historique que de faire de Virgile un citoyen romain et de le mettre en rapport avec un empereur. Il faut avouer que c'est bien peu. Voici, par exemple, un livre [FN: § 668-2]qui nous fait connaître « Les faietz merveilleux de Virgille ». Les titres des chapitres suffiront à donner une idée de la nature de la légende.
« I. Comment Romulus occit Remus son frere, et comment le filz de Remus occit Romulus son oncle ». On nous apprend que : « (p. 284) Si advint que Remus quis estoit empereur mourut, et son filz qu'il avoit fut empereur après luy. Et celluy chevalier qui avoit espousé la fille du senateur meut une grant guerre qui moult le greva et fit despendre du sien. Celluy chevalier eut ung filz de sa femme qui à grant peine nasquit, ne naistre ne vouloit, et fut contendue grant temps la nature de la mère, et après nasquit et le convint longuement veiller. Et pourtant fut il nomme Virgille. – II. Du naissement de Virgille et comment il fut mis à lescolle. (p. 285) Et quand Virgille nasquit si crousla toute la cité de Romme de l'un des boutz jusques à lautre bout.Virgille sen etoit allé à Tollette pour apprendre prendre, car il apprenait trop voluntiers, et moult fut sage des ars de nigromance... – III. Comment Virgille sen vint à Romme et se complaignit à lempereur. – IV. Comment lempereur de Romme assalit Virgille en son chastel. – V. Comment Virgille avoit enclos lempereur et son ost de murs. – VI. Comment lempereur fit paix avec Virgille.(p. 289) Et tant advint que Virgille ayma une damoiselle,... et la fit requerir damour par une vieille sorcière ». Cette demoiselle fait savoir à Virgile « (p. 290) que si vouloit coucher avec elle, il convenoit venir tout quoy auprès de la tour où elle gisoit, quant toutes gens seroient couchez, et elle lui avallerait une corbeille à terre bien encordée, et il entreroit dedans, et elle le tireroit à mont jusques en sa chambre. – VII. Comment la damoiselle pendit Virgille en la corbeille ». La demoiselle se joue de Virgile, et celui-ci se venge : « (p. 290) Si print Virgille ses livres et fist tant que tout le feux de Romme fust esteint et n'y avoit nul qui en peust apporter en la cité de dehors Romme. VIII. Comment Virgille estaingnit le feu de Romme ». L'empereur et ses barons demandent à Virgile comment ils pourront obtenir du feu ; il répond: « (p. 291) Vous ferez ung escharfault au marché, et en iceluy eacharfault vous ferez monter toute nue en sa chemise la damoiselle qui devant hier me pendit en la corbeille, et ferez crier par toute Romme que qui vouldra avoir du feu viennent à lescharfault en prendre, et allumer à la nature dicelle damoiselle, ou autrement ilz n'en auront point. – IX. Comment la damoiselle fut mise en lescharfault et y allait chacun allumer sa chandelle ou sa torche entre ses jambes. – X. Comment Virgille fist une lampe qui tousjours ardoit. – XI. Cy apres parle du vergier que Virgille fist à la fontaine de lestang. – XII. Lymage que fist Virgille à sa femme ». Cette image « (p. 293) estoit de telle vertu que toute femme qui lavoit veu navoit voulenté de faire le peché de fournication. Et de ce furent moult courroucées les dames de Romme qui aymoyent par amour.». Elles se plaignent à la femme de Virgile ; celle-ci jette l'image. – « XIII. Comment Virgille refist lymage et trabucha sa femme et comment il fist ung pont sur la mer ». Une fille du Sultan s'éprend de Virgile, et celui-ci la mène chez lui sur « ung pont en laer par dessus la mer. – XIV. Comment Virgille reporta la damoiselle en son pays. – XV. Comment Virgille fut pris avec la damoiselle et comment il eschappa et emmena la damoiselle. – XVI. Comment Virgille eschappa et ramena la damoiselle et fonda la cité de Naples. – XVII. Comment lempereur de Romme assiegea la cité de Naples. – XVIII. Comment Virgille fist peupler la cité d'escolliers et de marschandises. – XIX. Comment Virgille fist ung serpent à Romme. – XX. Comment Virgille mourut [FN: § 668-3] ».
§ 669. Supposons que nous ne connaissions de Virgile que cette longue légende. Quelle réalité historique pourrions-nous en tirer ? Vraiment aucune. Le récit sera beau, admirable, plein de vie autant qu'on voudra ; mais il demeure tout à fait étranger aux faits.
§ 670. Si nous voulons nous lancer en plein dans les interprétations, nous pouvons, par des raisonnements qui peuvent paraître bons, mais ne conduisent à rien de conforme à la réalité historique, tirer ce qu'il nous plaît de cette légende. On pourrait y voir le souvenir d'une guerre entre Rome et Naples, comme dans l'Iliade on voit le souvenir d'une guerre entre les Grecs et les Asiatiques. Les aventures érotiques pourraient faire placer Virgile parmi les dieux de la génération, dont il serait une forme romaine... ou napolitaine. La difficulté de sa naissance pourrait nous induire à voir en lui une des formes d'Hercule, ou, si nous préférons, de Bacchus. Naples étant une colonie grecque, ces hypothèses ont une confirmation historique, et l'on peut écrire un beau et long chapitre, pour montrer que notre légende est du grand nombre de celles qui font allusion à l'invasion des dieux de la Grèce en terre romaine. Il serait bon de rappeler le sénatus-consulte des Bacchanales, et de rapprocher des obscénités de ces mystères de Bacchus la façon obscène dont Virgile – qui pour la légende est une forme de Bacchus –fait rallumer le feu à Rome. De nombreuses interprétations de légendes s'appuient sur des preuves beaucoup plus faibles que celles dont nous pourrions faire état dans cette interprétation, entièrement fausse, nous le savons.
D'autres méthodes d'interprétation nous donneraient d'autres résultats, qui seraient tous étrangers à la réalité (§ 789).
§ 671. D'autres légendes peuvent avoir été formées diversement ; mais il est possible aussi qu'elles aient été formées comme celles-ci ; et, tant que nous n'avons pas quelque document historique, pour distinguer si la légende dont nous voulons tirer une réalité historique appartient à cette classe-ci ou à celle-là, nous ne pouvons rien, absolument rien en tirer [FN: § 671-1].
Des légendes analogues, il y en a tant qu'on veut dans l'antiquité, au moyen âge et jusqu'aux temps modernes. Nous voyons d'une manière certaine le roman se mêler à l'histoire [FN: § 671-2] ; aussi bien, en conséquence, quand nous ne connaissons que le mélange, nous demeurons dans le doute sur la manière dont il a été composé.
§ 672. Un procédé d'interprétation souvent employé consiste à éliminer d'un récit toute la partie qui semble fabuleuse, et à conserver le reste comme de l'histoire. Employé non comme interprétation, mais seulement comme manière d'éliminer des parties accessoires de textes qui ont, dans leurs autres parties, le caractère d'histoire, ce procédé est non seulement utile, niais indispensable même, en nombre de cas. Bien rares sont les textes anciens dans lesquels le merveilleux ne se mêle pas à la réalité historique ; et si ce merveilleux devait nous faire rejeter le reste, nous ne saurions plus rien de l'antiquité, ni même de temps plus rapprochés.
§ 673. Mais prenons bien garde aux deux conditions posées. Il faut que la fable soit accessoire, et que la partie qu'on tient pour historique possède d'autres caractères et d'autres témoignages qui la fassent accepter comme telle. Si la partie fabuleuse prévaut, si la partie historique est dépourvue de l'appui d'autres témoignages ou au moins d'une probabilité notable, la méthode, qui devient de la simple interprétation, est tout à fait trompeuse (§ 258). Enfin, les motifs qui font accepter le témoignage d'un auteur doivent être intrinsèques à la personne et à l'ouvrage ; l'on ne doit pas être mu par le motif extrinsèque de séparer la partie vraisemblable de celle qui ne l'est pas. Il ne suffit pas qu'une chose soit vraisemblable pour être vraie.
§ 674. Il y a plus. Il est des cas où, en éliminant de cette façon la partie sur laquelle tombe quelque soupçon de fable, et en conservant celle qui paraît être de l'histoire, on élimine précisément la partie qui, si elle n’est pas vraie, peut du moins être telle, et l'on conserve celle qui est certainement fausse.
Par exemple, dans un recueil de récits, on lit l'histoire suivante [FN: § 674-1]: « (p. 229) On list es croniques que l'an vint et deuxiesme de la fondation de Rome, les Romains firent ériger une columne de marbre dedans le capitolle de la cité, et sus la columne misrent l'ymage de Julius César, et sus l'ymage son nom escript ».
« Mais celluy ci César eut trois signes merveilleux devant que mourir. Le centiesme jour devant sa mort, la fouldre tomba devant son ymage, rasant de son nom suscript la première lettre. La nuyt de sa mort precedente, les fenestres de sa chambre furent si impétueusement ouvertes qu'il estimoit que la maison tomboit. Le mesme jour qu'il fut tué, comme il entroit au Capitolle, baillées lui furent des lettres indices, et (p. 230) qui luy demonstroient sa mort, lesquelles s'il les eust leues il fust évadé de son occision et meurtre ».
Dans ce récit, si nous voulons garder la partie qui semble être de l'histoire, et éliminer celle qui paraît fabuleuse, nous devrons conserver le fait que César vivait en l'an 22 de la fondation de Rome, et qu'en ce temps une colonne portant son image et son nom fut érigée au Capitole ; ce qui est entièrement faux. Nous devrons d'autre part éliminer les trois faits qui précédèrent la mort de César, et qui, de l'aveu de l'auteur, appartiennent au merveilleux. Mais ces faits ont justement un fondement dans les histoires d'un temps proche de celui de César [FN: § 674-2]; ils peuvent être faux, mais peuvent aussi bien être vrais, au moins en partie.
§ 675. Dans la légende de Virgile, rappelée tantôt, nous avons un exemple de la manière dont les récits de mythes se constituent en général. Cette manière ressemble à celle dont se forment les cristaux. Jetez un petit grain de sable dans une solution saturée d'alun, et vous verrez se former autour du grain de gros et nombreux cristaux. De même, autour d'un récit qui n'a rien de réel, mais qui est une simple expression concrète d'un sentiment, d'autres récits semblables et diverses fioritures se groupent et s'agglomèrent avec le premier. Parfois, les personnages sont dépourvus de tout caractère historique, et parfois on les choisit parmi les personnes historiques, auxquelles l'aventure paraît s'appliquer plus ou moins bien. Après avoir ainsi choisi un personnage, historique ou non, il arrive souvent qu'il devient un type qu'on fait intervenir dans d'autres aventures, imaginées d'une manière analogue. Il est évident que ces personnages et les aventures elles-mêmes constituent une partie accessoire du récit, dont la partie principale gît, au contraire, dans les sentiments qu'il exprime. Mais habituellement, quand on étudie ces récits, on intervertit l'importance des parties ; on prête principalement attention aux personnages et aux aventures, et l'on néglige les sentiments dont l'expression fait naître les récits [FN: § 675-1]. De cette façon, on fait aussi une classification artificielle des récits, en mettant ensemble, par exemple, tous ceux qui se rapportent à un même personnage, et qui ne se ressemblent que dans cette partie subordonnée ; tandis qu'une classification naturelle mettrait ensemble tous ceux qui expriment les mêmes sentiments, et qui, par conséquent, se ressemblent dans la partie principale ; et l'on ne se préoccuperait pas davantage des noms employés pour donner une forme concrète à l'expression des sentiments (§ 684-1). De même encore, autour d'un fait historique, si insignifiant qu'il se réduit souvent à un nom seul (Virgile), on dispose une riche et abondante floraison de récits qui n'ont rien, vraiment rien à voir avec l'histoire. Quand ensuite nous étudions ces légendes et voulons en trouver l'origine, nous ne pouvons la découvrir dans la partie pseudo-historique ; mais nous devons la rechercher dans la partie principale, qui est la manifestation de certains sentiments.
§ 676. Il arrive donc qu'autour d'un seul nom se rassemblent des aventures variées. Cela s'est produit pour les dieux du paganisme. Quand, plus tard, à la naissance de la critique, on a vu qu'il était impossible d'attribuer toutes ces aventures à une même personne, on a cherché une façon quelconque d'expliquer la légende. Mais au lieu de reconnaître le mode de formation indiqué tout à l'heure, on a préféré dédoubler ou même diviser en trois ou plusieurs personnes, le dieu ou le héros auquel toutes ces aventures étaient attribuées. Ainsi, comme dans les interprétations de Palæphate, on respecte la lettre de la légende, en en changeant le sens. Cicéron énumère trois Jupiter, cinq Vulcain, trois Esculape, etc. [FN: § 676-1]
§ 677. Il est incontestable que certaines divinités de divers peuples se sont fondues ensemble, et ont pris un même nom. Il suffit de se rappeler l'exemple de l'assimilation des divinités grecques aux divinités romaines. Mais l'erreur consiste à vouloir que toutes les légendes aient une origine semblable.
§ 678. Comme d'habitude, recourons à l'expérience pour savoir comment ces légendes se constituent (§ 547). Nous avons de nombreux cas dans lesquels il est certain que le nom d'une personne, à laquelle on prête diverses aventures, n'est pas du tout celui de deux ou plusieurs personnes qui se sont fondues ensemble. Par exemple, on attribue à Mme de Talleyrand une aventure assez comique [FN: § 678-1] ; mais si l'on tâche de vérifier le fait, on voit qu'elle était déjà connue avant la naissance de Mme de Talleyrand. Celle-ci avait la réputation d'une femme stupide, et on lui attribuait les aventures qui conviennent aux femmes stupides. Au contraire, son mari avait la réputation d'un homme d'esprit, avisé, intelligent ; et par le même procédé, on lui attribuait tous les bons mots qu'on pouvait trouver. Après avoir dit que Talleyrand s'attribuait souvent les bons mots de l'Improvisateur français, E. Fournier ajoute [FN: § 678-2]: « (p. 267) M. de Talleyrand était souvent approvisionné d'esprit avec moins de peine encore. Il lui en arrivait de partout, sans qu'il y songeât, sans même qu'il le sût. Tout mot bien venu prenait son nom pour enseigne, et ainsi recommandé ne faisait que mieux son chemin, en raison de cette nonchalante habitude des causeurs que Nodier définit ainsi : « C'est le propre de l'érudition populaire de rattacher toutes ses connaissances à un nom vulgaire [FN: § 678-*] ». Un mot ne lui venait quelquefois à lui-même que harassé, défloré. L'apprenant après tout le (p. 268) monde, il en riait naïvement comme d'une nouveauté, quand chacun était las d'en rire ».
§ 679. Voici encore une personne historique, mais de l'antiquité, à laquelle on prête nombre d'aventures chronologiquement impossibles. C'est la courtisane Laïs. Comme d'habitude, pour écarter les difficultés de la narration, on suppose deux Laïs. «La conjecture – dit Bayle [FN: § 679-1] – de ceux qui disent qu'il y a eu deux courtisanes nommées Laïs est fondée sur ce que la chronologie ne souffre pas que l'on applique à la même femme tout ce qui se dit de Laïs ».
Mais cela ne suffit pas ; et pour accepter les faits du récit, Bayle fait voir qu'il faut admettre trois Laïs. D'ailleurs, ajoute-t-il très justement, il est préférable de supposer qu'on a attribué à Laïs les aventures d'autres courtisanes.
§ 680. Il y a des légendes dont l'origine est historique. Par exemple, la Chanson de Roland, étudiée par G. Paris [FN: § 680-1] . Un fait historique paraît certain : « (p. 3) Le 15 août 778, l'arrière-garde de l'armée que le roi des Francs, Charles, ramenait d'Espagne après une expédition à moitié heureuse, fut surprise dans les Pyrénées par les Basques navarrais – avec lesquels les Francs n'étaient pas en guerre ouverte et entièrement détruite ». Le roi revint en arrière, mais ne put venger le désastre des siens, et dut continuer sa route. « (p. 3) Telle est la version que donnent les Annales (p. 4) royales et la Vie de Charlemagne d'Einhard ; c'est celle qu'ont adoptée tous nos historiens. La version arabe est toute différente, d'après Ibn-al-Athîr... ce furent les musulmans de Saragosse – ceux-là même qui avaient appelé Charles en Espagne – qui firent subir à l'armée franque, lorsqu'elle était hors du territoire arabe et se croyait en pleine sûreté, le grave échec dont il s'agit ».
Sur ce fondement historique fort étroit, est construit un vaste édifice de légendes, sans qu'aucun caractère extrinsèque nous autorise à remonter de ces légendes à la réalité historique. Après avoir essayé de reconstituer l'histoire du combat, G. Paris observe : « (p. 53) De cette image du combat telle que nous pouvons nous la former, il ne reste pas grand'chose (p. 54) dans nos poèmes ». Et il conclut : « (p. 61) Il résulte de toutes ces remarques... que la Chanson de Roland repose certainement, à l'origine, sur une connaissance directe des faits, des hommes et des lieux, et présente même en certains points une concordance tout à fait remarquable avec les renseignements fournis par l'histoire ; mais que la forme où elle nous est arrivée, postérieure de trois siècles à la forme première, est extrêmement éloignée de celle-ci et est due en très grande partie aux inventions successives d'amplificateurs (p. 62) et remanieurs, qui se souciaient uniquement de l'effet poétique, et qui d'ailleurs, en dehors de la Chanson même, n'avaient aucun moyen... de se procurer des renseignements sur les faits célébrés dans le poème ». Mais à quoi sert de savoir qu'une légende a un fond historique, si les moyens de le reconnaître sous le voile de la légende nous font défaut ? La Chanson de Roland avait un fond historique. Induits en erreur par l'analogie, voudrions-nous étendre cette conclusion à toutes les légendes du cycle de Charlemagne ? [FN: § 680-2]. Ce serait une grossière erreur, car il y en a beaucoup auxquelles ce fond historique fait défaut.
Nous concluons donc que si le critère consistant à tenir pour légendaire tout ce qui sent le surnaturel, peut avoir quelque succès pour les œuvres principalement historiques, il est au contraire presque toujours trompeur pour les légendes ; nous en avons des preuves en grand nombre. On ne peut donc tirer que peu ou point de réalité historique, et plutôt point que peu, des légendes dépourvues d'autres adjonctions historiques extrinsèques.
§ 681. (B-β 1) Les mythes, etc., ont une origine historique, et le récit a été altéré avec le temps. Les observations que nous venons de faire pour le genre β s'appliquent aussi à l'espèce (β 1), qui fait partie de ce genre. Un type de cette espèce est l'évhémérisme, que nous appellerons ancien, pour le distinguer du néo-évhémérisme de Spencer.
§ 682. L'histoire d'Évhémère ne nous est pas bien connue. On y peut distinguer deux parties : une interprétation, et les preuves qu'on en donne. L'interprétation, qui voit dans les dieux des hommes divinisés, est en partie vraie, sinon dans les cas signalés par Évhémère, du moins dans d'autres analogues. Les preuves n'ont pas la moindre valeur. Évhémère affirmait être parvenu dans ses voyages à une île nommée Panchea, qui était entièrement consacrée aux dieux, et y avoir vu un temple de ![]() édifié par ce dieu en personne, tandis qu'il habitait la terre. Dans ce temple, il y avait une colonne d'or sur laquelle étaient écrits les faits attribués à Ouranos, à Chronos, à Zeus, qui tous trois avaient vécu et régné. Évhémère remplissait entièrement un livre, intitulé
édifié par ce dieu en personne, tandis qu'il habitait la terre. Dans ce temple, il y avait une colonne d'or sur laquelle étaient écrits les faits attribués à Ouranos, à Chronos, à Zeus, qui tous trois avaient vécu et régné. Évhémère remplissait entièrement un livre, intitulé ![]() des exploits d'hommes devenus dieux.
des exploits d'hommes devenus dieux.
En fin de compte, nous ne savons pas si ces voyages étaient donnés comme preuves, ou s'ils étaient une simple fiction pour exposer une théorie qui disposait d'ailleurs de preuves meilleures. Plusieurs écrivains anciens ont considéré les récits d'Évhémère comme de simples mensonges. Strabon est de cet avis. Après avoir rappelé certains récits qu'il tient pour fabuleux, il ajoute [FN: § 682-1]: «Tout cela diffère peu des fables de Pittéas, d'Évhémère et d'Antiphane ; mais à eux on les leur pardonne ; ces charlatans s'entendaient bien à leur métier... ». Polybe aussi semble avoir tenu Évhémère pour un vrai menteur ; mais ce n'était que les preuves d'Évhémère qu'il rejetait, car, au sujet de l'interprétation, Polybe voyait aussi des hommes dans les dieux. Il dit, par exemple [FN: § 682-2]: (5) « Éole enseignait aux navigateurs comment ils devaient se comporter dans le détroit [de Sicile], fait en serpentin et d'une issue difficile, à cause du flux et du reflux. C'est pourquoi il fut appelé dispensateur des vents et tenu pour leur roi ». Il continue en citant des cas semblables, et finit par dire : (8) « Ainsi nous trouvons qu'en chacun des dieux on honore l'inventeur de choses utiles ».
§ 683. Polybe connaissait d'ailleurs des faits réels qui démontraient comment on avait divinisé des hommes. Il observe (X, 10, 11) que près de Carthagène il y a trois petites collines. « Celle qui est au levant est appelée colline d'Hèphaestos ; celle qui est voisine porte le nom d'Alestos. On dit que ce dernier a obtenu d'être honoré comme un dieu, pour avoir découvert des mines d'argent. La troisième est appelée colline de Chronos ».
§ 684. Les Pères de l'Église, qui, en général, n'employaient guère la critique historique, devaient accueillir favorablement la théorie et les preuves d'Évhémère, qui faisaient justement leur affaire.
Saint Augustin (De civ. dei, VII, 18) pense que l'opinion la plus croyable, au sujet des dieux, est l'hypothèse qu'ils ont été des hommes. Chacun d'eux, suivant ses aptitudes, ses habitudes, ses actions et les hasards, a obtenu de ses admirateurs d'être considéré comme un dieu et d'avoir un culte et des cérémonies. Il dit ailleurs (De civ. dei, VI, 7) : « Que pensaient du même Jupiter ceux qui placèrent sa nourrice au Capitole ? Ne sont-ils pas d'accord avec Évhémère, qui écrivit, non sous forme d'un bavardage fabuleux, mais avec le souci de l'histoire, que tous ces dieux avaient été hommes et mortels ? »
Lactance prend au sérieux ce que dit Ennius, interprète d'Évhémère, au sujet des règnes d'Uranus et de Saturne [FN: § 684-1]. Minucius Félix (XXI) dit : « Lis les écrits des historiens ou des philosophes ; tu reconnaîtras avec moi que les hommes ont été déifiés, à cause de leurs mérites ou de leurs largesses, comme le raconte Évhémère, qui nous fait connaître leurs dates de naissance, leurs patries, leurs tombeaux, dont il indique le lieu, comme pour Jupiter Diktéen, Apollon Delphien, Isis de Faria, Cérès d'Éleusis. Prodicus dit qu'on a déifié ceux qui, secourant les pays et trouvant de nouvelles utilités aux produits, les révélèrent aux hommes. Persée est aussi du même avis ; il ajoute qu'on donna leurs noms aux découvertes ; d'où vient le plaisant dicton : Vénus languit, sans Liberus et Cérès ».
685. Très nombreuses furent et sont toujours les interprétations qui appartiennent à ce genre, et par lesquelles on cherche à enlever les parties les moins croyables d'un récit, pour pouvoir sauver le reste. Aussi les naissances miraculeuses, par exemple, se changent-elles en naissances naturelles.
§ 686. À ce genre appartiennent les théories d'après lesquelles on peut, d'un nom, déduire la nature et les propriétés de la chose qui porte ce nom (chap. X). Ces théories ont pour prémisses, au moins implicites, qu'à l'origine, on a donné aux choses un nom qui correspond précisément à leur nature. À ces prémisses, les métaphysiciens peuvent en ajouter d'autres, toujours implicitement ; car, estimant que les choses sont comme se les imagine l'esprit humain, ils croient qu'il est indifférent de raisonner sur le nom ou sur la chose. En somme, c'est un des très nombreux cas dans lesquels on donne une existence objective à des sentiments subjectifs. Cette théorie atteint le comble de l'absurde dans le Cratyle de Platon.
§ 687. Laissons de côté ces considérations a priori et, comme d'habitude, recourons à l'expérience. Il est vrai que, de nos jours, les hommes de science tâchent de donner aux choses nouvelles des noms nouveaux, qui en indiquent quelque propriété. Dans ce cas, l'étymologie pourrait donc être utile pour trouver, sinon les propriétés réelles des choses, du moins l'idée qu'en avait celui qui a découvert la chose. Ainsi, le nom oxygène nous indique non pas que ce corps est le seul générateur d'oxydes, mais que tel se le figuraient ceux qui lui donnèrent ce nom.
Les noms donnés par le vulgaire, et par conséquent la majeure partie des termes du langage courant, n'ont pas même cet usage limité, et dépendent de circonstances accidentelles, qui n'ont souvent rien ou presque rien à faire avec le caractère des choses. [FN: § 687 note 1)]. Voyons un exemple.
§ 688. Parmi les interprétations rigoureusement étymologiques, il y en a une qui est demeurée célèbre. Longtemps on a dit et répété que servus, c'est-à-dire esclave, venait de servare, c'est-à-dire conserver, maintenir sain et sauf ; et, de cette étymologie, ou a tiré une superbe théorie de l'esclavage. Les Institutes de Justinien disent [FN: § 688-1] : « Les esclaves (servi) sont ainsi appelés parce que les généraux ordonnaient de vendre les prisonniers; c'est pourquoi ou avait l'habitude de les conserver (servare) et non de les tuer ». Mais aujourd'hui, cette étymologie ne vaut plus rien. À ce qu'il paraît, servus veut dire gardien de la maison. Ainsi est anéantie cette excellente théorie de l'esclavage. C'est vraiment dommage ! S'il y a des gens qui ont à mettre au jour une théorie de l'esclavage, déduite de l'étymologie de servus, ils feront bien de se dépêcher, parce que bientôt l'étymologie que nous venons de donner pourrait de nouveau changer [FN: § 688-2].
§ 689. En Italie et dans les pays où travaillent beaucoup d'ouvriers italiens, on emploie le nom de Kroumir, pour désigner les ouvriers qui travaillent tandis que leurs compagnons font grève. Si ce mot était ancien, on en pourrait tirer de belles théories étymologiques. Kroumir pourrait venir de ![]() , heurter, frapper, qui donne
, heurter, frapper, qui donne ![]() , coup, meurtrissure ; ainsi l'étymologie nous apprendrait que les Kroumirs sont frappés par leurs compagnons. Beaucoup d'étymologies qui ont eu et ont encore cours sont pires que celle-là [FN: § 689-1]. Mais nous savons d'où vient ce nom. Les Kroumirs étaient une tribu de la Tunisie. Les Français prirent prétexte de prétendues déprédations de cette tribu pour envahir la Tunisie. Le mécontentement éprouvé de ce fait en Italie fit que le nom de Kroumir se trouva associé à des sentiments désagréables ; et quand les ouvriers éprouvèrent d'autres sentiments désagréables envers ceux dont ils pensaient être trahis dans les grèves, ils employèrent sans autre ce mot de Kroumir.
, coup, meurtrissure ; ainsi l'étymologie nous apprendrait que les Kroumirs sont frappés par leurs compagnons. Beaucoup d'étymologies qui ont eu et ont encore cours sont pires que celle-là [FN: § 689-1]. Mais nous savons d'où vient ce nom. Les Kroumirs étaient une tribu de la Tunisie. Les Français prirent prétexte de prétendues déprédations de cette tribu pour envahir la Tunisie. Le mécontentement éprouvé de ce fait en Italie fit que le nom de Kroumir se trouva associé à des sentiments désagréables ; et quand les ouvriers éprouvèrent d'autres sentiments désagréables envers ceux dont ils pensaient être trahis dans les grèves, ils employèrent sans autre ce mot de Kroumir.
§ 690. Ce cas est le type d'une classe très étendue. Tous les jours, nous voyons se former des mots et des locutions qui ont pour origine des associations d'idées souvent tout à fait fortuites [FN: § 690-1]. Celui qui, dans les siècles futurs, voudrait connaître par ces mots et ces locutions les choses qu'ils désignaient, tomberait certainement dans l'erreur. Il est par conséquent manifeste que si nous voulons suivre maintenant cette méthode pour connaître l'antiquité, peut-être pouvons-nous être parfois dans le vrai, mais nous tomberons facilement dans l'erreur.
§ 691. L'opération étymologique directe tire le nom, des propriétés des choses ; l'opération inverse attribue aux choses certaines propriétés, simplement à cause de leur nom. Cette opération inverse paraît avoir joué un grand rôle dans la mythologie, et beaucoup d'événements semblent avoir été inventés à cause des noms [FN: § 691-1]. Pourtant, en de nombreux cas, il n'y a que de légères probabilités, et l'on n'a pas de preuves certaines.
L'étymologie sert aussi dans un autre genre d'interprétations c'est dans le genre (γ) de la classe B, comme nous le verrons plus loin (§ 780 et sv.).
§ 692. (B-β 3) Les mythes, etc., sont le produit d'expériences mal interprétées, de déductions fausses de faits réels. Ce genre diffère du précédent en ce qu'on donne une plus grande place à l'expérience, sinon en réalité, au moins en apparence, et que les déductions pseudo-expérimentales sont plus longues, plus ingénieuses et plus subtiles.
§ 693. La théorie de l'animisme appartient à ce genre. Elle prend plusieurs formes. Sous sa forme la plus précise, elle affirme que les peuples primitifs sont persuadés que l'homme, les animaux, les végétaux, même les êtres non-vivants ont une âme ; et d'après elle, les phénomènes religieux tirent leur origine et leur développement des déductions logiques de cette croyance. Sous une forme moins précise, on dit : « Nous pouvons affirmer que l'enfant et le sauvage sont animistes ; c'est-à-dire qu'ils projettent à l'extérieur la volonté qui agit en eux, qu'ils peuplent de vie et de sentiments semblables aux leurs le monde et en quelque sorte les êtres et les objets qui les entourent».
Ni ici ni ailleurs, nous ne voulons résoudre le problème des « origines », au point de vue chronologique (§ 885 et sv.). Les documents font défaut pour cette étude, qui devient ainsi une œuvre de pure imagination. Nous voulons seulement chercher à décomposer les phénomènes complexes en d'autres plus simples, et à en étudier les rapports. Il se peut que les phénomènes simples aient précédé chronologiquement les phénomènes composés ; il se peut aussi que c'ait été le contraire. Pour le moment, nous ne nous en occupons pas.
Dans la première forme d'animisme, il y a évidemment des déductions plus étendues que dans la seconde ; mais elles ne manquent pas non plus dans celle-ci. Pour la ramener à des sentiments correspondant à des actions non-logiques, il faut en changer les termes et dire que l'enfant et le sauvage en nombre de cas, et même parfois l'homme civilisé, agissent de la même manière envers les êtres humains, les êtres vivants, et même les objets avec lesquels ils sont en rapport.
§ 694. Quand on veut donner une teinte logique à ces actions non-logiques, on ajoute des déductions. On peut dire : « J'agis de cette façon, parce que je crois que les animaux, les plantes, les objets avec lesquels je suis en rapport, ont une volonté comme moi j'en ai une et comme en ont les autres hommes ». Ou bien on peut allonger les déductions, en attribuant une cause à cette volonté, en en faisant un caractère essentiel d'une entité nommée âme, et en affirmant que d'autres êtres ont une âme, comme l'homme a une âme.
Tylor va même un peu plus loin [FN: § 694-1] . Il dit : « (p. 493) La croyance à des êtres spirituels, tel est, dans sa plus large acception, le sens du mot spiritualisme ; c'est dans le même sens que nous employons ici le terme animisme ». Puis il ajoute: « (p. 494) L'animisme caractérise les tribus les plus inférieures dans l'échelle de l'humanité ; puis, de ce premier échelon, modifié profondément dans le cours de son ascension, mais, du commencement à la fin, gardant une continuité parfaite, il monte et s'élève jusqu'à la hauteur de notre civilisation moderne ».
Ce serait donc une évolution de ces sentiments non-logiques – ou de leur expression – que décrit notre auteur. À vrai dire, on est surpris que « les tribus les plus basses » de l'humanité aient déjà une théorie aussi subtile que celle de l'existence d'êtres spirituels. Leur langue même doit être assez perfectionnée pour pouvoir exprimer les abstractions être et spirituel. Il faut en outre qu'elle soit assez bien connue des voyageurs, pour qu'ils puissent en traduire avec précision ces termes dans nos langues.
§ 695. Notons que certains doutes subsistent encore, au sujet de langues pourtant très connues[FN: § 695-1]. Ainsi, pour la morale chinoise, on nous dit [FN: § 685-2]: « (p. 2) Rien n'est donc plus facile, pour le traducteur, que de céder à la tentation de solliciter le texte pour lui faire dire ce qui lui plaît, et, bien entendu, cette tentation est toujours grande quand il s'agit de traductions d'œuvres de philosophie ou de morale ». Il est donc raisonnable de se demander si les missionnaires et les voyageurs, par l'intermédiaire desquels nous connaissons les faits des peuples sauvages ou même seulement barbares, n'ont pas altéré le sens des termes dans leurs traductions [FN: § 695-3]. Mais enfin toute présomption, fût-elle même raisonnable et probable, doit s'effacer devant les faits. C'est donc à ceux-ci que nous demandons la solution de notre problème.
§ 696. D'abord, nous ne pouvons pas ranger parmi les phénomènes de l'animisme ceux qu'on observe chez nos enfants. Il est certain que ceux-ci parlent au chien de la maison et à leur poupée, comme si chiens et poupées pouvaient comprendre, et cela bien avant que les enfants aient les idées exprimées par les termes êtres et spirituels. Il y a plus ; même parmi les adultes, un chasseur qui tient des discours à son chien, serait ébahi, quand on lui demanderait s'il croit s'adresser à un être spirituel. En réalité, dans tous ces cas, nous avons des actions non-logiques, des expressions de certaines tendances, et non le fruit de déductions logiques [FN: § 696-1].
§ 697. Mais cela ne prouve rien quant aux sauvages ; aussi devons-nous examiner directement les faits qui se rapportent à eux. Tylor nous avertit que toutes ses recherches sont faites selon deux principes [FN: § 697-1] . « (p. 495) Les doctrines et les pratiques religieuses examinées sont d'abord considérées comme faisant partie de systèmes théologiques enfantés par la raison humaine sans l'intervention d'agents surnaturels et sans révélation, en d'autres termes, comme des développements de la religion naturelle. Ensuite, ces mêmes doctrines et ces pratiques sont considérées au point de vue des rapports existant entre les idées et les rites analogues du monde sauvage et du (p. 496) monde civilisé ».
§ 698. Le premier principe tend à résoudre a priori un problème qui ne devrait trouver sa solution que dans l'observation. Rien ne nous permet de voir, dans les doctrines et les pratiques religieuses, que le seul fruit de la raison, en excluant ainsi les actions non-logiques. Il est clair, d'autre part, que si nous les excluons a priori, nous ne pourrons les trouver ensuite dans les faits. Ce qui suit confirme cette observation. « (p. 496) Quelle idée les races inférieures se font-elles de l'âme ? Nous pouvons l'expliquer clairement, en reconstituant l'histoire du développement des doctrines animistes ». Dans ce passage, on trouve les erreurs habituelles de ce mode de raisonnement. 1° On traite de l'abstraction métaphysique âme, comme si c'était une chose réelle. Tout homme ayant des yeux voit le soleil. On peut donc chercher quelle idée il s'en fait ; – souvent cette idée est très confuse ; – mais avant de connaître l'idée qu'il se fait de l'âme, il faut savoir si, dans son esprit, quelque idée correspond vraiment à ce terme. 2° Nous voilà conduits aux reconstructions de théories des peuples sauvages, faites avec nos idées d'hommes civilisés contemporains. De cette façon, nous obtenons, non pas les théories des peuples sauvages, – si toutefois ils en ont – mais, ce qui est très différent, les théories que nous formerions si, mettant de côté certaines de nos idées, de nos connaissances, nous raisonnions avec notre logique, exclusivement sur les idées et les connaissances qui restent.
§ 699. Voici en effet comment Tylor continue : « (p. 496) L'intelligence humaine, encore à un état de culture peu avancé, semble surtout préoccupée de deux catégories de problèmes biologiques. À savoir : d'abord ce qui constitue la différence entre un corps vivant et un corps mort, la cause de la veille, du sommeil, de la catalepsie, de la maladie, de la mort. Ensuite, la nature de ces forces humaines qui apparaissent en rêve et dans les visions. Méditant sur ces deux ordres de phénomènes, les anciens philosophes sauvages doivent avoir été amenés dans le principe à cette induction toute naturelle qu'il y a dans chaque homme une vie et un fantôme. Ces deux éléments sont en étroite connexion avec le corps. La vie le rend apte à sentir, à penser, à agir ; le fantôme est son (p. 497) image, un second lui-même. Tous deux, aussi, sont nettement séparables du corps, – la vie est susceptible de s'en retirer, de le laisser insensible ou mort ; le fantôme peut apparaître à des personnes qui en sont éloignées ».
§ 700. Cette façon d'étudier les phénomènes, bien qu'un peu meilleure peut-être, part cependant toujours des mêmes principes que la manière employée par Rousseau (§ 821), qui écarte les faits pour ne se confier qu'à sa seule imagination. Il est certain que si les sauvages ont eu un Aristote, il aura pu raisonner avec cette logique rigoureuse, sur ces abstractions métaphysiques ; mais reste à savoir si cet Aristote a existé. Ajoutons qu'après avoir si bien raisonné, il faut que ces hommes en aient perdu l'habitude, puisqu'aux temps historiques, nous trouvons des raisonnements qui sont bien loin d'être aussi logiques et aussi clairs que ceux dont on gratifie leurs ancêtres sauvages.
§ 701. Nous ne chercherons pas comment les peuples sauvages ou barbares ont dû raisonner, mais bien comment ils raisonnent effectivement. Nous ne voulons pas nous écarter des faits, comme on s'en écarte dans la méthode chère à Rousseau (§ 821) et à ses disciples ; tout au contraire, nous tâchons de nous garder autant que possible de l'imagination, et de nous en tenir le plus étroitement que nous pouvons aux faits. Innombrables sont les faits démontrant que les peuples sauvages ou barbares ne sont que peu ou pas du tout portés aux raisonnements abstraits [FN: § 701-1], qu'ils sont fort éloignés de vouloir résoudre des problèmes métaphysiques ou philosophiques, ou même seulement quelque peu abstraits, et que souvent ils sont même très peu curieux.
§ 702. À propos de la tribu nègre dite des Mandingues, Mungo Park dit [FN: § 702-1] : « (p. 21) J'ai souvent demandé à quelques uns d'eux ce que devenoit le soleil pendant la nuit, et si le matin nous (p. 22) reverrions le même soleil, ou un autre que la veille. Mais je remarquai qu'ils regardoient ces questions comme très puériles. Ce sujet leur paraissoit hors de la portée de l'intelligence humaine. Ils ne s'étoient jamais permis de conjectures, ni n'avoient fait d'hypothèses à cet égard ». L'auteur dit d'autre part que « (p. 24) la croyance d'un Dieu, ainsi que celle d'un état futur de peines et de récompenses est universelle chez eux ». Mais reste à savoir si Mungo Park n'a pas un peu prêté ses idées à ces hommes, car il ajoute aussitôt des choses qui ne s'accordent pas très bien avec cette croyance. « (24) Si on leur demande (p. 25) pourquoi donc ils font des prières lorsqu'ils voient la nouvelle lune, ils répondent que l'usage en a fait une loi, et qu'ils le font parce que leurs pères l'ont fait avant eux. Tel est l'aveuglement de l'homme que n'a point éclairé la lumière de la révélation ». Puis : «(p. 25) Lorsqu'on les interroge en particulier sur leurs idées d'une vie future, ils s'en expriment avec un grand respect : mais ils tâchent d'abréger la discussion en disant mo o mo inta allo (personne ne sait rien là-dessus). Ils se contentent, disent-ils, de suivre, dans les diverses occasions de la vie, les leçons et les exemples de leurs (p. 26) ancêtres ; et lorsque ce monde ne leur offre ni jouissance, ni consolations, ils tournent des regards inquiets vers un autre, qu'ils supposent devoir être mieux assorti à leur nature, mais sur lequel ils ne se permettent ni dissertations, ni vaines conjectures ».
§ 703. Tout cela n'empêche pas qu'il y ait eu des peuples possédant une théorie de l'animisme analogue à celle mentionnée par Tylor [FN: § 703-1] ; le fait est même certain ; mais cela ne prouve pas le moins du monde, ni que ce phénomène soit l'« origine » de la religion, ni qu'il soit une forme simple de religions plus complexes.
§ 704. La réfutation que Herbert Spencer fait de l'animisme a les mêmes défauts que la théorie qu'il critique. Spencer cite [FN: § 704-1]des faits qui montrent que « (185) en nous élevant dans l'échelle animale, nous voyons que la faculté de distinguer l'animé de l'inanimé augmente. D'abord extrêmement vagues, les actes discriminatifs deviennent peu à peu plus définis ; d'abord très-généraux, ils deviennent ensuite plus spéciaux ; enfin les actes de classification deviennent moins souvent erronés. D'abord le mouvement, puis le mouvement spontané, puis le mouvement spontané adapté, tels sont les signes auxquels l'intelligence a successivement recours à mesure qu'elle progresse ».
Le fond de ces observations est vrai ; la forme est fausse ; et, malheureusement, dans la suite du raisonnement de Spencer, la forme prévaut. Ce que Spencer appelle classification est bien tel pour nous, mais pas pour les animaux qui la font.
§ 705. Revenons un instant aux expériences que nous avons rappelées, de Fabre (§ 155), sur les cerceris. Afin de pourvoir leurs larves, d'animaux encore vivants, mais paralysés, ils choisissent certaines espèces de coléoptères. Le terme choisissent appelle une explication. Si nous disons que les cerceris choisissent ces coléoptères, nous exprimons le point de vue objectif, et, en ce sens, la proposition est vraie. Mais personne n'admettrait que les cerceris connaissent nos classifications, et qu'ils choisissent ces espèces de coléoptères, comme pourrait le faire un entomologiste qui classe les insectes. Nous ignorons comment et pourquoi les cerceris choisissent ; mais il est certain que ce n'est pas de la manière rationnelle, scientifique, d'un entomologiste. On peut observer des faits semblables chez les hommes, et l'on ne doit pas confondre ces actions non-logiques avec des actions logiques, comme le sont les classifications scientifiques.
§ 706. Herbert Spencer étend les actions logiques aux animaux. Il dit [FN: § 706-1]: « (p. 184) Il y a encore un signe auquel les animaux intelligents distinguent le vivant du non-vivant : c'est l'adaptation du mouvement à ses fins. Quand un chat s'amuse d'une souris qu'il a attrapée, s'il la voit demeurer longtemps immobile, il la touche du bout de sa griffe pour la faire courir. Évidemment le chat pense qu'un être vivant qu'on dérange cherchera à s'échapper, et que ce sera pour lui un moyen de recommencer la chasse. Non seulement il s'attend à un mouvement spontané, en ce sens que c'est la souris qui le produira ; mais il s'attend à voir ce mouvement dirigé dans un sens qui éloigne la souris du danger » (§ 63).
En gros, le fait est vrai ; la façon dont il est décrit est entièrement fausse ; et l'erreur consiste à supposer que l'animal raisonne comme un homme logique [FN: § 706-2] . 1° Les animaux n'ont pas la notion abstraite du vivant et du non-vivant. Il suffit d'observer attentivement un chien pour s'en assurer. Les animaux peuvent encore moins savoir ce que sont des fins et une adaptation. 2° Rien ne nous permet de croire que le chat pense qu'un être vivant qui vient à être secoué cherche à fuir. Le chat a l'habitude de toucher avec la patte tout petit objet, et si possible de le faire bouger ; et l'on n'observe pas la moindre différence, à ce point de vue, entre un porte-plume qu'il connaît bien, par exemple, et une souris ou un insecte. Il agit très certainement comme s'il n'avait pas ces notions abstraites de vivant et de non-vivant, dont le gratifie Spencer. 3° De même, il n'a pas de notions qui correspondent aux termes abstraits indiquant un mouvement qui éloigne la souris du danger. Qui veut s'en assurer n'a qu'à prendre une boule de papier, l'attacher à un fil et la faire bouger, en l'approchant on en l'éloignant du chat. Il verra que celui-ci saute également sur la boule, qu'elle se meuve dans un sens ou dans l'autre. Laissez ensuite la boule immobile, au milieu de la chambre, et vous verrez bientôt le chat s'approcher et la toucher avec la patte, d'une manière tout à fait semblable, identique à celle dont il touche une souris ; il n'y a vraiment pas la moindre différence ; et pourtant, ici l'on ne peut dire avec Spencer qu’« un être vivant qu'on dérange cherchera à s'échapper ». Et si l'on venait à objecter qu'il croit la boule de papier vivante, cela signifierait qu'il est incapable de distinguer le vivant du non-vivant, et tout le raisonnement de Spencer tomberait. En tout cas, on voit clairement que Spencer a simplement traduit dans le langage des actions logiques, les actions non-logiques du chat. D'autres traduisent de la même façon les actions non-logiques des hommes.
§ 707. Le même Spencer passe des animaux aux hommes [FN: § 707-1] . « (p. 186) Dirons-nous que l'homme primitif est moins intelligent que les animaux inférieurs, moins intelligent que les oiseaux et les reptiles, moins même que les insectes ? À moins de cela, il faut dire que l'homme primitif distingue le vivant du non-vivant, et, si nous lui accordons plus d'intelligence qu'aux bêtes, il faut conclure qu'il le distingue mieux qu'elles ».
Cette manière de raisonner serait excellente si les actions étaient exclusivement logiques ; elle n'a pas la moindre valeur pour les actions non-logiques. Elle prouve trop ; c'est pourquoi elle ne prouve rien. Si elle était valable, elle aurait pour conséquence que l'homme, qui est certainement plus intelligent que les cerceris, doit distinguer mieux qu'eux les espèces de coléoptères dont les cerceris font leur proie. Adressez-vous si vous voulez à un homme très intelligent, même très instruit dans toutes les sciences, sauf en entomologie, et demandez-lui de vous trouver l'un de ces coléoptères. Vous verrez qu'il en est absolument incapable.
§ 708. Spencer a une autre théorie animiste, qui, développée, le conduit à un néo-évhémérisme dont le résultat est le même que celui de l'ancien ; mais la démonstration est différente. L'ancien évhémérisme possédait des preuves pseudo-historiques ; le nouveau tire ses preuves des déductions logiques de certains faits qui nous paraissent probables. Il y a quelque analogie avec l'évolution qui, dans la religion, substitue le consentement interne à l'autorité externe.
§ 709. Spencer suppose que le sauvage interprète ses rêves, le phénomène de la catalepsie et celui de la mort, avec une logique rigoureuse. Par une suite de déductions ingénieuses, le sauvage tire la conclusion qu'il existe un double de l'homme, qui peut se séparer du corps ; et il étend cette conclusion aux plantes et aux objets inanimés. Puisqu'on ne voit, dans la syncope et dans la catalepsie, qu'un état temporaire, le sauvage, raisonnant comme Spencer trouve qu'il doit raisonner, croit que la mort est aussi temporaire, ou que si elle est définitive, c'est parce que le double est trop longtemps loin du corps [FN: § 709-1] . « (p. 255) La croyance à la réanimation suppose la croyance à une vie subséquente ». Par conséquent, toujours suivant la logique, naît l'idée d'un autre monde. « (p. 294, § 114). La transition d'un séjour sur une montagne à un séjour dans le ciel, tel que les hommes primitifs conçoivent le ciel, ne présente aucune difficulté ». Et voilà le ciel peuplé de doubles d'hommes. « (p. 295, § 114) Mais,... l'origine qui fait descendre les hommes d'en haut, qui entraîne à croire que les morts vivent sur des sommets ou dans les cieux, n'est pas la seule origine possible ; il y en a une autre, qui est même probable et qui ne mène pas à la même conclusion ; au contraire, elle réserve cette demeure céleste à une race d'êtres différents à l'exclusion de toute autre ». Cette race est constituée par des « (p. 297, § 114) chefs appartenant à une race d'envahisseurs, importateurs de connaissances, de métiers, d'arts, d'engins, inconnus aux indigènes, passant pour des êtres d'un ordre supérieur, comme les hommes civilisés le sont aujourd'hui aux yeux des sauvages... ». Ces hommes se sont établis sur les sommets, près des nuages, et sont devenus des habitants du ciel, des divinités.
§ 710. L'origine des dieux connue de cette manière, nous expliquons facilement les autres phénomènes religieux [FN: § 710-1] . « (p. 437, § 162)... le culte du fétiche est le culte d'un esprit résidant dans le fétiche, ou d'un être surnaturel dérivé du fétiche... ». « (p. 443, § 164) Les sacrifices propitiatoires aux morts, d'abord origine des rites funèbres, plus tard des observances qui constituent le culte d'une manière générale, aboutissent donc, entre autres résultats différents, à l'idolâtrie et au fétichisme ».
Nous verrons plus loin (§ 793 et sv.) comment, de sa théorie, Spencer tire aussi l'explication du totémisme et des mythes analogues aux mythes solaires.
§ 711. La théorie de Spencer n'est ni meilleure ni pire que d'autres du même genre qui ont toutes le même caractère ; c'est-à-dire qu'on y prend pour prémisses certains faits supposés, mais qui sont grosso modo d'accord avec les faits observés ; puis on raisonne comme on croit que « l'homme primitif » a dû raisonner, et de ces prémisses on tire certaines conclusions. On est persuadé d'avoir ainsi découvert la façon dont certains phénomènes se sont produits, en des temps pour lesquels tout souvenir historique ou expérimental nous fait défaut.
§ 712. Dans ces théories, il y a une partie expérimentalement vraie. L'erreur consiste à passer du particulier au général, comme le ferait celui qui, ayant vu une forêt de sapins, affirmerait que toutes les forêts sont de sapins. Cette part de vérité expérimentale est notable dans le totémisme. Salomon Reinach propose d'énoncer de la façon suivante le code du totémisme [FN: § 712-1] . « (p. 17) 1° Certains animaux ne sont ni tués, ni mangés, mais les hommes en élèvent des spécimens et leur donnent des soins (p. 18.) 2° On porte le deuil d'un animal mort accidentellement et on l'enterre avec les mêmes honneurs que les membres du clan. 3° L'interdiction alimentaire ne porte quelquefois que sur une partie du corps d'un animal. 4°, Quand les animaux qu'on s'abstient de tuer ordinairement le sont sous l'empire d'une nécessité urgente, on leur adresse des excuses ou l'on s'efforce, par divers artifices, d'atténuer la violation du tabou c'est-à-dire le meurtre. (p. 19) 5° On pleure l'animal tabou après l'avoir sacrifié rituellement. (p. 20) 6° Les hommes revêtent la peau de certains animaux, en particulier dans les cérémonies religieuses; là où le totémisme existe, ces animaux sont des totems. (p. 21) 7° Les clans et les individus prennent des noms d'animaux; là où le totémisme existe, ces animaux sont des totems. (p. 22) 8° Nombre de clans font figurer des images d'animaux sur leurs enseignes et sur leurs armes ; nombre d'hommes les peignent sur leurs corps ou les y impriment par les procédés du tatouage. (p. 23) 9° Les animaux totem, lorsqu'ils sont dangereux, passent pour épargner les membres du clan totémique, mais seulement ceux qui appartiennent à ce clan par la naissance. (p. 24) 10° Les animaux totem secourent et protègent les membres du clan totémique. 11° Les animaux totem annoncent l'avenir à leurs fidèles et leur servent de guides. (p. 25-26) 12° Les membres d'un clan totémique se croient très souvent apparentés à l'animal totem par le lien d'une descendance commune ».
§ 713. Ce code est trop détaillé, trop précis [FN: § 713-1]. On représente mieux les faits, en disant que le totémisme, tel qu'il est compris par différents auteurs (§ 718-1), est un état d'esprit dans lequel on respecte, on honore, on révère certains animaux, auxquels on croit être uni par certains liens, auxquels on rend des services et dont on en attend.
§ 714. Beaucoup d'auteurs se sont occupés de ces phénomènes, et, comme il arrive habituellement, on a voulu donner un caractère général à ce qui est seulement particulier. Dans le totémisme, on a cru trouver jusqu'à l'origine de la « religion ». Partout où l'on a trouvé quelque fait, même vaguement semblable à celui du totémisme, on a cru démontrer que là existait le totémisme. Salomon Reinach cite un grand nombre de ces preuves. Frazer fait encore pire : l'allusion la plus lointaine à un animal lui suffit pour y voir le totémisme.
§ 715. Probablement sans s'en apercevoir, ces auteurs raisonnent comme le paléontologiste qui, trouvant quelques os fossiles, peut reconstituer l'animal auquel ils appartiennent. Mais les deux cas sont très différents. L'animal est certainement un être unique, dont les parties ont des liaisons nécessaires ; par exemple la dentition et l'alimentation. Il n'existe rien de semblable pour le complexe artificiel auquel on a donné le nom de totémisme. Il est impossible que la mâchoire d'un lion appartienne à un animal herbivore. Il se peut très bien que le fait d'honorer un animal ne soit pas lié à tous les autres caractères que l'on veut attribuer au totémisme.
§ 716. Comme d'habitude, voyons ce que dit l'expérience (547). Supposons que, dans un grand nombre de siècles, on n'ait que peu de renseignements, recueillis çà et là, sur la république de Florence. On constate que cette république entretenait des lions, que la rue où étaient logés ces animaux s'appelait Via dei Leoni et qu'elle conserva ce nom durant des siècles. En outre, des fouilles pratiquées à l'endroit où se trouvait la ville de Florence, ont amené la découverte de nombreux petits lions de pierre appelés marzocchi ; et l'on sait aussi que lorsque la république de Florence faisait la conquête de quelque territoire, elle y érigeait une colonne surmontée du marzocco. Quoi encore ? Il existe des légendes qui montrent que, comme le veut le code du totémisme, les lions respectaient les citoyens florentins [FN: § 716-1]. De cette façon, nous avons un faisceau de preuves bien plus importantes que celles dont se contentent les partisans du totémisme, dans des cas semblables ; et si nous devons les suivre dans leurs déductions, nous sommes forcés d'admettre que le lion a été le totem des Florentins, aux temps de leur république. Pourtant, nous sommes tout à fait certains que cela n'a pas été ; et il n'y a pas la moindre probabilité que cela ait eu lieu en des temps plus anciens, et que le marzocco ait été le totem des Florentins, aux temps de la république romaine, ou même à une époque plus reculée. Donc, si, dans ce cas, les preuves recueillies ne démontrent pas le totémisme, comment des preuves moins nombreuses, moins solides, pourraient-elles bien le démontrer, en des cas semblables ?
§ 717. On a découvert à Muri, près Berne, un groupe représentant une déesse (?) et une ourse ; rien de plus. On y voit la preuve de l'existence d'un clan totémique, dont le totem était l'ours [FN: § 717-1] . Si c'est là une preuve solide, pourquoi ne pourrions-nous pas aussi bien conclure que Venise était habitée par un clan totémique dont le totem était le lion ? C'est plus d'un seul et unique groupe, qu'on y trouve ! À Venise, on en voit beaucoup qui figurent un homme et un lion. Nous savons que l'homme est Saint Marc ; mais si nous ne le savions pas, nous pourrions le prendre pour un dieu, de même que l'image bernoise a été assimilée à celle d'une déesse ; et si celle-ci et son ourse sont la preuve d'un clan totémique, pourquoi l'image de Saint Marc et de son lion ne le serait-elle pas également ?
Si le raisonnement touchant le groupe bernois n’avait d'autre but que d'indiquer la voie à suivre dans nos recherches, on pourrait l'accepter, parce qu'en ce cas il s'appliquerait également bien à Florence et à Venise. Pour Berne, nos recherches ne peuvent être poussées plus avant, toute autre preuve faisant défaut, et nous nous arrêtons sans rien conclure. Pour Florence et Venise, il existe des preuves historiques; et nous allons de l'avant, jusqu'à conclure qu'il n'y a pas trace de totémisme.
§ 718. Tel qu'il est entendu par plus d'un auteur [FN: § 718-1] , le totémisme possède plusieurs caractères : A, B, C, D,... Nous venons de voir que si A se trouve chez un certain peuple, on ne peut conclure que B, C, D,... existent aussi... Vice-versa, si A n'existe pas, on ne peut conclure que B, C, D n'existent pas non plus.
§ 719. Cette considération enlève toute efficacité à certaines critiques que Foucart adresse au totémisme. Par exemple. il observe que [FN:§ 719-1] « (p. 72) tous les membres de la tribu indienne se disent descendants et parents de l'animal totem. Seul le (p. 73) chef égyptien est le descendant du dieu animal. Le Pharaon de l'époque historique est le seul qui soit le fils de l'Épervier, qui porte son nom, et qui, en cette qualité, soit l'héritier du royaume de l'Épervier et le prêtre de l'Épervier. Le reste des hommes de la nation ne sont pas et ne prétendent pas être Éperviers ». On pourrait objecter que les chefs ont peut-être usurpé et se sont approprié exclusivement ce qui jadis était à tous. Mais même si l'on néglige cette observation, et toute autre semblable, la critique de Foucart prouverait seulement qu'il existe une variété de totémisme, qui a le caractère indiqué par lui ; tandis qu'elle ne prouve rien contre le totémisme en général. Pour qu'elle puisse prouver quelque chose dans ce sens, il faudrait que le totémisme fût un corps indivisible. Nous pouvons répéter cela pour d'autres critiques. En somme, Foucart a démontré que le code totémique de Salomon Reinach ne s'appliquait pas à l'Égypte, telle que nous la connaissons ; mais il n'a pas du tout démontré que les Égyptiens n'ont pas eu avec les animaux, des rapports semblables à ceux que le totémisme nous a fait connaître.
On peut faire des observations semblables au sujet de la théorie qui voit dans la magie l'origine de la religion.
§ 720. (B -β 3) Les faits historiques sont des déviations d'un type ou constituent une série ayant une limite [FN: § 720-1] . Souvent, pour les auteurs de ces théories, elles ont un principe supérieur à l'expérience, et devraient par conséquent prendre place dans le genre (γ) de la Ie classe ; mais elles sont exposées uniquement comme des théories expérimentales, et rentrent donc dans ce genre [FN: § 720-2].
§ 721. Nous avons l'hypothèse d'un état primitif de perfection religieuse. Cette perfection se retrouve dans une des religions contemporaines, qui est naturellement la vraie religion. Les autres, que l'histoire nous fait connaître, sont des déviations corrompues du type. Nous avons aussi l'hypothèse contraire. Les diverses religions historiques sont des tentatives imparfaites, qui approchent peu à peu de la perfection. Cette perfection est au terme dont nous nous approchons avec les déviations. Dans l'hypothèse précédente, elle était à l'origine, et les déviations nous éloignaient de la perfection. Les controverses touchant un état primitif de perfection religieuse importent surtout pour l'attaque et la défense des religions juive et chrétienne ; elles sont donc en partie étrangères au domaine de la sociologie.
§ 722. Pendant de longs siècles, en Europe, cet état de perfection était un dogme que l'on ne pouvait mettre en doute sans danger. Puis est venue la réaction ; et à ce dogme on en a substitué un autre, qui n'est pas encore imposé directement par le bras séculier, et qui place l'état de perfection au terme de l'évolution.
§ 723. Nous devons rester étrangers à cette controverse, et nous tenir exclusivement dans le domaine de la science expérimentale. Celui qui a la foi peut aussi rester dans ce domaine, pourvu qu'il veuille séparer la foi de l'expérience. C’est du moins ce que le P. Marie-Joseph Lagrange affirme vouloir faire dans son livre : Études sur les religions sémitiques ; et c'est ce que n'affirment ni ne font certains sectaires du dieu Progrès, comme MM. Aulard, Bayet et Cie [FN: § 723-1].
§ 724. Si nous voulons nous en tenir exclusivement aux faits, nous verrons que le phénomène n'est pas uniformément croissant, ab, ou décroissant, mais qu'il suit une ligne ondulée p q r s t, qui tantôt monte, tantôt descend.
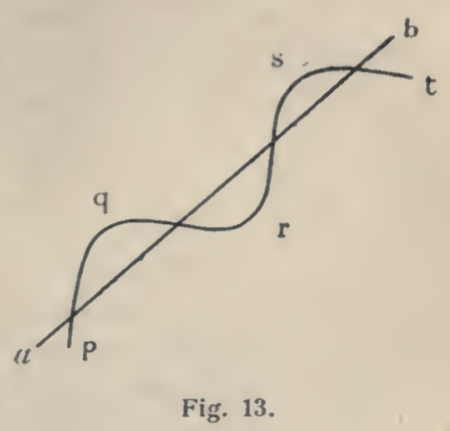
Figure 13.
§ 725. Les mythologies d'Hésiode et d'Homère sont certainement moins abstraites, moins subtiles que la religion de Platon, laquelle l'est encore plus que celle de l'Évangile et des premiers Pères de l'Église. Il parait probable que la Grèce ancienne, après une période archaïque de civilisation, a eu un moyen-âge, suivi d'une renaissance ; et l'on a ainsi un phénomène analogue à celui qui s'est produit en Europe, depuis les temps de la république romaine jusqu'aux nôtres.
§ 726. L'étude de la religion égyptienne paraît conduire aussi à des résultats semblables. Elle nous révèle plusieurs oscillations. Étudiant la dernière religion de l'ancienne Égypte, Erman dit [FN: § 726-1]: « (p. 238) Qui a suivi jusqu'à ce moment le développement de la religion égyptienne pourrait penser qu'elle marchait à sa complète dissolution et à une fin rapide. Le peuple égyptien, épuisé dans ses forces et semblant se survivre, était devenu une proie pour les conquérants étrangers. Et cependant, ce peuple vieillard se releva encore une fois et sa religion reprit avec lui une vie nouvelle, sinon une nouvelle jeunesse. Vers la fin du huitième siècle, nous rencontrons ce symptôme remarquable d'une envolée vers les idées du peuple... (p. 239) À ce retour vers l'ancien esprit égyptien, la religion gagna elle aussi une nouvelle force, et plus que jamais elle pénétra l'existence entière du peuple, comme si elle était l'unique objet de cette vie... (p. 239) Mais justement, c'est au milieu de ces dispositions que le côté étrange de la foi égyptienne, tel que la vénération des (p. 240) animaux prend son développement le plus excessif ».
§ 727. Si l'on raisonnait a priori, on serait porté à croire que l'adoration des animaux a commencé par comprendre toute l'espèce, puis s'est restreinte. Au contraire, du moins pour l'une des oscillations que l'on a pu observer, l'adoration d'un animal s'est étendue à tous les autres animaux de la même espèce. Prenons garde, d'autre part, que cela ne démontre pas le moins du monde que cette oscillation n'ait pas été précédée d'une autre en sens contraire.
§ 728. La théorie qui place la perfection au terme de l'évolution est généralement unie à une autre, que nous avons souvent rappelée, et suivant laquelle les sauvages contemporains sont très semblables aux ancêtres préhistoriques des peuples civilisés (§ 291). De cette manière, on a deux points fixes, pour déterminer la ligne de l'évolution; et, en la prolongeant suffisamment, on obtient, ou l'on croit obtenir, la limite [FN: § 728-1]dont l'évolution s'approchera désormais.
§ 729. Par exemple, Spencer veut s'opposer à la théorie qui attribue le culte des ancêtres aux races inférieures. Il objecte [FN: § 729-1]qu'il est étrange que « (p. 401) les partisans de la doctrine évolutionniste admettent et même affirment une différence aussi profonde entre les esprits des diverses races humaines ». « Ceux qui croient que la création est une œuvre de mains peuvent sans contradiction admettre que les Aryens et les Sémites ont été dotés par voie surnaturelle de conceptions plus élevées que celles des Touraniens : si les espèces animales (p. 402) ont été créées avec des différences fondamentales, pourquoi n'en serait-il pas de même des variétés humaines ? Mais il faut une inconséquence rare pour affirmer que le type humain est sorti par évolution des types inférieurs, et pour nier ensuite que les races humaines supérieures soient sorties par évolution, mentale aussi bien que physique, des races inférieures, et qu'elles aient dû posséder jadis les conceptions générales que les races inférieures possèdent encore ».
§ 730. C'est là un raisonnement suivant la métaphysique et non suivant la science expérimentale. D'abord, on ne peut enfermer les rapports des faits présents et des faits passés, dans le dilemme : ou création ou évolution unique (§ 344). Puis, en admettant même pour un instant la doctrine de l'évolution unique, il n'est pas prouvé que les races inférieures contemporaines soient identiques à nos ancêtres préhistoriques ; au contraire, il est plutôt probable qu'elles en diffèrent beaucoup, ne serait-ce que pour la raison qu'elles manquent de ces dispositions qui ont produit la civilisation de nos races. Il n'y a pas de preuve non plus que l'évolution mentale doive être parallèle à l'évolution physique. Enfin, même si elle lui était parallèle, pourquoi l'évolution mentale n'aurait-elle pas pu, d'un tronc commun M, pousser deux branches A et B, dont l'une aurait abouti au culte des ancêtres, et l'autre à une croyance différente ? Une évolution semblable a certainement eu lieu pour le physique, si l'on admet un tronc commun M, puisque nous avons maintenant au moins les trois branches des races blanche, noire et rouge.
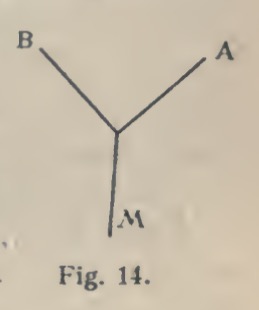
Figure 14
§ 731. La théorie suivant laquelle les sauvages contemporains sont identiques ou au moins semblables aux ancêtres préhistoriques des peuples civilisés, rencontre maintenant beaucoup de contradicteurs [FN: § 731-1]. Mais, comme il arrive généralement, on est allé d'un extrême à l'autre, en affirmant que les sauvages représentent la sénilité des races humaines, plutôt que leur enfance. On voit ici l'effet de la croyance qui place l'état parfait au commencement de l'« évolution », au lieu de le placer à la fin. Mais les faits échappent à ces idées a priori. Si, pour les anciens Gaulois d'avant la conquête romaine, on ne veut d'autres points de comparaison que les sauvages, ou les Français contemporains, il est manifeste qu'ils se rapprochent plus du premier terme de comparaison que du second ; et l'on ne peut admettre que les sauvages contemporains s'éloignent plus que les anciens Gaulois, de nos Français contemporains.
§ 732. La « série historique » des saint-simoniens [FN: § 732-1], quand on l'envisage au point de vue de la démonstration expérimentale qu’ils croient pouvoir en donner, appartient à ce genre, de même aussi la théorie des trois états de A. Comte. Ajoutons-y la théorie de la prémorale, de Herbert Spencer. Il veut tirer la morale de l'expérience, et tombe sur des faits qui ne s'accordent pas avec ses idées. Pour les exclure, il dit qu'ils n'appartiennent pas à la morale, mais à la prémorale.
§ 733. (B-β 4) Les mythes, etc., sont des imitations d'autres mythes semblables. D'après ce principe, partout où l'on rencontre deux institutions semblables, on admet que l'une est la copie de l'autre. Ici aussi l'erreur consiste seulement à vouloir généraliser un fait qui est tout à fait vrai dans des cas particuliers, et à dépasser ainsi l'expérience.
§ 734. Comme d'habitude, employons la méthode indiquée au § 547. Nous avons des exemples remarquables d'institution, presque identiques, et qui ne paraissent vraiment pas avoir été copiées l'une de l'autre. Pétrone décrit de la façon suivante une coutume de Marseille [FN: § 734-1]: « Quand les Marseillais étaient affligés de la peste, un pauvre s'offrait pour être entretenu, durant une année entière, par les deniers publics et avec les meilleurs mets. Puis, orné de verveine et couvert de vêtements sacrés, on le portait par toute la ville, accompagné de malédictions, afin que tous les maux de la ville retombassent sur lui ; enfin il était jeté [dans la mer] ».
§ 735. Au Mexique, les Aztèques avaient chaque année une cérémonie semblable. Ils choisissaient un jeune homme parmi les prisonniers. (p. 125) Désigné pour mourir une année à l'avance, ce jeune homme, à dater de ce jour, portait les mêmes vêtements que l'idole [du dieu Tezcatlipoca.] Il parcourait la ville à son gré, mais toujours escorté de gardes, et on l'adorait comme l'image de la divinité suprême. Vingt jours avant la fête, on mariait ce malheureux à quatre jeunes filles et, durant les cinq derniers jours, on lui procurait tous les plaisirs possibles. Le matin de la fête, on le conduisait au temple en grande pompe, et, un instant avant d'y arriver, il adressait ses adieux à (p. 126) ses femmes. Il accompagnait l'idole dans la procession... ; puis, l'heure du sacrifice venue, on l'étendait devant l'autel, où le grand prêtre, avec des façons respectueuses, lui ouvrait la poitrine et lui arrachait le cœur [FN: § 735 note 1)] ».
§ 736. L'idée commune d'une année entière de délices, suivie de la mort, n'a pas été transmise des Marseillais aux anciens Mexicains ou vice versa ; elle est née spontanément aux deux endroits. Cette même idée fait partie d'une autre, plus générale, qui plaît beaucoup aux hommes ; c'est le désir de combiner des choses contraires, opposées (§ 910 et sv.). De là partent une infinité de branches qui, d'une origine commune, aboutissent à divers phénomènes concrets.
§ 737. Frazer puis Reinach remarquèrent l'une de ces branches, laquelle, à son tour, se divise en d'autres [FN: § 737-1] . Reinach commence par rappeler « (p. 332) une coutume périodique analogue à celle des Saturnales romaines et caractérisée par la suspension momentanée des lois civiles et morales... Leur trait caractéristique [des Saturnales] était la licence permise aux esclaves, qui devenaient pour un temps les maîtres de la maison ». Voilà le contraste. Au moyen âge, nous aurons un autre contraste analogue mais non identique, dans la fête des fous [FN: § 737-2]. « (p. 333) En province, les choses se passaient de même, mais avec des traits, si l'on peut dire, plus archaïques [cela peut être ; mais Reinach ne donne aucune preuve de cet archaïsme]. Nous connaissons les détails de la fête des Saturnales dans une troupe de soldats romains campés sur le Danube, à Durostolum, sous les règnes de Maximien et de Dioclétien ; ils se sont conservés dans une relation du martyre de saint Dasius, publiée en 1897, d'après un manuscrit grec de la Bibliothèque Nationale, par M. Cumont [cette source est peut-être un peu suspecte ; dans les actes des martyrs, il y a souvent plus de foi que de vérité historique].
Trente jours avant la fête, les soldats désignaient au sort un beau jeune homme qu'ils habillaient en roi et qui, censé représenter le bon roi Saturne, paradait entouré d'une brillante escorte, avec le droit d'user et d'abuser de sa puissance. Le trentième jour, on l'obligeait à se tuer sur l'autel du Dieu Saturne qu'il personnifiait... Le roi des Saturnales à Rome n'est plus, à l'époque classique, qu'un roi de théâtre, un pître inoffensif; mais l'histoire de saint Dasius paraît prouver qu'à une époque plus ancienne ce roi perdait la vie avec la couronne... ». Et voilà l'erreur habituelle, de vouloir que l'évolution puisse se faire seulement suivant une ligne continue (§ 344). À supposer que le fait de saint Dasius soit vrai, pourquoi donc ce fait, arrivé après l'institution des Saturnales, à Rome, doit-il représenter un fait arrivé avant, et dont les Saturnales seraient la conséquence ? Et dans cette ligne continue, où plaçons-nous le fait des Mexicains ? Il est plus probable que celui-ci, le fait de Marseille et d'autres analogues, sont comme les extrémités A, B, C, D..., de branches qui divergent d'un tronc commun T, et parmi lesquelles il peut s'en trouver, comme les Saturnales E et la fête des fous F, qui donnent effectivement une évolution en ligne continue.
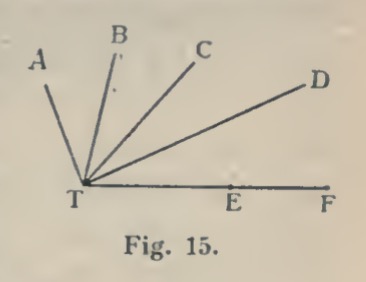
Figure 15
Reinach ajoute : « (p. 334) Des coutumes analogues aux Saturnales romaines existaient en Crète, à Thessalie, à Olympie, à Rhodes et ailleurs... Plus singulière encore était la fête des Sacaea, qui durait cinq jours à Babylone. Comme à Rome, les esclaves y devenaient les maîtres et, dans chaque maison, un esclave habillé en roi et portant le titre de Zoganes exerçait un éphémère pouvoir. En outre un condamné était habillé en roi et autorisé à se conduire en conséquence, jusqu'au point d'user des concubines royales ; à la fin de la fête, il était dépouillé de ses beaux vêtements, flagellé et pendu ou crucifié ». Puis Reinach remarque aussi la ressemblance de ces faits avec le récit d'Esther, avec celui d'une autre fête qu'on célébrait en Perse, et y ajoute ensuite le récit d'un fait historique, arrivé à Alexandrie, et raconté par Philon. De ces ressemblances, étendues au récit de la Passion du Christ, Reinach tire argument pour considérer ce récit comme mythique [FN: § 737-3].
§ 738. Il aurait pu étendre beaucoup plus les analogies qu'il avait remarquées, et aurait facilement trouvé une grande quantité de faits, de récits, de légendes, où l'on oppose le comble du bonheur au comble de la misère ; ou bien dans lesquels, par ironie ou pour un autre motif, on attribue des insignes de puissance au misérable, ou vice versa. La littérature de tous les pays puise largement à cette source ; et, sans se préoccuper de faits réels, elle nous donne, autant que nous voulons, des fables et des nouvelles. On pourrait, par exemple, citer le récit des Mille et une nuits, suivant lequel le pauvre Aboul-Hassân jouit, un jour, de tous les délices qui sont l'apanage du souverain, puis est bâtonné le lendemain, comme s'il était fou [FN: § 738-1]. Dans les romans grecs, on trouve habituellement une trame tissée dans le but de provoquer ce sentiment de contraste ; elle servit à Boccace pour les nouvelles de la cinquième journée, dans lesquelles « on traite de ce qui advint heureusement à un amant, après quelques graves et fâcheux accidents ».
Traitant des faits cités par Reinach, le P. Lagrange [FN: § 1]a très bien vu que les Sacées et autres fêtes analogues peuvent avoir des origines communes, mais qu'elles n'ont pas de rapport direct qui, par imitation ou autrement, fasse venir l'une de l'autre.
§ 739. Jusqu'ici, ce sont des produits de l'imagination. Mais les hommes aiment à placer le plus possible leurs fables dans la réalité, même sous de vaines apparences ; aussi a-t-on tiré de ces fictions diverses représentations théâtrales, toujours inoffensives à notre époque, mais qui, dans la Rome ancienne [FN: § 739-1], infligèrent parfois des souffrances réelles aux acteurs, et firent couler le sang. On prend ici sur le fait la transformation en actes de ce sentiment qui pousse à vouloir les contrastes, et qui donne naissance tant aux représentations sanglantes de Rome qu'à celles du Mexique.
§ 740. Tous ces récits, toutes ces représentations de faits ou ces faits eux-mêmes ont un noyau commun. C’est un autre exemple d'un phénomène dont nous avons déjà traité à propos de la faculté de produire ou d'éloigner les tempêtes (§ 186 et sv.), et qu'au chapitre suivant nous verrons être général. Nous retrouverons alors le noyau remarqué ici (§ 913 et sv.). Mais les récits, les représentations, les faits dans lesquels existe un caractère commun, ont aussi d'autres caractères qui les rendent différents et leur font constituer diverses catégories. On peut, par conséquent, les séparer en plusieurs genres, et cela de plusieurs manières, suivant le critère qu'on choisit pour la classification.
§ 741. La réalité peut être un premier critère. Nous placerons donc les simples fictions, comme les nouvelles de Boccace, dans une catégorie (a). Une autre catégorie, (b), contiendra les représentations scéniques de fictions. Nous y mettrons les tragédies, les drames, où l'on n'accomplit pas pour de vrai le fait d'Alexandrie raconté par Philon, la fête des fous, etc. Il y aura une catégorie (c), où la représentation est mêlée de réalité, où elle se fait pour de bon. Nous y mettrons, d'une part, les Saturnales, et d'autre part, les représentations sanglantes du cirque romain. Enfin viendra une catégorie (d), où la réalité est complète et où le sentiment des contrastes donne seul la forme. Nous y mettrons les faits de Marseille et du Mexique.
Le critère peut être tout autre ; c'est-à-dire qu'on peut considérer jusqu'où le contraste est poussé. Nous aurons ainsi une catégorie (1), dans laquelle le contraste consiste seulement à attribuer aux hommes ou aux choses des caractères qui ne jurent pas avec la réalité. Dans cette catégorie figureront le fait d'Alexandrie, la fête des fous, un très grand nombre de récits où le niais se montre homme d'esprit, ou vice versa, etc. (§ 668-3, 737-2). Dans une autre catégorie, (2), le contraste est poussé à l'extrême : un état heureux est suivi du pire malheur, ou vice versa. Les tragédies grecques renferment des parties importantes qui appartiennent à cette catégorie ; et c'est surtout la puissance de ce sentiment de contraste qui leur donne le sublime. Dans cette catégorie, nous placerons aussi les faits de Marseille et du Mexique. Au fond, le sentiment de contraste, qui naît de la vue du puissant et glorieux Agamemnon tombant sous la hache de Clytemnestre, n'est pas très différent du sentiment qu'on éprouve du fait d'un jeune homme qui est tué, après avoir joui, durant une année, de tous les plaisirs de la vie. On pourrait choisir d'autres critères, qui donneraient d'autres classifications, toujours au point de vue des sentiments ou des actions non-logiques.
D'autres points de vue, tels que ceux des actions logiques ou de la réalité expérimentale, nous transporteraient dans un tout autre domaine et sépareraient entièrement les objets qui, au point de vue des actions non-logiques, font partie d'une même catégorie. Par exemple, la tragédie d'Agamemnon et le fait du Mexique devraient se trouver dans des classes différentes.
§ 742. Dans les faits concrets, on peut trouver des mélanges de ces types. En outre, d'autres sentiments, certaines déductions logiques, des ornements de rhétorique, etc., s'y ajoutent (chap. VI et VII). Nous ne nous en occupons pas pour le moment ; nous voulions seulement donner un exemple des branches nombreuses et variées qui se séparent du tronc d'un même sentiment.
§ 743. En attendant, on voit, et l'on verra mieux par de nouveaux exemples (§ 746 à 763), qu'il n'y a que peu de chose ou rien à inférer de la similitude de certains faits, en ce sens que l'un serait imité d'un autre, ou qu'il tirerait son origine d'une autre transformation directe ; et l'on ne peut pas traiter d'artificielle ou de mythique la ressemblance de ces faits : elle peut fort bien être réelle, reproduisant ainsi le sentiment dont elle a pris naissance [FN: § 743-1].
§ 744. C'est pourquoi le P. Lagrange a raison de rejeter le raisonnement par lequel Salomon Reinach voudrait prouver que le récit évangélique de la Passion du Christ est une simple reproduction d'une légende ou d'un rite païen [FN: § 744-1]. Il cite divers faits de malheureux auxquels on accordait des plaisirs et l'on faisait fête, pour les maltraiter ensuite. L'un de ces faits, celui d'Alexandrie, raconté par Philon, doit être exclu ; car il ne fait pas partie des catégories (c) et (d) (§ 741) dont Reinach se prévaut, pour démontrer que le récit de la Passion du Christ est un mythe imité de fêtes existantes. Ceux qui restent prouvent bien peu de chose ; ils ne prouvent même rien, si ce n'est que dans la Passion du Christ se manifeste le sentiment de contraste, qui apparaît dans une infinité d'autres faits (§ 913 et sv.).
Si le raisonnement de Reinach était solide, pourquoi justement le récit de la Passion du Christ serait-il seul imité des autres récits, et pourquoi une partie de ceux-ci ne seraient-ils pas également imités d'autres récits ? Ensuite, si tous les faits où apparaît le sentiment de contraste, manifesté dans les Sacées ou en d'autres cérémonies analogues, devaient être considérés comme mythiques, il resterait en vérité peu de réel dans une grande partie de l'histoire. Je n'entends nullement résoudre ici le problème de la vérité de tous ces faits ; je dis seulement que, de leur ressemblance, on ne peut rien déduire pour nier la vérité d'une partie d'entre eux et pour l'accorder à d'autres.
§ 745. On peut apporter beaucoup d'autres exemples d'institutions semblables, bien que non imitées l'une de l'autre. Hérodote rappelle une fête des lanternes, en Égypte [FN: § 745-1], qui ressemble à une fête chinoise, et que nous pouvons trouver semblable à celle des rificolone, à Florence. Il est certain qu'entre elles n'existe pas le rapport d'une imitation.
§ 746. L'institution des Virgines Vestales, à Rome, est parfaitement semblable à celle des Vierges du Soleil, au Pérou. À Rome, le pontifex maximus choisissait les Vestales. Au Pérou, un rôle semblable était rempli par une femme, qui était chef de ces vierges. À Rome et au Pérou, les vierges ainsi choisies conservaient le feu sacré et devaient observer une chasteté très stricte. Si elles y manquaient, elles étaient ensevelies vivantes. Naturellement, ceux qui expliquent tout par la logique savaient et savent le pourquoi de ce genre de supplice, comme aussi de tout autre détail de ces deux institutions.
§ 747. D'abord, pourquoi élisait-on des vierges ? On a donné plusieurs explications, parmi lesquelles nous pouvons choisir à volonté. Denys d'Halicarnasse nous dit que Numa éleva un temple à Vesta et qu'il y confia le culte à des vierges, suivant l'usage des Latins. « Quelques difficultés surgissent à propos de ce qu'on garde dans le temple, et sur la raison pour laquelle le soin en est confié à des vierges. D'aucuns disent qu'on ne garde autre chose que le feu qui est visible à tout le monde, et que la garde en est confiée à des vierges plutôt qu'à des hommes, à cause de la ressemblance ; parce que le feu est sans tache, comme la vierge est pure, et qu'au plus chaste des dieux la chose la plus pure des mortels est agréable [FN: § 747-1]».
Ovide (§ 747 note 2) pose la question : « Pourquoi la déesse a-t-elle des vierges comme ministres de son culte ? » et il répond que c'est parce que Vesta est vierge. « Qu'y a-t-il d'étrange à ce qu'une vierge veuille des vierges pour la servir et accomplir avec des mains chastes les cérémonies du culte ? Tu ne dois voir en Vesta qu'une flamme vive, et tu n'as jamais vu un corps naître de la flamme. Il est donc juste que celle qui ne produit ni ne reçoit aucune semence soit vierge, et qu'elle ait des compagnes de virginité ».
Cicéron est plus pratique [FN: § 747-3]. « Que des vierges accomplissent son culte [de Vesta], afin qu'elles veillent plus facilement à la garde du feu, et que les femmes sentent toute la chasteté que leur nature peut supporter ».
Plutarque a des explications en abondance. Dans Numa [FN: § 747-4] , il nous dit que ce roi confia aux Vestales la garde du feu immortel, « (5) soit parce qu'il voulait donner la garde de la nature pure et incorruptible du feu à des corps intacts et purs, soit parce qu'il estimait la stérilité et l'infécondité du feu en accord avec la virginité [FN: § 747-5]». Puis dans Camille [FN: § 747-6] , voici apparaître d'autres explications ; et l'on nous dit (3) que le roi Numa institua le culte du feu parce qu'il est le principe de toute chose, et qu'il est l'image de la puissance éternelle qui gouverne tout. D'autres disent (6) que les Romains, comme les Grecs, font brûler le feu devant les choses sacrées, à cause de sa pureté.
§ 748. Mais le fait de la virginité des Vestales est loin d'être unique, et toutes ces explications logiques tombent d'elles-mêmes. Un courant de sentiment – non pas de logique – se fait sentir depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, mettant en rapport la virginité et le service des dieux ou de Dieu. La Pythie devait être vierge. Il va sans dire que les explications logiques ne manquent pas ; quand font-elles jamais défaut ? Loin de manquer, pour un seul fait il y en a plusieurs ; toutes bonnes, voire excellentes, il s'entend. « On dit qu'autrefois les prophétesses étaient vierges, à cause de leur nature sans tache et de leur ressemblance avec Artémis [qui était vierge], et parce qu'elles étaient aptes à garder le secret des oracles [FN: § 748-1]». Mais un Thessalien du nom d'Echécrate ayant enlevé et violé une Pythie dont il s'était épris, les habitants de Delphes firent une loi par laquelle, au lieu d'une vierge, c'était une femme de plus de cinquante ans qui devait être prophétesse. Mais il paraît que plus tard on recommença à donner cet emploi à de jeunes femmes. Tel est du moins ce qu'on peut déduire d'un passage de Plutarque [FN: § 748-2].
§ 749. Au temps de Pausanias, il y avait, sur les confins du pays des Orchomènes, dans les environs de Mantinée, un temple d'Artémis Imnia. Une jeune vierge était autrefois prêtresse de ce temple. Un certain Aristocrate, qui est quelque peu légendaire, viola cette vierge, qui s'était réfugiée dans le temple, auprès d'Artémis. Les Arcadiens le lapidèrent, et fixèrent ensuite comme loi qu' [FN: § 749-1]« au lieu d'une vierge, ils donnaient pour prêtresse à Artémis une femme qui avait eu des rapports avec des hommes ».
§ 750. Un autre temple d'Artémis Imnia avait un prêtre et une prêtresse qui devaient vivre dans la chasteté. Semblable était le devoir de ceux qui, à Éphèse, présidaient aux cènes, dans le temple d'Artémis ; mais ils ne restaient en charge qu'un an [FN: § 750-1] . Dans le temple de la Terre, près du fleuve Cratès, il y avait une femme qui devait avoir eu des rapports avec un seul homme, avant d'être nommée prêtresse, puis n'en devait plus connaître aucun [FN: § 750-2] .
§ 751. Au contraire, d'autres prêtresses restaient dans le temple tant qu'elles étaient vierges [FN: § 751-1] , et cessaient d'être prêtresses quand elles se mariaient. Plus prudents étaient les Tégéens, qui donnaient à Athéna une prêtresse qui gardait cet emploi seulement jusqu'à l'âge de la puberté [FN: § 751-2]. À Athènes, la femme de l'archonte-roi devait avoir été épousée par lui, vierge [FN: § 751-3] . On sait que chez les Israélites, le prêtre devait épouser une vierge [FN: § 751-4] .
§ 752. La virginité n'était pas la seule qualité exigée d'une Vestale il fallait encore qu'elle n'eût pas de défauts corporels, qu'elle ne fût ni sourde ni muette. À l'âge où elle était prise par le pontife pour le service de Vesta, elle devait avoir son père et sa mère vivants, ou, comme disaient les Latins, être matrima et patrima ; elle devait être de famille honorable, etc. [FN: § 752-1] De même, les victimes offertes aux dieux devaient être parfaites. Ce sentiment de la perfection des personnes et des choses mises au service des dieux, ou qui leur sont offertes, persiste depuis l'antiquité jusqu'à nos jours [FN: § 752-2].
§ 753. Il est tout à fait manifeste que ce n'est pas dans cette variété d'explications logiques que nous devons chercher la cause de ces faits, et que nous la trouverons uniquement si nous dirigeons nos recherches vers certains sentiments, dont les dits faits tirent origine, de même que les explications qu'on en donne.
§ 754. Passons maintenant au fait du supplice identique pour les Vestales, à Rome, et pour les Vierges du Soleil, au Pérou, qui étaient ensevelies vivantes si elles manquaient à leur vœu de chasteté. À Rome, on portait la Vestale coupable [FN: § 754-1]« (p. 28) dans une bière au campus sceleratus à (p. 29) la porte Colline ; là on la fustigeait, puis on l'enterrait toute vivante, sans oser la tuer, parce qu'on regardait comme un nefas de faire périr d'une mort violente une personne vouée à la divinité ».
Si cette explication ne vous satisfait pas, en voici une autre : on brûle les morts. Ne serait-il pas injuste de brûler celle qui n'a pas bien gardé le feu ? [FN: § 754-2]En voulez-vous une autre ? On remettait la coupable aux dieux, en leur laissant le soin de la châtier.
§ 755. Si vous n'êtes pas encore satisfaits, nous trouverons autre chose. A. Réville a découvert l'explication suivante, qui peut servir pour Rome et pour le Pérou [FN: § 755 note 1)].
« N'est-il pas étonnant que le supplice réservé [au Pérou] à celles qui le violaient [le vœu de chasteté] fût exactement le même que celui qui punissait à Rome la vestale impudique ! Elles étaient enterrées vivantes. Cette ressemblance tient à ce que dans les deux pays la coupable était considérée comme odieuse désormais aux divinités du jour, de la lumière; elle avait provoqué leur colère, il ne fallait pas continuer à leur infliger la vue d'un être digne de tous leurs ressentiments, elle ne pouvait plus qu'être vouée aux dieux souterrains de l'obscurité, de la mort, dont elle était devenue la servante ».
§ 756. Les Romains avaient d'autres motifs pour punir les Vestales. Il paraît qu'ils cherchaient principalement à éviter des malheurs qui les menaçaient. « Plusieurs indices apparaissent – dit Denys d'Halicarnasse [FN: § 756-1]– quand le service divin n'a pas été régulier ; principalement l'extinction du feu ; chose que les Romains craignent plus que tout autre malheur, parce que, quelle qu'en soit la cause, ils croient que c'est un présage de ruine pour la ville ».
§ 757. On raconte [FN: § 757-1] – histoire ou légende, peu importe – que vers l'an 481 av. J.-C., des prodiges manifestèrent, à Rome, la colère des dieux. On découvrit alors que la Vestale Opimia n'était plus vierge. Elle fut enterrée vive. Ensuite, les sacrifices redevinrent favorables, et la colère divine fut apaisée.
À une autre époque, légendaire aussi, soit en l'an 470 av. J.-C., une maladie fit mourir un grand nombre de femmes, à Rome [FN: § 757-2] . On ne savait à quel remède recourir, quand un esclave informa les pontifes que la Vestale Urbinia n'était plus vierge, et qu'elle offrait des sacrifices pour la ville avec des mains impures. Cette Vestale fut ensevelie vivante. L'un de ses amants se tua, l'autre fut tué. «L'épidémie des femmes et les morts fréquentes cessèrent aussitôt que ces choses furent faites ».
§ 758. En des temps historiques, c'est-à-dire après la défaite de Cannes, on vit des prodiges effrayants [FN: § 758-1] . Les Romains furent atterrés par le fait que, dans l'année, « deux Vestales, Opimia et Floromia, avaient été convaincues d'avoir transgressé leur vœu de chasteté. L'une avait été ensevelie vivante, suivant l'usage, près de la porte Colline ; l'autre s'était donné la mort ». Leurs amants furent frappés de verges jusqu'à la mort. Tout cela ne suffit pas pour dissiper la terreur. Alors on ouvrit les livres sybillins, qui prescrivirent des sacrifices extraordinaires. « Un homme et une femme gaulois, un homme et une femme grecs furent ensevelis vivants au forum boarium, en un lieu entouré de pierres, où avaient eu lieu d'autres sacrifices humains ; ce qui est indigne de la religion romaine ».
§ 759. Ici, il n'y a pas à dire que ces êtres humains, Gaulois et Grecs, aient été ensevelis vivants parce qu'ils étaient considérés comme odieux aux divinités du jour, de la lumière. Nous voyons la nature des actions non-logiques, qui se manifestent par ces sacrifices et par ceux des Vestales. C'est l'instinct de conservation, qui veut unir des remèdes extrêmes à des maux extrêmes (§ 929 et sv.). C'est le même instinct qui pousse à sacrifier des êtres humains, pour le succès d'opérations magiques (§ 931).
§ 760. La Vestale était ensevelie dans une petite cellule, avec très peu de provisions, soit un peu de pain, d'eau, de lait et d'huile [FN: § 760-1] . Ce genre de mort n'était pas propre uniquement aux Vestales coupables. Nous le trouvons cité dans une tragédie de Sophocle [FN: § 760-2] . Certaines traditions veulent que le genre de mort des Vestales coupables n'ait pas toujours été le même. Suivant Zonara [FN: § 760-3] , ce serait Tarquin l'Ancien qui aurait prescrit de les ensevelir vivantes.
§ 761. Sous l'empire, les lois anciennes ne furent pas toujours observées. Suétone raconte de Domitien [FN: § 761-1]: « Il réprima par des peines diverses et sévères, d'abord par la peine capitale, puis par le supplice selon l'usage ancien, les incestes des vierges Vestales, négligés par son père et son frère ». Il permit aux sœurs Ocellata et à Varronilla aussi, de choisir le genre de leur mort, et il exila leurs complices. La grande Vestale Cornelia, naguère acquittée, ayant été accusée à nouveau et convaincue, il la fit enterrer vive, et fit battre de verges, jusqu'à la mort, ses complices, à l'exception d'un ancien préteur, contre lequel manquaient les preuves, et qui fut exilé. Caracalla fit aussi enterrer vives des Vestales [FN: § 761-2] .
§ 762. On peut remarquer comme une coïncidence fortuite, qu'au Pérou les Vierges du Soleil pouvaient avoir des rapports avec les Incas, qui étaient fils du Soleil, et qu'à Rome, Héliogabale, qui était empereur et prêtre du Soleil, osa célébrer son mariage avec une Vestale, et dire [FN: § 762-1] : « J'ai fait cela afin que des fils divins naissent de moi, souverain pontife, et d'elle grande Vestale ».
§ 763. Voici une autre singulière coïncidence. Au Pérou, les vierges du Soleil pétrissaient une farine très pure, pour faire certains pains offerts aux Incas, lors d'une fête du Soleil. À Rome, les vierges Vestales préparaient un brouet de la farine (mola salsa), pour l'offrir à la déesse Vesta [FN: § 763-1]. Tous ces exemples confirment que, comme nous l'avons vu déjà, au § 744, la ressemblance de certains rites n'est en rien une preuve que l'un procède directement de l'autre.
§ 764. (B -.γ) Les mythes, etc., sont entièrement irréels. Dans ce genre, nous avons les nombreuses et importantes théories de l'allégorie, y compris celles du mythe solaire et d'autres semblables. Toutes ces théories, très en usage par le passé, ont encore des adeptes aujourd'hui. Elles sont chères aux esprits ingénieux, subtils, prompts à imaginer, désireux de découvertes inattendues. En Outre, elles constituent une transition utile entre la foi aveugle et l'incrédulité : on abandonne ce que l'on ne peut plus défendre, et l'on tâche de sauver le plus possible des mythes anciens.
§ 765. Pourtant il arrive souvent, en réalité, qu'on ne sauve que peu de chose ou rien. L'expérience du passé fait voir que l'on ne gagne pas beaucoup à tâcher de rendre plus « raisonnable » une ancienne croyance; et c'est même souvent le moyen d'en hâter la ruine. Les raisonnements abstraits, subtils, ingénieux, agissent très peu pour maintenir les sentiments non-logiques qui forment le fond des croyances [FN: § 765-1].
§ 766. Il est nécessaire de se rappeler, ici en particulier, ce que nous avons exposé déjà, d'une façon générale (§ 635 et sv.), sur le but de ce chapitre. Étant donné un texte dans lequel on suppose que les mythes, les allégories, etc., ont une part plus ou moins grande, ici nous recherchons surtout si et comment on peut remonter du texte aux idées de l'auteur, ou aux faits qu'il a voulu décrire.
§ 767. Grote a excellemment jugé l'interprétation allégorique et historique des anciens mythes grecs. Il dit [FN: § 767-1]: « (p. 167) La doctrine que l'on suppose avoir été symbolisée primitivement et postérieurement obscurcie dans les mythes grecs, y fut en réalité introduite pour la première fois par l'imagination inconsciente d'interprètes plus récents. C'était une des diverses voies que prenaient des hommes instruits pour échapper à la nécessité d'admettre littéralement les anciens mythes, et pour arriver à quelque nouvelle forme de croyance plus conforme aux idées qu'ils se faisaient de ce que devaient être les attributs et le caractère des dieux ». « (p. 169) Le même conflit de sentiments qui amenait les philosophes à décomposer les mythes divins pour les changer en allégories, poussait les historiens à réduire les mythes héroïques en quelque chose qui ressemblât à une histoire politique continue, avec une longue suite chronologique calculée sur les généalogies héroïques. L'un de ces procédés, aussi bien que l'autre, était une œuvre d'explications conjecturales et sans critérium ni témoignage quelconque justificatif. Tandis qu'on faisait ainsi disparaître la beauté caractéristique du mythe, en le réduisant en quelque chose d'antimythique, on cherchait à arriver à l'histoire et à la philosophie, par des routes impraticables ».
§ 768. Le commentaire des poésies homériques, dont Héraclide est l'auteur [FN: § 768-1] , peut être cité comme type des interprétations allégoriques. L'auteur a pour but de rendre raisonnables, moraux, pieux, les récits d'Homère. Ainsi, à propos du passage (Il. I, 396 et sv.), où il est dit que les dieux voulaient enchaîner Zeus, Héraclide remarque que « Pour ces vers, Homère mériterait d'être chassé non seulement d'une république de Platon, mais au-delà des lointaines colonnes d'Hercule et de l'inaccessible océan ». Après l'avoir démontré, Héraclide ajoute : « Au reste, pour excuser cette impiété, il n'y a qu'un seul remède : nous prouverons que le mythe est allégorique ». Suivent de longues explications, suivant lesquelles Zeus est l'éther, Héra est l'air, Poséidon, l'eau, Athéna, la terre, Thétis, la Providence. Quand Homère dit que Thétis a délivré Zeus qu'Héra, Poséidon et Athéna voulaient enchaîner, il exprime la perturbation des éléments, empêchée par la Providence.
§ 769. Dans l'Odyssée (V, 121), on dit que l'Aurore aux doigts de rose enleva Orion. Héraclide croit qu'Homère a voulu exprimer « qu'un jeune garçon a été enlevé par le destin, à la fleur de l'âge. En effet, c'était une coutume des anciens, quand un homme mourait, de ne transporter son corps ni la nuit ni à la chaleur de midi, mais de le transporter à l'aurore, quand les rayons du soleil n'étaient pas encore chauds. Aussi, quand mourait un jeune homme bien né et illustre par sa beauté, c'est avec à propos qu'ils appelaient enlèvement du jour son transport matinal, comme s'il n'était pas mort, mais qu'il avait été enlevé en raison d'un désir amoureux ». Ces allégories et d'autres semblables n'ont pas plus de réalité que les interprétations de Palæphate. Il vaudrait tout autant dire qu'une reine du nom d'Aurore a enlevé un jeune homme du nom d'Orion.
§ 770. Nous avons une infinité d'autres explications allégoriques des poésies d'Homère ; et, des temps anciens à nos jours, on en exhibe une à chaque instant. Eustache en a plusieurs, et peu à peu on arrive à un certain Hugon , pour lequel les poésies d'Homère sont une prophétie de la Passion du Christ, et [FN: § 770-1] à Croës [FN: § 770-2], pour lequel elles sont une histoire allégorique du peuple hébreu.
§ 771. C'est de la même façon et pour les mêmes motifs que Virgile a eu aussi ses explications allégoriques. Comparetti relève comment, dans les œuvres de Virgile, on vit une prophétie de la venue du Christ [FN: § 771-] . « (p. 134) L'interprétation la plus répandue, de cette nature, se trouve dans une allocution tenue par l'empereur Constantin, devant une assemblée ecclésiastique... la traduction (p. 135) de l'églogue [la IVe ]en vers grecs, telle qu'on la lit aujourd'hui dans ce discours, révèle l'ancien défaut des sibyllistes ; en plusieurs endroits, elle s'écarte arbitrairement de l'original, en altère le sens, avec l'intention évidente de l'adapter à l'interprétation chrétienne qui est développée dans le discours. Examinant dans ses différentes parties cette composition de Virgile, l'empereur y trouve la prédiction de la venue du Christ, désignée avec plusieurs circonstances. La vierge qui revient, c'est Marie ; la nouvelle progéniture envoyée par le ciel, c'est Jésus, et le serpent qui n'existera plus, c'est le vieux tentateur de nos pères, etc. ».
§ 772. Une autre interprétation passablement fantaisiste est celle de Fulgentius [FN: § 772-1)]. « (p. 144) Le De continentia Virgiliana, où Fulgentius déclare ce que contient, ou mieux ce qui est caché dans le livre de Virgile, est l'un des plus étranges et des plus curieux écrits du moyen âge latin... (p. 145) Dans un préambule, l'auteur se hâte de déclarer qu'il limitera son travail à l'Énéide seule, car les Bucoliques et les Géorgiques contiennent des sens mystiques si profonds, qu'il n'y a presque pas d'art capable de les pénétrer entièrement. C'est pourquoi il y renonce, le fardeau étant trop lourd pour ses épaules, et trop de science étant nécessaire ; car le premier sens des Géorgiques est tout astrologique ; le second, physionomiste et médical ; le troisième se rapporte entièrement à l'art des aruspices, etc. ».
§ 773. Toujours de la même manière et toujours pour le même motif, on a cherché et trouvé des allégories dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile. L'œuvre ainsi accomplie par les Pères de l'Église et leurs successeurs protestants, catholiques, modernistes, est immense. Philon le Juif a écrit les Allégories des lois sacrées, qui vont de pair avec les allégories homériques, avec les allégories virgiliennes, et avec les allégories que les modernistes ont aujourd’hui découvertes dans l'Évangile. En ce dernier cas, il est étrange qu'on appelle moderne un retour à l'antiquité, et cela ressemble un peu à la découverte que l'on ferait de l'Amérique, au XXe siècle.
§ 774. Voulez-vous savoir ce que signifient ces paroles de la Bible [FN: § 774-1]: « Adam et sa femme étaient tous deux nus »? Philon va vous le dire. Elles signifient que « l'esprit ne pensait pas, et que la sensation ne sentait pas ; mais celle-ci était privée et nue de pensée ; celui-là de la faculté de sentir ». On ne saurait être plus clair ni plus précis.
Voulez-vous savoir ce que signifie le miracle de l'eau changée en vin, ou celui de l'aveugle qui voit et du mort qui ressuscite ? L'abbé Loisy [FN: § 774-2] vous le dira avec non moins de clarté et de précision que Philon. L'eau changée en vin signifie l'Évangile substitué à la Loi. L'aveugle qui voit et le mort ressuscité représentent l'humanité appelée à la « vraie » lumière et à la « vraie vie » du Verbe incarné, qui est lui-même la lumière et la vie. L'abbé Loisy tance vertement ceux qui n'acceptent pas d'emblée ces explications lumineuses. Il dit : « (p. 52) Les théologiens de nos jours sont si éloignés (p. 53) de la mentalité de l'évangéliste [Jean], et, en même temps, ils ont si peu le sens du possible et du réel en matière d'histoire, qu'il faut renoncer à leur faire comprendre que les récits comme le miracle de Cana, la guérison de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare, inintelligibles, absurdes ou ridicules comme matière de foi, à moins qu'on y voie des tours audacieux de prestidigitateur, sont d'une interprétation facile et simple quand on se sert des clefs fournies par l'évangéliste lui-même, et qu'on reconnaît dans l'eau changée en vin la Loi remplacée par l'Évangile, dans l'aveugle qui voit, et dans le mort qui ressuscite, l'humanité appelée à la véritable lumière et à la véritable vie par le Verbe incarné, qui est lui-même la lumière et la vie ». On peut malheureusement répéter cela pour toutes les interprétations allégoriques de la mythologie ; et il est très difficile de faire un choix, pour en admettre une partie et rejeter le reste [FN: § 774-3].
§ 775. Y a-t-il des allégories dans l'Évangile selon St-Jean ? Cela se peut ; c'est même probable. Mais tout critère nous fait défaut pour pouvoir discerner la partie allégorique de la partie historique [FN: § 775-1] ; et il se pourrait encore que l'auteur même de l'Évangile ne discernât pas clairement ces parties. Cela ne suffit pas. À supposer que nous puissions savoir avec certitude qu'un récit est allégorique, il nous reste encore à savoir quelle est précisément l'allégorie que l'auteur avait dans l'esprit. À ce sujet, il suffira de citer l'exemple de l'Apocalypse, laquelle est certainement allégorique. Mais quelle peut être l'allégorie ? Il y a des siècles qu'on la cherche, et l'on n'a rien découvert de certain.
§ 776. L'abbé Loisy a une étrange façon de comprendre la valeur des preuves historiques. Il dit [FN: § 776-1]: « (p. 70) Ôtez de l'Évangile l'idée du grand avènement et celle du Christ-Roi, je vous défie de prouver l'existence historique du Sauveur ; car vous aurez enlevé toute signification historique à sa vie et à sa mort ». Par conséquent, ce serait l'idée contenue dans un récit qui démontrerait la réalité historique de ce récit !
§ 777. C'est la confusion habituelle entre les preuves subjectives et les preuves objectives. Il faut se décider. Ou bien un récit est du ressort de la foi, et dans ce cas les preuves objectives sont superflues ; ou bien c'est un récit historique d'éléments expérimentaux ; et dans ce cas, les preuves subjectives, les « idées », les croyances n'ont pas rang parmi les preuves. On peut faire la même objection aux néo-chrétiens comme Piepenbring, qui s'efforcent de toute manière d'éliminer de l'Évangile le surnaturel et le miracle [FN: § 777-1]. Si l'on doit envisager l'Évangile simplement comme un texte historique, son accord avec les sentiments de certaines personnes, « l'expérience du chrétien », n'ont aucune valeur. L'erreur de ces personnes consiste à croire que leurs conceptions humanitaires ont une plus grande valeur objective que la foi au miracle.
§ 778. Au point de vue de la réalité objective, on ne comprend pas ce que plus loin l'abbé Loisy veut dire par ces mots : « (p. 93) Ce Christ [de l'Évangile de Jean], sans doute n'est pas une abstraction métaphysique, car il est vivant dans l'âme de l'évangéliste » (§ 1630-3), Toute abstraction métaphysique quelque peu puissante est « vivante » dans l'esprit du métaphysicien. En face de l'Église romaine, l'abbé Loisy se pose en représentant de la critique historique et scientifique, alors qu'il est un théologien plus métaphysicien, plus subtil, plus abstrait que les théologiens romains [FN: § 778-1].
§ 779. Pour ajouter quelque chose de réel à l'allégorie, on fait appel à l'étymologie ; et l'on a ainsi des méthodes d'interprétation dont il y a des exemples jusqu'en nos temps, où l'une d'elles, la méthode d'interprétation qui conduit au mythe solaire, a obtenu un grand crédit [FN: § 779-1]. Pour la sociologie, la valeur intrinsèque de la méthode importe moins que la manière dont elle a été accueillie, ni est un indice d'un état mental important ; lequel démontre la tendance anti-scientifique, qui prévaut encore dans les études des traditions et des institutions des temps passés.
§ 780. Max Muller et ses disciples ont poussé jusqu'à ses extrêmes limites la méthode des interprétations allégorico-étymologiques. Leur procédé consiste à profiter, pour leurs démonstrations, du sens douteux et très étendu de certains mots, que Max Muller tire généralement du sanscrit, et d'en déduire, par des raisonnements peu ou pas précis, des conclusions bien délimitées et rigoureuses.
§ 781. Voici un exemple. Max Muller veut interpréter la fable de Prokris [FN: § 781-1]. Il la décompose en éléments. « (p. 111) Le premier de ces éléments est : Képhalos aime Prokris. Pour expliquer Prokris, il faut recourir à une comparaison avec le sanscrit, où prush et prish signifient “arroser”, et sont employés spécialement pour désigner les gouttes de pluie. Par exemple dans le Rig-Véda (I, CLXVIII, 8) : “Les éclairs sourient à la terre, quand les vents versent par ondée la pluie sur la terre”. La même racine, dans le (p. 112) langage teutonique a pris le sens de “gelée” et Bopp identifie prush avec l'ancien haut-allemand frus, frigere. En grec, nous devons rapporter a la même racine ![]() , une goutte de rosée, et aussi Prokris –
, une goutte de rosée, et aussi Prokris – ![]() – la rosée. Ainsi la femme de Képhalos n'est qu'une répétition de Hersé, sa mère ; Hersé, rosée, étant également dérivée du sanscrit vrish, arroser ; Prokris, rosée, qui se rattache à la racine sanscrite prush, ayant le même sens. La (p. 113) première partie de notre mythe signifie donc simplement : Le Soleil baise la rosée du matin ». Il se peut qu'on raisonne ainsi quand on est à moitié endormi ; mais on ne peut vraiment rien démontrer – ou l'on peut tout démontrer – de cette façon. Dans une note, l'auteur défend ses étymologies de Prokris et de
– la rosée. Ainsi la femme de Képhalos n'est qu'une répétition de Hersé, sa mère ; Hersé, rosée, étant également dérivée du sanscrit vrish, arroser ; Prokris, rosée, qui se rattache à la racine sanscrite prush, ayant le même sens. La (p. 113) première partie de notre mythe signifie donc simplement : Le Soleil baise la rosée du matin ». Il se peut qu'on raisonne ainsi quand on est à moitié endormi ; mais on ne peut vraiment rien démontrer – ou l'on peut tout démontrer – de cette façon. Dans une note, l'auteur défend ses étymologies de Prokris et de ![]() qui ont été attaquées. Il nous dit que « (p. 112, note) Prishat, féminin prishali, signifie arrosé, en latin guttatus, et s'applique à un daim moucheté, à une vache mouchetée, à un cheval moucheté ». Quand on dispose d'un terme qui, à lui seul, veut dire goutte de pluie, flocon de givre, rosée, animal tacheté, et d'autres termes d'une égale précision, il n'est pas difficile d'en tirer tout ce qu'on veut [FN: § 781-2] .
qui ont été attaquées. Il nous dit que « (p. 112, note) Prishat, féminin prishali, signifie arrosé, en latin guttatus, et s'applique à un daim moucheté, à une vache mouchetée, à un cheval moucheté ». Quand on dispose d'un terme qui, à lui seul, veut dire goutte de pluie, flocon de givre, rosée, animal tacheté, et d'autres termes d'une égale précision, il n'est pas difficile d'en tirer tout ce qu'on veut [FN: § 781-2] .
§ 782. Il serait trop simple de voir dans les centaures un produit de l'imagination, qui a créé ces monstres comme elle en a créé tant d'autres. Il doit y avoir quelque mystère sous ce terme, et l'étymologie nous permettra de choisir entre de nombreuses interprétations.
Il peut désigner [FN: § 782-1]« une population de bouviers ; car ce nom est dérivé de ![]() piquer, et
piquer, et ![]() , taureau ; il rappelle l'usage où sont les conducteurs de bœufs de mener ces animaux avec l'aiguillon ». Si cette étymologie ne vous plaît pas, en voici sur-le-champ une autre [FN: § 782-2] . « Une autre étymologie, celle-ci moderne, associe au mot
, taureau ; il rappelle l'usage où sont les conducteurs de bœufs de mener ces animaux avec l'aiguillon ». Si cette étymologie ne vous plaît pas, en voici sur-le-champ une autre [FN: § 782-2] . « Une autre étymologie, celle-ci moderne, associe au mot ![]() celui d'
celui d'![]() , lièvre, et fait des centaures des piqueurs de lièvres ». Vous n'êtes pas encore satisfait ? [FN: § 782-3]« La mythologie comparée, en leur supposant une origine asiatique, les a rapprochés des Gandharvas de l'Inde, dieux velus comme des singes, aimant, eux aussi, le vin et les femmes, cultivant la médecine, la divination, la musique, comme les ont cultivées les centaures de la mythologie hellénique. Ce rapprochement avec les Gandharvas (ce nom signifie cheval en sanscrit), tendrait à faire des centaures, ces hommes-chevaux, des personnifications des rayons solaires, que l'imagination aryenne comparait à des chevaux ; ou, comme on l'a dit aussi, des nuages qui semblaient chevaucher autour du soleil ». Cela ne vous suffit point encore ? Faisons-en des fils d'Ixion et de Néphélè. [FN: § 782-4]« Les uns ont vu dans Ixion et dans sa roue une image du soleil emporté d'un mouvement éternel. Pour d'autres, c'est une personnification de l'ouragan et de la trombe. Les centaures sont ou les rayons du soleil, ou les nuages qui l'entourent. On y verra les démons de la tempête, à moins qu'on ne préfère y voir un symbole des torrents qui descendent du Pélion ».
, lièvre, et fait des centaures des piqueurs de lièvres ». Vous n'êtes pas encore satisfait ? [FN: § 782-3]« La mythologie comparée, en leur supposant une origine asiatique, les a rapprochés des Gandharvas de l'Inde, dieux velus comme des singes, aimant, eux aussi, le vin et les femmes, cultivant la médecine, la divination, la musique, comme les ont cultivées les centaures de la mythologie hellénique. Ce rapprochement avec les Gandharvas (ce nom signifie cheval en sanscrit), tendrait à faire des centaures, ces hommes-chevaux, des personnifications des rayons solaires, que l'imagination aryenne comparait à des chevaux ; ou, comme on l'a dit aussi, des nuages qui semblaient chevaucher autour du soleil ». Cela ne vous suffit point encore ? Faisons-en des fils d'Ixion et de Néphélè. [FN: § 782-4]« Les uns ont vu dans Ixion et dans sa roue une image du soleil emporté d'un mouvement éternel. Pour d'autres, c'est une personnification de l'ouragan et de la trombe. Les centaures sont ou les rayons du soleil, ou les nuages qui l'entourent. On y verra les démons de la tempête, à moins qu'on ne préfère y voir un symbole des torrents qui descendent du Pélion ».
§ 783. Il convient de noter, comme type, le raisonnement suivant, grossièrement approché: « Une roue tourne ; le soleil tourne ; donc la roue d'Ixion est le soleil ». En général, voici la méthode qu'on emploie. On veut prouver que A est égal à B. On tâche, en choisissant convenablement certains termes pour désigner A et B, de faire naître, chez les hommes, nos contemporains, des sensations ayant quelques ressemblances. On conclut alors que, pour les hommes des temps passés, A était rigoureusement égal à B. Pour atteindre le but, il est nécessaire que l'exposé ne soit pas trop court ; il faut qu'il s'allonge de manière à donner le temps à ces sensations de naître et de croître, et en sorte que le grand nombre de mots recouvre la vanité du raisonnement [FN: § 783-1] .
§ 784. Maury voit, dans les centaures [FN: § 784-1] « (p. 202) la métamorphose que les Gandharvas subirent en Grèce » ; et il ajoute : « Les Gandharvas sont en effet les rayons du soleil, les flammes du foyer sacré dans lesquelles se jouent des reflets éclatants, les flots du Soma, où ces feux se réfléchissent, et que l'imagination de l'Arya compare à des chevaux ». Ces braves Gandharvas sont toutes ces choses ; excusez du peu. Comme si cela ne suffisait pas, ils se transforment aussi en centaures. Mais Ulenbeck ne croit vraiment pas que les Gandharvas aient rien à voir avec les centaures. V. Henry le blâme et lui oppose le raisonnement suivant [FN: § 784-2]: « ....dans la mythologie védique les Gandharvas passent pour des êtres prodigieusement puissants et lascifs. C'est l'épithète qui les précède, l'attribut qui les suit partout... De l'histoire des centaures que savons-nous ? Peu de chose, en vérité. Si les descriptions abondent, les contes proprement dits font défaut. Pourtant, dans cette incroyable indigence de faits, un seul récit surnage et précisément dans l'ordre d'idées où nous orientent les peintures védiques ; invités aux noces de Pirithoüs et d'Hippodamie, ils tentèrent de ravir l'épousée ; mais ils furent vaincus par Thésée et les Lapithes ». Si ce seul récit surnage, c'est parce qu'ainsi plaît à notre auteur ; car on trouverait, si l'on voulait, d'autres récits de non moindre importance ; par exemple, les aventures d'Hercule au pays des centaures.
§ 785. Il faut admirer comment notre auteur sait tirer parti de tout. Si les aventures des centaures et des Gandharvas étaient semblables, ce serait une preuve de l'identité de ces êtres fabuleux. Mais elles sont différentes ! N'en ayez nul souci. Il y a remède à tout, sauf à la mort. «la considération capitale, à mes yeux, c'est que l'histoire n'est point la même. Il en va du conte comme du nom : si les noms étaient identiques, l'étymologiste flairerait quelque emprunt ; si le récit était tout pareil, le mythographe le soupçonnerait d'avoir voyagé. Mais bien loin de là : les Hindous connaissent sur les Gandharvas un trait de mœurs que les Grecs ont oublié ». C'est notre auteur qui dit qu'ils l'ont oublié; mais il n'en donne pas la moindre preuve. « En récompense, ceux-ci racontent des centaures une anecdote dont les Hindous ignorent le premier mot ; et ce trait de mœurs et cette anecdote s'adaptent comme les cassures de deux fragments de vase, sortent visiblement du même fonds d'idées. Il semble que, réduisant ce fonds à sa plus simple expression, il ne reste plus qu'à formuler le concept premier, ou, si l'on veut, la naïve devinette qui porta dans ses flancs toute cette mythologie : Qui sont les mâles difformes qui vont toujours fécondant ? À quoi le moins informé répondra sans peine : les nuages ». Justement les centaures prennent place parmi les personnages de la mythologie grecque qui fécondent le moins ! Ils sont lascifs, mais peu fécondants. La solution de la devinette de notre auteur serait plutôt Zeus. C'est un mâle ; il est difforme, en ce sens qu'il change souvent de forme pour séduire des déesses ou des mortelles ; et quant à féconder, il n'a pas son pareil. Dans la mythologie grecque, on ne parle que de ses fils et de ses filles.
§ 786. Si l'on tombe sur quelque personnage historique dont l'existence n'est pas certaine et semble légendaire, on finit généralement par en faire un mythe solaire. Tel doit être, par exemple, Junius Brutus, le meurtrier de Tarquin [FN: § 786-1].
§ 787. Employons ici encore la méthode indiquée au § 547. Un auteur grec – pour le moment ne disons pas qui –nous parle d'un certain Lamproclès, ![]() . Ce nom est composé de
. Ce nom est composé de ![]() , brillant, et de
, brillant, et de ![]() , gloire, célébrité. Mais qui est essentiellement brillant, glorieux, fameux ? Le Soleil, assurément. D'autre part, nous savons que Lamproclès était fils d'une cavale dorée ; et qui ne voit pas que c'est le Soleil, qui apparaît après l'Aurore au peplum couleur de crocus –
, gloire, célébrité. Mais qui est essentiellement brillant, glorieux, fameux ? Le Soleil, assurément. D'autre part, nous savons que Lamproclès était fils d'une cavale dorée ; et qui ne voit pas que c'est le Soleil, qui apparaît après l'Aurore au peplum couleur de crocus – ![]() ? C'est là un mythe solaire, plus certainement qu'un très grand nombre d'autres. Mais il y a une difficulté. L'auteur dont on n'a pas encore donné le nom est Xénophon ; Lamproclès est fils de Socrate et de Xanthippe (
? C'est là un mythe solaire, plus certainement qu'un très grand nombre d'autres. Mais il y a une difficulté. L'auteur dont on n'a pas encore donné le nom est Xénophon ; Lamproclès est fils de Socrate et de Xanthippe (![]()
![]() = rouge doré,=
= rouge doré,= ![]() cheval) ; et, en vérité, ni le Soleil ni l'Aurore n'ont que faire en tout cela.
cheval) ; et, en vérité, ni le Soleil ni l'Aurore n'ont que faire en tout cela.
§ 788. Célèbre est la plaisanterie qu'on a faite du mythe solaire, en montrant que même l'histoire de Napoléon 1er pouvait s'expliquer par ce mythe [FN: § 788-1].
§ 789. Nous avons parlé d'une légende de Virgile (§ 670). On pourrait facilement y voir un mythe solaire. Le voyage aérien de Virgile, le feu qui s'éteint et se rallume, nous suggèrent l'idée du Soleil, qui parcourt le ciel, s'éteint chaque jour en se couchant, et se rallume en se levant. L'identité de Virgile et du Soleil devient plus évidente, quand on songe à la manière dont Virgile mourut [FN: § 789-1]« ...(p. 229) il sentra en ung basteau et sen alla esbattre sur mer luy quatrieme par compagnie ; et ainsi quilz alloient devisant sur leau, vint ung estourbillon de vent... (p. 330) Si furent enlevez en haulte mer, puis apres nul deulx ne fut veu ne aparceu... ». Pour les habitants de Naples, le Soleil se couche en effet dans la mer. Quant au bateau, qui ne voit que c'est un emprunt fait à la mythologie égyptienne, laquelle fait voyager le Soleil dans un bateau ?
§ 790. Un auteur a démontré, non pour plaisanter, mais sérieusement, que le récit évangélique de la vie du Christ est un mythe solaire, semblable à des mythes hébraïques et babyloniens [FN: § 790-1] .
§ 791. Tout cela ne vise pas du tout à nier l'existence de mythes solaires, mais seulement à montrer qu'ils doivent être reconnus au moyen de preuves historiques, et non en vertu de ressemblances entre les circonstances d'un récit, indéterminées, arbitrairement interprétées, et les caractères généraux du mouvement solaire.
§ 792. D'une manière plus générale, il y a certainement eu des allégories ; non seulement celles qui sont l'œuvre artificielle d'interprètes, mais aussi d'autres qui naissent spontanément du peuple. D'autre part, le développement du phénomène est souvent l'inverse de ce qu'on suppose, quand on croit que l'allégorie vient du nom ; au contraire c'est souvent le nom qui vient de l'allégorie. Ce n'est pas parce qu'une jeune fille avait les doigts roses, qu'on l'a nommée Aurore ; c'est le phénomène de l'aurore qui a suggéré l'allégorie des doigts de rose.
§ 793. Herbert Spencer ne l'entend pas ainsi. Il étend au totémisme et aux mythes solaires sa théorie des déductions imparfaites de faits expérimentaux. Le culte des animaux est né du fait que l'homme et l'animal sont confondus dans l'esprit du sauvage. L'habitude de donner des noms d'animaux aux enfants, ou aux hommes, comme surnoms, aide cette assimilation des hommes et des animaux [FN: § 793-1]« (p. 464, § 171)... nous ne devons pas nous étonner que le sauvage qui manque de connaissance, qui n'a qu'une langue grossière, ait l'idée qu'un ancêtre appelé le Tigre était un vrai tigre ». De cette descendance de l'homme portant un nom d'animal, confondue avec la descendance de l'animal, on tire, par de beaux raisonnements logiques, tous les caractères du totémisme. « (p. 467, § 172) Une seconde conséquence, c'est que les animaux, une fois regardés comme parents des hommes, sont souvent traités avec considération... (p. 468, § 172) Naturellement, comme nouvelle conséquence, l'animal particulier qui donne le nom à la tribu et que l'on regarde comme un parent, est traité avec des égards particuliers... (p. 469, § 173) Si les Africains de l'est, selon Livingstone, croient que les âmes des chefs morts entrent dans les lions et rendent ces animaux sacrés, nous pourrons en conclure que le même caractère sacré s'attache aux animaux dont les âmes humaines sont des ancêtres. Les indigènes du Congo, qui ont au sujet des lions la même croyance, croient que le « lion épargne l'homme qu'il rencontre, quand il en est salué avec courtoisie » ; c'est que, d'après eux, on se concilie la faveur de la bête-chef qui a été l'auteur de la tribu. On peut prévoir que les prières et les offrandes seront l'origine d'un culte, et que l'homonyme animal deviendra un dieu ». L'auteur conclut ainsi : « (p. 471, § 173) Ainsi, étant une fois donnée la méprise à propos de titres métaphoriques qui ne manque pas de se produire dans le langage primitif, le culte des animaux est une conséquence naturelle ».
§ 794. Cette théorie ne voit que des actions logiques. Elle s'applique aussi aux végétaux et aux êtres inanimés. « (p. 491, § 181) Si l'on traite avec vénération un animal parce qu'on le regarde comme un premier ancêtre, on peut prévoir qu'il en sera de même d'un ancêtre végétal... (p. 504, § 186) La montagne est le lieu d'où la race est venue, l'origine, le père de la race ; les distinctions impliquées par les divers mots dont nous nous servons en ce moment ne peuvent se rendre dans les langues grossières. Ou bien les premiers parents de la race habitaient des cavernes de la montagne, ou la montagne s'identifie avec le lieu d'où ils sont sortis, parce qu'elle marque d'une façon très saisissante la région élevée qui fut leur berceau ». De cette façon tout s'explique. « (p. 507, § 187). Il ne semble pas improbable qu’une erreur d'interprétation des noms d'individus ait donné lieu à la croyance que la mer est un ancêtre ». – « (p. 509, § 188) Il est possible qu'on ait donné quelquefois le nom d'aurore en manière de compliment à une jeune fille aux (p. 510) joues vermeilles ; mais je n'en saurais fournir une preuve. Seulement, nous avons une preuve certaine qu'Aurore est un nom de naissance ». Herbert Spencer rapporte de nombreux faits qui démontrent comment les sauvages ont donné le nom d'Aurore à des êtres humains. Dans nos pays, il y a beaucoup de femmes qui portent ce nom. « (p. 510, § 188) Si donc Aurore est le nom réel d'une personne, si dans les pays où règne cette manière de distinguer les enfants, on l'a peut-être donné souvent à ceux qui naissent le matin de bonne heure, il se peut dire que les traditions concernant une personne appelée de ce nom aient conduit le sauvage à l’esprit simple, enclin à croire à la lettre tout ce que ses pères lui disaient, à confondre cette personne avec l'aube du jour. Par suite il aura interprété les aventures de cette personne de la façon que les phénomènes de l'aube rendaient la plus plausible ».
Le lecteur remarquera cette façon de raisonner, en accumulant une longue série d'hypothèses et de vraisemblances ; et il constatera que, par cette longue voie, nous parvenons au même but que l'on atteint d'un saut, quand on dit qu'une femme du nom d'Aurore a enlevé un jeune homme du nom d'Orion (§ 769).
Spencer continue: « (p. 511, § 189) Le culte des étoiles a-t-il une semblable origine ? Peut-on aussi les identifier avec des ancêtres ? Il semble difficile de le concevoir, et pourtant il y a des faits qui nous autorisent à le soupçonner ». – « (p. 515, § 190) Est-ce que l'identification de la lune avec des personnes qui ont vécu autrefois a pour cause une erreur d'interprétation de noms ? Il y a des raisons de le croire, alors même que nous n'en aurions pas de preuve directe ». – « (p. 519, § 191) N'y eût-il aucune preuve directe que les mythes solaires proviennent d'erreurs suscitées par des récits concernant des personnes réelles ou des événements réels de l'histoire d'un homme, les preuves tirées par analogie suffiraient pour légitimer notre opinion, mais les preuves directes abondent ». Ces preuves directes sont au contraire de simples interprétations de l'auteur, semblables à celles dont nous avons déjà donné des exemples,
§ 795. Toutes ces explications simples et a priori nous transportent en dehors de la réalité, où l'on trouve les faits très complexes des récits de mythes. Des souvenirs de faits réels, des imaginations fantaisistes, et, chez les peuples qui possèdent une littérature, des souvenirs d'œuvres littéraires jouent un rôle dans ces mythes et se mélangent en proportions variées. Il s'y ajoute diverses théories, depuis celles qui sont puériles, jusqu'aux plus ingénieuses, des métaphores, des allégories, etc. N'oublions pas non plus le groupement spontané des légendes autour d'un noyau primitif (§ 740), et l'emploi successif de voies souvent différentes.
§ 796. Par exemple, la proposition affirmant qu'Apollon est un dieu solaire est mêlée d'erreur et de vérité. Il y a de l'erreur, en ce sens que dans un cycle comme celui de l'Iliade, Apollon n'est pas un dieu solaire. Il y a du vrai, en ce que, dans d'autres cycles, les mythes solaires se sont mêlés au mythe non encore solaire d'Apollon, et qu'ils ont finalement acquis une telle prédominance, que ![]() s'est confondu avec
s'est confondu avec ![]() et avec Apollon.
et avec Apollon.
§ 797. Arrêtons-nous un moment, et voyons où l'induction nous a conduits. Non seulement elle a confirmé l'importance des actions non-logiques, déjà notée dès le chapitre II, mais elle nous a fait voir, en outre, comment ces actions constituent le fond de nombreuses théories qui, jugées superficiellement, paraîtraient être un produit exclusif de la logique.
§ 798. La longue étude que nous venons de faire, de certaines théories, a en tout cas abouti à reconnaître que les théories concrètes peuvent être divisées au moins en deux parties, dont l'une est beaucoup plus constante que l'autre. Afin d'éviter autant que possible que l'on ne raisonne sur des mots, au lieu de raisonner sur des faits (§ 119), nous commencerons par employer de simples lettres de l'αbet, pour désigner les choses dont nous voulons parler ; et ce n'est qu'au chapitre suivant que nous substituerons des noms à ce mode de notation peu commode. Nous dirons donc que dans les théories concrètes que nous désignerons par (c), outre les données de faits, il y a deux éléments ou parties principales : une partie ou élément fondamental, que nous désignerons par (a), et une partie ou élément contingent, généralement assez variable, que nous désignerons par (b) (§ 217, § 514-4).
La partie (a) correspond directement à des actions non-logiques ; elle est l'expression de certains sentiments. La partie (b) est la manifestation du besoin de logique qu'a l'homme. Elle correspond aussi partiellement à des sentiments, à des actions non-logiques, mais les revêt de raisonnements logiques ou pseudo-logiques. La partie (a) est le principe qui existe dans l'esprit de l'homme ; la partie (b), ce sont les explications, les déductions de ce principe.
§ 799. Par exemple, il existe un état psychique, auquel on peut donner le nom de principe, sentiment, ou tout autre à volonté, en vertu duquel certains nombres paraissent vénérables.
C'est la partie principale (a) d'un phénomène que nous étudierons plus loin(§ 960 et Sv.). Mais l'homme ne se contente pas d'unir des sentiments de vénération et des idées de nombres ; il veut aussi « expliquer » comment cela se fait, « démontrer » qu'il est mu par la force de la logique. Alors intervient la partie (b), et l'on a les différentes « explications » et « démonstrations » du motif pour lequel certains nombres sont sacrés.
Il existe chez l'homme un sentiment qui lui interdit d'abandonner sur-le-champ d'anciennes croyances ; c'est la partie (a) d'un phénomène étudié tantôt (§ 172 et sv.). Mais l'homme veut justifier, expliquer, démontrer son attitude. Alors intervient une partie (b) qui, de diverses manières, maintient la lettre de ces croyances et en change le fond.
§ 800. La partie principale du phénomène est évidemment celle à laquelle l'homme s'attache avec le plus de force, et qu'il tâche ensuite de justifier ; c'est la partie (a); et c'est, par conséquent, cette partie qui est la plus importante dans la recherche de l'équilibre social.
§ 801. Mais la partie (b), bien que secondaire, a aussi un effet sur l'équilibre. Parfois cet effet est si petit qu'on peut le considérer comme étant égal à zéro ; quand, par exemple, on justifie la perfection du nombre six, en disant qu'il est égal à la somme de ses parties aliquotes. Mais cet effet peut aussi être important ; par exemple, quand l'Inquisition brûlait les gens qui tombaient dans quelque erreur de déductions théologiques.
§ 802. Nous avons dit (§ 798) que la partie (b) est constituée en proportions variables de sentiments et de déductions logiques. Il convient de noter que, d'habitude, dans les sujets sociaux, sa force persuasive dépend principalement des sentiments, plutôt que de la déduction logique, qui est acceptée surtout parce qu'elle correspond à ces sentiments. Au contraire, dans les sciences logico-expérimentales, la part du sentiment tend vers zéro, au fur et à mesure que ces sciences deviennent plus parfaites, et la force persuasive réside tout entière dans la partie logique et dans les faits (§ 2340 et sv.). Parvenue à cet extrême, la partie (b) change évidemment de nature ; nous l'indiquerons par (B). À un autre extrême, on trouve des cas où la déduction logique ne se manifeste pas clairement ; ainsi, dans le phénomène dit des « principes latents » du droit [FN: § 802-1]. Les physiologistes expliquent ces cas à l'aide du subconscient, ou d'une autre manière. Quant à nous, nous ne voulons pas ici remonter si haut : nous nous arrêtons au fait, laissant à d'autres le soin d'en chercher l'explication. Entre ces deux extrêmes se trouvent toutes les théories concrètes, qui approchent plus ou moins de l'un de ces extrêmes.
§ 803. Bien que le sentiment n'ait rien à faire dans les sciences logico-expérimentales, il envahit toutefois un peu ce domaine. Négligeant pour un moment ce fait, nous pourrons dire que si nous désignons par (C) les théories concrètes de la science logico-expérimentale, lesquelles constituent le 2e genre du § 523, ces théories peuvent se décomposer en une partie (A) constituée par des principes expérimentaux, des descriptions, des affirmations expérimentales, et en une autre partie (B), constituée par des déductions logiques, auxquelles s'ajoutent aussi des principes et des descriptions expérimentales, employés pour tirer des déductions de la partie (A).
Les théories (c) où le sentiment joue un rôle, et qui ajoutent quelque chose à l'expérience, qui sont au delà de l'expérience, et qui constituent le 3e genre du § 523, se décomposent de même en une partie (a), constituée par la manifestation de certains sentiments, et une partie (b), constituée par des raisonnements logiques, des sophismes, et en outre par d'autres manifestations de sentiments, employées pour tirer des déductions de (a). De cette façon, il y a correspondance entre (a) et (A), entre (b) et (B), entre (c) et (C). Nous ne nous occupons ici que des théories (c), et nous laissons de côté les théories scientifiques, expérimentales (C).
§ 804. Dans les théories (c) qui dépassent l'expérience ou qui sont pseudo-expérimentales, il est bien rare que les auteurs distinguent avec une clarté suffisante les parties (a) et (b). Habituellement, ils les confondent plus ou moins.
§ 805. EXEMPLE. Parmi les principes du droit romain se trouve celui du droit de propriété. Ce principe admis, on en tire logiquement de nombreuses conséquences, qui constituent une partie très importante de la théorie du droit civil romain. Il y a un cas célèbre, celui de la spécification, où ce principe ne suffit pas pour résoudre les questions qu'on rencontre en pratique. Un éminent romaniste, Girard, s'exprime ainsi [FN: § 1] : « (p. 316) La théorie de la spécification suppose qu'une personne a pris une chose, notamment une chose appartenant à autrui, et a donné par son travail à cette substance une forme nouvelle, a créé une nova species (speciem novam fecit ), a fait du vin avec des raisins, un vase avec du métal, une barque avec des planches, etc. [FN: § 805-*] La question qui se pose est de savoir (p. 317) si l'objet ainsi confectionné est toujours l'objet ancien, qui appartiendrait alors forcément toujours à l'ancien propriétaire, ou si c'est un objet nouveau pour lequel on pourrait concevoir qu'il eût aussi un maître nouveau ». Cette façon de poser la question confond déjà quelque peu les parties (a) et (b) du droit. Pour bien les distinguer, on devrait dire : « La question qui se pose est de savoir à qui l'on doit donner un objet unique, en lequel se sont confondus deux droits de propriété ».
§ 806. Celui qui s'occupe exclusivement de théories juridiques (c) devrait, dans ce cas, avouer simplement que les principes qui lui sont provenus de la partie (a) du droit, ne suffisent pas à résoudre le problème, et que, par conséquent, d'autres sont nécessaires. Le nouveau principe requis pourrait être qu'un objet ancien appartient toujours à l'ancien propriétaire, et qu'un objet nouveau peut avoir un propriétaire nouveau. Dans ce cas, l'énoncé du problème, donné par Girard, est parfait ; mais nous n'éludons une difficulté que pour en rencontrer une autre. Il nous faut maintenant un principe, pour savoir avec rigueur et précision comment on distingue l'objet nouveau de l'ancien ; non pas en général, prenons-y garde, mais au point de vue de la propriété. Par conséquent, nous n'avons approché que peu ou pas du tout de la solution du problème.
§ 807. Le droit (a) peut nous donner le principe d'après lequel la propriété de la chose l'emporte sur la propriété du travail. Nous pouvons prévoir que ce fut peut-être là le principe archaïque ; parce que, d'un côté, la propriété de la matière est une chose plus concrète que la propriété du travail, et qu'en général, le concret précède l'abstrait, et parce que, d'un autre côté, le travail n'était pas très considéré, dans l'ancienne société romaine.
§ 808. Girard dit : « (p. 317) Il est à croire que les anciens jurisconsultes considéraient, sans raffinements doctrinaux, l'objet comme étant toujours le même ». Il décrit ainsi plutôt l'évolution de la forme que celle du fond. Les anciens jurisconsultes avaient probablement dans l'esprit une tendance non-logique, qui les poussait à faire prévaloir la propriété de la matière sur celle du travail. Ensuite, eux ou leurs successeurs, voulant donner un motif logique à leur manière de procéder, auront imaginé de considérer que l'objet était toujours le même. Mais un autre prétexte quelconque aurait pu servir tout aussi bien.
§ 809. Le progrès de la civilisation romaine produisit le progrès correspondant des facultés d'abstraction et de la considération du travail. Nous devons donc prévoir qu'en des temps postérieurs, le droit (a) nous donnera d'autres principes non-logiques, qui seront plus favorables au travail.
§ 810. Traitant justement de la spécification, Gains dit (II, 79) : « En d'autres espèces, on recourt à la raison naturelle ». Cette naturalis ratio est notre vieille connaissance. Il serait extraordinaire qu'elle n'eût pas fait apparition. Elle était l'autorité sous laquelle les jurisconsultes romains plaçaient l'expression de leurs sentiments, qui correspondaient aux actions non-logiques de la société dans laquelle ils vivaient. Gaius dit (II, 77) que l'écrit fait sur parchemin appartient au propriétaire du parchemin ; tandis que (II, 78), pour un tableau peint sur toile, on décide le contraire ; et il ajoute qu'« on donne de cette différence un motif à peine valable ». C'est ce qui arrive habituellement, quand on veut expliquer logiquement les actions non-logiques.
§ 811. Girard continue : « (p. 317) Plus tard, les Proculiens ont, en vertu d'une analyse plus délicate, soutenu que c'était un objet nouveau et qu'il devait appartenir à l'ouvrier, soit en disant que celui-ci l'avait acquis par occupation, soit peut-être simplement en partant de l'idée qu'une chose doit être à celui qui l'a faite ». Là aussi, nous avons l'évolution de la forme plutôt que celle du fond. Ce n'est pas « une analyse plus délicate », qui a donné de nouveaux principes ; elle a donné la justification logique des sentiments non-logiques qui s'étaient developpés dans l'esprit des Romains et de leurs jurisconsultes.
§ 812. « (p. 317) En face de cette doctrine nouvelle, les Sabiniens, probablement sans nier qu'il y eût un objet nouveau, ont refusé d'admettre l'acquisition de l'œuvre par l'ouvrier et ont soutenu que la chose nouvelle devait appartenir au propriétaire de la chose ancienne ». Comme de coutume, les Sabiniens avaient une solution dictée par certains de leurs sentiments, et tâchaient ensuite de la justifier par des raisonnements logiques.
§ 813. Le Digeste nous donne un échantillon de ces raisonnements (XLI, 1, 7). « Si quelqu'un a créé en son nom une nouvelle espèce, avec les matériaux d'autrui, Nerva et Proculus estiment que le propriétaire est celui qui a créé. Sabinus et Cassius estiment plus conforme à la raison naturelle, que celui qui était propriétaire des matériaux soit propriétaire de ce qui est fait avec ces mêmes matériaux ; parce que sans matériaux, aucune espèce ne peut être produite ». Elle est complaisante, cette naturalis ratio ; elle ne refuse jamais son secours à personne, et grâce à elle, on peut démontrer très facilement le pour et le contre. Ces raisonnements sont vides de sens et ne manifestent que certains sentiments.
§ 814. On a fini par admettre une solution moyenne, sans pouvoir l'appuyer sur de meilleurs motifs. On a suivi l'opinion de Sabinus et de Cassius, quand on pouvait rendre à l'ouvrage fait sa forme primitive ; et quand cela n'était pas possible, on a suivi l'opinion de Nerva et de Proculus.
§ 815. Revenons au cas général. Le langage vulgaire est presque toujours synthétique et vise des cas concrets ; aussi confond-il habituellement les parties (a) et (b) que l'analyse scientifique doit séparer (§ 817). Au point de vue pratique, il peut être utile de traiter ensemble les parties (a) et (b). Si les principes (a) étaient précis, ceux qui les admettent en accepteraient aussi toutes les conséquences logiques (b) ; mais les principes (a) manquant de précision, on en peut tirer ce qu'on veut ; et c'est pourquoi les déductions (b) ne sont admises que dans la mesure où elles sont d'accord avec les sentiments qui, de cette manière, sont appelés à dominer les déductions logiques [FN: § 815-1] .
§ 816. Le blâme souvent adressé à la casuistique morale ou aux subtilités légales, a pour principale raison le fait que, grâce au manque de précision des principes (a), on a intentionnellement tiré de ceux-ci des conséquences qui répugnent au sentiment.
§ 817. Au point de vue scientifique, tout perfectionnement de la théorie est étroitement lié au fait de séparer autant que possible les parties (a) et (b). C'est là un point sur lequel on ne saurait trop insister. Il va sans dire que l'art doit étudier synthétiquement le phénomène concret (c), et que, par conséquent, il ne sépare pas les parties (a) et (b) ; et c'est un puissant moyen de persuasion, parce que presque tous les hommes ont l'habitude de la synthèse, et comprennent difficilement, ou mieux, sont incapables de comprendre l'analyse scientifique. Mais qui veut édifier une théorie scientifique ne peut s'en passer. Tout cela est très difficile à faire comprendre à ceux qui n'ont pas l'habitude du raisonnement scientifique, ou qui s'en défont quand ils traitent de matières touchant la sociologie. Ils veulent obstinément envisager les phénomènes d'une manière synthétique (§ 25, 31).
§ 818. Quand on lit un auteur avec l'intention d'en juger scientifiquement les théories, il faut donc effectuer d'abord la séparation qu'il n'a presque jamais faite, des parties (a) et (b). En général, dans toute théorie, il est nécessaire de bien séparer les prémisses, c'est-à-dire les principes, les postulats, les sentiments, des déductions qu'on en tire [FN: § 818-1].
§ 819. Il faut prendre garde que souvent, dans les théories qui ajoutent quelque chose à l'expérience (§ 803), les prémisses sont au moins partiellement implicites ; c'est-à-dire que la partie (a) de la théorie n'est pas exprimée ou ne l'est pas entièrement. Si on veut la connaître, il faut la chercher. C'est justement ce que nous avons été conduit à effectuer incidemment, depuis le chapitre II (§ 186 et sv., 740), puis dans les chapitres IV et V. Bientôt nous nous en occuperons à fond dans les chapitres suivants.
§ 820. Au point de vue logico-expérimental, le fait que les prémisses sont implicites, même seulement d'une manière partielle, peut être la source de très graves erreurs. Le seul fait d'exprimer les prémisses pousse à rechercher si et comment on doit les admettre ; tandis que, si elles sont implicites, on les accepte sans avoir conscience de ce qu'on fait ; on les croit rigoureuses, alors que, loin de l'être, c'est à peine si on peut leur trouver un sens quelconque.
§ 821. Souvent les auteurs passent sous silence les prémisses étrangères à l'expérience, et souvent aussi, quand ils les énoncent, ils essaient de faire naître une confusion entre elles et les résultats de l'expérience. On a un exemple remarquable de cette confusion, dans la théorie dont Rousseau fait précéder son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes [FN: § 821-1] . « Commençons donc d'abord par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature des choses qu'à en montrer la véritable origine, et semblables à celles que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde » [FN: § 821-2] . En somme, c'est donc une recherche expérimentale que veut faire Rousseau ; mais son expérience est d'une nature spéciale – comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience religieuse – et qui n'a rien à voir avec l'expérience des sciences physiques, malgré la confusion que Rousseau essaie de créer, et qui n'est qu'une preuve de sa grande ignorance. Notre auteur continue : « La religion nous ordonne de croire que Dieu lui-même ayant tiré les hommes de l'état de nature immédiatement après la création, ils sont inégaux parce qu'il a voulu qu'ils le fussent ; mais elle ne nous défend pas de former des conjectures tirées de la nature seule de l'homme et des êtres qui l’environnent [voilà la pseudo-expérience], sur ce qu'aurait pu devenir le genre humain s'il fût resté abandonné à lui-même. Voilà ce qu'on me demande, et ce que je me propose d'examiner dans ce discours. Mon sujet intéressant l'homme en général [abstraction qui a pour but de chasser l'expérience, après avoir fait semblant de l'admettre], je tâcherai de prendre un langage qui convienne à toutes les nations [dont une partie était absolument inconnue à ce savant rhéteur], ou plutôt, oubliant le temps et les lieux, pour ne songer qu'aux hommes à qui je parle, je me supposerai dans le lycée d'Athènes, ayant les Platon et les Xénocrate pour juges, et le genre humain pour auditeur ». Et il continue à pérorer, et découvre, en partant de la nature des choses, comment elles ont dû être ; cela sans avoir l'ennui de vérifier ses belles théories par les faits, puisqu'il a commencé par dire qu'il les mettait de côté. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de personnes qui admirent de tels discours vides de sens ; c'est pourquoi l'on doit en tenir compte, quand on veut étudier les phénomènes sociaux.
§ 822. Bon nombre d'autres auteurs, qui affectent pourtant de n'employer que des méthodes scientifiques et même de science « matérialiste », suivent d'une manière plus ou moins couverte la voie ouvertement parcourue par Rousseau. Voici, par exemple, Engels, qui avoue qu'on ne peut avoir de témoignages directs d'un certain état inférieur de l'humanité, mais qui en démontre a priori l'existence, comme étant une conséquence de la transformation de l'animal en homme. Il est beau d'écrire ainsi l'histoire [FN: § 822-1], et de tirer d'hypothèses tout à fait incertaines, la description de temps tout à fait inconnus. Les gens qui admirent de semblables façons de raisonner se croient plus « scientifiques » que ceux qui admiraient les saints Pères de l'Église catholique, quand ils niaient l'existence des antipodes (§ 15).
§ 823. Un cas amusant est celui de Burlamaqui (§ 439). Sa théorie du « droit naturel » est entièrement métaphysique. Il écrit pourtant [FN: § 823-1]: « ... si l'on fait bien attention à la manière dont nous avons établi les principes des lois naturelles, on reconnaîtra que la méthode que nous avons suivie est une nouvelle preuve de la certitude et de la réalité de ces lois. Nous avons mis à part toute spéculation abstraite et métaphysique, pour ne consulter que le fait, que la nature et l'état des choses ». Mais il ne tarde pas à se démentir lui-même, avec une grande naïveté, en continuant ainsi :. « C'est dans la constitution essentielle de l'homme et dans les rapports qu'il a avec les autres êtres, que nous avons puisé nos principes... ». La constitution essentielle dépasse l'expérience, à laquelle sont étrangères toutes les considérations sur les essences. Notre auteur comprend si peu ce qu'il dit, qu'il ajoute : « ...il nous semble qu'on ne saurait méconnaître les lois naturelles, ni douter de leur réalité, sans renoncer aux plus pures lumières de la raison, ce qui conduirait jusqu'au pyrrhonisme ». Dans le domaine expérimental, c'est l'accord de la théorie avec les faits qui décide, et non « la pure lumière de la raison ».
§ 824. En admettant la partie (a), on peut constituer par la méthode déductive la partie (b) ou mieux (B) ; c'est pourquoi son étude est beaucoup plus facile que celle de la partie (a). Cette étude a produit les seules sciences sociales qui sont aujourd'hui développées et rigoureuses : la science des théories juridiques et l'économie pure (§ 825). Cette étude de la partie (b) sera d'autant plus parfaite qu'elle sera constituée davantage par la logique seule ; d'autant plus imparfaite, au contraire, qu'un grand nombre de principes non-expérimentaux s'insinueront et seront acceptés, alors que, rigoureusement, ils devraient rester dans la partie (a). En outre, puisque cette partie (a) ou même (A) (§ 803) est celle qui donne ou peut donner lieu à des doutes et des incertitudes, plus elle sera petite, plus la science qu'on en déduit pourra être rigoureuse.
§ 825. L'économie pure a justement l'avantage de pouvoir tirer ses déductions d'un très petit nombre de principes expérimentaux, et emploie la logique avec tant de rigueur [FN: § 825-1] , qu'elle peut donner une forme mathématique à ses raisonnements ; ceux-ci ont aussi le très grand avantage de porter sur des quantités. La science des théories juridiques a aussi l'avantage de nécessiter un petit nombre de principes, mais n'a pas celui de pouvoir traiter de quantités. Ce grave inconvénient subsiste encore pour la sociologie ; mais il faut faire disparaître celui de l'intromission de la partie (a) dans la partie (b).
§ 826. En général, on peut admettre arbitrairement certains principes (a) ; et pourvu qu'ils soient précis, on en pourra tirer un corps de doctrine (c). Mais il est évident que si ces principes (a) n’ont rien à voir avec la réalité, la partie (c) n'aura rien à faire avec les cas concrets. Quand on veut constituer une science, il convient donc de choisir judicieusement les principes (a), de façon à s'approcher le plus possible de la réalité, en sachant toutefois que jamais une théorie (c) ne pourra la reproduire dans tous ses détails (§ 106).
§ 827. Il y a d'autres théories sociologiques, par lesquelles on a essayé de constituer un corps de doctrine rigoureusement scientifique, mais malheureusement sans réaliser cette intention, parce que les principes dont on tirait les déductions s'écartaient trop de l'expérience (§ 2015 et sv.).
§ 828. Le darwinisme social est l'une de ces théories. Si l'on admet que les institutions d'une société sont toujours celles qui correspondent le mieux aux circonstances où elle se trouve, excepté des oscillations temporaires, et que les sociétés qui ne possèdent pas d'institutions de ce genre finissent par disparaître, on a un principe apte à recevoir des développements logiques importants, et capable de constituer une science. Cette étude a été faite, et pendant quelque temps, on a pu espérer avoir enfin une théorie scientifique (c) de la sociologie, étant donné qu'une partie des déductions (b) étaient vérifiées par les faits. Mais cette doctrine tomba en décadence avec celle dont elle tirait son origine : avec la théorie darwinienne de la production des espèces animales et végétales. On s'aperçut que, trop souvent, on arrivait à donner des explications verbales des faits. Toute forme des institutions sociales ou des êtres vivants devait être expliquée par l'utilité qu'elle produisait ; et, pour y arriver, on faisait intervenir des utilités arbitraires et imaginaires. Sans s'en apercevoir, on revenait ainsi à l'ancienne théorie des causes finales. Le darwinisme social demeure encore un corps de doctrine (c) assez bien construit ; mais il faut le modifier beaucoup, pour le mettre d'accord avec les faits. Il ne détermine pas la forme des institutions : il détermine seulement certaines limites que celles-ci ne peuvent outrepasser (§ 1770).
§ 829. Une autre théorie (b) est constituée par le matérialisme historique. Si on le comprend en ce sens que l'état économique d'une société y détermine entièrement tous les autres phénomènes sociaux, on obtient un principe (a), dont on peut tirer de nombreuses déductions, de manière à constituer une doctrine. Le matérialisme historique a été un notable progrès scientifique, parce qu'il a servi à mettre en lumière le caractère contingent de certains phénomènes, tel que le phénomène moral et le phénomène religieux, auxquels on donnait, et beaucoup donnent encore, un caractère absolu. En outre, il renferme certainement une part de vérité, qui est la mutuelle dépendance du phénomène économique et des autres phénomènes sociaux. L'erreur, ainsi que nous aurons souvent à le rappeler, consiste à avoir changé cette mutuelle dépendance en une relation de cause à effet.
§ 830. Une circonstance accessoire est venue accroître considérablement l'erreur. Le matérialisme historique s'est joint à une autre théorie : celle de la « lutte des classes », dont il pourrait toutefois être entièrement indépendant ; et de plus, par une audacieuse dichotomie, ces classes furent réduites à deux. De cette manière, on abandonna de plus en plus le domaine de la science, pour faire des excursions dans celui du roman. La sociologie devient une science très facile ; il est inutile de perdre son temps et sa peine à découvrir les rapports des phénomènes, leurs uniformités ; quel que soit le fait que nous raconte l'histoire ; quelle que soit l'institution qu'elle nous décrive, quelle que soit l'organisation politique, morale, religieuse, qu'elle nous fasse connaître, tous ces faits ont pour cause unique l'action de la « bourgeoisie » pour « exploiter le prolétariat », et subsidiairement la résistance du « prolétariat » à l'exploitation. Si les faits correspondaient à ces déductions, nous aurions une science aussi et même plus parfaite que toute autre science humaine. Malheureusement, la théorie suit une voie, et les faits en suivent une autre, entièrement différente (§ 1884).
§ 831. Une autre théorie encore, qu'on peut dire être celle de Spencer et de ses adeptes, pourrait s'appeler la théorie des limites, si l'on enlève les nombreuses parties métaphysiques des œuvres de ces auteurs. Elle prend pour principe (a) que toutes les institutions sociales tendent vers une limite, sont semblables à une courbe qui a une asymptote (§ 2279 et sv.). Connaissant la courbe, on peut déterminer l'asymptote. Connaissant le développement historique d'une institution, on peut en déterminer la limite ; et même, on le fait plus facilement que dans le problème beaucoup plus simple de la détermination mathématique des asymptotes ; car, pour celle-ci, il ne suffit pas de connaître quelques points de la courbe : il faut en avoir l'équation, c'est-à-dire en connaître la nature intrinsèque ; tandis qu'une fois donnés quelques points de la courbe qui représente une institution, on peut, ou pour mieux dire, on croit pouvoir en déterminer ipso facto la limite.
§ 832. Ce principe (a) est susceptible de déductions scientifiques (b), et donne par conséquent un corps de doctrine étendu. On peut le voir dans la sociologie de Spencer et dans d'autres ouvrages analogues. Avec ces doctrines, nous nous approchons beaucoup de la méthode expérimentale, – toujours abstraction faite des parties métaphysiques de ces œuvres – car enfin, c'est des faits que nous tirons les conclusions. Malheureusement, ce n'est pas des faits seuls : il y a en outre l'intromission de ce principe, que les institutions ont une limite, et de cet autre, qu'on peut déterminer cette limite, en connaissant un petit nombre d'états successifs des institutions.
Ajoutons que, par une coïncidence qui serait vraiment étrange si elle était fortuite, la limite qu'un auteur suppose déterminée exclusivement par les faits, se trouve être identique à celle que l'auteur est poussé à désirer par ses propres sentiments. S'il est pacifiste comme Spencer, des faits complaisants lui démontrent que la limite dont se rapprochent les sociétés humaines est celle de la paix universelle ; s'il est démocrate, aucun doute que la limite ne sera le triomphe complet de la démocratie ; s'il est collectiviste, le triomphe du collectivisme ; et ainsi de suite. Alors surgit et se fortifie un doute : les faits ne serviraient-ils pas uniquement à voiler des motifs plus puissants de persuasion ?
Quoi qu'il en soit, les motifs admis de cette manière, par ces positivistes, ne correspondent pas du tout aux faits, et cela vicie toutes les déductions qu'on en tire. Ensuite, leurs théories présentent le grave défaut, qui d'ailleurs pourrait se corriger avec le temps, que nous sommes bien loin de posséder aujourd'hui les renseignements historiques qui seraient strictement indispensables à l'emploi de cette méthode.
§ 833. La théorie à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure est d'une autre nature que celles qui, choisissant un principe (a), tout à fait dépourvu de précision, vague, indéfini, nébuleux, en tirent des conclusions avec une logique apparemment rigoureuse. Ces conclusions ne sont autre chose que l'expression des sentiments de leur auteur, et le raisonnement qui les relie à (a) ne leur procure pas même la plus petite force démonstrative. En effet, un cas très fréquent est celui où, d'un même principe (a), un auteur tire certaines conclusions, tandis qu'un autre en tire d'entièrement opposées. En général, il y a peu à dire sur le raisonnement, mais beaucoup sur le principe, qui ne peut servir de prémisse à un raisonnement rigoureux, et qui, comme la gomme élastique, peut être étiré dans le sens désiré.
§ 834. Les théories (c) ne peuvent parvenir à une forme même passablement scientifique, que si les principes (a) sont tant soit peu précis. À ce point de vue, une précision artificielle vaut encore mieux que le défaut de toute précision. Quand nous traitons de matières juridiques, ce défaut de précision peut être corrigé par les fictions (§ 834 note 1). Dans d'autres sciences aussi, on peut tirer profit de cette méthode, employée dans le but de simplifier l'énoncé des théorèmes. On s'en sert même en mathématique. Par exemple, le théorème d'après lequel toute équation algébrique a un nombre de racines égal à son degré est utile et commode sous cette forme ; mais il n'est vrai que grâce à la fiction qui fait compter au nombre des racines, non seulement les racines réelles, mais aussi les racines imaginaires.
§ 835 C'est un fait très connu qu'à Rome le droit prétorien a corrigé le droit civil, non pas en en changeant les principes (a), qui conservèrent quelque temps toute leur rigueur formelle, mais en y ajoutant des interprétations et des dispositions. Le préteur annonce que, tandis que, d'après le droit civil, l'engagement obtenu par le dol est valable, il donnera une exception pour ne pas exécuter l'engagement, c'est-à-dire qu'il insère dans la formule la clause qui enjoint au juge de condamner, seulement si in ea re nihil dolo malo Auli Ageri (nom conventionnel du demandeur) factum sit neque fiat (exceptio doli mali) [FN: § 835-1] . Quelle que soit la théorie qu'on admette à propos de la bonorum possessio, il est incontestable qu'à une certaine époque, cette bonorum possessio a servi à l'introduction d'une hérédité prétorienne plus étendue que l'hérédité du droit civil. Les deux modes d'hérédité existaient ensemble. Si l'on voulait, par exemple, tenir compte de la consanguinité, on aurait pu modifier le droit civil, comme les empereurs le firent plus tard. On a préféré appeler à l'hérédité unde liberi ceux que le droit civil aurait appelés comme sui, s'ils n'avaient été l'objet d'une minima capilis diminutio.
§ 836. Cette façon de procéder était en rapport étroit avec l'état psychique dont nous avons longuement parlé au chapitre II ; mais en outre, probablement sans s'en apercevoir, on atteignait un résultat fort important : celui de donner de la stabilité aux principes (a) du droit et, par conséquent, de pouvoir constituer le corps de doctrines (c). C'est là probablement une des raisons principales pour lesquelles le droit romain put devenir tellement supérieur au droit athénien.
§ 837. Il existe des théories semblables à celles du droit romain, dans un très grand nombre de cas. On a pu croire que certains pays, comme l'Angleterre, qui n'avaient que le droit coutumier (en Angleterre : la common law ), possédaient seulement un droit (a). Mais c'est une erreur que Sumner Maine a très bien corrigée [FN: § 837-1] . Il a noté les analogies du droit anglais, supposé issu des case law antérieures, avec les responsa prudentium des Romains. La partie (b) existe dans le droit de la common law ; mais elle est théoriquement très inférieure aux parties (b) d'autres droits, qui ont décidément édifié et accepté les théories juridiques.
§ 838. Les êtres concrets juridiques sont constitués par les parties (a) et (b). Le droit descriptif (c) nous fait connaître ces êtres, comme la minéralogie nous fait connaître les roches et les minéraux dont la chimie nous apprend ensuite la composition.
§ 839. Le prof. Roguin nous a donné des traités de (b) et de (c), avec peu de (a). Par conséquent ces traités appartiennent, au moins en partie, à la science générale de la société. Dans son livre : La règle de droit, il s'occupe de (b). Il dit : « (p. V) il s'agit d'une étude absolument neutre, c'est-à-dire affranchie de toute appréciation. Il n'y a dans notre livre aucune trace de critique, au point de vue de la justice ou de la morale. Ce n'est pas non plus une étude de droit naturel, ni de philosophie, dans le sens ordinairement prêté à ce mot. L'ouvrage ne porte pas davantage sur l'histoire du droit ; il ne se préoccupe point de rattacher les institutions juridiques à leurs causes, ni d'en montrer les effets. Nous ne traitons pas même du droit comparé. – Nous avons eu pour but d'analyser les règles de droit ayant existé historiquement ou « même seulement (p. VI) imaginables, possibles, de montrer la nature distincte du rapport juridique à l'égard des relations d'autres espèces et d'en dégager les éléments constants ».
§ 840. Puis, dans son Traité de droit civil comparé, le même auteur s'occupe de (c), en y ajoutant quelque développement (b) [FN: § 840-1] . « (p. 9) Il importe de distinguer rigoureusement les constatations des appréciations [on le fait bien rarement en sociologie], l'histoire, qui enregistre les faits objectifs, de la critique, exprimant sur eux des jugements [on ne veut pas même le faire en histoire !] ».
§ 841. L'application des dispositions du droit civil est souvent facile, parce qu'elles excitent peu, du moins en général, les sentiments. Ceux-ci acquièrent déjà une grande force dans le droit pénal ; ils deviennent souverains dans le droit international. C'est l'une des très nombreuses raisons pour lesquelles les théories du droit pénal ont toujours été beaucoup moins parfaites que celles du droit civil. Dans la morale et dans la religion, les sentiments dominent, et par conséquent il est très difficile d'avoir des théories, sinon scientifiques, du moins un peu précises. On a simplement un monceau informe d'expressions de sentiments et de préjugés métaphysiques [FN: § 841-1] . L'école italienne du droit positif pourrait devenir scientifique, si elle se débarrassait des appendices inutiles de la foi démocratique, et si elle n'avait pas la manie des applications immédiates, qui sont le grand ennemi de tout genre de théories. Il semble en tout cas que c'est en suivant la voie qu'elle a ouverte, qu'on pourra parvenir à une théorie scientifique du droit pénal. La théologie possède une partie (b), qui est souvent bonne et bien développée, comme chez Saint Thomas, mais la partie (a) dépasse entièrement l'expérience ; et par conséquent, nous n'avons pas à nous en occuper. L'éthique part aussi de principes non expérimentaux, et a de plus une partie (b) vraiment informe, et qui perd presque toute valeur logique quand l'éthique se sépare de la théologie. Avec ces pseudo-sciences, nous sortons complètement du domaine logico-expérimental.
[450]
Chapitre VI↩
Les résidus [(§842 à §1088), vol. 1, pp. 450-577]
§ 842. Si l'on suivait la méthode déductive, ce chapitre devrait être placé au commencement de l'ouvrage. Plus tard, il conviendra peut-être d'employer cette méthode pour d'autres traités. J'ai préféré commencer maintenant par la méthode inductive, afin que le lecteur parcoure, lui aussi, le chemin suivi pour trouver les théories qui vont être exposées.
En observant les phénomènes concrets et complexes, nous avons vu immédiatement qu'il était avantageux de les diviser au moins en deux parties, et de séparer les actions logiques des actions non-logiques. Le chapitre II a pour but d'effectuer cette séparation, et d'acquérir une première idée de la nature des actions non-logiques et de leur importance dans les phénomènes sociaux. À cet endroit, surgit cette question : si les actions non-logiques ont tant d'importance dans les phénomènes sociaux, comment a-t-on pu négliger jusqu'à présent d'en tenir compte ? (§ 252). On répond, au chapitre III, que presque tous les auteurs qui se sont occupés d'études politiques ou sociales, ont vu ou entrevu les actions non-logiques. Ainsi nous faisons maintenant une théorie dont beaucoup d'éléments sont épars çà et là, souvent d'une façon à peine reconnaissable.
§ 843. Mais tous ces auteurs ont des idées auxquelles ils donnent explicitement une importance capitale ; telles seraient les idées de religion, de morale, de droit, etc., autour desquelles on bataille depuis des siècles. Et s'ils reconnaissent implicitement les actions non-logiques, ils exaltent explicitement les actions logiques, et le plus grand nombre d'entre eux les considèrent comme seules dignes d'être prises en considération dans les phénomènes sociaux. Nous devons voir ce qu'il y a de vrai dans ces théories, et décider ensuite s'il nous faut quitter la voie où nous sommes entrés, ou la poursuivre. Au chapitre IV, nous étudions justement ces façons d'envisager les phénomènes sociaux ; et nous reconnaissons qu'au point de vue logico-expérimental, elles manquent absolument de précision, et sont dépourvues de tout accord rigoureux avec les faits ; tandis que, d'autre part, nous ne pouvons nier la grande importance qu'elles ont dans l'histoire et dans la détermination de l'équilibre social. Ainsi acquiert de la force une conception que le chapitre I nous avait déjà donnée, et dont l'importance ira toujours en augmentant dans le reste de l'ouvrage ; c'est l'idée de la séparation de la vérité expérimentale de certaines théories, et de leur utilité sociale ; choses qui, non seulement ne se confondent pas, mais peuvent même être et sont souvent contradictoires (§ 1681 et sv., 1897 et sv.).
§ 844. Cette séparation est aussi importante que celle des actions logiques et des actions non-logiques; et l'induction nous montre que c’est pour l'avoir négligée, que la plupart des théories sociales sont tombées dans l'erreur, au point de vue scientifique.
§ 845. Nous étudions alors d'un peu plus près ces théories, et nous voyons comment et pourquoi elles sont erronées, et comment et pourquoi, tout en étant telles, elles ont eu et ont encore un si grand crédit. C'est la tâche du chapitre V. En procédant à cette étude, nous trouvons d'autres choses auxquelles nous n'avions pas pensé tout d'abord. Poursuivant nos recherches, nous continuons à analyser, à séparer. Et voici maintenant une nouvelle séparation, certainement aussi importante que les autres auxquelles nous avons procédé jusqu'à présent : la séparation d'une partie constante, instinctive, non-logique, et d'une partie déductive, qui vise à expliquer, justifier, démontrer la première.
§ 846. Arrivés à ce point, grâce à l'induction, nous avons les éléments d'une théorie. Il faut maintenant la constituer ; C'est-à-dire abandonner la méthode inductive pour la méthode déductive, et voir quelles sont les conséquences des principes que nous avons trouvés ou cru trouver. Nous comparerons ensuite ces déductions avec les faits. S'ils concordent, nous conserverons notre théorie s'ils ne concordent pas, nous l'abandonnerons.
§ 847. Dans le présent chapitre et, en raison de l'abondance des matériaux, dans les deux suivants aussi, nous étudierons la partie constante que nous avons désignée par la lettre (a). Aux chapitres IX et X, nous étudierons la partie déductive (b). Mais avant de poursuivre ces études difficiles, il est nécessaire de placer encore quelques considérations générales sur (a) et (b), ainsi que sur leur résultante (c).
§ 848. Nous avons déjà vu (§ 803) que, dans les théories de la science logico-expérimentale, on trouve des éléments (A) et (B), qui sont en partie semblables aux éléments (a) et (b) des théories non purement logico-expérimentales, et sont en partie différents.
Dans les sciences sociales, telles qu'on les a étudiées jusqu'à présent, on trouve des éléments qui se rapprochent plus de (a) que de (A), parce qu'on n'a pas évité l'intromission du sentiment, de préjugés, d'articles de foi et d'autres semblables tendances, postulats, principes, qui font sortir du domaine logico-expérimental.
§ 849. La partie déductive des sciences sociales, telles qu'on les a étudiées jusqu'à présent, se rapproche parfois beaucoup de (B), et l'on ne manque pas d'exemples, dans lesquels l'emploi d'une logique rigoureuse la ferait concorder tout à fait avec (B), si ce n'était le défaut de précision des prémisses (a) ; défaut qui enlève toute rigueur au raisonnement. Mais souvent, dans ces sciences sociales, la partie déductive se rapproche beaucoup de (b), parce qu'elle renferme de nombreux principes non-logiques, non-expérimentaux, et que les tendances, les préjugés, etc., y sont très puissants.
§ 850. Occupons-nous maintenant d'étudier à fond les éléments (a) et (b). L'élément (a) correspond peut-être à certains instincts de l'homme, ou pour mieux dire, des hommes, parce que (a) n'a pas d'existence objective et diffère suivant les hommes ; et c'est probablement parce qu'il correspond à ces instincts, qu'il est presque constant dans les phénomènes. L'élément (b) correspond au travail accompli par l'esprit pour rendre raison de l'élément (a). C'est pour cela qu'il est beaucoup plus variable, puisqu'il reflète le travail de la fantaisie. Nous avons vu déjà, au chapitre précédent, (§ 802) que la partie (b) doit, à son tour, être divisée, en partant d'un extrême où elle est purement logique, pour arriver à un autre extrême où elle est un pur instinct et une fantaisie. Nous nous occuperons de cela aux chapitres IX et X.
§ 851. Mais si la partie (a) correspond à certains instincts, elle est bien loin de les comprendre tous. Cela se voit à la manière même dont on l'a trouvée. Nous avons analysé les raisonnements et cherché la partie constante. Ainsi donc, nous ne pouvons avoir trouvé que les instincts qui donnent naissance à des raisonnements, et nous n'avons pu rencontrer sur notre chemin ceux qui ne sont pas recouverts par des raisonnements. Restent donc tous les simples appétits, les goûts, les dispositions et, dans les faits sociaux, cette classe très importante qu'on appelle les intérêts.
§ 832. En outre, il se peut que nous n'ayons trouvé qu'une partie d'une des choses (a), l'autre demeurant à l'état de simple appétit. Par exemple, si l'instinct sexuel ne se manifestait qu'en tendant à rapprocher les sexes, il n'apparaîtrait pas dans nos études. Mais cet instinct se recouvre souvent et se dissimule sous le couvert de l'ascétisme : il y a des gens qui prêchent la chasteté pour avoir l'occasion d'arrêter leurs pensées aux unions sexuelles. Quand nous examinerons leurs raisonnements, nous trouverons donc une partie (a), qui correspond à l'instinct sexuel, et une partie (b), qui est un raisonnement dont elle se revêt. En cherchant attentivement, peut-être trouverait-on des parties analogues dans les appétits pour les aliments et les boissons ; mais pour ceux-ci la part du simple instinct est en tous cas beaucoup plus importante que l'autre.
§ 853. Le fait d'être prévoyant ou imprévoyant dépend de certains instincts et de certains goûts ; et, à ce point de vue, on ne trouverait pas ce fait dans les choses (a). Mais l'imprévoyance a donné lieu, spécialement aux États-Unis d'Amérique, à une théorie par laquelle on prêche aux gens qu'ils doivent dépenser tout ce qu'ils gagnent ; et par conséquent, si nous examinons cette théorie, nous y trouverons une chose (a) qui sera l'imprévoyance.
§ 854. Un politicien est poussé à préconiser la théorie de la solidarité, par le désir d'obtenir argent, pouvoir, honneurs. Dans l'étude de cette théorie, ce désir, qui est d'ailleurs celui de presque tous les politiciens, n'apparaîtra qu'à la dérobée. Au contraire, les principes (a), propres à persuader autrui, occuperont la première place. Il est manifeste que si le politicien disait : « Croyez à cette théorie, parce qu'elle tourne à mon profit ». il ferait rire et ne persuaderait personne. Il doit donc se fonder sur certains principes qui puissent être admis par ceux qui l'écoutent.
En nous arrêtant à cette observation, il pourrait sembler que, dans le cas examiné, les (a) se trouveraient, non pas dans les principes au nom desquels la théorie est préconisée, mais bien dans ceux au nom desquels elle est acceptée. Mais en avançant davantage, on voit que cette distinction ne tient pas ; car souvent celui qui veut persuader autrui commence par se persuader lui-même ; bien plus, s'il est mû principalement par son propre intérêt, il finit par croire qu'il est mû par le désir du bien d'autrui. Rare et peu persuasif est l'apôtre incroyant ; au contraire, fréquent et persuasif est l'apôtre croyant ; et plus il est croyant, plus son œuvre est efficace. Par conséquent, les parties (a) de la théorie se trouvent aussi bien chez celui qui l'accepte que chez celui qui la préconise, mais il faut y ajouter l'intérêt, tant de celui-ci que de celui-là.
§ 855. Quand nous analysons une théorie (c), il faut distinguer soigneusement les recherches au point de vue objectif et celles au point de vue subjectif (§ 13). Très souvent, au contraire, on les confond, et ainsi naissent deux erreurs principales. D'abord – nous en avons parlé souvent déjà – on confond la valeur logico-expérimentale d'une théorie avec, sa force de persuasion ou avec son utilité sociale. Puis, erreur spécialement moderne, on substitue à l'étude objective d’une théorie, l'étude subjective, recherchant comment et pourquoi son auteur l'a construite. Cette seconde étude est certainement importante, mais doit s'ajouter et non se substituer à la première. Savoir si un théorème d'Euclide est vrai ou faux, et savoir comment Euclide l'a découvert, sont des investigations différentes et telles que l'une n'exclut pas l'autre. Si les Principia de Newton étaient d'un auteur inconnu, leur valeur en diminuerait-elle pour cela ?
C'est ainsi que l'on confond deux des aspects indiqués au § 541, et sous lesquels on peut envisager la théorie d'un auteur ; savoir : 1° ce que pensait l'auteur, son état psychique, et comment il a été déterminé ; 2° ce que l'auteur a voulu dire, en un passage déterminé. Le premier aspect, qui est personnel, subjectif pour l'auteur, vient à se confondre avec le second, qui est impersonnel, objectif. À cela contribue souvent la considération de l'autorité de l'auteur ; car, poussé par ce sentiment, on admet a priori que ce qu'il pense et croit, doit nécessairement être « vrai » ; aussi vaut-il tout autant rechercher ses idées, que d'examiner si ce qu'il a voulu dire est « vrai », ou est d'accord avec l'expérience, dans le cas des sciences logico-expérimentales.
§ 856. On a longtemps été porté à envisager les théories exclusivement sous le 2e aspect ; c'est-à-dire sous l'aspect de leur valeur intrinsèque, qui était parfois la valeur logico-expérimentale, et beaucoup plus souvent la valeur par rapport aux sentiments de celui qui les examinait, ou par rapport à certains principes métaphysiques ou théologiques. Maintenant, on incline à les considérer exclusivement sous l'aspect extrinsèque de la manière dont elles ont été produites et acceptées, c'est-à-dire sous les aspects 1°, et 3 du § 541. Si ces deux façons d'envisager les théories sont exclusives elles sont également incomplètes et, par ce fait, erronées.
§ 857. La seconde erreur notée au § 855 est l'opposé de la première. Celle-ci ne tenait compte que de la valeur intrinsèque de la théorie (2e aspect du § 541); celle-là ne tient compte que de sa valeur extrinsèque (1er et 3e aspect) ; elle apparaît souvent dans l'abus que l'on fait maintenant de la méthode historique, spécialement dans les sciences économiques et sociales. À l'origine, les auteurs qui créèrent l'économie politique eurent le tort de donner à leur science une valeur absolue, cherchant à la soustraire aux contingences de lieu et de temps. Heureuse fut donc la réaction qui s'efforça, au contraire, d'en tenir compte ; et, à ce point de vue, la méthode historique fit progresser la science. Tout aussi importants furent les progrès scientifiques qui, aux principes dogmatiques dont on voulait tirer d'une manière absolue la forme des institutions sociales, substituèrent l'étude de l'histoire de ces institutions ; étude par laquelle on arrivait à connaître leur développement et leurs rapports avec les autres faits sociaux. Nous nous plaçons entièrement dans le domaine de la science logico-expérimentale, quand, au lieu d'étudier, par exemple, ce que doit être la famille, nous étudions ce qu'elle a été réellement. Mais il faut ajouter, et non substituer, cette étude à celle qui recherche les rapports où se trouve la constitution de la famille avec les autres faits sociaux. Il est utile de connaître comment ont été produites, historiquement, les théories de la rente ; mais il est utile aussi de savoir dans quel rapport ces théories se trouvent avec les faits, quelle est leur valeur logico-expérimentale.
§ 858. D'autre part, cette étude est beaucoup plus difficile que celle qui consiste à écrire une histoire. Nous voyons en effet nombre de gens, absolument incapables non seulement de créer, mais aussi de comprendre une théorie logico-expérimentale de l'économie politique, qui écrivent présomptueusement une histoire de l'économie politique.
§ 859. En littérature, l'étude historique dégénère souvent en un récit anecdotique, facile à faire, agréable à entendre. Trouver comment mangeait, buvait, dormait et se vêtait un auteur, est beaucoup plus facile, au point de vue intellectuel et scientifique, qu'examiner dans quels rapports ses théories se trouvent avec la réalité expérimentale ; et si l'on peut parler de ses amours, on fait un livre d'une lecture délectable (§ 541).
§ 860. L'étude de la partie (b) d'une théorie est justement celle de la partie subjective ; mais celle-ci peut encore être divisée en deux ; c'est-à-dire qu'il faut distinguer les causes générales des causes spéciales pour lesquelles une théorie est produite ou acquiert du crédit. Les causes générales sont celles qui agissent durant un temps qui n'est pas trop court, et qui s'appliquent à un nombre important d’individus. Les causes spéciales sont celles qui agissent essentiellement d'une manière contingente. Une théorie est-elle produite parce qu'elle convient à une classe sociale ? elle a une cause générale ; est-elle produite parce que son auteur a été payé, ou parce qu'il manifeste ainsi sa colère contre un rival ? elle a une cause spéciale.
Dans l'étude que nous ferons des théories (b), nous nous occuperons seulement des causes générales. L'étude des autres est secondaire et peut venir plus tard.
§ 861. Les choses qui ont une influence notable sur l'organisation sociale donnent lieu à des théories. Nous les trouverons, par conséquent, lorsque nous chercherons les (a). À ces choses, comme nous le disions tantôt, il faut ajouter les appétits et les intérêts ; et nous aurons ainsi l'ensemble de choses qui agissent sensiblement pour déterminer l'organisation sociale(§ 851), en prenant garde pourtant que l'organisation elle-même réagit sur ces choses, et que nous avons, par conséquent, un rapport non pas de cause à effet, mais de mutuelle dépendance. Si nous supposons, comme cela semble probable, que les animaux n'ont pas de théories, il ne pourra exister pour eux aucune partie (a), peut-être pas d'intérêts non plus, et il ne resterait que les instincts. Les peuples sauvages, même s'ils sont très proches des animaux, ont certaines théories ; et par conséquent, pour eux existe une partie (a) ; de plus, il y a certainement des instincts et des intérêts. Les peuples civilisés ont des théories pour un très grand nombre de leurs instincts et de leurs intérêts ; aussi la partie (a) se retrouve-t-elle dans presque toute leur vie sociale.
§ 862. Nous rechercherons justement cette partie (a), dans le présent chapitre et dans les suivants.
En nombre de cas déjà, (§ 186 et sv., 514-3] , 740) nous avons séparé les parties (a) et (b), mélangées et confondues en un même phénomène (c). De cette façon, nous nous sommes mis sur la voie de trouver une règle qui nous guide dans ces analyses. Voyons encore mieux cela par des exemples, et puis nous procéderons systématiquement à cette étude.
§ 863. Exemple I. Les chrétiens font usage du baptême. Si l'on ne connaissait que cette action, on ne saurait si l'on peut la décomposer en d'autres, ni comment (§ 186, 740). En outre, nous avons une explication : on nous dit qu'on procède à cette opération, pour effacer le péché originel. Cela ne suffit pas encore ; et si nous ne connaissions pas d'autres faits semblables, il nous serait difficile de décomposer en ses parties le phénomène complexe. Mais nous connaissons d'autres faits semblables. Les païens aussi avaient l'eau lustrale, qui servait aux purifications. Si l'on s'arrêtait là, on mettrait en rapport l'usage de l'eau et le fait de la purification. D'autres faits semblables nous montrent au contraire que l'usage de l'eau n'est pas encore la partie constante des phénomènes. Pour les purifications, on peut se servir de sang et d'autres matières. Cela ne suffit pas : il y a diverses pratiques qui atteignent le même but. Pour les transgressions aux tabous, (§ 1252) on procède à certaines opérations qui enlèvent à l'homme la tache contractée en certaines circonstances. Ainsi s'élargit toujours le cercle de faits semblables, tandis que dans une si grande variété de moyens et d'explications de leur efficacité, le sentiment demeure constant que, grâce à certaines pratiques, on rétablit l'intégrité de l'individu, altérée par certaines raisons, réelles ou imaginaires. Le phénomène concret est donc composé de cette partie constante (a) et d'une partie variable (b), qui comprend les moyens employés pour rétablir l'intégrité, et les raisonnements par lesquels on veut expliquer l'efficacité de ces moyens. L'homme a le sentiment confus que l'eau peut laver les taches morales, comme elle lave les taches matérielles ; mais d'habitude, il ne justifie pas de cette manière, jugée trop simple, l'emploi de l'eau pour rétablir l'intégrité : il va à la recherche d'explications plus complexes, de raisonnements plus étendus, et découvre facilement ce qu'il désire.
§ 864. Le noyau (a) trouvé tout à l'heure se compose de diverses parties. Nous y distinguons d'abord un instinct des combinaisons : on veut « faire quelque chose », combiner certaines choses et certains actes. Puis il y a la persistance des liaisons imaginées de cette manière. On pourrait essayer tous les jours une nouvelle combinaison ; mais il y en a une, même fantaisiste, qui domine et qui parfois devient exclusive ; elle persiste dans le temps. Enfin, il y a un instinct qui pousse à croire à l'efficacité de certaines combinaisons pour atteindre un but. On pourra dire que les combinaisons réellement efficaces, comme serait le fait d'allumer le feu avec le silex, poussent l'homme à croire aussi à l'efficacité de combinaisons imaginaires. Mais nous n'avons pas à nous occuper, pour le moment, de cette explication ou d'autres semblables. Il nous suffit d'avoir reconnu l'existence du fait, et nous nous arrêtons là, pour le moment. Dans d'autres études, nous pourrons tâcher de pousser plus avant, et d'expliquer les faits auxquels nous nous arrêtons maintenant par d'autres faits ; ceux-ci par d'autres encore et ainsi de suite.
§ 865. Exemple II. Au chapitre II (§ 186 et sv.), nous avons vu de nombreux cas dans lesquels les hommes croient pouvoir susciter ou éloigner les tempêtes. Si nous ne connaissions qu'un seul de ces cas, nous n'en pourrions rien ou presque rien inférer. Mais nous en connaissons beaucoup, et nous y voyons un noyau constant. Négligeant pour un moment la partie de ce noyau, qui, comme précédemment, se rapporte à la persistance de certaines combinaisons et à la foi en leur efficacité, nous trouvons d'abord une certaine partie constante (a), correspondant au sentiment de l'existence d'une divinité dont on peut provoquer l'intervention par des moyens variables (b), pour qu'elle agisse sur les tempêtes. Ensuite voici un autre genre, dans lequel on croit pouvoir obtenir l'effet par certaines pratiques qui, en elles-mêmes, ne signifient rien ; par exemple, en dépeçant un coq blanc et en en portant les deux moitiés autour du champ que l'on veut préserver du vent chaud (§ 189). Ainsi s'élargit le cercle et apparaît une autre partie constante (a), correspondant à un instinct de combinaisons par lequel, au hasard, on unit des choses et des actes, en vue d'obtenir un effet.
§ 866. Exemple III. Les catholiques estiment que le vendredi est un jour de mauvais augure, à cause, dit-on, de la passion du Christ. Si nous ne connaissions que ce cas, il serait difficile de savoir lequel des deux faits, c'est-à-dire le mauvais augure ou la passion du Christ, est le principal et lequel est l'accessoire. Mais nous avons beaucoup d'autres faits semblables. Les Romains avaient les dies atri ou vitiosi, qui étaient de mauvais augure : par exemple, le 18 juillet, jour où ils avaient perdu la bataille de l'Allia. Voilà un genre de (a) : le sentiment qui fait considérer comme de mauvais augure le jour qui rappelle un événement funeste. Mais il y a d'autres faits. Les Romains et les Grecs avaient des jours de mauvais ou de bon augure, sans qu'il y ait pour cela une raison spéciale, de la nature des précédentes. Il y a donc une classe de (a), qui comprend le genre précédent de (a), et qui correspond à des sentiments de combinaisons de jours – et d'autres choses aussi – à un bon ou à un mauvais augure (§ 908 et sv.).
§ 867. Ces exemples nous mettent à même de trouver comment on peut décomposer un phénomène complexe (c), en ses éléments (a) et (b). Dans le présent chapitre, nous ferons un très grand nombre d'autres décompositions semblables.
§ 868. Avant de pousser plus avant, il sera bon, peut-être, de donner des noms aux choses (a), (b) et (c) ; car les désigner par des lettres de l'αbet embarrasse quelque peu l'exposé et le rend moins clair. Pour ce motif (§ 119), à l'exclusion de tout autre, nous appellerons résidus les choses (a), dérivations les choses (b), dérivées les choses (c). Mais il faut avoir toujours présent à l'esprit qu'il n'y a rien, absolument rien, à inférer du sens propre de ces noms, de leurs étymologies, et que leur signification est exclusivement celle des choses (a), (b) et (c).
§ 869. Comme nous l'avons déjà vu, les résidus (a) constituent un ensemble de faits nombreux, qu'il faut classer suivant les analogies qu'on y trouve; et nous aurons ainsi des classes, des genres, des espèces. Il en est de même pour les dérivations (b).
§ 870. Les résidus correspondent à certains instincts des hommes ; c'est pourquoi la précision, la délimitation rigoureuse, leur font habituellement défaut ; et même ce caractère pourrait presque toujours servir à les distinguer des faits ou des principes scientifiques (A), qui ont avec eux quelque ressemblance. Souvent les (A) sont issus des (a), moyennant une opération qui a précisé les (a). Ainsi, le terme chaud est indéterminé ; et, en l'employant, on a pu dire que l'eau des puits est chaude en hiver et froide en été. Mais le terme physique chaud, correspondant à des degrés de chaleur mesurés avec un thermomètre, est déterminé ; et l'on a pu voir que l'eau des puits n'est pas, en ce sens, plus chaude en hiver qu'en été ; car un thermomètre, plongé dans cette eau, marque à peu près les mêmes degrés, ou indique une température plus basse l'hiver que l'été.
§ 871. Voyez, par exemple, dans Macrobe [FN: § 871-1], combien le terme chaud a de sens différents, qui ont pour résidu les sentiments que ce terme fait naître dans l'esprit de certaines personnes (§ 506). (VI) Les médecins disent que le vin est chaud ; mais il semble à un interlocuteur des Saturnales que la nature du vin est plutôt froide que chaude. (VII) Il y a un grand froid, dans le corps de la femme, dit quelqu'un ; mais quelqu'un d'autre réplique que, par nature, le corps de la femme est plus chaud que celui de l'homme. Et il renferme une telle chaleur que, lorsqu'il était d'usage de brûler les morts, avec dix cadavres d'hommes, on en mettait un de femme, grâce auquel on pouvait facilement brûler les premiers. La chaleur est le principe de la génération. Les femmes ont en elles une si grande chaleur que, lorsqu'il fait froid, elles peuvent garder des vêtements légers. Tout cela est contesté par un autre, excepté pour la génération, dont la cause paraît être vraiment la chaleur. (VIII) Pourquoi, en Égypte, qui est un pays très chaud, le vin a-t-il une vertu presque froide, au lieu d'être chaude ? Parce que, quand l'air est chaud, il repousse le froid dans la terre ; et, l'air étant toujours chaud en Égypte, le froid, en pénétrant dans la terre, agit sur les racines de la vigne et donne au vin sa qualité. Puis on explique aussi pourquoi un éventail donne de la fraîcheur [FN: § 871-2].
§ 872. C'est là le type des raisonnements métaphysiques anciens et modernes. Leurs prémisses renferment des termes dépourvus de toute précision, dont on veut tirer des conclusions certaines, avec une logique rigoureuse, comme si c'étaient des axiomes mathématiques. En somme, ils ont pour but d'étudier, non pas les choses, mais les concepts que certaines personnes ont de ces choses. Il est des gens qui, par une concession extrême, acceptent d'exclure ces raisonnements des sciences physiques, et veulent les conserver dans les sciences sociales. Mais aucun motif ne peut justifier cette différence, tant que nous restons dans le domaine expérimental.
§ 873. Nous avons là un nouvel exemple, montrant comment les termes qui manquent de précision peuvent facilement être employés pour démontrer aussi bien le pour que le contre [FN: § 873-1]. Les femmes, dit l'un des interlocuteurs, peuvent se vêtir plus légèrement que les hommes, parce que la chaleur qu'elles ont dans le corps résiste au froid. Non, réplique un contradicteur, la raison en est le froid naturel que les femmes ont dans le corps ; car des choses semblables se conviennent réciproquement (VII).
§ 874. En général, c'est dans l'indétermination des résidus (a) qu'il faut chercher la raison pour laquelle ils ne peuvent servir de prémisses à des raisonnements rigoureux, comme peuvent l'être et le sont en effet, dans les sciences, les propositions (A).
§ 875. Il faut bien prendre garde de ne pas confondre les résidus (a) avec les sentiments, ni avec les instincts auxquels ils correspondent (§ 1689 et sv.). Les résidus (a) sont la manifestation de ces sentiments et de ces instincts, comme l'élévation du mercure, dans le tube d'un thermomètre, est la manifestation d'un accroissement de température. C'est seulement par une ellipse, pour abréger le discours, que nous disons, par exemple, que les résidus, outre les appétits, les intérêts, etc. (§ 851 et sv.), jouent un rôle principal dans la détermination de l'équilibre social. Ainsi disons-nous que l'eau bout à 100°. Les propositions complètes seraient : « Les sentiments ou instincts qui correspondent aux résidus, outre ceux qui correspondent aux appétits, aux intérêts, etc., jouent un rôle principal dans la détermination de l'équilibre social. L'eau bout quand l'état calorifique atteint une température indiquée par 100° du thermomètre centigrade ».
§ 876. Ce n'est que dans un but d'étude analytique que nous séparons divers résidus (a1), (a2), (a3)... ; tandis que chez l'individu existent les sentiments qui correspondent aux groupes (a1) (a2) (a3), (a1) (a3) (a4) ; (a3) (a5) ; etc. Ceux-ci sont composés, relativement aux résidus (a1), (a2), qui sont plus simples. On pourrait continuer et décomposer aussi (a1), (a2), en éléments plus simples encore ; mais il faut savoir s'arrêter à temps, parce que les propositions trop générales finissent par ne plus rien signifier du tout. Ainsi, les conditions de la vie sur notre globe sont diverses, et peuvent être réduites, d'une façon générale, à la lumière solaire, à l'existence de l'atmosphère, etc. ; mais il faut au biologiste des conditions beaucoup moins générales, dont il puisse tirer une plus grande quantité de lois de la vie.
§ 877. Il arrive parfois qu'une dérivée (c), à laquelle on est parvenu en partant d'un résidu (a), moyennant une dérivation (b), devienne à son tour résidu d'autres phénomènes, et soit sujette à des dérivations. Il se peut, par exemple, que le mauvais augure, tiré du fait d'être treize à table, soit une dérivée issue du sentiment d'horreur pour la trahison de Judas, suivie de sa mort. Mais dès lors cette dérivée est devenue, à son tour, un résidu, et, sans penser le moins du monde à Judas, les gens éprouvent toutefois un malaise à être assis à une table de treize convives.
§ 878. Dans l'étude que nous allons entreprendre, le lecteur voudra bien avoir toujours présentes à l'esprit les observations données tout à l'heure. S'il les oubliait, il comprendrait à rebours ce que nous allons exposer (§ 88).
§ 879. Arrivé à ce point, le lecteur se sera peut-être déjà aperçu que les recherches auxquelles nous nous livrons ont une analogie avec d'autres qui sont habituelles en philologie ; c'est-à-dire avec celles qui ont pour but de rechercher les racines et les dérivations dont les mots d'une langue sont issus. Cette analogie n'est pas artificielle. Elle provient du fait que, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de produits de l'activité de l'esprit humain, qui ont un processus commun. Prenons, par exemple, la langue grecque. On peut distribuer les mots de cette langue en familles ayant chacune sa racine. Ainsi, les mots qui signifient ancre ![]() hameçon
hameçon ![]() objet recourbé
objet recourbé ![]() bras recourbé
bras recourbé![]() courbure du bras
courbure du bras ![]() coude
coude ![]() etc., recourbé
etc., recourbé ![]() , en forme de crochet
, en forme de crochet ![]() pêcher à l'hameçon
pêcher à l'hameçon ![]() (
(![]() recourber
recourber![]() etc., etc., ont tous la même racine (résidu), c'est-à-dire
etc., etc., ont tous la même racine (résidu), c'est-à-dire ![]() qui correspond à l'idée assez indéterminée, de quelque chose qui est recourbé, replié, crochu, et qui manifeste cette idée. Par des dérivations qui ont leurs règles, de ces racines on tire les mots, comme des résidus (a) on obtient les dérivées (c). Nous avons des unions de racines, comme nous avons des unions de résidus. Ainsi l'adjectif « qui mord à l'hameçon »
qui correspond à l'idée assez indéterminée, de quelque chose qui est recourbé, replié, crochu, et qui manifeste cette idée. Par des dérivations qui ont leurs règles, de ces racines on tire les mots, comme des résidus (a) on obtient les dérivées (c). Nous avons des unions de racines, comme nous avons des unions de résidus. Ainsi l'adjectif « qui mord à l'hameçon » ![]() a pour racines a
a pour racines a ![]() et
et![]() correspondant, la première à quelque chose de recourbé, sans précision, la seconde à manger. Il y a des dérivations d'un grand usage en grec ; par exemple le suffixe
correspondant, la première à quelque chose de recourbé, sans précision, la seconde à manger. Il y a des dérivations d'un grand usage en grec ; par exemple le suffixe ![]() , qui, uni aux racines, donne un grand nombre de mots signifiant l'effet de l'action indiquée par les racines. Il y a de même, dans les faits sociaux, des dérivations très usuelles, par exemple la volonté de la divinité, qui sert à justifier une infinité de prescriptions. C'est ainsi que cette volonté, unie au résidu de l'amour pour ses parents, donne le précepte : « Honore ton père et ta mère, car c'est la volonté de Dieu ».
, qui, uni aux racines, donne un grand nombre de mots signifiant l'effet de l'action indiquée par les racines. Il y a de même, dans les faits sociaux, des dérivations très usuelles, par exemple la volonté de la divinité, qui sert à justifier une infinité de prescriptions. C'est ainsi que cette volonté, unie au résidu de l'amour pour ses parents, donne le précepte : « Honore ton père et ta mère, car c'est la volonté de Dieu ».
§ 880. Les résidus peuvent produire, par dérivation, des dérivées (c), qu'on observe effectivement dans la société ; ils peuvent aussi en produire d'autres (γ), qu'on n'observe pas, bien qu'elles se déduisent régulièrement comme les (c).
§ 881. Ce fait a son analogue en philologie, dans l'existence des verbes réguliers et des verbes irréguliers. En réalité, il ne faut pas prendre ces termes à la lettre : un verbe dit irrégulier est de fait aussi régulier qu'un autre. La différence consiste dans les différents modes de dérivations. Un procédé de dérivation, usité pour certaines racines, donne une classe de verbes qu'on trouve effectivement dans le langage ; employé pour d'autres racines, il donne des verbes qu'on ne trouve pas dans la langue. Et vice versa, le procédé de dérivation qui, avec ces dernières racines, donne des verbes qu'on trouve dans le langage, donne, avec les premières, des verbes qu'on n'y trouve pas.
§ 882. Les dérivées qui sont à leur tour résidus ont leur pareil dans le langage. Le mot indiqué tout à l'heure : « qui mord à l'hameçon », ne s'est pas formé directement des racines ![]() , et
, et ![]() , mais bien de
, mais bien de ![]() et de
et de ![]() . Les flexions, les conjugaisons, les formations de comparatifs, de superlatifs, de locatifs, etc., nous font voir des exemples de dérivations obtenues par d'autres dérivations.
. Les flexions, les conjugaisons, les formations de comparatifs, de superlatifs, de locatifs, etc., nous font voir des exemples de dérivations obtenues par d'autres dérivations.
§ 883. Ce n'est pas tout. Il y a encore des analogies d'un autre genre. La philologie moderne sait fort bien que le langage est un organisme qui s'est développé suivant ses propres lois, qui n'a pas été créé artificiellement. Seuls, quelques termes techniques, comme oxygène, mètre, thermomètre, etc., sont le produit de l'activité logique des savants. Ils correspondent aux actions logiques, dans la société, tandis que la formation du plus grand nombre des mots employés par le vulgaire, correspond aux actions non-logiques. Il est temps, désormais, que la sociologie progresse, et tâche d'atteindre le niveau auquel se trouve déjà la philologie.
§ 884. Nous avons indiqué ces analogies, uniquement pour aider le lecteur à se former une idée claire des théories que nous exposons. [Voir Addition A16 par l’auteur] Mais il voudra bien se souvenir qu'on ne peut tirer de ces analogies aucune démonstration, et que celle-ci doit procéder exclusivement de l'étude directe des faits. La méthode qui demande des démonstrations aux analogies est très mauvaise.
§ 885. Les recherches sur l'origine des phénomènes sociaux, recherches qui constituent jusqu'à présent la majeure partie de la sociologie, ont été souvent, sans que leurs auteurs s'en aperçussent, des recherches de résidus. Ces auteurs admettaient, sans trop préciser, que le simple avait dû précéder le composé, que le résidu devait être antérieur à la dérivée (§ 693). Quand Herbert Spencer voit, dans la déification des hommes, l'origine chronologique de la religion, il croit avoir trouvé le résidu des phénomènes religieux, le phénomène simple dont sont dérivés les phénomènes complexes que l'on observe aujourd'hui.
§ 886. Là-dessus, deux observations s'imposent. 1° Il convient de remarquer qu'aucune preuve n'est donnée de la vérité de l'hypothèse, d'après laquelle la connaissance du résidu serait chronologiquement antérieure à celle de la dérivée. Parfois, cela s'est produit ; mais d'autres fois, cela n'a certainement pas eu lieu. De même, en chimie, il y a des composés qui ont été connus après les corps simples dont ils tirent leur origine ; mais beaucoup d'autres ont été connus avant. En sociologie, les règles latentes du droit (§ 802-1) sont un excellent exemple de dérivées connues antérieurement à leurs résidus. La bonne femme athénienne qui, entendant parler Théophraste, le reconnut pour un étranger [FN: § 886-1], connaissait fort bien, par la pratique, la conjugaison d'un certain nombre de verbes grecs, beaucoup mieux que certains savants modernes ; mais elle n'avait pas la plus lointaine idée des règles des dérivations, par lesquelles, des racines, on obtient ces conjugaisons. 2° Même si la connaissance du résidu est antérieure à celle de la dérivée, il convient de suivre une voie directement opposée à celle qu'on a parcourue jusqu'à présent. La recherche chronologique du résidu (a) est difficile, souvent impossible, parce que, pour des temps éloignés de nous, les documents font défaut ; et l'on ne peut se permettre d'y suppléer parla fantaisie et le « bon sens » de l'homme moderne. On peut bien avoir ainsi des théories ingénieuses, mais elles ne correspondent que peu ou pas du tout aux faits. Vouloir découvrir, dans les temps primitifs, le résidu (a) dont sont dérivés des phénomènes (c) que nous pouvons observer dans le présent, c'est vouloir expliquer le connu par l'inconnu (§ 548, 57). Il faut au contraire déduire des faits les mieux connus ceux qui le sont moins : tâcher de découvrir les résidus (a) dans les phénomènes (c) que nous observons à l'époque présente, puis voir si, dans les documents historiques, on trouve des traces de (a). Si, de cette manière, on trouvait que (a) existait alors qu'on ne connaissait pas encore (c), on pourrait conclure que (a) est antérieur à (c), et que l'origine, dans ce cas, se confond avec le résidu. Mais si cette preuve fait défaut, on ne peut accepter la confusion indiquée.
§ 887. C'est pourquoi nous avons essayé, et nous essayerons toujours d'expliquer les faits du passé par d'autres qu'il nous est donné d'observer dans le présent (§ 547), et en tout cas, nous mettrons le plus grand soin à procéder toujours du plus connu au moins connu. Ici, nous ne nous occupons pas des origines ; non que nous méconnaissions l'importance historique de ce problème, mais parce que la connaissance des origines n'est pas ou presque pas utile à la recherche des conditions de l'équilibre social, tandis que la connaissance des instincts et des sentiments qui correspondent aux résidus est d'une grande importance pour cette recherche.
§ 888. Commençons par classer les résidus, puis nous classerons les dérivations. N'oublions pas que, dans les phénomènes sociaux, outre les sentiments manifestés par les résidus, il y a les appétits, les inclinations, etc. (§ 851), et qu'ici nous nous occupons seulement de la partie qui correspond aux résidus. Cette partie renferme souvent un grand nombre, et parfois même un très grand nombre de résidus simples. Il arrive de même que les roches contiennent beaucoup d'éléments simples, qui sont séparés par l'analyse chimique. Il y a des phénomènes concrets dans lesquels un résidu l'emporte sur les autres; par conséquent, ces phénomènes peuvent représenter approximativement ce résidu. La classification que nous faisons ici est objective (§ 855); mais nous devrons parfois ajouter quelque considération subjective.
Ie Classe.
INSTINCT DES COMBINAISONS (§ 889-990).
(1-α) Combinaisons en général (892-909).
(1-β) Combinaisons de choses semblables ou contraires (§ 910-943).
(I-β 1) Ressemblance et opposition en général (§ 913-921).
(I-β 2) Choses rares ; événements exceptionnels (§ 922-928).
(1-β 3) Choses et événements terribles (§ 929-931).
(I-β 4) État heureux uni à des choses bonnes ; état malheureux uni à des choses mauvaises (§ 932-936).
(I-β 5) Choses assimilées produisant des effets de nature semblable ; rarement de nature opposée (§ 937-943).
(I-γ) Pouvoir mystérieux de certaines choses et de certains actes (§ 944-965).
(1-γ 1) Pouvoir mystérieux en général (§ 947-957).
(I-γ 2) Noms unis mystérieusement aux choses (§ 958-965).
(1-δ) Besoin d'unir les résidus (§ 966-971).
(I-ε) Besoin de développements logiques (§ 972-975).
(I-ζ) Foi en l'efficacité des combinaisons (§ 976-990).
IIe Classe.
PERSISTANCE DES AGRÉGATS (991-1088).
(II-α) Persistance des rapports d'un homme avec d'autres hommes et avec des lieux (§ 1015-1051).
(II-α 1)Rapports de famille et de collectivité (§ 1016-1040).
(II-α 2 )Rapports avec des lieux (§ 1041-1042).
(II-α 3)Rapports de classes sociales (§ 1043-1051).
(II-β) Persistance des rapports entre les vivants et les morts (§ 1052-1055).
(II-γ) Persistance des rapports entre un mort et des choses qu'il possédait durant sa vie (§ 1056-1064).
(II-δ) Persistance d'une abstraction (§ 1065-1067). (II-ε) Persistance des uniformités «§ 1068).
(II-ζ) Sentiments transformés en réalités objectives (§ 1069). (II-êta) Personnifications (§ 1070-1085).
(II-η) Besoin de nouvelles abstractions (§ 1086-1088).
IIIe Classe.
BESOIN DE MANIFESTER SES SENTIMENTS PAR DES ACTES EXTÉRIEURS (§ 1089-1112).
(III-α) Besoin d'agir se manifestant par des combinaisons (§ 1092-1093).
(III-β) Exaltation religieuse (§ 1094-1112).
IVe Classe.
RÉSIDUS EN RAPPORT AVEC LA SOCIABILITÉ (§ 1113-1206).
(IV-α) Sociétés particulières (§ 1114).
(IV-β) Besoin d'uniformité (§ 1115-1132).
(IV-β 1) Uniformité obtenue en agissant sur soi-même (§ 1117-1125).
(IV-β 2) Uniformité imposée aux autres (§ 1126-1129).
(IV-β 3) Néophobie (§ 1130-1132).
(IV-γ) Pitié et cruauté «§ 1133-1144).
(IV-γ 1)Pitié pour soi reportée sur autrui (§ 1138-1141).
(IV-γ 2)Répugnance instinctive pour la souffrance en général (§ 1142-1143).
(IV-γ 3)Répugnance raisonnée pour les souffrances inutiles (§ 1144).
(IV-δ) Tendance à imposer à soi-même un mal, pour le bien d'autrui (§ 1145-1152).
(IV-δ 1) Tendance à exposer sa vie (§ 1148).
(IV-δ 2) Partage de ses biens avec autrui (§ 1149-1152).
(IV-ε) Sentiments de hiérarchie (§ 1153-1162).
(IV-ε 1)Sentiments des supérieurs (§ 1155).
(IV-ε 2)Sentiments des inférieurs (§ 1156-1159).
(IV-ε 3)Besoin de l'approbation de la collectivité (§ 1160-1162).
(IV-ζ) Ascétisme (§ 1163-1206).
Ve Classe.
INTÉGRITÉ DE L'INDIVIDU ET DE SES DÉPENDANCES (§ 1207-1323).
(V-α) Sentiments qui contrastent avec les altérations de l'équilibre social (§ 1208-1219).
(V-β) Sentiments d'égalité chez les inférieurs (§ 1220-1228).
(V-γ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant aux sujets qui ont souffert l'altération (§ 1229-1239).
(V-γ 1)Sujets réels (§ 1240-1295).
(V-γ 2)Sujets imaginaires ou abstraits (§ 1296-1311).
(V-δ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant à ceux qui l'ont altérée (§ 1312).
(V-δ 1) Agent réel d'altération (§ 1313-1319).
(V-δ 2) Agent imaginaire ou abstrait (§ 1320-1323).
VIe Classe.
RÉSIDU SEXUEL (§ 1324-1396)
§ 889. Ie CLASSE. Instinct des combinaisons. Cette classe est constituée par les résidus correspondant à cet instinct, qui est puissant dans l'espèce humaine, et qui a probablement été et demeure une cause importante de la civilisation. Un très grand nombre de phénomènes donnent pour résidu une tendance à combiner certaines choses. L'homme de science, dans son laboratoire, les combine suivant certaines règles, certaines vues, certaines hypothèses, la plupart du temps raisonnables ; mais quelquefois aussi il le fait au hasard. Il accomplit, en grande partie, des actions logiques. L'ignorant fait les combinaisons, guidé par des analogies, la plupart du temps fantaisiste, puériles, absurdes, et souvent aussi au hasard. Ce terme de hasard indique seulement notre ignorance des causes que ces actions peuvent avoir eues. En tout cas, ces actions sont en très grande partie non-logiques. Nous avons un instinct qui pousse aux combinaisons en général, et qui, pour des causes passagères, ignorées, donne le genre (I-α). Souvent on unit des choses semblables et parfois contraires ; c'est ainsi qu'on a le genre (1-β). Si ces ressemblances ou oppositions sont génériques, on a l'espèce (I-β 1). Souvent on unit des choses rares à des événements importants, et l'on a l'espèce (1-β 2); ou bien des choses et des événements terribles, et l'on a l'espèce (1-β 3). En outre, (1-β 4), un état heureux attire à lui des choses bonnes, louables, et vice versa. Un état malheureux attire à lui des choses mauvaises, répugnantes, qui font horreur, ou vice versa. Nous avons un genre (I-γ) de la combinaison mystérieuse de certaines choses et de certains actes. Ce genre se divise en deux espèces : la première (1-γ 1) comprend les opérations mystérieuses en général ; la seconde (1-γ 2) unit mystérieusement les noms aux choses. Suit un genre (1-δ), qui se rapporte au besoin que l'homme éprouve d'unir différents résidus. Enfin, on a deux genres : l'un (I-ε) est donné par le besoin, d'autant plus grand que les peuples sont plus civilisés, de recouvrir d'un vernis logique les actions non-logiques, et de créer des théories même imaginaires, pourvu qu'elles soient logiques. L'autre genre (I-ζ) est donné par la croyance en l'efficacité des combinaisons. En résumé, il y a, pour ce qui concerne la Ie classe : 1° une propension aux combinaisons ; 2° la recherche des combinaisons estimées les meilleures ; 3° la propension à croire à l'efficacité des combinaisons.
§ 890. En outre, il y a une partie passive, dans laquelle l'homme subit les combinaisons, et une partie active, dans laquelle il les interprète et les fait naître. La propension aux combinaisons est un sentiment général, indistinct, qui agit passivement et activement ; il est puissant dans les jeux, qu'on observe chez tous les peuples. La recherche des combinaisons estimées les meilleures est évidemment active. Quant à la propension à croire en l'efficacité des combinaisons, elle présente une partie passive et une partie active. En fait, sous l'aspect passif, on peut croire que A est nécessairement uni à B, et que, par conséquent, si l'on observe A, B doit se produire ; ou bien, sous l'aspect actif, qu'en produisant artificiellement A, on produira par conséquent aussi B (§ 971 et sv.)
§ 891. Dans les phénomènes concrets, des résidus d'autres classes jouent aussi un rôle ; et parmi ceux-ci il faut noter les résidus de la IIe classe, sans lesquels les combinaisons de la première seraient passagères et inconsistantes. On peut comparer de tels phénomènes à un édifice dont l'instinct des combinaisons, la recherche de celles qui sont les meilleures, la foi en leur efficacité fournissent les matériaux. La persistance des agrégats donne de la solidité à l'édifice, constitue le ciment qui l'affermit. Enfin, la foi en l'efficacité des combinaisons intervient pour pousser l'homme à se servir de cet édifice. En de nombreux phénomènes, spécialement chez les peuples civilisés, on trouve un mélange d'actions logiques, de déductions scientifiques et d'actions non-logiques, d'opérations dictées par le sentiment. Ici, nous avons disjoint par analyse des choses qui peuvent se trouver réunies.
§ 892. (1-α) Combinaisons en général. Les causes des combinaisons génériques existent précisément comme celles des combinaisons spéciales (1-β) ou d'autres ; et, si cela était utile, on pourrait séparer différentes espèces dans le genre (α). Des milliers et des milliers d'individus jouent au loto en assignant un numéro à certaines choses qu'ils ont rêvées ou à certains événements sur lesquels ils fixent leur attention [FN: § 892-1]. On comprend pourquoi le numéro 1 a été assigné au soleil. Il y a là un résidu (β-1) : le soleil, étant unique, a bien un rapport de convenance avec le nombre 1. Mais pourquoi la lune a-t-elle le numéro 6, une paire de ciseaux le numéro 7, la chatte blanche le 31, la chatte noire le 36, et ainsi de suite ? On ne viendra pas dire que c'est l'expérience qui a fait croire à cette correspondance. Cela peut être arrivé, en certains cas peu nombreux, mais à parcourir le livre des songes, on comprend qu'on n'a jamais pu faire des expériences assez étendues pour pouvoir donner tous les nombres de ce livre. Il faudrait vraiment avoir la manie des interprétations logiques, pour croire que les paroles privées de sens des opérations magiques aient été choisies par l'expérience ; que Caton, par exemple, ou quelqu'un d'autre pour lui, après avoir expérimenté diverses paroles, s'est arrêté à celles qu'il emploie dans son opération magique pour guérir les luxations (§ 184-1).
§ 893. C'est tout le contraire. On commence par avoir foi en certaines combinaisons et, après seulement, arrivent des gens qui essaient de justifier cette foi par la logique et l'expérience [FN: § 893-1]. Les Grecs croyaient aux songes, bien avant qu'un Artémidore parût pour en démontrer, au moyen de l'expérience, la correspondance avec la réalité.
§ 894 Quand on lit l'Histoire naturelle de Pline, on est frappé du nombre infini de combinaisons qu'on a essayées pour guérir les maladies ; il semble vraiment qu'on ait tenté toutes les combinaisons possibles [FN: § 894-1]. Par exemple, pour l'épilepsie, nous avons d'abord la racine de laserpitium chironium avec la présure de veau marin, à la dose de trois parties de la plante pour une partie de coagulum ; le plantago, la bétoine ou l'agaric dans l'oxymel, et ainsi de suite (XXVI, 70). Il y a en tout, dans ce paragraphe, 12 plantes, outre la présure de veau marin et celle de castor. Puis il y a des remèdes tirés du règne animal ; c'est-à-dire (XXVIII, 63) : les testicules d'ours, ceux de sanglier, l'urine du sanglier, et notez bien qu'elle est plus efficace si on l'a laissée se dessécher dans la vessie de l'animal, les testicules de porc, desséchés et broyés dans le lait de truie, les poumons de lièvre avec de l'encens et du vin blanc, etc. En tout, 19 combinaisons sont indiquées dans le paragraphe. N'oublions pas le sang de gladiateur (XXVIII, 2). Un autre paragraphe (XXXII, 37) indique 8 combinaisons tirées du règne animal. Un autre (XXX, 27) en donne 29. En additionnant, on a 69 combinaisons, et il y en a eu certainement d'autres que Pline n'a pas indiquées. Pour guérir la jaunisse, Pline nous dit qu'on peut boire du vin dans lequel on a lavé les pattes d'une poule, après les avoir nettoyées dans l'eau ; et comme il ajoute que ces pattes doivent être jaunes (XXX, 9-8), nous sommes dans le cas d'un résidu (β). Mais quand on nous dit (XXX, 30) que, pour la fièvre, il est bon de porter sur soi la plus longue dent d'un chien noir, nous ne réussissons à trouver aucun motif, même fantaisiste, de cette prescription. On pourrait en citer d'autres semblables, par centaines et par milliers, sur toute la surface du globe. Elles persistèrent dans nos pays jusqu'à une époque récente. Le cardinal de Richelieu fut traité au crotin de cheval détrempé dans du vin blanc. On guérissait la fièvre en portant au cou une araignée vivante, enfermée dans une coquille de noix [FN: § 894-2]. Les vipères et les crapauds jouaient
un rôle considérable dans la pharmacopée. Tout cela n'est qu'absurdité ; mais si ces absurdités n'avaient pas existé, la science expérimentale ne serait pas née non plus [FN: § 894-3].
§ 895. P. Du Chaillu raconte un fait qui est caractéristique [FN: § 895-1]. Après qu'il eut tué un léopard, les indigènes demandèrent l'extrémité de la queue, parce que c'était une amulette érotique. Ils voulaient aussi la cervelle, car c'était une amulette pour avoir du courage et être heureux à la chasse. Enfin ils le prièrent de détruire le fiel, parce que c'était un poison. Les deux premières combinaisons sont certainement inefficaces ; la première est du genre (I-α) ; la seconde peut être du sous-genre (1-β 1), car le léopard est bon chasseur ; la troisième combinaison peut être efficace, à cause des ptomaïnes qui tirent leur origine de la putréfaction.
§ 896. Il peut sembler ridicule de prêter attention à une histoire de queue de léopard, quand on veut rechercher la forme des grands événements sociaux. Mais qui raisonnerait de cette manière devrait s'abstenir de s'occuper des crachats des phtisiques, pour découvrir la maladie, ou de s'occuper des rats, pour édicter des mesures de précaution contre la peste. C'est ainsi qu'autrefois, la philologie dédaignait de s'occuper des dialectes, et ne s'attachait qu'à la langue des « bons auteurs ». Mais ce temps est aujourd'hui passé pour la philologie, et doit aussi passer pour la sociologie (§ 80). L'instinct des combinaisons est parmi les plus grandes forces sociales qui déterminent l'équilibre ; et si quelquefois il se manifeste par des phénomènes ridicules et qui tiennent de l'absurde, cela n'enlève rien à son importance.
§ 897. Les savants qui recherchent l'origine des choses se sont escrimés pour trouver comment on avait pu domestiquer les animaux, et ont rencontré de très grosses difficultés, surtout quand ils étaient poussés par le désir de considérer toutes les actions comme logiques. Nous n'examinerons pas ici toutes les hypothèses qu'on a faites à ce propos ; nous ne parlerons que d'une seule : celle de S. Reinach, parce qu'elle donne lieu à des observations qui s'appliquent au sujet que nous traitons ici.
§ 898. S. Reinach commence par exclure le cas de simples combinaisons [FN: § 898-1]. « (p. 88) Là où existent des animaux capables de devenir domestiques, l'homme n'en sait rien ; c'est l'expérience, une longue expérience qui seule peut l'édifier à cet égard. Mais n'ayant pas l'idée de la domestication, comment et pourquoi tenterait-il cette expérience ? Le hasard peut faire découvrir à l'homme primitif une paillette d'or, un minerai de cuivre ou de fer, mais il ne peut pas lui faire découvrir un animal domestique ; puisqu'il ne saurait y avoir d'animaux domestiques que par l'effet de l'éducation qu'ils reçoivent de l'homme ».
§ 899. Ce raisonnement serait excellent, si toutes les actions de l'homme étaient logiques ; d'où, à part le fait indiqué par Reinach, où le pur hasard fait tomber sous les yeux précisément la chose qu'il peut être utile et profitable d'accomplir, il résulte qu'il n'y aurait pas d'autre voie pour les découvertes, que de savoir d'abord ce qu'on veut trouver, puis de chercher les meilleurs moyens de l'obtenir. Telle est, en effet, la voie suivie pour arriver aux découvertes faites scientifiquement, grâce au raisonnement. Par exemple, on cherche une machine motrice qui soit légère et produise beaucoup de travail, et l'on trouve la machine des automobiles. Mais le plus grand nombre des découvertes, surtout dans le passé, n'ont pas été faites de cette façon. Il y a une autre voie pour y arriver : c'est justement l'instinct des combinaisons, qui pousse l'homme à mettre ensemble des choses et des opérations, sans avoir un plan préétabli, sans savoir précisément où il veut en venir, comme une personne qui parcourt un bois, pour le seul plaisir de se promener. Et même quand ce plan existe, il n'a souvent rien de commun avec le résultat qu'on obtient. Le cas de celui qui cherchait une chose et en a trouvé une autre est très fréquent. L'exemple suffira, des alchimistes qui cherchaient le moyen de faire de l'or et qui trouvèrent un grand nombre de composés chimiques. Voilà un individu auquel vient à l'esprit de laisser putréfier de l'urine d'homme. Il la mélange avec du sable fin et distille le tout. La conséquence de ces opérations étranges et compliquées est la découverte du phosphore. En beaucoup d'autres cas semblables, les combinaisons n'ont rien donné d'utile ; on marche à l'aveuglette : parfois on trouve, le plus souvent on ne trouve pas.
§ 900. Notons que, dans le cas des animaux domestiques, les hommes peuvent avoir eu quelque idée du résultat de certaines opérations. Il arrive souvent, aujourd'hui, que les enfants recueillent un petit moineau tombé du nid, et qu'ils l'élèvent ; pour peu qu'il fût utile, ils en feraient un animal domestique. Les enfants n'ont pas du tout ce but : ils veulent seulement s'amuser, donnent libre cours à l'instinct des combinaisons. Ainsi qu'ils le font quand ils se livrent à leurs jeux, ils combinent de la manière la plus étrange les objets dont ils disposent. Il arrive souvent aussi, à la campagne, qu'on élève un levraut trouvé dans les champs ; mais il ne devient jamais domestique ; et en l'élevant, on n'a pas d'autre but que de trouver du plaisir à la chose. Pourquoi n'aurait-on pas pu faire cela jadis, avec le lapin, et ne serait-ce pas la manière dont cet animal s'est domestiqué ?
§ 901. Il y a mieux. Voici un fait raconté par un voyageur, où l'on voit à l'œuvre le simple instinct des combinaisons, pour domestiquer des animaux [FN: § 901-1]. « (p. 287) Sur le territoire appartenant à Hinza, un Cafre, dont les richesses excitaient l'envie, fut accusé d'élever un loup qu'il retenait dans la journée, et qu'il lâchait dans la nuit pour détruire les troupeaux. On s'empara de lui et de tout ce qu'il possédait, ses bestiaux furent partagés, moitié à Hinza, moitié à ses conseillers. L'homme fut banni. En s'éloignant, à son tour, il s'empara du troupeau d'un autre, qu'il conduisit à Voosani, chef des Tambooky. Hinza envoya se plaindre et redemander le troupeau, en informant ce chef du crime de son protégé. Le troupeau fut rendu avec tous les témoignages d'une (p. 288) grande horreur pour le crime. Le missionnaire, parlant à Hinza sur ce sujet, lui demanda pourquoi il avait ruiné cet homme ; à quoi Hinza lui répondit d'un ton ironique et avec un sourire qui laissait voir qu'il savait à quoi s'en tenir : „C'est vrai, mais vous savez qu'élever un loup est une chose étrange “ ».
§ 902. De cette manière, nous voyons ici deux résidus ; soit celui des combinaisons, dans l'homme qui élève le loup, et celui de la néophobie (IV-β 3), chez ceux qui bannissent l'individu. Remarquons que ces deux résidus peuvent exister chez le même homme ; et peut-être celui qui élevait le loup aurait-il eu horreur d'autres nouveautés, comme ceux qui estimaient que la nouveauté du loup était un crime, se sont peut-être adonnés à d'autres combinaisons nouvelles.
§ 903. Suivant S. Reinach, les animaux domestiques sont d'anciens totem. Il part de là, ajoute des hypothèses et des descriptions de faits ignorés, comme s'il les avait vus. C'est un procédé analogue à celui de H. Spencer et de beaucoup d'autres sociologues. Un auteur ingénieux, intelligent, cultivé, fait une hypothèse. Il en raisonne selon sa logique, sa culture, ses sentiments, et puis s'imagine avoir reconstitué le passé d'hommes arriérés, peu intelligents, incultes et, de plus, vivant en de tout autres conditions que celles où vit le savant, créateur de l'hypothèse et de ses conséquences.
§ 904. « (p. 93) Soient – dit Reinach [FN: § 904-1] – des chasseurs sauvages vivant dans l'ancienne France, pays où existaient à l'état indigène des taureaux, des chevaux, des chèvres, des ours et des loups, pour ne point parler d'autres animaux. Ces chasseurs sont divisés en clans ou petites tribus dont chacune croit avoir pour ancêtre un animal différent. Le clan du loup croit descendre du loup, avoir fait un traité d'alliance avec les loups et, sauf dans le cas de légitime défense, ne pas pouvoir tuer de loups... Chacun de ces clans s'abstiendra de chasser et de tuer telle ou telle espèce d'animaux, mais il ne se contentera pas de cela, Puisque ces animaux sont les protecteurs du clan, qu'ils le guident dans ses pérégrinations, l'avertissent par leur inquiétude, par leurs cris, des dangers qui le menacent, il faut qu'il y ait toujours au milieu du clan, comme des sentinelles, deux ou plusieurs de ces animaux ». Les faits ne sont pas entièrement exacts. Il est de nombreux clans totémiques qui n'ont pas les sentinelles que l'auteur suppose exister. Passons : il suffit que d'autres en aient eu. Mais pourquoi justement « deux ou plusieurs individus » ? Un seul ne suffirait-il pas ? Il serait bien suffisant pour la garde, mais pas pour la reproduction, que notre auteur a en vue. « (p. 93) Ces animaux, pris tout jeunes, s'habitueront à l'homme, s'apprivoiseront; leurs petits, nés au contact même des hommes du clan, deviendront leurs amis ». Voilà pourquoi il devait y avoir au moins deux animaux totem. Mais cela ne suffit pas : il faut encore qu'ils soient mâle et femelle. Si un clan a pour totem le coq, qui, par son chant, l'avertit des dangers, il faut aussi lui procurer une ou plusieurs poules. Mais quand on est dans le royaume des hypothèses, tout peut facilement s'expliquer. Nous pouvons dire que ces hommes, adorant le coq, cherchent, dans une aimable intention, à lui procurer le plaisir de l'accouplement.
§ 905. La découverte des plantes qui sont un remède spécifique de certaines maladies, est tout aussi difficile à expliquer que la domestication des animaux. Par exemple, comment le simple hasard peut-il avoir fait connaître aux Péruviens que l'écorce du quinquina est un spécifique de la fièvre ? Dirons-nous peut-être que cette plante était le totem d'un clan qui, par vénération pour le totem, a voulu en employer l'écorce en cas de maladie ? Soit ; mais cette explication s'appliquera aussi à d'autres remèdes semblables, et nous aurons ainsi autant de totem qu'on a essayé de remèdes pour les maladies ; et celles-ci étant en nombre infini, nous devrons admettre, contrairement aux faits, ce nombre infini de totem.
§ 906. Il n'y a peut-être pas de plante qui n'ait passé pour guérir non seulement une, mais plusieurs maladies. Il faut lire, dans Pline, combien le raifort en guérit ! On voit ainsi à quel point est erronée l'idée de ceux qui croient que ces combinaisons sont semblables aux expériences qu'on fait dans nos laboratoires. C'est-à-dire qu'on aurait essayé une plante contre diverses maladies, et l'on en aurait conservé l'emploi seulement pour celles contre lesquelles il aurait été reconnu efficace. Au contraire, les recettes données par Pline avaient été conservées, bien qu'inefficaces, et beaucoup ont survécu jusqu'à nos jours. En réalité, c'est l'instinct des combinaisons qui l'emporte et qui se manifeste, même aujourd'hui, quand, en cas de maladie, on dit qu' « il faut faire quelque chose », et qu'on donne des remèdes, au petit bonheur.
§ 907. Il se pourrait aussi qu'au temps où l'on domestiqua les animaux, il se soit présenté des cas comme ceux que suppose Reinach ; c'est même probable ; et le fait qu'un animal était totem peut avoir été l'un des très nombreux motifs qui poussèrent aux combinaisons dont résulta la domestication des animaux. L'erreur de S. Reinach consiste principalement à prendre pour unique un motif qui peut avoir existé avec d'autres. Nous ne savons rien de ce temps et ne pouvons, par conséquent, nier une chose qui, en elle-même, est possible ; mais nous ne pouvons pas non plus l'affirmer ; et, parce qu'une chose est possible sous certaines conditions, affirmer qu'elle a dû se trouver dans ces conditions-là, c'est faire un raisonnement erroné. On peut aller encore plus loin. Si nous aussi ne voyons maintenant qu'une seule circonstance dans laquelle la chose soit possible, ce pourrait être une présomption qu'elle a effectivement eu lieu ainsi ; mais il serait encore possible qu'elle se fût produite dans d'autres circonstances que nous ignorons à l'heure qu'il est.
§ 908. Dans l'instinct qui pousse à considérer certains jours comme de bon ou de mauvais augure, il peut y avoir de nombreux résidus. Parfois il y a celui de simple combinaison (1-α). Par exemple, il est difficile d'en trouver d'autres en certaines correspondances établies par Hésiode. Parfois il peut s'y trouver un résidu du genre (I-β). Mais dans ce cas encore, on peut, à la longue, comme nous l'avons déjà vu (§ 831), revenir au genre (I-α). De cette façon, ainsi que l'observe Aulu-Gelle [FN: § 908-1], le vulgaire romain avait fini par confondre les religiosi dies, qui rappelaient, à l'origine, un événement funeste, avec les simples dies nefasti, pendant lesquels il était interdit au préteur de juger et de convoquer les comices. Outre les jours de fêtes publiques, il y en avait d'autres d'ordre privé. Certaines familles en avaient de spéciaux. Les particuliers célébraient alors, comme aujourd'hui encore, le jour de leur naissance, et avaient aussi d'autres fêtes pour différents motifs [FN: § 908-2]. En Grèce, nous trouvons de même les jours où l'on estimait funeste d'agir, et Lucien, dans une diatribe contre un certain Timarque, dit que les Athéniens appelaient ![]() les jours funestes, abominables, défavorables, de mauvais augure, dans lesquels « les magistrats ne siègent pas, aucune cause n'est introduite devant les juges, on n'accomplit aucune cérémonie religieuse et l'on ne fait rien de bon augure... On fait ainsi pour diverses raisons : ou à cause de grandes batailles perdues, pour lesquelles on décréta que les jours où ces faits avaient eu lieu seraient fériés et impropres à toute action légale, ou même pour Zeus,... » [FN: § 908-3]. Les points suspensifs sont de Lucien, qui dédaigne de rapporter des faits si connus.
les jours funestes, abominables, défavorables, de mauvais augure, dans lesquels « les magistrats ne siègent pas, aucune cause n'est introduite devant les juges, on n'accomplit aucune cérémonie religieuse et l'on ne fait rien de bon augure... On fait ainsi pour diverses raisons : ou à cause de grandes batailles perdues, pour lesquelles on décréta que les jours où ces faits avaient eu lieu seraient fériés et impropres à toute action légale, ou même pour Zeus,... » [FN: § 908-3]. Les points suspensifs sont de Lucien, qui dédaigne de rapporter des faits si connus.
§ 909. Ces combinaisons – ou superstitions, comme les appellent les auteurs chrétiens – ont survécu longtemps. Muratori [FN: § 909-1] remarque que, depuis une haute antiquité, les jours égyptiens furent observés, et notés même dans les calendriers publics, jusqu'au XVIe siècle de l'ère chrétienne. Ce résidu est l'un des plus tenaces ; nous le trouvons en tout temps, en tout pays, chez les hommes ignorants comme chez les hommes cultivés et même très cultivés, superstitieux ou sans préjugés [FN: § 909-2].
§ 910. (1-β) Combinaisons de choses semblables ou contraires. La ressemblance ou dissemblance des choses – peu importe si elle est imaginaire et fantaisiste – est un puissant motif de combinaisons. On comprend tout de suite pourquoi, quand on fixe son esprit aux associations d'idées suscitées par ces choses. Les raisonnements non-logiques sont souvent des raisonnements par association d'idées.
§ 911. Il faut prendre garde que si A et B sont des choses semblables, C et D des choses contraires, le phénomène contraire à la combinaison A + B est, non pas la combinaison C + D, mais bien l'absence de toute combinaison. À la croyance en Dieu n'est pas opposée la croyance au Diable, mais bien l'absence de l'une et de l'autre. À l'état d'esprit de celui qui parle à chaque instant de l'acte sexuel, n'est pas opposé l'état d'esprit de celui qui en parle toujours avec horreur, mais bien l'état d'esprit de celui qui s'en soucie peu, comme de tout autre besoin corporel. Il y a longtemps que les écrivains nous répètent que la haine n'est pas le contraire de l'amour, mais bien l'indifférence (§ 957-1).
§ 912. Le principe des homéopathes : similia similibus curantur, unit les choses semblables [FN: § 912-1]. Le principe opposé : contraria contrariis, unit des choses contraires. À ces affirmations arbitraires s'oppose la science expérimentale, qui n'a pas de principes a priori, mais qui, en chaque cas, laisse décider l'expérience.
§ 913. (I-β 1) Ressemblance ou opposition en général. Les résidus de ce genre sont extrêmement nombreux. On les rencontre souvent dans les opérations magiques : on unit des choses semblables et des opérations semblables [FN: § 913-1] ; on agit sur un homme, un animal, une chose, en opérant sur une parcelle qui leur a été enlevée. Il y a là une double ressemblance : celle des choses et celle des opérations. On unit aussi des choses contraires et, en beaucoup de cas, il semble que certains sentiments agissent pour pousser les hommes à rechercher des contrastes (§ 738 et sv.) [FN: § 913-2].
§ 914. La magicienne de Théocrite dit [FN: § 914-1] : « Delphis [son amant] me tourmenta, et moi je brûle sur Delphis un laurier. De même que celui-ci, en s'allumant, crépite fortement et brûle en un instant, et que nous n'en voyons pas même les cendres, qu'ainsi les chairs de Delphis soient aussi consumées par le feu.Comme je fais fondre cette cire, avec l'aide d'une divinité, qu'ainsi Delphis, le Myndien, soit aussitôt fondu par l'amour ; et comme je fais tourner ce rhombe de bronze, qu'ainsi cet homme [Delphis] soit tourné vers ma porte par Aphrodite ». En outre, elle opère sur des choses qui ont appartenu à son amant : « (53-54) Delphis a perdu cette frange de son manteau, et je la jette dans le feu sauvage, en l'effilant.». On a cru – et il y a aujourd'hui encore des gens qui croient – qu'en sévissant sur des images de cire, on peut nuire à ceux que ces images représentent [FN: § 914-2]. Tartarotti écrit [FN: § 914-3] : « (p. 192) Jean Bodin, l'un des écrivains les plus passionnés pour exalter la puissance du Démon, des magiciens et des sorcières, parlant de ceux qui font des statuettes de cire, puis les percent avec des aiguilles ou les consument au feu, espérant ainsi se venger de leurs ennemis, ne peut s'empêcher d'avouer que cela se produit rarement, par le fait que Dieu ne le permet pas souvent : « car de cent peut estre, qu'il n'y en aura pas deux offensez, comme il s'est cogneu par les confessions des Sorciers » (Démonomanie, liv. II, ch. VIII) ». Les juges qui jugèrent La Môle, accusé d'avoir fait une image de cire de Charles IX et de l'avoir transpercée avec des épingles, crurent ou firent semblant de croire à ces pratiques ; de même ceux qui jugèrent la maréchale d'Ancre [FN: § 914-4] et d'autres encore.
§ 915 Il est à noter qu'ici, comme d'habitude, nous avons un noyau autour duquel se disposent diverses amplifications : un résidu avec différentes dérivations. Chez Théocrite et chez Virgile, on trouve une simple ressemblance entre le fait de la fusion d'une figurine de cire et celui d'un homme qui brûle d'amour ; ce germe croit, prospère et devient une longue fable qu'on raconte d'un roi d'Écosse. En peu de mots, celui-ci souffrait d'une maladie que les médecins ne connaissaient pas. Chaque nuit, il transpirait abondamment et, de jour, pouvait reposer à peine. Après diverses péripéties, on découvrit que cela se produisait parce que, bien loin, en Moravie, certaines sorcières possédaient une figure de cire du roi ; et quand elles la mettaient devant le feu, le roi se fondait en sueur, et quand elles récitaient des incantations devant cette image, le roi ne pouvait dormir. Il va sans dire que tout cela arrivait par pratique diabolique. C'est là une dérivation que ni Virgile ni Théocrite ne pouvaient connaître, mais qui ne fait jamais défaut, à l'époque chrétienne. Théocrite, il est vrai, a une dérivation semblable dans le rhombe qu'on fait tourner et qui, grâce au pouvoir d'Aphrodite, doit rappeler l'amant infidèle. Wier, qui était médecin, et imbu de cet art expérimental qui déplut tant et déplaît encore aux métaphysiciens et aux théologiens [FN: § 915-1], [Voir Addition A17 par l’auteur]ne croit point à cette histoire du roi écossais [FN: § 915-2] ; mais les Boutroux et les W. James de ce temps y croyaient, et il leur semblait que c'était d'une vérité qui est bien meilleure que la vérité expérimentale, et qui possède une dignité bien plus grande.
§ 916. Pour extorquer de l'argent aux niais, les sorciers avaient et ont encore l'habitude de leur persuader d'enterrer quelque part de l'or ou des pierres précieuses, en leur donnant l'espoir que, par attraction, de l'autre or, d'autres pierres précieuses, s'ajouteront à celui-ci ou à celles-là, tandis qu'ensuite le sorcier se les approprie. À chaque instant, on lit dans les journaux quelque bel exploit de ce genre.
§ 917. L'antipathie, réelle ou imaginaire, de certains êtres entre eux, a aussi servi à chasser l'un par l'autre. Dans les Géopontiques, on enseigne la manière de sauver un champ du fléau de la plante parasite nommée orobanche, qui détruit les légumineuses. Cette plante s'appelait aussi herbe-lion ; et cela suffit pour qu'on suppose que ce qui passe pour être contraire au lion lui est aussi contraire [FN: § 917-1]. « Si tu veux que cette herbe n'apparaisse pas du tout, prends cinq coquilles [ou des tessons] et dessines-y avec de la craie ou avec une autre couleur blanche Hercule suffoquant le lion ; puis dépose-les aux quatre angles et au milieu du champ. On a trouvé un autre remède physique, agissant par antipathie, et dont Démocrite témoigne en disant que, puisque le lion, animal, est frappé de terreur à la vue d'un coq et s'en va, de même si quelqu'un †ayant dans les mains un coq, tourne résolument autour du champ, aussitôt l'herbe-lion est éloignée, et les légumineuses deviennent meilleures, car l'herbe-lion a peur du coq ». Il y a ici des résidus de deux genres : 1° un résidu du genre (1-γ 2), qui rattache le nom à l'herbe, de telle sorte que, parce qu'elle s'appelle herbe-lion, elle a aussi les caractères du lion, animal ; 2° un résidu du présent genre (I-βl 1), pour lequel existe une opposition entre le coq et le lion. Clisthène, tyran de Sicyone, voulait extirper de sa cité le culte d'Adraste, parce qu'il constituait un lien avec les Argiens dont Clisthène était l'ennemi. C'est pourquoi, raconte Hérodote (V, 67), il commença par demander à la Pythie s'il pouvait chasser Adraste. Ayant reçu d'elle un refus catégorique, il imagina un moyen indirect pour chasser Adraste. Il demanda Mélanippe aux Thébains ; et, l'ayant eu, il lui consacra une chapelle au prytanée. Il fit cela parce que Mélanippe avait été un ennemi acharné d'Adraste. En l'honorant et en lui transférant les fêtes qu'on célébrait pour Adraste, on supposait que celui-ci devait s'en aller.
§ 918. La parodie des actes d'un culte fait partie du présent genre de résidus. Cette parodie, souvent employée dans les siècles passés, chez les peuples catholiques, avait pour but d'obtenir des choses contraires à la religion et à la morale. De ce genre étaient les messes noires.
§ 919. Dans l'antiquité gréco-latine, les sacrifices sont souvent déterminés par des ressemblances arbitraires, étranges, absurdes. On peut les considérer comme produits par des résidus religieux, moyennant une dérivation dont le résidu principal est celui des combinaisons (I-β 1). En Grèce, la tête de la victime était dirigée vers le ciel, quand on sacrifiait aux dieux olympiques ; elle était dirigée vers la terre, quand on sacrifiait aux dieux infernaux. En règle générale, d'ailleurs avec nombre d'exceptions, on sacrifiait des animaux mâles aux dieux, femelles aux déesses. La similitude opérait en beaucoup de cas ; mais en beaucoup d'autres, il y avait des motifs qui, ou bien ne sont pas connus [FN: § 919-1], ou bien paraissent puérils, extravagants.
§ 920. De même, en d'autres occasions fort nombreuses, de singulières ressemblances apparaissent. Par exemple, à Rome, « la nouvelle mariée était ceinte d'une ceinture que l'époux déliait dans le lit. Cette ceinture était faite de laine de mouton, pour que l'époux fût attaché et lié à son épouse, comme la laine enlevée par flocons est entrelacée. L'époux délie le nœud herculéen de la ceinture, en vue du présage, afin qu'il soit aussi heureux en procréant des fils que le fut Hercule, qui en laissa soixante-dix [FN: § 920-1] ».
§ 921. On trouve aussi le présent résidu, uni à d'autres (Ve classe), dans le fait d'Auguste qui, une fois dans l'année, demandait l'aumône [FN: § 921-1] ; et plus généralement dans les pratiques employées pour échapper à l' « envie des dieux ». Il se retrouve aussi dans l'agrégat de sentiments qui fait traiter des objets inanimés comme s'ils étaient animés, et des choses et des animaux comme s'ils avaient l'usage de la raison. D'une façon générale, il joue un rôle, plus ou moins important, dans les sentiments qui nous poussent à employer l'analogie comme démonstration; et nous le retrouverons par conséquent dans les dérivations.
§ 922. (I-β 2) Choses rares ; événements exceptionnels. L'instinct qui pousse à croire que des choses rares et des événements exceptionnels s'unissent à d'autres choses rares et à d'autres choses exceptionnelles, ou même seulement à ce qu'on désire ardemment, contribue aussi à entretenir la foi en l'efficacité de cette union ; car justement parce que ces choses sont rares, il n'est pas donné de procéder aux nombreuses preuves et contre-preuves qui pourraient démontrer la vanité de la croyance. Mais il faut prendre bien garde de ne pas voir en cela la cause de la croyance ; car on peut observer que souvent des expériences contraires, même très fréquentes, n'ébranlent pas ou ébranlent peu la foi. Ainsi, dans l'Italie méridionale, beaucoup de personnes portent à leur chaîne de montre une corne de corail ou d'autre matière, qui doit être un remède certain contre la jettature ; et l'expérience n'a vraiment rien à voir avec cette pratique.
§ 923. La rareté de l'objet peut être intrinsèque ou extrinsèque ; c'est-à-dire que l'objet – ou l'acte – peut appartenir à une classe d'objets – ou d'actes – rares, ou bien être tel, en raison de quelque circonstance accidentelle et même imaginaire. Nombre de talismans et de reliques appartiennent à cette dernière catégorie [FN: § 923-1].
§ 924. Les présages donnent très souvent des résidus du genre (I-β 2). Souvent les présages sont inventés après que le fait s'est produit ; quelquefois on les exprime d'abord, puis on tâche d'en trouver une vérification. Il peut aussi arriver que l'attente d'un événement serve à en faciliter l'annonce. Les présages puisent leur force spécialement dans la croyance en l'efficacité des combinaisons (§ 926 et sv.).
§ 925. Suétone ne manque pas de nous raconter les prodiges qui présageaient le règne d'un nouvel empereur et sa mort ; il en trouve toujours à foison. Il y a, par exemple, la belle histoire d'une poule qu'un aigle laissa tomber sur les genoux de Livie, femme d'Auguste. Cette poule tenait au bec un rameau de laurier. L'événement est donc sans doute étrange, et naturellement il doit se relier à quelque fait important (§ 983). C'est effectivement ce qui se passa, au moins dans la fantaisie de celui qui imagina la fable. Livie planta le rameau de laurier, qui devint un arbre où les Césars prirent les rameaux dont ils se couronnaient dans leurs triomphes. L'usage vint de les planter ensuite au même endroit, et l'on remarqua – tant l'expérience a de valeur ! – qu'après la mort d'un César, le laurier qu'il avait planté dépérissait. Dans les dernières années de Néron, tout le bois de laurier se dessécha jusqu'aux racines, et tous les descendants de la poule moururent. Tout cela présageait évidemment la fin de la famille des Césars, qui s'éteignit avec Néron [FN: § 925-1]. Ces expériences sont semblables à celles que font aujourd'hui nos théologiens et nos métaphysiciens : on en tire précisément ce qu'on y a mis. Pourquoi donc le fait qu'une mule met bas doit-il présager quelque événement important ? On ne peut trouver d'autre motif que celui de l'union d'un fait rare avec un autre fait rare que les Romains jugèrent devoir être funeste [FN: § 925-2]. Avant que le consul L. Cornelius Scipion passât en Asie, les pontifes observèrent les prodiges, parmi lesquels se trouvait justement une mule qui avait mis bas [FN: § 925-3]. La foudre avait frappé les murs de Velletri, et cela présageait qu'un citoyen de cette ville devait avoir le pouvoir suprême. Entraînés par leur confiance dans ce présage, les Vellétriens firent la guerre aux Romains, mais sans grand succès. « Beaucoup plus tard [FN: § 925-4], il fut manifeste que ce prodige présageait la puissance d'Auguste », qui était d'une famille de Velletri. C'est là une des très nombreuses prophéties que l'on comprend seulement après que le fait s'est produit (§ 1579), quand toutefois elles n'ont pas été inventées de toutes pièces.
Les chrétiens, qui pourtant rapportent tout à Dieu, racontent souvent les présages sans parler, du moins explicitement, de l'intervention divine, parce qu'il semble naturel que des choses rares et des événements exceptionnels aillent ensemble. Par exemple, la légende de Charlemagne nous fait connaître les signes qui présagèrent la mort de cet empereur. Le soleil et la lune s'obscurcirent ; le nom de Charlemagne disparut spontanément de la paroi d'une église fondée par l'empereur ; et ainsi de suite : il y a, bien cinq signes en tout [FN: § 925-5]. Les présages, la divination, entendus comme manifestations de l'activité divine, sont une dérivation des résidus (I-β) et principalement des résidus (I-β 2). Toute chose exceptionnelle pouvait correspondre à ce résidu, et l'on recourut à l'intervention divine pour expliquer cette correspondance.
§ 926. L'origine divine des héros et des grands hommes est un phénomène constant au cours de nombreux siècles. Tout homme, réel ou légendaire, dont l'histoire ou la légende parle beaucoup, doit sa naissance à quelque opération divine ou du moins entourée de prodiges [FN: § 926-1]. Il ne faut pas confondre la légende d'une origine divine avec la qualification de divin, appliquée à un homme. Souvent cette qualification indique simplement que cet homme est éminent par certaines qualités, qu'il est admirable, vénérable, excellent. Dans ce sens, par exemple, Homère (Odyss., XIV) nomme le divin porcher, ![]() . Dans les cas concrets de générations divines, il y a différents résidus. Le noyau principal est formé : 1°, des résidus de la permanence des agrégats, par lesquels les dieux et les esprits sont un prolongement de la personne humaine [FN: § 926-2] ; 2° des résidus sexuels, par lesquels l'homme arrête volontiers son esprit sur l'acte de génération ; 3° des résidus du présent genre : ce qui est remarquable devant aussi avoir une origine remarquable. Cela a lieu de deux façons : ou parce que d'une chose on remonte à une origine imaginaire, ou parce que d'une origine imaginaire on descend à un produit également imaginaire.
. Dans les cas concrets de générations divines, il y a différents résidus. Le noyau principal est formé : 1°, des résidus de la permanence des agrégats, par lesquels les dieux et les esprits sont un prolongement de la personne humaine [FN: § 926-2] ; 2° des résidus sexuels, par lesquels l'homme arrête volontiers son esprit sur l'acte de génération ; 3° des résidus du présent genre : ce qui est remarquable devant aussi avoir une origine remarquable. Cela a lieu de deux façons : ou parce que d'une chose on remonte à une origine imaginaire, ou parce que d'une origine imaginaire on descend à un produit également imaginaire.
§ 927. On peut diviser les générations divines en deux genres : 1° êtres divins qui s'unissent à d'autres êtres divins et ont des produits divins. De là proviennent les théogonies, si nombreuses chez les différents peuples. Viennent ensuite divers appendices. Les êtres indiqués tout à l'heure comme divins peuvent être simplement spirituels ; ils peuvent s'écarter de la personnification jusqu'à devenir de simples abstractions métaphysiques (§ 1070 et sv.). Dans une autre direction, on ajoute un autre résidu à ceux du présent genre. Si la génération divine est habituelle, on l'exclut pour l'être suprême, lequel devient l'être éternel, incréé ; de même on regarde comme exceptionnel celui qui n'est engendré que par un seul être, comme Minerve, que Jupiter eut sans avoir commerce avec un être féminin, et Vulcain, que Junon eut sans avoir commerce avec un être masculin [FN: § 927-1]. 2°, Êtres humains qui s'unissent à des êtres humains, et aussi, mais très rarement, à des animaux. Les unions de mâles divins avec des femmes sont, dans nos races, plus fréquentes que celles de femmes divines avec des hommes ; cela parce que les légendes furent composées principalement par les hommes de peuples où la famille était patriarcale. Il ne peut y avoir d'autre motif au fait que, dans la Bible, ce sont des anges mâles qui s'enamourent des filles des hommes [FN: § 927-2; et note ajoutée à l’édition française par l’auteur : Addition 18], et non les anges femmes, des fils des hommes. Comme dans le genre précédent, il y a les appendices ; et, par différentes gradations, on arrive jusqu'au vent, qui féconde les juments et même les femmes [FN: § 927-3]. et [FN: § 927 note 3b]] Là encore, ont lieu de nouvelles adjonctions des résidus du présent genre. Quand la génération par union d'êtres divins avec des êtres humains est devenue commune, on ajoute d'autres circonstances, pour avoir des générations exceptionnelles. Il ne suffit pas qu'un homme naisse d'un dieu : il doit aussi naître d'une vierge. Celle-ci doit enfanter en restant vierge. Il ne suffit pas que Zeus engendre Héraclès : il faut, de plus, qu'il mette trois nuits pour accomplir cette œuvre [FN: § 927-4]. Dans le nombre de trois nuits, que les auteurs donnent généralement, mais non exclusivement, il y a aussi le résidu qui fait de trois un nombre sacré (§ 960-8); et c'est là un cas particulier d'un fait général, c'est-à-dire de l'adjonction, dans les légendes, de nombreux résidus secondaires aux résidus principaux.
Dans la haute antiquité classique, il serait plus facile d'énumérer les personnages célèbres ayant une origine humaine, que ceux ayant une origine divine, laquelle apparaît comme proprement normale. On a la preuve de la permanence tenace de ce résidu dans le fait que, sous son impulsion, les chrétiens eux-mêmes employèrent largement les légendes d'union d'êtres spirituels avec des femmes, pour engendrer des hommes exceptionnels. Dans cette fonction, les démons chrétiens se substituèrent simplement aux dieux du paganisme[FN: § 927-5] ; et, à vrai dire, on a usé et abusé de la génération par leurs œuvres. Ainsi, l'enchanteur Merlin était fils du démon, et l'on trouve aussi des gens pour donner une semblable origine à Luther [FN: § 927-6]. Aujourd'hui, le culte des hommes éminents a beaucoup diminué ; par conséquent ces origines appartiennent seulement au passé.
§ 928. Les légendes constituées au moyen des résidus sont ensuite expliquées par les dérivations. Tant que l'être divin ou seulement spirituel, formé par la persistance des agrégats, s'écarte encore peu de son origine humaine, on n'éprouve aucune difficulté à concevoir son union avec d'autres êtres semblables ou avec des êtres réels. De ce tronc se détache une branche, dans laquelle la difficulté n'est pas grande non plus ; c'est celle où les êtres divins se transforment plus ou moins en abstractions métaphysiques qui s'unissent ensemble. La persistance des agrégats facilite le passage entre des faits comme celui du chaud et de l'humide, qui font germer le grain, et d'autres faits où les principes métaphysiques deviennent générateurs d'êtres réels ou imaginaires. Mais dans une autre branche, apparaissent de plus grandes difficultés ; c'est celle où la personnification des êtres spirituels demeure, et où leur écart avec les êtres humains s'accroît. Les Grecs ne ressentirent nullement le besoin de rechercher comment la semence de Zeus avait pu féconder les nombreuses femmes qu'il avait connues charnellement, tandis que les chrétiens éprouvèrent le besoin de résoudre une question semblable, au sujet des démons qui avaient des rapports avec les femmes [FN: § 928-1].
Les anticléricaux puisent un motif dans ces fables pour condamner la religion chrétienne. Mais celle-ci ne les a pas inventées : elle les a reçues de l'antiquité ; et après tout, ces fables ne sont pas plus étranges que d'autres qui continuent à avoir cours. Au point de vue exclusivement logico-expérimental, celui qui croit aux dogmes du suffrage universel peut aussi croire à l'origine divine des héros, car l'effort intellectuel nécessaire pour avoir l'une ou l'autre foi n'est pas très différent. Au point de vue de l'utilité sociale, les fables anciennes et modernes peuvent avoir eu une utilité grande, petite, nulle, négative. On ne peut rien dire a priori ; cela dépend du lieu, du temps, des circonstances.
§ 929. (I-β 3) Choses et événements terribles. Ce résidu apparaît presque seul, en certains faits, dont le suivant est un type. À propos de la conjuration de Catilina, Salluste dit [FN: § 929-1] : « Il y en eut [des gens] dans ce temps-là qui dirent que Catilina, après son discours, voulant lier par un serment les complices de son crime, fit circuler une coupe remplie de vin et de sang humain ; qu'après qu'ils en eurent tous goûté avec des imprécations, comme il est d'usage dans les sacrifices solennels, il leur dévoila son projet : il voulait ainsi, disait-on, les unir entre eux plus fortement par la complicité dans cet horrible attentat. Mais plusieurs pensent que ce détail et beaucoup d'autres furent inventés par ceux qui voulaient apaiser la haine qui s'éleva plus tard contre Cicéron, et qui, pour cela, exagéraient l'atrocité du crime de ceux qui avaient été punis ».
Que le fait soit vrai ou inventé, il n'en reste pas moins que l'on unit deux choses terribles : boire le sang humain et conspirer pour détruire la république romaine. On voit encore ce résidu dans certains sacrifices humains, substitués aux sacrifices d'animaux. Ceux-ci suffisent dans les conditions ordinaires ; ceux-là subviennent aux conditions extraordinaires, terribles.
Le serment des complices de Catilina n'est pas raconté de la même façon par tous les auteurs ; mais le même résidu transparaît sous des formes diverses. Plutarque dit de Catilina et de ses complices [FN: § 929-2] : « Pour se lier réciproquement par la foi du serment, ayant tué un homme, ils en goûtèrent les chairs ». Dion Cassius dit de Catilina [FN: § 929-3] : « Ayant tué un jeune garçon, il jura sur ses entrailles, puis, en les touchant, lui et les autres conjurés confirmèrent le serment ». Nous avons vu aussi ce résidu dans les sacrifices humains faits à Rome, après la défaite de Cannes. Dion Cassius [FN: § 929-4] raconte comment les soldats de César se révoltèrent, parce qu'ils n'avaient pas reçu l'argent que César avait dépensé pour certains jeux. César saisit et conduisit au supplice un des rebelles. « Celui-ci fut donc puni pour ce motif ; deux autres hommes furent égorgés comme dans un sacrifice. La raison de ce fait, je ne saurais la dire ». La raison est à rechercher, au moins en partie, dans le résidu dont nous traitons. Le crime des rebelles parut énorme, et ne pouvait être expié que d'une manière terrible [FN: § 929-5]. On n'aura d'ailleurs pas manqué de prétextes logiques pour justifier ce sacrifice [FN: § 929-6].
§ 930. Le ver sacrum nous apparaît de la même façon. Dans les circonstances ordinaires, il suffisait de promettre aux dieux des sacrifices d'animaux, des jeux, des temples, la dîme du butin fait à la guerre, etc. Mais quand se produisait quelque chose d'extraordinaire, de terrible, on promettait aux dieux tous les êtres animés qui naîtraient en un printemps. Il paraît qu'en des temps reculés, les peuples italiques mettaient aussi les hommes parmi ces êtres ; mais à l'époque historique, les Romains les excluaient [FN: § 930-1]. Un ver sacrum fut voué, quand Rome était serrée de près par Annibal [FN: § 930-2]. Le contrat avec les dieux fut fait avec les précautions formalistes et minutieuses qui étaient propres aux Romains (§ 220 et sv.). Les dieux tinrent loyalement parole, mais les Romains rechignèrent. Ce n'est que vingt-un ans après qu'ils se décidèrent à accomplir leur vœu, et encore pas trop correctement [FN: § 930-3] aussi durent-ils l'accomplir à nouveau [FN: § 930-4].
§ 931. On trouve aussi le présent résidu dans les opérations magiques, quand on sacrifiait des enfants [FN: § 931-1]. Les descriptions d'Horace (Epod., 5) et de Juvénal (VI, 552) sont bien connues. En Europe, jusqu'au XVIIe siècle, on entend de fréquentes accusations, vraies ou fausses, de ces sacrifices. Il paraîtrait qu'on en fit un pour conserver a Mme de Montespan [FN: § 931-2] l'amour de Louis XIV.
§ 932. (I-β 4) État heureux uni à des choses bonnes; état malheureux uni à des choses mauvaises. Quand un certain état A est estimé heureux, on est porté à y rattacher toutes les choses estimées bonnes ; et, au contraire, si un état B est estimé malheureux, on est poussé à y rattacher tout ce qui est mauvais. Ce résidu est souvent uni à un autre de la IIe classe. Ainsi se forme un noyau, autour duquel se disposent nombre de concepts de choses bonnes ou mauvaises ; et de cette manière se prépare, grâce à l'abstraction, une personnification de cette nébuleuse, qui devient un être spécial, ayant une existence subjective dans la conscience des hommes, et auquel ensuite, suivant un procédé habituel, on confère une existence objective [FN: § 932-1] (§ 94 et sv.).
§ 933. Longtemps, en Europe, tout ce qui était bien était placé sous la protection de la « sagesse des ancêtres ». Aujourd'hui, tout ce qui passe pour bon est attribué au « Progrès ». Avoir un « sentiment moderne » de certaines choses, veut dire en avoir un sentiment juste et bon. Autrefois, on louait un homme en disant qu'il avait des « vertus antiques ». Aujourd'hui, on le loue en disant qu'il est un « homme moderne »; et quelques-uns emploient le néologisme : « qui a un sens de modernité ». Autrefois, il était louable d'agir « chrétiennement ». Aujourd'hui, il est louable d'agir « d'une manière humaine », et mieux, « d'une manière largement humaine » ; par exemple en protégeant les voleurs et les assassins. Secourir son semblable s'appelait autrefois être « charitable ». Aujourd'hui, on dit : « faire oeuvre de solidarité ». Pour désigner des hommes dangereux, voués au mal, on disait autrefois que c'étaient des « hérétiques » ou des « excommuniés ». Aujourd'hui, on dit que ce sont des « réactionnaires ». Tout ce qui est bon est « démocratique » ; tout ce qui est mauvais est « aristocratique ». Les pontifes du dieu « Progrès » et leurs fidèles frémirent d'indignation quand le sultan Abdul Hamid réprima la révolte des Arméniens ; ils l'appelèrent « le sultan rouge ». Mais après avoir dépensé tant d'indignation, il ne leur en resta plus quand, en 1910, les « Jeunes Turcs », couverts par le pavillon du « Progrès », réprimèrent la révolte des Albanais. Le critère de ces gens paraît être le suivant. Un gouvernement a le droit de réprimer une insurrection, s'il jouit plus et mieux que les insurgés, de la protection du dieu « Progrès »; autrement il n'a pas ce droit.
§ 934. Ceux qui sont hostiles à une institution lui attribuent la responsabilité de tous les maux qui arrivent. Ceux qui la favorisent lui accordent le mérite de tout bien. Que de lamentations fit-on entendre sur les impôts levés par les gouvernements de jadis ! Pourtant ils étaient moindres qu'aujourd'hui ; maintenant, bien que plus lourds, on les supporte allégrement. Les « libéraux », en Toscane, en voulaient au Grand Duc, parce qu'il maintenait « le jeu immoral du loto ». Voyez ce que Giusti écrivit à ce propos. Mais ensuite il leur parut naturel et moral que le gouvernement italien le maintint aussi. En France, sous l'Empire, les candidatures officielles excitaient l'indignation des républicains. Arrivés au pouvoir, ils en usèrent plus largement et plus intensément que l'Empire [FN: § 934-1]. Les mêmes Anglais qui affirment qu'en Russie les délits politiques sont dus exclusivement au mauvais gouvernement, sont persuadés, d'autre part, que des délits identiques, commis aux Indes, sont dus uniquement aux accès de brutalité criminelle de leurs sujets.
§ 935. Les anciens Romains attribuaient aux dieux le mérite des succès de leur république. Les peuples modernes accordent le mérite du progrès économique à des parlements corrompus, ignorants et peu estimables. Il s'y ajoute des considérations sur lesquelles nous aurons à revenir (§ 1069 et sv.). En France, sous l'ancienne monarchie, le roi avait quelque chose de divin. Si l'on voyait se produire quelque abus, on disait: « Si le roi savait ! » Aujourd'hui, la république, le suffrage universel sont devenus des divinités [FN: § 935-1]. « Le suffrage universel, notre maître à tous ! » s'écrient députés et sénateurs, élus grâce au vote de ceux qui proclament le dogme : « Ni Dieu ni maître ». Quand on ne peut nier un abus, on en accuse quelque circonstance souvent très accessoire. Il y a des gens qui sont persuadés que tous les maux qu'on peut voir dans un pays parlementaire sont dus au scrutin uninominal, ou au scrutin de liste, ou au scrutin qui ne tient compte que de la majorité, à laquelle on oppose la représentation proportionnelle [FN: § 935-2]. Ces gens croient parer par des artifices de forme à des maux affectant le fond. Ils ferment les yeux sur le fond, parce qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas aller contre le sentiment qui fait voir tout en beau dans le suffrage universel et dans la démocratie.
§ 936. En France, un juge de paix avait jugé qu'un homme idiot, au sens médical du terme, ne pouvait être électeur. La Cour de Cassation, par jugement du 8 avril 1910, cassa ce jugement et décida que « la faiblesse d'esprit, lorsqu'elle n'a pas motivé l'interdiction, n'est pas incompatible avec la jouissance du droit électoral tel que le réglemente le décret du 2 février 1852 ». Là-dessus, Mme Marguerite Durand présenta comme candidat, dans une réunion populaire, précisément un idiot, et fit cette observation: « Les femmes ne votent pas, mais les idiots sont électeurs et même éligibles ». Cette dame a ainsi montré le ridicule, non seulement de l'inégalité électorale des femmes et des hommes, mais du principe même du suffrage universel. Après tout, un idiot peut bien figurer aussi comme électeur parmi les entremetteurs, les délinquants et autres semblables gens qui votent allégrement. Rappelons-nous qu'ainsi nous ne démontrons nullement qu'à tout prendre, et en un certain moment historique, le suffrage universel soit condamnable. Nous démontrons seulement que l'auréole de sainteté dont on l'entoure est ridicule, et nous mettons en lumière les sentiments qu'exprime l'adoration de cette divinité. Cela ne prouve pas non plus que la croyance en cette divinité ne soit utile à la société. Ce peut être –ou ne pas être – l'un des très nombreux cas dans lesquels une croyance, intrinsèquement fausse, est socialement avantageuse. Dans une étude objective comme celle-ci, il faut s'en tenir strictement aux termes d'une proposition et ne jamais les outrepasser (§ 41, 73, 74, 1678 et sv.).
§ 937. (I-β 5) Choses assimilées produisant des effets de nature semblable ; rarement de nature opposée. Souvent les hommes ont cru qu'en s'assimilant certaines choses, ils acquéraient une part des qualités de ces choses. Quelquefois, ces phénomènes peuvent se confondre avec une communion mystérieuse entre l'homme et son totem ou sa divinité ; mais plus souvent, ce sont des choses distinctes.
§ 938. Zeus, à qui l'on avait prédit que de Métis et de lui naîtrait un fils qui serait le maître du ciel, engloutit Métis, grosse d'Athéna. Un vers d'Hésiode [FN: § 938-1] ajoute : « Afin que la déesse lui communiquât la connaissance du bien et du mal ». Pindare (Ol., I, 62) dit que Tantale osa dérober à Zeus et donner à ses compagnons le nectar et l'ambroisie, qui l'avaient rendu lui-même immortel. Ailleurs (Pyth., IX, 63), il dit que les Heures donnèrent à Aristée l'immortalité, en versant sur ses lèvres le nectar et l'ambroisie. On sait quel rôle considérable le Sôma joue dans la religion des Védas [FN: § 938-2].
§ 939. En voyant et en considérant la force, le courage, la rapidité d'Achille, on estima opportun de supposer que, dès l'enfance, il se nourrit de moelle d'os de lions et de cerfs ; on y ajouta aussi la moelle d'os d'ours et les entrailles de lions et de sangliers [FN: § 939-1]. Là, le résidu est manifeste, à moins toutefois que les fanatiques du totémisme ne veuillent affirmer qu'Achille avait en même temps pour totem le lion, l'ours, le sanglier, le cerf. Les Nouveaux-Zélandais mangent leur ennemi pour acquérir sa force. Comme toujours, on ne manque pas d'explications diverses (dérivations) ; mais le résidu se reconnaît facilement. Dumont d'Urville nous raconte comment les Nouveaux-Zélandais dévorent « l'âme » des ennemis qu'ils ont tués [FN: § 939-2]. On pourrait décrire d'une manière identique la façon dont Achille était nourri, quand il était enfant. On voulait qu'il s'assimilât le waidoua des lions, des ours, etc., et comme il réside dans la moelle ou dans les viscères, on lui faisait manger ces parties des animaux. De nombreux usages des peuples sauvages contiennent le résidu dont nous parlons ; ce dernier se retrouve aussi chez les peuples civilisés, sous une forme peut-être quelque peu voilée [FN: § 939-3].
§ 940. Quand les sauvages mangent le totem, on a un cas particulier du phénomène de l'assimilation de ce qu'on croit avantageux ; mais avec l'abus qu'on a fait aujourd'hui du totémisme, on a voulu voir dans la communion avec le totem le « fait primitif » dont les autres seraient issus. Les faits que nous connaissons ne démontrent pas du tout cela. Nous avons seulement de nombreux faits, ayant un résidu commun, qui est celui de l'assimilation. On voit aussi ce résidu dans ce que dit Justin de l'Eucharistie [FN: § 940-1] : « (3) Ensuite on porte au président des frères, du pain et une coupe de vin mélangé d'eau. Il prend ces choses, loue et glorifie le Père de l'Univers, au nom du Fils et du Saint-Esprit, puis fait une longue eucharistie pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui... (5) Quand le président a fait l'eucharistie et que tout le peuple a répondu, ceux que nous appelons diacres donnent à chacun des assistants, le pain eucharistique, le vin et l'eau, et en portent aux absents. (LXVI, 1) Nous appelons cet aliment Eucharistie... (2) Car nous ne le prenons pas comme du pain ordinaire ou comme une boisson ordinaire ; mais de même que c'est à cause du verbe de Dieu que Jésus-Christ, notre Sauveur, s'incarna et prit chair et sang pour notre salut, de même aussi à cause des paroles de sa prière, nous savons que l'aliment consacré [FN: § 940-2], grâce auquel notre sang et nos chairs sont nourris par transformation de Jésus incarné, est de la chair et du sang [FN: § 940-3] ».
§ 941. On sait comment à ce simple fait se sont ajoutées des dérivations sans fin, et avec quelle abondance et quelle âpreté ont disputé sur ce sujet les théologiens, et maintenant aussi les détracteurs du christianisme. Nous n'avons pas à nous occuper de cette question. Notons seulement que le sentiment qui forme le résidu de ce fait ne porte aucune atteinte à la doctrine catholique ou à toute autre doctrine théologique ; autrement, reconnaître comme résidu, par exemple, dans l'amour pour Dieu, le sentiment d'amour envers un être puissant et bienfaisant, serait porter atteinte à toute religion qui inspire cet amour. Quelle que soit la foi, elle ne peut s'exprimer que dans la langue parlée par les hommes, et au moyen des sentiments qui existent en eux. L'étude de ces modes d'expression ne porte aucune atteinte aux choses qu'ils expriment (§ 74).
§ 942. Des controverses comme celles qui ont eu lieu sur l'Eucharistie auraient pu se produire dans d'autres cas analogues. Par exemple, si le paganisme gréco-latin avait duré jusqu'à nos jours, et que les mystères d'Éleusis eussent prospéré, on aurait pu disserter sur le cicéon tout aussi longuement que sur l'Eucharistie, et peut-être même envoyer quelque hérétique au bûcher. Les initiés aux mystères d'Éleusis répétaient la formule [FN: § 942-1] : « J'ai jeûné ; j'ai bu le cicéon ; j'ai pris dans le ciste ; j'ai vu ; j'ai mis dans le panier, et puis du panier dans le ciste ». Le cicéon que buvaient les initiés n'était évidemment pas un cicéon quelconque, comme on le buvait d'habitude : il acquérait des qualités mystiques, par la cérémonie dans laquelle on l'employait. Déméter avait bu le cicéon, tandis que, désolée, elle cherchait sa fille (Hymn. Hom. in Cererem, 208-209) ; et suivant ses prescriptions, il était composé d'eau, de farine et de feuilles de menthe triturées. Dans la suite, la composition de cette boisson paraît avoir changé [FN: § 942-2] ; et il semble aussi qu'on y ajouta du vin, bien que Déméter eût refusé d'en boire. Dans l'Argonautique, sur laquelle on met le nom d'Orphée, les Argonautes, pour s'engager par serment, boivent un cicéon dont la composition est différente.
§ 943. De ces faits naît une riche moisson de dérivations qui importent peu à la sociologie. Celle-ci doit s'occuper, au contraire, du résidu qu'on rencontre en nombre de phénomènes sociaux, et qui contribue à les expliquer. Avec le fait raconté dans l'Argo-nautique, nous avons passé, comme il arrive souvent, d'un résidu spécial à un résidu général, c'est-à-dire du résidu (I-β 5) au résidu (I-α). Chez plusieurs peuples, on trouve l'usage de faire avaler à un malade un morceau de papier sur lequel on a tracé certains caractères, ou la cendre de ce morceau de papier, ou l'eau dans laquelle on l'a laissé infuser [FN: § 943-1].
§ 944. (I-γ) Pouvoirs mystérieux de certaines choses et de certains actes. On trouve ce résidu en beaucoup d'opérations magiques, dans les amulettes, les serments prêtés sur certaines choses, les ordalies, etc. Il constitue aussi la partie principale des phénomènes des tabous avec ou sans sanction. Ce résidu correspond à un sentiment par lequel des choses et des actes sont investis d'un pouvoir occulte, souvent indéterminé, mal expliqué.
§ 945. Si nous ne connaissions que le jugement de Dieu, du moyen âge, nous pourrions nous demander si la partie principale est l'intervention supposée, de la divinité. Mais on trouve les ordalies un peu partout, souvent avec intervention d'un jugement supposé de la divinité, et souvent aussi sans elle. Au moyen âge, le jugement de Dieu a été imposé à l'Église, malgré sa résistance, par la superstition populaire. On voit par conséquent que la partie principale est l'instinct des combinaisons, et que l'intervention supposée du jugement divin est une dérivation qui a pour but d'expliquer et de justifier cet instinct. L'étude des ordalies appartient à la sociologie spéciale ; il nous suffit ici d'avoir indiqué ce cas de l'instinct des combinaisons.
§ 946. Il sera utile de séparer de la catégorie générale (I-γ 1) une catégorie spéciale (I-γ 2), dans laquelle les noms des choses sont supposés avoir un pouvoir occulte sur ces choses.
§ 947. (I-γ 1) Pouvoirs mystérieux en général. Les faits sont innombrables. Nous ne parlerons ici que de quelques-uns. Souvent un résidu se voit bien dans les faits de peu d'importance. Le 2 mai 1910, fut justicié à Lucerne un certain Muff, incendiaire et assassin. Voici ce que les journaux racontent à ce propos [FN: § 947-1] : « Les derniers sacrements lui ont été administrés [à Muff]. En marchant au supplice, il portait sur lui une particule authentique de la vraie croix que Mme Erica von Handel-Mazzetti lui avait fait parvenir avec des paroles de consolation ». Il est impossible de donner logiquement une place quelconque à cette relique dans le jugement que Dieu portera, d'une part sur les crimes de cet homme, et de l'autre sur son repentir. Il faut donc conclure que cette relique a un genre de pouvoir mystérieux, comme serait celui d'une parcelle de bromure de radium, enfermée dans un tube de verre.
§ 948. Habituellement, notre résidu se manifeste sous les voiles d'une de ses dérivations. Les hommes qui éprouvent le besoin de rendre logique leur attitude (résidu I-ε) se demandent : «Comment ces choses, ces actes peuvent-ils bien agir ? » Et ils se répondent : « Par l'intervention d'un esprit, d'un dieu, du démon ». Cette réponse vaut celle qui explique que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive.
§ 949. Une anecdote racontée par Saint Grégoire de Tours met à découvert le résidu et sa dérivation. Un individu accusé d'avoir incendié la maison de son voisin, dit [FN: § 949-1] : « J'irai au temple de Saint Martin, et, en jurant sur ma foi, je reviendrai innocent de ce crime ». Celui qui apprit le fait à Saint Grégoire dit : « Il était certain que cet homme avait incendié la maison. Tandis qu'il s'acheminait pour prêter serment, m'étant tourné vers lui, je lui dis « À ce que disent les voisins, tu n'es pas innocent de ce crime mais Dieu est partout, et son pouvoir est le même hors de l'église que dedans. Si donc tu as la vaine croyance que Dieu et ses saints ne vengent pas le parjure, voici le temple sain ; prête serment dehors si tu veux, car il ne te sera pas permis d'en fouler le seuil ». Il prête serment et, aussitôt frappé par le feu céleste, il expire. On voit que le narrateur flotte entre deux idées peu conciliables : celle que le serment est également efficace en tout lieu, et l'autre, qu'il est plus efficace en certains lieux qu'en d'autres [FN: § 949-2] ; car c'est pour avoir osé prêter serment en présence du temple de Saint Martin, que le parjure fut frappé ; raison pour laquelle l'auteur ajoute : Multis haec causa documentum fuit, ne in hoc loco auderent ulterius peierare. « Pour beaucoup de gens, ce fut un enseignement de ne plus oser se parjurer en ce lieu »
§ 950. Marsden [FN: § 950-1] nous apprend comment on prête serment, à Sumatra, et sur quels étranges objets on le fait : un vieux poignard (cris), un vieux canon de fusil, un fusil, et quelquefois la terre sur laquelle on pose la main. L'auteur qui, d'habitude, pense surtout aux actions logiques, observe : « (p. 11) C'est une chose frappante de voir les hommes soumis à des pratiques aussi déraisonnables, et qui sont dans le fait, aussi bizarres et aussi puériles, quoique communes à des Nations le plus séparées par la distance des lieux, le climat, le (p. 12) langage... »
§ 951. D'habitude, on tâche justement de renforcer, de façons analogues, la foi au pouvoir occulte des choses. Dans l'Iliade (III, 271-291), Agamemnon sacrifie des victimes, pour rendre ferme et solennel le serment avec Priam. Il coupe des poils sur la tête des agneaux ; et ces poils sont distribués aux meilleurs des Troyens et des Achéens; Agamemnon égorge les agneaux et prononce un serment auquel Priam répond par un autre serment semblable. Un grand nombre d'années et même de siècles après ce récit légendaire, des actes de ce genre se répètent ; seule, la forme change. Peu importe que l'on jure sur des victimes, sur des reliques de saints ou sur d'autres objets, qu'on invoque Zeus, Hélios, les Fleuves, la Terre, le Dieu des chrétiens et les saints, un démon ou un autre être quelconque. Seul importe le fait que les hommes croient fermement se lier par le moyen de certains actes en partie mystérieux. On trouve là le résidu que nous observons depuis des époques reculées, et chez tous les peuples. Aujourd'hui encore, il est des pays où l'on doit jurer en posant la main sur la Bible ou sur l'Évangile, et il est nécessaire que la main soit nue. Il est impossible de découvrir aucun motif logique, pour lequel, si la peau d'un gant se trouve entre la main et l'Écriture Sainte, le serment risquerait d'être moins efficace. Il y a sans doute un sentiment vague, indéfini, qui pousse à croire que la peau du gant nuirait au pouvoir mystérieux du livre, comme un corps non conducteur empêche le passage de l'électricité. D'ailleurs ce sentiment n'a pas une forme définie de cette façon ou d'une autre analogue ; il est constitué par un instinct qui admet certaines choses, en rejette d'autres, et il peut s'exprimer par notre résidu.
§ 952. Un sentiment semblable se retrouve dans l'idée qu'on a du pouvoir des reliques. Au sujet des choses estimées bienfaisantes, il faut distinguer deux éléments : l'action de ces choses et le sentiment de vénération qu'on a pour elles. Un élément peut exister sans l'autre. On peut estimer bienfaisantes des choses qu'on ne vénère pas, et vénérer des choses qu'on n'estime pas bienfaisantes. Les deux choses peuvent aussi être unies ; c'est ce qu'on observe pour les reliques. Innombrables sont les cas dans lesquels une chose appartenant à un saint agit presque par sa vertu propre. En général, les hommes peuvent croire à l'efficacité de certains actes du culte d'une religion, sans croire à cette religion [FN: § 952-1]. Là apparaît clairement la nature non-logique de certaines actions (§ 157, 184-1). Logiquement, on devrait croire d'abord en une religion donnée, puis en l'efficacité des actes de son culte ; efficacité qui est la conséquence logique de la première croyance. Une question posée, sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse y répondre, est logiquement absurde. Mais les actions non-logiques suivent une voie inverse. En certains cas, on croit instinctivement à l'efficacité des actions du culte ; puis on veut avoir une « explication » de cette croyance, et alors on recourt à la religion. C'est là un des cas si nombreux dans lesquels le résidu apparaît comme partie principale, et la dérivation comme partie secondaire. En particulier, innombrables sont les cas dans lesquels une chose appartenant à un saint, agit presque par sa vertu propre sur qui entre en contact avec elle.
Les Actes des apôtres [FN: § 952-2] rapportent que « (11) Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, (12) au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient [FN: § 952-3] ».
§ 953. Les opérations magiques nous fournissent un nombre immense d'actions mystérieuses. Si nous connaissions seulement la magie des chrétiens, où le pouvoir des opérations magiques est attribué au démon, on bien d'autres magies où le pouvoir est aussi attribué à quelque être surnaturel, nous nous demanderions si la croyance en l'efficacité des opérations magiques est, non pas un résidu du genre envisagé maintenant, mais au contraire une dérivation, c'est-à-dire une conséquence de la croyance au démon et à d'autres êtres surnaturels.
§ 954. Mais le doute s'évanouit, quand on observe qu'il y a des opérations magiques, sans qu'on suppose l'intervention d'êtres surnaturels. La partie constante n'est donc pas cette intervention, mais bien la croyance en une action mystérieuse. L'intervention de l'être surnaturel est une dérivation par laquelle on cherche à expliquer, justifier les combinaisons qui révèlent le résidu. [Voir Addition A19 par l’auteur] En outre, il y a de nombreux cas dans lesquels des opérations magiques ou quasi-magiques se mêlent à la religion, sans qu'on y prenne garde, involontairement, sans la moindre intention perverse. L'Église catholique a dû condamner l'abus qu'on faisait de l'eau bénite, de l'hostie consacrée, de nombreuses pratiques du culte, et de beaucoup de superstitions [FN: § 954-1]. Saint Thomas tâche autant qu'il peut de ménager la chèvre et le chou, et de justifier le résidu par la dérivation. Au sujet du port des reliques sur soi, il dit [FN: § 954-2] : « Si on les porte à cause de la confiance qu'on a en Dieu et aux saints dont viennent les reliques, ce n'est pas illicite ; mais si l'on s'attachait à quelque chose vaine, supposons au fait que le vase est triangulaire, ou à une autre chose semblable n'appartenant pas à la vénération de Dieu et des saints, ce serait supersticieux et illicite ». Quant aux écrits qu'on peut porter sur soi, il faut bien regarder « s'ils contiennent des noms inconnus, afin que dessous ne se dissimule pas quelque chose d'illicite ». Ici, il est évident que l'action illicite serait involontaire. Les « superstitions » persistent, tandis que la religion change ; en d'autres termes, le résidu persiste et les dérivations varient. Les chrétiens, par exemple, n'inventèrent pas le mauvais œil ; ils ne le déduisirent pas de l'existence de leur démon ; ils l'expliquèrent seulement, l'ayant déjà trouvé dans la société païenne.
§ 955. Tertullien [FN: § 955-1] dit que « chez les idolâtres, il y a une chose redoutable, qu'ils appellent fascinum, qui cause le malheur par la louange et une trop grande gloire. Parfois, nous estimons que c'est œuvre du diable, parce qu'il hait le bien ; parfois nous estimons que c'est œuvre de Dieu, parce qu'il juge l'orgueil, en élevant les humbles et en écrasant les superbes ». On remarque ici deux choses : d'abord la variabilité des dérivations, qui vont d'un extrême à l'autre, du diable à Dieu ; puis l'intervention de Dieu pour rabaisser celui qui se glorifie trop ; elle rappelle en partie l'envie des dieux des païens. Saint Basile observe qu'il y avait des gens qui croyaient que les envieux pouvaient nuire à autrui par leur seul regard [FN: § 955-2], « presque comme un flux maléfique, qui jaillit des yeux de l'envieux, et qui nuit et corrompt ». Mais il rejette cela comme fables populaires et de bonnes femmes. Ce sont au contraire les démons, ennemis des bons, qui se servent des yeux des envieux pour nuire à autrui. Delrio accepte cette sainte autorité, rejette toute autre cause, et tient le fascinum pour oeuvre du diable. Comme d'habitude, la dérivation bourgeonne, se feuille, croît exubérante. Delrio sait même – voyez quel savant ! – comment opère le démon [FN: § 955-3]. « Le fascinum est une qualité pernicieuse, donnée par un sortilège des démons, ensuite d'un pacte tacite ou exprès de l'homme et du démon. Le diable répand cette qualité pernicieuse dans l'air ambiant, et l'homme, en respirant l'air infecté qui est autour de lui, l'attire au cœur au moyen des artères du cœur, et par là des maux et la consomption se communiquent à tout le corps. » Il y avait longtemps déjà qu'on connaissait de semblables explications ingénieuses. Plutarque [FN: § 955-4] en traite longuement. Le fait du fascinum est certain, dit-il ; mais la difficulté d'en trouver l'explication fait qu'il y a des incrédules. Et il continue, montrant comment le fascinum peut se produire d'une façon naturelle. Une autre explication, toujours naturelle, est donnée par Héliodore [FN: § 955-5]. Inutile de rapporter toutes ces sornettes ; il est bon seulement de remarquer cet exemple de dérivations variables d'un résidu constant.
Naturellement, le mal connu, on court au remède, qui peut être de différents genres, c'est-à-dire naturel, magique, religieux.
§ 956. Tandis que ces branches se détachent du tronc, le tronc lui-même subsiste à travers les siècles ; et, des temps anciens aux nôtres, persiste la simple idée d'une influence mystérieuse due au mauvais œil.
Hésiode [FN: § 956-1] dit : « Tu ne perdrais pas ton bœuf, si tu n'avais un mauvais voisin ». Columelle [FN: § 956-2] surenchérit. Il rappelle cette parole, et ajoute : « Ce qui est dit, non seulement du bœuf, mais de tout ce qui nous appartient » ; et il paraît confondre le mauvais œil avec les vexations du voisin. Catulle [FN: § 956-3], en embrassant sa maîtresse, craint le mauvais œil de l'envieux ; et Virgile [FN: § 956-4], dans les Églogues, craint aussi le fascinum. Pline [FN: § 956-5] rapporte que, « selon Isigone et Nimphodore, il y a, en Afrique, des familles de fascinateurs dont les incantations tuent les troupeaux, dessèchent les arbres, font mourir les enfants ». Isigone ajoute que chez les Triballes et les Illyriens, il y a des individus du même genre, qui fascinent par le regard, et tuent ceux qu'ils fixent longuement, surtout d'un œil irrité. Les adultes sont frappés plus facilement. Il est à noter qu'ils ont deux pupilles dans chaque œil. Il y a des femmes du même genre, en Scythie, qui sont appelées Bities, à ce que dit Apollonide. Philarque place dans le Pont les Tibiens et beaucoup d'autres gens de la même nature, qui sont connus parce qu'ils ont, dit-il, une double pupille dans un œil, et l'effigie d'un cheval, dans l'autre. En outre, ils ne peuvent être submergés, même s'ils sont chargés de vêtements. [Voir Addition A20 par l’auteur] Damon raconte l'histoire de gens semblables, soit des Pharnaciens, en Éthiopie, dont la sueur cause la consomption aux corps qu'elle touche. Même chez nous, Cicéron dit que toutes les femmes qui ont doubles pupilles nuisent par leur regard ». De nos temps aussi, on croit au mauvais œil, sans que le démon y ait aucune part. Il suffit, à ce propos, de rappeler que beaucoup de bons catholiques étaient persuadés que Pie IX était jettatore. Notez que les jettatrices sont plus nombreuses que les jettatori, et qu'elles sont presque toujours – on pourrait dire : toujours – vieilles et laides, ou au moins laides ; celles qui sont jeunes et belles n'ont pas le mauvais oeil [FN: § 956-6]. Il y a là un autre résidu : un résidu du genre (I-β).
§ 957. L'efficacité des remèdes est mystérieuse, comme la maladie est mystérieuse, bien que parfois d'autres résidus puissent offrir une explication quelconque [FN: § 957-1]. Nous parlerons plus à propos des tabous, en traitant des dérivations (§ 1481 et sv.).
§ 958. (I-γ 2) Noms unis mystérieusement aux choses. Le nom peut être uni aux choses de deux manières : sans motif expérimental, mystérieusement, ou bien parce qu'il rappelle certaines propriétés expérimentales, ou même imaginaires, des choses. La première manière donne le présent genre de résidus ; la seconde donne des résidus de persistance des agrégats (IIe classe). Au point de vue scientifique, le nom est une simple étiquette pour désigner une chose, et l'on peut toujours changer l'étiquette, pourvu qu'il y ait quelque utilité. C'est d'après cette utilité surtout qu'on doit juger les définitions (§ 119 et sv.).
§ 959. Sous les deux aspects rappelés tout à l'heure, il en va différemment. Le nom est uni à la chose par certains liens mystérieux, ou du domaine des abstractions, liens expérimentaux,pseudo-expérimentaux,sentimentaux,imaginaires,fantaisistes ;etcette combinaison échappe à l'arbitraire de l'homme, tandis que pour la science expérimentale, le nom est arbitraire.
§ 960. Un excellent exemple du genre de résidus naissant d'une union mystérieuse du nom à la chose, est celui qu'on a dans les nombres dits parfaits ; il démontre clairement le contraste entre les raisonnements logico-expérimentaux et ceux par accord de sentiments. Pour les mathématiciens, parfait est une simple étiquette (§ 119, 963) qui sert à désigner un nombre égal à la somme de ses parties aliquotes. Par exemple, pour 6, ces parties sont: 1, 2,3, et leur somme donne précisément 6. Les nombres parfaits aujourd'hui connus sont : 6, 28, 496, 8128, etc.; ils sont tous pairs ; on ne connaît pas de nombres parfaits impairs. Au lieu de désigner ces nombres par le nom de parfaits, on pourrait employer un autre nom quelconque ; par exemple les appeler imparfaits ; et il n'y aurait rien, absolument rien de changé. La formule d'Euler, qui donne des nombres parfaits, en donnerait d'imparfaits, mais ce seraient de même des nombres égaux à la somme de leurs parties aliquotes. Il n'en est pas ainsi, quand on raisonne avec le sentiment. Alors le nom est d'une grande importance : parfait est le contraire d'imparfait, et le même motif qui fait placer un nombre parmi ceux qui sont parfaits, l'enlève de ceux qui sont imparfaits. D'ailleurs ce que signifie précisément ce nom de parfait, on ne le sait pas avec plus de précision que l'on ne sait ce que veulent dire les noms semblables: juste, bon, vrai, beau, etc. Il semble seulement que tous ces termes sont les épithètes de certains sentiments agréables qu'éprouvent certains hommes. Rapporter tous les discours oiseux des pythagoriciens sur les nombres, serait du temps perdu. Aristote en a bien vu le caractère fantaisiste et arbitraire. À propos de leurs théories des nombres, Aristote [FN: § 960-1] dit : « Et si elles étaient quelque part en défaut, ils les adaptaient de manière à ce que les résultats de leurs études fussent cohérents. Je cite un exemple. Étant donné que la décade semble être parfaite et comprendre toute la nature des nombres, ils disent que les corps célestes doivent être au nombre de dix ; mais comme il n'y en a que neuf de visibles, ils ajoutent l’anti-terre ». Il se peut bien que 10 soit un nombre parfait. Comment pouvons-nous l'affirmer ou le nier, si nous ignorons ce qu'est précisément ce parfait ? Philolaüs ne nous le dit pas plus qu'un autre, mais chante un hymne à la décade [FN: § 960-2]. « Il faut contempler le pouvoir et la nature des nombres, d'après le pouvoir qui se trouve dans la décade. La vertu de la décade est suprême, parfaite, créatrice de toute chose, principe, guide et ordonnatrice de la vie divine, céleste et humaine. Sans elle, tout est sans fin, incertain, obscur ». Il y a monseigneur le nombre quatre, qui est divin, et par lequel on jure, dans les Vers dorés pythagoriciens (v. 45-48). Commentant ces vers, Hiéroclès demande [FN: § 960-3] « Comment le nombre quatre est-il dieu ? »; et il en donne cette raison : « La décade est l'intervalle qui sépare les nombres, puisque celui qui veut compter plus loin [que dix], revient en arrière aux nombres un, deux et trois, et compte la seconde décade, jusqu'à ce qu'il atteigne la vingtaine ; de même pour la troisième décade, jusqu'à ce qu'il atteigne la trentaine ; et l'on procède ainsi de nouveau, jusqu'à ce qu'ayant compté la dixième décade, on arrive à cent. Et de nouveau on compte cent dix, de la même manière. Ainsi l'on peut continuer sans fin, avec l'intervalle de la décade ». En d'autres termes et sans tant de propos oiseux, l'auteur veut dire que 10 est la base de la numération des Grecs. Il continue : « Le nombre quatre est la vertu [la force] de la décade » ; et il en donne pour motif que les nombres 1, 2, 3, 4, additionnés ensemble, donnent la décade. En outre, quatre dépasse l'unité de trois, et il est dépassé aussi de 3 par le nombre 7. Puis on nous dit que « l'unité et le nombre sept ont de très belles et très excellentes propriétés ». Ce cher nombre sept a eu une infinité d'admirateurs, et même à notre époque, l'illustre Auguste Comte. Ainsi sept mérite que nous voyons ce que Hiéroclès pense de lui. « Le nombre sept étant sans mère et vierge, occupe le second rang en dignité, après l'unité [FN: § 960-4] ». Par l'expression « sans mère », on veut dire qu'il n'a pas de facteurs, qu'il est un nombre premier. Par l'expression « vierge », on veut dire qu'aucun multiple de sept n'est compris entre un et dix. Pourquoi ces deux propriétés rendent un nombre plus digne qu'un autre, nous ne le savons pas, de même que nous ignorons ce que peut bien être la dignité d'un nombre. Aux propriétés énoncées, il s'en ajoute d'autres semblables qui, paraît-il, augmentent la noblesse du nombre sept.
Nous renonçons à décrire les belles propriétés que les pythagoriciens trouvaient à d'autres nombres, mais nous ne pouvons passer sous silence le très célèbre nombre trois, qui joue un si grand rôle dans le culte des hommes. Sachez donc que [FN: § 960-5] « comme le disent aussi les pythagoriciens, l'univers et toute chose sont déterminés par le nombre trois, car la fin, le milieu et le commencement constituent le nombre de l'univers : c'est la trinité. Puisque ce nombre est reçu de la Nature selon ses lois, nous l'employons pour célébrer les sacrifices aux dieux ». Suivent d'autres divagations, inutiles à rapporter. Rappelons seulement que « (3) Puisque si toutes les choses, l'univers, le parfait, ne diffèrent pas l'un de l'autre, suivant l'idée, mais seulement par la matière et par les choses auxquelles ou les applique, le corps serait la seule grandeur parfaite, car lui seul est défini par le nombre trois. C'est là le tout ». Quand on rêve, on raisonne peu près ainsi.
Les Grecs appelaient « sacrifice parfait [FN: § 960-6] » celui de trois animaux : un porc, un bélier, un bouc. Il était semblable au suovetaurilia [FN: § 960-7]des Latins, où l'on sacrifiait un porc, un bouc, un taureau. « Le nombre impair plaît aux dieux », dit Virgile ; et le commentaire de Servius nous explique qu'on peut comprendre cela du nombre trois ou d'un autre nombre impair [voir : (FN: § 960 note 8). La sainteté du nombre 333 333 1/3, employé dans les vœux à Rome [FN: § 960 note 9], doit être en rapport avec celle du nombre trois.
Pour éviter des longueurs, nous renonçons à rappeler les nombreuses trinités divines qui régnèrent et qui règnent encore. Nous ne parlerons que d'une seule un peu plus loin (§ 1658), parce qu'elle est née à notre époque : celle des saint-simoniens.
§ 961. Auguste Comte plagie les pythagoriciens et s'approprie leurs divagations. Il accorde au fétichisme d'avoir divinisé les nombres, et parle de [FN: § 961-1] « (p. 129) certaines spéculations numériques, qui, d'abord très saintes sous la spontanéité fétichique, furent ensuite viciées par les mystères métaphysiques. Elles concernent ce qu'on peut justement nommer les propriétés philosophiques ou religieuses des nombres, méconnues de nos docteurs académiques. Leur juste appréciation, réservée à la sociologie, repose sur l'aptitude logique des trois premiers nombres... D'ingénieuses expériences ont démontré que, chez les animaux, la numération distincte cesse au delà de trois. Mais on tenterait vainement d'attribuer à notre espèce un privilège plus étendu.Il faut d'ailleurs, dans les deux cas, considérer seulement la coexistence abstraite, toujours confuse après trois, tandis que la coexistence concrète peut être, de part et d'autre, exactement appréciée au delà, les objets y dispensant des mots. C'est uniquement d'une telle abstraction que dépend le principal caractère philosophique de chaque nombre, vu son attribution logique. En approfondissant ce phénomène intellectuel, on y (p. 130) reconnaît la source des propriétés mentales que j'assignai précédemment aux nombres sacrés, parmi lesquels un représente toute systématisation, deux distingue toujours la combinaison, et trois définit partout la progression ».
Cette métaphysique positiviste est tout à fait identique à la métaphysique sans l'épithète de positiviste. Qui dira pourquoi une combinaison doit toujours être de deux éléments, et ne peut l'être de trois ou d'un plus grand nombre ? Tout cela est puéril. Comme d'habitude, l'auteur s'en tire avec le raisonnement en cercle, en déclarant vicieuse toute combinaison qui n'est pas binaire [FN: § 961-2]. Il est certain que si l'on exclut celles des combinaisons qui ont plus de deux éléments, on peut dire que toutes les combinaisons sont de deux éléments. On voit qu'A. Comte exclut des nombres sacrés celui de quatre, qui est au contraire divin pour les pythagoriciens. En fin de compte, autant vaut le sentiment du positiviste moderne, que celui des philosophes anciens. Personne ne peut dire qui a raison et qui a tort, car il manque un juge pour trancher ce litige, et l'on ne sait même pas ce que veulent dire ici les termes : raison, tort. Après avoir élevé le nombre sept à une très haute dignité, A. Comte veut l'imposer comme base de la numération [FN: § 961-3]. « Formé de deux progressions suivies d'une synthèse, ou d'une progression entre deux couples, le nombre sept, succédant à la somme (les trois nombres sacrés [c'est-à-dire 1, 2, 3], détermine le plus vaste groupe que nous puissions distinctement imaginer. Réciproquement, il pose la limite des divisions que nous pouvons directement concevoir dans une grandeur quelconque [affirmations arbitraires de Comte ; comme tous les métaphysiciens, il ne déduit pas la théorie des faits, mais plie les faits à ses théories]. Un tel privilège (p. 128) doit systématiquement conduire à le prendre pour base de la numération finale, tant concrète qu'abstraite ». Quel rapport y a-t-il entre le fait que 7 est égal à 3 + 3 + 1 ou à 2 + 2 + 2 + 1, et celui d'être choisi comme base de la numération ? Mais l'adverbe systématiquement sauve tout. De la même façon, la vraie liberté s'oppose à la liberté sans épithète (§ 1554 et sv.).
Mais il y a encore d'autres bonnes raisons. « (p. 128) Il faut que cette base soit un nombre premier [c'est ce que dit le souverain pontife du positivisme ; les mathématiciens disent au contraire que le nombre qui a le plus de facteurs est préférable, et que par conséquent, 12 serait préférable à 10], surtout en vertu du besoin général d'irréductibilité [il n'est pas si général, puisque beaucoup de peuples ont choisi 10], mais aussi d'après l'avantage spécial d'une pleine périodicité dans les transformations fractionnaires ».
§ 962. Les auteurs israélites et les auteurs chrétiens devaient éprouver un grand respect pour les nombres six et sept, à cause du temps employé pour la création. Philon le Juif, qui reproduit plusieurs divagations pythagoriciennes sur les nombres, dit [FN: § 962-1] : « Puisque le monde entier a été achevé suivant la nature parfaite du nombre six, le Père honorait le septième jour qui suivait, en le louant et en l'appelant saint ; car ce n'est pas fête seulement pour un seul peuple ou pour une seule contrée, mais pour l'univers ; et cette fête est digne d'être seule appelée populaire et jour de naissance du monde [FN: § 962-2]. Je ne sais qui pourrait assez célébrer la nature du nombre sept, car elle dépasse tout ce que l'on peut exprimer ». Mais il tâche au moins de noter beaucoup de belles propriétés de ce saint nombre. Il revient plusieurs fois sur ce sujet très important. Dans le Commentaire allégorique des saintes lois, il commence par louer le nombre six [FN: § 962-3]. Il serait absurde de croire que le monde est né en six jours, puisque le temps ne peut être antérieur au monde ; donc, par l'expression six jours, on doit entendre, non un espace de temps, mais un nombre parfait. Le nombre six est parfait, car il est le premier qui soit égal à la somme de ses facteurs ; en outre, il est le produit de deux facteurs inégaux (2 x 3). Suit une explication d'une beauté transcendante... pour qui la comprend. « Le deux et le trois ont dépassé un, qui est la nature incorporelle ; le deux est l'image de la matière, comme elle, divisé et coupé ; le trois est l'image du corps solide, puisque le solide a trois dimensions ». Puis on trouve d'autres belles propriétés du nombre six, dans les corps vivants. Ceux-ci se meuvent dans six directions ; et il faut savoir que Moïse [FN: § 962-4] « fait correspondre les choses mortelles au nombre six, les immortelles et les bienheureuses, à sept ». Ajoutons que la bonne dame qui s'appelle la Nature aime le nombre sept et s'en réjouit [FN: § 962-5]. Mais trêve désormais à ces discours de Philon ; celui qui en voudrait davantage n'aurait qu'à lire les œuvres de cet auteur [FN: § 962-6].
§ 963. Saint Augustin se demande si l'on doit prendre à la lettre les six jours de la Genèse ; mais il n'a aucun doute sur la perfection du nombre six [FN: § 963-1]. « Nous disons ce nombre six parfait, parce qu'il est la somme de ses parties, qui, rien qu'en les multipliant, peuvent reproduire le nombre dont elles sont une partie ». C'est-à-dire que ces parties sont les facteurs de six. On voit très bien ici la différence entre les définitions de la science logico-expérimentale et les théories du sentiment. Six est égal à la somme de ses facteurs, c'est-à-dire de 1, 2, 3. C'est là un fait expérimental. Les mathématiciens mettent une étiquette (§ 119, 963) sur les nombres qui ont cette propriété. Sur cette étiquette, ils écrivent nombre parfait ; mais ils pourraient tout aussi bien écrire : nombre imparfait ou un autre nom quelconque. Ceux qui raisonnent par accord de sentiments font de cette définition un théorème. Le sentiment qu'ils ont du parfait concorde, on ne sait pourquoi, avec le sentiment qui naît en eux de l'idée qu'un nombre est égal à la somme de ses facteurs ; donc un tel nombre est parfait, et six étant un nombre de ce genre, est parfait. Mais en vérité, le raisonnement par accord de sentiments n'est pas si rigoureux. Il y a une masse confuse de sentiments issus de la considération du nombre six, et qui sont grosso modo d'accord avec l'autre masse indéterminée, de sentiments qu'engendre la considération du mot parfait. Ce dernier ensemble de sentiments s'accorde également bien, suivant les individus, avec l'ensemble issu d'autres nombres, par exemple de quatre, de dix, etc. Étant donnée la définition des mathématiciens, du nombre parfait, dix, n'est pas un nombre parfait ; mais d'après le sentiment, il peut fort bien l'être, car ce mot parfait désigne une chose indéterminée (§ 509).
D'après le raisonnement logico-expérimental, il serait ridicule de dire : « Six est égal à la somme de ses facteurs ; donc Dieu devait créer le monde en six jours ». Il n'y a pas de rapport entre les prémisses et la conclusion. Mais, au contraire, le raisonnement par accord de sentiments crée ce rapport, grâce au terme parfait, qu'il élimine ensuite, selon un procédé général (§ 480). « Le nombre six est parfait ; la création est parfaite ; donc elle doit avoir été accomplie en six jours ». Saint Augustin le dit clairement [FN: § 963-2] (2) : « En un nombre parfait, c'est-à-dire en six jours, Dieu accomplit l'œuvre qu'il fit ». [Voir Addition A21 par l’auteur]
§ 964. Il paraîtra peut-être que nous avons parlé trop longuement de ces extravagances, et il en serait bien ainsi si l'on voulait les envisager au point de vue objectif, c'est-à-dire logico-expérimental ; mais si on les considère au point de vue subjectif, et qu'on fasse attention qu'elles ont été propres à un nombre immense de personnes, en tout temps, on verra qu'elles doivent correspondre à des sentiments diffus et puissants, qui, par conséquent, ne peuvent être négligés dans une étude des formes sociales [FN: § 964-1].
§ 965. L'étude que nous venons d'accomplir a les buts suivants :
1° Citer un nouvel exemple de la partie constante (résidus) et de la partie variable (dérivations) des phénomènes. Mais nous en avons déjà donné tant d'exemples, qu'on aurait pu négliger celui-ci. La partie constante est ici un sentiment qui lie mystérieusement la perfection aux nombres. Le nombre auquel on assigne cet attribut varie suivant les inclinations du sujet, et les motifs fantaisistes de cette perfection varient encore davantage.
2° Citer un exemple remarquable de raisonnements par accord de sentiments, c'est-à-dire un exemple de dérivations. À ce point de vue, nous aurions dû placer cette étude au chapitre IX ; mais pour éviter de nous répéter, il est mieux d'en traiter ici. Le raisonnement sur les nombres parfaits est entièrement semblable à celui sur le droit naturel, sur la solidarité, etc.; et des hommes comme Saint Augustin le tenaient pour non moins solide, et même pour plus solide que d'autres raisonnements par accord de sentiments. Mais parmi les hommes de notre temps, il sera facile d'en trouver qui l'estiment absurde, tandis qu'ils tiennent les autres pour bons ; c'est pourquoi ces personnes comprendront les considérations générales sur les nombres parfaits, plus facilement que celles sur le droit naturel ou la solidarité. Tel est le principal but dans lequel nous nous sommes arrêtés sur ce sujet.
3°Montrer, par un bon exemple, la différence tant de fois notée, entre les définitions de la science logico-expérimentale et les affirmations métaphysiques, théologiques, sentimentales. Les personnes qui continuent à rechercher si une chose est juste, bonne, etc., ne s'aperçoivent pas que cette recherche diffère peu ou pas du tout de celle qui tend à découvrir si un nombre est parfait (§ 119, 387, 506, 963).
4° Opposer la précision des sciences logico-expérimentales à l'indétermination des recherches métaphysiques, théologiques, sentimentales. Ce contraste est semblable à celui que nous venons de voir, entre la conception que les mathématiciens ont de certains nombres, auxquels ils donnent arbitrairement le nom de parfaits, et l'idée de ceux qui approprient sentimentalement cette épithète à un nombre qu'ils ont en prédilection.
Au point de vue des buts 2°, 3°, 4°, nous venons de traiter longuement des nombres parfaits ; cela nous permettra d'être plus bref pour d'autres exemples analogues.
5° Citer un exemple où les actions non-logiques ne paraissent avoir aucune utilité sociale. Les actions non-logiques qui correspondent aux élucubrations du droit naturel, paraissent souvent avoir, et ont parfois effectivement une utilité sociale ; ce qui ne permet pas de voir si facilement leur absolue vanité logico-expérimentale.
§ 966. (I-δ) Besoin d'unir les résidus. Souvent l'homme éprouve le besoin d'unir certains résidus qui existent dans son esprit. C'est une manifestation de l'inclination synthétique, qui est indispensable, en pratique. Séparer ces résidus par l'analyse est une opération scientifique dont peu d'hommes sont capables. On peut le vérifier facilement. Demandez à une personne qui n'a pas l'habitude du raisonnement scientifique – et parfois même à qui a cette habitude ou devrait l'avoir – de résoudre la question: « A est-il B ? » ; et vous verrez qu'elle sera entraînée presque irrésistiblement à envisager en même temps, sans les séparer le moins du monde, d'autres questions comme : « Est-il utile que A soit B ? Est-il utile qu'on croie que A est B ? Est-ce d'accord avec le sentiment de certaines personnes, que A soit B ? » Ou bien : « Cela heurte-t-il quelque sentiment ? etc. ». Par exemple, un grand nombre de personnes ne sauraient se résoudre à envisager séparément la question : « L'homme qui suit les règles de la morale obtiendra-t-il le bien-être matériel ? » (§ 1898 et sv.).
§ 967. L'homme répugne à séparer la foi de l'expérience : il veut un tout complet, où il n'y ait pas de notes discordantes. Pendant bien des années, les chrétiens crurent que leur Écriture Sainte ne contenait rien qui fût contraire à l'expérience historique ou scientifique. Une partie d'entre eux a maintenant abandonné cette idée quant aux sciences naturelles, mais la conserve à l'égard de l'histoire. Une partie abandonne la science et l'histoire, mais veut au moins conserver la « morale ». Une partie veut qu'on obtienne l'accord tant désiré, sinon à la lettre, du moins allégoriquement, par de subtiles interprétations. Les musulmans sont persuadés que tout ce que l'homme peut savoir est contenu dans le Coran. Pour les anciens Grecs, l'autorité d'Homère était souveraine. Celle de Marx l'est ou l'était aussi pour certains socialistes. Une infinité de sentiments de bonheur se mélangent en un tout harmonieux, dans le Saint Progrès et la Sainte Démocratie des peuples modernes.
§ 968. Les Épicuriens séparaient entièrement les résidus correspondant aux divinités, des résidus d'un autre genre ; mais c'est là un cas unique ou très rare. En général, dans la conception des divinités, se confondent des résidus de nombreux genres. Un tel mouvement d'agrégation persiste parmi les différentes divinités, et constitue l'une des principales forces qui font passer du polythéisme au monothéisme.
§ 969. Le besoin d'unir les résidus a une grande part dans l'emploi que les hommes font de certains mots au sens complètement indéterminé, mais qu'ils croient correspondre à des choses réelles (§ 963). Par exemple, tous les hommes comprennent le terme bon ou son analogue bien, et croient qu'ils représentent une chose réelle. On appelle bon ce qui plaît au goût ; puis, étendant le cercle des sensations, ce qui plaît au goût et profite à la santé ; puis seulement ce qui profite à la santé. On étend à nouveau le cercle des sensations ; on y comprend des sensations morales, et celles-ci dominent le bon et le bien. Enfin, chez les philosophes et surtout les moralistes, on ne tient compte que des sensations morales. En résumé, ces termes reviennent à désigner un ensemble de résidus, pour lequel l'individu qui emploie le terme éprouve de l'attraction, ne ressent aucune répugnance.
§ 970. Le besoin d'unir des résidus persiste chez les intellectuels. On met ensemble le bien, le bon, le beau, le vrai, et il y en a même qui ajoutent l'humain, ou mieux le largement humain, l'altruisme, la solidarité, en en formant un ensemble qui chatouille agréablement leur sentimentalité. Cet ensemble ou un autre semblable, né d'un besoin de combinaisons, peut ensuite, grâce aux résidus de la permanence des agrégats, acquérir une existence indépendante, et même, en certains cas, être personnifié. [FN: § 970-1]
§ 971. Parmi les différences qui existent entre une œuvre scientifique et une œuvre littéraire, il ne faut pas négliger que la première sépare les résidus unis par la seconde. Celle-ci satisfait donc le besoin d'unir les résidus ; besoin laissé inassouvi par celle-là. Quant au besoin de logique, dont nous parlerons bientôt, il semblerait qu'il devrait être mieux satisfait par l'œuvre scientifique que par l'œuvre littéraire, et cela peut avoir lieu, en certains cas, mais ne se produit pas pour le plus grand nombre des hommes, parce qu'ils se contentent pleinement de la pseudo-logique de l'œuvre littéraire, qu'ils comprennent et goûtent beaucoup mieux que la logique précise et rigoureuse de la méthode expérimentale. C'est pourquoi enfin, si l'œuvre scientifique peut convaincre quelques personnes compétentes en la matière, l'œuvre littéraire persuade toujours mieux le plus grand nombre des hommes. C'est là une des si nombreuses causes pour lesquelles l'économie politique est demeurée en grande partie littéraire ; et il est bon qu'elle demeure en cet état, pour ceux qui veulent prêcher, mais non pour ceux qui veulent trouver les uniformités des phénomènes (§ 77).
§ 972. (I-ε) Besoin de développements logiques. Ce genre pourrait être considéré comme une espèce du précédent ; car il unit à d'autres résidus celui du besoin de raisonnement. Mais sa grande importance engage à en faire un genre à part. Le besoin de logique est satisfait, tant par une logique rigoureuse que par une pseudo-logique. Au fond, les hommes veulent raisonner ; que ce soit bien ou mal, peu importe. Qu'on remarque à quelles discussions fantaisistes ont donné lieu et donnent encore lieu des sujets incompréhensibles, comme les diverses théologies, les métaphysiques, les divagations sur la création du monde, sur la fin de l'homme, et l'on aura une idée de la prédominance du besoin satisfait par ces productions.
§ 973. Ceux qui ont proclamé «la faillite de la Science [FN: § 973-1] » avaient raison, dans ce sens que la science ne peut satisfaire le besoin infini de développements pseudo-logiques, éprouvé par l'homme. La science ne peut que mettre en rapport un fait avec un autre, et par conséquent c'est toujours à un fait qu'elle s'arrête. La fantaisie humaine veut passer outre, veut raisonner encore sur ce dernier fait, veut connaître la « cause », et si elle n'en trouve pas une réelle, elle en invente une imaginaire.
§ 974. On remarquera que c'est justement ce besoin de chercher des causes quelconques, réelles ou imaginaires, qui, s'il a créé de toutes pièces les imaginaires, a fait trouver les réelles. En ce qui concerne les résidus, la science expérimentale, la théologie, la métaphysique, les divagations sur l'origine et sur la fin des choses, ont un point de départ commun, qui est le désir de ne pas s'arrêter à la dernière cause des faits, laquelle nous est connue, mais de remonter plus haut, de raisonner sur elle, de trouver ou d'imaginer quelque chose d'autre, au delà de cette limite. Les peuples sauvages dédaignent les élucubrations métaphysiques des peuples civilisés, mais sont de même étrangers à leurs recherches scientifiques ; et celui qui affirmerait que sans la théologie et la métaphysique, la science expérimentale n'existerait pas non plus, se placerait dans des conditions telles qu'on ne pourrait pas facilement le réfuter. Ces trois genres d'activité sont probablement la manifestation d'un certain état psychique, et si cet état disparaît, ces genres d'activité font aussi défaut.
§ 975. Ici nous ne parlerons pas davantage de ce genre de résidus, parce qu'il en est longuement traité dans tout l'ouvrage. C'est de lui que provient le besoin de recouvrir les actions non-logiques d'un vernis logique, et nous nous sommes souvent et abondamment entretenus de ce sujet. C'est de lui aussi que provient la partie des phénomènes que nous avons désignée par (b), et qui constitue les dérivations, dont nous aurons à nous occuper aux chapitres IX et X. Elles ont habituellement pour but de satisfaire par une pseudo-logique le besoin de logique et de raisonnement que l'homme éprouve.
§ 976. (I-ζ) Foi en l'efficacité des combinaisons. Comme nous l'avons déjà noté (§ 890), on peut croire que A est nécessairement uni à B. Cette croyance peut naître de l'expérience, c'est-à-dire de l'observation constante que A est uni à B. D'ailleurs la science logico-expérimentale en déduit seulement qu'avec une probabilité plus ou moins grande, A sera toujours uni à B (§ 97). Pour donner le caractère de nécessité à cette proposition, il faut y ajouter quelque chose de non-expérimental, un acte de foi.
§ 977. Cela posé, si l'invention était identique à la démonstration [FN: § 977-1], le savant, dans son laboratoire, observerait les combinaisons AB, sans aucune idée préconçue ; mais il n'en est pas ainsi. Quand il cherche, invente, il se laisse guider par des suppositions, par des idées préconçues, peut-être même par des préjugés. Cela n'a pas d'inconvénients, car l'expérience viendra corriger ce que ces sentiments renfermeront d'erroné.
§ 978. Chez l'homme qui n'a pas l'habitude de la méthode logico-expérimentale, les parties sont interverties : les sentiments jouent le rôle prépondérant ; l'homme est mu surtout par la foi en l'efficacité des combinaisons. Souvent il ne se soucie pas de vérifications expérimentales ; souvent encore, quand il s'en préoccupe, il se contente de preuves absolument insuffisantes, parfois même ridicules.
§ 979. Ces idées sont souveraines, dans l'esprit du plus grand nombre des hommes ; c'est pourquoi il arrive précisément qu'elles étendent leur domination même à l'esprit des savants ; ce qui arrivera d'autant plus facilement que le savant, en étudiant sa science, sera plus en contact avec le reste de la population, et d'autant moins que les élucubrations de ses sentiments viendront se heurter à l'expérience. Tel est la cause pour laquelle celui qui étudie les sciences sociales éprouve des difficultés bien plus grandes, à suivre la méthode logico-expérimentale, que celui qui étudie une science comme la chimie ou la physique.
§ 980. Laissons maintenant de côté les sciences logico-expérimentales, et traitons des phénomènes, au point de vue des sentiments et des résidus. Si la combinaison AB n'est pas un fait de laboratoire, mais un fait de la vie courante, elle engendre à la longue, dans l'esprit de l'homme, un sentiment qui unit indissolublement A à B ; et l'on a de la peine à distinguer ce sentiment d'un autre, qui ait une origine étrangère à l'expérience ou pseudo-expérimentale.
§ 981. Quand on met un coq avec des poules, des œufs de celles-ci naissent des poussins. Quand un coq chante à minuit dans une maison, quelqu'un y meurt. Pour qui raisonne avec le sentiment, ces deux propositions sont également certaines, et même également expérimentales ; et le sentiment qui les dicte naît également d'expériences directes et d'expériences indirectes, rapportées par une autre personne. Si l'on objecte qu'il est arrivé d'entendre chanter un coq à minuit, sans que quelqu'un mourût, on peut répondre qu'il arrive souvent que d'un oeuf d'une poule vivant avec un coq ne naisse aucun poussin. L'homme de science sépare les deux phénomènes, non seulement par l'expérience directe, mais encore par l'assimilation (§ 556). Le vulgaire ne peut faire cela ; et quand il déclare que l'annonce de la mort par le chant du coq est un absurde préjugé, il n'a pas du tout des raisons meilleures que lorsqu'il le tenait pour une vérité indiscutable.
§ 982. En général, l'ignorant est guidé par la foi en l'efficacité des combinaisons (§ 78), maintenue vive par le fait que beaucoup sont vraiment efficaces ; mais cette foi naît en lui spontanément, comme on peut bien le voir chez l'enfant qui s'amuse à tenter les plus étranges combinaisons. L'ignorant distingue peu ou ne distingue pas du tout les combinaisons efficaces, des non-efficaces ; il joue les numéros du loto, correspondant à ses songes, de la même foi avec laquelle il se rend à la gare, à l'heure indiquée par l'horaire ; il consulte la somnambule ou le charlatan, comme il consulterait le médecin le plus éminent. Caton l'Ancien expose avec la même foi les remèdes magiques et les opérations agricoles.
§ 983. Quand la science expérimentale progresse, on veut donner une apparence expérimentale aux produits du sentiment, et l'on affirme que la foi aux combinaisons est due à l'expérience ; mais il suffit d'examiner les phénomènes d'un peu près, pour reconnaître combien cette explication est peu fondée.
§ 984. Si les préjugés ont aujourd'hui diminué chez le vulgaire, cela n'est pas arrivé sous l'influence directe des sciences expérimentales, mais en partie sous une influence indirecte ; c'est-à-dire par l'autorité de ceux qui cultivent ces sciences, et qui pourtant ont introduit quelques préjugés nouveaux ; en partie de même grâce à l'énorme accroissement de la vie industrielle, qui est aussi une vie expérimentale, et qui est venue heurter, fût-ce indirectement et sans qu'on en ait conscience, le préjugé du sentiment.
§ 985. La croyance que A doit nécessairement être uni à B se renforce et devient stable, grâce aux résidus de la persistance des agrégats. Précisément parce qu'elle a son origine dans les sentiments, elle tient de ceux-ci l'indétermination qui leur est propre, et souvent A et B ne sont pas des choses ou des actes déterminés, mais des classes de choses ou d'actes, qui, suivant l'habitude, correspondent aux genres (β) et (γ) [FN: § 985-1]. Par conséquent, une chose A est unie à une chose B quelconque, pourvu qu'elle lui soit semblable ou contraire, qu'elle soit exceptionnelle, terrible, heureuse, etc. Une comète annonce la mort d'un grand personnage, mais on ne sait pas précisément qui c'est.
§ 986. Quelle que soit l'origine expérimentale, pseudo-expérimentale, sentimentale, fantaisiste on autre, de la croyance que A est uni à B, celle-ci, quand elle existe et qu'elle est rendue stable, grâce à la persistance des agrégats, agit fortement sur les sentiments et sur les actions. Cela se produit en deux sens : passif et actif (§ 890 et sv.).
§ 987. Dans le sens passif, si l'on observe un élément de la combinaison AB, on éprouve du malaise, quand on n'observe pas la combinaison entière. Si donc B est postérieur à A, quand on observe A, on attend B (comètes et événements annoncés par elles ; présages en général). Quand on observe B, on est persuadé qu'il a dû être précédé de A, et l'on fouille tellement dans le passé, qu'on finit par trouver un A qui lui correspond [FN: § 987-1] (faits qu'on suppose avoir présagé la puissance impériale aux futurs empereurs romains). Enfin, si A et B sont également dans le passé, on les accouple ensemble, même s'ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre (présages racontés par les historiens, quand ils ne sont pas inventés de toute pièce).
§ 988. Il est à noter que souvent B demeure indéterminé ou déterminé seulement par le fait qu'il doit appartenir à une certaine classe. Il doit se passer quelque chose ; mais on ne sait pas précisément quoi (§ 925). La persistance des agrégats a fait que la combinaison AB s'est acquis une personnalité propre, indépendante de B, en de certaines limites.
§ 989. Dans le sens actif, on est persuadé qu'en produisant A, on suscite B. La science passive de la divination (§ 924) devient ainsi la science active de la magie. Les Romains avaient introduit un élément actif dans la divination, avec l'art d'accepter ou de rejeter les présages. Toutes les combinaisons ne se prêtent pas à cette transformation. D'abord, sont naturellement exclues les combinaisons dans lesquelles A n'est pas au pouvoir de l'homme, comme le tonnerre ou l'apparition des comètes ; mais, même quand A est au pouvoir de l'homme, il y a des cas dans lesquels on ne croit pas qu'en l'employant on fasse naître B. Un être surhumain naît d'une vierge ; mais on ne croit pas qu'avec une vierge on puisse provoquer cette naissance. Il fallut trois nuits ou plus pour engendrer Hercule ; mais on ne croit pas que celui qui a des rapports continus avec une femme pendant cet espace de temps, puisse s'attendre à avoir un fils semblable à Hercule. Il y a ensuite des cas dans lesquels on trouve un mélange de partie passive et de partie active ; par exemple, les paroles de bon augure. Si on les entend par hasard, elles présagent un événement heureux ; et il est bon de les faire entendre volontairement pour faciliter la venue de cet événement ; et vice-versa pour les paroles de mauvais augure.
§ 990. En général, on peut dire que l'idée de l'efficacité de A pour provoquer B, ajoute quelque chose à la simple idée de l'union AB.
Ce serait ici le lieu de traiter de la magie et d'autres pratiques analogues ; mais cette étude, faite en détail, doit être renvoyée à la sociologie spéciale.
§ 991. IIe CLASSE. Persistance des agrégats. Certaines combinaisons constituent un agrégat de parties étroitement unies, comme en un seul corps, qui finit, de la sorte, par acquérir une personnalité semblable à celle des êtres réels. On peut souvent reconnaître ces combinaisons à leur caractère d'avoir un nom propre et distinct de la simple énumération des parties. L'existence de ce nom contribue ensuite à donner une plus grande consistance à l'idée de la personnalité de l'agrégat (§ 1013), à cause du résidu d'après lequel à un nom correspond une chose (chapitre X). Les sentiments correspondant à l'agrégat peuvent demeurer presque constants, et peuvent aussi varier en intensité et en extension. Il faut tenir cette variation séparée de l'autre, beaucoup plus grande, des formes sous lesquelles ces sentiments se manifestent, c'est-à-dire de la variation des dérivations. En somme, on a un noyau avec une personnalité propre, mais qui peut se développer, comme le poussin qui devient poule ou la chenille qui devient papillon ; puis on a, sous forme de dérivation, les manifestations de ce noyau, comme seraient les actions variées et capricieuses de l'animal.
§ 992. Après que l'agrégat a été constitué, un certain instinct agit souvent ; avec une force variable, il s'oppose à ce que les choses ainsi unies se séparent, et si la séparation ne peut être évitée, il tâche de la dissimuler, en conservant le simulacre de l'agrégat. On peut, grosso modo, comparer cet instinct à l'inertie mécanique. Il s'oppose au mouvement donné par d'autres instincts. De là naît la grande importance sociale des résidus de la IIe classe.
§ 993. Des combinaisons qui disparaissent aussitôt qu'elles sont formées ne constituent pas un agrégat ayant une existence propre. Mais si elles persistent, elles finissent par acquérir ce caractère ; et ce n'est pas seulement par abstraction qu'elles revêtent une espèce de personnalité, comme ce n'est pas seulement par abstraction que nous connaissons un ensemble de sensations du nom de faim, de colère, d'amour, et un ensemble de fourmis, du nom de fourmilière. Il est nécessaire de bien saisir cela. Il n'y a pas de chose correspondant au nom de troupeau, en ce sens qu'on ne peut séparer le troupeau des moutons qui le constituent ; mais le troupeau n'est pas égal à la simple somme des moutons. Ceux-ci, par le seul fait qu'ils sont réunis, acquièrent des propriétés qu'ils n'auraient pas, s'ils n'étaient pas réunis. Un mâle et une femelle, mis ensemble à l'âge de la reproduction, sont quelque chose de différent du même mâle et de la même femelle, séparés. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait une entité X, distincte du mâle et de la femelle, et qui représente le mâle accouplé avec la femelle.
§ 994. À ces considérations, il faut en ajouter une autre, rappelée bien des fois déjà ; c'est-à-dire que si l'abstraction correspondant à l'agrégat n'a pas d'existence objective, elle peut avoir une existence subjective ; et cette circonstance est importante pour l'équilibre social. Un exemple éclairera la chose. Supposons qu'on ait observé que certains hommes se sont fait d'un fleuve une divinité. Ce fait peut être expliqué de bien des façons. (a) On peut dire que, du fleuve concret, ces hommes ont séparé par abstraction un fleuve idéal qu'ils considèrent comme une « force de la nature » et qu'ils adorent comme telle. (b) On peut dire que l'on a attribué au fleuve une ressemblance humaine, que, comme à un homme, on lui suppose une âme, et que cette âme a été divinisée. (c) On peut dire que ce fleuve a fait naître chez les hommes diverses sensations mal définies, au moins en partie, et très puissantes. Ces sensations persistent, et leur ensemble constitue, pour le sujet, une chose à laquelle il donne un nom, comme à toutes les autres choses subjectives qui sont remarquables. Cette entité, avec son nom, est attirée par d'autres entités semblables, et peut prendre place dans le panthéon du peuple considéré, comme elle peut prendre place auprès du drapeau dans l'agrégat patriotique (le Rhin allemand), ou bien, plus modestement, dans le bagage des poètes. On ne peut exclure aucune de ces trois formes de phénomènes ; mais la troisième explique plusieurs faits qui ne sont pas expliqués par les deux premières, et qui, parfois même, sont en contradiction avec elles. Le résidu auquel correspond la troisième hypothèse est par conséquent beaucoup plus usité que les deux autres.
§ 995. Nous avons déjà rencontré ces faits, en parlant des dieux de l'ancienne Rome (§ 176 et sv.), et nous avons vu qu'ils correspondaient à certaines associations d'actes et d'idées. Maintenant, nous poussons un peu plus loin l'analyse, et nous voyons des résidus de la Ire classe devenir persistants, grâce aux résidus de la IIe classe. Ce culte est un fétichisme, dans lequel le fétiche n'est pas une chose, mais un acte. Si nous voulions l'expliquer par les hypothèses (a) ou (b), nous ne réussirions pas à comprendre comment les Romains, dont l'esprit était incontestablement plus pratique, moins subtil, moins ingénieux que celui des Grecs, ont pu mettre au jour tant d'abstractions, voir partout tant de « forces de la nature », tandis qu'ils n'avaient peut-être pas même une idée correspondant à ce terme, et se montrer ainsi beaucoup plus idéalistes que les Grecs. Il semble plutôt qu'il aurait dû arriver le contraire. Avec l'hypothèse (c), les faits s'expliquent très facilement. Les résidus de la IIe classe étaient beaucoup plus puissants chez les Romains que chez les Grecs. Nous en avons donné des preuves au chapitre II. Il devait donc arriver – et il est arrivé – qu'un plus grand nombre d'agrégats acquissent une existence individuelle; et ce sont justement ces agrégats qu'ensuite des raisonneurs beaucoup plus subtils que le peuple fruste où ces ensembles se formèrent, ont pris pour des « personnifications des forces de la nature ».
§ 996. On possède des inscriptions consacrées à la déesse Annona [FN: § 996-1]. Il semble difficile que les Romains aient, par abstraction, personnifié l'approvisionnement de Rome, pour élever ensuite cette personnification aux honneurs de la divinité. Au contraire, on voit facilement comment les sensations provoquées par les besoins de cet approvisionnement important et difficile, étaient fortes et profondes. Elles constituèrent un agrégat qui, en persistant, acquit une personnalité propre et devint une chose. Celle-ci, avec son nom d'Annona, alla ensuite rejoindre un grand nombre d'autres compagnes dans le panthéon romain.
§ 997. L'Annona n'a pas d'existence objective, mais bien subjective. Si, au temps de la Rome antique, on avait eu l'idée de faire des pseudo-expériences religieuses, comme on en fait maintenant, on aurait trouvé dans l'esprit des Romains la déesse Annona avec ses compagnes et ses compagnons. Cela aurait prouvé que, dans l'esprit des Romains, existaient, sous ces noms, certains agrégats de sentiments et d'idées, mais n'aurait nullement démontré l'existence objective de ces agrégats. En un certain sens, si l'on veut user du langage poétique, on peut dire que ces agrégats étaient vivants dans la conscience des Romains ; mais on ne peut pas dire qu'ils prissent vie hors de cette conscience [FN: § 997-1].
§ 998. Les phénomènes de ce genre diffèrent d'autant plus qu'ils s'éloignent davantage des résidus. Chez les Romains, justement à cause de leur peu de goût pour les spéculations théologiques et philosophiques, on reste très près des résidus. Chez les Grecs, grâce à leur tendance à ces spéculations, on s'éloigne passablement des résidus avec les dérivations ; et l'une de ces dérivations nous donne l'anthropomorphisme des dieux de la Grèce ; ce qui explique le fait que les dieux de la Grèce sont beaucoup plus vivants que les dieux des Romains (§ 178).
§ 999. L'apothéose des empereurs romains, envisagée au point de vue logique, est absurde et ridicule; mais, considérée comme la manifestation de la permanence des résidus, elle apparaît naturelle et raisonnable. L'empereur, quel qu'il fût, personnifiait l'empire, l'administration régulière, la justice, la paix romaine, et ces sentiments ne disparaissaient pas le moins du monde, parce qu'un homme mourait, et qu'un autre prenait sa place. La permanence de cet agrégat était le fait ; l'apothéose avec l'approbation du Sénat une des formes sous lesquelles elle se manifestait.
§ 1000. Des considérations analogues s'appliquent à beaucoup d'autres cas de déification des hommes. La chose ne s'est pas produite comme se l'imagine H. Spencer, par l'effet d'une analyse logique (§ 684 et sv.). Elle n'est autre que l'une des très nombreuses manifestations de la permanence des agrégats. Nous verrons plus loin (§ 1074-1) que d'abord Rome est divinisée, et qu'ensuite on imagine une femme qui a eu ce nom et qui ainsi a été déifiée. Il y a un très grand nombre d'exemples semblables. Parfois, d'un dieu, on remonte à un homme imaginaire, et parfois encore d'un homme réel on va à un dieu. Tout cela constitue des dérivations essentiellement variables, tandis que les sentiments qui se manifestent de cette manière sont constants.
§ 1001. On a observé qu'il y a des usages qui subsistent après que les causes dont ils tirent leur origine ont disparu. Ce phénomène a reçu le nom de survivance, à vrai dire non en général, mais dans un cas particulier. Tylor dit [FN: § 1001-1] : « Quand un usage, un art, une opinion, a fait, à son heure, son entrée dans le monde, des influences contraires peuvent, pendant longtemps, le combattre si faiblement que son cours ne s'en poursuit pas moins d'âge en âge... » L'auteur donne à ce phénomène le nom de survivance ; mais c'est un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général. La persistance d'un usage peut être due au fait qu'il a été faiblement contrarié ; mais elle peut aussi être due au fait que cet usage a été secondé par une force supérieure à celle, pourtant très considérable, qui lui était contraire. C'est ainsi que l'Église chrétienne a certainement combattu de tout son pouvoir les « superstitions » païennes, mais avec des chances diverses : une partie ont été vaincues, ont disparu ; une partie n'ont pu être vaincues, ont subsisté. Quand l'Église s'est aperçue que la résistance était trop forte, elle a fini par transiger et par se contenter de donner une couleur nouvelle, souvent assez transparente, à une antique superstition.
§ 1002. Dans ces phénomènes, on voit clairement l'existence des résidus constitués par la persistance des agrégats ; mais nous pouvons avoir plus et mieux que cette simple observation ; c'est-à-dire que nous pouvons expliquer de nombreux faits. Mgr Duchesne dit [FN: § 1002-1] : «(p. 293) Les litanies sont des supplications solennelles, instituées pour appeler la protection céleste sur les biens de la terre. On les faisait au printemps, dans la saison des gelées tardives, si redoutées des laboureurs. Il ne faut pas s'étonner que, sur ce point, le christianisme se soit rencontré avec des usages religieux antérieurs à lui ». Le christianisme ne s'est pas « rencontré » ; il a dû se résigner à accepter certains usages ; ce qui est bien différent. «(p. 293) Les mêmes besoins, le même (p. 294) sentiment de certains dangers, la même confiance dans un secours divin, ont inspiré des rites assez semblables ». Il semblerait presque que la religion païenne et la religion chrétienne, agissant chacune pour son propre compte, indépendamment, se sont rencontrées par hasard, ou ont été poussées par des raisons analogues, pour instituer la même fête. On pourrait peut-être l'admettre d'une façon générale ; mais cela perd toute probabilité dans le présent cas, si l'on considère que les deux religions n'étaient pas du tout indépendantes, que la nouvelle se superposa à l'ancienne, et que les détails des fêtes sont identiques. Comme l'observe encore Mgr Duchesne lui-même : « (p. 294) À Rome, le jour consacré était le 25 avril, date traditionnelle, à laquelle les anciens Romains célébraient la fête des Robigalia. De celle-ci, le rite principal était une procession qui, sortant de la ville par la porte Flaminienne, se dirigeait vers le pont Milvius... La procession chrétienne qui lui fut substituée suivait le même parcours jusqu'au pont Milvius».
§ 1003. Il convient de remarquer qu'en d'autres cas, l'Église opposa une résistance plus grande et plus efficace à la persistance des anciens usages. Elle pourvut à ce que la Pâque chrétienne n'eût pas la même date que la Pâque israëlite ; elle s'efforça d'empêcher que l'on continuât à célébrer la fête païenne du 1er janvier, et arriva partiellement à ses fins, en y substituant la fête de Noël. Il est donc probable que, si elle avait pu, elle aurait aussi transporté à un autre jour la fête des Rogations.
§ 1004. Le même auteur, que nous citons justement parce qu'il n'est pas suspect d'hostilité à l'égard de l'Église catholique, nous fait connaître d'autres exemples.
« (p. 283) Le même calendrier [le calendrier philocalien] de l'année 336 contient, au 22 février, une fête intitulée Natale Petri de (p. 284) cathedra. Elle avait pour but de solenniser le souvenir de l'inauguration de l'épiscopat ou de l'apostolat de saint Pierre... Le choix du jour n'avait été dicté par aucune tradition chrétienne. Il suffit de jeter les yeux sur les anciens calendriers de la religion romaine (MOMMSEN, C. I. L. t. , p. 386) pour voir que le 22 février était consacré à une fête populaire entre toutes, celle des défunts de chaque famille. L'observation de cette fête et des [sic, probablement les ] rites qui l'accompagnaient étaient considérés comme incompatibles avec la profession chrétienne. Mais il était très difficile de déraciner des habitudes particulièrement chères et invétérées. C'est pour cela, on n'en peut douter, que fut instituée la fête du 22 février ». Ici Mgr. Duchesne est entièrement dans le vrai ; et l'explication qu'il donne est celle qui concorde le mieux avec les faits. L’Église catholique eut beaucoup de peine à faire cesser les banquets païens en l'honneur des morts ; et souvent elle dut user de prudence et se contenter de transformer ce qu'elle ne pouvait détruire [FN: § 1004-1].
§ 1005. Un très grand nombre de faits nous montrent les saints héritant du culte des dieux païens, et rendent ainsi manifeste qu'en somme il y a une chose identique prenant des formes diverses.
§ 1006. A. Maury dit [FN: § 1006-1] : « (p. 157) Cette substitution des pratiques chrétiennes aux rites païens s'accomplissait toutes les fois que ceux-ci étaient de nature à être sanctifiés. Elle avait surtout lieu dans les pays tels que la Gaule, la Grande-Bretagne (p. 158), la Germanie et les contrées septentrionales, où l'Évangile ne fut prêché qu'assez tard, où les croyances païennes se montraient plus vivaces et plus rebelles. L'Église elle-même avait engagé ses apôtres à ce compromis avec la superstition populaire ; aussi en trouvons-nous encore aujourd'hui des traces nombreuses dans nos campagnes. Le denier de Caron se dépose en certains lieux dans la bouche du mort, la statue du saint est plongée comme celle de Cybèle dans le bain sacré, la fontaine continue à recevoir au nom d'un (p. 159) saint les offrandes qu'on lui offrait jadis comme à une divinité, les oracles se prennent à peu près de la même façon que le faisaient nos ancêtres païens [ajoutez : et comme faisait le paganisme naturiste, avant le paganisme anthropomorphique], et il n'est pas jusqu'au culte du phallus qui n'ait été sanctifié sous une forme détournée ».
§ 1007. Un résidu, constitué par certaines associations d'idées et d'actes, dans la Rome ancienne, survit jusqu'à notre époque, sous des formes variées et successives (§ 178). Il ne change pas avec l'invasion de l'anthropomorphisme grec, grâce auquel la fontaine devient une divinité personnifiée. Il ne change pas non plus avec l'invasion du christianisme, et le dieu – ou la déesse – devient un saint ou une sainte. Parallèlement, une transformation métaphysique donne à ce résidu la forme abstraite d'une « force de la nature » ou d'une « manifestation de la puissance divine » ; mais ces transformations restent à l'usage des littérateurs et des philosophes, et le vulgaire ne leur fait pas bon accueil. La puissance du résidu est mise en lumière par sa conservation au milieu de vicissitudes si nombreuses et si diverses ; et l'on comprend ainsi comment, pour la détermination de l'équilibre social, il importe beaucoup plus d'envisager le résidu, que les formes différentes et fugitives dont il est revêtu par le temps.
§ 1008. On voit de même que les changements sont plus faciles pour la forme que pour le fond, pour les dérivations que pour les résidus [FN: § 1008-1]. Les banquets en l'honneur des morts peuvent devenir des banquets en l'honneur des dieux ; puis de nouveau des banquets en l'honneur des saints, et redevenir de simples banquets commémoratifs. On peut changer ces formes, mais on pourrait plus difficilement supprimer les banquets. D'une façon brève, mais assez peu précise, justement parce qu'elle est brève, on peut dire que les usages religieux ou autres semblables opposent d'autant moins de résistance à un changement, qu'ils s'éloignent davantage du résidu d'une simple association d'idées et d'actes, et que la proportion de concepts théologiques, métaphysiques, logiques qu'ils renferment, est plus grande.
§ 1009. Voilà pourquoi l'Église catholique a pu vaincre facilement les grands dieux du paganisme, et beaucoup plus difficilement les petits dieux secondaires ; et voilà pourquoi elle a pu faire accepter à la société gréco-latine la conception théologique d'un dieu unique, – ou d'une trinité – à condition de permettre aux résidus persistants de l'ancienne religion, de se manifester par l'adoration des saints et par beaucoup d'usages qui, au fond, s'écartaient peu de ceux qui existaient déjà. Voilà aussi pourquoi il est plus facile de changer la forme du gouvernement d'un peuple que sa religion, ses usages, ses coutumes, sa langue ; et dans le changement même du gouvernement, le fond se transforme peu sous les diverses formes. Un préfet de la troisième république, en France, est bien le frère jumeau d'un préfet du second empire, et la candidature officielle diffère peu, sous ces deux gouvernements.
§ 1010. Le fanatisme et l'imbécillité qui engendrèrent les procès de sorcellerie se retrouvent tout à fait pareils dans les procès modernes de lèse-religion sexuelle. Il est vrai qu'on ne brûle plus personne ; mais cela vient de ce que toute l'échelle des pénalités s'est abaissée. Quand elle était élevée, on brûlait les sorcières, on pendait les voleurs. Aujourd'hui, les hérétiques sexuels et les voleurs s'en tirent avec la prison. Mais la forme du phénomène et les principes qu'elle révèle sont les mêmes. La procédure de l'Inquisition ôtait au prévenu les garanties dont il avait joui auprès des cours épiscopales et civiles. Lea écrit [FN: § 1010-1] : « (p. 450) La procédure des cours épiscopales, dont il a été question dans un des chapitres précédents, était fondée sur les principes du droit romain ; elle était en théorie équitable et soumise à des règles rigoureusement définies. Avec l'Inquisition ces garanties disparurent ».
§ 1011. Et voilà qu'il arrive la même chose pour le délit d'hérésie sexuelle ; c'est-à-dire pour le délit consistant à imprimer des récits obscènes ou réputés tels, ou même seulement « immoraux », de photographier des femmes légèrement vêtues, de rappeler les ébats de Daphnis et de Chloé, et, en somme, ce que l'homme et la femme ont toujours fait et feront toujours dans la race humaine. Les états civilisés accueillent les réfugiés politiques, même s'ils ont commis des homicides ; mais ils livrent à ceux qui les recherchent les hérétiques sexuels, dont le délit est bien plus grand que l'homicide, comme l'était, en d'autres temps, le délit d'hérésie de la religion catholique. En Angleterre, dans le pays de l'Habeas corpus, la Chambre des Communes approuvait en seconde lecture, au mois de juin 1912, un bill qui permet à la police d'arrêter sans mandat de l'autorité judiciaire, n'importe qui est suspect d'être sur le point de commettre un délit connexe à la « traite des blanches ». Si l'on désignait par ce nom le simple fait d'attirer par fraude ou par tromperie une femme dans une maison de prostitution, il n'y aurait pas à parler de religion sexuelle. Ce serait là un délit comme tous ceux qui ont pour origine la fraude et la tromperie, rendu plus grave, en certains cas, par le tort plus grand fait à la victime. Mais il n'en est pas ainsi [FN: § 1011-1]. Il est arrivé souvent que, dans les ports de mer, on a arrêté des prostituées qui, délibérément et en pleine connaissance des faits, voulaient se rendre au-delà de la mer, pour le simple motif qu'elles espéraient gagner davantage en ces pays. Là, il n'y a pas trace, pas même semblant de fraude ou de tromperie, et le délit apparaît comme la transgression d'un tabou spécial. De même, à Bâle, il est arrivé qu'au milieu de la nuit, la police s'est rendue dans tous les hôtels, a réveillé les voyageurs, et là où elle trouvait un homme et une femme, dans une chambre, elle exigeait la preuve qu'ils étaient unis par un mariage légitime. Ici encore, quel que soit le titre qu'on veuille donner à la loi qui s'exécutait de cette façon, il est manifeste qu'il ne s'agit pas de fraude, de tromperie ou d'autre délit analogue, mais qu'il ne peut être question que de la transgression d'un tabou sexuel, semblable à la transgression du catholique qui mange de la viande un vendredi, du musulman qui, pendant le ramadan et de jour, mange, boit ou a commerce avec sa femme.
§ 1012. On a coutume de justifier les procédures exceptionnelles par la gravité du délit, qui est assez grande pour engager à courir le risque de condamner plusieurs innocents, pourvu que le coupable n'échappe pas. Et telle est en vérité la justification expérimentale des procédures exceptionnelles en temps de guerre ou en temps de révolution, comme serait celle de la loi des suspects, en France. La justification est sentimentale pour les procédures contre les hérétiques religieux, parmi lesquels prennent place aujourd'hui les dissidents de la religion sexuelle que les vertuistes veulent imposer aux sociétés civilisées [FN: § 1012-1].
§ 1013. En de nombreux faits de permanence des agrégats se manifeste un phénomène important. Le résidu est issu de la permanence de certains faits, et contribue ensuite à maintenir cette permanence, jusqu'à ce qu'elle vienne heurter quelque obstacle qui la fasse cesser ou la modifie. Il y a une suite d'actions et de réactions (§ 991).
§ 1014. La théorie idéaliste, qui prend le résidu pour la cause des faits est erronée. La théorie matérialiste, qui prend les faits pour la cause du résidu, est erronée aussi. En réalité, les faits renforcent le résidu et le résidu renforce les faits. Les changements se produisent parce que de nouvelles forces viennent à agir, ou sur les faits, ou sur le résidu, ou sur celui-ci et ceux-là, et que de nouvelles circonstances provoquent la diversité dans les formes d'existence (§ 976).
§ 1015. (II-α) Persistance des rapports d'un homme avec d'autres hommes et avec des lieux. Ce genre se divise en trois espèces qui ont des caractères semblables et analogues, à tel point qu'ils peuvent facilement se confondre et que les résidus peuvent se compenser. Ces résidus sont communs aux hommes et aux animaux. On a dit que certains animaux ont le « sentiment de la propriété ». Cela veut dire simplement qu'en eux persiste le sentiment qui les unit à des lieux et à des choses. Le sentiment qui les unit à des hommes et à d'autres animaux persiste aussi. Le chien connaît non seulement son maître, mais aussi les personnes et les animaux de la maison. Un chien vit dans un jardin, en respectant les chats et les poules du lieu, tandis que, sitôt hors de la grille, il court après les chats et les poules qu'il rencontre, de même qu'il attaque aussi un chat étranger qui s'introduit dans son jardin. Plusieurs coqs, nés d'une même couvée et demeurés toujours ensemble, ne se faisaient pas la guerre. On tint l'un d'eux à l'écart pendant six jours. On crut ensuite pouvoir le remettre avec les autres, sans danger. Il fut, au contraire, immédiatement assailli et tué. Un fait semblable s'est produit pour deux matous qui, nés ensemble, vivaient ensemble pacifiquement. On les sépara peu de temps, et quand on voulut les remettre ensemble, ils s'élancèrent furieusement l'un contre l'autre. Les sentiments qu'on appelle, chez l'homme, de famille, de propriété, de patriotisme, d'amour de sa langue, de sa religion, de ses amis, etc., sont de ce genre [FN: § 1015-1]. L'homme ne fait qu'y ajouter des dérivations et des explications, qui naissent parfois du résidu.
§ 1016. (II-α 1) Rapports de famille et de collectivité. Chez les animaux qui élèvent leur progéniture, il y a nécessairement une union temporaire entre l'un des parents ou tous les deux et la progéniture. Mais il ne semble généralement pas que des résidus importants naissent de cette union. Quand la progéniture se suffit à elle-même, elle se sépare de ses parents et ne les reconnaît plus. Au contraire, dans la race humaine, probablement à cause du temps beaucoup plus long pendant lequel la progéniture a besoin de ses parents ou de ceux qui lui en tiennent lieu, des résidus importants et parfois très puissants apparaissent.
§ 1017. Ils correspondent à la forme de l'association familiale où ils ont pris naissance, et qu'ils ont ensuite contribué à renforcer ou à modifier. La littérature qui nous est le mieux connue – ou qui seule nous est connue – est celle des peuples qui ont eu la famille patriarcale, c'est-à-dire de tous les peuples civilisés ; et par conséquent, les seuls résidus que nous connaissons bien sont ceux qui correspondent à ce type de famille. Nous les trouvons dans toute l'antiquité gréco-latine, dans la Bible, dans les littératures chinoise, hindoue, persane. De là vint l'idée que le type de famille patriarcale était l'unique type existant, et que les déviations étaient d'importance minime ou nulle, bien qu'elles fussent connues depuis les temps anciens. Les braves gens qui rêvent d'un « droit naturel » ne manquèrent pas de croire que la famille du type patriarcal appartenait à ce droit. Mais un jour vint où, au grand étonnement des savants, on découvrit que d'autres types de famille étaient non seulement usités chez des peuples sauvages ou barbares, mais qu'ils avaient eu peut-être une part dans l'organisation de la famille de nos ancêtres préhistoriques, laissant des vestiges qu'on reconnaît à l'époque historique.
§ 1018. Comme d'habitude, on passa d'un extrême à l'autre. C'était le temps où l'idée de l'unité d'évolution régnait souveraine. Aussi édifia-t-on, sur-le-champ, des théories qui, partant d'une époque primitive de la famille, – pour quelques-uns, c'est la promiscuité des sexes, la communauté des femmes – et passant par les types intermédiaires qu'on nous décrit avec une grande précision, comme si les auteurs avaient pu les observer, en viennent à nous montrer comment tous les peuples ont modifié l'organisation de la famille, d'une manière uniforme, et les peuples civilisés ont connu le type de famille qu'ils ont à présent.
§ 1019. Ces vestiges si rares de types différents de la famille patriarcale, qu'on trouve dans la littérature classique, furent regardés avec une loupe d'un puissant grossissement, et l'on en tira des théories complètes qui font honneur à l'esprit subtil et à l'imagination brillante de leurs auteurs, mais ne déposent pas également en faveur de leur sens historique ni surtout scientifique. Engels fit d'une pierre deux coups : il reconstitua une histoire inconnue à tout le monde, sauf à lui, et mit mieux en lumière l'infamie et l'hypocrisie bourgeoise, ainsi que la beauté idéale du terme de l'évolution vers lequel nous nous acheminons grâce au socialisme.
§ 1020. Les nouvelles théories sur la famille, scientifiquement erronées, furent utiles au point de vue didactique, parce qu'elles servirent à briser le cercle dans lequel, grâce à l'idée unique du type patriarcal, toute étude sur la famille s'enfermait autrefois ; et jusque là l'étude de Engels peut avoir été utile, en montrant à beaucoup de gens qui ne sont pas aptes à l'étude scientifique, ce que certaines formes de l'idéalisme bourgeois renferment de futile, d'absurde et d'hypocrite.
§ 1021. Chez un grand nombre de peuples, quelles qu'en soient les causes, certaines collectivités se constituèrent, qui se considéraient comme unies au sol et permanentes dans le temps, les individus qui mouraient étant au fur et à mesure remplacés par d'autres. Il arriva aussi que le noyau de ces collectivités était formé d'individus unis par les liens du sang. Le fait de l'existence des dites collectivités est en rapport de mutuelle dépendance avec celui de l'existence de sentiments qui s'adaptent à la permanence de la collectivité, et qui se manifestent de diverses manières, dont la principale est celle qu'on appelle la religion. Nous ne connaissons pas « l'origine » de ces collectivités. Nos documents historiques nous les font connaître à un état d'évolution avancée, souvent même de décadence. Cela posé, on a donné trois explications prinpales du phénomène historique. 1° En portant son attention sur le noyau, on a dit que ces collectivités avaient pour origine la famille, et que si, dans les temps historiques, ce n'étaient plus de simples familles, cela venait de déviations du type ou de « l'origine », causées par des abus qui avaient altéré l'institution « primitive ». 2° Portant son attention sur les sentiments qui existent dans la collectivité et la consolident, on dit que ces collectivités avaient pour origine les croyances religieuses (§ 254), et l'on expliqua le noyau familial par la prescription religieuse ordonnant que certains actes religieux fussent accomplis par des personnes ayant certains liens du sang (§ 254). Les déviations sont ici beaucoup moindres que dans le cas précédent, et à l'époque historique, dans les pays considérés, le lien religieux correspond au lien de la collectivité ; mais cela ne prouve nullement que celui-ci ait été l'origine de celui-là. Seule, la manie des interprétations logiques et l'erreur très grave qu'on commet en croyant que les sentiments doivent précéder les actes, peuvent induire à voir dans le lien religieux « l'origine » du lieu de la collectivité. 3° On a pu croire que ces collectivités étaient entièrement artificielles et constituées par un législateur. Cette explication a maintenant peu de crédit, et à juste titre.
§ 1022. Mais il y a une quatrième hypothèse, qui explique beaucoup mieux les faits connus, et qui consiste à envisager ces collectivités comme des formations naturelles, constituées par un noyau qui est généralement la famille avec divers appendices. Ces collectivités, par leur permanence, font naître ou renforcent certains sentiments qui, à leur tour, les rendent plus solides, plus résistantes et plus durables.
§ 1023. Ces considérations générales s'appliquent aux cas particuliers de la gens romaine, du ![]() , des castes hindoues. Les difficultés rencontrées par les savants cherchant à déterminer ce qu'étaient précisément la gens et le
, des castes hindoues. Les difficultés rencontrées par les savants cherchant à déterminer ce qu'étaient précisément la gens et le ![]() , viennent en partie de ce qu'ils cherchaient la précision là où elle n'existait pas, du moins en des temps très anciens. C'est l'erreur habituelle, consistant à s'imaginer que des hommes frustes et peu ou pas du tout portés à l'abstraction et au raisonnement scientifique, raisonnaient avec la rigueur et la précision de jurisconsultes vivant au milieu de peuples beaucoup plus civilisés et plus instruits. Ces jurisconsultes avaient à résoudre des problèmes compliqués, et devaient les résoudre d'une façon claire, précise, logique, pour savoir qui appartenait à la gens ou au
, viennent en partie de ce qu'ils cherchaient la précision là où elle n'existait pas, du moins en des temps très anciens. C'est l'erreur habituelle, consistant à s'imaginer que des hommes frustes et peu ou pas du tout portés à l'abstraction et au raisonnement scientifique, raisonnaient avec la rigueur et la précision de jurisconsultes vivant au milieu de peuples beaucoup plus civilisés et plus instruits. Ces jurisconsultes avaient à résoudre des problèmes compliqués, et devaient les résoudre d'une façon claire, précise, logique, pour savoir qui appartenait à la gens ou au ![]() . Mais, en des temps frustes, ces problèmes étaient beaucoup plus simples et se réduisaient à une question de fait ; ce qui ne veut pas dire que le fait fût arbitraire, mais seulement qu'il était déterminé par une infinité de motifs qui, ensuite, lorsqu'on voulut bien les déterminer et les classer, diminuèrent en nombre, et changèrent même de degré d'efficacité.
. Mais, en des temps frustes, ces problèmes étaient beaucoup plus simples et se réduisaient à une question de fait ; ce qui ne veut pas dire que le fait fût arbitraire, mais seulement qu'il était déterminé par une infinité de motifs qui, ensuite, lorsqu'on voulut bien les déterminer et les classer, diminuèrent en nombre, et changèrent même de degré d'efficacité.
§ 1024. Il est certain qu'à l'époque historique, la famille est le noyau de la gens romaine. Mais il est tout aussi certain que le lien du sang ne suffit pas à constituer la gens. Nous ne voulons pas traiter ici la question difficile de savoir si la gens était constituée par une ou plusieurs familles. À l'époque historique, il y a des jeunes filles d'une gens qui se marient dans une autre. Supposons aussi que cela ne soit pas arrivé dans les temps les plus anciens, et faisons ainsi disparaître cette difficulté. D'autre part, l'adoption et l'adrogation introduisent des étrangers dans la gens. Mettons-les aussi de côté : mais ensuite il reste des difficultés insurmontables. La filiation légitime ne suffit pas pour qu'un mâle fasse partie de la gens. Peu après sa naissance, il est présenté au père, qui peut l'accepter ou le répudier : liberum repudiare, negare. Cette disposition est commune à la Grèce et à Rome. Elle n'a pas la moindre apparence d'être d'une date récente ; au contraire, elle présente tous les signes d'un antique usage, et elle seule suffit à démontrer que dans la gens, et dans le![]() , il y a quelque chose d'autre que la descendance d'un ancêtre commun.
, il y a quelque chose d'autre que la descendance d'un ancêtre commun.
§ 1025. Il y a de plus les appendices de la famille, et par conséquent du ![]() . On les considère comme appendices, parce qu'on veut a priori que la descendance ait été l'unique origine de la collectivité familiale. Mais qui nous dit que ces appendices ne sont pas au contraire une survivance d'une partie de cette collectivité antique ? De même, en Inde, on considère aujourd'hui comme des abus les pratiques qui introduisent des étrangers dans la caste, et c'est peut-être avec raison ; mais qui nous dit que dans les anciens temps elles ne furent pas une des façons dont se constituèrent les castes [FN: § 1025-1] ?
. On les considère comme appendices, parce qu'on veut a priori que la descendance ait été l'unique origine de la collectivité familiale. Mais qui nous dit que ces appendices ne sont pas au contraire une survivance d'une partie de cette collectivité antique ? De même, en Inde, on considère aujourd'hui comme des abus les pratiques qui introduisent des étrangers dans la caste, et c'est peut-être avec raison ; mais qui nous dit que dans les anciens temps elles ne furent pas une des façons dont se constituèrent les castes [FN: § 1025-1] ?
§ 1026. L'ancienne clientèle est le plus important de ces appendices. Elle met bien en lumière le caractère de la cellule vivante des sociétés anciennes. Cette cellule n'est pas seulement constituée d'un noyau d'individus ayant une descendance commune, mais d'individus qui vivent ensemble, fortement liés par des droits et des devoirs communs. À Athènes, le nouvel esclave est appelé à faire partie de la famille par une initiation religieuse. Quand une famille vient à s'éteindre complètement, la loi de Gortyne attribue le patrimoine à ses esclaves attachés à la glèbe.
§ 1027. Ne pouvant nier tous ces faits, on a dû ajouter le lien religieux à la descendance commune, pour constituer la famille, la gens et le ![]() . Nous nous rapprochons ainsi davantage de la réalité, parce que ce lien religieux est justement l'une des formes sous lesquelles se manifestent ces liens de fait, qui s'ajoutent à la descendance commune. Mais ce n'est pas sans péril qu'on substitue ainsi l'indice à la chose, le mode de manifestation à la chose manifestée. On peut être induit à croire que la religion a été l'« origine » de la famille, de la gens et du
. Nous nous rapprochons ainsi davantage de la réalité, parce que ce lien religieux est justement l'une des formes sous lesquelles se manifestent ces liens de fait, qui s'ajoutent à la descendance commune. Mais ce n'est pas sans péril qu'on substitue ainsi l'indice à la chose, le mode de manifestation à la chose manifestée. On peut être induit à croire que la religion a été l'« origine » de la famille, de la gens et du ![]() ; ce qui serait erroné.
; ce qui serait erroné.
§ 1028. Fustel de Coulanges, qui attribue justement ce rôle à la religion, ne voit d'autres hypothèses que celles que nous avons indiquées aux numéros 1 et 3 du § 965. Il démontre facilement que le lien du sang ne suffisait pas pour constituer les collectivités envisagées, et sa démonstration met ainsi en lumière les autres liens que nous venons d'indiquer. Il démontre facilement aussi que l'origine de ces collectivités ne peut être artificielle. Mais il ne songe pas à démontrer que son raisonnement, qui donne la religion comme l’« origine » de ces collectivités, n'est pas l'habituel post hoc propter hoc. C'est là justement le point faible de sa théorie.
§ 1029. À propos de la théorie qui veut que l'origine de la gens soit artificielle, il dit [FN: § 1029-1] : « (p. 119) Un autre défaut de ce système est qu'il suppose que les sociétés humaines ont pu commencer par une convention et par un artifice, ce que la science historique ne peut pas admettre comme vrai ».
§ 1030. Tout à fait juste. Mais on a exactement la même difficulté à admettre que les croyances aient pu précéder les faits auxquels elles se rapportent. On comprend à la rigueur que les croyants d'une religion révélée admettent cela pour leur religion. Laissons donc de côté la croyance que peut avoir un chrétien, que les dogmes de sa foi sont antérieurs aux faits auxquels ils se rapportent ; mais ce même chrétien ne peut admettre cela pour les rites païens. Et même si l'on admet la théorie de la décadence et de la corruption d'une religion révélée, la nécessité subsiste de reconnaître que cette décadence et cette perversion ont été déterminées par les faits, et qu'elles n'en sont pas indépendantes.
§ 1031. La religion de l'antiquité gréco-romaine est en rapport étroit avec le fait de la constitution des collectivités, lesquelles comprenaient les cellules sociales ; elle est formée par les résidus qui naissaient de la permanence de ces organismes, et qui, à leur tour, en assuraient l'existence et la permanence (§ 1013).
§ 1032. Les résidus, très semblables en Grèce et à Rome, présentèrent des dérivations différentes, à cause du caractère différent de ces peuples ; et les résidus qui constituaient les religions des familles devinrent, sans beaucoup de modifications ni d'adjonctions, les résidus qui constituaient les religions des cités. Il n'y a pas lieu de s'étonner si l'on trouve dans ces religions le caractère indiqué par S. Reinach (§ 383) ; c'est-à-dire « un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés » : car ces résidus correspondent précisément à l'ensemble de liens, autrement dit d'obstacles au libre exercice des facultés, qui donnaient vie et force à la cellule sociale. Toute théorie a la tendance d'augmenter démesurément l'importance de ses principes ; aussi la religion, qui était la manifestation de liens existants, en créa-t-elle à son tour de nouveaux et parfois d'absurdes. Beaucoup de personnes ont dit que la religion enveloppait tous les actes de la vie antique ; mais on dirait mieux encore qu'elle était la manifestation de liens spontanés ou artificiels, qui existaient dans tous les actes de la vie. La séparation des religions et de l'État peut avoir un sens pour les peuples modernes ; elle ne pouvait pas en avoir pour l'antiquité gréco-romaine, où elle aurait signifié la séparation des liens de la vie civile et de l'État. La tolérance de l'ancienne cité romaine envers les diverses religions, pourvu que le culte national fût respecté, correspond parfaitement à la tolérance des États civilisés modernes envers les différentes morales et certains statuts personnels, pourvu que la législation de ces États soit respectée.
§ 1033. Le culte des cités fut en grande partie modelé sur le culte des familles ; il y eut imitation directe. Par exemple, le culte du feu domestique devint le culte du feu sacré de la cité, au Prytanée grec on dans le temple romain de Vesta. Mais il y a d'autres cas où un culte public tire son origine des mêmes résidus qui ont donné le culte familial ; et ce n'est pas – ou ne semble pas être – une imitation directe.
§ 1034. Les Pénates romains correspondent, au moins en partie, à l'idée des provisions alimentaires domestiques. L'importance que celles-ci avaient pour les familles antiques, les précautions qu'on devait prendre pour éviter la famine, les sentiments agréables qu'entraînait avec elle l'abondance des genres alimentaires, correspondaient à un résidu puissant, qui se manifestait dans le caractère religieux des Pénates, lesquels recouvraient aussi d'autres résidus.
§ 1035. En un temps très postérieur, l'origine de la déification de l'Annona est semblable (§ 996 et sv.) Mais là, il n'y a pas du tout d'imitation directe, pour autant que nous le savons : la déification de l'Annona n'a pas été une copie de celle des Pénates familiaux ou publics. Elle a au contraire pris naissance de ces mêmes sentiments, qui s'étaient autrefois manifestés en donnant aux provisions domestiques le caractère religieux.
§ 1036. On sait que les tribus grecques avaient un héros éponyme, et que les cités grecques et les latines avaient un fondateur plus ou moins divinisé. On a voulu voir dans ces faits la copie du fait réel de la descendance d'un unique auteur de la famille, du ![]() , de la gens ; et il peut bien en être ainsi ; mais cela pourrait aussi ne pas être, et l'existence de cet auteur pourrait être une fiction pareille à celle du héros éponyme et du fondateur divin. Nous ne pouvons rien trancher, tant que les preuves directes nous font défaut.
, de la gens ; et il peut bien en être ainsi ; mais cela pourrait aussi ne pas être, et l'existence de cet auteur pourrait être une fiction pareille à celle du héros éponyme et du fondateur divin. Nous ne pouvons rien trancher, tant que les preuves directes nous font défaut.
§ 1037. Au moyen âge, en nos pays, se reproduisirent des circonstances en partie semblables à celles dans lesquelles se constituèrent les anciennes familles de notre race ; et comme la confédération des anciennes familles indépendantes avait produit la cité, ainsi la hiérarchie féodale produisit la monarchie des siècles passés. La collectivité féodale avait un noyau de famille auquel s'ajoutaient des éléments étrangers. Flach observe [FN: § 1037-1] : « (p. 455) Les parents groupés autour de leur chef forment le noyau d'un compagnonnage bien plus étendu, dont l'importance ne me semble pas avoir été mise en suffisant relief par les historiens, la maisnie, la maison du seigneur, son corps d'élite, le centre de résistance de son (p. 456) armée, son meilleur conseil, son entourage de chaque jour. La maisnie se complète, en dehors de la famille naturelle, par les fils et les proches des vassaux ou des alliés les plus fidèles et même par des étrangers ». Comme dans les temps les plus anciens, la religion intervient pour manifester et renforcer le lien de cette collectivité. Mais les circonstances sont en partie changées. Les familles antiques constituaient leur religion : c'est pourquoi elles divinisaient les choses qui servaient aux liens. Les familles féodales avaient une religion constituée extérieurement à elles, et la divinisation était déjà consommée. Elles ne créèrent donc pas de nouvelles divinités, mais firent servir à leurs besoins celles qui existaient. Après avoir fait allusion à la recommandation et à l'hommage, Flach ajoute : « (p. 522) Mais l'autorité ainsi créée sur un homme ne l'est qu'en vue de son entrée dans la famille qui s'incarne dans le seigneur [comme autrefois dans le pater familias [FN: § 1037-2] , de son affiliation au corps familial, avec les droits et les devoirs qu'elle emporte. Or, cette affiliation s'opère par l'acte le plus grave, le plus solennel, que connussent les hommes dans les sociétés naissantes, par un serment religieux. Au temps du paganisme, l'affilié devenait participant du culte domestique ; il se livrait, il se dévouait corps et âme à une famille nouvelle et s'il manquait à sa foi il attirait sur sa tête la vengeance des dieux ». [Ce sont là des dérivations. Aux temps les plus reculés, la religion était la manifestation même de ces liens]. À l'époque chrétienne qui nous occupe, le serment par lequel le vassal engage sa personne est le plus redoutable ; il fait des martyrs de ceux qui sacrifient leur vie pour y rester fidèles, des maudits de ceux qui le violent ».
§ 1038. Pertile [FN: § 1038-1] nie que les fiefs fussent issus des clientèles de l'ancien droit romain ou des bénéfices militaires de l'Empire. Il observe que « (p. 204) puisque de ces institutions aux fiefs, il n'y a pas continuité de temps, par conséquent il ne peut pas y avoir filiation ». Il a raison, dans le sens d'une imitation directe, comme nous avons vu un peu plus haut que l'Annona ne venait pas directement des Pénates ; mais nier une origine commune serait une erreur. Les mêmes sentiments (résidus), se trouvant dans des circonstances de fait en grande partie semblables, et aussi en partie différentes, ont engendré les phénomènes en grande partie semblables, et aussi en partie différentes, de l'ancienne clientèle, de la recommandation, des bénéfices, des fiefs.
§ 1039. Pertile dit que « (p. 203), dans la clientèle,... l'élément réel fait complètement défaut ». C'est l'erreur habituelle des juristes, qui regardent plus à la forme qu'au fond. L'élément réel manquait dans la clientèle ancienne, au point de vue de la loi, mais pas en fait ; et, toujours en fait, l'élément militaire ne manquait pas non plus, en ce sens que le client aidait le patron, même dans des conflits violents.
§ 1040. Lisez le récit d'Eumée, dans l'Odyssée. Eumée, serviteur d'Ulysse, dit que si son maître revenait, il lui donnerait, à lui Eumée [FN: § 1040-1], « les choses qu'un maître bienveillant donne au serviteur qui a bien travaillé » ; c'est-à-dire une maison, un champ et une épouse. Dans la maison et dans le champ se trouvent bien, de fait, l'élément réel. Ulysse se fait reconnaître d'Eumée, et celui-ci combat aux côtés de son maître, pour défaire les prétendants. Tout cela montre qu'en fait il est avec Ulysse dans les mêmes rapports qu'un vassal avec son seigneur féodal.
§ 1041. (II-α 2) Rapports avec des lieux. Ces résidus se confondent souvent avec les précédents et avec les résidus (II-β). Chez les peuples modernes aussi, on parle du « pays natal », qui, en réalité, est celui où réside la famille, et où l'on a passé son enfance, car la mère peut avoir enfanté ailleurs. Chez les anciens peuples gréco-latins, les rapports avec des lieux s'unissaient aux rapports de famille, de collectivité, et à ceux avec les morts, pour donner un ensemble de résidus.
§ 1042. Un fait semblable se produit chez les peuples modernes. En regardant les choses d'une façon superficielle, on pourrait croire que le patriotisme moderne est territorial, parce que les nations modernes tirent leurs noms des territoires qu'elles occupent. Mais en regardant les choses de plus près, on s'aperçoit que pour donner le sentiment du patriotisme, ce nom du territoire suggère un ensemble de sentiments, d'une souche qu'on croit commune, de langue, de religion, de traditions, d'histoire, etc. En réalité, on ne peut définir avec précision le patriotisme, comme on ne peut définir avec précision la religion, la morale, la justice, le bon, le beau, etc. Tous ces noms rappellent seulement certains ensembles de sentiments, qui ont des formes mal définies et des limites très incertaines (§ 380 et sv.). Ces ensembles sont maintenus unis par la persistance des agrégats.
§ 1043. (II-α 3) Rapports de classes sociales. Le fait de vivre dans une collectivité donnée imprime certaines idées dans l'esprit, certaines manières de penser et d'agir, certains préjugés, certaines croyances, qui subsistent ensuite et acquièrent une existence pseudoobjective, comme tant d'autres entités analogues. Les résidus correspondants acquirent souvent la forme des résidus de rapports de famille. On supposa que les classes sociales, les nations elles-mêmes, étaient autant de descendantes ayant chacune un auteur commun, réel ou mystique, et de même ses dieux, ennemis de ceux d'autres collectivités. Mais ce n'est là qu'une simple dérivation. Aujourd'hui, elle est tombée en désuétude chez les peuples civilisés.
§ 1044. La forme des castes, en Inde, est particulière ; mais le fond est très général, et l'on observe ce phénomène dans tous les pays, et souvent avec une plus grande intensité là où justement on se prévaut d'un principe d'égalité. La distance qui sépare un milliardaire américain d'un homme du peuple, américain aussi, est plus grande que celle existant entre un noble allemand et un homme du peuple, et se rapproche beaucoup de celle qui, aux Indes, sépare les castes ; cette dernière distance est dépassée à son tour par celle qui, aux États-Unis d'Amérique, sépare le blanc du nègre.
§ 1045. En Europe, la propagande marxiste de la « lutte des classes », ou mieux les circonstances qui se manifestèrent sous cette forme, eurent pour effet de faire naître et de fortifier les résidus correspondants, dans la classe des « prolétaires »», ou mieux dans une partie du peuple ; tandis que d'autre part, le besoin qu'avaient les « entrepreneurs » de ne pas heurter les sentiments de la démocratie, mais au contraire de s'en prévaloir pour faire de l'argent, faisait diminuer et détruisait certains résidus de rapports collectifs, dans les hautes classes sociales.
§ 1046. Plusieurs caractères qu'on trouve chez les Israélites contemporains, et qu'on veut attribuer à leur race, ne sont au contraire que des manifestations de résidus produits par de longs siècles d'oppression. La démonstration est facile. Il suffit de comparer un Juif russe avec un Juif anglais. Le premier se distingue immédiatement de ses concitoyens chrétiens ; le second ne s'en distingue pas du tout. Il y a de plus les degrés intermédiaires, correspondant justement à la durée plus ou moins grande de l'oppression. On sait que les différentes professions se manifestent souvent par des types distincts ; c'est-à-dire qu'elles montrent différents résidus correspondant à leurs différents genres d'activité.
§ 1047. Les associations qu'on appelle des sectes, constituées par des sentiments forts et exclusifs, présentent des caractères bien connus et qui furent observés en tous temps. La persistance des rapports dans la secte renforce ces caractères, et affaiblit l'action du contraste avec d'autres sentiments existant hors de la secte. On a ainsi l'un des caractères principaux des sectaires ; caractère qui consiste à perdre les idées que les autres hommes ont généralement de la valeur relative des choses [FN: § 1047-1]. Ce que les autres hommes tiennent pour un péché très léger peut apparaître au sectaire comme un crime très grave ; [Voir Addition A22 par l’auteur] et vice-versa, ce qu'ils estiment honteux ou criminel peut apparaître au sectaire comme honorable ou honnête. Par exemple, les hommes, en général, tiennent pour déshonorant d'espionner, de dénoncer. Aux temps de l'Inquisition, beaucoup de gens le considéraient comme un devoir, en vue d'exterminer les hérétiques de la religion catholique. Aujourd'hui, beaucoup de gens le considèrent comme un devoir et un honneur, en vue de faire disparaître les hérétiques de la religion sexuelle des vertuistes. En Italie, la Camorra et la Maffia sont célèbres. Mais les principes qu'elles emploient s'appliquent à des cas divers ; par exemple, lorsque les législateurs refusent l'autorisation de procéder contre leurs collègues, pour des délits ou des contraventions qui n'ont rien de politique, pour des diffamations privées, et même pour des excès de vitesse en automobile. Il est évident que c'est bien là une camorra de législateurs. Les jurés d'Interlaken qui, pour satisfaire un caprice humanitaire, frappèrent d'une peine tout à fait légère Tatiana Leontieff, laquelle avait assassiné un pauvre vieillard inoffensif ; les jurés français qui, par un autre caprice, humanitaire ou simplement imbécile, on ne sait, acquittèrent un fils qui avait assassiné son père, se croient de bonne foi très supérieurs aux délinquants et infiniment au-dessus des « despotes qui règnent sur les pauvres peuples ».
§ 1048. Les sentiments des sectaires peuvent acquérir une force assez grande pour pousser ces gens à n'importe quel crime, fût-il le plus atroce, et le nom même d'assassin vient des actes de certains sectaires. Tout cela est fort connu ; mais on ne prend pas assez garde au fait suivant. Parmi les manifestations diverses qui, par exemple, de l'acte d'abjecte délation d'un dominicain de la vertu, en viennent à l'assassinat perpétré par un sectaire, il n'y a qu'une différence d'intensité des sentiments, et quelquefois seulement une différence de courage. C'est entre autres le cas de deux hommes dont, pour tirer une vengeance, l'un recourt au poison, et l'autre affronte son ennemi à main armée.
§ 1049. L'idée, très générale parmi les peuples barbares, que contre l'étranger, contre l'ennemi, tout est permis, que dans les rapports avec eux, les règles de la morale usitées envers les concitoyens ne s'appliquent pas, manifeste encore les résidus dont nous traitons. Cette idée appartient aussi à des peuples civilisés, comme le peuple romain, et n'a pas encore entièrement disparu chez nos peuples contemporains (§ 1050-2). Les peuples civilisés modernes, à l'image de ce qui avait lieu pour les peuples de l'ancienne Grèce, ont entre eux des rapports qui ne s'écartent pas trop des règles morales en usage chez ces peuples ; mais ils estiment n'avoir pas à tenir compte de ces règles, dans leurs rapports avec des peuples barbares, ou par eux jugés tels.
§ 1050. La théorie d'Aristote sur l'esclavage naturel [FN: § 1050-1] est aussi celle des peuples civilisés modernes, pour justifier leurs conquêtes et leur domination sur des peuples qu'ils disent de race inférieure. Et de même qu'Aristote disait qu'il est des hommes naturellement esclaves, d'autres naturellement maîtres, et qu'il convient que les premiers servent et que les seconds commandent, chose juste et profitable à tous, de même les peuples modernes, qui se gratifient de l'épithète de civilisés, disent qu'il y a des peuples qui doivent naturellement dominer : ce sont eux-mêmes, et d'autres qui doivent non moins naturellement obéir : ce sont ceux qu'ils veulent exploiter ; et il est juste, convenable et profitable à tous que ceux-là commandent et que ceux-ci servent. Il en résulte qu'un Anglais, un Allemand, un Français, un Belge, un Italien qui combat et meurt pour sa patrie est un héros ; mais qu'un Africain qui a l'audace de défendre sa patrie contre ces nations est un vil rebelle et un traître. Les Européens accomplissent leur devoir sacro-saint de détruire les Africains, comme au Congo [FN: § 1050-2], pour leur apprendre à se civiliser. D'ailleurs, il ne manque pas de gens pour admirer béatement cette œuvre de « paix, de progrès, de civilisation ». Il faut ajouter qu'avec une hypocrisie vraiment admirable, les bons peuples civilisés prétendent que c'est pour faire le bien de leurs peuples sujets, qu'ils les oppriment et même les détruisent ; et l'amour qu'ils leur portent est si grand qu'ils veulent les « délivrer » de force. C'est ainsi que les Anglais délivrèrent les Hindous de la « tyrannie » des radjas ; que les Allemands délivrèrent les Africains de la « tyrannie »des rois nègres ; que les Français délivrèrent les habitants de Madagascar, et, pour les rendre plus libres, en tuèrent un certain nombre et réduisirent les autres dans un état auquel il ne manque que le nom d'esclavage ; et que les Italiens délivrèrent les Arabes de l'oppression des Turcs. On dit tout cela sérieusement, et il y a même des gens qui le croient. Le chat attrape la souris et la mange ; mais il ne dit pas qu'il le fait pour le bien de la souris ; il ne proclame pas le dogme de l'égalité de tous les animaux, et ne lève pas des yeux hypocrites vers le ciel pour adorer le Dieu de l'univers.
§ 1051. Habituellement, la théorie de la supériorité, des peuples civilisés n'est employée que contre les peuples non européens. Mais la Prusse s'en sert aussi contre les Polonais ; et il y a des gens, en Allemagne, qui voudraient l'utiliser contre les peuples latins, qu'ils estiment barbares, en comparaison des très bons, très moraux, très vertueux, très intelligents et très civilisés peuples germaniques. En Angleterre et en Amérique, il est des gens qui revendiquent ces éminentes qualités pour la divine race anglo-saxonne [FN: § 1051-1]. Tous ces gens se croient absolument « scientifiques », et raillent, comme bourrées de vieux préjugés, les personnes qui ne sont pas de leur avis.
§ 1052. (II-β) Persistance des rapports des vivants avec les morts. L'ensemble des rapports d'un homme avec d'autres hommes persiste, par abstraction, même après l'absence ou la mort de cet homme. Nous avons ainsi des résidus d'un très grand nombre de phénomènes [FN: § 1052-1]. Ils sont en partie semblables aux résidus du genre (II-α). Cela explique comment on les rencontre unis à ces résidus en un grand nombre de cas, comme pour la famille, les castes, le patriotisme, la religion, etc. Unis aux résidus qui nous poussent à partager ce qui nous appartient avec les personnes pour lesquelles nous avons de l'affection, ou même simplement de la bienveillance (IV-δ 2), ils se manifestent dans les phénomènes complexes des honneurs aux morts, du culte dont ils sont l'objet, des repas et des sacrifices qu'on fait à l'occasion des funérailles, de la commémoration des morts [FN: § 1052-2].
§ 1053. Ceux qui veulent expliquer logiquement les croyances admettent que tous ces phénomènes ont pour postulat la croyance en l'immortalité de l'âme, car elles ne seraient plus logiques, si l'on se passait de ce postulat. Mais pour démentir cette opinion, outre une infinité de preuves historiques, il suffirait de remarquer que, parmi nos contemporains, les matérialistes n'honorent pas moins que d'autres leurs morts, et qu'à Londres et à Paris, pour ne parler que de ces villes, il y a des cimetières pour chiens, où ces animaux sont mis par des personnes qui ne supposent assurément pas que le chien ait une âme immortelle.
§ 1054. Les apparitions de morts, qu'on a crues réelles un peu dans tous les temps, un peu plus ou un peu moins, suivant les endroits, ne sont autre chose qu'une forme tangible donnée aux résidus de la persistance des rapports entre vivants et morts. Ces rapports se retrouvent aussi en partie, par raison de similitude, dans les apparitions de divinités, d'anges, de démons, de lutins et d'autres semblables entités personnifiées. Elles ont aujourd'hui leur écho dans le « dédoublement de la personne », dans la télépathie et en d'autres fables semblables [FN: § 1054-1].
§ 1055. En y réfléchissant bien, on voit que l'idée de la survivance du mort n'est autre chose que le prolongement d'une autre idée, en nous très puissante : celle de l'unité d'un homme, au cours des années. En réalité, la partie corporelle et la partie psychique d'un homme se transforment. Un homme âgé n’est identique à lui-même, enfant, ni matériellement ni moralement ; et pourtant nous admettons qu'il y a en lui une unité qui persiste. Ceux qui sortent du domaine expérimental l'appellent âme, sans d'ailleurs réussir à expliquer clairement ce que devient cette âme chez l'aliéné, chez le vieillard tombé en enfance, ni quand elle s'introduit dans le corps du nouveau-né, entre le moment où la semence de l'homme entre dans l'utérus de la femme, et celui où l'on entend les premiers vagissements du nouveau-né. Mais nous n'avons pas à nous occuper de toutes ces choses, parce qu'elles sortent du domaine expérimental, où nous voulons rester. Notre intention est seulement de montrer comment un même résidu se retrouve dans la croyance en l'unité de l'être vivant et de la survivance après la mort.
§ 1056. (II-γ) Persistance des rapports d'un mort avec des choses qui lui appartenaient durant sa vie. Les rapports d'un homme avec les choses qu'il a possédées persistent après sa mort, dans l'esprit des vivants. De là vient l'usage très général d'ensevelir ou de brûler avec le cadavre des objets qui appartenaient au mort, ou bien de les détruire, de tuer ses femmes, ses esclaves, ses animaux.
§ 1057. Comme d'habitude, l'explication logique de ces usages n'a pas manqué. On les a considérés comme une conséquence d'une nouvelle vie du mort. Si l'on place les armes d'un guerrier dans son tombeau, c'est pour qu'il s'en serve dans une autre vie. Si l'on fait des libations et qu'on dépose des aliments sur sa tombe, c'est pour que l'âme boive et mange. Si l'on sacrifie des êtres vivants au mort, c'est pour qu'ils l'accompagnent dans l'autre vie, etc.
§ 1058. Ces croyances existent certainement, mais sont des dérivations ; c'est-à-dire qu'elles sont essentiellement variables, tandis que la partie constante des phénomènes est la persistance des rapports du mort avec les choses qu'il a possédées.
§ 1059. Qu'on lise, par exemple, dans l'Iliade, le récit des funérailles de Patrocle. L'ombre de Patrocle apparaît en songe à Achille. Elle ne lui demande nullement des objets et des êtres qui l'accompagnent dans une autre vie. Patrocle demande à son ami que leurs os reposent ensemble dans la même urne. Voilà notre résidu, presque sans aucune dérivation ; et ce résidu est si puissant, qu'il est resté intact après des siècles et après tant de changements dans les peuples et dans leurs croyances. Aujourd'hui encore, il y a des personnes qui, par acte de dernière volonté, prescrivent que leur corps doit reposer auprès de celui d'une autre personne qui leur fut chère. Qu'ils soient chrétiens ou libres-penseurs, il n'y a aucune conséquence logique de leurs croyances qui puisse les pousser à agir ainsi : ils sont mus exclusivement par les sentiments qui se manifestent dans notre résidu. Les Mirmidons d'Achille consacrent leur chevelure à Patrocle ; mais il est manifeste que celui-ci ne pouvait rien en faire dans une autre vie. De même, les douze prisonniers troyens égorgés sur son bûcher ne pouvaient lui être des compagnons agréables. Pourquoi donnerait-on une autre explication des quatre chevaux et des deux chiens égorgés de la même manière ? En tout cas rien, dans le poème, ne permet de supposer qu'ils devaient servir à l'âme de Patrocle. Les auteurs de l'explication logique peuvent répliquer qu'« à l'origine », on sacrifiait les êtres qui devaient accompagner l'âme du mort, et qu'ensuite, le sens de la tradition s'étant perdu, on tuait un peu au hasard hommes et bêtes. Mais c'est là une simple hypothèse, qui n'est pas appuyée sur les faits, et pas davantage sur l'analogie avec d'autres faits, car ce sont généralement les actions non-logiques qui précédent les actions logiques, et l'on suppose ici qu'il est arrivé le contraire.
§ 1060. Le bûcher qui a consumé le corps de Patrocle est éteint avec du vin. Par l'emploi de ce précieux liquide (I-β 2), on veut honorer le héros ; et dans le poème, il n'y a pas la moindre allusion qui laisse croire que Patrocle boive ce vin. Dans l'Odyssée, Ulysse fait, en l'honneur des morts, les libations d'eau, de miel, de vin, et répand de la farine. Les morts ne goûtent à rien de tout cela et accourent seulement pour boire le sang des victimes. Elpénor demande à Ulysse de brûler ses armes avec son corps ; mais il n'y a pas la moindre allusion au fait qu'il doive s'en servir dans une autre vie. On les brûle pour le même motif qu'on plante une rame sur le tombeau qui recouvre le corps d'Elpénor. Ici, nous avons simplement une permanence des rapports entre un homme et les choses qui lui appartiennent. La mère d'Ulysse dit : « Sitôt que la vie a quitté les os blancs, l'âme, voltigeant comme un songe, erre çà et là ». Elle ne rappelle nullement qu'elle est accompagnée des objets déposés dans sa tombe ou brûlés sur son bûcher.
§ 1061. Le préjugé de l'explication logique a une si grande force, que souvent, sans s'en apercevoir, les auteurs l'ajoutent à leurs descriptions. Dans les plus anciennes sépultures de l'Égypte, on trouve, avec les ossements, des objets ou des images d'objets qui servaient aux vivants. Nous manquons de tout document qui indique les rapports que les contemporains supposaient exister entre ces choses. Voici maintenant comment un savant égyptologue, A. Erman, décrit les faits. Nous soulignons les explications logiques ajoutées par lui [FN: § 1061-1] : « (p. 164) En ce temps ancien, on mettait dans la main du défunt quelque objet qu'on supposait lui devoir servir dans la mort ; ainsi un des cadavres anciens de notre collection tient encore la large pierre à frotter sur laquelle durant sa vie il avait broyé le fard vert destiné à colorier son corps, et un autre a dans la main une bourse de cuir. Mais on met encore bien d'autres choses auprès du cadavre, surtout des pots et des écuelles avec des mets et de la boisson, pour que le défunt ne souffre pas de la faim ; des harpons et des couteaux de pierre pour qu'il puisse chasser sa nourriture et se défendre contre des ennemis ; un damier pour distraire ses loisirs... On y ajoutait aussi des choses ne pouvant avoir d'utilité qu'au surnaturel. La petite barque de glaise doit lui permettre de passer les lacs qui... entourent les champs célestes des bienheureux. Le bœuf de glaise sera abattu pour lui et l'hippopotame de même matière sera son butin de chasse ; la servante d'argile dans la grande cuve, lui pétrit de ses pieds la (p. 165) pâte de l'orge pour lui préparer la bière... À cette autre figure de femme se tenant coi écheoit évidemment de fournir à son seigneur les services de l’amour, aussi est-elle peinte de belles couleurs variées, comme si elle allait être parée et couronnée de fleurs ; et ses cuisses et son fondement ont-ils ce puissant développement que l'Africain de nos jours considère encore comme le suprême de la beauté féminine ».
§ 1062. Il est certain qu'en un temps postérieur, ces explications logiques correspondent pleinement à la croyance populaire. Mais cela ne prouve nullement qu'elles y correspondaient en un temps plus ancien, pour lequel les documents font défaut. C'est au contraire cette correspondance que les explications logiques supposent.
§ 1063. Enfin, le fait du développement chronologique est bien différent du fait des résidus et de leurs dérivations ; et nous n'avons pas besoin de deviner comment le premier s'est passé, en des temps pour lesquels nous n'avons pas de renseignements, si nous voulons étudier le second, en des temps que nous connaissons bien.
§ 1064. En décembre 1911, des malfaiteurs profanèrent la tombe de la Lantelme, pour voler les précieux et riches joyaux qui avaient été enterrés avec cette actrice. Leur projet ne réussit pas, et l'on retrouva dans la tombe une enveloppe avec les bijoux. Deux choses sont alors certaines, autant qu'une chose peut être certaine ; 1° que les bijoux furent ensevelis avec la morte ; 2° que ceux qui firent cela ne s'imaginaient nullement que les dits bijoux dussent servir matériellement à la morte, dans une autre vie. Maintenant, supposons que dans deux ou trois mille ans, on retrouve cette tombe avec les bijoux, comme on retrouve maintenant d'autres tombes du temps passé, avec des armes et des bijoux, et que, raisonnant comme nous raisonnons aujourd'hui, on conclue que les hommes de notre temps croyaient que le mort se servait dans une autre vie des objets ensevelis avec lui. Cette conclusion serait manifestement erronée. Pourquoi donc la conclusion semblable que nous tirons pour le passé, d'une manière semblable, de faits identiques, ne pourrait-elle pas être également erronée ? Nous mentionnons la possibilité de l'erreur ; nous ne disons pas qu'elle existe nécessairement ; mais la seule possibilité suffit pour ôter toute efficacité à un raisonnement qu'on peut résumer de la façon suivante : « Certains faits ont, à notre avis, une seule explication logique ; donc ces faits se sont nécessairement passés de la manière indiquée par la dite explication ». Non, ils peuvent s'être produits d'une autre façon ; et le choix entre les diverses façons doit être fait au moyen de preuves directes, et non pas indirectement, grâce à des inductions logiques ; les faits nous démontrent très souvent qu'elles sont trompeuses. Il faut aller du connu à l'inconnu, expliquer les faits par d'autres faits, et non par les impressions que notre esprit reçoit des faits (§ 547).
§ 1065. (II-α) Persistance d'une abstraction. Une agglomération de rapports une fois constituée, soit de la manière indiquée au § 991, soit d'une autre manière quelconque, une abstraction correspondante prend naissance. Elle peut persister, et alors un nouvel être subjectif est créé.
§ 1066. Ces résidus sont le fondement de la théologie et de la métaphysique, qu'on pourrait exactement définir : un ensemble de dérivations de ces résidus. C'est pourquoi la théologie et la métaphysique ont une grande importance ; non pas celle qu'on leur suppose, en les considérant comme des sciences logiques, mais celle qui provient du fait qu'elles manifestent des résidus qui correspondent à des forces sociales puissantes.
§ 1067. À ce point de vue, les faits du passé et ceux du présent démontrent une uniformité remarquable. Il y a, au contraire, une différence, quant à la personnification des abstractions, qui, chez les peuples de nos pays, se produisait beaucoup plus souvent par le passé qu'en des temps plus récents. Pour ne pas répéter deux fois les mêmes choses, nous parlerons plus loin (§ 1070 et sv.) de certaines abstractions, en même temps que de personnifications. En attendant, voyons d'autres abstractions, qui, par leur importance, méritent de constituer des genres séparés.
§ 1068. (II-ε) Persistance des uniformités. On trouve un cas important de la persistance des abstractions, dans l'opération qu'on exécute en donnant un caractère général à une uniformité particulière, ou même à un seul et unique fait. On observe un fait ; on l'exprime sous une forme abstraite ; cette abstraction persiste et devient une règle générale. Cela se produit tous les jours. On peut même admettre que les raisonnements de cette sorte sont le propre des gens qui n'ont pas l'habitude des raisonnements scientifiques, et même de beaucoup de ceux qui ont cette habitude. Rares sont les personnes qui expriment les faits particuliers sous une forme particulière, et qui savent bien distinguer cette expression de celle qui donne une règle générale; qui savent en outre distinguer la règle générale, qui est un moyen de recherche et qui est soumise à la vérification expérimentale, de la règle qu'on veut placer au-dessus de cette vérification (§ 63). En allant à l'extrême, dans la voie de ces abstractions qui dominent l'expérience, on obtient les principes métaphysiques, les principes naturels, les rapports nécessaires des choses, etc. (§ 531). Il est inutile que nous donnions ici des exemples de ces résidus, ainsi que des suivants : ils se trouvent en grand nombre dans tout cet ouvrage.
§ 1069. (II-ζ) Sentiments transformés en réalités objectives. Ces résidus sont infiniment nombreux, au point de manquer rarement dans un discours qui n'est pas rigoureusement scientifique. Ils constituent le fondement des démonstrations subjectives, obtenues au moyen des sentiments. Ils agissent puissamment sur les motifs pour lesquels on émet et on accepte les théories (§ 13). L'auto-observation des métaphysiciens, l'expérience du chrétien et d'autres opérations semblables transforment en effet les sentiments en réalités objectives.
§ 1070. (II-êta) Personnifications. Le premier degré de la personnification consiste à donner un nom à une abstraction, à une uniformité, à un sentiment, et à les transformer ainsi en individus objectifs. Puis, peu à peu, on s'élève au degré le plus élevé, où la personnification est complète : on atteint l'anthropomorphisme [FN: § 1070-1]. Si l'on y ajoute le résidu sexuel, on obtient des principes mâles et des principes femelles, ou bien des divinités entièrement semblables à l'homme et à la femme. On peut aussi personnifier des lieux et des choses, sans pour cela les diviniser. Ces personnifications naissent spontanément dans l'esprit, sans qu'il soit besoin de raisonnements [FN: § 1070-2]
§ 1071. Le langage est un excellent moyen de faire persister les agrégats et de les personnifier. Il suffit souvent de donner un nom à un agrégat d'abstractions, pour le transformer en une réalité objective. Vice versa, on suppose qu'à un nom quelconque doit nécessairement correspondre une telle réalité (§ 1543 à 1686). Il se peut que le langage agisse aussi pour donner un sexe à ces abstractions ; mais le résidu sexuel suffit à cet office. Le langage intervient ensuite pour déterminer le choix du sexe.
§ 1072. L'anthropomorphisme agit diversement chez des peuples différents et à des époques différentes. Il y a une grande différence entre l'anthropomorphisme grec et la religion archaïque romaine. Il y a aussi une grande différence entre l'anthropomorphisme de l'antiquité classique gréco-romaine et les conceptions religieuses de nos temps. Mais nous ne manquons pas d'abstractions qui, la personnification mise à part, ressemblent beaucoup à celles du passé.
§ 1073. Par exemple, on a dit souvent que le socialisme est une religion. Dans le domaine des dérivations anthropomorphiques, cette proposition est absurde, et personne, assurément, parmi les contemporains, ne s'est jamais représenté le socialisme sous les traits d'un homme, comme les anciens Romains se représentaient la déesse Rome sous les traits d'une femme. Mais, dans le domaine des résidus, la proposition rappelée tout à l'heure correspond aux faits, en ce sens que les sentiments qui se manifestaient jadis par le culte de la déesse Rome ou de la déesse Annona, et ceux qui se manifestent maintenant par la foi au Socialisme, au Progrès, à la Démocratie, etc., constituent des phénomènes semblables.
§ 1074. Les sentiments à l'égard de Rome commencent par donner lieu à une simple représentation, puis croissent en intensité jusqu'à la déification, et finissent par décroître jusqu'à une admiration poétique ou littéraire qui subsiste encore de nos jours [FN: § 1074-1]. Les Romains commencèrent par représenter Rome sous une forme féminine, puis en firent une déesse. Le sentiment vif qui correspondait à la divinisation subsista sous une autre forme, même après la chute du paganisme, tout en s'affaiblissant et en devenant une simple expression poétique. Nous avons ainsi un noyau de sentiments qui persistent avec des intensités différentes, et se manifestent sous diverses formes. Chez les peuples qui jouissaient de la « paix romaine », on avait à l'égard de Rome un ensemble de sentiments et d'idées correspondant à la puissance de Rome et aux bienfaits de son gouvernement. Ces sentiments et ces idées trouvaient justement leur expression dans le langage qu'employaient alors les hommes, en donnant à la ville de Rome le nom d'une divinité, et en lui élevant des temples [FN: § 1074-2]. Des sentiments semblables se manifestent par le culte commun de Rome et de l'empereur régnant : Romae et Augusto, disent les inscriptions ; et c'est ainsi que nous avons aussi un culte commun de Rome et de Vénus.
§ 1075. Le fait d'une grande admiration de Rome et celui de la déification de cette ville, sont différents au point de vue logique, mais sont semblables au point de vue du sentiment ; et souvent le second est une simple traduction du premier en langage courant. Martial n'exprime que des sentiments populaires, quand il s'écrie : « Rome, déesse de la terre et des nations, que rien n'égale et que rien ne surpasse... »
§ 1076. Ces sentiments persistent ensuite, par simple force d'inertie, même quand les faits dont ils tirent leur origine sont passés. L'abstraction se détache des faits et vit de sa vie propre. Saint Jérôme dit encore de Rome [FN: § 1076-1] : « Ville puissante, ville reine des villes, ville louée par la voix de l'apôtre, ton nom, Rome, est interprété comme signifiant force, chez les Grecs, et sublimité, chez les Hébreux ». Puis, peu à peu, il ne reste que la simple réminiscence poétique, chez les poètes contemporains. Mais si c'est aujourd'hui une réminiscence, il y eut un temps où ce fut un sentiment vif et fort.
§ 1077. Dès le milieu du XIXe siècle, les peuples de l'Europe occidentale ont vu leurs conditions de vie s'améliorer progressivement, et cette amélioration a été notablement plus grande à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe. Cela a créé un agrégat de sentiments et d'idées agréables, qui se sont ensuite cristallisés autour de noyaux qu'on a nommés Progrès et Démocratie. Ces êtres puissants et bienfaisants sont considérés par nos contemporains, avec des sentiments semblables à ceux qu'éprouvaient leurs aïeux pour la puissance de Rome.
§ 1078. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples semblables, car tout sentiment vif tend en général à prendre la forme d'une foi en une certaine abstraction ; mais l'exemple seul du pacifisme suffira. M. Kemeny écrit [FN: § 1078-1] : « (p. 99) C'est donc d'une doctrine que je veux parler, non d'une religion, encore moins d'une confession. Le sens de ces deux termes a été, au cours des siècles, tellement altéré, ils ont subi tant d'avatars, qu'ils en demeurent défigurés et qu'ils servent souvent aujourd'hui à exprimer des idées en opposition directe avec l'idée pacifiste [voilà l'idée de la religion, chassée par la porte... mais nous la verrons rentrer par la fenêtre] J'espère ne me rendre coupable d'aucun blasphème en déclarant que le pacifisme, dans son acception la plus haute, n'est ni un moyen ni un but, mais une croyance qui repose sur une sorte de révélation [n'est-ce pas là le caractère prédominant de beaucoup de doctrines qu'on appelle religions ? ] La substance morale du pacifisme étant d'un ordre supérieur [il nous manque la définition qui permette de séparer l'ordre supérieur de l'ordre inférieur ] et se retrouvant dans toute conception universelle de la vie [qu'est-ce que cela peut bien être ?], le pacifisme doit être mis au même rang que le bouddaïsme, le judaïsme, l'islam, le christianisme [mais pourquoi l'auteur a-t-il commencé par dire que ce n'est pas une religion ?], mais il est permis de dire qu'il dépasse toutes ces conceptions en tant qu'il est commun à toutes, qu'il se retrouve dans toutes, qu'il les réunit toutes ».
§ 1079. Cet exemple est remarquable, parce que c'est l'un de ceux, si nombreux, où l'on voit transparaître très clairement les résidus à travers les dérivations La puissance du sentiment fait disparaître la logique. L'auteur a commencé par exclure le pacifisme de la classe des « religions », et, quelques lignes plus bas, il le met « au même rang » que des doctrines qui, incontestablement, sont appelées des « religions » par tout le monde. Mais pour lui, il n'y a pas contradiction, car il écrit sous l'empire d'un sentiment puissant, pour lequel le pacifisme plane comme un aigle, au-dessus des autres religions. Voilà pourquoi il ne fait pas partie de leur classe, bien qu'il leur soit en partie semblable. M. Kemeny démontre que le pacifisme ne contredit aucune religion ; l'aigle vole comme le simple moineau ; puis l'auteur ajoute : « (p. 100) Il y a une autre analogie entre les religions et le pacifisme, analogie exprimée par ces mots que l'on prononce souvent en manière de plaisanterie : « C'est la foi qui sauve ! » Le pacifisme opère, lui aussi, le salut. Tous ceux qui ont travaillé au mouvement pacifiste avec suite, sincèrement, sans arrière-pensée égoïste ou intéressée, ont certainement constaté qu'ils sont devenus meilleurs. Le pacifisme détruit peu à peu les germes du mal ; il purifie les pensées, ennoblit les instincts et devient par là même un élément régénérateur des individus et des races ». Si à ces idées on ajoutait le désir des personnifications, on aurait une image du pacifisme, comme on a une image des divinités païennes, comme on représente la déesse Rome, comme on voit le Dieu des chrétiens dans les nuées, sous la forme d'un beau vieillard à grande barbe.
§ 1080. Ajoutons que, fût-ce à titre d'exception, des dérivations modernes, semblables aux anciennes, ne manquèrent pas. Auguste Comte a personnifié la terre, à laquelle il a donné le nom de « grand fétiche », et l'humanité, à laquelle il a décrété un culte. Ceux qui s'appellent aujourd'hui « humanitaires » expriment en un autre langage plusieurs idées de Comte.
§ 1081. Le terme de socialisme a représenté et représente encore quelque chose de grand, de puissant, de bienfaisant ; et autour de ce noyau se disposent une infinité de sensations agréables, d'espérances, de rêves. De même que les anciennes divinités se succédaient, se dédoublaient, se faisaient concurrence, ainsi de nos jours, outre la divinité du socialisme, nous avons celle des « réformes sociales » ou des « lois sociales » ; et les petits dieux ne manquent pas ; tels « l'art social », « l'hygiène sociale », « la médecine sociale », et tant d'autres choses qui, grâce à l'épithète « sociale », participent de l'essence divine.
§ 1082. Sir Alfred C. Lyall nous fait connaître les diverses formes de déification, chez les Indiens. Moyennant quelques modifications, elles s'appliquent aussi à beaucoup d'autres peuples [FN: § 1082-1]. Il expose ainsi ces formes [FN: § 1082-2] : « (p. 14) 1° Le culte de simples morceaux de bois, souches ou troncs d'arbres, de pierres et d'accidents de terrains locaux, ayant une dimension, une forme ou une position soit extraordinaire soit grotesque [cfr. les résidus de la Ie classe] ; 2° le culte d'objets inanimés, doués de mouvements mystérieux ; 3° le culte d'animaux redoutés ; 4°, le culte d'objets visibles animés ou inanimés, directement utiles et profitables ou qui possèdent soit des propriétés, soit des fonctions incompréhensibles ». Jusqu’ici, nous avons les formes les plus simples d'agrégats de sensations. Vient ensuite une abstraction plus éloignée des simples sensations : « (p. 15) 5° le culte d'un Deo ou esprit, être sans forme et intangible, – vague personnification de ce sentiment de crainte que l'on éprouve en certains endroits ». Puis viennent des catégories appartenant à la persistance de certaines sensations : « 6° le culte des parents morts ou autres personnes défuntes connues de l'adorateur en leur vivant ; 7° le culte des personnes qui ont été pendant leur vie en grande réputation ou qui sont mortes d'une façon étrange ou notable : culte célébré près de la tombe ». Nous passons ensuite à des abstractions d'une complication croissante : « 8° le culte dans les temples de personnes appartenant à la catégorie précédente, adorées comme demi-dieux ou divinités subalternes ; 9° le culte des nombreuses incarnations locales des anciens dieux et de leurs symboles ; 10° le culte des divinités départementales ; 11° le culte des dieux suprêmes de l'hindouisme, et des anciennes incarnations ou personnifications connues par la tradition des écritures brahmaniques ».
§ 1083. Jusque ici, la description du phénomène est parfaite mais l'auteur cède à la tendance générale des explications logiques, quand il suppose qu'on peut rechercher le culte de certains objets inanimés, dans « (p. 17) l'intelligence qui prétend voir la divinité s'incarner dans une souche ou une pierre, uniquement parce que celle-ci offre une forme bizarre ou exceptionnelle, exprime un type de fétichisme grossier ». Puis, sans s'en apercevoir, lui-même réfute cette théorie. Il dit : « (p. 18) Or, les brahmanes ont toujours sous la main une explication pour rendre plausible ce respect envers les objets d'aspect curieux, surtout envers les choses coniques ou concaves, et ils la proposent à quiconque se met sérieusement en quête de manifestations ou d'emblèmes divins. Mais ces interprétations semblent appartenir à un symbolisme ultérieur, que les gens ingénieux inventent d'habitude pour justifier, d'après des principes orthodoxes, ce qui n'est en réalité rien de plus qu'un fétichisme primitif s'élevant dans une atmosphère supérieure [FN: § 1083-1] ».
§ 1084. Étudiant directement les faits, sir Alfred C. Lyall a pu parvenir jusqu'aux résidus ; et si ceux-ci ne se manifestent pas toujours, c'est parce que les faits ne nous sont pas connus directement, mais seulement voilés par les interprétations des littérateurs, des poètes, des philosophes, des théologiens. Par exemple, tout ce que nous savons de l'antique religion des Veddas n'est autre chose qu'un produit littéraire et théologique, que nous connaissons par des hymnes religieux d'une vanité prolixe vraiment remarquable, et auxquels manque le bon sens autant que la précision. Nous n'avons pas d'autres documents pour découvrir les formes parallèles des croyances populaires qui existaient alors, selon toute probabilité, comme elles existent aujourd'hui et se manifestent dans les faits qu'a pu étudier sir Alfred C. Lyall [FN: § 1084-1].
§ 1085. De même, la mythologie des poètes tragiques grecs, pourtant si supérieure aux hymnes des Veddas, par la précision, le bon sens, la clarté, est probablement – on pourrait dire certainement – différente de la mythologie populaire – que nous devinons au moins dans les quelques documents que nous connaissons sur ce sujet ; par exemple, dans l'ouvrage de Pausanias.
§ 1086. (II-η) Besoin de nouvelles abstractions. Le besoin d'abstractions persiste quand certaines d'entre elles tombent en désuétude, sont rejetées pour un motif quelconque. Il en faut alors de nouvelles, pour remplacer celles qui disparaissent ou demeurent affaiblies. Les mythologies populaires sont ainsi remplacées, dans les classes cultivées, par des mythologies savantes, subtiles, abstruses. Ainsi naissent les théogonies ingénieuses, les recherches sur la création du monde, sur l'état primitif de l'humanité, etc. Puis on fait un nouveau pas : les abstractions surnaturelles donnent lieu aux abstractions métaphysiques ; on institue des recherches sur l'essence des choses ; on divague en un langage incompréhensible sur des matières encore plus incompréhensibles. Puis, aux abstractions métaphysiques on ajoute des abstractions pseudo-scientifiques. La nébuleuse de Laplace jouait un grand rôle dans les prédications socialistes qu'on entendait il y a quelques années ; et grâce à elle, ou démontrait clairement que l'évolution, la Sainte Évolution, devait conduire le monde à l'âge d'or socialiste. Celui qui cesse d'adorer les reliques des saints se met à adorer la Solidarité. Celui auquel répugne la théologie de l'Église romaine se tourne vers la théologie moderniste, qu'il dit être plus « scientifique [FN: § 1086-1] ». Les cas semblables, où la forme change et le besoin d'abstractions persistantes subsiste, sont en nombre infini.
§ 1087. D'après le peu que nous en savons, la religion primitive du peuple romain manquait, au moins en partie, de cet élément d'abstractions théologiques et métaphysiques. C'est l'une des très nombreuses causes qui facilitèrent l'invasion de l'hellénisme. Elle n'est pas étrangère à l'invasion des cultes orientaux de Mithra et du christianisme, bien que la substitution d'une nouvelle population à l'ancienne population de Rome ait de beaucoup la plus grande part en ce phénomène. La pauvreté de l'élément abstractions théologiques et métaphysiques, dans l'humanitarisme, en entrave le progrès comme religion. Il en est de même pour la doctrine assez voisine du protestantisme libéral.
§ 1088. Non seulement l'homme a besoin d'abstractions ; il a besoin aussi de les développer. Il les veut vives dans l'esprit, et non mortes. Ainsi, il arrive que plus une religion est florissante, plus les hérésies naissent vives et fortes. Il y a un besoin statique et un besoin dynamique d'abstractions.
[578]
Chapitre VII↩
Les résidus (Suite). Examen des IIIe et IVe classes. [(§1089 à §1206), vol. 1,pp. 578-648]
§ 1089. IIIe CLASSE. Besoin de manifester ses sentiments par des actes extérieurs. Des sentiments puissants sont généralement accompagnés de certains actes, qui peuvent même ne pas être en rapport direct avec ces sentiments, mais qui satisfont le besoin d'agir. On peut observer des phénomènes semblables chez les animaux. À la vue d'un oiseau, le chat claque des mâchoires. En voyant son maître, le chien s'agite, remue la queue ; le perroquet bat des ailes, etc.
§ 1090. Sir Alfred C. Lyall termine les observations que nous avons citées (§ 1083), en disant : « (p. 21) L'auteur de ce livre a connu un fonctionnaire hindou, d'une grande finesse d'esprit et d'une culture très suffisante, qui consacrait, chaque jour, de longues heures au culte méticuleux de cinq cailloux ronds, qu'il s'était désignés pour symboliser à ses yeux l'Omnipotence. Tout en professant une croyance générale à l'ubiquité de la présence divine, il lui fallait un symbole quelconque à manier et auquel il pût adresser ses hommages ». Il convient de noter ici, non seulement le besoin du symbole, mais surtout le besoin de « faire quelque chose », d'agir, de remuer les membres, de fixer son attention sur quelque chose de concret, enfin de s'échapper d'une abstraction passive. De nos jours, Flammarion et d'autres savants se réunissent à l'équinoxe de printemps, pour assister au lever du soleil.
§ 1091. Les actes par lesquels se manifestent les sentiments les renforcent et peuvent même les faire naître chez ceux qui ne les ont pas encore. C'est un fait psychologique bien connu, que si une émotion se manifeste par un certain état physique, il peut arriver que la personne qui se met en cet état fasse naître chez elle l'émotion correspondante. Par conséquent, les résidus de cette classe sont unis aux émotions, aux sentiments, aux passions, par une chaîne complexe d'actions et de réactions.
§ 1092. (III-α) Besoin d'agir se manifestant par des combinaisons. À propos des combinaisons, nous devons retrouver ici les résidus de la Ire classe. Nous avons proprement un genre de résidus composés. Rares sont les faits comme celui que nous avons cité tout à l'heure, d'après sir Alfred-C. Lyall, et qui nous montrent des combinaisons dues au simple hasard, ou mieux à des motifs complexes et indéfinis. D'habitude, une règle plus ou moins fantaisiste détermine le choix de la combinaison. Le besoin d'agir est tyrannique ; la fantaisie travaille et trouve moyen de le satisfaire. Dans ces phénomènes, notre résidu, c'est-à-dire le besoin d'agir, constitue le principal ; les résidus de la Ire classe, c'est-à-dire les combinaisons, sont secondaires ; et les règles de ces combinaisons, c'est-à-dire les dérivations des résidus de la Ire classe, sont accidentelles et, en général, de peu d'importance.
§ 1093. C'est justement pourquoi il est difficile, souvent impossible, de distinguer les opérations magiques, du culte religieux ; si bien que grâce à la tendance habituelle de substituer la recherche des « origines » à celle des résidus, on a pu dire que la magie était « l'origine » de la religion. Le besoin d'agir, qui correspond au résidu du présent genre, donne lieu à des opérations d'art naturel, de magie, de religion. On passe par degrés insensibles, de la première espèce d'opérations à la dernière. On en a de très nombreux exemples dans les opérations tendant à guérir les malades. Au chapitre II, nous avons exposé la variété des opérations engendrées par le besoin qu'éprouvaient les hommes d'éloigner ou de susciter les tempêtes (§ 186 et sv.).
§ 1094. (III-β) Exaltation religieuse. Le besoin calme et pondéré d'agir peut croître en intensité jusqu'à l'exaltation, l'enthousiasme, le délire. Aussi, entre le genre précédent et celui-ci, la différence n’est que de quantité. Les chants religieux, les contorsions, les danses, les mutilations accomplies dans le délire font partie de ce genre. Mais dans les mutilations, et plus généralement dans les souffrances volontaires, on trouve souvent un autre genre de résidus : celui de l'ascétisme, dont nous traiterons plus loin.
§ 1095. Le shamanisme est un cas remarquable de phénomènes qui nous montrent les dits résidus sans beaucoup d'adjonctions. Sir John Lubbock dit [FN: § 1095-1] : « (p. 338) Wrangel (Siberia and polar Sea, p. 123) qui, lui, regarde le shamanisme comme une religion dans le sens ordinaire du mot, s'étonne "qu'il ne comporte aucun dogme" ; ce n'est – dit-il – ni un système enseigné, ni un système transmis de génération en génération ; bien que fort répandu, il semble prendre sa source dans chaque individu séparément, comme le résultat d'une imagination surexcitée au plus haut degré et influencée par des impressions extérieures, qui se ressemblent beaucoup dans toute l'étendue des déserts de la Sibérie Septentrionale ». Ayant, comme tous ceux qui traitent ces matières, l'idée fixe des dérivations logiques, sir John Lubbock ajoute : « (p. 338) Il est fort difficile, dans la pratique, d'établir une distinction entre le shamanisme et le totémisme, d'une part, et l'idolâtrie de l'autre. La principale différence réside dans la conception de la divinité. Dans le totémisme, les divinités habitent notre terre, dans le shamanisme, elles vivent ordinairement dans un monde à part et s'inquiètent fort peu de ce qui se passe ici-bas. La divinité honore quelquefois le shaman de sa présence, ou elle lui permet de visiter les régions célestes ».
§ 1096. Là, nous avons l'erreur habituelle, consistant à croire qu'on passe de l'abstrait au concret, tandis qu'en réalité on suit la voie inverse. Alors qu'il n'y avait pas encore de faits concrets du genre examiné, les hommes, à ce qu'il paraîtrait, ont commencé par se forger une idée logique et abstraite de la divinité, puis en ont déduit les règles de leurs actions ; enfin, les faits concrets se sont produits suivant cette idée et ces règles. En général, il arrive précisément le contraire. La théorie qui fait vivre les divinités sur la terre, et celle qui les place dans un autre monde sont très accessoires, en comparaison des faits concrets du totémisme et du shamanisme. Elles n'ont pas engendré les faits, mais ont été imaginées pour les expliquer.
§ 1097. L'exaltation religieuse n'est le propre d'aucune religion, d'aucun peuple, mais se rencontre dans la plupart des religions et chez le plus grand nombre des peuples, parfois très légère, parfois intense. Elle n'est donc pas la conséquence de l'une des religions qu'on observe. Au contraire, c'est d'elle que certaines théories sont la conséquence. Nous pouvons l'étudier en des faits qui se passent sous nos yeux, et procéder ainsi du connu à l'inconnu, pour étudier des faits plus éloignés ou plus reculés. Voyez, par exemple, l'Armée du Salut. Son principal moyen de propagande réside justement dans l'exaltation religieuse. Elle veut appartenir à la religion chrétienne, mais ne changerait rien à son œuvre si elle appartenait à une autre religion, par exemple au mahométisme.
§ 1098. Le « Réveil du Pays de Galles » est peu différent. La partie théologique est minime ; l'enthousiasme religieux est la partie principale. M. Bois, qui a étudié le Réveil [FN: § 1098-1]des années 1904-1905, observe que les gens saisis par cette ferveur religieuse fuient la discussion avec les incrédules [FB: § 1098-2]. Il note fort bien la différence entre la mission Torrey, dont une petite partie est théologique, et le Réveil, qui ne l'est pas du tout [FN: § 1098-3]. L'auteur nous raconte ce qu'il a vu au meeting du 11 avril : « (p. 269). Meeting étrange. Prières ferventes, passionnées, de femmes et d'hommes boxant les (p. 270) poings fermés. Plusieurs tombent dans le hwyl [FN: § 1098-4]... Évidemment, quand on tombe dans le hwyl, on ne se possède plus, on n'a presque plus conscience de soi, c'est le subconscient qui s'épanouit. Une petite fille, à ma droite, séparée de moi par une jeune fille, commence à prier en même temps que d'autres. On chante, rien n'y fait. La petite continue. On l'écoute un moment toute seule avec des amen, oui, très bien. Puis l'assemblée en a assez, il faut croire, car elle se met à chanter un grand hymne. La petite continue de prier. Il y a très longtemps qu'elle prie. Elle est dans le hwyl, complètement oublieuse de tout ce qui l'entoure, les yeux fermés, comme possédée par une influence extérieure qui la maîtrise ».
§ 1099. Cet état d'inconscience et d'exaltation est identique à celui du shaman, bien que les dérivations par lesquelles les croyants veulent expliquer ces états soient entièrement différentes. De même, quand M. Bois nous décrit l'état extatique dans lequel tombent les fanatiques du Réveil [FN: § 1099-1], nous retrouvons des faits semblables à ceux, bien connus, qu'on observa en tout temps, et chez tous les peuples.
§ 1100. On peut affirmer que les cris de l'Angekok sont inspirés du diable, et que ceux des fidèles du Réveil sont inspirés de Dieu. C'est là un problème dont la science expérimentale n'a pas à s'occuper, et qu'elle ne saurait résoudre en aucune façon. Mais il est certain qu'expérimentalement les deux cas sont identiques et manifestent les mêmes résidus.
§ 1101. Les prophètes de tous les temps paraissent avoir eu quelque chose de commun avec ces exaltés. La démocratie moderne a voulu aller chercher ses ancêtres parmi les prophètes hébreux [FN: § 1101-1]. Ce sont de ces généalogies fantaisistes qui chatouillent agréablement la vanité des parvenus. En attribuant à Dieu l'inspiration de leurs prophètes et au diable celle des prophètes païens, les premiers chrétiens se rapprochaient de la vérité, en ce sens qu'ils avaient l'intuition que dans ces phénomènes il y avait des manifestations du même résidu. Ceux qui voyaient dans les uns et les autres de ces prophètes des charlatans et des imposteurs, s'écartaient beaucoup plus de la vérité, et confondaient l'exception avec la règle.
§ 1102. De même, ceux qui ne voient chez les prophètes israëlites que des dégénérés et des aliénés s'écartent aussi de la vérité [FN: § 1102-1]. Assurément, la pathologie mentale joue un rôle dans ces phénomènes; mais elle ne les règle pas entièrement ; et, pour s'en persuader, il suffit d'observer les phénomènes que nous avons sous les yeux (§ 547).
En attendant, aux États-Unis d'Amérique, nous avons des prophètes, tel celui qui prit le nom d'Élie, parfaitement sains d'esprit, et qui ont pour but unique – qu'ils atteignent souvent – de gagner de l'argent. Il ne manque pas de faits analogues, partout et en tout temps. Récemment, en Angleterre, l'enquête Marconi a démontré que certains hommes politiques qui jouissent de la faveur des fanatiques Gallois, et qui, dans leurs discours en public, imitent les prophètes d'Israël, n'oublient pas leur intérêt ni les spéculations de bourse. Ces faits ne jouent aucun rôle dans le phénomène que nous examinons. Mais, parmi les gens de l'Armée du Salut et ceux du Réveil, parmi les énergumènes de l'anti-alcoolisme ou de la « vertu » sexuelle, parmi les humanitaires, parmi les prophètes du dieu Progrès, etc., il y a incontestablement des individus qui s'écartent peu du type normal de l'homme sain ; et si d'autres s'en écartent davantage, cela prouve que l'enthousiasme peut facilement s'ajouter à un état pathologique, mais ne prouve pas qu'on ne puisse le rencontrer chez les gens sains.
§ 1103. On remarquera que l'importance sociale du prophétisme réside moins dans les prophètes que dans les gens qui y croient ; et quand, parmi ceux-ci, se trouve un Newton, il convient de reconnaître que notre résidu a une grande part dans les phénomènes sociaux.
§ 1104. Seule, la manie de juger les phénomènes d'après leur partie accessoire, qui est celle des dérivations, peut cacher la parfaite similitude de tous les phénomènes d'exaltation religieuse ou d'autres genres analogues.
§ 1105. Par exemple, l'extase, la manie de la Pythie, avait exactement le même résidu que d'autres phénomènes d'extase religieuse ; et quant au bon sens, la Pythie en avait plus que beaucoup de prophètes israélites. Bouché-Leclercq dit [FN: § 1105-1] : « (p. 101) La Pythie enivrée, disait-on, par les vapeurs de l'antre et saisie par le dieu, tombait aussitôt dans une extase que les poètes se sont plu à décrire sous les couleurs les plus criardes et que nous ne décrirons pas après eux. Ce qui est certain, c'est que cette crise nerveuse n'était pas toujours simulée, car au temps de Plutarque une pythie en mourut. (Def. orac., 51) ».
§ 1106. L'étude des phénomènes du Réveil gallois nous fait comprendre ce qu'étaient les phénomènes qu'on observait au temps des Croisades (§ 547). C'est une erreur d'y voir exclusivement l'effet « des superstitions du moyen âge ». Ils provinrent de nombreuses circonstances, dont une partie s'observe encore. Ces circonstances sont celles qui correspondent à l'enthousiasme, tel qu'il se manifeste aujourd'hui encore dans les Réveils et en d'autres faits semblables. La grande part que les jeunes garçons et les jeunes filles prennent aux Réveils nous fait comprendre comment ont pu avoir lieu les croisades d'enfants [FN: § 1106-1].
§ 1107. Les Anglais sont plus pondérés que les Gallois, et plusieurs d'entre eux étaient choqués par l'anarchie du Réveil. L'un d'eux disait à M. Bois (loc. cit.) : « (p. 261) Ces péans de louanges, que voulez-vous, cela me rappelle les chorybantes ! » En somme, il ne s'éloignait pas trop de la vérité, car les deux phénomènes ont le même résidu [FN: § 1107-1]. M. Bois nous raconte aussi ce que pensait une dame anglicane, à laquelle il parlait avec enthousiasme d'une réunion du Réveil (loc. cit.) : « (p. 137) Mon admiration et mon enthousiasme ne trouvent que peu d'écho. Mon hôtesse, qui appartient à l'Église anglicane, a assisté à une réunion galloise. Elle a été toute scandalisée du manque d'ordre, de régularité, de ce meeting. Pensez un peu ! Elle avait apporté son livre d'hymnes anglicans, comme on fait quand on va à une réunion qui se respecte ; elle n'a pu une seule minute se servir de son livre !... »
§ 1108. Tels auront été, à peu près, les sentiments de nombreux sénateurs romains, quand fut édicté le sénatus-consulte des Bacchanales ; et leurs sentiments ne devaient guère différer de ceux qu'Euripide fait exprimer à Penthée [FN: § 1108-1].
§ 1109. Le récit de Tite-Live est manifestement exagéré. Les reproches d'obscénité faits aux Bacchanales sont ceux que les sectes religieuses ont l'habitude de s'adresser réciproquement. Justement parce que ces reproches sont toujours répétés, on ne peut savoir s'ils sont vrais ou non [FN: § 1109-1]. Il nous est donc impossible d'accepter comme certain le témoignage de Tite-Live, et nous ignorons jusqu'à quel point furent justifiées les accusations portées contre les Bacchanales. Toutefois, supposons pour un moment qu'elles fussent vraies. Il n'en reste pas moins que le Sénat défendit aussi les mystères, célébrés dans la Grande Grèce, mystères qui ne passaient nullement pour être obscènes. Il est donc manifeste que le Sénat avait de bien autres visées que celle de protéger la morale. Il suffit d'ailleurs de lire le discours que Tite-Live attribue au consul Postumius, pour voir que les intentions politiques étaient au premier plan (XXXIX, 16). «Le mal serait moindre s'ils n'avaient fait que s'efféminer par ces ignominies qui leur font grand'honte, et si leurs mains s'étaient abstenues des crimes, leurs esprits des conjurations. La République ne souffrit jamais d'un si grand mal, ni de plus d'hommes ni de plus de choses. Sachez que toutes les luxures, les fraudes, les scélératesses qui furent commises en ces dernières années, ont pris naissance dans ce sanctuaire de crimes. Encore cette conjuration n'a-t-elle pas révélé tous les maux. Elle se borne aux crimes privés, parce qu'elle n'est pas assez forte pour opprimer la République... »
§ 1110. Les légendes des ennemis que rencontre Dionysos et qui sont vaincus par lui nous révèlent, dans le sentiment grec, une certaine résistance à l'enthousiasme religieux. Cette résistance fut moins efficace chez les Grecs que chez les Romains, parce que la vie des premiers était moins sérieuse, moins retenue, moins digne que celle des seconds.
§ 1111. Avant d'écrire la vie d'Épaminondas, Cornelius Nepos avertit le lecteur qu'il ne doit pas juger des mœurs étrangères d'après celles de sa patrie. « Nous savons, en effet, que suivant nos mœurs, la musique ne convient pas à une personne distinguée, que nous plaçons la danse parmi les vices ; tandis que, chez les Grecs, ces choses sont bienvenues et honorées ». Et pourtant le chant et la danse figurent dans le culte romain des Saliens et des Arvales. Dans les Lupercales, les Luperques, presque nus, parfumés, couraient autour du pomerium de l'ancienne ville du Palatin, fouettaient avec des lanières de cuir les femmes qu'ils rencontraient, et les rendaient ainsi fécondes. Notons en passant que cette fête fut parmi les dernières à disparaître par l'effet du christianisme. Comme nous l'avons déjà dit (§ 1008, 1004), de tels résidus sont beaucoup plus résistants que les dérivations.
§ 1112. L'enthousiasme religieux a souvent pour effet de faire croire que certaines personnes sont en communication avec la divinité. Souvent aussi ont lieu des excursions dans le monde surnaturel. Williams décrit un fait de ce genre, vu par lui aux îles Viti [FN: § 1112-1]. Comparez cette description avec celle que donne Bois, de certains phénomènes du Réveil, [FN: § 1112-2] et vous verrez, sans en pouvoir douter le moins du monde, que les dérivations sont différentes, mais que le résidu est le même dans les deux cas.
§ 1113. IVe CLASSE. Résidus en rapport avec la sociabilité. Cette classe est constituée par des résidus qui sont en rapport avec la vie sociale. On y peut mettre aussi les résidus qui sont en rapport avec la discipline, si l'on admet que les sentiments correspondants sont renforcés par la vie en société. En ce sens, on a observé que tous les animaux domestiques, excepté le chat, vivaient en société, lorsqu'ils étaient en liberté. D'autre part, la société est impossible sans quelque discipline, et par conséquent l'établissement d'une sociabilité et celui d'une discipline ont nécessairement certains points de contact.
§ 1114. (IV-α) Sociétés particulières. Chez le plus grand nombre des peuples, on observe le besoin d'associations particulières. Il y en a des genres très différents : dans la seule intention de se distraire, avec un but d'utilité particulière, avec des vues religieuses, politiques, littéraires, etc. Ce n'est pas ici le lieu d'en donner une description, même sommaire. Nous voulons seulement noter les résidus qu'on observe en général dans des faits semblables.
Après avoir remarqué la diffusion des collèges funéraires, à Rome, Renan observe que les membres de ces associations deviennent étroitement unis et comme parents. De cette façon, on comprend comment des sentiments puissants sont issus du fait des réunions de ce genre. Renan, lui-même, a retrouvé les mêmes sentiments parmi les chrétiens orientaux de son temps. Ils sont d'ailleurs peu différents de ceux que nous pouvons facilement observer chez beaucoup de sectes religieuses, politiques, sociales. Les corporations du moyen âge ressemblaient aux anciens collèges. Le fait que le patron était un saint chrétien, au lieu d'être un dieu païen, n'en changeait certainement pas la nature. On observera aussi que la plus grande partie des manifestations de l'activité des sociétaires étaient les mêmes, y compris les banquets ; et c'est l'un des cas si nombreux dans lesquels on voit changer la forme, tandis que le fond demeure identique : les dérivations changent ; le résidu persiste. Il faut distinguer les sentiments qui poussent les hommes à constituer des sociétés particulières, des sentiments qui se développent dans ces sociétés, et qui correspondent à toutes sortes de résidus. Parmi ceux-ci, il faut mentionner les résidus II-α 3 (§ 1038 et sv.).
§ 1115. (IV-β) Besoin d'uniformité. Ce besoin existe aussi chez les animaux qui vivent en société. Si l'on teint une poule en rouge et qu'on la remette avec ses compagnes, celles-ci l'attaquent aussitôt. Chez les peuples barbares, le besoin d'uniformité est beaucoup plus grand que chez les peuples civilisés.
§ 1116. Dans les sociétés humaines, l'uniformité recherchée peut être générale chez un peuple, mais différente aussi, en divers groupes d'individus de ce peuple. La cristallisation des solutions d'un sel donne une image du phénomène. Autour d'un noyau se déposent des couches successives, qui constituent un gros cristal. Mais il n'y a pas qu'un seul cristal, dans la solution : il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul centre de réunion des personnes semblables dans une société donnée : il y en a plusieurs. Parfois, il y a lutte entre les diverses collectivités qui veulent étendre à d'autres leur propre uniformité ; parfois la lutte n'existe pas, et chacun se contente de l'uniformité de la collectivité dont il fait partie, et respecte les autres uniformités.
§ 1117. (IV-β 1) Uniformité obtenue en agissant sur soi-même. À ce genre appartient l'imitation. Elle joue un grand rôle dans les phénomènes sociaux : un individu en imite d'autres ; une collectivité, une nation en imite d'autres. Toutefois, nous avons vu (§ 733 et sv.) qu'il serait erroné de croire que là où l'on rencontre des institutions semblables, elles le sont nécessairement devenues par imitation. Elles peuvent être semblables, parce qu'elles naissent de causes semblables. En outre, il peut aussi arriver que l'imitation intervienne pour renforcer la similitude. Par exemple, les lois contre le vol proviennent chez les différents peuples, de causes semblables. Mais quand ces peuples en viennent à des rapports d'échange, ils peuvent imiter certaines formes de ces lois. On peut faire des observations analogues pour les institutions politiques et pour d'autres genres de l'activité sociale.
§ 1118. L'imitation peut avoir pour but d'obtenir quelque chose d'utile – ou d'estimé tel – en employant des moyens qui, mis en œuvre par d'autres individus, ont atteint ce résultat. On a ainsi des actions logiques. Mais souvent ce but n'existe pas ou n'est pas connu, et l'on a des actions non-logiques, auxquelles on s'efforce, comme d'habitude, de donner une teinte logique.
§ 1119. Le résidu se manifeste presque à l'état pur, dans l'uniformité temporaire imposée par la mode [FN: § 1119-1]. Souvent, il est vraiment impossible d'y trouver aucune utilité quelconque. Dire que « l'on suit la mode pour faire comme tout le monde », c'est dire simplement qu'on imite parce qu'on imite. Il est vrai que celui qui n'imiterait pas serait aussitôt en butte au blâme public ; mais ce n'est que la sanction d'un sentiment général, grâce à laquelle on passe, en ce cas, du présent genre au suivant.
§ 1120. La manière dont ces faits prennent naissance est souvent obscure. La manière dont ils sont imités et le motif de cette imitation dépendent souvent d'un ensemble de circonstances peu connues, que nous désignons par le nom de hasard. Par conséquent, le procédé qui veut attribuer des causes logiques à des faits qu'on observe à un moment donné, est souvent erroné, et les déductions qu'on fait dans ce sens sont alors fantaisistes.
§ 1121. En 1909, les femmes portaient, en Europe, de grands chapeaux, dits à la veuve joyeuse. Supposons qu'un voyageur, ne connaissant rien de l'Europe, y fût alors arrivé. Il aurait pu rechercher les causes logiques de cet usage, comme les voyageurs européens recherchent les causes logiques de faits semblables, observés chez les sauvages. Il aurait dit, par exemple, dans la relation de son voyage, que les femmes européennes croyaient s'assurer un heureux veuvage en portant de grands chapeaux d'une forme spéciale. Un autre aurait démontré qu'au contraire c'était un préservatif du veuvage. Un autre encore y aurait vu les restes de coutumes d'un autre état social.
§ 1122. Ce qui est ici une hypothèse arbitraire est au contraire une réalité pour un très grand nombre d'études sur les usages de l'antiquité et de peuples sauvages ou barbares. Par exemple, quand on observe un tabou, on veut aussitôt y trouver une raison logique. On ne saurait nier que le fait ne se soit produit ; mais ces cas sont rares. Il se peut aussi que nous soyons à même d'y découvrir cette raison ; mais ces cas sont très rares. Les cas habituels sont ceux dans lesquels, ou bien il n'y a pas de raison logique, ou bien, s'il y en a une, nous ne savons pas la trouver, et nous en imaginons une autre.
§ 1123. Les wahabites défendent l'usage du tabac. Pour eux, cette substance est tabou. Dans ce cas, il est inutile de chercher un motif archéologique, puisque la prohibition est récente. Palgrave a cherché une explication logique de ce tabou [FN: § 1123-1]. Il la trouve dans la « (p. 80) passion des sectaires pour les signes de ralliement bien tranchés ». Il y a là du vrai, en ce sens que les sectaires imitent des usages qui sont propres à la secte. Mais ensuite Palgrave s'écarte quelque peu de la réalité, quand il y ajoute des motifs de desseins logiques des chefs de la secte [FN: § 1123-2]. S'il disposait de documents et d'observations directes pour le prouver, il n'y aurait qu'à accepter l'explication. Mais celle-ci n'est qu'une induction issue de la prémisse implicite que les tabous doivent avoir une raison logique, qu'on tente de découvrir en tenant compte des intentions du législateur.
§ 1124. En général, cette voie est trompeuse. Les fondateurs de religions ne sont pas des hypocrites astucieux, qui veulent atteindre certains buts par des chemins couverts. L'apôtre est généralement un homme persuadé de sa religion ; et c'est même une condition presque indispensable pour qu'il puisse persuader autrui. Par conséquent, lui attribuer des intentions astucieuses et fourbes, quand on manque de documents, éloigne du vrai, selon toute probabilité. Cela n'empêche pas qu'après la prohibition du tabac, survenue pour des raisons multiples que nous ignorons, le fait qu'elle était un moyen facile de distinguer les wahabites des autres musulmans, ait contribué à la maintenir, ainsi que le remarque Palgrave. Les explications logiques que les wahabites donnent eux-mêmes de la prohibition du tabac, appartiennent aux dérivations.
§ 1125. Dans les tabous, il y a des usages si étranges qu'ils défient toute explication logique possible. Par exemple, voyez ce que dit Frazer [FN: § 1125-1]. Qui voudrait d'autres faits en trouverait tant et plus dans les relations de voyages. Mais sans nous éloigner de nos pays, voyez les usages étranges de beaucoup de nos sectes, comme celles des Francs-Maçons ou des Bons-Templiers. Celle-ci est une secte anti-alcoolique. Dans une réunion secrète tenue à Lausanne, on ne voyait que son huissier, vêtu de rouge flamboyant. Qui trouvera le rapport qu'il peut y avoir entre cette couleur et l'anti-alcoolisme ?
§ 1126. (IV-β 2) Uniformité imposée aux autres. Non seulement l'homme imite pour s'uniformiser avec les autres : il veut que les autres fassent de même. Si un autre homme s'écarte de l'uniformité, cela paraît détonner et produit, indépendamment de tout raisonnement, une impression de malaise chez les personnes qui sont en rapport avec lui. On tâche de faire disparaître le contraste par la persuasion ; plus souvent parle blâme ; plus souvent encore par la force. Comme d'habitude, les vains discours logiques ne manquent pas, pour expliquer cette attitude. Mais la cause n'est pas de celles qu'on indique : elle réside, au moins en grande partie, dans le sentiment d'hostilité aux transgressions d'uniformité, auquel s'ajoutent des sentiments d'ascétisme et d'autres semblables.
§ 1127. Le besoin d'uniformité est particulièrement puissant dans les matières où l'on prétend faire usage de la logique. Au point de vue logique, le comble de l'absurde semble être atteint par une doctrine qui condamne un homme au bûcher parce qu'il ne pense pas comme les autres, sur une question de théologie, incompréhensible à tout homme raisonnable. Mais ce jugement n'a de valeur que pour la dérivation, pour le motif logique qu'on a imaginé à l'acte exécuté. L'acte lui-même n'est que la manifestation du sentiment d'hostilité à une transgression estimée très grave par rapport à l'uniformité. Aujourd'hui, on ne brûle plus les transgresseurs, parce que toute l'échelle des pénalités a été diminuée ; mais on condamne à la prison des gens qui prêchent le malthusianisme. Il est permis de ne pas croire à la présence réelle de Jésus Christ dans l'hostie, mais il n'est pas permis de croire que celui qui n'a pas les moyens d'entretenir des enfants fait mieux de ne pas leur donner naissance, et d'employer des moyens aptes à empêcher la conception [FN: § 1127-1]. Il est extraordinaire que les gens qui condamnent ces derniers hérétiques pleurent les premiers ; que le persécuteur des hérétiques de la religion sexuelle parle avec horreur de ceux qui persécutaient les hérétiques de la foi catholique ; qu'il les traite d'ignorants fanatiques, et dise et croie de bonne foi être beaucoup plus qu'eux sage, savant et dépourvu de préjugés. C'est bien ce qui se passe. Il y a des gens qui croient que pour condamner la religion catholique, il suffit de citer l'Inquisition et les tortures qu'elle infligeait aux hérétiques, tandis qu'ils admirent des juges anglais qui condamnent à la peine du fouet ceux qui ne sont accusés d'autre chose que d'avoir vendu des dessins obscènes [FN: § 1127-2].
Joinville raconte comment Saint Louis punissait les blasphémateurs de sa foi [FN: § 1127-3]. C'est un grand scandale pour nos libres penseurs, qui estiment très juste que ceux qui s'avisent de blasphémer contre l'un de leurs dogmes, soient également punis. Les fanatiques de la sainte Science disent vouloir demeurer dans le domaine de la logique et de l'expérience ; c'est même pour cela qu'ils s'estiment si supérieurs aux croyants d'autres religions. Mais si vraiment l'on veut rester dans ce domaine, il est impossible de démontrer que faire voir le dessin d'une femme nue est un plus grand crime que blasphémer contre le dieu d'une religion quelconque, ni que les crimes de la première espèce causent plus de tort à la société que ceux de la seconde. C'est justement pourquoi, ne pouvant s'appuyer sur la raison, les fanatiques, dans tous les pays et dans tous les temps, sont portés à recourir à la force, pour imposer à autrui les uniformités qui leur sont chères. Le même Joinville raconte une anecdote, où l'on voit ce recours à la force exposé naïvement et sans aucune hypocrisie. Les catholiques invitent les Juifs à une discussion. Un chevalier des premiers n'emploie d'autre argument que les coups, et le bon roi l'approuve et le loue [FN: § 1127-4]. « Voilà l'effet de la « superstition catholique », diront quelques-uns de nos contemporains. Un instant. Ce chevalier a eu le grand honneur d'être le précurseur du sénateur Bérenger, qui oppose à ses contradicteurs, non pas des raisonnements, mais des dénonciations au procureur de la république, et qui se trouve exactement dans le cas où le roi Louis voulait qu'on usât de la force ; car il est difficile à M. Bérenger de démontrer sa foi d'une autre manière [FN: § 1127-5].
§ 1128. Le besoin d'uniformité n'existe pas également dans tous les sens. N'étant pas le moins du monde théologiens, les Romains n'imposaient l'uniformité que pour les actes extérieurs du culte. Le gouvernement chinois tolère toutes sortes de religion, pourvu qu'elle soit soumise à l'État. Les gouvernements modernes séquestrent les journaux où l'on représente une femme nue, et laissent vendre les journaux qui prêchent le sac, l'incendie et le meurtre des bourgeois [FN: § 1128-1].
§ 1129. En outre, ces manifestations de l'instinct d'uniformité sont irrégulières et déraisonnables, comme presque toutes les manifestations de semblables instincts. À Athènes, on fit peu de procès pour impiété, et les impies étaient nombreux. Les persécutions des Romains contre les chrétiens furent faites sans suite ni méthode. Les persécutions qui furent opérées par l'Église catholique furent beaucoup mieux ordonnées, plus logiques, parce qu'elles n'étaient pas une pure manifestation de l'instinct d'uniformité. L'Église catholique disciplina la matière et y ajouta un peu de logique. La logique tend à disparaître, dans les persécutions des gouvernements modernes, contre les hérétiques de la religion sexuelle qui est aujourd'hui officielle. On laisse vendre, sans le moindre obstacle, des livres très obscènes. On saisit des journaux beaucoup moins obscènes. Certains auteurs sont condamnés ; d'autres jouissent de l'impunité, sans qu'on puisse trouver le moindre motif raisonnable pour justifier cette différence. On porte plainte à tort et à travers. Il semble qu'on voie une de ces grosses mouches qui ne savent trouver la sortie d'une chambre où elles sont enfermées.
L'attitude de certains gouvernements à l'égard de l'anti-militarisme, ne paraît pas moins étrange. En Allemagne, cette doctrine a toujours été réprimée ; mais en France et en Italie, elle est tantôt tolérée, tantôt poursuivie. En France, on met Hervé en prison, et on laisse les instituteurs prêcher l'anti-militarisme à l'école ; bien plus, pour défendre l'école laïque, on menace de la prison et de l'amende ceux qui les désapprouvent. En Italie, il y a peu d'années, il était permis de prêcher l'anti-militarisme et de vilipender l'armée. En 1912, on fait un procès à la Propaganda de Naples, pour des articles anti-militaristes, parmi lesquels s'en trouve un d'un haut officier de l'armée, publié en 1887, dans la Riforma sociale. La contradiction apparente disparaît, si l'on prend garde que l'œuvre du gouvernement suit, épouse les variations des dérivations que le sentiment d'une partie de la population veut uniformes ; et parmi tous ces changements persiste le besoin d'uniformité.
§ 1130. (IV-β 3) Néophobie. C'est le sentiment qui empêche les innovations qui viendraient à troubler l'uniformité. Il est très fort chez les peuples sauvages ou barbares, et notable encore chez les peuples civilisés, où il n'est surmonté que par l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe).
§ 1131. À Paris, en février 1911, le peuple se jeta sur des femmes portant la jupe-culotte, et les frappa. Des faits semblables eurent lieu en Italie, en Espagne, un peu partout. Auparavant, on les avait aussi observés pour les grands chapeaux, ou pour d'autres innovations de la mode.
§ 1132. Il faut remarquer que parmi les personnes affectées de ces néophobies, il y en a beaucoup pour lesquelles, au contraire, tout ce qui est nouveau en politique ou en religion doit être bon, par cela seul que c'est nouveau. Elles sont froissées des innovations des tailleurs et des modistes, tandis qu'elles sont indignées parce que le Pape n'accepte pas les innovations des modernistes, et blâment tout retard des gouvernements dans l'acceptation des innovations sociales. C'est une preuve nouvelle que les résidus contradictoires peuvent subsister ensemble dans l'esprit d'un même homme. Les résidus de la religion du Progrès, qui contrastent avec ceux de la néophobie, sont dans ce cas.
On pourrait aussi envisager le contraire de la néophobie, soit l'amour des innovations ; mais on peut se demander s'il est directement un sentiment, ou s'il n'est plutôt que l'effet des sentiments qui poussent aux combinaisons et, de nos jours, aussi des sentiments d'adoration pour le dieu Progrès.
§ 1133. (IV-γ) Pitié et cruauté. Ces sentiments contraires doivent être étudiés ensemble. Comme nous l'avons déjà observé (§ 911), la classe contraire à tous les deux serait l'indifférence. Il n'est pas facile de distinguer le sentiment de pitié de beaucoup d'autres qui en prennent la forme. Il est incontestable que, depuis un siècle jusqu'à présent, la répression des crimes est devenue toujours plus faible. Il ne se passe pas d'année qu'on ne fasse de nouvelles lois en faveur des délinquants, tandis que celles qui existent sont appliquées par les cours et par le jury, avec une indulgence toujours croissante. Il semblerait donc que la pitié envers les délinquants va en augmentant, tandis que celle envers leurs victimes va en diminuant.
§ 1134. D'autre part, il y a des cas dans lesquels ce peut être la pitié en général qui va en augmentant ; et la différence notée dépend du fait que les délinquants mis en jugement sont présents, tandis que les victimes sont absentes. Les sentiments de pitié sont surtout intenses pour ceux qui sont présents ; ils sont beaucoup plus faibles pour ceux qui sont absents. Le jury voit l'assassin et éprouve de la pitié pour lui. Le même fait se produit aussi avec les juges. On ne voit pas la victime : elle a disparu ; y penser devient un devoir pénible. Notez que ces mêmes jurés qui ont aujourd'hui absous un assassin, s'ils assistent demain à un assassinat, voudront peut-être, avec le reste de la foule, lyncher celui qui a commis le crime.
§ 1135. À ce propos, le livre chinois de Meng-Tseu contient un récit caractéristique. Un roi voit passer un bœuf qui doit être sacrifié. Il en a pitié et ordonne qu'on y substitue un mouton. Il avoue que cela est arrivé parce qu'il voyait le bœuf et qu'il ne voyait pas le mouton [FN: § 1135-1].
§ 1136. Mais il y a d'autres cas, où l'assassin a disparu, tandis que les victimes restent ; et il est évident que, quand cela se produit, le raisonnement que nous venons de faire ne tient plus. Un cas qui peut servir de type à une classe étendue de faits, est celui de Liabeuf [FN: § 1136-1], voleur, souteneur, assassin, qui fut glorifié par certains révolutionnaires, parce qu'il tua un agent de police, et pleuré par de belles dames [FN: § 1136-2] et par de riches bourgeois qui s'adonnent au sport de la pitié tolstoïenne ou de toute autre espèce analogue. Chez les révolutionnaires, l'action peut être logique : ils sont ennemis de la police ; il est donc naturel qu'ils favorisent ceux qui la combattent. Chez certains bourgeois, l'action peut aussi être logique, avec le but d'obtenir la faveur de certains électeurs et de certains politiciens. Mais il n'en reste pas moins des individus pour lesquels ces raisons ou d'autres semblables n'ont pas de valeur, et qui accomplissent par conséquent des actions non-logiques, sentimentales. Celles-ci sont complexes. Il n'y a pas seulement chez eux un sentiment générique de pitié, mais bien un sentiment spécial de pitié pour le malfaiteur, d'autant plus intense que ce dernier est plus malfaisant. S'il n'y avait eu qu'un sentiment générique de pitié chez les bourgeois qui, poussés par le sentiment, demandaient la grâce de Liabeuf, le pleuraient, le favorisaient, ce sentiment aurait dû se manifester pour la victime et sa veuve, au moins autant que pour l'assassin. Au contraire, aucun de ces bourgeois ne songe le moins du monde à la pauvre veuve de l'agent Deray, tué par Liabeuf [FN: § 1136-3]. Qu'on y ajoute la vive opposition de beaucoup de gens à ce qu'on permette aux agents de police de faire usage de leurs armes, pour leur propre défense [FN: § 1136-4]. Il fallut les exploits des apaches Garnier, Bonnot et Cie, pour que la peur de maux futurs l'emportât sur la pitié humanitaire chez les bons bourgeois, et pour que le gouvernement permît enfin aux agents de police de faire usage de leurs armes contre les malfaiteurs qui voulaient les tuer.
§ 1137. Les sentiments sont toujours quelque peu complexes et souvent très complexes. Par conséquent, pour faire une analyse scientifique, nous devons avoir en vue principalement, non pas les personnes, mais les sentiments. Si donc nous examinons ceux-ci, nous serons amenés à décomposer la masse complexe des sentiments de pitié pour les malfaiteurs, de la façon suivante : l° le résidu sexuel : on le rencontre dans presque tous les jugements de crimes dits passionnels. 2° les résidus des sentiments des sectes, du patriotisme et d'autres analogues : nous sommes très indulgents envers les individus appartenant à notre collectivité ; indifférents ou même hostiles envers qui n'y appartient pas ; 3° les résidus de la IIe classe. La foi religieuse et la foi politique nous rendent bienveillants envers qui partage nos sentiments ; malveillants envers qui ne les partage pas. En outre, il faut tenir compte de l'avantage personnel de celui qui fait montre de pitié pour en retirer quelque avantage. C'est là une action logique. On peut diviser en trois genres les autres résidus se rapportant à la pitié. Dans l'un, prévaut le sentiment de ses propres souffrances, qui se reflète sur celles d'autrui (IV-γ 1). Dans les deux autres, le sentiment est moins personnel ou ne l'est pas du tout ; il conduit à une répugnance instinctive (IV-γ 2) pour la souffrance d'autrui, ou à une répugnance raisonnée (IV-γ 3).
§ 1138. (IV-γ 1) Pitié pour soi reportée sur autrui. Les gens qui sont malheureux, qui ont la tendance d'accuser de leurs maux le milieu dans lequel ils vivent, la société, sont portés à la bienveillance envers tous ceux qui souffrent. Ce n'est pas un raisonnement logique, mais une suite de sensations. Si nous voulons les exprimer sous forme de raisonnement, nous leur enlevons ce qui leur donne précisément de la force et de la vigueur, c'est-à-dire l'indétermination. En tenant compte de cette restriction, voici à peu près le raisonnement qui correspond à ces sensations : « Je suis malheureux ; c'est la faute de la société. Un tel est malheureux, ce doit donc être aussi la faute de la société ; nous sommes compagnons d'infortune ; j'ai pour mon compagnon l'indulgence que j'aurais pour moi-même, j'ai pitié de lui ».
§ 1139. On trouve quelque chose de semblable dans l'humanitarisme de notre époque. Des gens qui ne vivent pas dans de bonnes conditions économiques sont persuadés que c'est la faute de la société. Par analogie, ils estiment aussi que les délits des voleurs, des assassins, sont de même l'effet des fautes de la société. Aussi, voleurs et assassins leur paraissent-ils être des frères malheureux, dignes de bienveillance et de pitié. Les « intellectuels » sont persuadés de n'avoir pas une place suffisante dans la hiérarchie sociale. Ils envient les riches, les militaires gradés, les prélats, etc., en somme le reste de la haute classe sociale. Ils supposent que les pauvres, les délinquants sont, eux aussi, victimes de cette classe. Ils se sentent en cela semblables à eux ; c'est pourquoi ils éprouvent de la bienveillance et de la pitié pour eux. Quand le procès de la Tarnowska se déroulait à Venise, l'accusée reçut une poésie qui lui était adressée par une maîtresse d'école. Celle-ci lui souhaitait une prompte libération. Il se peut que cette maîtresse d'école fût une femme honnête, mais malheureuse, et que le malheur la fit compagne de l'accusée, pour laquelle elle ressentait de la pitié. Les romans de George Sand, les Misérables de Victor Hugo se sont largement vendus à des gens qui éprouvaient des sentiments semblables. Certaines femmes éprouvent indistinctement le sentiment qu'il leur serait agréable d'avoir un mari qui pourvût à leur entretien et à leur luxe, et beaucoup d'amants qui satisfissent leurs désirs amoureux. Certains hommes trouvent de même commode de faire entretenir par d'autres les femmes dont ils jouissent. Tous ces sentiments trouvent leur expression dans une théorie dite « du droit au bonheur ». En d'autres termes que ceux du beau langage, c'est simplement le droit à l'adultère. On a, par conséquent, des sentiments de bienveillance pour l'adultère, et même un peu pour les souteneurs.
§ 1140. Ces sentiments peuvent aussi agir de manière à pousser à la rebellion, aux attentats. Quand les brigands Bonnot et Garnier [FN: § 1140-1] eurent trouvé la mort, dans leur conflit avec la police, beaucoup de gens, quand ils se croyaient lésés par elle, même pour une simple contravention, criaient : « Vive Bonnot ! » Les attentats contre les souverains, les présidents de républiques, les hommes très en vue, sont souvent l'œuvre de toqués qui souffrent et donnent libre cours à leur sentiment, en s'en prenant, au hasard, à la première personne revêtue d'une dignité éminente, qu'ils rencontrent.
§ 1141. L'existence de ces résidus rend probable la bonne foi de beaucoup de ceux qui, demandant des avantages pour eux-mêmes, disent les demander pour la « société ». Il se peut donc qu'un grand nombre de ceux qui font du socialisme pratique en obtenant des avantages pour eux-mêmes, croient faire du socialisme théorique, où les avantages seraient pour tous, ou du moins pour le plus grand nombre.
§ 1142. (IV-γ 2) Répugnance instinctive pour la souffrance en général. C'est un sentiment de répulsion à la vue de la souffrance, sans qu'on s'inquiète le moins du monde si elle peut être utile. Il a donné naissance au proverbe italien : Le médecin pitoyable fait la plaie infecte. Ce sentiment s'observe souvent chez les êtres faibles, veules, privés d'énergie [FN: § 1142-1] ; et il arrive que quand ils réussissent à le vaincre, ils deviennent très cruels. Cela explique l'observation faite en plusieurs circonstances, que les femmes sont plus pitoyables et aussi plus cruelles que les hommes.
§ 1143. Chez les Grecs et chez les Romains, la coutume qu'avaient les pères de famille, de sacrifier des animaux, a probablement empêché le développement du genre de pitié noté ici. C'est à lui que recourent souvent ceux qui condamnent toutes les guerres. Ils insistent principalement sur les souffrances des blessés et des morts, sans s'arrêter à considérer l'utilité qu'elles peuvent avoir. Mais parmi ces humanitaires, il en est qui oublient facilement ces déclamations, quand d'autres sentiments l'emportent. On doit prendre en considération les souffrances des blessés et des morts, seulement lorsque cela peut être utile à certains pacifistes (§ 1559). Ce genre de pitié se retrouve abondamment chez les élites en décadence. Il peut même servir de symptôme de cet état.
§ 1144. (IV-γ, 3) Répugnance raisonnée pour les souffrances inutiles. Ce sentiment est propre aux êtres forts, énergiques, qui savent ce qu'ils veulent, et sont capables de s'arrêter au point précis qu'ils estiment utile d'atteindre. Instinctivement, les sujets d'un gouvernement comprennent très bien la différence entre ce genre de pitié et le précédent. Ils respectent, estiment, aiment la pitié des gouvernements forts ; raillent et méprisent la pitié des gouvernements faibles. Pour eux, la seconde est de la lâcheté ; la première, de la générosité. Le terme inutile est ici subjectif : il désigne un sentiment de celui qui l'emploie. En certains cas, on peut aussi savoir que certaines choses sont objectivement inutiles à la société ; mais en un très grand nombre d'autres, on demeure dans le doute, et la sociologie est bien loin d'être assez avancée pour pouvoir trancher cette question. Pourtant, conclure d'une possibilité éventuelle et lointaine d'une utilité quelconque, que les souffrances infligées sont utiles, serait un raisonnement erroné. Il faut se décider suivant les probabilités plus ou moins grandes. Il serait évidemment absurde de dire qu'il peut être utile de tuer au hasard une centaine de personnes, parce qu'il peut se trouver parmi elles un futur assassin. Mais, au contraire, un doute surgit, au sujet du raisonnement qu'on a souvent fait, pour justifier les persécutions contre les sorcières, en disant que, parmi elles, il y avait un grand nombre de vulgaires criminelles. Peut-être le doute subsisterait-il, s'il n'y avait pas quelque moyen de séparer de l'empoisonneuse la femme hystérique qui croit avoir des rapports avec le diable. Mais comme ce moyen existe, le doute disparaît et les souffrances infligées sont objectivement inutiles.
Ce n'est pas ici le lieu de continuer à exposer ces considérations, qui nous font sortir de la matière des résidus, pour nous transporter dans celle des actions logiques.
§ 1145. (IV-δ) Tendance à s'imposer à soi-même un mal pour le bien d'autrui. La vie en société a pour fondement nécessaire une bienveillance réciproque des individus. Ce sentiment peut être fort ou léger, mais ne peut faire entièrement défaut. Il se manifeste chez les animaux comme chez les hommes par une aide mutuelle et par la commune défense, ou bien, en un mot, par le fait que l'individu souffre pour le bien d'autrui. On observe aussi de semblables phénomènes chez les animaux qui ne vivent pas en société, dans leurs rapports avec leur progéniture qui est nourrie par l'un des parents ou par tous les deux. La lionne partage sa proie avec ses lionceaux ; le faucon et sa femelle avec leurs petits. On peut voir, dans nos maisons, le canari donner la becquée à sa femelle et à ses petits.
§ 1146. Tous les faits connus induisent à croire que le sentiment grâce auquel l'homme aide et défend la famille et la collectivité à laquelle il appartient est, au moins en partie, semblable à celui qu'on observe chez les animaux. La différence consiste en ce que l'homme recouvre ses actions d'un vernis logique. On a fait de très belles théories pour démontrer que l'homme doit aimer sa patrie. Mais l'effet de ces théories est presque nul. En tout cas, il est insignifiant, en comparaison du sentiment non-logique qui pousse au patriotisme. Il faut vraiment avoir l'esprit malade des songe-creux du « contrat social », de la « dette sociale », de la « solidarité », pour se figurer que les hommes défendent leur patrie comme l'associé d'une entreprise commerciale paie sa quote part.
§ 1147. Les sentiments par lesquels un homme s'impose un mal, afin d'être utile à autrui, agissent sur les individus composant une collectivité, non seulement pour les pousser directement à exécuter certains actes, mais aussi pour les induire à approuver, ou même à admirer ceux qui les accomplissent. Par ce moyen, ils agissent indirectement sur l'individu qui est poussé à exécuter certains actes, non seulement par son sentiment favorable à ces actes, mais aussi, et souvent plus encore, par le désir d'obtenir l'approbation d'autrui, d'en éviter le blâme. Vice versa, ainsi que nous le verrons en général au § 1161, là où nous trouvons certains actes exécutés pour satisfaire ce dernier désir, nous pouvons conclure avec certitude que, dans la collectivité, il existe des sentiments correspondant aux résidus de l'espèce (δ).
§ 1148. (IV-δ 1) Tendance à exposer sa vie. On expose ou même on sacrifie sa vie, poussé par un sentiment intime de sociabilité, et par l'importance qu'on attache à l'estime d'autrui. Chez les animaux, il semble que le premier sentiment puisse seul agir. Des mâles polygames ont l'habitude de défendre leurs femelles. Il est commun d'observer que le coq défend ses poules, le taureau ses vaches. Quand des animaux domestiqués, même d'espèces différentes, vivent ensemble, ils se défendent réciproquement. On voit un chien défendre le chat de la maison, et celui-ci défendre un petit chien. Chez les hommes, il est impossible, dans le plus grand nombre des cas, de distinguer un sentiment de ce genre, d'un autre sentiment qui pousse à désirer l'approbation de la collectivité. Tacite nous dit que, chez les Germains, les chefs étaient entourés de compagnons qui combattaient courageusement pour les défendre, et qui étaient notés d'infamie, s'ils revenaient vivants d'une bataille où leur chef avait péri [FN: § 1148-1]. Le général japonais Nogi, vainqueur de Port-Arthur, se tua avec sa femme, le jour des funérailles du Mikado. Dans ce cas, le sacrifice de la vie n'avait pas d'utilité directe. C'était une simple manifestation de sentiments de sociabilité, de hiérarchie, mêlés à la persistance d'agrégats des anciens Samouraï, et à des sentiments du désir de l'approbation de ceux précisément qui avaient ces sentiments.
§ 1149. (IV-α 2) Partage de ses biens avec autrui. Par degrés insensibles, de la forme précédente on passe à celle-ci, moins accusée, où l'on renonce en faveur d'autrui seulement à certaines jouissances. Là encore, les exemples sont innombrables chez les animaux et chez les hommes.
§ 1150. La fillette qui habille sa poupée et lui offre des aliments ne fait pas qu'imiter sa mère : elle manifeste aussi un sentiment qui surgit spontanément en elle, comme il se manifeste chez l'hirondelle qui a couvé pour la première fois et qui porte de la nourriture à ses petits.
§ 1151. Le présent résidu, combiné avec ceux de la IIe classe, donne lieu à des sacrifices qui sont offerts à des objets inanimés ou animés, à des morts, aux dieux. D'autres causes peuvent ensuite s'ajouter à celles-ci, dans les phénomènes plus complexes.
§ 1152. En examinant les choses d'une façon superficielle, on pourrait croire qu'on rencontre ce résidu chez tous les individus de la classe dominante qui prennent le parti de la classe sujette ; mais il n'en est pas ainsi ; et, en y regardant bien, on voit qu'on peut répartir ces individus dans les catégories suivantes. 1° Les personnes qui se mettent à la tête des gens sujets, afin d'obtenir ainsi quelque avantage politique, financier ou autre. L'histoire est pleine des faits et gestes de ceux-là. Les aristocraties tombèrent habituellement sous leurs coups. Autrefois, ils ne pouvaient employer que la violence, ce qui restreignait leur nombre. Maintenant, grâce aux moyens pacifiques des élections, leur nombre s'est accru démesurément ; car, pour assurer leur succès, il n'y a pas besoin d'une révolution. En outre, la démocratie offre un débouché à toutes les ambitions, depuis l'électeur influent d'une commune, aux conseillers communaux, provinciaux, aux députés, aux sénateurs : du modeste emploi obtenu grâce à la faveur du député, jusqu'à la charge de directeur général ou de conseiller à la Cour de Cassation. Combien de gens font aujourd'hui les socialistes pour obtenir ces charges, comme ils feraient les réactionnaires, si un gouvernement de ce genre venait au pouvoir ! 2° Des gens qui, dans l'intérêt de leurs affaires, se soumettent aveuglément aux ordres de leurs maîtres. En France, sous la Restauration, le « bon jeune homme » allait à la messe. Sous le règne de Louis-Philippe, il lisait les œuvres de Voltaire. Sous le second Empire, il était tout à son honneur de dire qu'« il ne s'occupait pas de politique ». Aujourd'hui, au contraire, il doit s'en occuper, être blocard [FN: § 1152-1], humanitaire, socialiste, peut-être même de l'opposition. Demain, peut-être devra-t-il être nationaliste. Aujourd'hui, les industriels et les financiers ont découvert qu'ils peuvent trouver leur avantage en s'alliant aux socialistes. Vous voyez des industriels et des banquiers, riches à millions, qui réclament des « lois sociales », et vous pourriez croire qu'en eux c'est le pur amour du prochain qui agit, que c'est, enflammés par cet amour, qu'ils brûlent de partager leurs biens. Mais faites bien attention à ce qui arrivera après l'adoption des « lois sociales », et vous verrez que leur richesse ne diminue pas, qu'elle s'accroît ; en sorte qu'ils n'ont rien donné du tout aux autres; au contraire, ils en ont retiré quelque chose. En France, le ministère Caillaux-Bertaux était constitué. en grande partie de millionnaires. Chez eux, même en y regardant au microscope, on ne trouvait pas trace du désir de partager ses biens avec autrui. En Italie, le ministère « démocratique » Giolitti avait à la Chambre, une majorité de gens qui paraissaient s'entendre fort bien en « affaires », spécialement lorsqu'il s'agissait des leurs. L'appui du trust métallurgique ne lui faisait pas défaut, ni celui des sucriers. Mais il est quelque peu douteux que le désir de partager ses biens avec autrui poussât tous ces braves gens. Ils devinrent nationalistes et belliqueux, quand ce fut leur intérêt ; et ils approuvèrent le suffrage universel étendu aux illettrés, quand le maître leur assura que c'était un excellent moyen d'obtenir de « bonnes élections [FN: § 1152-3] » et de gagner ainsi des sommes rondelettes.
En Angleterre, Lloyd Georges veut bien distribuer au « pauvre peuple » la fortune des lords, mais il est bon ménager de la sienne, et ne dédaigne pas les spéculations de bourse. Personne n'a jamais su ce qu'a donné à autrui son collègue John Burns ; mais tous voient ce qu'il a reçu et les beaux traitements qu'il a su obtenir... poussé par le désir de faire le bien d'autrui. 3° Les gens qui, de bonne foi, sont disposés à donner quelque chose à autrui, parce qu'ils comprennent instinctivement qu'ils recevront davantage : ils donnent un œuf pour recevoir un bœuf. Il y a chez eux le présent résidu, combiné avec d'autres qui font espérer l'avantage désiré. 4° Finalement, un petit nombre d'« intellectuels » manquant d'énergie, de connaissances, de bon sens, qui prennent au sérieux les déclamations des catégories précédentes ; mais leur nombre est très restreint, et plusieurs de ceux qu'on serait tenté de ranger dans cette catégorie appartiennent au contraire aux précédentes. 5° On ne peut enfin nier qu'il puisse y avoir des personnes ayant de l'énergie, des connaissances, du bon sens, et qui, en défendant les doctrines sociales de la solidarité, soient vraiment poussées par le désir de partager leurs biens avec autrui ; mais il n'est pas facile d'en trouver des exemples. Saint-Simon était riche et mourut pauvre et abandonné. Il semblerait donc pouvoir être cité comme l'un de ces exemples. Mais il dilapida ses biens pour se procurer des jouissances ; et dans la pauvreté, il eut l'orgueil d'être un messie, le fondateur d'une religion nouvelle. C'est là que gît le principal mobile de ses actes. Toutes ces catégories se retrouvent, par exemple, chez ceux qui suivent la doctrine de la « solidarité », qu'on invoque beaucoup plus pour demander que pour donner ; et ceux qui y croient sans arrière-pensée sont aussi rares que les merles blancs. Comme nous l'avons déjà noté (§ 1147), et comme nous le verrons encore (§ 1162), l'existence de ces diverses catégories n'enlève rien à l'importance des sentiments manifestés par les résidus du présent genre ; au contraire, elle démontre combien elle est grande ; car, fût-ce indirectement, on y recourt et l'on s'en sert sous des formes nombreuses et variées.
§ 1153. (IV-ε) Sentiments de hiérarchie. Les sentiments de hiérarchie, tant de la part des inférieurs que de celle des supérieurs, s'observent déjà chez les animaux, et sont très répandus dans les sociétés humaines. Il semble même que là où celles-ci sont quelque peu complexes, elles ne pourraient subsister sans ces sentiments. La hiérarchie se transforme, mais subsiste pourtant toujours dans les sociétés qui, en apparence, proclament l'égalité des individus. Il s'y constitue une espèce de féodalité temporaire dans laquelle on descend des grands politiciens aux plus petits. Qui en douterait n'a qu'à essayer, en France ou en Italie, d'obtenir quoi que ce soit sans l'appui de, l'électeur influent ou du député, du chef, en art, en science, dans l'administration, ou bien du camoriste. Parmi les sentiments de hiérarchie, nous pouvons placer le sentiment de déférence que l'individu éprouve pour la collectivité dont il fait partie, ou pour d'autres, et le désir d'en être approuvé, loué, admiré.
§ 1154. S'imaginer que l'ancienne féodalité, en Europe, fut imposée exclusivement par la force est une chose absurde. Elle se maintenait en partie par des sentiments d'affection réciproque, qui s'observèrent aussi dans d'autres pays où existait la féodalité ; par exemple, au Japon. On peut répéter la même chose pour la clientèle romaine, pour les maîtrises du moyen âge, pour les monarchies et, en général, pour toutes les organisations sociales où existe une hiérarchie ; celle-ci ne cesse d'être spontanée pour être imposée exclusivement ou d'une manière prépondérante par la force, qu'au moment où elle est sur le point de disparaître. Nous disons prépondérante, parce que le secours, même très atténué, de la force ne fait jamais défaut.
§ 1155. (IV-ε 1) Sentiments des supérieurs. Ce sont des sentiments de protection et de bienveillance, auxquels s'ajoutent souvent des sentiments de domination et d'orgueil. Ces derniers peuvent coexister avec des sentiments d'humilité apparente, ainsi qu'on en a des exemples dans les corporations religieuses et chez les ascètes. On peut, de bonne foi, éprouver de l'orgueil à être plus humble qu'un autre.
§ 1156. (IV-ε 2) Sentiments des inférieurs. Ce sont des sentiments de sujétion, d'affection, de respect, de crainte. Éprouver ces sentiments est une condition indispensable à la constitution des sociétés animales, à la domestication des animaux, à la constitution des sociétés humaines. En réalité, on les observe souvent, aussi chez ceux qui se disent anarchistes, et parmi lesquels il y a des hommes qui sont, mais ne s'appellent pas des chefs. Il ne manque pas d'anarchistes pour accepter avec une foi superstitieuse l'autorité de médecins et d'hygiénistes, souvent quelque peu charlatans. Les manifestations du sentiment d'autorité sont très nombreuses et fort diverses. On accepte l'autorité de qui a ou est présumé avoir quelque signe, réel ou imaginaire, de supériorité [FN: § 1156-1]. De là le respect du jeune homme pour le vieillard ; du novice pour l'homme expert ; autrefois : de l'illettré pour le lettré, de celui qui ne parlait qu'en langue vulgaire, pour celui qui s'exprimait en latin ; de l'homme du peuple pour le noble, pour un souverain souvent fort méprisable ; aujourd'hui : de l'ouvrier qui n'appartient pas à un syndicat et de beaucoup de bourgeois pour le syndicaliste ; du faible pour le fort ou celui que l'on croit tel ; de l'homme d'une race pour celui d'une autre, réputée supérieure ; de la femme pour l'homme, quand elle ne domine pas, en raison d'autres circonstances; des sujets pour le souverain ; des fidèles pour le prêtre, pour le prophète, pour l'ascète, pour l'homme que l'on croit être plus que d'autres dans les bonnes grâces de la divinité ; de l'électeur pour le politicien ; de l'homme simple pour l'homme mystérieux, pour le devin, pour le charlatan ; aujourd'hui, spécialement pour le médecin, pour l'hygiéniste, pour qui préconise des « mesures sociales », pour qui se révèle prêtre du dieu Progrès ; de pauvres d'esprit pour la femme libre, qu'ils se figurent dépourvue des appétits de son sexe ; de l'ancienne béguine pour quelque moinillon ; de la nouvelle béguine pour les pontifes de l'humanitarisme ; et ainsi de suite.
§ 1157. En vertu de la persistance des abstractions (§ 1060 et sv.), le sentiment d'autorité peut se détacher plus ou moins de l'homme, et s'attacher au signe, réel ou présumé, de l'autorité. De là naît l'utilité, pour qui jouit de l'autorité, de maintenir le prestige, l'apparence de la supériorité. L'écart peut être complet, et le sentiment d'autorité peut s'appliquer à des objets inanimés ; ainsi le respect que beaucoup de personnes portent à ce qui est écrit, imprimé, et, en certains pays, écrit sur papier timbré (§ 1430). Ce résidu tient une place plus ou moins grande en d'autres phénomènes, comme le fétichisme, l'adoration des reliques, etc.
§ 1158. Dans la Mandragore de Machiavel, le préjugé vulgaire du respect envers qui parle latin est fort bien mis en lumière [FN: § 1158-1]. Molière s'en moque aussi. Mais il y eut un temps où c'était l'opinion des gens bien pensants, que l'on devait chercher la vérité historique dans les textes latins, et qu'un texte méritait créance, par le seul fait qu'il était écrit en latin [FN: § 1158-2]. En des temps même très rapprochés de nous, on croyait qu'un manuscrit était certainement d'autant meilleur qu'il était plus ancien. La paléographie a montré que certains manuscrits anciens sont moins corrects que d'autres, plus récents.
§ 1159. En Angleterre, il existait un singulier privilège, dit privilegium clericale, the benefit of Clergy, par lequel certaines personnes échappaient à la condamnation, au moins une première fois, quand elles avaient commis un crime. Ce privilège s'appliquait non seulement à ceux qui étaient dans les ordres sacrés, mais à quiconque savait lire. Blackstone, qui veut en donner un motif logique, dit [FN: § 1159-1] qu'« en ces temps, l'ignorance et la superstition étaient si grandes que quiconque savait lire et écrire était appelé clerc, clericus, et de ce fait, sans être dans les ordres sacrés, jouissaient des immunités du clergé ». Mais les hommes de ce temps n'étaient pas assez stupides pour considérer comme appartenant au clergé des gens qu'ils savaient fort bien ne pas y appartenir. Le privilège n'avait donc pas cette origine. Il provenait, au contraire, du respect qu'on avait pour le clergé et pour d'autres catégories analogues de citoyens. Le roi Jacques Ier, par son Statut 21, c. 6, étendit aux femmes, même si elles ne savaient pas lire, le privilège du clergé, lorsqu'elles seraient convaincues d'un vol d'une valeur moindre que dix shellings. Les Statuts 3, 4, 5, de Guillaume et de Marie étendirent sans restriction aux femmes le privilège du clergé, dont jouissaient les hommes. Il est donc évident que, même en un temps assez rapproché de nous, c'était là simplement un privilège accordé à certaines catégories de personnes, estimées dignes d'égards spéciaux, et parmi lesquelles se trouvaient justement celles qui savaient lire et écrire.
§ 1160. (IV-ε 3) Besoin de l'approbation de la collectivité. C'est l'un des cas où apparaît le mieux la différence entre le sentiment et sa manifestation, qui constitue le résidu. Le besoin que l'individu éprouve d'être bien vu de la collectivité, d'en obtenir l'approbation, est un sentiment très puissant [FN: § 1160-1], et c'est vraiment le fondement de la société humaine. Mais il agit tacitement, souvent sans être exprimé. Il arrive même que celui qui recherche le plus l'admiration, la gloire, fasse semblant de ne pas s'en soucier. Il peut aussi arriver, bien que cela paraisse étrange, que chez un même individu cette préoccupation existe réellement, tandis que, sans s'en apercevoir, il se laisse effectivement guider par l'approbation ou par l'admiration d'autrui. Cela se voit chez les ascètes de bonne foi.
§ 1161. Presque toujours, les sentiments de sociabilité, manifestés par les diverses espèces de résidus que nous examinons, sont accompagnés par le sentiment du désir d'être approuvé par autrui ou d'en éviter le blâme. Mais il n'est pas tellement fréquent que ce sentiment se manifeste au moyen du résidu correspondant. Vice versa, ce résidu en recouvre parfois d'autres. Par exemple, un individu dit être poussé par le désir d'obtenir l'estime d'autrui, tandis que, dans une certaine mesure, aussi faible soit-elle, il est aussi poussé par le désir d'accomplir la chose qui mérite cette estime. Quand un homme fait une chose en disant: « Ceci est bien », ou s'abstient d'en faire une autre, en disant : « Ceci est mal », on peut se demander si ces expressions signifient : « Ceci est approuvé par la collectivité – ceci est blâmé par elle », ou bien: « Ceci s'accorde avec mon sentiment – ceci y répugne ». Généralement, ces deux causes agissent ensemble : l'approbation ou le blâme de la collectivité renforce le sentiment qui existe déjà chez l'individu (§ 163). Il peut assurément se trouver un parfait hypocrite qui, n'ayant aucune envie de faire une chose, l'accomplit pour obtenir l'estime publique. Il peut se trouver un lâche qui se fait tuer à la guerre, pour fuir l'infamie de la lâcheté. Mais ces gens ne sont pas si fréquents. Habituellement, celui qui a un faible désir de faire une chose l'accomplit pour obtenir l'estime publique ; celui qui est courageux s'exalte et se fait tuer, poussé par l'idée de la gloire.
§ 1162. Remarquons que, pour montrer l'importance du sentiment correspondant à notre résidu, il faut aussi tenir compte des cas notés tout à l'heure, où l'individu n'est pas du tout ou pas entièrement poussé par un sentiment correspondant à ce résidu, mais bien, en tout ou partie, par le désir d'obtenir l'approbation de la collectivité ou d'en éviter le blâme; car si ce résidu n'agit pas directement sur l’individu, il agit indirectement, par le moyen de l'approbation ou du blâme d'autrui ; et c'est parce que ce sentiment est fort dans la collectivité, que l'approbation et le blâme sont puissants. Même l'ascète parfaitement hypocrite démontre la puissance de l'ascétisme, dans la collectivité dont l'opinion lui importe. L'hypocrisie de l'ascète lui est utile, et se produit uniquement dans la mesure où l'ascétisme est approuvé, admiré par cette collectivité ; si elle le réprouvait ou ne s'en souciait nullement, l'hypocrisie n'aurait plus de but.
§ 1163. (IV-ζ) Ascétisme. Chez les hommes, on observe un genre spécial de sentiments, qui n'a aucune correspondance chez les animaux, et qui pousse l'individu à s'infliger des souffrances, à s'abstenir de plaisirs, sans aucun but d'utilité personnelle, à aller au rebours de l'instinct qui pousse les êtres vivants à rechercher les choses agréables et à fuir les choses désagréables. Voilà le noyau des phénomènes connus sous le nom d'ascétisme.
§ 1164. Si nous ne connaissions qu'un genre d'ascétisme, par exemple l'ascétisme catholique, nous pourrions difficilement distinguer du résidu la dérivation. Un homme fait pénitence, parce qu'il croit être agréable à Dieu et faire amende honorable de ses péchés. Ce sentiment religieux pourrait être le résidu, et la pénitence, la conséquence logique du résidu. En effet, i1 y a des cas où il semble bien qu'il en soit ainsi. Mais il y a d'autres cas, dans lesquels la partie variable est la raison de la pénitence ; bien plus, où la pénitence elle-même devient une simple renonciation aux biens de la vie ; et c'est là la partie constante. Tandis que les motifs varient avec la diversité des idées que l'homme a de la divinité, il reste une partie constante, qui est l'idée religieuse en général. Mais voici qu'il y a des ascètes, comme les anciens cyniques, dépourvus de toute idée religieuse, et par conséquent cette partie constante s'évanouit aussi [FN: § 1164-1]. Voici les Spartiates qui sont ascètes, uniquement pour maintenir une forte discipline ; voici les bouddhistes, qui sont ascètes pour mettre un frein à toute énergie vitale ; voici finalement, parmi nos contemporains, des gens qui se font ascètes au nom de la sainte Science, laquelle, à ce qu'ils disent, condamne l'usage des boissons alcooliques ; d'autres ont peur de regarder une belle femme, au nom d'une morale sexuelle qui leur est propre, en vertu de laquelle – on ne sait pourquoi – le plaisir sexuel est le pire des pires crimes ; en voici d'autres qui ne peuvent souffrir la littérature amusante ; d'autres encore, qui font la guerre aux œuvres théâtrales qui n'engendrent pas l'ennui, qui ne « résolvent pas quelque question sociale »; et ainsi de suite. Il est donc manifeste que la partie constante se trouve dans les souffrances que les hommes s'infligent à eux-mêmes ; la partie variable, dans les motifs qu'ils ont – ou prétendent avoir – pour le faire.
§ 1165. Le résidu principal se trouve dans cette partie constante mais il n'y est pas seul. Tous les phénomènes de la société sont complexes, mélangés, renferment de nombreux résidus. Ici, outre le résidu de l'ascétisme, nous avons souvent, chez l'ascète, le résidu de l'orgueil ; car il se sent supérieur au commun des mortels, et chez ceux qui l'admirent, nous avons justement la reconnaissance de cette supériorité (§ 1161). Parfois, il y a le résidu religieux; d'autres fois, quand on veut imposer l'ascétisme à autrui, le résidu de l'uniformité ; d'autres fois encore, le résidu d'une utilité présumée, réelle ou imaginaire, etc. Il faut éliminer tous ces résidus, pour arriver à celui de l'ascétisme pur.
§ 1166. Maintenant que nous l'avons trouvé, il nous reste encore à savoir à quels autres résidus il est analogue, c'est-à-dire dans quelle classe nous devons le mettre [FN: § 1166-1]. La chose n'est pas facile ; et il semblerait presque qu'on devrait en faire une classe à part. Mais nous ne tardons pas à voir que les actes d'ascétisme font partie d'une grande classe qui comprend des actes d'abstinence, de renonciation aux jouissances, de maux qu'un individu s'inflige volontairement à lui-même. Dans cette classe, les genres se distinguent par le but de ces sacrifices et par leur intensité. Deux individus réduisent volontairement leur consommation de pain, l'un en temps de famine, pour qu'il y ait un peu de pain pour tout le monde, l'autre en temps d'abondance, dans le seul but de s'infliger une peine. Ce sont évidemment deux genres distincts d'actes, bien que le second puisse être considéré comme une manifestation différente de certains instincts qui existaient aussi chez le premier. Quatre individus s'abstiennent de boire du vin ; le premier, parce qu'il a reconnu que le vin nuit à sa santé ; le second, pour épargner l'argent qu'il consacre au vin et en faire jouir ses enfants ; le troisième, pour donner le bon exemple de l'abstinence à un ivrogne qui se ruine, lui et sa famille ; le quatrième, pour s'infliger une peine. Nous avons ainsi quatre genres différents d'actes. Le premier dépend de l'égoïsme : des résidus de l'intégrité personnelle. Le second et le troisième dépendent de l'amour du prochain, des résidus de la sociabilité. Le quatrième se distingue de ces deux derniers, d'abord parce que le but qu'on observe en eux disparaît, au moins en partie, et souvent à cause de l'intensité des sentiments, qui est habituellement plus grande. On peut donc faire une seule catégorie des trois derniers genres d'actes, et considérer le quatrième genre comme un cas particulier des instincts qui nous donnent les deux autres.
§ 1167. De cette façon nous sommes sur la voie de trouver la place des actes d'ascétisme, dans une classification naturelle : ils nous apparaissent comme des actes qui dépendent des résidus de la sociabilité, et dans lesquels s'atténue, s'affaiblit et peut même disparaître le but de la sociabilité, tandis que l'intensité s'accroît, grandit démesurément, devient hyperbolique. En général, l'abstinence d'un individu, outre qu'elle peut être utile à l'individu lui-même, cas dont nous ne nous occupons pas ici, peut être utile aux autres, à la collectivité. Là où la nourriture fait défaut, le jeûne est utile. Là où il y a peu de richesse, s'abstenir des consommations voluptuaires est utile à la collectivité. Si tous les hommes cédaient à l'instinct sexuel sitôt qu'ils voient une femme, la société humaine se dissoudrait. L'abstinence, dans ce domaine, est donc très utile ; et cela explique comment l'ascétisme sexuel est très répandu. Ce n'est pas qu'il ait artificiellement pris naissance de ce but, mais c'est parce que, comme manifestations de certains sentiments, il ne rencontra pas d'obstacles dans l'utilité sociale. Aussitôt après vient l'ascétisme alimentaire, qui se manifeste par les jeûnes, par l'usage restreint d'aliments grossiers, car le besoin de nourriture était l'un des principaux des sociétés anciennes, et les famines y étaient fréquentes. Observons que les résidus de l'orgueil, de l'admiration, et autres semblables sont aussi favorisés par ces circonstances, car s'abstenir de rapports sexuels et de nourriture est une preuve de volonté peu commune.
§ 1168. Prévoir, savoir s'abstenir d'un bien présent en vue d'un bien futur est très utile à la collectivité ; c'est même une condition indispensable à sa civilisation. L'économie, très utile à l'individu, peut s'hypertrophier jusqu'à l'avarice ; de même, pour la collectivité, l'abstention des biens présents peut s'hypertrophier jusqu'à l'ascétisme. Notons que la jouissance présente est souvent représentée par le plaisir des sens ; la jouissance future, fruit de l'abstinence et de la prévoyance, est représentée par des réflexions intellectuelles. De là naît l'un des nombreux motifs pour lesquels on subordonne les sens à l'intelligence. L'ascète va plus loin et déclare vain tout plaisir procuré par les sens. Il y a des gens qui poussent encore plus loin dans cette voie ; le plaisir des sens n'est pas seulement vanité : [Voir Addition A23 par l’auteur]il devient une faute, un crime, et l'on doit passer sa vie à mortifier ses sens. Il est souvent utile à la collectivité que l'individu se sacrifie lui-même à sa foi ; et l'admiration pour les martyrs provient, au moins en partie, de ce sentiment instinctif. L'individu qui se voue entièrement à une foi, qui ne voit rien d'autre dans le monde, semble facilement aux hommes pondérés n'être pas très sain d'esprit. En poussant à l'extrême limite dans cette voie, on trouve les ascètes chrétiens qui, par ascétisme, simulaient la folie [FN: § 1168-1].
§ 1169. L'admiration pour les signes extérieurs de l'ascétisme provient en partie de l'utilité que pourraient avoir parfois, et moyennant certaines restrictions, les actes de l'ascétisme. En général, les hommes n'y regardent pas de si près, et prennent facilement l'indice pour la chose. On trouve une autre origine du sentiment d'admiration, dans l'envie et dans le sentiment qui pousse l'homme privé de certaines jouissances à désirer que d'autres hommes en soient aussi privés. Il se sent leur compagnon, et admire ceux qui, spontanément, se privent de ce qu'une dure nécessité lui enlève. Cela explique en partie la faveur que les ordres mendiants acquirent auprès de la plèbe, et fait comprendre aussi le phénomène général de l'admiration pour la chasteté. Pour beaucoup d'êtres humains, la société de femmes jeunes et belles est un luxe qu'ils ne peuvent se procurer. La jalousie du mâle leur fait détester ceux qui peuvent en jouir. Les sentiments d'un sacrifice commun leur font admirer ceux qui, pouvant en jouir, s'en privent. Beaucoup de féministes haïssent l'homme et persécutent les femmes qui jouissent des plaisirs de l'amour, uniquement parce qu'elles n'ont pu trouver un homme qui les aime. De tout temps, on a remarqué qu'un grand nombre d'êtres humains méprisent ce qu'ils ne peuvent avoir, et tiennent pour louable ce mépris chez eux-mêmes et chez les autres.
§ 1170. Il y a certains actes qui ne semblent pas du tout pouvoir être directement utiles à la collectivité. Par exemple, quel avantage celle-ci peut-elle tirer du fait qu'un homme vit sur une colonne ? Mais il faut observer qu'indirectement, les sentiments qui se manifestent de cette façon et d'autres manières qui sont ridicules, peuvent être utiles, en tant qu'ils correspondent à une domination sur les instincts sensuels et matériels, qu'on ne trouve pas chez tous les hommes. À propos de ces actes et des autres qui, pouvant être utiles à la collectivité, entre d'étroites limites, dépassent, et souvent de beaucoup, ces limites, nous observerons que, chez l'homme comme chez l'animal, on trouve une tendance à continuer certains actes, quand même leur utilité cesse pour l'individu qui les accomplit. Ainsi, un chat qui n'a pas de souris à prendre, joue avec une boule de papier comme si c'était une souris. Des écureuils auxquels on donne autant de nourriture qu'ils en veulent, continuent à faire des provisions. Le chien auquel on donne autant de pain qu'il en veut, enterre un gros morceau de pain qui lui reste, puis le déterre pour le manger, alors qu'il en a d'autres à sa disposition.
§ 1171. Les actes de l'ascétisme sont en grande partie des actes qui ont un résidu inhérent à la vie sociale, et qui persistent quand ils ont cessé d'être utiles ; ou bien qui acquièrent une intensité qui les porte au delà du point où ils seraient utiles. Le résidu de l'ascétisme doit donc être placé parmi les résidus en rapport avec la sociabilité, et représente souvent une hypertrophie des sentiments de sociabilité.
§ 1172. Cette dernière circonstance explique pourquoi les ascètes sont souvent très égoïstes. En se développant outre mesure, l'ascétisme a attiré à lui tous les instincts de sociabilité de l'individu ; il ne lui en reste plus pour faire preuve de bienveillance envers autrui, et souvent, pas même envers sa famille [FN: § 1172-1] (§ 1187).
§ 1173. L'instinct de sociabilité est beaucoup plus développé dans la race humaine que chez les animaux. C'est pourquoi l'on ne trouve l'ascétisme que chez les hommes. De même, l'intelligence de l'homme étant très supérieure à celle des animaux, la folie est une maladie propre aux hommes.
§ 1174. Mais si le noyau de l'ascétisme est une hypertrophie de certains instincts relatifs à la sociabilité, il s'en suit, comme il arrive généralement en des phénomènes analogues, qu'autour de ce noyau se disposent d'autres manifestations qui sont étrangères à la sociabilité. L'abstention de choses utiles à autrui attire à elle, par imitation, l'abstention de choses qui ne sont d'aucune utilité à autrui, ou même de choses telles que s'en abstenir porte préjudice à autrui. L'abstention de choses utiles, comme les vêtements, les aliments et autres objets semblables, est souvent accompagnée, chez les ascètes, d'actes ridiculement inutiles, comme ceux des stylites, qui se tenaient debout sur une colonne, ou d'actes qui nuisent à la collectivité, comme la saleté, qui va souvent de pair avec d'autres actes d'ascétisme.
§ 1175. Dans nos sociétés, la manifestation de l'ascétisme qui apparaît dans les macérations et les mutilations, a presque cessé, ou a cessé entièrement. Elle aussi peut avoir été, autrefois, une hypertrophie des instincts qui poussaient les individus à souffrir pour la collectivité. Par exemple, c'était probablement le cas de la flagellation rituelle, dont nous avons des exemples en de nombreux pays et à différentes époques, avec des dérivations justificatives, variant selon les pays et les époques (§ 1190).
§ 1176. Dans les phénomènes de l'ascétisme, on observe souvent l'hypocrisie. Il semble même que le type du parfait hypocrite soit celui qui feint l'ascétisme. On en a trop dit sur ce sujet pour que nous y ajoutions quelque chose. Mais outre ce cas où le noyau de l'ascétisme disparaît entièrement des phénomènes, il y en a d'autres, où il est réduit presque jusqu'à disparaître, tandis que d'autres résidus prévalent dans le phénomène composé.
§ 1177. Quand on observe un certain nombre de cas concrets d'ascétisme, en apparence égaux, il est difficile, disons tout à fait impossible de les diviser, même approximativement, entre les différentes classes [FN: § 1177-1]. D'habitude, on se trompe autant si on y suppose en tous la bonne foi, que si l'on y voit uniquement des manifestations d'hypocrisie. Il y a des ascètes francs et sincères ; et, même pour ceux-là, nous ne savons pas ce que peut en eux le résidu de l'ascétisme ou la dérivation qui, née de ce résidu, en reproduit ensuite les actes correspondants, même quand il vient à disparaître. Il y a ceux qui sont mus par le besoin d'imiter ; chez beaucoup, il est prépondérant ; d'autres, qui sont poussés plus ou moins par leur intérêt, par des sentiments variés ou complexes, étrangers à l'ascétisme. Enfin, il y a les hypocrites. Pour ceux-là aussi, on observe divers degrés : tel est en partie ascète et en partie hypocrite ; tel autre est entièrement ou presque entièrement hypocrite [FN: § 1177-2].
§ 1178. Chez les dominicains de la vertu, qui, de nos jours, persécutent ce qu'ils appellent l'immoralité, il y a de même un petit nombre de gens convaincus, étrangers à tout plaisir sexuel. D'autres, peu nombreux, agissant avec sincérité, vainquent les désirs de la chair par l'idée « morale ». D'autres, en nombre considérable, trouvent dans leur action pour la « morale » le prétexte cherché de s'occuper de choses obscènes. Ils ne liraient pas un livre obscène par plaisir : ils le lisent pour prendre connaissance de ce qu'ils croient qu'on doit réprimer comme crime. Des femmes qui eurent beaucoup d'amants dans leur jeunesse, parvenues à l'âge mûr, s'occupent volontiers de remettre les prostituées dans le droit chemin, et jouissent par la conversation de ce qui vient à leur manquer matériellement. Jusque là, le résidu de l'ascétisme accompagne les autres ; mais il disparaît chez les hypocrites, chez les personnes qui haïssent l'autre sexe, parce qu'elles sont trop attirées par le leur ; chez celles qui compensent la lascivité de leurs actes par l'austérité de leurs paroles ; chez les pauvres d'esprit qui répètent comme des perroquets ce qu'ils entendent dire à autrui. En un mot, ce sont des actes concrets, qui ont une apparence semblable, et sont issus des causes les plus diverses [FN: § 1178-1].
§ 1179. Parmi les résidus étrangers à l'ascétisme, qui, dans les cas concrets, s'ajoutent au résidu de l'ascétisme, ceux de l'intégrité personnelle (Ve classe) sont remarquables. Ils se manifestent par l'orgueil de l'ascète ; et, grâce à eux, l'ascétisme devient une espèce de sport. Les cyniques d'Athènes jouissaient certainement de la surprise ou de l'étonnement dont, en voyant leurs actes, les autres gens faisaient preuve. Le récit du fait, vrai ou imaginé, de Platon qui, accusé d'orgueil par Diogène, lui retourne l'accusation, manifeste les sentiments que beaucoup éprouvaient pour les bizarreries des cyniques [FN: § 1179-1] ; et l'on peut en dire autant du récit que Lucien fait de la mort de Peregrinos. Quand Daniel monta sur sa colonne (§ 1187-5), il ne manqua pas de gens qui crurent qu'il le faisait par vanité.
§ 1180. En outre, dans tous les temps et dans tous les pays, la vie ascétique, sincère ou simulée, ou en partie sincère et en partie simulée, permit à beaucoup de gens d'obtenir des honneurs et des subsides du vulgaire [FN: § 1180-1]. Il convient de noter que tous les hommes ne ressentent pas également les douleurs physiques ; et, de même qu'autrefois il y avait des gens qui résistaient longtemps à la torture, et d'autres qui en étaient aussitôt accablés, de même il y en a qui supportent facilement, par ascétisme, des douleurs que d'autres ne pourraient tolérer en aucune façon. L'histoire des tatouages, des mutilations diverses, des cruautés employées contre les prisonniers de guerre, chez les sauvages américains et chez d'autres peuples, confirment ces déductions [FN: § 1180-2].
§ 1181. En Orient, on observa des faits extraordinaires d'ascétisme, et on en observe encore. Ces peuples ont pour la douleur physique l'endurance des sauvages et des brutes: aussi n'est-il pas très étonnant qu'il se trouve parmi eux des gens qui, pour se faire admirer, et parfois aussi pour gagner de l'argent, se soumettent à de cruelles pratiques. Sonnerat décrit bien les multiples formes de l'ascétisme, aux Indes [FN: § 1181-1]. Il suffira que nous rapportions ici cette citation. Elle peut servir de type à un grand nombre d'autres semblables, qu'on pourrait trouver pour divers pays.
§ 1182. Depuis les temps anciens, on trouve aux Indes des moines et des ascètes. L'étudiant des Veddas doit habiter auprès de son maître, lui obéir et le servir. On voit bien ici les résidus de la hiérarchie se mêler à ceux de l'ascétisme, tels qu'on les retrouve aussi chez les moines des couvents chrétiens. L'étudiant des Veddas doit être absolument chaste, tempérant, humble et vivre dans la pauvreté [FN: § 1182-1]. Le bouddhisme possède un code complet de la vie ascétique, en partie semblable à celui imaginé par Saint François d'Assise. C'est l'un des cas si nombreux, où des institutions semblables sont constituées spontanément sans qu'il y ait eu imitation (§ 733 et sv.). Avec peu de variantes, on trouve des pratiques analogues, en divers temps et chez différents peuples. Même à notre époque, il y a encore des gens qui les admirent. M. Paul Sabatier ne se sent pas de joie, en racontant les pratiques ascétiques, parfois très sales, de Saint François d'Assise [FN: § 1182-2]. Le résidu joue donc encore un rôle qu'on ne saurait négliger, dans les sentiments de certains hommes de notre époque. Les dérivations mettent de grandes différences entre les malpropretés des ascètes hindous, des cyniques d'Athènes, des Franciscains et d'autres sectes semblables ; mais toutes contiennent des résidus identiques.
§ 1183. Les hommes qui ne sont pas sous l'empire des sentiments correspondant à ces résidus, répètent, au sujet des ascètes de ce genre, ce que le vieux Rutilius disait déjà des moines de son temps [FN: § 1183-1], quand il s'étonnait de les voir fuir les dons de la fortune ; ou bien ils en rient, comme Lucien, de Peregrinos [FN: § 1183-2]. Comme d'habitude, les hommes louent les ascètes qui ont la même foi qu'eux et blâment les autres. Les chrétiens se moquent des ascètes hindous et admirent les leurs. Les humanitaires ne peuvent souffrir l'ascétisme chrétien, et exaltent l'ascétisme anti-alcoolique et anti-sexuel. Il y a des gens qui entrent dans une ardente colère contre l'Église catholique, à cause du célibat des prêtres, et ne voudraient pas que les jeunes gens connussent l'étreinte féminine avant le mariage. Ils ne s'aperçoivent pas, dans leur misère intellectuelle, que ces deux choses sont absolument identiques et procèdent de causes semblables.
§ 1184. Diogène [FN: § 1184-1] « en été, se roulait dans le sable brûlant ; en hiver, il embrassait les statues couvertes de neige, s'accoutumant à toute chose ». Pour vaincre ses désirs charnels, Saint François se jetait nu dans la neige [FN: § 1184-2]. Que ces récits appartiennent à l'histoire ou à la légende, ceux qui transmirent l'histoire ou composèrent la légende démontrent également, par Diogène et par Saint François, l'existence du résidu qui pousse à fuir les joies de la vie et à en rechercher les douleurs, quelle que soit d'ailleurs la raison qu'il plaise d'assigner à cette attitude. Les cyniques dégénérèrent, comme autrefois les Francicains dégénérèrent. Mais précisément le fait que tous deux, bien que dégénérés, continuaient cependant à être en faveur, démontre quelle force avaient, dans la population, les résidus qui procuraient cette faveur ; et les moqueries des gens de bon sens ne la diminuaient pas [FN: § 1184-3].
§ 1185. Philon le Juif composa un traité pour décrire la vie contemplative des Thérapeutes. On s'est demandé si le traité était bien de Philon, et aussi, avec des raisons plus sérieuses, si ces Thérapeutes furent des hommes en chair et en os, ou de simples imaginations de l'auteur. Cela importe peu, vu le but que nous poursuivons. Le fait qu'un auteur quelconque a décrit ces faits, réels ou imaginaires, démontre qu'au temps où il écrivit, il y avait un fort courant d'ascétisme. Pour le moment, c'est tout ce qu'il nous importe de noter. Les femmes étaient admises dans la secte, mais devaient rester vierges, L'horreur des rapports sexuels est une manie qui fait rarement défaut dans l'ascétisme, spécialement quand il est très intense et se rapproche des maladies mentales.
§ 1186. L'existence des Esséniens est certaine. Ils sont semblables aux ascètes hindous, et les parfaits des Albigeois leurs ressemblèrent [FN: § 1186-1]. « À l'occident, mais à une distance du rivage où il n'y a rien à craindre des exhalaisons, sont les Esséniens, nation solitaire, singulière pardessus toutes les autres, sans femme, sans amour, sans argent, vivant dans la société des palmiers. Elle se reproduit de jour en jour, grâce à l'affluence de nouveaux hôtes ; et la foule ne manque pas de ceux qui, fatigués de la vie, sont amenés par le flot de la fortune à adopter ce genre de vie ». Flavius Josèphe dit [FN: § 1186-2] « qu'ils possèdent leurs biens en commun, de telle sorte que le riche n'en jouit pas plus que le pauvre. Il y a plus de quatre mille hommes qui font ainsi. Ils n'ont ni femmes ni serviteurs, parce que ceux-ci sont une cause d'injustice, celles-là de disputes ». Il est très probable que l'auteur substitue ces causes à celles de l'ascétisme, qu'il n'a pas bien comprises.
§ 1187. Parmi les nombreuses folies des ascètes, celle des Stylites n'est pas la dernière. On donne ce nom de Stylites à certains dévots chrétiens qui passèrent une partie de leur vie sur une colonne. Le premier de ceux-ci dont on fasse mention est Saint Siméon [FN: § 1187-1], dit justement le Stylite, qui vécut au Ve siècle. Il naquit en Cilicie ; et dès sa prime jeunesse, il entra dans un monastère, puis alla dans un autre où il resta dix ans, menant une vie plus qu'austère, à tel point que, si nous voulons nous en tenir à ce que rapporte Théodoret, il ne mangeait qu'une fois la semaine, tandis que les autres moines mangeaient de deux jours l'un. En outre, il se mortifiait d'autres façons jugées tellement excessives par ses supérieurs qu'ils l'expulsèrent. Ensuite il alla s'enfermer dans une cellule, près d'Antioche, où il s'infligea des souffrances que nous nous abstiendrons de rapporter ici. Il y resta trois ans, après lesquels il se rendit sur le sommet d'une montagne, où, ceint d'une très lourde chaîne de fer, il demeura muré dans un endroit resserré. Des gens venaient à lui de toutes les parties de la terre, et il faisait toutes sortes de beaux et grands miracles [FN: § 1187-2]. À la fin, ennuyé d'un si grand concours de gens, il se tint debout sur une colonne. Il s'en fit faire d'abord une de six coudées ; puis successivement d'autres de douze, de vingt-deux, de trente-six coudées. « Il voulait ainsi voler vers le ciel et quitter la terre ». Pour le justifier, le bon Théodoret rappelle les pénitences d'Isaïe, de Jérémie, d'Osée, d'Ézéchiel [FN: § 1187-3] ; et cela devait imposer silence à ceux qui se moquaient du Stylite. Perché sur sa colonne, Saint Siméon convertit beaucoup de gens qui venaient le visiter, et Théodoret dit les avoir vus. Il n'était pas permis aux femmes d'entrer dans l'enceinte où s'élevait sa colonne, et il ne permit pas même à sa mère de le voir (§ 1172). On discute pour savoir combien d'années il demeura ainsi perché [FN: § 1187-4]. Il eut un successeur spirituel. Ce fut Daniel, qui voulut lui aussi vivre sur une colonne [FN: § 1187-5]. Ces saints hommes eurent d'autres imitateurs. On les mentionne jusqu'en l'an 806, où nous avons une lettre de Théodore Studite, qui les nomme précisément, en conseillant à l'empereur Nicéphore de choisir le patriarche de Constantinople parmi les évêques, les stylites et les reclus [FN: § 1187-6].
§ 1188. Si nous ne connaissions que les faits des stylites chrétiens, nous pourrions demeurer dans le doute, et estimer que l'acte de ces personnes était une conséquence logique de leurs croyances (§ 186, § 714, § 829). Mais on observe des faits parfaitement semblables, là où ces croyances font entièrement défaut. C'est pourquoi il se peut que ces deux genres de faits aient une cause commune, indépendante des croyances, et à laquelle rien n'empêche qu'on puisse ajouter les croyances; ajouter, disons-nous, et non substituer. De même, dans les actes d'ascétisme visant à faire pénitence, les résidus de l'intégrité personnelle (Ve classe) se mêlent à ceux de l'ascétisme ; car le pénitent a aussi en vue de se laver de ses fautes. Mais ceux de l'ascétisme reparaissent, quand la pénitence est faite pour les fautes d'autrui.
§ 1189. Quel que soit l'auteur de la Déesse syrienne, il est certain qu'il n'était pas chrétien, et qu'il ne décrivait pas des coutumes chrétiennes. Mais nous trouvons justement, dans cet écrit, d'autres stylites, au moins temporaires [FN: § 1189-1], et un genre d'ascétisme qui, en considérant les effets matériels, s'écarte peu de celui de Saint Siméon. Nous avons quatre explications du fait du stylite de la Déesse syrienne ; et, après tout, elles sont bien dignes de figurer avec celles que l'on donne des stylites chrétiens.
§ 1190. La flagellation ascétique a été un phénomène très répandu, dans l'espace et dans le temps. La flagellation des jeunes Spartiates auprès de l'autel d'Artémis Orthia, et celle des pénitents chrétiens au moyen âge, sont célèbres. Les auteurs ont recueilli un grand nombre d'autres faits semblables. Assez nombreuses sont les explications qu'on a données de ces faits. On les a considérés comme des preuves de courage et d'indifférence à la douleur ; et en cela il y a du vrai. On a dit que Lycurgue avait voulu accoutumer ses concitoyens à supporter patiemment les mauvais traitements. Les explications de ce genre sont toujours peu probables. On a dit que c'étaient les restes d'un antique usage de sacrifices humains. Cela peut être ; mais les preuves font entièrement défaut. On a dit que par la flagellation on éloignait les mauvais démons. C'est là une dérivation ; et il est probable qu'elle cache un résidu. On a dit qu'on transmettait à la victime la force et la vitalité des choses employées pour flageller. C'est là une autre dérivation. On a voulu que la flagellation eût pour effet de purifier celui qui était flagellé. Comme d'habitude, c'est une dérivation. Pour les chrétiens, la flagellation fut une manière de faire pénitence.
§ 1191. Enfin, l'explication totémique ne pouvait manquer, car maintenant le totémisme joue un rôle en toute chose. S. Reinach la fait sienne, en suivant Thomsen [FN: § 1191-1] : « (p. 180) C'est avec des baguettes de coudrier que l'on fouette les jeunes Spartiates, et la déesse qui préside à la cérémonie est elle-même la déesse du coudrier (Lygodesma, du grec lygos, coudrier). C'est avec des lanières de cuir de bouc ou de chèvres que les Luperques frappent les Romaines, et la déesse qui préside à la cérémonie, dea Luperca, participe à la fois de la louve et de la chèvre (lupus, hircus). Donc le but de la flagellation, c'est de faire passer dans le corps du patient la force et la vitalité soit de l'arbre, soit de l'animal, c'est-à-dire sans doute un ancien totem ». Ce donc est tout à fait merveilleux. Il serait vraiment à désirer que la conclusion fût unie aux prémisses avec un peu plus d'efficacité. Notez, en attendant, que l'explication ne changerait pas, quelle que soit la matière employée pour flageller. Est-ce qu'il n'y a de force et de vitalité que chez le boue et la chèvre ? Ne pourrait-on pas répéter l'explication pour le cuir d'un autre animal quelconque ? Et puis il faut admirer le saut gigantesque que l'on fait, en concluant que, si l'on veut faire passer dans celui qui est flagellé la force et la vitalité de la matière du fouet, ou que représente le fouet, ce dernier est nécessairement un ancien totem. Quand on se contente de preuves aussi faibles et aussi fragiles, on peut démontrer tout ce qu'on veut.
§ 1192. Ici, comme nous l'avons souvent dit déjà (§ 23, 670), nous ne recherchons pas les « origines », par trop obscures des phénomènes : nous cherchons, au contraire, quels sont les sentiments qui produisent certains actes. Nous ne tâchons pas de deviner ce qui s'est passé en un temps pour lequel les documents nous font défaut : nous voulons seulement étudier les faits qui nous sont connus par des documents historiques.
§ 1193. Tout d'abord, observons que les phénomènes concrets de la flagellation ne sont pas nécessairement homogènes ; et il se pourrait même, par exemple, que les coups, assurément peu douloureux, reçus par les Romaines, aux Lupercales, n'eussent que peu ou point à faire avec la flagellation très douloureuse des Spartiates. Voyons donc si nous pouvons trouver quelque phénomène de flagellation qui soit très simple et qui, par conséquent, nous fasse mieux connaître certains résidus.
§ 1194. Casati décrit justement l'un de ces faits [FN: § 1194-1]. Des jeunes gens se flagellent pour montrer leur courage et se faire admirer par les jeunes filles. Naturellement, les totémistes diront que le fouet étant en cuir d'hippopotame, le but de la flagellation est de faire passer dans les jeunes gens la force de l'hippopotame, lequel est un ancien totem. Et si le fouet était fait du cuir d'un autre animal A ou d'un végétal B, il suffirait de substituer A ou B à l'hippopotame, pour avoir toujours la même explication, qui, à la vérité, ne peut jamais faire défaut, car enfin le fouet doit pourtant être fait de quelque chose. Mais, si nous laissons de côté ces explications nuageuses, nous trouvons dans le fait raconté par Casati l'expression de sentiments que nous savons être largement répandus parmi les hommes, et qui se retrouvent donc probablement en d'autres phénomènes analogues.
§ 1195. Il serait étonnant qu'ils eussent fait défaut dans la flagellation des jeunes Spartiates. Les Spartiates s'appliquaient dans tous leurs actes à se montrer ennemis des commodités de la vie, témoignant de l'indifférence et du mépris, non seulement pour la douleur, mais aussi pour la mort. Il serait alors étonnant qu'ils eussent abandonné ces sentiments précisément dans la flagellation, où ils sont au contraire le mieux à leur place. L'idée des anciens, que la flagellation fut instituée par un artifice du légendaire Lycurgue, est erronée ; mais il est très probable que ce fut une manifestation des sentiments d'endurcissement à la douleur et du sacrifice de l'individu à la collectivité, sentiments qui étaient si puissants à Sparte. Un pays où les mères repoussaient leurs fils, quand ils fuyaient de la bataille ou s'échappaient seuls, tandis que leurs compagnons étaient morts (§ 1148-1), où les hommes menaient une vie plus que dure, devait nécessairement avoir des enfants qui recherchaient les douleurs que comportait leur âge. Le fait que la flagellation avait lieu auprès de l'autel d'Artémis Orthia est secondaire. Si cette déesse avait manqué, on aurait eu vite fait d'en trouver une autre. Le fait concret de Sparte paraît donc différer de celui que raconte Casati, en ce qu'à un résidu commun, qui consiste à se glorifier de supporter la douleur, on ajoute, à Sparte, le sentiment que cette douleur est infligée au nom de la collectivité et de ses dieux, par conséquent le sentiment du sacrifice individuel.
§ 1196. Au moyen âge, la flagellation volontaire reparaît. Il serait vraiment ridicule d'y voir aucune trace de totémisme ou de l'intention de se fortifier. L'histoire de Saint Dominique l'Encuirassé, qui propagea la coutume de la flagellation, nous est bien connue ; et rien, absolument rien en elle ne rappelle les idées indiquées plus haut. Saint Dominique l'Encuirassé se flagellait afin de faire pénitence pour lui et pour autrui. C'est la dérivation qui recouvrait le résidu de l'ascétisme. Il n'y a pas lieu de s'étonner si, quand on inventait toutes sortes d'austérités, pour satisfaire le besoin d'ascétisme, la flagellation s'est trouvée parmi ces austérités. Il serait étonnant qu'elle eût fait défaut. Condamnée par beaucoup de personnes, cette nouvelle mortification de la chair trouva un défenseur en Saint Damien, qui observe très judicieusement qu'on ne peut la condamner, si l'on ne condamne pas en même temps les autres mortifications des Saints Pères. À ceux qui objectaient que Jésus-Christ, les apôtres, les martyrs avaient été flagellés par d'autres et ne s'étaient pas infligé la peine spontanément, il répond que nous pouvons nous punir par nous-mêmes, et que nous pouvons nous châtier par nos propres mains de la même façon que nous jeûnons volontairement [FN: § 1196-1].
§ 1197. Dans la vie de Saint Dominique l'Encuirassé, on nous dit qu'il eut ce surnom parce qu'il porta toujours une tunique de fer, et qu'il resta vierge jusqu'à sa mort, pratiquant toutes sortes de pénitences corporelles. Il passa sa vie à réciter des psaumes, à s'agenouiller, à se fustiger. Peu d'années avant de mourir, il s'aperçut que le fouet de cuir produisait une douleur plus grande que les verges d'osier ; aussi laissa-t-il celles-ci pour celui-là. Son cas appartient à l'aliénation mentale. Mais, de même que la mégalomanie est une maladie mentale qui manifeste l'excès de l'orgueil, les folies de Saint Dominique manifestent l'excès d'un sentiment par lequel l'individu perd tout souci de son intégrité personnelle. Il faut remarquer que Saint Dominique faisait pénitence pour les péchés des autres ; il se sacrifiait pour sauver autrui. Un admirable calcul, rapporté par Saint Damien, démontre qu'on pouvait satisfaire à cent ans de pénitence, en récitant vingt psaumes, en se battant de verges ou en se fouettant. Il paraît que Saint Dominique accomplit cette opération en six jours [FN: § 1197-1]. Une fois, au commencement du carême, Saint Dominique pria Saint Damien de lui imposer mille ans de pénitence, et paya presque entièrement sa dette avant la fin du carême.
§ 1198. Pierre Damien, qui veut étendre l'usage de se fouetter, ressemble toutes proportions gardées, à nos ascètes contemporains, qui veulent ôter à la vie humaine toute joie matérielle, et qui persécutent ainsi sans pitié le sourire de la femme et la chaleur du vin [FN: § 1198-1]. Et, si l'on peut considérer ces derniers comme des pseudo-ascètes, la comparaison s'établit entre ceux qui les admirent et ceux qui admiraient les flagellations du saint encuirassé [FN: § 1198-2].
§ 1199. Les œuvres de Saint Damien nous ont conservé le souvenir des pénitences de Saint Dominique l'Encuirassé, et il est probable que d'autres, fussent-elles moins austères, auront existé, dont le récit ne nous est pas parvenu. Quoi qu'il en soit, vers 1260, une épidémie de flagellation sévit en Italie [FN: § 1199-1] ; elle dura quelques années et en différentes contrées, tantôt s'affaiblissant et s'éteignant, tantôt se rallumant. Muratori veut que les flagellants de ce temps aient donné naissance à « (p. 364) beaucoup de Confraternités modernes ; car cette idée ayant profondément pénétré dans l'esprit des gens, que s'administrer la discipline était un acte très salutaire de pénitence, et l'ardeur de la religion bouillonnant en eux, ils formèrent des sociétés pieuses sous leurs gonfalons, faisant ensuite diverses processions, chantant les choses de Dieu et se réunissant aux jours de fête, dans leur église où, s'administrant la discipline et implorant la divine miséricorde, ils exécutaient d'autres actes de dévotion chrétienne » [FN: § 1199-2].
§ 1200. L'Église romaine, toujours modérée, condamna l'excès d'ascétisme des flagellants. De même, aujourd'hui, l'Église officielle anglaise demeure hostile aux enthousiasmes du Réveil gallois.
L'épidémie des flagellants de 1260 s'étendit aussi à l'Allemagne et y fit grand bruit. Raynaldo, continuateur des Annales de Baronio, tire de Stero la description des pénitences des flagellants allemands [FN: § 1200-1], et nous apprend aussi comment cette secte devint hérétique. Il dit : « (loc. cit., VIII) Cette piété des pénitents dégénéra ensuite en une hideuse hérésie, malgré une si grande pompe de sainteté et un si beau commencement. Par l'œuvre du démon, elle se changea en scélératesse et en ribauderie ». On recommence à parler des flagellants, en Allemagne, dans l'année 1349 ; et nous les voyons surgir pour apaiser la colère divine, qui se manifestait par la peste dont ces malheureuses contrées étaient accablées [FN: § 1200-2]. Comme d'habitude, la superstition se mêlait à l'ascétisme, et toujours comme d'habitude, l'hypocrisie cachait les mauvaises actions. On lisait une lettre reçue en l'église de Saint-Pierre, à Jérusalem, où elle avait été apportée par un ange ; elle portait que Jésus-Christ était irrité des crimes du monde, et que, prié par la Vierge et les anges de faire miséricorde, il prescrivait que chacun devait s'exiler pendant trente-quatre jours et se flageller. Les réponses pseudo-scientifiques dont se prévalent nos contemporains qui voudraient supprimer l'usage du vin et les rapports avec la femme, sont également absurdes, au moins en partie.
§ 1201. L'auteur de la vie du pape Clément VI dit des flagellants que « sous le couvert de pénitence et de bonnes œuvres, ils perpétraient secrètement beaucoup de mauvaises actions ». Dans une bulle adressée à l'archevêque de Magdebourg, le même pape dit que : « sous une apparence de piété, ils mettent cruellement la main à des œuvres impies. Ils répandent le sang des Juifs (que la pitié chrétienne accueille et protège, ne permettant de les offenser en aucune façon) et souvent des chrétiens, et accaparent sans raison les biens des clercs et des laïques » (RAYN., loc. cit., ann. 1349, XXI). En conséquence, le pape ordonne de condamner et de disperser les flagellants. L'Université de Paris rendit aussi une sentence contre eux, et le roi Philippe leur défendit, sous peine de mort l'entrée du royaume.
§ 1202. Les flagellants reparaissent de nouveau à Misura, en 1414, et sont de nouveau persécutés et dispersés. Ils disaient que le baptême usuel par l'eau était vain et devait être remplacé par le baptême du sang, de la flagellation. En 1417, on les voit en Aragon ; et Gerson écrit un traité contre l'abus de la flagellation, qu'il admet seulement dans une mesure modérée et imposée par les supérieurs. Henri III de France institua des congrégations de flagellants, en 1582. Mais là, le phénomène dévie et l'érotisme s'y mêle [FN: § 1202-1]. C'est ainsi que, même après cette époque, beaucoup de personnes, bien que très religieuses, furent hostiles à la flagellation, parce que souvent elle servait à de perverses jouissances érotiques. Ces faits sont entièrement ou en grande partie étrangers à l'ascétisme.
§ 1203. Il faut de même exclure des faits comme ceux des Luperques, à Rome, que les totémistes veulent, sans justes motifs, rapprocher de la flagellation des jeunes Spartiates. La douleur éprouvée par ceux qui étaient flagellés constituait la partie principale de cette flagellation; elle était exclue des Lupercales, ou du moins n'apparaissait pas. On sait qu'aux Lupercales, les Luperques couraient par la ville avec des lanières de cuir taillées dans les peaux des victimes, et en frappaient les femmes qui, de cette façon, devaient devenir fécondes. C'est là simplement une des si nombreuses pratiques imaginées par la fantaisie humaine, pour faire cesser la stérilité des femmes [FN: § 1203-1], à l'égal des autres pratiques non moins nombreuses, imaginées aussi pour remédier à l'impuissance des hommes. Il se pourrait encore que, parmi les motifs bizarres de ces imaginations, il y eût aussi celui que donnent les totémistes ; en ce cas, ils auront deviné, comme on peut deviner des faits sur lesquels tout renseignement certain fait défaut. Pausanias (VIII, 23) dit qu'à Aléa, en Arcadie, on célèbre une fête en l'honneur de Bacchus, « et qu'en cette fête de Bacchus, suivant un oracle de Delphes, on fouette les femmes, comme les éphèbes spartiates auprès de Orthia ». Avec si peu de renseignements, vouloir connaître le pourquoi du fait, c'est comme chercher à deviner les numéros du loto. Il est inutile de s'en occuper.
§ 1204. À notre époque, chez les peuples civilisés, les manifestations de l'ascétisme qui apparaissaient dans les jeûnes et les flagellations ont presque disparu. Déjà en 1831, dans une instruction aux confesseurs, il est écrit [FN: § 1204-1] : « (p. 311) La manière vraie et directe de dompter la pétulance de la chair rebelle, est justement l'usage du jeûne ou d'autres macérations, telles que le cilice, le fouet et autres semblables. Ce sont là, en majeure partie, les œuvres pénitentielles qui sont prescrites par les Saints Pères. Il n'est cependant pas toujours possible ou convenable d'imposer des jeûnes formels, comme ils se pratiquent dans l'Église, ou tels qu'on les détermine dans les Canons sacrés, uniquement en pain et en eau, plusieurs fois la semaine et pendant plusieurs années. Qui, de nos jours, parmi les pénitents, les accepterait, ou qui les observerait ? Donc, les jeûnes et toute autre mortification corporelle doivent être modérés dans la mesure du possible, suivant la discipline présente et l'usage commun des sages Confesseurs ». Aujourd'hui moins que jamais, on ne peut parler de cilice et de discipline, de jeûnes stricts, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. On dit qu'on en fait encore un usage modéré en Espagne.
§ 1205. De même, chez les Israélites modernes de nos pays, le vœu du naziréat paraît être tombé en désuétude, car on ne voit vraiment pas de ces Nazirs. Mais ils sont en partie remplacés par les anti-alcooliques de toute religion, et même sans religion. D'après la Bible (Nomb. VI), le Nazir devait s'abstenir de la consommation de vin et de toute autre boisson alcoolique, de vinaigre, de toute boisson tirée du raisin, de raisin frais et de raisin sec [FN: § 1205-1]. Il ne devait pas se couper les cheveux et devait observer d'autres règles pour se maintenir pur. Le naziréat était fixé à trente jours ou à un autre temps déterminé, ou perpétuel. Le Talmud en traite longuement [FN: § 1205-2].
§ 1206. Les manifestations d'ascétisme, sous forme de macérations corporelles, continuent chez les mahométans, les Hindous et d'autres peuples peu civilisés. Elles étaient fréquentes aussi chez les peuples sauvages plus avancés, tandis qu'elles sont beaucoup plus rares chez les peuples qui ont une vie presque bestiale. Chez les peuples civilisés modernes, l'évolution de l'ascétisme aboutit à l'anti-alcoolisme [FN: § 1206-1], à la phobie de tout ce qui rappelle l'acte sexuel, à l'humilité pathologique de quelques humanitaires de bonne foi. Occasionnellement, on voit diverses autres manifestations, telles que les jeûnes prolongés, recommandés maintenant au nom de la sacro-sainte Science, après avoir été si longtemps suggérés ou imposés au nom de quelque autre divinité.
Aux résidus de l'ascétisme s'ajoutent ceux de l'instinct des combinaisons (Ire classe) ; et l'on a une casuistique très étendue, qui, pour un genre donné d'ascétisme, paraît ridicule à ceux qui n'ont pas les sentiments correspondant à ce genre. Mais souvent ils en ont d'autres, correspondant à un autre genre d'ascétisme, et font usage d'une casuistique exactement semblable à celle dont ils se moquent.
De tous ces genres d'ascétismes, rendus plus virulents, en certains cas, par la casuistique, et qu'on veut imposer à autrui, provient une somme énorme de souffrances qui ont affligé et affligent encore la race humaine. En les tolérant, en les acceptant même souvent de bon gré, au lieu de les repousser et de détruire comme des serpents venimeux ceux qui les leur suscitent, les hommes démontrent clairement quelle puissance ont les sentiments correspondants, qui sont proprement une perversion de l'instinct de sociabilité, sans lequel la société humaine n'existerait pas.
[649]
Chapitre VIII↩
Les résidus (Suite). Examen des Ve - et VIe classes. [(§1207 à §1396),vol. 1, pp. 649-784]
§ 1207. Ve CLASSE. Intégrité de l'individu et de ses dépendances. Cette classe est constituée par les sentiments concernant l'intégrité de l'individu et de ses dépendances ; elle est donc, en un certain sens, le complément de la classe précédente. Défendre ses biens et tâcher d'en accroître la quantité sont deux opérations qui se confondent souvent. La défense de l'intégrité et le développement de la personnalité sont par conséquent deux opérations qui peuvent ne pas différer beaucoup et même se confondre. Cet ensemble de sentiments qu'on appelle « les intérêts » est de la même nature que les sentiments auxquels correspondent les résidus du présent genre. Donc, à la rigueur, il devrait en faire partie ; mais il est d'une si grande importance intrinsèque pour l'équilibre social, qu'il est utile de l'envisager à part des résidus.
§ 1208. (V-α) « Sentiments qui contrastent avec les altérations de l'équilibre social. Cet équilibre peut être celui qui existe réellement ou bien un équilibre idéal, désiré par l'individu. De toute façon, quand il est altéré ou qu'on le suppose tel, l'individu souffre, même s'il n'est pas atteint directement par le fait de l'altération, et quelquefois, mais rarement, même s'il en retire aussi avantage.
§ 1209. Chez un peuple où existe l'esclavage, par exemple chez les anciens Grecs, un citoyen, même s'il n'a pas d'esclaves, ressent l'offense qu'on fait à un maître, en lui enlevant son esclave. C'est une réaction contre un acte qui vient à troubler l'équilibre existant. Un autre citoyen voudrait maintenir les Barbares en esclavage et en retirer les Grecs : il a en vue un équilibre partiellement idéal, pour ces temps. Un autre citoyen encore voudrait qu'il n'y eût pas du tout d'esclaves : il a en vue un équilibre entièrement idéal, toujours pour ces temps.
§ 1210. Si un état d'équilibre existant vient à être altéré, des forces naissent, qui tendent à le rétablir. C'est là tout simplement la définition de l'équilibre (§ 2068 et sv.) Ces forces sont principalement des sentiments qui nous sont manifestés par les résidus du genre que nous étudions maintenant. Passivement, ils nous font sentir l'altération de l'équilibre, et, activement, nous poussent à refouler, éloigner, compenser les causes d'altération, et se transforment donc en les sentiments du genre (δ) (§ 1305 et sv.). Les forces ou sentiments qui naissent du trouble de l'équilibre social sont presque toujours perçus sous une forme spéciale, par les individus qui font partie de la société. Il va sans dire que ces individus ignorent les forces et l'équilibre. C'est nous qui donnons ces noms aux phénomènes. Les membres de la société où l'équilibre est altéré ressentent dans leur intégrité, telle qu'elle existait à l'état d'équilibre, un trouble désagréable, et qui peut être même douloureux, très douloureux. Comme d'habitude, ces sensations font partie des catégories indéterminées qui portent le nom de juste et d'injuste. Celui qui dit : «Cette chose est injuste » exprime que cette chose blesse ses sentiments, tels qu'ils sont dans l'état d'équilibre social où il vit.
§ 1211. Là où existe un certain genre de propriété, il est injuste de l'enlever à un homme. Là où elle n'existe pas, il est injuste de la lui donner. Cicéron veut que ceux qui gouvernent l'État s'abstiennent de ce genre de libéralité qui enlève à certaines personnes pour donner à d'autres [FN: § 1211-1] . « Il y en a beaucoup – dit-il – particulièrement s'ils sont avides de faste et de gloire, qui enlèvent à quelques-uns ce dont ils gratifient les autres ». C'est là, au contraire, le principe des lois dites « sociales », si cher aux hommes de notre époque. Les soldats qui partagent le butin fait sur l'ennemi appellent injuste le fait d'altérer les règles en usage dans ce partage. De même, ce sentiment existe chez les voleurs qui se répartissent leur prise. D'autres résidus se trouvent aussi dans cette nébuleuse du juste et de l'injuste, mais ce n'est pas ici le lieu d'en traiter.
§ 1212. Les diverses parties de l'équilibre social sont peu distinctes, surtout quand les sciences sociales sont peu avancées. Aussi le sentiment qui pousse à résister à l'altération de cet équilibre met-il sur le même pied les altérations de parties insignifiantes et celles de parties très importantes ; il estime également justes la sentence qui condamne au bûcher un antitrinitaire, et celle qui condamne à mort un assassin. Le seul fait de se vêtir autrement que le veut l'usage commun heurte ce sentiment, à l'égal d'autres transgressions beaucoup plus importantes de l'ordre social. Même aujourd'hui, chez les peuples qui se disent civilisés, on ne tolère pas qu'une femme se promène habillée en homme.
§ 1213. Le résidu que nous examinons donne lieu à une observation de grande importance, bien qu'elle ne semble pas telle, au premier abord. Supposons une collectivité où l'homicide devienne fréquent : elle est évidemment en train de se dissoudre. Pour s'opposer à cette dissolution, il n'est pas nécessaire que le sentiment correspondant à notre résidu agisse : l'intérêt immédiat des membres de la collectivité suffit. Dans le langage ordinaire, on dira que l'individu qui s'oppose à cet état de choses est mu, non par un « idéal de justice », mais par l'instinct de conservation ; instinct qu'il possède en commun avec les animaux, et qui n'a rien à voir avec l' « idéal de justice». Supposons ensuite une autre collectivité, très nombreuse, où le nombre des homicides soit très restreint. La probabilité qu'un individu soit victime d'un de ces homicides est très petite, égale ou inférieure à la probabilité de tant d'autres dangers (rencontre d'un chien enragé, accidents de chemin de fer, etc.) auxquels l'individu ne prend aucunement garde. Le sentiment de la défense directe de sa vie agit en ce cas très faiblement. Au contraire, un autre sentiment surgit et agit vivement : celui de répulsion pour ce qui trouble l'équilibre social, tel qu'il existe et tel que l'individu l'accepte.
§ 1214. Si ce sentiment n'existait pas, toute altération naissant dans l'équilibre social et légère ne rencontrerait que peu ou point d'opposition, et pourrait par conséquent aller en croissant impunément, jusqu'à ce qu'elle frappât un nombre d'individus assez grand pour donner lieu à la résistance de ceux qui veulent directement éviter le dommage. Cela se produit en effet dans certaines proportions, en toute société, même dans les plus civilisées ; mais ces proportions sont réduites par le fait de l'intervention du sentiment de répulsion contre l'altération de l'équilibre, quel que soit le nombre d'individus qui en pâtissent. En conséquence, l'équilibre social devient beaucoup plus stable : une action beaucoup plus énergique se produit aussitôt qu'il commence à être altéré [FN: § 1214-1].
§ 1215. Les exemples de ces phénomènes sont excessivement nombreux. L'un des derniers est donné par la France, en 1912. Pendant de longues années, on avait fait preuve d'une indulgence toujours croissante pour les malfaiteurs. L'école laïque était devenue une chaire d'anarchie, et sous une quantité d'autres formes, on était en train de dissoudre l'agrégat social. Les effets se manifestèrent par les sabotages dans les arsenaux, sur les chemins de fer, etc., et finalement par les exploits de la bande anarchiste Bonnot, Garnier et Cie. Alors se produisit un peu de réaction. Assurément, la crainte d'un danger direct pour les habitants de Paris et des environs y avait part ; mais enfin la probabilité, pour un citoyen, d'être frappé par ces malandrins était très petite. Le sentiment de s'opposer au trouble de l'équilibre social existant intervint avec une force plus grande. Il est en partie analogue, dans la société, à l'instinct qui, chez l'animal, fait fuir ce péril.
§ 1216. On comprend donc comment, en ajoutant au résidu que nous envisageons maintenant les résidus de la IIe classe (persistance des agrégats), on forme des résidus composés, de grande importance sociale, correspondant à des sentiments vifs et puissants, exactement semblables à ceux qui, avec très peu de précision, sont désignés par le terme « idéal de justice ». Au point de vue logico-expérimental, dire que « l'injustice », aussi bien celle qui est faite à une seule personne qu'à un grand nombre de gens, offense également « la justice », n'a pas de sens. Il n'existe pas de personne appelée justice, et nous ne savons pas ce que peuvent être les offenses qu'elle recevrait. Mais l'expression seule est défectueuse, et, au fond, par elle on exprime le sentiment, peut-être indistinct, inconscient, qu'il est utile que l'opposition aux troubles de l'ordre social ne soit pas en raison directe du nombre d'individus lésés, mais ait une valeur notable, indépendante de ce nombre.
§ 1217. Revenant à l'exemple de la bande Bonnot, Garnier et Cie, plusieurs fidèles de la sacro-sainte Science, qui n'a rien affaire avec la science logico-expérimentale, observèrent avec douleur que la réaction qui se manifestait était absurde, qu'on ne pouvait affirmer que ces malfaiteurs fussent le produit d'une des causes contre lesquelles on réagissait ; et ils répétaient cela pour chacune de ces causes, en faisant le sophisme habituel de l'homme chauve. Ils ajoutaient que des malfaiteurs, il y en avait toujours eu, en tout temps et dans toutes les sociétés [FN: § 1217-1].
§ 1218. En tout cela, il y a une part de vérité : c'est que la réaction qui s'est produite est déterminée, non par la logique, mais au contraire par l'instinct. On pourrait ajouter que si la logique avait dominé, il n'y aurait pas eu de réaction, pour la bonne raison que l'action aussi aurait fait défaut. Instinctive était la pitié qui renvoyait les malfaiteurs impunis, qui prêchait l'anarchie aux jeunes gens, qui détachait tout lien de hiérarchie ; instinctive était par conséquent aussi la crainte qui poussait les hommes à réagir contre ces faits ; instinctif est l'acte de l'animal qui s'approche de l'appât placé pour le capturer ; instinctif aussi l'acte qui le fait fuir si, près de l'appât, il découvre des traces de danger, réel ou imaginaire.
§ 1219. De tout cela, on peut seulement tirer cette conséquence que les actions non-logiques jouent un grand rôle dans la vie sociale, et qu'elles produisent parfois le mal, parfois le remède à ce mal.
§ 1220. (V-β) Sentiment d'égalité chez les inférieurs. Ce sentiment est souvent une défense de l'intégrité de l'individu appartenant à une classe inférieure, et une façon de le faire monter dans une classe supérieure. Cela se produit sans que l'individu qui éprouve ce sentiment soit conscient de la diversité qu'il y a entre le but réel et le but apparent. Au lieu de son propre intérêt, il met en avant celui de sa classe sociale, simplement parce que c'est là la façon usuelle de s'exprimer.
§ 1221. Des tendances marquées tirent leur origine de la nature de ce sentiment, et paraissent, au premier abord, contradictoires. D'un côté, il y a la tendance à faire participer le plus grand nombre possible de personnes aux avantages que l'individu demande pour lui-même. D'un autre côté, il y a la tendance à restreindre ce nombre autant que possible. La contradiction disparaît, si l'on considère que la tendance est de faire participer à certains avantages tous ceux dont le concours peut être efficace pour obtenir ces avantages, de manière que leur intervention produise plus qu'elle ne coûte, et en outre d'exclure tous ceux dont le concours n'est pas efficace ou l'est si peu qu'il produit moins qu'il ne coûte. De même, à la guerre, il était utile d'avoir le plus grand nombre possible de soldats pour la bataille, et le plus petit nombre pour le partage du butin. Les demandes d'égalité cachent presque toujours des demandes de privilèges.
§ 1222. Voici une autre contradiction apparente. Les inférieurs veulent être égaux aux supérieurs, et n'admettent pas que les supérieurs soient leurs égaux. Au point de vue logique, deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps ; et si A est égal à B, il s'en suit nécessairement que B est égal à A. Mais la contradiction disparaît, si l'on considère que la demande d'égalité n'est qu'une manière déguisée de réclamer un privilège. Celui qui appartient à une classe et demande l'égalité de cette classe avec une autre, entend en réalité doter la première d'un privilège à l'égard de la seconde. Si, poser que A est égal à B signifie en réalité que A est plus grand que B, affirmer que B est plus petit que A n'est pas le moins du monde contradictoire. Au contraire, c'est parfaitement logique. On parle de l'égalité pour l'obtenir en général. On fait ensuite une infinité de distinctions pour la nier en particulier. Elle doit appartenir à tous, mais on ne l'accorde qu'à quelques-uns [FN: § 1222-1] .
§ 1223. Les Athéniens avaient très à cœur d'être égaux devant la loi, ![]() , et chantaient les louanges d'Armodius et d'Aristogiton qui les avaient rendus égaux ; mais l'égalité ne s'appliquait pas aux étrangers, aux métèques, et pas même au fils dont le père seul était citoyen ; et parmi les citoyens mêmes, on ne considérait pas comme contraire à l'égalité que les pauvres opprimassent les riches. Les citoyens spartiates qui jouissaient de tous leurs droits étaient les égaux, les
, et chantaient les louanges d'Armodius et d'Aristogiton qui les avaient rendus égaux ; mais l'égalité ne s'appliquait pas aux étrangers, aux métèques, et pas même au fils dont le père seul était citoyen ; et parmi les citoyens mêmes, on ne considérait pas comme contraire à l'égalité que les pauvres opprimassent les riches. Les citoyens spartiates qui jouissaient de tous leurs droits étaient les égaux, les ![]() ; mais, en fait, ils constituaient une aristocratie très restreinte, dont le nombre des membres allait toujours en diminuant. Même le seul fait de ne pouvoir prendre part au repas commun faisait disparaître l'égalité. Parmi nos contemporains, l'égalité des hommes est un article de foi ; mais cela n'empêche pas qu'en France et en Italie il n'y ait d'énormes inégalités entre les « travailleurs conscients » et les « travailleurs non-conscients », entre les simples citoyens et ceux qui sont protégés par des députés, des sénateurs, de grands électeurs, etc. Avant de rendre un jugement, les magistrats regardent bien avec qui ils ont affaire [FN: § 1223-1] . Il y a des tripots auxquels la police n'ose pas toucher, parce qu'elle y trouverait des législateurs ou d'autres gros personnages. Parmi ceux-ci, en Italie, combien ont des canifs dont la lame a plus de quatre centimètres ? Une loi vraiment absurde l'interdit aux simples citoyens, mais pas à ceux qui appartiennent à l'aristocratie politique ou qui jouissent de sa protection. C'est ainsi qu'en d'autres temps il était permis au noble de porter des armes, interdit au plébéien.
; mais, en fait, ils constituaient une aristocratie très restreinte, dont le nombre des membres allait toujours en diminuant. Même le seul fait de ne pouvoir prendre part au repas commun faisait disparaître l'égalité. Parmi nos contemporains, l'égalité des hommes est un article de foi ; mais cela n'empêche pas qu'en France et en Italie il n'y ait d'énormes inégalités entre les « travailleurs conscients » et les « travailleurs non-conscients », entre les simples citoyens et ceux qui sont protégés par des députés, des sénateurs, de grands électeurs, etc. Avant de rendre un jugement, les magistrats regardent bien avec qui ils ont affaire [FN: § 1223-1] . Il y a des tripots auxquels la police n'ose pas toucher, parce qu'elle y trouverait des législateurs ou d'autres gros personnages. Parmi ceux-ci, en Italie, combien ont des canifs dont la lame a plus de quatre centimètres ? Une loi vraiment absurde l'interdit aux simples citoyens, mais pas à ceux qui appartiennent à l'aristocratie politique ou qui jouissent de sa protection. C'est ainsi qu'en d'autres temps il était permis au noble de porter des armes, interdit au plébéien.
§ 1224. Tout le monde connaît bien ces choses ; c'est même pour cela qu'on n'y fait plus attention ; et si quelque naïf s'en plaint, on a pour lui un sourire de commisération comme pour celui qui se plaindrait de la pluie ou du soleil ; ce qui n'empêche pas qu'on croit de bonne foi avoir l'égalité. Il y a des endroits, aux États-Unis d'Amérique, où, dans les hôtels, on ne peut faire cirer ses bottines, parce qu'il est contraire à la sainte égalité qu'un homme cire les bottines d'un autre. Mais ceux-là mêmes qui ont cette haute conception de l'égalité veulent chasser des États-Unis les Chinois et les Japonais, sont estomaqués à la seule idée qu'un petit Japonais puisse s'asseoir sur un banc d'école à côté d'un de leurs fils, ne permettent pas qu'un nègre soit logé dans un hôtel dont eux-mêmes occupent une chambre, ne permettent pas non plus qu'il prenne place dans un vagon de chemin de fer qui a l'honneur de les contenir ; enfin, chose qui serait incroyable si elle n'était vraie, ceux qui, parmi ces ardents fidèles de la sainte Égalité, croient que Jésus-Christ est mort pour racheter tous les hommes, qu'ils appellent leurs frères en Jésus-Christ, et qui donnent leur obole aux missionnaires qui vont convertir les Africains et les Asiatiques, refusent de prier leur Dieu dans un temple des États-Unis où il y a un nègre [FN: § 1224-1]!
§ 1225. La démocratie européenne et celle d'Amérique prétendent avoir pour fondement l'égalité parfaite des êtres humains ; mais cette égalité ne s'applique qu'aux hommes et non aux femmes. « Un homme, un vote ! » crient les énergumènes ; et ils se voilent la face, saisis d'une sainte horreur, si quelqu'un émet l'avis que le vote de l'homme cultivé ne devrait pas être égal à celui de l'ignorant, le vote de l'homme malhonnête à celui de l'homme honnête, le vote du vagabond à celui du citoyen utile à sa patrie. Il faut une égalité parfaite, parce qu'un être humain est égal à un autre être humain. Mais ensuite on oublie ces beaux principes, s'il s'agit des femmes. L'égalité des êtres humains devient, par un joli tour de passe-passe, l'égalité des mâles, et même de certains mâles [FN: § 1225-1]. Notez encore que les mêmes personnes qui tiennent le principe du suffrage universel pour un dogme indiscutable, supérieur à toute considération d'opportunité ou de convenance, dénient ensuite ce suffrage aux femmes, pour des motifs d'opportunité et de convenance, parce que, disent-ils, le vote des femmes renforcerait le parti clérical ou conservateur.
§ 1226. Ici, nous ne recherchons pas quelle peut être l'utilité sociale de ces mesures. Elle peut être grande, même si les raisonnements par lesquels on veut la démontrer sont absurdes ; de même qu'elle peut ne pas exister. Maintenant, nous étudions seulement ces raisonnements et les sentiments dont ils partent. Si les raisonnements sont faux à l'évidence, et sont toutefois approuvés et acceptés, comme cela ne peut avoir lieu en raison de leur force logique, il faut bien que cela se produise par la puissance des sentiments qu'ils recouvrent. C'est justement le fait qu'il nous importe de relever.
§ 1227. Le sentiment qui, très mal à propos, porte le nom de sentiment d'égalité est vif, actif, puissant, précisément parce qu'il n'est pas effectivement d'égalité, parce qu'il ne se rapporte pas à une abstraction, comme le croient encore quelques naïfs « intellectuels », mais parce qu'il se rapporte aux intérêts directs de personnes qui veulent se soustraire à des inégalités qui leur sont contraires, et en instituer d'autres en leur faveur. Ce but là est pour eux le principal.
§ 1228. Les résidus que nous avons encore à examiner, c'est-à-dire les genres (γ) et (δ), ont un caractère commun qui est le suivant. L'intégrité ayant été altérée en quelque façon, on vise à la rétablir, si possible, ou bien à obtenir des compensations à l'altération soufferte. Si le rétablissement s'obtient par des opérations se rapportant aux sujets qui ont subi l'altération de l'intégrité, on a le genre (V-γ), qui se subdivise en (V-γ 1), si les sujets sont réels, et en (V-γ 2), s'ils sont imaginaires. Si le rétablissement s'obtient par des opérations se rapportant à ceux qui ont altéré l'intégrité, on a le genre (V-δ), que l'on peut aussi subdiviser en (V-δ 1), si l'agent de l'altération est réel, et en (V-δ 2), s'il est imaginaire.
§ 1229. (V-γ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant aux sujets, qui ont souffert l'altération. À ce genre appartiennent les purifications, très usitées dans les sociétés anciennes, et qui continuent à l'être chez les peuples sauvages ou chez les barbares. Maintenant, chez les peuples civilisés, elles ne sont que peu ou point employées ; aussi pourrions-nous nous borner à les mentionner ; mais elles nous présentent d'excellents exemples de la manière dont les résidus agissent et germent avec les dérivations. Par conséquent, l'étude de ces purifications nous est indirectement utile pour bien comprendre des phénomènes analogues. C'est la raison pour laquelle nous nous en entretiendrons quelque peu.
§ 1230. Le sujet est assez complexe ; aussi convient-il de faire des distinctions. D'abord, nous avons à envisager les phénomènes: (a) au point de vue des individus et des choses, réelles ou imaginaires, qui y jouent un rôle ; ce qui constitue une étude objective du sujet; (b) au point de vue des sentiments des personnes qui interviennent dans les opérations de purification ou de rétablissement de l'intégrité ; c'est alors une étude subjective.
§ 1231. (a) Aspect objectif. Il faut faire les trois distinctions suivantes.
1° Les sujets qui souffrent l'altération. Là aussi, il y a différents points de vue.
Nature des sujets. Ils peuvent être réels ou imaginaires ; ce qui nous donne la division des genres (V-γ 1) et (V-γ 2). Il y aurait encore à considérer les sujets qui sont des abstractions de sujets réels, comme la famille, la nation, etc. Pour ne pas multiplier sans nécessité le nombre des genres, nous les comprendrons dans le genre (V-γ 2). Si l'on voulait envisager les actions au point de vue logique, on pourrait penser que la conception de l'altération de l'intégrité fut primitive pour l'homme, et fut ensuite étendue, par similitude ou par la persistance des agrégats, aux choses, aux abstractions, aux êtres imaginaires. Mais nous n'avons aucune preuve de ce fait, qui peut s'être produit à certains moments et pas à d'autres. Il peut aussi être arrivé que le passage ait eu lieu parfois en sens inverse, c'est-à-dire des choses aux hommes. Mais, si on laisse de côté les origines, et qu'on ne se préoccupe que de la mutuelle dépendance des faits, il devient manifeste que la similitude et la permanence des agrégats tendent à maintenir en une masse homogène les altérations de l'intégrité des hommes, des choses, des êtres abstraits ou imaginaires ; et souvent, on peut bien dire que, pour ces motifs, le concept des altérations passe de l'un à l'autre de ces sujets. Puisque l'homme est pour nous le sujet principal, on comprend que ce passage ait habituellement lieu de l'homme aux autres sujets. Les sujets réels peuvent être des hommes, des animaux, des plantes, des choses, des édifices, des villes, des territoires, des collectivités, par exemple une armée, des familles, des nations, etc. Ils sont extrêmement nombreux et variés.
Extension dans l'espace. Ici aussi, sans vouloir rien affirmer à propos des origines, nous pouvons observer que, dans les conceptions, l'être humain apparaît souvent comme un noyau dont l'altération s'étend ensuite aux divers groupes dont l'homme est supposé faire partie. Parmi ces groupes, les suivants sont importants : la famille, la parenté plus ou moins étendue, les groupes ethniques, comme la tribu, la cité, la nation et même tout le genre humain. La permanence des agrégats fait qu'on n'envisage pas seulement les individus qui composent ces groupes, mais que les groupes eux-mêmes acquièrent une existence indépendante. L'altération de l'intégrité suit souvent aussi une voie inverse : des groupes indiqués tout à l'heure, elle s'étend à l'individu. Chez un grand nombre de peuples, les actions non-logiques font de la famille une unité qui est ensuite considérée comme telle, par les dérivations logiques ou pseudo-logiques. Ce caractère, qui était général chez nos ancêtres gréco-latins, est encore très accusé dans la société chinoise. Le fait est en dépendance étroite avec celui de la responsabilité de la famille, et avec des phénomènes singuliers comme le lévirat ou l'épiclérat, par lesquels on rétablit, dans les limites du possible, l'intégrité d'un homme qui n'a pas de fils, et l'on maintient l'intégrité de sa descendance ou de l'agrégat qui porte le nom de famille.
Extension aux animaux, aux êtres inanimés, aux êtres abstraits ou imaginaires. La voie directe, allant de l'homme à ces êtres, est habituelle ; mais la voie inverse ne fait pas défaut non plus. Tous ces êtres peuvent être envisagés comme des personnes et souffrir d'altérations de l'intégrité.
Extension dans le temps. Elle ne peut faire défaut, quand l'altération ne subsiste pas matériellement, au moment du rétablissement. Les deux opérations étant successives, on suppose implicitement que le sujet est unique (§ 1055). Si un homme fait pénitence pour une faute qu'il a commise, on suppose l'unité de celui qui a péché et de celui qui fait pénitence. Mais l'extension dans le temps a lieu en beaucoup d'autres cas. L'altération et le rétablissement s'étendent des ancêtres aux descendants. On sait que les Chinois préfèrent la première façon et les Européens la seconde. Poussée à son extrême limite, l'extension à la descendance donne naissance à l'idée du péché originel (§ 1288). Une autre extension dans le temps fait sortir des bornes de la vie terrestre ; alors apparaissent les divers phénomènes de la métempsycose, du nirvana, des âmes récompensées ou punies, de la rédemption, etc.
2° L'altération . Elle peut aussi être réelle ou imaginaire. Ce peut être une altération matérielle ou une altération de conditions immatérielles ; et les considérations présentées tout à l'heure sur les diverses espèces d'extensions s'appliquent à elles.
La manière dont se transmet l'altération. Ce peut être un contact, l'effet de certains rapports entre les sujets, par exemple la descendance. Ce peut être des actes ayant des effets réels ou imaginaires, etc. Comme d'habitude, grâce à la persistance des agrégats, on étend la conception des formes réelles aux formes imaginaires.
3° Les moyens par lesquels l'altération se produit et ceux par lesquels le rétablissement a lieu. Eux aussi peuvent être réels ou imaginaires. Les résidus des combinaisons interviennent et donnent une immense variété de pratiques considérées comme efficaces pour altérer, et un plus grand nombre encore, pour rétablir l'intégrité. Il faut ajouter à ces moyens les opérations magiques et beaucoup de pratiques religieuses. Celui qui considère toutes les actions comme logiques donne habituellement la première place aux moyens, et croit que les purifications ont lieu en vertu de certains raisonnements. Celui qui connaît le rôle important des actions non-logiques accorde la première place aux sentiments, considère les moyens comme subordonnés, et sait que les raisonnements ne sont que l'enveloppe des sentiments qui engendrent les purifications (§ 1239). Il faut prendre garde que le choix des moyens peut être important pour l'utilité sociale. En cas d'épidémie, les anciens se purifiaient par de copieux lavages [FN: § 1231-1], tandis que les hommes du moyen âge se purifiaient par des processions et des pénitences, restant comme avant dans un état de saleté repoussant. C'étaient diverses enveloppes d'un même sentiment ; mais la première était utile aux hommes, la seconde inutile et même nuisible par les contacts entre gens sains et malades, dans les processions, et par les accrocs que les pénitences faisaient à l'hygiène.
§ 1232. Ajoutons quelques considérations communes aux distinctions que nous venons de faire. En toutes ces distinctions, nous trouvons des cas réels bien constatés. Non seulement un homme peut souffrir des altérations matérielles de son intégrité, mais il peut en souffrir dans sa réputation ; et cela non seulement personnellement, mais encore comme faisant partie de certains groupes. L'extension de l'altération à la famille est effective, quand les lois interviennent pour l'imposer, et même sans l'intervention des lois. L'homme qui s'enrichit met sa famille dans l'aisance ; celui qui se ruine la rend misérable. Il y a des maladies héréditaires qui font souffrir les enfants par la faute des parents. Les peuples souffrent des erreurs de leurs gouvernants, et profitent de leurs opérations heureuses. Les façons dont l'altération se transmet effectivement ne sont pas seulement matérielles : la parole est aussi un moyen puissant, et la diffamation peut être pire qu'une blessure corporelle. Souvent on ne s'aperçoit pas du passage du réel à l'imaginaire, et souvent on ne peut le fixer avec précision, pas même avec l'aide de la science moderne. Par exemple, on est encore dans le doute, au sujet de l'hérédité de certaines maladies ; et tous les doutes ne sont pas dissipés sur les manières dont les maladies se transmettent. Il ne semble pas que le contact du porc puisse nuire à l'homme, comme le croient les musulmans. D'autre part, nous savons maintenant que les rats sont un puissant moyen de diffusion de la peste. On pourrait rechercher l'origine de la croyance, lorsqu'il s'agit de cas imaginaires, dans l'observation qu'on aurait faite des cas réels ; et cela peut avoir eu lieu quelquefois ; mais on ne peut l'admettre en général, car ce serait croire qu'à l'origine des connaissances humaines, on trouve la science rigoureusement logico-expérimentale, qui dégénère ensuite en connaissances imaginaires ; tandis que tous les faits connus démontrent que c'est le contraire qui a lieu. Dans les préceptes que l'antiquité nous a laissés, nous trouvons mélangés des remèdes dont l'efficacité est réelle, et d'autres dont l'efficacité est imaginaire. Il est certain que les hommes n'ont pas commencé par connaître les premiers, étendant ensuite l'idée d'efficacité aux seconds ; ils les ont connus mélangés ; et il ne manque pas de cas où ils ont commencé par les seconds pour arriver ensuite aux premiers.
§ 1233. Les cas réels ont contribué à engendrer une croyance générale indistincte, qui acceptait ensemble les cas réels et les cas imaginaires, et qui était renforcée, tant par l'observation des cas réels que par les effets supposés de cas imaginaires, comme aussi grâce à certains instincts de répugnance pour certaines choses ; instinct dont l'origine, chez la race humaine, nous est inconnue, de même qu'elle nous est inconnue chez les races d'animaux. Les dérivations interviennent ensuite largement, pour accroître la complexité des phénomènes concrets.
§ 1234. (b) Aspect subjectif. Au point de vue des sentiments des personnes qui recourent au rétablissement de l'intégrité, nous distinguerons : 1° le sentiment que l'individu a de son intégrité et de celle de ses dépendances, avec les diverses extensions déjà mentionnées (§ 1231); 2° le sentiment que si cette intégrité est altérée, elle peut être rétablie ; 3° les sentiments qui poussent à user de certains moyens pour atteindre ce but.
§ 1235. La variabilité de ces sentiments s'accroît du 1er aux 3es, tandis que leur importance diminue pour l'équilibre social. Voyons-les maintenant en détail.
1° Le sentiment de l'altération de l'intégrité est tout d'abord indistinct, comme sont tous les sentiments semblables. On ne distingue pas ou l'on distingue mal les divers genres d'intégrité, telle que l'intégrité matérielle, morale, politique, etc. On ne distingue pas bien non plus l'intégrité de l'homme, de l'animal, des choses. Puis, peu à peu, les diverses espèces d'intégrité se séparent et donnent lieu à diverses théories. La même confusion existe pour les causes d'altération de l'intégrité. D'abord, on se préoccupe peu de savoir si cette cause vient d'une action de l'individu dont l'intégrité est altérée ou de l'action d'un autre. Mais bientôt on distingue les deux choses. Plus tard et plus difficilement, on sépare la cause volontaire de la cause involontaire. Dans cette considération de la volonté, il entre un peu de métaphysique.
§ 1236. On fait d'autres distinctions et l'on sépare d'autres modes d'altération de l'intégrité. Une distinction importante est celle des altérations permanentes et des altérations temporaires. Le type de la première est la souillure de l'homicide, en Grèce, au temps où il devait être purifié, ou bien l'état de péché mortel du catholique. Le type de la seconde est l'état d'un individu frappé par un sortilège, ou bien du catholique tenté par le démon.
§ 1237. 2° Les mêmes confusions et les mêmes distinctions que celles mentionnées tout à l'heure ont lieu pour le rétablissement de l'intégrité. Par exemple, en un cas extrême, le rétablissement de l'intégrité s'opère exclusivement par des actes extérieurs, mécaniques (§ 1252), qui peuvent même se faire à l'insu de l'individu dont l'intégrité doit être rétablie. Dans un autre cas extrême, le rétablissement de l'intégrité s'opère exclusivement grâce à des actes intérieurs, volontaires, de l'individu. Les cas intermédiaires, qui se rencontrent plus que d'autres, chez les peuples civilisés, sont ceux dans lesquels le rétablissement de l'intégrité a lieu moyennant des actes extérieurs mécaniques, auxquels s'ajoutent des actes intérieurs, volontaires. Les premiers et les seconds ont des importances diverses.
§ 1238. 3° Le sentiment qui pousse au choix des moyens correspond aux résidus des combinaisons (Ire classe), qui donnent un très grand nombre de moyens, lequel s'accroît encore par les dérivations. Parfois subsiste le sentiment qu'il doit y avoir un moyen, sans qu'on puisse précisément déterminer lequel, et la purification s'effectue par quelque chose d'indéterminé ; ou bien on emploie des moyens nombreux et variés, dans l'espoir que celui qui est convenable se trouve parmi eux.
§ 1239. La forme des usages, dans les purifications, est le plus souvent de peu d'importance pour l'équilibre social. Le sentiment que l'intégrité est altérée chez qui transgresse une certaine règle, un tabou, est de grande importance. Le sentiment que cette intégrité peut être rétablie est aussi très important. Mais, en général, il importe peu que ce rétablissement s'effectue en touchant un plat d'étain (§ 1252-1), ou d'une autre manière. Dans la théorie des actions logiques, on renverse cette gradation d'importance, car on suppose que c'est la foi aux moyens de purification qui pousse les hommes à se purifier, et fait naître en eux les sentiments qui se rapportent à la purification (§ 1231).
§ 1240. (V-γ 1) Sujets réels. En traitant de ce genre, nous devrons faire aussi une allusion au genre suivant (V-γ 2), à cause de la complexité des phénomènes. Chez les hommes, le sentiment de l'intégrité est parmi les plus puissants et a ses racines dans l'instinct de conservation de la vie ; mais il s'étend bien au delà. L'altération de l'intégrité est souvent aussi ressentie instinctivement, et donne naissance à un très grand nombre de phénomènes concrets.
§ 1241. Ce qu'on appelle le remords est une manifestation de l'idée d'altération de l'intégrité. Si celui qui a l'habitude d'observer certaines règles vient à les transgresser, il ressent, par ce seul fait, un malaise ; et il lui semble être en quelque sorte diminué dans sa personnalité. Pour faire cesser cet état pénible, il cherche et emploie quelque manière d'effacer cette tache et de rétablir son intégrité en l'état primitif. Les pratiques usitées pour éviter les conséquences d'une transgression d'un tabou montrent ce phénomène sous une forme assez simple.
§ 1242. Quand on veut tout réduire en actions logiques, on fait une grande différence entre le remords qui suit la transgression d'une règle de vraie morale ou de vraie religion, et celui qu'on éprouve pour avoir transgressé des règles de la superstition. Mais, au point de vue des actions non-logiques, ces deux cas sont tout à fait identiques. Naturellement chacun croit vraie sa morale et sa religion [FN: § 1242-1] . Le musulman rit du catholique qui éprouve du remords pour avoir mangé gras un vendredi. Le catholique rit du musulman qui éprouve du remords pour avoir touché un porc avec le pan de son habit ; et l'athée anti-alcoolique rit de tous les deux, lui qui éprouve du remords pour avoir bu un peu de vin. On a souvent cité comme extraordinaire un cas de remords des indigènes australiens [FN: § 1242-2] ; mais en somme il fait partie de la même classe que beaucoup de remords des peuples civilisés. Le remords, au moins en partie, n'est pas l'effet du raisonnement ; il naît spontanément, instinctivement, du sentiment d'une transgression qui altère l'intégrité personnelle. On a cité un grand nombre de faits qui démontrent que le remords existe aussi chez le chien.
§ 1243. Il n'est pas possible de faire que ce qui a été n'ait pas été ; mais on peut opposer à une force une autre force, égale et contraire, de sorte qu'elles se contrebalancent et que l'effet soit nul. Un fait peut être compensé par un autre fait, de manière que l'impression du second efface celle du premier. On peut sécher un homme qui a été mouillé, le réchauffer s'il a eu froid, le nettoyer s'il a été sali. À cause de la persistance des abstractions, ces opérations matérielles ou d'autres semblables s'étendent à la partie intellectuelle et morale de l'homme ; elles germent, poussent des rameaux et donnent une abondante moisson d'actions diverses.
§ 1244. L'intégrité peut être profondément ou légèrement altérée ; si bien que le rétablissement peut être une régénération de l'individu ou un simple acte qui en compense un autre, lequel souille l'individu. L'Église catholique fait une distinction de ce genre dans la classification des péchés mortels et véniels. Un sortilège altère l'intégrité d'un individu qui en est victime ; mais ce n'est pas une tache indélébile, comme le serait un homicide accompli par lui. En général, mais spécialement pour les altérations profondes, le rétablissement a pour but de replacer l'individu en l'état primitif où il était avant les actes qui l'ont souillé.
§ 1245. La souillure qu'on suppose ainsi exister peut être considérée comme une conséquence matérielle de certains actes, et s'efface matériellement aussi par l'effet d'autres actes. Ou bien, avec l'aide d'autres résidus et grâce à des dérivations, la souillure dépend de certaines conditions, parmi lesquelles il y a très souvent la volonté de l'individu. De même, des conditions identiques ou analogues doivent être réunies pour effacer la souillure.
§ 1246. D'une manière semblable, pour rétablir l'intégrité, on peut employer des moyens exclusivement matériels, exactement comme si l'on avait à effacer une souillure matérielle. On peut user de moyens exclusivement moraux [FN: § 1246-1] , intellectuels ; mais généralement ils sont accompagnés de moyens matériels. Très souvent, il semble qu'il y ait eu une évolution par laquelle des concepts moraux, spirituels, se sont ajoutés aux moyens matériels [FN: § 1246-2] ; et en avançant dans l'évolution, ces concepts dominent exclusivement, tandis que les moyens matériels apparaissent comme de simples symboles, sont entièrement secondaires. Cela donne facilement lieu à l'erreur d'après laquelle ils auraient toujours été tels, et n'auraient joué d'autre rôle que celui de donner une forme extérieure aux concepts moraux et spirituels. L'eau enlève les souillures matérielles : on suppose qu'elle peut enlever aussi les souillures morales [FN: § 1246-3] . Elle est habituellement employée par les hommes, pour se nettoyer des souillures matérielles ; de même, elle est l'un des principaux éléments qui enlèvent les souillures morales. On ajoute parfois d'autres choses à l'eau, soit matériellement, soit verbalement [FN: § 1246-4]. De très nombreuses combinaisons provenant des résidus de la Ire classe y jouent un rôle. Le sang, le soufre, d'autres matières ont aussi été employées dans les purifications. Remarquable est l'idée de purification suivant laquelle on crut que le déluge était une purification de la terre [FN: § 1246-5].
§ 1247. Chez un grand nombre de peuples anciens, les souillures matérielles et les souillures morales, qu'elles soient l'effet d'actes involontaires ou d'actes volontaires, ont été considérées comme identiques. Souillent de la même façon le fait d'être sale ou criminel, l'homicide involontaire et l'homicide volontaire, l'impureté de la femme qui enfante et celle de l'homme accusé de quelque méfait. La souillure matérielle peut être de saleté réelle, mais aussi de saleté imaginaire [FN: § 1247-1]. La souillure contractée par un individu peut s'étendre, par contact ou autrement, à d'autres individus, à des choses, à des abstractions.
§ 1248. Comme d'habitude, les idées d'altération de l'intégrité dépendent directement des sentiments, et ne sont qu'en relation indirecte avec les utilités des individus et de la société, justement au moyen des sentiments (§ 2115). Par conséquent ces deux modes d'envisager les altérations de l'intégrité sont entièrement différents. Quand on regarde les phénomènes synthétiquement, et qu'on accorde la première place à des considérations éthiques ou d'utilité sociale, il y a non seulement une grande différence, mais encore une opposition entre des phénomènes qui apparaissent comme semblables au point de vue des résidus et des dérivations. Ainsi, au point de vue botanique, le persil (Carum Petroselinum) et la ciguë (Aethusa Gynapium) sont des espèces très voisines d'ombellifères.
§ 1249. Dans l'évangile de Marc (VII, 3 et sv.), Les pharisiens reprochent à Jésus-Christ que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, comme tous les Israélites avaient l'habitude de le faire ; mais Jésus répond, puis explique à ses disciples que ce ne sont pas les choses matérielles qui rendent l'homme impur, mais bien les choses morales, comme les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les homicides, etc. Durant un très grand nombre de siècles, les chrétiens se sont complu à opposer leur religion idéale à la religion matérielle des Israélites, sans s'apercevoir que, par des voies détournées, ils revenaient exactement à ces mêmes pratiques qu'ils reprochaient aux pharisiens ; et les catholiques ont cru et croient encore que manger de la viande le vendredi souille l'homme, précisément comme les pharisiens croyaient que prendre un repas sans s'être lavé les mains le souillait. Si grande est la force des résidus, qu'ils amènent des doctrines opposées au même point ; et si grande est la force des dérivations que la plupart des gens ne s'aperçoivent pas de ce contraste. Jésus avait dit [FN: § 1249-1]: « Il n'y a rien hors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller; mais c'est ce qui vient de lui qui peut le souiller ». On ne saurait être plus clair ; et les explications données aux disciples font vraiment disparaître tous les doutes. Et pourtant les catholiques croient que la viande, qui est hors de l'homme, mangée le vendredi, souille l'homme, et qu'il faut certaines pratiques pour le laver de cette souillure. Les dérivations ne manquent pas : il y en a tant qu'on veut pour démontrer qu'il n'y a pas la moindre contradiction entre affirmer que rien de ce qui est hors de l'homme ne peut le souiller, en entrant en lui, et la doctrine suivant laquelle la viande qui entre en lui, le vendredi, le souille. C'est là un des si nombreux cas où l'on voit que, pour l'équilibre social, l'importance des résidus dépasse de beaucoup celle des dérivations. Ceux-là se modifient difficilement ; celles-ci s'étirent dans le sens qu'on veut, comme la gomme élastique.
§ 1250. Le fait relevé tout à l'heure, de l'Évangile, est un cas particulier d'un phénomène général. Quand le résidu du rétablissement de l'intégrité agit seul ou presque seul, on peut accepter les moyens exclusivement matériels, pour rétablir l'intégrité. Mais ensuite il s'y ajoute d'autres résidus de la classe de la persistance des agrégats. Grâce à cette persistance, on a pris l'habitude de placer dans une classe supérieure des hommes présentant certains caractères ; et ce sentiment est froissé quand, par les moyens matériels des purifications, ou d'autres, on place dans la classe supérieure des hommes auxquels font défaut les caractères que la persistance de la sensation unit à elle. Diogène exprime bien cela quand il dit [FN: § 1250-1] : « Il est ridicule qu'Agésilas et Épaminondas soient dans la fange, tandis qu'une abjecte populace qui est initiée sera dans les îles des bienheureux ».
§ 1251. Dans les exemples suivants, pour éviter de fastidieuses et inutiles répétitions, nous serons obligés de traiter ensemble le fait d'effacer la souillure et les moyens de le faire ; mais il sera facile au lecteur de séparer les deux choses.
§ 1252. Un individu qui a transgressé un tabou éprouve des sentiments d'avilissement, de crainte ; il les fait disparaître et rétablit son intégrité par certains actes (§ 1481). Souvent, on compense les transgressions du tabou par certaines actions mécaniques [FN: § 1252-1] où il n'y a rien de moral. Nous avons ainsi un type de purification par des pratiques exclusivement matérielles. D'autres résidus s'y ajouteront ensuite et surtout des dérivations, et l'on aura d'autres types très nombreux. Le caractère du défaut de l'élément moral, ou au moins de celui qui consiste dans le repentir, dans le désir de ne pas faire le mal, se trouve aussi dans les purifications préventives : celles qui précèdent l'acte qu'elles doivent compenser. Si nous devons en croire Ovide [FN: § 1252-2], la prière qu'il met dans la bouche des marchands qui invoquent Mercure, pour qu'il les absolve des péchés passés et futurs, nous fournit un exemple de purification préventive. On sait que l'Église catholique ne
§ 1253. En Grèce, à une certaine époque, on voit apparaître l'usage de purifier l'homicide volontaire ou involontaire. Nous ne recherchons pas ici si cet usage est indigène ou s'il vient d'autres pays. Il est certain qu'on ne le trouve pas dans Homère ; mais cela ne suffit pas pour résoudre le problème. En tout cas, postérieurement, il est général. Il consiste alors en certains actes qui doivent être accomplis par une personne qui ne soit pas l'homicide. Cette personne n'est pas nécessairement le prêtre d'une divinité ; mais ce n'est pas non plus le premier venu. Il paraît que ce doit être un personnage important. La souillure est la conséquence automatique de l'homicide, indépendamment des circonstances dans lesquelles il est commis, même si c'est pour une cause réputée légitime. Là se voit le résidu pur de notre genre. Hérodote (I, 35) raconte comment un homme vint vers Crésus pour être purifié : «(2) Étant venu dans la maison de Crésus, il le pria de le purifier suivant le rite du pays. Crésus le purifia. Le rite de la purification est semblable chez les Lydiens et chez les Grecs ». C'est seulement une fois la cérémonie accomplie que Crésus s'informe du nom et de la condition de son visiteur. Il lui dit: « (3) Homme, qui es-tu ? et de quel endroit de la Phrygie es-tu venu t'asseoir à mon foyer ? Quel homme ou quelle femme as-tu tué ? » Le caractère matériellement automatique du rite est ici bien clair. Quel que soit l'homme, quel que soit l'homicide, crime ou justice faite, c'est tout un : la purification doit être accomplie et se fait de la même manière. Le Phrygien dit son nom, celui de son père et de son grand-père, et ajoute: « (4) J'ai tué involontairement mon frère ». Voilà donc que l'homicide involontaire souille précisément comme l'homicide volontaire. Observons que, chez Hérodote, il n'est fait aucune allusion aux dieux : leur intervention est une adjonction postérieure ; elle apparaît avec de nouveaux résidus qui s'agglomèrent avec le résidu principal. Dans la Bibliothèque d'Apollodore (I, 9, 24), pour que les Argonautes sachent qu'ils sont poursuivis par la colère de Zeus à cause du meurtre d'Absirte, il est nécessaire que le navire leur parle et les avise du fait, ajoutant que cette persécution ne cessera pas, tant qu'ils ne seront pas purifiés par Circé. Ensuite l'auteur dit simplement que « s'étant présentés à Circé comme des suppliants, elle les purifia ».
§ 1254. Apollonius de Rhodes nous fait connaître les détails de cette purification. Il suit probablement d'anciennes traditions, auxquelles il ajoute des tentatives d'explications logiques, où il fait intervenir Zeus. Tout d'abord, les Argonautes souffrent de nombreux malheurs sur mer, précisément comme celui qui a transgressé un tabou et ne s'est pas purifié. Puis le navire Argo parle et leur dit « (IV, 585-588) qu'ils ne pourraient éviter d'errer longuement ni les terribles tempêtes, si Circé ne les purifiait du cruel homicide d'Absirte ». Après un voyage difficile, ils arrivent à l'île de Circé. Jason et Médée entrent dans le palais de la déesse et, sans mot dire, s'asseyent auprès du foyer, suivant l'usage des suppliants. Jason plante en terre le fer dont il a tué Absirte. Voyant cela, Circé comprit ce qu'on lui voulait. Après avoir adoré la justice du Zeus des suppliants (702-709), « elle fit les sacrifices au moyen desquels, par les ablutions, on purifie les criminels suppliants, quand ils viennent s'asseoir au foyer. D'abord, elle plaça sur l'autel la victime expiatoire : un petit cochon de lait [FN: § 1254-1] , et, l'ayant égorgé, elle mouilla leurs mains de sang. De nouveau, elles les purifia par d'autres libations, invoquant Zeus qui purifie, protecteur des prières qui vengent le sang répandu ».
§ 1255. Chez Apollodore, les purifications apparaissent comme des opérations régulières, après les homicides. Les filles de Danaos, ayant tué les fils d'Aegyptos, sont purifiées par Athéna et par Hermès, qui agissent suivant l'ordre de Zeus (II, 1, 5). Héraclès, ayant tué ses fils dans un accès de folie, est purifié par Thestios (II, 4, 12). Il doit aussi se faire purifier du meurtre des Centaures (II, 5, 12). Dans un nouvel accès de folie, il tue Iphitos, fils d'Eurytos, puis demande à Nélée de le purifier ; mais celui-ci, étant ami d'Eurytos, refuse ; aussi Héraclès se fait-il purifier par Déiphobe (II, 6, 2). Il faut remarquer que, malgré la purification, il est frappé d'une grave maladie, en expiation du meurtre d'Iphytos, et qu'il n'en est délivré qu'après s'être vendu comme esclave, et avoir donné le prix de la vente au père d'Iphytos (II, 6, 2). On voit une autre tradition se superposer à la première sans que l'auteur essaie même de les faire concorder. La légende nous donne d'autres nombreux exemples de purifications d'homicides involontaires. Pélée est purifié pour deux homicides de ce genre [FN: § 1255-1] . Il y a plus. L'œuvre de Thésée qui détruit les brigands est méritoire : pourtant il doit être purifié [FN: § 1255-2] . Apollon lui-même doit être purifié du meurtre du serpent Python. Plutarque, qui vivait en des temps très postérieurs à ceux où cette légende prit naissance, estime ridicule qu'un dieu doive être purifié [FN: § 1255-3] . Ajax se purifie après avoir massacré des moutons, dans un accès de folie [FN: § 1255-4] . Il y a des gens qui vont jusqu'à vouloir la purification des chasseurs et des chiens qui reviennent de la chasse [FN: § 1255-5] . Le caractère purement mécanique de la souillure de l'homicide et de la purification qui en est la conséquence, ressort bien d'un récit de Pausanias [FN: § 1255-6] . Un enfant, en s'amusant, se frappe la tête contre un bœuf de bronze et meurt. Cette statue est réputée souillée par l'homicide. « Les Éléens voulaient déporter hors de l'Altis le bœuf [de bronze], accusé de l'homicide ; mais le dieu de Delphes leur prescrivit de purifier le bœuf par les rites que pratiquaient les Hellènes pour les homicides involontaires ».
§ 1256. La légende d'Oreste est l'un des cas où l'on voit la purification simplement matérielle se transformer, au moins partiellement, en purification morale. Oreste est purifié à Delphes par Apollon ; mais cela ne suffit pas, et son procès à Athènes est bien connu. Pausanias, l'auteur, raconte comment le roi spartiate Pausanias tua involontairement une jeune fille du nom de Kléonice. Il eut ensuite recours à toutes sortes de purifications, sans qu'elles suffisent à le laver de la souillure contractée par cet homicide ; c'est pourquoi il fut le seul qui ne fut pas sauvé par l'asile de Chalcioicos [FN: § 1256-1] .
§ 1257. Les rapports sexuels, légitimes ou non, entre l'homme et la femme, passaient pour une cause d'impureté, chez les anciens Grecs comme chez d'autres peuples. Là aussi, nous avons le passage de l'impureté exclusivement matérielle à l'impureté morale. La pythagoricienne Théano, à qui l'on demandait: « Combien de jours après avoir eu des rapports avec un homme la femme devient-elle pure ? », répondit : « Si c'est avec son mari, immédiatement ; si c'est avec un autre homme, jamais [FN: § 1257-1]».
§ 1258. Chez un grand nombre de peuples, et principalement chez les peuples barbares ou sauvages, ce n'est pas seulement l'acte sexuel qui est cause d'impureté, mais aussi les menstruations de la femme [FN: § 1258-1]. À ce propos, on pourrait citer un très grand nombre d'exemples. La Bible contient des prescriptions remarquables [FN: § 1258-2] que les chrétiens n'observent plus. L'accouchement est considéré, chez un très grand nombre de peuples, comme une cause d'impureté. Dans l'île de Délos, il ne devait y avoir ni morts ni enfantements. À Rome et à Athènes, le nouveau-né était aussi purifié.
§ 1259. En Grèce, le contact ou la vue d'un mort était une cause d'impureté. Un vase, pris dans une autre maison et plein d'eau, était placé devant la maison mortuaire, pour purifier ceux qui en sortaient [FN: § 1259-1] . Ceux qui avaient assisté à des funérailles se purifiaient [FN: § 1259-2].
§ 1260. Très nombreuses étaient les formes d'impureté, qui toutes correspondaient à un sentiment, réel ou imaginaire, de l'altération de l'intégrité personnelle, et qu'on faisait disparaître grâce à d'opportunes pratiques de purification. Au milieu d'un si grand nombre de causes d'impuretés, l'homme superstitieux craint tout. Théophraste nous le montre sortant du temple, après s'être lavé les mains et aspergé d'eau lustrale, et se promenant tout le jour avec des feuilles de laurier dans la bouche. Il purifie sa maison à chaque instant. Il n'ose pas aller auprès d'une tombe ni d'une accouchée. Il va à la mer pour s'asperger d'eau de mer. S'il fait une rencontre réputée mauvaise, il se purifie en se versant de l'eau sur la tête, et en faisant porter autour de lui une scille maritime et un petit chien [FN: § 1260-1]. Cynthie purifie la chambre après avoir chassé les courtisanes avec lesquelles elle avait surpris Properce [FN: § 1260-2]. Pour qui fixe son attention principalement sur les dérivations, il y a un abîme entre les purifications des crimes et ce jeu amoureux ; pour qui s'arrête au contraire aux parties constantes et importantes des phénomènes, il y a similitude parfaite. Juvénal décrit les purifications que pratique la femme superstitieuse [FN: § 1260-3] . En hiver, elle se plonge trois fois dans le Tibre et, timide, se lave la tête.
§ 1261. L'impureté s'étend de celui qui l'a contractée à toute autre personne qui a contact ou rapport avec lui : des parents aux enfants, d'un individu à la collectivité dont il fait partie, aux animaux, aux choses matérielles, à un pays entier. Si nous devons ajouter foi aux lois dites de Manou, même le seul fait de la mort d'un conjoint est une cause d'impureté, sans qu'il faille voir ou toucher le mort [FN: § 1261-1]. On voit donc que le phénomène assume la forme d'une nébuleuse qui s'étend plus ou moins loin autour d'un noyau.
§ 1262. Quand on envisage la famille comme l'unité sociale, la conséquence en est que toute altération de l'intégrité d'un des membres de la famille se répercute sur toute celle-ci, dans l'espace et dans le temps [FN: § 1262-1], comme la blessure faite à un membre du corps d'un être vivant se répercute sur tout le corps. Dans les pénalités qui frappent une famille entière, pour le crime commis par l'un de ses membres, il y a une action logique : on vise à agir sur l'affection qu'on suppose que cet individu a pour sa famille; mais il y a aussi le résidu qui fait considérer la famille comme l'unité sociale. C'est pourquoi ces pénalités collectives disparaissent quand l'individu devient cette unité, comme il est arrivé en Europe, tandis qu'elles subsistèrent jusqu'à notre époque en Chine, où la famille est l'unité.
§ 1263. Si un homme n'a ni fils ni filles, l'intégrité de la famille est altérée. On néglige les filles, quand la famille se maintient par les mâles. Il faut rétablir cette intégrité. Aussi a-t-on les diverses dispositions qui permettent à l'homme dont la femme est stérile d'en prendre une autre, en répudiant ou en conservant la première. Si l'homme est mort sans laisser de fils, ce remède ne sert plus ; et l'on a alors les dispositions de l'épiclérat, à Athènes, du lévirat, chez les Israëlites, ou d'autres institutions semblables. Les dérivations recouvrent ensuite ces faits ; mais pas au point d'en cacher le fond à celui qui les observe attentivement. Pour donner une idée de ces phénomènes, il suffira de transcrire ici les dispositions des lois de Manou [FN: § 1263-1]. Les traiter à fond est la tâche de la sociologie spéciale qui fera suite à cette sociologie générale.
§ 1264. Les prescriptions bibliques, développées ensuite dans le Talmud, nous donnent un exemple d'une épaisse forêt de règles touchant les impuretés et les purifications. En traiter longuement ici serait perdre son temps ; mais il sera utile d'en avoir au moins une idée, car, de ce cas particulier, on tire une vue du phénomène en général. Les objets impurs ou immondes se disposaient en une série d'impuretés décroissantes, comme de père à fils. Tout en haut, on trouve l'ancêtre des immondices [FN: § 1264-1]suivent les pères des immondices et quatre degrés de descendances des fils des immondices. Le contact avec l'ancêtre donne naissance à certains pères. Le premier degré des fils comprend les objets devenus impurs par le contact avec les pères ; le second degré des fils contracte l'impureté, du contact avec le premier; le troisième, du contact avec le second ; le quatrième, du contact avec le troisième. Père et fils peuvent être suivant la loi, ex lege, ou bien suivant les commentateurs : ex instituto scribarum. L'ancêtre des immondices, c'est le cadavre humain. Les pères suivant la loi sont au nombre de trente-deux [FN: § 1264-2] : les reptilia, les cadavres des bêtes, des hommes, etc. Les reptilia sont énumérés dans la Bible. Ce sont certains animaux ; mais lesquels ? On ne le sait pas précisément ; car les interprètes ne sont pas d'accord sur les noms [FN: § 1264-3]. Les partisans des actions logiques peuvent s'évertuer tant qu'ils veulent : ils ne réussiront jamais à trouver pourquoi justement ces animaux seraient immondes, et d'autres pas. Les pères des immondices sont au nombre de vingt-neuf, suivant les sages [FN: § 1264-4]. Les fils des immondices ont aussi ce caractère, ou de par la loi ou par institution des sages. Dans les choses profanes, le premier degré est immonde et engendre l'impureté par le contact ; le second ne l'engendre pas. Dans les choses saintes, les trois premiers degrés sont immondes et engendrent l'impureté, le quatrième ne l'engendre pas. Les pères des immondices contaminent hommes et récipients ; les fils seulement les mets et les boissons. « Si un homme a touché un reptile, il contracte une immondice du premier degré, et contamine l'huile, s'il l'a touchée. Si, à son tour, cette huile a touché du miel, elle le contamine... et si ce miel a touché de l'eau, il la contamine; et de cette façon, l'huile, le miel et l'eau ont chacun le premier degré d'immondice [FN: § 1264-5]». L'impureté dure plus ou moins longtemps, et il y a un grand nombre de prescriptions sur cette matière. Sur la lèpre, le Talmud a tout un livre, et ajoute beaucoup de prescriptions à celles, déjà fort nombreuses, de la Bible.
§ 1265. Quand on a bien reconnu les immondices, il faut les faire disparaître. Il est recommandé de se laver avec de l'eau ; c'est toujours autant et cela profitera à la propreté. Des prescriptions minutieuses guident le fidèle dans cette opération ; la Bible en donne plusieurs et le Talmud les amplifie.
§ 1266. Semblablement à ce qui arrive chez d'autres peuples, on fait des purifications avec des eaux spéciales et en usant de modes déterminés. Chez les Israélites, le sacrifice de la vache rousse est remarquable. Elle doit être sans tache et sans défauts. Une fois tuée, le prêtre en prend le sang et en asperge la tente d'assignation. C'est ainsi que les Grecs purifiaient avec le sang de petits cochons ; et Aristophane, plaisantant cet usage, suppose que l'assemblée des femmes s'ouvre par le sacrifice de la luxurieuse belette [FN: § 1266-1] . La vache était brûlée de la manière prescrite, et la cendre recueillie et mêlée à l'eau, donnait l'eau de purification [FN: § 1266-2]. Les Romains avaient coutume de sacrifier, vers la mi-avril, la vache forda,c'est-à-dire portante et féconde. Les prêtres extrayaient du ventre des mères les veaux, qui étaient brûlés par la plus ancienne des Vestales (Virgo Vestalis Maxima), et la cendre était conservée pour purifier le peuple, le jour de Palès [FN: § 1266-3](fêtes Palilies ou Parilies). Auparavant déjà, dans le même but, on avait conservé le sang du cheval sacrifié, en octobre, au Champ de Mars [FN: § 1266-4] . Le 21 avril, on célébrait les Palilies. Le peuple allait chercher à l'autel de Vesta le sang du cheval, la cendre des veaux et des tiges sèches de fèves. Ensuite, il se faisait asperger d'eau avec un rameau de laurier ; il faisait des fumigations de soufre, et sautait sur de la paille enflammée [FN: § 1266-5]. De cette fête nous sont restés les feux d'allégresse qu'on allume encore en plusieurs contrées. Le mercredi des cendres, les catholiques brûlent les palmes de l'année précédente et, avec les cendres, font le signe de la croix sur le front des fidèles [FN: § 1266-6] .
§ 1267. On voit ici disparaître la propriété qu'a l'eau de laver un homme ou une chose, puisque toucher l'eau de purification entraîne une souillure. Le caractère imaginaire prévaut sur le caractère réel. Comme d'habitude, le Talmud subtilise sur cet effet de l'eau de purification. On distingue les eaux dont la quantité est suffisante pour être répandues, de celles dont elle ne l'est pas. Les premières souillent celui qui les porte ; les secondes seulement celui qui les touche. Et prenons bien garde que « si une ficelle est attachée à la chose immonde, et que l'homme soulève la chose immonde au moyen de la ficelle, comme la pesanteur de la chose immonde le touche, il est souillé par l'immondice du poids, de telle sorte qu'à son tour il souille ses vêtements et tous les vêtements et les vases qu'il touche, excepté les vases de terre » [FN: § 1267-1].
§ 1268. La casuistique portant sur les circonstances matérielles des faits est abondante et subtile. En voici un exemple. Un gallinacé avale un reptile et passe par un four. S'il demeure vivant, il ne souille pas le four ; s'il meurt, il le souille [FN: § 1268-1] . Si quelqu'un fait tomber du lait du sein d'une femme dans un four, celui-ci est immonde ; de même si, en balayant le four, la femme se pique un doigt et le met dans sa bouche [FN: § 1268-2] . Il y a plusieurs observations sur les belettes ou les chattes qui se promènent avec un reptile dans la gueule [FN: § 1268-3] , sur les crachats purs et immondes, semi-fluides et secs, en un lieu public et en un lieu privé [FN: § 1268-4] . Enfin, sur les questions sexuelles, il ne manque pas de nombreuses dissertations allant de pair avec celles que les anti-cléricaux reprochent d'une façon si acerbe aux jésuites [FN: § 1268 note 1268-5]. On discute longuement sur le mode et sur l'efficacité des ablutions ; il y a des choses qui séparent, et d'autres qui ne séparent pas l'eau, du corps, suivant les circonstances [FN: § 1268-6].
§ 1269. Maintenant, si nous considérons les choses d'un peu haut, en négligeant les menus détails, comme on fait pour dessiner une carte géographique, nous verrons aisément la forme qu'assume le phénomène. Le noyau est une répugnance instinctive pour les cadavres et pour diverses espèces d'ordures. En certains cas, cette répugnance est utile aux hommes, de même qu'il est utile aux animaux de s'abstenir d'aliments vénéneux. C'est l'un des très nombreux cas d'actions non-logiques dont nous avons parlé au chapitre II.
§ 1270. Comment se fait-il que ces instincts soient utiles aux animaux ? Nous n'en savons rien. Le fait est certain. Les bœufs, les chèvres, les moutons laissent de côté les plantes vénéneuses, dans les pâturages, et il est remarquable qu'ils les mangent au contraire dans le foin. Les oiseaux laissent de côté les graines vénéneuses. On pourra dire avec les darwinistes que, par sélection, les animaux qui n’avaient pas cet instinct ont péri ; on pourra trouver d'autres causes ; mais, de toute façon, le fait subsiste, et nous nous en tenons là.
§ 1271. Pour l'homme, à ce noyau s'ajoutent deux appendices (§ 1273 et sv.). Le premier tire son origine de l'adjonction des résidus de la Ire classe, qui poussent à une infinité de combinaisons et à leurs explications logiques. Nous avons cité le Talmud, justement parce qu'il donne un exemple remarquable de ces combinaisons matérielles et de leurs explications, lesquelles restent dans un domaine juridique, avec très peu de considérations métaphysiques ou théologiques, l'autorité de la Bible étant principalement invoquée, comme celle des lois écrites le serait par un juriste.
§ 1272. Les subtilités hébraïques ne sont point exceptionnelles : on en trouve d'autres, semblables, chez d'autres peuples, spécialement chez les Hindous et chez les mahométans. Un grand nombre de prescriptions des Hindous sont presque identiques à celles des Israélites [FN: § 1272-1].
§ 1273. Dans les actions non-logiques de l'impureté et de la purification, on trouve d'excellents exemples du second et du quatrième genre d'actions non-logiques, dont nous avons parlé aux § 151 et sv. Ces actions non-logiques ont un but logique subjectif, qui est d'obéir à des prescriptions religieuses. Une partie n'ont pas de but logique objectif ; par exemple le fait de ne pas soulever de loin un objet impur ; elles appartiennent au second genre. Une partie ont un but logique objectif, car elles sont utiles à l'hygiène, par exemple le fait de tenir pour souillées les boissons dans lesquelles est tombé un lambeau de cadavre. Ce but serait accepté par le sujet, s'il le connaissait; nous avons donc des actions non-logiques de l'espèce (4 α) (§ 151 et sv.).
§ 1274. Il en est résulté que les actions de cette dernière partie ont été prises pour des actions logiques, et cela a contribué en outre à étendre cette conception à des actions qui n'appartiennent pas à l'espèce (4 α). Mais ce caractère logique n'existe pas. On peut soutenir que les prescriptions concernant les menstrues de la femme sont d'ordre hygiénique ; mais il est impossible, à ce point de vue, de distinguer les menstrues de l'Israélite de celles de la païenne, comme aussi le cadavre de l'Israélite du cadavre du païen.
§ 1275. Le second appendice tire son origine du besoin d'expliquer, non plus matériellement, les combinaisons, mais les principes mêmes qui leur donnent naissance, ou bien du désir de rendre logiques les actions non-logiques. Ici agissent non seulement les résidus du besoin de logique (I-ε), mais aussi les résidus de la persistance des agrégats (II-α). Cet appendice se divise en deux. D'une part, nous avons les explications pseudo-expérimentales ; de l'autre, celles qui dépassent l'expérience.
§ 1276. Un type des explications pseudo-expérimentales est celui qui eut tant de crédit, et suivant lequel on croyait que la prohibition de la viande de porc était un principe hygiénique, auquel on ajoutait une sanction religieuse [FN: § 1276-1].
§ 1277. Le totémisme, qui explique tout, explique aussi la répulsion des Sémites pour le porc, qui serait un ancien totem, et, comme tel, respecté et exclu de l'alimentation. Cela pourrait être vrai, et il y a des faits qui viennent à l'appui de cette théorie. Burckhardt rapporte [FN: § 1277-1] : « (p. 162) Il y a quelques années qu'un vaisseau anglais échoua près de Djidda [en Arabie], et parmi les débris du naufrage était un porc, animal que probablement on n'avait pas vu encore à Djidda. Ce porc, lâché dans la ville avec deux autruches, devint la terreur de deux marchands de pain et de légumes, car le contact d'un animal aussi immonde que le porc, ne le touchât-on qu'avec le bord de la robe, rend un musulman impur et hors d'état de faire sa prière sans des ablutions particulières : on garda l'animal pendant six mois, et enfin il mourut à la grande satisfaction des habitants ». Il y a là tous les caractères du respect pour le totem ; et si tous les faits étaient de ce genre, l'explication donnée deviendrait très probable. Mais il y en a d'autres qui ne concordent pas avec cette explication. D'abord, nous observons que, dans la Bible, le porc n'est pas seul dans la classe des animaux qui ne doivent pas être mangés, mais qu'il a de nombreux compagnons. S'ils étaient peu nombreux, on pourrait croire que ce sont tous des totems ; mais est-il bien possible que tous ces animaux si nombreux soient des totems ? que, par exemple, tous les animaux aquatiques, en grande partie inconnus des Hébreux, et qui n'ont ni nageoires ni écailles, fussent des totems ? [FN: § 1277-2]On pourrait répondre : « La prescription de ne pas manger les totems a été postérieurement étendue à d'autres animaux ». Admettons-le. Reste maintenant à savoir si le porc était le totem dont provint la prohibition, ou bien un animal auquel elle fut étendue, à partir d'autres animaux qui étaient totems. Là-dessus nous n'avons pas le moindre renseignement. Concluons donc qu'il se peut bien que le porc fût un ancien totem, mais que cela doit être démontré par des preuves spéciales, qui, pour le moment, nous font défaut ; tandis que le fait général de la répulsion pour l'emploi de sa chair ou pour son contact ne prouve rien, parce qu'il prouverait trop.
§ 1278. Rabbinowicz veut expliquer la prescription suivant laquelle, à propos de certaines lois de l'impureté, un mort païen doit être considéré comme pur ; mais les dérivations auxquelles il recourt sont ensuite réfutées par lui-même [FN: § 1278-1].
§ 1279. Les païens sont considérés comme purs en certains cas, principalement parce que, dans le noyau des actions non-logiques, celles-ci se rapportaient aux membres de la collectivité, c'est-à-dire aux Hébreux. Mais ensuite, par le raisonnement, elles s'étendirent aussi aux étrangers. Rabbinowicz dit que les Hébreux ne pouvaient distinguer les tombes des païens. Mais ils ne pouvaient pas non plus distinguer les crachats des païens ; et, en ce cas, le Talmud donne une solution diamétralement opposée à la première ; Rabbinowicz lui-même la rappelle : « (p. 411) S'il y a une païenne dans la ville, les salives sont impures (pour les haberim qui s'engageaient à observer les lois mosaïques sur la pureté, car la femme païenne peut se trouver à l'époque des menstrues) [FN: § 1279-1]». Nous avons beaucoup d'autres problèmes semblables, avec des solutions diverses, lesquelles ne peuvent pas toujours être réduites à des considérations de commodité pour les Israëlites qui devaient vivre avec les païens [FN: § 1279-2].
§ 1280. Les explications qui dépassent l'expérience ont pour but de donner le pourquoi des prescriptions en lesquelles on a foi, et qui imposent certaines pratiques. Elles commencent par les simples affirmations des tabous, pour s'élever peu à peu aux plus abstruses subtilités métaphysiques et théologiques. Dans le Lévitique, on trouve une forme simple d'explications : les règles de la pureté et de la purification sont données comme venant de Dieu. Puis on renforce l'affirmation par quelque exhortation [FN: § 1280-1] . Enfin, suit une des explications habituelles des tabous : on dit que celui qui les transgresse court le danger de mort, et l'on y ajoute aussi une explication religieuse [FN: § 1280-2] .
§ 1281. Le christianisme ajouta une autre couche d'explications. Les Israëlites faisaient des sacrifices et, de même que d'autres peuples, se servaient du sang de la victime, pour purifier [FN: § 1281-1] . Les chrétiens voulurent supprimer cet usage, et non contents de cela, ils voulurent aussi expliquer pourquoi ils le supprimaient. Saint Paul dit que le sang de Christ, répandu une fois pour toutes, est le plus parfait des sacrifices et se substitue aux anciens [FN: § 1281-2]. Mais cette raison est bien celle des dérivations, qui sera traitée dans le chapitre suivant. Nous avons fait ici cette digression pour montrer, par un autre exemple, ajouté à ceux que nous avions déjà donnés, comment, des phénomènes concrets complexes, on extrayait les résidus. Il convient de remarquer la persistance des agrégats, par laquelle les chrétiens n'osent pas faire disparaître entièrement l'idée du sacrifice, mais se contentent de transformer ce sacrifice, en sorte que cette idée persiste, mais sous une forme différente.
§ 1282. Les résidus de l'intégrité rendue aux personnes et aux choses se rencontrent en un grand nombre d'autres cas. L'Église catholique réconciliait les pénitents et continue à réconcilier les églises et les cimetières [FN: § 1282-1].
§ 1283. La persistance des agrégats fait que des pratiques qui s'appliquent aux hommes, par exemple les actes juridiques et le rétablissement de l'intégrité, s'étendent aux animaux et aux choses. Mais on ne doit pas conclure qu'il y a imitation directe ; elle peut exister en partie ; d'un autre côté, on a aussi des conséquences directes d'un même sentiment.
§ 1284. De même, on étend dans l'espace l'idée de la purification. Il y a certains signes qui montrent qu'un péril indéterminé menace une collectivité, un pays entier, et il faut pourvoir à son éloignement.
§ 1285. Comme type de ces phénomènes, on peut noter la procuration des prodiges des Romains [FN: § 1285-1]. Un prodige était une menace de dangers futurs : il fallait courir au remède. En outre, il souillait, et il fallait purifier. Celui qui a pris un poison par inadvertance doit se procurer un contre-poison qui en neutralise l'effet. Dans la description qui nous est restée de ces faits, on voit clairement le sentiment qu'on devait faire quelque chose, et la recherche pressante de ce quelque chose.
§ 1286. En certains cas, on savait avec précision quelle avait été l'altération de l'intégrité, altération qu'on appelait piaculum ; et le même nom désignait les mesures prises pour rétablir cette intégrité altérée. Pour un sacrifice qui n'avait pas été accompli rigoureusement selon les rites, on rétablissait l'intégrité en renouvelant le sacrifice. Pour diverses autres transgressions, on avait divers sacrifices. Aulu-Gelle raconte que le Sénat, ayant appris que, dans le sanctuaire, les javelots de Mars s'étaient spontanément remués, ordonna de sacrifier à Jupiter et à Mars ; si d'autres victimes venaient à être nécessaires – si quid succidaneis opus est – on sacrifierait à Robigus. Aulu-Gelle disserte longuement sur le terme succidaneae, et conclut que ce sont des victimes qui servent de complément, si les premières ne suffisent pas. « Pour le même motif, on appelle praecidaneae les victimes qui sont sacrifiées la veille des sacrifices solennels. Et de même, on appelle Porca praecidanea la truie qu'on avait coutume de sacrifier à Cérès, en guise de piaculum, avant la nouvelle poussée des plantes, si dans la famille où quelqu'un était mort, ou n'avait pas fait, ou l'on avait mal fait les purifications nécessaires [FN: § 1286-1]».
§ 1287. On confond souvent la lustratio et le piaculum, car tous deux visent en somme à rétablir l'intégrité. Les Arvales fratres devaient nécessairement entrer dans le bois sacré, avec des instruments de fer tranchants, pour accomplir les sacrifices. D'autre part, il était défendu de porter ces instruments dans le bois. Par conséquent, cette prescription, transgressée à chaque instant, nécessitait le secours d'une fonction pour rétablir l'intégrité. C'était la tâche du Magister ou du Pro-Magister, qui, le matin, faisait le sacrifice expiatoire de deux porcs et d'une génisse, et attendait, dans l'après-midi, les Arvales. Cela se passait durant la solennité annuelle, qui avait lieu en mai ou en juin. Mais ensuite, chaque fois qu'il y avait quelque travail à exécuter dans le bois sacré, il fallait des sacrifices expiatoires spéciaux. Dans ces usages fort anciens du collège des Arvales, apparaît clairement le caractère mécanique du rétablissement de l'intégrité ; rétablissement qu'on voit être une opération tout à fait semblable à celle qu'on ferait pour aiguiser à nouveau la hache qui a servi à la coupe d'un arbre. Il y a une chose que l'on doit faire, que l'on fait régulièrement, et il n'y a pas de faute à la faire ; mais il est nécessaire d'y opposer une autre opération, pour rétablir un certain équilibre troublé par la première.
§ 1288. L'idée de l'altération de l'intégrité s'étend aussi dans le temps, et aboutit à la responsabilité des descendants pour les fautes des ascendants, et ainsi à la conception chrétienne du péché originel, et à d'autres analogues, comme celle des Orphiques [FN: § 1288-1], d'après lesquels l'intégrité des êtres humains avait été primitivement altérée. Comme conséquence de semblables idées, on croyait que diverses expiations et purifications étaient nécessaires. Platon déjà [FN: § 1288-2]fait mention des devins qui se donnent aux riches comme possédant des purifications capables d'effacer les crimes des hommes et de leurs ancêtres. Ovide reproduit les récits qu'on faisait, de son temps, sur la tache originelle du genre humain [FN: § 3] . À vrai dire, toutes ces historiettes, ces dérivations par lesquelles se manifeste le sentiment de la tache originelle, importent assez peu ; et pourtant, c'est d'elles que s'occupent beaucoup de ceux qui disent étudier les religions, tandis qu'ils négligent les sentiments, les résidus manifestés de cette, façon, et qui agissent principalement pour déterminer l'équilibre social.
§ 1289. On trouve, dans le baptême chrétien, le type du rétablissement de l'intégrité depuis le péché originel. Nous n'avons pas à traiter ici des innombrables dérivations aux-quelles cet acte donna lieu, et moins que jamais de sa valeur spirituelle, sujet qui sort entièrement du domaine expérimental où nous voulons demeurer. Mais, au point de vue des résidus, il est impossible de ne pas rapprocher le baptême chrétien du baptême de Saint Jean-Baptiste et des ablutions que pratiquèrent et pratiquent encore tant de peuples. Dans le baptême chrétien, l'effet de l'une de ces ablutions a pris une forme précise, quant au rétablissement de l'intégrité, et le baptême ôte non seulement le péché originel, mais tout autre péché qui peut avoir souillé l'individu, jusqu'au moment précis du baptême [FN: § 1289-1]. Innombrables sont les passages des saints Pères qui y font allusion, et qu'on peut résumer par le passage suivant qu'on trouve dans les œuvres de Saint Augustin, et qui est d'un auteur inconnu [FN: § 1289-2] : « Rémission des péchés. Le saint baptême efface entièrement tout péché, les péchés originels et les propres péchés : péchés de langue, de faits, de pensée, connus, inconnus, tous sont remis. Celui qui fit l'homme renouvelle l'homme... »
§ 1290. C'est pourquoi, celui qui raisonnait logiquement tirait la conséquence qu'il était profitable d'attendre d'être à l'article de la mort pour se faire baptiser, parce qu'ainsi, tout péché étant effacé, on devait nécessairement être sauvé ; et il appuyait cette opinion sur l'autorité de l'Évangile, où il est dit (Matth. XX) que les ouvriers de la dernière heure seront payés comme ceux de la première. Mais on sait que la logique n'a aucune place dans de semblables raisonnements, et qu'une dérivation peut également prouver le pour et le contre. L'Église s'opposa fortement à ces interprétations qui, à vrai dire, auraient condensé toute la religion en une simple action mécanique, à l'article de la mort [FN: § 1290-1]. De même, elle condamna comme hérétiques les Hémérobaptistes. Ceux-ci, raisonnant aussi en bonne logique, se baptisaient tous les jours, pour effacer les taches morales, comme en nous lavant tous les jours, nous effaçons les taches matérielles [FN: § 1290-2].
§ 1291. On peut envisager l'intégrité avant la naissance et aussi après la mort ; mais tandis que dans le premier cas elle produit ses effets sur un sujet réel, c'est-à-dire sur l'homme vivant, dans le second, elle se rapporte à un sujet abstrait ou imaginaire.
§ 1292. Il fut un temps où, dans l'Empire romain, les purifications par le sang de taureau (taurobole) ou par le sang de bouc (criobole) devinrent assez fréquentes [FN: § 1292-1]. Le taurobole était usité soit comme sacrifice public pour la santé de l'empereur, soit pour la régénération d'un simple particulier. Un homme descendait dans une fosse au-dessus de laquelle on égorgeait un taureau ou un bouc, et il recevait le sang de l'animal. Cela le purifiait, soit pour toujours, soit pour un certain temps, après lequel on devait répéter l'opération [FN: § 1292-2]. Naturellement, les chrétiens étaient indignés de la concurrence que ces purifications faisaient aux leurs. Firmicus Maternus dit: « (28-29) Pourquoi le Taurobole ou le Criobole te recouvre-t-il de sang, par des taches scélérates ? Pour laver les taches qui sont sur toi, demande une fontaine claire, demande de l'eau pure, afin qu'après de nombreuses taches, tu te nettoies grâce au sang de Christ, parle Saint-Esprit ». Tertullien dit que dans les mystères des païens, le démon imite les sacrements de la religion chrétienne [FN: § 1292-3] . Il se pourrait encore qu'il eût raison, car nous ignorons qui est ce démon ainsi que ses us et coutumes. « Il asperge ses croyants et fidèles, et leur promet d'effacer leurs crimes par cette ablution ». Ailleurs [FN: § 1292-4] , traitant de l'efficacité du baptême chrétien, il dit: « Les Gentils aussi, étrangers à toute compréhension des puissances spirituelles, attribuent la même efficacité à leurs idoles. Mais, veuves de toute vertu, leurs eaux sont trompeuses. Par une ablution, ils initient à une Isis ou à une Mithra ; ils aspergent leurs propres dieux. Du reste, ils aspergent d'eau les fermes, les maisons, les temples et les villes entières, tout autour, et expient partout. En certains jeux d'Apollon et d'Éleusis, ils se baignent et pensent être régénérés et gagner l'impunité des parjures. De même, chez les anciens, celui qui s'était souillé d'homicide recourait à des eaux purificatrices ».
§ 1293. On comprend que dans une si grande variété de rites, le choix restât douteux. Si le sentiment qui pousse à la purification naissait de la croyance en une puissance purificatrice, on devrait déduire le sentiment de cette croyance. Au contraire, on observe que le sentiment existe d'abord, puis qu'on cherche la façon de le satisfaire par un rite ; et parfois, celui qui veut se purifier ne sait à qui recourir.
§ 1294. C'est ce qui eut lieu dans la célèbre purification d'Athènes faite par Épiménide [FN: § 1294-1] . « Il prit des brebis noires et blanches, les conduisit auprès de l'Aréopage, et, de là, les laissa aller où elles voulaient, ordonnant à ceux qui les suivaient de les sacrifier au dieu de l'endroit, n'importe où elles se seraient arrêtées. Après cela, la peste cessa. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, pour les dèmes athéniens, on trouve des autels sans noms, qui rappellent les expiations faites alors ». Juvénal [FN: § 1294-2]nous montre la matrone romaine prêtant attention à toutes sortes de charlatans. Elle écoute et prie le prêtre de la mère des dieux, la Juive, le Chaldéen.
§ 1295. Selon Zosime [FN: § 1295-1] , Constantin se serait décidé en faveur de la religion chrétienne, parce qu'elle avait des expiations purificatrices de ses crimes, qu'il ne trouvait pas dans la religion païenne. Il se peut que le fait ne soit pas tout à fait exact. Constantin avait d'autres et peut-être de plus puissants motifs ; par exemple, celui du grand nombre de soldats chrétiens qui se trouvaient dans ses légions. Mais, d'autre part, la superstition agit aussi sur les criminels. On connaît assez le fait de brigands qui portent sur eux des images de la Madone. Après avoir fait tuer sa mère, Néron « fit faire un sacrifice aux mages, pour essayer d'en invoquer et d'en apaiser l'ombre. Dans son voyage en Grèce, il n'osa pas se faire initier aux mystères d'Éleusis, parce que la voix du héraut en éloigne les impies et les scélérats [FN: § 1295-2]». Dans sa Vie de Constantin, Eusèbe [FN: § 1295-3]dit qu'avant de marcher contre Maxence, Constantin rechercha à quel dieu il devait se fier pour gagner la bataille, et qu'il se décida pour le Dieu des chrétiens, parce que les empereurs, adorateurs des dieux païens, avaient eu un sort contraire. Donc, le fait de la recherche à laquelle se serait adonné Constantin, pour trouver la religion qui pouvait lui être le plus profitable, est rapporté également par Zosime qui lui est hostile, et par Eusèbe qui lui est favorable. Ces auteurs ne divergent que dans les motifs du choix. Dans le récit de Zosime, on trouve le résidu du rétablissement de l'intégrité. Dans le récit d'Eusèbe, il y a, comme résidu, le sentiment de l'intérêt individuel. Dans les deux cas s'ajoutent les résidus des combinaisons (Ire classe).
Les résidus par lesquels, moyennant une certaine consécration, on donne à des hommes, à des animaux, à des choses, des qualités qu'ils n'ont pas, pour obtenir une certaine intégrité imaginaire, sont tout proches des résidus du rétablissement de l'intégrité; à tel point qu'on les confond parfois avec eux. Ici, l'intégrité ne se rétablit pas, après qu'elle a été altérée : elle se crée en perfectionnant ce qui était imparfait.
§ 1296. (V-γ 2). Sujets imaginaires ou abstraits. Dans ce genre, on trouve des composés des résidus des genres précédents, unis à ceux de la persistance des agrégats. Commençons par les cas où ceux-ci dominent. La persistance d'une abstraction (II-δ) donne à cette abstraction une personnalité dont l'intégrité peut être atteinte ; et tout individu qui sent profondément l'abstraction sent aussi l'atteinte qu'on porte à cette intégrité, non seulement comme si c'était sa propre chose, mais aussi comme si c'était une chose appartenant à la collectivité ; c'est pourquoi, au genre de résidus indiqué tout à l'heure s'ajoute le genre (β) de la IVe classe.
§ 1297. Ainsi s'expliquent les pénalités qui, chez tant de peuples, à toute époque, frappent les atteintes portées à la religion dominante, aux coutumes du peuple, à des abstractions de tout genre [FN: § 1297-1]. Prêcher que le Père est antérieur au Fils, ou quelque autre erreur théologique semblable, crier simplement un vivat ou un à bas, reproduire sur une carte postale les belles formes de Pauline Borghèse, sculptée dans le marbre par Canova, passent pour des crimes graves, et troublent profondément un grand nombre d'hommes, parmi lesquels beaucoup sont très indulgents pour les exploits des voleurs et des assassins. Innombrables sont les cas dans lesquels, aux siècles passés, le peuple s'ameutait contre les hérétiques, les maltraitait, les dépouillait, les tuait. Nos contemporains les pangermanistes ne tolèrent pas la moindre contradiction au dogme qui proclame le peuple allemand de beaucoup supérieur à tous les peuples qui ont existé, existent et existeront sur notre globe terrestre, peut-être même dans le système solaire, passant sous silence, par modestie, les planètes qui peuvent graviter autour d'autres soleils, et les peuples qu'elles peuvent héberger. À chaque instant, les journaux publient la protestation furibonde de quelque pangermaniste, mis hors de lui parce que le menu d'un restaurant est écrit en français. Dans d'autres journaux s'allume une sainte colère, parce que les horaires de chemins de fer portent Genève plutôt que Genf. Il y a des gens qui perdent la tête à la seule idée que les amoureux s'écrivent poste restante, à entendre roucouler les colombes, à constater l'absence d'une feuille de vigne, et qui, d'envie ou mus par quelque autre haine, deviennent semblables aux chiens enragés, si l'idée leur vient que d'autres pourraient contempler de belles nudités féminines. Pourtant, l'austérité est souvent plus apparente que réelle. Naturellement, les dérivations surviennent, comme toujours, pour démontrer que ces élucubrations sont logiques, très logiques, et qu'elles ont pour seul et unique but le bien public ; que ceux qui « ont introduit de nouveaux dieux dans la cité » devaient autrefois à juste titre, et pour le bien du peuple, être condamnés à boire la ciguë, et doivent, de nos jours, faire de la prison ou du moins payer des amendes variées.
§ 1298. Dans le phénomène concret, on trouve d'habitude les éléments suivants : 1° il y a les résidus de la persistance des agrégats, qui permettent de considérer comme réel un sujet abstrait ou imaginaire ; 2° il est nécessaire qu'il y ait quelque fait réel ou imaginaire, par lequel on croit ou l'on suppose que l'intégrité du dit sujet a été atteinte ; 3° les résidus du rétablissement de l'intégrité interviennent pour pousser à des actes qui compensent l'atteinte portée ; 4° il s'y ajoute les résidus qui s'opposent à l'altération de l'équilibre social. Les dérivations transforment des sujets et des actes imaginaires en sujets et actes réels, et substituent aux sentiments manifestés par les résidus, des déductions logiques et pseudo-expérimentales.
§ 1299. Il y a d'autres cas où la persistance des agrégats, tout en jouant un rôle notable, ne domine pas entièrement. Le sentiment qui, chez tant de peuples et à diverses époques, fait accepter une législation pénale, est constitué par les trois genres de résidus indiqués tout à l'heure. En général, les résidus de la persistance des agrégats disparaissent ou sont insignifiants, quand la loi pénale n'existe pas et que la vengeance personnelle règne seule ; mais ils apparaissent déjà là où la vengeance s'étend et devient un devoir de la famille, de la tribu. Là aussi, les dérivations voudraient nous faire croire que ces législations ont des motifs exclusivement logiques. Tel les cherche dans la volonté d'un dieu ; tel dans celle d'un législateur semi-divin ou très sage ; tel, dans la sagesse des ancêtres ; tel, dans la volonté populaire ; tel, dans des abstractions métaphysiques ; tel, dans des buts de défense sociale, dans l'amendement du délinquant ou dans d'autres conceptions analogues.
§ 1300. Notez que tous ces raisonnements différents et parfois contradictoires aboutissent très souvent au même but. Il est donc manifeste qu'ils sont secondaires, et que le but et les sentiments qui les font accepter constituent le facteur principal. Un quidam tue l'un de ses concitoyens, en des circonstances telles que 1'opinion publique ne l'excuse pas. Il sera en butte à la vengeance de la famille de sa victime, aux pénalités décrétées par un dieu, par un législateur légendaire, par le souverain, par le peuple, par l'invention subtile des légistes ; mais, comme dit le proverbe, tout chemin mène à Rome, et quelle que soit la voie suivie, on finit également par infliger une certaine peine à l'homicide. Depuis tant de siècles que les savants cherchent comment et pourquoi cela peut ou doit se faire, ils n'ont pas encore pu s'accorder sur une théorie unique, et ils continuent à disputer, chacun pour défendre la sienne. Il demeure donc manifeste qu'historiquement, aussi bien que logiquement, la conclusion précède les prémisses ; ce qui démontre qu'elle n'en résulte pas, mais qu'au contraire on imagine les prémisses pour lui attribuer une raison.
§ 1301. Un cas qui s'est produit de nos jours, en France, est digne d'attention. Les humanitaires avaient, en fait, supprimé la peine de mort. Le Président de la République graciait tous les condamnés à la peine capitale. Le Parlement avait supprimé le crédit affecté au traitement du bourreau. Grâce aux résidus humanitaires et aux dérivations, la peine de mort n'existait plus. Le cas Soleilland se produisit : une brute viola et tua cruellement une enfant du peuple. L'assassin fut condamné à mort, puis, conséquence des théories humanitaires, il obtint la grâce. Les dérivations ne sont efficaces que lorsqu'elles correspondent aux résidus, qui sont les vrais moteurs des actions humaines. Dans le cas cité, cette correspondance n'existait pas. Les résidus de l'intégrité personnelle et de la persistance des agrégats existant toujours dans l'âme populaire des Français, ne s'accordaient pas avec la dérivation humanitaire ; aussi les faits tournèrent-ils contrairement à celle-ci et dans le sens des résidus [FN: § 1301-1] Le Président de la République dut se résigner à approuver des condamnations capitales ; le Parlement rétablit le crédit en faveur du bourreau ; les pires homicides recommencèrent à être justiciés. Un fait semblable se produisit postérieurement, quand la bande Bonnot et Garnier semait le carnage parmi les bons bourgeois. L'instinct de conservation se réveilla en eux [FN: § 1301-2]. Un autre fait semblable eut lieu dans de bien moindres proportions, en Suisse. Après le verdict des excellents jurés d'Interlaken, qui fit condamner à une peine insignifiante l'« héroïne » Tatiana Léontieff, les terroristes russes, raisonnant logiquement, conclurent que la Suisse devenait un pays favorable à leurs exploits. C'est pourquoi, peu de temps après, ils tentèrent une « expropriation » dans une banque de Montreux, procédant à l'« exécution », vulgairement appelée assassinat, de ceux qui s'y opposaient. Mais le bon sens du peuple se réveilla, et l'instinct de conservation l'emporta sur les stupidités des humanitaires. On peut citer des faits analogues en tout pays et en tout temps.
§ 1302. Les théories sur l'antimilitarisme et sur l'antipatriotisme n'ont pas changé, durant ces dernières années, en France et en Italie ; mais les résidus de la IVe classe, et spécialement ceux du genre (δ) de cette classe, ont changé d'intensité, quelles qu'en soient les causes ; aussi jurés et magistrats condamnèrent-ils des actes anti-militaristes et anti-patriotiques pour lesquels ils acquittaient jadis, sans que la législation fût changée le moins du monde [FN: § 1302-1]. Le gouvernement italien expulsa Hervé, qu'il aurait peut-être accueilli au moins avec indifférence, quelques années plus tôt, au temps de la bienveillante indulgence envers ceux qui insultaient l'armée. Les sages changent avec les temps. Là, les faits apparaissent plus clairement, parce qu'une seule cause et un seul effet se manifestent, et parce que le changement suit à bref délai ; mais ils sont précisément semblables aux autres faits du droit pénal, où plusieurs causes s'entrecroisent avec leurs effets, lesquels se produisent en un plus long espace de temps. Le droit pénal correspond plus directement aux résidus que le droit civil ; c'est pourquoi celui-ci paraît souvent être plus logique que celui-là.
§ 1303. Les religions qui admettent la métempsycose font renaître l'être sous une forme humaine ou animale, pour le purifier. Platon parle aussi d'une manière fictive de ce fait, dans la République et le Timée [FN: § 1303-1], où cet illustre rêveur, qui a encore des admirateurs parmi nos contemporains, imagine une foule d'absurdités, sur la façon dont le monde a été créé. Mais on suppose que chez ceux même qui ont définitivement disparu de cette terre, persiste un sentiment d'intégrité qui s'ajoute aux nombreux résidus de la IIe classe, pour déterminer les actions des vivants à l'égard des morts.
§ 1304. Dans l'Iliade, Patrocle demande à Achille de l'ensevelir promptement, pour qu'il puisse entrer au séjour des morts [FN: § 1304-1]. De même, et pour un motif semblable, dans l'Odyssée, l'ombre d'Elpénor parle à Ulysse [FN: § 1304-2] . L'Énée de Virgile voit les âmes de ceux dont le corps gît sans sépulture errer pendant cent ans, avant de pouvoir entrer dans l'Érèbe. Dante voit les âmes des contumaces de l'Église gardées dans l'Anti-Purgatoire durant un espace de temps égal à trente fois celui de leur vie. Le résidu reste le même, tandis que les dérivations croissent, varient, se modifient.
§ 1305. Toujours de ce même résidu naquit la dérivation catholique du Purgatoire et des moyens liturgiques de rétablir l'intégrité des âmes qui y séjournent. Plaisantant sur les superstitions de son temps, Lucien raconte comment Dèmaenétè, après sa mort, apparut à son mari Eucratès. Celui-ci dit [FN: § 1305-1]: « Le septième jour après sa mort, je gisais sur ce lit où je suis maintenant... Et voici qu'entre Dèmaenétè, elle-même, et qu'elle s'assied auprès de moi ; ... lorsque je la vis, en l'embrassant, je me mis à pleurer et à me lamenter ; mais elle me fit taire et me reprocha de lui avoir fait don de tous ses effets personnels et de ne lui avoir pas brûlé l'une de ses sandales brodées d'or. Elle me dit que cette sandale se trouvait sous le coffre où elle était tombée. C'est pourquoi, ne l'ayant pas découverte, nous en avions brûlé une seule. Tandis que nous parlions encore, un maudit petit chien maltais qui était sous le lit aboya, et à cet aboiement elle disparut. On trouva la sandale sous le coffre, et on la brûla aussi ». Dans le même écrit, Lucien fait raconter par Arignôtos (31) comment un spectre hantait une maison, et disparut lorsque le cadavre fut retrouvé et enseveli.
§ 1306. Cette fable est d'un type dont il y a une infinité d'exemples chez les Gentils et chez les chrétiens. Un mort apparaît et tourmente les gens jusqu'à ce qu'on ait pourvu à son ensevelissement, chez les Gentils ; à son ensevelissement et à des messes, oraisons, etc., en sa faveur, chez les chrétiens. L'origine de la dérivation est manifeste. Pline le Jeune [FN: § 1306-1] , par exemple, raconte l'histoire d'une maison d'Athènes, hantée par un fantôme. Le philosophe Athénodore l'achète à vil prix. Un fantôme enchaîné lui apparaît. Athénodore le suit jusqu'à un endroit où le fantôme disparaît. On creuse en cet endroit : on trouve des ossements avec des chaînes ; on les ensevelit honorablement, et le fantôme n'apparaît plus.
§ 1307. Chez les chrétiens, les fantômes demandent des prières [FN: § 1307-1]. Mais la dérivation continue à s'allonger, parce qu'on se demande si ce serait, non pas l'âme du mort, mais plutôt un démon, qui fait cette demande. Tertullien dit [FN: § 1307-2]: « (3) Nous faisons tous les ans des oblations pour les défunts et pour les anniversaires [des martyrs] ». Et il ajoute: « (4) Si vous demandez une prescription de l'Écriture sur ces disciplines et sur d'autres, vous n'en trouvez aucune. Mais on vous mettra devant les yeux la tradition qui en est la source, l'usage qui les confirme, la foi qui les observe ». Cela paraît bien d'accord avec tous les faits connus. Le résidu du rétablissement de l'intégrité donnait lieu à des dérivations variées, qui apparaissaient dans la tradition, étaient confirmées et modifiées par l'usage, et finissaient par faire partie de la foi.
§ 1308. Avec la doctrine du Purgatoire, l'Église catholique n'a fait que donner une forme précise à des dérivations d'un résidu aussi vieux que l'histoire de nos races, et même de beaucoup d'autres [FN: § 1308-1] ; et depuis le temps où, dans nos pays, on faisait des libations sur les tombes des morts, ce résidu est parvenu jusqu'à nous. Cette doctrine peut avoir tiré profit de l'existence de ce résidu, comme elle peut avoir tourné à son avantage d'autres forces sociales, mais elle ne peut avoir créé ce résidu, qui existait nombre de siècles avant son apparition. Dom Calmet a donc parfaitement raison, quand il écrit: « Ceux qui prétendent que tout ce qu'on dit des Esprits, et du retour des âmes, n'est qu'une invention de certaines gens d'Église, qui ont intérêt à entretenir les peuples dans cette opinion, ne font pas attention que les Païens, qui ne tiroient aucun avantage de ces apparitions, et que les peuples barbares du Septentrion, par exemple, qui n'y entendoient aucune finesse, parlent des Esprits, des apparitions, des folets, des Démons, des bons Génies à peu près comme en parlent les Chrétiens et les Ecclésiastiques [FN: § 1308-2]». Mais il y a aussi une autre erreur dans laquelle on tombe en concluant que si de tels phénomènes ne sont pas un produit de la fraude, ils ont nécessairement une existence objective. Le dilemme supposé n'existe pas. Il y a une troisième hypothèse, qui correspond souvent à la réalité : que ces phénomènes manifestent seulement l'existence subjective de certains résidus, qui persistent et prennent des formes variées et changeantes avec le temps.
§ 1309. Le concile de Trente dit que l'Église catholique enseigne [FN: § 1309-1]« qu'il y a un Purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues reçoivent du soulagement par les suffrages des fidèles, et principalement par le sacrifice de l'autel, toujours agréé de Dieu ». Si nous voulons résumer les croyances de nos ancêtres gréco-romains, et plus généralement des Indo-Européens, nous dirons « qu'il est un lieu (la demeure de ![]() , le séjour des inferi) où les âmes sont détenues, et que celles-ci profitent du culte que les vivants leur rendent, et principalement de la nourriture que les descendants de chaque mort portent sur sa tombe ». Comme d'habitude, ceux qui accordent la première place aux dérivations estiment qu'entre ces deux croyances, il y a un abîme. Ceux pour lesquels l'étude des phénomènes sociaux n'est qu'un prétexte pour prêcher la « vertu » ou le « progrès » ne peuvent tolérer qu'on ose comparer une croyance où la paix des morts dépend, au moins en partie, de leurs bonnes actions, et une croyance où elle dépend d'opérations mécaniques, telles que les libations et les offrandes d'aliments.
, le séjour des inferi) où les âmes sont détenues, et que celles-ci profitent du culte que les vivants leur rendent, et principalement de la nourriture que les descendants de chaque mort portent sur sa tombe ». Comme d'habitude, ceux qui accordent la première place aux dérivations estiment qu'entre ces deux croyances, il y a un abîme. Ceux pour lesquels l'étude des phénomènes sociaux n'est qu'un prétexte pour prêcher la « vertu » ou le « progrès » ne peuvent tolérer qu'on ose comparer une croyance où la paix des morts dépend, au moins en partie, de leurs bonnes actions, et une croyance où elle dépend d'opérations mécaniques, telles que les libations et les offrandes d'aliments.
§ 1310. Ils ont raison les uns et les autres, quand on envisage les choses au point de vue sous lequel il leur plaît de les étudier ; mais il y a aussi un autre aspect : c'est l'aspect exclusivement scientifique, sous lequel on envisage les phénomènes sociaux comme le naturaliste envisage les plantes et les animaux ; et sous cet aspect, les deux croyances mentionnées tout à l'heure sont entièrement semblables. Elles sont des dérivations des résidus de persistance des agrégats et du rétablissement de l'intégrité altérée.
§ 1311. Non seulement l'intégrité de l'âme peut être altérée, mais aussi celle du cadavre. On raconte de nombreux faits de cadavres d'excommuniés, qui sortaient de l'église où ils étaient ensevelis, quand le diacre disait: « Que ceux qui ne communient pas se retirent [FN: § 1311-1] ». Un autre conte est celui de l'incorruptibilité du cadavre des excommuniés. Dom Calmet écrit: « (p. 344) C'est une très ancienne opinion que les corps des excommuniés ne pourrissent point. Cela paroît dans la vie de S. Libentius, Archevêque de Brême, mort le 4 de janvier 1013. Ce S. Prélat ayant excommunié des Pirates, l'un d'eux mourut, et fut enterré en Norvège. Au bout de 70 ans on trouva son corps entier et sans (p. 345) pourriture, et il ne fut réduit en cendres qu'après avoir reçû l'absolution de l'Evêque Alvarede. (p. 345) Les Grecs modernes, pour s'autoriser dans leur schisme, et pour prouver que le don des miracles et l'autorité Episcopale de lier et de délier, subsiste dans leur Église, plus visiblement même, et plus certainement que dans l'Église Latine et Romaine, soutiennent que parmi eux les corps de ceux qui sont excommuniés ne pourrissent point [FN: § 1311-2] ». On sait que les corps des saints sont aussi incorruptibles. Comme d'habitude, la même dérivation prouve le pour et le contre.
§ 1312. (V-δ) Rétablissement de l'intégrité par des opérations se rapportant à ceux qui l'ont altérée. Il existe un sentiment qui pousse l'animal ou l'homme à réagir contre celui qui l'a offensé, à rendre le mal pour le mal. Tant que cela n'a pas eu lieu, l'homme éprouve un sentiment de malaise, comme si quelque chose lui manquait. Son intégrité est altérée, et ne revient à son état primitif que lorsqu'il a accompli certaines opérations portant sur son agresseur. On trouve des types de ces sentiments dans ceux qui poussent à la vengeance [FN: § 1312-1]ou au duel.
§ 1313. (V-δ 1) Agent réel d'altération. [Note ajoutée par l’auteur à l’édition française [FN: § 1313-1] Ce genre est de beaucoup le plus important, et même presque le seul qu'il vaille la peine d'envisager. L'offense frappe souvent des collectivités plus ou moins étendues, même si elle est faite à un seul des individus qui en font partie. Les conjoints, les parents, les subordonnés, les compagnons, les concitoyens et jusqu'aux animaux (par exemple, le chien qui défend son maître) de l'homme auquel l'offense est faite, peuvent la ressentir comme une offense personnelle, avoir le sentiment que leur intégrité est altérée ; et par conséquent, le besoin du rétablissement de l'intégrité peut naître chez eux ; besoin qui les pousse à réagir contre l'offenseur. De là proviennent les nombreuses variétés du devoir de vengeance, du droit au prix du sang, qu'on observe chez les peuples barbares ou semi-barbares. Souvent ces résidus se confondent avec ceux du genre (V-α).
De nos jours, chez les peuples civilisés, si un citoyen est offensé à l'étranger, le gouvernement du pays de ce citoyen prend souvent prétexte de l'offense pour obtenir des compensations ; et c'est là une simple action logique. Mais beaucoup de gens sont poussés à approuver cette façon de procéder, par le même sentiment que celui qui, en d'autres temps, faisait de la vengeance un devoir. Un Européen est tué dans un pays barbare. On bombarde un village où les coupables ne sont pas, et l'on tue nombre d'innocents. Ainsi est rétablie l'intégrité des citoyens du pays civilisé, aux dépens des citoyens du pays barbare.
§ 1314. Cette Tatiana Léontieff, que les très sages jurés d'Interlaken condamnèrent à une peine fort légère, avait tué un malheureux M. Muller, croyant frapper le ministre Durnovo, sur lequel, disait cette héroïne, elle voulait venger les souffrances des socialistes russes. Au juge qui lui demandait si elle regrettait son erreur, elle répondit négativement, parce que « ce M. Muller était aussi un bourgeois ». En sorte que la thèse de cette mégère, acceptée par les bons jurés, paraît avoir été la suivante. Le ministre Durnovo avait offensé les socialistes russes ; donc, il était juste de tuer un M. Muller, qui n'avait pas pris une part, même lointaine, aux faits du ministre Durnovo, mais qui était un « bourgeois ».
§ 1315. Au point de vue logique, ce raisonnement est absurde et stupide ; aussi ne vaut-il pas par la logique, mais par les sentiments qu'il manifeste, lesquels correspondent justement aux résidus que nous étudions. Pour venger un de ses ressortissants, le gouvernement russe tue des gens qui n'offensèrent en rien ce ressortissant, mais qui sont de la même nation que l'offenseur. Pour venger certains amis, entre autres un grand ami, Tatania Léontieff tue un malheureux qui n'avait pris part ni de près ni de loin aux offenses dont on se plaignait, mais qui appartenait à la même collectivité (la bourgeoisie) que l'offenseur. Dans les deux cas, l'intégrité de certains A, qui a été altérée, se rétablit en altérant l'intégrité de certains B. Quant aux jurés, ils estimaient que l'intégrité de certaines de leurs conceptions humanitaires avait été offensée par le gouvernement russe ; c'est pourquoi ils tenaient pour excusable tout acte qui eût pour cause ou pour prétexte le désir de rétablir cette intégrité.
§ 1316. On ne sait pas pourquoi Tatiana Léontieff devait choisir justement M. Muller pour victime expiatoire, et non pas son père à elle, qui était non seulement un « bourgeois », mais par dessus le marché un employé du gouvernement russe ; ou bien l'un de ces braves jurés, qui étaient aussi des « bourgeois » ; ni pourquoi elle trouvait bon de mener la vie large avec l'argent qui lui venait de son père, bourgeois et payé par le gouvernement russe ; ni pourquoi messieurs les humanitaires veulent qu'on tue un chien enragé, et qu'on laisse au contraire courir le monde aux pires criminels ou déséquilibrés. Mais il est inutile, de chercher des motifs logiques aux actions non-logiques.
§ 1317. Celui qui est exclu d'une collectivité voit, par ce fait, son intégrité altérée, et cette altération peut être ressentie assez fortement pour jouer le rôle d'une peine très grave. Sans même aller jusqu'à l'exclusion, la seule déclaration que l'intégrité d'un individu n'existe plus peut équivaloir à une peine infligée par la force [FN: § 1317-1].
§ 1318. Cela explique pourquoi, en plusieurs droits primitifs, on trouve des sentences sans sanction d'aucune sorte, et des sentences à l'exécution desquelles ne veille aucune autorité publique. Les juristes auxquels ces faits causèrent de la surprise, devraient faire attention que de nos jours nous avons encore les sentences des jurys d'honneur, qui sont du même genre ; et bien qu'il n'y ait pas de force publique pour exécuter ces sentences, la simple déclaration qu'elles contiennent peut être une peine beaucoup plus grave que celles de quelques jours de prison, subis en suite de jugement régulier d'un tribunal ordinaire. Des sentences qui n'ont pas directement de sanction peuvent en avoir une indirectement, parce qu'elles altèrent l'intégrité de l'homme qu'elles frappent. Par ce fait, l'homme en question ne peut plus traiter sur un pied d'égalité avec les autres hommes qui étaient ses égaux. Mais il faut prendre garde que cette conséquence est accessoire ; le fait principal est la diminution de l'intégrité déclarée par certaines personnes d'autorité. César observa qu'en Gaule la force des sentences des druides provenait de ces conséquences indirectes [FN: § 1318-1]. Il aurait pu comparer ce fait avec celui de la note du censeur, à Rome, ou avec la déclaration sacer esto des anciennes lois [FN: § 1318-2] Dans les faits concrets, les résidus interviennent presque toujours en très grand nombre ; mais parmi les faits que nous venons de citer se dégage principalement le résidu par lequel le malfaiteur est déclaré privé de son intégrité ; il déchoit ; il est exclu de la collectivité. Les anciennes lois de l'Irlande nous montrent des faits semblables [FN: § 1318-3], que Sumner Maine compara opportunément avec d'autres faits juridiques des Indes, et dont nous avons déjà parlé (§ 551).
§ 1319. De ce sentiment, qui veut opposer à une altération de l'intégrité une autre altération analogue, naissent en nombre immense les dispositions qui fixent la manière et la quantité de l'altération qui sert de compensation. Sous le rapport de la quantité, des règles très simples du talion, nous arrivons par un long chemin jusqu'à la dosimétrie (ainsi l'appelle Enrico Ferri) aussi savante que ridicule, du code de Zanardelli. Ce n'est pas ici le lieu de discuter de tout cela. Le phénomène est complexe, et l'on a un substratum de résidus variés, recouvert de dérivations plus ou moins complexes.
§ 1320. (V-δ 2) Agent imaginaire ou abstrait d'altération. Le résidu apparaît clairement, quand les hommes s'en prennent à leur fétiche, à quelque saint, à des êtres spirituels, à leur dieu. Si c'était utile, on pourrait citer à ce propos un très grand nombre d'exemples. On peut les résumer de la façon suivante. l° Les hommes traitent l'être imaginaire comme un être réel ; ils le louent et le blâment, l'exaltent et l'injurient, font avec lui contrat, lui promettent des cadeaux s'il leur procure des avantages, le menacent de représailles s'il les laisse subir des dommages, en adorent l'image, s'il les satisfait, le négligent ou le traitent avec mépris, vont même jusqu'à le frapper, s'il les mécontente. 2° On explique et l'on justifie ensuite par les dérivations ces simples associations d'idées et les actions non-logiques qui en sont la conséquence. L'être imaginaire peut être considéré comme toujours bon. Le contrat prend alors la forme d'une simple promesse de manifester sa reconnaissance par des cadeaux. Par exemple, le contrat que les Romains faisaient avec Jupiter, pour qu'il leur donnât la victoire ; ou bien la promesse d'un cadeau des catholiques modernes, si Saint Antoine de Padoue leur fait retrouver une chose perdue. L'être imaginaire peut être considéré comme tantôt bon, tantôt mauvais, et l'on tâche de le traiter de manière à ce qu'il soit bon. Il peut être considéré comme principalement ou exclusivement mauvais [FN: § 1320-1], et l'on tâche de l'apaiser par de bons traitements ou de le punir en le maltraitant. Enfin, il peut être considéré comme essentiellement mauvais, tel le démon des chrétiens ; et les mauvais traitements sont tout ce qu'il mérite. De cette façon, on passe graduellement des simples associations d'idées à une ingénieuse et subtile théologie. Mais au fond, les résidus recouverts des dérivations sont les mêmes.
§ 1321. On sait assez que les peuples qui ont des fétiches les abandonnent ou les maltraitent, quand ils en sont mécontents, et il ne semble pas qu'ils fassent là-dessus de nombreux raisonnements [FN: § 1321-1] . Elles n'en font pas davantage, nos bonnes femmes qui maltraitent l'image du saint qui ne leur a pas accordé la grâce demandée ; ni ceux qui blasphèment, non par mauvaise habitude, mais dans l'intention bien arrêtée d'offenser Dieu ou la Madone. Tout cela n'est pas seulement le propre d'une foule ignorante. L'ancienne Grèce admirait les poèmes d'Homère, où les mortels combattent contre les dieux. Dans les temps les plus anciens, cela ne paraît nullement avoir fait scandale. Plus tard, Platon s'indigne des aventures des dieux d'Homère. Plus tard encore, en commentant les poèmes homériques, les Alexandrins s'efforcent de les ramener à une meilleure leçon. Dans l'Iliade, Diomède frappe Aphrodite, puis Arès [FN: § 1321-2] . Il existe une tentative de justification, car Athéna conseille et protège Diomède, qui peut ainsi se considérer comme le moyen dont se sert Athéna pour frapper Arès. Pour consoler sa fille Aphrodite, Dionée rappelle que nombre de dieux eurent à supporter de terribles souffrances de la part des hommes. Dans l'Iliade [FN: § 1321-3]aussi, Hélène injurie Aphrodite. Beaucoup plus tard, nous trouvons un fait analogue dans les Dionysiaques [FN: § 1321-4]. Au point de vue de la réalité, les deux récits sont également imaginaires ; mais comme indices de sentiments, la valeur en est inégale. La popularité ancienne de l'Iliade montre que les injures d'Hélène ne provoquaient aucun scandale dans le peuple, et par conséquent le récit qu'elle contient est un indice de sentiments très généraux. Au contraire, le récit des Dionysiaques n'est que l'indice des sentiments d'un nombre restreint de lettrés, et c'est peut-être seulement un artifice poétique.
§ 1322. Quand Platon s'indigne contre les poètes, à cause des fables qu'ils racontent sur les dieux [FN: § 1322-1] , il représente la réaction de la logique contre ces associations d'idées non-logiques. Mais il faut comprendre que les hommes qui croient à ces aventures des dieux n'en tirent nullement les conclusions logiques qu'elles pourraient entraîner, et que, par conséquent, la vénération qu'ils portent à leurs dieux ne diminue nullement ; de même qu'à notre époque, la vénération de la bonne femme pour le saint qu'elle maltraite parce qu'il ne l'a pas exaucée, ne diminue pas le moins du monde ; de même que l'amour des Gallois mystiques pour certains de leurs chefs trop experts au jeu de la bourse, ne diminue pas ; de même que ne diminue pas le respect des « prolétaires » pour certains de leurs chefs, qui font argent du socialisme [FN: § 1322-2] , ou pour d'autres gens qui n'ont de « prolétaire » que le nom, étant au fond de riches bourgeois.
§ 1323. Pausanias (III, 15) parle d'une statue d'Aphrodite portant les fers aux pieds, et rapporte deux traditions. Suivant la première, Tindare fit faire la statue de cette façon, pour montrer allégoriquement que les femmes devaient être soumises à leurs maris. Suivant l'autre, il fit cela pour se venger d'Aphrodite, qui avait induit Hélène et Clytemnestre à mal faire. Il semble ridicule à Pausanias de supposer que, par ce moyen, on puisse se venger de la déesse. Arien [FN: § 1322-1]rapporte, mais sans trop y attacher créance, qu'Alexandre le Grand, très affligé de la mort d'Ephestion, fit renverser le temple d'Esculape, pour se venger de ce dieu, qui n'avait pas sauvé Ephestion. Suétone [FN: § 1322-2]rapporte qu'à la mort de Germanicus, le peuple lapida les temples des dieux et en renversa les autels. Ces sentiments paraissent étranges ; mais il y en a d'analogues, même à notre époque, non seulement parmi le vulgaire qui injurie Saint Janvier si le sang tarde à bouillir, mais aussi parmi des personnes cultivées [FN: § 1323-3].
§ 1324. VIe CLASSE. Résidu sexuel. Le simple appétit sexuel, bien qu'il agisse puissamment sur la race humaine, ne doit pas nous occuper ici, cela pour les motifs exposés au § 852. Nous devons surtout étudier le résidu sexuel de raisonnements et de théories. En général, ce résidu et les sentiments dont il tire son origine se rencontrent dans un très grand nombre de phénomènes ; mais ils sont souvent dissimulés, spécialement chez les peuples modernes.
§ 1325. L'antiquité gréco-latine envisagea l'acte sexuel comme la satisfaction d'un besoin, à l'égal de boire, de manger, de s'orner, etc., et les regarda tous avec indifférence, condamnant en général l'abus, et souvent la recherche dans le plaisir. Dans un passage célèbre du discours contre Nééra, l'orateur dit [FN: § 1325-1]: « Nous avons les hétaïres pour la volupté, les concubines pour les soins journaliers du corps, les femmes pour avoir des enfants légitimes et garder fidèlement les choses de la maison ». Pour Rome, nous avons d'abord une division entre les femmes qui devaient garder la chasteté et celles qui n'avaient pas ce devoir [FN: § 1325-2]. Il est évident que la loi a uniquement en vue des buts civils, qu'elle impose aux ingénues certains devoirs réputés utiles à l'État, et qu'elle laisse les hommes libres de commettre le péché charnel, s'il ne nuit pas à l'État. Pour nos vertuistes, tous les amours libres sont illicites. Pour les Romains, les uns étaient licites, les autres illicites [FN: § 1325-3]. Ils n'avaient pas pour l'adultère des matrones les indulgences faciles de nos vertuistes, et leurs sectaires n'éprouvaient aucune indignation contre les amours avec les affranchies ou avec d'autres femmes semblables. C'étaient non pas les résidus sexuels qui les guidaient, mais des considérations d'utilité pour l'État. Une inscription trouvée à Isernia nous apprend que les auberges exposaient le tarif, non seulement des mets, mais aussi des filles qu'elles fournissaient au public [FN: § 1325-4]. Un voyageur dépense un as pour le pain, deux as pour les victuailles, huit as pour la fille et deux as pour le foin du mulet. Dans le Digeste [FN: § 1325-5], Ulpien nous apprend qu'en beaucoup d'endroits les lupanars appartenaient à d'honnêtes gens. Dans la suite, pour des causes encore partiellement obscures, vers la fin de l'empire romain, la considération de l'acte sexuel s'impose, prédominante, à l'esprit des hommes, et prend des formes religieuses, se manifestant souvent par une sainte horreur. Il est vraiment extraordinaire que maintenant, chez les peuples civilisés, ce tabou soit resté la dernière religion à laquelle le bras séculier accorde son appui. On peut impunément blasphémer Dieu et les saints, prêcher la guerre civile, le carnage et le pillage, mais on ne peut publier de livres ou de figures obscènes. De même, les Wahabites estiment que fumer du tabac est le pire des crimes, bien autrement infâme que de tuer ou de voler. Le fait de renverser ainsi l'échelle de gravité des crimes, comme cela semble à qui n'a pas certains sentiments religieux, est justement un caractère essentiel de la répression des hérésies religieuses, et de la puissance du sentiment qui pousse à agir ainsi les hommes dont l'esprit est opprimé par le préjugé et par certains sentiments.
§ 1326. Dans nos races, trois tabous d'abstinence persistent à travers les siècles ; ce sont, par ordre d'intensité croissante, l'abstinence de la viande, celle du vin et celle de tout ce qui concerne les rapports sexuels. On peut faire remonter l'abstinence de la viande jusqu'à Pythagore. Plutarque nous a laissé deux discours tendant à éloigner les hommes de l'usage de la viande. Il nous reste un traité entier de Porphyre, sur l'abstinence de la viande. Les chrétiens la recommandèrent et l'imposèrent sous diverses formes. Finalement, nous avons les végétariens modernes [FN: § 1326-1]. Dans l'antiquité, on traite beaucoup de la modération dans l'usage du vin, mais peu ou pas de l'abstinence totale. Les premiers chrétiens conseillèrent un usage restreint ou même l'abstinence du vin, comme celle de la viande, soit pour faire pénitence, soit encore plus pour réprimer les tentations qui poussent au péché charnel. Nous avons, là-dessus, un grand nombre de prescriptions des saints Pères [FN: § 1326-2] . Pourtant, l'Église catholique, qui visa toujours au juste milieu, tout en imposant l'abstinence de la viande en certains jours, permettait l'usage du vin, se montrant ainsi beaucoup plus libérale que certains de nos pseudo-savants contemporains. Aujourd'hui, les sectaires anti-alcooliques reproduisent les exploits des fanatiques religieux. L’abstinence des plaisirs de l'amour et de tout ce qui peut les rappeler, même de loin, s'observe, au moins en théorie, chez les premiers chrétiens, et maintenant, toujours en théorie, elle a de nouveau donné lieu à un fanatisme de pudeur pathologique.
§ 1327. Les résidus de ces phénomènes sont complexes. On y peut distinguer au moins trois parties. 1° La partie la moins importante est celle d'un résidu de combinaisons par lequel une secte est poussée à prendre un signe quelconque qui la distingue du vulgaire, de l'étranger, ou d'autres sectes. Par exemple, on observe la prohibition de certains aliments, chez un très grand nombre de peuples. Quand la Bible défend l'usage de la viande de lièvre, il est impossible d'y voir aucun motif d'ascétisme ou autre semblable (§ 1276 suiv.): c'est un simple résidu de combinaisons. Ce résidu est souvent mêlé à un autre résidu, d'intégrité personnelle : à l'orgueil; la combinaison a non seulement pour but de distinguer, mais aussi d'exalter [FN: § 1327-1] . Il est probable qu'il y a en des résidus de ce genre chez les chrétiens, qui voulaient rester distincts des Gentils. 2° La partie la plus importante, dans les deux premiers tabous, très importante aussi dans le troisième, est un résidu d'ascétisme. Il se manifeste en ce que ces tabous sont accompagnés d'abstinences et de macérations qui appartiennent certainement à l'ascétisme. C'est plus que clair chez les chrétiens ; chez d'autres abstinents, c'est moins manifeste ; chez quelques-uns, on l'aperçoit à peine ; par exemple, chez nos anti-alcooliques contemporains, qui prétendent ne rechercher que l'utilité publique ; mais ce n'est pas seulement le hasard qui, généralement, les rend humanitaires, religieux, moralistes, pudibonds : peut-être, sans que plusieurs d'entre eux s'en aperçoivent, ne sont-ils pas exempts de résidu ascétique. 3° Des sentiments accessoires de l'ascétisme, tels que la vanité, l'envie envers qui jouit de ce qu'on ne peut avoir soi-même, le désir de l'estime et de l'admiration d'une collectivité, etc. Nous avons déjà traité de tout cela (§ 1169 à 1171). 4° Le besoin de manifester par des actes extérieurs sa foi ascétique ; besoin auquel correspondent les résidus de la IIIe classe.
§ 1328. Il y a des cas d'exaltation religieuse pour les trois tabous mentionnés tout à l'heure. Pour le tabou de la viande, on peut observer la forme religieuse aux Indes, mais non dans nos pays. Pour le tabou du vin, on peut voir quelques cas, çà et là, parmi nos contemporains. Pour le tabou du sexe, c'est un phénomène général, des temps passés aux nôtres.
§ 1329. Pour les tabous de la viande et du vin, il y a effectivement des pays où ils sont à peu près observés ; c'est-à-dire qu'il y a réellement des collectivités qui s'abstiennent de viandes et de boissons fermentées. Toutefois, quant à ces boissons, l'abstinence n'est souvent qu'apparente, comme à notre époque en Turquie. Mais pour le tabou sexuel, les différences de fond sont peu nombreuses, et l'on observe seulement de notables différences de forme. La prostitution est interdite dans les pays musulmans ; mais elle y est remplacée, non seulement par le concubinage, mais aussi par de pires pratiques. Elle était interdite aussi dans nos contrées, en des temps où les mœurs étaient loin d'être meilleures que celles d'aujourd'hui. C'est l'un des cas si nombreux où la puissance des sentiments rend le fond presque constant et ne laisse varier que la forme [FN: § 1329-1]. Le contraste est si grand qu'on est induit à admettre le paradoxe suivant lequel c'est justement là où la morale et les lois condamnent le plus sévèrement l'immoralité, que celle-ci est la plus grande. De nombreux faits portent à croire que c'est le cas de plusieurs États de l'Amérique ; mais nous ne pouvons pas, de cas particuliers, tirer une règle générale.
§ 1330. Dans la religion sexuelle, comme en un grand nombre d'autres religions, la rigueur de la forme engendre la perversion [FN: § 1330-1] et l'hypocrisie : l'histoire du fruit défendu est de tous les temps [FN: § 1330-2] .
Au moyen âge et même un peu plus tard, quand la manie religieuse était à l'état aigu, les invocations au diable et les pactes avec lui étaient fréquents. Aujourd'hui que cette manie a énormément diminué, qui pense encore à ces pratiques ? Beaucoup de débordements obscènes ont peut-être eu, au moins en partie, une origine semblable à celle de l'invocation du diable. Henri III de France, qui alternait habituellement les pratiques de l'ascétisme religieux avec celles des vices contre nature, n'est qu'un type d'une classe très étendue. De nos jours, justement dans les pays qui affectent le plus d'être pudibonds, se produisirent des faits extrêmement obscènes, comme ceux du procès Taw, aux États-Unis d'Amérique, la traite des vierges, révélée par la Pall Mall Gazette, le procès Oscar Wilde, en Angleterre, le procès Eulenbourg et d'autres semblables, en Allemagne. En outre, là où les mœurs de Cythère sont exclues, on voit, à la place, les usages de Sodome et de Lesbos. Le résidu est constant, et si on lui enlève sa forme naturelle, il en prend d'autres.
Les gens qui ont l'esprit hanté par une idée fixe sont poussés à des actes ridicules, qui font rire ceux qui sont exempts de tels préjugés. C'est ainsi que beaucoup d'actes du culte de peuples barbares et aussi de peuples civilisés nous semblent risibles. Les manifestations du résidu sexuel n'échappent pas à cette règle générale. Aujourd'hui, en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, on observe des faits de pudeur sexuelle, hypocrite ou sincère, aussi ridicules que ceux des plus étranges tabous [FN: § 1330-3].
§ 1331. Le résidu sexuel n'existe pas seulement dans les idées qui ont en vue l'union des sexes ou un souvenir complaisant de cette union, mais aussi dans les idées qui révèlent un blâme, une répugnance, de la haine pour cette union. Cela peut paraître étrange ; pourtant de nombreux faits montrent que l'idée de la chasteté, là où elle domine l'esprit, peut avoir un résidu sexuel [FN: § 1131-1] ; et beaucoup ont été conduits par cette voie à quelque vice secret.
§ 1332. Le résidu sexuel peut exister dans des relations très innocentes et très chastes, et c'est une erreur manifeste de supposer que là où existe ce résidu, des rapports physiques existent nécessairement aussi. Il y a un très grand nombre d'exemples de femmes qui, sous l'empire d'une forte passion religieuse, suivaient des hommes et les traitaient avec une grande affection, sans qu'il y eût aucune trace d'amour physique. On a pu le voir dans le Réveil au Pays de Galles, en 1904, où Evan Roberts était l'objet de la tendre admiration de femmes qui demeuraient, semble-t-il, tout à fait pures [FN: § 1132-1]. Ces faits doivent nous porter à ne pas accorder trop facilement créance aux accusations que les adversaires se lancent mutuellement à ce propos. On a dit, par exemple, que la comtesse Mathilde avait eu pour le pape Grégoire plutôt les sentiments d'une amante que ceux d'une fille ; cela paraît très peu probable.
§ 1333. D'autre part, l'existence du résidu sexuel, aussi bien dans des discours et des écrits chastes que dans des discours et des écrits obscènes, doit nous enseigner que, pour pousser à des actes d'amour physique, il peut y avoir ou non diversité entre les premiers et les seconds. Cela dépend des individus. Il y a des gens qui sont plus facilement portés à des actes d'amour physique par des discours et des écrits chastes, et d'autres, au contraire, qui y sont portés par des écrits obscènes. On a dit, et il se peut, que le Pastor fido entraîna plus de femmes aux plaisirs amoureux que le Décaméron [FN: § 1333-1].
§ 1334. On trouve le résidu sexuel dans une très grande partie de la littérature. Drames, comédies, poésies, romans, s'en passent difficilement. Les modernes distinguent, on ne sait trop d'après quel critère, une certaine littérature « morale » d'une autre littérature, « immorale » ; et souvent ce n'est rien d'autre qu'une hypocrisie de gens qui s'offusquent du nom plus que de la chose, et préfèrent les actes aux paroles. En tout cas, s'il n'est pas absolument impossible d'écrire un roman, une comédie, un drame, sans amour, tout en intéressant le lecteur, il n'en demeure pas moins vrai que ce sont des cas très rares ; ce qui montre le grand pouvoir des résidus sexuels, dont on ne peut se passer dans les œuvres littéraires. Le public accourt nombreux pour entendre des procès où il s'agit d'amour, et les écoute d'autant plus avidement qu'on y traite davantage de faits obscènes. Dans ce public, il ne manque pas d'hommes, et encore moins de femmes, qui, ailleurs, s'évertuent à défendre la morale et à réprimer l'immoralité [FN: § 1334-1] .
§ 1335. Bien souvent déjà, nous avons dû remarquer comment les résidus sexuels se manifestent par des phénomènes semblables à ceux qu'on appelle religieux, et qui constituent ainsi un ensemble auquel il convient d'accorder une place dans cette classe. Nous pouvons ajouter que la religion sexuelle a, comme les autres, ses dogmes, ses croyants, ses hérétiques, ses athées ; nous avons dû souvent déjà rappeler tout cela ; mais comme cette opinion est opposée à celle qui est généralement admise, il ne sera pas superflu d'ajouter d'autres preuves à celles que nous avons déjà données.
§ 1336. Nous rappelons qu'il s'agit ici exclusivement de savoir si certains phénomènes ont ou n'ont pas des caractères donnés il ne s'agit pas d'en apprécier les effets individuels ou sociaux (§ 74). Quand nous aurons reconnu que ces phénomènes constituent un agrégat semblable à d'autres qui portent le nom de religion, nous ne saurons pas encore s'ils appartiennent au genre des phénomènes utiles ou à celui des phénomènes nuisibles. Il y a des religions nuisibles, d'autres anodines, d'autres utiles, d'autres encore très utiles ; et les recherches faites ici ne nous apprendront pas dans quelle classe la religion sexuelle doit être placée.
§ 1337. En général, les religions n'admettent pas d'être subjectives : elles veulent être objectives, et entendent que la science logico-expérimentale confirme entièrement leurs dogmes. Peu développées, elles se contentent de la partie matérielle ; plus avancées, elles veulent des parties intellectuelles, abstruses et principalement mystérieuses. On voile certains objets du culte ; on ne prononce pas certains noms, ou bien on ne les prononce qu'avec un saint respect ou une sainte horreur. Les Hébreux ne prononçaient pas le nom de leur Dieu ; les Romains avaient pour leur ville un nom ignoré du vulgaire ; les Athéniens punissaient sévèrement celui qui tentait de dévoiler les mystères d'Éleusis. Souvent, on trouve dans les religions un sentiment mêlé d'amour et de crainte, même de terreur, pour les êtres qui sont l'objet du culte. Les dogmes, comme les prescriptions des tabous, sont les prémisses et jamais les conclusions de raisonnements logiques. Le seul fait de les nier est un crime ou du moins révèle une nature perverse. Le croyant fervent en est profondément ému et venge souvent l'offense faite à ses théories, non pas en opposant d'autres raisonnements, faits, ou observations, mais en recourant à la force, soit directement, soit au moyen de l'autorité publique. Les procès pour impiété se soustraient souvent aux règles générales de la procédure : la seule accusation d'un crime si grave suffit pour enlever à l'inculpé les garanties usuelles qu'on ne refuse pas pour d'autres crimes. La défense d'une religion donnée devient la défense de « la morale », de « la justice », de « l'honnêteté », et doit par conséquent être approuvée même par qui n'appartient pas à cette religion, pourvu seulement qu'il soit « moral », « juste » et « honnête ». Tel ne pouvait être le non-chrétien, au moyen âge ; tel encore ne peut être, pour beaucoup de musulmans, celui qui n'est pas musulman. On rencontre tous ces caractères dans l'ensemble des phénomènes qui constituent la religion sexuelle présente. Ajoutons qu'elle admet les maximes connues sous le nom de « raison d'État », en vertu desquelles la fin justifie les moyens ; et par conséquent, quand le but est d'une très haute importance, ces maximes enjoignent de ne pas se préoccuper de frapper l'innocent, pourvu que le coupable n'échappe pas (§ 1012-1).
§ 1338. Chez les peuples anciens et aussi chez des peuples sauvages modernes, les organes et les actes sexuels font partie du fétichisme général. Nous les séparons, parce que nous jugeons les faits avec nos conceptions où le fétichisme sexuel persiste, tandis que les autres fétichismes ont disparu ou se sont affaiblis. Il serait superflu d'apporter ici les preuves de ces faits du fétichisme sexuel chez les divers peuples, car, d'un côté ces faits sont bien connus, de l'autre, ils n'appartiennent pas à la matière de la sociologie générale : ils ne doivent avoir leur place que dans la sociologie spéciale, où l'on étudie à fond le fétichisme. Mais nous devons rappeler quelques faits qui servent à prouver la continuité du phénomène dans nos nations et l'importance du résidu sexuel, car il nous faut connaître tous les résidus qui peuvent agir sur l'équilibre social. Comme d'habitude, nous portons nos regards principalement sur la civilisation qui, de la Grèce et de Rome, s'étend maintenant à nos contrées.
§ 1339. Nous avons vu que, chez les anciens Romains, presque toutes les actions non-logiques de la vie donnaient lieu, grâce à la persistance des agrégats, à des conceptions qui apparurent plus tard comme autant de petits dieux (§ 176 et sv.) Il y en avait principalement pour tous les actes de l'homme, dès la conception jusqu'à la mort. Si nous les disposons en ordre, par catégories [FN: § 1339-1] , nous observerons que, pour les modernes, il y a un hiatus considérable, là où pour les anciens Romains il y avait continuité. 1° Dieux des actes précédant la consommation du mariage ; c'est-à-dire: Iuno iuga, ou Iuno pronuba, qui unit par le mariage; Deus Iugatinus, qui préside à l'union matrimoniale ; Afferenda, pour le transport de la dot ; Domiducus, qui conduit l'épouse dans la maison du mari ; Domitius, qui l'y fait rester ; Manturna, qui la fait demeurer avec l'époux ; Unxia, qui présidait à l'onction que l'épouse faisait à la porte ; Cinxia, qui présidait à l'enlèvement de la ceinture de l'épouse [FN: § 1339-2], Virginiensis dea, qui préside à la virginité de l'épouse. Les modernes parlent de tout cela librement et même avec complaisance ; la conception fétichiste n'existe plus pour aucun de ces actes. Mais l'hiatus se manifeste avec la catégorie suivante. 2° Dieux qui président à la consommation du mariage [FN: § 1339-3]. Ils sont aussi nombreux que ceux des autres catégories ; et, pour les Romains, ce genre de fétichisme n'était pas différent des autres, tandis que les peuples modernes l'ont seul conservé, abandonnant les autres. Au delà de l'hiatus, nous avons les catégories suivantes dont, de nouveau, les modernes parlent librement. Les dieux et les déesses de l'enfantement font transition entre la catégorie présente et les suivantes. 3° Dieux qui président à la naissance. Iuno Lucina, invoquée par les femmes en couches ; Diespiter, qui préside à la naissance ; Candelifera, à cause de la chandelle allumée, à l'accouchement ; les deux Carmentes: Prorsa et Postverta ; Egeria; Numeria. 4° Dieux à invoquer après la naissance. Intercidona ;... Deus Vagitanus, qui ouvre la bouche au nouveau-né pour qu'il vagisse ; Cunina, qui s'occupe du berceau ; etc. Nous en connaissons 10 en tout. 5° Dieux qui président à l'enfance. Potina et Educa enseignent à boire et à manger... Il y en a 13 en tout (§ 176-2). 6° Divinités de l'adolescence. Il y a en 26. Suivent une infinité de dieux et de déesses, pour toutes les occupations de la vie, jusqu'à la mort, où apparaissent Libitina et Nenia.
§ 1340. L'hiatus apparaît avec un caractère nettement religieux, chez les Pères de l'Église ; et tant qu'il demeure tel, il échappe à tout jugement de toute personne qui veut rester dans le domaine expérimental, et qui, par conséquent, ne peut traiter des phénomènes religieux qu'en les envisageant extrinsèquement, comme des faits sociaux.
§ 1341. Précisément à ce point de vue, il convient de remarquer que lorsque la lutte contre le paganisme s'apaisa, ce caractère apparut comme subordonné à la religion chrétienne. Mais, tant que durait la lutte, c'était au contraire la religion sexuelle qui venait à l'aide pour soutenir la religion chrétienne et en démontrer la vérité. L'idée de Saint Augustin et d'autres Pères de l'Église est manifestement la suivante : « La religion païenne est fausse, parce qu'elle est obscène ». Cela montre combien forts sont les sentiments de la religion sexuelle, puisqu'ils pouvaient être invoqués comme arbitres. On voit, en outre, qu'on ne peut accepter l'affirmation si souvent répétée jusqu'à nos jours, que c'est la religion chrétienne qui a introduit le culte de la chasteté dans le monde. Au contraire, c'est ce culte, sincère ou hypocrite, qui a puissamment contribué au triomphe de la religion chrétienne. Il suffit de lire les Pères de l'Église pour voir aussitôt, sans le moindre doute, que pour défendre leurs dérivations, ils tablaient sur les sentiments favorables à la chasteté, contraires aux plaisirs sexuels, et qui existaient non seulement chez leurs disciples, mais aussi chez les Gentils. Ils se prévalaient de ces sentiments afin de parvenir jusqu'à l'esprit de ceux qui repoussaient encore leurs dogmes, et pour essayer de les persuader qu'ils devaient accepter une religion qui exprimait si bien des sentiments préexistants en eux.
Ce cas ne paraîtra pas nouveau au lecteur, après les exemples très nombreux que nous avons cités, et qui montrent que les dérivations suivent, ne précèdent pas les sentiments ; ce qui n'empêche pas qu'elles puissent ensuite les renforcer. Le cas dans lequel nous voyons les sentiments sexuels appelés à juger des religions et des sectes religieuses n'est pas rare ; il apparaît au contraire comme faisant partie d'une série très étendue d'autres faits semblables. Les adeptes des diverses religions et de leurs différentes sectes s'accusent réciproquement d'obscénité et d'immoralité. Les agapes des chrétiens étaient traitées par les païens d'obscènes promiscuités d'hommes et de femmes ; et les chrétiens orthodoxes répétèrent la même accusation contre les réunions des hérétiques. Les protestants se firent une arme de l'accusation habituelle d'obscénité et d'immoralité contre le clergé catholique. En même temps, les chrétiens croyants la tournèrent contre les athées, et il y eut un temps où libéraux et libertins étaient synonymes [FN: § 1341-1]. Les philosophes du XVIIIe siècle se servirent avec insistance de cette arme qui, non encore émoussée, est toujours employée en France et en Italie, et constitue, contre la religion chrétienne, l'argument sinon unique, du moins principal de nombreux journaux quotidiens.
§ 1342. Nous n'avons pas à rechercher ici quelle part de vérité ou d'erreur peuvent renfermer ces accusations. Nous devons seulement remarquer que le fait d'avoir été produites en si grande quantité et pendant tant de siècles jusqu'à nos jours, démontre incontestablement le grand pouvoir qu'ont ces sentiments dans nos sociétés ; ce qui est encore confirmé par un très grand nombre d'autres faits.
§ 1343. Le culte des organes de la génération a existé dans beaucoup de pays ; et cela ne doit pas surprendre, si l'on observe qu'il faisait partie du fétichisme général [FN: § 1343-1], là où l'hiatus que nous avons mentionné au § 1339 ne s'était pas encore produit. Dans l'antiquité gréco-latine, nous trouvons le culte du Phallus, non seulement là où la fantaisie est exubérante, comme en Grèce, mais aussi dans la grave et austère Rome, où il n'est en rien un produit de la décadence, mais où il apparaît comme un fétichisme ayant survécu à d'autres, qui s'éteignaient peu à peu. Le christianisme triomphant le trouva encore en pleine vigueur et ne réussit pas à l'éteindre entièrement. Au contraire, il persista pendant tout le moyen âge, et l'on sait assez qu'aux temps où la foi chrétienne était le plus intense, on ne cessa de sculpter des figures obscènes, jusque dans les cathédrales, de les dessiner dans les miniatures des livres sacrés [FN: § 1343-2], et que les saints chrétiens héritèrent des fonctions des dieux de la génération. L'Église eut beaucoup à faire pour éliminer ces obscénités de tous genres. [Voir Addition A24 par l’auteur]
§ 1344. Comme d'habitude, les résidus persistent tandis que les dérivations changent, et aujourd'hui l'hiatus qu'on observe là où, pour les Romains, il y avait continuité, on veut le justifier par des arguments à la mode, c'est-à-dire de pseudo-science, transformant ainsi les actions non-logiques en actions logiques. On dit que les persécutions contre ceux qui, en hérétiques, méconnaissent l'hiatus inexistant pour les Romains, sont nécessaires pour avoir une jeunesse forte et énergique. Mais est-ce que vraiment la jeunesse romaine, qui conquit tout le bassin de la Méditerranée, n'était pas forte et énergique ? [FN: § 1344-1]Mais étaient-ils faibles les soldats de César, qui vainquirent les Gaulois et d'autres peuples, sans compter les légions mêmes de Pompée ? Dirons-nous que César s'entendait moins à la guerre que M. Bérenger ? [FN: § 1344-2]. On dit encore que ces persécutions sont nécessaires pour sauvegarder les vertus familiales, comme si elles étaient rares et faibles chez les anciens Romains, quand l'image du Phallus protégeait les enfants, les hommes et jusqu'aux triomphateurs, contre le mauvais œil [FN: § 1344-3]. On dit qu'elles protègent la chasteté des femmes, comme si les matrones romaines des beaux temps de la République étaient moins chastes que ne le sont les femmes modernes de plusieurs États, où l'hypocrisie sexuelle règne en souveraine.
§ 1345. On pourrait faire beaucoup d'autres observations semblables ; mais les suivantes suffiront. Aux États-Unis, la poste refuse de transporter un roman anglais, parce qu'on l'estime trop « sensuel » ; elle transporte sans le moindre scrupule des écrits où l'on prêche l'assassinat des bourgeois et le pillage de leurs biens [FN: § 1345-1]. Mais est-ce qu'à s'en tenir à la logique et à l'expérience seules, on doit vraiment juger ces actes moins nuisibles à l'individu et à la société qu'un peu de « sensualité » ? Le sénateur Bérenger, qui, pour sauvegarder la morale, scrute attentivement les costumes des danseuses, est l'auteur d'une loi grâce à laquelle nombre de malfaiteurs sont remis en circulation, et peuvent continuer à accomplir leurs exploits. Mais est-ce que ces exploits sont vraiment moins dignes de blâme que la vue des jambes ou même des cuisses d'une danseuse ? Il y a des villes, aux États-Unis, où l'autorité charge des femmes de se promener pour provoquer les déclarations amoureuses des hommes qui sont attirés par leurs avances, et pour les faire arrêter. Cette autorité n'enrôle pas de même des hommes pour provoquer les anarchistes à faire du mal et pour les arrêter. Donc, a-t-on reconnu par la logique et l'expérience que faire un compliment amoureux à une femme qu'on rencontre sur son chemin, est plus nuisible à l'individu et à la société que tuer, incendier, voler ? (§ 1325). Le 28 mars 1913, la Chambre française discutait la loi d'amnistie. On proposait d'amnistier ceux qui avaient fait de la propagande anti-militariste, en incitant les citoyens à ne pas répondre à l'appel sous les armes, ou, s'ils y étaient contraints, à faire feu sur leurs officiers plutôt que sur l'ennemi, et en leur enseignant comment ils devaient faire pour détériorer les canons, de manière à ce qu'ils ne pussent plus tirer. Après une très vive discussion, cette proposition d'amnistie fut repoussée par 380 voix contre 171. On proposait aussi d'amnistier ceux qui avaient fait de la propagande malthusienne [FN: § 1345-2] ; et cette proposition fut repoussée par 471 voix contre 16. Donc, trahir son pays, tuer les officiers, détruire le matériel de guerre, livrer sa patrie aux ennemis, est un moindre crime que d'exposer librement son avis sur cette question : convient-il de tenir compte des contingences économiques dans la procréation des enfants ? Tout cela ne tient pas debout, et le caractère non-logique, religieux, d'une semblable façon d'agir est évident.
§ 1346. Plus modeste, mais pas meilleur, est l'argument qui veut justifier l'hiatus en disant qu'il tend à éviter l'image de choses malpropres. Mais qu'y a-t-il de plus malpropre qu'un cadavre en décomposition, grouillant de vers ? Pourtant, on en peut parler librement, et il n'est pas nécessaire, pour désigner le cadavre, la pourriture, les vers, d'employer des termes grecs ou latins. Il est donc manifeste que pour produire l'hiatus un autre sentiment agit, qui n'est pas seulement la répulsion pour ce qui est malpropre.
§ 1347. Ce sentiment appartient à la classe de ceux qui poussent les hommes à employer le mystère dans leurs religions ; et l'hiatus qu'on observe est plus de forme que de fond : il apparaît comme une oscillation dans l'extension du mystère, lequel ne faisait pas défaut chez les anciens Romains, mais enveloppe aujourd'hui un grand nombre de choses qu'on laissait autrefois en pleine lumière.
§ 1348. Si nous voulons étudier ces faits en restant dans le domaine logico-expérimental, nous ne devons participer en aucune façon aux sentiments religieux dont ils tirent leur origine, ou du moins en faire abstraction, pendant que nous accomplissons cette étude.
§ 1349. Ces sentiments peuvent être d'une grande utilité pour la vie sociale ; ils sont certainement très nuisibles aux recherches théoriques qui se font dans le domaine logico-expérimental. Donc, les personnes qui ne se sentent pas l'esprit tout à fait libre à cet égard feront mieux de ne pas continuer à lire ce chapitre. De même, ceux qui croient à l'origine divine du Coran agiront sagement en ne lisant pas une critique historique de ce livre et de la vie de Mahomet.
§ 1350. Un homme peut être guidé par le scepticisme expérimental, en une matière, et par la foi, dans une autre ; mais il ne peut, sans tomber en contradiction, être en même temps et dans la même matière, sceptique et croyant. Le croyant, précisément parce qu'il est croyant, ne peut faire autrement que tenir sa propre religion pour vraie et les autres pour fausses ; par conséquent, il juge et doit juger les faits d'après ce critère. Des actions qui, expérimentalement, sont tout à fait semblables, sont estimées par lui bonnes ou mauvaises, suivant qu'elles appartiennent à sa religion ou à une autre ; il voit très facilement la paille qui est dans l'œil de son prochain, mais n'aperçoit pas la poutre qui est dans le sien.
§ 1351. Ainsi que le croyant d'une autre religion, le croyant de la religion sexuelle repousse a priori tout argument quelconque, opposé à sa religion ; et il estime qu'on doit contraindre les autres gens à embrasser sa foi, tandis qu'il se plaindrait amèrement, si l'on voulait lui imposer une religion qui n'est pas la sienne. Là où il jouit de l'appui du bras séculier, il réalise par la force ce qu'il ne réussit pas à obtenir par la persuasion. Dans un grand nombre de pays chrétiens, on peut injurier le Christ tant qu'on veut, sans que les tribunaux interviennent pratiquement, tandis qu'ils condamnent promptement un écrit obscène [FN: § 1351-1].
§ 1352. Les anciens Romains lisaient sans la moindre colère les vers où Horace désigne les parties sexuelles de la femme par leur nom latin, et n'auraient toléré ni l'anti-patriotisme ni l'anti-militarisme. Chez les modernes, il y a beaucoup de gens qui tolèrent ces sentiments, et qui crient à tue-tête pour demander la punition de ceux qui écrivent comme Horace. Le grand prêtre Caïphe, entendant Jésus offenser ses sentiments religieux, déchira ses vêtements : scidit vestimenta sua, en disant: « Tu as blasphémé ! » De même M. Bérenger, grand prêtre de nos vertuistes, entre en fureur à la seule pensée que Regina Badet se montre sur la scène avec un costume trop rudimentaire. Les musulmans ont horreur du porc et ne voudraient en manger à aucun prix, tandis qu'ils s'entretiennent librement des rapports sexuels. Nos vertuistes ont – ou du moins feignent d'avoir – horreur de ces conversations, tandis qu'ils mangent allègrement la viande de porc. Dubois [FN: § 1352-1]rapporte que: « (p. 252) Un Européen de ma connaissance avait écrit une lettre à un de ses amis en faveur d'un brahme que je lui avais recommandé. Sa lettre finie, il la cacheta avec un pain à cacheter qu'il avait humecté en le mettant sur le bord de sa langue : le brahme s'en aperçut, ne voulut pas recevoir la lettre, sortit de fort mauvaise humeur, comme une personne qui se croyait grièvement insultée, et aima mieux renoncer aux avantages qu'il aurait pu retirer de cette recommandation, que d'être porteur d'une missive souillée de la sorte ». Un de nos vertuistes, de ceux qui sont si habiles à voir la paille dans l'œil de leur prochain, rira de l'absurdité de ce brahme, sans prendre garde qu'il ferait exactement de même, si, par exemple, le cachet de la lettre reproduisait l'image de ce phallus que les Romains employaient sans aucun scrupule, pour repousser le mauvais œil [FN: § 1352-2].
§ 1353. On trouve le résidu sexuel mélangé à d'autres résidus, dans un grand nombre de phénomènes, et nous devrons répéter ici en partie les remarques faites à propos de l'ascétisme [FN: § 1353-1] .
§ 1354. Comme d'habitude, nous excluons la simple hypocrisie, qui est d'ailleurs beaucoup plus rare qu'on ne le croit. Elle est souvent un art d'accomplir certaines actions logiques, et ne trouve pas sa place parmi les résidus.
§ 1355. Le résidu sexuel fait partie d'un grand nombre d'effusions religieuses, et parfois on le reconnaît immédiatement ; d'autres fois, il est presque impossible à discerner et à séparer du sentiment exclusivement religieux [FN: § 1355-1] . Les ennemis de l'Église catholique ont voulu le voir même là où il n'était pas ; les amis ont voulu le nier même là où il est évident. Beaucoup de prêtres qui abandonnent l'Église catholique sont poussés par le besoin de la femme [FN: § 1355-2] ; parfois ils s'en rendent compte ; parfois non. Ce besoin n'est pas étranger à un grand nombre de critiques des modernistes, pas plus que le désir de faire la cour à la Démocratie, pour obtenir des avantages.
§ 1356. Le culte de la femme [FN: § 1356-1] apparaît explicitement ou implicitement, d'une manière ouverte ou à peine voilée, dans un très grand nombre de religions ; et là-dessus on pourrait écrire un gros volume. N'oublions pas les générations des êtres divins, où se manifeste le résidu sexuel, ni les allégories et les personnifications masculines ou féminines d'abstractions ou d'autres agrégats fantaisistes. Tout cela montre qu'à chaque instant l'idée du sexe vient à l'esprit. Il est certain que la chasteté forcée, surtout quand elle est sincèrement observée, provoque le sentiment sexuel, là où il n'y a et ne peut y avoir de rapports érotiques. Cela se voit déjà en germe dans l'affection passionnée de certaines fillettes pour leurs poupées, pour un animal, pour leurs amies ; quelquefois il est uni à l'amour filial, à l'insu du sujet. On peut s'en rendre compte en remarquant ce qui se passe lorsque la jeune fille se marie ou s'unit de tout autre façon à un homme : alors ces formes d'affection disparaissent ou diminuent. Des femmes séparées de l'homme ont souvent pour un petit chien un sentiment dans lequel, à leur insu, entre l'amour. D'autres se vouent à des œuvres de bienfaisance, à des propagandes humanitaires, à des pratiques religieuses. Beaucoup de féministes sont simplement des hystériques auxquelles manque un homme.
§ 1357. La vénération et la haine d'une certaine chose peuvent être également des formes d'une religion qui a cette chose pour objet. Cette religion n'est exclue que par l'indifférence (§ 911). C'est pourquoi l'hiatus que nous avons relevé plus haut tient plus à la forme qu'au fond. Le nègre qui maltraite son fétiche, le catholique qui blasphème son saint, font preuve d'une religion que n'a pas l'homme auquel ce fétiche et ce saint sont indifférents. Cela est bien connu pour l'amour ; il y a longtemps déjà qu'on a observé que l'amour et la haine sont très voisins et s'opposent à l'indifférence. C'est aussi une ancienne observation, que les hommes qui disent le plus de mal des femmes sont aussi ceux qui les aiment le plus [FN: § 1357-1] .
§ 1358. Le fait que souvent le désir sexuel conduit à la haine de l'acte sexuel et, chez les saints chrétiens, à la haine de la femme, ne doit pas nous étonner. Dans les invectives des ascètes, apparaît souvent, mêlé à un sentiment de simple ascétisme, le sentiment du besoin sexuel inassouvi. Celui-ci peut devenir assez intense pour provoquer des hallucinations ; et le chrétien est persuadé que le diable le tente pour l'induire au péché d'impureté. Cette imagination n'est pas entièrement vaine : ce diable existe réellement dans l'esprit d'un homme, et serait chassé par la femme plus sûrement que par les exorcismes.
§ 1359. Qu'on lise seulement une partie de ce que le bon frère Bartolomée de San Concordio [FN: § 1359-1] accumula contre les femmes, et l'on verra que chez les Pères de l'Église, il y a, sur ce sujet, de quoi composer un grand nombre de volumes.
§ 1360. Ceux qui de bonne foi se repaissent volontiers de ces discours sont poussés, par l'ardeur de leurs sens inassouvis, à penser toujours à la femme : ils la fuient par crainte d'un danger imminent ; ils la haïssent parce qu'ils l'aiment trop ; ils envient, sans s'en apercevoir, celui qui la possède ; et ce sentiment se mêle, dans l'exaltation de la virginité, aux louanges adressées aux époux qui, vivant en parfaite continence, n'usent pas des droits du mariage, à l'horreur de la fornication. Chez les saints, la bonne foi paraît vraiment parfaite. C'est justement cette bonne foi qui rend les sentiments plus vifs et les fortifie.
§ 1361. Chez d'autres non plus, la bonne foi peut ne pas faire défaut. L'empressement que mettent les prêtres et les moralistes à éloigner les femmes des « tentations » peut être l'effet d'un simple zèle religieux ou moral ; mais quelquefois il s'y mêle la jalousie sexuelle, qui peut exister même en l'absence de relations charnelles, car l'eunuque, c'est bien connu, est souvent jaloux et même très jaloux ; et dans nos contrées on observe combien peut être vive la jalousie de l'impuissant. Il y a aussi des béguines humanitaires, laides et vieilles, et d'autres femmes semblables qui, bien que n'ayant pas de rapports charnels avec un jeune homme, en sont fort jalouses et entrent en fureur si elles le voient regarder une femme jeune et belle, et surtout s'il parle avec elle. Tout cela peut se produire sans que le sujet s'aperçoive du résidu sexuel qui existe en lui. L'envie peut aussi se mêler au sentiment sexuel, de manière à ne pouvoir en être séparée, même par la personne qui éprouve ces sentiments complexes.
§ 1362. Vers la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe, l'idée était générale que seuls les théologiens chrétiens voulaient priver l'homme des plaisirs des sens et, par conséquent, des jouissances sexuelles que lui offre la « Nature » [FN: § 1362-1] ; mais les faits survenus dans la suite, et surtout dès 1900, démontrent que les théologiens de la libre-pensée ne restent pas en arrière des théologiens chrétiens dans cette œuvre, et que les inquisiteurs modernes du crime d'hérésie dans la religion sexuelle sont les dignes compagnons des anciens inquisiteurs du crime d'hérésie dans la religion catholique.
§ 1363. Il est remarquable que la religion chrétienne, et principalement la religion catholique, tout en réprouvant les plaisirs amoureux, en tire la plus grande partie des métaphores dont elle se sert dans les manifestations de la foi. Sans parler de l'Église, qui est l'épouse de Christ, ni des interprétations de l'érotisme du Cantique des Cantiques, grâce auxquelles un chant d'amour, à la vérité quelque peu grossier et ridicule, devient l'épithalame de l'Église, épouse de Christ, on peut remarquer que les religieuses sont appelées les épouses de Christ, lui consacrent leur virginité et brûlent pour lui d'un amour où le céleste se mêle au profane, et que les saints Pères ne savent s'entretenir un peu longuement d'un sujet sans faire allusion, ne fût-ce que métaphoriquement, à l'amour. L'image de la femme encombre leur esprit et, chassée d'un côté, elle revient d'un autre.
§ 1364. Déjà dans l'Évangile, il y a des passages dans lesquels apparaît discrètement le résidu sexuel. Par exemple, on ne voit pas pourquoi la parabole des dix vierges ne pourrait être remplacée par une autre, dans laquelle on n'amènerait pas la pensée à s'arrêter sur les femmes vierges et sur la consommation du mariage. Mais c'est principalement dans le développement postérieur du christianisme que règne la femme, élevée même aux splendeurs du trône céleste, sous la forme de la Vierge Marie.
§ 1365. Qu'on veuille comparer ces écrits avec les Mémorables de Socrate, composés par Xénophon. Chez l'auteur grec, l'amour de la femme est un besoin physique comme tant d'autres dont la satisfaction n'est pas blâmée, et dont l'excès seul est nuisible. L'auteur s'en occupe peu, de même qu'il s'occupe peu des autres besoins semblables à celui de manger ; l'amour n'encombre pas son esprit : on voit que d'autres soins réclament toute son attention. Au contraire, on s'aperçoit que le désir de la femme pèse sur l'esprit des saints Pères comme un cauchemar, et qu'il provoque chez eux des sentiments semblables à ceux que le damné de Dante, torturé par la soif, éprouvait à la pensée de l'eau désirée [FN: § 1365-1].
§ 1366. Dans un passage très connu [FN: § 1366-1], Saint Paul accepte le mariage comme un moindre mal : mieux vaudrait demeurer sans avoir commerce avec la femme ; mais à celui qui ne peut s'en abstenir, il est permis de se marier. Saint Paul est certainement misogyne ; mais nous connaissons trop peu de choses de lui pour savoir si ce sentiment venait, comme chez Leopardi, de ce qu'il était contrefait, ou de ce qu'il était repoussé par les femmes, ou de quelque autre motif semblable, ou bien du simple mysticisme.
§ 1367. Saint Cyprien écrit [FN: § 1367-1] : « Maintenant, notre discours s'adresse aux vierges pour lesquelles notre sollicitude doit être d'autant plus grande que leur gloire est sublime. Elle [la virginité] est la fleur née de l'Église, l'honneur et l'ornement de la grâce spirituelle, nature joyeuse, œuvre intègre et pure de la gloire et de l'honneur, image de Dieu répondant à la sainteté du Seigneur, partie la plus illustre du troupeau du Christ. La glorieuse fécondité de notre mère l'Église se réjouit pour elles [les vierges], et fleurit abondamment en elles, et plus la virginité augmente en nombre, plus s'accroît l'allégresse de la mère ». En écrivant ces louanges si chaleureuses, le saint croyait certes être mu simplement par le sentiment religieux ; mais il est très probable qu'à son insu le sentiment sexuel agissait sur lui.
§ 1368. Saint Augustin nous dit avoir aimé les femmes, dans sa jeunesse ; mais il nous apprend qu'après sa conversion il devint l'adversaire de tout commerce avec elles, fût-il légitime [FN: § 1368-1].
§ 1369. Chez Saint Jérôme, la puissance des sentiments pour tout ce qui touche à la femme et aux plaisirs amoureux est vraiment remarquable. Saint Jérôme ne cesse de conseiller, d'encourager, de sermonner, de reprendre les vierges et les veuves. Il s'occupe beaucoup moins des femmes mariées et il semble vraiment que, peut-être sans s'en apercevoir, il considère le mari comme un rival. Il se plaint « d'avoir été accusé par la fureur hérétique de condamner le mariage [FN: § 1369-1] ». Mais il faut reconnaître qu'il avait bien donné quelques motifs à cette accusation.
§ 1370. S'adressant à la vierge Eustochia, il fait allusion aux maux profanes du mariage : la grossesse, les pleurs des nourrissons, la jalousie excitée par les maîtresses du mari, les soins du ménage [FN: § 1370-1]. Il fait dire à la vierge qu'elle ne veut pas tomber sous le coup de la sentence de la Genèse : Tu enfanteras avec douleur et dans l'angoisse. « Cette loi est celle des femmes et non la mienne ». (loc. cit., p. 144 b). En ce qui concerne la crainte de la grossesse, il est le précurseur de nos néo-malthusiens contemporains. M. Bérenger, qui a la manie des dénonciations, devrait s'adresser au procureur de la République pour le faire punir, ou, comme cela n'est pas possible, puisqu'il est mort depuis si longtemps, pour faire au moins expurger ses livres. On pourrait, d'autre part, invoquer en faveur du saint le fait que, sans avoir besoin d'espions, il notait les sévères punitions qu'encoururent ceux qui avaient éloigné les vierges de la chasteté [FN: § 1370-2].
§ 1371. Le pauvre saint était tourmenté par l'idée de la femme ; idée rendue dominante par les désirs inassouvis, et qui résistait à la macération. Il raconte que, retiré dans le désert « en compagnie des scorpions et des bêtes sauvages, souvent le chœur des jeunes filles me tourmentait. Mon visage pâlissait à cause des jeûnes, et mon esprit brûlait dans mon corps glacé ; dans la chair déjà morte d'un homme, seuls les feux de la luxure brûlaient » [FN: § 1371-1] . Ces hallucinations sont trop connues pour que nous nous y arrêtions. Les démons tourmentaient sans cesse les saints ascètes, et les tentaient sous des formes féminines. Outre son propre exemple, Saint Jérôme en cite d'autres et, d'une façon générale, la vie des saints n'en manque pas [FN: § 1371-2].
On comprend facilement que Saint Jérôme, chez lequel le résidu sexuel était si puissant, ait été en butte aux accusations qu'il repousse dédaigneusement, et peut-être avec raison, de trouver trop de plaisir dans la compagnie des femmes. Il dit [FN: § 1371-3]: « Souvent, beaucoup de vierges m'entourèrent. Souvent, j'ai expliqué les livres saints comme j'ai pu, à un grand nombre d'entre elles. La leçon engendra l'assiduité ; l'assiduité, la familiarité ; la familiarité, la confiance. Qu'elles disent si elles trouvèrent jamais en moi autre chose que ce qui convenait à un chrétien ? Acceptai-je jamais de l'argent ? Ne méprisai-je pas les cadeaux, petits ou grands ? L'argent d'autrui sonna-t-il dans ma main ? Fus-je immodeste dans mes discours ou dans mes regards ? On ne me reproche que mon sexe ; et c'est la seule chose qu'on me reproche, à cause du voyage de Paula et de Mélanie à Jérusalem ».
§ 1372. Pourtant, ses entretiens étaient un peu dangereux, et ces perpétuels discours sur les plaisirs amoureux devaient mettre en péril la chasteté. Il dit à la vierge Eustochia [FN: § 1372-1] : « Il est difficile que l'âme humaine n'aime pas quelque chose, et il est nécessaire que notre esprit se prenne d'affection pour quelque chose. L'amour charnel est vaincu par l'amour spirituel. Le désir est éteint par le désir [c'est un peu dangereux]. D'autant celui-ci diminue, d'autant celui-là s'accroît. Répète souvent sur ton lit : « Dans la nuit, j'ai cherché celui qu'aime mon âme ». Ces paroles du Cantique des Cantiques se rapportent – ou mieux le saint croyait qu'elles se rapportaient – à un époux spirituel ; mais, hélas ! elles évoquent aussi l'image d'un époux matériel, surtout si on les prononce sur un lit. Il y a dans tout cela, même si c'est fait innocemment, le résidu sexuel ; de même qu'il existe aussi dans l'œuvre d'un certain pasteur français qui, poussé par la haine de la pornographie, étudie curieusement la longueur des jupes des danseuses et cherche si elles dissimulent bien l'entre-jambes.
§ 1373. Les hérétiques ne le cédaient en rien aux orthodoxes, en fait de préoccupations sexuelles. Comme nous l'avons dit déjà (§ 1341 et sv.), il faut ajouter peu de foi aux accusations d'obscénité qu'échangent les différentes sectes religieuses ; mais elles servent à nous faire connaître le pouvoir et la force de la religion sexuelle qui fournit ainsi aux hommes des armes pour leurs disputes, et au nom de laquelle s'exercèrent et s'exercent toujours des persécutions, grandes ou petites, comme il s'en exerça au nom de tant d'autres religions.
§ 1374. Dans le livre de Saint Augustin sur les hérésies [FN: § 1374-1], nous trouvons un grand nombre d'affirmations sur les mauvaises mœurs qu'à tort ou à raison on impute aux hérétiques. Le saint traite longuement des Manichéens ou Cathares. D'une part, il les dépeint comme voyant le mal dans la matière, et par conséquent comme très rigoureux pour réprouver tout ce qui est charnel ; d'autre part, il les accuse de turpitudes. D'après ce que nous savons de leurs successeurs, au moyen âge, c'est-à-dire des Albigeois, il semblerait probable qu'ils furent d'une rigueur ascétique excessive [FN: § 1374-2] et exempts de toute turpitude ; mais nous ne pouvons rien dire de certain. Saint Augustin prétend qu'ils affirmaient que les vertus saintes se changeaient en mâles pour attirer les femelles de la nation ennemie, et en femelles pour allumer la concupiscence des mâles [FN: § 1374-3]. Qu'il soit vrai ou qu'on ait imaginé que les Manichéens parlaient de cette façon, le fait subsiste que le résidu sexuel jouait un rôle important dans leurs raisonnements ou dans ceux de leurs adversaires.
§ 1375. Saint Épiphane, auquel Saint Augustin emprunte une partie de ces renseignements, ajoute des détails obscènes, spécialement au sujet des Gnostiques, en les tirant de Saint Irénée [FN: § 1375-1]. Ces derniers détails paraissent difficilement pouvoir être vrais en tous points, et semblent avoir été inventés, au moins en partie, par quelque esprit lascif.
§ 1376. Un peuple chez lequel les unions sexuelles seraient absolument interdites disparaîtrait bientôt, s'il ne se rénovait pas, comme les Esséniens, au moyen d'individus provenant d'autres peuples. Par conséquent une religion qui veut s'étendre beaucoup ou être universelle, doit nécessairement admettre l'union des sexes, et se limiter à la régler, si elle ne vise pas à l'extinction de ses disciples et du genre humain. Saint Paul ne paraît pas y avoir pensé ; et, en admettant le mariage, il songeait uniquement à éviter le péché très grave de la fornication ; mais ces considérations ne furent pas étrangères à l'attitude que prit l'Église à l'égard du mariage, quand elle devint un pouvoir social important et espéra devenir le régulateur suprême de la société humaine. De petites sectes hérétiques ont bien pu supprimer la concession faite par l'apôtre à propos du mariage, condamner absolument et pour tous les hommes tout commerce sexuel, et, pour éviter plus sûrement l'union sexuelle abhorrée, aller même jusqu'à recommander ou à prescrire la castration. Mais l'Église catholique sut tenir un juste milieu, en décidant que le mariage était un état louable, moins digne toutefois que la virginité. Diverses opinions furent ensuite émises sur les mariages subséquents, qui furent tolérés, blâmés, interdits ; sur le divorce et sur un très grand nombre d'autres sujets dont il n'y a pas lieu de parler ici.
§ 1377. Si l'on écarte un très petit nombre de sectes hérétiques, en des cas d'ailleurs souvent douteux, tous les chrétiens admettent avec Saint Paul que l'impudicité est l'un des plus grands péchés. Dans cette idée, qui appartient aussi à nombre d'incroyants ou d'athées modernes, le résidu sexuel apparaît manifestement. Il persiste tandis que changent les dérivations religieuses qui le dissimulent.
§ 1378. Cette réprobation du péché charnel fut-elle vraiment très efficace pour l'empêcher en pratique ? Il y a lieu d'en douter, quand on lit l'histoire sans idées préconçues, en y cherchant ce qui s'est passé, et non ce que nous voudrions qu'il se fût passé. D'abord, en général, si nous trouvions qu'avec l'augmentation de la foi en une religion qui condamne le péché charnel, les mauvaises mœurs diminuent, et vice versa, nous pourrions voir dans cette coïncidence un certain indice montrant que les théories contre les mauvaises mœurs ont probablement agi sur les faits. Mais si, au contraire, nous trouvons que des temps de foi vive sont aussi des temps de très mauvaises mœurs, nous aurons un indice différent. Nous ne conclurons pas que la foi favorise les mauvaises mœurs, puisqu'il est évident que bien d'autres causes peuvent avoir agi. Nous ne conclurons pas non plus que la foi n'a en rien favorisé les bonnes mœurs, car enfin, nous ne savons pas si, à son défaut, les mauvaises mœurs n'auraient pas été pires. Mais nous pourrons bien conclure que les résidus sexuels sont assez puissants pour vaincre souvent les prescriptions de la foi ; puisque nous ne faisons ainsi que résumer les nombreux faits en une expression générale. Cette conclusion peut aussi être acceptée par des croyants fervents, par exemple par de fervents catholiques ; seulement ceux-ci s'expriment d'une façon différente. Quand nous parlons de la puissance des résidus, ou mieux des sentiments manifestés par les résidus, ils parlent de la puissance du démon, qui rôde quaerens quem devoret. Du reste, s'ils veulent être logiques, ils ne peuvent même pas nier que ces faits démontrent le peu d'utilité des théories, puisqu'ils expriment la même chose de façon différente, en disant que pour résister aux pièges du démon, l'homme a besoin de la grâce divine.
§ 1379. Un très grand nombre de faits nous apprennent que chez certains peuples et en certains temps, la foi vive peut être unie aux mauvaises mœurs. Des premiers siècles du christianisme jusqu'en des temps très proches du nôtre, on n'entend que des plaintes sur les mauvaises mœurs des chrétiens. Même en faisant une large part à la rigueur des censeurs et en admettant qu'ils voyaient le mal plus grave qu'il n'était réellement, pouvons-nous croire que toutes ces plaintes n'eussent pas le moindre fondement dans le monde concret ? Et puis, outre les discours, il y a les faits. Supposons aussi qu'ils aient été en partie inventés ; mais est-il possible qu'ils l'aient été tous ? Si on voulait l'admettre, on devrait aussi mettre en doute tout fait historique considéré comme certain. Les sophismes employés pour nier la vérité n'ont jamais fait défaut. Tel a cru pouvoir opposer aux vices présents les vertus d'un passé qui ne fut jamais un présent pour personne, et qui par conséquent n'existait que dans son imagination. Tel a voulu opposer aux vices de son pays les prétendues vertus des pays étrangers. Ce fut en partie le cas de Tacite [FN: § 1379-1] , quand il écrivit la Germanie, et ce préjugé engendra les déclamations de Salvien [FN: § 1379-2]. Celui-ci oppose avec prolixité les vertus des Barbares aux vices des Romains. Mais s'il disait vrai, il faut croire que ces vertus ne durèrent pas longtemps, puisque, à peine un siècle après le temps où écrivait Salvien, nous avons l'histoire de Saint Grégoire de Tours, qui nous montre les Barbares avides de sang, d'argent, de luxure [FN: § 1379-3].
§ 1380. De notre temps, les admirateurs du moyen âge ne veulent admettre en aucune façon que ce fut un temps de mauvaises mœurs. Il n'est sorte de sophismes auxquels ils n'aient recours pour se soustraire à l'évidence des faits. Par exemple, ils affirment que les figures obscènes sculptées ou dessinées, et parvenues du moyen âge jusqu'à nous (1343-2) et le parler indécent que nous trouvons dans un grand nombre d'écrits médiévaux, par exemple dans les nouvelles et les fabliaux [FN: § 1380-1] , bien loin d'être l'indice de mœurs corrompues, révèlent au contraire l'état sain et moral de gens qui peuvent sans danger appeler les choses par leur nom. À entendre certains auteurs, on serait tenté de croire que les hommes et les femmes du moyen âge étaient aussi naïfs que Daphnis et Chloé. De tels raisonnements pourraient être acceptés comme probants, si l'on voulait tirer la conclusion d'immoralité sexuelle uniquement des sculptures, des dessins, du langage inconvenant ; et il est parfaitement vrai qu'un parler châtié dissimule parfois des mœurs plus corrompues qu'un parler rudement obscène. Mais ces raisonnements ne sont pas probants, parce que dans les écrits en question, ce n'est pas la forme seule qui est obscène, mais aussi le fond. Qu'on transcrive en langage châtié, même très châtié, les nouvelles et les fabliaux, qu'on fasse entendre seulement par des périphrases ce qui y est dit brutalement : le fond restera toujours, et il est aussi obscène que possible.
§ 1381. Outre les écrits [FN: § 1381-1], il y a les faits que nous apprennent les chroniques et autres documents ; et vraiment il y en a plus qu'il ne faut pour pouvoir assurer avec certitude que le moyen âge ne fut pas plus chaste que notre époque : il semble au contraire qu'il fut plus corrompu. Certains auteurs ne veulent pas accepter pour preuve des mauvaises mœurs du temps les faits de mauvaises mœurs du clergé ; ils en rejettent la faute sur la religion, l'« idolâtrie catholique », la « papauté », comme disaient les Réformateurs ; mais c'est là un autre sophisme démenti par les faits. Les mœurs du clergé n'étaient pas pires que les mœurs des gens, en général ; elles étaient même meilleures ; et si beaucoup d'évêques étaient aussi corrompus que beaucoup de barons féodaux, un grand nombre d'autres donnaient des exemples de vertu qu'on trouvait difficilement chez les laïques. Enfin, souvent, quand les anciennes chroniques relèvent des faits de mauvaises mœurs du clergé, on voit clairement que de tels faits étaient tenus pour coutumiers chez les laïques, et que si elles s'en indignent, c'est uniquement parce qu'il s'agit de prêtres. Il y aurait trop à dire, si nous voulions rapporter ici une partie, même très petite, des faits si nombreux qui démontrent qu'au moyen âge, et même dans les temps qui précédèrent et qui suivirent, les mauvaises mœurs se trouvaient dans les actes et non pas seulement dans les termes. Il serait d'ailleurs de peu d'utilité de rappeler des choses très connues, que seule la passion sectaire peut oublier. Les mesures mêmes prises par les conciles, les souverains, les communes, les autorités de toute espèce et de toute qualité, contre les mauvaises mœurs, en démontrent l'existence ; car on n'interdit pas d'une façon répétée ce qui n'existe pas. Les taxes établies en maints endroits sur les prostituées montrent qu'elles n'étaient pas en petit nombre, car autrement la taxe n'aurait rapporté que peu de chose ou rien du tout [FN: § 1381-2]. Nous connaissons beaucoup de procès pour bestialité ; et un grand nombre d'animaux inculpés furent brûlés. Avec les documents sur les mauvaises mœurs des croisés, on pourrait composer une bibliothèque. Admettons qu'une partie des faits aient été exagérés ; il est cependant impossible que tous n'aient aucun fondement dans la réalité [FN: § 1381-3].
§ 1382. Parmi les dogmes de la religion sexuelle qui règne de nos jours, il y a celui en vertu duquel la prostitution est un mal « absolu ». Tout dogme religieux échappe, de par son essence même, à la discussion. Mais, au point de vue expérimental, il reste à savoir si la prostitution est ou non le métier qui convient le mieux à la nature de certaines femmes, auxquelles il plait plus que d’autres métiers qu'elles pourraient exercer, et s'il est ou non, entre certaines limites, utile à la société entière (§ 1382-3). Les croyants de la religion sexuelle moderne ne donnent pas la moindre preuve que la question se résout dans le sens qui leur plaît. Il faut croire à leurs affirmations, comme on croyait autrefois à l'existence de Iuppiter optimus maximus, et comme les musulmans croient encore que le contact du porc est la cause d'une très grave impureté. Ces dogmes peuvent être utiles ou non à la société en certaines circonstances ; mais ce n'est pas ici l'objet de notre étude, qui a exclusivement pour but de reconnaître la nature des résidus et leur intensité (§ 1336).
La prostitution sacrée a existé chez un grand nombre de peuples. Cela surprend quiconque est sous l'impression de l'hiatus mentionné au § 1339, mais non l'observateur qui, se soustrayant à cette impression, prend garde qu'en somme la conception dont l'hyatus découle n'est pas d'une autre nature que les sacrifices de divers genres, y compris les sacrifices humains, qu'on avait l'habitude d'offrir aux dieux, ou que les consécrations semblables à celle du ver sacrum des Romains (§ 930). Nous n'avons pas à nous occuper de ce sujet, qui sera mieux à sa place dans la sociologie spéciale [FN: § 1382-1].
La prostitution vulgaire se voit chez tous les peuples civilisés et en tous les temps. Elle existait chez le peuple hébreu, élu de Dieu [FN: § 1382-2], et ne faisait pas défaut chez les païens. Les Romains et les Grecs considéraient les courtisanes comme ayant une profession qui, tout en étant inférieure à d'autres, était pourtant nécessaire [FN: § 1382-3]. La prostitution persista, après cette époque ; le christianisme ne la fit pas disparaître ; elle s’est maintenue jusqu'aujourd'hui, et il est probable qu'elle durera encore, malgré l'indignation de certains de nos contemporains, souvent plus chastes en théorie qu'en pratique. L'hypocrisie des croyances médiévales, et ensuite des modernes, poussa parfois les gouvernements à frapper la prostitution par des lois, qui n'eurent que peu ou point d'effet ; ce qui est une nouvelle preuve de la puissance des résidus que nous étudions. La prostitution ne fit pas défaut chez le peuple très catholique du moyen âge. Nous en trouvons la preuve dans les nombreux règlements qu'on lit à son sujet et dans les incessantes menaces de punir les prostituées, menaces qui, précisément parce qu'elles sont toujours renouvelées, apparaissent inefficaces. Déjà dans les lois barbares il est question des prostituées [FN: § 1382-4] . Dans les capitulaires du pieux empereur Charlemagne, on parle de prostituées qui s'introduisaient jusque dans le palais [FN: § 1382-5] , ainsi que de graves dérèglements qui compromettaient la prospérité de l'empire ; et l'on statue des peines contre des vices infâmes [FN: § 1382-6]. Dans les constitutions du royaume de Sicile, il est interdit de faire violence aux courtisanes [FN: § 1382-7].
§ 1383. Le bon roi Saint Louis découvrit que dans son camp, à Damiette, on avait établi des lupanars près de son pavillon [FN: § 1383-1] . Souvent, à propos du roi des ribauds [FN: § 1383-2], on fait allusion aux prostituées qui suivaient la cour, et à d'autres qui étaient sous la juridiction de ce personnage. Quand, ensuite, au XVIe siècle, nous voyons déborder la corruption, nous devons remarquer qu'elle n'apparaît pas ex novo, mais que c'est seulement une des nombreuses oscillations d'un phénomène continu [FN: § 1383-3]. En un mot, la prostitution existe chez presque tous les peuples civilisés et en tout temps. Il y a de notables différences de forme et très peu de différences de fond.
§ 1384. Jusqu'ici, nous avons parlé de la population en général. Examinons les diverses classes en particulier. Si, cela faisant, nous trouvions que, chez les hommes qui occupent une haute situation dans une organisation religieuse où le péché charnel est condamné, les mauvaises mœurs disparaissent, nous aurions un indice d'effet probable de la doctrine sur les faits. Mais si cela n'arrive pas, si là où la foi apparaît plus forte les mœurs ne sont pas meilleures, nous conclurons encore, comme précédemment, non pas que la foi est malfaisante, ni qu'elle est absolument inefficace, mais bien qu'en de nombreux cas elle ne suffit pas à vaincre les résidus sexuels.
§ 1385. Des reproches, quant aux mœurs, adressés aux anciens philosophes de la Grèce et de Rome, en passant par les accusations portées contre le clergé catholique ou, en général, contre le clergé chrétien, on arrive jusqu'à ceux qu'à notre époque on pourrait adresser aussi aux vertuistes.
§ 1386. Celui qui incline à donner aux actions logiques une importance grande ou exclusive, est poussé, en observant que peu ou beaucoup de croyants d'une religion sont malhonnêtes, à conclure que cette religion est « fausse », vaine, nuisible. Mais celui qui sait quelle grande part les actions non-logiques ont dans les faits et gestes des hommes, sait aussi que cette conclusion ne tient pas debout. La philosophie n'est pas condamnable par le fait qu'il y eut des philosophes malhonnêtes, ni la religion catholique parce qu'il y eut des prêtres coupables, ni la religion des vertuistes, parce qu'il y a parmi eux des gens dissolus. Il faut juger ces religions et les autres avec d'autres critères. Remarquez qu'en plusieurs cas, même en négligeant la considération des actions non-logiques et en restant strictement dans le domaine des actions logiques, ces reproches ne sont pas justifiés.
§ 1387. Par exemple, on a vivement reproché aux jésuites de traiter dans leurs œuvres des cas de conscience relatifs à l'acte sexuel. Ce reproche pourrait peut-être se justifier logiquement, s'il émanait de qui pense que ni la morale ni la loi ne doivent se préoccuper de ce sujet ; mais s'il émane, comme il arrive souvent, de qui veut au contraire que la morale et la loi interviennent, il est injustifié, puisqu'il est manifestement impossible de régler une matière quelconque sans en parler [FN: § 1387-1]. Remarquez d'ailleurs que les jésuites ne furent pas le moins du monde les seuls à suivre cette voie : ils furent précédés par les Pères de l'Église et se trouvent en compagnie de tous ceux, croyants ou athées, qui voulurent ensuite régler l'acte sexuel.
§ 1388. Les abolitionnistes qui, à notre époque, veulent abolir la prostitution, s'expriment avec plus d'obscénité que les jésuites, et de plus s'expriment en langue vulgaire, tandis que les jésuites écrivaient en latin. Nos vertuistes, qui combattent les mauvaises mœurs, s'y prennent souvent de telle manière qu'ils font venir l'eau à la bouche. Ne parlons pas de ceux qui, sous le prétexte d'instruire la jeunesse, afin de la maintenir chaste, écrivent des livres pour l'instruire des détails de l'acte sexuel.
§ 1389. Il y a surabondance et même pléthore de témoignages prouvant que les théories sur les bonnes mœurs sont loin de concorder toujours avec les faits relatifs à la conduite des adeptes de ces théories. Nous devons nous tenir sur nos gardes au sujet de ces faits, et en exclure plusieurs. En attendant, ceux qui sont rapportés par les adversaires sont suspects, parce qu'ils peuvent, même si l'on admet la bonne foi, manifester uniquement la malveillance, qui, pour se donner libre cours, se sert des armes efficaces fournies par les résidus sexuels. Les témoignages des indifférents ne sont pas toujours acceptables sans réserve, parce que l'effet sur notre esprit, du contraste entre les discours vertueux et la mauvaise conduite, nous fait voir avec un verre grossissant les vices de celui qui prêche la vertu. Il ne faut pas non plus toujours accueillir sans réserve les témoignages des croyants d'une religion contre leurs prêtres, parce que la tendance à exagérer le mal pour le corriger et à substituer le prêche à la froide observation, est naturelle à l'homme. Mais, autant pour l'indifférent que pour le croyant, notre remarque s'applique aux commentaires des faits plutôt qu'aux faits eux-mêmes. Tout est possible, mais il est peu probable qu'un croyant invente de toutes pièces un fait, pour le seul plaisir de médire des gens qui ont la même foi que lui, et qu'un indifférent qui a le désir de bien observer les faits, les invente. Enfin, ce sont là les causes d'erreur qu'on trouve dans tous les documents historiques ; et si nous voulons absolument les exclure, nous devons aussi renoncer à nous occuper de toute recherche historique, quelle qu'elle soit.
§ 1390. Voyous un cas concret, à l'appui des observations théoriques que nous venons de faire. Saint Jérôme nous apprend que, de son temps déjà, il y avait des prêtres ressemblant aux petits abbés galants que vit le XVIIIe siècle, de même qu'il y avait des femmes ressemblant beaucoup à nos vertuistes contemporaines, lesquelles, par seul amour de la vertu, ne se lassent jamais d'étudier la prostitution. Ces observations du saint et les lois que les empereurs durent rendre pour faire disparaître la trop grande familiarité des ecclésiastiques avec les femmes, écartent le doute qu'il y ait une calomnie dans ce qu'écrit Ammien Marcellin, des pontifes romains de son temps [FN: § 1390-1]: « En considérant le faste de cette dignité dans la ville de Rome, je comprends l'avidité à l'obtenir et pourquoi on se la dispute de toutes ses forces ; car celui qui l'obtient sera sûr de s'enrichir par les oblations des matrones, et de se promener en voiture, vêtu avec recherche, jouissant de banquets splendides, à tel point que leurs tables surpassent celles des rois ».
§ 1391. Dans le code Théodosien, nous avons une loi qui défend aux ecclésiastiques et à ceux qui se disent « continents » d'aller dans les maisons des veuves et des pupilles, et de recevoir d'elles des libéralités sous prétexte de religion [FN: § 1391-1]. Une autre loi leur défend de garder dans leurs maisons des femmes avec lesquelles la vie en commun était un scandale [FN: § 1391-2]. On trouve des lois de ce genre dans d'autres législations ; nous en avons dans les Capitulaires de Charlemagne [FN: § 1391-3] . La longue lutte des papes contre le clergé concubinaire, au moyen âge, est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en apporter ici des preuves.
§ 1392. Le mal était ancien ; et si l'on veut qu'avoir commerce avec les femmes soit une décadence et une corruption du christianisme, il faut avouer que cette décadence et cette corruption commencèrent bientôt. Saint Cyprien, qui vivait au IIIe siècle, en traite longuement. Dans une lettre qu'il écrit à Pomponius, avec d'autres prêtres, il s'exprime ainsi [FN: § 1392-1]: « Très cher frère, nous avons lu la lettre que tu nous as envoyée par Paconius, notre frère, demandant et désirant que nous te répondions ce que nous pensions de ces vierges qu'on trouve dans le même lit que des hommes, tandis qu'elles avaient décidé de demeurer en leur état et d'observer fermement la continence. Tu dis que, parmi ces hommes, il y a un diacre, et que ces vierges, tout en confessant ouvertement avoir dormi avec un homme, certifient être intactes. » Le saint, s'appuyant sur des citations bibliques, réprouve ces mœurs : « ... On ne peut souffrir que les vierges habitent avec des hommes, je ne dis pas seulement qu'elles dorment avec eux, mais aussi qu'elles vivent ensemble... Enfin, combien de ruines graves voyons-nous se produire ici chez beaucoup de gens, et que de vierges voyons-nous avec la plus grande douleur être corrompues par cette union illicite et dangereuse... Si vraiment elles ne veulent ou ne peuvent persévérer, il vaut mieux qu'elles se marient, plutôt que de tomber dans le feu, pour leur péché [FN: § 1392-2] ». Les femmes mariées et les veuves qui fréquentaient trop les prêtres ne faisaient pas mieux [FN: § 1392-3].
§ 1393. Aux reproches que les Pères de l'Église et ses dignitaires font au sujet des mauvaises mœurs du clergé, on a l'habitude d'objecter que ces reproches ne correspondent pas à la vérité, parce que les Pères et les dignitaires de l'Église feignent le mal pour obtenir le bien. Cette objection a été faite, parmi beaucoup d'autres, au cardinal Damien [FN: § 1393-1]. Mais est-il possible d'admettre que Saint Cyprien ait inventé la lettre de Pomponius à laquelle il répond ? que tout ce qu'il dit soit fiction ? Même si l'on faisait cette concession, on ne saurait admettre l'objection, parce qu'il y a les actes des conciles et un très grand nombre d'autres documents qui confirment que des femmes vivaient avec les clercs. Mais, pour défendre le clergé, il n'est pas nécessaire de taxer toutes ces preuves de fausseté : il suffit d'observer qu'en somme les mœurs du clergé n'étaient pas pires, et paraissent au contraire avoir été meilleures que les mœurs générales du temps.
§ 1394. On appelait les femmes qui vivaient avec les clercs sousintroduites, étrangères, sœurs, agapètes [FN: § 1394-1]. Il en est souvent fait mention dans les actes des conciles. Saint Jean Chrysostôme a deux homélies entières contre ces femmes. Dans la première [FN: § 1394-2] , il dit qu'autrefois nos ancêtres connurent deux causes pour lesquelles les femmes cohabitaient avec les hommes : l'une, juste et rationnelle, le mariage ; l'autre, plus récente, injuste et illégale, la fornication, qui est l'œuvre des mauvais démons. À son époque, on a vu une troisième cause, étrange et paradoxale. Il y a des hommes, en effet, qui, sans mariage et sans rapports charnels, introduisent des jeunes filles dans leurs maisons et vivent avec elles jusqu'à la vieillesse. Les motifs qu'ils en donnent, le saint les tient pour imaginaires, et pense que la principale cause consiste en ce qu'« il y a une certaine volupté à habiter avec une femme, non seulement avec le lien conjugal, mais aussi sans mariage ni commerce charnel [FN: § 1394-3]». Il ajoute que cette volupté est même plus grande que celle de l'union conjugale, car dans celle-ci, par ses continuels rapports sexuels, l'homme se rassasie de la femme, qui d'ailleurs se fane plus vite que la vierge. Il paraît que l'intimité était poussée assez loin, puisque le saint, après avoir rappelé un dicton qui met en lumière le danger du baiser, ajoute : « Et moi, je ne devrais pas aussi dire cela à ceux qui embrassent et caressent la femme qui habite avec eux ! » [FN: § 1394-4]Il continue longuement et réfute les prétextes qu'on invoquait pour justifier cette cohabitation. Dans la seconde homélie [FN: § 1394-5] , le saint s'en prend aux femmes qui cohabitent avec l'homme. Il ne veut pas que les vierges se vêtent avec recherche. Quant à celles qui vivent avec un homme, le saint voudrait qu'elles fussent ensevelies vivantes. Il parle de certaines preuves honteuses qu'elles prétendent donner de leur virginité [FN: § 1394-6] . Il réfute, il prêche, il gémit, il réconforte. Il serait vraiment étrange que de si longs discours n'eussent aucun fondement dans les faits réels. Au contraire, ils démontrent à l'évidence que le scandale existait et ne devait pas être des moindres. D'ailleurs, il ne manque pas d'un grand nombre d'autres témoignages de faits semblables.
§ 1395. En l'année 314, le concile d'Ancyre, en Galatie, par son 19e canon, interdit aux vierges d'habiter avec les hommes sous le nom de sœurs. En l'année 325, le concile de Nicée défend aux clercs d'avoir des femmes sousintroduites [FN: § 1395-1], excepté la mère, la sœur, la tante et d'autres personnes insoupçonnables. Ensuite, l'Église ne cessa de lutter, mais avec peu de succès, pour empêcher que ses prêtres n'eussent des maîtresses ou des concubines. On sait combien grave et difficile devint, au moyen âge, la répression du clergé concubinaire. Il y eut certainement des papes qui se préoccupèrent peu de la morale sexuelle ; mais il y en eut, non moins certainement, d'autres qui, de tout leur pouvoir, voulurent l'imposer sévèrement. Enfin, à grand'peine, on put obtenir que le scandale public cessât ; mais on n'obtint pas grand'chose quant au fond [FN: § 1395-2].
§ 1396. Si l'on réfléchit à la puissance des armes spirituelles, morales, matérielles, dont disposait l'Église, et aux résultats presque insignifiants qu'elle a obtenus, on ne tardera pas à voir quelle est la force considérable des résidus sexuels, et combien sont ridicules ces pygmées qui, aujourd'hui, s'imaginent pouvoir les réfréner.
[785]
Chapitre IX↩
Les dérivations
§ 1397. Dans ce chapitre, nous nous occuperons des dérivations, telles qu'elles ont été définies au § 868 ; et puisqu'elles renferment la raison pour laquelle certaines théories sont produites et acceptées, nous étudierons les théories au point de vue subjectif indiqué au § 13. Souvent déjà, nous avons rencontré des dérivations, bien que nous n'ayons pas encore fait usage de ce terme, et l'on en trouvera chaque fois qu'on fixera son attention sur les façons dont les hommes tâchent de dissimuler, de changer, d'expliquer les caractères qu'ont en réalité certaines de leurs manières d'agir. C'est ainsi qu'au chapitre III, nous avons traité longuement des raisonnements, qui sont des dérivations par lesquelles on tâche de faire apparaître logiques les actions non-logiques ; et nous avons alors classé certaines dérivations considérées sous cet aspect. Nous en avons rencontré d'autres, envisagées sous d'autres aspects, aux chapitres IV et V.
Les hommes se laissent persuader surtout par les sentiments (résidus) ; par conséquent, nous pouvons prévoir, ce qui d'ailleurs est confirmé par l'expérience, que les dérivations tireront leur force, non pas de considérations logico-expérimentales, ou du moins pas exclusivement de ces considérations, mais bien des sentiments [FN: § 1397 -1]. Dans les dérivées, le noyau principal est constitué par un résidu ou par un certain nombre de résidus. Autour de ce noyau viennent se grouper d'autres résidus secondaires. Cet agrégat est créé par une force puissante, et quand il a été créé, il est maintenu uni par cette force, qui est le besoin de développements logiques ou pseudo-logiques qu'éprouve l'homme, besoin qui se manifeste par les résidus du genre (1-ε). C'est ensuite de ces résidus, avec l'aide d'autres encore, que les dérivations tirent en général leur origine.
§ 1398. Par exemple, au chapitre II, nous avons vu une catégorie étendue de dérivations qui expliquent certaines opérations sur les tempêtes ; elles naissent justement du besoin de développements logiques ou réputés tels (I-ε). Le noyau principal est constitué par les résidus de la foi en l'efficacité des combinaisons, (I-ζ) : on sent instinctivement qu'il doit y avoir un moyen quelconque d'exercer une action sur les tempêtes. Autour de ce noyau se disposent divers résidus de l'action mystérieuse de certaines choses et de certains actes ; et l'on a différentes opérations magiques. Dans ces opérations magiques interviennent, d'une manière accessoire, les résidus de choses rares et d'événements exceptionnels (I-β 2), les noms liés mystérieusement aux choses (I-γ 2), ainsi que d'autres opérations mystérieuses (I-γ 1), et même des combinaisons en général (I-α). Puis, toujours d'une manière accessoire, on fait intervenir les résidus de la IIe classe. On trouve une famille très étendue de ces résidus dans les explications que l'on donne des phénomènes, en avant recours à des personnifications (II-êta), telles que des divinités, des démons, des génies. Il est rare que, dans une catégorie de dérivations, il ne se trouve pas une famille de cette sorte.
§ 1399. Nous avons déjà traité abondamment des résidus, et il ne nous resterait d'autre chose à faire, au sujet des dérivées, que de noter les résidus principaux et les résidus accessoires. Mais nous n'aurions ainsi envisagé que le fond des dérivées, alors qu'il y a pourtant d'autres aspects sous lesquels on peut considérer les dérivations. D'abord, si l'on prête attention à la forme, il faut observer le rapport dans lequel la dérivation se trouve avec la logique ; c'est-à-dire si elle est un raisonnement correct ou un sophisme. Cette étude appartient aux traités de logique (§ 1410), et nous n'avons pas à l'entreprendre ici. Ensuite, il faut considérer le rapport dans lequel la dérivation peut être avec la réalité expérimentale. Elle peut être rigoureusement logique, et, par suite d'un défaut des prémisses, n'être pas d'accord avec l'expérience. Elle peut aussi n'être qu'apparemment logique, et, à cause du sens vague des termes, ou pour un autre motif, n'avoir aucune signification expérimentale, ou avoir une signification qui n'a qu'un lointain rapport avec l'expérience. Tel est l'aspect sous lequel nous avons envisagé les dérivations que nous avons étudiées aux chapitres III, IV et V, sans employer encore cette dénomination. Maintenant, en leur en ajoutant d'autres, nous devrons les étudier en détail, sous l'aspect subjectif de la force persuasive qu'elles peuvent avoir. Restera enfin un autre aspect sous lequel il est nécessaire de les envisager : celui de l'utilité sociale qu'elles peuvent avoir ; sujet dont nous nous occuperons au chapitre XII. En tout cas, pour avoir la théorie complète des dérivations, il faut rapprocher les chapitres III, IV et V du présent chapitre. La déduction parcourt à rebours la voie de l'induction ; par conséquent, celui qui utilise successivement ces deux voies retrouve la seconde fois sur son chemin une partie au moins des théories et des raisonnements qu'il avait rencontrés la première.
§ 1400. Il y a plusieurs critères pour classer les dérivations suivant l'aspect sous lequel on les considère (§ 1480). Puisque nous nous attachons ici au caractère subjectif des explications que l'on donne par les dérivations, de certaines actions, de certaines idées, et à la force persuasive de ces explications, nous tirerons de la nature de celles-ci le critère de notre classification. Là où n'existe pas d'explications, les dérivations font aussi défaut ; mais sitôt qu'on recourt aux explications, ou qu'on tente d'y recourir, les dérivations apparaissent. L'animal, qui ne raisonne pas, qui accomplit uniquement des actes instinctifs (§ 861), n'a pas de dérivations. Au contraire, l'homme éprouve le besoin de raisonner, et en outre d'étendre un voile sur ses instincts et sur ses sentiments ; aussi manque-t-il rarement chez lui au moins un germe de dérivations, de même que ne manquent pas les résidus. Dérivations et résidus se rencontrent chaque fois que nous étudions des théories ou des raisonnements qui ne sont pas rigoureusement logico-expérimentaux. Ainsi est-il arrivé au chapitre III (§ 325), où nous avons rencontré le type de dérivation le plus simple, qu'on trouve dans le précepte pur, sans motif ni démonstration. Il est employé par l'enfant et l'ignorant, lorsqu'ils font usage de la tautologie: « On fait ainsi parce qu'on fait ainsi »; tautologie par laquelle s'expriment simplement les résidus de la sociabilité, car, en somme, on veut dire : « Je fais ainsi, ou une autre personne fait ainsi, parce que, dans notre collectivité, on a l'habitude de faire ainsi ». Puis vient une dérivation un peu plus complexe, qui vise à donner une raison de l'habitude, et l'on dit : « On fait ainsi parce qu'on doit faire ainsi ». Ces dérivations, qui sont de simples affirmations, constitueront la première classe. Mais déjà dans la dernière des dérivations que nous venons de rapporter, une entité indéterminée et mystérieuse s'est fait entrevoir : c'est le devoir, premier indice d'un procédé général d'extension des dérivations qui, sous des noms différents, croissent avec l'invocation de divers genres de sentiments. Peu à peu, les hommes ne se contentent plus de ces noms seuls : ils veulent quelque chose de plus concret ; ils veulent aussi expliquer d'une façon quelconque pourquoi on emploie ces noms. Que peut bien être ce devoir qu'on met au jour ? Ignorants, hommes cultivés, philosophes répondent ; et, des réponses puériles du vulgaire, on va jusqu'aux théories abstruses de la métaphysique ; mais, au point de vue logico-expérimental, ces théories ne valent pas mieux que les réponses du vulgaire. On fait le premier pas en appelant à son aide l'autorité de sentences ayant cours dans la collectivité, l'autorité de certains hommes, et, par de nouvelles adjonctions, on allègue l'autorité d'êtres surnaturels ou de personnifications qui sentent et agissent comme des hommes. Ainsi, nous avons la IIe classe des dérivations. Le raisonnement acquiert de nouveaux développements, se subtilise, s'abstrait, quand on fait intervenir des interprétations de sentiments, des entités abstraites, des interprétations de la volonté d'êtres surnaturels ; ce qui peut donner une très longue chaîne de déductions logiques ou pseudo-logiques, et produire des théories qui ont quelque ressemblance avec les théories scientifiques, et parmi lesquelles nous trouvons celles de la métaphysique et de la théologie. Nous avons ainsi la IIIe classe. Mais les dérivations ne sont pas encore épuisées : il reste une classe étendue dans laquelle rentrent des preuves principalement verbales ; ce sera la IVe classe. On y trouve des explications de pure forme, qui usurpent l'apparence d'explications de fond. Ensuite (§ 1419) nous verrons comment ces classes se divisent en genres, et nous les étudierons en détail ; mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire que nous ajoutions quelques considérations générales sur les dérivations et sur les dérivées.
§ 1401. Commençons par traduire dans le langage des résidus et des dérivations ce que nous avons exposé (§ 798-803) en nous servant de lettres alphabétiques. Dans les matières qui se rapportent à la vie des sociétés, les théories concrètes se composent de résidus et de dérivations. Les résidus sont des manifestations de sentiments. Les dérivations comprennent des raisonnements logiques, des sophismes, des manifestations de sentiments employées pour dériver ; elles sont une manifestation du besoin de raisonner qu'éprouve l'homme. Si ce besoin n'était satisfait que par les raisonnements logico-expérimentaux, il n'y aurait pas de dérivations, et à leur place, on aurait des théories logico-expérimentales. Mais le besoin de raisonnement de l'homme trouve à se satisfaire de beaucoup d'autres manières : par des raisonnements pseudo-expérimentaux, par des paroles qui excitent les sentiments, par des discours vains et inconsistants ; ainsi naissent les dérivations. Elles font défaut aux deux extrêmes : d'une part, pour les actions instinctives, d'autre part, pour les sciences rigoureusement logico-expérinientales. On les rencontre dans les cas intermédiaires.
§ 1402. Ce sont justement les raisonnements concrets correspondant à ces cas, qui sont connus directement. Ici, nous avons fait l'analyse, en séparant une partie presque constante (a) et une partie beaucoup plus variable (b) (§ 798 et sv.), auxquelles nous avons donné ensuite les noms de résidus et de dérivations (§ 868), et nous avons vu que la partie la plus importante pour l'équilibre social est celle des résidus (§ 800). Mais ainsi, nous sommes allés à l'encontre de l'opinion commune qui, dominée par l'idée des actions logiques, incline à intervertir le rapport indiqué tantôt, et à donner une plus grande importance aux dérivations (§ 415). La personne qui prend connaissance d'une dérivation croit l'accepter – ou la rejeter – par des considérations logico-expérimentales, et ne s'aperçoit pas qu'au contraire, elle est habituellement poussée par des sentiments, et que l'accord – ou l'opposition – de deux dérivations est un accord – ou une opposition – de résidus. Celui qui entreprend d'étudier les phénomènes sociaux s'arrête aux manifestations de l'activité, c'est-à-dire aux dérivations, et il ne remonte pas aux causes de l'activité elle-même, c'est-à-dire aux résidus. Il est ainsi arrivé que l'histoire des institutions sociales est devenue l'histoire des dérivations, et souvent l'histoire de dissertations sans fondement. On a cru faire l'histoire des religions en faisant l'histoire des théologies ; l'histoire des morales en faisant l'histoire des théories morales ; l'histoire des institutions politiques, en faisant l'histoire des théories politiques. En outre, comme la métaphysique a doté toutes ces théories d'éléments absolus dont on a cru tirer par la logique pure des conclusions non moins absolues, l'histoire de ces théories est devenue l'histoire des déviations de certains types idéaux existant dans l'esprit de l'auteur, déviations qu'on observe dans le monde concret. De nos jours, plusieurs personnes ont senti que cette voie s'écartait de la réalité, et, pour s'en rapprocher, elles ont substitué à ces raisonnements la recherche des « origines », sans s'apercevoir que, de cette façon, elles aboutissaient souvent a la simple substitution d'une métaphysique à une autre, en expliquant le plus connu par le moins connu, les faits susceptibles de l'observation directe, par des imaginations qui, se rapportant à des temps trop reculés, manquent entièrement de preuves, et en ajoutant des principes comme celui de l'évolution unique, qui dépassent entièrement l'expérience.
§ 1403. En somme, les dérivations constituent les matériaux employés par tout le monde. Mais les auteurs précités donnent aux dérivations une valeur intrinsèque, et les considèrent comme agissant directement dans la détermination de l'équilibre social, tandis que nous leur donnons ici uniquement la valeur de manifestations et d'indices d'autres forces, qui sont celles qui agissent en réalité dans la détermination de l'équilibre social. Jusqu'à présent, les sciences sociales ont été très souvent des théories composées de résidus et de dérivations, et qui avaient en outre un but pratique : elles visaient à persuader les hommes d'agir d'une certaine façon réputée utile à la société. Le présent ouvrage est un essai de transporter an contraire ces sciences exclusivement dans le domaine logico-expérimental, sans aucun but d'utilité pratique immédiate, avec la seule et unique intention de connaître les uniformités des faits sociaux (§ 86). Celui qui écrit un livre en ayant pour but de pousser les hommes à agir d'une certaine manière, doit nécessairement recourir aux dérivations, puisqu'elles constituent le langage au moyen duquel on parvient jusqu'aux sentiments des hommes et par lequel on peut en conséquence modifier leur activité. Au contraire, celui qui vise exclusivement à faire une étude logico-expérimentale doit s'abstenir avec le plus grand soin d'employer les dérivations : elles sont pour lui un objet d’étude, jamais un moyen de persuasion.
§ 1404. Ici, à propos du rôle que nous attribuons au sentiment dans les dérivations, nous nous trouvons en face d'un problème analogue à celui qui a été posé et résolu au chapitre III : si le rôle que le sentiment joue dans les dérivations est vraiment d'une si grande importance, est-il bien possible que tant d'hommes de talent qui étudièrent pratiquement et théoriquement les sociétés humaines ne s'en soient pas aperçus ? Nous devons répondre comme nous l'avons déjà fait pour le problème analogue du chapitre III, et dire que ce rôle a été effectivement aperçu, bien qu'indistinctement, sans qu'une théorie rigoureuse en fût donnée, sans que son importance en fût correctement appréciée, et cela pour divers motifs, parmi lesquels se trouve le préjugé qui attribue un rôle prépondérant aux actions logiques, dans les actions humaines.
Citons maintenant quelques exemples de la façon dont ce sujet a été compris par différents auteurs.
§ 1405. Suivant une théorie qui paraît assez probable, l'enthymème d'Aristote est un jugement accompagné de l'énoncé de sa cause ; l'enthymème des logiciens modernes est un syllogisme dans lequel l'une des prémisses est passée sous silence. Nous acceptons cette dernière définition ; on verra ensuite que les conséquences que nous en tirons sont vraies a fortiori pour l'enthymème d'Aristote.
§ 1406. Les dérivations sont souvent employées sous forme d'enthymème. Si l'on envisage l'art oratoire, il y a cette première raison qu'un discours composé de syllogismes serait lourd, ennuyeux, insupportable ; ensuite il y a un autre motif, d'un ordre plus général, et qui s'applique aussi bien à l'art oratoire qu'à un raisonnement scientifique ou prétendu tel. La forme syllogistique met en lumière le défaut logique des dérivations de la même façon qu'elle fait apparaître les sophismes. Il est donc bon de s'en abstenir, dans les raisonnements qui sont constitués par des associations d'idées ou de résidus. L'enthymème néglige une des propositions du syllogisme, et l'on peut prendre ses dispositions de manière à supprimer la proposition dans laquelle le défaut de logique est le plus apparent. Généralement, on néglige la majeure, c'est-à-dire la prémisse qui contient le moyen terme et le prédicat. La conclusion à laquelle on veut arriver contient le sujet et le prédicat ; le sujet est d'une telle importance qu'il est difficile de supprimer la mineure qui le contient. Quand le moyen terme est une entité non-expérimentale «§ 470), on gagne quelque chose à supprimer au moins l'une des propositions qui le contiennent.
§ 1407. Voici, par exemple, un enthymème cité par Aristote [FN: § 1407-1] « Ne garde pas une colère immortelle, toi qui es mortel ». Prise dans son sens littéral, cette proposition n'a pas de sens ; car il est évident que la colère d'un homme prend fin quand cet homme meurt et disparaît ; et il est par conséquent tout à fait inutile de lui recommander de ne pas garder une « colère immortelle ». Mais le sens de la proposition est bien différent : il consiste à recommander de ne pas garder sa colère trop longtemps, de ne pas avoir une colère très longue, laquelle est appelée immortelle.
Le résidu principal (a) est l'un de ceux qui dépendent de la sociabilité (IVe classe). Le résidu qu'on y ajoute pour dériver est l'un de ceux qui unissent les noms aux choses (I-γ). L'association d'idées qu'on fait naître ainsi est d'abord la répugnance qu'une personne éprouve à unir deux choses contraires, telles que immortel et mortel, puis la confusion qu'on crée entre immortel et très long. C'est dans cette confusion que gît le point faible du raisonnement. C'est pourquoi on doit autant que possible soustraire ce point faible à l'attention.
§ 1408. Il faut observer que la proposition que nous venons de citer est un enthymème au sens d'Aristote, mais non au sens moderne. Dans ce dernier sens, le syllogisme complet serait : « L'homme est mortel ; un mortel ne peut avoir une colère immortelle ; donc l'homme ne peut avoir une colère immortelle ». Mais ce n'est point ce que l'on veut démontrer ; on veut au contraire exprimer que l'homme ne peut – ou ne doit – avoir une trop longue colère. Si on l'exprime sous forme d'enthymème, on dira : « L'homme, étant mortel, ne doit pas avoir une trop longue colère » ; et sous cette forme, beaucoup de personnes accepteront le raisonnement, parce qu'elles seront frappées du contraste entre la vie courte de l'homme et une longue colère. Maintenant, complétons le syllogisme. « L'homme est mortel ; un mortel ne doit pas avoir une trop longue colère ; donc l'homme ne doit pas avoir une trop longue colère ». La proposition : « un mortel ne doit pas avoir une trop longue colère » attire justement l'attention sur le point faible du raisonnement ; il convient donc de la supprimer, pour éviter qu'on ne s'aperçoive de l'erreur ; et de cette façon, on est poussé à substituer l'enthymème au syllogisme. Cela est plus utile pour l'enthymème Aristote que pour l'enthymème moderne. Si, après avoir énoncé un jugement, nous nous bornons à indiquer la raison qui en est l'origine – ou qui semble en être l'origine – et si nous négligeons les propositions intermédiaires, nous nous plaçons dans les conditions les plus favorables au raisonnement par associations d'idées, ou de résidus, par opposition au raisonnement strictement logique. Aristote sentait cela instinctivement, quand il disait que l'enthymème était le syllogisme oratoire [FN: § 1408-1] . Il a raison aussi quand il voit dans les sentences une partie de l'enthymème [FN: § 1408-2] : les sentences sont la réduction ultime d'un syllogisme, dont il ne reste que la conclusion.
§ 1409. Il faut prendre garde à l'erreur où l'on tomberait, en croyant que la sentence est acceptée parce qu'elle fait partie d'un enthymème, et l'enthymème parce qu'il fait partie d'un syllogisme. Cette opinion peut être vraie, au point de vue de la logique formelle, mais non à celui des motifs pour lesquels un homme se laisse persuader. On accepte la sentence, on accepte l'enthymème, à cause des sentiments qu'ils provoquent, pour des motifs intrinsèques, sans les réunir au syllogisme complet (§ 1399). Aristote ajoute l'exemple à l'enthymème, comme moyen de persuasion [FN: § 1409-1] . L'exemple est une des dérivations les plus simples. On cite un fait, et l'on y ajoute un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats) ; c'est-à-dire qu'on donne à un cas particulier la force d'une règle générale.
§ 1410. Après avoir fait allusion aux sophismes de logique, John Stuart Mill [FN: § 1410-1] ajoute, mais seulement pour les exclure de son étude, deux autres sources d'erreur : l'une intellectuelle, l'autre morale. Cela se rapproche assez de la distinction que nous avons faite entre les dérivations (B) et (b). Dans un traité de logique, Mill a raison de ne pas s'occuper de ces sources d'erreur ; pour la sociologie, au contraire, elles sont d'une grande importance.
§ 1411. Quand le logicien a découvert l'erreur d'un raisonnement, quand il a dévoilé un sophisme, son œuvre est achevée. L'œuvre du sociologue commence, au contraire ; il doit rechercher pourquoi ces sophismes sont acceptés, pourquoi ils persuadent. Les sophismes qui ne sont que des subtilités logiques lui importent peu ou point, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'écho parmi les hommes; au contraire, les sophismes – ou même les raisonnements bien faits – qui sont acceptés par beaucoup de gens lui importent au premier chef. La logique cherche pourquoi un raisonnement est erroné, la sociologie pourquoi il obtient un consentement fréquent.
§ 1412. Suivant Mill, les sources d'erreurs morales se divisent en deux classes principales : l'indifférence à connaître la vérité et les inclinations, dont la plus fréquente est celle qui nous pousse dans le sens que nous désirons ; bien qu'ensuite nous puissions accepter une conclusion agréable aussi bien qu'une conclusion désagréable, pourvu qu'elles soient capables de susciter quelque sentiment intense. Cette indifférence et ces inclinations sont les sentiments correspondant à nos résidus ; mais Mill en traite assez mal. Il a été induit en erreur par le préjugé que seules les actions logiques sont bonnes, utiles, louables, tandis que les actions non logiques sont nécessairement mauvaises, nuisibles, blâmables. Il ne s'aperçoit pas que lui-même raisonne sous l'empire de cette inclination.
§ 1413. Le but de la dérivation est presque toujours présent à l'esprit de celui qui veut démontrer quelque chose ; mais il échappe souvent à l'observation de celui qui admet la conclusion de la dérivation. Quand le but est une certaine règle que l'on veut justifier, on tâche d'unir ce but à certains résidus : par des raisonnements plus ou moins logiques, si l'on cherche à satisfaire surtout le besoin de développements logiques qu'éprouvent ceux qu'on veut persuader, ou bien par l'adjonction d'autres résidus, si l'on vise à agir surtout sur les sentiments.
§ 1414. Ces opérations, rangées suivant leur degré d'importance, peuvent être exprimées de la façon suivante : 1° Le but. 2° Les résidus dont la dérivation tire son origine. 3° La dérivation. Une figure graphique fera mieux comprendre le phénomène. Soit B, le but, auquel on parvient en partant des résidus R’, R’’, R’’’,... et grâce aux dérivations R'rB, R'tB, R'vB... Par exemple, dans les théories morales, le but est le précepte qui défend de tuer un autre homme. On peut y arriver par une dérivation très simple : le tabou du sang. On peut partir du résidu d'un dieu personnel et atteindre le but par des dérivations nombreuses et variées. On peut partir d'un résidu métaphysique, ou d'utilité sociale, ou d'utilité personnelle, ou de quelque autre résidu semblable, et atteindre le but grâce à un nombre extrêmement grand de dérivations.

[Figure 16]
§ 1415. En général, les théologiens, les métaphysiciens, les philosophes, les théoriciens de la politique, du droit, de la morale, n'admettent pas l'ordre indiqué tout à l'heure (§ 1402). Ils ont la tendance d'assigner la première place aux dérivations. Pour eux, les résidus sont des axiomes ou des dogmes, et le but est simplement la conclusion d'un raisonnement logique. Comme ils ne s'entendent habituellement pas sur la dérivation, ils en disputent à perdre haleine, et se figurent pouvoir modifier les faits sociaux, en démontrant le sophisme d'une dérivation. Ils se font illusion et ne comprennent pas que leurs disputes sont étrangères au plus grand nombre des gens [FN: § 1415-1], qui ne pourraient les comprendre en aucune façon, et qui, par conséquent, n'en font aucun cas, si ce n'est comme d'articles de foi auxquels ils donnent leur consentement grâce à certains résidus. L'économie politique a été et continue à être en partie une branche de la littérature, et comme telle, elle n'échappe pas à ce que nous avons dit des dérivations. Il est de fait que la pratique a suivi une voie entièrement divergente de la théorie.
§ 1416. Ces considérations nous conduisent à d'importantes conclusions qui appartiennent à la logique des sentiments, mentionnée déjà au § 480.
1° Si l'on détruit le résidu principal dont procède la dérivation, et s'il n'est pas remplacé par un autre, le but aussi disparaît [FN: § 1416-1] . Cela se produit d'habitude, quand on raisonne logiquement sur des prémisses expérimentales, c'est-à-dire dans les raisonnements scientifiques. Pourtant, même dans ce cas, il se peut que la conclusion subsiste, quand les prémisses erronées sont remplacées par d'autres. Au contraire, dans les raisonnements non-scientifiques, le cas habituel est celui dans lequel les prémisses abandonnées sont remplacées par d'autres – un résidu est remplacé par d'autres. Le cas exceptionnel est celui où cette substitution n'a pas lieu. Entre ces cas extrêmes, il y a des cas intermédiaires. La destruction du résidu dont procède la dérivation ne fait pas disparaître entièrement le but, mais en diminue et affaiblit l'importance ; il subsiste, mais il agit avec moins de force. Par exemple, on a observé, aux Indes, que les indigènes qui se convertissent perdent la moralité de leur ancienne religion, sans acquérir celle de leur foi nouvelle et de leurs nouvelles coutumes (§ 1741).
2° Quand on raisonne scientifiquement, si l'on peut démontrer que la conclusion ne procède pas logiquement des prémisses, la conclusion tombe. Au contraire, dans le raisonnement non-scientifique, si l'on détruit une des formes de dérivation, une autre ne tarde pas à surgir. Si l'on montre le vide du raisonnement qui unit un certain résidu à une conclusion (au but), la plupart du temps, le seul effet en est la substitution d'une nouvelle dérivation à celle qui vient d'être détruite. Cela a lieu parce que le résidu et le but sont des éléments principaux, et que la dérivation est secondaire, et souvent de beaucoup. Par exemple, les diverses sectes chrétiennes ont des doctrines sur les bonnes œuvres et la prédestination, lesquelles, au point de vue logique, sont entièrement différentes et parfois même opposées, contradictoires ; et pourtant ces sectes ne diffèrent en rien par la morale pratique. Voici un Chinois, un musulman, un chrétien calviniste, un chrétien catholique, un kantien, un hégélien, un matérialiste, qui s'abstiennent également de voler ; mais chacun donne de ses actes une explication différente. Enfin, ce sont les dérivations qui unissent un résidu qui existe chez eux tous à une conclusion qu'eux tous acceptent. Et si quelqu'un invente une nouvelle dérivation ou détruit une de celles qui existent, pratiquement il n'obtiendra rien, et la conclusion demeurera la même.
3° Dans les raisonnements scientifiques, grâce à des déductions rigoureusement logiques, les conclusions les plus fortes s'obtiennent de prémisses dont la vérification expérimentale est aussi parfaite que possible. Dans les raisonnements non-scientifiques, les conclusions les plus fortes sont constituées par un puissant résidu, sans dérivations. On a ensuite les conclusions obtenues d'un fort résidu auquel s'ajoutent, sous forme de dérivation, des résidus qui ne sont pas trop faibles. Au fur et à mesure que s'allonge la distance entre le résidu et la conclusion, au fur et à mesure que des raisonnements logiques se substituent aux résidus, la force de la conclusion diminue, excepté pour un petit nombre d'hommes de science. Le vulgaire est persuadé par son catéchisme, et non par de subtiles dissertations théologiques. Ces dissertations n'ont qu'un effet indirect ; le vulgaire les admire sans les comprendre, et cette admiration leur confère une autorité qui s'étend aux conclusions. C'est ce qui est arrivé, de nos jours, pour le Capital de Marx. Un très petit nombre de socialistes allemands l'ont lu ; ceux qui peuvent l'avoir compris sont rares comme les merles blancs ; mais les subtiles et obscures dissertations du livre furent admirées de l'extérieur, et conférèrent de l'autorité au livre. Cette admiration détermina la forme de la dérivation, et non pas les résidus ni les conclusions, qui existaient avant le livre, qui continueront à exister quand le livre sera oublié, et qui sont communs tant aux marxistes qu'aux non-marxistes.
4° Au point de vue logique, deux propositions contradictoires ne peuvent subsister ensemble. Au point de vue des dérivations non-scientifiques, deux propositions qui paraissent contradictoires peuvent subsister ensemble, pour le même individu, dans le même esprit. Par exemple, les propositions suivantes paraissent contradictoires : on ne doit pas tuer – on doit tuer ; on ne doit pas s'approprier le bien d'autrui – il est permis de s'approprier le bien d'autrui ; ou doit pardonner les offenses – on ne doit pas pardonner les offenses. Pourtant elles peuvent être acceptées en même temps par le même individu, grâce à des interprétations et des distinctions qui servent à justifier la contradiction. De même, au point de vue logique, si A est égal à B, il s'ensuit rigoureusement que B est égal à A ; mais cette conséquence n'est pas nécessaire dans le raisonnement des dérivations.
§ 1417. Outre les dérivations, qui sont constituées d'un groupe de résidus principaux et d'un autre groupe, secondaire, de résidus qui servent à dériver, nous avons les simples unions de plusieurs résidus ou de plusieurs groupes, qui constituent seulement un nouveau groupe de résidus. En outre, nous avons les conséquences logiques – ou estimées telles – de la considération de l'intérêt individuel ou collectif, lesquelles font partie des classes de déductions scientifiques dont nous ne nous occupons pas ici.
§ 1418. La démonstration des dérivations est très souvent différente de la raison qui les fait accepter. Parfois cette démonstration et cette raison peuvent concorder ; par exemple, un précepte est démontré par l'argument d'autorité, et il est accepté grâce au résidu de l'autorité. D'autres fois elles peuvent être entièrement différentes ; par exemple, celui qui démontre quelque chose en se servant de l'ambiguïté d'un terme, ne dit certainement pas : « Ma démonstration est valide, grâce à l'erreur engendrée par l'ambiguïté d'un terme » ; tandis que celui qui accepte cette dérivation est, sans s'en apercevoir, induit en erreur par le raisonnement verbal.
§ 1419. Classification des dérivations :
Ire CLASSE
Affirmation (§ 1420-1433).
(I-α) Faits expérimentaux ou faits imaginaires (§ 1421-1427).
(I-β ß) Sentiments (§ 1428-1432).
(I-γ) Mélange de faits et de sentiments (§ 1433).
IIe CLASSE
Autorité (1434-1463).
(II-α) Autorité d'un homme ou de plusieurs hommes (§ 1435-1446).
(II-β) Autorité de la tradition, des usages et des coutumes (§ 1447-1457).
(I-γ) Autorité d'un être divin ou d'une personnification (§ 1458-1463).
IIIe CLASSE
Accord avec des sentiments ou avec des principes (§ 1464-1542).
(III-α ) Sentiments (§ 1465-1476).
(III-β) Intérêt individuel (§ 1477-1497).
(III-γ) Intérêt collectif (§ 1498-1500).
(III-δ) Entités juridiques (§ 1501-1509).
(III-ε) Entités métaphysiques (§ 1510-1532).
(III-ζ) Entités surnaturelles (§ 1533-1542).
IVe CLASSE
Preuves verbales (§ 1543-1686).
(IV-α ) Terme indéterminé désignant une chose réelle et chose indéterminée correspondant à un terme (§ 1549-1551).
(IV-β) Terme désignant une chose, et qui fait naître des sentiments accessoires, ou sentiments accessoires qui font choisir un terme (§ 1552-1555).
(IV-γ) Terme à plusieurs sens, et choses différentes désignées par un seul terme (§ 1556-1613).
(IV-δ) Métaphores, allégories, analogies(§ 1614-1685).
(IV-ε) Termes douteux, indéterminés, qui ne correspondent à rien de concret (§ 1686).
§ 1420. Ire CLASSE. Affirmation. Cette classe comprend les simples récits, les affirmations d'un fait, les affirmations d'accord avec des sentiments, exprimées non pas comme telles, mais d'une façon absolue, axiomatique, doctrinale. Les affirmations peuvent être de simples récits ou des indications d'uniformités expérimentales ; mais souvent elles sont exprimées de telle manière qu'on ne sait si elles expriment uniquement des faits expérimentaux, ou si elles sont des expressions de sentiments, ou bien si elles participent de ces deux genres. Nombreux sont les cas où il est possible de découvrir, avec une certaine probabilité, la manière dont elles sont composées. Prenons, par exemple, le recueil de sentences de Syrus. Les quatre premières appartiennent au genre (I-α); ce sont: «Nous autres hommes sommes également proches de la mort. – Attends d'un autre ce que tu auras fait à un autre. – Éteins par tes larmes la colère de qui t'aime. – Qui dispute avec un homme ivre se bat contre un absent ». Vient ensuite une sentence du genre (1-β) : « Mieux vaut essuyer une injure que la faire ». Suivent quatre sentences du genre (I-α), puis de nouveau une du genre (1-β), qui est : « Adultère est celui qui aime violemment sa femme ». Enfin, voici une sentence du genre (I-γ): « Tout le monde demande : Est-il riche ? personne : est-il bon ? » Là, il y a l'affirmation d'un fait (I-α) et un blâme de ce fait, (I-β). Voyons encore les sentences de Ménandre : « Il est agréable de cueillir toute chose en son temps ». C'est une sentence du genre (I-α). « Ne fais ni n'apprends aucune chose honteuse » est une sentence du genre (1-β). « Le silence est pour toutes les femmes un ornement ». C'est une sentence du genre
§ 1421. (I-α) Faits expérimentaux ou faits imaginaires. L'affirmation peut être subordonnée à l'expérience. En ce cas, c'est une affirmation de la science logico-expérimentale, qui ne trouve pas place parmi les dérivations. Mais l'affirmation peut aussi subsister par sa vertu propre, par une certaine force intrinsèque, indépendante de l'expérience. Dans ce cas, c'est une dérivation.
§ 1422. Comme nous l'avons déjà remarqué (§ 526, 1068), il y a une différence entre un simple récit et l'affirmation d'une uniformité. Tous deux peuvent appartenir à la science logico-expérimentale ou aux dérivations, suivant qu'ils sont subordonnés à l'expérience ou qu'ils subsistent par leur vertu propre.
§ 1423. Souvent, la personne qui suit la méthode des sciences logico-expérimentales commence par une dérivation qu'elle soumet ensuite à l'expérience. Dans ce cas, la dérivation n'est qu'un moyen de recherche, et, comme telle, peut avoir sa place dans la science logico-expérimentale, mais pas comme moyen de démonstration.
§ 1424. Quand d'un fait ou de plusieurs faits on tire l'expression d'une uniformité, le résidu que l'on y ajoute et qui sert à la dérivation exprime le sentiment que les rapports des faits naturels ont quelque chose de constant (§ 1068). C'est là un procédé scientifique, pourvu qu'on prenne garde que l'uniformité ainsi obtenue n'a rien d'absolu ; c'est une dérivation non-scientifique du genre (I-β), si l'on donne un caractère absolu au résidu de la constance des « lois » naturelles, ou si, d'une autre manière quelconque, on fait dépasser l'expérience par l'affirmation.
§ 1425. La simple affirmation a peu ou point de force démonstrative ; mais elle a parfois une grande force persuasive [FN: § 1425-1]. C'est pourquoi nous la trouvons ici, comme nous l'avons déjà trouvée là où nous recherchions de quelle manière on tâche de persuader que les actions non-logiques sont des actions logiques (chapitre III), tandis que nous ne l'avons pas trouvée là où nous avons étudié les démonstrations (chapitre IV). Cependant l'affirmation vraiment pure et simple est rare, et chez les peuples civilisés, très rare ; il y a presque toujours quelque adjonction, quelque dérivation ou quelque germe de dérivation.
§ 1426. Au contraire, l'affirmation de renfort est fréquente dans le passé et dans le présent. On l'ajoute à d'autres dérivations, sous forme d'exclamation. Dans la Bible, Dieu donne, par l'entremise de Moïse, certains ordres à son peuple, et ajoute de temps à autre, comme pour les renforcer: « Je suis l'Éternel, votre Dieu [FN: § 1426-1] ». Fréquentes sont de nos jours les affirmations qu'une certaine mesure est selon le progrès, la démocratie, qu'elle est largement humaine, qu'elle prépare une humanité meilleure. Sous cette forme, l'affirmation est à peine une dérivation ; ce n'est plutôt qu'une façon d'invoquer certains sentiments. Mais en étant souvent répétée, elle finit par acquérir une force propre, devient un motif d'agir, assume le caractère de dérivation.
§ 1427. On a aussi l'affirmation simple dans le tabou sans sanction, dont nous avons déjà parlé (§ 322). Ce genre de dérivations simples s'observe en un très grand nombre de dérivations composées ; il est même rare qu'une dérivation concrète en soit dépourvue. L'affirmation arbitraire se trouve généralement parmi des affirmations expérimentales, ou s'insinue, se dissimule au milieu d'un raisonnement, et usurpe pour elle le consentement donné à d'autres propositions parmi lesquelles elle se trouve.
§ 1428. (I-β) Sentiments. L'affirmation peut être une manière indirecte d'exprimer certains sentiments. Elle est acceptée comme « explication » par ceux qui ont ces sentiments. Elle est donc simplement la manifestation des résidus accessoires qui constituent la dérivation.
§ 1429. Quand d'un sentiment individuel on tire une uniformité ou un précepte, le résidu qui s'ajoute et qui sert à la dérivation est le sentiment qui transforme les faits subjectifs en faits objectifs (résidus II-ζ). Souvent il s'y ajoute ensuite les résidus de sociabilité (IVe classe). Un homme en voit fuir d'autres et fuit, lui aussi. C'est un mouvement instinctif, une action réflexe comme on en observe aussi chez les animaux. Il entend crier : « Fuyez ! » et s'enfuit. Nous sommes encore dans le cas précédent. On lui demande: « Pourquoi avez-vous fui ? » Il répond: « Parce qu'ayant entendu crier : Fuyez! je croyais qu'on devait fuir ». On voit ainsi poindre la dérivation, qui pourra se développer si l'on entreprend d'expliquer le pourquoi de ce devait. Voici une personne qui lit une poésie et s'écrie : « Elle est belle ! » Si elle disait : « Elle me paraît belle », ce serait la simple affirmation d'un fait subjectif ; mais en disant: « Elle est belle ! » elle transforme ce fait subjectif en un fait objectif. Eu outre, celui qui entend a l'idée que ce qu'on dit beau doit lui donner à lui-même l'impression du beau, et là intervient un résidu de sociabilité. C'est ainsi que les hommes ont généralement les goûts de la collectivité dans laquelle ils vivent.
§ 1430. Une affirmation est acceptée, obtient crédit, par les sentiments de divers genres qu'elle suscite chez qui l'écoute ; et ainsi ces sentiments acquièrent l'apparence d'une « explication ». Elle a de la valeur parce qu'elle est exprimée d'une façon doctorale, sentencieuse, avec une grande sûreté, sous une forme choisie, en vers mieux qu'en prose, imprimée mieux que manuscrite, dans un livre de préférence à un journal, dans un journal mieux qu'exprimée verbalement, et ainsi de suite (§ 1157).
§ 1431. Nous avons trois catégories de causes de la valeur de l'affirmation. l° Il y a un sentiment indistinct que celui qui s'exprime d'une de ces manières doit avoir raison. La dérivation est vraiment réduite au minimum : c'est celle qui appartient proprement au genre dont nous nous occupons. 2° Il y a l'idée que ces formes choisies font autorité. La dérivation est un peu plus développée et appartient à la IIe classe (§ 1434 et sv.). 3° Il y a l'idée plus ou moins indéterminée que cette autorité est justifiée. La dérivation appartient encore à la IIe classe (§ 1435), et peut se développer jusqu'à donner un raisonnement logique. Pour ne pas répéter deux fois les mêmes choses, nous traiterons ici des trois catégories ensemble.
On pourrait supposer, en faisant abstraction de la réalité, que les sentiments de la 3e catégorie produisent ceux de la 2e, et ceux-ci les sentiments de la 1re : on démontrerait « d’abord que certaines circonstances confèrent de l'autorité, puisqu'on accepte en général cette autorité ; enfin, même indépendamment de cette autorité, qu'on éprouve du respect pour les formes sous lesquelles elle s'exprime. Cela peut arriver parfois ; mais si l'on tient compte de la réalité, on voit que les trois catégories sont souvent indépendantes ; qu'elles ont une vie propre, et que lorsque existe un rapport entre la 2e et la 3e, il est l'inverse de celui que nous venons d'indiquer. En de nombreux cas, l'homme qui accepte l'affirmation exprimée sous les formes indiquées tout à l'heure ne fait pas tant de raisonnements. Il dit, par exemple: « J'ai lu cela dans mon journal », et pour lui cela suffit comme preuve de la réalité de la chose [FN: § 1431-1] . C'est là une dérivation du genre qui nous occupe. Elle n'existe que lorsque, explicitement ou implicitement, le sentiment de respect pour la chose imprimée ou écrite sert à expliquer, à justifier le consentement que rencontre ce qui est imprimé ou écrit. Si, au contraire, ce sentiment se manifeste simplement, sans qu'on en tire des conséquences, par exemple quand la chose imprimée ou écrite est considérée comme un fétiche, une amulette, ou même seulement considérée avec respect, on a un seul résidu, qui est celui dont nous avons déjà traité aux § 1157 et sv. Cette observation est générale : un sentiment s'exprime par un résidu; si celui-ci sert ensuite à expliquer, à justifier, à démontrer, on a une dérivation. Il convient encore d'observer que dans le fait d'un homme qui fait siennes les opinions d'un journal qu'il lit habituellement, il y a, outre la présente dérivation, un ensemble d'autres dérivations et de résidus, parmi lesquels ceux de la sociabilité, puisque le journal exprime ou est réputé exprimer l'opinion de la collectivité à laquelle appartient le lecteur. En d'autres cas, c'est l’idée d'autorité qui agit (§ 1157 et sv.), ajoutée à la précédente ou indépendante d'elle. Enfin, en un très petit nombre de cas, il s'y ajoute des sentiments de justification de l'autorité (§ 1432) ; mais habituellement les hommes ont d'abord le sentiment de l'autorité et tâchent de trouver ensuite une manière de la justifier.
§ 1432. Au point de vue logico-expérimental, le fait qu'une affirmation est énoncée avec une grande sûreté peut être un indice, fût-ce lointain, que cette affirmation n'est pas à mettre en doute. À moins qu'il ne s'agisse d'une répétition machinale, le fait qu'une affirmation est exprimée en latin prouve que l'auteur a fait certaines études, indice probable d'une autorité légitime. En général, le fait d'être exprimée sous une forme qui n'est pas accessible à tout le monde peut indiquer, souvent peut-être à tort, que cette affirmation provient de personnes mieux que d'autres à même de connaître la réalité. Dans le cas de l'imprimé, du journal, du livre, on peut remarquer qu'une affirmation exprimée sous l'une de ces formes doit par cela même presque toujours être considérée comme rendue publique ; ce qui a pour conséquence qu'elle peut être réfutée plus facilement qu'une affirmation clandestine qui passe de bouche en bouche. C'est pourquoi, si la réfutation n'a pas lieu, la première affirmation a plus de probabilités d'être vraie que la seconde. Mais il arrive bien rarement que les hommes soient mus par des considérations de cette sorte ; et ce ne sont pas des raisonnements logico-expérimentaux, mais bien des sentiments, qui les poussent à ajouter foi aux affirmations faites sous les formes indiquées.
§ 1433. (I-γ) Les genres (I-α ) et (I-β), séparés dans le domaine de l'abstraction, se trouvent presque toujours réunis dans le concret et constituent le présent genre. À la vérité, celui qui donne une explication peut, bien que cela se produise rarement, ne pas avoir le sentiment auquel on recourt pour la donner ; mais celui qui l'accepte a généralement ce sentiment, autrement il n'y donnerait pas son consentement. Il suit de là qu'en réalité, la plus grande partie des dérivations concrètes de la Ire classe appartiennent au genre (I-γ), et que les expressions des faits et des sentiments sont chez elles si intimement combinées, qu'on ne peut aisément les séparer. Souvent, il s'y ajoute aussi des sentiments d'autorité et d'autres semblables.
§ 1434. IIe CLASSE. Autorité. Ici, nous avons un mode de démonstration et un mode de persuasion. Nous avons déjà parlé du premier (§ 583 et sv.); parlons maintenant surtout du second. Dans cette classe, nous avons diverses dérivations, qui sont les plus simples après celles de la classe précédente. Comme dans beaucoup d'autres dérivations les résidus qui servent à dériver sont ceux de la persistance des agrégats. Aux résidus (II-ζ) qui transforment les sentiments en réalités objectives, s'ajoutent des résidus d'autres genres ; par exemple, ceux de l'autorité du père mort ou des ancêtres (II-β), de la tradition (II-α), de la persistance des uniformités (II-ε), etc. Comme d'habitude, les résidus de la Ire classe interviennent pour allonger et développer les dérivations.
§ 1435. (II-α) Autorité d'un homme ou de plusieurs hommes [FN: § 1435-1]. Un cas extrême est celui de dérivations exclusivement logiques. Il est évident que pour certaines matières, l'opinion d'une personne qui en a une connaissance pratique présente une plus grande probabilité d'être vérifiée par l'expérience, que l'opinion d'une personne ignorante et qui n'a pas cette connaissance. Une telle considération est purement logico-expérimentale, et nous n'avons pas à nous en occuper ici [FN: § 1435-2] . Mais il y a d'autres genres de dérivations par rapport auxquelles la compétence de l'individu n'est pas expérimentale ; elle peut être déduite d'indices trompeurs, ou même être entièrement imaginaire. Nous nous écartons le moins du cas logico-expérimental, lorsque nous présumons, avec une probabilité plus ou moins grande (§ 1432), l'autorité d'après des indices qui peuvent être véridiques ou trompeurs, et en outre lorsque, grâce à la persistance des agrégats, nous étendons la compétence au delà des limites
§ 1436. Parce que M. Roosevelt est un éminent politicien, il croit être savant en histoire, et donne à Berlin, une conférence dans laquelle il fait montre d'une certaine ignorance de l'histoire grecque et de la romaine. L'Université qui a été honorée par Mommsen lui décerne le titre de docteur honoris causa. Il fait la découverte vraiment admirable que l'adage : si vis pacem para bellum est de Washington, et il est nommé membre étranger de l'Académie des sciences morales et politiques de Paris. Certes, il connaît l'art de faire les élections politiques ; il sait aussi battre la grosse caisse, et n'ignore pas la manière de chasser le rhinocéros blanc ; mais comment tout cela lui confère-t-il la compétence de donner des conseils aux Anglais, sur la façon de gouverner l'Égypte, ou aux Français, sur le nombre d'enfants qu'ils doivent avoir ? Il y a sans doute des motifs politiques et de basse adulation, pour expliquer les honneurs qui lui furent décernés par l'Académie des sciences morales et politiques de Paris, et par les Universités de Berlin et de Cambridge, ainsi que les flatteries qu'il reçut d'hommes politiques puissants, dans son rapide voyage en Europe [FN: § 1436-1] ; mais là même où ces motifs font défaut, nous trouvons l'admiration des vains discours de M. Roosevelt. Il y a aussi le sentiment que l'homme qui réussit à se faire nommer président des États-Unis d'Amérique et à faire grand bruit dans cette fonction, doit être compétent en toute matière qui a quelque rapport avec les sciences sociales et historiques ; et aussi le sentiment que celui qui est compétent en une chose l'est en toutes ; le sentiment d'admiration générale, qui empêche de séparer les parties en lesquelles un homme est compétent, de celles où il ne l'est pas.
Autrefois, l'autorité du poète envahissait tous les domaines. En de nombreux cas, il y avait à cela un petit fondement logico-expérimental, parce que le poète était aussi, l'homme cultivé. Aujourd'hui, ce motif n'a plus de valeur pour le poète et le littérateur contemporains ; et pourtant, en de nombreux cas, ils passent pour compétents en des matières qui leur sont parfaitement étrangères. Voici M. Brieux qui, dans chacune de ses productions dramatiques, vous « résout » quelque « question sociale ». Il ne sait rien et décide de tout. Il découvre une thèse connue depuis les temps les plus anciens, et, après Plutarque et Rousseau, enseigne aux mères qu'elles doivent allaiter leurs enfants. Aussi est-il admiré par un grand nombre de bonnes gens. Anatole France est un romancier de tout premier ordre, très compétent quant au style et à la forme littéraire. En une langue merveilleuse, il a écrit des romans où l'on trouve une psychologie sagace et une fine ironie. En tout cela, son autorité est incontestable. Mais voilà qu'un beau jour il lui vient à l'idée de l'étendre à d'autres matières qu'il connaît beaucoup moins. Il veut résoudre des problèmes politiques, économiques, religieux, historiques. Il devient dreyfusard, socialiste, théologien, historien ; et il ne manque pas d'admirateurs dans toutes ses transformations. Le sentiment de l'autorité – aidé de la passion politique – est si fort en ce cas, qu'il résiste aux preuves contraires les plus évidentes. L'histoire de Jeanne d'Arc écrite par Anatole France conserve des admirateurs, après que Lang a publié les erreurs nombreuses et graves qu'elle contient. Il y en a de grossières, d'involontaires, et d'autres que l'on ne peut malheureusement tenir pour telles. Cependant, le livre jouit encore d'une grande autorité [FN: § 1436-2].
§ 1437. Le résidu de la vénération (§ 1156 et suiv.) sert souvent à donner du poids aux affirmations ; il peut avoir différents degrés et, de la simple admiration, aller jusqu'à la déification. Sous toutes ses formes, il peut être employé pour la dérivation, mais aux degrés les plus élevés, il devient souvent une forme de l'autorité ou de la tradition verbale ou écrite [FN: § 1437-1] .
§ 1438. On peut placer dans le présent genre de dérivations les nombreuses affirmations pseudo-expérimentales qu'on trouve en tout temps, et que chacun répète comme un perroquet. Parfois elles ont une apparence de preuve, dans un témoignage plus ou moins intelligent, plus ou moins véridique ; mais souvent aussi cette preuve fait défaut, et les affirmations restent en l'air, on ne sait comment, sans la moindre preuve expérimentale ou autre. Pour trouver de ces dérivations il suffit d'ouvrir plusieurs livres anciens et aussi quelques livres modernes. Nous n'ajouterons qu'un seul exemple à ceux que nous avons déjà cités. Saint Augustin veut prouver, contre les incrédules, la réalité des tourments qui attendent les damnés. Les incrédules lui objectaient qu'il n'était pas croyable que la chair brûlât sans se consumer, et que l'on souffrît sans mourir. À cela, le saint répond qu'il y a d'autres faits, également merveilleux, qui seraient incroyables s'ils n'étaient certains, et il en cite un grand nombre [FN: § 1438-1]. Sans doute, au point de vue expérimental, cette dispute est vaine, d'un côté comme de l'autre, parce que les tourments des damnés sont étrangers au monde expérimental, et que la science expérimentale ne peut en traiter d'aucune façon ; mais un fait étrange subsiste c'est que presque tous les faits cités par le saint sont imaginaires à tel point que si le livre était d'un adversaire, on aurait pu croire que celui-ci a voulu montrer la vanité des miracles dont le saint voulait donner la preuve. On aurait pu répondre au Saint : « Nous acceptons votre raisonnement ; nous vous concédons que les miracles que vous citez sont aussi vrais que les faits auxquels vous les comparez... lesquels faits sont faux ! » Pour l'un de ces faits, soit pour la chair de paon qui ne se corrompt pas, il y, a une pseudo-expérience ; pour les autres, la preuve est donnée par des dérivations fondées sur l'autorité [FN: § 1438-2] .
Saint Augustin est le précurseur de nos contemporains adorateurs de la Sainte Science : il dit croire uniquement à ce qui est prouvé par les faits, refusant d'ajouter foi aux fables des païens [FN: § 1438-3] ; et les fidèles de l'humanitarisme positiviste répètent qu'ils veulent croire uniquement ce qui est prouvé par les faits, refusant d'ajouter foi aux « fables » des chrétiens. Mais, par malheur, autant les faits du premier que les faits des derniers sont uniquement pseudo-expérimentaux.
Il convient de remarquer qu'à la fin pourtant un certain doute sur les faits s'insinue dans l'esprit de Saint Augustin [FN: § 1438-4] ce qui ne semble pas être le cas de nos admirateurs de la démocratie et de l'humanitarisme. L'omnipotence de Dieu est, en somme, pour Saint Augustin, la meilleure preuve des miracles. En cela, il a raison ; car, sortant ainsi du domaine expérimental, il échappe aux objections de la science logico-expérimentale, lesquelles conservent, au contraire, toute leur efficacité contre ceux qui s'obstinent à demeurer dans ce domaine.
§ 1439. Dans les dérivations, le résidu de l'autorité traverse les siècles sans perdre de sa force. De nos jours, après avoir parlé par la bouche des admirateurs de Eusapia Paladino, de Lombroso, de William James, il nous apparaît tel qu'il était quand Lucien écrivait son Menteur. Les fables dont se moque Lucien s'écartent très peu de celles qui ont cours aujourd'hui, et se justifiaient, de son temps, comme elles se justifient du nôtre, par l'autorité d'hommes réputés savants, graves. Bien longtemps avant que Lombroso et William James eussent promis de revenir, après leur mort, pour s'entretenir avec leurs amis, la femme d'Eucratès était venue, après sa mort, s'entretenir avec son mari. Le philosophe Arignôtos raconte d'autres histoires encore plus merveilleuses, et l'incrédule Tykhiadès, laissant voir qu'il n'y ajoutait guère foi, est considéré comme privé de bon sens, parce qu'il ne cède pas à de semblables autorités [FN: § 1439-1]. Il suffit d'ouvrir au hasard l'un des nombreux livres qui racontent des faits merveilleux, pour y trouver des observations semblables [FN: § 1439-2].
§ 1440. De nos jours, ces croyances existent aussi. Un grand nombre de gens croient à la guérison par la prière (§ 1695-2). Un très grand nombre vivent dans la crainte sacrée des médecins hygiénistes, qui sont les saints défendant les malheureux mortels des maléfices des démons devenus microbes. Un manuel de morale [FN: § 1440-1] (!) en usage dans les écoles françaises nous apprend que « (p. 33) pour être bien portant, il faut ne jamais boire d'alcool, ni de boissons alcooliques. Il ne faut jamais avaler une seule goutte d'eau-de-vie, de liqueur, d'absinthe ou d'apéritif ». Rien ne nous permet de croire que l'auteur ne pensait pas ce qu'il affirme ; et, dans le cas contraire, il aurait vraiment donné un déplorable exemple, dans un traité de morale. Il croyait donc – et les lecteurs doivent croire, en vertu de son autorité – qu'il suffit «d'avaler une seule goutte d'eau-de-vie ou de liqueur » pour n'être pas bien portant. Il est très facile de faire un essai, et de vérifier s'il est vrai qu'après avoir bu une seule goutte de liqueur on n'est pas bien portant. Dans ce cas, comme en beaucoup d'autres, on verra que l'expérience dément l'autorité. Mais il y a mieux. Un auteur affirme, comme résultat de l'expérience, que si un homme est buveur, sa fille ne peut plus allaiter, et que cette faculté est perdue à jamais pour les générations suivantes [FN: § 1440-2]. Ici la substitution de l'autorité à l'expérience est éclatante et se dément d'elle-même. Pour démontrer expérimentalement que la faculté d'allaiter est perdue à jamais pour « les générations suivantes », il est évidemment nécessaire d'avoir examiné ces générations, au moins pendant quelques siècles. Comment cela est-il possible ? Où sont les statistiques de quelques siècles en arrière, qui indiquent qu'un homme était buveur, puis indiquent que les femmes qui descendaient de lui ont pu ou non allaiter ? Passons sur le fait que si ce que dit cet auteur était vrai, on ne verrait plus, dans les pays de vignobles, de femmes allaitant leurs enfants ; il suffit de se promener dans une de ces contrées et de n'être pas aveugle pour s'assurer du contraire.
§ 1441. Voici un autre personnage, qui dit [FN: § 1441-1] – et il trouve des gens pour y croire – qu'il suffit d'un demi-litre de vin ou de deux litres de bière pour diminuer du 25 au 40 % la capacité de travail cérébral. Ainsi, dans les universités allemandes, où professeurs et étudiants boivent encore plus que les quantités qui viennent d'être indiquées, de bière ou de vin, on devrait avoir bien peu de capacité de travail cérébral. Le grand mathématicien Abel, qui abusait des boissons alcooliques, devait être un idiot ; mais nous ne nous en apercevons pas. Bismarck aussi devait avoir bien peu de capacité de travail cérébral [FN: § 1441-2] !
§ 1442. Il est remarquable que beaucoup, parmi les croyants de cette religion anti-alcooliste soient des adversaires acharnés de la religion catholique, et qu'ils se moquent de ses miracles, sans s'apercevoir que leurs miracles sont aussi étonnants que ceux des catholiques, et que s'il est vrai que la croyance en les uns et les autres est dictée par le sentiment, elle trouve ensuite sa justification dans l'autorité, avec cette différence en défaveur des croyants de la religion anti-alcooliste, qu'aujourd'hui il n'y a pas moyen de faire des expériences pour prouver qu'un miracle fait au temps passé était faux, tandis que chacun peut faire des expériences ou des observations qui démontrent la fausseté des affirmations miraculeuses rapportées tout à l'heure [FN: § 1442-1].
§ 1443. Le résidu de l'autorité apparaît aussi dans les artifices qu'on met en œuvre pour la détruire. On peut le voir dans une infinité de polémiques théologiques, morales, politiques.
§ 1444. Au point de vue logico-expérimental, la vérité de la proposition : A est B, est indépendante des qualités morales de l'homme qui l'énonce. Supposons que demain on découvre qu'Euclide fut un assassin, un voleur, en somme le pire homme qui ait jamais existé ; cela porterait-il le moindre préjudice à la valeur des démonstrations de sa géométrie ?
§ 1445. Il n'en est pas ainsi au point de vue de l'autorité. Si la proposition : A est B, est acceptée seulement grâce à l'autorité de celui qui l'énonce, tout ce qui peut affaiblir cette autorité nuit à la démonstration que A est B. L'artifice des polémistes consiste à placer dans le domaine de l'autorité une proposition qui a sa place dans le domaine logico-expérimental.
§ 1446. Il faut remarquer que ces moyens, justement parce qu'ils n'ont aucune force logico-expérimentale, perdent toute efficacité, quand on en fait un usage trop étendu. Désormais, on sait que lorsqu'un théologien dit d'un autre qu'il est un pervers, cela signifie seulement qu'ils sont d'avis différent ; et quand un journaliste dit d'un homme d'État qu'il est un malfaiteur, cela indique simplement qu'il a, pour le combattre, des motifs d'intérêt personnel, de parti ou d'opinion. En politique, ces moyens de détruire l'autorité peuvent n'avoir plus le moindre effet.
§ 1447. (II-β) Autorité de la tradition, des usages ou des coutumes. Cette autorité peut être verbale, écrite, anonyme, celle d’une personne réelle ou d'une personne légendaire. Dans ces dérivations, une grande part revient aux résidus de la persistance des agrégats, grâce auxquels, autrefois la « sagesse des ancêtres », aujourd'hui les « traditions du parti », acquièrent une existence propre et indépendante. Les dérivations qui emploient l'autorité de la tradition sont très nombreuses. Non seulement il n'y a pas de pays ou de nation qui n'ait ses traditions, mais encore les sociétés particulières n'en manquent pas. Ces traditions sont une partie importante de toute vie sociale. Expliquer un fait par la tradition est très facile, car, parmi les innombrables légendes qui existent, et qu'au besoin on peut même créer, on n'éprouve pas la moindre difficulté à en trouver une qui, grâce à quelque ressemblance plus ou moins lointaine, à un accord plus ou moins indéterminé de sentiments, s'adapte au fait que l'on veut « expliquer » [FN: § 1447-1].
§ 1448. Parfois, l'usage ne se distingue pas de la tradition, et souvent celui qui suit un certain usage ne sait donner d'autre motif de ses actions que : « On fait ainsi ».
§ 1449. Les traditions peuvent constituer des résidus indépendants, et là où ils sont assez puissants, la société devient comme rigide, et repousse presque toute nouveauté. Mais souvent les traditions ne sont que des dérivations et, en ce cas, la société peut innover peu ou beaucoup, même en contradiction avec le fond de la tradition, l'accord persistant seulement dans la forme. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de sectes chrétiennes.
§ 1450. Comme nous l'avons vu souvent, les dérivations sont en général d'une nature élastique. Celles de la tradition possèdent ce caractère à un degré éminent. On peut tirer tout ce qu'on veut, par exemple, d'un livre qui enseigne la tradition. Les Grecs trouvaient tout dans Homère, les Latins dans Virgile, et les Italiens trouvent beaucoup de choses dans Dante. Le cas de la Bible et de l'Évangile est très remarquable. Il serait difficile de dire ce qu'on n'y a pas trouvé. On en a tiré des doctrines en très grand nombre, différentes, contradictoires même, et l'on a démontré avec une égale facilité le pour et le contre.
§ 1451. Naturellement, chaque secte est persuadée de posséder la « vraie » interprétation, et repousse dédaigneusement celles d'autrui; mais cette « vérité » n'a rien de commun avec la vérité expérimentale, et tout critère fait défaut pour savoir qui a raison. Dans ce procès, il y a bien des avocats, mais pas de juges (§ 9).
§ 1452. On peut observer expérimentalement que certaines interprétations s'écartent du sens littéral ; mais celui qui possède une foi vive ne s'en soucie guère, et c'est de propos délibéré qu'il abandonne ce sens littéral. Par exemple, si le Cantique des Cantiques se trouvait dans un autre livre que la Bible, chacun y verrait immédiatement un chant d'amour (§ 1627). La foi y voit autre chose, et comme elle se place en dehors de l'expérience, celui qui veut rester dans le domaine de cette expérience ne peut rien objecter.
§ 1453. Tant que la tradition ne sert qu'à dériver, la critiquer a peu d'effet sur l'équilibre social. On ne peut dire que cet effet soit nul, mais, sauf les cas exceptionnels, il n'est pas grand.
§ 1454. À partir du XVIIIe siècle, on a combattu la Bible avec une formidable artillerie de science, d'érudition, de critique historique. On a démontré, d'une manière tout à fait évidente, qu'un grand nombre de passages de ce livre ne peuvent être pris dans leur sens littéral. L'unité du livre a été détruite, et au lieu du magnifique édifice que l'on a tant admiré, il ne reste que des matériaux informes. Eh bien, on ne voit diminuer ni l'admiration, ni le nombre des croyants [FN: § 1454-1] ; ceux-ci se comptent encore par millions, et il y a des gens qui, tout en critiquant la partie historique de la Bible, tombent à genoux devant le livre et l'adorent. Les dérivations changent, les résidus subsistent.
§ 1455. De nos jours, de braves gens se sont imaginé pouvoir détruire le christianisme, en tâchant de démontrer que le Christ n'a pas de réalité historique : ils ont donné un beau coup d'épée dans l'eau. Ils ne s'aperçoivent pas que leurs élucubrations ne sortent pas d'un cercle très étroit d'intellectuels, et qu'elles ne parviennent pas jusqu'au peuple, jusqu'au plus grand nombre des croyants. En général, ils ne persuadent que ceux qui sont déjà persuadés.
§ 1456. De même, des gens se sont imaginé qu'ils auraient détruit, en France, le patriotisme catholique, et qu'ils auraient ainsi contribué à assurer la suprématie du « bloc » radical-socialiste, s'ils avaient pu démontrer que Jeanne d'Arc était hystérique ou aliénée [FN: § 1456-1] . Ils n'ont été écoutés que par ceux qui étaient déjà de leur avis ; et loin de diminuer l'admiration de leurs adversaires pour Jeanne d'Arc, ils ont contribué à l'augmenter.
§ 1457. Les livres vénérés finissent souvent par acquérir un pouvoir mystérieux, et peuvent servir à la divination. C'est ce qui est arrivé par exemple à la Bible, à Virgile et à d'autres.
§ 1458. (II-γ) Autorité d'un être divin ou d'une personnification. Si l'on s'en tenait uniquement au fond, les dérivations de ce genre devraient être rangées parmi les précédentes, puisqu'à vrai dire nous ne pouvons connaître la volonté d'un être divin ou d'une personnification que par l'intermédiaire d'hommes et de traditions ; mais au point de vue de la forme, l'intervention surnaturelle est assez importante pour donner lien à un genre séparé. L'intervention d'une divinité engendre trois genres différents de dérivations. 1er La volonté de cette divinité étant supposée connue l'homme peut y obéir par simple respect, sans subtiliser trop sur les motifs de cette obéissance, en donnant simplement pour motif de ses actions la volonté divine, ou en y ajoutant un petit nombre de considérations sur le devoir qu'on a de la respecter. C'est ainsi qu'on a le présent genre. 2e L'homme peut obéir à cette volonté par crainte du châtiment qui menace le transgresseur des commandements divins. Ici, c'est l'intérêt individuel qui agit ; on a des actions qui sont la conséquence logique des prémisses. Ces dérivations appartiennent au genre (III-β) ou bien au genre (III-γ) si à l'intérêt individuel se substitue ou s'ajoute celui de la collectivité. 3e L'homme peut encore tâcher de mettre ses actions en accord avec la volonté divine, par amour pour la divinité, pour agir suivant les sentiments qu'on suppose à cette divinité, parce qu'en soi cela est bon, louable, de son devoir, indépendamment des conséquences. De cette façon naissent les dérivations du genre (III-ζ).
§ 1459. Comme nous l'avons dit souvent, nous séparons par l'analyse, dans le problème abstrait, ce qui est uni dans la synthèse du fait concret. Dans la pratique, les dérivations où figure une entité surnaturelle réunissent très souvent les deux premiers genres mentionnés tout à l'heure, et même de telle façon qu'il est difficile de les séparer. Elles ajoutent aussi souvent le troisième genre ; mais c'est là un passage à la métaphysique, on l'observe spécialement chez les gens qui se livrent à de longs raisonnements. Beaucoup d'individus éprouvent pour l'être surnaturel un sentiment complexe de vénération, de crainte, d'amour, qu'ils ne sauraient eux-mêmes pas diviser en éléments plus simples. Les controverses de l'Église catholique sur la contrition et l'attrition sont en rapport avec la distinction que nous venons de faire entre les genres de dérivations [FN: § 1459-1].
§ 1460. Dans les trois genres de dérivations, il faut faire attention aux manières dont on croit reconnaître la volonté de l'être divin ou l'accord avec les sentiments de cet être. Ces sentiments sont généralement simples, dans les deux premiers genres, bien qu'il y ait plusieurs exceptions, et beaucoup plus complexes dans le troisième. La divination antique comprenait une branche spéciale pour connaître la volonté des dieux.
§ 1461. Une entité abstraite peut parfois donner lieu aux dérivations qui sont propres à la divinité, quand cette entité abstraite se rapproche de la divinité, grâce aux résidus de la persistance des agrégats : c'est, pour ainsi dire, une divinité en voie de formation.
§ 1462. La dérivation qui invoque la volonté présumée ou les sentiments présumés de l'être surnaturel, a d'autant plus d'efficacité pour persuader que le résidu correspondant à l'être surnaturel est plus fort. La manière dont on s'imagine connaître sa volonté est secondaire. Il y a toujours quelque biais pour faire en sorte que l'être surnaturel veuille ce qui importe le plus à celui qui l'invoque (§ 1454-1] ). Souvent, les hommes se figurent qu'ils agissent d'une certaine façon par obéissance à la volonté d'êtres surnaturels, tandis qu'au contraire, ils supposent cette volonté, parce qu'ils agissent de cette façon. « Dieu le veut ! » s'écriaient les croisés, qui, réellement, étaient poussés en grande partie par un instinct migrateur semblable à celui qui existait chez les anciens Germains, par le désir de courir les aventures, par le besoin de nouveauté, par répugnance pour une vie réglée, par cupidité [FN: § 1462-1]. Si les hirondelles raisonnaient, elles pourraient dire aussi que, si elles changent de pays, deux fois l'an, c'est pour obéir à la volonté divine. De nos jours, c'est pour obéir aux lois du « Progrès », de la « Science », de la « Vérité », que certaines personnes s'approprient les biens d'autrui, ou qu'elles favorisent ceux qui se les approprient ; mais, en réalité, elles sont poussées par le désir très naturel de ces biens, ou de la faveur des gens qui se les approprient. Dans l'Olympe du « Progrès », une nouvelle divinité a maintenant sa place ; on lui a donné le nom d'« intérêts vitaux » ; elle préside aux relations internationales. Aux temps barbares, un peuple partait en guerre contre un autre, le mettait à sac, le pillait, sans tant de raisonnements. À notre époque, cela se fait encore, mais s'accomplit uniquement au nom des « intérêts vitaux » ; et cela constitue, dit-on, une immense amélioration. À qui n'est pas expert en une telle matière, le brigandage des États européens en Chine paraîtra peut-être assez semblable à celui d'Attila dans l'Empire romain ; mais celui qui est versé dans la casuistique des dérivations voit aussitôt entre les deux brigandages une énorme différence. Pour le moment, les « intérêts vitaux » ne sont pas encore invoqués par les brigands privés, qui se contentent d'une divinité plus modeste, et justifient leurs faits et gestes en disant qu'ils veulent « vivre leur vie ».
§ 1463. Parfois, la dérivation finit par avoir une valeur indépendante, et constitue un résidu ou bien une simple dérivation du présent genre (II-γ). Cela a lieu souvent avec les abstractions divinisées mais non personnifiées ; ce qui empêche de leur attribuer trop explicitement une volonté personnelle, et il est nécessaire qu'elles se contentent de quelque « impératif ». Nous en avons un grand nombre d'exemples, en tout temps. Au nôtre, voici un exemple important. L'automobile jouit de la protection du Progrès, qui est dieu ou peu s'en faut, de même que la chouette jouissait à Athènes de la protection de la déesse Athéna. Les fidèles du Progrès doivent respecter l'automobile, comme les Athéniens respectaient les chouettes. À notre époque où triomphe la démocratie, si l'automobile n'avait pas la protection du Progrès, elle serait proscrite, car elle est employée surtout par les gens riches ou, pour le moins, aisés, et tue bon nombre d'enfants de prolétaires, et même quelques prolétaires adultes ; elle empêche aux enfants des pauvres de jouer dans la rue, remplit de poussière les maisons des pauvres paysans et des habitants des villages [FN: § 1463-1]. Tout cela est toléré, grâce à la protection du dieu Progrès ; du moins en apparence car, en réalité, il y a aussi l'intérêt des hôteliers et des fabricants d'automobiles [FN: § 1463-2] . On va jusqu'à traiter ceux qui n'admirent pas les automobiles comme on traitait autrefois les hérétiques. Voici, par exemple, en Suisse, le canton des Grisons, qui ne veut pas laisser passer les automobiles sur les routes construites avec son argent. Aussitôt les prêtres et les fidèles du dieu Progrès se récrient et condamnent avec une colère vraiment comique cet acte hérétique et coupable de lèse-majesté divine ; ils demandent que la Confédération oblige le canton entaché d'une si grande perversité hérétique, de laisser libre parcours aux automobiles ; et ils avaient même proposé, pour arriver à leurs fins, une adjonction à la constitution fédérale ; peu s'en fallut qu'on ne la soumît au referendum populaire.
Notez, en ce cas, une dérivation qu'on rencontre habituellement dans les autres religions, et qui consiste à rendre l'individu fautif de ce qui est proprement une conséquence de la règle générale. Quand il se produit quelque accident qui, en vérité, a pour cause la grande vitesse qu'on permet aux automobiles, on en rejette toute la faute sur le conducteur de la machine, baptisé à cette occasion du nom de chauffard. Ainsi on dissimule la cause effective, et l'on ne risque pas de la faire disparaître. De même, dans les pays où existe la corruption parlementaire, on fait de temps à autre des enquêtes et des procès pour faire croire que les quelques individus frappés sont seuls coupables, et éviter le blâme qui retomberait sur toute l'institution qui produit de tels effets.
§ 1464. IIIe CLASSE. Accord avec des sentiments ou avec des principes. Souvent l'accord existe seulement avec les sentiments de celui qui est l'auteur de la dérivation ou de celui qui l'accepte, tandis qu'il passe pour un accord avec les sentiments de tous les hommes, du plus grand nombre, des honnêtes gens, etc. Ces sentiments se détachent ensuite du sujet qui les éprouve, et constituent des principes.
§ 1465. (III-α) Sentiments. Accord avec les sentiments d'un nombre petit ou grand de personnes. Nous avons déjà parlé de ces dérivations (§ 591-612), en les envisageant spécialement dans les rapports qu'elles peuvent avoir avec la réalité expérimentale ; il nous reste à ajouter des considérations au sujet de la forme qu'elles prennent.
§ 1466. L'accord avec les sentiments peut se manifester de trois façons, qui sont semblables à celles que nous avons indiquées déjà (§ 1458) pour l'obéissance à l'autorité ; c'est-à-dire que nous avons les trois genres suivants. 1° L'homme peut mettre ses actions en accord avec les sentiments vrais ou supposés d'êtres humains, ou d'un être abstrait, par simple respect pour l'opinion du plus grand nombre ou des doctes personnages qui sont les ministres de cet être abstrait. Nous avons ainsi les dérivations (III-α). 2° L'homme peut agir sous l'empire de la crainte de conséquences fâcheuses pour lui ou pour autrui ; et nous avons des dérivations des genres (III-β),(III-γ), (III-δ). 3° Enfin, l'homme peut être mu par une force mystérieuse qui le pousse à agir de manière à mettre ses actions en accord avec les sentiments indiqués ; et, dans le cas extrême, on a un « impératif » qui agit par une vertu propre et mystérieuse. Ainsi se constituent les genres (III-ε), (III-ζ). Dans les résidus qu'on emploie pour dériver, ceux de la sociabilité (IVe classe) jouent un rôle important.
§ 1467. Dans ce genre (III-α ) se trouve aussi l'accord avec les sentiments de l'auteur de la dérivation. Cet auteur ne raisonne pas objectivement, mais par simple accord de sentiments (§ 1454-1), usant largement des résidus de l'instinct des combinaisons (Ire classe). Il suffit que A ait avec B une analogie lointaine ou même imaginaire, pour qu'on emploie A en vue d'« expliquer » B par un accord indistinct de sentiments indéterminés. Quand intervient une certaine détermination et que les sentiments se manifestent sous une forme métaphysique, nous avons les dérivations du genre (III-ε). Souvent les dérivations par accord de sentiments prennent une forme simplement verbale, et l'accord s'établit entre les sentiments que font naître certains termes. Alors les dérivations ont proprement leur place dans la IVe classe.
§ 1468. Les cas concrets présentent souvent les trois genres de dérivations mentionnés au § 1466 ; mais le second, qui est très important pour les personnifications divines, se voit souvent à peine, ou disparaît entièrement dans les dérivations par accord de sentiments, surtout dans les dérivations métaphysiques. En outre, on trouve dans un grand nombre de dérivations par accord de sentiments un groupe de résidus de la IVe classe, dépendants de la sociabilité, c'est-à-dire un sentiment de vénération éprouvé par l'individu envers la collectivité, un désir d'imitation et d'autres sentiments semblables. C'est justement dans cet agrégat puissant de sentiments que réside la force qui pousse les hommes à accepter les raisonnements qui ont pour fondement le consentement d'un grand nombre ou de tous les hommes. C'est la solution du problème indiqué (§ 597, 598). Ici, nous avons à nous occuper principalement de l'accord de sentiments qu'on suppose agir par vertu propre (III-α ).
§ 1469. L'accord avec les sentiments subsiste souvent de lui-même, sans qu'on cherche explicitement à donner une forme précise au rapport dans lequel il peut se trouver avec la réalité objective. C'est l'affaire de la métaphysique de rechercher cette forme précise, qui s'exprime souvent par l'affirmation de l'identité de l'accord des idées et de l'accord des objets correspondants (§ 594, 595). On peut exprimer cette identité en disant que « s'il existe un concept dans l'esprit de tous les hommes, ou du plus grand nombre, ou dans un être abstrait, ce concept correspond nécessairement à une réalité objective ». Souvent on n'exprime pas cette identité ; elle demeure sous-entendue ; c'est-à-dire qu'elle ne s'énonce pas explicitement, qu'on ne donne pas une forme verbale au résidu auquel elle correspond (résidu II-ζ). Parfois on l'exprime sous diverses formes, comme évidente ou axiomatique ; c'est la manière propre aux métaphysiciens. Parfois encore, on essaie d'en donner une démonstration, en allongeant pour cela la dérivation. On dit, par exemple, que ce qui existe dans tout esprit humain y a été mis par Dieu, et doit donc nécessairement correspondre à une réalité objective : c'est la manière propre aux théologiens, employée pourtant aussi par d'autres personnes. Il y a encore la belle théorie de la réminiscence ; et l'on ne manque pas d'autres théories métaphysiques de cette sorte, y compris les théories positivistes d'H. Spencer.
§ 1470. Voyons quelques exemples pratiques de ces dérivations. Longtemps on a attribué une grande importance au consentement universel pour démontrer l'existence des dieux ou de Dieu. On peut obtenir ce consentement de la manière indiquée tout à l'heure : en sous-entendant que Dieu a imprimé un certain concept dans l'esprit humain, qui nous le manifeste ensuite [FN: § 1470-1] ; ou bien inversement, en partant de ce concept, et en vertu d'un principe métaphysique, on peut conclure à l'existence de Dieu. « Grecs et Barbares – nous dit Sextus Empiricus [FN: § 1470-2] – reconnaissent les dieux ». Maxime de Tyr nous fait la bonne mesure. Il commence par observer (4) qu'il règne une extrême diversité d'opinions sur ce qu'est Dieu, le bien, le mal, sur le honteux et sur l'honnête ; mais (5) dans un si grand désaccord, tous sont d'avis qu'il est un dieu unique, souverain et père de toute chose, auquel viennent s'ajouter d'autres dieux, ses fils et collègues. « C'est ce que disent l'Hellène et le Barbare, le continental et l'insulaire, le sage et l'ignorant... » C'est là un bel exemple d'un auteur donnant pour objective une théorie subjective, qui est la sienne. Combien de gens étaient loin de penser comme Maxime de Tyr [FN: § 1470-3] !
§ 1471. L'auteur veut répondre à l'objection qui est générale en (des cas semblables : de tous, qui éprouvent, affirme-t-on, certains sentiments, se trouvent exclus de fait plusieurs hommes qui ne les éprouvent pas. Il s'en tire par un procédé général aussi, de dérivation [FN: § 1471-1] (§ 592 et suiv.), en excluant, sans autre forme de procès, ces hommes du nombre des personnes à envisager. Ceux qui ne partagent pas l'avis de Maxime de Tyr sont des gens de rien ; donc il est évident que tous ceux qui ne sont pas des gens de rien partagent son avis. « Que si, dans le cours des temps, il a existé deux ou trois athées abjects et stupides, que leurs yeux trompent, qui sont induits en erreur par leur ouïe, eunuques quant à l'âme, sots, stériles, inutiles comme des lions sans courage, des bœufs sans cornes, des oiseaux sans ailes, cependant même par ceux-là tu connaîtras le divin... » [FN: § 1471-2]. Injurier ses adversaires n'a aucune valeur au point de vue logico-expérimental, mais peut en avoir beaucoup sous le rapport des sentiments [FN: § 1471-3].
§ 1472. L'affirmation suivant laquelle tous les peuples auraient une conception des dieux ne resta pas sans réponse. Elle fut mise en doute ou même nettement niée [FN: § 1472-1]. Cela importe peu au sujet dont nous traitons ici. Remarquons seulement que, comme d'habitude, le terme dieux ou Dieu n'étant pas bien défini, on peut à volonté trouver ou non cette conception dans l'esprit de certains hommes.
§ 1473. Il parait qu'on fait aussi une différence entre tous les peuples et tous les hommes, parce qu'on voudrait distinguer entre les simples gens qui représentent l'opinion populaire, et certains hommes qui veulent par trop subtiliser. Parmi ces derniers, on rangerait les athées, auxquels on pourrait ainsi légitimement opposer le bon sens du plus grand nombre.
§ 1474. Comme d'habitude, par les dérivations on peut prouver le pour et le contre ; et il ne manqua pas de gens qui se prévalurent du défaut de consentement universel, pour contester l'existence des dieux et de la morale. Platon accuse du fait les sophistes. Il semble qu'au fond ceux-ci disaient : les dieux, étant différents chez les divers peuples, ne tirent pas leur existence de la nature, mais de l'art ; le beau est autre selon la nature et selon la loi ; le juste n'existe pas par nature, puisque les hommes, toujours en désaccord à son sujet, font tous les jours de nouvelles lois.
§ 1475. On sous-entend souvent le consentement du plus grand nombre ; c'est-à-dire qu'il nous paraît si évident, que nous admettons, sans éprouver le besoin de nous exprimer explicitement sur ce point, que tous ou le plus grand nombre doivent être de cet avis. Parfois, comme nous l'avons déjà remarqué (§ 592 et sv.) on donne ce consentement comme démonstration ; parfois, il est à son tour démontré au moyen de quelque autre principe métaphysique [FN: § 1475-1], auquel on a vainement opposé le fait expérimental qu'un grand nombre d'opinions générales étaient fausses, par exemple celle portant sur l'astrologie. Cette adjonction au principe du consentement universel sert à donner satisfaction au besoin que l'homme a d'explications logiques.
§ 1476. Dans presque toutes les dérivations concrètes, on trouve la dérivation du consentement universel, du plus grand nombre, des honnêtes gens, des sages, de l'esprit humain, de la droite raison, de l'homme pondéré, avisé, etc. Très souvent, cette dérivation est implicite ; souvent elle se dissimule sous différentes formes ; par exemple, en une manière impersonnelle de s'exprimer : On croit, on comprend, on admet, etc., ou en rappelant un nom : Cette chose s'appelle ainsi ; ce qui veut dire simplement que l'auteur de la dérivation donne à cette chose un nom qui convient à certains de ses sentiments. Les proverbes aussi, les adages, les dictons universels, employés comme preuve, dissimulent généralement le consentement, vrai ou supposé, du plus grand nombre.
§ 1477. (III-β ß) Intérêt individuel. Si l'on veut persuader un individu de faire une certaine chose A qu'il ne ferait pas spontanément, différents moyens peuvent être employés, et une partie seulement d'entre eux appartiennent aux dérivations.
§ 1478. Les moyens suivants n'appartiennent pas aux dérivations. 1° L'individu ne sait pas qu'il lui serait utile de faire A : on le lui enseigne. C'est le rôle de l'expérience, de l'art, de la science. Par exemple, l'expérience vous enseigne à épargner dans l'abondance, pour faire face à la disette ; l'art vous enseigne à vous procurer le fer dont vous ferez la charrue ; la science vous enseigne le moyen d'atteindre un but déterminé. 2° Faire A est imposé à l'individu par une puissance extérieure et réelle, moyennant une sanction réelle. Si la puissance ou la sanction, ou toutes les deux, sont imaginaires, irréelles, on a un procédé qui appartient aux dérivations. Les lois civiles et les lois pénales ont précisément pour but d'établir des sanctions réelles. Le simple usage, la coutume, ont aussi une sanction ; elle consiste dans le blâme qui frappe celui qui les transgresse, dans les sentiments d'hostilité du reste de la collectivité auxquels il s'expose. 3° Faire A est imposé par la nature même de l'individu, de telle sorte que s'il ne le fait pas, il en éprouve du remords, de la peine.
§ 1479. Les procédés suivants appartiennent aux dérivations : 4° On affirme simplement – bien qu'en réalité cela ne soit pas – que faire A sera utile à l'individu considéré ; ne pas faire A lui sera nuisible [FN: § 1479-1] . Ce procédé correspond au 1er quand les déductions ne sont pas logico-expérimentales. Il nous donne les tabous avec sanction spontanée, intrinsèque au tabou. Parmi les résidus employés dans ces dérivations, il y a surtout ceux même qui sont utilisés dans la Ire classe (affirmation) et la IIe classe (autorité) des dérivations. 5° Faire – ou ne pas faire – A, est imposé à l'individu par une puissance extérieure, moyennant une sanction, quand la puissance ou la sanction, ou toutes les deux sont irréelles. Ce procédé correspond au 2d, où puissance et sanction sont réelles. 6° On affirme, sans pouvoir le démontrer, que l'individu considéré éprouvera du remords, de la peine d'avoir fait ou de ne pas avoir fait A. Ce procédé correspond au 3e. Toutes ces dérivations sont d'une grande importance dans les sociétés humaines, car elles servent surtout à faire disparaître le contraste qui pourrait exister entre l'intérêt individuel et l'intérêt de la collectivité ; et l'un des procédés les plus employés pour atteindre ce but consiste à confondre les deux intérêts, grâce aux dérivations, à affirmer qu'ils sont identiques, et que l'individu, en pourvoyant au bien de sa collectivité, pourvoit aussi au sien propre (§ 1903 à 1998). Parmi les nombreuses dérivations qu'on emploie dans ce but, il y ajustement celles que nous examinons maintenant. L'identité indiquée des deux intérêts s'obtient spontanément par le 4e et le 6e procédés, ou grâce à l'intervention d'une puissance irréelle, par le 5e procédé.
§ 1480. Au chapitre III (§ 325 et sv.), nous avons classé les préceptes et les sanctions, eu égard surtout à la transformation des actions non-logiques en actions logiques (§ 1400). Voyons la correspondance des deux classifications. Les classes du chapitre III sont désignées par (a), (b), (c), (d). En (a), la démonstration n'existe pas ; (a) est donc exclue des dérivations ; elle a sa place parmi les résidus. En (b), la démonstration existe, mais a été supprimée. Si elle est rétablie, et dans la mesure où elle est rétablie, (b) fait partie des dérivations, pourvu qu'il s'agisse d'une démonstration pseudo-expérimentale ; en ce cas, (b) correspond au 4e procédé, ou bien aussi au 6e. Si la démonstration est logico-expérimentale, (b) correspond au 1er et aussi au 3e. En (c), il y a une sanction réelle, imposée par une puissance réelle ; nous sommes donc dans le cas du 2e procédé. En (d), ou la puissance, ou la sanction, ou toutes les deux sont irréelles ; par conséquent, celle classe correspond au 5e procédé. Voyons maintenant séparément le 4e, le 5e et le 6e procédés.
§ 1481. 4e procédé. Démonstration pseudo-expérimentale. Le type est le tabou avec sanction. Nous avons déjà parlé du tabou sans sanction (§ 321 et sv.). On admet que la transgression du tabou expose à de funestes conséquences, semblables à celles qui affligent celui qui transgresse la prescription de ne pas faire usage d'une boisson vénéneuse. Dans l'un et l'autre cas, il y a des remèdes pour se soustraire à ces conséquences. Pour le tabou, les conséquences et les remèdes sont pseudo-expérimentaux (4e procédé), et pour la prescription concernant le poison, ils sont expérimentaux (1er procédé). En parlant des résidus, nous avons vu (§ 1252-1) quels remèdes on emploie, à l’île Tonga, pour faire disparaître les conséquences fâcheuses d'une transgression du tabou. Nous traitions alors du rétablissement de l'intégrité de l'individu ; et, à ce point de vue, nous avons mis ensemble la transgression du tabou avec ses remèdes, et la transgression, par un catholique, des préceptes de sa religion ; transgression à laquelle il remédie par la confession et la pénitence. Mais sous l'aspect des dérivations que nous envisageons maintenant, ces deux transgressions doivent être séparées, parce que la première concerne des maux et des remèdes qui ont une forme réelle, bien que le fond soit pseudo-expérimental ; et la seconde concerne les maux d'une vie future, par conséquent irréels, et des remèdes spirituels, tels que la contrition et l'attrition du pécheur. De nouvelles dérivations viennent s'ajouter au simple tabou. Là où existe le concept d'un être surnaturel, on le met en rapport avec le tabou, de même qu'avec toute autre opération importante [FN: § 1481-1]. Puis l'action spontanée du tabou se change en une action provoquée artificiellement ; et sans attendre que les effets nuisibles de la transgression du tabou se produisent spontanément, le pouvoir public avise au châtiment des coupables.
§ 1482. S. Reinach [FN: § 1482-1] admet que le précepte biblique d'honorer son père et sa mère est un tabou qui, en somme, aurait été primitivement : « (p. 6) N'insulte pas (ne frappe pas, etc.) ton père ou ta mère, ou tu mourras ». C'est un effet spontané de l'action. De même aussi, toujours suivant Reinach (p. 4), toucher l'arche du Seigneur avait pour effet spontané la mort. Quand Ouzza meurt pour avoir touché l'arche, « (p. 4) ce n'est pas l'Éternel qui frappe l'innocent Ouzza ; c'est Ouzza qui commet une imprudence, analogue à celle d'un homme qui touche une pile électrique et meurt foudroyé ».
§ 1483. D'une part, ce genre de tabou est très fort, parce qu'il met en action, directement et sans développements subtils, les résidus des combinaisons (§ 1416, 3°) ; et de fait, on observe l'existence de semblables tabous, non seulement en des temps reculés, mais aussi en des temps plus récents [FN: § 1483-1] . D'autre part, de semblables sanctions précises des tabous sont exposées à être démenties par l'observation ; par conséquent, au fur et à mesure que l'emploi de la logique et de l'observation se propagent, ces tabous se transforment nécessairement ; d'abord en rendant l'existence de la sanction plus indéterminée, et par ce fait moins sujette à être démentie ; ensuite, grâce à une double transformation, dont une branche rejette la sanction dans un monde surnaturel, et sert tant au vulgaire qu'aux gens cultivés, et dont une autre accumule les nuages de la métaphysique autour de la sanction, si bien qu'elle devient incompréhensible, et que, par conséquent, on n'en peut démentir l'existence, puisque personne ne peut nier l'existence d'une chose inconnue.
Chez les anciens, la prospérité des méchants était un argument cher aux athées, pour prouver que les dieux n'existaient pas. Les chrétiens leur brisèrent cette arme dans la main, car personne n'est jamais revenu de l'enfer ou du paradis pour raconter ce que devenaient les méchants ou les justes, et, à vrai dire, le voyage de Dante et ceux du même genre dépassent le monde expérimental.
§ 1484. Le roi Rio-Rio abolit le tabou, à Haouaï, en montrant publiquement qu'on pouvait le transgresser sans aucun effet fâcheux [FN: § 1484-1]. Son expérience eut l'effet désiré parce qu'il s'agissait d'un effet physique ; mais elle n'aurait pu avoir lieu si l'effet imminent avait été surnaturel ou métaphysique.
§ 1485. Le tabou ni le précepte, avec sanction surnaturelle, ne doivent nous occuper ici ; nous n'avons pas à examiner non plus les théories qui, grâce à des sophismes verbaux ou autres, font en réalité disparaître l'intérêt individuel qu'on dit vouloir envisager (§ 1897 et sv.). Nous n'étudierons maintenant que les dérivations dont le caractère prépondérant est de réduire au principe de l'intérêt individuel des actions qui ne paraissent pas en dépendre.
§ 1486. Comme type de ces dérivations, on peut prendre la théorie de Bentham. Au premier abord, il semble que toute équivoque soit exclue, et que, sous le rapport de la précision, la théorie ne laisse rien à désirer. Bentham dit [FN: § 1486-1] : « (p. 4) Je suis partisan du principe d'utilité... lorsque j'emploie les termes juste, injuste, moral, immoral, bon, mauvais, comme des termes collectifs qui renferment des idées de certaines peines et de certains plaisirs, sans leur donner aucun autre sens : bien entendu que je prends ces mots, peine et plaisir, dans leur signification vulgaire, sans inventer des définitions arbitraires pour donner l'exclusion à certains plaisirs ou pour nier l'existence de certaines peines. Point de subtilité, point de métaphysique ; il ne faut consulter ni Platon, ni Aristote. Peine et plaisir, c'est ce que chacun sent comme tel ; le paysan, ainsi que le prince, l'ignorant ainsi que le philosophe ».
§ 1487. On ne peut être plus clair. Mais là surgit aussitôt le problème qui se pose toujours en de semblables théories : « Comment concilier ce principe de l'égoïsme absolu avec le principe de l'altruisme(§ 1479), auquel l'auteur ne veut pas renoncer ? » Tel s'en tire avec les sanctions d'une puissance terrestre ou ultra-terrestre ; tel autre change le sens des termes ; tel autre recourt aux subtilités, réprouvées par notre auteur ; tel autre enfin, posant quelque principe, retire la concession qu'il a faite. Cette dernière voie est celle que suit notre auteur.
§ 1488. Le premier procédé employé par Bentham consiste à recourir à l'approbation ou à la désapprobation d'autrui. Voilà que le principe altruiste est introduit. Mais cela ne suffit pas : il faut encore le concilier avec le premier principe. Dans ce but, Bentham affirme que la désapprobation d'autrui nuit à l'individu, et que, par conséquent, il est utile à celui-ci de l'éviter [FN: § 1488-1]. Ainsi, il nous retire la concession qu'il nous avait faite. Si l'on dit à un voleur : « Si l'on découvre ton vol, tu seras mal vu et tu en pâtiras »; il peut répondre : « En mettant dans la balance, d'un côté le plaisir que me procure l'objet que je veux dérober, de l'autre le mal probable que ce vol peut m'attirer, je trouve que le plaisir est plus grand que le mal ». Nous ne pouvons alors rien lui objecter, si nous ne voulons pas aller à l'encontre du principe que nous avons posé, à savoir que « peine et plaisir, c'est ce que chacun sent comme tel », et sans mériter le reproche que « il est absurde de raisonner sur le bonheur des hommes autrement que par leurs propres désirs et par leurs propres sensations ». On trouve une idée claire de cette théorie de Bentham dans un cas pratique imaginé par lui-même [FN: § 1488-2], et qui est justement un de ces récits qu'on fait aux enfants quand on les menace de l'ogre. La meilleure réfutation est celle qu'a faite Mark Twain (3), dans ses deux récits humoristiques du bon petit garçon et du méchant petit garçon.
§ 1489. Ce premier procédé de démonstration n'est donc pas très efficace, et il semble que le défaut n'en a pas complètement échappé à Bentham [FN: § 1489-1] . C'est pourquoi il a recours à un second procédé de démonstration, et invoque un autre principe : celui « du plus grand bonheur du plus grand nombre [FN: § 1489-2] ». Il mettait ainsi en action les résidus de la sociabilité (IVe classe). En de nombreux cas, ce principe s'oppose au premier ; et, en se servant des deux principes à la fois, on supprime, on ne résout pas le problème moral qu'on avait posé, et qui consiste précisément à trouver le moyen de concilier, dans ces cas, l'utilité pour l'individu avec l'utilité pour le plus grand nombre.
Nous sommes tombés par hasard sur l'un de ces problèmes, où l'on sent qu'il y a un certain maximum de bonheur ou d'utilité pour les individus particuliers, et un maximum aussi pour la collectivité. Mais, ainsi que toutes les intuitions, celle-ci laisse le sujet comme enveloppé d'un nuage. Nous tâcherons de le dissiper au chapitre XII, en essayant de préciser les notions.
§ 1490. Une application singulière, faite par Bentham, du principe du bien du plus grand nombre est celle de l'esclavage. Suivant l'auteur, on pourrait admettre cette institution, s'il y avait un seul esclave pour chaque maître. Après cela, on serait tenté de croire qu'il conclut à une législation dans ce sens. Au contraire, il veut que l'esclavage soit graduellement aboli. Ici l'on voit bien que la dérivation a un but prédéterminé auquel on doit arriver. Bentham, ou celui qui recueillit ses œuvres, ne dédaigne pas le secours des gens qui, invoquant l'autorité du plus grand nombre, en excluent leurs adversaires. Il dit : « (p. 323) Les propriétaires d'esclaves à qui l'intérêt personnel n'a pas ôté le bon sens et l'humanité, conviendroient sans peine des avantages de la liberté sur la servitude... [FN: § 1490-1] » Que viennent faire ici le bon sens et l'humanité, que Bentham avait proscrits ? Et puis, si le maître d'esclaves a de l'humanité, cela suffit pour abolir l'esclavage, et il était inutile de construire une théorie qui s'appuie exclusivement sur l'intérêt personnel [FN: § 1] .
§ 1491. Les difficultés que rencontre Bentham sont principalement les deux suivantes. 1° Il veut que toutes les actions soient logiques, et se place ainsi en dehors de la réalité, où beaucoup d'actions sont au contraire non-logiques [FN: § 1491-1] . 2° Il veut concilier logiquement des principes logiquement incompatibles, tel que le principe égoïste et le principe altruiste.
§ 1492. Je n'entends nullement m'occuper ici de la valeur intrinsèque de cette théorie ni d'autres quelconques (§ 1404); et les recherches sur l'accord de ces théories avec les faits visent uniquement les rapports des dites théories avec les dérivations. La valeur logico-expérimentale de la théorie de Bentham est fort mince ; cependant elle a joui d'un grand crédit. Comment cela est-il possible ? Pour le même motif que celui en vertu duquel d'autres théories semblables ont obtenu un tel succès ; c'est-à-dire parce qu'elles unissaient les résidus de l'intégrité personnelle et ceux de la sociabilité. Cela suffit : les gens ne regardent pas de si près à la manière dont les résidus sont unis, c'est-à-dire à la dérivation. Bentham inclinerait à faire rentrer les animaux dans « le plus grand nombre » de sa formule. De même aussi John Stuart Mill, qui estime que « le principe général auquel toutes les règles de la pratique [de la morale] doivent être conformes et le critérium par lequel elles doivent être éprouvées, est ce qui tend à procurer le bonheur dit genre humain, ou plutôt de tous les êtres sensibles... [FN: § 1492-1] ».
§ 1493. Une autre belle dérivation est celle de Spinoza, qui cherche, comme d'habitude, à concilier le principe égoïste avec le principe altruiste [FN: § 1493-1] : « Car si, par exemple, deux individus entièrement de même nature se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu deux fois plus puissant que chacun séparément. Rien donc de plus utile à l'homme que l'homme ; les hommes, dis-je, ne peuvent rien souhaiter qui vaille mieux pour la conservation de leur être, que de s'accorder tous en toutes choses [FN: § 1493-2] ». S'il y avait deux hommes affamés et un seul pain, ils s'apercevraient bientôt que rien n'est plus nuisible à un homme qu'un autre homme ; et l'homme qui se trouverait en présence d'un autre homme aimant la même femme que lui, aurait le même sentiment ; et l'affamé et l'amoureux souffriraient que d'autres hommes fussent de « même nature » qu'eux. Mais Spinoza va de l'avant, et dit que de ce principe il « suit que les hommes qui sont gouvernés par la Raison [on comprend que ceux qui ne sont pas de l'avis de Spinoza ne sont pas gouvernés par la Raison], c'est-à-dire que ceux qui cherchent ce qui leur est utile sous la conduite de la Raison, n'appètent rien pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes, et sont ainsi justes, de bonne foi et honnêtes ». Les dérivations changent ainsi de forme, mais le fond est toujours que pour faire son propre bien, il faut faire celui d'autrui [FN: § 1493-3] , et nous retrouvons ce principe dans la doctrine moderne de la solidarité.
§ 1494. Burlamaqui commence par trouver la sanction des lois naturelles dans les maux que le cours ordinaire des choses inflige à qui transgresse ces lois. Nous avons ainsi une dérivation semblable à celle de Bentham. Notre auteur continue et, en homme prudent, il estime qu'il ne faut pas se fier entièrement à dame Nature, pour qu'elle fasse respecter ses lois, cette bonne dame étant parfois distraite ; c'est pourquoi il ajoute la sanction d'une vie surnaturelle. De cette façon, voyageant en dehors du monde expérimental, il évite les objections qu'on pourrait lui faire dans ce monde [FN: § 1494-1].
§ 1495. D'autres auteurs, Pufendorf, Hobbes, Spinoza, Locke, voient une sanction des lois naturelles dans le fait que l'individu, s'il les transgresse, cause un dommage à la société et, par conséquent, à lui-même, en tant qu'il fait partie de la société. C'est bien ainsi, d'une façon générale (§ 2115 et sv.) ; mais il faut tenir compte de la somme de l'utilité directe pour l'individu, et de la somme des maux indirects. Au contraire, chez ces auteurs et chez d'autres, nous avons un raisonnement qu'on retrouve en un très grand nombre de dérivations, et qu'on pourrait appeler le sophisme de répartition. Voici en quoi il consiste. Soit un individu qui fait partie d'une collectivité, et qui accomplit une certaine action A, laquelle nuit à la société. On veut démontrer qu'en ne se préoccupant que de son intérêt personnel, il trouve avantage à s'abstenir de cette action. Pour cela, on observe que l'individu en question, faisant partie de la collectivité, aura sa part du dommage causé à cette collectivité ; et l'on conclut que l'action A lui est nuisible, que s'il l'accomplit, ce ne peut être que par ignorance. De là résulte le principe d'après lequel les erreurs des hommes sur ce qui constitue le bien sont l'origine de tout mal [FN: § 1495-1].
§ 1496. Voici en quoi consiste le sophisme : 1° On élimine la considération de la quantité d'utilité ou de dommage, en supposant que tous agissent d'une certaine façon, tous d'une autre ; et l'on ne s'occupe pas du cas où une partie agissent d'une façon, une partie d'une autre ; 2° On néglige cette considération et, poussant les choses à l'extrême, on tient compte seulement de l'utilité ou seulement du dommage. Admettons cependant que si tous les individus s'abstenaient de faire A, chacun, en tant qu'il fait partie de la collectivité, retirerait une certaine utilité. Maintenant, si tous les individus moins un continuent à ne pas faire A, l'utilité pour la collectivité diminuera peut-être très peu, tandis que cet individu obtient, en faisant A, une utilité particulière beaucoup plus grande que la perte qu'il éprouve comme membre de la collectivité. Si l'on n'aperçoit pas immédiatement ce sophisme, cela tient à un résidu qui, la plupart du temps, intervient implicitement, et qui donne naissance à la première partie, indiquée tout à l'heure, du sophisme. C'est-à-dire qu'on suppose, sans le dire, que tous les individus agissent comme celui qu'on envisage ; et, en ce cas, il ne reste, pour cet individu, que le dommage réparti ; l'utilité directe disparaît, au moins en grande partie. La réponse à faire à ce raisonnement serait que celui qui fait A ne désire pas du tout que les autres fassent de même ; mais on ne peut la donner, pour ne pas blesser le résidu de l'égalité. Soit, par exemple, un voleur. Nous voulons lui persuader que voler est contre son intérêt individuel. Dans ce but, nous lui faisons remarquer les dommages que la société, en général, éprouve par le fait de l'existence du vol, et nous lui montrons qu'il souffre sa part de ces dommages. Il y a les dépenses pour la police, pour les magistrats, pour les prisons, etc.; il y a le dommage du manque de sécurité, etc. Il est certain que si personne ne volait, la société en retirerait un avantage, et chacun de ses membres aurait sa part de cet avantage. Mais le voleur peut répondre : 1° L'avantage direct qui me vient du vol est plus grand que le dommage indirect que j'éprouve comme membre de la collectivité, spécialement si l'on considère que mon abstention du vol n'a pas pour conséquence que d'autres s'abstiennent également de voler ; 2° Il est vrai que si tout le monde ou un grand nombre de gens volaient, le dommage indirect, en beaucoup de cas, l'emporterait sur l'utilité directe ; mais je ne désire nullement que tous volent je désire, au contraire, fortement que tous soient honnêtes et moi seul voleur [FN: § 1496-1] .
§ 1497. Nous trouvons une dérivation semblable dans celle qui fut quelque temps en usage pour défendre la solidarité. On disait que tous les hommes sont mutuellement dépendants ; et même, pour donner plus de force à l'argument, on faisait ressortir la dépendance mutuelle de tous les êtres (§ 449) ; on observait que les animaux dépendent des végétaux, ceux-ci des minéraux, et l'on concluait que, chaque homme dépendant des autres, il ne peut réaliser son bonheur qu'en contribuant à celui des autres. L'énumération est incomplète. Outre le genre de dépendance où A réalise son bonheur en contribuant à celui de B, C..., il y a aussi le genre de dépendance où A réalise son bonheur au détriment de B, C... ; par exemple, le loup qui mange les moutons, le maître qui exploite ses esclaves [FN: § 1497-1] . Le raisonnement dont nous avons parlé tout à l'heure est puéril et ne peut être accepté que par des personnes déjà persuadées.
§ 1498. (III-γ) Intérêt collectif. Si cet intérêt est réel, et si l'individu accomplit logiquement des actions en vue de cet intérêt, il n'y a pas de dérivation : nous avons simplement des actions logiques dont le but est d'atteindre un résultat voulu par l'individu. Il existe des résidus (IVe classe) qui poussent cet individu à exécuter ces actions. Mais, le plus souvent, le but objectif diffère du but subjectif (§ 151), et nous avons des actions non-logiques qu'on justifie par des dérivations. Ce genre de dérivations est très usité par qui veut obtenir quelque chose et feint de le demander, non pour lui, mais pour une collectivité. Un certain nombre de politiciens veulent quelque chose pour eux-mêmes ; ils le demandent pour le parti, pour le pays, pour la patrie. Certains ouvriers veulent améliorer leur condition, et demandent une amélioration pour les « prolétaires », pour la «classe ouvrière ». Certains industriels veulent obtenir des faveurs du gouvernement pour leur industrie, et les demandent pour l’industrie en général, pour les travailleurs. Depuis plus d'un demi-siècle, les « spéculateurs » (§ 2235) ont déployé tant d'habileté qu'ils ont obtenu des faveurs toujours croissantes des pouvoirs publics, au nom de l'intérêt des classes laborieuses, ou même de « l'intérêt public ».
1499. Pour trouver des exemples de cette dérivation, il suffit de lire une partie seulement des innombrables écrits en faveur de la protection douanière, de l'augmentation des dépenses publiques, et de nombreuses mesures par lesquelles les « spéculateurs » s'approprient l'argent de ceux qui ont des recettes fixes ou presque fixes, des « rentiers » (§ 2235). En politique, toutes les classes dominantes ont toujours confondu leur intérêt avec celui du pays entier. Quand les politiciens craignent l'augmentation excessive du nombre des prolétaires, ils sont malthusiens et démontrent que c'est dans l'intérêt du public et du pays. Quand ils craignent, au contraire, de ne pas avoir une population suffisante pour leurs desseins, ils sont anti-malthusiens, et démontrent également bien que c'est dans l'intérêt du public et du pays. Tout cela est accepté, tant que durent les résidus favorables à de telles dérivations ; tout cela est changé, lorsqu'ils se modifient ; jamais en vertu de raisonnements.
§ 1500. Ce genre de dérivations est si connu que l'idée est commune d'y faire rentrer presque tous les autres. On suppose explicitement ou implicitement que celui qui fait usage de raisonnements défectueux est de mauvaise foi, et qu'il emploierait de bons raisonnements s'il était de bonne roi. Cela est en dehors de la réalité. On peut fort bien s'en rendre compte par le grand nombre de dérivations importantes, voire très importantes, que nous exposons dans ce chapitre.
§ 1501. (III-δ) Entités juridiques. L'homme qui vit dans les sociétés civilisées se familiarise avec certaines relations morales ou juridiques qui façonnent, pour ainsi dire, son existence, dont s'imprègne son esprit, et qui finissent par faire partie de sa mentalité ; puis, par la persistance des agrégats, par la tendance à donner un caractère absolu à ce qui est relatif, il les étend au delà des limites entre lesquelles elles peuvent avoir une valeur. Elles n'étaient applicables qu'à certains cas et à certaines circonstances, et il les applique à n'importe quel cas, quelle circonstance. De cette façon prennent naissance la conception d'une morale absolue et celle d'un droit absolu. Ensuite, l'homme dont nous parlons suppose que ces relations, nées et développées avec la société, ont préexisté à celle-ci, qui en tire son origine. Ainsi surgissent les théories du « pacte », du « contrat social », de la « solidarité », avec son annexe, la « dette sociale », de la « paix par le droit », etc. Non content de cela, il étend aux animaux, aux êtres vivants en général, même aux inanimés, les relations juridiques et morales qui existent entre les hommes. Il va même jusqu'à étendre aux choses le pouvoir que la parole a parfois sur les hommes. De là l'idée des charmes magiques ; et la parole devient un puissant moyen d'agir sur les choses ; elle fait mouvoir et arrête les astres mêmes. Dans ces phénomènes, les résidus (I-β 1) entrent en jeu. Grâce à eux, certaines analogies, vraies ou supposées, nous poussent à étendre à un objet les caractères et les propriétés d'un autre objet. Le fond de ces phénomènes est donné par la persistance des agrégats, la forme par les dérivations au moyen desquelles on tâche de donner une apparence logique à ces actions non-logiques. Comme d'habitude, dans les phénomènes concrets, on a un mélange de différentes actions non-logiques, de dérivations et d'actions logiques par lesquelles ou cherche à tirer profit des actions non-logiques existantes ; mais cela revient à démontrer l'existence de ces actions non-logiques, car on ne peut utiliser ce qui n'existe pas, ni en tirer profit. Étant donnée la persistance des agrégats, par laquelle les hommes étendent les relations juridiques à des cas dans lesquels elles n'ont rien à faire, il est des personnes qui se prévalent de cette persistance pour parvenir à leurs fins ; mais il est évident qu'elles ne pourraient le faire, si cette persistance n'existait pas. Les gens habiles emploient les moyens qu'ils trouvent. Au moyen âge, ils profitaient des procès aux morts et aux animaux ; aujourd'hui, ils profitent des déclamations sur la « solidarité » ; demain, ils trouveront un autre expédient. Dans l'histoire, nous voyons des peines juridiques infligées à des êtres qui ne sont pas des hommes vivants : à Athènes, chez les anciens Hébreux, dans nos pays, au moyen âge, et même en des temps plus récents. Comme d'habitude, si nous ne connaissions qu'un seul genre de ces faits, nous demeurerions dans le doute sur la partie à considérer comme constante (résidus), et la partie à considérer comme variable (dérivations) ; mais le doute disparaît quand nous prêtons attention aux différents genres qui nous sont connus, et nous voyons que les dérivations d'un genre ne sont pas employées pour les autres genres. À Rome, la persistance des agrégats qui agit, paraît être principalement celle des rapports du chef de famille avec les liberi qui sont en son pouvoir [FN: § 1501-1], ou avec les esclaves ; et si nous ne connaissions que des faits de ce genre, nous ne pourrions affirmer que des actions juridiques ont été étendues aux animaux. Mais voici qu'à Athènes, apparaît l'action contre les animaux, indépendamment de leur propriétaire ; et même quand le procès est dirigé contre celui-ci, la personnalité de l'animal apparaît plus nettement [FN: § 1501-2] . On fait aussi procès contre les choses inanimées ; et Démosthène, s'opposant au décret qui voulait condamner sans jugement quiconque aurait tué Caridème, compare clairement le jugement des choses inanimées à celui des hommes, et dit qu'on ne peut ôter à ceux-ci une garantie qu'on accorde à celles-là [FN: §1501-3] . Une loi qu'on attribuait à Dracon [FN: § 1501-4] prescrivait de jeter hors des frontières le bois, les pierres, le fer qui, en tombant, auraient tué un homme. Platon reproduit cette loi, à l'instar d'autres lois anciennes, dans son livre sur Les Lois[FN: § 1501-5]. Aux choses inanimées, il ajoute les animaux qui auraient tué un homme ; et il faut remarquer que le cadavre du parricide doit, exactement de la même façon, être jeté hors des frontières de l'État. Pausanias raconte [FN: § 1501-6] qu'à Thasos un rival de Théagène allait toutes les nuits frapper la statue de celui-ci. La statue, pour punir cet homme, tomba sur lui et le tua. « Les fils du mort ouvrirent une action en homicide contre la statue. Les Thasiens jetèrent la statue à la mer, suivant une loi de Dracon... » Mais ensuite leur pays devint stérile, et l'oracle de Delphes en donna pour cause qu'ils avaient oublié le plus grand de leurs concitoyens ; aussi recherchèrent-ils la statue et la replacèrent-ils là où elle était primitivement. Que tout cela soit de la fable ou une légende issue de quelque fait historique, peu importe, puisque nous avons à prêter attention uniquement aux sentiments de ceux qui composèrent et de ceux qui accueillirent le récit ; et chez ces personnes apparaît avec évidence la persistance (les agrégats, en vertu desquels nous voyons une statue avoir des rapports juridiques analogues à ceux d'un homme. Enfin, nous avons, à Athènes, le procès fictif pour le meurtre du bœuf [FN: § 1501 note 7] ; où l'on peut voir, si l'on veut, des phénomènes de totémisme, mais où apparaît certainement aussi l'extension aux animaux des relations juridiques fixées pour les hommes. Pline raconte [FN: § 1501-8] qu'en Afrique on mettait en croix des lions pour effrayer les autres. Dans la Bible, on trouve plusieurs passages qui font clairement allusion à l'extension aux animaux de relations juridiques s'appliquant aux hommes [FN: § 1501 note 9].C'est de ces passages qu'aux siècles passés on tira en partie les dérivations ayant pour but de justifier cette extension ; tandis que d'un autre côté il ne manqua pas de gens qui, par d'ingénieuses dérivations, s'efforcèrent de donner un sens logique à ces passages. Le procès fait au cadavre du pape Formose [FN: § 1501-10] est demeuré célèbre. « (p. 274) Un jugement solennel contre Formose fut ordonné : (p. 275) le mort fut cité à comparaître en personne devant le tribunal d'un Synode [nous verrons plus loin qu'on citait de la même manière les animaux]. C'était en février ou en mars de l'an 897... Les Cardinaux, les Évêques et beaucoup d'autres dignitaires du clergé s'assemblèrent en synode. Le cadavre du pape, arraché à la tombe où il reposait depuis huit mois, fut revêtu des ornements pontificaux et déposé sur un trône, dans la salle du concile. L'avocat du pape, Stéphane, se leva, se tourna vers cette momie horrible, aux côtés de laquelle siégeait un diacre tremblant qui devait lui servir de défenseur [les animaux auront aussi leur avocat] ; il porta les accusations, et le pape vivant, avec une fureur insensée, demanda au mort : « Pourquoi, homme ambitieux, as-tu usurpé la chaire apostolique de Rome, toi qui étais déjà évêque de Porto ? » L'avocat de Formose parla, dans sa défense, pour autant que la frayeur ne lui paralysa pas la langue. Le mort demeura convaincu et fut jugé [ainsi demeureront convaincus et jugés les animaux]. Le Synode signa le décret de déposition, et prononça la sentence de condamnation ». L'Inquisition fit aussi de nombreux procès aux morts. Le but était de s'emparer des biens laissés par eux à leurs héritiers ; le moyen était les préjugés populaires, parmi lesquels l'extension aux morts des relations juridiques des vivants n'était pas le dernier.
§ 1502. Dans nos contrées, les procès contre les animaux durent du XIIe, et même avant, jusqu'au XVIIIe siècle. Berriat Saint-Prix a compilé un catalogue de ces procès, principalement en France [FN: § 1502-1]. Une partie eurent lieu devant les tribunaux laïques, une partie devant les tribunaux ecclésiastiques. La procédure devant le tribunal civil était la même que si l'accusé avait été un être humain [FN: § 1502-2]. Même devant les tribunaux ecclésiastiques, on procédait de cette manière ; mais, en de nombreux cas, la procédure apparaît comme une adjonction, un moyen d'éviter de frapper des innocents des foudres de l'Église ; et nous avons des cas où l'on fait allusion seulement à ces innocents, et pas à l'Église [FN: § 1502-3]. Puis, sous l'action du sentiment qui étendait aux animaux les rapports juridiques, on voulut que le procès précédât la sentence. Des motifs accessoires contribuèrent ensuite à faire traîner le procès en longueur : d'abord le profit qu'en retiraient les hommes de loi ; ensuite, en des temps où le scepticisme allait croissant, il se peut que les autorités ecclésiastiques ne fussent pas entièrement persuadées de l'efficacité qu'avaient les foudres de l'Église pour détruire les animaux, et qu'il ne leur déplût point que, le procès traînant en longueur, les animaux disparussent naturellement, sans attendre d'être frappés d'excommunication. Autrement, il serait difficile de comprendre les longueurs de procès comme celui sur lequel Menabrea nous fournit d'amples renseignements [FN: § 1502-4]. Cet auteur nous donne d'autres exemples des dérivations qui se manifestaient dans ces procès. « (p. 100) Une procédure faite en 1451... dans le but d'expulser les sangsues qui infestaient les eaux du territoire de Berne..., nous fournit des détails très curieux touchant le mode en usage pour la citation. On envoyait un sergent ou huissier sur le local où se tenaient les insectes, et on les assignait à comparaître personnellement tel jour, à telle heure, par-devers le magistrat, aux fins de s'ouïr condamner à vider dans un bref délai les fonds usurpés, sous les peines du droit. Les insectes ne paraissant pas, on renouvelait volontiers jusqu'à trois fois l'assignation, pour que la contumace fût mieux établie... Comme on peut bien se l'imaginer, les défendeurs (p. 101) faisaient toujours défaut... on nommait donc un curateur ou un procurateur aux bestioles. Cet officier jurait de remplir ses fonctions avec zèle, avec loyauté ; on lui adjoignait ordinairement un avocat. C'est en servant de défenseur aux rats du diocèse d'Autun, que le fameux jurisconsulte Barthélemy Chassanée, qui mourut premier président du parlement de Provence, commença sa réputation... Quoique les rats eussent été cités selon les formes, il fit tant qu'il obtint que ses clients seraient de rechef assignés par les curés de chaque paroisse, attendu, disait-il, que la cause intéressant tous les rats, ils devaient tous être appelés. Ayant gagné ce point, il entreprit de démontrer que le délai qu'on leur avait donné était insuffisant ; qu'il eût fallu tenir compte non seulement de la distance des lieux, mais encore de la difficulté du voyage, difficulté d'autant plus grande que les chats se tenaient aux aguets et occupaient les moindres passages ; bref, amalgamant la Bible aux auteurs profanes, amoncelant textes sur textes, et épuisant les ressources de l'érudite éloquence de ce temps-là, il parvint à faire (p. 102) proroger le terme de la comparution. Ce procès rendit Chassanée fort recommandable ».
§ 1503. Tout cela nous semble ridicule ; mais qui sait si, dans quelques siècles, les élucubrations de notre temps sur la solidarité ne seront pas tout aussi ridicules, et si l'invention de M. Bourgeois, d'une dette qui, à chaque instant s'éteint et à chaque instant renaît, ne semblera pas digne de figurer à côté de la défense des rats, soutenue par Chassanée. Il ne manquait pas de jurisconsultes et de théologiens qui estimaient qu'on ne pouvait étendre aux bêtes les procédures instruites contre les êtres raisonnables, et parmi les théologiens, nous ne trouvons rien moins que Saint Thomas [FN: § 1503-1]. Mais tout cela ne suffit pas à empêcher ces procédures ; de même que de nos jours rien ne sert d'avoir montré le manque de sens du « contrat social », de la doctrine de la « solidarité », de la « paix par le droit », de la Christian Science, et d'autres semblables théories fantaisistes, pour empêcher qu'on ne continue à employer ces dérivations [FN: § 1503-2] . Comme d'habitude, l'homme voit la paille qui est dans l'œil de son prochain et pas la poutre qui est dans le sien.
§ 1504. Les dérivations changent de forme pour s'adapter aux circonstances, le but qu'elles doivent atteindre restant le même. Parmi ceux qui estiment que la société humaine est née d'une convention, d'un pacte ou d'un contrat, plusieurs théoriciens ont parlé comme s'ils décrivaient un phénomène historique : un beau jour, des hommes qui ne vivaient pas encore en société se seraient assemblés quelque part, et auraient constitué la société, tout comme on voit aujourd'hui des hommes s'assembler pour constituer une société commerciale.
§ 1505. Cette conception apparaissant manifestement absurde, on a cherché à la rendre quelque peu raisonnable en abandonnant le domaine de l'histoire, et l'on a dit que les relations qui constituent la société existent, non parce que cette constitution a été effectivement établie par des hommes ne vivant pas encore en société, mais parce que ces relations doivent exister comme si cette constitution s'était réalisée [FN: § 1505-1] . Par exemple, c'est la façon dont les fidèles de Rousseau défendent maintenant les théories de leur maître. Mais, qu'on place le contrat social à l'origine des sociétés, au milieu ou à leur terme, il n'en demeure pas moins que les parties contractantes disposent de choses qui ne sont pas en leur pouvoir, puisque l'homme est un animal sociable qui ne peut vivre seul, sauf peut-être en des cas exceptionnels où il se trouverait réduit à une extrême misère. C'est pourquoi, au point de vue de la logique formelle, le raisonnement ne tient pas, même sous sa forme nouvelle.
§ 1506. Ensuite, on ne comprend pas pourquoi il ne s'applique pas aussi aux sociétés animales, comme celles des fourmis et des abeilles. Si nous supposons que seul le raisonnement et les déductions logiques peuvent conserver la société humaine, en empêcher la dissolution, comment expliquerons-nous que les sociétés des fourmis et des abeilles durent et se conservent ? Si, au contraire, nous admettons que ces sociétés sont maintenues par l'instinct, comment pourrons-nous nier que cet instinct joue aussi un rôle dans les sociétés humaines ?
§ 1507. La théorie de Rousseau est au fond celle de Hobbes ; mais, ainsi qu'il arrive d'habitude avec les dérivations, l'un de ces auteurs aboutit à une conclusion opposée à celle de l'autre. Aujourd'hui, c'est la théorie de Rousseau qui est en vogue, parce que nous vivons à une époque démocratique ; demain, la théorie de Hobbes pourrait prévaloir, si des temps favorables au pouvoir absolu revenaient ; et quand viendrait un temps favorable à une autre organisation sociale, on aurait bientôt fait de trouver la dérivation qui, toujours en partant de l'hypothèse du contrat social, aboutirait à des conclusions s'adaptant à cette organisation. Le point de départ et le point auquel on doit arriver sont fixes, parce qu'ils correspondent à certains résidus qui forment la partie constante du phénomène; avec un peu d'imagination, on trouve facilement une dérivation qui unisse ces points. Si une dérivation ne plaît pas, on en trouve d'autres, et pourvu qu'elles s'accordent avec certains résidus existant chez les hommes auxquels on s'adresse, il est à peu près certain qu'ils l'accueilleront favorablement.
§ 1508. Dans ce genre de dérivations, il faut ranger les théories de « la paix par le droit ». On a l'habitude d'objecter à ces théories que le droit sans la force qui l'impose n'a que peu ou point de valeur, et que si l'on fait emploi de la force, la guerre, chassée d'un côté, revient de l'autre. Cette objection ne se soutient qu'en partie. 1° De nombreuses règles de la vie sociale sont imposées sans qu'on fasse emploi de la force ; et il n'est pas absurde d'admettre que, sinon toutes les règles d'un certain droit international, au moins une partie d'entre elles sont imposées par l'opinion publique, par des sentiments existant chez les individus ; c'est ce qui arrive partiellement, en réalité. 2° La guerre ne disparaîtrait pas, mais deviendrait plus rare, quand une force internationale imposerait un certain droit ; de même que les actes de violence diminuent dans une société où la force du pouvoir public s'impose aux particuliers. D'un plus grand poids, et de beaucoup, est l'objection qui vise le terme de droit, lequel, dans ce cas, ne correspond à rien de précis. Les différents peuples dits civilisés occupent des territoires par la force, et il n'est pas possible de trouver un autre motif pour justifier les répartitions territoriales actuelles. Les justifications qu'on a tenté de donner se résolvent en des sophismes souvent puérils. Si la Pologne avait été plus forte que la Prusse, comme elle le fut aux temps passés, elle aurait pu conquérir la Prusse ; ayant été plus faible que la Prusse unie à la Russie et à l'Autriche, elle fut conquise par ces trois puissances. Si la Russie avait été plus forte que le Japon, elle aurait conquis la Corée ; au contraire, le Japon se l'est appropriée par la force des armes. Cela seul est réel ; le reste n'est que vain discours [FN: § 1508-1].
§ 1509. De même, pour les différentes classes sociales, il est impossible de trouver un droit capable de distribuer entre elles la richesse sociale. Les classes qui ont plus de force, d'intelligence, d'habileté, de ruse, etc., que d'autres, se font la part du lion. On ne voit pas comment on pourrait démontrer des principes d'une autre répartition, et surtout pas comment, si on les avait démontrés, on pourrait les imposer et les appliquer dans la vie réelle. Chaque homme a certainement son principe d'une répartition idéale pour lui : principe qui souvent n'est que l'expression de ses sentiments et de ses intérêts individuels ; et c'est ce principe qu'il s'imagine être le droit. Telle est la dérivation habituelle au moyen de laquelle on change le nom pour faire accepter la chose.
§ 1510. (III-ε) Entités métaphysiques. Dans ces dérivations, on recherche l'accord avec certaines unités étrangères au domaine expérimental. Au fond, c'est un accord de sentiments qui agit, une combinaison de résidus ; mais la forme est donnée par l'intervention de ces entités, qui sont étrangères à l'expérience, sans être surnaturelles. Pour dériver, on emploie principalement les résidus (II-δ), (II-thêta), auxquels, comme d'habitude, on en ajoute d'autres, dans les différents cas particuliers. Au point de vue logico-expérimental, il y a peu ou point de différence entre ces dérivations et celles qui font intervenir des divinités personnifiées [FN: § 1510-1] .
§ 1511. Les dérivations métaphysiques sont principalement à l'usage des gens cultivés. Le vulgaire, du moins dans nos pays, est porté à revenir de ces abstractions aux personnifications. Sans doute, il serait absurde de croire que, parmi nos contemporains, il y a des gens qui se représentent la Solidarité sous la forme d'une belle femme, comme les Athéniens se représentaient la déesse Athéna. Cependant, pour notre vulgaire, la Solidarité, le Progrès, l'Humanité, la Démocratie, ne figurent pas dans la même classe que de simples abstractions, telles qu'une surface géométrique, l'affinité chimique, l'éther lumineux [FN: § 1511-1] : elles sont dans des régions beaucoup plus élevées ; ce sont des entités puissantes, et qui font le bien du genre humain.
§ 1512. Dans ce domaine, l'évolution d'Auguste Comte est très remarquable. Il est poussé par une force irrésistible à attribuer des caractères concrets à ses abstractions, et va jusqu'à personnifier l'Humanité sous la forme du Grand-Être, à parler de la Terre, comme si elle était une personne, et à recommander l'adoration de l'espace sous la forme du Grand Milieu. Comme nous l'avons déjà observé (§ 1070 et sv.), ces sentiments constituent un agrégat confus dans l'esprit de nombreuses personnes, qui ne se préoccupent nullement de le diviser en ses parties aliquotes, ni de savoir où finit l'abstraction et où commence la personnification.
§ 1513. On trouve cette dérivation dans tous les raisonnements où l'on invoque la Raison, la Droite Raison, la Nature, les fins de l'homme ou d'autres fins semblables, le Bien, le Souverain Bien, le Juste, le Vrai, le Bon, le Droit, et maintenant spécialement la Science, la Démocratie, la Solidarité, l'Humanité, etc. Ce ne sont que des noms qui indiquent des sentiments indistincts et incohérents.
§ 1514. Il est une entité célèbre : l'entité métaphysique imaginée par Kant et admirée encore par tant de gens. Elle s'appelle Impératif catégorique [FN: § 1514-1]. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent savoir ce que c'est, mais ils ne réussissent malheureusement pas à le faire comprendre à ceux qui veulent rester dans la réalité. La formule de Kant concilie, comme d'habitude, le principe égoïste avec le principe altruiste, qui est représenté par la « loi universelle ». Celle ci flatte les sentiments d'égalité, de sociabilité, de démocratie. Enfin, beaucoup de gens ont accepté la formule kantienne pour conserver la morale usuelle, tout en se soustrayant à la nécessité de la placer sous la dépendance d'un dieu personnel. On peut faire dépendre cette morale de Jupiter, du Dieu des chrétiens, de celui de Mahomet, de la volonté de cette respectable dame qui porte le nom de Nature, ou de l'éminent Impératif catégorique : cela revient au même. Kant donne encore une autre forme à sa formule : « (p. 60) N'agis que d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Le caractère habituel de ces formules est d'être si indéterminées qu'on peut en tirer tout ce qu'on veut ; aussi aurait-on plus vite fait de dire : « Agis comme il plaît à Kant et à ses disciples », puisque, de toute façon, la « loi universelle » finira par être éliminée.
§ 1515. La première question qui se pose, quand on cherche à comprendre quelque chose à ces termes de la formule, est de savoir si 1° la « loi universelle» dépend de quelque condition ; ou bien si 2° elle ne dépend d'aucune condition. Autrement dit, cette loi doit-elle s'exprimer dans les sens suivants : 1° Tout homme qui a les caractères M doit agir d'une certaine façon ? Ou bien : 2° Tout homme, quels que soient ses caractères, doit agir d'une certaine façon ?
§ 1516. Si l'on accepte la première façon de s'exprimer, la loi ne signifie rien, et la difficulté consiste maintenant à fixer les caractères M qu'il convient d'envisager ; car si l'on s'en remet à l'arbitraire de celui qui doit observer la loi, il trouvera toujours moyen de choisir des caractères tels qu'il puisse faire tout ce qu'il veut, sans transgresser la loi. S'il veut justifier l'esclavage, par exemple, il dira comme Aristote qu'il y a des hommes nés pour commander (parmi lesquels, bien entendu, se trouve le digne interprète de la loi) et d'autres hommes nés pour obéir. S'il veut voler, il dira que le principe d'après lequel celui qui possède moins prend à celui qui possède davantage, peut fort bien être une loi universelle. S'il veut tuer son ennemi, il dira que la vendetta peut très bien être une loi universelle ; et ainsi de suite.
§ 1517. Par la première application qu'il fait de son principe, il semblerait que Kant repousse cette interprétation [FN: § 1517-1]. Sans faire de distinctions d'individus, il recourt au principe suivant lequel le suicide ne pourrait être une loi universelle de la nature.
§ 1518. Voyons maintenant la seconde manière d'interpréter la loi, manière suivant laquelle le raisonnement de Kant, cité tout à l'heure, pourrait tant bien que mal être soutenu. Il y a une autre difficulté : c'est que, pour appliquer la formule, toute la race humaine devrait constituer une masse homogène, sans la moindre différenciation dans les emplois des individus. Il est possible, si l'on fait des distinctions, que certains hommes commandent et que d'autres obéissent ; c'est impossible si l'on ne fait pas de distinctions ; car il ne peut y avoir une loi universelle d'après laquelle tous les hommes commandent si aucun n'obéit. Un homme veut passer sa vie à étudier les mathématiques. Si l'on fait des distinctions, il peut le faire sans transgresser la loi kantienne, car il peut bien y avoir une loi universelle d'après laquelle celui qui possède certains caractères M, passe sa vie dans l'étude des mathématiques, et celui qui ne possède pas ces caractères cultive les champs ou fait autre chose. Mais si l'on ne veut pas de distinctions, si l'on ne veut pas, ainsi qu'on ne l'a pas voulu dans le cas du suicide, séparer les hommes en classes, il ne peut y avoir une loi universelle d'après laquelle tous les hommes passent leur vie à étudier les mathématiques, ne serait-ce que parce qu'ils mourraient de faim, et par conséquent personne ne doit passer sa vie à cette étude. On n'aperçoit pas ces conséquences, parce qu'on raisonne avec le sentiment, et non en se plaçant en présence des faits.
§ 1519. Comme le font souvent les métaphysiciens, Kant, après nous avoir donné un principe qui devrait être unique – à ce qu'il dit – en ajoute ensuite d'autres qui surgissent on ne sait d'où.
Le troisième cas considéré par Kant est le suivant : « (p. 63) Un troisième se reconnaît un talent [là, nous trouvons des conditions dont on ne parlait pas dans le cas de l'homme qui se suicide ; pourquoi n'a-t-on pas dit alors : Un individu se reconnaît un tempérament tel que pour lui la vie est souffrance et non bonheur ?] qui peut, au moyen de quelque culture, le rendre un homme propre à toutes sortes d'emplois. Mais il se trouve dans des circonstances honorables, et préfère s'adonner au plaisir, au lieu de prendre la peine d'étendre et de perfectionner ses heureuses dispositions [FN: § 1519-1] ». Il veut savoir si cela peut être une loi naturelle. La réponse est affirmative, au moins sous un certain aspect. « (p. 63) Il aperçoit alors qu'à la vérité une nature est compatible encore avec une telle loi, fût-elle universelle, bien que l'homme (comme les habitants des îles de la mer du Sud) laissât ses talents sans culture et ne songeât qu'à passer sa vie dans l'oisiveté, les amusements, les plaisirs... [FN: § 1519-2] ». Donc, il paraîtrait, si nous voulons rester strictement attachés à la formule qu'on nous a donnée pour unique, que la chose pouvant être une loi universelle, est licite. Mais, au contraire, il n'en est pas ainsi : « (p. 64) ... mais il est impossible qu'il puisse vouloir que ce soit là une loi universelle de la nature, ou qu'elle eût été mise en nous comme telle par l'instinct naturel [dans la formule, on ne nous parle pas de cet instinct naturel]. En effet un être raisonnable veut nécessairement que toutes ses facultés soient développées en lui, parce qu'elles lui sont toutes données pour lui servir à atteindre toutes sortes de fins [FN: § 1519-3] ». Voilà un nouveau principe : certaines choses données [on ne sait par qui] en vue de certains buts.
Pour raisonner de cette façon, il faut modifier la formule de Kant et dire : « N'agis que d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. D'autre part, ne te laisse pas tromper par cet adjectif possessif ta ; dire ta volonté, ce n'est qu'une façon de parler ; en réalité, c'est la volonté qui doit nécessairement exister chez l'homme, tout compte fait de ce qui lui a été donné, de ses fins et d'autres belles choses qui seront indiquées en temps et lieu ». Cela posé, on pourrait aussi se passer, au point de vue logico-expérimental, de la volonté, puisqu'elle est de toute façon éliminée. Mais il n'en est pas ainsi au point de vue du sentiment. Cette invocation à la volonté est nécessaire pour avoir l'appui du sentiment égoïste, et donner, à celui qui écoute, la satisfaction de concilier ce sentiment avec le sentiment altruiste.
D'autres sentiments sont aussi éveillés par ce principe de la « loi universelle ». D'abord celui d'une règle absolue, imposée par la Nature, dominant la mesquinerie des conflits humains, dépassant les discussions captieuses. Puis cet agrégat de sentiments qui nous font voir confusément l'utilité qu'il y a à ce que les sentences des juges soient motivées, qu'elles invoquent des règles générales, que les lois soient aussi faites suivant ces règles, et non pour ou contre un individu donné.
§ 1520. Remarquons en passant que cette utilité existe réellement, car cet état de choses met aussi un frein au caprice, comme le ferait la règle de Kant ; mais cette utilité n'est pas très grande, puisque, si l'on veut, on trouve toujours moyen de donner une apparence de généralité à une décision particulière. Si, parmi A, B, C, ... on veut favoriser ou léser A, on cherche, et l'on trouve toujours, un caractère par lequel A diffère de B, C, ... et l'on décide en considérant ce caractère, par conséquent avec une apparence de généralité. Laissons de côté l'autre manière, très en usage, de décider en général et d'appliquer en particulier, avec ou sans indulgence. Ainsi, dans nos lois, on trouve encore celle qui punit l'agression en général ; mais en particulier on ferme un œil et même les deux sur les agressions commises par les grévistes au détriment des « renards ».
En Italie, avant la guerre de 1911, on laissait insulter impunément les officiers. Un député put diffamer un officier, pour des motifs exclusivement d'ordre privé, qui n'avaient rien de politique, et, bien que condamné par les tribunaux, il ne fit jamais un jour de prison, pas même après son échec aux nouvelles élections. La guerre venue, on sauta de l'autre côté de la selle. Des personnes furent injuriées et frappées impunément, uniquement parce qu'elles ne se levaient pas quand on jouait la Marche royale, à la Scala de Milan.
§ 1521. Les théologiens scrutent la volonté de Dieu, et Kant scrute celle de la Nature. D'une manière ou de l'autre, nous n'échappons pas à ces investigations, aussi profondes que difficiles et imaginaires.
« (p. 14) Nous admettons comme principe qu'on ne trouve dans la nature d'un être organisé, c'est-à-dire d'un être destiné à vivre de manière à atteindre une fin, aucun organe qui ne soit merveilleusement approprié à cette fin [FN: § 1521-1]. [C'est là une réminiscence de la célèbre théorie des causes finales]. Si donc un être doué de la raison et de la volonté est chargé de sa conservation, de l'accroissement de son bien-être, en un mot, de son bonheur, et que ce soit là proprement la fin que la nature [qu'est-ce que cette entité ?] lui destine, on devrait alors trouver en lui une disposition conforme à cette fin. [Ce ne sont là que des affirmations arbitraires sur la fin arbitraire d'une entité arbitraire]. Mais il semble que cette créature serait très défectueuse si la nature avait chargé sa raison d'atteindre elle-même le but qu'elle lui destine [FN: § 1521-2] [cela pourrait être favorable à la théorie des actions non-logiques] ».
Tout ce raisonnement procède par affirmations arbitraires sur des choses fantaisistes ; il est véritablement puéril. Et pourtant beaucoup de personnes l'ont accepté et l'acceptent ; aussi est-il évident qu'elles ne peuvent être mues que par des sentiments que cette poésie métaphysique excite agréablement. Cela confirme, une fois de plus, l'importance des dérivations ; cette importance n'est pas du domaine de l'accord d'une théorie avec les faits, mais bien de celui de l'accord de cette théorie avec les sentiments.
§ 1522. D'une façon générale, ainsi que nous l'avons souvent répété, il ne faut pas s'arrêter à la forme des dérivations, mais rechercher dans le fond qu'elles recouvrent s'il y a des résidus qui ont quelque importance pour l'équilibre social. Aux nombreux exemples déjà donnés, nous ajoutons le suivant, et ce ne sera pas le dernier.
En août 1910, l'empereur allemand fit, à Kœnigsberg, un discours dont on parla beaucoup. Il disait :
« Ici, de sa propre autorité, le Grand Électeur s'est proclamé souverain ; ici, son fils a posé sur sa tête la couronne royale ; ici, mon grand-père, toujours de sa propre autorité, a posé sur sa tête la couronne royale de Prusse, démontrant clairement qu'il ne la recevait pas d'un parlement ni d'une assemblée populaire, mais qu'il recevait son pouvoir de la grâce de Dieu, qu'il se considérait comme l'exécuteur de la volonté du Ciel, et qu'en cette qualité, il croyait avoir le droit de porter la couronne impériale... Nous devons être prêts, considérant que nos voisins ont fait d'énormes progrès ; seule, notre préparation assurera la paix. C'est pourquoi je suis mon chemin, exécuteur, moi aussi, de la volonté divine, sans me soucier des mesquineries de la vie quotidienne, vouant ma vie au bien-être et au progrès de la patrie, et à son développement dans la paix. Mais pour faire cela, j'ai besoin du concours de tous mes sujets ».
Nous avons, dans ce discours, une dérivation du genre (III-γ).
Les partis d'opposition s'élevèrent contre ce discours, et l'accusèrent d'être « un cri de guerre contre le peuple et la représentation populaire », en parfaite contradiction avec la « conception moderne de l'État », une invocation du principe suranné du droit divin, opposé au « principe moderne du droit du peuple ». Ce sont là autant de dérivations du genre (III-δ), avec une tendance vers le genre (III-γ) le « droit du peuple » n'étant pas très différent du « droit divin » des rois.
§ 1523 Nous ne devons pas nous laisser-induire en erreur par le terme peuple, qui paraît indiquer une chose concrète. Sans doute, on peut appeler peuple l'agrégat des habitants d'un pays, et, dans ce cas, c'est une chose réelle, concrète. Mais c'est uniquement en vertu d'une abstraction hors de la réalité, que l'on considère cet agrégat comme une personne ayant une volonté et le pouvoir de la manifester. D'abord, d'une manière générale, pour que cela soit, il serait nécessaire que cet agrégat puisse comprendre les questions et être capable de volonté à leur sujet. Cela n'arrive jamais ou presque jamais. Ensuite, pour descendre au cas particulier, il est certain que, parmi les Allemands, il en est qui approuvent le discours de l'empereur, comme il en est qui le désapprouvent. Pourquoi ceux qui le désapprouvent auraient-ils le privilège de s'appeler « peuple » ? Ceux qui l'approuvent ne font-ils pas également partie du « peuple » ? Dans des cas de ce genre, on répond habituellement que c'est la majorité qu'on désigne par le nom de « peuple ». Alors, si l'on veut être précis, on ne devrait pas opposer au droit divin le droit du peuple, mais bien le droit de la majorité du peuple ; mais on n'exprime pas l'idée sous cette forme, pour ne pas en diminuer la force. Cette majorité est presque toujours une nouvelle abstraction. Généralement, on désigne par ce terme la majorité des hommes adultes, les femmes étant exclues. De plus, même en ces termes restreints, très souvent on ne sait pas ce que veut précisément cette majorité. On s'approche de la solution du problème dans les pays où existe le referendum ; mais dans ce cas encore, comme une partie souvent importante des hommes adultes ne vote pas, c'est uniquement par une fiction légale qu'on suppose que la volonté exprimée par les votants – pour autant qu'ils ont tous compris ce qu'on leur demande – est la volonté de la majorité. Dans les pays où n'existe pas le referendum, ce n'est que grâce à une longue série d'abstractions, de fictions, de déductions, que l'on arrive à faire équivaloir à la volonté du peuple la volonté d'un petit nombre d'hommes.
§ 1524. Il convient de remarquer que ceux qui croient à la « volonté du peuple » ne sont pas le moins du monde d'accord sur la façon dont elle se manifeste, et que leurs dissentiments ressemblent à ceux des orthodoxes et des hérétiques d'une religion quelconque. Ainsi, un profane pourrait croire qu'en France, sous Napoléon III les plébiscites manifestaient la « volonté du peuple ». Il tomberait dans l'erreur, comme y tombaient ces chrétiens qui estimaient que le Père doit être antérieur au Fils. Ces plébiscites ne manifestaient aucunement la « volonté du peuple »; tandis que la volonté de la majorité des Chambres de la troisième République la manifeste excellemment. Chaque religion a ses mystères, et celui-ci n'est après tout pas plus obscur que tant d'autres.
Dans tous les pays, quand on discute de réformes électorales, chaque parti s'occupe de ses intérêts, et accepte la réforme qu'il estime lui être la plus profitable [FN: § 1524-1] , sans se préoccuper beaucoup de la vénérable « expression de la volonté générale ». Beaucoup de « libéraux » refusent d'accorder le droit de vote aux femmes, parce qu'ils craignent qu'elles ne soient « réactionnaires », tandis que, justement pour ce motif, beaucoup de réactionnaires acceptent ce droit. En France, les radicaux ont en sainte horreur le referendum populaire : la « volonté générale » doit être exprimée par leur bouche, autrement elle n'est pas la « volonté générale ». En Italie, à l'extension du droit de vote n'a certes pas été étrangère l'espérance qu'ont eue des hommes politiques astucieux de s'en servir à leur avantage. En Allemagne, Bismarck l'accueillit comme une arme contre la bourgeoisie libérale. Il semblerait que les partisans de la représentation proportionnelle fassent exception ; mais beaucoup d'entre eux sont favorables à ce mode de représentation, parce qu'ils le considèrent comme un moyen d'obtenir, sans une lutte trop vive, sans courir les risques d'une bataille, une petite place autour de l'assiette au beurre.
§ 1525. La « conception moderne de l'État » est une autre abstraction. La conception manifestée par l'empereur est aussi celle de beaucoup d'hommes « modernes » ; qui dira pourquoi elle n'a pas droit à cette épithète de « moderne » ? Remarquons ici l'enthymème. Le raisonnement est le suivant : « La conception exprimée par l'empereur est contraire à la conception moderne de l'État ; donc elle est mauvaise ». Le syllogisme complet serait : « La conception exprimée par l'empereur est contraire à la conception moderne de l'État ; tout ce qui est contraire à la conception moderne de l'État est mauvais ; donc la conception de l'empereur est mauvaise ». On a supprimé la majeure, parce que c'est précisément la proposition qui appelle l'attention sur le point faible du raisonnement.
§ 1526. Maintenant, laissons de côté les dérivations, et cherchons le fond qu'elles recouvrent. Nous envisageons ainsi un cas particulier d'un problème général, relatif à l'utilité sociale, problème qui sera traité spécialement au chapitre XII. Ici, un très bref aperçu suffira. Dans toutes les collectivités, il y a deux genres d'intérêts : le genre des intérêts présents et le genre des intérêts futurs. De même, dans les sociétés anonymes, on doit trancher cette question : convient-il de répartir une part plus ou moins grande des bénéfices comme dividende aux actionnaires, ou d'en conserver plus ou moins pour renforcer les finances de la société ? On a différentes solutions, selon les circonstances et la composition des assemblées d'actionnaires.
§ 1527. Pour les peuples, l'intérêt des générations présentes est souvent opposé à l'intérêt des générations futures. L'intérêt matériel que perçoit presque exclusivement une partie de la population, est en opposition avec des intérêts de genres différents ; tel celui de la prospérité future de la patrie, qui est perçu surtout par une autre partie de la population, et que la première partie dont nous parlions tout à l'heure perçoit uniquement sous la forme d'un des résidus de la persistance des agrégats.
§ 1528. Les différents gouvernements sont portés à donner une importance différente à ces intérêts. Ainsi, la république romaine a eu, sous le même nom, des tendances diverses, suivant que le Sénat ou le peuple prévalait. Si nous écartons le voile des dérivations, nous trouvons, dans le discours de l'empereur allemand, l'affirmation des intérêts de la patrie, en opposition avec les intérêts temporaires d'une partie de la population. Dans les discours des adversaires, nous trouvons le contraire. Ainsi ceux-ci comme celui-là s'expriment par des dérivations aptes à émouvoir les sentiments, car il n'y a pas d'autre moyen de se faire entendre du vulgaire.
§ 1529. Le discours de l'empereur est beaucoup plus clair que celui de ses adversaires. Dans la proposition : « C'est pourquoi je poursuis mon chemin, exécuteur, moi aussi, de la volonté divine, sans me soucier des mesquineries de la vie quotidienne », remplacez « exécuteur de la volonté divine » par « représentant des intérêts permanents de la patrie », et vous aurez une proposition qui se rapproche du genre scientifique. Le motif pour lequel les contradicteurs sont moins clairs se trouve dans le fait qu'en Allemagne, le résidu du patriotisme est très fort, et qu'il est par conséquent difficile de dire trop clairement que l'on préfère les intérêts présents aux intérêts futurs et permanents de la patrie. Si l'on voulait traduire le discours impérial dans le langage de la science expérimentale, il conviendrait de commencer par rappeler que, si Bismarck, soutenu par la volonté de son souverain, n'avait pas gouverné contre la volonté de la Chambre populaire, l'empire allemand n'aurait peut-être pas pu être constitué. Le 7 octobre 1862, le Landtag prussien rejetait le budget par 251 voix contre 36. Les intérêts temporaires d'une partie de la population étaient en conflit avec les intérêts permanents de la patrie. Le roi Guillaume se décida à intervenir en faveur de ces derniers. Sous la signature de Bismarck, il décréta, le 13 octobre, la clôture de la session, et gouverna sans se préoccuper de l'approbation de cette assemblée.
Partant de ces observations, on conclurait du passé au futur. Les raisonnements des sciences expérimentales cherchent dans le passé le moyen de connaître l'avenir. On suit donc ces raisonnements, quand on recherche si, en certaines circonstances, on peut espérer qu'un moyen employé précédemment, et qui a eu un certain effet, peut encore être employé avec l'espoir d'obtenir un effet semblable.
Essayons de traduire aussi dans le langage de la science expérimentale les discours des adversaires de l'empereur. Parmi ces personnes, les plus logiques sont les socialistes, qui considèrent comme nuisible l'œuvre de Bismarck. Elles sont opposées aux intérêts que défendait Bismarck en 1862, et restent logiquement opposées aux intérêts semblables que défend l'empereur en 1910. Elles veulent exprimer que les intérêts présents des ouvriers doivent prévaloir sur tout autre genre d'intérêts. Puisqu'enfin c'est une tendance très commune, dans l'Europe contemporaine, on ne s'éloigne pas beaucoup de la vérité en donnant à cette tendance le nom de « conception moderne de l'État »; et puisque la forme parlementaire du gouvernement semble favoriser cette tendance, il n'est pas si erroné d'opposer la majorité parlementaire aux droits du souverain. Moins logiques sont les partis bourgeois qui font opposition à l'empereur, alors qu'en somme ils veulent précisément ce qu'il veut ; mais ils sont poussés à suivre cette voie par le désir de satisfaire un grand nombre de sentiments, sans se demander s'il n'en est pas d'inconciliables. Cette manière d'agir est fréquente en politique, et souvent très utile à un parti.
L'analyse que nous venons de faire pourrait être répétée pour la plus grande partie des manifestations de l'activité sociale. Grâce à elle, nous pouvons parvenir à nous former une certaine conception des forces qui déterminent l'équilibre social.
§ 1530. Les entités métaphysiques peuvent s'affaiblir jusqu'à être à peine perceptibles ; elles apparaissent d'une manière effacée dans certains accords de sentiments, et servent uniquement à leur donner une couleur intellectuelle. On en trouve souvent dans les explications des us et coutumes. Par exemple, on salue, on révère, on adore le soleil, parce qu'il est le principe de la vie sur la terre. On a cru que l'on pouvait prolonger la vie d'une personne en sacrifiant des enfants, comme si la vie était un fluide qui passe d'un être à un autre. En vertu de la même conception, un homme avancé en âge a pu croire prolonger sa vie en dormant à côté d'une jeune femme. Des ressemblances souvent imaginaires sont transformées en utilités métaphysiques, et servent à expliquer des faits. En général, le rôle de ces entités est de donner une apparence logique aux résidus de l'instinct des combinaisons (Ie classe).
§ 1531. Le concept métaphysique peut être sous-entendu. On a ainsi des dérivations qui se rapprochent beaucoup des dérivations par accord de sentiments (§ 1469), et qui peuvent être confondues avec elles. On en trouve un exemple remarquable dans le fait de ces métaphysiciens qui réfutent la science logico-expérimentale en ayant recours aux principes mêmes qu'elle déclare faux, et qui veulent à tout prix trouver l'absolu dans les raisonnements où l'on ne fait que leur répéter que tout est relatif. Ils opposèrent aux conclusions de la science expérimentale, et cela leur parut être un argument sans réplique, que pour obtenir des conséquences nécessaires, il faut avoir un principe supérieur à l'expérience. Si l'on ne savait pas que les hommes peuvent, en certaines matières, employer des dérivations absurdes, et en d'autres matières raisonner correctement, on se demanderait comment il est possible qu'il y ait des gens à l'esprit assez obtus, pour n'avoir pas encore compris que la science expérimentale n'a pas, ne cherche pas, ne désire pas, ne peut avoir de conséquences nécessaires (§ 976) ; que l'absolu contenu dans ce concept de nécessité lui est entièrement étranger, et qu'elle cherche uniquement des conséquences valables entre certaines limites de temps et d'espace. Maintenant, ces savantes personnes ont fait une belle trouvaille que la race des perroquets, toujours et partout nombreuse, répète sans se lasser. Aux déductions expérimentales tirées d'un certain nombre de faits, elles opposent qu'on n'a pas examiné tous les faits, et concluent, d'une manière plus ou moins explicite, que ces déductions ne sont pas nécessaires, ou bien qu'elles ne sont pas universelles ; et c'est fort bien : ces personnes sont en cela parfaitement d'accord avec les adeptes de la science expérimentale, et enfoncent une porte ouverte ; mais il est vraiment ridicule qu'elles s'imaginent avoir découvert que la science expérimentale ne fait pas ce que sur tous les tons elle dit, répète et ressasse ne pas vouloir faire. Enfin, il n'est de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, et s'il y a des gens qui s'obstinent à ne pas vouloir comprendre que la science expérimentale ne recherche rien qui soit nécessaire, universel, ou qui ait quelque autre semblable qualité absolue, il n'y a qu'à les laisser dans leur ignorance, et rire de leurs attaques contre la science expérimentale, comme on rit de celles de Don Quichotte contre les moulins à vent.
La science expérimentale est dans un perpétuel devenir, justement parce que tous les jours on découvre de nouveaux faits ; et par conséquent, tous les jours on peut devoir modifier les conclusions tirées des faits jusqu'alors connus. Qui se livre à des études scientifiques est semblable à un tailleur qui, chaque année, fait des habits pour un enfant. Celui-ci grandit, et chaque année le tailleur doit faire un habit à une mesure différente. Soit A, B, C,... P, la série des faits connus jusqu'à présent, en une science donnée, et dont on tire certaines déductions. Demain, on découvre de nouveaux faits, Q, R. Par conséquent, la série est prolongée ; elle devient A, B, C,... P, Q, R, et l'on peut en tirer encore les mêmes déductions que précédemment, ou bien on doit les modifier plus on moins, ou bien encore les abandonner entièrement. Tel a été jusqu'à présent le processus de toutes les sciences logico-expérimentales, et rien ne porte à croire qu'il sera différent à l'avenir.
§ 1532. Il y a plus. Nous ne pouvons pas aujourd'hui tirer de déductions universelles, parce que les faits Q, R, qu'on découvrira demain, nous sont encore inconnus, et il peut arriver que nous ne voulions pas non plus tirer de déductions générales des faits A, B, C,... P, qui nous sont connus, mais qu'au contraire, nous voulions les séparer en différentes catégories, et tirer, des déductions partielles de la catégorie A, B, C, d'autres déductions partielles de la catégorie D, E, F, et ainsi de suite. Ce procédé est général ; il est l'origine de toute classification scientifique.
Ainsi que nous l'avons déjà observé (§ 1166-1] ), si, après avoir choisi et mis ensemble les faits A, B, C, parce qu'ils ont un caractère commun X, nous énoncions la proposition suivante : ces faits ont ce caractère, nous ferions un simple raisonnement en cercle. Mais des propositions du genre des suivantes sont réellement des théorèmes. Il existe un certain nombre de faits où l'on trouve le caractère X. Là où il y a le caractère X existe aussi le caractère Y. Par exemple, nous choisissons les animaux qui allaitent leur progéniture, et nous les appelons mammifères. Ce serait raisonner en cercle que de dire : les mammifères allaitent leur progéniture. Mais les propositions suivantes sont des théorèmes : il existe un très grand nombre d'animaux qui allaitent leur progéniture ; – les animaux qui allaitent leur progéniture sont à sang chaud. Tout cela est plus que simple et élémentaire, mais est oublié, négligé, ignoré, en vertu d'une dérivation où existe, au moins implicitement, le principe de l'absolu, et sous l'empire de sentiments correspondant à ce principe. Le métaphysicien, habitué à raisonner d'une certaine façon, devient incapable d'entendre un raisonnement de nature entièrement différente. Il traduit dans sa langue, et par conséquent déforme les raisonnements exprimés dans la langue des sciences expérimentales, qui lui est entièrement étrangère et inconnue.
§ 1533. (III-ζ) Entités surnaturelles. Dans l'exposé d'une théorie, dans l'écrit qui la contient, il peut y avoir plus ou moins de récits de faits expérimentaux ; mais la théorie elle-même réside dans les conclusions qui sont tirées de ces prémisses, réelles ou imaginaires ; elle est ou n'est pas logico-expérimentale, et objectivement, il n'est pas question de plus ou de moins. Nous ne pouvons rien connaître de ce qui arrive en dehors du domaine expérimental ; c'est pourquoi le problème de savoir si une théorie s'en éloigne plus ou moins n'a aucun fondement objectif. Mais on peut poser le problème au point de vue des sentiments, et nous pouvons rechercher si certaines théories paraissent au sentiment s'éloigner plus ou moins de la réalité expérimentale. La réponse est différente, suivant les diverses classes de personnes. Nous pouvons, tout d'abord, les diviser en deux catégories : (A) les personnes qui, dans cette recherche, emploient rigoureusement la méthode logico-expérimentale ; (B) les personnes qui ne l'emploient que peu ou point. En outre, il faut faire attention qu'il y a des matières qui ne comportent qu'un genre d'explications. Ici, nous traitons des matières où l'on trouve les divers genres d'explications : expérimentales et non-expérimentales.
(A) Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette catégorie. Laissons de côté les quelques hommes de science qui distinguent clairement ce qui est expérimental de ce qui ne l'est pas. Pour eux, l'ordre des théories, quant à leur contenu expérimental, est simplement le suivant ; l° théories logico-expérimentales ; 2° théories qui ne sont pas logico-expérimentales.
(B) Cette catégorie doit être divisée en genres, suivant l'emploi plus ou moins étendu, plus ou moins perspicace, plus ou moins judicieux, que l'on fait de la méthode logico-expérimentale.
(a) Aujourd'hui, et parfois quelque peu aussi dans le passé, les personnes cultivées qui font un usage plus ou moins étendu des méthodes logico-expérimentales, et aussi les personnes moins cultivées qui subissent l'influence des premières, s'imaginent que les personnifications s'éloignent beaucoup plus du domaine expérimental que les abstractions. On est entraîné dans cette voie, en partie par la confusion qu'on établit, spontanément ou à dessein, entre ces abstractions et les principes expérimentaux. Ainsi le contenu expérimental paraît décroître dans l'ordre suivant : 1° faits expérimentaux ; 2° principes pseudo-expérimentaux ; 3° abstractions sentimentales ou métaphysiques ; 4° personnifications, divinités. Des excroissances se produisent ensuite, par exemple celle des hégéliens, qui réduisent tout à la troisième catégorie ; mais les hommes qui suivent cette doctrine sont toujours peu nombreux, voire très peu nombreux, et le plus grand nombre des personnes, fussent-elles cultivées, ne comprend même pas ce qu'ils veulent dire. Les mystères de la métaphysique vont de pair avec les mystères de n'importe quelle autre religion.
b) Pour les gens sans culture, quand ils ne subissent pas l'influence des personnes cultivées et de leur autorité, l'ordre est différent. Les personnifications semblent se rapprocher de la réalité, beaucoup plus que toute autre abstraction. Il n'y a pas besoin de faire un grand effort d'imagination pour transporter chez d'autres êtres la volonté et les idées qu'on observe habituellement chez l'homme. On conçoit beaucoup plus facilement Minerve que l'intelligence abstraite. Le Dieu du Décalogue est plus facile à comprendre que l'impératif catégorique. L'ordre du contenu expérimental devient donc : 1° faits expérimentaux ; 2° principes pseudo-expérimentaux ; 3° personnifications, divinités ; 4° abstractions sentimentales ou métaphysiques. Là aussi des excroissances se produisent ; ainsi celles des mystiques, des théologiens et autres, qui confondent toutes les parties indiquées, dans celle qui concerne exclusivement la divinité. Les hommes qui suivent ces doctrines sont en nombre beaucoup plus grand que les métaphysiciens purs ; toutefois, chez les peuples civilisés, ils demeurent peu nombreux en comparaison de la population totale.
c) Enfin, pour les gens qui, ou bien ne sont pas capables de s'occuper de spéculations théologiques, métaphysiques, scientifiques, ou bien les ignorent, volontairement ou non, ou bien ne s'en occupent pas, quelle qu’en soit la raison, il reste uniquement : 1° faits expérimentaux; 2° principes pseudo-expérimentaux. Ces deux catégories se confondent et donnent une masse homogène où l'on trouve, par exemple, des remèdes expérimentaux et des remèdes magiques. Là aussi se produisent des excroissances, telles que le fétichisme et d’autres semblables. Un grand nombre, un très grand nombre de personnes ont pu ou peuvent s'approprier ces idées, auxquelles le nom de doctrines ne convient plus.
§ 1534. Nous savons déjà que l'évolution ne suit pas une ligne unique, et que par conséquent l'hypothèse d'une population qui, de l'état (c) passerait à l'état (b), puis à l'état (a) (§ 1536), serait en dehors de la réalité ; mais pour arriver au phénomène réel, nous pouvons partir de cette hypothèse, et y ajouter ensuite les considérations qui nous rapprocheront de la réalité. Si donc, par hypothèse, une population passe successivement par les trois états (c), (b), (a), il résulte des considérations que nous avons faites, que la masse des actions non-logiques de (c) et des explications rudimentaires qu'on en donne, produira peu à peu les explications par voie de personnifications, puis, par le moyen d'abstractions, les explications métaphysiques. Mais, parvenus à ce point, nous devons nous arrêter, si nous voulons envisager l'ensemble d'une population ; car, jusqu'à présent, on n'a jamais vu, nous ne disons pas une population entière, mais seulement une partie importante d'une population, parvenir à donner des explications exclusivement logico-expérimentales, et atteindre ainsi l'état (A). Il ne nous est vraiment pas donné de prévoir si cela pourra jamais arriver. Mais si nous considérons un nombre restreint, voire très restreint, de personnes cultivées, on peut dire que, de notre temps, il y a des personnes qui se rapprochent de cet état (A) ; et il pourrait aussi arriver, bien que le moyen de le démontrer nous fasse défaut, qu'à l'avenir, il y ait un plus grand nombre de personnes qui atteignent entièrement cet état.
Une autre conséquence des considérations que nous avons faites est que, pour être compris par le plus grand nombre de gens, même s'il s'agit des personnes cultivées, il faut parler le langage qui convient aux états (a) et (b), tandis que le langage propre de l'état (A) n'est pas et ne peut pas être compris.
§ 1535. Le phénomène hypothétique décrit ici s'écarte du phénomène réel, principalement sur les points suivants : 1° Nous avons séparé les matières qui admettent et celles qui n'admettent pas différents genres d'explication. En réalité elles sont mélangées, et l'on passe par degrés insensibles d'un extrême à l'autre. 2° Nous avons encore substitué des variations discontinues aux variations continues, en séparant les états (a), (b), (c). En réalité, il y a une infinité d'états intermédiaires. Pourtant, cette manière de s'exprimer ne serait pas un grand mal, car enfin il est presque toujours nécessaire de suivre cette voie, quand on ne peut faire usage des mathématiques. 3° La déviation par laquelle nous avons considéré la population comme homogène, tandis qu'elle est au contraire hétérogène, est d'une plus grande importance que les deux précédentes. Il est vrai que l'état d'une classe influe sur celui d'une autre ; mais il ne s'ensuit pas qu'on doive réduire ces classes à l'unité. La division de la société en une partie cultivée et une partie inculte est très grossière ; en réalité, les classes à considérer sont plus nombreuses. Pour donner une forme tangible à ces considérations, soient A, B, C, D,... différentes couches d'une population. Une certaine évolution porte l'état A à une position m, ce qui influe sur B, outre l'action générale de l'évolution, et porte cet état en n. Mais la résistance de B agit aussi sur A, de manière que la position m n'est pas donnée seulement par le sens général de l'évolution, mais aussi par la résistance de B. On peut faire de semblables considérations, en envisageant plusieurs couches A, B, C,... au lieu des deux seules que nous venons d'indiquer. En conclusion, l'état de la population sera représenté par la ligne m, n, p, q,... qui passe par les points m, n, p, q,... auxquels sont parvenues les diverses couches, par l'action générale de l'évolution et par les actions et réactions réciproques des différentes couches. Si, au lieu des nombreuses couches, on en considère une seule, par exemple A, on représente le résultat général de l'évolution, l'état général de la population par la ligne mx, qui peut différer beaucoup de l'état réel m, n, p... 4° Plus grande encore est la déviation de la réalité et l'erreur d'avoir considéré une évolution unique, là où il y en a plusieurs, et de l'avoir envisagée comme uniformément croissante en un certain sens, tandis qu'elle est généralement ondulée. 5° Enfin, puisque nous traitons ici exclusivement de dérivations, l'erreur de confondre l'évolution de celles-ci avec l'évolution générale de la société ne devrait pas être à craindre ; car cette évolution comprend non seulement celle des dérivations, mais aussi les évolutions des sciences logico-expérimentales, des résidus, de l'action des sentiments, des intérêts, etc. Pourtant il est bon de rappeler cette erreur, parce qu'on a l'habitude de la commettre, spécialement les personnes qui ne distinguent pas bien les actions logiques des actions non-logiques.
§ 1536. Le phénomène hypothétique décrit précédemment pour l'ensemble d'une population a été vu tant bien que mal par A. Comte, et constitue le fond de sa célèbre théorie des états fétichiste, théologique, métaphysique, positiviste. Il envisage une évolution qu'on pourrait dire semblable à l'évolution (c), (b), (a), (A), (fig. 17), mais avec les restrictions que nous allons voir. Avec le Cours de Philosophie positive, il tombe en plein dans l'erreur que nous avons indiquée au n° 5. L'évolution des explications des phénomènes naturels est pour lui l'évolution de l'état social. Plus tard, il corrigea en partie cette erreur, dans le Système de Politique positive, et fit « explicitement dominer le sentiment » (§ 286) ; mais avec cela il tomba dans des erreurs plus grandes (§ 284 et sv.). Comte était très éloigné du scepticisme expérimental, qu'il haïssait même profondément. C'était un dogmatique ; aussi exposa-t-il sa théorie, non telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire comme une première et grossière approximation, mais comme si elle avait une valeur précise et absolue. Et pourtant, il avait entrevu l'erreur que nous avons relevée au n° 3. Il ne lui avait pas échappé que, dans la réalité, on observait un certain mélange des couches intellectuelles [FN: § 1536-1]. En conclusion, pour nous reporter à la fig. 17, Comte veut substituer la ligne mx à la ligne réelle m, n, p, q,... pour avoir l'état de la société composée des couches A, B, C,... et il s'en tire en donnant à la ligne mx le nom de « vrai caractère philosophique des temps correspondants » ; tandis que la ligne m, n, p, q,... qui correspond à la réalité, n'est pas jugée digne de l'épithète vraie. L'emploi de semblables épithètes est un procédé général, usité justement pour faire croire que de nombreuses choses se réduisent à une seule, qui est celle que veut l'auteur. C'est aussi un procédé général que d'employer une suite d'affirmations (Ie classe) substituées aux démonstrations logico-expérimentales, en dissimulant sous l'abondance des mots la pauvreté du raisonnement [FN: § 1536-2] .
§ 1537. Une autre erreur très grave de A. Comte consiste à avoir donné de la philosophie positive une définition qui ne correspond en rien à l'emploi qu'il fait de ce terme, dans la suite de ses ouvrages [FN: § 1537-1]. Selon sa définition, la philosophie positive correspondrait à l'état (A), et l'évolution serait (c), (b), (a), (A); mais ensuite, la philosophie positive de Comte devient une sorte de métaphysique, et l'évolution s’arrête à la succession (c), (b), (a); ou bien, si l'on veut faire une concession à A. Comte, à la succession (c), (b), (a), (a 1) ; où l'on désigne par (a 1) un état dans lequel le sentiment range dans l'ordre suivant, en commençant par celle qui s'en éloigne le moins les théories qui s'écartent du domaine expérimental: 1° faits expérimentaux et interprétations positivistes de ces faits, c'est-à-dire la métaphysique positiviste ; 2° les autres métaphysiques ; 3° les théologies. Déjà dans le Cours de philosophie positive, on voit apparaître la tendance de l'auteur, non pas seulement à coordonner les faits, comme il le dit, mais bien à les interpréter suivant certains principes a priori existant dans son esprit. Cela est très différent de ce que nous promettait l'auteur, et n'est en somme que le procédé usité par toute autre métaphysique. Comme preuve de la tendance que nous avons relevée, on pourrait citer tout le Cours de Philosophie positive. À chaque pas, nous trouvons qu'au moyen des épithètes vrai, sain, nécessaire, inévitable, irrévocable, accompli, l'auteur tâche de soumettre les faits à ses idées, au lieu de les coordonner et d'y soumettre ses idées [FN: § 1537-2]. Mais tout cela n'est rien en comparaison des développements métaphysiques qui surabondent dans le Système de politique positive, et surtout en comparaison des abstractions divinisées qui apparaissent dans la Synthèse subjective. En conclusion, A. Comte a suivi personnellement une évolution qui, en gros, peut être exprimée de la façon suivante : 1° explications expérimentales, ou mieux pseudo-expérimentales ; 2° explications métaphysiques, quand il accordait encore la prédominance à l'intelligence sur le sentiment (§ 284 et sv.); 3° explications théologiques, quand il accorde la prédominance au sentiment, et spécialement quand, au dernier terme de l'évolution, dans la Synthèse subjective, il divinise ses abstractions. De cette façon, il a évolué dans une direction contraire à celle qu'il suppose dans les sociétés humaines.
§ 1538. Nous nous sommes arrêté quelque peu sur le cas de A. Comte, parce qu'il met en relief une grave erreur qui est générale, spécialement de notre temps, et qui consiste à supposer que les dérivations des personnifications s'écartent beaucoup plus de la réalité expérimentale que les dérivations métaphysiques ; tandis qu'au contraire il n'y a entre elles qu'une différence de forme. En somme, on exprime la même idée en disant comme Homère [FN: § 1538-1] : « Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus » ; ou bien comme disent les modernes : « Ainsi s'accomplit ce qu'impose le Progrès ». Qu'on personnifie ou non le Progrès, la Solidarité, une Humanité meilleure, etc., cela importe peu, au point de vue du fond expérimental.
§ 1539. Au point de vue de la forme de la dérivation, la personnification s'écarte davantage de l'abstraction métaphysique, lorsqu'on suppose qu'elle manifeste une volonté au moyen d'une révélation, de la tradition ou par d'autres semblables moyens pseudo-expérimentaux, ce qui constitue le genre de dérivations (II-γ) ; tandis qu'au contraire la personnification tend à se confondre avec l'abstraction métaphysique, lorsqu'on recherche l'accord, de celle-ci et de celle-là avec certaines réalités. Les dérivations de ce genre constituent une grande partie des théologies et des métaphysiques.
§ 1540. Il est important de remarquer un moyen employé pour connaître la volonté divine, avec laquelle les actions des hommes doivent s'accorder. Il consiste à supposer que Dieu doit agir comme un homme de bon sens, et vouloir ce que celui-ci veut. En somme, la volonté divine disparaît donc de la conclusion, et la volonté de l'homme de bon sens ou supposé tel subsiste seule (§ 1454-1). Nous avons ainsi un nouveau cas de la méthode générale de raisonnement, dans lequel on élimine un X non-expérimental (§ 480). Même quand on a recours à la révélation contenue dans l'Écriture Sainte, si l'on admet une interprétation un peu étendue, allégorique ou d'un genre semblable, on finit par éliminer cette révélation, et, somme toute, l'accord se fait uniquement avec les sentiments de celui qui interprète cette Écriture. Comme en d'autres cas semblables, le besoin que l'on éprouve d'avoir une dérivation au lieu d'une simple affirmation est remarquable. Au point de vue expérimental, la simple affirmation a la même valeur, souvent même vaut mieux, parce qu'on ne peut la réfuter. Mais là agissent les résidus (I-ε) du besoin de développements logiques ou pseudo-logiques.
§ 1541. Saint Augustin veut expliquer le passage de la Genèse où il est dit que le firmament sépare les eaux qui sont au-dessous de celles qui sont au-dessus [FN: § 1541-1] . Il objecte : « (2) Beaucoup de gens affirmaient, en effet, que les eaux, par leur nature, ne peuvent être sur le ciel sidéral » ; et il blâme la réponse qui s'en remet à l'omnipotence divine : « Il ne faut pas réfuter ceux-ci, en disant qu'en présence de l'omnipotence de Dieu, à qui toute chose est possible, nous devons croire que l'eau, bien que tellement pesante, comme nous le savons et le sentons, est au-dessus du corps céleste où sont les astres ». Et pourtant il eût été plus prudent de suivre cette voie, et de ne pas s'embarrasser dans les explications physiques, quelque peu fantaisistes, qu'il estime opportun de donner.
§ 1542. Comme d'habitude, par de semblables dérivations, ou peut toujours prouver également bien le pour et le contre. Le principe que Dieu agit comme un homme de bon sens sert à démontrer la « vérité » des Saintes Écritures, et sert également à en montrer la « fausseté » [FN: § 1542-1]. Inutile d'ajouter qu'au point de vue logico-expérimental, ni l'une ni l'autre de ces démonstrations n'ont la moindre valeur (2). Même au point de vue exclusivement logique, en laissant de côté toute expérience, on ne peut concilier la notion d'un Dieu omniscient avec la conception que l'homme peut juger l'œuvre de ce Dieu. En effet, l'ignorant est absolument incapable de comprendre ce que fait l'homme de science dans son laboratoire, et beaucoup de personnes ne sont pas, en cette matière, meilleurs juges que l'ignorant. On voit donc combien vaine est la prétention de ceux qui veulent, avec des connaissances rudimentaires, juger les œuvres de ceux qui possèdent des connaissances beaucoup plus étendues (§ 1995-1). De tels jugements, au sujet des personnifications, ont pour prémisse indispensable que la personnification soit faite, au moins mentalement, à l'image de celui qui la crée.
[887]
Chapitre X↩
Les dérivations (Suite)
§ 1543. IVe CLASSE. Preuves verbales. Cette classe est constituée par des dérivations verbales obtenues grâce à l'usage de termes d'un sens indéterminé, douteux, équivoque, et qui ne sont pas d'accord avec la réalité. Si l'on voulait entendre cette classification dans un sens très large, elle s'appliquerait à presque toutes les dérivations qui ne correspondent pas à la réalité ; elle comprendrait ainsi presque toutes les dérivations, et il n'y aurait plus lieu de distinguer la IVe classe des autres. Aussi est-il bon de restreindre le sens de la définition aux cas où le caractère verbal de la dérivation est bien tranché et l'emporte sur les autres. Il convient de ranger dans cette classe les sophismes logiques, en ce qui concerne le partie purement formelle, qui servent à satisfaire le besoin de raisonnements logiques éprouvé par les hommes (résidus I-ε). Mais cette partie est presque toujours accessoire : elle ne détermine pas le jugement de celui qui accepte la dérivation. Ce jugement est déterminé en vertu d'une partie beaucoup plus importante : les sentiments éveillés par le raisonnement. Comme d'habitude, ces sophismes logiques ne trompent que les personnes déjà disposées à se laisser induire en erreur ; ou, pour mieux dire, il n'y a d'erreur en aucune sorte. L'auteur du raisonnement et ceux qui l'acceptent se comprennent entre eux, grâce à un accord mutuel de sentiments, accord auquel ils donnent, comme toujours, la couleur du sophisme logique.
§ 1544. Dans les preuves verbales, les résidus qu'on emploie le plus pour dériver sont ceux qui donnent corps à une abstraction ayant un nom, qui prêtent une réalité à cette abstraction parce qu'elle a un nom, ou qui, vice versa, supposent qu'à un nom doit nécessairement correspondre une chose. Ce sont là les résidus (II-ζ). Ensuite, d'autres résidus de la IIe classe agissent aussi, et de même on trouve souvent les résidus (I-γ), qui unissent mystérieusement les noms aux choses. Enfin, il y a d'autres résidus, suivant les cas particuliers. Les résidus indiquent le désir d'atteindre un but ; et l'accomplissement de ce désir est obtenu au moyen de divers artifices, que le langage permet de mettre facilement en œuvre.
§ 1545. Ainsi que nous l'avons fait remarquer plusieurs fois, les termes du langage ordinaire ne correspondent généralement pas à des choses bien déterminées ; par conséquent, tout raisonnement dans lequel on emploie ces termes est exposé au danger de n'être autre chose qu'une dérivation verbale. Le danger est minime dans les raisonnements scientifiques, parce qu'on a toujours présentes à l'esprit les choses dont les noms employés sont de simples indications, semblables à des étiquettes ; il augmente dans les dérivations qui enlèvent ce caractère d'étiquettes aux termes : et, en suivant cette voie, on arrive aux dérivations métaphysiques, auxquelles ne manque presque jamais le caractère de dérivations verbales.
§ 1546. Un terme qui, employé dans un syllogisme, est susceptible de prendre plusieurs sens, peut donner à ce syllogisme plus de trois termes, et par conséquent le rendre faux. Très souvent, c'est le moyen terme qui, par son indétermination, rend le syllogisme faux. On passe d'un extrême, où l'on a un simple calembour, que personne ne prend au sérieux, à un autre extrême, où l'on a un raisonnement qui paraît profond, justement parce qu'il est obscur et indéterminé. Supposons le raisonnement : A est X, X est B, donc A est B. Si X a deux sens entre lesquels il ne peut y avoir confusion, par exemple un canon d'artillerie et un canon de l'Église, on a une simple plaisanterie. Si i désigne un agrégat de sentiments complexe et indéterminé, certains sentiments prédominent dans la proposition A est X, d'autres, dans la proposition X est B. Par conséquent, en réalité X est double ; mais les gens ne s'en aperçoivent pas et admirent le raisonnement (§ 1607). Ainsi, si X est la Nature, la Droite Raison, le Bien ou autres entités semblables, on peut être presque certain, pour ne pas dire tout à fait certain, que le raisonnement est de ce genre. Par exemple : « On vit bien quand on vit selon la Nature ; la Nature n'admet pas la propriété ; donc on vit bien quand il n'y a pas de propriété ». Dans la première proposition, de l'agrégat confus de sentiments, désigné par le terme Nature, surgissent les sentiments qui séparent ce qui est conforme à nos tendances (ce qui nous est naturel), de ce que nous faisons uniquement par contrainte (ce qui nous est étranger, déplaisant, hostile), et le sentiment approuve la proposition : « On vit bien, quand on vit selon la Nature ». Dans la seconde proposition surgissent les sentiments qui séparent le fait de l'homme (ce qui est artificiel), de ce qui existe indépendamment de l'action de l'homme (ce qui est naturel) ; et là aussi, celui qui se laisse guider par le sentiment admet que la propriété n'est pas l'œuvre de la Nature, que la Nature ne l'admet pas. Ensuite, de ces deux propositions résulte logiquement que l'on vit bien quand on vit sans la propriété ; et si cette proposition est aussi admise par le sentiment de celui qui entend le raisonnement, il estime celui-ci parfait sous tous les rapports. En vérité, le raisonnement est parfait, en ce sens qu'il satisfait tous les désirs de celui qui écoute, y compris le désir d'une teinte logique de quelque dérivation (§ 963, 1602).
§ 1547. Dans les cas concrets, les dérivations de la IVe classe que nous séparons en genres, sont employées ensemble, et souvent aussi s'ajoutent à d'autres dérivations. Il ne faut jamais oublier que ce n'est que par abstraction que nous pouvons isoler les dérivations simples qui composent les dérivations complexes qu'on observe dans l’usage courant.
§ 1548. Dans les genres de la IVe classe, les dérivations revêtent deux formes ; sous la première, on va de la chose au terme ; sous la seconde, on va du terme à la chose, réelle ou imaginaire. Dans les cas concrets, fréquemment les deux formes se mêlent, et, après être allé de la chose au terme, on revient du terme à une autre chose. Tel est le fond d'un nombre infini de raisonnements. Comme nous l'avons déjà dit au § 108, on peut sortir du domaine logico-expérimental aussi bien en employant des termes qui correspondent à des entités qui ne se trouvent pas dans ce domaine, qu'en faisant usage de termes indéterminés qui correspondent mal à des entités expérimentales. C'est pourquoi, parmi les dérivations, nous trouvons l'usage de ces termes. Nous avons déjà vu un grand nombre de dérivations verbales, au chapitre V. Au § 658 nous avons remarqué comment on va de la chose au nom et du nom à la chose, et, dans les paragraphes suivants, nous avons fait voir les erreurs qui se produisaient ainsi, c'est-à-dire les divergences entre les dérivations et la réalité. Les théories suivant lesquelles, de l'étymologie on peut déduire la nature de la chose dont on connaît le nom (§ 686 et sv.), sont justement des dérivations verbales dans lesquelles on va du nom à la chose. À cette opération étymologique directe s'ajoute une opération étymologique inverse (§ 691). Toutes les considérations faites à ce sujet au chapitre V sont ici sous-entendues.
§ 1549. (IV-α) Terme indéterminé désignant une chose réelle, et chose indéterminée correspondant à un terme. Ce genre de dérivation est si fréquent qu'il fait rarement défaut dans les dérivations concrètes. C'est pourquoi nous en avons déjà souvent parlé, et nous devrons encore en parler souvent, à l'avenir. Ici, nous nous bornerons à traiter d'un cas typique.
§ 1550. Un sophisme célèbre, connu sous le nom de sorite, a donné beaucoup à faire aux logiciens. Vous avez un grain de blé ; vous en-ajoutez un autre : vous n'avez pas un tas de grains ; vous en ajoutez un autre : vous n'avez pas non plus un tas de grains ; continuez ainsi indéfiniment, et vous en viendrez à la conclusion qu'un amoncellement de grains aussi grand qu'on voudra n'est pas un tas de grains ! La conclusion est évidemment fausse. Mais où gît l'erreur du raisonnement ? Le sophisme se présente souvent d'une façon inverse : en diminuant un tas d'un grain à la fois, et en démontrant ainsi que le dernier grain qui reste est un tas. De ce genre est le sophisme de l'homme auquel on enlève, un à un, tous ses cheveux sans qu'il devienne chauve, lorsqu'il lui en reste un seul. Cicéron explique bien qu'on peut généraliser le sophisme [FN: § 1550-1] : « (29, 92) Ce n'est pas seulement pour un tas de grains, duquel vient le nom [de sorite], mais pour n'importe quelle autre chose, telles la richesse et la pauvreté, le clair et l'obscur, beaucoup et peu, le grand et le petit, le long et le court, le large et l'étroit, que nous n'avons pas de réponse, si nous sommes interrogés au sujet d'augmentations ou de diminutions insensibles ». Il s'en tire avec une dérivation de ce genre allant du terme à la chose : parce que certains termes existent, il s'imagine qu'il doit aussi exister des choses réelles correspondantes : « La Nature [quand elle entre en scène, le sophisme est certain] ne nous donne aucune connaissance des limites des choses ». Donc, il y a vraiment une chose qui correspond au terme long, mais dame Nature n'a pas daigné nous faire connaître quelles sont les limites du long, et par conséquent nous autres, malheureux, ne pouvons le distinguer du court. Et si, au lieu de choses, il y avait seulement des sentiments qui correspondent à ces termes ? Dame Nature serait innocente de toute faute, et ce serait nous qui aurions le tort de ne pas savoir exprimer nos sentiments avec une précision suffisante. Chrysippe avait inventé une méthode dite du repos, pour se soustraire au sophisme. Il dit que, lorsqu'on vous demande si trois c'est peu ou beaucoup, avant d'arriver à ce terme beaucoup, il faut vous reposer. À quoi Carnéade objecte que cela n'empêchera pas qu'on ne revienne vous demander si, en ajoutant un au nombre auquel vous vous êtes arrêté, on obtient un grand nombre [FN: § 1550-2] . De plus, voici les sceptiques qui adoptent la méthode du repos, de Chrysippe, et l'étendent à tout raisonnement [FN: § 1550-3] . Carnéade se servait de ce sorite pour prouver qu'il n'y avait pas de dieux [FN: § 1550-4] .
§ 1551. Les philosophes qui n'ont pas pu trouver l'erreur de ce sophisme en ont été empêchés par l'habitude du raisonnement métaphysique. Ils ne pouvaient reconnaître cette erreur, sans reconnaître en même temps que tous leurs raisonnements étaient erronés. En effet, l'erreur du sorite consiste à employer des termes qui sont indéterminés, ne correspondent à rien de réel, et qui peuvent seulement éveiller certains sentiments. Il n'y a rien d'objectif qui corresponde aux termes beaucoup et peu, grand et petit, pesant et léger, etc. Mais le métaphysicien auquel il arriverait de reconnaître cela, entendrait aussitôt opposer à ses plus beaux raisonnements que dans la même et identique classe des termes que nous venons de relever, se trouvent aussi ceux de bon et mauvais, beau et laid, honnête et malhonnête, juste et injuste, moral et immoral, etc. (§ 963). La réponse à faire au sorite est la suivante : « Définissez ce que vous entendez par le terme tas (ou amoncellement ou autre semblable), et nous vous répondrons. Par exemple, si vous dites que le tas est composé de mille grains, lorsque nous serons arrivés à 999 grains, et que vous en ajouterez un autre, nous dirons : Voilà le tas ! Et si vous ne voulez pas définir rigoureusement les termes qu'il vous plaît d'employer dans votre raisonnement, à nous, il ne nous plaît pas de répondre. C'est à celui qui veut une réponse qu'il appartient d’expliquer clairement sa demande ». C'est ce que l'on doit répondre, aujourd'hui encore, aux économistes qui cherchent la cause de la valeur. Veuillez nous dire, braves gens, ce qu'est exactement cette valeur. Apprenez-nous comment et pourquoi elle doit avoir une cause, et ensuite nous vous répondrons; mais pas avant ». Dans le langage vulgaire, le terme valeur a certainement un sens évident, de même que le terme tas ; malheureusement ces sens sont également indéterminés, et cette circonstance empêche de pouvoir employer l'un ou l'autre dans des raisonnements scientifiques [FN: § 1551-1] .
§ 1552. (IV-β ß) Terme désignant une chose, et qui fait naître des sentiments accessoires, ou sentiments accessoires qui font choisir un terme. Ce genre de dérivations joue un grand rôle dans l'éloquence judiciaire et en politique. Il est très efficace pour persuader, d'autant plus que les sentiments ainsi suggérés par les termes s'insinuent chez celui qui écoute, sans que celui-ci s'en aperçoive. Dans sa Rhétorique, Aristote donne de bons conseils à ce propos [FN: § 1552-1] . « (10) Si l'on veut favoriser une chose, on doit prendre la métaphore de ce qu'il y a de meilleur ; si l'on veut nuire, de ce qu'il y a de pire ». Et plus loin : « (14) Les épithètes peuvent être empruntées au pire ou au honteux, comme : [Oreste] matricide ; ou bien au meilleur, comme : vengeur de son père ». Pour des motifs semblables, le fait de rester fidèle à sa foi se nomme persévérance, si la foi est orthodoxe, obstination, si elle est hérétique. En 1908, les amis du gouvernement russe appelaient exécution l'acte par lequel le gouvernement donnait la mort à un révolutionnaire ; assassinat, l'acte par lequel les révolutionnaires tuaient ceux qui appartenaient au gouvernement. Les ennemis du gouvernement intervertissaient les termes : c'est le premier acte qui était un assassinat, le second qui était une exécution. On fait une interversion analogue entre les termes expropriation et vol [FN: § 1552-2].
Répondant à un député, le comte de Bismarck disait, en 1864, au Landtag de Prusse [FN: § 1552-3] : « M. le député nous a reproché ... de ne vouloir rien avoir de commun avec l'Allemagne. Il faut qu'il y ait un charme tout particulier dans ce mot : „ allemand “. On voit que chacun cherche à s'approprier ce mot-là ; chacun nomme „ allemand “ ce qui lui est utile, ce qui peut être profitable à son intérêt de parti, et l'on varie, suivant le besoin, la signification du mot. De là vient qu'à certaines époques ce qui s'appelle „ allemand “ c'est de faire de l'opposition à la Diète, tandis qu'en d'autres temps, on dit qu'il est „ allemand “ de prendre parti pour la Diète devenue progressiste ». Aujourd'hui, celui qui veut favoriser quelque chose doit l'appeler moderne, démocratique, humain, et mieux encore largement humain, progressiste. À pareil feu d'artillerie peu de gens résistent. Si l'on s'en tient au sens propre des mots, il semblerait qu'un libre penseur devrait être un homme qui ne veut que peu ou point de liens à la pensée, ou mieux à la manifestation de la pensée, car la pensée intérieure est libre, tout à fait libre, et l'on ne peut vouloir ôter des liens qui n'existent pas. Au contraire, en fait, le libre penseur est un croyant qui veut faire dominer sa religion et imposer des liens à la pensée de ceux qui n'ont pas ses opinions [FN: § 1552-4]. Celui qui veut la liberté, dans le sens d'ôter les liens, devrait vouloir que, sans liens, on puisse parler aussi bien pour que contre la religion catholique. Au contraire, les libres penseurs admettent qu'on attaque la religion chrétienne, ou mieux la religion catholique, et refusent la faculté de la défendre. Ils veulent empêcher aux prêtres d'enseigner ; ils veulent que l'État ait le monopole de l'enseignement, pour pouvoir imposer leurs théories, pour lier la pensée dans le sens qu'ils estiment bon. Nous n'entendons nullement rechercher ici si cela peut être utile ou non à la société ; nous disons seulement que celui qui procède de cette façon détourne le mot libre de son sens usuel et lui fait signifier à peu près le contraire de ce sens.
§ 1553. De même, lorsqu'on parle de liberté et des liens qui l'entravent, souvent on laisse exprès indéterminée la nature de ces liens, et l'on ne distingue pas s'ils sont acceptés volontairement, ou s'ils sont imposés par une puissance extérieure, bien que cette différence soit essentielle en la matière [FN: § 1553-1]. On entend souvent parler de la « tyrannie papale » ; et l'on emploie le même terme, que la soumission à l'autorité papale soit volontaire, ou qu'elle soit appuyée par le bras séculier. Pourtant ce sont des choses entièrement différentes. De même, on entend souvent accuser d'oppression les personnes qui veulent exclure un individu quelconque de leur compagnie, qui veulent l'excommunier ; et l'on ne distingue pas si cette excommunication implique des peines édictées par les pouvoirs publics, ou bien si elle n'a d'autre effet que celui d'exclure l'individu d'une compagnie privée. Pourtant ce sont là encore des choses bien différentes. En France, par exemple, l'excommunication au moyen âge et l'excommunication aujourd’hui sont des choses qui, sous le même nom, diffèrent entièrement quant au fond. Aujourd'hui, le non-catholique se soucie peu d'être excommunié, et ne craint nullement d'être persécuté par la force publique. Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient intervertir les rôles, et qui demandent, au nom de la liberté, que le pouvoir public intervienne pour imposer leur compagnie à ceux qui n'en veulent pas. C'est là un changement complet du sens des mots. Littéralement, on appelle libre la condition dans laquelle chacun choisit à soit gré sa compagnie, sans l'imposer à d'autres et sans qu'elle lui soit imposée par d'autres. S'il vous plaît d'appeler libre l'état dans lequel on vous impose la compagnie qui vous déplaît et vous répugne, il faut aussi, si nous voulons nous entendre, trouver un autre mot pour désigner au contraire l'état dans lequel on ne vous impose pas d'accepter la compagnie qui ne vous plaît pas [FN: § 1553-2].
§ 1554. En vérité, le sort échu au terme liberté est assez comique. En beaucoup de cas, maintenant il signifie précisément le contraire de ce qu'il signifiait il y a cinquante ans ; mais les sentiments qu'il fait naître demeurent les mêmes ; c'est-à-dire qu'il désigne un état de choses favorable aux personnes qui en font usage ou qui l'acceptent. Si Pierre lie Paul, celui-ci appelle liberté l'absence de ce lien ; mais si, à son tour, Paul lie Pierre, il appelle liberté le renforcement de ce lien. Dans les deux cas le terme liberté suggère à Paul des sentiments agréables. Il y a un demi-siècle, on appelait, en Angleterre, « parti libéral » celui qui voulait réduire autant que possible les liens qui ôtent en partie à l'individu la faculté de disposer de sa personne et de ses biens. Aujourd'hui, ou nomme « parti libéral » celui qui veut augmenter ces liens. Alors, le parti « libéral » voulait réduire les impôts ; aujourd'hui, il les augmente. En France et en Italie, les « libéraux » d'autrefois demandaient avec insistance qu'il fût permis à l'individu de travailler quand il lui plaisait, et jetaient feu et flamme contre la « tyrannie des rois et des prêtres » qui l'obligeaient à chômer aux jours de fête [FN: § 1554-1]. En France, au temps de la Restauration, les « libéraux » et le gouvernement se faisaient une guerre à mort pour ce motif. Qui ne se souvient des lignes écrites par P.-L. Courier, à ce propos ? [FN: § 1554-2] Même jusqu'en 1856, la crainte de voir imposer le repos dominical pousse à la résistance le Sénat de l'Empire, pourtant si soumis et si domestiqué ; mais un sentiment violent pousse même l'agneau à se révolter. Le sénateur Lavalette [FN: § 1554-3] « (p. 11) propose d'ajouter au serment que devra prêter la régente, conformément au sénatus-consulte de 1813, celui de faire respecter les lois du Concordat, y compris les lois organiques et la liberté du culte. Le coup visait directement l'Impératrice, suspectée d'être favorable à la suppression du mariage civil, au repos dominical obligatoire, et à toutes les exagérations ultramontaines ». Quand vint la votation, l'amendement fut admis par 56 voix et rejeté par 64. Maintenant tout est changé. La doctrine « libérale » veut qu'on impose le repos dominical, auquel, pour faire plaisir aux anticléricaux, on a donné le nom de repos hebdomadaire. Les ultra libéraux demandent qu'on institue des inspecteurs d'État, qui empêchent le travail que pourrait faire le citoyen, enfermé à double tour dans son domicile. Pour justifier ces mesures, on recourt à une dérivation du genre (IV-β 2). On dit que permettre à un individu de travailler en certains jours lèse la liberté de ceux qui ne veulent pas travailler ces jours-là, et que par conséquent on raisonne correctement en disant qu'on lui impose le chômage au nom de la liberté. Ceux qui sont métaphysiciens ajoutent qu'ainsi « l'État crée la liberté [FN: § 1554-4] ». Le terme liberté employé dans cette dérivation a trois sens : 1° un sens indéfini d'une personnification abstraite ; 2° un sens défini, qui est celui de la faculté de faire – ou de ne pas faire – et qui se dédouble en les deux suivants : (2-a) la faculté qu'a un individu déterminé ; (2-b) la faculté qu'ont d'autres individus différents de l'individu déterminé. Souvent, ces deux facultés s'opposent l'une à l'autre, et par conséquent, une mesure qui protège l'une lèse l'autre. Les dérivations tirent parti de ce triple sens pour transporter sur le premier ce qui n'est valable que pour l'un des seconds. Parfois, pour dissimuler cette amphibologie, ou ajoute une épithète à la liberté, dans le premier sens (§ 1561). La dérivation que nous examinons transporte sur le premier sens ce qui est valable pour le sens (2-b), et dit que la mesure envisagée protège la liberté. On pourrait, avec tout autant de raison, transporter sur le premier sens ce qui s'applique au sens (2-a), et l'on dirait alors que la mesure lèse la liberté. Le conflit pratique ne se résout ni par l'une de ces dérivations ni par l'autre, mais seulement en examinant si, en vue du but que l'on veut atteindre, il est utile de faire prévaloir (2-a) sur (2-b) ou vice versa. Mais ainsi, on passerait des dérivations au raisonnement logico-expérimental.
§ 1555. Nous venons de voir dans quel rapport se trouve la dérivation avec la réalité logico-expérimentale. Il nous reste à voir pourquoi on emploie cette dérivation. D'où provient cette obstination à désigner par un terme unique des choses différentes et même opposées ? Simplement du fait que l'on veut conserver les sentiments agréables que suggère ce terme [FN: § 1555-1] . C'est pour le même motif que l'empire romain continua à porter le nom de république. En outre aussi, mais certainement dans une mesure très secondaire, il y a là l'effet d'un reste de pudeur de certains politiciens qui, brûlant aujourd'hui ce qu'ils ont adoré hier, copiant les gouvernements « réactionnaires » dont ils disent tant de mal, veulent faire semblant d'avoir conservé la doctrine qui leur était profitable, lorsqu'ils combattaient ces gouvernements. Quant à la justification, en particulier, dont nous avons parlé, elle est employée, comme les autres dérivations de ce genre, pour transporter, à volonté, sur le sens (2-a) ou sur le sens (2-b), les sentiments favorables et indéterminés qui sont suscités par le sens 1.
§ 1556. (IV-γ) Terme à plusieurs sens et choses différentes désignées par un seul terme. On emploie cette dérivation, soit directement pour attribuer un sens à une proposition qu'on emploie ensuite dans un autre sens (§ 491-1), soit indirectement, pour éviter la contradiction de deux propositions ; ce qu'on obtient en dédoublant un ou plusieurs termes de ces propositions. On emploie aussi cette dérivation pour allonger un peu l'expression d'une simple affirmation, et donner ainsi au discours une apparence de raisonnement logique (§ 1420 et sv.). Au lieu de dire simplement : A est B, on dit : A est X ; puis, ou bien on sous-entend, par accord de sentiments, ou bien on dit explicitement que X est B, et l'on a ainsi « démontré » que A est B. Logiquement, cette voie allongée n'est pas meilleure que la voie abrégée (§ 783) ; mais elle est préférable, par rapport aux sentiments, car elle satisfait le besoin de développements pseudo-logiques [FN: § 1556-1].
De ce genre sont les sophismes très nombreux dans lesquels le moyen terme a deux sens, se dédouble, et ceux, très nombreux aussi, dans lesquels un terme a successivement deux significations, ce qui peut aboutir à un raisonnement en cercle. Un type très usité est le suivant. On affirme que tous les A ont l'opinion B. Ici, A a un sens générique, indéterminé et qui s'accorde simplement avec les sentiments de celui qui écoute. Par conséquent, d'habitude, on n'en demande pas davantage. Mais si l'on demande : « Définissez-moi A », la réponse, plus ou moins entortillée, embrouillée, implicite, aboutit au fond à affirmer qu'on appelle A ceux qui ont l'opinion B ; et ainsi A prend une nouvelle signification. De cette manière, le raisonnement revient à dire que celui qui a l'opinion B a l'opinion B. Nous avons déjà donné de nombreux exemples de cette sorte (§ 592, 593 et passim).
§ 1557. Comme exemple de l'usage direct du présent genre de dérivations, on peut citer celui du terme solidarité (§ 451 et sv.). Les solidaristes avouent eux-mêmes qu'on l'emploie dans des sens très différents. M. Croiset [FN: § 1557-1] dit, à propos de ce terme : « (p. VI). Tout le monde l'emploie, et à force de l'employer, on oublie volontiers de se demander ce qu'il signifie. Or, si l'on y regarde, on s'aperçoit sans peine qu'il s'applique à des choses fort différentes. Il y a d'abord une solidarité de fait qui n'est que la dépendance réciproque de divers éléments associés. Par exemple, en droit, des débiteurs sont solidaires lorsque chacun est tenu de payer la dette de tous. En biologie, les parties d'un organisme sont dites « solidaires », lorsque les modifications subies par l'une d'entre elles ont leur contre-coup sur les autres » [FN: § 1557-2]. À mettre ensemble deux choses très différentes, l'auteur se trompe. Deux individus également solvables sont condamnés à payer solidairement une certaine dette. Le créancier se fait payer par l'un d'eux, mais celui-ci a recours contre l'autre et se fait rendre la part qu'il a payée pour lui, de la dette commune. Un individu est condamné à avoir la main coupée, en un lieu où existe ce genre de peine. Si nous voulons, pour un moment, assimiler les deux bras à deux débiteurs solidaires, ils ont à acquitter solidairement la dette commune. Un seul la paye, et bien que l'autre ait sa main entière, l'individu ne s'amusera pas à en couper la moitié, ou toute autre partie, pour récupérer le bras privé de la main. Donc il y a une différence essentielle entre la solidarité des deux bras considérés comme des individus ayant une dette commune, et leur solidarité biologique. Ensuite l'auteur nous fait très naïvement connaître le motif pour lequel ce terme de solidarité a eu tant de succès. Le motif est, au fond, que ce terme est assez indéterminé pour que chacun puisse lui faire signifier ce qu'il désire [FN: § 1557-3] . L'observation est bonne et s'applique en général aux dérivations à termes ambigus et indéterminés. Voilà pourquoi des termes semblables sont excellents pour les dérivations, très mauvais pour les raisonnements scientifiques. Pour éveiller les sentiments et pour dissimuler la réalité, il est utile que les termes ne soient pas précis. Pour trouver les rapports qui existent entre les faits, il est utile que les termes soient aussi précis que possible. Les apôtres de la solidarité font donc très bien d'employer des termes indéterminés ; mais, à défaut d'autre preuve, cela seul suffirait à montrer la vanité de leur prétention de nous donner des raisonnements scientifiques.
§ 1558. Comme exemple de l'usage indirect des dérivations du présent genre, ou peut citer la proposition : « Tu ne dois pas tuer ». On forme cette proposition en donnant au terme tuer un sens général, pour avoir l'appui du tabou du sang, qui défend de verser le sang humain en général, ou du moins le sang des hommes d'une même collectivité. Mais voici apparaître des cas dans lesquels, au contraire, on doit tuer. Alors, pour faire disparaître la contradiction, on restreint le sens du terme tuer, et les deux propositions en lesquelles se dédouble le précepte : « Tu ne dois pas tuer » s'entendent dans ce sens : « On ne doit pas tuer, si ce n'est en certaines circonstances », et « l'on doit tuer en certaines circonstances ». De cette façon, il est vrai, la contradiction disparaît, mais devenues explicites, les deux propositions signifient peu de chose ou rien ; c'est pourquoi on ne leur donne pas directement cette forme.
§ 1559. Les pacifistes ont la formule : « Les conflits internationaux doivent être résolus par l'arbitrage, par le tribunal international de La Haye, et non par la guerre » ; et ils appellent cela assurer la paix par le droit. En 1911, l'Italie déclara la guerre à la Turquie, sans se soucier le moins du monde ni d'arbitrages ni du tribunal de La Haye. Les pacifistes étrangers restèrent fidèles à la formule, et blâmèrent le gouvernement italien. Plusieurs pacifistes italiens le louèrent, au contraire, parce qu'en faisant la guerre, il avait revendiqué « le bon droit de l'Italie ». Bien entendu, si un autre pays quelconque, X, s'était trouvé dans le même cas que l'Italie, plusieurs pacifistes du pays X auraient dit exactement ce qu'ont dit les pacifistes italiens, tandis que ceux-ci auraient désapprouvé le gouvernement du pays X [FN: § 1559-1]. De tels pacifistes, qui se montrent favorables à la guerre, paraissent donc avoir la formule : « Les conflits internationaux doivent être résolus par l'arbitrage, excepté le cas où il est plus profitable au pays qui veut faire la guerre de les résoudre par la guerre ». Mais, en présence de ces termes, on se demande : Qui n'est pas pacifiste ? En réalité, comme nous l'avons vu tant de fois, ces personnes agissent, poussées par certains sentiments, et non par un raisonnement logique.
§ 1560. Nous avons là un bon exemple des divergences possibles entre l'accord d'une théorie avec la réalité, et son utilité sociale.
Les pacifistes italiens se divisèrent en deux camps : d'un côté, ceux qui applaudissaient à la guerre de Libye, et que l'on pourrait appeler pacifiste-belliqueux ; de l'autre, ceux qui restèrent fidèles à leur doctrine pacifiste, et qu'on pourrait nommer pacifistes-pacifistes. Les premiers avaient certainement tort, au point de vue logique, et avaient peut-être raison, au point de vue de l'utilité que pouvait retirer leur nation. Il n'est pas moins certain que les seconds avaient raison, au point de vue de la logique et de la fidélité à leurs principes, tandis qu'ils pouvaient avoir tort, au point de vue de l'utilité. Ce n'est pas ici le lieu de résoudre, en ce cas spécial, le problème de l'utilité. Il suffit, pour notre raisonnement, que les solutions indiquées tout à l'heure comme possibles le soient effectivement. Plus loin (§ 1704 et sv.) nous verrons les résidus qui se dissimulaient sous ces dérivations, et nous traiterons d'un aspect de l'utilité, au chapitre XII.
§ 1561. Un moyen très usité pour dédoubler les termes consiste à y ajouter certaines épithètes, comme : vrai, droit, honnête, élevé, bon, etc. Ainsi, on distingue un vrai A d'un simple A, et la différence entre ces deux choses peut aller jusqu'à les rendre opposées. De cette façon, par exemple, on fait disparaître la contradiction que nous avons relevée (§ 1554) pour le terme liberté : on distingue une vraie liberté, de la simple liberté, et parfois la première est exactement le contraire de la seconde. Travailler quand il vous semble bon et quand il vous plaît, c'est de la simple liberté ; mais travailler seulement quand cela semble bon et plaît à d'autres, c'est de la vraie liberté. Boire du vin quand cela vous semble bon et vous plaît, c'est de la simple liberté ; le tsar l'octroie aux Finlandais ; mais si l'on vous interdit de boire même une seule goutte de vin, cela, c'est de la vraie liberté, et l'assemblée libérale de la Finlande l'aurait octroyée à ses administrés, si elle n'en avait été empêchée par le despotisme du tsar.
§ 1562. Cet emploi de l'épithète vrai est utile, parce que, comme nous l'avons vu pour le terme solidarité, signifiant peu de chose ou rien du tout, on peut lui faire signifier ce qu'on veut [FN: § 1562-1] . Et si quelque indiscret veut savoir ce que l'une de telles épithètes peut bien vouloir dire, aussitôt on lui sert un beau raisonnement en cercle. Veux-je donner à un terme A la signification du terme ?Je dis que le vrai A est B. Mais quelqu'un me demande : Comment distingue-t-on le vrai A du A qui n'est pas vrai ? Je réponds d'une façon plus ou moins voilée que seul le A qui est B mérite le nom de vrai.
§ 1563. C'est ainsi qu'on affirme que la raison conduit à une certaine conclusion B, par exemple à l'existence de Dieu, ou de la solidarité. L'athée, ou l'anti-solidariste répondent : « Ma raison à moi ne me conduit pas à cette conclusion ». On leur réplique : « Parce que vous ne faites pas usage de la droite raison ». Mais comment distingue-t-on la droite raison de celle qui n'est pas droite ? D'une manière bien simple : La droite raison croit en Dieu, ou en la solidarité.
§ 1564. Chacune des sectes chrétiennes a eu ses martyrs, et chacune a cru que seuls les siens étaient de vrais martyrs. Saint Augustin dit clairement et sans ambages : « (4) Tous les hérétiques aussi peuvent souffrir pour l'erreur, non pour la vérité, parce qu'ils mentent contre le Christ lui-même. Tous les païens et les impies qui souffrent, souffrent pour l'erreur » [FN: § 1564-1] . Bien entendu, la « vérité » est celle à laquelle Saint Augustin croit, et l'erreur, toute autre croyance. Bayle a bien vu le sophisme d'un raisonnement semblable à celui de Saint Augustin, et qui avait pour but de démontrer que les orthodoxes ont raison et les hérétiques tort de persécuter ceux qui n'ont pas leur croyance [FN: § 1564-2] . Ce sophisme, vieux de bien des siècles, est toujours vivace. Il a servi aux chrétiens pour persécuter les païens, aux catholiques pour persécuter les protestants ; et vice versa ; aux diverses sectes protestantes, pour se persécuter mutuellement, aux chrétiens pour persécuter les libres penseurs, et maintenant à ceux-ci pour persécuter ceux-là, et spécialement les catholiques. Sous le second Empire, en France, on ne voulait pas que Renan enseignât ; sous la troisième République, on ne veut pas que le Père Scheil enseigne (§ 618-2) ; mais l'Empire avait tort, parce qu'il était dans « l'erreur », et la République a raison, parce qu'elle est dans le « vrai ». Beaucoup de personnes, en Italie aussi, font le raisonnement suivant : « Les catholiques n'ont pas le droit d'enseigner, parce qu'ils enseignent l'erreur, seuls les libres penseurs ont le droit d'enseigner, parce qu'ils enseignent la vérité ». Naguère, c'était un raisonnement opposé qui était de mode. C'est ainsi que les sages changent avec les temps [FN: § 1564-3]. Autrefois les cléricaux disaient, aujourd'hui les libéraux répètent qu'on doit accorder la liberté du bien, non celle du mal ; la liberté du vrai, non celle de l'erreur. Inutile d'ajouter que ce qui est bien et vrai pour les uns est mal et erroné pour les autres, et vice versa. Les termes vérité, erreur ont autant de sens qu'il y a de partis. C'est seulement grâce à une dérivation (IV-β) qu'on préfère ces termes à leurs synonymes : ce que je crois, et : ce que je ne crois pas.
§ 1565. Les dérivations du genre (IV-γ) mettent généralement en action les résidus de la IIe classe. Les notions et les sentiments qu'un terme donné fait naître en nous persistent quand on ajoute une épithète à ce terme ; ils peuvent même être renforcés par un choix opportun des épithètes. Si la liberté est une bonne chose, combien meilleure doit être la vraie liberté ! Si la raison ne peut pas nous induire en erreur, la droite raison le pourra d'autant moins.
§ 1566. Le plus grand nombre des propositions exprimées sous la forme : « Cette doctrine est vraie, donc on peut, on doit l'imposer », emploient un terme équivoque. Les personnes auxquelles on veut imposer cette doctrine n'admettent nullement qu'elle soit vraie ; elles la disent fausse. La proposition indiquée plus haut devrait donc être exprimée ainsi : « Cette doctrine est pour nous la vérité ; donc nous pouvons, nous devons l'imposer ». Mais, sous cette forme, la proposition a beaucoup moins de force persuasive que sous la première forme.
§ 1567. Dans les dérivations théoriques, le sens du substantif vérité oscille souvent entre deux extrêmes. D'une part, le mot signifie ce qui est d'accord avec les faits ; c'est ce qu'on appelle parfois la vérité expérimentale et la vérité historique. D'autre part, il signifie ce qui est d'accord avec certains sentiments, lesquels emportent le consentement de la foi [FN: § 1576-1] . Entre ces deux extrêmes, il y a une infinité de sens intermédiaires. L'accord avec les faits peut être la conséquence d'observations et d'expériences scientifiques, de recherches appartenant à ce qu'on appelle la critique historique, ou même seulement de l'effet que produisent les faits sur l'esprit d'une personne ou de plusieurs personnes, des sentiments qu'ils font naître. Là aussi, nous trouvons des degrés intermédiaires entre les extrêmes : d'une part, le scepticisme scientifique ou historique, qui corrige certaines impressions par d'autres, et qui permet par conséquent de les adapter autant que possible aux faits ; d'autre part, une foi si vive que les faits ne peuvent l'ébranler en aucune façon ; et l'impression qu'ils font est toujours déformée d'autant qu'il est nécessaire pour l'accorder avec la foi [FN: § 1567-2]. La mécanique, d'Aristote à Laplace, l'histoire naturelle, de Pline à Cuvier, l'histoire romaine, de Tite-Live à Mommsen, l'histoire grecque, d'Hérodote à Grote et à Curtius, etc., ont progressé de ce dernier extrême au premier, et le terme vérité a continuellement changé de sens (§ 776 et sv.).
§ 1568. Ainsi que nous l'avons déjà dit (§ 645), celui qui répète un récit fait par autrui emploie souvent des termes quelque peu différents de ceux qu'il a entendus ; mais il estime dire la vérité, en ce sens que ses termes lui font éprouver la même impression que ceux qu'il a entendus. Il n'est pas possible de se rappeler les termes précis d'un long discours. La mémoire n'a gardé que le souvenir de l'impression éprouvée. C'est cette impression qu'on s'efforce de reproduire, lorsqu'on veut rapporter le discours ; et ce faisant, on croit de parfaite bonne foi avoir dit la vérité. En pratique, devant les tribunaux, cette reproduction approximative des faits suffit d'habitude, étant donné le but que se propose le tribunal. Si elle paraît insuffisante sur quelque point, le président prie le témoin de s'expliquer mieux.
§ 1569. On sait assez que les historiens anciens ont la manie de rapporter les discours qu'ils affirment avoir été prononcés par leurs personnages. Polybe même, pourtant si précis, suit cette voie [FN: § 1569-1] . Par exemple, il nous rapporte le discours tenu par P. Cornelius à ses soldats, avant la bataille du Tessin. Pourtant il est tout à fait certain que Polybe ne pouvait savoir, mot pour mot, ce que contenait ce discours. Il est donc évident que ce ne peut pas être la reproduction précise d'un fait, mais que c'est uniquement la manifestation de l'impression produite sur Polybe par les récits du fait. On peut en dire autant des récits des anciens historiens, en général, et aussi d'une partie considérable de ceux des historiens modernes. Ils nous font connaître plus souvent leurs impressions que des faits.
Parfois ces impressions se rapprochent de la réalité historique ;. parfois elles s'en écartent, et, la distance qui les sépare de la réalité s'accroissant, elles peuvent finir par n'avoir plus aucun rapport avec elle.
§ 1570. À cet extrême correspondent les impressions que décrit Jean Réville, à propos du quatrième évangile [FN: § 1570-1] : « (p. 113) Le but de l'évangile, le but même du Prologue, est historique, voilà ce qu'il importe essentiellement de ne pas perdre de vue. Seulement l'auteur écrit l'histoire comme l'écrivaient tous les hommes de son temps, imbus de l'esprit alexandrin, c'est-à-dire avec un souverain dédain pour la réalité matérielle concrète, de même que Philon ou saint Paul. L'histoire, telle que la comprennent ces grands esprits, ce n'est pas la narration pragmatique des événements, la fidélité dans la reproduction des détails, le souci d'une chronologie exacte, la (p. 114) résurrection intégrale du passé. La tâche de l'historien consiste pour eux à faire ressortir la valeur morale et spirituelle des faits, leur sens profond, ce qu'il y a de vérité éternelle [autre belle entité !] dans chaque phénomène historique contingent et éphémère. L'histoire se transforme pour eux en une vaste allégorie, un symbole perpétuel dont la valeur intime importe seule*. Cela est très difficile à comprendre pour nos intelligences modernes dont la mentalité est toute différente, mais c'est l'évidence même pour ceux qui ont vécu dans l'intimité de Philon et de la plupart des premiers écrivains chrétiens ». Au point de vue scientifique, ce passage contient de bonnes observations, avec l'adjonction de dérivations étrangères à la science. L'auteur éprouve le besoin de nous apprendre que Philon et Saint Paul sont de « grands esprits ». Il y a au contraire des gens qui les tiennent pour des auteurs dont la valeur logico-expérimentale est fort sujette à caution. On ne peut résoudre ce problème en passant ; mais il est singulier que l'auteur adresse cette louange à ces personnages précisément lorsqu'il nous les fait voir comme de piètres historiens. Encore s'il avait fait lui-même cette distinction ! Il y a là une dérivation (IV-β). L'auteur veut, par des sentiments accessoires, dissiper le blâme que pourraient faire naître les faits. Ensuite, on voit apparaître une respectable entité qui a nom « la tâche de l'historien ». Ces « grands esprits » la comprennent en ce sens qu'ils doivent écrire l'histoire sans se soucier des faits [FN: § 1] . Cela admis, on se demande pourquoi les Mille et Une nuits n'auraient pas leur place parmi les livres d'histoire. À ce qu'il paraît, il y a des « phénomènes historiques contingents et éphémères », et d'autres qui ne le sont pas. Quels sont donc ces phénomènes ? L'auteur ne le dit pas. Ensuite, il est impossible de savoir ce que peut bien être cette « vérité éternelle », dont il existe, à ce qu'il paraît, une quantité plus ou moins grande dans « chaque phénomène historique ». Annibal a passé avec son armée en Italie. C'est là un fait historique. Mais qui dira combien il renferme de « vérité éternelle » ? De tels propos sont vides de sens.
§ 1571. Ainsi, après avoir rappelé les doutes qui existent au sujet de la réalité historique du déluge biblique, A. Loisy ajoute [FN: § 1571-1] : « (p. 152) Le récit de la création est (p. 153) vrai, bien qu'il ne contienne pas d'histoire et qu'il s'encadre dans une cosmologie qui n'est plus admise aujourd'hui. Qui sait s'il n'y a pas dans les chapitres suivants, des récits qui sont vrais aussi à leur manière, bien qu'ils ne contiennent pas tous les éléments historiques matériellement exacts que nous nous efforçons d'y trouver ? » (§ 774 et sv.). Il est évident que, dans ce passage, le mot vrai a pour l'auteur un sens différent de celui qu'il possède, par exemple, dans la proposition : « Il est vrai que Garibaldi a débarqué en Sicile, en 1860 ». Mais tant que l'auteur ne nous dit pas le sens précis qu'il veut donner au mot vrai, nous ne pouvons ni accepter ni repousser les conclusions dans lesquelles se trouve ce terme, si nous voulons demeurer dans le domaine logico-expérimental. Si nous en sortons, si nous allons dans celui du sentiment, nous accepterons ou nous repousserons les conclusions, suivant les sentiments indéterminés que ce mot éveillera en nous [FN: § 1571-2]. On remarquera que tout concourt à agir sur le sentiment. L'auteur veut absolument tirer parti des sentiments favorables que le terme vrai éveille en nous ; aussi parle-t-il d'un récit qui est vrai, bien qu’il ne contienne pas d'histoire, d'éléments historiques matériellement exacts. Pourquoi matériellement ? Si l'on entend le mot vrai dans le sens de en accord avec les faits, comment un récit peut-il bien être historique et ne pas être matériellement exact ? Il pourrait être historique dans l'ensemble et ne pas être exact partiellement ; mais il ne semble pas que ce soit ce que l'auteur entend ; et s'il avait jamais entendu cela, il ne devait pas parler de récits vrais à leur manière. Jules César a été ou n'a pas été dictateur. Dans le premier cas, la dictature de César est un fait historique ; dans le second, elle ne l'est pas. On ne comprend pas ce que voudrait dire la proposition suivante : « Dire que César n'a pas été dictateur est un récit vrai à sa manière, bien qu'il ne renferme pas les éléments matériellement exacts que nous y cherchons ».
Il est difficile de deviner ce que l'auteur a exactement voulu dire. Il se peut qu'il ait voulu exprimer qu'il y a des récits qui ne correspondent pas à la réalité historique, à la réalité expérimentale, mais qui correspondent à certaines choses étrangères au monde de l'expérience, choses que le sentiment de certains hommes croit connaître. Si c'était effectivement de cette idée qu'il s'agit, il eût été plus précis de l'énoncer d'une façon analogue à celle que nous avons indiquée ; mais, au point de vue des dérivations, il était bon de s'en abstenir, afin de ne pas perdre ce cortège de sentiments agréables que le terme vérité traîne à sa suite.
§ 1572. Dans un chapitre plein de réticences, Mgr. Duchesne se donne beaucoup de peine pour justifier, sans en avoir l'air, les persécutions contre les donatistes [FN: § 1572-1] . Après avoir cité un ouvrage de Saint Augustin, il écrit : « (p. 143) Sous d'autres formes encore, livres de controverses, conférences locales, sermons, lettres, les évêques s'efforçaient de présenter la vérité et de la faire parvenir au public donatiste ». Il est évident que pour Mgr. Duchesne aussi, cette vérité est différente de celle que « présentaient et faisaient parvenir au public » Saint Augustin et d'autres Saints Pères, lorsqu'ils niaient qu'il y eût des antipodes. Si donc on voulait éviter l'équivoque, au lieu du mot vérité, on devrait écrire : ce que les catholiques croient être la vérité. Mais alors, on manquerait le but, qui est de créer une confusion entre la vérité subjective, qui n'est reconnue que par les personnes qui ont la foi, et la vérité objective, qui est prouvée par l'accord avec les faits, et par conséquent de faire naître un sentiment de blâme contre les donatistes, capables de nier cette vérité objective.
§ 1573. C'est précisément grâce aux termes qui, en réalité, sont subjectifs, que ces dérivations peuvent être employées pour prouver aussi bien le pour que le contre. Par exemple, les dérivations dont se sert Mgr. Duchesne, pour justifier les persécutions souffertes en Afrique par les donatistes, sont précisément les mêmes que celles dont on se sert en France, de notre temps, pour justifier les persécutions contre les coreligionnaires de Mgr. Duchesne. Celui-ci commence par reprocher aux donatistes d'avoir été les ennemis des catholiques. De même les libres penseurs français reprochaient aux catholiques d'être leurs ennemis et ceux de la République. Il arriva qu'en Afrique un évêque catholique de Bagaï (p. 130) fut maltraité par les donatistes. Il arriva qu'en France Dreyfus fut maltraité, dit-on, par les catholiques. « (p. 130) Poussé à bout, l'épiscopat catholique [le gouvernement républicain français]. se rappela qu'il existait des lois contre les fauteurs de schisme [contre les congrégations religieuses] et qu'en somme toute cette église donatiste [le plus grand nombre des congrégations religieuses] représentait une vaste contravention ». Après avoir rappelé les pénalités de la loi de Théodose contre les hérétiques, Mgr. Duchesne continue : « (p. 131) C'eût été beaucoup de sévérité, s'il s'était agi d'hérétiques paisibles [de catholiques qui ne s'occupent pas de politique, dira-t-on, en France ; qui ne sont pas des moines ligueurs, dira Waldeck-Rousseau]; mais, eu égard au tempérament des donatistes et aux excès qu'ils se permettaient sous l'œil de fonctionnaires complaisants, c'était trop peu [nos anti-cléricaux contemporains diront : mais eu égard au tempérament des cléricaux et aux excès qu'ils se permettaient contre Dreyfus, contre les Israélites, les protestants, contre les libres penseurs, sous l'œil de magistrats complaisants, c'était trop peu] ». Mgr. Duchesne se réjouit de la persécution exercée, au temps de Saint Augustin, contre les donatistes, comme le ministre Combes, un chef des anti-cléricaux, se réjouit de la persécution exercée, de notre temps, contre les catholiques, ou, si l'on veut, les « cléricaux » français. « (p. 132) On ne peut nier que la pression officielle ait abouti à de sérieux résultats. L'exaltation des circoncellions [des moines ligueurs de Waldeck-Rousseau] n'était pas le fait de tous les donatistes [de tous les catholiques français]. Il ne manquait pas parmi eux de gens sensés qui se rendaient compte de la stupidité de leur schisme [de l'infaillibilité du pape, dira-t-on en France] et ne cherchaient qu'un (p. 133) prétexte pour s'en détacher ; beaucoup étaient donatistes par habitude, par tradition de famille, sans savoir pourquoi, sans même y penser sérieusement [c'est dans des termes tout à fait identiques que les anti-cléricaux français parlaient des catholiques] ; d'autres n'étaient retenus dans la secte que par la frayeur que leur inspiraient les violents. En somme, l'intervention de l'État tendait beaucoup moins à molester les consciences qu'à les délivrer d'une oppression insupportable ». C'est justement ce qu'ont dit et répété Waldeck-Rousseau, Combes et tous les anti-cléricaux français ; et il ne manque pas de métaphysiciens pour nous apprendre qu'en persécutant les cléricaux le gouvernement a « créé la liberté ».
§ 1574. Ces bons et doux catholiques de Saint Augustin ne demandaient rien d'autre – dit Mgr. Duchesne – que l'unité de la foi. Mais n'est-ce pas précisément ce que demandait M. Combes ? Il disait : « Nous croyons qu'il n'est pas chimérique de considérer comme souhaitable et comme praticable de réaliser dans la France contemporaine ce que l'ancien régime avait si bien établi dans la France d'autrefois. Un seul roi, une seule foi : telle était alors la devise. Cette maxime a fait la force de nos gouvernements monarchiques, il faudrait en trouver une qui soit analogue et qui corresponde aux exigences du temps présent (séance du Sénat, du 24 juin 1904) ». Mgr. Duchesne cite un certain refrain, et ajoute : « (p. 127) Les enfants catholiques chantaient cela par les rues et popularisaient ainsi la politique d'union ». En France, au XXe siècle, La Lanterne et d'autres journaux anti-cléricaux se donnaient la même tâche. Sous Louis XIV, dans les Cévennes, les dragons aussi s'employaient activement à réaliser « l'unité de la foi ».
§ 1575. Les vérités qu'on trouve en ce monde sont si nombreuses, qu'il peut bien y en avoir une qui soit conforme au rapport existant entre le récit de Mgr. Duchesne et les faits tels qu'ils sont racontés par Saint Augustin, avec les commentaires dont celui-ci les accompagne. Mais il est certain que cette vérité n'est pas la vérité historique, et que le texte du saint fait une tout autre impression que la prose de l'auteur moderne.
En vérité, Saint Augustin vise à quelque chose de plus et de mieux qu'à réprimer « une contravention aux lois ». Le bon saint nous donne une théorie complète de la persécution. Il compare le schismatique au frénétique [FN: § 1575-1] , et veut employer la force pour guérir aussi bien l'un que l'autre. Il n'admet pas qu'on ne doive pas être forcé à la justice [FN: § 1575-2] , et il le prouve par un grand nombre de beaux exemples bibliques. Cet excellent homme veut employer l'exil et les amendes contre les dissidents, afin qu'ils apprennent à préférer ce qu'ils lisent dans l'Écriture aux rumeurs et aux calomnies des hommes [FN: § 1575-3] . Il va sans dire que les rumeurs et les calomnies sont les choses jugées telles par le docte Saint Augustin, par le grand savant qui lisait dans l'Écriture qu'il n'y a pas d'antipodes, contrairement aux rumeurs et aux calomnies des ignorants qui y croyaient. Pour qu'il ne subsiste aucun doute sur ses intentions, le saint ajoute : « Et cela, en vérité, je l'ai dit de tous les donatistes et de tous les hérétiques qui, devenus chrétiens par les sacrements, s'éloignent de la vérité du Christ ou de l'unité » [FN: § 1575-4]. Quiconque lirait uniquement l'histoire de Mgr. Duchesne, et ne recourrait pas au texte de Saint Augustin, serait loin de soupçonner l'existence de toute cette doctrine. Ce n'est pourtant pas une chose négligeable, et Mgr. Duchesne sait fort bien que lorsqu'en France, sous Louis XIV, on voulut persécuter les protestants, l'archevêque de Paris fit imprimer la traduction de deux lettres de Saint Augustin, pour justifier la nouvelle persécution par l'ancienne. Il n'ignore pas non plus que Bayle en tira argument pour une éloquente défense de la tolérance [FN: § 1575-5]. Mgr. Duchesne n'aurait pas mal fait de nous donner son avis sur ce point, sans recourir, pour pouvoir garder le silence, au prétexte de la contravention.
§ 1576. Il ne parle pas non plus de la cupidité qui portait les catholiques à s'approprier les biens des donatistes. Saint Augustin, qui nous apprend le fait [FN: § 1576-1], donne une réponse de peu de valeur, en disant que les donatistes qui se convertirent conservèrent leurs biens, et il feint de ne pas comprendre l'accusation, quand il objecte qu'il y a contradiction entre vouloir convertir les donatistes et vouloir les dépouiller de leurs biens : le reproche vise les biens, non pas de ceux qui se convertissent, mais de ceux qui ne se convertissent pas. Elles sont belles les métaphores dont se sert Saint Augustin, pour justifier les persécutions contre les donatistes [FN: § 1576-2] . « Devais-je raisonnablement m'opposer à cette mesure – dit-il – afin que vous ne perdiez pas les choses que vous dites vous appartenir, et que vous puissiez proscrire le Christ en toute sécurité ? afin que vous puissiez faire testament selon le droit romain, tandis que vous déchiriez par des incriminations calomnieuses le Testament de droit divin donné à vos pères [remarquez le double sens de testament et le jeu de mots tenant lieu d'argument] ... afin que vous puissiez librement contracter des achats et des ventes, tandis que vous osiez diviser ce que le Christ vendu a acheté ? » Et l'auteur continue ainsi, accumulant des contrastes obtenus grâce à des termes à double sens et des jeux de mots. Ces arguments pitoyables et absurdes ont été admirés par un grand nombre de gens. Ainsi que nous l'avons si souvent dit et répété en des cas semblables, cela montre la vanité des dérivations. Au fond, le raisonnement de Saint Augustin est le suivant : « Vous croyez ce que nous, nous estimons erroné. Par conséquent, tout est licite pour vous amener de cette croyance, que nous estimons mauvaise, à la nôtre, que nous estimons bonne ; et vous ne pouvez vous plaindre de rien, puisqu'en vous convertissant, vous avez un moyen d'éviter tout dommage ». Mais sous cette forme, le raisonnement a beaucoup moins de force persuasive que sous la forme employée par Saint Augustin, où la vérité et l'erreur, le bon et le mauvais, de subjectifs deviennent objectifs.
§ 1577. Il est naturel que celui qui partage la foi de Saint Augustin ne puisse admettre que les termes rappelés plus haut sont subjectifs. Mais s'il voulait qu'ils fussent objectifs, il pourrait aussi admettre, sans nuire à sa foi, que leur objectivité est différente de celle qu'on trouve dans une expérience de chimie ou de physique ; et cela suffirait pour éviter toute contestation avec la science expérimentale, qui s'occupe uniquement de faits de ce dernier genre.
§ 1578. D'autres fois, la confusion entre les nombreuses espèces de vérités a lieu sans aucune intention préconçue d'en tirer avantage. Elle reproduit seulement une confusion analogue qui existe dans l'esprit de l'auteur. Celui-ci voit les faits à travers un verre coloré, et les décrit tels qu'il les voit. Il dit ce qui lui paraît bien, et ne se soucie guère de rechercher dans quel rapport est ce bien avec la réalité expérimentale. Quand Renan parle de l'« ineffable vérité » [FN: § 1578-1] des sentences de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, il est évident qu'il donne au terme vérité un sens entièrement différent de celui qu'il aurait, si l'auteur parlait d'une expérience de chimie ou de physique ; mais on ne sait pas à quelle réalité objective correspond le terme dont Renan fait usage, et il semble probable qu'il corresponde simplement à certains de ses sentiments. De toute façon, on voit dans ses œuvres que, pour lui, la vérité historique n'est pas du tout la vérité scientifique. Il observe que deux récits d'une même scène, faits par des témoins oculaires, diffèrent essentiellement, et demande : « Faut-il pour cela renoncer à toute la couleur des récits et se borner à l'énoncé des faits d'ensemble ? Ce serait supprimer l'histoire [FN: § 1578-2] . » Non ; ce serait simplement supprimer le roman historique. Celui qui refuserait de s'occuper d'histoire parce qu'il ne peut la connaître au complet, dans tous ses moindres détails, refuserait de posséder le moins parce qu'il ne peut avoir le plus ; mais vice versa, celui qui accepte le moins qui est certain, ou presque certain, ne s'oblige pas ainsi à accepter aussi le plus, qui est incertain ou manifestement contraire aux faits. Nous ne pouvons avoir une description complète d'aucun fait ; mais il faut du moins s'efforcer de savoir ce qui nous est connu du fait, et ce que nous devons négliger. En outre, la probabilité a différents degrés. Il est presque certain que la bataille du Tessin a eu lieu ; il est très douteux qu'avant de la livrer, P. Cornelius ait prononcé le discours que lui attribue Polybe ; il est presque certain, en tout cas, qu'il doit y avoir quelque différence entre les paroles dites par P. Cornelius, et celles que rapporte Polybe. Il est presque certain – pour ne pas dire certain, au sens vulgaire – que Jutes César a existé ; il est très douteux, pour ne pas dire plus, que Romulus soit également un personnage réel. Nous ne pouvons donc mettre dans la même classe des choses si différentes. Au point de vue des dérivations, la confusion est utile ; au point de vue logico-expérimental, on ne saurait tolérer ces équivoques. Que l'on donne le nom qu'on voudra à l'accord d'un récit avec les faits ; qu'on l'appelle vérité historique ou autrement, cela importe peu. Mais si l'on ne veut pas parler pour ne rien dire, il faut que ce nom soit différent de celui qui désigne les miracles des diverses religions, les différentes légendes, les présages et les récits du genre de la Lampe merveilleuse d'Aladin. Une partie de ces récits auront, si l'on veut, une vérité supérieure à la vérité expérimentale, – soit, ne disputons pas là-dessus – mais en somme, il faut que cette vérité, supérieure autant qu'on voudra, ait un nom qui permette de la distinguer de l'humble, inférieure et vulgaire vérité expérimentale [FN: § 1578-3].
§ 1579. L'abbé de Broglie explique assez bien une notion subjective de la nature des prophéties. Kuenen avait démontré que les prophéties de la Bible ne concordent pas avec les faits ; l'abbé de Broglie répond [FN: § 1579-1] : « p. 194) Kuenen part d'une fausse notion de la prophétie. Il suppose que les textes prophétiques n'ont qu'un seul sens, que ce sens doit être clair, qu'il doit être celui que les Prophètes et leurs contemporains ont compris. Il n'admet d'accomplissement de prophétie que quand les événements sont conformes au sens ainsi fixé ». Tel est, en effet, le sens des raisonnements objectifs de la critique historique, et, en général, de la science logico-expérimentale [FN: § 1579-2] . L'abbé de Broglie oppose à Kuenen certains raisonnements subjectifs qu'on peut parfaitement accepter, pourvu qu'on les distingue des précédents. C'est là le point essentiel, si l'on ne veut pas divaguer. L'abbé de Broglie écrit : « (p. 194) Tout autre est la vraie notion de la prophétie ». Et comme d'habitude, ce terme vrai nous conduit à l'amphibologie. Cela n'arriverait pas, si, au lieu de vraie notion, l'abbé de Broglie disait « ma notion », ou bien « la notion des catholiques », ou s'il usait d'une autre expression équivalente ; mais il ne le fait pas, parce que la dérivation a besoin du mot vrai, pour faire naître certains sentiments. Notre auteur continue. « (p. 194) C'est une parole de Dieu, adressée aux générations futures et qui ne doit être comprise qu'après l'événement. C'est une énigme dont l'événement doit donner la clef » [FN: § 1579-3]. Si l'on raisonne objectivement, on doit reconnaître que, de cette façon, les prophéties des païens valent celles des chrétiens, et l'énigme du « mur de bois » qui devait sauver les Athéniens est même beaucoup plus claire qu'un grand nombre de prophéties bibliques. De notre temps, les somnambules nous gratifient aussi de prophéties vraies, qui ne sont comprises que par les gens bien disposés, et après que le fait prédit a eu lieu. Le Livre des Songes nous fait aussi connaître, avec une certitude absolue, les numéros qui sortiront au tirage de la loterie ; mais par malheur, c'est en général seulement après le tirage que l'on comprend quels numéros on devait jouer ; ce qui est profondément regrettable pour les pauvres gens qui portent leur argent à la loterie. Un certain Guynaud s'est donné la peine d'écrire un livre pour démontrer que toutes les prophéties de Nostradamus se sont vérifiées ; et ses raisonnements ne sont, après tout, pas plus mauvais que d'autres du même genre sur la vérification des prophéties [FN: § 1579-4] (§ 621 et sv.). Mais il n'est pas très difficile d'accorder des prophéties avec des faits passés. Lors même que l'erreur des faits est patente, l'abbé de Broglie tente encore une conciliation, et finit par dire que si l'on n’y réussit pas, on peut suspendre son jugement à ce sujet [FN: § 1579-5].
§ 1580. On pose souvent cette question ; « Comment doit-on écrire l'histoire ? » D'abord, il y a l'amphibologie du terme histoire, qui peut signifier deux genres bien différents de compositions, suivant le but visé : 1° On peut avoir le but exclusivement scientifique de décrire les faits et leurs rapports. Uniquement pour nous entendre, appelons histoire scientifique ce genre de composition. 2° On peut avoir divers autres buts : par exemple celui de fournir une lecture agréable ; c'est ce qu'on essaye de faire dans le roman historique ; un but didactique, qui serait de peindre l'histoire sous des couleurs si vives qu'elle pénètre et s'imprime dans l'esprit ; dans cette intention, on se résigne, s'il le faut, à sacrifier la précision au coloris ; et l'on s'efforce d'atteindre ce but au moyen d'histoires qui se rapprochent plus ou moins du roman historique ; un but d'utilité sociale ou d'une autre utilité semblable, qui consisterait à faire naître, à provoquer, à émouvoir les sentiments, de manière à fortifier le patriotisme, le respect pour un certain genre de régime politique, le désir de grandes et utiles entreprises, le sens de l'honnêteté, etc. On tend vers ce but au moyen de compositions flottant entre l'histoire scientifique et le roman historique, et qui ont pour caractéristique de savoir colorer opportunément les faits, et surtout de les passer sous silence, lorsqu'il le faut [FN: § 1580-1] . On doit savoir s'écarter de la réalité expérimentale, sans se laisser prendre en flagrant délit de mensonge. Souvent l'auteur est aidé en cette tâche, parce qu'avant d'induire les autres en erreur, il s'est trompé lui-même. Il voit les faits tels qu'il les dépeint aux autres. Ensuite, dans la question que nous étudions, il y a une autre amphibologie : celle du terme doit-on, qui peut se rapporter au but même, ou bien aux moyens à employer pour l'atteindre. La proposition : comment doit-on écrire l'histoire ? peut signifier : 1° Lequel des buts précédents doit-on, faut-il choisir? 2° Ce but choisi, quels moyens doit-on, faut-il employer pour l'atteindre ? La première de ces propositions est elliptique, comme toutes les autres du genre [FN: § 1580-2] . L'indication du but spécial en vue duquel on doit choisir ce but de l'histoire fait défaut. Par exemple, on peut dire : En vue de la prospérité matérielle, politique ou autre, d'un pays, d'une classe sociale, d'un régime politique, etc., comment est-il bon que se comportent les divers auteurs qui écrivent l'histoire ? Ou bien : Quand et comment est-il bon d'employer ces compositions historiques ? Convient-il d'en employer une seule ? ou bien de les employer toutes en proportions différentes, suivant les diverses classes sociales [FN: § 1580-3], suivant les diverses fonctions sociales des individus ? Ou bien encore : Dans un pays donné et en un temps donné, laquelle de ces compositions est-il bon d'employer dans les écoles primaires, laquelle dans les écoles secondaires, laquelle dans les universités, pour procurer des avantages déterminés à la société entière, à une partie de la société, à un régime politique déterminé, etc. ? La seconde des propositions indiquées est de nature technique. Le but est exprimé, et lorsqu'on demande de quels moyens on doit faire usage pour l'atteindre, cela revient à demander quels sont les moyens les mieux adaptés pour l'atteindre.
La proposition : « Comment doit-on enseigner l'histoire ? » se confond en grande partie avec la précédente, car, en général, on écrit l'histoire dans le but de l'enseigner, et, de toute manière, elle donne lieu à des observations analogues. D'habitude, on ne fait pas la distinction des genres que nous avons indiqués ici, et les compositions qui portent le nom d'histoire sont un mélange de ces genres, avec une adjonction d'un grand nombre de considérations éthiques. Mais il serait prématuré de s'arrêter maintenant sur ce sujet, qui trouvera mieux sa place au chapitre XII.
§ 1581. Jusqu'à présent, nous nous sommes placés au point de vue objectif. Si nous considérons ces propositions au point de vue subjectif, elles sont, en général, bien exprimées, et l'amphibologie disparaît, parce qu'au fond leur signification est la suivante : « Quels sont les sentiments qui, chez vous, s'accordent avec les sentiments qu'éveillent dans votre esprit les termes : écrire, enseigner l'histoire ? »
§ 1582. Précisément parce que, ainsi posé, le problème a une solution unique, beaucoup de personnes s'imaginent qu'il n'en a qu'une aussi, quand on l'envisage au point de vue objectif ; et s'il leur vient, par hasard, quelque doute, elles distinguent avec peine les différentes solutions objectives. Souvent, presque toujours, un auteur qui écrit une histoire plus ou moins altérée ne sait pas lui-même quelle altération il apporte aux faits, et il les raconte tels qu'ils se présentent à son esprit, sans trop se soucier de rechercher s'il les voit tels qu'ils sont. Il serait surpris, si on lui demandait : « Dites-nous au moins si c'est une histoire scientifique que vous voulez écrire, ou bien une histoire mélangée de roman historique, de digressions polémiques ou autres ». Il dirait peut-être : « C'est une histoire et voilà tout ». Ainsi que nous l'avons souvent observé, celui qui suit le raisonnement scientifique distingue, sépare des choses que les personnes étrangères à ce raisonnement confondent au moins en partie.
§ 1583. Même celui qui recherche de quelle manière on doit enseigner l'histoire, pour qu'elle soit le plus possible utile à la société, doit ou croire ou au moins feindre de croire qu'il y a une solution unique. Ni lui ni l'artiste qui joue dans un drame ne peuvent s'interrompre pour avertir le public que ce qu'ils disent est de la fiction ; tous deux doivent s'incarner dans leur rôle, éprouver ce qu'ils disent. Mais ces considérations nous entraînent dans un domaine différent de celui auquel appartient ce chapitre.
§ 1584. Le terme souverain bien [FN: § 1584-1], ou même simplement bien, a une infinité de sens, et chaque philosophe le définit à sa façon. Ces sens ont ceci de commun : un noyau de certains sentiments agréables, qui demeurent, après qu'on a éliminé des sentiments désagréables ou seulement même réputés tels. À un extrême, nous avons uniquement les plaisirs sensuels du moment ; puis vient s'ajouter la considération des peines ou des plaisirs futurs ; puis l'action qu'ont sur l'individu ceux qui sont en rapport avec lui ; puis l'opposition que l'individu même trouve entre les plaisirs sensuels et les plaisirs, ou les peines qu'il éprouve, grâce à certains résidus, particulièrement ceux de la IIe et de la IVe classe ; continuant ainsi, on voit ces résidus devenir prédominants, et les plaisirs sensuels accessoires ; jusqu'à ce qu'enfin, on atteigne l'autre extrême, où tout sentiment agréable est mis en un anéantissement des sens, en une vie future, en quelque chose qui dépasse, en somme, le domaine expérimental.
§ 1585. Jusqu'ici, nous avons considéré l'individu, vu de l'extérieur ; mais l'individu lui-même, dans son for intérieur, ne voit presque jamais les choses de cette façon. On remarquera tout d'abord que, à l'instar de ce qui arrive en général pour de semblables sentiments, là où nous cherchons des théories précises, il n'existe qu'un ensemble d'idées peu déterminées ou dont la détermination est seulement verbale. Et cela non seulement pour le vulgaire, mais aussi pour les gens instruits, même savants, très savants. Pourtant, il arrive que les commentateurs cherchent tant et plus quelle était l'idée de leur auteur, et ne réussissent presque jamais à la trouver [FN: § 1585-1] . Il n'y a pas à s'en étonner, ni à en attribuer la faute à quelque défaut de leurs connaissances ou de leur raisonnement, car ils cherchent ce qui n'existe pas (§ 541 1°, 578). Ensuite, comme nous l'avons déjà remarqué tant de fois, chez l'individu qui veut donner une forme précise et logique aux sentiments qu'il éprouve, il y a d'habitude la tendance à attribuer une valeur absolue à ce qui n'est que relatif, à rendre objectif ce qui n'est que subjectif. Par conséquent, celui qui a en lui l'un des innombrables agrégats de sentiments décrits plus haut n'exprimera pas son état en disant simplement ce qu'il éprouve : il exprimera comme absolue et objective cette façon de sentir. Il ne dira jamais : « À moi et pour moi ceci paraît être le souverain bien ». Il dira, ce qui est bien différent : « Ceci est le souverain bien » ; et il emploiera des dérivations pour le prouver.
§ 1586. La dérivation sera en partie justifiée par le fait qu'outre le phénomène subjectif indiqué tout à l'heure, il y en a d'autres encore, qui sont objectifs, et qu'il faut considérer. Un certain agrégat A de sentiments existant chez un individu, nous pouvons nous poser les problèmes suivants. Quel sera, à un moment déterminé, et pour un but déterminé, l'effet, sur l'individu, de l'existence de A. De même, quel sera cet effet sur d'autres individus déterminés, sur des collectivités déterminées ? Au fond, ces problèmes constituent la théorie de l'équilibre social, et la difficulté de les résoudre est très grande. C'est pourquoi, ne pouvant faire autrement, nous devons chercher à les simplifier, en sacrifiant plus ou moins la rigueur.
§ 1587. On peut obtenir une première simplification en ne tenant pas compte des déterminations précises de l'individu, des collectivités, du moment, ou bien, en d'autres termes, en considérant certains phénomènes moyens et généraux. Mais, pour ne pas tomber en de graves erreurs, il faut se rappeler ensuite que les conclusions de ces raisonnements seront, elles aussi, moyennes et générales. Par exemple, on peut dire : « Le plaisir présent peut être compensé par la peine future ». C'est une manière elliptique de dire : « Pour beaucoup d'hommes, en général, il y a compensation entre le plaisir présent et le plaisir futur ». On peut dire : « Pour beaucoup d'hommes, en général, le plaisir présent peut causer une grave peine, en raison de la perte de l'estime et de la considération (en général) des autres individus de la collectivité ». Mais il serait erroné de tirer de cette proposition générale une conséquence particulière, en disant, par exemple : « Le plaisir présent peut causer à Paul une grave peine, en raison de la perte de l'estime et de la considération des individus M, N, P... ». En effet, il se pourrait que Paul ne se souciât point de cette estime ni de la considération, en général, ou bien, en particulier, de l'estime et de la considération de M, N, P...
§ 1588. On indique souvent l'effet sur les collectivités d'une manière quelque peu indéterminée, en parlant de la prospérité économique, militaire, politique, de la nation ; ou bien de la prospérité de la famille ou d'une autre collectivité restreinte, au point de vue de l'économie, de la dignité, de l'estime d'autrui, etc. Quand on ne peut avoir le plus, on est bien forcé de se contenter du moins, et ces problèmes, bien que nullement rigoureux, peuvent toutefois conduire à des théories sociologiques qui, en moyenne et en général, ne s'écartent pas trop des faits. Pour l'heure, nous devons nous considérer comme heureux, si nous pouvons les résoudre tant bien que mal, au moins en partie. Au fur et à mesure que la science progressera, on s'efforcera de les poser et de les résoudre plus rigoureusement.
§ 1589. Mais pour celui qui ne suit pas les méthodes de la science expérimentale, ces problèmes ne sont même pas posés de la façon peu rigoureuse indiquée tout à l'heure ; ils sont posés d'une manière absolument indéterminée. On recherche, par exemple, ce que doit faire l'individu, sans même établir les distinctions si simples entre son « bien » direct et son « bien » indirect, entre le « bien » de l'individu considéré comme faisant partie d'une collectivité et le « bien » de la collectivité. Peut-être, par une concession extrême, parlera-ton du « bien » de l'individu et du « bien » de la nation à laquelle il appartient, et nous pourrons nous estimer heureux si, au bien de la nation on ne substitue pas le « bien » de l'humanité. Mais, dans cette considération, les résidus de la sociabilité ne tardent pas à s'imposer, et au lieu de rechercher la solution des problèmes, on fait un prêche pour démontrer à l'individu qu'il doit sacrifier son « bien » à celui de l'humanité.
§ 1590. Tout cela se reflète dans les dérivations au moyen desquelles, partant des sentiments qui existent chez l'individu, ou de certains résidus, on arrive à démontrer que cet individu doit agir de la manière que l'auteur de la dérivation estime bonne. Cette manière ne s'écarte jamais beaucoup de celle qui est reçue par la société dans laquelle vit l'auteur. Comme d'habitude, on sait d'où l'on part ; on sait où l'on doit arriver ; la dérivation suit une voie quelconque qui joint ces deux points.
§ 1591. La dérivation qui use du mot souverain bien, ou bien, met tout dans ce mot : elle y met les agrégats des sentiments dont elle part ; elle y met aussi tout ce qu'elle peut des résultats qu'elle veut obtenir. Ainsi, l'une des plus fréquentes dérivations est celle qui, partant des sentiments d'égoïsme, donne le moyen d'atteindre le but des oeuvres de l'altruisme.
§ 1592. Un phénomène analogue a eu lieu en économie politique. Les économistes littéraires, incapables d'avoir une notion précise de l'équilibre économique, ont mis dans le terme valeur tout ce qu'ils pouvaient y mettre comme données de faits et comme résultats auxquels ils voulaient arriver. C'est ainsi que le terme valeur est devenu, bien qu'en de moindres proportions, un quid simile du terme souverain bien.
§ 1593. Les philosophes anciens et les modernes, ainsi que les théologiens, se sont donné beaucoup de peine pour trouver ce que pouvait bien être ce souverain bien ; et comme c'est une chose subjective, au moins en grande partie, chacun trouvait aisément ce qui lui plaisait. L'extrême, auquel on ne considère autre chose que le plaisir présent des sens, extrême qui n'est atteint, pas même par le chien, lequel sait aussi considérer des peines et des plaisirs futurs, n'a pas ou presque pas de théoriciens ; il est même douteux que les propositions qu'on pourrait citer comme étant de cette espèce, soient autre chose que des plaisanteries.
§ 1594. La première adjonction au sentiment du plaisir sensuel présent peut être la considération des conséquences, sensuelles elles aussi, de ce plaisir. À vrai dire, il ne semble pas que personne ait jamais été assez stupide pour les négliger entièrement. Celui qui le ferait, devrait avaler, uniquement parce qu'elle a bon goût, une boisson qu'il saurait être toxique. La question consiste donc uniquement dans la considération plus ou moins étendue de ces conséquences [FN: § 1594-1] .
§ 1595. Chez les cyrénaïques, qui appelaient souverain bien le plaisir présent, il semble que l'extension des conséquences n'était pas grande, mais était pourtant notable. Aristippe [FN: § 1595-1] , pour le peu que nous en savons, voulait que l'homme gouvernât toujours par son esprit les sentiments de plaisir sensuel et présent auxquels il cédait. C'est ce qu'exprime le mot célèbre d'Aristippe à l'égard de Laïs [FN: § 1595-2] : « Je la possède ; elle ne me possède pas ». Suivent d'autres adjonctions, toujours pour considérer d'autres plaisirs, outre les plaisirs présents ; ainsi, on disait déjà d'Aristippe qu'il déconseillait de rien faire contre les lois, à cause des peines établies [FN: § 1595-3] , et l'on ajoute : de l'opinion ; mais cela nous transporte dans un autre domaine. En suivant cette voie, on peut, par des dérivations opportunes, arriver où l'on veut.
§ 1596. Quand on dit que le souverain bien c'est la volupté [FN: § 1596-1] (I, 12, 40) Extremum autem esse bonorum voluptatem, il y a déjà une dérivation qui appartient au genre (IV-γ), et qui feint de donner l'explication d'un terme indéterminé, obscur, en le présentant comme équivalent d'un autre terme, lui aussi indéterminé, obscur. À la vérité, la volupté qui figure dans cette formule n'est pas la volupté vulgaire, que tout le monde connaît, mais une autre, qu'il faut déterminer. Cicéron plaisante là-dessus [FN: § 1596-2] : « (II, 3, 6) Alors il dit en riant : Ce serait vraiment parfait que celui-là même qui dit que la volupté est le but de tout ce que nous attendons, l'extrême, l'ultime des biens, ne sût pas ce que c'est ! » Il ajoute que les termes de voluptas en latin, ![]() en grec, sont parfaitement clairs, et que ce n'est pas sa faute à lui s'il ne les comprend pas quand ils sont employés par Épicure ; mais que c'est la faute de celui-ci, qui les détourne de leur sens vulgaire. En cela, Cicéron a raison ; mais sa critique va beaucoup au-delà de ce qu'il voudrait, car elle atteint tous les raisonnements métaphysiques, y compris ceux de Cicéron lui-même. Pour ne pas chercher trop loin, voici que, lorsque Cicéron veut prouver que la volupté n'est pas le souverain bien, il dit, en parlant d'hommes qui satisfont tous les plaisirs des sens : « (II, 8, 24) Je ne dirai jamais que ces gens dissolus vivent bien ou bienheureusement ». Dans cette proposition, il induit le lecteur en erreur, par le double sens de vivre bien ou bienheureusement, cette expression pouvant se rapporter aux sensations des gens dissolus ou à celles de Cicéron, lequel devrait dire, par conséquent : « Les gens dissolus estiment leur vie bonne et bienheureuse, et moi, si je devais mener cette vie, je ne l'estimerais pas telle ». Cicéron ajoute ensuite : « (II, 8, 24) De là résulte, non pas que la volupté n'est pas la volupté, mais qu'elle n'est pas le souverain bien ». Cela est vrai ou faux, suivant la personne dont il s'agit. Pour les gens dissolus, c'est le souverain bien ; pour Cicéron, ce n'est pas le souverain bien ; et cette dernière expression se rapporte à une chose qui n'est pas bien définie [FN: § 1596-3].
en grec, sont parfaitement clairs, et que ce n'est pas sa faute à lui s'il ne les comprend pas quand ils sont employés par Épicure ; mais que c'est la faute de celui-ci, qui les détourne de leur sens vulgaire. En cela, Cicéron a raison ; mais sa critique va beaucoup au-delà de ce qu'il voudrait, car elle atteint tous les raisonnements métaphysiques, y compris ceux de Cicéron lui-même. Pour ne pas chercher trop loin, voici que, lorsque Cicéron veut prouver que la volupté n'est pas le souverain bien, il dit, en parlant d'hommes qui satisfont tous les plaisirs des sens : « (II, 8, 24) Je ne dirai jamais que ces gens dissolus vivent bien ou bienheureusement ». Dans cette proposition, il induit le lecteur en erreur, par le double sens de vivre bien ou bienheureusement, cette expression pouvant se rapporter aux sensations des gens dissolus ou à celles de Cicéron, lequel devrait dire, par conséquent : « Les gens dissolus estiment leur vie bonne et bienheureuse, et moi, si je devais mener cette vie, je ne l'estimerais pas telle ». Cicéron ajoute ensuite : « (II, 8, 24) De là résulte, non pas que la volupté n'est pas la volupté, mais qu'elle n'est pas le souverain bien ». Cela est vrai ou faux, suivant la personne dont il s'agit. Pour les gens dissolus, c'est le souverain bien ; pour Cicéron, ce n'est pas le souverain bien ; et cette dernière expression se rapporte à une chose qui n'est pas bien définie [FN: § 1596-3].
§ 1597. Nous avons une proposition : A est égal à B, et nous voulons au contraire qu'il soit égal à C. Pour cela, nous avons deux procédés : ou bien de respecter la première proposition, et de changer le sens de B, de manière à ce qu'il soit identique à C ; ou bien de nier la première proposition, et d'y substituer la suivante : A est égal à C.
§ 1598. La dérivation s'allonge, parce qu'en outre de la volupté, on veut tenir compte de résidus de la persistance des agrégats (juste, honnête, etc.), et de résidus de l'intégrité personnelle (honorable, digne, etc.), soit relativement à l'individu, en les plaçant dans l'agrégat de sentiments qu'il éprouve, soit à l'égard d'autres personnes, de la collectivité, en plaçant dans la dérivation l'indication de certains buts qu'on veut atteindre. On a ainsi un très grand nombre de théories dont nous n'avons pas à nous occuper ici ; nous nous bornerons à exposer le peu qui est nécessaire pour mieux comprendre la nature des dérivations.
§ 1599. Cicéron [FN: § 1599-1] rappelle que, selon Hiéronyme de Rhodes, le souverain bien est l'absence de toute douleur (II, 3, 8). Il blâme Épicure, qui ne sait se décider (II, 6, 18), car il devrait, ou accepter la volupté au sens vulgaire, que Cicéron dit être celui d'Aristippe, ou prendre pour volupté l'absence de douleur, ou unir les deux choses, et avoir ainsi deux buts. « (II, 6, 19) En vérité, de nombreux et grands philosophes tirent une semblable union des buts des biens ; ainsi Aristote, qui unit l'usage de la vertu à une vie de prospérité parfaite. Calliphon ajouta la volupté à l'honnête ; Diodore ajouta à l'honnête l'absence de douleur. Épicure aurait pu faire de même, s'il avait uni la maxime qui maintenant est de Hiéronyme avec celle qui fut d'Aristippe ». Il compte ensuite (II, 11, 35) qu'en ce qui concerne le souverain bien, il y a trois opinions dans lesquelles il n'est pas question de l'honnête : celles d'Aristippe ou d'Épicure, d'Hiéronyme, de Carnéade [pour celui-ci le souverain bien consiste à jouir des principes de la nature : Carneadi frui principiis naturalibus, esset extremum], trois autres où l'honnête est mis avec quelque chose d'autre ; ce sont celles de Polémon, de Calliphon, de Diodore. Une seule, dont Zénon est l'auteur, met le souverain bien dans la décence et dans l'honnêteté.
§ 1600. Suivant Saint Augustin, Varron faisait un compte plus ample des opinions possibles, et arrivait au nombre respectable de 298 ; mais ensuite il observe qu'elles se réduisent à douze, en triplant les quatre choses : la volupté – le repos – la volupté unie au repos – les premiers biens de la Nature – la vertu. Varron supprime les trois premières, non qu'il les blâme, mais parce qu'elles sont comprises dans les premiers biens de la Nature [c'est là une belle, mais obscure entité], et il réduit ainsi les opinions à trois : la recherche des premiers biens de la nature pour arriver à la vertu, ou la vertu pour arriver à ces biens, ou la vertu pour elle-même. Saint Augustin [FN: § 1600-1] tourne en plaisanterie tous ces bavardages, et, les négligeant, établit et arrête que la vie éternelle est le souverain bien, la mort éternelle le souverain mal. Ainsi nous voilà arrivés à l'autre extrême des dérivations.
§ 1601. Le noyau de sentiments correspondant aux divers sens donnés par les métaphysiciens et par les théologiens au terme vrai, est constitué principalement par des notions qui ne trouvent pas d'opposition dans l'esprit de celui qui emploie l'un des noms que l'on donne à ces sens. Ainsi naît spontanément la conception de l'égalité du bien et du vrai, qui sont des agrégats de sentiments, lesquels ne trouvent ni l'un ni l'autre d'opposition dans l'esprit de celui qui emploie ces mots. Pour des motifs semblables, on peut étendre l'égalité à ce qu'on dit être beau. Y aura-t-il un homme qui, trouvant une chose bonne et vraie, ne la jugera pas de même belle ? Ce qui existe dans son esprit doit exister dans l'esprit de tous, surtout si c'est un métaphysicien ou un théologien ; et quiconque a le malheur de ne pas penser comme lui, ne mérite certainement pas le nom d'homme. D'où résulte aussitôt la conclusion que tous les hommes sont d'accord avec lui ; et le pouvoir et le lustre de ses excellentes théories s'accroissent. Mais il se peut que cet homme éminent trouve un pareil, qui ne soit pas d'accord avec lui. Autrefois ils se persécutaient alors mutuellement, se mettaient en prison, parfois se brûlaient ; aujourd'hui, adoucis, ils se contentent de s'injurier.
§ 1602. Il y a aussi une belle entité qui s'appelle Nature et qui, avec son adjectif naturel, auquel se joint encore un certain état naturel, joue un grand rôle dans les dérivations. Ce sont des mots si indéterminés que souvent celui-là même qui les emploie ne sait ce qu'il veut leur faire exprimer [FN: § 1602-1] . Dans la vie journalière, l'homme rencontre beaucoup de choses qui lui sont contraires, lui causent des maux ou seulement des ennuis, par suite de certaines circonstances qu'il estime artificielles. Telles seraient les attaques des brigands, les embûches des voleurs, les arrogances de ceux qui sont riches ou puissants, etc. Si l'on élimine toutes ces circonstances, il reste un noyau, que nous appellerons naturel, par opposition aux artifices éliminés, et qui doit nécessairement être parfaitement bon, puisque nous nous sommes précisément débarrassés de tout ce qu'il y avait de mal (§ 1546). Qu'on veuille bien observer, en effet, la manière dont raisonnent tous les auteurs métaphysiciens, théologiens, adeptes des physiocrates, de Rousseau, et autres semblables rêveurs. Ils ne disent pas : « Voici un état que nous appelons naturel. L'observation de tel et tel qui l'ont vu et étudié, a fait connaître qu'il avait certaines qualités ». Au contraire, ces personnes, partant de l'état présent, éliminent tout ce qui leur paraît mal, et donnent le nom de naturel à ce qui reste. Bien plus, Rousseau, admiré, adoré encore par beaucoup de gens, avoue naïvement qu'il ne se soucie pas des faits (§ 821). Parmi ses nombreux précurseurs, on peut mettre ce saint Père qui, louant le bel ordre donné par Dieu à la Nature, raconte que, dans cette Nature, tous les petits animaux vivent dans la paix et la concorde [FN: § 1602-2] . N'avait-il donc jamais vu des araignées manger des mouches, des oiseaux manger des araignées, des abeilles essaimer ? N'avait-il pas lu Virgile [FN: § 1602-3] ? De nos jours encore, nous trouvons des auteurs qui valent ce saint Père, et rien n'est plus amusant que la manière de raisonner de ceux qui se moquent des « superstitions catholiques », et qui accueillent avec respect les superstitions des fidèles de Rousseau.
§ 1603. Dans les notes de sa traduction du traité des Lois de Cicéron [FN: § 1603-1] , Ch. de Rémusat trouve au moins quatre sens dans lesquels le mot Nature est employé par Cicéron. À cause du manque de place, je me borne à les indiquer brièvement ; mais le lecteur fera bien de les voir dans l'original. Nous avons : l° un sens général : la nature est l'ensemble des faits de l'univers 2° un sens particulier : la nature est la constitution de chaque être 3° un autre sens, expliqué ainsi : « Mais Cicéron l'emploie aussi dans un sens propre et singulier, qui n'est déterminé qu'implicitement et par la connaissance de sa doctrine [excellent moyen de créer des logomachie]. La nature d'un être est ce qui le constitue, ce qu'il est, ou sa loi. En conséquence elle est bonne, elle est sa perfection ; témoin ces phrases : Ad summum perducta natura, 1, 8; ducem naturam, 1, 10, etc. Ainsi l'expression du droit naturel n'est pas indifférente ; car elle emporte que le droit existe par lui-même, qu'il fait partie de la loi générale des êtres [il y a des gens qui comprennent cela !] Voyez : Natura constitutum, 1, 10 ; quod dicam naturam esse, quo modo est natura, utilitatem a natura, 1, 12 ». 4° Une certaine puissance. « C'est par une dérivation vague de cette acception que l'on se représente aussi la nature comme une puissance distincte et agissante qui produit et conserve le monde... Natura largita est, docente natura, 1, 8 ; eadem natura, 1, 9; natura factos, natura dati, a natura data, 1, 12 ».
Le lecteur peut aisément se figurer combien est précieux pour les dérivations ce terme qui signifie tout. et rien.
§ 1604. Avec Aristote, dame Nature change entièrement d'aspect. Le Stagirite [FN: § 1604-1] commence par remarquer (II, 1, 1) que les êtres naturels ont en eux un principe de mouvement ou de repos, tandis qu'au contraire un lit, un vêtement ou d'autres objets semblables n'ont pas ce principe, parce qu'ils ne tendent pas à changer. Il suit de là que « (2) la nature est principe et cause du mouvement et du repos, pour l'être en lequel ce principe existe primitivement en soi et non par accident ». Ensuite, il y a encore une autre définition. « (1, 10) En un sens, nous pouvons appeler nature la matière première existant chez les êtres qui ont en eux un principe de mouvement et de mutation. En un autre sens : la forme et l'espèce selon la définition [FN: § 1604-2] ». Aujourd'hui encore, il y a des gens qui s'imaginent comprendre ces discours et les admirent. Dans la préface de sa traduction du traité que nous venons de citer d'Aristote, Barthélemy Saint-Hilaire dit : « (p. IV). je n'hésite pas à déclarer pour la Physique qu'elle est une de ses œuvres [d'Aristote] les plus vraies et les plus considérables » [FN: § 1604-3] . Pourtant, au sujet de la définition de la nature, indiquée tout à l'heure, le bon Barthélemy Saint-Hilaire a quelques scrupules : « (p. XXXII) Je ne voudrais pas soutenir que cette définition (p. XXXIII) de la nature soit à l'abri de toute critique... Lui-même [Aristote] sans doute la trouvait insuffisante ; car il essaie de l'approfondir un peu davantage. Il se demande donc puisqu'il reconnaît deux éléments essentiels dans l'être, la matière et la forme, avec la privation, si c'est la matière ou la forme qui est la véritable nature [comment distingue-t-on la vraie nature de celle qui n'est pas vraie ?] des êtres. Il incline à penser que la forme d'une chose est bien plutôt sa nature que ne l'est la matière ; car la matière n'est en quelque sorte qu'en puissance, tandis que la forme est l'acte et la réalité ». Nous avons ainsi un excellent exemple de dérivations verbales : on a mis ensemble un grand nombre de mots qui excitent certains sentiments, mais qui ne correspondent à rien de réel.
§ 1605. D'après la manière dont furent constitués les agrégats de sentiments correspondant aux termes : fin de l'homme, souverain bien, droite raison, nature, on comprend aisément que ces termes peuvent être pris l'un pour l'autre, car, en somme, ils représentent, avec beaucoup d'indétermination, un même ensemble de sentiments. C'est ainsi que les Stoïciens ont pu dire que la fin de l'homme, le souverain bien, c'est vivre suivant la nature. Qu'est-ce que cette nature représente de précis ? On l'ignore ; et il est bon qu'on ne le sache pas, parce que les sens divers et indéterminés qu'on lui donne servent à faire accepter la proposition indiquée tout à l'heure, et d'autres semblables. Bien plus, selon Stobée, Zénon commença par dire d'une manière encore plus indéterminée, que la fin, c'est de vivre d'une façon harmonique ; ce qui, ajoute Stobée, [FN: § 1605-1] « est vivre suivant une raison et harmoniquement. Mais ceux qui vinrent ensuite, en corrigeant, expliquèrent ainsi : vivre en harmonie avec la nature [FN: § 1605-2] ... Cléanthe, le premier,... ajouta la nature, et établit que la fin, c'était de vivre en harmonie avec la nature ». Continuant à rendre équivalents des termes qui correspondent à certains sentiments, les Stoïciens disent que la fin, c'est la félicité : « c'est là vivre suivant la vertu, vivre harmoniquement ou, ce qui revient au même, vivre suivant la nature ».
§ 1606. Il convient ensuite de porter spécialement notre attention sur le principe de sociabilité et sur le principe altruiste qui existent en de tels agrégats de sentiments, et de ne pas oublier la droite raison. Toutes ces belles choses, nous les fourrerons dans la notion de nature, et nous dirons avec les stoïciens, selon Diogène Laërce [FN: § 1606-1] : « Par conséquent, la fin c'est vivre conséquemment à la nature, c'est-à-dire suivant sa propre nature et suivant celle de l'univers, sans rien faire de ce que la loi commune prohibe habituellement, ce qui est la droite raison qui arrive partout [sic ], qui est auprès de Zeus, et qui avec lui gouverne toute chose existante. C'est là la vertu de l'homme heureux et la prospérité de la vie, alors que tout se fait en accord avec l'esprit de chacun, avec la volonté du modérateur de toute chose. C'est pourquoi Diogène dit expressément que la fin, c'est la droite raison dans le choix de ce qui est selon la nature; et Archidamos dit que c'est vivre en accomplissant tous ses devoirs ». Voilà un bon exemple de dérivation verbale : on accumule des mots, et l'on a un mélange où il y a un peu de tout.
§ 1607. Le type de ces dérivations est le suivant. On veut démontrer que A est égal à B. On commence par démontrer que A est égal à X, parce que les sentiments éveillés par A et par X concordent ; et l'on prend soin de choisir X d'un sens tellement vague et indéterminé que, d'une part, les sentiments que fait naître ce terme concordent avec ceux qui sont provoqués par A ; d'autre part, ils peuvent aussi concorder avec ceux provoqués par B. De cette façon s'établit l'égalité de X et de B. Mais comme on a déjà vu que A est égal à X, il en résulte que A est aussi égal à B, ce que précisément on voulait démontrer. Ce raisonnement est semblable à celui que nous avons déjà vu (§ 480 et sv.), et au moyen duquel on prouve l'égalité de A et de B par l'élimination d'une entité X, étrangère au domaine expérimental. De même, en d'autres cas, l'intervention d'un terme indéterminé qui correspond mal à une chose réelle, a des conséquences semblables à l'intervention d'un terme correspondant à une entité qui se trouve entièrement en dehors du domaine expérimental (§ 108, 1546). Un exemple remarquable de ces dérivations est celui que nous avons examiné précédemment (§ 1557 et sv.), en traitant de la solidarité. Nous avons vu alors que X (solidarité-fait) est vraiment, de l'aveu des auteurs même du raisonnement, l'opposé de B (solidarité-devoir); et pourtant, la proposition A est X (parmi les hommes existe la solidarité-fait) sert à démontrer que A est B (parmi les hommes, il faut qu'existe la solidarité-devoir).
Au point de vue de la logique formelle, les raisonnements avec X indéterminé sont des syllogismes à plus de trois termes, le moyen terme X étant devenu multiple, précisément à cause de son indétermination, sans que, souvent, on puisse même fixer avec précision combien il a de sens. Ensuite, si X sort du domaine expérimental, outre la cause d'erreur indiquée, qui subsiste presque toujours, nous avons la majeure et la mineure du syllogisme, qui n'ont pas de sens, parce qu'elles établissent des rapports entre des faits expérimentaux et des entités non-expérimentales.
§ 1608. Rousseau dit que la volonté générale X ne peut errer ; ce qui correspond à la proposition : X est A (sans erreurs, droite). Pour démontrer cela, il considère tous les citoyens comme constituant une seule personne, ayant une seule volonté, et comme il donne d'ailleurs un sens spécial au terme erreur, la proposition veut dire qu'une personne est seule juge de ce qui lui est agréable ou désagréable. Sous cette forme on peut admettre la proposition. Maintenant, on modifie X, et l'on ne peut faire autrement, puisque ces citoyens qui agissent tous ensemble comme une seule personne n'existent pas. On affirme, sans donner de preuve, que la volonté générale X est exprimée par la somme des volontés particulières, quand les citoyens votent sans communiquer entre eux. Comme cela aussi est impossible, on modifie nouvellement X, et, se contentant du peu qu'on puisse avoir, on suppose que X est la somme des volontés particulières sans brigues et sans associations partielles. Ainsi s'établit l'égalité de la volonté générale avec le vote des citoyens B, lorsqu'ils votent sans brigues et sans associations partielles. Mais nous avons vu que X est égal à A ; donc A est égal à B, et nous concluons qu'il ne peut y avoir d'erreur A dans la décision des citoyens B qui votent sans brigues et sans associations partielles. Le jeu plaît aux admirateurs de Rousseau, et ils le continuent. De nouveau, X se modifie et devient l'expression de la majorité des élus de la majorité (?) des électeurs, sans qu'il soit plus question des brigues ni des associations. C'est ainsi que nous avons l'un des dogmes les plus sublimes de la religion démocratique [FN: § 1608-1].
§ 1609. Ce raisonnement est accepté par beaucoup de gens. Ce n'est pas en vertu de sa valeur logico-expérimentale, car elle est zéro ; ni du manque d'intelligence des personnes qui l'acceptent, parce qu'il y en a de très intelligentes. D'où vient donc le succès de la dérivation ? Il a une infinité de causes. En voici quelques-unes : 1°Les gens qui font partie, ou croient faire partie de la majorité, acceptent volontiers une théorie qu'ils comprennent dans ce sens qu'elle consacre leur infaillibilité. 2° Les habiles qui gagnent de l'argent au moyen des droits protecteurs et de tant d'autres façons ; ceux qui obtiennent de l'élection populaire pouvoir, honneurs, richesses, jugent tous les théories, non d'après leur valeur intrinsèque, mais d'après la force qu'elles ont de flatter les électeurs dont ils dépendent. Est-ce la faute des habiles, si les électeurs se repaissent de sornettes ? Blâmé de s'être jeté aux pieds du tyran Denys, Aristippe répondit : « Ce n'est pas ma faute à moi, mais à Denys, qui a les oreilles aux pieds ». 3° Des personnes qui ne font pas partie de la majorité, mais sont hostiles à leurs supérieurs dans la hiérarchie sociale, qui s'attachent à ceux qu'ils croient être en majorité, pour combattre ces supérieurs, ou simplement pour leur faire pièce. 4° Un petit nombre d'individus qui ont un besoin intense de religiosité acceptent ce dogme de la religion démocratico-humanitaire, comme ils auraient accepté tout autre dogme. Ils auraient peut-être été prêtres de Cybèle, aux temps du paganisme, moines au moyen âge, ils sont aujourd'hui adulateurs de la plèbe. 5° Beaucoup de personnes peu intelligentes acceptent l'opinion de la collectivité, grande ou restreinte, dans laquelle elles vivent, et passent facilement de l'admiration de Bossuet à celle de Voltaire, de Rousseau, de Tolstoï et de tous ceux qui obtiennent de la renommée et du crédit. 6° Des personnes, qui jugent les théories sans y comprendre grand'chose, estiment cette théorie bonne uniquement parce qu'elle flatte agréablement leurs sentiments. Enfin, on pourrait trouver d'autres causes semblables, en fixant son attention sur les nombreuses catégories qu'on peut former, suivant les différentes façons dont les intérêts et les sentiments agissent sur le jugement des hommes.
§ 1610. Le genre de dérivations (IV-γ) a un cas extrême, dans lequel on observe de simples coïncidences verbales. Par exemple, en 1148, au concile de Reims [FN: § 1610-1] « fut amené un gentilhomme Breton nommé Eon de l'Étoile, homme presque sans lettres : qui se disoit être le fils de Dieu et le juge des vivans et des morts, sur l'allusion grossière de son nom avec le mot latin Eum dans cette conclusion des exorcismes Per eum qui judicaturus est : et dans celle des oraisons Per eumdem. Cette imagination toute absurde qu'elle étoit, ne laissa pas de lui servir à séduire une grande multitude de peuple ignorant des extrémitez de la France, c'est-à-dire, de Bretagne et de Gascogne... » L'amphibologie des termes et des propositions est un excellent moyen pour expliquer les oracles et les prophéties ; et quand on y ajoute les métaphores (IV-δ) et les allégories (IV-ε), il serait vraiment nécessaire d'être entièrement dépourvu d'imagination pour ne pas savoir tirer de ces oracles et de ces prophéties tout ce qu'on peut désirer. Prenant comme point de départ des raisonnements de ce genre, qu'on prétend faits sérieusement, on arrive peu à peu à de simples plaisanteries, telles que la réponse donnée à celui qui demandait s'il pouvait demeurer en sécurité quant à ses ennemis : Domine stes securus, qu'on peut comprendre dans le sens qu'il pouvait effectivement demeurer en sécurité, et qui signifiait le contraire : Domi ne stes securus.
§ 1611. Un exemple remarquable des dérivations du présent genre (IV-γ), au moyen desquelles on parcourt les deux voies, de la chose au mot et du mot à la chose, nous est donné par les explications du terme démon.
§ 1612. 1° De la chose au mot. Les Grecs désignaient par le terme ![]() des choses imaginaires, variables suivant les temps et les auteurs. Dans Homère,
des choses imaginaires, variables suivant les temps et les auteurs. Dans Homère, ![]() se confond souvent avec la notion de
se confond souvent avec la notion de ![]() , ou mieux avec la notion de l'action du
, ou mieux avec la notion de l'action du ![]() . On a dit, mais cela est douteux, que souvent c'est l'action mauvaise qui est indiquée ainsi. Chez Hésiode, les
. On a dit, mais cela est douteux, que souvent c'est l'action mauvaise qui est indiquée ainsi. Chez Hésiode, les ![]() sont d'une nature intermédiaire entre celle des dieux et celle des hommes, mais ils sont tous bons. Dans la suite, cette nature intermédiaire permit de distinguer de bons et de mauvais démons. Messieurs les philosophes ont voulu s'en mêler, et comme leur sens moral était offusqué de voir la religion populaire attribuer aux dieux de bonnes et de mauvaises actions, ils jugèrent à propos, pour s'épargner la peine que leur causaient les mauvaises, d'en faire cadeau aux démons [FN: § 1612-1]. C'est là une dérivation semblable à celle qui distingue la droite raison, qui fait tout bien, de la simple raison, qui pèche parfois. Ce thème des mauvaises actions fut développé par plusieurs auteurs, qui créèrent des démons pervers au-delà de toute expression.
sont d'une nature intermédiaire entre celle des dieux et celle des hommes, mais ils sont tous bons. Dans la suite, cette nature intermédiaire permit de distinguer de bons et de mauvais démons. Messieurs les philosophes ont voulu s'en mêler, et comme leur sens moral était offusqué de voir la religion populaire attribuer aux dieux de bonnes et de mauvaises actions, ils jugèrent à propos, pour s'épargner la peine que leur causaient les mauvaises, d'en faire cadeau aux démons [FN: § 1612-1]. C'est là une dérivation semblable à celle qui distingue la droite raison, qui fait tout bien, de la simple raison, qui pèche parfois. Ce thème des mauvaises actions fut développé par plusieurs auteurs, qui créèrent des démons pervers au-delà de toute expression.
§ 1613. 2° Du mot à la chose. Les chrétiens trouvèrent ce terme ![]() en usage, et en tirèrent profit pour remonter du mot à la chose. Les Grecs, qui d'abord avaient mis ensemble dieux et démons, à un moment donné les séparèrent, pour pouvoir rejeter exclusivement sur les démons les fautes et les crimes qu'il leur était difficile de nier chez les dieux [FN: § 1613-1] . Les chrétiens ne se le firent pas dire deux fois ; et, confondant, de bonne foi ou à dessein, l'ancien et le nouveau sens du terme démon, ils conclurent que, de l'aveu des païens eux-mêmes, les dieux de ceux-ci étaient des êtres malfaisants. De cette façon, la dérivation réalisait le désir des chrétiens, qui trouvaient des témoins et des preuves de leur propre théologie dans le camp même de l'adversaire. Cet excellent Platon ayant, dans le Banquet, raconté plusieurs fables absurdes sur les démons, Minucius Félix [FN: § 1613-2] a grand soin de ne pas laisser perdre ce trésor, et se prévaut de l'autorité de Platon pour démontrer que les démons animaient les statues des dieux. Lactance aussi estime que les dieux des Gentils sont des démons, et, s'adressant aux Gentils, il leur dit [FN: § 1613-3] : « S'ils estiment qu'on ne doit pas se fier à nous, qu'ils en croient Homère, qui met le très grand Jupiter au rang des démons, ainsi que d'autres poètes et philosophes qui nomment de la même manière les démons et les dieux. De ces deux noms, le premier est vrai, le second faux ». Tatien, lui aussi, fait de Zeus le chef des démons. Il peut avoir tort, aussi bien qu'il peut avoir raison, car l'un et les autres nous sont également inconnus ; c'est pourquoi la science expérimentale ne saurait absolument pas décider si Tatien dit vrai ou non [FN: § 1613-4] .
en usage, et en tirèrent profit pour remonter du mot à la chose. Les Grecs, qui d'abord avaient mis ensemble dieux et démons, à un moment donné les séparèrent, pour pouvoir rejeter exclusivement sur les démons les fautes et les crimes qu'il leur était difficile de nier chez les dieux [FN: § 1613-1] . Les chrétiens ne se le firent pas dire deux fois ; et, confondant, de bonne foi ou à dessein, l'ancien et le nouveau sens du terme démon, ils conclurent que, de l'aveu des païens eux-mêmes, les dieux de ceux-ci étaient des êtres malfaisants. De cette façon, la dérivation réalisait le désir des chrétiens, qui trouvaient des témoins et des preuves de leur propre théologie dans le camp même de l'adversaire. Cet excellent Platon ayant, dans le Banquet, raconté plusieurs fables absurdes sur les démons, Minucius Félix [FN: § 1613-2] a grand soin de ne pas laisser perdre ce trésor, et se prévaut de l'autorité de Platon pour démontrer que les démons animaient les statues des dieux. Lactance aussi estime que les dieux des Gentils sont des démons, et, s'adressant aux Gentils, il leur dit [FN: § 1613-3] : « S'ils estiment qu'on ne doit pas se fier à nous, qu'ils en croient Homère, qui met le très grand Jupiter au rang des démons, ainsi que d'autres poètes et philosophes qui nomment de la même manière les démons et les dieux. De ces deux noms, le premier est vrai, le second faux ». Tatien, lui aussi, fait de Zeus le chef des démons. Il peut avoir tort, aussi bien qu'il peut avoir raison, car l'un et les autres nous sont également inconnus ; c'est pourquoi la science expérimentale ne saurait absolument pas décider si Tatien dit vrai ou non [FN: § 1613-4] .
§ 1614. (IV-δ) Métaphores, allégories, analogies. Données comme une simple explication, comme un moyen de se faire une idée d'une chose inconnue, les métaphores et les analogies peuvent être employées scientifiquement pour passer du connu à l'inconnu ; mais, données comme une démonstration, elles n'ont pas la moindre valeur scientifique. Parce qu'une chose A est, en certains points, semblable, analogue à une autre chose, B, il ne s'ensuit nullement que tous les caractères de A se retrouvent en B, ni qu'un certain caractère soit précisément l'un de ceux pour lesquels l'analogie existe.
§ 1615. Il y a des usages directs et des usages indirects des métaphores et des analogies. Comme exemple d'usages directs, on peut prendre le suivant. A et B ont en commun le caractère P, par lequel A est analogue à B, et métaphoriquement dit égal à B. Mais B a aussi un caractère Q, qui ne se retrouve pas en A. De l'égalité de A et de B on tire la conclusion que A a aussi le caractère Q. C'est là l'usage le plus fréquent du raisonnement par analogie, parce qu'on aperçoit moins l'erreur, si l'on a soin de ne pas séparer P de Q, et de s'exprimer de manière à ne pas laisser apercevoir que c'est seulement à cause du caractère commun P, que A est dit égal à B. Comme exemple d'usages indirects, on peut citer le suivant. A est analogue à B pour un certain caractère P, qui se trouve être commun en A et en B. De même, B est analogue à C pour un certain caractère commun Q, qui n'existe pas en A. On raisonne ainsi : A est égal à B; B est égal à C ; donc A est égal à C (§ 1632).
Cet usage n'est pas très fréquent, parce que la forme du raisonnement fait saisir le sophisme. Pour le dissimuler mieux, il faut supprimer autant que possible toute forme de raisonnement logique, et employer la dérivation qui persuade par les sentiments accessoires que suggèrent certains termes (IV-β).
§ 1616. Les dérivations au moyen de métaphores, d'allégories, d'analogies, sont très usitées par les métaphysiciens et les théologiens. Les œuvres de Platon sont une suite de métaphores et d'analogies, données comme démonstrations. Par exemple, il écrit la République pour étudier ce qu'est le juste et l'injuste, et c'est par l'analogie qu'il résout ce problème. Il commence (p. 386 e) par établir une analogie entre la recherche de la justice et la lecture de l'écriture. Celle-ci ne se lit-elle pas mieux quand elle est écrite avec de grands caractères ? Donc cherchons quelque chose où la justice se trouve en grands caractères. La justice se trouve en l'homme et dans la société ; mais la société est plus grande que l'homme ; donc il sera plus facile d'y discerner la justice. Et dans tout le livre on continue sur ce pied. Dans le Phédon, Platon donne une excellente démonstration de l'immortalité de l'âme : « (p. 71) Socrate. Dis-moi donc, au sujet de la vie et de la mort, ne dirais-tu pas que vivre est le contraire de mourir ? – Kébès. Certainement. – Soc. Et qu'ils naissent l'un de l’autre ? Kéb. Oui. – Soc. Donc qu'est-ce qui naît du vivant ? – Kéb. Le mort. – Soc. Mais qui donc naît du mort ? – Kéb. On est forcé d'avouer que c'est le vivant. – Soc. Donc, ô Kébès, du mort naissent les vivants et tout ce qui a vie. – Kéb. Il semble. – Soc. Donc nos âmes sont [après la mort] aux Enfers ? – Kéb. Il me semble... ».
§ 1617. Au temps de la querelle des investitures, le pape et l'empereur brandissaient des métaphores, en attendant que des armes plus concrètes décidassent de la victoire. La métaphore des deux glaives est célèbre. « C'est que sur le fondement de cette parole des apôtres à Jésus-Christ : Seigneur, voici deux glaives ; on prétendoit que ces deux glaives signifioient la puissance temporelle, qu'on appelloit le glaive matériel, et la puissance ecclesiastique, qu'on appelloit le glaive spirituel ; et c'est en ce sens que Saint Bernard dit dans cette lettre : L'un et l'autre glaive appartient à Pierre ; l'un doit être tiré à sa sollicitation, l'autre de sa main, toutes les fois qu'il en est besoin. C'est de celui qui convenoit le moins à Pierre, qu'il lui fut dit de le mettre dans le fourreau. Il étoit donc aussi à lui, mais il ne le devoit pas tirer de sa main » [FN: § 1617-1]. Les partisans de l'empereur n'admettaient nullement que le glaive matériel appartînt aussi au pape. « D'où vient cette autorité au pape de tirer un glaive meurtrier outre le glaive spirituel ? Le pape Gregoire premier dit, que s'il eût voulu se mêler de faire mourir des Lombards, ils n'eussent plus eu ni roi ni ducs. „ Mais, ajoute-t-il, parce que je crains Dieu, je ne veux participer à la mort d'aucun homme, quel qu'il soit “. À cet exemple tous les papes suivans se contentoient du glaive spirituel : jusques au dernier Gregoire, c'est-à-dire, Hildebrand, qui le premier s'est armé contre l'empereur du glaive militaire, et en a armé les autres papes par son exemple » [FN: § 1617-2] . On employait d'autres belles métaphores. « Grégoire VII, successeur de Saint Pierre, représentant de Jésus-Christ sur la terre, croyait pouvoir châtier les successeurs de Nemrod, qui n'étaient pour lui que des anges rebelles. L'âme ne l'emportait-elle point sur la matière, l'Église sur la société laïque, et le sacerdoce sur l'Empire, comme le soleil sur la lune et l'or sur le plomb ? [FN: § 1617-3] ». Ces deux métaphores, la comparaison du pouvoir papal à l'âme, du pouvoir laïque à la matière, et la comparaison du pouvoir papal au soleil, du pouvoir laïque à la lune, furent largement employées. Dans sa lettre à Henri, roi d'Angleterre, Saint Yves se sert de la première métaphore ; et elle est confirmée par Saint Thomas [FN: § 1616-4] .
§ 1618. Il est encore d'autres métaphores : celle qui considère l'Église comme unie à l'État, à l'instar de l'union matrimoniale de l'homme (l'Église) avec la femme (l'État) [FN: § 1618-1] ; et celle qui, du nom de Saint Pierre, tire la démonstration du fondement divin de l'Église et de la papauté, et au sujet de laquelle on a tant écrit [FN: § 1618-2].
§ 1619. Nous avons déjà étudié les explications métaphoriques, principalement pour rechercher si et comment on pouvait remonter aux faits dont on supposait qu'elles tiraient leur origine (chap. V). Maintenant, nous les considérons principalement comme moyen d'arriver à certaines conclusions qu'on a en vue. Un peuple a un livre vénéré ou sacré ; par exemple Homère pour les Grecs, le Coran pour les musulmans, la Bible pour les Israélites et pour les chrétiens. Ou peut accepter le livre à la lettre [FN: § 1619-1]. Mais, tôt ou tard, il arrive qu'on veut voir s'il y a un autre sens que le sens littéral. On pourrait se livrer à cette recherche sans autre but que de trouver ce sens ; c'est ce que font parfois les érudits. Mais généralement on a une intention prédéterminée, et, à vrai dire, on ne cherche pas ce qu'il y a dans le livre, mais de quelle manière on peut le faire concorder avec une certaine conception déjà connue a priori. En d'autres termes, on cherche une interprétation, une dérivation, pour concilier deux choses indépendantes : le texte et la conception que l'on veut justifier (§ 1414, 1447). Pour cela, l'interprétation symbolique et l'interprétation allégorique nous offrent des moyens puissants et faciles. Nous ne parlons pas ici d'interprétations comme celles de Palaephate, dont nous nous sommes déjà occupés ailleurs (§ 661).
§ 1620. S'il y avait une règle quelconque pour déterminer quel symbole, quelle allégorie doit nécessairement représenter une expression donnée A, les interprétations symboliques ou allégoriques pourraient n'être pas vraies, c'est-à-dire ne pas correspondre aux faits, mais elles seraient du moins déterminées. Mais cette règle n'existant pas, il appartient à l'arbitraire de l'interprète de choisir le symbole et l'allégorie, et ce choix se fait souvent grâce à des ressemblances lointaines, puériles, absurdes ; par conséquent, l'interprétation devient entièrement arbitraire, indéterminée. Par exemple, cela est maintenant manifeste pour tout le monde, dans les interprétations allégoriques qu'on a données autrefois des poésies homériques. Aujourd'hui, il ne se trouve plus personne pour les prendre au sérieux ; et pourtant, si grande est la force des sentiments qui poussent à accepter certaines dérivations que, de nos jours, les modernistes les renouvellent pour l'Évangile, et trouvent des gens qui les admirent.
§ 1621. Le lecteur voudra bien se rappeler que nous parlons toujours exclusivement au point de vue de la science logico-expérimentale, et que, de ce fait, toute excursion quelconque dans le domaine de la foi nous est interdite. Si la foi impose une certaine interprétation, nous n'avons pas à dire si elle a tort ou raison : bien plus, ces termes n'ont même pas de sens en ce cas, ou, si l'on veut, ils en ont un entièrement différent de celui qu'on leur attribue dans le domaine logico-expérimental. Si quelqu'un dit que la foi lui impose de croire que le Cantique des cantiques raconte l'amour du Christ pour son Église, nous n'avons rien à objecter. Cette question échappe entièrement à la présente étude. Mais s'il veut démontrer cette interprétation par des arguments logico-expérimentaux, il pénétrera ainsi dans notredomaine, et nous jugerons ces arguments d'après les règles des sciences logico-expérimentales.
De même, il ne faut pas oublier que nous ne traitons pas ici de l'utilité sociale que peuvent avoir certaines interprétations ou certaines doctrines. Ce sujet sera étudié au chapitre XII. Une interprétation peut être absurde, au point de vue expérimental, ou à celui de la logique formelle, et être – ou ne pas être – utile à la société. C'est une chose à voir dans chaque cas particulier.
§ 1622. L'allégorie est souvent introduite à cause du besoin que l'homme éprouve d'ajouter des ornements à ses récits, même sans aucun but déterminé. C'est le motif pour lequel certains écrivains ne peuvent rien raconter sans y mêler des allégories, spontanément et même sans s'en apercevoir. Mais, plus souvent, l'allégorie est employée pour arriver à une fin, pour concilier des théories entre elles, des théories avec des faits, etc. [FN: § 1622-1]
§ 1623. Un cas singulier est celui de Saint Augustin, qui commença par l'allégorie, pour finir par s'en tenir au sens littéral, tandis qu'habituellement on suit la voie opposée. Il avait besoin de l'allégorie pour combattre les Manichéens, et il s'en servit ; ensuite il en vint au sens qu'il appelle littéral [FN 1623-1]. Pourtant, il ne faut pas se laisser induire en erreur par ce mot, car Saint Augustin admet aussi le sens figuré comme étant littéral, et ainsi il ne lui est pas moins facile qu'avec l'allégorie de tirer ce qu'il veut de l'Écriture sacrée. Lorsque, par exemple, le saint docteur dit [FN: 1623-2] (II, 13, 27) que la lumière peut signifier la créature spirituelle ; quand il dit (IV, 9, 16) que le repos du Seigneur, le septième jour, doit être entendu en ce sens que Dieu a donné le repos en lui avec le don du Saint Esprit à ses créatures raisonnables, parmi lesquelles se trouve l'homme ; quand il dit (IV, 35, 57) que le premier jour que Dieu fit, c'est la créature spirituelle et raisonnable, c'est-à-dire les anges surcélestes et les vertus ; et lorsqu'en de nombreux autres endroits il parle de même, il faut reconnaître que s'il n'use pas d'allégories, il use de métaphores ou de symboles ou d'interprétations analogues qui, au fond, sont aussi éloignées du sens littéral que pourraient l'être les allégories les plus hardies.
§ 1624. Saint Augustin accepte en même temps la réalité historique et l'allégorie, dans les récits de l'Évangile, et c'est là une théorie professée par beaucoup de personnes. Selon Saint Augustin, dans le miracle, il y a le fait historique, et en même temps une leçon pour nous [FN: § 1624-1] . « (3, 3) Nous trouvons trois morts visiblement ressuscités par notre Seigneur ». Pour le saint, c'est un fait historique ; mais il ajoute : « (3, 3) Notre Seigneur Jésus-Christ voulait que ce qu'il faisait corporellement fût aussi entendu spirituellement ». « (4, 4) Voyons donc ce qu'il voulut nous enseigner par les trois morts qu'il a ressuscités ». Tout cela est très clair.
Le fait historique et l'allégorie se trouvent souvent ensemble. Par conséquent, on ne peut savoir si l'auteur a voulu raconter un fait ou nous donner un enseignement allégorique ; car le dilemme n'existe pas, les deux choses pouvant subsister ensemble. En réalité, cela arrive fréquemment; en outre, ou bien l'auteur ne connaît pas les limites entre le récit et l'allégorie, ou bien il les oublie et il est incapable de distinguer ces deux choses l'une de l'autre ; ce qui, a fortiori, rend inutile toute tentative semblable, faite par d'autres personnes, sur le traité de cet auteur. C'est pour cette raison qu'il n'y a rien de solide dans la dispute à laquelle les modernistes, renouvelant d'anciennes tentatives, se livrent pour interpréter l'Évangile de Jean. Parfois, un auteur sépare un récit de la morale allégorique qu'on en peut tirer. Ce récit et cette morale peuvent, dans son esprit, être tous deux étrangers à la réalité ; par exemple lorsque l'auteur fait parler des animaux et en tire une morale ; en ce cas, il n'y a aucune difficulté, au point de vue logique. Il se peut aussi que l'auteur prenne le récit pour un fait réel, et l'interprète cependant en un sens allégorique [FN: § 1624-2] . En ce cas, il n'est pas facile de saisir le lien logique qu'il établit entre le fait et l'allégorie. Mais la difficulté naît principalement de l'habitude de notre esprit, qui veut chercher de la précision là où il n'y en a pas, là où l'auteur du récit et de l'allégorie s'est contenté d'un lien indéterminé.
§ 1625. De l'allégorie voulue et clairement tenue pour non-réelle, comme celle dont usent les poètes, on passe par degrés insensibles à l'allégorie que l'auteur emploie sans le savoir, et qui, dans son esprit, se confond avec la réalité. On observe souvent ce fait, lorsque la parole exprime un sentiment vif, qui donne forme et vie aux épithètes, aux images, aux allégories [FN: § 1625-1]. Les légendes tirent fréquemment leur origine de ces phénomènes. C'est là un des si nombreux cas où, comme nous l'avons vu, les termes sont indéterminés, parce que les limites des sentiments qu'ils expriment sont aussi indéterminées. On ne distingue pas bien le caractère réel du caractère allégorique d'une chose, de la même façon qu'on ne distingue pas bien le caractère objectif du caractère subjectif d'une personnification (§ 1070 et sv.). Par exemple, on ne sait si les anciens Grecs, qui entendaient nommer le songe pernicieux de l'Iliade, donnaient à ce terme un sens exclusivement allégorique, plutôt qu'un sens mêlé d'allégorie et de réalité.
§ 1626. En cette matière, nous avons plus et mieux que de simples probabilités : nous avons des faits qui sont connus en toute certitude. En outre, puisqu'on les observe en un temps comme le nôtre, où dominent la tendance scientifique et la critique historique, nous pouvons, a fortiori, admettre que des faits analogues ont pu avoir lieu en des temps où la science et la critique faisaient défaut. L'un de ces faits, vraiment remarquable, est celui de la Synthèse Subjective d'A. Comte. D'une part, l'auteur nous donne ses conceptions, non comme des réalités, mais comme des fictions utiles ; et d'autre part, il lui arrive de se complaire tellement à ces fictions qu'il les confond avec la réalité [FN: § 1626-1]. C'est là un cas où il nous est donné de connaître la voie AT (§ 636) qui, de certains faits A, mène a une théorie T. Supposons que, dans plusieurs siècles, on ne connaisse plus cette voie, et qu'il ne reste qu'une certaine théorie suivant laquelle la Terre a sagement préparé les conditions favorables à l'existence d'un certain Grand Être. Alors surgiront des interprètes de cette mythologie. Une partie d'entre eux, se proposant seulement, dans ses études, de deviner A, fera très probablement fausse route, et trouvera tout autre chose que A. D'autres nombreuses personnes, partant de cette vénérée théorie T, voudront arriver à certaines fins préétablies C, et inventeront dans ce but de belles et savantes dérivations, obtenues au moyen de subtiles interprétations allégoriques et métaphoriques.
§ 1627. Les interprétations de ce genre, dont on a voulu faire usage pour mettre d'accord les Saintes Écritures avec les faits expérimentaux, sont trop connues pour que nous nous y attardions. Souvent déjà, nous avons rencontré l'exemple vraiment remarquable du Cantique des cantiques (§ 1452). Puisque ce livre a trouvé place, par hasard ou autrement, dans les Saintes Écritures, il est nécessaire qu'il soit littérairement beau et moral ; ce qu'on démontre par les allégories, par les métaphores et par d'autres interprétations semblables [FN: § 1627-1] . Nous en avons à profusion, en tout temps. M. Gautier (loc. cit. § 1627-1) les classe de la façon suivante [FN: § 1627-2] : « (p. 129) 1° Allégorie politique. Ce système n'a jamais eu un grand nombre d'adhérents ; mais il est représenté par une série d'hypothèses individuelles, cherchant la clef du Cantique dans l'histoire d'Israël... 2° Allégorie théocratique. Les interprètes qui se rattachent à ce point de vue ont, comme les précédents, le mérite de ne pas sortir des limites de l'ancienne alliance. D'après eux, le Cantique dépeint (p. 130) l'amour réciproque de Yahvé et d'Israël. Dans le détail, il règne une grande variété d'interprétations... 3° Allégorie messianique ou christologique. …Celui-ci [le Cantique proclame l'union de l'époux et de l'épouse, du Christ, le divin chef, et de son Église... 4°Allégorie mystique. Avec ce mode d'interprétation, on quitte le sol de l'histoire... on est dans la sphère intime des rapports de l'âme avec Dieu... On ne s'étonnera pas de le voir adopté et développé dans les milieux monastiques ; il faut aussi noter qu'il est en faveur dans l'Église grecque ». L'auteur ajoute encore une autre interprétation : « (p. 131) Certains théologiens sentant la difficulté d'attribuer à l'auteur du Cantique une intention religieuse, et répugnant pourtant à renoncer à tout caractère de ce genre pour un livre biblique, ont eu recours à une distinction. C'est le cas de Franz Delitzsch et de Zœckler. Ceux-ci ne prétendent pas que l'auteur du livre ait voulu (p. 132) écrire une allégorie ; il s'est simplement proposé, suivant eux, de chanter l'amour humain. Mais, ajoutent-ils, il n'en est pas moins permis et même commandé de donner à ce poème une signification spirituelle, religieuse ; sa présence dans le recueil biblique prouve que telle est la volonté de Dieu. Dans ce cas... ce n'est plus d'allégorie qu'il s'agit, mais d'interprétation typique ou typologique [FN: § 1627-3] ». Il faut que les hommes aient beaucoup de temps à perdre, pour l'employer à ces vétilles. Nos contemporains s'occupent moins de ces divagations théologiques, mais ils les ont remplacées par des divagations métaphysiques. C'est bonnet blanc, blanc bonnet.
Renan aussi a son interprétation, qui n'est autre chose qu'un cas particulier de son système d'explication des antiquités chrétiennes. Il enlève à celles-ci le surnaturel et le mystique, mais il y laisse, il exalte même le sens éthique. Si ces antiquités ne sont pas divines, elles sont du moins hautement morales. C'est là le motif du succès qui accueillit l'œuvre de Renan. Il y avait d'un côté les croyants, de l'autre les mécréants, athées ou voltairiens, au milieu un très grand nombre de personnes qui ne voulaient aller ni à l'un ni à l'autre de ces extrêmes, et qui, partant, étaient disposées à accepter une œuvre qui fût quelque peu sceptique, sans manquer aux égards dus aux croyances ; qui enlevât le surnaturel, mais laissât le sublime ; qui suivit cette voie du juste milieu dans laquelle tant de gens aiment à demeurer [FN: § 1627-4]. L'humanitarisme n'a pas assez d'énergie pour repousser entièrement les anciennes croyances ; il en repousse uniquement ce qui ne s'accorde pas avec sa foi. De même que les chrétiens qui voyaient des démons dans les dieux des païens, l'humanitarisme voit des travestissements éthiques dans la théologie. À ce point de vue, on pourrait dire que Renan, John Stuart Mill, Auguste Comte, Herbert Spencer et un grand nombre d'autres, sont chrétiens, sans le Christ. Mais à d'autres points de vue, des différences apparaissent. Ils ont des résidus communs et des dérivations différentes. Donc, pour Renan : « (p. 137) Le poème n'est ni mystique, comme le voulaient les théologiens, ni inconvenant, comme le croyait Castalion, ni purement érotique, comme le voulait Herder ; il est moral; il se résume en un verset, le 7e du chap. VIII, le dernier du poème : „ Rien ne peut résister à l'amour sincère ; quand le riche prétend acheter l'amour il n'achète que la honte “. L'objet du poème n'est pas la voluptueuse passion qui se traîne dans les sérails de l'Orient dégénéré, ni le sentiment équivoque du quiétiste hindou ou persan, cachant sous des dehors menteurs (p. 138) son hypocrite mollesse, mais l'amour vrai... ». Si cela suffit pour rendre moral un poème, on peut trouver plusieurs passages analogues dans le livre des épigrammes érotiques de l'Anthologie grecque, et par conséquent les baptiser « moraux ». Par exemple : « (29) Si l'on demande le prix d'un baiser, celui-ci devient plus amer que l'ellébore ». (267) À un jeune homme qui dit aimer une jeune fille, et qui ne l'épouse pas parce qu'elle n'est pas assez riche, on objecte : « Tu n'aimes pas ; tu te trompes ; comment un cœur amoureux peut-il donc si bien compter ? » Piepenbring non plus ne laisse pas le Cantique des cantiques sans défense. Il cite [FN: § 1627-5] (p. 703) Budde, qui estime que, dans cet ouvrage, Salomon et la Sulamite sont des types allégoriques ; le premier est le type de la gloire, la seconde de la beauté. « (p. 704) Il établit en outre, à la suite de Wetzstein, que le Cantique des Cantiques n'est autre chose qu'un recueil de chansons de noce... Il se pourrait que l'éditeur de ce recueil eût voulu protester par sa publication contre la polygamie et faire l'éloge de l'affection mutuelle de deux époux, ce qui conférerait à ces pages une valeur morale sérieuse, malgré le réalisme trop cru qui s'y rencontre ». Voyez quelles bonnes raisons il trouve pour sauver la morale ! Voilà encore un des nombreux cas où l'on voit bien le caractère artificieux des dérivations.
§ 1628. Comme au § 636, traçons un graphique. T est le texte du Cantique des Cantiques ; A est son origine ; C est la conséquence que l'on veut tirer de T. Celui qui use des dérivations veut souvent nous faire croire que C se confond avec A. C doit être nécessairement une chose édifiante, et l'on cherche simplement la voie qui, de T peut mener en C. Il est des gens qui suivent la voie allégorique T p C, et démontrent que le Cantique des Cantiques exprime l'amour de Jésus-Christ et de l'Église. Il est des gens qui suivent la voie T n C, et démontrent que le Cantique des Cantiques chante les types de la gloire et de la beauté. Il est des gens qui suivent la voie T p C, et démontrent que le poème chante la victoire de l'amour sur la richesse. Viennent ensuite des gens qui suivent la voie T q C, et trouvent l'éloge de la monogamie. On peut continuer ainsi indéfiniment ; et l'on peut être certain que, quelle que soit la conclusion morale C à laquelle on veut arriver, la voie qui de T mène à C ne fera jamais défaut.

[Figure 19]
§ 1629. Parfois, surtout aux temps passés, la dérivation est vraiment étrange. Voyez, par exemple, le long commentaire de Saint Bernard sur le Cantique des Cantiques. La fantaisie créatrice d'allégories y dépasse toute limite. Voici, au hasard, quelques-unes de ces allégories. Que de choses en ces quelques mots : « Les fils de ma mère combattirent contre moi ». D'abord, l'épouse, – c'est-à-dire l'Église, – rappelle qu'elle a été persécutée. Comment donc ? C'est très clair. « Anna, Caïphe et Juda Iscariot étaient fils de la synagogue, et ils combattirent cruellement à sa naissance l'Église qui était aussi fille de la synagogue, en mettant en croix son fondateur Jésus. Ainsi donc, Dieu accomplit alors par eux ce qu'il avait déjà annoncé par le Prophète, disant : « Je frapperai le pasteur, et je disperserai les brebis »... De ceux-là donc et des autres qu'on sait avoir combattu les chrétiens, l'épouse dit « Les fils de ma mère combattirent contre moi[FN: § 1629-1]». L'Ecclésiaste et l'Ecclésiastique n'ont pas non plus donné peu à faire aux commentateurs. L'Ecclésiastique fut placé par les protestants parmi les livres apocryphes [FN: § 1629-2] , mais l'Ecclésiaste reste parmi les livres du canon biblique. Dans l'Ecclésiaste, il y a certainement des préceptes épicuriens ; mais, grâce à d'ingénieuses interprétations, les commentateurs en font des préceptes moraux et religieux. Saint Jérôme emploie principalement deux modes d'interprétation. D'une part, il suppose, sans la moindre preuve, que l'auteur ne parle pas en son propre nom lorsqu'il recommande de se donner du bon temps [FN: § 1629-3] . D'autre part, il prend dans un sens spirituel ce qui manifestement est dit dans un sens matériel. Par exemple, manger et boire doivent être entendus en un sens spirituel [FN: § 1629-4] , et là où l'auteur parle d'embrasser la femme, il faut entendre embrasser la sagesse [FN: § 1629-5] . À ce taux-là, on peut faire un texte moral et religieux même de l'Art d'aimer d'Ovide.
§ 1630. Les modernistes se sont trouvés en présence des mêmes difficultés que leurs prédécesseurs, en voulant concilier une foi ancienne avec une nouvelle ; et pour surmonter ces difficultés, ils ont usé de méthodes identiques à celles qui avaient été mises en œuvre déjà depuis des siècles et des siècles. Le point de départ des modernistes est l'Écriture Sainte des chrétiens, Écriture qu'ils entendent conserver. Le point auquel ils veulent arriver, c'est un accord avec la foi en la Science et la Démocratie. À l'égard de la Science, ils disent, il est vrai, qu'on ne peut leur adresser le reproche exprimé par les paroles de Grégoire IX, de plier« (p. 120) à la doctrine philosophique les pages célestes de l'Écriture [FN: § 1630-1] » ; mais, au fond, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arriver à cet accord et c'est pourquoi ils ont eu recours à « l'expérience intime du chrétien », qui est une parodie des expériences de la chimie, de la physique et des autres sciences naturelles.
À l'égard de la sainte Démocratie, ils manifestent clairement leurs intentions [FN: § 1630-2] et laissent apercevoir l'envie mal cachée d'en obtenir des honneurs et des faveurs. Mais cette Démocratie a déjà la sainte Science dans son panthéon ; comment s'en tirer ? Ne vous mettez pas en peine. Les allégories et les métaphores doivent pourtant bien servir à quelque chose. Voici M. Loisy qui renouvelle, en la disant moderne, l'antique exégèse de Philon le Juif, et qui supprime la réalité historique du Christ dans l’Évangile selon Saint Jean [FN: § 1630-3] . Cependant, M. Loisy reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. L'allégorie, le symbole sont de belles choses, mais la réalité n'est pas non plus à dédaigner [FN: § 1630-4] : « (p. 169) Ainsi la mort de Jésus est un fait historique dont la réalité n'a subi aucune transfiguration ; mais ce n'est pas en tant que mort naturelle qu'elle appartient à la foi ; c'est en tant que mort volontaire et symbole principal de la rédemption ». Enveloppée d'un brouillard si épais, l'idée de l'auteur n'est pas facile à saisir. « (p. 170) Pareillement, si l'on entend par science ce qu'entendent les modernes, et avec eux les savants modernistes, il est évident que la science en elle-même [comment distingue-t-on la science en elle-même de la simple science ?] ne peut être subordonnée à la foi, bien que le travail scientifique, en tant qu'émanant d'un être moral, puisse être entièrement (p. 171) inspiré, on peut même dire gouverné par son influence ». C'est là une énigme. Si le « travail scientifique » est inspiré et gouverné par la foi, comment se peut-il que la science, qui est le fruit de ce travail, ne soit pas subordonnée à la foi ? Si vous « inspirez et gouvernez » un artisan, il semblerait que ce qu'il produit devrait vous être subordonné. Il est vrai que ce sont, comme d'habitude, les épithètes, qui permettent de changer le sens des termes et de les élever de la terre aux nues. Cette science en elle-même doit être pour le moins cousine, sinon sœur, de la Droite Raison. Une autre belle inconnue, c'est le travail scientifique en tant qu'émanant d'un être moral. Il semblerait que les travaux scientifiques entrepris pour trouver un théorème de mathématique, une uniformité chimique, physique, astronomique, biologique, etc., demeurent les mêmes, qu'ils émanent d'un être moral ou d'un être immoral. Comment fait-on de les dédoubler ? Euclide était-il ou n'était-il pas un être moral ? Nous n'en savons vraiment rien, et n'éprouvons nullement le besoin de le savoir, pour juger sa géométrie. Comparée à ces phrases nébuleuses de M. Loisy, l'Encyclique papale, à laquelle il veut répondre, apparaît comme un modèle de clarté [FN: § 1630-5] ; et c'est justement à cause de cette clarté que, selon les modernistes, l'Encyclique se trompe en rapportant leurs opinions, lesquelles veulent exprimer et taire en même temps les choses.
§ 1631. M. L. Bourgeois et ses disciples solidaristes avaient à résoudre un problème analogue. Le point de départ était l'organisation sociale présente ; le point auquel on voulait arriver était une espèce de socialisme bourgeois. Pour effectuer le passage, on recourt à des dérivations de genres différents. Il est, entre autres, une belle métaphore, celle d'une dette qui, sans cesse payée, renaît et subsiste sans cesse [FN: § 1631-1]. Il semble que ce soit une plaisanterie ; au contraire, ce raisonnement puéril est tout à fait sérieux. Nous avons, en ce cas, une dérivation avec une entité juridique (III-δ) qui dégénère et devient une dérivation verbale (IV-δ). La notion d'une dette qui renaît au fur et à mesure qu'on la paie n'a de juridique que l'apparence : elle est simplement verbale.
§ 1632. Voyons un exemple de l'emploi indirect des métaphores. Dans son traité du Baptême [FN: § 1632-1], Tertullien commence par remarquer qu'il y a une femme du nom de Quintilla, qui combat le baptême ; puis il fait un raisonnement du genre de celui que nous avons indiqué (§ 1615). Quintilla A est une vipère B, – il ne le dit pas, mais on le comprend, – parce que Quintilla a en commun avec la vipère le caractère P d'être venimeuse. La vipère aime habiter les lieux arides. Voilà le caractère Q, qu'on trouve chez la vipère, et qui n'apparaît pas directement chez Quintilla. Mais de l'analogie entre elle et la vipère, on conclut que Quintilla doit aussi aimer le sec, fuir l'humide et l'eau C. Ensuite Tertullien refait un raisonnement implicite du même genre pour les chrétiens. Ceux-ci sont faits tels par le baptême ; le baptême est administré avec de l'eau ; donc celui qui est ennemi de l'eau est ennemi des chrétiens. Enfin on conclut que Quintilla est ennemie des chrétiens. Il est douteux que personne ait jamais pu prendre au sérieux ce raisonnement puéril ; mais il peut avoir été bien accueilli à cause des sentiments accessoires provoqués par les termes employés ; c'est-à-dire qu'il a été accepté comme un mélange de dérivations du présent genre (IV-β).
§ 1633. Ce traité de Tertullien est une mine de dérivations. En noter quelques-unes encore ne sera pas une digression inutile.
Quelqu'un s'étonnait qu'un peu d'eau puisse donner l'éternité. Tertullien répond en citant les mystères des Gentils, semblables au baptême chrétien [FN: § 1633-1] . C'est là une dérivation par analogie et par autorité (IIe classe). Ensuite, il examine pourquoi l'eau est estimée digne de régénérer le chrétien. Il répond par des analogies qui mettent en œuvre des résidus (I-β). Ensuite, on a des dérivations par analogie, auxquelles s'ajoutent des dérivations (III-α). Tout d'abord – dit Tertullien – il faut étudier l'origine de l'eau. « Au commencement – est-il dit – Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et désordonnée ; les ténèbres étaient sur l'abîme, et l'esprit de Dieu flottait sur les eaux. Tu as donc, homme, à vénérer l'eau, d'abord pour son antiquité, ensuite pour sa dignité, puisque l'esprit divin la préférait comme siège à tous les autres éléments ». Il continue, raconte de l'eau nombre de belles choses, et ne s'arrête que parce qu'il craint, s'il en disait davantage, de faire le panégyrique de l'eau plutôt que du baptême [FN: § 1633-2] . Il conclut qu'il n'y a pas à douter que l'eau, dont Dieu s'est servi en tant de choses, ne serve aussi à ses sacrements, et que, « elle qui gouverne la vie terrestre ne procure aussi la vie céleste » [FN: § 1633-3] .
§ 1634. Tertullien recourt ensuite à une dérivation (III-α) du consentement universel (IV). Il rapporte l'opinion qu'il existe des esprits immondes sur les eaux. Puis il la confirme en observant qu'on appelle Nympholeptes, Limphatices, Hydrophobes, ceux que les eaux tuèrent, rendirent fous, frappèrent de terreur. C'est là une dérivation (IV-δ), grâce à laquelle, de l'existence d'un terme métaphorique, on conclut qu'il existe une chose correspondante. Ayant ainsi posé qu'il existe des esprits immondes sur les eaux, et qu'ils agissent au détriment de l'homme, Tertullien conclut par une dérivation du présent genre (IV-δ). (IV) « Il ne sera pas malaisé de croire que le saint ange de Dieu gouverne l'eau pour le salut des hommes, puisque l'ange du mal, par un usage profane, emploie ces mêmes éléments au détriment de l'homme ». La dérivation est renforcée par une autre (IV-β), qui met en œuvre des résidus (I-β)
§ 1635. Ce type de dérivations composées, qui apparaît ici avec une clarté naïve, se retrouve, d'une façon plus ou moins dissimulée, dans un très grand nombre de raisonnements ; c'est-à-dire qu'on a une dérivation par métaphore ou analogie (IV-δ), à laquelle s'ajoutent des dérivations de sentiments accessoires (IV-β), et qui mettent en œuvre divers résidus et principalement des résidus de la Ire classe.
§ 1636. Des allégories et des métaphores peuvent être opposées à d'autres allégories et à d'autres métaphores. Des raisonnements non-scientifiques sont souvent victorieusement opposés à d'autres raisonnements non-scientifiques. Ce qui, au point de vue logico-expérimental, est une pure logomachie, peut, au point de vue de la propagande d'une doctrine, avoir une grande efficacité, par le moyen des sentiments ainsi provoqués.
§ 1637. Les adversaires de la peine de mort ont un argument usuel tiré d'une métaphore. Ils disent que la peine de mort est « un assassinat légal », et que la « Société » oppose ainsi un assassinat à un autre assassinat.
§ 1638. On va même plus loin dans cette voie. Anatole France [FN: § 1638-1] dit que « les juges n'ont rien trouvé de mieux, pour châtier les larrons et les homicides, que de les imiter », et qu'en somme la justice ne tend qu'à doubler leurs délits et leurs crimes. Assurément, au point de vue logico-expérimental, ce verbiage vaut ceux dont on use pour démontrer que la « Société » a le droit d'infliger l'amende et la peine de mort. Mais, outre ces questions de métaphores, il en est d'autres qui portent sur les choses. Pour nous exprimer comme A. France, donnons le même nom à ce qu'on a appelé, jusqu'à présent, vol et amende, ou bien assassinat et exécution judiciaire. Pourtant, si nous voulons nous entendre, il faudra bien faire comprendre de quelle chose nous voulons précisément parler. Mettons donc un astérisque au terme vol*, pour désigner l'amende, et un astérisque aussi au terme assassinat*, pour désigner l'exécution judiciaire de la peine de mort. En cette matière, il y a d'autres problèmes que ceux des noms à donner aux choses. Si l'on disait à un homme : « Vous êtes homicide, aussi bien si vous tuez votre fils, que si vous tuez le brigand qui veut tuer votre fils, donc, il doit vous être indifférent de faire l'une ou l'autre chose », il est probable qu'il répondrait : « À moi, le nom ne m'importe nullement ; je tue le brigand et je sauve mon fils ». À la société humaine aussi, les noms importent peu. Parmi les problèmes de choses qu'on aurait à envisager, deux surtout sont à noter. 1° Comment se fait-il que le plus grand nombre des nations civilisées ont opposé en fait le vol * au vol, l'assassinat * à l'assassinat ? 2° Ces mesures sont-elles utiles ou indifférentes ou nuisibles à la prospérité de la société ? Ces problèmes ne peuvent évidemment être résolus qu'au moyen de considérations sur les choses, et non au moyen de considérations sur les noms des choses ; il faut étudier les faits, et non les métaphores des littérateurs. La dérivation employée par A. France est copiée de la dérivation générale, très en usage chez les humanitaires, au moyen de laquelle on donne aux délinquants le nom de « malheureux » [FN: § 1638-2] ; puis, profitant du sens équivoque de ce terme, on conclut que les délinquants méritent les plus tendres attentions de la « société ». Telle est l'origine d'œuvres comme les Misérables de Victor Hugo, au moyen desquelles les littérateurs gagnent de l'argent en flattant les instincts humanitaires. Le chien enragé aussi est un « malheureux », et la « société » n'a rien trouvé d'autre à opposer à la mort qu'il donne aux gens, que la mort qu'on lui inflige. Il se pourrait que ce fût encore là un bon moyen pour se débarrasser de certains délinquants beaucoup plus dangereux que les chiens enragés. Quiconque désire connaître les beaux exploits de ces gens en trouvera facilement tant qu'il voudra dans les chroniques des journaux.
La fièvre humanitaire a maintenant acquis un tel degré d'acuité que ceux qui en souffrent ne se contentent plus des faits du présent, mais recherchent avidement ceux du passé, même d'un passé reculé, pour donner libre cours à leur passion aveugle ; et comme les hommes industrieux savent produire ce que le consommateur demande, nous voyons de stupéfiantes manifestations avoir lieu en faveur des délinquants du passé [FN: § 1638-3] . On ne sait pas si c'est pour faire une satire discrète de cette fièvre, ou par amour du paradoxe, ou pour ces deux raisons, que l'éminent avocat Henri Robert revient sur le cas quelque peu lointain de Lady Macbeth, et fait une défense éloquente de cette remarquable personne, à tel point que la tourbe humanitaire veut l'absoudre et la réhabiliter. Mais il y a mieux : plusieurs excellentes personnes constituent un comité pour réviser le procès de la trop célèbre madame Lafarge, fait sous le règne de Louis-Philippe. Peut-être lirons-nous un jour en quatrième page des journaux : « Bonne récompense à qui indiquera un procès qui puisse servir de dada aux humanitaires ».
§ 1639. Nous avons vu comment, en partant d'un fait réel, une description, un récit, successivement altérés, modifiés, transformés, aboutissent à une légende. Quand on parcourt cette voie, on ajoute souvent des allégories, des métaphores, des symboles. Ainsi croit et se développe la légende, en s'écartant toujours plus du fait réel qui lui a donné naissance (voir: FN: § § 1639 note 1).
§ 1640. Telle est la voie par laquelle on passe de la chose aux mots ; mais les légendes se forment aussi par une autre voie, dans laquelle on passe des mots à la chose ; c'est-à-dire que la légende n'a pas le moindre fondement réel, qu'elle est créée de toutes pièces, en partant de certains mots. Il arrive aussi, en réalité, qu'on suive les deux voies ensemble. Par exemple, une chose réelle donne naissance à un récit, qui s'altère et se modifie, et auquel on ajoute des métaphores, des allégories ; puis celles-ci sont supposées figurer des choses réelles ; c'est-à-dire que des mots on va à la chose, qui est imaginaire, mais que l'on suppose réelle, et de laquelle on part ensuite pour obtenir de nouveaux récits, de nouvelles métaphores, et ainsi de suite.
§ 1641. Le besoin qu'éprouvent les hommes d'exercer leurs facultés de raisonnement et de logique (résidus I-ε) est tel que lorsqu'ils portent leur attention sur un terme quelconque T, ils veulent l'expliquer, c'est-à-dire qu'ils veulent en tirer une dérivation plus ou moins logique. Ainsi, de T, un auteur arrive à certaines choses, A, qui sont imaginaires ; un autre arrive à d'autres choses, B, imaginaires aussi ; d'autres encore emploient d'autres dérivations. Les choses A, B, tirées de T, ont parfois une certaine ressemblance, qui peut même être grande. Quand nous ne connaissons que A et B, nous ne savons si B n'est pas constitué au moyen de A, en copiant en partie A (ou vice versa), ou bien si A et B sont indépendants et ont une commune origine T1. Il y a des exemples des deux phénomènes ; par conséquent le choix a priori est impossible. Il faut recourir à l'observation des faits, et voir si une des voies TA, TB ou AB existe ; quelquefois, ces voies peuvent même exister ensemble. On a des phénomènes de ce genre, lorsqu'on cherche les sources d'un auteur. Aujourd'hui, on tâche un peu trop de deviner, et beaucoup de recherches de ce genre ont des fondements plus que mal assurés [FN: § 1641-2].
§ 1642. Si A est chronologiquement antérieur à B, beaucoup d'auteurs admettent sans autre que B est une imitation de A. Nous avons vu des cas (§ 733 et sv.) où il apparaît clairement que cette déduction peut être entièrement erronée. Par conséquent, du seul fait que A est antérieur et semblable à B, on ne peut rien déduire au sujet de la dépendance dans laquelle B serait par rapport à A ; il faut d'autres faits, d'autres observations.
§ 1643. C'est un fait bien connu que le quatrième Évangile est d'un style très différent de celui des trois premiers ; il y a beaucoup plus de métaphysique, de symbolisme que dans les trois premiers. Il se peut que son auteur rapporte d'une façon différente les faits dont il a eu connaissance, comme l'ont eue les trois premiers évangélistes (qu'il parcoure la voie, du fait à la théorie); il se peut, au contraire que, tenant un récit d'autres personnes, il tire de ce récit sa propre exposition métaphysique (qu'il parcoure la voie, de la théorie au fait), et il n'est pas exclu que ces deux voies puissent avoir été parcourues ensemble. Nous ne voulons nullement nous occuper ici de ces problèmes, ni ajouter un chapitre à tant d'autres qui ont été écrits déjà sur ce sujet. Nous entendons nous placer exclusivement au point de vue tout à fait restreint d'un exemple de dérivation.
§ 1644. Déjà dans Saint Paul, il est fait mention d'une certaine science mensongère, qui pourrait être semblable à ce qui fut ensuite connu sous le nom de Gnose, semblable aux fioritures du quatrième Évangile. Nous n'examinons pas s'il y a eu rapport direct entre ces choses [FN: § 1644-1] , ou si indépendamment elles sont nées du besoin de raisonner, de donner un développement métaphysique à l'histoire, à la légende, ou bien si elles se sont produites autrement [FN: § 1644-2] . Nous les notons seulement comme de simples faits, et nous voyons que parmi elles il existe une certaine gradation, telle qu'on observe le développement métaphysique maximum dans la Gnose.
§ 1645. Les termes de Gnose, Gnosticisme, ne sont pas bien déterminés. Laissons de côté Clément d'Alexandrie, pour lequel le vrai gnostique est le catholique, et considérons uniquement les sectes hérétiques. Il y en a plusieurs, et même le manichéisme est mis en rapport avec la Gnose [FN: § 1645-1]. Bornons-nous à la Gnose valentinienne, comme type de l'espèce. On y trouve des traces marquées d'un parcours, du terme à la chose. Les mots deviennent des personnes, et ces personnes conservent le sexe correspondant au genre grammatical du mot. Ces entités une fois créées avec des sexes différents, on les accouple, et elles donnent naissance à de nouvelles entités ne se distinguant pas des mots qui leur servent de nom. Puis la légende croît et se développe. Les entités ont tous les caractères des mots, vivent et agissent selon ces caractères. Les nombres jouent un rôle dans la légende. Que les valentiniens aient hérité la conception suivante des pythagoriciens, ou qu'ils la tiennent d'ailleurs, ils ont l'idée que quelque chose de réel correspond à une certaine perfection imaginée par eux, des nombres ; et ils assignent à cette perfection un rôle dans la légende. Certaines entités appelées æons, aeons, ou éons [FN: § 1645-2], jouent un rôle éminent dans les doctrines des gnostiques. Il est impossible de savoir ce que ceux-ci pouvaient bien entendre sous ce nom, et cela ne doit pas étonner, car il est probable qu'eux-mêmes n'en savaient rien.
§ 1646. Saint Irénée nous fait connaître la doctrine des valentiniens. Il écrit en grec. De ce texte, il ne reste que des fragments, mais il en existe une vieille traduction latine. Nous traduisons ici du texte grec ; et comme en grec le genre de certains mots est autre qu'en français, nous plaçons à côté du mot français un m ou un f suivant que le mot grec est masculin ou féminin [FN: § 1646-1]. « Ils disent qu'à une hauteur invisible et innommable, il y a un parfait Æon préexistant. Celui-ci (lacune), ils l'appellent aussi premier père et abîme (m). (lacune). Étant infini, invisible, éternel, incréé, il demeura en repos et en parfaite tranquillité, durant un temps infini, éternel. Avec lui était l'Intelligence (f), qu'ils appellent aussi Grâce (f) et Silence (f) ; il lui vint à l'idée de manifester [émanation] cet Abîme, principe de toute chose. Il déposa comme un sperme cette émanation qu'il eut l'intention d'émettre comme dans la matrice de sa compagne Silence (f). Celle-ci reçut ce sperme et, devenue grosse, donna le jour à l'Esprit (ou la Raison) (m), semblable et égale à celui qui l'avait émise, et comprenant seule la grandeur de son père. Cet Esprit (m), ils l'appellent aussi Unigenitus, père et principe de toute chose. Avec lui fut émise la Vérité. C'est là la tétrade (le nombre quaternaire) primitive et originaire pythagoricienne, qu'ils disent être aussi racine de toute chose. C'est donc : Abîme (m) et Silence (f), ensuite Esprit (m) et Vérité (f) ». Après cette première tétrade en vient une autre, constituée par le Verbe (m) avec la Vie (f), et par l'Homme (m) avec l'Église (f). Avec la première tétrade, on a ainsi une ogdoade ![]() , qui est, paraît-il, une fort belle chose. Le Verbe et la Vie produisent dix autres Æons, dont il nous semble inutile de citer ici les noms. L'Homme, en faisant l'amour avec madame l'Église
, qui est, paraît-il, une fort belle chose. Le Verbe et la Vie produisent dix autres Æons, dont il nous semble inutile de citer ici les noms. L'Homme, en faisant l'amour avec madame l'Église ![]() , en produit douze. En tout, les Æons sont donc trente, et forment le Plérôme [FN: § 1646-2].Vient ensuite toute une histoire de la passion de Sophia (f) (sagesse). Un récit qui doit être des valentiniens, qui croyaient que l'Abîme avait engendré sans conjoint, nous apprend comment Sophia [FN: § 1646-3] « voulut imiter son père, et engendrer d'elle-même sans conjoint, afin d'accomplir une œuvre nullement inférieure à celle du Père. Elle ignorait que seul celui qui est incréé, principe de tout, racine, hauteur et abîme, peut engendrer sans conjoint » [FN: § 1646-4].
, en produit douze. En tout, les Æons sont donc trente, et forment le Plérôme [FN: § 1646-2].Vient ensuite toute une histoire de la passion de Sophia (f) (sagesse). Un récit qui doit être des valentiniens, qui croyaient que l'Abîme avait engendré sans conjoint, nous apprend comment Sophia [FN: § 1646-3] « voulut imiter son père, et engendrer d'elle-même sans conjoint, afin d'accomplir une œuvre nullement inférieure à celle du Père. Elle ignorait que seul celui qui est incréé, principe de tout, racine, hauteur et abîme, peut engendrer sans conjoint » [FN: § 1646-4].
Héra aussi voulut imiter Zeus, qui seul avait engendré Athéna ; et, sans avoir commerce avec personne, elle engendra Héphaistos (Vulcain), lequel, quoique boiteux, est un dieu puissant. La pauvre Sophia n'en put faire autant. « Donc la Sophia ne produisit que ce qu'elle pouvait produire : une substance amorphe et confuse. C'est ce que dit Moïse : La terre était invisible et confuse » [FN: § 1646-5] . L'histoire continue longuement ; mais ce que nous en avons dit jusqu'ici suffit à en faire connaître la nature.
§ 1647. L'auteur des Philosophumena s'attache principalement aux allégories métaphysiques des valentiniens, et dit (VI, 2, 29) que Valentin tira sa doctrine, non de l'Évangile, mais de Pythagore et de Platon [FN: § 1647-1] . Saint Épiphane s'attache, au contraire, aux personnifications des valentiniens, et dit (I, 3) qu'elles reproduisent les générations des dieux des Gentils, tels que nous les voyons dans Hésiode, Stésichore et d'autres poètes [FN: § 1647-2] . Ces deux aspects sous lesquels on considère la doctrine valentinienne ont certainement une part de vérité. Cependant, il ne faut pas oublier que tous les rêveurs métaphysiciens possèdent une source commune à laquelle ils s'abreuvent, ainsi d'ailleurs que tous les inventeurs de légendes. C'est pourquoi il est difficile de savoir jusqu'à quel point ils se copient, et jusqu'à quel point les idées qu'ils expriment naissent spontanément en eux (§ 733 et sv.).
§ 1648. Il y a certainement beaucoup de cas où l'on a des preuves directes de plagiat, d'interpolations, de falsifications; d'autres dans lesquels, à défaut de preuves directes, on a de grandes probabilités d'imitations ; mais quand les preuves directes manquent entièrement, il n'est pas permis de conclure de la seule ressemblance à l'imitation.
Par exemple, il est souvent malaisé de distinguer les imitations mutuelles du néo-orphisme et du christianisme, les parties nées spontanément de celles qui sont seulement imitées [FN: § 1648-1] . Les auteurs israélites et chrétiens qui croyaient que Platon avait imité les Saintes Écritures hébraïques [FN: § 1648-2], se trompaient ; mais leur assertion pourrait se changer en une autre, concordant avec les faits, si l'on disait que les Israélites, les chrétiens, les auteurs comme Platon, les orphiques, etc., ont tiré leurs doctrines d'un fonds commun de résidus et de dérivations ; ce qui suffit à expliquer les ressemblances de doctrines indépendantes. Quand celles-ci entrent ensuite en contact avec les parties semblables nées spontanément, il s'y ajoute des imitations, en partie voulues, en partie involontaires.
§ 1649. Les valentiniens oscillent entre la combinaison abstraite d'éléments et l'union sexuelle. Ils imitent en cela beaucoup d'autres doctrines qui cherchent à se servir du puissant résidu sexuel, tout en lui ôtant tout caractère de volupté matérielle. Dans un fragment de Valentin, qui nous a été conservé par Saint Épiphane, les deux sexes s'unissent dans l'Æon, qui est appelé mâle-femelle ![]()
![]() ; mais ensuite on parle de l'union des Æons dans les mêmes termes que pour l'homme et la femme, en ajoutant que la copulation est « sans corruption » [FN: § 1649-1] . Le néo-orphisme aussi oscille entre l'allégorie et la personnification, et, comme en beaucoup d'autres doctrines, on a tantôt des êtres personnifiés, tantôt de simples abstractions métaphysiques [FN: § 1649-2] .
; mais ensuite on parle de l'union des Æons dans les mêmes termes que pour l'homme et la femme, en ajoutant que la copulation est « sans corruption » [FN: § 1649-1] . Le néo-orphisme aussi oscille entre l'allégorie et la personnification, et, comme en beaucoup d'autres doctrines, on a tantôt des êtres personnifiés, tantôt de simples abstractions métaphysiques [FN: § 1649-2] .
§ 1650. Un autre exemple remarquable se trouve dans ce Justin dont les Philosophamena nous font faire la connaissance [FN: § 1650-1]. Il découvre trois principes, non engendrés, de toutes les choses, et divague sur la façon dont ils produisirent le créé. Dans cette doctrine comme dans celle des valentiniens, les allégories tiennent compte de la Bible. Mais précédemment, sans cette aide, Hésiode avait imaginé comment toutes les choses avaient été engendrées [FN: § 1650-2]. De semblables cosmogonies, il y en a tant qu'on veut, en tous temps et chez tous les peuples. Même un auteur du XIXe siècle, Fourier, a voulu avoir la sienne [FN: § 1650-3] ; et qui voudrait en composer d'autres réaliserait facilement son intention par des allégories.
§ 1651. D'autres allégories verbales apparaissent dans la controverse entre les réalistes et les nominalistes. On sait que les réalistes transformaient en réalités les abstractions et les allégories, et se laissaient entraîner par ce grand courant qui traverse les siècles, des temps reculés jusqu'à nos jours [FN: § 1651-1]. Au point de vue logico-expérimental, cette controverse peut durer et dure en effet indéfiniment (§ 2368 et sv.), car il manque un juge pour trancher. À la vérité, tant le réaliste que le nominaliste décrivent uniquement leurs propres sentiments ; par conséquent, ils ont « raison » tous les deux, et la contradiction de leurs théories est une contradiction de sentiments. Chacun selon ses propres goûts préférera l'une ou l'autre théorie, ou bien une théorie intermédiaire, mais lorsqu'il en aura choisi une, tout moyen lui fera défaut pour enfermer autrui dans ce dilemme : ou de l'accepter, ou de refuser créance à des faits logico-expérimentaux.
Si nous ne nous laissons pas arrêter par le caractère incertain et nébuleux de ces théories, caractère qui les exclut nécessairement du domaine logico-expérimental, nous pourrons dire que les nominalistes semblent se rapprocher beaucoup plus de la science expérimentale. Mais la proposition qui affirme l'existence des individus ne peut appartenir à la science expérimentale ; elle sort entièrement du domaine expérimental ; le terme existence, employé de cette façon, appartenant proprement à la métaphysique. Expérimentalement, dire qu'une chose existe signifie seulement qu'elle fait partie du monde expérimental.
§ 1652. Mais, en cette matière (§ 2373), il est un autre problème qui appartient entièrement à la science expérimentale, et qui consiste à rechercher quelle est la voie, parmi les deux suivantes, qu'il convient de suivre pour découvrir les uniformités des faits. 1° Étudier directement les individus, en les classant selon des normes variables, d'après les résultats que l'on cherche ; considérer comme un moyen de raisonnement l'ensemble des caractères communs que présente une classe, et quand une théorie est obtenue, vérifier si elle reproduit les faits particuliers qu'elle doit expliquer. 2° Étudier un ensemble mal défini, mal déterminé, de caractères, en demeurant satisfait si le nom qu'on donne à cet ensemble concorde avec nos sentiments, et déduire de cette étude les rapports des individus que l'on croit, que l'on suppose faire partie de cet ensemble ; et l'on tient pour une démonstration les déductions logiques tirées de cette étude, sans se soucier autrement de vérifications expérimentales. L'expérience du développement des sciences a prononcé. Toutes les uniformités que nous connaissons, nous les avons découvertes, ou pour mieux dire démontrées, en suivant la première voie ; tandis que la seconde a toujours conduit à des théories qui ne concordent pas avec les faits. Par conséquent, l'expérience du passé nous enseigne quelle est la voie que nous devons suivre, si nous voulons avoir des théories qui concordent avec les faits.
Les doctrines nominalistes ajoutent une partie métaphysique, souvent petite, à une partie expérimentale, souvent grande ; tandis qu'il arrive généralement le contraire pour les doctrines réalistes [FN: § 1652-1]. Il est manifeste qu'elles portent sur un monde bien différent de celui de la réalité expérimentale [FN: § 1652-2] .
§ 1653. Les allégories sont un produit de la fantaisie humaine ; c'est pourquoi elles se ressemblent lorsqu'elles appartiennent à des hommes d'une même race ou de races voisines, et quelquefois aussi de n'importe quelle race.
Par exemple, les récits de la création se ressemblent chez les différents peuples, parce que ceux-ci conçoivent la création de la même façon que la production des êtres qu'ils ont sous les yeux. Aussi imaginent-ils spontanément, et non en se copiant mutuellement, des êtres mâles et femelles, des principes masculins et féminins qui, en s'unissant, produisent toute chose. Ils font souvent et volontiers naître le monde ou les choses d'un œuf ; ils font guerroyer ces êtres ou ces principes, les font aimer, haïr, jouir, souffrir. Il se peut que, parfois, un de ces récits ait été copié sur un autre, au moins partiellement ; mais ils peuvent aussi être semblables sans qu'il y ait imitation. [FN: § 1653-1]
§ 1654. Les croyants diront que la ressemblance de ces récits a pour but de reproduire un fait unique, dont le souvenir a été transmis diversement. Cela peut être ; mais cette question dépasse le monde expérimental. Le moyen de la trancher nous fait donc défaut.
§ 1655. Les allégories et les métaphores ont habituellement part à la formation des légendes ; mais on ne peut conclure de ce fait qu'une légende donnée soit nécessairement une simple allégorie, et surtout pas qu'elle soit l'allégorie qui paraît vraisemblable à notre imagination. Outre les allégories et les métaphores, il y a dans les légendes un élément historique ou pseudo-historique, romanesque ; et de plus parfois les imitations, les réminiscences ne font pas défaut. Ainsi, il semble très probable que la métaphore, l'allégorie, ont joué un rôle important dans la formation de la Gnose valentinienne ; mais il nous est impossible de savoir précisément quel est ce rôle. Nous connaissons cette théorie presque exclusivement par les écrits de ses adversaires. Mais, quand bien même nous aurions les textes originaux, nous ne saurions comment déterminer avec précision la part de la métaphore et celle de l'allégorie. Il est d'ailleurs probable que les auteurs mêmes de cette théorie ne connaissaient pas cette part, du moins si nous en jugeons par les faits qui nous sont connus.
§ 1656. Il est nécessaire d'aller du connu à l'inconnu. Nous avons précisément plusieurs exemples de formation de semblables légendes. Par exemple, Fourier en a créé une. C'est un mélange de récits et de métaphores ; et l'on ne pas voit très clairement si l'auteur lui-même savait quelles étaient les limites précises des éléments qu'il mettait en œuvre [FN: § 1656-1]. Le rôle que jouent les Æons, chez les valentiniens, les planètes le jouent chez Fourier ; et comme les Æons, elles s'accouplent et engendrent les choses de l'univers.
§ 1657. Si nous ne savions pas comment s'est constituée la théorie de Fourier, et si, cette théorie nous étant donnée, nous voulions en deviner les origines, il est évident que nous nous tromperions en supposant : 1° que Fourier a voulu simplement écrire une histoire ; ou bien : 2° qu'il a voulu se servir de simples métaphores. En réalité, il est demeuré entre ces deux extrêmes. Pour lui, les faits existent, mais les mots par lesquels il les exprime sont la preuve de leur existence, à cause des sentiments que font naître les métaphores produites par ces mêmes mots (IV-β).
§ 1658. C'est pourquoi, s'il nous arrive de trouver par hasard une théorie analogue, nous pourrons, faute de preuves contraires directes, admettre du moins comme possible que cette théorie a été constituée d'une façon semblable à celle de Fourier.
§ 1659. Voici un autre exemple. Enfantin, Père Suprême de la religion saint-simonienne, découvre une nouvelle trinité, et, avec l'enthousiasme d'un néophyte, il en célèbre les beautés sublimes [FN: § 1659-1]. Il n'y a pas le moindre motif pour mettre en doute la bonne foi de l'auteur. Naïvement, celui-ci nous fait assister à la naissance d'une théologie. Saint-Simon et ses disciples avaient en l'esprit la notion de la trinité catholique, peut-être aussi celle de la perfection du nombre trois, cher aux dieux païens. Sans qu'ils s'en aperçussent, cette notion les conduisit à créer de nombreuses trinités. Ensuite, un beau jour, ils les découvrent, s'étonnent, les trouvent en accord avec leurs sentiments, sont frappés d'admiration à la vue de tant de belles et profondes élucubrations. Il est de même probable que les gnostiques valentiniens avaient en l'esprit des conceptions mythologiques semblables à celles que nous lisons dans Hésiode, et en outre les concepts métaphysiques de Platon, de Pythagore et d'autres philosophes. Avec ces matériaux, sans s'en apercevoir, ils édifièrent leur théogonie. Aujourd'hui nous les découvrons, nous les analysons, nous les distinguons, et nous gratifions les auteurs gnostiques de desseins et de conceptions qu'ils n'ont peut-être jamais eus.
§ 1660. Comme dernier exemple, rappelons le récit, fait par Éginhard, de la bière changée en vin [FN: § 1660-1]. L'auteur croit évidemment raconter un fait. Non seulement il n'y mêle en aucune façon des métaphores, mais il cherche en vain ce que ce prodige peut bien signifier, quelle allégorie il en peut tirer. Supposons que nous ne connaissions pas le naïf récit d'Eginhard, et que nous n'ayons connaissance que du fait brut. De celui-ci, nous voulons remonter à la matière qui est ainsi racontée, et nous raisonnons comme M. Loisy à propos des miracles du quatrième Évangile. Nous dirons que le miracle rapporté par Eginhard est « inintelligible, absurde ou ridicule comme matière de fait, à moins qu'on y voie des tours audacieux de prestidigitateur ». (§ 774). Nous ne manquerons pas de moyens pour trouver « une interprétation facile et simple » de ce miracle ; et nous aurons le choix entre une infinité de métaphores également vraisemblables. Mais, en ce cas, l'erreur sera évidente, puisque Eginhard, bien loin de vouloir exprimer une métaphore, la cherche et avoue ne pouvoir la trouver. Il pourrait donc en arriver de même pour les interprétations allégoriques du quatrième Évangile. Pourquoi donc si, dans cet Évangile, l'eau changée en vin exprime non un fait mais l'allégorie de la « Loi remplacée par l'Évangile » (§ 774), le récit d'Eginhard n'exprimerait-il pas, non ce qui dans l'esprit du narrateur était un fait, mais une allégorie supposée ? Les personnes qui racontèrent le fait à Eginhard avaient en l'esprit le miracle raconté dans l'Évangile, et, naturellement, sans la moindre intention de tromper, elles rapportèrent ce qu'elles croyaient de bonne foi être un fait. Pourquoi, agissant d'une manière semblable, des causes analogues ne nous auraient-elles pas donné les récits des miracles du quatrième Évangile ?
§ 1661. Cette manie de vouloir traduire en allégories tous les récits que nous estimons être étrangers au monde réel, n'a aucun fondement expérimental. Au contraire, nous avons une foule d'exemples qui rendent manifeste que beaucoup d'auteurs qui racontent des miracles croient de bonne foi raconter des faits réels. Les métaphores qui peuvent se trouver dans le récit s'y introduisent à l'insu de l'auteur même, et non pas suivant ses intentions arrêtées. En d'autres cas, si même elles s'y introduisent suivant ses intentions arrêtées, elles s'ajoutent au fait sans en altérer le moins du monde la réalité effective ou supposée.
§ 1662. Nous avons déjà vu (§ 1623, 1624) comment Saint Augustin admet en même temps l'interprétation littérale et l'interprétation allégorique. On pourrait citer, à ce propos, un très grand nombre d'autres exemples. Il suffira de donner encore celui de Saint Cyprien. Il s'exprime clairement au sujet du miracle du changement de l'eau en vin. Pour lui, c'est un fait réel, mais il a eu lieu pour enseigner et démontrer (docens et ostendens) certaines choses [FN: § 1662-1] . Entièrement arbitraire est donc la voie que l'on voudrait suivre maintenant, en intervertissant ce rapport, et en supposant que les auteurs n'ont pas cru à la réalité des faits qui peuvent avoir aussi une interprétation allégorique.
§ 1663. Quand nous avons un exemple aussi évident sous les yeux, comment faisons-nous d'affirmer, sans la moindre preuve, que l'auteur du quatrième Évangile suivit une voie entièrement différente de celle que parcourut Saint Cyprien, et sépara ce que celui-ci réunit ? Tant que nous n'aurons pas de preuves à ce propos, et que nous voudrons nous laisser guider par de simples probabilités, celles-ci seront au contraire en faveur d'une ressemblance entre la voie parcourue par l'auteur du quatrième Évangile, et celle suivie par Saint Cyprien.
§ 1664. Un autre exemple du même auteur – qui nous en fournirait autant que nous voudrions – confirme ce mélange indéterminé entre la réalité effective ou supposée, et la métaphore. Saint Cyprien dit [FN: § 1664-1] : « C'est pourquoi le Saint Esprit vint sous la forme d'une colombe. La colombe est un animal simple et joyeux, sans fiel amer, sans morsures cruelles, etc. » Ou bien les mots n'ont plus aucun sens, et les textes ne signifient plus rien, ou bien il faut de toute nécessité reconnaître que Saint Cyprien croit que réellement le Saint Esprit a pris la forme d'une colombe ; et ce qu'il ajoute c'est pour donner les causes de cette transformation, et en aucune façon pour la mettre en doute.
§ 1665. Les dérivations par métaphores sont souvent à l'usage des personnes cultivées, mais souvent aussi elles servent aux personnes de culture moyenne, pour mettre la foi d'accord avec la science logico-expérimentale. Tout ce qui, dans un récit ou une théorie, ne semble pas pouvoir être accepté au point de vue expérimental, est mis sans autre au compte de la métaphore. La différence entre la foi et ce demi-scepticisme consiste en ce que la foi croit à la réalité du récit et y ajoute la métaphore : le fait réel est un signe qui nous enseigne quelque chose ; tandis que le demi-scepticisme ne croit pas à la réalité du récit ; il n'ajoute pas la métaphore à la réalité : au contraire, il la substitue au fait ; elle seule est réelle ; le fait est imaginaire. Quant à la science expérimentale, elle n'a pas à accepter ou à rejeter les conclusions de la foi, ni du demi-scepticisme : ce sont des choses qui sortent de son domaine ; elle se borne à repousser des conclusions dictées exclusivement par le sentiment, sans aucun fondement expérimental.
§ 1666. Au chapitre V (§ 637 et sv.), nous avons mentionné les deux problèmes qui se posent à l'égard des théories. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le premier, et, dans celui-ci, le second. Il nous reste maintenant à les envisager ensemble, en résumant les considérations que l'on peut faire partiellement sur eux. Prenons comme types des cas concrets : 1° un récit purement mythologique, par exemple le récit des amours d'Aphrodite et d'Arès, au VIIIe chant de l'Odyssée ; 2° une fable entièrement allégorique, où l'on fait parler les animaux ; par exemple, la fable du loup et de l'agneau ; 3° la Gnose valentinienne (§ 1645 et sv.) ; 4° la théorie des créations de Fourier (§ 1650-3, 1656-1) ; 5° la théorie d'Auguste Comte sur la Terre et le Grand Être (§ 1626-1) ; 6° la théorie des réalistes (§ 1651) ; 7° la théorie de la solidarité.
§ 1667. Au point de vue du premier problème du chapitre V, c'est-à-dire au point de vue des rapports avec les faits réels, tous ces types sont égaux, et leur valeur logico-expérimentale est proprement zéro : ils ne correspondent en aucune façon aux faits expérimentaux. Au point de vue du deuxième problème du chapitre V, c'est-à-dire en considérant la voie suivie dans les déductions, et son efficacité persuasive, on peut distinguer : a) la composition de la dérivation ; b) la façon dont elle est accueillie.
§ 1668. (a) La composition de la dérivation. Les sept types notés ont un caractère commun : l'usage arbitraire de certaines entités, étrangères au domaine expérimental. Tertullien, qui voit la paille qui est dans l'œil de son prochain, refuse toute créance aux valentiniens, et leur demande de démontrer leur assertion au sujet de l'Abîme, dont ils « s'imaginent prouver péremptoirement l'existence parce qu'ils le définissent tel que nous savons qu'il doit être ». Bravo ! Comme si l'on pouvait prouver l'existence des songes ! Prouver l'existence de l'Abîme, du Chaos, des dieux et des déesses, de la copulation des planètes, de la Terre sensitive de Fourier, des universaux, des bêtes qui parlent, etc., est chose entièrement impossible.
§ 1669. Mais il y a des degrés dans l'arbitraire, qui est limité par les sentiments que suscitent les mots et par certaines conventions au sujet de leur usage. Dans les créations de Fourier, l'arbitraire paraît être très grand. Quand les gnostiques font copuler des entités de nom masculin avec des entités de nom féminin, ils mettent sous les yeux du lecteur des faits qui lui sont bien connus. Au contraire, on ne comprend pas bien comment et pourquoi, chez Fourier, la Terre copule avec elle-même et avec Pallas. Si l'on prend garde que le pôle nord et le pôle sud sont tous deux froids, on ne sait pas pourquoi le fluide du premier est mâle et celui du second femelle. Mais si nous portons notre attention sur les termes nord, sud, nous comprendrons comment le sud, qui suggère l'idée de chaleur, va mieux avec la nature douce de la femme. On a un peu moins d'arbitraire, mais toujours beaucoup, dans les compositions mythologiques. On doit, en vérité, respecter certaines conventions ; mais, entre ces limites, le mythe peut prendre des formes aussi variées que l'on veut. De même, dans les fables qui font parler les animaux, l'arbitraire n'est pas moindre que dans les romans modernes. Le Roman de Renart est un bel exemple de la très grande variété de semblables fables. Dans la Théogonie d'Hésiode, l'arbitraire est moindre, bien que toujours important. On comprend que le sentiment accepte volontiers que le Chaos existait tout d'abord, et aussi l'Amour. Que la Terre ait produit le Ciel, ou le Ciel la Terre, le sentiment le comprend ; de même aussi, que la Terre et le Ciel, unis ensemble, aient produit un grand nombre de choses. Mais pourquoi, parmi ces choses, il y a Kœos, Kreios, Hypérion, etc., nous ne pouvons guère le tirer du sentiment. Chez les gnostiques valentiniens, l'arbitraire est encore moindre. Le sentiment comprend que l'origine de toute chose soit préexistante, en un lieu très lointain et innommable ; et l'on ne refuse pas à ces entités les noms d'Abîme et de Premier Père. Tous ces mots sont choisis uniquement parce qu'ils suscitent des sentiments qui concordent avec celui que nous avons d'ignorer ce principe de toute chose. La fable de Sophia, qui veut connaître le Père, éveille en nous le sentiment du désir qui existe chez les hommes de connaître ce qui est au-delà de l'expérience. L'analogie fait comprendre comment les larmes conviennent à la matière humide, le rire à la lumière et ainsi de suite (§ 1670). Les analogies avec la perfection pythagoricienne des nombres ou avec la valeur numérique des lettres, bien que très superficielles et arbitraires, ont des rapports avec certains sentiments existant dans l'esprit humain. Dans la mythologie d'A. Comte, l’arbitraire n'est pas très différent de ce qu'il est dans les théories gnostiques ; mais il ne s'affirme pas si clairement. Dans la théorie de la solidarité, l'arbitraire n'est pas très différent de celui des deux types précédents. En somme, le but est de persuader aux gens qui ont de l'argent de le partager avec la clientèle de certains politiciens. C'est pourquoi on recourt à la solidarité, à la dette qui, à chaque instant, s'éteint et renaît. On aurait pu tout aussi bien avoir recours à des entités différentes, telles que la plus-value de Marx, ou à d'autres semblables. L'arbitraire diminue, quand nous passons aux théories réalistes. On comprend que pour individualiser Socrate, on ait recours à la Socratité (§ 1651-1) et que le sentiment se complaise à une si belle explication. Il est également beau de savoir que la côtelette est une manifestation de la côtelettité ; mais tout comme le vulgaire ignorant, les métaphysiciens mangent la côtelette, sans avoir recours à la côtelettité pour apaiser leur faim.
§ 1670. Voyons ces dérivations, au point de vue des personnifications. Elles sont complètes dans les récits du type de la narration des amours d'Aphrodite et d'Arès, à tel point même que l'on peut souvent les prendre pour des récits historiques quelque peu altérés. La personnification est complète aussi, mais entièrement artificielle dans les fables où les animaux parlent. Les gnostiques valentiniens se débattent contre les difficultés de l'accord entre les personnifications et les allégories. Ils vont des unes aux autres, sans jamais trouver un terrain ferme où s'arrêter. En donnant un sexe à leurs entités, il semblerait vraiment qu'ils les ont personnifiées, mais ils ne tardent pas à aller des personnifications aux abstractions, changeant l'Æon en un principe androgyne (IRÉNÉE, I, 1). Pourtant, ils ne demeurent pas dans l'abstraction, puisqu'ils nous parlent d'une génération obtenue comme d'un sperme déposé comme dans une matrice [FN: § 1670-1] , et d'entités qui conçoivent, fécondent, enfantent. Ils s'efforcent ensuite de faire disparaître le sens matériel, en parlant de copulation « sans corruption » (§ 1649). Pour la production de la matière, ils se passent aussi de l'union des sexes. « Ils disent que des larmes d'Achamoth naquit la matière humide ; de son rire, la matière lumineuse ; de sa tristesse, la matière solide ; de sa frayeur, la matière mobile ». Enfin, ils oscillent entre le sens propre et le sens métaphorique, entre la personnification et l'allégorie, sans s'arrêter jamais définitivement à un sens déterminé.
§ 1671. On sait assez que la métaphore engendre très facilement la personnification. Nous en avons un très grand nombre d'exemples. Les personnifications employées dans la mythologie de A. Comte ressemblent à celles des gnostiques, avec cette différence que A. Comte commence par dire que ce sont des fictions, puis l'oublie et en parle comme de véritables personnes. On ne trouve aucune personnification dans la théorie de la solidarité. La personnification est nulle aussi dans la théorie des réalistes. Mais il faut prendre garde qu'il s'agit de la forme et non du fond. Enfin de compte, l'Abîme des valentiniens, l'essence universelle des réalistes, jouent le même rôle, sous des dehors différents. Toutes les choses existantes proviennent tant de l'une que de l'autre, et cette provenance est conçue en usant d'une personnification beaucoup plus accusée, comme une génération des Æons, ou bien, supprimant la personnification, en considérant les individus comme des accidents de l'essence universelle. On peut ajouter, si l'on veut, le Chaos d'Hésiode ou toute autre chose de ce genre. Enfin, en faisant produire toute chose par l'Abîme, par les universaux, par le Chaos, ou par d'autres entités semblables, on satisfait des sentiments de même nature et l'on crée des théories que les différentes personnes accueillent selon leurs goûts.
§ 1672. Voyons le point de vue de la transformation des métaphores, non plus en personnes, mais seulement en réalités objectives [FN: § 1672-1]. Ce caractère manque entièrement ou presque entièrement aux fables mythologiques ou à celles des animaux parlants. Il est de même très peu accentué dans la mythologie de Fourier. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans la Gnose valentinienne, les métaphores se mêlent aux personnifications, s'y confondent, et il est difficile ou même impossible de les séparer. A. Comte commence par essayer de les séparer, puis il les réunit, et finit par de simples personnifications. Les métaphores prédominent dans la théorie de la solidarité et chez les réalistes.
§ 1673. Les confusions entre les métaphores et la réalité sont habituelles chez qui raisonne sous l'empire du sentiment. Chez les rêveurs de la métaphysique et de la théologie, la chose, le symbole, la métaphore, l'allégorie, tout se mêle et se confond dans l'esprit. Il est impossible de raisonner sérieusement avec des gens qui emploient des termes si indéterminés, si nébuleux, qu'eux-mêmes en ignorent le sens. Voici M. L. Bourgeois qui nous parle avec une grande admiration des notions tirées de l'idée de la mutuelle dépendance, lesquelles « remplissent d'un contenu tout nouveau l'idée morale [FN: § 1673-1] ». Ces mots accolés ensemble ne veulent rien dire, et l'idée morale se remplit, comme la Sigè est fécondée par l'Abîme. Si M. L. Bourgeois avait vécu au temps des valentiniens, il aurait peut-être personnifié ses métaphores.
§ 1674. Toutes ces dérivations à métaphores verbales sont très usitées en métaphysique, où souvent elles dominent exclusivement et dans la partie métaphysique des théologies, où toutefois elles sont généralement accessoires. Un mot suscite certains sentiments. Le mot se transforme en chose, et l'on croit facilement que les sentiments qu'il suscite sont produits par cette chose. La poésie, la littérature, l'éloquence et même la conversation ordinaire ne peuvent se passer de ces transformations ; autrement elles manqueraient leur but principal, qui est d'émouvoir les sentiments. Elles donnent ainsi une certaine tournure d'esprit qui persiste quand on raisonne de science, et quand le but n'est pas au moins explicitement, d'émouvoir les sentiments, mais est seulement de rechercher les rapports des faits entre eux.
§ 1675. (b) Façon dont les dérivations sont accueillies. Au point de vue de la foi que les hommes ont en elles, on notera les caractères suivants. Les fables des animaux parlants n'ont jamais été prises pour des réalités. Les mythologies des valentiniens, de A. Comte, de Fourier, ont eu un certain nombre de croyants. De même aussi les métaphores de la solidarité. Beaucoup plus nombreux sont, parmi les gens cultivés, ceux qui croient à un réalisme plus ou moins mitigé. Le plus grand nombre de croyants est, de beaucoup, celui des gens qui ont cru, ou qui croient encore à la mythologie. Pour nous, maintenant, la mythologie grecque est un roman, mais un grand nombre d'hommes la tinrent pour une réalité, durant des siècles ; et nous l'avons remplacée par d'autres du même type. Le nombre des croyants s'accroît lorsque, de ces types simples de dérivations, on passe aux types composés, spécialement à ceux qui naissent de l'union du premier et du dernier type ; c'est-à-dire pour l'union du récit mythologique avec les métaphores du réalisme. La plus grande partie des religions sont constituées de cette façon.
§ 1676. Au point de vue des sentiments que satisfont les sept types notés « § 1666), on peut observer que l'instinct des combinaisons est surtout satisfait par le premier. Chez les enfants et chez beaucoup d'hommes, le second type le satisfait aussi ; mais chez beaucoup de personnes, des instincts moraux sont en outre satisfaits ; c'est-à-dire que les résidus de la seconde classe interviennent. Le sixième type, et plus généralement les raisonnements métaphysiques, satisfont le besoin d'explications logiques que l'homme cultivé éprouve (résidus I-ε). De même aussi le septième type et d'autres analogues, qui recouvrent par le raisonnement des appétits brutaux. Les 3e, 4e, 5e types s'efforcent d'unir la satisfaction de l'instinct de combinaison à celui du raisonnement logique ; et il semble qu'ils n'atteignirent leur but qu'en petite partie, car ils durèrent peu et n'eurent pas beaucoup de croyants. Au contraire, les religions qui durèrent longtemps et eurent de nombreux croyants atteignirent mieux ce but. L'ancienne religion romaine fut supplantée par celle de la Grèce, parce qu'elle [FN: § 1676-1] ne satisfaisait en aucune façon l'instinct du raisonnement. Le néo-platonisme fut vaincu par le christianisme, parce qu'il ne satisfaisait pas le besoin de combinaisons concrètes. De même, le modernisme, qui rénove les explications allégoriques de Philon, ne fait pas son chemin dans le peuple, parce qu'il satisfait uniquement les besoins intellectuels d'un petit nombre de raisonneurs. La théologie n'est plus de mode, pas même quand elle se dissimule sous le voile démocratique.
§ 1677. Il est nécessaire de bien comprendre que la personnification satisfaisant le besoin du concret, et l'allégorie le besoin de l'abstraction, les dérivations tendent à les employer autant que possible ensemble, pour tirer parti de toutes les deux. Mais il n'est pas facile de les faire concorder. Là, l'Église catholique se montre sage et habile en dissimulant sous le mystère la correspondance qui pourrait exister entre le concret et l'allégorie. Le quatrième Évangile est le complément nécessaire des trois premiers, pour satisfaire complètement le besoin religieux des hommes ; et c'est avec beaucoup de bon sens que l'Église catholique réprouve les interprétations des modernistes, comme elle en réprouva déjà d'autres analogues, qui visaient à séparer la réalité historique de l'allégorie. Elle condamna les fables des gnostiques, qui faisaient trop pencher la balance d'un côté, mais elle accepta dans une certaine mesure des interprétations allégoriques qui satisfaisaient le besoin de raisonner et de déduire qu'éprouvent les hommes. À ce point de vue, Saint Thomas est vraiment remarquable, et nous ne saurions quel autre auteur pourrait lui être comparé. Il satisfait de la meilleure façon possible les divers besoins du concret et de l'allégorie, et sait éviter, avec un art consommé, les contrastes qui se manifestent à chaque instant entre la réalité et l'allégorie.
§ 1678. Il est un autre aspect sous lequel les dérivations doivent être considérées. Il est d'une grande importance : c'est celui du jugement qu'on porte sur les dérivations par rapport à la réalité, et cela non seulement en ce qui concerne leur accord avec l'expérience, mais aussi en ce qui touche leur rapport avec l'utilité individuelle ou l'utilité sociale. Nous avons déjà traité longuement le premier sujet, en parlant de la façon dont les actions logiques et les non-logiques étaient envisagées (chap. IV et V) ; mais il nous reste à ajouter certaines choses, qui ne pouvaient trouver leur place qu'après l'exposition faite tout à l'heure des théories. Après cela, nous n'aurons pas épuisé la matière, et nous devrons encore étudier les oscillations concomitantes de ces dérivations et d'autres phénomènes sociaux, ce que nous ferons au chapitre XII (§ 2329 et sv.).
§ 1679. Il y a des gens qui ne veulent s'attacher qu'aux actions logiques, tenant les non-logiques pour issues d'absurdes préjugés, capables seulement de causer des maux à la société. De même, il y a des gens qui veulent envisager une doctrine uniquement au point de vue de l'accord avec l'expérience, et qui déclarent que tout autre point de vue est vain, stupide, nuisible. Cette théorie offusque les sentiments de beaucoup d'autres gens et ne concorde pas avec les faits, puisque ceux-ci démontrent clairement que des doctrines (dérivations) qui sortent du domaine logico-expérimental sont des expressions de sentiments qui jouent un rôle important dans la détermination de l'équilibre social (§ 2026). La théorie dont nous parlons est donc fausse, au sens que nous donnons à ce terme ; mais où est l'erreur ?
§ 1680. Les adversaires de ceux qui dédaignent les théories estimées non-réelles contestent ce caractère de non-réalité. Ils sentent instinctivement qu'il est faux que ces théories soient de vains assemblages de mots sans effet social ; et, voulant leur restituer leur dignité, ils s'efforcent de toute façon de les faire paraître réelles ou supérieures à la réalité (§ 2340). C'est là une nouvelle erreur qui, à son tour, offusque les sentiments de ceux qui vivent dans la pratique et dans la réalité. Elle démontre une fois de plus la vanité logico-expérimentale de l'affirmation qu'on oppose à ces personnes. Ainsi apparaît une des causes qui font naître et se perpétuer les oscillations qu'on observe depuis tant de siècles entre le scepticisme et la foi, entre le matérialisme et l'idéalisme, entre la science logico-expérimentale et la métaphysique (§ 2341).
§ 1681. Ne nous occupons ici que de quelques-unes des oscillations que nous étudierons ensuite d'une façon générale (§ 2329 et sv.). En un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire de la fin du XVIIIe siècle au commencement du XIXe, nous avons vu régner le scepticisme voltairien, auquel succéda l'humanitarisme de Rousseau, et ensuite apparaître la religion révolutionnaire ; puis vint le retour de la religion chrétienne ; ensuite, de nouveau le scepticisme, le positivisme ; et maintenant derechef commence une nouvelle oscillation dans le sens mystico-nationaliste. Si nous exceptons les sciences naturelles, et si nous portons notre attention seulement sur les théories sociales, nous voyons qu'on n’avance pas beaucoup, ni dans un sens ni dans l'autre. En somme, si la foi n'est qu'un préjugé nuisible, comment se fait-il qu'elle survive à tant de siècles, se transformant et renaissant à chaque instant, après que ses ennemis, du temps de Lucrèce à nos jours, croient l'avoir éteinte ? Et si le scepticisme scientifique est vraiment si inutile, si peu concluant, si nuisible au genre humain, comment se fait-il qu'il puisse, de temps à autre, revenir à la charge, ne fût-ce qu'avec le simple bon sens d'un Lucien, d'un Montaigne, d'un Bayle, d'un Voltaire ? Comment se fait-il que l'on ne constate pas de progrès dans les opinions sociales, alors qu'il est incontestable dans les sciences naturelles ?
§ 1682. Si nous voulons ne fixer notre attention que sur les faits, nous verrons qu'il y a erreur de part et d'autre, parce qu'on réduit à l'unité des choses qui doivent demeurer séparées. Il faut distinguer l'accord avec les faits d'une doctrine ou d’une théorie et leur importance sociale. Le premier peut être nul et la dernière très grande. Mais cette importance ne prouve pas l'accord, de même que l'accord ne prouve pas l'importance. Une théorie peut ne pas correspondre à des faits objectifs, être entièrement fantaisiste à ce point de vue, et correspondre au contraire à des faits subjectifs de grande importance pour la société (§ 844). Celui qui voit l'importance sociale d'une mythologie, la veut aussi réelle. Celui qui en nie la réalité, en nie aussi l'importance sociale. Tout au contraire, les faits font clairement voir que les mythologies n'ont pas de réalité et ont une grande importance sociale. En cette matière, le préjugé est si fort que beaucoup de gens s'imaginent que l'ère des mythologies est définitivement close, que ce sont là de vains souvenirs d'un passé qui ne reviendra plus, et ils ferment ainsi volontairement les yeux sur les très nombreux faits qui les montrent encore vives et prospères. De même, il est d'autres personnes qui s'imaginent que l'œuvre, accomplie durant tant de siècles, par la science logico-expérimentale est vaine, et que, pour connaître les faits, on pourra revenir aux songeries d'un Platon, rénovées par un Hegel.
§ 1683. Les oscillations observées dans les opinions sociales sont, dans le domaine de la théorie (§ 2340 et sv.), le résultat de l'antagonisme de deux forces opposées : la correspondance des dérivations à la réalité et leur utilité sociale. Si les deux forces se confondaient, un mouvement continu qui établirait la prédominance absolue de leur ensemble ne serait pas impossible, au moins sous un certain aspect. Mais puisqu'au lieu de se confondre elles restent distinctes et de sens différent, et qu'il demeure, d'une part, sinon impossible, au moins malaisé de se soustraire entièrement à la réalité, et, d'autre part, de négliger entièrement l'utilité sociale, il en résulte nécessairement que dans tout ce qui se rapporte à l'organisation sociale, la théorie oscille comme un pendule, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il n'en est pas ainsi dans les sciences naturelles, parce que les théories mathématiques, chimiques, astronomiques, etc., n'ont, pour le moment du moins, que peu ou point d'importance sociale. C'est pourquoi le pendule se déplace toujours plus du côté des théories logico-expérimentales, sans qu'aucune force, du moins aucune force importante (§ 617), le fasse revenir du côté des dérivations métaphysiques, théologiques ou autres semblables [FN: § 1683 note 1). Au temps passé, cette force put être observée en quelques cas ; elle se manifesta par les procès pour impiété, à Athènes, dans le procès de Galilée et en d'autres semblables ; mais elle finit par s'épuiser, parce qu'elle ne correspondait pas à une utilité sociale effective, ou pour mieux dire, parce que, l'utilité sociale n'étant qu'un des éléments du phénomène, très important, c'est vrai, cette force ne correspondait pas à des sentiments dont les hommes ne pouvaient se passer sans de très graves altérations de l'équilibre social. Étant donné qu'ici nous ne visons d'aucune manière à prêcher, mais bien uniquement à rechercher les uniformités des faits sociaux, nous pouvons sans aucun inconvénient, nous devons même maintenir le pendule exclusivement du côté où il se déplace de plus en plus dans les sciences naturelles (§ 86, 1403).
§ 1684. Peut-être le lecteur a-t-il trouvé superflue l'exposition que nous avons faite du gnosticisme, et s'est-il dit : « Qu'est-ce que ces fables ont affaire avec la sociologie ? » – Elles ont affaire avec la sociologie, parce qu'elles expriment des sentiments qui sont toujours puissants dans notre société ; et, sans parler de leurs manifestations dans les théories de Saint-Simon, de Fourier, de A. Comte, du socialisme humanitaire et d'autres, on voit tous les jours naître et prospérer, en Amérique et en Angleterre, des sectes chrétiennes non moins absurdes, au point de vue exclusivement expérimental, que les sectes gnostiques. Maintenant s'y ajoutent le néo-bouddhisme, la théosophie, le spiritisme, l'occultisme, etc., qui ont des adeptes dans toute l'Europe. Qui veut se persuader que les modernes ne le cèdent en rien aux anciens pour imaginer des fantasmagories qu'ils regardent comme de sublimes vérités, n'a qu'à lire, parmi tant de livres, celui de Sinnett sur le Bouddhisme ésotérique ou positivisme hindou [FN: § 1684-1].
D'une manière plus générale, on peut se demander pourquoi nous nous occupons longuement de l'étude des dérivations théologiques de la religion chrétienne. Les fidèles de cette religion les considèrent comme l'expression de vérités absolues ; les ennemis, comme l'expression d'absurdes préjugés, qui – disent-ils – ont été actuellement dissipés par les « lumières de la science », et dont, par conséquent, il est à peu près inutile de s'occuper sérieusement.
Nous nous plaçons entièrement en dehors de ces deux points de vue opposés. Les dérivations de la religion chrétienne, comme celles du Talmud, du paganisme, et autres semblables, sont étudiées par nous en vue de connaître les résidus qui leur ont donné naissance et les formes générales que l'on observe dans les dérivations. Si ces résidus avaient disparu actuellement, si ces formes étaient tombées en désuétude, notre étude aurait un caractère purement historique ; elle n'en conserverait pas moins une importance que l'on reconnaîtra devoir être assez grande, si l'on remarque que, par exemple, la religion chrétienne a été pendant des siècles l'expression de l'état psychique de millions et de millions d'hommes. Mais nous avons vu que les résidus qui existaient au temps du paganisme, ceux que nous trouvons au moyen âge chrétien, ceux que nous observons actuellement, sont, en grande partie, d'une même nature, et que seules les dérivations ont beaucoup changé d'aspect, tout en conservant des développements analogues ; notre étude n'est donc pas exclusivement historique, et elle nous permet d'étendre nos connaissances des phénomènes contemporains.
C'est ce que nous pouvons répéter au sujet de l'étude des sociétés politiques de la Grèce et de Rome ; elle constitue une des meilleures préparations à l'étude de nos sociétés modernes, qui, fort différentes quant à la forme, conservent, avec les sociétés anciennes, un fond commun, dû précisément au fait que les résidus se transforment et changent fort lentement.
Il est bien entendu qu'il ne s'agit que d'études théoriques. Nous avons assez souvent dit et répété que nous n'avions pas la moindre intention de rechercher ici des recettes pour résoudre les problèmes concrets qui se présentent à l'homme pratique.
§ 1685. Après avoir rapporté les fantasmagories des gnostiques et la passion de Sophia, Renan, qui, comme d'habitude, veut ménager la chèvre et le chou, exprime mal une idée, vraie sous certains aspects, en louant la partie de ces fantaisies qui exalte certains sentiments [FN: § 1685 -1]. Il se rapprocherait beaucoup plus des faits si, au lieu de parler objectivement, il parlait subjectivement, et disait que les sentiments qui étaient satisfaits par la Théogonie d'Hésiode et par d'autres productions semblables, y compris les mythes gnostiques qu'il rapporte, existent encore chez un grand nombre d'hommes de notre temps, et se manifestent d'une façon analogue à celle dont ils se manifestaient par le passé. Celui qui veut prêcher aux hommes pour les attirer dans la voie qu'il estime la meilleure, blâme ou loue ces sentiments et leurs manifestations. Celui qui s'occupe uniquement de science les décrit et tâche d'en découvrir les rapports avec les autres faits sociaux.
§1686. (IV-ε) Termes douteux, indéterminés, qui ne correspondent à rien de concret. C'est la limite extrême des dérivations verbales, qui finissent par apparaître comme un simple cliquetis de mots [FN: § 1686 -1]. Peu de ces dérivations servent au vulgaire, qui, interdit, stupéfait de l'étrangeté des mots, reste bouche bée, supposant qu'elles cachent Dieu sait quels mystères [FN: § 1686-2] . Le plus grand nombre est à l'usage des métaphysiciens, qui s'en repaissant continuellement, finissent par s'imaginer qu'elles correspondent à des choses réelles. Le lecteur trouvera dans leurs œuvres autant d'exemples qu'il voudra ; nous n'en avons déjà rapporté que trop dans ce livre ; c'est pourquoi il nous reste peu de chose à ajouter. Nous devons remarquer seulement que le torrent de ces mots dépourvus de sens et incohérents coule de l'antiquité jusqu'à nos jours [FN: § 1686-3]. Tantôt il se gonfle et se répand en inondations, tantôt il se retire et coule dans un lit régulier. En tout cas, il subsiste, et l'on voit par conséquent qu'il satisfait à un besoin humain, comme le chant, la poésie, les fables. Chaque temps a ses termes à la mode. Par exemple, aujourd'hui, en Italie, on emploie beaucoup le terme superare (dépasser, surpasser) et ses dérivés superatori (dépasseurs), superamento (dépassement). [FN: § 1686-4] Que signifient-ils de précis ? Personne ne le sait ; mais ce doit être quelque chose de fort beau, parce qu'à entendre ces termes, les adversaires demeurent abasourdis, consternés, et ne savent plus que dire. En effet, que voulez-vous répondre à qui vous objecte que votre théorie est dépassée (superata) ? Veuille le dieu de la métaphysique que le théorème du carré de l'hypothénuse ne soit pas aussi dépassé (superato), sinon adieu géométrie ! En général, les termes maintenant à la mode sont, en un sens favorable : vivant, dynamique, spirituel, auxquels s'opposent, en un sens défavorable, ceux de mort, stase et mécanique. De ce dernier, par un audacieux néologisme, on a fait en italien le verbe mecanizzare. Que voulez-vous répondre à qui vous objecte que votre histoire est morte, tandis que la sienne est vivante ? [FN: § 1686-5] ou bien que vous mécanisez dans la stase ce que lui spiritualise dans la dynamique ? Si vous comprenez cela, vous n'éprouverez aucune difficulté à saisir le sens précis des célèbres plaidoiries prononcées par deux seigneurs devant Pantagruel, et du mémorable arrêt par lequel Pantagruel mit fin à leur débat [FN: § 1686-6] . Dans sa comédie Les Grenouilles, Aristophane feint, pour se moquer d'Euripide, qu'à presque tous les vers de ce poète, on peut ajouter, en manière de conclusion : « Il perdit sa fiole ». Semblablement, ces mots privés de sens concret peuvent s'adapter à n'importe quel raisonnement [FN: § 1686-7] .
[1010]
Chapitre XI.↩
Propriétés des résidus et des dérivations
§ 1687. L'étude que nous venons de faire des résidus et des dérivations nous a fait connaître les manifestations de certaines forces qui agissent sur la société, et par conséquent ces forces mêmes aussi. Ainsi, peu à peu nous approchons de notre but, qui est de nous rendre compte de la forme que prend la société, sous l'empire des forces qui agissent sur elle. La voie est longue ; mais, voulant nous laisser guider exclusivement par les faits, nous n'avons trouvé aucun moyen de l'abréger. Nous avons reconnu et classifié les résidus et les dérivations. Cela faisant, nous avons aussi découvert certaines de leurs propriétés. Maintenant, il convient que nous étudiions ces dernières en détail. Pour connaître la forme que revêt la société, il est manifeste que nous devrons considérer ensemble tous les éléments qui déterminent cette forme. Mais avant de pouvoir le faire, il est nécessaire que nous étudiions séparément ces éléments et certaines de leurs combinaisons. C'est ce que nous ferons dans le présent chapitre, pour étudier dans le suivant l'ensemble social.
Nous commencerons par considérer ces éléments d'une manière intrinsèque, abstraction faite de leur rapport avec l'utilité sociale. Étant donnés certains résidus et certaines dérivations, deux genres de problèmes se posent. 1° Comment agissent ces résidus et ces dérivations ? 2° En quel rapport cette action est-elle avec l'utilité sociale ? L'empirisme vulgaire traite en même temps des deux problèmes, qu'il ne distingue pas ou qu'il distingue mal (§966 et sv.). Il convient que l'analyse scientifique les sépare ; et il est essentiel, pour éviter de trop faciles erreurs, qu'en traitant du premier, on n'ait pas l'esprit préoccupé par le second.
§ 1688. Avant de pousser plus loin, il sera bon de faire quelques observations sur la manière de nous exprimer. Remarquons tout d'abord, en ce qui concerne les dérivations, que nous avons désigné par ce nom un phénomène qu'il convient de diviser en deux, pour des études ultérieures. Il y a la dérivation proprement dite et la manifestation à laquelle elle aboutit. C'est-à-dire qu'il y a une démonstration, ou mieux une pseudo-démonstration, et un théorème ou un pseudo-théorème. Ces deux derniers peuvent rester constants, tandis que varient les dérivations qui y conduisent. Par exemple, dans la dérivation qui veut démontrer l'existence de la solidarité-droit, nous pouvons séparer la manifestation de cette existence dans l'esprit de celui qui emploie la dérivation, et la démonstration qu'on en donne, c'est-à-dire la dérivation proprement dite. Celle-ci peut varier, tandis que celle-là reste constante ; et parfois la seconde est répétée d'imitation par qui est dépourvu ou presque dépourvu de la première. Les hommes s'approprient souvent mécaniquement, sans grande persuasion, des propos qui sont de mode dans la société au milieu de laquelle ils vivent (§2003 et sv.). Nous continuerons, comme par le passé, à désigner par le nom de dérivation le phénomène dans son ensemble, et quand nous voudrons distinguer les deux parties, nous emploierons les noms de manifestations et de dérivations proprement dites.
En analysant les dérivations proprement dites, on trouve d'abord comme fondement le besoin de développements logiques, puis les résidus de la Ie classe, par lesquels on satisfait ce besoin, et enfin des résidus de toutes les autres classes, qu'on emploie comme moyens de persuasion. En analysant les manifestations, on trouve comme fondement les résidus. C'est en effet ainsi que nous les avons trouvés dans les chapitres précédents. À ces résidus s'ajoutent, comme vernis logique, des dérivations proprement dites, des raisonnements divers. En outre, dans les cas concrets, autour d'un résidu principal s'en disposent d'autres, qui sont accessoires.
§ 1689. L'erreur principale des raisonnements vulgaires, ainsi que des raisonnements métaphysiques, consiste non seulement à intervertir les termes du rapport entre les dérivations et les actions humaines, dans l'idée que celles-là sont en général la cause de celles-ci, tandis qu'elles en sont au contraire la conséquence, mais encore à donner une existence objective aux dérivations proprement dites et aux résidus dont elles sont issues.
Comme nous l'avons déjà dit (§94,149), nous ne donnons aucun sens métaphysique à ces termes : existence objective ; il est bon, par conséquent, que nous indiquions le sens dans lequel ils sont employés ici. Prenons, par exemple, le « droit naturel » ou le « droit des gens ». Dans l'esprit d'un très grand nombre de personnes, les notions de certains rapports entre les hommes sont acceptées favorablement, les notions de certains autres repoussées avec défaveur. En outre, les premières notions s'unissent à d'autres auxquelles on donne habituellement les noms de bon, honnête, juste, etc., et se heurtent à d'autres auxquelles on donne habituellement des noms contraires : mal, malhonnête, injuste, coupable, etc. Rien ne s'oppose à ce qu'on donne le nom de droit naturel à l'ensemble, même indéterminé, de ces premières notions, et qu'on exprime le fait indiqué plus haut en disant que la notion du droit naturel existe dans l'esprit « des hommes ». Il est des personnes qui, de là, concluent qu'il doit aussi exister une chose de ce nom, et qu'il ne reste qu'à la trouver et à la définir avec précision. Si à cela nous objections qu'une existence subjective n'a pas pour conséquence une existence objective, nous tomberions dans une discussion métaphysique dont nous voulons au contraire nous tenir éloigné. Notre réponse est tout autre, et consiste surtout à remarquer que, par le même mot exister, on a exprimé deux choses différentes, dans les propositions précédentes. Pour mieux voir cela, faisons un raisonnement parallèle au précédent. C'est un fait que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est-à-dire des chimistes, la notion de chlorure de sodium est acceptée avec d'autres notions de réactions chimiques et s'y trouve liée. Rien n'empêche que nous exprimions ce fait en disant que la notion de chlorure de sodium existe dans l'esprit « des hommes ». De là, on peut conclure, bien qu'en pratique on suive la voie inverse, qu'il doit exister une chose de ce nom.
Les deux raisonnements ont bien une partie semblable, mais ils en ont une autre entièrement différente. Chez les chimistes, les conséquences logiques de la notion de chlorure de sodium se vérifient en pratique avec une si grande probabilité qu'on peut les qualifier du terme vulgaire de certaines. Les conséquences logiques du droit naturel se vérifient quelquefois, en pratique ; plus souvent elles ne se vérifient pas. Le chimiste ne dit pas : « Le chlorure de sodium en solution devrait précipiter le nitrate d'argent ». Il dit, ce qui est bien différent : « Le chlorure de sodium en solution précipite le nitrate d'argent ». L'adepte du « droit naturel » ne peut pas employer cette dernière expression, et doit toujours se contenter de la première. Il suffit d'ouvrir l'histoire pour voir que le « droit des gens » est comme le caoutchouc. Les puissants en font ce qu'ils veulent. Sans remonter trop haut, en 1913, certains puissants États européens décident qu'il doit exister une principauté d'Albanie, laissent le Monténégro faire le siège de Scutari, puis, un beau jour, l'obligent à abandonner la ville ; et comme le Monténégro hésite, ils envoient, sans aucune déclaration de guerre, leurs escadres établir le blocus des côtes monténégrines, et capturent le yacht du roi Nicolas. Il est impossible de découvrir quel « droit » ces puissances ont de faire cela, et notamment quel « droit » elles ont sur le territoire albanais et sur Scutari, à moins qu'on ne veuille donner au terme « droit » le sens qu'il a dans la fable du loup et de l'agneau. Ces États font donc ce qu'ils veulent du « droit des gens », mais ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent des réactions chimiques ; et avec toute leur puissance, ils ne pourraient pas empêcher que le chlorure de sodium en solution ne précipitât une solution de nitrate d'argent. Il y a donc une différence essentielle, au point de vue pratique, entre les deux cas considérés, et l'existence du chlorure de sodium et d'autres corps chimiques est différente de l'existence du « droit naturel », « des gens » ou d'autres semblables entités. Dans les deux cas aussi, les conséquences logiques qu'on peut tirer sont différentes. Par exemple, je tire la conséquence logique qu'un certain poids de chlorure de sodium contient un poids déterminé de chlore ; je fais l'analyse et je vérifie cette conséquence. Il en va tout autrement des conséquences logiques de ces entités dépourvues de toute précision, et qui portent les noms de « droit des gens », « droit naturel », et autres semblables. Toujours à propos du Monténégro, le ministre anglais des affaires étrangères déclare qu'on ne peut permettre au Monténégro d'occuper Scutari, parce que la population n'y est pas de la même race qu'au Monténégro, ne parle pas la même langue, n'a pas la même religion. Donc, il semblerait qu'un pays n'a pas le « droit » d'en occuper un autre qui présente ces caractères. On demande : les Hindous sont-ils de la même race, parlent-ils la même langue, ont-ils la même religion que les Anglais ? Si l'on répond négativement, pourquoi le Monténégro n'a-t-il pas le « droit » d'occuper Scutari, et les Anglais ont-ils le « droit » d'occuper les Indes ? [FN: § 1689-1] Cela demeure un mystère.
D'une façon générale, quand nous disons que la notion de droit naturel existe dans l'esprit des hommes, nous exprimons le fait que dans l'esprit de certains hommes se trouvent des notions auxquelles on donne ce nom. On peut faire un essai pratique, et l'on verra qu'il réussit. En outre, de ce fait on peut tirer la conséquence qu'en raisonnant avec ces hommes, il est utile, pour les persuader, de tenir compte de cette notion qu'ils ont en eux. Là aussi l'expérience réussira ; c'est pour ce motif que les puissants, au lieu de dire simplement qu'ils veulent une chose, se donnent la peine d'employer des sophismes pour démontrer qu'ils « ont le droit » d'avoir cette chose ; ils imitent le loup dans ses propos à l'agneau. La proposition énoncée tout à l'heure est donc du genre de l'autre, qui affirme l'existence, en certains esprits, de la notion du chlorure de sodium, avec cette différence que cette dernière est beaucoup plus précise. Semblable encore est la proposition qui affirme l'existence d'une chose portant le nom de chlorure de sodium. Au contraire, la proposition qui affirme l'existence du « droit naturel » est d'un genre entièrement différent [FN: § 1689-2]. Pour que cette proposition fût du genre précédent, les conditions suivantes seraient nécessaires : 1° qu'on puisse définir avec quelque précision ce qu'on entend par ce terme ; 2° que les conséquences logiques de cette définition se vérifient en pratique. Ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie. Au chapitre IV, nous avons précisément fait voir qu'il est impossible de savoir avec un peu de précision ce que les auteurs entendent par le terme de « droit naturel » ; et il y a de très nombreuses preuves montrant qu'on peut bien déduire logiquement de ce terme ce qui devrait arriver suivant certains auteurs, mais non, du moins en général, ce qui arrive effectivement [FN: § 1689-3]. C'est pourquoi, dans une étude qui a pour but de connaître ce qui a lieu sûrement, de semblables entités ne peuvent nous être d'aucun usage. Nous les considérons seulement comme des manifestations de sentiments ; sentiments que nous avons précisément recherchés, dans les chapitres VI, VII et VIII, parce qu'ils appartiennent à la catégorie des choses dont nous pouvons faire usage pour connaître ce que l'on observe en réalité. Pour le même motif, nous avons recherché, dans les chapitres IX et X, les voiles dont ces choses sont recouvertes, les formes sous lesquelles elles se présentent. Ainsi nous avons procédé d'une manière analogue à celle de l'homme de science qui recherche d'abord la composition d'un corps chimique, et ensuite la forme sous laquelle il cristallise.
§ 1690. Pour revenir aux observations sur la manière de s'exprimer, il faut remarquer que, les sentiments étant manifestés par les résidus, il nous arrivera souvent, afin d'abréger, de nommer simplement les résidus pour désigner aussi les sentiments qu'ils manifestent. En ce sens, nous disons que les résidus sont parmi les éléments qui déterminent l'équilibre social ; proposition qui doit être traduite et entendue en ce sens que « les sentiments manifestés par les résidus sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social ». Mais cette proposition aussi est elliptique et doit être traduite à son tour. Prenons garde au danger d'attribuer une existence objective (§94, 149, 1689) aux résidus, ou même aux sentiments. En réalité, nous observons seulement des hommes se trouvant dans un état révélé par ce que nous appelons des sentiments. C'est pourquoi la proposition énoncée tout à l'heure doit se traduire sous cette forme : « Les états dans lesquels se trouvent certains hommes, et qui sont révélés par les sentiments, lesquels se manifestent par les résidus, sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social ». Mais si nous voulons vraiment nous exprimer d'une manière rigoureuse, cela ne suffit point encore. Que peuvent bien être ces états « des hommes », ou si l'on veut, ces « états psychiques » ? Ce sont des abstractions. Qu'y a-t-il dessous ? Nous devrons donc dire : « Les actes des hommes sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social. Parmi ces actes, il y a certaines manifestations auxquelles nous avons donné le nom de résidus, et qui sont étroitement liées à d'autres actes ; de telle sorte que, les résidus étant connus, on peut aussi, en des circonstances données, connaître les actes. Par conséquent nous dirons que les résidus sont parmi les éléments qui se trouvent en rapport de mutuelle détermination avec l'équilibre social ». On peut bien dire cela une fois, pour fixer avec une rigueur stricte le sens des termes employés, mais il serait inutile, fastidieux, et vraiment pédant de parler toujours avec de pareilles longueurs. C'est pourquoi, à la proposition précédente, on substitue cette autre, qui s'exprime en disant : « Les résidus sont parmi les éléments qui déterminent l'équilibre social » ; et cela ne peut apporter aucun inconvénient, si l'on se rappelle toujours le sens donné aux termes ainsi employés [FN: § 1690-1].
Les dérivations aussi manifestent des sentiments, soit directement ceux qui correspondent aux résidus dont ils tirent leur origine, soit indirectement ceux qui servent à dériver. Mais nommer les dérivations au lieu des résidus qu'elles manifestent, ainsi que le langage vulgaire a l'habitude de le faire, pourrait induire en de graves erreurs. C'est pourquoi nous nous en abstiendrons dans tous les cas où le doute au sujet de la signification de la proposition nous paraîtra possible.
Le sujet étant très important, il conviendra d'ajouter quelques éclaircissements. Nous observons, par exemple, différents cas dans lesquels la poule défend ses poussins, et nous résumons l'observation des faits passés, la prévision des faits futurs, la notion d'une uniformité, en disant que « la poule défend ses poussins », qu'il y a en elle un sentiment qui la pousse à les défendre, que cette défense est la conséquence d'un état psychique donné. De même, nous observons divers cas dans lesquels certains hommes se font tuer pour leur patrie, et nous résumons l'observation des faits passés, la prévision des faits futurs, la notion d'une uniformité étendue à un grand nombre d'individus, en disant que « les hommes – ou certains hommes – se font tuer pour leur patrie », qu'il y a en eux un sentiment qui les pousse à se sacrifier pour leur patrie, que ce sacrifice est la conséquence d'un état psychique donné. Mais, chez les hommes, nous observons aussi certains faits qui sont la conséquence de l'emploi du langage par l'être humain, et qui, par conséquent, ne peuvent être observés chez les animaux. C'est-à-dire que les hommes expriment par le langage certaines choses que nous mettons en rapport avec les faits observés, lorsque ces hommes se font tuer pour leur patrie. Ils disent, par exemple, Dulce et decorum est pro patria mori. Nous disons qu'ils expriment ainsi un certain sentiment, un certain état psychique, etc. Mais cela n'est pas très rigoureux, car les sentences que nous considérons de cette manière comme exprimant un sentiment (on dirait mieux : un ensemble de sentiments), un état psychique, etc., sont multiples et variées. En séparant dans ces sentences et autres propositions la partie constante de la partie variable, nous avons trouvé les résidus et les dérivations ; et nous avons dit que le résidu exprime ce sentiment, cet état psychique, etc. Mais ainsi nous ajoutons quelque chose aux faits. L'observation expérimentale nous dit seulement qu'il y a des faits concomitants d'hommes qui se sacrifient pour leur patrie, et qui s'expriment d'une certaine manière [FN: § 1690-2]. Nous rendons compte de cela au moyen des propositions suivantes qui, d'abord rapprochées de la réalité, s'en écartent ensuite toujours plus. 1° On remarque à la fois des actes de dévouement pour la patrie, et des expressions qui approuvent, louent ces actes. Ces expressions ont une partie commune que nous appelons résidu. 2° Les hommes se sacrifient pour leur patrie, et ont un sentiment manifesté par les résidus, sentiment qui les pousse à faire cela. La différence avec la réalité gît dans le terme sentiment, qui n'est pas précis. En outre, l'uniformité est énoncée sans conditions, tandis qu'il devrait y en avoir. Enfin, même si l'on suppose qu'il y a toujours un sentiment qui pousse aux actes, cela pourrait donner lieu à des objections. 3° Au lieu de dire : « et ont un sentiment, etc. », on dit : « parce qu'ils ont un sentiment, etc. ». Le terme parce que éloigne de la réalité, en indiquant un rapport de cause à effet, tandis que nous ne savons pas avec précision si ce rapport existe. 4° Les hommes croient que se sacrifier pour sa patrie est un devoir ; c'est pourquoi ils accomplissent ces actes de sacrifice. Là, nous nous éloignons beaucoup de la réalité, en admettant que les actes sont des conséquences des croyances, et en substituant les actions logiques aux actions non-logiques. Cette dernière manière de s'exprimer est usuelle, mais induit facilement en erreur, même si l'on a dans l’esprit que c'est uniquement une forme de la première. On peut employer la seconde manière de s'exprimer, pourvu qu'on ait présent à l'esprit que, rigoureusement, nous devons toujours nous en rapporter à la première. Nous avons fait et ferons un abondant usage de cette seconde manière de s'exprimer, spécialement sous la forme équivalente qui met en rapport les actes et les résidus. On peut employer la troisième manière, mais toujours avec la précaution de s'en rapporter à la première, et en se tenant sur ses gardes contre le danger de tirer des conséquences logiques du terme parce que qui y est employé. Les termes : sentiments, résidus, sont commodes en sociologie, de même que le terme force est commode en mécanique. On peut les employer sans inconvénients si l'on a toujours présente à l'esprit la réalité à laquelle ils correspondent.
§ 1691. LES RÉSIDUS EN GÉNÉRAL. Pour reconnaître et classer les résidus, nous les avons considérés indépendamment de l'intensité des sentiments qu'ils manifestent, et indépendamment du nombre de personnes chez lesquelles ils se rencontrent ; par abstraction, nous les avons séparés des êtres concrets auxquels ils appartiennent. Il faut maintenant tenir compte de toutes ces circonstances.
Parlons d'abord de l'intensité. Il faut distinguer entre l'intensité propre au résidu, et celle qui lui vient de la tendance générale de l'individu à être plus ou moins énergique. Par exemple, celui qui a un fort sentiment de patriotisme et peu de courage, combattra avec beaucoup moins d'énergie pour sa patrie que celui qui a un sentiment beaucoup moins fort, mais est courageux. Celui qui a fortement l'instinct des combinaisons, mais est paresseux, réalisera moins de combinaisons que celui qui possède cet instinct à un moindre degré, mais est actif. On peut donc admettre que certaines circonstances, auxquelles nous donnons le nom d'énergie ou, au contraire, de faiblesse, élèvent ou abaissent le niveau général de certains résidus [FN: 1691-1].
§ 1692. Voyons ensuite les résidus en rapport avec les êtres concrets auxquels ils appartiennent. Supposons qu'en un lieu et en un temps déterminés, on ait observé mille phénomènes A ; qu'en un autre lieu ou en un autre temps, on ait observé cent phénomènes B ; enfin, qu'en un lieu ou un temps encore différents, on ait observé un seul phénomène C. Pour trouver les résidus, nous avons comparé A avec B, avec C , en en cherchant la partie constante, sans tenir compte du nombre des phénomènes A, B, C. Maintenant, nous devons diriger notre étude vers cette partie du sujet, et étudier la répartition des résidus. D'ailleurs, nous ne pourrons pas avancer beaucoup dans cette voie, parce que nous manquons encore d'une théorie de la division de la société en classes. Nous pourrons donc seulement commencer l'étude, que nous poursuivrons au chapitre suivant, après avoir donné cette théorie (§2025 et sv.).
§ 1693. Pour la partie statique, nous devons examiner : 1° la répartition des résidus dans une société donnée ; 2° la répartition entre les diverses couches de cette société. Pour la partie dynamique, il faut voir : l° comment, à peu près, les résidus varient dans le temps, soit qu'ils changent chez les individus d'une même couche sociale, soit que le changement ait lieu par le mélange des couches sociales ; 2°comment chacun de ces deux phénomènes se produit.
§ 1694. En outre, il faut prendre garde au mouvement rythmique que l'on observe en tous les phénomènes sociaux (§2329). Un phénomène à peu près constant est représenté, non pas par une droite mn, mais bien par une courbe ondulée svt. Un phénomène d'intensité croissante est représenté, non pas par une droite ab, mais bien par une courbe ondulée rpq. Les lignes telles que mn, ab, représentent le mouvement moyen du phénomène. C'est ce mouvement que nous nous proposons d'étudier maintenant (§1718).

Figure 22

Figure 23
§ 1695. RÉPARTITION ET CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION D'UNE SOCIÉTÉ. Ici, nous ne recherchons pas quelles causes déterminent le caractère d'une société : si c'est la race, le climat, la position géographique, la fertilité du sol, la productivité économique, etc. Nous étudions les sociétés historiques en tant que faits, sans vouloir, pour le moment, remonter aux origines. Dans ces sociétés historiques, nous observons des phénomènes qui, au fond, varient peu, tandis que leur forme varie beaucoup. Par exemple, les différentes religions qui se succèdent peuvent revêtir des formes aussi diverses que l'on voudra, mais en fin de compte, elles sont des manifestations de sentiments religieux qui varient peu. On peut en dire autant des différentes formes de gouvernement ; elles ont chacune leur propre « droit divin », explicite ou implicite [FN: § 1695-1]. Le libre-penseur moderne impose, au nom de la déesse Science, une morale qui diffère peu de celle que le Dieu des Israëlites donna à son peuple, ou de celle que le peuple chrétien reçut de son Dieu, ou de celle que plusieurs peuples de l'antiquité reçurent des dieux ou de législateursdivins ou légendaires. Les dérivations par lesquelles on justifie le caractère impératif et absolu de toutes ces morales ne varient pas beaucoup non plus.
Même en des phénomènes beaucoup moins importants, on observe de semblables uniformités. Par exemple, aux malades qui, pour recouvrer la santé, affluaient dans les temples d'Esculape, se sont substitués, au moyen âge, des fidèles qui demandaient la santé aux saints, visitaient leurs lieux sacrés et leurs reliques, et ont aujourd'hui des descendants parmi les fidèles qui se rendent à Lourdes, ou parmi les adeptes de la Christian Science [FN: § 1695-2], ou aussi parmi ceux qui remplissent la bourse de quelque charlatan. Nous n'avons pas de statistiques précises qui nous fassent connaître le nombre de ces personnes et, par conséquent si et comment leur proportion a varié par rapport à l'ensemble des habitants ; mais il est certain que cette proportion a été et demeure considérable ; qu'elle n'était pas et n'est pas petite ; et que, si l'on peut admettre comme probable qu'elle ait diminué des temps passés aux nôtres, toute preuve certaine de ce fait nous manque. Ne pouvant avoir le plus, nous devons nous contenter du moins, qui est, après tout, toujours mieux que rien.
§ 1696. Aux phénomènes rappelés tout à l'heure, il faut en ajouter d'autres analogues. Dans les temples d'Esculape, la thérapeutique ne consistait pas exclusivement en opérations surnaturelles ou, si l'on veut, de suggestion : souvent elle était, en partie du moins, matérielle, et par conséquent d'ordre médical. À ce point de vue, si nous voulons prendre comme terme de comparaison les cures de Lourdes, celles de la Christian Science et celles d'autres sectes semblables [FN: § 1696-1], il semble que l'on ait rétrogradé dans la voie qui aboutit à une augmentation de l'élément scientifique, car, à Lourdes et chez les adeptes de la Christian Science, tout traitement médical a disparu ; il est même fortement blâmé par les Scientistes. Mais il faut aller plus loin, et ajouter encore les traitements que l'on opérait autrefois, en très grand nombre, par la magie, par les reliques et par d'autres moyens fantaisistes, qui feraient pencher en faveur d'une conclusion opposée à la précédente.
§ 1697. On remarquera encore que les cures des temples d'Esculape ne sont pas remplacées exclusivement, de nos jours, parcelles de Lourdes, par celles de la Christian Science, ou par d'autres semblables, mais que, parmi elles, il faut ranger aussi celles de nombreux médecins que, par un heureux néologisme, Daudet a nommés les morticoles [FN: 1697-1]. On remarquera aussi que la crédulité ancienne a exactement son parallèle dans la crédulité moderne [FN: 1697-2]. En aucun temps, les thaumaturges ne se sont enrichis comme aujourd'hui aux dépens des naïfs, et en beaucoup de pays, la loi protège ces ministres de la déesse Science autant et plus que n'ont été protégés, en d'autres temps, les ministres des dieux païens. Dans les cliniques, dans les lieux de cure, qui sont les temples du thaumaturge, les fidèles accourent en grand nombre. Certains d'entre eux guérissent, si la bonne mère Nature les regarde d'un œil favorable, tandis que tous contribuent à enrichir le prêtre de la déesse et ses acolytes, parmi lesquels il ne faut pas oublier le pharmacien, qui fait payer cent ce qui coûte un, ni l'inventeur de spécialités médicinales, lesquelles passent comme des météores, guérissent pendant un temps plus ou moins long, souvent très court, puis disparaissent, mais laissent riche l'heureux spéculateur sur la crédulité d'autrui, qui exploite le bon public avec la complicité du législateur. Aucun fait, pour évident et manifeste qu'il soit, ne peut ouvrir les yeux des exploités.
On accusait autrefois les confesseurs d'extorquer des legs aux moribonds, en les menaçant des châtiments éternels. Aujourd'hui, les thaumaturges font mieux encore : ils exploitent aussi les héritiers, en leur envoyant un compte hyperbolique d'honoraires, persuadés que, pour éviter un procès et l'accusation d'ingratitude envers le défunt, les héritiers préféreront payer. Il ne faut pas se dissimuler non plus qu'afin de capter la bienveillance des humanitaires, et pouvoir, avec leur appui, continuer de telles extorsions, ces nouveaux saints hommes soignent gratuitement les pauvres, de même qu'autrefois les saints religieux servaient aux pauvres gens, devant les portes des couvents, de grandes marmites de soupe. On se moqua de cette charité, lorsque la foi vint à diminuer. Aujourd'hui, la foi aux nouveaux thaumaturges est encore si vive qu'elle ne laisse pas de place à de semblables moqueries [FN: § 1697-3].
Connaissant l'absolu, le prêtre voulait l'imposer. Nonobstant les continuels démentis de l'expérience, plusieurs de nos docteurs s'imaginent que leur science est parvenue à une certitude dont elle est, au contraire, bien éloignée [FN: 1697-4]. Ils veulent imposer aux populations qui regimbent leurs présomptueuses volontés d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles d'hier, qui ne seront pas celles de demain. Au XVIIIe siècle, en Italie et en France, le directeur spirituel régnait ; aujourd'hui, certains docteurs ont pris sa place. Comme d'habitude, dans l'une et l'autre de ces superstitions, les hommes faibles et les femmes mordent plus facilement à l'hameçon. Il y avait alors des directeurs spirituels, semblables aux directeurs médicaux d'aujourd'hui qui tyrannisent les familles, y sèment la zizanie, les ruinent. Là où la persuasion ne réussit pas, la force de la loi y supplée. Les religieux catholiques défendaient à leurs sujets de manger de la viande en carême, et faisaient payer les dispenses de cette obligation. Nos directeurs hygiéniques défendent à leurs sujets, en plusieurs pays, de boire du vin ou d'autres boissons alcooliques, excepté comme remèdes dont ils sont les dispensateurs exclusifs, non sans quelque profit pécuniaire qui dépasse souvent de beaucoup celui qu'obtenaient les religieux des temps passés [FN: § 1697-5]. L'Église se mêlait de prohiber ou de permettre les mariages, et se faisait payer les dispenses dans les cas prohibés. Aujourd'hui, certains humanitaires proposent d'empêcher que l'on puisse se marier sans un certificat médical, ce qui ouvrirait aux directeurs hygiéniques une nouvelle source de profits pécuniaires... et aussi d'autres avantages, lorsque les futures épouses seraient jeunes et attrayantes.
§ 1698. On pourrait citer un grand nombre d'autres faits semblables. Tous montrent que des superstitions qu'on croirait facilement avoir disparu se sont, au contraire, transformées, et subsistent toujours sous une autre forme. Par exemple, du moyen-âge à notre époque, le rôle de la magie dans la vie des sociétés a diminué d'importance, même si l'on tient compte de ce qu'en ont hérité les somnambules, les spirites, les télépathistes et autres thaumaturges [FN: § 1698-1]. Mais le domaine dont la magie était chassée a été partiellement occupé par la déesse Science. D'une manière générale, dans le domaine des arts et des sciences, l'évolution a certainement eu lieu dans le sens d'un accroissement d'importance de la science expérimentale ; mais le fait d'une semblable évolution est moins certain, si l'on considère le domaine de la politique et de l'organisation sociale. Il convient de remarquer que les simples combinaisons étrangères à l'expérience scientifique sont bien loin d'avoir disparu de la vie des sociétés ; tout au contraire, elles subsistent en grand nombre et sont prospères et florissantes. Comme les résidus du genre (I-δ) correspondent à ces combinaisons, au moins en grande partie, on peut dire que, dans son ensemble, ce genre a changé beaucoup moins qu'il ne semblait à première vue.
§ 1699. Ajoutons que la même science expérimentale tire son origine de l'instinct des combinaisons et correspond à des résidus de la IIe classe. C'est ce qu'elle a de commun avec les divagations de la magie et d'autres doctrines fantaisistes. Celui qui n’y prend pas garde pourrait croire que la Ie classe entière a subi un accroissement considérable, des temps passés aux nôtres, et a refoulé les résidus de la IIe classe. Cet accroissement existe certainement, mais une étude attentive le fait reconnaître moindre qu'il ne paraît. Les combinaisons de la science expérimentale se sont énormément accrues du passé à nos jours ; mais elles ont occupé, en grande partie, le domaine tenu autrefois par les combinaisons de l'empirisme, de la magie, de la théologie, de la métaphysique. Au point de vue de l'utilité sociale, ce déplacement des combinaisons est très avantageux ; mais au point de vue du rôle que les résidus jouent dans les actions humaines, la compensation qui s'est établie est manifeste, de sorte que la somme totale a changé beaucoup moins que les deux parties dont elle se compose ; et si l'on considère la Ie classe dans soli ensemble, on verra qu'au fond elle varie peu et lentement.
§ 1700. On peut émettre des considérations semblables pour les autres classes. Voyons, par exemple, la IIe classe (persistance des agrégats). On y trouve un genre (II-β) qui n'a pas disparu. Au contraire, c'est grâce à l'observation des faits contemporains qu'au chapitre VI nous avons pu le dégager des dérivations qui le masquaient autrefois. Mais il n'est pas douteux qu'à notre époque il joue un rôle beaucoup moins important qu'en des temps reculés, lorsque nos ancêtres gréco-latins n'avaient presque aucun autre culte que celui des morts, ou bien quand, au moyen âge, le principal souci des vivants semblait être de fonder des messes pour les morts. On peut, par conséquent, affirmer en toute sécurité que l'importance des résidus du genre (II-β) a beaucoup diminué depuis les temps passés jusqu'à nos jours.
§ 1701. Mais il est remarquable que cette diminution a été, au moins en partie, compensée par des accroissements des autres genres de la même classe. Celle-ci n'a donc pas beaucoup changé, dans son ensemble. Les dieux du polythéisme gréco-latin conquirent peu à peu le domaine laissé libre par le culte des morts ; et, à leur tour, ils furent dépossédés par les divinités et par les saints du christianisme [FN: 1701-1]. Au XVIe siècle, la Réforme fit une guerre implacable au culte des reliques, et surtout à celui que l'Église romaine vouait à l'allégement des châtiments des morts ; mais, au fond, elle y substitua d'autres persistances d'agrégats. Sous la domination de Calvin, on jouissait de beaucoup moins de liberté, on était soumis à beaucoup plus de règles dictées par des considérations ultra-expérimentales, à Genève qu'à Rome sous la domination des papes ; et, somme toute, le protestantisme fut beaucoup plus strict, beaucoup plus oppressif que là religion catholique, dans les pays où il s'y substitua, tandis que même la religion catholique, poussée par la guerre qu'on lui faisait, devint plus restrictive, moins indulgente, plus envahissante. En somme, à Rome, sous Léon X et avant Luther, il régnait une liberté de pensée qui disparut dans les pays protestants, et ensuite dans les pays catholiques aussi. Les admirateurs même du protestantisme disent qu'il accrut la « religiosité » ; ce qui revient à dire qu'il accrut l'importance des résidus de la IIe classe.
§ 1702. Un grand nombre d'autres observations confirment ces déductions. Celui qui porte son attention principalement sur la forme logique perçoit de très grandes différences entre diverses religions qui sont opposées ; tandis que celui qui porte son attention principalement sur les sentiments, y découvre des formes diverses d'un même fond. En Europe, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le socialisme se développa, refoulant une partie des religions existantes, ainsi la religion catholique et le nationalisme, en assimilant d'autres, ainsi l'humanitarisme et le christianisme dit « libéral », bien qu'il soit peu chrétien [FN: § 1702-1] et pas du tout libéral. Puis, vers le commencement du XXe siècle, eut lieu un retour offensif des religions différentes du socialisme [FN: § 1702-2] ; la marée positiviste humanitaire redescendit un peu, et le sentiment religieux socialiste recula. Les religions accessoires telles que le libéralisme [FN: § 1702-3], l'humanitarisme, le tolstoïsme, etc., reculèrent aussi, et même davantage, tandis que se renforçait notablement le nationalisme, que prospérait le catholicisme, que cessait l'éclipse subie par les diverses métaphysiques, et que même la magie et l'astrologie recommençaient à se développer [FN: § 1702-4].
§ 1703. Les différences d'intensité qu'on observa dans la faveur croissante du public pour une partie de ces dérivations, et la faveur décroissante pour une autre partie, sont un indice certain des différences d'intensité des résidus auxquels elles correspondent. Vers 1913, on vit cela clairement en Italie, où la rapide montée de la marée nationaliste alla de pair avec un déclin non moins rapide de la foi socialiste. Le mouvement se produisit en France aussi ; la marée de la foi nouvelle était occasionnée non seulement par le nationalisme, mais aussi, bien qu'en petite partie, par la vigueur nouvelle du catholicisme. En Allemagne aussi, le socialisme déclina quelque peu [FN: § 1703-1]. En Angleterre, il est de même arrivé que l'avance d'une des religions sociales a été compensée par le recul d'une autre, ou de plusieurs autres ; mais en ce pays, c'est le socialisme qui a avancé ; c'est le nationalisme et le libéralisme qui ont reculé. Comme le mouvement actuel, en Angleterre, a lieu en partie, c'est-à-dire pour le nationalisme, dans une direction contraire à celle du mouvement général des peuples européens, il se pourrait qu'il ne durât pas longtemps. La transformation du Japon au XIXe siècle est très remarquable [FN: § 1703-2]. Les dérivations ont changé ; demeurent les sentiments, les résidus, qui s'expriment en partie diversement. La IIe classe (persistance des agrégats) est peu ou point changée, mais les genres ont subi des variations souvent considérables.
§ 1704. Il est important de considérer l'exemple de l'Italie, rappelé plus haut ; ce n'est pas à cause de l'ampleur et de l'intensité du mouvement, car, dans l'histoire, nous en avons un grand nombre d'autres d'une ampleur et d'une intensité bien plus considérables ; c'est parce que, ce mouvement avant eu lieu sous nos yeux, nous en pouvons mieux connaître la nature. Ici, nous ne recherchons pas quel rôle ont pu jouer, dans le mouvement, les artifices politiques et financiers, et pas davantage si et comment les sentiments ont crû comme de faibles petites plantes arrosées par la bienfaisante rosée politique et financière. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre XII. Ici, nous considérons les sentiments déjà existants, et nous recherchons uniquement comment a varié la répartition des résidus de la IIe classe, et comment le phénomène fut en partie masqué par le voile des dérivations. Sur ce dernier point, nous ajouterons d'autres considérations à celles qui ont été faites précédemment (§1559 et sv.). Dès 1908, on pouvait voir se dessiner le mouvement qui apparut ensuite clairement en 1911. Alors, la religiosité d'un grand nombre de socialistes, de libéraux, d'humanitaires, de tolstoïens, etc., prit la forme de religiosité nationaliste et belliqueuse. Nous avons un signe, qui n'est pas négligeable, de la décadence du sentiment socialiste chez ses chefs, dans le fait qui se produisit lorsque, le 23 février 1912, la Chambre approuva le décret d'annexion de la Libye. À l'appel nominal, 38 députés, dont 33 socialistes, émirent un vote défavorable. Au scrutin secret, ils ne furent que 9. Par conséquent, un certain nombre d'entre eux avaient une foi socialiste ou nationaliste si faible, qu'ils pouvaient émettre des votes contraires lors de la votation publique et de la votation secrète [FN: § 1704-1]. Cela rappelle l'observation de Machiavel, que : « les hommes savent très rarement être tout bons ou tout mauvais ».
§ 1705. La transformation de la religiosité pacifiste en religiosité belliqueuse fut très remarquable, à cause du contraste qu'elle présentait.
Ne fussent les conditions sanitaires de l'Italie, qui empêchèrent les pacifistes étrangers de venir à Rome au congrès de la paix que leurs coreligionnaires italiens s'obstinaient à vouloir assembler, tandis qu'on préparait l'expédition de Tripoli, ce congrès de la paix aurait eu pour principal thème les louanges que les pacifistes italiens [FN: § 1705-1], à peu d'exceptions près [FN: § 1705-2], s'apprêtaient à donner à la guerre.
§ 1706. Comme d'habitude, et à l'instar des exemples si nombreux que nous avons vus, les dérivations vinrent à la rescousse pour démontrer qu'en ce cas spécial, la guerre ne répugnait nullement aux doctrines pacifistes générales. C'est là un des cas très nombreux dans lesquels apparaît nettement le caractère accessoire des dérivations, qui ne déterminent pas les événements, mais sont, au contraire, déterminées par eux, ainsi que la fable bien connue du loup et de l'agneau en donne un exemple depuis des temps très reculés.
§ 1707. La guerre était déterminée par un ensemble d'intérêts et de sentiments semblables à ceux qui, depuis un siècle au moins, ont déterminé les guerres coloniales de tous les grands états européens, et l'Italie ne faisait que suivre et encore de loin tant d'autres pays, sur la voie qu'ils avaient largement ouverte. Elle n'aurait peut-être pas pu s'en abstenir sans courir de graves dangers. Si l'on avait simplement dit cela, on aurait exprimé les causes réelles de l'événement. Mais on voulut recourir à des dérivations qui satisfissent les sentiments correspondant aux résidus de la IIe classe.
§ 1708. 1° D'abord les sentiments de justice. L'ultimatum du marquis de San Giuliano relevait des injustices commises par la Turquie au détriment de l'Italie ; par exemple, qu'une jeune fille italienne avait été enlevée, disait-on. La conclusion logique eût été d'exiger réparation de ces injustices, que cette jeune fille fût rendue aux autorités italiennes. Au contraire, par un raisonnement très spécial, la conclusion était que l'Italie devait s'emparer de Tripoli, et la jeune fille enlevée, après avoir servi de prétexte, disparaissait, et l'on ne parlait plus d'elle.
2° Puis vinrent au bon moment les atrocités que les combattants turco-arabes commirent, dit-on, sur les morts, les blessés, les prisonniers italiens. Mais, en bonne logique, la cause doit précéder l'effet ; et il est étrange de donner pour cause d'une guerre des faits arrivés depuis cette guerre, et qui en sont une conséquence.
3° On disait aussi que l'Italie devait délivrer les Arabes de l'oppression des Turcs. Il est vrai que les Arabes ne voulaient pas être délivrés ; mais cela importait peu ou point ; ils devaient, de vive force, être « délivrés ». Pour conquérir la Grèce, la Rome ancienne trouva le prétexte de « délivrer » les Grecs. La Rome moderne, beaucoup plus modeste, se contentait de « délivrer » les Arabes tripolitains. Les sophismes et les dérivations ont la vie très longue.
4° Subsidiairement, on recourut quelque peu aux sentiments de l'intégrité nationale. Un décret ayant uni la Tripolitaine et la Cyrénaïque à l'Italie, les Arabes qui ne voulaient pas se soumettre étaient des « rebelles ». On peut être pacifiste et demander que l'on étouffe la « rébellion ».
5° On fit aussi une légère allusion aux sentiments chrétiens. Mais on ne tarda pas à abandonner cette voie dangereuse, qui pouvait conduire à donner à la guerre un caractère de conflit entre le christianisme et l'islamisme.
6° Un argument plus important fut le recours aux sentiments religieux d'aujourd'hui. Si, dans le passé, on opposait la religion du Christ à celle de Mahomet, de nos jours et de la même façon, on oppose la religion du saint Progrès et de la très sainte Civilisation, à la superstition de l'immobilité et de la barbarie. Les pacifistes rénovèrent la vieille théorie suivant laquelle les peuples chrétiens ne devaient pas se faire la guerre entre eux, et ne devaient combattre que les infidèles [FN: § 1708-1]. Ils nous disent qu'ils voulaient la paix entre les nations civilisées, mais non entre celles-ci et les nations barbares. La nouvelle théorie est beaucoup moins précise que l'ancienne, car enfin il est facile de savoir si une nation est chrétienne ou non, au moins dans la forme. Mais comment faire pour savoir si elle est civilisée, et surtout si elle atteint le point de civilisation nécessaire pour avoir la paix et non la guerre ? La Post de Berlin voudrait que l'Allemagne s'emparât des colonies du Portugal, pour y substituer la civilisation germanique saine à la civilisation latine corrompue. Beaucoup d'Allemands croient fermement qu'il existe une seule civilisation, la germanique, et que le reste est barbarie. Devons-nous accepter cette théorie ? Qui tranchera cette question ardue ? Elle n'est nouvelle que de forme. Le fond se trouve déjà dans la demande qu'en une nouvelle de Boccace, Saladin adresse au Juif Melchisédeck : « J'aimerais assez que tu me dises laquelle des trois lois tu tiens pour la vraie, de la judaïque, de la sarrasine ou de la chrétienne ». Le Japon est-il civilisé ou barbare ? Est-il permis ou non, suivant la doctrine pacifiste, de lui faire la guerre ? Les difficultés croissent pour les puissances qui englobent diverses nations réputées les unes civilisées, les autres barbares. La France est certainement une nation civilisée. Perd-elle cette qualité à cause de ses possessions africaines et asiatiques ? Et l'Angleterre ? Et la Russie ? Il est évident que la théorie invoquée dans un but de discussion n'est ni vraie ni fausse : elle n'a tout simplement aucun sens.
7° On ne découvre pas beaucoup plus de sens à cette belle trouvaille des pacifistes, qui nous présentent leur paix comme devant exister seulement entre les nations européennes et, supposons-nous, aussi entre les nations américaines. Cette épithète d'européennes se rapporte-t-elle à la race ou au territoire ? Si elle se rapporte à la race, la guerre de l'Italie contre la Turquie se justifie, il est vrai ; mais une guerre contre les Magyars ou contre les Russes parmi lesquels se trouvent tant de Tartares, se justifierait également ? Si l'épithète se rapporte au territoire, la Turquie a un territoire en partie européen, en partie asiatique, ainsi que l'Angleterre, la Russie et d'autres nations ; la théorie pacifiste finit alors par ne plus s'appliquer à aucun peuple. Négligeons aussi de moindres considérations, comme celles de la fatalité historique de l'ancienne domination de Rome en Afrique, et d'autres qui empruntent leur forme à semblable rhétorique.
§ 1709. L'une des plus belles trouvailles, parmi tant d'autres, est celle selon laquelle le pacifisme aurait pour règle qu'on peut faire la guerre chaque fois qu'on l'estime utile à sa patrie. Si l'on admet cela, il sera bien difficile de trouver dans le monde quelqu'un qui ne soit pas pacifiste ; car enfin, qui est assez dénué de bon sens pour dire : « Je désire la guerre, parce que je crois qu'elle sera funeste à ma patrie ? » Et qui dira pourquoi, si les nationalistes du pays A ont le droit de faire la guerre, ceux du pays B n'auraient pas également ce droit ? Et si on l'accorde à tous, quel but peut bien avoir le pacifisme ? Ces excellents pacifistes n'en finissaient plus de louer l'arbitrage et les congrès de La Haye, qui prescrivaient d’avoir recours à cet arbitrage avant de se mettre en guerre ; et puis ils approuvèrent leur gouvernement, lequel ne s'en soucia en aucune façon. Ainsi, que devient la « Paix par le droit » ? Pour résoudre le problème qui divise les pacifistes et les non-pacifistes, il ne s'agit pas de savoir si l'on doit faire ce qui est utile on nuisible à sa patrie. Il s'agit de savoir si la guerre est toujours nuisible, excepté dans le cas de défense de son propre territoire, ainsi que l'affirment les pacifistes qui ne sont pas italiens, et comme l'affirmaient aussi ceux qui sont italiens, avant la guerre pour la conquête de Tripoli ; ou bien si la guerre, même de conquête, peut être parfois utile, ainsi que l'affirment les adversaires des pacifistes. De même, il s'agit de savoir si, comme l'affirment les pacifistes, les règles du « droit » suffisent à résoudre les conflits internationaux, ou bien si, comme l'affirment les non-pacifistes, la guerre est parfois indispensable. Si l'on admet que celle-ci peut avoir lieu chaque fois qu'une nation la préfère à l'arbitrage, il est impossible de trouver quelqu'un qui ne soit pas pacifiste. Ajoutons, pour montrer l'absolue vanité des motifs invoqués pour justifier la guerre de Libye, que sitôt la victoire obtenue, on ne se soucia plus de ces motifs ou prétextes. On disait que la guerre était entreprise en vertu d'un sentiment de justice, pour réparer les offenses dont des citoyens italiens avaient été victimes. Aucune de celles-ci ne fut réparée. Bien plus, les nouvelles et beaucoup plus graves offenses résultant de l'expulsion des Italiens du territoire turc demeurèrent sans réparation. Les sentiments de pitié pour les peuples opprimés par les Turcs, très vifs en faveur des Arabes, auxquels il plaisait d'être « opprimés » par les Turcs, ne s'étendirent pas aux peuples chrétiens qui voulaient se soustraire au joug des Turcs ; et l'Italie fit la paix juste au moment qui put être profitable à la Turquie contre ces peuples. Quant aux saints Progrès, Civilisation et autres analogues, le gouvernement italien ne s'en soucia plus, à moins que l'on ne veuille affirmer que dans la guerre entre la Turquie d'une part et les peuples balkaniques et helléniques de l'autre, le saint Progrès et la très sainte Civilisation étaient du côté de la Turquie. Enfin si, dans son conflit avec l'Italie, la Turquie devait être considérée comme nation non-européenne, à laquelle il était par conséquent licite de faire la guerre, tout à coup par un tour de passe-passe, elle sembla se transformer en nation européenne, dans son conflit avec la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro et la Grèce ; et l’on ne devait donc pas lui faire la guerre. En vertu d'une telle transformation, on conclut la paix au plus tôt.
§ 1710. Toutes ces dérivations si peu logiques, et parfois même ridicules, aboutissent au même point. Il est donc évident qu'on les a émises en vue de la conclusion qu'on en voulait tirer, et non pas que, trouvées indépendamment de la conclusion, celle-ci en est résultée. C'est pourquoi nous voyons, comme en tant d'autres cas semblables, que ces dérivations sont seulement l'accessoire, et que le principal gît dans les sentiments et dans les intérêts dont provient la conclusion, que l'on tente a posteriori de justifier par les dérivations. Ainsi disparaît la diversité que celles-ci paraissent manifester, et qui n'est qu'apparente. Le fond demeure ; il est beaucoup plus constant : c'est la réalité. D'une façon générale, il arrive souvent qu'en public les hommes politiques attribuent à leurs actes des causes qui ne sont pas les véritables. Cela arrive surtout quand ils donnent des règles générales comme étant ces causes [FN: § 1710-1) (§1689).
§ 1711. En ce qui concerne le degré plus ou moins grand de résistance opposée par les diverses formes de religiosité à la vague nationaliste qu'on observa en Italie, dans l'année 1911, il faut remarquer que, parmi les socialistes, bon nombre restèrent fidèles à leurs doctrines opposées aux guerres bourgeoises. De même, presque tous les mazziniens restèrent rigidement opposés à ce qu'ils estimaient être une guerre monarchique ; tandis qu'un très grand nombre de pacifistes italiens se firent belliqueux ; que les humanitaires, les tolstoïens se tapirent, disparurent, s'évanouirent. Il convient donc aussi de disposer en ce même ordre de degré de résistance des différents partis, la force des croyances, au moins en Italie et dans le temps présent. Peut-être l'ordre ne serait-il pas très différent pour d'autres pays.
§ 1712. Dans la IIIe classe des résidus, les actes du culte de la religion chrétienne ont diminué, chez les peuples civilisés modernes, mais ont été partiellement remplacés par des actes du culte des saints socialistes, des saints humanitaires, et surtout du culte de l'État et du dieu Peuple. On ne voit pas quelle différence fondamentale il y a entre les fêtes d'un saint catholique et les fêtes du bicentenaire de Rousseau, pour lesquelles l'État français inscrivit trente mille francs à son budget.
Il est naturel que, pour l'humanitaire, le saint catholique est une vieille baderne, et Rousseau un homme éminent ; tandis que, pour le catholique, les rôles sont intervertis. Mais cette différence dans les jugements fait précisément voir la ressemblance des sentiments qui animent l'humanitaire et le catholique. Les processions catholiques ont presque disparu, mais ont été remplacées par les « cortèges » et par les « manifestations » politiques et sociales. Les protestants ne vont pas à la messe comme y vont les catholiques ; mais ils se rendent à des réunions de prières de leur religion, parfois très bruyantes, comme le sont celles des « réveils ». On les trouve avec les libres-penseurs dans les réunions des spirites, tandis que les Anglais et les Américains psalmodient à qui mieux mieux. Pour beaucoup de ceux qui s'écartent de la religion chrétienne, l'enthousiasme chrétien s'est changé en enthousiasme « social », ou « humanitaire », ou « patriotique », ou « nationaliste » ; il y en a pour tous les goûts. Le dieu Peuple n'a plus un athée. On peut, de même que pour tout autre dieu, différer sur la manière de l'adorer, mais non sur le devoir de l'adorer. Et qui donc n'éprouve pas le besoin de proclamer qu'on doit tout sacrifier au bien du peuple ? En paroles, cela s'entend, car pour les actes, souvent il en est autrement. Tous les partis rivalisent pour se prosterner devant le Peuple, et les Chevaliers d'Aristophane figurent également bien les faits d'Athènes et ceux auxquels nous assistons aujourd'hui. Il n'est pas un réactionnaire, quelque excessif qu'il soit, qui ose dire du mal du dieu Peuple ; seul un esprit bizarre comme celui de Nietzsche se le permit, et il apparaît comme l'exception qui confirme la règle [FN: § 1712-1]. Les hommes de science qui, dans leur for intérieur, se rendent compte de la vanité de la nouvelle religion, dissimulent l'athéisme, comme le dissimulaient déjà leurs prédécesseurs, lorsque c'était un délit de mettre en doute la « vérité » de la religion chrétienne ; ils parlent des « abus » de la démocratie, comme on parlait en d'autres temps des « abus » du clergé.
En conclusion, les formes des résidus de la IIIe classe peuvent avoir beaucoup changé, mais le fond a varié beaucoup moins, surtout si on le considère dans son ensemble.
§ 1713. Pour la IVe classe, on pourrait croire qu'il y a eu une forte augmentation, en même temps qu'une non moins grande diminution des résidus de la Ve classe. Pour beaucoup de personnes, c'est un article de foi que, de nos jours, la « sociabilité » s'est beaucoup accrue, tandis que « l'individualisme » diminuait. Mais, au fond, il n'en est pas ainsi, et le changement est souvent exclusivement formel. Par exemple, le sentiment de la subordination qui, dans les temps passés, se manifestait par la sujétion des classes inférieures par rapport aux classes supérieures, se manifeste aujourd'hui pour les classes inférieures par un assujettissement aux chefs de grèves, de syndicats, de partis [FN: § 1713-1], et, pour les classes supérieures, par une soumission à la plèbe, qui est aujourd'hui adulée comme ne le fut jamais aucun roi absolu des siècles passés [FN: § 1713-2]. En ces temps-là, les rois essuyaient parfois de vertes admonestations des papes ; ils éprouvaient aussi de l'opposition de la part de leur noblesse ; tandis qu'aujourd'hui personne n'a la hardiesse de blâmer « le peuple », et encore moins de lui résister ouvertement ; ce qui n'empêche pas que les politiciens le gouvernent, le trompent, l'exploitent, de même qu'autrefois les sycophantes et les démagogues exploitaient Démos à Athènes, de même qu'en des temps plus rapprochés de nous, les courtisans tiraient profit de leurs maîtres [FN: § 1713-3]. En de nombreux parlements, il n'est pas difficile d'apercevoir, sous des dérivations politiques, le fond des intérêts privés par lesquels l'organisation se maintient. Le fait est bien connu ; on peut le constater en de nombreuses publications de divers genres [FN: § 1713-4]. De ces publications sous forme de livres, d'opuscules, de revues et de journaux, on pourrait Composer une grande bibliothèque. Mais les plus importantes sont les publications officielles des enquêtes parlementaires, très difficiles à se procurer, et que personne ne lit, mais qui pourront servir à l'historien futur pour répéter le mot sur Rome que Salluste met dans la bouche de Jugurtha [FN: § 1713-5]. De temps en temps éclate un « scandale », comme celui des banques en Italie, du Panama en France. On fait une enquête qui, à défaut d'autre chose, sert à faire croire au public que c'est une exception, alors qu'au contraire c'est la règle ; puis les eaux agitées reprennent leur tranquillité accoutumée ; et comme les forces constantes finissent par l'emporter sur les forces temporaires, les politiciens se remettent à leurs manœuvres usitées, et le cas n'est pas rare de voir que l'un d'eux, sévèrement frappé à la suite d'une enquête, soit de nouveau ministre et devienne même le maître du pays [FN: § 1713-6], tandis que les opérations dites de « sauvetage » accroîtront le pouvoir de ceux qui tiennent le couteau par le manche.
En général, les partis d'opposition reprochent ces faits aux hommes qui sont au gouvernement, et croient avoir ainsi démontré qu'il serait utile au pays de les chasser du pouvoir. Les amis des gouvernants nient, s'efforcent de trouver des circonstances atténuantes, et, avec plus de succès, tâchent de faire tomber ces faits dans l'oubli. Les gens experts en l'art de gouverner reconnaissent, lorsqu'ils se trouvent dans l'intimité, la vérité des faits, mais ils ajoutent que cela n'ôte rien à l'utilité qu'il y a à ce que leurs amis demeurent au pouvoir [FN: § 1713-7]. Inutile d'ajouter que, lorsque les hommes de l'opposition arrivent au pouvoir, et que ceux du gouvernement passent à l'opposition, les raisonnements s'intervertissent aussi avec les rôles. Il se peut que tout cela soit utile, comme ayant pour effet de maintenir vifs certains sentiments qui profitent à la société ; mais c'est un sujet dont il n'y a pas lieu de nous occuper ici (§2140) ; nous avons seulement voulu rappeler que nous recherchons ici exclusivement comment varient certains résidus, et l'on ne doit donc pas attribuer à nos observations plus de portée qu'elles n'en ont dans ce sujet restreint, et entendre, même implicitement, que, au point de vue de l'utilité sociale, elles condamnent ou approuvent les faits relevés. (§41) Il s'agissait uniquement de faire voir que les raisonnements dont on veut les recouvrir sont comme d'habitude du genre des dérivations.
§ 1714. Nous avons aujourd'hui, sous une forme différente, une nouvelle féodalité, qui reproduit en partie le fond de l'ancienne [FN: § 1714-1]. Aux temps de celle-ci, les seigneurs rassemblaient leurs vassaux pour faire la guerre et, s'ils remportaient la victoire, ils les récompensaient par le butin. Aujourd'hui, les politiciens, les chefs des syndicats, agissent de la même façon, et rassemblent leurs troupes pour les élections (§2265), pour accomplir des actes de violence contre leurs adversaires et gagner de cette façon des avantages dont jouit ensuite le camp victorieux. Autrefois, les vassaux qui refusaient de suivre leurs seigneurs à la guerre étaient punis, de même que le sont aujourd'hui les kroumirs, les jaunes, les brebis noires des Anglais, les renards des Français, lorsqu'ils refusent de prendre part à une guerre industrielle. Le sentiment que provoque la « trahison » de ces insoumis, chez les troupes fidèles, est précisément le même que celui éprouvé par les hommes du moyen âge pour la félonie du vassal. Les privilèges dont les nobles jouissaient en ce temps ont leurs correspondants dans les privilèges judiciaires, fiscaux [FN: § 1714-2] et autres dont jouissent maintenant les députés et, dans une mesure restreinte mais non négligeable, leurs électeurs aussi, s'ils sont du côté du gouvernement.
§ 1715. Autrefois, le besoin d'uniformité se manifestait en certaines choses ; aujourd'hui, il se manifeste en d'autres, mais il est cependant toujours le même. Le besoin d'uniformité à l'égard de la religion chrétienne a diminué et a même presque disparu en certains pays, tandis que le besoin des uniformités économiques, sociales, humanitaires, croissait et devenait prédominant. Les hommes du moyen-âge voulaient l'unité religieuse et admettaient les statuts personnels et différents régimes pour les diverses communes ou provinces d'un même état ; les hommes modernes laissent pleine liberté de différences religieuses, mais veulent, au moins en paroles, l'uniformité des statuts des personnes, des communes, des provinces. Il était défendu à l'ancien Athénien d'introduire de nouveaux dieux dans la cité ; mais il lui était permis, à part certaines prescriptions religieuses, de travailler quand et comment il lui plaisait. Aujourd'hui, en beaucoup de pays, la loi ne se soucie plus des dieux nouveaux, mais fixe rigoureusement les jours et les heures auxquels il est permis de travailler. L'ancien Romain devait respecter le culte officiel, mais pouvait boire du vin ; aujourd'hui, en plusieurs pays, le culte officiel n'existe plus, ou bien est peu protégé, mais ou interdit de boire du vin. Les inquisiteurs de la foi catholique recherchaient avec diligence les offenses à leur sainte religion ; nos abstinents et nos dominicains de la vertu recherchent avec non moins de diligence les offenses à la sainte religion de l'abstinence du vin et des femmes ; et si les effets de ces inquisitions sont différents, c'est d'abord que les temps se sont faits plus doux pour la répression de tous les délits, et que, si le désir ne manque pas aux inquisiteurs modernes, le pouvoir leur fait défaut, au moins en partie [FN: § 1715-1]. D'autre part, la police est aujourd'hui mieux faite ; aussi l'oppression a-t-elle gagné en extension ce qu'elle a perdu en intensité, et la somme des souffrances infligées de cette façon aux hommes demeure assez grande.
Selon le processus ondulatoire des phénomènes sociaux, que nous avons noté tant de fois déjà, on observe maintenant (année 1913) un retour à l'état psychique qui existait en France, quand on y faisait le procès de Madame Bovary et d'autres livres « immoraux ». En Italie, des procès de ce genre n'ont pas fait défaut de nos jours. En France, les critiques que l'on adresse maintenant à des productions littéraires estimées « immorales » rappellent, bien que dans une moindre mesure, celles qu'on adressa à La Dame aux Camélias [FN: § 1715-2]. En Angleterre, un évêque se met à critiquer les chansons de Gaby Desly, et veut qu'on interdise au public de les entendre. Au fond, c'est toujours le même sentiment d'individus qui veulent imposer à autrui par la force leur propre « morale ». Parmi ceux-là, il est beaucoup d'hypocrites, mais il y a aussi des personnes de bonne foi. L'état d'esprit de celles-ci paraît être le suivant. Elles ont en elles certaines persistances d'agrégats, si vives et puissantes qu'elles dominent entièrement leur esprit. C'est à ce phénomène qu'on donne le nom de foi. L'objet de cette dernière peut être divers ; indiquons-le d'une manière générale par A. La personne qui a cette foi attribue à A une valeur absolue, repousse de son esprit tout doute, toute considération d'opportunité, toute intromission d'autres faits entrant en ligne de compte [FN: § 1715-3]. Contraindre autrui à avoir la même foi en A, ou du moins à agir comme s'il l'avait, revient en somme à obliger les gens à faire leur propre bien et celui d'autrui ; c'est simplement une manière de donner une forme concrète au bien absolu ; Compelle intrare. En ce qui concerne le fond des phénomènes, il importe peu que A soit la foi d'Anytos et de Mélètos, ou celle de Saint-Augustin, ou celle de Torquemada, ou celle de M. Béranger, de gens cultivés, ou d'imbéciles, d'hommes d'État, ou de littérateurs, d'un grand nombre de gens, ou d'un petit nombre : il n'y a de variable que les dérivations par lesquelles on veut faire apparaître les conclusions de la foi comme des démonstrations d'une « science », laquelle n'est qu'une pure ignorance. On remarquera que le mouvement oscillatoire se produit autour d'une ligne qui indique qu'en moyenne, de nos jours, le phénomène diminue d'intensité. Nous ne sommes plus aux temps où l'on condamnait à boire la ciguë ou au bûcher les dissidents. Nos « moralistes » et nos dominicains de la vertu doivent se contenter d'infliger de moindres peines.
§ 1716. [Note ajoutée à l’édition française par l’auteur : [FN: § 1716-1a]] Si l'on compare le seigneur féodal à l'homme riche notre contemporain, on peut dire que le sentiment d'intégrité de l'individu a beaucoup diminué. Mais si l'on étend la comparaison à toutes les classes sociales, on verra bientôt que, par compensation, ce sentiment s'est grandement accrû dans les classes populaires. Celles-ci n'eurent jamais un sentiment de leur dignité tel qu'elles le possèdent aujourd'hui, pas même chez les démocraties latines et grecques, surtout si l'on y tient compte des esclaves et des affranchis. De même la protection des sentiments d'intégrité du délinquant a aujourd'hui atteint une intensité beaucoup plus grande que jamais, dans nos contrées. Pour employer la phraséologie vulgaire, nous dirons que, dans la répression des délits, on sacrifiait l’« individu » à la « société » dans les siècles passés, et que maintenant on sacrifie la « société » à l'« individu ». Alors on ne craignait pas beaucoup de frapper l'innocent, pourvu que le coupable ne pût échapper ; aujourd'hui, on ne regarde pas de si près à épargner le coupable, non seulement pour sauver l'innocent, mais encore pour satisfaire les sentiments humanitaires [FN: § 1716-1]. On voit les mêmes personnes invoquer le « droit de la société » contre l'« individu », pour dépouiller autrui de ses biens, et le « droit de l'individu » contre la « société », pour protéger le délinquant. C'est là l'un des si nombreux cas dans lesquels un même individu peut employer en même temps des dérivations contradictoires. Nous ne devons pas nous y arrêter, et il nous faut rechercher les sentiments auxquels ils servent de voile. Ici, ils sont manifestes : ce sont simplement les sentiments favorables à une certaine classe de personnes qui désirent s'emparer du bien d'autrui et commettre impunément des délits. Parfois il n'y a qu'une différence de forme. Pierre, qui appartient à la classe nombreuse des pauvres, veut s'approprier un objet qui est la propriété de Paul, lequel appartient à la classe restreinte des riches. Il peut exécuter l'opération de deux façons [FN: § 1716-2] : 1° se faire attribuer par la loi la possession de cet objet ; dans ce but il lui convient d'invoquer le droit des plus nombreux en regard des moins nombreux, ce qu'il exprime en parlant du droit de la « société » à l'égard de l'« individu » ; 2° s'emparer directement de l'objet. Mais, en ce cas, Pierre n'appartient plus à la classe la plus nombreuse de la société, mais bien à la plus restreinte. La dérivation précédente ne peut donc être employée comme avant : on peut identifier à la « société » la partie pauvre de celle-ci ; on ne peut pas, quelque grands que soient l'ignorance et le manque de bon sens avec lesquels certaines dérivations sont acceptées, identifier à la « société » la respectable classe des délinquants ; il faut donc trouver une autre dérivation qui permette d'atteindre le but. On la trouve facilement en parlant alors des « droits » de l'individu délinquant contre la société [FN: § 1716-3]. Dans le premier cas, si un innocent est frappé, on dit : « C'est un malheur, mais le bien de la société l'emporte sur tout ». Si, dans le second cas, un innocent est frappé, on dit : « On ne peut tolérer cela en aucune façon ; périsse la société, plutôt que l'innocent ». Quiconque que veut avoir des exemples pratiques de ces deux manières de raisonner, employées, bien que contradictoires, par les mêmes personnes, n'a qu'à lire les écrits humanitaires et socialistes, en France, au temps de « l'affaire Dreyfus » [FN: § 1716-4].
Nous avons trouvé les sentiments dont partent les dérivations ; mais nous ne devons pas nous en tenir là : il convient que nous voyions encore pourquoi on emploie ces dérivations et non d'autres. Ce n'est évidemment pas pour le plaisir d'employer des dérivations contradictoires qu'on fait usage des deux que nous venons de citer ; il doit y avoir quelque motif ; ce motif ne peut être que d'agir sur les sentiments de celui qui écoute la dérivation. Il est vrai qu'elle manifeste certains sentiments, mais elle a aussi pour but d'agir sur certains autres. Ici, il n'y a pas de doute quant aux sentiments sur lesquels on veut agir. Pour la première dérivation, ce sont ceux qui correspondent aux intérêts de la partie pauvre de la population, et dans ceux-là déjà, il y a une notable proportion de sentiments d'intégrité individuelle. Pour la seconde dérivation, il peut y avoir, chez certains politiciens, le désir d'obtenir la faveur de quelques délinquants [FN: § 1716-5] qui sont d'excellents agents électoraux, ou bien de gagner la faveur des parents et des amis de ces délinquants ; mais c'est là la partie la moins importante du phénomène, et si l'on use de cette dérivation, il est évident qu'elle correspond aux sentiments d'un grand nombre de personnes. Ces sentiments sont surtout ceux de l'intégrité personnelle, qu'on ne veut pas permettre d'offusquer, même chez le délinquant. On observera en outre que jamais, en aucun temps de l'histoire, il ne fut permis aux délinquants, ou pour mieux dire à certains d'entre eux, d'être insolents à l'égard des magistrats, comme ils le sont aujourd'hui. Il est des procès aux assises où les rôles du président qui interroge et de l'accusé qui répond semblent intervertis [FN: § 1716-6]. Tout cela est encore confirmé par la très grande répugnance que l'on a aujourd'hui pour les peines corporelles, qui ne sont rejetées que parce qu'elles attentent à la « dignité humaine » ou, en d'autres termes, parce qu'elles sont parmi les plus grandes offenses à l'intégrité individuelle.
En conclusion donc, si nous regardons au fond et non aux dérivations qui le recouvrent, nous voyons que, à notre époque, les résidus de la Ve classe (intégrité personnelle) ont plutôt augmenté que diminué, en comparaison des résidus de la IVe classe (sociabilité).
§ 1717. Les résidus de la VIe classe (résidus sexuels) sont peut-être les moins variables. Les voiles dont on les recouvre se transforment, l'hypocrisie qu'ils provoquent change, mais, dans le fond, on ne perçoit pas qu'ils subissent des changements importants (§1379 et sv.).
§ 1718. En somme, pour une société donnée, on peut fixer l'échelle suivante des variations, qui croissent de la première à la dernière catégorie : 1° les classes des résidus ; 2° les genres de ces classes ; 3° les dérivations. Une figure fera mieux comprendre les rapports entre les classes et les genres de résidus. Le mouvement, dans le temps, d'une classe de résidus, peut, par exemple, être représenté par la courbe ondulée MNP. Certains genres sont représentés par les courbes, ondulées elles aussi, mnpq, rsvt. Les ondulations sont plus petites pour la classe que pour beaucoup de genres. Le mouvement moyen de la classe, qui, par exemple, va en augmentant, est représenté par AB ; et pour les genres dont une partie va en augmentant, une partie en diminuant, par ab, xy. La variation représentée par AB est beaucoup moins grande que celle de plusieurs genres ab, xy. Dans l'ensemble, il y a une certaine compensation entre ceux-ci, et c'est ainsi que s'atténue, pour la classe, tant la variation représentée par AB que l'ampleur des ondes de la courbe MNP.

Figure 24
Pour les phénomènes sociaux, en général, l'étude de ce mouvement oscillatoire présente des difficultés, qui peuvent être graves, lorsqu'on veut se rendre compte de la façon dont le phénomène se produit, abstraction faite de variations occasionnelles, temporaires, accessoires. Par exemple, celui qui comparerait la position r à la position s, pour en déduire le mouvement général du phénomène, conclurait que ce mouvement va en augmentant d'intensité, tandis qu'au contraire, la ligne xy montre qu'en moyenne et en général, il va en diminuant d'intensité. De même, celui qui comparerait la position s à la position v, trouverait que le phénomène va en diminuant d'intensité beaucoup plus vite que cela n'a lieu en réalité, en moyenne, en général, comme le fait voir la ligne xy[FN: § 1718-1]. Lorsqu'on peut mesurer le phénomène, et que l'on a des observations pour un temps assez long, il n'est pas très difficile de remédier à cet inconvénient. Par l'interpolation, on peut déterminer la ligne xy, autour de laquelle oscille le phénomène, et en connaître, par conséquent, le mouvement moyen, général [FN: § 1718-2]. Cela est beaucoup plus difficile, quand on ne peut avoir, ou que l'on n'a effectivement pas de mesures précises du phénomène ; ce qui nous oblige à substituer aux déterminations rigoureuses des mathématiques une estimation où l'arbitraire, le sentiment individuel, et peut-être aussi la fantaisie, ont une part plus ou moins grande. C'est pourquoi, il faut subordonner ces estimations à une critique sévère, et ne négliger aucune vérification possible.
§ 1719. Entre les diverses classes de résidus, il se produit peu ou point de compensation. Il semblerait, à première vue, qu'il y ait cette compensation entre les résidus de la VIe classe et des résidus religieux d'autres classes ; et l'on verrait même en cela le motif pour lequel un grand nombre de religions font la guerre à la religion sexuelle, s'efforçant de s'enrichir de ses dépouilles. Mais en étudiant les faits de plus près, on découvre que la controverse porte sur les dérivations et non sur les résidus. Les autres religions ne détruisent pas les résidus de la religion sexuelle : elles se les approprient, en ne changeant que la forme sous laquelle ils s'expriment. Nous avons vu cela longuement, au chapitre X.
§ 1719 bis. À propos du peu de changement qu'apporte le temps aux résidus, une observation se présente, analogue à celles que nous avons déjà faites au sujet des actions non-logiques (§252), et en d'autres occasions semblables. Si vraiment les changements des résidus sont fort lents, comment ce fait a-t-il pu échapper aux nombreux auteurs de talent qui ont étudié les caractères des sociétés humaines ? Il ne leur a nullement échappé ; seulement ils l’ont exprimé, ainsi que c'est l'habitude dans les commencements de toute science, d'une manière vague, et sans viser en aucune sorte à la rigueur scientifique.
Dans le dicton : nil novi sub sole, et dans d'autres analogues, il y a déjà, plus ou moins voilée par le sentiment [FB: § 1719 bis-1], la conception qu'une partie au moins des phénomènes sociaux demeure constante. Dans le pédantisme des grammairiens voulant imposer à leurs contemporains et aux générations futures l'usage exclusif des formes du langage qui ont servi aux générations passées, il y a, comme prémisse implicite, l'idée que les sentiments n'ont pas changé, ne changeront pas, au point que de nouvelles formes de langage soient nécessaires pour les exprimer. La vie du langage nous donne une image de la vie des autres phénomènes sociaux. Le fond de la langue change, mais fort lentement ; des néologismes s'imposent, mais en petit nombre ; les formes grammaticales se modifient, mais la substance persiste pendant des siècles.
Une longue suite de littérateurs a imité les auteurs anciens ; des pédants ont même voulu prescrire cette imitation. Cela ne se comprendrait pas, si ces personnes et celles auxquelles s'adressaient leurs œuvres n'avaient pas eu des sentiments fort semblables à ceux qui sont exprimés par les anciens [FN: § 1719 bis-2]. D'ailleurs – abstraction faite de toute imitation – comment pourrions-nous encore goûter les poésies homériques, les élégies, les tragédies, les comédies grecques et les latines, si nous n'y trouvions pas exprimés des sentiments que nous partageons, du moins en grande partie ? Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, Plaute, Térence, Virgile, Horace, et une infinité d'autres auteurs de l'antiquité gréco-latine sont-ils, pour nous, des étrangers que nous ne comprenons plus ? Ne trouvons-nous pas chez Thucydide, Polybe, Tacite, et chez beaucoup d'autres historiens anciens, la description de phénomènes qui, sous une forme différente, parfois même très différente, nous révèlent un fond de sentiments humains identiques à ceux que nous observons actuellement ? Tout penseur qui a réfléchi et médité sur les phénomènes sociaux a fini, le plus souvent, par y reconnaître une partie variable et une autre partie, relativement fixe [FN: § 1719-bis-3]. Nous n'avons fait ici que donner une forme rigoureuse à cette conception ; comme le chimiste en découvrant l'alumine et le carbonate de chaux a donné une forme rigoureuse aux notions qui existaient bien avant lui, et grâce auxquelles les hommes distinguaient l'argile et la pierre à chaux.
§ 1720. Si, durant un certain temps, les classes des résidus changent peu ou pas, dans une même société, cela n'empêche nullement qu'elles puissent être très différentes dans des sociétés différentes. C'est un cas que nous avons étudié au chapitre II.
§ 1721. Afin de ne pas anticiper sur les présentes études, nous avons alors employé une terminologie différente de celle dont nous faisons maintenant usage. Au §172, nous disions: « Un état psychique très important est celui qui établit et maintient certains rapports entre des sensations ou des faits, par l'intermédiaire d'autres sensations P, Q, R... » Maintenant, nous dirons que le maintien de ces rapports est une persistance d'agrégats. Nous avons fait une longue étude de ces phénomènes au chap. VI. Au §174, nous parlions d'une force X qui unit les sensations P, Q, R… ; maintenant, nous dirons que cette force est celle qui maintient les agrégats, qu'elle mesure l'intensité de la persistance des agrégats. La force Y, (§174), qui pousse à innover, correspond aux résidus de la Ie classe (instinct des combinaisons).
L'étude accomplie, au chapitre II, des différences entre les sociétés de Sparte, d'Athènes, de Rome, de l'Angleterre, de la France, n'est autre chose qu'une étude des différences que l'on observe, dans ces sociétés, entre l'intensité des sentiments correspondant aux résidus de la Ie classe, et l'intensité des sentiments correspondant aux résidus de la IIe classe. Il est remarquable que les mêmes conclusions auxquelles nous aboutissons maintenant, avec la théorie des résidus, nous aient été alors imposées directement par l'étude des faits, indépendamment de toute théorie générale quelconque.
§ 1722. Maintenant que nous avons une théorie générale, nous pouvons nous occuper de nouveau du sujet traité déjà directement, et exprimer les conclusions sous une forme plus générale. Par exemple, au chapitre II, nous écrivions (§174) : « Supposons que chez deux peuples Y soit identique et X différent. Pour innover, le peuple chez lequel X est faible fait table rase des rapports P, Q, R,... et leur en substitue d'autres ; le peuple chez lequel X est intense laisse subsister autant que possible ces rapports, et modifie la signification de P, Q, R,... ». Nous dirons maintenant : « Supposons que chez deux peuples les résidus de la Ie classe (instinct des combinaisons) soient d'égale force, et les résidus de la IIe classe (persistance des agrégats) de force inégale. Pour innover, le peuple chez lequel les résidus de la IIe classe sont le moins forts fait table rase du fond et des noms des agrégats P, Q, R,… , et y substitue d'autres agrégats et d'autres noms ; le peuple chez lequel les résidus de la IIe classe sont le plus forts change bien le fond des agrégats P, Q, R,..., mais laisse subsister autant que possible les noms, en se servant pour cela de modifications opportunes des dérivations, par lesquelles il justifie, fût-ce en usant de sophismes, le fait de donner un nom identique à des choses différentes ». Ajoutons que cela a lieu justement parce qu'en général les dérivations varient beaucoup plus facilement que les résidus, et que, comme toujours, le mouvement se produit selon le point de moindre résistance.
Les proportions des diverses classes de résidus, chez les différents peuples, sont peut-être les meilleurs indices de leur état social.
§ 1723. RÉPARTITION ET CHANGEMENT DES RÉSIDUS DANS LES DIVERSES
COUCHES D'UNE SOCIÉTÉ. Les résidus ne sont pas répandus également ni également puissants, dans les diverses couches d'une même société. Le phénomène est commun et connu en tout temps. On a souvent relevé la superstition et la néophobie des classes inférieures de la société, et il est bien connu qu'elles furent les dernières à conserver la foi en la religion qui leur doit précisément son nom de paganisme. Chez elles, les résidus des IIe et IIIe classes sont plus répandus et plus puissants ; tandis que c'est au contraire souvent l'inverse pour les résidus de la Ve classe (intégrité de l'individu).
§ 1724. Diviser la société en deux couches, dont l'une est appelée inférieure, l'autre supérieure, nous rapproche un peu plus de la réalité, que considérer la société comme homogène ; toutefois, nous sommes encore loin du fait concret et de la réalité. Si nous voulons nous en rapprocher davantage, il faut diviser la société en un plus grand nombre de classes, et en constituer autant qu'il y a, en gros, de caractères différents des hommes ; mais pour ne pas dévier de l'étude que nous avons en vue, nous devons remettre à plus tard cette recherche (§2025 et sv.).
§ 1725. RAPPORTS ENTRE LES RÉSIDUS ET LES CONDITIONS DE LA VIE. On
peut tirer des diverses occupations des hommes d'utiles divisions des résidus. Ces divisions même furent connues depuis les temps les plus reculés ; mais presque toujours, les auteurs qui en traitent mêlent, comme d'habitude, deux choses bien différentes : 1° le fait simple de la différence des résidus, suivant la différence des occupations, du genre de vie; 2° une appréciation de la valeur éthique, politique, sociale, etc. des divers résidus. Souvent même, la première chose apparaît seulement comme une conséquence indirecte de la seconde.
§ 1726. Par exemple, lorsque Caton [FN: § 1726-1], louant les agriculteurs, dit : « Les agriculteurs donnent des hommes très vigoureux et des soldats très courageux, qui réalisent des gains très honorés et non pas odieux ; et ceux qui s'occupent d'agriculture ne roulent pas de mauvaises pensées », il exprime indirectement l'opinion que, chez les agriculteurs, on trouve des résidus différents de ceux qu'on rencontre chez d'autres citoyens ; et la dernière phrase laisse entendre qu'ils sont moins portés à innover, c'est-à-dire que chez eux, les résidus de la IIe classe présentent une importance plus grande que chez d'autres hommes.
§ 1727. Beaucoup d'observations ont été faites en tout temps, au sujet des commerçants, des militaires, des magistrats, etc., et dans l'ensemble on admet que les sentiments varient suivant le genre d'occupation. De cette façon, la théorie dite du matérialisme économique pourrait se confondre avec la théorie des résidus, si l'on remarque que ceux-ci dépendent de l'état économique. Cela serait certainement vrai ; mais l'erreur consiste à vouloir séparer l'état économique, des autres phénomènes sociaux avec lesquels il est au contraire en rapport de dépendance mutuelle, et en outre à substituer un unique rapport de cause à effet aux nombreux rapports analogues qui s'entrelacent.
§ 1728. Nous pouvons rapprocher de ces observations celles qui ont été faites à propos de l'influence qu'ont sur le caractère des hommes les conditions du sol, du climat, etc. Hippocrate en parle longuement dans son traité Des airs, des eaux et des lieux. Les rapports qu'il établit entre les conditions de la vie des hommes et leur caractère sont probablement erronés ; mais le fait subsiste de ces différences de caractère, indépendantes de la volonté, des raisonnements, du progrès des connaissances. Il explique la différence de caractère des Européens et des Asiatiques par les différences du sol et du climat, auxquelles il ajoute les différences des institutions ; et non content d'avoir mentionné les différences générales, il en parle aussi à l'égard de chaque peuple. À vrai dire, peu ou point d'auteurs nient les différences de caractère des divers peuples ; ils diffèrent sur les causes, mais non sur l'existence du fait. Singulière est la conception de l'empereur Julien, qui veut que la diversité de caractère des différents peuples provienne des divers êtres divins préposés à les gouverner. Pourtant, à ces êtres, il ajoute ensuite l'air et la terre [FN: § 1728-1].
§ 1729. Sans s'apercevoir de la contradiction avec sa théorie, qui donne une très grande importance aux actions logiques (§354 et sv.), Buckle fait des observations analogues à celles d'Hippocrate, sur l'influence que le climat et le sol, auxquels il ajoute l'alimentation qui en dépend, ont sur le caractère des hommes, sur leurs mœurs, sur leur civilisation. Ici encore, il faut remarquer que les rapports trouvés par Buckle sont peut-être en partie vrais et en partie erronés ; mais, quoi qu'il en soit, il n'en subsiste pas moins le fait d'une détermination des actions humaines par les résidus, et non par les dérivations ; et l'on voit varier ces actions avec les résidus. L'auteur sait aussi d'où proviennent ces résidus. Nous nous arrêtons sur cette voie, et laissons de nouvelles études prononcer sur ce sujet.
§ 1730. À ce propos, on pourrait citer un grand nombre d'autres auteurs ; il suffira de rappeler ici Demolins, qui croit avoir démontré que la civilisation d'un peuple est déterminée par les voies qu'il a suivies dans ses migrations. Les livres de cet auteur se lisent avec plaisir et intérêt : ils attirent comme le chant des Sirènes. Ses raisonnements paraissent excellents et très concluants ; cependant, parvenu au terme, on se demande : « Mais est-il bien vrai que la voie de migration, souvent hypothétique, ait une si grande vertu pour déterminer chaque caractère d'un peuple, sans l'intervention d'autres facteurs ? » Et alors, on s'aperçoit que la force du raisonnement dépend plus du talent de l'auteur que de la puissance des faits et de la logique, et l'on met un point d'interrogation là où il y avait précédemment un simple point. Là aussi, nous laissons à d'autres études le soin de déterminer l'influence de la voie de migration sur les caractères de la civilisation. Nous nous contentons, pour le moment, du fait que ces caractères, au moins en partie, ne dépendent pas du raisonnement, de la logique des hommes, de la connaissance d'une certaine morale, d'une certaine religion, etc. ; c'est-à-dire, pour répéter ce que nous avons observé souvent déjà, qu'ils dépendent beaucoup plus des résidus que des dérivations, sans pourtant exclure que les dérivations puissent agir aussi, dans une mesure secondaire.
§ 1731. Les théories relevées tout à l'heure sont des tentatives d'expliquer les phénomènes sociaux par des rapports de cause à effet ; elles sont semblables à celles qu'on eut en économie politique, antérieurement à la synthèse de l'économie pure. Elles ne sont pas entièrement fausses : elles contiennent une part, parfois peut-être importante, qui concorde avec l'expérience ; mais elles en contiennent aussi une qui s'en écarte entièrement. Cela surtout parce que l'on néglige la mutuelle dépendance des phénomènes de deux façons : 1° là où l'on ne voit qu'une seule « cause », il y en a un très grand nombre ; 2° même si, par abstraction, on en considère une seule, et qu'on la mette en rapport de cause à effet avec d'autres phénomènes, on s'éloigne encore de la réalité, en ce que cette « cause » supposée a, avec ses effets, des rapports de mutuelle dépendance, qui donnent naissance à une suite d'actions et de réactions.
Il faut d'ailleurs faire attention que les phénomènes sociaux, ainsi que les phénomènes économiques, ayant généralement une forme ondulée, nous devons avant toute chose être fixés sur les ondulations dont nous cherchons les rapports. Supposons deux phénomènes avec des indices mesurables, que nous prendrons pour les ordonnées de deux courbes (§1718-2), et cherchons les rapports qu'il peut y avoir entre ces deux phénomènes. Si l'on veut tenir compte des moindres oscillations, c'est un problème entièrement insoluble, tandis qu'on peut en avoir une solution au moins grossièrement approchée, si l'on se résigne à ne considérer que les oscillations les plus notables, ou bien la marche générale des phénomènes. Cette marche générale peut être déterminée de deux manières. La première, fort imparfaite expérimentalement, consiste à substituer aux phénomènes concrets des entités abstraites que l'on suppose représenter plus ou moins bien ces phénomènes. C'est ainsi que l'on dira que la hauteur des marées dépend de l'attraction du soleil et de la lune. Cette hauteur n'existe pas ; il y a une infinité de hauteurs, selon les points que l'on considère. De même quand on dit que le change des monnaies d'un pays dépend de l'état des dettes et des créances de ce pays avec l'étranger, on met en rapport deux entités abstraites, qui n'ont pas d'existence concrète. Il n'y a pas un change, il y a une infinité de changes, parfois même un change différent à chaque contrat réel. Il n'y a pas un état des dettes et des créances ; il y a une infinité de dettes et de créances, et chaque moment en voit naître et disparaître quelques-unes. Les économistes disent que sur un même marché il ne saurait exister, en même temps, des prix différents, pour la même marchandise. Ce sont là des abstractions qui parfois se rapprochent de la réalité, parfois s'en écartent et peuvent ne la représenter que fort imparfaitement. De même l'offre et la demande d'une marchandise sur un marché donné sont encore des abstractions. D'ailleurs on peut, en général, répéter la même chose pour toutes les entités que considère l'économie politique. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir ; les personnes qui s'occupent de ces entités font des interpolations (§1694) sans s'en apercevoir. Mais il vaut toujours mieux n'agir qu'à bon escient, et cette remarque nous conduit à nous occuper de la seconde manière d'étudier la marche des phénomènes. Cette manière consiste à tracer les courbes qui représentent les phénomènes, à interpoler ces courbes, et à rechercher les rapports qui existent entre les courbes interpolatrices (§1718-2).
Mais ici il faut se garder d'une nouvelle erreur que l'on fait facilement de nos jours. La seconde manière de considérer les phénomènes ne doit pas nous faire négliger la première, car toutes deux peuvent concourir à augmenter la somme de nos connaissances. Parce que le phénomène décrit par l'arpentage est plus concret que celui décrit par la topographie, lequel à son tour est plus concret que celui dont s'occupe la géodésie, nous ne devons pas négliger, abolir la géodésie, pour y substituer la topographie, qui devrait à son tour céder la place à l'arpentage. Parce que la théorie empirique des marées nous rapproche plus du concret que la pure théorie astronomique, nous ne devons pas jeter celle-ci par dessus bord [FN: § 1731-1]. Parce que nous étudions empiriquement les ondulations des phénomènes économiques, nous ne devons pas négliger pour cela l'Économie abstraite.
Il est un fait très remarquable, et c'est que chacune des manières que nous venons de mentionner peut utilement se développer autant dans le sens abstrait que dans le sens concret. Lorsque la théorie des marées de Newton devient celle de Laplace, elle se développe dans le sens abstrait ; lorsque les observations empiriques de la hauteur des marées dans les différents ports devient la théorie de Thomson et de G.-H. Darwin, la théorie des marées se développe dans le sens concret. Lorsque, à l'ancienne économie, s'ajoute le chapitre de l'économie mathématique, la science se développe dans le sens abstrait ; lorsque l'on considère les ondulations des phénomènes économiques et des phénomènes sociaux (§2292-1), ainsi que nous le faisons maintenant, la science se développe dans le sens concret [FN: § 1731-2]. C'est ce que n'arrivent pas à comprendre prendre les très nombreuses personnes qui, ayant le jugement faussé par les préjugés ou l'ignorance, n'ont aucune idée de la nature logico-expérimentale des sciences sociales et des sciences économiques. Parfois leurs élucubrations font songer à un individu qui chercherait des recettes de cuisine dans un traité de mathématique, ou des théorèmes de géométrie dans un livre de cuisine [FN: § 1731-3].
§ 1732. Il faut donc prendre garde de ne pas tomber en des erreurs analogues, et pour cela, nous devrons avoir toujours présent à l'esprit que, lorsque nous parlons, par exemple, de l'action des résidus sur les autres facteurs sociaux, nous ne nous attachons qu'à une partie du phénomène, et qu'il en est une autre, laquelle consiste non seulement en l'action de tous ces faits sur les résidus, mais aussi dans les actions mutuelles de tous ces phénomènes (2203 et sv.).
On peut distinguer différents procédés de traiter des phénomènes mutuellement dépendants : (1) on considère uniquement des rapports de cause à effet, et l'on néglige entièrement cette mutuelle dépendance. (2) Au contraire, on en tient compte. (2a) On considère encore des rapports de cause à effet, mais on s'efforce de tenir compte de la mutuelle dépendance, en faisant attention aux actions et aux réactions, et par d'autres moyens. (2b) On raisonne directement dans l'hypothèse de la mutuelle dépendance [FN: § 1732-1] (§ 2091 et Sv.). Le meilleur procédé est évidemment (2b), mais on ne peut malheureusement l'employer qu'en un très petit nombre de cas, à cause des conditions qu'il exige. En effet, il impose l'emploi de la logique mathématique, qui seule peut tenir compte de la mutuelle dépendance dans toute son étendue. Par conséquent, il ne s'applique qu'aux phénomènes mesurables. Il demeure exclu d'un très grand nombre d'autres, parmi lesquels presque tous ceux de la sociologie. Ensuite, même pour les phénomènes que l'on peut mesurer, de graves difficultés surgissent, sitôt que le phénomène est un peu compliqué. On en a un exemple remarquable dans la mécanique céleste, qui rencontre encore des difficultés insurmontables pour déterminer les mouvements d'un grand nombre de corps de masses presque égales, lorsqu'elle ne peut plus considérer une partie des dépendances mutuelles comme des perturbations. L'économie pure arrive à poser les équations de certains phénomènes, mais non à résoudre ces équations, au moins en général [FN: § 1732-2]. Par conséquent, dans les sciences économiques et sociales, le procédé (2b) demeure un but idéal que l'on n'atteint presque jamais en réalité [FN: § 1732-3]. Dirons-nous nous pour cela que ce procédé est inutile ? Non, parce que nous en tirons notamment deux grands avantages. 1° Il donne à notre esprit une image des phénomènes, image que nous ne pourrions obtenir d'aucune autre façon. Assurément la surface de la terre n'a pas la forme d'une sphère géométrique, et pourtant le fait de considérer cette forme sert à nous donner une idée de ce qu'est la terre. 2° Il nous indique la voie que nous devons suivre pour éviter les erreurs du procédé (1), et pour nous rapprocher de la réalité. Même un signal qu'il est impossible d'atteindre peut servir à indiquer un chemin. Nous pouvons, par analogie, transporter en sociologie les résultats que nous donne l'économie mathématique, laquelle nous fournit ainsi des notions que nous ne pourrions obtenir d'une autre manière, et que nous éprouverons ensuite avec l'expérience, pour décider si nous devons les accepter on les rejeter. 3° Enfin, la notion, même imparfaite, de la mutuelle dépendance, nous engage à adopter le procédé (2a) qui, grâce à l'emploi des rapports de cause à effet (§2092), permet d'obtenir des résultats au moins semblables à ceux que l'on obtiendrait avec le procédé (2b), et d'éviter les erreurs du procédé (1), lequel est le plus imparfait et le plus erroné de tous [FN: § 1732-4]. En l'état présent de nos connaissances, l'utilité du procédé (2b) est donc moins directe qu'indirecte ; il nous éclaire, nous guide et nous fait éviter les erreurs du procédé (1) ; ainsi, il nous rapproche beaucoup plus de la réalité [FN: § 1732-5]. Ce n'est pas ici le lieu de nous arrêter à étudier les détails du procédé (2a). Nous en traiterons longuement plus loin (§2091 et sv.). Notons seulement, car cette considération nous sera nécessaire, que ce procédé (2a) devient facile, lorsqu'on a un phénomène principal qui prend la forme d'un rapport de cause à effet, précisément ou approximativement, et d'autres phénomènes, accessoires, secondaires, de moindre importance, par lesquels se manifeste la mutuelle dépendance. Quand nous pouvons réduire à ce type, qui est celui de la mécanique céleste, les phénomènes que nous voulons étudier, nous sommes sur une bonne voie pour en acquérir la connaissance.
Visant précisément à ce but, nous avons vu que les résidus étaient beaucoup plus constants que les dérivations ; c'est pourquoi nous avons pu considérer qu'ils étaient en partie la « cause » des dérivations, mais sans oublier l'action secondaire des dérivations, qui peuvent être parfois la « cause » des résidus, ne fût-ce que d'une manière subordonnée. Nous voyons maintenant que dans les différentes classes sociales, il y a divers résidus ; mais, pour le moment, nous n'entendons nullement établir si c'est le fait de vivre dans une certaine classe qui produit certains résidus chez les individus, ou bien si c'est l'existence de ces résidus chez ces individus qui les pousse dans cette classe, ou mieux encore si les deux effets se manifestent simultanément. Nous parlerons de tout cela dans le prochain chapitre ; bornons-nous maintenant à décrire les uniformités qui apparaissent dans la distribution des résidus chez les diverses classes sociales.
§ 1733. Un grand nombre de faits nous sont connus à ce sujet, bien que manquant d'une grande précision, et souvent recouverts par des voiles littéraires et métaphysiques ; cependant, nous pouvons en déduire avec une certaine probabilité que dans les diverses couches sociales, l'échelle de variabilité croissante mentionnée au §1718 peut subsister, soit : 1° les classes des résidus ; 2° les genres de ces classes ; 3° les dérivations. Mais la variabilité est plus grande pour les couches sociales que pour la société entière, car, pour celle-ci, il se produit des compensations entre les diverses couches. En outre, il y a des catégories sociales composées d'un petit nombre d'individus pour lesquels les variations peuvent être grandes et soudaines, tandis qu'elles sont petites et lentes pour le plus grand nombre des citoyens. De même que les classes supérieures changent plus facilement la façon de s'habiller, elles changent aussi plus facilement leurs sentiments, et plus encore leurs façons de les exprimer. Les changements de mode, dans les diverses manifestations de l'activité humaine, se suivent de beaucoup plus près dans les classes riches ou élevées que dans les classes pauvres ou basses. Il y a aussi plusieurs changements qui demeurent dans les limites des premières et ne s'étendent pas aux secondes, très souvent parce qu'elles disparaissent des classes supérieures, avant d'être parvenues aux classes inférieures.
§ 1734. Malheureusement, l'histoire et la littérature nous font mieux connaître l'état d'âme, les sentiments, les mœurs du petit nombre d'individus qui font partie des couches supérieures, que ceux du nombre beaucoup plus grand d'individus qui font partie des couches inférieures. De là naissent des erreurs nombreuses et graves, car on est poussé à étendre à toute la population, ou au moins à une grande partie de la population, ce qui ne s'applique qu'à un nombre restreint, peut-être très restreint d'individus. Il s'y ajoute une autre erreur, qui provient du fait qu'on ne tient pas compte, chez les individus, des changements que la circulation des élites apporte dans les classes supérieures, et que l'on confond, par conséquent, des changements d'individus avec des changements de sentiments chez les mêmes individus. Par exemple, dans une classe X qui demeure fermée, les sentiments et leurs expressions peuvent changer ; mais si la classe X est ouverte, à ce changement s'en ajoute un autre, qui provient de ce que la composition de la classe se modifie. Ce changement dépend, à son tour, de la rapidité plus ou moins grande de la circulation.
§ 1735. ACTION RÉCIPROQUE DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS. Les résidus
peuvent agir : (a) sur d'autres résidus ; (b) sur les dérivations. De même, les dérivations peuvent agir : (c) sur les résidus ; (d) sur les dérivations. Ici, nous ne considérons ces effets qu'intrinsèquement, sans rechercher en quel rapport ils peuvent être avec l'utilité des individus ou de la société.
En général, de l'action des résidus sur les dérivations (b), nous n'avons plus rien à dire ici, puisque nous en avons déjà longuement parlé jusqu'à présent ; et nous avons fait voir que, contrairement à l'opinion générale, les résidus agissent puissamment sur les dérivations, et les dérivations faiblement sur les résidus. C'est pour arriver à cette démonstration que nous avons commencé notre étude par la considération des actions non-logiques. Il ne nous reste plus à parler que d'un cas spécial, qui est celui de certaines oscillations des dérivations, correspondant à des oscillations des résidus. Mais nous ne pouvons le faire ici, parce qu'il nous manque beaucoup de notions que nous acquerrons seulement au chapitre suivant. C'est pourquoi nous devons renvoyer à la fin du dit chapitre l'étude de ce sujet (§2329 et sv.). En attendant, nous étudierons les genres de rapports (a), (c), (d).
§ 1736. (a) ACTION DES RÉSIDUS SUR LES RÉSIDUS. Il convient de distinguer d'abord les résidus a, b, c... qui correspondent à un même ensemble P de sentiments, des résidus m, n, r, s qui correspondent à un autre ensemble Q de sentiments. Les résidus a, b, c, qui correspondent à un même ensemble P de sentiments, concordent ensemble, ne sont pas trop discordants, ne sont pas trop ouvertement contradictoires. Au contraire, il peut y avoir discordance et contradiction entre les résidus a, b, c... correspondant à l'en semble de sentiments P, et les résidus m, n, r,... correspondant à un autre ensemble Q. Puisque les résidus se manifestent à nous par les dérivations, nous aurons également des dérivations pas trop discordantes et des dérivations discordantes. D'autres dérivations discordantes proviennent de l'utilité d'agir sur diverses personnes possédant divers résidus (§1716).

Figure 26
§ 1737. RÉSIDUS DISCORDANTS ET LEURS DÉRIVATIONS. On observe souvent,
chez un même individu, des dérivations contradictoires, qui révèlent des résidus contradictoires, eux aussi, et l'individu, ou bien n'aperçoit pas la contradiction, ou bien s'efforce de la faire disparaître par des sophismes manifestes [FN: § 1737-1]. Nous en avons donné de nombreuses preuves, et nous en donnerons d'autres, parce qu'il importe beaucoup de mettre ce fait en lumière. Considérons différents groupes de résidus, et supposons que chacun de ces groupes corresponde à certains ensembles de sentiments. Nous verrons que l'action mutuelle de ces groupes, lorsqu'ils sont discordants, est généralement faible ou nulle pour tous, et se manifeste seulement chez les gens cultivés, par des tentatives sophistiques de concilier les dérivations nées de ces groupes, tandis que les gens incultes ne s'en soucient souvent même pas.
§ 1738. En général, exception faite des personnes qui ont l'habitude de faire de longs et subtils raisonnements, l'individu ne tâche pas de faire concorder ensemble les dérivations discordantes ; il se contente de les faire concorder avec ses sentiments, c'est-à-dire avec les résidus qui correspondent à ces sentiments. Cela suffit au plus grand nombre des hommes. Un plus petit nombre éprouvent un besoin de logique, de raisonnements pseudo-scientifiques,
qui les poussent à subtiliser sur l'accord des dérivations entre elles. Les théologiens, les métaphysiciens, ont toujours été en très petit nombre, comparés au reste de la population.
§ 1739. Les critiques littéraires et les critiques historiques recherchent souvent quelle était la pensée d'un auteur, d'un homme d'État. Cette recherche suppose qu'il existe une pensée unique. Cela est parfois vrai, mais beaucoup plus souvent faux. Si ces critiques s'examinaient eux-mêmes, ils trouveraient aisément des exemples de conceptions contradictoires, sans aller en chercher chez d'autres personnes. Celui qui est déterministe verrait que souvent il agit comme s'il ne l'était pas. Ces critiques ne manqueraient pas de trouver ensuite plusieurs préceptes de morale qu'ils interprètent à leur manière, et qui sont interprétés d'une manière différente par d'autres personnes. Il va sans dire que chacun trouve sa propre interprétation bonne et celle d'autrui mauvaise. Admettons ; mais cela confirme que ce sont des choses différentes ; et pour qui a une autre interprétation, il y a contradiction entre le précepte formel et la façon dont notre critique l'observe. Dans un moment où il est joyeux, un individu affirmera que celui qui observe les règles de la religion et de la morale est certain de vivre heureux. Dans un moment de tristesse, il s'écriera avec Brutus : « Vertu, tu n'es qu'un nom ! » Quelle est l'idée de cet individu ? Il en a deux, et il est également de bonne foi en les exprimant, bien qu'elles soient contradictoires. De semblables faits sont d'une grande importance pour déterminer les phénomènes sociaux. C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter de les affirmer simplement, mais nous devons en donner des preuves abondantes. Cela justifie la minutie de beaucoup de détails que nous avons cités et que nous citerons ; tandis qu'en l'absence de ce but, nous perdrions purement et simplement notre temps.
§ 1740. ACTION DES RÉSIDUS CORRESPONDANT À UN MÊME ENSEMBLE DE
SENTIMENTS. Elle peut se produire de trois façons, qui doivent être distinguées avec soin. Soit P, une disposition psychique correspondant à un ensemble de sentiments qui sont manifestés par les résidus a, b, c, d,... Ces sentiments peuvent être d'intensité diverse ; ce que nous exprimons elliptiquement en disant que les résidus sont d'intensité diverse (§1690).

Figure 27
§ 1741. 1° Si, pour un motif quelconque, l'état psychique, commune origine P des sentiments, augmente d'intensité, tous les résidus a, b, c,... augmenteront aussi d'intensité en devenant A, B, C... ; et vice versa, si P diminue d'intensité. Parmi les motifs pour lesquels P croît ou diminue d'intensité, il peut y avoir l'augmentation ou la diminution d'un groupe de résidus a, qui réagit sur P. En ce cas, l'augmentation ou la diminution de a fait croître ou diminuer tous les groupes b, c,... Pour une collectivité très nombreuse, cet effet est souvent lent et peu important, car, ainsi que nous l'avons vu, le total d'une classe de résidus varie lentement et peu. Pour un individu particulier il peut être plus rapide et plus fort. Tel est le cas cité (§1416) des personnes qui, aux Indes, se convertissent au christianisme, et qui perdent la moralité de l'ancienne religion sans acquérir celle de la nouvelle. C'est aussi ce qu'on a pu observer en Grèce pour les sophistes dégénérés, et en d'autres cas analogues. Chez eux, certains résidus a furent détruits, et par conséquent toute la catégorie b, c, d,... fut affaiblie.
§ 1742. 2° Nous avons un grand nombre de cas où l'on voit qu'un groupe de résidus peut augmenter au détriment d'autres groupes de la même classe. Par exemple, l'instinct des combinaisons, qui peut s'appliquer à divers genres de combinaisons. Il y a donc là une nouvelle répartition en a, b, c,.., sans que P varie.
Si nous réunissons les effets 1°, et 2°, nous aurons diverses combinaisons. Par exemple a augmente ; cela fait augmenter P, et par conséquent aussi b, c,... ; mais l'augmentation de a est obtenue en outre en prenant une partie de ce qui revenait à b, c,... En conséquence, il pourra y avoir un groupe b qui augmente parce que la partie que lui enlève a est plus petite que la partie qu'il gagne par l'augmentation de P ; un autre groupe c pourra diminuer, parce qu'on lui ôte plus que ce qu'il garde, etc.
§ 1743. 3° Il pourrait y avoir une action directe de a sur b, c,... sans passer par l'intermédiaire de P. Il est facile de confondre cette manière avec la première. On peut remarquer que, lorsque a est devenu A, on a vu b devenir B, c devenir C, etc. ; et, raisonnant en vertu du post hoc propter hoc, on peut croire que c'est le fait de a devenu A qui est la « cause » des changements de b en B, de c en C, etc. ; et l'on arrive ainsi à supposer un rapport direct entre a et b, c,...
§ 1744. L'observation vulgaire donne une forme spéciale à ce raisonnement, par la substitution habituelle des actions logiques aux actions non-logiques. On suppose que a a une origine logique P, et que, par conséquent, si l'on modifie a, en le faisant devenir A, on estime que l'origine logique est renforcée, et que, de ce fait, les changements de b en B, de c en C, etc., sont déterminés.
Par exemple, on dit : « Celui qui est religieux s'abstient de mal faire, parce qu'il sait que Dieu punit les mauvaises actions ; donc si nous faisons croître le sentiment religieux a, nous ferons croître aussi l'honnêteté b, les bonnes mœurs c, l'honorabilité d, etc. [FN: § 1744-1] ». Les faits ont démontré que ce raisonnement est erroné ; et nous connaissons maintenant les causes de l'erreur, lesquelles consistent à confondre les actions logiques avec les actions non-logiques. Le raisonnement deviendrait bon si à l'augmentation de a on substituait l'augmentation de P. Nous pouvons exprimer cela d'une manière assez imparfaite, mais qui a le mérite de donner une vive image du phénomène, en remarquant que les actes dont b, c, d,... tirent leur origine sont en partie semblables à ceux dont a tire la sienne ; et si nous les appelons tous religieux et religions les ensembles a, b, c, d,... nous pourrons observer qu'en faisant croître une de ces religions, on agit peu sur les autres, tandis qu'en faisant croître les sentiments de persistance des agrégats P, dont elles sont issues, on agit puissamment sur toutes. Habituellement, on croit le contraire, et l'on estime que faire croître une de ces religions est un moyen efficace d'accroître les autres. Nous traiterons de ce sujet plus loin (§1850 et sv.).
§ 1745. Mais le fait qu'une démonstration donnée de l'action d'un résidu sur les autres est erronée, n'empêche nullement qu'il puisse y avoir des cas où cette action existe réellement, et nous devons la rechercher directement dans les faits. Il n'est pas facile de la trouver, et souvent, quand on croit l'observer, il est possible aussi de l'interpréter comme une action selon le premier procédé ; on demeure donc dans le doute sur la conclusion à tirer. Mais il y a aussi des faits qui démontrent clairement l'indépendance des résidus a, b, c,..., par exemple le fait si connu de brigands qui sont de fervents catholiques, et une infinité d'autres faits analogues, dans lesquels b, c, d,.., n'apparaissent pas liés à a. En se bornant à certaines probabilités, on peut dire que l'action directe, quand elle existe, se manifeste principalement entre les résidus qui sont les plus voisins ou au moins du même genre ; difficilement entre les résidus de genres différents ou de classes différentes. Par exemple, celui qui croit déjà facilement à un grand nombre de fables, accordera créance à une de plus. Cela paraît être une action directe, bien que l'on puisse dire aussi que la croyance en un grand nombre de fables révèle un état psychique grâce auquel on accorde facilement créance à une nouvelle fable.
§ 1746. (c) ACTION DES DÉRIVATIONS SUR LES RÉSIDUS. Ce sujet se rapproche beaucoup de celui dont nous avons traité tout à l'heure. Parmi les manifestations des sentiments se trouvent les dérivations, et l'action de celles-ci sur les résidus est par conséquent semblable à l'action des résidus de la IIIe classe et d'un genre de la Ie classe, c'est-à-dire du genre (I-ε), sur les autres résidus. C'est seulement grâce à cette action que les dérivations ont une efficacité importante pour la détermination de l'équilibre social. Une dérivation qui donne uniquement libre cours au besoin de logique éprouvé par l'homme, et qui ne se transforme pas en sentiments, ou qui ne renforce pas des sentiments, agit peu ou point sur l'équilibre social. Ce n'est qu'une dérivation de plus ; elle satisfait certains sentiments, et voilà tout. On peut dire brièvement, mais aussi sans beaucoup de rigueur, que, pour agir sur la société, les raisonnements doivent se transformer en sentiments, les dérivations en résidus. Il faut pourtant faire attention que cela est vrai seulement pour les actions non-logiques, et pas pour les actions logiques.
§ 1747. En général, une dérivation est acceptée, moins parce qu'elle persuade les gens, que parce qu'elle exprime sous une forme claire des idées que ces gens ont déjà d'une manière confuse. C'est là généralement le phénomène principal. Une fois la dérivation acceptée, elle accroît la force et la vigueur des sentiments qui, de cette façon, trouvent la manière de s'exprimer. C'est un fait bien connu que les sentiments sur lesquels la pensée s'arrête souvent, croissent plus vivaces que d'autres auxquels elle ne s'arrête pas (§1749, 1832). Ce phénomène est généralement secondaire, par rapport au premier.
C'est précisément parce que les dérivations n'ont guère d'efficacité que par les sentiments qu'elles excitent, que les personnes qui sont étrangères à ces sentiments, soit qu'elles ne les partagent pas, soit que les ayant autrefois partagés, elles les aient oubliés, se rendent difficilement compte de la valeur pratique de certaines dérivations. On accuse souvent alors ceux qui les ont prohibées d'avoir manqué d'intelligence, tandis qu'il n'y a peut-être en eux qu'un défaut d'habileté [FN: § 1747-1].
§ 1748. Au point de vue logico-expérimental, le seul moyen de réfuter valablement une affirmation A consiste à en démontrer l'erreur ; pour les actions logiques, cela se fait par la logique et l'observation (§1834). Il n'en est pas ainsi au point de vue des sentiments et pour les actions non-logiques. Les raisonnements et les observations expérimentales ont peu d'influence sur les sentiments et les actions non-logiques ; les dispositions naturelles de l'individu en ont beaucoup et sont presque seules à en avoir. C'est pourquoi, aux sentiments il convient d'opposer d'autres sentiments. Une dérivation absurde peut être un bon moyen de réfuter une autre dérivation absurde, tandis que tel ne serait pas le cas au point de vue logico-expérimental. Enfin, le silence peut être un bon moyen d'ôter sa force à une affirmation A, tandis que la réfuter, même victorieusement au point de vue logico-expérimental, peut lui profiter au lieu de lui nuire (§1834) [FN: § 1748-1].
§ 1749. [Note ajoutée à l’édition française par l’auteur : [FN: § 1749-1a]] Parler à un individu d'une chose, soit pour en dire du bien, soit pour en dire du mal, peut disposer cet individu, s'il ne l'est pas encore, à s'occuper de cette chose, ou accroître cette disposition s'il l'a déjà [FN: § 1749-1]. Bien plus, il est remarquable que pour beaucoup de personnes qui aiment la contradiction, dire du mal d'une chose est un moyen plus sûr de la leur faire accepter, que d'en dire du bien. En certaines matières, ainsi en matière sexuelle, on éveille aussi, de cette façon, un certain instinct de perversité, qui pousse l'individu à faire précisément ce qu'on voudrait l'empêcher de faire [FN: § 1749-2]. C'est pourquoi, en ces matières, il arrive souvent que le silence, lorsqu'il maintient vraiment l'individu dans l'ignorance, est presque le seul moyen efficace d'agir sur lui.
En matière politique, le silence sur les hommes est aussi très efficace. Nombreux sont les cas dans lesquels il vaut mieux pour un politicien être attaqué et injurié que de ne pas occuper l'esprit du public. C'est pourquoi un fait quelconque qui le mette en évidence peut être aussi l'origine d'un succès pour lui. De très nombreux avocats trouvèrent dans un procès le commencement de la gloire et du pouvoir ; ainsi Gambetta. Pour ôter de la valeur aux faits, n'en pas parler est moins efficace, mais cependant toujours utile [FN: § 1749-3]. L'efficacité dépend de la possibilité d'empêcher ainsi que le public ne s'occupe du fait, soit parce que beaucoup de gens demeurent sans en avoir connaissance, soit parce qu'une partie de ceux qui le connaissent, n'en entendant plus parler, sont portés à l'oublier. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher quand et comment cela se fait, puisque maintenant nous recherchons seulement quelle est l'action des résidus, et non les façons dont l'organisation sociale permet d'atteindre certains buts. Le silence sur les raisonnements est aussi plus ou moins efficace, suivant qu'il sert à faire ignorer, oublier, négliger les raisonnements que l'on veut combattre, et vaut souvent plus et mieux que n'importe quelle réfutation. De même, la répétition, n'eût elle pas la moindre valeur logico-expérimentale, vaut plus et mieux que la meilleure démonstration logico-expérimentale [FN: § abc-1]. La répétition agit surtout sur les sentiments, modifie les résidus ; la démonstration logico-expérimentale agit sur la raison ; elle peut, dans l'hypothèse la plus favorable, modifier les dérivations, mais a peu d'effet sur les sentiments. Quand un gouvernement ou quelque puissance financière veut faire défendre une mesure par les journaux à sa dévotion, il est remarquable que souvent, presque toujours, les raisonnements employés sont loin d'être les meilleurs pour démontrer l'utilité de la mesure ; on emploie généralement les pires dérivations verbales, d'autorité, et autres semblables. Mais cela importe peu ; au contraire, c'est parfois utile ; il faut surtout avoir une dérivation simple, que tout le monde puisse comprendre, même les plus ignorants [FN: § 1749-5], et la répéter indéfiniment.
§ 1750. Il arrive souvent que la réfutation, même excellente, d'un raisonnement absurde soit un moyen de donner du crédit à ce raisonnement, s'il correspond à des sentiments en ce moment puissants (§1749 [FN: § abc-1]) Cela s'applique aussi aux raisonnements qui sont bons au point de vue logico-expérimental et, en général, aussi à des attaques de tout genre et des persécutions contre des théories, des opinions, des doctrines. De là provient l'illusion que la Vérité a la force de surmonter victorieusement les persécutions ; ce qui peut être en accord avec les faits, pour les raisonnements de pure science logico-expérimentale, mais l'est beaucoup moins, et souvent se trouve en complet désaccord avec eux, pour les raisonnements qui dépendent un peu ou beaucoup des sentiments.
§ 1751. L'effet noté tout à l'heure des réfutations et des persécutions peut être appelé indirect. On observe un effet semblable pour le silence. Si cet effet s'étend à une classe importante et nombreuse de faits, et à des sentiments puissants, il laisse non satisfaits parmi ces derniers les sentiments correspondant à la IIIe classe des résidus et au genre (I-ε) de la Ie classe, tandis que l'abstinence même augmente le besoin de les satisfaire. Cela est remarquable en matière sexuelle, et tout le monde sait que les voiles accroissent le désir ; mais ce n'est pas moins vrai en matière religieuse et politique. Là où il est interdit d'attaquer la religion dominante ou le régime politique existant, le plus petit blâme, la moindre attaque, émeuvent fortement les gens ; là où c'est permis, et où cela se fait souvent, les gens s'y habituent et n'y font plus attention.
Cela a lieu pour les deux parties que nous avons vues exister dans les effets des dérivations(§1747). En effet, les individus contraints au silence refoulent en eux-mêmes des sentiments qui se manifestent à la première occasion favorable ; et celle-ci peut être justement la production de certaines dérivations, qui sont, par conséquent, accueillies avec une très grande faveur, et qui, une fois acceptées, donnent une force et une vigueur nouvelles aux sentiments. Puisque dans la réalité, nous observons ensemble ces deux parties des phénomènes, nous ne savons trop comment les séparer, et la tendance que nous avons à réduire toutes les actions à des actions logiques, nous porte à donner à la seconde partie une importance beaucoup plus grande qu'elle n'a en réalité, lorsque pourtant nous ne la considérons pas exclusivement. Les vérifications que nous pouvons faire dans le cas concret concernent principalement le phénomène dans son ensemble, constitué des deux parties, que nous ne pouvons séparer que par l'analyse.
En France, vers la fin du XVIIIe siècle, les attaques de Voltaire, de d'Holbach et d'autres philosophes, contre la religion catholique, furent en rapport avec un phénomène d'ensemble contraire à cette religion, et qui ne se renouvelle plus maintenant, lors d'attaques analogues. Dans le phénomène de la fin du XVIIIe siècle, il y avait très probablement une partie qui était réellement un effet des écrits contraires à la religion ; mais la plus grande partie était certainement celle qui manifestait des sentiments existant déjà chez les hommes (§1762 et sv.). Dans les pays où, comme maintenant en Allemagne, on ne permet pas de publier quoi que ce soit contre le souverain, le plus léger blâme à son adresse est lu avidement par le public. Dans les pays où, comme aujourd'hui en Belgique, on peut dire ce qu'on veut du souverain, personne ne prend garde à ce qui s'écrit contre lui [FN:§ 1751-1]. Très connu est le fait qui s'est produit en France, en 1868, lorsque l'Empire, après avoir longtemps imposé silence à la presse, lui donna un peu de liberté. Le public suivit avec avidité, non seulement les attaques acharnées, mais aussi celles qui nous paraissent aujourd'hui avoir été de peu d'importance [FN: § 1751-2].
§ 1752. Tant pour le silence que pour les réfutations et les persécutions, nous avons donc un effet direct et un effet indirect (§1835) ; et la détermination de la résultante de ces deux effets est une question de quantité. À un extrême, l'effet direct surpasse de beaucoup l'effet indirect, puis, peu à peu, l'un augmente et l'autre diminue, et l'on atteint l'extrême opposé, où l'effet indirect dépasse de beaucoup l'effet direct. Au premier extrême, on trouve les mesures qui frappent un petit nombre de faits, et qui n'émeuvent pas des sentiments puissants. De ce genre sont, par exemple, les mesures prises contre un petit nombre de dissidents en politique, en religion, en morale. À l'autre extrême, on trouve les mesures qui visent des faits nombreux, et qui émeuvent des sentiments puissants. De ce genre sont, par exemple, les mesures par lesquelles on essaie vainement d'empêcher les manifestations de l'appétit sexuel.
§ 1753. Aux siècles passés, en Europe, on croyait que gouvernement, religion, morale, ne pouvaient subsister, si l'on ne réglait pas les manifestations de la pensée ; et les faits survenus aussitôt après la Révolution de 1789, parurent démontrer la vérité de cette théorie. C'est pourquoi, dans les premières années du XIXe siècle, elle eut un regain de vogue. Ensuite, peu à peu, ces liens de la manifestation de la pensée disparurent, et maintenant ils sont supprimés en grande partie, excepté pour la religion sexuelle ; et les gouvernements, la religion, la morale subsistent ; il semble donc que la théorie est erronée. De tels jugements sont trop absolus, parce que les circonstances dans lesquelles la théorie est mise en pratique sont changées. Ôter la liberté de pensée à ceux qui n'éprouvent pas le besoin de la manifester n'a aucun effet ; l'ôter à ceux qui éprouvent ce besoin laisse non satisfaits des désirs qui deviennent intenses. C'est pourquoi, ainsi qu'il arriva en France, vers la fin du XVIIIe siècle, la liberté d'exprimer sa pensée a des effets intenses et nuisibles pour les institutions du passé. Pourtant, ces effets s'affaiblissent peu à peu, et cette liberté finit par agir très peu sur les sentiments, car, là où elle est usuelle, elle agit surtout par les dérivations qui, nous le savons déjà, n'ont en général pas grand effet. Mais c'est justement pourquoi il devient alors efficace de passer sous silence un fait, un raisonnement, car c'est l'un des cas où l'effet direct dépasse de beaucoup l'effet indirect.
Les considérations auxquelles nous venons de nous livrer nous conduisent à la limite où commence l'étude des mesures aptes à atteindre un but, c'est-à-dire l'étude des mouvements virtuels. Nous nous en occuperons plus loin (§1825 et sv.).
§ 1754. Jusqu'à présent, nous nous sommes exprimés comme si la société était une masse homogène. Mais puisque tel n'est pas le cas, ce que nous avons dit peut uniquement s'appliquer, et même seulement d'une manière approximative, à une couche de la population, telle qu'on puisse, sans erreur grave, la considérer comme homogène ; et pour connaître les effets sur l'ensemble de la population, il est nécessaire de tenir compte des effets sur les différentes couches (§2025 et sv.). De là provient un phénomène connu empiriquement depuis longtemps : celui de la diversité des effets de la liberté de manifester sa pensée, pour les gens cultivés et pour la partie inculte de la population. Mais c'est là un sujet dont nous parlerons plus à propos au chapitre suivant.
§ 1755. [Note ajoutée à l’édition française par l’auteur : [FN: § 1755-1a]] On a un bon exemple de l'action des dérivations dans les effets que produisent les grands journaux, de nos jours. Qu'ils aient un grand pouvoir, c'est une observation banale ; mais ce pouvoir ne provient pas de ce qu'ils puissent faire usage de la force pour imposer leurs raisonnements, ni de la valeur logico-expérimentale de ceux-ci, qui sont souvent puérils. Il naît seulement de l'art d'agir sur les résidus, au moyen des dérivations. Les résidus sur lesquels on veut agir doivent généralement préexister ; ce qui fixe les limites du pouvoir des journaux, qui ne peuvent aller à l'encontre des résidus, mais uniquement s'en servir en vue de leurs fins [FN: § 1755-1]. Exceptionnellement et à la longue, un résidu nouveau peut surgir, ou bien quelque résidu qui semblait disparu peut reparaître. Cette action sur les résidus explique aussi qu'il y ait des journaux d'opposition payés par les gouvernements [FN:§ 1755-2]. Au point de vue logique, la chose paraît absurde. Comment un gouvernement peut-il avoir assez peu de bon sens pour payer les gens qui parlent contre lui ? Mais si l'on prend garde aux sentiments, on aperçoit l'utilité de la mesure. Tout d'abord, le gouvernement obtient que le journal payé se taise opportunément, qu'il ne réveille pas le chat qui dort, qu'il pousse ses lecteurs à faire éclater leur colère par des moyens qui soient moins que d'autres dangereux pour le gouvernement. Ensuite, il y a des moments où une forte agitation s'empare du pays. À ces moments, une goutte d'eau peut faire déborder la coupe, et il est utile que les journaux d'opposition ne versent pas cette goutte. Enfin, et c'est surtout à quoi visent les puissants syndicats financiers qui, à l'instar du gouvernement, subsidient parfois des journaux apparemment ennemis, il y a un moyen de combattre certaines mesures, certains projets de lois, moyen qui a sur les sentiments un effet favorable, autant et plus que la meilleure défense. Il faut ajouter que le fait de disposer d'un journal d'opposition [FN:§ 1755-3] donne un moyen – et souvent c'est le seul – de faire parvenir jusqu'à ses adversaires certains discours qu'ils ne liraient pas dans les journaux favorables au gouvernement ou aux syndicats financiers, ou bien qu'ils tiendraient pour suspects, précisément parce qu'ils les lisent dans ces journaux. On a aussi un moyen puissant d'agir par les journaux, en passant sous silence certains faits, certains raisonnements, certains discours, certains ouvrages. Souvent, en certains cas, c'est uniquement le silence que le gouvernement ou la finance demandent aux journaux sur lesquels ils ont quelque influence [FN: § 1755-4]. Le mensonge par omission peut être aussi utile que le mensonge par commission.
Presque tous les grands journaux, y compris plusieurs de ceux qui s'affichent socialistes, sont directement ou indirectement liés à la ploutocratie qui règne aujourd'hui dans les pays civilisés, et aux gouvernements auxquels elle a part [FN:§ 1755-5]. Il est remarquable que la Confédération Générale du Travail ait senti cela, instinctivement, il est vrai, et l'ait exprimé dans le manifeste qu'elle publia à l'occasion de la guerre balkanique, en 1912 [FN: § 1755-6]. Nous ne parlons pas ici de la façon dont le sentiment est exprimé, c'est-à-dire de la dérivation, qui est absurde comme tant d'autres, mais uniquement du sentiment irraisonné, qui appartient à l'instinct. Tout cela est très connu [FN: § 1755-7], et aucune personne prenant part à la vie publique ou appartenant à la haute finance n'est assez naïve pour le nier, si on l'interroge en particulier ; mais en public, elle hausse les épaules, et nie hypocritement. Il est surprenant de voir des gens qui savent ces choses en général, et qui nonobstant accordent créance à leur journal, à des arguments sur lesquels on ne peut douter que l'argent de la finance internationale ait une grande influence. Par exemple, durant la guerre des Balkans, les nouvelles données par un grand nombre de journaux avaient avec la réalité beaucoup moins de rapport qu'avec les visées de la « spéculation » ou de la finance internationale [FN: § 1755-8] ; et pourtant ces nouvelles étaient crues par des personnes qui savaient bien quand et comment ces visées se manifestent. Les ploutocrates démagogues tels que Caillaux et Lloyd George sont loués, grâce à des arguments sonnants, par des journaux d'une grande renommée ; et beaucoup de petits poissons mordent à l'hameçon, ce qui n'est pas fait pour étonner, mais de gros poissons rusés s'y laissent prendre aussi, ce qui est moins facile à comprendre. Il est vrai que ces derniers feignent souvent de croire ce qui tourne à leur profit.
§ 1756. Il y a un petit nombre de dérivations très en usage pour agir sur les gens ignorants, et que nous trouvons dans les harangues au peuple d'Athènes, à celui de Rome, et bien davantage dans nos journaux. L'une des plus fréquentes a pour but de mettre en œuvre les sentiments d'autorité (IV-ε 2). Si l'on voulait donner une forme logique à la dérivation, on devrait dire : « Une certaine proposition A ne peut être bonne que si elle est faite par un homme honnête ; je démontre que celui qui fait cette proposition n'est pas honnête, ou qu'il est payé pour la faire ; donc j'ai démontré que la proposition A est nuisible au pays [FN:§ 1756-1] ». Cela est absurde ; et celui qui use de ce raisonnement sort entièrement du domaine des choses raisonnables. Il n'en est pas ainsi pour qui l'écoute et demeure persuadé, non par la force de la logique, mais par une association de sentiments. Cette personne, à son insu, a l'intuition qu'elle est incapable de juger directement si A est favorable ou contraire au bien du pays, qu'elle doit s'en remettre au jugement d'autrui ; et, pour accepter ce jugement, elle veut qu'il vienne d'une personne digne d'estime.
Cette dérivation est souvent presque la seule employée par certains journaux pour lesquels il n'existe plus de problèmes de choses, et qui résolvent toutes les questions par des injures contre les personnes. Il convient de remarquer que, pour les plumitifs, il est beaucoup plus facile d'injurier que de raisonner. C'est souvent un moyen efficace, parce que le public qui se repaît de ces écrits est ignorant, et parce qu'il juge plus avec le sentiment qu'avec la raison. Mais la corde trop tendue casse, et il est arrivé en beaucoup de pays que désormais l'injure et la calomnie lancées contre les hommes politiques ne soient plus très efficaces ; elles l'étaient bien davantage, lorsqu'elles étaient réprimées par les tribunaux et, de ce fait, moins habituelles.
§ 1757. Un genre remarquable de ces dérivations tend à mettre en œuvre les résidus sexuels. Une règle qui souffre peu d'exceptions, voulait, aux siècles passés, que les fidèles de la religion dominante accusassent de mauvaises mœurs les fidèles des sectes dissidentes (§1341 et sv.). À vrai dire, les faits étaient presque toujours faux [FN:§ 1757-1] : mais peu importe : supposons qu'ils fussent vrais. En ce cas, la dérivation contient une partie logique ; c'est-à-dire que l'on peut à bon droit l'opposer justement à celui qui prêche une certaine morale et agit contrairement à cette morale. Mais une telle partie disparaît, quand on emploie la dérivation contre des hommes politiques ou contre des souverains. Les faits démontrent clairement qu'il n'existe pas le moindre rapport entre les mœurs sexuelles d'un homme et sa valeur comme homme politique ou comme souverain. Et pourtant, c'est un argument que les ennemis de ces hommes emploient presque toujours contre eux, et quand la haine est vive, l'accusation de relations incestueuses devient normale. De simples hommes politiques eurent l'honneur d'être traités, sous ce rapport, à l'égal des souverains.
§ 1758. En général, les dérivations qui agissent sur les résidus sexuels ont l'avantage de pouvoir être difficilement réfutées, et de nuire à l'adversaire, même, si par hasard, la réfutation est parfaite. Par exemple, on a affirmé, mais sans pouvoir le prouver, que Napoléon Ier avait eu des rapports sexuels avec ses sœurs ; et pour beaucoup de gens, cela suffit pour le condamner comme homme privé, comme homme politique, comme souverain. De même autrefois, l'accusation d'hérésie, même non prouvée, suffisait pour qu'un homme fût au moins suspect aux bons catholiques. Aujourd'hui, l'hérésie de la religion sexuelle occupe la place tenue jadis par l'hérésie de la religion catholique.
§ 1759. D'autres dérivations très en usage sont les dérivations verbales. Par exemple, aux temps de la Restauration, en France, tout ce qui déplaisait au parti dominant portait l'épithète de « révolutionnaire », et c'était une condamnation suffisante. Aujourd'hui, on dit « réactionnaire », et c'est aussi une condamnation suffisante. De cette façon, on fait agir les sentiments de parti, de secte (résidus de la sociabilité, IVe classe).
§ 1760. La concurrence des grands journaux n'est pas considérable, parce que fonder un de ces journaux coûte beaucoup. Par conséquent, il peut être très utile d'avoir plusieurs journaux à sa disposition, et il est utile aussi qu'ils appartiennent à divers partis. C'est ce qu'ont très bien compris les puissants syndicats financiers : aidés de la forme anonyme des sociétés qui possèdent les journaux, ils ont su acquérir de l'influence sur ces sociétés et s'en servir adroitement [FN: § 1760-1]. On cite les noms de plusieurs journaux appartenant à des partis opposés, ennemis même, et qui dépendent d'un même trust de journaux. Parmi les faits de ce genre, plusieurs sont établis par de bonnes preuves. En somme ces trusts exploitent les sentiments des lecteurs de journaux, et leur influence est du même genre, mais beaucoup plus grande, que celle dont jouirent les jésuites [FN:§ 1760-2].
§ 1761. Revenons au sujet général des rapports entre les dérivations et les résidus. Il faut prendre garde que souvent nous nous imaginons que les dérivations se sont transformées en résidus, tandis que c'est le phénomène opposé qui a eu lieu : que ce sont les résidus qui se manifestent par les dérivations (§1747, 1751). Nous sommes facilement induits en cette erreur par la manière dont les phénomènes sociaux nous sont connus. Nous en avons connaissance surtout par la littérature ; aussi nous est-il facile de prendre l'effet pour la cause, et de croire que ce qu'exprime la littérature est la cause, tandis que ce n'est que l'effet.
§ 1762. Par exemple, nous observons, en un certain temps, qu'une conception donnée prend naissance dans les productions littéraires, puis se développe, croît avec vigueur, et il nous semble que nous décrivons bien les faits en disant que c'est la littérature qui a fait entrer cette conception dans l'esprit des hommes. Cela peut parfois arriver ; mais le cas inverse est beaucoup plus fréquent : ce sont les sentiments existant dans l'esprit des hommes, qui ont fait naître, croître et prospérer cette littérature (§1751). Ajoutons que les résidus du genre (IV- ε 2), c'est-à-dire les sentiments d'autorité, agissent de manière à nous induire en erreur. Quand nous lisons les oeuvres d'un grand écrivain, il nous semble évident que lui seul a eu le pouvoir de façonner la société selon les conceptions qu'il exprime.
§ 1763. Lorsque nous lisons, par exemple, les œuvres de Voltaire, nous sommes poussés à croire qu'il a été l'artisan de l'incrédulité qui se manifeste chez les hommes de son temps. Mais, en y réfléchissant un peu, nous nous demandons comment, si c'est là une règle générale, les œuvres de Lucien, qui ne le cèdent en rien à celles de Voltaire, tant pour la perfection littéraire que pour la force de la logique, n'ont pas eu un effet semblable à celles de Voltaire, et comment il se fait que Lucien reste seul dans son incrédulité, tandis qu'autour de lui croissaient la foi et la superstition. Il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ces faits et tant d'autres semblables, qu'en reconnaissant que la semence jetée germe ou ne germe pas, suivant qu'elle tombe dans une terre favorable ou défavorable.
En France, les philosophes du XVIIIe siècle ont reproduit contre le christianisme des arguments avancés déjà par l'empereur Julien et par Celse. Pourquoi eurent-ils un succès que n'eurent pas leurs prédécesseurs ? Évidemment parce que les esprits des hommes auxquels ils s'adressaient étaient différents.
Il y a plus : si Voltaire avait été l'artisan principal des idées répandues parmi ses concitoyens, ces idées n'auraient pas dû diminuer d'intensité, tant que durait l'activité littéraire de leur auteur. Au contraire, vers la fin de la vie de Voltaire, lorsque sa renommée allait encore croissant, voilà qu'un mouvement entièrement opposé à ses théories se manifeste, et que les classes cultivées se tournent vers Rousseau. En vérité, celui-ci n'a guère fait qu'exprimer des dérivations correspondant à des résidus négligés par Voltaire ; c'est à cette circonstance qu'il a dû la faveur du public ; de même que Voltaire dut la faveur dont il jouit aux dérivations correspondant à d'autres résidus. Ces auteurs ne furent pas les artisans des sentiments du public ; ce sont, au contraire, ces sentiments qui furent les artisans de la renommée de ces auteurs.
Il faut entendre cela de la partie principale du phénomène (§1747), car les faits montrent clairement que l'œuvre des auteurs n'a pas été entièrement vaine, et qu'elle a pourtant produit quelque effet ; mais celui-ci, comparé au premier, apparaît secondaire.
§ 1761. Les observations que nous venons de faire se rapportent à l'efficacité de certains raisonnements, mais n'ont rien à voir avec la valeur intrinsèque de ces raisonnements. Il est évident que la valeur scientifique d'un Newton, la valeur en l'art de la guerre d'un Napoléon Ier ou d'un Moltke, l'habileté politique d'un Bismarck, la valeur littéraire d'un Lucien ou d'un Voltaire, n'ont rien à faire avec les résidus. Mais pour qu'elles obtiennent des effets importants, il est nécessaire qu'elles rencontrent des circonstances favorables, dans des sociétés où existent certains résidus. Si Newton avait vécu au moyen âge, il n'aurait peut-être produit qu'une œuvre de théologie ; si Voltaire avait vécu au temps de Lucien, il n'aurait pas trouvé d'écho, et si Lucien avait vécu au temps de Voltaire, ses doctrines seraient devenues populaires ; si Bismarck avait vécu en un pays ou auraient régné les politiciens démocrates ou les ploutocrates, il serait peut-être resté parfaitement inconnu, et si même il avait pu parvenir jusqu'au Parlement, il s'y serait vu préférer un Depretis ou un Giolitti, en Italie, un Rouvier ou un Caillaux, en France.
§ 1765. Il est encore une autre cause à l'erreur qui attribue aux dérivations une part trop grande dans la détermination de l'équilibre social. Elle naît du fait qu'on attribue une existence objective à certaines notions, à certains principes, à certains dogmes, et qu'on raisonne ensuite comme s'ils agissaient par leur vertu propre, indépendamment des résidus. Les résidus de la IIe classe (persistance des agrégats) agissent fortement pour produire cette illusion. Les entités métaphysiques qui sont créées grâce à eux sont entièrement semblables aux dieux des théologiens, et agissent d'une manière analogue. Autrefois, peu nombreuses étaient les histoires qui racontaient les événements et en cherchaient les rapports, sans faire intervenir les dieux. De nos jours, peu nombreuses sont celles qui, explicitement ou implicitement, n'admettent pas que principes et théories donnent au phénomène social sa forme.
§ 1766. (d) ACTION DES DÉRIVATIONS SUR LES DÉRIVATIONS. Nous avons déjà
traité de ce sujet, en étudiant les dérivations, et nous avons remarqué comment, lorsqu'un type devient à la mode, des dérivations de ce genre naissent en grand nombre. Les résidus de la sociabilité, qui poussent l'homme à ressembler à ses concitoyens, à les imiter, agissent pour donner une forme commune à certaines dérivations. En outre, celui qui, en un cas spécial, a été empêché par l'intensité de ses sentiments, de voir le vice d'un certain raisonnement, est facilement entraîné à ne plus apercevoir ce vice, en d'autres cas où il ne serait pas détourné par la force des sentiments. Cela favorise la production de dérivations semblables à celles qui sont employées dans ce cas spécial [FN: § 1766-1]. Ajoutons qu'il faut beaucoup moins d'effort intellectuel pour imiter que pour créer. C'est pourquoi les auteurs de second ordre ont l'habitude de répéter des phrases, des formules, des raisonnements employés par les auteurs d'une autorité et d'une renommée plus grandes.
§ 1767. L'action mutuelle des dérivations est très importante elle a pour effet de faire disparaître, du moins en apparence, la contradiction qu'il peut, au fond, y avoir entre ces dérivations. Nous en avons déjà parlé longuement, et nous avons aussi remarqué l'erreur d'un grand nombre de personnes cultivées, qui, parce qu'elles ont un besoin puissant de logique, apparent ou réel, s'imaginent que tout le monde, et chacun au même degré, éprouve ce besoin. C'est pourquoi, entre autres choses, elles produisent des religions scientifiques, croyant satisfaire un besoin populaire, tandis que ces religions demeurent à l'usage exclusif de leurs quelques fondateurs. Lorsqu'une dérivation est acceptée, il arrive que parmi les personnes cultivées, les littérateurs, les théologiens, les métaphysiciens, les pseudo-savants, il est des personnes qui en tirent des conséquences logiques, lesquelles s'écartent toujours plus des résidus qui correspondent à la dérivation dont ces conséquences sont issues, et qu'elles s'éloignent, par conséquent, toujours plus aussi de la réalité. Soient, par exemple, A, certains sentiments, certains résidus auxquels correspond la dérivation S : quand cette correspondance ne s'altère pas, S est un moyen d'exprimer un fait réel, et il ne s'en écarte que dans la forme.
Mais une déduction logique C, tirée de S, pourra s'écarter de A dans le fond, et de beaucoup (§2083). Ce fait se présente à nous sous différentes formes. 1° Forme du défaut de précision. La dérivation S, exprimée en langage vulgaire, ne correspond parfois à rien de précis, et n'est acceptée que par un accord indéterminé avec certains sentiments. Elle ne peut donc servir de prémisse à aucun raisonnement rigoureux (§826 et sv.). 2° Forme du défaut de correspondance. Dans l'hypothèse la plus favorable, même quand il y a correspondance entre S et A, celle-ci n'est jamais parfaite, et, par conséquent, les déductions tirées de S ne s'appliquent pas à A. C'est pourquoi, considérant ensemble ces deux formes, on peut dire que, vu le défaut de précision ou de correspondance de S, on ne peut tirer de S aucune déduction rigoureuse, ou bien si l'on peut en tirer, elles ne s'appliquent pas à A. 3° Forme de l'ensemble des sentiments. Le groupe de sentiments A n'est jamais bien défini. Par conséquent, le défaut de correspondance entre A et S naît, non seulement de l'imperfection de la correspondance entre la partie définie de A et de B, entre le noyau de la nébuleuse des sentiments et S, mais en outre du défaut complet de correspondance entre la partie indéfinie de A et S, entre les nues qui entourent le noyau de A et de S. 4° Forme de la mutuelle dépendance des groupes de sentiments. Le groupe A n'est pas indépendant d'autres groupes M, P, Q... Chez l'individu, ces groupes se sont accommodés au mieux pour exister ensemble ; ils vivent en un certain accord, qui est rompu par leurs conséquences logiques (§1937). Par exemple, autrefois chez beaucoup de seigneurs chrétiens, on trouvait, imposé par la religion, le sentiment A du pardon des injures et le sentiment M, imposé par les nécessités de la vie pratique, de la défense de l'honneur, et aussi de la vengeance. Mais cet accord eût été rompu entre les conséquences logiques de A et celles de M, si, d'une part, on avait tiré de A la conséquence que le seigneur devait souffrir patiemment, sans même se défendre, toute injure, tout mépris, et si, d'autre part, on avait tiré de M la conséquence que l'Évangile, qui ne tient aucun compte de M, est un livre absurde et inutile. 5° Forme de la correspondance entre les théories et les faits sociaux. Si, pour chaque individu, la correspondance entre A et S était parfaite, elle le serait aussi pour une collectivité composée d'individus semblables, et de S, on pourrait déduire logiquement les actions de cette collectivité. La connaissance des formes politiques et sociales deviendrait aisée. En effet, il n'est pas difficile de connaître les dérivations qui ont cours dans une société ; et si de ces dérivations on pouvait tirer logiquement la connaissance des faits politiques et sociaux, la science sociale ne rencontrerait pas, pour se constituer des difficultés ni plus grandes ni autres que celles rencontrées par la géométrie. On sait assez qu'il n'en est pas ainsi, et que ces raisonnements géométriques nous écartent toujours, peu ou prou, de la réalité. Mais c'est une erreur que d'en accuser la nature du raisonnement : ce sont les prémisses qui nous écartent de la réalité. C'est aussi une erreur que vouloir apprécier l'importance sociale d'un résidu par la correspondance, avec la réalité, des déductions qu'on tire de ce résidu, tandis qu'au contraire, cette importance consiste surtout dans sa correspondance avec les sentiments qu'il exprime [FN:§ 1767-1].
Nous avons souvent déjà et longuement parlé des problèmes qui revêtent les quatre premières formes. Il nous reste maintenant à étudier à fond ceux de la cinquième ; mais ils font partie d'une question plus générale dont nous allons nous occuper.
§ 1768. RAPPORT DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS AVEC LES AUTRES
FAITS SOCIAUX. Nous avons vu (§802, 803) qu'il y a correspondance entre les sciences logico-expérimentales, qui partent de principes expérimentaux (A) pour en tirer avec une logique rigoureuse des conséquences (C), et les raisonnements sociaux qui partent de résidus (a), pour en tirer, par des dérivations (b), mélangées de résidus et de logique, des conséquences (c). Excluons pour un moment le cas où les observations ne seraient pas bonnes, ou dans lequel la logique serait erronée ; alors les conclusions des sciences logico-expérimentales concorderont sûrement avec les faits, puisque les principes (A) représentent précisément des faits, et le raisonnement est rigoureux. Mais on ne peut en dire autant des raisonnements sociaux, puisque nous ne savons en quel rapport les résidus (a) sont avec les faits, ni quelle valeur a le raisonnement (b) dont d'autres résidus font partie. Et pourtant, l'expérience journalière fait voir qu'un grand nombre de ces raisonnements conduisent à des conséquences concordant avec les faits ; et cela ne peut être mis en doute, si l'on prend garde que ces raisonnements sont les seuls qu'on emploie dans la vie sociale, et que, s'ils conduisaient à des résultats ne concordant pas en général avec les faits, il y a longtemps que toutes les sociétés auraient été détruites, anéanties. Comment peut bien se produire cet accord avec les faits, des conclusions tirées des résidus ?
§ 1769. La solution de ce problème doit être cherchée dans le rapport où se trouvent les résidus et les dérivations avec les faits sociaux. Si les résidus étaient l'expression de ces faits, comme le sont les principes des sciences expérimentales, si les dérivations étaient rigoureusement logiques, l'accord des conclusions avec l'expérience devrait être certain et parfait. Si les résidus étaient pris au hasard, si les dérivations l'étaient aussi, cet accord serait extraordinairement rare. Donc, puisque l'accord a lieu souvent mais non toujours, résidus et dérivations doivent occuper une position intermédiaire entre les deux extrêmes notés tout à l'heure. On prendra garde qu'un résidu qui s'écarte de l'expérience peut être corrigé par une dérivation qui s'écarte de la logique, de telle sorte que la conclusion se rapproche des faits expérimentaux. Cela se produit parce qu'en accomplissant des actions non-logiques, les hommes, poussés par l'instinct, se rapprochent précisément de ces faits expérimentaux (§1776), et, sans s'en apercevoir, corrigent par un mauvais raisonnement les conséquences tirées d'un résidu qui s'écarte de la réalité.
§ 1770. Le problème que nous examinons est une partie d'une question encore plus générale : la façon dont les formes des êtres vivants et celles des sociétés sont déterminées. Ces formes ne sont pas produites au hasard ; elles dépendent des conditions dans lesquelles vivent les êtres et les sociétés. Mais quelle est précisément cette dépendance, nous ne le savons pas, après avoir dû écarter la solution darwinienne qui nous l'aurait enseigné. Pourtant si nous ne pouvons résoudre complètement le problème, nous pouvons du moins connaître certaines propriétés des formes et des résidus. Tout d'abord, il est évident que ces formes et ces résidus ne peuvent être en contradiction trop flagrante avec les conditions dans lesquelles ils sont produits ; c'est ce qu'il y a de vrai dans la solution darwinienne (§828, 2142). Un animal qui a seulement des branchies ne peut vivre dans l'air sec ; un animal qui a seulement des poumons ne peut vivre perpétuellement immergé ; de même des hommes qui ont seulement des instincts anti-sociaux ne pourraient vivre en société. Ensuite, on peut pousser plus loin et reconnaître qu'il y a une certaine adaptation entre les formes et les conditions de vie. La solution darwinienne est erronée, parce qu'elle veut cette adaptation parfaite ; mais cela n'empêche pas qu'en gros l'adaptation a lieu. Il est certain qu'animaux et plantes ont des formes adaptées en partie, et parfois merveilleusement adaptées à leurs conditions d'existence. De même, on ne peut nier que les peuples aient des instincts plus ou moins adaptés à leur genre de vie (§ 1937). Prenons garde pourtant que c'est là un rapport entre deux choses, mais il n'est nullement établi que l'une soit conséquence de l'autre. Reconnaissons que le lion vit de proie et a des armes puissantes pour la capturer, mais ne disons pas qu'il vit de proie, parce qu'il a ces armes, ou qu'il a ces armes parce qu'il vit de proie. Un peuple belliqueux a des instincts belliqueux ; mais nous ne disons pas s'il est belliqueux à cause de ses instincts, ou s'il a ces instincts parce qu'il est belliqueux.
§ 1771. Maintenant, nous avons, très en gros, la solution de notre problème. Les raisonnements sociaux donnent des résultats qui ne s'écartent pas trop de la réalité, parce que les résidus, soit ceux dont proviennent les dérivations, soit ceux qui servent à dériver, se rapprochent graduellement de la réalité. Si les premiers résidus sont dans ce cas, et si les dérivations sont quelque peu logiques, on obtient des conséquences qui, d'habitude, ne s'écartent pas trop de la réalité. Si les premiers résidus ne sont pas dans le cas indiqué plus haut, ils sont corrigés par les seconds, qui conseillent l'usage de dérivations sophistiques, pour se rapprocher de la réalité.
§ 1772. Voyons maintenant d'autres particularités du phénomène. Nous pouvons, pour la correspondance entre les résidus et les autres faits sociaux, répéter les considérations présentées déjà au §1767, pour la correspondance entre les dérivations et les résidus. 1° Certains résidus correspondent assez mal aux faits dont dépend l'organisation sociale. On ne peut en aucune façon les faire correspondre à des principes logico-expérimentaux tirés de ces faits. 2° Même les résidus qui, tant bien que mal, correspondent aux faits déterminant l'organisation sociale, et qui, en gros, correspondent à des principes logico-expérimentaux tirés de ces faits, n'ont pas une correspondance précise, et manquent totalement de la précision exigée pour de tels principes.
Au sujet des dérivations, nous pouvons remarquer qu'habituellement elles vont au delà de la réalité dans le sens qu'elles indiquent, et qu'au contraire, elles demeurent très rarement en deçà. On peut noter trois formes principales dans ce phénomène. Tout d'abord, à cause de la tendance que le sentiment a de pousser à l'extrême, les dérivations ont une tendance marquée à se transformer en idéal et en mythe : une inondation locale devient facilement le déluge universel ; l'utilité, pour la vie en société, de suivre certaines règles se transforme en commandements divins ou en impératif catégorique. Ensuite, la nécessité d'énoncer en peu de mots les dérivations pour les faire accepter et pour les imprimer dans l'esprit, fait que l'on prend garde uniquement au principal, et qu'on néglige l'accessoire : on énonce un principe, sans faire attention aux restrictions, aux exceptions, qui le rapprocheraient beaucoup plus de la réalité. On dit : « Tu ne tueras point », allant ainsi très au delà de la règle qu'on veut établir, et qu'on exprimerait longuement, en indiquant dans quels cas et dans quelles circonstances on ne doit pas tuer, dans quels autres on peut, dans quels autres encore on doit tuer. On dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », allant ainsi au delà de la règle qu'on veut établir, pour que les hommes vivant en une collectivité donnée se témoignent une mutuelle bienveillance. Enfin, l'efficacité d'une foi pour pousser les hommes à une action énergique est d'autant plus grande que la foi est plus simple, plus absolue, plus dépourvue de restrictions et de doutes, c'est-à-dire qu'elle s'écarte plus du scepticisme scientifique. De là vient que la dérivation, dans la mesure où elle a pour but de pousser les hommes à agir, emploie des principes simples qui dépassent la réalité, qui tendent à un but au delà et souvent très au delà de celle-ci. En conclusion, pour revenir des dérivations à la réalité, il est presque toujours nécessaire de faire la part de l'exagération.
Les conditions qui, d'une argumentation font une bonne dérivation, sont donc très souvent opposées à celles qui en font un bon raisonnement logico-expérimental, et autant l'argumentation se rapproche de l'une de ces limites, autant elle s'éloigne de l'autre. Mais le raisonnement logico-expérimental correspond à la réalité, et par conséquent, si les hommes qui agissent suivant les dérivations se rapprochent de la réalité, il faut que la divergence existant entre ces dérivations et la réalité soit corrigée en une certaine mesure. Cette correction est obtenue grâce au contraste et à la composition (§2087 et sv.) des nombreuses dérivations qui existent dans une société. La forme la plus simple, mais aussi la moins
fréquente, sous laquelle ce phénomène se manifeste, est celle de deux dérivations, A et B, directement contraires, telles que A, dépassant la réalité d'une part, B d'autre part. A et B se rapprochent beaucoup plus de la réalité lorsqu'elles existent ensemble, que chacune d'elles considérée séparément : par exemple, la dérivation A, qui prescrit d'aimer son prochain comme soi-même, et la dérivation B, qui impose le devoir de vengeance. La façon la plus compliquée, mais aussi la plus fréquente, est celle de nombreuses dérivations A, B, C,., qui ne sont pas directement opposées, et qui, unies, composées ensemble (§2087 et sv., 2152 et sv.), donnent une résultante, laquelle se rapproche beaucoup plus de la réalité que chacune d'elles ; par exemple, les nombreuses dérivations qu'on observe chez tous les peuples civilisés, sur le droit des gens, sur l'égoïsme patriotique, sur l'indépendance de la justice, sur la raison d'État, sur l'abolition de l'intérêt de l'argent, sur l'utilité d'accroître la dette publique, etc.
§ 1773. COMMENT LA DIVERGENCE ENTRE LES RÉSIDUS ET LES PRINCIPES LOGICO-EXPÉRIMENTAUX AGIT SUR LES CONCLUSIONS. Supposons que nous raisonnions selon la méthode logico-expérimentale, en prenant comme prémisses certains résidus (a). Nous arriverions ainsi à des conclusions (c). Si nous raisonnions de la même manière sur des principes rigoureusement expérimentaux (A), nous aboutirions à des conclusions (C). Nous voulons savoir en quel rapport se trouvent les conclusions (c) avec les conclusions (C). Pour cela, il faut savoir en quel rapport les résidus (a) sont avec les principes (A). Faisons une hypothèse qui se vérifie en certains cas. Supposons que (a) coïncide avec (A), seulement entrer certaines limites, et qu'au delà de ces limites il s'écarte de (A), ou bien que certains résidus, ou les propositions qui les expriment, représentent la réalité seulement entre certaines limites, et voyons quelles conclusions on peut tirer de ces propositions. Il faut distinguer le cas où les limites sont connues, de celui où elles sont inconnues. Si elles sont connues, le problème est bientôt résolu. Les conclusions tirées de ces propositions seront vraies dans les limites entre lesquelles s'appliquent les dites propositions. Les propositions scientifiques sont toutes de ce genre, et se vérifient entre des limites plus ou moins éloignées.
§ 1774. Si les limites ne sont pas connues, le problème est beaucoup plus difficile et souvent insoluble. Malheureusement pour les raisonnements sociaux, pour les raisonnements par dérivations, les limites nous sont peu ou point connues ; aussi devons-nous nous contenter de solutions grossièrement approximatives. Nous pouvons dire que de propositions vraies entre certaines limites mal connues, on tire des conclusions qui concordent avec les faits, pourvu que le raisonnement ne nous écarte pas trop de l'état où les propositions sont vraies. C'est bien peu de chose, et l'on peut s'en contenter uniquement parce que peu est mieux que rien.
§ 1775. Exemples. On sait que sous la pression barométrique de 760 mm. de mercure, lorsque la température monte de 4 à 100° centigrades, le volume de l'eau augmente. Dans ce cas, les limites entre lesquelles la proposition est vraie sont bien déterminées, et nous sommes avertis de ne pas l'étendre au delà de ces limites ; en effet, de 0 à 4°, le volume de l'eau diminue au lieu d'augmenter. Quand nous disons que dans une société donnée, il est utile que les mesures sociales soient décidées par la majorité des citoyens, même en laissant de côté le défaut de précision de cette proposition, nous ignorons entre quelles limites elle concorde avec les faits. Il est probable que l'on répondrait négativement à qui demanderait s'il est utile que la moitié plus un des hommes d'une société puissent décider de tuer et de manger l'autre moitié moins un. Mais il est probable aussi que l'on répondrait affirmativement à qui demanderait s'il est utile que la moitié plus un puisse décréter une loi pour la circulation des automobiles. Entre certaines limites, la proposition peut donc concorder avec les faits, tandis qu'entre certaines autres elle ne concorde pas. Mais quelles sont ces limites ? Nous ne sommes pas en mesure de donner une réponse satisfaisante à cette question [FN: § 1775-1].
§ 1776. Là où la science fait encore défaut, l'empirisme vient à l'aide. Il a et il aura longtemps encore une très grande part en matière sociale, et souvent il corrige les défauts des prémisses (§1769). Celui qui a une bonne carte topographique et sait bien s'en servir trouvera sûrement le chemin pour aller d'un lieu à un autre. Mais l'animal, guidé par l'instinct, le trouvera tout aussi bien, et parfois mieux ; de même l'homme qui, pour avoir parcouru plusieurs fois ce chemin, le suit d'instinct. Celui qui a une mauvaise carte topographique, et l'interprète rigoureusement, trouvera peut-être moins facilement son chemin que ceux qui se trouvent dans les cas extrêmes mentionnés tout à l'heure. Les géographes anciens disaient que le Péloponèse avait la forme d'une feuille de platane [FN: § 1776-1]. Celui qui part de cette prémisse et raisonne logiquement, connaîtra moins bien la topographie du Péloponèse que celui qui a une carte moderne faite suivant les règles de l'art, et même, si l'on veut, que celui qui a une carte médiocre du Péloponèse. Celui qui se décide au hasard se rapproche du premier quant à l'accord avec l'expérience. Viennent ensuite ceux qui se laissent guider par les résidus et par les dérivations ; ils ressemblent à celui qui sait que le Péloponèse a la forme d'une feuille de platane. Enfin, nous avons ceux qui sont simplement des hommes pratiques ; ils ressemblent à l'ignorant qui a parcouru le Péloponèse en long et en large. Ces deux catégories de personnes obtiennent souvent des résultats qui ne s'écartent pas trop de l'expérience.
§ 1777. On a l'habitude de dénommer fausses les propositions qui ne sont pas un simple résumé de l'expérience, comme le sont les principes expérimentaux. Voyous ce qu'on peut tirer de ces propositions. Il faut d'abord expliquer le terme faux. Si l'on indique par là une proposition entièrement en désaccord avec les faits, aucun doute que, raisonnant logiquement sur des prémisses fausses, on arrive à des conclusions fausses, c'est-à-dire ne concordant pas avec les faits. Mais le terme faux désigne souvent une explication fausse d'un fait réel ; et, en ce cas, de ce genre de propositions, on peut, entre certaines limites, tirer des conclusions vraies, c'est-à-dire concordant avec les faits.
§ 1778. Exemples. Pour expliquer comment la pompe aspire l'eau, on disait autrefois que « la Nature avait horreur du vide ». Le fait était vrai. L'explication fausse. Raisonnant maintenant d'une manière semblable à celle dont on raisonnait alors, nous pouvons néanmoins tirer de cette explication des conclusions qui sont vérifiées par l'expérience. On prend une bouteille et on la remplit d'eau ; on la ferme avec la main ; on plonge le col dans l'eau et l'on enlève la main. Qu'arrivera-t-il ? Nous répondrons : « L'eau restera suspendue dans la bouteille, parce que, si elle en sortait, la bouteille resterait vide, et nous savons que cela n'est pas possible, puisque la Nature a horreur du vide ». Faisons l'expérience, et nous verrons que la conclusion concorde avec le fait. Faisons la même expérience avec un tube fermé à l'un des bouts, haut d'un mètre, plein de mercure, et dont l'autre bout est ouvert et plonge dans un bain de mercure. La conclusion précédente ne se vérifie plus : le mercure descend dans le tube et en laisse vide une partie. Si, au lieu d'un fait physique, il s'agissait d'un fait social, d'autres dérivations pour l'expliquer ne feraient pas défaut. On pourrait, par un beau et subtil raisonnement, analogue à ceux qui sont en usage dans les théories du droit naturel, démontrer que l'horreur de dame Nature pour le vide cesse à environ 760 mm. de mercure. On sait que le nombre 7 est parfait, de même le nombre 6 ; unis, ils doivent donner un ensemble absolument parfait, et l'amour de dame Nature pour cet ensemble parfait peut vaincre l'horreur qu'elle a pour le vide. Si la hauteur du mercure était exprimée en pouces ou en tout autre système de mesures, cela n'apporterait aucune difficulté. Bien des auteurs, entre autres Nicomaque Gerasene (§963), nous enseigneraient à trouver toujours la perfection du nombre que nous aurions en vue. À qui objecterait que la hauteur à laquelle dame Nature cesse d'avoir horreur du vide est beaucoup plus grande avec l'eau qu'avec le mercure, on pourrait répondre qu'il en doit être ainsi, car enfin l'eau est « le meilleur des éléments », et que, par conséquent, elle doit être privilégiée au regard du mercure. Ce raisonnement vaut à peu près ceux de M. Léon Bourgeois sur la solidarité.
Pour expliquer pourquoi on devait secourir les voyageurs étrangers, les païens grecs disaient que ces voyageurs étaient envoyés par Zeus, et les chrétiens citaient l'Évangile, où il est dit que celui qui accueille l'étranger accueille Jésus-Christ. Si, de ces propositions on tire la conclusion qu'il est utile de secourir l'étranger, on a une proposition qui peut concorder avec les faits pour les peuples anciens et aussi, dans une plus faible proportion, pour les peuples modernes. C'est une conclusion semblable à celle à laquelle nous avons abouti pour la bouteille pleine d'eau. Si l'on voulait tirer ensuite la conclusion, qui ressort logiquement aussi, à savoir que les étrangers doivent être honorés, suivant les Grecs comme envoyés de Zeus, suivant les chrétiens comme s'ils étaient Jésus-Christ en personne, on aurait des conclusions qui n'ont jamais concordé avec les faits, ni chez les Grecs ni chez les chrétiens.
Donc, en raisonnant grosso modo, nous pouvons dire que des dérivations existant en une société donnée, on peut tirer des conclusions qui seront vérifiées par l'expérience, pourvu : 1° qu'on déduise une certaine tare de ces dérivations, qui vont habituellement au delà du but auquel on vise en réalité (§1772) ; 2° que le raisonnement ne nous éloigne pas trop de l'état de cette société ; 3° qu'on ne pousse pas à l'extrême limite logique le raisonnement qui a pour prémisses les résidus correspondant à ces dérivations. Les termes certaine tare, trop, extrême limite, sont peu précis, justement parce qu'on ne précise pas les limites entre lesquelles les dérivations ou les résidus qui les produisent, correspondent aux faits, et aussi parce que, dans le langage vulgaire, les dérivations sont exprimées d'une manière peu ou pas rigoureuse. On énoncerait peut-être plus clairement la dernière des conditions posées tout à l'heure, en disant que le raisonnement sur les dérivations doit être plus de forme que de fond, et qu'en réalité il convient de se laisser guider par le sentiment des résidus, plutôt que par la simple logique [FN:§ 1778-1].
§ 1779. Vers la fin du XIXe siècle, en France, le parti révolutionnaire trouva bon de mettre en pratique l'œuvre de certains théoriciens qu'on appelle « intellectuels », et qui voulaient précisément soumettre la pratique aux conclusions qu'ils tiraient logiquement de certains de leurs principes (§1767-1). Les « intellectuels » croyaient naïvement récolter l'admiration des gens qui se servaient d'eux uniquement comme d'instruments ; et ils opposaient orgueilleusement les splendeurs de leur logique aux ténèbres des « préjugés » et des « superstitions » de leurs adversaires ; mais, en fait, ils s'éloignaient de la réalité beaucoup plus que ceux-ci. Par exemple, quelques « intellectuels » partaient du principe qu'on ne doit jamais condamner un innocent, et en tiraient les conséquences les plus extrêmes, sans vouloir entendre autre chose (§2147, exemple II). Il est évident que ce principe est utile à une société, mais il est vrai aussi que cela n'a lieu qu'en de certaines limites. Pour réfuter cette affirmation, il serait nécessaire de suivre l'une des deux voies suivantes : 1° nier qu'il puisse y avoir divergence entre l'observation de ce principe et la prospérité d'une nation ; 2° ou bien affirmer que l'homme ne doit pas se soucier de cette prospérité, mais bien se contenter de suivre ce principe. Ni l'une ni l'autre de ces propositions n'étaient admises par les « intellectuels », gens en réalité beaucoup moins logiques qu'ils ne voulaient le paraître ; elles auraient mieux trouvé leur place parmi les « superstitions » attaquées par les « intellectuels », car la première ne diffère pas beaucoup de celle qui affirme que Dieu récompense les bons et punit les méchants ; la seconde est celle du croyant ascète qui méprise les biens terrestres. La politique faite de cette manière est puérile ; et les « intellectuels » étaient ainsi plus loin de la réalité que beaucoup de politiciens pratiques de petite envergure.
§ 1780. On peut parcourir à rebours la voie suivie par les dérivations ; c'est-à-dire que de certaines manifestations on peut déduire les principes dont elles sont la conséquence logique. Dans les sciences logico-expérimentales, si les manifestations concordent avec les faits, les principes dont ils sont la conséquence concordent aussi. Il n'en est pas ainsi dans les raisonnements à dérivations : les principes dont les manifestations seraient la conséquence logique, peuvent être en contradiction complète avec les faits (§2024).
§ 1781. Par exemple, voici un tolstoïen qui réprouve toute guerre, même si elle est strictement défensive. Le principe dont on déduit cette doctrine est que les hommes, pour être heureux, « ne doivent pas résister au mal ». Mais le résidu qui est ainsi exprimé est très différent ; c'est un résidu subjectif, au lieu d'être un résidu objectif. Pour demeurer en accord avec les faits, le tolstoïen devrait dire : « Je m'imagine que je serais heureux si je ne résistais pas au mal ». Ce qui n'empêche pas qu'un autre puisse, au contraire, se sentir malheureux s'il ne résiste pas au mal ; et pour changer sa proposition subjective en proposition objective, le tolstoïen devrait démontrer, ce qu'il ne fait ni ne peut faire, que les autres hommes doivent se rendre malheureux pour lui faire plaisir. Le tolstoïen qui raisonne avec une logique rigoureuse, tire du principe que « l'on ne doit pas résister au mal », des conséquences qui peuvent atteindre le comble de l'absurde. Le tolstoïen qui ne s'est pas placé entièrement en dehors de la réalité, sacrifie la logique, se laisse guider par les sentiments, parmi lesquels il y a aussi ceux de la conservation individuelle et de la conservation sociale, et aboutit à des conséquences moins absurdes ; bien plus, s'il sait employer une subtile casuistique, et s'il ne répugne pas à laisser de côté la logique rigoureuse, il peut même aboutir à des conséquences qui concordent avec les faits.
§ 1782. De cette façon, et pour résumer, nous sommes portés à affirmer qu'en des cas semblables, raisonner avec une logique tout à fait rigoureuse conduit à des conclusions contredites par les faits, et que raisonner très défectueusement au point de vue logique, avec des sophismes évidents, peut conduire à des conclusions qui se rapprochent beaucoup plus des faits.
§ 1783. Cette proposition provoquera l'indignation des nombreuses personnes qui s'imaginent que raison et logique sont les guides des sociétés humaines ; et pourtant ces personnes admettent sans s'en apercevoir, et sous d'autres formes, des propositions qui sont équivalentes à celle-là. Par exemple, tout le monde a toujours, opposé la théorie à la pratique ; et même les hommes qui, en certaines matières, sont exclusivement théoriciens, reconnaissent en d'autres matières l’utilité, la nécessité de la pratique. De semblables propositions sont des dérivations qui manifestent les faits suivants. 1° Quand la théorie part de propositions rigoureusement scientifiques, elle isole par abstraction un phénomène qui, en réalité, est lié à d'autres. 2° Quand la théorie part de propositions empiriques qui ne sont vraies qu'en de certaines limites, nous sommes exposés, dans le raisonnement, à sortir de ces limites sans nous en apercevoir. 3° Quand la théorie part de dérivations, celles-ci, manquant habituellement de précision, ne peuvent servir de prémisses à un raisonnement rigoureux. 4° Dans ce cas, nous savons peu de chose ou rien des limites au-delà desquelles les dérivations cessent d'être vraies, si même elles ne sont entièrement fausses. Toutes les difficultés que nous venons de relever, et d'autres semblables, font que souvent l'homme pratique, qui se laisse guider parles résidus, aboutit à des conclusions que les faits vérifient beaucoup mieux que celles de l'homme exclusivement théoricien, qui raisonne en toute logique.
§ 1784. En politique, le théoricien n'a pas encore pu prendre une revanche comme il l'a eue en beaucoup d'arts. Quand les circonstances futures d'un phénomène diffèrent beaucoup de celles où l'empirique a vu se produire un phénomène donné, l'empirique ne peut rien prévoir au sujet de ce phénomène, et s'il l'essaie, il se trompe sûrement, sauf les quelques cas où il devine tout à fait au hasard. Au contraire, si le théoricien a à sa disposition une théorie qui n'est pas trop imparfaite, il peut prévoir des faits qui se rapprochent de ceux qui ont lieu réellement.
§ 1785. Au moyen âge, les maîtres maçons ont construit des édifices merveilleux. Ils y sont arrivés par la pratique et l'empirisme, sans avoir la plus lointaine idée de la théorie de la résistance des matériaux, mais uniquement en essayant à plusieurs reprises, en se trompant et en rectifiant les erreurs. Grâce à la théorie de la résistance des matériaux, les architectes modernes, non seulement évitent en grande partie ces erreurs, mais en outre construisent des édifices que les maîtres maçons ou d'autres artisans des siècles passés n'auraient jamais su construire. La pratique avait enseigné aux médecins certains remèdes, qui étaient souvent meilleurs que ceux des charlatans ou des alchimistes, et qui quelquefois aussi ne valaient rien du tout. Aujourd'hui, les théories chimiques ont fait disparaître, non pas toutes, mais un très grand nombre des erreurs où l'on tombait autrefois, et la biologie a permis de faire un meilleur usage des nombreuses substances que la chimie met à la disposition des médecins. Il y a peu de temps, pour produire de la fonte dans un haut fourneau, il valait mieux suivre les prescriptions d'un empirique que celles d'un théoricien. Maintenant, cette industrie ne s'exerce plus sans l'aide de chimistes et d'autres théoriciens. On en peut dire autant de la teinturerie et de beaucoup d'autres arts.
§ 1786. Au contraire, pour la politique et pour l'économie politique, nous sommes encore bien loin du jour où la théorie pourra donner des prescriptions utiles. Ce n'est pas seulement la difficulté de la matière qui nous éloigne de ce jour, mais aussi l'invasion de la métaphysique et de ses raisonnements, qui seraient mieux nommés divagations, et le fait singulier que cette invasion a son utilité, puisque le raisonnement par dérivations métaphysiques – ou théologiques – est le seul que beaucoup d'hommes soient capables de tenir et de comprendre. Ici apparaît très caractérisé le phénomène du contraste entre connaître et agir. Pour connaître, la science logico-expérimentale seule a de la valeur ; pour agir, il vaut beaucoup mieux se laisser guider par les sentiments. Ici apparaît aussi un autre phénomène important : celui de l'efficacité de la division d'une collectivité en deux parties, afin de faire disparaître cette opposition. La première partie, dans laquelle prédomine le savoir, régit et dirige l'autre, dans laquelle prédominent les sentiments ; de telle sorte qu'en conclusion l'action est bien dirigée et énergique.
§ 1787. Nous avons vu que, dans les prévisions politico-sociales, il y a un grand nombre de cas où l'on aboutit plus facilement à des résultats en accord avec les faits, en prenant pour guides les résidus plutôt que les dérivations. C'est pourquoi, dans les cas indiqués, les prévisions seront d'autant meilleures que les dérivations se mêleront moins aux résidus. Tout au contraire, lorsqu'on veut obtenir des propositions scientifiques, connaître les rapports des choses et des faits, abstraire de cas concrets un phénomène donné pour l'étudier, on atteindra le but d'autant mieux que les résidus nous guideront moins dans le raisonnement, que celui-ci sera exclusivement logico-expérimental, et que les résidus seront uniquement considérés comme faits externes, jamais subis comme dominant notre pensée. En d'autres termes, les déductions pratiques ont avantage à être essentiellement synthétiques et inspirées par les résidus ; les déductions scientifiques, à être essentiellement analytiques, et de pure observation (expérience) appuyée de déductions logiques.
§ 1788. Si nous voulons nous servir des termes vulgaires de « pratique » et de « théorie», nous dirons que la pratique est d'autant meilleure qu'elle est plus pratique, la théorie d'autant meilleure qu'elle est plus théorique. La pratique théorique ou la théorie pratique sont en général très mauvaises.
§ 1789. Les hommes pratiques sont souvent poussés à donner une théorie de leurs actions, laquelle vaut habituellement peu de chose ou rien du tout. Ils savent faire; ils ne savent pas expliquer pourquoi ils font. Les théories de ces hommes sont presque toujours des dérivations qui n'ont pas le moindre rapport avec les théories logico-expérimentales.
§ 1790. Le contraste entre la pratique et la théorie prend quelquefois la forme d'une négation absolue de la théorie. Par exemple, une certaine « école historique » a nié non seulement l'existence des théories économiques, mais aussi celle de lois en cette matière (§2019 et sv.). Si, après cela, les adeptes de cette école s'étaient bornés à s'occuper de la pratique, ils auraient pu prendre rang parmi les hommes d'État, au lieu de n'être que des sophistes et des faiseurs de vains discours, comme ils l'ont été. Il y aurait eu beaucoup de vérité, dans le fond de leurs croyances, et seule la façon de les exprimer aurait été erronée. Ils auraient dû dire que les théories de l'économie politique et de la sociologie ne sont pas encore capables d'effectuer la synthèse des phénomènes sociaux, de nous donner des prévisions sûres pour les phénomènes concrets, et que, par conséquent, à l'instar de ce qui est arrivé en
d'autres branches du savoir humain, tant que la théorie n'est pas beaucoup plus avancée, il convient de se contenter de la pratique et de l'empirisme.
§ 1791. Mais les adeptes de « l'école historique » étaient surtout des théoriciens. Leurs critiques aux théories de l'économie politique étaient des critiques de théoriciens ; ils appelaient « pratiques » leurs critiques, croyant changer le fond en changeant le nom. En réalité, leurs théories sont bien plus mauvaises que celles de l'économie politique, car elles se fondent sur des dérivations éthiques dépourvues de toute précision et sans beaucoup ou même sans aucun rapport avec les faits, tandis que les théories économiques trouvent au moins un appui dans les faits, et ne pèchent que parce qu'elles sont incomplètes et qu'elles ne peuvent faire la synthèse des phénomènes sociaux concrets. Ces dernières théories sont imparfaites ; les premières sont erronées et souvent fantaisistes.
§ 1792. Remarquez la contradiction de ces prétendus historiens. D'un côté, ils affirment qu'il n'existe pas de lois, C'est-à-dire d'uniformités, en économie politique ni en sociologie. D'un autre côté, ils raisonnent d'une façon qui présuppose nécessairement l'existence de ces lois. D'abord, à quoi peut bien servir leur étude de l'histoire, s'il n'existe pas d'uniformités, et si, par conséquent, l'avenir n'a aucun rapport avec le passé ? C'est une pure perte de temps, et il vaudrait mieux lire des contes de fées ou des romans qu'étudier l'histoire. Celui qui, au contraire, estime que l'on peut tirer du passé des règles pour l'avenir, admet par cela même qu'il existe des uniformités.
Ensuite, si l'on s'attache au fond du sujet, on ne tarde pas à voir que l'erreur de ces braves gens provient de ce qu'ils ne sont jamais arrivés à comprendre qu'une loi scientifique n'est autre chose qu'une uniformité. L'esprit faussé par les divagations de leur métaphysique et de leur éthique, brûlant du désir de trouver des dérivations qui puissent justifier certains courants sentimentaux, et plaire à un public ignorant autant qu'eux de toute règle du raisonnement scientifique, ils s'imaginent que les lois économiques et sociales sont des êtres mystérieux et puissants, qui voudraient s'imposer à la société, et ils s'insurgent contre ces prétentions, surtout s'il s'agit de lois qui leur déplaisent ; tandis qu'ils admettent ces prétentions avec empressement, s'il s'agit des lois imaginaires de la métaphysique et de l'éthique. Ils sont les croyants d'une religion différente de celle à laquelle ils s'opposent ; ils nient les lois, supposées absolues, de leurs adversaires. Mais à ces divinités, ils en substituent d'autres, qui sont tout autant étrangères au monde logico-expérimental. Certaines lois les gênaient ; ils ne se sentaient pas capables de les réfuter ; ils étaient étrangers au raisonnement scientifique, et de ce fait incapables de comprendre que ni ces lois ni d'autres d'aucun genre ne pouvaient avoir un caractère absolu. C'est pourquoi, afin de supprimer l'obstacle qui se présentait à eux, ils agirent comme les croyants d'une religion nouvelle, qui abattent les anciens autels pour en élever de nouveaux ; comme agirent les chrétiens, en proclamant que les dieux des païens étaient de vains simulacres, et que seul leur Dieu était vivant et vrai. Ils ne manquaient pas d'ajouter à la persuasion de la foi, de pseudo-raisonnements pour démontrer que leur religion était beaucoup plus rationnelle que l'ancienne. Ces balivernes acquièrent et conservent du crédit, parce qu'elles conviennent aux sentiments et à l'ignorance de qui les écoute. On s'explique ainsi que les historiens, en économie, peuvent, avec peu ou point de difficulté, continuer à répéter comme des perroquets que les lois économiques et les lois sociologiques souffrent des « exceptions », tandis que – disent-ils – ce n'est pas le cas des lois scientifiques. Ils ne savent pas, ils ne soupçonnent même pas que leurs « exceptions » ne sont autre chose que des phénomènes qui proviennent de l'intervention de causes étrangères à celles que la science considère par abstraction, et que cette intervention existe en chimie, en physique, en géologie et dans toutes les sciences, comme en économie et en sociologie. Les différences sont tout autres qu'ils ne se les figurent. Elles consistent dans le degré de difficulté à séparer par abstraction, ou même matériellement, certains phénomènes de certains autres. Parmi ces différences, il convient de noter que certaines sciences, ainsi la géologie, doivent recourir surtout à l'observation (différente de l'expérience) ; elles ne peuvent séparer matériellement un phénomène des autres, comme le peuvent faire les sciences telles que la chimie, qui sont en mesure de recourir largement à l'expérience (différente ici de la simple observation). À ce point de vue, l'économie politique et la sociologie se rapprochent de la géologie et s'éloignent de la chimie.
§ 1793. La haine de Napoléon Ier pour « l'idéologie » manifeste nettement le contraste entre la pratique et la théorie. Dans la séance du 20 décembre 1812, Napoléon Ier, répondant au Conseil d'État, accuse l'idéologie d'avoir occasionné les malheurs qui avaient frappé la France, et lui oppose l'étude de l'histoire [FN: § 1793-1]. Cette dernière observation est excellente, puisqu'elle conseille de recourir à l'expérience, qui est l'origine et la source de toute science. Mais, précisément par ce fait, elle contredit l'invocation de Napoléon aux « principes sacrés de la justice », invocation qui appartient à la métaphysique pure. Napoléon ne s'apercevait pas qu'ainsi il ne faisait qu'opposer une « idéologie » à une autre « idéologie » ; et lorsqu'il affirme que cette dernière est la cause des malheurs de la France, il exprime une théorie, qui peut concorder ou ne pas concorder avec les faits, mais qui, de toute façon, demeure une théorie.
§ 1794. Des cas semblables se présentent pour beaucoup d'auteurs qui, en parole, repoussent les théories, et en fait opposent simplement une théorie à une autre théorie. Taine [FN: § 1794-1], par exemple, met parmi les causes de la Révolution française l'usage de la « méthode mathématique », terme par lequel il entend les déductions de pure logique. « (p. 304) Conformément aux habitudes de l'esprit classique et aux préceptes de l'idéologie régnante, on construit la politique sur le modèle des mathématiques. On isole une donnée simple, très générale, très accessible à l'observation, très familière, et que l'écolier le plus inattentif et le plus ignorant peut aisément saisir ». En effet, de cette façon est constituée non seulement cette théorie, mais toutes les théories, excepté la considération de l'écolier ignorant. La conséquence à tirer de ce fait est qu'aucune théorie, même lorsqu'elle part de principes expérimentaux [FN: § 1794-2], ce qui arrive rarement pour les théories sociales (§1859), ne peut, si elle est considérée séparément, représenter les phénomènes concrets et complexes. C'est pourquoi, après avoir séparé les phénomènes par l'analyse scientifique, et en avoir ainsi étudié les différentes parties, il est nécessaire de les réunir, et de procéder à la synthèse, qui fera connaître le phénomène concret. Taine n'entend nullement s'engager dans cette voie. Il note une erreur de raisonnement, et veut démontrer qu'elle fut l'origine des malheurs de la France. En agissant ainsi, il crée une théorie aussi abstraite, aussi unilatérale, aussi « mathématique » que celles qu'il réprouve. De plus, cette théorie est fausse, parce qu'il prend l'effet pour la cause, ou mieux parce qu'elle ne tient pas compte de la mutuelle dépendance des faits.
§ 1795. L'usage de ce que Taine appelle la « méthode mathématique » n'a certainement pas produit la Révolution, et jamais aucune méthode n'eut ce pouvoir. Mais, en réalité, il y avait en France un certain état d'esprit qui se manifestait théoriquement par cette « méthode » notée par Taine, et pratiquement par les actes qui préparaient la Révolution.
§ 1796. Sous d'autres formes encore apparaît le sentiment confus, indistinct qui oppose la pratique à la théorie, et qui, somme toute, est mû par l'intuition que, pour se rapprocher des faits, il convient de raisonner sur les résidus plutôt que sur les dérivations. De ce genre est l'assertion qu'en toute chose il faut s'en tenir au « juste milieu » ; ou celle-ci, que les prescriptions (dérivations) doivent être interprétées suivant « l'esprit » et non suivant la lettre ; ce qui toutefois signifie souvent qu'on doit les interpréter dans le sens qui plaît à celui qui fait cette observation.
§ 1797. DÉRIVATIONS INDÉTERMINÉES ; COMMENT ELLES S'ADAPTENT À CERTAINES FINS. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§1772), les dérivations vont habituellement au delà des limites de la réalité. Parfois, comme dans les mythes, les hommes ne se soucient pas d'une telle divergence ; mais parfois, comme dans les dérivations pseudo-expérimentales, ils s'efforcent, par différents moyens, d'établir un certain accord avec la réalité. Parmi ces moyens, celui de l'indétermination des termes par lesquels on exprime la dérivation, est très efficace. Il n'existe presque aucune prescription morale ou religieuse qu'on puisse suivre à la lettre. Cela montre bien l'écart qui existe entre les dérivations et la réalité, et comment les premières s'adaptent à cette dernière, parce qu'elles permettent des interprétations sophistiques. Les dérivations peuvent être employées uniquement pour rechercher les résidus qu'elles manifestent, mais ne peuvent servir de prémisses à des raisonnements rigoureusement logiques, pour en déduire des conclusions en accord avec la réalité.
§ 1798. C'est ce que les croyants théologiens ou métaphysiciens ne veulent pas admettre. Ils prétendent que leurs prescriptions sont claires, précises, rigoureuses, et qu'elles correspondent entièrement à la réalité. Malgré cela, ils ne sont pas disposés à accepter toutes les conséquences qu'on en peut tirer. Pour repousser la conclusion d'un raisonnement, il est nécessaire de nier les prémisses ou de ne pas accepter la manière d'en tirer les conclusions. Les croyants ne veulent pas suivre la première voie. Ils sont donc nécessairement contraints de suivre la seconde. C'est pourquoi, parmi eux, il en est qui nient sans autre que l'on puisse raisonner logiquement sur leurs prémisses, et qui veulent qu'on les prenne non « suivant la lettre, mais suivant l'esprit ». Il en est d'autres qui, au lieu de repousser la logique, la prennent pour alliée, et demandent à la casuistique le moyen de conserver les prémisses et d'échapper à certaines de leurs conséquences. Viennent enfin d'autres encore, qui suppriment tout à fait le problème gênant, en affirmant que rien n' « existe » si ce n'est les concepts de l'esprit humain – lequel, au fond, n'est autre que leur esprit – que cet esprit « crée la réalité ». Il est par conséquent manifeste qu'aucune divergence ne peut exister entre leurs conceptions et l'expérience. C'est là un moyen vraiment excellent de repousser toute objection de la science expérimentale [FN: § 1798-1] (§1910 et sv.).
§ 1799. Les religions sont idéalistes ; elles ne pourraient être autrement, sans cesser d'être des religions, et sans perdre toute efficacité et toute utilité sociale. Elles dépassent la réalité, et pourtant elles doivent vivre et se développer dans la réalité. Il est donc nécessaire qu'elles trouvent moyen de faire concorder idéalisme et réalité. Pour cela, les actions non-logiques viennent à l'aide, et, pour justifier ces actions non-logiques, on a recours aux dérivations et à la casuistique. Il arrive souvent que ce fait est amèrement reproché à une religion donnée par ses adversaires, qui devraient, au contraire, la louer de savoir conserver le stimulant de l'idéalisme, en le conciliant avec les nécessités de la réalité, et qui, se servant eux-mêmes de ces moyens et de ces procédés, font voir clairement qu'on ne peut pas s'en passer. On pourrait donner une infinité de preuves de ces faits, prises en toute contrée et en toute religion. Nous nous bornerons ici à quelques exemples pris dans nos contrées et dans la religion chrétienne [FN:§ 1799-1]. On sait que celle-ci, au fur et à mesure qu'elle faisait des prosélytes dans le monde romain, dut se relâcher de son rigorisme primitif, et tolérer des libertés que d'abord elle condamnait énergiquement. En outre, beaucoup de conversions étaient en grande partie purement formelles, beaucoup de changements, de forme plutôt que de fond. C'est ce qui arriva surtout pour les conversions des Barbares, au temps de la chute de l'empire romain. Par exemple, on peut voir dans Saint Grégoire de Tours combien mince était la couche de vernis chrétien des rois francs et des chefs barbares, qui adaptaient la nouvelle religion à leur tempérament sauvage et batailleur. C'est justement pourquoi les régions occidentales du bassin de la Méditerranée purent mieux résister aux invasions asiatiques que les régions orientales, où le tempérament des habitants était et devenait plus doux. Un peuple d'ascètes et de moines, tel qu'il devrait être formé, s'il prenait à la lettre les dérivations des premiers chrétiens, ne peut pas être un peuple belliqueux ; et l'on ne voit pas comment des hommes qui véritablement « ne résisteraient pas au mal », pourraient résister à l'envahisseur de leur pays. Heureusement pour les peuples des régions occidentales de la Méditerranée, les dérivations chrétiennes n'affaiblirent pas du tout leurs instincts belliqueux ; elles en tempérèrent seulement les excès qui pouvaient être nuisibles. On peut aujourd'hui observer quelque chose de semblable, mais en de bien moindres proportions, dans le contraste qui existe entre la France et l'Allemagne. Dans le premier de ces pays règne la religion démocratico-humanitaire, qui semble être contraire aux qualités belliqueuses du peuple. Dans le second subsiste la religion patriotique, qui les exalte. Mais ce contraste peut tenir plus de la forme que du fond, ou bien être passager, et correspondre seulement à l'une des si nombreuses oscillations qu'on observe dans les phénomènes sociaux. Messieurs les éthiques ont coutume de parler avec horreur des prélats guerriers et des barons bardés de fer du moyen âge ; mais ils devraient se dire que si les sentiments qui se manifestaient de cette façon avaient disparu, les pays de l'Europe occidentale auraient eu le sort des pays de l'Asie Mineure et de la Turquie d'Europe, et nos philosophes, au lieu de pouvoir déraisonner commodément en un pays civilisé, auraient servi quelque conquérant asiatique. D'autres braves gens s'indignent hautement parce qu'au moyen âge et un peu plus tard, le Saint-Siège ne fut pas assez religieux ou pas assez « chrétien », comme ils le disent, et parce qu'il sut opportunément concilier les dérivations chrétiennes avec les nécessités sociales et politiques. Mais c'est précisément une des causes qui ont permis à la civilisation présente de renaître, après la décadence de la civilisation gréco-latine, puis de croître et de se développer. Celui qui rejette et blâme cette civilisation peut aussi en blâmer les origines. Il n'en est pas ainsi de qui l'accepte, la loue, en jouit, car la contradiction ne permet pas qu'on veuille la fin sans accepter les moyens. Nous n'entendons ainsi nullement affirmer que tout fût utile à la société, dans cette entreprise pour concilier certaines dérivations religieuses et morales avec la pratique de la vie. Il est certain, au contraire, qu'il y avait une partie utile et une partie nuisible ; nous voulons seulement dire que la première fut plus importante que la seconde.
§ 1800. La majeure partie des préceptes de l'Évangile sont des dérivations poétiques qui révèlent certains résidus. C'est justement parce qu'ils manquent de précision, et souvent se contredisent, qu'ils ont pu être acceptés en des temps si différents, par toute espèce de peuples. Quand les résidus de la Ie classe prédominent, on interprète les préceptes de l'Évangile de façon à les rendre compatibles avec la vie ordinaire. Quand les résidus de la IIe classe et ceux de l'ascétisme prédominent, on s'efforce de s'en tenir au sens littéral, et de s'en servir contre tout progrès de la civilisation. Par exemple, toute prévoyance disparaîtrait, et les peuples civilisés retourneraient à l'état sauvage, si l'on prenait à la lettre le précepte d'après lequel on ne doit pas épargner, pas se soucier de l'avenir plus que ne s'en soucient les oiseaux des champs [FN:§ 1800-1]. Si l'on veut entendre dans leur sens rigoureux les règles données de cette manière, ces règles ne s'appliquent qu'à l'imprévoyant et au vagabond. Par conséquent, en toute société civilisée, il est nécessaire de corriger ces règles par quelque interprétation [FN:§ 1800-2]. Généralement on a voulu les entendre en ce sens qu'il faut s'occuper plus de l'âme que du corps ; mais, en ce cas, à quoi s'appliquent les exemples des oiseaux et du lis ? Ont-ils peut-être une âme dont ils s'occupent plus que de leur corps ?
§ 1801. Les observations de Saint Jérôme sont dignes de remarque [FN:§ 1801-1]. Il veut, au fond, que nous entendions les paroles de Saint Matthieu dans ce sens que nous devons, il est vrai, travailler pour nous procurer le pain quotidien, mais que nous ne devons nous soucier de l'avenir en aucune façon.
§ 1802. Le pur ascétisme, qu'on trouve non seulement dans la religion chrétienne, mais en d'autres, fuit le travail, et de tout temps il y eut des hommes qui vécurent oisifs, en parasites de la société. Cette attitude est la conséquence de certains sentiments, et non de raisonnements, qui interviennent seulement a posteriori pour donner une justification logique des actions. Diogène vivait à peu près comme un frère capucin, en ce qui concerne les moyens d'existence ; mais il donnait de son attitude des motifs différents de ceux qu'avançait le frère. Lorsque ces raisonnements ont des conséquences qui heurtent trop violemment les conditions de la vie individuelle ou sociale, ils se modifient nécessairement pour s'adapter à ces conditions. Il y eut de tout temps des saints, des ermites, des fanatiques, qui voulurent prendre à la lettre les paroles de l'Évangile. En revanche, il y eut des hommes au courant des nécessités de l'existence ordinaire, qui s'efforcèrent de donner de l'Évangile une interprétation qui ne fût pas trop rigoureuse.
§ 1803. Il paraît qu'au temps de Saint Augustin, il y avait des personnes qui suivaient le sens littéral de ces préceptes, et l'opposaient au conseil que donne Saint Paul de travailler. Saint Augustin n'éprouve aucune difficulté pour concilier des préceptes si différents [FN: § 1803-1], et, par un procédé logique étrange, il tire de cette contradiction même la démonstration que la contradiction n'existe pas. En résumé, son raisonnement est le suivant : « Vous dites que A contredit B ? Eh bien non, cela prouve que l'on doit entendre B d'une façon différente du sens littéral ». La conception de Saint Augustin est évidemment que les Saintes Écritures constituent un ensemble dont les parties ne peuvent jamais se contredire. C'est pourquoi il n'y a en elles aucune contradiction, parce qu'il ne peut pas y en avoir. Saint Augustin [FN:§ 1803-2] dit qu'il a dû écrire le livre du travail des moines, parce que, parmi ceux-ci, il en était qui ne voulaient pas travailler, croyant ainsi obéir à l'Évangile. Le Saint montre leur erreur et leur contradiction, du fait qu'effectivement ils ne suivent pas le précepte évangélique à la lettre. À la vérité, il démontre ainsi uniquement que le suivre à la lettre est très difficile, ou pour mieux dire impossible ; mais il ne démontre nullement que le sens soit autre que celui des termes employés. Pour se sortir d'embarras, le Saint change entièrement le sens des paroles de l'Évangile. Il dit [FN: § 1803-3] : « Tout le précepte se réduit donc à la règle que, même en étant prévoyants, nous devons penser au règne de Dieu, et qu'en combattant pour le règne de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter de la prévoyance [des biens matériels] » On trouve de semblables interprétations chez d'autres saints Pères, qui cherchent le moyen de concilier le texte, pourtant bien clair, de l'Évangile, avec la nécessité de la vie des peuples civilisés [FN:§ 1803-4].
Saint Thomas a une ingénieuse interprétation, par laquelle il cherche à ménager la chèvre et le chou. Il examine la question : « Quel doit être le souci de l'avenir ? [FN: § 1803-5] » Comme d'habitude, il commence par citer les arguments en faveur de la solution qu'il rejette ensuite. Dans le présent cas, cette solution est qu'on doit avoir souci de l'avenir. Sont en faveur de cette thèse : 1° le passage (Prov., VI, 6), où l'on trouve l'exemple de la fourmi prévoyante ; 2° la prévoyance appartient à la prudence, qui est une vertu ; 3° le passage (Jean, XII), d'où il appert que le Christ avait une bourse, confiée à Judas, et cet autre (Act., IV, 34, 35), où il est dit que les apôtres gardaient le prix des terres qui était déposé à leurs pieds. « Il est donc permis d'avoir le souci de l'avenir. Mais ce que dit le Seigneur (Matth., VI, 34) est contraire à cela : Nolite solliciti esse in crastinum... Conclusion : il faut que l'homme ait le souci de l'avenir en temps convenable et opportun, non pas en dehors de ce temps ». On ne voit pas trace de cette invention du « temps convenable et opportun » dans l'Évangile, et surtout pas des explications qu'ajoute Saint Thomas : « À chaque jour suffit sa peine ; c'est ainsi qu'à l'été revient le soin de moissonner, à l'automne de vendanger. Si donc quelqu'un se souciait déjà de la vendange en été, il se mettrait à tort en souci pour l'avenir. C'est pourquoi ce souci, étant superflu, est prohibé par le Seigneur, lorsqu'il dit : Nolite solliciti esse in crastinum... Quant à l'exemple de la fourmi, on répond « que la fourmi a le souci convenant au temps, et que, par ce fait, elle nous est donnée comme devant être imitée ». Quand on voit un génie puissant, tel que Saint Thomas, recourir à de si misérables arguments, il faut vraiment reconnaître que mettre d'accord la lettre du précepte évangélique avec les nécessités pratiques de la vie est une entreprise désespérée.
§ 1804. Au IVe siècle de notre ère, parut l'hérésie des masaliens, appelés aussi euchites et enthousiastes. On dit qu'à l'origine ce furent des Gentils [FN: § 1804-1] ; cela peut être, car enfin on trouve les résidus d'ascétisme chez les Gentils, comme chez les chrétiens. Ensuite, il y eut des hérétiques chrétiens de cette sorte. Ceux-ci fuyaient le travail manuel et passaient leur temps à prier et à dormir [FN: § 1804-2]. L'Église catholique, qui fut toujours étrangère à de telles extravagances, les repoussa, et voulut du moins discipliner la vie contemplative, mais en tout temps, elle eut à batailler contre de semblables tendances.
§ 1805. À ce point de vue, remarquable est la controverse avec les franciscains, qui voulaient s'imposer à l'Église, et que l'Église sut, au contraire, s'assimiler et employer à ses fins. C'est là un des si nombreux exemples où l'on voit que l'art de gouverner consiste à se servir des résidus, et non à vouloir les modifier.
§ 1806. Au XIIe et au XIIIe siècle, il se produisit, en Italie et en France, une renaissance de la civilisation, renaissance qui se manifestait, comme toujours, par la recrudescence des résidus de la Ie classe, qui disputaient le terrain aux résidus de la IIe classe. Le clergé qui, en ce temps, était l'unique classe intellectuelle de la société, se rapprochait peu à peu, dans ses mœurs, de la société laïque. Les moralistes décrivent le phénomène comme une « perversion » des mœurs du clergé catholique. C'est ainsi qu'ils le décriront de nouveau, au temps de la Renaissance et de la Réforme protestante. Ils ont raison, si l'on admet le point de vue auquel ils envisagent les faits. Mais il en est un autre aussi, qui est celui du progrès de la civilisation ; et, sous cet aspect, la « perversion » des mœurs du clergé est une « amélioration » dans les conditions d'existence des peuples civilisés, lesquelles, ou bien ne s'améliorent pas, ou bien même empirent, sitôt que ces mœurs sont « corrigées ou réformées », grâce à une augmentation considérable de certains résidus de la IIe classe et de l'ascétisme. Ce n'est pas que les mœurs bonnes ou mauvaises du clergé aient un rapport direct avec le progrès de la civilisation ; mais elles sont un indice de l'influence de certains résidus de la IIe classe, de même que l'ascension du mercure dans un thermomètre n'est pas la cause de l'élévation de la température, mais en est seulement l'indice. Au XIIe et au XIIIe siècle, une marée de religiosité, venue, comme toujours, des classes inférieures, arrêta le progrès de la civilisation, de même que l'arrêta, mais pour peu de temps, la marée de religiosité de la Réforme protestante. La marée du moyen âge provoqua l'Inquisition ; celle du XVIe siècle fit naître les jésuites. Toutes deux retardèrent pour plusieurs siècles la liberté de pensée (résidus de la Ie classe) à laquelle on marchait, lorsqu'elles survinrent. Tels sont les phénomènes ; mais, dans les dérivations, ils apparaissent déformés (§2329 et sv.).
§ 1807. L'une des plus grandes déformations est celle dont nous allons nous occuper tout à l'heure en détail ; elle voit, dans les phénomènes, des conséquences de certaines interprétations logiques de l'Écriture Sainte, on y trouve des applications d'autres raisonnements semblables. Une autre déformation n'est certes pas à négliger : c'est celle qui met d'un côté la papauté, qui veut gouverner despotiquement et imposer la « superstition », de l'autre les hérétiques, qui veulent avoir la « liberté », et faire usage du raisonnement scientifique. En fait, la « superstition », ou si l'on veut la « religiosité », était plus grande chez les hérétiques. Ceux-ci accordaient moins de liberté, et là où ils dominaient, ils imposaient des règles très restrictives et pénibles, dictées par leur ascétisme [FN: § 1807-1]. Il faut prendre garde que les marées de religiosité (prédominance des résidus de la IIe classe) se sont produites autant dans la partie orthodoxe que dans la partie hérétique ou schismatique ; cela démontre encore plus que l'orthodoxie et l'hérésie, ou le schisme, ne furent autre chose que des voiles recouvrant un fond commun.
§ 1808. Cette déformation et d'autres semblables donnent lieu à de très nombreuses interprétations des faits. Celui qui est ennemi de la papauté, par exemple, approuve nécessairement tous les hérétiques et les schismatiques ; et il est comique de voir des libres penseurs, ennemis de toute religion – disent-ils – admirer ceux qui voulaient imposer des formes religieuses extrêmement strictes et rigoureuses. Combien d'admirateurs modernes de Calvin, s'ils avaient vécu de son temps, eussent été persécutés et opprimés par lui ! Villari, qui se dit « positiviste », admire Savonarola, uniquement parce qu'il était ennemi du pape ; mais si Villari avait vécu sous le pouvoir de ce frère, il ne s'en serait pas tiré en douceur, lui et ses « vanités ». Somme toute, le pape Borgia n'opprimait ni la littérature ni la science, et Savonarola, s'il avait pu gouverner, aurait détruit toute littérature profane, toute science, sauf peut-être la théologie, pour autant qu'on peut l'appeler une science. Nous ne recherchons pas ici si cela eût été « bien » ou « mal »; nous entendons seulement noter la contradiction qui existe, à vouloir admirer en même temps la « science libre » et la superstition envahissante et opprimante de Savonarola.
§ 1809. La marée de religiosité qui se produisit au moyen âge, se manifesta en partie par des hérésies comme celle des Albigeois, en partie par des œuvres qui étaient orthodoxes, sinon en fait, du moins en apparence. Telle fut l'institut, un des ordres mendiants. Saint François d'Assise, qui a des admirateurs jusqu'en nos temps, même parmi les fidèles du dieu Progrès, fut le fondateur d'un ordre de Frères dont les paroles évangéliques citées plus haut étaient – ou devaient être – la règle rigoureuse. Il est maniteste que ces personnes ne peuvent être qu'une exception dans une société civilisée. Si les franciscains doivent vivre d'aumône, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un pour la leur faire. S'ils ne doivent pas penser au lendemain, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui y pense pour eux. Ils peuvent être imprévoyants, s'ils vivent en une société de gens prévoyants ; autrement, ils mourraient de faim, et tout serait dit.
§ 1810. L'attitude des papes, en présence du phénomène franciscain, dépendait de causes diverses. Les sentiments de religiosité (résidus de la IIe classe) n'y étaient pas étrangers ; ils se manifestèrent surtout chez Célestin V. Mais c'étaient principalement les résidus de la Ie classe qui agissaient, et les papes avaient à résoudre le problème, qui très souvent s'est présenté aux gouvernants : de savoir, par des combinaisons opportunes, se servir des sentiments qui pourraient leur susciter des adversaires, ou favoriser ceux qui existaient déjà, afin de combattre ces adversaires même. Les flots de la religiosité et de la superstition se soulevaient contre la digue de la papauté. Celle-ci demanda à la religiosité et à la superstition même le moyen de renforcer ce rempart. C'est pourquoi, si l'on regarde superficiellement l'œuvre de la papauté à l'égard des franciscains, elle paraît changeante et contradictoire ; et si, au contraire, l'on pénètre mieux le fond des choses, et que l'on écarte des cas exceptionnels comme celui de Célestin V, elle apparaît parfaitement unie et dirigée vers un même but. Les papes favorisaient les franciscains jusqu'à l'extrême limite de l'orthodoxie ; ils les réprimaient quand ils dépassaient cette limite. Ils voulaient bien se servir d'eux comme d'auxiliaires ; ils ne pouvaient les tolérer comme ennemis. Ils se servaient d'eux volontiers contre les hérétiques, contre le clergé riche et puissant qui voulait se maintenir indépendant du Saint Siège, car pour combattre cette partie du clergé, la réforme des mœurs était une bonne arme ; mais la réforme devait s'arrêter au point au delà duquel le Saint Siège lui-même aurait été lésé. En fin de compte, cette conception l'emporta, parce qu'ainsi qu'il arrive toujours, le prétendu retour à l'Évangile finissait par n'être que le voile de l'hérésie [FN: § 1810-1]. C'est même ce motif fondamental qui, de nos jours, a fait apparaître de nouveaux admirateurs de Saint François, lesquels sont simplement des ennemis du pape et s'ils louent Saint François, c'est pour attaquer le pape.
§ 1811. Il y a aussi, chez eux, un résidu d'humanitarisme démocratique ; il apparaît encore mieux chez leurs prédécesseurs, qui ne furent pas seulement les franciscains, interprètes très stricts de la Règle, mais aussi les cathares et d'autres sectes analogues. Au fond, l'œuvre des uns et des autres consistait en une poussée qui visait à détruire la civilisation ; en une prédominance des résidus de la IIe classe, qui sont toujours si puissants dans les couches inférieures de la société.
§ 1812. Innocent III voyait l'absurdité de la règle de Saint François, et hésitait à l’approuver ou à la rejeter [FN: § 1812-1] « (p. 428) Il ne pouvait certainement pas repousser ces forces nouvelles, qui venaient à son aide d'une manière inattendue pour combattre l'hérésie ; et, l'on ne peut douter qu'il bénît le mendiant d'Assise, sans lui défendre de persévérer dans son œuvre ; mais il ne se départit jamais de ses doutes sur la Règle, qui lui paraissait ne pas répondre aux besoins réels et aux tendances de la nature humaine ; et il ne voulut pas accorder une bulle d'approbation ». En 1223, le pape Honorius III rendit une bulle d'approbation à la Règle. Il voyait croître une force nouvelle, et cherchait à en tirer parti.
§ 1813. Ce n'étaient pas seulement les papes qui voulaient se servir à leurs fins de la religiosité des franciscains ; Frédéric II eut la même intention, lui qui n'avait guère trop de religiosité [FN:§ 1813-1]. Il était d'un type parfaitement opposé à celui de Célestin V. Sur ce fond s'étendait le voile des dérivations ; nous allons nous en occuper.
§ 1814. Aussitôt après la mort de Saint François, et peut-être précédemment aussi, se manifesta dans l'Ordre la dissension entre ceux qui voulaient s'en tenir strictement à la Règle, ou si l'on veut aux paroles de l'Évangile, et ceux qui voulaient concilier la première et les autres avec les nécessités de la vie des gens civilisés [FN: § 1814-1]. Plus tard, l'Ordre se divisa en trois : les Petits Frères et les Spirituels, observateurs rigides de la Règle, mais différents par leurs conceptions théologiques, et les Conventuels, qui interprétaient la Règle avec quelque liberté [FN: § 1814-2]. Le pape Célestin V permit que l'on détachât de l'ordre des Mineurs un autre ordre, sous le nom de Frères du pape Célestin ou pauvres ermites. Ces gens étaient intransigeants sur l'observation de la Règle. Ce pape, qui ne demeura pas sur le trône de Saint Pierre, était un homme simple et très religieux. Le pape Boniface VIII, qui lui succéda, s'entendait, au contraire, en politique, et persécuta ces pauvres ermites [FN: § 1814-3].
§ 1815. Enfin, puisque sans rien posséder et sans prévoyance, les hommes ne peuvent pas vivre, il fallait trouver un biais pour interpréter les paroles de l'Évangile et la Règle de Saint
François, afin qu'elles ne heurtassent pas trop le besoin de posséder et la prévoyance. On sait que les dérivations sont comme le caoutchouc, et qu'on peut les étirer de manière à leur faire signifier ce qu'on veut. Il ne fut donc pas difficile de trouver non seulement un, mais plusieurs biais. Les principaux furent une observance formelle pour les Frères, tandis que d'autres gens possédaient et avaient de la prévoyance pour les Frères. Grégoire IX confia cette mission à des personnes interposées ; Jean XXII l'attribua aux supérieurs, auxquels les simples Frères devaient obéissance. Il agit ainsi, parce que ses adversaires s'en faisaient une arme contre lui. Mais s'il l'avait voulu, il aurait pu maintenir l'interprétation de Grégoire IX, et en tirer ce qu'il lui plaisait.
§ 1816. La dérivation imaginée par Grégoire IX est ingénieuse, La Règle interdisait aux Frères de recevoir de l'argent ; comment donc acheter ou vendre ? D'une façon très simple. Une personne qui n'est pas tenue d'observer la Règle reçoit l'argent et le dépense pour les besoins des Frères. Les Frères ne doivent rien posséder en propre. Comment donc avoir des immeubles et des meubles ? Il n'y a là aucune difficulté. La nue propriété demeurera à d'autres personnes, et les Frères en auront l'usufruit. Ainsi, il est de même exclu que n'importe qui puisse s'approprier ce dont les Frères ont l'usage. Ils obéissent à la Règle en ne résistant pas à qui veut les dépouiller ; mais le propriétaire intervient et repousse l'agresseur. Tolstoï vivait d'une façon semblable : il « ne résistait pas au mal », ne repoussait pas celui qui voulait le dépouiller ; mais sa femme y pourvoyait ; elle résistait aux envahisseurs, les repoussait, et conservait la fortune dont son mari vivait.
§ 1817. Innocent IV, en 1245, et Nicolas III, en 1279, perfectionnèrent la forme de la théorie. Le pape Nicolas dit qu'on doit distinguer la propriété, la possession, l'usufruit des choses, et qu'il ne peut y avoir de profession qui exclue l'usage des choses nécessaires à la vie. Il démontre longuement que l'esprit de la Règle de Saint François est de permettre cet usage. La Règle dit que les Frères peuvent avoir des bréviaires ; donc elle permet l'usage des bréviaires et d'autres livres utiles pour les offices divins. La Règle veut que les Frères prêchent. « Il est certain que cela présuppose la science ; la science nécessite l'étude ; on ne peut étudier convenablement sans l'usage des livres. Il ressort de tout cela que la Règle permet aux Frères l'usage des choses nécessaires à l'alimentation, à l'habillement, au culte divin, à l'étude savante ». Qui veut donner aux Frères veut donner à Dieu. « Et il n'est personne à qui, au lieu de Dieu, on puisse transférer cette propriété plus convenablement qu'au Saint-Siège, et à la personne du Pontife romain, vicaire du Christ, père de tous et spécialement des Minorites » [FN: § 1817-1]. Avec la constitution Exivi de paradiso, du pape Clément V, on revient pour quelque temps à l'interprétation littérale, et l'on voit de nouveau apparaître les très respectables oiseaux, nourris par la divine Providence [FN: § 1817-2]. Vint ensuite le pape Jean XXII, qui comprenait beaucoup mieux les nécessités de la vie pratique. Comme il avait à se plaindre des Frères Mineurs dissidents, il se tourna contre eux. Il n'eut pas beaucoup de peine à relever l'absurdité de la dérivation grégorienne, et ce qu'il y avait de ridicule à séparer la propriété de l'usufruit, pour les choses qui se consomment, car c'est vraiment une singulière dérivation que celle qui conserve la propriété d'une bouchée de pain à d'autres personnes qu'à celle qui le mange. Comme la controverse des franciscains avait, ainsi qu'il arrive habituellement en des cas semblables, tourné en disputes puériles, en l'espèce sur la coupe et la longueur des vêtements, le pape Jean XXII [FN: § 1817-3] décréta par une constitution de 1317, qu'il appartenait aux supérieurs des franciscains de déterminer la forme des vêtements, la qualité de l'étoffe, et de conserver le grain et le vin, réprimandant les Frères et leur rappelant que leur vertu principale devait être l'obéissance. Les franciscains ne cessèrent pas leur opposition : ils osèrent se révolter contre la volonté du pape, qui, de cette façon, fut poussé à développer sa dérivation [FN:§ 1817-4]. Il révoqua la bulle de Nicolas III. Ensuite, par la bulle Ad conditorem, il affirma qu'il était permis, d'une façon générale, à un pape, de révoquer les constitutions de ses prédécesseurs, et démontra la vanité de la séparation de la propriété et de l'usufruit, pour les choses qui se consomment [FN: § 1817-5]. Par conséquent, il refusa la propriété, que l'on voulait donner au pape, des biens des Mineurs, et l'attribua à ceux-ci, qui devaient en disposer par l'intermédiaire de leurs supérieurs [FN:§ 1817-6]. Cette fluctuation d'interprétations fait ressortir les difficultés insurmontables qu'il y a de concilier la rigueur théorique du précepte franciscain avec la vie pratique. Ici, nous les voyons avec un grossissement ; nous les découvrons de même dans les doctrines de la non-résistance au mal, du pacifisme, de l'humanitarisme. Mais nous les trouvons aussi, en des proportions différentes, parfois moindres, dans presque toutes les doctrines éthiques, celles du droit naturel, et en d'autres semblables, qu'on peut défendre uniquement grâce à des distinctions et des interprétations sophistiques, subtiles, prodigieuses, qui leur enlèvent toute détermination précise.
§ 1818. De nos jours, Tolstoï, par sa théorie du devoir de ne pas résister au mal, donne un nouvel exemple de dérivations absurdes. Les antimilitaristes se rapprochent de lui, eux qui veulent désarmer leur pays, et qui rêvent d'une paix universelle. Les antialcooliques [FN: § 1818-1], les vertuistes, les ascètes et les ultra hygiénistes qui vivent dans la terreur sacrée du microbe, augmentent encore la beauté d'un si beau chœur.
§ 1819. Parmi tous ces gens, nombreux sont ceux qui ne mettent pas d'accord leurs discours et leurs œuvres. Les discours vont d'un côté, les faits de l'autre, tandis que les gens plus scrupuleux cherchent à concilier les uns et les autres. Souvent, celui qui admire et exalte l'idée évangélique de Tolstoï, de ne pas défendre ce que l'on possède contre qui veut s'en emparer, se montre ensuite, dans les faits, impitoyable avec ses débiteurs, et ne permet à aucun d'eux de lui prendre la moindre chose [FN: § 1819-1]. Il trouve, quand c'est nécessaire, des prétextes sans fin qui justifient amplement cette attitude. Il ne manque pas de pacifistes, d'anti-militaristes, qui veulent néanmoins que leur patrie soit grande et puissante à la guerre, et qui exhibent de superbes raisonnements pour louer la guerre au nom de la paix. Combien de gens veulent prohiber les boissons alcooliques et font usage –pour soigner leur santé, disent-ils – de l'éther, de la morphine, de la cocaïne, ou boivent tant de thé qu'ils se donnent une maladie à laquelle on a donné le nom de théisme ; et combien d'autres font partie, en compagnie de leur maîtresse adultère, des sociétés « pour le relèvement moral », ou pour empêcher la « traite des blanches », et se justifient en disant qu'ils ont le droit de « vivre leur vie ».
§ 1820. G. Eusèbe [FN: § 1820-1] rapporte de Numenius une anecdote, sûrement inventée, mais qui fait voir, comme avec une loupe, le fait dont nous parlons. Numenius raconte donc qu'un certain Lacide, volé à son insu par ses esclaves, voyait disparaître les objets enfermés dans la dépense, sans savoir comment cela se faisait. Arcésilas, discourant sur l'impossibilité où nous sommes de rien entendre, l'avait persuadé. À son tour, Lacide professait cette doctrine, et disait que nous ne pouvons rien savoir de certain, donnant comme preuve le fait qui lui était arrivé. L'un de ses auditeurs, qui connaissait la fraude des esclaves, la lui révéla ; aussi le brave homme eut-il soin de mieux fermer la dépense. Mais les esclaves ne s'arrêtèrent pas pour cela ; ils brisaient les cachets mis par lui à la dépense ; puis, effrontément, ils lui démontraient que, n'étant sûr de rien, il ne pouvait pas non plus être certain d'avoir mis les cachets à la dépense. Le jeu dura longtemps, au détriment et à la honte du pauvre Lacide, jusqu'à ce que celui-ci mit tout raisonnement de côté et dit aux esclaves : « Garçons, nous discutons d'une manière dans les écoles et nous vivons d'une autre ».
§ 1821. Engagé sur cette voie des dérivations, on aboutit facilement au ridicule. Au XVIe siècle, un certain Gedicus considère comme sensée l'argumentation d'un livre où l'on veut démontrer que les femmes n'appartiennent pas à la race humaine, mulieres non esse homines, tandis qu'il s'agit là seulement d'une plaisanterie satirique [FN:§ 1821-1].
§ 1822. Un autre exemple remarquable des façons dont on s'efforce d'échapper aux conséquences logiques de certains principes, est celui de la morale. Les peuples civilisés s'imaginent naïvement mettre en pratique les principes de la morale théorique en cours chez eux, tandis qu'ils agissent très diversement, et recourent à de subtiles interprétations, et à une ingénieuse casuistique, pour concilier la théorie et la pratique, qui sont toujours en désaccord.
§ 1823. À chaque pas, dans l'histoire des peuples civilisés, on trouve la mise en pratique du principe que la fin justifie les moyens ; et ceux qui l'affirment explicitement ne sont pas ceux qui l'emploient le plus. Chaque secte, chaque parti accuse ses adversaires d'actes immoraux, et ne voit aucunement les siens propres. Les « libéraux » ont-ils assez crié contre les gouvernements « réactionnaires » ? et puis ils ont fait pis. En Italie, les gouvernements du passé étaient accusés de « spéculer sur l'immoralité », par le jeu du loto ; et le gouvernement très moral qui leur a succédé a maintenu et maintient ce jeu. C'est au nom d'un gouvernement qui retire des dizaines de millions par année du jeu de loto, que les magistrats condamnent celui qui joue aux jeux de hasard [FN:§ 1823-1]. En France, et en d'autres pays, les courses de chevaux jouent le rôle du loto. Les censeurs autrichiens étaient ridicules, mais pas plus que M. Luzatti, qui distribuait à tire-larigot des feuilles de vigne aux statues des musées. Les Bourbons de Naples étaient, dit-on, amis de la camorra ; mais le gouvernement qui leur a succédé ne dédaigne pas de se montrer bienveillant envers elle, pour obtenir des élections de députés à sa guise.
§ 1824. Il y a de braves personnes, lesquelles, de parfaite bonne foi, n'ont aucune parole de reproche pour les gens qui, dans le Midi de la France, font voter les absents et les morts, tandis que ces mêmes personnes entrent en fureur à la seule idée que les jésuites pouvaient admettre que la fin justifie les moyens. Parmi ceux qui, en Italie, ont toléré les abus de confiance révélés par « l'enquête sur les banques, » et par d'autres analogues, et qui continuent à en tolérer de semblables, il y a des honnêtes gens convaincus de suivre rigoureusement les principes de la morale théorique. Parmi les personnes qui, en France, approuvent le procureur général Bulot, lorsqu'il déclare que les magistrats doivent s'incliner devant la « raison d'État, le fait du prince », sous peine d'être révoqués [FN: § 1824-1], il y a des gens d’une moralité au moins moyenne, qui croient de bonne foi que le gouvernement présent a supprimé les abus de la justice qui entachaient les gouvernements passés, et que si, sous la monarchie, il y avait des privilégiés, sous la république, la loi est égale pour tous. Cette foi n'est nullement ébranlée par des procès comme ceux de Rochette ou de Mme Caillaux. Nous ne voulons ici que relever l'écart entre la pratique et la morale théorique, ainsi que l'illusion de ceux qui se les imaginent identiques ; mais nous n'entendons nullement porter un jugement quelconque sur les effets socialement utiles ou nuisibles de cet écart, ni sur ceux dérivant du fait que le plus grand nombre des gens s'en rend compte ou non.
§ 1825. MESURES POUR ATTEINDRE UN BUT. Les considérations précédentes se rapportent aux mouvements réels. Occupons-nous maintenant d'étudier un problème qui touche aux mouvements virtuels, en recherchant quels phénomènes se produisent, quand les résidus ou les dérivations se modifient. Nous ferons ici cette étude en considérant séparément certains groupes de résidus et de dérivations (§1687), et nous connaîtrons ainsi seulement une partie du phénomène. Pour le connaître dans son intégrité, nous devons considérer ensemble tous les éléments qui agissent sur la société. C'est ce que nous ferons au chapitre suivant. Nous y étudierons la composition de certaines forces qu'ici nous envisageons séparément.
Nous avons déjà établi les fondements de cette étude (§1735 à 1767), au sujet de l'action mutuelle des résidus et des dérivations ; mais tandis que nous recherchions alors ce qu'était cette action, à un point de vue général, maintenant, nous nous efforçons d'apprendre comment elle doit être pour atteindre un but déterminé.
§ 1826. Il faut prendre garde à la division, mentionnée déjà, (§1688) des dérivations en dérivations proprement dites, et en manifestations, qui correspondent aux démonstrations et aux doctrines. Considérons un ensemble de sentiments P, dont proviennent les résidus, ou mieux les groupes de résidus (a), (b), (c)... De l'un de ceux-ci, (a), au moyen des dérivations proprement dites m, n, p,... on obtient les manifestations ou les doctrines r, s, t, ... et semblablement, des autres groupes b, c, ... Ce n’est que pour simplifier que nous considérons un ensemble de sentiments. En réalité, nous devrions en considérer un plus grand nombre, dont les effets sont tantôt distincts, tantôt unis en certains groupes de résidus. Mais cette étude synthétique pourra être effectuée avec les éléments que nous allons exposer.
§ 1827. Nous pourrons distinguer les cas suivants de mouvements virtuels. 1° Le cas dans lequel on supprime (a) est le plus facile. Cette suppression entraîne celle des manifestations r, s, t,…, et il n'y aurait rien à ajouter, si le groupe (a) n'était pas accompagné de groupes analogues qui persistent. Quand il est seul, les manifestations r, s, t,... disparaissent bien, mais les autres qui sont analogues demeurent. En outre, l'affaiblissement ou la disparition du groupe (a) peuvent être compensé par le renforcement ou par l'apparition d'autres résidus de la même classe (§1742).

Figure 28
§ 1828. Ainsi, nous exposons d'une autre manière le même sujet dont nous avons déjà traité, lorsque nous avons observé que, pour une collectivité très nombreuse, la totalité des résidus d'une classe variait peu, beaucoup moins que les genres particuliers et les espèces. Ce sujet est très important ; mais pour le traiter avec toute l'ampleur voulue, il nous faudrait presque autant d'espace que nous en employons ici pour la sociologie entière. Par conséquent, nous devons nous arrêter dans cette voie, d'autant plus qu'il nous reste à étudier d'autres problèmes très importants, à propos desquels nous ne pourrons toutefois pas exposer tout ce que nous aurions à dire.
§ 1829. 2° Qu'arrive-t-il si l'on modifie ou si l'on détruit une ou plusieurs des dérivations proprement dites m, n, p,... ? Ce problème a déjà été résolu à un point de vue général. Nous avons vu en de nombreux cas que les dérivations, c'est-à-dire l'ensemble des dérivations proprement dites et des manifestations, avaient une importance secondaire au regard des résidus, tandis que l'importance des dérivations proprement dites était encore moindre et souvent négligeable. La production de ces dérivations est très facile, et si l'on en fait disparaître une, il en apparaît aussitôt une autre, sans aucun changement dans le fond des phénomènes.
Pourtant, ce n'est là qu'une première approximation. Bien que secondaire et parfois très faible, l'action des dérivations proprement dites peut ne pas être absolument nulle. Il resterait, par conséquent, comme seconde approximation, à la rechercher. Mais ici le manque d'espace nous empêche de pouvoir nous entretenir longuement de ce sujet, et nous devons nous contenter de quelques traits.
§ 1830. Qu'arrive-t-il si l'on modifie ou si l'on détruit une ou plusieurs des manifestations r, s,... ? Pour résoudre ce problème, il faut se rappeler ce qu'en de très nombreux exemples nous avons trouvé, au sujet de l'action réciproque des résidus (a) et des manifestations r, s,.... L'action principale, et de beaucoup la plus importante, est celle de (a) sur r, s, Une classe entière de résidus, la IIIe, pousse les individus chez lesquels elle se trouve, à se livrer à ces manifestations. Si cette action était isolée, s'il n'y en avait pas d'autres, la suppression de r n'aurait d'autre effet que de faire disparaître, précisément r. Vice versa, si une autorité quelconque contraignait les individus à accomplir r, cette action n'aurait d'autre effet que de faire apparaître r.
§ 1831. Que cela soit la partie principale du phénomène, c'est prouvé par le fait que celui qui a une religion éprouve le besoin d'accomplir les actes du culte, et que, vice versa, contraindre celui qui n'a pas de sentiments religieux à accomplir les actes du culte, ne fait pas naître chez lui ces sentiments.
§ 1832. Mais outre cette partie principale du phénomène, il y en a aussi une autre, secondaire : une réaction de r sur (a). 1° Les manifestations spontanées de certains sentiments servent à renforcer ces sentiments. Le sentiment religieux pousse à des actes du culte, et ceux-ci renforcent le sentiment religieux (§1747). Les manifestations qui ne sont pas spontanées peuvent quelquefois avoir un effet semblable, généralement assez faible ; mais elles ont ensuite un autre effet en sens contraire, qui naît par réaction contre la violence que subit l'individu ; et cet effet peut, en certains cas, être important. 2° Si certaines manifestations r sont supprimées spontanément, il peut se produire un effet opposé à celui noté maintenant, lorsqu'elles s'accomplissent spontanément, c'est-à-dire un affaiblissement des sentiments correspondants à (a). On obtient un effet semblable, qui peut être, en certains cas, important, lorsque ces manifestations sont impunément tournées en dérision. Le ridicule est une arme qui, sinon toujours, du moins souvent, est efficace pour affaiblir les résidus de la persistance des agrégats. Si les manifestations sont supprimées par la force, le phénomène devient complexe. Nous en avons déjà étudié un cas particulier (§1752 et sv.). En général, on peut remarquer que si des sentiments puissants correspondent aux manifestations que l'on empêche d'accomplir, ces sentiments sont renforcés par la réaction que produit cette suppression [FN: § 1832-1]. Si, au contraire, les sentiments sont faibles, à la longue ils peuvent être encore affaiblis. Toujours d'une manière générale, l'emploi de la force est beaucoup plus efficace pour empêcher de tourner en ridicule certaines manifestations que pour les imposer. Protéger directement certains résidus de la IIe classe est peu utile ; les protéger indirectement, en empêchant qu'ils soient offusqués, peut souvent être très utile. C'est là un cas particulier du fait général que celui qui gouverne peut mieux et plus facilement se servir des résidus existants que les modifier (§1843).
§ 1833. Le motif pour lequel les sentiments forts sont renforcés, est qu'en réalité on ne supprime pas la manifestation (r) : on empêche seulement qu'elle soit publique; mais elle demeure dans le domaine privé, ne fût-ce que dans la conscience, et se fortifie à cause des obstacles mêmes qui sont mis à ce que les gens se livrent à cette manifestation [FN: § 1833-1]. Par conséquent, avec cette restriction, on peut dire que la suppression de r affaiblit toujours, peu ou beaucoup, (a), pourvu que cette suppression soit réelle et s'étende aussi aux intimes pensées individuelles. Qu'une dérivation disparaisse parce qu'elle est repoussée par le public, ou parce qu'elle est réprouvée par l'autorité, il semble à beaucoup de personnes que c'est la même chose au point de vue de l'équilibre social. Au contraire, ces deux cas diffèrent du tout au tout. Dans le premier cas, la disparition de la dérivation est l'indice d'un changement qui a lieu dans les conditions de l'équilibre social ; dans le second cas, elle n'est que l'indice du désir qu'ont les autorités de changer ces conditions, au moyen d'une action, laquelle, le plus souvent, demeure inefficace (§1715).
§ 1834. Nous avons maintenant l'explication générale des faits particuliers rappelés précédemment (§1748 à 1754). Si, dans les sciences logico-expérimentales, on réfute facilement une assertion A, en en démontrant la fausseté (§1748), cela vient du fait que la manifestation r, constituée par cette assertion, disparaît ainsi, et qu'elle ne correspond pas à des sentiments (a) d'une force considérable. Le fait est confirmé par l'exception qu'il faut faire, lorsqu'un homme de science a des sentiments d'amour-propre ou d'un autre genre, qui l'induisent à accueillir A indépendamment de la valeur logico-expérimentale de la démonstration. Si, dans les matières où les actions non-logiques et le sentiment jouent un rôle, le fait de combattre la manifestation r ne lui enlève aucune force (§1748), cela provient de ce qu'ainsi les sentiments manifestés par r ne s'affaiblissent pas, mais qu'au contraire, en certains cas, ils se fortifient (§1749, 1750).
§ 1835. L'effet, que nous avons appelé indirect, des réfutations et des persécutions (§1751), est celui que nous considérons maintenant : celui de contrarier la manifestation, qui comprend les deux parties indiquées au §1747, c'est-à-dire la manifestation de sentiments ou d'idées existant déjà, et qui correspondent à (a), et l'effet propre de la dérivation (§1751).
§ 1836. Les sentiments qui, pour l'ensemble d'une population ou d'une classe sociale, sont appelés puissants, peuvent l'être intrinsèquement, ou parce qu'ils sont suscités par un grand nombre de faits, ou parce qu'ils appartiennent à beaucoup d'individus ; et vice versa pour les sentiments appelés faibles. C'est pourquoi, au §1752, on a tenu compte non seulement de la puissance intrinsèque des sentiments, mais aussi du nombre plus ou moins grand des faits et des individus auxquels certaines mesures s'appliquent.
§ 1837. Quand la suppression externe de r renforce (a), il s'ensuit que s, t,... sont aussi renforcés ; c'est-à-dire qu'il y a des cas dans lesquels l'affaiblissement ou la destruction d'une manifestation r fait croître les autres manifestations s, t,... Cet effet est semblable à celui qu'on obtient, lorsqu'un groupe de résidus s'affaiblit, et que, par compensation, d'autres se fortifient. Ces deux effets s'observent aussi confondus ensemble.
§ 1838. De très importantes conséquences au sujet des mouvements virtuels résultent des considérations précédentes ; nous les rangerons sous quatre chefs : (α) du §1838 au §1841 ; (β) du §1842 au §1849 ; (γ) du §1850 au §1859 ; (δ) du §1860 au §1862.
(a) Si un gouvernement veut supprimer un certain groupe de résidus (a), il a un moyen sûr, qui est de supprimer, si possible, tous les individus chez lesquels ces résidus existent. L'efficacité de ce procédé est prouvée par l'Espagne, où l'Inquisition réussit à extirper l'hérésie et la libre pensée. Si l'État romain avait pu procéder de même à l'égard du christianisme, il l'aurait probablement aussi extirpé ; mais il ne pouvait pas agir ainsi, parce que les résidus r qui se manifestaient par le christianisme, étaient les mêmes que ceux qui se manifestaient par le culte de Mithra, s, du Soleil, t, par la philosophie néo-platonicienne, v, par le mysticisme de Philon, x, et par tant d'autres, y, z,... L'empereur Julien, grand ennemi des chrétiens, avait en lui les mêmes résidus que ceux-ci. Toutes les manifestations r, s, t, v, x, y, z,... en apparence si diverses, appartenaient en très grande partie à un même groupe de sentiments (a), qui étaient ceux de tant de personnes que, pour détruire (a), il eût été nécessaire de détruire presque toute la population de l'empire romain, ce qui, évidemment, était impossible. L'empereur Constantin fit mieux que de s'obstiner, comme ses prédécesseurs, à vouloir détruire ou modifier ces sentiments : il s'en servit comme d'un moyen de gouverner (§1843).
§ 1839. La suppression des résidus (a) peut avoir lieu spontanément ; en ce cas, au lieu de mouvements virtuels, nous avons des mouvements réels. Les événements qui agissent puissamment sur une population modifient fortement les sentiments de ceux qui virent ces événements. Mais quand la mort les a tous ou presque tous détruits, ceux qui vivent alors, et qui ne connaissent les dits événements que par tradition, en reçoivent une impression beaucoup plus faible. De cette façon, on peut dire approximativement que les individus qui avaient des sentiments correspondant au groupe (a) ont disparu [FN: § 1839-1].
§ 1840. On observe des phénomènes semblables, lorsqu'au lieu de disparaître, apparaissent des individus ayant ces sentiments. C'est ce qu'on put observer dans l'empire romain, quand, à l'ancienne population du Latium, ou même à la population italique, se substitua celle des affranchis ou d'autres individus ayant surtout une origine orientale. Nous nous exprimons d'une manière impropre, quand nous parlons d'une invasion du christianisme dans l'empire romain. Ce ne fut pas une invasion d'idées, de dérivations : ce fut une invasion d'hommes qui apportaient avec eux les résidus qui se manifestèrent par des dérivations. Les anciens peuples de Rome, du Latium et de l'Italie, avaient certains résidus auxquels correspondait une certaine religion. Les peuples orientaux avaient divers résidus auxquels correspondait une religion différente. Rome vainquit ces peuples par les armes et les asservit ; mais ensuite, elle en tira ses affranchis, qui devinrent ses citoyens, et permit que les peuples vaincus affluassent à Rome, des provinces sujettes, voire de la Judée méprisée. C'est pourquoi ce n'est pas la Grèce seule, mais bien aussi l'Asie, l'Afrique et d'autres contrées barbares, qui apportèrent à Rome leurs sentiments et les conceptions ou les dérivations correspondantes. Non seulement vers la fin de l'Empire, mais aussi au beau milieu de son existence, les Romains n'avaient que le nom de commun avec les populations qui conquirent le bassin de la Méditerranée.
§ 1841. Pour supprimer (a), beaucoup de personnes croient qu'on peut recourir à un changement de l'éducation. Ce procédé peut être efficace, si l'action du changement d'éducation est continuée durant le reste de la vie. Autrement, il a peu ou point d'efficacité. Les futurs chrétiens furent instruits dans les écoles païennes ; la plupart des chefs des ennemis de la religion chrétienne, en France, vers la fin du XVIIIe siècle, furent instruits dans les écoles des jésuites ; et la plupart des chefs de la Révolution française aussi. Cela ne prouve pas que l'effet de l'éducation soit zéro ; cela prouve qu'elle est seulement une partie des multiples effets dont la résultante est donnée par les actions de l'homme.
§ 1842. (β) Pour agir sur (a), les gouvernements opèrent habituellement sur les manifestations r, s,... Ils y sont poussés moins par un raisonnement logique que par l'action non-logique des sentiments qui sont heurtés par les manifestations r, s,... La dérivation habituellement employée est la suivante : « Par r se manifestent des sentiments qui sont nuisibles à la société ; donc je réprimerai r ». Si le raisonnement était logico-expérimental, on devrait ajouter : « parce qu'en réprimant r, je détruirai les sentiments qui se manifestent ainsi ». Mais c'est là justement le point faible de cette proposition, car il n'est pas du tout démontré qu'en réprimant la manifestation de certains sentiments on détruise ces sentiments.
§ 1843. Il y aune abondance vraiment imposante de faits qui démontrent le peu d'efficacité de l'action qu'on veut exercer sur les résidus, en agissant sur les manifestations, et pis encore sur les dérivations. Les mesures de rigueur contre les manifestations de la pensée par le moyen de la presse ont-elles empêché la première révolution française, la chute de Charles X, en France, et les mouvements révolutionnaires de 1831, dans toute l'Europe ; puis, de nouveau, les mouvements de 1848, le fait que les révolutionnaires se sont renforcés en France, sous Napoléon III, les mouvements révolutionnaires en Russie, après la guerre du Japon ? Et comment pourrait-on user de plus de rigueur envers la presse qu'on ne le faisait en Russie ? Au faîte de sa puissance, le prince de Bismarck, auréolé des victoires sur la France et de la fondation de l'empire allemand, parut vouloir détruire les résidus qui se manifestaient sous la forme du socialisme et du catholicisme, en réprimant leurs manifestations : il obtint précisément l'effet contraire : il les renforça. Le socialisme est devenu le parti le plus nombreux, en Allemagne. Le catholicisme, avec le parti du Centre, a obtenu souvent une part prépondérante dans le gouvernement [FN:§ 1843-1]. En homme pratique et avisé qu'il était, Bismarck finit par reconnaître lui-même l'erreur commise parle Kulturkampf [FN:§ 1843-2]. Le gouvernement de l'empereur Guillaume II suivit très opportunément une voie opposée, et, au lieu de se mettre à combattre ou à vouloir modifier les résidus qui se manifestaient par le catholicisme, il s'en servit comme d'un moyen de gouverner. Il ne sut ou ne voulut pas faire de même pour les sentiments manifestés par les Alsaciens-Lorrains et les Polonais ; c'est pourquoi, en ce cas, son œuvre fut vaine, comme l'avait été celle du Kulturkampf (§2247-1). Le fait de la Pologne est tout à fait typique. Un pays a été partagé en trois. Dans les territoires soumis à la domination russe ou prussienne, le gouvernement veut combattre ou modifier les sentiments : il fait une œuvre inutile qui n'aboutit à rien. Dans la partie soumise au régime autrichien, le gouvernement se sert de ces mêmes sentiments comme d'un moyen de gouverner, et il obtient du succès [FN: § 1843-3]. Rome acquit la sympathie et la fidélité des peuples conquis, précisément parce qu'elle respectait leurs sentiments. Pour une cause semblable, la domination anglaise se maintient aux Indes ; et il arrive aussi que de toutes les colonies françaises, la Tunisie est celle où la domination française est le mieux acceptée et le mieux vue, parce que c'est aussi celle où les sentiments, les us et coutumes des sujets, sont le plus respectés.
Prenons garde, en outre, que les peuples supportent plus facilement de lourdes charges que des tracasseries qui semblent petites et insignifiantes, et qui choquent leurs mœurs. On sait que la révolte des cipayes, aux Indes, fut occasionnée par le bruit que les Anglais enduisaient de graisse de porc la ficelle qui fermait les cartouches, qu'on déchirait alors avec les dents avant de les mettre dans le fusil. De petites vexations en fait de langue, d'usages religieux et, dans les pays orientaux, en fait de femmes, sont difficilement tolérées. Mais il faut faire attention que pour petit et insignifiant que ces faits paraissent, au point de vue logique, ils sont au contraire grands et importants au point de vue des sentiments. Les gouvernements qui ne saisissent pas cela obtiennent exactement l'effet contraire à celui qu'ils ont en vue. En 1913, le chancelier allemand dit, au Reichstag, que les difficultés avec les habitants de l'Alsace-Lorraine provenaient de ce que ceux-ci préféraient leurs cousins et cousines français à leurs cousins allemands. Or l'art de gouverner consiste précisément à savoir se servir de ces sentiments, et non à perdre sa peine à vouloir inutilement les détruire, ce qui a souvent pour effet de les renforcer. Celui qui sait se soustraire à la domination aveugle de ses propres sentiments se trouve en des conditions favorables pour se servir de ceux d'autrui à ses propres fins. Au contraire, celui qui est soumis à la domination de ses sentiments ne sait pas se servir ou se sert mal de ceux d'autrui; il les heurte inutilement, et n'obtient pas ce qui lui serait avantageux. On peut généralement en dire autant pour les rapports entre gouvernants et gouvernés. L'homme politique qui sert le mieux ses intérêts et ceux de son parti est celui qui n'a pas de préjugés et qui sait tirer parti de ceux d'autrui.
§ 1844. Les faits de la religion sexuelle nous fournissent un autre exemple excellent de l'inutilité de l'œuvre qui, en réprimant les manifestations, vise à détruire les résidus dont ces manifestations proviennent. On se demande si, au cours des siècles, toutes les lois et les mesures prises contre les mauvaises mœurs ont eu le moindre effet sur celles-ci ; à tel point que si l'on ne se mettait pas en garde contre le raisonnement post hoc propter hoc, on inclinerait à dire qu'au contraire, là où les mesures prises contre les mauvaises mœurs sont les plus rigoureuses, c'est là que celles-ci sont les plus mauvaises. Nous pouvons voir autour de nous que les mesures qui répriment une manifestation r servent uniquement à renforcer les autres manifestations s, t,... Là où l'on fait la guerre à Cythère, la puissance de Sodome, de Lesbos et d'Onan s'accroît. Là où, sous prétexte de réprimer la « traite des blanches », on fait la chasse aux femmes légères, là fleurissent l'adultère et les mariages annuels résultant de divorces faciles.
§ 1845. En beaucoup de faits frappés par la législation pénale, nous avons des manifestations du genre de celles que nous venons de noter. Les vols et les assassinats ne sont certes pas des manifestations théoriques ; mais il n'en résulte pas qu'ils soient indépendants des sentiments, qu'ils n'en soient pas une manifestation. C'est justement pourquoi ils ont quelques caractères semblables à ceux que nous avons notés tout à l'heure.
1° Dans la mesure où les actions non-logiques entrent dans ces faits, ceux-ci échappent au raisonnement. C'est pourquoi la menace de la peine a peu d'efficacité pour empêcher les hommes de commettre les délits graves et les délits dits passionnels, parce que, si nous laissons de côté les exceptions, ces délits procèdent de sentiments forts poussant à des actions non-logiques. Dans les moindres délits, le sentiment a moins d'influence ; par conséquent, le rôle de la logique devient plus important : la menace de la peine a plus d'efficacité pour empêcher des contraventions que pour empêcher l'assassinat.
2° La cause principale des délits, sauf toujours les exceptions, est l'existence de certains sentiments (a). La théorie du criminel-né ajoute que ces sentiments viennent de naissance à l'individu. Cela semble vrai en partie, mais pourrait difficilement être admis en entier, car l'ensemble des circonstances de lieu, de temps et autres, dans lesquelles l'individu a vécu, ont certainement modifié au moins certains sentiments qu'il possédait de naissance. Mais opposée à la théorie dite de la « responsabilité », qui ramène tout à des actions logiques, la théorie du criminel-né apparaît presque comme la vérité opposée à l'erreur.
3° Parmi les faits les moins douteux de la science sociale, il y a celui-ci : que jusqu'à présent, l'effet de la peine pour amender le criminel a été plus qu'insignifiant, surtout en ce qui concerne les crimes les plus graves. Souvent même, il est arrivé qu'au contraire il a rendu le criminel plus mauvais. Cela se produit en vertu de la règle générale suivant laquelle supprimer par la force les manifestations d'un groupe de sentiments, diminue souvent peu ou point l'intensité de ce groupe, et quelquefois l'accroît. Beaucoup de tentatives ont été faites pour porter remède à ce défaut de la législation pénale, et à vrai dire sans grand effet ; le peu qu'on a obtenu a été précisément le résultat d'une action sur les sentiments (a).
§ 1846. 4° Le seul moyen qui se soit montré efficace pour faire diminuer les crimes consiste à faire disparaître les criminels, moyen analogue à celui indiqué en (α), §1837.
5° En outre, il est certain que l'état général des sentiments de la population agit sur les crimes. Il y a des peuples de voleurs, d'autres d'escrocs, d'autres d'assassins, etc. C'est-à-dire que les groupes de sentiments (a), (b),... sont différents suivant les peuples, les lieux, les temps, et souvent des compensations s'opèrent entre les divers genres.
§ 1847. 6° Notons d'autres raisonnements erronés : ce sont ceux qui, de l'inefficacité de la peine au point de vue des actions logiques, concluent à son inefficacité en général. Par exemple, il est erroné de dire : « La peine de mort est inefficace, parce qu'elle n'empêche pas un homme directement et logiquement de tuer ». Son efficacité est d'une autre nature. Tout d'abord, il est certain qu'elle fait disparaître l'assassin, qu'elle délivre la société d'une partie, au moins, des individus qui ont un penchant à tuer. Ensuite elle agit indirectement en renforçant les sentiments qui font envisager le crime avec horreur. Il est difficile de nier ce fait, si l'on prend garde à l'efficacité des règles dites de l'honneur, lesquelles n'ont pas de sanction pénale directe, mais engendrent un certain état de choses, grâce aux sentiments qui conviennent à cet état de choses ; en sorte que la majeure partie des hommes répugnent à transgresser ces règles. Ainsi, le Sicilien manquera difficilement aux règles de l'omertà [FN: § 1847-1], parce que, dès sa naissance, il a eu ou acquis les sentiments qui conviennent à ces règles, et la punition qui frappe les transgresseurs maintient et renforce ces sentiments.
Autre exemple. Le raisonnement suivant est erroné. Du fait supposé (la vérité est peut-être différente), que la loi appelée loi de sursis n'a pas augmenté le nombre des récidives, on conclut à son innocuité. Les modifications des sentiments se produisent lentement, parfois très lentement. Il faut que plusieurs générations passent, pour qu'on puisse connaître sûrement l'effet de cette loi et d'autres semblables. En outre, ce n'est pas à la récidive seule qu'il faut prendre garde, mais à la criminalité en général. L'effet de la loi de sursis s'étend très au delà du criminel qu'elle protège : le reste de la population s'habitue à penser qu'on peut commettre impunément un premier délit ; et si cela agit sur les sentiments, la répulsion qui éloigne instinctivement l'homme civilisé du délit venant à diminuer, la criminalité générale peut croître, sans que la récidive croisse également. La répression énergique des délits, exercée aux siècles passés, durant de longues années, a contribué à maintenir certains sentiments de répugnance pour le crime, sentiments que nous trouvons aujourd'hui chez les hommes ; et pour les détruire, il faudra aussi un temps assez long. Les peuples qui se paient aujourd'hui le luxe de l'humanitarisme agissent comme l'enfant prodigue qui dilapide l'héritage paternel.
§ 1848. Il faut prendre garde ici à ce que nous avons déjà mentionné au §1832, touchant l'effet produit par la possibilité de tourner en ridicule certaines manifestations de sentiments. La douceur des lois, la loi du sursis, par laquelle on tend presque à octroyer au citoyen le droit de commettre un premier délit, l'indulgence extrême des tribunaux et du jury, la patience humanitaire des magistrats qui tolèrent, dans les débats publics, que l'accusé leur manque de respect (§1616-1), et qu'il aille parfois jusqu'à les insulter et à se moquer de la peine dont il est menacé, le confort dont on jouit dans certaines prisons modernes, où, sous prétexte de procéder au « relèvement moral » du délinquant, on le traite avec toutes sortes d'égards, et où il se trouve souvent beaucoup mieux que chez lui ; les réductions des peines déjà si douces, les grâces et les amnisties fréquentes : tout cela permet à un très grand nombre d'hommes de tourner en dérision le délit et sa répression, de se vanter – se posant en hommes courageux et dépourvus de préjugés – de n'avoir aucune répugnance à commettre un délit et de n'en pas craindre la répression, laquelle est souvent plus apparente que réelle.
La religion humanitaire renforce ces sentiments, en fournissant les dérivations au moyen desquelles ils s'expriment, les mythes qui en sont la théologie.
§ 1849. 7° Semblable est généralement l'action des théologies, des morales métaphysiques ou autres, qui toutes, pour autant qu'elles sont de simples dérivations ou des manifestations de dérivations, ont peu ou point d'effet direct sur la criminalité. Pour autant qu'elles sont des manifestations de sentiments, elles paraissent avoir un effet qui, en grande partie, provient de ces sentiments mêmes (§1680). Par conséquent, si on laisse de côté l'effet indirect noté tout à l'heure, on obtient peu ou rien en agissant sur elles. Le peu d'effet que cette action est capable de donner provient de la réaction des dérivations sur les sentiments qui leur donnent naissance, et ensuite de l'action de ces sentiments sur la criminalité. Nous avons là un cas particulier de la loi générale que nous avons trouvée dans l'action des résidus et dès dérivations.
§ 1850. (γ) De même, lorsque nous recherchons les effets qui résultent d'une modification de (a), nous avons un cas particulier de la loi générale de l'action des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments (§1740). Les gouvernements qui, d'une manière ou d'une autre, agissent sur (a), doivent savoir que, même s'ils ne s'en aperçoivent pas, ils agissent aussi sur d'autres résidus de la même classe [FN: § 1850-1]. Quelquefois ils le savent, et c'est là le motif pour lequel, par raison d'État, les gouvernements ont protégé une religion déterminée. Pour justifier cette manière d'agir, outre le sophisme déjà signalé au §1644, et par lequel on substitue des actions logiques aux actions non-logiques, ces gouvernements se servent aussi d'un raisonnement qui a pour but de démontrer qu'en protégeant un genre de résidus, on favorise aussi tous les autres genres de résidus dépendant de certains ensembles de sentiments (§1744). Dans ce but, on fait usage de dérivations qui sont des variétés du type suivant : « Quiconque est religieux a des sentiments que je désire voir chez les bons citoyens ; donc je dois m'efforcer de faire que tout le monde ait la religion X, que j'ai déterminée et que je protégerai ». Laissons de côté la question de l'efficacité de cette protection, qui consiste habituellement en actions sur les manifestations religieuses. Nous venons de traiter de cette question. Supposons pour un moment que la protection soit efficace, et poursuivons.
§ 1851. Le raisonnement logico-expérimental correspondant à la dérivation indiquée tout à l'heure serait : « Quiconque est religieux a les sentiments que je désire voir chez les bons citoyens ; mais on ne peut être religieux qu'en ayant les sentiments d'une religion donnée ; donc je m'efforcerai de faire que les citoyens aient précisément les sentiments de cette religion ». La proposition : « on ne peut être religieux qu'en ayant les sentiments d'une religion donnée » est absolument démentie par l'expérience, et nombre d'hommes pratiques le savent (§1843), même s'ils estiment utile de n'en pas parler en public. Beaucoup de religions, différentes dans la forme, sont des manifestations de sentiments religieux qui diffèrent peu. En outre, la religiosité est habituellement plus grande chez les hérétiques que chez ceux qui suivent la religion orthodoxe protégée par le gouvernement, lequel protège en effet une certaine théologie, certains actes du culte, mais persécute précisément cette même religiosité qu'il dit vouloir protéger. Ici, l'erreur est double : d'abord la confusion déjà signalée entre les dérivations et les résidus, c'est-à-dire entre la théologie et la religiosité ; puis la confusion entre certains résidus et le reste des résidus du même genre ou de genres analogues. Si les résidus de différentes religions sont a1, a2, a3,... et si l'on renforce l'ensemble de sentiments dont ils dépendent (§1744), on aura renforcé la religiosité ; mais si l'on renforce a1 au détriment de a2, a3,... la religiosité peut n'avoir pas augmenté, mais avoir, au contraire, diminué. Que l'on compare l'état de la religion catholique, aux États-Unis d'Amérique, où toutes les sectes chrétiennes ont une liberté très large, avec l'état de cette même religion, en France, lorsque, comme sous Napoléon III, par exemple, elle jouissait de la protection du gouvernement, et l'on apercevra aussitôt combien cette protection est inefficace pour renforcer les résidus religieux. Qu'on y ajoute l'exemple de Rome sous la papauté, où l'on avait en même temps de vigoureuses répressions des manifestations contraires au catholicisme et des résidus religieux catholiques très faibles [FN: § 1851-1].
§ 1852. L'erreur que nous avons signalée tout à l'heure a été perçue par beaucoup de personnes ; mais, comme d'habitude, au lieu de se manifester sous forme logico-expérimentale, cette intuition a pris la forme d'une dérivation qui, sous l'aspect logico-expérimental, est tout aussi erronée que celle à laquelle elle s'oppose. Les hérétiques ont revendiqué la « vérité » de leur hérésie, opposée à l' « erreur », de la religion dominante ; ils ont exalté leur « religiosité », opposée au relâchement de leurs adversaires ; ils ont démontré qu'ils étaient tout aussi bons citoyens que les orthodoxes, et même meilleurs. Puis les métaphysiciens et les théoriciens se sont mis à subtiliser sur ce sujet. Ils ont invoqué les « droits » de la conscience individuelle en présence des pouvoirs publics, la sacro-sainte « liberté de pensée », qui est de telle nature qu'on peut l'invoquer pour soi, tandis qu'on la dénie à ses adversaires, la « tolérance », dont les orthodoxes doivent user envers les hérétiques, tandis que ceux-ci sont dispensés d'en user à l'égard des orthodoxes ; un grand nombre d'autres argumentations semblables, qui ont parfois persuadé, non par la force de leur logique, mais parce qu'elles correspondaient à des sentiments qui, développés avec le changement des conditions sociales, entraient en conflit avec d'autres sentiments, lesquels étaient autrefois tout aussi vigoureux, et confondaient la religiosité en général avec l'une de ses manifestations. Ces argumentations ont aussi parfois persuadé, parce qu'elles correspondaient à des sentiments qui tiraient leur origine du renforcement des instincts des combinaisons, et de changements analogues en d'autres résidus.
§ 1853. Il est nécessaire de faire ici une distinction importante. Nous avons démontré que, pour obtenir les effets de la religiosité, il est bon que les personnes chargées de réglementer les actions d'autrui soient quelque peu, peut-être même très indifférentes aux formes de la religion ; mais la démonstration ne s'étend pas à ceux qui agissent, et ce serait une grave erreur que de vouloir la leur appliquer. Au contraire, l'attachement à sa foi et l'aversion pour celle d'autrui est généralement l'indice d'un sentiment vif de sa propre foi ; il est par conséquent aussi un indice que l'on obtiendra les effets désirés de la religiosité. Elliptiquement, on pourrait dire qu'il est bon que celui qui doit agir ait cet attachement et cette aversion, pourvu qu'on entende par là, non les dérivations par lesquelles ces deux sentiments se manifestent, mais les sentiments qui renforcent la foi (§1744). Si quelqu'un disait qu'il serait bien que les hommes fussent tolérants envers ceux qui ont une foi différente, il n'y aurait rien à objecter, sinon que celui qui affirme cela suppose inexistante une liaison (§126) qu'on observe habituellement. Il est de même utile que celui qui se sert de la religiosité des autres à des fins sociales, ne s'adonne pas à certaines manifestations extrêmes de cette religiosité. Celui qui a une foi vive la manifeste parfois d'une manière nullement raisonnable, et qui peut être parfaitement ridicule [FN: § 1853-1]. De même aussi, si quelqu'un disait – et beaucoup de gens le disent effectivement – qu'il serait bien que les hommes s'abstinssent de ces démonstrations, tout en éprouvant un sentiment vif de leur foi, la réponse serait identique à celle donnée tout à l'heure : soit qu'il n'y a rien à objecter à ce désir, sinon que croire cela possible c'est supposer inexistante une liaison qu'on a observée habituellement. Tout cela n'empêche pas que l'on puisse s'efforcer d'affaiblir ces liaisons, que l'on puisse essayer de diminuer l'intolérance de certains sentiments, le manque de bon sens et le ridicule de certaines manifestations. L'erreur naît lorsque, sans se soucier de l'existence des liaisons, on condamne et l'on veut supprimer les conséquences des sentiments qu'on veut conserver [FN:§ 1853-2].
La différence relevée ici entre celui qui fait agir et celui qui agit est d'ordre général ; nous en verrons un grand nombre d'autres exemples.
§ 1854. Pour faciliter l'exposition, nous avons employé tout a l'heure le terme religion, qui n'est et ne peut être défini avec précision ; c'est pourquoi il faut être en garde contre les erreurs qui pourraient provenir de son indétermination. Les ensembles appelés religions sont constitués par des résidus et des dérivations. Il y a des résidus communs à ces différents ensembles ; il y en a de différents. C'est de là précisément, en grande partie, que naît la difficulté de donner une définition unique de ces ensembles. Les définitions déjà données sont innombrables. On en discute depuis des siècles sans rien conclure ; à ces définitions s'en ajouteront d'autres à l'avenir, et l'on continuera à discuter sur les définitions futures comme sur les définitions passées, tant que les hommes se complairont à ces vains discours. Nous savons déjà que la valeur sociale des religions, comme celle de toute autre doctrine, dépend très peu des dérivations, énormément des résidus. En plusieurs religions, il y a un groupe important de résidus, constitué principalement par des persistances d'agrégats, qui correspondent à des sentiments de discipline, de soumission, de hiérarchie. C'est ce dont eurent plus ou moins l'intuition les gouvernements qui voulaient protéger la religion pour avoir des sujets fidèles. Ces sentiments se manifestent principalement par le culte. De là vient qu'au point de vue de l'utilité sociale, le culte importe beaucoup plus que la théologie. Cela est contraire à l'opinion commune, mais en accord avec les faits.
§ 1855. La haute valeur sociale de l'ancienne religion romaine provient justement de ce qu'elle était constituée presque exclusivement d'actes du culte, et qu'elle avait, par conséquent, un maximum de parties utile. Parmi les sectes chrétiennes, la valeur du catholicisme pour maintenir la discipline dépasse de beaucoup celle des autres sectes.
§ 1856. Ici surgit spontanément une objection. L'Italie est catholique ; pourtant les sentiments de discipline y sont beaucoup moins puissants qu'en Prusse, pays protestant. Pour rendre l'objection plus forte, laissons de côté le fait que le luthéranisme prussien est une des sectes protestantes où se maintiennent le plus les actes de discipline, et ne fixons notre attention que sur le fait principal qui donne la solution du problème : sur l'existence simultanée de différents groupes analogues de résidus. Parmi ceux-ci il en est de remarquables : ceux qui se manifestent par la foi monarchique et par l'esprit militaire, ainsi que par la soumission aux autorités. En Italie, ces résidus sont faibles ; en Prusse, ils sont très forts. C'est là un des si nombreux cas où un groupe de résidus se fortifie au détriment des groupes analogues.
§ 1857. Lorsqu'on fixe son attention principalement ou uniquement sur les dérivations, on désigne souvent par le même nom des choses différentes. Par exemple, un ensemble où il y a unité de dérivations nous apparaît comme une religion unique, tandis qu'elle peut être divisée en plusieurs, si l'on fait attention aux résidus différents, grâce auxquels elle est acceptée par des classes diverses de personnes. Voyons, par exemple, le socialisme. Les classes inférieures, qui attendent de cette religion l'amélioration de leur sort, acceptent le socialisme surtout grâce aux résidus d'intégrité personnelle, et en outre grâce aux intérêts. Dans les classes supérieures, nous avons d'abord ceux qui se servent du socialisme à leurs fins. Leurs actions sont principalement logiques ; par conséquent nous n'en parlons pas. Puis nous avons des gens qui acceptent le socialisme, mus surtout par des résidus de sociabilité, parmi lesquels ceux de l'ascétisme jouent souvent un grand rôle. La religion socialiste de ces gens, envisagée au point de vue des résidus, est donc entièrement différente de celle des classes inférieures. Des considérations analogues s'appliquent aux autres religions; par exemple à la religion catholique. Si l'on exclut, comme d'habitude, ceux qui s'en servent à leurs propres fins, il reste, avec unité de dérivations, des religions différentes selon les différents résidus qui sont mis en action ; et ici, nous avons une classe où les résidus de l'ascétisme ont une action de beaucoup prépondérante, en comparaison de celle des autres résidus. C'est ce que comprirent bien les hommes qui gouvernèrent l'Église catholique ; et, sous l'unité de dérivations, ils surent admettre les nombreuses variétés de résidus, qui se trouvent chez le clergé séculaire, le clergé régulier, les laïques, les différents ordres de frères, etc. Voilà un nouvel exemple où l'on voit, comme d'habitude, que l'art de gouverner consiste en grande partie à savoir utiliser les résidus existants (§1843).
§ 1858. Au point de vue de leur valeur sociale, les résidus de l'ascétisme sont en général inutiles et même nuisibles. Par conséquent, il est assez probable que la religion socialiste des classes inférieures est socialement utile, tandis que la religion ascétique des classes supérieures est nuisible. En somme, la première peut être révolutionnaire, mais elle n'est pas du tout contraire à la hiérarchie; au contraire, elle la favorise, et l'autorité des chefs socialistes est beaucoup mieux respectée que celle des magistrats de beaucoup de gouvernements. La religion socialiste est une grande école de discipline, et l'on peut dire qu'à ce point de vue, elle vient immédiatement après la religion catholique. Elle sert à renforcer les résidus de la Ve classe (intégrité personnelle) chez les hommes des couches inférieures de la société, et mieux que n'importe quelle autre mesure – y compris celle de l'instruction obligatoire – elle a pu soulever des individus appartenant à une masse amorphe à la dignité de citoyens ; par conséquent, la force d'action s'est accrue dans la société entière. Au contraire, la religion ascétique n'est que débilitante pour toute énergie. Quand elle est efficace, elle affaiblit les résidus de la Ve classe dans les couches sociales supérieures, et, du petit nombre d'individus qui l'acceptent de bonne foi, elle fait des êtres inermes, imbéciles, inutiles à eux-mêmes et à autrui, et tels que s'ils jouaient un rôle important dans le gouvernement de la société – ce qui n'est heureusement pas le cas – ils la mèneraient à sa ruine. La pratique de cette religion n'a pas une utilité plus grande que n'en avaient les actions des frères qui se macéraient dans le désert. Étant en dehors de la réalité des intérêts, cette pratique ne permet pas aux conflits sociaux de se résoudre suivant leur équilibre, et provoque une inutile consommation d'énergie. En conclusion, la religion du socialiste prolétaire et révolutionnaire a des effets opposés à ceux de la religion du socialiste « intellectuel » et « transformiste ». C'est ce que comprennent par intuition les gouvernements qui font la cour à cette dernière religion, dont ils peuvent se servir à leurs fins, et qui combattent avec acharnement la première, qui les empêcherait de continuer à exploiter le pays [FN: § 1858-1]. C'est aussi ce que comprennent par intuition plusieurs socialistes, quand ils repoussent la coopération des « capitalistes », des « intellectuels », et qu'ils ne veulent pas renoncer à la « lutte des classes ». On peut faire des observations analogues pour la foi des syndicalistes, des anarchistes ou d'autres sectes analogues qui se substitueront peu à peu à celles-ci. Souvent les classes supérieures ont, à leur déclin, de la répugnance à faire usage de la force. Cela arrive d'habitude parce que le plus grand nombre des individus qui les composent préfèrent recourir presque uniquement à la ruse, et le plus petit nombre, par manque d'intelligence ou par lâcheté, répugne à des actes énergiques. Comme nous le verrons plus loin (§2170 et sv.), l'usage de la force est indispensable dans la société, et si une classe gouvernante ne veut pas y recourir, il est nécessaire, au moins dans les sociétés qui continuent à subsister et à prospérer, que cette classe cède la place à une autre qui veuille et sache employer la force. De même que la société romaine fut sauvée de la ruine par les légions de César et par celles d'Octave, il se pourrait que notre société fût un jour sauvée de la décadence par ceux qui seront alors les héritiers de nos syndicalistes et de nos anarchistes.
§ 1859. Le point faible de la religion humanitaire n'est pas dans la défectuosité logico-expérimentale de ses dérivations. À ce point de vue, elles valent tout autant que les dérivations des autres religions ; mais, parmi celles-ci, il y en a qui renferment des résidus utiles aux individus et à la société, tandis que la religion humanitaire n'a que peu ou point de ces résidus. Comment se peut-il qu'une religion qui n'a d'autre but que le bien de l'humanité, et qu'on appelle humanitaire précisément pour ce fait, puisse ne pas avoir de résidus correspondant au bien de la société ? La réponse à cette objection a déjà été donnée au §1779. Les principes dont la doctrine humanitaire est une conséquence logique ne correspondent en rien aux faits. Ils expriment, sous une forme objective, un sentiment subjectif d'ascétisme. L'intention des humanitaires de bonne foi est de faire le bien de l'humanité, de même que l'intention d'un enfant qui tue un petit oiseau en le caressant trop était de faire le bien de cet animal. D'autre part, n'oublions pas que l'humanitarisme a eu aussi quelque effet social favorable, puisqu'il a contribué à faire diminuer les peines ; et si parmi celles-ci il y en avait d'utiles dont la réduction fut nuisible à la société, il y en avait aussi d'inutiles dont la réduction fut profitable (§1861). En revanche, la doctrine de l'humanitarisme ne tient pas debout, au point de vue logico-expérimental, soit parce qu'elle n'a aucune valeur intrinsèque de ce genre, soit et surtout parce que, même si par une hypothèse qui n'est pas du tout probable, elle avait cette valeur, cela ne servirait à rien pour pousser les hommes à des actions utiles, car ils sont guidés principalement par le sentiment. De semblables observations servent à juger l'action des « intellectuels ». Cette action a très peu d'éléments utiles et beaucoup de nuisibles, parce qu'au point de vue des sentiments, les intellectuels ferment les yeux à la réalité, telle qu'elle se reflète en un grand nombre de sentiments qu'ils condamnent par le fait qu'ils n'en comprennent pas le rôle social ; et, au point de vue logico-expérimental, ils ne raisonnent pas sur les faits, mais sur les dérivations, dont ils tirent avec une rigueur logique inopportune des conséquences qui divergent entièrement des faits (§1782). Les considérations que nous venons de présenter s'appliquent à la religion démocratique en général. Les nombreuses variétés de socialisme, de syndicalisme, de radicalisme, de solidarisme, de tolstoïsme, de pacifisme, d'humanitarisme, etc., forment un ensemble que l'on peut rattacher à la religion démocratique, et qui est semblable à celui des innombrables sectes qui apparurent à l'origine de la religion chrétienne. Nous voyons maintenant croître et dominer la religion démocratique, de même que les hommes des premiers siècles de notre ère virent commencer et croître la domination de la religion chrétienne. Les deux phénomènes ont de nombreuses et profondes analogies. Pour connaître le fond de ces phénomènes, il faut mettre de côté les dérivations et aller jusqu'aux résidus. La valeur sociale de l'une ou de l'autre de ces deux religions ne réside nullement dans leurs théologies, mais gît au contraire dans les sentiments manifestés par elles. Pour connaître la valeur sociale du marxisme, savoir si la théorie de la plus-value de Marx est erronée ou non, importe à peu près tout autant que pour connaître la valeur sociale du christianisme, il importe de savoir si et comment le baptême lave le péché originel ; c'est-à-dire que cela importe peu ou point. Certaines exagérations du syndicalisme n'enlèvent pas plus de valeur à la religion démocratique, que les exagérations franciscaines n'en enlèvent à la religion catholique. Les théories de la solidarité et la cosmogonie biblique sont également en dehors de la réalité expérimentale ; mais cela ne diminue nullement l'importance sociale des religions auxquelles les premières et la seconde appartiennent. Ainsi que nous l'avons relevé maintes et maintes fois, on ne peut, de la vanité logico-experimentale de ces dérivations ou d'autres semblables, tirer la conclusion qu'elles sont nuisibles ou même seulement inutiles ; ce sont des choses qui ont peu ou point de rapport. L'analogie de certaines dérivations de la religion chrétienne et de la démocratique explique qu'elles se confondent en certaines sectes, telles que celles des tolstoïens, des démocrates chrétiens, des protestants dits libéraux, des modernistes, des nouveaux admirateurs de Saint François, etc. Si l'on excepte et si l'on met à part les dérivations, nous voyons apparaître la grande transformation sociale qui s'est manifestée à l'origine du christianisme, et la non moins grande transformation sociale qui s'accomplit maintenant, et qui est manifestée par la religion démocratique. La découverte des rapports de ces transformations avec l'utilité sociale est un problème très important et très difficile. Pour le résoudre, il est nécessaire d'avoir une théorie de l'utilité sociale beaucoup plus développée, beaucoup moins imparfaite que celle dont nous pouvons à peine tracer maintenant les grandes lignes. Mais nous pouvons bien dire qu'on obtiendra la première approximation du problème en négligeant de considérer les dérivations dont l'action est secondaire et doit, par conséquent, n'être envisagée que dans des approximations successives. Nous pouvons ajouter qu'il est indispensable de considérer les sentiments manifestés par ces transformations, non pas objectivement, séparés des individus, mais en rapport avec eux, les mêmes sentiments pouvant être utiles chez certains individus, nuisibles chez d'autres. Enfin, il faut aussi laisser entièrement de côté des questions secondaires, telles par exemple que celle de la moralité de certains adeptes de ces religions. Chaque religion a ses parasites ; c'est un fait secondaire qui a peu d'action sur la valeur sociale des religions. Ceux de nos contemporains qui n'appartiennent pas à la religion démocratique sont, en grande partie, dans des conditions semblables à celles des Gentils qui assistaient à l'envahissement de la religion chrétienne. Aujourd'hui, quelques-uns estiment à tort, de même qu'autrefois leurs prédécesseurs estimaient à tort, pouvoir s'opposer efficacement au développement de la religion dont ils sont adversaires ; et ils croient pouvoir le faire en réfutant les dérivations de cette religion. D'autres personnes trouvent ces dérivations si absurdes qu'elles dédaignent de s'en occuper ; et en cela aussi elles agissent comme certains de leurs prédécesseurs [FN: § 1859-1]. Les uns et les autres font usage habituellement de dérivations qui ne sont pas du tout meilleures que celles qu'ils repoussent. Très peu de gens ont l'idée, peut-être pourrait-on dire que personne n'a l'idée de laisser entièrement de côté les dérivations, et d'étudier exclusivement les faits et les rapports qui existent entre eux.
§ 1860. (δ) Enfin l'on peut vouloir faire disparaître une certaine manifestation r, en conservant les autres s, t... ; ou bien vice versa instituer r sans que s, t,... existent aussi. C'est presque toujours très difficile, souvent impossible. Pour que les hommes accomplissent réellement et constamment les actions r, il est nécessaire qu'ils aient les sentiments correspondant aux résidus (a) dont (r) est la conséquence. S'ils ont ces résidus, avec r apparaîtront s, t... ; s'ils ne les ont pas, il n'y aura pas r, mais s, t.n'y seront pas non plus.
§ 1861. Supposons, par exemple, qu'on veuille supprimer les peines r pour les délits de pensée et les délits d'hérésie des différentes religions, et conserver des peines très graves s, t,.pour le vol et l'assassinat. Cela n'est pas impossible, puisque nous avons l'exemple de la Rome ancienne, mais est très difficile, puisque, durant de nombreux siècles, cela n'a pas eu lieu en Europe, chez, les peuples dits civilisés. En effet, chez eux, on a observé que là où r a disparu ou presque disparu, s, t,.se sont aussi affaiblis. Cet effet a été obtenu parce que le groupe de résidus (a) dont dépendent les peines s'est modifié dans le sens d'un accroissement des sentiments de pitié pour ceux qui transgressaient les règles en vigueur dans la société. En outre, certains intérêts, contraires à certaines religions, se sont développés, et cela explique pourquoi la diminution des peines a été plus grande pour certains délits d'hérésie que pour d'autres. Par exemple, après la chute du second Empire, en France, les intérêts des républicains étaient contraires à ceux des catholiques. Les peines pour offense à la religion catholique furent donc supprimées et, par extension, celles pour offense à la religion chrétienne. L'Empire s'était fait le champion – en paroles – de la religion sexuelle [FN:§ 1861-1] ; la République augmenta ensuite la liberté, dans ce domaine aussi ; mais plus tard, l'action de l'Empire oubliée, il se produisit un peu de réaction.
§ 1862. On observe aussi dans l'espace des effets semblables à ceux que nous avons signalés dans le temps. En France, les délits d'offense à la religion chrétienne sont entièrement exempts de peine, tandis qu'en Angleterre il y a quelque reste de peine pour celui qui offense le christianisme. Les délits d'hérésie sexuelle sont beaucoup moins recherchés et punis en France qu'en Angleterre. On observe une différence analogue pour les délits de droit commun, qui sont traités avec beaucoup plus d'indulgence en France qu'en Angleterre. De semblables faits résultent de ce que les hommes raisonnent, non d'après les méthodes des sciences logico-expérimentales, mais en usant principalement du sentiment (§826 et sv.).
§ 1863. Obstacles à l'institution d'une législation. Les obstacles à l'institution d'une législation parfaitement adaptée au but que se propose le législateur sont de deux genres. D'abord il faut trouver cette législation. Pour cela, il est nécessaire de résoudre, non seulement le problème particulier que nous venons de nous proposer (§1825), mais aussi l'autre, plus général, des effets indirects des mesures prises, soit de la composition des forces sociales (§2087). Pour accomplir cette œuvre, à supposer même que le législateur raisonne suivant les méthodes de la science logico-expérimentale, il lui manque encore les éléments scientifiques avec lesquels il pourrait résoudre son problème. On peut d'ailleurs raisonnablement espérer qu'en progressant la sociologie pourra un jour fournir ces éléments.
§ 1864. Mais ce n'est pas tout : il faut ensuite mettre en pratique cette législation. On ne peut le faire qu'en agissant sur les intérêts et sur les sentiments, et il faut prendre garde que les dérivations que l'on devra employer de ce fait diffèrent entièrement des raisonnements logico-expérimentaux qui peuvent faire découvrir la législation adaptée à ce but. Qu'on étudie quels furent, par le passé, les motifs invoqués pour faire accepter des mesures sociales, et l'on verra qu'ils étaient vraiment vains, et que très souvent les hommes visaient un but et en atteignirent un autre. Dans le petit nombre de cas où les gouvernants atteignirent le but qu'ils avaient voulu, ils entraînèrent le peuple, en lui faisant voir un but différent, et en l'encourageant par des discours du caractère voulu pour être entendus par le vulgaire, c'est-à-dire puérilement inefficaces, au point de vue logico-expérimental. Prenons garde, en outre, que là où, pour atteindre un certain but, on peut agir sur les intérêts et sur les sentiments en les modifiant, cette modification, outre les effets désirés, pourra facilement en avoir d'autres auxquels on ne vise pas du tout, et il restera à considérer ensemble les uns et les autres de ces effets, et à voir quelle sera, en fin de compte, l'utilité sociale pour l'ensemble. Ce problème est analogue à celui que doit résoudre la mécanique pratique pour construire une machine. Celle-ci transforme une partie de l'énergie en un effet voulu, et en perd une autre partie. La première partie est souvent très petite en proportion de la seconde.
§ 1865. Les mesures sociales ont aussi, en général, une partie utile et une partie inutile ou nuisible ; mais quiconque veut la première doit nécessairement accepter la seconde. Ici aussi, nous répétons qu'il faut considérer non seulement les effets directs, ainsi que nous le faisons maintenant, mais aussi les effets indirects, dont nous nous occuperons au chapitre suivant.
§ 1866. Quand le mécanicien a trouvé la meilleure machine, il éprouve peu de difficultés à la faire accepter, et sans exclure absolument les dérivations, il peut faire principalement usage de raisonnements logico-expérimentaux. Il n'en est pas de même de l'homme d'État, pour lequel les dérivations sont, au contraire, le principal, et l'expression de raisonnements logico-expérimentaux n'est que secondaire et exceptionnelle. Le choix d'une machine étant en très grande partie une action logique, il n'y a aucun inconvénient, par exemple, si l'on démontre que la machine à vapeur ne transforme en effet utile qu'une petite partie de l'énergie calorifique produite dans le foyer de la chaudière ; au contraire, cela peut être utile, puisque cela met sur la voie d'accroître la partie utilement consommée. Mais si le choix d'une machine était principalement une action non-logique, si, dans ce choix, le sentiment jouait un rôle important, il serait avantageux de posséder une théorie absurde, qui affirmerait que dans la machine à vapeur on ne perd pas la plus petite partie de l'énergie produite (§1868 et sv.).
Pour faire accepter la machine, il convient que quelqu'un se préoccupe d'y parvenir ; il convient encore beaucoup plus, il est même indispensable que, de même, pour faire accepter une mesure sociale, il y ait quelqu'un qui la patronne. Dans un cas comme dans l'autre, l'intérêt individuel est un puissant moteur ; mais pour les mesures sociales, le sentiment est encore plus efficace, spécialement s'il s'exalte et prend la forme d'une religion. Par conséquent, c'est une condition favorable, s'il est tel qu'il s'exprime par des dérivations enthousiastes, dépassant la froide réalité, et très différentes des raisonnements sceptiques des sciences logico-expérimentales. Actuellement, la popularité de ces sciences tient beaucoup à ce que le vulgaire les accepte comme des dérivations. Le progrès des sciences logico-expérimentales a fait naître un sentiment de vénération à leur égard, et il faut le satisfaire, mais cela n'est pas difficile parce que le vulgaire se contente d'une lointaine, très lointaine apparence logico-expérimentale donnée aux dérivations.
§ 1867. La proposition que nous venons d'énoncer au sujet des sentiments manifestés par les dérivations, est exprimée vulgairement en disant que les dérivations enthousiastes réussissent mieux que le froid raisonnement à déterminer les hommes à l'action ; et l'on peut aussi accepter ce mode elliptique de s'exprimer, pourvu que l'on entende qu'il s'agit, non des dérivations, mais bien des sentiments qu'elles manifestent (§2085).
§ 1868. Les sentiments qui s'expriment par des dérivations dépassant l'expérience et la réalité ont une grande efficacité pour pousser les hommes à l'action. Ce fait explique la façon dont se produit un phénomène très bien observé et mis en lumière par G. Sorel ; c'est que les doctrines sociales agissant avec efficacité (on dirait mieux : les sentiments manifestés par ces doctrines) prennent la forme de mythes [FN:§ 1868-1]. Répétant en d'autres termes une observation faite tant de fois déjà, nous dirons que la valeur sociale de ces doctrines (ou des sentiments qu'elles expriment) ne doit pas être jugée par leur forme mythique, qui n'est qu'un moyen d'action, mais bien intrinsèquement, par l'effet produit.
§ 1869. Cette matière n'étant pas facile, il sera peut-être bon, pour l'expliquer, d'avoir recours à l'intuition visuelle en mettant sous les yeux du lecteur une image grossière, peut-être même erronée si l'on y regarde de trop près, mais capable d'éclairer la notion beaucoup plus précise que donne le raisonnement. Négligeons les cas où les gens, croyant aller d'un côté, vont, en fait, d'un autre côté (§1873), et attachons-nous à ceux où l'on va, au moins en partie, du côté désiré. Supposons qu'un individu se trouve en h, où il jouit d'une certaine utilité représentée par l'indice ph, et qu'on veuille l'engager à se porter en m, où il jouira d'une utilité plus grande qm. Lui exposer la chose de cette façon serait peu propre à le pousser à l'action. Au contraire, on lui propose un point T, placé très loin sur la tangente hT à la courbe hm, et où l'on jouirait d'une utilité très grande rT, mais entièrement fantaisiste. Il arrive alors quelque chose d'analogue à ce qui se produit pour un point matériel mu par une force tangentielle h T sur une courbe hm ; c'est-à-dire que l'individu a T en vue et se porte vers T, mais, retenu par les liaisons de la pratique, il ne peut suivre la tangente hT : il est contraint de rester sur la courbe, et finit par se trouver en m, où d'autre part il ne serait peut-être jamais allé, s'il n'avait pas été sollicité par la force tangentielle selon hT.
§ 1870. Il est évident que pour connaître les conditions dans lesquelles l'individu se trouvera en m, il n'y a pas lieu de se préoccuper de T. L'indice rT est en somme arbitraire, et n'a aucun rapport avec l'indice réel mq, excepté celui-ci : que le déplacement vers T et vers m fait croître l'indice qui avait ph pour valeur. En outre, il n'importe vraiment pas du tout que T soit imaginaire, fantaisiste, si m est, au contraire, concret, réel.

Figure 29
§ 1871. Un être qui accomplirait exclusivement des actions non-logiques serait poussé de h en m, sans en avoir conscience. L'homme, qui est un animal logique, veut savoir pourquoi il se meut dans le sens hm ; aussi, celui qui est déjà poussé sur la voie hm par l'instinct, par ses intérêts ou par d'autres causes semblables, donne-t-il libre cours à sa fantaisie et imagine-t-il un but ou fin T. Lorsque ensuite, par la persistance des agrégats, la conception fantaisiste de T prend, chez lui, la valeur d'un sentiment, cette conception agit aussi indépendamment d'autres causes pour le pousser sur la voie hm. Elle agit de même sur ceux qui trouvent ces sentiments dans la société où ils vivent, et qui n'auraient pas d'autres motifs, ou en auraient de très peu déterminants pour parcourir la voie indiquée. Quand le but imaginé T est seulement une explication, il satisfait le désir de raisonnements logiques ou pseudo-logiques, mais a peu ou point d'effet pour pousser les hommes à agir ; et comme explication il a la valeur limitée du fait que les dérivations se rapprochent plus ou moins des raisonnements logico-expérimentaux. Les dérivations correspondent à la réalité dans la mesure où le trait hm de la courbe peut se confondre approximativement avec le trait hs de la tangente.
§ 1872. La divergence entre m et T et le fait que, pour aller en m, il faut viser à T, ont de nombreuses conséquences, outre celle que nous avons relevée tout à l'heure. Nous aurons à nous en entretenir dans ce chapitre et le suivant.
§ 1873. Il peut arriver, et il arrive effectivement parfois, que le phénomène ne se produise pas d'une manière analogue à celle indiquée par la fig. 29, mais qu'il ait lieu d'une manière analogue à celle indiquée par la fig. 30. Autrement dit, il arrive que l'individu qui voudrait se mouvoir selon h T, pour accroître l'utilité dont il jouit, se meuve, au contraire, de h à f, et fasse diminuer cette utilité, laquelle, au lieu de l'indice ph, finit par avoir l'indice plus petit vf. À ces cas se rattachent ceux où les dérivations ne correspondent en rien à la réalité, c'est-à-dire dans lesquels on ne peut supposer, pas même pour un petit parcours, que hT coïncide approximativement avec hf. En outre, il arrive souvent que la tendance à se porter en T se manifeste, de fait, dans une tout autre direction ; c'est le cas que nous avions commencé par exclure (§1869). L'intuition visuelle peut aussi aider grosso modo à mieux comprendre cela. La figure 30 peut représenter une section verticale de la superficie hf, sur laquelle l'individu doit se mouvoir. Voyons-en une projection horizontale (fig. 31). Le point h est mu par une force directe selon hT, mais il rencontre certains obstacles (préjugés, sentiments, intérêts, etc.) qui le contraignent à se mouvoir sur la ligne ehfg. Par conséquent, sous l'action de la force hT, il ne se meut nullement vers T, mais arrive en f. De même, un navire peut se mouvoir contre le vent. Les considérations développées tout à l'heure nous serviront encore dans la suite (§ 2148 et sv.) à l'étude de phénomènes analogues.

Figure 30

Figure 31
§ 1874. Nous venons de voir ce qui peut arriver ; reste à savoir ce qui arrive habituellement en réalité. Si l'on prend garde à l'ensemble des phénomènes, on voit immédiatement que, fût-ce entre des limites restreintes, les actions qui ont des buts idéaux T, ou qui sont accomplies comme si elles avaient ces buts, doivent en beaucoup de cas atteindre aussi des buts d'utilité individuelle et sociale, c'est-à-dire arriver à un point m où les indices de ces utilités vont croissant. En effet, les actions non-logiques sont encore en grand nombre et d'une grande importance à l'époque actuelle ; elles étaient en plus grand nombre et d'une plus grande importance dans le passé. Le moteur d'un grand nombre de ces actions, c'est-à-dire le but T auquel elles tendent, est exprimé par des dérivations théologiques, métaphysiques et autres semblables, tandis que le but pratique des hommes est le bien-être et la prospérité d'eux-mêmes et de leur société. Si ces deux buts étaient toujours opposés, si celui qui tend vers le premier n'atteignait jamais le second, il n'aurait pas été possible de voir subsister et prospérer des sociétés où il était si important d'atteindre le premier but. Pour revenir à la fig. 29 du §1869, les faits observés démontrent qu'il doit y avoir eu, dans les sociétés humaines, un grand nombre de cas où les phénomènes se sont produits d'une manière analogue à celle qui est indiquée par cette figure ; c'est-à-dire qu'en se portant vers T, les hommes doivent avoir pourvu à ce qui leur est utile, et s'être portés en m, parce que si tous les cas s'étaient, au contraire, produits presque tous comme ceux indiqués par la fig. 30 du §1873, c'est-à-dire si les hommes, se portant vers T, étaient allés en f, à leur détriment, les sociétés humaines auraient dû décliner toujours ; et comme cela n'est pas arrivé, l'hypothèse que nous avons faite demeure exclue.
§ 1875. Prenons garde que s'il est ainsi démontré que souvent les hommes qui visent un but imaginaire en ont atteint un autre, réel, qui leur a été favorable, il n'est nullement démontré que cela ait toujours eu lieu. Par conséquent, il reste encore à résoudre le problème qui recherche quand et entre quelles limites ces buts coïncident, étant données les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles on considère le phénomène. Nous ne savons pas non plus si, quand et où la substitution d'un but imaginaire à un but réel peut être utile. Avant d'entreprendre l'étude de ces problèmes et des différentes solutions qui en furent données, il faut que nous portions notre attention sur un sujet de nature plus générale.
§ 1876. LES BUTS IDÉAUX ET LEURS RAPPORTS AVEC LES AUTRES FAITS SOCIAUX [FN:§ 1876-1]. Supposons une société composée d'individus qui, en partie, agissent en visant certains principes idéaux T, en observant certaines règles idéales, ou bien en accomplissant des actions non-logiques qui apparaissent à un observateur comme des conséquences de ces principes, de ces règles, et étudions la nature et les effets des actions accomplies de cette manière, ainsi que les rapports de ces actions avec les diverses utilités (§2115 et sv.). Deux problèmes se posent aussitôt. 1° Comment les faits sont-ils en réalité ? 2° Comment sont-ils vus par ceux qui s'en occupent, et spécialement par les auteurs des théories et des doctrines ? Pour ceux-ci, les solutions des problèmes sont, au moins en grande partie, explicites ; mais pour le plus grand nombre d'hommes elles sont souvent implicites, c'est-à-dire que, sans les énoncer, les hommes agissent comme s'ils se laissaient guider par elles. On peut dire, mieux encore, pour éviter le danger habituel de confondre les actions logiques avec les actions non-logiques, que les actions des hommes sont de telle sorte que quiconque veut trouver un principe logique qu'elles supposent, est conduit à l'une des solutions indiquées. Ce principe est donc simplement déduit des actions par celui qui les observe ; ce n'est pas du tout un principe dont celui qui agit déduise logiquement sa manière d'agir (§2147 et sv.). Un autre problème vient s'ajouter à celui-là : 3° Comment les faits doivent-ils être vus pour que cela soit utile aux individus, à la société, etc. (§2115 et sv.). Mais ce problème rentre dans les précédents, si l'on considère comme but T la croyance à certains faits, et, de cette façon, il correspond au 1er problème posé tout à l'heure. Cela nous permet aussi d'apercevoir un autre problème qui correspond au 2° que nous venons de rappeler, et que l'on peut énoncer en disant : 4° Comment le rapport entre l'utilité et la manière dont les hommes interprètent les faits a-t-il été vu par les gens, et spécialement par les auteurs ? On a fait allusion souvent déjà aux 3e et 4e problèmes, sans les nommer explicitement, et nous aurons à en parler encore, au cours de cet ouvrage. Plus loin (§1896, 1932), nous en traiterons un peu en général et dans un cas particulier. Ici nous considérerons seulement le 1er et le 2e problèmes, et nous aurons les sujets d'étude suivants :
- I. Le but ou fin T (§1877 et 1878)
- I – 1° Premier problème (§1877);
- 1 – 2° Second problème (§1878) ;
- II. Les rapports de T et de m (§1879 à 1891) ;
- II - 1° Premier problème 1879 à 1882) ;
- II - 2° Second problème 1883 à 1891) ;
- II - 2° (a) On confond, ou du moins on rapproche beaucoup T et m (§1883 et 1884) ;
- II - 2°(b) On sépare entièrement et a priori les buts T, de l'utilité m (§1885 à 1891);
- II - 2° (b-α) On considère certains buts T (§1886)
- II - 2° (b-β) On oppose nettement les buts imaginaires T à l'utilité (§1887) ;
- II - 2° (b-γ) Cas intermédiaires (§ 1888 à 1891);
- III. Manière dont on unit T comme effet à certaines causes (§1892 et 1893);
- III - 1° Premier problème (§1892)
- III - 2°Second problème (§1893) ;
- IV. Nature des voies qui conduisent au but T (§1894 et 1895)
- IV - 1° Premier problème 1894)
- IV - 2° Second problème 1895).
§ 1877. 1 - Le but ou fin T. Puisque nous le supposons en dehors de l'expérience, les buts logico-expérimentaux auxquels tendent les sciences et les arts demeurent exclus de la présente étude.
I - l° Pour les animaux, T paraît être un simple instinct. Il peut l'être aussi pour les hommes, dans un petit nombre de cas ; mais, habituellement, il s'exprime au moins sous forme de résidus, et pour satisfaire le besoin de logique que l'homme éprouve, sous forme de dérivations manifestations (§1688). Il faut distinguer le but T (α) qu'un homme a spontanément, du but T (β) qu'un autre homme s'efforce de lui suggérer. Cette distinction a une très grande importance dans les sociétés humaines, à cause de l'opposition que l'individu ressent entre son utilité propre et celle d'un autre homme ou de la société. On peut dire que l'histoire de la morale et de la législation est l'histoire des tentatives faites pour concilier tant bien que mal ces différents genres d'utilité. Pour les animaux, l'instinct pourvoit à cette conciliation. L'effet en est admirable, pour concilier l'utilité des petits avec celle des père et mère, et souvent pour substituer la première à la seconde. Il se produit quelque chose de semblable pour les hommes ; mais le besoin qu'ils éprouvent de raisonner les empêche de s'en tenir à des actes purement instinctifs, et les pousse dans le vaste domaine des dérivations.
§ 1878. 1 - 2° La manière dont les hommes qui ont arrêté leur attention sur les buts T les ont vus, est généralement la suivante : ils les ont considérés comme des principes absolus, ou du moins comme des principes expérimentaux, résultant d'une forme réelle présumée aux principes imaginaires. Cela a eu lieu non seulement en vertu de la tendance que les résidus de la persistance des agrégats, dont les T sont constitués, ont d'assumer une forme absolue, ou tout au moins une apparence de réalité concrète, mais aussi en vertu de l'utilité pratique qu'il y a de ne laisser aucun doute s'insinuer dans l'esprit de qui l'on veut persuader, et de se servir dans ce but de la force que l'absolu, ou du moins la réalité présumée, confère aux principes. Les deux motifs subsistent de nos jours. Le second se fortifie même avec les progrès de la science, qui donne une plus grande autorité à la réalité. Il ne semble pas que ces motifs soient sur le point de disparaître prochainement. On peut donc prévoir qu'il continuera à y avoir des T à caractère absolu et des T imaginaires présentés comme réels, et que si les liaisons que nous connaissons maintenant ne changent pas, la société ne peut exister sans de tels buts (§2143 et sv.).
Les auteurs qui ne veulent pas se placer entièrement en dehors du monde réel sont contraints de reconnaître l'existence de ces buts dans le passé et dans le présent ; mais une partie d'entre eux affirment qu'ils disparaîtront, et qu'au terme de l'évolution il n'y aura plus que des buts expérimentaux.
§ 1879. II. Les rapports entre le but T et le point m auquel les individus parviennent effectivement, et les rapports entre le but T et les différentes utilités.
II - 1° La solution du problème objectif résulte de l'ensemble des études auxquelles nous nous livrons ici. C'est en partie pour y arriver que nous avons dû traiter longuement des résidus et des dérivations, afin de retrouver le fond sous la forme. En résumé, on peut dire que le fait de viser à une fin imaginaire T, pour atteindre une fin réelle m, est un moyen souvent indispensable, mais aussi toujours imparfait, d'atteindre cette fin. L'emploi de ce moyen est analogue à celui d'une machine qui transforme en énergie utile une partie seulement de l'énergie totale qu'elle consomme (§1864 et sv.). Par conséquent, si l'on affirme que le fait de substituer la recherche d'une fin réelle, expérimentale, à celle d'une fin imaginaire T, supprimerait une déperdition de forces, accroîtrait l'utilité de la société, on ne s'écarte nullement de la vérité ; de même qu'on ne s'en écarterait pas non plus en affirmant que le fait d'employer des machines qui transforment en effet utile la totalité de l'énergie consommée, supprimerait une déperdition dans l'économie sociale, et accroîtrait l'utilité de celle-ci.
§ 1880. Reste à savoir maintenant si cela est possible. C'est le problème le plus important pour qui ne veut pas rester dans les nuages. Ainsi que nous l'avons déjà relevé (§130 et sv.), si l'on conserve toutes les liaisons du système social, ce qui existe ne diffère pas de ce qui pourrait exister, et les cas possibles sont ceux où l'on suppose inexistantes certaines liaisons dont ou peut effectivement observer l'absence en des cas réels (§2143 et sv.).
§ 1881. En somme, ce fait est admis aussi, implicitement du moins, par ceux qui, aux fins imaginaires, veulent substituer des fins réelles, et rendre la vie sociale entièrement logico-expérimentale ; mais habituellement ces personnes réduisent ces liaisons à une seule : l'ignorance. Elles ne doutent nullement qu'une fois cette ignorance dissipée, la société suivra la voie qu'elles indiquent. On peut supposer inexistante la liaison de l'ignorance, au moins en grande partie, car il est certain qu'il y a et qu'il y a eu des hommes instruits, et que, dans l'ensemble de la société, le savoir s'est accru avec les siècles. Il n'y a donc pas là de difficulté qui nous entrave ; mais elle surgit insurmontable, dans la partie du sujet qui réduit à la seule liaison de l'ignorance toutes les liaisons qu'il faut supprimer pour rendre la conclusion possible. Si les hommes les plus intelligents, les plus instruits ou « savants », au sens vulgaire du mot, étaient aussi ceux qui donnent le plus d'importance aux principes logico-expérimentaux dans les matières sociales et excluent les autres principes, il serait permis de conclure qu'avec le temps des hommes semblables refuseraient tout ce qui n'est pas logico-expérimental, et que les autres hommes, en se rapprochant des premiers par leur savoir, se rapprocheraient d'eux aussi en ce qu'ils admettraient uniquement les principes logico-expérimentaux. Mais les faits ne se passent point ainsi. Parmi les hommes intelligents, instruits et « savants », au sens vulgaire du mot, si les théologiens ont vu diminuer leur nombre et leur pouvoir, les métaphysiciens proprement dits prospèrent, jouissent de la renommée et du pouvoir. Ils sont renforcés par d'autres métaphysiciens, dits « positivistes », ou qui, sous différents noms, sortent à chaque instant du domaine logico-expérimental. De nombreux savants, éminents dans les sciences naturelles, où ils font usage exclusivement ou presque exclusivement des principes logico-expérimentaux, les oublient bel et bien lorsqu'ils dissertent sur les « sciences » sociales [FN:§ 1881-1]. Quant à l'ensemble de la population, on observe une succession de théologies et de métaphysiques, plutôt qu'une diminution de la totalité de ces phénomènes (§2329 et sv.), ainsi que nous l'avons vu souvent déjà, et comme nous le rappellerons de nouveau tout à l'heure en étudiant le second problème.
§ 1882. Nous conclurons donc que le fait de viser à certains buts ou fins imaginaires T fut souvent dans le passé, continue dans le présent, et continuera probablement dans un avenir prochain, à être utile aux sociétés humaines (§1932) ; que souvent il arrive qu'il y a plusieurs fins T, T', T". , très différentes au point de vue des dérivations, mais équivalentes ou presque équivalentes au point de vue de l'utilité sociale (§1740, 1850 et sv.) ; mais que tout cela n'empêche nullement que le fait de tendre à d'autres fins imaginaires, théologiques ou métaphysiques, puisse avoir été dans le passé, soit dans le présent, et soit à l'avenir nuisible à la société (§1873, fig. 30). On ne peut pas résoudre d'une façon générale le problème de l'utilité de ces fins : il faut distinguer de quelles fins il s'agit, et voir dans quels rapports elles se trouvent avec les autres faits sociaux. Il faut faire cette distinction, non seulement qualitativement, mais aussi quantitativement (§2142 et sv.). En outre, il faut rechercher s'il existe une certaine proportion plus avantageuse que d'autres à l'utilité sociale, entre la poursuite de buts imaginaires et celle de buts logico-expérimentaux. Ce n'est pas tout. La société étant hétérogène, il faut tenir compte de ce fait, et il est nécessaire de se livrer aux recherches susdites pour les différentes classes sociales. C'est précisément ce que nous ferons au chapitre suivant.
§ 1883. II-2°. Quand les doctrines qui ont eu cours sur les rapports entre T et m font largement usage des dérivations, elles apparaissent mieux dans l'étude de III et de IV. Maintenant, nous prêtons plus attention au fond qu'à la forme des doctrines qui établissent un rapport entre T et m.
II-2° (a). On confond, ou du moins on rapproche beaucoup T et m. On peut le faire de deux façons : (A) on croit que tendre à la fin idéale est la meilleure manière de réaliser son utilité et celle d'autrui. On tend à T et l'on arrive à m. (B) Vice versa, on croit tendre à une fin idéale, quand au contraire, on recherche en somme son utilité personnelle ou celle d'autrui. On tend à m et l'on invoque T. D'ailleurs tout cela demeure très indéterminé [FN: §1883-1], ainsi que nous le verrons mieux en un cas particulier (§1897 et sv.). Les diverses utilités notamment sont souvent confondues.
(A) Ces doctrines sont beaucoup plus nombreuses et plus importantes que les autres. Cela parce que le but des doctrines est presque que toujours de persuader l'individu de tendre à une fin qui procure l'utilité d'autrui ou de la société. Si nous désignons par T (1) la fin égoïste qui procurerait l'utilité m (1) de l'individu, et par T (2) la fin altruiste qui procurerait l'utilité m (2) d'autrui ou de la société, le but d'un très grand nombre de doctrines éthiques est de confondre en une seule masse homogène T (1), T (2), m (1), m (2). Si l'on met au premier plan l'utilité m (1) de l'individu, de laquelle se rapprochent jusqu'à se confondre ou à être très rapprochées les fins T (1), T (2) et l'utilité m (2), on a les germes dont naîtront, par des dérivations opportunes, les différentes « morales utilitaires ». Depuis les temps les plus reculés, ces morales utilitaires parviennent jusqu'à nous. Elles s'expriment depuis les fables en usage à l'enfance de nos races jusqu'aux élucubrations de Bentham et des positivistes. Le plus grand nombre des individus ne peut oublier son utilité propre m (1) ; il faut donc leur montrer qu'on la réalise en tentant à T (2), et en parvenant à m (2).
Si l'on met au premier plan T (2), souvent confondu avec T (1), et desquels se rapprochent m (1) et m (2), on a les germes de nombreuses morales théologiques et métaphysiques. Pour mieux rapprocher T (2) de m (1) et les confondre, les morales théologiques font usage de sanctions appliquées par leur être surnaturel. Les morales métaphysiques y substituent un impératif quelconque, sans grande efficacité, il est vrai (§1886, 1938).
§ 1884. (B) L'égoïste agit consciemment, visant à m et invoquant T ; mais un grand nombre de gens de parfaite bonne foi font aussi cela. Rares sont les hommes cyniquement égoïstes, et rares aussi sont les purs hypocrites. La plupart des hommes désirent concilier leur avantage personnel avec les résidus de la sociabilité (IVe classe), faire leur propre bien, et paraître faire celui d'autrui, couvrir l'égoïsme du manteau de la religion, de l'éthique, du patriotisme, de l'humanitarisme, de la fidélité au parti, etc., tendre à des satisfactions matérielles, et faire semblant de n'en rechercher que d'idéales [FN:§ 1884-1]. En outre, ces hommes se procurent de la sorte l'appui des personnes qui sont alléchées par la beauté du but idéal T, tandis qu'elles se soucieraient assez peu, peu ou pas du tout, du but humble et terre à terre m. C'est pourquoi ils se mettent en quête de théories capables d'atteindre le but. Ils en trouvent aisément ; et les théoriciens de la théologie, de l'éthique, de la sociabilité, ainsi que d'autres personnages, leur en fournissent beaucoup. Tous réalisent parfois aussi leur propre avantage, en vendant une marchandise recherchée sur le marché, tandis qu'ils semblent n'être en quête que de doctrines sublimes.
§ 1885. II-2° (b) On sépare entièrement les fins T de l'utilité m. Habituellement, ce n'est qu'en apparence que l'on s'occupe des fins T en général, tandis qu'en somme les auteurs des doctrines ont principalement ou exclusivement en vue certaines de leurs fins particulières T.
§ 1886. II-2° (b-α). On considère uniquement certaines fins T. L'auteur ne se soucie pas de l'utilité m, ou bien il l'envisage comme n'ayant que peu ou point de valeur. On a ainsi les morales théologiques ou métaphysiques qui, faisant abstraction de l'utilité, imposent d'une manière absolue ce que l'homme doit faire, et en outre les morales ascétiques, mystiques et autres semblables. Grâce aux puissants résidus de l'ascétisme, ces dernières morales sont importantes, mais beaucoup moins que les morales de la classe (I). En général, l'ascétisme est sa propre fin ; mais parfois, grâce aux sanctions surnaturelles, il peut aboutir à une morale qui ait l'apparence d'une morale de la classe (I) ; c'est lorsqu'au lieu de l'utilité réelle m, il considère une utilité imaginaire. Cette apparence est trompeuse, car, comme critère de classification, m doit être essentiellement réel.
§ 1887. II-2° (b-β). On oppose nettement les fins imaginaires T à l'utilité m. Les auteurs ont l'habitude de s'exprimer comme s'ils traitaient de toutes les fins imaginaires ; mais en somme ils n'ont en vue que certaines fins, auxquelles ils veulent en substituer d'autres, également imaginaires. On a le choc de deux théologies, de deux métaphysiques, et non le choc de la théologie et de la métaphysique avec la science logico-expérimentale. Dans cette catégorie figurent les doctrines purement ascétiques, qui ne visent pas à une félicité ultra-terrestre, qui sont leur propre fin, qui repoussent délibérément l'utilité. Il s'y trouve aussi les doctrines pessimistes, qui affirment que quelle que soit la fin proposée, on ne pourra jamais arriver à la félicité, que l'on confond ici avec l'utilité.
§ 1888. II-2° (b-γ) Cas intermédiaires. On ne sépare pas a priori T de m : on les considère comme des phénomènes séparés, qui peuvent avoir entre eux différents rapports. Si ceux-ci sont expérimentaux, on arrive à la solution logico-expérimentale ; c'est-à-dire qu'on a la solution II-1°. S'ils dépassent l'expérience, ou bien sont fixés a priori, on a diverses dérivations. Parmi celles-ci, il faut remarquer les doctrines qui divisent les fins imaginaires T en deux classes, dont une (T h) passe pour être toujours utile, une autre (T k) toujours nuisible, extrêmement nuisible. Inutile d'ajouter que la classe (T h) est celle qui correspond à la religion de l'auteur. On confond très souvent ce cas avec les précédents, parce que les auteurs n'admettent habituellement pas la division des fins imaginaires ou même seulement idéales T en deux genres (T h) et (T k). Pour eux le genre (T h) existe seul, et les fins (T h) sont les seules existantes ; par conséquent elles sont « réelles », « vraies », tandis que les fins (T k) sont inexistantes, « irréelles », « fausses ». De la sorte, les fins (T h) étant les seules existantes suivant les théories de ces auteurs, elles prennent la place de la catégorie (T) dont il s'agit dans les cas précédents, et elles se confondent avec elle.
§ 1889. On observe des phénomènes de cette sorte dans l'histoire, lorsqu'une religion veut en supplanter une autre. Alors on les aperçoit clairement. Ils sont un peu plus voilés, quand les doctrines matérialistes, positivistes ou autres semblables, attaquent toutes les « religions » ; mais il suffit d'un peu d'attention pour s'apercevoir que ces doctrines ne diffèrent des religions qu'elles combattent que par le nom et pas par le fond, et qu'en réalité ce qu'on dit être la lutte de la « Raison » contre les religions positives est seulement la lutte de deux théologies. Il ne faut pas oublier que si l'on invoque aujourd'hui la « Raison » contre le christianisme, celui-ci l'a déjà invoquée contre le paganisme, et que la théologie moderne du Progrès n'est nouvelle qu'en partie, tandis que partiellement elle reproduit sous d'autres formes des conceptions anciennes.
§ 1890. Dans la théologie du Progrès, l'histoire de l'humanité est surtout, peut-être exclusivement le récit de la lutte entre un principe du « Mal », qui est la « Superstition », et un principe du « Bien », qui est la « Science ». Écrire l'histoire revient simplement à paraphraser le vers de Lucrèce :
Tantum Religio potuit suadere malorum.
La religion du Progrès est polythéiste. La Superstition, reine des ténèbres, princesse du Mal, a tout un cortège de divinités inférieures, et, ainsi qu'il arrive habituellement, parmi celles-ci il en est dont le crédit augmente, et d'autres dont le crédit diminue ou même s'annule. À une certaine époque, l'auri sacra fames occupait la première place dans la hiérarchie. Aujourd'hui, elle est bien déchue. Aux temps de la ferveur chrétienne fut en vogue la superstition païenne, que l'on opposait à la Vraie Religion. Dans les temps modernes, la Propriété privée disputa la première place à la Superstition. Rousseau la dénonça dans des invectives terribles. Mais aux temps de la révolution de 1789, la Superstition régna de nouveau, avec tout un cortège de ministres : les rois, les nobles, les prêtres. Ensuite, on revint à d'autres spéculations théoriques, et le Capitalisme succéda à la Propriété privée, comme Jupiter succéda à Saturne. Bienheureux qui possède cette clé du savoir ! Tout phénomène passé, présent ou futur est expliqué par le mot magique de Capitalisme. Le Capitalisme seul est la cause de la misère, de l'ignorance, des mauvaises mœurs, des vols, des assassinats, des guerres. Il ne sert à rien de citer l'exemple des femmes disciples de Messaline [FN:§ 1890-1], que l'on trouve en tout temps. C'est un article de foi que si le capitalisme n'existait pas, toutes les femmes seraient chastes, et la prostitution n'existerait plus. Il ne sert à rien de citer l'exemple des peuples sauvages qui passent leur vie en guerres perpétuelles. La foi nouvelle nous impose de croire que, sans le capitalisme, on ne verrait aucune espèce de guerre. Cependant aujourd'hui un grand nombre de socialistes prennent part à la guerre. Ils cherchent à s'excuser par une belle casuistique : ils sont opposés aux guerres en général, partisans de celle qui leur profite en particulier. S'il existe des pauvres, des ignorants, des paresseux, des malfaiteurs, des alcooliques, des aliénés, des débauchés, des voleurs, des assassins, des conquérants, c'est exclusivement la faute du capitalisme. Le raisonnement par lequel on démontre ce fait est le post hoc, propter hoc habituel. La société est capitaliste. Donc, ses maux proviennent du Capitalisme. Il s'y ajoute d'autres raisons, qui reviennent en somme à affirmer que si les hommes avaient de tout à satiété, ils ne commettraient pas d'actes malfaisants et de crimes pour se procurer ce qui leur manque ; et comme on admet que seul le Capitalisme empêche les hommes d'avoir tout à satiété, il en résulte que cette entité est la cause de tout acte malfaisant.
§ 1891. Au principe du Mal s'oppose le principe du Bien, qui fut jadis la Vraie Religion, et qui est aujourd'hui la Science. Elle aussi s'entoure de divinités secondaires, telles que la Démocratie, l'Humanitarisme, le Pacifisme, la Vérité, la Justice, et toutes les entités qui peuvent mériter l'épithète de progressistes. Ainsi que les anges de lumière combattent les anges des ténèbres, ces divinités luttent contre les entités dites réactionnaires, et défendent et sauvent la pauvre humanité des embûches de ces démons.
§ 1892. III. Manière dont on unit T, comme effet, à certaines causes. III-1° Nous avons déjà vu l'une de ces manières, qui consiste en la confusion que l'on cherche à établir entre les fins et les utilités. Mais ce n'est pas la seule, soit parce qu'on peut lier les fins et les intérêts d'une autre manière que par cette confusion, soit parce qu'outre les intérêts, les hommes ont des passions, des sentiments, auxquels on peut lier les fins. Quant aux moyens d'obtenir l'union des fins à d'autres faits, nous avons, non seulement, la persuasion, mais aussi la contrainte. Celle-ci apparaît dans l'hostilité que subit celui qui viole des usages, des coutumes, des règles, en usage dans la société où il vit. Elle est mise en pratique dans les lois pénales. Nous ne nous en occupons pas ici. Pour la persuasion, on a d'innombrables productions littéraires, depuis les simples fables jusqu'aux plus subtiles élucubrations théologiques, éthiques, métaphysiques, positivistes, etc. Comme nous l'avons vu tant de fois déjà, la force persuasive de ces productions ne réside pas dans les dérivations, mais bien dans les résidus et dans les intérêts qu'elles mettent en action. C'est pourquoi seules resteront en usage les productions qui lient les fins à de puissants résidus et à d'importants intérêts. On peut trouver ces résidus dans les différentes classes. Très forts sont certains résidus de persistance des agrégats. Seuls ou unis à d'autres résidus, parmi lesquels il faut noter surtout ceux de la sociabilité, ils donnent les nombreuses entités dont les hommes ont peuplé leurs Olympes divins, métaphysiques, sociaux. Nous pouvons donc prévoir que les fins T seront liées à ces entités. C'est précisément ce qu'on observe dans les morales théologiques, métaphysiques, et dans celles qui se fondent sur la vénération pour la tradition, pour la sagesse des ancêtres, à laquelle correspond aujourd'hui l'excellence du Progrès, pour les us et coutumes de la tribu, de la cité, de la nation, des gens. Dans les us et coutumes, les résidus de la sociabilité jouent un rôle remarquable ; et l'un des genres de ces résidus, le genre IV-dzéta, joue un rôle principal dans les morales de l'ascétisme.
Pour rester dans la réalité, il faut prendre garde qu'un grand nombre de fins T exprimant des règles de vie sont données, sinon dans la forme, du moins dans le fond. Elles sont un produit de la société où on les observe, et non la conséquence de recherches théoriques. Par conséquent on recherche non pas la fin T, mais bien, T étant donnée, avec quoi et comment il faut la lier (§636, 1628). Dans le temps, le but auquel on veut persuader à l'individu qu'il doit tendre varie peu, au moins quant au fond. Les résidus avec lesquels on le lie varient un peu plus. Les dérivations et les raisonnements pseudo-scientifiques qui servent à la liaison varient beaucoup plus.
§ 1893. III-2° Généralement, dans les doctrines, quand les fins ne s'imposent pas d'elles-mêmes d'une manière absolue, on les tient pour une conséquence de principes théologiques, métaphysiques, ou de l'intérêt ; et l'on a ainsi les diverses morales dont nous avons déjà vu les germes en étudiant les rapports de T et de m (§1883 et sv.). Quant au mode d'union, on croit sans autre qu'il est rigoureusement logique. Aujourd'hui, on le dit scientifique et même expérimental. De la sorte, l'expression de la fin T apparaît comme l'énoncé d'un théorème. Il est vraiment miraculeux qu'on retrouve ainsi ce qui existait dans la conscience de qui était à la recherche du théorème, et très souvent dans l'opinion de la collectivité à laquelle cet individu appartient. Il n'y a pas de danger que le moraliste théoricien aboutisse dans ses recherches à un théorème qui répugne à sa conscience, et il est bien rare qu'il aboutisse à un théorème qui répugne à l'éthique de la société où il vit. Vice versa, si l'on démontre qu'une certaine fin T n'est pas une conséquence logique de principes expérimentaux ou du moins « rationnels », on croit avoir démontré qu'elle ne peut être que nuisible. Là encore, il est vraiment merveilleux que les fins qui ne plaisent pas au moraliste, ou qui sont contraires à l'éthique de sa collectivité, soient précisément celles que de ce fait on trouve contraires à l'expérience, ou du moins à la « raison ».
1894. IV. Nature des voies qui conduisent au but T. IV-1° C'est proprement le sujet de l'étude des dérivations. Nous l'avons déjà faite en grande partie. D'abord, nous avons trouvé (§306 et sv.) les voies qui aboutissent à faire paraître logiques les actions non-logiques accomplies en visant au but T. On suit ces voies avec l'intention explicite, mais plus souvent implicite, de confondre T avec m, car les actions logiques mènent à m ; et si elles mènent aussi à T, la logique étant unique, on ne peut distinguer T de m. Ensuite, nous avons trouvé d'autres voies, quand nous avons étudié les dérivations en général. Ces voies nous sont apparues alors comme des cas particuliers de faits généraux. Nous verrons tout à l'heure d'autres cas particuliers (§1902 et sv.). Ici, nous n'avons pas à nous étendre sur ce sujet.
§ 1895. IV-2° Nous n'avons pas non plus à nous arrêter sur la manière dont ces voies sont considérées dans les doctrines, parce que nous avons souvent exposé, et nous avons récemment rappelé que les dérivations et les raisonnements pseudo-scientifiques sont considérés comme des raisonnements logico-expérimentaux. Nous ne nous attarderons pas non plus à décrire ici comment, bien que scientifiquement faux, ce fait peut souvent être utile au point de vue social. Nous avons déjà traité abondamment de ces sujets, et nous aurons à y revenir.
§ 1896. Maintenant disons deux mots des 3e et 4e problèmes mentionnés au §1876.
3° Comment il est utile aux individus, à la société, etc., que les faits soient vus. Nous aurons surtout à considérer le problème II-1° du §1876, et nous devons répéter que sa solution résultera de l'ensemble des études que nous sommes en train d'accomplir. Nous traiterons longuement de ce problème au chapitre suivant. Pour le moment, nous nous bornons à le poser. On doit le comprendre comme embrassant, non pas les doctrines considérées en elles-mêmes, séparées des individus qui les professent, mais bien les doctrines considérées dans leurs rapports avec les individus et le rôle qu'elles jouent dans la société. C'est ce que les empiriques comprirent en tout temps, et que la théologie de l' « égalité » nie aujourd'hui a priori. Pour employer la terminologie en usage, laquelle pourtant pourrait induire en erreur par son manque de précision, nous dirons qu'il peut être utile que les hommes croient vraies des doctrines erronées. Nous nous rapprocherons un peu plus de la réalité en employant des expressions plus précises, et en disant qu'il peut être utile que les hommes croient conformes à l'expérience, à la réalité, des doctrines qui ne le sont pas.
4° Comment le rapport entre les utilités et la manière dont les hommes comprennent les faits a été vu par les gens, et spécialement par les auteurs. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les empiriques ont vu parfois, mais indistinctement, une solution qui se rapproche de celle que nous avons indiquée tout à l'heure : la solution de la science logico-expérimentale. Un très petit nombre de théoriciens en eurent quelque notion ; le plus grand nombre accepta des solutions qui correspondent à celles de II-2° (a). On a confondu la « vérité » et l'utilité, en affirmant qu'il est toujours utile pour soi-même et pour les collectivités, que les hommes voient les faits sous leur véritable aspect. Si par « vérité » on entend la conformité avec l'expérience, cette proposition est erronée, ainsi que les empiriques l'ont bien vu en tout temps. Si, comme il arrive souvent, par « vérité » on entend la conformité avec certains concepts nébuleux de l'auteur, la proposition peut se rapprocher de la réalité expérimentale ou s'en écarter entièrement, suivant que l'utilité de ces concepts nébuleux se rapproche ou s'écarte de l'expérience (§1773 et sv.). À la « vérité » peuvent venir s'ajouter d'autres fins que l'on confond avec l'utilité. Parmi elles figure très souvent la « justice ». On affirme, par exemple, que seul est utile ce qui est vrai, juste, moral, etc. En outre, la théologie de l' « égalité », qui fait aujourd'hui partie de celle du Progrès, repousse avec horreur l'idée qu'il peut être utile que les individus aient des doctrines différentes, qu'ils tendent à des fins différentes, suivant leur rôle social.
Les autres solutions sont de moindre importance. Il n'est pas nécessaire de nous y arrêter maintenant. Nous ne pouvons poursuivre ces études, parce que les notions précises des différentes utilités nous font défaut (§2115 et sv.). Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre suivant. En attendant, afin de mieux comprendre les théories générales exposées tout à l'heure, et qui sont très importantes pour la sociologie, il sera bon d'examiner un cas particulier.
§ 1897. RAPPORT ENTRE OBSERVER DES RÈGLES DE LA RELIGION ET DE LA MORALE, ET RÉALISER LE BONHEUR INDIVIDUEL [FN: § 1897-1]. En tout temps, les hommes se sont occupés de rechercher si, en observant ces règles, l'homme faisait son bonheur. Ce problème est plus restreint que les précédents ; d'abord parce qu'on ne recherche pas les rapports en général, mais qu'on veut uniquement connaître si l'on arrive ou si l'on n'arrive pas au bonheur. Par conséquent, on exclut les solutions théologiques ou métaphysiques de II-2°
(b) (§1876), qui considèrent le devoir, abstraction faite de l'utilité ; et l'on considère uniquement celles qui tiennent compte d'une certaine utilité, réelle ou imaginaire [FN: § 1897-2]. Une autre raison pour laquelle ce problème est plus restreint que le précédent, c'est que les fins T, considérées dans les problèmes plus étendus que nous avons étudiés tout à l'heure, ne consistent pas seulement à observer les règles de la religion et de la morale, mais sont, en général, tout ce qui est conseillé, imposé par une foi ou par un sentiment vif. Aussi trouvons-nous parmi elles d'autres règles en usage dans la société, qui naissent de la tradition ou d'une autre façon semblable, ainsi que des fins sentimentales, idéales, mythiques ou d'autres genres analogues. Enfin, l'utilité apparaît ici sous une forme spéciale, sous celle du bonheur.
§ 1898. Pour résoudre le problème particulier que nous nous sommes posé, il faut tout d'abord donner une plus grande précision à l'énoncé. Nous pouvons négliger le très grand défaut de précision des termes : religion, morale, parce qu'ils ne sont pas essentiels au problème, qui demeurerait le même, si l'on parlait d'observer certaines règles, auxquelles on peut donner le nom que l’on veut, par conséquent aussi les noms nullement précis de religion et de morale. Mais il y a, dans l'énoncé du problème, deux points sur lesquels le doute est important et ne peut en aucune façon être négligé. Le premier est le sens des termes : bonheur, malheur ; et nous verrons que ceux qui voulaient résoudre le problème en un certain sens ont tiré parti de ce doute (§1904). L'autre point qui n'est pas précis, c'est de savoir qui est l'agent et qui est celui qui réalise le bonheur ou le malheur. Là-dessus, il faut faire les distinctions suivantes.
I. On peut supposer réunies dans la même ou les mêmes personnes l'action et la réalisation ; c'est-à-dire qu'on peut demander : « Si un homme observe exactement les règles de la morale et de la religion, sera-t-il nécessairement heureux ? et malheureux s'il les transgresse ? » Ou bien : « Si les hommes constituant une collectivité observent ou transgressent les règles susdites, seront-ils heureux ou malheureux ? » – II. Les personnes qui observent ou transgressent les règles, et celles qui sont heureuses ou malheureuses peuvent être différentes. Surtout dans les investigations pratiques, on a considéré les cas où un homme observe ou transgresse certaines règles, et où ses descendants ou ses concitoyens, ou plus généralement d'autres hommes appartenant à une certaine collectivité, éprouvent du bonheur ou du malheur, par suite de la manière d'agir de cet homme.
§ 1899. Il est généralement utile à la société de donner une réponse affirmative aux questions que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire : « En observant les règles de la religion, de la morale, de la tradition, les hommes sont-ils heureux, ou font-ils le bonheur de ceux auxquels ils tiennent ? » Cette observation nous met en présence du 3e problème (§1876) ; et si nous voulons raisonner avec une rigueur scientifique, nous devons le distinguer nettement des 1er et 2e problèmes dont nous sommes en train de nous occuper. Le raisonnement vulgaire, qui s'appuie surtout sur l'accord de sentiments, ne fait habituellement pas cette distinction ; et c'est précisément parce qu'on mélange des questions tout à fait distinctes, qu'on obtient des solutions affirmatives en plus grande abondance que des solutions négatives, et qu'on les estime dignes de louange, tandis que les solutions négatives, et même celles qui mettent seulement en doute les solutions affirmatives, passent pour mériter le blâme.
§ 1900. Il convient d'observer que si l'on donne une réponse entièrement affirmative aux questions, dans le premier cas du §1898, par cela seul, on donne ainsi une réponse au moins partiellement négative, dans le second ; et vice versa. En effet, si un homme peut seulement éprouver du bonheur ou du malheur de par ses actes, c'est-à-dire suivant qu'il observe ou qu'il transgresse certains principes, il s'ensuit qu'il ne peut, en aucun cas, éprouver de bonheur ou de malheur de par les actes d'autrui. Vice versa, s'il peut éprouver du bonheur ou du malheur de par les actes d'autrui, il s'ensuit qu'il ne peut pas éprouver de bonheur ou de malheur uniquement de par ses actes.
§ 1901. Cela est si simple et si évident, qu'à s'en tenir seulement à la logique, il est difficile de comprendre comment on peut l'oublier ou le négliger. Pourtant c'est ce qui arrive à un très grand nombre d'auteurs. Le motif est celui que nous avons eu à rappeler souvent déjà : la prédominance du sentiment, qui chasse la logique, et empêche l'homme de se rendre compte des principes dont ses actions seraient une conséquence logique. Seul un observateur étranger connaît ces principes, tandis que celui qui agit les admet implicitement (§1876).
§ 1902. Examinons maintenant quelles sont les solutions que l'on a données aux problèmes indiqués ici, soit qu'on les ait considérés ensemble, soit qu'on les ait séparés. Tout d'abord, classons les solutions.
SOLUTIONS AFFIRMATIVES (§1903 à 1998).
Cas particuliers de la théorie générale II-2° (a)
Solutions verbales (§1903 à 1929).
(A 1) Pétition de principe (§1904 à 1912).
(A 2) Changement du sens des préceptes et des règles, d'objectif en subjectif (§1913 à 1918).
(A 3) Casuistique, Interprétation des préceptes et des règles (§1919-1929).
Solutions objectives. Bonheur et malheur pris au sens vulgaire (§1930 à 1998). (B 1) Affirmation d'un accord parfait (§1934 à 1976).
Pour supprimer les exceptions :
(B 2) Bonheur et malheur repoussés dans l'espace et dans le temps (§1977 à 1988).
Cas particuliers de la théorie générale II-2° (b-α.) :
(B 3) Bonheur et malheur repoussés hors du monde réel (§1989 à 1994).
(B 4) On ne réussit pas à trouver une interprétation. Les voies du Seigneur sont insondables (§1995 à 1998).
SOLUTIONS NÉGATIVES (§1999 à 2001). Cas particulier de la théorie générale II - 2° (b-β) :
(C) Négation absolue; pessimisme (§1999 et 2000).
Cas particulier de la théorie générale I - 1°- ou de II - 2° (b -γ) :
(D) Négation conditionnelle. Il y a deux phénomènes différents qui peuvent avoir certains points communs (§2001).
Les solutions (B 1) et (C) proviennent de ce que chacune considère exclusivement un groupe de résidus. Les solutions (A), (B2), (B3), (B4) proviennent du désir de concilier les dérivations contradictoires issues de différents groupes de résidus. Le genre de solutions (D) comprend, outre des solutions intermédiaires des genres précédents, la solution scientifique, qui vise exclusivement à la recherche des uniformités. Examinons maintenant ces différents genres de solutions.
§ 1903. (A) Solutions verbales. Elles appartiennent à la grande classe des dérivations verbales dont nous avons parlé au chap. X. Ici, nous devons considérer des cas particuliers de ce phénomène général.
§ 1904. (A1) PÉTITION DE PRINCIPE. On tire argument de l'absence de précision des termes du langage vulgaire (§1898), pour donner au terme « bonheur » le sens d'un état créé par l'observance de certains principes. Cela posé, il est évident que si l'homme heureux est celui qui observe certains principes, celui qui observe ces principes est heureux. On peut répéter la même chose d'une collectivité, d'un État.
§ 1905. Diogène Laërce rapporte dans les termes suivants les opinions des stoïciens [FN:§ 1905-1]. « Des choses existantes, ils disent que les unes sont bonnes, les autres mauvaises, les autres indifférentes. La vertu, la prudence, la justice, l'énergie, la tempérance et d'autres semblables sont bonnes. Les choses qui sont contraires à celles-là sont mauvaises : la sottise, l'injustice et le reste. Celles qui ne profitent ni ne nuisent sont indifférentes ; ainsi la vie, la santé, la volupté, la beauté, la force, la richesse, la gloire, la noblesse et les choses qui leur sont contraires : la mort, la maladie, la peine, la laideur, la faiblesse, la pauvreté, l'obscurité et les autres choses semblables ». Cela posé, il est facile de conclure que nous devons rechercher les choses bonnes, fuir les mauvaises, ne pas nous soucier des indifférentes. Mais, de la sorte, nous exprimons seulement qu'en agissant suivant certaines règles, on en vient à cette fin qui est d'agir suivant ces règles ; ce qui est tout à fait évident, mais ne nous enseigne vraiment rien. Pourtant, dans le raisonnement des stoïciens, il y a quelque chose de plus. C'est qu'ils insinuent, par association d'idées, que nous devons agir de cette façon. Ainsi, la tautologie est dissimulée ; mais, par malheur, l'adjonction est purement métaphysique.
§ 1906. On cherche aussi à confondre les biens, tels qu'ils sont définis à nouveau, avec les biens, au sens habituel. Suivant ce procédé, dans son explication de la doctrine des stoïciens, Cicéron leur fait dire : « Je demande ensuite qui pourrait vraiment se glorifier d'une vie misérable, et non d'une vie heureuse » ? Ainsi, l'on cherche à insinuer adroitement que la vie heureuse est « glorieuse », et Cicéron oublie que les stoïciens ont précisément rangé la gloire parmi les choses indifférentes.
Quand on sort du domaine de la réalité pour errer dans les espaces imaginaires, il est bon de ne pas s'éloigner ensuite de ces espaces, si l'on veut éviter des erreurs et des contrastes inévitables, qui peuvent aller jusqu'au ridicule. C'est pour ce motif que la métaphysique de Hegel subsiste, tandis que sa Philosophie de la nature est oubliée. Il s'est trompé en suivant une voie où les subtilités et les divagations métaphysiques se dissipent à la lumière de l'expérience.
§ 1907. Plusieurs auteurs anciens se moquèrent des fantaisies des stoïciens et de leur désir de paraître ce qu'ils n'étaient pas. Athénée (IV, p. 158) rapporte que selon la doctrine des stoïciens « le Sage peut faire bien toute chose, même faire cuire intelligemment les lentilles ». Il cite des vers de Théognètos, dans lesquels on dit que [FN: § 1907-1] « les livres des stoïciens pervertirent la vie » de l'un des interlocuteurs. Dans l'une de ses satires, Horace se moque aussi des stoïciens, qui sont des mendiants et se croient des rois [FN:§ 1907-2].
§ 1908. L'auteur du Traité en faveur de la noblesse, sur lequel on met le nom de Plutarque, raconte d'une manière plaisante comment les imaginations métaphysiques sont contredites par la réalité : « (XVII, 2) Mais ni lui [Chrysippe] ni aucun des stoïciens n'ont besoin de la noblesse, eux qui sont les adeptes de cette philosophie qui peut leur procurer instantanément toute chose, comme avec une baguette magique, ainsi qu'ils s'en vantent, et les rendre riches, bien nés, beaux, royaux. Mais ces riches vont mendiant leur nourriture à autrui. Ces rois ne sont obéis de personne ; ils dépendent de tout le monde, bien qu'ils possèdent toute chose, et c'est à peine s'ils peuvent payer le trimestre de leur loyer ».
§ 1909. De même, ces hommes éminents qui affirment que « le monde extérieur n'existe pas » – cela se peut, parce qu'expérimentalement ce cliquetis de mots ne signifie rien – se transportent dans un monde fantaisiste qui n'a rien à faire avec la vie pratique (§95, 1820). Ces concepts de la métaphysique trouvent leur plein développement dans les affirmations de la Christian Science, suivant lesquelles, pour ne pas souffrir de la maladie, il suffit de se persuader que la maladie n'existe pas (§1695-2). En effet, tout concept qui n'existe pas chez un individu est pour lui inexistant. Mais c'est là une simple tautologie, et l'observation démontre que certains concepts s'imposent aux individus en général, bien que ceux-ci s'efforcent de les repousser de toute façon. Il est vrai que les adeptes de Madame Eddy, qui fonda la Christian Science, repoussèrent loin d'eux le concept de la mort de cette personne, et que, par conséquent, pour eux, ce concept n'existait pas. Mais un jour vint où il s'imposa à eux, ou, pour mieux dire, la négation de ce concept ne put plus s'accorder avec d'autres concepts, auxquels nous donnons vulgairement le nom de mort. À nous, cela nous suffit : nous ne voulons nullement discuter la question métaphysique de l'existence ou de la non-existence de la mort.
§ 1910. De même, il est certain que, pour un individu, l'histoire consiste tout entière dans les concepts qu'il a. Il est certain que si quelques concepts lui font défaut, la partie de l'histoire correspondant à ces concepts est pour lui inexistante. Mais c'est aussi un fait d'observation que les concepts qu'il a ainsi contrastent plus ou moins avec d'autres concepts qu'il peut acquérir dans la suite, suivant les rapports de ces concepts avec ce que nous appelons des faits historiques (§1798). Si un Polonais ignore l'histoire du partage de sa patrie, il peut s'imaginer qu'elle constitue encore un royaume indépendant, et pour lui le partage est inexistant ; il peut le demeurer longtemps, pendant toute la vie de ce Polonais, si on enferme celui-ci dans une maison de santé, et s'il ne revient pas à l'état que nous appelons vulgairement celui de l'homme sain. Mais s'il revient à cet état, voici que de nouveaux concepts entrent en lutte avec celui qu'il avait jusqu'alors admis, et les chassent de son esprit. Ce fait d'observation vulgaire nous suffit, et nous laissons à autrui le soin de disserter sur la non-existence du monde extérieur.
§ 1911. Un autre raisonnement du genre (A 1) est celui d'Épictète. Il commence par diviser les choses en deux catégories [FN: § 1911-1] (I, 1) celles qui sont en notre pouvoir et celles qui n'y sont pas. Sont en notre pouvoir : les opinions, l'impulsion, le désir [les appétits], l'aversion et, en peu de mois, n'importe laquelle de nos actions. Ne sont pas en notre pouvoir : le corps, les biens, la renommée, les magistratures et, en peu de mots, tout ce qui n'est pas notre œuvre.
(2) Celles qui sont en notre pouvoir sont, de leur nature, libres, dégagées, déliées ; celles qui ne sont pas en notre pouvoir sont inermes, esclaves, liées, étrangères [au pouvoir d'autrui] ». Cela posé, la suite du raisonnement ne fait pas un pli : « (3) ... si tu considères comme tien uniquement ce qui est tien [les choses en ton pouvoir], et que tu considères, ainsi que cela est, comme n'étant pas tien ce qui t'est étranger n'est pas en ton pouvoir personne ne te contraindra jamais, personne ne te liera, tu n'adresseras de reproches à personne, tu n'accuseras pas, tu ne feras rien contre ta volonté, personne ne te nuira, tu n'auras pas d'ennemi, car aucun mal ne te sera imposé ». En effet, il est parfaitement vrai que si une chose quelconque t'est imposée et que tu dises vouloir la faire, tu pourras affirmer que tu ne fais rien contre ta volonté. Ainsi raisonnait celui qui, tombé de cheval, disait : « Je voulais descendre ».
§ 1912. La doctrine d'Épictète et d'autres analogues, telles que la résignation du chrétien à la volonté de Dieu, ne sont pas des théories scientifiques : ce sont des consolations pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas combattre. Il est certain que souvent on diminue la douleur en n'y pensant pas, et en tâchant de se figurer qu'elle n'existe pas. On trouve de nouveau quelque chose de semblable dans la Christian Science, et les cas ne manquent pas où le médecin, et mieux encore le charlatan, soulage la douleur du malade par sa seule présence. La faveur qui accueillit la doctrine d'Épictète est l'un des nombreux symptômes qui présageaient le succès du christianisme.
§ 1913. (A 2) Changement du sens des préceptes ou des règles, d'objectif en subjectif. Dans le genre (A 1), la tautologie provenait du changement de sens des termes bien, bonheur, malheur. Dans le présent genre elle provient du changement de sens des préceptes. En effet, si l'on considère uniquement les règles que l'individu observe avec plaisir, on peut certainement affirmer qu'en les observant il éprouve du plaisir.
§ 1914. Par exemple, si nous considérons objectivement la torture, nous pourrons dire qu'en général c'est un malheur pour les hommes de la subir ; mais si nous considérons subjectivement ce qu'elle fait éprouver à un martyr chrétien, nous verrons que c'est pour lui un bonheur de la subir pour sa foi.
§ 1915. Quand on observe que celui qui agit mal ne peut être heureux, parce qu'il éprouve des remords, on suppose implicitement qu'il est capable de les éprouver ; mais il n'est pas difficile de voir que, chez un grand nombre de personnes, ils sont très faibles ou même n’existent pas du tout ; aussi, pour eux, la peine dont on les menace est presque ou entièrement indifférente [FN: § 1915-1].
§ 1916. En somme, la plupart de ceux qui veulent réformer la société supposent qu'elle sera constituée par des personnes douées des sentiments et des conceptions qu'il leur plaît d'imaginer, et c'est uniquement sous ces conditions qu'ils peuvent promettre à ces personnes de les rendre heureuses.
§ 1917. Par exemple, les protestants qui n'admettent plus la divinité du Christ créent une doctrine entièrement subjective. Ils disent que le Christ est le type de l'homme parfait. C'est uniquement une conception à eux, et ils n'ont aucun moyen de combattre qui dirait, au contraire, que c'est le type de l'homme imparfait. Mais ce moyen existe pour qui croit à la divinité du Christ, car cette divinité est quelque chose d'objectif, d'indépendant de l'opinion individuelle, et l'on peut donc menacer le mécréant de l'action de cette entité objective. Mais comment le menacer de l'action d'une chose qui dépend de lui, et qu'il peut accepter, changer, repousser comme il lui plaît ? Ajoutons qu'à l'égard de l'Ancien Testament, beaucoup de personnes font usage d'une pétition de principe : elles excluent de l'inspiration divine toutes les parties qu'elles jugent contraires à leur morale, après quoi elles peuvent conclure en toute sécurité que leur morale concorde avec l'inspiration divine.
§ 1918. Le pouvoir des préceptes, dans une société et en un temps donnés, provient surtout du fait que ces préceptes sont acceptés par le plus grand nombre des personnes qui composent cette société, et du fait que ceux qui les transgressent éprouvent un sentiment pénible, se trouvent mal à l'aise. Ces préceptes sont simplement l'expression peu précise des résidus existant dans la société. Par conséquent, il est inutile de rechercher si, d'une façon générale, et pour le plus grand nombre d'individus qui constituent la société, le fait de suivre ces préceptes procure du plaisir, le fait de les transgresser du déplaisir. S'il n’en était pas ainsi, ces préceptes n'exprimeraient pas des résidus existant chez le plus grand nombre des individus, ils n'auraient pas cours dans la société considérée. Le problème à résoudre est différent. Au point de vue du plaisir individuel (ophélimité), il consiste à rechercher quel effet ont les préceptes sur les personnes qui ne possèdent pas les résidus exprimés par ces préceptes, et de quelle manière on peut persuader aux dissidents qu'ils éprouveront un plaisir ou une peine qu'ils ne ressentent pas directement. Au point de vue de l'utilité, nous avons à rechercher si le fait d'observer ces préceptes est avantageux à l'individu, à la collectivité, à la nation, dans le sens qu'on voudra donner au terme utilité ; par exemple, dans le sens de la prospérité matérielle, si on la considère comme utile. Si l'on empêche un animal de suivre son instinct, il éprouve un sentiment de malaise ; mais il se peut qu'en fin de compte son bien-être matériel soit augmenté. Si un homme politique transgresse une règle usuelle dans la société où il vit, il se peut qu'il éprouve un sentiment de malaise, et il se peut qu'en fin de compte, son action soit nuisible à la société ; mais il se peut aussi qu'elle lui soit utile. Ce sont là les cas qu'il convient d'examiner.
§ 1919. (A 3) Casuistique. Interprétation des préceptes et des règles. Précisément afin d'éviter ces sentiments de malaise, afin de les remplacer par les sentiments agréables que suscite le fait de suivre des préceptes, tandis qu'en même temps l'utilité qui résulte de leur transgression est réalisée, on recourt à la casuistique et aux interprétations. Cela est même nécessaire pour satisfaire certains sentiments et ne pas s'écarter, du moins en apparence, des conséquences logiques des dérivations. De la sorte, on obtient en outre l'avantage, petit ou grand, d'être sans paraître, de travailler dans son propre intérêt, et de sembler rigide observateur de la morale et de l'honnêteté, digne, par conséquent, de la bienveillance du public, aux gens qui parfois se laissent persuader par les sophismes, et le plus souvent ne demandent qu'un prétexte pour être persuadés. Cela peut se faire artificieusement, mais quelquefois aussi de bonne foi [FN: § 1919-1]. À travers la casuistique usitée par les gouvernements et les États pour justifier quelqu'une de leurs actions, le salus populi suprema lex esto transparaît souvent. Si l'on affirmait cela sans autre, ce serait un bon motif logique, et l'on aurait ainsi une des solutions D mais comme on ne veut pas choquer les personnes qui croient aux solutions affirmatives, on s'efforce de concilier l'inconciliable, en confondant ces solutions avec la solution D. D'autre part, ceux qui accusent et blâment les gouvernements et les États d'avoir transgressé certains préceptes, expriment bien rarement d'une manière claire quelle solution du problème ils acceptent. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas si, niant que la salus populi consiste à transgresser les règles, ils admettent l'une des solutions affirmatives ; ou bien si, admettant la solution D et repoussant la salus populi, ils veulent que même au risque de subir de graves dommages, voire peut-être la ruine complète, on suive les préceptes en acceptant l'une des solutions métaphysiques ou théologiques (§1897) ; ou bien encore si, repoussant la solution D, ils mettent la salus populi dans le fait d'observer une solution telle que (A 2), (B 2), (B 3). Ils s'efforcent de persuader par un simple et indistinct accord de sentiments.
Moyennant l'appui efficace de la casuistique et des interprétations, on peut affirmer que le fait de suivre certains préceptes et certaines règles procure toujours la prospérité matérielle des individus, des collectivités, des États, de l'humanité. Par exemple, on prêche en général que l'on doit toujours tenir les promesses qu'on a faites ; mais ensuite, dans les cas particuliers où il est avantageux de ne pas les tenir, on ne manque jamais d'excellents prétextes pour se soustraire à ce devoir.
§ 1920. L'histoire de Rome abonde en interprétations de ce genre. Grâce à elles, tout en agissant avec mauvaise foi, les Romains étaient persuadés d'agir de bonne foi. Un exemple suffira : celui de la casuistique par laquelle les Romains trompèrent les Numantins, tout en conservant l'apparence de la bonne foi [FN:§ 1920-1]. Grâce à cette belle casuistique, Rome sauva l'armée, qui aurait pu être détruite par les Numantins, et s'en tira en offrant aux Numantins un consul dont elle ne pouvait vraiment tirer aucun parti comme général. Les Numantins avant refusé ce cadeau généreux, Mancinus revint à Rome, et réintégra même sa place au Sénat [FN: § 1920-2]. Ce sont là les miracles éclatants d'une casuistique savante !
§ 1921. On dit que l'histoire des Fourches Caudines a été copiée sur celle de Numance [FN: § 1921-1]. Si elle est vraie, on a une preuve que cette casuistique était habituelle chez les Romains. Si elle est fausse, la preuve est encore meilleure, car, en inventant, les Romains auront certainement choisi ce qui leur paraissait le mieux ; et le fait d'avoir copié l'histoire de Numance montre qu'ils n'y trouvaient rien de contraire à la réputation d'honnêteté qu'ils entendaient conserver, et dont ils se faisaient gloire. Cela est confirmé par Cicéron qui, écrivant un traité pour nous enseigner nos devoirs, cite en l'approuvant l'action des Romains aux Fourches Caudines et à Numance [FN: § 1921-2]. Il était assez intelligent pour comprendre que si l'on voulait agir honnêtement avec les Numantins, ce n'était pas le consul seul qu'on devait leur livrer, mais toute l'armée, en la replaçant ainsi dans les conditions où elle se trouvait lorsqu'elle fut délivrée, grâce à un traité que les Romains refusaient de respecter.
§ 1922. De nos jours, la célèbre dépêche d'Ems a donné lieu à une discussion dans laquelle brille une très belle casuistique. Welschinger écrit [FN:§ 1922-1] : « (p. 125) Dans sa critique des Pensées et Souvenirs [de Bismarck], l'historien Horst-Kohl considère « comme un fait extraordinaire » que le roi Guillaume ait autorisé son ministre à communiquer la dépêche d'Ems aux ambassadeurs et aux journaux. „ La forme – dit-il – fut l'affaire du ministre, et notre démocratie sociale, qui n'a pas le culte de la patrie, est d'une insolence inqualifiable, quand elle parle de la falsification de la dépêche d'Ems, alors que Bismarck agissait seulement pour accomplir un ordre royal avec l'assentiment de Moltke et de Roon, sous la pression violente du sentiment de l'honneur surexcité au plus haut degré. Bismarck prévit le préjudice apporté à notre évolution vers trop de condescendance. Persuadé que pour passer par-dessus le gouffre qui avait été creusé entre le Sud et le Nord par la différence des dynasties, des mœurs et des coutumes de races différentes, il n'y avait qu'à jeter un pont par une guerre nationale faite en commun contre un ennemi toujours prêt à la (p. 126) guerre depuis des siècles, il donna à la communication un tour particulier [FN:§ 1922-2] qui amena les Français dans la situation pénible de déclarer eux-mêmes la guerre, ou de garder le soufflet que Bismarck avait su leur donner “ ».
Cela rappelle la célèbre restriction mentale de celui qui, à la question : « A-t-il passé par là ? », répondit : « Non », sous-entendant « dans ma manche ». Non, Bismarck n'a pas falsifié la dépêche d'Ems : il lui a « donné un tour particulier ». Il se peut que la démocratie sociale n'ait pas « le culte de la patrie » ; mais M. Horst-Kohl ne semble vraiment pas avoir le culte de la vérité. Nous entendons la vérité expérimentale, parce qu'il y a tant de vérités que parmi elles il pourrait bien s'en trouver une à l'usage de M. Horst-Kohl.
§1923. Ensuite, cet « historien » devient le défenseur de la morale la plus rigide ; il dit : « (p. 126) Si la guerre est venue à éclater par la faute des Allemands, alors les Français sont absolument autorisés à se plaindre d'une entreprise aussi brutale et à réclamer l'Alsace-Lorraine qui, comme prix de la victoire, reste entre nos mains ».
Si M. Horst-Kohl croit réellement ce qu'il écrit, il est doué d'une prodigieuse naïveté. Combien de changements y aurait-il à faire à la carte géographique des États, si chacun devait restituer les provinces conquises par suite d'une guerre qu'il a voulue ! Mais il est des gens qui accueillent favorablement de pareilles inepties. C'est pourquoi elles sont dignes d'attention. Toujours il y eut, il y a et il y aura des puissants : princes ou peuples, aristocraties ou plèbes, partis grands ou petits, pour transgresser les lois de la morale ; et pour défendre leur œuvre, jamais il n'a manqué, il ne manque ou il ne manquera de casuistes qui, de bonne foi ou non, gratis ou payés, produisirent, produisent et produiront de beaux et subtils raisonnements. Pourtant, seuls ceux qui peuvent répéter le quia nominor leo ont la faculté de transgresser les règles, et d'avoir dans leur manche de complaisants casuistes pour démontrer qu'ils en sont respectueux. À vrai dire, les raisonnements de ces dignes personnages persuadent uniquement, en général, ceux qui sont déjà persuadés, ceux qui ont la vue obscurcie par un sentiment fort, par un culte du genre de celui dont parle le casuiste Horst-Kohl. Par conséquent leur efficacité à persuader est faible ; mais elle peut servir a fortifier les sentiments préexistants qui les font accueillir favorablement. Vice versa, le blâme adressé aux puissants, pour leurs transgressions des règles de la morale, est approuvé et répété surtout par ceux qui sont déjà leurs adversaires ou leurs ennemis [FN:§ 1923-1], et qui sont mus par des sentiments de nature semblable, mais de sens contraire à ceux des gens qui sont favorables ou amis des puissants. Quant aux puissants, ils ne se soucient guère de ces logomachies, auxquelles ils ne prêtent attention que pour les légers avantages qu'ils en peuvent retirer : ils laissent dire et continuent leur œuvre.
§ 1924. Des cas où l'interprétation est donnée de bonne foi, on passe peu à peu à ceux où elle est entièrement le produit de la mauvaise foi. Ces derniers cas sont fort nombreux. S'ils apparaissent mieux chez les anciens que chez les modernes, c'est peut-être seulement parce que les premiers étaient moins hypocrites que les seconds.
§ 1925. Il est difficile de croire que des prétextes du genre des suivants fussent donnés de bonne foi. Craignant les Épirotes, les Acarnaniens demandèrent la protection de Rome, et « obtinrent du Sénat romain l'envoi d'ambassadeurs qui enjoindraient aux Étoliens de retirer les garnisons des cités de l'Acarnanie, afin que fussent libres ceux qui seuls ne s'allièrent pas aux Grecs contre Troie, dont Rome était issue ». Ce souvenir mythologique vint à point aux Romains. Le livre des Stratagèmes de Polyen et celui de Frontin sont tout pleins de tromperies de toute sorte. Virgile dit fort bien qu'à la guerre on use de la vertu ou de la tromperie [FN: § 1925-1].
§ 1926. On ne sait pas pourquoi on a voulu donner comme propre aux jésuites la maxime – la fin justifie les moyens. En réalité, elle est aussi ancienne que toute littérature à nous connue. C'est l'une des interprétations par lesquelles on s'efforçait d'accorder la théorie et la pratique. Agésilas [FN:§ 1926-1] parlait fort bien de la justice et, en paroles, il la plaçait au-dessus de l'utilité, mais en fait il intervertissait les termes. Judith aussi estimait que, pour faire disparaître Holopherne, la fin justifiait les moyens ; et c'est un peu pour cela que les protestants ont exclu son livre de leur Bible ; mais il y est resté beaucoup d'autres choses qui valent les embûches de Judith ! [FN: § 1926-2]
§ 1927. La fête des Apaturies n'était très probablement que la fête des Fratries ; le peuple inventa une étymologie qui faisait de cette fête la glorification de la fraude.
On disait donc que la possession de certains territoires, objet de contestations entre Athéniens et Béotiens, devait être disputée entre les rois des deux pays. « Thymœtès [FN: § 1927-1], en ce temps roi des Athéniens, craignant ce duel, céda son royaume à qui voudrait bien s'exposer au danger du combat contre Xanthos, roi des Béotiens. Mélanthos, séduit par la récompense de la royauté, se chargea du combat, et l'on fixa les clauses du traité. Quand on en vint aux mains, Mélanthos vit une sorte de figure d'homme imberbe qui suivait Xanthos. Il cria qu'agir ainsi était injuste, car amener un auxiliaire était contraire aux clauses du traité. Frappé de stupeur, en entendant cet incroyable discours, Xanthos fit volte-face pour regarder. Aussitôt Mélanthos darda sa lance et le tua... ...Ensuite les Athéniens, suivant les prescriptions de l'oracle, élevèrent un temple à Dionysos Mélanthidos, et y sacrifièrent chaque année. Ils sacrifièrent aussi à Zeus trompeur, parce que, dans le combat, la ruse les avait secourus.
Dans un très grand nombre de récits mythologiques ou historiques de l'antiquité, on voit percer la fraude, et elle recueille plus de louange que de blâme.
§ 1928. Dans l'Iliade, Zeus n'a pas honte d'envoyer le songe pernicieux (ou plein, réel) dire des mensonges à Agamemnon et le tromper. Après avoir promis vie sauve à Dolon, les Grecs le tuent. Dans l'Odyssée, Ulysse dit autant de mensonges que de mots, et sa protectrice Athéna s'en réjouit [FN: § 1928-1]. Dante use d'une restriction mentale, lorsqu'il promet an frère Albéric de lui ôter du visage les durs voiles [de glace]. Invité ensuite à tenir sa promesse, il ne le fait pas.
E cortesia fu lui esser villano.
2836.(Inf., XXXIII, 150)
Avec une si grande et si belle abondance d'interprétations, on justifie tout ce que l'on veut, et la même personne peut affirmer successivement des choses contradictoires, sans le moindre scrupule de manquer aux règles de la logique [FN:§ 1928-2].
§ 1929. Machiavel n'eut qu'un tort, si l'on peut parler de tort. Ce fut de mépriser de semblables niaiseries, en écrivant (c. XL) [FN: § 1929-1] : « Se servir de la ruse dans la conduite de la guerre est une chose glorieuse. Quoique ce soit une action détestable d'employer la fraude dans la conduite de la vie [cela est dit seulement pour excuser ce qui suit ; c'est pourquoi l'auteur ne se soucie pas de la contradiction], néanmoins, dans la conduite de la guerre, elle devient une chose louable et glorieuse ; et celui qui triomphe par elle de ses ennemis ne mérite guère moins de louanges que celui qui en triomphe par les armes. C'est le jugement que portent ceux qui ont écrit l'histoire des grands hommes. Les exemples en sont trop nombreux pour que j'en rapporte aucun. Je ferai observer seulement que je ne regarde pas comme une ruse glorieuse celle qui nous porte à rompre la foi donnée et les traités conclu ; car, bien qu'elle ait fait quelquefois acquérir des États et une couronne, ainsi que je l'ai exposé précédemment, elle n'a jamais procuré la gloire. [On remarquera la cause pour laquelle Machiavel conseille de s'abstenir d'un certain genre de fraudes]. (c. XLI) La patrie doit se défendre par l’ignominie ou par la gloire, et, dans l'un et l'autre cas, elle est bien défendue. – Partout où il faut délibérer sur un parti d'où dépend uniquement le salut de l'État, il ne faut être arrêté par aucune considération de justice ou d'injustice, d'humanité ou de cruauté, de gloire ou d'ignominie ; mais, rejetant tout autre parti, ne s'attacher qu'à celui qui le sauve et maintient sa liberté. Les Français ont toujours imité cette conduite, et dans leurs actions et dans leurs discours, pour défendre la majesté de leurs rois et la puissance de leur royaume... [FN: § 1929-2] » (§1975-2], 2449).
§ 1930. (B) Solutions objectives. Les divagations de la rhétorique et de la philosophie sont en partie un produit de luxe ; mais la vie pratique exige d'autres considérations, et les gens veulent surtout savoir comment ils doivent s'y prendre pour atteindre le bonheur, pris au sens vulgaire, c'est-à-dire la prospérité matérielle. C'est pourquoi il leur faut des réponses aux problèmes objectifs qui appartiennent à cette matière. Le vulgaire se soucie peu de savoir d'où procèdent les règles. Il lui suffit qu'elles existent dans la société et qu'elles soient acceptées et respectées. Dans l'opposition à leur transgression se manifeste surtout le sentiment qui s'oppose aux perturbations de l'équilibre social (résidus (α) de la Ve classe). C'est le même sentiment qui se manifeste dans les plus anciens documents bibliques et, en général, à l'origine de toute civilisation. Il apparaît presque seul dans l'opinion que la transgression du tabou a nécessairement des conséquences nuisibles. Le même sentiment se retrouve dans l'idée que ce qui est légal est juste. En somme, par cette formule on dit qu'il faut respecter volontairement tout ce qui est légal, qu'on ne doit pas troubler l'équilibre social existant. L'invasion du raisonnement est contenue par la force des sentiments qui défendent les règles existantes, et aussi par l'utilité sociale de ces règles. Par conséquent, le raisonnement abandonne la logique et l'expérience, fait appel au sophisme, se superpose ainsi au sentiment sans trop l'offusquer. Ce mélange de sentiments et d'explications sophistiques est essentiellement hétérogène. De là proviennent les contradictions extraordinaires qui ne font jamais défaut dans ces raisonnements. Nous en avons déjà vu plusieurs, quand nous étudiions les dérivations (§1481 et sv.) Autour de ce noyau se disposent ensuite d'autres résidus, tels que les (dzéta) et (êta) de la IIe classe.
§ 1931. Ces solutions objectives, précisément parce qu'elles sont objectives, sont aisément contredites par les faits. Le vulgaire ne s'en soucie pas ; il n'attache guère d'importance aux théories, et accepte même des solutions objectives contradictoires, sans se soucier de la contradiction. Les hommes qui ont l'habitude des recherches logiques, les penseurs, les théoriciens, veulent savoir d'où procèdent les règles que l'on dit devoir être observées ; ils n'omettent pas de leur attribuer des origines qui, habituellement, sont le produit de leur imagination. En outre, certains contrastes entre les théories et les faits causent à ces personnes du malaise, de l'ennui, de la souffrance. C'est pourquoi elles s'efforcent, autant qu'elles le peuvent, de supprimer, d'écarter, de dissimuler ces contrastes. En général, elles n'abandonnent pas entièrement les solutions objectives, ni surtout, parmi celles-ci, les solutions optimistes ; mais elles tâchent de supprimer, ou du moins d'expliquer, par des interprétations appropriées, les exceptions qu'on ne peut nier. C'est là un cas particulier de l'emploi des dérivations, dont nous avons déjà parlé (§1737, 1738). Ainsi, on a les genres (B 2), (B 3), (B 4), qui, partant du domaine expérimental, finissent par en sortir entièrement [FN:§ 1931-1].
Le motif pour lequel nous pouvons prévoir que dans une société stable donnée nous trouverons en majeure partie des résidus favorables à sa conservation, nous permet aussi de prévoir que, dans cette société, nous trouverons surtout en usage des solutions affirmatives de notre problème, lesquelles y seront plus que d'autres divulguées et bien accueillies ; tandis que les personnes qui éprouvent le besoin de développements logiques ou pseudo-logiques, s'efforceront par tous les moyens, avec un art subtil, grâce à d'ingénieux sophismes, de faire disparaître les contradictions qui se manifestent par trop ouvertement entre ces solutions et la pratique. Cela se produit effectivement. Nous avons déjà vu que, dans les dérivations, on tâche de créer une confusion entre le bien de l'individu et celui de la collectivité, afin de pousser l'individu à s'efforcer de travailler au bien de celle-ci, tout en croyant, même quand ce n'est pas vrai, travailler à son bien propre. En ces cas, cela est aussi utile à la société qu'expérimentalement erroné.
§ 1932. Il convient de donner ici un aperçu des solutions des 3e et 4e problèmes indiqués d'une façon générale au §1896. Les résidus les plus nombreux et les plus efficaces dans une société ne peuvent pas être entièrement contraires à la conservation de la société, car, si cela était, la société se dissoudrait et finirait par ne plus exister. Il faut que ces résidus soient, au moins en partie, favorables à la conservation de la société. L'observation confirme précisément que les résidus existant dans une société lui sont en grande partie favorables. Il convient donc à la société que ni ces résidus ni les préceptes (dérivations) qui les manifestent ne soient offusqués et amoindris. Mais ce but est mieux atteint si l'individu estime, croit, s'imagine qu'en observant ces préceptes, en acceptant ces dérivations, il travaille à son propre bien. Donc, en raisonnant d'une manière générale, très en gros, sans s'arrêter à des exceptions possibles et nombreuses, on peut dire qu'il convient à la société qu'au moins dans l'esprit du plus grand nombre d'individus étrangers à la classe dirigeante, le 3e problème soit résolu de telle sorte que les faits apparaissent, non tels qu'ils sont en réalité, mais tels que la considération des fins idéales les représente. Par conséquent, si nous passons du cas général à notre cas particulier, il convient à la société que les individus mentionnés tout à l'heure acceptent, observent, respectent, vénèrent, aiment spontanément les préceptes existant dans la société où ils vivent. Parmi ces préceptes, la place d'honneur est occupée par ceux qu'on appelle, fût-ce sans aucune précision, les préceptes de la « morale » et de la « religion ». On dirait mieux « des religions », en désignant par ce nom, non seulement les persistances d'agrégats qu'on a l'habitude d'appeler ainsi, mais aussi un grand nombre d'autres du même genre. De là proviennent la grande efficacité et la grande puissance des deux forces, morales et religions, pour le bien de la société, à tel point qu'on peut dire que sans morales ni religions, aucune société ne peut subsister, et que l'affaiblissement de ces forces coïncide habituellement avec la décadence de la société [FN: § 1932-1]. Les personnes qui ont porté leur attention sur ce sujet ne se sont donc pas trompées, depuis les temps les plus reculés où nous connaissions leurs idées, lorsqu'elles ont résolu le 4e problème en ce sens qu'il est utile que les hommes voient les faits, non tels qu'ils sont en réalité, mais tels que les représente la considération des fins idéales ; par conséquent, pour employer la terminologie courante, lorsqu'elles ont attribué une très grande importance à la « morale » et à la « religion », généralement celles qui existaient alors ; tandis qu'un petit nombre de personnes très avisées et d'une grande perspicacité attribuaient cette importance aux « morales » et aux « religions » en général, se rapprochant ainsi de la réalité, où cette importance revient à certaines persistances d'agrégats et aux actions non-logiques qui en sont une conséquence implicite ou explicite. Mais précisément parce qu'il y avait un écart plus ou moins grand avec la réalité, on ne peut pas dire qu'en émettant ce jugement sur les « morales » et sur les « religions », ni surtout sur une morale spéciale et une religion spéciale, ces personnes ne soient parfois allées au delà de la vérité, faisant ainsi le mal de la société, tandis qu'elles cherchaient à faire son bien. Elles se trompèrent généralement, lorsqu'elles voulurent donner les motifs de la solution acceptée du 4e problème. Elles eurent recours à des motifs fallacieux et presque toujours imaginaires, fantaisistes. Mais enfin, c'est là une simple erreur théorique qui importe peu, car, quels que soient les motifs, l'effet subsiste. Au contraire, il fut et il est encore une autre erreur, très nuisible celle-là. C'est celle, déjà notée, de confondre les morales et les religions avec une morale et une religion spéciales ; par quoi l'on attribue aux dérivations une importance qui revient uniquement aux résidus. De là provinrent, lorsque les adeptes de ces théories trouvèrent le champ libre, un énorme gaspillage d'énergie dépensée pour produire des effets peu ou point importants, et des souffrances souvent considérables, infligées aux hommes sans aucun avantage. Quand les adeptes des théories que nous venons de rappeler rencontrèrent de la résistance, il naquit aussi, chez leurs adversaires, une idée erronée : celle d'étendre à toute persistance d'agrégats en général, à tout genre d'actions non-logiques, les objections que l'on peut adresser à juste titre aux gens qui veulent imposer une dérivation déterminée, provenant de certaines persistances d'agrégats. Si une certaine persistance d'agrégats Q, utile à la société, se manifeste par les dérivations A, B, C, D, ..., il est ordinairement nuisible à la société de vouloir imposer une dérivation déterminée A, en excluant les autres B, C, ... ; tandis qu'il est utile à la société que les hommes acceptent les dérivations qui leur plaisent le mieux, et qui manifestent que le résidu existe chez eux, lequel seul, ou presque seul, est important [FN: § 1932-2].
§ 1933. Les solutions négatives sont souvent de capricieuses manifestations de pessimisme, des effusions de personnes blessées et vaincues dans les combats de la vie. Elles prennent difficilement une forme vulgaire. Les solutions scientifiques, qui ne sont pas des manifestations de sentiments, mais qui résultent de l'observation des faits, sont extrêmement rares. Lorsqu'elles sont émises, très peu de gens les comprennent. C'est ce qui est arrivé pour la partie scientifique des raisonnements de Machiavel (§1975). Les solutions optimistes et les solutions pessimistes peuvent coexister, parce que – nous l'avons vu tant de fois – on peut observer des résidus contradictoires simultanément, ou successivement chez le même individu. Le vulgaire laisse subsister la contradiction ; les personnes cultivées tâchent de la faire disparaître. De là proviennent plusieurs de nos solutions.
§ 1934. (B 1) Affirmation d'un accord parfait. Nous ignorons si l'on a jamais affirmé, tout à fait explicitement, un accord parfait, et tiré ensuite de cet accord toutes les conséquences, toutes les déductions qu'il comporte. Implicitement, il apparaît dans les morales utilitaires (§1935). Il ne manque pas d'autres doctrines qui affirment cet accord en général, comme une théorie abstraite [FN:§ 1934-1], sans d'ailleurs trop se soucier de rechercher quelles en seraient les conséquences nécessaires. Très souvent, ces doctrines sont uniquement des manifestations de sentiments vifs, qui prennent les désirs pour la réalité, dans l'intention de faire le bien, soit de l'individu, soit de la société ; ou bien elles sont des manifestations d'une foi vive en certaines entités ou certains principes entièrement étrangers au domaine expérimental. Souvent, presque toujours, leur forme manque de toute précision, et tandis que, prises à la lettre, elles semblent affirmer quelque chose de certain, l'ambiguïté des termes, les nombreuses exceptions, les diverses interprétations, ôtent au précepte le meilleur de sa substance, ainsi qu'à l'affirmation suivant laquelle le précepte est favorable au bien de qui l'observe.
§ 1935. Depuis les anciens temps jusqu'aux nôtres, on trouve des théories qui affirment que transgresser les règles de la morale et, surtout chez les anciens, celles de la religion, a pour conséquence le malheur terrestre, tandis que le fait d'observer ces règles a pour conséquence le bonheur terrestre. Il est un genre remarquable parmi ces théories : celui des théories dites de la morale utilitaire, suivant lesquelles la morale n'est que l'expression d'un jugement correct sur l'utilité. Une action malhonnête n'est autre chose que la conséquence d'un jugement erroné sur l'utilité. On ne pourrait avoir un accord plus parfait de la morale et de l'utilité, car c'est l'accord rigoureusement logique de la conclusion avec les prémisses d'un syllogisme. Ces théories ont une apparence de théories scientifiques, et sont constituées par des dérivations dont nous avons déjà parlé (§1485 et sv.). Elles jouissent de la faveur, surtout lorsqu'on cherche à faire passer pour entièrement rationnelle la vie humaine, et à expulser les actions non-logiques. Aussi trouvent-elles facilement une place dans les théologies de la Raison, de la Science, du Progrès.
§ 1936. Dans d'autres théologies et, d'une manière générale, dans les doctrines qui ne repoussent pas la partie idéale, on trouve des théories différentes des précédentes, et qui prennent parfois une apparence scientifique. Elles ne repoussent pas les caractères métaphysiques et théologiques ; au contraire, ce sont ceux auxquels elles s'attachent principalement. D'une façon générale, et en portant uniquement notre attention sur les lignes principales communes à ces théories, nous trouvons qu'elles présentent les caractères suivants. 1° La punition de celui qui transgresse les préceptes occupe souvent une place éminente ; la récompense de celui qui les respecte apparaît comme secondaire. Cela probablement parce que, dans la vie humaine, les maux sont plus nombreux et font plus d'impression que les biens. 2° Les confusions des deux genres de problèmes indiqués au §1898 sont habituelles. À la rigueur, on pourrait affirmer que quiconque agit suivant les préceptes de la morale et de la religion, en réalisant son propre bonheur, ne peut en aucune façon porter préjudice à ceux qui sont confiés à ses soins ou qui sont en rapport avec lui d'une manière ou d'une autre. Mais on le fait rarement ; on le sous-entend plus qu'on ne le dit ; on le laisse sous une forme implicite et nébuleuse. Très souvent on parle de châtiments et de récompenses, sans dire s'ils seront le lot de l'individu qui a fait l'action mauvaise, ou la bonne, ou bien s'ils s'étendront aux autres gens. Pour l'individu lui-même, on a soin de ne pas oublier l'échappatoire consistant à renvoyer à un temps indéterminé la conséquence de ses actes. Autrement dit, on n'exprime pas si l'on veut ou non recourir aux exceptions du groupe (B-2). 3° Il faut remarquer qu'à vouloir être rigoureux, nous devons voir aussi une confusion en ce qu'on attribue à un même individu un fait dont il est l'auteur, et le châtiment ou la récompense qui lui revient après un certain temps. En raisonnant ainsi, on admet implicitement que l'individu est unique dans les différents temps qui se suivent. Matériellement, on ne peut pas l'admettre. Mais si l'on admet une unité métaphysique, appelée âme ou autrement, laquelle subsiste tandis que le corps change, on peut admettre l'unité de l'individu. Autrement, si l'on veut raisonner en toute rigueur, on doit dire en quel sens on entend cette unité. 4° Les théories dont nous parlons contiennent ordinairement en grande abondance et à un haut degré les contradictions indiquées au §1931. Elles énoncent des propositions et les contredisent aussitôt, implicitement, ou même explicitement. Elles affirment que chacun éprouve du malheur ou du bonheur uniquement de son propre fait, et peu après elles émettent quelque autre affirmation dont il ressort que l'homme éprouve aussi du malheur et du bonheur par le fait d'autrui. Souvent même elles affirment cela explicitement, et personne ne semble se soucier de la contradiction. En réalité, de même qu'elles considèrent toujours un individu à différents moments comme une unité, de même elles sont souvent entraînées à considérer comme une unité la famille, une certaine collectivité, la nation, l'humanité. Là agissent les résidus de la permanence des agrégats ; ils font que l'agrégat devient l'unité. En des temps reculés, un grand nombre de personnes ne se posaient même pas ce problème : la famille doit-elle être considérée comme une unité, pour les châtiments et les peines ? De même aujourd'hui, un grand nombre de personnes ne se posent pas non plus ce problème : au même point de vue, l'agrégat matériel que nous appelons un individu doit-il être considéré comme une unité dans le temps ? (§1982).
§ 1937. Un grand nombre des théories que nous examinons ne se soucient pas de ces problèmes. En affirmant que chacun éprouve du malheur ou du bonheur par son propre fait, elles laissent indéterminé le sens de ce terme chacun. Ensuite, lorsqu'on cherche à le déterminer, surgissent les théories que nous examinerons dans les genres (B-2) et suivants. Le défaut de précision et de logique est très grand en ces matières. Il s'explique facilement par le fait, que nous avons noté tant de fois, de la contradiction des résidus qui existent chez un même individu, et du désir qu'a celui-ci de faire disparaître ces contradictions, du moins en apparence.
Parfois ce désir n'existe même pas, non seulement pour les rigoristes qui ne voient qu'un côté des questions, mais aussi pour la moyenne des hommes, lorsqu'il s'agit de contradictions qui sont devenues habituelles et frustes. À la longue, elles finissent par s'effacer, paraissent naturelles ; la plupart des individus ne s'en aperçoivent même pas, et ils agissent comme si elles n'existaient pas. C'est là un fait général, et qui s'observe dans toutes les branches de l'activité humaine.
Par exemple, un grand nombre de personnes admettent, implicitement ou explicitement, qu'on peut changer, déterminer entièrement les actions des hommes, par des raisonnements ou des prédications agissant sur les sentiments, et en même temps, elles reconnaissent l'existence de caractères tels qu'ils nous sont explicitement exposés en des œuvres du genre de celles de Théophraste et de La Bruyère ; ou implicitement dans un nombre infini de productions littéraires, depuis l'Iliade et l'Odyssée jusqu'aux romans modernes ; ou tels qu'ils nous sont révélés par l'expérience journalière des rapports avec nos semblables. Or il y a contradiction entre ces deux manières de voir [FN:§ 1937-1]. On ne saurait admettre que le prodigue et l'avare n'aient entendu bon nombre de raisonnements et de sermons contre leurs défauts, et s'ils ne s'en sont pas corrigés, si raisonnements et sermons n'ont pas eu de prise sur eux, cela veut dire évidemment qu'il y a quelque autre chose qui détermine leurs actions, et que ce quelque autre chose est assez puissant pour résister aux raisonnements et aux sermons. Si malgré tout ce que, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, on a pu dire et écrire contre l'intempérance, et ce qu'on a pu faire pour la réprimer, on trouve encore des intempérants, il faut bien admettre l'existence d'une force qui les produit et qui résiste aux forces contraires. En exposant ici une théorie des actions non-logiques, nous n'avons fait que donner une forme scientifique à des conceptions plus ou moins vagues qui existent généralement chez presque tous les hommes, on pourrait même dire : chez tous ; que bon nombre d'auteurs ont exprimées plus ou moins clairement, et que d'innombrables faits ne permettent pas de négliger. Nous ne nions pas que raisonnements et sermons puissent agir sur les hommes (§1761 et sv.), nous affirmons que leur action n'est pas exclusive ni même, en bien des cas, prépondérante, qu'ils ne déterminent pas seuls les actions des hommes, que d'autres éléments interviennent, qui n'appartiennent pas aux catégories des raisonnements et des sermons, ni même à celle des dérivations. Or un grand nombre de personnes nient cela en théorie, agissent pratiquement comme si elles l'admettaient, et ne s'aperçoivent pas de la contradiction.
Parfois quelque auteur porte son attention sur cette contradiction ou d'autres analogues, et en tire des effets littéraires, depuis la simple plaisanterie jusqu'à d'importantes recherches psychologiques. Les contradictions entre la religion et la pratique de la vie ont donné lieu à une infinité de productions intellectuelles aboutissant à des conclusions opposées, selon le but qu'elles se proposent, ou selon qu'elles donnent le premier rang à la religion ou à la pratique. Elles sont dirigées contre celle-ci, si l'on admet qu'on y doive trouver une rigoureuse application des théories religieuses. C'est le thème des prédicateurs, des ascètes, des saints, des rigoristes de tout genre. Elles sont dirigées contre la religion, si l'on admet que les nécessités de la vie priment les doctrines, et si l'on veut attaquer la religion en un point faible. C'est le thème des athées, des matérialistes, des « libertins », et en général de ceux qui n'ont qu'une foi assez tiède ou n'en ont pas du tout. Entre ces deux extrêmes, se tiennent les casuistes, qui, par d'ingénieux sophismes et des prodiges d'interprétations, s'efforcent de concilier l'inconciliable. Des phénomènes semblables s'observent dans les rapports de la religion et de la morale, qui parfois est considérée comme un simple appendice de la religion ; parfois comme une unité indépendante, mais qui doit nécessairement aller d'accord avec la religion ; parfois, au contraire, comme s'opposant à celle-ci, ou à l'une de ses sectes. Tantôt c'est la religion qui juge la morale, tantôt c'est la morale qui juge la religion. Les premiers chrétiens soutenaient que la morale faisait voir que leur religion était supérieure à la religion païenne. Les païens ripostaient, mais sans obtenir beaucoup d'effet, que le patriotisme donnait un jugement contraire. Les chrétiens et les païens, ainsi que les différentes sectes chrétiennes entre elles, se sont réciproquement accusés d'immoralité, et ont largement usé et abusé de ce genre d'argument. C'est d'une des oppositions entre la rigueur des préceptes religieux et les nécessités de la vie pratique que Pascal a tiré ses Provinciales. Admirable production au point de vue littéraire, mais qui sonne faux au point de vue de la réalité expérimentale, car elle se borne à dénoncer les sophismes des casuistes, et elle ne les remplace pas, laissant ainsi subsister, en la dissimulant, la contradiction entre la doctrine et les nécessités de la pratique. Les raisonnements des casuistes n'ont aucune valeur logique, mais les préceptes de Pascal manquent également de valeur pratique.
Les contradictions entre le droit et la vie pratique, surtout entre le droit international et les nécessités de la politique, ont existé de tout temps; elles fourmillent dans l'histoire gréco-romaine, se compliquent de questions religieuses au moyen-âge, persistent très nombreuses dans les siècles suivants, et sont loin de faire défaut de nos jours.
Il s'agit donc, en somme, d'un phénomène très général, auquel se rattachent les cas particuliers que nous sommes en train d'étudier.
§ 1938. La notion du châtiment ou de la récompense qui suivent les actions présente, outre la forme pseudo expérimentale, deux autres formes qui souvent s'unissent en une seule : la forme métaphysique et la forme religieuse. Dans la forme métaphysique, châtiment ou récompense suivent nécessairement l'action, sans qu'à vrai dire on sache pourquoi. Cette forme est aujourd'hui dissimulée sous un voile pseudo-expérimental ; mais en somme, elle reste la même. Sous la forme religieuse, on sait pourquoi châtiment ou récompense suivent nécessairement l'action : c'est par la volonté d'une divinité. Mais cette intervention ouvre la porte à l'arbitraire de la divinité, qui ne se contente généralement pas d'être une gardienne plus ou moins rigide de la morale, mais qui agit aussi pour son propre compte, venge les offenses et les négligences auxquelles elle peut être en butte, autant et souvent plus sévèrement que les offenses et les négligences affectant la morale.
§ 1939. Quand le sentiment religieux est puissant, on ne voit là rien de blâmable. Quand il s'affaiblit, et que les sentiments de bienveillance envers nos semblables se développent, on s'efforce de réduire autant que possible, parfois jusqu'à la faire disparaître, cette dernière partie de l'action divine. On dit alors qu'une religion est d'autant plus « en progrès, parfaite », que la divinité s'occupe plus de la morale, et néglige le reste. Mais on ne prend pas garde qu'en procédant ainsi, la limite dont la « religion parfaite » se rapproche est l'absence de toute religion et la confusion de la religion et de la métaphysique (§1917, 1883).
§ 1940. Il est maintenant nécessaire d'apporter les preuves de nos affirmations. Le lecteur ne devra pas regretter que dans ce but nous exposions de nombreux détails, car il se souviendra que les théories n'ont d'autre valeur que celle de représenter les faits, quelle que soit leur importance, et que par conséquent seuls ces faits peuvent donner ou enlever de la valeur aux théories. À vrai dire, si l'on voulait citer les preuves au complet, on devrait transcrire toute l'histoire ; et comme cela est impossible, il faut nous résigner à choisir et à exposer un petit nombre de cas qui peuvent servir de types.
§ 1941. On peut retrouver des exemples de contradictions presque chez tout auteur qui affirme l'accord dont nous traitons. Parfois la contradiction est explicite, c'est-à-dire que dans le même auteur se trouvent certains passages qui disent le contraire de ce qu'expriment certains autres passages. Parfois elle est implicite, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans les conséquences que l'on peut tirer de différents passages.
§ 1942. Nous avons des exemples de contradictions explicites dans le poème qui a pour titre Les travaux et les jours. Il est un grand nombre de passages où l'auteur exprime que celui qui fait le mal est toujours puni. Ainsi (265-266) : « L'homme qui machine du mal contre autrui machine du mal contre lui-même ». Il ajoute trois vers (267-269) pour dire que Zeus voit tout ; puis, sans aucune transition, il dit (270-273) : « Maintenant je ne serai pas juste parmi les hommes, ni mon fils non plus, puisqu'il est mal d'être un homme juste, si l'homme injuste a plus de droits [FN: § 1942-1] ».
§ 1943. On trouve des contradictions de ce genre chez un grand nombre d'auteurs moralistes. Voici, par exemple, que dans la Sagesse de Jésus, fils de Sirach, on nous dit que la Sagesse remplit la maison de toute chose ; et puis l'on ajoute que la sagesse du pauvre le relève et le fait asseoir parmi les grands [FN: § 1943-2]. Et comment ? Elle n'a donc pas rempli sa maison de toute chose, puisqu'il est resté pauvre !
§ 1944. Comme exemple de contradictions implicites, celui des anciens Israélites suffira. D'une part, ils étaient persuadés que Iaveh récompensait toujours par des biens terrestres l'homme juste et pieux, et qu'il châtiait l'homme injuste et impie, en le privant des biens terrestres [FN: § 1944-1]. D'autre part, ils croyaient que le pauvre jouissait de la faveur de Iaveh [FN: § 1944-2]. Ces deux propositions ont des conséquences contradictoires. De la première proposition on déduit que les riches devraient être justes, pieux et favorisés par Iaveh, et les pauvres, au contraire, injustes, impies et en horreur à Iaveh. De la seconde proposition résulte exactement le contraire. La contradiction est criante [FN: § 1944-3] ; elle ne pouvait échapper aux penseurs israélites, qui s'efforcèrent de l'éliminer de diverses manières. Mais nous en parlerons plus loin (§1979).
§ 1945. Les peuples se sont imaginé et s'imaginent encore que dans leurs guerres ils remportent la victoire grâce au secours de leurs dieux. L'agrégat qui porte le nom de peuple est considéré comme une unité, et l'action de chaque individu particulier qui fait partie de l'agrégat contribue à attirer ou à repousser la faveur des dieux. Parfois l'action d'un seul individu suffit à faire châtier, beaucoup plus rarement à faire récompenser tout l'agrégat. Parfois il semble nécessaire que les individus soient assez nombreux pour constituer une partie notable de l'agrégat.
§ 1946. Quant aux dieux, chaque peuple peut avoir les siens propres, et le peuple victorieux remporte la victoire pour lui-même et pour ses dieux. Ceux-ci sont ennemis des dieux étrangers, que ce peuple ne doit honorer en aucune façon. Le type de semblables phénomènes est celui des Israëlites avec leur Dieu « jaloux ». Les peuples qui se combattent peuvent avoir aussi des dieux propres, ou bien des dieux communs ; mais dans les deux cas, il faut que chaque peuple révère non seulement ses dieux, mais aussi les autres. Des types de ces phénomènes sont ceux des Grecs et des Romains avec leurs dieux. L'Iliade nous a rendu familières des conceptions de ce genre et d'autres genres analogues. Il peut y avoir un seul dieu pour deux ou plusieurs peuples combattants, et l'on suppose que ce dieu se décide en faveur d'un peuple plutôt que d'un autre, suivant certaines règles, pas bien déterminées, mais qui, chez les peuples modernes, tendent à se confondre avec celles de la « morale » et de la « justice », telles que chaque peuple les comprend. Le type de ces phénomènes se voit dans les luttes entre les peuples catholiques, ou bien entre les peuples protestants. Dans les guerres entre catholiques et protestants, autrefois on opposait volontiers les croyances ; aujourd'hui on raisonne plutôt comme si elles ne différaient pas, et comme si un Dieu unique devait décider qui il favoriserait, en suivant les règles de la « morale » et de la « justice ». Inutile d'ajouter que tout cela ne supporte pas la moindre critique logico-expérimentale.
§ 1947. En 1148, la ville de Damas fut assiégée par les Croisés, qui, repoussés, durent lever le siège. Chrétiens et musulmans, chacun de son côté, attribuèrent le fait à leur propre Dieu. On peut, à ce sujet, comparer le récit de Guillaume de Tyr et celui des auteurs musulmans [FN:§ 1947-1].
§ 1948. Le Dieu d'Israël était quelque peu capricieux ; le Dieu des chrétiens, qui lui succéda, agit souvent d'une manière qu'on ne comprend pas bien. Il commença par donner la victoire aux Croisés, qui défendaient sa foi ; puis il les priva de son secours, à cause – dit-on – de leurs péchés. Il paraît que sa colère dure toujours, car le sépulcre du Christ continue à être au pouvoir des infidèles [FN:§ 1948-1].
§ 1949. Inutile de rappeler les ordalies ou jugements de Dieu : elles sont trop connues. Si nous prenons garde uniquement aux dérivations, ces ordalies sont strictement connexes à la théorie suivant laquelle Dieu punit les mauvaises actions et récompense les bonnes. Bayle cite un fait qui peut servir d'exemple aux contradictions comiques de cette théorie. Le chevalier de Guise, fils du duc de Guise qui, en 1588, fut assassiné à Blois, tua, dans la rue, à Paris, le 5 janvier 1613, le baron de Lux. Le fils de celui-ci provoqua en duel le chevalier de Guise et fut tué par lui. « On n'oublia point de remarquer l'inégalité du succès dans des combats où la justice paroissoit semblable. Si le Chevalier devoit vaincre dans le premier, parce qu'il cherchoit la vengeance du sang de son père, il devoit être vaincu dans le second, parce qu'il s'agissoit de faire raison au fils d'un homme qu'il avoit tué. Et néanmoins le sort lui fut aussi favorable dans le second que dans le premier. Ce fut une chose qui surprit beaucoup de gens et sur laquelle on fit beaucoup d'attention. Mais communément parlant ces sortes d'affaires se décident selon le plus ou le moins d'adresse, et de courage, et de force des combattants, ou par le concours de quelques causes fortuites ; et non pas selon le plus ou le moins de droit [FN: § 1949-1] ».
§ 1950. De nos jours, on ne croit plus que Dieu manifeste par les duels des particuliers de quel côté est le bon droit ; mais on continue à croire plus ou moins qu'il le manifeste dans les guerres entre les nations. Une guerre juste doit, pour un grand nombre de personnes, être une guerre victorieuse. Vice versa, une guerre victorieuse est nécessairement une guerre juste. Beaucoup d'Allemands furent et demeurent persuadés que la guerre de 1870 fut victorieuse parce que le Seigneur voulut donner la victoire aux vertus germaniques contre la corruption latine [FN: § 1950-1]. Cela se peut ; mais il se pourrait que le génie des Bismarck, des Moltke, des Roon, ainsi que l'humanitarisme stupide de Napoléon III, de ses ministres, de l'opposition démocratique, même de la part des conservateurs, aient eu aussi quelque part dans les victoires allemandes.
§ 1951. Il est toujours utile que les peuples croient que leurs dieux combattent en leur faveur (§1932). Le roi de Prusse agit donc excellemment en prescrivant un jour de prière, par son décret du 21 juillet 1870. Il disait : « Je dois d'abord remercier Dieu de ce qu'aux premiers bruits de guerre, un seul sentiment s'est manifesté dans tous les cœurs allemands : celui d'un armement général contre l'oppression, et celui d'une espérance réconfortante en la victoire que Dieu accordera à notre juste cause. Mon peuple se serrera autour de moi dans cette guerre, comme autrefois il s'est serré autour de mon père qui repose en Dieu. C'est en Lui que je mets toute mon espérance, et je demande à mon peuple de faire de même... ». Mais Dieu était aussi prié par l'autre camp, comme autrefois les dieux d'Homère étaient priés par les Grecs et par les Troyens. Napoléon III, lui aussi, s'adressait au peuple français, en disant : « Dieu bénira nos efforts. Un grand peuple qui défend une juste cause est invincible ». Le Dieu des chrétiens n'entendit point ces prières et mena l'armée française à Sedan, de même que le Zeus de l'Iliade n'entendit pas les prières des Troyens, et permit la destruction de leur cité. Ollivier, sous le ministère duquel on déclara la guerre « juste », mais hélas malheureuse, de 1870, se console en espérant que si la « justice » ne fut pas récompensée, elle le sera du moins à l'avenir. Il écrit : [FN: § 1951-1] « (p. 12) ...il [Bismarck] oblige à la guerre par (p. 13) une impertinence intolérable un souverain systématiquement pacifique [voilà une première faute] depuis la campagne d'Italie [origine des malheurs de la France, comme le vit bien Thiers], sans la complaisance duquel [voilà la faute qui n'aura plus de remède] il n'eût pas même tenté la fortune à Sadowa [où il vainquit l'Autriche et prépara la défaite de la France et la ruine du très humain Napoléon III] et qui, partout favorable à l'indépendance des peuples [en sacrifiant son pays à ces utopies], était décidé, malgré les alarmes de ses diplomates [qui voyaient un peu plus clair que cet aveugle], à n'opposer aucun obstacle au libre développement de l'Allemagne et à ajouter ainsi un service nouveau à ceux déjà rendus par la généreuse France aux peuples germaniques en 1789, 1830, 1848 [tous ces braves gens méritaient peut-être des prix de vertu ; mais il est douloureux que c'ait été la France qui dût payer ces prix sous la forme des cinq milliards d'indemnité de guerre à l'Allemagne]. L'ingratitude, a dit Cavour, est le plus odieux des péchés. C'est aussi le plus maladroit des calculs [FN: § 1951-2] [affirmation gratuite d'Ollivier, sans la moindre bribe de démonstration]. Bismarck a voulu noyer dans le sang d'une victoire commune les antipathies des États du Sud frémissants encore de leur défaite récente. Mieux que ce remède dangereux, la patience eût apaisé les colères [autre affirmation sans aucune bribe de démonstration). Une unité allemande qui se fût constituée sans un démembrement de la France, étant sûre d'un lendemain paisible, aurait pu devenir pour tous un bienfait, non une calamité. Dieu punit quelquefois en accordant le succès. L'avenir le démontrera ». Qui vivra verra ! En attendant cette punition à venir, qui frappera les descendants, les Français contemporains souffrent et les Allemands exultent. Que l'on compare ce naïf passage éthique d'Ollivier aux discours réalistes de Bismarck, et l'on comprendra aisément comment et pourquoi le second devait vaincre le premier.
Un auteur qui est loin d'être en tout de l'avis d'Émile Ollivier H. Welschinger, dit pourtant à son tour : [FN: § 1951-3] « (p. 56) le souvenir de la guerre de 1870 et le traité de Francfort, qui en a été la suite lamentable, seront pour bien longtemps encore – à moins de réparations qui sont le secret de l'éternelle Justice – une cause de discorde entre les deux nations ». Ainsi invoquée par deux camps opposés, l'éternelle Justice ne devait pas savoir vers qui se tourner ; elle finit par préférer le camp où une armée plus nombreuse et mieux préparée était commandée par des généraux meilleurs.
§ 1952. On peut constater dans l'histoire que c'est ordinairement le camp qu'elle préfère. Quand l'armée thébaine brisa à Leuctres la puissance spartiate, elle fut efficacement soutenue par l'éternelle Justice, qui avait à venger les deux filles de Schédasos, auxquelles certains Spartiates avaient fait violence, en des temps reculés (§2437-4), et qui avaient leur tombe sur le champ de bataille. Cette influence des puissances surnaturelles avait été annoncée avant le combat ; mais Grote observe avec justesse : [FN: § 1952-1] « (p. 7) tandis que les autres étaient ainsi encouragés par l'espoir d'un secours surhumain, Épaminondas, auquel la direction de la prochaine bataille avait été confiée, prit soin (p. 8) qu'il ne manquât aucune précaution humaine ». Voilà peut-être ce qui aura déterminé à l'action l'éternelle Justice. Ce que lit Épaminondas est certainement ce qu'il convient toujours de faire en des cas semblables. Il est bon de discourir sur l'éternelle Justice, mais il est encore mieux d'agir comme si elle n'existait pas.
§ 1953. Aujourd'hui, bon nombre de personnes qui ne croient plus au surnaturel n'ont changé que la forme de la dérivation, et à la divine justice elles ont substitué la « justice immanente des choses », qui est une très belle mais peut-être un peu obscure entité. Elle préfère agir dans les affaires privées plutôt que dans les entreprises guerrières, peut-être parce qu'elle a plusieurs pacifistes parmi ses fidèles (§1883-1).
§ 1954. Il est certain que chez les anciens Israélites, les Grecs et les Romains, l'action de la divinité ne concordait pas entièrement avec la défense de la morale et de la justice. Il y avait quelque chose de plus, qui avait pour but de défendre certaines prérogatives divines. Cela déplaît à des théoriciens qui voudraient que cette différence n'existât pas ; aussi la nient-ils tout simplement et sans se soucier des contradictions manifestes ou voilées dans lesquelles ils tombent ; ils nous fournissent ainsi d'excellents exemples de ces contradictions, exemples d'autant meilleurs que leurs auteurs sont plus intelligents, pondérés, cultivés.
§ 1955. Chez les Pères de l'Église et plus tard, jusqu'à notre époque, chez les théologiens catholiques, on comprend que la foi était un obstacle à la croyance que le Dieu de l'Ancien et celui du Nouveau Testament pussent faire quelque chose qui ne fût pas parfaitement moral et juste. C'est pourquoi, par des interprétations diverses, ces auteurs modifient les conceptions qui sont exprimées en un sens opposé, dans l'Écriture. Nous n'avons pas à nous y arrêter, car ce sujet sort, au moins en partie, du domaine expérimental. Remarquons seulement que, parmi les protestants libéraux, il ne manque pas de gens qui, précisément au point de vue expérimental, reviennent aux conceptions des anciens Israélites [FN: § 1955-1].
§ 1956. Au contraire, nous devons nous arrêter quelque peu sur le fait qu'à notre époque de si grande diffusion de science et de critique, il y a beaucoup de gens qui, tout en disant vouloir demeurer dans le domaine logico-expérimental, ferment les yeux afin de ne pas voir les faits, et gratifient les hommes du passé d'opinions qu'en réalité ils n'ont jamais eues. Ce fait a lieu parce que là où le sentiment domine, le sens critique s'affaiblit ou même disparaît. Voici un auteur, Maury, qui est pourtant l'un des meilleurs connaisseurs de l'antiquité classique, et qui s'exprime ainsi [FN: § 1956-1] : « (p. 48) Le châtiment céleste, voilà ce dont en effet étaient menacés ceux qui avaient enfreint les lois de la morale, de même que la récompense attendait les bonnes actions. La tragédie d'Ion d'Euripide finit par une allocution mise dans la bouche du chœur, qui déclare que les bons trouvent enfin le prix de la vertu, et les méchants la juste peine de leur crime, idée qui apparaît dès les temps homériques. La vengeance divine, qui n'est que la détermination prise par la divinité de ne point laisser le crime impuni, que l'implacable aversion qu'elle nourrit contre lui, atteint toujours le criminel »…« (p. 49) Aux mythes antiques qui nous peignent simplement, sous les apparences du symbole et de l'allégorie, les phénomènes physiques, succèdent d'autres mythes plus moraux dont l'objet est de faire ressortir ce principe redoutable de l'inévitabilité de la vengeance divine ».
§ 1957. Si l'on voulait s'en tenir à cette opinion, pourtant très autorisée, on estimerait que les anciens Grecs, et spécialement Euripide, penchaient pour la solution affirmative de notre problème, et croyaient que les dieux récompensaient toujours les bons et châtiaient les méchants ; mais si l'on étudie directement les faits, on arrivera à une conclusion bien différente.
§ 1958. Tout d'abord, chez Euripide lui-même, on peut facilement trouver plusieurs passages tout à fait contraires à celui que nous venons de citer. Par exemple, dans Hélène, le chœur dit qu'il ne sait si c'est un dieu ou quelqu'un qui n'est pas dieu, ou un être intermédiaire, qui gouverne les événements du monde, à voir leurs fluctuations tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. [FN: § 1958-1] Pis encore, dans l'Hercule furieux, le chœur dit que les bons n'ont pas un meilleur sort que les méchants. [FN: § 1958-2]
§ 1959. Ensuite, plus particulièrement si l'on considère la tragédie Ion, citée par Maury, on trouve peu judicieuse la conclusion du chœur. Apollon fait violence à la vierge Créuse, et la rend mère d'Ion. Pour cacher sa faute involontaire, la jeune fille expose l'enfant. Ensuite, Apollon ment et trompe Xouthos, mari de Créuse, en lui faisant croire qu'Ion est son fils, à lui Xouthos, et Apollon dit naïvement qu'il fait cela pour introduire Ion dans une famille riche et illustre. Créuse ne sait pas qu'Ion est son fils, et celui-ci ne sait pas qu'elle est sa mère. Croyant qu'il est, comme l'a dit Apollon, un fils bâtard de son mari, elle veut l'empoisonner, et lui, pour se venger, veut la tuer. Grâce à une certaine corbeille, elle reconnaît son fils, et Athéna survient pour dissiper tous les doutes et pour confirmer cette descendance.
§ 1960. En tout cela, on ne voit pas où sont « les bons qui trouvent enfin la récompense de la vertu ». Ne parlons pas d'Apollon, qui est un beau type de malfaiteur ; mais on ne voit pas que Créuse ait été plus vertueuse que d'autres personnes, et l'on ne peut certes pas appeler vertu la tentative d'empoisonner Ion ; son unique mérite fut d'enflammer Apollon. Le pauvre Xouthos n'a fait de mal à personne, et il est gratifié d'un fils qui ne lui appartient nullement. Quant à Ion, c'est un bon diable qui, à part son dessein de tuer Créuse, ne fait ni bien ni mal. En vérité, cet exemple est mal choisi pour qu'on y voie la récompense des « bons » et le châtiment des « méchants ».
§ 1961. En somme, la conclusion de la tragédie est différente ; elle consiste dans le fait que la protection des dieux est efficace ; mais non que cette protection s'obtienne toujours par la vertu.
Ce fait est plus apparent dans la tragédie Hippolyte, et Maury aurait dû y prendre garde. La malheureuse Phèdre n'a pas « honoré l'iniquité », comme dit Maury ; elle n'a pas non plus négligé de « vénérer les dieux ». Aphrodite reconnaît que Phèdre lui a édifié un temple magnifique ; mais elle la sacrifie allégrement au désir qu'elle a de se venger d'Hippolyte. Elle dit clairement : « Il est certain que Phèdre est une noble femme, mais elle succombera tout de même, car son mal ne m'empêchera pas de faire que mes ennemis satisfassent à ma vengeance [FN: § 1961-1] ».
Quand on a sous les yeux de tels passages d'un auteur, il faut vraiment que le sentiment obscurcisse la raison, pour citer ce même auteur dans le but de démontrer que « la vengeance divine n'est que la détermination prise par la divinité de ne pas laisser le crime impuni ».
§ 1962. Maury est loin d'être isolé ; il y a même de nos jours un très grand nombre de personnes qui, parce qu'elles estiment bon de croire que la vertu est récompensée et le vice puni, s'imaginent retrouver cette conception en tout temps, chez tous les peuples, et même chez des auteurs qui sont loin d'avoir une telle conception. Il importe de noter de semblables faits, parce qu'ils nous font voir combien, même de nos jours, les résidus de la IIe classe sont puissants. Un savant qui étudie l'histoire des us et coutumes d'un peuple ne sait pas et ne veut pas se borner à la recherche des uniformités : il éprouve le besoin irrésistible de louer sa morale, sa foi politique, sa religion ; il sort du domaine des recherches scientifiques et se met à prêcher.
§ 1963. Dans un livre qui, d'autre part, renferme une foule d'excellentes observations et de judicieuses déductions, on lit [FN: § 1963-1] : « (p. 178) L'essence de la foi religieuse, telle qu'elle était professée par tout être intelligent, durant les beaux temps de la Grèce, (p. 179) peut se résumer ainsi en quelques mots : il existe un ensemble d'êtres divins dont la puissance s'exerce sur la nature et sur l'humanité, d'où procèdent le bien et le mal, de qui nous pouvons à notre gré nous concilier ou nous aliéner la faveur. Le moyen de leur être agréable et de nous les rendre propices, c'est, d'une part, d'accomplir en leur honneur les cérémonies religieuses auxquelles ils ont été habitués de tout temps et dont eux-mêmes nous ont imposé la loi ; de l'autre, de nous bien comporter et de remplir nos devoirs envers l'État et envers nos semblables, devoirs qui eux aussi nous ont été impérieusement tracés soit par les dieux, soit par les hommes inspirés ou que révèlent à chacun de nous notre raison et notre conscience ». Au lieu du pluriel dieux, mettez le singulier dieu, et vous aurez précisément ce que les chrétiens pensent de leur religion. L'auteur transporte cette conception dans le passé. C'est l'un des innombrables cas de persistance des agrégats (IIe classe). Ses lecteurs éprouvent l'impression que les « éternelles vérités » de leur morale et de leur religion pouvaient vraiment être obscurcies par le polythéisme, mais qu'elles existaient pourtant dans la conscience de tout « être intelligent ». Et ceux qui, tels les athées et les sceptiques, ne croyaient pas à ces belles choses ? Nous les éliminons facilement, grâce à l'épithète intelligent ; c'est-à-dire que nous les déclarons étrangers à cette catégorie, et tout est dit (§1471, 1476). Où Schœmann a-t-il trouvé chez les auteurs grecs que pour, nous rendre les dieux « propices », il suffit « d'accomplir en leur honneur les cérémonies » et de « remplir nos devoirs » ? Quelles cérémonies en l'honneur des dieux la fille d'Agamemnon avait-elle négligé d'accomplir ? À quels devoirs envers ses semblables avait-elle manqué, pour mériter que les dieux imposassent à son père de la sacrifier ? Et Mégara, femme d'Héraclès, et leurs enfants, pour quelle négligence de cérémonies ou de devoirs méritèrent-ils d'être tués par Héraclès ? Euripide nous montre la Furie que, sur l'ordre d'Hèra, Iris charge de troubler la raison d'Héraclès. La Furie hésite à remplir une mission si perverse, mais finit par obéir ; et il ne semble pas que le public trouvât rien à redire à la tradition suivie par le poète. Quand et comment Hector avait-il péché contre les dieux et contre ses semblables, pour devoir être tué par Achille, et pour que son cadavre dût être traîné autour des murs de Troie ? Et ainsi de suite : on peut citer autant qu'on veut de légendes semblables. Il est vrai que Platon les repousse et les blâme, et c'est peut-être à lui que pensait notre auteur ; mais en ce cas, celui-ci devait nommer clairement Platon, au lieu de nous parler de « tout être intelligent ».
§ 1964. Decharme cite un fragment de la tragédie d'Eschyle intitulée Les Héliades, où l'on dit [FN: § 1964-1] : « (p. 102) Zeus est l'éther, Zeus est aussi la terre, Zeus est aussi le ciel; Zeus est toutes choses et ce qu'il y a au-dessus de toutes choses ». Decharme ajoute : « Rien de plus élevé qu'une pareille doctrine ; rien de plus contraire en même temps à la religion populaire... Cette conception toute nouvelle de Zeus, qui ne pouvait être alors que le rêve de quelques grands esprits, nous permet de mesurer combien la religion d'Eschyle a dépassé celle de son temps ». Ne nous arrêtons pas à la partie subjective du raisonnement. L'auteur a un certain idéal et appelle « grands esprits » ceux qui se rapprochent de son idéal. Ne nous attachons qu'aux faits. Est-il bien vrai qu'on trouve de telles conceptions dans les tragédies d'Eschyle, au lieu de celles de la religion populaire ? À vrai dire, il importerait peu de résoudre ce problème, si l'on recherchait uniquement les opinions d'Eschyle ; mais en trouvant les opinions exprimées dans ses tragédies, qui furent accueillies favorablement par le peuple athénien, nous découvrons les résidus que ce peuple acceptait, et cela nous importe davantage.
§ 1965. Dans la trilogie de l'Orestie, le contraste est manifeste entre la conception d'une conséquence spontanée, mécanique, du délit, et la conception du jugement qu'on en peut tirer, si l'on tient compte des circonstances dans lesquelles le délit a été commis. On peut même dire que le but de la trilogie est de poser le problème qui naît de ce contraste, et de le résoudre. Comme on sait, les Érinyes sont vaincues par Apollon ; ce qui signifie que la seconde conception l'emporte sur la première. Pourtant, celle-ci est loin de disparaître entièrement, et les raisonnements d'Apollon ne sont pas très concluants. [FN: § 1965-1]
§ 1966. On peut former trois catégories des passages de la trilogie qui ont trait à cette matière.
1° Passages qui supposent que l'homicide engendre l'homicide, ou, d'une manière générale, que la transgression de certaines règles engendre une autre transgression, abstraction faite de toute notion de « juste » ou « d'injuste », ou du moins si l'on attribue un rôle effacé à cette notion. Par exemple, quand Clytemnestre a tué Agamemnon, le chœur en accuse le génie qui a envahi la maison des fils de Tantale, et Clytemnestre dit [FN: § 1966-1] : « Maintenant ta bouche a bien jugé, en invoquant le démon trois fois funeste de ces gens ; car il nourrit dans nos cœurs une cupidité sanguinaire. Avant que la calamité ancienne ait pris fin, voici du nouveau sang ». Ensuite, nous avons les passages [FN: § 1966-2] : « Y a-t-il expiation pour le sang tombé à terre ? » – « L'homicide doit payer sa dette [FN: § 1966-3] ». Électre demande au chœur ce qu'il doit souhaiter aux assassins de son père [FN: § 1966-4]. « Le chœur : „ Qu'un démon ou un mortel vienne vers lui “. – Électre : „ Un juge ou un vengeur, dis-tu. “ – Le chœur : „ Prie simplement que quel-qu'un les tue à leur tour “ ». Enfin, la fatalité qui pèse sur les Atrides est une dérivation de l'idée qu'il existe un lien nécessaire entre le délit et ses conséquences. Comme toutes les dérivations de ce genre, celle-ci est peu précise et peu logique. De là les difficultés que nous rencontrons quand nous voulons connaître avec précision la doctrine de l'auteur, et pis encore, d'une façon générale, ce que les hommes du temps comprenaient par le mot destin. Nous cherchons ce qui n'existe pas : une doctrine précise ; et au contraire, cette doctrine ne l'est pas. Il faut prendre garde que ce n'est pas nécessairement le bien qui naît du bien, le mal du mal, ce qui supposerait, implicitement du moins, un sentiment de « justice ». Au contraire, le mal peut naître du bien. Eschyle exprime clairement cette opinion, que pourtant il n'admet pas. Le chœur dit [FN: § 1966-5] : « Une vénérable maxime existe depuis longtemps parmi les mortels : un grand et complet bonheur de l'homme engendre, et ne demeure pas stérile ; mais d'un sort prospère naît une inextinguible misère. Mon sentiment est différent de celui des autres, car, au bout de quelque temps, l'impiété engendre une descendance semblable à elle-même ; mais une maison vraiment juste a toujours dans son sort une belle descendance ». Égisthe rappelle les crimes successifs, engendrés l'un par l'autre, et qui pèsent sur les Atrides. En tout cas l'homicide a pour conséquence nécessaire, inévitable, de souiller le meurtrier, qu'il soit ou non coupable, qu'il soit homicide volontaire ou involontaire (§1253). D'ailleurs Eschyle a des doutes à cet égard. Le chœur des Euménides dit qu'Athéna ne peut juger Oreste, car celui-ci, souillé d'homicide, ne peut jurer ; mais Athéna répond [FN: § abc-6] : « Préfères-tu entendre correctement qu'agir correctement ? » ce qui veut dire : « Préfères-tu la forme au fond de la justice ? » Il convient de remarquer que le problème ainsi posé n'est pas résolu, et qu'Athéna exprime seulement une opinion ; tandis que le procès continue, parce qu'Oreste affirme et démontre qu'il est purifié [FN: § 1966-7], c'est-à-dire parce que le motif invoqué par les Euménides est inexistant.
§ 1967. 2° Passages où la conception de la justice est principale. D'abord, on peut observer que toute la trilogie aboutit à la prédominance de cette conception sur les usages anciens : les divinités nouvelles vainquent et dominent les divinités anciennes. Ensuite on fait souvent concorder la conception de la fatalité avec celle de la « justice ». Nous avons vu tantôt ces conceptions en lutte. L'auteur tranche le différend en faveur de la dernière. « La vie heureuse est, parmi les mortels, une déesse et une déesse souveraine ; la balance de la justice agit promptement sur celui qui est en lumière ; d'autres, qui sont aux confins de la lumière et des ténèbres, souffrent plus tard ; d'autres restent dans une nuit éternelle [FN: § 1967-1] ». Les Euménides se glorifient d'être les dispensatrices de la justice [FN: § 1967-2]. « Notre fureur ne se déchaîne pas sur celui qui étend les mains : il passe sa vie sain et sauf. Mais si quelque criminel comme cet homme [Oreste], cache ses mains tachées de sang, nous, justes témoins, venant au secours des morts, vengeresses du sang, finalement nous nous manifestons à lui ». Ces deux genres de passages indiquent également le châtiment comme conséquence inévitable du crime ; ils diffèrent par la manière dont la conséquence découle. Mais si tout délit engendre des maux, tous les maux ne sont pas engendrés par les délits ; en d'autres termes, il y a des châtiments qui sont infligés pour des faits qui ne sont pas des transgressions des règles de la justice et de la morale, et vice versa, il y a des transgressions qui restent sans châtiment. Nous avons ainsi le troisième genre de passages.
§ 1968. 3° Passages où la « justice » fait entièrement défaut. Par exemple, Clytemnestre décrit la destruction de Troie : la mort des vaincus, le pillage, l'incendie ; tout cela n'est rien : [FN: § 1968-1] « S'ils révèrent les dieux tutélaires et les temples de la terre conquise, les vainqueurs ne seront pas vaincus à leur tour [FN: § 1968-2] ».
§ 1969. L'envie des dieux, dont parlent tant les auteurs de la Grèce antique (§1986), apparaît aussi dans la trilogie. Agamemnon craint d'offenser les dieux en marchant sur des tissus de pourpre [FN: § 1969-1]. Le chœur dit que du bonheur naît le malheur, et que la prospérité humaine se brise sur quelque écueil caché. Aussi conseille-t-il de jeter, par mesure de prudence, une partie des biens qu'on possède [FN: § 1969-2].
§ 1970. Ces contrastes apparaissent fort bien dans le discours que tient Zeus, au premier chant de l'Odyssée. Eustathe voit bien qu'on y posait le problème du bien ou du mal que l'homme, par ses actions, s'attire à lui-même, et du bien ou du mal qu'indépendamment de ces actions les dieux ou le destin lui suscitent. Zeus commence par se plaindre de ce que les hommes accusent à tort les dieux de leurs maux, tandis qu'en réalité ils se les attirent eux-mêmes [FN:§ 1970-1]. La théorie est évidente : du délit vient le châtiment, et Zeus est seulement témoin des événements qui ont lieu. Athéna réplique et expose une autre théorie [FN: § 1970-2]. Les maux des hommes devraient être le seul châtiment de leurs mauvaises actions. Égisthe a été justement puni ; mais Ulysse, qui n'a pas mal agi, ne devrait pas subir le châtiment de l'exil loin de sa patrie. Zeus reprend la parole [FN: § 1970-3]. Il a déjà oublié son affirmation d'après laquelle les hommes accusent à tort de leurs maux les dieux ; il dit que les maux d'Ulysse ont pour origine la colère de Poséidon, qui persécute Ulysse, parce qu'il a aveuglé le Cyclope.
Pourtant, en agissant ainsi, Ulysse n'a nullement péché contre les règles de la justice. Nous avons donc une troisième théorie. Les maux des hommes leur viennent en partie de ce qu'ils agissent follement, en partie de ce qu'ils sont frappés par quelque dieu, sans aucune faute de leur part. Les autres dieux entravent, il est vrai, l'œuvre de Poséidon à l'égard d'Ulysse ; mais ils n'essaient même pas de porter secours aux malheureux Phéaciens que Poséidon punit, non pas pour quelque mauvaise action, mais au contraire pour avoir accompli la bonne action de ramener Ulysse dans sa patrie, pour avoir obéi au précepte divin qui veut que les étrangers soient considérés comme venant de Zeus.
§ 1971. Avec ces passages et d'autres sous les yeux, on ne comprend pas comment J. Girard peut dire que, dans l'Odyssée [FN: § 1971-1], « (p. 97) s'il est une idée d'où dépende visiblement toute la suite des faits, c'est : d'une part, que les hommes par leur obstination dans le mal attirent sur eux le châtiment, et, de l'autre, qu'un prix éclatant est réservé à la vertu énergique et patiente ». Une belle récompense, en vérité, fût réservée aux pauvres et vertueux Phéaciens ! Les contradictions relevées tout à l'heure dans le premier chant de l'Odyssée ne semblent pas avoir été aperçues par leur auteur. Plus tard, des doutes se manifestèrent sur ces sujets, et l'on chercha à résoudre les problèmes auxquels ils donnèrent naissance. Dans son commentaire, Eustathe [FN: § 1971-2] attribue, comme origine aux maux des hommes, d'une part Zeus et le destin, qu'il met ensemble ; d'autre part, l'imprudence, ou mieux le manque de discernement ![]() des hommes, qui s'attirent des maux à eux-mêmes. Il semble qu'il s'attache surtout à cette question : les maux sont-ils indépendants ou dépendants de l'action des hommes ?
des hommes, qui s'attirent des maux à eux-mêmes. Il semble qu'il s'attache surtout à cette question : les maux sont-ils indépendants ou dépendants de l'action des hommes ?
§ 1972. L'exemple que nous venons de donner est l'un de ceux, fort nombreux, que l'on peut citer pour montrer qu'en beaucoup de cas la recherche de l'idée qu'avait l'auteur d'une composition littéraire est vaine, et cela pour le motif que dans ces cas, il n'y a pas une idée unique (§541), ni chez l'auteur, ni chez celui qui l'écoute. L'un et l'autre se laissent guider par le sentiment, qui laisse les propositions indéterminées, et parfois les accepte même si elles sont contradictoires. Il y a, chez les hommes, deux sentiments qui naissent, l'un des infortunes « méritées », l'autre des infortunes « imméritées ». Si l'on dit que toute infortune est méritée, en certaines circonstances, le premier sentiment peut agir seul, tandis que le second reste latent. Vice versa, si l'on parle du destin qui fait endurer des maux à l'innocent, le second sentiment agit, et le premier est inactif.
§ 1973. Il est nécessaire d'avoir cela présent à l'esprit, lorsqu'on traite des dieux et du destin, du contraste entre la « Justice » et la « fatalité ». L'empereur Julien se moque du Dieu des Hébreux, qui se fâche pour des motifs futiles ; mais il oublie que les dieux du paganisme étaient tout aussi faciles à irriter [FN: § 1973-1]. En réalité, les hommes ont l'habitude d'attribuer à leurs dieux les caractères des hommes puissants.
§ 1974. Dans le petit livre de Bayet, que nous citons souvent, parce qu'il est généralement en usage dans les écoles laïques françaises, et qu'il renferme par conséquent les théories protégées par la « défense de l'école laïque », on commence par donner une solution affirmative du problème que nous étudions ici. En effet, nous lisons dans cet ouvrage [FN: § 1974-1] : « (p. 1) Les bonnes actions sont celles qui nous sont utiles, c'est-à-dire celles qui nous rendront VRAIMENT HEUREUX. Les mauvaises actions sont celles qui nous sont nuisibles, c'est-à-dire celles qui nous rendront MALHEUREUX. On peut donc dire que la morale nous enseigne quelles sont les choses qu'il faut faire pour être vraiment heureux ». Donc, quiconque suit les enseignements de la morale sera vraiment [attention à cet adverbe] heureux ; mais pour qu'aucun doute ne subsiste, l'auteur, après la théorie générale, cite encore un cas particulier : « (p.1) On dit, par exemple, que nous avons le devoir de ne pas mentir : cela veut dire que, si nous mentons, nous serons malheureux tôt ou tard, et que si, au contraire, nous ne mentons pas, nous serons VRAIMENT HEUREUX ». Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore compris, on ajoute : « (p. 2) Il est aussi sot et aussi dangereux de ne pas écouter ce que dit la MORALE que de ne pas écouter ce que dit la MÉDECINE ». Fort bien ; la théorie exposée est claire. Mais, un peu plus loin, l'auteur cite F. Buisson, qui dit qu'autrefois les manants étaient « (p. 26) courbés sur la glèbe, noirs, livides, taillables et corvéables à merci ». Donc ils étaient malheureux ; donc, si celui qui observe les règles de la morale est toujours heureux, cela signifie que les manants n'observaient pas ces règles. Mais ce n'est certainement pas ce que veut dire l'auteur. Il y a mieux. Comme nous l'avons vu (§1716-2]), l'auteur affirme que les conditions présentes de la société ne sont pas justes, et que « tout le monde doit désirer que cela change ». Donc, si la théorie exposée est vraie, on doit conclure que si les pauvres sont aujourd'hui malheureux, c'est parce qu'ils n'observent pas les règles de la morale. Le remède à leurs maux consisterait donc à observer ces règles, puisque, dit l'auteur, « la morale nous enseigne quelles sont les choses qu'il faut faire pour être vraiment heureux ». Est-ce peut-être la conclusion de l'auteur ? En aucune façon ! Il a déjà oublié ce qu'il avait dit peu avant, et il donne comme remède l'élection de députés et de sénateurs d'un certain parti (§1716-2]). Mais si cela est nécessaire et suffisant pour donner plus de bonheur aux pauvres, pourquoi l'auteur a-t-il commencé par dire qu'on obtenait cet effet en observant les règles de la morale ? Il pourrait, il est vrai, répondre que, pour lui, élire des députés et des sénateurs d'un certain parti, c'est une règle de morale. Ainsi nous revenons au genre (A-1). Si l'on appelle moral tout ce qui, suivant un auteur, peut procurer le bonheur, il est très certain qu'on peut conclure, toujours selon cet auteur, que la morale procure le bonheur. Toute pétition de principe donne toujours une conclusion incontestable. La Science de M. Bayet est probablement la respectable entité qui, de nos jours, a été divinisée ; mais elle n'a vraiment rien à faire avec la science logico-expérimentale. Nombre de siècles se sont écoulés depuis le temps où fut composé le premier chant de l'Odyssée, jusqu'à celui où M. Bayet a donné ses œuvres au monde. Peut-être le mérite littéraire de ces deux compositions est-il quelque peu différent ; mais dans l'un et dans l'autre nous trouvons des contradictions analogues. Pourtant l'Odyssée est exempte de la présomption d'avoir dissipé les ténèbres de la « superstition » par l'éclat de la sacro-sainte Science.
§ 1975. Le second sujet indiqué au §1898 se rapporte aux conséquences produites, dans le cas où la personne qui observe ou transgresse les règles est différente des personnes qui retirent un avantage, ou bien subissent un dommage de ce fait, auquel elles sont étrangères. Quand il y aurait lien de traiter ce sujet, il arrive parfois que les auteurs négligent entièrement le problème de la correspondance de ce fait avec le bonheur ou le malheur des personnes, ou bien qu'ils font seulement une lointaine allusion à une solution implicite. De nos jours, cela se produit surtout au sujet des rapports entre gouvernants et gouvernés, et, en général, les auteurs semblent se rapprocher plus ou moins implicitement de l'une des deux thèses suivantes : 1° Les gouvernants doivent observer les règles existantes, et il n'y a pas lieu de se soucier d'autre chose, ni de résoudre le problème des conséquences ; 2° les gouvernants peuvent transgresser ces règles pour faire le bien public ; mais on admet cela sans trop en parier, et parfois même en affirmant le contraire. D'une manière ou de l'autre, on échappe à la nécessité de résoudre le problème de la correspondance entre les actions et les conséquences [FN:§ 1975-1]. Celui qui voit objectivement les faits, celui qui ne veut pas, de propos délibéré, fermer les yeux à la lumière, est tout de même obligé de reconnaître que ce n'est pas en étant des moralistes timorés que les gouvernants font prospérer les nations; mais il passe le fait sous silence, ou s'excuse de l'exprimer, et accuse des événements la « corruption » des mœurs. Pourtant, même ainsi, il n'évite pas le reproche d'immoralité dont on gratifia Machiavel, parce qu'il avait simplement exprimé des uniformités que tout le monde peut vérifier dans l'histoire [FN:§ 1975-2] (§2449). On l'a accusé d'avoir plagié Aristote et d'autres auteurs : il s'est simplement rencontré avec ceux qui ont décrit la réalité. Cet exemple montre la difficulté qu'il y a à faire une analyse scientifique. La plupart des gens sont incapables de séparer deux études qui sont pourtant entièrement différentes : I. L'étude des mouvements réels, qui porte sur les faits et sur leurs rapports. Les faits que rapporte Machiavel sont-ils ou non vrais ? Les rapports qu'il aperçoit entre eux sont-ils ou non réels ? C'est ce dont ne semblent guère, se soucier la plupart de ceux qui l'attaquent ou le défendent ; toute leur attention se porte vers la partie suivante. II. L'étude des mouvements virtuels, qui est l'étude des mesures à prendre en vue d'un but déterminé. Qui attaque Machiavel l'accuse de prêcher aux princes de devenir des tyrans ; qui l'excuse répond qu'il a seulement montré comment on peut atteindre ce but, mais qu'il n'a pas recommandé ce but. L'accusation et l'excuse peuvent subsister toutes deux, mais elles sont étrangères à la question de savoir comment les faits se passeront, en certains cas hypothétiques. On remarquera qu'en homme pratique, Machiavel a voulu traiter d'un cas concret, qui devient ainsi un cas particulier de la question générale. Il a écrit Le Prince, mais, exactement sur le même modèle, il aurait pu écrire Les Républiques. [FN: § 1975-3] Il l'a même fait en partie dans les Discours sur la première décade de Tite-Live, et, s'il avait vécu de nos jours, il aurait pu faire porter ses études sur les Régimes parlementaires. Il a recherché quels sont les moyens les plus appropriés pour que les princes conservent le pouvoir, et il a examiné les deux hypothèses, du prince nouveau et du prince héréditaire. Sur le même modèle, il aurait pu faire des recherches analogues pour les autres régimes politiques. Toujours sur le même modèle, il aurait pu étendre ses recherches au point de vue du but, et étudier quels sont les moyens les plus appropriés pour obtenir les puissances économiques, militaire, politique, etc. Ainsi, du cas particulier concret étudié par lui, il se serait élevé jusqu'à la question générale des mouvements virtuels, qui est précisément une de celles que considère la sociologie. On ne pouvait pas encore faire cela de son temps, de même qu'on ne pouvait le faire au temps de son unique et grand prédécesseur Aristote, parce que les sciences sociales n'étaient même pas nées. Aussi demeure-t-on émerveillé de la puissance extraordinaire du génie d'Aristote, et plus encore de celle du génie de Machiavel, de ces hommes qui, avec les éléments si imparfaits que leur fournissaient les connaissances du temps où ils vivaient, surent s'élever à un si haut degré. Mais on voit aussi combien grande est l'ignorance de certains de nos contemporains, qui ne sont même pas capables de saisir l'importance de la question étudiée par Machiavel, auquel ils opposent des billevesées éthiques et sentimentales, dépourvues de toute valeur scientifique ; cependant qu'avec une prétention ridicule, ils s'imaginent étudier les sciences politiques et sociales.
On trouve des exemples importants chez Émile Ollivier [FN:§ 1975-3]. Il essaie, sans trop insister il est vrai, d'établir la concordance entre les bonnes œuvres et le bonheur, en reculant ce dernier dans l'avenir (§1951) ; mais il ne s'arrête pas à cet essai, tandis que, dans tout l'ouvrage de seize volumes [plus tard dix-sept], il s'efforce de présenter Napoléon III comme un parfait honnête homme. Comme, d'autre part, il est incontestable que le sort ne lui fut pas propice, cela prouve, en admettant les yeux fermés les affirmations d'Ollivier, que les bonnes actions peuvent ne pas aller de pair avec le succès. Ajoutons que dans le passage où il s'en remet à l'avenir pour changer le sort de mauvais en bon, il ne nous explique pas du tout comment l'avenir peut remédier aux maux des gens qui sont morts avant que le sort change. Il ne semble pas avoir de théorie très précise (§ 1995-3), et il ne traite pas la question de la divergence entre les malheurs des Français en 1870 et les bonnes œuvres précédentes de leur empereur. Devons-nous admettre que c'est là un cas analogue, bien qu'opposé, à celui des Achéens qui souffrirent tant de maux occasionnés par l'orgueil d'Agamemnon ? ou devons-nous admettre une autre explication ? Ollivier ne s'aperçoit pas que les justifications qu'il donne des actions de Napoléon III, au point de vue de la morale privée, sont une condamnation certaine des actions de ce souverain comme homme d'État [FN: § 1975-4].
§ 1976. D'une façon générale, les personnes qui ont une foi vive y trouvent le souverain bien, et sont, par conséquent, portées à croire que le fait d'observer les règles imposées par cette foi conduit nécessairement au bonheur. Pourtant, quand le terme bonheur désigne une chose existant dans le domaine expérimental, affirmer une concordance parfaite entre l'observation des règles de la morale et de la religion d'une part, et le bonheur d'autre part, ou bien entre la transgression de ces règles et le malheur, c'est se mettre trop souvent en contradiction avec l'observation des faits [FN:§ 1976-1], pour qu'on obtienne le consentement des hommes, à moins que l'on ne trouve moyen de faire disparaître le contraste par des explications appropriées. C'est à quoi s'employèrent un grand nombre de gens, depuis les anciens temps jusqu'à l'époque moderne. Dans ce but, parfois les théoriciens inventèrent de toutes pièces les arguments ; plus souvent, et avec beaucoup plus d'efficacité, ils les cherchèrent dans les expressions déjà existantes de certains résidus. Par exemple la persistance des agrégats pousse les hommes à considérer comme une unité une certaine collectivité, et le théoricien peut tirer parti de ce fait pour expliquer comment une personne appartenant à cette collectivité subit des maux sans les avoir mérités en aucune façon. Il suffit pour cela d'invoquer des fautes commises par quelque autre personne de la collectivité (§1979).
§ 1977. (B-2) Bonheur et malheur repoussés dans l'espace et dans le temps. Un individu accomplit une action M, dont on affirme que doit découler un fait P, lequel peut être aussi l'effet du hasard. Il est évident que plus long sera l'espace de temps que nous accorderons pour que P se produise, après que M a eu lieu, plus grande deviendra la probabilité que P puisse se produire par simple hasard. Bien plus, si l'espace de temps est assez long, la réalisation de P est si probable qu'on peut la qualifier de certaine. Si les gens qui tâchent de deviner les numéros de la loterie donnent un siècle pour qu’un numéro sorte, au lieu de désigner un tirage déterminé, ils peuvent être presque certains, disons même certains, que leurs prédictions seront vérifiées. De même, si le temps dans lequel doit se vérifier la prophétie est long et indéterminé, ou ne court aucun danger d'être démenti en affirmant qu'un peuple qui agit mal est tôt ou tard puni, et un peuple qui agit bien, tôt ou tard récompensé. Aucun peuple, durant une longue série d'années ou de siècles, n'a que des événements heureux ou que des événements malheureux. Par conséquent, si l'on n'est pas limité par le temps, on trouvera toujours la punition ou la récompense cherchées.
Il est un procédé remarquable de repousser dans le temps et dans l'espace les conséquences des événements heureux ou malheureux qui arrivent aux hommes. On affirme que, si des malheurs affligent un homme qui est bon, cela tourne à son avantage, parce que cela sert à le corriger de quelque vice ou de quelque défaut, ou que cela engage d'autres hommes à se corriger des leurs ; et si, mais plus rarement, un événement heureux arrive à un méchant homme, on dit que cela tourne à son détriment, parce que, aveuglé, il court à sa perte ; ou bien que cela sert à inspirer aux gens le mépris des biens terrestres, en leur montrant que les méchants en jouissent eux aussi (§ 1995-3).
§ 1978. Étant donnée la brièveté de la vie humaine, on a moins de chances de trouver pour l'homme que pour les peuples la correspondance désirée, dans le temps, entre les actions et leurs conséquences. Cependant il est difficile que tout aille bien ou que tout aille mal pour un homme, dans le cours de son existence. Par conséquent, même pour lui, on trouvera la correspondance cherchée entre une action qu'il a accomplie et le châtiment ou la récompense de cette action. C'est pourquoi nous avons un grand nombre de théories qui, pour le même individu, reculent l'expiation dans le temps. D'autres affirment que le mal d'un homme sert à le corriger, et qu'en conséquence, après un certain temps, il fera le bien de cet homme. Celui qui dit aujourd'hui : « Attendez l'avenir pour voir si la faute ne sera pas punie, la bonne action récompensée », ne peut se voir opposer aujourd'hui un démenti certain par l'expérience, car l'avenir nous est inconnu, à nous comme à lui. Mais si la théorie qu'il énonce est générale, si elle s'applique au passé, – et c'est bien ainsi qu'il l'entend ordinairement, – nous devrions connaître aujourd'hui la punition ou la récompense qui revint avant leur mort aux hommes dont nous savons l'histoire ; et quand on fait cette recherche, on voit que la théorie n'est pas du tout vérifiée par l'expérience. Ce fait échappe à qui se laisse dominer par le sentiment. C'est un cas analogue à celui que nous avons cité (§1440-2), de gens qui croient que les femmes descendant d'hommes qui boivent du vin perdent la faculté d'allaiter. Ces gens ne prennent pas garde que si c'était vrai, on ne trouverait plus, dans les pays viticoles, une seule femme qui puisse allaiter.
§ 1979. Si nous élargissons le cercle de nos recherches, et que nous passons d'un individu à d'autres individus, nous pouvons encore plus aisément retrouver quelques maux, ou quelques biens, à mettre en rapport avec une action déterminée. Des résidus puissants poussent les hommes à considérer la famille comme une unité, et nous pouvons tirer parti de cette circonstance pour trouver, parmi les descendants d'un homme, quelqu'un qui subit le châtiment ou reçoit la récompense d'une action accomplie par cet homme [FN:§ 1979-1]. Le succès de cette recherche est certain : quand a-t-on jamais vu, au cours des siècles, la descendance d'un homme n'être l'objet que d'événements heureux, ou que d'événements malheureux ?
§ 1980. Le malheureux Crésus envoya des ambassadeurs pour reprocher à Apollon les infortunes dont lui, Crésus, avait été accablé. Par la bouche de la Pythie, le dieu répondit sans reprocher en aucune façon à Crésus d'avoir jamais péché contre les dieux ou contre les hommes. Il dit : « Le sort fixé par le destin ne peut pas être évité, même par un dieu. Crésus a été frappé à cause de la faute de son cinquième ascendant... » Hérodote [FN: § 1980-1], qui rapporte cette légende, n'y trouve rien à redire. Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, commettait toutes sortes de crimes et de sacrilèges, et en riait allègrement. Après avoir saccagé le temple de Proserpine à Locres, il revenait à Syracuse. Son navire était poussé par un bon vent, ce qui lui fit dire à ses amis : « Voyez quelle bonne navigation les dieux immortels eux-mêmes accordent aux sacrilèges ! » Valère Maxime, qui rapporte ce fait [FN: § 1980-2], ajoute d'autres semblables exemples d'impiété, et conclut : « Bien qu'il ne payât pas la peine due à ses crimes, il reçut néanmoins, après sa mort, dans l'infamie de son fils, le châtiment auquel il avait échappé pendant sa vie. Si la colère divine est lente à la vengeance, elle compense le retard du supplice par sa gravité ». L. Cornelius Sulla fut heureux sa vie entière [FN:§ 1980-3] ; mais Faustus Sulla, son fils, fut tué par les soldats de Sitius, et Publius Sulla, son neveu, fut l'un des complices de Catilina. Dînant chez un vétéran, à Bologne, Auguste lui demanda s'il était vrai que celui qui, en Arménie, avait le premier enlevé la statue de la déesse Anaïtis, était mort frappé de cécité et de paralysie [FN: § 1980-4]. Le vétéran répondit que c'était précisément grâce à la jambe de la déesse qu'Auguste dînait ; que lui, le vétéran, avait le premier frappé la statue, et que toute sa fortune provenait de ce butin. Si nous connaissions l'histoire de tous les descendants de ce vétéran, aucun doute que nous n'en trouvions un auquel il sera arrivé quelque malheur, et nous pourrions admettre qu'il subissait la peine du crime de son ancêtre. De même, lorsque Crésus perdit le trône et la liberté, la Pythie découvrit aisément qu'il était puni pour le crime de son cinquième ascendant [FN:§ 1980-5] ; et si Crésus avait eu une vie toujours heureuse, son fils aurait pu subir la punition de son sixième ascendant, et ainsi de suite à l'infini [FN: § 1980-6].
§ 1981. Nonobstant un nombre immense de mauvaises actions, les Romains ont joui d'une longue prospérité ; mais rien ne nous empêche de croire qu'ils ont expié leurs mauvaises actions par l'invasion des Barbares. De même, les invasions des mahométans peuvent avoir puni les fautes des chrétiens, et les invasions des chrétiens en terre musulmane peuvent avoir puni les fautes des mahométans. Qui cherche trouve, et sans trop de peine.
§ 1982. La « responsabilité » des fautes, comme la « récompense » des vertus, peut non seulement passer aux descendants, mais aussi s'étendre à des collectivités diversement composées. Chez les anciens, l'opinion était générale que la faute d'un homme retombait sur tous ses concitoyens. Rome sut aussi tirer parti des mauvaises actions de certains consuls, mais elle n'en fit pas une théorie. Quand les auteurs anciens ne montrent aucune répugnance à admettre que les enfants subissent le châtiment dû à leur père, il est évident que la famille leur apparaît comme une unité, représentée par le paterfamilias. De même, lorsqu'ils parlent d'une cité frappée à cause des mauvaises actions de l'un de ses citoyens, ils la voient comme une unité [FN: § 1982-1]. Dans les deux cas, la punition de l'unité, à cause de la faute d'une partie de cette unité, est « juste », comme est « juste » la punition du corps entier d'un individu pour le crime commis par sa main. Cette considération de l'unité renferme le résidu principal (persistance des agrégats) ; et ce n'est qu'accessoirement qu'on fait usage des dérivations qui s'efforcent de concilier la punition – ou la récompense – de l'agrégat, avec la faute – ou le mérite individuel. Ajoutons que ce que nous appelons « faute » est assimilé, au moins en partie, à une souillure qui altère l'intégrité de l'individu, de sa famille, des diverses collectivités dont il fait partie. C'est pourquoi l'on voit surgir spontanément l’idée que l'intégrité doit être rétablie, non pour l'individu seul, mais aussi pour la famille et pour les diverses collectivités (§1231 et sv.).
§ 1983. Parmi les diverses dérivations mentionnées tout à l’heure, il faut remarquer celle qui affirme que la cité est frappée avec justice, parce qu'elle pouvait se soustraire au châtiment en punissant elle-même le coupable [FN: § 1983-1]. De nombreux faits rendent manifeste l'artifice de cette dérivation. Souvent le châtiment frappait la cité ou la collectivité avant qu'elles eussent connu le crime et le coupable, et par conséquent lorsqu'il était absolument impossible de châtier directement le coupable, ou d'expier le crime de quelque manière que ce fût. Les anciennes légendes fournissent à foison des exemples de peuples frappés pour des crimes ignorés, qui sont ensuite révélés par les prophètes ou par les devins. Les Achéens ne savaient en aucune façon pourquoi la peste les décimait, et pour qu'ils l'apprissent, il fallut que Calchas, protégé par Achille, leur révélât la colère d'Apollon et la cause de cette colère. Ajoutons que même après cette révélation, il ne s'agit nullement d'un châtiment quelconque que les Achéens auraient dû infliger à Agamemnon ; et la peste cesse, non pas à cause de ce châtiment, lequel ne se produit ni avant ni après, mais bien par la satisfaction donnée à Apollon. Agamemnon se décide volontairement à restituer Criséis à son père, « parce qu'il veut que le peuple soit sauf et ne périsse pas [FN: § 1983-2] ». Pour se dédommager, il enlève Briséis à Achille. Comment les Thébains pouvaient-ils bien éviter d'être frappés par la peste, puisqu'ils ignoraient entièrement les crimes dont Œdipe s'était involontairement rendu coupable ? Aussi, l'oracle d'Apollon ne leur reproche aucune faute : il prescrit une expiation, comme un médecin prescrit une médecine à son malade [FN: § 1983-3].
§ 1984. Si un peuple souffrait pour les mauvaises actions de son roi, il profitait, en revanche, de ses bonnes actions. Hésiode décrit le bonheur des peuples gouvernés par un roi juste, et leur malheur s'ils sont gouvernés par un roi injuste. Chez lui se mêle l'idée que les actions du roi sont punies ou récompensées sur le peuple, avec l'idée expérimentale que le malheur ou le bonheur du peuple dépend d'un mauvais ou d'un bon gouvernement [FN: § 1984-1].
§ 1985. Les collectivités qui souffraient par la faute d'un de leurs membres pouvaient être composées plus ou moins arbitrairement. La simple compagnie, même accidentelle, des méchants, pouvait nuire. Dans le domaine expérimental, cela peut arriver en de nombreux cas ; par exemple, celui qui néglige les mesures de prudence dans une poudrière peut causer la mort de toutes les personnes qui s'y trouvent. On suppose qu'il en est de même en d'autres cas, où il n'existe pas de preuve expérimentale. Se trouvant sur un navire, au milieu de la tempête, et accusé d'être la cause du malheur commun à tous ses compagnons, Diagoras répondit en montrant d'autres navires également en danger par le fait de la même tempête, et il demanda si ceux qui l'accusaient croyaient que lui, Diagoras, était aussi sur ces navires-là [FN: § 1985-1]. L'observation parait concluante à beaucoup de personnes, mais elle ne l'est pas. Si l'on suppose que l'athéisme de Diagoras pouvait nuire aux gens qui se trouvaient avec lui sur un navire, on peut admettre également qu'il nuisait à tous ceux qui se trouvaient dans son voisinage à lui, Diagoras, fût-ce même sur d'autres navires. Il s'agit là uniquement de plus ou de moins, d'étendre ou de restreindre l'espace où l'impiété de Diagoras agissait pour attirer la tempête.
§ 1986. L'envie des dieux ![]() , qui ne permettait pas à un homme de passer sa vie entièrement heureux, s'étendait à sa descendance et à sa collectivité. Il est singulier que Plutarque, qui reprend Hérodote pour avoir cru à cette envie [FN: § 1986-1], en cite lui-même un exemple dans la vie de Paul-Émile [FN: § 1986-2]. En ce cas comme en d'autres semblables, ce sont les résidus de la IIe classe qui agissent. Paul Émile et ses enfants sont considérés comme un agrégat, et l'on ne songe pas à séparer les enfants du père. L'agrégat ne doit pas être entièrement heureux : il est frappé en l'une de ses parties.
, qui ne permettait pas à un homme de passer sa vie entièrement heureux, s'étendait à sa descendance et à sa collectivité. Il est singulier que Plutarque, qui reprend Hérodote pour avoir cru à cette envie [FN: § 1986-1], en cite lui-même un exemple dans la vie de Paul-Émile [FN: § 1986-2]. En ce cas comme en d'autres semblables, ce sont les résidus de la IIe classe qui agissent. Paul Émile et ses enfants sont considérés comme un agrégat, et l'on ne songe pas à séparer les enfants du père. L'agrégat ne doit pas être entièrement heureux : il est frappé en l'une de ses parties.
§ 1987. D'ordinaire, les théoriciens modernes blâment sévèrement les vieux préjugés, d'après lesquels les vices du père pèsent sur son fils. Ils ne s'aperçoivent pas qu'il existe un phénomène semblable dans notre société, en ce sens que les vices du père profitent au fils et le disculpent [FN: § 1987-1]. Pour le criminel moderne, c'est une vraie chance que d'avoir parmi ses ascendants ou d'autres parents un criminel, un aliéné ou même seulement un alcoolique. Devant les tribunaux, un tel fait lui vaut une diminution de peine, et parfois même le fait acquitter. Désormais, il n'y a presque plus de procès pénal où l'on ne fasse usage de ce moyen de défense. La démonstration métaphysique par laquelle on établit qu'une peine doit être infligée au fils à cause des vices du père, a autant et pas plus de valeur que celle par laquelle on établit que, pour la même raison, la peine dont le fils aurait autrement été frappé, doit être supprimée ou diminuée. Quand on ne trouve aucune excuse au criminel dans les vices de ses ascendants, on a toujours la ressource de la trouver dans les mauvaises actions de la « société ». En n'ayant pas convenablement pourvu au bonheur du criminel, elle a la « responsabilité » du crime. Ensuite, la peine frappe, non pas la société, mais l'un de ses membres, pris au hasard, ou sans rapport aucun avec la faute présumée [FN:§ 1987-2].
§ 1988. La notion de solidarité, en vertu de laquelle les bons subissent la peine des méchants, apparaît aussi çà et là dans l'antiquité. Elle est devenue fondamentale dans le catholicisme. Pour faire concurrence aux I et aux socialistes, Brunetière a beaucoup insisté sur ce dernier point.
§ 1189. (B-3). Bonheur et malheur repoussés hors du monde réel. Au point de vue de la logique formelle, il est impossible de contester l'exactitude de ces solutions. Ainsi que nous l'avons souvent dit et répété, la science expérimentale ne peut en aucune façon s'occuper de ce qui dépasse le domaine expérimental ; aux limites de ce domaine, elle perd toute compétence.
§ 1990. Mais précisément en ce domaine, nous devons rappeler simplement ici qu'on ne saurait admettre l'affirmation de ceux qui s'imaginent que les peines et les récompenses surnaturelles ont été inventées par des gens qui s'en servaient pour maîtriser les hommes. Les notions de ces peines et de ces récompenses existent indépendamment de tout dessein prémédité. Elles font partie des résidus de la persistance des agrégats, pour lesquels la personnalité humaine subsiste après la mort. Les hommes pratiques se sont servis de ces notions, comme ils se servaient d'autres sentiments existant dans la société, et les théoriciens en ont fait usage pour résoudre leurs problèmes. Ils peuvent bien leur avoir donné des formes littéraires, métaphysiques, pseudo-scientifiques : ils ne les ont pas inventées ; ils ont façonné une matière déjà existante, et, comme les hommes pratiques, ils s'en sont servis ensuite à leurs fins.
§ 1991. Maïmonide nous fait connaître la théorie de la secte musulmane des Kadrites et de celle des Mo'tazales [FN: § 1991-1], qui poussent à l'extrême les explications (B-2) et (B-3). En général, on ne va pas si loin, et nous avons de très nombreuses explications mixtes et surtout mal déterminées.
§ 1992. Nous avons d'autres interprétations, semblables aux précédentes. Ce sont celles qui, au lieu de repousser les conséquences d'un acte dans un monde imaginaire, se bornent à les repousser dans le domaine du possible. On dit, par exemple : « Cet homme est heureux, mais il aurait pu l'être davantage ; cet autre est malheureux, mais il évite ainsi un malheur plus grand ». Le domaine du possible est indéfini, et l'on démontre ainsi tout ce qu'on veut. De tout temps, on a fait sur ce sujet d'élégants exercices de rhétorique.
§ 1993. Un ermite blâmait les jugements de Dieu, parce qu'il voyait des gens qui vivaient mal avoir beaucoup de biens, et d'autres qui vivaient bien, souffrir beaucoup de maux. Un ange survint, et le conduisit en un lieu où demeurait un autre ermite, qui, après une longue pénitence, voulait retourner parmi les tentations du monde. L'ange jeta le second ermite dans un précipice. La mort, qui contrastait en apparence avec la bonne vie de cet ermite, en était, au contraire, la récompense, parce qu'il obtenait ainsi la béatitude éternelle [FN: § 1993-1]. Ainsi de suite, l'ange montra au premier ermite d'autres cas semblables, dans lesquels le mal apparent devient un bien réel, ou vice versa.
§ 1994. Que le lecteur ne croie pas que notre temps ne s'adonne plus à ces fables. Quand on cite aux anti-alcooliques les exemples d'hommes parvenus à un grand âge, d'autres très forts dans les travaux matériels ou intellectuels, bien qu'ils aient bu du vin et d'autres boissons alcooliques, ils répondent que s'ils s'en étaient abstenus, ils auraient vécu encore plus longtemps, ils auraient été encore plus remarquables, matériellement et intellectuellement. Un beau type de dominicain de la vertu a dit, dans une conférence : « On cite de grands hommes d'État et de grands capitaines qui n'étaient pas chastes, des guerriers très braves qui ne l'étaient pas non plus ; c'est vrai, mais s'ils avaient été chastes, ils eussent été encore meilleurs ». Les gens qui tiennent de semblables raisonnements, ou mieux ces vains propos, oublient que le fardeau de la preuve incombe à qui émet une affirmation, et qu'à invoquer uniquement des possibilités, on prend facilement des vessies pour des lanternes.
§ 1995. (B-4). On ne réussit pas à trouver une interprétation. Les voies du Seigneur sont insondables [FN:§ 1995-1]. On peut simplement affirmer que nous ne pouvons pas savoir pourquoi un certain acte a telles conséquences, et l'on peut ne pas se soucier de savoir si elles sont « justes » ou « injustes ». Telle paraît être la conclusion du livre de Job, et telle était la doctrine des Ascharites, comme l'expose Maïmonide [FN:§ 1995-2]. À qui n'affirme rien, on ne peut rien objecter. C'est pourquoi il n'y aurait rien à opposer à la personne qui se bornerait à dire qu'elle ne sait rien des voies du Seigneur, si cette personne s'en tenait logiquement à sa doctrine. Mais souvent il n'en est pas ainsi. L'auteur commence par faire voir qu'il connaît très bien les « voies du Seigneur », et c'est seulement lorsqu'il est serré parles objections qu'il proclame que ces voies sont insondables. Dans les raisonnements de Saint Augustin, nous avons de ce procédé un exemple qui peut servir de type. Il est général ; on le trouve souvent chez les théologiens et chez d'autres penseurs [FN:§ 1995-3].
§ 1996. Comme d'habitude, on n'aperçoit pas la contradiction de ceux qui affirment ne pas connaître ce qu'ils prétendent connaître ; c'est parce que le sentiment domine. En somme le raisonnement est du type suivant : « A doit être B ; et si on ne le constate pas, je ne saurais en dire la raison; mais cela ne diminue pas ma foi que A doive être B ». Sous cette forme, la science expérimentale n'a rien à reprendre, pour le motif tant de fois rappelé qu'elle n'a rien à faire avec la foi. Mais souvent la forme, au moins implicite, est différente, et se rapproche du type suivant : « A est B ; et si on ne le constate pas, c'est une illusion, parce qu'en réalité, d'une manière que je ne connais pas, A est B ». Quand A et B sont dans le domaine de l'expérience, cette proposition appartient à la science logico-expérimentale, et celle-ci ne peut admettre que A soit B, si l'on constate que A n’est pas B, et elle ne se soucie pas de savoir si l'on peut connaître ou non la cause de ce fait.
§ 1997. Dans ce cas aussi, ce ne sont pas les théoriciens qui ont inventé que les « voies du Seigneur » sont insondables. Ils ont trouvé dans les populations ce sentiment, qui dépend des résidus de la IIe classe ; ils s'en sont servis tout en donnant à ses manifestations des formes qui leur plaisaient.
§ 1998. De ce genre de solutions se rapproche beaucoup celui des solutions métaphysiques, telles que l'impératif catégorique de Kant. Elles posent en principe une certaine conception du devoir, sans dire ce qu'il en sera de l'individu qui refusera de le remplir, qui n'en tiendra aucun compte. Les contradictions habituelles ne font pas défaut dans ces solutions, car on énonce tout ce qu'il plaît à l'auteur d'imposer, et on tait la réponse aux objections. Un type de ces raisonnements est le suivant. « On doit faire A parce qu'il est une conséquence de B ». Et pourquoi doit-on faire B ? « Parce que c'est une conséquence de C ». Et ainsi de suite, on arrive à cette question : « Pourquoi doit-on faire P ? » On y répond par quelque impératif catégorique. Ces solutions métaphysiques sont généralement à l'usage des théoriciens. Les hommes pratiques et le vulgaire n'y prêtent pas grande attention.
§ 1999. Négation absolue. Pessimisme. Ces solutions sont peu importantes pour l'équilibre social, parce qu'elles ne sont jamais populaires. Elles sont particulièrement usitées par des littérateurs et des philosophes [FN: § 1999-1]. Elles n'ont de valeur que comme manifestations de l'état psychique de certains individus. Dans un moment de découragement beaucoup de gens répètent le mot de Brutus : « Vertu, tu n'es qu'un nom ! » Beaucoup se complaisent à lire les productions pessimistes de Leopardi, comme ils se complaisent à entendre une belle tragédie ; mais ni les premières ni la seconde n'agissent dans une mesure notable sur leurs actes.
§ 2000. Le pessimisme a souvent pour effet de pousser aux jouissances matérielles, et nombre de littérateurs expriment cette idée : « Jouissons tandis que nous sommes en vie, parce qu'après la mort nous ne jouirons plus ». En Russie, après la guerre contre le Japon, il y eut un mouvement révolutionnaire et d'ardents espoirs d'un bel avenir. La révolution domptée et ces espoirs dissipés, il vint un temps de découragement et une propension aux jouissances matérielles.
§ 2001. (D) Négation conditionnelle. On a deux phénomènes différents qui peuvent avoir certains points communs. Le lecteur qui a prêté attention aux nombreux faits que nous avons exposés, et auxquels on en pourrait ajouter facilement un très grand nombre d'autres, a déjà aperçu la solution scientifique des problèmes posés au §1897. Quant au premier de ces problèmes, le fait de suivre avec précision les règles existantes dans une collectivité a certains effets favorables à l'individu, à la collectivité considérés séparément, à l'individu et à la collectivité pris ensemble, et certains autres effets contraires (§2121 et sv.). Ordinairement, les premiers sont plus importants que les seconds. On ne peut connaître les uns et les autres que moyennant une étude de chaque cas particulier. Quant au second problème, il est bon, dans une certaine mesure, que l'on croie toujours favorable à l'individu et à la collectivité le fait de suivre les règles existant dans une collectivité ; qu'il n'y ait là dessus aucun doute ni contestation. D'autre part, cette croyance peut être nuisible dans une certaine mesure ; mais ordinairement les effets favorables l'emportent sur les effets nuisibles. Pour connaître ces effets, il faut une analyse de chaque cas particulier.
Revenant aux problèmes plus généraux exposés au §1897, nous pouvons répéter à la lettre ce que nous avons dit tout à l'heure, en substituant seulement les résidus existant dans une collectivité et leurs conséquences, aux règles indiquées. Il faut ensuite étudier les diverses solutions que donnent de ces problèmes les théologies et les métaphysiques. À l'égard du premier problème, les théologies des religions dites positives et les métaphysiques admettent ordinairement qu'agir suivant les résidus existants sanctionnés par elles, et suivant les conséquences de ces résidus, ne peut avoir que des effets « bons, justes, utiles ». Au contraire, les théologies de la sainte Raison et celles du Progrès proclament qu'agir suivant certains de ces résidus, qualifiés par elles de « préjugés », et les conséquences qu'on en tire, ne peut avoir que des effets « mauvais, injustes et pernicieux ». Comme d'habitude, la science logico-expérimentale n'accepte ni les unes ni les autres de ces affirmations dogmatiques, mais entend discuter chaque cas au moyen de l'expérience, qui seule peut nous faire connaître l'utilité ou le dommage de certaines manières d'agir.
§ 2002. L'étude que nous venons d'accomplir nous offre un excellent exemple de la vanité expérimentale de certaines doctrines, unie à leur grande utilité sociale.
Il y a plus de deux mille ans que les moralistes recherchent quels rapports peuvent exister entre le fait d'observer exactement les règles de la morale, et celui du bonheur ou du malheur qui en résulte pour les individus et les collectivités. Ils n'ont pas encore réussi à trouver une théorie qui concorde avec les faits, ni même à pouvoir en énoncer une qui revête une forme précise, et n'emploie que des termes ne dépassant pas le monde expérimental. Ils ressassent indéfiniment les mêmes choses. Une théorie disparaît, puis renaît, puis reparaît de nouveau, et ces alternances continuent sans trêve ni repos (§616 et sv.).
Aujourd'hui encore, quand les historiens et d'autres adeptes des sciences sociales veulent juger d'après la « morale » les actions des hommes, ils s'abstiennent de dire, comme cela serait pourtant nécessaire, quelle solution du problème indiqué ils acceptent. Ils la laissent implicite, enveloppée dans les nuées du sentiment ; ce qui leur permet de la changer quand cela leur est utile, et souvent d'en avoir successivement deux ou davantage, qui sont contradictoires. Il est facile de comprendre combien peu de valeur logico-expérimentale peuvent avoir des conclusions tirées ainsi de prémisses implicites, incertaines, inconsistantes, nébuleuses. Ces conclusions sont acceptées par accord de sentiments, et non pour d'autres motifs. Les polémiques auxquelles on se livre à leur sujet sont de simples logomachies.
Si l'on compare l'éthique d'Aristote aux éthiques modernes, on voit aussitôt qu'entre elles la différence est beaucoup moindre qu'entre la physique d'Aristote et la physique moderne. Pourquoi cela ?
On ne peut dire que le fait se soit produit parce que les sciences naturelles auraient été étudiées par des hommes d'un plus grand talent que ceux qui ont étudié, l'éthique. Outre que souvent un seul et même auteur, par exemple Aristote, a écrit sur les unes et sur l'autre, il n'est pas possible de trouver dans l'histoire un seul indice de cette hypothétique différence de talent.
On pourrait chercher la cause de la différence de développement de ces disciplines dans les difficultés intrinsèques de leur étude, et dire que la physique, la chimie, la géologie et les autres sciences naturelles ont progressé plus que l'éthique, parce que leur étude est plus facile. Ne nous arrêtons pas à l'observation de Socrate, qui veut qu'elle soit, au contraire, plus difficile [FN: § 2002-1] : c'est une observation qui est vraie, mais seulement pour les raisonnements faits par le sentiment. Mais comment s'expliquer que jusqu'au XVe siècle, à peu près, la physique, la chimie et d'autres sciences semblables n'ont pas fait plus de progrès que l'éthique ? Pourquoi la plus grande facilité supposée à leur étude n'eut-elle aucune influence ? Ces sciences vont de pair avec l'éthique, si même elles ne restent en arrière, tant qu'on emploie dans les unes et les autres la même méthode théologique, métaphysique ou sentimentale. Elles s'en détachent et progressent rapidement, quand les méthodes sont différentes, et que les sciences naturelles font usage de la méthode expérimentale. Il est donc évident que c'est de cette différence des méthodes que provient la différence de progrès de l'éthique et des sciences naturelles.
Nous ne sommes pas encore arrivés au terme des points d'interrogation. Nous devons nous demander : pourquoi cette différence de méthodes ? Le hasard peut l'avoir fait surgir ; mais pourquoi subsiste-t-elle depuis des siècles et persiste-t-elle ? Les Athéniens furent également hostiles à Anaxagore, qui disait que le soleil était une pierre incandescente, et à Socrate, qui prêchait une morale dont ils ne voulaient pas. En des temps plus rapprochés des nôtres, on condamna également les « erreurs » de Copernic, reproduites par Galilée, et les « erreurs » morales des hérétiques. Pourquoi le champ est-il aujourd'hui laissé libre au premier genre d'« erreurs », tandis que le second est condamné, au moins par l'opinion publique, et en partie aussi par le pouvoir public ?
Il est évident que cette différence d'effets est l'indice de forces différentes, elles aussi. Au premier rang de celles-ci apparaît l'utilité des recherches expérimentales portées à la connaissance du vulgaire ou même effectuées par lui ; tandis que, dans les mêmes circonstances, les recherches et les discussions touchant l'éthique peuvent être nuisibles à la société, et parfois même en ébranler les fondements.
Nous avons donc la preuve et la contre-preuve des effets produits quand la vérité expérimentale et l'utilité sociale concordent ou divergent (§73).
§ 2003. PROPAGATION DES RÉSIDUS. Si certains résidus se modifient chez des individus donnés d'une collectivité, cette modification peut s'étendre directement, par imitation. Mais ce cas se distingue très difficilement de celui de l'extension provoquée indirectement par le changement de certaines circonstances, qui produisent la modification des résidus d'abord chez certaines personnes, et peu à peu chez d'autres. Toutefois ou peut facilement reconnaître que ce second cas est beaucoup plus fréquent que le premier, parce qu'on voit les modifications des résidus se combiner avec des modifications des circonstances économiques, politiques et autres.
§ 2004. PROPAGATION DES DÉRIVATIONS. Ici aussi, il y a des cas analogues. Comme les résidus sont parmi les circonstances principales qui déterminent les dérivations, on peut avoir les trois cas suivants : 1° propagation par imitation ou d'une autre manière directe ; 2° propagation à cause des modifications des résidus correspondant aux dérivations : 3° propagation à cause d'autres circonstances qui agissent sur la collectivité.
Il faut prendre garde qu'un même résidu A peut avoir de nombreuses dérivations S, S', S",..., (§2086), et que le choix entre celles-ci peut avoir lieu pour diverses causes, même de peu d'importance, parfois être déterminé uniquement par le caprice, par la mode, par des circonstances insignifiantes. On peut faire une remarque semblable pour les différentes manifestations de certains résidus ou de certains sentiments. Par exemple, on sait assez que de temps à autre une forme quelconque de suicide devient à la mode, et qu'elle manifeste le sentiment de dégoût de la vie [FN:§ 2004-1].
§ 2005. Il suit de là que, contrairement à ce qui a lieu pour les résidus, l'imitation joue un grand rôle dans la propagation des formes des dérivations et de certaines autres manifestations des résidus. Tous ceux qui parlent la même langue expriment par des termes en grande partie semblables les mêmes sentiments. De même, tous ceux qui vivent dans un certain ambiant, qui en subissent les actions multiples, sont poussés à manifester les mêmes sentiments sous des formes en grande partie semblables. La similitude s'étend aux dérivations ou manifestations de résidus différents. Supposons qu'au résidu A correspondent les dérivations S, S', S",..., qu'au résidu B correspondent les dérivations T, T', T",..., qu'au résidu C correspondent les dérivations U, U', U",.... et ainsi de suite. Supposons en outre que S, T, U,.soient semblables en quelque manière, qu'ils soient de même nature, comme aussi S', T',U',.... de même S", T", U",.et ainsi de suite. Cela posé, si maintenant il arrive que, grâce à certaines circonstances, fussent-elles de peu d'importance, on ait choisi S pour manifester le résidu A, il arrivera très facilement que, pour manifester B on choisisse T, pour manifester C on choisisse U, etc. ; c'est-à-dire que l'on choisisse autant de termes de la série semblable S, T, U,... En d'autres circonstances, en un autre temps, on choisira les termes de la série semblable S', T', U',… ; de même pour d'autres séries semblables. C'est précisément ce que l'on constate dans la réalité. Par exemple, nous observons qu'en nu certain temps les dérivations théologiques S, T, U,... sont à la mode, qu'en un autre temps, elles sont remplacées par certaines dérivations métaphysiques S', T', U',.Le temps n'est pas éloigné où était en usage la série des dérivations positivistes, ou celle des dérivations du darwinisme, par lesquelles on expliquait tous les phénomènes et quelques autres par dessus le marché. Les phénomènes concrets sont complexes. L'imitation y joue un rôle plus ou moins important, mais un grand nombre d'autres circonstances y ont part aussi (§1766).
§ 2006. Le marxisme nous offrit une infinité de dérivations semblables S", T", U",. qui
expliquaient tout phénomène social par le « capitalisme » (§1890). Dans ce cas l'imitation est évidente. Ces dérivations manifestent certains résidus qui dépendent surtout de circonstances économiques et sociales ; mais d'autres dérivations auraient pu les manifester tout aussi bien. Le choix des dérivations S", T", U",. se fit principalement par imitation.
§ 2007. Il faut tenir compte de ce fait, lorsqu'on veut, des dérivations remonter aux résidus. Il existe de grands courants sociaux qui produisent des changements généraux dans les dérivations, tandis que les résidus subsistent. Nous avons donné dans cet ouvrage de nombreux exemples de ce phénomène. Une époque peut employer principalement les dérivations S, T, U,... ; une autre les dérivations S', T', U',... Si l'on s'en tient à la forme, il semble qu'il y ait eu un grand changement, que ce soient là vraiment des états distincts de la civilisation ; tandis qu'en somme ce sont seulement des temps où se manifestent, sous des formes différentes, des résidus qui sont les mêmes ou presque les mêmes.
§ 2008. Nous avons là un cas particulier de phénomènes beaucoup plus généraux, que l'on observe quand les dérivations religieuses, éthiques, métaphysiques, mythiques, s'adaptent aux nécessités de la vie pratique. Les théories ne peuvent être entièrement séparées de la pratique. Il faut qu'il y ait entre les premières et la seconde une certaine adaptation, qui se produit par une suite d'actions et de réactions. Ainsi que nous l'avons vu dans tout cet ouvrage, et contrairement à l'opinion courante, particulièrement à l'opinion des éthiques, des littérateurs, des pseudo-savants, l'influence de la pratique sur les théories est, dans les matières sociales, beaucoup plus grande que celle des théories sur la pratique. Ce sont les théories qui s'adaptent à la pratique, plutôt que la pratique aux théories. Mais de la sorte on ne nie pas, – nous l'avons souvent dit et répété, – qu'il y ait aussi une influence des théories sur la pratique. On affirme seulement, ce qui est bien différent, qu'habituellement elle est beaucoup moindre que l'influence de la pratique sur les théories. Par conséquent, le fait de considérer uniquement cette influence donne très souvent une première approximation du phénomène concret, ce que ne donnerait pas la considération exclusive de l'influence des théories sur la pratique. Cette simple observation a pour conséquence de montrer la vanité d'un très grand nombre d'ouvrages consacrés à l'étude des phénomènes politiques et sociaux, et aussi de plusieurs ouvrages d'économie [FN: § 2008-1].
§ 2009. LES INTÉRÊTS. Les individus et les collectivités sont poussés par l'instinct et par la raison à s'approprier les biens matériels utiles, ou seulement agréables à la vie, ainsi qu'à rechercher de la considération et des honneurs. On peut donner le nom d'intérêts à l'ensemble de ces tendances. Cet ensemble joue un très grand rôle dans la détermination de l'équilibre social.
§ 2010. LE PHÉNOMÈNE ÉCONOMIQUE. On trouve une partie très considérable de cet ensemble en économie. Nous devrions traiter ici de cette science, si elle n'avait déjà été l'objet d'ouvrages importants, auxquels il nous suffira de renvoyer. Nous nous bornerons à donner un aperçu des rapports de l'économie avec les autres parties de la sociologie.
§ 2011. L'ÉCONOMIE PURE. De la même manière que le droit pur tire les conséquences de certains principes, l'économie pure tire les conséquences de certaines hypothèses (§825). L'une et l'autre de ces sciences s'appliquent aux phénomènes concrets, pour autant que les hypothèses faites jouent un rôle prépondérant dans ces phénomènes.
L'évolution historique des connaissances humaines se résout en une marche descendante qui, moyennant l'analyse, va du concret à l'abstrait, suivie d'une marche ascendante qui, moyennant la synthèse, remonte de l'abstrait au concret. Partant de la nécessité pratique d'évaluer la surface des champs ou d'autres terres, on descend à des recherches abstraites, telles que celles de la géométrie, de l'arithmétique, de l'algèbre ; de ces recherches abstraites
on remonte à l'art de l'arpenteur, à la géodésie. Nous avons trois anciens traités grecs sur l'économie : deux qui portent le nom d'Aristote, bien qu'un au moins de ceux-ci ne soit pas de cet auteur, et un de Xénophon. Ce sont des considérations pratiques sur l'art du ménage des citoyens ou de la cité. De ces considérations, par une infinité de degrés, on est descendu jusqu'aux abstractions de l'économie pure ; il s'agit maintenant de remonter jusqu'à l'étude des phénomènes concrets ; mais ce n'est pas en s'efforçant de donner aux abstractions obtenues par l'analyse les caractères des économies anciennes qu'on atteindra la connaissance de ces phénomènes : ce n'est pas en tâchant de donner des caractères concrets à la géométrie d'Euclide qu'on est parvenu à la connaissance de l'art de l'arpenteur, ou de la géodésie. La voie suivie en une infinité de cas semblables est entièrement différente ; elle consiste essentiellement en une synthèse de nombreuses théories.
De tout temps il s'est trouvé des gens pour proclamer l'inutilité des recherches abstraites. En un certain sens ces gens ont raison. Le plus souvent, une de ces recherches, isolée des autres, n'a que peu ou point d'utilité directe pour la pratique. Ce n'est que par leur ensemble et aussi par les habitudes intellectuelles qu'elles donnent que ces recherches peuvent être utiles en pratique. Sous ce rapport, l'économie pure, isolée, n'a pas plus d'utilité directe que ne l'ont un grand nombre de théories de la géométrie, de l'arithmétique, de l'algèbre, de la mécanique, de la thermodynamique, etc., théories que l'on enseigne pourtant dans toutes les écoles des ingénieurs. Quant à l'utilité directe, l'étude de l'échange, en économie pure, est semblable à l'étude que l'on fait, dans tous les cours de physique, sur la chute des corps dans le vide. Elle lui ressemble par ses qualités et par ses défauts, par son utilité et par son inutilité. Une plume qui tombe dans l'air ne suit pas mieux la loi de la chute des corps dans le vide, que certains échanges pratiques ne suivent les lois données par l'économie pure. Du premier fait on ne déduit pas l'inutilité de l'étude de la mécanique, pas plus que du second on ne saurait déduire l'inutilité de l'étude de l'économie pure (§87-1).
§ 2012. Comme d'habitude, la théorie est venue après l'art. Les analyses des juris-consultes romains ont suivi les décisions des préteurs. De même, l'œuvre d'Adam Smith a suivi d'innombrables recherches sur des questions pratiques d'économie, et les œuvres de Walras et d'Edgeworth sur l'économie pure sont venues après une infinité d'ouvrages d'économie pratique et théorique.
§ 2013. Supposons certains êtres qui aient des appétits ou des goûts, et qui, à les satisfaire, rencontrent certains obstacles. Que se passera-t-il ? L'économie pure répond à cette question. C'est une science très étendue, à cause de la grande diversité des goûts et de l'extra-ordinaire diversité des obstacles. Les résultats auxquels elle arrive constituent une partie intégrante et très importante de la sociologie ; mais ils n'en constituent qu'une partie, qui, en certains phénomènes, peut même être petite, négligeable, et qui, en tout cas, doit être combinée avec les autres parties, pour nous donner l'image des phénomènes concrets.
§ 2014. L'ÉCONOMIE APPLIQUÉE. De même qu'on passe de la mécanique rationnelle à la mécanique appliquée par l'adjonction de considérations sur les phénomènes concrets, de même on passe de l'économie pure à l'économie appliquée. Par exemple, la mécanique rationnelle nous donne la théorie d'un levier idéal ; la mécanique appliquée nous enseigne à construire des leviers concrets. L'économie pure nous fait connaître le rôle de la monnaie dans le phénomène économique ; l'économie appliquée nous fait connaître les systèmes monétaires existants, ceux qui ont existé, leurs transformations, etc. De la sorte, nous nous rapprochons davantage de la réalité, sans toutefois l'atteindre encore. La mécanique appliquée nous enseigne comment agissent les organes d'une machine à vapeur ; mais il appartient à la thermodynamique de nous apprendre comment agit la vapeur. Ensuite, nous devrons recourir à un grand nombre d'autres considérations, y compris celles de l'économie, pour nous guider dans le choix d'une machine motrice. L'économie appliquée nous fournit d'abondants renseignements sur la nature et sur l'histoire des systèmes monétaires ; mais pour savoir comment et pourquoi ils ont existé, il faut faire appel à d'autres considérations. Laissons de côté la géologie et la métallurgie, qui doivent nous enseigner comment les métaux précieux furent obtenus. Mais en nous bornant à la considération des forces sociales seules, il nous reste encore à savoir comment et pourquoi certains gouvernements ont falsifié la monnaie, et d'autres pas ; comment le monométallisme or anglais existe en même temps que le bimétallisme boiteux français, le monométallisme argent chinois, la circulation de papier en un grand nombre d'États. La monnaie est un instrument des échanges, et sous ce rapport son étude appartient à l'économie ; mais c'est aussi un instrument pour prélever des impôts, sans qu'une grande partie du public s'en aperçoive ; et sous ce rapport l'étude de la monnaie appartient à différentes branches de la sociologie. Remarquons que nous avons choisi exprès un phénomène où la partie économique est de beaucoup prépondérante. Pour d'autres phénomènes, l'écart entre la théorie et la pratique est plus apparent. L'économie pure nous enseigne que la protection douanière a pour effet direct (prenons garde à cette restriction) une destruction de richesse. L'économie appliquée confirme cette déduction ; mais ni l'une ni l'autre de ces sciences ne peut nous dire pourquoi le libre-échange anglais existe en même temps que le protectionnisme américain, le protectionnisme allemand et tant d'autres, différents par leur intensité et leurs modalités. Nous comprenons encore moins comment il se fait que la prospérité de l'Angleterre se soit accrue avec le libre-échange, et que la prospérité de l'Allemagne se soit accrue au contraire avec la protection (§2184 et sv.).
§ 2015. Les gens qui, d'une part, entendaient dire que les théories économiques démontraient que le protectionnisme avait pour effet une destruction de richesse, et qui, d'autre part, voyaient prospérer les pays où ce protectionnisme était en vigueur, n'y comprenaient plus rien. Ne connaissant pas les causes réelles de cette contradiction, ils en supposaient d'imaginaires. Les uns déclaraient erronées les théories économiques, qu'ils n'étaient même pas capables de comprendre ; d'autres allaient plus loin, et proclamaient la vanité et l'erreur de toute théorie sociale... sauf de la leur, bien entendu ; d’autres imitaient don Quichotte, qui savait préparer un baume, excellent pour guérir les blessures des chevaliers, mais nuisible aux écuyers ; ils exhibaient une économie nationale quelconque, propice à eux et à leurs amis ; d'autres, ne pouvant trouver la raison de ce qui existait, rêvaient à ce qui aurait dû exister ; d'autres encore abandonnaient le terrain semé d'obstacles de l'économie, et pataugeaient dans les marais de l'éthique et de la métaphysique ; d'autres enfin divaguaient sur d'autres voies diverses, toutes également éloignées de la seule qui peut conduire au but, et qu'on trouve dans l'étude expérimentale des phénomènes sociaux qui agissent sur le phénomène économique et le modifient.
§ 2016. On peut décrire en quelques mots la voie suivie, au moins en partie, par les économistes classiques, en disant que la science s'appliqua à étudier non seulement ce qui était, mais encore ce qui devait être. Elle substitua partiellement une prédication à l'étude objective des faits. Cette œuvre est excusable chez les premiers économistes. Il eût même été difficile de faire autrement à l'époque d'Adam Smith et de J.-B. Say. Il semblait alors que toute la civilisation se renouvelât matériellement et intellectuellement. Le passé était misère, ignorance, préjugés ; l'avenir serait prospérité, savoir, œuvres rationnelles : une religion nouvelle fascinait les esprits humains, et la sainte Science repoussait dans les gouffres de l'enfer les actions non-logiques ; elle ne laissait de place dans l'Olympe qu'à la logique et à la très sainte Raison. À ces motifs de caractère général, s'en ajoutaient d'autres, de caractère particulier, parce que la science économique avait fait tout d'un coup un pas de géant, comparable à ceux faits par la physique et par la chimie. Il semblait donc naturel que l'analogie dût se poursuivre, que seule l'ignorance pût soutenir les anciennes divagations économiques, physiques et chimiques, contre les nouvelles théories, et que les doctrines économiques du passé dussent disparaître devant les nouvelles, comme la théorie du phlogistique avait disparu devant la théorie des équivalents. C'est pourquoi le rôle principal des économistes consistait à dissiper cette ignorance en enseignant et en prêchant la vérité. Cette conception parut trouver une confirmation expérimentale décisive et splendide dans le succès de la ligue de Cobden. Voilà, pouvait-on dire, que les prévisions faites sont vérifiées. L'éloquence savante de Cobden et de ses amis a dissipé les ténèbres de l'ignorance ; elle a vaincu et défait le protectionnisme ; elle a institué le libre-échange, dont l'Angleterre a retiré ensuite une incroyable prospérité. Partout surgissaient des ligues imitées de celle de Cobden. Il semblait vraiment que toute l'organisation économique dût être renouvelée dans le sens que voulaient les économistes. Mais aucune de ces ligues n'obtint des résultats même vaguement sem blables à ceux obtenus par la ligue de Cobden. Pendant quelque temps on put espérer expliquer ce fait par la difficulté qu'on rencontre à instruire les ignorants. Mais maintenant cette excuse n'est plus valable ; il est manifeste que si ces ignorants n'apprennent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre. On a aussi accusé les politiciens qui les induisent en erreur par des artifices trompeurs. En effet, cela concorde en grande partie avec les faits ; mais il reste à expliquer comment et pourquoi les politiciens ont ce pouvoir. C'est précisément là que se pose une question sociologique qui domine la question économique.
§ 2017. Les économistes classiques se préoccupaient de ce qui devait être. Ils le déterminaient par la logique, en partant d'un petit nombre de principes ; et comme la logique et ces principes s'appliquent à tout le globe terrestre, ils trouvaient des lois qui avaient aussi cette application étendue. Mais étant donné que leurs conclusions étaient démenties par les faits, il fallait trouver où était l'erreur. Comme d'habitude, on crut la trouver dans les prémisses et dans la théorie ; on les déclara fausses, tandis qu'elles sont simplement incomplètes. On voulut les rejeter entièrement, tandis qu'il faut seulement les compléter.
§ 2018. Supposons un géomètre qui découvre le théorème du carré de l'hypothénuse. Il conclut avec raison qu'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit ont respectivement 3 et 4 mètres aura une hypothénuse de 5 mètres. Il veut mettre en pratique les résultats de la théorie, et dit : « Quelle que soit la manière dont on suppose qu'on mesure ces trois côtés, on trouvera toujours les nombres indiqués ». À Paris, un observateur veut vérifier cette proposition. Il prend une ficelle, et, sans l'étirer du tout, il mesure deux côtés de l'angle droit, l'un de 3 et l'autre de 4 mètres, puis tire la ficelle autant qu'il peut, et trouve 4 m 60 pour l'hypothénuse. À Londres, un autre observateur procède de façon inverse, et, pour les côtés 3 et 4, il trouve une hypothénuse de 5 m 40. Les résultats de la théorie ne concordent pas avec les faits. Pour rétablir l'accord, il faut simplement ajouter à la théorie géométrique des considérations sur les manières de mesurer les segments de droite. Ces considérations pourront donner lieu à différentes théories, et l'ensemble de celles-ci et de la théorie géométrique nous permettra d'expliquer et de prévoir les faits tels que ceux de Paris et de Londres.
§ 2019. Au contraire, on voit surgir certaines personnes qui pour rétablir l'accord avec les faits, nient sans autre l'existence de la géométrie, rejettent le théorème du carré de l'hypothénuse, parce qu'il est obtenu au moyen d'un « abus » de la méthode déductive, et parce qu'il ne tient pas dûment compte de l'éthique, laquelle est pourtant si importante pour les hommes. D'une manière subordonnée, même si ce théorème pouvait exister, elles nient qu'il puisse être le même à Paris et à Londres ; elles proclament vouloir substituer à la géométrie « universelle » autant de géométries « nationales », différentes suivant les pays, et elles concluent qu'au lieu de s'occuper de théories géométriques, il faut faire simplement l'« histoire » de toutes les mesures qu'on a jamais faites des triangles rectangles. Si, en en mesurant un, quelque enfant se mouche et se trompe dans le compte des centimètres, ils écrivent une belle dissertation sur l' « éthique » de l'acte de se moucher, et décrivent longuement l'enfant, nous disant s'il avait les cheveux rouges ou noirs, et nous donnant force renseignements précieux du même genre. Telle est l'image très peu déformée d'un grand nombre d'ouvrages de l'« école historique » en économie politique (§1790 et sv.).
§ 2020. Cette discipline eut quelque temps du succès pour des motifs étrangers à la science logico-expérimentale. Ce fut une réaction des sentiments nationalistes contre les sentiments cosmopolites, et en général un retour offensif des sentiments de la persistance des agrégats (IIe classe) contre les sentiments de l'instinct des combinaisons (Ie classe). Sa partie éthique donna naissance au socialisme de la chaire, qui satisfit les désirs de certains nationalistes bourgeois, lesquels ne voulaient pas aller jusqu'aux doctrines cosmopolites de Marx. Mais elle eut aussi des effets en rapport avec la science logico-expérimentale, bien qu'elle y demeurât étrangère.
En opposant une autre erreur à celle de l'économie classique, elle les décela toutes les deux.
Directement, par suite de ses tendances éthiques, elle était moins expérimentale que l'école classique ; mais, indirectement, grâce à l'étude de l'histoire, elle servit à désagréger un édifice qui était en train de dépasser l'expérience pour s'élever dans les régions de la métaphysique.
§ 2021. Marx aussi estima se rapprocher de la réalité en rejetant la théorie de la valeur, et en substituant à la théorie, très imparfaite, qui avait cours en son temps, une autre, encore plus imparfaite, qui est en somme une mauvaise, très mauvaise copie de la théorie de Ricardo. Par la théorie de la plus-value, il ajouta, lui aussi, des considérations éthiques là où elles n'avaient que faire. Mais son œuvre sociologique est supérieure à celle de l'école historique. Il contribua, lui aussi, à désagréger l'édifice éthico-humanitaire de l'économie classique, élevé à l'usage de la bourgeoisie. La conception de la « lutte des classes » montra l'absolue nécessité d'ajouter de nouvelles notions à celles de l'économie, pour arriver à la connaissance du phénomène concret. L'éthique de Marx n'est, en somme, pas meilleure que l'éthique bourgeoise ; mais elle est différente. Cela suffit pour mettre sur la voie qui mène à la connaissance de leur erreur commune.
§ 2022. Sous un grand nombre d'autres formes qu'il serait trop long de rappeler ici, le besoin se manifesta, pour se rapprocher de la réalité, d'ajouter de nouvelles considérations à celles qui étaient usitées en certaines théories économiques. Nous avons déjà dit un mot de l'une de ces formes (§38, 1592) en faisant allusion au dessein d'introduire ces considérations grâce à l'indétermination du terme valeur. En ce cas, l'erreur affecte moins le but que le moyen. Celui-ci est si indirect, et conduit par une voie si longue, avec une telle abondance de détours souvent inextricables et bordés de précipices, qu'il n'est pas possible d'atteindre le but. Ce moyen ressemble à celui qu'emploierait une personne qui se proposerait d'étudier toute la grammaire latine en partant de l'étude de la conjonction et. Il est vrai que tout chemin mène à Rome ; mais celui-ci est vraiment bien long et peu praticable.
Plusieurs économistes voient maintenant que leur science donne des résultats qui divergent plus ou moins du phénomène concret, et comprennent par intuition la nécessité de la perfectionner, mais ils se trompent sur la voie à suivre pour accomplir leur dessein. Ils s'obstinent à vouloir tirer de leur science seule ce qui est nécessaire pour se rapprocher du phénomène concret (§2011) ; tandis qu'au contraire il faut recourir à d'autres sciences, traiter spécialement du phénomène concret, et non accessoirement, à l'occasion d'un problème économique. Ils veulent modifier, parfois détruire, au lieu d'ajouter. C'est pourquoi, de même que nous voyons l'écureuil tourner dans sa roue, nous les voyons ergoter indéfiniment sur la valeur, sur le capital, sur l'intérêt du capital, etc., répétant, pour la centième fois, des choses banales, cherchant quelque nouveau « principe » dont ils puissent faire sortir une économie meilleure. Malheureusement, ce n'est que pour un petit nombre d'entre eux que meilleur veut dire mieux en accord avec les faits. Pour le plus grand nombre, et de beaucoup, il veut dire, au contraire, mieux en accord avec leurs sentiments. Même dans la première hypothèse, cette recherche est vaine, du moins pour le moment. Tant que la science n'a pas fait beaucoup plus de progrès, il importe moins de s'occuper des principes économiques que de l'enchevêtrement des résultats de l'économie avec ceux des autres sciences sociales. Mais c'est ce dont beaucoup ne se soucient nullement, parce que c'est là une étude longue, fatigante, qui exige la connaissance d'un grand nombre de faits ; tandis qu'au contraire, quiconque a un brin d'imagination, du papier et une plume à sa disposition, peut écrire une dissertation sur les « principes ».
Ces considérations s'appliquent aussi à un grand nombre d'autres doctrines (§2269, 2273) qui ont pour but de donner des théories des phénomènes de la société humaine. Une science sociale quelconque, si elle n'est pas purement, exclusivement descriptive, si elle ne se borne pas à dire : « En tel et tel cas on a observé A et, en même temps, B, C, D... », en s'abstenant rigoureusement de tirer la moindre conséquence de cette coïncidence et de la juger en aucune façon, repose nécessairement sur la solution de problèmes appartenant à la catégorie dont le type général est : « En quels rapports mutuels se trouvent A, B, C... ? » Et ce type ne diffère que par la forme du suivant, qui considère les mouvements virtuels (§136) : « Si A apparaît où il n'était pas, ou bien est modifié là où il était, quels autres faits B, C voit-on apparaître ou se modifier ? Si B apparaît où il n'était pas, ou bien est modifié là où il était, quels autres faits A, C..., voit-on apparaître ou se modifier ? » Et ainsi de suite pour C, D [FN:§ 2022-1]. Pour mieux voir la chose, réduisons le cas général des rapports au cas particulier d'un rapport de cause à effet entre A et B, C. Il est bien évident que toute science sociale qui se propose d'étudier les effets de l'intervention de la cause A doit être en mesure d'en connaître les effets B, C Ce problème ne diffère du suivant que par la forme : Si l'on fait intervenir ou si l'on modifie A, quels effets B, C apparaîtront, ou se modifieront ?
C'est aux différentes branches des sciences sociales et à leur synthèse, exprimée par la sociologie, que nous pouvons demander la solution de tels problèmes. Mais un grand nombre des auteurs qui étudient les sciences sociales, bien loin d'avoir une idée, même très vaguement approchée, des solutions, ne sont pas en mesure de comprendre comment se posent ces problèmes, dont, le plus souvent, ils ignorent jusqu'à l'existence.
Le but de leurs recherches est généralement de trouver des arguments pour défendre une doctrine qui leur est dictée par la coterie intellectuelle à laquelle ils appartiennent ou dont ils recherchent la faveur, par les gouvernements qui les emploient ou dont ils désirent la bienveillance, les partis politiques ou sociaux auxquels ils se rattachent [FN: § 2022-2], les croyances théologiques, métaphysiques, ethniques, patriotiques ou autres qu'ils partagent. Ils plaident plutôt qu'ils ne jugent impartialement. Si A leur plaît, il s'agit de montrer que tous ses effets ne peuvent qu'être « favorables », s'il leur déplaît, « défavorables » ; sans que d'ailleurs on définisse ces termes : favorables, défavorables, en indiquant, au moins, quelle utilité (§ 2111 et sv.) on a en vue [FN:§ 2022-3].
Parfois, les meilleurs de ces auteurs se cantonnent dans une partie de la science, et s'efforcent d'éviter toute incursion dans les parties dont l'accès leur semble dangereux. Ainsi firent de nombreux économistes classiques, proclamant hautement qu'ils s'abstenaient rigoureusement de traiter les questions politiques [FN: § 2022-4]. D'autres arrivent à un résultat analogue, simplement parce que, soit par paresse d'esprit, influence des préjugés, ignorance, ou toute autre cause, ils acceptent des solutions toutes faites pour certaines matières [FN: § 2022-5]. Beaucoup d'économistes admettent les solutions de la morale courante, sans les soumettre au moindre examen. Ils ont accepté la sainteté de la propriété quiritaire ; et maintenant que le vent a tourné, ils se laissent dominer par les conceptions d'un socialisme plus ou moins mitigé. Beaucoup d'auteurs supposent la toute puissance de l'entité par eux nommée État, surtout de l'État éthique ; ils étudient avec soin des effets insignifiants des incidences d'un impôt, et négligent ceux, bien plus importants, qui permettent à un gouvernement de l'établir, ou l'en empêchent ; ils se perdent en des calculs compliqués d'intérêt composé, supposent que les épargneurs se décident par des raisonnements que ceux-ci n'ont jamais faits, et oublient les effets de l'impôt sur la circulation des élites, et les effets de cette circulation sur l'impôt. Il n'y a pas bien longtemps qu'ils avaient pour article de foi que l'impôt « doit » être proportionnel ; actuellement, leurs successeurs ont pour article de foi qu'il « doit » être progressif ; le plus souvent, les gens qui s'occupent de ces matières ignorent que de tels changements de doctrines sont en état de dépendance avec les autres faits sociaux ou bien ils se trompent lourdement à ce sujet.
De la sorte, et de bien d'autres encore, on aboutit à négliger, à méconnaître la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux ; ce qui est actuellement une des erreurs les plus nuisibles au progrès expérimental des sciences sociales.
§ 2023. Pour résoudre des questions semblables à celle que nous avons posée au §2014, il est nécessaire de considérer, non pas le phénomène économique seul, mais tout le phénomène social, dont ce premier phénomène ne constitue qu'une partie. L'état complexe X d'un pays peut évidemment être décomposé en deux autres états : l'un économique A, et l'autre non-économique B. Supposons que l'état économique A devienne A'. Si nous admettons que la connaissance de cet état A' suffise pour connaître l'état social complexe X’ qui suit ce changement, nous admettons par là même que A et B sont indépendants, que l'on peut faire varier A sans faire varier B, et vice-versa. Si, au contraire, nous n'admettons pas cela, nous ne pouvons pas non plus admettre que, pour connaître complètement X’, la connaissance de A' suffise. La connaissance de ce que devient B, c'est-à-dire de B' ; est nécessaire ; et l'on ne peut l'obtenir si l'on ne connaît pas la mutuelle dépendance de A et de B.
Plusieurs économistes ont raisonné, non par analyse et par abstraction, mais sur l'ensemble du phénomène concret, comme si A et B étaient indépendants. Ils ont cru pouvoir étudier A sans se soucier de B. On ne saurait en faire un reproche à ceux qui ont constitué la science, car il faut étudier les questions l'une après l'autre ; et l'étude de l'action de la partie A seule est une préparation nécessaire à l'étude de l'action combinée de A et de B. Les partisans de l'interprétation matérialiste de l'histoire eurent le grand mérite de découvrir la dépendance de A et de B ; mais ils commirent l'erreur de prétendre que cette dépendance était un rapport par lequel A était la cause de B. À eux non plus on ne peut reprocher trop cette erreur, car avant de trouver la forme réelle de la dépendance entre A et B, il était nécessaire d'avoir l'idée de l'existence d'une telle dépendance. Maintenant que le progrès de la science a mis en lumière la dépendance de A et de B, les économistes qui persistent à l'ignorer ne sont plus excusables, ni les auteurs qui persistent à donner à cette dépendance une forme qu'elle n'a pas en réalité. Nous devons étudier ici le phénomène complexe de la société, en tenant compte de la mutuelle dépendance de A et de B, dans sa forme réelle. C'est ce que nous ferons au chapitre suivant.
§ 2024. On a beaucoup fait pour l'étude du phénomène économique; et l'œuvre ainsi accomplie nous sera très utile pour arriver à la connaissance de cette partie spéciale du phénomène social, considérée indépendamment des autres. Pour utiliser les ouvrages dits de science économique, il convient que nous en éliminions tout ce qui se rapporte à l'éthique, directement ou indirectement, ne fût-ce que parce que les auteurs, ne traitant pas à fond cette partie de leur sujet, acceptent et emploient des expressions indéterminées, dont on peut tirer tout ce qu'on veut, ainsi que nous l'avons fait voir tout au long dans les chapitres précédents. Nous devons aussi éliminer tout ce qui a la nature de conseils, de recommandations, de prêches adressés en vue de pousser les hommes à certaines œuvres pratiques. C'est une matière étrangère à la science, et qui doit en demeurer séparée si l'on veut éviter le danger de tomber en de graves erreurs.
§ 2025. HÉTÉROGÉNÉITÉ SOCIALE ET CIRCULATION ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES [FN: § 2025-1]. Plusieurs fois déjà nous nous sommes trouvés en présence de cette hétérogénéité, et nous aurons à nous en occuper davantage, maintenant que nous passerons à l'étude des conditions de l'équilibre social ; il est donc nécessaire que nous en traitions spécialement.
On pourrait étudier séparément l'hétérogénéité de la société et la circulation entre les différents groupes sociaux ; mais comme, dans la réalité, les phénomènes correspondants sont unis, il sera bon de les étudier ensemble, afin d'éviter des répétitions. Que cela plaise ou non à certains théoriciens, il est de fait que la société humaine n'est pas homogène : que les hommes sont différents physiquement, moralement, intellectuellement. Ici, nous voulons étudier les phénomènes réels. Donc, nous devons tenir compte de ce fait. Nous devons aussi tenir compte de cet autre fait : que les classes sociales ne sont pas entièrement séparées, pas même dans les pays où existent les castes, et que, dans les nations civilisées modernes, il se produit une circulation intense entre les différentes classes. Il est impossible de considérer dans toute son ampleur le sujet de la diversité des multiples groupes sociaux [FN:§ 2025-2], et les façons si nombreuses dont ils se mélangent. Par conséquent, comme d'habitude, ne pouvant obtenir le plus, il faut se contenter d'avoir le moins, et s'efforcer de simplifier le problème, afin de le rendre plus abordable. C'est un premier pas dans une voie que d'autres pourront poursuivre. Nous considérerons le problème seulement en rapport avec l'équilibre social, et nous tâcherons de réduire le plus possible le nombre des groupes et des modes de circulation, en mettant ensemble les phénomènes qui se présentent comme analogues en quelque façon [FN: § 2025-3].
§ 2026. LES ÉLITES ET LEUR CIRCULATION [FN: § 2026-1]. Commençons par donner du phénomène une définition théorique, aussi précise que possible ; ensuite, nous verrons quelles considérations pratiques nous pourrons y substituer, dans une première approximation. Négligeons tout à fait, pour le moment, la considération de la nature bonne ou mauvaise, utile ou nuisible, louable ou blâmable des différents caractères des hommes, et portons notre attention uniquement sur le degré de ces caractères. Autrement dit, sont-ils de peu d'importance, moyens ou grands ? et plus précisément, quel indice quantitatif peut-on assigner à chaque homme, eu égard au degré du caractère considéré ?
§ 2027. Supposons donc qu'en toutes les branches de l'activité humaine, on attribue à chaque individu un indice qui indique ses capacités, à peu près de la manière dont on donne des points aux examens, dans les différentes matières qu'enseignent les écoles. Par exemple, à celui qui excelle dans sa profession, nous donnerons 10. À celui qui ne réussit pas à avoir un seul client, nous donnerons 1, de façon à pouvoir donner 0 à celui qui est vraiment crétin. À celui qui a su gagner des millions, que ce soit bien ou mal, nous donnerons 10. À celui qui gagne des milliers de francs, nous donnerons 6. À celui qui arrive tout juste à ne pas mourir de faim, nous donnerons 1. À celui qui est hospitalisé dans un asile d'indigents, nous donnerons 0. À la femme politique, telle l'Aspasie de Périclès, la Maintenon de Louis XIV, la Pompadour de Louis XV, qui a su capter les bonnes grâces d'un homme puissant, et qui joue un rôle dans le gouvernement qu'il exerce de la chose publique, nous donnerons une note telle que 8 ou 9. À la gourgandine qui ne fait que satisfaire les sens de ces hommes, et n'a aucune action sur la chose publique, nous donnerons 0. À l'habile escroc qui trompe les gens et sait échapper aux peines du code pénal, nous attribuerons 8, 9 ou 10, suivant le nombre de dupes qu'il aura su prendre dans ses filets, et l'argent qu'il aura su leur soutirer. Au pauvre petit escroc qui dérobe un service de table à son traiteur et se fait encore mettre la main au collet par les gendarmes, nous donnerons 1. À un poète comme Musset, nous donnerons 8 ou 9, suivant les goûts. À un rimailleur qui fait fuir les gens en leur récitant ses sonnets, nous donnerons 0. Pour des joueurs d'échecs, nous pourrons avoir des indices plus précis en nous fondant sur le nombre et le genre des parties qu'ils ont gagnées. Et ainsi de suite, pour toutes les branches de l'activité humaine.
§ 2028. Prenons garde que nous traitons d'un état de fait, et non d'un état virtuel. Si quelqu'un se présente à l'examen d'anglais en disant : « Si je voulais, je pourrais savoir très bien l'anglais. Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas voulu l'apprendre », l'expert répondra : « Le motif pour lequel vous ne le savez pas ne m'importe nullement : vous ne le savez pas, je vous donne 0 ». Si, de même, on disait : « Cet homme ne vole pas, non parce qu'il ne saurait pas, mais parce qu'il est un honnête homme », nous répondrons : « Très bien, nous l'en louons, mais comme voleur nous lui donnons 0 ».
§ 2029. Il est des gens qui vénèrent Napoléon Ier, comme un dieu ; il en est qui le haïssent comme le dernier des malfaiteurs. Qui a raison ? Nous ne voulons pas résoudre cette question à propos d'un sujet tout à fait différent. Bon ou mauvais, il est certain que Napoléon Ier n'était pas un crétin, ni même un homme insignifiant, comme il y en a des millions. Il avait des qualités exceptionnelles, et cela suffit pour que nous le placions à un degré élevé. Mais par là nous ne voulons nullement préjuger des questions qu'on pourrait poser sur l'éthique de ces qualités ou sur leur utilité sociale.
§ 2030. En somme, comme d'habitude, nous faisons ici usage de l'analyse scientifique, qui sépare les sujets et les étudie l'un après l'autre. Toujours comme d'habitude, à la rigueur qu'on obtiendrait en considérant des variations insensibles de nombres donnés, il faut substituer l'approximation des variations brusques de grandes classes. Ainsi dans les examens, on distingue les candidats reçus de ceux qui ne le sont pas ; ainsi, au point de vue de l’âge, on distingue les enfants, les jeunes gens, les vieillards.
§ 2031. Formons donc une classe de ceux qui ont les indices les plus élevés dans la branche où ils déploient leur activité, et donnons à cette classe le nom d'élite. Tout autre nom et même une simple lettre de l'alphabet, seraient également propres au but que nous nous proposons (§119).
§ 2032. Pour l'étude à laquelle nous nous livrons, celle de l'équilibre social, il est bon encore de diviser en deux cette classe. Nous mettrons à part ceux qui, directement ou indirectement, jouent un rôle notable dans le gouvernement ; ils constitueront l'élite gouvernementale. Le reste formera l'élite non-gouvernementale [FN: § 2032-1].
§ 2033. Par exemple, un célèbre joueur d'échecs fait certainement partie de l'élite. Non moins certainement, ses mérites de joueur d'échecs ne lui ouvrent pas la voie pour exercer une influence dans le gouvernement ; et par conséquent, si d'autres de ses qualités ne viennent à son aide, il ne fait pas partie de l'élite gouvernementale. Les maîtresses des souverains absolus ou d'hommes politiques très puissants font souvent partie de l'élite, soit à cause de leur beauté, soit par leurs dons intellectuels. Mais seule une partie d'entre elles, qui avaient les aptitudes spéciales qu'exige la politique, jouèrent un rôle dans le gouvernement.
§ 2034. Nous avons donc deux couches dans la population : 1° la couche inférieure, la classe étrangère à l'élite ; nous ne rechercherons pas, pour le moment, l'influence qu'elle peut exercer dans le gouvernement ; 2° la couche supérieure, l'élite, qui se divise en deux : (a) l'élite gouvernementale ; (b) l'élite non-gouvernementale.
§ 2035. En réalité, il n'y a pas d'examens pour assigner à chaque individu sa place dans ces différentes classes. On y supplée par d'autres moyens : par certaines étiquettes qui remplacent l'examen tant bien que mal. De semblables étiquettes existent aussi là où il y a des examens. Par exemple, l'étiquette d'avocat désigne un homme qui devrait connaître le droit, et qui souvent le connaît, mais qui parfois n'y connaît rien. D'une manière analogue, dans l'élite gouvernementale se trouvent ceux qui portent l'étiquette de fonctions politiques d'un certain rang ; par exemple : ministre, sénateur, député, chef de service au ministère, président de cour d'appel, général, colonel, etc., sauf les exceptions inévitables de ceux qui ont réussi à se faufiler parmi les précédents sans posséder les qualités correspondant à l'étiquette qu'ils ont obtenue.
§ 2036. Ces exceptions sont beaucoup plus considérables que pour les avocats, les médecins, les ingénieurs, ou pour ceux qui se sont enrichis par leur propre habileté, ou encore pour ceux qui font preuve de talent en musique, en littérature, etc. Le motif en est, entre autres, qu'en toutes ces branches de l'activité humaine les étiquettes sont obtenues directement par chaque individu, tandis que pour l'élite une partie des étiquettes sont héréditaires ; par exemple celles de la richesse. Autrefois, il y en avait aussi d'héréditaires dans l'élite gouvernementale. Aujourd'hui, telles sont celles des souverains. Mais si l'hérédité directe a disparu, l'hérédité indirecte demeure puissante, et celui qui a hérité un grand patrimoine est facilement nommé sénateur, en certains pays, ou se fait élire député en payant les électeurs et en les adulant, si besoin est, par des professions de foi archidémocratiques, socialistes, anarchistes. La richesse, la parenté, les relations, sont utiles aussi en beaucoup d'autres cas, et font donner à qui ne devrait pas l'avoir l'étiquette de l'élite en général ou de l'élite gouvernementale en particulier.
§ 2037. Là où l'unité sociale est la famille, l'étiquette du chef de famille profite aussi à tous ceux qui la composent. À Rome, celui qui devenait empereur élevait généralement ses affranchis à l'élite, souvent même à l'élite gouvernementale. Pourtant, un nombre plus on moins grand de ces affranchis qui jouaient un rôle dans le gouvernement possédaient des qualités, bonnes ou mauvaises, grâce auxquelles l'étiquette qu'ils avaient obtenue par la faveur de César se trouvait à sa place. Dans nos sociétés, l'unité sociale est l'individu ; mais la situation qu'il occupe dans la société profite aussi à sa femme, à ses enfants, à sa parenté, à ses amis.
§ 2038. Si toutes ces déviations du type étaient peu importantes, on pourrait les négliger, comme on les néglige en pratique, dans les cas où, pour exercer une fonction, un diplôme est exigé. On sait qu'il est des personnes qui possèdent ces diplômes sans les mériter ; mais enfin l'expérience montre que dans l'ensemble on peut ne pas tenir compte de ce fait.
§ 2039. On pourrait encore, au moins sous certains aspects, négliger ces déviations, si elles demeuraient presque constantes ; c'est-à-dire si la proportion variait peu ou point, entre les gens qui possèdent l'étiquette d'une classe sans avoir les qualités correspondantes, et le total de la classe.
§ 2040. Mais il n'en est pas ainsi ; les cas réels que nous devons considérer dans nos sociétés diffèrent de ces deux-là. Les déviations sont trop nombreuses pour être négligées. Leur nombre est variable ; et de cette variation résultent des phénomènes d'une grande importance pour l'équilibre social. Il est donc nécessaire que nous les étudiions en particulier.
§ 2041. En outre, il faut considérer la manière dont les divers groupes de la population se mélangent. Celui qui passe d'un groupe à un autre y apporte généralement certaines tendances, certains sentiments, certaines aptitudes qu'il a acquis dans le groupe dont il vient. Il faut tenir compte de cette circonstance.
§ 2042. On a donné le nom de CIRCULATION DES ÉLITES à ce phénomène, dans le cas particulier où l'on ne considère que deux groupes, l'élite et le reste de la population.
§ 2043. En conclusion, nous devons surtout porter notre attention : 1° dans un même groupe, sur la proportion entre l'ensemble du groupe et le nombre de personnes qui en font nominalement partie, sans toutefois posséder les caractères exigés pour en faire effectivement partie ; 2° entre différents groupes : sur les manières dont s'effectuent les passages d'un groupe à l'autre, et sur l'intensité de ce mouvement, c'est-à-dire sur la vitesse de la circulation.
§ 2044. Il faut remarquer que cette vitesse de circulation doit être considérée, non seulement d'une manière absolue, mais aussi par rapport à l'offre et à la demande de certains éléments. Par exemple, un pays qui vit toujours en paix a besoin de peu de soldats dans la classe gouvernante, et la production des soldats peut être exubérante en proportion des besoins. Survient un état de guerres continuelles ; il faut beaucoup de soldats. La production, bien que restant la même, peut être insuffisante pour les besoins [FN: § 2044-1]. Notons en passant que ce fut l'une des causes de la destruction de nombreuses aristocraties.
§ 2045. Autre exemple. Dans un pays où le commerce et l'industrie sont peu développés, la production d'individus possédant à un haut degré les qualités requises pour ces genres d'activité est exubérante. Le commerce et l'industrie se développent : cette production, tout en restant la même, ne suffit plus aux besoins.
§ 2046. Il ne faut pas confondre l'état de droit avec l'état de fait ce dernier seul, ou presque seul, est important pour l'équilibre social. Il y a de très nombreux exemples de castes fermées légalement, et dans lesquelles, en fait, se produisent des infiltrations souvent assez considérables. D'autre part, à quoi sert qu'une caste soit légalement ouverte, si les conditions de fait qui permettent d'y entrer font défaut ? Si tous ceux qui s'enrichissent font partie de la classe gouvernante, mais que personne ne s'enrichisse, c'est exactement comme si cette classe était fermée ; et si peu de gens s'enrichissent, c'est comme si la loi mettait de grands obstacles à l'accès de cette classe. On vit un phénomène de ce genre à la fin de l'empire romain. Celui qui devenait riche entrait dans l'ordre des curiales ; mais très peu de personnes devenaient riches.
Théoriquement, nous pouvons envisager un très grand nombre de groupes ; pratiquement nous sommes forcés de nous borner aux plus importants. Nous procéderons par approximations successives, en allant du simple au composé.
§ 2047. LA CLASSE SUPÉRIEURE ET LA CLASSE INFÉRIEURE EN GÉNÉRAL.
Le moins que nous puissions faire est de diviser la société en deux couches : une couche supérieure, dont font habituellement partie les gouvernants, et une couche inférieure, dont font partie les gouvernés. Ce fait est si manifeste qu'il s'est en tout temps imposé à l'observateur le moins expert ; il en est de même du fait de la circulation des individus entre ces deux couches. Platon lui-même s'en douta, et voulait la régler artificiellement (§278). On a souvent parlé des « parvenus », et les études littéraires faites sur eux sont très nombreuses. Donnons maintenant une forme plus précise à des considérations entrevues depuis longtemps. Nous avons mentionné déjà (§1723 et sv.) la différence de répartition des résidus entre les divers groupes sociaux, et surtout entre la classe supérieure et la classe inférieure. Cette hétérogénéité sociale est un fait que décèle la moindre observation.
§ 2048. La proportion des résidus de la Ie et de la IIe classe change avec le temps dans les différentes couches sociales, et ces changements sont assez importants pour la détermination de l'équilibre. L'observation vulgaire les a perçus sous une forme spéciale, celle de changements, dans la couche supérieure, des sentiments dits « religieux ». On remarqua qu'en certains temps ils allaient en s'affaiblissant, en certains autres en croissant, et que ces oscillations correspondaient à des changements sociaux importants. D'une façon plus précise, on peut décrire le phénomène en disant que, dans la couche supérieure, les résidus de la IIe classe s'affaiblissent peu à peu jusqu'à ce qu'une marée, montant de la couche inférieure, vienne de temps en temps les renforcer [FN:§ 2048-1].
§ 2049. Vers la fin de la République romaine, les hautes classes n'avaient plus que des sentiments religieux très affaiblis. Ces sentiments s'accrurent dans une mesure considérable, grâce à l'entrée dans les hautes classes, d'hommes des basses classes : des étrangers, des affranchis et d'autres gens que l'empire romain introduisit dans les hautes classes (§2549). On eut un nouvel et fort accroissement lorsque, au temps du Bas-Empire, le gouvernement passa entre les mains d'une bureaucratie provenant des basses classes et d'une plèbe militaire. Ce fut le temps où la prédominance des résidus de la IIe classe se manifesta par la décadence de la littérature, des arts et des sciences, et par l'invasion des religions orientales, principalement du christianisme [FN: § 249-1].
§ 2050 La réforme protestante, au XVIe siècle, la révolution anglaise au temps de Cromwell, la révolution française de 1789, manifestent de grandes marées religieuses qui, parties des classes inférieures, submergent le scepticisme des classes supérieures. De nos jours, aux États-Unis d'Amérique, le mouvement qui élève les individus des classes inférieures est très intense. Nous y voyons un peuple où les résidus de la IIe, classe sont très puissants. Il y naît en abondance des religions étranges et en opposition avec tout sentiment scientifique, ainsi la Christian Science, et l'on y voit des lois hypocrites pour imposer la morale, à l'instar de celles du moyen âge européen.
§ 2051. Certains agrégats, parfois mal définis, et qu'on appelle des aristocraties, font partie de la couche supérieure de la société, de l'élite. Il est des cas où le plus grand nombre de ceux qui appartiennent à ces aristocraties possèdent effectivement les caractères qu'il faut pour y rester ; par exemple l'aristocratie romaine des premiers temps de la République, et de nos jours, en partie du moins, les Magyars, en Hongrie. Il est d'autres cas où ces caractères font défaut à un nombre considérable de membres des dites aristocraties, par exemple celle de France à la veille de la grande révolution. Les membres de ces aristocraties peuvent jouer un rôle plus ou moins grand dans l'élite gouvernementale, ou bien en être exclus.
§ 2052. À part quelques exceptions que nous négligeons, à l'origine les aristocraties guerrières, religieuses, commerciales, les ploutocraties, devaient certainement faire partie de l'élite, et parfois elles la constituaient entièrement. Le guerrier victorieux, le commerçant dont les affaires prospéraient, le ploutocrate qui s'enrichissait, étaient certainement des hommes tels que chacun dans son art était supérieur au vulgaire. Alors l'étiquette correspondait au caractère effectif. Mais ensuite, avec le temps, il se produisit une fissure, souvent considérable, et parfois très considérable ; tandis que, d'autre part, certaines aristocraties qui, à l'origine, jouaient un rôle important dans l'élite gouvernementale, finirent par n'en plus constituer qu'une partie minime. C'est ce qui eut lieu surtout pour l'aristocratie guerrière.
§ 2053. Les aristocraties ne durent pas. Quelles qu'en soient les causes, il est incontestable qu'après un certain temps elles disparaissent. L'histoire est un cimetière d'aristocraties. Le peuple athénien constituait une aristocratie, par rapport au reste de la population, des métèques et des esclaves. Il disparut sans laisser de descendance. Les diverses aristocraties romaines disparurent. Les aristocraties barbares disparurent. Où sont, en France, les descendants des conquérants francs ? Les généalogies des lords anglais sont très exactes. Il subsiste fort peu de familles descendant des compagnons de Guillaume le Conquérant ; les autres ont disparu. En Allemagne, l'aristocratie actuelle est en grande partie constituée par les descendants des vassaux des anciens seigneurs. La population des États européens s'est accrue dans une mesure énorme depuis plusieurs siècles à aujourd'hui. Or, il est certain, très certain, que les aristocraties ne se sont pas accrues en proportion.
§ 2054. Ce n'est pas seulement quant au nombre que certaines aristocraties sont en décadence ; c'est aussi quant à la qualité, en ce sens que l'énergie y diminue, et que se modifient les proportions des résidus qui leur servirent à s'emparer du pouvoir et à le conserver. Mais nous traiterons plus loin ce sujet (§2190 et sv.). La classe gouvernante est entretenue, non seulement en nombre, mais, ce qui importe davantage, en qualité, par les familles qui viennent des classes inférieures, qui lui apportent l'énergie et les proportions de résidus nécessaires à son maintien au pouvoir. Elle est tenue en bon état par la perte de ses membres les plus déchus.
§ 2055. Si l'un de ces mouvements cesse, et qui pis est, s'ils cessent tous deux, la partie gouvernante s'achemine vers la ruine, qui souvent entraîne avec elle celle de la nation entière. L'accumulation d'éléments supérieurs dans les classes inférieures, et vice-versa, d'éléments inférieurs dans les classes supérieures, est une cause puissante de perturbation de l'équilibre. Si les aristocraties humaines étaient semblables aux races de choix des animaux, qui se reproduisent longtemps, à peu près avec les mêmes caractères, l'histoire de la race humaine serait entièrement différente de celle que nous connaissons.
§ 2056. Par l'effet de la circulation des élites, l'élite gouvernementale est dans un état de transformation lente et continue. Elle coule comme un fleuve ; celle d'aujourd'hui est autre que celle d'hier. De temps en temps, on observe de brusques et violentes perturbations, semblables aux inondations d'un fleuve. Ensuite la nouvelle élite gouvernementale recommence à se modifier lentement : le fleuve, rentré dans son lit, s'écoule de nouveau régulièrement.
§ 2057. Les révolutions se produisent parce que, soit à cause du ralentissement de la circulation de l'élite, soit pour une autre cause, des éléments de qualité inférieure s'accumulent dans les couches supérieures. Ces éléments ne possèdent plus les résidus capables de les maintenir au pouvoir, et ils évitent de faire usage de la force ; tandis que dans les couches inférieures se développent les éléments de qualité supérieure, qui possèdent les résidus nécessaires pour gouverner, et qui sont disposés à faire usage de la force.
§ 2058. Généralement, dans les révolutions, les individus des couches inférieures sont dirigés par des individus des couches supérieures, parce que ceux-ci possèdent les qualités intellectuelles utiles pour livrer bataille, tandis qu'ils sont dépourvus des résidus que possèdent précisément les individus des couches inférieures.
§ 2059. Les changements violents ont lieu par soubresaut. Par conséquent, l'effet ne suit pas immédiatement la cause, qui peut avoir agi quelque temps avant que le soubresaut se produise. Lorsqu'une classe gouvernante ou une nation se sont maintenues longtemps par la force et se sont enrichies, elles peuvent subsister encore quelque temps sans faire usage de la force : en achetant la paix aux adversaires, et en la payant non seulement à prix d'or, mais aussi au prix des honneurs et de la réputation dont elles avaient jusqu'alors joui, et qui constituent un certain capital. Tout d'abord, on garde le pouvoir à force de concessions, et l'on s'imagine qu'on peut le faire indéfiniment. C'est ainsi que l'empire romain de la décadence achetait la paix aux Barbares avec de l'argent et des honneurs. C'est ainsi que, dilapidant en peu de temps le patrimoine de ses ancêtres, patrimoine fait d'amour, de respect et de vénération presque religieuse pour la monarchie, Louis XVI put, toujours en cédant, être le roi de la Révolution. C'est ainsi que l'aristocratie anglaise put prolonger son pouvoir durant la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à l'aurore de sa décadence, annoncée par le Parliament Bill, au commencement du XXe.
[1306]
Chapitre XII↩
Forme générale de la société
§ 2060. LES ÉLÉMENTS. La forme de la société est déterminée par tous les éléments qui agissent sur elle ; et ensuite, elle réagit sur les éléments. Par conséquent, on peut dire qu'il se produit une détermination mutuelle. Parmi les éléments, nous pouvons distinguer les catégories suivantes : 1° le sol, le climat, la flore, la faune, les circonstances géologiques, minéralogiques, etc.; 2° d'autres éléments extérieurs à une société donnée, en un temps donné ; autrement dit, les actions des autres sociétés sur celle-ci, actions qui sont extérieures dans l'espace, et les conséquences de l'état antérieur de cette société, conséquences qui sont extérieures dans le temps ; 3° des éléments intérieurs, dont les principaux sont la race, les résidus ou les sentiments qu'ils manifestent, les tendances, les intérêts, l'aptitude au raisonnement, à l'observation, l'état des connaissances, etc. Les dérivations aussi figurent parmi ces éléments.
§ 2061. Les éléments que nous avons mentionnés ne sont pas indépendants ; la plupart sont mutuellement dépendants. En outre, parmi les éléments, il faut ranger les forces qui s'opposent à la dissolution, à la destruction des sociétés durables. C'est pourquoi, lorsqu'une de celles-ci est constituée sous une certaine forme déterminée par les autres éléments, elle agit à son tour sur ces éléments. Ceux-ci, en ce sens, doivent aussi être considérés comme étant en état de mutuelle dépendance avec la société dont nous parlons. On observe quelque chose de semblable pour les organismes des animaux. Par exemple, la forme des organes détermine le genre de vie ; mais celui-ci, à son tour, agit sur les organes (§ 2088 et sv.).
§ 2062. Pour déterminer entièrement la forme sociale, il serait nécessaire d'abord de connaître tous ces innombrables éléments, ensuite de savoir comment ils agissent, et cela sous forme quantitative. En d'autres termes, il serait nécessaire d'affecter d'indices les éléments et leurs effets, et d'en connaître la dépendance, enfin, d'établir toutes les conditions qui déterminent la forme de la société. Grâce à l'emploi des quantités, on exprimerait ces conditions par des équations. Celles-ci devraient se trouver en nombre égal à celui des inconnues, et les détermineraient entièrement [FN: § 2062-1].
§ 2063. Une étude complète des formes sociales devrait considérer au moins les principaux éléments qui les déterminent, en négligeant uniquement ceux dont l'action peut être jugée accessoire. Mais actuellement, cela n'est pas plus possible pour les formes sociales que pour les formes animales ou végétales. Il est, par conséquent, nécessaire de se limiter à une étude qui embrasse seulement une partie du sujet. Heureusement pour notre étude, plusieurs éléments agissent sur les tendances et sur les sentiments des hommes ; c'est pourquoi, en considérant les résidus, nous tiendrons compte indirectement de ces éléments.
§ 2064. L'action de la première catégorie d'éléments, indiquée au § 2060, c'est-à-dire du sol, du climat, etc., est certainement très importante. Pour le démontrer, il suffirait de comparer la civilisation des peuples des régions tropicales avec celle des peuples des régions tempérées. On s'est livré à beaucoup d'études sur ce sujet, mais sans grand profit jusqu'à présent. Nous n'étudierons pas ici directement l'action de ces éléments ; mais nous en tiendrons compte indirectement, en admettant comme donnés les résidus, les tendances, les intérêts des hommes soumis à l'action de ces éléments.
§ 2065. Afin de diminuer encore les difficultés, nous bornerons notre exposé aux peuples de l'Europe et du bassin de la Méditerranée, en Asie et en Afrique. Ainsi, nous laisserons encore de côté les importantes et insolubles questions concernant les races. Nous devons nécessairement tenir compte de l'influence des autres peuples sur l'un d'eux, car les divers peuples de la région considérée ne demeurèrent jamais isolés ; mais la puissance militaire, politique, intellectuelle, économique, etc., par laquelle se manifestent ces actions, dépend des éléments des sentiments, des connaissances des intérêts ; par conséquent, on pourra retrouver, au moins en partie, les causes de la puissance dans ces éléments.
§ 2066. En tout cas, que le nombre des éléments que nous considérons soit petit ou grand, nous supposons qu'ils constituent un système, que nous appellerons système social (§ 119), et nous nous proposons d'en étudier la nature et les propriétés.
Ce système change de forme et de caractère avec le temps ; et quand nous nommons le système social, nous entendons ce système considéré aussi bien en un moment déterminé, que dans les transformations successives qu'il subit en un espace de temps déterminé. De même, lorsqu'on nomme le système solaire, on entend ce système considéré aussi bien en un moment déterminé, que dans les moments successifs qui composent un espace de temps, petit ou grand.
§ 2067. L'ÉTAT D'ÉQUILIBRE [FN: § 2067-1] . D'abord, si nous voulons raisonner avec quelque rigueur, nous devons déterminer l'état auquel nous voulons considérer le système social, dont la forme change continuellement. L'état réel, statique ou dynamique, du système est déterminé par ses conditions. Supposons qu'on provoque artificiellement quelque modification dans sa forme (mouvements virtuels, § 130) ; aussitôt une réaction se produira ; elle tendra à ramener la forme changeante à son état primitif, modifié par le changement réel. S'il n'en était pas ainsi, cette forme et ses changements ne seraient pas déterminés, mais demeureraient arbitraires.
§ 2068. Nous pouvons utiliser cette propriété pour définir l'état que nous voulons considérer. Pour le moment, nous le désignerons par la lettre X. Cet état est tel, dirons-nous, que si l'on y introduisait artificiellement quelque modification différente de celle qu'il subit en réalité, aussitôt se produirait une réaction qui tendrait à le ramener à l'état réel [FN: § 2068-1] Ainsi, l'état X est rigoureusement défini.
§ 2069. Il change à chaque instant, et nous ne pouvons ni ne voulons l'envisager ainsi dans ses moindres détails. Par exemple, pour tenir compte de l'élément fertilité d'un champ, nous ne voulons pas chaque minute, chaque heure, chaque jour, ni chaque mois, considérer comment croît le grain dans le champ ensemencé ; nous ne portons notre attention que sur son produit annuel. Pour tenir compte de l'élément patriotisme, nous ne pouvons pas suivre chaque soldat, dans tous ses mouvements, du jour où il est appelé sous les armes jusqu'à celui où il se fait tuer. Il nous suffit de noter le fait global de la mort d'un certain nombre d'hommes. De même encore, l'aiguille de la montre se meut par secousses. En mesurant le temps, nous négligeons cette circonstance, comme si l'aiguille se mouvait d'un mouvement continu. Considérons donc des états successifs X1, X2, X3,...., auxquels on parvient au bout de certains espaces de temps, fixés précisément en vue d'atteindre les états que nous voulons envisager, et qui sont tels que chacun des éléments y a produit l'action propre que nous voulons considérer.
Afin de mieux comprendre cela, voyons quelques exemples. Nous en avons lui, très simple, en économie pure. Supposons un individu qui, dans l'unité de temps, par exemple chaque jour, troque du pain contre du vin. Il commence par avoir zéro de vin, et s'arrête quand il a une certaine quantité de vin [FN: § 2069-1] (fig. 32). L'axe des temps est Ot. Indiquons par ab = bc = cd = de , les espaces qui représentent l'unité de temps. L'axe des quantités de vin est Oq. Au commencement de la première unité de temps, l'individu a zéro de vin; il est en a. À la fin, il a la quantité bX1 de vin ; il est en X1. Chaque jour, la même opération se répète, et à la fin de chaque jour, ou de chaque unité de temps, l'individu est en X1, X2, X3, .... Tous ces points se trouvent sur une ligne MP, parallèle à Ot, et qui en est séparée par une distance égale à la quantité de vin que l'individu retire chaque jour du troc. La ligne MP est appelée ligne d'équilibre, et, d'une façon générale, c'est la ligne déterminée par les équations de l'économie pure [FN: § 2069-2] . Elle peut ne pas être parallèle à l'axe Ot, car il n'est pas nécessaire que chaque jour la même opération se répète identique. Par exemple, elle peut être la ligne MP de la fig. 33. ab = bc = cd = ... sont toujours les unités de temps, mais au début de ces unités, l'individu est en a, en s en r, en d, en u, ..., et à la fin, en X1, en X2 , en X3 , en X4 , en X5, .... La ligne MX1X2X3X4X5... est encore appelée ligne d'équilibre. Lorsqu'on dit que l'économie pure nous donne la théorie de l'équilibre économique, cela revient à dire qu'elle nous enseigne comment, des positions a, s, r, d, u, ..., on passe aux positions finales X1, X2, X3, X4, X5…, et pas autre chose [FN: § 2069-3].

Figure 32

Figure 33
Maintenant voyons le cas le plus général. Dans la figure précédente, ab, bc, cd, ... ne sont plus égaux entre eux, mais représentent divers espaces de temps, supposés par nous pour étudier un phénomène au terme de ces espaces de temps, dans lesquels un élément exerce l'action propre que nous voulons considérer. Les points a, s, r, d, u, ... représentent l'état de l'individu, au début de cette action ; X1 , X2 , X3 , ... l'état de l'individu, quand elle est accomplie. La ligne MX1 , X2,... P est appelée ligne de l'état X (§ 2076).
§ 2070. Cette définition est identique, sous une forme différente, à celle qui est donnée au § 2068. En effet, si tout d'abord nous partons de la définition donnée tout à l'heure de l'état X1, nous voyons que l'action de chaque élément étant accomplie, la société ne peut pas, d'elle-même, assumer une autre forme que X1, et que si elle en était écartée artificiellement, elle serait forcée d'y revenir aussitôt, car autrement sa forme ne serait pas entièrement déterminée, ainsi qu'on l'a supposé, par les éléments considérés. En d'autres termes, supposons que la société soit arrivée en un point X1, (fig. 34), en suivant une voie aX1; supposons encore qu'en X1, l'action que nous voulons considérer, et qui est produite par certains éléments, soit accomplie. Si la société est écartée artificiellement de X1, cela ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants : 1° en portant cette société en des points tels que l, n, qui se trouvent en dehors de la ligne aX1, ; 2° en portant cette société en un point m de aX1. Dans le premier cas, la société doit tendre à revenir en X1, autrement son état ne serait pas, comme on l'a supposé, complètement déterminé par les éléments considérés. Dans le second cas, l'hypothèse serait en contradiction avec la supposition que nous avons faite, à savoir que l'action des éléments est complète ; en effet, elle n'est complète qu'en X ; elle est incomplète en m. À ce point, les éléments considérés agissent encore, et portent la société de m en X1. Ensuite, partant de la définition donnée au § 2068, on voit que, vice versa, si l'on éloigne artificiellement la société de l'état X1, et qu'elle tende à y revenir, cela indique que la société a été portée, ou bien, comme dans le premier des cas précédents, en des points l, n, différents de ceux qui sont déterminés par les éléments considérés, ou bien en un point m, où l'action des éléments considérés n'est plus accomplie. Si, au lieu d'atteindre successivement les points X1 , X2 , X3..., le système parcourait d'un mouvement continu la ligne X1X2X3 ... , il n'y aurait rien à changer aux définitions données tout à l'heure. On devrait dire seulement que si le système s'écartait artificiellement de la ligne X1X2 ..., il tendrait bientôt à y revenir, et que si les éléments accomplissent leur action propre lorsqu'on leur fait parcourir cette ligne, ils n'accompliraient pas la même action, si le système ne se trouvait pas exactement sur la ligne considérée.

Figure 34
§ 2071. Nous avons ainsi la définition précise et rigoureuse annoncée au § 123 pour l'état que nous avons l'intention de considérer. Afin de la mieux connaître, examinons les analogies, de même que pour connaître la forme de la terre, on examine une sphère. Commençons par l'analogie d'un phénomène concret. L'état X que nous considérons est semblable à celui d'un fleuve ; les états X1 , X2, ..., sont semblables à ceux de ce fleuve, chaque jour, par exemple. Le fleuve n'est pas immobile ; il coule, et toute modification, si petite soit-elle, qu'on apporte à sa forme et à son cours, est la cause d'une réaction qui tend à rétablir l'état primitif.
§ 2072. Voyons ensuite une analogie abstraite, à laquelle nous avons fait allusion au § 121. L'état X que nous considérons est analogue à celui de l'équilibre dynamique d'un système matériel [FN: § 2072-1] . Les états X1 , X2 , ... sont analogues à des positions d'équilibre successives de ce système. On peut remarquer aussi que l'état X est analogue à l'état d'équilibre d'un organisme vivant [FN: § 2072-2] .
§ 2073. Cherchons des analogies dans un domaine plus voisin du nôtre. Les états X1 , X2 , X3 ,..., sont analogues à ceux que l'économie pure considère pour un système économique. L'analogie est si grande que l'on peut considérer les états du système économique comme des cas particuliers des états généraux du système sociologique[FN: § 2073-1].
§ 2074. Il est une autre analogie que nous ne pouvons pas négliger si nous voulons pénétrer en notre matière. L'état X est analogue à celui qu'on appelle équilibre statistique, dans la théorie cinétique des gaz. Pour comprendre cela, considérons un cas particulier, celui, par exemple, de la consommation des cigares d'une certaine qualité, en un pays donné. Les états X1 , X2 , X3, ..., représenteront, par hypothèse, les consommations annuelles de ces cigares. Commençons par supposer qu'elles sont presque toutes égales : nous dirons que la consommation des cigares est constante. Mais par là nous n'entendons nullement affirmer que la consommation de chaque individu est constante. Au contraire, nous savons très bien qu'elle est très variable ; mais toutes les variations se compensent à peu près. De ce fait, la résultante est zéro, ou mieux voisine de zéro. Le cas n'est certes pas exclu où il pourrait se produire en un même sens un si grand nombre de ces variations que la résultante ne serait plus voisine de zéro. Mais ce cas a une probabilité si petite qu'il n'est pas nécessaire de le considérer. C'est ce qu'on exprime en disant que la consommation est constante. Si, au contraire, la probabilité n'est pas extrêmement petite, nous observerons des oscillations autour de la valeur constante de la consommation. Ces oscillations suivront la loi des probabilités. Supposons ensuite que X1 , X2 , X3, ... représentent des consommations croissantes. Nous pourrons répéter, avec les modifications nécessaires, les observations que nous venons de faire. Nous dirons que nous ne supposons nullement que les consommations de chaque individu soient croissantes ; que nous savons, au contraire, qu'elles sont très variables, mais que nous traitons d'un équilibre statistique, dans lequel les variations se compensent de telle sorte qu'il en résulte une consommation totale croissante ; que celle-ci peut avoir une probabilité si grande qu'on n'observe pas d'oscillations dépendant des probabilités, ou bien pas assez grande pour que ces oscillations se produisent. Enfin, par la préparation de l'étude de ces cas particuliers, il sera facile de comprendre la signification générale de X1 , X2 , X3 ,... pour des consommations variables de n'importe quelle façon.
§ 2075. Qu'on étende à tout un système social les considérations exposées pour le système des consommateurs d'une qualité de cigares, et l'on aura une idée claire de l'analogie que nous avons en vue, pour les états X1 , X2 , X3, ...
§ 2076. Nous pourrions continuer à désigner par les lettres X et X1 , X2,... les états sociaux que nous voulons considérer (§ 119) ; mais peut-être le lecteur commence-t-il à être las de cette façon de désigner les choses, et préférerait-il qu'on leur donnât des noms. Nous pourrions prendre ce nom au hasard; mais il vaut peut-être mieux l'emprunter à une chose analogue à celle que nous voulons désigner. C'est pourquoi, nous en tenant à l'analogie mécanique, nous appellerons états d'équilibre les états X et X1 , X2 ,… mais il faut rechercher le sens de ce terme exclusivement dans les définitions données aux § 2068 et 2069, en tenant compte des observations du § 2074.
§ 2077. Nous venons de simplifier notre problème en substituant la considération de certains états successifs à celle de l'infinité des changements insensibles qui conduisent à ces états. Nous devons continuer dans cette voie, et nous efforcer de simplifier encore la considération de la mutuelle dépendance et celle des éléments à considérer.
§ 2078. Dans notre étude, nous nous arrêtons à certains éléments, comme le chimiste s'arrête aux corps simples ; mais nous n'affirmons pas du tout que les éléments auxquels nous nous arrêtons ne soient pas réductibles à un plus petit nombre, ou même, par exemple, à une unité. De même, le chimiste n'affirme pas que le nombre des corps simples soit irréductible, et que, par exemple, on ne puisse, un jour, y reconnaître différentes manifestations d'un seul élément [FN: § 2078-1].
§ 2079. ORGANISATION DU SYSTÈME SOCIAL. Le système économique est composé de certaines molécules mues par les goûts, et retenues par les liaisons des obstacles qui s'opposent à l'obtention des biens économiques. Le système social est beaucoup plus compliqué. Même si nous voulons le simplifier le plus possible sans tomber en de trop graves erreurs, nous devrons du moins le considérer comme composé de certaines molécules contenant certains résidus, certaines dérivations, certains intérêts, certaines tendances. Ces molécules, sujettes à de nombreuses liaisons, accomplissent des actions logiques et des actions non-logiques. Dans le système économique, la partie non-logique est entièrement reléguée dans les goûts. On la néglige, parce que les goûts sont supposés donnés. On se demandera si l'on ne pourrait pas faire de même pour le système social : admettre comme donnés les résidus, où serait reléguée la partie non-logique, et étudier les actions logiques auxquelles ils donnent naissance. En effet, on aurait ainsi une science qui serait semblable à l'économie pure ou même à l'économie appliquée. Mais, malheureusement la ressemblance cesse, sous le rapport de la correspondance avec la réalité. En de certaines circonstances il n'y a pas un trop grand écart entre la réalité et l'hypothèse suivant laquelle les hommes accomplissent, pour satisfaire leurs goûts, des actions économiques que l'on peut en moyenne considérer comme logiques. Aussi les conséquences de telles hypothèses donnent-elles, en ces circonstances, une forme générale du phénomène, dont les divergences d'avec la réalité sont peu nombreuses et pas considérables. Au contraire, il y a un grand écart entre la réalité et l'hypothèse suivant laquelle, des résidus, les hommes tirent des conséquences logiques, et agissent d'après celles-ci. En ce genre d'activité, ils emploient les dérivations plus souvent que les raisonnements rigoureusement logiques. C'est pourquoi quiconque voudrait prévoir leurs faits et gestes, sortirait entièrement de la réalité. Les résidus ne sont pas seulement, comme les goûts, l'origine des actions, mais agissent aussi sur toute la suite des actions qui sont accomplies dès l'origine. Nous nous en rendons compte précisément parce que les dérivations se substituent aux raisonnements logiques. Donc, la science constituée sur l'hypothèse qu'on tire les conséquences logiques de certains résidus donnés, fournirait du phénomène une forme générale qui aurait peu ou rien de commun avec la réalité [FN: § 2079-1] . Cette science serait à peu près une doctrine semblable à celle de la géométrie non-euclidienne, ou à celle de la géométrie dans l'espace à quatre dimensions. Si nous voulons demeurer dans la réalité, nous devons demander à l'expérience de nous faire connaître non seulement certains résidus fondamentaux, mais aussi les diverses manières dont ils agissent pour déterminer les actions des hommes. Pour de semblables motifs, l'étude de beaucoup de faits dits économiques ne peut se faire sans l'aide de la sociologie.
§ 2080. Portons notre attention sur les molécules du système social, c'est-à-dire sur les individus. Ceux-ci possèdent certains sentiments, manifestés par les résidus. Pour abréger, nous désignerons ces sentiments par le seul nom de résidus. Nous pourrons dire alors que chez les individus existent des mélanges de groupes de résidus, mélanges qui sont analogues à ceux de composés chimiques qu'on trouve dans la nature ; tandis que les groupes mêmes de résidus sont analogues à ces composés chimiques. Au chapitre précédent, nous avons déjà étudié la nature de ces mélanges et de ces groupes ; nous avons remarqué que si une partie d'entre eux semblent être presque indépendants, une autre partie sont dépendants, de telle sorte que l'accroissement de l'un est compensé par la diminution d'autres mélanges ou d'autres groupes, et vice versa. Plus loin, nous verrons d'autres genres de dépendance (§ 2088). Que ces mélanges et ces groupes soient dépendants ou indépendants, il convient maintenant de les ranger parmi les éléments de l'équilibre social.
§ 2081. Les résidus se manifestent par les dérivations, qui sont ainsi un indice des forces qui agissent sur les molécules sociales. Nous les avons divisées en deux catégories (§ 1826) : les dérivations proprement dites et les manifestations auxquelles elles aboutissent. Ici, pour avoir une vue du tout, nous les considérons ensemble.
§ 2082. Contrairement à l'opinion vulgaire qui, dans la détermination de la forme sociale, attribue une grande importance aux dérivations et, parmi celles-ci, aux dérivations proprement dites, aux théories, nous avons vu, grâce à de nombreuses et longues recherches, que, directement, ces éléments agissent peu dans la détermination de cette forme, et que ce fait échappe, parce qu'on attribue aux dérivations les effets qui sont le propre des résidus manifestés par ces dérivations. Pour acquérir une efficacité notable, les dérivations doivent d'abord se transformer en sentiments (§ 1746) ; ce qui, d'ailleurs, n'est pas si facile.
§ 2083. En ce qui concerne les dérivations, un fait est capital les dérivations ne correspondent pas précisément aux résidus dont elles proviennent (§ 1767 et sv., 1780 et sv.). De ce fait découlent les principales difficultés que nous rencontrons pour constituer la science sociale, car seules les dérivations nous sont connues. Parfois on ne sait trop comment remonter des dérivations aux résidus dont elles procèdent. Cela n'arriverait pas si les dérivations étaient de la nature des théories logico-expérimentales (§ 1768, 2007). Ajoutons que les dérivations renferment un grand nombre de principes que l'on n'invoque pas explicitement, qui demeurent implicites, et qui, précisément pour cela, manquent beaucoup de précision (§ 2002). L'incertitude est plus grande pour les dérivations proprement dites que pour les manifestations, mais elle ne fait pas défaut non plus chez celles-ci. Afin de porter remède en quelque mesure à ce défaut, il est nécessaire de rassembler un grand nombre de dérivations appartenant au même sujet, et d'en chercher la partie constante, en la séparant de la partie variable.
§ 2084. Lors même qu'il y a correspondance, au moins approximative, entre la dérivation et le résidu, celle-là dépasse habituellement le sens de celui-ci et la réalité (§ 1772). Elle indique une limite extrême en deçà de laquelle reste le résidu. Très souvent elle renferme une partie imaginaire qui exprime une fin placée bien au delà de celle que l'on indiquerait, si l'on exprimait rigoureusement le résidu (§ 1869). Si la partie imaginaire croît et se développe, on a les mythes, les religions, les morales, les théologies, les métaphysiques, les théories idéales. Cela arrive principalement lorsque les sentiments qui correspondent à ces dérivations sont intenses, et d'autant plus facilement que l'intensité est plus grande.
§ 2085. C'est pourquoi, prenant le signe pour la chose, on peut dire que les hommes sont poussés à une action énergique par ces dérivations. Mais cette proposition, prise à la lettre, serait loin d'être vraie, et doit être remplacée par cette autre : que les hommes sont poussés à une action énergique par les sentiments qui s'expriment par ces dérivations (§ 1869). En de nombreux cas, il est indifférent d'employer la première ou la seconde proposition. Ce sont surtout ceux où l'on remarque une correspondance entre les actions et ces dérivations. La correspondance existant entre les actions et la chose révélée par les dérivations existe aussi entre les actions et les dérivations, et vice versa. En d'autres cas, le fait de substituer la première à la seconde proposition peut être cause de graves erreurs. Ces cas sont surtout ceux où, voulant modifier les actions, on croit y arriver en modifiant les dérivations. La modification du signe ne modifie point la chose à laquelle correspondent les actions ; par conséquent, elle ne modifie pas non plus celles-ci. (§ 1844 et sv.)
§ 2086. Quand des dérivations on veut remonter aux résidus, il faut prendre garde qu'un même résidu B peut avoir un grand nombre de dérivations T, T', T", ..., (§ 2004 et sv.) qui peuvent aisément se substituer les unes aux autres. C'est pourquoi : 1° si, dans une société, on trouve T, et dans une autre T', on ne peut conclure que ces deux sociétés aient des résidus correspondants qui soient différents ; car elles peuvent, au contraire, avoir le même résidu B (§ 2004 et sv.) ; 2° la substitution de T à r a peu ou point d'efficacité pour modifier la forme sociale, car cette substitution n'altère pas les résidus B qui, beaucoup plus que les dérivations, déterminent cette forme (§ 1844 et sv.) ; 3° mais le fait que celui qui doit agir estime, ou n'estime pas, cette substitution indifférente, peut avoir de l'efficacité, non pas pour ces opinions considérées intrinsèquement, mais bien pour les sentiments qu'elles manifestent (§ 1847) ; 4° parmi les dérivations T, T', T", ..., il peut y en avoir de. contradictoires. Deux propositions qui sont telles se détruisent ; il n'en est pas ainsi de deux dérivations contradictoires : non seulement elles peuvent subsister ensemble, elles se renforcent même mutuellement. Souvent d'autres dérivations interviennent pour faire disparaître la contradiction, et rétablir l'accord. Ce phénomène est d'importance très secondaire, parce que les hommes trouvent et acceptent très facilement des dérivations sophistiques de cette sorte. Ils éprouvent un certain besoin de logique, mais le satisfont aisément par des propositions pseudo-logiques. Par conséquent, la valeur intrinsèque, logico-expérimentale, des dérivations T, T', T",, ... a d'habitude peu de rapport avec l'efficacité de leur action sur l'équilibre.
§ 2087. COMPOSITION DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS. NOUS avons considéré des groupes séparés de résidus ; voyons maintenant comment ils agissent lorsqu'on les considère ensemble. Le phénomène présente quelque analogie, sous un certain aspect, avec les compositions chimiques et, sous un autre aspect, avec la composition position des forces, en mécanique. D'une façon générale, supposons une société sur laquelle agissent certains sentiments correspondant aux groupes de résidus A, B, C, .... qui nous sont manifestés par les dérivations a, b, c, .... Donnons à chacun de ces groupes de résidus un indice quantitatif qui corresponde à l'intensité de l'action de chaque groupe. Nous aurons ainsi les indices α, β, γ, …, En outre, nous appellerons S, T, U, les dérivations, les mythes, les théories, etc., correspondant aux groupes A, B, C.... Le système social sera alors en équilibre, sous l'action des forces α, β, γ, …, qui sont à peu près dirigées dans le sens des dérivations S, T, U, .... et les obstacles entrant en ligne de compte. Ainsi, nous exprimons simplement sous une forme nouvelle ce que nous avons dit précédemment.
§ 2088. Continuant à donner cette forme au raisonnement, nous énoncerons les propositions suivantes. 1° On ne peut pas, ainsi qu'on le fait d'habitude, juger séparément de l'effet de chaque groupe de résidus ou de la variation d'intensité de ce groupe. Si cette intensité varie, pour que l'équilibre soit maintenu, il faut généralement qu'il se produise des variations d'autres groupes. Ici apparaît un genre de dépendance, différent de celui que nous avons rappelé au § 2080. Il faut donner des noms différents à des choses différentes § 119). Nous donnerons le nom de premier genre de dépendance à la dépendance directe entre les divers groupes de résidus, et nous appellerons second genre de dépendance la dépendance indirecte provenant de la condition que l'équilibre soit maintenu, ou d'autres conditions analogues. 2° Le mouvement réel a lieu selon la résultante des forces α, β, γ, .... qui ne correspond en rien à la résultante imaginaire (si toutefois elle se conçoit) des dérivations S, T, U, .... 3° Ces dérivations nous font seulement connaître le sens dans lequel certains mouvements tendent à s'accomplir (§ 2087) ; mais ce sens même n'est généralement pas celui qui serait indiqué par la dérivation prise dans son acception rigoureuse, comme on devrait entendre une proposition logico-expérimentale. Par exemple, nous avons vu souvent que deux dérivations contradictoires peuvent subsister ensemble, ce qu'on ne peut admettre pour deux propositions logiques. Les deux propositions : A est égal à B ; B n'est pas égal à A, est inférieur à A, sont logiquement contradictoires, et, par conséquent, ne peuvent subsister ensemble. Au contraire, comme dérivations, elles peuvent subsister ensemble, et elles expriment une seule et même chose : c'est que les A veulent dominer sur les B. Ils font usage de la première proposition pour affaiblir la résistance de ceux qui, sans être favorables aux B, ne voudraient pas qu'ils fussent assujettis. Ils font usage de la seconde proposition pour inciter à l'action ceux qui sont déjà favorables aux A. 4° Comme d'habitude, si le système social ne se meut pas suivant la direction indiquée par les résidus A, auxquels correspond la force α, cela n'a pas lieu parce qu'on a contrecarré directement A, ou moins encore parce qu'on a réfuté la dérivation correspondante S, mais parce que le mouvement selon A a été dévié par l'action des résidus B, C, .... Parmi ceux-ci, il faut distinguer les résidus des différentes classes (§ 2153-4°), parce qu'en vertu de la propriété que possède l'ensemble d'une même classe de demeurer presque constant, il faut prêter attention à l'action des diverses classes plus qu'à celle de chaque résidu. Nous poursuivrons plus loin ces considérations (§ 2148 et sv.).
§ 2089. Afin de mieux comprendre la différence entre les dépendances mutuelles du premier et celles du second genre, représentons-nous une certaine société. Son existence est déjà un fait ; en outre, nous avons les divers faits qui se produisent dans cette société. Si nous considérons ensemble le premier de ces faits et les seconds, nous dirons qu'ils sont tous mutuellement dépendants (§ 2204). Si nous les séparons, nous dirons que les derniers sont mutuellement dépendants entre eux (mutuelle dépendance du premier genre), et qu'en outre, ils sont mutuellement dépendants avec le premier fait (mutuelle dépendance du second genre). De plus, nous pourrons dire que le fait de l'existence de la société résulte des faits que l'on observe dans la société ; c'est-à-dire que ceux-ci déterminent l'équilibre social. Nous pourrons ajouter que si le fait de l'existence de la société est donné, les faits qui se produisent dans cette société ne sont plus entièrement arbitraires, mais qu'il faut qu'ils satisfassent à certaines conditions ; c'est-à-dire que l'équilibre étant donné, les faits qui le déterminent ne sont pas entièrement arbitraires.
Voyons maintenant quelques exemples de la différence entre les dépendances mutuelles du premier et celles du second genre. La tendance des Romains au formalisme dans la vie pratique agissait de manière à faire naître, subsister, accroître ce formalisme dans la religion, dans le droit, dans la politique; et vice versa. Nous avons ici une mutuelle dépendance du premier genre. Au contraire, nous avons une mutuelle dépendance du second genre, dans le fait que la tendance des Romains à l'indépendance pouvait subsister grâce au formalisme politique, qui faisait éviter le danger de l'anarchie. C'est effectivement ce qui arriva jusque vers la fin de la république. La tendance au formalisme politique ayant alors disparu (surtout parce que les Romains avaient été remplacés par des hommes d'autres nations), la tendance à l'indépendance dut aussi diminuer et accepter comme moindre mal le despotisme impérial. Si cette tendance n'avait pas diminué, la société romaine se serait dissoute, ou pour des causes internes, ou parce qu'elle aurait été soumise par d'autres peuples, ainsi qu'il arriva précisément à la Pologne, pour la même raison. Ici, il n'y a pas de mutuelle dépendance directe entre les résidus de la IIe classe (tendance au formalisme politique) et les résidus de la Ve classe (tendance à l'indépendance), qui serait une mutuelle dépendance du premier genre. Mais il y a une mutuelle dépendance indirecte, qui provient du fait que, pour la collectivité romaine, en ce temps et en ces circonstances, on n'avait pas une position d'équilibre dans l'état où l'indice de la tendance à l'indépendance (résidus de l'intégrité personnelle) serait demeuré constant, tandis que diminuait l'indice du formalisme politique (résidus de la persistance des agrégats). C'est là la mutuelle dépendance du second genre.
§ 2090. À la façon même dont agit la mutuelle dépendance du second genre, on s'aperçoit que ses effets doivent souvent se produire beaucoup plus lentement que ceux de la mutuelle dépendance du premier genre ; puisqu'il faut qu'il survienne une altération de l'équilibre, et qu'ensuite celle-ci se répercute sur les autres résidus. En outre, toujours pour ce motif, le second genre de mutuelle dépendance jouera un rôle beaucoup plus considérable que le premier dans les mouvements rythmiques sociaux (§ 1718).
§ 2091. Nous avons déjà traité des diverses manières de tenir compte de la mutuelle dépendance (§ 1732). Pour suivre la meilleure méthode (2-b) indiquée dans ce paragraphe, il serait nécessaire de pouvoir assigner un indice à chacune des choses mutuellement dépendantes, et ensuite de faire usage de la logique mathématique, pour déterminer ces indices par un système d'équations. On a pu faire cela pour l'économie pure ; on ne peut le faire, du moins maintenant, pour la sociologie, et nous sommes, par conséquent, obligés d'employer des méthodes moins parfaites (§ 2203 et sv.).
§ 2092. Comme nous nous servons ici du langage vulgaire au lieu du langage mathématique, il ne sera peut-être pas inutile de citer un exemple très simple de la méthode (2-a). Il met en lumière le rapport en lequel cette méthode se trouve avec la méthode (2-b). Soient deux quantités x et y qui sont en un état de mutuelle dépendance. Si nous faisons usage du langage mathématique, en suivant la méthode (2-b), nous disons qu'il existe une équation entre les deux variables x et y, et il n'est pas nécessaire d'ajouter autre chose. Si nous faisons usage du langage vulgaire, nous devons suivre le mode (2-a ), et nous dirons que x est déterminée par y, mais qu'elle réagit ensuite sur y, de telle sorte que y se trouve aussi dépendre de x. On remarquera que l'on pourrait invertir les termes et dire que y est déterminée par x, mais qu'elle réagit ensuite sur x, de telle sorte que x se trouve aussi dépendre de y. Adopté pour les équations, parfois ce mode donne les mêmes résultats que le mode (2-b), parfois il ne les donne pas [FN: § 2092-1]. C'est pourquoi, d'une manière générale, il ne faut substituer le mode (2-a) au mode (2-b) qu'avec beaucoup de circonspection, et il est nécessaire, en tout cas, d'examiner attentivement les effets de ces substitutions.
§ 2093. Admettons, uniquement par hypothèse, qu'on ait pu assigner certains indices x1, x2, ... aux sentiments, certains autres y1 , y2, ... aux conditions économiques, certains autres z1, z2, ... aux coutumes, aux lois, aux religions, d'autres encore, u1 , u 2, ... aux conditions intellectuelles, au développement scientifique, aux connaissances techniques, et ainsi de suite. Pour nous servir du langage mathématique, nous dirons que l'état X défini au § 2068 est déterminé par un nombre d'équations égal au nombre des inconnues x1, x2, ... y1 , y2, ..., z1 , z2, ... etc. De même nous dirons que les états X1 , X2 , X3, ..., définis au § 2069, sont déterminés.
§ 2094. En outre, considérant la dynamique du système, nous appellerons aussi déterminé le mouvement qui, si les circonstances indiquées par les paramètres des équations ne variaient pas, porterait le système successivement aux positions X1 , X2 , X3 , .... Si ces circonstances variaient, le mouvement varierait aussi, et les positions successives seraient X 1 , X'2, X3 ... (fig. 35).
§ 2095. Nous pouvons supposer donné un certain nombre d'inconnues, pourvu que nous supprimions un nombre égal d'équations. Nous pourrions, par exemple, supposer donnés certains sentiments correspondant aux indices x1, x2, ..., et alors le mouvement qui porte aux positions X 1 , X2 , X3, … serait celui qui se produirait si ces sentiments demeuraient constants, tandis que le mouvement X 1 , X'2 , X'3, … serait celui qui se produirait si ces sentiments variaient.

Figure 35
§ 2096. Si nous supprimons quelques équations du système qui détermine l'équilibre et le mouvement, un nombre, égal d'inconnues seront indéterminées (§ 130), et nous pourrons considérer les mouvements virtuels ; c'est-à-dire que nous pourrons faire varier certains indices et déterminer les autres [FN: § 2096-1]. En cela se manifestera la mutuelle dépendance des éléments.
§ 2097. Pour nous servir du langage vulgaire, nous dirons que tous les éléments considérés déterminent l'état d'équilibre (§ 2070), qu'il existe certaines liaisons (§ 126), et que si, par hypothèse, nous en supprimons quelques-unes, on pourra considérer des changements hypothétiques de la société (mouvements virtuels) [FN: § 2097-1] . Pour mieux comprendre la mutuelle dépendance, qui apparaît d'emblée avec le langage mathématique, nous ajouterons que les sentiments dépendent des conditions économiques, comme celles-ci dépendent de ceux-là, et qu'il existe des dépendances analogues entre les autres éléments.
§ 2098. L'examen des faits nous permet de pousser notre étude au delà de ces considérations générales. Pour nous servir du langage mathématique, nous dirons que les variables ne sont pas de même nature dans toutes les équations, ou, pour mieux dire, qu'on peut les supposer approximativement de nature différente.
§ 2099. Tout d'abord, on remarque qu'il existe des groupes diversement variables. Bornons-nous à une grossière approximation, et réduisons-les à trois. L'un d'eux est si peu variable que, pour une durée pas trop longue, il est possible de le considérer comme constant (conditions géographiques, climatériques, géologiques, etc.). On peut donc le faire passer dans le groupe des quantités constantes. Un autre groupe est peu variable (par exemple les classes des résidus). On peut le supposer constant pour une courte durée ; mais ensuite il faut tenir compte du fait qu'il varie si le temps se prolonge. Un autre est assez variable (par exemple, les connaissances intellectuelles) ; un autre est très variable (par exemple, les dérivations).
§ 2100. Ensuite, il faut faire attention que, toujours approximativement, on peut diviser en différents groupes les équations qui déterminent l'équilibre, de telle sorte que la mutuelle dépendance avec les autres groupes devient négligeable. Nous avons de bons exemples de ce phénomène en économie pure. Il peut y avoir des équations où figurent seulement deux variables. En ce cas, on peut dire que l'une est déterminée par l'autre.
§ 2101. Pour nous servir du langage vulgaire, nous dirons que, dans la détermination de l'équilibre, on peut considérer certains éléments comme constants pour une assez longue durée ; d'autres comme constants pour une durée moins longue, mais toujours pas courte ; d'autres comme variables, etc. Nous ajouterons que, au moins approximativement, et dans une première approximation, la mutuelle dépendance peut être considérée seulement en certains groupes d'éléments, les divers groupes étant supposés indépendants. Quand l'un de ces groupes se réduit à deux éléments, et que l'un de ceux-ci est presque constant, on peut dire que cet élément est la cause et l'autre l'effet.
§ 2102. Par exemple, si, par hypothèse, on détache des autres éléments la situation géographique d'Athènes et sa prospérité commerciale, au temps de Périclès, on peut dire que le premier élément est la cause, et le second l'effet. Mais nous avons constitué ce groupe arbitrairement. Si ces deux éléments étaient unis indissolublement, puisque le premier n'a pas changé, le second ne devait pas changer non plus, et puisque, au contraire, le second a changé, cela signifie qu'il ne dépendait pas exclusivement du premier, qu'il n'était pas l'effet de cette cause.
§ 2103. Autre exemple. Si, pour Rome antique, nous formons un groupe constitué par les mœurs et par la prospérité politique et économique, et si nous admettons, par hypothèse, que les mœurs étaient, au temps des guerres puniques, meilleures qu'à la fin de la République ; si nous admettons, en outre, une autre hypothèse, à savoir que les mœurs et la prospérité forment un groupe indépendant, nous pourrons dire, avec beaucoup d'auteurs, que les bonnes mœurs furent la cause de la prospérité de Rome. Mais voici que les mêmes auteurs ou d'autres nous disent que la prospérité de Rome fut la cause de la corruption des mœurs. Au sens ordinaire que l'on donne au terme cause, cette proposition contredit la précédente. Elles peuvent subsister ensemble si, faisant abstraction du rapport de cause à effet, on parle uniquement d'une mutuelle dépendance. Sous cette forme, on pourrait énoncer le rapport entre les mœurs et la prospérité d'un peuple en disant que les bonnes mœurs accroissent la prospérité, laquelle réagit sur les mœurs et les corrompt. Ni cette proposition ni les précédentes ne concordent avec les faits ; mais ici, nous n'avons pas à nous occuper de cela.
§ 2104. On comprend aisément qu'au lieu d'un groupe de deux éléments, on puisse considérer un groupe d'un plus grand nombre d'éléments, puis divers groupes, chacun constitué de plusieurs éléments. C'est là le seul procédé dont nous disposons pour obtenir des solutions approximatives, qui s'amélioreront à mesure qu'augmentera le nombre des éléments et des groupes considérés (§ 2203 et sv.).
§ 2105. LES PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME SOCIAL. Un système d'atomes et de molécules matérielles possède certaines propriétés thermiques, électriques et autres. D'une manière analogue, un système constitué par des molécules sociales a, lui aussi, certaines propriétés qu'il importe de considérer. L'une d'elles fut de tout temps perçue par intuition, ne fût-ce que d'une façon grossière. C'est à elle qu'avec peu ou point de précision on a donné le nom d'utilité, de prospérité, ou un autre semblable. Nous devons maintenant rechercher dans les faits si, sous ces expressions indéterminées, il y a quelque chose de précis, et en découvrir la nature. L'opération à laquelle nous procédons est analogue à celle qu'ont effectuée les physiciens, lorsqu'aux concepts vulgaires et indéterminés du chaud et du froid, ils substituèrent le concept précis de la température.
§ 2106. Portons notre attention sur ce qu'on nomme prospérité économique, morale, intellectuelle, puissance militaire, politique, etc. Si nous voulons traiter scientifiquement de ces entités, il est nécessaire de pouvoir les définir rigoureusement ; et si nous voulons les introduire dans la détermination de l'équilibre social, il est nécessaire de pouvoir, en quelque manière, les faire correspondre à des quantités, fût-ce par de simples indices.
§ 2107. On a pu faire cela en économie pure ; c'est la cause du progrès de cette science ; mais on ne peut le faire également en sociologie. Toujours comme d'habitude, nous surmonterons cette difficulté en substituant de grossières approximations aux données précises en nombres, qui nous font défaut. De même, celui qui ne dispose pas d'une table de mortalité est obligé de se contenter de l'approximation grossière qu'on obtient, en reconnaissant que la mortalité commence à être grande dans les premières années de l'enfance, puis diminue, puis croît de nouveau, dans les dernières années (§ 144). C'est peu, très peu de chose ; mais c'est mieux que rien ; et le moyen d'accroître ce peu est, non pas de le rejeter, mais de le conserver et d'y faire des adjonctions successives.
§ 2108. Si nous demandons : « L'Allemagne est-elle, maintenant, en 1913, plus puissante militairement et politiquement qu'en 1860 ? », tout le monde répondra oui. Si, ensuite, nous demandons : « De combien exactement ? », personne ne pourra répondre. On peut répéter la même chose pour des questions semblables ; et l'on comprend que les choses nommées puissance militaire, politique, intellectuelle, etc., sont susceptibles de croître ou de diminuer, sans d'ailleurs que nous puissions assigner des nombres précis qui leur correspondent dans les différents états.
§ 2109. Moins précise encore est l'entité prospérité et force d'un pays, laquelle résume ces diverses puissances. Pourtant chacun comprend que la prospérité et la puissance de la France, par exemple, sont plus grandes que celles de l'Abyssinie, et qu'aujourd'hui, en 1913, elles sont plus grandes qu'immédiatement après la guerre de 1870. Tout le monde comprend, sans qu'il y ait besoin d'aucune précision numérique, la différence entre Athènes au temps de Périclès, et Athènes après la bataille de Chéronée, entre la Rome d'Auguste et la Rome d'Augustule. Des différences même beaucoup plus légères sont perçues et évaluées tant bien que mal. C'est pourquoi, si la précision des nombres nous fait défaut, nous avons cependant toujours du phénomène une idée pas trop éloignée de la vérité. On peut ensuite descendre aux détails et considérer les différentes parties de cet ensemble.
§ 2110. Pour avoir une idée plus précise, il est nécessaire d'énoncer les normes, en partie arbitraires, que l'on entend suivre pour déterminer les entités que l'on veut définir. L'économie pure a pu le faire : elle a choisi une norme unique, soit la satisfaction de l'individu, et a établi qu'il est l'unique juge de cette satisfaction. C'est ainsi qu'on a défini l'utilité économique ou ophélimité. Mais si nous nous posons le problème, très simple aussi, de rechercher ce qui est le plus profitable à l'individu, abstraction faite de son jugement, aussitôt apparaît la nécessité d'une norme, qui est arbitraire. Par exemple, dirons-nous qu'il lui est avantageux de souffrir physiquement pour jouir moralement, ou vice versa ? Dirons-nous qu'il lui est avantageux de rechercher uniquement la richesse ou de se préoccuper d'autre chose ? [FN: § 2110-1] En économie pure, nous lui laissons le soin de décider. Si maintenant nous voulons le priver de cet office, il faut que nous trouvions quelqu'un d'autre à qui le confier.
§ 2111. L'UTILITÉ. Quel que soit le juge que l'on veuille choisir, quelles que soient les normes que l'on décide de suivre, les entités qui sont déterminées de cette façon jouissent de certaines propriétés communes. Nous allons les étudier. Donc, après avoir fixé les normes suivant lesquelles il nous plaît de déterminer un certain état limite dont on suppose qu'un individu, ou une collectivité, se rapprochent, et après avoir donné un indice numérique aux différents états qui se rapprochent plus ou moins de cet état limite, de telle sorte que l'état le plus rapproché ait un indice plus grand que celui de l'état qui s'en écarte le plus, nous dirons que ces indices sont ceux d'un état X. Puis, comme d'habitude, uniquement pour éviter l'ennui que procure dans le discours l'usage de simples lettres de l'alphabet, nous substituerons à la lettre X un nom quelconque. Ce nom, toujours comme d'habitude, afin d'éviter de trop fréquents néologismes, nous l'emprunterons à quelque phénomène analogue. Quand on sait ou qu'on croit savoir qu'une chose « est avantageuse » à un individu, à une collectivité, on dit qu'il est « utile » que l'un et l'autre s'efforcent d'obtenir cette chose, et l'on estime que l'utilité dont ils jouissent est d'autant plus grande qu'ils se rapprochent le plus de la possession de cette chose. C'est pourquoi, par simple analogie, et pour aucun autre motif, nous donnerons le nom d'UTILITÉ à l'entité X définie tantôt [FN: § 2111-1] .
§ 2112. Il faut prendre garde que, précisément parce que le nom est déduit d'une simple analogie, l'utilité ainsi définie peut parfois concorder tant bien que mal avec l'utilité du langage vulgaire ; mais, d'autres fois, elle peut ne pas concorder, tant et si bien qu'elle peut être exactement le contraire. Par exemple, si nous fixons comme état limite pour un peuple celui de la prospérité matérielle, notre utilité diffère peu de l'entité à laquelle les hommes pratiques donnent ce nom ; mais elle diffère grandement de l'entité que l'ascète a en vue. Vice versa, si nous fixons comme état limite celui du parfait ascétisme, notre utilité coïncidera avec l'entité que l'ascète a en vue, mais différera entièrement de celle que vise l'homme pratique.
Enfin, comme en ce cas les hommes ont l'habitude de désigner du même nom des choses contraires, il ne nous reste de choix qu'entre deux manières de nous exprimer : 1° nous écarter résolument du langage vulgaire, donner des noms différents à ces choses différentes, et comme elles sont assez nombreuses, nous aurons de nombreux néologismes ; 2° conserver un même nom à ces choses, en faisant attention qu'il les désigne seulement d'une manière générale, comme le nom d'une classe d'objets, comme en chimie le nom de corps simple, en zoologie le nom de mammifère, etc., et que les espèces appartenant à cette classe seront fixées d'après le critère choisi pour déterminer l'utilité.
§ 2113. Il est certainement regrettable qu'un seul terme désigne des choses différentes. C'est pourquoi il serait bon d'éviter l'usage du terme utilité dans le sens défini au § 2111, sens qui concorde avec l'un de ceux que ce terme a en langage vulgaire, et d'y substituer l'usage d'un nouveau terme, ainsi qu'on l'a fait en économie, où l'on a disjoint l'ophélimité et l'utilité. Je crois qu'il viendra un temps où il sera nécessaire de le faire. Si je m'en abstiens ici, c'est uniquement par crainte d'abuser des néologismes [FN: § 2113-1].
§ 2114. Prenons garde d'ailleurs qu'un seul terme nouveau ne nous tirera pas entièrement d'embarras. En effet, même quand on considère l'une des utilités particulières, à propos du but, par exemple celle qui est en rapport avec la prospérité matérielle, on trouve encore diverses espèces d'utilités, eu égard aux personnes ou aux collectivités, à la manière dont on les obtient, à la conception qu'en ont les hommes, et à d'autres semblables circonstances.
§ 2115. Tout d'abord, il faut distinguer les cas, suivant qu'il s'agit de l'individu, de la famille, d'une collectivité, d'une nation, de la race humaine. Il ne faut pas seulement considérer l'utilité de ces diverses entités ; il faut encore établir une distinction : séparer leurs utilités directes de celles qu'elles produisent indirectement, grâce à leurs rapports mutuels. Par conséquent, négligeant d'autres distinctions qu'il serait peut-être bon d'établir, et nous bornant à celles qui sont vraiment indispensables, nous devons tenir compte des genres suivants :
(a) Utilité de l'individu ;
(a-1) Utilité directe ;
(a-2) Utilité indirecte, obtenue parce que l'individu fait partie d'une collectivité ;
(a-3) Utilité d'un individu, en rapport avec les utilités des autres individus ;
(b) Utilité d'une collectivité donnée ; on peut établir pour ce genre d'utilités des distinctions analogues aux précédentes ;
(b-1) Utilité directe pour la collectivité, considérée séparément des autres collectivités ;
(b-2) Utilité indirecte, obtenue par l'influence d'autres collectivités ;
(b-3) Utilité d'une collectivité, en rapport avec les utilités des autres collectivités.
Bien loin de concorder, ces diverses utilités sont souvent en opposition manifeste. Nous avons déjà vu un grand nombre d'exemples de ces phénomènes (§ 1975 et sv.). Les théologiens et les métaphysiciens, par amour de l'absolu, qui est unique, les moralistes, pour inciter l'individu à s'occuper du bien d'autrui, les hommes d'État, pour l'inciter à confondre son utilité personnelle avec celle de sa patrie, et d'autres personnes, pour de semblables motifs, ont coutume de ramener, parfois explicitement, souvent implicitement, toutes les utilités à une seule.
§ 2116. En demeurant dans le domaine logico-expérimental, on peut établir d'autres distinctions et considérer les diverses utilités de deux manières : telles que se les représente l'un des membres de la collectivité, ou telles que les voit un étranger, ou l'un des membres de la collectivité, qui s'efforce, autant qu'il le peut, de porter un jugement objectif. Par exemple, un individu qui ressent fortement l'utilité directe (a-1), et peu ou point l'utilité indirecte (a-2), soignera simplement ses intérêts, sans se soucier de ses concitoyens, tandis que celui qui juge objectivement les actions de cet individu verra qu'il sacrifie la collectivité à son profit.
§ 2117. Nous n'avons pas encore fini de faire des distinctions. Chacune des espèces indiquées au § 2115 peut être considérée suivant le temps, c'est-à-dire au présent et aux divers temps futurs. L'opposition entre ces différentes utilités ne peut être moindre que pour les précédentes, ni moindre non plus la différence pour qui se laisse guider par le sentiment et pour qui considère ces utilités objectivement.
§ 2118. Afin de donner une forme beaucoup plus concrète au raisonnement, considérons spécialement une des utilités, celle qui est en rapport avec la prospérité matérielle. Dans la mesure où les actions humaines sont logiques, on peut, à la rigueur, observer que l'homme qui va à la guerre et qui ignore s'il restera sur un champ de bataille ou s'il reviendra chez lui, agit poussé par des considérations d'utilité individuelle, directe ou indirecte, puisqu'il compare l'utilité probable, au cas où il reviendrait sain et sauf, avec le dommage probable, au cas où il mourrait ou serait blessé. Mais ce raisonnement ne s'applique plus à l'homme qui va à une mort certaine pour la défense de sa patrie. Il sacrifie délibérément son utilité individuelle à l'utilité de sa nation. Nous sommes ici dans le cas de l'utilité subjective indiquée au § 2117.
§ 2119. La plupart du temps, l'homme accomplit ce sacrifice par une action non-logique, et les considérations subjectives d'utilité ne se font pas ; il ne reste que les considérations objectives que peut faire celui qui observe les phénomènes. Tel est le cas pour les animaux, dont beaucoup, poussés par l'instinct, se sacrifient pour le bien d'autres sujets de leur espèce : la poule qui affronte la mort en défendant ses poussins ; le coq pour défendre la poule ; la chienne pour défendre ses petits, et ainsi de suite ; par instinct, ils sacrifient leur vie pour l'utilité de leur espèce. Les espèces animales très prolifiques l'emportent en sacrifiant les individus. On tue les souris par milliers, et il en reste toujours. Le phylloxéra a vaincu l'homme et s'est rendu maître de la vigne. L'utilité d'aujourd'hui s'oppose souvent à celle des jours prochains, et l'opposition donne naissance aux phénomènes bien connus sous le nom de prévoyance et d'imprévoyance, pour les individus, pour les familles, pour les nations.
§ 2120. UTILITÉ TOTALE. Si l'on tient compte, pour un individu, des trois genres d'utilité indiqués au § 2115, on a, en conclusion, l'utilité totale dont jouit l'individu. Par exemple, l'individu peut retirer, d'une part un dommage direct, d'autre part une utilité indirecte, comme membre d'une collectivité ; et cette utilité indirecte peut être assez grande pour compenser et au delà le dommage direct, de sorte qu'en fin de compte il reste une certaine utilité. Il en va de même pour une collectivité. Si l'on pouvait avoir des indices pour ces différentes utilités, en les additionnant, on aurait l'utilité totale de l'individu ou de la collectivité.
§ 2121. MAXIMUM D'UTILITÉ D'UN INDIVIDU ou D'UNE COLLECTIVITÉ. Comme l'utilité à laquelle nous venons de faire allusion a un indice, il peut se faire qu'en un certain état elle ait un indice plus grand qu'en des états voisins, c'est-à-dire que nous ayons un maximum. Pratiquement, fût-ce d'une manière confuse, des problèmes de cette sorte sont perçus par intuition. Nous en avons rencontré un déjà sur notre chemin, quand nous avons recherché l'utilité qu'un individu pouvait avoir à suivre certaines règles existant dans la société (§ 1897 et sv.), ou, plus généralement, l'utilité qu'il pouvait retirer en visant certains buts idéaux (§ 1876 et sv.). Nous n'avons considéré alors que la solution qualitative des problèmes, et là même nous n'avons pu pousser bien loin, parce qu'une définition rigoureuse de l'utilité nous faisait défaut. Il est donc nécessaire de revenir sur ce sujet.
§ 2122. Quand on considère, pour un individu, un genre déterminé d'utilité, on a des indices des utilités partielles et aussi un indice de l'utilité totale ; c'est ce qui nous permet d'estimer l'utilité dont jouit l'individu, en des circonstances données. En outre, si en même temps que celles-ci varient, l'indice de l'utilité totale, après avoir commencé par croître, finit par décroître, il y aura un certain point où cet indice sera maximum. Tous les problèmes posés précédemment d'une manière qualitative (§ 1876 et sv. ; § 1897 et sv.) deviennent alors quantitatifs, et aboutissent à des problèmes de maxima. Par exemple, au lieu de rechercher si, en observant certaines règles, un individu fait son bonheur, nous aurons à rechercher si et de combien s'accroît son ophélimité ; et, entrés dans cette voie, nous en viendrons à rechercher comment et quand cette ophélimité devient maxima.
§ 2123. Les problèmes particuliers posés au § 1897 sont compris dans les problèmes plus généraux du § 1876, et ceux-ci, à leur tour, font partie d'une catégorie encore plus générale. Si l'état d'un individu dépend d'une certaine circonstance à laquelle on peut assigner des indices variables, et si, pour chacun de ces indices nous pouvons connaître l'indice de l'utilité totale pour un individu (ou pour une collectivité considérée comme un individu), nous pourrons connaître la position de l'individu (ou de la collectivité) à laquelle cette utilité atteint un maximum.
§ 2124. Enfin, si nous répétons cette opération pour toutes les circonstances dont dépend l'équilibre social, lorsque les liaisons seront données, nous aurons autant d'indices parmi lesquels nous pourrons en choisir un plus grand que tous ceux qui l'avoisinent ; et cet indice correspondra au maximum d'utilité, toutes les circonstances mentionnées plus haut entrant en ligne de compte.
§ 2125. Si difficiles que soient pratiquement ces problèmes, ils sont théoriquement plus faciles que d'autres dont nous devons parler maintenant.
§ 2126. Jusqu'à présent, nous avons considéré les maxima d'utilité d'un individu séparé des autres, d'une collectivité séparée des autres ; il nous reste à étudier ces maxima lorsqu'on compare entre eux les individus ou les collectivités. Pour abréger, nous nommerons seulement les individus, dans la suite de cet exposé, mais le raisonnement s'appliquera aussi à la comparaison entre collectivités distinctes. Si les utilités des individus étaient des quantités homogènes, et que, par conséquent, on pût les comparer et les additionner, notre étude ne serait pas difficile, au moins théoriquement. On additionnerait les utilités des divers individus, et l'on aurait l'utilité de la collectivité constituée par eux. Nous reviendrions ainsi aux problèmes déjà étudiés.
§ 2127. Mais les choses ne vont pas si facilement. Les utilités des divers individus sont des quantités hétérogènes, et parler d'une somme de ces quantités n'a aucun sens ; il n'y en a pas : on ne peut l'envisager. Si l'on veut avoir une somme qui soit en rapport avec les utilités des divers individus, il est nécessaire de trouver tout d'abord un moyen de faire dépendre ces utilités de quantités homogènes, que l'on pourra ensuite additionner.
§ 2128. MAXIMUM D'OPHÉLIMITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ, EN ÉCONOMIE POLITIQUE. Un problème d'une nature analogue à celle du précédent s'est posé en économie politique, et a dû être résolu par cette science. Il sera utile que nous en donnions un rapide aperçu, pour nous préparer à la solution beaucoup plus difficile du problème sociologique. En économie politique, nous pouvons déterminer l'équilibre sous la condition que chaque individu obtienne le maximum d'ophélimité. Les liaisons peuvent être données de telle sorte que cet équilibre soit parfaitement déterminé. Maintenant, si l'on supprime quelques liaisons, cette détermination unique cessera, et l'équilibre sera possible en une infinité de points pour lesquels les maxima d'ophélimité individuels sont atteints. Dans le premier cas, seuls étaient possibles les mouvements qui amenaient au point d'équilibre déterminé ; dans le second, d'autres mouvements sont possibles aussi. Ces derniers sont de deux genres bien distincts. Dans le premier genre, que nous nommerons P, les mouvements sont tels qu'en agissant dans l'intérêt de certains individus, on nuit nécessairement à d'autres. Dans le second genre, que nous nommerons Q, les mouvements sont tels que l'on agit dans l'intérêt, ou au détriment de tous les individus, sans exception. Les points P sont déterminés lorsqu'on égale à zéro une certaine somme de quantités homogènes dépendant des ophélimités hétérogènes [FN: § 2128-1].
§ 2129. La considération des deux genres de points P et Q est d'une grande importance en économie politique. Quand la collectivité se trouve en un point Q dont elle peut s'éloigner à l'avantage de tous les individus, en leur procurant à tous de plus grandes jouissances, il est manifeste qu'au point de vue économique et si l'on ne recherche que l'avantage de tous les individus qui composent la collectivité, il convient de ne pas s'arrêter en un tel point, mais de continuer à s'en éloigner tant que c'est à l'avantage de tous. Lorsque ensuite ou arrive en un point P où cela n'est plus possible, il faut, pour s'arrêter on pour continuer, recourir à d'autres considérations, étrangères à l'économie ; c'est-à-dire qu'il faut décider, au moyen de considérations d'utilité sociale, éthiques ou autres quelconques, dans l'intérêt de quels individus il convient d'agir, en en sacrifiant d'autres. Au point de vue exclusivement économique, une fois la collectivité parvenue en un point P, il convient qu'elle s'arrête. Ce point a donc, dans le phénomène, un rôle analogue à celui du point où l'on obtient le maximum d'ophélimité individuel, et auquel, par conséquent, l'individu s'arrête. À cause de cette analogie, on l'appelle : point du maximum d'ophélimité pour la collectivité [FN: § 2129-1]. Mais, comme d'habitude, il n'y a rien à déduire de l'étymologie de ces termes (§ 2076) ; et pour éviter le danger toujours imminent de divagations de cette sorte, nous continuerons à nommer ce point, point P.
§ 2130. Si une collectivité pouvait être considérée comme une personne, elle aurait un maximum d'ophélimité, ainsi que l'a cette personne ; c'est-à-dire qu'il y aurait des points où l'ophélimité de la collectivité serait maxima. Ces points différeraient des points Q indiqués au § 2128. En effet, puisqu'il est possible de s'éloigner de ces points à l'avantage de tous les individus de la collectivité, il est évident que, de cette façon, on peut faire croître l'ophélimité de la collectivité. Mais on ne peut pas dire que ces points coïncideraient avec les points P. Considérons une collectivité constituée par deux individus, A et B. Nous pouvons nous éloigner d'un certain point P, en ajoutant 5 à l'ophélimité de A et en retranchant 2 de l'ophélimité de B, nous portant ainsi en un point s ; ou bien ajoutant 2 à l'ophélimité de A, et retranchant 1 à l'ophélimité de B, nous portant ainsi en un point t. Nous ne pouvons pas savoir auquel de ces deux points s, t, l'ophélimité de la collectivité sera plus grande ou moins grande, tant qu'on ne nous dit pas de quelle façon on peut comparer les ophélimités de A et de B ; et c'est précisément parce qu'on ne peut les comparer, parce qu'elles sont des quantités hétérogènes, que le maximum d'ophélimité de la collectivité n'existe pas ; tandis qu'au contraire le maximum d'ophélimité pour la collectivité peut exister, puisqu'on le détermine indépendamment de toute comparaison entre les ophélimités d'individus différents.
§ 2131. LE MAXIMUM D'UTILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ, EN SOCIOLOGIE [FN: § 2131-1]. Étendons les considérations précédentes à la sociologie. Chaque individu, dans la mesure où il agit logiquement, s'efforce d'obtenir un maximum d'utilité individuelle, ainsi que nous l'avons indiqué au § 2122. Si nous supposons qu'une partie des liaisons qu'impose l'autorité publique sont supprimées, sans être remplacées par d'autres, une infinité de positions d'équilibre deviennent possibles avec les conditions de maxima individuels indiquées plus haut. L'autorité publique intervient pour en imposer quelques-unes et en exclure d'autres. Supposons qu'elle agisse logiquement et dans le seul dessein d'obtenir une certaine utilité. Cela a lieu bien rarement, mais il n'est pas nécessaire de nous préoccuper ici de ce fait, puisque nous considérons, non pas un cas réel et concret, mais bien un cas théorique et hypothétique. Pour ce cas, l'autorité publique doit nécessairement comparer les différentes utilités ; il n'est pas nécessaire de rechercher maintenant d'après quels critères. Lorsque, par exemple, elle met en prison le voleur, elle compare les souffrances qu'elle lui impose avec l'utilité qui en résulte pour les honnêtes gens, et elle estime grosso modo que cette utilité compense au moins ces souffrances ; autrement, elle laisserait courir le voleur [FN: § 2131-2] . Pour abréger, nous n'avons comparé ici que deux utilités ; mais il va sans dire que, tant bien que mal, et souvent plutôt mal que bien, l'autorité compare toutes les utilités dont elle peut avoir connaissance. En somme, elle accomplit grossièrement l'opération que l'économie pure effectue avec rigueur, et, au moyen de certains coefficients, elle rend homogènes des quantités hétérogènes. Cela fait, on peut additionner les quantités obtenues. et déterminer, par conséquent, des points du genre P.
§ 2132. En pratique, on se rend compte de tout cela, plus ou moins bien, souvent mal, très mal, et l'on dit que l'autorité publique doit s'arrêter au point à partir duquel, en continuant, elle ne procurerait aucun « avantage » à toute la collectivité ; qu'elle ne doit pas infliger de souffrances « inutiles » à la collectivité entière ni à une partie de la collectivité ; qu'elle doit agir tant qu'elle peut dans l'intérêt de cette collectivité, sans que ce soit au détriment du but qu'elle a en vue « pour le bien public » ; qu'elle doit « proportionner » l'effort au but, et ne pas imposer de lourds sacrifices avec de petits « avantages ». La définition précédente a pour objet de substituer des considérations rigoureuses à ces expressions manquant de toute précision et fallacieuses par leur indétermination.
§ 2133. En économie pure, on ne peut pas considérer une collectivité comme une personne ; en sociologie, on peut considérer une collectivité, sinon comme une personne, au moins comme une unité. L'ophélimité d'une collectivité n'existe pas. On peut, à la rigueur, envisager l'utilité d'une collectivité. C'est pourquoi, en économie pure, il n'y a pas danger de confondre le maximum d'ophélimité pour une collectivité avec le maximum d'ophélimité d'une collectivité, lequel n'existe pas ; tandis qu'en sociologie, il faut faire bien attention de ne pas confondre le maximum d'utilité pour une collectivité avec le maximum d'utilité d'une collectivité, puisque tous deux existent.
§ 2134. Considérons, par exemple, l'augmentation de la population. Si l'on fixe son attention sur l'utilité de la collectivité, il sera bon, surtout pour sa puissance militaire et politique, de pousser la population jusqu'à la limite, assez élevée, au delà de laquelle la nation s'appauvrirait et la race tomberait en décadence. Mais si nous attachons notre esprit au maximum d'utilité pour la collectivité, nous trouverons une limite beaucoup plus basse [FN: § 2134-1] . Il y aura lieu de rechercher en quelles proportions les différentes classes sociales jouissent de cette augmentation de puissance militaire et politique, et en quelle proportion diverse elles l'acquièrent par leurs sacrifices. Quand les prolétaires disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, lesquels ne font qu'accroître le pouvoir et les gains des classes gouvernantes, ils parlent d'un problème de maximum d'utilité pour la collectivité. Peu importent les dérivations dont ils usent, telles que celles de la religion du socialisme ou du pacifisme : il faut regarder ce qu'il y a dessous. Les classes gouvernantes répondent souvent en confondant un problème de maximum de la collectivité avec le problème de maximum pour la collectivité. Elles essaient aussi de ramener le problème à la recherche d'un maximum d'utilité individuelle, en tâchant de faire croire aux classes gouvernées qu'il y a une utilité indirecte, laquelle, si l'on en tient dûment compte, change en avantage le sacrifice que l'on demande à ces classes. Effectivement, cela peut arriver quelquefois ; mais cela n'arrive pas toujours ; et nombreux sont les cas où, même en tenant largement compte des avantages indirects, il résulte, non pas un avantage, mais bien un sacrifice pour les classes gouvernées. En réalité, seules les actions non-logiques sont capables de faire qu'en ces cas les classes gouvernées, oubliant le maximum d'utilité individuelle, se rapprochent du maximum d'utilité de la collectivité, ou bien seulement de celui de la classe gouvernante. Celle-ci a très souvent compris ce fait par intuition.
§ 2135. Supposons une collectivité en des conditions telles qu'il n'y ait pour elle d'autre choix que d'être très riche avec une grande inégalité de revenus pour ses membres, ou bien d'être pauvre avec des revenus presque égaux. La recherche du maximum d'utilité de la collectivité peut faire approcher du premier état ; celle du maximum pour la collectivité peut faire approcher du second. Nous disons peut, parce que l'effet dépendra des coefficients employés pour rendre homogènes les utilités hétérogènes des différentes classes sociales. L'admirateur du « surhomme » assignera à l'utilité des classes inférieures un coefficient presque égal à zéro, et obtiendra un point d'équilibre qui se rapproche beaucoup du premier état. L'homme entiché de l'égalité assignera à l’utilité des classes inférieures un coefficient élevé, et obtiendra un point d'équilibre qui se rapprochera beaucoup du second état. Nous n'avons pas d'autre critère que le sentiment, pour choisir entre l'un et l'autre état.
§ 2136. Il existe une théorie – nous ne recherchons pas ici jusqu'à quel point elle concorde avec les faits – suivant laquelle l'esclavage fut une condition nécessaire du progrès social, parce que – dit-on – il a permis à un certain nombre d'hommes de vivre dans les loisirs, et par conséquent de s'occuper de recherches intellectuelles. Cela étant admis pour un moment, celui qui veut résoudre un problème de maximum d'utilité de l'espèce et regarde seulement à l'utilité de l'espèce, décidera que l'esclavage a été « utile »; celui qui veut résoudre aussi un problème de ce genre, mais regarde seulement à l'utilité des hommes réduits en esclavage, décidera que l'esclavage a été nuisible, et il laissera de côté, pour le moment, certains effets indirects. On ne peut demander : « Qui a raison ? Qui a tort ? » parce que ces termes n'ont pas de sens, tant qu'on n'a pas choisi un critère pour établir la comparaison entre ces deux décisions (§ 17).
§ 2137. De là nous devons conclure, non pas qu'il est impossible de résoudre des problèmes qui considèrent en même temps différentes utilités hétérogènes, mais bien que, pour traiter de ces utilités hétérogènes, il faut admettre quelque hypothèse qui les rende comparables. Lorsque cette hypothèse fait défaut, ce qui arrive très souvent, traiter de ces problèmes est absolument vain ; c'est simplement une dérivation dont ou recouvre certains sentiments, sur lesquels seuls, par conséquent, nous devrons fixer notre attention, sans trop nous soucier de leur enveloppe.
§ 2138. Même dans les cas où l'utilité de l'individu n'est pas en opposition avec celle de la collectivité, les points de maximum de la première et les points de maximum de la seconde ne coïncident habituellement pas. Revenons, pour un moment, au cas particulier étudié aux § 1897 et sv. Soit, pour un individu donné, A le point extrême qui représente l'observation très stricte de tout précepte existant dans la société, B un autre point extrême qui représente la transgression des préceptes qui ne sont pas reconnus comme proprement indispensables, mnp la courbe d'utilité de l'individu, lequel commence à éprouver un dommage en A, puis obtient un avantage qui devient maximum en n, qui diminue ensuite et se change en un dommage en B. D'une manière analogue, soit srv, la courbe de l'utilité qu'obtient la société, par le fait que l'individu considéré observe plus ou moins bien les préceptes. Cette utilité a un maximum en r. Au point q, intermédiaire entre A et B, on a, pour l'individu, le maximum d'utilité qn. Au point t, intermédiaire aussi entre A et B, on a le maximum d'utilité tr de la collectivité, lequel est obtenu par le fait de l'individu considéré [FN: § 2138-1] .

Figure 36
§ 2139. Au lieu d'un seul individu, on peut en considérer plusieurs qui aient à peu près la même courbe d'utilité m, n, p ; et alors la courbe srv d'utilité de la collectivité dont font partie les individus mentionnés, sera celle que l'on obtient en tenant compte des actions de ces individus. Au lieu de simples transgressions aux règles existant dans une société, considérons les transformations de ces règles et les innovations qui s'accomplissent dans la société. Nombreux sont les cas où t est beaucoup plus rapproché de B que q ; autrement dit, dans le cas de certains individus, il est avantageux pour la société que l'innovation soit plus grande que celle qui donnerait le maximum d'utilité à ces individus. Par exemple, les individus déjà riches et puissants ont souvent peu à gagner s'ils innovent, tandis que la société peut retirer grand avantage de leurs innovations. Ou bien encore : pour les individus aimant la vie tranquille, t est beaucoup plus près de B que q ; c'est-à-dire que, pour eux, toute innovation, qui d'ailleurs peut être utile à la société, leur est désagréable, pénible. Tout au contraire, pour les « spéculateurs », t est beaucoup plus loin de B que q ; c'est-à-dire que les spéculateurs tendent à innover plus qu'il n'est utile à la société. De cette façon, si nous considérons différentes catégories d'individus, on comprend qu'entre leurs actes il puisse y avoir une certaine compensation, grâce à laquelle, chacun tirant de son côté, il résulte une position toute proche de t, où l'on a le maximum d'utilité de la société.
§ 2140. RÉSIDUS ET DÉRIVATIONS EN RAPPORT AVEC L'UTILITÉ. Précédemment (§ 2123) nous avons considéré par abstraction certaines choses qui pouvaient agir sur l'équilibre social. Maintenant nous spécifions et considérons principalement les résidus et les dérivations. Nous avons déjà traité un sujet analogue, lorsque nous recherchions les mesures capables d'atteindre un certain but (§ 1825 et sv.). Le problème a été alors considéré qualitativement, et nous n'avons pas pu pousser bien avant, parce que la définition de l'utilité nous manquait « 2111 et sv.). Les mouvements virtuels ont été considérés, en général, par rapport à un but quelconque, et seulement d'une manière subordonnée par rapport à l'utilité. Maintenant, nous nous occuperons principalement de l'utilité.
§ 2141. Comme préparation à notre étude, laissons de côté pour un moment la société humaine, et supposons deux types extrêmes de sociétés abstraites. 1° Une société où agissent exclusivement les sentiments, sans raisonnements d'aucun genre. Très probablement, les sociétés animales se rapprochent beaucoup de ce type. 2° Une société où agissent exclusivement les raisonnements logico-expérimentaux. En recourant à l'intuition visuelle du § 1869, nous dirons que, dans le premier cas, les individus se portent instinctivement de h en m (fig. 29), sans raisonner, sans avoir en vue un but idéal T ; par conséquent, la tangente hT n'existe pas. Dans le second cas, les individus se portent de h en m, en vertu du seul raisonnement, et la tangente cesse d'exister, parce qu'elle se transforme en l'arc de courbe hm.
§ 2142. Dans le cas du premier type, la forme de la société est déterminée si l'on donne les sentiments et les circonstances extérieures dans lesquelles se trouve la société, ou bien si l'on donne seulement les circonstances, et si l'on ajoute la détermination des sentiments, au moyen des circonstances. Le darwinisme, poussé à l'extrême, donnait la solution complète du problème par le théorème de la survivance des individus les mieux adaptés aux circonstances [FN: § 2142-1] (§ 828, 1770). Pourtant, même en ce cas si simple, le voile qui recouvre ces sujets n'était pas entièrement déchiré. Tout d'abord, on pouvait demander : « Comment peut-il bien se trouver sur le même sol tant de variétés d'animaux ? L'une des espèces devrait être mieux adaptée que les autres, et les avoir par conséquent détruites. Ensuite, sous cette expression « mieux adaptée » se cachent les mêmes difficultés que nous avons rencontrées, quand nous avons traité de l'« utilité ». Le « mieux adapté » en vue de la prospérité individuelle peut ne pas être le «mieux adapté » en vue de la prospérité de l'espèce. Voyez, par exemple, les souris : elles subsistent uniquement grâce à leur extraordinaire fécondité. Supposons qu'il naisse certaines souris mieux adaptées que les autres pour fuir les pièges de l'homme, mais qui soient en même temps d'une moindre fécondité. Il se pourra qu'échappant aux pièges, elles se substituent à d'autres souris, puis qu'en raison de leur moindre fécondité l'espèce disparaisse.
§ 2143. Dans le cas du 2e type, la forme de la société n'est pas du tout déterminée lorsqu'on donne les circonstances extérieures ; il faut encore indiquer quel est le but que doit atteindre la société au moyen du raisonnement logico-expérimental. N'en déplaise aux humanitaires et aux positivistes, une société déterminée exclusivement par la « raison » n'existe pas et ne peut exister ; et cela, non pas parce que les « préjugés » des hommes les empêchent de suivre les enseignements de la « raison », mais parce que les données du problème que l'on veut résoudre par le raisonnement logico-expérimental font défaut (§ 1878, 1880 à 1882). Ici apparaît de nouveau l'indétermination de la notion d'utilité, indétermination que nous avons rencontrée déjà, lorsque nous avons voulu définir l'utilité (§ 2111). Les notions que les différents individus ont au sujet de ce qui est bien pour eux-mêmes ou pour autrui sont essentiellement hétérogènes, et il n'y a pas moyen de les réduire à l'unité.
§ 2144. Ce fait est nié par ceux qui croient connaître l'absolu. Ils ramènent toutes les opinions des hommes à la leur, car ils éliminent les autres par les procédés des dérivations, procédés dont nous avons donné de nombreux exemples ; mais cette élimination n'a de valeur que pour ces personnes et pour leurs adeptes, tandis que les autres hommes demeurent d'un avis différent.
§ 2145. Même les réformateurs de la société ne remarquent habituellement pas et négligent le fait de la diversité d'opinions des hommes, au sujet de l'utilité. C'est parce qu'ils tirent implicitement de leurs propres sentiments les données dont ils ont besoin. Ils disent et croient résoudre un problème objectif, qui est celui-ci : « Quelle est la meilleure forme sociale ? » ; tandis qu'ils résolvent, au contraire, ce problème subjectif : « Quelle est la forme qui satisfait le mieux mes sentiments ? [FN: § 2145-1] » Naturellement, le réformateur estime que ses sentiments doivent être ceux de tous les honnêtes gens, et que ces sentiments sont, non seulement excellents de leur propre nature, mais aussi très utiles à la société. Malheureusement, cette croyance ne change rien à la réalité.
§ 2146. La société humaine se trouve en un état intermédiaire des deux types indiqués tout à l'heure. Sa forme est déterminée, non seulement par les circonstances extérieures, mais aussi par les sentiments, les intérêts, les raisonnements logico-expérimentaux ayant pour but d'obtenir la satisfaction des sentiments et des intérêts, et aussi, d'une manière subordonnée, par les dérivations qui expriment, et parfois fortifient des sentiments et des intérêts, et qui servent, en certains cas, de moyen de propagande. Les raisonnements logico-expérimentaux ont une grande valeur, lorsque le but est donné et que l'on cherche les moyens propres à l'atteindre. Par conséquent, ils sont employés avec succès dans les arts et métiers, en agriculture, dans l'industrie, dans le commerce. Ainsi, à côté de nombreuses sciences techniques, on a pu constituer une science générale des intérêts, l'économie, qui suppose ces raisonnements employés exclusivement dans certaines branches de l'activité humaine. Ces raisonnements trouvent aussi leur application à la guerre, et ont donné naissance à la stratégie et à d'autres sciences semblables. Ils pourraient aussi s'appliquer à la science du gouvernement ; mais, jusqu'à présent, ils ont été employés comme arts individuels de gouverner, plutôt que pour constituer une science abstraite ; cela parce que le but n'est pas déterminé, ou que, s'il est déterminé, on ne veut pas le dévoiler. En général, pour ces motifs et pour d'autres, les raisonnements logico-expérimentaux ont joué un rôle effacé dans l'organisation de la société. Il n'y a pas encore de théories scientifiques en cette matière, et pour tout ce qui s'y rattache, les hommes sont mus beaucoup plus par les sentiments que par les raisonnements. Un certain nombre de personnes savent tirer profit de cette circonstance et s'en servir pour satisfaire leurs intérêts ; ce faisant, de temps à autre, elles utilisent opportunément des raisonnements en partie empiriques et en partie logico-expérimentaux.
§ 2147. Presque tous les raisonnements dont on fait usage en matière sociale sont des dérivations. Souvent, leur partie la plus importante est celle que l'on tait, qui est implicite (§ 1876), à peine mentionnée. En la recherchant, c'est-à-dire en étudiant de quels principes les conclusions pourraient bien être une conséquence, on peut, en de nombreux cas, parvenir à la connaissance des sentiments et des intérêts qui font accepter les conclusions auxquelles aboutit la dérivation. Pour mieux connaître la nature de ces dérivations, étudions deux exemples. Nous ne pourrons examiner que quelques-uns des principes implicites qu'on peut y supposer, parce que, à vouloir les chercher tous, on devrait prêter attention à l'infinité de motifs qui déterminent les opinions des hommes. Nos raisonnements sont strictement bornés aux dérivations et ne visent pas le fond du sujet. À ce propos, le lecteur voudra bien se rappeler le paragraphe (III-m) de la table III.
Exemple I. Examinons l'apologue bien connu, de Bastiat, au sujet de l'usage d'un rabot [FN: § 2147-1] , et la manière dont Bastiat se sert de cet apologue, dans sa controverse avec Proudhon [FN: § 2147-2] . La dérivation apparaît déjà dans le sujet de cette controverse. On veut savoir si l'intérêt du capital est légitime ou non [FN: § 2147-3] , et aucun des deux interlocuteurs n'essaie même de définir ce terme de légitime. Pour Bastiat, il semble que légitime veuille dire en accord avec ses sentiments, lesquels, par une dérivation des moins dissimulées (§ 591 et sv.), deviennent ceux de tous les hommes. Proudhon a aussi cette notion, mais il en ajoute un grand nombre d'autres semblables, pour mettre ses théories en accord avec les sentiments des personnes auxquelles il s'adresse [FN: § 2147-4] (dérivations de la IIIe classe), et cet accord s'établit facilement, car il a lieu entre des choses indéterminées que l'on étire comme on veut et jusqu'où l'on veut. Bastiat et Proudhon sont d'accord que le prêt est un service [FN: § 2147-5], mais ni l'un ni l'autre ne définit ce qu'il entend précisément par ce terme, et il arrive naturellement que chacun d'eux tire des conclusions différentes de la proposition qu'ils ont admise tous deux. Chez Bastiat domine l'idée que celui qui a rendu un « service » a « droit » à une rémunération. Chez Proudhon domine l'idée que les hommes d'une société se rendent mutuellement des « services », et que, par conséquent, leurs « droits » à des rémunérations se compensent. Ces propositions peuvent être vraies ou fausses, suivant le sens des termes qui y sont employés ; elles sont du genre des propositions du droit naturel. Proudhon indique ensuite un moyen pratique de réaliser cette compensation des rémunérations ; mais nous n'avons pas à nous occuper ici de ce sujet. Examinons seulement le principe implicite d'après lequel il faut d'abord reconnaître à quelle organisation s'appliquent la « justice » et le « droit », puis, d'une manière subordonnée, quel est, en pratique, le moyen de trouver cette organisation [FN: § 2147-6). Si le principe était exposé explicitement, aussitôt surgiraient les nombreux problèmes sur les multiples utilités, et sur les rapports dans lesquels elles peuvent se trouver avec les règles, quelles
qu'elles soient, qui portent les noms de « justice » et de « droit ». Les deux interlocuteurs ont quelque intuition de ces problèmes, et s'efforcent de démontrer – avec peu de succès, il est vrai – l'identité de la « justice » et du « droit » avec une « utilité » fort mal définie [FN: § 2147-7). Bastiat fait usage d'une dérivation très usitée, et qui consiste à présenter un exemple hypothétique en guise de démonstration (§ 1409). L'exemple peut trouver sa place dans les raisonnements logico-expérimentaux, s'il est donné uniquement pour faire mieux comprendre l'idée de l'auteur, mais jamais à titre de démonstration. Le syllogisme complet serait : un phénomène A supposé a pour conséquence B ; les phénomènes réels sont égaux ou semblables à A dans la partie que nous considérons ; donc, ils auront pour conséquence B. Mais en citant seul l'exemple hypothétique : A a pour conséquence B, on supprime souvent la proposition qu'il importerait le plus de démontrer, à savoir que les phénomènes réels sont égaux ou semblables à A ; et on laisse la conclusion implicite pour dissimuler cette suppression (§ 1406). L'exemple hypothétique de Bastiat est donné précisément par l'apologue du rabot ; mais on ne peut pas reprocher à l'auteur de supprimer la proposition affirmant que l'exemple est le type du phénomène réel, car il l'exprime clairement [FN: § 2147-8] . En revanche, on peut dire qu'il se trompe et que la réalité est différente. Bastiat réduit à deux les parties en présence : un homme qui a une scie et un rabot, et un autre homme qui veut faire des planches. Cette réduction va trop loin en ce qui concerne la ressemblance avec les phénomènes réels. On se rapprocherait un peu de la vérité en considérant trois hommes : un qui utilise les planches, deux qui les produisent, dont l'un n'a que ses deux mains pour travailler, et l'autre a la scie et le rabot. Cette petite modification de l'hypothèse suffit à changer entièrement les conclusions de Bastiat, même en acceptant sa façon de les tirer. Elles subsistent uniquement pour le consommateur, dans ses rapports avec le groupe des deux producteurs, mais elles n'ont plus aucune valeur pour répartir entre eux le produit de leur travail. En effet, le travailleur n'a aucun besoin de planches ; il est donc inutile de lui dire qu'en un an il en ferait une, à peine, sans la scie et le rabot, et qu'au contraire il en fait cent avec ces instruments. Le problème à résoudre est différent. Il y a un travail commun de l'ouvrier et du capitaliste, et l'on veut connaître en quelle proportion le produit de ce travail doit être réparti entre eux. Ce problème est insoluble, si l'on ne définit pas rigoureusement le terme doit, et l'apologue de Bastiat ne nous est, par conséquent, d'aucun secours. Celui qui estime que le produit doit revenir au « capital », tiendra pour usurpée la part qui va à l'ouvrier, en sus de ce qui est strictement nécessaire pour le maintenir dans des conditions telles qu'il puisse travailler, et il conclura en faveur de l'esclavage, ou de toute autre organisation donnant un maximum de bénéfice au capitaliste. Celui qui estime que le produit doit revenir au « travail », tiendra pour usurpée la part que prend le capital ; il l'appellera plus-value et nommera sur-travail le travail auquel il correspond. Celui qui estime que le produit doit revenir non pas aux individus qui l'obtiennent, mais à la société, qui assure à ces individus les conditions sans lesquelles ils ne pourraient produire, celui-là jugera que le produit revient à la société, qui le répartit ensuite au mieux. Celui qui estime que le produit doit se partager suivant certaines règles, par exemple selon celles de la libre concurrence, estimera qu'il faut laisser l'ouvrier et le capitaliste débattre entre eux ce partage. Et ainsi de suite, on aura autant de solutions que l'on assignera de sens au terme doit. Nous aurons d'autres solutions encore, si nous supposons que le terme doit sous-entend qu'on atteint certains buts d'utilité sociale. Par exemple, on pourrait rechercher quelles règles de répartition correspondent à un maximum de puissance politique et militaire du pays, quelles sont celles qui correspondent à un maximum de jouissances pour une collectivité déterminée, et ainsi de suite. On ne peut déclarer « vraie » ni « fausse » en elle-même aucune de ces solutions ; et ce n'est qu'après qu'on aura énoncé avec précision ce qu'on entend par ce terme doit, qu'on pourra rechercher si la solution proposée est ou non une conséquence de cette définition.
Il reste à résoudre de nombreux problèmes sur les critères d'après lesquels on détermine qui est le consommateur, qui l'ouvrier, qui le capitaliste, et sur les conséquences de ces critères. Pour les individus présentant tels caractères, il peut y avoir, par exemple, des castes rigoureusement fermées ; ou bien il se peut que l'on passe de l'une à l'autre, et il reste encore à voir jusqu'à quel point, dans la réalité, on observe ce qui est légalement possible (§ 2046). D'autres problèmes surgissent encore ici, tels ceux, très importants, de l'hérédité. La possession du rabot fabriqué par Jacques doit-elle passer, oui ou non, à son fils, ou à d'autres personnes choisies par lui ? [FN: § 2147-9) Il est difficile d'affirmer que tous ces moyens de procéder sont indifférents en ce qui concerne les effets économiques ; mais enfin, si l'on tient à l'affirmer, soit, pourvu qu'on le dise explicitement ; et lorsqu'on ne cherche pas à supprimer ainsi l'étude des problèmes qui se posent par le fait qu'on envisage les effets économiques des différents modes de circulation entre les classes sociales, il faut examiner les solutions de ces problèmes, et faire connaître ce qu'on en pense. Les difficultés qui naissent de cette indétermination sont habituellement évitées de la manière indiquée plus haut, c'est-à-dire en séparant entièrement les problèmes économiques des autres problèmes sociaux, sans d'ailleurs qu'on explique clairement quels seront les effets réciproques des différentes solutions. En présence de l'affirmation explicite signalée tout à l'heure, on trouve dans le raisonnement de Bastiat un grand nombre de propositions implicites. Quand il fait intervenir un contrat entre Jacques et Guillaume, au sujet du rabot, il suppose implicitement la liberté de contracter, tandis qu'on discute précisément si elle doit ou non exister. Pour dissimuler ce défaut de raisonnement, il a recours à la « morale » ; mais à quelle « morale » ? À celle qui est en usage dans les sociétés où cette liberté existe en partie ; par conséquent, tournant en cercle, il donne, comme démonstration, en général, de certaines règles de la « morale », ces règles mêmes, établies sous l'influence d'une société particulière. Mais comme d'autre part notre société n'admet qu'en partie la liberté des contrats, sa « morale » renferme aussi des principes contraires à cette liberté, et les adversaires de Bastiat peuvent en tirer, avec tout autant de raison, des conséquences opposées à celles que tire Bastiat.
D'une façon générale, soient A et B, deux sociétés dans lesquelles les règles de répartition du produit entre les capitalistes et les travailleurs sont différentes. Celui qui envisage le problème uniquement sous son aspect économique, admet implicitement que cette différence de répartition n'a pas d'effet sur l'organisation sociale, et que, par celle-ci, elle ne réagit pas sur l'organisation économique (§ 2203 et sv.). Cela peut être, mais il faut le démontrer, parce que cela pourrait aussi ne pas être ; et quand, de fait, cela ne serait pas, nous aurions à résoudre un très grand nombre de problèmes qu'implicitement le raisonnement de Bastiat suppose négligeables, en les passant sous silence. Les dérivations de Bastiat sont, comme il arrive d'habitude, essentiellement qualitatives ; elles négligent la composition des résidus et des dérivations (§ 2087 et sv.) ; mais nous ferons mieux comprendre cela par l'exemple suivant.
Exemple II Vers la fin de l'année 1913, à Saverne en Alsace, un conflit éclata entre les autorités militaires et les autorités civiles. Pour maintenir l'ordre, les premières agirent indépendamment des secondes.
Nous n'entendons nullement nous occuper ici du fond des faits, lequel est un cas particulier d'un problème général qui sera étudié plus loin (§ 2174 et sv.), ni des caractères de légalité – ou d'illégalité – que peuvent présenter ces faits. Nous consacrons la présente étude exclusivement aux dérivations auxquelles ils ont donné naissance [FN: § 2147-10] . Ces dérivations furent semblables, grosso modo, à celles que provoqua l'affaire Dreyfus (§ 1779) ; mais elles eurent un effet bien différent, parce que la solidité des organisations conservatrices, en Allemagne (§ 2218), rendit impossible le bouleversement social que leur désagrégation permit en France [FN: § 2147-11). Au fond, dans l'un et l'autre cas se trouvaient en présence ceux qui veulent que l'habileté civile et la force révolutionnaire prédominent sur la force militaire du gouvernement, et d'autre part, ceux qui ne veulent pas que cela ait lieu [FN: § 2147-12). Désignons par A et B les deux états indiqués de cette manière. L'individu qui en choisit un, mu uniquement par la foi en certains de ses principes abstraits, se met en dehors du domaine logico-expérimental, et nous n'avons pas à nous occuper de lui. Bien au contraire, nous devrons prêter attention à ses actes, s'il se range dans ce domaine, en affirmant, par exemple, que sa solution assure quelques-unes des différentes utilités de l'individu et de la société. C'est là une proposition qui concerne exclusivement la science logico-expérimentale, et, pour en traiter, il est nécessaire de résoudre des problèmes analogues à ceux dont nous avons parlé aux § 1897 et sv. Ils sont ignorés ou résolus explicitement dans les dérivations. Celui qui affirme que l'intervention des autorités militaires est condamnable uniquement parce qu'elle est contraire à la légalité, aux droits individuels, à la Démocratie ou au Progrès, affirme par là implicitement, ou bien qu'il faut s'occuper uniquement de ces entités, sans se soucier de leurs utilités diverses [FN: § 2147-13) ou bien que la solution obtenue en cherchant à être en accord avec ces entités, concorde avec la solution qui serait donnée par les utilités que l'on veut considérer. On peut en dire autant à l'égard de qui approuve l'intervention des autorités militaires, uniquement parce qu'elle est en accord avec certains de ses principes à lui. Il n'est pas fait la moindre allusion à tout cela, dans les dérivations. Les solutions de ces problèmes sont ou bien entièrement omises, ou bien implicites. Pour donner une forme un peu plus concrète à ces considérations, fixons notre attention sur l'une des utilités, sur la puissance militaire du pays, et considérons les deux états de choses qu'on pourrait présentement appeler germanique et latin, mais dont il faudrait intervertir les noms, si nous traitions du temps où eut lieu la bataille de Iéna (§ 2364). En l'état de choses latin, on admet que l'autorité militaire doit être l'humble servante de l'autorité civile ; en l'état de choses germanique, on admet qu'elle est au-dessus de l'autorité civile. En France, le préfet a le pas sur le général ; en Prusse, non seulement le général, mais tout officier a le pas sur toute autorité civile [FN: § 2147-14] . En l'état de choses latin, on veut que si la force révolutionnaire, ou même seulement populaire, se trouve en opposition avec la force militaire du gouvernement, la première ait tous les droits et la seconde tous les devoirs, et surtout celui de tout souffrir avant de faire usage des armes : injures, coups, lapidation, tout est excusé si cela vient du peuple, tandis qu'il est absolument interdit de réagir à la force armée du gouvernement. Le peuple est toujours excusable ; parce qu'il est « excité » par la seule présence de la force publique, il peut s'abandonner impunément à toute impulsion. Au contraire, la force publique doit avoir une patience inépuisable [FN: § 2147-15] : frappée sur une joue, elle doit présenter l'autre ; les soldats doivent être autant de saints ascètes ; on ne comprend pas pourquoi on leur met en main un fusil ou un sabre plutôt qu'un rosaire du saint Progrès. L'état de choses germanique est l'opposé. La force militaire doit être absolument respectée par tout le monde. Quiconque a les nerfs facilement excités à la seule vue de cette force, fait bien de rester chez soi ; autrement il apprendra à ses dépens que, comme disait Bebel à ses partisans, les balles frappent et les sabres coupent. Réagir contre les insultes ou les coups n'est pas seulement une permission pour la force publique : c'est une obligation. Un officier est déshonoré s'il essuie impunément la plus légère violence. Ce sont ceux qui ont insulté la force publique qui doivent faire preuve de patience. Quand cette force publique réagit, elle se préoccupe uniquement d'imposer le respect à ses adversaires.
Le principe de « ne pas résister au mal » est totalement inconnu dans l'armée prussienne, et dans toute l'armée allemande : officiers et soldats savent que s'ils portent des armes, c'est pour s'en servir lorsque c'est nécessaire, et pour se faire respecter. En Allemagne, il est absolument impossible qu'il se produise un fait semblable à celui qui eut lieu en France, lorsque le ministre de la marine Pelletan, se rendant à un arsenal pour le visiter, était avec un amiral dans une voiture derrière laquelle les ouvriers de l'arsenal criaient à tue-tête « ... et nos balles seront pour les amiraux ! » Les Allemands peuvent avoir tort, mais ils n'admettent pas cela. La défense de la patrie, sa puissance militaire, sont-elles également assurées par l'un et l'autre de ces deux états de choses ? Et si elles ne le sont pas, lequel des deux états de choses leur est le plus favorable ? Ces problèmes ne sont pas parmi les principaux sur lesquels portent les dérivations favorables à l'état de choses latin ; ils occupent, au contraire, la première place, mais sont résolus a priori, dans les dérivations favorables à l'état de choses germanique [FN: § 2147-16). Le motif de cette différence consiste probablement en ce qu'il est facile de saisir comment l'état de choses germanique est favorable à la puissance militaire du pays, tandis qu'il est difficile de le saisir pour l'état de choses latin. Malgré les différences de l'intuition, on ne peut en toute rigueur exclure a priori que l'état de choses latin soit également favorable ou plus favorable que l'état de choses germanique, à la puissance militaire du pays ; mais pour accepter de semblables affirmations, il serait nécessaire au moins d'avoir un commencement de démonstration, lequel fait totalement défaut dans les dérivations favorables à l'état de choses latin [FN: § 2147-17). Et là, on voit bien comment les dérivations peuvent se passer de la logique : les mêmes Français qui déplorent les maux des Alsaciens-Lorrains conquis par l'Allemagne, s'efforcent, sans s'en apercevoir, de détruire la puissance militaire de leur propre pays, c'est-à-dire de provoquer de nouvelles conquêtes allemandes. Ils se plaignent d'un mal et veulent l'étendre. Le défaut de logique disparaîtrait si, dans les dérivations, on devait sous-entendre cette proposition : qu'elles visent non à l'utilité présente, mais à celle de l'avenir, et cette autre proposition, que la conquête peut être un mal temporaire et un bienfait futur. On a vu des exemples de ce fait dans les conquêtes romaines ; il n'est donc pas impossible. Reste à démontrer qu'il se produira effectivement. On pourrait considérer aussi d'autres utilités, par exemple celles de certaines collectivités. Il est évident que l'état de choses latin est favorable aux collectivités qui veulent agir contre la loi ou contre l'arbitraire gouvernemental. Pour imposer leur volonté, il suffit qu'elles aient le courage de descendre dans la rue. L'état de choses germanique est favorable au maintien de l'ordre, du respect de la loi, et aussi de l'arbitraire et des crimes de ceux qui gouvernent. Là aussi apparaissent les dérivations. Du côté de ceux qui veulent renverser le régime social actuel, on estime que ce renversement est toujours un « bien »; et la croyance se raffermit avec les mythes de la sainte Démocratie, de même qu'en intervertissant les rôles, elle se raffermirait avec les mythes de la sainte Aristocratie ou de la sainte Monarchie, si les révolutionnaires étaient aristocrates ou monarchistes. Du côté de ceux qui veulent maintenir l'état social actuel ou qui en font leur profit, on emploie moins de dérivations, parce que celui qui détient le pouvoir n'a pas besoin de beaucoup de raisonnements pour inciter ses subordonnés à l'action. On se sert des dérivations seulement quand on croit opportun de justifier ses actes, et pour briser l'opposition de ceux qui mordent à cet hameçon. D'habitude, ces dérivations visent à montrer que le maintien de l'ordre légal, avec lequel on confond visiblement l'arbitraire des gouvernants, est le « bien » suprême, auquel on doit tout sacrifier ; ou bien elles invoquent le principe que la fin justifie les moyens ; et pour les gouvernants, quel meilleur but peut-il y avoir que de se maintenir au pouvoir et d'en tirer profit ? [FN: § 2147-18) Si dans la suite il éclate un conflit de nations différentes, par exemple en des cas semblables à celui de Saverne, personne, dans la nation dominatrice, n'oserait mettre en doute que le but suprême est le maintien de cette domination. La foi nationaliste est en cela identique à la foi musulmane, à la foi chrétienne, à la foi démocratique et à tant d'autres fois imaginables. Il s'y ajoute des mythes en très grand nombre, par lesquels on démontre clair comme le jour que la nation dominatrice est digne de dominer, et que la nation assujettie ne mérite autre chose que la sujétion. Depuis le temps où la Rome antique proclamait la légitimité de sa domination sur les peuples vaincus, jusqu'à nos jours où les nations dites civilisées « démontrent » qu'il est légitime, juste, convenable, utile et, ajoutent celles qui sont chrétiennes, conforme à la volonté du Seigneur, qu'elles dominent, exploitent, oppriment, détruisent les nations auxquelles il leur plaît de refuser le nom de civilisées, on trouve en nombre immense des dérivations du genre indiqué, lesquelles, sous d'autres noms, répètent presque toutes les mêmes choses.
Aussi bien ceux qui préconisent l'état de choses latin que ceux qui préconisent l'état de choses germanique, négligent entièrement le problème quantitatif (§ 2174 et sv.). Les forces et les liaisons qui déterminent l'état A sont possibles de même que les forces et les liaisons qui déterminent l'état B, puisque, en réalité, on observe ces deux états. Mais des forces et des liaisons qui déterminent un état intermédiaire C sont-elles aussi possibles ? Si non, pour connaître où se trouve le maximum d'utilité, il suffit de comparer A et B [FN: § 2147-19). Si oui, pour connaître ce maximum, il faut comparer A, C, B. Dans le cas spécial que nous examinons, cela revient à rechercher jusqu'à quel point, pour atteindre certains buts, il faut donner de l'importance et de la force à l'armée, par rapport aux autorités civiles. Et si l'on fait cette recherche, on obtiendra des résultats qui, à première vue, sembleront paradoxaux : que l'état de choses latin, préconisé par les démocrates, pourrait bien, en dernière analyse, être funeste à la démocratie, soit par la conquête étrangère, soit par un acheminement vers l'anarchie, qui a été déjà le tombeau de tant de démocraties. Semblablement, on verra que l'état de choses germanique, préconisé par les monarchistes, pourrait bien, en dernière analyse, être funeste à la monarchie. Un état intermédiaire C pourrait peut-être mieux que A et que B atteindre les buts visés par quelques-uns de ceux qui préconisent ces états extrêmes. Quiconque veut traiter scientifiquement le sujet doit considérer au moins une partie de ces problèmes et d'autres semblables ; et plus il en considérera, meilleur sera son raisonnement, au point de vue logico-expérimental. Au contraire, celui qui cherche à persuader autrui, à pousser les hommes à agir, doit s'abstenir de ces recherches, non seulement parce qu'elles ne peuvent être comprises du vulgaire auquel on s'adresse, mais aussi, comme nous l'avons dit tant de fois, parce qu'elles favoriseraient le scepticisme scientifique, qui est contraire à l'action énergique et résolue du croyant ; et, au point de vue de l'efficacité des dérivations, son langage sera d'autant meilleur qu'il considérera moins de problèmes scientifiques et qu'il possédera plus l'art de les dissimuler et de les voiler.
§ 2148. COMPOSITION DES UTILITÉS, DES RÉSIDUS ET DES DÉRIVATIONS. Pour connaître les utilités complexes qui résultent de la composition des résidus et des dérivations, nous poursuivrons le raisonnement commencé au § 2087, lorsque nous avons considéré d'une manière synthétique l'action des résidus et des dérivations. La matière n'est pas facile ; par conséquent, il ne faut refuser aucun secours, même s'il nous vient d'analogies imparfaites. Faisons donc appel, comme nous l'avons fait déjà, à l'intuition visuelle (§ 1869), non pour démontrer quoi que ce soit, car ce serait une grave erreur, mais uniquement pour mieux comprendre les raisonnements abstraits. Afin de pouvoir faire usage de figures graphiques dans l'espace à trois dimensions, supposons que l'état d'un individu soit tel qu'on puisse le représenter par un point h d'une surface dont l'ordonnée sur un plan horizontal représente l'indice de l'ophélimité dont jouit l'individu. En projection horizontale, l'état de l'individu est donc représenté par le point h, et si l'on fait une section verticale qui passe par h, on obtient la droite gl, qui est la section du plan horizontal de projection, la courbe To, qui est la section de la surface, et l'ordonnée ph, qui est l'indice de l'utilité dont jouit l'individu (§ 1869). Le point h est soumis aux forces de direction A, B,... et d'intensité α, β, ..., ainsi qu'il a été dit au § 2087 il doit toujours se maintenir sur la surface que nous avons supposée, et qui est déterminée par les liaisons.

Figure 37
§ 2149. Parlons maintenant, non plus de l'ophélimité d'un individu, mais de l'utilité d'une collectivité, et supposons que la fig. 37 s'applique au cas de cette utilité. Supposons que le point h se trouve dans la position où l'on obtient le maximum d'utilité de la collectivité. Il se peut que sur la droite hA il y ait un point h' où l'utilité de la collectivité soit plus grande qu'en h ; par conséquent l'idée surgit spontanément qu'il est bon de faire croître , pour porter la collectivité au point h'. Telle est la façon dont on raisonne habituellement en matières sociales.
§ 2150. Mais si l'équilibre était possible en h', l'hypothèse suivant laquelle h est un point de maximum d'utilité de la collectivité, ne correspondrait pas à la réalité. Selon cette hypothèse, l'équilibre n'est possible en aucun autre point voisin de h, et où l'utilité de la collectivité serait plus grande ; donc il n'est pas possible en h'. Par conséquent, faire croître α portera le point d'équilibre, non pas en h', mais bien en un point tel que h", où l'utilité de la collectivité est moindre. Cela se produit parce que l'augmentation de α pour conséquence de modifier β, γ, ...; et ici apparaît le second genre de mutuelle dépendance des résidus (§ 2088).
§ 2151. Le raisonnement que nous venons d'exposer ne dépend nullement des hypothèses que nous avons faites pour représenter dans un espace à trois dimensions la position du point h, ni de n'importe quelle autre représentation analogue. Ce raisonnement peut donc être répété indépendamment de ces hypothèses, et la conclusion s'applique au cas général de l'utilité dépendante des résidus.

Figure 38
§ 2152. Ajoutons maintenant la considération des dérivations, et appliquons au cas général le raisonnement tenu au § 1869, en un cas particulier. Reproduisons la fig. 37 du § 2148, en y ajoutant les dérivations S, T, U, V, ..., ou si l'on veut, les mythes, les idéologies, qui poussent les hommes à agir suivant les directions A, B, C,... mus par les forces α, β, γ,... La section verticale est supposée faite selon hBT. La force β selon hB, provient de ce que les hommes visent à un but imaginaire T ; et si cette force agissait seule, elle porterait l'individu au point m. Mais si l'équilibre est obtenu au point h, l'effet de cette force est compensé, détruit par ceux des autres forces. Cela a lieu aussi bien si h est un point de maximum d'utilité, que s'il est un point quelconque, pourvu qu'il soit un point d'équilibre.
§ 2153. Maintenant, nous pouvons répéter, en introduisant la considération de l'utilité, les observations faites au § 2088. 1° Si l'on a un motif d'admettre que B, agissant seul, ferait croître l'utilité, il ne s'ensuit nullement qu'en agissant à l'encontre des autres résidus, et en rapport de subordination avec les liaisons, il aurait encore pour effet une augmentation d'utilité. 2° La variation de l'utilité dépend de l'action de la résultante des forces manifestées par les résidus ; elle ne dépend pas de la résultante imaginaire des dérivations, si toutefois elle est concevable. La résultante réelle est bien différente : elle indique la direction dans laquelle se meuvent les individus, dans une société où existent les dérivations considérées ; et dans cette direction, on peut se rapprocher de la réalité beaucoup plus que ne l'indique toute dérivation considérée à part (§ 1772) ; il en est de même pour l'utilité. Cela a lieu effectivement dans les sociétés où l'activité des hommes est orientée davantage vers le réel, moins vers la fantaisie, et où la prospérité augmente. 3° Il ne faut pas attacher trop d'importance au fait que la dérivation, dépassant les limites de la réalité, vise un but imaginaire qu'on peut, en conséquence, tenir à juste titre pour nuisible. La dérivation indique seulement la direction dans laquelle le mouvement tend à se produire, et non pas la limite où arrivera l'individu. Celui-ci arrivé à cette limite, l'utilité peut s'être accrue, tandis qu'elle diminuerait ensuite et se changerait en désavantage, si l'individu poussait au-delà, du côté de la dérivation. 4° Soient A, B,..., certains résidus d'une même classe (I) ; P, Q, R,. d'autres résidus d'une autre classe (II). Soient encore X, la résultante des résidus A, B, C,. de la classe (I), Y la résultante des résidus P, Q, R,... de la classe (I), et ainsi de suite. Soit enfin omega, la résultante totale de toutes les forces X, Y,.... laquelle détermine le mouvement réel et par conséquent l'utilité. Si l'on n'a pas l'utilité – ou le dommage – qui découlerait des résidus A considérés à part, cela n'a pas lieu parce que A n'agit pas, et moins encore parce qu'on a réfuté valablement une dérivation qui correspond à A ; mais à cause de l'opposition des résidus B, C,... P, Q,... En outre, en vertu de la propriété de l'ensemble d’une classe A, B,. de demeurer presque constante, A peut diminuer beaucoup, disparaître même, sans que X varie beaucoup, et sans que, comme conséquence, la résultante omega et l'utilité qu'elle engendre varient beaucoup. On reconnaît bien mieux les variations de omega et de l'utilité, en prêtant attention aux variations des résultantes X, Y,... qu'en s'attachant aux variations de l'un quelconque des résidus A, B,.. P, Q,....

Figure 39
§ 2154. De même, nous pourrons appliquer à l'utilité les observations présentées au § 2086, à propos des différentes dérivations T, T’, T",…, correspondant à un même résidu B. 1° Puisque ce sont les résidus qui agissent principalement sur l'équilibre, on ne peut conclure de l'existence d'une des différentes dérivations T, T', T",. , que peu de choses ou rien au sujet de l'utilité. 2° La substitution de T' à T a peu ou point d'effet pour modifier l'utilité. 3° Mais le fait que celui qui doit agir juge au contraire très utile la dérivation T acceptée par lui, et tient les autres pour nuisibles, ce fait peut être avantageux ; ou, pour mieux dire, les sentiments manifestés de cette façon peuvent être utiles. En effet, hormis un petit nombre d'ascètes, les hommes se résolvent difficilement à distinguer l'utilité, de ce qu'ils estiment être « bon ». Par conséquent, s'ils estiment vraiment « bonne » la dérivation T, ils la jugent de même « utile » ; et si cela n'avait pas lieu, ce serait un indice qu'ils n'ont pas grande foi en cette dérivation. Ce qu'il y a d'imaginaire et de nuisible en cette croyance, est ensuite corrigé par les autres croyances qui existent aussi dans la société [FN: § 2154-1] (§ 1772, 2153). 4° Si d'une manière intrinsèque, au point de vue logico-expérimental, une dérivation semble pouvoir mieux que d'autres accroître l'utilité, on ne peut en conclure qu'il en sera ainsi en réalité. Il se pourrait encore que la dérivation qui, en elle-même, paraît plus utile, corresponde à des sentiments moins avantageux que ceux auxquels correspond une dérivation qui, en elle-même, paraît moins utile. Toutes les propositions que nous venons d'énoncer sont en contradiction avec l'opinion vulgaire ; mais l'expérience fait voir qu'elles concordent avec les faits.
§ 2155. Il résulte aussi de ce que nous avons exposé que le problème de l'utilité est quantitatif, et non qualitatif, comme on le croit habituellement. Il faut rechercher en quelles proportions les conséquences d'une certaine dérivation S (fig. 38), ou du principe auquel elles aboutissent, peuvent être utiles à la société, combinées avec les conséquences d'autres dérivations, T, U, V,…, et non pas, ainsi qu'on a coutume de le faire, si S est utile ou nuisible à la société, problème qui peut n'avoir aucun sens. Généralement, les dérivations ne tiennent aucun compte de ces considérations quantitatives, pour les motifs, tant de fois indiqués, qui les font viser à l'absolu (§ 1772) ; et quand une dérivation finit par proclamer un certain principe, l'affirmation que l'on doit s'y rallier d'une manière absolue, sans restrictions de quantité ou d'autre sorte, est presque toujours implicite.
Il sera utile d'ajouter à ces raisonnements abstraits des considérations de nature beaucoup plus concrète, et à l'énoncé de propositions générales, d'ajouter des exemples de cas particuliers. Nous commencerons par examiner un cas important où se mêlent, sans distinction bien nette, les raisonnements sur des buts idéaux T et les raisonnements sur des buts réels ; puis nous verrons différents cas d'utilités complexes.
§ 2156. L'HISTOIRE. Nous avons vu (§ 1580) que les ouvrages qui portent ce nom sont habituellement un composé de divers genres d'observations, auxquelles s'ajoutent des dérivations et des considérations éthiques, sans que les buts que vise l'auteur et les mythes T soient bien séparés des faits réels m (fig. 29). D'une façon générale, on peut dire que, jusqu'à présent, on a fait l'histoire des dérivations plutôt que celle des résidus, l'histoire des conceptions T, plutôt que celle des forces manifestées par ces conceptions.
§ 2157. C'est fort bien quand l'histoire se rapproche plus ou moins d'une composition qui a pour but d'agir sur les sentiments des hommes (§ 1580), quand l'exhortation se mêle plus ou moins à l'observation expérimentale ; mais il faut évidemment faire usage d'un autre procédé quand l'histoire a pour but exclusif ou du moins principal de décrire les faits réels et leurs rapports.
§ 2158. Si l'on considère exclusivement et d'une manière intrinsèque les conceptions, les buts idéaux, les mythes, on obtient des éthiques, des métaphysiques, des théologies. Si l'on considère exclusivement des faits réels, et en conséquence uniquement comme tels les conceptions, les buts idéaux, les mythes, on obtient des études de science expérimentale ou, pour leur donner un nom (§ 119), des histoires scientifiques (§ 1580, 2076).
§ 2159. Les compositions qui sont aptes à persuader les gens, à émouvoir les sentiments, à entraîner les hommes dans une voie déterminée, sont un mélange des deux catégories précédentes, parce que l'esprit humain demande, en proportions variables, l'idéal et le réel. Ces proportions varient en un temps donné et en un pays donné, suivant les individus, et, si l'on considère la moyenne des individus, en divers pays et en des temps différents, ces proportions ont une marche rythmique, comme c'est le cas de presque tous les phénomènes sociaux.
§ 2160. Dans nos contrées et à notre époque, les histoires théologiques sont tombées en désuétude, tandis que les histoires métaphysiques et les histoires éthiques continuent à jouir d'un grand crédit, qui parait bien devoir se maintenir encore longtemps [FN: § 2160-1]. Parfois ces caractères théologiques, métaphysiques, éthiques sont explicitement avoués par les auteurs; mais aujourd'hui cela arrive rarement. Plus souvent, les auteurs ne distinguent pas les différentes parties dont se compose leur histoire (§ 1582) ; ils ont recours à l'amphibologie du terme vérité historique (§ 1578), pour dissimuler ce mélange ; ils n'expriment pas clairement que, suivant leur conception, ce sont les dérivations qui déterminent les formes sociales ; mais ils font en sorte que cette propriété des dérivations soit une conséquence implicite de la proposition, tenue pour axiomatique, suivant laquelle les actions des hommes sont une conséquence de leurs croyances.
§ 2161. Voyons dans quels rapports se trouvent les écrits de ces auteurs avec la science logico-expérimentale. Celui qui attribue une origine surnaturelle à la religion respecte du moins la logique formelle, en donnant à la religion la valeur de cause première des phénomènes sociaux. Au contraire, celui qui attribue une origine terrestre à la religion doit, s'il veut aussi rester uniquement dans le domaine de la logique formelle, expliquer comment et pourquoi la religion est une cause et non un effet. Quand, par exemple, les adversaires de la religion chrétienne la rendent responsable de la dissolution de l'empire romain, il leur reste encore à nous expliquer pourquoi la propagation de cette religion a été une cause et non un effet de cette dissolution, et aussi pourquoi ces phénomènes ne peuvent pas être envisagés comme simplement concomitants. Celui qui affirme que les concepts moraux sont imprimés par Dieu dans l'esprit de l'homme, peut sans autre les attribuer comme cause première aux phénomènes sociaux. En outre, il n'a aucun besoin de rechercher si, quand et dans quelle mesure il convient aux hommes de les suivre : ils obéissent à l'ordre de Dieu, cela suffit ; ils n'ont pas à se préoccuper d'autre chose. Mais quiconque sort de cette forteresse, inexpugnable en face de la logique formelle, et veut attribuer la morale comme cause aux phénomènes sociaux, doit premièrement expliquer, comme dans le cas précédent, pourquoi elle est une cause et non un effet ou un phénomène concomitant. Ensuite, il faut qu'il dise quelle solution il entend donner au problème posé au § 1897 ; autrement dit, il faut qu'il dise en quel rapport il estime que se trouvent certaines règles de morale ou d'une autre discipline avec l'utilité sociale. Celui qui fait une étude de cas de conscience n'a pas besoin d'énoncer cela, ni celui qui fait exclusivement une étude des phénomènes sociaux sans établir une dépendance entre eux et les cas de conscience. Mais celui qui mélange les deux études doit exprimer dans quel rapport il veut les placer : quel pont il entend construire pour passer de l'une à l'autre.
§ 2162. Les historiens ont coutume de s'abstenir de donner ces explications, parce qu'ils veulent se soustraire à l'entreprise difficile, ou mieux impossible, de démontrer la solution qu'ils adoptent. Ils se contentent d'admettre implicitement que le fait de suivre les règles de la morale a toujours pour conséquence l'utilité sociale (solutions affirmatives, § 1903 à 1998). Ils trouvent créance, parce que cette proposition est vraie, très en gros, pour les actions des simples particuliers, et parce que, grâce à la persistance des agrégats, on l'étend au gouvernement de la chose publique. Le fait de disjoindre, de cette façon, les différentes parties du phénomène social et d'admettre des solutions implicites pour les parties qu'on ne prend pas en considération, ce fait a pour l'auteur le grand avantage de faciliter l'étude de la partie dont il traite, puisqu'il peut l'envisager seule, et d'obtenir plus facilement pour ses conclusions l'approbation du public, puisqu'elles supposent implicitement certaines solutions qui sont assez généralement acceptées. C'est pourquoi le procédé indiqué n'est pas employé seulement par les historiens, mais aussi par les économistes (§ 2147) et par d'autres auteurs qui étudient les phénomènes sociaux. Il se compose de deux parties. La première consiste dans la disjonction des différents éléments du phénomène social ; la seconde consiste à admettre pour les éléments qu'on ne prend pas en considération des solutions implicites presque toujours en accord avec les sentiments du public auquel s'adresse le discours. Au point de vue logico-expérimental, la première partie de l'opération est admissible, elle est même indispensable ; car autrement on ne pourrait pas étudier le phénomène. Ainsi que nous l'avons dit et répété tant de fois, la science est essentiellement analytique. Mais la seconde partie de l'opération appartient aux dérivations et nous fait sortir entièrement du domaine logico-expérimental, où il n'y a aucune place pour des propositions implicites dictées par le sentiment, et où l'on ne peut trouver que des faits et des déductions de faits. La science logico-expérimentale repousse donc absolument les solutions implicites qui appartiennent aux sentiments, et dont les dérivations font et doivent faire très largement usage ; elle y substitue des solutions explicites, obtenues exclusivement en considérant les faits.
Les historiens ont aussi coutume de s'attarder à juger au point de vue éthique et légal les actions des hommes publics, et comme d'habitude sans énoncer sur quelles règles éthiques, sur quelles lois ils fondent leur jugement. Là encore leurs prémisses sont implicites ; on les accepte parce que, grâce à la persistance des agrégats, elles s'étendent en dehors du domaine où s'appliquent les règles et les lois qui régissent les relations entre particuliers. Bien qu'en de bien moindres proportions ce phénomène est semblable à celui où les règles juridiques établies pour les hommes sont étendues aux animaux. On a longuement discuté si César avait ou non le « droit » de franchir le Rubicon. Résoudre aujourd'hui ce problème est à peu près aussi utile à l'étude de l'histoire et des phénomènes sociaux, que de donner une réponse à la célèbre question posée au moyen âge : utrum chimaera, bombinans in vacuo, possit comedere secundas intentiones; mais ce peut être un exercice utile à l'étude abstraite du droit public romain.
§ 2163. Pour un grand nombre d'historiens, c'est un article de foi que Napoléon III commit un crime, en faisant le coup d'État qui lui donna le pouvoir. Cela peut être ou non, suivant le sens, qu'on donnera au terme crime. Dans les rapports entre particuliers, il est défini par le code pénal, par les lois, par la jurisprudence ; mais de quel code, de quelles lois, de quelle jurisprudence veut-on faire usage pour juger les faits politiques ? Il faut l'énoncer clairement. Il ne suffit pas de dire, comme le font beaucoup de personnes, que c'est un crime de renverser tout gouvernement légitime, parce qu'ensuite il faudrait définir ce qu'est un gouvernement légitime. En vérité, de Louis XVI à Napoléon III, et de Napoléon III à la République, ce fut une succession ininterrompue de gouvernements qui surgissaient en en renversant un autre, soi-disant légitime, et qui affirmaient ensuite être tout aussi légitimes et même davantage. Nous ne pouvons rien décider, tant qu'on ne nous dit pas d'après quelles règles on doit juger ces contestations ; et quand bien même nous le saurions, et que ce jugement serait rendu, on ne voit pas bien en quoi il pourrait servir le moins du monde à accroître nos connaissances des phénomènes sociaux et de leurs rapports. Le lecteur voudra bien remarquer que nous avons eu la discrétion de nous arrêter à Louis XVI ; mais nous pouvions remonter plus haut, et rechercher la légitimité du pouvoir royal, constitué sur les ruines de la féodalité, la légitimité du pouvoir de Pépin, des rois francs, des conquérants romains des Gaules, et ainsi de suite à l'infini. On peut remédier à l'absurdité de ces recherches en admettant la prescription ; mais reste à en fixer le terme. Sera-t-il de trente ans, comme en France pour la propriété privée ? ou bien d'un autre nombre d'années ? Et puis, quelle est l'autorité qui le détermine ? Et par quels moyens se fera-t-elle obéir ? Vues à la lumière des règles de la morale et du droit privé, les mœurs de Catherine II de Russie étaient condamnables, tout au moins répréhensibles, et les actes accomplis par elle en vue de s'assurer le trône, criminels [FN: § 2163-1] . Mais ce jugement-là n’est pas en rapport de dépendance très étroite avec les phénomènes sociaux et leurs relations. Par exemple, il ne nous sert de rien pour résoudre cette question : aurait-il été plus utile à la Russie que ce fût le mari de Catherine qui régnât, plutôt que Catherine elle-même ? Élisabeth d'Angleterre voulait paraître chaste ; or, il paraît qu'elle ne le fût pas. Quel rapport cela peut-il bien avoir avec l'évolution sociale, en Angleterre, au temps de cette reine ? Ces faits ont du rapport avec l'histoire, non par la valeur éthique qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes, mais comme circonstances concomitantes de certains événements, ou parce qu'ils en déterminent certains autres. Parmi ces circonstances, on peut mentionner aussi la valeur éthique extrinsèque, c'est-à-dire le jugement que des personnes mêlées aux événements portent sur ces actes. Mais en cela il faut procéder avec prudence et se tenir sur ses gardes, car, très souvent, ce n'est pas le jugement qu'on porte qui agit sur les événements, mais bien les événements sur ce jugement, lequel est bienveillant ou sévère, selon les sentiments que l'on éprouve, d'autre part, envers les personnes que l'on juge. L'affaire du collier a beaucoup nui à Marie-Antoinette ; il semble pourtant qu'elle n'y fut en rien fautive. Au contraire, des faits bien autrement scandaleux et certains n'avaient jusqu'alors pas nui aux membres de la famille royale de France. En politique surtout, le scandale nuit au faible et cause peu d'ennuis au fort. On petit en voir des exemples chaque jour.
§ 2164. M. Aulard, quand il traite du troisième volume de Taine et en cite la préface, adresse deux critiques à l'auteur : de n'avoir pas été assez exact, et d'avoir négligé plusieurs documents. Au point de vue de l'histoire des phénomènes sociaux, ni l'une ni l'autre de ces critiques ne tient debout. Les inexactitudes incriminées n'ont rien de fondamental. Elles peuvent avoir de l'importance parfois pour porter un jugement éthique sur les hommes ; elles importent peu ou point à l'histoire des phénomènes sociaux [FN: § 2164-1]. Les documents cités par Taine sont plutôt trop que pas assez nombreux. Il n'est pas nécessaire de tant de preuves pour savoir que dans la Révolution française, comme en tant d'autres révolutions, les politiciens dérobèrent à pleines mains et supprimèrent par la mort leurs ennemis. Et quiconque prête attention aux procédés des politiciens, en des temps tranquilles, s'aperçoit facilement que leurs faits et gestes, en temps de révolution, démontrent l'existence de forces qui, d'une époque à l'autre, diffèrent seulement par leur intensité. Taine croit, au contraire, qu'il y a principalement une différence de qualité, et il veut accuser les politiciens de la Révolution française de fautes dont les politiciens de tous les temps et de tous les pays ne sont pas indemnes ; en outre, par une erreur plus grande encore, il cherche l'origine de ces fautes dans des raisonnements faux des politiciens.
§ 2165. M. Aulard omet ces reproches et d'autres semblables, que l'on peut adresser à l'étude de Taine. C'est probablement parce qu'en somme il suit la même voie que cet auteur, et entre eux la différence consiste uniquement en ce que le jugement éthique porté sur les Jacobins est défavorable chez Taine, favorable chez M. Aulard. Mais l'histoire n'a que faire d'un tel jugement éthique, ni dans un sens ni dans l'autre [FN: § 2165-1] . Qu'on veuille lire de suite Le Prince de Machiavel, la Cité Antique de Fustel de Coulanges, les Philippiques de Cicéron, le volume cité tout à l'heure et surtout sa préface. On ne tardera pas à voir que les deux premiers ouvrages appartiennent à une classe, les deux derniers à une autre, et qu'on ne peut confondre en aucune façon ces classes. Les premiers de ces ouvrages étudient des rapports de faits sociaux ; les derniers ont principalement en vue des jugements éthiques.
§ 2166. En somme, il n'y a pas grande différence, à propos des faits, entre les admirateurs et les détracteurs de la Révolution française. Mais les derniers disent que les hommes de la Révolution furent poussés à l'action par leur tempérament pervers ; et les premiers affirment qu'ils y furent poussés par la résistance et la perversité de leurs adversaires [FN: § 2166-1]. Il importe à peu près autant à l'histoire des phénomènes, de trancher cette question, que de savoir si César, Auguste, Cromwell et tant d'autres hommes semblables étaient honnêtes et avaient de bonnes mœurs, ou s'ils étaient malhonnêtes et avaient de mauvaises mœurs. Taine croit imiter l'homme de science qui décrit des animaux, mais il fait erreur. Son ouvrage peut ressembler à un ouvrage littéraire tel que l'histoire des animaux de Buffon, et non à un ouvrage tel que le Traité de Zoologie concrète de DELAGE et HÉROUARD. C'est à ce traité, au contraire, que ressemble la description que fait Machiavel, des exploits de Valentin.
§ 2167. Les discussions éthiques sur la Révolution française n'ont pas non plus le mérite d'être nouvelles ; elles sont absolument semblables à celles qu'on a faites, qu'on fait et qu'on fera pour toute révolution politique, sociale, religieuse. Ceux qui sont favorables à la révolution la disent « justifiée » par les machinations des adversaires des révolutionnaires. Ceux qui sont opposés à la révolution la condamnent à cause des machinations des révolutionnaires. On ne peut savoir qui a raison ou tort, si l'on ne nous dit pas premièrement quelles règles sont applicables pour absoudre ou condamner ; et quand bien même, par hypothèse, on le saurait, cette sentence procurerait peut-être un certain plaisir éthique, mais elle serait tout à tait incapable de nous faire connaître les rapports des faits politiques et sociaux ou les uniformités que l'on peut y trouver (§ 2166-1).
§ 2168. Parmi les nombreux motifs pour lesquels les historiens de la Révolution française ont suivi la voie indiquée tout à l'heure, – en quoi ils ne diffèrent pas des historiens en général – nous devons mentionner ici deux des principaux, dont l'un est subjectif et l'autre objectif. Le motif subjectif, que nous venons d'énoncer en partie, est celui pour lequel les historiens nous donnent un mélange de dissertations éthiques, de prédications, d'exhortations, d'observations de faits et des rapports de ces faits. Dans l'hypothèse la plus favorable, ces observations ne sont que l'un des buts auxquels tend l'historien, et souvent elles ne sont pas même un but, mais, au contraire, un moyen d'atteindre les autres buts. Ce motif est général et se retrouve dans presque toutes les histoires.
§ 2169. Le motif objectif est général aussi, mais il apparaît beaucoup plus dans l'histoire de la Révolution française. Il consiste en ce que chacun des partis en lutte est poussé à employer la même phraséologie, comme étant celle qui est la plus propre à agir sur le sentiment. Ainsi des dérivations identiques recouvrent des résidus différents. C'est pourquoi celui qui s'arrête aux dérivations ne peut rien connaître des forces qui agissaient en réalité. En certains cas, la contradiction est si patente qu'elle n'a pu échapper aux historiens. S'ils découvrent, par exemple, qu'Auguste fonde l'Empire en prétendant restaurer la République, et que Robespierre, adversaire de la peine de mort, en fait très largement usage, au lieu d'y voir le fait général des différences entre les dérivations et les résidus, ils ont recours à un jugement éthique sur ces hommes, en relevant les contradictions dans lesquelles ils sont tombés. Il est constant que la restauration qu'Auguste disait avoir faite de la République était un mensonge, tout comme l'humanitarisme de Robespierre. Mais si nous voulons étudier les faits, nous ne pouvons nous arrêter là, et deux questions se posent immédiatement ; l'une est de peu d'importance, l'autre en a beaucoup. La première est de savoir si Auguste ou Robespierre étaient de bonne ou de mauvaise foi, car il se pourrait encore, comme nous l'avons vu en tant d'autres cas, qu'en faisant usage des dérivations pour persuader autrui, ils se fussent persuadés eux-mêmes [FN: § 2169-1] . La seconde question qui, presque seule, importe à l'histoire, est de rechercher comment et pourquoi les sentiments et les intérêts recouverts par ces dérivations obtinrent du succès. Croit-on vraiment que les Romains furent induits en erreur par Auguste, les Français par Robespierre, comme un client est induit en erreur par le joaillier qui lui vend un diamant faux, en lui faisant croire qu'il est authentique ? Cette thèse est insoutenable. En réalité, même les personnalités d'Auguste et de Robespierre s'effacent, au moins en partie, et nous devons dire que les sentiments et les intérêts représentés par ces hommes l'emportèrent sur les sentiments et sur les intérêts représentés par d'autres hommes. Les phénomènes observés furent la résultante de tous les facteurs sociaux, parmi lesquels les dérivations jouèrent un rôle, c'est vrai, mais peu important (§ 2199).
§ 2170. L'EMPLOI DE LA FORCE DANS LA SOCIÉTÉ. En général, les sociétés existent parce que chez la plus grande partie de leurs membres, les sentiments qui correspondent aux résidus de la sociabilité (IVe classe) sont vifs et puissants. Mais il y a aussi, dans les sociétés humaines, des individus chez lesquels une partie au moins de ces sentiments s'affaiblissent et peuvent même disparaître. De là découlent deux effets très importants, et qui, en apparence, sont contraires : l'un qui menace de dissolution la société, l'autre qui en fait sortir la civilisation. Au fond, il s'agit toujours d'un mouvement, mais qui peut se produire dans différentes directions.
§ 2171. Il est évident que si le besoin d'uniformité (IV-β) était assez puissant, chez chaque individu, pour empêcher qu'un seul d'entre eux s'écartât d'une façon quelconque des uniformités existant dans la société où il vit, celle-ci n'aurait aucune cause interne de dissolution. Mais elle n'aurait pas non plus de cause de changement, soit du côté d'une augmentation, soit du côté d'une diminution de l'utilité des individus ou de la société. Au contraire, si le besoin d'uniformité faisait défaut, la société ne subsisterait pas, et chaque individu irait pour son propre compte, comme font les grands félins, les oiseaux de proie et d'autres animaux. Les sociétés qui vivent et qui changent ont donc un état intermédiaire entre ces deux extrêmes.
§ 2172. On peut concevoir une société homogène, où le besoin d'uniformité est le même chez tous les individus, et correspond à l'état intermédiaire mentionné tout à l'heure ; mais l'observation démontre que ce n'est pas le cas des sociétés humaines. Elles sont essentiellement hétérogènes, et l'état intermédiaire dont nous parlions existe parce que, chez certains individus, le besoin d'uniformité est très grand ; chez d'autres il est modéré, chez d'autres très petit, chez quelques-uns il peut même faire presque entièrement défaut, et la moyenne se trouve, non pas chez chaque individu, mais dans la collectivité de tous ces individus. On peut ajouter, comme donnée de fait, que le nombre des individus chez lesquels le besoin d'uniformité est supérieur à celui qui correspond à l'état intermédiaire de la société, est beaucoup plus grand que le nombre de ceux chez lesquels ce besoin est plus petit, immensément plus grand que le nombre de ceux où il manque entièrement.
§ 2173. Pour le lecteur qui nous a suivi jusqu'ici, il est inutile d'ajouter qu'après avoir noté les effets de la plus grande et de la moins grande puissance des sentiments d'uniformité, on peut prévoir aussitôt qu'ils auront donné naissance à deux théologies (§ 2147, exemple II), l'une exaltant l'immobilité en une certaine uniformité, réelle ou imaginaire, l'autre exaltant le mouvement dans une certaine direction. C'est en effet ce qui a eu lieu, et d'une part l'on a peuplé les Olympes populaires, où les dieux avaient fixé et établi une fois pour toutes comment devait être la société humaine ; on a peuplé les Olympes des réformateurs utopistes, qui tiraient de leur esprit transcendant le concept de la forme dont la société humaine ne devait désormais plus s'écarter. D'autre part, depuis les temps de l'antique Athènes jusqu'à nos jours, les dieux, maîtres du mouvement dans une certaine direction, exauçaient les prières des fidèles ; et maintenant ils triomphent dans notre nouvel Olympe, où règne, majestueux, l'omnipotent Progrès. De cette façon, l'état intermédiaire de la société s'établissait comme d'habitude : il était la résultante de nombreuses forces, parmi lesquelles apparaissent les deux catégories indiquées et dirigées vers des buts imaginaires divers, et correspondant à des classes diverses de résidus (§ 2152 et sv.).
§ 2174. Le problème qui recherche si l'on doit ou non employer la force dans la société, si c'est avantageux ou non, n'a pas de sens, car on fait emploi de la force, tant du côté de ceux qui veulent conserver certaines uniformités, que du côté de ceux qui veulent les transgresser [FN: § 2174-1] ; et la violence de ceux-ci s'oppose, s'attaque à la violence de ceux-là. En effet, quiconque est favorable à la classe gouvernante et dit qu'il réprouve l'emploi de la force, réprouve en réalité l'emploi de la force par les dissidents qui veulent se soustraire aux règles de l'uniformité. S'il dit qu'il approuve l'emploi de la force, en réalité, il approuve l'emploi qu'en font les autorités, pour contraindre les dissidents à l'uniformité. Vice versa, quiconque est favorable à la classe gouvernée et dit qu'il réprouve l'emploi de la force dans la société, réprouve en réalité l'emploi de la force par les autorités sociales en vue de contraindre à l'uniformité les dissidents ; et s'il loue, au contraire, l'emploi de la force, en réalité il entend l'emploi de la force par ceux qui veulent se soustraire à certaines uniformités sociales [FN: § 2174-2] .
§ 2175. Il n'a pas grand sens non plus le problème qui recherche s'il convient à la société d'employer la force, pour imposer les uniformités existantes, ou bien s'il convient de l'employer pour les transgresser ; car il est nécessaire de distinguer entre les différentes uniformités, et de voir lesquelles sont utiles, lesquelles sont nuisibles à la société. À vrai dire, cela ne suffit pas non plus, car il faut aussi examiner si l'utilité de l'uniformité est assez grande pour compenser le dommage de l'emploi de la force qui l'impose, ou bien si le dommage de l'uniformité est assez grand pour surmonter les dommages de l'emploi de la force qui la détruit (§ 2195). Parmi ces dommages, il ne faut pas négliger celui, très grave, de l'anarchie, qui serait la conséquence d'un emploi fréquent de la force pour détruire les uniformités existantes ; de même que, parmi les utilités du maintien des uniformités même nuisibles, il faut ranger le fait de donner de la force et de la stabilité à l'organisation sociale. En conséquence, pour résoudre la question de l'emploi de la force, il ne suffit pas de résoudre celle de l'utilité en général de certaines organisations : il faut aussi et surtout faire le compte de tous les avantages et de tous les dommages, soit directs, soit indirects (§ 2147, exemple II). Cette voie conduit à la solution d'un problème scientifique, mais elle peut être, et souvent est effectivement différente de celle qui conduit à un accroissement de l'utilité de la société. Par conséquent, il est bon qu'elle soit suivie par ceux qui ont à résoudre un problème scientifique, ou bien, mais en partie seulement, par certaines personnes de la classe dirigeante ; tandis qu'au contraire, pour l'utilité sociale, il est souvent bon que ceux qui sont dans la classe dirigée et qui ont à agir, acceptent, selon les cas, une des théologies : celle qui impose de conserver les uniformités existantes, ou bien celle qui persuade qu'il faut les changer.
§ 2176. Outre les difficultés théoriques, ces considérations servent à expliquer comment il se fait que les solutions qu'on donne habituellement au problème général indiqué tout à l'heure, n'ont pas grand'chose et parfois rien de commun avec la réalité. Les solutions des problèmes particuliers s'en rapprochent bien davantage, parce que, appliquées à un lieu et à un temps déterminés, elles présentent moins de difficultés théoriques, et parce que l'empirisme tient compte implicitement d'un grand nombre de circonstances que la théorie ne peut estimer explicitement, tant qu'elle n'est pas très développée. Ce n'est pas ici le lieu d'étudier l'emploi de la force, depuis les temps anciens jusqu'à l'époque moderne, ni d'examiner trop de détails. Nous nous bornerons au temps présent, et nous chercherons, très en gros, si nous pouvons trouver une formule qui donne l'image générale des faits que l'on observe. Si nous traitions d'un passé très récent, nous devrions mettre ensemble les transgressions des règles d'uniformité intellectuelles et celles de l'ordre matériel. Le temps n'est pas éloigné où elles étaient mises sur le même pied, on bien les premières estimées plus graves que les secondes. Mais aujourd'hui, hormis certaines exceptions, ce rapport est renversé, et les règles d'uniformité intellectuelles que les pouvoirs publics cherchent à imposer sont peu nombreuses. Il faut donc les considérer séparément des règles de l'ordre matériel. Nous allons parler de celles-ci ; plus loin, nous aborderons les premières (§ 2196 et sv.). Nous attachant donc aux transgressions de l'ordre matériel chez les peuples civilisés modernes, nous voyons qu'en général l'emploi de la force pour les réprimer est admis d'autant plus facilement que la transgression peut être considérée comme une anomalie individuelle, ayant pour but d'obtenir des avantages individuels ; d'autant moins que la transgression apparaît davantage comme une œuvre collective, ayant pour but des avantages collectifs, spécialement si elle tend à substituer certaines règles générales à celles qui existent.
§ 2177. Cela exprime ce qu'il y a de commun en un grand nombre de faits où l'on distingue le délit dit privé du délit dit politique. Par exemple, on établit une différence, souvent très grande, entre l'individu qui tue ou dérobe pour son propre compte, et celui qui commet les mêmes actes avec l'intention d'être utile à son parti. En général, chez les peuples civilisés, on accorde l'extradition du premier, on refuse celle du second. On a de même une indulgence toujours croissante pour les délits commis à l'occasion de grèves ou d'autres conflits économiques, sociaux, politiques. On incline toujours plus à n'opposer aux agresseurs qu'une résistance passive, en interdisant aux agents de la force publique de faire usage de leurs armes, ou en autorisant cet usage seulement en des cas d'extrême nécessité. Ces cas ne se présentent d'ailleurs jamais en pratique, parce que, tant que l'agent est en vie, on affirme que la nécessité n'est pas extrême ; et il est tout à fait inutile d'admettre ce caractère d'extrême nécessité lorsque l'agent est tué, et qu'il ne peut, par conséquent, plus profiter de la bienfaisante autorisation de faire usage de ses armes. La répression par le moyen des tribunaux se fait toujours plus molle. Les délinquants, ou bien ne sont pas condamnés, ou bien, s'ils sont condamnés, ils demeurent en liberté, grâce à la loi de « sursis » ; ou bien encore, s'ils ne profitent pas de cette loi, les réductions de peine, les grâces, les amnisties, viennent à leur secours, de telle sorte qu'ils ont peu ou rien à craindre des tribunaux (§ 2147-18). Enfin, d'une façon à vrai dire très indistincte, confuse, nébuleuse, l'idée apparaît qu'un gouvernement existant peut bien opposer une certaine force à ses adversaires, mais pas trop grande, et qu'il est toujours condamnable, si l'emploi de la force est poussé au point de donner la mort à un nombre important, souvent même à un petit nombre de ces adversaires ou à un seul ; et l'on n'admet pas non plus que le gouvernement se débarrasse de ces adversaires en les mettant en prison ou autrement. À cette formule, qui exprime d'une manière abstraite ce qui se passe d'une manière concrète, s'opposent diverses théories qui expriment ce qui devrait arriver, suivant leurs auteurs. Nous en parlerons plus loin (§ 2181 et sv.). Pour le moment, fixons notre attention sur les rapports de mutuelle dépendance entre cette façon d'employer la force, et les autres faits sociaux. Comme d'habitude, nous aurons une suite d'actions et de réactions, où l'emploi de la force apparaît parfois comme cause et parfois comme effet.
§ 2178. À l'égard des gouvernements, nous avons à considérer principalement cinq catégories de faits. 1° Un petit nombre de citoyens peuvent, pourvu qu'ils soient violents, imposer leur volonté aux gouvernants qui ne sont pas disposés à repousser cette violence par une violence pareille. L'effet voulu par ces citoyens se produit très facilement si, en n'usant pas de la force, les gouvernants sont mus principalement par des sentiments humanitaires. Si, au contraire, ils n'usent pas de la force parce qu'ils estiment plus judicieux d'employer d'autres moyens, on a souvent l'effet suivant. 2° Pour empêcher la violence ou pour y résister, la classe gouvernante recourt à la ruse, à la fraude, à la corruption et, pour le dire en un mot, le gouvernement, de lion se fait renard. La classe gouvernante s'incline devant la menace de violence, mais ne cède qu'en apparence, et s'efforce de tourner l'obstacle qu'elle ne peut surmonter ouvertement. À la longue, une telle façon d'agir produit un effet puissant sur le choix de la classe gouvernante, dont seuls les renards sont appelés à faire partie, tandis que les lions sont repoussés (§ 2227). Celui qui connaît le mieux l'art d'affaiblir ses adversaires par la corruption, de reprendre par la fraude et la tromperie ce qu'il paraissait avoir cédé à la force, celui-là est le meilleur parmi les gouvernants. Celui qui a des velléités de résistance et ne sait pas plier l'échine en temps et lieu est très mauvais parmi les gouvernants, et ne peut y demeurer que s'il compense ce défaut par d'autres qualités éminentes. 3° De cette façon, les résidus de l'instinct des combinaisons (Ie classe) se fortifient dans la classe gouvernante; ceux de la persistance des agrégats (IIe classe) s'affaiblissent, car les premiers sont précisément utiles dans l'art des expédients, pour découvrir d'ingénieuses combinaisons qu'on substituera à la résistance ouverte ; tandis que les résidus de la IIe classe inclineraient à cette résistance ouverte, et un fort sentiment de persistance des agrégats empêche la souplesse. 4° Les desseins de la classe gouvernante ne portent pas sur un temps trop lointain. La prédominance des instincts des combinaisons, l'affaiblissement de la persistance des agrégats, font que la classe gouvernante se contente davantage du présent et se soucie moins de l'avenir. L’individu prévaut, et de beaucoup, sur la famille ; le citoyen, sur la collectivité et sur la nation. Les intérêts présents ou d'un avenir prochain, ainsi que les intérêts matériels, prévalent sur les intérêts d'un avenir lointain et sur les intérêts idéaux des collectivités et de la patrie. On s'efforce de jouir du présent sans trop se soucier de l'avenir. 5° Une partie de ces phénomènes s'observent aussi dans les relations internationales. Les guerres deviennent essentiellement économiques. On tâche de les éviter avec les puissants, et l'on ne s'attaque qu'aux faibles. On considère ces guerres avant tout comme une spéculation (§ 2328). Souvent, on achemine inconsciemment le pays à ces guerres, en faisant naître des conflits économiques que l'on espère ne jamais voir tourner en conflits armés ; lesquels sont souvent imposés par des peuples où l'évolution qui conduit à la prédominance des résidus de la Ie classe n'est pas si développée.
§ 2179. À l'égard des gouvernés, on a les rapports suivants, qui correspondent en partie aux précédents. 1° S'il y a, dans la classe gouvernée, un certain nombre d'individus disposés à employer la force, et s'ils ont des chefs capables de les conduire, on observe souvent que la classe gouvernante est dépossédée, et qu'une autre prend sa place. Le fait se produit facilement si la classe gouvernante est mue surtout par des sentiments humanitaires ; très facilement, si elle ne sait s'assimiler les éléments de choix qui surgissent dans la classe gouvernée : une aristocratie humanitaire et fermée, ou peu ouverte, réalise le maximum d'instabilité. 2° Il est, au contraire, plus difficile de déposséder une classe gouvernante qui sait se servir de la ruse, de la fraude, de la corruption, d'une manière avisée. C'est très difficile, si cette classe réussit à s'assimiler le plus grand nombre de ceux qui, dans la classe gouvernée, ont les mêmes dons, savent employer les mêmes artifices, et pourraient par conséquent être les chefs de ceux qui sont disposés à faire usage de la violence. La classe gouvernée qui, de cette manière, demeure sans guide, sans habileté, sans organisation, est presque toujours impuissante à instituer quoi que ce soit de durable. 3° Ainsi, dans la classe gouvernée, les résidus de l'instinct des combinaisons s'affaiblissent un peu. Mais le phénomène n'est pas comparable à celui du renforcement de ces résidus dans la classe gouvernante, car celle-ci, étant composée d'un nombre bien moindre d'individus, change considérablement de nature si l'on y ajoute, ou si l'on y enlève un nombre restreint d'individus ; tandis que ce nombre apporte peu de changement à un total énormément plus grand. Il reste, en outre, dans la classe gouvernée, beaucoup d'individus possédant des instincts de combinaisons qui ne sont pas utilisés en politique ou dans des opérations du même ordre, mais seulement dans les arts qui en sont indépendants. Cette circonstance donne de la stabilité aux sociétés, car il suffit à la classe gouvernante de s'adjoindre un nombre restreint d'individus, pour priver de ses chefs la classe gouvernée. D'ailleurs, à la longue, la différence de nature s'accroît entre la classe gouvernante et la classe gouvernée. Chez la première, les instincts des combinaisons ont tendance à prédominer ; chez la seconde, ce sont les instincts de persistance des agrégats qui ont cette tendance. Quand la différence devient suffisamment grande, il se produit des révolutions. 4° Celles-ci donnent souvent le pouvoir à une nouvelle classe gouvernante, présentant un renforcement des instincts de persistance des agrégats ; et cette classe ajoute, par conséquent, à ses projets de jouir du présent, ceux de jouissances idéales à obtenir dans l'avenir ; le scepticisme le cède en partie à la foi. 5° Ces considérations doivent être en partie étendues aux relations internationales. Si les instincts des combinaisons se renforcent chez un certain peuple, au delà d'une certaine limite, proportionnellement aux instincts de persistance des agrégats, ce peuple peut facilement être vaincu à la guerre par un autre peuple, chez lequel ce phénomène ne s'est pas produit. La puissance d'un idéal pour mener à la victoire s'observe aussi bien dans les guerres civiles que dans les guerres internationales. Celui qui perd l'habitude d'employer la force, celui qui est habitué à juger commercialement une opération d'après son doit et son avoir en argent, celui-là est facilement incliné à acheter la paix. Il se peut que cette opération, considérée en elle-même, soit bonne, parce que la guerre aurait coûté plus d’argent que le prix payé pour la paix. Mais l'expérience démontre qu'à la longue, s'ajoutant à celles qui suivent inévitablement, cette opération a pour effet d'entraîner un peuple à sa ruine. Très rarement, le phénomène noté tout à l'heure de la prédominance des instincts des combinaisons se produit dans la population entière. D'habitude, on l'observe seulement dans les couches supérieures, et peu ou point dans les couches inférieures et plus nombreuses. Par conséquent, lorsque la guerre éclate, on demeure étonné de l'énergie dont le vulgaire fait preuve, énergie que l'on ne prévoyait nullement à considérer les couches supérieures seules. Parfois, ainsi qu'il arriva à Carthage, cette énergie ne suffit pas à sauver la patrie, parce que la guerre a été mal préparée, mal conduite par les classes dirigeantes du pays, et bien préparée, bien conduite par les classes dirigeantes de l'ennemi. D'autres fois, ainsi qu'il arriva pour les guerres de la Révolution française, l'énergie populaire suffit à sauver la patrie, parce que, si la guerre a été mal préparée par les classes dirigeantes du pays, elle a été encore plus mal préparée et plus mal conduite par les classes dirigeantes de ses ennemis ; ce qui donne le temps aux couches inférieures de la société de chasser du pouvoir leur classe dirigeante, et d'y substituer une autre, beaucoup plus énergique, et dans laquelle les instincts de persistance des agrégats se trouvent en proportions très supérieures. D'autres fois encore, ainsi qu'il arriva en Allemagne après la défaite de Iéna, l'énergie populaire se propage dans les classes supérieures, et les pousse à une action qui peut être efficace, parce qu'elle nuit à une foi vive une habile direction.
§ 2180. Les phénomènes que nous venons de noter sont les principaux ; mais il s'en ajoute un très grand nombre d'autres, secondaires. Parmi ceux-ci, il convient de remarquer que si la classe gouvernante ne sait pas, ne veut pas, ne peut pas faire usage de la force pour réprimer les transgressions des uniformités dans la vie privée, l'action anarchique des gouvernés y supplée. En histoire, c'est un fait bien connu que la vengeance privée disparaît ou reparaît, suivant que le pouvoir public abandonne ou assume la répression des délits. C'est ainsi que l'on a vu reparaître la vengeance privée sous la forme du lynchage, en Amérique et même en Europe. On observera encore que là où l'action du pouvoir public est faible, il se constitue de petits États dans le grand État, de petites sociétés dans une plus grande. De même, là où l'action de la justice publique disparaît, celle de la justice privée, sectaire, s'y substitue, et vice versa [FN: § 2180-1]. Dans les relations internationales, sous les flagorneries des déclamations humanitaires et éthiques, il n'y a que la force. Les Chinois s'estimaient supérieurs en civilisation aux Japonais (§ 2550-1), et ils l'étaient peut-être ; mais aux Chinois manquait la force militaire qui, grâce à un reste de « barbarie » féodale, ne faisait pas défaut aux Japonais. Aussi, attaqués par les hordes européennes dont les exploits en Chine rappellent, comme l'a si bien dit G. Sorel, ceux des conquistadores espagnols en Amérique, les pauvres Chinois, lorsque leur pays eut subi le meurtre, les rapines et les pillages des Européens, durent, pour comble, leur payer une indemnité, tandis que les Japonais, vainqueurs des Russes, se font respecter de tout le monde. Il y a quelques siècles, l'habileté diplomatique consommée des maîtres chrétiens de Constantinople ne les sauvait pas de la ruine que leur apportaient le fanatisme et la force des Turcs. Et maintenant, en 1913, exactement dans le même lieu, les vainqueurs, déchus de leur fanatisme et de leur force, se fiant à leur tour aux espoirs trompeurs de l'habileté diplomatique, sont vaincus et défaits par la force de leurs anciens sujets. Très grave est l'illusion des hommes politiques qui s'imaginent pouvoir suppléer par des lois inermes à l'emploi de la force armée. Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait citer, ceux de la constitution de Sulla et de la constitution conservatrice de la troisième République française suffiront. La constitution de Sulla tomba, parce qu'on ne garda pas la force armée qui pouvait la faire respecter. La constitution d'Auguste subsista, parce que les successeurs de cet empereur s'appuyèrent sur la force des légions [FN: § 2180-2] . La Commune vaincue et défaite, Thiers s'imagina que le gouvernement devait s'appuyer sur les lois plus que sur la force armée, et ses lois furent éparpillées comme feuilles au vent, par la tempête de la ploutocratie démocratique [FN: § 3] . Nous ne rappelons pas l'exemple de Louis XVI de France, qui, par son veto, croyait pouvoir arrêter la Révolution : c'était l'illusion d'un homme privé de sens et de courage [FN: § 2180-4) (§ 2201).
§ 2181. Comme d'habitude, tous ces faits apparaissent voilés par les dérivations. En un sens, nous avons des théories qui condamnent dans tous les cas l'emploi de la violence par les gouvernés ; en un autre sens, des théories qui la réprouvent si elle est employée par les gouvernants (§ 2147 18, 2174).
§ 2182. Quand on n'éprouve pas trop le besoin de faire usage de la logique, les premières théories font simplement appel, par des abstractions du genre de celles de 1'« État », à la vénération pour les hommes qui détiennent le pouvoir, et à la réprobation envers ceux qui cherchent à troubler ou à bouleverser l'ordre existant (§ 2192). Quand on estime utile de satisfaire le besoin de logique qu'éprouve l'homme, on s'efforce de créer une confusion entre l'acte de celui qui, exclusivement pour son propre compte, transgresse une uniformité fixée dans la société, et l'acte de celui qui la transgresse dans un intérêt collectif, et pour la remplacer par une autre. On cherche ainsi à étendre au second acte la réprobation dont le premier est généralement l'objet. À notre époque, on tient des raisonnements qui ont quelque rapport avec la théologie du Progrès. Plusieurs de nos gouvernements ont une origine révolutionnaire. Comment, sans renier cette origine, condamner les révolutions qu'on pourrait tenter contre eux ? On y parvient en leur attribuant un nouveau droit divin : l'insurrection était légitime contre les gouvernements du passé, qui fondaient leur pouvoir sur la force ; elle ne l'est plus contre les gouvernements modernes, qui fondent le leur sur la « raison ». Ou bien : l'insurrection était légitime contre les rois et les oligarchies ; elle ne l'est en aucun cas contre le « peuple ». Ou encore : on peut l'employer là où n'existe pas le suffrage universel ; on ne le peut plus là où l'on possède cette panacée. Et de nouveau : elle est inutile et par conséquent coupable, dans tous les pays où le « peuple » peut exprimer sa « volonté ». Enfin, pour ne pas oublier de donner quelque satisfaction à messieurs les métaphysiciens : l'insurrection n'est pas tolérable là où existe un « État de droit ». Le lecteur voudra bien nous excuser de ne pas lui définir cette belle entité : malgré toutes les recherches que nous avons faites, elle nous demeure parfaitement inconnue, et nous préférerions avoir à décrire la Chimère.
§ 2183. Toujours comme d'habitude, toutes ces dérivations sont dépourvues de sens précis. Tous les gouvernements font emploi de la force, et tous affirment être fondés sur la raison. En fait, avec ou sans suffrage universel, c'est toujours une oligarchie qui gouverne, et qui sait donner l'expression qu'elle désire à la « volonté populaire »; ainsi de la loi royale qui donnait l'imperium aux empereurs romains, ainsi des votes de la majorité d'une assemblée élue de façons diverses, ainsi du plébiscite qui donna l'Empire à Napoléon III, ainsi de tant d'autres volontés populaires, jusqu'au suffrage universel savamment guidé, acheté, manipulé par nos « spéculateurs ». Qui est ce dieu nouveau qu'on appelle « Suffrage universel » ? Il n'est pas mieux défini, pas moins mystérieux, pas moins en dehors de la réalité que tant d'autres divinités, et sa théologie ne manque pas plus qu'une autre de contradictions patentes. Les fidèles du « Suffrage universel » ne se laissent pas guider par leur dieu ; ce sont eux qui le guident, qui lui imposent les formes sous lesquelles il doit se manifester. Souvent, tandis qu'ils proclament la sainteté de la majorité, ils s'opposent par l'« obstruction » à la majorité, même s'ils ne sont qu'une petite minorité ; et tout en encensant la déesse Raison, ils ne dédaignent nullement, en certains cas, le secours de la ruse, de la fraude, de la corruption.
§ 2184. En somme, ces dérivations expriment surtout le sentiment de ceux qui, cramponnés au pouvoir, veulent le conserver, et aussi le sentiment beaucoup plus général de l'utilité de la stabilité sociale. Si, dès qu'une collectivité, petite ou grande, n'était pas satisfaite de certaines règles fixées dans la société dont elle fait partie, elle recourait aux armes pour supprimer ces règles, la société elle-même se dissoudrait. La stabilité sociale est si utile que, pour la maintenir, il est avantageux de recourir à des buts imaginaires (§ 1879, 1875), à des théologies diverses, parmi lesquelles celle du suffrage universel peut aussi trouver place, et de se résigner à souffrir certains dommages réels. Pour qu'il soit utile de troubler la stabilité sociale, il faut que ces dommages soient très graves, et comme les hommes sont guidés efficacement non par le raisonnement scientifique du sceptique, mais par des sentiments vifs qui s'expriment sous forme d'idéaux, les théories du « droit divin » des rois, des oligarchies, du « peuple », des « majorités », d'assemblées politiques, et autres semblables, peuvent être utiles entre certaines limites, et l'ont été effectivement, quelque absurdes qu'elles soient au point de vue scientifique.
§ 2185. Les théories qui approuvent l'emploi de la force par les gouvernés s'unissent presque toujours avec celles qui réprouvent cet emploi par les gouvernants. Un petit nombre de rêveurs réprouvent d'une manière générale l'emploi de la force par n'importe qui ; mais ces théories, ou bien n'ont aucun effet, ou bien n'ont que celui d'affaiblir la résistance des gouvernants, laissant le champ libre à la violence des gouvernés ; aussi pouvons-nous nous borner à considérer d'une façon générale le phénomène sous la première forme.
§ 2186. Un grand nombre de théories n'est pas nécessaire pour pousser à la résistance et à l'emploi de la force ceux qui sont on croient être opprimés. Pourtant, les dérivations sont surtout destinées à persuader ceux qui seraient neutres dans le conflit, de désapprouver la résistance des gouvernants et, par conséquent à rendre cette résistance moins vive, ou bien aussi à persuader de cette idée les gouvernants eux-mêmes; ce qui, d'ailleurs, ne peut guère réussir aujourd'hui, sauf avec les gens qui sont contaminés par l'humanitarisme. Il y a quelques siècles, on pouvait obtenir, dans nos contrées, par des dérivations religieuses, un certain succès auprès de ceux qui étaient sincèrement chrétiens, et dans d'autres contrées, par des dérivations de la religion qu'on y pratiquait, auprès de ceux qui y croyaient fermement. Comme l'humanitarisme est une religion semblable à la religion chrétienne, à la religion musulmane, etc., nous pouvons dire, d'une façon générale, que l'on peut parfois obtenir le concours des neutres et affaiblir la résistance des gouvernants, en faisant usage de dérivations de la religion, quelle qu'elle soit, si ces personnes la professent sincèrement. Mais comme les dérivations se prêtent aisément à la démonstration du pour et du contre, ce moyen est souvent peu efficace, quand il ne sert pas simplement à voiler des intérêts.
§ 2187. De notre temps, où les conflits sont surtout économiques, on accuse le gouvernement d'« intervenir » dans une contestation économique, s'il veut protéger les patrons ou les « renards », les « jaunes », contre la violence des grévistes. Si les agents de la force publique ne se laissent pas assommer sans faire usage de leurs armes, on dit qu'ils manquent de sang-froid, qu'ils sont « impulsifs, neurasthéniques ». On doit leur refuser, comme aux « renards », la faculté de faire usage de leurs armes quand ils sont attaqués par les grévistes ; car ceux-ci pourraient être tués, et le crime d'agression, même si malheureusement il existe, ne mérite pas la peine de mort (§ 2147-18). Les jugements des tribunaux sont flétris comme étant des « jugements de classe » ; en tout cas, ils sont toujours trop sévères. Enfin, il convient que les amnisties effacent tout souvenir de ces conflits. On pourrait croire que du côté des « renards », et de celui des patrons, on se sert de dérivations directement opposées, puisque les intérêts sont opposés ; mais cela n'a pas lieu, ou a lieu d'une manière atténuée, en sourdine. Pour les « renards », la cause en est qu'ils ont généralement peu de courage ; ils ne sont soulevés par aucun idéal ; ils se gênent presque de leur action, et agissent sans l'oser dire. Quant aux patrons, la cause est que beaucoup d'entre eux sont des « spéculateurs », qui espèrent se récupérer des dommages de la grève avec l'aide du gouvernement, et aux frais des consommateurs ou des contribuables. Leurs conflits avec les grévistes sont des contestations de complices qui se partagent le butin. Les grévistes, qui font partie du peuple, lequel abonde en résidus de la IIe classe, ont non seulement des intérêts, mais aussi un idéal. Les patrons « spéculateurs », qui font partie de la classe enrichie par les combinaisons, ont, au contraire, des résidus de la Ie classe à foison. Par conséquent, ils ont surtout des intérêts et point ou très peu d'idéal. Ils emploient mieux leur temps à des opérations lucratives qu'à édifier des théories. Parmi eux se trouvent plusieurs démagogues ploutocrates, habiles à faire tourner à leur profit une grève qui semblerait vraiment faite contre eux [FN: § 2187-1] .
Il y a ensuite des considérations générales qui servent aussi bien dans les conflits civils que dans les conflits internationaux, et qui reviennent à invoquer les sentiments de pitié pour les souffrances occasionnées par l'usage de la force, en faisant entièrement abstraction des causes pour lesquelles on en fait usage, et de l'utilité, ou du dommage, découlant du fait qu'on l'emploie ou non. Il s'y ajoute parfois des expressions de vénération ou du moins de compassion, pour le « prolétariat », qui jamais ne peut mal faire, ou du moins est excusable quoi qu'il fasse. Autrefois, on usait d'expressions analogues, correspondant à des sentiments analogues, en faveur du pouvoir royal, théocratique, aristocratique.
§ 2188. Il est remarquable, parce que cela concorde avec la nature essentiellement sentimentale des dérivations, que les théories qui seraient les meilleures au point de vue logico-expérimental sont habituellement négligées. Par exemple, au moyen âge, il y avait une excellente raison à donner en faveur du pouvoir clérical, lorsqu'il avait contestation avec le pouvoir impérial, royal ou du baron : c'est qu'il était presque l'unique contrepoids de ces pouvoirs, presque l'unique défense de l'intelligence, de la science, de la culture, contre la force ignorante et brutale. Mais cette raison était peu ou point invoquée, et les hommes préféraient se référer à des dérivations tirées de la doctrine de la révélation et des Saintes Écritures (§ 1617). Aujourd'hui, quand les patrons qui jouissent de la protection économique s'indignent parce que les grévistes veulent supprimer la concurrence que leur font les « jaunes », on ne répond pas qu'ils veulent empêcher d'autres de faire ce qu'ils font eux-mêmes, et qu'ils ne disent pas comment et pourquoi la libre concurrence des ouvriers est bonne, et celle des patrons mauvaise. Voici un individu qui veut passer la frontière en introduisant de la saccharine en Italie. Les douaniers accourent et empêchent par la violence cette concurrence aux fabricants de sucre, en allant, s'il le faut, jusqu'à faire usage de leurs armes, et parfois à tuer le contrebandier, que personne ne plaint ; tandis que c'est grâce à cette violence, à ces homicides, que plusieurs personnes ont pu gagner des richesses considérables, qui leur procurent de la considération, des honneurs, et jusqu'à un siège parmi les législateurs. Reste à savoir pourquoi la violence ne peut être également employée pour augmenter les salaires des ouvriers.
§ 2189. On peut objecter que la violence qui protège les intérêts des patrons est légale, et que celle dont les grévistes font usage contre les « jaunes » est illégale. Ainsi, la question n'est plus l'utilité de la violence, mais l'utilité du moyen par lequel on l'exerce, et c'est, à la vérité, une question importante. La violence légale est l'effet des règles existant dans une société, et, en général, son emploi est d'une utilité plus grande, ou d'un désavantage moindre que l'emploi de la violence privée, laquelle tend à détruire ces règles. On remarquera que les grévistes pourraient répondre, et parfois ils répondent effectivement, qu'ils font usage de la violence illégale, parce qu'on leur ôte le moyen d'employer la force légale. Si, par la violence légale, la loi contraignait quelqu'un d'autre à leur donner ce qu'ils demandent, ils n'auraient pas besoin de recourir à la violence illégale. On peut répéter cela dans un très grand nombre d'autres cas. Quiconque fait usage de la violence illégale ne désire rien de mieux que de pouvoir la transformer en violence légale.
§ 2190. Mais le sujet n'est pas épuisé ; maintenant, nous arrivons au point saillant de la question. Laissons de côté le cas particulier, et parlons d'une manière générale. C'est proprement une contestation entre la ruse et la force. Pour en décider dans le sens qu'il n'est jamais utile d'opposer la force à la ruse, en aucun cas, fût-il exceptionnel, il serait nécessaire de démontrer que toujours, sans aucune exception, l'emploi de la ruse est plus utile que celui de la force (§ 2319). Supposons que, dans un certain pays, il y ait une classe gouvernante A, qui s’assimile les meilleurs éléments de toute la population, au point de vue de la ruse. Dans ces circonstances, la classe gouvernée B est privée en grande partie de ces éléments, et par ce fait, elle ne peut avoir que peu ou point d'espoir de jamais vaincre la partie A, tant que l'on combat par la ruse. Si celle-ci était accompagnée de la force, la domination de la partie A serait perpétuelle. Mais c'est le cas d'un petit nombre d'hommes. Chez la plupart, celui qui fait emploi de la ruse est moins capable d'employer la violence, le devient toujours moins, et vice-versa. Par conséquent, si l'on accumule dans la partie A des hommes qui savent mieux se servir de la ruse, la conséquence en est qu'on accumule dans la partie B des hommes qui sont plus aptes à employer la violence. De cette façon, si le mouvement continue, l'équilibre tend à devenir instable, puisque les A sont servis par la ruse, mais qu'il leur manque le courage pour faire usage de la force, ainsi que les instruments nécessaires pour cet usage ; tandis que les B ont bien le courage et les instruments, mais l'art de s'en servir leur fait défaut. Si les B viennent à trouver des chefs qui possèdent cet art, et l'histoire nous enseigne qu'habituellement ils leur viennent de dissidents des A, ils ont tout ce qu'il faut pour remporter la victoire et chasser du pouvoir les A. Nous en avons des exemples innombrables dans l'histoire, depuis les temps les plus reculés jusqu'aux nôtres [FN: § 2190-1].
§ 2191. Il faut observer ici que souvent ce bouleversement est utile à la collectivité, surtout dans le cas où la classe gouvernante tend toujours plus à l'humanitarisme. Il l'est moins lorsqu'elle est constituée par des individus qui ont toujours plus la tendance d'employer les combinaisons au lieu de la force, moins encore, au point de devenir nuisible, si ces combinaisons ont pour conséquence, même indirecte, la prospérité matérielle de la collectivité. Supposons un pays où la classe gouvernante A tende toujours plus à l'humanitarisme, c'est-à-dire qu'elle accepte uniquement les persistances des agrégats les plus nuisibles, qu'elle repousse les autres comme de vieux préjugés, et qu'en préparant le « règne de la raison », elle devienne toujours moins capable d'user de la force, autrement dit qu'elle s'exonère du principal devoir des gouvernants. Ce pays s'achemine à une ruine complète. Mais voici que la partie gouvernée B s'insurge contre la partie A. Pour la combattre, par des discours, la partie B fait usage des dérivations humanitaires si chères à la partie A ; mais sous ces dérivations se cachent des sentiments bien différents, qui ne tardent pas à se manifester par des actes. Les B font largement usage de la force : non seulement ils dépossèdent les A, mais ils en tuent plusieurs ; et, à vrai dire, ils accomplissent ainsi une œuvre aussi utile que celle qui consiste à détruire des animaux nuisibles. Les B apportent avec eux, au gouvernement de la société, une grande somme de persistance des agrégats. Il importe peu ou point que ces persistances d'agrégats soient différentes des anciennes : il importe seulement qu'elles existent (§ 1744, 1850), et que, grâce à elles, la collectivité acquière de la stabilité et de la force. Le pays échappe à la ruine et renaît à la vie. Celui qui juge superficiellement peut-être tenté de n'arrêter son esprit qu'aux massacres et aux pillages qui accompagnent le bouleversement, sans se demander si ce ne sont pas là les manifestations, déplorables sans doute, de forces sociales et de sentiments qui sont, au contraire, très utiles. Celui qui dirait que ces massacres et ces pillages, loin d'être condamnables, sont, au contraire, l'indice que ceux qui les commirent méritaient le pouvoir, pour l'utilité de la société, celui-là exprimerait un paradoxe, parce qu'il n'existe pas de rapport de cause à effet, ni d'étroite et indispensable dépendance mutuelle entre ces maux et l'utilité de la société. Mais ce paradoxe renfermerait pourtant un grain de vérité, étant donné que les massacres et les pillages sont le signe extérieur par lequel se manifeste la substitution de gens forts et énergiques à des gens faibles et vils [FN: § 2191-1].
Nous venons de décrire d'une manière abstraite un grand nombre de bouleversements concrets, depuis celui qui donna l'Empire à Auguste jusqu'à la révolution française de 1789 (§ 2199 et sv.). Si la classe gouvernante française avait eu la foi qui conseille l'emploi de la force, et la volonté de l'employer, elle n'aurait pas été dépossédée, et, en travaillant dans son intérêt, elle aurait travaillé dans celui du pays. Puisqu'elle devint incapable d'accomplir cette tâche, il était utile qu'une autre classe se substituât à elle, et comme c'était justement l'emploi de la force qui faisait défaut, c'était une conséquence d'uniformités très générales que l'on allât à l'autre extrême, où l'on fait usage de la force, même plus qu'il n'est besoin. Si Louis XVI n'avait pas été un homme peu sensé et encore moins courageux, qui se laissa tuer sans combattre, et qui préféra porter sa tête sous la guillotine plutôt que de tomber en brave, les armes à la main, c'eût peut-être été lui qui eût détruit ses adversaires. Si les victimes des massacres de septembre, leurs parents, leurs amis, n'avaient pas été pour la plupart des humanitaires sans aucun courage ni aucune énergie, c'eût été eux qui eussent détruit leurs ennemis au lieu d'avoir attendu d'être détruits. Il était utile au pays que le gouvernement passât à ceux qui faisaient preuve de la foi et de la volonté nécessaires à l'emploi de la force. L'utilité pour la société est moins apparente lorsque la classe gouvernante est composée de gens chez lesquels prédominent les instincts des combinaisons, et même, en de certaines limites, cette utilité peut ne pas exister. Mais si la classe gouvernante perd trop les sentiments de persistance des agrégats, on arrive facilement à un point où elle n'est plus capable de défendre, non seulement son propre pouvoir, mais encore, ce qui est pis, l'indépendance du pays. Alors, si l'on croit cette indépendance utile, on doit aussi estimer utile la disparition de la classe qui ne sait plus remplir sa tâche de défense nationale. Comme d'habitude, c'est de la classe gouvernée que peuvent sortir ceux qui ont assez de foi et de volonté pour employer la force à défendre la patrie.
§ 2192. La classe gouvernante A s'efforce, de diverses façons, de maintenir son pouvoir et d'écarter le danger dont les B la menacent (§ 1827, 1838, 2394 et sv.). C'est pourquoi, tantôt elle s'efforce de se servir de la force des B, et c'est le moyen le plus efficace ; tantôt elle s'efforce d'empêcher que ses dissidents ne se mettent à la tête des B, ou plutôt de cette partie des B qui est disposée à user de la force ; mais cela est bien difficile à réaliser. Les A usent de dérivations pour calmer les B (§ 2182) : ils leur disent que « tout pouvoir vient de Dieu », que recourir à la violence est un « crime », qu'il n'y a aucun motif d'employer la force pour obtenir, si c'est « juste », ce qu'on peut obtenir par la « raison ». Cette dérivation a pour but principal d'empêcher les B de livrer bataille sur un terrain qui leur est favorable, afin de les attirer sur un autre terrain, celui de la ruse, où leur défaite est certaine, s'ils combattent contre les A qui, en fait de ruse, leur sont immensément supérieurs. Mais, comme d'habitude, l'efficacité de ces dérivations dépend en majeure partie de sentiments préexistants qu'elles expriment, et seulement en petite partie de sentiments qu'elles créent.
§ 2193. À ces dérivations il faut en opposer d'autres, ayant une efficacité analogue ; et il est bon qu'une partie des dérivations mettent en œuvre des sentiments partagés par les gens qui s'imaginent être neutres, bien qu'en réalité ils ne le soient peut-être pas, et qui voudraient ne prendre parti ni pour les A ni pour les adversaires des A, mais avoir uniquement en vue ce qui est « juste » et « honnête ». On trouve ces sentiments surtout parmi ceux qui sont manifestés par les résidus de la sociabilité (IVe classe), et plus encore parmi les sentiments de pitié (IV-γ et IV-γ 2). C'est pourquoi le plus grand nombre des dérivations qui sont favorables à la violence de la classe gouvernée, défendent cette violence plutôt indirectement que directement, en condamnant la résistance de la classe gouvernante, au nom de la sociabilité, de la pitié, de la répulsion pour les souffrances d'autrui [FN: § 2193-1]. Ces derniers sentiments sont presque les seuls qu'invoquent un grand nombre de pacifistes, lesquels, pour défendre leur thèse, ne savent faire autre chose que décrire les « horreurs de la guerre ». Souvent, aux dérivations concernant les conflits sociaux s'ajoutent les sentiments d'ascétisme, qui agissent parfois sur une partie des individus de la classe A, et peuvent par conséquent être très profitables aux B.[FN: § 2193-2]
§ 2194. En somme, toutes ces dérivations expriment surtout les sentiments de ceux qui veulent changer l'organisation sociale. Elles sont donc utiles ou nuisibles, suivant que ce changement est utile ou nuisible. Celui qui voudrait affirmer que le changement est toujours nuisible, que la stabilité est le plus grand bien, devrait, en conséquence, être prêt à démontrer, ou bien qu'il serait utile que les sociétés humaines fussent restées toujours dans un état de barbarie, ou bien que le passage de cet état à l'état civilisé présent a eu lieu ou aurait pu (§ 133 et sv.) avoir lieu sans guerres ni révolutions. Cette seconde affirmation est tellement contredite par la réalité, telle qu'elle apparaît dans l'histoire, que le simple fait d'en traiter est absurde. Reste la première affirmation, que l'on pourrait défendre en donnant un sens spécial au terme « utilité », et en accordant crédit aux théories qui célèbrent les joies de l'« état de nature ». Quiconque ne veut pas aller jusque là ne peut pas admettre non plus la première proposition ; il est donc contraint par les faits et par la logique de reconnaître que les guerres et les révolutions furent parfois utiles, ce qui, d'ailleurs, ne veut pas dire toujours. Cela étant admis pour le passé, tout fondement fait défaut pour démontrer que cela n'aura pas lieu également dans l'avenir.
§ 2195. Nous voici donc, comme d'habitude, chassés du domaine qualitatif, où dominent les dérivations, et conduits dans le domaine quantitatif de la science logico-expérimentale. On ne peut pas affirmer d'une façon générale que la stabilité soit toujours utile, ni que le changement le soit toujours. Il faut examiner chaque cas en particulier, évaluer l'utile et le nuisible, et voir si le premier surpasse le second, ou vice-versa.
§ 2196. Nous avons déjà remarqué (§ 2176) qu'en de nombreux cas, il se trouve que la stabilité est utile. Non moindre serait le nombre des cas où l'on trouverait que les transgressions aux règles existantes sont utiles, si l'on mettait ensemble les règles de l'ordre intellectuel et celles de l'ordre matériel. Mais si on les sépare, on verra que, surtout dans les transgressions qui sont l'œuvre d'un petit nombre d'individus, il est de très nombreux cas où les transgressions des règles de l'ordre intellectuel par un seul individu ou par quelques-uns sont utiles, et qu'il y a peu de cas où ces transgressions aux règles de l'ordre matériel soient utiles aussi. Or il est une formule (§ 2176) en vertu de laquelle les transgressions de l'ordre matériel doivent être d'autant plus réprimées qu'elles sont plus individuelles, d'autant moins réprimées qu'elles sont plus collectives. On voit donc qu'en un très grand nombre de cas, les effets de cette formule ne nous écartent pas trop du maximum d'utilité sociale, comme ce serait le cas si l'on appliquait aussi cette formule aux transgressions de l'ordre intellectuel. Telle est, en somme, la principale raison que l'on peut donner en faveur de ce qu'on appelle « la liberté de pensée ».
§ 2197. Les auteurs des dérivations ne l'entendent pas ainsi. Les dissidents défendent leur opinion, parce qu'elle est « meilleure » que celle de la majorité. Il est utile qu'ils aient cette foi, parce qu'elle seule peut leur donner assez d'énergie pour résister aux persécutions auxquelles ils s'exposent presque toujours. Tant qu'ils sont peu nombreux, ils demandent seulement une petite place au soleil pour leur secte ; mais, en réalité, ils soupirent après le moment où, de persécutés, ils pourront se changer en persécuteurs ; ce qui ne manque pas d'arriver sitôt que leur nombre a effectivement augmenté au point qu'ils puissent imposer leur volonté. Alors cesse l'utilité de la dissidence passée, et apparaît le dommage de la nouvelle orthodoxie.
§ 2198. Dans l'étude du phénomène de l'emploi de la force, plus encore que dans l'étude d'autres phénomènes sociaux, nous sommes portés à considérer uniquement les rapports de cause à effet, et de cette façon, en de nombreux cas, nous ne nous écartons pas trop de la réalité, car enfin, dans la suite d'actions et de réactions qu'il faut considérer, l'action de la force produisant certains effets est considérable. D'ailleurs, il convient de ne pas s'arrêter sur ce point, mais d'aller de l'avant, pour voir s'il est des phénomènes plus généraux auxquels nous puissions nous attacher.
§ 2199. Par exemple, un peu plus haut (§ 2169), nous avons comparé la révolution qui s'est produite à Rome, au temps d'Auguste, et celle qui eut lieu en France, au temps de Louis XVI, et nous avons vu que, pour comprendre ces révolutions, nous devions rechercher sous les dérivations les sentiments et les intérêts que ces dérivations reflètent. En continuant, en faisant un pas de plus, nous observons qu'au temps de la chute de la république romaine comme à celui de la chute de la monarchie française, la classe gouvernante ne savait pas ou ne pouvait pas employer la force, et qu'elle fut chassée du pouvoir par une autre classe, qui savait et pouvait user de la force (§ 2191). À Rome comme en France, cette classe sortit du peuple, et constitua, à Rome les légions de Sulla, de César, d'Octave ; en France, les bandes révolutionnaires qui vainquirent le pouvoir royal, en complète décadence, et l’armée qui vainquit les troupes médiocres des potentats européens. Les chefs de cette classe parlaient naturellement latin à Rome et français en France, et non moins naturellement faisaient usage des dérivations qui convenaient à chacun de ces peuples. Au peuple romain ils offrirent des dérivations qui s'adaptaient aux sentiments pour lesquels on changeait le fond en conservant la forme (§ 174 et sv.). Au peuple français, ils offrirent des dérivations qui appartenaient à la religion du « Progrès », si chère alors à ce peuple. Aux temps de la révolution anglaise, Cromwell et d'autres ennemis de la monarchie des Stuarts ne s'étaient pas servi autrement des dérivations bibliques.
§ 2200. Les dérivations françaises nous sont beaucoup mieux connues que les dérivations romaines, non seulement à cause de la plus grande quantité de documents français qui nous sont parvenus, mais aussi parce qu'il semble très probable que les dérivations françaises ont été plus nombreuses. Si Octave avait continué à être le défenseur du Sénat, peut-être aurait-il fait une consommation très abondante de dérivations ; mais quand, près de Bologne, s'entendant avec Antoine et Lépide [FN: § 2200-1], il confia sa fortune exclusivement à la force des légions, il remisa les dérivations à l'arsenal comme armes inutiles, et ne les ressortit qu'après la victoire, pour atténuer les souffrances des conservateurs romains. Quelque chose de semblable se produisit en France, pour Napoléon Ier ; mais avant lui, les, Jacobins, qui lui montrèrent la voie, ne purent faire seulement œuvre de lions : ils durent recourir aussi aux artifices des renards. De sa propre autorité, Octave s'était assuré le concours d'une troupe armée, d'abord à ses frais, ensuite avec l'argent qu'il pouvait extorquer à autrui, grâce à la force. Les chefs révolutionnaires français, ne pouvant s'engager dans cette voie dès l'abord, durent, en commençant, se procurer des troupes révolutionnaires au moyen des dérivations. Celles-ci, exprimant les sentiments de nombreux adversaires du gouvernement, groupaient ces adversaires autour des chefs révolutionnaires ; et comme elles exprimaient aussi les sentiments de presque tous les gouvernants, elles avaient pour effet d'endormir complètement leur vigilance, et d'affaiblir entièrement leur résistance, déjà très faible. Ensuite, sitôt que les chefs révolutionnaires furent au pouvoir, ils imitèrent les triumvirs et un grand nombre d'autres gouvernants de ce genre, en dispensant à leurs partisans l'argent et les biens de leurs adversaires.
§ 2201. Ainsi que nous l'avons répété nombre de fois déjà, si l'effet des dérivations est beaucoup moins grand que celui des résidus, il n'est pas nul, et les dérivations servent à donner une force et une efficacité plus grande aux résidus qu'elles expriment. On ne peut donc pas dire que les historiens qui ont étudié exclusivement, ou ne fût-ce même que principalement, les dérivations de la révolution française, aient porté leur attention sur une partie du phénomène dépourvue de toute valeur concluante ; on peut dire seulement qu'ils se sont trompés en considérant comme principal ce qui n'était que secondaire. Plus grande a été l'erreur de ne pas rechercher quel rôle avait joué l'emploi de la force, et les causes pour lesquelles certains hommes n'en firent pas usage et d'autres en usèrent. Le petit nombre de ceux qui ont porté leur attention sur l'emploi de la force ont fait de nouveau fausse route, en admettant que c'était à cause des dérivations que les gouvernants s'abstinrent de cet emploi ; tandis qu'une telle abstention et les dérivations avaient une commune origine dans les sentiments de ces hommes. Pourtant, à qui l'observe attentivement, le phénomène paraît bien établi sur des preuves et des contre-preuves. Louis XVI tombe parce qu'il ne veut pas, ne sait pas, ne peut pas se servir de la force ; et parce qu'ils veulent, qu'ils savent, qu'ils peuvent s'en servir, les révolutionnaires triomphent. Ce n'est pas l'efficacité de leurs théories, mais uniquement celle de la force de leurs partisans qui porte au pouvoir diverses factions, jusqu'à ce que le Directoire, qui s'en était tiré par la force, dans son conflit avec de plus faibles que lui, succombe lui-même à la force dans son conflit avec Bonaparte, rendu fort par ses troupes victorieuses. À son tour, le pouvoir de Bonaparte dura jusqu'à ce qu'il fût écrasé par la force plus grande des armées coalisées. De nouveau, voici que se succèdent, en France, des gouvernements, qui tombent parce qu'ils ne veulent pas, ne savent pas, ne peuvent pas se servir de la force [FN: § 2201-1] , tandis que surgissent de nouveaux gouvernements, grâce à l'emploi de la force. On observa ce fait à la chute de Charles X, à celle de Louis-Philippe, à l'avènement de Napoléon III ; et l'on peut ajouter que si le gouvernement versaillais put se maintenir, en 1871, contre l'insurrection de la Commune, ce fut parce qu'il eut à son service une forte armée et sut s'en servir.
§ 2202. Mais ici se pose spontanément cette question : pourquoi certains gouvernements ont-ils fait usage de la force, et d’autres n'en ont-ils pas fait usage ? On comprend que le pas fait tout à l'heure dans l'explication des phénomènes doit être suivi d'autres pas. En outre, on voit qu'il peut n'être pas exact de dire, comme nous venons de le faire, qu'un gouvernement est tombé parce qu'il n'a pas employé la force ; car, s'il y avait des faits dont dépendrait celui de n'avoir pas employé la force, ces faits seraient proprement la cause des phénomènes, tandis que le fait de n'avoir pas employé la force ne serait qu'une cause apparente. Il se pourrait aussi que ces faits dépendissent à leur tour, au moins en partie, de l'abstention de l'emploi de la force, et que, par conséquent, aux rapports de cause à effet, il s'en superposât d'autres, de mutuelle dépendance. Ce n'est pas tout. Si l'on remarque que les gouvernements qui ne savent pas ou ne peuvent pas se servir de la force tombent, on remarque aussi qu'aucun gouvernement ne dure en faisant exclusivement usage de la force (§ 2251). De tout cela, il ressort à l'évidence que nous avons considéré seulement une face du problème, et qu'il est par conséquent nécessaire d'étendre le champ de nos recherches, et d'étudier les phénomènes d'une façon beaucoup plus générale. C'est ce que nous allons faire maintenant.
§ 2203. LES CYCLES DE MUTUELLE DÉPENDANCE. – Reportons notre attention sur l'ensemble des éléments dont dépend l'équilibre social ; et puisque nous ne pouvons malheureusement pas les considérer tous et tenir rigoureusement compte de la mutuelle dépendance, suivons la voie indiquée déjà aux § 2104 et 2092. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les éléments, nous considérerons un nombre restreint de catégories que nous choisirons naturellement parmi les plus importantes, et que nous étendrons ensuite peu à peu, pour y ranger le plus possible d'éléments. Quant à la mutuelle dépendance, nous substituerons le procédé (2-a) au procédé (2-b) du § 1732, en prenant toujours garde aux écueils signalés au § 2092-1.
§ 2204. Un élément d'une catégorie donnée agit sur ceux des autres catégories, qu'il soit séparé des autres éléments de sa catégorie, ou qu'il y soit uni. Nous appellerons direct l'effet qu'il a si on le considère séparément des autres éléments de la même catégorie ; indirect l'effet qu'il a en vertu de son union avec les éléments de la même catégorie. Ainsi l'on continue la distinction commencée au § 2089. Nous avions alors divisé les faits en deux catégories : 1° le fait de l'existence d'une société ; 2° les faits accomplis dans cette société, ou les éléments dont résulte cette existence. Maintenant divisons cette seconde catégorie, d'abord en groupes, puis séparons dans chaque groupe un élément des autres du même groupe, et cherchons quel effet il a sur les éléments des autres catégories (effet direct), lorsqu'il est séparé, et quel effet il a sur eux, quand on le considère comme uni aux éléments de sa catégorie (effet indirect).
§ 2205. Considérons maintenant la mutuelle dépendance des catégories. Pour être bref, indiquons par des lettres les éléments suivants : (a) résidus, (b) intérêts, (c) dérivations, (d) hétérogénéité et circulation sociale. Si nous pouvions faire usage de la logique mathématique, la dépendance mutuelle entre ces éléments s'exprimerait par des équations (§ 2091); mais puisqu'on ne peut le faire pour le moment, il nous reste à nous servir du langage vulgaire (§ 2092), à considérer cette dépendance mutuelle sous une autre forme, celle d'actions et de réactions des éléments, et à suivre la voie indiquée au § 2104.
§ 2206. Nous dirons donc que : (I) ; (a) agit sur (b) , (c) , (d) – (II) ; (b) agit sur (a) , (c) , (d) – (III) ; (c) agit sur (a), (b), (d) – (IV) ; (d) agit sur (a), (b), (c). D'après ce que nous avons exposé aux chapitres précédents, on voit que la combinaison (I) donne une partie très importante du phénomène social ; et peut-être en avaient-ils quelque lointaine et imparfaite idée, ceux qui plaçaient dans l'éthique le fondement de la société. Peut-être aussi y a-t-il là ce grain de réalité qui peut se trouver dans les doctrines métaphysiques qui soumettent les faits aux « concepts ». En effet, les résidus et les sentiments correspondants se reflètent dans ces concepts, fût-ce d'une manière imparfaite. Enfin, c'est cela aussi qui assure la continuité de l'histoire des sociétés humaines, car précisément la catégorie (a) varie peu ou lentement. Mais nous en parlerons longuement plus loin. La combinaison (II) donne aussi une partie assez considérable du phénomène social, à laquelle on peut appliquer ce que nous venons de dire à propos de la combinaison (I). L'importance de la combinaison (II) fut aperçue par les adeptes du « matérialisme historique », qui, d'ailleurs, tombèrent dans l'erreur de prendre la partie pour le tout, et de négliger les autres combinaisons. La combinaison (III) est de moindre importance que toutes les autres ; c'est parce que les humanitaires, les « intellectuels », les adorateurs de la déesse Raison, ne l'ont pas vu, que leurs élucubrations sont erronées, non-concluantes, vaines. Mais plus que les autres combinaisons, celle-ci nous est connue par la littérature ; c'est pourquoi on lui donne habituellement une importance qui va bien au delà de la réalité. La combinaison (IV) n'est pas de peu d'importance. C'est ce qu'ont en partie aperçu Platon et Aristote, pour ne pas parler d'autres anciens. Aujourd'hui, les considérations de Lapouge, de Hamon et d'autres, bien que partiellement erronées et imparfaites, ont eu le grand mérite de mettre en évidence ce phénomène très important ; tandis que le fait de le négliger vicie radicalement les théories dites démocratiques.
§ 2207. Il faut avoir présent à l'esprit que les actions et les réactions se suivent indéfiniment, comme en cercle (§ 2102-1) ; par exemple, en commençant par la combinaison (I), on arrive à la combinaison (IV), et de celle-ci on passe de nouveau à la combinaison (I). Dans la combinaison (I), l'élément (a) agissait sur (d) ; dans la combinaison (IV), l'élément (d) agit sur (a) ; puis on revient à la combinaison (1) , par laquelle (a) agit de nouveau sur (d) , et ainsi de suite. Par conséquent, une variation de (a) , en vertu de la combinaison (I), fait varier les autres éléments (b) , (c) , (d) . Uniquement afin de nous entendre (§ 119), nous donnerons le nom d'effets immédiats à ces variations de (a) , (b) , (c) , (d) , provoquées par la combinaison (I). Mais, en vertu des autres combinaisons, les variations de (b) , (c) , (d) font aussi varier (a) . Par le mouvement circulaire que nous avons mentionné, cette variation se répercute dans la combinaison (I), et donne lieu à de nouvelles variations de (a) , (b) , (c) , (d) .Toujours afin de nous entendre, nous donnerons à celles-ci le nom d'effets médiats. Parfois, il est nécessaire de considérer en semble deux ou plusieurs combinaisons. Plus loin (§ 2343 et sv.), nous verrons un exemple très important où, à cause de l'entrelacement des effets, nous sommes obligés d'étudier ensemble les combinaisons (II) et (IV). L'état d'équilibre concret que l'on observe en une société est une conséquence de tous ces effets, de toutes ces actions et réactions. Il est donc différent d'un état d'équilibre théorique obtenu en considérant un ou plusieurs des éléments (a) , (b) , (c) , (d) , au lieu de les considérer tous. Par exemple, l'économie politique appartient à la catégorie (b) , et comprend une partie qui est l'économie pure. Celle-ci nous fait connaître un équilibre théorique, différent d'un autre équilibre théorique, qu'on obtiendrait par l'économie appliquée ; ce nouvel équilibre rentre toujours dans la catégorie (b) ; il est différent des autres équilibres théoriques que l'on obtiendrait en combinant (b) avec une partie des éléments (a) , (b) , (d) , différent enfin de l'équilibre théorique, beaucoup plus rapproché de la réalité, obtenu en combinant ensemble tous les éléments (a) , (b) , (c) , (d) [FN: § 2207-1] (§ 2552).
§ 2208. Il sera utile de donner une forme moins abstraite à ces considérations, et, en même temps, d'aller de cas particuliers à des cas plus généraux, suivant la méthode inductive. Mettons dans la catégorie (b) la protection douanière des industries, au moyen de droits d'importation. Nous aurons d'abord ses effets économiques directs et indirects. L'économie politique, qui est la science de la catégorie (b) , s'occupe surtout de ces effets-là. Nous ne nous arrêterons pas ici, et rappellerons seulement quelques effets qu'il nous est nécessaire de considérer. Parmi ceux-là nous devons tout d'abord nous attacher à certains effets économiques, jusqu'à présent quelque peu négligés par l'économie politique. Ceux qui défendaient le libre-échange ont d'habitude considéré, au moins implicitement, les bas prix comme un bien pour la population, tandis que ceux qui défendaient la protection les considéraient comme un mal. La première de ces opinions était facilement acceptée par qui prêtait attention surtout à la consommation ; la seconde par qui s'arrêtait surtout à la production ; mais au point de vue scientifique, elles avaient toutes les deux peu ou point de valeur, car elles partaient d'une analyse incomplète du phénomène [FN: § 2208-1]. On fit un grand pas en avant dans la voie scientifique, lorsque, grâce aux théories de l'économie mathématique, on put démontrer qu'en général la protection a pour conséquence directe une destruction de richesse [FN: § 2208-2] . Si l'on pouvait ajouter la proposition, admise implicitement par un grand nombre d'économistes, suivant laquelle toute destruction de richesse est un « mal », on pourrait logiquement conclure que la protection est un « mal » [FN: § 2208-3). Mais pour admettre cette proposition, il faut d'abord rechercher quels sont les effets économiques indirects et les effets sociaux de la protection. Pour ne parler maintenant que des premiers, nous voyons que la protection transporte, d'une partie A de la population à une partie B, une certaine somme de richesse, moyennant la destruction d'une somme q de richesse. Cette somme est le coût de l'opération. Si, avec la nouvelle distribution de la richesse, la production n'augmente pas d'une quantité plus grande que q, l'opération est économiquement nuisible à l'ensemble de la population. Si elle augmente d'une quantité plus grande que q, elle est économiquement utile. Il ne faut pas exclure ce cas a priori, car dans la partie A se trouvent les paresseux, les fainéants, ceux qui font peu usage des combinaisons économiques ; tandis que parmi les B se trouvent les gens avisés en matière économique, capables de la plus grande activité, et ceux qui savent très bien se servir des combinaisons économiques. Pour parler ensuite d'une manière générale, non seulement des effets économiques, mais aussi des effets sociaux, nous devrons distinguer entre les effets dynamiques, qui se produisent peu de temps après que l'on a institué la protection, et les effets statiques, qui se produisent après que la protection a été établie depuis longtemps. Il faut aussi distinguer entre les effets qui ont lieu pour des productions qui peuvent aisément s'accroître, telles les productions industrielles, en général, et celles qui ont lieu pour les productions qui peuvent difficilement s'accroître, telles les productions agricoles. L'effet dynamique est plus considérable pour les industriels que pour les agriculteurs. Lorsqu'on établit la protection, les industriels qui possèdent déjà les usines qui seront protégées, et ceux qui savent judicieusement prévoir ou instituer la protection, jouissent d'un monopole temporaire. Celui-ci ne prendra fin que lorsque de nouveaux industriels viendront faire concurrence aux premiers, Il faut pour cela un temps qui n'est souvent pas court. Au contraire, les agriculteurs ont peu à craindre de nouveaux concurrents ; par conséquent, pour eux, l'effet dynamique diffère peu de l'effet statique. En outre, la protection peut donner naissance à de nouvelles industries, et, par conséquent, faire croître, sinon les gains, du moins le nombre des industriels. Cela peut aussi avoir lieu pour l'agriculture, mais en de bien moindres proportions ; et d'habitude, la protection substitue seulement une culture à une autre. Au contraire, l'effet statique est moins considérable pour les gains des industriels que pour ceux des agriculteurs ; il accroît les rentes de ceux-ci, tandis que la concurrence annule les rentes des monopoles temporaires des industriels. C'est précisément pour cela que la protection industrielle détruit, habituellement, plus de richesse que la protection agricole ; car avec celle-ci, les rentes nouvelles qui constituent un simple transfert de richesse, échappent à la destruction.
§ 2209. Voyons les effets immédiats (§ 2207) sur les autres catégories. Combinaison II. L'effet le plus grand a lieu sur d, c'est-à-dire sur l'hétérogénéité sociale. Les effets dynamiques de la protection industrielle enrichissent non seulement l'individu bien doué au point de vue technique, mais surtout l'homme bien doué sous le rapport des combinaisons financières, ou de la ruse, permettant de se concilier les faveurs des politiciens, qui confèrent les avantages de la protection. Telles de ces personnes qui possèdent ces qualités à un degré éminent deviennent riches, puissantes, gouvernent le pays. Il arrive de même pour les politiciens qui savent opportunément vendre les avantages de la protection. Chez tous ces individus, les résidus de la Ie classe sont intenses, et ceux de la IIe beaucoup plus faibles. D'autre part, ceux chez lesquels les qualités du caractère ont plus d'importance que les qualités d'ingéniosité technique on financière, ou qui ne possèdent pas les qualités mentionnées d'activité et d'habileté, sont frustrés. En, effet, d'une part ils ne retirent aucun avantage de la protection, et d'autre part ce sont eux qui en font les frais. Les effets statiques de la protection industrielle sont, non pas identiques, mais analogues, et, s'ils enrichissent beaucoup moins de gens, ils ouvrent néanmoins la voie à l'activité de ceux qui possèdent les qualités indiquées d'ingéniosité et de ruse, et ils accroissent la population industrielle, souvent au détriment de la population agricole. Bref, admettons que, pour constituer la classe gouvernante, on tienne compte des examens hypothétiques que nous supposions au § 2027, dans le but d'éclairer le sujet. On donne alors plus de points aux individus qui ont des résidus de la Ie classe, intenses et nombreux, et qui savent s'en servir pour tirer profit de la protection. On en donne moins à ceux qui ont des résidus de la Ie classe rares et faibles, ou qui ne savent pas mettre opportunément en valeur les résidus nombreux et forts. De cette façon, la protection industrielle tend à développer les résidus de la le classe, chez la classe gouvernante. En outre, la circulation se fait plus intense. Dans un pays où il y a peu d'industries, celui qui naît bien doué, sous le rapport des instincts de combinaisons, trouve beaucoup moins d'occasions d'appliquer ces instincts que celui qui naît dans un pays où il y a un grand nombre d'industries, et où il en surgit toujours de nouvelles. L'art de capter les faveurs de la protection offre un vaste champ d'activité à ceux qui possèdent ces qualités, même s'ils ne s'en servent pas directement dans l'industrie. Pour continuer l'analogie indiquée au § 2027, on peut dire que les examens ayant pour but de connaître qui possède en plus grande quantité les résidus de la Ie classe, se font plus fréquents, et qu'un plus grand nombre de candidats y sont appelés.
§ 2210. Il ne semble pas qu'il se produise des effets intenses sur la catégorie (a – résidus), entre autres parce que les résidus changent lentement (§ 2321). Au contraire, des effets considérables se produisent sur la catégorie (c – dérivations), et l'on remarque une belle floraison de théories économiques pour la défense de la protection. Beaucoup d'entre elles peuvent aller de pair avec les dédicaces et les sonnets qu'on adressait autrefois aux gens riches, pour obtenir d'eux quelque subside (§ 2553).
§ 2211. Combinaison III. Les dérivations agissent peu ou point sur les résidus, peu sur les intérêts, un peu sur l'hétérogénéité sociale (d) , parce que dans toute société, les gens habiles à louer les puissants peuvent s'introduire dans la classe gouvernante. Schmoller n'aurait peut-être pas été nommé à la Chambre des Seigneurs de Prusse, s'il avait été libre-échangiste. Vice versa, les libre-échangistes anglais ont obtenu les faveurs du gouvernement dit « libéral ». Nous avons ainsi des effets indirects en dehors des catégories. Les intérêts (b) ont agi sur les dérivations (c) , et celles-ci agissent sur l'hétérogénéité sociale (d) .
§ 2212. Combinaison IV. Ici, nous avons de nouveau des effets très importants. Nous les trouvons moins dans l'action de l'hétérogénéité sur les résidus que dans l'action des intérêts ; cela pour le motif habituel du peu de variabilité des résidus.
§ 2213. D'ailleurs, et si l'on envisage la combinaison IV en général, l'action indirecte ou médiate des intérêts sur les résidus n'est pas négligeable, et peut même devenir considérable, si elle s'exerce durant de longues années. Chez une nation préoccupée exclusivement de ses intérêts économiques, les sentiments qui correspondent aux combinaisons sont exaltés, ceux qui correspondent à la persistance des agrégats sont méprisés. On observe donc des changements dans ces deux classes de résidus. Les genres des résidus, et spécialement les formes sous lesquelles ils s'expriment, se modifient, et les dérivations changent. La perfection apparaît dans l'avenir, au lieu d'être placée dans le passé ; le dieu Progrès s'installe dans l'Olympe. L'humanitarisme triomphe, parce que désormais on soigne mieux ses intérêts par la fraude que par la force. Tourner les obstacles et ne pas les surmonter de vive force devient un principe. Avec de telles pratiques et à la longue, le caractère s'amollit, et la ruse, sous toutes ses formes, devient souveraine.
§ 2214. Ces phénomènes ont été aperçus en tout temps. Mais, en général, les auteurs qui y fixèrent leur attention ne tardèrent pas à dévier de l'étude des faits, pour s'adonner à des considérations éthiques, pour louer ou blâmer, et pour rechercher de quelle façon l'on devait s'y prendre afin d'atteindre un certain idéal qui était le leur [FN: § 2214-1] .
§ 2215. Revenant maintenant au cas particulier de la protection, nous remarquons le fait suivant. Une fois que, grâce à cette protection, les intérêts ont porté dans la classe gouvernante des hommes largement pourvus de résidus de la Ie classe, ces hommes agissent à leur tour sur les intérêts, et poussent la nation entière vers les occupations économiques, vers l'industrialisme. Le phénomène est si remarquable qu'il n'a pas échappé, même à des observateurs superficiels, ou à d'autres, qu'aveuglent des théories erronées. Il a été souvent décrit sous le nom d'accroissement du « capitalisme » dans les sociétés modernes. Ensuite, par le raisonnement habituel post hoc propter hoc, on a pris cet accroissement du capitalisme pour la cause de l'amollissement des sentiments moraux (persistance des agrégats).
§ 2016. Dans le phénomène mentionné tout à l'heure, nous avons un effet médiat : les intérêts ont agi sur l'hétérogénéité ; celle-ci, à son tour, agit sur les intérêts. Ainsi, par une suite d'actions et de réactions, il s'établit un équilibre où deviennent plus intenses la production économique et la circulation des élites. La composition de la classe gouvernante se trouve ainsi profondément modifiée.
§ 2217. L'augmentation de la production économique peut être telle qu'elle surpasse la destruction de richesse produite par la protection. D'où, somme toute, la protection peut donner un profit et non une perte de richesse. Par conséquent, il peut arriver, mais il n'arrive pas nécessairement, que la prospérité économique d'un pays s'accroisse avec la protection industrielle.
§ 2218. On remarquera que c'est là un fait médiat, qui est produit par l'action de la protection industrielle sur l'hétérogénéité sociale et la circulation des élites, lesquelles réagissent ensuite sur le phénomène économique. C'est pourquoi l'on peut supprimer le premier anneau de cette chaîne, et pourvu que l'on conserve le second, l'effet se produira également. C'est pourquoi aussi, si la protection agissait différemment sur l'hétérogénéité sociale et sur la circulation des élites, l'effet se produirait aussi différemment, C'est ce qui arrive, en effet, pour la protection agricole, en général. Par conséquent, demeurant au point du cycle où nous sommes, nous dirons qu'on pourra avoir un effet médiat d'une augmentation de prospérité économique, soit avec la protection industrielle, soit avec le libre-échange, qui supprime une coûteuse protection agricole. Ce dernier cas est, très en gros, le phénomène qui eut lieu en Angleterre, au temps de la ligue de Cobden. La suppression de la protection agricole eut un puissant effet. Beaucoup moindre fut celui de la suppression de la protection industrielle, parce qu'en ce temps-là l'industrie anglaise était la première du monde ; aussi les effets furent-ils au plus haut degré ceux de la première mesure. Ajoutons qu'en Angleterre la circulation des élites était déjà intense, et qu'elle fut accrue par diverses mesures politiques. Au contraire, quand l’Allemagne eut recours au protectionnisme, cette circulation était lente, et s'accomplissait en grande partie pour des causes étrangères aux causes économiques. Le protectionnisme agricole avait peu ou point d'action sur cette circulation, déjà lente par elle-même, tandis que le protectionnisme industriel la stimula d'une façon merveilleuse. Par conséquent, ce fut surtout ce genre de protectionnisme qui produisit ces effets. En Angleterre, on observa aussi les effets qui découlent de la disparition de la protection agricole, et le pays s'achemina toujours plus vers un état d’industrialisme démagogique qui ne peut exister en Allemagne, tant que la classe des Junker, protégée par les droits agricoles, est forte et vigoureuse.
En Italie, après la constitution du nouveau royaume, le protectionnisme financier et celui des entreprises publiques avaient déjà produit sur l'hétérogénéité sociale l'action dont nous avons vu déjà que la protection industrielle était capable. Quand donc celle-ci fut établie, mêlée à une forte proportion de protection agricole, elle produisit des effets médiats peu importants, sauf peut-être dans l'Italie septentrionale ; tandis que dans l'Italie méridionale, la protection agricole produisit presque seule un effet ; et de fait, dans l'ensemble, les effets médiats furent presque insensibles ; on ne vit clairement que les effets économiques de la destruction de richesse [FN: § 2218-1] , jusqu'à ce qu'ils fussent ensuite masqués par la superposition des effets d'une période de prospérité générale de tous les peuples civilisés.
§ 2219. On ne pouvait obtenir de l'économie politique seule la connaissance des causes de ces divers effets, qui pourtant sont de nature économique. Il fallait en combiner l'étude avec celle d'une autre science, plus générale, qui, nous enseignant à faire peu de cas des dérivations, au moyen desquelles on créait des théories erronées, nous montrât combien nombreuses étaient les forces qui agissent réellement sur les phénomènes, et quelle était leur nature. Ces phénomènes, bien que strictement économiques en apparence, dépendaient en réalité d'autres phénomènes sociaux.
§ 2220. Le lecteur remarquera que nous venons d'ébaucher seulement à grands traits une première image du phénomène, et qu'il nous reste beaucoup à faire pour noter les parties secondaires. Mais ce n'est pas ici le lieu de procéder à cette étude (§ 2231 et sv., 2310 et sv.). En revanche, nous devons nous appliquer à faire disparaître une autre imperfection, qui tire son origine du fait que nous nous sommes arrêtés en un point du cycle, tandis qu'il est nécessaire de poursuivre, et de voir d'autres et de nouveaux effets médiats.
§ 2221. Si aucune force ne s'y opposait, le cycle d'actions et de réactions mentionné tout à l'heure se continuant indéfiniment, la protection économique et ses effets devraient aller toujours croissant. C'est en effet ce qu'on remarque chez nombre de peuples, au XIXe siècle ; mais, d'autre part, il naît et se développe des forces qui s'opposent à ce mouvement. En traitant, non plus d'un cas particulier de protection, mais d'un cas général, nous trouverons ces forces dans les modifications que subit l'élite, et dans les variations des circonstances qui rendent possible le mouvement du cycle considéré (§ 2225). L'histoire nous enseigne que lorsque la proportion des résidus de la Ie et de la IIe classe varie chez l'élite, les mouvements ne continuent pas indéfiniment en un même sens, mais que, tôt ou tard, ils sont remplacés par des mouvements en sens contraire. Souvent ceux-ci ont lieu par l'effet de guerres, comme ce fut le cas pour la conquête que Rome fit de la Grèce. Ce pays possédait en grande abondance des résidus de la Ie classe, tandis que Rome avait alors une plus grande quantité de résidus de la IIe classe. Souvent aussi les mouvements contraires au cours observé durant un temps assez long se produisirent sous forme de révolutions intérieures [FN: § 2221-1] . Un exemple remarquable de ces phénomènes est la substitution de l'Empire à la République, à Rome. Ce fut là surtout une révolution sociale, qui changea beaucoup la proportion des résidus dans la classe gouvernante. Considérant les deux effets ensemble, on peut dire, en général et grosso modo, que là où l'un ne se produit pas, l'autre se manifeste. Il en est comme des fruits qui, une fois mûrs, sont cueillis par la main de l'homme ou tombent naturellement à terre : de toute façon ils sont détachés de la plante. La cause indiquée tout à l'heure des modifications de l'élite est parmi les plus importantes qui déterminent la forme ondulatoire assumée par le phénomène. Nous en rechercherons plus loin des exemples remarquables (§ 2311, 2343 et sv., 2553).
§ 2222. Nous voyons, chez nombre de peuples, la protection industrielle accompagner la protection agricole, et même, actuellement en Europe, elles ne vont pas l'une sans l'autre ; et comme elles ont, au moins en partie, des effets opposés, on voit que les résultats des faits poussent les empiriques à se tenir presque instinctivement dans une certaine moyenne. En général, les protections du genre de la protection industrielle et celles du genre de la protection agricole, unies ensemble à divers degrés, donnent chez les gouvernants diverses proportions correspondantes de résidus de la Ie et de la IIe classe, avec les divers effets découlant de ce fait (§ 2227).
§ 2223. Les considérations précédentes s'étendent facilement à tout autre genre de protection, non seulement économique, mais aussi de natures diverses. Par exemple, la protection des classes belliqueuses, réalisée lorsque les hommes acquièrent richesses, honneurs, pouvoirs, surtout par la guerre, agit comme la précédente sur l'hétérogénéité sociale, mais en un sens différent; c'est-à-dire qu'elle tend à développer les résidus de la IIe classe chez les gouvernants. Comme la précédente, elle intensifie la circulation, et permet à ceux qui ont des instincts belliqueux de s'élever des couches inférieures dans la classe gouvernante. En ce cas, les résidus subissent des effets appréciables, pour autant que le fait est possible, et si l'on tient compte de leur peu de variabilité. La guerre tend à augmenter l'intensité des résidus de la IIe classe. Comme d'habitude, les effets produits sur les dérivations sont considérables, moindres toutefois que dans le cas précédent, parce que les théories sont peu ou point nécessaires à la guerre. Pour mieux voir cela, en des cas extrêmes, il suffit de comparer Sparte et Athènes. C'est pourquoi, les dérivations aussi ont peu ou point d'influence sur l'hétérogénéité sociale, un peu plus sur les résidus. Enfin, portant notre attention sur la combinaison IV, nous voyons que la protection des intérêts favorables à la guerre pousse la nation à s'occuper de la guerre. C'est pourquoi l'on a ici aussi un effet médiat.
§ 2224. En ce cas naissent aussi des forces qui tendent à produire un mouvement contraire à celui du cycle considéré. On a déjà remarqué, dans les temps anciens, que la guerre moissonnait largement les aristocraties guerrières. Par conséquent, d'un côté, les guerres fréquentes font entrer dans la classe gouvernante les hommes animés de sentiments belliqueux, et de l'autre, elles les détruisent. Somme toute, ces deux mouvements en sens contraire peuvent, suivant les cas, enrichir ou appauvrir d'éléments belliqueux cette classe, et par conséquent accroître aussi ou diminuer en elle certains résidus. Dans les temps modernes, la guerre exige non seulement des hommes, mais aussi d'immenses dépenses, auxquelles ne peut pourvoir qu'une production économique intense. C'est pourquoi, si la guerre accroît les éléments belliqueux dans la classe gouvernante, la préparation de la guerre les diminue en faisant entrer dans cette classe des éléments industriels et commerciaux. Ce second effet est maintenant prépondérant en France, en Angleterre, en Italie ; beaucoup moindre en Allemagne.
§ 2225. En ce qui concerne les circonstances qui rendent possibles les cycles considérés (§ 2221), il faut remarquer que pour le cycle belliqueux, il est nécessaire qu'il se trouve des pays riches à exploiter par la conquête. Pour le cycle industriel, il est avantageux, mais non indispensable, qu'il y ait des peuples peu développés économiquement, qu'on puisse exploiter par la production industrielle. Il faut prendre garde à un phénomène jusqu'ici peu aperçu : au fait que, pour se développer, l'industrialisme a besoin d'une classe nombreuse de gens qui épargnent ; tandis que l'industrialisme même déprime généralement l'instinct d'épargne, et pousse les hommes à dépenser tout ce qu'ils gagnent (§ 2228).
D'une manière générale et dans tous les temps, on peut observer que le mouvement du cycle belliqueux présente des contrastes plus grands que celui du cycle industriel. En effet, jusqu'à un certain point, le cycle industriel se suffit à lui-même : il produit la richesse qu'il consomme. Quand la prospérité des peuples pauvres qu'on exploite commence à se développer, leur consommation augmente, et par conséquent les peuples riches en profitent. Le dommage pourra se produire seulement lorsque les peuples pauvres commenceront à égaler les peuples riches. Quant à l'épargne, nous savons que les résidus se modifient très lentement. C'est pourquoi l'effet du cycle industriel sur les sentiments qui poussent à épargner, n'est pas du tout rapide. L'épargne peut continuer à croître longtemps, évitant ainsi que l'on ne vienne à manquer de matière exploitable, matière indispensable à la continuation de l'industrialisme. Au contraire, pour tirer avantage des arts qui ont trait à la guerre, un peuple a besoin de pouvoir les exercer contre des peuples suffisamment riches ; et si ceux-ci disparaissent, le peuple qui est en très grande partie belliqueux meurt de consomption. Un cas exceptionnel fut celui de la Rome antique, où, durant de longues années, on put observer les effets médiats des guerres de conquête. Mais cela se produisit d'abord parce qu'il fallut longtemps pour que la matière qui alimentait les conquêtes vînt à manquer ; ensuite parce que celles-ci n'étaient pas seules à faire la prospérité matérielle de Rome : des commerces et des industries n'y contribuaient pas peu. De la sorte, on atteignit le maximum de prospérité vers la fin de la République et le commencement de l'Empire; puis vinrent à manquer en même temps les peuples riches à conquérir et à exploiter, ainsi que la prospérité commerciale et industrielle. La conquête de régions barbares ne pouvait apporter à Rome aucun profit comparable à celui qu'elle avait retiré de la conquête des riches régions de la Grèce, de l'Afrique, de l'Asie; tandis que l'arrêt de la circulation des élites et la destruction toujours croissante de la richesse épuisaient les sources de la production économique.
§ 2226. C'est à l'exploitation de peuples économiquement peu développés qu'on dut en partie la prospérité de Carthage et de Venise, et qu'on doit, partiellement aussi, celle des États industriels et commerciaux modernes. Plusieurs de ces derniers ne produisent pas la quantité de blé nécessaire à l'alimentation de leurs peuples. Par conséquent, ils ont besoin, pour vivre, d'être en relations avec des peuples agricoles qui ont, au contraire, un excédent de production de blé. Que deviendrait l'Angleterre, si tous les peuples du globe n'avaient que le blé nécessaire à leur consommation ? Il est certain que l'état de choses actuel serait profondément changé. La prospérité de Carthage vint se briser contre la puissance militaire de Rome, comme la prospérité de Venise fut gravement ébranlée par les conquêtes turques. Mais il ne semble pas que de pareils dangers menacent la prospérité des peuples industriels modernes, du moins pour le moment. D'une manière générale, supposons des peuples où l'un des deux cycles que nous avons indiqués est en train de s'accomplir, et d'autres peuples où c'est l'autre cycle qui s'accomplit. Si ces deux groupes de peuples viennent à se faire la guerre, l'un ou l'autre peut être détruit, selon le degré d'évolution. C'est ainsi que les peuples modernes chez lesquels se produit l'évolution industrielle vainquent, dominent, détruisent les peuples barbares ou semi-barbares encore arriérés dans l'évolution militaire. Tout au contraire, les peuples économiquement les plus développés du bassin de la Méditerranée furent subjugués par Rome, et l'empire romain fut détruit par les barbares. Chez les peuples civilisés de notre époque, les différences du degré d'évolution du cycle qu'ils accomplissent sont petites. C'est pourquoi, bien que considérable, la force résultant de la disparité de cette évolution n'est pas prépondérante.
§ 2227. Parmi les effets que provoque le changement de proportion des résidus, de l'instinct des combinaisons et de la persistance des agrégats dans la classe gouvernante (§ 2221), il faut prendre garde à ceux qui peuvent affaiblir la résistance de cette classe, en lutte avec la classe gouvernée [FN: § 2227-1] . Pour avoir une première idée de ces importants phénomènes, on peut observer que grosso modo la classe gouvernante et la classe gouvernée sont l'une à l'égard de l'autre comme deux nations étrangères. La prédominance des intérêts principalement industriels et commerciaux peuple la classe gouvernante d'hommes rusés, astucieux, possédant de nombreux instincts de combinaisons, et la dépeuple d'hommes au caractère fort, d'hommes fiers, possédant de nombreux instincts de persistance des agrégats (§ 2178). Cela peut arriver pour d'autres causes. D'une manière générale, c'est-à-dire en considérant la combinaison (IV) du § 2206, nous verrons que si l'on gouvernait seulement avec la ruse, la fourberie et les combinaisons, le pouvoir de la classe chez laquelle les résidus de l'instinct des combinaisons l'emportent de beaucoup serait très durable. Il prendrait fin seulement quand la classe se dissocierait d'elle-même par dégénérescence sénile. Mais pour gouverner, il faut aussi la force (§ 2176 et sv.) ; et à mesure que les résidus de l'instinct des combinaisons se développent, et que ceux de la persistance des agrégats s'atrophient chez les gouvernants, ceux-ci deviennent toujours moins capables d'user de la force. Nous avons donc un équilibre instable, et des révolutions se produisent, comme celle du protestantisme contre les hommes de la Renaissance, ou du peuple français, en 1789, contre sa classe gouvernante. Ces révolutions réussissent pour des causes en partie analogues à celles pour lesquelles Rome, fruste et inculte, conquit la Grèce civilisée et cultivée. Une exception qui confirme la règle est celle de Venise, qui garda longtemps son régime politique, parce que son aristocratie sut conserver ces sentiments de persistance des agrégats, sentiments nécessaires à l'emploi de la force. Le peuple chez lequel prédominent les résidus de la persistance des agrégats les apporte dans la classe gouvernante, soit par infiltrations (circulation des élites), soit par secousses, au moyen des révolutions (§ 2343 et sv.).
§ 2228. Chez les peuples modernes économiquement avancés, les industries, les commerces, et aussi l'agriculture, ont besoin de capitaux énormes. En outre, les gouvernements de ces peuples sont très coûteux, parce qu'ils doivent suppléer par la ruse et par les dépenses qui en sont la conséquence, à la force qui leur fait défaut : ils vainquent par l'or, et non par le fer. C'est pourquoi ces peuples, chez lesquels s'accomplit avec une intensité toujours croissante le cycle industriel, ont besoin d'une grande quantité d'épargne (§ 2317). Mais les caractères de l'épargne vont mieux avec les résidus de la persistance des agrégats qu'avec ceux de l'instinct des combinaisons. Les gens aventureux, toujours en quête de nouvelles combinaisons, épargnent peu. Par conséquent, il faut à la classe gouvernante industrielle et commerciale au plus haut point, un substratum de gens de nature différente et qui épargnent. Si elle ne le trouve pas dans son propre pays, elle doit le chercher à l'étranger, comme c'est le cas des États-Unis d'Amérique, qui font une si abondante consommation de l'épargne européenne. La classe gouvernante française trouve dans son propre pays l'épargne dont elle a besoin, et qui est produite en grande quantité surtout par la femme, chez laquelle les résidus de la persistance des agrégats sont encore prépondérants. Mais si les femmes françaises deviennent semblables aux américaines, et s'il n'y a pas quelque compensation, il pourra se produire une diminution considérable de la quantité d'épargne que la France fournit à sa classe gouvernante et à d'autres pays (§ 2312 et sv.).
§ 2229. Nous devons remarquer ensuite qu'en l'état actuel des sciences sociales, non encore parvenues à l'état de sciences logico-expérimentales, la prédominance des résidus de la Ie classe est proprement la prédominance, non seulement des intérêts, mais aussi de dérivations, de religions intellectuelles, et non de raisonnements scientifiques. Souvent ces dérivations s'écartent de la réalité beaucoup plus que les actions non-logiques du simple empirique. Quand la chimie n'existait pas encore, un empirique connaissait mieux la teinturerie qu'une personne dominée par les élucubrations théoriques qui se manifestent par la magie et autres semblables billevesées. Comme les mandarins chinois, les « intellectuels » européens sont les pires des gouvernants ; et le fait que les « intellectuels » européens ont joué un rôle moins important que les mandarins, dans le gouvernement de la chose publique, est une des si nombreuses causes pour lesquelles le sort des peuples européens fut différent de celui du peuple chinois. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le peuple japonais, guidé par ses chefs féodaux, a tellement dépassé en puissance le peuple chinois. Il est certain que les « intellectuels » peuvent être éloignés du gouvernement, même là où, dans la classe gouvernante, les résidus de l'instinct des combinaisons sont prépondérants. Venise eut ce bonheur singulier ; mais, en général, la prédominance des résidus de l'instinct des combinaisons, dans la classe gouvernante, porte celle-ci à faire largement appel aux «intellectuels », qui sont, au contraire, repoussés des classes où prédominent les résidus de la persistance des agrégats : les « préjugés », pour parler le jargon de nos humanitaires.
§ 2230. Nous avons indiqué (§ 2026 et sv.) une classification générale des couches sociales, et nous avons aussi fait allusion (§ 2052) aux rapports entre cette classification et celle des aristocraties. Le sujet n'est pas épuisé ; il peut donner lieu à un grand nombre d'autres considérations, parmi lesquelles il en est une d'ordre économique, très importante.
§ 2231. On a confondu, et l'on continue à confondre, sous le nom de capitalistes[FN: § 2231-1], d'une part les personnes qui tirent un revenu de leurs terres et de leurs épargnes, d'autre part les entrepreneurs. Cela nuit beaucoup à la connaissance du phénomène économique, et encore plus à celle du phénomène social. En réalité, ces deux catégories de capitalistes ont des intérêts souvent différents, parfois opposés. Ils s'opposent même plus que ceux des classes dites des « capitalistes » et des « prolétaires » [FN: § 2231-2]. Au point de vue économique, il est avantageux pour l'entrepreneur que le revenu de l'épargne et des autres capitaux qu'il loue à leurs possesseurs soit minimum ; il est, au contraire, avantageux à ces producteurs qu'il soit maximum. Un renchérissement de la marchandise qu'il produit est avantageux à l'entrepreneur. Peu lui importe un renchérissement des autres marchandises, s'il trouve compensation dans les avantages de sa propre production ; tandis que tous ces renchérissements nuisent au possesseur de la simple épargne. Quant à l'entrepreneur, les droits fiscaux sur la marchandise qu'il produit lui nuisent peu ; parfois ils lui profitent, en éloignant la concurrence. Ils nuisent toujours au consommateur dont les revenus proviennent de ce qu'il place à intérêt son épargne. D'une façon générale, l'entrepreneur peut presque toujours se récupérer sur le consommateur, des augmentations de frais occasionnées par de lourds impôts. Le simple possesseur d'épargne ne le peut presque jamais. De même, le renchérissement de la main d'œuvre ne nuit souvent que peu à l'entrepreneur : uniquement pour les contrats en cours ; tandis que l'entrepreneur petit se récupérer par une augmentation du prix des produits, pour les contrats futurs. Au contraire, le simple possesseur d'épargne subit d'habitude ces renchérissements sans pouvoir se récupérer en aucune façon. Par conséquent, en ce cas, les entrepreneurs et leurs ouvriers ont un intérêt commun, qui se trouve en opposition avec celui des simples possesseurs d'épargne. Il en est de même pour les entrepreneurs et les ouvriers des industries qui jouissent de la protection douanière. La protection douanière agricole a souvent des effets contraires. Aussi est-elle repoussée par les ouvriers industriels, qui sont plus impulsifs, tandis qu'elle est acceptée par les entrepreneurs, mieux et plus avisés, parce qu'ils la considèrent comme un moyen de maintenir la protection industrielle.
§ 2232. Au point de vue social, les oppositions ne sont pas moindres. Prennent rang parmi les entrepreneurs, les gens dont l'instinct des combinaisons est bien développé, instinct indispensable pour réussir en cette profession. Les gens chez lesquels prédominent les résidus de la persistance des agrégats restent parmi les simples possesseurs d'épargne. C'est pourquoi les entrepreneurs sont généralement des gens aventureux, en quête de nouveautés, tant dans le domaine économique que dans le domaine social. Les mouvements ne leur déplaisent pas : ils espèrent pouvoir en tirer profit. Les simples possesseurs d'épargne sont, au contraire, souvent des gens tranquilles, timorés, qui dressent toujours l'oreille, comme fait le lièvre. Ils espèrent peu et craignent beaucoup des mouvements, car ils savent, par une dure expérience, qu'ils sont presque toujours appelés à en faire les frais (§ 2214). Le goût pour une vie aventureuse et dépensière, comme le goût pour une vie tranquille et vouée à l'épargne, sont en grande partie l'effet d'instincts, et bien peu du raisonnement [FN: § 2232-1]. Ils sont semblables aux autres caractères des hommes ; ainsi le courage, la lâcheté, la passion du jeu, la concupiscence, les dispositions pour certains exercices corporels ou pour certains travaux intellectuels, etc. Tous ces caractères peuvent être quelque peu modifiés par des circonstances accessoires ; mais il n'y a aucun doute que ce sont principalement des caractères individuels, sur lesquels le raisonnement n'a que peu ou point d'influence. Vouloir changer par le raisonnement un homme lâche en un homme courageux, un homme imprévoyant en un homme prévoyant, éloigner du jeu un joueur, des femmes un débauché, ou produire d'autres effets semblables, tout le monde sait que c'est œuvre presque toujours – on pourrait même dire toujours – vaine. On ne peut pas contester ce fait en exhibant des statistiques [FN: § 2232-2] , comme on l'a voulu faire pour démontrer que l'épargne est une action essentiellement logique, et que sa quantité est déterminée principalement par l'intérêt qu'on en peut obtenir. En ces cas, les statistiques de phénomènes très complexes, substituées à l'observation directe de phénomènes simples qu'on veut connaître, ne peuvent qu'induire en erreur [FN: § 2232-3). Toutes les actions de l'homme qui tirent leur origine de l'instinct peuvent être plus ou moins modifiées par le raisonnement ; et ce serait une erreur d'affirmer que cela n'a pas lieu aussi pour les actions qui tirent leur origine de l'instinct d'épargne ; mais cela n'empêche pas que cet instinct représente la partie principale du phénomène, partie qui demeure non-logique.
§ 2233. Les faits mentionnés tout à l'heure nous mettent sur la voie d'une classification plus générale, contenant la précédente, et dont nous devrons souvent nous servir pour expliquer les phénomènes sociaux [FN: § 2233-1] (§ 2313 et sv.). Mettons dans une catégorie que nous appellerons (S) les personnes dont le revenu est essentiellement variable et dépend de leur habileté à trouver des sources de gain. Si nous raisonnons d'une manière générale et négligeons les exceptions, dans cette catégorie se trouveront précisément les entrepreneurs dont nous venons de parler. Avec eux seront, en partie du moins, les possesseurs d'actions de sociétés industrielles et commerciales, mais non les possesseurs d'obligations, qui trouveront mieux leur place dans la classe suivante. Il y aura aussi les propriétaires de bâtiments, dans les villes où l'on fait des spéculations immobilières ; de même les propriétaires de terres, avec la condition semblable de l'existence de spéculations sur ces terres ; les spéculateurs à la Bourse ; les banquiers qui gagnent sur les emprunts d'État, sur les prêts aux industries et aux commerces. Ajoutons toutes les personnes qui dépendent de celles-là : les notaires, les avocats, les ingénieurs, les politiciens, les ouvriers et les employés qui retirent un avantage des opérations indiquées plus haut. En somme, nous mettons ensemble toutes les personnes qui, directement ou indirectement, tirent un profit de la spéculation, et qui par différents moyens contribuent à accroître leurs revenus, en tirant ingénieusement parti des circonstances.
§ 2234. Rangeons dans une autre catégorie, que nous appellerons (R) , les personnes dont le revenu est fixe ou presque fixe et dépend peu par conséquent des combinaisons ingénieuses que l'on peut imaginer. Dans cette catégorie figureront, grosso modo [FN: § 2234-1], les simples possesseurs d'épargne, qui l'ont déposée dans les caisses d'épargne, dans les banques, ou qui l'ont placée en rentes viagères, en pensions ; ceux dont les revenus consistent principalement en titres de la dette publique, en obligations de sociétés, ou en autres titres semblables à revenu fixe ; les possesseurs d'immeubles et de terrains, étrangers à la spéculation, les agriculteurs, les ouvriers, les employés qui dépendent de ces personnes, ou qui, d'une manière ou d'une autre, ne dépendent pas de spéculateurs. Enfin, nous rassemblons ainsi toutes les personnes qui, ni directement ni indirectement, ne tirent profit de la spéculation, et qui ont des revenus ou fixes ou presque fixes, ou du moins peu variables.
§ 2235. Dans le seul dessein d'abandonner l'usage incommode de simples lettres, donnons le nom de spéculateurs aux personnes de la catégorie (S) , et de rentiers aux personnes de la catégorie (R) [FN: § 2235-1]. Nous pourrons répéter, pour ces deux catégories de personnes, à peu près ce que nous avons dit précédemment (§ 2197) des possesseurs de simple épargne et des entrepreneurs, et les deux nouvelles catégories auront des conflits économiques et sociaux analogues à ceux des précédentes. Dans la première des catégories dont nous nous occupons maintenant, ce sont les résidus de la Ie classe qui prédominent ; dans la seconde, ce sont ceux de la IIe classe. Il est facile de comprendre comment cela se produit. Celui qui possède des capacités remarquables en fait de combinaisons économiques ne se contente pas d'un revenu fixe, souvent assez mesquin ; il veut gagner davantage ; et s'il trouve des circonstances favorables, il s'élève à la première catégorie. Les deux catégories remplissent dans la société des fonctions d'utilité diverse. La catégorie (S) est surtout cause des changements et du progrès économique et social. La catégorie (R) est, au contraire, un puissant élément de stabilité, qui, en un grand nombre de cas, évite les dangers des mouvements aventureux de la catégorie (S) . Une société où prédominent presque exclusivement les individus de la catégorie (R) demeure immobile, comme cristallisée. Une société où prédominent les individus de la catégorie (S) manque de stabilité : elle est en un état d'équilibre instable, qui peut être détruit par un léger accident à l'intérieur ou à l'extérieur.
Il ne faut pas confondre les (R) avec les « conservateurs », ni les (S) avec les « progressistes », les innovateurs, les révolutionnaires (§ 226, 228 à 244) ; il peut y avoir des points communs, il n'y a pas d'identité. On trouve des évolutions, des innovations, des révolutions que les (R) appuient. D'abord, en grand nombre, celles qui ramènent dans les classes supérieures des résidus de la persistance des agrégats, lesquels en avaient été bannis par les (S) . Une révolution peut être faite contre les (S) : telle est celle qui aboutit à la fondation de l'empire romain, et, en partie, celle de la Réforme protestante. Ensuite, les (R) , précisément parce que chez eux prévalent les résidus de la persistance des agrégats, peuvent être aveuglés par ces sentiments au point d'agir contre leurs propres intérêts : ils se laissent duper aisément par qui fait appel à leurs sentiments, et fort souvent ils ont été les artisans de leur propre ruine (§ 1873). Si les seigneurs féodaux, qui avaient fort accentué le caractère des (R) , ne s'étaient pas laissé entraîner par un ensemble de sentiments dont la passion religieuse n'était qu'une partie, ils auraient facilement compris que les Croisades devaient amener leur ruine. Si la noblesse française, qui vivait de ses rentes, et la partie de la bourgeoisie qui se trouvait dans les mêmes conditions, n'avaient pas été, au XVIIIe siècle, sous l'empire des sentiments humanitaires, elles n'auraient pas préparé la Révolution, qui devait leur être fatale. Parmi les personnes qui furent guillotinées, plus d'une avait longuement, patiemment, savamment aiguisé le couperet qui devait lui trancher la tête. De nos jours, ceux des (R) qui sont dits « intellectuels » marchent sur les traces des nobles français du XVIIIe siècle, et travaillent autant qu'il est en leur pouvoir à la ruine de leur classe (§ 2254).
Il ne faut pas confondre non plus les catégories (R) et (S) avec celles que l'on peut former en considérant les occupations économiques (§ § 1726,1727). Ici encore, nous trouvons des points de contact, mais nous n'avons pas une coïncidence parfaite. Un négociant en détail se trouve souvent dans la catégorie (R) ; un négociant en gros peut aussi y appartenir, mais en de nombreux cas on le trouve dans la catégorie (S) . Parfois une même entreprise peut changer de caractère. Un individu de la catégorie (S) fonde une industrie qui est le résultat d'heureuses spéculations ; quand elle donne, ou paraît donner de beaux bénéfices, il la transforme en société anonyme, retire son épingle du jeu, et passe dans la catégorie (R) . Un grand nombre d'actionnaires de cette société appartiennent aussi à la catégorie (R) : ce sont ceux qui, en achetant des actions, ont cru acquérir des titres de tout repos. S'ils ne se trompent pas, le caractère de l'industrie en question change donc aussi : elle passe de la catégorie (S) à la catégorie (R) . Mais en bien des cas, la meilleure spéculation du fondateur de l'industrie est celle qu'il fait en la transformant en société anonyme, qui bientôt périclite, et comme d'habitude, ce sont les (R) qui paient les pots cassés. Il n'est guère d'industrie plus avantageuse que celle qui consiste à exploiter l'inexpérience, la naïveté, les passions des (R) . Dans nos sociétés, la richesse d'un grand nombre de personnes n'a pas d'autre source [FN: § 2235-2] .
§ 2236. Les diverses proportions en lesquelles les catégories (S) et (R) se trouvent dans la classe gouvernante, correspondent à divers genres de civilisation. Ces proportions sont parmi les principaux caractères à considérer dans l'hétérogénéité sociale [FN: § 2236-1]. Si, par exemple, nous reportons notre attention sur le cycle considéré un peu plus haut (§ 2209 et sv.), nous dirons que, dans les pays démocratiques modernes, la protection industrielle accroît la proportion de la catégorie (S) dans la classe gouvernante. De cet accroissement résulte une nouvelle augmentation de la protection, et cela continuerait ainsi indéfiniment, si des forces ne naissaient pas, qui s'opposent à ce mouvement (§ 2221). Pour continuer ces recherches, il faut que nous ajoutions, aux considérations qui viennent d'être faites, l'étude d'autres phénomènes.
§ 2237. LE RÉGIME POLITIQUE. Parmi les divers phénomènes compliqués que l'on observe dans une société, celui du régime politique est très important. Il est étroitement lié à celui de la nature de la classe gouvernante, et tous deux sont en rapport de mutuelle dépendance avec les autres phénomènes sociaux.
§ 2238. Comme d'habitude, on a souvent attribué une importance exagérée à la forme, et négligé quelque peu le fond. On a considéré principalement la forme sous laquelle se manifeste le régime politique. D'autre part, spécialement en France, sous le règne de Napoléon 111, et surtout parmi les économistes, se manifesta la tendance à donner peu ou point de valeur, non seulement à la forme du régime politique, mais encore au fond même de ce régime. Ainsi, on passait d'un extrême à l'autre, et à des théories exclusivement politiques de la société, on opposait des théories exclusivement économiques, entre autres celle du matérialisme historique. On tombait de la sorte dans l'erreur habituelle de négliger la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux (§ 2361 et sv.).
§ 2239. Pour ceux qui attribuent une très grande importance à la forme du régime politique, il est de prime importance de trancher la question suivante : « Quelle est la meilleure forme de régime politique ? » Mais cette question a peu ou point de sens, si l'on n'ajoute pas à quelle société cette forme doit s'adapter, et si l'on n'explique pas le terme « meilleure », qui fait une vague allusion aux diverses utilités individuelles et sociales (§ 2115). Bien que çà et là on ait quelquefois saisi ce fait, la considération des formes de régime politique a donné lieu à des dérivations sans fin, qui aboutissent à divers mythes. Ces mythes et ces dérivations sont de nulle valeur, au point de vue logico-expérimental; tandis que les uns et les autres, ou mieux les sentiments qu'ils manifestent, peuvent produire des effets très importants pour pousser les hommes à agir. Il est certain que les sentiments manifestés par la foi monarchique, républicaine, oligarchique, démocratique, etc., ont joué et jouent encore un rôle appréciable dans les phénomènes sociaux, ainsi qu'on peut l'observer pour les sentiments manifestés par d'autres religions. Le « droit divin » d'un prince, celui d'une aristocratie, celui du « peuple », de la plèbe, de la majorité, et tous ceux qu'on peut imaginer, n'ont pas la moindre valeur expérimentale. Nous ne devons, par conséquent, les considérer qu'extrinsèquement, comme des faits et une manifestation de sentiments. Ceux-ci, comme les autres caractères des hommes constituant une société donnée, agissent de manière à déterminer le genre et la forme. Ensuite, il ne faut pas oublier que le fait de remarquer que l'un quelconque de ces « droits » n'a pas de fondement expérimental, ne diminue nullement l'utilité qu'on peut lui reconnaître pour la société. Ce fait la diminuerait, si la proposition était une dérivation, étant donné qu'en ces raisonnements on sous-entend, en général, que « tout ce qui n'est pas rationnel est nuisible ». Mais ce fait laisse intacte la considération de ]'utilité, lorsque la proposition est rigoureusement logico-expérimentale, car cette proposition ne renferme pas le sous-entendu de l'affirmation indiquée tout à l'heure (§ 2147). L'étude des formes du régime politique appartient à la sociologie spéciale. Nous ne nous en occupons ici que pour rechercher le fond, recouvert par les dérivations, et pour étudier les rapports des diverses compositions de la classe gouvernante avec les autres phénomènes sociaux.
§ 2240. En cette matière, comme en d'autres semblables, dès les premiers pas, nous nous heurtons à l'obstacle de la terminologie. Cela est naturel, car, pour les recherches objectives que nous voulons effectuer, nous avons besoin d'une terminologie objective ; tandis que, pour les raisonnements subjectifs que l'on fait habituellement, il faut une terminologie subjective, qui est la terminologie vulgaire. Par exemple, chacun reconnaît qu'aujourd'hui la « démocratie » tend à devenir le régime politique de tous les peuples civilisés. Mais quelle est la signification précise de ce terme « démocratie » ? Il est encore plus indéterminé que le terme complètement indéterminé de « religion ». Il est, par conséquent, nécessaire que nous le laissions de côté, et que nous nous mettions à étudier les faits qu'il recouvre [FN: § 2240-1] .
§ 2241. Voyons donc les faits. Tout d'abord, nous constatons une tendance marquée des peuples civilisés modernes à user d'une forme de gouvernement où le pouvoir de faire des lois appartient en grande partie à une assemblée élue par une fraction au moins des citoyens. On peut ajouter qu'il existe une tendance à accroître ce pouvoir, et à augmenter le nombre des citoyens qui élisent l'assemblée.
§ 2242. Exceptionnellement, en Suisse, le pouvoir de légiférer de l'assemblée élue est restreint par le referendum populaire. Aux États-Unis d'Amérique, il a quelque tempérament dans les Federal Courts. En France, Napoléon III tenta de le restreindre au moyen des plébiscites. Il ne réussit pas, et l'on ne peut affirmer avec certitude que ce fut pour s'y être mal pris, car le régime qui en sortit fut détruit par la force armée d'une nation ennemie. La tendance à augmenter le nombre des participants aux élections est générale. C'est là une voie que, pour le moment, on ne parcourt pas à rebours. On étend toujours le droit de vote. Après l'avoir donné aux hommes adultes, on veut l'accorder aux femmes. Il n'est pas impossible qu'on l'étende aussi aux adolescents.
§ 2243. Sous ces formes presque égales chez tous les peuples civilisés, il y a une grande diversité de fond, et l'on donne des noms semblables à des choses dissemblables. Nous voyons, par exemple, que le pouvoir de l'assemblée législative élue passe d'un maximum à un minimum. En France, la Chambre et le Sénat étant électifs, on peut les considérer, dans la recherche que nous faisons ici, comme une assemblée unique. On peut dire qu'elle est entièrement souveraine, et que son pouvoir n'a pas de limites. En Italie, le pouvoir de la Chambre des députés est limité, en théorie par le Sénat, en fait par la monarchie. En Angleterre, il existait une limite effective au pouvoir de la Chambre des Communes dans celui de la Chambre des Lords, aujourd'hui affaibli, et une autre limite dans celui de la monarchie, maintenant fort diminué aussi. Aux États-Unis d'Amérique, le président, élu indépendamment de la Chambre, limite effectivement le pouvoir de celle-ci. En Allemagne, le Conseil fédéral, et plus encore l'empereur, avec l'aide de la caste militaire, limitent grandement le pouvoir du Reichstag. Ainsi, par degrés, on arrive à la Russie, où la Douma a peu de pouvoir, et au Japon, où l'assemblée élue en a aussi très peu. Laissons de côté la Turquie et les républiques de l'Amérique centrale, où les assemblées législatives sont quelque peu chimériques.
§ 2244. Ne nous arrêtons pas à la fiction de la « représentation populaire ». Autant en emporte le vent. Allons de l'avant, et voyons quel fond se trouve sous les diverses formes du pouvoir de la classe gouvernante. À part des exceptions qui sont en petit nombre et de peu de durée, on a partout une classe gouvernante peu nombreuse, qui se maintient au pouvoir, en partie par la force, en partie avec le consentement de la classe gouvernée, qui est beaucoup plus nombreuse. Au point de vue du fond, les différences résident principalement dans les proportions de la force et du consentement ; au point de vue de la forme, dans les manières dont on fait usage de la force et dont on obtient le consentement.
§ 2245. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§ 2170 et sv.), si le consentement était unanime, l'usage de la force ne serait pas nécessaire. Cet extrême ne s'est jamais vu. Un autre extrême est représenté par quelques cas concrets. C'est celui d'un despote qui, grâce à ses soldats, se maintient au pouvoir contre une population hostile. Ce phénomène appartient au passé, ou bien il s'agit d'un gouvernement étranger qui maintient dans la sujétion un peuple indocile. C'est un phénomène dont il y a actuellement encore plusieurs exemples. Le motif pour lequel, dans le premier cas, l'équilibre est beaucoup plus instable que dans le second, doit être recherché dans l'existence de divers résidus. Les satellites du despote n'ont pas des résidus essentiellement différents de ceux du peuple sujet. C'est pourquoi il leur manque la foi qui maintient et en même temps contient l'usage de la force ; et ces satellites disposent volontiers du pouvoir à leur caprice, comme le firent les prétoriens, les janissaires, les mameluks, ou bien ils abandonnent la défense du despote contre le peuple. Au contraire, le peuple dominateur a généralement des us et coutumes, et parfois une langue et une religion, différents du peuple sujet ; par conséquent, il y a différence de résidus, et la foi nécessaire pour user de la force ne fait pas défaut. Mais elle ne fait pas défaut non plus chez le peuple sujet, quand il s'agit de résister à l'oppression, et cela explique comment, à la longue, l'équilibre peut être rompu.
§ 2246. Précisément par crainte de cette éventualité, il arrive que les peuples dominateurs s'efforcent de s'assimiler les peuples sujets ; et quand ils y réussissent, c'est certainement le meilleur moyen d'assurer leur pouvoir ; mais souvent ils échouent, parce qu'ils veulent changer violemment les résidus, au lieu de tirer parti de ceux qui existent. Rome posséda à un degré éminent l'art de tirer parti des résidus ; c'est pourquoi elle put s'assimiler un grand nombre de peuples qui l'entouraient, dans le Latium, en Italie, dans le bassin de la Méditerranée.
§ 2247. Plusieurs fois déjà nous avons eu l'occasion de remarquer que l'œuvre des gouvernements est d'autant plus efficace qu'ils savent mieux tirer parti des résidus existants [FN: § 2247-1] (§ 1843) ; d'autant moins qu'ils ignorent cet art ; et qu'elle est généralement inefficace et vaine, quand ils visent à les changer violemment. En effet, presque tous les raisonnements sur la cause pour laquelle certains actes des gouvernements réussissent ou échouent, aboutissent à ce principe.
§ 2248. Nombre de personnes sont empêchées de le reconnaître à cause des dérivations. Par exemple, si A est la dérivation par laquelle s'expriment certains sentiments des sujets, on trouve facilement une autre dérivation, B qui, en somme, exprime de même les sentiments de la classe dominante. Mais celle-ci estime que cette dérivation B est une réfutation valide et évidente de A. Sous l'empire de cette foi, elle admet qu'il sera facile d'imposer B aux sujets, car enfin c'est seulement les obliger d'ouvrir les yeux et de reconnaître une chose d'une vérité évidente. Au conflit des sentiments se substitue de la sorte un conflit de dérivations, soit une logomachie. D'autres personnes se rapprochent un peu plus de la réalité, mais usent de sophismes. Elles insistent longuement sur l'utilité pour un peuple d'avoir une unité de foi en certaines matières, et négligent entièrement de considérer la possibilité d'y arriver sans aller au devant de graves inconvénients, qui peuvent compenser, et au-delà, l'avantage espéré. D'autres personnes encore supposent implicitement que celui qui tire parti des sentiments d'autrui, alors qu'il ne les partage pas, doit nécessairement le faire dans un dessein malhonnête et nuisible à la société. Aussi condamnent-elles sans autre cette œuvre, comme étant celle d'hypocrites malveillants. Mais cette façon de raisonner est propre à un petit nombre de moralistes, et s'observe bien rarement chez les hommes pratiques.
§ 2249. Le fait de tirer parti des sentiments existant dans une société, afin d'atteindre un certain but, n'est intrinsèquement ni avantageux ni nuisible à la société. L'avantage et l'inconvénient dépendent du but. Si celui-ci est profitable à la société, il y a un avantage ; s'il est nuisible, il y a un inconvénient. On ne peut pas dire non plus que lorsque la classe gouvernante vise à un but qui lui est avantageux, sans se soucier de ce qu'il est pour la classe sujette, celle-ci subisse nécessairement un dommage. En effet, il est des cas très nombreux où la classe gouvernante, recherchant exclusivement son propre avantage, procure en même temps celui de la classe gouvernée. Enfin, le fait de tirer parti des résidus existant dans une société est seulement un moyen, et vaut ce que vaut le résultat auquel il conduit.
§ 2250. Aux résidus, il faut ajouter les intérêts, comme moyen de gouvernement. Parfois ils peuvent ouvrir la seule voie qu'il y ait pour modifier les résidus. Il convient d'ailleurs de faire attention que les intérêts seuls, non recouverts de sentiments, sont bien un puissant moyen d'agir sur les gens chez lesquels prédominent les résidus de l'instinct des combinaisons, et par conséquent sur un grand nombre des membres de la classe gouvernante, mais qu'ils sont, au contraire, peu efficaces, s'ils sont seuls, sans les sentiments, lorsqu'il s'agit d'agir sur les gens chez lesquels prédominent les résidus de la persistance des agrégats, et par conséquent sur le plus grand nombre des membres de la classe gouvernée. En général, on peut dire, très en gros, que la classe gouvernante voit mieux ses intérêts, parce que chez elle les voiles du sentiment sont moins épais, et que la classe gouvernée les voit moins bien, parce que chez elle ces voiles sont plus épais. On peut dire aussi qu'il en résulte que la classe gouvernante peut tromper la classe gouvernée, et l'amener à servir ses intérêts, à elle classe gouvernante. Ces intérêts ne sont pourtant pas nécessairement opposés à ceux de la classe gouvernée ; souvent même tous deux coïncident, de telle sorte que la tromperie tourne à l'avantage de la classe gouvernée elle-même.
§ 2251. Dans toute l'histoire, le consentement et la force apparaissent comme des moyens de gouverner. Ils apparaissent déjà dans les légendes de l'Iliade et de l'Odyssée, pour assurer le pouvoir des rois grecs ; on les voit aussi dans les légendes des rois romains. Puis, à l'époque historique, à Rome, ils agissent aussi bien sous la République que sous le Principat ; et il n'est point démontré que le gouvernement d'Auguste obtint moins le consentement de la classe gouvernée que ne purent l'obtenir les divers gouvernements de la fin de la République. Puis, plus tard, des rois barbares et des républiques du moyen âge jusqu'aux rois de droit divin, il y a deux ou trois siècles, et enfin aux régimes démocratiques modernes, on trouve toujours ce mélange de force et de consentement.
§ 2252. De même que les dérivations sont beaucoup plus variables que les résidus qu'elles manifestent, les formes sous lesquelles apparaissent l'usage de la force et le consentement sont beaucoup plus variables que les sentiments et les intérêts dont ils proviennent, et les différences de proportions entre l'usage de la force et le consentement ont en grande partie pour origine les différences de proportions entre les sentiments et les intérêts. La similitude entre les dérivations et les formes de gouvernement va plus loin ; les unes aussi bien que les autres agissent beaucoup moins sur l'équilibre social que les sentiments et les intérêts dont elles proviennent. Beaucoup de savants s'en sont doutés. Pourtant, ils allèrent un peu trop loin, en affirmant que la forme du gouvernement est indifférente.
§ 2253. Il existe partout une classe gouvernante, même là où il y a un despote ; mais les formes sous lesquelles elle apparaît sont diverses. Dans les gouvernements absolus, seul un souverain paraît en scène ; dans les gouvernements démocratiques, c'est un parlement. Mais dans la coulisse se trouvent ceux qui jouent un rôle important au gouvernement effectif. Sans doute, ils doivent parfois s'incliner devant les caprices de souverains ou de parlements ignorants et tyranniques ; mais ils ne tardent pas à reprendre leur œuvre tenace, patiente, constante, dont les effets sont bien plus grands que ceux de la volonté des maîtres apparents. Dans le Digeste, nous trouvons d'excellentes constitutions sous le nom de très mauvais empereurs, de même qu'à notre époque, nous voyons des codes passables approuvés par des parlements assez ignares. En l'un et l'autre cas, la cause du fait est la même, c'est-à-dire que le souverain laisse faire les jurisconsultes. En d'autres cas, le souverain ne s'aperçoit même pas de ce qu'on lui fait faire, et les parlements moins encore qu'un chef ou qu'un roi avisé. Moins que tout autre s'en aperçoit le souverain Démos ; et parfois cela a permis de réaliser, contrairement à ses préjugés, des améliorations des conditions sociales, ainsi que des mesures opportunes pour la défense de la patrie. Le bon Démos croit faire sa volonté, et fait, au contraire, celle de ses gouvernants. Mais très souvent cela profite uniquement aux intérêts de ces gouvernants, qui, depuis le temps d'Aristophane jusqu'au nôtre, usent largement de l'art de berner Démos [FN: § 2253-1]. Comme le firent déjà les ploutocrates de la fin de la République romaine, nos ploutocrates se préoccupent de gagner de l'argent, soit pour eux-mêmes, soit pour assouvir les appétits de leurs partisans et de leurs complices ; ils se soucient peu ou point d'autre chose. Parmi les dérivations dont ils usent pour démontrer l'utilité de leur pouvoir pour la nation, il faut remarquer celle qui affirme que le peuple est plus capable de juger les questions générales que les questions spéciales. En réalité, c'est exactement l'inverse. Il suffit de raisonner quelque peu avec des personnes qui ne sont pas cultivées, pour constater qu'elles comprennent beaucoup mieux les questions spéciales, qui sont habituellement concrètes, que les questions générales, qui sont habituellement abstraites. Mais les questions abstraites présentent cet avantage pour les gouvernants, que quelle que soit la solution donnée par le peuple, ils sauront en tirer les conséquences qu'ils voudront. Par exemple, le peuple élit des hommes qui veulent abolir l'intérêt du capital, la plus-value des industries, et réfréner l'avidité des spéculateurs (questions générales), et ces hommes, directement ou indirectement, en soutiennent d'autres ; ils accroissent énormément la dette publique, et par conséquent les intérêts payés pour ce capital ; ils maintiennent, ils accroissent même la plus-value dont jouissent les industriels. Beaucoup de ceux-ci s'enrichissent grâce à la démagogie, et confient le gouvernement de l'État aux spéculateurs. On voit même certains de leurs chefs devenir des diplomates, tel Volpi, qui conclut le traité de Lausanne, ou des ministres, tels Caillaux et Lloyd George.
§ 2254. La classe gouvernante n'est pas homogène. Elle-même a un gouvernement et une classe plus restreinte ou un chef, un comité qui effectivement et pratiquement prédominent. Parfois, le fait est patent, comme pour les Éphores, à Sparte, le Conseil des Dix, à Venise, les ministres favoris d'un souverain absolu ou les meneurs d'un parlement. D'autres fois, le fait est en partie masqué, comme pour le Caucus, en Angleterre, les Conventions des États-Unis, les dirigeants des « spéculateurs », qui opèrent en France et en Italie, etc. [FN: § 2254-1]. La tendance à personnifier les abstractions, ou même seulement à leur donner une réalité objective, est telle que beaucoup de personnes se représentent la classe gouvernante presque que comme une personne, ou au moins comme une unité concrète, qu'ils lui supposent une volonté unique, et croient qu'en prenant des mesures logiques, elle réalise les programmes. C'est ainsi que beaucoup d'antisémites se représentent les Sémites, beaucoup de socialistes les bourgeois ; tandis que d'autres personnes se rapprochent davantage de la réalité, en voyant dans la bourgeoisie une organisation qui agit en partie sans que les bourgeois en soient conscients. Comme d'autres collectivités, les classes gouvernantes accomplissent des actions logiques et des actions non-logiques. La partie principale du phénomène, c'est l'organisation, et non pas la volonté consciente des individus, qui, en certains cas, peuvent même être entraînés par l'organisation là où leur volonté consciente ne les porterait pas. Quand nous parlons des « spéculateurs », il ne faut pas se les figurer comme des personnages de mélodrame qui, mettant à exécution des desseins pervers par de ténébreux artifices, régissent et gouvernent le monde. Cela n'aurait guère plus de réalité qu'une fable mythologique. Les « spéculateurs » sont des hommes qui se préoccupent simplement de leurs affaires, et chez lesquels les résidus de la Ie classe sont puissants. Ils s'en servent pour tâcher de gagner de l'argent, et se meuvent selon la ligne de moindre résistance, comme le font en somme tous les hommes. Ils ne tiennent pas des assemblées pour concerter leurs desseins communs, et n'en délibèrent pas non plus d'une autre manière. Mais l'accord se produit spontanément, parce que si, en des circonstances données, il y a une ligne de plus grand profit et de moindre résistance, la plupart de ceux qui la cherchent la trouveront, et, chacun la suivant pour son compte, il semblera, bien que cela ne soit pas, que tous la suivent d'un commun accord. Mais d'autres fois, il arrivera aussi que, mus par les forces de l'organisation dont ils font partie, leur volonté sera récalcitrante, et ils poursuivront involontairement la ligne de conduite qu'implique leur organisation. Il y a cinquante ans, les « spéculateurs » ignoraient entièrement l'état de choses actuel auquel les a conduits leur œuvre. La voie suivie est la résultante d'une infinité de petites actions, déterminées chacune par l'intérêt présent. Ainsi qu'il arrive dans tous les phénomènes sociaux, elle est la résultante de certaines forces agissant au milieu de certaines liaisons et de certains obstacles. Par exemple, lorsque nous disons qu'aujourd'hui les « spéculateurs » préparent la guerre en faisant des dépenses toujours croissantes, nous n'entendons nullement affirmer qu'ils en soient conscients. Bien au contraire. Ils préparent la guerre en faisant des dépenses toujours croissantes, et en suscitant des conflits économiques, parce qu'ils y trouvent un profit direct. Mais, bien qu'importante, cette cause n'est pas la principale : il en est une autre de plus grande importance. Elle consiste à se servir, comme d'un moyen de gouverner, des sentiments de patriotisme existant dans la population. En outre, les « spéculateurs » des différents pays se font concurrence, et se prévalent des armements pour obtenir des concessions de leurs rivaux. Il existe d'autres causes semblables ; toutes poussent à accroître les armements, sans que cela ait lieu en vertu d'un plan préconçu. D'autre part, les spéculateurs qui possèdent en abondance des résidus de la Ie classe, saisissent par intuition, sans qu'il soit besoin de raisonnements et de théories, que si une grande et terrible guerre éclatait, entre autres cas possibles, il se pourrait qu'ils dussent céder la place aux hommes chez lesquels abondent les résidus de la IIe classe. C'est pourquoi, en vertu du même instinct qui fait fuir le cerf devant le lion, ils sont opposés à une telle guerre, tandis qu'ils consentent volontiers à de petites guerres coloniales, auxquelles ils peuvent présider sans aucun danger. C'est de leurs intérêts et de leurs sentiments que résulte leur œuvre, et non pas de leur volonté réfléchie et arrêtée. Par conséquent, cette œuvre peut en fin de compte aboutir où ils le désirent, mais elle pourrait aussi les entraîner là où ils n'auraient jamais voulu aller. Il pourrait encore arriver qu'un jour éclatât la guerre préparée mais non voulue. Elle serait la conséquence de l'œuvre antérieure des « spéculateurs », œuvre qu'ils n'auront jamais voulue, à aucun moment. De même, les « spéculateurs » de la Rome antique préparèrent la chute de la République et l'avènement de César et d'Auguste, mais sans savoir qu'ils entraient dans cette voie, et sans vouloir le moins du monde atteindre ce résultat. En ce qui concerne les « spéculateurs », de même qu'en ce qui concerne d'autres éléments de l'organisation sociale, le point de vue éthique et le point de vue de l'utilité sociale doivent être nettement distingués. Au point de vue de l'utilité sociale, les « spéculateurs » ne sont pas condamnables parce qu'ils accomplissent des actions réprouvées par l'une des éthiques qui ont cours ; on ne doit pas les excuser non plus, si l'on se place au point de vue de ces éthiques, parce qu'ils sont utiles socialement. Il faut aussi rappeler que l'existence de cette utilité dépend des circonstances dans lesquelles se déroule l'œuvre des spéculateurs, et notamment du nombre de ceux-ci, proportionnellement aux individus chez lesquels les résidus de la IIe classe sont puissants, soit dans la population totale, soit dans la classe gouvernante. Pour connaître et évaluer cette utilité, nous avons à résoudre un problème quantitatif, et non un problème qualitatif. À notre époque, par exemple, le développement considérable de la production économique, l'extension de la civilisation à des pays nouveaux, l'augmentation notable de l'aisance des populations civilisées, sont dus en grande partie à l'œuvre des spéculateurs ; mais ceux-ci ont pu l'accomplir, parce qu'ils sortaient de populations où il y avait encore en abondance des résidus de la IIe classe. Il est douteux, il est même peu probable qu'on puisse réaliser de tels avantages si, dans la population ou même seulement dans la classe gouvernante, les résidus de la IIe classe diminuent beaucoup (§ 2227-1, 2383-1).
§ 2255. Si nous voulons avoir des exemples concrets de l'emploi des moyens de gouverner indiqués tout à l'heure, nous n'avons qu'à songer à l'Italie, au temps du gouvernement du ministère Depretis. Comment ce politicien put-il bien jouer le rôle de maître de la Chambre et du pays, pendant tant d'années ? Il n'était pas le chef d'une armée victorieuse ; il n'avait pas l'éloquence qui entraîne les hommes, ni l'autorité que donnent des actions d'éclat ; il n'était pas imposé par le souverain. D'où venait donc sa force ? Une seule réponse est possible : il sut magistralement se servir des sentiments et des intérêts qui existaient dans le pays ; de ces derniers surtout ; cela en devenant le véritable chef du syndicat des « spéculateurs » qui régnait sur le pays et qui détenait le pouvoir effectif dont il n'avait que l'apparence. Il fit la fortune d'un grand nombre de « spéculateurs », par la protection douanière, par les conventions ferroviaires, par les concessions gouvernementales où l'État était volé à pleines mains, par les désordres des banques, découverts plus tard : jamais chef de bande n'accorda plus de pillages et de rapines à ses troupes. Le gouvernement de Crispi fut un intermède : il voulut modifier les résidus et ne se soucia pas beaucoup des intérêts des « spéculateurs ». Il voulait faire naître le sentiment du nationalisme en un peuple où il n'existait pas encore, et comme d'habitude son œuvre fut vaine. Au lieu de se servir des socialistes, il les combattit, et par conséquent se fit des ennemis de leurs chefs les plus intelligents et les plus actifs. Les « spéculateurs » lui furent ou hostiles ou indifférents : il leur donnait peu ou rien à dévorer. Enfin, les conditions de la période économique dans laquelle il gouvernait lui furent défavorables (§ 2302). Il tomba brusquement par suite d'une défaite subie en Abyssinie ; mais même sans cela il n'aurait pu se maintenir au gouvernement. On remarquera le contraste entre Crispi et son successeur Giolitti. Celui-ci fut vraiment un maître en l'art de se servir des intérêts et des sentiments. Non moins que Depretis, il se fit chef du syndicat des « spéculateurs », protecteur des trusts. Pour les soutenir, il fallait de l'argent. Les banques, ayant placé une grande partie de leurs ressources en emprunts d'État, ne pouvaient donner toute l'aide dont on avait besoin. Le ministère Giolitti se mit en mesure de procurer de l'argent au gouvernement par le monopole des assurances. Par conséquent, en rendant disponible l'argent des banques, il aidait les trusts [FN: § 2255-1]. Il sut utiliser les sentiments d'une manière vraiment admirable, sans en négliger aucun. Crispi avait voulu créer les sentiments nationalistes, et avait fait œuvre vaine. Giolitti les trouva existant déjà dans le pays, et il s’en servit largement avec succès. Il ne chercha nullement à combattre le socialisme ; il en circonvint et flatta les chefs. Les uns « reléguèrent Marx au grenier » (c'est ainsi qu'il s'exprima) ; d'autres furent apprivoisés à tel point qu'ils méritèrent le nom de socialistes royaux. Il soutint largement les coopératives socialistes. Son œuvre fut possible parce qu'il fut favorisé par les circonstances économiques (§ 2302), qui furent au contraire défavorables à Crispi. Ces circonstances favorables permirent à Giolitti de mener à bonne fin la guerre de Libye et de renvoyer à plus tard la liquidation des nombreuses dépenses occasionnées par sa politique. Ami des socialistes, au moins de ceux qui n'étaient pas trop sauvages, dont la foi n'était pas trop vive, il ne se montra point l'ennemi des cléricaux. Au contraire, il sut se servir d'eux aussi, et s'il ne les apprivoisa pas, du moins il les rendit plus traitables et en tira largement parti dans les élections. Grâce au concours des sentiments nationalistes, il dissocia le bloc républicain, et le réduisit à un petit noyau de personnes demeurées aveuglément fidèles à leurs principes. Il étendit le droit de suffrage électoral pour faire peur à la bourgeoisie et s'en faire le protecteur, tandis qu'il s'efforçait aussi d'apparaître comme celui des partis populaires. En somme, il n'est pas de sentiments ni d'intérêts, en Italie, dont il n'ait su judicieusement tirer parti à ses fins. C'est pourquoi il réussit, et put entreprendre la campagne de Libye, bien autrement coûteuse et dangereuse que la campagne d'Abyssinie, qui fut fatale à Crispi (§ 2302). On dit qu'il ne voulait pas la guerre de Libye, et qu'il la fit uniquement pour satisfaire certains sentiments, s'en servant comme d'un moyen de gouverner. Comme tous les hommes chez lesquels prédominent fortement les résidus de la Ie classe, il se servait des sentiments, mais ne les comprenait pas très bien ; il ne saisissait pas comment ils pouvaient subsister dans les masses populaires, tandis qu'il les voyait céder chez les chefs qu'il adulait et bernait. Il n'avait pas une juste conception de la valeur sociale de ces sentiments. Cela ne portait guère préjudice à ses menées d'alors, mais l'empêchait d'avoir une vue claire de l'avenir ainsi préparé. Au reste, il se souciait peu de cela et ne se préoccupait que du présent. En portant un grand coup à l'empire ottoman, par la guerre de Libye, il préparait la guerre balkanique, et par conséquent altérait profondément l'équilibre européen ; cependant il ne songeait pas à préparer la puissance militaire de son pays, en vue de conflits futurs. Il n'augmentait pas convenablement les dépenses en faveur de l'armée et de la flotte, parce qu'il lie voulait pas exaspérer les contribuables, et parce qu'il avait surtout besoin des suffrages des socialistes. Au contraire, il se vantait d'avoir maintenu ou accru, malgré la guerre, les dépenses en faveur des travaux publics et les subventions de divers genres aux électeurs. Il dissimulait, au budget, les dépenses de la guerre, remettant à plus tard le soin de les solder. Il accroissait à la dérobée la dette publique, par l'émission de bons du trésor à longue échéance, qu'il faisait absorber par les banques et les caisses d'épargne, au risque de compromettre gravement l'avenir. De cette façon, tout en faisant la guerre, il en dissimulait les charges. Sur le moment, cela était avantageux, car il contentait ainsi ceux qui voulaient la guerre et ceux qui ne voulaient pas en supporter les conséquences indispensables ; mais on renvoyait ainsi à plus tard et on aggravait les difficultés qu'on n'aplanissait pas. En ce cas particulier, on voit, comme avec une loupe grossissante, l'œuvre à laquelle les « spéculateurs » tendent généralement. Le fait que les résidus de la Ie classe prédominaient fortement chez Giolitti et ses partisans, et que ceux de la IIe classe leur faisaient presque défaut, profita, puis finit par nuire à leur pouvoir. Celui-ci se trouva ébranlé par l'action d'une cinquantaine de députés socialistes que les élections de 1913 envoyèrent au Parlement, et chez lesquels prédominaient, au contraire, les résidus de la IIe classe. Avant ces élections, le parti socialiste avait dû choisir entre le « transformisme » et l'intransigeance, c'est-à-dire entre une voie où les résidus de la Ie classe étaient en plus grande abondance, et une autre voie, où les résidus de la IIe classe prédominaient. Ainsi qu'il arrive habituellement, tant pour les nations que pour les partis, les chefs avaient la tendance de suivre la première voie, mais il monta du peuple une marée qui mit en évidence d'autres chefs, et les poussa avec une partie des anciens dans la seconde voie, où prédominent les sentiments. Ce fut une heureuse circonstance pour le parti socialiste, parce qu'il se mit ainsi dans des conditions favorables pour livrer bataille à un gouvernement sans convictions ni foi.
Nous avons ici un cas particulier d'un phénomène général, dont nous devrons parler longuement. En d'autres termes, nous voyons que la plus grande force d'un parti n'est pas réalisée par la prédominance exclusive des résidus de la Ie classe, ni de ceux de la IIe, mais par une certaine proportion des uns et des autres.
§ 2256. L'intermède du gouvernement Luzzatti confirme les déductions du paragraphe précédent. M. Luzzatti avait grandement servi les intérêts de ceux qui jouissent de la protection douanière ; mais ceux-ci n'avaient plus besoin de son aide lorsqu'il devint président du Conseil, parce qu'alors la protection n'était pas en danger, et l'on sait que le passé ne nous appartient plus. D'autre part, le ministre Luzzatti était loin de représenter aussi bien que Giolitti le syndicat des « spéculateurs », et il ne savait pas comme lui se servir des sentiments existants, tout en y restant étranger. C'est pourquoi Giolitti, demeuré le maître effectif quand le ministre Luzzatti gouvernait, retira sans le moindre effort le pouvoir à ce dernier, lorsque vint le moment que lui, Giolitti, estimait convenable. De même, M. Sonnino, très supérieur à d'autres hommes d'État, par la culture et les conceptions politiques, n'a jamais pu rester au pouvoir, parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas représenter fidèlement le syndicat des « spéculateurs ». En France, le ministre Rouvier fut souvent le maître du Parlement, précisément à cause de ses mérites comme chef d'un semblable syndicat. Son dernier ministère prit fin, non à cause de difficultés intérieures, mais bien en raison de la politique extérieure. La force de M. Caillaux réside tout entière dans les « spéculateurs » qui l'entourent. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces noms ou à d'autres, et croire que ces faits soient particuliers à certains hommes, à certains régimes politiques, à certains pays, alors que ce sont au contraire des faits dépendant étroitement de l'organisation sociale dans laquelle les « spéculateurs » constituent l'élite gouvernementale [FN: § 2256-1]. En Angleterre, les campagnes électorales contre la Chambre des Lords furent soutenues financièrement par les « spéculateurs » dont les ministres dits « libéraux » se firent les chefs [FN: § 2256-2). En Allemagne, les trusts des grands industriels et des grands financiers arrivent jusque sur les marches du trône ; mais la caste militaire leur dispute encore partiellement la place. Aux États-Unis d'Amérique, Wilson et Bryan, parvenus au pouvoir comme adversaires en apparence, et probablement sincères, des trusts et des financiers, agirent de manière à les favoriser, en maintenant l'anarchie au Mexique, dans le but d'avoir un président soumis à la finance des États-Unis. Ces pacifistes poussèrent la désinvolture jusqu'à inviter le gouvernement du Mexique au congrès de la paix à la Haye, au moment précis où la flotte des États-Unis attaquait Vera-Cruz, tuant hommes, femmes, enfants. Le passé le plus proche de nous ressemble au présent. En France, Louis-Napoléon Bonaparte put devenir Napoléon III, parce qu'il se fit le chef des « spéculateurs » ; tandis qu'en Italie, les gouvernements d'autrefois tombaient pour les avoir ignorés, omis, négligés. C'est peut-être aller trop loin, mais pas énormément, que de dire que si le gouvernement du roi de Naples et les autres gouvernements voisins avaient accordé la concession des Chemins de fer Méridionaux, et pris l'initiative d'autres entreprises semblables, ils n'auraient pas été renversés. Durant bien des années, les « libéraux », en France et en Italie, nous ont corné aux oreilles leur admiration pour le gouvernement parlementaire anglais, qu'ils donnaient au monde pour modèle. Une partie d'entre eux ignoraient peut-être la grande corruption de ce régime, que décrit fort bien Ostrogorski ; mais une partie la connaissaient certainement, et s'ils la passaient sous silence, c'était parce que les loups ne se mangent pas entre eux.
§ 2257. Pour se maintenir au pouvoir, la classe gouvernante emploie des individus de la classe gouvernée ; on peut les diviser en deux catégories, qui correspondent aux deux moyens principaux par lesquels on s'assure ce pouvoir (§ 2251). Une catégorie fait usage de la force, ainsi les soldats, les agents de police, les bravi des siècles passés. L'autre catégorie emploie l'artifice, et, de la clientèle des politiciens romains, arrive à celle de nos politiciens contemporains. Ces deux catégories ne font jamais défaut, mais ne se trouvent pas dans les mêmes proportions réelles, et moins encore dans les mêmes proportions apparentes. La Rome des prétoriens marque un autre extrême, où le principal moyen réel de gouvernement, et encore plus le principal moyen apparent, est la force armée. Les États-Unis d'Amérique marquent l'autre extrême, où le principal moyen de gouvernement est, en réalité et un peu moins en apparence, les clientèles politiques. Sur celles-ci on agit par différents moyens [FN: § 2257-1] . Le principal est le moins manifeste : le gouvernement protège les intérêts des « spéculateurs », souvent sans qu'il y ait avec eux aucune entente explicite. Par exemple, un gouvernement protectionniste jouit de la confiance et de l'appui des industriels protégés, sans qu'il ait besoin de conclure des accords explicites avec tous ; mais il peut bien y avoir quelque accord avec les principaux. Il en est de même pour les travaux publics ; pourtant l'accord avec les grands entrepreneurs tend à devenir la règle. Ensuite, il y a des moyens plus connus, moins importants au point de vue social, mais qui passent au contraire pour plus importants au point de vue éthique. Ce sont entre autres, aujourd'hui, les corruptions politiques d'électeurs [FN: § 2257-2), de candidats élus, de gouvernants, de journalistes, et autres semblables [FN: § 2257-3), auxquelles font pendant, sous les gouvernements absolus, les corruptions de courtisans, de favoris, de favorites, de gouvernants, de généraux, etc., lesquelles n'ont d'ailleurs pas entièrement disparu. Ces moyens furent usités de tout temps, depuis ceux de l'antique Athènes et de la Rome républicaine jusqu'à nos jours. Mais ils sont proprement la conséquence du gouvernement d'une classe qui s'impose par la ruse pour régner sur un pays. C'est pourquoi les innombrables tentatives faites pour en réprimer l'usage ont été et demeurent vaines. On peut couper tant qu'on veut le chiendent : il croit de nouveau vivace, si la racine reste intacte. Nos démocraties, en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, tendent toujours plus vers un régime de ploutocratie démagogique. Peut-être s'acheminent-elles ainsi vers quelque transformation radicale, semblable à l'une de celles qu'on observa dans le passé.
§ 2258. À part quelques exceptions dont la principale est celle des honneurs qu'un gouvernement peut accorder (§ 2256-1, 2257-3), des dépenses sont nécessaires pour assurer tant le concours de la force armée que celui de la clientèle. Il ne suffit donc pas de vouloir employer ces moyens : il faut aussi pouvoir le faire. Cela dépend en partie de la production de la richesse, et cette production elle-même n'est pas indépendante de la manière dont on se sert de la force armée et des clientèles. Le problème est donc compliqué et doit être considéré synthétiquement (§ 2268). Analytiquement, on peut dire qu'en de nombreux cas la force armée coûte moins que les clientèles ; mais il se peut qu'en certains cas celles-ci soient plus favorables à la production de la richesse. On devra en tenir compte dans la synthèse (§ 2268).
§ 2259. L'évolution « démocratique » paraît être en rapports étroits avec l'emploi plus large du moyen de gouverner qui fait appel à l'artifice et à la clientèle, par opposition au moyen qui recourt à la force. On vit cela déjà vers la fin de la République, à Rome, où se produisit le conflit précisément entre ces deux moyens, et où, avec l'Empire, la force l'emporta. On le voit mieux encore dans le temps présent, où le régime d'un bon nombre de pays « démocratiques » pourrait être défini : une féodalité en grande partie économique (§ 1714) où le principal moyen de gouverner en usage est le jeu des clientèles [FN: § 2259-1] ; tandis que la féodalité guerrière du moyen âge faisait usage surtout de la force des vassaux. Un régime en lequel le « peuple » exprime sa « volonté », – à supposer qu'il en ait une, – sans clientèles ni brigues ni coteries, n'existe qu'à l'état de pieux désirs de théoriciens, mais ne s'observe en réalité ni dans le passé ni dans le présent, ni dans nos contrées, ni en d'autres.
§ 2260. Ces phénomènes, aperçus par beaucoup d'auteurs, sont habituellement décrits comme une déviation, une « dégénérescence » de la « démocratie ». Mais quand et où a-t-on jamais vu l'état parfait, ou au moins bon, dont celui-ci a dévié, ou « dégénéré » ? Personne ne peut le dire. On peut seulement observer que lorsque la démocratie était un parti d'opposition, elle avait moins de tares qu'actuellement ; mais c'est là un caractère commun à presque tous les partis d'opposition, auxquels, pour mal faire, il manque moins la volonté que le pouvoir.
§ 2261. On remarquera, en outre, que les défauts des divers régimes politiques peuvent bien être différents, mais que, dans l'ensemble, on ne peut affirmer que certains genres de ces régimes diffèrent beaucoup des autres, à ce point de vue [FN: § 2261-1]. Les reproches adressés à la démocratie moderne ne diffèrent pas beaucoup de ceux qu'on adressait à certaines démocraties antiques, par exemple à celle d'Athènes. S'il y a un grand nombre de faits de corruption dans les unes et les autres, il ne serait pas difficile d'en trouver de semblables dans les monarchies absolues, dans les monarchies tempérées, dans les oligarchies, et dans d'autres régimes (§ 2445 et sv., 2454).
§ 2262. Les partis ont l'habitude d'envisager ces faits au point de vue éthique, et de s'en servir pour se combattre mutuellement. Le point de vue éthique est celui qui impressionne le plus le peuple. Aussi l'ennemi religieux ou politique est-il généralement accusé, à tort on à raison, de violer les règles de la morale. Souvent on a en vue la morale sexuelle (§ 1757 et sv.), qui impressionne beaucoup un grand nombre de personnes. Ce genre d'accusation fut très usité contre les hommes puissants, dans les siècles passés. Il sert encore parfois aujourd'hui, dans la politique, en Angleterre. C'est ainsi que dans ce pays-là la carrière politique de Sir Charles Dilke fut brisée. Dans l'histoire, on ne trouve aucun rapport entre des fautes semblables ou plus grandes d'un homme et sa valeur politique. Le rapport semble plus probable quand les fautes se rattachent à l'appropriation du bien d'autrui et aux corruptions. Cependant, dans ce domaine aussi, les hommes qui occupent une place éminente dans l'histoire sont généralement bien loin d'être exempts de telles fautes, et, pour rester dans le domaine de l'éthique, les différences sont de forme plus que de fond. Sulla, César, Auguste, distribuaient brutalement à leurs vétérans les biens des citoyens ; avec plus d'artifice, et mieux, les politiciens modernes les distribuent à leurs partisans, grâce à la protection économique et autres semblables moyens. Il existe réellement une différence de fond entre ces deux modes de procéder ; mais il faut les chercher dans un autre domaine (§ 2267). La considération exclusive du phénomène, au point de vue éthique, empêche de voir les uniformités de rapports de faits qui s'y trouvent. Supposons, par exemple, une certaine organisation sociale dans laquelle existe cette uniformité : que pour gouverner, il est nécessaire aux gouvernants d'accorder des faveurs, de protéger les financiers et les entrepreneurs de la production économique, et de recevoir en retour les faveurs de ces personnes, d'être protégés par eux. Les rapports entre les gouvernants et ces « spéculateurs » seront tenus secrets autant que possible. Pourtant, de temps à autre, on en découvrira un. En d'autres termes, on en viendra à savoir que certains A, qui sont au gouvernement, ont eu certains rapports avec les « spéculateurs », et ce sont presque toujours des B, adversaires des A, qui dévoilent le fait [FN: § 2262-1]. Cela posé, si l'on voulait procéder selon les méthodes de la science expérimentale, on devrait s'y prendre comme suit : 1° Sous l'aspect des mouvements réels. Il y aurait lieu d'examiner si le fait est accidentel, isolé, ou bien s'il rentre dans une nombreuse classe de faits semblables. En ce dernier cas, il faudrait examiner à quelle uniformité correspond cette classe de faits, et en quel rapport de dépendance cette uniformité se trouve avec les autres uniformités de la société considérée. 2° Sous l'aspect des mouvements virtuels. À supposer que l'on veuille empêcher le retour de faits semblables à celui dont il s'agit, il est nécessaire de rechercher quels liens doivent être supprimés ou modifiés, parmi ceux qu'il est possible de supprimer (§ 134), afin d'obtenir l'effet voulu.
Cette manière de raisonner ne s'observe presque jamais, mieux vaut dire jamais [FN: § 2262-2). Cela pour deux causes principales. La première est celle tant de fois notée, et suivant laquelle, aux raisonnements logico-expérimentaux, les hommes préfèrent habituellement les dérivations, et parmi celles-ci les dérivations éthiques. La seconde est que le petit nombre des gens qui seraient capables de voir la réalité des choses, ont intérêt à en écarter l'attention du public. Il faut en effet prendre garde que d'habitude les B n'ont nullement le dessein d'ôter à tout le monde le pouvoir d'accomplir les faits blâmés, mais bien de l'enlever uniquement aux A. Ils visent moins à changer l'ordre social qu'à le faire tourner à leur profit, en dépossédant les A et en se substituant à eux. C'est pourquoi il est bon que les actes paraissent être une conséquence non pas de l'ordre social, mais de la perversité des A. Il semblerait que les partis dits « subversifs », qui veulent détruire l'ordre social actuel, devraient procéder autrement. Mais ils ne le font pas, parce que les changements qu'ils désirent sont généralement d'un autre genre que ceux qui empêcheraient le retour des faits indiqués. Par conséquent, ces partis suivent aussi la voie des dérivations éthiques, en ajoutant que la perversité des A est causée par l'organisation qu'eux, les B, veulent détruire, par exemple le « capitalisme ». Les A et les B font bon accueil à ces dérivations, car en visant à des éventualités très reculées et peu probables, ils distraient l'attention de causes beaucoup plus rapprochées et beaucoup plus faciles à atteindre [FN: § 2262-3).
De cette façon, le raisonnement se prolonge toujours plus dans les divagations éthiques, et les meilleures, pour ceux qui en font usage, sont celles qui distraient l'attention des points où ils voient un danger. Les suivantes sont habituellement les plus usitées.
1° Comme ce sont les B qui ont dévoilé les méfaits des A, les amis des A prennent l'offensive contre les B, et disent qu'après tout ceux-ci ne sont pas « meilleurs » que les A ; en quoi ils ont souvent raison ; et ce qui fait que leur avis est aussi partagé par des personnes de bonne foi [FN: § 2262-4]. Ainsi un problème très dangereux se change en un autre, plus anodin. Au lieu de chercher s'il y a, dans l'ordre social, une cause qui produit les méfaits des A et des B, lesquels sont dévoilés, ceux des A par les B, et ceux des B par les A, on cherche quelle est la comparaison morale à établir entre les A et les B. Comme ce dernier problème est presque insoluble, après un grand débat, l'énorme émotion causée par le scandale des A n'aboutit à rien. 2° On a une variété de la dérivation précédente, lorsqu'on démontre que les B, en dévoilant les méfaits des A, sont mus par un intérêt de parti. Il existe d'autres dérivations semblables, qui toutes ont pour but de substituer ce problème : « Comment et pourquoi les méfaits des A ont-ils été dévoilés? », à cet autre : « Ces méfaits existent-ils, oui ou non, et quelle en est la cause ? » 3° On obtient d'autres dérivations, non plus en comparant les A et les B, mais en traitant d'eux séparément. À l'égard des A, on recourt au procédé, si efficace dans les défenses devant les jurés, et consistant à rechercher chacun des actes de la vie d'un accusé, avec une telle abondance de détails, qu'on masque le fait visé par l'accusation. On dit que les A ont été de bons patriotes, qu'ils ont bien servi leur parti, et l'on exhibe quantité d'autres choses semblables, entièrement étrangères à l'accusation. Une dérivation très en usage consiste à affirmer – que ce soit vrai ou non – que les A n'ont retiré aucun avantage pécuniaire direct des faits qui leur sont reprochés. On passe sous silence les avantages pécuniaires directs ou indirects, les avantages sous forme d'honneurs, de pouvoir, et autres semblables, qu'ont retirés des personnes de leur famille, des amis, des partisans, des électeurs, etc. On passe aussi sous silence l'avantage indirect que les A ont obtenu, en parvenant au pouvoir et en s'y maintenant, grâce à l'appui des personnes qu'ils ont soutenues, à celui de la presse payée par les financiers protégés [FN: § 2262-5), ou directement favorisée. Mais quand bien même on pourrait démontrer qu'en accomplissant leurs méfaits, les A furent mus par des sentiments d'une morale très pure et très élevée, ces méfaits et le dommage qu'en éprouve le public n'en existeraient pas moins. Comme d'habitude, au problème de cette existence et de ce dommage on en substitue un autre, qui y est étranger : celui de la valeur morale des A. Mutatis mutandis, on emploie contre les A des dérivations analogues : au lieu de prouver l'existence et les dommages des faits dont ils sont accusés, on démontre que les A ont peu ou point de valeur morale ; ce qui est un problème entièrement différent du premier. À l'égard des B, on obtient des dérivations analogues par de semblables substitutions de problèmes. 4° Un grand nombre de dérivations recommandent le silence afin de ne pas porter préjudice aux amis, au parti, au pays. En somme, sous des dehors plus ou moins enjolivés, on prêche qu'il n'importe pas tant d'empêcher les mauvaises actions que d'empêcher qu'elles ne soient connues [FN: § 2262-6). 5° Enfin, nous avons des procédés qui sont plutôt des artifices que des dérivations. On s'en sert pour étendre autant que possible à un grand nombre de personnes les accusations portant sur des faits analogues à ceux qui sont dénoncés. Cela est facile, car ce sont des faits usuels en certains régimes, et ces procédés sont très efficaces, attendu que, écrit déjà Machiavel [FN: § 2262-7] , « quand une chose importe à beaucoup de gens, beaucoup de gens doivent en prendre soin ». Parfois, on demeure surpris de voir qu'au moment de remporter la victoire et de précipiter les A dans l'abîme, les B s'arrêtent tout à coup, hésitent et finissent par se contenter d'une demi-victoire. Mais la raison en est qu'ils se sentent aussi coupables que les A et craignent de donner l'éveil. Les nombreuses personnes honnêtes, naïves, qui ignorent la réalité des faits, ont recours à des dérivations d'espèces très variées, grâce auxquelles les causes des actions se recouvrent des voiles de l'indulgence, de la pitié, de l'amour pour la patrie, etc.
§ 2263. On peut diviser en deux catégories les hommes qui, grâce à des manœuvres politiques et financières, font de gros bénéfices. La première de ces catégories comprend ceux qui dépensent à peu près ce qu'ils gagnent. Ces personnes se prévalent souvent de cette circonstance pour dire que les manœuvres politiques et financières ne leur ont rien rapporté, puisqu'elles ne les ont pas enrichies. La seconde catégorie est constituée par ceux qui ont retiré de leurs gains non seulement ce dont ils avaient besoin pour subvenir à de grandes dépenses, mais encore ce qui leur a constitué un patrimoine. Les deux catégories sont composées des hommes nouveaux qui gouvernent les nations modernes, tandis que peu à peu ceux qui tiennent un patrimoine de leurs ascendants disparaissent de la classe gouvernante. Rarement, les manœuvres de certains « spéculateurs » sont découvertes et tournent au désavantage de ceux qui s'y sont livrés. Mais ceux qui sont frappés constituent un très petit nombre de ceux qui se livrent à ces manœuvres, tandis que le plus grand nombre échappe à toute peine ou à tout blâme. Parmi eux, un nombre, petit il est vrai, mais encore notable, gagne de grandes fortunes, de grands honneurs, et gouverne l'État. En Italie, on peut observer que presque tous les grands patrimoines constitués récemment proviennent des concessions gouvernementales, des constructions de chemins de fer, des entreprises subventionnées par l'État, de la protection douanière, et que de la sorte nombre de gens ont pu s'élever aux premiers honneurs du royaume. C'est pourquoi toute cette organisation apparaît aux politiciens avisés comme celle d'une grande loterie, où l'on peut gagner des lots considérables, d'autres moins importants, d'autres peu importants, et où malheureusement on court le risque professionnel de se trouver parmi ceux qui sont frappés. Mais enfin, ce risque n'est pas plus grand que celui de subir des dommages et des malheurs dans la plupart des professions.
§ 2264. Parfois il arrive que le négociant qui fait faillite est plus honnête que celui qui s'enrichit. Il arrive de même souvent que les politiciens frappés sont parmi les moins coupables. Les circonstances peuvent leur avoir été défavorables ; ou bien ils peuvent avoir manqué de ce qu'il faut d'habileté, d'énergie ou de courage à mal faire pour se tirer d'affaire. « Les hommes, dit Machiavel, savent très rarement être ou tout bons ou tout mauvais », et dans ces luttes des politiciens, souvent ce sont les plus « mauvais » qui se tirent d'affaire. Il est comique de les voir juger et condamner les moins « mauvais », au nom de la vertu et de la morale. Cela rappelle le mot de Diogène qui [FN: § 2264-1] , « voyant un jour certains magistrats mener [en prison l'un des trésoriers qui avait dérobé une fiole, dit : Les grands voleurs mènent en prison] le peti voleur ». Il est certain que si la justice consiste à « donner à chacun le sien », un grand nombre de ces condamnations ne sont pas « justes », parce que ceux qui sont frappés ont reçu plus qu'il ne leur revenait [FN: § 2264-2).
§ 2265. De petits pays, comme la Suisse, avec une population très honnête, peuvent demeurer en dehors de ce courant qui inonde tous les grands pays civilisés, et qui coule boueux du passé au présent. On a souvent remarqué que le régime absolu en Russie n'était pas moins corrompu ni corrupteur que le régime ultra-démocratique des États-Unis d'Amérique. Les libre-échangistes disaient que la seule cause en était l'existence de la protection douanière dans ces deux pays. Il y a là quelque chose de vrai, car il est incontestable que la protection douanière offre un vaste champ à la corruption. Mais il y a aussi d'autres causes, car la corruption politique n'est pas absente de l'Angleterre libre-échangiste. La part de la vérité deviendrait plus grande si, au lieu de la protection douanière, il s'agissait de la protection économique. Mais en ce cas aussi il resterait toujours d'autres champs ouverts à la corruption [FN: § 2265-1] : dans les mesures militaires, dans les constructions de forts et de navires, dans les travaux publics, dans les diverses concessions de l'État (§ 2548), dans l'administration de la justice, où les députés et autres politiciens ont tant de pouvoir, dans les faveurs et les honneurs dont dispose l'État, dans la répartition des impôts, dans les lois dites sociales, etc.
§ 2266. Le souci d'être bref nous interdit d'apporter trop de preuves des affirmations précédentes : il suffira de s'en référer à quelques types. Quant aux différents pays et à la variété des régimes politiques, dans le premier semestre de 1913 nous avons en Russie les accusations habituelles de corruption de l'administration de la marine et de la guerre ; en Hongrie, le scandale des banques qui versèrent des millions dans la caisse électorale du parti alors au pouvoir, et de la société constituée en vue d'installer une maison de jeu dans l'île Marguerite, société qui paya 500 000 couronnes aux intermédiaires politiques, et versa 1 500 000 couronnes dans la caisse électorale du parti ; en Angleterre, le scandale de la télégraphie sans fil ; en France, celui des casinos de jeu ; en Italie, le scandale du Palais de Justice, pour ne pas parler de celui des fournitures pour la Libye ; en Allemagne, les accusations de corruption portées contre les puissantes maisons qui fournissent les armements de l'armée. On remarquera qu'en tous ces cas, moins le dernier, c'étaient principalement des parlementaires qui étaient compromis, parce qu'en tous ces pays, moins le dernier, ce sont précisément eux qui détiennent le pouvoir, et qui, par leurs intrigues, font pression sur le gouvernement, lorsqu'ils n'en font pas partie. Là où les députés peuvent faire et défaire les ministères, la corruption parlementaire règne généralement. Quant au temps et aux différents partis, on peut observer qu'en France, sous le règne de Napoléon III, les républicains faisaient grand bruit au sujet de la corruption du gouvernement. Mais ensuite, parvenus au pouvoir, ils montrèrent, avec le Panama et d'autres nombreux faits de corruption, qu'à ce point de vue ils ne restaient pas en arrière de leurs prédécesseurs. En Italie, quand la droite gouvernait, les diverses gauches poussaient les hauts cris contre la corruption de leurs adversaires ; ensuite, arrivées successivement au pouvoir, elles en firent autant et même pis. Aujourd'hui, il paraît que l'on doit attendre l’âge d'or pour le moment où la « corruption bourgeoise » cédera la place à l' « honnêteté socialiste ». Mais il n'est pas certain que cette promesse sera mieux tenue que tant d'autres semblables, faites par le passé.
§ 2267. Considérons tous ces faits d'un peu haut, en nous dégageant autant que possible des liens des passions sectaires et des préjugés, nationaux, de parti, de perfection, d'idéal et d'autres semblables entités. Nous voyons qu'en somme, quelle que soit la forme du régime, les hommes qui gouvernent ont en moyenne une certaine tendance à user de leur pouvoir pour se maintenir en place, et à en abuser en vue d'obtenir des avantages et des gains particuliers, que parfois ils ne distinguent pas bien des gains et des avantages du parti, et qu'ils confondent presque toujours avec les avantages et avec les gains de la nation. Il suit de là : 1° que, à ce point de vue, il n'y aura pas grande différence entre les diverses formes de régime. Les différences résident dans le fond, c'est-à-dire dans les sentiments de la population : là où celle-ci est plus honnête ou moins honnête, on trouve aussi un gouvernement plus honnête ou moins honnête ; 2° que les usages et les abus seront d'autant plus abondants que l'intromission du gouvernement dans les affaires privées sera plus grande ; au fur et à mesure que la matière à exploiter augmente, ce qu'on en peut retirer augmente aussi ; aux États-Unis, où l'on veut imposer la morale par la loi [FN: § 2267-1], on voit des abus énormes, qui font défaut là où cette contrainte n'existe pas, ou existe dans de bien moindres proportions; 3° que la classe gouvernante s'efforce de s'approprier les biens d'autrui, non seulement pour son usage propre, mais aussi pour les faire partager aux personnes de la classe gouvernée qui défendent la classe gouvernante, et qui en assurent le pouvoir, soit par les armes, soit par la ruse, avec l'appui que le client donne au patron ; 4° que, le plus souvent, ni les patrons ni les clients ne sont pleinement conscients de leurs transgressions des règles de la morale existant dans leur société, et que, quand bien même ils s'en aperçoivent, ils les excusent facilement, soit en considérant qu'en fin de compte d'autres feraient de même soit sous le prétexte commode de la fin qui justifie les moyens; et pour eux, la fin qui consiste à maintenir son propre pouvoir ne peut être qu'excellente ; bien plus, c'est en parfaite bonne foi que plusieurs d'entre eux confondent cette fin avec celle du salut de la patrie ; il peut aussi y avoir des personnes qui croient défendre l'honnêteté, la morale, le bien public, tandis qu'au contraire leur œuvre recouvre les machinations de gens qui cherchent à gagner de l'argent [FN: § 2267-2) ; 5° que la machine gouvernementale consomme de toutes façons une certaine quantité de richesses, quantité qui est en rapport, non seulement avec la quantité totale de richesses entrant dans les affaires privées auxquelles s'intéresse le gouvernement, mais aussi avec les moyens dont use la classe gouvernante pour se maintenir au pouvoir, et par conséquent avec les proportions des résidus de la Ire et de la IIe classe, dans la partie de la population qui gouverne et dans celle qui est gouvernée.
§ 2268. Entreprenons maintenant de considérer les différents partis de la classe gouvernante. Dans chacun d'eux, nous pouvons distinguer trois catégories : (A) des hommes qui visent résolument à des fins idéales, qui suivent strictement certaines de leurs règles de conduite ; (B) des hommes qui ont pour but de travailler dans leur intérêt et dans celui de leur client ; ils se subdivisent en deux catégories : (B-α) des hommes qui se contentent de jouir du pouvoir et des honneurs, et qui laissent à leurs clients les avantages matériels ; (B – β) des hommes qui recherchent pour eux-mêmes et pour leurs clients des avantages matériels, généralement de l'argent. Ceux qui sont favorables à un parti appellent « honnêtes » les (A) de ce parti, et les admirent ; ceux qui sont hostiles au parti les disent fanatiques, sectaires, et les haïssent. Les (B–α) sont généralement tenus pour honnêtes par ceux qui leur sont favorables, regardés avec indifférence, au point de vue de l'honnêteté, par leurs ennemis. Les (B–β), lorsqu'on découvre leur existence, sont appelés « malhonnêtes » par tout le monde ; mais leurs amis s'efforcent de ne pas les laisser découvrir et, pour atteindre leur but, ils sont capables de nier même la lumière du soleil. D'habitude, les (B–α) coûtent au pays beaucoup plus que les (B–β) ;car sous leur vernis d'honnêteté, il n'y a sorte d'opérations qu'ils ne fassent pour priver autrui de ses biens et pour en faire profiter leurs clientèles politiques. Il convient d'ajouter que parmi les (B – α) se dissimulent aussi plusieurs personnes qui, sans rien prendre pour elles-mêmes, font en sorte d'enrichir leur famille [FN: § 2268-1] . La proportion des catégories indiquées tout à l'heure dépend en grande partie de la proportion des résidus de la Ire et de la IIe classe. Chez les (A) , les résidus de la IIe classe l'emportent de beaucoup ; c'est pourquoi on peut appeler ces personnes honnêtes, fanatiques, sectaires, suivant le point de vue auquel on les considère. Chez les (B) , ce sont les résidus de la le classe qui prédominent ; c'est pourquoi ces personnes sont plus aptes à gouverner. Quand elles parviennent au pouvoir, elles se servent des (A) comme d'un lest, qui d'ailleurs sert aussi à donner au parti un certain semblant d'honnêteté ; mais, dans ce but, les (B–α) remplissent mieux les conditions voulues. Ces gens constituent une marchandise peu abondante et très recherchée par les partis (§ 2300). Dans la clientèle, chez les hommes du parti qui n'est pas au pouvoir, chez les électeurs, les proportions des résidus de la Ie et de la IIe, classe correspondent, sans d'ailleurs être identiques, à celles qui existent dans la partie gouvernante, dans l'état major. Seul un parti où les résidus de la IIe classe sont abondants peut élire un grand nombre d'individus de la catégorie (A) . Mais, sans s'en rendre compte il en élit aussi d'autres, de la classe (B) , car ceux-ci sont rusés, avisés, maîtres en l'art de trouver des combinaisons, et induisent facilement en erreur les électeurs naïfs chez lesquels existent en grande quantité des résidus de la IIe classe.
Dans nos organisations politiques, il faut diviser les partis en deux grandes classes: (I) partis qui s'acheminent au gouvernement ; lorsqu'un y arrive, les autres forment l'opposition ; (II) partis intransigeants, qui ne parviennent pas au gouvernement. Il résulte de ce que nous avons déjà remarqué, que dans les partis (I), il y aura un minimum de (A) et un maximum de (B) , et vice-versa dans les partis (II). En d'autres termes, on exprime cela en disant que les partis qui n'arrivent pas au pouvoir sont souvent plus honnêtes, mais aussi plus fanatiques et plus sectaires que ceux qui y parviennent. C'est là le sens de l'expression commune en France : la République était belle sous l'Empire. Ce fait dépend essentiellement des organisations. Dans les partis qui parviennent au gouvernement, un premier choix s'effectue aux élections. Sauf les exceptions, qui ne sont pas très nombreuses, on ne devient député qu'en payant, ou bien en accordant, et plus encore en promettant, des faveurs gouvernementales. Cela constitue un filet qui laisse passer bien peu de (A) . Ceux qui se rapprochent le plus des (A) , ce sont les candidats qui se trouvent être assez riches pour acheter la députation, laquelle est pour eux un luxe. Cela paraît bizarre, mais c'est pourtant vrai, que ces gens sont, après les (A) , les plus honnêtes des politiciens. Ils sont en petit nombre, parce que les dépenses nécessaires pour acheter les électeurs sont énormes ; et celui qui les fait de ses propres deniers veut ensuite s'en récupérer par des gains ; et celui qui ne peut ou ne veut faire ces dépenses, en charge le gouvernement, sous la forme de concessions et de faveurs de diverses espèces. Grande est la concurrence, et seuls viennent à flot les hommes chez lesquels existent des instincts de combinaisons en grande abondance (résidus de la Ire classe). Un second et plus rigoureux choix a lieu parmi les députés qui deviennent ministres. Les candidats députés devaient faire des promesses aux électeurs, les candidats ministres doivent faire des promesses aux députés, et s'engager à travailler dans l'intérêt de ceux-ci et de leur clientèle politique [FN: § 2268-2] . Les naïfs croient que pour faire cela il suffit de n'être pas honnête. Ils se trompent : il faut de rares qualités de finesse, d'habileté dans tous les genres de combinaisons. Les ministres ne disposent pas de coffres dont ils puissent tirer l'argent à la poignée, pour le distribuer à leurs partisans. Il faut, avec un art subtil, trouver dans le domaine économique des combinaisons de protection économique, de faveurs aux banques, aux trusts, de monopoles, de réformes fiscales, etc., et, dans les autres domaines, des combinaisons de pression sur les tribunaux, de distribution d'avantages honorifiques, etc., profitant à ceux qui soutiennent le pouvoir. En outre, il est bon de s'efforcer de séparer les (A) des autres partis. Celui qui a une foi opposée à celle de ces (A) réussira difficilement dans ses intentions ; mais celui qui n'a aucune foi, qui a presque uniquement des résidus de la Ire classe, pourra beaucoup mieux agir sur ces (A) , et se servir de leur propre foi pour les attirer à lui, ou du moins pour enlever toute efficacité à leurs oppositions. On peut donc être sûr que dans les partis qui s'acheminent au gouvernement, les résidus de la Ire classe prédominent de beaucoup. Il ne peut en être autrement avec les organisations présentes. C'est pourquoi elles tendent toujours plus vers une ploutocratie démagogique. Souvent les différents partis s'accusent mutuellement de malhonnêteté. Ils ont raison ou tort, suivant le point de vue auquel on considère les faits. Presque tous les partis ont leurs (B – β) ; par conséquent, celui qui les considère exclusivement peut, à bon droit, accuser le parti de malhonnêteté. Ils ont aussi leurs (B–α), et celui qui les considère peut ou non accuser le parti de malhonnêteté, suivant le sens qu'il donne à ce terme. Enfin, peu nombreux sont les partis qui n'ont pas leurs (A) ; et quiconque les considère exclusivement dira que le parti est honnête. Ensuite, si l'on veut prêter attention à la proportion des (A) et des (B) , on trouvera certains cas où les (A) prédominent certainement, et où, par conséquent, on peut dire que le parti est « honnête ». Mais en un grand nombre d'autres cas, on ne sait vraiment pas si, chez les divers partis qui se disputent le gouvernement, il existe une grande différence entre les proportions des (A) et des (B) . On peut dire seulement que les (A) sont assez rares. Dans les couches inférieures de la population, les résidus de la IIe classe existent encore en grande quantité ; par conséquent, les gouvernements qui, en réalité, sont mus par de simples intérêts matériels, doivent au moins feindre de viser à des fins idéales ; et les politiciens doivent se recouvrir d'un voile d'honnêteté, à vrai dire souvent assez ténu. Quand l'un d'eux est pris la main dans le sac, le parti adverse fait grand tapage, tâchant de tirer parti du fait comme d'une arme utile à ses fins. Le parti auquel appartient le présumé coupable s'efforce tout d'abord de le défendre ; puis, si cela lui paraît trop difficile ou impossible, il le jette par dessus bord, comme un navire en danger se défait de sa cargaison. La population suit le développement du fait comme elle suit le développement de l'action d'une œuvre théâtrale, et si elle peut y découvrir un tant soit peu de sentiment et d'amour, la moitié du monde se prélasse à ce spectacle gratuit. Les incidents insignifiants deviennent le principal du fait, et l'on néglige entièrement ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'organisation qui a ces faits pour conséquence. Si un ministre se laisse prendre à exercer une pression sur un magistrat, tout le monde crie à tue-tête, mais personne ne demande que les magistrats, rendus vraiment indépendants, soient soustraits à l'influence des ministres. Cela vient de ce que les partis d'opposition veulent bien se servir du fait pour chasser du pouvoir leurs rivaux, mais qu'ils entendent faire exactement comme eux, lorsqu'ils seront au pouvoir, et parce que le vulgaire ne comprend que les faits concrets, particuliers, et ne sait pas s'élever à la considération des règles abstraites, générales. Par conséquent, les « scandales » succèdent aux « scandales », sans interruption. Tandis que l'un éclate, l'autre se prépare et va éclater, et les gens s'émeuvent à chaque nouveau cas, trouvant extraordinaire ce qui est au contraire parfaitement ordinaire et une conséquence des institutions voulues ou tolérées par ces gens eux-mêmes. Les éthiques croient que le fait est un produit du hasard, qui a porté au pouvoir un homme « malhonnête » ; que ce fait est parfaitement semblable à celui d'un caissier qui dérobe son patron. Il n'en est point ainsi. Ce n'est pas un cas fortuit qui a donné le pouvoir à un homme de cette sorte : c'est le choix, conséquence des institutions ; et si l'on veut établir la comparaison avec le caissier, il faut ajouter que celui-ci n'a pas été choisi comme on fait d'habitude, mais que le patron est allé le chercher parmi les personnes qui ont le plus la tendance de se sauver en emportant la caisse, et qui présentent le plus d'aptitudes à commettre cet acte, grâce à des qualités de ruse et d'autres analogues [FN: § 2268-3].
§ 2269. Il est nécessaire d'avoir une notion des résultats économiques des différents modes de gouverner (§ 2258). Au sujet des dépenses, on a cru pouvoir les déduire de la somme prélevée sous forme d'impôt ou acquise autrement par l'État. Mais cette somme ou une autre semblable représente seulement une partie des dépenses de la nation, car il faut tenir compte des protections économiques et politiques, du coulage résultant des lois dites « sociales », et enfin de toute autre mesure qui entraîne des dépenses et du coulage, même si ces deux rubriques ne figurent pas au bilan de l'État. Après qu'on a évalué d'une manière quelconque le coût de l'entreprise gouvernement, il reste à en évaluer la production. Ce problème est très difficile, voire impossible à résoudre dans toute son extension. Par conséquent, on a dû chercher des solutions approximatives. L'une de celles-ci, qui d'ailleurs n'est pas présentée comme telle, mais à laquelle on a l'habitude d'attribuer une valeur absolue, trouve aujourd'hui un grand crédit. On l'obtient en supposant que le gouvernement satisfait aux « besoins publics », et qu'il y pourvoit en levant des impôts. Ainsi, on évalue en même temps les deux parties du bilan économico-social de l'État, et l'on égalise automatiquement la valeur de la production à son coût.
§ 2270. Théoriquement, cette solution a le mérite de se prêter à de faciles calculs en vue de disposer de la meilleure manière possible les recettes et les dépenses. En peu de mots, on admet un certain besoin A, on en évalue le coût a, et l'on s'arrange à en répartir la charge entre les contribuables grâce à des recettes équivalentes. Ensuite, pour satisfaire le désir de développements logiques, on ajoute un grand nombre de dérivées sur les « besoins » et sur la « répartition », en faveur de laquelle on s'adonne à des prêches, selon les principes sentimentaux d'une des nombreuses éthiques sociales en cours. De cette façon, on obtient la solution qui concorde le mieux avec les sentiments de l'auteur de la théorie et de ses adeptes, mais non celle qui représente le mieux les faits tels qu'ils sont.
§ 2271. Parmi ces dérivations, il faut noter un genre pseudo-scientifique que l'on obtient en étendant les conceptions de l'économie pure aux « besoins » sociaux des hommes. On suppose que ces « besoins » sont satisfaits par l' « État ». Ensuite, au moyen des considérations sur l'utilité marginale, on déduit les règles d'un certain équilibre entre ces « besoins » et les « sacrifices » nécessaires à les satisfaire. On a ainsi des théories qui peuvent concorder en certains cas avec la logique formelle, mais qui s'écartent de la réalité au point de n'avoir parfois avec elle rien de commun. Les manières dont cette séparation se produit sont diverses. Il suffira de relever ici les suivantes. 1° La notion de « besoins » n'est nullement déterminée ; par conséquent elle ne peut servir de prémisse à un raisonnement rigoureux. Les économistes se heurtèrent à une difficulté de ce genre, et ne trouvèrent d'autre moyen de l'éviter que de distinguer une utilité objective, dont ils ne s'occupèrent pas, et une utilité subjective (ophélimité), qu'ils prirent en considération, uniquement pour déterminer l'équilibre économique. Ce n'est pas tout : ils durent aussi admettre, d'abord, que l'individu est seul juge de la question de savoir si cette utilité subjective existe ou non, ensuite qu'il est seul juge de l'intensité de cette utilité. Tout cela ne pourrait avoir un sens pour une collectivité, que si l'on pouvait la considérer comme une personne unique (§ 2130), ayant une unité de sensation, de conscience, de raisonnement. Mais comme cela ne concorde pas avec les faits, les déductions qu'on tire de cette hypothèse ne peuvent concorder non plus avec eux. La notion des « besoins » collectifs est employée pour faire disparaître artificiellement les difficultés qui naissent du fait que l'on doit considérer les diverses espèces d'utilités, pour se rapprocher de la réalité (§ 2115 et sv.). 2° À supposer que l'on puisse préciser la notion de « besoins », nous n’avons pas encore fait disparaître toutes les causes principales d'erreurs, et nous nous trouvons en présence d'une erreur de grande importance. Le raisonnement que l'on fait sur les « besoins » collectifs suppose que les hommes les satisfont par des actions logiques ; au contraire il n’en est rien, et les actions non-logiques jouent un très grand rôle dans le phénomène. Il est vrai qu'elles jouent aussi un certain rôle dans les phénomènes concrets économiques, mais ce rôle est généralement assez peu important, au moins dans le commerce en gros ; par conséquent, on peut le considérer comme nul dans une première approximation, et la théorie qui suppose que les hommes accomplissent des actions logiques pour se procurer des biens économiques, donne des conclusions que l'expérience vérifie, au moins en très grande partie.
Il en va tout autrement pour les phénomènes concrets sociaux. Dans une partie d'entre eux, à la vérité très importante, les actions non-logiques sont prédominantes, à tel point qu'une théorie qui considère uniquement les actions logiques ne donne pas même une première approximation, mais aboutit à des conclusions qui n'ont que peu ou rien de commun avec la réalité. 3° Enfin, des raisonnements semblables à ceux que nous examinons négligent des effets très importants de l'action gouvernementale, par exemple les effets de la circulation des élites. Il est vrai que le terme « besoins collectifs » est si élastique que l'on y peut faire entrer tout ce qu'on veut, et qu'on peut dire, par exemple, qu'une circulation des élites, d'une certaine sorte et d'une certaine intensité, est un « besoin collectif ». On peut même introduire dans cette notion le besoin de stabilité des gouvernements, celui des révolutions, de la substitution de la classe gouvernante à une autre, et ainsi de suite indéfiniment. Mais il est vrai aussi qu'un terme signifiant tant de choses finit par ne plus rien signifier, et que le raisonnement auquel il sert de prémisse dissimule une logomachie.
§ 2272. Pratiquement, les solutions mentionnées, au § 2270 servent à la classe gouvernante ou à celle qui veut le devenir, pour justifier son pouvoir et le faire plus facilement accepter de la classe sujette. Supposons que la classe gouvernante A veuille faire accepter une certaine mesure X dont elle fait son profit ; il est évident qu'il lui est avantageux de donner le nom de « besoin social » à cette mesure, et de s'efforcer de faire croire à la classe gouvernée, laquelle n'en retire aucun avantage et en fait les frais, qu'au contraire cette mesure est destinée à satisfaire un « besoin »» de cette classe. S'il se trouve quelque mécréant qui prétende ne pas éprouver ce « besoin », on lui répond aussitôt qu'il « devrait » l'éprouver. Par exemple, parmi les « besoins collectifs », on range d'habitude la défense nationale. Voici un pays G qui maintient dans la sujétion l'une de ses provinces A, dont les habitants n'éprouvent nullement le « besoin » d'être unis à G ; tout au contraire, ils éprouvent le « besoin » opposé de s'en détacher et de s'unir au pays F. Le pays G fait payer un impôt à tous les citoyens, y compris ceux de A, afin d'augmenter les armements dirigés contre le pays F, et de se mettre en mesure d'empêcher que A puisse s'unir à lui. On devrait donc dire que cet impôt est destiné à profiter à ceux qui tiennent la province A dans la sujétion, ou, si l'on veut, à satisfaire un de leurs « besoins ». Mais on préfère affirmer, en pleine contradiction avec les faits, que de la sorte on satisfait un « besoin collectif » de tous les habitants, y compris ceux de A. De cette façon, l'oppression que subissent les habitants de A est moins évidente. De même, voici un pays dans lequel un parti socialiste ou syndicaliste déclare qu'il n'éprouve nullement le « besoin » d'une certaine guerre voulue par le reste de la population. Il est bon de dire que cette guerre satisfait un « besoin » de la « nation », parce qu'ainsi on passe sous silence, on dissimule, on s'efforce d'atténuer le désaccord qui règne entre ceux qui éprouvent le « besoin » et ceux qui, au contraire, ne l'éprouvent pas du tout. Les sophismes de ce genre sont dissimulés par l'ambiguïté voulue du terme « besoin collectif », (dérivations IV-γ). Il peut signifier au moins quatre choses distinctes et différentes : 1° un besoin effectif de tous les membres de la collectivité ; 2° un besoin effectif de certains membres de la collectivité, besoin qui renferme aussi certains caractères déterminés, par exemple le besoin des « honnêtes gens », des « patriotes », de ceux qui ont une certaine foi, etc. ; 3° un besoin que la majorité effective de la collectivité déclare être un « besoin de la collectivité » ; 4° un besoin que la majorité d'une certaine assemblée, ou certains gouvernants, délégués dans ce but par la loi, ou qui ont obtenu ce pouvoir par la ruse, par la force ou autrement, déclarent être un « besoin de la collectivité ». Habituellement, les raisonnements que l'on fait au sujet de l'utilité de satisfaire ces besoins, ont en vue le premier de ceux-ci. Or, on veut au contraire appliquer les conclusions au second, lequel, grâce à l'indétermination des termes, se trouve être tout simplement ce que l'auteur de la dérivation estime bon [FN: § 2272-1] ; ou bien, on veut les appliquer au quatrième, qui n'est autre chose que la manifestation de la volonté des gouvernants ; ou encore à quelque autre besoin de ce genre.
§ 2273. Souvent, dans la matière qu'on appelle la science des finances, nous avons donc deux genres de dérivations 1° des dérivations qui ont en vue de tirer des conséquences de certains principes éthiques ou sentimentaux, et qui peuvent s'éloigner beaucoup de la réalité ; 2° des dérivations qui ont en vue de donner une couleur théorique à des résultats auxquels on est parvenu par une tout autre voie. Avec ces dérivations, on arrive à des conclusions concordant avec la réalité, mais seulement parce qu'elles ont été fixées préventivement. Si l'on regarde uniquement la réalité, on voit aussitôt que les gouvernements s'efforcent de retirer tout ce qu'ils peuvent de leurs contribuables, et qu'ils ne sont jamais retenus par le fait qu'ils n'auraient pas de « besoins » à satisfaire. Le seul tempérament est la résistance des contribuables. La science pratique des finances d'un ministre ne consiste donc point à rechercher des démonstrations théoriques de théorèmes et des conséquences de certains principes ; elle consiste tout entière à trouver un moyen de vaincre cette résistance, de plumer l'oie sans trop la faire crier. Cette science, ou cet art, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, a été très perfectionné de nos jours ; et désormais, par tradition, dans les ministères des différents pays, il s'est établi certaines règles qui permettent de soutirer de l'argent en suivant la ligne de moindre résistance. On sait tirer avantage des fortes commotions qui peuvent se produire dans un pays ; on sait évaluer la force nécessaire pour pousser aux dépenses, force qui provient des personnes qui en retireront profits et bénéfices, et la force de résistance aux nouveaux impôts, qui provient des personnes sur lesquelles ils pèseront. On connaît les artifices capables d'accroître la première et de diminuer la seconde. C'est après avoir tenu compte de toutes ces circonstances que l'on décide les nouvelles dépenses et les nouveaux impôts. Il n'y a pas grand mal si l'on recouvre ensuite ces visées d'un vernis de dérivations qui les fasse apparaître comme une conséquence logique de certains sentiments. Au contraire, cela peut être utile, car il est un grand nombre de personnes sur lesquelles n'agissent pas, ou agissent faiblement les intérêts qui poussent à désirer les nouvelles dépenses ou à résister aux nouveaux impôts ; on peut facilement duper ces personnes par de belles dérivations. Les gouvernements n'en manquent jamais ; ils trouvent toujours des théoriciens qui se mettent à leur service pour leur en fournir [FN: § 2273-1] . Mais il faut prendre garde que les dérivations sont les conséquences des visées du gouvernement, non pas celles-ci de celles-là.
§ 2274. Si nous voulons résoudre le problème posé au § 2258, nous devons tout d'abord écarter les dérivations dont nous avons vu quelques exemples ; puis, ayant présente à l'esprit la complexité du phénomène, nous devons en rechercher les parties essentielles. Parmi celles-ci se trouvent certainement les parties dont nous avons déjà tenu compte, c'est-à-dire les effets produits sur la prospérité économique et sociale, ceux de la défense contre des agressions qui pourraient venir de l'étranger, ceux de la sécurité publique, d'une bonne et prompte justice, de certains travaux publics, et d'un grand nombre d'autres fonctions gouvernementales. Mais les effets de la circulation des élites sont tout aussi importants, si ce n'est plus. Il en est de même pour le stimulant ou la dépression qu'éprouve indirectement l'économie nationale, par rapport aux formes de gouvernement. Il faut prendre garde que très souvent les gouvernants visent à certains effets, et en obtiennent indirectement d'autres. Parmi ceux-ci, il en est qui ne sont ni prévus ni voulus. Par exemple, les gouvernements qui instituent la protection douanière, afin de procurer des gains à leur clientèle, obtiennent l'effet, auquel ils n'ont nullement pensé, de favoriser la circulation des élites. Au point de vue éthique, on peut juger une mesure indépendamment des autres phénomènes sociaux. Au point de vue de l'utilité, on ne peut faire cela : il faut voir, dans l'ensemble, comment cette mesure modifie l'équilibre. Une mesure blâmable au point de vue éthique, peut être louable au point de vue de l'utilité sociale ; et vice versa, une mesure louable au point de vue éthique peut être blâmable au point de vue de l'utilité sociale. Mais à ce point de vue, il est bon que la partie intéressée de la population croie, au contraire, qu'il y a identité entre la valeur éthique d'une mesure et son utilité sociale. Il serait long et difficile de faire une étude de cette matière en prêtant attention au moins aux détails principaux. Contentons-nous ici de l'effleurer en nous efforçant d'en acquérir une idée générale. Étant donné l'objet de cette étude, portons notre attention sur certains types de gouvernements que l'histoire nous fait connaître.
I. Gouvernements qui font principalement usage de la force matérielle et de celle des sentiments religieux ou d'autres analogues. Par exemple : les gouvernements des cités grecques à l'époque des « tyrans », de Sparte, de Rome au temps d'Auguste et de Tibère, de la république de Venise dans les derniers siècles de son existence, d'un grand nombre d'états européens au XVIIIe siècle. À ces gouvernements correspond une classe gouvernante chez laquelle les résidus de la IIe classe prédominent sur ceux de la Ire. La circulation des élites est généralement lente. Ce sont des gouvernements peu coûteux, mais qui, d'autre part, ne stimulent pas la production économique, soit parce qu'ils répugnent naturellement aux nouveautés, soit parce qu'ils ne favorisent pas, grâce à la circulation des élites, les personnes qui ont au plus haut degré l'instinct des combinaisons économiques. Si d'ailleurs cet instinct subsiste dans la population, on peut avoir une prospérité économique passable (Rome au temps du Haut-Empire), pourvu que les gouvernements n'y fassent pas obstacle. Mais souvent, à la longue, il y a un obstacle, parce que l'idéal des gouvernements de cette sorte est une nation figée dans ses institutions (Sparte, Rome au temps du Bas-Empire, la Venise décadente). Ces gouvernements peuvent s'enrichir par les conquêtes (Sparte, Rome) ; mais comme de cette façon on ne produit pas de richesse nouvelle, cet enrichissement est nécessairement précaire (Sparte, Rome). En outre, dans le passé, on vit souvent ces régimes dégénérer en gouvernements d'une tourbe armée (prétoriens, janissaires), capables tout au plus de dilapider la richesse.
§ 2275. II. Gouvernements qui font principalement usage de l'artifice et de la ruse. (II-a) Si l'artifice et la ruse sont surtout employés pour agir sur les sentiments, on a certains gouvernements théocratiques, aujourd'hui entièrement disparus de nos contrées, et dont nous pouvons par conséquent négliger de nous occuper. Peut-être les gouvernements des anciens rois en Grèce et en Italie pourraient-ils s'en rapprocher, au moins en partie ; mais leur histoire nous est trop peu connue pour que nous puissions l'affirmer. (II-b) Si l'artifice et la ruse sont surtout employés pour agir sur les intérêts – ce qui d'ailleurs ne veut pas dire qu'on néglige les sentiments – on a des gouvernements comme ceux des démagogues à Athènes, de l'aristocratie romaine à diverses époques de la République, de nombreuses républiques du moyen-âge, et enfin le type très important du gouvernement des « spéculateurs » de notre temps.
§ 2276. Les gouvernements de tout le genre II, même ceux qui agissent sur les sentiments, possèdent une classe gouvernante chez laquelle les résidus de la Ire classe prédominent sur ceux de la IIe. En effet, pour agir efficacement par l'artifice et par la ruse, tant sur les intérêts que sur les sentiments, il faut posséder l'instinct des combinaisons à un haut degré, et ne pas être retenu par trop de scrupules. La circulation des élites est habituellement lente dans le sous-genre (II-a) ; elle est au contraire rapide, et parfois très rapide, dans le sous-genre (II-b) . Dans le gouvernement de nos « spéculateurs », elle atteint un maximum. Les gouvernements du sous-genre (II-a) sont habituellement peu coûteux, mais aussi peu producteurs ; plus que d'autres, ils endorment les populations et ôtent tout stimulant à la production économique. Ne faisant pas un usage important de la force, ils ne peuvent suppléer à cette production par celle des conquêtes ; bien plus, ils deviennent facilement la proie des voisins qui savent user de la force ; par conséquent, ils disparaissent, ou par suite de cette conquête, ou par décadence interne. Les gouvernements du sous-genre (II-b) sont coûteux et souvent très coûteux, mais ils produisent aussi beaucoup et parfois énormément. Il peut donc y avoir un excédent de production sur les dépenses, tel qu'il assure une grande prospérité au pays ; mais il n'est nullement certain que cet excédent, avec l'accroissement des dépenses, ne puisse se réduire à de plus modestes proportions, disparaître, et peut-être aussi se changer en déficit. Cela dépend d'une infinité de conditions et de circonstances. Ces régimes peuvent dégénérer en gouvernements de gens avisés mais sans grande énergie, qui sont facilement abattus par la violence, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est ce qu'on vit pour un grand nombre de gouvernements démocratiques des cités grecques, et ce qui joua un rôle au moins important dans la chute de la République romaine et dans celle de la République de Venise.
§ 2277. En réalité, on trouve des combinaisons de ces différents types. Parfois, tantôt l'un, tantôt l'autre de ceux-ci y prédomine. Les gouvernements chez lesquels existe une proportion notable du type (II-b) , avec une quantité importante du type (I), peuvent durer longtemps en sécurité grâce à la force, et sans que la prospérité économique vienne à diminuer. Le Haut-Empire romain se rapproche de ce type mixte. Ces gouvernements courent le risque de la dégénérescence du type (I), et s'exposent en outre à ce que la proportion qu'ils renferment du type (II-b) se réduise par trop. Les gouvernements chez lesquels existe une notable proportion du type (II-b) , avec une petite quantité du type (I), peuvent durer longtemps parce qu'ils ont une certaine force pour se défendre, tandis qu'ils acquièrent une importante prospérité économique. Ils courent le risque de la dégénérescence de (II-b) , et en outre s'exposent à ce que la proportion qu'ils renferment du type (I) se réduise par trop, ce qui les met presque certainement en danger d'invasion étrangère. Ce phénomène a joué un rôle dans la destruction de Carthage et dans la conquête de la Grèce par les Romains.
§ 2278. Il convient aussi de remarquer qu'un mélange des types. (I) et (II-b) peut exister chez un gouvernement qui fait principalement usage de la force dans ses relations avec l'étranger, et de l'artifice dans ses relations intérieures. De ce genre se rapproche celui du gouvernement de l'aristocratie romaine, aux beaux temps de la République.
§ 2279. PÉRIODES ÉCONOMIQUES. Les mouvements rythmiques d'un groupe d'éléments se répercutent sur les mouvements des autres éléments, de manière à produire le mouvement que l'on observe pour l'ensemble des groupes. Parmi ces actions et réactions, il en est de remarquables : celles qui se produisent entre le groupe des éléments économiques et les autres groupes.
§ 2280. On peut juger de l'état économique d'un pays d'une manière qualitative, d'après l'opinion exprimée par les auteurs au sujet de l'enrichissement ou de l'appauvrissement du pays. Ce moyen, à la vérité très imparfait, est le seul qui soit à notre disposition pour le passé. Nous voyons Athènes s'enrichir après les guerres médiques, s'appauvrir après le désastre de Sicile ; Sparte s'enrichir lorsqu'elle avait l'hégémonie en Grèce, s'appauvrir après la bataille de Leuctres. Pour Rome, les phénomènes ondulatoires sont aussi très accusés. Nous les voyons se produire depuis la Rome antique, quasi légendaire, jusqu'à la Rome du moyen-âge. En des temps plus rapprochés des nôtres, les phénomènes deviennent plus généraux, c'est-à-dire que les ondulations ont une tendance à être les mêmes pour plusieurs pays en même temps. Cela résulte de la solidarité économique de ces pays.
§ 2281. Là où existent des statistiques des phénomènes économiques, fussent-elles imparfaites, on trouve un moyen de substituer des évaluations quantitatives aux évaluations qualitatives. Cette substitution est toujours avantageuse, même si la méthode suivie est imparfaite, ne serait-ce que parce qu'elle ouvre la voie d'un perfectionnement continuel, grâce à de meilleures statistiques et par leur emploi plus judicieux.
§ 2282. Le problème des rapports entre le mouvement de la population et les conditions économiques induisit les économistes à rechercher quels étaient au moins les indices de ces conditions. Pour les pays principalement agricoles, l'abondance des récoltes peut être prise comme indice ; mais la quantité des récoltes n'est pas connue directement, dans les temps passés, et l'on chercha un autre indice dans le prix du blé, qui est le principal aliment de nos peuples. Le prof. Marshall accepte cet indice pour l'Angleterre, jusque vers le milieu du XIXe siècle, quand ce pays devint principalement industriel. Ensuite, on chercha les indices dans le mouvement du commerce international et dans les sommes compensées au Clearing House. À propos des crises économiques, Clément Juglar remarqua que plusieurs autres indices concordent. C'est précisément cette concordance qui fait mieux voir le cours général du mouvement économique. On a cherché diverses combinaisons d'indices économiques, afin d'avoir une idée du cours économique général d'un pays ; mais jusqu'à présent on a peu ou rien obtenu de cette manière [FN: § 2282-1] . La difficulté principale provient de la manière de combiner les indices, et, si on les additionne, des coefficients que l'on doit assigner à chacun d'eux. On ne peut leur assigner à tous également le coefficient un, parce que l'on compenserait ainsi l'augmentation d'un phénomène économique très important par la diminution d'un phénomène économique insignifiant. Il faut un coefficient qui ait au moins un rapport lointain avec l' « importance » du phénomène. Non seulement il est très difficile à trouver, mais encore on ne sait même pas précisément ce qu'est cette « importance » ; bien plus, à vrai dire, ces indices sont aussi nombreux que les buts auxquels on tend. Par exemple, il semblerait naturel d'assigner comme « importance » aux titres de crédit leur valeur effective. Supposons qu'il s'agisse de 100 millions en titres de dettes publiques et de 100 millions en actions de sociétés industrielles. Les valeurs étant égales, nous assignerons un indice égal aux uns et aux autres. Par conséquent, si les titres de dette publique acquièrent la valeur de 110 millions, et que les actions industrielles descendent à 90 millions, il y aura compensation parfaite. Cela va bien, si nous recherchons l'effet produit sur l'ensemble du capital en dette publique et en actions ; cela ne va plus si nous voulons étudier le mouvement économique. On sait que souvent, dans les temps de dépression économique, les titres de dette publique renchérissent et que les actions industrielles baissent de prix. C'est pourquoi, au lieu de compenser les 10 millions d'augmentation des titres de la dette publique par les 10 millions de diminution des actions industrielles, on se rapprocherait davantage de la réalité, mais on en serait toujours éloigné, si l'on changeait le signe de la diminution, si on l'additionnait à l'augmentation, et si l'on considérait la somme de 20 millions comme un indice du changement de l'état économique. Les nombreux indices, additionnés avec différents coefficients, donnent donc souvent une précision trompeuse [FN: § 2282-2] , et tant que la science n'a pas progressé, et de beaucoup, il convient de s'en tenir à de simples indices généraux, comme seraient, en Angleterre, les sommes compensées au Clearing House, ou à d'autres indices analogues. Les variations du nombre des individus d'une population sont généralement petites. On peut donc les négliger en présence de variations économiques considérables, comme seraient, dans un court espace de temps, les variations des sommes compensées au Clearing House, ou les variations du commerce international. Mais il y a un motif de prime importance pour considérer directement le total du commerce international, et non ce total divisé par le nombre des individus qui constituent la population. En effet, nous recherchons un indice de la prospérité économique du pays ; et il est évident que si chaque individu continue à faire les mêmes recettes, à fournir la même production économique, la prospérité économique croît si la population croît, elle diminue si la population diminue. Supposons qu'en Angleterre la somme du commerce international et celle des compensations au Clearing House demeurent constantes pour chaque habitant, et que la population diminue de moitié : on devra admettre que la prospérité économique a diminué. Autrement, on arriverait à un résultat absurde. En effet, supposons que, dans toute l'Angleterre, il reste un seul homme. Grâce au commerce des peaux d'animaux sauvages, alors prospère dans l'île, cet homme obtient une somme égale à celle que l'on a aujourd'hui par habitant : la prospérité économique de l'Angleterre n'aurait pas diminué, ce qui est absurde. Vice-versa, si la production demeure constante, ainsi que le commerce par habitant, une augmentation de population est une augmentation de prospérité économique pour le pays [FN: § 2282-3].
§ 2283. L'affluence des métaux monétaires est très importante pour les variations des conditions économiques dans un pays, comme aussi, de nos jours, la production de l'or, car tous les pays civilisés ont entre eux des communications commerciales très intenses. L'or lui-même est devenu la monnaie, internationale. Sans vouloir donner trop de rigueur à la théorie quantitative de la monnaie, car le phénomène subit de nombreuses perturbations, il est certain qu'une augmentation considérable dans l'affluence des métaux monétaires agit puissamment sur les prix. Le fait s'est vérifié dans un trop grand nombre de cas, depuis les temps anciens jusqu'aux nôtres, pour qu'on puisse l'expliquer comme une simple coïncidence fortuite. Il est au plus haut point un rapport de cause à effet, sans que nous voulions exclure les réactions que les prix peuvent avoir sur l'affluence des métaux monétaires et sur leur production. De nos jours, les différentes façons dont les opérations financières et commerciales sont compensées agissent aussi beaucoup sur les prix, sans qu'il soit besoin de recourir à la monnaie métallique. Mais il faut prendre garde que de cette façon on rend plus sensibles les effets de l'augmentation d'une quantité d'or déterminée, car elle devient une fraction plus considérable de l'or qui demeure en circulation.
L'émission de papier-monnaie, ce que l'on a nommé l'inflation, a, sur les phénomènes sociaux, certains effets analogues à ceux de l'abondance des métaux précieux.
§ 2284. Des études nombreuses et remarquables ont été faites, non seulement sur la théorie de la production des métaux précieux et les variations concomitantes des prix, mais aussi sur certaines conséquences sociales de ces phénomènes. Les auteurs portèrent principalement leur attention sur les changements que les variations des prix produisaient dans les conditions des créanciers et des débiteurs, et par conséquent aussi dans les conditions des classes riches et des classes pauvres. Comme ces variations de prix eurent lieu souvent dans le sens d'une hausse, ce cas fut le mieux étudié. D'autres phénomènes, d'importance égale, et parfois plus grande, furent au contraire négligés, entre autres la variation dans l'intensité de la circulation des élites et ses conséquences politiques. En outre, on trouve là presque toujours l'erreur habituelle consistant à substituer des rapports de cause à effet aux rapports de mutuelle dépendance. L'affluence des métaux monétaires, ou, d'une façon générale, la production des métaux précieux, les variations de prix qui en sont la conséquence, les organisations concomitantes des systèmes monétaires, sont toutes des phénomènes qui font partie de la catégorie (b) du § 2205, c'est-à-dire de la catégorie des intérêts ; nous devons les considérer comme faisant partie des cycles étudiés aux § 2206 et sv.
§ 2285. Il faut faire attention que c'est surtout l'ensemble de la catégorie (b) qui agit sur les cycles, et que les phénomènes rappelés tout-à-l'heure, dépendant de l'affluence des métaux précieux, ne constituent qu'une partie de cet ensemble. C'est pourquoi les conséquences de ces phénomènes peuvent être partiellement annulées par les conséquences en sens contraire d'autres phénomènes ; ou bien, d'une manière analogue, elles peuvent croître en intensité.
§ 2286. Dans les temps passés et dans les temps modernes, on observe de nombreuses coïncidences entre l'abondance monétaire et la prospérité économique et politique d'un pays, mais souvent sans qu'on puisse bien discerner où est la cause et où est l'effet ; et ce serait une grave erreur d'admettre que l'affluence des métaux monétaires a pour conséquence nécessaire la prospérité d'un pays. Athènes fut prospère quand elle recevait les tributs de ses alliés, et quand elle retirait une grande quantité d'argent des mines du Laurium. D'une part, si les tributs des alliés étaient une cause de prospérité, ils en étaient aussi un effet, puisqu'ils étaient imposés par la puissance athénienne. D'autre part, l'argent des mines était une cause prédominante, mais il était aussi partiellement un effet, puisque si le peuple athénien avait été pauvre et faible, il n'aurait pas eu les esclaves et d'autres capitaux nécessaires à l'exploitation des mines. Le temps de la plus grande prospérité de Rome antique était celui où les conquêtes y faisaient affluer l'or, l'argent, le cuivre des peuples vaincus en Asie, en Afrique, en Europe. Dans ce cas, l'affluence des métaux monétaires est un effet prédominant des conquêtes. Les peuples modernes sont obligés de faire des dépenses énormes pour les armements ; elles n'étaient pas nécessaires aux peuples antiques. Par conséquent, si la richesse monétaire de Rome peut avoir été directement de quelque utilité aux conquêtes, elle ne fut certainement pas la cause principale des victoires du peuple romain. La combinaison (I) du § 2206 était donc alors d'une importance beaucoup plus grande que la combinaison (II), tandis qu'il ne peut y avoir une telle différence pour les peuples modernes. La combinaison (III), comme d'habitude, était de peu d'importance. Quant à la combinaison (IV), elle agissait en sens contraire de la combinaison (I), de manière à renforcer, ou même seulement à entretenir les résidus de la Ire classe. Ce fut l'une des causes de la décadence de l'Empire (§ 2550 et sv.).
§ 2287. Il est un cas différent du précédent : c'est celui où l'affluence des métaux précieux provient, non pas de la conquête ou de quelque autre semblable événement indépendant de la prospérité économique, mais où elle est une conséquence partielle de cette prospérité même, laquelle permet au peuple qui en jouit de se procurer ces métaux. Le fait fut manifeste pour plusieurs communes et républiques du moyen-âge, chez lesquelles nous trouvons à la fois bonne monnaie et prospérité économique, unies dans une dépendance mutuelle.
§ 2288. Sauf précisément ces exceptions, le moyen-âge est une époque de misère matérielle et intellectuelle ; c'est aussi une époque de misère monétaire. On ne peut pas dire que celle-ci fût la cause de celle-là, mais il serait téméraire d'affirmer qu'elle y était étrangère, car la dépendance est mise en lumière par les phénomènes de la période suivante.
§ 2289. La découverte de l'Amérique est l'un de ces nombreux événements imprévus et impossibles à prévoir, qui provoquent tout d'un coup de grands changements dans la catégorie (b) . Les découvertes de la technique industrielle, au XIXe siècle, sont un autre de ces événements; mais ils étaient un effet de la prospérité, dans une mesure beaucoup plus grande que la découverte de l'Amérique, qui eut lieu grâce à des moyens peu nombreux et misérables. Dès la fin du XVe siècle, lorsque l'Amérique fut découverte, jusque vers le milieu du XVIIe siècle, deux périodes très remarquables coïncident en Europe. On a une période de prospérité économique, intellectuelle, politique, et une période de grande abondance monétaire et d'augmentations extraordinaires des prix. Les phénomènes des deux périodes apparaissent ici beaucoup plus mutuellement dépendants que dans les cas de Rome (§ 2286) et du moyen-âge (§ 2288). En effet, si le premier mouvement provenait d'un cas fortuit, c'est-à-dire de la découverte de l'Amérique, ce mouvement continua et crût en intensité, parce que les conditions de l'Europe devinrent toujours plus favorables à la production de la richesse. La cause en fut principalement la prédominance acquise peu à peu par les résidus de la Ire classe et les buts vers lesquels étaient tournés les sentiments correspondants, les hommes se vouant alors aux arts et aux sciences, de préférence à la théologie et à la magie. Le premier mouvement partit donc de la combinaison (I), mais il fut suivi de la combinaison (II), et il serait difficile d'affirmer laquelle de ces deux combinaisons était, dans l'ensemble, la plus importante. La combinaison (IV) semble être d'une importance égale ; elle agit dans le même sens que les deux premières, ce qui arrive aussi pour la combinaison (III), laquelle, d'ailleurs, bien que notable, a peu d'influence sur les événements.
§ 2290. Depuis le milieu du XVIe siècle jusque vers l'an 1720, avec une grossière approximation, nous avons une période de calme pour la prospérité économique, et une période dans laquelle la production des métaux précieux ne varie pas beaucoup. Mais après 1720 et jusque vers 1810, toujours d'une manière grossièrement approchée, on a une période de rapide augmentation de la production des métaux précieux, et une période de prospérité économique, qui se manifeste principalement en Angleterre, tandis que, sur le continent, elle est troublée par les guerres de la révolution française. Celle-ci apparaît tout à fait comme un phénomène de la combinaison (IV), c'est-à-dire un phénomène dépendant de la circulation des élites. Après 1810, nous sommes aidés par des statistiques, d'abord peu parfaites, puis toujours meilleures; aussi pouvons-nous donner un peu plus de précision à notre exposé.
§ 2291. Il faut comprendre la description que nous avons faite jusqu'ici des phénomènes, comme étant analogue à celle que l'on fait lorsque, sur une carte géographique, on représente une chaîne de montagnes par une ligne. En réalité, il n'y a pas de ligne appelée Apennins, qui divise en deux l'Italie, ni une ligne appelée Alpes, qui l'entoure ; cependant cette image générale et grossière de la péninsule est commode.
§ 2292. Aujourd'hui, nous nous rapprochons bien davantage du phénomène réel, grâce à l'emploi des statistiques. Pourtant, nous devons demeurer toujours dans les considérations générales, et rechercher des images d'ensemble qui négligent les détails. Nous avons déjà indiqué (§ 1718) la manière d'étudier ces phénomènes d'une façon générale. Maintenant, il nous reste à examiner cette manière dans le cas particulier dont nous nous occupons [FN: § 2292-1] .
§ 2293. Prenons comme exemple le mouvement commercial de la France avec l'étranger. Dans l'appendice II, on trouvera les tableaux numériques de cette statistique et d'autres encore. Continuons ici à exposer les conclusions [FN: § 2293-1] . Si l'on dessine un diagramme sur ces données, et si l'on observe attentivement la courbe ainsi obtenue, on voit surtout trois genres de variations : 1° Variations accidentelles ; 2° Variations à courte période ; 3° Variations à longue période.
1° Variations accidentelles. – Elles n'interrompent pas pour longtemps la direction générale de la courbe, qui aussitôt reprend comme avant. Un exemple remarquable est celui de 1848 ; plus remarquable encore celui de 1870. Les forces qui déterminent l'équilibre dynamique demeurant en action, si une force accidentelle vient à le troubler, aussitôt que cette force disparaît, l'équilibre se rétablit (§ 2268), et le processus reprend son cours.
2° Variations à courte période. – Souvent déjà ces variations ont été aperçues, et en partie étudiées sous le nom de crises. Un exemple remarquable est celui de 1881. On a une partie ascendante, le long de laquelle on remarque des variations accidentelles, et une partie descendante semblable. Il est caractéristique que l'on ne passe pas peu à peu de la partie ascendante à la partie descendante, mais qu'on y passe brusquement. Une augmentation insolite de prospérité présage souvent une chute prochaine.
3° Variations à longue période. – Elles n'ont pas été étudiées jusqu'à présent, cela en grande partie parce qu'on n'avait pas encore les données statistiques nécessaires.
Si l'on regarde dans l'ensemble la courbe du mouvement commercial, en s'efforçant de faire abstraction des variations précédentes, on voit aussitôt qu'elle n'a pas une allure uniforme. À des périodes de rapide augmentation font suite des périodes de lente augmentation, ou de dépression, suivies de nouveau de périodes d'augmentation plus ou moins rapide. Par exemple, de 1852 à 1873, il y a une période de rapide augmentation, interrompue par la guerre de 1870-1871, et suivie d'une période de légère augmentation, ou de dépression, de 1873 à 1897. Arrive de nouveau une période de rapide augmentation, de 1898 à 1911. On observe aussi dans le passé de semblables périodes, mais en de beaucoup moindres proportions. Par exemple de 1806 à 1810, il y a déclin. Puis, de 1816 à 1824 vient une période de dépression; ensuite une période d'augmentation, de 1832 à 1846.
Cette manière de considérer les phénomènes est d'ailleurs un peu grossière ; il faut que nous trouvions moyen d'obtenir une plus grande précision. On y arrivera en interpolant la courbe obtenue, c'est-à-dire en cherchant autour de quelle ligne elle oscille. Les résultats de ces calculs se trouveront dans l'appendice II.
§ 2294. Si nous faisons des diagrammes analogues au précédent, pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour la Belgique, nous voyons que les conclusions sont semblables. Dans tous ces pays, on peut distinguer trois variations à période longue, lesquelles vont à peu près de 1854 à 1872, de 1873 à 1896, de 1898 à 1912. La considération du phénomène de l'émigration en Italie, des sommes compensées au Clearing House de Londres, du produit des théâtres de Paris, confirment ces déductions [FN: § 1194-1] . Il est donc évident que nous avons à faire à un phénomène de nature très générale.
§ 2295. On sait assez qu'après 1870 la production de l'argent devint si grande que ce métal ne put continuer à être employé comme vraie monnaie, et finit, dans les pays civilisés, par être employé uniquement comme monnaie fiduciaire. C'est pourquoi, tandis que jusqu'au XIXe siècle nous avons considéré la production globale de l'or et de l'argent, depuis le XIXe siècle, nous devons considérer la production de l'or, laquelle finit peu à peu par être l'unique source de la vraie monnaie.
§ 2996. La moyenne annuelle de la production de l'or, qui était seulement de 189 millions de francs dans la décade de 1841 à 1850, devient de 687 millions entre 1851 et 1855, et se maintient à peu près à cette somme, jusqu'à la fin de la période de 1866 à 1870. Par conséquent, nous avons une certaine correspondance entre la période de prospérité économique de 1854-1872, et une période de grande production aurifère. Dans la période de 1871-1875, la production annuelle moyenne de l'or atteint 599 millions de francs. Après 1875, nous avons la statistique des productions annuelles séparées. Il y a une période de productions décroissantes ou constantes qui finit en 1891 à peu près. Cette période aussi correspond assez bien à celle de calme économique, entre 1873 et 1876. Enfin, de 1892, où la production de l'or est de 750 millions de francs, jusqu'en 1912, où elle est de 2420 millions de francs, on a une période de rapide et grande augmentation de la production aurifère. Cette période correspond à peu près à celle de 1898-1912, de grande prospérité économique.
§ 2297. Nous répétons que les rapports trouvés tout à l'heure ne doivent pas être interprétés en ce sens que l'augmentation de la production de l'or serait la cause de la prospérité économique. Certainement, cette augmentation a eu une influence en ce sens par ses effets sur les prix, et plus encore sur la circulation des élites ; mais sans aucun doute, elle a été aussi un effet de cette prospérité. Aujourd'hui, la majeure partie de l'or n'est plus extrait des alluvions, comme c'était le cas au début, en Californie et en Australie. On l'extrait de mines, où il faut des travaux souterrains très coûteux, et des machines très chères. C'est pourquoi la production de l'or n'est aujourd'hui possible que moyennant des capitaux immenses. Par ce fait, elle dépend de la prospérité économique elle-même, laquelle devient de la sorte une cause, après avoir été un effet. On remarquera aussi que la production de l'or fait augmenter les prix, mais que ceux-ci, à leur tour, réagissent sur cette production, en faisant croître le coût de l'extraction. Il existe actuellement un grand nombre de mines à minerai pauvre, qui ne peuvent être exploitées avec les prix actuels de la main-d'œuvre et des installations. Elles pourraient être exploitées, sitôt que ces prix diminueraient, même d'une petite quantité. Cela pourra se produire au fur et à mesure que l'on exploitera le minerai riche.
§ 2298. Ces rapports appartiennent à la catégorie économique désignée par (b) au § 2205. Ils nous font voir comment cet ensemble (b) se constitue de ses différentes parties ; mais nous ne devons pas nous arrêter sur ce point : il faut examiner les actions et les réactions entre cette catégorie et les autres. Nous l'avons déjà fait, sans tenir compte des ondulations, dans le cas particulier de la protection douanière. Nous sommes partis de là pour traiter de la protection économique, et aussi, plus généralement, des cycles d'actions et de réactions entre les différentes catégories d'éléments (§ 2208 et sv.). Ce que nous avons dit alors pourra, avec des adjonctions et des modifications légères, nous faire connaître le phénomène, même dans le cas des ondulations.
§ 2299. Occupons-nous maintenant de l'état économique et social des peuples civilisés, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Les combinaisons (§ 2206) les plus importantes sont la combinaison (II) et la combinaison (IV). Fixant d'abord notre attention sur la partie vraiment la plus importante du phénomène, nous pouvons même considérer, dans une première approximation, un cycle restreint dans lequel les intérêts (b) agissent sur la circulation des élites (d) et, en retour, celle-ci sur ceux-là. Il serait difficile peut-être impossible, de séparer les deux parties du cycle, qu'il convient par conséquent de considérer dans son ensemble.
§ 2300. Si l'on voulait indiquer en peu de mots les différences qui existent entre l'état social (M) avant la révolution française, et l'état actuel (N), on devrait dire qu'elles consistent principalement en une prédominance des intérêts économiques et en une beaucoup plus grande intensité de la circulation des élites [FN: § 2300-1] . Désormais, la politique étrangère des États est presque exclusivement économique (§ 2328), et la politique intérieure se réduit aux conflits économiques. D'autre part, sauf un petit nombre de restrictions, en Allemagne et en Autriche, non seulement tous les obstacles à la circulation des élites ont disparu, mais encore celle-ci est devenue effectivement intense, grâce à l'appui de la prospérité économique. Aujourd'hui, presque tous ceux qui possèdent à un haut degré les résidus de la Ire classe, (instinct des combinaisons), et qui savent faire preuve d'aptitudes dans les arts, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le commerce, dans la constitution d'entreprises financières, honnêtes ou malhonnêtes, dans la duperie des bons producteurs d'épargne, dans l'habileté à obtenir l'autorisation d'exploiter les citoyens les moins habiles, grâce à la politique, aux protections douanières ou autres, aux faveurs de tout genre, ceux-là sont certains, à moins d'une étrange malchance, non seulement de s'enrichir, mais aussi d'obtenir honneurs et pouvoir, en somme de faire partie de la classe gouvernante. Toujours sauf des exceptions, telles, en partie, que les faits qui s'observent en Allemagne, les chefs de cette classe sont les hommes qui savent le mieux servir les intérêts économiques de la classe gouvernante. Parfois, ils se font payer directement en argent, parfois indirectement par l'argent que retirent les personnes de leur famille ou leurs amis ; parfois, ils se contentent du pouvoir et des honneurs que confère ce pouvoir, abandonnant l'argent à leurs troupes. Cette dernière catégorie de personnes est beaucoup plus recherchée que les autres, pour gouverner le pays. En effet, ces personnes échappent aux critiques de l'opposition, qui, afin d'être entendue du bon peuple, doit faire usage du langage des dérivations, et qui se tient aux aguets pour découvrir quelque accusation venimeuse d'« immoralité » à lancer contre ses adversaires. Grâce à cet art, un politicien qui s'approprie quelques milliers de francs avec trop de désinvolture est mis à pied, si le secours de ceux auxquels il est utile n'est pas efficace ; tandis que le politicien qui ne prend rien pour lui-même, mais qui fait cadeau, aux frais du public, de plusieurs millions, et même de plusieurs centaines de millions de francs à ses troupes, celui-là conserve le pouvoir et gagne en bonne réputation et en honneurs (§ 2268).
§ 2301. La circulation des élites d'aujourd'hui fait donc entrer dans la classe gouvernante un grand nombre de personnes qui détruisent la richesse, mais elle y en fait entrer un plus grand nombre encore qui la produisent. Nous avons là une preuve très certaine que l'action de ces dernières l'emporte sur celle des premières, puisque la prospérité économique des peuples civilisés s'est énormément accrue. En France, après 1854, au temps de la fièvre des constructions de chemins de fer, plusieurs financiers peu honnêtes, plusieurs politiciens, se sont enrichis et ont détruit de grandes sommes de richesse; mais des sommes incomparablement plus grandes de richesses ont été produites par les chemins de fer, et le résultat final de l'opération a été une grande augmentation de prospérité pour le pays. Nous n'avons pas à rechercher ici si on pouvait l'obtenir également en épargnant les dépenses que coûtèrent les parasites financiers, politiques et autres ; nous traitons de mouvements réels, non de mouvements virtuels ; nous décrivons ce qui a eu lieu et ce qui a lieu, nous ne voulons pas aller plus loin. Le lecteur voudra bien se souvenir de cette observation dans toute la suite de cet ouvrage.
§ 2302. Dans les périodes où la prospérité économique croît rapidement (§ 2294), il est beaucoup plus facile de gouverner que lorsqu'elle est stagnante. On peut constater ce fait d'une manière empirique, en comparant les états politiques et sociaux des périodes économiques indiquées au § 2293. On peut dire qu'en France, les succès du second Empire coïncident avec la période de prospérité économique qui commence en 1854. Plus tard, surgissent des difficultés, et peut-être, même sans la guerre de 1870, l'Empire aurait-il couru de très graves dangers dans la période 1873-1896. Ces dangers ne manquèrent pas aux gouvernements de cette période, non seulement en France, mais ailleurs aussi. Un peu partout en Europe, c'est le temps héroïque du socialisme et de l'anarchie. Bismarck lui-même, pourtant si puissant, a besoin, pour gouverner, des lois exceptionnelles contre les socialistes. En Italie, cette période aboutit à la révolte de 1898, domptée uniquement par la force. Ensuite, de nouveau, de 1898 jusqu'à présent, revient un temps de gouvernement facile, ou, si l'on veut, pas trop difficile ; il aboutit, en Italie, en 1912, à la dégénérescence des partis d'opposition et à la facile dictature de Giolitti ; tandis qu'en Allemagne, les socialistes – que les temps ont changé ! – approuvent au Reichstag les nouvelles et très grosses dépenses en faveur des armements, et qu'en Angleterre, les pacifistes successeurs des Fenians de la période 1873-1898 obtiennent facilement le Home Rule.
Que l'on compare, en Italie, l'effet de la guerre d'Abyssinie, intervenue dans la période 1873-1898, et celui de la guerre de Libye, intervenue dans la période 1898-1912 (§ 2255). Pour le moment, nous ne recherchons pas de causes et d'effets, ni de rapports de mutuelle dépendance : nous notons seulement des coïncidences, lesquelles pourraient être fortuites. Quelles qu'en aient été les causes, il est certain, très certain, que la population italienne accueillit d'une façon bien différente la guerre d'Abyssinie et celle de Libye. Contre la première, les partis dits « subversifs » s'insurgèrent avec une extrême énergie, tandis qu'ils acceptèrent la seconde, consentants ou résignés. Il fallut qu'il s'en passât de belles et de bonnes, pour que, du socialisme jusqu'alors existant, il se détachât un parti dit des « socialistes officiels », lequel, manquant à la vérité de chefs jouissant d'autorité, condamna la guerre de Libye. Que l'on compare, en France, l'opposition aux entreprises coloniales, au temps de Jules Ferry (période 1873-1898), au consentement ou à la résignation avec laquelle fut accueillie l'entreprise du Maroc (période 1898-1912), bien autrement coûteuse et dangereuse. Assurément, le contraste entre ces deux périodes n'est pas très différent de celui que nous avons trouvé dans la comparaison analogue faite tout à l'heure pour l'Italie. Que l'on compare encore l'émotion de la population française, quand on découvrit les détournements des politiciens au préjudice de l'entreprise du Panama, avec le calme et l'indifférence qui accueillirent les détournements, sans doute non moins malhonnêtes ni de moindre importance, grâce auxquels on fit disparaître la plus grande partie du célèbre milliard des congrégations. Dans le second cas, il semblait vraiment que, songeant aux pirates, beaucoup de gens se disaient en eux-mêmes : « Pauvres diables, il est vrai qu'ils ont fait de beaux bénéfices ; mais après tout, il y en a pour tout le monde : pour eux et pour nous ». Une telle indulgence n'est guère possible que si le gâteau est assez grand pour qu'en outre des grosses tranches que se taillent les principaux politiciens, les politiciens secondaires en obtiennent d'autres plus petites, et que beaucoup de gens en aient au moins une miette. On ne saurait croire combien le fait de n'avoir rien à ronger allume le zèle des politiciens et les pousse à une défense féroce de la morale, de l'honnêteté et de tant d'autres belles choses. Que l'on compare encore les furieuses luttes de l'affaire Dreyfus, auxquelles on peut attribuer l'effet d'une grande révolution, avec les conflits politico-sociaux beaucoup plus pacifiques de la période 1898-1912, et l'on devra bien reconnaître qu'il y a quelque chose de changé dans les conditions de la société politique.
§ 2303. Il serait facile de citer un grand nombre d'autres faits semblables dans le présent ; il ne serait pas difficile d'en trouver d'analogues dans le passé. C'est une remarque banale qu'alors les mauvaises récoltes et les famines provoquaient la mauvaise humeur des sujets, et les poussaient facilement à la révolte. Dans des temps plus proches des nôtres, de mauvaises récoltes et des famines ne furent pas non plus étrangères au développement de la révolution française. Il est impossible d'admettre que tant de coïncidences soient fortuites. Il est évident qu'il doit y avoir quelque rapport entre les phénomènes dont on remarque ainsi la coïncidence. Cette conclusion sera confirmée par l'analyse, laquelle nous fera connaître la nature de ce rapport.
§ 2304. Elle peut évidemment varier, lorsque varient les conditions sociales. Les famines poussaient les peuples à la révolte, comme la faim fait sortir le loup du bois ; mais le rapport entre les conditions économiques et l'humeur de la population est bien autrement compliqué chez les peuples économiquement très développés, comme le sont les peuples modernes.
§ 2305. Pour ceux-ci, comme nous l'avons déjà dit (§ 2299), il faut que nous considérions principalement le cycle restreint dans lequel (b) agit sur (d) , et vice versa. En un mot, on peut dire que, pour se maintenir en place, les gouvernements modernes emploient toujours moins la force et toujours plus un art très coûteux, et qu'ils ont grandement besoin que la prospérité économique seconde leur action ; qu'en outre, ils ressentent beaucoup plus les variations de cette prospérité. Sans doute, même les gouvernements qui usaient surtout de la force étaient en danger, lorsque la misère se faisait cruellement sentir, parce qu'alors à leur force s'en opposait une autre plus grande, produite par le désespoir. Mais ils pouvaient demeurer en sécurité, tant que les conditions économiques changées n'avaient pas atteint cette limite ; tandis qu'au contraire, tout changement de ces conditions, souvent même peu important, se répercute sur l'organisation, bien autrement compliquée et changeante, des gouvernements qui s'en remettent surtout à l'art coûteux des mesures économiques. Pour pousser les sujets à la révolte, il fallait des souffrances économiques bien plus grandes que celles qui se traduisent par des élections contraires au gouvernement. On comprend donc facilement que les périodes économiques mentionnées au § 2293, lesquelles n'atteignirent pas la limite de la misère, correspondent, sous des gouvernements différents, à des conditions différentes. Sous des gouvernements qui s'en remettent surtout à la force, elles produisent beaucoup moins de changements sociaux et politiques que sous des gouvernements qui recourent largement à l'art des combinaisons économiques.
§ 2306. Précisément pour pouvoir mettre en œuvre les combinaisons qui leur sont indispensables, les gouvernements modernes sont entraînés à dépenser, en un temps donné, plus que ne comporteraient leurs recettes. Ils comblent la différence en faisant de nouvelles dettes, avouées ou dissimulées [FN: § 2306-1], qui leur permettent d'effectuer tuer immédiatement des dépenses, – dont ils rejettent le poids sur l'avenir. Cet avenir s'éloigne d'autant plus que la prospérité économique croît plus rapidement; car, grâce à elle, le produit des impôts existants s'accroît, sans nouvelles aggravations, et les bonis des budgets futurs de l'État peuvent, au moins en partie, servir à payer les déficits des budgets passés. Nos gouvernements se sont peu à peu accoutumés à cet état de choses, pour eux si commode et si agréable. Désormais ils escomptent régulièrement les augmentations des budgets futurs pour compenser les dépenses présentes. Le fait se produit dans un grand nombre de pays, grâce à différents procédés, parmi lesquels il faut noter celui des budgets spéciaux ou extraordinaires, que l'on institue parallèlement au budget général ou ordinaire ; celui qui consiste à faire figurer le montant de nouvelles dettes aux recettes de l'État, ou à constituer débitrices certaines administrations de l'État, pour des sommes qu'elles ont dépensées, et d'inscrire ces sommes au crédit de l'État, qui se trouve être en même temps créancier et débiteur. De la sorte, on porte à l'actif les dépenses qui devraient figurer au passif. Ensuite, lorsque par ces artifices ou d'autres semblables on a changé un déficit réel en un boni fictif, on charge des journalistes bien payés de proclamer aux gens la bonne nouvelle des finances prospères ; et si quelqu'un émet quelque doute sur ces jeux de comptabilité, on l'accuse de « discréditer le pays ».
§ 2307. Cette façon d'agir ne provoque pas de graves difficultés dans les périodes de rapide augmentation de prospérité économique : l'augmentation naturelle des recettes [FN: § 2307-1] du budget couvre les supercheries du passé, et l'on remet à l'avenir le soin d'amender celles du présent. Mais les difficultés surgissent dans les périodes de calme ; elles deviendraient bien plus grandes s'il se produisait une période un peu longue de régression économique. L'organisation sociale actuelle est telle que peut-être aucun gouvernement ne pourrait surmonter un tel danger, et qu'il se produirait de terribles catastrophes, d'une intensité bien plus grande que celles dont nous parle l'histoire. Même la stagnation économique peut n'être pas exempte de dangers.
§ 2308. Mais négligeons ces éventualités hypothétiques ; traitons uniquement des mouvements réels, et voyons maintenant l'un des motifs des coïncidences relevées au § 2302. Ce motif est que, dans les périodes de stagnation économique, le gouvernement doit demander aux gouvernés de plus grands sacrifices, tandis que diminuent les bénéfices qu'il pouvait leur procurer, ainsi qu'à ses partisans. En effet, d'un côté, il doit payer les dépenses du passé, pour lesquelles il avait escompté les augmentations de recettes qui présentement font défaut ; d'un autre côté, si la période de stagnation se prolonge, il devient toujours plus malaisé de faire des dépenses en comptant sur l'avenir pour les payer.
§ 2309. Supposons la circulation économique et la circulation des élites stagnantes. Les gens qui possèdent à un haut degré l'art des combinaisons économico-politiques, sur lesquelles s'appuient nos gouvernements, ne trouvent plus alors leur récompense, ni comme conséquence naturelle des institutions existantes, ni artificiellement par l'intervention directe du gouvernement.
Il est difficile à celui-ci d'amadouer l'adversaire, parce qu'il devient difficile de trouver quelque chose à lui offrir. Si même on trouve suffisamment pour les chefs, les partisans qui demeurent ventre vide s'agitent et refusent de les suivre. Par exemple, les diverses conditions du budget empêchaient Crispi, et permettaient à Giolitti, de subventionner largement les coopératives et d'autres associations socialistes, ainsi que les trusts industriels et financiers. C'est certainement une cause, petite ou grande, de la diversité des phénomènes relevés au § 2302. Lorsqu'en 1913 on eut un commencement de stagnation économique en Italie, les partisans militants du socialisme refusèrent de suivre leurs chefs déjà apprivoisés, et en suivirent d'autres, qui se présentèrent aux élections avec un programme nettement opposé à la guerre de Libye et à l'augmentation des dépenses militaires. Les chefs avaient oublié que chez le peuple persistait l'idéalisme qu'eux-mêmes avaient perdu, soit spontanément, soit grâce aux faveurs du gouvernement. À cet idéalisme populaire, le gouvernement ne pouvait s'opposer en excitant, par de grosses dépenses, les intérêts populaires. C'est pourquoi l'opposition au gouvernement et aux chefs qui s'étaient mis dans sa dépendance s'accrut et se fortifia.
§ 2310. Maintenant nous sommes en mesure de poursuivre les études commencées au § 2231 et sv. Les périodes de rapide augmentation de la prospérité économique sont favorables aux « spéculateurs », qui s'enrichissent et pénètrent dans la classe gouvernante, s'ils n'en font pas encore partie. Ces périodes sont défavorables aux « rentiers » à rente presque fixe. Ceux-ci déclinent, soit à cause de l'augmentation naturelle des prix, soit parce qu'ils ne peuvent faire face à la concurrence des spéculateurs, pour se concilier les faveurs du public et des politiciens. Des effets inverses se produisent dans les périodes de stagnation économique. Tout cela doit s'entendre dans un sens très général, en gros, parce que plusieurs détails du phénomène peuvent être différents.
§ 2311. Il suit de là que lorsque les périodes de rapide augmentation de la prospérité économique prédominent sur les périodes de stagnation, la classe gouvernante recrute toujours plus de « spéculateurs » qui y renforcent les résidus de l'instinct des combinaisons (§ 2178 et sv.) ; elle voit diminuer le nombre des « rentiers » à rente presque fixe, gens qui ont généralement plus puissants les résidus de la persistance des agrégats. Ce changement dans la composition de la classe gouvernante a pour effet de pousser toujours plus les peuples aux entreprises économiques, et d'accroître la prospérité économique, jusqu'à ce que surgissent de nouvelles forces qui neutralisent le mouvement (§ 2221 et sv.). Le contraire se produit quand prédominent les périodes de stagnation ou surtout de décadence économique. On a des exemples des premiers phénomènes chez les peuples civilisés modernes. On trouve des exemples des seconds phénomènes chez les peuples du bassin méditerranéen, au temps de la décadence de l'Empire romain, jusqu'après les invasions barbares et au moyen-âge. Ces effets sur la composition de la classe gouvernante ne sont pas les seuls qu'on remarque dans les périodes indiquées de prospérité et dans celles de stagnation. Plus loin, nous traiterons d'autres périodes (§ 2343 et sv.).
§ 2312. Dans les sociétés humaines civilisées, les producteurs d'épargne remplissent une fonction d'une très grande importance (§ 2228). Ils ressemblent aux abeilles qui recueillent le miel dans les alvéoles ; la comparaison se soutient encore en ce que l'on peut souvent dire d'eux : Sic vos non vobis mellificatis, apes. On ne va pas au delà de la vérité en affirmant que la civilisation est en raison directe de la quantité d'épargne que possède ou que met en œuvre un peuple. Si la prospérité économique croît, la quantité d'épargne consacrée par la production croît aussi, Si la prospérité économique est stagnante, la quantité d'épargne consacrée à la production décroît aussi.
§ 2313. Pour aller de l'avant, nous devons nous référer à la classification que nous avons faite aux § 2233-2234, en considérant deux catégories (S) et (R) , auxquelles nous avons donné les noms de spéculateurs et de rentiers uniquement par raison de commodité (§ 2235). Quand les producteurs de cette épargne ont le nécessaire pour vivre, ils se trouvent en grande partie dans la classe (R) des rentiers à rente presque fixe [FN: § 2313-1]. Leurs caractères sont contraires à ceux des individus qui appartiennent à la classe (S) , soit des « spéculateurs » (§ 2232). Ce sont en général des gens renfermés, prudents, timides, qui fuient toute aventure, non seulement dangereuse, mais tant soit peu risquée en apparence. Ils sont très faciles à gouverner et aussi à dépouiller, pour qui sait se servir avec opportunité des sentiments correspondant aux résidus de la persistance des agrégats, lesquels sont chez eux puissants [FN: § 2313-2). Les « spéculateurs » sont au contraire habituellement exubérants, prompts à accepter les nouveautés, prompts à l'action économique ; ils se plaisent aux aventures économiques dangereuses, et les recherchent. En apparence, ils se soumettent toujours à qui dispose de la force ; mais ils travaillent par dessous, et savent détenir la réalité du pouvoir dont d'autres n'ont que le semblant. Aucun échec ne les décourage ; chassés d'un côté, ils reviennent de l'autre, comme les mouches. Si l'orage gronde, ils courbent la tête sous la rafale, mais la redressent sitôt qu'elle a passé. Par leur insistance tenace et leur art subtil des combinaisons (Ie classe des résidus) ils surmontent tous les obstacles. Leurs opinions sont toujours celles qui leur sont le plus profitables sur le moment : hier conservateurs, ils sont aujourd'hui démagogues ; demain ils seront anarchistes, pour peu que les anarchistes soient près de s'emparer du pouvoir [FN: § 2313-3). Mais ils savent n'être pas tout entiers d'une couleur, car il convient de se concilier l'amitié de tous les partis quelque peu importants. Sur la scène, on voit lutter les uns contre les autres des spéculateurs catholiques et sémites [FN: § 2313-4] , monarchistes et républicains, libre-échangistes et socialistes ; mais dans la coulisse ces gens-là se serrent la main et poussent d'un commun accord aux entreprises qui peuvent rapporter de l'argent [FN: § 2313-5]. Quand l'un d'eux tombe, ses ennemis usent envers lui de pitié, attendant qu'au moment opportun on leur témoigne des égards analogues. Les deux catégories de personnes dont nous avons parlé savent peu se servir de la force, et la craignent. Les hommes qui en font usage et ne la craignent pas constituent une troisième catégorie, qui dépouille très facilement la première, plus difficilement la seconde ; celle-ci, aujourd'hui vaincue et défaite, se relève demain et gouverne.
§ 2314. On trouve une preuve très évidente du peu de courage des rentiers, dans la résignation lâche et stupide avec laquelle ils acceptent les conversions des dettes publiques des États [FN: § 2314-1]. Autrefois, on pouvait se demander s'il y avait avantage à les accepter ou à les refuser. Désormais, après tant d'exemples dans lesquels, à la suite des conversions, les titres sont descendus au-dessous du pair, il faut vraiment être borné pour espérer qu'une nouvelle conversion puisse avoir un résultat différent. Les possesseurs de titres anglais et les possesseurs de titres français, au temps des dernières conversions, ne pouvaient-ils donc pas prévoir, dès l'origine, ce qui les attendait à l'avenir ? En 1913, le consolidé anglais est tombé à 72 % et le français à 86. Et bien, si dans quelques années ces titres remontaient au delà du pair, leurs possesseurs seraient assez stupides ou assez lâches pour accepter une nouvelle conversion. On remarquera qu'il suffirait qu'une petite partie d'entre eux se missent d'accord pour refuser toute espèce de conversion ; mais il serait plus facile de lancer un troupeau de moutons à l'assaut d'un lion, que d'obtenir de ces gens-là le moindre acte énergique : ils courbent la tête et se laissent égorger. Exactement comme un troupeau de moutons, les possesseurs d'épargne française se laissent tondre par le gouvernement, lequel accorde ou refuse aux gouvernements étrangers la faculté d'émettre des emprunts en France, sans égard à la protection de l'épargne, mais bien à ses convenances politiques à lui, auxquelles parfois se subordonne, s'ajoute, et même se substitue l'intérêt privé de certains démagogues ploutocrates. À cela s'ajoutent des impôts variés sur les ventes-achats des titres, le timbre sur les titres, etc., le tout grevant les possesseurs d'épargne. Quelques-uns, il est vrai, commencent maintenant à prendre la défense de leurs propres intérêts, en envoyant leur argent à l'étranger ; mais au total, ils forment une toute petite fraction, tant par le nombre que par la somme d'épargne.
§ 2315. On trouve un autre exemple de moindre importance, mais pourtant toujours notable, dans l'action des cléricaux possesseurs d'épargne, en France, durant les années qui précédèrent la suppression des congrégations religieuses et la confiscation de leurs biens. On savait sans aucun doute que, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, cela devait arriver. Les possesseurs de ces biens ne surent pas mettre en œuvre la moindre combinaison pour éviter le dommage imminent. Au contraire, ils s'efforcèrent de le rendre plus grave, par leur manie de posséder des immeubles, c'est-à-dire de donner à leur richesse la forme la plus favorable à une confiscation par le gouvernement. Cependant il était très facile d'éviter, au moins en grande partie, la spoliation imminente. L'argent et les titres pouvaient être placés en lieu sûr, si on les déposait à l'étranger. Quant aux immeubles, s'ils tenaient vraiment à en avoir la propriété, ils pouvaient la conférer à une société anonyme dont ils auraient gardé le plus grand nombre de titres et négocié quelques-uns aux bourses de Londres, de Berlin, de New-York, de manière à élever devant qui voudrait dépouiller la société anonyme l'obstacle de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Amérique.
§ 2316. Ce fait n'est pas spécial aux cléricaux français. Depuis le temps où fut dépouillé l'oracle de Delphes jusqu'à nos jours, on remarque un courant continu qui, des producteurs ou des simples possesseurs d'épargne, va aux institutions religieuses, lesquelles sont ensuite dépouillées par le gouvernement, exactement comme les agriculteurs récoltent chaque année le miel que les industrieuses abeilles ne cessent jamais de butiner [FN: § 2316-1].
Ce phénomène même n'est qu'un cas particulier d'un phénomène bien plus général, qui consiste en ce que, dans nos sociétés, telles que nous les connaissons depuis les temps historiques, les producteurs et les possesseurs d'épargne sont continuellement dépouillés du fruit de leur économie.
Considérée en ses moyens, cette opération s'accomplit par la violence, la guerre, le pillage, la violence des particuliers, ou bien la fraude et la tromperie, par des lois d'impôts frappant spécialement les possesseurs d'épargne, des émissions de fausses monnaies ou de dettes publiques qui seront répudiées tôt ou tard, partiellement ou en totalité, des monopoles, des droits protecteurs, des mesures de tout genre venant altérer les conditions de la production et les prix qui seraient donnés par la libre concurrence, etc. La forme la plus simple est celle d'une spoliation directe et violente d'un certain nombre d'épargneurs, souvent choisis au hasard, uniquement en considération de leur richesse ; elle correspond en quelque sorte à la chasse des animaux sauvages. Des formes de plus en plus compliquées, de plus en plus ingénieuses et générales, apparaissent dans le cours de l'histoire ; elles correspondent en un certain sens à l'élevage des animaux domestiques. L'analogie s'étend aux effets de ces formes. Le premier genre détruit incomparablement plus de richesses, amène beaucoup plus de perturbations sociales que le second.
Considérée en ses modalités, l'opération qui dépouille les possesseurs d'épargne peut être plus ou moins directe ou indirecte : être imposée, ou, au moins en partie, volontaire. Le type du premier mode se trouve dans l'impôt, les prestations obligatoires, les atteintes à l'héritage, les mesures, fréquentes dans l'antiquité, pour abolir ou alléger les dettes [FN: § 2316-2] . Le type du second mode s'observe lorsque l'opération a lieu en deux actes. Dans le premier, les individus donnent leur épargne à certaines corporations, principalement à des corporations religieuses, à des temples ; ils la confient à l'État ou à des institutions garanties par l'État. Dans le second acte, les corporations et les institutions sont dépouillées, parfois par l'ennemi, quelquefois par de puissants particuliers, souvent par l'État national, qui, souvent aussi, s'approprie les sommes dont il s'était reconnu débiteur ou dont il avait garanti la restitution. Les premières opérations sont entièrement ou principalement volontaires. Sous l'empire de mythes religieux, païens autrefois, ensuite chrétiens [FN: § 2316-3] , aujourd'hui nationalistes, les individus se laissent entraîner à faire don de leur épargne, espérant s'assurer les bienfaits de leurs dieux, ou attirés par les arrérages qu'on promet de leur payer, et par l'espoir, souvent fallacieux, qu'ils ne perdront pas intérêt et principal. Les secondes opérations suivent naturellement. Elles ont lieu selon la ligne de moindre résistance : on prend l'épargne là où elle se trouve et là où, une résistance énergique faisant défaut, elle est moins bien défendue [FN: § 2316-4] . Prélever une somme par l'impôt, ou par un emprunt qu'on répudiera ensuite, directement ou par des mesures dites de protection, provoque des résistances fort différentes chez le peuple. Considérée dans le temps, la spoliation se manifeste soit par des catastrophes que séparent de grands espaces de temps, parfois de plusieurs siècles, soit par des phénomènes se reproduisant en de plus courtes périodes, tels par exemple les pertes infligées aux épargneurs, lors de ce que l'on a appelé des « crises économiques », soit par des dispositions, législatives ou autres, agissant d'une manière continue, telles les liturgies et la triérarchie à Athènes anciennement, ou des impôts progressifs, de nos jours. En somme, en tout cela, nous avons un nouvel exemple des oscillations de grande, moyenne, et de petite ampleur, que présentent les phénomènes économiques et les phénomènes sociaux (§ 2293).
Les grandes oscillations prennent, surtout sous l'empire de sentiments éthiques, le caractère de catastrophes ; on croit que la considération de celles-ci doit être écartée de l'étude d'une société régulière et normale. C'est là une illusion. Il faut bien se rendre compte qu'elles ne diffèrent des autres oscillations que par l'intensité, et que leur ensemble est aussi régulier, aussi normal que tout autre phénomène social [FN: § 2316-5). Pour toutes les oscillations la forme peut changer, le fond demeure constant. La différence est principalement de forme entre la falsification matérielle des monnaies métalliques et les émissions de papier-monnaie [FN: § 22316-6] , entre les emprunts faits à des trésors sacrés, et certaines émissions de dettes publiques, entre les usurpations brutales accomplies autrefois par la puissance des armes, et les opérations financières des politiciens modernes, entre les dons faits à des satellites armés, et les largesses octroyées aux électeurs influents. Pourtant un changement appréciable s'observe dans la forme, par l'élimination graduelle des procédés les plus brutaux. À notre époque, on ne voit plus se reproduire de violentes et brutales spoliations du genre de celles qui servirent à Octave, Antoine et Lépide, pour s'assurer le concours de leurs soldats (§ 2200-1). De même, le système de livrer les contribuables à la rapacité de certaines personnes, auxquelles ensuite on fait rendre gorge violemment [FN: § 2316-7), a presque entièrement disparu des pays civilisés, ou s'est transformé.
Le transfert des biens économiques qui résulte des atteintes à la propriété peut parfois avoir pour effet d'augmenter la production. C'est ce qui arrive quand les biens passent des mains de personnes qui ne savent ou ne veulent pas en tirer le meilleur parti possible, aux mains de qui les exploite mieux. Mais le plus souvent, les biens provenant de la spoliation sont dissipés à l'instar de ceux que procure le jeu, et le résultat final est une destruction de richesse. Les vétérans enrichis par Sulla, au bout de peu de temps étaient retombés dans le besoin (§ 2577-1). Nos contemporains peuvent voir le luxe des gens que la politique enrichit, et le gaspillage auquel ils se livrent. Réunissant les atteintes à la propriété et la prodigalité spontanée des possesseurs d'épargne ou de leurs héritiers, nous pouvons dire que nous trouvons là des forces qui viennent contrecarrer les efforts des producteurs d'épargne, et restreindre considérablement l'accumulation de la richesse.
La régularité remarquable que présentent, dans le temps et l'espace, les phénomènes que nous venons d'étudier, nous conduit à admettre que, depuis les temps historiques et dans nos sociétés, le droit de propriété privée ne subsiste que tempéré par des actes et des dispositions qui lui sont opposés. En d'autres termes, nous n'avons pas d'exemples de sociétés dans lesquelles ce droit subsiste indéfiniment et en toute rigueur. Nous concevons en outre qu'on ne doit pas se placer exclusivement au point de vue restreint d'une éthique qui, en ces atteintes, ne trouve que des incidents regrettables, condamnables, venant léser le droit, la justice, l'équité, mais qu'il convient de se placer à un point de vue beaucoup plus étendu, et de voir en de tels phénomènes la manifestation d'une liaison qui est le complément nécessaire [FN: § 2316-8] des liaisons établies par le droit de propriété privée.
Les preuves de ce théorème se trouvent dans l'histoire, mais il est en outre confirmé par de nombreuses déductions, parmi lesquelles il convient de remarquer celles auxquelles donne lieu la théorie de l'intérêt composé.
Depuis longtemps, on a observé que cette théorie, appliquée à un long espace de temps, donne des résultats que la pratique dément absolument [FN: § 2316-9] . « (470) Un centime placé à intérêt composé, au taux 4 %, à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, donnerait, en l'an 1900, un nombre fabuleux de francs, exprimé par 23 suivi de vingt-neuf zéros [plus exactement un nombre de 31 chiffres, dont les premiers sont 23 085...]. En supposant que le globe terrestre fût entièrement en or, on trouve qu'il faudrait plus de 31 de ces globes pour représenter cette somme. On arriverait à un résultat tout aussi absurde, en éliminant la considération de la monnaie et en supposant que les biens économiques, en général, se soient multipliés suivant cette progression. Une somme de 100 000 francs placée à l'intérêt du 3 % donnerait, en 495 ans, 226 milliards ; c'est-à-dire à peu près la fortune actuelle de la France. En 1660, la fortune de l'Angleterre aurait été, selon Petty, de 6 milliards ; admettons le chiffre de 8 milliards pour le Royaume-Uni. Si nous prenons l'évaluation de la Trésorerie, c'est-à-dire 235 milliards, en 1886, le taux moyen de l'intérêt, pour qu'en 226 ans la somme de 8 milliards se transforme en une somme de 235 milliards, est de près de 1,5 %. (471) On conclut de cela que ce n'est qu'exceptionnellement que la richesse peut augmenter suivant une progression géométrique dont la raison atteint ou dépasse 1,02 ou 1,03… Si la richesse devait continuer à croître, en Angleterre, suivant la même progression que nous observons de 1865 à 1889, on aurait, au bout de quelques siècles, des revenus absolument fabuleux. Il est donc certain que cette progression ne pourra pas se maintenir pour les siècles futurs... (472) Les tarifs des assurances sur la vie sont établis par des calculs d'intérêts composés. On peut les admettre tant qu'il ne s'agit que d'une petite partie de la population et de la richesse du pays. Ces calculs conduiraient à des résultats entièrement en dehors de la réalité, s'ils devaient comprendre toute la population et une fraction notable de la richesse nationale … » On peut ajouter que si quelques familles avaient placé à intérêt composé un centime, à la naissance de Jésus-Christ, et avaient pu conserver la richesse ainsi produite, il y a longtemps qu'elles auraient absorbé toute la richesse qui existe sur notre globe. On arrive ainsi, pour la répartition de la richesse, à des résultats tout aussi absurdes que ceux que l'on obtiendrait pour le total de la richesse.
En présence de tels faits, solidement établis, on s'est arrêté à la conclusion que la théorie et les calculs des intérêts composés ne peuvent pas s'appliquer à une partie notable de la population, pendant un temps fort long ; conclusion qui, à vrai dire, reproduit simplement la description des faits, ne les explique pas. Nous même, en 1896, nous n'avons pas été beaucoup au delà [FN: § 2316-10). Aujourd’hui les théories de la sociologie nous permettent de compléter cette étude. Si les résultats pratiques ne confirment pas les déductions théoriques, cela ne tient pas à un défaut de la théorie des intérêts composés, cela tient à ce que l'on a admis une prémisse qui ne se trouve pas dans la réalité. Cette prémisse, implicite dans les calculs d'intérêts composés, consiste à supposer que, en un très grand espace de temps, on peut accumuler la richesse grâce à des taux d'intérêt ne s'écartant pas trop de ceux qu'on observe, pendant ce même espace de temps, pour les accumulations de courte durée et pour de faibles fractions de la richesse totale.
Le fait que des conclusions rigoureusement logiques d'une certaine prémisse ne se vérifient pas, suffit pour prouver que cette prémisse est erronée, ou du moins incomplète ; telle doit donc être celle que nous venons d'énoncer. Mais comment expliquer la contradiction entre les résultats donnés par la théorie, selon qu'on l'applique à des temps plus ou moins longs, à des fractions plus ou moins grandes de la richesse totale ?
Si l'on négligeait la considération que les taux d'intérêt adoptés sont à peu près ceux qu'on observe en réalité, on pourrait supposer que la richesse accumulée devient de moins en moins productive, et que, à la longue, le taux de l'intérêt tend vers zéro. C'est peut-être ce qui se dégage vaguement des théories optimistes sur la diminution du taux de l'intérêt. Mais ces théories sont démenties par les faits [FN: § 2316-11] , qui prouvent clairement que, depuis le temps où florissait Athènes jusqu'à nos jours, le taux de l'intérêt a subi des variations successives, le faisant augmenter et diminuer tour à tour, et qu'il est loin d'être tombé à zéro en notre temps. Il faut donc écarter l'hypothèse d'un taux d'intérêt se réduisant, à la longue, à zéro ; et alors on est forcé d'admettre que si l'accumulation qui serait la conséquence des taux réels d'intérêt ne se produit pas, c'est parce qu'elle est tenue en échec par des destructions successives de la richesse. Or, c'est ce que l'observation révèle effectivement. L'histoire est remplie de la description des nombreuses causes de destruction de la richesse. Les unes en affectent le total : ce sont les guerres, les révolutions, les épidémies, les pillages et les gaspillages de toutes sortes ; les autres affectent principalement la distribution de la richesse, et empêchent des accumulations indéfinies dans les mêmes familles, dans les mêmes collectivités, tout en ayant aussi, par ricochet, des effets sur le total de la richesse : ce sont les atteintes à la propriété privée des individus, des familles, des collectivités, les transferts de richesses imposés par la force, ou provoqués par la prodigalité. C'est ainsi que les courbes de l'accumulation de la richesse, pour une même famille, une même collectivité, pour une même nation, et enfin pour l'humanité entière, affectent, au lieu de la forme régulièrement croissante que donnerait un taux constant d'intérêt, une forme ondulée, présentant des oscillations autour d'une courbe moyenne (§ 1718). Celle-ci, pour toute l'humanité, est certainement plus ou moins croissante, depuis les temps historiques jusqu'à nos jours, sans qu'on puisse exclure qu'il y ait eu des périodes décroissantes. Non moins certainement, pour une même nation, pour une même collectivité, pour une même famille, elle est aussi telle, mais sûrement avec des périodes décroissantes.
La durée des périodes est longue pour la population totale du globe, modérée pour les nations [FN: § 2316-12] , plus courte pour les collectivités, fort courte pour les familles. Ce n'est là, en somme, qu'un cas particulier d'un phénomène très général (§ § 2293, 2330), et les oscillations révèlent et manifestent les différentes forces qui agissent sur l'agrégat social.
D'autres effets ont une importance tout aussi considérable que les effets économiques. Si nous nous plaçons au point de vue de la circulation des élites, les mesures ayant les caractères de catastrophes, de violence, ou même simplement d'une application très générale, peuvent, parmi des conséquences utiles à la société, en avoir de nuisibles à un degré plus élevé que celui d'effets du même genre produits par des mesures ayant des caractères de persuasion, de fraude, et qui, par là-même, ne s'appliquent qu'à certaines catégories de personnes. En effet, les premières mesures atteignent plus ou moins indistinctement les individus, quelle que soit la place qu'ils occupent dans la circulation des élites ; les secondes atteignent principalement les individus qui, par leur simplicité, leur naïveté, leur crédulité, leur défaut de courage ou simplement d'initiative, se trouvent dans les plus bas degrés de l'échelle des élites. Les premières mesures peuvent donc, bien plus que les secondes, détruire des éléments utiles à la société.
Si maintenant, des considérations que nous venons de développer, on tirait la conclusion qu'on peut abolir complètement la propriété privée ou d'autres institutions analogues, on tomberait dans une erreur très générale en économie et en sociologie. Cette erreur, que nous avons eu de nombreuses occasions de signaler, consiste à substituer des conditions qualitatives aux conditions quantitatives, à négliger la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux, à s'imaginer qu'on peut, pour expliquer les phénomènes concrets, se borner à considérer une seule de leurs liaisons, et qu'on peut la modifier sans que les autres soient affectées.
Pour compléter notre étude, il ne faut pas oublier que l'histoire nous fournit des faits correspondant, en un sens exactement opposé, à ceux que nous venons de noter. Elle nous fait connaître qu'en des sociétés fondées, en apparence du moins, sur l'absence ou la réduction à un minimum de la propriété privée, ou sur l'égalité des conditions, on a toujours vu apparaître et se développer la propriété privée ou des institutions analogues, ainsi que l'inégalité des conditions ; ce qui manifeste la nécessité (expérimentale) d'autres liaisons, en un sens opposé à celui des premières [FN: § 2316-13] .
Ici encore, il faut ajouter que celui-là ferait fausse route qui, de ces faits, tirerait la conséquence que l'on peut supprimer entièrement toute atteinte à la propriété privée ou à d'autres institutions analogues, ainsi qu'à l'inégalité des conditions, et qu'il tomberait exactement dans la même erreur que celle précédemment indiquée.
Nous avons ici simplement un nouvel exemple de la composition des forces qui agissent sur la société.
Enfin, il est encore un autre genre d'erreurs sur lequel doit se porter notre attention, et qui consiste en la confusion que l'on fait habituellement entre les mouvements réels et les mouvements virtuels.
Du fait que l'histoire constate l'existence de certaines catégories de liaisons simultanées, qui subsistent de tout temps, on peut déduire qu'elles sont en un état de mutuelle dépendance (mouvements réels) non seulement entre elles, mais aussi avec les autres conditions de l'équilibre social ; on ne peut pas conclure que la forme sous laquelle elles se manifestent procure à la société le maximum d'une des utilités qu'on peut avoir en vue (mouvements virtuels).
§ 2317. Par suite du peu de courage des producteurs et des possesseurs d'épargne, leur volonté agit peu sur les phénomènes économiques. Ceux-ci sont déterminés par la quantité totale d'épargne, beaucoup plus que par la résistance que les possesseurs d'épargne pourraient opposer à qui veut les dépouiller. De même, pour continuer l'analogie employée un peu plus haut, la quantité de miel qu'obtient l'apiculteur dépend de la quantité totale qu'en récoltent les abeilles, et non de la résistance que celles-ci pourraient opposer à qui le leur enlève [FN: § 2317-1].
§ 2318. Dans les périodes de stagnation économique, la quantité d'épargne disponible augmente. Ainsi se prépare la période suivante de rapide augmentation de prospérité économique, dans laquelle la quantité d’épargne disponible diminue et une nouvelle période de stagnation se prépare ; et ainsi de suite indéfiniment.
§ 2319. À ces deux genres d'oscillations s'en superpose un troisième, dont la durée est beaucoup plus longue et se compte généralement par siècles. En d'autres termes, il arrive à chaque instant que les éléments sachant et voulant faire usage de la force, et chez lesquels existent puissantes les persistances des agrégats, secouent le joug qui leur est imposé par les spéculateurs ou par d'autres catégories de personnes expertes en l'art des combinaisons. Ainsi commence une nouvelle période, durant laquelle peu à peu les catégories vaincues reviennent au pouvoir, pour en être ensuite de nouveau dépossédées, et ainsi de suite (§ 2331).
§ 2320. Dans l'étude de ces phénomènes, il faut prendre garde que souvent il existe en un même pays une catégorie très étendue où l'on observe cette évolution, et une autre, restreinte ou très restreinte, où l'usage de la force est constant. Un exemple typique de ce fait s'est vu dans l'empire romain. L'évolution indiquée s'accomplissait dans la population civile, mais en même temps il existait un nombre très restreint de soldats, chez lesquels il n'y avait pas évolution, et qui, par la force, soutenaient l'Empire et lui donnaient un chef. De nos jours, en de beaucoup moindres proportions, on peut voir quelque chose de semblable dans l'empire allemand. Il faut aussi prendre garde que les personnes dont nous venons de former des catégories ont des amis, des clients, des tenants et des aboutissants de divers genres, avec lesquels elles sont tantôt d'accord, tantôt en désaccord, et dont il est nécessaire de tenir compte pour évaluer l'action sociale de ces personnes. De nos jours, les rapports entre les industriels et leurs ouvriers, entre les politiciens et la bureaucratie [FN: § 2320-1], ainsi que d'autres rapports semblables, sont très connus (§ 2327).
§ 2321. Élargissons maintenant le cycle restreint étudié aux 2219 et sv., dans lesquels on considérait seulement les intérêts (b) et la circulation des élites (d) . Considérons l'action de ces éléments sur les résidus (a) et sur leurs dérivations (c) . La seconde action est facile à connaître, parce qu'elle nous est révélée par la lecture et par un très grand nombre de faits. Il n'en est pas ainsi de la première, qu'il faut découvrir sous ces manifestations. En général, on se trompe parce qu'on la suppose beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité. Par exemple, il y a quelques années, on aurait pu croire que le cycle (b) (d) - (d) (b) avait modifié beaucoup les résidus (a) , en ce sens qu'il n'avait laissé subsister chez les hommes que les sentiments de rationalisme et d'humanitarisme ; mais voici que le nationalisme surgit très puissant ; ensuite, avec une intensité moindre, mais pourtant notable encore, on remarque l'impérialisme et le syndicalisme, tandis que refleurissent d'antiques religions, l'occultisme, le spiritisme, les sentiments métaphysiques ; la religion sexuelle atteint le comble d'un fanatisme ridicule ; et voici encore que la foi en des dogmes antiques ou nouveaux se manifeste sous un grand nombre de formes. De la sorte, il apparaît que le cycle indiqué avait vraiment agi beaucoup plus sur les dérivations que sur les résidus.
§ 2322. Un phénomène semblable se produisit dans la Rome antique, au temps d'Hadrien et de Marc Aurèle, lorsque la courbe de la domination des intellectuels et celle du rationalisme atteignirent leur point culminant. Il semblait alors vraiment que désormais le monde devait être régi par la raison ; mais avec le principat de Commode commença la descente de cette courbe, non pas ainsi que beaucoup le croient encore, à cause des « vices » de l'empereur, mais par une réaction naturelle, semblable à tant d'autres que nous montre l'histoire. En attendant, dans les bas-fonds sociaux mûrissait la riche moisson de foi qui se manifesta ensuite dans la philosophie païenne, dans le culte de Mithra, dans d'autres semblables, et finalement dans le christianisme.
§ 2323. Il n'est nullement permis de déduire de là que l'action du cycle (b) (d) - (d) (b) sur les résidus (a) soit nulle. On doit seulement tirer cette conclusion : tandis que dans le cycle on remarque des variations rythmiques considérables, des périodes bien tranchées présentant des caractères différents, dans les résidus (a) , on constate des effets beaucoup plus faibles.
§ 2324. Le cycle (b) (c) (d) - (d) (c) (b) ... est important. On comprend facilement que les dérivations (c) s'adaptent aux nouvelles conditions de la circulation des élites (d) . Elles subissent, bien qu'à un moindre degré, l'influence du changement des conditions économiques. À ce point de vue, on peut les considérer comme des effets de ces causes. Au fur et à mesure que la classe dominante s'enrichit d'éléments chez lesquels prédominent les instincts des combinaisons, et qu'il lui répugne d'employer loyalement et franchement la force, les dérivations s'adaptent à ces conceptions. L'humanitarisme et le pacifisme apparaissent et prospèrent ; on parle comme si le monde pouvait être régi par la logique et par la raison, tandis que toutes les traditions sont tenues pour de vieux préjugés. Que l'on parcoure la littérature : à Rome, au temps des Antonins ; dans nos contrées, à la fin du XVIIIe siècle, particulièrement ; en France ; puis de nouveau dans la seconde moitié du XIXe siècle ; et l'on reconnaîtra facilement ces caractères.
§ 2325. Parfois, on observe le développement parallèle d'une autre littérature, qui a principalement en vue de changer la répartition du gain entre la classe gouvernante et ceux qui la soutiennent : à Rome, entre les patriciens et les plébéiens, entre les sénateurs et les chevaliers, pour la répartition du butin de guerre, des tributs des provinces ; dans nos contrées, entre les politiciens et les spéculateurs, entre les chefs d'industries et leurs ouvriers, pour la répartition du produit de la protection économique et des tributs prélevés sur les possesseurs de rentes fixes, les petits actionnaires et les producteurs d'épargne. Plus grand est le butin à partager, plus vive est la lutte, plus abondante est la littérature qu'elle suscite, et par laquelle on démontre combien telle ou telle classe est méritoire et utile, ou bien coupable et nuisible, suivant les préférences spontanées ou grassement payées de l'auteur. Plusieurs intellectuels et humanitaires de bonne foi, et beaucoup de simples d'esprit, demeurent émerveillés, abasourdis, à l'ouïe de si miraculeuses démonstrations, et ils rêvent d'un monde qu'elles régiront ; tandis que les spéculateurs les acceptent favorablement, bien qu'ils en connaissent la vanité : pendant que les gens s'y arrêtent et s’en repaissent, eux, sans être dérangés, effectuent leurs opérations profitables.
§ 2326. Au début du XIXe siècle, soit parce que la classe gouvernante possédait des résidus de la persistance des agrégats en plus grande quantité qu'il ne lui en est resté aujourd'hui, soit parce qu'elle n'était pas instruite par l'expérience qui l'aida ensuite, elle n'estimait nullement ces dérivations inoffensives, et surtout ne les croyait pas avantageuses. C'est pourquoi elle les persécutait et les réprimait par la loi. Mais ensuite, peu à peu, elle s'aperçut qu'elles n'étaient en rien un obstacle à ses profits, et qu'au contraire, parfois et même souvent, elle les favorisait ; aussi la classe gouvernante est-elle devenue aujourd'hui indulgente, et la loi ne réprime t-elle plus ces dérivations. Alors, les riches financiers étaient presque tous conservateurs ; aujourd'hui, ils favorisent les révolutionnaires intellectuels, socialistes, et même anarchistes. Les plus virulentes invectives contre le « capitalisme » s'impriment avec l'aide des « capitalistes ». Parmi eux, ceux qui n'ont pas le courage de pousser si loin se faufilent du moins parmi les radicaux [FN: § 2326-1]. Un type remarquable de ce phénomène est le célèbre comité Mascuraud, en France, lequel est composé d'industriels et de négociants riches, qui poussent jusqu'au point où le radicalisme confine au socialisme. Sous des noms différents, on remarque des faits semblables en Italie, en Angleterre, en Autriche-Hongrie, en Allemagne. Si nous ne le voyions pas de nos yeux, il semblerait étrange que, dans tous les pays, les défenseurs des prolétaires ne soient pas eux-mêmes prolétaires, mais au contraire des hommes très fortunés, quelques-uns même riches ou richissimes, comme certains députés et certains littérateurs socialistes. Bien plus, à vrai dire, les prolétaires n'ont d'adversaires dans aucun parti : dans les livres, dans les journaux, dans les productions théâtrales, dans les discussions parlementaires, toutes les personnes aisées déclarent vouloir le bien des prolétaires. Entre elles, il n'y a de discussion que sur la manière de réaliser ce bien, et c'est d'après ces diverses manières que se constituent les différents partis. Mais toute la bourgeoisie aisée ou riche de notre temps est-elle vraiment devenue si soucieuse du bien d'autrui et si négligente du sien propre ? Qui donc croirait que nous vivons au milieu de tant de saints et d'ascètes ? Ne serait-ce pas que quelque Tartufe, conscient ou inconscient, se faufile parmi eux ? Lorsque certains riches personnages, tels que Caillaux, se donnent tant de mal pour établir l'impôt progressif, sont-ils vraiment mus uniquement par le désir de partager leurs biens avec autrui, sans qu'il y ait même un brin du désir opposé, de les accroître ? Tout est possible, mais il est des choses qui paraissent peu probables L'apparence est peut-être différente de la réalité. Les riches qui paient ceux qui prêchent qu'on doit leur enlever leurs biens paraissent dépourvus de bon sens ; mais ils sont au contraire fort avisés, car, tandis que d'autres bavardent, eux accroissent leur fortune. Les spéculateurs semblent de même dépourvus de sagesse, lorsqu'ils se montrent favorables à l'impôt progressif, ou qu'ils le décrètent ; ils sont au contraire très sagaces quand, grâce à ce jeu, ils peuvent effectuer des opérations dont ils retirent beaucoup plus que ne leur enlève l'impôt [FN: § 2326-2] .
§ 2327. Les industriels croyaient aussi, il y a un certain temps, que toute augmentation de salaire de leurs ouvriers devait faire diminuer le profit de l'industrie. Mais l'expérience leur a aujourd'hui appris qu'il n'en était pas ainsi : que les salaires des ouvriers et les profits de l'industrie pouvaient croître en même temps, l'augmentation étant payée par les rentiers, par les petits actionnaires et par les producteurs d'épargne, ou même par d'autres industriels moins avisés. Cette découverte fut faite en premier lieu par les industriels qui jouissaient de la protection douanière. Naturellement ils auraient aimé toucher le bénéfice dans son intégralité ; mais ils finirent par comprendre qu'ils travaillaient mieux à leurs intérêts en partageant ce bénéfice avec les ouvriers, et que, déduction faite de la part de ceux-ci et de la compensation accordée aux politiciens dispensateurs de la manne protectionniste, il restait toujours un beau bénéfice. C'est pourquoi il est aujourd'hui beaucoup plus facile qu'autrefois de résoudre les conflits provoqués par les grèves, spécialement dans les industries qui jouissent de la protection douanière, ou qui vendent leurs produits au gouvernement. Bien plus, ceux-là même qui exercent ces industries savent faire tourner à leur profit les grèves mêmes (§ 2187-1). Les gens ingénieux trouvent moyen de tirer avantage de ce qui semblerait devoir leur porter préjudice.
§ 2328. Les artifices et l'ingéniosité des spéculateurs apparaissent aussi dans la politique internationale. Ces gens ont avantage à préparer la guerre, à cause de l'activité économique nécessaire à la préparation des armements, et parce que, pour la défense de leurs intérêts, ils tirent parti des sentiments de nationalisme. Mais la guerre elle-même pourrait nuire gravement à leur domination, parce que sur les champs de bataille le soldat compte plus que le spéculateur ; et ils restent interdits à l'idée qu'un général victorieux pourrait leur ôter le pouvoir. C'est pourquoi, avec l'aide de leurs bons amis intellectuels, ils s'efforcent de toute façon de persuader les peuples civilisés que désormais le règne de la force est terminé, que les grandes guerres sont devenues impossibles, grâce à la puissance des moyens de destruction, et qu'il suffit de dépenser beaucoup pour les armements, afin de préparer la guerre, sans qu'ensuite il soit nécessaire de la faire. Mais, en ce qui concerne les dépenses, ils se heurtent à la concurrence d'autres affamés du budget, qui veulent que ces dépenses soient affectées aux « réformes sociales » ou à d'autres buts semblables ; et ils doivent transiger avec eux. Les puissants syndicats financiers tantôt font prêcher par leurs journaux la concorde et la paix, et exalter les miracles du droit international et les bienfaits « de la paix par le droit » ; tantôt ils poussent aux discordes, à la protection des « intérêts vitaux » de la nation, à la défense de la « civilisation » de leur peuple, à la sauvegarde de « droits » spéciaux, suivant les avantages qu'il en résultera pour leurs savantes combinaisons. Les populations secondent plus ou moins ces manœuvres ; c'est un exemple remarquable des dérivations et du fait que les mêmes sentiments peuvent être orientés vers des buts différents. Mais celui qui suscite la tempête ne peut pas toujours l'apaiser à sa guise [FN: § 2328-1] , et les spéculateurs courent le risque de voir leurs incitations aux discordes aller plus loin qu'ils ne l'ont prévu, et aboutir à la guerre qu'ils abhorrent. Aujourd'hui la ruse domine, mais il n'en résulte nullement que la force ne dominera pas demain, fût-ce pour peu de temps.
§ 2329. OSCILLATIONS DE DÉRIVATIONS, EN RAPPORT AVEC LES OSCILLATIONS SOCIALES. Ce phénomène est très important ; comme manifestation d'idées et de doctrines, il apparaît dans les conflits entre les diverses dérivations sentimentales, théologiques, métaphysiques, et entre celles-ci et les raisonnements des sciences logico-expérimentales. En faire l'histoire serait faire l'histoire de la pensée humaine. Comme manifestation de force agissant dans la société, il apparaît dans le conflit entre les sentiments correspondant à divers résidus, surtout entre ceux qui correspondent aux résidus de la Ire classe et ceux qui correspondent aux résidus de la IIe classe ; par conséquent aussi dans le conflit entre les actions logiques et les actions non-logiques. C'est pourquoi il est très général et domine, sous diverses formes, toute l'histoire des sociétés humaines. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'en suivant la méthode inductive, il nous soit souvent arrivé de le rencontrer.
Les deux cas suivants sont remarquables. Tout d'abord, traitant des doctrines qui dépassent l'expérience, nous avons vu surgir cette question : comment l'expérience a-t-elle agi de manières si différentes dans les dérivations sentimentales, théologiques, métaphysiques, et dans les raisonnements scientifiques (§ 616 et sv.) ? Nous avons dû donner un aperçu de la réponse à cette question, tout en renvoyant au présent chapitre des études ultérieures. Ensuite, lorsque nous étudiions les dérivations, nous avons eu à examiner comment et pourquoi certaines dérivations, évidemment fausses, vaines et absurdes au point de vue expérimental, persistaient et se reproduisaient depuis des siècles et des siècles (§ 1678 et sv.). Ce fait faisait surgir une objection d'un grand poids contre le prétendu caractère de ces dérivations, car on pourrait se demander comment il était possible que depuis si longtemps les gens ne se fussent pas encore aperçus qu'elles étaient fausses, vaines et absurdes. Nous ne pouvions alors ni négliger cette question et passer outre sans autre, ni y répondre entièrement, car nous manquions de certains éléments que nous avons acquis seulement plus tard. C'est pourquoi nous avons dû nous contenter de commencer alors l'étude que nous allons achever. En attendant, avec le progrès de nos recherches, cette question s'était étendue (§ 1678 et sv.) ; elle a pris maintenant la forme de la mutuelle dépendance entre le mouvement ondulatoire des résidus et celui des dérivations, ainsi qu'entre ces faits et les autres faits sociaux, parmi lesquels il faut considérer principalement les faits économiques. Lorsqu'on considère de longs espaces de temps, la proportion des résidus de la persistance des agrégats, comparés à ceux de l'instinct des combinaisons, peut varier dans une mesure sensible, surtout pour les classes intellectuelles de la société. Alors apparaissent des phénomènes importants en ce qui concerne les dérivations.
§ 2330. Même avec ces limites déjà très larges, le problème indiqué n'est encore qu'un cas particulier d'un sujet plus général : celui de la forme ondulatoire des diverses parties des phénomènes sociaux et des rapports mutuels entre ces parties et ces ondulations [FN: § 2330-1] .
On peut dire que, de tout temps, les hommes ont eu quelque idée de la forme rythmique, périodique, oscillatoire, ondulée des phénomènes naturels, y compris les phénomènes sociaux. Cette conception est en rapport avec les persistances d'agrégats, (résidus de la IIe classe) qui naissent de l'observation du retour périodique du jour et de la nuit, des saisons, et plus tard, lorsqu'on commence à faire des observations astronomiques, des phases de la lune, du mouvement des corps célestes. En d'autres domaines, on remarque des retours périodiques de fertilité et de stérilité, d'abondance et de disette [FN: § 2330-2] , de prospérité et de décadence. Chez les individus, on remarque une succession ininterrompue, la mort faisant disparaître des personnes qui sont remplacées par d'autres ; les âges de l'enfance, de la virilité, de la vieillesse, se succédant indéfiniment chez des individus différents. La conception d'une succession analogue pour les familles, les cités, les peuples, les nations, l'humanité entière, naît spontanément lorsque, la tradition ou l'histoire embrassant un assez grand nombre d'années, des hommes intelligents et curieux portent leur attention sur ce sujet. D'autre part, le spectacle des cataclysmes terrestres et l'action des résidus de la persistance des abstractions (II-δ) font appliquer à tout l'univers, plus ou moins en connaissance de cause, la conception d'un mouvement rythmique. Ensuite, et en ces cas divers, le besoin de développements logiques (résidus I-epsilon) et l'intervention des résidus de la persistance des uniformités (II-epsilon) induisent à créer des doctrines, qui croissent et prospèrent par l'adjonction de considérations métaphysiques et pseudo-expérimentales.
Fort probablement, les auteurs qui raisonnent a priori ou d'une manière dogmatique, ainsi que le font la plupart des métaphysiciens, étendent instinctivement à tout l'univers les impressions qu'ils ont reçues de certains faits, et affirment ainsi que tout est soumis au rythme du mouvement. Mais d'autres auteurs aboutissent à la même conclusion par une généralisation hâtive et dépassant de beaucoup les faits, que d'ailleurs ils déforment [FN: § 2330-3).
En général, les retours sont notés, non par rapport à des phénomènes bien définis et caractérisés, mais par rapport à des abstractions plus ou moins vagues ; ce qui, en y ajoutant en cas de besoin la doctrine des exceptions (§ 1689 [FN: § 3] ), permet d'adapter la théorie à toutes les circonstances, et de la vérifier sûrement. Même de nos jours, même pour des phénomènes qui ont des indices facilement mesurables, on a vu naître la théorie de Jevons sur les « crises économiques », sans que le terme de « crise » fût bien défini. En un sens opposé apparaît souvent un besoin de précision, par lequel on est conduit à des résultats illusoires : on veut fixer quel sera exactement, ou en moyenne, l'espace de temps qui s'écoulera entre un retour et l'autre. C'est là une conséquence de l'instinct qui pousse beaucoup de personnes à donner une forme concrète à leurs abstractions (résidus II-dzeta).
Parfois on ne fixe pas de terme aux oscillations ; mais parfois aussi, plus souvent, sous l'empire de l'instinct qui pousse l'homme à rechercher son bien et celui de ses semblables, on voit apparaître plus ou moins explicitement la conception d'une limite à ces oscillations, laquelle se trouve généralement en un état heureux ; seuls quelques pessimistes la mettent en un état malheureux, en une complète destruction.
Une étude un peu diffuse de ces théories, n'en déplaise aux fanatiques de la « méthode historique » et aux partisans des « bibliographies complètes », ne serait d'aucune utilité pour la connaissance des phénomènes que les théories devraient représenter. Le temps qu'on emploierait à ce travail peut être plus utilement consacré à l'étude objective des phénomènes, ou, si l'on préfère, des témoignages directs s'y rapportant (§ 95, 1689), ainsi qu'à la recherche des indices mesurables des phénomènes et à la classification des oscillations par ordre d'intensité ; cela pour voir si, de la sorte, on parvient à isoler les plus grandes oscillations et à découvrir quelques-unes au moins des très nombreuses relations qui existent entre les oscillations des différents phénomènes (§ 1718, 1731, 2293). L'étude des théories que nous avons mentionnées peut être utile à la connaissance des dérivations dont elles se composent. C'est encore une étude objective, seulement l'objet ne se trouve plus ici dans les phénomènes que veulent représenter ces théories ; il est contenu dans l'expression même des théories, dans les écrits qu'on examine. Nous avons déjà cité assez d'exemples de telles dérivations, pour pouvoir ici n'en traiter que très brièvement.
Platon avait la conception d'une cité parfaite, et il ne pouvait se dissimuler que les cités existantes dont il avait connaissance n'étaient pas établies sur ce modèle. D'autre part, puisqu'il prêchait pour faire passer dans la réalité cette cité imaginaire, il devait admettre la possibilité de son existence, qui était seulement repoussée hors du temps présent dans le passé ou dans le futur, on dans les deux à la fois. Par là, elle se trouvait être l'origine, ou le terme, ou même l'origine et le terme d'une certaine évolution qui, par une généralisation chère aux métaphysiciens, devient universelle [FN: § 2330-4] . Naturellement, Platon, qui sait tout, connaît aussi la durée exacte des périodes de retour. « Pour les générations divines, la révolution est comprise en un nombre parfait ». Pour les hommes, les indications de Platon sont tellement obscures qu'aucun des commentateurs modernes n'a pu y voir goutte. Les anciens étaient plus heureux [FN: § 2330-5), mais ils ne nous ont point fait part de leurs lumières. Nous ignorons donc quel est ce nombre, et c'est là un grand malheur ; en revanche, d'autres auteurs nous ont fait connaître des nombres analogues et tout aussi certains.
Aristote qui, au moins dans la Politique, fait beaucoup moins que Platon usage de la métaphysique, beaucoup plus de la méthode expérimentale, blâme la théorie de Platon, mais il faut reconnaître que ses critiques ne sont pas toujours fondées, car elles portent parfois plutôt sur la forme que sur le fond. Polybe est un des historiens anciens qui, dans ses recherches, se rapproche le plus de la réalité expérimentale ; c'est un digne précurseur de Machiavel. De prime abord, on est donc étonné de voir qu'il fasse sienne la théorie de Platon, au point de la transcrire pour expliquer les transformations du gouvernement des cités [FN: § 2330-6] ; mais il se peut qu'il ait cru reproduire ainsi des faits d'expérience, et que son erreur consiste principalement en une généralisation hâtive, qui l'a entraîné hors de la réalité. Lorsqu'il veut comparer les différentes formes des républiques, il exclut celle de Platon, reconnaissant son caractère purement imaginaire. Dans le traité De la production et de la destruction des choses attribué à Aristote, on trouve la conception d'une transformation continuelle des choses, et, précisant cette notion, on ajoute que la transformation, lorsqu'elle est nécessaire, doit se faire en cercle (II, 11, 7) ; ce qui revient à une généralisation de la théorie de Platon.
Bon nombre d'auteurs ont travaillé sur ce fonds commun, en partie expérimental, des oscillations ininterrompues. G. B. Vico a une théorie, dite des retours (ricorsi) , qui, principalement métaphysique, dépasse presque autant que la théorie de Platon les bornes de la réalité. Il avoue d'ailleurs que la conclusion de son ouvrage est en parfait accord avec celle du philosophe grec [FN: § 2330-7). Il conserve encore de nos jours des admirateurs, et il en aura probablement tant que durera le grand courant métaphysique qui traverse les siècles.
La Théorie des périodes politiques de G. Ferrari paraît nous conduire en plein domaine expérimental ; malheureusement cette apparence est en grande partie trompeuse. L'auteur traite un peu trop arbitrairement les faits, et leur donne souvent une portée qu'ils n'ont pas. Son principal défaut, qui est d'ailleurs habituel chez d'autres auteurs en des cas analogues, est de vouloir soumettre les faits à des règles inflexibles, d'une précision illusoire. En d'autres termes, il veut donner des formes immuables et arrêtées aux ondulations, qui sont essentiellement variables et de formes diverses. Attiré par le mirage de ce but, il imagine des phénomènes en dehors de la réalité, tels que les « générations pensantes », dont la durée moyenne est d'à peu près 30 ans, et les « périodes politiques » qui, se composant de quatre générations pensantes, durent à peu près 125 ans. Les métaphysiciens méprisent les faits (§ 821) ; Ferrari rend du moins hommage aux faits en tâchant de les faire rentrer dans les cadres qu'il a tracés. Ainsi que d'autres auteurs, il a pour cela la grande ressource des exceptions (§ 1689-1). Il attribue deux vies pensantes à certains hommes, tels que Voltaire, Gœthe, Aristophane, Sophocle, Rossini, etc. ; il admet des retards et des accélérations des générations pensantes et des périodes politiques ; il trouve chez les différentes nations des « traductions » des périodes, note leur « vitesse comparée », et, en somme, détruit en partie lui-même les fondements de sa théorie [FN: § 2330-8). Il a pourtant, en comparaison des métaphysiciens, le grand mérite de s'exprimer clairement et au-dessous de détails d'une précision illusoire et de développements arbitraires, on trouve des considérations qui, de même que celles de la théorie de Draper (§ 2341-1), se rapprochent de la réalité expérimentale. Ce sont là des cas analogues aux nombreux autres que nous avons déjà vus (§ 252, 253, 2214), en lesquels on retrouve une vision des faits, sous les voiles de la métaphysique et d'une pseudo-expérience.
§ 2331. Habituellement, les petites oscillations ne paraissent pas être dépendantes ; ce sont des manifestations peu durables dont il est trop malaisé, impossible même, de découvrir les uniformités. La dépendance des grandes oscillations se voit plus facilement : ce sont des manifestations durables, dont on réussit parfois à connaître les lois (uniformités), soit pour un phénomène considéré séparément des autres, soit pour les phénomènes considérés en l'état de mutuelle dépendance. Depuis longtemps déjà, on a eu l'idée de ces uniformités ; d'ailleurs cette idée est souvent demeurée indistincte, et a été exprimée d'une manière très imparfaite. Quand, par exemple, on remarque la correspondance existant entre la richesse d'un pays et les mœurs de ce pays, on ne fait autre chose que de remarquer l'uniformité de mutuelle dépendance des oscillations ; mais, habituellement, on dépasse l'expérience, et l'on divague dans le domaine de l'éthique.
On commet d'habitude plusieurs erreurs dans l'étude des uniformités indiquées. On peut diviser ces erreurs en deux classes : (A) erreurs qui naissent du fait que l'on ne tient pas compte de la forme ondulatoire des phénomènes ; (B) erreurs qui naissent de l'interprétation donnée à cette forme ondulatoire.
§ 2332. (A-1.) Les ondulations sont l'indice de périodes du phénomène que l'on peut appeler ascendantes et descendantes. Si elles sont un peu longues, ceux qui vivent au temps d'une de ces oscillations ont facilement l'opinion que le mouvement doit continuer indéfiniment dans la direction qu'ils observent, ou du moins aboutir à un état stationnaire, sans mouvement contraire subséquent (§ 2392, 2319).
§ 2333. (A-2.) L'erreur précédente s'atténue sans disparaître, lorsqu'on admet une ligne moyenne autour de laquelle oseille le phénomène, mais que l'on croit que cette ligne moyenne coïncide avec celle d'une des périodes ascendantes du phénomène. Jamais, ou presque jamais, on ne la fait coïncider avec la ligne d'une période descendante. Nous exposerons plus loin un cas particulier du présent sujet et du précédent (2391 et sv.).
§ 2334. (B-1.) On sait que, dans le passé, le phénomène apparaît sous forme d'oscillations, mais on admet implicitement que le cours normal est celui, favorable à la société, d'un bien toujours croissant ; ou bien, comme concession extrême, qu'il est constant et ne décline jamais. Le cas d'un cours toujours plus défavorable est habituellement exclu. En général, les oscillations que l'on ne peut nier sont supposées anormales, accessoires, accidentelles ; chacune a une cause que l'on pourrait (§ 134) et que l'on devrait faire disparaître, ce qui ferait disparaître aussi l'oscillation. Les dérivations sous cette forme générale ne sont pas habituelles. Sous la forme suivante, elles sont au contraire très usitées. Il est aisé de connaître la cause de ce fait : elle réside simplement dans la tendance de l'homme à chercher son avantage et à fuir son désavantage.
§ 2335. (B-2.) On admet qu'il est possible de séparer les oscillations : qu'on peut conserver celles qui sont favorables, supprimer celles qui sont défavorables, en agissant sur leur cause. Presque tous les historiens admettent ce théorème, au moins implicitement, et se donnent beaucoup de mal pour nous enseigner comment les peuples auraient dû agir pour demeurer toujours dans des périodes favorables, et ne jamais passer à des périodes défavorables. Nombre d'économistes aussi savent et enseignent bénévolement comment on pourrait éviter les crises. Par ce nom ils désignent exclusivement la période descendante des oscillations [FN: § 2335-1] . Toutes ces dérivations sont fréquemment employées, quand on traite de la prospérité sociale (§ 2540 et sv.) ; elles sont chères à un très grand nombre d'auteurs, qui s'imaginent naïvement faire oeuvre scientifique, lorsqu'ils se livrent à des prêches moraux, humanitaires, patriotiques.
§ 2336. (B -3.) Uniquement pour mémoire, car nous avons dû en parler même trop, notons l'erreur consistant à transformer en rapports de cause à effet les rapports de mutuelle dépendance des phénomènes. Dans notre cas, on suppose que les oscillations d'un phénomène ont des causes propres, indépendantes des oscillations des autres phénomènes.
§ 2337. (B-4.) Précisément en négligeant la mutuelle dépendance, et en voulant trouver une cause aux oscillations d'un phénomène, on cherche cette cause dans la théologie, dans la métaphysique, ou dans des divagations qui n'ont d'expérimental que l'apparence. Les prophètes israélites trouvaient la cause des périodes descendantes de la prospérité d'Israël dans la colère de Dieu. Les Romains étaient persuadés que tout malheur qui frappait leur cité avait pour cause quelque transgression dans le culte des dieux ; il fallait la découvrir, puis offrir une compensation adéquate aux dieux, pour ramener la prospérité. Un très grand nombre d'historiens, même parmi les modernes, cherchent et trouvent des causes semblables dans la « corruption des mœurs », dans l'auri sacra fames, dans les transgressions aux règles de là morale, du droit, de l'humanitarisme, dans les péchés de l'oligarchie qui opprime le peuple, dans la trop grande inégalité des fortunes, dans le capitalisme, et ainsi de suite ; des dérivations semblables, il y en a pour tous les goûts [FN: § 2337-1] .
§ 2338. En réalité, les oscillations des diverses parties du phénomène social sont en rapport de mutuelle dépendance, à l'égal de ces parties même ; elles sont simplement des manifestations des changements de ces parties. Si l'on tient à se servir du terme fallacieux de cause, on peut dire que la période descendante est la cause de la période ascendante qui la suit, et vice-versa. Mais il faut entendre cela uniquement en ce sens que la période ascendante est indissolublement unie à la période descendante qui la précède, et vice-versa ; donc, en général : que les différentes périodes sont seulement des manifestations d'un seul et unique état de choses, et que l'observation nous les montre se succédant les unes aux autres, de telle sorte que suivre cette succession est une uniformité expérimentale [FN: § 2338-1] . Il existe divers genres de ces oscillations, selon le temps où elles se produisent. Ce temps peut être très court, court, long, très long. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§ 2331), les oscillations très courtes sont habituellement accidentelles, en ce sens qu'elles manifestent des forces peu durables ; celles qui se produisent en un temps assez long manifestent habituellement, des forces assez durables. Étant donné que nous connaissons mal des temps très reculés, et vu l'impossibilité où nous sommes de prévoir l'avenir, les oscillations très longues peuvent perdre le caractère d'oscillation, et apparaître comme manifestant un cours qui se dirige toujours dans la même direction (§ 2392).
§ 2339. Revenons maintenant au problème particulier que nous nous sommes posé (§ 2329). Nous voyons que, pour le résoudre, nous devons appliquer notre attention aux forces agissant sur les diverses parties du phénomène social, entre lesquelles nous cherchons les rapports de mutuelle dépendance. Il convient de diviser ces forces en deux classes : 1° les forces qui naissent du contraste entre les théories et la réalité, de l'adaptation plus ou moins parfaite des premières à la seconde ; elles se manifestent dans les différences entre les sentiments et les résultats de l'expérience. Nous appellerons intrinsèque cet aspect du problème ; 2° les forces qui agissent de manière à modifier les sentiments ; elles proviennent des rapports dans lesquels se trouvent ces sentiments et d'autres faits, tels que l'état économique, l'état politique, la circulation des élites, etc. Nous appellerons extrinsèque cet aspect du problème (§ 2552).
§ 2340. 1° Aspect intrinsèque. Nous avons déjà commencé cette étude (§ 616 et sv., 1678 et sv.), que l'induction nous avait présentée ; maintenant nous la continuons. En un temps et pour les personnes dont les résidus de la persistance des agrégats (la chose A du § 616) ont diminué de force, tandis que ceux de l'instinct des combinaisons ont pris une nouvelle vigueur (tandis que la science expérimentale acquiert du crédit, disions-nous au § 616), les conclusions que l'on tire des premiers résidus paraissent en contradiction absolue avec la réalité, et l'on en conclut que ces résidus sont de « vieux préjugés », qu'on doit les remplacer par les résidus de l'instinct des combinaisons (§ 1679). On condamne inexorablement, au point de vue de la vérité expérimentale et à celui de l'utilité individuelle ou sociale, les actions non-logiques, auxquelles on veut substituer les actions logiques, qui devraient être dictées par la science expérimentale, mais qui, en réalité, sont souvent conseillées par une pseudo-science, et constituées par des dérivations de peu ou de point de valeur expérimentale. Habituellement, on exprime ce fait par la dérivation suivante ou par d'autres analogues : « La raison doit remplacer la foi, les préjugés ». On croit aussi que le sentiment exprimé par cette dérivation « démontre » que les résidus de la persistance des agrégats sont « faux », et ceux de l'instinct des combinaisons « vrais ». En un autre temps, où se produit un mouvement inverse, et où les résidus de la persistance des agrégats acquièrent une force nouvelle, tandis que décroît celle des instincts des combinaisons, on observe des phénomènes contraires (§ 1680). Les résidus de la persistance des agrégats qui sont affaiblis peuvent être utiles, indifférents, ou nuisibles à la société. Dans le premier cas, les dérivations de l'instinct des combinaisons, grâce auxquelles on repousse les résidus de la IIe classe, se trouvent en complète contradiction avec la pratique, car ils aboutiraient à donner à la société des formes qui ne lui conviennent pas, et qui pourraient même en provoquer la destruction. On sent cela par instinct plus qu'on ne le démontre par un raisonnement ; puis commence un mouvement en sens contraire à celui qui avait donné la prédominance aux résidus de la Ire classe : le pendule oscille dans la direction opposée, et l'on atteint un autre extrême. Parce que les conclusions tirées des résidus de la Ire classe sont parfois contredites par la réalité, on dit qu'elles le sont toujours, on les tient pour « fausses »; on étend aussi ce caractère aux principes même du raisonnement expérimental ; tandis que l'on ne tient pour « vrais », ou du moins pour « vérité supérieure », que les principes de la persistance des agrégats. Ces sentiments donnent naissance à un grand nombre de dérivations comme celles-ci : nous avons en nous des idées, des concepts qui dominent l'expérience ; l'« intuition » doit se substituer à la « raison » ; la « conscience doit revendiquer ses droits contre l'empirisme positiviste » ; « l'idéalisme doit remplacer l'empirisme, le positivisme, la science » ; cet idéalisme est seul la « vraie science ». On tient pour certain que, grâce à l'absolu, cette « vraie science » se rapproche de la réalité beaucoup plus que la science expérimentale, toujours contingente, et même qu'elle constitue la « réalité » ; que la science expérimentale, qui se confond avec la pseudo-science des dérivations des résidus de la Ire classe, est fallacieuse et nuisible. Autrefois, on avait ces opinions-là dans toutes les branches des connaissances humaines. Aujourd'hui, elles ont disparu, ou presque disparu des sciences physiques, dans lesquelles le dernier exemple remarquable fut celui de la Philosophie de la Nature, de Hegel ; mais elles persistent dans les sciences sociales. Elles furent éliminées des sciences physiques par le progrès de la science expérimentale, et parce qu'elles étaient inutiles. Elles persistent dans les sciences sociales, non seulement parce que l'étude expérimentale y est très imparfaite, mais surtout a cause de leur grande utilité sociale. En effet, il est de nombreux cas dans lesquels les conclusions tirées des résidus de la persistance des agrégats, obtenues grâce à l'« intuition », se rapprochent de la réalité plus que les conclusions tirées de l'instinct des combinaisons. Celles-ci constituent les dérivations de la pseudo-science, laquelle, en matière sociale, occupe la place de la science expérimentale. En outre, en de nombreux cas aussi, ces dérivations paraissent si nuisibles, que toute société qui ne veut pas tomber en décadence ou périr doit nécessairement les repousser. Mais les conséquences d'une prédominance exclusive des résidus de la IIe classe ne sont pas moins nuisibles, non seulement dans les arts et les sciences physiques, où cela est très évident, mais aussi en matière sociale, où il est facile de voir que, sans l'instinct des combinaisons et l'emploi du raisonnement expérimental, tout progrès est impossible. Par conséquent, il n'est pas possible de s'arrêter non plus à l'extrême où prédominent les résidus de la IIe classe. De rechef, une nouvelle oscillation se produit, qui nous ramène vers l'extrême où dominent les résidus de la Ire classe : ainsi le pendule continue indéfiniment à osciller.
§ 2341. On peut décrire ces mêmes phénomènes sous d'autres formes, qui en font ressortir des aspects remarquables. Nous arrêtant à la surface, nous pouvons dire que dans l'histoire on voit une époque de foi suivie d'une époque de scepticisme, à laquelle fait suite une autre époque de foi, et de nouveau, une autre époque de scepticisme, et ainsi de suite [FN: § 2341-1] (§ 1681). La description n'est pas mauvaise, mais les termes de foi et de scepticisme pourraient induire en erreur, si l'on voulait faire allusion à une religion spéciale, ou même à un groupe de religions. Pénétrant davantage dans la matière, nous pouvons dire que la société a pour fondement des persistances d'agrégats. Celles-ci se manifestent par des résidus qui, au point de vue logico-expérimental, sont faux et parfois manifestement absurdes. Par conséquent, lorsque le point de vue de l'utilité sociale prédomine, au moins en partie, les doctrines favorables aux sentiments de la persistance des agrégats sont acceptées d'instinct ou autrement. Quand prédomine, ne fût-ce qu'en petite partie, le point de vue logico-expérimental, ces doctrines sont repoussées, et sont remplacées par d'autres qui, en apparence, mais rarement en fait, concordent avec la science logico-expérimentale. Ainsi l'esprit des hommes oscille entre deux extrêmes, et comme il ne peut s'arrêter ni à l'un ni à l'autre, le mouvement continue indéfiniment. Il serait possible qu'il eût un terme, au moins pour une partie de l'élite intellectuelle, si les membres de celle-ci voulaient bien se persuader qu'une foi peut être utile à la société, quoique fausse ou absurde expérimentalement (§ 1683, 2002). Ceux qui observent seulement les phénomènes sociaux ou qui raisonnent de la foi d'autrui, et non de la leur propre, peuvent avoir cette opinion. En effet, nous en trouvons des traces chez les hommes de science ; nous la trouvons aussi, plus ou moins explicite, plus ou moins voilée, chez les hommes d'État guidés par l'empirisme. Mais le plus grand nombre des hommes, ceux qui ne sont ni exclusivement des hommes de science, ni des hommes d'État éminents, qui ne dirigent pas, mais sont dirigés, et qui surtout raisonnent de leur propre foi plus que de celle d'autrui, peuvent difficilement avoir cette opinion, soit à cause de leur ignorance, soit parce qu'il y a contradiction patente entre le fait d'avoir une foi qui pousse à une action énergique, et le fait de l'estimer absurde. Cela n'exclut absolument pas que le cas puisse parfois aussi se produire, mais il demeure très exceptionnel. Enfin, si nous voulons résumer en peu de mots les raisonnements exposés tout à l'heure, nous dirons que la « cause » de l'oscillation est non seulement le défaut de connaissances scientifiques, mais surtout le fait que l'on confond deux choses distinctes : l'utilité sociale d'une doctrine et son accord avec l'expérience. Il nous est arrivé plusieurs fois déjà de devoir relever combien grande est cette erreur et combien elle nuit à l'étude des uniformités des faits sociaux.
§ 2342. Le mouvement indiqué ne se produit pas pour les personnes soustraites à la considération de l'un des extrêmes. Un très grand nombre de personnes vivent satisfaites de leur foi, et ne se donnent nul souci de la faire concorder avec la science logico-expérimentale. D'autres, très peu nombreuses, vivent dans les nuages de la métaphysique ou de la pseudo-science, et ne se soucient pas des nécessités pratiques de la vie. Un grand nombre de personnes se trouvent dans des situations intermédiaires, et participent plus ou moins au mouvement oscillatoire.
§ 2343. 2° Aspect extrinsèque. Ces considérations ont un défaut qui pourrait devenir la source de graves erreurs. Elles induisent à supposer implicitement que, dans le choix des dérivations, les hommes se laissent guider par la logique ou par une pseudo-logique. C'est ce que l'on pourrait comprendre, quand nous disons qu'animés de certains sentiments, ils acceptent certaines dérivations comme une conséquence logique. Ce fait a lieu uniquement pour un petit nombre d'entre eux, tandis que le plus grand nombre est poussé directement par les sentiments à faire siens les résidus et les dérivations. L'aspect intrinsèque étudié tout à l'heure est important pour la théorie des doctrines, mais non pour la théorie des mouvements sociaux. Ceux-ci ne sont pas une conséquence de celles-là : c'est plutôt le contraire. Il faut donc mettre en rapport avec d'autres faits celui de l'alternance d'époques de foi et d'époques de scepticisme (§ 2336, 2337).
§ 2141. Commençons, comme d'habitude, par suivre la méthode inductive. Le phénomène que nous voulons maintenant étudier est semblable à celui des oscillations économiques (§ 2279 et sv.) ; on y observe des oscillations d'intensité diverse. Négligeons les plus petites ; arrêtons-nous aux plus grandes, et même à celles qui sont de beaucoup les plus grandes, afin d'avoir une idée grossièrement approximative des faits. Recherchons les oscillations des résidus dans l'ensemble de la population ; par conséquent, les oscillations dans la partie intellectuelle, des littérateurs, des philosophes, des pseudo-savants, des savants, n'ont que la valeur d'indices ; par elles-mêmes elles ne signifient rien ; il faut qu'elles soient largement acceptées par la population pour en indiquer les sentiments. Le fait des ouvrages d'un Lucien, qui apparaît comme une île de scepticisme au milieu d'un océan de croyances, a une valeur presque nulle, tandis que le fait des ouvrages d'un Voltaire, à cause du grand crédit dont ils jouirent, apparaît comme un continent de scepticisme, et mérite par conséquent d'être tenu pour un indice important. Tous ces moyens sont imparfaits, même plus imparfaits que ceux dont on peut se servir pour évaluer les oscillations économiques, lorsque des statistiques précises font défaut ; mais nous devons nous en contenter, puisque nous ne pouvons obtenir mieux, au moins pour le moment.
§ 2345. ATHÈNES. Si nous portons notre attention sur l'état d'Athènes, de la guerre médique à la bataille de Chéronée, nous avons tout d'abord une époque où, dans l'ensemble de la population, il existe en grande quantité des résidus de la persistance des agrégats, tandis que dans la classe gouvernante se trouvent à foison des résidus de l'instinct des combinaisons. Désignons par (1) l'époque de la bataille de Marathon [FN: § 2345-1] (490 av. J.-C.), et désignons par a b l'intensité des résidus de la persistance des agrégats, dans l'ensemble de la population.
Nous avons des faits remarquables, comme celui de la condamnation de Miltiade après l'expédition de Paros (489 av. J.-C.), qui nous montrent l'écart entre les résidus de la persistance des agrégats, chez la classe gouvernée et chez ses chefs. Ensuite, comme dit Aristote [FN: § 2345-2] , durant dix-sept années après la guerre médique, la constitution fut aux mains de l'Aréopage, c'est-à-dire qu'elle se désagrégea peu à peu. On arriva ainsi à la réforme d'Ephialte (460 av. J.-C.), laquelle dépouilla l'Aréopage de ses attributions constitutionnelles. Nous avons un excellent indice du mouvement intellectuel de ce temps dans l'Orestie d'Eschyle (458 av. J.-C.). Il est impossible de n'y pas voir clairement le reflet de la lutte entre ceux qui restaient fidèles aux résidus de la persistance des agrégats, et ceux qui y substituaient les résidus des combinaisons [FN: § 2345-3] . Les premiers furent complètement vaincus. Par conséquent, le point (2) correspondant à 458 av. J.-C. doit se trouver sur une partie fortement descendante de la courbe [FN: § 2345-4] . Mais celle-ci descendait encore plus pour les gouvernants. Périclès se soustrayait aux « préjugés » populaires [FN: § 2345-5] , et préparait la puissance d'Alcibiade. Ensuite il se produisit une petite réaction, et les sceptiques amis de Périclès furent persécutés. Anaxagore dut s'en aller d'Athènes [FN: § 2345-6] (431 av. J.-C.). Au point (3) correspondant à cette époque, la courbe se redresse un peu, puis elle redescend ; nous en avons une preuve patente dans les trois comédies d'Aristophane : les Acharniens (425 av. J.-C.), les Chevaliers (424 av. J.-C.), les Nuées (423 av. J.-C.). Ces comédies, à l'instar de l’Orestie, nous font voir la lutte entre les partisans et les destructeurs des persistances d'agrégats. Ce n'est pas seulement la différence entre la tragédie et la comédie qui est cause des manières différentes dont cette lutte apparaît dans l'Orestie et dans les trois comédies d'Aristophane, mais bien la grande différence entre l'intensité des résidus de la IIe classe chez le peuple, au temps de la trilogie d'Eschyle, et au temps des comédies mentionnées. Désormais la mythologie est vaincue, et la lutte se donne dans le domaine de la métaphysique et de la politique [FN: § 2345-7] . Nous assignerons donc un point (4) à l'année 424 av. J.-C. Il correspondra à une nouvelle descente de la courbe. Ce mouvement continue jusqu'au fait de Mélos (416 av. J.-C.) indiqué par (5), et qui doit être certainement voisin d'un minimum, autant pour les gouvernés que pour les gouvernants. On n'avait jamais disserté plus cyniquement [FN: § 2345-8), laissant de côté toute conception religieuse, morale, de justice. Ajoutons que c'était le temps où Alcibiade était maître d'Athènes. Dans la suite, on a une très petite réaction, lorsque Alcibiade est accusé d'avoir profané les mystères (415 av. J.-C.). On a une plus grande réaction au temps du procès de Socrate [FN: § 2345-9] (339 av. J.-C.), que nous désignons par (6). Plus tard, nous n'avons pas d'indice qui montre de grands changements dans le peuple, jusqu'à la bataille de Chéronée (338 av. J.-C.), que nous désignons par (7), bataille qui met fin à l'indépendance d'Athènes, et en confond l'histoire avec celle du reste de la Grèce, jusqu'à la conquête romaine.

Figure 40
§ 2346. Pour la classe intellectuelle, la descente continue ; elle est le plus remarquable au temps que l'on a nommé celui des sophistes. Comme c'est l'habitude pour d'autres termes semblables, celui-ci est si indéterminé qu'on n'en connaît pas la signification précise. Avec les années, il a peu à peu pris le sens de personne qui fausse les raisonnements en vue d'un but personnel, ainsi il a reçu une forte teinte éthique. Comme nous ne traitons pas ici d'éthique, il ne peut pas nous servir. Il ne nous importe vraiment pas du tout de distinguer les gens qui se faisaient payer pour donner des leçons de raisonnement, de ceux qui les donnaient gratis. Il nous importe, au contraire, de distinguer les gens qui visaient à saper les persistances d'agrégats, à substituer les actions logiques aux actions non-logiques, à déifier la Raison, des gens qui défendaient ces persistances d'agrégats, étaient favorables à la tradition, aux actions non-logiques, ne sacrifiaient pas à la déesse Raison. Uniquement pour nous entendre, nous appellerons A les premiers, B les seconds.
§ 2347. Plusieurs auteurs opposent Socrate aux sophistes ; d'autres le rangent parmi ceux-ci. On ne peut trancher cette controverse, si d'abord on ne définit ce terme de sophiste. Ici nous ne voulons pas nous en occuper. Mais pour nous, il est certain que Socrate et Platon aussi doivent être rangés dans la catégorie A, puisque tous deux visent à saper les persistances d'agrégats existant à Athènes, et à y substituer des produits de leur raisonnement. Les moyens employés peuvent être différents de ceux de Protagoras, de Gorgias, de Prodicos et d'autres ; la fin, consciemment ou non, est la même.
§ 2348. Habituellement, les auteurs s'indignent et se plaignent parce que, dans les Nuées, Aristophane nomme Socrate. Ils peuvent avoir raison au point de vue éthique ; ils ont tort au point de vue logico-expérimental des doctrines, et à celui de l'utilité sociale. Il est bien vrai que Socrate, comme le dit Aristophane, et que Platon surtout, visaient à détrôner le Zeus de la tradition mythologique, pour donner le pouvoir aux Nuées de leur métaphysique. Le démon de Socrate est pour le moins cousin de la déesse Raison, et frère de la « conscience » de nos protestants libéraux. Quant à Platon, il croit à l'omnipotence de la déesse Raison, au point de s'en remettre à elle seule pour créer de toutes pièces une république d'hommes en chair et en os. Au point de vue de l'utilité sociale, il est manifeste que de cette façon on ébranle les fondements des actions non-logiques sur lesquelles repose la société. Ce ne sont pas les doctrines indiquées qui peuvent produire cet effet ; au contraire, elles sont un effet concomitant de celui de la désagrégation sociale. C'est pourquoi la condamnation de Socrate fut inutile, et par conséquent stupide, perverse, criminelle, comme le furent et continuent à l'être les condamnations de gens qui manifestent des opinions tenues pour hérétiques par leurs contemporains. Mais nous avons déjà suffisamment parlé de tout cela (§ 2196 et passim) ; il n'est pas nécessaire de nous y arrêter plus longtemps.
§ 2349. À première vue, il paraît y avoir une très grande différence entre un athée, tel qu'il apparaît dans une tragédie de Critias [FN: § 2349-1], et un homme religieux, tel que semble l'être Platon. Au point de vue de l'éthique, cela peut être, mais non à celui de l'utilité sociale, à laquelle importent surtout certains caractères communs chez le Sisyphe de Critias et le Socrate de la République de Platon. Aucun des deux n'accepte les dieux de la tradition : ils les façonnent à leur manière, ils trahissent les persistances d'agrégats en les transformant. Sisyphe dit qu'il « lui semble qu'à l'origine il a existé un homme avisé et sage », lequel imagina les dieux pour contenir les hommes dans le devoir. Mais précisément cet homme sage est aussi le Socrate de la République, lequel, s'il ne crée pas de toutes pièces les dieux, façonne d'autre part à sa manière ceux de la tradition, exactement dans le même but que le législateur de Sisyphe, c'est-à-dire pour rendre les hommes meilleurs. Ce procédé est à relever, parce qu'il est général. Nos modernistes ont tendance à s'en servir ; les protestants libéraux en usent nettement, en façonnant à leur manière le Christ de la tradition, et en le transformant en un produit de leur imagination. Il y a là un cas particulier du phénomène indiqué comme aspect intrinsèque (§ 2340). Lorsque, dans l'esprit de certains intellectuels, la conception traditionnelle de certaines persistances d'agrégats heurte une autre conception que leur pseudo-science estime meilleure pour l'utilité sociale, ils suivent l'une des deux voies qui aboutissent au même but. En d'autres termes, ou bien ils déclarent entièrement fausses et vaines les persistances d'agrégats traditionnelles, ou bien ils les modifient, les transforment, les façonnent à leur manière ; et ils ne s'aperçoivent pas que, de la sorte, ils les détruisent ; car les manifestations qu'ils estiment être accessoires sont au contraire essentielles pour les persistances d'agrégats, et les supprimer revient à vouloir faire vivre un homme à qui l'on a enlevé le corps. Les dieux d'Homère, auxquels s'en prend Platon, ont été vivants dans l'esprit de millions et de millions d'hommes. Le dieu de Platon n'a jamais été vivant : il est demeuré le fantôme littéraire d'un petit nombre de songe-creux.
§ 2350. Les variations dans l'intensité des résidus de la Ire et de la IIe classe ne semblent pas avoir de rapport avec le régime démocratique ou le régime aristocratique [FN: § 2350-1]. Dans l'aristocratie, nous trouvons un Nicias, chez lequel prédominent les résidus de la IIe classe, un Périclès, chez lequel prédominent les résidus de la Ire classe, un Alcibiade, où ces derniers se trouvent presque seuls, et Alcibiade ressemble à nos ploutocrates démagogues contemporains. Le régime des Trente tyrans fut indulgent envers Socrate, auquel il se contenta d'adresser une verte admonestation, tandis que le régime démocratique le condamna à boire la ciguë.
§ 2351. Les variations indiquées ne semblent pas non plus avoir de rapports avec l'état de la richesse ; car, si l'affaiblissement des résidus de la IIe classe se produit lorsque Athènes est riche, les réactions ont lieu aussi quand elle continue à être riche. Enfin, lorsqu'elle devient pauvre, on ne voit pas que les résidus de la IIe classe reprennent beaucoup de vigueur. Au temps de la conquête de la Grèce par les Romains, Athènes n'est pas revenue à l'état où elle était au temps de Marathon. Les variations mentionnées semblent bien avoir quelque rapport avec le rapide accroissement de la richesse, que l'on voit uni à un affaiblissement des résidus de la IIe classe, ainsi qu'à la réaction subséquente [FN: § 2351-1] ; mais ce pourrait être une simple coïncidence : il faut chercher d'autres faits avant de rien conclure à ce sujet.
§ 2352. Les variations indiquées sont concomitantes avec celles que nous avons vu se produire suivant l'aspect intrinsèque (§ 2340 et sv.); mais nous ne pouvons pas dire dans quel rapport elles se trouvent entre elles. Il est probable qu'il y a plusieurs de ces rapports. Peut-être un Anaxagore, un Socrate, un Platon, ont-ils été poussés par des causes de l'aspect intrinsèque ; mais il est très peu probable que ces causes aient agi sur un Critias ou sur un Alcibiade, pour ne pas parler des Athéniens qui discutaient avec les Méliens (§ 2345-8).
§ 2353. ROME. Il ne nous est pas donné de connaître avec précision quel fut l'état de Rome avant la seconde guerre punique. Des faits innombrables démontrent qu'il faut faire peu de cas des déclamations des auteurs sur le « bon vieux temps ». Il y a eu probablement alors des vices à Rome, comme il y en eut ensuite ; seulement ils étaient moins connus, parce qu'ils sévissaient sur une scène moins apparente, entre des limites plus restreintes, et que les littérateurs manquaient pour nous en conserver le souvenir. Les légendes nous font voir aussi des vices, sans qu'on puisse savoir quel rapport ils avaient avec la réalité historique.
§ 2354. Il est certain qu'au IIe siècle avant J.-C., deux faits concomitants se produisent à Rome : un accroissement très rapide de la prospérité économique, et une décroissance des résidus de persistance des agrégats dans le peuple, mais beaucoup plus dans les classes élevées [FN: § 2354-1] (§ 2545 et sv.). Cette action est suivie d'une réaction, comme à Athènes, ainsi qu'il apparaît en d'autres phénomènes semblables que nous étudierons. Les différences résident principalement dans la nature et dans l'intensité de la réaction. L'action et la réaction apparaissent donc unies, et c'est leur ensemble qu'il faut mettre en rapport avec les variations de la richesse (§ 2351-1) et avec les variations de la circulation des élites.
§ 2355. Les auteurs ont vu les faits ; mais, entraînés comme d'habitude par la manie des considérations éthiques, ils n'ont pu comprendre dans quel rapport ces faits se trouvaient (§ 2539 et sv.). Il y a plusieurs principes éthiques dont les historiens font grand usage, sans s'être jamais donné la peine de les vérifier par les faits. L'un de ces principes est que la richesse engendre la corruption des mœurs. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de soi pour voir que la riche Angleterre n'est pas plus corrompue que des provinces russes misérables, et que les mœurs du peuple piémontais aisé ne sont pas pires que celle du peuple misérable de la Sardaigne, ou d'un autre peuple semblable des provinces méridionales. Si l'on voulait établir une comparaison pour le peuple italien, à diverses époques, qui oserait affirmer que les mœurs de Milan ou de Venise sont actuellement pires qu'elles n'étaient il y a un siècle ? Pourtant, la richesse de ces villes s'est énormément accrue. On trouve un autre principe en paraphrasant le mot de Pline : Latifundia perdidere Italiam (§ 2557). L'accroissement de l'inégalité des richesses est présumé on ne le démontre pas, parce qu'on ne peut le démontrer. On croit le rendre évident en citant des exemples de citoyens très riches ; mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut encore savoir si la richesse des autres classes sociales ne s'est pas accrue dans les mêmes proportions. De nombreux faits montrent que ce cas est au moins possible. En outre, nous manquons entièrement de preuves établissant qu'un pays ayant des citoyens très riches soit nécessairement en décadence. Après les guerres napoléoniennes, nous trouvons en Angleterre en même temps de vastes latifundia des lords et une prospérité très grande. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, les trusts correspondent précisément aux latifundia romains, et se trouvent unis à une prospérité telle qu'on n'en a encore jamais vu. Négligeons le capitalisme qui, expliquant tout (§ 1890), explique aussi la décadence de Rome et d'autres pays. Pour certains auteurs, le régime démocratique explique la décadence d'Athènes ; et pour d'autres, le régime aristocratique celle de Rome.
§ 2356. Duruy prend occasion de la transformation de la société romaine, après les guerres puniques, pour faire un peu de morale (§ 2558). Il dit : [FN: § 2356-1] « (p. 224) ...Nous dirons, avec la sagesse des nations, que la richesse qui n'est pas le fruit du travail et de toutes les vertus qui y tiennent ne profite pas à ses possesseurs ; que la fortune mal acquise s'en va comme elle est venue, en laissant derrière elle beaucoup de ruines morales ; et nous ajouterons avec l'expérience des économistes [FN: § 2356-2] , que l'or est comme l'eau d'un fleuve : s'il inonde subitement, il dévaste ; (p. 225) s'il arrive par mille canaux où il circule lentement, il porte partout la vie [FN: § 2356-3) ». Donc, mes chers enfants, pour conclure une si belle parabole, à laquelle il ne manque que d'être mise en vers ou en musique, soyez bons, vertueux, et travaillez ; ainsi, vous vivrez heureux. Mais ne lisez pas l'histoire, parce que vous auriez de la peine à eu faire correspondre les faits avec ces affirmations. Voici, par exemple, Corinthe, où la richesse était certainement beaucoup plus le fruit du travail, beaucoup moins celui de la conquête, qu'elle ne le fut à Rome. Pourtant elle fut vaincue et saccagée par les Romains. Si la richesse « qui n'est pas le fruit du travail... ne profite pas à ses possesseurs », c'est le contraire qui aurait dû se produire. S'il est vrai que « la fortune mal acquise s'en va comme elle est venue », et que la richesse des Romains fut « mal acquise », comment se fait-il qu'ils en jouirent si longtemps encore après l'époque pour laquelle Duruy fait ses observations ? et qu'ils n'en furent dépouillés que par les barbares, lesquels n'acquéraient certainement pas la richesse par le travail, mais bien par la conquête et les pillages ?
§ 2357. Il faut donc ôter tous ces voiles dont les historiens enveloppent leurs récits, et s'efforcer de parvenir jusqu'aux faits eux-mêmes. Ce faisant, on ne peut nier les deux faits relevés au § 2354, et qui sont semblables à d'autres, observés déjà pour Athènes. Comme nous en trouverons encore d'autres semblables, nous devrons rechercher si, au lieu de simples coïncidences, il peut y avoir un rapport de mutuelle dépendance.
§ 2358. À Rome comme à Athènes (§ 2345 et sv.), plusieurs réactions se produisirent contre l'affaiblissement de la persistance des agrégats. Elles changèrent momentanément la direction générale du mouvement. Celle qui eut lieu à Rome, au temps de Caton le Censeur, fut remarquable. Elle fut de courte durée, et bientôt le mouvement reprit sa marche générale.
§ 2359. Une circonstance spéciale rend difficile l'étude du phénomène à Rome, depuis le temps de la conquête de la Grèce jusqu'à la fin de la République : c'est l'influence intellectuelle de la Grèce sur la classe cultivée romaine, qui nous empêche de séparer d'une manière sûre des imitations de la littérature, de la philosophie, de la science grecques le produit spontané des esprits latins. Par exemple, si nous ne connaissions que le poème de Lucrèce, nous ne saurions quelle valeur lui attribuer comme indice des conceptions de la classe cultivée romaine. Mais ce doute se dissipe grâce au fait que nous connaissons le De natura deorum et le De divinatione de Cicéron, et à cause d'un grand nombre d'autres faits littéraires et historiques. Tous ces faits nous induisent à conclure que, vers la fin de la République, plusieurs persistances d'agrégats s'étaient beaucoup affaiblies dans la classe cultivée de Rome.
§ 2360. Elles s'étaient beaucoup moins affaiblies dans la classe populaire [FN: § 2360-1]. C'est là un phénomène général dont on possède de nombreux exemples. En outre, cette classe populaire elle-même se transformait par l'adjonction d'éléments étrangers, spécialement d'éléments orientaux, qui apportaient à Rome leurs propres habitudes intellectuelles. Nous trouvons là l'une des plus grandes causes de la différence de l'évolution intellectuelle à Athènes et à Rome.
§ 2361. Le minimum de la persistance des agrégats dans la classe cultivée romaine, et peut-être aussi dans le peuple, semble avoir été atteint au temps qui sépare Horace de Pline le Naturaliste ; mais nous n'en avons aucune preuve. Ensuite commence un mouvement général ascendant [FN: § 2361-1] , présentant des ondulations de détail, et qui durera jusqu'au moyen âge.
§ 2362. Dans les classes supérieures, au temps d'Hadrien, il se produisit une réaction, dans le sens d'un accroissement des instincts des combinaisons, ou, si l'on préfère, avec une tendance opposée à l'accroissement des persistances d'agrégats. Ce fut lorsque les sophistes grecs acquirent, pour peu de temps, un grand crédit à Rome. Cette réaction se poursuivit au début du règne de Marc Aurèle. Cette invasion de l'art sophistique n'est semblable qu'en petite partie à celle qu'on observe à Athènes (§ 2346 et sv.), surtout parce qu'à Rome elle se limita à un petit nombre d'intellectuels (§ 1535). Il manqua un Socrate pour la faire descendre dans le peuple, ou, pour mieux dire, il manqua au peuple les dispositions à l'accepter. La plèbe cosmopolite de Rome, en ce temps-là, n'avait rien de commun, en fait d'intelligence et de culture, avec le peuple athénien du temps de Socrate.
§ 2363. Ensuite, le mouvement général de renforcement des persistances d'agrégats s'accéléra. Chez les auteurs païens, c'est-à-dire chez les personnes qui demeurent le plus attachées aux conceptions traditionnelles des races gréco-latines, il est beaucoup plus lent que chez les auteurs chrétiens, lesquels acceptent les rêveries des religions orientales. Jusque dans Macrobe, qui vivait au Ve siècle, il y a beaucoup plus de bon sens, un sentiment de la réalité bien plus grand, que chez Tertullien, qui vivait au IIIe siècle, que chez Saint Augustin, qui vivait au IVe siècle, et que chez d'autres semblables auteurs.
§ 2364. Déjà chez Polybe, et davantage au temps de Pline et de Strabon, on voit que les gens cultivés avaient quelque idée de la possibilité d'un état intermédiaire, ainsi que nous l'avons indiqué au § 2341. À ce point de vue, les auteurs de ce temps se rapprochaient beaucoup plus de la réalité expérimentale qu'un grand nombre de nos auteurs contemporains, qui vont à l'un ou à l'autre extrême, où il n'est pas possible de s'arrêter. Il se peut qu'une certaine, intuition, même en partie erronée, de la possibilité d'un état intermédiaire, ait exercé une influence dont l'effet fut de laisser quelques auteurs païens dans une certaine indifférence, à l'égard des fables des religions orientales qui envahissaient l'Empire romain. Ils ne croyaient pas qu'elles pussent parvenir jusqu'aux classes intellectuellement supérieures, et peut-être ne se seraient-ils pas trompés, si ces classes avaient subsisté telles qu'ils les connaissaient ; mais elles déclinèrent rapidement. Ce ne furent pas les superstitions orientales qui s'élevèrent au niveau des classes supérieures : ce furent celles-ci qui s'abaissèrent au niveau de celles-là.
§ 2365. La cause principale d'un tel phénomène doit être recherchée dans la circulation des élites, qui sera étudiée plus loin (§ 2544 et sv.). Supposons qu'après le règne d'Hadrien Rome ait continué à s'enrichir, comme elle s'enrichissait à la fin de la République et au commencement de l'Empire, et que, comme alors, les classes dirigeantes fassent demeurées ouvertes à ceux qui possédaient en abondance des instincts des combinaisons, et de ce fait gagnaient des fortunes ; alors les élites auraient pu se maintenir au-dessus de l'état dans lequel les persistances d'agrégats prédominent de beaucoup. Mais, au contraire, l'Empire allait s'appauvrissant, la circulation des élites s'arrêtait, l'instinct des combinaisons se manifestait par des intrigues dont le but était d'obtenir les faveurs de l'empereur ou d'autres personnages puissants. Par conséquent, il se produisait un mouvement tout à fait contraire à celui qu'on observe vers la fin de la République et au commencement de l'Empire. L'étude des deux mouvements opposés conduit ainsi à une conclusion unique.
§ 2366. En Occident, après les invasions barbares, il y a peut-être encore une lueur de science dans le clergé ; mais il est certain qu'elle disparaît entièrement dans le reste de la population, qui finit par ne plus même savoir écrire. Nous ne pouvons pas savoir quand le maximum de cette misère intellectuelle fut atteint, parce que les documents nous font défaut. Au temps de Grégoire de Tours (VIe siècle), l'ignorance semble vraiment considérable [FN: § 2366-1] . Selon le mouvement ondulatoire habituel, nous avons une petite oscillation, dans le sens d'un accroissement des connaissances intellectuelles, au temps de Charlemagne ; puis le mouvement général de descente reprend.
§ 2367. Mais voici que, vers la fin du XIe et le commencement du XIIe siècle, une petite renaissance intellectuelle se produit dans les classes cultivées, ainsi qu'un intense mouvement d'action et de réaction, en ce qui concerne les persistances d'agrégats, dans certaines populations. Le mouvement intellectuel donne naissance à la philosophie Scholastique [FN: § 2367-1]. Il fait son apparition dans le clergé, car le clergé était alors la seule classe cultivée. Il est provoqué par les forces que nous avons appris à connaître en considérant l'aspect intrinsèque (§ 2340). Dans la population, le mouvement se divise en deux : 1° un lent affaiblissement des sentiments religieux; 2° une violente réaction, qui renforce ces sentiments. Le premier mouvement se produit encore surtout dans le clergé, pas dans la partie intellectuelle, mais bien dans celle qui appartenait à la classe gouvernante. C'est là un cas particulier du phénomène général de l'affaiblissement des persistances d'agrégats dans les élites ou dans les aristocraties. Le second mouvement se produit surtout dans la classe gouvernée et la moins cultivée. C'est aussi un cas particulier du phénomène général, dans lequel on voit partir du peuple la réaction en faveur des persistances d'agrégats.
§ 2368. Le nominalisme et le réalisme sont deux théories métaphysiques, par conséquent indéfinies au sens expérimental. Si l'on part d'un concept indéfini, on peut tirer des conséquences diverses, suivant la voie que l'on sait. Si nous prenons garde au fait qu'en attribuant l' « existence » aux individus seuls, le nominalisme semblait vouloir envisager exclusivement les entités expérimentales, et si nous nous engageons dans la voie qui s'ouvre ainsi devant nous, nous pouvons considérer la doctrine logico-expérimentale comme l'extrême du nominalisme, dont on a fait disparaître les accessoires métaphysiques (§ 64). Mais, du noyau, indéfini au point de vue expérimental, du nominalisme, d'autres voies s'ouvrent à nous. Saint Anselme nous en indique une, lorsqu'à propos des nominalistes il dit qu'il y a des dialecticiens hérétiques qui « estiment que les substances universelles ne sont que souffle de voix » [FN: § 2358-1] , ce qu'on peut entendre dans ce sens qu'il ne faut tenir aucun compte des abstractions, ni des persistances d'agrégats qu'elles expriment. Si nous continuons dans cette voie, nous atteindrons l'extrême où les résidus de ces persistances sont considérés comme de « vieux préjugés » (§ 616, 2340), que l'homme raisonnable ne doit tenir que pour de vaines fables.
§ 2369. De même, en partant du réalisme indéfini, on peut, mais plus difficilement, arriver à la considération des actions non-logiques, ce qui nous rapprocherait de la réalité ; et d'autre part l'on peut très facilement atteindre l'extrême où l'on substitue la métaphysique à l'expérience, et où l'on crée des entités imaginaires, en transformant en réalités les abstractions et les allégories (§ 1651).
§ 2370. Les secondes des voies indiquées, aussi bien pour le nominalisme que pour le réalisme, sont celles qui se rapprochent le plus des conséquences pratiques que les gens tiraient de ces doctrines. C'est pourquoi, en examinant les faits sous cet aspect, nous pouvons dire que la dispute entre le nominalisme et le réalisme met en opposition les deux extrêmes indiqués au § 2340. Quand dominent les persistances d'agrégats, les espèces et les genres acquièrent l'« existence » métaphysique, et l'on a la solution réaliste. Mais celle-ci vient donner contre les écueils de l'expérience. Alors on nie l' « existence » métaphysique des espèces et des genres : on dit que seul l' « individu » existe, et l'on a la solution nominaliste. Une solution intermédiaire qui, si elle n'était pas entièrement métaphysique, pourrait nous rapprocher de la position qui se trouve entre les extrêmes des oscillations, est celle du « conceptualisme », qui reconnaît l' « existence » de l'espèce et du genre, sous forme de concepts.
§ 2371. Victor Cousin [FN: § 2371-1] affirme que le conceptualisme d'Abélard est un simple nominalisme. Il se peut qu'il ait raison dans le domaine de la métaphysique, où nous ne voulons pas entrer. Nous ne nous soucions pas plus de discuter sur l' « existence » du genre, de l'espèce, de l'individu, que nous ne songeons à discuter sur les belles formes du sphinx de Thèbes. Les métaphysiciens – bien heureux sont-ils ! – savent ce que veut dire ce terme : exister. Nous ne le savons pas, et n'avons pu l'apprendre d'eux, parce que nous n'entendons rien à leurs discours, et parce que nous ne sommes pas parvenu à trouver un juge de leurs interminables controverses (§ 1651). Laissons donc entièrement de côté ces genres de recherches, et bornons-nous à celles où l'on a pour juge l'expérience.
§ 2372. Au point de vue expérimental, la solution du conceptualisme contient un peu plus – à la vérité pas beaucoup plus – de parties réelles que le nominalisme, mais beaucoup plus que le réalisme. V. Cousin dit : « (p. CLXXX) ...examinons le conceptualisme en lui-même, et nous reconnaîtrons aisément que ce n'est pas autre chose qu'un nominalisme plus sage [que peut bien être une théorie plus sage qu'une autre ?] et plus conséquent. D'abord, le nominalisme renferme nécessairement le conceptualisme. Abélard argumente ainsi contre son ancien maître [Roxelin] : Si les universaux ne sont que des mots, ils ne sont rien du tout ; car les mots ne sont rien ; mais les universaux sont quelque chose : ce sont des conceptions ». Roxelin aurait très bien pu répondre : « Qui a jamais songé à nier cela ? Assurément, quand la bouche prononce un mot, l'esprit y attache un sens, et ce sens qu'il y attache est une conception de l'esprit. Je suis donc conceptualiste comme vous. Mais vous, pourquoi n'êtes-vous pas nominaliste comme moi ? Dire que les universaux ne sont que des conceptions de l'esprit, c'est dire implicitement qu'ils ne sont que des mots ; car, dans mon langage, les mots sont les opposés des choses [voilà précisément son erreur ; les mots manifestent aussi des états psychiques qui sont des choses pour qui les observe de l'extérieur [FN: § 2372-1]]. et, n'admettant pas que les universaux soient des choses, j'ai dû en faire des mots. Je n'ai rien voulu dire de plus ; rejetant le réalisme, j'ai conclu au nominalisme, en sous-entendant le conceptualisme ». C'est possible ; mais, par malheur, ce qu'il sous-entendait était tout aussi important que ce qu'il exprimait.
§ 2373. En effet, si au lieu de rester dans les régions nébuleuses de la métaphysique, V. Cousin avait daigné descendre dans le domaine expérimental, il aurait vu qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si les universaux ou, en général, les abstractions sont ou non autre chose que des mots, mais qu'il s'agit d'une question de bien plus grande importance : de savoir à quels états psychiques correspondent ces mots, et surtout s'ils manifestent des persistances d'agrégats plus ou moins puissantes, ou bien de simples jeux de la fantaisie. La socratité, dont les scholastiques nous disent que Socrate est une manifestation, n'est qu'un mot, comme la justice, sur laquelle on disserte depuis si longtemps, sans avoir jamais pu la définir ; mais le premier de ces mots correspond à une abstraction métaphysique qui n'a jamais présenté la moindre importance pour l'organisation sociale, tandis que le second correspond à une très forte persistance d'agrégats, qui est un fondement solide des sociétés humaines. Un Romain moderne nomme Bacchus, en s'exclamant : « Per Bacco ! » tout comme le nommait un croyant de l'antiquité. Dans les deux cas, Bacchus n'est qu'un mot ; mais il manifeste des concepts ou des sentiments essentiellement différents. Donc, nous nous rapprochons de la réalité, en ne nous arrêtant pas aux mots, et en recherchant le concept. Si Roxelin a voulu qu'il n'y ait que des choses et des paroles, il s'est en cela éloigné de la réalité ; s'il n'a fait que s'exprimer de la sorte, on en peut conclure seulement que cette expression est erronée. Le conceptualisme a bien fait de commencer au moins par la rectifier, mais il a eu le tort de s'arrêter au début de la voie dans laquelle il s'engageait, et de ne pas pousser plus loin l'analyse, en séparant les « concepts » et en en recherchant par l'expérience la nature et les caractères, pour les classifier.
§ 2374. Le mouvement intellectuel dont nous venons de parler appartient à la classe dont fait partie le mouvement des sophistes en Grèce et d'autres semblables. Il naît d'un besoin de recherches qui accroît la force de l'instinct des combinaisons, et qui n'est éprouvé que par un nombre restreint d'individus.
§ 2375. Parallèle, mais bien distinct, est le mouvement qui affaiblit la force de la persistance des agrégats dans la partie la moins intellectuelle de la classe gouvernante. À ce moment-là, il se manifeste sous une forme spéciale. Le désir des biens matériels et des jouissances sensuelles est presque constant. Il peut être réprimé par des sentiments religieux puissants ; aussi sa prédominance est-elle un indice de l'affaiblissement de ces sentiments et des persistances d'agrégats auxquels ils correspondent. On observe précisément ce fait au temps dont nous parlons : le clergé est devenu presque tout entier concubinaire, dissolu, cupide, simoniaque.
§ 2376. Nous avons sur ce fait des renseignements directs, mais encore plus de renseignements indirects, dans les reproches amers que les réformateurs adressent au clergé. Par conséquent, il se produit ce fait singulier que l'action de l'affaiblissement de la persistance des agrégats, dans une partie de la classe gouvernante, nous est surtout connue par la réaction qu'elle a provoquée dans la partie gouvernée.
§ 2377. Ces mouvements d'action et de réaction sont remarquables dans le midi de la France (cathares, vaudois), dans le nord de l'Italie [FN: § 2377-1] (les arnaudistes à Brescia, les patarins à Milan), précisément au moment où la richesse s'accroissait dans ces régions plus rapidement que dans d'autres du monde catholique. Voilà donc un nouveau cas dans lequel se trouvent unies les variations de la prospérité économique avec celles des résidus des combinaisons, par opposition aux résidus de la persistance des agrégats (§ 2351 [FN: § 2377-2] ). Au fur et à mesure que nous trouvons ainsi de nouveaux cas d'union semblable, il devient de moins en moins probable qu'elle est due au hasard seul, et toujours plus probable qu'elle révèle un état de mutuelle dépendance.
§ 2378. La cour de Rome prit des dispositions différentes dans les trois cas rappelés ; elle réprima les cathares et les arnaudistes, et s'allia, ne fût-ce que pour peu de temps, avec les patarins. Sous cette différence apparente, il y a une unité de but, qui était d'utiliser les résidus existants pour maintenir son pouvoir. L'archevêque de Milan voulait traiter d'égal à égal avec le pape, et peut-être visait-il à se rendre indépendant de lui. Il était avantageux d'utiliser la force des patarins pour rendre vains ses efforts. Arnaud de Brescia et les cathares faisaient directement la guerre au pape ; celui-ci devait par conséquent les combattre, en défendant en Provence, à Brescia, à Rome, les mœurs du clergé qu'il réprimait à Milan.
§ 2379. Pour combattre le clergé milanais, le pape Nicolas II fait approuver par le Concile de Rome, en l'an 1059, un canon qui interdit aux laïques d'entendre la messe d'un prêtre qu'ils savent être concubinaire, ce qui fait dépendre de la chasteté du prêtre la validité de la fonction religieuse [FN: § 2379-1]. Mais cette même doctrine est ensuite condamnée par l'Église chez les vaudois. On sait que par les dérivations on démontre également bien le pour et le contre. De même, aujourd'hui, bon nombre de députés socialistes s'élèvent contre le « capitalisme », pour entrer dans les bonnes grâces des électeurs, tandis qu'ils défendent les ploutocrates capitalistes, pour jouir de leurs faveurs.
§ 2380. Les réformateurs avaient besoin d'un vernis de dérivations pour manifester leurs sentiments, et l'on sait qu'on trouve toujours très facilement ce vernis. Il semble que les cathares avaient recours aux dérivations du manichéisme ; ils auraient pu également bien employer celles de n'importe quelle autre secte hérétique ; et si la papauté avait été manichéenne, ils auraient pu recourir à des dérivations contraires au manichéisme.
§ 2381. Plus remarquable encore est le cas d'Arnaud de Brescia, qui fut, dit-on, disciple d'Abélard [FN: § 2381-1]. Bien loin d être favorables aux réformateurs, qui voulaient accroître la force des persistances d'agrégats religieux, les théories du nominalisme leur étaient contraires. Mais les dérivations ont si peu d'importance qu'elles peuvent servir parfois à manifester des résidus auxquels elles semblent devoir être contraires. De même, les théories marxistes ne sont nullement favorables à la ploutocratie qui règne aujourd'hui ; pourtant elles servent parfois à la défendre.
§ 2382. La réaction religieuse des albigeois fut domptée par l'Église romaine, mais y provoqua une autre réaction religieuse. C'est là, sous différentes formes, un phénomène général ; nous le voyons se reproduire au temps de la Réforme et à celui de la Révolution française.
§ 2383. La Réforme nous montre d'une manière très nette les caractères que nous avons déjà vus en d'autres oscillations semblables. Tout d'abord, sous l'aspect intrinsèque, la Renaissance est en partie une réaction de la réalité expérimentale contre les préjugés religieux et moraux ; et si elle prend la forme d'un retour à l'antiquité païenne, c'est là une simple apparence, qui n'ajoute rien d'essentiel au fond, parfaitement semblable en cela au retour des réformateurs à l'Écriture Sainte. C'est une erreur très grave de croire que la Réforme ait profité le moins du monde à la liberté de pensée. Au contraire, elle y a nui grandement, et a arrêté tout à fait l'Église romaine dans la voie qu'elle parcourait vers la tolérance et la liberté ; les Églises réformées et l'Église romaine peuvent aller de pair au point de vue du contenu scientifique de leurs doctrines ; elles sont bien distinctes des humanistes, qui, au contraire, se rapprochaient plus de la réalité expérimentale, bien qu'ils en fassent encore très éloignés. Mais le mouvement humaniste, qui s'étendait jusqu'aux cardinaux, fut entièrement arrêté par la Réforme et par la réaction consécutive de l'Église catholique.
§ 2384. Sous l'aspect extrinsèque, la Renaissance se manifeste en un temps de prospérité économique. Nous avons là-dessus une infinité de témoignages [FN: § 2384-1]. C'est aussi un temps de forte augmentation des prix, par suite de l'affluence des métaux précieux provenant d'Amérique. Les anciennes institutions ne tiennent plus ; tout semble devoir se rénover : le monde moderne naît. Une réaction religieuse se produit, et, comme d'habitude, elle vient du peuple. Les chefs de celui-ci se souciaient peu de la religion, sinon comme d'un moyen de gouverner. Le peuple la met au premier plan de ses préoccupations ; il veut l'imposer de diverses manières, et en fait le but d'un grand nombre de ses œuvres. En somme, c'est là une des réactions habituelles dans lesquelles les résidus de la IIe classe refoulent ceux de la Ire.
§ 2385. Mais dans le cas où subsistent les conditions économiques grâce auxquelles les résidus de la Ire classe se renforcent, ceux-ci regagnent peu à peu du terrain. De nouveau, la « raison » recommence à désagréger l'édifice de la « superstition ». Dans les classes supérieures de la société, cet édifice tombe en ruines vers la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre [FN: § 2385-1] un peu plus tôt qu'en France, environ un demi-siècle ; et alors on put observer les mêmes phénomènes qu'au début du XVIe siècle. Deux cents ans suffirent pour accomplir cette oeuvre. Les « philosophes » du XVIIIe siècle sont les héritiers des humanistes. Comme eux ils inclinent au paganisme. On a ainsi l'une des nombreuses formes que peut prendre la lutte des résidus de la Ire classe contre ceux de la IIe classe, lorsque ceux-ci sont défendus par la religion chrétienne. Le contraire pourrait arriver, – et peut-être est-il arrivé en partie à l'origine de la religion chrétienne, – si la lutte avait lieu dans une société païenne.
§ 2386. La fin du XVIIIe siècle est un temps de prospérité économique. Nous sommes à l'aube des transformations modernes de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. Cette circonstance favorisait, comme d'habitude, la prédominance des résidus de la Ire classe, et cette prospérité était à son tour favorisée par cette prédominance. La marée de la prospérité économique monta tout d'abord en Angleterre ; c'est pourquoi ce fut d'abord dans ce pays que redescendit la courbe de la proportion entre les résidus de la IIe classe et ceux de la Ire. Ce fut aussi pour cela que la réaction s'y produisit en premier lieu, et que la courbe se releva, à cause du mouvement ondulatoire qui est propre à cette courbe, même quand les conditions économiques demeurent presque constantes [FN: § 2386-1]. De la sorte, action et réaction anticipèrent en Angleterre sur les mouvements correspondants en France. L'action avait revêtu des formes semblables dans les deux pays : des formes « philosophiques ». La réaction, égale en somme, prit des formes diverses, surtout chrétienne en Angleterre et démocratique en France. La Révolution française fut une réaction religieuse analogue, sous une autre forme, à la réaction religieuse en Angleterre, et analogue aussi à la réaction religieuse de la Réforme. Mais la forme changea bientôt : de démocratique et humanitaire, au début de la Révolution, elle devint patriotique et guerrière sous Napoléon, et catholique sous Louis XVIII. Le point le plus élevé de la courbe de la proportion entre les résidus de la IIe et ceux de la première classe était atteint, dans toute l'Europe, peu après 1815, et la forme était presque partout chrétienne.
§ 2387. Mais ces mouvements sont essentiellement ondulatoires ; par conséquent, on eut de nouveau un mouvement descendant de la courbe. Il fut rapide, parce qu'il correspondait à une nouvelle ondulation rapide et puissante de prospérité économique : la production économique se transformait ; la grande industrie, les grands commerces, la finance internationale naissaient. Les résidus de la Ire classe recommencèrent peu à peu à dominer, et les positivistes, les libres-penseurs, les intellectuels du XIXe siècle reprennent leur œuvre habituelle, désagrégeant l'édifice des « préjugés », et se montrant les héritiers des philosophes du XVIIIe siècle. Ils ne combattent pas au nom du paganisme, comme combattaient les humanistes, ni au nom du sens commun, comme faisaient les philosophes du XVIIIe siècle, mais ils élèvent le drapeau de la sainte Science. Le maximum d'intensité du mouvement dont ils sont l'expression est atteint entre 1860 et 1870. Ensuite, ce mouvement s'affaiblit et, dans la première décade du XXe siècle, commence une réaction en faveur des résidus de la IIe classe.
§ 2388. Au mouvement général se superposent, comme d'habitude, des ondulations secondaires. Il faut faire attention de ne pas confondre celles-ci avec celui-là. Cette conclusion est facile pour les ondulations qui apparaissent à nos yeux, et qui, par leur proximité, acquièrent une importance très supérieure à celle qu'elles ont, quand on considère le mouvement général pour une longue période (§ 2394).
§ 2389. Parmi ces ondulations secondaires, remarquable est celle qui suivit la guerre de 1870 et qui, bien que déterminée surtout par les circonstances dans lesquelles se trouvaient les sociétés européennes, est due cependant en petite partie à l'action du prince de Bismarck. Celui-ci contribua, bien qu'involontairement, à combattre par le Kulturkampf les résidus de la IIe classe, et fit durer par conséquent la prédominance des résidus de la Ire classe. Pour obtenir des effets momentanés, il protégea les vieux catholiques, sans prendre garde que de la sorte il portait un coup aux principes de la politique impériale. Plus tard, il se ravisa, et fit la paix avec la curie romaine. En cela, l'empereur Guillaume II se montra plus avisé. Il comprit fort bien que les conflits affaiblissant les résidus de la IIe classe n'étaient nullement avantageux à l'Empire. En outre, le prince de Bismarck, toujours pour les besoins momentanés de sa politique, favorisa la République anticléricale en France ; ce qui eut aussi pour effet de faire durer la prédominance des résidus de la Ire classe. D'autre part, par aversion pour le libéralisme bourgeois, dont il avait souvent eu à se plaindre, il donna le suffrage universel à l'empire allemand [FN: § 2389-1] . Il favorisa ainsi le parti socialiste ; ce qui renforça certains résidus de la IIe classe. D'autres résidus augmentèrent d'intensité, grâce à la constitution du parti catholique dit du centre, et à la diffusion de l'antisémitisme.
§ 2390. Actuellement, la prospérité des résidus de la IIe classe semble principalement destinée à renforcer le patriotisme sous diverses formes, par exemple celles du nationalisme et de l'impérialisme. Le socialisme fortifie aussi d'autres résidus, qui entrent en conflit avec les précédents. Mais maintenant, en 1914, il est en train de décliner vers des combinaisons politiques, et subit l'invasion de résidus de la Ire classe. C'est pourquoi il résiste mal au nationalisme ou à l'impérialisme. On voit même un grand nombre de socialistes changer la forme de leur foi, et s'associer, sous différents prétextes, aux nationalistes et aux impérialistes. Subsidiairement, nous voyons aujourd'hui refleurir diverses religions, depuis les religions chrétiennes jusqu'à la religion sexuelle et à celle de l'anti-alcoolisme ; alors que la métaphysique refleurit aussi, et que l'on voit revenir en honneur des billevesées qui semblaient, il y a un demi-siècle, ne pouvoir acquérir aucun crédit. Jusqu'à quand continuera, et jusqu'où ira l'oscillation que nous voyons commencer maintenant ? Il ne nous est pas donné de le prévoir ; mais les faits observés dans le passé nous permettent d'affirmer qu'elle aboutira à une nouvelle oscillation en sens contraire.
§ 2391. Si l'on considère d'un peu haut tous ces phénomènes qui se produisent ainsi régulièrement, et se renouvellent depuis un passé reculé jusqu'à nos jours, il est impossible de ne pas admettre l'idée que les oscillations observées sont la règle, et qu'elles ne sont pas près de cesser. Ce qui se passera dans un très lointain avenir nous est inconnu ; mais il est très probable que le cours des événements, déjà si long, n'est pas sur le point de changer dans un avenir prochain [FN: § 2391-1] .
§ 2392. Il n'est nullement démontré que ces oscillations se produisent autour d'une ligne ab, correspondant à une proportion constante entre les résidus de la IIe classe et ceux de la 1re classe, plutôt qu'autour d'une ligne m p, indiquant que cette proportion va diminuant. Au contraire, de très nombreux faits nous induisent à croire que cette dernière ligne m p représente le cours général et moyen du phénomène. Nous avons vu que les classes des résidus changent lentement, mais qu'elles ne sont pas constantes. Par conséquent, le cours indiqué par la ligne m p n'est nullement contraire aux propriétés des résidus. D'autre part, si l'on compare l'état de nos sociétés à celui des sociétés gréco-romaines, il paraît aussitôt évident qu'en de nombreuses branches de l'activité humaine, telles que les arts, les sciences et la production économique, les résidus de la Ire classe et les déductions de la science logico-expérimentale ont certainement refoulé les résidus de la IIe classe. Dans l'activité politique et sociale, le fait apparaît avec moins de clarté. Peut-être aussi cet effet est-il très faible ? Mais ce n'est là qu'une partie de l'activité humaine, et si l'on considère cette activité dans son ensemble, on peut conclure en toute sécurité que les résidus de la Ire classe et les déductions de la science logico-expérimentale ont accru le domaine dans lequel s'exerce leur influence, et que c'est même à cela, en grande partie, qu'on doit la diversité des caractères de nos sociétés, comparées aux anciennes sociétés de la Grèce et de Rome.

Figure 41
§ 2393. Par conséquent, en somme, l'opinion qui attribue une part toujours plus grande à la « raison » dans l'activité humaine, n'est pas erronée ; elle est au contraire d'accord avec les faits. Mais cette proposition est indéfinie comme toutes celles que la littérature substitue aux théorèmes de la science ; elle donne facilement lieu à plusieurs erreurs, parmi lesquelles les suivantes sont à remarquer.
§ 2394. 1° Cette proposition peut se rapporter uniquement à l'ensemble social ; elle a une valeur très différente pour les diverses parties de cet ensemble, et c'est une erreur que d'étendre à l'activité politique et sociale les caractères que l'on a observés dans les arts, dans les sciences, dans la production économique. 2° Elle représente un cours moyen, et c'est une erreur que de la confondre avec le cours réel s t r v Les hommes sont frappés surtout par les faits qu'ils ont sous les yeux. Il suit de là que les personnes qui se trouvent, par exemple, sur le segment descendant s t de la courbe, s'imaginent qu'il correspond au cours moyen, que le reste de la courbe continuera indéfiniment à descendre comme le segment s t, qu'il ne se redressera jamais plus. En d'autres termes, elles ne prévoient pas qu'on observera le segment ascendant t r. Vice-versa, les personnes qui se trouvent sur ce segment ascendant t r ne prévoient pas le segment descendant r v. Cela arrive plus rarement, soit parce que le cours général et moyen de la courbe m p est contraire à cette opinion et favorable à la première, soit, et c'est maintenant la courbe la plus puissante, parce que la seconde opinion se heurte à la théologie du Progrès, tandis que la première concorde avec elle. 3° On commet une erreur du même genre, mais atténuée, en attribuant à la courbe moyenne un cours voisin de celui de l'ondulation qu'on a sous les yeux. Ainsi, celui qui se trouve sur le segment descendant r v est induit à croire que la courbe moyenne descend beaucoup plus rapidement que ce n'est le cas en réalité. 4° Enfin, il y a l'erreur habituelle consistant à donner une forme absolue au phénomène contingent de l'expérience. De cette façon naissent des théologies et des métaphysiques de la régression, de l'immobilité, du progrès : on vante, on exalte, on magnifie la sagesse des ancêtres, l'âge d'or placé dans le passé ; ou bien la sereine immutabilité des dogmes d'une religion, d'une morale, d'une constitution politique et sociale ; ou bien encore le saint Progrès, les bienfaits de l'« évolution », l'âge d'or placé dans l'avenir. Presque tous les auteurs des siècles passés tenaient pour assuré que les hommes, leurs contemporains, étaient physiquement des nains, en comparaison des hommes géants de temps plus reculés. Aujourd'hui, bon nombre d'auteurs substituent le moral au physique, et intervertissent les termes : ils tiennent pour assuré que les hommes, nos contemporains, sont moralement des nains, en comparaison des hommes moralement géants qui vivront en des temps futurs, quand le loup aura fait amitié avec l'agneau, et qu'il y aura « un peu plus de justice » dans le monde.
De la sorte, les segments expérimentaux s t r v.... des ondulations se transforment en segments imaginaires, étrangement déformés ; quelquefois, ils finissent par avoir peu ou rien de commun avec la réalité. Ces segments imaginaires sont principalement déterminés, au moins en général, par les segments s t r auxquels ils correspondent. Nous avons précisément fait l'étude de ce rapport, en considérant ce que nous avons appelé l'aspect extrinsèque (§ 2343 et sv.) ; mais les théories représentées par ces segments imaginaires agissent aussi et réagissent mutuellement. Nous l'avons remarqué en considérant ce que nous avons appelé l'aspect intrinsèque (§ 2340 et sv.).
§ 2395. Les erreurs logico-expérimentales relevées tout à l'heure peuvent parfois être utiles à la société ; mais ici, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons longuement exposé sur ce sujet. Nous limitant donc à la correspondance entre la théorie et les faits, nous voyons que l'étude scientifique des phénomènes a précisément pour but d'éviter ces erreurs, et de substituer aux visions de l'imagination les résultats de l'expérience. Les unes et les autres peuvent parfois avoir une partie commune ; mais quiconque veut acquérir meilleure et plus ample connaissance des phénomènes naturels, et se soustraire au danger d'être induit en erreur, ne peut se fier qu'aux résultats de l'expérience, toujours corrigés et recorrigés par de nouvelles observations.
§ 2396. L'ENSEMBLE SOCIAL. Nous sommes maintenant arrivés à une conception générale de l'ensemble social, non seulement en un état statique, mais aussi en un état dynamique ; non seulement par rapport aux forces qui agissent effectivement sur cet ensemble social, mais aussi par rapport à l'apparence que présentent ces forces, à la manière plus ou moins déformée dont elles sont vues. Ajoutons quelques considérations sur ces forces, par rapport à une étude logico-expérimentale, telle que nous avons essayé de l'accomplir.
§ 2397. L'étude logico-expérimentale met seulement en rapport des faits avec d'autres faits. Si l'on procède à cette étude directement, en décrivant uniquement les faits que l'on observe ensemble, on a l'empirisme pur. Il peut servir à découvrir des uniformités, si, par l'observation ou par l'expérience, on réussit à séparer deux seules catégories de faits, que l'on met ainsi en rapport. Mais sitôt que les catégories sont nombreuses et que les effets s'enchevêtrent, il devient bien difficile, et souvent impossible, de trouver des uniformités par l'empirisme seul. Il faut trouver moyen de démêler l'enchevêtrement ainsi constitué. En certains cas, on peut effectuer cette opération matériellement par l'expérience. En d'autres cas, l'expérience n'est pas possible, ou bien elle ne réussit pas à démêler l'enchevêtrement, et alors il faut essayer, de nouveau essayer diverses hypothèses d'abstraction, qui servent à dénouer idéalement ce que l'on ne peut dénouer matériellement. Parmi ces hypothèses, on acceptera seulement celle qui donnera des résultats concordant avec l'observation. Le procédé par lequel on a trouvé cette hypothèse peut être même absurde ; cela importe peu ou point, car elle tire toute sa valeur, non pas du procédé par lequel elle a été trouvée, mais des vérifications subséquentes.
§ 2398. Mais si elle a été déduite par abstraction de certains faits, A, B, P, on a ainsi déjà commencé la vérification, puisque, déduite de ces faits, elle les a certainement pour résultats ; il reste uniquement à voir si elle a aussi pour résultats les faits Q, R, V, non encore considérés (§ 2078-1).
§ 2399. En suivant la méthode déductive, nous aurions donc pu présenter, dès le début, les résidus et les dérivations comme de simples hypothèses, sans dire d'où nous les avions tirées, puis montrer que ces hypothèses avaient des résultats concordant avec les faits. Au contraire, en suivant la méthode inductive, nous avons tiré résidus et dérivations d'un très grand nombre de faits. Ainsi, pour ces faits, la vérification a été effectuée dès ce moment ; il nous est resté uniquement à l'accomplir pour d'autres faits qui, alors, n'avaient pas été considérés. Nous avons fait et continuons à faire cette vérification. Donc, en conclusion, ce sont les faits que nous avons présentés et que nous mettons en rapport.
§ 2400. Cette méthode n'a rien de spécial ; elle est au contraire générale dans toutes les sciences. Souvent, une hypothèse y est utilisée un certain temps, et fait progresser la science ; puis elle est remplacée par une autre, qui remplit une fonction analogue, et qui, de même, cède la place à une autre encore, et ainsi de suite. Quelquefois, une hypothèse peut durer très longtemps ; c'est le cas de la gravitation universelle.
Les sciences logico-expérimentales sont constituées par un ensemble de théories analogues à des êtres vivants, qui naissent, vivent et meurent, les nouveaux remplaçant les anciens, tandis que la collectivité seule subsiste (§ 52). La durée de la vie est inégale pour les théories, tout comme pour les êtres vivants, et ce ne sont pas toujours celles dont la vie est la plus longue qui sont les plus utiles au développement de la science. La foi et la métaphysique espèrent atteindre un état définitif, éternel ; la science sait qu'elle ne peut arriver qu'à des états provisoires, transitoires [FN: § 2400-1] ; chaque théorie accomplit son œuvre, et il n'y a rien à lui demander de plus [FN: § 2400-2).
Si une telle succession de doctrines est déterminée en grande partie par une seule force, il peut arriver que les états successifs des doctrines se rapprochent de plus en plus d'une certaine limite : que la courbe de ces états ait une asymptote (§ 2392). C'est ce qui a lieu pour les sciences logico-expérimentales. La force, sinon unique du moins principale, qui agit actuellement sur ces sciences, est la recherche de la correspondance des théories avec l'expérience ; les théories se rapprochent donc de plus en plus de la réalité expérimentale, tandis qu'autrefois d'autres forces entraient en jeu et empêchaient cet effet de se produire. Les doctrines économiques et sociales demeurent encore soumises à des forces analogues, et par conséquent continuent à s'écarter parfois notablement de la réalité expérimentale, l'existence même d'une asymptote de leurs oscillations étant douteuse.
Si la succession des doctrines est déterminée par un grand nombre de forces, dont l'intensité est à peu près du même ordre de grandeur, le mouvement révélé par cette succession peut être tellement compliqué qu'il nous devienne impossible d'en donner une expression générale. Mais si ces forces, sans se réduire à une seule, sont du moins en petit nombre, il est des cas où nous pouvons découvrir une telle expression. On peut, par exemple, reconnaître des mouvements oscillatoires autour d'une certaine position, soit qu'ils tendent à un équilibre en cette position, soit qu'ils se continuent indéfiniment sans manifester clairement aucune tendance de ce genre. Ce sont des mouvements d'une telle nature que nous avons vus se produire sous l'empire de deux forces principales, qui sont la correspondance avec la réalité expérimentale et l'utilité sociale (§ 1683, 2329, 2391).
Ce n'est que par une première approximation qu'on peut réduire à deux les très nombreuses forces qui agissent dans les cas concrets. Si, pour pousser plus loin l'étude des phénomènes, nous mettons en ligne de compte de nouvelles forces, en les ajoutant aux deux principales que nous avons considérées, nous trouverons des mouvements de plus en plus compliqués et difficiles à étudier (§ 2339, 2388). Ici, nous avons pu faire quelques pas dans cette voie (§ 2343 et sv.), mais les obstacles dont elle est hérissée ne nous ont pas permis de nous y avancer autant que nous l'aurions désiré.
Si nous avions suivi la voie déductive, l'exposé que nous venons de faire aurait dû trouver sa place au commencement de l'ouvrage ; mais alors, privé des développements donnés dans le cours de l'ouvrage, il aurait pu être entendu en un sens différent de celui qu'il a réellement, ou même n'être pas compris. La voie déductive permet de fixer ce sens et de bien le faire comprendre ; et la théorie générale, ne venant qu'après l'étude des cas particuliers, est convenablement expliquée par ceux-ci.
§ 2401. La découverte que fit Kepler, trouvant que Mars parcourait une ellipse dont un des foyers coïncidait avec le centre du soleil, était purement empirique ; elle ne décrivait les phénomènes que sommairement. En ce cas, grâce à l'imperfection des observations (§ 540-1] ), on avait pu séparer le mouvement d'une planète, par rapport au soleil, des mouvements des autres planètes. Si les observations avaient été plus parfaites, ou n'aurait pas pu le faire ; Kepler n'aurait pas trouvé une ellipse, et c'eût été un grave obstacle aux progrès de l'astronomie Ici, deux cas sont à considérer.
§ 2402. 1° Pour notre système solaire, on aurait pu surmonter cet obstacle sans grande difficulté. Un savant aurait observé que si la courbe parcourue par Mars n'était pas une ellipse, elle ne s'en écartait d'ailleurs pas beaucoup. Il aurait pu faire l'hypothèse que si l'on considérait le soleil et Mars séparément des autres planètes, la courbe devait être une ellipse, et que si elle ne l'était pas, c'était parce que le soleil et Mars n'étaient pas séparés des autres planètes.
§ 2403. 2° Beaucoup plus grave, peut-être insurmontable aurait été l'obstacle si, au lieu de notre système solaire, où l'astre central a une masse énormément plus grande que celle de ses satellites, il se fût agi d'un système d'astres et de planètes à masses peu différentes.
§ 2404. Parfois, mais par malheur trop rarement, les faits mis en rapport par la statistique peuvent être assimilés à ceux du premier cas, rappelé tout à l'heure. En d'autres termes, par l'interpolation, on peut trouver une certaine courbe hypothétique, dont on peut supposer que la courbe réelle est déduite en faisant intervenir des perturbations. Mais beaucoup plus souvent, il faut assimiler les faits de l'économie, et encore plus ceux de la sociologie, à ceux du 2e, cas.
§ 2405. Newton fit une hypothèse, dite de la gravitation universelle, dans laquelle, si l'on suppose le soleil immobile et une planète qui tourne autour, il en résulte une courbe du genre de celle que trouva Kepler, c'est-à-dire une ellipse.
§ 2406. Cette hypothèse a un mérite singulier qu'on trouve rarement en d'autres hypothèses analogues : c'est qu'on peut renverser le rapport entre l'hypothèse et les faits. Autrement dit, si l'on suppose qu'une planète parcourt une ellipse autour du soleil immobile, il en résulte une loi d'attraction qui est précisément celle de Newton. Au contraire, en général, spécialement en économie et en sociologie, une hypothèse peut bien avoir certains faits pour résultat, mais de ces faits, on peut tirer un grand nombre d'autres hypothèses.
§ 2407. L'hypothèse de Newton a encore un autre très grand mérite : c'est que, jusqu'à maintenant du moins, appliquée à l'ensemble du soleil et de toutes ses planètes, elle a suffi à expliquer toutes les perturbations observées dans les mouvements des corps célestes. Si cela n'était pas arrivé, l'hypothèse de Newton aurait pu subsister, mais on aurait dû y en ajouter d'autres ; par exemple, que l'attraction réciproque des planètes était différente de celle des planètes et du soleil. Il est inutile d'ajouter qu'en économie ni en sociologie nous n'avons d'hypothèses simples aussi fécondes que celle de Newton.
§ 2408. Il est donc indispensable, tant en économie politique qu'en sociologie, de considérer un grand nombre d'éléments des phénomènes complexes que l'observation nous révèle directement [FN: § 2408-1]. Ce que nous pouvons dire de plus simple, en économie, c'est que l'équilibre résulte de l'opposition entre les goûts et les obstacles. Mais cette simplicité n'est qu'apparente, car il faut ensuite tenir compte de la grande diversité des goûts et des obstacles. On trouve une complication beaucoup plus grande en sociologie où, aux actions logiques, seules considérées par l'économie, il faut ajouter les actions non-logiques, et au raisonnement logique, les dérivations (§ 99).
§ 2409. On ne peut pas déduire les lois dites de l'offre et de la demande, des statistiques des quantités d'une marchandise produite ou présentée sur le marché et des prix de cette marchandise. Lorsque les économistes ont dit que si l'offre croît, le prix diminue, ils ont exprimé la loi d'un phénomène idéal, qu'on observe rarement parmi les phénomènes concrets. C'est une illusion de croire que nous nous rapprochons davantage de la réalité en partant des lois de l'offre et de la demande, plutôt que de l'utilité des premiers économistes, de la marginal utility, de la rareté, de l'ophélimité d'économistes postérieurs, pour constituer les théories de l'économie [FN: § 2409-1]. De toute façon, on recourt à des abstractions, et l'on ne peut faire autrement. Théoriquement, on peut partir de n'importe laquelle de ces considérations ou d'autres quelconques ; mais dans les différents cas, il faut prendre des précautions qu'oublient un grand nombre d'auteurs, qui dissertent d'économie politique sans en savoir un traître mot. Toujours au point de vue théorique, il faut prendre garde que les consommations de marchandises ne sont pas indépendantes [FN: § 2409-2), comme le supposèrent plusieurs des auteurs qui constituèrent l'économie pure (§ 2404-3] ). Il ne faut pas négliger non plus de considérer les mouvements ondulatoires des phénomènes économiques, ni un très grand nombre d'autres circonstances, par exemple celle de la spéculation, qui change la forme des phénomènes, forme que nous avons dû supposer d'abord plus simple, pour faciliter notre étude.
§ 2410. Ces considérations s'appliquent a fortiori à la sociologie. On ne peut déduire directement que peu ou rien de la simple description des phénomènes. En ce sens, l'adage : « l'histoire ne se répète jamais » est très vrai. Il faut décomposer ces phénomènes concrets en d'autres phénomènes, idéaux, plus simples, et s'efforcer d'obtenir ainsi quelque chose de plus constant que le phénomène réel, très compliqué et variable [FN: § 2410-1]. Ici, nous avons cherché ces éléments moins variables, plus constants, dans les résidus et les dérivations. On pourrait également chercher ailleurs. Cela importe moins que de prendre garde qu'en ces recherches il ne s'introduise des éléments et des formes qui éloignent de la réalité objective. Il est tout aussi certain que « l'histoire ne se répète jamais » identiquement, qu'il est certain qu'elle « se répète toujours » en certaines parties que nous pouvons dire principales. D'un côté, il serait vain et absurde, au-delà de toute expression, de supposer qu'il peut y avoir, dans l'histoire, des événements qui reproduisent identiquement ceux de la guerre du Péloponnèse, qui en soient la copie exacte. Mais d'un autre côté, l'histoire nous montre que la guerre provoquée par la rivalité d'Athènes et de Sparte n'est qu'un terme d'une série infinie de guerres analogues suscitées par des causes analogues ; qu'il y en a des quantités infinies de semblables, au moins en partie, depuis les guerres que provoqua la rivalité de Carthage et de Rome, jusqu'à d'autres que l'on voit en tout temps, jusqu'à notre époque. Dans la Politique, V, 3, 7, Aristote dit : « Enfin, il faut que l'on sache clairement que ceux qui ont été cause de puissance pour la cité], donnent naissance à des troubles, que ce soient de simples particuliers, des magistrats, des tribus, ou en somme une partie quelconque du peuple ». Il décrivait ainsi la partie principale d'un très grand nombre de faits à lui connus, et il en prévoyait un très grand nombre d'autres qui se produisirent après lui ; ainsi parmi ceux qui se rapprochent le plus de nous, les faits de Cromwell et de Napoléon Ier. La partie principale de ces événements est précisément donnée par les sentiments (résidus), qui varièrent très peu depuis le temps d'Aristote jusqu'au nôtre. On en peut dire autant d'un grand nombre de maximes de Machiavel, qui conservent de nos jours la valeur qu'elles eurent de son temps. Les classes des résidus varient peu et lentement. C'est pourquoi on peut les ranger parmi les éléments qui déterminent la partie constante, presque constante, ou du moins peu variable des phénomènes. Les différents genres d'une classe de résidus varient bien davantage et plus promptement que la classe elle-même. Aussi faut-il se tenir sur ses gardes en les rangeant parmi les éléments qui déterminent la partie peu variable des phénomènes. Les dérivations varient énormément et vite ; c'est pourquoi on les range en général seulement parmi les éléments qui déterminent les parties subordonnées, variables, et habituellement négligeables des phénomènes. De ce que nous venons d'exposer, on tire aussi la cause d'un fait auquel nous avons dû souvent faire allusion ; c'est que pour la recherche des uniformités sociologiques, les détails trop menus, les faits trop nombreux, peuvent nuire au lieu d'être utiles [FN: § 2410-2] ; car celui qui s'arrête à toutes les moindres circonstances des faits s'égare facilement comme dans une épaisse forêt. Il est empêché d'attribuer des indices convenables aux divers éléments ; il intervertit les rôles de ceux qui sont principaux et de ceux qui sont secondaires, de ceux qui sont presque constants et de ceux qui sont très variables, et il finit par composer un ouvrage littéraire dépourvu de toute valeur scientifique.
§ 2411. Dans les sciences sociales, il faut surtout se tenir sur ses gardes contre l'intromission des sentiments de l'auteur, lequel incline à rechercher, non pas simplement ce qui existe, mais ce qui devrait exister pour concorder avec ses sentiments religieux, moraux, patriotiques, humanitaires ou autres [FN: § 2411-1]. La recherche des uniformités expérimentales est en elle-même un but. Quand on a trouvé ces uniformités, elles peuvent servir à d'autres buts ; mais confondre ces deux recherches porte un grave préjudice à toutes les deux. En tout cas, c'est un obstacle très grave et souvent insurmontable pour la découverte des uniformités expérimentales. Tant que les sciences naturelles rencontrèrent de semblables obstacles, elles progressèrent peu ou point. C'est seulement quand ces obstacles diminuèrent, puis disparurent, que les sciences naturelles accomplirent le merveilleux progrès qu'elles nous présentent aujourd'hui. Si donc nous voulons ramener les sciences sociales au type des sciences naturelles, il faut que nous procédions dans les premières comme dans les secondes, en réduisant les phénomènes concrets très compliqués à des phénomènes théoriques beaucoup plus simples, en nous laissant guider dans cette opération exclusivement par l'intention de découvrir des uniformités expérimentales, et en jugeant leur efficacité uniquement par les vérifications expérimentales que nous pouvons faire. Un très grand nombre de ces vérifications ont déjà été exposées ici pour des cas particuliers. Maintenant nous en ajouterons quelques autres pour des cas plus généraux.
[1601]
Chapitre XIII↩
L’équilibre social dans l’histoire
§ 2413. Bien souvent, nous avons été amenés à reconnaître que l'un des facteurs principaux, pour la détermination de l'équilibre social, était la proportion existant, chez les individus, entre les résidus de la Ire classe et ceux de la IIe Dans une première approximation, on peut considérer cette proportion à trois points de vue, en établissant la comparaison : 1° entre des populations en général, de pays différents, ou bien entre des populations en général, du même pays, mais en des temps différents ; 2° entre des classes sociales, et surtout entre la classe gouvernante et la classe gouvernée ; 3° par rapport à la circulation des élites d'une population.
§ 2414. Avant d'aller plus loin, il faut prendre garde à deux erreurs. La première consisterait à considérer la proportion des résidus comme la cause, et les phénomènes sociaux comme l'effet. Nous avons trop souvent noté cette erreur de substituer les rapports de cause à effet aux rapports de mutuelle dépendance, pour qu'il soit nécessaire d'y revenir.
§ 2415. La seconde erreur consisterait à considérer comme unique, dans les rapports de mutuelle dépendance, la condition d’une certaine proportion de résidus, et pis encore de confondre une semblable condition, fût-elle nécessaire, avec une condition nécessaire et suffisante. En outre, afin d'abréger, nous parlons uniquement des résidus de la Ire et de la IIe classe, pour avoir une première approximation du phénomène ; mais il faut évidemment tenir compte des autres résidus. Pourtant, plusieurs résidus de la sociabilité, de l'intégrité personnelle, etc., ont leurs correspondants dans les persistances d'agrégats ; par conséquent, on en tient compte indirectement lorsqu'on évalue les résidus de la IIe classe. Afin de mieux comprendre ce fait, examinons des phénomènes analogues. Pour avoir une abondante moisson de blé, il faut qu'il se trouve dans le terroir une certaine proportion de phosphore et d'azote assimilables. Mais il est évident que cela ne suffit pas, et, sans parler d'un grand nombre d'autres conditions indispensables, il faut aussi tenir compte des circonstances météorologiques. Si celles-ci sont favorables, une terre contenant en proportions convenables du phosphore et de l'azote peut donner un rendement inférieur à celui d'une autre terre qui ne présente pas ces proportions, mais pour laquelle les circonstances météorologiques sont plus favorables. Pourtant, à la longue, il s'établit une certaine compensation entre les années où les circonstances météorologiques sont défavorables et celles où elles sont favorables. En moyenne, le rendement supérieur provient de la terre qui possède en proportions convenables du phosphore et de l'azote. C'est pourquoi l'analyse chimique des terres est loin d'être inutile. Elle est au contraire le fondement de l'agriculture moderne.
Autre exemple. La proposition qui met en rapport la proportion des résidus des différentes classes avec d'autres phénomènes sociaux, est analogue à celle qui met en rapport, dans une armée moderne, la proportion de l'artillerie et des autres armes avec la probabilité de remporter la victoire. D'abord, cette condition n'est pas unique ; il y en a beaucoup d'autres, entre autres que l'armée soit ravitaillée en vivres et en munitions. Ensuite, si cette condition peut être, dans certains cas, nécessaire, elle n'est jamais suffisante. Il ne suffit pas que l'artillerie et les autres armes soient en proportion convenable : il faut encore savoir s'en servir. Enfin, de la même façon qu'il faut tenir compte d'autres résidus à part ceux de la Ire et de la IIe classe, il faut aussi s'assurer que l'artillerie dispose des chevaux nécessaires, qu'elle a de bons officiers, sous-officiers et soldats, des munitions en quantité suffisante, etc. Il ne suffit pas que dans les classes gouvernantes il existe en proportion convenable des résidus de la Ire et de la IIe classe : il faut encore qu'ils soient convenablement mis en valeur. Il est évident, par exemple, que si l'instinct des combinaisons se manifeste par des opérations magiques au lieu d'être employé à des opérations économiques ou guerrières, il ne servira à rien du tout ; et si on le perd en intrigues, de salon [FN: § 2415-1] , au lieu de l'appliquer à des mesures politiques, il servira vraiment à peu de chose. Enfin, si les persistances d'agrégats dégénèrent en sentiments ascétiques, humanitaires et autres semblables, leurs effets pourront être comparés à ceux d'une artillerie dont les canons seraient en bois. Mais lorsque, dans une armée, on a employé les différentes armes avec une habileté passable, par des moyens opportuns, à la longue, l'efficacité d'une proportion convenable de ces armes se manifeste ; et lorsque les résidus agissent de la manière la mieux adaptée à la prospérité sociale, à la longue l'efficacité d'une proportion semblable se manifeste. C'est précisément ce que nous avons l'intention de vérifier ici.
§ 2416. Considérons, en général, les populations de différents pays. Sur l'axe o z, portons les indices de la prospérité économique, militaire, politique de ces pays, et sur l'axe o x, les diverses proportions en lesquelles se trouvent, dans des pays, les résidus de la Ire classe et ceux de la IIe, auxquels on pourra aussi ajouter des résidus d'autres classes. Il ne nous sera pas difficile de trouver des pays p où cette proportion soit petite, c'est-à-dire où il existe peu de résidus de la Ire classe, en comparaison de ceux de la IIe. Nous trouverons aussi des pays q où, au contraire, les résidus de la Ire classe prédominent fortement sur ceux de la IIe. Enfin, nous aurons d'autres pays r, où l'on aura une proportion intermédiaire o r. En de très nombreux cas, nous observerons que les indices de la prospérité p a, q d sont moindres que les indices r b. Nous en conclurons que la courbe des indices de prospérité a très probablement un maximum en s c, pour une proportion o s que nous ne pouvons pas fixer avec précision, mais que du moins nous savons être intermédiaire entre o p et o q.

Figure 42
§ 2417. Si, au lieu de comparer différents pays, nous comparons les divers états successifs d'un même pays, nous ne pouvons pas déduire grand'chose des proportions existant entre les résidus de la Ire classe et ceux de la IIe, parce que, dans l'ensemble de la population, les résidus varient lentement. Par conséquent, les effets de diverses proportions peuvent être masqués par d'autres phénomènes plus variables. Mais si nous prêtons attention à la proportion des résidus dans la classe gouvernante, comme cette proportion varie parfois assez rapidement, nous pourrons en distinguer les effets de ceux d'autres phénomènes. Pourtant cette variation étant étroitement liée à celle de la circulation des élites, très souvent on ne pourra connaître que les effets d'ensemble, sans qu'il soit possible de bien distinguer la part qui revient à chacune de ces deux causes.

Figure 43
§ 2418. En outre, l'indice de l'utilité sociale ne dépend pas seulement de la proportion des différentes catégories de résidus dans la classe gouvernante, mais aussi de cette proportion dans la classe gouvernée. Il faut par conséquent représenter le phénomène dans un espace à trois dimensions (fig. 43). Le plan x y, supposé horizontal, est celui de la figure; l'axe o z, supposé vertical, et qui par ce fait n'est pas indiqué sur la figure, sera celui des indices d'utilité. Sur le plan horizontal, l'axe o x sera celui de la proportion des catégories de résidus dans la classe gouvernante ; l'axe o y celui de la proportion dans la classe gouvernée. Supposons que nous fassions différentes sections verticales h h', k k', ll', parallèles au plan o x z (fig. 44). Dans chacune de ces sections, nous trouverons des points de maximum c, c', c" .… ; et en comparant les différents maxima s c, s' c', s" c", nous en trouverons un c" qui sera plus grand que les autres. Il nous indiquera par conséquent les proportions les plus convenables, dans la classe gouvernante et dans la classe gouvernée.

Figure 44
§2419. La Grèce antique fut un laboratoire d'expériences sociales et politiques, riche en observations très étendues. Dès que l'on porte son attention sur les phénomènes indiqués au §2416, les exemples de Sparte et d'Athènes viennent à l'esprit comme s'appliquant aux indices p a, q d, de la fig. 42. Les faits de la prédominance des résidus de la IIe classe à Sparte et de la prédominance de ceux de la Ire à Athènes sont trop connus pour que nous nous étendions sur ce sujet ; mais il sera bon d'ajouter quelques mots pour montrer que les deux extrêmes éloignèrent du maximum s c. Sparte n'admettait pas les innovations, parce que chez elle les résidus de la IIe classe étaient trop puissants. Athènes admettait immédiatement les innovations, mais elle ne savait pas en tirer le profit qu'elles comportaient, parce que, chez elle, les résidus de la Ire classe étaient trop puissants.
§ 2420. La principale utilité des sentiments de persistance des agrégats est de s'opposer efficacement à de nuisibles tendances de l'intérêt individuel et au déchaînement des passions [FN: § 2420-1] . Leur principal désavantage est de pousser à des actions qui sont une conséquence logique de ces sentiments, mais qui nuisent à la société. Pour remplir la première fonction, il faut que ces sentiments aient une force considérable. Quand celle-ci diminue beaucoup, ils ne peuvent plus résister à des intérêts puissants et à des passions violentes ; ils ne produisent que les seconds effets, qui sont nuisibles à la société.
§ 2421. C'est ce qu'on observe en divers cas à Athènes. Un exemple caractéristique est celui d'Alcibiade. Celui-ci sut persuader aux Athéniens, contre l'opinion du conservateur Nicias, d'entreprendre l'expédition de Sicile. Si les Athéniens avaient eu de forts sentiments de persistance des agrégats, ils auraient suivi l'opinion de Nicias, ou du moins se seraient contentés d'une faible expédition qui diminuât peu ou point leurs forces ; précisément comme le fit Sparte, lorsque, peu de temps après, persuadée à son tour par Alcibiade, elle n'envoya au secours de Syracuse que Gylippe avec les quelques galères qu'elle put obtenir de Corinthe. Au contraire, les Athéniens envoyèrent en Sicile une armée puissante, qui distrayait de la Grèce une partie très considérable de leurs forces. Passe encore s'ils avaient eu dans leurs résolutions assez de constance pour passer outre à tout incident qui pût entraver la grave et dangereuse entreprise. Mais, chez eux, les résidus de la IIe classe étaient trop faibles pour produire cette constance ; tandis qu'il en restait d'assez puissants pour imposer à Nicias, réputé honnête homme et religieux, de diriger l'entreprise avec Alcibiade, et pour rappeler ensuite ce dernier, au moment précis où son activité était le plus nécessaire en Sicile. Les Spartiates, eux aussi, voulurent plus tard se débarrasser d'Alcibiade ; mais ils le firent lorsqu'ils estimèrent, à tort peut-être, que son concours ne leur était plus nécessaire, et quand ils le soupçonnèrent de les avoir trahis. Comme on sait, lorsque la flotte était sur le point de quitter Athènes, un matin, on s'aperçut que les hermès placés dans les rues d'Athènes avaient été mutilés. La cité fut atterrée du terrible sacrilège. Elle manifestait ainsi des sentiments de persistance des agrégats, comme on en aurait observé dans d'autres cités helléniques [FN: § 2421-1] . Mais quelle que fût leur puissance, elle ne suffit pas à vaincre l'instinct des combinaisons, et le peuple athénien maintint au commandement de la flotte Alcibiade, sur lequel pesait l'accusation de ce sacrilège. Lui-même pourtant, en vue de ses desseins particuliers, réclamait à grands cris un jugement immédiat, et faisait observer « qu'il eût été plus sage de ne pas l'envoyer à la tête d'une si grande flotte, sous le coup d'une telle accusation, et avant qu'il s'en fût lavé [FN: § 2421-2]». L'instinct des combinaisons l'emporta donc alors : on considérait exclusivement la grande valeur que l'on attribuait à la combinaison en vertu de laquelle Alcibiade dirigeait l'expédition. Si les Athéniens demeuraient fermes dans cette résolution, l'expédition pouvait peut-être bien tourner pour eux. Mais les voici qui changent tout à coup d'avis et, juste au moment où il était de toute utilité qu'Alcibiade demeurât en Sicile, ils envoient la trirème salaminienne pour le rappeler dans sa patrie, où il devait répondre de l'accusation de profanation des mystères d'Éleusis. La conséquence en fut qu'Alcibiade se réfugia à Sparte et, par ses conseils, amena la ruine d'Athènes [FN: § 2421-3] .
§ 2422. On observa quelque chose de semblable en France, au temps de l'affaire Dreyfus. À la profanation des mystères d'Éleusis, on substitua la profanation de la procédure de défense d'un accusé supposé innocent ; et cela parut être un prétexte suffisant pour désorganiser et affaiblir toutes les institutions de la défense nationale, pour nommer des officiers et des généraux, non en raison de leurs mérites militaires, mais à cause de leurs mérites dans une basse politique, pour confier le ministère de la guerre à un André et celui de la marine à un Pelletan. Si l'Allemagne avait alors fait la guerre à la France, comme Sparte fit la guerre à Athènes, elle pouvait causer un désastre non moins grand que ne fut pour Athènes celui de l'expédition de Syracuse [FN: § 2422-1] . À Athènes, les controverses au sujet de l'affaire des hermès et de celle de la profanation des mystères d'Éleusis, en France les controverses au sujet de l'affaire Dreyfus, étaient en grande partie des voiles et des prétextes dont on recouvrait certaines passions et certains intérêts. Mais s'ils avaient alors une valeur comme voiles et comme prétextes, c'était précisément parce que beaucoup de gens ne leur soupçonnaient pas cette qualité, mais les croyaient de sincères expressions de sentiments. Les gens qui les acceptaient étaient mus par des sentiments correspondant à certains résidus de la IIe classe.
§2423. C'eût été un moindre mal pour la France, si la puissance de la persistance des agrégats avait été assez grande pour lui interdire toute aventure dépendant de l'instinct des combinaisons. Mais, comme pour Athènes, cet instinct l'emporta à son tour, lorsque la France voulut établir sa domination sur le Maroc, oubliant, comme autrefois Athènes lorsqu'elle rappela Alcibiade, que la guerre ne se fait pas avec les bavardages des politiciens, les insanités des intellectuels [FN: § 2423-1], les combinaisons occultes des ploutocrates, mais bien avec le savoir-faire des généraux et la foi des armées. La France s'en tira alors, parce qu'il n'y avait pas en Allemagne un autre Bismarck qui jouât la partie qu'avait jouée déjà Philippe de Macédoine contre Athènes. Comme nous le verrons mieux plus loin (§ 2449 et sv., 2434), ces leçons ont peu ou point d'effet pour empêcher de commettre de semblables erreurs. C'est une nouvelle preuve de la nature non-logique des actions ainsi accomplies.
§2424. Pour revenir aux Athéniens, nous voyons qu'ils ne profitèrent nullement de la leçon du premier rappel d'Alcibiade, et qu'ils répétèrent la même erreur. Ayant abandonné Sparte, Alcibiade avait restauré la puissance athénienne d'une manière inespérée. Il n'y avait évidemment qu'à le laisser continuer ; mais son lieutenant Antiochus, désobéissant aux ordres formels d'Alcibiade, avait accepté la bataille navale contre Lysandre, et avait été défait. Ce fut là le prétexte qui servit aux ennemis d'Alcibiade pour obtenir, par les accusations habituelles d'offenses à la religion, qu’il fût destitué de son commandement. De la sorte, la ruine d'Athènes se prépara de nouveau. Il semble tout à fait évident que, dans cette cité, une certaine proportion entre les instincts des combinaisons et ceux de la persistance des agrégats faisait défaut. Suivant cette proportion, tandis que les premiers résidus poussaient aux aventures, les seconds, soutenus par la persévérance et la fermeté des résolutions, auraient mené à bonne fin les entreprises décidées.
§2425. À Sparte aussi, on observe un semblable défaut ; mais les termes sont intervertis. Certes, la persévérance et la fermeté dans les résolutions ne manquent pas ; c'est l'instinct des combinaisons qui manque, lui qui permet de tirer un parti profitable de ces forces. Si Alcibiade n'avait pas conseillé aux Spartiates de secourir Syracuse et d'occuper Décélie, Dieu sait combien de temps encore Athènes aurait pu résister, et si le sort n'aurait pas été contraire à Sparte. Mais une fois les combinaisons opportunes de Syracuse et de Décélie présentées aux Spartiates peu imaginatifs, ils surent accomplir ces entreprises avec persévérance, fermeté et clairvoyance.
§ 2426. Le fait raconté par Hérodote, au sujet d'Amopharétès, caractérise bien la mentalité spartiate [FN: § 2426-1] . À Platée, Amopharétès refusait d'opérer une manœuvre stratégique ordonnée par son chef Pausanias, parce qu'elle l'aurait éloigné des Barbares, ce qui était déshonorant pour un Spartiate.
§2427. Les phénomènes que nous sommes en train d'étudier apparaissent avec plus d'évidence dans l'art de la guerre, parce qu'en cette matière nous avons des indices certains : les victoires et les défaites sont, parmi les événements historiques, ceux qui nous sont le mieux connus. Déjà sans aller chercher bien loin, en parlant de la conduite d'Alcibiade à l'égard des Spartiates, nous avons trouvé un fait remarquable qui montre combien il est utile que l'instinct des combinaisons soit prédominant chez les chefs, et celui de la persistance des agrégats chez les subordonnés [FN: § 2427-1]. En somme, c'est précisément parce qu'Alcibiade eut pour exécuter ses combinaisons des hommes comme les Spartiates, qu'il put être utile à ces derniers, beaucoup plus qu'il ne fut utile à ses concitoyens athéniens. Cette observation nous amène à reconnaître que la première coopération est d'un genre plus efficace que la seconde, et plus efficace encore qu'une autre dans laquelle c'est un Nicias qui gouverne, et où ceux qui l'élisent et acceptent son gouvernement sont des hommes chez lesquels l'instinct des combinaisons est puissant. Nous allons voir de nouveaux et meilleurs exemples de tout cela.
§ 2428. À la bataille de Leuctres, la formation tactique des Spartiates était encore celle qu'ils employaient au temps des guerres médiques [FN: § 2428-1] , tandis que le progrès de la formation tactique des Athéniens était immense, au temps de Miltiade et à celui d’Iphicrate. Mais cela profitait peu à Athènes : les Spartiates ne savaient pas innover ; les Athéniens ne pouvaient pas se servir des innovations qu'ils imaginaient facilement, parce que chez eux la persévérance et la fermeté de résolution, qui sont indispensables pour cueillir le fruit de la victoire, faisaient entièrement défaut. Avec Sparte, Athènes était dans un rapport en partie analogue à celui où nous voyons ensuite Pyrrhus et Annibal avec Rome. Mais l'analogie cesse, si nous portons notre attention sur Sparte ; car les Romains apprirent l'art de la guerre de Pyrrhus et d'Annibal, et surent bientôt tirer parti des connaissances acquises, tandis que Sparte n'apprit rien d’Iphicrate, de Chabrias, ni d'autres adversaires de talent.
§ 2429. Il était donc facile de prévoir que Sparte comme Athènes auraient été vaincues, si elles étaient entrées en conflit avec un peuple chez lequel se seraient unis la possibilité des innovations et le pouvoir de s'en servir. C'est précisément ce qui arrive lorsque prédominent chez les chefs les résidus de la Ire classe, et chez la classe gouvernée les résidus de la IIe classe. Le fait se vérifia pour Thèbes, au temps d'Épaminondas, puis pour la Macédoine, au temps du roi Philippe et d'Alexandre-le-Grand [FN: § 2429-2](fig. 45). Dans ces deux pays, les innovations de l'art de la guerre furent accueillies favorablement. Elles portèrent des fruits parce qu'elles furent appliquées par des chefs qui possédaient à un haut degré l'instinct des combinaisons, et qui commandaient à des peuples auxquels la persistance des agrégats donnait de la fermeté dans leurs résolutions ; et cela mieux pour la Macédoine que pour Thèbes, parce que, précisément à cause de l'intensité différente des résidus de la IIe classe, les Macédoniens demeuraient plus fidèles à leurs chefs que les Thébains.
§2430. Le fait de la puissance thébaine, qui naquit et disparut dans une courte période, est remarquable en ce qu'il dura précisément le temps pendant lequel les conditions indiquées au § 2429 subsistèrent. Lorsque, par la mort de Pélopidas ou d'Épaminondas, la première de ces conditions vint à disparaître, la puissance de Thèbes s'évanouit. Il sera donc bon que nous examinions quelque peu les circonstances particulières de ce fait.
§ 2431. La naissance de la puissance thébaine fut absolument imprévue. Lorsque à l'assemblée réunie à Sparte la paix fut conclue entre tous les états de la Grèce moins Thèbes, en constatant cette exclusion des Thébains [FN: § 2431-1] , nous dit Xénophon, « les Athéniens eurent l'opinion que, ainsi qu'on le disait, il était à prévoir que les Thébains étaient décimés ; de leur côté, les Thébains eux-mêmes se retirèrent entièrement découragés ». Après cela, sitôt que les Spartiates, conduits par leur roi Cléombrote, envahirent la Béotie, les habitants furent frappés de terreur et craignirent que leur cité ne fût tout-à-fait détruite [FN: § 2431-2] . Cela était parfaitement raisonnable, si l'on considère la grande force de l'armée que commandait Cléombrote et la réputation de Sparte, jusqu'alors invincible à la guerre.
§ 2432. Le peuple thébain fut favorisé par des préjugés correspondant aux résidus de la IIe classe : « À cause de la gloire des ancêtres, datant des temps héroïques, la cité des Thébains était pleine de courage et aspirait à accomplir de grandes choses [FN: § 2432-1]». Jusque là pourtant Thèbes allait de pair avec Sparte, pleine elle aussi, de la gloire des ancêtres. Les Thébains [FN: § 2432-2]« avaient aussi des chefs extrêmement courageux, trois d'entre eux surtout : Épaminondas, Gorgias et Pélopidas ».
§ 2433. Épaminondas possédait à un haut degré le génie des combinaisons guerrières ; mais Cléombrote n'en était pas dépourvu, et il le prouva par son invasion de la Béotie [FN: § 2433-1] . Tandis que les Béotiens s'attendaient à le voir arriver par la route de la Phocide, il s'avança du côté des passages difficiles de Tisbé, atteignit Créüse et s'empara de cette ville ainsi que de douze trirèmes qui se trouvaient dans le port. La différence consistait en ce qu'à Sparte les innovations ne devaient pas sortir du cercle des institutions de Lacédémone, car la force des résidus de la IIe classe était si grande, chez les Spartiates, qu'en dehors de ce cercle, ils ne toléraient aucune innovation ; taudis qu'à Thèbes, les chefs pouvaient disposer de l'armée comme ils croyaient bon de le faire, car la force, ou si l'on veut aussi la nature des résidus de la IIe classe chez le peuple, ne s'y opposait pas.
§ 2434. Avant la bataille de Leuctres, des avertissements sérieux n'avaient pas manqué aux Spartiates pour les engager à modifier leurs formations tactiques. En 390 av. J.-C., l'Athénien Iphicrate avait détruit un corps de 600 hoplites spartiates, sous les murs de Corinthe, grâce à la savante formation qu'il avait su donner à ses peltastes (FN: § 2434-1). Mais l'inertie spartiate n'en fut nullement émue. Elle ne disparut pas, même après la terrible défaite de Leuctres. En revanche, Épaminondas, libre d'innover, changea entièrement l'ordre de bataille alors en usage, non seulement chez les Spartiates, mais aussi chez tous les autres peuples de la Grèce. Il fut le précurseur de Napoléon Ier, suivant lequel il faut s'efforcer d'être supérieur à l'ennemi, à un moment donné et sur un point donné. Les Grecs avaient l'habitude d'engager la bataille, autant que possible, sur tout le front de l'armée. Au contraire, Épaminondas rangea l'armée obliquement, de telle sorte que la gauche, avec le bataillon sacré en tête, comprenait les hoplites sur cinquante rangs de profondeur, ce qu'on n'avait alors jamais vu [FN: § 2434-2]. De cette façon, il attaquait avec une force irrésistible la droite spartiate, où se trouvaient le roi et les principaux chefs. La déroute de l'aile droite ennemie lui donnait une victoire complète. Les choses se passèrent comme le prévoyait le capitaine thébain. « Lorsqu’ils en vinrent aux mains, au début, comme on combattait vigoureusement des deux côtés, le combat était indécis. Ensuite, ceux qui étaient avec Épaminondas l'emportant, à cause de leur courage et de leur ordre très serré, un grand nombre de Péloponésiens furent tués ; car ils étaient incapables de tenir contre le violent assaut de ces soldats d'élite ; mais parmi ceux qui résistaient, les uns tombèrent, les autres furent blessés, recevant toutes leurs blessures par devant[FN: § 2434-3]». Plus tard, à la bataille de Mantinée, Épaminondas employa de nouveau la tactique qu'il avait trouvée utile à Leuctres [FN: § 2434-4] , et les Lacédémoniens, nullement instruits par leur précédente défaite, continuèrent pour leur malheur à suivre l'ancienne tactique.
§2435. Les préjugés du peuple thébain lui furent utiles en lui donnant le courage de résister à Sparte. Ils furent sur le point de lui nuire à l'occasion de certains présages avant la bataille. Mais grâce à l'instinct des combinaisons d'Épaminondas, et à sa sagesse, les funestes présages se changèrent en heureux présages, auxquels Épaminondas en ajouta artificieusement d'autres excellents. C'est pourquoi, en conclusion, au lieu que sa foi aux présages lui causât quelque préjudice, le peuple thébain en retira grand profit.
§ 2436. En sortant de Thèbes, l'armée rencontra un crieur public qui conduisait un esclave aveugle [FN: § 2436-1] , et qui criait qu'on ne devait pas le laisser sortir de Thèbes. On considéra ces paroles comme un mauvais augure pour la sortie de l'armée. Mais aussitôt Épaminondas récita un vers d'Homère, qui dit que le meilleur augure est de défendre sa patrie. Un augure pire encore se manifesta : « Le secrétaire de camp allait portant une pique à laquelle était suspendue une bandelette, et publiant par l'armée les ordres des capitaines. Il arriva qu'un coup de vent ayant soufflé, la bandelette se détacha de la pique, et alla tomber sur le cippe d'une tombe, lieu où des Spartiates et des Péloponésiens, conduits par Agésilas, avaient précédemment été ensevelis. De nouveau les plus vieux se mirent à supplier qu'on n'allât pas plus avant, puisque les dieux s'y opposaient d'une manière évidente [FN: § 2436-2]». Diodore ajoute qu'Épaminondas passa outre, dédaignant ces présages [FN: § 2436-3] . Mais la suite, racontée par Diodore lui-même, rend plus croyable ce que raconte Frontin, à savoir que, par une ingénieuse explication, Épaminondas tourna le présage en sa faveur [FN: § 2436-4](§ 2439). En outre, il sut imaginer les présages de toutes pièces, et tirer ainsi avantage de la superstition de ses soldats. Il en imagina autant qu'on en pouvait vraiment désirer. Un contemporain d'Épaminondas, Xénophon [FN: § 2436-5] , qui put certainement s'entretenir avec ceux qui étaient présents à la bataille de Leuctres, raconte comment les Thébains acquirent confiance dans le succès, grâce à un oracle suivant lequel les Lacédémoniens devaient être défaits dans le lieu [Leuctres] où deux jeunes filles, violées par certains Lacédémoniens, s'étaient donné la mort (§ 1952). En outre, à Thèbes, les temples des dieux s'étaient ouverts spontanément, et les prêtresses déclarèrent que les dieux promettaient victoire. Ce n'est pas tout. On dit aussi que les vases du temple d'Héraclès avaient été dispersés ; ce qui signifiait qu'Héraclès était parti pour combattre. Bien que pieux et crédule, Xénophon ajoute [FN: § 2436-6]: « Pourtant d'aucuns disent que toutes ces choses étaient artifices des capitaines [FN: § 2436-7] ».
§ 2437. Diodore, qui tirait probablement ses renseignements des écrits aujourd'hui perdus d'Éphore, dévoile clairement l'artifice [FN: § 2437-1] , et raconte plusieurs détails. D'après lui [FN: § 2437-2] , Épaminondas fit dire par certains voyageurs arrivés de Thèbes que les armes suspendues dans le temple d'Héraclès avaient disparu ; ce qui faisait croire que les anciens héros les avaient prises pour venir combattre aux côtés des Béotiens. Un autre voyageur, revenant de l'antre de Trophônios, dit que Zeus-roi lui avait ordonné de prescrire aux Thébains, victorieux à Leuctres, d'instituer des jeux publics en l'honneur de Zeus-roi. « (1) Cette habileté [d'Épaminondas] fut secondée par le Spartiate Léandre, exilé de Lacédémone, et qui combattait alors avec les Thébains ; car, appelé dans l'assemblée, il affirma qu'il existait un antique oracle pour les Spartiates, suivant lequel ils perdraient l'hégémonie lorsqu'ils auraient été vaincus à Leuctres par les Thébains. (2) Il vint aussi vers Épaminondas certains indigènes, interprètes d'oracles, disant que, près du sépulcre des filles de Leuctres et de Skédazos, un très grave désastre devait frapper les Lacédémoniens, pour la raison suivante. (3) Leuctres était l'homme dont la plaine avait tiré son nom. Sa fille et celle d'un certain Skédazos, toutes deux vierges, furent violées par les délégués Lacédémoniens. Elles ne purent supporter l'ignominieuse injure, et, ayant prononcé des imprécations contre le pays qui avait envoyé les odieux délégués, elles s'ôtèrent la vie de leurs propres mains [FN: § 2437-3]». Ce n'est pas encore tout. Plutarque raconte (voir : § 2437-4) comment Pélopidas eut un songe opportun qui lui prescrivait d'immoler une vierge rousse aux jeunes filles violées par les Spartiates. Après des discussions et des opérations capables de frapper l'esprit des soldats, on reconnut que la vierge rousse était une jument, et on la sacrifia.
§2438. Pélopidas et son ami Épaminondas étaient de fins connaisseurs de l'esprit humain. Si Pélopidas avait appris en songe qu'il fallait immoler sans autre une jument, son songe aurait frappé beaucoup moins l'esprit des soldats que l'angoisse d'un terrible sacrifice humain, heureusement évité par une ingénieuse interprétation. Les Romains, plus frustes que les Grecs, et peut-être frappés d'une plus grande terreur, recoururent, en des circonstances analogues, au sacrifice humain, sans substitution (§ 758).
§ 2439. La science des combinaisons d'Épaminondas, de Pélopidas, et peut-être d'autres chefs thébains, avait fait ses preuves, unie à une certaine force de permanence des agrégats chez les gouvernants thébains [FN: § 2439-1]. On vit de meilleurs résultats encore avec un plus grand écart entre les gouvernants et les gouvernés, dans le cas de Philippe de Macédoine et de ses sujets.
§ 2440. De même, au temps des guerres médiques, la science des combinaisons de Thémistocle avait fait ses preuves, unie à une certaine force de persistance des agrégats chez les Athéniens, lorsqu'il les engagea à abandonner leur cité et à se réfugier à Salamine. Avec un rapport inverse de ces résidus, l'épreuve fut mauvaise pour la combinaison par laquelle Nicias, chef des Athéniens, poussé par la force de la persistance des agrégats qui existait en lui, accorda créance aux oracles, et provoqua ainsi la ruine complète de l'armée qu'on lui avait confiée [FN: § 2440-1]. Les cas rappelés plus haut nous montrent par conséquent que les oracles sont utiles s'ils sont employés pour persuader les gouvernés, par des gouvernants qui n'y ont peut-être pas foi, et qu'ils sont nuisibles, s'ils sont tenus pour vrais par des gouvernants qui les considèrent comme un but, et non comme un moyen de persuasion. Si l'on veut généraliser cette proposition, et par conséquent l'étendre à des temps où n'existent pas des oracles, il faut substituer à ce terme d'oracle celui de persistance des agrégats (§ 2455). Ajoutons qu'il est avantageux que cette proposition soit ignorée des gens qu'on veut persuader, l'artifice devant être dissimulé pour être pleinement efficace. Mais, dans ce but, il est peu ou point nuisible qu'elle soit connue d'un nombre restreint de savants, l'expérience journalière montrant que les gens continuent à avoir foi en des assertions qui sont nettement contredites par les résultats connus de la science logico-expérimentale.
§ 2441. Philippe de Macédoine vécut dans sa jeunesse à Thèbes, et apprit d'Épaminondas l'art de la guerre [FN: § 2441-1] . S'il avait été citoyen de Sparte ou d'Athènes, il n'aurait pas pu faire grand'chose. Mais il eut à diriger un peuple chez lequel les préjugés étaient assez forts pour assurer l'obéissance au roi, et pas assez pour résister aux changements qu'il voulait introduire. La monarchie des rois macédoniens n'était pas absolue ; mais elle était beaucoup plus puissante que celle des rois spartiates. Si Épaminondas n'avait pas été tué à Mantinée, et avait encore vécu plusieurs années, il aurait peut-être pu s'opposer heureusement à la puissance naissante de Philippe. C'est là le rôle du hasard dans les événements humains. Il est certaines
§ 2442. À un autre extrême, Athènes eut en ce temps des généraux éminents. Elle ne sut ni les conserver ni s'en servir. Timothée et Iphicrate ne semblent avoir été en rien inférieurs à Philippe ; mais ils avaient le malheur d'avoir à faire avec le peuple athénien, entiché de nouveautés et de procès, incapable de cette sérieuse discipline que donne la persistance des agrégats. Un procès éloigna en même temps Timothée et Iphicrate, et laissa Athènes sans défense contre la puissance naissante et formidable de la Macédoine [FN: § 2442-1].
§2443. Là où les sentiments de la persistance des agrégats n'ont pas une grande force, les hommes cèdent facilement à l'impulsion présente, sans trop se soucier de l'avenir. Facilement entraînés par un appétit désordonné, ils oublient les grands intérêts de la collectivité. Les Macédoniens obéissaient en toutes choses à Philippe, puis à Alexandre. Les Thébains suivaient les prescriptions d'Épaminondas, mais lui intentèrent un procès, qu'il gagna d'ailleurs. Les Athéniens ne respectaient pas beaucoup leurs généraux ; ils les tracassaient, leur intentaient des procès, les condamnaient, se privaient d'eux par leur propre faute. Les leçons du passé ne profitaient pas à l'avenir, car les sentiments des agrégats ne duraient pas.
§2444. On observe des phénomènes analogues en comparant l'Allemagne à la France, depuis le temps du second Empire à nos jours (§ 2469 et sv.). Le premier de ces pays ressemble en quelque sorte à la Macédoine ou à Thèbes ; le second à Athènes. La force de la persistance des agrégats supplée au défaut de connaissances logico-expérimentales, en vertu desquelles les citoyens pourraient comprendre que l'utilité indirecte de l'individu est sacrifiée, quand on sacrifie au-delà d'une certaine limite l'utilité de la collectivité. Les citoyens qui préparent la défaite de Coronée, ou ceux qui préparent la capitulation de Sedan, provoquent leur propre dommage individuel.
§2445. Souvent on étudie ces phénomènes exclusivement par rapport à la forme démocratique, oligarchique, monarchique du gouvernement. Certaines personnes ont voulu rejeter la faute de tous les maux d'Athènes sur la démocratie athénienne. D'autres, au contraire, ont voulu innocenter celle-ci de ses péchés. On ne peut certes nier que les formes de gouvernement exercent une influence sur le phénomène social ; mais il faut observer d'abord qu'elles sont, au moins en partie, une conséquence de la mentalité des habitants, laquelle est de ce fait une cause beaucoup plus importante des phénomènes sociaux ; ensuite que, sous les mêmes formes de gouvernement, il peut se produire des phénomènes entièrement différents ; ce qui montre clairement l'existence de causes plus puissantes qui prévalent sur ces formes.
§2446. La forme monarchique a permis à Philippe de Macédoine, complètement défait par Onomarque, de conserver néanmoins le pouvoir et de prendre ensuite sa revanche. S'il avait été un général de la République athénienne, il aurait probablement été condamné à mort ; ce qui aurait pu empêcher la puissance macédonienne de naître. S'il avait été un général de la République thébaine, il aurait été destitué, comme il arriva à Épaminondas, et c'eût été encore un très grave dommage pour la Macédoine. On serait induit à conclure de là que, par la stabilité qu'elle donne au commandement, la forme monarchique est favorable à la prospérité du pays. Cela est vrai en de nombreux cas ; mais pas en d'autres. La stabilité est utile si le chef est bon, comme un Épaminondas ou un Philippe ; il n'y a là-dessus aucun doute. Elle est utile aussi si le chef est médiocre, parce que le dommage du changement peut dépasser de beaucoup l'utilité d'ôter le commandement à qui est peu capable ; mais elle est certainement nuisible si elle conserve le pouvoir à un chef absolument mauvais, comme furent un grand nombre d'empereurs romains [FN: § 2446-1]. En outre, on observera que la conduite des Athéniens et des Thébains n'était nullement une conséquence nécessaire de la forme républicaine, car celle-ci existait aussi à Rome, lorsque après la défaite de Cannes, tous les ordres de l'État allèrent à la rencontre du consul vaincu pour le remercier de n'avoir pas désespéré des destins de Rome [FN: § 2446-2] . Il n'est pas du tout démontré que toutes les républiques doivent prêter attention à des hommes tels qu'un Cléon d'Athènes, un Ménéclide de Thèbes, ou un Caillaux de la république française contemporaine.
§ 2447. Parlant de l'état de la Prusse avant la bataille de Iéna, von der Goltz dit [FN: § 2447-1]: « “ (p. 396) En France, l'autorité civile donne toujours la main à l'armée, tandis qu'en Allemagne, l'esprit qui domine, aussi bien dans le gouvernement que dans le peuple, est de mettre toujours des obstacles dans le chemin de l'autorité militaire „ [Maintenant les termes sont intervertis : ce qu'on disait de l'Allemagne s'applique à la France, et vice-versa]. Tel était le résumé de l'opinion de Sharnhorst, et il ajoutait : “C'est pourquoi on a dit, non sans raison : Les Français, avec un gouvernement républicain, sont régis monarchiquement, tandis que les puissances alliées, avec un gouvernement monarchique, sont régies comme si elles étaient en république ” ».
§2448. Lorsque les gouvernants eurent les sentiments manifestés par l'affaire Dreyfus, la République française négligea grandement la défense nationale. Mais l'Empire l'avait négligée à peu près tout autant. En revanche, la République conservatrice, après 1871, l'avait mise au premier plan de ses préoccupations. Il est donc impossible de trouver en ce cas un rapport entre la forme du gouvernement et les mesures prises pour la défense nationale.
§2449. Comme nous l'avons dit souvent déjà, les faits du passé et ceux du présent se prêtent un mutuel appui dans la recherche des uniformités sociales. Les faits du présent, plus connus dans leurs détails, nous permettent de mieux comprendre ceux du passé. Les faits du passé, lorsqu'ils ressemblent à ceux du présent, sous certains rapports, servent à préparer l'induction qui donnera à ces rapports la valeur d'uniformités.
§ 2450. Par exemple, si l'on veut bien comprendre ce qui se passait dans l'Athènes antique, on doit considérer ce qui est arrivé en France depuis le temps du ministère Waldeck-Rousseau. Les désastres français de la guerre de 1870 eurent des causes puissantes dans le fait que les considérations politiques étaient substituées aux considérations militaires. Politiques furent les motifs de la marche sur Sedan ; politiques, les motifs de l'inaction de Bazaine à Metz. Il semblerait qu'un peuple qui a reçu ces terribles leçons devrait désormais bannir la politique des questions militaires. Au contraire, voici Waldeck-Rousseau, qui peut aller de pair avec les pires démagogues athéniens, occupé à désorganiser toute l'armée pour des raisons politiques [FN: § 2450-1]. Afin d’accomplir l'œuvre néfaste à son pays, il fait mettre au ministère de la guerre le général André. Celui-ci employait son temps en basses intrigues politiques, négligeant entièrement la défense nationale, à tel point que, lorsqu'en 1905 on craignit la guerre avec l'Allemagne, il fallut d'urgence pourvoir au strict nécessaire pour la défense de la frontière du nord-est, que le général André avait volontairement négligée, dans le but de complaire à ses complices politiciens.
§ 2451. Ce n'est pas tout. En France comme à Athènes, les mêmes erreurs se reproduisirent, parce que si les causes subsistent, les effets subsistent aussi. En 1911, une nouvelle menace de guerre fit voir aux gouvernants français que le général Michel, auquel on avait confié le commandement suprême pour des raisons politiques, aurait été incapable de l'exercer [FN: § 2451-1] . Son mérite était principalement sa complaisance envers les politiciens. Un colonel Picquart avait été nommé général pour services rendus dans le procès Dreyfus. Aux manœuvres de 1910, il paraît qu'il ne fut pas très brillant. Afin de ne pas dire cela, ce qui eût déplu aux politiciens, le général Michel, contrairement à l'usage jusqu'alors suivi, ne fit pas immédiatement la critique des manœuvres, gagna du temps, et la fit ensuite aussi atténuée que possible.
§ 2452. Lorsque, sous la menace d'une guerre, on dut remplacer le général Michel par un autre, chacun reconnaissait qu'en fait de mérites militaires, on devait faire appel au général Pau. Mais, pour assumer le commandement, ce général posait comme condition qu'il aurait une part prépondérante à la nomination des généraux de corps, et que ceux-ci seraient choisis uniquement pour leurs mérites militaires, sans considérer les protections des politiciens. Cette condition ne put être acceptée par le gouvernement, qui chercha un autre commandant, plus souple à la politique [FN: § 2452-1].
§ 2453. Qu'on veuille lire maintenant ce qu'Isocrate écrit des causes qui provoquèrent la condamnation de Timothée, à Athènes, et l'on verra que ce sont là des causes et des effets constants. Isocrate rapporte qu'il avertit Timothée : « Tu vois la mentalité de la foule, comme elle recherche le plaisir, et préfère par conséquent ceux qui recherchent ses bonnes grâces, plutôt que ceux qui agissent bien ; ceux qui la trompent aimablement et gentiment, plutôt que ceux qui lui sont utiles gravement et avec autorité [FN: § 2453-1]». Il continue et lui conseille d'agir de manière à se concilier la bienveillance des politiciens. Timothée répondit que ces conseils étaient sages, mais qu'il ne pouvait changer son tempérament et se ravaler au niveau de ceux qui ne supportent pas des hommes de qualités supérieures aux leurs. En somme, il ne savait pas se résigner au « culte de l'incompétence », dont Faguet a aujourd'hui si bien parlé.
§ 2454. On trouve des observations semblables à celles d'Isocrate chez beaucoup d'auteurs. Elles affectent souvent la forme inutile et fausse de prédications morales, ou celle, tout aussi inutile et fausse, d'accusations contre certaines formes de gouvernement (§ 2261). Ce n'était pas – comme certains le prétendent – le régime démocratique d'Athènes qui était la cause des vices indiqués plus haut. Régime et vices étaient une conséquence des sentiments des Athéniens et de toutes les circonstances qui les entouraient [FN: § 2454-1]. Les comparaisons établies entre divers peuples ou divers temps et circonstances dans lesquels on considère un même peuple, servent à mettre en lumière les effets des forces permanentes, en les séparant des effets des forces contingentes. Les principaux de ces derniers effets sont ceux qui dépendent du tempérament des hommes auxquels la fortune donne le pouvoir dans l'État [FN: § 2454-2] . C'est pourquoi nous avons exposé un peu longuement le cas de la France, qui nous fournit trois exemples très remarquables. Tout d'abord, c'est l'Empire qui néglige la défense nationale, qui n'ose pas imposer au pays les sacrifices qu'elle eût nécessités. Ensuite, c'est la République qui, aussitôt après la guerre de 1870, impose ces sacrifices, que le pays accepte allègrement. Enfin, c'est la République, après 1900, qui n'ose pas, qui ne peut pas imposer des sacrifices au pays. Si l'on veut comparer cette République-là uniquement à la République conservatrice antérieure, on peut rejeter la faute sur l’extension de la démocratie. Mais cette déduction ne se soutient plus, si l'on étend la comparaison à l'Empire qui, sans être démocratique, a agi comme la République démocratique. De même, si l'on ne compare que l'Empire et la République conservatrice, on peut, comme beaucoup l'ont fait, rejeter la faute des désastres de la guerre exclusivement sur le pouvoir personnel de l'empereur. Mais cette conclusion ne peut subsister si l'on établit la comparaison entre l'Empire et la République démocratique, dans laquelle il n'est pas question du pouvoir personnel de l'empereur, tandis que subsiste l'insuffisance de préparation qui amena la défaite de 1870. Au contraire, les phénomènes s'expliquent très facilement si l'on prête attention à la force des résidus de la IIe classe. Là où ces résidus sont puissants et maintenus tels par un gouvernement avisé, qui sait s'en servir, la population accepte volontiers le fardeau de la préparation à la guerre. Là où ils sont, au contraire, faibles ou affaiblis par un gouvernement qui s'occupe seulement de certains intérêts matériels sans jeter un regard vers l'avenir, la population refuse le fardeau de la défense nationale [FN: § 2454-3]. Si l'on étudie attentivement l'histoire, on voit que les avertissements de quitter la mauvaise voie ont bien rarement fait défaut aux peuples qui s'acheminaient à la défaite et à la ruine ; et peu nombreux, très peu nombreux furent les gouvernements assez imprévoyants pour ne pas entrevoir la débâcle. Donc la force nécessaire à pousser les peuples à pourvoir à leur défense existait ; mais elle agissait plus ou moins efficacement selon son intensité. Celle-ci dépendait surtout de l'intensité des résidus de la IIe classe chez les gouvernants, et rencontrait une résistance plus ou moins grande, suivant que, chez les gouvernés, l'intensité de ces mêmes résidus était plus ou moins grande. Le peuple romain vainquit les peuples grec et carthaginois, surtout parce qu'il possédait plus intenses les sentiments de persistance des agrégats, connus sous le nom d'amour de la patrie, et d'autres sentiments qui soutiennent et renforcent celui-là. Cependant, ces gouvernants possédaient en abondance des résidus de la Ie classe, grâce auxquels ils pouvaient utiliser convenablement les résidus de la IIe classe qui existaient chez les gouvernés.
§ 2455. Même si l'on considère des collectivités restreintes ou un petit nombre d'hommes, on voit l'utilité de certaines combinaisons des résidus de la Ie classe et de ceux de la IIe. Par exemple, c'est peut-être l'union de Bismarck avec Guillaume Ier qui leur a permis d'accomplir de grandes choses. Une anecdote bien connue, racontée par Bismarck, nous montre clairement comment les « préjugés » (persistance des agrégats) de Guillaume Ier sauvèrent la monarchie prussienne. En 1862, le conflit entre le roi de Prusse et son parlement était devenu aigu. Le roi revenait découragé, de Baden à Berlin, et Bismarck alla à sa rencontre pour le persuader ; il dit [FN: § 2455-1]: « (p. 358) Encore sous l'impression de l'entrevue avec sa femme, il était visiblement déprimé, et lorsque je lui demandai la permission de lui exposer ce qui s'était passé pendant son absence, il m'interrompit en disant : “ Je prévois parfaitement comment tout cela finira. Là-bas, place de l'Opéra, sous mes fenêtres, on vous coupera la tête à vous, et un peu plus tard, à moi ”. Je devinai, comme cela me fut plus tard confirmé par des témoins, que pendant les huit jours de son séjour à Baden on l'avait travaillé avec des variations sur le thème Polignac, Strafford, Louis XVI. Lorsqu'il se tut, je répondis ce simple mot : “ Et après, Sire? ” – “ Eh bien, après, mais nous serons morts ! ” répliqua le roi. “ Oui, repris-je, après nous serons morts, mais il nous faut bien mourir tôt on tard, et pouvons-nous périr d'une manière plus digne ?... (p. 359) Votre Majesté est dans la nécessité de lutter. Vous ne pouvez pas capituler, vous devez vous opposer à la violence qui vous est faite, dût votre personne être en danger ”. Plus je parlais dans ce sens, plus le roi s'animait et entrait d'esprit dans le rôle de l'officier combattant pour la monarchie et la patrie. [Persistance des agrégats. – Résidus de la IIe classe.] Devant les dangers “ extérieurs ” et personnels, sur le champ de bataille comme dans un attentat, il était d'une intrépidité rare et qui chez lui était naturelle... Il offrait, développé au plus haut degré, le type idéal de l'officier prussien : dans le service, il marche à une mort certaine, sans regrets, sans crainte, avec le simple mot : “ Oui, mon, commandant ” ; par contre, quand il doit agir sous sa propre responsabilité, il redoute les critiques de son supérieur et du monde plus que la mort [absence des résidus de la première classe. Mais Bismarck avait ce qui manquait à Guillaume Ier.] ... Maintenant..., l'effet de notre conversation dans le (p. 360) compartiment mal éclairé fut qu'il envisagea le rôle que lui créait la situation plutôt au point de vue de l'officier. Il redevenait avant tout militaire et envisageait sa situation comme étant celle d'un officier chargé de défendre jusqu'à la mort le poste qui lui est assigné, advienne que pourra ». Si Charles X, Louis-Philippe, Mac Mahon, en France, avaient pensé et agi de la sorte, ils n'auraient pas si facilement perdu le pouvoir.
§2456. En 1859, la guerre d'Italie avait montré, d'une part aux gouvernants de la Prusse, d'autre part à ceux de la France, l'urgente nécessité de perfectionner leur organisation militaire. Des deux côtés l'on s'y mit, mais avec des résultats bien différents. Le roi Guillaume avait, dans son État, un pouvoir beaucoup moins grand, et rencontrait une opposition beaucoup plus forte que Napoléon III en France. Pourtant, Guillaume atteignit pleinement son but et Napoléon ne réussit pas. Pourquoi ? Tout en soutenant la thèse erronée d'après laquelle la France était parfaitement préparée à la guerre, en 1870, Émile Ollivier admet, en contradiction avec sa propre thèse, que la préparation ne put être achevée ni en 1860, ni en 1867 (§ 2461).
§ 2457. Nous avons déjà cité (§ 1975-3) ce qu'il dit au sujet de la préparation après 1860, et nous avons examiné ses deux affirmations concernant la corrélation existant entre les bonnes œuvres et la félicité. Voyons maintenant les faits qu'il rapporte à propos des résidus de la Ie et de la IIe classe, chez les gouvernants et les gouvernés. Bien que différents en apparence, en somme, les deux aspects concordent en grande partie, car l'adoption des principes éthiques employés par Ollivier dépend précisément de ces résidus de la IIe classe, lesquels peuvent être nuisibles ou avantageux, suivant qu'ils existent surtout chez les gouvernants ou surtout chez les gouvernés.
§ 2458. Napoléon III apparaît dans l'histoire sous deux aspects principaux : celui du chef inconscient d'une coterie de spéculateurs (§ 2463-1, 24651) qui s'en servirent comme d'un instrument, et celui d'un brave et digne homme chez lequel prédominaient les résidus de la IIe classe [FN: § 2458-1] (§ 1975). Ce ne fut pas pour lui un petit avantage que son gouvernement commençât et se continuât dans une période de prospérité économique croissante (§ 2302).
§ 2459. L'idée maîtresse de l'histoire d'Ollivier consiste à opposer un souverain brave, honnête, moral (Napoléon III) à un autre, méchant, pervers, cruel (Guillaume Ier). L'auteur est tellement pénétré de la conception éthique, qu'il ne s'aperçoit pas que ses louanges constituent les pires accusations qu'on puisse porter contre le souverain qu'il veut défendre, et qui finit par apparaître imprévoyant et incapable. S'il a été tel que le dépeint Ollivier, il s'est montré peut-être un parfait honnête homme, mais certainement aussi un non moins parfait imbécile (§ 1975). S'il ne comprenait pas quels événements se préparaient en Allemagne, c'est qu'il ne comprenait vraiment rien. On se prend à rire en songeant à ce rêveur, qui suppose que la « suprématie morale » peut exister sans la suprématie de la force. Si plus tard, lorsqu'il se rencontra avec Bismarck, Napoléon lui avait demandé ce qu'il pensait de cette stupéfiante conception, Bismarck aurait eu un moment de véritable gaieté.
§2460. Mais quelles qu'aient été les causes d'inertie de l'empereur, l'explication donnée par Ollivier pourrait être bonne, et nous devons l'examiner. Tout ce que nous connaissons de la mentalité de ce rêveur humanitaire que fut Napoléon III, montre qu'il y a un peu de vrai dans la cause alléguée par Ollivier. Mais on ne peut la considérer comme unique ni même comme principale, car, lorsqu'elle vint à disparaître, le même effet se manifesta encore.
§ 2461. Ollivier lui-même nous en donne la preuve. En 1867, tout le monde prévoit la possibilité d'une guerre [FN: § 2461-1] . Le rêve puéril de la « suprématie morale » semblait s'être évanoui, et Napoléon III institua [FN: § 2461-2]« une (p. 318) Haute commission composée des personnages éminents de son gouvernement dans tous les ordres, et la chargea de rechercher ce qu'il y aurait à faire pour mettre nos forces nationales en situation d'assurer la défense du territoire et le maintien de notre influence politique ». Le maréchal Niel prépara un projet de loi pour renforcer l'armée. Le Corps Législatif nomma une commission opposée aux sacrifices qu'on demandait au pays. L'empereur résista et fit même menacer de dissolution le Corps Législatif. Mais la commission tint bon. « (p. 347) L'Empereur pensa d'abord à relever le défi qu'on lui jetait et à recommencer en France la lutte du roi Guillaume contre son Parlement. Rouher déploya à l'en détourner autant de véhémence qu'il en avait mis à intimider la Commission... Le maréchal Niel fléchit à son tour... „ Il eût mieux valu obtenir davantage, mais ce qu'on aurait serait suffisant. “ Et sans même prendre les ordres de (p. 348) l'Empereur, il entra en pourparlers avec la Commission et lui concéda que toute la classe ne serait pas incorporée, et qu'un contingent annuel serait fixé par la Chambre. L’Empereur fut douloureusement surpris de cette concession de son ministre. Quand on vint la lui apprendre, il laissa tomber sa tête entre ses mains et demeura quelques instants accablé. Abandonné par tous, il n'avait plus qu'à se résigner lui aussi [FN: § 2461-3]».
§ 2462. Ici nous sommes sur la voie de l'explication réelle. Guillaume Ier était entouré d'hommes tels que Roon, Moltke, Bismarck. Napoléon était entouré d'hommes tels que Randon, Niel, Rouher. Ce n'est pas tout. Il faut élargir encore le cercle des gouvernants. En Prusse, une monarchie héréditaire s'appuie sur une noblesse fidèle : les résidus de la IIe classe prédominent. En France, un aventurier couronné s'appuie sur une coterie de spéculateurs et de jouisseurs : les résidus de la le classe prédominent.
§2463. En France, les gens de l'opposition démocratique ne valaient pas mieux que les partisans de l'autorité impériale. Sous des formes différentes, une seule conception apparaissait : « Nous voulons nous enrichir, jouir ; nous ne voulons pas faire de sacrifices [FN: § 2463-1] ». Ici, nous voyons de nouveau les effets de la faiblesse des résidus de la IIe classe, qui sont parmi les forces les plus capables de déterminer les hommes au sacrifice. De nouveau, nous constatons ce défaut lorsqu'un gouvernement radical-socialiste accorda à ses fidèles la réduction à deux ans du service militaire ; puis quand, en 1913, une forte opposition se manifesta contre le projet de le ramener à trois ans ; ce qui était absolument indispensable en présence de l'accroissement formidable de l'armée allemande ; et quand, enfin, le ministre Barthou fut renversé au cri de : « À bas la loi des trois ans ! », loi que le ministre Vaillant eut du moins le courage de promulguer, tout en faisant le contraire de ce qu'il disait.
§ 2464. Sans beaucoup de succès, le maréchal Niel suppliait les élus de la majorité de faire quelque sacrifice pour l'armée. Il disait : « [FN: § 2464-1](p. 565) Si vous me faites exagérer le nombre des hommes en congé, nous aurons des régiments sans effectifs suffisants, les officiers découragés, les sergents et les caporaux partis. Le système nouveau paraîtra détestable, vous l'aurez fait échouer alors qu'il doit triompher ».
§ 2465. La Prusse offre un tout autre spectacle. Stoffel en fut frappé. Il avertit, mais en vain, son gouvernement de se tenir sur ses gardes. En France, l'armée était soumise à la finance [FN: § 2465-1], en Prusse la finance à l'armée. Non pas que les résistances fissent défaut en Prusse ; elles y furent, au contraire, très vives, mais purent être vaincues grâce aux traditions et aux préjugés d'une population jusqu'alors très peu industrielle, peu commerçante, peu spéculatrice. Entre la Prusse et la France, avant 1870, des rapports analogues à ceux qui existaient entre la Macédoine et Athènes, aux temps de Philippe, ne font pas défaut. « (p. 101) Les personnes des plus riches familles, tous les noms illustres servent comme officiers, endurent les travaux et les exigences de la vie militaire, prêchent d'exemple, et, à la vue d'un tel spectacle, non seulement on se sent pris d’estime pour ce peuple sérieux et rude, mais on en vient presque à redouter la force que donnent à son armée de pareilles institutions ». Et en note : « J'ai déjà dit qu'en Prusse tous les honneurs, tous les avantages, toutes les faveurs sont pour l'armée ou ceux qui ont servi. Celui qui pour une cause quelconque n'a pas été soldat n'arrive à aucun emploi ; dans les villes et les campagnes, il est l'objet des sarcasmes de ses concitoyens [FN: § 2465-2]». Au contraire, en France, même après la terrible leçon de 1870, l'armée demeure subordonnée aux politiciens. De même que Machiavel prenait la partie pour le tout en parlant de la religion là où il faut entendre les résidus de la IIe classe, de même Stoffel parle de la morale, là où nous devons entendre ces mêmes résidus. « (p. 103) Je dois encore signaler une qualité qui caractérise tout particulièrement la nation prussienne, et (p. 104) qui contribue à accroître la valeur morale de son armée : c'est le sentiment du devoir. Il est développé à un tel degré dans toutes les classes du pays, qu'on ne cesse de s'en étonner quand on étudie le peuple prussien. N'ayant pas à rechercher ici les causes de ce fait, je me borne à le citer. La preuve la plus remarquable de cet attachement au devoir est fournie par le personnel des employés de tout grade des diverses administrations de la monarchie : payés avec une parcimonie vraiment surprenante, chargés de famille le plus souvent, les hommes qui composent ce personnel travaillent tout le jour avec un zèle infatigable, sans se plaindre, ou sans paraître ambitionner une position plus aisée. “ Nous nous gardons bien d'y toucher, me disait ces jours derniers M. de Bismarck ; cette bureaucratie travailleuse et mal payée nous fait le meilleur de notre besogne et constitue une de nos principales forces” ». On observait quelque chose de semblable au Piémont avant 1859, et ce ne fut pas la dernière cause des succès de ce pays.
§ 2466. Mais tout cela est impossible là où les résidus de la Ire classe prédominent grandement, où la spéculation, l'industrie, la banque, le commerce accaparent tous les hommes intelligents et travailleurs. Avant 1870, la Prusse était pauvre et forte. Aujourd'hui, elle est certainement plus riche ; mais il se peut aussi qu'elle soit plus faible, si, dans la classe gouvernée, l'augmentation de la persistance des agrégats, manifestée par le pangermanisme et par d'autres phénomènes analogues, n'a pas compensé l'augmentation de l'instinct des combinaisons ; et vice-versa si, dans la classe gouvernante, elle l'a plus que compensée [FN: § 2466-1]. Quant à la France, elle ressemble aujourd'hui à ce qu'elle était avant 1870. Si les résidus de la Ire classe ne s'y sont pas accrus, il est certain qu'ils n'ont pas diminué. Mais les résidus de la IIe classe se sont aussi accrus chez les gouvernés. Ils se manifestent par la nouvelle efflorescence de la religion de la métaphysique, et par l'intensification du nationalisme. Nous demeurons par conséquent dans le doute au sujet du sens suivant lequel peut avoir varié la proportion entre les résidus de la IIe classe et ceux de la Ire.
§ 2467. Prenons garde d'ailleurs qu'il s'agit toujours de plus ou de moins dans la proportion entre la persistance des agrégats et l'instinct des combinaisons, non seulement dans la classe gouvernée, mais aussi dans la classe gouvernante, et que le maximum de pouvoir politique et militaire ne se trouve ni à l'un des extrêmes ni à l'autre. Par exemple, avant 1866, le Hanovre s'était complètement endormi, et, satisfait de son état de tranquillité, il ne se préparait nullement aux éventualités qui pouvaient surgir. Dans un de ses discours, Bismarck disait à ce propos [FN: § 2467-1]: « M. le député de Vincke a prétendu avec une apparence de raison que les Hanovriens, comme le dit le proverbe français, avaient mangé leur pain blanc le premier, qu'ils n'avaient eu pendant longtemps nul souci de la défense du pays, et que, s'ils eussent agi comme ils le devaient, ils n'auraient pas fait ces économies. Certes, Messieurs, une mauvaise organisation de la défense nationale porte en soi son châtiment. Pour avoir négligé cette défense le Hanovre a perdu son autonomie, et le même sort attend tous les États qui négligeront leur défense ; c'est ainsi que cela se paye ».
§2468. L'exemple du Hanovre nous enseigne que la cause des différences observées en 1870, entre la France et la Prusse, n'est pas la différence existant entre les races latines et germaniques. Il y a plus. La même Prusse fut vaincue dans la campagne de Iéna pour des causes analogues, au moins en partie, à celles qui provoquèrent la défaite de la France en 1870.
§ 2469. Écoutons ce que dit von der Goltz [FN: § 2469-1] , et nous verrons qu'en nombre de passages, il suffit d'intervertir les termes Prusse et France, pour avoir une description des événements de 1870 : « (p. 306) ...dans ces campagnes [du Rhin] la Prusse n'avait mis sur pied qu'une partie de ses forces, parce que, comme dit Clausewitz, “ elle voulait observer les règles d'une sage prudence ”. Elle se consolait en pensant que si elle voulait mettre en jeu tous ses moyens dans une campagne sérieuse, elle triompherait facilement de la France nouvelle ». Avant 1870, la France avait les informations de Stoffel, et les négligea. Avant Iéna, le gouvernement prussien eut de semblables informations, et les négligea également. « (325) Les relations avec les armées françaises ont donc toujours existé ; on ne manqua jamais d'occasions d'étudier ces armées, pas plus que de rapports officiels sur leur manière d'être. Le ministre von Alvensleben s'était prononcé, dès le 12 mai 1798, dans un mémoire très remarquable, sur la situation de la Prusse. “ Pour combattre avec avantage les Français, il faut adopter leurs coutumes et leurs méthodes, sans lesquelles nous serons toujours dans un état d'infériorité.Pour se procurer ces ressources, il faut, comme en France, piller tout le pays avant de commencer. Pour se procurer des recrues, il faut mettre en réquisition toutes les provinces... “ Alvensleben n'ignorait pas ce que la mesure proposée avait de radical. Il craignait même que son adoption n'amenât une révolution, et ne trouvait malheureuse ment, comme moyen terme, que de recommander l'alliance avec la France » [FN: § 2469-2] .
§ 2470. Au lieu de Napoléon, mettez Bismarck, au lieu de la Prusse, mettez la France, et vous aurez, décrits par von der Goltz, les faits diplomatiques qui précédèrent la guerre de 1870. « (p. 337) Napoléon avait complètement joué la Prusse. Mais ce ne furent pas seulement les hommes d'État qui se laissèrent tromper : il y eut dans la nation beaucoup de gens qui prirent pour argent comptant l'assurance donnée, en août 1806, par le Journal de Paris : “ La France et la Prusse sont liées par la plus étroite amitié. ” Ce qui nous surprend le plus, c'est que dans ces jours où le danger d'une guerre était de tous les instants, on philosophait en Allemagne, non seulement sur l'abolition des armées permanentes, mais aussi sur la possibilité de la paix universelle, qu'on regardait comme prochaine. “ Jamais, par le concours des circonstances, une époque n'a été plus propice pour réaliser cette grande idée, qui fera le bonheur de l'humanité, ” déclarait un savant dans les nouvelles de Berlin, du 9 mai 1805... (p. 338) L'erreur des diplomates fut par suite l'erreur de beaucoup d'autres. Plus le danger augmentait, plus les esprits s'endormaient avec confiance dans la sécurité ». Exactement comme la France [FN: § 2470-1] , lorsqu'à la veille de la guerre de 1870, ses politiciens se rendaient aux congrès de la Paix pour proclamer la paix universelle ; ou quand, à la veille du coup d'Agadir, leurs successeurs répétaient les mêmes sottises (§ 2454-2).
§ 2471. Le crédit qu'acquièrent à de certains moments les dérivations humanitaires est d'habitude un signe de l'affaiblissement des résidus de la IIe et de la Ve classe, qui tendent à la conservation de l'individu et de la collectivité. Les beaux parleurs s'imaginent que leurs déclamations peuvent être substituées aux sentiments et aux actes qui maintiennent l'équilibre social et politique.
§ 2472. Continuons à voir chez notre auteur comment les mêmes causes produisent les mêmes effets. De même que la France en 1866, « (p. 339) pendant l'année 1805, la Prusse eut, pour agir, une occasion telle qu'il ne s'en était pas présenté de plus favorable depuis 1740... (p. 340) Il n'y avait qu'un pas à faire. Comme on jugerait différemment aujourd'hui cette armée tant conspuée pour sa défaite d'Iéna et d'Auerstaedt, si la politique avait fait ce pas... (p. 341) Tandis que l'opinion publique se réjouissait du maintien de la paix, tandis que les esprits éclairés considéraient la politique d'hésitation comme la plus haute sagesse... (p. 375) La pensée dominante des deux hommes d'État dirigeants, Hardenberg et Haugwitz, qui croyaient tirer un profit de la grande crise sans tirer l'épée [semblablement Napoléon III, en 1866] était une chimère incompréhensible, étant donné la manière de faire de Napoléon [de Bismarck]. Chercher à obtenir une part du butin, sans avoir la résolution formelle de la conquérir sur l'adversaire, n'est ni honorable ni prudent. “ Une politique qui pêche volontiers en eau trouble, est dangereuse ; elle n'est bonne que lorsqu'elle est intimement liée à beaucoup d'audace et de force, car il n'est pas de puissance qui nous permettra de la jouer impunément si nous ne lui inspirons de la crainte ” [c'est exactement ce que dit Machiavel, et ce que Napoléon III oublia en 1866 (§ 1075-3). Donc, lorsque, le 24 janvier 1806, la majeure partie de l'armée fut mise sur le pied de paix alors que Napoléon maintenait, dans l'Allemagne du Sud, ses forces sur le pied de guerre, la Prusse se livra à la merci de l'ennemi, qu'elle venait d'aigrir et de rendre défiant par le bruit de ses armes. Puis, au mois d'août 1806, elle se décida à faire la guerre, alors qu'il était impossible de se dissimuler les desseins de Napoléon [de Bismarck en 1870.] Cette résolution fut dictée par la crainte d'une attaque et put être justifiée comme un acte de désespoir. Mais le moment était complètement défavorable [exactement comme pour la France, en 1870]... Après des fautes si graves, il était difficile de compter sur une guerre heureuse... (p. 377) Cette politique, cette direction supérieure, la composition malheureuse du quartier général, l'infériorité numérique des troupes, furent les principales causes extérieures de la catastrophe ». On peut répéter les mêmes choses de la France en 1870. Il est inutile qu'Ollivier tente de rejeter la faute sur les généraux. Ils ont peut-être agi mal, très mal ; mais s'ils avaient été sous les ordres d'un Moltke et d'un Guillaume Ier, s'ils s'étaient trouvés dans d'autres conditions politiques, ils auraient agi aussi bien que leurs adversaires.
§ 2473. Bon nombre de personnes croient que l'humanitarisme est un produit de la démocratie. Elles se trompent : il peut exister dans un État monarchique ou aristocratique, aussi bien que dans un État républicain ou démocratique. Il ne faut pas confondre la démocratie de fait avec la démocratie idéale des humanitaires, de même qu'il ne faut pas
§ 2174. Continuons à écouter notre auteur : (p. 391) L'armée était anxieusement surveillée afin de l'empêcher de donner des signes de mécontentement. Quelque tranquille qu'on fût en Prusse, et bien que la confiance dans l'armée ne fût nullement ébranlée, les classes dirigeantes n'étaient pas exemptes d'une secrète peur de révolution ». Donc, dans la Prusse monarchique semi-féodale de 1800, il se produisait les mêmes phénomènes que dans la France républicaine, démocratique, de 1900. Ce qui suit confirme cette déduction. « (p. 391) Möllendorf ne cessait de recommander aux postes et aux sentinelles, lorsqu'il s'agissait de dissiper les rassemblements, et en général dans le cas où ils avaient à rétablir l'ordre, d'agir toujours avec patience et ménagement et de n'avoir recours à une rigueur modérée que lorsque les moyens de conciliation étaient impuissants [FN: § 2174-1] . On ne devait pas exciter les bourgeois à des offenses par paroles ou actions, ou à la résistance, ni même leur en fournir l'occasion. Il était absolument défendu de maltraiter un tapageur arrêté ; on devait au contraire le traiter convenablement ». Ce sont là des dogmes de nos humanitaires modernes. « (p. 392) Funk raconte en outre ce qui suit dans son journal (p. 393) “ La Saxe avait joui de près de trente années de paix et d'une administration dans laquelle l'élément militaire était tenu à l'écart presque partout. Les baillis et bourgmestres regardaient fièrement, du haut de leur grandeur, les officiers supérieurs, certains que ceux-ci, en cas de conflits, seraient condamnés par toutes les instances ”. Ce qui est dit ici pour la Saxe s'applique également à la Prusse, bien qu'à un degré moindre ». C'est ce qui se passait, en 1913, en France et en Italie, avant la guerre de Libye.
§ 2475. L'auteur cite une poésie de 1807, où il est dit : « (p. 401) “Jadis la plus grande gloire d'un héros consistait à mourir en combattant pour la patrie et son roi. Mais depuis que le monde et les hommes cultivent la civilisation et la philosophie, on appelle combattre jusqu'à la mort « organiser l'assassinat ”. De sorte que la civilisation nous amène à ménager même le sang de l'ennemi ». C'est exactement ce que disent aujourd'hui nos humanitaires. L'auteur conclut : « (p. 401) Il est donc incontestable que l'esprit de l'époque fut la principale cause de la faiblesse intérieure de l'armée prussienne ».
§ 2476. Il est important de remarquer que cette conclusion d'un homme pratique concorde parfaitement avec celle de notre théorie, laquelle fait dépendre les phénomènes sociaux surtout des sentiments (résidus). L'exemple rappelé plus haut fait voir une fois de plus que les dommages sont semblables, malgré la diversité des peuples, lorsqu'il y a un excès de résidus de la Ie classe (la Prusse en 1800, la France en 1870). En s'éloignant, d'un côté ou de l'autre, de la proportion qui correspond au maximum d'utilité, on trouve également des États qui subissent des dommages pour cette cause.
§2477. Après l'équilibre des nations, voyons l'équilibre des divers états sociaux. Autrement dit, étudions des exemples de la circulation des élites. Il convient de commencer par une étude de mouvements virtuels, en recherchant comment la classe gouvernante peut se défendre, par l'élimination des individus capables de la déposséder (§ 2192, 1838). Les moyens d'éliminer les individus possédant des qualités supérieures et capables de nuire à la domination de la classe gouvernante sont succinctement les suivants.
§ 2478. 1° La mort. C'est le moyen le plus sûr, mais aussi le plus préjudiciable pour l'élite. Aucune race, aussi bien d'hommes que d'animaux, ne peut supporter longtemps un tel triage et la destruction de ses meilleurs individus. Ce moyen fut très en usage dans les familles régnantes, surtout en Orient. Celui qui montait sur le trône faisait disparaître ceux de ses proches qui auraient pu prétendre au pouvoir. L'aristocratie vénitienne fit aussi assez souvent usage de la mort pour prévenir ou réprimer les desseins de ceux qui voulaient changer les institutions de l'État, ou simplement pour éliminer le citoyen devenu trop influent par sa force, ses vertus ou son génie.
§2479. 2° Les persécutions qui ne vont pas jusqu'à la peine capitale : la prison, la ruine financière, l'éloignement des fonctions publiques. Le moyen est très peu efficace. On a ainsi des martyrs, souvent beaucoup plus dangereux que si on les avait laissés tranquilles. Ce moyen profite peu ou point à la classe gouvernante ; mais il n'est pas très nuisible à l'élite, considérée dans l'ensemble de la classe gouvernante et de la classe gouvernée. Parfois même il peut être avantageux, parce que, dans cette dernière classe, la persécution exalte les qualités d'énergie et de caractère, lesquelles souvent font précisément défaut dans les élites qui vieillissent ; et la partie persécutée peut finir par prendre la place de la classe gouvernante.
§ 2480. L'effet noté plus haut dans les conflits entre deux parties de l'élite est un cas particulier d'un effet beaucoup plus général, qu'on observe très souvent dans les conflits entre la classe gouvernante et la classe gouvernée. On peut dire que la résistance de la classe gouvernante est efficace uniquement si celle-ci est disposée à la pousser à l'extrême, sans tergiversations, en usant de la force et des armes, lorsque c'est nécessaire [FN: § 2480-1] ; autrement non seulement elle est inefficace, mais encore elle peut être utile, parfois très utile aux adversaires. Le meilleur exemple est celui de la révolution française de 1789, dans laquelle la résistance du pouvoir royal durait tant qu'elle était utile pour accroître la force des adversaires, et cessait précisément lorsqu'elle aurait pu les vaincre. On trouve d'autres exemples moins importants dans d'autres révolutions, en France ou ailleurs. On en trouve aussi lors des petits bouleversements qui ont lieu de temps en temps dans les pays civilisés. En 1913 et en 1914, le gouvernement anglais, par son procédé de mettre en prison les suffragettes et de les remettre en liberté aussitôt qu'il leur plaisait de jeûner [FN: § 2480-2] , a résolu le problème de trouver une forme de résistance présentant le minimum d'efficacité en faveur du gouvernement, le maximum en faveur de ses adversaires. En Italie, les « grèves générales » et les émeutes plus ou moins révolutionnaires qui troublent la paix du pays sont dues en grande partie à ce que le gouvernement résiste à ses adversaires juste assez pour exciter leur colère [FN: § 2480-3], assurer leur union, provoquer leur insurrection, et qu'il s'arrête au point précis où il pourrait la réprimer [FN: § 2480-4]. Si le gouvernement suit cette voie, ce n'est pas par ignorance, mais parce que, à l'instar de tous les gouvernements de presque tous les pays civilisés de notre temps, le fait qu'il représente les « spéculateurs » lui ferme toute autre voie. Les « spéculateurs » veulent surtout la tranquillité, qui leur permet d'effectuer des opérations lucratives. Ils sont disposés à acheter à tout prix cette tranquillité. Ils se préoccupent du présent, se soucient peu de l'avenir [FN: § 2480-5] , et sacrifient sans le moindre scrupule leurs défenseurs à la colère de leurs adversaires. Le gouvernement punit certains de ses employés, dont la seule faute est d'avoir obéi aux ordres qu'ils ont reçus. Il envoie des soldats s'opposer aux révoltés, avec l'ordre de ne pas faire usage de leurs armes [FN: § 2480-6], cherchant ainsi à sauver la chèvre de l'ordre et le chou de la tolérance envers les adversaires les moins acharnés [FN: § 2480-7] .
De la sorte, les spéculateurs ont pu et pourront encore prolonger leur domination. Mais, ainsi qu'il arrive très souvent dans les faits sociaux, les mêmes mesures, utiles dans un certain sens, pendant un certain temps, finissent par agir en sens contraire et par provoquer la ruine des gouvernements qui s'y fient. C'est ce qui est arrivé pour un grand nombre d'aristocraties. S'il vient un jour où le gouvernement des « spéculateurs », au lieu d'être utile, soit nuisible aux sociétés, on pourra dire alors qu'il a été utile aux sociétés que les « spéculateurs » aient persisté à prendre des mesures qui devaient causer leur ruine. Sous cet aspect, l'humanitarisme actuel peut, en fin de compte, être utile à la société. Il jouerait un rôle analogue à celui de certaines maladies qui, en détruisant des organismes affaiblis, dégénérés, en débarrassent certaines collectivités d'être vivants, et par conséquent leur sont utiles.
§ 2481. 3° L'exil, l'ostracisme. Ils sont assez efficaces. Dans les temps modernes, l'exil est peut-être l'unique peine pour délits politiques procurant plus d'avantages que de désavantages à ceux qui l'emploient pour défendre le pouvoir. L'ostracisme athénien ne procura ni grands avantages ni grands désavantages. Ces moyens nuisent peu ou point au développement des qualités de l'élite.
§ 2482. 4° L'appel de la classe gouvernante, à condition de la servir, de tout individu qui pourrait lui devenir dangereux. Il faut prendre garde à la restriction : « à condition de la servir ». Si on la supprimait, on aurait simplement la description de la circulation des élites ; circulation qui se produit précisément quand des éléments étrangers à l'élite viennent à en faire partie, y apportant leurs opinions, leurs caractères, leurs vertus, leurs préjugés. Mais si, au contraire, ces personnes changent leur manière d'être, et d'ennemis deviennent alliés et serviteurs, on a un cas entièrement différent, dans lequel la circulation fait défaut.
§2483. Ce moyen fut employé très souvent et chez un grand nombre de peuples. Aujourd'hui, c'est à peu près le seul qu'emploie la ploutocratie démagogique qui règne dans nos sociétés ; et il s'est montré très efficace pour en maintenir le pouvoir. Il nuit à l'élite, parce qu'il a pour effet d'exagérer encore plus les instincts et les penchants qui, chez elle, sont déjà excessifs. En outre, avec la corruption qui l'accompagne toujours, il déprime fortement les caractères, et ouvre la voie à qui saura et voudra user de la violence pour secouer le joug de la classe dominante.
§ 2484. Par exemple, les gouvernants qui possèdent en abondance des résidus de la IIe classe, et qui manquent de ceux de la Ie classe, auraient besoin d'avoir de nouveaux éléments chez lesquels ces proportions seraient renversées. Ces éléments seraient fournis par la circulation naturelle. Mais si, au contraire, la classe gouvernante s'ouvre uniquement à ceux qui veulent bien être semblables à ses membres, et qui vont même plus loin, animés par l'ardeur des néophytes, elle accroît la prédominance déjà nuisible de certains résidus, et s'achemine ainsi à sa propre ruine. Vice versa, supposons une classe qui, à l'instar de notre ploutocratie, soit profondément dépourvue des résidus de la IIe classe, et possède en abondance des résidus de la Ie. Elle aurait besoin d'acquérir des éléments pauvres en résidus de la Ie classe et riches en résidus de la IIe. Au contraire, si elle s'ouvre seulement aux gens qui trahissent leur foi et leur conscience, pour se procurer les avantages dont la ploutocratie est généreuse envers qui se met à son service, cette classe acquiert des éléments dont elle ne retire aucun avantage, pour se fournir de ce qui lui fait le plus besoin. Elle prive, il est vrai, ses adversaires de certains chefs, ce qui lui est très utile. Mais elle n'acquiert rien de bon pour accroître sa propre force. Tant qu'elle pourra user de ruse et de corruption, elle aura probablement toujours la victoire ; mais elle tombera très facilement si la violence et la force interviennent [FN: § 2484-1] . Il s'est passé quelque chose de semblable lors de la décadence de l'Empire romain.
§2483. Lorsque dans un pays, les classes qui, pour un motif quelconque, étaient demeurées longtemps séparées, se mélangent tout à coup, ou plus généralement quand la circulation des élites acquiert brusquement une intensité notable après avoir été stagnante, on observe presque toujours une augmentation considérable dans la prospérité intellectuelle, économique, politique du pays. C'est ainsi que les époques de transition entre un régime oligarchique et un régime quelque peu démocratique, sont très souvent des époques de prospérité. Comme exemples très remarquables, on peut citer Athènes au temps de Périclès, la Rome républicaine après les conquêtes de la plèbe, la France après la Révolution de 1789. Mais d'autres exemples ne manquent pas non plus : l'Angleterre au temps de Cromwell, l'Allemagne au temps de la Réforme, l'Italie après 1859, l'Allemagne après la guerre de 1870.
§ 2486. Si ce phénomène avait pour cause la différence du régime, il devrait persister tant que le nouveau régime subsiste ; mais ce n'est pas le cas. Il dure un certain temps, et puis change. L'Athènes de Périclès ne tarde pas à décliner, tandis que le régime devient toujours plus démocratique. La prospérité de la Rome des Scipion dure plus longtemps ; mais la décadence est manifeste vers la fin de la République. La prospérité revient pour quelque temps avec le régime impérial, lequel s'achemine bientôt à la décadence. La France de la République et de Napoléon Ie, devient la France de Charles X et de Louis-Philippe. Pour obtenir une image du phénomène, on peut supposer deux substances chimiques séparées, qui unies produisent une effervescence. Cette effervescence se produit sitôt que cesse la séparation ; mais elle ne peut durer indéfiniment.
§ 2487. Après ce que nous avons exposé, l'explication de ce fait est aisée (fig. 46). Dans la période de temps a b, la circulation des élites diminue, et la prospérité descend de l'indice a m à l'indice b n, parce que la classe gouvernante décline. Dans le court espace de temps b c, il se produit une révolution ou un autre événement quelconque, qui active la circulation des élites, et l'indice de la prospérité monte brusquement de b n à c p. Mais ensuite l'élite décline de nouveau, et l'indice diminue de c p à d q.
 |
| figure 46 |
§ 2488. La diminution comme l'augmentation de la circulation peut porter sur la quantité comme sur la qualité. À Athènes, les deux faits étaient simultanés, car les citoyens athéniens constituaient une caste fermée ou presque fermée, à laquelle les métèques n'avaient pas accès. Pour faire partie de la classe gouvernante, les mérites de guerre comptaient peu. À Rome, après quelques générations, les affranchis venaient alimenter la classe des citoyens ingénus. Mais, vers la fin de la République, les intrigues et la corruption étaient la source principale du pouvoir. Avec l'Empire, des qualités meilleures donnèrent de nouveau accès à la classe gouvernante ; mais de nouveau se manifesta une nouvelle et plus grave décadence. La ploutocratie moderne ne met aucun obstacle à la circulation, au point de vue du nombre. C'est pourquoi la prospérité qu'elle provoque dure plus longtemps. Mais elle exclut la force et l'énergie de caractère des qualités qui donnent accès à la classe gouvernante. Ce sera probablement l'une des causes pour lesquelles la courbe actuelle p q r de la prospérité (fig. 47), qui pour le moment croît selon le segment p q, pourra décroître à l'avenir suivant le segment s r.

Figure 47
§2489. Après ces quelques aperçus théoriques, passons à l'examen d'exemples concrets. À Sparte, dans l'antiquité, et à Venise, dans les temps modernes, nous avons des exemples d'aristocraties fermées ou semi-fermées. Ils nous montrent la décadence de ces aristocraties, et confirment d'autre part que l'usage de la force est capable, malgré la décadence, d'assurer la domination de ces aristocraties sur les classes inférieures de la population. Ils démentent ainsi l'affirmation des « moralistes » qui prétendent que les classes supérieures se maintiennent uniquement parce qu'elles font le bien de leurs sujets. Il serait utile aux sujets qu'il en fût ainsi ; mais malheureusement cela n'est pas.
§2190. Aux beaux temps de Sparte, sa population se divisait en trois classes : les Spartiates, qui étaient la classe gouvernante, les périèques, qui étaient une classe libre, mais sujette de la classe dominante, les ilotes, qui étaient des serfs attachés à la glèbe. On ne peut déterminer avec précision les premières dates de la chronologie spartiate ; mais on ne s'éloignera peut-être pas de la vérité en remontant jusqu'à 750 av. J.-C. Depuis ce temps, avec une fortune variable, la domination de l'oligarchie spartiate dura jusqu'en l'an 227 av. J.-C., où Cléomène III détruisit les éphores. Ainsi l'oligarchie domina pendant cinq siècles. Les moyens qui lui permirent d'y arriver ont quelques points de ressemblance avec les moyens dont se servit l'oligarchie vénitienne. Un pouvoir occulte et terrible prévenait et réprimait chez la classe inférieure toute tentative, même seulement supposée, d'améliorer son sort.
§ 2491. On a beaucoup discuté sur la [mot grec], qui, suivant Plutarque, aurait été une véritable chasse aux ilotes [FN: § 2491-1] . Cette opinion semble aujourd'hui abandonnée [FN: § 2491-2]; mais les auteurs même les plus bienveillants envers les Spartiates admettent que la krupteia était dure et cruelle pour les ilotes. Des faits indéniables font mieux voir la cruauté spartiate. Par exemple, celui que raconte Thucydide, et qui se produisit au temps ou les Athéniens occupaient Pylos [FN: § 2491-3] .
§ 2492. Ce n'est certes pas à dire que les Spartiates conservaient leur pouvoir parce qu'ils ne rencontraient pas de résistance. Aristote remarque avec justesse : « Souvent les pénestes thessaliens causèrent des dommages aux Thessaliens, comme aussi les ilotes aux Lacédémoniens ; car ils épient toute occasion de tirer parti des désastres (Pol. II, 6, 2) ». L'aristocratie spartiate demeura la maîtresse parce qu'elle était plus forte que ses sujets ; et seule la guerre avec d'autres États put briser son pouvoir. Les Messéniens furent délivrés, non par leur propre énergie, mais par la victoire des Thébains à Leuctres. Aristote remarque encore très judicieusement que les Crétois n'eurent pas à souffrir de l'hostilité de leurs esclaves, car, bien que les différents États de l'île de Crète se fissent la guerre, ils s'abstenaient de favoriser la rébellion des esclaves, parce qu'ils en possédaient tous du même genre (Pol. II, 6, 3).
§ 2493. Au contraire, là où la force des maîtres disparaissait, les esclaves renversaient l'ordre des choses et prenaient la place des maîtres. Dans l'île de Chio, il paraît que l'équilibre était instable ; c'est pourquoi tantôt les uns, tantôt les autres dominaient. Vers l'an 412 av. J.-C., les Athéniens, en guerre avec l'aristocratie qui dominait à Chio, envahirent l'île et causèrent de graves désastres : « C'est pourquoi les esclaves de Chio, qui étaient nombreux et s'étaient accrus d'une manière exorbitante pour une seule cité, si ce n'est celle des Lacédémoniens, étaient difficiles à ramener au devoir dans leurs méfaits. La plupart désertaient aussitôt que l'armée athénienne leur semblait avoir pris une position solide en construisant ses fortifications ; et comme ils connaissaient très bien la campagne, ils causaient de très grands dommages [FN: § 2493-1]». L'occupation de Pylos par les Athéniens eut un effet semblable à l'égard des ilotes spartiates ; de même aussi l'occupation de Décélie par les Spartiates, à l'égard des esclaves athéniens. Notons que les Athéniens traitaient les esclaves avec une grande bienveillance, qui paraît même excessive à l'auteur anonyme de la République athénienne. Au temps d'un certain Nymphodore, les esclaves de Chio s'enfuirent dans les montagnes, s'y défendirent et attaquèrent tour à tour avec tant de succès, que leurs maîtres durent pactiser avec eux, jusqu'à ce que, grâce à la trahison, le chef de ces esclaves fugitifs eût été tué [FN: § 2493-2] . Plus tard, Mithridate réduisit en servitude les gens de Chio, et les soumit à leurs propres esclaves [FN: § 2493-3] . Là-dessus, les moralistes imaginèrent que ce fut une juste punition, parce que les gens de Chio avaient, les premiers, introduit l'usage d'acheter des esclaves.
§ 2494. Très général est le phénomène des aristocraties qui, d'abord ouvertes, finissent par se fermer ou par s'efforcer de se fermer. Nous l'observons aussi chez les Spartiates. Aristote rapporte comme une tradition [FN: § 2494-1]que, pour parer au danger du dépeuplement de l'État par les longues guerres, les premiers rois de Sparte avaient accordé le droit de cité à des étrangers. Mais Éphore, cité par Strabon, est tout à fait affirmatif. Il dit que « tous les habitants voisins des Spartiates se soumirent, à condition de leur être égaux et de participer au droit de cité et de commandement [FN: § 2494-2]».
§ 2495. D'ailleurs, l'accès à la classe privilégiée fut bientôt fermé. Hérodote dit que seul Thésamène et son frère Hégias reçurent le droit de cité spartiate [FN: § 2495-1] . Nous avons donc dans l'aristocratie spartiate un type de classe fermée, ou pour mieux dire, semi-fermée, car aucune classe ne réussit longtemps à s'enfermer d'une manière absolue [FN: § 2495-2]. Elle demeura en cet état jusqu'au temps de Cléomène III. Une tentative de réforme avait été faite vers l'an 242 av. J.-C. par Agis IV ; mais elle échoua, et l'oligarchie eut encore assez de vigueur pour conserver le pouvoir [FN: § 2495-3] .
§ 2496. L'accès de la classe privilégiée était fermé, mais non pas la sortie : les meilleurs éléments du reste de la population ne pouvaient s'élever à cette classe ; mais les éléments inférieurs en étaient chassés. Il ne suffisait pas d'être d'origine spartiate pour prendre rang dans la classe dominante dite des égaux, des ![]() . Il fallait encore remplir strictement les devoirs difficiles et rigoureux de cette classe. Parlant de cette législation comme étant de Lycurgue, Xénophon dit clairement [FN: § 2496-1]: « Si quelqu'un négligeait de bien accomplir les choses voulues par la loi, il [Lycurgue] prescrivit qu'il ne devait plus être parmi les égaux ».
. Il fallait encore remplir strictement les devoirs difficiles et rigoureux de cette classe. Parlant de cette législation comme étant de Lycurgue, Xénophon dit clairement [FN: § 2496-1]: « Si quelqu'un négligeait de bien accomplir les choses voulues par la loi, il [Lycurgue] prescrivit qu'il ne devait plus être parmi les égaux ».
§2497. Parmi ces conditions exigées par la loi, il y avait celle de prendre part aux repas communs en payant son écot. Quiconque en était empêché par la pauvreté était déchu de la classe des égaux [FN: § 2497-1]. De la sorte, ceux qui manquaient d'énergie guerrière ou civile, et ceux qui ne savaient pas conserver leur patrimoine étaient exclus de la classe gouvernante. Donc, en somme, étaient exclus la plupart des éléments décadents. Cette circonstance était très favorable à la conservation du pouvoir par l'oligarchie ; elle a été probablement une des causes principales de sa durée. Une circonstance défavorable était l'exclusion de tout nouvel élément, de telle sorte que non seulement le nombre de la classe gouvernante allait toujours en diminuant – de 10 000 à 2000, dit-on – mais encore qu'il ne se complétait pas par de nouveaux et de meilleurs éléments.
§ 2498. Pourtant, et voici une nouvelle circonstance favorable, le besoin d'éléments nouveaux était moindre que dans d'autres cas, parce que ces besoins nouveaux n'étaient pas nécessaires pour renforcer les résidus de la IIe classe chez les gouvernants. Le mode d'éducation de ceux-ci, la discipline militaire en temps de paix, l'aversion pour la littérature, la philosophie et les arts libéraux ou manuels, d'autre part les guerres continuelles, supprimaient un grand nombre des causes pour lesquelles, chez les aristocraties en décadence, les résidus de la IIe classe diminuent, tandis que ceux de la Ire augmentent. L'humanitarisme, gangrène des aristocraties qui se meurent, ne trouvait pas place chez les Spartiates, même quand ils furent déchus de leurs vertus antiques. Il suffit de rappeler l'usage de fustiger jusqu'au sang les jeunes garçons devant l'autel d'Artémis Orthia. Il durait encore au temps de Pausanias. On a beaucoup discuté sur l’origine de cet usage. Cette origine, comme tant d'autres, importe peu ou point à la sociologie. Il importe au contraire de savoir de quels sentiments cet usage était l'indice. Nous avons vu déjà (§ 1190 et sv.) que des sentiments d'ascétisme y jouaient un rôle considérable. Ces sentiments sont l'hypertrophie de sentiments du sacrifice de l'individu à la collectivité. Le fait que cet usage barbare a duré si longtemps est aussi un indice manifeste de l'absence des sentiments humanitaires chez les Spartiates, et même de la simple pitié ; celle-ci n'aurait pas permis que l'usage pût durer si longtemps, quelle que fût son origine. En outre, il y a l'indice d'une singulière puissance de la persistance des agrégats [FN: § 2498-1](résidus de la IIe classe).
§ 2499. D'autre part, le manque d'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe) était une circonstance défavorable à l'aristocratie spartiate, même dans son unique genre d'activité, celui de la guerre, et surtout en politique. Dans cette dernière, la légèreté et la mobilité athéniennes d'une part, la gravité et la lourdeur spartiates d'autre part, paraissent avoir eu pour conséquence des désavantages assez semblables.
§ 2500. À Venise, nous avons un autre exemple d'aristocratie fermée. Jusqu'en l'an 1296, l'accès en était libre. Ce furent des temps de grande prospérité pour Venise. De 1296 à 1319 s'accomplit le changement qui aboutit à la serrata del consiglio maggiore, et qui ferme l'accès de la classe gouvernante [FN: § 2500-1]. Elle resta fermée pendant plus de quatre siècles. En l'an 1775, on décréta que le Livre d'or resterait ouvert pendant vingt ans, et qu'on y pourrait inscrire jusqu'à quarante nobles de terre ferme ; mais il ne semble pas que ces nobles firent grand honneur à cette avance.
§2501. La classe gouvernante vénitienne n'était pas réduite en nombre comme la classe gouvernante spartiate ; mais la décadence du caractère et de l'énergie y était extrême. Cette divergence provient surtout de la différence d'activité des deux aristocraties : civile pour celle de Venise, guerrière pour celle de Sparte. À Venise, l'énergie du caractère était un motif de mise à l'écart, et les inquisiteurs d'État extirpaient avec grand soin toute plante qui croissait trop vigoureuse. À Sparte, seul demeurait parmi les égaux celui qui avait assez d'énergie et de vigueur pour supporter le poids de la discipline militaire. À Venise, la qualité de patricien était indélébile, et restait acquise même au citoyen déchu. À Sparte, par une élimination naturelle, le citoyen déchu était exclu des ![]() . Des deux causes qui faisaient obstacle aux circulations des élites, l'une, le manque de nouveaux éléments, était commune à Venise et à Sparte ; l'autre, le manque d'élimination des éléments décadents, avait une influence plus grande à Venise qu'à Sparte.
. Des deux causes qui faisaient obstacle aux circulations des élites, l'une, le manque de nouveaux éléments, était commune à Venise et à Sparte ; l'autre, le manque d'élimination des éléments décadents, avait une influence plus grande à Venise qu'à Sparte.
§ 2502. L'usage de la force pour maintenir le pouvoir était commun aux deux aristocraties. Ce fut la cause principale de leur longue durée. Elles tombèrent toutes deux, non par suite de transformations intérieures, mais par l'effet d'une force extérieure plus grande [FN: § 2502-1] . La classe gouvernante vénitienne savait que le peuple ne peut rien par lui-même s'il n'est dirigé par des éléments de la classe gouvernante ; c'est pourquoi elle visait principalement à empêcher la survenance de ces éléments. L'efficacité d'une telle organisation est prouvée par la longue durée de cette aristocratie, lors même qu'elle perdit toute vigueur autre que celle, conservée par la tradition, de frapper à temps tout individu qui pût devenir le chef de bouleversements futurs. La classe gouvernante spartiate ne négligeait pas ce moyen de gouverner. En plusieurs cas, les éphores se montrèrent à la hauteur des inquisiteurs d'État à Venise. Mais, soit en raison de l'activité guerrière de Sparte, soit pour d'autres causes, leur action était beaucoup moins efficace que celle des inquisiteurs vénitiens. C'est pourquoi Sparte, plus que Venise, eut des chefs de mérite. Les Spartiates furent vaincus non par manque de valeur, mais par défaut de science stratégique. Au contraire, au temps de la décadence, les deux choses avaient fait défaut aux Vénitiens.
§ 2503. Sparte aurait eu besoin d'appeler dans l'élite des hommes possédant à un haut degré l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe). Venise aurait eu au contraire besoin d'appeler dans sa classe gouvernante des hommes possédant à un haut degré des instincts de la persistance des agrégats (résidus de la IIe classe). Nous ne savons pas si Sparte possédait dans son peuple les éléments qu'il fallait à sa classe gouvernante. Venise les avait certainement. Parlant du temps où la République était sur le point de disparaître, Malamani observe très justement [FN: § 2503-1]: « (p. 122) D'ailleurs, au milieu de cette orgie, à ce banquet funèbre païen auquel participait une grande partie de l'aristocratie vénitienne, la classe du menu peuple, qui tient plus que toute autre à ses traditions, conservait presque entièrement encore la rigide candeur des mœurs antiques... Rarement la corruption entrait dans les masures des ouvriers. Ils vivaient entre eux, formaient une société à part, avec ses mœurs, avec ses lois. Sous des formes rudes, ils conservaient vivant le culte de la famille... »
§2504. Venise fit preuve d'endurance dans l'infortune ; elle manqua d'ardeur dans le succès. On répète sur tous les tons que la ruine de Venise résulta de la découverte de l'Amérique et du Cap de Bonne-Espérance, qui dévia le commerce dont Venise était primitivement l'intermédiaire. Mais quand ces découvertes eurent lieu, Venise était la première puissance maritime du monde. Pourquoi donc n'aurait-elle pas pu faire des conquêtes en Amérique, aux Indes orientales, aux îles de la Sonde, comme en firent les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Français, et même les Danois ? Aucun obstacle ne s'y opposait, excepté la pusillanimité du patriciat vénitien, qui, s'il avait été rajeuni par des éléments populaires, aurait peut-être eu plus d'ardeur et de désir de nouveauté.
§ 2505. À la victoire de Lépante, le rôle principal fut joué par les galères vénitiennes, dont la puissante artillerie n'avait pas sa pareille [FN: § 2505-1]. L'instinct des combinaisons ne manquait donc pas non plus à Venise ; c'était l'énergie d'en tirer parti qui faisait défaut. Après la victoire de Salamine, la disproportion entre la puissance d'Athènes et celle du Grand Roi était plus grande que la disproportion, après la victoire de Lépante, entre la puissance de Venise et celle du Sultan. Mais les Athéniens firent preuve d'ardeur : leur flotte parcourut les mers, chassant les Perses. Au contraire, les prudents Vénitiens, après Lépante, se retirèrent à Corfou, et par leur inaction perdirent tout le fruit de la victoire, qui demeura parfaitement inutile. Les dernières années de la République furent celles d'une extrême décadence et d'une grande misère. Venise n'avait plus aucune puissance, même sur mer [FN: § 2505-2] .
§ 2506. L'aristocratie spartiate conserva dans les revers sa renommée méritée de force de caractère. Dans l'aristocratie vénitienne, la tyrannie cauteleuse des inquisiteurs d'État éteignit jusqu'aux sentiments d'intégrité personnelle. Quand l'aristocratie vénitienne en était encore à ses origines et avait une plus grande vigueur, elle produisit un Marino Faliero ; et si la conjuration que tenta ce personnage en compagnie d'un homme du peuple énergique avait réussi, peut-être l'aristocratie vénitienne aurait-elle eu une fin plus honorable. Mais on ne peut affirmer que le peuple et la bourgeoisie eussent été plus heureux, et non plus malheureux, exposés qu'ils auraient été aux maux habituels des bouleversements politiques et sociaux, et saisis par la tourmente des révolutions. À cause de l'origine différente des classes gouvernantes, tandis qu'à Sparte le préjugé religieux était très fort, à Venise il était moins fort qu'en d'autres états contemporains. En 1309, les Vénitiens se laissèrent excommunier par le Saint-Siège pour lui avoir enlevé Ferrare. Plus tard, le 25 mai 1483, le pape Sixte IV lança de nouveau l'excommunication contre la République vénitienne [FN: § 2506-1]. Le Conseil des Dix fit la sourde oreille, ordonna aux ecclésiastiques de continuer à administrer les sacrements, comme s'il n'y avait pas eu d'excommunication, et fut parfaitement obéi. La bulle du pape Jules II contre les Vénitiens n'eut pas un meilleur sort : ils furent vaincus par les armes temporelles de la ligue de Cambrai, et non par les armes spirituelles de l'Église [FN: § 2506-2] . Par son monitoire du 17 avril 1606, Paul V menace d'excommunication le doge et le Sénat si, dans les vingt-quatre jours, ils n'ont pas accordé satisfaction aux demandes du pape [FN: § 2506-3]« (p. 1109) et si, trois autres jours après les vingt-quatre, le doge et le Sénat persistent, il soumet à l'interdit tout le territoire, en sorte qu'on ne puisse célébrer de messes ni d'Offices divins... Lors de la publication du Monitoire à Rome, on commença, à Venise, par avoir recours à l'aide divine... On commanda ensuite à tous les prélats ecclésiastiques de ne faire publier ni laisser afficher en aucun lieu le Monitoire ; et même, quiconque en possédait une copie devait, sous peine de mort, la présenter aux magistrats, à Venise, et aux Recteurs, dans l'État... C'est pourquoi, tenant pour nul le Monitoire, on pensa uniquement protester par des lettres imprimées qui devaient être affichées dans des lieux publics... (p. 1110). Parmi les ordres religieux, partirent de Venise, ceux des jésuites, des capucins, des théatins, des réformés de Saint-François... aucun autre Ordre ne partit. Les Offices divins se célébrèrent exactement comme d'habitude; la ville et le peuple demeurèrent tout à fait tranquilles, par la volonté et par la prévoyance du Sénat, sans une goutte de sang versé ni la mort de personne ». On obtint cela parce que, ni dans le clergé ni dans le peuple, il n'y avait de fanatisme [FN: § 2506-4] ; ce qui permettait au gouvernement de se faire obéir dans sa controverse avec le Pape. Venise ne favorisa aucun schisme, aucune hérésie ; elle se préoccupait des intérêts temporels, et se souciait peu ou point de théologie. Là peut être intervenue la clairvoyance de l'État, cherchant à ôter tout prétexte d'offense à la Cour de Rome [FN: § 2506-5] ; mais il n'y avait certainement pas peu d'indifférence religieuse et de pauvreté en résidus de la IIme classe.
§2507. L'exemple de Venise est excellent, parce qu'il fait bien comprendre comment se composent les forces sociales. Il montre qu'il faut les considérer quantitativement et non pas seulement qualitativement, en outre, que les diverses espèces d'utilités sont hétérogènes.
L'usage du gouvernement vénitien de confier à des étrangers le commandement des armées de terre ferme, à l'exclusion des patriciens nationaux, fut cause, à la fois de faiblesse militaire pour la République, et de force pour les institutions civiles, qui échappèrent au danger d'être détruites par quelque capitaine victorieux. La pauvreté des résidus de la IIme classe, en comparaison de ceux de la Ire, assura pour nombre de générations, pour nombre de siècles, une vie heureuse aux Vénitiens. Ce bonheur contrasta avec les angoisses, les ruines, les carnages qui accablaient les malheureux habitants des pays où, grâce à l'abondance des résidus de la IIme classe, le fanatisme opprimait les hommes. Mais cette pauvreté fut aussi, du moins en partie, cause de la chute de la République vénitienne. Ici, une question se pose. Est-il bon ou non d'acheter le bonheur de nombre de siècles, d'un très grand nombre de générations, par la perte de l'indépendance de l'État ? On ne voit pas comment y répondre, car la comparaison porte sur deux utilités hétérogènes. Un problème analogue se pose en tout temps, pour presque chaque pays. On le résout dans un sens ou dans l'autre, suivant la valeur que le sentiment attribue à l'utilité présente et à l'utilité future, à l'utilité des hommes vivants et à celle de ceux qui viendront après eux, à l'utilité des individus et à celle de la nation. On peut se demander s'il ne serait pas possible d'éviter l'un et l'autre extrême, et de suivre une voie intermédiaire qui conciliât l'utilité des générations présentes avec celle des générations futures ? Cette nouvelle question n'est pas plus facile à trancher que la précédente. Tout d'abord, il faut remarquer que les difficultés de la comparaison entre les utilités hétérogènes du présent et celles de l'avenir sont atténuées, il est vrai, mais non supprimées ; car, pour tracer la voie intermédiaire, il sera tout de même nécessaire de comparer ces utilités, et suivant que le sentiment fera préférer l'une ou l'autre, la voie intermédiaire se dirigera davantage d'un côté ou de l'autre. Ensuite, il faut prendre garde au fait que la nouvelle question nous transporte dans le domaine difficile des mouvements virtuels, et que, pour y répondre, il est nécessaire de résoudre d'abord le problème ardu de la possibilité (§ 134) de supprimer certaines liaisons, et d'en ajouter certaines autres. Toutes ces difficultés échappent généralement aux personnes qui traitent de matières sociales ou politiques, parce qu'elles résolvent les problèmes, non au moyen de l'expérience, mais avec leur sentiment et celui d'autres personnes qui sont de leur avis. C'est pourquoi leurs raisonnements ont peu ou rien de commun avec la science logico-expérimentale. Ce sont des dérivations qui se rapprochent de simples manifestations de sentiments, de théories métaphysiques, théologiques. Comme telles, elles ont leur place parmi les dérivations que nous avons déjà étudiées d'une manière générale. Elles en suivent les oscillations; elles en ont les avantages et les défauts, sous l'aspect extrinsèque de l'utilité sociale. Pourtant leurs oscillations, semblables en cela à celles de la morale, sont beaucoup moins amples que celles de simples théories. En effet, les considérations de l'utilité sociale les empêchent de s'écarter trop de l'extrême où l'on prêche le sacrifice de ses intérêts à ceux d'autrui, de l'individu à la collectivité, des générations présentes à celles de l'avenir. Elles manifestent presque toujours des sentiments de sociabilité (résidus de la Vme classe), beaucoup plus intenses que ceux dont l'auteur est réellement animé, ou qu'ont ceux qui les approuvent. Elles sont en quelque sorte un vêtement qu'il est bienséant d'endosser.
§2508. À Athènes, on peut envisager de deux façons les classes gouvernantes. Nous avons d'abord les citoyens athéniens, qui forment une classe gouvernante par rapport aux esclaves, aux métèques et aux sujets des territoires sur lesquels s'étend la domination athénienne. Puis dans cette même classe, nous avons une nouvelle division et une élite qui gouverne.
§ 2509. La première classe, celle des citoyens athéniens, demeura fermée autant que possible. Afin d'être moins nombreux à profiter de l'argent extorqué à leurs alliés, les Athéniens décrétèrent, sur la proposition de Périclès, en 451 av. J.-C., que seuls seraient citoyens athéniens ceux qui étaient nés de père et de mère athéniens [FN: § 2509-1] . D'une façon générale, dans les beaux temps de la République, le peuple se montra très peu disposé à accorder le droit de cité [FN: § 2509-2] .
§2510. Ces obstacles à la circulation des élites disparaissaient, par le fait qu'il y eut irrégulièrement de brusques admissions d'un grand nombre de citoyens. Pourtant elles ne correspondaient nullement aux choix qu'opère ordinairement la circulation des élites.
§ 2511. Après la chute des Pisistratides, Clisthène donna le droit de cité à un grand nombre de gens, probablement afin de renforcer le parti plébéien dont il était le chef [FN: § 2511-1] . Il n'est nullement certain que ces gens fussent des éléments de choix. Chassés de leur cité, les habitants de Platée, et plus tard les esclaves qui avaient combattu à la bataille des Arginuses, obtinrent le droit de cité réduit. En conclusion, il n'y eut jamais de circulation proprement dite.
§ 2512. Au contraire, dans la classe des citoyens athéniens, il se constitue, depuis le temps de Solon, une classe gouvernante avec circulation libre. L'Aréopage accueillait ce qu'il y avait de meilleur dans la population [FN: § 2512-1] . Comme en d'autres temps le sénat de Rome et la Chambre des lords anglais, il constituait une aristocratie de magistrats. Aristote dit clairement que, lorsque après la bataille de Salamine les Athéniens rendirent à l'Aréopage son ancien pouvoir, ils jouirent d'un excellent gouvernement [FN: §2512-2] .
§ 2513. Grote lui-même, qui admire tant la démocratie athénienne, reconnaît qu'on observe la plus grande prospérité au début de la guerre du Péloponèse [FN: § 2513-1], et sans avoir la moindre idée de notre théorie, il note qu'avant ce temps-là les arts, les lettres et la philosophie n'étaient pas encore florissants (indice de défaut des résidus de la Ie classe) ; postérieurement, « bien que les manifestations intellectuelles d'Athènes subsistent dans toute leur vigueur et même avec une force accrue », l'énergie des citoyens est beaucoup plus faible (prédominance des résidus de la Ie classe sur ceux de la IIe, qui peu à peu font défaut). C'est là un cas remarquable, dans lequel le maximum de prospérité est donné par une certaine proportion entre les résidus de la Ie classe et ceux de la IIe, de sorte qu'un excès des uns est aussi nuisible qu'un excès des autres.
§ 2514. Un autre exemple remarquable est celui des Albigeois. L'enveloppe de leurs sentiments, c'est-à-dire la doctrine, semble être une branche du manichéisme. On put remarquer des doctrines analogues en divers pays, mais le phénomène social acquit de l'intensité surtout dans ceux qui prospéraient économiquement : en Italie, où l'on vit plusieurs hérésies, tempérées par le scepticisme national ; dans les Flandres, et de la façon la plus remarquable, dans le Midi de la France. Au XIIe siècle, ces régions étaient plus prospères matériellement et intellectuellement que d'autres pays. Elles s'étaient enrichies, et leur littérature, antérieure à la littérature italienne, est la première de nos littératures en langue vulgaire. Le contraste avec le Nord de la France, pauvre, ignorant, grossier, est très grand. Dans le Midi, les résidus de la Ie classe dominaient [FN: § 2514-1]; dans le Nord, ceux de la IIe classe étaient de beaucoup les principaux.
Paris, avec son université, était une exception. Ainsi qu'il arrive très souvent en des cas semblables, dans le Midi on observait, d'une part un certain manque de religion, d'autre part un certain fanatisme religieux. D'un côté, mœurs extrêmement faciles, de l'autre, rigueur excessive. Dans les cours d'amour, on raisonnait aimablement de l'amour sexuel ; dans les réunions des hérétiques, on le condamnait sans miséricorde.
§ 2515. Schmidt décrit bien l'état du Midi de la France [FN: § 2515-1] au XIIe siècle. Cet état est semblable à celui que l'on observe de nouveau au temps de la Renaissance en Italie et en d'autres pays économiquement prospères. Il ne manque pas de témoignages de la sagacité des Provençaux au XIIe siècle. Raoul de Caen a tout un chapitre où il décrit l'ingéniosité des Provençaux à la croisade [FN: § 2s515-2] , lesquels avaient l'esprit plus subtil que les « Français », mais étaient aussi moins courageux. C'est pourquoi on disait : « Les Français pour les combats, les Provençaux pour les vivres ». Il raconte comment ils frappaient un cheval ou un mulet, par dessous, dans les intestins, de telle sorte qu'on ne voyait pas la blessure. L'animal mourait. Les bons Français étaient stupéfaits d'un tel accident et disaient : « Éloignons-nous : sans doute le démon a soufflé sur cet animal ». Alors, « semblables aux corbeaux, les Provençaux entouraient le cadavre, le découpaient en morceaux, et chacun en emportait un, soit pour le manger, soit pour le vendre au marché ».
§ 2516. Voir dans la guerre des Albigeois une simple guerre de religion, c'est se mettre hors de la réalité. Quiconque étudie les dérivations admettra facilement que la doctrine des Cathares était une espèce de manichéisme, admettant deux principes : un bon et un mauvais. Mais les croisés qui vinrent du Nord conquérir les florissantes et riches contrées du Midi de la France se souciaient peu ou point qu'il y eût un, deux ou plusieurs principes. Il est même assez probable qu'ils étaient incapables de comprendre ce qu'on voulait dire par ces raisonnements bizarres. Ils se souciaient davantage de l'or, des belles femmes, des terres fertiles dont ils entreprenaient la conquête [FN: § 2516-1] ; et comme toujours, celui qui possédait des richesses et ne savait pas les défendre, se les voyait ravir par celui qui était pauvre, mais avait de l'énergie pour combattre et pour vaincre.
§ 2517. De même, parmi les nobles du Midi qui étaient favorables à l'hérésie des Albigeois, il s'est peut-être trouvé aussi des gens qui étaient mus par de belles considérations théologiques ; mais beaucoup avaient des raisons plus matérielles et plus tangibles [FN: § 2517-1] . Un phénomène semblable eut lieu au temps de la Réforme, et nombre de princes allemands se soucièrent bien plus de s'approprier les biens du clergé que de l'interprétation des Saintes Écritures. Pour eux, la meilleure interprétation était celle qui mettait le plus facilement en leur pouvoir les biens qu'ils convoitaient.
§ 2518. Comme d'habitude, le vulgaire était entraîné par l'envie que lui inspirait la vie aisée des classes supérieures. Ce sentiment était bien plus puissant que n'importe quelle subtile théorie théologique. Nous en trouvons des traces chez beaucoup d'auteurs ; entre autres chez Etienne de Bourbon [FN: § 2518-1]qui, pour avoir jugé comme inquisiteur les Albigeois, connaissait parfaitement leurs idées. Ainsi qu'il arrive habituellement aussi, une vague d'ascétisme et de religiosité montait des classes inférieures et menaçait de bouleverser la société entière.
§ 2519. Les prélats du Midi vivaient dans le luxe, aimaient la culture et la vie séculière [FN: § 2519-1]. Peu à peu, ils perdaient l'intolérance des prélats barbares qui, pauvres, ignorants et fanatiques, imposaient cruellement leur domination, ainsi qu'il arrive toujours en des cas semblables. Des faits analogues eurent lieu au XVIe siècle, dans la lutte entre le fanatisme de la Réforme et la culture d'un Léon X. Au point de vue d'une certaine éthique, les mauvaises mœurs du clergé constituaient alors une aggravation des conditions de la vie ordinaire. Au point de vue de la liberté intellectuelle, de la tolérance, d'une vie agréable, du progrès des arts, elles constituaient une amélioration [FN: § 2519-2] . Une somme immense de souffrances eût été épargnée à l'humanité si les marées de religiosité n'avaient pas submergé ces terres promises (§ 2707).
§ 2520. Nous savons déjà par un très grand nombre de faits que les dérivations ont peu d'importance pour les conséquences logiques qu'on en peut tirer. Elles en ont au contraire beaucoup pour les résidus dont elles sont l'indice, pour les sentiments qu'elles expriment. C'est sous cet aspect que nous devons considérer l'humanitarisme et l'ascétisme des Cathares [FN: § 2520-1]. Comme théorie, ils n'ont pas d'importance ; comme indice des sentiments de ceux qui acceptaient cet humanitarisme et cet ascétisme, ils servent à expliquer pourquoi les guerriers énergiques du Nord vainquirent les peuples lâches du Midi. De même, les déclamations d'un Tolstoï, qui va prêchant qu'on ne doit pas résister au mal et d'autres semblables sottises, n'ont pas la moindre importance comme théories. Elles en ont, comme indice de l'état d'esprit des gens qui les admirent, et nous font ainsi connaître l'une des causes de la défaite des Russes dans leur guerre contre le Japon. « (p. 88) Et à l'égal des richesses, il [le Cathare] condamne les honneurs et la puissance, pour laquelle s'acharne la vaine ambition des hommes, n'épargnant pas les guerres sanguinaires ou les artifices frauduleux pour la conquérir. Mais la guerre est une œuvre violente, que les adeptes du méchant démon peuvent désirer et imposer dans leur fureur, mais non certes les douces créatures du Dieu bon, lesquelles, au contraire, la condamnent toujours, même quand elle est provoquée par les autres ou faite pour se défendre*. Et non moins que la guerre, ils condamnent le meurtre de son prochain, au point de refuser même aux pouvoirs publics le droit de mettre à mort les citoyens qui violent la loi. Au milieu d'une société cruelle et violente, ces hérétiques prêchaient l'abolition de la pendaison ** [FN: § 2521-2]». C'est pourquoi ils furent détruits par le fer et par le feu. Il ne pouvait en être autrement.
§ 2521. Quand une société s'affaiblit par défaut de résidus de la IIe classe, par humanitarisme, parce que l'énergie qui emploie la force fait défaut, il arrive souvent qu'une réaction se produit, ne fût-ce que dans une petite partie de cette société. Mais il est remarquable qu'au lieu de tendre à accroître les résidus qui donneraient le plus de force à la société, comme il devrait arriver si c'était une réaction logique, cette réaction se manifeste principalement par un accroissement de force de certains résidus qui sont peu ou point utiles à la conservation sociale. Elle démontre ainsi son origine non-logique. Parmi les résidus qu'on voit ainsi se fortifier, il y a presque toujours ceux de la religion sexuelle, qui est précisément la moins utile à la société ; on peut même dire qu'elle est tout à fait inutile. Cela s'explique aisément si l'on considère que ces résidus existent avec une assez grande intensité chez presque tous les hommes, et que leur accroissement ou leur diminution peuvent, en de nombreux cas, servir de thermomètre pour juger de l'intensité d'autres classes de résidus, parmi lesquels se trouvent ceux qui sont utiles à la société. Il arrive aussi que ceux qui veulent recouvrir d'un vernis logique les actions non-logiques prennent l'indice pour la chose, et s'imaginent qu'en agissant sur la religion sexuelle, ils agiront aussi sur les résidus auxquels elle peut servir d'indice. Cette erreur, dont les hommes sont coutumiers, pour d'autres religions encore que pour la religion sexuelle, est semblable à celle de l'individu qui s'imaginerait pouvoir produire en hiver la chaleur de l'été en ajoutant du mercure à son thermomètre, de manière à lui faire marquer les degrés de chaleur désirés.
§ 2522. L'affaiblissement des sentiments non-logiques qui sont utiles à la conservation sociale provoqua, au temps des Cathares, une réaction extraordinaire d'ascétisme sexuel [FN: § 2522-1] ; au temps de la Renaissance, des réactions semblables, dont on trouve un type dans l'œuvre de Savonarola ; de notre temps, des réactions encore plus absurdes, dont nous avons parlé souvent déjà. Elles furent et sont toujours toutes, non seulement inutiles, mais encore nuisibles, parce qu'en donnant une certaine satisfaction aux instincts de conservation sociale, elles empêchent que ces instincts ne s'appliquent dans le seul sens où ils seraient efficaces : à renforcer les résidus de la IIe classe qui sont à la base de la société, et l'énergie belliqueuse qui la conserve.
§ 2523. Ce n'est pas par mauvaises mœurs, mais par manque de foi et de courage que les comtes de Toulouse furent détruits. Que l'on compare le scepticisme de Raymond VI et de son fils Raymond VII avec le fanatisme avisé de Simon de Montfort. En 1213, les Provençaux et les Aragonais assiégeaient Muret. Simon partit avec son armée pour secourir cette forteresse. Il avait beaucoup moins de gens que ses ennemis, mais la foi et le courage le soutenaient. Il ne tint pas compte des conseils de ceux qui voulaient le dissuader de livrer bataille, il engagea le combat [FN: § 2523-1]et vainquit. Il termina sa vie en brave au siège de Toulouse, frappé d'une pierre à la tête et percé de plusieurs flèches.
§ 2524. Ces pauvres comtes de Toulouse ne surent jamais se décider à suivre une voie. De temps en temps, ils essayaient de résister, puis perdaient courage et se livraient pieds et poings liés à leurs ennemis, en demandant humblement pardon au pape et au roi [FN: § 2524-1]. Ils ne comprirent jamais que, pour vaincre, il faut être disposé à mourir les armes à la main. Ils furent ainsi les dignes précurseurs de ce pauvre homme de Louis XVI de France qui, lui aussi, au lieu de combattre, se jeta dans les bras de ses ennemis, et leur livra ses amis, de même que les comtes de Toulouse livrèrent leurs fidèles sujets à l'Inquisition. La force des armes décide qui doit être sauvé, qui doit périr, qui doit être le maître, qui doit être l'esclave. Depuis longtemps déjà Tyrtée l'avait chanté [FN: § 2524-1] .
§2525. Les habitants du Midi de la France furent vaincus par les soldats du Nord, pour la même raison qui donna la victoire aux Macédoniens sur les Athéniens, ou aux Romains sur les Carthaginois : parce que le rapport entre les instincts conservateurs et ceux des combinaisons était trop faible.
§ 2526. Il faut prendre garde à la contingence du contact et de l'usage de la force, entre des peuples possédant des proportions différentes de ces résidus de la IIe et de la Ie classe. Si, pour un motif quelconque, on ne fait pas usage de la force, le peuple où la proportion de ces résidus est très différente de celle qui assure le maximum de puissance dans les luttes, ne tombe pas sous la domination du peuple où cette proportion se rapproche davantage du maximum. Il en est de même pour les diverses classes sociales. La position d'équilibre est différente suivant que l'usage de la force joue un rôle plus ou moins grand.
§ 2527. Si l'on compare aujourd'hui les populations du Midi et celles du Nord de la France, on constate quelque chose d'analogue à ce qui se passait, au temps de la guerre des Albigeois, touchant la proportion entre les résidus de la Ie et ceux de la IIe classe [FN: § 2527-1]. Nous disons quelque chose d'analogue et non d'identique. Comme aujourd'hui l'usage de la force n'intervient pas entre ces deux fractions d'une même unité politique, nous devons prévoir que le phénomène sera inverse de celui qu'on put observer aux temps de la guerre des Albigeois, et que ce sera le Midi, où les résidus de la Ie classe l'emportent de beaucoup sur les autres, qui dominera sur le Nord, où ce sont, au contraire, les résidus de la IIe classe qui l'emportent. C'est exactement ce qui se passe. On a remarqué plusieurs fois que la plupart des ministres et des politiciens qui gouvernent aujourd'hui la France sont du Midi. Là où la ruse agit le plus, les résidus de la Ie classe ont une valeur qui diminue beaucoup là où la force agit davantage. C'est le contraire qui a lieu pour les résidus de la IIe classe.
§ 2528. En revanche, la Chine, presque soustraite durant un grand nombre d'années à la pression de la force extérieure, put subsister avec une très faible proportion de résidus de la le classe. Maintenant, poussée par l'exemple du Japon, elle se met à innover, c'est-à-dire à accroître les résidus de la Ie classe (§ 2550).
§ 2529. L'exemple des Italiens, au temps de la Renaissance, est plus remarquable encore que celui des Albigeois. Déjà à la fin du moyen âge, l'Italie est tellement supérieure aux autres pays de l'Europe, dans toutes les branches de l'activité humaine, qu'il est inconcevable qu'elle n'ait pas restauré l'empire romain, et que, au contraire, elle ait pu subir de nouvelles invasions barbares. En fait de richesse, l'Italie dépassait tout autre pays. Ses banquiers prêtaient aux particuliers et aux souverains, et les noms de Lombard Street et de Boulevard des Italiens sont de nos jours les témoins fossiles d'un temps qui n'est plus. La littérature, les arts, les sciences florissaient en Italie, alors qu'ailleurs ils étaient encore dans l'enfance. Les Italiens parcouraient le globe terrestre. Un Marco Paolo visitait des régions asiatiques inconnues ; un Colomb découvrait l'Amérique; un Améric Vespuce lui donnait son nom. La diplomatie vénitienne était la première du monde ; dans la politique pratique, un Laurent de Médicis, dans la politique théorique, un Machiavel, n'avaient pas leurs égaux.
§ 2530. Mais peut-être les Italiens ne se distinguaient-ils que dans les arts civils ? Point du tout. Dans les arts militaires aussi, ils faisaient preuve de mérites [FN: § 2530-1] . François Ier et Charles-Quint se disputaient un Andrea Doria, pour commander leurs flottes. Pierre Strozzi était fait maréchal de France. Léon et Philippe Strozzi servirent honorablement dans les armées françaises. Les condottieri ont eu peut-être beaucoup de vices, mais ils n'en donnèrent pas moins de grands capitaines.
§2531. Pourquoi donc, avec tant de circonstances favorables, l'Italie fut-elle conquise, au lieu de faire elle-même des conquêtes ? On a bientôt fait de répondre : parce qu'elle était divisée. Mais pourquoi était-elle divisée ? La France et l'Espagne étaient aussi divisées ; elles s'étaient pourtant constituées en unités. Pourquoi cela n'était-il pas arrivé en Italie aussi ? Pour les mêmes raisons que celles qui donnèrent d'autre part à l'Italie tant d'avantages au point de vue de la richesse, de la prospérité intellectuelle, d'un art politique et militaire habile ; parce que chez elle l'instinct des combinaisons l'emportait de beaucoup en importance sur l'instinct de la persistance des agrégats [FN: § 2531-1] . D'autres pays, où la proportion existant entre ces instincts s'écartait moins de celle qui assure le maximum de puissance, devaient nécessairement vaincre et envahir l'Italie, s'ils entraient en lutte avec elle ; il en avait précisément été ainsi pour Rome à l'égard de la Grèce.
§ 2532. Les maux qui venaient à l'Italie d'un défaut de l'instinct de la persistance des agrégats furent, au moins en partie, aperçus par Machiavel, lequel, semblable à un aigle, plane au dessus de la multitude des historiens éthiques (§ 1975). À la vérité, il parle de la religion, mais par ce terme il entend une religion quelconque. Ce fait, avec celui de considérer les religions indépendamment d'une vérité intrinsèque possible, de leur contenu théologique, – ainsi que l'avaient déjà fait Polybe, Strabon et d'autres – montre clairement que Machiavel avait en vue les instincts que ces religions manifestent, c'est-à-dire les résidus de la IIme classe. Seulement, ainsi que font tous les autres auteurs, il s'exprime comme si les actions des hommes étaient toutes logiques et une conséquence des résidus qui existent chez ces hommes. Mais, dans ce cas, cela n'infirme pas le fond du raisonnement, car, que ce soient les dérivations qui agissent directement, ou bien que ce soit l'indice de l'influence des résidus dont elles proviennent, les conclusions demeurent intactes. De même, nous ne pouvons pas faire un grief à Machiavel de ce qu'il accepte les légendes de Rome, légendes que l'on croyait alors de l'histoire ; et cela n'enlève rien à la force de son raisonnement, car enfin, ce qu'il dit de Romulus, il l'entend d'institutions militaires, et ce qu'il dit de Numa, il l'entend d'institutions religieuses et d'autres analogues.
§ 2533. Dans ses Discours (I, 11), il écrit : (Trad. Périès) « Lorsqu'on examine l'esprit de l'histoire romaine, on reconnaît combien la religion servait pour commander les armées, ramener la concorde parmi le peuple, veiller à la sûreté des bons, et faire rougir les méchants de leur infamie. De sorte que s'il fallait décider à qui Rome eut de plus grandes obligations, ou à Romulus, ou à Numa [si l'on devait décider si la grandeur de Rome provenait plutôt des institutions militaires ou des sentiments exprimés par les discours religieux], je crois que ce dernier obtiendrait la préférence. Dans les États où la religion est toute-puissante, on peut facilement introduire l'esprit militaire, au lieu que chez un peuple guerrier, mais irréligieux, il est difficile de faire pénétrer la religion... aussi est-il hors de doute que le législateur qui voudrait à l'époque actuelle fonder un État trouverait moins d'obstacles parmi les habitants grossiers des montagnes, où la civilisation est encore inconnue [où abondent les résidus de la IIe classe et où ceux de la Ie sont rares], que parmi ces peuples des villes, dont les mœurs sont déjà corrompues [dérivation morale habituelle] ».
§2534. Plus loin (I, 12) : « Les princes et les républiques qui veulent empêcher l'État de se corrompre, doivent surtout y maintenir sans altération les cérémonies de la religion et le respect qu'elles inspirent ». On remarquera que Machiavel parle des cérémonies, et non des dogmes. On remarquera aussi que, nominalement chrétien, il parle de la religion des Gentils. Nous sommes vraiment très près d'une théorie des résidus de la IIme classe.
§ 2535. Mais Machiavel s'explique encore plus clairement (I, 12) : « Que les chefs d'une république ou d'une monarchie maintiennent donc les fondements de la religion nationale [les dérivations importent peu ; les résidus importent beaucoup]. En suivant cette conduite, il leur sera facile d'entretenir dans l'État les sentiments religieux [entendez : une juste proportion des résidus de la IIe classe], l'union et les bonnes mœurs. Ils doivent en outre favoriser et accroître tout ce qui pourrait propager ces sentiments, fût-il même question de ce qu'ils regarderaient comme une erreur ». Voilà pourquoi Machiavel raisonne ici en homme de science et non en fanatique.
§2536. Il dit ensuite de l'Italie (I, 12) : « Et comme quelques personnes prétendent que le bonheur de l'Italie dépend de l'Église de Rome, j'alléguerai contre cette Église plusieurs raisons qui s'offrent à mon esprit, et parmi lesquelles il en est deux surtout extrêmement graves, auxquelles, selon moi, il n'y a pas d'objection. D'abord, les exemples coupables de la cour de Rome ont éteint, dans cette contrée, toute dévotion et toute religion, ce qui entraîne à sa suite une foule d'inconvénients et de désordres ; et comme partout où règne la religion on doit croire à l'existence du bien, de même où elle a disparu, on doit supposer la présence du mal. C'est donc à l'Église et aux prêtres que nous autres Italiens, nous avons cette première obligation d'être sans religion et sans mœurs ; mais nous leur en avons une bien plus grande encore, qui est la source de notre ruine ; c'est que l'Église a toujours entretenu et entretient incessamment la division dans cette malheureuse contrée ».
§ 2337. Ici, Machiavel s'arrête à la surface des choses. Il est vrai que la papauté entretient l'Italie divisée ; mais pourquoi les Italiens tolèrent-ils cela ? Pourquoi ont-ils rappelé la papauté, qui était allée à Avignon, et ne l'y ont-ils pas laissée, ou ne se sont-ils pas opposés à ce qu'elle revienne leur nuire ? Certainement pas à cause d'une religion qu'ils n'avaient pas, mais parce que la présence de la papauté à Rome favorisait certaines de leurs combinaisons ; parce que chez eux les résidus de la Ire classe l'emportaient sur ceux de la IIme.
§ 2538. La réforme en Allemagne fut une réaction d'hommes chez lesquels prédominaient les résidus de la IIme classe, contre des hommes chez lesquels prédominaient les résidus de la Ire classe ; une réaction de la force et de la religiosité germanique contre l’ingéniosité, la ruse, le rationalisme italien. Les premiers vainquirent, parce que la force entra enjeu. Si la force n'était pas entrée en jeu, les seconds pouvaient vaincre. Si l'empire germanique du moyen âge avait duré, englobant l'Italie, peut-être les Italiens de notre temps gouverneraient-ils cet empire, comme les Français du Midi gouvernent la France ?
§2539. ROME. Pour étudier l'évolution sociale à Rome, il faut, comme d'habitude, la rechercher sous les dérivations qui la masquent dans l'histoire. Tout d'abord, il faut écarter les dérivations éthiques, qui non seulement apparaissent dans cette histoire et en d'autres, mais qui nous poursuivent jusque dans la vie journalière. Nous avons déjà parlé longuement de ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'y revenir (§ 2161 et sv.). Ensuite, il faut se tenir sur ses gardes contre les dérivations religieuses. Elles apparaissent nettement, par exemple chez Bossuet, et sont plus ou moins voilées chez un grand nombre d'autres auteurs chrétiens, qui ne peuvent parler de l'histoire romaine sans avoir l'esprit encombré de comparaisons de la morale et des mœurs chrétiennes avec la morale et les mœurs païennes. Un grand nombre d'auteurs modernes ne se soucient plus de la théologie chrétienne ; mais nous n'y gagnons pas grand'chose, parce qu'elle est remplacée par d'autres théologies, démocratiques, humanitaires ou autres semblables. Négligeons la théologie sexuelle, dont nous avons déjà longuement traité. Si elle fait écrire beaucoup d'absurdités, elle n'est toutefois pas coupable de graves erreurs en histoire romaine.
§ 2540. Nous retrouvons dans ce cas particulier les erreurs relevées déjà d'une manière générale (§ 2331 et sv.). Toutes ces dérivations ont une cause commune : c'est que nous regardons les événements à travers des verres colorés par nos sentiments. Un petit nombre d'auteurs, qui s'efforcent d'être impartiaux et qui y réussissent tant bien que mal, usent de verres légèrement colorés. La plupart usent de verres fortement colorés. Parfois ils le font volontairement pour certains vernis, parmi lesquels les vernis religieux mentionnés tout à l'heure et celui du patriotisme. Ce dernier ne devrait même jamais faire défaut, selon certains auteurs allemands et leurs imitateurs d'autres pays. En outre, ces auteurs confondent habituellement l'histoire avec la description de l'évolution d'une de leurs belles entités métaphysiques, à laquelle ils ont donné le nom d'État. Née et débutante à Rome, elle ne devint parfaite – est-il nécessaire de le dire – que dans l'Empire allemand moderne. Un autre vernis que l'on n'aperçoit pas, bien qu'il fasse rarement défaut, est celui qui provient de la conviction implicite que tout « mal » dont l'histoire nous donne connaissance aurait pu être évité grâce à des mesures judicieuses (§ 2334, 2335). De la sorte, nous nous rapprochons de l'opinion d'après laquelle la société humaine devrait, par vertu propre, être prospère, heureuse, parfaite, si ce cours normal n'était pas troublé par des causes accidentelles qu'il est possible d'éviter (§ 134). Cette opinion est semblable à celle qui trouve la cause des infortunes humaines dans le péché originel ; mais elle est moins logique, parce que, le péché originel se perpétuant, on comprend aisément que les maux dont il est la cause se perpétuent. Au contraire, si tous les maux de la société proviennent de causes qu'il est possible (§ 134) d'éviter, on ne comprend pas que parmi les très nombreuses sociétés dont nous connaissons l'histoire, il ne s'en soit pas trouvé au moins une qui présente une prospérité continue. De même, on pourrait dire que s'il est possible de rendre l'homme immortel, il est plus qu'étrange que les hommes dont nous avons eu connaissance jusqu'à présent aient été tous mortels. En réalité, l'état normal de la prospérité des sociétés humaines est celui d'une courbe ondulée. Celui d'une ligne qui représenterait un état de prospérité toujours constante ou toujours croissante ou toujours décroissante, serait anormal, tellement anormal qu'on ne l'a jamais constaté (§ 2338).
§ 2541. Quand, par exemple, les historiens mentionnés considèrent la décadence de la République romaine, ils admettent comme un axiome qu'elle doit avoir eu une cause, qu'il reste seulement à trouver dans les mesures prises par les hommes de ce temps, et qui doit être essentiellement différente de la cause de la prospérité de la République, ces états de choses contraires devant nécessairement avoir des causes contraires. Il ne leur vient pas à l'esprit que des états de choses dont l'un succède à l'autre peuvent, bien que contraires, avoir une cause commune, une même origine (§ 2338). De même, si l'on veut faire usage de ce terme de cause, celui qui considère l'individu peut dire que la vie est la cause de la mort, puisqu'elle en est certainement suivie ; et qui considère l'espèce peut dire que la mort est la cause de la vie, car tant que subsiste l'espèce, la mort de certains individus est suivie par la vie d'autres individus. De même que la naissance peut être appelée la cause ou l'origine commune, tant de la vie que de la mort, certains faits peuvent être appelés cause ou origine commune, d'abord de la prospérité, puis de la décadence d'une société humaine, et vice versa. Cette observation ne vise nullement à affirmer que ce soit le cas pour tous les faits, mais seulement qu'il peut en être ainsi pour quelques-uns. Elle a pour unique but de faire ressortir qu'il faut laisser de côté toute solution axiomatique du problème, et s'en tenir uniquement aux études expérimentales (§ 2331 et sv.).
§ 2542. Une autre erreur dont nous devons nous garder consiste à envisager comme simples des faits extrêmement compliqués. Sous une forme générale, cette erreur est souvent dissimulée par des dérivations de personnifications, grâce auxquelles nous avons la tendance de considérer comme une seule personne ayant des intérêts et des sentiments simples, un ensemble de personnes possédant des intérêts et des sentiments divers, parfois même opposés (§ 2254, 2328-1). Par exemple, nous traitons de la manière d'agir de Rome ou de la Macédoine. Nous ne commettons aucune erreur si, par ces noms, nous indiquons seulement la résultante des diverses forces qui existaient dans ces pays. L'erreur commence lorsque, oubliant cette diversité de forces, nous supposons à Rome ou à la Macédoine une volonté unique, comme il en existe une chez un individu. Nous savons qu'à Rome, en l'an 200 av. J.-C., certains Romains voulaient la guerre contre la Macédoine, et que d'autres ne la voulaient pas (§ 2556). Pourvu que nous n'ayons pas l'intention d'exprimer autre chose que ce fait, nous pouvons dire qu'alors Rome ne voulut pas faire la guerre à la Macédoine. Si nous voulons faire allusion, au moins en gros, aux forces composant la résultante, nous ajouterons que le Sénat proposa cette guerre, et que le Peuple la repoussa. En continuant de la sorte, on peut mentionner d'autres forces composantes, mais il serait impossible d'exclure d'une façon absolue toute manière analogue de s'exprimer, sans tomber dans une pédanterie ridicule, insupportable. Il n'y a aucune erreur tant que l'on fixe soit attention uniquement sur les choses désignées par ces noms. L'erreur commence avec la personnification de ces choses ; elle croît avec cette personnification, et atteint le comble quand celle-ci est complète. Rome n'avait pas une volonté unique à l'égard de la guerre contre la Macédoine, comme un individu particulier aurait pu en avoir une. Le Sénat n'avait pas non plus cette volonté unique, ni les spéculateurs qui étaient poussés à cette guerre, ni divers partis qu'on pourrait nommer dans leur collectivité. Au fur et à mesure que, partant de l'ensemble Rome, nous multiplions le nombre des parties, nous nous rapprochons de la réalité, sans jamais pouvoir l'atteindre tout à fait. Ce sont diverses approximations. Il est indispensable de les employer ; elles ne peuvent induire en erreur, pourvu qu'on les tienne pour telles, et qu'on n'aille pas au delà de ce qu'elles peuvent exprimer. Il faut aussi prendre garde que l'on commet une erreur analogue lorsqu'on suppose, fût-ce implicitement, qu'un même nom désigne, à divers moments, une même chose. Par exemple, les noms Sénat et Peuple subsistent dans l'histoire romaine, tandis que les choses qu'ils désignent changent entièrement. Cette erreur, commise autrefois par quelques historiens, a été maintenant corrigée par d'autres. Elle est beaucoup moins à craindre, parce qu'elle est moins insidieuse que la première dont nous avons fait mention. Celle-ci continue à dominer dans une infinité d'ouvrages contemporains, où l'on parle de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, etc., comme si c'étaient de simples personnes.
§ 2543. Mais ici apparaissent deux écueils dont on pourrait bien dire : Incidit in Scyllam, cupiens vitare Charybdim. Il n'y a pas encore un siècle, on tendait à écrire l'histoire sans se soucier des détails, excepté d'anecdotes plus ou moins romantiques, auxquelles on accordait une large place. Aujourd'hui, on tend au contraire à recueillir le plus menu détail, et à disserter sans fin sur des sujets ne présentant aucune importance. Cela est utile pour préparer des matériaux, mais non pour les mettre en œuvre. Ce travail ressemble à celui de l'ouvrier qui taille des pierres, non à celui de l'architecte qui construit. Celui qui se livre à la recherche d'uniformités doit entreprendre l'étude des détails, grands ou menus, cela comme un moyen, non comme un but. Il faut ensuite qu'il abandonne l'espoir de pouvoir achever d'un coup la théorie qu'il édifie, et qu'il se persuade bien que seules les approximations successives pourront le rapprocher du terme désiré. On trace d'abord les lignes principales des phénomènes, puis l'on s'attache aux lignes secondaires, et ainsi de suite, selon la perpétuelle évolution de la science.
§ 2544. Toutes ces lignes sont idéales ; nous les obtenons par abstraction, c'est-à-dire que nous recherchons certains éléments principaux du phénomène concret. Celui-ci porte un seul nom, bien que composé de plusieurs éléments. De même, nous nommons argile un composé de plusieurs corps chimiques, et terre végétale un composé d'un nombre encore plus grand de ces corps. C'est à quoi ne prirent pas garde les auteurs qui dissertèrent si longuement de la lutte entre la « liberté républicaine » et le « despotisme impérial » à Rome, ni ceux qui, dans les anciens conflits entre les patriciens et les plébéiens, virent une lutte entre l'aristocratie et la plèbe, tandis qu'aujourd'hui on sait fort bien que c'étaient des luttes entre deux aristocraties. En des temps moins reculés, les luttes entre les sénateurs et les chevaliers ne sont point un phénomène simple, ainsi que tant de gens se l'imaginent. Pour preuve, il suffirait de remarquer que sénateurs et chevaliers, poussés par une communauté d'intérêts, tombaient d'accord lorsqu'ils s'opposaient aux lois agraires.
Ces lignes ne sont pas des lignes géométriques ; pas plus d'ailleurs que ne le sont les lignes qui séparent de la terre ferme les eaux de l'Océan. Il n'y a que la présomptueuse ignorance pour exiger une rigueur qui n'appartient pas à la science du concret. Les termes de cette science doivent correspondre à la réalité, mais cela n'a lieu qu'en de certaines limites [FN: § 1] . On ne peut définir rigoureusement la terre végétale, l'argile, ni dire quel est le nombre exact d'années, de jours, d'heures, etc., qui séparent de la jeunesse l'âge mûr ; ce qui n'empêche pas la science expérimentale de faire usage de ces termes, sous la réserve des approximations qu'ils comportent. La rigueur du raisonnement est atteinte par la considération de cette approximation. Du reste, même les mathématiques sont obligées de suivre cette voie pour faire usage des nombres dits irrationnels.
§2545. Cherchons donc à nous faire, en gros, une première idée des phénomènes. Nous avons précédemment reconnu que, dans les phénomènes sociaux, la façon dont les hommes obtiennent le nécessaire pour vivre, l'aisance, la richesse, les honneurs, le pouvoir, est d'une grande importance, tant pour les intérêts que pour les sentiments, et que, sous cet aspect, il convient, dans une première approximation, de diviser ces phénomènes en deux catégories (§ 2233). Voyons si, en suivant cette voie, nous trouverons quelque uniformité. Si oui, nous continuerons, sinon, nous ferons demi-tour.
§2546. Pour étudier des éléments différents, il faut commencer par les classer. Dans la circulation des élites à Rome, nous devons prendre en considération les éléments suivants :
(A). Les règles du passage d'une classe à une autre.
(A-1). Les règles légales du passage d'une classe à une autre. Dans les temps primitifs de l'histoire, il existe de graves obstacles légaux à la circulation. Les luttes entre les plébéiens et les patriciens tendent à les supprimer. Ils disparaissent pour les citoyens, et sont atténués pour les affranchis ; puis, vers la fin de l'Empire, les classes fermées ou presque fermées apparaissent de nouveau.
(A-2). Les mouvements effectifs du passage d'une classe à une autre. Ils dépendent surtout de la facilité de s'enrichir de diverses manières. Ils sont grands vers la fin de la République et le commencement de l'Empire.
(B). Les qualités de caractère de la nouvelle élite.
(B-1). Au point de vue ethnique [FN: § 2546-1] . D'abord, les nouveaux éléments sont : romains, latins, italiens. L'élite se renouvelle sans changer de caractère ethnique. En dernier lieu, viennent surtout les Orientaux. Le caractère de l'élite change entièrement. De même, il faut considérer les proportions, différentes au cours de l'histoire, et d'après lesquelles les habitants de la ville et ceux de la campagne concourent au gouvernement de l'État. Belot a probablement donné une importance trop grande à ces proportions ; mais ses observations conservent une part de vérité. D'un autre côté, il a pris l'indice pour la chose. Le fait matériel d'habiter la ville ou la campagne importe moins que les différents sentiments, les différents intérêts que cet indice représente. C'est pourquoi nous devrons porter principalement notre attention sur ces sentiments, sur ces intérêts.
(B-2). Au point de vue des résidus de la Ire et de la IIe classe. Quand l'élite se renouvelle en partie par les nouveaux riches, quand les préoccupations agricoles cèdent la place aux préoccupations financières ou commerciales, les résidus de la Ire classe s'accroissent dans la partie qui gouverne l'État ; ceux de la IIe classe diminuent. De la sorte, à Rome, on arrive, vers la fin de la République, à un État où la caste dominante est riche en résidus de la Ire classe, pauvre en résidus de la IIe ; tandis que, dans la caste dominée, surtout chez les hommes qui vivent loin de la ville, les résidus de la IIme classe abondent. Avec l'Empire commence un mouvement en sens contraire, à l'égard de la caste dominante, qui s'enrichit de résidus de la IIme classe, si bien qu'elle finit par égaler en cela la caste dominée.
(B-3). Au point de vue des rapports entre l'aptitude à employer la force, et l'usage qu'on en fait. À l'origine, on ne distingue pas le citoyen du soldat ; l'élite est homogène à ce point de vue : elle peut et sait user de la force. Puis, peu à peu, la qualité de citoyen se sépare de celle de soldat ; l'élite se divise en deux, la partie la plus petite domine surtout par la force ; la plus grande ne peut ni ne sait plus user de la force.
§ 2547. Les phénomènes se succèdent en se modifiant petit à petit avec le temps ; mais pour les décrire, nous sommes contraints par la nécessité d'en former des groupes, de séparer et de disjoindre ce qui est uni et continu. Cédant donc à cette nécessité, considérons les espaces de temps suivants. Nous leur donnons des limites nettes, uniquement pour faciliter l'exposé, comme on ferait pour la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse, dans la vie humaine, qui passe en changeant par degrés (§ 2544) : I. Du temps de la seconde guerre punique à la fin de la République. – II. Du principat d'Auguste au temps des Antonins. – III. Des Antonins à Gallien.
Il ne faut jamais oublier la mutuelle dépendance des différentes parties de l'état social, c'est-à-dire des éléments (a), (b), (c), (d), indiqués au § 2206. Ailleurs [FN: § 2547-1] , nous avons longuement traité de l'évolution des organisations économiques, ce qui nous permet de nous borner ici à de courts aperçus en cette matière, et de nous attacher davantage aux autres éléments.
§2548. Du temps de la seconde guerre punique à la fin de la République. Laissons de côté les temps antérieurs, parce que leur histoire est incertaine, et plus encore leur chronologie. Dans l'espace de temps indiqué ici, la puissance politique, militaire et financière de Rome s'accroît et atteint son maximum, comme aussi les manifestations de l'intelligence (§ 2354 et sv.); la liberté économique est assez grande.
(A-1). Les obstacles légaux à la circulation de l'élite, d'abord considérables, se réduisent à rien pour les citoyens [FN: § 2548-1] . Les campagnards et les citadins tendent à l'égalité. Les descendants au second degré – exceptionnellement aussi au premier degré – des affranchis obtiennent l'ingénuité et peuvent entrer dans l'élite.
(A-2). Effectivement, la guerre, le commerce, enfin le recouvrement des impôts [FN: § 2548-2] , font surgir de nombreuses sources de richesses. La circulation est intense, sans être pourtant trop hâtive [FN: § 2548-3], au moins en général. Une règle, qui d'ailleurs souffre diverses exceptions selon les temps, et qui persistera jusqu'à la chute de l'Empire, veut qu'une famille ne puisse s'élever dans les couches sociales que peu à peu. D'esclave, un homme devient affranchi ; ses descendants au second degré sont ingénus. S'ils obtiennent des magistratures, ils peuvent entrer dans l'ordre équestre. Ensuite, leurs descendants peuvent acquérir la nobilitas. Toujours si l'on observe la règle, le même homme ne peut obtenir les magistratures que dans un ordre déterminé. Le mouvement général, d'abord lent, devient intense vers la fin de la République, qui marque un temps d'anarchie, où l'on observe peu les règles.
(B-1). Toute ou presque toute l'élite est composée d'éléments indigènes. Toutefois, vers la fin de la République, de grands changements soudains se produisent chez les citoyens et dans l'élite [FN: § 2548-4]. Enfin, on sait que la guerre sociale se termina avec l'admission au droit de cité romain d'une partie des citoyens des cités italiques.
(B-2) Quelques-uns des nouveaux citoyens étaient vraisemblablement des paysans, et ont apporté dans le peuple romain des résidus de la IIme classe ; mais le plus grand nombre étaient probablement des gens avisés, riches en résidus de la Ire classe ; car, seuls ces individus savaient se tirer des circonstances difficiles du temps, et obtenir des puissants les droits de cité. Il faut faire une observation analogue pour les esclaves qui obtenaient la liberté. Une comparaison établie par Denys d'Halicarnasse [FN: § 2548-5] , entre les affranchis anciens et ceux de son temps, montre que ces derniers possédaient des résidus de la Ire classe en plus grande abondance que les premiers. Ces résidus s'accroissaient aussi, en comparaison de ceux de la IIme classe, dans la caste gouvernante, qui recevait une quantité toujours plus grande de « spéculateurs ». Il faut distinguer le mouvement qui apporte de nouveaux citoyens de celui qui modifie l'élite. Dans celle-ci même, il faut distinguer différentes parties. Les soldats n'y manquent pas encore ; ce sont eux qui, après quelques tentatives infructueuses, constitueront l'Empire. Les « spéculateurs » forment la plus grande partie de l'élite. Ils se tournent toujours du côté d'où souffle un vent favorable ; ils intriguent au forum et achètent les votes aux comices, tant que cela peut leur profiter ; ils se révoltent avec la plus grande facilité et favorisent les militaires, s'ils peuvent en retirer quelque avantage. Nous les trouvons surtout parmi les chevaliers, mais il y en a aussi dans les autres classes. Enfin, il est une catégorie de gens timorés, souvent honnêtes, qui croient en l'efficacité des lois contre les armes, qui perdent toujours plus leur énergie [FN: § 2548-6]et creusent leur propre fosse. Dans l'histoire, on voit apparaître ces gens surtout parmi les sénateurs, chez lesquels on trouve d'ailleurs aussi des « spéculateurs » (§ 2542). Nous avons déjà remarqué d'une façon générale (§ 2338) que ce sont les mêmes causes qui provoquent d'abord la prospérité, puis la décadence. À la naissance d'un enfant, on peut prévoir à peu près ce qu'il sera physiquement quand il sera vieux ; de même, on peut prévoir, lorsqu'on connaît les circonstances, quel sera le développement d'aristocraties comme celles de Sparte ou de Venise, de peuples qui se séparent des autres, comme celui d'Athènes ou aussi de Chine, de peuples chez lesquels des conquêtes et des spéculations fournissent les nouveaux éléments de la classe dominante, comme ce fut le cas pour le peuple romain. Quelques mots de Florus [FN: §2548-7]donnent la synthèse du phénomène à la fin de la République. Ils nous décrivent les maux auxquels aboutit l'évolution de la ploutocratie. Mais précédemment, plutôt que des maux, il en était résulté un bien pour Rome. Polybe le vit ; il connut Rome, précisément lorsque les causes qui firent ensuite tomber l'État en décadence faisaient sa puissance et sa prospérité. Il fut frappé du fait que toute la population visait à des entreprises économiques et financières. Sous des formes quelque peu différentes, le phénomène était au fond en grande partie semblable à celui qu'on observe aujourd'hui chez les peuples civilisés. Polybe s'arrête surtout (VI, 17) aux travaux affermés par les censeurs ; entre autres les perceptions d'impôts. Il remarque que tout le peuple y prend part « (VI, 17, 4). Les uns afferment pour eux-mêmes, auprès des censeurs ; d'autres s'associent avec les premiers ; d'autres se portent caution ; d'autres engagent leurs biens pour ces cautions ». Voilà qu'est né ce qu'on appellera un jour la ploutocratie. Tant qu'elle est faible, elle demeure soumise ; quand elle sera forte, elle dominera. En attendant, entre ces deux états, elle donnera à Rome puissance et prospérité. Les hommes qu'a vus Polybe exploitaient, et leurs descendants exploiteront encore plus les conquêtes de Rome [FN: § 2548-8] et tous les pays du bassin de la Méditerranée, même ceux que la domination romaine n'atteignait pas encore. On pourra plus ou moins leur appliquer à eux tous les paroles de Cicéron au sujet des Gaules [FN: § 2548-9]: « La Gaule est pleine de négociants, pleine de citoyens romains. Aucun Gaulois ne tient un négoce sans un citoyen romain. Il ne circule pas non plus une pièce de monnaie dans les Gaules sans qu'elle soit sur les registres des citoyens romains ». La prospérité économique et financière fut alors vraiment très grande. Elle ressemble, toutes proportions gardées, à la prospérité des peuples civilisés modernes au début du XXme siècle. Alors comme aujourd'hui, les prix montaient et le luxe croissait [FN: § 2548-10] . Il est évident que de tels et de si graves intérêts de la classe nombreuse des « spéculateurs » constituaient une force assez puissante pour avoir la haute main dans l'État, si elle n'était pas contenue par une autre force égale ou à peu près (§ 2087 et sv.). Au temps de Polybe, la ruse suffisait encore. Cet auteur remarque (VI, 17, 5) que tous les travaux affermés par les censeurs dépendent du Sénat : « (6) et vraiment les cas sont nombreux où le Sénat peut causer de grands dommages, ou au contraire favoriser ceux qui ont affermé les recettes et les entreprises publiques [FN: § 2548-11]». Voilà que nous apercevons une nouvelle force. Nuisible ou profitable, elle devra être prise en considération par la ploutocratie, dont les opérations seront alors plus profitables que nuisibles à la République, et de beaucoup. En même temps, l'obstacle une fois surmonté, la corruption et la violence auront le champ libre, jusqu'à ce que surgisse une autre force plus grande, celle des armes, qui les refoulera. Celui qui peut être très utile ou très nuisible à autrui se trouve nécessairement exposé à la corruption ou à la violence d'autrui. On observe ce fait en tout temps (§ 2261-1). Le présent et le passé s'expliquent mutuellement. Un corps qui, comme le Sénat romain, a tant de pouvoir, est aussi exposé à la rivalité de ceux qui veulent le déposséder et acquérir pour eux-mêmes ce pouvoir. En outre, celui qui dépend de ce corps ou des rivaux de ce corps, s'aperçoit tôt ou tard qu'il vaudrait mieux ne dépendre de personne, et tâche de dominer. On pouvait donc bien prévoir que le Sénat ne serait pas laissé en possession pacifique du pouvoir, et que la corruption et la violence changeraient de forme suivant qui détiendrait ce pouvoir, tandis qu'elles s'accroîtraient en même temps que les profits qu'on attendait ou qu'on obtenait d'elles. Polybe eut aussi l'occasion d'observer l'un des moyens par lesquels le Sénat maintenait son pouvoir : le privilège qu'il avait de juger les causes privées et les causes publiques. On pouvait donc aisément prévoir que la lutte s'engagerait à propos de ce privilège. On sait assez qu'il en fut effectivement ainsi.
(B-3). L'élite est encore en grande partie une classe guerrière mais la séparation entre les fonctions militaires et les fonctions civiles commence déjà [FN: § 2548-12]. En outre, l'armée, qui était primitivement composée surtout de citoyens propriétaires, et dans laquelle les résidus de la IIme classe étaient par conséquent puissants, tend à devenir en partie un ramassis de mercenaires, donc d'hommes qui sont l'instrument et l'auxiliaire des chefs chez lesquels abondent les résidus de la Ire classe [FN: § 2548-13].
§ 2549. II Du principat d'Auguste au temps des Antonins. Nous sommes toujours près du maximum observé dans la période précédente, mais la décadence commence. Au gouvernement par la ruse s'est substitué le gouvernement par la force. Il n'est plus nécessaire de corrompre les comices, car, rendus impuissants, ils ne tardent pas à disparaître entièrement. À la violence dans les comices succédera bientôt celle des prétoriens. Mais, sous Auguste et Tibère, les prétoriens sont encore soumis à l'empereur : ils constituent un moyen de gouverner, ils ne dominent pas. Les « spéculateurs » sont tenus en bride ; ils peuvent faire beaucoup de bien et peu de mal. C'est une période analogue à celle qu'on observa quand ils étaient tenus en bride par l'autorité du Sénat, par l'influence des citoyens campagnards. Mais, de même que cette organisation gouvernementale devait donner un temps de prospérité, puis un temps de décadence, ainsi la nouvelle organisation gouvernementale devait provoquer des phénomènes analogues ; et de même que la période précédente avait montré le bon et le mauvais côté d'un gouvernement qui a pour moyen principal la ruse (résidus de la Ire classe), la nouvelle période montrera le bon et le mauvais côté d'un gouvernement qui s'appuie principalement sur la force (résidus de la IIme classe.
(A-1). La tendance à la cristallisation commence [FN: § 2549-1]. On a une noblesse qui tend à se fermer : un ordo senatorius et un ordo equester [FN: § 2549-2] . Ces phénomènes sont en état de mutuelle dépendance avec l'augmentation des résidus de la IIme classe. Le nombre des citoyens augmente ; les fils des affranchis obtiennent l'ingénuité. Il est naturel qu'au fur et à mesure de la dégradation du droit de cité, ce droit soit accordé avec une libéralité toujours plus grande.
(A-2). Sous le Haut Empire, le commerce et l'industrie continuent à jouir de la liberté qu'ils avaient eue sous la République [FN: § 2549-3] . Ils offrent toujours le moyen de s'enrichir à un grand nombre de gens [FN: § 2549-4] . Ils absorbent même une partie des énergies qu'on dépensait précédemment dans les brigues des comices. De même, aujourd'hui, les occupations économiques absorbent, en Allemagne, au moins une petite partie des énergies qui, dans d'autres pays, sont dépensées en brigues politiques. La circulation effective de l'élite est toujours considérable [FN: § 2549-5] .
(B-1). L'invasion d'éléments étrangers, déjà commencée à la fin de la République, croît en intensité, non seulement parmi les citoyens, mais aussi dans l'élite, et appauvrit toujours plus de vieux sang romain ou même seulement italien [FN: § 2549-6] (§ 2546-1) le peuple et ses chefs, qui continuent à se dire Romains. Ces étrangers apportent en grande abondance des résidus de la IIme classe. Le vieux chêne romain dépérit ; une petite plante naît, qui grandira ensuite avec l'invasion des religions orientales, le culte de Mithra, le triomphe du christianisme.
(B-2). La manière dont les esclaves obtiennent la liberté ne change pas beaucoup. Par conséquent, un choix d'hommes possédant certains résidus de la Ire classe continue à exister ; mais ce choix se fait dans une collectivité où les résidus de la IIme classe sont puissants. Si l'on choisit les hommes de plus haute taille dans un peuple de nains, on a des hommes plus petits que si on les choisit dans un peuple normal, et beaucoup plus petits que si on les choisit dans un peuple de géants. Ces considérations s'appliquent à l'élite. On y entre surtout par les artifices de la « spéculation » et par la faveur des empereurs [FN: § 2549-7] . Ce fait tend à y accroître les résidus de la Ire classe. Mais l'origine ethnique y oppose de nombreux résidus de la IIme classe. Par conséquent, dans l'ensemble, d'abord la proportion des résidus change peu, il y a une certaine égalité entre le présent et le passé ; puis, petit à petit, les résidus de la IIme classe l'emportent. La classe gouvernante devient une classe de fonctionnaires [FN: § 549-82] , présentant l'étroitesse d'idées propre à ces personnes.
(B-3). La séparation entre les fonctions civiles et les fonctions militaires s'accentue [FN: § 2549-9]; et ces fonctions tendent à se séparer complètement [FN: § 2549-10]. La classe militaire domine par l'Empereur. Elle constitue une force brutale, non une élite. La classe gouvernementale prend un caractère toujours plus civil. Elle ne peut pas, elle ne veut pas, elle ne sait pas faire usage de la force.
§ 2550. III. Des Antonins à Gallien. La grande prédominance des résidus de la persistance des agrégats manifeste toujours plus ses effets. La décadence politique, militaire, financière, intellectuelle de Rome, devient toujours plus grande. Les institutions économiques et sociales deviennent toujours plus rigides. Les barbares vont envahir l'empire.
(A-1). La cristallisation des sociétés croît et s'achève. Alexandre Sévère ferme les corporations des arts et métiers. Le décurionat devient une obligation onéreuse (§ 2607-2). La société romaine s'achemine à une société de caste [FN: § 2550-1].
(A-2). La circulation effective devient toujours moindre. L'institution de nombreuses corporations fermées, l'appauvrissement de l'Empire tarissent les sources des nouveaux éléments pour l'élite. Celle-ci ne reçoit plus qu'un petit nombre de « spéculateurs » et de favoris des empereurs. La division en castes est encore plus effective que légale.
(B-1). Désormais, l'élite se compose en grande partie d'éléments étrangers. Les empereurs eux-mêmes sont étrangers.
(B-2). Les « spéculateurs » et d'autres éléments semblables deviennent insuffisants pour renouveler l'élite ; aussi les résidus de la Ire classe y diminuent-ils, tandis que les résidus de la IIme classe s'y accroissent d'une manière démesurée, parce que les quelques éléments nouveaux sont surtout des Orientaux et des Barbares superstitieux.
(B-3). La séparation entre l'élite civile et les fonctions militaires est complète. Désormais l'élite est composée d'un ramassis de gens veules, mûrs pour être conquis par les Barbares [FN: § 2550-2].
§ 2551. Tous ces caractères vont en s'accentuant [FN: § 2551-1] jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident. Alors les Barbares brisent la cristallisation de la société. C'est le principal bienfait dont la nouvelle société leur est redevable. Du reste, encore plus superstitieux que les peuples qu'ils conquièrent, ils augmentent les résidus de la IIme classe, là où ils étaient déjà en quantité surabondante. Par conséquent, à ce point de vue, ils précipitent la ruine de la société. Mais grâce à leur ignorance, ils brisent la machine des institutions impériales, qu'ils auraient cependant voulu conserver, mais qu'ils sont incapables de faire fonctionner. Ils déposent ainsi la semence qui produira une nouvelle civilisation. En effet, avec le temps, çà et là apparaissent des points où, dans un état de mutuelle dépendance, se développent les résidus de la Ire classe et l'activité commerciale (§ 2609). C'est d'une manière semblable qu'en d'autres temps Athènes, Rome et d'autres antiques cités grecques et italiques avaient pris naissance. La diversité des circonstances donne une forme différente aux phénomènes; mais sous cette forme transparaît paraît un fond qui est semblable. Dans le pays où, comme en Provence et en Italie, le commerce, les arts, les industries, permettent aux « spéculateurs » de s'enrichir et d'entrer dans l'élite de la population, en y apportant des résidus de la Ire classe dont cette élite manquait grandement, la prospérité politique, militaire, financière, intellectuelle, reparaît : nous sommes au temps des Communes.
§ 2552. Il faut prendre garde au cours général de semblables phénomènes : celui d'une courbe ondulée dont nous avons vu déjà de nombreux exemples [FN: § 2552-1] . Les considérations représentées aux § 2330 à 2339 s'appliquent au présent cas. Comme d'habitude, nous avons à examiner les théories ou dérivations (c) (§ 2205) et les faits correspondants (a), (b), (d). Appelons (s) l'ensemble de ces faits, uniquement pour nous entendre. Nous avons déjà étudié (§ 2203 et sv.) le phénomène général de la mutuelle dépendance de ces éléments (a), (b), (c), (d) et les cycles qu'on y observe. Maintenant nous allons considérer le phénomène particulier des ondulations qui se produisent au cours du temps, dans ces éléments, et les rapports de mutuelle dépendance que ces ondulations présentent.
L'étude des états successifs de l'organisation économique et de l'organisation sociale conduit à examiner les oscillations successives des catégories (b) et (d), auxquelles on peut ajouter, si l'on veut, les oscillations des sentiments (a), que nous savons d'ailleurs ne pas atteindre une ampleur considérable, si ce n'est dans des temps assez longs. Avec cette restriction, nous pouvons dire que nous considérons les oscillations de l'ensemble (s). Les conceptions des états de (s) et des théories (c) qui y correspondent apparaissent plus ou moins indistinctement sous les termes de « libre échange » ou de « protectionnisme », d'« individualisme » ou d'« étatisme », employés dans le langage vulgaire. Les deux premiers termes ont un sens quelque peu précis ; à la rigueur, on peut les employer dans un raisonnement scientifique (§ 2544). Les deux derniers sont indéfinis, analogues à ceux de « religion », de « morale », etc. Pour pouvoir s'en servir, il faut au moins avoir une lointaine idée de ce qu'ils signifient. D'abord, il est nécessaire de séparer les faits des théories. Si l'on croit que toutes les actions sont logiques, et si, voulant inventer la réalité, on s'imagine que les théories, les dérivations, déterminent les actions de l'homme, on peut sans grave inconvénient confondre les théories et les faits, et ne pas distinguer entre les théories (c) de l'« individualisme » et de l'« étatisme » d'une part, et les faits (a), (b), (d), auxquels ils correspondent d'autre part. Il n'en est pas ainsi pour celui qui connaît le rôle important des actions non-logiques dans les phénomènes sociaux. Il ne lui est pas permis, s'il veut raisonner avec tant soit peu de rigueur expérimentale, de confondre (c) avec l'ensemble (a), (b), (d), que nous désignons par (s). Nous avons séparé (c) de (s) ; mais cela ne suffit pas. À la rigueur, nous pouvons savoir si une théorie (c) est « individualiste » ou « étatiste », de même que nous pouvons savoir si une autre théorie se rapproche plus du nominalisme que du réalisme ; mais il est beaucoup plus difficile de savoir à quels faits (s) correspondent les faits dits de l'« individualisme » ou de l'« étatisme ». Vouloir obtenir en cela de la précision est aussi inutile que de vouloir définir rigoureusement les termes « religion », « morale », « droit », etc. Il convient donc de suivre une autre voie pour classer les états (s). Nous pouvons obtenir quelque rigueur en portant notre attention sur la force des liaisons qui règlent les actions de l'individu. Si cette liaison est faible, nous nous rapprochons de l'état appelé « individualiste » ; si elle est forte, nous nous rapprochons de l'état dit « étatiste ». Il faut ensuite séparer les liaisons économiques qui appartiennent à (b), des liaisons de la circulation des élites, qui appartiennent à (d). Les liaisons de ces deux catégories peuvent être faibles, comme vers la fin de la République romaine et au commencement de l'Empire. Elles peuvent être fortes chez toutes les deux, comme au temps de la grande décadence de l'Empire. Les liaisons de première catégorie peuvent être faibles et celles de la seconde fortes, comme aux temps qui suivirent les invasions barbares. Enfin, les liaisons de la première catégorie peuvent être fortes et celles de la seconde très faibles, comme dans l'état auquel s'acheminent nos sociétés. D'une manière analogue à ce que nous avons fait au § 2339, nous distinguons un aspect intrinsèque et un aspect extrinsèque, tant pour les oscillations des dérivations (c) que pour celles des faits sociaux (s). On obtient le premier aspect, si l'on sépare (c) et (s), et en considérant pour chacune de ces catégories l'action d'une période ascendante sur la période descendante qui la suit, puis de celle-ci sur la période ascendante qui vient après, et ainsi de suite. On obtient le second aspect, en unissant (c) avec (s), et en considérant les actions mutuelles de ces deux catégories. Nous avons donc à étudier les aspects suivants :
- (I) Aspect intrinsèque :
- (I-α). Dérivations (c) ;
- (1-β). Ensemble des faits sociaux (s).
- (II). Aspect extrinsèque :
- (II-α). Action de (c) sur (s) ;
- (II-β). Action de (s) sur (c) ;
- (II-γ). Action des différentes parties de (c) ; (II-δ). Action des différentes parties de (s).
Nous n'avons pas à nous occuper ici spécialement de cette dernière catégorie, car elle fait partie de l'étude générale que nous sommes en train d'accomplir sur les formes des sociétés. Voyons les autres.
§ 2553. (I-α). Aspect intrinsèque des dérivations. Jusqu'à présent, presque tous les auteurs de théories, en matière sociale, ont été mus surtout par la foi en quelque idéal. Par conséquent, ils ont accepté uniquement les faits qui paraissaient concorder avec cet idéal, et ne se sont guère souciés des faits contraires. Lors même que ces théories ont un vernis expérimental, elles tendent à la métaphysique. On peut ranger les dérivations de l'« individualisme » et de l'« étatisme » dans le même genre que le nominalisme et le « réalisme » ; et, bien que les analogies soient beaucoup moins frappantes, les dérivations du « libre échange » et du « protectionnisme » ne s'écartent pas trop de ce genre. Donc, en cela, le cas que nous étudions maintenant est semblable à celui dont il est question aux § 2340 et sv. ; mais entre les deux cas, il y a toutefois une différence notable. Elle consiste en ce qu'actuellement la discordance entre la théorie et la réalité a peu ou point d'influence pratique. Ainsi disparaît la cause qui agissait pour déterminer la succession des périodes, dans le cas du
§2340. Ce fait a lieu parce que dans les matières touchant aux sciences naturelles, il est difficile, presque impossible, d'éviter le contraste entre les dérivations et la réalité expérimentale, tandis que cela est très facile dans les matières touchant les « sciences » sociales. Dans celles-ci, on juge les théories suivant leur accord avec les sentiments ou avec les intérêts, plutôt que d'après leur accord avec la réalité expérimentale. Nous pouvons donc conclure que, dans le présent cas, l'aspect intrinsèque de (c) est peu important.
(I-β) Aspect intrinsèque de l'ensemble des faits sociaux. Contrairement au précédent, cet aspect est très important. Une période d'« individualisme » (dans laquelle les liaisons sont faibles) prépare une période d'« étatisme » (dans laquelle les liaisons sont fortes ») et vice-versa. Dans la première période, l'initiative privée prépare les matériaux dont les institutions rigides de l'État se serviront durant la seconde ; et pendant celle-ci, les inconvénients croissants de la cristallisation sociale préparent la décadence (§ 2607 et sv.), que seule l'apparition nouvelle de la souplesse et de la liberté d'action des particuliers peut changer en progrès (§ 2551). L'expérience nous montre que les oscillations peuvent être d'ampleur et de durée différentes ; mais elle ne nous fait connaître aucun peuple civilisé chez lequel on n'observe pas de ces oscillations. Il est donc peu probable, du moins pour aujourd'hui, qu'il puisse y avoir un état social où elles disparaissent entièrement.
Une société dans laquelle les personnes abondamment douées de résidus de la Ie classe ont toute liberté d'action, apparaît comme désordonnée ; en outre, une partie de la richesse est certainement dilapidée en efforts stériles. Par conséquent, quand la cristallisation commence, la société paraît non seulement mieux organisée, mais aussi plus prospère. La cristallisation de la société romaine, sous le Bas Empire, ne fut pas seulement imposée par le gouvernement : elle fut aussi voulue par la population elle-même, qui y voyait une amélioration de ses conditions. Le fait d'attacher définitivement le colon au sol, l'artisan à son métier, le décurion à la curie, non seulement profitait au gouvernement qui établissait ainsi dans la société une organisation meilleure et plus avantageuse pour lui-même, mais encore, il plaisait aux jurisconsultes, aux intellectuels, qui admiraient un si bel ordre. Elle était désirée, voulue par les propriétaires qui entretenaient les colons, par les corporations qui s'assuraient le concours des gens qui, plus avisés et plus habiles, auraient pu porter ailleurs leurs richesses, par les citoyens qui exploitaient les décurions. On comprend mieux le phénomène en observant les faits contemporains qui sont en partie semblables. La prospérité de nos contrées est, – ne fût-ce qu'en partie – le fruit de la liberté d'action des éléments, au point de vue économique et social, durant une partie du XIXe siècle. Maintenant la cristallisation commence, exactement comme dans l'Empire romain. Elle est voulue par les populations et, en de nombreux cas, paraît accroître la prospérité [FN: § 2553-1]. Sans doute nous sommes loin encore d'un état où l'ouvrier est définitivement attaché à son métier ; mais les syndicats ouvriers, les restrictions imposées à la circulation entre un État et un autre, nous mettent sur cette voie. Les États-Unis d'Amérique, constitués par l'émigration, et qui doivent à l'émigration leur prospérité actuelle, s'efforcent maintenant par tous les moyens de repousser les émigrants. D'autres pays, comme l'Australie, en font autant. Les syndicats ouvriers cherchent à interdire le travail aux gens qui ne sont pas syndiqués. D'autre part, ils sont bien loin de consentir à accepter tout le monde. Les gouvernements et les communes interviennent chaque jour davantage dans les affaires économiques. Ils y sont poussés par la volonté des populations, et souvent avec un avantage apparent pour celles-ci. En Italie, la loi sur la « municipalisation » des services publics était voulue par la population, si bien que le gouvernement l'accorda, tout en l'utilisant comme une arme électorale. Déjà surgissent d'autres analogies qui apparaîtront peut-être davantage dans la suite [FN: §2553-2] . Le pouvoir impérial de la décadence romaine donnait la chasse aux curiales, pour les ramener à leurs onéreuses fonctions (§ 2607) ; le pouvoir de la ploutocratie démocratique de nos sociétés ne donne pas encore la chasse aux personnes aisées, mais bien à leur argent. Pour se soustraire à des charges exorbitantes, les contribuables envoient leur argent à l'étranger, et le gouvernement dont ils dépendent s'indigne et s'efforce de les punir par différents moyens. C'est pourquoi des accords que l'on peut bien appeler une complicité d'exploiteurs, ont été conclus entre les gouvernements de la ploutocratie démocratique, en France et en Angleterre. Le premier de ces gouvernements a voulu obtenir, mais pour le moment en vain, que le gouvernement suisse l'aidât à donner la chasse aux contribuables. Il y a, dans nos sociétés, une propension à faire voter les impôts par la grande majorité, qui ne les paie pas, et à en faire retomber le poids sur une petite minorité. À l'égard des exploiteurs, il y a certainement une grande différence entre cet état de choses et celui de l'Empire romain, où le pouvoir impérial fixait l'impôt que devaient payer les gens aisés ; mais la différence est beaucoup moindre pour les exploités, auxquels il importe vraiment peu que leur argent aille aux auxiliaires de l'empereur ou aux ploutocrates démagogues. Bien plus, à vrai dire, les légions d'un Alexandre Sévère, qui était pourtant si généreux envers ses soldats, coûtaient beaucoup moins que les électeurs du parti d'un Lloyd George [FN: § 2553-3], sans compter que les premiers défendaient au moins leur pays, tandis que les seconds ne défendent que leurs propres jouissances.
En conclusion, il est facile de voir que nous nous mouvons sur une courbe semblable à celle qu'à déjà parcourue la société romaine après la fondation de l'Empire, et qui, après avoir présenté une période de prospérité, se prolongea jusqu'à la décadence. L'histoire ne se répète jamais, et il n'est pas du tout probable, à moins que l’on ne croie au « péril jaune », que la période future et nouvelle de prospérité provienne d'une autre invasion barbare. Il serait moins improbable qu'elle résultât d'une révolution intérieure, laquelle donnerait le pouvoir aux individus qui possèdent en abondance des résidus de IIe classe, et qui savent, qui peuvent, qui veulent faire usage de la force. Mais ces éventualités lointaines et incertaines sont dans le domaine de la fantaisie, plus que dans celui de la science expérimentale.
(II-α) Aspect intrinsèque. Action de (c) sur (s). Cette action n'est pas exclue, mais elle est habituellement peu importante. Il faut surtout remarquer que (c), après avoir tiré son origine de (s), réagit sur ces phénomènes et les accentue : expression d'un état d'esprit, il lui donne plus d'intensité et de vigueur ; manifestation partielle des sentiments de l'intégrité (Ve classe), il les concilie avec les sentiments de la sociabilité (IVe classe) ; voile d'intérêts, il les recouvre et les dissimule à la vue des gens qui ne le sont pas ; théorie dissimulatrice de faits brutaux, il les « justifie », en les conciliant avec la « morale » existant dans la société, et, d'une façon générale, avec les persistances d'agrégats (IIe classe) qui s'y trouvent ; en outre, il satisfait le besoin que les hommes éprouvent d'« expliquer » les phénomènes (résidus I-epsilon), et de cette façon il les distrait de recherches expérimentales qui pourraient servir à apporter quelque modification en (s), fût-elle très petite ; fiction agréable, il satisfait le désir et apaise l'envie des gens qui cherchent à oublier, dans les régions de l'idéal et de la fantaisie, les misères et les laideurs de la réalité, et enlève aux organisations existantes des adversaires militants, contribuant ainsi à maintenir (s) sans trop de changements [FN: § 2553-4] .
(II-β) Aspect extrinsèque. Action de (s) sur (c). On peut voir facilement que les oscillations des dérivations (c) qui constituent les théories du « libre échange » ou du « protectionnisme », et celles des dérivations qui constituent les théories de l'« individualisme » ou de l'« étatisme » suivent de près les oscillations de l'ensemble (s). Cela conduit à dire que les oscillations de (c) correspondent à celles de (s) parce qu'elles en résultent, plutôt que celles de (s) ne résultent de celles de (c). Les théories favorables au libre échange apparaissent lorsque la circulation des élites et les intérêts sont favorisés par le libre-échange [FN: § 2553-5] . Il en est de même pour les théories du protectionnisme. On peut répéter cela pour les théories de l'« individualisme » et de l'« étatisme » (§ 2208 et sv.). Les oscillations de l'ensemble (s) sont donc le phénomène principal. En somme, l'importance des oscillations de (c) consiste presque entièrement en ce qu'elles nous donnent l'image des oscillations de (s).
(II-γ) Aspect extrinsèque. Action des différentes parties de (c). L'usage des raisonnements logico-expérimentaux de l'empirisme, de la pratique, de la science, agit, sinon beaucoup, du moins quelque peu sur les dérivations employées en matière sociale, soit à l'égard des individus, soit à l'égard des collectivités. Dans ses considérations sur les matières sociales, le naturaliste Aristote se rapproche plus de la réalité que le métaphysicien Platon. Machiavel s'en rapproche considérablement, parce qu'il est habitué aux raisonnements de la politique empirique. Pour le même motif, Bismarck ne s'en écarte pas trop, et pour un motif contraire, le rêveur humanitaire qui s'appela Napoléon III s'en écarta beaucoup. À l'égard des collectivités, les théories économiques d'Adam Smith et de J. B. Say se rapprochent de la réalité expérimentale beaucoup plus que tout ce qu'on avait écrit jusqu'alors, mais ne l'atteignent pourtant pas tout à fait. Elles apparaissent au moment où le progrès des sciences naturelles est rapide et très grand. Vice versa, les divagations de l'école historique, les négations puériles de l'existence des lois (uniformités) des sciences sociales apparaissent là où un mysticisme étatiste, un patriotisme morbide empêchent tout contact entre les sciences naturelles qui ont progressé et la littérature qui usurpe le nom de sciences sociales.
§ 2554. Jusqu'ici, nous avons tracé les lignes principales de l'évolution, à Rome, de l'ensemble (s), constitué par les sentiments, par les intérêts, par la circulation des élites, en négligeant un grand nombre de détails qui nous auraient masqué la vue synthétique de l'ensemble. Il convient maintenant d'envisager au moins une partie de ces détails, afin d'acquérir une connaissance plus complète et plus précise du phénomène.
L'origine du sénat romain est obscure. Nous n'avons pas à nous arrêter sur ce sujet. Il se peut que, conformément à la tradition, la nomination des sénateurs appartînt au roi, puis aux consuls. Aux temps historiques, la nomination est confiée aux censeurs (vers l'an 442 de Rome). Lorsqu'ils établissent le cens, ils confirment les sénateurs déjà inscrits et nomment les nouveaux. En fait, l'arbitraire ne jouait pas un grand rôle, car certains magistrats étaient régulièrement inscrits comme sénateurs, au cens qui suivait le terme de leur magistrature. Le nombre de ces magistrats alla toujours croissant aussi longtemps que dura la République. Tant que le Sénat prit une grande part au gouvernement de l'État, c'est-à-dire à peu près jusqu'au temps de Marius et de Sulla, la classe gouvernante put, avec une certaine approximation, être représentée par la classe sénatoriale. Le fait que les fonctions militaires étaient jusqu'alors unies aux fonctions civiles, parmi lesquelles les fonctions judiciaires n'étaient pas les dernières, l'obtention des magistratures par l'élection populaire, la gratuité des magistratures, les us et coutumes, tout cela faisait que cette classe était composée de gens possédant des aptitudes militaires, une certaine intelligence, la pratique de l'administration, la connaissance du droit, et n'ignorait pas les combinaisons par lesquelles on obtenait la faveur populaire ; en outre, elle était passablement aisée ou même riche. Il devait donc s'y trouver une certaine proportion des résidus de l'instinct des combinaisons et de la persistance des agrégats. Cette classe était en grande partie analogue à celle de l'Aréopage à Athènes, ou à celle de la Chambre des Lords, ou de la Chambre des Communes en Angleterre, au temps des guerres contre Napoléon Ier. Si l'on prête attention au fait qu'au-dessous, il y avait une classe gouvernée, chez laquelle les résidus de la persistance des agrégats étaient puissants, tandis que ceux de l'instinct des combinaisons se trouvaient en quantité suffisante pour suivre les propositions de la classe gouvernante, on comprend facilement que le maximum de prospérité fût atteint précisément dans la période qui va de la seconde guerre punique à la conquête de la Grèce et de l'Asie.
§2555. Les éléments de la richesse et de la spéculation semblent n'avoir jamais manqué à Rome, depuis l'origine des temps historiques. Ils ont peut-être indirectement servi à provoquer l'ascension dans la classe gouvernante, au moins des descendants des nouveaux riches. Mais directement, de ce fait, ils n'eurent pas un grand pouvoir jusqu'à la conquête des opulentes régions grecques et asiatiques.
§2556. Il est remarquable qu'en l'an 200 avant J.-C. le peuple rejeta la proposition de déclarer la guerre au roi de Macédoine. Tite-Live dit que « (XXXI, 6) fatigués d'une guerre longue et difficile, les hommes firent cela spontanément, poussés par la répugnance pour les fatigues et les dangers. En outre, Q. Bebius, tribun de la plèbe, suivant l'antique procédé d'accuser les patriciens, leur reprochait de faire naître les guerres les unes des autres, afin que la plèbe ne pût jamais jouir de la paix ». Sous ces mots, il est facile de découvrir l'éternel conflit entre les deux classes de citoyens indiquées au § 2235 : entre la classe caractérisée par un revenu presque fixe, et celle qui est caractérisée par un revenu très variable. Les petits propriétaires romains étaient ruinés par la guerre, s'ils ne prenaient pas part aux spéculations qu'elle provoquait. Au contraire, ceux qui dépouillaient les provinces et spéculaient, s'enrichissaient. Entre les uns et les autres se produisait le conflit que Tite-Live raconte comme s'il avait eu lieu entre le Sénat et le peuple (§ 2542). Lui-même nous en donne la preuve. Lorsque, en l'an 171 avant J.-C., on proposa la troisième guerre de Macédoine, il y avait, pour la rejeter, des motifs encore plus graves que ceux indiqués plus haut. Pourtant le peuple accepta sans opposition, et les hommes accouraient s'enrôler volontairement parmi les soldats, « parce qu'ils voyaient que ceux qui avaient pris part à la première guerre de Macédoine ou à celle contre Antiochus en Asie, s'étaient enrichis [FN: § 2556-1]».
§ 2557. Ainsi se transformait peu à peu la nature de la population romaine. Le nombre et la puissance de ceux auxquels les pillages de la guerre et les spéculations procuraient un revenu variable croissaient d'une façon démesurée. La plèbe citadine leur prêtait son appui, grâce à l'intérêt commun que ces deux classes avaient à maintenir une telle organisation. En effet, la seconde participait aux entreprises de la première directement, ou en vendant ses suffrages [FN: § 2557-1] , ou d'une autre façon. De même, une partie de la plèbe campagnarde, abandonnant ses champs, trouvait dans les armes un métier lucratif. D'autre part, la multitude croissante des clients ne manquait pas non plus d'offrir son appui. Ensuite, il y avait lutte entre ces différentes classes pour le partage du butin. En attendant, cette partie de la plèbe campagnarde qui vivait du travail de la terre, allait en diminuant. Ce ne sont pas les latifundia qui perdirent l'Italie, mais bien cet ensemble de faits dont les latifundia même provinrent en partie (§ 2355). Les guerres de la conquête romaine produisaient alors le même effet que, de nos jours, la rapide expansion de l'industrie et l'exploitation des pays neufs en Amérique, en Asie, en Afrique. Dans nos contrées, le nombre et la puissance des « spéculateurs » se sont beaucoup accrus et s'accroissent toujours. Le peuple citadin leur prête son appui, grâce à l'intérêt commun que ces deux collectivités ont à maintenir l'organisation actuelle de ploutocratie démagogique. En effet, la seconde participe aux entreprises de la première, directement ou indirectement par des intrigues politiques. De même, une partie de la plèbe urbaine, abandonnant ses champs, accourt vers les villes, où l'attirent un meilleur salaire et un travail plus facile. Il faut y ajouter de nombreux bourgeois, tels que les avocats, les notaires, les ingénieurs, les médecins, etc., qui font payer grassement leur concours par les « spéculateurs », auxquels l'argent coûte si peu ; ces spéculateurs font preuve de la munificence des anciens patrons envers leurs clients. Ensuite, il y a quelquefois lutte par les grèves ou autrement entre ces différentes classes, pour le partage du butin. En attendant, on se plaint toujours plus de l'abandon des campagnes, et l'on restreint la surface occupée par la petite propriété. Si l'esclavage et le colonat existaient, les latifundia augmenteraient. On sait assez que bien loin de s'opposer à un tel mouvement, la plèbe socialiste l'invoque et se montre hostile de différentes manières à la petite propriété, et plus encore au métayage. En Romagne, non seulement des grèves, mais aussi des conflits armés se produisent pour changer l'organisation de la propriété, et l'acheminer vers un état dans lequel il ne resterait que des propriétaires et des mercenaires ; état analogue à celui des latifundia. Les « spéculateurs » qui dominent dans la Rome moderne, à l'instar de ceux qui dominaient dans la Rome de la fin de la République, ne font rien, de même qu'ils ne faisaient rien alors, pour s'opposer à cette transformation. Au contraire, comme ils y aidaient alors, ils y aident aujourd'hui, lorsqu'ils ont besoin des suffrages de la plèbe. Ce phénomène contemporain nous permet de mieux comprendre celui de la Rome ancienne. Il nous montre que les latifundia furent en de nombreux cas une conséquence de faits dont on les a crus la cause, et mieux encore qu'ils furent dans un état de mutuelle dépendance avec ces faits.
§2558. Les auteurs éthiques se sont escrimés à disserter sur la « corruption » qui fut la « conséquence » de l'augmentation de la richesse à Rome. Ils ont répété avec une infinité de variantes ce que disait déjà Diodore de Sicile [FN: § 2558-1] . L'un s'en prend à la richesse en général ; l'autre seulement à la richesse produite par le « crime » de la guerre et des extorsions qui en furent la conséquence. D'une manière générale, les déclamations sur la pauvreté vertueuse du passé, opposée à la richesse vicieuse du présent, recouvrent le fait d'un changement dans la proportion existant entre les individus qui possèdent une rente presque fixe, chez lesquels prédominent les résidus de la IIe classe, et les individus possédant des revenus très variables, et chez lesquels prédominent les résidus de la Ire classe.
§ 2559. D'autres auteurs accusèrent la concentration de la richesse § 2355) ; d'autres, les latifundia (§ 2557) ; d'autres, le « capitalisme (§ 1890) ; d'autres, la perversité de l'« aristocratie » romaine, qui opprimait et anémiait le bon peuple ; d'autres, l'esclavage, « honte » de ces temps ; d'autres encore s'en prirent aux défauts de la constitution politique de Rome. Certains prétendent que si cette constitution avait été plus démocratique, si elle avait eu un parlement pour représenter les peuples sujets – si elle s'était rapprochée davantage de la constitution parfaite de l'empire allemand, disent certains autres – elle aurait certainement assuré une prospérité très longue, peut-être éternelle, à la puissance romaine. Ces ouvrages peuvent être agréables, comme les romans historiques de Dumas, mais ils s'écartent beaucoup de la réalité.
§ 2560. Les faits sont si puissants qu'ils transparaissent à travers les dérivations dont les auteurs les recouvrent (§ 2356). Voici, par exemple, Duruy qui écrit [FN: § 2560-1]: « (p. 283) Un siècle de guerres, de pillage et de corruption [simplement la transformation produite par les nouvelles sources de richesse ; un segment du cycle (b) (d)-(d) (b) (§ 2321)] avait dévoré la classe des petits propriétaires [comment dévoré ? Ils avaient simplement changé d'occupation : de la classe des personnes à revenu presque fixe, ils avaient passé dans celle des « spéculateurs » ou des auxiliaires de ceux-ci] à qui Rome avait dû sa force et sa liberté ». Il devait dire que cette prospérité était due à une proportion favorable entre cette classe et l'autre, où prédominaient les résidus de l'instinct des combinaisons, et qu'elle avait disparu lorsque la proportion était devenue défavorable. Il est remarquable que, sans trop de recherches, on puisse déduire cela de ce qu'il dit lui-même un peu plus haut. « (p. 282) Les prodiges étaient toujours aussi nombreux, aussi bizarres, c'est-à-dire le peuple et les soldats aussi grossiers, aussi crédules [prédominance des résidus de la persistance des agrégats]. Les généraux voulaient des temples, mais, comme Sempronius Gracchus, pour y graver le récit de leurs exploits ou y peindre leurs victoires. Ils immolaient avant l'action de nombreuses victimes, mais pour contraindre, comme Paul Émile, l'impatience des soldats et attendre le moment propice. Ils observaient gravement le ciel avant et durant la tenue des comices, mais pour se réserver le moyen de dissoudre l'assemblée, obnuntiatio, si les votes semblaient devoir contrarier les desseins du Sénat ».
§ 2561. Puis il dit très bien : « (p. 293) Ainsi chaque jour les besoins croissaient, et chaque jour aussi, du moins pour le pauvre, qui avait les périls, mais non les profits durables de la conquête, les moyens de les satisfaire diminuaient ». De la sorte, ceux que Duruy appelle les pauvres, et qui étaient en réalité des individus de la classe à revenus presque fixes, étaient chassés par force dans la classe des « spéculateurs » ou de leurs auxiliaires. On peut constater le même phénomène à l'époque actuelle. Les parvenus et les gains subits eurent à Rome des effets semblables à ceux qu'ils ont eus chez tous les peuples et en tous les temps [FN: § 2561-1]. Deloume se rapproche beaucoup de la vérité au sujet du phénomène qui se produisait après la conquête de la région méditerranéenne et peu de temps avant la fin de la République [FN: § 2561-2]. C'est une époque qui présente plusieurs analogies avec le temps présent. La comparaison avec l'Angleterre, que Deloume fait sienne, suivant en cela Guizot, est parfaitement conforme à la vérité ; il est remarquable qu'elle se soutienne jusqu'à présent. Ce furent les squires, les petits propriétaires fonciers, qui sauvèrent le pays, au temps des guerres napoléoniennes. Ensuite, la part qu'ils prenaient au gouvernement alla toujours en diminuant, tandis qu'augmentait et que continue à augmenter la part des « spéculateurs ». On sait assez qu'aujourd'hui (en 1913) le ministre Asquith a, dans sa majorité, bon nombre de ces « spéculateurs » millionnaires, qui sont parmi les plus fervents admirateurs des invectives de son parti contre les « riches ». Leur lutte avec les lords correspond à celle qui eut lieu à Rome vers la fin de la République, entre les chevaliers et les sénateurs.
§ 2562. La conquête de la région méditerranéenne procura aux vainqueurs une source de gros profits pour qui possédait à un haut degré l'art des combinaisons. Avec de l'argent largement dépensé à Rome, on acquérait le droit d'exploiter des provinces, de se récupérer de ses frais et au-delà [FN: § 2562-1] ; c'était une spéculation, précisément comme celle des gens de notre temps qui s'enrichissent grâce aux droits protecteurs qu'ils achètent des électeurs et des législateurs.
§2563. Les phénomènes de ce temps et ceux d'aujourd'hui sont semblables en de nombreux points ; pourtant ils présentent une différence très importante, qui explique, au moins en partie, le caractère que présenta la constitution de l'Empire romain. La différence consiste en ce que les auxiliaires des « spéculateurs » étaient alors en partie civils et en partie militaires ; tandis qu'aujourd'hui ces auxiliaires sont presque exclusivement civils. La partie militaire, à Rome, finit par se tourner contre les spéculateurs.
§2564. Beaucoup de gens ne trouvaient pas accès aux sources de gain mentionnées plus haut, et manquaient des aptitudes nécessaires à ces combinaisons ; mais l'énergie, le courage, les résidus de la persistance des agrégats ne leur faisaient pas défaut. Ces gens se mirent au service de chefs ingénieux, hardis, fortunés, pour un temps plus ou moins long, et formèrent les armées de Marius, de Sulla, de César, d'Antoine, d'Octave. Si l'on ne prête attention qu'aux agriculteurs, on voit alors diminuer la classe moyenne à Rome. Mais aux agriculteurs manquants se substituent les soldats de métier, et aux races italiques les races grecque et orientales.
§2565. Nous avons remarqué plusieurs fois que le point faible du gouvernement des « spéculateurs » gît dans leur défaut de courage et dans leur manque d'aptitudes à savoir faire usage de la force. Ces gouvernements sont donc habituellement détruits par les gens qui savent employer la force, que ce soient des ennemis intérieurs ou des étrangers : ils succombent à la suite de guerres civiles ou extérieures. En ce qui concerne les révolutions intérieures, on remarquera que la catastrophe finale est souvent précédée de tentatives de révoltes, tentatives qui sont réprimées et qui échouent.
§ 2566. Si l'on se laisse guider exclusivement par les conceptions des actions logiques, on est entraîné à juger séparément ces tentatives, à rechercher la cause et les effets de chacune. Habituellement on trouve la cause dans les souffrances de la classe sujette. Comme ces souffrances ne font jamais défaut, et qu'elles diffèrent seulement d'intensité, cette cause ne fait jamais défaut non plus. Si l'on pouvait établir cette proposition : que les tentatives de révolution sont d'autant plus fréquentes et ont une probabilité de victoire d'autant plus grande que les souffrances sont plus grandes [FN: § 2566-1], la cause trouvée aurait de la valeur, en considération de l'intensité de ces souffrances. Mais en réalité il n'en est pas ainsi. Depuis les temps les plus anciens, on a observé que les révoltes ont souvent lieu quand les conditions du peuple se sont améliorées. C'était même une maxime de gouvernements anciens que les peuples sont d'autant moins dociles qu'ils sont plus aisés [FN: § 2566-2] . Cela est peut-être vrai jusqu'à un certain point, mais non au-delà. Une théorie contraire voudrait que la classe gouvernante ne puisse assurer son pouvoir qu'en faisant le bien de la classe gouvernée. Là encore, il y a une part, mais seulement une part de vérité. Les personnes qui acceptent cette théorie sont entraînées, peut-être à leur insu, par le fait qu'elles ont accepté l'une des solutions affirmatives indiquées aux § 1902 et sv., par le désir de montrer que celui qui fait le bien obtient nécessairement la récompense de ses œuvres, ou par l'intention de faire que cela ait lieu à l'avenir, s'il n'en a pas toujours été ainsi dans le passé [FN: § 2566-3].
§2567. En ce qui concerne les effets des tentatives de révolte, beaucoup de gens proclament sans autre que toute révolte vaincue et réprimée est désavantageuse ou du moins inutile à la classe sujette. Ils auraient raison si l'on pouvait envisager le fait séparément des autres et comme une action logique, car personne ne pourra nier qu'il est désavantageux ou du moins inutile de s'exposer à une défaite. Mais en réalité la question se présente différemment. Ces tentatives malheureuses de révoltes doivent être considérées comme des manifestations d'une force qui, d'abord inférieure à celle qui la tient en échec, finit par la vaincre, lorsque se produit la catastrophe finale. Il se peut que ces tentatives affaiblissent cette force ou qu'elles n'agissent pas dans une mesure notable ; mais il se peut aussi qu'elles en accroissent l'intensité ; cela dépendra des circonstances. Il se peut enfin – et c'est ce qui arrive très souvent – que les tentatives de révolte soient une conséquence de l'intensité de la force qu'elles manifestent. En ce cas on ne saurait vouloir que, d'une part l'intensité de cette force aille en croissant, et que, d'autre part, les tentatives qui la manifestent fassent défaut.
§2568. On observe fréquemment que la catastrophe se produit, non parce que la force manifestée par les tentatives de révolte croît, au point de l'emporter sur les forces qui maintenaient l'équilibre social, mais parce que cette force, en croissant, modifie l'action d'autres forces, et surtout de celles de l'armée. Soit parce que l'armée cesse de s'opposer aux éléments révolutionnaires, soit parce qu'elle se ligue avec eux, ou encore parce qu'elle s'y superpose, elle détermine le changement de l'organisation sociale. Celui-ci est de la sorte, non pas directement, mais indirectement un effet de la force qui se manifeste par les tentatives de révolte ; mais il n'en est pas moins dépendant de cette force.
§ 2569. Les personnes qui jugent les tentatives de révolte d'après les règles de la légalité, du droit, de l'équité, de l'éthique, de la religion, raisonnent plus mal encore que celles qui prennent en considération uniquement des actions logiques. Nous avons déjà parlé longuement de dérivations analogues (§ 2147-18-, 2181 et sv.). Il nous reste à ajouter quelques considérations touchant le cas spécial examiné tout à l'heure.
§ 2570. Quant à la légalité, il est évident qu'on y attente, non seulement par tout acte révolutionnaire, ou par tout coup d'État, mais aussi par tout autre acte qui prépare le bouleversement de l'organisation existante. Il est donc parfaitement inutile de disputer là-dessus. C'est pourtant ce qu'on fait, du côté de ceux qui défendent, aussi bien que du côté de ceux qui veulent changer une certaine organisation sociale. Ceux qui la défendent cherchent à se servir des sentiments qui représentent comme « coupable » tout acte contraire à la légalité. Aussi ne comprennent-ils pas, ou feignent-ils de ne pas comprendre, que c'est précisément cette légalité qu'on veut changer. Ceux qui veulent attaquer l'organisation sociale cherchent pour la détruire, à se servir des forces mêmes qui naissent de cette organisation. Aussi s'efforcent-ils de démontrer, même contre toute évidence, que des actes tendant à la révolte sont « légaux », et que par conséquent ils ne peuvent ni ne doivent être réprimés par les personnes qui défendent cette organisation [FN: § 2570-1] .
§2571. Quant aux principes du droit, de l'équité, de l'éthique, de la religion, on les invoque parce qu'on ne sait que trouver d'autre, lorsqu'on ne veut pas demeurer dans le domaine logico-expérimental, et parce qu'ils ont le grand avantage de se prêter à la démonstration de tout ce qu'on désire. Les principes des religions, excepté ceux de la toute puissante religion démocratique, sont aujourd'hui tombés en désuétude. Restent les principes du droit, de l'équité, de l'éthique, qui sont vivaces. On y a recours pour juger non seulement les conflits d'ordre intérieur, mais aussi ceux d'ordre international.
§2572. Les principes juridiques peuvent être quelque peu et même très précis ; ils peuvent donc donner des conclusions concordant avec la réalité, ou du moins ne s'en écartant pas trop (§ 1772 et sv.), s'ils sont employés dans les contestations entre simples particuliers, dans les sociétés où ils sont généralement acceptés, et dont ils manifestent par conséquent des sentiments communs. Cette condition disparaît lorsqu'une partie de la population s'insurge contre l'autre. L'accord de ces principes avec la réalité disparaît donc aussi, et l'on ne peut plus les utiliser, si l'on ne veut pas leur donner une valeur absolue qui échappe au domaine expérimental. Des considérations analogues s'appliquent à leur usage dans les conflits internationaux. Ils peuvent donner des conclusions qui ne soient pas en contradiction avec la réalité, s'ils sont employés entre nations qui y consentent, et dont ils manifestent des sentiments communs. Mais cette propriété disparaît si ce consentement et cette communauté de sentiments font défaut. La précision fait aussi défaut aux principes éthiques, et les personnes qui les emploient dans les cas examinés tout à l'heure recherchent uniquement les rapports des faits avec leurs sentiments, et non pas les rapports des faits entre eux, les uniformités expérimentales. Mais la première opération est beaucoup plus facile à effectuer que la seconde et produit des ouvrages plus facilement compris du vulgaire. C'est pourquoi elle est généralement en usage.
§ 2573. L'histoire de la décadence de la République romaine offre plusieurs exemples de tentatives parties d'en bas ou d'en haut pour renverser les institutions légales. Nous ne nous étendrons quelque peu que sur une seule de ces tentatives, parce qu'elle présente quelques analogies avec les mouvements révolutionnaires, anarchistes et autres de notre temps. La conjuration de Catilina est restée célèbre dans l'histoire. Le récit qu'en fait Salluste apparaît comme une amplification ridicule qu'on pourrait à grand peine tolérer dans un drame populaire. L'auteur commence par déclamer contre la soif de l'or, l'avarice ; puis il s'en prend à l'ambition, et nous apprend qu'elle s'écarte moins de la vertu que l'avarice. Ensuite, il pleure sur la perte de la vertu, s'élève contre les mauvaises mœurs. Enfin, il veut bien se rappeler qu'il s'est proposé de nous parler de la conjuration de Catilina, et, après ce bel exorde, il montre d'une manière lumineuse quelles furent les causes de ces maux. « Dans une ville aussi grande que corrompue, Catilina groupait autour de lui, presque comme une garde, – ce qui lui était facile – un ramassis de toutes les infamies et de toutes les scélératesses » [FN: § 2573-1] .
§2574. Heureusement, nous avons d'autres récits, parmi lesquels celui d'Appien. Comme il est plus sobre, il semble se rapprocher davantage de la réalité des faits. Que Catilina fût un individu peu recommandable, c'est ce que disent tous les auteurs, et cela paraît très probable. Mais il semble aussi que cet homme peu honnête n'avait pas d'aptitudes pour les ingénieuses machinations qui procuraient la richesse et le pouvoir à d'autres gens qui n'étaient pas plus honnêtes que lui. En revanche, il avait le courage qui empêche de se résigner à l'oppression. Autour de lui se groupèrent des hommes qui lui étaient semblables. Si nous voulons les tenir tous pour des malfaiteurs, ce qui serait peut-être d'une sévérité excessive, nous dirons que leur conflit avec la classe gouvernante était la lutte des brigands contre les escrocs. Cela explique pourquoi César avait envers les premiers cette bienveillance que l'on témoigne habituellement à ceux qui luttent contre des gens que l'on méprise encore davantage ; ou plutôt, cela explique pourquoi César, qui se souciait peu de l'honnêteté des moyens, pourvu qu'il atteignît son but, méditait dès lors de se servir des brigands qui employaient la force afin d'abattre les escrocs, et pour demeurer lui seul maître des richesses du monde romain.
§ 2575. Appien nous dit que Catilina demanda le consulat et ne l'obtint pas. C'est-à-dire qu'il essaya de lutter par la ruse, et qu'il fut vaincu parce qu'il n'était pas apte à ce genre d'entreprises. « Après cela, il s'abstint entièrement de participer à la vie publique [c'est ainsi que font les intransigeants antiparlementaires de notre temps, pour des motifs analogues], parce qu'elle ne menait à la monarchie, ni promptement, ni sûrement, mais qu'elle était pleine de rixes et de haines [FN: § 2575-1]». Ce n’est pas la tête brûlée que Salluste voudrait nous faire voir. Cicéron lui-même nous raconte que la tombe de Catilina était ornée de fleurs, et qu'on y rendait des honneurs funèbres [FN: § 2575-2] .
§ 2576. Les moralistes qui veulent faire de l'histoire un roman croient devoir ou condamner ou absoudre Catilina. Ceux qui le condamnent voient en lui un ennemi de la patrie ; ceux qui l'absolvent le tiennent pour un ami du « peuple », désireux de secouer le joug de l’« oligarchie ». Il ne manque pas non plus de gens qui suivent la voie intermédiaire, et déclarent juste le but visé par Catilina, pervers les moyens auxquels il eut recours [FN: § 2576-1] .
Les faits sont beaucoup plus compliqués que ces élucubrations poétiques. Catilina semble avoir été un ambitieux dépourvu de scrupules, semblable en cela à Marius, à Sulla, à Crassus, à Pompée, à César, à Octave et à un grand nombre d'autres citoyens qui assurément n'avaient pas une vertu bien rigide. Il cherchait sa voie, et, comme il arrive d'habitude, il la trouva dans le sens de la moindre résistance. S'il avait été plus habile en fait de menées politiques, il les aurait employées avec succès ; il s'y essaya, ne réussit pas, et vit que ce n'était pas son affaire. Il avait un tempérament courageux, fier, intrépide, prompt à faire usage de la force, et peut-être comprit-il, sans en avoir clairement conscience, que là était sa voie ; et il la suivit.
§ 2577. Il aurait pu être un de ces innombrables et obscurs rebelles dont l'histoire s'occupe à peine. Mais le hasard voulut qu'un grand nombre d'autres individus se trouvassent dans son cas. Ils s'y trouvaient à cause de la prédominance des « spéculateurs » dans la classe gouvernante. De la sorte, le phénomène prit de plus amples proportions et fut accentué davantage par l'histoire. Les anciens soldats de Sulla se joignirent à Catilina. Précisément en raison de leur origine, ils étaient accoutumés à la violence et sans expérience des machinations subtiles des politiciens [FN: § 2577-1] . D'autres partisans vinrent à lui ; c'étaient des hommes ruinés, endettés, et qui voulaient, par la violence, obtenir un meilleur sort. Il s'est probablement trouvé parmi eux cette lie sociale qui monte à la surface dans toutes les révolutions ; mais le fait que des hommes comme César furent suspectés d'être des leurs montre qu'il y avait aussi des gens d'autre sorte [FN: § 2577-2]: il y avait ceux que les spéculateurs-politiciens avaient vaincus, et qui désiraient ardemment une lutte où l'on vaincrait par la force plus que par la ruse, par une volonté tenace plus que par une souple ingéniosité [FN: § 2577-2] .
§ 2578. Ce qu'il y avait chez eux de volonté tenace et de force, on le voit dans le fait que, le Sénat ayant promis l'impunité et deux cents sesterces à ceux qui auraient fait des révélations sur la conjuration, personne ne trahit. On le voit mieux encore par la façon dont ils tombèrent à la bataille de Fésules : tous frappés par devant, et le plus grand nombre couvrant de leur cadavre le poste où, vivants, ils avaient combattu [FN: § 2578-1] .
§ 2579. Salluste leur fait dire qu'ils avaient pris les armes, non contre la patrie, mais pour se défendre des usuriers qui avaient privé beaucoup de gens de leur patrie, tous de l'honneur et de leur patrimoine [FN: § 2579-1] . D'autre part, c'étaient précisément les « spéculateurs », c'est-à-dire les chevaliers, qui défendaient Cicéron, gardaient le Sénat, et menaçaient à main armée César supposé complice de Catilina [FN: § 2579-2]
§2380. En ce temps-là à Rome, comme de nos jours dans toute l'Europe, l'accroissement de la richesse avait renchéri la vie. C'est pourquoi ceux qui voulaient se contenter de leur fortune héréditaire étaient bientôt au-dessous de leurs affaires, s'endettaient, se ruinaient. Seuls se tiraient d'affaire, et même s'enrichissaient souvent, ceux qui demandaient à la politique et à la spéculation de nouveaux gains. Plus lâches que les Romains, les vaincus modernes se résignent en partie. Plus fiers que les modernes, les vaincus romains, avant de se résigner, voulaient tenter le sort des armes, qui souvent rompent les filets lâches, bien qu'ingénieux, de la ruse.
§ 2581. Plutarque dit : « Toute l'Étrurie se soulevait déjà en révolte, ainsi qu'une grande partie de la Gaule cisalpine ; et Rome courait le plus grand danger d'un changement complet, à cause de l'inégalité qui y régnait entre les fortunes [c'est l'erreur habituelle répétée par les modernes, qui attribue à l'inégalité des effets qui découlent d'autres causes] ; tandis que les personnages qui étaient le plus en vue, par leur gloire ou l'élévation de leur esprit, s'étaient appauvris par leurs folles dépenses en théâtres, en banquets, en intrigues de magistratures et en édifices [c'était les gens inhabiles aux ruses de la politique ; les habiles se récupéraient largement de ces dépenses en exploitant les provinces, ou bien s'enrichissaient par les spéculations, comme Crassus] ; et par conséquent les richesses accumulées étaient tout entières entre les mains d'hommes ignobles et abjects [d'habiles politiciens, de gens possédant presque exclusivement les résidus des combinaisons] ; et quiconque eût osé, eût été capable de renverser la république, qui d’elle-même était déjà infirme [FN: § 2581-1]». C'est-à-dire quiconque eût osé opposer la force à cette ruse pouvait espérer la victoire. Elle échappa à Catilina, sourit quelque temps à César, fut définitive pour Auguste.
§ 2582. Napoléon dit que [FN: § 2582-1]« Cicéron croyait avoir détruit tout un parti ; il se trompait : Cicéron n'avait fait que déjouer une conspiration et dégager une grande cause [pour l'auteur, c'est celle de la « démocratie » contre l'oligarchie] des imprudents qui la compromettaient ; la mort illégale des conjurés réhabilita leur mémoire... » Ainsi nous retombons dans le roman moral. L'erreur de Cicéron, comme dit Napoléon III, aurait été de ne pas respecter la légalité ! César et Auguste la respectèrent en vérité ! [FN: § 2582-2]Si l'on veut absolument parler de l'erreur de Cicéron, ou la trouvera plutôt dans l'absurde croyance que l'éloquence et, si l'on veut, la raison et le bon droit pouvaient se substituer à la force.
§ 2583. La conjuration de Catilina ne fut que l'une des nombreuses tentatives de rébellion qui précédèrent la catastrophe finale, un incident dans les guerres civiles qui marquèrent la fin de la République, et qui furent en partie des luttes entre gens chez lesquels prédominaient les résidus de la Ire classe et gens chez lesquels prédominaient les résidus de la IIe classe. Ceux-ci triomphèrent avec Auguste qui, après la victoire, entreprit, mais en vain, de restaurer la religion, la morale, les mœurs des anciens temps. Avec le rôle donné à l'élément militaire, l'Empire romain acquit de la stabilité, du moins pour quelque temps.
§2584. La victoire qui constitua l'Empire ne fut d'ailleurs pas exclusivement celle de la force, puisque César et Auguste y ajoutèrent la ruse dans une large mesure, et que César ne manqua pas d'être fortement appuyé par la ploutocratie. On remarquera qu'alors comme aujourd'hui cette ploutocratie se met toujours du côté qui lui paraît présenter le plus de chances de succès. En France, elle encensa Napoléon III, auteur du coup d'État ; puis, après 1870, elle eut Thiers pour idole ; aujourd'hui (en 1912) elle se prosterne devant les radicaux-socialistes. Pourvu qu'elle y gagne, elle se soucie peu du pavillon qui couvre la marchandise. Vers la fin de la République, la spéculation qui exploitait les provinces et s'enrichissait de leurs impôts était prédominante. Mais une spéculation semblable à celle de l'époque moderne ne faisait pas défaut ; elle s'appliquait à la production économique et donnait la main aux machinations de la politique [FN: § 2584-1]. L’Empire romain diminua ce lien, et, pour son bonheur, il eut une spéculation surtout économique.
§ 2585. Cette spéculation faisait monter dans les classes supérieures les gens qui s'enrichissaient [FN: § 2585-1] . Ainsi, dans la classe gouvernante montaient des éléments apportant l'instinct des combinaisons ; mais ils y arrivaient lentement, de telle sorte que l'instinct des combinaisons avait le temps de s'associer à la permanence des agrégats. L'organisation de l'Empire était celle de classes distinctes et séparées, dans lesquelles on entrait par hérédité et aussi par circulation, en montant dans une classe supérieure, en descendant dans une classe inférieure. Mais, à part des exceptions dues en grande partie à la faveur impériale, l'ascension n'était pas brusque ; elle était graduelle, et telle que, pour monter très haut, il fallait plusieurs générations [FN: § 2585-2]. Tant que, en fait comme en droit, l'enrichissement éleva à la classe supérieure, tant que la classe à laquelle les nouveaux riches arrivaient ainsi joua vraiment un rôle, si petit fût-il, dans le gouvernement, et tant qu'elle ne fut pas seulement une classe honorifique, l'Empire fut économiquement prospère, bien que les vertus guerrières de la classe dominante allassent en diminuant. Le maximum de prospérité fut atteint au début, quand la classe civile produisait la richesse, et que la classe militaire maintenait l'ordre à l'intérieur et à l'extérieur [FN: § 2585-3]. L'Empire déclina ensuite parce que sur ses frontières il n'y avait plus de peuples riches à exploiter par les armes, et parce qu'à l'intérieur la cristallisation des institutions économiques, le progrès de l'organisation, après une courte période de prospérité, aboutissait, comme d'habitude, à la décadence économique. La production était grande, pour le motif rappelé (§ 2553) qu'elle croit et s'améliore lorsque la cristallisation de la société commence, après une période dans laquelle cette société était dissolue. Les frais pour conserver la stabilité à l'intérieur et pour défendre les frontières de l'Empire étaient minimes, en tout cas inférieurs aux folles dépenses de la ploutocratie démagogique, dans les dernières années de la République. Sous Tibère, la solde des prétoriens qui assurent et conservent le gouvernement [FN: § 2585-4]n'est rien en comparaison des dépenses que faisaient les politiciens, vers la fin de la République, pour acheter du peuple le pouvoir (§ 2562). Mais par une évolution naturelle, cette organisation devait se changer en celle de la décadence de l'Empire (§ 2541). La période ascendante était fermement liée à la période descendante (§ 2338). La prospérité première de cet organisme se changea peu à peu dans la décadence de la sénilité. La cristallisation de la société continuant à croître, faisait diminuer la production (§ 2607 et sv.), tandis qu'augmentait la dilapidation de la richesse. La puissance militaire se superposant toujours plus à la puissance civile, et changeant de manière d'agir et de caractère, rendait le gouvernement instable, alors que primitivement elle lui avait donné la stabilité ; elle substituait l'insolence à l'obéissance dont précédemment elle faisait preuve envers ses chefs. Elle exploitait ainsi à son profit l'organisation sociale, provoquant un gaspillage de richesse (§ 2608), et enfin la faiblesse et la destruction de la force même des troupes (§ 2606).
§2586. L'Empire se fonda principalement sur l'armée ; mais ce ne fut pas d'elle que sortit la plus grande partie de la classe gouvernante. Les légions faisaient facilement un empereur, mais ne donnaient pas beaucoup d'administrateurs ; elles en donnaient peu ; aussi n'étaient-elles pas une source abondante du renouvellement de l'élite. La classe gouvernante devenait toujours plus une classe d'employés, avec les qualités et les défauts inhérents à ces fonctions ; de plus en plus l'énergie guerrière y disparaissait.
§ 2587. À ce point de vue, le fait qui se produisit après la mort d'Aurélien est très connu [FN: § 2587-1]. Les légions demandaient un empereur au Sénat. Le Sénat ne voulait pas le donner. Les légions insistaient. Ainsi, l'Empire demeura six mois sans empereur. Finalement le Sénat, presque contraint, nomma un empereur. Qui ? Peut-être un capitaine, ou tout au moins un homme énergique ? Loin de là : un vieillard de soixante-quinze ans. Là se manifeste le défaut d'instinct des combinaisons politiques chez les légions, et le défaut d'énergie guerrière chez le Sénat. Le premier défaut pouvait être compensé par le hasard qui faisait tomber le choix des légions sur un empereur doué de cet instinct des combinaisons politiques. Le second défaut n'avait pas de remède. Il fut en partie la cause premièrement de la destruction de l'élite, ensuite de celle de l'Empire.
§2588. Ce qu'on nous raconte de l'élection de Tacite nous montre qu'en ce temps déjà sévissait la maladie de l'humanitarisme, qui a recommencé de nos jours à sévir dans nos contrées.
§2589. Mus par des préjugés éthiques contre la richesse, contre le luxe, contre le « capital », la plupart des auteurs ne s'attachent qu'à ces circonstances, dans l'histoire de Rome ; tandis que pour l'équilibre social, la modification des sentiments (résidus) de la classe gouvernante est beaucoup plus importante.
§ 2590. Dans les premiers temps de l'Empire, les indices de ta circulation des élites ne manquent pas. S'ils ne sont pas aussi nombreux que nous le voudrions, il faut en rechercher la cause dans les préjugés qui faisaient estimer le récit de ces faits peu convenable à la dignité de l'histoire. C'est pourquoi nous n'avons de renseignements sur cette circulation que par hasard [FN: § 2590-1] . Tel fut le cas pour ce Rufus dont parle Tacite. D'ailleurs ces indices suffisent à nous faire connaître le phénomène. En attendant, déjà à propos de ce Rufus, apparaissent clairement les caractères de lâcheté ingénieuse de la nouvelle élite. On les retrouve en d'autres exemples. « Sur l'origine de Rufus, que certains disent fils d'un gladiateur, je ne dirai pas ce qui n'est pas, et j'ai honte de la vérité. Fait citoyen, il s'aboucha avec le questeur de l'Afrique. Se trouvant à Adrumète tout seul sous les portiques, à midi, une femme surhumaine humaine lui apparut et lui dit : „ Rufus, tu seras vice-consul “. Persuadé par cet oracle, il revint à Rome, et grâce à l'argent de ses amis et à sa vive intelligence, il devint questeur ; puis, à l'égal des nobles, préteur, grâce au vote du prince Tibère, qui dit, pour couvrir son humble origine : „ Rufus me parait être né de lui-même “. Il vécut longtemps, fut odieusement adulateur envers ses supérieurs, arrogant avec ses inférieurs, désagréable avec ses égaux. Il obtint l'imperium consulaire, les honneurs du triomphe et finalement l'Afrique, où il mourut ; et l'augure se réalisa [FN: § 2590-2]».
§ 2591. Dans sa satire des mœurs, Pétrone décrit un type imaginaire, mais qui avait certainement son correspondant dans la réalité ; et si l'on élimine la partie pornographique, et que l'on substitue d'autres luxes à celui de la bonne chère, ce type est tout à fait semblable au type moderne de certains milliardaires exotiques. Voyez donc comment Trimalcion acquiert son immense patrimoine [FN: § 2591-1] . Il charge de vin cinq navires pour les envoyer à Rome. Ils font naufrage ; mais lui ne se décourage pas. Il charge de nouveaux navires, plus grands, plus forts, plus heureux que les premiers. Il y met du vin, du lard, des fèves, des parfums de Capoue, des esclaves. Ainsi, en une seule fois, il gagna dix millions de sesterces. Il continua à faire le commerce, toujours avec succès ; il finit par se contenter de prêter de l'argent aux affranchis. Il voulait même se retirer entièrement des affaires, mais il en fut dissuadé par un astrologue. Ne croirait-on pas entendre parler l'un de nos ploutocrates, lorsque, s'adressant aux convives, Trimalcion s'écrie : « Croyez-moi : aie un as, tu vaudras un as ; sois riche, tu seras estimé. C'est ainsi que votre ami, qui fut grenouille, est aujourd'hui roi [FN: §2591-2]». Il veut parler philosophie et belles lettres [FN: § 2591-3] , mais s'y connaît à peu près autant que nos parvenus, qui croient tout savoir parce qu'ils ont gagné de l'argent. Trimalcion montre à ses invités les joyaux de sa femme, et veut qu'ils en sachent le poids exact [FN: § 2591-4] . Bon nombre de nos riches parvenus modernes agissent de même.
§ 2592. Mais la femme de Trimalcion est, au point de vue économique, très supérieure aux femmes de notre ploutocratie. Lorsqu'elles sont riches, ou seulement dans une certaine aisance, elles dédaignent de s'occuper de leur maison, et sont de simples objets de luxe, fort coûteux. Au contraire, la bonne Fortunata s'occupe avec grand soin de l'économie domestique [FN: § 2592-1] . Elle avait donné ses joyaux à son mari ruiné [FN: § 2592-2] , bien différente en cela de nombreuses femmes de notre ploutocratie, qui auraient incontinent demandé le divorce contre l'homme qui ne pouvait plus entretenir leur luxe.
§ 2593. Trimalcion n'est pas le seul enrichi. Voici le sévir Abinna [FN: § 2593-1], sculpteur ou tailleur de pierre, qui fait cadeau à sa femme de joyaux coûteux. Voici l'avocat (causidicus) Philéron [FN: § 2593-2]qui, de la misère s'est élevé à une grande richesse. Plusieurs affranchis, anciens compagnons de servitude de Trimalcion, sont aussi enrichis [FN: § 2593-3] . Ainsi, le commerce avec Trimalcion, l'industrie avec Abinna, la science avec Philéron, donnent les nouveaux riches. On rit d'eux ; mais ce rire même prouve leur existence. Martial se moque d'un cordonnier qui avait donné à Bologne un spectacle de gladiateurs [FN: § 2593-4], et un drapier qui avait fait de même à Modène.
§ 2394. Juvénal attaque aussi dans ses satires les riches parvenus. Même si l'on fait la part large à la fantaisie poétique qui agrandit les objets, il n'est pas croyable que les récits de Juvénal fussent en pleine contradiction avec ce que chacun savait et pouvait voir à Rome. Il cite son barbier, qui s'est considérablement enrichi [FN: § 2594-1]. Le fait particulier peut n'être pas vrai ; le type l'est certainement.
§ 2595. L'invasion des étrangers à Rome est bien notée aussi par Juvénal (FN: § 2595-1). « Celui qui vint un jour dans cette ville les pieds blanchis de gypse ne cède pas le pas au tribun sacré ». Juvénal dit des Grecs venus à Rome (III, 92-93) : « Nous aussi nous pouvons louer ainsi, mais eux persuadent ». Plus loin : « (119-120) Il n'y a place pour aucun Romain là où règne un Protogène, un Diphilus ou un Erimarque ». - « (130-131) Ce fils d'origine libre fait humblement sa cour à un esclave enrichi ». - « (60-66) (FN: § 2595-2). Je ne puis supporter, Quirites, cette ville grecque, si peu qu'il s'y trouve de lie achéenne. Il y a longtemps déjà que l'Oronte syrien versa dans le Tibre sa langue et ses mœurs... » Il pouvait ajouter : sa religion. Le mal, dont l'existence doit certainement avoir un fondement de vérité, prend des proportions gigantesques, lorsque Juvénal dit, à propos des places des chevaliers au théâtre : « (153-158) Qu'il sorte, dit-il, s'il a quelque pudeur et qu'il s'en aille des degrés équestres, celui qui n'a pas le cens légal ; et qu'ici prennent place les fils des entremetteurs, nés dans quelque lupanar. Que le fils d'un crieur public bien connu applaudisse ici parmi les élégants fils de gladiateurs, et parmi ceux d'un maître des gladiateurs (FN: § 2595-3) ».
§2596. Il devait aussi y avoir un grand nombre d'hommes sortis de rien, dans une société qui n'estimait pas sotte et absurde la satire où l'on écrivait : « (III, 29-39) Retirons-nous de la patrie. Qu'ils y restent ceux auxquels il est facile de prendre à forfait les travaux d'un édifice, ou de curer un fleuve, un port, un cloaque, de porter au bûcher un cadavre, et de vendre aux enchères un esclave. Ces gens-là, naguère joueurs de corne, habitués perpétuels des arènes provinciales, connus pour sonner de la trompe, donnent aujourd'hui des spectacles de gladiateurs, et pour se rendre populaires, lorsque le vulgaire tourne en bas le pouce, ils tuent qui l'on veut. Ensuite, sortis de là, ils louent les latrines publiques. Et pourquoi pas ? Puisqu'ils sont de ceux que la Fortune élève d'un humble à un haut état, chaque fois qu'elle veut jouer ? »
§ 2597. La faveur impériale tirait du néant certains affranchis et les portait aux plus grands honneurs [FN: § 2597-1]. Claude se laissait gouverner par eux. Mais leur nombre fut toujours restreint, et la plupart progressaient par leurs mérites, dans les administrations impériales ou privées [FN: § 2597-2] . Sénèque parle de la richesse des affranchis [FN: § 2597-3] , et Tacite nous les montre envahissant toute la classe gouvernante, malgré la résistance des citoyens ingénus [FN: § 2597-4] . Sous le principat de Néron, on parla au Sénat des fraudes des affranchis « qui traitaient à égalité avec leurs maîtres », et l'on voulait les réprimer. « On alléguait, d'un autre côté, « qu'il fallait punir les fautes des particuliers, sans attaquer les droits d'un corps très étendu ; que ce corps servait à recruter les tribus, les décuries, les cohortes même de la ville ; qu'on en tirait des officiers, des magistrats et des pontifes ; que beaucoup de chevaliers, que plusieurs sénateurs n'avaient pas une autre origine ; qu'en faisant des affranchis une classe à part, on manifesterait la disette des citoyens libres de naissance »... Néron écrivit au Sénat d'examiner séparément les plaintes des patrons contre chaque affranchi, sans toucher aux droits du corps. Peu de temps après, Pâris, affranchi de Domitia, déclaré faussement citoyen, fut enlevé à sa maîtresse, non sans honte pour le prince, qui fit prononcer par jugement que Pâris était né de parents libres [FN: § 2597-5]». Néron protégeait les parvenus. Suétone nous le montre désireux de gouverner uniquement avec eux [FB: § 2597-6].
§ 2598. D'autre part, la guerre et l'appauvrissement épuisaient le patriciat. Dion Cassius observe que, pour entretenir les sacrifices, Auguste dut créer de nouveaux patriciens, en remplacement du grand nombre de ceux qui avaient disparu dans les guerres civiles [FN: § 2598-1] . Tacite rappelle aussi les nombreux parvenus qui, des municipes, des colonies et aussi des provinces, passèrent au Sénat [FN: § 2598-2] . Il raconte de même que, malgré l'opposition des sénateurs, Claude y fit entrer les Gaulois [FN: § 2598-3] . Et voilà de nouveau que Vespasien doit restaurer l'ordre sénatorial défaillant en nombre et en qualité [FN: § 2598-4] .
§ 2599. La circulation apparaît d'une façon parfaitement claire. Cela n'arrivait pas seulement à Rome entre la classe inférieure et la classe supérieure. Mais de tout l'Empire, et même des contrées situées au-delà des frontières, les esclaves affluaient à Rome. Parmi eux, ceux qui possédaient une plus grande abondance de résidus de la Ire classe étaient Grecs ou Orientaux, acquéraient facilement la liberté. Leurs descendants, toujours grâce à la prédominance des résidus de la Ire classe, s'enrichissaient, montaient dans la hiérarchie sociale, devenaient chevaliers et sénateurs. De la sorte, le sang latin et le sang italique étaient éliminés de la classe gouvernante. Celle-ci, pour de nombreux motifs, dont l'origine servile et la lâcheté asiatique n'étaient peut-être pas les derniers, devenait toujours plus étrangère à l'usage des armes.
§ 2600. Elle y était poussée même par les empereurs, à cause de la crainte qu'ils avaient d'elle. Dion Cassius déjà fait allusion à cette idée, dans le discours, probablement inventé, qu'il met dans la bouche de Mécène, pour conseiller Auguste sur la forme du gouvernement [FN: § 2600-1] . Ensuite, les empereurs y veillèrent avec soin, jusqu'à ce qu'enfin Gallien en vint à interdire aux sénateurs d'aller dans le camp de l'armée. Sévère avait déjà supprimé l'usage de tirer les prétoriens de l'Italie, de l'Espagne, de la Macédoine et de la Norique [FN: § 2600-2] . Il les avait fait venir de toutes les parties de l'Empire, même des plus barbares [FN: § 2600-3] .
§2601. On peut représenter l'évolution à peu près comme suit. Sous la République, obligation effective du service militaire pour les membres de l'élite. Dans les premiers temps de l'Empire, obligation toute formelle, mais sans que le service effectif fût interdit. Ensuite, absence de service effectif.
§ 2602. Pline le Jeune nous donne un exemple de ce qu'était le service militaire des jeunes chevaliers dans le temps de transition [FN: § 2602-1]. Tandis qu'il faisait son service militaire, il s'occupait de comptabilité. D'autre part, il loue Trajan d'avoir fait un service militaire effectif. Claude « institua un genre fictif de troupes, appelé surnuméraire, qui servit de titre aux absents » [FN: § 2602-2] .
§ 2603. Auguste interdit aux sénateurs de s'éloigner de l'Italie sans sa permission, exception faite de la Sicile et de la Gaule Narbonnaise, « parce que les hommes y étaient désarmés et pacifiques. » [FN: § 2603-1]Il était interdit aux sénateurs de mettre le pied en Égypte [FN: § 2603-2] , et cela était si important qu'il s'y ajouta aussi des sanctions religieuses [FN: § 2603-2] . Selon Borghesi, sous Alexandre Sévère, ou selon Kuhn, sous Aurélien, le gouvernement des provinces fut divisé en deux. C'est-à-dire qu'il y eut un praeses pour l'administration civile et un dux pour l'administration militaire.
§ 2604. La séparation toujours croissante entre la classe militaire et la classe civile rendait celle-ci toujours plus lâche et plus incapable de se défendre à main armée. Quand Septime Sévère traversa l'Italie avec ses légions, les villes furent frappées de terreur, « car, en Italie, les hommes étaient depuis longtemps étrangers aux armes et à la guerre ; ils ne s'entendaient qu'à la paix et à l'agriculture » [FN: § 2604-1] . De la sorte, on avait un indice de la faiblesse ou de l'absence de résistance qu'ils auraient ensuite opposée aux invasions barbares.
§ 2605. Cependant, au temps de Gallien, le danger grave et imminent d'une invasion barbare parut réveiller pour très peu de temps la valeur de la population. « L'empereur Gallien se trouvant au-delà des Alpes, occupé à la guerre contre les Germains, le Sénat romain, voyant le danger extrême, arma autant de soldats qu'il y en avait dans la ville, et donna des armes aux hommes les plus vigoureux du peuple, rassemblant de la sorte une armée plus grande que celle des Barbares, qui, craignant d'en venir aux mains, s'éloignèrent de Rome... » [FN: § 2605-1] . Mais l'oligarchie militaire qui exploitait l'empire se mit bientôt à l'abri, et Gallien, par crainte que le pouvoir ne passât aux optimates, interdit au Sénat d'avoir des troupes, et même de venir à l'armée [FN: § 2605-2]. Alexandre Sévère disait : « Les soldats ont leur fonction, tout comme les littérateurs. C'est pourquoi chacun doit s'occuper de ce qu'il connaît » [FN: § 2605-3] . Arrius Menander (Dig., XLIX, 16, I) nous dit : « Se faire soldat est, de la part de celui qui n'en a pas le droit, un crime grave, lequel est rendu plus grand, comme d'autres délits, par le rang et par la dignité de l'armée ».
§ 2606. Ainsi, l'armée de l'Empire finit par être un ramassis de propres à rien, et il fallut recourir aux Barbares pour avoir des soldats, ce qui était proprement installer l'ennemi chez soi. Végèce décrit bien le phénomène : « Le temps n'améliora jamais une armée où l'on négligea le choix des recrues. Nous le savons par notre usage et notre expérience. De là proviennent les défaites que les ennemis nous infligèrent partout. On doit les imputer à la grande négligence et à l'incurie que, par suite d'une longue paix, on met dans le choix des soldats ; au fait que les meilleurs citoyens (honestiores) recherchent les fonctions civiles ; au fait que, par la faveur ou par la fraude des recruteurs, on accepte dans l'armée de la part des propriétaires qui doivent les fournir, des hommes tels que leurs patrons les dédaignent » [FN: § 2606-1] .
§2607. La société romaine se cristallisait. Toutes sortes d'obstacles s'opposaient à la circulation légale aussi bien qu'effective des élites. Si de temps à autre la faveur impériale surmontait ces obstacles pour un individu en particulier, il entrait souvent dans la classe gouvernante des hommes peu dignes d'y être. Donnant probablement une forme légale à ce qui existait déjà en partie, Alexandre Sévère institua des corporations d'arts et métiers [FN: § 2607-1]. Cette organisation s'accrut ensuite et prospéra, se rapprochant de celle qu'on voudrait instaurer aujourd'hui avec les syndicats obligatoires [FN: § 2607-2] . Peu à peu, l'artisan est attaché à son métier, l'agriculteur à la glèbe, l'augustalis à sa corporation [FN: § 2607-3], le décurion à la curie. Tous s'efforçaient de se délier et de fuir ; mais le gouvernement donnait la chasse aux fugitifs, et si la faveur de l'empereur ou des grands ne les sauvait pas, ils étaient ramenés aux fonctions auxquelles eux et leurs descendants devaient pour toujours rester attachés.
§ 2608. La production de la richesse diminue et le gaspillage en augmente à cause des nombreuses charges imposées aux riches. D'autre part, les hautes classes n'étaient plus les classes gouvernantes, et le fait d'y appartenir donnait plus d'honneurs que de pouvoir. Les empereurs étaient nommés par une troupe grossière, corrompue, dépourvue de tout sens politique. Il manquait des révolutions non-militaires, civiles, qui auraient mélangé les classes, produit une nouvelle circulation des élites, et élevé des hommes abondamment pourvus de résidus de la Ie classe. Avec beaucoup de raison, Montesquieu compare l'Empire romain de la décadence à la régence d'Alger, en son temps. Mais il faut ajouter qu'Alger n'avait pas une bureaucratie qui, à l'instar de la bureaucratie romaine de la décadence, tarit toute source d'activité et d'initiative individuelle. La société romaine déclinait économiquement et intellectuellement, tandis qu'elle subissait les dégâts d'une caste militaire imbécile et d'une bureaucratie vile et superstitieuse.
§ 2609. En Occident, l'invasion barbare vint briser cette société cristallisée (§ 2551 et sv.), à laquelle, avec l'anarchie, elle apporta aussi une certaine espèce de souplesse et de liberté. Celui qui passe sans autres des corporations de la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire d'un état de liaisons très fortes ma (fig. 48), aux corporations du moyen âge, c'est-à-dire à un autre état de liaisons, fortes aussi, pc, suit une ligne ac qui ne coïncide pas avec la ligne réelle abc, et il néglige un minimum de liaisons nb, qu'on atteignit avec l'anarchie qui suivit les invasions barbares [FN: § 2609-1] . La confusion que l'on fait entre l'état réel et l'état légal d'un pays contribue à entretenir cette erreur. Là où la loi n'accorde pas explicitement la liberté, on suppose que celle-ci n'existe pas et ne peut exister, tandis qu'au contraire elle peut fort bien être la conséquence, soit de l'absence des lois, soit – et c'est le cas le plus fréquent – du fait qu'elles ne sont pas exécutées, ou qu'elles sont mal exécutées. De même, la cristallisation d'un pays est souvent moindre qu'il ne ressort de l'examen des lois, parce que celles-ci ne représentent que très en gros l'état réel. La corruption des officiers publics est aussi, en de nombreux cas, un remède efficace à l'oppression des lois qu'autrement on ne pourrait supporter.

Figure 48
§ 2610. Dans l'Empire romain d'Orient, l'état de cristallisation subsista, alors qu'il avait été brisé dans celui d'Occident ; et l'on put observer les effets de l'organisation poussée à l'extrême [FN: § 2610-1]. Une anecdote conservée jusqu'à nos jours peut nous donner un aperçu pittoresque de ce qu'on pouvait observer au temps d'Attila. Priscus, qui accompagnait Maximin, envoyé en ambassade par Théodose à Attila, rencontra, dans le camp des Huns, un Grec alors riche chez les Scythes. Cet individu lui raconta comment, fait prisonnier de guerre, et échu comme part de butin à Onégèse, le premier des Scythes après Attila, il recouvra la liberté et acquit de la fortune. « Ensuite, ayant combattu avec valeur contre les Romains et contre la nation des Acatires, et ayant donné à son maître barbare le butin qu'il avait fait à la guerre, il obtint la liberté, suivant la loi des Scythes. Il épousa une femme barbare. Il en eut des enfants, et, devenu le commensal d'Onégèse, il lui semblait mener alors une vie plus agréable qu'avant ; car ceux qui se trouvent chez les Scythes ont, après la guerre, une vie tranquille. Chacun jouit de ses biens, et n'est molesté en aucune façon par qui que ce soit. Au contraire, ceux qui sont chez les Romains sont facilement tués à la guerre, car ils doivent remettre en d'autres l'espoir de leur salut, puisque les tyrans ne leur permettent pas de faire usage des armes. Et à ceux qui en font usage, l'incapacité des chefs est pernicieuse : ils dirigent mal la guerre. D'ailleurs, en temps de paix, les charges sont plus accablantes que les maux en temps de guerre, à cause de la très dure exaction des impôts et des vexations des malfaiteurs, car les lois ne sont pas égales pour tout le monde. Si quelque violateur de la loi est un riche, son délit n'encourt aucune peine ; si c'est un pauvre, ignorant des roueries, on lui applique la peine prévue par la loi, à moins qu'il ne meure avant que le jugement soit rendu, étant donnés la longue durée du procès et le grand gaspillage des fortunes. Il y a, en effet, une manière absolument inique d'obtenir par marchandage ce qui ressortit à la loi ; et de vrai aucun tribunal ne mettra un frein aux injustices subies, si l'on ne donne pas de l'argent aux juges et aux chanceliers » [FN: § 2610-2]. Priscus répond et tresse des couronnes au gouvernement romain. Il est remarquable que l'ambassade dont il faisait partie démontrait précisément la lâcheté et la corruption de ce gouvernement. Maximin était un honnête homme, une de ces personnes dont en tout temps les gouvernements se servent pour masquer leurs actions mauvaises et malhonnêtes (§ 2268, 2300) ; mais il était accompagné par Edécon et Bigilas, qui devaient ourdir la trame pour assassiner Attila [FN: § 2610-3] . Le gouvernement impérial savait organiser toute chose, même l'assassinat. Pourtant, cette fois, cela ne lui réussit pas. Attila eut vent de la machination, et envoya des ambassadeurs qui admonestèrent l'empereur par de fières paroles. Attila rappelait que Théodose, en lui payant tribut, s'était fait son esclave ; et il ajoutait : « Il n'agit donc pas justement celui qui tend des embûches, tel un esclave malfaisant, à celui qui est meilleur que lui, et dont la fortune a fait son maître » [FN: § 2610-4] .
§ 2611. Une seule anecdote suffira, parmi l'infinité qu'on pourrait citer, pour montrer comment on s'élevait à la classe gouvernante, là où régnait l’organisation byzantine. Synésios, qui vivait environ un siècle avant le temps auquel se rapporte l'anecdote précédente, écrit à son frère [FN: § 2611-1]: « L'entremetteur Chilon n'est vraisemblablement pas inconnu à beaucoup de gens, étant donné son art très célèbre ; car la comédienne Andromaque, la plus belle des femmes qui brillèrent de notre temps, fut de sa troupe. Après avoir passé sa jeunesse à un si beau métier, parvenu à l'âge mûr, il estima qu'il convenait à son état précédent de s'illustrer dans l'armée. Il vint donc, il y a peu de temps, ayant obtenu de l'empereur le commandement des terribles Marcomans. Puisqu'ils étaient précédemment des soldats très braves, maintenant qu'on leur a donné un si célèbre général, il semble qu'ils nous feront assister à de grands et nobles exploits ». Comment ce Chilon obtint-il la faveur impériale ? Par l'entremise de certains Jean et Antiochus, qui paraissent également n'avoir pas valu grand'chose. Avec de semblables façons de constituer la classe gouvernante, on comprend aisément que peu à peu les provinces de l'Empire furent perdues, et finalement la capitale elle-même. Il faut remarquer que le phénomène n'est pas spécial à la bureaucratie byzantine : il est général et apparaît presque toujours à l'âge sénile des bureaucraties. On l'observa et on l'observe encore en Chine, en Russie et en d'autres pays. De la sorte, l'organisation sociale commence par amener la prospérité, et finit par provoquer la ruine [FN: § 2611-2] (§ 2585).
§2612. Ainsi que nous l'avons relevé plusieurs fois et naguère encore (§ 2553), les ondulations des dérivations suivent celles des faits. C'est pourquoi, lorsqu'il y a environ un siècle on était dans la période ascendante de la liberté, on blâmait les institutions cristallisées et restrictives de l'Empire byzantin. Aujourd'hui que nous sommes dans la période descendante de la liberté, ascendante de l'organisation, on admire et on loue ces institutions ; on proclame que les peuples européens doivent une grande reconnaissance à l'Empire byzantin, qui les a sauvés de l'invasion musulmane ; et l'on oublie que les vaillants soldats de l'Europe occidentale surent vaincre et chasser seuls à mainte reprise Arabes et Turcs, et qu'avant les peuples asiatiques, ils se rendirent aisément maîtres de Constantinople. Byzance nous fait voir où peut atteindre la courbe que nos sociétés sont en train de parcourir. Quiconque admire cet avenir est nécessairement amené à admirer aussi ce passé, et vice-versa.
ADDITIONS↩
Volume I
AVERTISSEMENT. – La guerre européenne actuelle constitue une expérience sociologique de grande importance. Il est utile à la science que l'on compare ses enseignements à ceux des faits antérieurs. C'est pourquoi, afin d'avoir l'un des termes de la comparaison, l'auteur aurait désiré que ces volumes eussent été publiés avant les déclarations de guerre, le manuscrit de l'ouvrage étant achevé dès l'année 1913. Mais comme cela n'a pas été possible, il a voulu du moins s'efforcer de séparer les conséquences théoriques des faits connus avant la conflagration, de celles des faits connus après.
Pour réaliser son intention, d'une part, l'auteur s'est rigoureusement abstenu d'introduire, dans les épreuves corrigées après le mois d'août 1914, n'importe quel changement qu'auraient pu suggérer, même d'une manière très indirecte, les événements de la guerre européenne, les quelques citations qui se rapportent à l'année 1913 n'ayant rien de commun avec cette guerre. D'autre part, l'auteur se propose d'étudier, dans un Appendice, les résultats théoriques de l'expérience sociologique aujourd'hui en cours de développement. Ce travail ne pourra être accompli que lorsque la guerre actuelle aura pris fin.
Les chiffres précédés de § désignent le paragraphe ou la note ; précédés d'un p. : la page. L'indication 1. 2 d signifie : ligne 2 en descendant ; l’indication 1. 3 r : ligne 3 en remontant. Les lignes se comptent dans le paragraphe ou le fragment de paragraphe contenu à la page indiquée. Dans les additions, la petite lettre a placée en apostrophe indique, une note à ajouter. Elle remplace les chiffres 1, 2,... en apostrophe, employés dans le corps de l'ouvrage.
[Addition 1]
p. 1 § 2 1. 3 r. Le but seul nous a ) importe...
2 a En ce qui concerne l'emploi du pronom personnel de la première personne du pluriel ou du singulier, pour désigner l'auteur, je suis, dans cet ouvrage, l'usage des écrivains latins. Cet usage est exprimé de la façon suivante par ANTOINE, dans sa Grammaire de la langue latine : « (p. 133) Le latin dit en parlant de lui-même à la première personne nos (nostri, nobis), noster, au lieu de ego, meus, quand il veut présenter son affirmation avec une (p. 134) certaine réserve comme étant aussi celle des lecteurs ou des auditeurs, ou bien une action à laquelle il les fait participer ; il met au contraire ego quand il exprime son opinion personnelle en l'opposant à celle de tous les autres »
[Addition 2]
p. 28 § 59 1. 7 d. ... de ces principes sur l'expérience a )
59 a L'impression du présent chapitre était déjà achevée quand fut publié, dans la Revue de Théologie et de Philosophie (n° 16, septembre-octobre 1915), un article du prof. ADRIEN NAVILLE, dans lequel sont fort bien exprimées, par opposition aux théories de Bergson, des conceptions semblables à celles qui sont exposées ici. Il est utile de relever les conclusions auxquelles aboutit un éminent philosophe tel que Naville. « (p. 18 de l'extrait) Ma conclusion au sujet du procès de la science et de la théorie des deux vérités est donc que la science est limitée, relative, partiellement conventionnelle, qu'elle baigne dans le mystère et laisse ouvert tout un monde de questions qui relèvent de la spéculation transcendante, mais que dans son domaine et là où elle se prononce, il n'y a pas d'autorité supérieure à la sienne ». Il est bon de nous arrêter aussi à d'autres passages de l'article de Naville. « (p. 3) Il s'est produit en effet de nos jours un phénomène assez étonnant, c'est que la royauté de la science a été contestée. Et cela non par des intelligences attardées, routinières, par (p. 4) des tenants de l'ignorance ou d'une dogmatique qui voudrait s'éterniser. Au contraire ce sont les esprits les plus vifs, les plus ouverts, les plus agiles, ce sont des novateurs très éclairés et très hardis qui intentent à la science un véritable et grave procès. Ce n'est pas sans doute que son culte ait entièrement disparu. Peut-être même s'est-il généralisé et les adorateurs de la science sont-ils plus nombreux aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. Les masses populaires professent pour son nom un respect qui paraît encore grandissant [§ 2360] et leurs chefs les entretiennent dans ce sentiment [voir à la Table IV : Religions et métaphysiques diverses – Du Progrès – De la Raison –De la Science]... Mais si la science a conservé tout son prestige pour ceux qui habitent les régions inférieures ou les régions moyennes du monde intellectuel, il en est autrement pour ceux qui se promènent sur les sommets. Ceux-ci sont devenus défiants, ils discutent la science, ils la critiquent, ils lui intentent formellement un procès ». Après avoir rappelé plusieurs de ces critiques, l'auteur ajoute : « (p. 16) M. Bergson, je l'ai déjà dit, est un des critiques les plus sévères de la science qu'il y ait jamais eu. Non assurément qu'il en fasse fi ; il en proclame la valeur autant que personne, mais à la condition qu'elle reste dans sa fonction qui est, si j'ose dire ainsi, de formuler la vérité utile et non la vérité vraie [voir Table IV : Vérité. Sens divers de ce mot]. La vérité vraie ne peut être obtenue que par des procédés tout différents de ceux de la science ». Ainsi, de la simple étude des faits et sans aucun préjugé, Naville est conduit à noter un cas particulier d'un phénomène dont nous donnerons la théorie générale au chapitre XII (§ 2339 et sv.). Et, toujours de l'étude directe des faits, il est conduit aussi à noter des cas particuliers du même phénomène. « (p. 6) Qu'il y ait deux vérités [bien plus ! elles sont en nombre infini : quot homines, tot sententiae], une vérité profonde, la philosophie, et une autre, moins profonde et en somme moins vraie, c'est une thèse qui a bien souvent paru au cours de l'histoire ». Considérée au point de vue de la logique et de l'expérience, cette théorie des vérités différentes est une pure divagation, un entrechoquement de mots vides de sens. Mais au point de vue des sentiments et de leur utilité individuelle et sociale (§ 1678 et sv.), elle témoigne, ne fût-ce qu'en opposant une erreur à une autre, du désaccord entre l'expérience et l'opinion de ceux qui estiment que les actions non-logiques tirent leur origine exclusivement de préjugés surannés, absurdes et nuisibles (§ 1679). « Dans l'Europe occidentale, elle [la théorie des deux vérités] s'est produite (p. 7) avec une insistance particulière aux derniers siècles du moyen âge. Son apparition marquait le déclin et annonçait la fin de la scolastique. La scolastique avait été l'alliance de la doctrine ecclésiastique et de la philosophie. Il y a eu en Europe deux scolastiques, une chrétienne, et une juive… quand on apprit le grec et qu'on fit connaissance intime avec Aristote, l'Église se demanda si elle devait tourner le dos à la pensée et à la science grecques ou les accepter comme des auxiliaires et des alliées ; elle prit ce dernier parti. Et cette alliance, ce fut la scolastique. La synagogue juive prit un parti analogue... Toutefois l'alliance entre la doctrine ecclésiastique et la recherche philosophique n'avait pas été conclue sur le pied de l'égalité. L'Église s'attribuait la haute main, elle était (p. 8) maîtresse ; la recherche philosophique, libre entre certaines limites, ne devait pas les dépasser... Vers la fin du moyen âge le nombre des esprits émancipés alla en augmentant et c'est alors que se produisit d'une manière assez générale dans certains milieux universitaires, à Paris et à Padoue, par exemple, la théorie des deux vérités ». Alors, elle servait à passer de la théologie du sentiment à la théologie de la raison, et profitait indirectement à la science expérimentale. Aujourd'hui, elle sert à passer de la théologie de la raison à la théologie du sentiment ; elle pourra aussi servir à la science expérimentale, en faisant connaître expérimentalement l'utilité individuelle et sociale des actions non-logiques.
[Addition 3]
p. 59 § 1321 2 r. ... où il ne soit pas admissible a )
132 a ADRIEN NAVILLE, loc. cit. p. 28 § 69 a : « (p. 11) Je sais fort bien que le déterminisme sourit au savant et procure à l'esprit scientifique [pour être précis, il faut dire : à la Théologie de la Raison] une grande satisfaction. Le déterminisme c'est la croyance [ce terme suffit pour nous avertir que nous dépassons les limites de la science expérimentale] que tout peut être expliqué, or le savant cherche des explications : le déterminisme c'est la croyance que tout phénomène peut être compris, c'est-à-dire rattaché à d'autres phénomènes qui l'enveloppent et le produisent... Mais pour naturel que soit ce penchant [au déterminisme], il ne prouve rien. Et nous ne le voyons pas se produire chez tous les savants ».
[Addition 4]
p. 95 § 182 1. 1 d ... voyant un scorpion on dit deux a.…
182 a On trouve de nombreux faits semblables. Par exemple : THIERS : Traité des superstitions... Avignon, 1777, t. I. L'auteur compte parmi les superstitions : « (p. 415) Arrêter un serpent en le conjurant avec ces mots (Mizauld. Cent. 2, num. 93) : “Adiuro te per eum qui creavit te, ut maneas : quod si nolueris, maledico maledictione qua Dominus Deus te exterminavit” » Il est évident que, dans le phénomène, le fait principal est le sentiment que l'on peut agir sur certains animaux au moyen de mots déterminés (partie (a) du § 798), et que le fait accessoire réside en ces mots (partie (b) du § 798). Le fait principal fait partie d'une classe très nombreuse, dans laquelle rentrent les sentiments qui servent à faire croire à l'homme qu'il peut agir sur les choses au moyen des mots (genre (1-gamma) du § 888). Il est à remarquer que si notre auteur croit vaines quelques superstitions, il n'attribue pas à toutes ce caractère. « (p. VIII) J'ai rapporté les Superstitions dans toute leur étendue, lorsque j'ai jugé que cela ne pourrait avoir de mauvaises suites, et qu'il était en quelque façon nécessaire de n'en rien retrancher, pour les mieux faire comprendre. Mais, j'ai souvent caché sous des points et des ET caetera, certains mots, certains caractères, certains signes, certaines circonstances, dont elles doivent être revêtues pour produire les effets qu'on (p. IX) en espère, parce que j'ai eu crainte d'enseigner le mal en voulant le combattre ».
[Addition 5]
p. 100 § 189 In fine :
Dans les Géopontiques (I, 14), on rappelle plusieurs manières de sauver les champs de la grêle ; mais l'auteur du recueil conclut en disant qu'il a transcrit ces ouvrages uniquement afin de ne pas paraître omettre des choses transmises par les anciens. En somme, il a simplement différentes croyances.
[Addition 6]
p. 100 § 190 1. 1 r. ... explications a ).
190 a Il existe des inscriptions latines avec invocations aux vents. C. I. L, VIII, 2609, 2610. ORELLI, 1271 : Iovi O. M. tempestatium divinarum potenti leg. III. Aug. dedicante... A. MAURY ; Hist. des relig. de la Gr., t. I « (p. 166) Les vents furent aussi adorés par les populations primitives de la Grèce : mais leur culte, qui joue un si grand rôle dans le Rig- Veda, s'était singulièrement affaibli chez les Hellènes. Ils continuent sans doute à être personnifiés, mais on ne les invoque plus que par occasion et en (p. 167) certaines localités spéciales ». Plus loin, en note : « (p. 169) (2). Le culte des vents et des montagnes était associé chez les Chinois à celui des cours d'eau (Tcheou-li, trad. édit. Biot, t. II, p. 86). Lorsque l'empereur passait en char sur une montagne, le cocher faisait un sacrifice au génie de la montagne (Ibid. t. II, p. 249). – (3) Les anciens Finnois invoquaient aussi les vents comme des dieux, surtout ceux du sud et du nord. Ils adressaient aux vents froids des formules déprécatoires ».
[Addition 7]
p. 107 § 196 1. 3 d. Le noyau est un concept mécanique ; a )...
196 a Il apparaît presque à nu dans le fait de la « pierre pluviale » qu'il suffisait de porter à Rome, pour conjurer la pluie. FESTUS, s. r. Aquaelicium : « On l'emploie [ce terme] quand l'eau pluviale est attirée par certaines pratiques, de même que pour le passé on dit, avec la “pierre pluviale” promenée par la ville ». S. r. Manalis tapis : Manalem vocabant lapidera etiam petram quandam, quae erat extra portam Capenam iuxta aedem Martis, quam cum propter nimiam siccitatem in urbem pertraherent, insequebatur pluvia statim, eumque, quod aquas manarent, manalem lapide dixere. Donc, il suffisait de promener cette pierre par la ville, et aussitôt venait la pluie. Des usages semblables paraissent avoir existé chez des peuples voisins. F. P. FULGENTII expositio sermonum antiquorum, s. r. Quid sint manales lapides, p. 112 Teubner, 169 M, 769 St. : Labeo qui disciplinas Etruscas Tagetis et Bacitidis quindecim voluminibus explanavit, ita ait : « Fibrae iecoris sandaracei coloris dum fuerint, manales tunc verrere opus est petras », id est quas solebant antiqui in modum cilindrorum per limites trahere pro pluviae commutandam inopiam. Cfr. NONIUS ; 1. XV, s. r. Trulleum, p. 547 Mercier.
[Addition 8]
p. 107 § 196 1. 1 r. race humaine a )
196 a PAUS. ; VIII, Arcad., 38. L'auteur parle de la fontaine Agno, sur le mont Lycée. « Quand la sécheresse a duré longtemps, et que par conséquent les semences dans la terre et les arbres commencent à souffrir, alors le prêtre de Zeus Lycéen, après avoir adressé des prières et sacrifié à l'eau, suivant les, règles établies, touche avec une branche de chêne la surface, mais non le fond de la fontaine. L'eau étant remuée, il s'élève une vapeur semblable à une nuée. Peu après la nuée devient nuage, et, attirant à elle les autres nuages, elle fait tomber la pluie sur la terre, pour les Arcadiens ». Nous verrons (§ 203) que les sorcières faisaient pleuvoir ou grêler, par des moyens semblables. Les différences sont les suivantes : 1° C'est le démon des chrétiens qui intervient, au lieu des divinités païennes. Il est naturel que chaque peuple fasse intervenir les êtres divinisés par sa religion. 2° Chez Pausanias, l'opération est bienfaisante au plus haut point ; chez les chrétiens, elle peut l'être, mais, en général, elle est malfaisante. Il est naturel que les êtres divinisés agissent chacun suivant sa nature ; or la nature du démon est essentiellement malfaisante. Dans le présent exemple, nous voyons un fait imaginaire expliqué de différentes manières. Les sentiments correspondant au fait imaginaire constituent évidemment la partie constante du phénomène ; les explications en sont la partie variable.
[Addition 9]
p.108 § 197 1. 1 r. ... d'autres calamités semblables a ).
197 a Savamment et longuement, les auteurs du Malleus recherchent si le démon doit toujours agir de concert avec le sorcier, ou s'ils peuvent agir séparément. : Prima pars, secunda quaestio : An catholicum sit asserere quod ad effectum maleficialem semper habeat daemon cum malefico concurrere, vel quod unus sine altero, ut daemon sine malefico, vel e converso talem effectum possit producere. Par exemple, pour démontrer que l'homme peut agir sans l'aide du démon, ou en général la « force inférieure » sans la « force supérieure », quelques-uns citent le fait rapporté par Albert, que la sauge pourrie d'une certaine manière et jetée dans un puits suscite la tempête. Le Malleus n'a aucun doute sur ce fait, mais il l'explique. Il commence par distinguer les effets en : ministeriales, noxiales, maleficiales et naturales. Les premiers sont produits par les bons anges, les seconds par les mauvais, les troisièmes par le démon avec l'aide des sorciers et des sorcières ; les derniers ont lieu grâce à l'influence des corps célestes. Cela dit, il est facile de comprendre comment le fait de la sauge se produit sans l'intervention du démon. Et ad tertium de salvia putrefacta et in puteum proiecta dicitur, quod licet sequatur effectus noxialis absque auxilio daemonis, licet non absque influentia corporis coelestis.
[Addition 10]
p. 115 § 2033 In fine.
Peut-être Delrio avait-il sous les yeux d'autres passages du Fourmilier ou du Malleus. Par exemple, pour ce dernier, le fait rapporté secunda pars, quaestio 1, cap. tertium : super modum quo de loco ad locum corporaliter transferuntur. Une sorcière n'avait pas été invitée à certaines noces. Elle appelle à son aide le démon. Celui-ci, à la vue de quelques bergers, la transporte sur une montagne où, manquant d'eau, elle emploie son urine et fait grêler sur les invités de la noce. Ipsa indignata, vindicare se aestimans, daemonem advocat, et suae tristitiae causam aperuit, ut grandinem excitare vellet, et cunctos de chorea dispergere petiit, quo annuente, psam sublevavit, et per aera ad montem prope oppidum, videntibus certis pastoribus, transvexit, et ut postmodum fassa fuerat, cum aqua sibi deesset ad fundendam in foveam, quem modum, ut patebit, ubi grandines excitant, observant, ipsa in foveam quam parvam fecerat, urinam loco aquae immisit, et cum digito, more suo, astante daemone, movit, et daemon subito illum humorem sursum elevans, grandinem vehementem in lapidibus super chorisantes (sic) tantummodo et oppidanos immisit. Unde ipsis dispersis, et de causa illius mutuo conferentibus, malefica oppidum postea ingreditur, unde suspitio magis aggravatur. Nous rions de ces absurdités, mais les sentiments qu'elles manifestent ont été cause de bien des souffrances et d'un grand nombre de morts. La pauvre femme dont il s'agit fut brûlée. Unde capta, et fassa quod ea de causa, nimirum quia invitata non fuerat, talia perpetrasset, ob multis etiam aliis maleficiis ab ea perpetratis FN1 [probablement certains méfaits du même genre], incinerata fuit. Voir aussi : NICOLAI REMIGI... daemoriolatreiae libri tres, lib. I, cap. 25.
[FN1] Par un usage incorrect, mais non isolé en ces temps-là, les auteurs construisent ici la préposition ob avec l'ablatif au lieu de l'accusatif.
[Addition 11]
p. 157 § 263 1. 1 r. ... d'autres sciences naturelles a ).
263 a Tandis que le présent ouvrage était en cours d'impression, deux livres importants ont été publiés sur l'économie mathématique : ANTONIO OSORIO : Théorie mathématique de l'échange. Paris, 1913 – JACQUES MORET ; L'emploi des mathématiques en économie politique. Paris, 1915.
[Addition 12]
p. 160 § 272 1. 4 d. ... à laquelle on arrive a ).
272 a On observe des contradictions analogues dans les controverses métaphysiques et les disputes théologiques sur le « libre arbitres », la « prédestinations », la « grâce efficace » (§ 280) etc. Pascal tourne agréablement en dérision quelques-unes de ces contradictions, mais comme il raisonne en métaphysicien et en théologien, il y substitue des raisonnements qui ont peu et parfois moins de valeur. Il avait commencé par dire (Ie Provinciale) : « (p. 31). je ne dispute jamais du nom, pourvu qu'on m'avertisse du sens qu'on lui donne ». Il paraissait ainsi vouloir se placer entièrement dans le domaine de la science logico-expérimentale (§ 119) ; mais aussitôt après il s'en écarte pour aller dans celui de la métaphysique, de la théologie, du sentiment.
[Addition 13]
p. 253 § 469 1. 5 r. ... séparent a ).
469 a On trouve une autre analogie dans le fait que la philologie scientifique est une science moderne, que même des hommes éminents ont ignorée durant des siècles et des siècles, et qui naquit et se développa grâce à l'emploi de la méthode expérimentale. Par exemple, la grammaire grecque est beaucoup mieux connue des hommes de science modernes que des hommes de science de la Grèce ancienne. Il semble impossible qu'Aristote, ou l'auteur de la Poétique, quel qu'il soit, ait pu écrire : « ... puisque dans les noms composés nous n'avons pas coutume de donner un sens à chaque partie, ainsi dans ![]() n'a aucun sens »...
n'a aucun sens »... ![]()
![]() . [Poet., 20, 8, p. 1456]. Les éditions « critiques », obtenues par la méthode expérimentale, sont modernes ; les humanistes n'en avaient aucune idée. Il ne faut pas confondre la philologie scientifique avec les fantaisies de l'hypercritique. Celles-ci d'ailleurs ne sont pas nouvelles. Les changements et les suppressions que plusieurs philologues modernes se permettent arbitrairement dans les textes grecs et dans les latins, sont entièrement semblables aux altérations dont les poésies homériques furent victimes au temps des critiques alexandrins ; et pour justifier de tels arrangements, les raisons invoquées par les modernes le disputent en subtilité et parfois en absurdité à celles qui furent données par les anciens.
. [Poet., 20, 8, p. 1456]. Les éditions « critiques », obtenues par la méthode expérimentale, sont modernes ; les humanistes n'en avaient aucune idée. Il ne faut pas confondre la philologie scientifique avec les fantaisies de l'hypercritique. Celles-ci d'ailleurs ne sont pas nouvelles. Les changements et les suppressions que plusieurs philologues modernes se permettent arbitrairement dans les textes grecs et dans les latins, sont entièrement semblables aux altérations dont les poésies homériques furent victimes au temps des critiques alexandrins ; et pour justifier de tels arrangements, les raisons invoquées par les modernes le disputent en subtilité et parfois en absurdité à celles qui furent données par les anciens.
[Addition 14]
p. 292 § 541 1. 1 r. ... pas d'accord avec eux a ).
541 a Un fait encore à noter. Les éditions critiques nous permettent de remonter, avec une probabilité plus ou moins grande, aux archétypes des manuscrits qui nous sont parvenus, mais elles ne peuvent pas nous apprendre dans quel rapport ces archétypes se trouvent avec la pensée de l'auteur. Cette pensée pourrait ne pas nous être entièrement connue, même si nous avions le texte original dicté par l'auteur. Que l'on prenne garde, en effet, à ce qui arrive souvent aujourd'hui, lorsqu'on fait usage de l'imprimerie : en lisant les épreuves, l'auteur s'aperçoit d'imperfections qui lui avaient échappé en lisant le manuscrit, surtout s'il l'a dicté à quelqu'un d'autre, et il y apporte des modifications.
[Addition 15]
p. 316 § 587 1. 1 r. ... proie et aux corbeaux a )
587 a Jeté à l'eau, un homme qui ne sait ou ne peut nager, est submergé et se noie. Si, au contraire, il surnage, on a cru autrefois que cela se produisait parce qu'il était innocent ; de même on a cru que cela se produisait parce qu'il était coupable (Additions 956). Le Père Le Brun, Histoire critique des pratiques superstitieuses, Paris, 1732, t. II, relève cette étrange contradiction. Après avoir rappelé des miracles d'innocents qui surnageaient, par exemple, le suivant : « On la lie [une femme accusée d'un crime] en effet comme on lioit ceux qu'on éprouvoit par l'eau froide, et du haut d'un pont d'une hauteur prodigieuse, on la précipite dans la rivière. Mais par l'intercession de la très-sainte Vierge, elle demeura toujoûrs sur l'eau qui la porta saine et sauve sur le sable... », il conclut : « (p. 256) Il est assés évident que ces miracles sont opposez à l'épreuve de l'eau froide. Par ces miracles les innocens n'enfonçoient pas dans l'eau (p. 257), soûtenus par une protection visible de Dieu qui a paru dans cent autres miracles pareils. Mais par une bizarrerie surprenante, qui fit introduire l'épreuve de l'eau froide, il plût à des personnes que les innocens enfonçassent dans l'eau, et que les coupables n'y pussent enfoncer ».
[Addition 16]
p. 464 § 884 1. 2-3 d. ... que nous exposons a )
884 a On pourrait relever un grand nombre d'autres analogies. Il suffira de citer la suivante, entre l'abus de la méthode historique en sociologie et la critique à outrance des textes S. REINACH ; Manuel de philologie, t. I : « (p. 48) Bœckh a très bien signalé le cercle vicieux auquel n'échappe pas la critique philologique. Pour expliquer un texte, il faut le lire sous une certaine forme, et pour le lire sous cette forme et l'y laisser, il faut pouvoir l'expliquer et le comprendre. De là, chez bien des savants, la tendance à corriger ou à supprimer tous les passages qu'ils ne comprennent pas ». Beaucoup de ceux qui recherchent « les origines » des phénomènes procèdent d'une manière analogue. Reinach ajoute en note : « Nauck, dans le Sophocle de Schneidewin, 7e édit. : “La conjecture qui peut prétendre à la vraisemblance est celle qui, à tous les points de vue, réalise le mieux ce que l'esprit le plus exigeant veut trouver chez un tragique grec”. On dirait que c'est pour lui que Bœckh a écrit : “Les Athéniens avaient interdit, sur la proposition de Lycurgue, d'altérer le texte des tragiques : on voudrait presque que les anciens classiques fussent protégés aujourd'hui par une défense analogue” ». Aujourd'hui, avec la recherche des « origines », chacun admet uniquement ce qui concorde avec sa foi. Trouvez donc, si vous le pouvez, un humanitaire qui accepte des récits de faits contraires à sa foi, un marxiste qui ne subordonne pas les faits à la doctrine du capitalisme !
[Addition 17]
p. 482 § 915 1. 5 r. ... aux métaphysiciens et aux théologiens a )
915 a M. PSELLI de operatione daemonum, Kiloni, 1688, p. 85. L'auteur blâme les médecins qui ne veulent pas reconnaître l'œuvre du démon, et qui recourrent à des explications de faits expérimentaux : (p. 85) ![]() ...
... ![]()
![]() (p. 86)
(p. 86) ![]()
![]() . « Aucun sujet de s'étonner, si les médecins parlent ainsi, eux qui ne voient rien au delà de ce qui tombe sous le coup des sens, et ne se préoccupent que du corps ». C'est précisément ce qu'aujourd'hui les métaphysiciens, admirateurs de Hegel, de Kant ou des concepts sublimes du droit des gens, reprochent à ceux qui veulent demeurer dans le domaine de la réalité expérimentale.
. « Aucun sujet de s'étonner, si les médecins parlent ainsi, eux qui ne voient rien au delà de ce qui tombe sous le coup des sens, et ne se préoccupent que du corps ». C'est précisément ce qu'aujourd'hui les métaphysiciens, admirateurs de Hegel, de Kant ou des concepts sublimes du droit des gens, reprochent à ceux qui veulent demeurer dans le domaine de la réalité expérimentale.
[Addition 18]
p. 491 § 927 2 1. 5 d. ... dans l'antiquité a ).
927 a ZADOC KAHN ; La Bible traduite du texte original par les membres du Rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn, grand Rabbin. Paris, 1899, t. I : « (p. 6) Or quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que ![]() des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent ».
des filles leur naquirent, les fils de la race divine trouvèrent que les filles de l'homme étaient belles, et ils choisirent pour femmes toutes celles qui leur convinrent ».
[Addition 19]
p. 512 § 954 1 1. 1 r. ...les résidus des combinaisons a ).
954 a J. B. THIERS ; Traité des superstitions qui regardent les sacremens, Paris, 1777, t. II. « (p. 20) Après que le Cardinal de Cusa a observé qu'il y a de la Superstition à faire servir les choses saintes à d'autres usages qu'à ceux auxquels elles sont destinées, il apporte pour exemple l'eau bénite que l'on boit pour recouvrer la santé quand on l'a perdue, dont on fait des aspersions dans les terres et les champs pour les rendre plus fertiles, et que l'on donne à boire aux animaux pour les délivrer des maladies qui les tourmentent... Mais, ce sçavant Cardinal, en déclarant ces trois pratiques Superstitieuses, ne faisoit pas attention aux paroles dont l'Église se sert dans la bénédiction de l'eau. Car, elle marque bien nettement que l'eau- bénite est d'un grand usage pour (p. 21) exterminer les Démons, pour chasser les maladies, pour dissiper le mauvais air et les mauvais vents, pour purifier les maisons, et tous les autres lieux où elle est repandue, et pour en éloigner tout ce qui peut troubler la paix et la tranquilité des fidéles qui l'habitent... Si bien qu'il n'y a nulle Superstition à faire boire de l'eau-bénite aux hommes et aux bêtes malades, ni à en jetter dans les maisons et sur les terres des Chrétiens, pourvû qu'on le fasse avec une foi pure, et une confiance entiere en la bonté et en la toute-puissance de Dieu ».
[Addition 20]
p. 515 § 956 1. 12 r. ... de vêtements a ).
956 a Au moyen âge et même postérieurement, on attribue cette propriété aux individus coupables d'un crime, spécialement celui d'hérésie et surtout celui de sorcellerie ; aussi croit- on pouvoir les découvrir par « l'épreuve de l'eau froide ». Le B. P. PIERRE LE BRUN ; Histoire critique des pratiques superstitieuses, Paris, 1732, t. II : « (p. 240) L'epreuve de l'eau froide se faisoit en cette maniere : On dépoüilloit un homme entierement, on lui lioit le pied droit avec la main gauche, et le pied gauche avec la main droite, de peur qu'il ne pût remuer ; et le tenant par une corde, on le jettoit dans l'eau. S'il alloit au fond, comme y va naturellement un homme ainsi lié, qui ne peut se donner aucun mouvement, il étoit reconnu (p. 241) innocent, mais s'il surnageoit sans pouvoir enfoncer, il étoit censé coupable ». En d'autres cas, au contraire, la personne qui, jetée dans l'eau, surnageait, on la supposait protégée par Dieu (Additions § 587). Là, on voit bien l'action mystérieuse de certains actes. On estime que le fait de surnager n'est pas naturel ; donc il doit être uni à certains caractères éthiques de l'individu ; mais il peut aller aussi bien avec l'innocence qu'avec la culpabilité. Comme d'habitude, les « explications » de fait ne manquent pas. Pour l'innocent, on dira que Dieu protège celui qui n'est pas coupable. « (p. 284) Les Fideles ont toûjours crû avec raison qu'il falloit un miracle pour préserver ceux qu'on jettoit dans l'eau ; et des personnes innocentes et pieuses, implorant le secours de Dieu, ont été souvent préservées des eaux où on les avoit jettées pour les noyer ». Pour le coupable, nous avons diverses explications dues à l'ingéniosité subtile des auteurs. « (p. 253) Sa principale ressource [d'Hincmar] est que depuis Jesus-Christ, plusieurs choses ont été changées, et que l'eau destinée à sanctifier les hommes par le baptême, et consacrée par l'attouchement du corps de Jesus-Christ dans le Jourdain ne doit plus recevoir dans son sein les méchans, lors qu'il est nécessaire d'être informé de leurs crimes ». Un autre auteur, Adolphe Seribonius, philosophe de grand renom, vit, en 1583, procéder à des épreuves de l'eau froide ; il chercha les causes des effets qu'elles produisaient. « (p. 271)... il prétendit que les Sorciers étoient nécessairement plus legers que les autres hommes, parce que le démon, dont la substance est spirituelle et volatile, pénétrant toutes les parties de leur corps, leur comuniquoit de sa legereté, et qu'ainsi devenus moins pésans que l'eau, il n'étoit pas possible qu'ils enfonçassent »
[Addition 21]
p. 524 § 963 1. 1 r. qu'il fit »a ).
963 a Après avoir nommé la Sainte Trinité, SAINT ÉPIPHANE, De numerorum mysteriis, écrit un chapitre intitulé : « Que le nombre même de la trinité, qui est écrit dans les Saintes Écritures, est de nature mystérieuse et admirable ». Il rapporte un très grand nombre de faits pour le prouver. Les suivants nous suffiront à titre d'exemples : Il y a trois choses en nous : l'intelligence, l'esprit, la raison. Il y a trois choses qu'on ne peut rassasier : l'enfer, l'amour de la femme, la terre aride. Il y a trois vertus : la Foi, l'Espérance et la Charité. C'est pendant trois jours et trois nuits que Jonas demeura dans le ventre de la baleine. L'auteur loue ensuite le nombre six et le déclare parfait.
Afin que d'autres nombres ne soient pas navrés de tant de louanges adressées à certains d'entre eux, rappelons l'ouvrage de NICOMACHUS GERASENUS, qui a pour titre : Arithmetica theologica, dans lequel tous les nombres de un à dix reçoivent un tribut de juste louange. Photius, Bibliotheca, c. 187, ose dire que cet ouvrage ne contient que des raisonnements vains, et que l'auteur considère arbitrairement les nombres comme des dieux et des déesses.
[Addition 22]
p. 557 § 1047 1. 2 d. ... un crime très grave a ) ;
1047 a Comtesse LYDIE ROSTOPTCHINE ; Les Rostoptchine. Paris. « (p. 222) J'ai dit plus haut combien ma grand'mère détestait l'ivrognerie, ce vice naturel facilité par l'inclémence du climat, elle ne distinguait pas entre le buveur invétéré et celui qui avait bu par hasard, histoire de s'amuser ou d'oublier, tous deux étaient également dignes du Knout et de la Sibérie. (p. 225) Un autre jour, douloureusement gravé dans ma mémoire, nous nous promenions de rechef dans l'allée, lorsqu'une femme, ses vêtements déchirés et ensanglantés, apparut et courant à toutes jambes, poursuivie par les palefreniers, elle s'était enfuie de l'écurie où elle recevait les verges, la malheureuse tomba en sanglotant aux pieds de ma grand'mère. Jamais je n'oublierai l'horreur de cette scène. la victime prostrée et l'implacable suzeraine lui demandant sévèrement la cause du châtiment ordonné par (p. 226) Timothée. En entendant le nom abhorré de vootka, sourde aux supplications véhémentes de ma mère et à celles plus timides de mon père, ignorante de nos larmes, celle que je m'indignais en ce moment d'appeler ma grand'mère se détourna en silence et continua sa promenade, les palefreniers s'approchèrent, empoignèrent la victime et l'entraînèrent pour lui faire subir le reste de son châtiment – et la malheureuse était enceinte ».
[Addition 23]
p. 621 §1168 1. 2 r. ... vanité a ).
1168 a Dans un très grand nombre d'écrits des anti-alcoolistes, on considère uniquement l'effet, estimé mauvais, du vin et d'autres boissons alcooliques sur la santé, sans tenir compte du plaisir que l'homme éprouve en buvant modérément. Il semblerait donc que l'homme doive se soucier uniquement de sa santé, et que le plaisir n'est que vanité. Si l'on raisonnait logiquement, ce qui n'arrive pas dans les raisonnements par accord de sentiments, on devrait, de cette façon, condamner presque toutes les actions de l'homme : il ne devrait pas sortir de chez lui, pour éviter de recevoir une tuile sur la tête, ou de rencontrer un chien enragé, ou d'être frappé de quelque autre malheur ; il ne devrait pas nager, par crainte de se noyer ; ni aller dans la montagne, de peur de tomber dans un précipice ; ni donner un baiser à celle qu'il aime – et cela a été dit sérieusement – par crainte des microbes ; ni aller au théâtre ou dans d'autres lieux fermés, parce que l'air renfermé n'est pas sain ; en somme, pour le dire brièvement et en latin, il devrait propter vitam vivendi perdere causas.
[Addition 24]
p. 740 § 1343 1 In fine.
Voir aussi : D'ANSSE DE VILLOISON ; De triplici Theologia Mysteriisque Veterum commentatio, p. 246 et sv., dans DE SAINTE-CROIX ; Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des anciens peuples ou recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme. Paris, 1784.
Notes ajoutées par l’auteur à l’édition française↩
§927-3. ARISTOTE, De animal. hist., rapporte, sans en prendre la responsabilité, la croyance que les juments peuvent être fécondées par le vent.
§1313. Les sentiments complexes auxquels on donne le nom de haine appartiennent en partie à ce genre. La crainte est très souvent l'origine de la haine, chez l'homme et chez l'animal. La haine, en de nombreux cas, se change en mépris lorsque la crainte disparaît. En général la haine naît du désir de repousser une atteinte à l'intégrité. Une foi vive fait partie de cette intégrité, et cela explique la violence des haines théologiques. Elles s'atténuent lorsque la foi diminue, ou lorsque l'individu ne la considère plus comme essentielle à sa propre personnalité. Pour un artiste, un littérateur, un poète, non seulement la vanité, mais aussi un sentiment profond de leur art, font voir dans toute manifestation contraire, parfois même dans le simple silence, une offense à l'intégrité. Souvent tout changement à l'état de choses existant est aussi estimé une offense, qui est repoussée par l'attachement à la tradition, la néophobie.
§1749-1. Carpenteriana, Paris 1741 : « (p. 237). La Mothe-le-Vayer aïant fait un Livre de dur débit, son Libraire vint lui en faire ses plaintes, et le prier d'y remedier par quelque autre Ouvrage. Il lui dit de ne se point -mettre en peine ; qu'il avoit assez de pouvoir à la Cour pour faire défendre son Livre ; et qu'étant défendu, il en vendroit autant qu'il voudroit. Lorsqu'il l'eut fait défendre, ce qu'il prédît arriva ; chacun courut acheter ce Livre, et le Libraire (p. 338) fut obligé de le réimprimer promptement, pour pouvoir en fournir à tout le monde ».
§1755. Au commencement du mois d'octobre 1918, on put lire dans les journaux la note suivante : « Le grand organe libéral anglais le Daily Chronicle a été acheté par sir Henry Dalziel et quelques sociétaires pour la somme de 87 millions de francs... Le nouveau propriétaire, M. Dalziel, est un journaliste riche et député libéral, qui est surtout connu comme l'ami intime et le fidèle appui de M. Lloyd George tant au Parlement que dans la presse. En cela consiste principalement la signification politique de l'achat du Daily Chronicle, lequel paraissait récemment peu enclin à appuyer Lloyd George et penchait davantage vers les tendances du parti libéral, qui accepte Asquith comme chef. On annonce que la politique du journal ne changera pas, mais il est probable que sous le nouveau propriétaire il soutiendra vigoureusement Lloyd George ».
§1716-1. Un livre excellent sur le sujet traité ici a été publié après que ces lignes ont été écrites. Voir : DANIEL BELLET ; Le mépris des lois et ses conséquences sociales, Paris, Flammarion éditeur, 1918.
Les Notes
Note du Chapitre I. Préliminaires (§1 à §144), vol. 1, pp. 1-64↩
[FN: § 3-1]
Dans le premier chapitre du Manuel, on trouvera exposés, spécialement au point de vue de l'économie politique, certains sujets touchés ici à propos de la sociologie.
[FN: § 6-1]
Pour plus de détails, voir : GUIDO SENSINI : La teoria della Rendita. – PIERRE BOVEN : Les applications mathématiques à l'économie politique.
[FN: § 8-1]
Cette classification, à peine ébauchée ici, sera amplement étudiée dans les chapitres suivants.
[FN: § 13-1]
Il y a des théories qui n'ont que l'apparence logico-expérimentale, mais dont le fond ne possède pas ce caractère. Voir § 407 et sv., un exemple particulier et très important de ces théories pseudo-logico- expérimentales. Proprement, elles ont leur place parmi les théories non logico-expérimentales.
[FN: § 16-1]
Manuel, I, 36 et sv.
[FN: § 16-2]
Manuel, I, 41 : « Il est absurde d'affirmer, comme certains le font, que leur foi est plus scientifique que celle d'autrui. La science et la foi n'ont rien de commun, et celle-ci ne peut pas contenir plus ou moins de celle-là. »
[FN: § 19-1]
A. VERA : Introduction à la philosophie de Hegel.
[FN: § 23-1]
Manuel, I, 33.
[FN: § 35-1]
Manuel, III, 228.
[FN: § 38-1]
Manuel, III, 226 ; Systèmes, t. I, p. 338 et sv.
[FN: § 49-1]
CIC. ; De div., 1, 85 (77) : Quo tempore, cum signifer primi hastati signum non posset movere loco, nec quidquam proficeretur, plures cum accederent, Flaminius, re nuntiata, suo more neglexit. Itaque tribus bis horis concisus exercitus, atque ipse interfectus est.
[FN: § 49-2]
MICHAUD ; Hist. des croisades, t. !, 1. III « (p. 356) Beaucoup de croisés attribuèrent la victoire remportée sur les Sarrasins à la découverte de la sainte lance. Raymond d'Agiles atteste que les ennemis n'osaient approcher des bataillons au milieu desquels brillait l'arme miraculeuse. » En note : « Raymond d'Agiles ajoute qu'aucun de ceux qui combattaient autour de la sainte lance, ne fut blessé. Si quelqu'un me dit, ajoute-t-il, que le comte d'Héraclé, porte-étendard de l'évêque, fut blessé, c'est qu'il avait remis l'étendard à un autre et qu'il s'était un peu éloigné. »
[FN: § 50-1]
Manuel, I, 45, 51.
[FN: § 50-2]
L'expérience règne jusque dans la mathématique. Il est en effet bien connu que l'analyse moderne a démenti plusieurs théories tenues pour certaines, à cause de l'intuition de l'espace.
[FN: § 51-1]
Systèmes socialistes, II, p. 71 et sv. Manuel, p. 35, note 1 ; p. 14, note 1.
[FN: § 58-1]
Par exemple, à propos d'Héraclite, ZELLER, Phil. der Griech., I, p. 658, note justement que lorsque ce philosophe est conduit à des hypothèses qui sont en contradiction avec les résultats connus par nos sens, il ne reconnaît pas la fausseté de ces hypothèses, comme aurait fait un empirique, mais déclare que les sens nous trompent, et que la raison seule nous donne des connaissances certaines.
[FN: § 61-1]
P. BOVEN ; Les appl. math. à L’éc. pol.: « (p. 106) D'abord quelques définitions [de Walras]. Celle de la valeur est intéressante : « La valeur d'échange est la propriété qu'ont certaines choses de n'être pas obtenues ni cédées gratuitement, mais d'être achetées ou vendues, reçues et données en certaines proportions de quantité contre d'autres choses. » (p. 107). Cette « propriété qu'ont certaines choses » parait être du domaine de la physique ou de la métaphysique. Ce n'est pas la même chose que le prix…. On sent que l'auteur est embarrassé de nous dire ce que c'est que cette propriété ; il tourne autour de la chose, la qualifie, la classe, indique les conditions dans lesquelles on la rencontre et comment elle se comporte ; mais il ne nous la montre que sous un verre dépoli. »
[FN: § 62-1]
V. PARETO : L'Économie et la Sociologie, dans Rivista di Scienza, 1907, n. 2 : « Ce terme [valeur] a fini par indiquer une entité métaphysique, mystique, qui peut tout signifier, parce qu'elle ne signifie plus rien du tout. Déjà Stanley Jevons, voyant les équivoques sans nombre auxquelles donnait lieu ce terme, avait proposé de le bannir de la science. Depuis lors le dégât est encore devenu plus grand, si c'est possible, * et l'usage de ce terme pourrait peut-être à l'avenir servir à distinguer les ouvrages d'économie politique non scientifiques, des ouvrages scientifiques. »
« Nous avons trouvé dans un traité d'économie politique publié récemment que « le prix est une manifestation concrète de la valeur ». Nous connaissions déjà les incarnations du Bouddha ; il faut y ajouter les incarnations de la valeur. Avec cette admirable phraséologie, on pourra dire que le chat est la manifestation concrète de la félinité, et l'eau la manifestation concrète du principe liquide. Mais qu'est le principe liquide ? Hélas! nous l'ignorons. »
[FN: § 65-1]
La façon dont Boèce, traduisant Porphyre, pose le problème, est très connue : Mox de generibus et speciebus, illud quidem sive subsistant, sive in solis undis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint an incorporalia, et utrum separata a sensibilibus an in sensibilibus posita et circa haec consistentia dicer recusabo.
[FN: § 67-1]
Voir ce raisonnement au § 485.
[FN: § 69-1]
Manuel, I, 39, 40, pp. 26-27.
[FN: § 69-2]
Manuel, I, 42-48.
[FN: § 69-3]
Manuel, I, 4 et sv.
[FN: § 69-4]
Comme toujours, nous employons les termes : précision, précis, dans le sens indiqué aux § 108 et 119-1]; c'est-à-dire qu'ils expriment une désignation aussi exacte que possible des choses. Par exemple, le chimiste ne refuse pas d'employer le mot eau pour désigner l'eau pure, comme il est possible de l'obtenir avec les moyens aujourd'hui en notre pouvoir ; mais il refuserait d'en user pour désigner l'eau de mer. Le mathématicien sait fort bien qu'il n'y a aucun nombre qui, multiplié par lui-même, donne deux, c'est-à-dire qui soit racine de deux ; mais il se sert sans scrupules d'une valeur approchée autant que l'exige son calcul, par exemple 1,414214 ; cependant il refuserait d'employer la valeur 5, pour le même calcul. Les mathématiciens ont longtemps raisonné comme s'il existait un nombre dont le carré soit 2 (en général un nombre irrationnel) ; aujourd'hui, ils ont reconnu la nécessité de recourir à deux classes de nombres réels ; la première comprend tous les nombres rationnels dont le carré est plus petit que deux : la seconde, tous les nombres rationnels dont le carré est plus grand que deux. Cet exemple est remarquable pour deux raisons : 1° Il montre le continuel devenir de la science, faisant voir que dans une discipline pourtant déjà si parfaite, comme est la mathématique, on a pu maintenant atteindre une perfection et une précision plus grande encore. Il y a des exemples analogues pour les séries et pour un très grand nombre de démonstrations. 2° C'est un exemple d'approximations successives, c'est-à-dire atteignant toujours une plus grande précision. Les mathématiciens anciens firent bien de ne pas s'égarer dans ces subtilités, et les modernes ont eu raison de s'en occuper ; les premiers préparèrent la voie aux seconds, et ceux-ci la préparent à leurs successeurs. Hipparque, Kepler, Newton, Laplace, Gauss, Poincaré nous donnent en mécanique céleste des approximations succes- sives. Hegel, au contraire, trouve du premier coup l'absolu ; mais il y a cette différence entre ses élucubrations et les théories des savants, qu'avec les premières on ne peut calculer, même très en gros, la position d'un astre ; on est dans le cas de celui qui donnerait 100 pour racine de 2 ; tandis qu'avec les secondes, on peut calculer ces positions avec une approximation croissante ; c'est le cas de celui qui donne à 2 pour racine une valeur comme 1,414214. En sociologie, nous tâcherons de parcourir le chemin suivi par les astronomes, les physiciens, les chimistes, les géologues, les botanistes, les zoologistes, les physiologistes et, en somme, par tous ceux qui cultivent les sciences naturelles modernes, et de fuir, autant qu'il est en notre pouvoir, la route qui amena les Pères de l'Église à nier les antipodes, et Hegel à arguer à propos de mécanique, de chimie et d'autres sciences semblables ; route suivie en général par les métaphysiciens, les théologiens, les littérateurs, dans une étude qu'ils disent être des faits naturels et qui n'est autre qu'un vain discours sur des sentiments.
[FN: § 69-5]
Manuel, I, 14, 30. J'ai donné de nombreux exemples de cette méthode des approximations successives, dans le Cours et le Manuel. Pour la sociologie, on en trouvera un bon, dans : MARIE KOLABINSKA ; La circulation des élites en France. L'auteur a eu le mérite de ne s'occuper que des parties principales du phénomène, en laissant de côté les secondaires. C'est la seule façon dont on peut construire une théorie scientifique, au mépris des divagations faciles de la littérature éthique, qu'on persiste à nommer Sociologie. On trouvera beaucoup d'autres exemples d'approximations successives, dans le présent ouvrage.
[FN: § 70-1]
Par conséquent, nous nous abstenons de porter aucun jugement sur la discussion engagée entre l'orthodoxie catholique et les modernistes, au sujet de cette inspiration. C'est une chose qui sort du domaine expérimental où nous voulons rester. Nous devons seulement observer que l'interprétation des modernistes ne saurait être rattachée aux sciences positives.
[FN: § 75-1]
Je fais ici une seule exception ; elle est d'ailleurs plus apparente que réelle, puisque, tel un exemple, elle vise à mieux expliquer le fait objectif relevé. Il m'arrivera de dire du mal, beaucoup de mal, de certains actes des démagogues athéniens. Je crois qu'il importe fort peu au lecteur de savoir ce que je pense de cette république ancienne ; mais s'il m'est permis de l'exprimer, je dirai que personne, je crois, ne l'admire plus que moi et n'aime davantage l'esprit grec. De même, je me moquerai de la Sainte Science ; ce qui ne m'empêche pas d'avoir consacré ma vie à la science expérimentale. On peut rire de l'humanitarisme démo- cratique de certains politiciens français, et avoir un grand respect pour les savants de ce pays ; penser même que la république est peut-être le régime qui lui convient le mieux. On peut relever la liberté de mœurs de certaines femmes émancipées, des États-Unis, et avoir un grand respect pour les excellentes mères de famille que l'on trouve dans ce pays. Railler les hypocrisies des dominicains de la vertu, en Allemagne, se concilie très bien avec l'admiration pour cette puissante nation et le respect de la science allemande. J'estime superflu de faire des distinctions semblables pour l'Italie et d'autres pays. En voilà assez : le lecteur voudra bien se rappeler que cette exception restera unique, et il se gardera de chercher dans cet ouvrage ce qui n'y est pas, c'est-à-dire l'expression des sentiments de l'auteur ; mais exclusivement des relations objectives entre des choses, des faits et des uniformités expérimentales.
[FN: § 77-1]
Cours, t. I, 198, p.102.
[FN: § 77-2]
Cours, t. I, 196, p. 100 : « il est donc bien évident que la population des trois états considérés ne saurait continuer à croître indéfiniment avec le taux actuel. » Les trois états dont on parle sont la Norvège, l'Angleterre avec le Pays de Galles et l'Allemagne. Pour le premier, la raison annuelle d'accroissement géométrique, qui était de 13,9 0/00, de 1861 à 1880, est tombée à 5,7 0/00, de 1905 à 1910. Pour l'Angleterre avec le Pays de Galles et l'Allemagne, on a les nombres suivants :
Table 1
On voit qu'après avoir atteint son maximum entre 1895 et 1900, l'accroissement (le la population allemande est maintenant en baisse.
Le phénomène prévu, du ralentissement dans l'accroissement de la population ressort encore mieux, à l'examen des naissances annuelles par mille individus :
Table 2
Le fait du ralentissement dans l'accroissement de la population allemande est surtout remarquable dans les grandes villes, où la richesse s'est beaucoup accrue.
Table 3
Cela confirme ce qui est dit dans le Cours, t. I, 198, p. 102 : « Il est donc évident que des forces limitant l'accroissement de la population ont dû s'opposer à la force génésique dans le passé, ou s'y opposeront dans l'avenir. »
[FN: § 77-3]
Cours, t. I, 211[FN: § 1] , p. 111. Si P est la population dans l'année t, comptée depuis 1801, on a :
log P = 6,96324 + 0,005637 t.
Cette formule nous donne la loi théorique de la population, de 1801 à 1891. Les chiffres suivants sont donnés dans le Cours :
Table 4
La plus grande différence, c'est-à-dire l'erreur maximale de la formule, est 0,550. Si l'on calcule la population de 1910 au moyen de cette formule, on trouve 37,816 ; tandis que la population réelle est de ; 35,796. La différence est 2,020, beaucoup plus grande que l'erreur la plus forte. Il est donc démontré que la population ne suit plus la loi observée de 1801 à 1891, et qu'elle augmente moins.
[FN: § 77-4]
Cours, t. I, 211-2, p. 111. Il convient de tenir compte de ce qui est dit plus haut : « (179... (p. 92) les mouvements de la transformation des capitaux personnels dépendent en partie du mouvement économique. (180) Il faut faire attention que nous n'avons pas démontré (p. 93) qu'ils dépendent explicitement de l'état économique, mais seulement de ses variations... » En note : « Si l'état économique est caractérisé par une fonction F d'un nombre quelconque de variables qui sont fonction du temps t ; nous avons démontré que les nombres des mariages, des naissances, et jusqu'à un certain point des décès, sont fonction de dF/dt; mais nous n'avons pas démontré que ces nombres sont des fonctions explicites de t…»
[FN: § 77-5]
Cours, t. II, 965, pp. 322-323.
[FN: § 77-6]
La définition de la « diminution de l'inégalité des revenus » est donnée dans le Cours, t. II, 965-1, p. 320. Voir en outre Manuel, p. 389 et sv. – G. SENSINI ; La teoria della Rendita p. 342 à 353 et spécialement la note 185-4, p. 350.
[FN: § 77-7]
Édition italienne du Manuel.
[FN: § 85-1]
Voir à ce propos Le mythe vertuiste.
[FN: § 86-1]
Allant contre le courant général des sciences sociales actuelles, ce livre sera sévèrement blâmé par tous ceux qui, habitués à suivre ce courant, ferment leur esprit aux innovations. Ces personnes jugent une théorie en se posant cette question : « Est-elle d'accord avec les doctrines que je tiens pour bonnes ? » Si oui, elles la placent, elle aussi, parmi les bonnes ; sinon parmi les mauvaises. Il est donc manifeste que le présent ouvrage, étant en plein désaccord avec leurs théories, est certainement mauvais. Il trouvera peut-être plus d'indulgence parmi les jeunes gens qui n'ont pas encore l'esprit encombré des préjugés de la science officielle, et chez ceux qui jugent une théorie en se posant la question : « Est-elle d'accord avec les faits ? »
Je crois m'être assez clairement exprimé pour que le lecteur sache désormais que je recherche exclusivement cet accord, et que je ne m'occupe pas d'autre chose, ni de près ni de loin.
[FN: § 87-1]
Le prof. Charles Gide, qui avait sous les yeux le Manuel, publié en 1906, imprimait ce qui suit, en 1909. Histoire des doctrines économiques : « (p. 623) Mais les hédonistes [parmi lesquels l'auteur place V. Pareto. Pourquoi ? Dites-le moi] sont très réservés en ce qui concerne les possibilités de réalisation de leur monde économique, ils sont au contraire très affirmatifs, un peu trop même, en ce qui concerne les vertus de leur méthode et ne sont pas exempts sur ce point d'un orgueil dogmatique qui rappelle celui des socialistes utopistes. On croit entendre Fourier quand on lit que « ce que l'on a déjà trouvé en économie politique n'est rien à côte de ce que l'on pourra découvrir dans la suite » – entendez par la méthode mathématique – » Et en note : « V. PARETO. Giornale degli economisti. septembre 1901. »
Encore si la citation était exacte, M. Gide aurait au moins pu remarquer que l'auteur avait changé d'avis, et avait adopté celui qu'on voit clairement exprimé dans le Manuel. Mais la citation n'est pas exacte, parce que M. Gide applique à la pratique ce que l'auteur dit seulement de la théorie pure! On dirait vraiment que M. Gide n'a pas lu l'article qu'il cite. On y trouve les passages suivants : « (p. 239) Or le caractère principal des nouvelles théories économiques est seulement de nous avoir donné, jusqu'à présent, une image générale du phénomène complexe ; cette image n'est qu'approximative, comme le serait celle d'une sphère, comparée au globe terrestre ; mais en attendant nous ne connaissons rien de mieux. »
« (p. 241) Les équations de l’économie pure. » Il est bien entendu qu'elles servent seulement d'instrument d'étude, au même titre qu'il est, par exemple, utile de connaître les dimensions de l'ellipsoïde terrestre. « (p. 242)... on peut dire qu'elle [l'économie pure], a bien trouvé l'instrument nécessaire à ses recherches, mais que c'est à peine si elle l'a employé : il y a presque tout à faire, dans cette voie sur laquelle devraient se mettre les économistes qui veulent vraiment faire progresser la science. » Il s'agit de science et de science pure, non de pratique, comme on voudrait l'insinuer par la comparaison avec Fourier ! Voici la conclusion de la citation que M. Gide a séparée du reste de l'article, en la tronquant par-dessus le marché : « (p. 252) Là encore, il convient de répéter que nous ne sommes qu'aux débuts de la science nouvelle et que ce qu'elle a déjà trouvé n'est rien en comparaison de ce qu'elle pourra découvrir dans la suite. On ne peut même pas comparer l'état actuel de l'économie pure à celui de l'astronomie après la publication des Principia de Newton. » On remarquera la comparaison avec une science abstraite comme l'astronomie et non avec une science con- crète. Dans la suite de son ouvrage, le prof. Charles Gide, continue à me gratifier d'opinions et de théories qui ne m'ont jamais appartenu, que souvent même j'ai combattu, parce qu'elles étaient tout à fait contraires à celles qui sont effectivement les miennes. Pour d'autres détails, voir V. PARETO; Économie mathématique, dans l'Encyclopédie des Sciences mathématiques.
[FN: § 89-1]
Un savant personnage demandait à l'un de mes élèves si ma scienceétait démocratique ! On a dit et écrit qu'elle était socialiste ; un autre a prétendu qu'elle était réactionnaire. La science qui recherche seulement les uniformités (lois) des faits n'est rien de tout cela : elle n'a aucune épithète ; elle se contente de rechercher ces uniformités et rien d'autre. Personnellement, j'ai été partisan de la liberté économique, dans le Cours ; mais dans le Manuel, j'ai abandonné cette attitude et m'en abstiens, quand je m'occupe de science.
[FN: § 99-1]
Manuel1, 20.
[FN: § 101-1]
Il y a encore des professeurs d'économie politique qui répètent comme des perroquets que les lois physiques n'ont pas d'exceptions, tandis que les lois économiques en ont. Telle est leur ignorance ! Et, comme par un fait exprès, il y en a qui, en disant que les lois physiques sont dépourvues d'exceptions, citent celle des corps qui diminuent de volume en se refroidissant !
[FN: § 104-1]
C'est une des nombreuses formes de la méthode des approximations successives (§ 69-9°, 540).
[FN: § 104-2]
Manuel, III, 29, 30 (p. 156 et sv.) ; .35 (p. 159).
[FN: § 106-2]
Manuel, p. 10. On pourrait dire, pour contenter les hégéliens : on a observé que de nouveaux concepts s'ajoutent sans cesse à celui que les hommes se créent d'un phénomène, à un moment donné et cette série paraît, autant qu'on peut le connaître, devoir être indéfinie.
[FN: § 108-1]
Cette empreinte, à vrai dire très peu nette, des faits dans notre esprit, constitue tout ce qu'il y a de vrai (expérimentalement) dans les théories qui attribuent une valeur scientifique à l'intuition. Elle sert à connaître la réalité, comme une mauvaise, parfois une très mauvaise photographie peut servir à connaître un endroit quelconque. Quelquefois, au lieu d'une photographie, même très mal faite, on n'a qu'une image fantaisiste.
[FN: § 112-1]
Premiers Principes, II, chap. III, § 46: « Troisièmement, la pensée n'étant possible que sous relation, la réalité relative ne peut être conçue comme telle qu'en connexion avec une réalité absolue ; et la connexion de ces deux réalités étant également persistante dans la conscience, est réelle au même sens que les termes qu'elle unit sont réels. » Toute l'œuvre de Spencer est pleine de semblables concepts.
[FN: § 112-2]
Voici un exemple pris au hasard. Premiers Principes, II, chap. III, § 48 : « Si telle est notre connaissance de la réalité relative, qu'avons-nous à dire de l'absolue ? Une seule chose : c'est qu'elle est un mode de l'Inconnaissable uni à la matière par la relation de cause à effet. » Il y a des gens qui croient comprendre cela.
[FN: § 118-1]
J'ai fait voir dans le Manuel que l'on peut aussi exposer les théories économiques sans employer les mots : valeur, prix, capital, etc. Les économistes littéraires ne peuvent comprendre cela. Ils ont raison, à un certain point de vue ; parce que pour eux, par exemple, capital ne désigne pas une chose, mais bien un ensemble de sentiments ; et il est naturel qu'ils veuillent conserver un nom pour le désigner. Pour leur faire plaisir, on pourrait appeler capital objectif, la chose et capital subjectif, l'ensemble de sentiments. On pourrait dire alors : Celles des théories économiques qui se bornent à la recherche des rapports existant entre les faits économiques n'ont que faire de la notion de capital subjectif, elles peuvent, selon le cas, admettre ou non celle de capital objectif. Les théories économiques dont le but est de persuader autrui en vue d'un résultat pratique, tirent grand profit de la notion de capital subjectif, car c'est par les sentiments qu'on persuade autrui. C'est pourquoi il leur est utile de créer une confusion entre le capital objectif et le capital subjectif, afin que le raisonnement scientifique ne s'oppose pas au raisonnement de sentiment. Sur quelques points, ces théories s'approchent plus du cas concret que celles de l'économie pure, parce que dans la notion de capital subjectif, elles introduisent des notions de sociologie qui ne trouvent pas place en économie scientifique. Elles ont cependant un énorme défaut : celui du manque de précision. Pour approcher la réalité, au lien d'employer implicitement et presque à la dérobée, des notions sociologiques, il vaut mieux les adopter ouvertement, ce qui force à donner au moins quelque précision au discours. On se rendra mieux compte de tout cela dans GUIDO SENSINI ; La teoria della Rendita. La notion de capital subjectif est la plus importante pour la sociologie, qui étudie justement les sentiments que ces mots expriment. Comme le phénomène concret est à la fois économique et sociologique, si on l'étudie en économie appliquée, on rencontre des notions analogues à celle du capital subjectif. C'est pourquoi, dans le Manuel, j'ai étudié les phénomènes concrets, non seulement sous leur aspect économique et intrinsèque, mais aussi au point de vue de la manière dont ils sont compris parles hommes qui s'y trouvent mêlés. (Voir dans l'index du Manuel : Vue subjective.)
[FN: § 118-2]
Au point de vue historique pur, cela a lieu seulement pour les choses nouvelles. Pour celles qui ressemblent déjà plus ou moins à des choses déjà connues, on choisit le plus souvent le nom de ces choses, en se contentant de lui donner un sens plus précis, qui peut souvent différer considérablement du sens admis par le langage vulgaire.
[FN: § 119-1]
On voudra bien se rappeler ce qui a été dit déjà au § 108. Il n'y a rien d'absolu dans la science logico- expérimentale, et le terme précis signifie ici: avec la plus petite erreur possible. La science s'efforce de rendre la théorie aussi proche que possible des faits, tout en se rendant compte qu'on ne peut obtenir une coïncidence absolue. Si, parce qu’elle est irréalisable, quelqu'un repousse aussi la coïncidence approxima- tive, il n'a qu'à émigrer de ce monde concret, où tout n'est qu'approximatif.
[FN: § 119-2]
Manuel,édit. franc., p. 556, note 1.
[FN: § 119-3]
Sur d'autres erreurs nées du défaut de précision des mots et sur les logomachies de l’économie littéraire, voir Manuel, p. 219, note 1 (III, 178) – p. 246 (III, 227) – p. 329, note 1 (V, 70) – p. 333, note 1 (V, 81) – p. 391, note 1 (VII, 24), – p. 414 (VII, 79) – p. 439, note 1 (VIII, 11) – p. 544, note 1 (Appendice, 6) – p. 636, note 1 (Appendice, 108) – p. 638, note 1 (Appendice, 108). – Mais voir surtout GUIDO SENSINI; La teoria della Rendita ; et PIERRE BOVEN ; Les applications mathématiques à l'Économie politique.
[FN: § 131-1]
Le mot condition a donc ici un sens différent et plus étendu que celui qu'il avait au § 126.
[FN: § 144-1]
Nous emploierons toujours les termes qualité, quantité, qualitatif, quantitatif, dans un sens qui n'a rien de métaphysique ; c'est tout simplement celui qui est adopté en chimie, quand on oppose l'analyse qualitative à l'analyse quantitative. La première nous fait connaître, par exemple, qu'un corps donné est un alliage d'or et de cuivre : la seconde nous apprend quel poids d'or et quel poids de cuivre se trouvent dans un poids donné de cet alliage. Quand nous indiquerons un certain élément, dans un phénomène sociologique, nous dirons que notre proposition est qualitative; quand nous pourrons indiquer la quantité de cette chose, même d'une façon très grossière, nous dirons que c'est une proposition quantitative. Malheureusement, nous manquons de balances capables de poser les choses dont traite la sociologie, et nous devrons, en général, nous contenter d'en indiquer la quantité, au moyen de certains indices qui croissent ou diminuent avec la chose elle-même. En économie politique, nous avons un exemple remarquable de cet usage, à propos de l'ophélimité (Manuel, Appendice).
Notes du Chapitre II. Les actions non-logiques (§145 à §248), vol. 1, pp. 65-149↩
[FN: § 145-1]
Ce chapitre, écrit une première fois en français, fut en partie traduit en italien par une autre personne, et publié dans la Rivista italiana di Sociologia, maggio-agosto, 1910.
[FN: § 154-1]
HÉSIODE ; Op. et dies, 757-758.
[FN: § 155-1]
E. BLANCHARD ; Hist. des insectes., v. I. Mais il y a plus. J.-H. Fabre qui a fait d’intéressantes observations sur ces insectes et d’autres semblables, a pu voir que le nombre des eumènes préparés pour nourrir la larve, varie de cinq à dix, selon que celle-ci deviendra mâle ou femelle. Puisque l’œuf est pondu après que les provisions ont été rassemblées, Fabre croit que la mère sait à l'avance le sexe de l'œuf qu'elle pondra (Souvenirs entomologiques, 2e série, p. 69). Il revient sur la question du sexe de l'œuf de certains insectes, dans la 3e série (p. 387 et sv.). Il a pu observer comment se nourrissait la larve de l'eumène. (Souv. ent., 2e série) : « p. 74) L'œuf n'est pas déposé sur les vivres, il est suspendu au sommet du dôme par un filament qui rivalise de finesse avec celui d'une toile d'araignée. » Puis : « (p. 74) La larve est éclose et déjà grandelette. Comme l'œuf, elle est suspendue suivant la verticale, par l'arrière, au plafond du logis... le ver est attablé : la tête en bas, il fouille le ventre flasque de l'une des chenilles. Avec un fétu de paille, je touche un peu le gibier encore intact. Les chenilles s'agitent. Aussitôt le ver se retire de la mêlée. » Il rentre dans une espèce de fourreau. « (p. 75) La dépouille de l'œuf, conservée cylindrique et prolongée peut-être par un travail spécial du nouveau-né, forme ce canal de refuge. Au moindre signe de péril dans le tas des chenilles, la larve fait retraite dans sa gaine et remonte au plafond, où la cohue grouillante ne peut l'atteindre. » Quand, plus tard, le ver est plus fort et les chenilles plus faibles, le ver se laisse tomber.
[FN: § 155-2]
J.-H. FABRE; Souven. entom., 1re série, pp. 67-79. Un autre exemple vraiment extraordinaire est donné dans la 4e série. Le calicurgue donne la chasse aux araignées appelées épeires. L'épeire « (p. 253) a sous la gorge deux poignards acérés, avec goutte de venin à la pointe ; le Calicurgue est perdu si l'aranéide le mord. Cependant son opération d'anesthésie réclame une parfaite sûreté de bistouri. Que faire en ce péril qui troublerait le chirurgien le mieux affermi ? Il faut d'abord désarmer le patient, et puis l'opérer. Voici qu’en effet le dard du Calicurgue, dirigé, d'arrière en avant, plonge dans la bouche de l'Épeire avec précautions minutieuses et persistance accentuée. Dès l'instant, les crochets venimeux se referment inertes et la proie redoutable est dans l'impuissance de nuire. L’abdomen de l'hyménoptère détend alors son arc et va plonger l'aiguillon en arrière de la quatrième paire de pattes, sur la ligne médiane, presque à la jonction du ventre et du céphalothorax... Les noyaux nerveux, foyer du mouvement des pattes, sont situés un peu plus haut que le point blessé, mais la direction de l'arme d'arrière en avant permet de les atteindre. De (p. 254) ce dernier coup résulte la paralysie de huit pattes à la fois... Tout d'abord, comme sauvegarde de l'opérateur, un coup dans la bouche, ce point terriblement armé, redoutable entre tous ; puis, comme sauvegarde de la larve, un second coup, dans les centres nerveux du thorax, pour abolir les mouvements. »
[FN: § 156-1]
J.-H. FABRE; Souv. ent., 1re série.
[FN: § 156-2]
J.-H. FABRE; Souv. ent., 4e série.
[FN: § 157-1]
J.-H. FABRE, Souv. ent., 1re série.
[FN: § 158-1]
ALBERT DAUZAT : La lang. franç. d'auj., dit très bien : « (p. 238) Un principe auquel se rallient aujourd'hui la grande majorité des linguistes, domine toute la matière : c'est l’inconscience (les phénomènes linguistiques. [Il exprime ainsi en d'autres termes la même idée que nous émettons sous le nom d'actions non-logiques]. Accepté à peu près univer- sellement dans le domaine de la phonétique – on a renoncé depuis longtemps à expliquer les transformations des sons par des fantaisies individuelles – ce principe rencontre, au contraire, en sémantique, les mêmes oppositions que soulevaient tout à l’heure les lois. M. Bréal fait intervenir très nettement la volonté dans l'évolution sémantique... Cette théorie, qui, il y a cinquante ans, n'aurait guère rencontré d'adversaires, est aujourd'hui repoussée par la presque totalité des linguistes, qui souscrivent volontiers à l'axiome suivant posé par V. Henry : « (p. 239) Toute explication d'un phénomène linguistique qui présuppose, à un degré quelconque, l'exercice de l'activité consciente d'un sujet parlant, doit a priori être écartée et tenue comme non avenue. » Mais cela est exagéré. La terminologie scientifique est presque toujours l'effet de l'activité consciente ; et certains termes du langage ordinaire peuvent avoir une origine semblable. D'autre part, l'objection de Bréal n'empêche pas qu'un grand nombre de phénomènes soient conscients seulement en apparence, parce que l'activité du sujet se résout en actions non-logiques du 2e genre et surtout du 4e. A. DARMESTETER ; La vie des mots : « (p. 86) Au fond, partout dans ces changements [du sens des mots] on retrouve deux éléments intellectuels coexistants : l'un principal, l'autre accessoire. À la longue, par un détour inconscient, l'esprit perd de vue le premier, et ne considère que le second... Sous le couvert d'un même fait physiologique – le mot – l'esprit passe ainsi d'une idée à une autre. Or cette marche inconsciente, qui transporte le fait dominant du détail principal au détail accessoire, est la loi même des transformations dans le monde moral ». Plus loin, il ajoute : « (p. 133) Ainsi, malgré les liens de famille que le développement de la langue peut établir entre les mots, le plus souvent ils vivent chacun de leur vie propre, et suivent isolément leur destinée, parce que les hommes en parlant ne font point d'étymologie ». Rien de plus vrai. C'est pourquoi l'on tombe si souvent dans l’erreur, quand on veut déduire le sens d'un mot, de son étymologie ; ou bien, ce qui est pire, quand on prétend reconstruire par l'étymologie, l'histoire inconnue d'un lointain passé.
[FN: § 159-1]
MOMMSEN : Le dr. pub. rom., t. I.
[FN: § 159-2]
Cours, 719, t. II, p. 88: « Il suit de là que, tandis que les entrepreneurs s'efforcent de réduire les prix de revient, ils obtiennent, sans le vouloir, l'autre effet de réduire le prix de vente [cela n'arrive pas sous le régime du monopole], puisque la concurrence ramène toujours l'égalité entre ces deux prix. » Cfr. 151, 718. Manuel V, 11, p. 277; V, 74 : « (p. 315) De cette façon les entreprises concurrentes aboutissent là où elles ne se proposaient nullement d'aller (§ 11). Chacune d'elles ne recherchait que son propre avantage, et ne se souciait des consommateurs que dans la mesure où elle pouvait les exploiter, et, au contraire, par suite de toutes ces adaptations et réadaptations successives imposées par la concurrence, toute cette activité des entreprises tourne au profit des consommateurs. »
[FN: § 160-1]
Op. et dies, 735-739.
[FN: § 160-2]
Op. et dies, 778-779.
[FN: § 160-3]
CIC. ; De Leg., II, 12, 31: Quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere, vel habita rescindere ? Quid gravius, quam rem susceptam dirimi, si unus augur alio die dixerit ?
[FN: § 167-1]
Manuel II, 108 ; IX, 62.
[FN: § 174-1]
CIC. ; De nat. deor., III, 2, 5.
[FN: § 175-1]
E. DESCHAMPS ; Au pays des Veddas. En Grèce aussi et à Rome, on faisait dépendre la majeure partie des actions, d'oracles, de présages, etc. Avec le temps, bon nombre de ces pratiques devinrent de simples formalités. CIC. De div.; I, 16, 28 : Nihil fere quondam maioris rei, nisi atiApicato, ne privatim, quideni. gerebatur: quod etiarn nunc nuptiarum auspices declarant, qui, re omissa, nomen tanturn lenent. Nam ut nunc extis (quanquam id ipsum aliquando minus, quani olim), sic tain- avibus magnie res impetriri solebant.
[FN: § 175-2]
H.-C.-P. BELL; Superstitions ceremonies connected with the cultivation of alvi or hill paddy. Cité de E. DESCHAMPS.
[FN: § 176-1]
Elles existent encore chez des peuples presque civilisés, comme les Chinois, et n'ont pas complètement disparu chez nous.
MATIGNON: Superst. crim. et misère en Chine: « (p. 4) La superstition, telle que je vais essayer de la décrire, n'a rien à faire avec la religion... » L'auteur explique l'entité mystérieuse dont parlent les Chinois, sous le nom de Fong-Choué (littéralement vent et eau). (p. 7) « On pourrait, d'une façon générale, le considérer comme une sorte de superstition topographique. Pour les Chinois, un point quelconque de l'Empire du Milieu est un centre de forces, d'influences spirituelles, sur la nature desquelles ils n'ont que des idées vagues, mal définies, peu ou pas comprises, d'autant plus craintes et respectées. » L'auteur cherche à expliquer les faits par les croyances, et n'y réussit pas, parce que les faits ne sont pas conséquence des croyances (actions logiques), mais les croyances, des faits (actions non-logiques). « (p. 8) Le fong-choué nous paraît donc quelque chose de vague, de mystérieux, d'obscur, d'une interprétation difficile, pour ne pas dire impossible [comme l'était la divination, en Grèce et à Rome]. Et cependant, pour les Chinois, cette fantaisie devient la science ». C'est-à-dire que c'est simplement le vernis logique répandu abondamment sur leurs actions non-logiques. Ailleurs: « (p. 11) il faut que l'astrologue ait fixé un jour heureux pour les funérailles, et que surtout, par de longues et sagaces recherches, il ait pénétré à fond la question palpitante du fong-choué ». – « (p. 18) Le Chinois qui fait bâtir n'a pas seulement à tenir compte du fong- choué de ses voisins. Il doit aussi se préoccuper de celui de sa maison. Une meule, un puits, un coin de mur, l'intersection de deux rues ne devront pas se trouver devant la porte principale... Ce n'est pas tout. Si l'emplacement convient au fong-choué, la destination de l'immeuble lui agréera-t-elle ? X bâtit une maison avec l’intention d'en faire une boutique de riz. Le capricieux fong-choué aurait préféré qu'on y vendît du thé. Pas de doute. Les affaires de X ne pourront que péricliter ». – « (p. 19 Cette superstition du fong-choué est extrêmement tenace [simplement parce qu'elle n'est autre chose que la manifestation de l'état psychique chinois]. C'est la dernière qui résiste au christianisme. Et encore, quels sont les Chinois, considéré comme bons chrétiens, qui ont totalement renoncé à leur croyance ?»
Le fait est général (§ 1002 et sv.).
[FN: § 176-2]
PRELLER ; Les dieux de l'anc. Rome.
MARQUARDT ; Le culte chez les Romains, t. I, donne une liste de dieux qui ne peut être que très incomplète, car un grand nombre de ces noms ne sont certainement pas parvenus jusqu'à nous. Voir au § 1339 quelques-uns de ces dieux : citons ici, à titre d'exemple : « (p. 17) Potina et Educa, qui apprennent à l'enfant à manger et à boire ; Cuba qui protège l'enfant transporté du berceau dans le lit: Ossipago, quae durat et solidat infantibus parvis ossa ; Carna, qui fortifie les chairs ; Levana quae levet de terra; Statanus, Statilinus, dea Statina, qui enseignent à l'enfant à se tenir debout, Abeona et Adeona, qui soutiennent ses premiers pas : Farimus, Fabulinus, qui l'aident à parler ». L'auteur continue en énumérant les divinités de l'adolescence, les dieux du mariage, les divinités protectrices dans les diverses circonstances de la vie, et ajoute : « (p. 19) Les dieux que nous venons d'indiquer avaient pour mission de protéger les personnes ; il y avait une autre série de dieux qui veillaient aux diverses occupations des hommes et aux lieux qui en étaient le théâtre... » Marquardt a tort, quand il affirme que : «( p. 23) À l'origine du moins, comme l'a démontré Ambrosch, ces milliers de noms qui figuraient dans les indigitamenta n'ont fait que désigner les diverses fonctions (potestates) d'un petit nombre de divinités ». Nous sommes encore dans l'abstrac- tion. Les preuves qu'on en tire ne peuvent être acceptées. Les voici, d'après Marquardt : « (p. 23) 1° Le fait d'indigitare consistait dans une prière adressée à un ou plusieurs dieux non pas d'une manière vague, mais avec indication de ceux de leurs pouvoirs dont on attendait des secours ; on invoquait un dieu à plusieurs reprises et en joignant à son nom divers attributs ». Ces différents attributs correspondent parfois à divers dieux qui se sont confondus en une seule personnalité : d'autres fois ce peut être des aspects différents d'un même dieu ; mais cela ne prouve pas que Potina, Educa, Cuba, par exemple, soient des puissances abstraites d'une même personne divine. (p. 211) «2° En second lieu, il n'était pas permis par le droit pontifical d'offrir une seule et même victime à deux dieux en même temps ». Brissaud, traducteur de Marquardt, démontre lui aussi que ce motif n'est pas fondé. (p. 24) « 3° Enfin on ne doutait pas non plus qu'une partie des noms rapportés ci-dessus ne fussent des surnoms de dieux connus. » Le fait que quelques dieux recevaient certains surnoms, n'implique pas que tous les dieux des indigitamenta ne fussent que des surnoms et encore moins que, comme il est dit en marge (loc. cit. p. 23), « on désignait par là divers attributs de la providence divine ». Autrement il faudrait conclure que les surnoms des empereurs romains indiquaient les divers attributs d'une même personnalité.
[FN: § 176-3]
PLINE: Natur. hist., II 5, 3 (7) Quamobrem maior caelitum populus etiarn quain hominuin intelligi potest, cum singuli quoque ex semetipsis totidem deos faciant, lunones Geniosque adoptando sibi, gentes vero quaedam animalia, et aliqua etiarn obscena, pro diis habeant, ac multa dictu magis pudenda, per fcetidas caepas, alia et similia iurantes.
[FN: § 177-1]
Nous ne pouvons accepter ce que dit Marquardt, loc. cit. (176 2) : « (p. 8) Leurs divinités [des Romains] n'étaient que des « abstractions ; ils adoraient en elles ces forces de la nature, dans la dépendance desquelles l'homme se sent à chaque instant, mais qu'il peut s'assujettir en observant ponctuellement les prescriptions d'ordre extérieur établies par l'État, pour honorer les dieux ». Il est nécessaire d'intervertir les termes. Pour réussir dans leurs entreprises, les Romains observaient exactement certaines règles qui, spontanées tout d'abord, furent ensuite employées par l'État. Quand plus tard on voulut expliquer ces règles, on y vit une adoration des forces naturelles. D'autre part, le même Marquardt relève le rôle prépondérant des actes matériels et la menue importance des abstractions : « (p. 9) La pratique de la religion n'exigeait qu'un appareil matériel des plus simples, mais en revanche les rites étaient hérissés de difficultés et de complications : la moindre irrégularité dans une cérémonie enlevait à celle-ci toute son efficacité ».
[FN: § 177-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Il est facile de s'en rendre compte chez les enfants. Or l'embryologie et la physiologie admettent que l'ontogénie répète la phylogénie ; autrement dit que le développement de l'individu répète celui de son espèce.
[FN: § 177-3]
ANTOINE ; Syntaxe de la langue latine: « (p. 125) La faculté d'employer les adjectifs substantivement est beaucoup plus restreinte en latin qu'en grec et même qu'en français. Le latin évite le substantif même là où il existe, et le remplace volontiers par une périphrase, p. ex. : animi eorum qui audiunt, au lieu de auditorum. Il faut, pour qu'on puisse ainsi faire de l'adjectif un substantif, qu’il ressorte clairement de la disposition des mots et de l'ensemble de la phrase que l'adjectif représente bien, non la qualité, mais une personne ou une chose douée de cette qualité ». C'est juste le contraire de ce qu'on imagine par la transformation des petits dieux en abstractions qualificatives. – RIEMANN et GŒLZER ; Grammaire comparée du grec et du latin, p. 741, notent : « L’adjectif n'était pas à l'origine distinct du substantif... ; le substantif est sorti de l'adjectif : avant d'atteindre la substance on n'a d'abord vu dans tout objet que ses modes, que ses qualités apparentes et frappantes : c'est « le vivant », animal c'est « le doué de vie », etc. C'est seulement assez tard et dans un état de civilisation avancée que, devenu capable de concevoir l'idée de l'être indépendamment de ses modes, l'esprit a distingué les substantifs des adjectifs... ». On ne saurait donc admettre le contraire ; à savoir qu'on ait d'abord conçu des êtres abstraits : la providence, etc..., et qu'on ait ensuite imaginé les formes sous lesquelles ces êtres se manifestaient. L'observation démontre au contraire qu'on est remonté des formes aux êtres, la plupart du temps imaginaires.
[FN: § 177-4]
D. AUG. : VI, 9 «... Si quelqu'un assignait au petit enfant deux nourrices dont l'une ne lui donnerait qu'à manger et l'autre qu'à boire, de même que deux déesses, Educa et Potina, furent préposées à cet office, ne dirait-on pas que cet homme est fou, et qu'il agit en sa maison comme un mime ? On prétend que Liberus tire son nom de liberare, quod mares in coeundo per eius beneficium. emissis seminibus liberentur ; et que Libera fait de même pour la femme. Ils supposent aussi que Libera est Vénus, quod et ipsas perhibeant semina emittere ; et Ob hoc Libero eamdem virilem corporis partem in templo poni, femineam Liberae... Quand le mari et la femme s'unissent, c'est le Dieu Iugatinus qui préside. Soit. Mais il s'agit de conduire l'épouse à la maison [de l'époux] ; à cela préside le dieu Domiducus ; pour que l'épouse reste dans la maison, intervient le dieu Domitius ; pour qu'elle reste avec le mari, intervient la déesse Manturna. Que faut-il encore ? Qu'on épargne la pudeur humaine ; que la concupiscence de la chair et du sang fassent le reste gouvernées secrètement par la pudeur. Pourquoi remplir la chambre à coucher d'une foule de dieux, quand, même les paranymphes se sont retirés ? On la remplit ainsi, non pour que l'idée de leur présence rende plus grand le souci de la pudicité, mais afin que grâce a leur coopération, la jeune fille, craignant l'inconnu, à cause de la faiblesse de son sexe, perdît sa virginité sans difficulté. Dans ce but interviennent la déesse Virginensis et le dieu père Subigo et la déesse mère Prema et la déesse Pertunda et Vénus et Priape. Qu'est-ce que cela ? Si l'époux avait besoin d'être aidé par les dieux, en toute entreprise, un seul parmi les dieux ou une seule parmi les déesses ne suffisaient-ils pas ? N'était-ce pas assez de Vénus seule, appelée à l'aide, dit-on, parce que, sans son intervention, aucune femme ne peut cesser d'être vierge ?... Et en vérité si la déesse Virginensis est présente, afin que la ceinture de la vierge soit déliée, si le dieu Subigo est présent, ut viro subigatur, si la déesse Prema est présente, ut subacta. ne se commoveat comprimatur, qu'est-ce que la déesse Pertunda fait là ? Qu'elle ait honte, qu'elle sorte et que le mari fasse aussi quelque chose. Valde inhonestum est, ut quod vocatur illa, impleat quisquam nisi ille. Mais peut-être tolère-t-on cela parce qu'on dit que c'est une déesse et non un dieu ; car si on croyait que c'est un mâle, et qu'il s'appelât Pertundus, le mari appellerait à l'aide contre lui, pour protéger la pudeur de sa femme, encore plus que la femme en couches, contre Sylvain. Sed quid hoc dicam, cum ibi sit et Priapus ni nimius masculus, super cuius immanissimum et turpissimum. facinum. sedere nova nupta iubebatur, more honestissimo et religiosissimo matronarum ? ». Saint Augustin a des raisons à revendre, si l'on veut juger ces actions au point de vue logique ; mais il ne dit pas qu'à l'origine, c'étaient des actions non-logiques, des formalités mécaniques, qui jouèrent ensuite un rôle parmi les actes du culte divin.
[FN: § 177-5]
D. AUG., ; loc. cit. (§ 177-3).
[FN: § 178-1]
G. BOISSIER: La religion rom.,t. I
[FN: § 179-1]
Tout cela n'est pas entièrement hypothétique. Cette fameuse plante a toute une littérature ! EUSTATHE (Odyss., éd. Rom. p. 1658 éd. Bâle, p. 397) nous offre le choix entre deux interprétations. L'une est mythologique. Le géant ![]() , fuyant après la bataille contre Zeus, débarqua dans l'île de Circé et attaqua Circé. Le Soleil accourut au secours de sa fille et tua le géant. Du sang qui coula à terre, naquit une plante qu'on appela
, fuyant après la bataille contre Zeus, débarqua dans l'île de Circé et attaqua Circé. Le Soleil accourut au secours de sa fille et tua le géant. Du sang qui coula à terre, naquit une plante qu'on appela ![]() , à cause du terrible combat
, à cause du terrible combat ![]() soutenu par le géant. La fleur est semblable au lait, à cause de l'éclat du soleil ; la racine est noire par l'effet du sang noir du géant ou de la frayeur de Circé. – Ephestion raconte à peu près la même histoire. Si cette interprétation ne vous plaît pas, Eusthate vous en offre une autre qui est allégorique :
soutenu par le géant. La fleur est semblable au lait, à cause de l'éclat du soleil ; la racine est noire par l'effet du sang noir du géant ou de la frayeur de Circé. – Ephestion raconte à peu près la même histoire. Si cette interprétation ne vous plaît pas, Eusthate vous en offre une autre qui est allégorique : ![]() est l'instruction ; la racine est noire à cause des ténèbres de l'ignorance ; les fleurs sont blanches par l'effet de la splendeur de la science. La plante est difficile à arracher, parce qu'il est difficile de posséder la science. – Il ne manque plus qu'un disciple de Max Müller, pour nous dire que cette plante à racine noire, à fleurs blanches, que les hommes ne peuvent arracher et qui a des effets bienfaisants, c'est le soleil qui sort des ténèbres de la nuit, resplendit au-dessus des hommes, échappe à leur pouvoir et donne la vie à la terre.
est l'instruction ; la racine est noire à cause des ténèbres de l'ignorance ; les fleurs sont blanches par l'effet de la splendeur de la science. La plante est difficile à arracher, parce qu'il est difficile de posséder la science. – Il ne manque plus qu'un disciple de Max Müller, pour nous dire que cette plante à racine noire, à fleurs blanches, que les hommes ne peuvent arracher et qui a des effets bienfaisants, c'est le soleil qui sort des ténèbres de la nuit, resplendit au-dessus des hommes, échappe à leur pouvoir et donne la vie à la terre.
PLIN. : Nat. hist., XXV, 8, (4). Trad. LITTRÉ : «La plante la plus célèbre est, d'après Homère, celle qu'il croit être appelée moly (allium magicum, L.) par les dieux : ce poète en attribue la découverte à Mercure, et il en signale l'efficacité contre les plus puissants maléfices (Odyss., X, 302). Aujourd'hui, dit-on, elle croît aux environs du lac Phénée, et dans la contrée de Cyllène en Arcadie. Elle est semblable à la description d'Homère ; elle a la racine ronde et noire, la grosseur d'un oignon et la feuille de la seille, on a de la peine à l'arracher. Les auteurs grecs nous en peignent la fleur tirant sur le jaune, tandis qu'Homère a dit qu'elle était blanche. J'ai rencontré un médecin habile dans la connaissance des herbes, qui m'a assuré que cette plante croissait en Italie, et qui m'en a fait apporter quelques jours après, de la Campanie, un échantillon qu'on avait tiré à grand'peine des difficultés d'un terrain pierreux. La racine avait trente pieds de long, et encore elle n'était pas entière ; elle s'était cassée ».
THEOPHR. : Hist. plant., IX, 15, 7, dit de cette plante : ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() : « Le moly se trouve à Phénée et dans la contrée de Gyllène ; on dit aussi qu'il est semblable à celui dont parle Homère. Il a la racine ronde, semblable à l'oignon ; ses feuilles sont semblables à celles de la seille. On l'emploie comme contrepoison et dans les opérations magiques. Il n'est pas si difficile-à arracher que le dit Homère ». Tous ces auteurs croient à la réalité de la plante appelée
: « Le moly se trouve à Phénée et dans la contrée de Gyllène ; on dit aussi qu'il est semblable à celui dont parle Homère. Il a la racine ronde, semblable à l'oignon ; ses feuilles sont semblables à celles de la seille. On l'emploie comme contrepoison et dans les opérations magiques. Il n'est pas si difficile-à arracher que le dit Homère ». Tous ces auteurs croient à la réalité de la plante appelée ![]() par Homère. Au moyen âge, nous voyons que la mandragore jouit d'un grand crédit. Mercure a disparu, mais Satan le remplace.
par Homère. Au moyen âge, nous voyons que la mandragore jouit d'un grand crédit. Mercure a disparu, mais Satan le remplace.
O'REILLY ; Les deux procès de condamnation, les enquêtes et la sentence de réhabi- litation de Jeanne d'Arc, t. II « p. 164) Art. 7. Jeanne avait l'habitude de porter sur elle une mandragore, espérant par là se procurer fortune et richesse en ce monde : elle croit en effet que la mandragore a la vertu de procurer fortune. –D. Qu'avez-vous à dire sur la man- dragore ? – R. Je nie entièrement. (p. 165) (Extr. des interr. se rapp. à l'art. 7) – Le jeudi le 1er mars, interrogée sur ce qu'elle a fait de sa mandragore – A répondu qu'elle n'en eut jamais, mais qu'elle a entendu dire qu'il y en avait une près de sa maison, sans l'avoir jamais vue ; c'est, lui a-t-on dit, chose dangereuse et mauvaise à garder – elle ne sait à quoi cela peut servir. – Interrogée sur l'endroit où serait celle dont elle a entendu parler ? – A répondu avoir entendu dire qu'elle était en terre, près d'un arbre, mais elle n'en sait la place : elle a entendu dire qu'au-dessus était un coudrier ».
[FN: § 180-1]
BOISSIER ; La religion rom., v. 1.
[FN: § 182-1]
Ici, l'induction nous met en présence d'un phénomène qui sera longuement étudié au chap. VI, et que nous rencontrerons ailleurs encore. D'autres cas semblables, que nous nous abstenons de citer, se trouveront dans ce chapitre. Parcourons en tout sens notre champ d'investigations ; nous achèverons dans les chapitres suivants, des études que nous ne faisons qu'effleurer ici.
[FN: § 182-2]
PLINE ; Nat. hist., XXVIII, 3, 1,12). Trad. LITTRÉ. Cette citation nous servira ailleurs aussi ; c'est pourquoi nous la donnons avec une certaine ampleur.
[FN: § 182-3]
Texte: In universurn vero omnibus horis credit vita, nec sentit. Dalechamps : Credit vulgi opinio valere verba, nec certa cognitione et rerum sensu id persuasum habet. Cicéron, lui aussi, exclut le raisonnement. Cic. ; De div., 1, 3, 4 : Atque haec, ut ego arbitror, veteres, rerum magis eventis moniti, quam ratione docti, probaverunt.
[FN: § 182-4]
Texte : Quippe victimas caedi sine precatione non videtur referre, nec deos rite consuli. La difficulté réside dans le verbe referre. GRONOVIUS dit fort bien : Sine precatione non videtur referre, (id est, nihil iuvare putatur, nihil. prodesse vulgo creditur) caedi victimas, nec videtur deos rite consuli. Quo significat necessario preces adhibendas.
[FN: § 182-5]
Texte : Praeterea alia sunt verba impetritis, alia depulsoriis, alia commentationis. Com- mentationis id est : commendationis. Impetritum est un terme augural et désigne une demande faite aux dieux, selon le rite. Cic. ; De div., II, 15, 31): qui evenit, ut is, qui impetrire velit, convenientem. hostiam rebus suis immolet ? « ... comment se fait-il que celui qui veut obtenir [quelque chose des dieux] sacrifie une victime appropriée à ses fins ?» VAL. MAX.; I, 1 : Maiores nostri statas solennesque caerimonias pontificum. scientia, bene gerendarum rerum auctoritates augurum observatione. Apollinis praedictiones vatum libris, portentorum depulsiones Etrusca disciplina [éloigner les mauvais présages par la science des Étrusques] explicari voluerant. Prisco etiam instituto rebus divinis opera datur, cum aliquid commendandum est praecatione ; cum exposcendum, voto ; cum solvendum, gratulatione ; cum inquirendum vel extis vel sortibus, impetrito [par une demande, c'est-à-dire en prenant les augures], cum solemni ritu peragendum, sacrificio : quo etiam ostentorum ac fulgurum. denuntiationes procurantur.
[FN: § 182-6]
Cfr. Liv. VIII, 9 et X, 28.
[FN: § 182-7]
Texte : Confitendum sit de tota coniectione. Gronovius : Perinde est ac si dixisset, de tota lite, de tota quaestione.
[FN: § 182-8]
Voir plus loin (§ 960 et suiv.) quelques-unes des nombreuses élucubrations sur les nombres. Notez la tentative de justifier par la logique, l'observation des jours de fièvre, l'imagination non-logique.
[FN: § 182-9]
Voir en outre : CIC. ; De div., 1, 45, 102 : Neque solum deorum voces Pythagorei observaverunt, sed etiam hominum, quae vocant omina. Quae maiores nostri quia valere censebant, idcirco omnibus rebus agendis, « Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque esset », praefabantur ; rebusque divinis, quae publice fierent, ut « faverent linguis », imperabatur ; inque feriis imperandis, « ut litibus et iurgiis se abstinerent». Itemque in lustranda colonia, ab eo, qui eam deduceret, et cum imperator exercitum, censor populum lustraret, bonis nominibus, qui hostias ducerent, eligebantur : quod idem in delectu consules observant, ut primus miles fiat bono nomine.
[FN: § 184-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Un exemple entre beaucoup d'autres. On peut entendre des protestants invoquer saint Antoine de Padoue, pour qu'il leur fasse retrouver un objet perdu. Ces mêmes personnes ont une profonde pitié pour les catholiques qui croient aux saints.
[FN: § 184-2]
THÉOCR.; Idyll., II, 17. Il y a, tant qu'on veut, des exemples de ce genre, chez tous les peuples ; on n'a que l'embarras du choix. Ainsi les incantations qu'enseigne Caton ne semblent avoir aucun rapport avec les dieux; elles agissent par leur vertu propre. CAT. ; De re rust., 160. Luxum si quod est, hac cantione sanum fiet. Harundinem prende tibi viridem. P. IV, aut V, longam. Mediam diffinde, et duo homines teneant ad coxendices. Incipe cantare in alio. s. f. motas vaeta, daries dardaries astataries dissunapiter, usque dum coeant. Ferrum insuper iactato. Ubi coierint et altera alterant tetigerit, id manu prende, et dextra sinistra praecide. Ad luxum, aut ad fracturam alliga, sanum fiet. Pline rappelle cette recette magique donnée par Caton, et en ajoute d'autres. PLIN.; Nat. hist., XXVIII, 4, 7, (2) : Cato prodidit luxatis membris carmen auxiliare ; M. Varro podagris. Caesarem dictatorem post unum ancipitem vehiculi casum, ferunt semper, ut primum consedisset, id quod plerosque nunc facere scimus, carmine ter repetito securitatem itinerum. aucupari solitum.
[FN: § 184-3]
Luc.; Philopseudes, 14 : Un magicien hyperboréen, pour complaire à Glaucus, amoureux de Chrysis, fait venir celle-ci. « Enfin l'Hyperboréen forma un petit amour de terre glaise. « Va – lui dit-il – et amène Chrysis ». La figurine de terre glaise s'envola. Bientôt après, frappant à la porte, Chrysis se présenta et, étant entrée, elle embrassa Glaucus comme folle d'amour et demeura avec lui jusqu'à ce que nous entendîmes le chant du coq. Alors la lune s'envola au ciel, Hécate s'enfonça sous terre, les autres fantômes s'évanouirent, et nous renvoyâmes Chrysis, quand commençait à poindre l'aurore. (15) Si tu avais vu ces faits, Tichiade, tu ne nierais plus qu'il y a beaucoup de choses utiles dans les enchantements. – Tu as raison – dis-je – je les croirais si je les voyais ; mais actuellement j'estime être digne d'excuse, si je n'ai pas, pour ces choses, la vue aussi perçante que la vôtre. Je connais bien la Chrysis dont tu parles ; c'est une femme amoureuse et facile. Je ne vois pas pourquoi vous aviez besoin de lui envoyer un ambassadeur de terre glaise, un magicien hyperboréen et la lune même, quand avec vingt drachmes on peut l'amener jusqu'aux Hyperboréens. Car c'est grâce à ces enchantements que cette femme se livre entièrement ; et elle éprouve des impressions toutes contraires à celles des fantômes ; car, si ceux-ci entendent le bruit du bronze ou du fer, ils s'enfuient – du moins c'est vous qui le dites – mais elle, si elle entend sonner de l'argent, elle accourt au bruit. »
[FN: § 185-1]
HÉS. Op. et dies, 346.
[FN: § 185-2]
PLIN. Nat. hist., XXVIII, 4, 3 : Qui fruges excantassit... Qui malum, carmen incantassit. Voir en outre SENEC. ; Nat. quaest., IV, 6-7 (§ 194).
[FN: § 185-3]
Maintenant encore on compose des philtres amoureux, par des procédés qui ne diffèrent guère de ceux employés anciennement. Un arrêt du tribunal de Lucera, commenté par l'avocat VITTORIO PASOTTI – Monitore dei Tribunati, Milano, 9 août 1913 – nous apprend que trois femmes avaient pris dans un cimetière des os humains, pour en composer un philtre qui devait induire un homme à épouser une certaine femme.
[FN: § 188-1]
PALL.; I, 35 : Contra grandinem multa dicuntur. Panne, roseo mola cooperitur. Item cruentae secures contra caelum minaciter levantur. Item omne horti spatium alba vite praecingitur : vel noctua pennis patentibus extensa suffigitur : vel ferramental quibus operandum est, sevo unguntur ursino. Aliqui ursi adipem cum oleo tusum reservant, et falces hoc, cum putaturi sunt, ungunt. Sed hoc in occulto debet esse remedium, ut nullus putator intelligat, cuius vis tanta esse perhibetur, ut neque nebula neque aliquo animali possit noceri. Interest etiam ut res profanata non valeat ». PLIN. Nat. hist., XXVIII, 23 : Iam primum abigi grandines turbinesque contra fulgura, ipsa in mense connudata, sic averti violentiam caeli : in navigando quidem tempestates etiam sine menstruis.
[FN: § 188-2]
CLEMENT. ALEX. ; Stromat., VI, 8, p. 758-755, éd. Potter ; 630-631, éd. Paris. Cet auteur raconte d'autres faits encore. La Grèce souffrant d'une grande sécheresse, la Pythie prescrivit d'avoir recours aux prières d'Éaque. Celui-ci alla sur une montagne et pria. Il ne tarda pas à pleuvoir abondamment. On peut encore voir, sur ce point, le scoliaste de Pindare : Nem., V, 17 ; DIOD. SIC, VI, 61 : PAUS., I, 44. À ce propos, l'auteur rappelle le cas de Samuel (I Rois, 12, 18), qui lui aussi a fait pleuvoir. Puis Clément revient aux Grecs et raconte comment Aristée, à Céos, obtint de Jupiter, des vents qui tempérèrent l'ardeur de la canicule. HYGIN.; Poet. astron, II, 4, rappelle aussi ce fait. Il n'oublie pas que la Pythie prescrivit aux Grecs d'apaiser les vents, au temps de l'invasion perse (HÉROD.; VII, 178). Il vient ensuite à parler d'Empédocle, puis revient à la Bible et cite Psaume 83; Deut., X, 16, 17; ISA., XL, 26. Il fait cette remarque : « Certains disent que la peste, la grêle, les tempêtes et autres semblables calamités sont occasionnées non seulement par des perturbations naturelles, mais aussi par certains démons ou par la colère de mauvais anges. » Suit l'histoire de ceux qui, à Kléones, doivent éloigner la grêle ; et l'on nous parle des sacrifices qu'on fait dans ce but (§ 194) ; on nous rappelle la purification d'Athènes par Épiménide et autres histoires semblables.
[FN: § 189-1]
MELA ; III, 6. Sena in Britannico mari, Osismicis adversa litoribus, Gallici numinis oraculo insignis est : cuius antistites, perpetua virginitate sanctae, numero novem esse traduntur : Barrigenas [Gallicenas ?] vocant, putantque ingeniis singularibus praeditas, maria ac ventos concitare carminibus, seque in quae velint animalia vertere, sanare quae apud alios insanabilia sunt, scire ventura et praedicare, sed nonnisi deditas navigantibus et in id tantum, ut se consulerent profectis.
REINACH s'est occupé de ce texte (Cultes, Mythes et religions, t. I). Il croit que Méla a reproduit des informations trouvées dans des textes grecs. « Quelle que soit la source immédiate de Méla dans ce qu'il dit de l'île de Sena, on a lieu de supposer que le fond de son récit est fort ancien. Je crois en trouver l'origine dans l'Odyssée même, ce prototype, comme le disait déjà Lucien, de tous les romans géographiques de l'antiquité ». Il se peut qu'il en soit ainsi ; il se peut aussi que les fables de l’Odyssée et les autres aient une origine commune dans l'idée qu'on peut agir sur les vents ; idée qu'on a plus tard expliquée et sur laquelle on a brodé.
[FN: § 190-1]
Dans le monde latin, on a des inscriptions contenant des invocations aux vents, C. 1. L. VIII, 2609, 2610. ORELLI, 1271. Iovi O. M. tempestatium divinarum potenti leg. III. Aug. dedicante... A. MAURY ; Hist. des relig. de la Gr., t. I « (p. 166) Les vents furent aussi adorés par les populations primitives de la Grèce mais leur culte, qui joue un si grand rôle dans le Rig-Véda, s'était singulièrement affaibli chez les Hellènes. Ils continuent sans doute à être personnifiés, mais on ne les invoque plus que par occasion et en (p. 167) certaines localités spéciales ». Plus loin, en note : « (p. 169 (2) Le culte des vents et des montagnes était associé chez les Chinois à celui des cours d'eau (Tcheou-li, trad. édit, Biot, t. II, p. 86). Lorsque l’empereur passait en char sur une montagne, le cocher faisait un sacrifice au génie de la montagne (Ibid. t. II, p. 249). – (3) Les anciens Finnois invoquaient aussi les vents comme des dieux, surtout ceux du sud et du nord. Ils adressaient aux vents froids des formules déprécatoires... »
[FN: § 191-1]
MATTH. ; 8, 23-91. Surpris de voir cesser la tempête, les disciples s'écrient : « (27) ![]() « Quel est celui à qui obéissent même les vents et la mer ? »
« Quel est celui à qui obéissent même les vents et la mer ? »
[FN: § 192-1]
VIRG. ; Aen., III :.
(115) Placemus ventos, et Gnosia regna petamus.
……………………………………………………………
(118) Sic fatus, meritos aris mactavit honores,
Taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo ;
Nigram Hiemi pecudem, Zephyris felicibus albam.
SERVIUS note : meritos honores] Unicuique aptos... Ratio enim victimarum sit pro qualitate numinum : nam aut hae immolantur, quae obsunt eorum muneribus, ut porcus Cereri ; quia obest frugibus : hircus Libero ; quia vitibus nocet. Aut certe ad similitudinem : ut inferis nigras pecudes ; superis albas immolent : tempestati atras ; candidas serenitati. Nigram Hiemi, etc.] Bono usus est ordine, ut prius averteret mala, sic conciliaret optanda. – ARISTHOPHANE ; Gren., 847-848, plaisante sur cet usage et demande qu'on immole un agneau noir pour éloigner la tempête qui menace Eschyle et sa critique d'Euripide. Le scoliaste note : « un agneau noir]. Parce qu'il s'agit d'un sacrifice au cyclone [Typhon], pour faire cesser l'ouragan – un agneau noir]. Puisqu'on en sacrifie un à Typhon, quand le vent souffle en cyclone... Noir à juste titre et non blanc, parce que le Typhon est noir. »
[FN: § 193-1]
HÉRODOTE ; VII, 178.
[FN: § 193-2]
HÉRODOTE ; VII, 189. À une époque postérieure, on trouve une interprétation qui enlève au fait son caractère surnaturel, qui l'explique logiquement. Ç'est là un cas particulier d'un fait général. Scholia in Apollonii Argonaut., 1, v. 211. « Chez les Mégariens, Eragora dit que Borée, qui enleva Orestie, était fils de Strimon et non pas un vent ». Il reste à trouver des interprétations analogues pour des cas semblables, dans lesquels, au dire des Athéniens, Borée leur fut favorable ; mais c'est très facile : il y aura eu autant d'autres individus du nom de Borée.
[FN: § 193-3]
AEL. ; Var. hist., XII, 61.
[FN: § 193-4]
PAUS.; VIII, 36.
[FN: § 193-5]
Hérodote manifeste aussi quelque doute à propos du secours que Borée porta aux Athéniens ; il observe qu'il ne saurait dire si ce fut vraiment grâce aux prières des Athéniens, que Borée frappa la flotte des Barbares mais, dit-il, les Athéniens affirment que Borée les secourut à cette occasion comme avant. HÉRODOTE ; VII, 189, 3: ![]()
![]() ... « Les Athéniens affirment que Borée les a secourus à cette occasion comme avant et qu'il a fait cela... »
... « Les Athéniens affirment que Borée les a secourus à cette occasion comme avant et qu'il a fait cela... »
[FN: § 194-1]
Par exemple : TIBULLE ; I, 2. L'auteur, parlant d'une magicienne, dit qu'elle dissipe les nuages du ciel et fait tomber la neige en été, selon son caprice.
(51) Cum libet, haec tristi depellit nubila caelo,
Cum libet, aestivo convocat orbe nives.
OVID. Amorum, 1, 8 :
(5) Illa magasartes Aeaeaque carmina, novit,
..........
(9) Cum voluit, toto glomerantur nubila coelo,
Cum voluit, puro fulget in orbe dies.
Idem ; Metam., VII. C'est Médée qui parle :
(201) ... nubila pello,
Nubilaque induco ; ventos abigoque vocoque,
SENECA ; Med. :
(754) Et evocavi nubibus siccis aqua ;
.....
(765) Sonuere fluctus, tumuit insanum mare T
acente vento…
Idem ; Hercul. Oet., 452 et sv.
LUCAIN ; Phars., VI, décrit longuement les opérations magiques de la femme thessalienne. Il convient de remarquer qu'elles agissent non par la faveur des dieux, mais contre leur volonté, en les forçant. En Thessalie :
(440) ... Ibi plurima surgunt
Vim factura Deis...
À la voix de la magicienne :
(461) Cessavere vices rerum ; dilataque longa
Haesit nocte dies : legi non paruit aether,
Torpuit et praeceps, audito carmine. mundus,
Axibus et rapidis impulsos Iupiter urgens
Miratur non ire polos. Nunc omnia complent
Imbribus, et calido producunt nubila Phoebo ;
Et tonat ignaro caelum Iove : vocibus isdem
Humentes late nebulas, nimbosque solutis
Excussere comis. Ventis cessantibus, aequor
Intumuit ; rursus vetitum sentire procellas
Conticuit, turbante Noto, etc.
PHILOSTR. ; Vit. Apoll., III, 14 (p. 53. Didot). Arrivés à l'endroit où étaient les Bracmanes, Apollonius et ses compagnons « virent deux cuves de pierre noire, l'une pour la pluie, l'autre pour les vents. Si l'Inde souffre de la sécheresse, on ouvre celle qui contient la pluie ; aussitôt elle envoie des nuages et des pluies à toute la terre. S'il pleut trop, on la ferme et la pluie cesse. Je crois qu'on emploie la cuve des vents comme l'outre d'Éole ; car si on l'ouvre, il en sort un des vents qui souffle où il faut, et la terre se dessèche ».
[FN: § 194-2]
SENECA ; Nat. quaest., IV, 6-7. (6) Non tempero mihi, quo minus omnes nostrorum ineptias proferam. Quosdam peritos observandarum nubium esse affirmant, et praedicere, cum grando futura sit, et hoc intelligere usu ipso, cum colorem nubium notassent, quam grando toties insequebatur. Illud incredibile, Cleonis fuisse publice praepositos [mot grec] speculatores futurae grandinis, etc.
[FN: § 195-1]
SUIDA S.; s. r. [mot grec]
[FN: § 195-2]
Proprement : démons; mais il faut prendre garde au double sens du [mot grec], païen et du démon chrétien (§ 1613).
[FN: § 195-3]
CLAUD.; De VI cons. Honor.
(369)... nam flammeus imber in hostem
Decidit ...
(374) Tunc contenta polo mortalis nescia teli
Pugna fuit ; Chaldaea mago seu carmina ritu
Armavere Deos ; seu, quod reor, omne Tonantis
Obsequium Marci mores potuere mereri.
Notez la transformation morale. Borée intervient uniquement à cause de ses liens de parenté avec les Athéniens. Jupiter Tonnant intervient, non pour favoriser Mare Aurèle, mais à cause de ses vertus. De semblables transformations sont générales.
[FN: § 194-4]
M. Anton. Phil., 24.
[FN: § 195-5]
DAVIS ; La Chine, t. II. L'auteur transcrit un passage de l'Histoire des trois royaumes : « (p. 66) Liou-peï saisit l'occasion de fondre sur Tchang-pao avec toutes ses forces. Ce dernier, pour le repousser, monta sur son coursier, les cheveux en désordre et agitant l'épée qu'il tenait à la main ; puis il se livra à des opérations magiques. Alors le vent s'éleva, le tonnerre gronda avec fracas, et il descendit du haut des cieux un nuage noir dans lequel on voyait aux prises une multitude d'hommes armés. Liou-peï battit aussitôt en retraite et alla consulter Tchou-tsien qui lui dit : Laissez-le recourir encore aux sortilèges ; je vais préparer du sang de truie, de mouton et de chien... Le lendemain Tchang-pao s'avança. pour offrir le combat. Liou-peï alla à sa rencontre, mais à peine l'avait-il atteint, que Tchang-pao eut de nouveau recours à ses enchantements ; le vent souffla, le tonnerre se fit entendre un nuage sombre obscurcit le firmament, et l'on crut voir descendre des escadrons de cavaliers. Liou- peï tout aussitôt fit semblant de fuir, et Tchang-pao s'élança à sa poursuite ; mais il n'avait pas encore tourné la colline, que les troupes qui étaient cachées sortirent de leur embuscade, et lancèrent sur leurs ennemis l'impur liquide qu'ils avaient tenu en réserve. L'air parut aussitôt rempli d'hommes et de chevaux de papier ou de paille qui tombèrent à terre pêle- mêle ; le vent s'apaisa et le tonnerre cessa ».
[FN: § 195-6]
Heliog., Cum Marcomannis bellum inferre vellet, quos Antoninus pulcherrime profligaverat, dictum est a quibusdam, per Chaldaeos et magos Autoninum Marcum id egisse, ut Marcomanni P. R. semper devoti essent atque amici, idque factis carminibus et consecratione : cum quaereret quae illa essent, vel ubi essent, suppressum est. Constabat enim illum ob hoc consecrationent quaerere ut eam dissiparet spe belli concitandi...
[FN: § 195-7]
DIO CASS. ; LXXI, 9.
[FN: § 195-8]
D. IUST., Apol., I, 71. L'empereur écrit au Sénat ; et le faussaire imagine que Marc- Aurèle dit des chrétiens : « Ils prièrent un dieu que je ne connaissais pas ; aussitôt l'eau du ciel tomba sur nous, très fraîche, tandis qu'une grêle de feu s'abattait sur les ennemis des Romains ». Voyez comment le miracle croît et embellit ! TERTULL. ; Apolog., 5 et EUSÈBE ; Eccl. hist., V, 1-6, rappellent le fait et la fameuse lettre. Eusèbe ne parle pas de la demande que Marc-Aurèle aurait adressée aux chrétiens pour qu'ils se missent en prière. Ceux-ci s'agenouillent spontanément et prient avant le combat. Les ennemis en furent étonnés ; mais il arriva quelque chose de plus merveilleux : un ouragan mit en fuite les ennemis, tandis qu'une pluie bienfaisante réconfortait les Romains. ZONAR.; Ann. XII, 2, répète au contraire à peu près l'histoire du pseudo-Justin. OROS. ;VII, 15 : ...Nam cum insurrexissent gentes inmanitate barbarae, multitudine innumerabiles, hoc est Marcomanni, Quadi, Vandali, Sarmatae, Suebi, atque omnis paene Germania, et in Quadorum usque fines progressus exercitus, circumventusque ab hostibus, propter aquarum penuriam praesentius sitis quant liostis periculum sustineret : ad invocationem nominis Christi, quam subito magna fidei constantia quidam milites effusi in preces palam fecerunt, tanla vis pluviae effusa est, ut Romanos quidem largissime ne sine iniuria refecerit, barbaros autem crebris fulminum ictibus perterritos, praesertim cum plurimi eorum occiderentur, in fugam coegerit. Voir en outre : NICEPH. ; IV, 12. CEDR.; I.–GREGOR. NYSS. ; Or. II in laud. s. XL Martyrun.
[FN: § 196-1]
TERTULL. Ad Scopulam, 4 : Marcus quoque Aurelius in Germanica expeditione Christianorum militum orationibus ad deum factis imbres in siti illa impetravit. Quando non geniculationibus et ieiunationibus nostris etiam siccitates sunt depulsae ?
[FN: § 196-2]
PAUS.; VIII, Arcad., 38: L'auteur fait mention de la fontaine Hagno, sur le mont Lycée. « Lorsque la sécheresse a duré longtemps, et qu'en conséquence les semences confiées à la terre et les arbres se dessèchent, alors le prêtre du dieu Lycéen, après avoir adressé une prière à la fontaine et lui avoir sacrifié selon les rites, touche, avec une branche de chêne, l'eau de la fontaine, à la surface et non au fond. L'eau étant remuée, il s'élève une vapeur semblable à un brouillard ; peu après elle devient un nuage qui, attirant à lui les autres nuages, fait tomber la pluie sur la terre de l'Arcadie. » Nous verrons plus loin (§ 203) que les sorcières, par des procédés exactement semblables, faisaient pleuvoir et grêler. Les différences sont les suivantes : l° Au lieu de la divinité de la fontaine, des païens, c'est le démon des chrétiens qui intervient. Il est naturel que chaque peuple fasse intervenir les êtres divinisés de sa religion. 2° Chez Pausanias, l'opération est essentiellement bienfaisante ; chez les chrétiens, elle peut l'être aussi, mais en général elle est malfaisante. Il est naturel aussi que les êtres divinisés agissent chacun selon son propre caractère, et le démon est essentiellement malfaisant. Cet exemple nous montre un même fait imaginaire, expliqué de façons différentes. Ce sont évidemment les sentiments correspondant à ce fait imaginaire qui sont la partie constante du phénomène, tandis que les explications en donnent la partie variable. – SCHWAB ; Le Talmud de Jérusalem, t. VI. La Mischnâ rapporte comment, par la prière, on fit venir la pluie. « (p. 171). En général, pour toute calamité que l'on voudrait voir détournée du public, on sonne du cor, sauf en cas d'excédent de pluie (causant des peines inutiles). Il est arrivé que l'on pria Honi, le faiseur de cercles, d'intercéder auprès de Dieu pour obtenir de la pluie. Allez, dit-il, faites rentrer les fours servant à rôtir l'agneau pascal... qu'ils ne fondent pas sous l'eau (tant il était certain du succès) ; mais malgré sa prière, la pluie ne tomba pas. Il traça alors un cercle, se plaça au milieu et dit : " Maître de l'univers, tes enfants ont mis leur confiance en moi, jugeant que je suis un de tes familiers ; je jure par ton grand nom que je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants ". Des gouttes de pluie commencèrent alors à tomber. "Ce n'est pas là ce que j'ai demandé, s'écria-t-il, mais de quoi remplir des puits, des citernes et des grottes". La pluie tomba alors à torrents. "Ce n'est pas ainsi que je la désire, dit-il, mais une pluie agréable, de bénédiction et de faveur". La pluie tomba alors régulièrement, en telle quantité que les Israélites durent se rendre de Jérusalem à la montagne du Temple pour échapper à l'inondation. "Comme tu as prié pour que la pluie vienne, lui dit-on alors, supplie qu'elle cesse". "Allez voir, leur répondit-il, si la pierre des Toïm a disparu sous l'eau (elle reparaîtra)". Le commentaire explique que cela est impossible. « (p. 173) "Or, leur dit-il, comme il est impossible que cette pierre disparaisse du monde, de même il est impossible de solliciter que la pluie s'en aille ; mais allez et apportez-moi un taureau pour être offert en action de grâce". Ceci fut fait, et Honi lui ayant imposé les deux mains, s'écria : "Maître de l'univers, lorsque tes enfants ont souffert d'un mal (de la sécheresse), ils n'ont pas pu le supporter ; et lorsque tu leur as envoyé le bienfait (la pluie), ils n'ont pas pu non plus le supporter ; qu'il te plaise donc de leur procurer un soulagement". Aussitôt, le vent souffla, les nuages furent dispersés, le soleil brilla, la terre devint sèche, et les habitants étant sortis trouvèrent la campagne couverte de champignons. » Les champignons font défaut dans le miracle de la légion de Marc-Aurèle.
[FN: § 197-1]
CLÉMENT. ALEX.; Strom., VI, p. 755, éd. Pott.; p. 681, éd. Paris.
[FN: § 197-2]
Les auteurs du Malleus dissertent doctement et longuement pour savoir si le démon peut opérer sans le magicien, ou le magicien sans le démon. Prima pars, secunda quaestio : An catholicum sit, asserere quod ad effectum maleficialem semper habeat daemon cum malefico, concurrere, vel quod unus sine altero, ut daemon sine malefico, vel e converso talent, effectum possit producere. Il y a de graves problèmes à résoudre. Par exemple, pour prouver que l'homme peut opérer sans l'aide du démon – ou, plus généralement, la « force inférieure » sans l'aide de la « force supérieure », – on cite d'après Albert le fait que la sauge, putréfiée d'une certaine manière et jetée dans un puits, excite la tempête. Le Malleus ne met aucunement en doute un fait aussi certain, mais il l'explique. Il distingue d'abord les effets en : ministeriales, noxiales, maleficiales et naturales. Les premiers sont le fait des bons anges ; les seconds, des mauvais ; les troisièmes, du démon, par le moyen des magiciens ; les derniers ont lieu grâce à l'influence des corps célestes. Cela posé, il est facile de comprendre que le fait de la sauge a lieu sans l'intervention des démons : Et ad tetertium de salvia putrefacta et in puteum proiecta dicitur. Quid licet sequatur effectus noxialis absque auxilio daemonis ; licet non absque influentia corporis coelestis.
[FN: § 197-3]
D. GREGOR. TUR. ; vitae patrum, c. XVII ; De sancto Nicetio Treverorum episcopo, 5. Saint Grégoire de Tours raconte une histoire arrivée à Saint Nicaise. Un homme vint un jour le remercier de l'avoir sauvé d’un grand péril en mer. Voici comment c'était arrivé : « Il y a peu de temps, m'étant embarqué pour gagner l'Italie, je me trouvai en compagnie d'une foule de païens, au milieu desquels j'étais seul chrétien, parmi cette multitude de campagnards. Une tempête s'étant levée, je me mis à invoquer le nom de Dieu, et à lui demander qu'il la fît cesser par son intercession. D'autre part, les païens invoquaient leurs dieux : tel appelait à grands cris Jupiter, tel autre Mercure ; d'autres imploraient le secours de Minerve, d'autres encore de Vénus. Comme nous nous trouvions déjà dans un péril de mort extrême, je leur dis : «Braves gens! n'invoquez donc pas ces dieux, car ils ne sont pas des dieux, mais des démons. Si vous voulez maintenant vous sauver du désastre présent, invoquez Saint Nicaise, afin qu'il obtienne de la miséricorde de Dieu, que vous soyez sauvés ». Comme ils s'écriaient d'une seule voix et avec clameur : « Dieu de Nicaise, sauve-nous ! », aussitôt la mer s'apaisa ; les vents cessèrent ; le soleil reparut, et le navire alla où nous voulûmes ».
[FN: § 198-1]
Corpus iuris canonici ; Decret. Grat, II, 26, 5,12. Episcopi. Le sabbat des sorcières est traité de songe : Quapropter Sacerdotes per Ecclesias sibi commissas populo Dei omni instantia praedicare debent, ut noverint haec omnino falsa esse, et non a divino, sed a maligne spiritu talia phantasmata mentibus fidelium irrogari... Quis enim non in somniis, et nocturnis visionibus extra se educitur, et multa videt dormiendo, quae nunquam viderat vigilando ? Quis vero tant stultus, et hebes sit, qui haec omnia, quae in solo spiritu fiunt, etiam in corpore accidere arbitretur ? Ce décret est pris dans RÉGINON ; De ecclesiasticis disciplinis et religione christiana, 1. II, c. 364 ; et c'est peut-être un fragment d'un capitulaire de Charles le Chauve, BARONII ; Annales, ann. 382-XX. Il dit du pape Damas : Nec non etiam excom- municandos esse omnes maleficiis, auguriis, sortilegiis, omnibusque aliis superstitionibus vacantes : qua sententia praesertim feminas illas plectendas esse, quae illusae a daemone, se putant noctu super animalia ferri, atque una cum Herodiade circumvagari.
[FN: § 198-2]
S. AGOBARDI... lib. de Grandine et Tronitruis, p. 147-148 (Migne). Baluzi note : Tempestuarios etiam vocat Herardus archiepiscopus Turonensis in capite 3 suorum Capitulorum : « De maleficis, incantatoribus, divinis, sortilegis, sommariis, tempestuariis, et brevibus pro frigoribus, et de mulieribus veneficis, et quae diversa fingunt portenta, ut probibeantur, et publicae poenitentiae multentur. » Ce scepticisme de Saint Agobard lui a nui auprès d'écrivains ecclésiastiques, qui ont coloré leur hostilité de différents prétextes. GUILLON ; Biblioth. chois. des Pères de l'Église, t. XXV ; « (p. 255) S'il est difficile d'échapper à une sorte d'enthousiasme que produit naturellement l'admiration des belles actions chez un homme d'un grand talent, il ne l'est pas moins de se défendre d'un certain chagrin, qui résulte de l'aspect de mauvaises actions chez des hommes élevés à une grande fortune avec un esprit médiocre. Telle est l'impression qui résulte d'elle-même de ce qui nous est raconté au sujet de l'archevêque de Lyon, Agobard. On l'a mis au nombre des saints ; nouveau problème qui se présente à la surprise des lecteurs. »
[FN: § 200-1]
EUNAP. ; Vit.; Aedesius, (p. 462-463, Didot). L'auteur raconte comment il arriva qu'une année, le vent favorable venant à faire défaut, les navires ne purent amener du blé à Byzance. Rassemblé au théâtre, le peuple qui souffrait de la faim cria à l'empereur Constantin que le philosophe Sôpater était cause du mal ; car « il avait lié les vents par sa science transcendante ». Persuadé de ce fait, l'empereur Constantin ordonna de tuer cet homme. – SUIDAS , s. r. sopater Apamensis, dit que ce philosophe fut tué par Constantin, « afin de rendre évident qu'il [Constantin] n'appartenait plus à la religion hellénique ». Ce récit concorde avec le premier, et ce passage de Suidas explique la « persuasion » dont parle Eunapius. – Theod. Cod., IX, 16, 5 : Multi magicis artibus ausi elementa turbare, vitas insontium labefactare non dubitant, et manibus accitis audent ventilare, ut quisque suos conficiat malis artibus inimicos: Hos, quoniarn naturae peregrini sunt, feralis pestis absumat. La même loi, dans Iust. Cod., IX, 18, 6. – Leg. Wisig., VI, 2, 3: Malefici et immissores tempestatum, qui quibusdam incantationibus grandinem in vineas messesque mittere perhibentur, et hi qui per invocationem daemonum mentes hominum conturbant... ubicumque a iudice, vel actore, vel procuratore loci reperti fuerint vel detecti, ducentenis flagellis publice verberentur, et decalvati deformiter decem convicinas possessiones circuire cogantur inviti, ut eorum alii corrigantur exemplis. – Capitul. sec. anni 805, 25 : De incantatoribus vel tempestariis. De incantationibus, auguriis, vel divinationibus, et de his qui tempestates vel alia maleticia faciunt, placuit sancto Concilio ut ubicunque deprehensi fuerint, videat Archipresbyter diocesis illius, ut diligentissime examinatione constrigantur si forte confiteantur malorum quae gesserunt...
[FN: § 201-1]
D. AGOB.; De grand. et tonit. : (15) Haec stultitia est portio non minima infidelitatis; et in tantum malum. istud iam adolevit, ut in plerisque locis sint homines miserrimi, qui dicant se non equidem nosse immittere tempestates, sed nosse tamen defendere a tempestate habitatores loci. His habent statutum quantum de frugibus suis donent, et appellant hoc canonicum. Multi vero sunt qui sponte sacerdotibus decimam nunquam donant, viduis et orphanis caeterisque indigentibus eleemosynas non tribuunt, quae illis frequenter praedicantur, crebro leguntur, subinde ad haec exhortantur, et non acquiescunt. Canonicum. autem quem dicunt, suis defensoribus (a quibus se defendi credunt a tempestate) nullo praedicante nullo admonente, vel exhortante, sponte persolvunt, diabolo inliciente.
[FN: § 201-2]
Capitulare Francofordiense ... anno Christi DCCXCIV, 23 : ... Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad Ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus, in anno quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a daemonibus devoratas, et voces exprobrationi auditas. Exorcisé sur les reliques des saints Marcelin et Pierre, un de ces méchants démons, qui possédait une fillette, explique clairement le fait : «Je suis – dit-il – satellite et disciple de Satan. Longtemps je fus portier de l'enfer ; mais il y a plusieurs années qu'avec onze de mes compagnons, je dévaste le royaume des Francs. Comme cela nous avait été ordonné c'est nous qui avons détruit le blé, le vin et tous les autres fruits qui naissent de la terre pour l'usage de l'homme ». Cet intelligent démon explique longuement les causes de cette dévastation : Propter malitiam, inquit, populi huius, et multimodas iniquitates eorum qui super eum constituti sunt. Et, montrant le bout de l'oreille, il n'oublie pas les dîmes : Rari sunt qui fideliter ac devote decimas dent. EINHARDI hist. transl. beat. Christi martyr. Marcell. et Petri, 50.
[FN: § 203-1]
Malleus maleficarum. Secunda pars, quaest 1, cap. 15. Super modum quo grandines et tempestates concitare ac etiam fulgura super homines el iumenta rulminare solent.
[FN: § 203-2]
Malleus maleficarum. Secunda pars, quaest. 1, cap. 13, in fine. Super modum quo obstetrices maleficae maiora damna inferunt, dum infantes aut interimunt, aut daemonibus execrando offerunt. Cap. XIII, in fine.
[FN: § 203-3]
DELRIO ; Disq. mag., 1. II, q. 11, t. I, p. 155 : Recentiora exempla nuperi scriptores protulerunt [En marge: Spranger in Malleo, Remigius li. I daemonola., c. 25]. Addam duo, unum lepidum [il appelle plaisant un récit qui se termine par renvoi d'une femme au bûcher !] horrendum alterum. In ditione Trevirensi rusticus fuit, qui com filiola sua octenni, caules plantabat in horto, : filiolam forte collaudavit, quod apte hoc munus obiret. Illa, sexu et aetate garrula, se nosse alia facere, magis stupenda iactat. Pater, quid id foret sciscitatur, secede paullum, inquit, et in quam voles horti partem subitum imbrem dabo. Miratus ille : age secedam, ait : quo recedente, scrobem puella fodit, in eam de pedibus (ut coin Hebraeis loquar pudentius) aquam fondit, eamque bacillo turbidat nescio quid submurmurans. Et ecce tibi subito pluviam de nubibus in conditum locum. Quis (inquam obstupefactus Pater) te hoc docuit ? Mater, respondet, huius et aliorum similium peritissima. Zelo incitatus agricola, post paucos dies, invitatum se ad nuptias simulans, uxorem cum gnata, festive nuptiali modo exornatas in currum imponit, in vicinum oppidum devehit, et iudici tradit maleficii crimen supplicio expiaturas. Hoc, mihi fide dignissimorum virorum narratio suggessit. Ubi notandus modus scrobiculam faciendi, et quod in eam ieceris bacillo confutandi. Voici, comme terme de comparaison, le passage du texte du Malleus, qui raconte la manière dont la pluie fut provoquée : Tunc pater puellam per manum ad torrentem deduxit. Fac, inquit, sed tantummodo super agrum nostrum. Tunc puella manum in aquam misit, et in nomine sui magistri, iuxta doctrinam matris movit. Et ecce tantummodo pluvia agrum illum perfudit, quod cernens pater, fac, inquit, et grandinem, sed tantummodo super unum ex agris nostris, etc. L'autre exemple rapporté par Delrio est celui cité de Pontanus, d'une ville assiégée par le roi de Naples, qui manquait d'eau et en obtint par la pluie, provoquée au moyen d'opérations magiques et sacrilèges. Il est probable que Delrio avait en vue d'autres passages du Fourmilier ou du Malleus. Par exemple, pour ce dernier, le fait rapporté secunda pars, cap. tertium : super modum. quo de loco ad locum corporaliter transferuntur. Une sorcière n'avait pas été invitée à une noce ; elle invoque l'aide du démon qui, à la vue de certains bergers, la transporte sur une montagne. Là, manquant d'eau, elle emploie son urine, et fait grêler sur les gens de la noce : ipsa indignata, vindicare se aestimans, daemonem advocat, et suae tristitiae causam aperuit, ut graridinem excitare vellet, et cunctos de chorea dispergere petiit, quo annuente, ipsam sublevavit, et per aëra ad montem prope oppidum, videntibus certis pastoribus transvexit, et ut postmodum fassa fuerat, aqua sibi deesset ad fundendam in foveam, quem modum ut patebit, ubi grandines excitant, observant, ipsa in foveam quam parvam fecerat, urinam loco aquae immisit, et cum digito, more suo, astante daemone movit, et daemon subito illum humorem sursum elevans, grandinem vehementem in lap - dibus super chorisantes [sic] tantummodo et oppidanos immisit. Unde ipsis dispersis, et de causa illius mutuo conferentibus, malefica oppidum postea ingreditur, unde suspitio magis aggravatur. At vero cum. pastores ea quae viderant recitassent, suspitio vehemens in violentam crevit. Nous rions de ces absurdités, mais les sentiments qu'elles expriment ont causé bien des souffrances et des morts. La pauvre femme dont il vient d'être question fut brûlée. Unde capta, et fassa quod ea de causa, nimirum quia invitata non fuerat, talia perpetrasset, ob multis etiam aliis maleficiis [peut-être tout aussi certains] ab ea perpetratis, incinerata fuit. Voyez aussi : NICOLAI REMIGII... daemonolatreiae libri tres, lib. I, cap. 25.
[FN: § 204-1]
DELRIO ; Disquis. mag., 1, V, s. 16 – t. III, p. 99; 1. 11, q. 11 – t. I, p. 152 : Tertio... possunt Magi tempestates sedare, possant excitare fulgura et tonitrua, grandines, et imbres et similia meteorologica ciere, et in agros quos volunt immittere.... Il reprend ceux qui n'y croient pas, et qui disent que Dieu seul peut le faire : (p. 153) Sed nimirum, Deus haec omnia facit, ut causa efficiens principalis, independens, et universalis : creaturae vero, ut causae efficientes, particulares, dependentes, ac minus principales. Quare sequenda communis, quam proposui, sententia theologorum et iurisconsultorum. Probatur primo, ex S. S., nam ibi Satanas facit ignem de caelo decidere et absumere servos ac Pecua, Iobi ; excitat quoque ventum, vehementem, ...Deinde grandinem qua Aegyptii puniti, expresse S. S. dicit per malos angelos immissam... Denique cur ab Apostolo toties vocantur daemones, principes aeris huius ? Potissimum (p. 151) propter magnam in aerem potestatem. Hoc confirmat non modo lex vetus XII tabularum... sed et Imperatoriae, et Pontificiae sanctiones. Confirmant et ii quos citavi Patres omnes... Quarto probatur historiis et exemplis. De ventis et tempestate sedata a Magis tempore Xerxis, testis est Herodotus. [Notez qu'il ne parle pas du doute manifesté par Hérodote (§ 193)]. De Finnis et Lapponibus sic scribit Olaus : « olim mercatoribus ventos venales exhibebant, tres nodos ma gica arte sacratos offerentes, quorum primo soluto placidos ventos, secundo vehementiores, tertio vehementissimos sint habituri ». Auparavant (l. II, q. 9, p. 137), il rapporte la fable d'après laquelle un roi faisait venir le vent du côté où il tournait son chapeau : Ericus rex Gotthorum quocumque verteret pileum, inde ventum prosperum eliciebat. C'est pourquoi on appelait ce roi (152) Piteus ventosus.
[FN: § 205-1]
GODELMANN ; De Magis venificis et Lamiis, II, 6, 21, p. 68.
[FN: § 206-1]
WIER; Histoires..., I. III, c. 16, t. I : « (p. 357) Davantage ces pauvres vieilles sont subtilement trompées par le Diable : car incontinent qu'il a conu et preveu selon le mouvement des elemens, et le cours de nature (ce qu'il faict plustot et plus facilement que ne scauroyent faire les hommes) les mutations de l'air et les tempestes, ou alors qu'il a entendu que quelcun doit recevoir une playe par l'oculte volonté de Dieu, de laquelle il est en cela executeur, il tormente les esprits de ces femmelettes, il les remplit de diverses imaginations, et leur donne des diverses (p. 358) occasions : comme si pour se venger de leur ennemy elles devoyent troubler l'air, esmouvoir des tempestes, et faire tomber la gresle ». Le brave Bodin oppose de sérieuses objections, à ce propos.
BODIN ; De la demonomanie. réfutations- des opinions de Jean Wier : « (235 b) Quant à ce que dit Wier que les sorcieres ne peuvent de soy-mesmes faire tonner ni gresler, je l'accorde, et peut [sic] aussi tuer et faire mourir les hommes par le moyen des images de cire et paroles : Mais on ne peut nier, et Wier en demeure d'accord, que Sathan ne fasse mourir, et hommes, et bestes, et fruicts, si Dieu ne l'en garde, et ce par le moyen des sacrifices, voeuz, et prieres des sorciers, et par une iuste permission de Dieu, qui se venge de ses ennemis par ses ennemis ».
[FN: § 206-2]
TARTAROTTI; Del congr. nott. delle Lamie, c. XVI : « (p. 189) Il semble qu'il y ait plus de force démonstrative dans le fait que ces personnes s'étant vantées, par exemple, de faire naître une tempête ou de donner la mort à celui-ci ou celui-là, le fait s'est accompli avec les circonstances précises qui avaient été prédites; et il y en a des témoins dignes de foi. Cependant, dans l'hypothèse de l'illusion, ce cas aussi s'explique facilement, si l'on répond que le démon, afin d'inculquer à ses adeptes une haute opinion de son pouvoir, aime à s'attribuer les événements naturels, prévoit toute chose, incite les sorcières à les produire, et que ces événements s'accomplissent ainsi, non grâce à sa puissance, et encore moins à celle des sorcières, mais parce qu’ils étaient dans l'ordre naturel des choses ».
[FN: § 208-1]
BODIN ; De la demonomanie..., réfutation des opinions de Jean Wier. « (p. 240 b) Il faut donc condamner toute l'antiquité d'erreur et d'ignorance, il faut rayer toutes les histoires et bifer les loix divines et humaines comme faulses et illusoires, et fondees sur faux principes : et contre tout cela opposer l'opinion de Wier, et de quelques autres sorciers, qui se tiennent la main pour establir et asseurer le regne de Sathan (p. 241 a) : ce que Wier ne peut nier, s'il n'a perdu toute honte... ».
[FN: § 209-1]
DUVAL; Procès de sorciers à Viry : « (p. 88) Marguerite... faiet plaincte et partye criminelle par devant nous, Claude Dupuis, chastellain dicelle baronnye, en la meilleure force et forme que dénunce se peut faire, contre [suivent les noms de trois femmes], occasion de ce que le vingt-neuviesme jour dapvril, à heure de midy, ladicte Marguerite, venant des champs de monder des febves, estant au curtil caillant des herbes, survindrent lesdictes susnomméez tenantz une chascune delles un pan (pieu) de bois en leurs mains, luy disant semblables (p. 89) parolles : faulse hyrige (sorcière), il te fault aller à Viry ; et commençarent à frapper la dicte dénunceante sur son corps de leur pouvoir et aussy luy attacharent ses bras de une corde, de sorte qu'elle ne se povoit remuer. » On interroge les femmes dénoncées, lesquelles : « (p. 91) ... declarent ne sçavoir rien et navoir aulcunement batu ladicte Marguerite ny le vouldroit avoir faict. Confesse toutteffois luy avoir dict et appellée hyrige en sa propre présence pourceque plusieurs aultres ainssi la y appeloient et quasi tous ceulx qui la cognoissent pour ce spéciallement que despuis la mort du filz de Pierre Testu dict Grangier, ladicte Marguerite sen est fuye à cause quon disoit quelle lavoit tué... ». Suit le procès, et le châtelain entend plusieurs témoins. Une partie ignore, une autre confirme que Marguerite a été frappée ; mais le châtelain, ses jurés et les femmes accusées de l'agression n'en demeurent pas convaincus. Cependant puisque : « (p. 102) ont confessé avoir dict et reproché à ladicte Marguerite quelle estoit hiryge, chose qui importe grande diffamation », ils ordonnèrent de procéder au criminel, pour connaître la vérité de cette accusation. Ainsi, de plaignante, Marguerite devient accusée. On interroge plusieurs témoins, qui parlent d'enfants morts, à ce qu'ils disent, par la faute de cette Marguerite. L'un d'eux raconte comment celle-ci s'était disputée avec une certaine femme du nom d'Andrée, « (p. 106) et ung peu après mouroit un sien enfant aussy celuy de Claude son frère de mort estrange ». Aujourd'hui, on aurait recherché si elle leur avait donné du poison. Alors, on croyait qu'un tel moyen matériel n'était pas nécessaire pour donner la mort. « (p. 106) ... avant la maladie desdictz enfantz ladicte Marguerite vinct en la maison du dict tesmoingz et sen alla asseoir au milieu et entre les deux bris (berceaux) desditz enfants demandant à ladicte Andrée quelle luy donnast place pour reposer certain chenevas... a laquelle demande ladicte Andrée ne voullu accorder dont ladicte Marguerite feust marrye et couroucée et incontinentz apprès les dictz enfantz tombarent malades et consequemment se moururent ». D'autres faits semblables sont mis à sa charge. Un témoin dépose « (p. 108) que la fame et renommée est audict villaige de Vers et partout là où lon la cognoist et que plusieurs gens luy ont dict et impétré en sa face quelle estoit hiryge sans ce quelle en aye fait aucun contre ny instance... »
[FN: § 211-1]
LEA; Hist. de 1’inq., trad. Reinach, t. III, p. 434 de l'édition originale. PERTILE est aussi de cet avis. PERTILE ; Stor. del dir. ital., t. V : « (p. 1147) Et l'Église procédait avec douceur, excommuniant ceux qui pratiquaient la magie, les soumettant aux pénitences canoniques... Elle ne se désista pas de ce système, même plus tard, quand, au XIIIe siècle, la foi s'étant affaiblie par un retour vers le paganisme, et par la diffusion d'un nouveau manichéisme dans les sectes des cathares et des patarins, les anciennes superstitions surgirent de nouveau, plus fortes que jamais ». Mais ici, l'auteur, qui écrit pourtant de nos jours, croit devoir justifier ces croyances qu'il appelle superstitions : « (p. 447) Lesquelles étaient vraiment tout à fait honteuses ; (p. 448) elles consistaient non seulement dans la persuasion d'avoir commerce avec le diable, de pactiser avec lui, en lui donnant son âme, et d'agir par son intermédiaire en l'invoquant, en se consacrant à lui et en l'adorant, mais, ce qui est pire, dans l'abus des choses les plus saintes... ». Brave homme, ce que tu appelles honteux, d'autres le considèrent comme ridicule, objectivement, et comme pathologique, subjectivement ! Voyez quel pouvoir a le préjugé. Voici un auteur laïque qui écrivait vers la fin du XIXe, siècle, et qui paraît croire à la réalité des pactes avec le diable, très honteux, selon lui, tandis que les théologiens modernes manifestent tout au moins de nombreux doutes. Dict. encycl. de la théol. cath., s. r, Magie, t. XIV : « (p. 100) La principale question... est de savoir s'il est possible que les démons entrent au service spécial d'un homme... On ne peut a priori répondre négativement à la question posée... Une seconde question est de savoir de quelle manière s'établit cette relation de service entre le démon et l'homme. La foi populaire répond en admettant que le diable peut être conjuré et être obligé par là à servir l'homme. Mais cette imagination populaire est inadmissible... Les histoires par lesquelles on s'abusait volontiers autrefois à cet égard... ont sans aucun doute, leur source dans la fanfaronnade ou l'imagination maladive des prétendus possesseurs, et aucune ne mérite la moindre croyance. Une autre opinion, admise par beaucoup de théologiens, et qui joua un rôle important dans la période des procès de sorcellerie, est celle qui prétend que l'homme peut contracter un pacte avec le diable et le contraindre ainsi à lui rendre certains services. La conclusion d'un pareil pacte est considérée comme un procédé tantôt objectif et réel, tantôt subjectif mais réel encore, tantôt implicite, tantôt explicite. Quant à la réalité objective, on peut concevoir ce pacte comme ayant été contracté par l'homme en santé ou dans l'état maladif de l'extatique... (p. 101) Quant à admettre un commerce direct avec le diable..., cette opinion est tellement grossière que nous pensons pouvoir ne pas nous y arrêter plus longtemps ». L'auteur admet le pacte dans l'état extatique : « Mais on voit facilement qu'il ne peut être question d'un pacte que dans un sens impropre. ...En outre il se peut que le prétendu pacte ne soit autre chose qu'un phénomène subjectif : c'est le cas des malades d'esprit qu'on appelle démonomanes. Dans ce cas le malade s'imagine avoir conclu un pacte avec le diable, et son imagination n'a absolument rien qui lui corresponde dans la réalité... Quant au moyen par lequel un démon peut être lié au service d'un homme pour l'aider à exercer un pouvoir magique, nous affirmons qu'il n'existe pas, et que si le démon se met au service de l'homme, il le fait librement attiré qu'il est par l'affinité élective qui existe entre sa méchanceté et celle de l'homme... ». En outre : « ... le démon n'est pas au-dessus des lois de la nature,... lui aussi ne peut produire que ce qui est naturellement possible en soi ».
[FN: § 212-1]
CAUZONS ; La magie et la sorc., t. III : « (p. 64)... l'ouvrage de Delrio est un des ouvrages catholiques auxquels on dut le plus de victimes... Nous disons « des ouvrages catholiques », parce que les Réformés eurent une large part aux procès de sorcellerie. S'il est difficile de prouver qu'ils brûlèrent plus de sorciers que les catholiques, il est tout aussi difficile de démontrer qu'ils en brûlèrent moins. Ce (p. 65) qui est bien certain, c'est que la persécution des malheureux magiciens sévit intense en Allemagne et en Angleterre, bien plus sérieuse qu'en Espagne, qu'en Italie et même qu'en France, où cependant les bûchers flambèrent nombreux, surtout à certaines époques et dans certains districts ».
[NOTE DU TRADUCTEUR]. il semble bien que les protestants se soient souvent montrés plus impitoyables que les catholiques envers les sorciers. Ils n'admettaient pas qu'une sincère pénitence du coupable pût effacer sa faute. Voici deux exemples pris presque au hasard, dans la riche collection qu'en possèdent les Archives cantonales vaudoises à Lausanne. (Procès criminel de Anthoyne Cuender [femme], originelle de Mesire [Mézières] ...detenue au chasteau de Lausanne, 21 déc. 1620). « De tous lesquelz malefices et forfaictz par ladicte detenue confessez, icelle comme bien penitente et repentante, en demande mercy et pardon a Dieu, a nosditz Seigneurs et a la noble Justice, declairant vouloir vivre et mourrir en sesdictes confessions, lesquelles elle a soustenues a la corde [au supplice de la corde] veritables. – Sur ce s'est présenté le Prénommé Procureur fi[s]cal..., lequel a demandé, pour s'estre ladicte detenue de tant desnaturée et oubliée, que d'avoir renoncé Dieu son Createur pour prendre le Diable ennemy du genre humain pour son maistre, ayant de luy recues graisses et demoniaque pour affliger et faire mourir gens et bestes. Ce quelle auroit faict en plusieurs et diverses personnes et bestes qui seroyent actes et faicts exorbitantz et dignes de mort exemplaire, mesmes contrariant aux loix divines et humaines icelle detenue debvoir estre pourtant remise entre les mains de l'Executeur de la Haulte Justice, lequel lui ayant lié les mains et mis une corde au col, la doibgt mener et conduyre au lieu accoustumé supplicier semblables delinquants. Et illec montée sus ung eschauffault de bois et attachée a une eschelle icelle renversée, doibgt mettre le feu aux quattre boutz d'iceluy, entant que l'ame de ladicte, detenue soit separée de son corps, et iceluy reduict en cendres, et ce pour chastiment de sesdictz malefices et forfaictz, et estre en exemple a semblables malfaicteurs, ses biens commis et confisquez... ». Les juges admettent les conclusions du Procureur fiscal.– Le 29 janvier 1610, Jaques Pasquier d’Escublens, puni une fois déjà du collier, est condamné à Lausanne, pour sorcellerie. Il a spontanément fait confession de son hommage au Diable, et reconnu avoir fait mourir plusieurs personnes en complicité avec d'autres sorciers. Sa propre femme aurait été sa victime. Le jugement porte : « Iceluy detenu debvoir estre remys entre les mains de lexecuteur de la haulte Justice, lequel après lui avoir lié les mains et mis une corde au col le doibgt conduire au lieu accoustumé d'executer tels malfaiteurs et delinquants, Et illec le mettre à la renverse sus des congruyns [bâtis] de bois attachez en terre, Et la briser les os de ses membres avecques une roue, Et dela trainer le dict delinquant tout vif sus un eschauffault de bois, ou l'ayant attachez en une eschelle, et renversée contre terre doibge mettre le feu audict eschauffault et le faire consumer avec le corps dudict delinquant, en sorte qu'il soyt reduict en cendre, et l'ame separee d'iceluy,... ». (Pièce non classée.) Les conclusions du Procureur fiscal sont admises par les juges.
[FN: § 213-1]
D. AUG. ; De divinatione daemonum, c. 3, 7 : Daemonum ea est natura, ut aerii corporis sensu terrenorum corporum sensum facile praecedant ; celeritate etiam propter eiusdem aerii corporis superiorem mobilitatem non solum cursus quorumlibet hominum vel ferarum, verum etiam volatus avium incomparabiliter vincant. Quibus duabus rebus quantum ad aerium corpus attinet praediti, hoc est, acrimonia sensus et celeritate motus, multa ante cognita praenunciant vel nuntiant, quae homines pro sensus terreni tarditate mirentur. Accessit etiam daemonibus per tam longum tempus quo eorum, vita protenditur, rerum longe maior experientia, quam potest hominibus propter brevitatem vitae provenire... – c. 5, 9: Quae cuni ita sint, primuni sciendum est, quoniam de divinations daemonum questio est, illos, ea plerumque praenuntiare quae ipsi facturi sunt... Comme le médecin prévoit le cours de la maladie, grâce aux signes extérieurs, sic daemon in aeris affectione atque ordinatione sibi nota, nobis ignota, futuras praevidet tempestates. – TERTULL.; Apolog., 22 ...Habent de incolatu aëris et de vicinia siderum et de commercio nubium caelestes sapere paraturas, ut et pluvias, quam iam sentiunt, repromittant.
[FN: § 213-2]
D. AUG. ; De civ. dei, XXI, 6, 1. – D. THOM.; Summa theol., 1a, 115, 6.
[FN: § 214-1]
Theod. Cod., IX, 16, 3: De incantamentis, quatenus ea prohibita sint vel permissa. Costantini M. Lex – Eorum est scientia punienda, et severissimis merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibus, aut contra hominum moliti salutem, aut pudicos ad libidinem deflexisse animos detegentur : Nullis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus, aut in agrestibtis locis, ne maturis vindemiis metuerentur imbres, aut ruentis grandinis lapidatione quaterentur, innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus, aut existimatio laederetur, sed quorum proficerent actus, ne divina munera et labores hominum sternerentur. – La même loi se trouve dans : Iust. Cod., IX, 18, 4. Cette constitution fut abrogée par l'empereur Léon, Novell.65, Ad Stylianum, de incantatorum poena.
[FN: § 215-1]
Malleus malef., Pars II, quaest. 2, cap. 7 : Super remedia contra grandines et fulmina, ac etiam super iumenta maleficiata. Mais il y a encore d'autres remèdes. Le juge demande à une sorcière an per aliquem modum tempestates a maleficis concitatae sedari possent. Respondit, possunt, per hoc, videlicet : Adiuro vos grandines, et ventos, per quinque vulnera Christi, et per tres clavos, qui eius manus et pedes perforarunt, et per quatuor evangelistas sanctos, Mathaeum, Marcum, Lucam et Ioannem, ut in aquam resoluti descendatis. L'auteur traite aussi de l'usage fort ancien de sonner les cloches. Aujourd'hui, on y a substitué, avec des résultats pas très différents, les canons paragrêles.
[FN: § 221-1]
PLAT.; Euthyphr., p. 14-17: ![]()
![]() C'était en somme l'opinion d'un grand nombre de Grecs. Il convient de rappeler ce que nous avons dit à propos de la différence existant entre Athènes et Rome, à savoir qu'elle réside plus dans l'intensité de certains sentiments que dans leur nature.
C'était en somme l'opinion d'un grand nombre de Grecs. Il convient de rappeler ce que nous avons dit à propos de la différence existant entre Athènes et Rome, à savoir qu'elle réside plus dans l'intensité de certains sentiments que dans leur nature.
[FN: § 221-2]
MACROB. Satur., III, 9 : « On sait que toutes les villes sont protégées par des dieux particuliers ; et c'était une coutume antique des Romains, inconnue de beaucoup, que lorsqu'ils assiégeaient une ville ennemie, et pensaient être sur le point de la prendre, ils en invoquaient les dieux tutélaires par une certaine incantation ; car autrement ils ne croyaient pas pouvoir prendre la ville ; ou, s'ils l'avaient pu, ils estimaient impie d'avoir fait prisonniers les dieux. Pour la même raison, les Romains voulurent que le nom du dieu qui protégeait Rome et le nom latin, lui-même, de la ville, restassent inconnus ».
Macrobe donne ensuite une formule pour invoquer les dieux d'une ville assiégée, et une autre pour consacrer les villes et les armées, après en avoir invoqué les dieux. Mais il avertit que seuls les dictateurs et les empereurs pouvaient s'en servir : Dis pater, Veiovis, Manes, sive vos quo alio nomine fas est nominare... Il faut que les paroles de la formule soient accompagnées de gestes déterminés : Cum Tellurem dicit, manibus terram tangit, cum Iovem dicit, manus ad coelum tollit. Cum votum recipere dicit, manibus pectus tangit. S'il ne s'agissait que de se faire comprendre des dieux, ce serait ridicule ; au contraire, c'est raisonnable, si les paroles et les gestes ont une vertu propre. –- VIRG.; Aeneid., II, 351 : Excessere omnes adytis arisque relictis Di. – SERVIUS note : Quia ante expugnationem evocabantur ab hostibus numina, propter vitanda sacrilegia. Inde est quod Romani celatum esse voluerunt, in cuius dei tutela Urbs Roma sit : et iure Pontificum cautum est, ne suis nominibus dii Romani appellarentur, ne exaugurari possint. Et in Capitolio fuit clypeus consecratus, cui scriptum erat : Genio Urbis Romae sive mas sive foemina. Et Pontifices ita precabantur : Iupiter optime maxime, sive quo alio nomine te appellari volueris ; nam et ipse ait : Sequimur te, sancte deorum, quisquis es (Aeneid., IV, 576-577).
[FN: § 222-1]
GELLIUS; II, 28.
[FN: § 223-1]
ARNOB. ; Adv. Gent., VII, 31. – ORELLI fait la remarque suivante : Veteres, cum aliquid consecrabant, caute et accurate loquebantur legesque semper et conditiones expresse addebant, ne qua se tacita religione obligarent ; quod ex pluribus, inscriptionibus patet. Et il en donne un exemple.
[FN: § 223-2]
PLIN.; N. H., XXVIII, 4, 3, (2). – CICERON ne comprend plus ces associations d'idées : De Divin., II, 36; parlant de M. Marcellus : Et quidem ille dicebat, si quando rem agere vellet, ne impediretur auspiciis, lectica operta facere iter se solere. Huic simile est, quod nos augures praecipimus, ne iuge auspicium obveniat, ut iumenta iubeant diiungere.
[FN: § 224-1]
BOUCHÉ-LECLERCQ; Hist. de la divin. dans l'ant., t. IV.
[FN: § 225-1]
BOUCHÉ-LECLERCQ; loc. cit. Le même auteur, p. 170, traduit ainsi le rituel d’Iguvium. : « Que celui qui va observer les oiseaux propose ainsi de (p. 171) son siège à l'auspiciant : « Je stipule que tu observes l'épervier à droite, la corneille à droite, le pic à gauche, la pie à gauche, les oiseaux volants de gauche et les oiseaux chantants de gauche étant favorables ». Que l'auspiciant stipule ainsi : « Je les observe, l'épervier à droite, la corneille à droite, le pic à gauche, les oiseaux volants de gauche et les oiseaux chantants de gauche étant favorables pour moi, pour le peuple Iguvien, dans ce temple déterminé ». – CIC. ; De div., II, 38, 71 : Etenim, ut sint auspicia, quae nulla sunt ; haec certe, quibus utimur, sive tripudio, sive de coelo, simulacra sunt auspiciorum, auspicia nulle modo. – 34, 71 : « Q. Fabi, te mihi in auspicio esse volo ». Respondet, « audivi ». Hie apud maiores nostros adhibebatur peritus, nunc quilibet. Peritum autem esse necesse est eum, qui, silentium quid sit, intelligat : id enim silentium dicimus in auspiciis, quod omni vitio caret : (72) hoc intelligere perfecti auguris est. Illi autem, qui in auspicium adhibetur, cum ita imperavit is, qui auspicatur, « Dicito, si silentium esse videbitur ; » nec suspicit, nec circumspicit ; statim respondet : «Silentium esse videri ». Tum ille, «Dicito, si pascuntur Pascuntur ». – Voir dans TITE-LIVE, X, 40, l'histoire d'un auspice qui, bien qu'inventé, est favorable par le seul fait qu'il est annoncé. Le consul Papirius répond à celui qui l'avertit que l'auspice est inventé : Tu quidem macte virtute diligentiaque esto : ceterum qui auspicio adest, si quid falsi nuntiat, in semet ipsum religionem recipit. Mihi quidem tripudium nuntiatum, populo romano exercituique egregium auspicium est.
[FN: § 226-1]
GROTE ; Hist. de la Grèce, trad. franç., t. VI. – Les Argiens abusaient de ces dispositions de leurs voisins, les Spartiates. Au temps de la guerre contre Épidaure, tandis que les Spartiates restaient inactifs pendant tout le mois Karneios, les Argiens abrégèrent arbitrairement ce mois, de quatre jours, et commencèrent les hostilités. Thucyd., V, 54. Dans d'autres occasions, au contraire, ils créaient un mois Karneios fictif, pour obtenir une trêve des Lacédémoniens. C'est pourquoi Agésipolis, sachant qu'il devait diriger son armée contre Argos, commença par aller demander, à Olympie et à Delphes, s'il devait accorder cette trêve et il lui fut répondu d'une façon concordante qu'il pouvait la refuser. XÉNOPH. Hell., IV, 7.
[FN: § 226-2]
SERV.; Ad Aeneid., IX, 53 : Post tertium autem et trigesimum diem, quam res repetissent ab hostibus, Feciales hastam mittebant. Denique cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent, nec invenirent locum, ubi hanc solennitatem per Feciales indicendi belli celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in Circo Flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi implerent: denique in eo loco ante pedem Bellonae consecrata est columna. Le chef d'une armée devait régulariser ses auspices ; et cela ne pouvait avoir lieu qu'au Capitole. Comment faire, quand l'armée se trouvait dans des pays lointains ? La chose est très simple. On construisait un Capitole fictif, sur le sol étranger, et l'on y prenait les auspices. – SERV. ; Ad Aeneid., II, 178 : Tabernacula aut eligebantur ad captanda auspicia ; sed hoc servatum a ducibus Romanis, donec ab his in Italia pugnatum est, propter vicinitatem ; postquam vero imperium longius prolatum est, ne dux ab exercitu diutius abesset, si Romain ad renovanda auspicia de longinquo revertissent, constitutum, ut unus locus de captivo agro Romanus fieret in ea provincia, in qua bellabatur, ad quem, si renovari opus esset auspicia, dux rediret.
[FN: § 227-1]
IHERING. ; Espr. du dr. rom., t. III.
[FN: § 227-2]
BEAUCHET ; Hist. du dr. priv. de la Rép. Athén., t. III.
[FN: § 228-1]
F. GIRARD; Manuel élém. de dr. rom.
[FN: § 228-2]
L'auteur cite CIC. ; Pro Mur., 12, 26.
[FN: § 228-3]
Ici l'auteur fait allusion à une controverse que nous n'avons pas besoin de résoudre, étant donné notre but qui est seulement de montrer, sans entrer dans les détails, la partie presque mécanique, exécutée par le magistrat.
[FN: § 230-1]
MOMMSEN ; Hist. rom., trad. franç., II, p. 5 : « Partout : et à Rome, et chez les Latins, et chez les Sabeliens, les Étrusques et les Apuliens, dans toutes les cités italiques enfin, comme dans les cités grecques, des magistrats annuels remplacent tôt ou tard les magistrats à vie ». Parmi les cités grecques, il faut naturellement excepter Sparte. Il convient de remarquer que Rome et les cités italiennes n'ont pas eu la période des tyrans, comme la Grèce ; et il est probable que l'absence de cette période, en Italie,, est due précisément, au moins en partie, à l'état psychique des populations italiennes ; état psychique que nous trouvons spécialement à Rome. À Sparte, les deux rois devaient la dignité royale à la succession ; ils présidaient les conseils, administraient la justice, commandaient l'armée et servaient d'intermédiaires entre Sparte et les dieux.
[FN: § 230-2]
La tradition est unanime à montrer que les consuls héritent presque de tous les pouvoirs des rois. Liv.; II, 1 : Libertatis autem originem inde magis, quia annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quidquam sit ex regia potestate, numeres. Omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere... – CIC. ; De rep., II, 32 : Tenuit igitur hoc in statu senatus rempublicain temporibus illis ... , atque uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genere ipso ac iure regiam. DIONYS., IV, 73, 74, 75.
Peu importe, étant donné notre but, que ces traditions soient plus ou moins authentiques. De toute façon, elles nous révèlent l'état d'âme de ceux qui les ont arrangées ou partiellement inventées ; et c'est justement cet état d'âme que nous voulons remarquer.
[FN: § 230-3]
MOMMSEN ; Le droit publ. rom., t. I.
[FN: § 231-1]
MOMMSEN ; Le droit publ. rom., t. II.
[FN: § 231-2]
VAL. MAX.; III, 8,3, nous raconte comment C. Pison se refusa à « renuntiare » M. Palicanus, homme fort séditieux, qu'il estimait indigne du consulat : In hoc miserando pariter et erubescendo statu civitatis, tantum non manibus tribunorum pro rostris Piso collocatus, cum hinc atque illinc eum ambissent, et : An Palicanum suffragiis _populi consulem creatum, renuntiaturus esset, interrogaretur, primo respondit : Non existimare se, tantis tenebris offusam esse rempublicam, ut huc indignitatis veniretur. Deinde, cum perseveranter instarent, ac dicerent : Age, si ventum fuerit ? – Non renuntiabo, inquit. – GELL. ; VI, 9 : At aedilis, qui comitia habebat, negat accipere ; neque sibi placere, qui scriptum faceret, eum aedilem fieri. – Le même fait se trouve dans LIV. ; IX, 46. Il y a du reste de nombreux autres exemples de ce genre. LIV. ; XXXIX, 39 : L. Porcius consul primo in ea sententia esse, ne nomen eius acciperet...
La Lex Iul. mun., I, 132, défend expressément de « renuntiare » certains individus réputés indignes : ... neve, quis eius rationem comitieis ; conciliove habeto, neive quis quem, sei adversus ea comitieis conciliore creatum est, renuntiato ;... (les mots imprimés en italique sont une reconstitution de Mommsen).
[FN: § 233-1]
CIC.; Philipp., II, 34. – DION.; XLIV, 1-3. – VELLEIUS ; 56 : Cui magnam invidiam conciliarat M. Antonius omnibus audendis paratissimus, consulatus collega, imponendo capiti eius Lupercalibus sedentis pro rostris insigne regium, quod ab eo ita repulsum erat, ut non offensus videretur.
[FN: § 233-2]
Reconstitution de I. Franzius : In consulatu sexto et septimo [postquam bella civili]a extinxeram, per consensum universorum [civium mihi tradita]m rempublicam ex mea potestate in Senatu[s populique Romani a]rbitrium transtuli, quo pro merito meo Sena[tus consulto Augustus appel]l[at]u[s] sum, et laureis postes aedium mearum v[inctae sunt p]u[bli]c[e] su[pe]rque eas ad ianuam meam. e[x] qu[erna fronde co]r[o]n[a ci]v[ic]a posi[ta ob servatos cive]s, qu[ique es]se[t pe]r [inscriptione]m [t]e[stis meae] virtutis, clementiae, iustitiae pietatis, est p[osit]us clupe[us aureus in curia a Senatu populoque R]o[mano quo]d, quamquam dignitate omnibus praestarem, potestatem tamen nih[ilo] amplio[rem haberem quam] con[l]e[gae mei.
[FN: § 234-1]
MOMMSEN ; Le droit publ. rom., t. V.
[FN: § 233-3]
VELL. ; II, 89 : Restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum modum.
[FN: § 235-1]
GAIUS ; 1, 5 : Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. – ULP. : Dig., 1, 4, 1 : Quod principi placuit, legis habet vigorem : utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat.
Les Institutes de Justinien (1, 2, 6) répètent la même chose. En ces temps-là, c'était vraiment de l'archéologie.
[FN: § 235-2]
HIST. AUG. ; Caracall., 10 : Interest scire quemadmodum novercam suam Iuliam uxorem duxisse dicatur. Quae cum esset pulcherrima, et quasi per negligentiam se maxima corporis parte nudasset, dixissetque Antoninus : Vellem, si liceret, respondisse fertur : Si libet, licet. An nescis te imperatorem esse, et leges dare, non accipere ?
AUR. VICT.; De Caesar., XXI : Il dit de Caracalla : ... pari fortuna, et eodem matrimonio, quo pater. Namque Iuliam novercam, cuius facinora supra memoravi, forma captus, coniugem adfectavit ; cum illa factiosior adspectui adolescentis, praesentiae quasi ignara, semet dedisset intecto corpore adferentique, vellem, si liceret, uti : petulantius multo (quippe quae pudorem velamento exuerat) respondisset : libet ? plane licet.
Sous cette forme, l'histoire doit avoir été inventée. Julie était mère, non belle-mère de Caracalla.
[FN: § 236-1]
BREAL et BAILLY, Dict. étym. latin, s. r. lego, dérivent religio de lego : « (p. 157) Religio signifiait « le scrupule », et particulièrement « le scrupule pieux ». LIV. VIII, 17 : Religio deinde incessit, vitio eos creatos. TER.; Andr., V, 4, 38... CIC. Caec., 38... Id. Div., 1, 35 : Nec eam rem habuit religioni. TER.; Heaut., II, 1, 16 Hoc facere religio est. De ce premier sens sont dérivés tous les autres du mot religio ». Or cette étymologie n'est plus acceptée ; mais cela importe peu, puisque, ni maintenant ni jamais, nous ne voulons déduire les propriétés des choses, de l'étymologie de leurs noms. – FORCELLINI est dans l'erreur, quand il donne comme dérivé un sens qui est plutôt primitif ; mais il exprime bien ce sens, s. r. Religio, en disant : (10) Translate est minuta et scrupulosa diligentia et cura : exactitude. – CIC.; Brut., 82 : Eius oratio nimia religione attenuata. Id., Orat. : Atheniensium semper fuit prudens sincerumque iudicium, nihil ut possent, nisi incorruptum audire et elegans, quorum religioni cum serviret orator, nullum verbum insolens, nullum odiosum ponere audebat : délicatesse. (11) Item iusta muneris funetio : ponctualité. Id., 5, Ven, 1... – il convient de noter que la signification primitive de ( superstitio » n'est pas du tout celle que nous exprimons par « superstition », mais simplement un excès de religion, quelque chose qui sort de l'ordre, de la régularité qu'aimaient les Romains. GELL., IV, 9, cite un vers d'un poème ancien : « Roligentem oportet esse ; religiosum nefas ». Cela signifie, explique-t-il, qu'on doit être religieux, non pas superstitieux. À ce propos il cite Nigidius : Hoc, inquit, inclinamentum semper huiuscemodi verborum ; ut : vinosus, mulierosus, religiosus, nummosus, significat copiam quamdam immodicam rei, super qua dicitur. Quocirea religiosus is appellabatur, qui nimia et superstitiosa religione sese alligaverat, eaque res vitio assignabatur. Sed praeter ista, quae Nigidius dicit, alio quodam diverticulo significationis religiosus pro casto atque observanti cohibentique sese certis legibus finibusque dici captas.
[FN: § 237-1]
LIV. ; II, 82 : Et primo agitatum dicitur de consulum caede, ut solverentur sacramento ; doctos deinde, nullam scelere religionem exsolvi, Sicinio quodam auctore, iniussu consulum in Sacrum montem secessisse...
[FN: § 238-1]
CIC.; Verr., I, 23, 60, explique « qu'on a entendu dire qu'un homme n'a pas tenu de registres. On l’a dit faussement d'Antoine, car il les a tenus très exactement. Il y a pourtant quelque exemple de cette conduite blâmable. Nous avons entendu dire que d'autres ne les ont tenus qu'à partir d’une certaine époque. Il y a des motifs qui justifient cette conduite. Mais ce qui est nouveau et ridicule, c'est ce qu'il [Verrès] nous a répondu, quand nous lui avons demandé ses registres : qu'il les avait tenus jusqu'au consulat de M. Terentius et de C. Cassius, puis avait cessé de les tenir ». À propos de ce passage, Asconius observe « Moris autem fuit, unumquenque domesticam rationem sibi totius vitae suae per dies singulos scribere, ex quo appareret, quid quisque de redditibus sais, quid de arte, foenore, lucrove seposuisset quoque die, et quid item sumptus damnive fecisset... ». – On avait demandé à M. Celius, ses registres. Cicéron répond, pro Al. Coelio, 7, 17 : Tabulus, qui in patris potestate est, nullas conficit.
[FN: § 239-1]
DION HAL. ; II, 19, dit que « chez les Romains, on n'entend pas parler d'Uranus émasculé par ses propres fils, de Saturne qui dévore ses enfants, de Jupiter qui chasse Saturne et le fait prisonnier, ni de guerre ni de blessures ni de chaînes mises aux dieux, ni de leur esclavage chez les hommes... » ![]()
![]() D'après notre auteur, le culte aussi était plus moral à Rome qu'en Grèce.
D'après notre auteur, le culte aussi était plus moral à Rome qu'en Grèce.
[FN: § 239-2]
ESCH. ; Choeph. 71-74 :
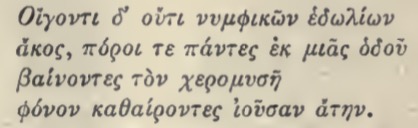
Bota traduit, suivant le scoliaste : « Ner vero expugnatori virginalium thalamorum remedium est, et si omnes ex uno loco fontes confluerent ad abluendum, qui manus occisoris polluit, sanguinem, frustra lavaret ». – Le scoliaste note : (71) ![]()
![]()
![]()
![]() . « De même que celui qui entre dans le lit d'une vierge n'a aucun moyen de rendre à la jeune fille sa virginité, ainsi le meurtrier n'a aucun moyen d'effacer l'homicide ». (72)
. « De même que celui qui entre dans le lit d'une vierge n'a aucun moyen de rendre à la jeune fille sa virginité, ainsi le meurtrier n'a aucun moyen d'effacer l'homicide ». (72) ![]() SOPH. ; Oed. rex, 1227-1228 : « Je ne crois pas que les eaux de l'Ister et du Phase pourraient laver les délits commis dans ce palais. Une épigramme de l'Ant. Palat., XIV, 71, nous donne un oracle de la Pythie : « Étranger, entre avec une âme pure dans un temple pur, après avoir touché l'eau des Nymphes ; car une gouttelette suffit aux hommes vertueux ; mais l'homme pervers ne pourrait se laver avec tout l'Océan ».
SOPH. ; Oed. rex, 1227-1228 : « Je ne crois pas que les eaux de l'Ister et du Phase pourraient laver les délits commis dans ce palais. Une épigramme de l'Ant. Palat., XIV, 71, nous donne un oracle de la Pythie : « Étranger, entre avec une âme pure dans un temple pur, après avoir touché l'eau des Nymphes ; car une gouttelette suffit aux hommes vertueux ; mais l'homme pervers ne pourrait se laver avec tout l'Océan ».
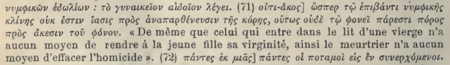
[FN: § 239-3]
POLYBE ; VI, 56, 13.
[FN: § 239-4]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. On peut faire la même observation, au sujet de la colonisation espagnole en Amérique. D'un côté, une Population sauvage et incapable de saisir les finesses de la morale chrétienne, mais brave et d'une loyauté que ses ennemis ont toujours vantée ; de l'autre, des hommes civilisés, très catholiques, ennemis mais d'une brutalité au moins égale à celle des sauvages, et d'une mauvaise foi consommée. L'histoire des colonisations est riche de faits semblables.
[FN: § 240-1]
Il convient de noter que, selon Plutarque (Nicias, 23, 3), Anaxagore ne faisait connaître ses théories sur les éclipses qu'à un petit nombre de personnes. Mais alors, de telles investigations n'étaient pas tolérées à Athènes. « Protagoras fut exilé, Anaxagore mis en prison et relâché avec peine par Périclès, et Socrate, bien qu'il ne s'occupât pas de physique, fut mis à mort à cause de sa philosophie ». PLUT. ; Périclès, 32, 2 : ![]()
![]()
![]() « Une loi proposée par Diopétès met au nombre des délits tombant sous le coup d'une action publique,
« Une loi proposée par Diopétès met au nombre des délits tombant sous le coup d'une action publique, ![]() le fait de nier l'existence des dieux et de discuter sur les choses célestes ; ce qui jetait le soupçon sur Périclès, à cause d'Anaxagore ». DIOG. LAERCE (II, 12, Anax.) dit qu'Anaxagore fut accusé d'impiété par Cléon, pour avoir dit que le soleil était une masse incandescente. PLAT. (Apol., p. 26) suppose que Mélitos accuse Socrate d'avoir dit que le soleil est une pierre et la lune une terre. À quoi Socrate répond :
le fait de nier l'existence des dieux et de discuter sur les choses célestes ; ce qui jetait le soupçon sur Périclès, à cause d'Anaxagore ». DIOG. LAERCE (II, 12, Anax.) dit qu'Anaxagore fut accusé d'impiété par Cléon, pour avoir dit que le soleil était une masse incandescente. PLAT. (Apol., p. 26) suppose que Mélitos accuse Socrate d'avoir dit que le soleil est une pierre et la lune une terre. À quoi Socrate répond : ![]() « Tu crois accuser Anaxagore, ami Mélitos ».
« Tu crois accuser Anaxagore, ami Mélitos ».
[FN: § 240-2]
PLUT. ; Cat. mai., 22, 6 :
![]()
[FN: § 240-3]
C'est l'hérésie des Ariens.
[FN: § 241-1]
Sir HENRY SUMNER MAINE ; Ancient Law.
[FN: § 241-2]
IHERING, ; L'espr. du dr. rom., t. I.
[FN: § 243-1]
THUCID.; II, 35 et sv.
[FN: § 243-2]
CIC.; De harusp. resp., IX, 19: Quam volumus licet, patres conscripti, ipsi nos amemus : tamen nec numero Hispanos, nec robore Gallos, nec calliditate Poenos, nec artibus Graecos, nec denique hoc ipso huius gentis ac terrae domestico, nativoque sensu, Italos ipsos ac Latinos, sed pietate ac religione, atque hac una sapientia, quod deorum immortalium numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnes gentes nationesque superavimus. Dans le De nat. deor., II, 3, 8, Cicéron fait dire à Balbus : Et, si conferre volumus nostra cum externis, ceteris rebus aut pares, aut etiam inferiores reperiemur : religione, id est cultu Deorum, multo superiores. – Notez qu'il explique que la religion est le culte des dieux.
[FN: § 243-3]
CIC.; De harusp. resp., IX, 18 : ...qui statas solemnesque caerimonias, pontificatu ; rerum bene gerendarum auctoritates, augurio ; fatorum veteres praedictiones Apollinis, vatum, libris ; portentorum explanationes, Etruscorum disciplina contineri putarunt...
[FN: § 244-1]
Cette restriction est nécessaire ; car après la première décade du XXe siècle, le gouvernement de l'Angleterre a été confié à des Gallois et à des Irlandais fanatiques. Si cela indique un changement dans la nature du pays entier, si ce n'est pas un phénomène temporaire, l'Angleterre de l'avenir ne ressemblera pas à l'Angleterre du passé. C'est de cette dernière, qui, seule, nous est encore bien connue aujourd'hui, que nous voulons parler, quand nous nommons l’Angleterre.
[FN: § 246-1]
Il ne faut pas chercher à déduire le sens de ce terme, de son étymologie. Il sera défini au chapitre XII.
[FN: § 247-1]
VELL. PATERC., II, 4 : ... et cum omnis concio adclamasset, « Hostium – – inquit – armatorum totiens clamore non territus, qui possum vestro moveri, quorum noverca est Italia ? »
Notes du Chapitre III. Les actions non-logiques dans l’histoire des doctrines (§249 à §367), vol. 1, pp. 150-204↩
[FN: § 256-1]
Les recherches sur les origines sont en grande partie hypothétiques. Nous acceptons les données de Sumner Maine à titre d'hypothèses, sans vouloir les examiner ici.
[FN: § 256-2]
Sir HENRY SUMNER MAINE; Ancient Law, c. V : (p. 126) It is so framed as to be adjusted to a system, of small independent corporations. Courcelle Seneuil traduit adjusted par conçu, ce qui implique l'idée des actions logiques. COURCELLE, SENEUIL ; L'ancien Droit : « (p. 119) Ce droit est conçu pour un système de petites corporations indépendantes ».
[FN: § 256-3]
Loc. cit. §256-1, c. VI : (p. 183) Men are regarded and treated, not as individuals, but always as members of a particular group.
[FN: § 256-4]
Loc. cit. §256-2, c. V.
[FN: § 256-5]
Sur les rives du Léman, on peut voir des groupes de cygnes, qui occupent chacun un espace différent de la surface du lac. Si un cygne de l'un des groupes tente d'envahir l'endroit occupé par un autre groupe, il est assailli, frappé, repoussé. Les vieux cygnes meurent, les jeunes naissent et grandissent, et le groupe demeure comme unité.
[FN: § 257-1]
DURUV ; Hist. des Rom., t. III.
[FN: § 263-1]
Manuel, III, 1.
[FN: § 270-1]
ARIST.; Polit ., I, 1, 1.
[FN: § 271-1]
ARIST.; Polit ., I, 1, 4 :
![]()
[FN: § 271-2]
ARIST.; Polit ., I, 1, 8 :
![]()
[FN: § 273-1]
ARIST.; Polit., I, 1, 10 :
![]()
[FN: § 274-1]
CIC.; De lege agraria, II, 35, 95. Pour combattre la loi agraire, Cicéron voulait persuader à ses concitoyens qu'une colonie fondée à Capoue aurait pu devenir dangereuse pour Rome ; donc il se peut qu'il ne crût pas plus que cela à l'argument dont il usait. Mais nous n'avons pas à nous en préoccuper, puisque nous recherchons, non pas la pensée de Cicéron, mais bien les opinions qui avaient cours en son temps ; et s'il employait cet argument, cela veut dire qu'il correspondait, d'après lui, à l'opinion d'une partie – importante ou non, – de ses concitoyens.
[FN: § 275-1]
ARIST.; Rhetor., II, 12 et sv. On peut aussi trouver une certaine idée des actions non-logiques, dans le fait qu'Aristote attribue à la partie non raisonnable de l'homme, les vertus ; c'est-à-dire la tempérance, la justice, le courage, etc. ARIST. ; Magn. moral., I, 5, 1 : « Dans la partie [de l'âme] qui est raisonnable, naissent la prudence, l'intelligence, la sagesse, la facilité d'apprendre, la mémoire et autres choses semblables. Dans la partie non raisonnable se trouve ce qu'on appelle les vertus : la tempérance, la justice, l'énergie et toutes les autres vertus morales qui paraissent dignes de louange.
[FN: § 275-2]
La doctrine d'Aristote sur la nature logique ou non-logique des actions en général n'était peut-être pas très précise ; d'ailleurs les doctrines semblables ne le sont généralement pas. Toutefois il semble que l'auteur reconnaissait des éléments non-logiques, auxquels il ajoutait des éléments logiques, en subordonnant les premiers aux seconds. Dans la Politique, VII, 12, 6, il dit que trois choses rendent l'homme bon et vertueux ![]() : « la nature, l'habitude, la raison ». Quant à la partie non-logique, Aristote admet que les hommes agissent, au moins en partie, sous l'influence de circonstances extérieures, telles que le climat, le sol, etc. Dans la Politique, VII, 6, il met clairement en rapport les actions des hommes avec ces circonstances; et dans le livre De part. an., II, 4, il dit estimer que ce rapport existe en général pour les êtres vivants. L'auteur (Aristote ?) des Problèmes, XIV, ajoute de nouvelles considérations au sujet du dit rapport.
: « la nature, l'habitude, la raison ». Quant à la partie non-logique, Aristote admet que les hommes agissent, au moins en partie, sous l'influence de circonstances extérieures, telles que le climat, le sol, etc. Dans la Politique, VII, 6, il met clairement en rapport les actions des hommes avec ces circonstances; et dans le livre De part. an., II, 4, il dit estimer que ce rapport existe en général pour les êtres vivants. L'auteur (Aristote ?) des Problèmes, XIV, ajoute de nouvelles considérations au sujet du dit rapport.
Jusqu'ici, nous sommes donc dans le domaine des actions non-logiques. Mais l'auteur les élimine bientôt par un procédé qui est général, et qui consiste à les subordonner aux actions logiques : elles deviennent les matériaux que la raison met en œuvre. Magn. moral., I, 11, 3 :
« Le jugement, la volonté et tout ce qui est selon la raison constituent le principe de l'action, soit bonne soit mauvaise ». Il ne s'aperçoit pas qu'il contredit ainsi ce qu'il avait affirmé, en disant, par exemple dans le passage cité tout à l'heure, de la Politique, que les hommes qui habitent un pays froid sont courageux. Dans ce cas, le «principe » de l'action courageuse, c'est-à-dire la « délibération et la volonté » de s'exposer au péril, est déterminé – selon Aristote – par le climat et non par la « raison ». Il croit se tirer d'embarras, en disant, Magn. moral, I, 11, 5, qu'il faut tout d'abord le secours de la nature, puis la volonté. Mais en laissant de côté la question métaphysique du libre arbitre, dont nous n'avons pas l'intention de nous occuper, le problème primitif de savoir si ces deux choses qu'il suppose indépendantes le sont effectivement, puis en quelle proportion elles se trouvent dans une action concrète, ce problème n'en subsiste pas moins. Et justement, en l'étudiant, on voit qu'il y a des actions où le premier élément (actions non-logiques) prévaut, et d'autres où c'est le second (actions logiques).
Aristote fut détourné de la voie scientifique, non seulement par des considérations métaphysiques, mais encore par le grand ennemi de toute science sociale : la manie de faire œuvre pratique. Dans la Morale à Nicomaque, II, 2, 1, il dit qu'il ne veut pas seulement s'occuper de théorie :
« Car ce n'est pas pour savoir ce qu'est la vertu, que nous étudions, mais afin de devenir bons, puisque autrement cette étude ne serait utile en rien ». Aristote n'avait à sa disposition aucun autre moyen d'agir sur autrui, que le raisonnement ; par conséquent il était et devait être poussé à le faire prévaloir dans les actions humaines.
[FN: § 278-1]
PLAT.; De leg.. IV, p. 705. De même ARIST., Polit., VII, 5, traite des avantages et des inconvénients du voisinage de la mer.
[FN: § 278-2]
PLAT., De Rep., III, p. 415. Systèmes, t. I, p. 276.
[FN: § 280-1]
RITTER ; Hist. de la phil. anc. trad. fr., tome III: « (p. 248) Socrate plus porté à la dialectique qu'à la physique, avait en conséquence cherché le principe de toute moralité dans la dialectique seulement ; ainsi la vertu n'était fondée à ses yeux que sur la raison et la science. Mais déjà Platon avait trouvé que le courage et la modération, comme deux côtés nécessaires de la vertu, doivent préexister dans la nature de l'homme, dont l'appétit est dans le cœur, mais pas dans la raison. Aristote (p. 249) alla plus loin dans la même direction, et s'attacha plus étroitement encore à la physique, porté qu'il y était naturellement. Il ne considère pas la raison comme le premier principe de la vertu, mais bien l'impulsion naturelle et les états passionnés de l'âme ![]() ».
».
ZELLER ; La phil. chez les Grecs, tr. fr., tome III « (p. 130) la science à ses yeux [de Socrate] n'est pas seulement une condition indispensable et un auxiliaire de la vraie moralité, mais (p. 131) elle est immédiatement la moralité tout entière, et là où la science fait défaut, il ne se contente pas de reconnaître simplement une vertu imparfaite, il ne voit plus du tout de vertu. Nous ne trouverons que plus tard, chez Platon et plus complètement chez Aristote, des corrections apportées à cette forme étroite de la doctrine socratique de la vertu » (p. 118, éd. allem.).
[FN: § 282-1]
Summa theol., Ia, IIae, q. 55, a. IV : Virtus est bona qualitas, seu habitus mentis, qua recte vivitur, et qua nullus male utitur ; et quam Deus in nobis sine nobis operatur. On découvre encore mieux la nature des actions non-logiques dans l'observation suivante, faite au même endroit, par le saint docteur : Sed notandum quod habituum operativorum aliqui sunt semper ad malum, sicut habitus vitiosi ; aliqui vero quandoque ad bonum, et quandoque ad malum, sicut opinio se habet ad verum et falsum.
[FN: § 284-1]
Auguste COMTE ; Cours de phil. pos., t. I.
[FN: § 285-1]
H. SPENCER ; Class. des scienc.
[FN: § 286-1]
A. COMTE; Syst. de polit. pos., t. IV.
[FN: § 286-2]
Lui-même aperçoit, jusqu'à un certain point, une évolution semblable. Syst. de pol .poss, t. III : « (p. VII) En comparant ce volume avec la partie historique de mon traité fondamental, on trouvera que la coordination générale y devient plus profonde et plus complète, tandis que les explications spéciales y sont moins développées. Sous ce dernier aspect, cette cons- truction définitive de ma philosophie de l'histoire contredit mes anciennes annonces, qui promettaient ici plus de détails et de preuves que dans la première ébauche, à laquelle je dois, au contraire, renvoyer maintenant pour cela. Appréciant mieux les vraies conditions du régime philosophique, j'ai senti que les assertions coordonnées, où je voyais d'abord un mode purement provisoire, devaient constituer l'état normal de toute exposition vraiment systé- matique. Mes progrès accomplis et l'autorité qu'ils m'ont procurée permettent à ma maturité de suivre la marche libre et rapide de mes principaux ancêtres, Aristote, Descartes et Leibnitz, qui se bornaient à formuler leurs pensées, en laissant au public la vérification et (p. VIII) le développement. Cette répartition du commerce mental est à la fois la plus honorable pour les initiés et la plus profitable aux initiateurs ». Dans cette dernière observation, il a vraiment raison. il est très avantageux de pouvoir obtenir créance, sans avoir l'ennui de donner aucune preuve.
[FN: § 287-1]
A. COMTE; Syst. de polit. posit., t. IV : « (p. 377) Pour modifier la vie publique, il lui suffit [au Sacerdoce de l'humanité] que la situation ait fait surgir une volonté prépondérante et responsable. Cette condition se trouve assez remplie, en France, depuis l'avènement de la dictature, qui dispense la doctrine organique de se soumettre à des assemblées toujours disposées à perpétuer l'état révolutionnaire, même quand elles sont rétrogrades ». Ibidem :
« (p. 878), Sans convertir ni le public ni ses chefs, le positivisme peut donc, en vertu de sa réalité fondamentale et de sa pleine opportunité, conquérir assez d'ascendant partiel pour instituer la transition finale, à l'insu même des principaux coopérateurs d’un tel mouve- ment ». Une action qui a lieu à l'insu de celui qui l'accomplit appartient évidemment au genre des actions non-logiques.
[FN: § 289-1]
Herbert SPENCER ; Sociologie, t. I, p. 145.
[FN: §289- 2]
Cf. § 701, 711.
[FN: § 295-1]
J. S. MILL : Aug. Comte et le posit.
[FN: § 296-1]
STAT.; Theb., III, 661, ou Pétrone. Le scoliaste Lactance note, à propos de ce vers de Stace : Primus in orbe deos fecit timor negat deos ulla re alia celebrari nisi timore mortalium. Ut Lucanus (1, 486) : « quae finxere timent » et Petronius Arbiter istum secutus (fragm. XXVII, 1 B) : « primus in orbe deos fecit timor ». (Sic et Mintanor musicus : «deum, doloris quem prima compunctio humani finxit generis ».)
[FN: § 296-2]
D’HOLBACH ; Syst. de la nat., t. I, ch. XVIII «... (p. 448) C'est dans le sein de l'ignorance, des alarmes et des calamités que les hommes ont toujours puisé leurs premières notions sur la divinité... (p. 456) La première théologie de l'homme lui fit d'abord craindre et adorer les éléments mêmes, des objets matériels et grossiers... ».
[FN: § 296-3]
Cicéron exprimait déjà l'opinion que les pratiques de la divination avaient été acceptées par les anciens, comme faits plutôt que comme conséquences de raisonnements. De div., I, 3, 4 : Atque haec, ut ego arbitror, veteres, rerum magis eventis moniti, quam ratione docti probaverunt. Cela arrive très souvent ; le fait, l'action non-logique précède ; puis vient l’explication du fait, le vernis logique.
[FN: § 298-1]
J. S. MILL; La Liberté. Les restrictions dont parle le texte se rapportent à l'usage de termes peu précis, comme : intérêts légitimes ou illégitimes. Mais on ne saurait en rejeter la faute spécialement sur Mill, car c'est celle de presque tous les auteurs qui traitent de cette matière.
[FN: § 299-1]
Cette bonne âme de Mill ajoute : « Pour justifier cela, il faudrait que la conduite qu'on veut détourner cet homme de tenir, eût pour effet de nuire à quelque autre ». Il ne savait pas que les sophismes ne manquent jamais, pour démontrer qu'autrui est lésé. Voyez, par exemple, ce qui arrive dans les pays où l'on veut imposer la tempérance et la vertu, au nom du très saint « Progrès ». Giornale d'Italia, 19 mars 1912 : Atlanta (Géorgie), 2 mars. – Hier soir, le comm. Alexandre Bonci, de passage ici pour ses occupations artistiques, sa femme, son secrétaire et son pianiste, furent arrêtés au Georgian Terrace Hotel de cette ville, pour contravention à la loi de tempérance. Il paraît que M. Bonci et ses amis, en bons Italiens qui boivent du vin au moins à déjeuner et à dîner, adoptèrent un ingénieux moyen pour échapper à la loi qui défend l'usage du vin et des liqueurs, dans l'État de Géorgie. Depuis quelques jours, la direction de l’hôtel avait remarqué que les époux Bonci et leurs amis avaient l'habitude vers le milieu du repas, de mettre sur la table quatre de ces petits flacons dont se servent les pharmaciens, munis d'étiquettes, où étaient écrites les instructions sur l'usage des prétendues médecines. La régularité avec laquelle les Bonci et leurs amis avalaient le contenu des petites bouteilles, deux fois par jour, comme si chaque membre de la société était affecté de la même maladie et avait besoin de la même cure, finit par éveiller les soupçons de l'house detective (policier spécial) de l'hôtel. Il en parla à un zélé policeman, qui, hier soir, juste au moment de la... cure, séquestra les petites bouteilles. Elles se trouvèrent être chacune de la capacité d'un verre, et ne contenir rien d'autre que d'excellent Chianti, dont le commandeur est, paraît-il, bien fourni dans ses voyages, afin de faire face aux... surprises de la loi américaine. Malgré les vives protestations de M. Bonci, les quatre contrevenants furent mis dans une automobile et conduits à la Court House, où le magistrat Ralendorf, après un interrogatoire sommaire, renvoya la cause à ce matin, en ordonnant de ne laisser les inculpés en liberté que sous caution de 2000 dollars. Et alors arriva le plus beau ou plutôt le pire ; car la perspective de passer la nuit en prison commençait à ennuyer le célèbre ténor, qui, en ce moment-là, n'avait pas plus de 150 dollars en poche… » Il est probable que si M. Bonci s'était souvenu des merveilleux effets que l'on obtient en graissant la patte aux vertuistes américains, comme il convenait de la graisser aux vertueux inquisiteurs, il aurait évité les ennuis qu'il éprouva.
D'une façon générale : vous passez, dans un vagon qui sert de restaurant, sur le territoire de l'un des états abstinents des États-Unis d'Amérique, et l'on enlève de votre table le verre de vin que vous alliez boire. « Quel tort fais-je à autrui – dites-vous – en buvant ce verre de vin ? » La réponse ne se fait pas attendre : « Vous donnez le mauvais exemple». Et les bon- nes gens qui imposent ainsi leur volonté parlent avec indignation des catholiques espagnols, qui, justement afin qu'on ne donne pas le mauvais exemple, ne veulent tolérer aucun culte public non catholique.
[FN: § 301-1]
CONDORCET; Esq. d'un tab. hist. des pr. de l'esp. hum. – 9e époque.
[FN: § 302-1]
CONDORCET ; loc. cit. – 9e époque.
[FN: § 301-2]
CONDORCET; loc. cit. – 10e époque.
[FN: § 303-1]
D'HOLBACH ; Syst. de la Nat., t. I, c. XVI : « (p. 398) [titre du chapitre] Les erreurs des hommes sur ce qui constitue le bonheur sont la vraie source de leurs maux. Des vains remèdes qu'on leur a voulu appliquer ». « ... (p. 406) Si nous consultons l'expérience, nous verrons que c'est dans les illusions et les opinions sacrées que nous devons chercher la source véritable de cette foule de maux, dont nous voyons partout le genre humain accablé. L'ignorance des causes naturelles lui créa des dieux ; l'imposture les rendit terribles ; leur idée funeste poursuivit l'homme sans le rendre meilleur, le fit trembler sans fruit, remplit son esprit de chimères, s'opposa au progrès de sa raison, l’empêcha de chercher son bonheur. Ses craintes le rendirent esclave de ceux qui le trompèrent sous prétexte de son bien... Des préjugés non moins dangereux ont aveuglé les hommes sur leurs gouvernements... (p. 407) Nous trouvons le même aveuglement dans la science des mœurs... (p. 409) C'est ainsi que la somme des malheurs du genre humain ne fut point diminuée, mais s'accrut au contraire par ses religions, par ses gouvernements, par son éducation, par ses opinions, en un mot par toutes les institutions qu'on [qui est ce on qu'on oppose, et qui est par conséquent distinct du genre humain?] lui fit adopter, sous prétexte de rendre son sort plus doux. L'on ne peut trop le répéter ; c'est dans l'erreur que nous trouverons la vraie source des maux dont la race humaine est affligée : ce n'est point la nature (p. 410) qui la rendit malheureuse, ce n'est point un dieu irrité qui voulut qu'elle vécut dans les larmes ; ce n'est point une dépravation héréditaire qui a rendu les mortels méchants et malheureux, c'est uniquement à l'erreur que sont dus ces effets déplorables ».
[FN: § 303-2]
ELIE RECLUS ; Les prim. « (p. 161) Puisque la moralité, au moins dans ses lignes générales, se mesure au développement de l'intelligence, on ne s'étonnera pas de la trouver ici [chez les Peaux-Rouges] à ses rudiments ».
[FN: § 306-1]
On indique ici par principe la cause attribuée aux actions.
[FN: § 307-1]
Phaedr., p. 229.
[FN: § 307-2]
Cela est aussi rappelé par le Socrate de Xénophon. XÉNOPH. ; Memorab., IV, 3, 16 :
« Puisque tu vois que le dieu de Delphes, lorsqu'on lui demande comment être agréable aux dieux, répond : En suivant l'usage de sa cité ».
CIC. ; De leg., II, 16, 40: Deinceps in lege est, de ritibus patriis colantur optimi : de quo cum consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraculum editurn est, eas, quae essent in more maiorum. Quo cum iterum venissent, maiorumque morem dixissent saepe esse mutatum, quaesivissentque, quem morem potissimum sequerentur e variis ; respondit, optimum. Cicéron ajoute ici un motif logique qui n'a pas la moindre valeur : Et profecto ita est, ut id habendum sit antiquissimum et Deo proximum, quod sit optimum.
[FN: § 308-1]
CIC. ; De nat. deor., III, 2, 6. CIC. ; De div., II, 12, 28 : Ut ordiar ab aruspicina, quam ego reipublicae causa, communisque religionis, colendam censeo ; (sed soli sumus ; licet verum exquirere sine invidia, mihi praesertim de plerisque dubitanti).
[FN: § 308-2]
Principe signifie ici : cause attribuée aux actions.
[FN: § 310-1]
VOLTAIRE; t. V: Remarques pour servir de supplément à l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. – IV. Des usages méprisables ne supposent pas toujours une nation méprisable. Parmi tant d'erreurs, notons les suivantes :
1° Lé traité De divinatione fut écrit après la mort de César. Mais cela importe peu ; car si l'on peut supposer que César envoya des ambassadeurs en Chine, on peut supposer aussi qu'il vivait quand Cicéron écrivit De divinatione. 2° Le Panthéon chinois est beaucoup plus riche que celui de Rome ; mais Voltaire est excusable de cette erreur, que partageaient tous les philosophes, ses contemporains. Il pouvait, au contraire, éviter sans grand’peine les erreurs suivantes : 3° Volontairement ou non, Voltaire confond la divination romaine avec celle des Étrusques. Tagès n'appartient qu'à cette dernière. 4° Iupiter optimus maximus n'est pas du tout un dieu unique, dans le culte officiel. 5° Les Pénates ne sont pas le moins du monde les dieux des « bonnes femmes » : Pénates sunt omnes dii, qui domi coluntur (SERV. ; Ad Aen., II 514). Rome, elle-même, avait ses Pénates. Cicéron, que Voltaire voudrait opposer aux bonnes femmes, les invoque : Quamobrem vos, du patrii ac PENATES, qui huic urbi atque huic imperio praesidetis, qui hoc imperium, qui hanc libertatem, populumque romanum, qui haec tecta atque templa, me consule, vestro numine auxilioque servastis, testor, integro me animo ac libero, P. Sullae causam defendere (Pro P. Sulla, XXXI, 86). Voir aussi In. L. Catil., IV, 9, 18. 6° Que César y crût on non, il consultait les devins. On y fait allusion même dans De div. (I, 52, 119 ; II, 16, 36), que cite Voltaire. De plus : DIO CASS. ; XLIV, 17-18 ; PLUTARCH. ; Caes., 63-64; SUET.; Caes., 81. PLINE ; Nat. hist., XXVIII, 4, nous rapporte une superstition de César, qui, lorsqu'il allait en voiture, récitait une certaine formule, pour être en sécurité pendant le trajet. 7° Cicéron ne songe pas à tourner tous les auspices en ridicule. Lui-même était augure, et parle des auspices avec le plus grand respect : Maximum autem et praestantissimum in republica ius est augurum, et cum auctoritate coniunctum. Neque vero hoc, quia sum ipse augur, ita sentio, sed quia sic existimare nos est necesse (De 1eg. ; II, 12, 31). Il ne croyait que peu ou pas du tout à leur vertu intrinsèque ; mais il les estimait utiles à la république, et par conséquent ne les tournait pas en ridicule. (Cf. les citations § 313 1). 8° Caton ne traite pas des augures, mais des aruspices : Vetus autem illud Catonis admodum scitum est, qui mirari se aiebat, quod non rideret aruspex, aruspicem cum vidisset (CIC ; De div., II 24, 51). D'ailleurs beaucoup commettent l'erreur de confondre la divination romaine des augures avec la divination étrusque des aruspices. Ce n'est que quand ils ne pouvaient s'en passer que les Romains recouraient à la divination des Étrusques. Le père des Gracques leur adressait ces paroles : Ego non iustus, qui et consul rogavi, et augur, et auspicato ? An vos Tusci, ac barbari, auspiciorum populi Romani ius tenetis, et interpretes esse comitiorum potestis ? Itaque tum illos exire iussit (De nat. deor., II. 4, 11).
[FN: § 311-1]
Cette observation et la suivante sont à la vérité étrangères au présent chapitre, et n'ont d'autre fin que de combattre l'habitude de supposer ce que l'auteur ne dit pas (§ 41, 74 et sv.).
[FN: § 312-1]
Les termes utile, utilité sont pris, ici et dans la suite, au sens qu'ils ont ordinairement. Une chose utile à une société sera celle qui est apte à accroître la prospérité économique et politique, de cette société. Plus loin, au chapitre XII, nous reviendrons sur ce sujet.
[FN: § 313-1]
POLYB.: VI, 56. Après avoir remarqué que la religion est toute puissante à Rome, il ajoute : «Cela paraîtra étrange à beaucoup de personnes. Quant à moi, j'estime que ce fut établi en vue de la foule. En effet, si la cité pouvait ne renfermer que des hommes sages, cette institution pourrait n'avoir pas été nécessaire. Mais toute foule étant légère et pleine de passions déréglées, de colères déraisonnables, de désirs violents, il ne reste qu'à la contenir par des terreurs mystérieuses et de semblables craintes tragiques. C'est pourquoi il me semble que les anciens n'ont pas introduit ces croyances aux dieux et aux enfers, sans de puissants motifs ni par hasard ». – STRABO ; I, 2, 8 :
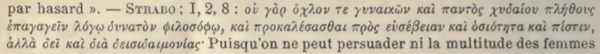
Puisqu'on ne peut persuader ni la multitude des femmes ni toute la foule du vulgaire, par des discours philosophiques, ni l'exhorter à la piété, à la religion et à la foi, mais qu'on doit employer la superstition »...
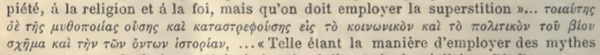
... « Telle étant la manière d'employer des mythes tournant au profit de la société, de la vie civile et de la réalité,... Cf. PLUTARCH. : Ad Colot., 31. LIV. ; I, 19. Parlant de Numa Pompilius : ...omnium primum, rem ad multitudinem imperitam, et illis seculis rudem, efficacissimam, deorum metum iniiciendum ratus est... Ici, nous sommes entièrement dans le domaine des actions logiques, auquel on est conduit par artifice. CIC. ; De leg., II, 13, 32. Atticus dit des deux augures Marcellus et Appius : nam eorum ego in libros incidi : cum alteri placeat, auspicia ista ad utilitatem esse reipublicae composita ; alteri disciplina vestra quasi divinare videatur prorsus posse. CIC. ; De div., II, 18, 43. Itaque in nostris commentariis scriptum habemus : « Jove tonante, fulgurante, comitia populi habere nefas ». Hoc fortasse reipublicae causa constitutum est. Comitiorum enim non habendorum causas esse voluerunt. CIC. ; De div. ; II, 33, 70 : Et tarMen credo, Romulum, qui urbem auspicato condidit, habuisse opinionem, esse in providendis rebus augurandi scientiam. Errabat enim multis in rebus antiquitas ; quam vel usu iam, vel doctrina, vel vetustate immutatam videmus. Retinetur autem, et ad opinionem vulgi, et ad magnas utilitates reipublicae, mos, religio, disciplina, ius augurum, collegii auctoritas. Peu après, II, 35, 75, il ajoute « qu'il estime que le droit augural fut constitué d'abord sous l'influence de la croyance à la divination, ensuite conservé et maintenu par raison d'État ».
Cela paraît être exactement le fond de l'opinion de Cicéron ; elle s'approche d'ailleurs de la vérité. Les actions non-logiques, nées spontanément, peuvent être ensuite conservées soit par tradition, soit pour l'utilité qu'elles apportent. On comprend que l'origine logique, œuvre de Romulus, est une simple fable. ARIST. ; Métaph. (XI, 8, 13, p. 1074, numérot. Didot). Après avoir traité de la divinité des astres, il ajoute :
« Le reste a été ajouté fabuleusement, pour persuader le grand nombre, et pour les lois et l'utilité commune ». Voir aussi : PLUTARCH. ; De plac. philosoph., I, 7, 2. SEXT. EMP. ; I. IX, Adversus physicos ; de diis, 14 à 16, p. 551.
[FN: § 313-2]
POLYB.; VI, 11. Il compare la république de Lycurgue à celle des Romains. Il croit que Lycurgue est un personnage réel, et qu'il a institué sa république avec un but prédéterminé. Puis il ajoute : « Les Romains ont atteint le même but en constituant leur république. Ce ne fut pas par des raisonnements ![]() mais instruits par de nombreuses luttes et les événements, qu'ils atteignirent le même but que Lycurgue, en choisissant toujours le mieux, et qu'ils constituèrent la meilleure de nos républiques ».
mais instruits par de nombreuses luttes et les événements, qu'ils atteignirent le même but que Lycurgue, en choisissant toujours le mieux, et qu'ils constituèrent la meilleure de nos républiques ».
[FN: § 314-1]
MONTESQ. ; Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, lue à l'académie de Bordeaux le 18 juin 1716 ; dans Grand. et déc. des Rom., Lettres pers. et œuvres choisies. Firmin Didot, Paris, 1866.
[FN: § 316-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Telle est l'idée fondamentale des théories anarchistes. PIERRE KROPOTKINE ; L'Anarchie, p. 16 : « En effet, il est certain qu'à mesure que le cerveau humain s'affranchit des idées qui lui furent inculquées par les minorités de prêtres, de chefs militaires, de (p. 17) juges tenant à asseoir leur domination et de savants payés pour la perpétuer, – une conception de la société surgit, dans laquelle il ne reste plus de place pour ces minorités dominatrices ». De même ELISÉE RECLUS ; L'Évolution, la Révolution et l'Idéal anarchique, ne voit guère dans les phénomènes religieux, du moins dans les phéno- mènes religieux contemporains, que les actions logiques de gens intéressés, dupant les ignorants et les simples d'esprit. Il dit : « (p. 212) Mais si l'Église catholique a pu faire des progrès apparents, si la France des encyclopédistes et des révolutionnaires (p. 213) s'est laissé « vouer au Sacré Cœur » par une assemblée d'affolés, si les pontifes du culte ont très habilement profité, de l'apeurement général des conservateurs politiques, pour leur vanter la panacée de la foi corn me le grand remède social ; si la bourgeoisie européenne, naguère
composée de sceptiques frondeurs, de voltairiens n'ayant d'autre religion qu'un vague déisme, a cru prudent d'aller régulièrement à la messe et de pousser même jusqu'au confessionnal ; si le Quirinal et le Vatican, l'État et l'Église mettent tant de bonne grâce à régler les anciennes disputes, ce n'est pas que la croyance au miracle ait pris un plus grand empire sur les âmes dans la partie active et vivante de la société. Elle n'a gagné que des peureux, des fatigués de la vie, et l'hypocrite adhésion de complices intéressés. En effet, ceux qui veulent à tout prix maintenir la société privilégiée doivent se rattacher au dogme qui en est la clef de voûte... ».
[FN: § 322-1]
S. REINACH; Cultes, mythes et relig., t. I.
[FN: § 323-1]
W. MARSDEN ; Hist. de Sumat., t. II
[FN: § 325-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. C'est l'argument le plus commun et le plus persuasif en matière de mode. C'est celui que les hommes donneraient à un grand nombre de leurs actions, si on leur en demandait les motifs.
[FN: § 327-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Les préceptes hygiéniques, par exemple, sont souvent exprimés sous cette forme. Parfois ils appartiennent au premier cas (propositions scientifiques), parfois au second (propositions pseudo-scientifique).
[FN: § 333-1]
Odyss. ; VI, 207-208 :
![]()
[FN: § 336-1]
PIEPENBRING; Théol. de l'anc. test. « (p. 98) La sainteté de Dieu est dans un rapport intime avec sa jalousie, sa colère et sa vengeance... (p. 99) Dans le vieux cantique, Ex. 15, le poète, parlant à Jéhova, s'écrie : « Par la grandeur de ta majesté tu renverses tes adversaires ; tu déchaînes ta colère : elle les consume comme du chaume » [Les abstractions des néo- chrétiens ont-elles ce pouvoir ?] ... La colère de Dieu éclate donc chaque fois que sa volonté rencontre de l'opposition, qu'elle est méconnue et transgressée, et elle se manifeste par des châtiments sévères » Les néo-chrétiens inclinent à croire que tout est changé depuis la venue de Christ ; il n'en est rien. Les Pères des premiers siècles de l'Église insistent, et avec énergie, sur les châtiments qui frapperont les mécréants.
[FN: § 336-2]
Parmi les nombreux passages qu'on pourrait citer, nous nous contenterons d'en mentionner un : Ad. Cor. I, X, 8 : ![]()
![]() « Ne forniquons point comme quelques-uns d'entre eux forniquèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. [Voir Nombr. XXV, 1-9] L'abstraction qui résulté de la pseudo-expérience des néo- chrétiens, a-t-elle la puissance d'en faire autant ? Non. En ce cas, seul celui qui admet déjà cette abstraction lui obéira ; seul celui qui en est déjà persuadé le sera. Mais c'est là le caractère essentiel des principes des actions non-logiques (§ 308-2). L'apôtre continue : « (9) Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux [des Israélites] qui périrent par les serpents ». [Voir Nombr., XXI, 4-9 ; « (10) Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur [Voir Nombr., XI, XVI]. Plus loin : « (22)
« Ne forniquons point comme quelques-uns d'entre eux forniquèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. [Voir Nombr. XXV, 1-9] L'abstraction qui résulté de la pseudo-expérience des néo- chrétiens, a-t-elle la puissance d'en faire autant ? Non. En ce cas, seul celui qui admet déjà cette abstraction lui obéira ; seul celui qui en est déjà persuadé le sera. Mais c'est là le caractère essentiel des principes des actions non-logiques (§ 308-2). L'apôtre continue : « (9) Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux [des Israélites] qui périrent par les serpents ». [Voir Nombr., XXI, 4-9 ; « (10) Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur [Voir Nombr., XI, XVI]. Plus loin : « (22) ![]()
![]() – Voulons-nous rivaliser avec le Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? » Tout homme raisonnable répondra non, s'il s'agit du Seigneur tout puissant ; mais beaucoup de personnes raisonnables répondront oui, s'il s'agit d'une abstraction que quelques personnes tirent de leur propre sentiment.
– Voulons-nous rivaliser avec le Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? » Tout homme raisonnable répondra non, s'il s'agit du Seigneur tout puissant ; mais beaucoup de personnes raisonnables répondront oui, s'il s'agit d'une abstraction que quelques personnes tirent de leur propre sentiment.
[FN: § 337-1]
AUGUSTE SABATIER ; Les relig. d'aut. et la relig. de l'esprit : « (p. 440) La lettre, le signe alphabétique, caractérise la religion mosaïque d'après la forme de son apparition historique, son mode d'être et d'agir... La lettre tue. L'Esprit caractérise la religion évangé- lique d'après la nature même du rapport intérieur et moral qu'elle institue entre Dieu et l'homme, d'après le mode d'être de l'Évangile et le principe de son action... Il me semble dès lors que vous devez entendre ce qu'est la religion de l'Esprit. C'est le rapport religieux réalisé dans la pure spiritualité. C'est Dieu et l'homme conçus l'un et l'autre sous la catégorie de l'Esprit et se pénétrant l'un l'autre, pour arriver à une pleine communion. Par définition, les corps sont impénétrables les uns aux autres... Tout autres sont les relations des esprits. Leur tendance intime est de vivre la vie les uns des autres et de s'unir dans une vie supérieure commune. Ce que la loi de gravitation est dans le monde physique pour y maintenir l'harmonie, l'amour l'est et l'opère dans le monde spirituel et moral ». [Dieu sait ce que l'auteur se figure être la loi de gravitation !] « (p. 441) Force ultime du développement moral de l'être humain, l'esprit de Dieu ne le contraint plus du dehors ; il le détermine, l'anime du dedans et le fait vivre... L'accomplissement des devoirs naturels, l'exercice régulier de toutes les facultés humaines, le progrès de la culture comme de la justice, voilà la perfection de la vie chrétienne. Devenu réalité intérieure, fait de conscience, le christianisme n'est plus que la conscience élevée à sa plus haute puissance ».
[FN: § 346-1]
A. BRACHET : Gramm. hist. de la lang. franç. : « (p. 293) Avant d'atteindre le degré de précision qu'elle possède aujourd'hui, l'étymologie, – comme toute science et peut-être plus qu'aucune autre, – a traversé une longue période d'enfance, de tâtonnements, et d'efforts incertains, durant laquelle les rapprochements arbitraires, les analogies superficielles, et les combinaisons hasardées constituaient à peu près tout son avoir ». Ici l'auteur cite RÉVILLE ; Les ancêtres des Européens : « Les rêveries de Platon dans le Cratyle, les étymologies absurdes de Varron et de Quintilien chez les Romains, en France les fantaisies philologiques de Ménage au dix-septième siècle, sont restées célèbres. On ne voyait par exemple aucune difficulté à rattacher jeune à jeune sous prétexte (p. 294) que la jeunesse est le matin de la vie et qu'on est à jeun quand on se lève. Le plus souvent on tirait l'un de l'autre deux mots d'une forme toute différente, – et pour combler l'abîme qui les séparait, on inventait des intermédiaires fictifs. C'est ainsi que Ménage tirait le mot rat du latin mus : « on avait du dire d'abord mus, puis muratus, puis ratus, enfin rat ». N'alla-t-on pas jusqu'à supposer qu'un objet pouvait tirer son nom d'une qualité contraire à celle qu'il possédait, parce que l'affirmation provoque la négation, et à soutenir que le latin lucus (bois sacré), venait de non lucere (ne pas luire), – sous prétexte que lorsqu'on est entré dans un bois, on n'y voit plus clair ? ». L'auteur continue : « (p. 294) Comment de cet amas d'aberrations érudites a-t-il pu sortir à la longue une science capitale aujourd'hui ? Par la découverte et l'application de la méthode comparative, qui est celle des sciences naturelles ». Et qui est aussi celle que nous devons adopter.
[FN: § 351-1]
MAX MULLER; Ess. sur la myth. comp. ... J’ai rétabli la forme grecque des noms que le texte donne transcrits en lettres latines.
[FN: § 354-1]
BUCKLE ; Hist. de la civil. en Angl., t. I.
[FN: § 354-2]
L'auteur cite à l'appui : James Mackintosh, Condorcet, Kant.
[FN: § 355-1]
Manuel, I, 18, p. 15.
[FN: § 356-1]
Buckle, lui-même, finit par faire allusion, ici et là, aux actions non-logiques, du moins implicitement. Par exemple, quand il cherche les causes de la différence entre la révolution anglaise et la Fronde, en France, il croit : « (III, p. 7) qu'en Angleterre, une guerre pour la liberté était aussi une guerre de castes, tandis qu'en France, il n'y avait pas trace de guerre entre les diverses classes de la société ». En outre, il dit que les nobles français « (p. 20) ne cherchaient que de nouvelles sources de plaisirs propres à satisfaire cette vanité personnelle qui a acquis de tous temps à la noblesse une si grande notoriété ». Or, quel que soit le moyen qu'on veuille tenter pour unir ces faits à des déductions logiques du principe intellectuel, il est certain que les faits indiqués tout à l'heure dépendent d'inclinations naturelles, qui ne peuvent être, prises pour conséquence d'une différence des connaissances scientifiques et intellectuelles entre l’Angleterre et la France de ce temps-là ; car cette différence n'existait pas.
[FN: § 358-1]
BAYLE; Pensées diverses... à l'occ. de la Comète.
[FN: § 360-1]
BAYLE; Cont. des pensées diverses...
[FN: § 363-1]
MONTESQ. ; L'espr. des lois, liv. XXIV, ch. II – Paradoxe de Bayle.
Montesquieu a raison de dire: « Pour diminuer l'horreur de l'athéisme, on charge trop l'idolâtrie »; mais il aurait dû reconnaître l'artifice employé là, car il s'en sert lui-même dans d'autres occasions.
[FN: § 365-1]
SUMNER MAINE ; L'ancien droit, trad. COURCELLE SENEUIL.
Notes du Chapitre IV. Les théories qui dépassent l’expérience (§368 à §632), pp. 205-344↩
[FN: § 383-1]
S. REINACH ; Orpheus: «p. 4)... je, propose de définir la religion : un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés... Les scrupules dont il est question, dans la définition que j'ai proposée, sont d'une nature particulière... je les appellerai des tabous... ». Il ajoute que le scrupule du tabou « n'est jamais fondé sur une raison d'ordre pratique, comme le serait, dans le cas d'un arbre, la crainte de se blesser ou de se piquer ».
Précédemment, Reinach avait dit : « (p. 2) La mythologie est un ensemble d'histoires controuvées – non pas inventées, mais combinées et enjolivées à plaisir – dont les person- nages échappent au contrôle de toute histoire positive. La religion est, au premier chef, un sentiment, et l'expression de ce sentiment par des actes d'une nature particulière qui sont les rites ».
Reinach considère ici la mythologie non à sa formation, mais déjà formée, développée, et peut-être arrivée au seuil de la décadence, au moment où l'on n'a aucune répugnance à ajouter des fictions poétiques aux croyances populaires (§ 1027-1029). Si nous admettons pour un moment cette forme restreinte, nous voyons que dans ses observations, Reinach tient compte des actions logiques et non-logiques, bien que d'une manière peu distincte. La religion serait essentiellement non logique, constituée par ce que nous appellerons des résidus, au chap. VI. La mythologie serait essentiellement composée par des développements littéraires, logiques, par ce que nous appellerons dérivations, au chap. IX.
[FN: § 384-1]
M. J, LAGRANGE ; Quelq. rem. sur l'Orpheus de M. Sal. Reinach.
[FN: § 390-1]
M. J. LAGRANGE ; Étud. s. les rel. sém. : « (p. 7). Tout le monde admet du moins qu'il n'y a pas de religion sans la croyance à des pouvoirs supérieurs avec lesquels on peut nouer des relations ». Ces assertions portant sur tout le monde sont souvent démenties par les faits. Voici par exemple Reinach qui fait partie de « tout le monde », et ne semble pas admettre ce que dit le P. Lagrange. Mais pourquoi ces auteurs s'obstinent-ils à vouloir donner le même nom à des choses différentes ? Simplement parce qu'ils veulent faire leur profit des sentiments que suggère ce nom.
[FN: § 391-1]
CIC. ; De div., I, 5, 9 . Ego enim sic existimo : si sint ea, genera divinandi vera, de quibus accepimus, quaeque colimus, esse deos ; vicissimque, si dii sint, esse, qui divinent. – De nat. deor., II, 3, 7 : Praedictiones vero, et praesensiones rerum futurarum quid aliud declarant, nisi hominibus ea, quae sint, ostendi, monstrari, portendi, praedici ? Ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur ?
[FN: § 393-1]
CIC. ; De nat. deor., I, 19, 51. Exposant les opinions d'Épicure, il dit de la nature d'un dieu : Nihil enim agit : nullis occupationibus est implicatus : nulla opera molitur : sua sapientia et virtute gaudet : habet exploratum fore se semper tum in maximis, tum in aeternis voluptatibus.
DIOG. LAERT. ; X, 139 :
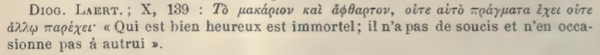
« Qui est bien heureux est immortel ; il n'a pas de soucis et n'en occasionne pas à autrui ».
[FN: § 394-1]
Annales du Musée Guimet, tome I ; Notes abrégées sur les réponses faites dans le Hioun-Kakou... par M.M. Simatchi, Atsoumi et Ahamatsou aux questions de M. Émile Guimet. D sont les demandes ; R les réponses.
[FN: § 394-*]
« La secte sïn-siou est une des plus répandues au Japon... ».
[FN: § 400-1]
AD. FRANCK ; Dict. des sc. phil. ; s. r. Droit.
[FN: § 404-1]
Nous rencontrons ici, dans un cas particulier, des espèces générales d'explications, dont nous traiterons aux chap. IX et X.
[FN: § 410-1]
ARIST. ; Éth. Nicom., V, 7, 1.
« Une partie du droit politique est naturelle, une partie est légale. Naturel est celui qui a partout la même force, et non celui qui change selon l'apparence ». Mag. Moral., I, 34,19 : « Une partie des choses justes le sont par nature, une autre de par la loi ». il dit ensuite que les choses justes par nature peuvent aussi changer, et donne comme exemple que nous pourrions également employer la main droite et la main gauche, mais que cela ne nous empêcherait pas d'avoir toujours une main droite et une main gauche. Puis il ajoute : (21)
« Puisque ce qui persiste le plus souvent est juste selon la nature ». En outre : « Donc la justice selon la nature est meilleure que selon la loi ».
[FN: § 410-2]
ARIST. ; Rhét. En outre (I, 10, 3) :
«J'appelle... commune celle qui, sans être écrite, paraît être reconnue par tous ».
[FN: § 415-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Voir aussi le traité De officiis, où Cicéron subordonne la morale aux mêmes abstractions. Après avoir dit que la nature ne nous trompe jamais : « (I, 28 100) ... quam si sequemur ducem [naturam], nunquam aberrabimus, consequemurque et id quod acutum et perspicax natura est, et id quod ad hominum consociationem accommodatum, et id quod vehemens atque fortem», il déclare quem: « (I, 29, 101) Omnis autemn actio vacare debet et neglegentia, nec vero agere quidquam, cuius non possit causam probabilem reddere... Efficiendum autem est ut appetitus rationi obediant... ». Il est vrai que Cicéron explique cette contradiction apparente, en disant : « (I, 28, 100-101) Duplex est enim vis animorum atque naturae : una pars in appetitu posita est, quae est ![]() Graece, quae hominem huc et illuc rapit ; altera in ratione quae docet et explanat quid faciendum fugiendumve sit. Ita fit ut ratio praesit, appetitus obtemperet ». Mais la signification de natura est si mobile, dans tout le traité, qu'il est impossible de savoir exactement ce que l'auteur entend par là.
Graece, quae hominem huc et illuc rapit ; altera in ratione quae docet et explanat quid faciendum fugiendumve sit. Ita fit ut ratio praesit, appetitus obtemperet ». Mais la signification de natura est si mobile, dans tout le traité, qu'il est impossible de savoir exactement ce que l'auteur entend par là.
[FN: § 425-1]
GROTIUS-BARBEYRAC; Le dr. de la guerre et de la paix, I, 10, 1. Grotius, continue en observant que « (2) les actions à l'égard desquelles la Raison fournit de tels principes, sont obligatoires ou illicites par elles-mêmes, à cause de quoi on les conçoit comme nécessairement ordonnées ou défendues de Dieu »; et que c'est cela qui distingue ce droit du Droit humain. Il est visible qu'ici comme d'habitude, on saisit qu'il y a, dans le droit, quelque chose qui n'est pas arbitraire. C'est ce quelque chose qui s'unit « nécessairement » à Dieu, à la Nature, à la Droite Raison et à d'autres entités semblables.
NOTES DE BARBEYRAC :
† L'auteur dit, moralement nécessaire. mais le terme dont je me suis servi, est plus clair, et l'opposition plus juste.
* J'ai ajouté et sociable; comme l'Auteur s'exprime lui-même plus bas, § 12, num. 1, et chap. suivant, § 1, num. 3. Il y a apparence que son Copiste, ou ses Imprimeurs, avoient sauté ici ces deux mots, sans qu'il s'en soit aperçû, comme il est arrivé en d'autres endroits.
[FN: § 425-2]
PUFENDORF ; De iure naturae et gentium, lib. I, cap. 1, § 10.
[FN: § 425-3]
BURLAMAQUI ; Principes du droit naturel, IIe partie, chap. 5, § 6.
[FN: § 431-1]
PUF.; De off. hom. et civis, 1. I, c. II, § 16.
[FN: § 428-2]
BURLAMAQUI; Elém. du dr. nat., III 13, 1 « 2° Il faut remarquer ensuite qu'en matière de droit naturel, les preuves que l'on tire du consentement et des mœurs des nations, ou des sentiments des philosophes, ne sont pas suffisantes pour établir que telles ou telles choses sont du droit naturel ; on sait assez combien les nations même les plus sages et les plus éclairées se sont égarées sur les choses les plus importantes ». Pufendorf récuse aussi le témoignage du consentement universel. PUFENDORF-BARBEYRAC ; Le dr. de la nat. et des gens, II, 3, 7 : « Il y en a d'autres qui posent pour fondement du Droit Naturel, le consentement de tous les Hommes, ou de toutes les Nations, ou du moins de la plupart et des plus civilisées, à reconnoître certaines choses pour honnêtes ou deshonnêtes. Mais outre que par là on donne seulement une démonstration a posteriori [c'est-à-dire une démonstration expérimentale, qui répugne à tout bon métaphysicien], comme on parle, et qui ne nous enseigne point pourquoi telle on telle chose est prescrite ou défendue par le Droit Naturel, c'est dans le fond une méthode bien peu sûre et environnée d'un nombre infini de difficultez ; car si on en appelle au consentement de tout le Genre Humain, il naît de là, comme le montre fort bien Hobbes (De Cive, cap. II, § 1), deux inconvénients fâcheux. Le premier, c'est que, dans cette supposition il seroit impossible qu'aucun homme qui feroit actuellement usage de la Raison, péchât jamais contre la Loi Naturelle : car dès-là qu'une seule personne, qui fait partie du Genre Humain, entre dans quelque opinion différente de celle des autres, le consentement du Genre Humain devient imparfait. L'autre, c'est qu'il paroît visiblement absurde de prendre pour fondement des Lois Naturelles, le consentement de ceux qui les violent plus souvent qu'ils ne les observent ».
Voir en outre : PUFENDORF-BARBEYRAC; Le dr. de la nat. et des gens, I, 6, 18 : « La Loi naturelle, c'est celle qui convient si nécessairement à la Nature raisonnable et Sociable de l'Homme, que sans l'observation de cette Loi il ne sauroit y avoir parmi le Genre Humain de Société honnête et paisible. Ou si l'on veut, C'est une Loi qui a, pour ainsi dire, une bonté naturelle [Notez l'indétermination habituelle des métaphysiciens. Ils n'arrivent jamais à avoir une idée précise], c'est-à-dire, une vertu propre et interne de procurer l'avantage du Genre Humain. Elle est encore appelée Loi Naturelle, à cause qu'elle peut être connue par les lumières naturelles de la Raison, et par la contemplation de la Nature Humaine en général ».
[FN: § 430-1]
Pufendorf est cruel pour les pauvres animaux ; il ne veut décidément pas qu'ils aient un droit naturel commun avec l'homme. PUFFNDORF-BARBEYRAC ; Le dr. de la nat. et des gens, I. 11, c. 3, § 3. « Il s'est trouvé néanmoins des gens, qui, apparemment pour faire briller leur esprit plûtôt que pour soûtenir sérieusement ce qu'ils pensoient, ont ramassé de tous côtez ce qui pouvoit servir à établir ce prétendu droit, commun aux Hommes et aux Bêtes. Mais il y a longtemps que les Sçavans ont réfuté toutes les raisons qu'on allègue là-dessus. Je me contenterai de toucher ici en peu de mots celles qu'on tire de l'Ecriture Sainte ». Suit une assez longue dissertation, pour démontrer que les pénalités qu'on trouve dans la Bible contre les animaux, ne présupposent pas un droit des animaux.
[FN: § 431-1]
ARIST.; Probl., X, 15 :
L'auteur continue en disant : (Trad. BARTHÉLEMY-SAINT HILAIRE) « Or la sensation, selon les lois naturelles, doit avoir lieu en avant ; et il faut voir devant soi l'objet vers lequel le mouvement nous porte. Plus la distance entre les yeux est grande, plus les regards se portent de côté. Ainsi, pour être conforme à la nature, il faut que l'intervalle soit le plus petit possible ; car à cette condition, on se dirigera le plus sûrement en avant. Comme les autres animaux n'ont pas de mains, il faut nécessairement qu'ils regardent de côté. Aussi leurs yeux sont-ils à une distance plus grande ; et c'est ce qu'on peut remarquer surtout sur le bétail, parce que ces animaux spécialement marchent en baissant la tête ». Oh ! sainte Nature, de quelles belles explications tu nous gratifies !
[FN: § 433-1]
PUFENDORF-BARBEYRAC; Le dr. de la nat. et des gens, II, 3, 13.
[FN: § 435-1]
Loc. cit. Barbeyrac note : « Comme cette période, qui ne se trouve pas dans la première Edition, n'étoit pas bien ajustée à la suite du discours, j'ai changé un peu la liaison, sans néanmoins m'éloigner en aucune manière des idées de mon Auteur ». Il use ensuite de la manière habituelle d'ôter toute force aux objections de ses adversaires, en excluant ses adversaires même du nombre de ceux auquel il est permis de juger des principes posés par l'auteur. « Il faut toûjours supposer ici, que ceux avec qui l'on dispute ne sont ni Pyrrhoniens, ni disposez de manière à se mettre peu en peine du Vrai ou du Faux ; autrement ce serait en vain qu'on voudroit les désabuser ». Au point de vue expérimental, vain est le raisonnement qui n'accepte d'objections que de ceux dont la doctrine est d'accord avec celle que l'on veut démontrer. Mais au point de vue des sentiments, le raisonnement qui s'appuie sur ceux-ci, ne peut être admis que par qui a déjà ces sentiments, au moins en partie. Barbeyrac continue : « La question a toûjours été aussi, si le Juste était tel de sa nature, et non par l'effet d'une volonté arbitraire, ![]() , c'est-à-dire, en conséquence des rapports essentiels qu'il y a entre nos Actions et leurs objets, ou la nature des choses ». Ce dilemme n'existe que pour les métaphysiciens. La science expérimentale donne une troisième solution du problème : elle montre que le mot juste indique simplement certains sentiments des hommes qui l'emploient, et qu'il est donc peu précis comme le sont aussi ces sentiments.
, c'est-à-dire, en conséquence des rapports essentiels qu'il y a entre nos Actions et leurs objets, ou la nature des choses ». Ce dilemme n'existe que pour les métaphysiciens. La science expérimentale donne une troisième solution du problème : elle montre que le mot juste indique simplement certains sentiments des hommes qui l'emploient, et qu'il est donc peu précis comme le sont aussi ces sentiments.
[FN: § 436-1]
PUFENDORF-BARBEYRAC ; Le dr. de la nat. et des gens, II, 3, 15 « ... nous n'aurons pas beaucoup de peine à découvrir le véritable fondement du Droit Naturel... Voici donc la Loi fondamentale du Droit Naturel : c'est que chacun doit être porté à former et entretenir, autant qu'il dépend de lui, une Société paisible avec tous les autres, conformément à la constitution et au but de tout le Genre Humain sans exception. [Cela deviendra plus tard la loi universelle de Kant]. Et comme quiconque oblige à une certaine fin, oblige en même tems aux moyens sans quoi on ne sauroit l'obtenir, il s'ensuit de là, que tout ce qui contribue nécessairement à cette Sociabilité universelle, doit être tenu pour prescrit par le Droit naturel, et tout ce qui la trouble, doit au contraire être censé défendu par le même droit ».
[FN: § 439-1]
BURLAMAQUI ; Princip. du dr. de la nat. et des gens, IIe part., chap. 8, § 2.
[FN: § 441-1]
VATTEL ; Le droit des gens, t. I.
[FN: § 443-1]
I. SELDENI de jure naturali et gentium iuxta disciplinam Hébraeorum libri septem, 1. I, c. 4, (p. 43) In designatione, atque definitione Iuris Naturalis, quae apud scriptores solet diversimode occurrere, alii ex Aliorum Animantium actibus, ac usu Iura hominibus aliquot Naturalia petunt ; alii Iuris naturalis Corpus e Moribus omnium, seu plurimarum Gentium communibus ; ex Naturali Ratione, seu recto eiusdem usu alii ; et demum alii e Naturae, adeoque Naturalis rationis Parentis, id est, sanctissimi Numinis Imperio, atque Indicatione.
[FN: § 444-1]
J. DE PAVLY ; Le Talmud de Babylone. Deuxième traité, Shabbath, IX : « (18) Chaque parole sortie de la bouche de Dieu au mont Sinaï, se faisait entendre en soixante-dix langues différentes et remplit tout l'univers d'un parfum agréable. La voix de Dieu était si retentissante qu'à chaque parole les Israélites reculaient de douze lieues ».
MOÏSE SCHWAB ; Le Talmud de Jérusalem. Traité Sota, c. VII, 5 – t. VII – « (p. 305) Ensuite, on apporta des pierres, on construisit l'autel, on l'enduisit de ciment, et l'on inscrivit les paroles de la Loi en soixante-dix langues, comme il est dit (Deutéron., XXVII, 8)... ». Commentaire : « (p. 306) On a enseigné (contrairement à la Mischnâ) : Les dites paroles ont été inscrites sur les pierres de l'endroit où ils passèrent la nuit (Josué, IV, 3), selon l'avis de R. Juda; R. Yossé dit qu'elles furent écrites sur les pierres de l'autel. D'après celui qui professe la première opinion, disant que la Loi a été inscrite sur les murs d'une hôtellerie, on comprend que chaque jour les nations du monde aient pu envoyer leurs scribes (Notarii) qui reproduisaient ces textes, puisque la Loi était écrite en soixante-dix langues... mais comment admettre l'avis de celui qui dit (d'accord avec la Mischnâ) que la Loi a été inscrite sur les pierres de l'autel ? En ce cas, ne s'agit-il pas d'une construction passagère, dont on a dû enfouir sous terre tout ce qui a servi au culte, avant le départ, et comment alors les païens en auraient-ils pu profiter ? C'était, en effet, un miracle que, pendant le court espace de temps où l'autel resta érigé, Dieu développa l'intelligence de chaque nation, de façon qu'elle pût copier (rapidement) le texte de la Loi écrit en soixante-dix langues ».
SURENH. ; Leg. misch., pars III, De uxore adulterii suspecta VII, 5, Bartenor... in scriptura septuaginta nationum, ut quicunque addiscere vellet Legem, addiscere eam posset, ne haberent nationes quo se excusarent, dicendo, non habuimus unde disceremus.
[FN: § 446-1]
MONTAIGNE ; Essais, II, 12: « (p. 506) Mais ils sont plaisants, quand, pour donner quelque (p. 507) certitude aux loix, ils disent qu'il y en a aulcunes fermes, perpetuelles et immuables, qu'ils nomment naturelles, qui sont empreintes en l'humain genre par la condition de leur propre essence... ».
[FN: § 447-1]
LE MERCIER DE LA RIVIÈRE ; L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767 ; réimpression de 1910.
[FN: § 448-1]
DE MABLY ; Doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. La Haye, 1768.
[FN: § 448-2]
Physiocrates ; édit. Guillaumin, 1re partie, QUESNAY ; Droit naturel EUGÈNE DAIRE, dans ses Observations, au commencement de la 2e partie, trouve admirables ces théories de Quesnay et de son commentateur Le Mercier de la Rivière. « (p. 438) En somme, publicistes et théologiens, au lieu d'étudier, dans la nature de l'homme et dans ses rapports avec le monde extérieur, les lois immuables qui établissent et maintiennent l'ordre au sein des sociétés, imaginèrent qu'il leur appartenait d'inventer ces lois ; et les institutions actuelles de l'Europe témoignent encore du succès avec lequel ils ont, sous ce rapport, substitué leurs propres vues à celles du Créateur ». Il faut croire que le Créateur n'avait pas prévu cette substitution, car, s'il l'avait prévue, il aurait bien pu l'empêcher. Notre auteur dit que Le Mercier de la Rivière prend le contrepied de la doctrine de Rousseau : « (p. 489) au lieu de vouloir que le législateur crée l'ordre, il l'invite seulement à s'y conformer, et à n'en pas chercher la base ailleurs que dans le sentiment et la raison, départis à l'homme pour reconnaître les lois immuables dont dépendent ici-bas son existence et son bonheur ». Il y a là une timide tentative de sortir des brumes de la métaphysique, mais elle est des plus imparfaites. Négligeons l'appel au Créateur et à ses vues, qui nous transportent dans le domaine de la théologie ; mais « les lois immuables qui établissent et maintiennent l'Ordre », « le sentiment et la raison départis à l'homme pour les reconnaître, nous font faire une excursion dans le domaine des causes finales, et en tous cas nous font sortir du domaine expérimental, où n'existent pas de « lois immuables » établies dans tel ou tel but, mais de simples uniformités (§ 99) des faits.
[FN: § 449-1]
Essai d'une philosophie de la Solidarité (L. BOURGEOIS) : « (p. 3) Et d'abord, qu'est-ce que la solidarité objective, considérée comme un fait ? – Kant a dit : « Ce qui constitue l'organisme, c'est la réciprocité entre les parties ». Toute la biologie est en germe là. [Cet adorateur de la Science aurait pu citer, sur ce point, un biologiste et non un métaphysicien]... « Ainsi l'idée de vie est identique à l'idée d'association. Et la doctrine de l'évolution a montré suivant quelle loi cette interdépendance des parties contribue au développement, au progrès de chaque être, de chaque agrégat ».
[FN: § 450-1]
Ess. d'une phil. de la Solid. (L. BOURGEOIS) : « (p. 13) Nous voici donc bien loin de la solidarité-fait et tout proche de la solidarité-devoir. Ne confondons jamais l'une et l'autre : ce sont des contraires. Mais il était indispensable de constater la première pour apercevoir la nécessité morale de la seconde ». Dame Science n'a fait que passer rapidement sur la scène et a disparu dans les coulisses. La « solidarité-fait » a d'autre part trouvé un défenseur dans la personne du Dr Papillaut (Ess. d'une ph. de la Solid.): « (p. 25) Je voudrais réclamer au nom
de la solidarité naturelle, à laquelle, à mon sens, on fait vraiment la part trop petite.. ». Comparez l'attitude de Bentham à l'égard de la morale.
[FN: § 451-1]
Ess. d'une phil. de la, Solid. (L. BOURGEOIS) « (p. 8) Quand nous demandons quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire une société humaine pour se maintenir en équilibre, nous sommes ainsi conduits à reconnaître qu'il n'y a qu'un mot qui les puisse exprimer : il faut que la justice soit ». Ici se pose un problème. Les sociétés qui ont existé jusqu'à présent, étaient-elles oui ou non en équilibre ? Si elles l'étaient, cela veut dire qu'elles possédaient déjà la justice ; et dans ce cas, comment expliquer que M. Bourgeois veuille la donner maintenant, grâce à la solidarité ? Si elles n'étaient pas en équilibre, que pourra bien être cet équilibre, que l'on n'a pas encore vu, jusqu'à présent ? « (p. 8) Je sais bien qu'on a parfois assigné à la société un autre objet, qui n'est rien moins que le bonheur assuré à chacun de ses membres... Le bonheur n'est pas matériel, partageable, réalisable extérieurement. L'idéal de la société c'est la justice pour tous ». Ce qu'est exactement cette justice, il semble que M. Bourgeois n'en sache rien, ou ne veuille pas nous le dire. On lui avait fait l'objection : « (p. 62) M. Léon Bourgeois a déclaré que (p. 63) peu importe l'origine de l'idée de justice, du moment qu'on est d'accord sur ce point que la justice est nécessaire. Cependant des conséquences pratiques fort importantes dérivent de la conception qu'on se fait de la justice... ». Voici la réponse : « (p. 65) M. Léon Bourgeois... répond qu'il n'a pas voulu, dans cette exposition, se préoccuper de l'origine de la notion de justice. [Il ne s'agit pas de l’origine, mais de ce qu'est cette justice]. De quelque manière qu'on cherche à les expliquer, l'idée et le besoin de justice existent au cœur de l'homme. C'est là un fait qu'il suffit de constater à titre de fait et dont on peut partir, d'autant mieux que si, théoriquement, il y a désaccord sur les principes premiers d'où on le fait dériver, pratiquement il y a accord en somme sur le sens, la portée, le contenu de cette notion de justice ». Et voilà qu'apparaît ainsi ce consentement universel qu'on n'aura jamais assez loué (§ 591 et sv.). Ce qui eût été extraordinaire ordinaire, c'est qu'il manquât. Et dame Raison ? Patience un instant ; elle aussi vient au secours de M. Bourgeois. – Dans un autre livre du même auteur, c'est-à-dire dans L. BOURGEOIS ; Solidarité, on lit : « (p. 76) Si la notion première du bien et du mal est une nécessité [que peut bien vouloir dire cela ?], si le sentiment de l'obligation morale constitue en nous un « impératif catégorique », l'opération intellectuelle, par laquelle l'homme s'efforce de définir le bien et le mal et cherche les conditions de l'obligation morale, est du domaine de la raison... (p. 77) tout a évolué autour de l'homme, à mesure qu'évoluait en lui l'idée morale, fonction suprême de la raison ». Dieu accorde longue et heureuse vie à cette bonne dame Raison, afin que les métaphysiciens futurs puissent y avoir recours, comme y ont eu recours leurs prédécesseurs ! La Nature intervient, elle aussi. Ess. d'une phil. de la Solid. (L. BOURGEOIS) : « (p. 10) Observons d'abord que la nature a ses fins à elle, des fins qui ne sont pas les nôtres. L'objet propre de l'homme, dans la société, c'est la justice [même dans les sociétés où existe l'esclavage ?], et la justice n'a jamais été l'objet de la nature ; celle-ci n'est pas injuste, elle est ajuste. Il n'y a donc rien de commun entre le but de la nature et celui de la société ». Mais comment se fait-il que certains précurseurs de M. Bourgeois, les stoïciens, nous disaient au contraire que le principe suprême de la morale était de vivre selon la Nature ? (§ 1605). Comment faire pour savoir qui a raison : ceux-ci ou M. Bourgeois ? Depuis le temps très lointain où les métaphysiciens s'occupent de rechercher le but de la Nature, ils auraient dû le découvrir. Au contraire, chacun va son chemin, et nous autres, malheureux, ne savons qui écouter.
Le principe de sociabilité qui servit déjà à Pufendorf (§ 4-36) ne fait pas défaut. Implicitement, il est partout ; explicitement, il apparaît çà et là. (XAVIER LÉON) : « (p. 242) La raison ignore les individus comme tels, c'est la communauté des individus, c'est l'humanité tout entière qui la réalise [qu'ils sont heureux ceux qui savent ce que cela veut dire « réaliser la raison »!] ; elle est essentiellement la (p. 243) raison humaine »... « (p. 245) C'est ce caractère éminemment social de la raison qui est le fondement de la solidarité humaine, c'est lui qui confère à la solidarité cette valeur morale qu'on s'épuiserait en vain à faire sortir de la constatation tout empirique d'un fait – biologique ou social – ou des conséquences d'un contrat plus ou moins t tacite ». (Voir le reste de la citation : 453 1.
[FN: § 453-1]
L. BOURGEOIS; Solidarité : « (p. 25) La méthode scientifique pénètre aujourd'hui tous les ordres de connaissances. Les esprits les plus réfractaires viennent, tout en protestant, s'y soumettre peu à peu ». Cela est écrit pour les anticléricaux. En continuant la lecture du livre, on apprend à connaître la Science de M. L. Bourgeois. « (p. 73) L'idée du bien et du mal est, en soi, une idée irréductible ; c'est un fait premier, un attribut essentiel de l'humanité ». Mais les métaphysiciens avaient déjà dit cela, il y a plus de mille ans, et il était inutile que, pour le répéter, M. L. Bourgeois invoquât la Science ! Cette Science de M. L. Bourgeois a tout l'air d'être identique à la métaphysique. Mais pourquoi donc donner deux noms différents à la même chose ? Il n'y a d'autres motifs que de flatter certains préjugés qui ont cours aujourd'hui, et sont favorables à dame Science. Ess. d'une phil. de la Solid. (XAVIER LÉON) : « (p. 245) La solidarité est donc justifiée parce qu'elle est une exigence de la raison ; elle est au fond le principe d'intelligibilité de notre action, la condition de réalisation de l'unité de la raison dans l'humanité ». Si ce n'est pas de la métaphysique, qu'est-ce que la métaphysique ?
[FN: § 455-1]
Dict. encycl. de la th. cath., s. r. Droit t. VI, p. 515. – L'auteur cite saint Paul ; Rom. II, 13 ; mais il doit y avoir une erreur ; il veut probablement dire II, 15. – PAUL; Rom., II, 14-15: (15)
![]()
« ceux-là montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs... ».
[FN: § 456-1]
PAUL.; Rom., II, 14-15.
[FN: § 456-2]
Dict. encycl. de la th. cath., s.r., Droit., t. VI, p. 515.
[FN: § 456-3]
SUMNER MAINE ; Early history of institutions, trad. DURIEU DE LEYRITZ : « (p. 35) Il [le Senchus Mor, un des anciens livres de lois irlandaises] représente les règles légales qu'il formule, comme découlant de la loi de nature, et de la loi de la lettre. La loi de la lettre, c'est la loi biblique complétée par toute la somme de droit canonique qu'on peut imaginer les monastères de la primitive Église d'Irlande capables d'avoir élaborée ou de s'être appropriée [sic]. Quant aux termes ambigus de loi de nature, ils n'ont aucun rapport avec la fameuse formule des jurisconsultes romains ; ils se réfèrent à un texte de saint Paul dans son Épître aux Romains cité plus haut... La loi de nature est donc l'ancien élément du système, antérieur au christianisme, et le Senchus Mor s'en exprime ainsi : , (p. 36) Les jugements de la droite nature, au temps que l'Esprit-Saint a parlé par la bouche des Brehons [les anciens docteurs de la loi, irlandais] et des vertueux poètes des hommes d'Érin, depuis la première prise de possession de l'Irlande, jusqu'à la réception de la foi, ont tous été exposés par Dubhthach à Patrice. Ce qui n'était pas contraire à la parole de Dieu exprimée dans la loi écrite et le Nouveau Testament et la conscience des croyants, fut maintenu dans les lois des Brehons par Patrice et par les ecclésiastiques et les chefs de l'Irlande, car la loi de nature a été tout à fait bonne, sauf quant à la foi, à ses obligations et à l'harmonie de l'Église et du peuple. Et c'est le Senchus Mor ».
[FN: § 457-1]
THOM.; Summ. théol., I a II ae, q. 91 ; Conclusio des art. 1, 2, 3, 4.
[FN: § 457-2]
THOM. ; Sum. théol., I a, II ae, q. 93 a. 3 ; Conclusio. Quoniam, teste B. Augustino, in temporali lege nihil est iustum ac legitimum quod non sit ex loge aeterna profectum ; certum est omnes leges, inquantum participant de ratione recta, intantum. a lege aeterna derivari.
[FN: § 458-1]
Corp. iur. can., C. VI : Ius autem aut natarale est, aut civile, aut gentium. C. VII : Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur... Cfr. ISID. ; Etym., V, 4, 1. Mais prenons bien garde que, comme nous le dit Lancelot dans ses Institutes de Droit canonique, 1. I, tit. II, § 3 : Haec tamen de ea consuetudine intelligere nos oportet, quae neque divino iuri, neque canonicis contradicit institutis : si quid autem contra fidem catholicarn usurpare dignoscitur non tam consuetudo, quam vetustas erroris est appellanda. – ISID.; Etym., II, 10, 3 : Porro si ratione lex consistat, lex erit omne, quod iam ratione constiterit, dumtaxat, quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti ratione proficiat.
[FN: § 460-1]
LOCKE ; An ess. conc. hum. und., I, c. II, § 13.
[FN: § 461-1]
GROTIUS-BARBEYRAC ; Le dr. de la guerre et de la paix., « (I, 1, 12, P. 53) Or il y a deux manières de prouver qu'une chose est de Droit Naturel : l'une a priori,... c'est-à-dire par des raisons tirées de la nature même de la chose ; l'autre a posteriori, ou par des raisons prises de quelque chose d'extérieur. La première qui est plus subtile et plus abstraite, consiste à montrer la convenance ou disconvenance nécessaire d'une chose avec une Nature Raisonnable et Sociable, telle qu'est celle de l'homme [il y en a d'autres ? Lesquelles?]. En suivant l'autre, plus populaire à [la science est populaire, et la métaphysique sublime], on conclut, sinon très certainement, du moins avec, beaucoup de probabilité, qu'une chose est (p. 54) de Droit Naturel, parce qu'elle est regardée comme telle parmi toutes les Nations, ou du moins parmi les Nations civilisées. Car un effet universel supposant une cause universelle ; une opinion si générale ne peut guères venir que de ce que l'on appelle le Sens Commun ».
NOTE DE BARBEYRAC :
« Cette manière de prouver le Droit Naturel, est de peu d'usage, parce qu'il n'y a que les maximes les plus générales du Droit Naturel, qui aient été reçues parmi la plupart des Nations. Il y en a même de très évidentes, dont le contraire a été pendant longtemps regardé comme une chose indifférente, dans les pays les plus civiliséz, ainsi qu'il paroit par la coûtume horrible d'exposer les enfans ».
[FN: § 462-1] HOBBES ; De cive, Libertas, c. VIII ; Leviath., c. XV. Cet auteur distingue le droit naturel, qui est la liberté qu'a chacun de se défendre, et la loi naturelle, qui est la norme d'après laquelle chacun s'abstient de faire ce qui peut lui nuire à lui-même. Leviath, c. XIV : Jus et lex differunt ut libertas et obligatio.
[FN: § 463-1] DIOG. LAERT.; Epicurus, X, 150 : « Le juste naturel est le pacte de l'utile, conclu afin de ne pas se léser réciproquement, ni d'être lésé. Comme les animaux ne purent conclure un pacte pour ne pas se léser réciproquement ni être lésés, il ne peut y avoir pour eux ni juste ni injuste. De même pour les peuples qui ne purent ou ne voulurent faire de pactes, afin de ne pas se léser ni être lésés ».
[FN: § 466-1]
La Liberté, 25 juillet 1912: « Moulins. – La Cour d'assises de l'Allier a jugé un jeune homme de 18 ans, Louis Auclair, représentant de commerce à Moulins, qui était accusé de parricide. Depuis la mort de sa mère, survenue l'an dernier à Côsne-sur-I'Œil, Louis Auclair vivait en mésintelligence avec son père. Ce dernier, ayant vendu ses biens pour une vingtaine de mille francs, acheta à Montluçon, avenue Jules-Ferry, un bar qu'il se mil à exploiter avec son fils ; mais il ne tarda pas à se livrer à la débauche, ce qui donna à Louis Auclair de grandes inquiétudes sur le sort de sa part d'héritage. Il y eut entre le père et le fils de violentes altercations. Un beau jour, le jeune homme déroba 1000 francs au débitant et s'enfuit habiter à Moulins. Le 9 avril dernier, il retourna à Montluçon et se querella encore avec son père. La nuit suivante, vers minuit, il pénétra dans le bar, et le débitant, accouru au bruit, le trouva près du tiroir-caisse. Le jeune homme assure aujourd'hui qu'il n'était venu là que par bravade et non pour un cambriolage. Quoi qu'il en soit, le père bouscula son fils, qui le tua d'un coup
de revolver dans le ventre. Le jury a rendu un verdict si indulgent que la Cour a puni d'un an de prison seulement ce crime abominable ». Supposons qu'on lise cela, non de la France contemporaine, mais de quelque pays ignoré. On en pourrait conclure que les lois écrites y étaient très indulgentes pour les parricides, et ce serait une déduction erronée.
[FN: § 466-2]
Voici un exemple pris au hasard, et qui est le type d'un très grand nombre d'autres, non seulement en France, mais aussi en Italie et ailleurs. On lit dans la Liberté du 23 mars 1912, sous la signature de GEORGES BERTHOULAT : « La justice sabotée. – Malgré le consortium du mutisme, tout le monde est fixé sur les interventions politiques dans l'affaire Rochette. En dehors des renseignements déjà connus, le simple bon sens y suffit : comment un homme tel que M. Rochette, suité de tant d'obligés, avocats-conseils ou autres, parmi les pontifes du bloc, se serait-il abstenu de faire donner cette garde parlementaire ? On peut être assuré qu'il l'a au contraire exigé... Et c'est ainsi que, par ordre supérieur, M. le procureur général a dû requérir la remise scandaleuse à laquelle s'est rallié docilement M. Bidault de l'Isle, démarche que M. Fabre appelle lui-même dans son procès-verbal, « la seule humiliation de sa carrière ». À côté de ce sabotage de la justice, M. le Provost de Launay en a établi hier à la tribune du Sénat un autre non moins grave, dans cette stupéfiante affaire de la Chartreuse, qui est, plus encore que le cas de Duez, le joyau des liquidations où s'évapora le fameux milliard. Comment la Chartreuse qui valait cinquante millions fut-elle adjugée à cinq cent mille francs ? C'est qu'elle a été avilie... Mais là encore il y a eu des influences politiques : elles se sont si bien employées que le liquidateur... se fit tout à coup le tuteur de celui que visait sa plainte. Et le tribunal de Grenoble, bien qu'en ayant été saisi régulièrement, jugea en 1906, 1908 et 1909 que les pièces l'ayant introduite devant lui devaient être tenues pour inexistantes. Elles existent si bien que le Sénat en a eu connaissance officiellement hier. Cependant, la politique ayant décidé le sauvetage des pilleurs de la Chartreuse, le tribunal et la Cour de Grenoble ne reculèrent point devant cet extraordinaire déni de justice... Enfin, pour compléter le trio des sabotages sensationnels, que penser de celui-ci : la grâce obtenue le 11 février dernier par M. Bourgeois, à l'instigation de son dompteur M. Vallé, en faveur des incendiaires d'Ay ? Il y avait là des gaillards condamnés à des peines de prison d'ailleurs relativement infimes – car s'ils n'eussent pas été les clients de M. Vallé, la loi les vouait aux travaux forcés – pour avoir été pris en flagrant délit, éventrant les toits à coups de hache, y versant du pétrole et mettant le feu. La ville d'Ay va avoir, du chef de leurs incendies et déprédations, des millions d'indemnité à payer... ».
Qu'on y ajoute les sentences du « bon juge » et d'autres tout aussi fantastiques. Une femme tue son mari et sa tante, sans aucun motif sérieux. Voici le compte-rendu de l'audience, que donne la Liberté du 12 mai 1912 :
« Cachée sous ses grands voiles de deuil, Mme P. a comparu cet après-midi devant la Cour d'assises. Elle n'a cessé, durant toute l'audience, de sangloter, interrompant même l'interrogatoire par quelques crises de nerfs. – Pourquoi avez-vous tué votre mari ? interroge le président. – J'étais poussée par une puissance surhumaine, mais si, à ce moment, quelqu'un était venu m'arrêter en me disant : Malheureuse, que vas-tu faire ? je serais revenue à moi, rien ne serait arrivé ! – Vous étiez si peu affolée qu'après avoir tué votre mari, vous avez rechargé votre arme dans les water-closets de la gare d'Austerlitz, – J'aurais rechargé dix revolvers à ce moment-là ! J'étais affolée, je me rendais si peu compte de ce qui s'était passé que je croyais que j'allais surprendre mon mari et ma tante à Savigny ; je ne me souvenais plus de ce que je venais de faire rue Sedaine ! – Après le second crime, vous êtes revenue à Paris et vous avez embrassé votre fille en disant : Pardonne-moi, je suis une criminelle ! – À ce souvenir, l'accusée éclate en sanglots et a une crise de nerfs. Lorsqu'elle est revenue à elle, elle s'écrie à plusieurs reprises : – Ma fille, pardonne-moi, je t'en prie! – On entend alors les témoins. La défense demande à la Cour d'entendre la petite Pâquerette, âgée de 9 ans, enfant de l'accusée. Le président et le ministère public veulent s'opposer à cette audition qu'ils qualifient d'inconvenante ; mais la défense insiste. L'accusée éclate en sanglots et, maintenue par quatre gardes, crie : – Ma chérie ! Ma pauvre petite ! Pardonne à ta mère ! – La fillette déclare, d'une petite voix qu'on entend à peine, que – sa maman lui disait toujours de penser à son père dans sa prière du soir, et que jamais elle ne lui dit du mal de son papa. Cette scène attristante impressionne profondément tout l'auditoire. Après une suspension d'audience, l'avocat général Wattine prononce un réquisitoire sévère. Le jury a rapporté un verdict négatif et la Cour a acquitté Mme P. ». – Ce fait n'est cité qu'à titre d'exemple, comme type d'innombrables autres.
Le phénomène est général, comme le montre une lettre adressée au Temps (août 1912), par M. Loubat, procureur général à Lyon : « Le jury doit être composé en vue de la défense sociale et non des quelques affaires politiques, d'ailleurs très rares aujourd'hui, qui peuvent être portées à la Cour d'assises. Les résultats du système sont assez éloquents. Notre plus haute juridiction criminelle, qui devrait approcher de la justice absolue, en raison des châtiments redoutables et parfois irréparables dont elle dispose, est la plus aléatoire, la plus capricieuse, la plus versatile qu'on puisse imaginer. Certains verdicts sont des actes d'aberration ; le parricide, lui-même, trouve grâce devant le jury. Dans la même session, on voit acquitter des accusés aussi coupables que d'autres qui sont condamnés à mort. Le tribunal qui se permettrait de pareils coups de tête soulèverait l'opinion publique. Ces scandales seraient impossibles si le jury comprenait plus d'hommes moins crédules et plus capables de résister aux impressions d'audience ».
On comprend que pour produire un effet pratique, le procureur général devait limiter son attaque au point où le mal paraissait être le plus grave. Mais, au point de vue théorique, les verdicts des tribunaux valent souvent ceux du jury, et personne n'ignore les services que la Cour de Cassation rendit au gouvernement dans l'affaire Dreyfus.
Une personne très compétente écrit de Paris dans la Gazette de Lausanne, 4 septembre 1912 : « Vous vous étonnerez peut-être que nous ne possédions que trois ou quatre vice- présidents très capables sur douze [vice-présidents du tribunal de la Seine]. moi, ce qui m'étonne, c'est que nous en possédions autant. Car on ne les choisit pas pour leurs capacités, on les choisit pour leurs opinions. S'ils sont instruits, c'est par l'effet de la chance ; et s'ils sont indépendants, c'est par l'effet d'une distraction. Nous avons au tribunal un ancien sénateur radical qui a été remercié par ses électeurs. On l'a nommé parce qu'il était radical et qu'il avait été mis à mal par la « réaction ». Il s'est trouvé que c'était un jurisconsulte de premier ordre, et c'est tant mieux. Mais il n'aurait pas su les causes de révocation des donations qu'on l'aurait nommé sans une hésitation de plus ».
En Italie, c'est encore pire et de beaucoup.
[FN: § 466-3]
On ferait un volume, si l'on voulait citer une partie, même très petite, des très nombreux faits que l'on pourrait rapporter à ce propos. L. LATAPIE, dans La Liberté, 11 janvier 1913, dit que le magistrat est maintenant « sans courage et sans force devant le débordement du désordre et de la criminalité. Il défend la société à coups de mouchoir parfumé contre le surin et l’eustache des bandits. Hier, la foule a laissé pour mort, dans le quartier de la Goutte-d'Or, un cambrioleur qu'elle avait pris sur le fait. Savez-vous combien de condamnations pour cambriolage on a trouvées dans son dossier ? Vingt-trois ! Cela veut dire que vingt-trois fois la police a surpris et arrêté cet apache ; et vingt-trois fois les magistrats l'ont rejeté à la rue après une condamnation légère. Cependant, il existe une loi sur la relégation visant les criminels irréductibles. Les magistrats ne l'appliquent pas, par peur sans doute de diminuer la clientèle des partis avancés. Il est certain que si Paris était purgé subitement des cinquante mille coquins reléguables qui troublent la sécurité, l'armée de la Révolution perdrait ses meilleures troupes. Or, la magistrature vit en bons termes avec la Révolution. Les excès contre les biens et contre les personnes trouvent en elle une indulgence inlassable dès qu'ils se couvrent d'un prétexte politique. Les voleurs et les assassins savent si bien cela qu'ils ne manquent plus jamais de s'affilier au parti Anarchiste avant d'accomplir leurs exploits. S'ils assassinent les garçons de banque et prennent leur portefeuille, c'est pour venger la Démocratie, et s'ils tirent sur les agents, c'est pour améliorer la Société. Les juges pâlissent d'inquiétude devant ces redoutables problèmes sociaux et leur conscience se recroqueville en forme d'escargot sous leur robe rouge. Qui sait ? La magistrature a une grande part de responsabilité dans tous les désordres qui éclatent en France. Elle ne sait inspirer nulle part le respect et la crainte de la Justice. Elle a tellement habitué les agitateurs professionnels à l'impunité que ceux-ci se considèrent comme intolérablement persécutés lorsqu'on fait mine de leur appliquer les lois. Et la presse gouvernementale, qui vit en perpétuelle coquetterie avec les révolutionnaires, ne contribue pas peu à augmenter l'inquiétude et l'hésitation parmi les juges. Je connais la défense que ceux-ci nous opposent : – Après tout, disent-ils, pourquoi serions-nous les seuls à avoir du courage ? Nous nous inspirons de l'attitude de nos gouver- nants. Qu'ils donnent, eux, l'exemple de l'énergie contre les entreprises révolutionnaires, qu'ils rompent toute solidarité avec les institutions qui ont pour but avéré la guerre contre la société et contre la patrie, et nous rétablirons la majesté sévère de la loi ».
Cette dernière observation a sa cause dans un motif de polémique. En réalité, magistrats, gouvernement, public, sont mus par des intérêts et des sentiments semblables. Quand le public est sous l'impression du délit, il frappe le coupable, et, quand cette impression est effacée, se repaît des insanités des humanitaires de tout genre. Les magistrats et les dirigeants suivent la voie qui plaît au public.
En décembre 1912, on jugea, devant les assises de Paris, Mme Bloch, qui avait tué la maîtresse de son mari, une certaine dame Bridgemann, laquelle, à l'instar des femmes libres d'outre Atlantique, menait joyeuse vie avec ses amants, pendant que son mari s'évertuait à gagner de l'argent. Mme Bloch fut acquittée. Jusque-là rien d'étonnant : des cas semblables se produisent par dizaines ou par centaines ; mais ce qui l'est moins, c'est d'entendre le ministère public, qui doit soutenir l'accusation, inciter à l'homicide. Voici ses paroles textuelles : « Ce qu'a fait l'accusée est grave. Elle avait une victime désignée ; elle l'avait chez elle, c'était son mari. Si elle l'avait frappé, nous n'aurions qu'à nous incliner ».
Le correspondant du Journal de Genève, qui a pourtant l'habitude de défendre les pires humanitaires, écrit (28 décembre 1912) : « La chose a fait scandale et toute la presse a protesté. Mais il faudrait plus et mieux pour empêcher la justice de se discréditer elle-même. Le cabotinage fait des ravages affreux dans le monde du palais. On y paraît à la fois moins indépendant que naguère à l'égard du pouvoir et plus accessible au désir d'une mauvaise réclame. Un grand effort serait nécessaire pour rendre à la justice la sérénité, la gravité et l'indépendance qui sont les conditions essentielles de son bon fonctionnement et de son autorité. L'affaire Rochette n'est pas non plus de nature à contribuer au bon renom de la magistrature. On sait que cet aigrefin de haut vol a disparu au moment où il devait se constituer prisonnier ».
Mais tout cela provient des sentiments qui existent dans le public et de l'organisation politique qui en est la conséquence. Ce sont des faits généraux, et l'on ne saurait en accuser telle ou telle personne en particulier.
[FN: § 469-1]
Même à une époque assez récente, l'orthographe était en partie arbitraire.
[FN: § 469-2]
S. REINACH ; Traité d'épigraphie grecque « (p. 237) L'orthographe, surtout dans les documents privés, (p. 238) soustraits au contrôle des secrétaires du peuple ou du sénat, est encore plus individuelle que l'écriture : elle reflète non seulement les habitudes générales de l'époque, mais les caprices ou les manies de chaque lapicide... Ajoutons que le mot d'orthographe éveille en nous une idée de règle qui a été longtemps étrangère à l'antiquité. Pour nous, l'orthographe est une manière fixe d'écrire les mots, en dépit souvent de la prononciation qu'on leur donne ; pour les anciens jusqu'à l'époque alexandrine, comme pour les Français jusqu'au seizième siècle, l'orthographe proprement dite n'existe pas et l'on écrit les mots comme on les prononce. L'écriture était vivante chez eux, elle est savante chez nous... On citerait de nombreuses preuves empruntées à l'épigraphie même, de l'inconstance de la graphie chez les anciens. Ainsi, dans un décret athénien, on trouve à la fois les formes ![]() , à quelques lignes de distance... (p. 45) M. Curtius a montré, en s'appuyant sur les inscriptions, comment l'ancien état de la langue grecque, à l'égard des consonnes finales, était celui d'une mobilité absolue, pareille à celle qui se constate jusqu'à la fin pour les consonnes des prépositions apocopées par synalèphe
, à quelques lignes de distance... (p. 45) M. Curtius a montré, en s'appuyant sur les inscriptions, comment l'ancien état de la langue grecque, à l'égard des consonnes finales, était celui d'une mobilité absolue, pareille à celle qui se constate jusqu'à la fin pour les consonnes des prépositions apocopées par synalèphe ![]() . Puis il s'établit entre ces différentes formes une sorte de lutte pour la vie, et l'orthographe dominante dans la langue classique fut celle qui sortit victorieuse de ce conflit entre différentes formes ».
. Puis il s'établit entre ces différentes formes une sorte de lutte pour la vie, et l'orthographe dominante dans la langue classique fut celle qui sortit victorieuse de ce conflit entre différentes formes ».
[FN: § 471-1]
DAVIS ; La Chine, t. II : « (p. 200) Les physiologistes chinois désignent l'homme sous le nom de siao-tien-ti, « petit univers, ou microcosme », et appliquent à cette définition la doctrine du yin et du yang, c'est-à-dire du double principe... maintenant l'ordre et l'harmonie du monde naturel. Ils supposent que c'est dans une certaine proportion entre ces principes, ou entre la force et la faiblesse, le froid, le sec et l'humide, que consiste la santé du corps humain, et que les différents degrés de force ou de faiblesse produisent les maladies et finale- ment la mort. Il règne dans tout leur système médical une grande prétention à l'harmonie et au raisonnement, qui serait admirable, si elle était fondée sur quelque chose de vrai ». Ces braves gens sont si instruits que « (p. 200) ils n'aperçoivent même pas la différence qui existe entre les artères et les veines, et certainement ne savent pas un mot des fonctions des poumons... Ils appellent le cœur « l'époux », et les poumons la « femme ». Ne pratiquant pas la dissection, il serait bien singulier que leurs connaissances fussent plus étendues ». De ce genre étaient chez nous, en d'autres temps, les dissertations de sciences naturelles ; telles sont encore aujourd'hui beaucoup de dissertations de science (?) sociale.
[FN: § 471-2]
CONDILLAC ; Essai sur l'origine des connaissances humaines, section V, 7.
[FN: § 473-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Ainsi, qui sera juge dans la controverse suivante ? Au cours de son Oraison funèbre de Mme Marie Vignerod, duchesse d'Aiguillon, [Voir VILLEMAIN ; Oraisons funèbres de Bossuet... suivies d'un choix d'oraisons funèbres de Fléchier et de Mascaron, Paris, 1843, p. 345.] Fléchier dit, à propos de la mort des justes : « L'âme se resserre en elle-même, et croit voir, à chaque moment, les portes de l'éternité s'entr'ouvrir pour elle ». Un commentateur LA HARPE) cité en note par Villemain, observe : « Si Fléchier avait dit : Leur âme se recueille en elle-même pour contempler l'éternité, etc., il y aurait un juste rapport entre l'idée et l’expression, parce que la contemplation est la suite du recueillement ; mais que l'âme du juste se resserre quand elle croit voir les portes de l'éternité, l'idée est absolument fausse. L'âme du juste, au contraire, doit s'ouvrir, se dilater, s'élancer au-devant de l'éternité ». On nous dira peut-être que La Harpe, ne critique en somme qu'une expression. C'est entendu ; mais sur quoi se fonde-t-il pour le faire ? Sur une prétendue nécessité de fait extra-expérimental : « L'âme du juste... doit s'ouvrir, etc.». Les abstractions âme, portes de l'éternité, etc., échappant entièrement à l'expérience, il est impossible à qui veut rester dans ce domaine, de savoir si vraiment Fléchier émet une « idée absolument fausse ».
[FN: § 474-1]
Le traité De Melisso est attribué à Aristote. Le philosophe dont on parle maintenant serait Xénophane ; mais ni l'une ni l'autre de ces assertions ne paraît vraie. Pour nous, cela présente peu d'importance, puisque nous étudions seulement des types de raisonnements ; peu nous importent leurs auteurs.
[FN: § 474-2]
De Melisso, c. I, éd. Bekker, p. 977 b – Fragm. philos., éd. Didot, I, p. 294:
Plus loin, c. IV, Bekker, p. 978; Didot, p. 299, on rappelle un fait analogue de Parménide ; et dans les fragments de Parménide, Didot, I, p. 124 : (102)
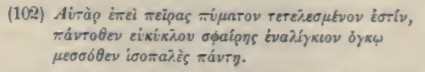
« Mais puisqu'il est parfait jusqu'à ses extrémités, partout, il est semblable à une sphère bien arrondie, toute également distante de son centre ».
[FN: § 474-3]
De Mélisso, c. IV; Bekker, p. 978 ; Didot, p. 298.
[FN: § 475-1]
De Melisso, c. II; Bekker, p. 976; Didot, p. 289. ARIST.; De caelo, II, 13,7.
[FN: § 477-1]
Summa theol., Prima, q. CVII, I.
[FN: § 478-1]
A. FRANCK; Dict. des sc. philos., s. r. Bien.
[FN: § 485-1]De civ. dei, XVI, 9.
[FN: § 486-1]
LACTANT. ; Div. instit., 1. III, de falsa sapientia, 24, 1 : Quid illi, qui esse contrarios vestigiis nostris antipodas putant ? Num aliquid loquuntur ? aut est quisquam tam ineptus, qui credat, esse homines, quorum vestigia sint superiora, quam capita ? aut ibi, quae apud nos iacent, inversa pendere ? fruges et arbores deorsum versus crescere ? pluvias et nives et grandines sursum versus cadere in terram ? Lactance répond aux « philosophes » comme nos hégéliens répondent aux physiciens. Il dit que du mouvement du soleil et de la lune, les « philosophes déduisirent que le ciel était rond : (7) Hanc igitur coeli rotunditatem illud sequebatur, ut terra in medio sinu eius esset inclusa : quod si ita, esse terram ipsam globo similem. Neque enim fieri posset, ut non esset rotundum, (8) quod rotundo conclusum teneretur. Si autem rotunda etiam terra esset, necesse esse, ut in omnes coeli partes eandem faciem gerat, id est, montes erigat, campos tendat, maria consternat. Quod si esset, etiam sequebatur illud extremum, ut nulla sit pars terrae, quae non ab hominibus caeterisque animalibus incolatur. Sic pendulos istos Antipodas coeli rotunditas adinvenit. (9) Quod si quaeras ad iis, qui haec portenta defendunt : Quomodo ergo non cadunt omnia in inferiorem illam coeli partem ? respondent, hanc rerum esse naturam, ut pondera in medium ferantur, et ad medium connexa sint omnia, sicut radios videmus in rota ; quae autem levia sunt, ut nebula, fumus, ignis, a medio deferantur, ut coelum, petant. (10) Quid dicam de iis nescio, qui cum semel aberraverint, constanter in stultitia perseverant, et vanis vana defendunt. On
dirait vraiment Hegel, quand il s'en prend à Newton. Le bon Lactance conclut : (11) At ego multis argumentis probare possem, nullo modo fieri posse, ut coelum terra sit inferius [toujours la manière hégélienne de raisonner sur les concepts ; Lactance raisonne sur le concept inférieur], nisi et liber iam concludendus esset.... Quel dommage ! Ainsi nous ne connaissons pas ces nombreux arguments ?
[FN: § 487-1]
PLUTARCH.; Deplacitis philosoph., III, 10.
[FN: § 487-2]
PLUTARCH., De facie in orbe lunae, 7, 2: « On ne doit pas écouter les philosophes, quand ils veulent repousser les paradoxes par des paradoxes... (3) Quels paradoxes ne font-ils pas ? Ne disent-ils pas que la terre est sphérique ? elle qui a de si grandes profondeurs, hauteurs, inégalités ? qu'elle est habitée par les antipodes, qui rampent à la façon des vers ou des lézards, la partie supérieure tournée en bas ? »
[FN: § 487-3]
LUCRET.; I, 1056-1063. D'autre part, il demeure en faveur de Lucrèce qu'il n'entendait pas persécuter ceux qui ne pensaient pas comme lui.
[FN: § 488-1]
Le lecteur se rappellera qu'ici, comme ailleurs, nous opposons les concepts aux faits, le subjectif à l'objectif, non au sens métaphysique, mais au sens expérimental, comme il a été énoncé aux § 94 et 95.
[FN: § 489-1]
COSMA IND. ;
(Édit. WINSTEDT, p. 38).
[FN: § 489-2]
COSMAS IND. ; (65 A – Winst., p. 46 – Migne, p. 66)
[FN: § 490-1]
ARIST. ; De caelo, I, 2, 4
[FN: § 491-1]
De caelo, I, 2, 9 :
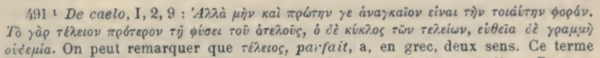
On peut remarquer que ![]() , parfait, a, en grec, deux sens. Ce terme signifie ce qui est fini, achevé, et aussi ce qui est sans défaut, excellent. Dans ce dernier sens, Aristote, Eth. Nic., V, 1, 15, nomme la
, parfait, a, en grec, deux sens. Ce terme signifie ce qui est fini, achevé, et aussi ce qui est sans défaut, excellent. Dans ce dernier sens, Aristote, Eth. Nic., V, 1, 15, nomme la ![]() , pour désigner une vertu très grande, excellente. Ce sens équivoque de
, pour désigner une vertu très grande, excellente. Ce sens équivoque de ![]() convient pour dissimuler la vanité du raisonnement du De caelo. Le mouvement circulaire est fini, achevé, parce qu'il revient sur lui-même, parce qu'il peut continuer indéfiniment sur la même courbe ; et quand, de cette façon, on a admis l'épithète
convient pour dissimuler la vanité du raisonnement du De caelo. Le mouvement circulaire est fini, achevé, parce qu'il revient sur lui-même, parce qu'il peut continuer indéfiniment sur la même courbe ; et quand, de cette façon, on a admis l'épithète ![]() on arrive, en vertu du double sens, à tenir le mouvement circulaire pour meilleur que tout autre mouvement. Voyez encore, pour les différents sens de parfait, Metaphys., IV, 16, p. 1021, Bekk.
on arrive, en vertu du double sens, à tenir le mouvement circulaire pour meilleur que tout autre mouvement. Voyez encore, pour les différents sens de parfait, Metaphys., IV, 16, p. 1021, Bekk.
Il y a aussi une autre amphibologie. Le raisonnement sur le cercle parfait est répété, De caelo, II, 4, 2. Le cercle est dit parfait, en comparaison de la ligne droite, parce qu'on peut ajouter quelque chose à la droite, tandis qu'on ne peut rien ajouter au cercle. L'auteur continue :
« Donc si le parfait est antérieur à l'imparfait, pour cela aussi la première des figures serait le cercle ». Ce le raisonnement a autant de valeur pour le cercle que pour toute autre figure fermée. Dans ce sens, Aristote dit, De gen. et corrup., II, 10, 8 : Quand l'air vient de l'eau, et le feu de l’air, et de nouveau l'eau, du feu, nous disons que la production a lieu en cercle, puisqu'elle est revenue sur elle-même :
Si l'on devait entendre dans ce sens le passage du De caelo, cité au commencement, on y opposerait seule- ment un mouvement revenant sur lui-même, à un mouvement qui se prolonge indéfiniment sur une ligne non fermée ; mais il n'en est nullement ainsi, et il s'agit bien d'un cercle géométrique, dans le passage de De caelo, puisque, II, 46, on exclut non seulement les figures composées directes, mais aussi celles dont les droites tirées du centre ne sont pas égales, comme les figures lenticulaires ou faites en forme d'œuf. On voit par conséquent que le mouvement circulaire a tantôt un sens tantôt un autre : tantôt c'est simplement un mouve- ment suivant une courbe fermée, tantôt c'est un mouvement suivant un cercle géométrique.
[FN: § 491-2]
Prenons garde d'autre part que c'est le cercle et la sphère en eux-mêmes. L'auteur établit qu'il y a des sciences plus vraies que d'autres. Il suppose un homme qui a la vraie connaissance de la justice, et veut montrer comment elle se mélange à une autre connaissance moins parfaite. Philebus, p. 62 : « Cet homme sera-t-il suffisamment savant s'il connaît la divine raison intrinsèque du cercle et de la sphère ![]() , et qu'il ignore la raison humaine des cercles et de la sphère. ? »
, et qu'il ignore la raison humaine des cercles et de la sphère. ? »
[FN: § 492-1]
LAPLACE; Traité de mécanique céleste, Paris, an VII; I, p. 14.
[FN: § 496-1]
POISSON ; Traité de mécanique, I, p. 2: « On donne, en général, le nom de force à la cause quelconque qui met un corps en mouvement ». Les auteurs s'aperçurent ensuite de l'erreur d'une telle définition. SAINT VENANT ; Principes de mécanique fondés sur la Cinématique (lithographié), p. 65 : « À notre point de vue tout pratique, nous ne nous arrêtons pas à discuter si les masses ont quelque rapport avec les quantités de matière des divers corps hétérogènes, et, les forces,... avec les causes efficientes du mouvement qu'ils prennent ».
[FN: § 496-2]
Rivista di Scienze, n° 1. E. PICARD ; La mécanique classique et ses approximations successives, p. 6 : « Dans l'étude des champs constants, la force s'est trouvée successivement définie de deux manières différentes, d'abord par des mesures statiques, et ensuite à un point de vue dynamique par l'intermédiaire des accélérations correspondant aux champs. Aucune relation n'était a priori nécessaire entre ces deux évaluations, et nous devons regarder comme un résultat expérimental que les nombres représentant les forces envisagées au point de vue dynamique et au point de vue statique sont proportionnels ». Le lecteur remarquera cette dernière proposition ; le concept qu'elle exprime est essentiel en science.
[FN: § 498-1]
CIC.; De nat. deor., II, 16, 44. Quae autem natura moverentur, haec aut pondere deorsum, aut levitate in sublime ferri : quorum neutrum astris contingeret, propterea quod eorum motus in orbem circumque ferretur. Nec vero dici potest, vi quadam majore fieri, ut contra naturam astra moveantur : quae enim potest maior esse ? Restat igitur, ut motus astrorum sit volontarius...
[FN: § 499-1]
Nous en traiterons amplement au chap. IX.
[FN: § 502-1]
Pour que cela soit vrai, il faut rapporter le mouvement des planètes au soleil supposé immobile, en admettant qu'on peut négliger les masses des planètes, en comparaison de celle du soleil, ainsi que les actions réciproques des planètes.
[FN: § 502-2]
HEGEL; Philosophie de la Nature, trad. Vera, I. Vera est un hégélien de grande renommée, qui doit avoir compris ce que l'auteur voulait dire.
[FN: § 503-1]
HEGEL; Phil. de la Nat., trad. Vera, I. Nous transcrivons les notes du traducteur ; elles apportent de la clarté à un texte déjà plus que lumineux. Mais la plus belle note est celle qui vient après les paroles suivantes, dans le texte, au point où nous nous sommes arrêtés : « (p. 297) ... loi qui n'est profonde que parce qu'elle est simple, et qu'elle exprime la nature intime de la chose ». Je regrette que cette note soit trop longue pour être citée en entier ; mais le petit passage suivant suffira : « (p. 297) Or, par là même que la chute n'est qu'un moment de la mécanique finie, le temps, l'espace et la matière n'y existent que d'une manière abstraite et incomplète, c'est-à-dire que tous les éléments qui les constituent ne s'y trouvent pas complètement développés et dans leur unité. Le temps n'y existe que comme racine, et l'espace que comme carré, et comme un carré purement formel ». Plaignons cette pauvre chute où le temps n'existe que comme racine !
Je ne conteste pas que cette façon d'assembler des mots qui paraissent enfilés au hasard, ne conduise à des lois « profondes et simples, qui expriment la nature intime de la chose », parce que je ne sais vraiment pas ce qu'est cette vénérable nature ; mais, dans cette Sociologie, je ne recherche pas cette nature intime, et je tâche par conséquent de m'abstenir de mon mieux de discours du genre de celui qui vient d'être noté (§ 20). Peut-être qu'un jour viendra, où les traités de sociologie que l'on composera, comparés à ceux qui ont cours aujourd'hui, apparaîtront comme la mécanique céleste de Gauss, comparée aux songes de Platon ou aux divagations de l'astrologie.
* (NOTE DE VERA) : « Eine blos empirische Grösse, und als qualitativ nur als abstrakte Einheit. C'est ainsi qu'il existe dans la chute ».
** « Für sich, pour soi, c'est-à-dire ici complète ». Hélas, les merveilles qui portent le nom de « totalité réfléchie, pour soi, complète », nous sont également inconnues.
*** « Producirt sich, und bezieht sich darin auf sich selbst, c'est-à-dire le carré ».
† « Als das positive Aussereinander, en tant que continuant l'extériorité positive ».
[FN: § 504-1]
HEGEL; Phil. de la Nat., trad. Vera, II.
[FN: § 504-*]
(NOTE DE VERA) : Unterworfene, soumise, vaincue, par opposition à l'identité individuelle (individuelle Selbst) du métal qui n'est pas passif polir la lumière.
[FN: § 504-2]
La densité du diamant est d'environ 3,5. Certains verres ou cristaux ont les densités suivantes : cristal 3,3 ; flints divers, de 3,6 à 4,3. Au contraire, le métal aluminium (fondu) a la densité 2,56. Donc, si l'on raisonnait comme fait Hegel, l’aluminium devrait être plus transparent que le diamant et le cristal. Il est vraiment regrettable pour les métaphysiciens que ce soit le contraire. Mais de semblables contradictions ne les troublent nullement, et ils trouvent toujours moyen de ménager la chèvre et le chou. Dans les sciences physiques, ils ont été tellement discrédités par leurs erreurs répétées et leurs théories fantastiques, que personne ne se soucie plus d'eux ; cependant ils continuent à pontifier dans la littérature qui usurpe le nom des sciences sociales.
[FN: § 505-1]
A. FOUILLÉE : Crit. des syst. de morale contemp.
[FN: § 505-2]
DAVIS ; La Chine, t. II : « (p. 216) Klaproth a remarqué que, dans une encyclopédie écrite avant la fin du IXe siècle, il est dit que « la lune étant le principe le plus pur de l'eau, influence les marées ». HEGEL ; Philosophie de la Nature, t. I : « (p. 878) La lune est le cristal sans (p. 379) eau, qui s'efforce de se compléter, et d'apaiser la soif de sa rigidité par notre mer, et qui produit ainsi la marée. La mer se soulève et est, pour ainsi dire, sur le point de s'élever vers la lune, et celle-ci semble à son tour vouloir s'emparer d'elle ». C'est ainsi que nos métaphysiciens contemporains dissertent sur les phénomènes sociaux.
[FN: § 506-1]
D. THom.; Opusc. L. De natura luminis. Et pourtant cet auteur avait commencé par une observation juste, en remarquant que le langage vulgaire nous induit en erreur sur la nature de la lumière. Nam quidam dixerunt lumen esse corpus, ad quod falso sunt moti ex quibusdam locutionibus, quibus utuntur loquentes de lumine. Consuevimus enim dicere, quod radius transit per aerem, et quod radii reverberantur, et quod radii intersecant, quae omnia videntur esse corporum.
[FN: § 507-1]
ARISTOT.; De gen. et corrup. I, 2, 10. Nous avons traduit ![]() par « faits usuels », littéralement : « les choses sur lesquelles on est d'accord ».
par « faits usuels », littéralement : « les choses sur lesquelles on est d'accord ».
[FN: § 508-1]
F. BACONIS... Novum organum scientiarum, I, 15 : In notionibus nil sani est, nec in logicis, nec in physicis, non Substantia, non Qualitas, Agere,.Pati, ipsum Esse, bonae notiones sunt ; multo minus Grave, Leve, Densum, Tenue, Humidum, Siccum, Generatio, Corruptio, Attrahere, Fugare, Elementum, Materia, Forma, et id genus ; sed omnes phantasticae et male terminatae.
[FN: § 508-2]
F. BACONIS... Novum Organum scientiarum, II, 5 : At praeceptum sive Axioma de transformatione corporum, duplicis est generis. Primum intuetur corpus, ut turmam sive coniugationem naturarum simplicium, ut in auro haec couveniunt ; quod sit flavum, quod sit ponderosum...
[FN: § 510-1]
HEGEL; Phil. de la Nat.. t. I.
[FN: § 511-1] Les notes suivantes sont de Vera.
* C'est l'entendement, plutôt que la raison spéculative, qui domine dans la lumière, précisément parce qu'elle est une identité abstraite.
† Hier Aeusseres und Anderes. C'est-à-dire que la lumière se pose d'abord comme moment opposé et extérieur à un autre moment.
** Das Dunkele. L'obscurité, le principe obscurcissant.
[FN: § 514-1]
Pour être bref, nous mettons ces propositions et le syllogisme sous la forme d'équations mathématiques ; soit A = X, X = B; donc A = B. Ainsi nous évitons les questions secondaires qui se rapportent à la nature des prémisses du syllogisme. Ce livre n'est pas un traité de logique, et nous voulons seulement indiquer le point principal du problème.
Qu'on veuille bien prendre garde à ce qui est dit du syllogisme, au § 97, et qui garde sa valeur pour le raisonnement sous forme d'équation.
[FN: § 514-2]
Les métaphysiciens répondent que tout raisonnement se fait sur des concepts, qu'il soit ou non expérimental. Admettons-le, puisque nous ne voulons jamais discuter sur les mots. Pour employer cette terminologie (§ 95), nous dirons que la différence consiste dans le nombre des concepts et dans la façon de s'en servir. Ainsi, pour connaître le mouvement des corps célestes, Hegel met en œuvre quelques concepts, ramassés çà et là. Par leur intermédiaire, il arrive à des conclusions déjà connues, que d'autres avaient tirées, dans leur recherche d'une représentation approximative de ce mouvement. Mais lui, dans son ignorance, se figure qu'il s'agit là d'une représentation précise. Par conséquent, si l'on comparait les concepts qu'il obtient par ce moyen, avec les concepts que l'on a grâce aux lunettes, en mesurant la position des corps célestes, on trouverait de grands écarts. Au contraire, ses contemporains astronomes employaient un très grand nombre de concepts, appelés par eux observations astronomiques ; ils les combinaient avec un autre grand nombre de déductions logico- mathémathiques, et en tiraient, au sujet de la position des astres, des concepts qui avaient le précieux mérite de s'accorder assez bien, en tout cas beaucoup mieux que les concepts hégéliens, avec les concepts qu'on avait acquis grâce aux observations astronomiques d'alors, et avec ceux qu'on tira des observations astronomiques, futures à ce moment, et passées pour nous.
Donc, celui qui veut avoir des concepts s'écartant, comme ceux de Hegel, des concepts donnés par l'observation, n'a qu'à suivre le sentier où s'est engagé Hegel. Celui qui veut au contraire avoir des concepts se rapprochant davantage des concepts donnés par les observations, doit prendre la -voie suivie par les astronomes, les physiciens, les chimistes, etc. Ici, nous voulons trouver, en sociologie, des concepts de ce genre ; et c'est pourquoi nous suivons cette voie, qui seule y mène. Nous n'avons absolument aucun autre motif pour la suivre.
[FN: § 514-3]
G. SENSINI ; La teoria della Rendita : (p. 201, note) « ... les économistes littéraires s'adonnent à des investigations d'une fécondité extraordinaire, qui peuvent se résumer ainsi : Traiter un sujet quelconque, X, sans préciser en rien le sens des mots à employer ; ce qui permettra de jouer à l'infini sur leur ambiguïté. Ne jamais poser un problème avec la rigueur nécessaire ; car, ce faisant, dans l'immense majorité des cas, on verrait que les questions posées ne tiennent pas debout, oui bien qu'elles sont insolubles, parce qu'elles sont mal formulées. Faire un abondant usage d'expressions métaphysiques et en général indéterminées, qui, ne signifiant rien signifient en même temps tout, et mettent à l'abri de toute objection... Faire appel, d'une manière plus on moins voilée, aux sentiments en général, et en particulier à ceux qui sont le plus à la mode, au moment où l'on écrit... (p. 202) L'immense majorité des productions économico-littéraires qui font aujourd'hui la fortune de leurs auteurs, sont de cette espèce ».
[FN: § 514-4]
On comprend par conséquent pourquoi la proposition : A a l'attribut B, est la partie constante et socialement de majeure importance, tandis que les prémisses qui conduisent à cette conclusion sont la partie variable et de moindre importance (§ 850 et sv.).
Dans l'exemple des tempêtes, rapporté au chap. II (§ 186 à 216), la conclusion est que l'on peut, par certaines pratiques, repousser ou attirer des tempêtes, de la grêle, des vents, la partie variable est l'explication de ce pouvoir, c'est-à-dire que c'est celle qui fournit les prémisses dont la proposition indiquée est la conclusion. L'induction nous a fait connaître le fait, et nous l'avons exprimé d'une façon générale (§ 217). Maintenant nous en poursuivons l'étude, et nous voyons les causes de ce fait, c'est-à-dire que nous le mettons en rapport avec d'autres faits.
[FN: § 518-1]
Manuel, I, 39, 40.
[FN: § 536-1]
J. DE MORGAN; Les prem. civil. : «(p. 29) Les documents sur lesquels s'appuie l'histoire proprement dite sont de quatre natures différentes : 1° Les textes contemporains des événements, inscriptions, monnaies et médailles, histoires, annales et mémoires. (p. 30) 2°, Les documents archéologiques, monuments et objets divers rencontrés sur le sol ou dans le sol. 3° Les écrits postérieurs aux événements qu'ils narrent. 4° Les considérations des sciences dont j'ai parlé plus haut (géologie, zoologie, botanique, anthropologie, ethnographie, sociologie, linguistique), auxquelles il convient d'ajouter les observations sur les industries, les arts, le commerce, les connaissances scientifiques, etc. ».
[FN: § 537-1]
Par conséquent le critique trouvera toujours et facilement quelque fait omis. Certaines gens, qui critiquent des œuvres qu'ils seraient incapables d'écrire, même en partie, s'en prévalent pour dire : « Vous avez omis ce fait », ou bien : «Vous avez cité cette édition, qui n'est pas la meilleure ». Ce serait fort bien, même parfait, si l'on pouvait ajouter : « Et ce fait est important pour ou contre votre théorie » ; ou bien : « La meilleure leçon que l'on tire de la meilleure édition est également importante ». Mais sans cette adjonction, l'observation est puérile, et ne montre que la vanité du pédant, parfois cultivé, plus souvent ignorant.
[FN: § 538-1]
On sait assez que, dans la paléographie moderne, tous les manuscrits qui proviennent d'un archétype comptent pour un seul. Par exemple, pour le texte de Plaute, l'Ambrosianus compte plus que tous les autres manuscrits.
[FN: § 538-2]
G. SOREL; L'Indépendance, 15 février 1912. L'auteur conclut l'analyse d'un livre par l'observation suivante, qui s'applique à beaucoup d'autres cas semblables : « (p. 97) Cet ouvrage, établi suivant les plus rigoureux principes de la Sorbonne, pour la composition duquel 422 auteurs ont été utilisés, nous fournit un remarquable échantillon de l'insignifiance des résultats auxquels aboutissent les méthodes enseignées par Lanson ».
[FN: § 538-3]
Pour vouloir critiquer Taine avec trop d'empressement, il est arrivé à ce bon M. Aulard une aventure amusante. Voir : AUGUSTIN COCHIN; La crise de l'histoire révolutionnaire. – Taine et M. Aulard. De même pour un fait insignifiant, tiré de Clément d'Alexandrie, la critique de M. Aulard est entièrement erronée. V. PARETO ; Un petit problème de philologie, dans L'Indépendance, 1er mai 1912 : « Au fond, il importe peu à l'histoire de la Révolution française que Taine ait traduit fidèlement, ou n'ait pas traduit fidèlement un passage de Clément d'Alexandrie. M. Aulard aurait donc pu, sans le moindre inconvénient, négliger ce sujet. Mais s'il voulait s'en occuper, il fallait y mettre le temps et l'attention nécessaires. Si M. Aulard avait fait cela, il aurait vu que la comparaison faite par Clément d'Alexandrie est exactement parallèle à celle qu'a voulu faire Taine ; et par conséquent il se serait abstenu de se livrer à une critique qui n'est aucunement fondée ». Il est comique de voir que, dans la transcription de ce passage de Taine, M. Aulard tombe en des erreurs semblables à celles qu'il reproche à Taine. Confrontez le IIIe, volume de Taine, 10e, édition, in-8°, Paris 1887, avec la transcription de M. Aulard : (Taine) « des voiles tissus d'or. (Aulard) : des voiles tissés d'or. (Taine) : d'un air grave en chantant. (Aulard) : d'un air grave et, chantant. (Taine : et soulève. (Aulard) : il soulève ». Il y a 3 erreurs en 11 lignes imprimées de l'édition de Taine. M. Aulard dira qu'elles sont insignifiantes, qu'elles ne changent rien au sens, qu'elles laissent sa critique intacte, et qu'il n’appartient qu'à un sophiste de les relever. Parfaitement ; on ne peut mieux dire ; tel est mon avis, et c'est pourquoi je n'ai pas mentionné ces corrections dans l'article cité. Mais pourquoi M. Aulard a-t-il oublié ces excellents préceptes dans les critiques qu'il adresse à Taine ? Medice, cura te ipsum.
[FN: § 540-1]
J. BERTRAND ; Les fondateurs de l'astronomie : « (p. 146) Kepler a pu affirmer, il est vrai, qu'une erreur de huit minutes était impossible, et cette confiance a tout sauvé ; s'il avait pu en dire autant d'une erreur de huit secondes, tout était perdu... Kepler se trompait, en effet, en regardant l'important avantage obtenu sur la planète rebelle et opiniâtre, comme une de ces victoires décisives qui terminent à jamais la lutte, ces grandes lois, éternellement vraies [Bertrand pouvait nous épargner cette considération métaphysique] dans de justes limites, ne sont pas rigoureusement mathématiques [elles constituent la première approximation : celle dite du mouvement elliptique]. De nombreuses perturbations écartent incessamment Mars de sa route, en l'affranchissant peu à peu des liens (p. 147) délicats dans lesquels l'heureux calculateur avait cru l'enlacer à jamais. Pour qui pénètre plus au fond [approximations successives] ces irrégularités expliquées et prévues confirment, il est vrai, avec éclat la théorie de l'attraction qu'elles agrandissent en l'éclairant ; mais la connaissance prématurée de ces perturbations, conséquence nécessaire d'observations plus précises, en enveloppant la vérité dans d'inextricables embarras, aurait retardé pour bien longtemps peut-être les progrès de la mécanique du ciel. Kepler, rejetant alors l'orbite elliptique aussi bien et au même titre que l'orbite circulaire, eût été forcé de chercher directement les lois du mouvement perturbé, au risque d'épuiser, contre d'invincibles obstacles, toutes les ressources de sa pénétration et l'opiniâtreté de sa patience ». Au contraire, la connaissance du mouvement elliptique conduisit à l'idée que les planètes étaient attirées par le soleil ; puis l'attraction s'étendit aux actions réciproques des planètes entre elles et avec le soleil ; et l'on eut les approximations successives de la mécanique céleste.
[FN: § 540-2]
On appelle souvent erreur cette omission volontaire de certains détails dans une première approximation, et l'on ne fait ainsi que confirmer le dicton que si la parole est d'argent, le silence est d'or. À un autre genre appartiennent le reproche de traiter l'une des parties de la science sociale séparément des autres, et l'objection que si l'on traite de l'une d'entre elles, sans parler en même temps d'une autre, c'est parce qu'on l'ignore ou qu'on la néglige (§ 33 et sv.) mais ces faits ont la même origine, savoir une présomptueuse ignorance du caractère des théories scientifiques, et de la nécessité de les construire au moyen de l'analyse. Toutefois, il faut remercier ces braves gens de ne pas étendre leurs reproches au delà des limites des sciences sociales ; car ils pourraient blâmer avec autant de raison celui qui écrit un traité d'économie, parce qu'il n'y insère pas un traité de l'art culinaire, qui pourtant, nul ne le conteste, est très utile pour agrémenter de la vie (Cours, I, p. 2, § 2 ; p. 14 § 34).
[FN: § 541-1]
G. SOREL; Quelques prétentions juives, dans L'Indépendance, 1er Mai 1912 : « (p. 217) Le plus souvent, lorsque nous cherchons à connaître le rôle historique d'un groupe humain, nous étudions des individus auxquels nous croyons pouvoir attribuer la faculté d'avoir représenté, d'une façon plus ou moins parfaite, les forces morales de la masse ; nous notons les sentiments, les vœux, les conceptions philosophiques que ces personnages exceptionnels ont exprimés ; nous construisons enfin, au moyen de ces éléments particuliers, la conscience des droits et des devoirs qui auraient existé, suivant notre appréciation, dans telle fraction du peuple ».
« Parfois on a voulu s'illusionner sur la sûreté des résultats obtenus par cette méthode, en disant que les hommes. représentatifs seraient entièrement déterminés par leur milieu... Quelques écrivains, admirant l'originalité dont ont fait preuve plusieurs de ces hommes représentatifs, virent, au contraire, en eux des génies créateurs ;... (p. 218) La vérité est évidemment entre ces deux opinions extrêmes... ».
[FN: § 541-2]
BERGK ; Poet. lyr. ; Scholia : « (9) Je porterai le fer dans les rameaux de myrte, comme Harmodius et Aristogiton, quand ils tuèrent le tyran et rendirent les Athéniens égaux devant la loi ». «(11) Je porterai le fer dans les rameaux de myrte, comme Harmodius et Aristogiton, quand, aux Panathénées, ils tuèrent Hipparque, le tyran ».
[FN: § 541-3]
G. SOREL; Le syst. hist. de Renan, t. 1.
[FN: § 541-4]
G. SOREL; Quelques prétentions juives. dans L'Indépendance, 1er Mai 1912 : « (p. 231) C'est bien le cas d'appliquer ces remarques judicieuses que fait Renan : « En histoire religieuse, un texte vaut, non pas ce que l'auteur a voulu dire, mais ce que le besoin du temps lui fait dire. L'histoire religieuse de l'humanité se fait à coups de contre-sens ». Et en note : « Renan; Histoire du peuple d'Israël. tome IV, p. 193. – Cette remarque s'applique aussi fort bien à l'histoire profane ; ainsi la social-démocratie a fait d'effroyables contre-sens pour se donner l'air de suivre les enseignements hégéliens ».
[FN: § 544-1] A. KARR ; Contes et nouvelles.
[FN: § 545-1]
HERONDAE ; Mimiambi, II (Crusius) : (16).
« Si alors, amenant un navire de Aché, il a apporté du grain et fait cesser la funeste famine... ». Une autre leçon (Blass) serait : « Si je n'ai pas, en amenant un vaisseau de Aché, apporté du grain et fait cesser la funeste famine... »
[FN: § 545-2]
Par exemple, L'Argent, de Zola, donne une idée synthétique assez approximative de la vie à la Bourse de Paris, au temps de l'Union générale. Bel Ami, de MAUPASSANT, donne une idée qu'on trouverait difficilement dans d'autres ouvrages, des spéculations des politiciens, au temps de l'occupation de Tunis par la France, et de la part qu'a la presse dans ces spéculations. On peut observer des faits semblables, au temps du conflit entre la France et le Maroc, à la suite du coup d'Agadir.
[FN: § 545-3]
Vers la fin du XVIIIe siècle, un peu partout dans les pays civilisés et spécialement en France, se produisit l'invasion de la doctrine qui veut que toutes les actions soient logiques, et qui place toute action non-logique parmi les « préjugés ». L'extension du phénomène s'aperçoit bien, quand on voit que l'invasion s'étend jusqu'aux romans. En voici un exemple. CRÉBILLON ; La nuit et le moment : « (p. 19) Cidalise. Au vrai, Clitandre, vous n'aimez donc pas Araminte ? (Clitandre hausse les épaules). Mais pourtant vous l'avez eue. – Clitandre. Ah! c'est autre chose. – Cid. En effet on dit qu'aujourd'hui cela fait une différence. –Clit : – Et je crois de plus que ce n'est pas d'aujourd'hui que cela en fait une. – Cid. Vous m'étonnez. Je croyais que c'était une obligation que l'on avait à la philosophie moderne. – Clit. Je croirais bien aussi qu'en cela, comme en beaucoup d'autres choses, elle a rectifié nos idées ; mais qu'elle nous a plus appris à connaître les motifs de nos actions et à ne plus croire que nous agissons au hasard, qu'elle ne les a déterminées. Avant, par (p. 20) exemple, que nous sussions raisonner si bien, nous faisions sûrement tout ce que nous faisons aujourd'hui ; mais nous le faisions entraînés par le torrent, sans connaissance de cause et avec cette timidité que donnent les préjugés. Nous n'étions pas plus estimables qu'aujourd'hui ; mais nous voulions le paraître, et il ne se pouvait pas qu'une prétention si absurde ne gênât beaucoup les plaisirs. Enfin, nous avons eu le bonheur d'arriver au vrai [le Vrai et la Vérité sont les grandes divinités de semblables religions] ; eh ! que n'en résulte-t-il pas pour nous ? Jamais les femmes n'ont mis moins de grimaces dans la société ; jamais l'on a moins affecté la vertu. On se plaît, on se prend. S'ennuie-t-on l'un avec l'autre ? on se quitte avec tout aussi peu de cérémonie que l'on s'est pris... Il est vrai que l'amour n'est pour rien dans tout cela, mais l'amour qu'était-il, qu'un désir que l'on se plaisait à s'exagérer, un mouvement des sens dont il avait plu à la vanité des hommes de faire une vertu ? [des auteurs plus sérieux avaient dit cela de l'instinct religieux et d'autres semblables]. On sait aujourd'hui que le goût seul existe... (p. 21) et je crois à tout prendre, qu'il y a bien de la sagesse à sacrifier à tant de plaisirs quelques vieux préjugés qui rapportent assez peu d'estime et beaucoup d'ennui à ceux qui en font la règle de leur conduite ». Ce passage a plus de valeur, pour la compréhension de la Révolution française, qu'un très grand nombre de descriptions de faits.
Les Misérables de Victor Hugo et, si l'on veut, les romans de George Sand, donnent une idée précise et claire des débordements de l'humanitarisme, dans les sociétés civilisées du XIXe siècle.
[FN: § 547-1]
Nous en avons fait usage implicitement, quand nous avons cherché dans quels rapports la méthode métaphysique était avec les faits expérimentaux. Cette méthode peut-elle ou non conduire à des résultats que l'expérience vérifie ensuite ?
Voyons des cas, comme ceux de la mécanique céleste, de la physique, de la chimie, où les résultats expérimentaux sont bien connus, et adoptons cette méthode; laissons-la même employer par Hegel, tant admiré des métaphysiciens. Si, dans ces cas, elle nous conduit à des conclusions en accord avec l'expérience, nous aurons lieu d'espérer qu'elle produira un effet semblable, quand nous l'emploierons en d'autres matières, comme la science sociale, où les vérifications expérimentales sont moins aisées. Si, au contraire, elle nous conduit, en mécanique céleste, en physique, en chimie, à des conclusions que l'expérience montre privées de sens, fantaisistes, absurdes, nous aurons lieu de craindre que son usage n'ait pas un meilleur sort dans les sciences sociales ou les sciences historiques (§ 484 et sv., 502 et sv., 514-2).
[FN: § 549-1]
Un éminent égyptologue, Édouard NAVILLE, fait, dans le Journal de Genève, 25 août 1912, une analyse du livre The life of a South African Tribe, by HENRI A. JUNOD, vol. I, The social life. Il écrit : « Un des côtés par lequel le livre de M. Junod peut être le plus utile à ceux qui s'adonnent à l'étude des langues très anciennes, c'est le langage. Les primitifs s'expriment presque toujours par métaphores. Tout ce qui, même de loin, se rapproche d'une idée abstraite, doit être rendu par quelque chose tombant sous les sens. D'autre part, tel acte tout à fait grossier ou élémentaire, peut être exprimé par le sens rituel ou religieux qu'on attribue à cet acte. Quiconque n'a pas la clef de ces énigmes risque de s'égarer complètement dans l'interprétation qu'il donne à ces mots ou à ces phrases. Voici, par exemple, un usage qui a été retrouvé dans les tombes égyptiennes, où l'on dépose avec le défunt des vases et des objets brisés. Les Bantou font de même ; ils brisent sur la tombe les objets sans valeur qui appartenaient au mort, surtout les vieux vases en terre, et les manches de zagaïes. Il faut que tout meure avec lui. Cet acte s'appelle « montrer sa colère à la mort ». Nous trouverions dans un texte égyptien ou assyrien une expression pareille « montrer sa colère à la mort », je doute fort qu'aucun philologue même le plus érudit arrivât à donner à cette expression le sens véritable : briser des pots de terre. Je crois que malheureusement dans nos traductions nous avons à nous reprocher de graves erreurs commises ainsi par ignorance. À mon sens c'est ce qui fait que beaucoup de textes égyptiens comme ceux des Pyramides ou le Livre des Morts, nous paraissent si souvent étranges, et même enfantins. Nous n'avons pas la clef des métaphores qui abondent surtout dans le langage religieux. L'ouvrage de M. Junod fourmille d'expressions de cette espèce. Il y en a à chaque page. Je n'en citerai ici que deux. « Manger les bœufs » veut dire accepter le prix d'achat, le « lobola » d'une femme qui se paie par deux, trois, jusqu'à dix de ces animaux. « Manger deux troupeaux » est une expression juridique qui veut dire accepter à tort deux « lobola ».
[FN: § 550-1]
C'est pourquoi j'ai cité, ici, avec beaucoup de précaution, les textes écrits en des langues que je ne connais pas. Ne sachant pas l'hébreu, j'espère que les traductions du Talmud que j'ai employées reproduisent au moins approximativement le texte ; mais je m'abstiens de toute conclusion qui dépendrait trop étroitement du sens précis de quelque terme.
Il serait très utile qu'une personne connaissant les langues orientales : l'arabe, le sanscrit, le chinois, le japonais, etc., nous donnât des traductions littérales, avec commentaires philologiques des passages de textes qui peuvent servir à la sociologie. Tant que cela ne sera pas fait, nous irons un peu à tâtons, dans l'usage que nous ferons des documents écrits en ces langues.
SUMNER MAINE; Early history of institutions, trad. DURIEU DE LEYRITZ. « (p. 14) Il y a cependant une cause plus permanente et plus sérieuse d'embarras pour celui qui veut asseoir des conclusions sur les lois irlandaises. Jusqu'à une époque relativement récente, elles étaient en fait inintelligibles, et c'est leurs premiers traducteurs... (p. 15) qui les ont rendues accessibles à tous. Leur traduction a été revue avec soin par le savant éditeur du texte irlandais ; mais il est probable que plusieurs générations d'érudits adonnés aux études celtiques auront à controverser sur les termes de ces lois avant que le lecteur qui les aborde sans aucune prétention à l'érudition celtique puisse être sûr de posséder le sens exact de chacun des passages qu'il a sous les yeux. …Quant à moi, je m'appliquerai à ne conclure que lorsque le sens et le sujet du texte paraîtront raisonnablement certains, et je m'abstiendrai de certaines recherches très séduisantes qui ne pourraient s'étayer que sur des fragments d'une signification douteuse ».
[FN: § 551-1]
SUMNER MAINE; loc., cit. 550-1 « (p. 354) Les savants auteurs des différentes introductions placées en tête de la publication officielle (p. 355) des anciennes lois de l'Irlande, sont intimement convaincus que la juridiction des tribunaux irlandais était – pour user d'un terme technique, – volontaire. Suivant cette façon de voir, les légistes brehons concevaient assez clairement le droit de saisie, mais c'étaient l'opinion publique et le respect populaire pour une caste professionnelle, qui assuraient dans la pratique l'observation de ce droit ». « (p. 51)... l'absence de toute sanction est souvent l'une des plus grandes difficultés qui s'opposent à l'intelligence du droit brehon. Qu'un homme désobéisse à la loi ou s'oppose à ce qu'elle soit appliquée, qu'arrivera-t-il ? Le savant auteur de l'une des préfaces modernes placées en tête du troisième volume soutient que le pivot du système brehon, c'est l'arbitrage, et je crois (p. 52) aussi que pour autant que ce système est connu, il justifie cette conclusion. Le but unique des Brehons était de forcer les plaideurs à déférer leurs querelles à un Brehon ou à quelque personne puissante conseillée par un Brehon ».
SUMNER MAINE ; Ancient law, trad. Courcelle Seneuil « (p. 7) Il est certain que, dans l'enfance du genre humain, on ne conçoit pas l'idée d'une législation quelconque, ni même d'un auteur déterminé du droit ; on n'y songe pas : le droit est à peine arrivé à l'état de (p. 8) coutume ; il est plutôt une habitude... Il est sans doute fort difficile pour nous d'entrer dans une conception si éloignée de nous dans le temps et par l'association d'idées à laquelle elle est liée... ».
[FN: § 557-1]
BERTRAND; Calcul des probabilités.
[FN: § 558-1]
BERTRAND ; Calcul des probabilités.
[FN: § 558-2]
Et pourquoi pas ? Deux individus n'ont en main ni éphémérides ni calendriers ; l'un dit à l'autre : « S’il pleut le mois prochain, tu me donneras dix francs ; s'il y a une éclipse de lune, je te donnerai la même somme ». Personne ne voudra accepter une semblable gageure, parce que, d'habitude, il est plus facile, en nos pays, de trouver un mois où il pleuve, qu'un mois où il y ait une éclipse de lune.
[FN: § 561-1]
Expliquer, explication, sont pris ici dans le sens d'indication de la cause, de l'origine, de la loi des phénomènes. Si, comme cela arrive quelquefois, on entendait par expliquer, explication, mettre un fait en relation avec d'autres semblables, nous ne serions plus dans le cas considéré ici, au texte, mais dans celui étudié aux § 556 et sv.
[FN: § 563-1]
P. MANSION; Calcul des probabilités « (p. 77) La déduction logique explicite, dit Newman... n'est pas ce qui nous donne la certitude dans le domaine des faits concrets [jusque là, c'est d'accord avec la science expérimentale, dans ce sens qu'il faut des prémisses expérimentales ; la logique seule ne donne rien]. Nous y arrivons, au contraire, par une accumulation de probabilités indépendantes entre elles [il y a là beaucoup de vrai] surgissant de la nature et des circonstances du fait examiné [et de nos investigations, des expériences, des observations] ; probabilités trop faibles pour agir, isolément sur notre esprit, trop fines, trop détournées pour être mises explicitement en syllogisme; trop nombreuses et trop variées d'ailleurs pour être ainsi transformées [c'est vrai en certains cas, faux en d'autres] ».
[FN: § 564-1]
P. MANSION; Calcul des probabilités : « (p. 78) Nous sommes tous certains, dit-il [Newman], sans aucune possibilité de doute, que l'Angleterre est une île. C'est là une proposition à laquelle nous donnons un assentiment complet... Nous ne craignons pas qu'aucune découverte vienne jamais ébranler notre croyance... Et cependant les arguments que nous (p. 79) pouvons faire valoir pour expliquer notre conviction sur ce point sont-ils en rapport avec l'extrême certitude que nous en avons ? On nous a dit dans notre enfance que l'Angleterre est une île ; elle est entourée par la mer sur toutes les cartes, jamais la chose n'a été mise en question devant nous [il devait ajouter : et pourtant c'était permis par les lois et les coutumes]... Mais nous n'en avons pas de preuve directe comme celui qui aurait fait le tour de l'Angleterre ; et nous n'avons peut-être même jamais rencontré quelqu'un qui l'ait fait [argument de peu de valeur : les choses que nous connaissons directement ou par témoignage direct, sont en très petit nombre en comparaison de celles dont nous avons une connaissance indirecte]. Est-ce à dire que notre conviction n'est pas raisonnable ? Nullement. Mais il est certain que nous ne pouvons que difficilement analyser d'une manière complète [et que peut- on bien faire d'une manière vraiment complète ?] les raisons de notre assentiment ».
[FN: § 583-1]
Saint Augustin distingue, il est vrai, l'autorité divine, de l'autorité humaine ; mais ensuite il montre lui-même que l'autorité divine ne nous est connue que par l'intermédiaire d'hommes et d'écrits. D. AUGUST.; De ordine, II, 9, 27 : Auctoritas autem partim divina, est, partim. humana : sed vera, firma, summa ea est quae divina nominatur. Mais il y a ces maudits démons qui induisent en erreur : In qua metuenda est aeriorum animalium mira fallacia, quae per rerum ad istos sensus corporis pertinentium quasdam divinationes, nonnullasque potentias decipere animas facillime consuerunt... Illa ergo auctoritas divina dicenda est, quae non solum in sensibilibus signis transcendit omnem humanam facultatem, sed et ipsum hominem agens, ostendit ei quousque se propter ipsum, depresserit. Humana vera suctoritas plerumque fallit... Mais comment pourrons-nous connaître l'autorité divine ? Voici la réponse : D. AUGUST.; De vera relig., 25, 46: Quid autem agatur [Deus] cum genere humano, per historiam commendari voluit, et per prophetiam. Temporalium. autem rerum fides, sive praeteritarum, sive futurarum, magis credendo quam intelligendo valet. Sed nostrum est considerare quibus vel hominibus vel libris credendum sit ad colendum recte Deum, quae una salus est.
[FN: § 585-1]
Parmi une infinité d'exemples, le suivant suffira. En Italie, le projet de donner à l'État le monopole des assurances sur la vie rencontra de l'opposition. Entre autres motifs opposés, on affirmait que les tables de mortalité employées parle gouvernement étaient inexactes. C'est là une controverse scientifique, exactement de la même nature que celle de Galilée avec l'Inquisition, au sujet du mouvement du soleil. Lorsque la loi eut été approuvée par le Parlement, toutes les controverses, même scientifiques, se trouvèrent résolues par cette approbation ; et le Giornale d'Italia, 16 septembre 1912, publiait la note suivante : « Comme on sait, le Giornale d'Italia n'a pas été favorable à la création du monopole des assurances, et fonda son opposition sur ces théories économiques que l'honorable député Nitti avait toujours affirmées avec conviction, sur d'évidentes raisons de justice, et enfin sur des considérations d'opportunité, qui devaient malheureusement peser d'un grand poids, ensuite de l'hostilité des financiers européens contre l'Italie, durant la guerre. Mais, en vertu de notre profond respect (ossequio), qui ne se démentit jamais, à l'égard des lois de l'État, notre opposition a cessé le jour même où le monopole des assurances fut approuvé par les deux branches du Parlement. Désormais l'Institut National des Assurances existe, et c'est un intérêt de l'État, c'est-à-dire de la collectivité nationale. Tous les Italiens aimant leur pays doivent donc souhaiter qu'il réponde réellement au but dans lequel l'État l'a créé : c'est-à-dire qu'il vulgarise la pratique utile des assurances, et devienne un puissant facteur de progrès économique pour notre pays », Il est impossible de trouver la moindre différence entre cette attitude et celle du catholique qui, après que le pape a prononcé ex cathedra, soumet à cette décision son jugement et sa volonté.
[FN: § 587-1]
VICTOR HENRY; Le Pars. « (p. 16) On sait que les Perses repoussent comme une affreuse profanation la crémation après décès. Ici encore, constatons l'accord de vue, que voile à peine un antagonisme tout superficiel. L'épithète courante de l'Agni védique est pavaka « le purificateur ». – Le feu est l'être pur par excellence, disent les brâhmanes : il faut donc que le corps passe par le feu et y laisse toutes ses souillures, pour que le défunt entre pur au royaume éternel de Yama ; après quoi, le feu ainsi contaminé perdra ses qualités nocives par la vertu d'une lustration rituelle. – Le feu est l'être pur par excellence, ripostent les mazdéens : qui donc oserait en outrager la sainteté, en lui infligeant l'abominable tâche de dévorer ce qu'il y a sur terre de plus immonde, un cadavre en voie de corruption ? – La mystique est coutumière de ces raisonnements poussés à l'outrance, où les extrêmes se touchent ».
[FN: § 587-2]
OLDENB.; La rel. du Veda, p. 288.
[FN: § 587-3]
SONNERAT; Voy. aux Ind. or., t. I. L'auteur observe que : « (p. 85 note) les Brames sectateurs de Vichenou croient que le feu les purifie de leurs péchés ; ceux de Chiven prétendent qu'étant consacrés au service de Dieu, ils n'ont pas besoin de passer par le feu, et que le mal qu'ils ont fait ne peut leur être imputé ; qu'il leur suffit d'être arrosés d'eau lustrale, dont ils usent en abondance ».
[FN: § 587-4]
Anth. Palat., Epigr. sepul., 162. Pline raconte que Tiridate ne voulut pas venir à Rome par mer, pour ne pas souiller l'eau par les besoins naturels de l'homme. PLIN.; Nat. Hist., XXX, 6 : Navigare noluerat, quoniam exspuere in maria, aliisque mortalium. necessitatibus violare naturam eam fas non putant.
[FN: § 587-5]
CHARDIN ; XVII : « (p. 9)... je décrirai ici le cimetière qu'ils ont proche d'Ispahan, à demi-lieue de la ville, dans un lieu fort écarté. C’est une tour ronde, qui est faite de grosses pierres de taille ; elle a environ trente-cinq pieds de haut, et quatre-vingt-dix pieds de diamètre, sans porte et sans entrée... Quand ils portent un mort dans ce tombeau, trois ou quatre de leurs prêtres montent avec des échelles sur le haut du mur, tirent le cadavre avec une corde, et le font descendre le long de ce degré... (p. 10) Il y a... une manière de fosse au milieu, que je vis remplie d'ossements et de guenilles. Ils couchent les morts tout habillés sur un petit lit... Ils les rangent tout autour contre le mur, si serrés qu'ils se touchent les uns les autres... (p. 11) J'y vis des corps encore frais ; il n'y avait rien de gâté aux mains et aux pieds, qui étaient nus ; mais le visage l'était beaucoup, à cause que les corbeaux qui remplissent le cimetière, et qui sont par centaines aux environs, se jettent d'abord sur cette partie. À cinquante pas de ce sépulcre, il y a une petite maison de terre... d'où le principal prêtre se met à observer par quel endroit et comment les corbeaux entameront ce corps. Comme il y en a toujours beaucoup autour de ce cimetière, à cause des cadavres qui y sont exposés à découvert, il ne manque point d'en venir fondre bientôt quelqu'un dessus, et de s'attacher d'abord aux yeux, à ce que l'on assure, comme une partie délicate, que ces oiseaux carnassiers aiment plus que le reste. Le prêtre, qui fait ses observations par un petit trou, pour ne pas effaroucher l'oiseau funèbre, prend garde à quel œil il touche le premier, et dans quelles circonstances ; et il en tire ses conjectures, tant pour la condition du défunt dans l'autre vie que pour la fortune de ses enfans et de ses héritiers dans celle-ci. Le côté droit est dit-on le bon côté... C'est ce que l'on assure généralement dans tous les pays où il y a des Guèbres ; mais j'en ai vu quelques-uns qui m'ont pourtant nié toute cette magie ou superstition ».
[FN: § 594-1]
Restreintes aujourd'hui à la métaphysique et à ses appendices en science sociale, les controverses sur ces correspondances des concepts avec la réalité objective étaient autrefois en grand usage dans les sciences naturelles : la géographie même fut affectée de cette maladie.
STRAB. ; 1, 4, 7-8, p. 66-67, cite Ératosthène, qui estimait vaines et frivoles les disputes ayant pour but de fixer avec précision les limites des continents, parce que là où il n'y a pas de termes précis, on ne peut diviser la terre avec précision. Mais Strabon le gourmande et lui dit entre autres :
; «Qui est-ce qui, comptant trois parties et nommant chacune des parties, ne concevait pas d'abord l'entier dont il faisait ces parties ? » Il ajoute ensuite un motif passablement comique : s'il y a deux princes, dont l'un prétend posséder toute la Lybie, l'autre toute l'Asie, il faut décider à qui appartiendra la basse Égypte. Voilà un joli cas d'amnésie. Strabon, qui vivait au temps de l'empire romain, aurait pu se rappeler que ces controverses se résolvent par les armes, et non par les raisonnements des géographes.
[FN: § 597-1]
KANT; Principes métaphysiques de la Morale, trad. Tissot, Paris 1854, 3e éd.
[FN: § 599-1]
DESCARTES; Disc. de la méth., IVe partie.
[FN: § 601-1]
SPINOZA. : Les princ. de la phil. de Desc., IIe partie, prop. XI ; scolie.
[FN: § 605-1]
Acta et dec. sacr. oecum. conc. vat., c. II : Eadem sancta mater Ecclesia tenet et docet, Deum, rerun omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse ; ... attamen placuisse eius sapientiae et bonitati, alia, eaque supernaturali via, se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare...
[FN: § 605-2]
Acta et dec. sacr. oecum. conc. vat., c. IV : (p. 134) De fide et ratione. Hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis, non solum principio, sed obiecto etiam distinctum : principio quidem, quia in altero naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus, obiecto autem, quia praeter ea, ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt. ...(p. 135) Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest. Et voici le motif a priori pour lequel cela doit être : cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit ; Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam contradicere. Et nous voilà de nouveau dans les tautologies. Personne ne dit que le vrai peut contredire le vrai ; mais on dit que l'une des deux choses réputées vraies ne l'est pas. Toutes ces explications sont d'ailleurs inutiles pour qui admet que Dieu est tout puissant : il suffit de dire que Dieu l’a voulu ainsi. Pourquoi donc ces subtilités ? Parce que l'homme a un besoin de logique qu'il faut satisfaire d'une façon quelconque : (p. 135) Neque solum fides et ratio inter se dissidere nunquam possunt, sed opem quoque sibi mutuam ferunt, cum recta ratio fidei fundamenta demonstret, eiusque (p. 136) lumine illustrata rerum divinarum scientiam excolat... (p. 139) Canones, III, De Fide, 3. Si quis dixerit. revelationem, divinam externis signis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere ; anathema sit.
[FN: § 606-1]
D. THOM.; De ver. cath. fid. contra Gentiles, I, proem., 7, 1. Ea enim, quae naturaliter rationi sunt insita, verissima esse constat, in tantum ut nec ea esse falsa sit possibile cogitare [c'est là le principe de toute métaphysique, sans lequel elle ne peut subsister] ; nec id quod fide tenetur, cum tam evidenter divinitus confirmatum sit, fas est credere falsum [mais les incroyants nient justement que Dieu ait évidemment confirmé ce que les croyants admettent]. Quia igitur solum falsum vero contrarium est, ut ex eorum. diffinitionibus inspectis manifeste apparet, impossibile est illis principiis, quae ratio naturaliter cognoscit, praedictam veritatem fidei contrariam esse.
[FN: § 608-1]
TERTULL.; Apolog., II.
[FN: § 608-2]
D. THOM. ; Summa theol., IIa IIae. q. CLIV, 2, 1. Quia apud gentiles fornicatio simplex non reputabatur illicita propter corruptionem naturalis rationis ; Iudaei, autem ex lege divina instructi, eam illicitam reputabant.
[FN: § 611-1]
PIEPENBRING; Théol. de l’anc. test.: « (p. 22) Si cette idée que Jéhova seul est le Dieu d'Israël et que les Israëlites ne doivent point adorer d'autres dieux, peut être ramenée à Moïse, nous ne pouvons pas faire remonter jusqu'à lui le monothéisme absolu, qui n'apparaît sûrement en Israël que beaucoup plus tard. Nous voyons, en effet, que non seulement le peuple, mais les rois et Salomon lui-même, qui avait fait construire un temple à Jéhova, s'adonnaient au culte des dieux étrangers ou le favorisaient. Cela prouve qu'ils attribuaient une existence réelle à ces dieux... (p. 94) Schultz dit avec raison que, en vertu du réalisme puissant de l'antiquité, l'impression première ne pouvait pas être que les dieux étrangers n'étaient que des produits de l'imagination... ». On comprend que, pour Piepenbring, le seul vrai Dieu est celui d'Israël, et que les autres sont faux ; mais on comprend moins comment il croit pouvoir le prouver en repoussant l'origine surnaturelle de la Bible. Si nous devons nous en tenir à l'expérience interne, pourquoi celle de Piepenbring vaut-elle mieux qu'une autre, qui donne des conclusions opposées ?
[FN: § 612-1]
Theaet., p. 153.
[FN: § 612-2]
PLAT.; Crito, p. 44. Socrate, parlant du plus grand nombre, en dit :
« Puisqu'ils ne peuvent faire que quelqu'un soit sage ou inintelligent, ils agissent au hasard ».
Si le Lachès n'est pas de Platon, il exprime d'autre part des idées platoniciennes, et cela nous suffit. Dans ce dialogue, Socrate dit d'une manière claire et nette qu'on ne doit pas prendre garde au jugement du plus grand nombre. Lachès, p. 184. « Socrate. Donnerais-tu ton assentiment à ce que le plus grand nombre d'entre nous louerait, Lysimaque ? – Lysimaque. Que pourrais-je faire d'autre, Socrate ? – Toi aussi, Mélésias, tu le ferais ? Si tu voulais prendre conseil au sujet des exercices gymnastiques de ton fils, accorderais-tu ta confiance à la majorité d'entre nous, plutôt qu'à une personne formée et exercée par de bons maîtres ? – Mélésias. J'accorderais ma confiance à ceux-ci, Socrate. » ... « Socrate : Je pense, en effet, qu'il convient de juger suivant la science et non d'après le nombre, si l'on veut juger correctement ».
[FN: § 612-3]
RITTER ; Hist. de la Philosophie, t. II. « (p. 185)... il [Platon] conseillait de s'en tenir à ce qui, dans l'opinion, semble devoir être regardé comme légitime, afin de le soumettre ensuite à un examen sévère pour en faire le commencement de la philosophie. Platon considère les déterminations d'idées données dans l'opinion comme un commencement convenable pour la recherche philosophique ».
[FN: § 615-1]
Les théories qu'expose LUCRÈCE, suivant celles d'Épicure, n'ont que peu ou point de valeur expérimentale ; mais il y a du vrai dans ce qu'en dit Lucrèce, spécialement s'il s'agit, non des théories d'Épicure, seules, mais des doctrines philosophiques en général ; 1.I :
(63) Humana ante oculos fede quom vita iaceret
In terris, oppressa gravi sub Religione,
.............................................
(67) Primum Graius homo mortaleis toliere contra
Est oculos ausus primusque obsistere contra :
.............................................
Quare Religio, pedibus subiecta, vicissim.
Obteritur, nos exaequat victoria coelo.
« Quand on voyait la vie humaine se traîner à terre, lourdement opprimée sous la Religion... Un Grec, le premier, homme mortel, osa lever les yeux contre elle, et, le premier, lui résister... C'est pourquoi la Religion, jetée sous les pieds, fut à son tour foulée, et la victoire nous égala au ciel » .
[FN: § 618-1]
V. PARETO; Le mythe vertuiste.
[FN: § 618-2]
C'est ainsi que plusieurs Italiens ont dû vivre à l'étranger. En Prusse, les socialistes sont exclus de l'enseignement universitaire. En France, les hérétiques de la religion radicale- humanitaire sont persécutés de toute façon. C'est ainsi qu'on refusa une chaire au Père Scheil. J. Morgan, qui est l'une des meilleures autorités en fait d'assyriologie, dit de lui : « À peine compte-t-on aujourd'hui, en Europe, quatre ou cinq de ces savants [des assyriologues] dont l'opinion fasse autorité et, parmi eux, est V. Scheil que j'ai la bonne fortune et l'honneur d'avoir pour collaborateur dans mes travaux en Perse. Son nom restera à jamais attaché à sa magistrale traduction des lois de Hammourabi et au déchiffrement des textes élamites, tour de force accompli sans l'aide d'un bilingue ». (Les premières civilisations : p. 36). On refusa à ce savant la chaire d'assyriologie au Collège de France, sous prétexte qu'étant un religieux, il n'aurait pas eu l'impartialité nécessaire pour traiter les matières qui ont rapport avec les études bibliques. Mais ensuite, sans se préoccuper le moins du monde de la criante contradiction, on oublia un semblable prétexte, afin de pourvoir de la chaire d'histoire des religions l'ex-abbé Loisy, connu spécialement par sa violente polémique contre le catholicisme. Il ne peut donc y avoir doute que dans ces deux cas parallèles, on ait voulu punir l'adversaire et récompenser l'ami qui désertait le camp ennemi, Mme Curie fut repoussée par l'Académie des Sciences, pour des motifs qui n'avaient rien de scientifique.
[FN: § 619-1]
SUMNER MAINE; Ancient Law, trad. COURCELLE SENEUIL, c. 1. L'auteur affirme que la poésie homérique contient l'indication des formes primitives des concepts juridiques. (p. 3) « Si nous pouvons parvenir à déterminer les formes primitives des concepts juridiques, ce sera au moyen de ces poèmes (a) ; les idées rudimentaires du droit sont pour le juri-consulte ce que les couches primitives de la terre sont pour le géologue (b) : elles contiennent en puissance toutes les formes que le droit a prises plus tard (c). La légèreté ou les préjugés qui se sont opposés à ce qu'on les examinât sérieusement, doivent porter le blâme de la condition peu satisfaisante dans lequel se trouve la science du droit (d) . En réalité, les recherches du juriste sont conduites comme l'étaient celles du physicien et du physiologue, lorsque l'observation n'avait pas encore remplacé l'affirmation hypothétique (e). Des théories plausibles et intelligibles (f), mais sans vérification d'aucune sorte, comme celle du droit naturel ou du contrat social (g), sont généralement préférées à de sérieuses recherches sur l'histoire primitive de la société et du droit (h) ; et elles obscurcissent la vérité, non seulement en éloignant l'attention du point où la vérité se trouve, mais par l'influence très réelle et très importante qu'elles exercent sur les développements postérieurs de la jurisprudence, lorsqu'on les a une fois acceptées et qu'on y croit (i) »
Ce passage renferme un mélange d'assertions en accord avec les faits et d'autres qui ne le sont pas. Il sera utile de les séparer, parce que cet exemple s'appliquera à d'autres cas analogues. Nous allons le faire en présentant les observations suivantes. (a) Affirmation douteuse. Les poèmes homériques furent très remaniés. Il y a maintenant des personnes qui prétendent qu'ils ne sont pas du tout archaïques. Voir : MICHEL BRÉAL ; Pour mieux connaître Homère. L'auteur résume ainsi le but de son ouvrage : (p. 5) « Je voudrais essayer de montrer que l'épopée grecque appartient à un âge de l'humanité qui est déjà loin de l'enfance, et qu'elle représente une civilisation nullement commençante ». J'avoue que je ne suis pas du tout persuadé par les raisonnements de l'auteur ; mais d'autres pourraient l'être. Ce serait donc sur des fondements peu solides que Sumner Maine voudrait édifier exclusivement la science du droit. Cette observation est générale et s'applique à tous les cas dans lesquels on veut expliquer ce qui est bien connu par ce qui l'est moins. (b) Admettons-le ; mais poursuivons l'analogie. Toute l'histoire de la terre ne peut pas nous faire connaître la composition des roches ; il faut que la chimie intervienne (c) They contain, potentially, all the forms in which law has subsequently exhibited itself. Cette expression : potentially est purement métaphysique ; elle vient entacher un raisonnement que l'auteur donne comme étant seulement expérimental. (d) Cela est juste et vrai aussi pour l'économie et la sociologie. (e) Idem. (f) Intelligibles oui, parce qu'en accord avec les sentiments, mais pas avec l'expérience. L'auteur aurait fait cette distinction très importante, si, au lieu de ne s'arrêter qu'à la méthode historique, il avait pensé à la méthode expérimentale. (g) Ce n'est pas seulement que la vérification manque, mais les termes employés ne correspondent à rien de réel. L'auteur a été induit en erreur comme en (f) (h) Il faut dire : « sont préférées à de sérieuses recherches expérimentales ». (i) Très juste, si l'observation se rapporte à la méthode expérimentale.
[FN: § 620-1]
TERTULL. ; Apol., XX : Plus iam offerimus pro ista dilatione maiestatem seripturarum, si non vetustate divinas probamus, si dubitatur antiquitas. [La preuve de l'antiquité, pour donner de l'autorité] ... ... Coram sunt quae docebunt, mundus et saeculum et exitus. Quicquid agitur, praenuntiabaturm; quicquid videtur, audiebatur [comme d'habitude, les preuves font défaut, car celles qui suivent n'en sont certes pas]. Quod terrae vorant urbes, quod insulas maria fraudant, quod externa atque interna bella dilaniant, quod regnis regna compulsant, quod fames et lues et locales quaeque clades et frequentiae plerumque mortium vastant, quod humiles sublimitate, sublimes humilitate mutantur... Il en coûtait peu de prédire des choses fréquentes en ces temps-là. Apollon avait été plus précis : il avait prophétisé les défaites de Crésus et de Pyrrhus, et beaucoup d'autres beaux événements.
[FN: § 620-2]
DRAPER ; Les conf. de la se. et de la rel. « (p. 48) La plus étrange partie de tout ce présomptueux système [la science chrétienne] était encore sa logique et la nature de ses preuves. Celles-ci reposaient toujours sur le miracle. On supposait un fait prouvé par quelque fait extraordinaire mais différent ! Un écrivain arabe, parlant de cela, dit : « Si quelqu'un m'affirme que trois sont plus que dix et ajoute : en preuve de ceci, je vais changer ce bâton en serpent ; je peux admirer son adresse, mais je ne serai certainement pas convaincu ». Et cependant, pendant plus de mille ans, ce fut là la logique courante acceptée dans toute l'Europe. Des propositions absurdes étaient acceptées sur des preuves non moins absurdes ».
[FN: § 623-1]
GALLUPPI ; Elementi di teol. nat. § 43. – Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Foi, IX, : « (p. 32) Voyons donc quelle est la série des faits, quelle est la masse des motifs, quelle est l'armée de témoins qui fondent la conviction du Chrétien affirmant que Jésus de Nazareth est l'envoyé de Dieu, est Dieu même. Ce sont les prophéties, les miracles, l'expérience personnelle de chaque Chrétien [tautologie : celui qui croit tient pour valable ce qu'il croit], l'histoire générale du monde ». Les prophéties et les miracles sont une concession à l'expérience, « Cependant la foi des Chrétiens a encore une base qui surpasse par sa profondeur et son étendue toutes les autres [preuve métaphysique, supérieure à l'expérience, par sa nature propre] : c'est l'expérience intime de la vérité que fait en lui-même tout homme qui suit la doctrine évangélique et les ordonnances du ciel ». Et voici que les modernistes retournent maintenant cette preuve contre les catholiques, qui, pour se défendre, doivent faire appel à la tradition et à l'histoire. L'impératif catégorique est aussi le produit « de l'expérience » que fait en lui-même tout homme qui suit la doctrine kantienne et les ordres de la raison pure ; mais il ne prouve rien à qui ne se soucie ni de Kant ni de sa raison pure. Une autre superbe tautologie est la suivante: « L'histoire. Le terme de cette certitude est l'unité de la doctrine chrétienne, et cette doctrine une s'établit pendant deux siècles, à travers des obstacles sans nombre... ». Personne ne peut nier qu'en tout temps il y a eu des divergences d'opinions entre les chrétiens ; mais si nous appelons orthodoxe une de ces opinions, et les autres hérétiques, nous pourrons affirmer l'unité de la foi,.. parce que nous aurons préalablement exclu ce qui la rendait multiple.
[FN: § 624-1]
J. CALVIN ; Inst. de la relig. chrest., I, 7, 5 : « (t. I, p. 26) Ainsi que ce poinct nous soit résolu, qu'il n'y a que celuy que le sainct Esprit aura enseigné, qui se repose en l'Escriture en droicte fermeté : et combien qu'elle porte en soy sa créance pour estre reçue sans contredit, et n'estre submise à preuves et argumens [nous sommes donc bien en dehors du domaine logico-expérimental] : toutesfois que c'est par le tesmoignage de l'Escriture qu'elle obtient la certitude, qu'elle mérite. Car jà soit qu'en sa propre majesté [et s'il y a des gens qui ne la voient pas !] elle ait assez dequoy estre révérée : neantmoins elle commence lors à nous vrayment toucher, quand elle est scellée en nos coeurs par le Sainct Esprit [il pouvait dire sans tant de longueurs : y croit qui y croit!]. Estans donc illuminez par la vertu d'icelay, desjà nous ne croyons pas ou à nostre jugement, ou à celuy des autres, que l'Escriture est de Dieu : mais par-dessus tout jugement humain nous arrestons indubitablement qu'elle nous a esté donnée de la propre bouche de Dieu, par le ministère des hommes. ...Nous ne cherchons point ou argumens ou véri-similitudes, ausquelles nostre jugement repose : mais nous luy submettons nostre jugement et intelligence, comme à une chose eslevée par-dessus la nécessité d'être jugée ». Qu'il est donc prolixe, ce brave homme ! Il pouvait dire tout cela en beaucoup moins de mots ; mais il en emploie un grand nombre, parce que c'est une musique qui plaisait à ses lecteurs.
[FN: § 624-2]
J. GOUSSET; Théol. dogmat., t. I : « (p. 156, § 281) Ire Règle. L'Écriture doit être interprétée, non par la raison (p. 157) seule, comme le prétendent les sociniens et les rationalistes modernes ; ni par des révélations immédiates, comme l'ont rêvé quelques sectaires enthousiastes ; ni par un secours spécial et individuel du Saint-Esprit, donné à chaque particulier, comme le veulent les luthériens et les calvinistes, mais suivant l'enseignement de l'Église catholique ». C'est-à-dire qu'on substitue l'autorité au principe métaphysique. Tous deux sont étrangers à la science logico-expérimentale.
[FN: § 624-3]
J. CALVIN ; Inst. de la relig. chrest., I, 8, 4 « (t. I, p. 25) Néantmoins ceux qui veulent et s'efforcent de maintenir la foy de l'Escriture par disputes pervertissent l'ordre. Il est vray qu'il y aura tousjours assez de quoy rembarrer les ennemis ; et de moy... toustefois si j'avoye à désmesler ceste querele avec les plus fins contempteurs de Dieu qu'on pourroit trouver, et qui appètent d'estre veus bons cavillateurs, et fort plaisanteurs en renversant l'Escriture, j'espère qu'il ne me seroit pas difficile de rabatre tout leur caquet : et si c'estoit un labeur utile de réfuter toutes les faussetez et malices, et je n'auroye pas grand'peine à monstrer que toutes leurs vanteries qu'ils ameinent en cachete ne sont que fumées ». Ibidem : « (p. 25, § 4) ... Il est bien vray que quand je voudroye débatre ceste cause par raisons et argumens, je pourroye produire en avant plusieurs choses pour approuver que s'il y a un Dieu au ciel, c'est de Luy que la Loy et les Prophéties sont sorties. Mesmes quand tous les plus savans et les plus habiles du monde se lèveroyent à l'encontre, et appliqueroyent tous leurs sens pour se faire valoir à l'opposite, toutesfois sinon qu'ils fussent endurcis à une impudence désespérée, on leur arrachera ceste confession, qu'on voit par signes manifestes que c'est Dieu qui parle par l'Escriture... ». Ainsi l'on prouve ce qu'on veut. Ceux qui ne pensent pas comme Calvin, sont « endurcis à une impudence désespérée » ; de quoi il résulte à l'évidence que tous les hommes qui ne sont pas si impudents pensent comme lui. Et il y a des gens qui admirent ces raisonnements !
[FN: § 625-1]
Dans le seul chapitre dont les citations précédentes sont tirées, nous trouvons : I, 7, 1 : (p. 23) ... ainsi ces vileins sacriléges ne taschans sinon à eslever une tyrannie desbordée sous ce beau tiltre d'Eglise... (2) Or tels brouillons... C'est doncques une resverie trop vaine d'attribuer à l'Eglise puissance de juger l'Escriture… Quant à ce que ces canailles (sic!) demandent dont et comment nous serons persuadez que l'Escriture est procédée de Dieu... (8)... il est aisé d'apercevoir combien telle application est sotte et perverse... (p. 25, § 4)... Mais encore que nous ayons maintenu la sacrée Parole de Dieu contre toutes détractions et murmures des meschans... ». Et, au chapitre suivant (I, 8) : « (p. 81, § 8) Je sais bien qu'ont accoustumé de gazouiller certains brouillons... (9) Ce que ces canailles amènent du livre des Machabées... ». De même, le sénateur Bérenger dénonce au procureur de la République les adversaires qu'il n'est pas en mesure de réfuter.
[FN: § 627-1]
G. FULLIQUET ; Les exp. du chr., : « (p. 202) Seulement, les nécessités de l'époque de la Réformation et l'obligation de soutenir la polémique catholique ont amené les Réformateurs à insister beaucoup sur la valeur de la Bible, seule autorité suffisante, assez reconnue des adversaires pour pouvoir être opposée à l'autorité ecclésiastique de la tradition [ici l'auteur refait un peu l'histoire à sa façon]. En apparence les Réformateurs se bornent à substituer la Bible à l'Église sans changer la conception catholique de la foi : acceptation et maintien de doctrines par confiance, non plus en l'Église, mais en la Bible… La foi n'est pas plus la confiance en la Bible qu'elle n'était la confiance en l'Église. La foi n'est pas acceptation de doctrines. La foi c'est la confiance du cœur en Dieu et en Christ. (p. 203) Seulement, pour la foi, la Bible a un rôle essentiel à jouer : la Bible met à notre portée les expériences religieuses dans la personne des serviteurs de Dieu, qui les ont trouvées dans le passé ; ... la Bible reste à jamais, non l'autorité, ce qui en ce domaine ne signifie rien, mais l'influence souveraine en matière de foi. Mais la Bible n'a aucune autorité quelconque en matière de croyance [c'est ainsi qu'on se débarrasse des contradictions, hélas! importantes et nombreuses, entre l'Écriture Sainte et les faits], car la croyance n'est jamais et ne peut être que l'expression des expériences de la foi, de la vie de la foi ». Cette obstination à nommer expérience ce qui n'a rien de commun avec l'expérience des sciences naturelles a pour but, peut-être à l'insu de celui qui emploie ce terme, de faire tourner à son profit les sentiments d'approbation qui, à notre époque, entourent l'étude des sciences naturelles.
[FN: § 628-1]
PIEPENBRING; Théol. de l'anc. Test.
Notes du Chapitre V. – Les théories pseudo-scientifiques (§633 à §841), pp. 345-449↩
[FN: § 639-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Le droit est l'une des disciplines les plus riches en raisonnements de cette sorte. Un des meilleurs exemples qu'on y puisse trouver est l'abondante littérature consacrée à l'étude de la cause dans les contrats. PLANIOL. Traité élém. de dr. civ., t. II, IIIe part., chap. IV, fait justice de la doctrine française, mais ne semble pas voir pourquoi toutes ces discussions sont oiseuses. Il résume ainsi son opinion : « (p. 352, N° 1037). La théorie de la cause, telle que la doctrine française l'a construite a un double défaut : 1° elle est fausse, au moins dans deux cas sur trois ; 2° elle est inutile ». On n'a jamais eu de peine à trouver en défaut n'importe laquelle de ces théories sur la cause des contrats : elles sont toutes éphémères ; mais la persistance avec laquelle on les rajeunit montre la ténacité des conceptions métaphysiques, en droit.
[FN: § 647-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Voir entre autres : Grand Larousse illustré, s. r. Tartufe.
[FN: § 647-2]
E. FOURNIER ; L'esprit des autres.– Ibidem – « (p. 36) J'en connais qui se fâcheraient tout rouge si j'allais leur soutenir que tel vers n'est pas de leur cher Despréaux. Dites, par exemple, à l'un ou l'autre de ces routiniers opiniâtres, que le vers célèbre
La critique est aisée, et l'art est difficile
n'est pas dans l'Art poëtique, et vous verrez la belle querelle qu’ils vous feront. Ils égrèneront vers par vers les quatre chants du (p. 37) poème, voire toutes les œuvres du poëte, et non seulement ils ne trouveront pas celui qu'ils cherchent, mais ils en découvriront même certains au passage qui en sont la contre-partie... N'importe, ils ne s'avoueront pas battus pour si peu, et soutiendront de plus belle que leur vers chéri est de Boileau, et qu'il est dans l'Art poëtique... parce qu'il devrait y être ».
[FN: § 647-3]
Cité de FOURNIER; L'esprit dans l'histoire. L'auteur ajoute dans une note : « D'après le compte-rendu du Journal des Débats du même jour (10 mars 1833), M. de Montlosier fit un signe affirmatif. – Les Mémoires de Bailly, publiés en 1804, t. I, p. 216, ne rapportent les paroles de Mirabeau, ni comme on les répète ordinairement, ni comme elles sont reproduites ici. Les Éphémérides de Noël, au contraire (Juin, p. 164), consacrent dès 1803 la version donnée par M. de Dreux-Brézé ».
[FN: § 648-1]
DUGAS-MONTBEL : Obs. sur l'Iliade : « III, 8-9. Platon, dans sa République... cite, en y faisant un léger changement, le vers 8... Il est probable que Platon citait de mémoire. Cependant, on peut supposer aussi qu'alors le texte d'Homère n'était pas précisément ce qu'il est aujourd'hui. Au reste, Strabon, qui cite le vers 8, et Aulu-Gelle, qui cite les vers 8 et 9, donnent l'un et l'autre des textes conformes à nos éditions. – IV, 431. J'ai déjà fait observer que Platon, qui sans doute citait Homère de mémoire, liait le commencement de ce vers au vers 8 du IIIe chant de l'Iliade. – IX, 591-4. Aristote, en rapportant ce passage, ne le donne pas exactement tel qu'il se trouve dans nos éditions... Il est possible que l'Homère d'Aristote différât dans ce passage de celui que nous avons aujourd'hui... Cependant, je crois qu'ici la différence entre les deux textes tient à ce qu'Aristote citait de mémoire, comme nous l'avons dit de Platon ».
[FN: § 649-1]
Parmi tant d'exemples qu'on pourrait donner, le suivant suffira : HAGENMEYER ; Le vrai et le faux sur Pierre l'Hermite : « (p. 2) Lorsqu'on a sous la main, d'une part des documents [de l'histoire des Croisades] attribués à des auteurs des XI, et XII, siècles, que l'on doit considérer comme des sources provenant de témoins oculaires, et d'autre part une relation des mêmes faits écrite à une époque postérieure, il suffit de les rapprocher pour s'apercevoir que souvent la tradition a été complètement dénaturée ; c'est un fait dont chacun peut faire l'expérience ; il n'est même pas rare que, sous les ornements légendaires dont est surchargé le récit moderne, on ait peine à retrouver la relation primitive, et si l'on est réduit à lui seul, il devient bien difficile d'y retrouver le fonds de vérité historique qui s'y trouve contenu ».
[FN: § 649-2]
Recueil des historiens des Croisades; Historiens orientaux, t. V.
[FN: § 652-1]
Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John - In two parts – By Sir ISAAC NEWTON – London ; J. Darby and Browne in Bartholomew Close ; 1733. L'auteur dit que Daniel est facile à comprendre : ...amongst the old Prophets, Daniel is most distinct in order to time, and easier to be understood (p. 14). – C'est ainsi qu'il prédit clairement la destruction de l'empire romain ; (cap. VI) On the ten Kingdoms represented by the horns of the fourth Beast.
Now by the war above described the Western Empire of the Romans, about the time that
Rome was besieged and taken by the Goths, became broken into the following ten Kingdoms.
1. The Kingdom of the Vandals and Alans in Spain and Africa.
2 « ... « Suevians in Spain.
3. « ... « Visigots.
4 « ... « Alans in Gallia.
5. « ... « Burgundians.
6. « ... « Franks
7. « ... « Britains.
8 « ... « Hunns.
9. « ... « Lombards.
10. « ... « Ravenna.
Seven of these Kingdoms are thus mentioned by Sigonius... and the Franks, Britains, and Lombards, and you have the ten : for these arose about the same time with the seven (p. 46-48).
[FN: § 652-2]
P. OROSII Hist. ad. pag., I, II : Item anno ante Urbem conditam DCCLXXV [admirez quelle précision !] inter Danai atque Aegypti fratrum filios quinquaginta parricidia una, nocte commissa sunt. I, 17 : At vero ante Urbem conditam CCCCXXX anno raptus Helenae, coniuratio Graecorum et concursus mille navium, dehinc decennis obsidio ac postremo famosum Troiae excidium praedicatur. – CLEM. ALEX.; Strom., I, 21, a de belles et nombreuses connaissances en chronologie ! Par exemple, sous Lyncée, on a le rapt de Proserpine, la fondation du temple d'Éleusis, l'agriculture de Triptolème, l'arrivée de Cadmus à Thèbes, le règne de Minos ; et il continue à citer des dates fantaisistes.
[FN: § 653-1]
LARCHER; Hist. d’Her., t. VII – Idem (p. 576) Les femmes de Lemnos, outrées de la préférence des Lemniens pour leurs concubines, massacrent leurs maris. Années av. J. C. 1355... Œdipe, fils de Laïus, épouse Jocaste sa mère, sans la connoitre, et monte sur le trône. Années av. J. C. 1354 ». Et ainsi de suite.
[FN: § 654-1]
Guill. le Bret., apud GUIZOT. Puis notre auteur dit : « (p. 185) Francion, avec son peuple, parvint jusqu'au Danube, bâtit une ville, appelée Sicambrie, et y régna... Deux cent trente ans s'étant écoulés, vingt-trois mille d'entre eux les quittèrent. [Quel savant auteur ! Il sait l'année de l'émigration et le nombre des émigrants !], sous la conduite d'Hybor... ils vinrent dans la Gaule. Là ayant trouvé un endroit très agréable et très commode sur la Seine, ils y bâtirent une ville, qu'ils appelèrent Lutèce, à cause de la bourbe qui remplissait ce lieu, et se donnèrent le nom Parisiens, de Pâris, fils de Priam, ou plutôt ils furent appelés ainsi du mot grec Parrhesia, qui signifie audace. [Cet auteur fait même de la critique historique]. Ils y demeurèrent mille deux cent soixante ans... ».
DUGAS MONTBEL ; Obs. sur l'Iliade, t. I, p. 298 (chant VI, 402-3) : « Le fameux poète Ronsard a été bien plus loin que Racine, puisqu'il suppose que ce même Astyanax, étant venu dans la Gaule, fut nommé Francion, et devint la tige des rois de France... On trouve l'origine de cette fable dans un prétendu passage de Manethon rapporté par Annius de Viterbe, lequel, dans ses notes, cite aussi l'autorité de l'historien Vincent de Beauvais, qui prétend qu'après la ruine de Troie Astyanax vint dans les Gaules, épousa la fille du roi, et succéda à son beau-père. Beaucoup de poètes n'ont pas établi leurs fictions sur d'aussi bons fondements historiques ». L'origine de la fable remonte peut-être au temps de Lucain. LUC. ; Phars. I :
(427) Arvernique ausi Latio se fingere fratres,
Sanguine ab Iliaco populi;...
Dans les fragments de Frédégaire, la fable est déjà abondante et bien agencée. FRED.; Fragm., p. 698 et sv. (p. 705 et sv.). Encore vers la fin du XVIe siècle, un homme comme Pasquier hésitait à nier de semblables absurdités. ESTIENNIE PASQUIER ; Les mémoires et recherches de la France, livre I, c. 14 : « (p. 68) Au demeurant quant aux Troyens, c'est vrayement grand merveille que chasque nation presque d'un commun consentement s'estime fort honorée de tirer son ancien estre de la destruction de Troye. En cette manière appellent les Romains pour leur premier autheur, un Aenee : les François, un Francion : les Turcs, Turcus: ceux de la grand' Bretaigne, Brutus : et les premiers habitateurs de la mer Adriatique se renomment d'un Anthenor... Quant à moy, je n'ose ny bonnement contrevenir à cette opinion, ny semblablement y consentir librement ; toutesfois il me semble que de disputer de la vieille origine des nations, c'est chose fort chatouilleuse : parce qu'elles ont esté de leur premier avenement si petites, que les vieux autheurs n'estoient soucieux d'emploier le temps à la deduction d'icelles : (p. 69 tellement que petit à petit la memoire s'en est du tout esvanouye, ou convertie en belles fables et frivoles ».
[FN: § 655-1]
Doctrin. SAINT-SIM., Expos. (p. 19) Moïse, Numa, Jésus, ont enfanté des peuples morts ou mourant aujourd'hui ».
[FN: § 658-1]
MENZERAT, dans le Bulletin mensuel de l'Institut Solvay, mai 1910. L'auteur renvoie aussi à ISAAC TAYLOR ; Words and Places, 1902. « (p. 277) Les représentations du peuple à l'égard des noms sont des plus bizarres. Ainsi l'Orange River aurait de l'eau de cette couleur, la mer rouge (traduction du lac d'Edôm) aurait de l'eau rouge ; la Floride est considérée comme la terre « pleine de fleurs », en réalité c'est la terre découverte le jour de Pâques (Pasqua Florida). La pensée populaire veut expliquer des choses qu'elle ne comprend pas ; c'est l'origine des mythes étiologiques. Ce groom anglais qui avait sous sa garde deux chevaux Otello et Desdemona, et qui les appelait Old Fellow et Thursday Morning, peut nous fournir l'exemple de ce que peut cette fantaisie. C'est naturellement toujours un individu qui trouve de semblables indications, au moins en partie. La citadelle de Carthage était Bozra (mot phénicien); les Grecs la confondaient avec ![]() = la peau de bœuf. La légende qui a suivi est connue. L'exemple classique est celui de Romulus, qui aurait fondé Rome (forme impossible au point de vue linguistique) ; ou encore celui (p. 278) d'Antwerpen (Anvers) = an de werpen (néerlandais) werf, allemand Werft) ; la légende en a fait handt werpen = la main jetée, et les armes d'Anvers ont conservé le souvenir de cette fondation légendaire. Une légende très instructive à ce point de vue est encore celle de l'évêque Hatto de Mayence, soi-disant mangé par les souris dans son bourg au milieu du Rhin, en face de Bingen ; ce bourg s'appelait Mausthurm = la tour de la douane ; le peuple en a fait Mausthurm, aujourd'hui Mâuseturm = la tour des souris. Enfin, il y a près de Grenoble une tour célèbre : la Tour sans venin, et la légende veut savoir qu'aucun animal venimeux ne peut vivre dans ses environs ; cette superstition a son origine dans l'altération : Tour de Sainte-Verena ».
= la peau de bœuf. La légende qui a suivi est connue. L'exemple classique est celui de Romulus, qui aurait fondé Rome (forme impossible au point de vue linguistique) ; ou encore celui (p. 278) d'Antwerpen (Anvers) = an de werpen (néerlandais) werf, allemand Werft) ; la légende en a fait handt werpen = la main jetée, et les armes d'Anvers ont conservé le souvenir de cette fondation légendaire. Une légende très instructive à ce point de vue est encore celle de l'évêque Hatto de Mayence, soi-disant mangé par les souris dans son bourg au milieu du Rhin, en face de Bingen ; ce bourg s'appelait Mausthurm = la tour de la douane ; le peuple en a fait Mausthurm, aujourd'hui Mâuseturm = la tour des souris. Enfin, il y a près de Grenoble une tour célèbre : la Tour sans venin, et la légende veut savoir qu'aucun animal venimeux ne peut vivre dans ses environs ; cette superstition a son origine dans l'altération : Tour de Sainte-Verena ».
[FN: § 660-1]
A. MAURY ; Croyances et légendes de l'antiquité.
[FN: § 660-2]
CLAVIER ; Bibliothèque d’Apollodore, notes, t. II (p. 49 ) L'histoire de la naissance d'Orion est racontée plus au long par le schol. d'Homère d'après Euphorion (Il., XVIII, 486), Palæphate (5), Ovide (Fastes, V, 499) et Hygin (Fab., 195, et Poet. Astron., II, 34). Jupiter, Neptune et Mercure ayant été bien reçus par Hyriéus, fils de Neptune et d'Halcyone fille d'Atlas, qui demeurait à Tanagre en Bœotie. voulurent lui donner des preuves de, leur satisfaction. Hyriéus ayant demandé un fils, ils prirent la peau du bœuf qu'il venait de leur sacrifier, et s'étant retirés à part, ils firent dans cette peau, ce que, pour me servir de l'expression d'Ovide, la pudeur défend de dire ; ils fermèrent la peau, l'enterrèrent, et Orion en sortit au bout de dix mois. On lui donna d'abord le nom d'Orion, ![]()
![]() . (Etymolog. magn., p. 823). Cette mauvaise étymologie a peut-être été le seul fondement de la fable que je viens de rapporter, qui était de l'invention des poètes modernes; car Hésiode, que Phérécydes avait probablement suivi, le disait fils (p. 50) de Neptune et d'Euryale fille de Minos (Erathostenes cataster, 3; HYGIN, poet. astron., II, 34) ».
. (Etymolog. magn., p. 823). Cette mauvaise étymologie a peut-être été le seul fondement de la fable que je viens de rapporter, qui était de l'invention des poètes modernes; car Hésiode, que Phérécydes avait probablement suivi, le disait fils (p. 50) de Neptune et d'Euryale fille de Minos (Erathostenes cataster, 3; HYGIN, poet. astron., II, 34) ».
[FN: § 661-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. VIENNET ; Épîtres et Satires, II. À l'Empereur Napoléon, sur la généalogie que ses courtisans voulaient lui faire : « Toujours la vérité sort de règle à la fable ».
[FN: § 661-2]
Larcher prend encore au sérieux les élucubrations de Palæphate. LARCHER ; Hist. d'Hérod., t. III, p. 494 (note a 1. IV, 75) « Médée (PALAEPH.; De incred., 44) introduisit en Grèce l'usage des bains chauds... L'appareil des chaudières et du feu, fit croire qu'elle rajeunissait les hommes en les faisant cuire ; et cela d'autant plus qu'elle cachoit sa méthode afin que les Médecins ne vinssent point à l'apprendre. Pélias fut étouffé par la vapeur du bain ».
[FN: § 661-2]
PALAEPH.; De incred., 20:
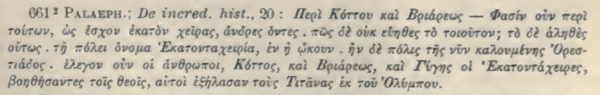
[FN: § 661-3]
PALAEPH. ; De incred. hist., 18. ![]() . – Pour la Chimère : 29.
. – Pour la Chimère : 29. ![]() .
.
[FN: § 661-4]
HERACLITI ; De incred., 15.
[FN: § 661-5]
GROTE ;.Hist. de la Grèce, t. II : « (p., 145, note) Le savant M. Jacob Bryant estime les explications de Palæphate comme si elles étaient fondées sur des faits réels. Il admet, par exemple, la ville de Nephelê, citée par cet auteur dans son explication de la fable des Centaures. En outre, il parle avec beaucoup d'éloges de Palæphate en général : , Il (Palæphate) écrivit de bonne heure et semble avoir été, un esprit sérieux et sensé ; il voyait l'absurdité des fables sur lesquelles reposait la théologie de son pays » (Ancient Mythology, vol. I, p. 411-435) ».
« De même aussi, sir Thomas Brown (Enquiry into Vulgar Errors, liv. I, ch. 6, p. 221, édit. 1885) cite Palæephate comme ayant signalé d'une manière incontestable la base réelle des fables ».
[FN: § 663-1]
RENAN ; Vie de Jésus : « (p. LV) Dans un tel effort pour faire revivre les hautes âmes du passé, une part de divination et de conjecture doit être permise. Une grande vie est un tout organique qui ne peut se rendre par la simple agglomération de petits faits. Il faut qu'un sentiment profond embrasse l'ensemble et en fasse l'unité. La raison d'art en pareil sujet est un bon guide ; le tact exquis d'un Gœthe trouverait à s'y appliquer. La condition essentielle des créations de l'art est de former un système vivant dont toutes les parties s'appellent et se commandent ». Cette définition est celle d'un roman historique.
RENAN ; Les Évangiles : « (p. XXXIII) Dans ce volume, comme dans ceux qui précèdent, on a cherché à tenir le milieu entre la critique qui emploie toutes ses ressources à défendre des textes depuis longtemps frappés de discrédit, et le scepticisme exagéré, qui rejette en bloc et a priori tout ce que le christianisme raconte de ses premières origines ». Sur cette façon d'écrire l'histoire, voir G. SOREL; Le système historique de Renan. Tout ce livre est à lire et à étudier attentivement.
S. REINACH ; Orpheus : « (p. 332) Peut-on du moins tenter d’extraire des Évangiles les éléments d'une biographie de Jésus ? Il est contraire à toute saine méthode de composer – comme l'a fait encore Renan – une vie de Jésus, en éliminant le merveilleux des Evangiles. On ne fait pas de l'histoire vraie avec des mythes, pas plus que du pain avec le pollen des fleurs ». On ne saurait mieux dire ! Mais pourquoi l'auteur oublie-t-il cela, quand, à son tour, il veut faire de l'histoire vraie avec les légendes, et particulièrement avec les légendes qui lui paraissent appartenir au totémisme !
[FN: § 664-1]
DuRuy; Hist. des Rom., t. I. Il a dit d'abord : « (p. 1, note) Nous ne voulons pas discuter les légendes de la période royale. Le lecteur, curieux de ces sortes de jeux d'esprit, pourra consulter les premiers volumes de Niebuhr... Pour nous, aux hypothèses, quelque ingénieuses et érudites qu'elles soient, mais toujours aussi incertaines que les traditions qu'elles combattent, nous préférons l'admirable récit de Tite-Live, sinon comme vérité, du moins comme tableau ». En premier lieu, il faut s'entendre sur le but de l'auteur. S’il veut faire œuvre poétique, il fait bien de choisir le « tableau » qui lui paraît être le meilleur, et quelqu'un d'autre pourra, avec autant de raison, préférer Le Roland furieux de l'Arioste, aux légendes que préfère Duruy. Mais s'il veut écrire un ouvrage historique, il importe vraiment peu de savoir quel est le récit poétique qui plaît le plus à l'auteur ; il importe uniquement, exclusivement, de savoir quel est le récit qui se rapproche le plus des faits.
[FN: § 664-2]
Pourtant Duruy observe que « (p. 62) il serait aisé de trouver la ressemblance [de la légende de Romulus] dans d'autres traditions nationales. Ainsi, comme Romulus, Sémiramis est fille d'une déesse ; comme lui, comme Cyrus exposé dans une forêt et allaité par une chienne, elle est abandonnée dans le désert, nourrie par des colombes et recueillie par un pâtre du roi... ». De cette façon, il était sur la voie d'une classification naturelle des légendes (§ 675), et il a déjà noté un élément principal ; c'est-à-dire que les personnages éminents doivent avoir une naissance ou une origine extraordinaire. En continuant, il en pouvait relever d'autres. il dit très bien : « (p. 62) Ces légendes qu'on retrouve jusque sur les rives du Gange, dans l'histoire de Chandragupta, étaient, avec bien d'autres, le patrimoine commun des peuples de race aryenne ». Mais Duruy fait aussitôt volte-face, et, en disant que la légende de Romulus fait partie d'un cycle légendaire commun aux peuples aryens, il revient à l'interprétation historique qu'il a lui-même exclue. « (p. 62) Pour nous Romulus, que l'on rattachera, si l'on veut, à la maison royale d'Albe, sera un de ces chefs de guerre comme en ont eu (p. 63) l'ancienne et la nouvelle Italie, et qui devint roi d'un peuple auquel la position de Rome, d'heureuses circonstances... donnèrent l'empire du monde ». Non ; Romulus, Sémiramis, Cyrus, etc., ne sont que des noms par lesquels on donne une forme concrète aux sentiments dont les nombreuses légendes semblables, notées par Duruy lui-même, tirent leur origine.
[FN: § 668-1]
COMPARETTI; Virgilio nel medio evo.
[FN: § 668-2]
COMPARETTI ; loc. cit., 668-1, t. II, p. 282 à 300. Les faietz merveilleux de Virgille.
[FN: § 668-3]
Plusieurs traits de cette légende sont attribués à d'autres personnages, dans d'autres récits. Par exemple, dans l'histoire de Joseph d'Arimathie, on attribue à Ipocras l'incident de la corbeille, que suivit la vengeance ; ce fait ne diffère que par la forme. P. PARIS; Les rom. de la Table ronde, t. I : «(p. 546) L'histoire des philosophes atteste qu'Ipocras fut le plus habile de tous les hommes dans l'art de physique. Il vécut longtemps sans être grandement renommé ; mais une chose qu'il fit à Rome répandit en tous lieux le bruit de sa science incomparable ». Il arrive à Rome au moment où l'on y pleure pour mort Gaius, neveu de l'empereur Augustus César. Il s'aperçoit que la mort de Gaius n'est qu'apparente et le guérit : aussi est-il grandement honoré et choyé par l'empereur. Il s'éprend d'une dame venue de Gaule à Rome. Celle-ci feint de répondre à ses vœux, et le persuade de se mettre dans une corbeille, afin d'être tiré en haut, jusqu'à la chambre de l'objet aimé et de pouvoir en jouir. « (p. 255) La dame et sa demoiselle étaient en aguet à leur fenêtre : elles tirèrent la corde jusqu'à la hauteur de la chambre où Ipocras pensait entrer ; puis elles continuèrent à tirer, si bien que le corbillon s'éleva plus de deux lames au-dessus de leur fenêtre. Alors elles attachèrent la corde à un crochet enfoncé dans la tour, et crièrent : Tenez-vous en joie, Ipocras, ainsi doit-on mener les musards tels que vous ». Le matin, tous voient Ipocras, qui est couvert de honte. Il pourvoit ensuite à sa vengeance. Il remet à un nain sale et contrefait une herbe au contact de laquelle la belle femme devient amoureuse du nain, l'épouse et demeure avec lui. L'auteur, qui paraît n'avoir pas eu beaucoup d'imagination, copie de nouveau cette aventure, pour faire mourir son Ipocras. Dardane, neveu d'Antoine, roi de Perse, était tenu pour mort. Ipocras le guérit et, en compagnie d'Antoine, va chez le roi de Tyr dont il épouse la fille : mais celle-ci, irritée de ce mariage, finit, après diverses tentatives demeurées vaines à cause de la science de son mari, par employer cette même science et par l'empoisonner. Le roi Antoine se désespère et demande s'il y a un remède. Ipocras répond : « (p. 271) Il y en a bien un ; ce serait une grande table de marbre qu'une femme entièrement nue parviendrait à chauffer au point de la rendre brûlante. – Eh bien ! faisons l'essai et, puisque votre femme est la cause de votre mort, c'est elle que nous étendrons sur le marbre... La dame fut donc étendue sur le marbre, et, le froid de la pierre la gagnant peu à peu, elle mourut dans de cruelles angoisses, une heure avant Ipocras... ».
Le fond de ces histoires gît dans certains sentiments qu'on revêt de formes plus ou moins élégantes et ingénieuses ; puis, sur les fables ainsi construites, on met le nom d'un homme connu. Ici nous avons trois sentiments principaux : 1° le sentiment que l'homme sage ou puissant est abattu par de petites causes ; ce sentiment naît des contrastes qu'on observe souvent dans la vie ; 2° un sentiment misogyne, suivant lequel la femme est l'instrument de la ruine de l'homme sage et de l'homme puissant ; 3° le sentiment de la vengeance. Les histoires qui ont leur origine dans ces sentiments sont en nombre infini. Agamemnon, guerrier très courageux, vainqueur des Troyens, fut tué dans son bain par une faible femme ; suit la vengeance consommée par le fils. Le magicien Virgile est dupé par une simple femme, et en tire une cruelle vengeance. Le très savant Ipocras, qui guérit les morts, ne sait se garder du poison que lui a donné sa femme, mais finit par en tirer vengeance. Les noms d'Agamemnon, de Virgile, d’Ipocras ou d'autres personnages semblables sont tout à fait accessoires, et peuvent être remplacés par d'autres, à volonté. Les circonstances mêmes des faits importent peu, et varient suivant la fantaisie de l'auteur, qui imagine ou copie des légendes déjà connues.
[FN: § 671-1]
G. SOREL; Le syst. hist. de Renan, t. I : «(p. 41) L'interprétation des apocalypses devait jouer un grand rôle dans le travail que Renan voulait entreprendre en 1848 ; nous avons vu que cette interprétation devait aboutir à retrouver l'histoire sous la légende ; je ne crois pas qu'il y ait de sophisme plus dangereux que celui qui suppose une telle entreprise ; une légende peut être très précieuse pour connaître la manière de penser d'un peuple, mais elle ne peut nous fournir des faits, et ce sont des faits que Renan voulait demander aux apocalypses ».
[FN: § 671-2]
CHASSANG : Hist. du roman dans l'ant. grecque et latine « (p. 432) Qu'on parcoure seulement les chroniqueurs byzantins, on y verra partout le souvenir des anciens romans... Zonaras, par exemple, connaît l'histoire de Cyrus d'après Hérodote et d'après Xénophon, et il préfère ce dernier, parce que, dit-il, « c'est un abrégé qu'il écrit, et qu'il lui suffit de donner les récits les plus vraisemblables » , (Zonaras, III, 25). Ainsi, grâce à Zonaras, la Cyropédie qui (p. 483) pour Cicéron était un roman, fait son entrée dans l'histoire. Cédrénus, mieux inspiré, suit Hérodote; mais au récit de l'historien d'Halicarnasse, il mêle quelques fables juives ou chrétiennes. Ces fables se retrouvent avec plus de développement encore, dans J. Malalas ; il est vrai que Malalas a son autorité, et une autorité grave : c'est Jules l'Africain qui, parmi les sources où il a puisé, signale l'Histoire de la guerre entre les Samiens et Cyrus, par le sage Pythagore ! »
[FN: § 674-1]
Le Violier des Histoires romaines, ancienne traduction française des Gesta romanorum, chap. 89.
[FN: § 674-2]
SUET. ; Caesar, 81 : ... ac subito cubiculi fores sponte patuerunt... quinta fere hora progressus est : libellumque insidiarum indicem, ab obvio quodam porrectum, libellis ceteris, quos sinistra manu tenebat, quasi mox lecturus, commiscuit. – Cfr. DIO CASS. ; XLIV, 18. – PLUT. ; Caes., 63.
[FN: § 675-1]
On procède généralement de même, quand on juge les raisonnements et les théories qui ont cours dans la société ; c'est-à-dire qu'on donne la première place à l'exposition logique et à la pseudo-expérience, qui sont des parties accessoires ; tandis qu'on met à l'arrière-plan ou qu'on néglige entièrement les actions non-logiques, qui forment la partie principale du phénomène.
Le présent traité de sociologie vise à replacer ces parties dans leur ordre naturel ; c'est pourquoi nous avons commencé par l'étude des actions non-logiques ; C'est pourquoi nous avons apporté, nous apportons ici et nous apporterons de nouveau dans la suite, des exemples de l'interversion qu'on fait dans l'ordre de ces parties, jusqu'à ce que, séparées et jugées suivant leur importance, nous puissions les étudier à fond, dans les chapitres VII à X. Tant que nous n'aurons pas fait cela, nous n'aurons pas les éléments réels de l'équilibre social.
[FN: § 676-1]
CIC. ; De nat. deor ., III, 22.
[FN: § 678-1]
B. DE LACOMBE; La vie privée de Talleyrand : « (p. 197)... Témoin cette autre histoire dont Napoléon faisait encore des gorges chaudes à Sainte-Hélène (0' MÉARA ; Napoléon en exil, 1822, I, p. 413) : Talleyrand avait invité à dîner l'égyptologue Denon ; pour préparer à sa femme un sujet de conversation, il lui conseilla de parcourir un des livres de son convive; Mme de Talleyrand se trompa de volume ; elle prit, dans la bibliothèque, les Aventures de Robinson Crusoé ; elle les dévora d'une traite avec passion ; le soir venu, à table, toute pleine de sa lecture, elle n'eut rien de plus pressé que de parler à Denon de ses aventures prodigieuses : « Ah! Monsieur, par quelles émotions vous avez dû passer ! Ce naufrage ! Cette île déserte ! Et que vous deviez avoir une drôle de figure avec votre chapeau pointu ! » Le savant n'y comprenait rien et restait abasourdi. Enfin le mystère s'éclaircit ; Mme de Talleyrand l'entreprenait sur son compagnon de misère, le fameux Vendredi... Le malheur de cette anecdote, dont on a voulu tour à tour que Denon, Humboldt et un sir Georges Robinson fassent les héros, c'est qu'elle n'a pas même été inventée pour Mme de Talleyrand ; des années avant sa naissance, parait-il, les conteurs de salon la colportaient déjà : ils n'y faisaient qu'une variante : ils attribuaient le quiproquo à un abbé. Avec les historiettes qui courent sur la princesse de Bénévent, on écrirait tout un volume ».
[FN: § 678-2]
E. FOURNIER ; L'Esprit dans l'histoire.
[FN: § 678-*]
« Questions de littérature légale, p. 68. – L'homme qu'on choisit ainsi pour lui faire endosser l'esprit de tout le monde, est pour les badauds de Paris, lit-on dans la Revue Britannique )oct. 1840, p. 316), ce que la statue de Pasquin est pour les oisifs de Rome, une sorte de monument banal où chacun s'arroge le droit d'afficher ses saillies bonnes ou mauvaises » (Note de Fournier).
[FN: § 679-1]
BAYLE ; Dict. Hist., s. r. Laïs, t. III. En note : « (p. 35) On conjecture qu'il y a eu deux courtisanes nommées Lais. Celle dont je parle fut transportée à Corinthe, lorsque Nicias commandoit l'armée des Athéniens dans la Sicile, c'est-à-dire, l'an 2 de l'Olympiade 91. Elle avait alors sept ans, si nous en croyons le scholiaste d'Aristophane. Or puis que Demosthène n'osa aller à Corinthe qu'en cachette afin de jouir de Laïs ; il fallait qu'il ne fût pas un jeune Ecolier, mais un homme qui avait acquis beaucoup de réputation. On doit donc supposer que pour le moins il avait trente ans ; ainsi Laïs aurait eu alors soixante-sept ans. Il n'y a donc nulle apparence, ni que Demosthène se fût soucié de la voir, ni qu'elle lui eût demandé une grosse somme. Ce fut donc une autre Laïs qui la demanda à Demosthène. Il y a donc eu deux courtisanes nommées Laïs. La difficulté sera très-grande, quand même on supposera que Demosthène fit ce voyage de Corinthe à l’âge d'environ vingt ans ; car notre Laïs eût été presque sexagénaire... Plutarque, parlant de Laïs, fille de la concubine d'Alcibiade, dit expressément qu'elle était native d'Hyccara en Sicile, et qu'elle en fut transportée esclave. Ainsi selon Plutarque la même Laïs, qu'Athénée nomme la jeune, est celle qui était née en Sicile avant la 91 Olympiade : de sorte que si celle qui demanda une grosse somme à Demosthène, est différente de celle-ci, il faudra qu'il y ait eu trois Lais... Pour moi, au lieu d'admettre deux Laïs, j'aimerais mieux dire que les auteurs grecs, qui observoient mal la chronologie, ont appliqué à la courtisane de ce nom une aventure de Demosthène, qui concernait une autre fille de joie ».
[FN: § 689-1]
GASTON PARIS ; Légendes du moyen âge.
[FN: § 680-2]
Beaucoup de légendes du cycle de Charlemagne n'ont rien de commun avec la réalité. On lit, par exemple, dans Menagiana : « (p. 110) Une des plus grandes naïvetez qu'on ait jamais écrites, c'est dans le Roman de Galien restauré, la réception que le Roi Hugon Empereur de Constantinople, fit à Charlemagne accompagné de ses douze Pairs, et ce qui s'en suivit. Charlemagne et ses douze pairs, au retour du S. Sépulcre, passant à Constantinople, y furent reçus au palais du Roi Hugon, qui après un magnifique festin, où étaient la Reine son épouse, et les deux princes Henri et Tibère ses fils, et la belle Jaqueline sa fille, les fit conduire dans une superbe salle pour s'y reposer ». Avant de s'endormir, Charlemagne et ses pairs s'amusent à se vanter d'entreprises impossibles. Ayant appris ces vantardises, le roi Hugon contraint Charlemagne et ses pairs à les mettre à exécution. Avec l'aide du ciel, Charlemagne coupe en deux un homme entièrement armé : et ainsi de suite. Supposez qu'une histoire semblable se trouve dans Suidas, au lieu d'être dans Menagiana, et qu'elle se rapporte aux héros de la Grèce, et soyez certains qu'on n'en finirait plus de la commenter de mille manières, en y cherchant quelque réalité historique... qui n'y est certainement pas. Ôtez, si vous le voulez tout le merveilleux de cette légende ; réduisez-la au simple fait historique du passage de Charlemagne à Constantinople ; même ce fait est entièrement faux.
[FN: § 682-1]
STRAB; II, 3, 5, p. 102, Didot, 84.
[FN: § 682-2]
POLYB.; XXXIV, 2,5 (apud STRAB.; I, 2, 15, p. 23, Didot, 19).
[FN: § 684-1]
LACT.; De falsa relig., XIII, XIV. Ibidem, XI : Antiquus auctor Evhemerus, qui fuit ex civitate Messene, res gestas Iovis et caeterorum, qui du putantur, collegit, historiamque contexuit ex titulis et inscriptionibus, sacris quae in antiquissimis templis habebantur, maximeque in fano Iovis Tryphilii, ubi auream columnam positam esse ab ipso Iove, titulus indicabat : in qua columna gesta sua perscripsit, ut monimentum esset posteris reram saarum. ...Ennius in Sacra historia, descriptis omnibus, quae in vita sua gessit, ad ultimum sic aitm: « Deinde Iuppiter, postquam terram quinquies circuivit, omnibusque amicis atque cognatis suis imperia divisit, reliquitque hominibus leges ; mores frumentaque paravit, multaque alia bona fecit, immortali gloria memoriaque affectus sempiterna monimenta suis reliquit ; aetate pessum acta, in Creta vitam commutavit, et ad deos abiit : eumque Curetes, filii sui, curaverunt, decoraveruntque eum, et sepulcrum eius est in Creta, in oppido Cnoso : et dicitur Vesta hanc urbem creavisse : inque sepulcro eius est inscriptum antiquis litteris Graecis : ZAN KPONOY, id est latine : Iuppiter Saturni ». Hoc certe non poetae tradunt, sed antiquarum rerum scriptores... LYCOPHR., dans la Cassandre, 1194, fait allusion à la région où naquit Zeus. TZETZE observe sur ce vers que les savants savent que les rois portèrent le nom de Zeus et passèrent pour dieux, et qu'ils naquirent en Crète, en Arcadie, à Thèbes et en mille autres lieux – ![]() – et qu'on leur dédia des inscriptions. Nous avons le phénomène habituel des mêmes sentiments qu'on exprime de diverses manières (§ 675).
– et qu'on leur dédia des inscriptions. Nous avons le phénomène habituel des mêmes sentiments qu'on exprime de diverses manières (§ 675).
Cfr. ARNOB. ; Ad. gent., IV, 14 – D. CYPR.; De idol. vanit. : Antrum Iovis in Creta visitur, et sepulchrum eius ostenditur. D. EPIPH. ; Ancoratus, 108. Il dit de Zeus : « Dont nombre de gens connaissent le sépulcre, puisqu'en Crète, sur la montagne appelée Lasio de nos jours encore, on le montre du doigt. » – CLEM. ALEX. : Protrep., p. 24, Potter, p. 18 Paris. – Les auteurs païens en parlent aussi : CIC. ; De nat. deor., 21, 53. – LUCIAN. ; De sacrif., 10. – STAT. ; Theb., 1, 278-279. – LUCIAN. ; Phars., VIII, 872. – CALLIMAQUE ; In Iov., 1-9, taxe de mensongers de semblables récits : « Zeus, les uns disent que tu es né sur le mont Ida [en Crète], les autres en Arcadie. Qui, ô père, est menteur ? Les Crétois mentent toujours. En effet, à toi, maître, ils t'ont construit un sépulcre ; tu n'es pas mort : tu es éternel ».
[FN: § 687-1]
A. DARMESTETER; La vie des mots. Parlant de la qualité d'un objet, qui sert à lui donner un nom, l'auteur dit: « (p. 41) Chose curieuse, cette qualité n'a nullement besoin d'être essentielle et vraiment dénominative. Ainsi cahier est, étymologiquement, un groupe de quatre choses (ancien français, caier, caern, cadern, du latin quaternum, groupe de quatre - S. e. feuillets)... (p. 42) La confiture est tout simplement une préparation (confectura). « Le chapelet n'est autre chose qu'une petite couronne (de chapel, chapeau, guirlande) ». – R. TÖPFFER ; Nouv. voy. en zizag, Voy. à la grande Chartreuse : « (p. 10) Nous l'avons déjà dit, faites vivre ensemble, voyager ensemble, pendant quelques jours seulement, une société de gens, et vous verrez toujours se former des mots et des acceptions de mots exclusivement propres à cette société, et cela si certainement, si naturellement, qu'en vérité, au rebours de ce que pensent les doctes, il paraît bien plus difficile d'expliquer comment il pourrait se faire qu'un langage ne naquit pas là où des hommes vivent ensemble, qu'il ne l'est de se figurer comment il y naît ».
[FN: § 688-1]
INST. IUSTIN.: I, 3, 3 : Servi autem ex eo appellati sunt, quod imperatores, captivos vendere iubent, ac per hoc servare, nec occidere solent. M. BRÉAL et A. BAILLY: Dict. étym. latin, s. r. servus : « Servus veut dire littéralement « gardien ». Il correspond au grec ![]() (pour
(pour ![]() ), d'où
), d'où ![]() et
et ![]() .
.
L'esclave est considéré comme le gardien de la maison. V. J. Darmesteter, Mem. Soc. Ling., II, 309. Cette origine du mot ayant été peu à peu oubliée, servus a signifié simplement « esclave », et ce sens est le seul qui ait passé dans les dérivés tels que servio et servitus. – L'étymologie de servus, entendu comme le prisonnier de guerre dont on a épargné la vie, est donc à rejeter ».
[FN: § 688-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. En attendant, voici un exemple tout récent de cette façon de reconstituer l'histoire. Les interprétations de la première étymologie sont, il est vrai, hypothétiques, mais elles montrent bien la méthode de l'auteur, qui laisse errer son imagination au gré de sa fantaisie. Il s'agit d'abord du nom d'un petit village des hautes Alpes valaisannes. Gazette de Lausanne, 5 août 1913, Étymologies. (Signé H. M.) : « Evolène ![]() . Qu'est-ce donc que ces « jolis bras » ? À quelle légende, à quelle tradition, à quelle aventure dramatique ou romanesque peuvent-ils bien faire allusion ? Car enfin il doit en être de ce terme comme de tant d'autres noms de lieux dont la signification ou l'origine s'est dès longtemps perdue ; je veux dire que cette poétique dénomination n'est point le fait du hasard, mais qu'elle eut jadis sa raison d'être. Où est l'historien, le folkloriste, l'hellénisant qui nous la retrouvera ? N'y faudrait-il voir peut-être qu'une aimable fantaisie d'érudit, une manière de madrigal, que sais-je, dédié aux belles filles de l'endroit ? Ah ! dame, voilà qui serait fort admissible, après tout. Ou bien s'agit-il de quelque souvenir rapporté de la croisade quatrième ? J'imagine qu'à cette époque, aussi bien que de nos jours, il devait être de mise, très bien porté même, d'employer des vocables provenant des lointains pays où l'on avait guerroyé : cela vous posait un personnage ! Mais encore... Chillon, lui, comme on sait, s'explique de reste : c'est le château du « rivage »
. Qu'est-ce donc que ces « jolis bras » ? À quelle légende, à quelle tradition, à quelle aventure dramatique ou romanesque peuvent-ils bien faire allusion ? Car enfin il doit en être de ce terme comme de tant d'autres noms de lieux dont la signification ou l'origine s'est dès longtemps perdue ; je veux dire que cette poétique dénomination n'est point le fait du hasard, mais qu'elle eut jadis sa raison d'être. Où est l'historien, le folkloriste, l'hellénisant qui nous la retrouvera ? N'y faudrait-il voir peut-être qu'une aimable fantaisie d'érudit, une manière de madrigal, que sais-je, dédié aux belles filles de l'endroit ? Ah ! dame, voilà qui serait fort admissible, après tout. Ou bien s'agit-il de quelque souvenir rapporté de la croisade quatrième ? J'imagine qu'à cette époque, aussi bien que de nos jours, il devait être de mise, très bien porté même, d'employer des vocables provenant des lointains pays où l'on avait guerroyé : cela vous posait un personnage ! Mais encore... Chillon, lui, comme on sait, s'explique de reste : c'est le château du « rivage » ![]() , et ce même mot désignera plus tard la contrée de la « côte » par excellence, le Chili, où je note, en passant, la ville de « Chillan ». Voyez aussi Evian, qui prétend venir de
, et ce même mot désignera plus tard la contrée de la « côte » par excellence, le Chili, où je note, en passant, la ville de « Chillan ». Voyez aussi Evian, qui prétend venir de ![]() , je réjouis, « je guéris » (vieille noblesse !) etc. Tandis qu'Evolène... les bras jolis... énigme !... » Quelques jours après, Ibid., 9 août, Étymologies (non signé), un autre étymologiste propose d'autres étymologies pour expliquer les mêmes noms, en se fondant sur un ouvrage d'autorité. L'auteur de cet ouvrage : « fait dériver Evolène (Evelina en 1250) du celtique Ewe = eau et du latin Lenis =tranquille. Donc : eau tranquille ; et il ajoute que la Borgne, qui y coule, est effectivement à peu près paisible. Le nom Chillon viendrait du patois et signifierait « plate-forme de rocher ». Castrum Quilonis (1195) signifierait donc « château construit sur un chillon », c'est-à-dire sur une plate-forme de rocher. Evian dériverait des racines celtiques Ewe = eau et Ona = rivière, de même que « Evionnaz », Evunna vers 1020 ».
, je réjouis, « je guéris » (vieille noblesse !) etc. Tandis qu'Evolène... les bras jolis... énigme !... » Quelques jours après, Ibid., 9 août, Étymologies (non signé), un autre étymologiste propose d'autres étymologies pour expliquer les mêmes noms, en se fondant sur un ouvrage d'autorité. L'auteur de cet ouvrage : « fait dériver Evolène (Evelina en 1250) du celtique Ewe = eau et du latin Lenis =tranquille. Donc : eau tranquille ; et il ajoute que la Borgne, qui y coule, est effectivement à peu près paisible. Le nom Chillon viendrait du patois et signifierait « plate-forme de rocher ». Castrum Quilonis (1195) signifierait donc « château construit sur un chillon », c'est-à-dire sur une plate-forme de rocher. Evian dériverait des racines celtiques Ewe = eau et Ona = rivière, de même que « Evionnaz », Evunna vers 1020 ».
[FN: § 689-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. RABELAIS se moque de ces étymologies : Œuvres, t. II, Pantagruel, I. V, chap. XXXV, (éd. Flammarion) p. 250. Pantagruel demande pourquoi la ville de Chinon, en Touraine, serait la première du monde : « Je, dy, trouve en l'Escriture sacrée que Cayn fut premier bastisseur de villes ; vray donques semblable est que la premiere, il, de son nom, nomma Caynon, comme depuis ont à son imitation tous autres fondateurs et instaurateurs de villes imposé leur nom à icelles. Athené, c'est en grec Minerve, à Athenes ; Alexandre à Alexandrie ; Constantin à Constantinople ; Pompée à Pompeiopolis, en Cilicie ; Adriau à Adrianople ; Canaan aux Cananeens ; Saba aux Sabeians ; Assur aux Assyriens ; Ptolomaïs, Cesarea, Tiberium, Herodium, en Judée ».
[FN: § 690-1]
La Liberté, 10 décembre 1910 : « Du Cri de Paris : Elle sait où est le compteur : C'est la nouvelle locution à la mode. On l'entend dans les petits théâtres et les cafés-concerts. On ne dit pas d'une femme « elle est la maîtresse de M. X... », on dit : – Elle sait où est le compteur. Tout le monde comprend. Mais peu de personnes connaissent l'origine de cette expression. Hâtons-nous de l'expliquer à nos lecteurs. Un de nos auteurs dramatiques, jeune et riche, avait convié quelques actrices fort jolies, et quelques camarades, à venir entendre la lecture d'une pièce nouvelle dans un pied-à-terre élégant qu'il préfère dans certains cas à son domicile officiel. Les invités pénètrent en bande dans une pièce où règne l'obscurité la plus complète. L'auteur dramatique frotte une allumette, tourne une clef et s'écrie : – Zut, le gaz est fermé ! Aussitôt, sans l'ombre d'une hésitation – il est vrai qu'il n'y avait pas de lumière – une des jeunes femmes présentes ouvre un placard et découvre le compteur. La lumière se fit dans la salle et dans l'esprit des assistants, qui connurent ainsi l'élue du moment. – Bon, se dirent-ils, elle sait où est le compteur ! – Et la locution fit fortune ».
[FN: § 691-1]
DUGAS MONTBEL; Obs. sur l'Iliade, t. II, (XVIII, 486): « (p. 145) Quant à Orion, il a été dans la suite le sujet d'une aventure fort dégoûtante, et racontée très-crûment par Voltaire (Dict. phil., s. r. Allégorie) qui nomme cela une allégorie. Ce n'est point le désir d'imaginer une allégorie qui a fait concevoir cette turpitude ; elle n'est due qu'au rapport qui existe entre le nom d' ![]() et celui d'
et celui d' ![]() , Urina. Ainsi donc, ce n'est point non plus à cause de son aventure qu'il fut nommé Orion, comme le disent les petites scholies, mais, au contraire, ce fut à cause de son nom qu'on imagina l'aventure. La preuve c'est que toutes ces vilenies n'ont été inventées qu'après Homère, qui cependant connaissait le nom ». La preuve n'est pas très solide, mais le fait est probable.
, Urina. Ainsi donc, ce n'est point non plus à cause de son aventure qu'il fut nommé Orion, comme le disent les petites scholies, mais, au contraire, ce fut à cause de son nom qu'on imagina l'aventure. La preuve c'est que toutes ces vilenies n'ont été inventées qu'après Homère, qui cependant connaissait le nom ». La preuve n'est pas très solide, mais le fait est probable.
[FN: § 694-1]
TYLOR: La civil. primit. , t. I.
[FN: § 695-1]
Nous ne pouvons pas même donner une traduction rigoureuse du terme ![]() dans les poèmes homériques. Dans les œuvres postérieures, on peut traduire par âme ; mais chez Homère, il a différents sens qui ne sont pas bien définis. Du THEIL ; Dict. d'Hom. : «
dans les poèmes homériques. Dans les œuvres postérieures, on peut traduire par âme ; mais chez Homère, il a différents sens qui ne sont pas bien définis. Du THEIL ; Dict. d'Hom. : « ![]() propr. souffle, haleine, et comme celle-ci est le signe de la vie, de là, esprit c.-à.-d. 1° vie, force vitale, âme, esprit
propr. souffle, haleine, et comme celle-ci est le signe de la vie, de là, esprit c.-à.-d. 1° vie, force vitale, âme, esprit ![]() : .Il V, 696, l'esprit l'abandonna, c.-à.-d. il tomba en défaillance ; mais aussi la vie l'abandonna, Od. XIV, 426, (où il est dit d'animaux) ; en outre, il se joint souv. à
: .Il V, 696, l'esprit l'abandonna, c.-à.-d. il tomba en défaillance ; mais aussi la vie l'abandonna, Od. XIV, 426, (où il est dit d'animaux) ; en outre, il se joint souv. à ![]() Il V, 396 ; à
Il V, 396 ; à ![]() , Il. XVI, 453 ; à
, Il. XVI, 453 ; à ![]() , Il. XI, 334 ; et au pl.
, Il. XI, 334 ; et au pl. ![]()
![]() Od. III, 74 ; Il. 1, 3, exposant leur vie ; on concevait ce principe vital comme une véritable substance ; quand l'homme meurt, elle s'exhale par sa bouche, Il. IX, 409, ou par une blessure, Il. XIV, 518 de là les âmes des morts dans les enfers, esprit, âme, ombre :
Od. III, 74 ; Il. 1, 3, exposant leur vie ; on concevait ce principe vital comme une véritable substance ; quand l'homme meurt, elle s'exhale par sa bouche, Il. IX, 409, ou par une blessure, Il. XIV, 518 de là les âmes des morts dans les enfers, esprit, âme, ombre : ![]() l'âme d'Agamemnon, d'Ajax ; cette âme était à la vérité sans corps, mais elle conservait la forme du corps, Od. XI, 207; elle n'a pas les
l'âme d'Agamemnon, d'Ajax ; cette âme était à la vérité sans corps, mais elle conservait la forme du corps, Od. XI, 207; elle n'a pas les ![]() ... Il. XXIII, 103; ce n'était donc qu'un fantôme,
... Il. XXIII, 103; ce n'était donc qu'un fantôme, ![]() , Od. XI, 601 ; aussi les deux mots
, Od. XI, 601 ; aussi les deux mots ![]() se trouvent-ils réunis, Il. XXIII, 103 ; Od. XXIV, 14 ; et dans ce sens
se trouvent-ils réunis, Il. XXIII, 103 ; Od. XXIV, 14 ; et dans ce sens ![]() est opposé au corps que l'ancien Grec appelle son moi, sa personnalité
est opposé au corps que l'ancien Grec appelle son moi, sa personnalité ![]() , Il. 1, 3 ; Od. XIV, 32 ;
, Il. 1, 3 ; Od. XIV, 32 ; ![]() n'est jamais employé dans HOM. pour marquer les situations de l'âme ». Quand nous aurons des explications aussi amples sur les termes employés par les peuples barbares, nous pourrons avoir quelque idée des termes que les voyageurs ou les missionnaires traduisent arbitrairement par notre terme âme.
n'est jamais employé dans HOM. pour marquer les situations de l'âme ». Quand nous aurons des explications aussi amples sur les termes employés par les peuples barbares, nous pourrons avoir quelque idée des termes que les voyageurs ou les missionnaires traduisent arbitrairement par notre terme âme.
[FN: § 695-2]
F. FARJENEL: La mor. chin., 5.
[FN: § 695-3]
Même des hommes de science parfaitement au courant de la matière peuvent, dans un moment d'inattention, faire usage de termes qui ne correspondent pas au texte qu'ils ont en vue. A. MAURY ; Hist. des relig. de la Gr., t. I : « (p. 336) L'Élysée, ou mieux le champ Élysée ![]() , est dépeint par l'Odyssée* comme une terre où le juste coule en paix une vie facile, sous un ciel toujours serein,... » L'auteur cite « (*IV, 561). Or le terme juste ne convient pas à ce passage. On n'y fait aucune allusion à des hommes justes ; on parle de Ménélas, qui ira au champ Élysée, non parce qu'il a été juste, mais « parce qu'il a [pour femme] Hélène, et qu'il est pour eux [les immortels] le gendre de Zeus ».
, est dépeint par l'Odyssée* comme une terre où le juste coule en paix une vie facile, sous un ciel toujours serein,... » L'auteur cite « (*IV, 561). Or le terme juste ne convient pas à ce passage. On n'y fait aucune allusion à des hommes justes ; on parle de Ménélas, qui ira au champ Élysée, non parce qu'il a été juste, mais « parce qu'il a [pour femme] Hélène, et qu'il est pour eux [les immortels] le gendre de Zeus ».
(569) ![]()
Il est impossible de traduire autrement, et toutes les traductions ont le sens indiqué ; par exemple en latin : quoniam habes Helenam, et ipsis Iovis gener es. Le vers (561) cité de Maury :
(561) ![]()
et ceux qui suivent font allusion au fait dont la raison est donnée au vers (569) : dit que Ménélas ne mourra pas, mais ira au champ Élysée, parce que, etc. Supposons que nous ne connaissions de ce passage de l'Odyssée, que ce qu'en rapporte Maury : nous penserions qu'il contient un principe moral, lequel n'existe vraiment pas.
[FN: § 696-1]
Le 25 janvier 1910, un grand nombre de personnes, rassemblées à la Place d'armes, à Turin, attendaient le coucher du soleil pour voir la comète. Celle-ci ne s'étant pas montrée immédiatement, une partie du public siffla, comme si ce fût au théâtre ! Et pourtant il est certain qu'aucune de ces personnes ne s'imaginait que la comète eût une âme. Il n'y a là pas autre chose qu’un de ces mouvements impulsifs qui nous font traiter de la même manière les hommes, les animaux et les choses. PORTER, dans Bibl. univ. des voy., t. 16, raconte quel plaisir et quelle admiration les indigènes de l'île Madison manifestèrent, après avoir vu tirer le canon : « (p. 171) ils embrassèrent et saisirent le canon, s'inclinèrent devant, le caressèrent avec amour, et finirent par glisser deux longs bâtons pour l'emporter vers la montagne » [selon les ordres de Porter]. Les indigènes ne croyaient pas que le canon fût un être animé ; ils manifestaient seulement certains sentiments d'admiration, qu'ils éprouvaient pour sa puissance. – A. ERMAN ; La rel. égypt. Après avoir remarqué combien différaient les manières dont les Égyptiens se représentaient le monde, l'auteur ajoute . « (p. 15) C'est de tous ces divers traits que plus tard l'Égypte de l'époque historique composa son tableau du monde et en fit un mélange, au petit bonheur, sans se préoccuper des contre-sens et des impossibilités qu'elle éditait. On représente le ciel sous la forme d'une vache et on fait voyager sur son ventre la barque du soleil ; on le dit un océan et cependant c'est par lui qu'est engendré le soleil ; le dieu-soleil est un scarabée, alors que le soleil est en même temps son œil. Et les noms et les images qui (p. 16) s'adaptent à ces diverses conceptions se déroulent complètement emmêlés les uns aux autres ». On trouve quelque chose d'analogue jusque dans la mythologie grecque.
[FN: § 697-1]
TYLOR; La civil. primit. , t. I.
[FN: § 701-1]
COOK; 3e voyage, Paris, 1785, II. Parlant des habitants de Nootka (Amérique septentrionale), l'auteur dit : « (p. 352) Leurs autres passions, et surtout la curiosité, paraissent absolument engourdies. Ils ne montraient jamais le moindre désir d'examiner les choses qui leur étaient inconnues, et qui auraient produit le plus grand étonnement chez des personnes curieuses. Contens de se procurer les choses qu'ils connaissaient ou dont ils avaient besoin, tout le reste leur était indifférent ; les personnes, les vêtements, les usages des Européens si différens des leurs, la grandeur même et la construction des vaisseaux, loin d'exciter chez eux de l'admiration, ne fixaient pas même leur attention ». – PRUNEAU DE POMMEGORGE, dans HOVELACQUE ; Les Nègres « (p. 29) Ne pouvant m'imaginer, comme on me l'avait dit, qu'ils [les Sérères] n'eussent aucun culte, et me trouvant un soir au soleil couchant, au bord de la mer, avec cinq à six vieillards, je leur fis demander par mon interprète, s'ils connaissaient celui qui avait fait ce soleil qui allait disparaître... enfin s'ils connaissaient le ciel et les étoiles qui allaient paraître une heure après. À ma question chacun de ces vieillards, comme interdits, se regardait [sic] sans répondre ; cependant, après un instant de silence, un me demanda si moi-même je connaissais tous les objets dont je venais de parler ». L'auteur ignore qu'au point de vue de la science expérimentale, la connaissance qu'il s'imagine avoir de celui qui a fait le soleil a beaucoup moins de valeur que l'ignorance nettement manifestée par les nègres. – PORTER ; dans Bibl. univ. des voy., t. 16. L'auteur parle d'un chef de l'île Madison : « (p. 166) Après qu'il fut demeuré quelque temps sur le pont, je voulus lui faire concevoir une haute idée de notre force ; et en conséquence j'assemblai (p. 167) tout mon équipage : il parut à peine s'en apercevoir. Je fis alors tirer un coup de canon qui ne sembla produire sur lui d'autre effet qu'une sensation douloureuse : il dit que cela lui avait fait mal aux oreilles. Je l'invitai ensuite à descendre dans la cabine, où rien n'attira particulièrement son attention, jusqu'à ce que je lui montrasse quelques dents de baleine... je lui demandai s'il avait vu dans le vaisseau quelque chose qui lui plût, ajoutant que s'il me désignait cette chose, je le prierais de l'accepter. Il me répondit qu'il n'avait rien vu qui lui plût autant que les dents de petites baleines... » – HOVELACQUE ; Les nègres : « p. 456) L'abstraction est absolument en dehors de sa faculté de conception [du nègre] : point de mots abstraits dans son langage ; seules les choses tangibles ont le don de le saisir. Quant à généraliser, quant à tirer de l'ensemble des phénomènes matériels une systématisation quelconque, il ne faut pas le lui demander ».
[FN: § 702-1]
MUNGO PARK ; Voy. dans l’int. de 1'Afr., vol. II. On trouve des considérations analogues chez l'auteur suivant. BURCHELL ; dans Bibl. unir. des voy., t. 26. L'auteur parle à un Bachapin : « (p. 446) Je n'eus pas de peine à lui faire concevoir l'état d'une existence future, attendu que les Bachapins avaient quelques notions confuses de cette espèce ; mais jusqu'à quel degré croyaient-ils aux récompenses et aux châtiments que chaque (p. 447) humain doit recevoir après sa mort, voilà ce que je n'ai jamais pu découvrir au juste [on ne peut en effet pas découvrir ce qui n'existe pas]. Il ne m'a pas semblé non plus qu'ils eussent aucune idée très sublime de l'âme et de son immortalité. Quant à l'existence d'un pouvoir suprême veillant sur le monde, ils ne la nient pas précisément [ils ne nieraient probablement pas non plus un théorème de géométrie !] mais la foi qu'ils y ajoutent est tellement mêlée de supposition, qu'elle ne peut guère influer avec avantage sur leur conduite morale ou sur leurs sentiments religieux. Ces notions superstitieuses ne doivent être que le résultat de la faiblesse des esprits, et le respect dont elles continuent à être honorées prouve mieux que tout autre argument combien est faible l'état de l'intelligence et de la raison parmi ces peuples ».
[FN: § 703-1]
Tylor rejette plusieurs témoignages de voyageurs déclarant que certains peuples avaient une religion, en leur opposant des témoignages contraires d'autres voyageurs. En certains cas, il a raison ; il peut avoir raison en d'autres et peut avoir tort en d'autres encore ; car il n'est pas certain que le second témoignage soit toujours plus croyable que le premier. En tout cas, il n'en reste pas moins vrai que les sauvages s'adonnent généralement peu aux raisonnements abstraits ; et il n'est pas du tout sûr que le concept auquel les voyageurs donnent le nom d'âme, soit identique à celui que nous appelons ainsi. L'exemple certain de la ![]() grecque suffit à nous montrer combien il est facile de se tromper dans ces interprétations (§ 695-1).
grecque suffit à nous montrer combien il est facile de se tromper dans ces interprétations (§ 695-1).
[FN: § 704-1]
H. SPENCER; Principes de Sociologie, t. I, § 64.
[FN: § 706-1]
H. SPENCER; Principes de Sociologie, t. I, § 63.
[FN: § 706-2]
Voir, sur ce sujet, TULLIO MARTELLO; L'economia moderna e la odierna crisi del darwinismo.
[FN: § 707-1]
H. SPENCER; Principes de Sociologie , t. 1, § 65.
[FN: § 709-1]
H. SPENCER ; Principes de Sociologie, t. I, § 99.
[FN: § 710-1]
H. SPENCER; Principes de Sociologie, t. I.
[FN: § 712-1]
S. REINACH; Cultes, Mythes et Religions, t. I.
[FN: § 713-1]
Dans un ouvrage récent, Reinach ne défend plus le code complet du totémisme. S. REINACH; Orpheus : « (p. 20) Définir le totémisme est très difficile. On peut dire, quitte à préciser ensuite, que c'est une sorte de culte rendu aux animaux et aux végétaux, considérés comme alliés et apparentés de l'homme ». I. G. FRAZER ; Le totémisme : « (p. 3) Un totem est une classe d'objets matériels que le sauvage regarde avec un respect superstitieux, croyant qu'il existe entre lui et chaque membre de cette classe une relation intime et très spéciale... (p. 4) Les rapports entre un homme et son totem ont un caractère d'utilité réciproque : le totem protège l'homme, et celui-ci prouve son respect pour son totem de différentes manières ; il ne le tue pas, par exemple, si c'est un animal; il ne le coupe ni le cueille si c'est une plante. Un totem, et ceci le distingue du fétiche, n'est jamais un individu isolé, mais toujours une classe d'objets, généralement une espèce animale ou végétale, plus rarement une catégorie d'objets inanimés naturels, moins souvent encore d'objets artificiels ».
[FN: § 716-1]
G. VILLANI; Croniche, I. VI, c. 69. «Au temps du dit peuple de Florence, un magnifique et fort lion fut donné en cadeau à la commune; il était enfermé à la place de Saint-Jean. Il arriva que, mal surveillé par celui qui le gardait, le dit lion sortit de sa cage, courant par le pays ; ce dont toute la ville fut frappée de peur. Il arriva à Orto San Michele, y prit un enfant et le tenait entre ses pattes. En l'entendant, la mère qui n'en avait pas d'autres et qui portait cet enfant dans son sein quand le père mourut, comme désespérée, poussant de grands cris, échevelée, courut contre le lion et lui arracha l'enfant d'entre les pattes. Le lion ne fit aucun mal ni à la femme ni à l'enfant ; il regarda simplement ». N'est-ce pas précisément une conséquence de l'article 9 du code du totémisme (§ 712) ? Villani continue : « On se demanda ce qui en était : si c'était la noblesse de la nature du lion, ou si la destinée préservait la vie du dit enfant, pour qu'il vengeât plus tard son père, comme il le fit... ». Ce que Villani appelle « noblesse de la nature du lion » n'est-ce pas évidemment la bienveillance du totem pour son clan ? En comparant un grand nombre d'autres explications avec celle-ci, le lecteur verra qu'elles s'appuient sur des preuves beaucoup plus faibles, et qu'elles sont pourtant admises en toute confiance. On remarquera encore que si l'on avait du temps à consacrer à ces recherches, on trouverait facilement d'autres textes à l'appui des conclusions totémiques concernant le lion de Florence. Par exemple le suivant : BAYLE ; Dist. hist., t. II, s. r. Delphinus : « (267) (A) On a retranché... un endroit curieux qui se trouve dans un Manuscrit de ses Lettres. Le curieux et savant Père Mabillon nous a fait savoir ce que c'est. Le Passage retranché, étoit à la Lettre XXXV du VIIe livre, et contient ceci. Les habitans d'Arezzo avoient jetté dans un puits un lion † de pierre qui étoit au haut de la grande Eglise. On l'en tira quand les François entrèrent dans cette Ville sous Charles VIII, et on le plaça au milieu de la grande rue, et tous les habitans d'Arezzo qui passoient par là furent obligez de se mettre à genoux devant ce lion, et à demander pardon de leur révolte ». Si nous ne connaissions que ce texte, Dieu sait quelle belle théorie on en pourrait tirer ! Ce lion était un marzocco, et le fait raconté rentre dans la grande classe de ceux où l'on voit imposer le salut au drapeau insulté. Une note de Bayle met le lecteur à même de comprendre la chose ; mais sans la note, celui qui ne saurait pas que le Marzocco était l'enseigne de Florence, pourrait supposer toute autre chose qu'un salut au drapeau.
† (NOTE DE BAYLE) : « C'étoient les Armes de Florence ».
[FN: § 717-1]
S. REINAGH; Cultes, Mythes et Religions, t. I, pp. 55-58.
[FN: § 718-1]
Rappelons qu'il n'existe pas une chose à laquelle on ait donné le nom de totémisme, comme il existe un animal auquel on a donné le nom d'éléphant. Il existe différents états d'âme, que certains auteurs ont réunis en une classe, à laquelle ils ont donné le nom de totémisme. La composition de cette classe est arbitraire, entre certaines limites.
[FN: § 719-1]
FOUCART; La méth. comp. dans l'hist. des relig. L'auteur dit : « (p. 52) Ces cultes [des animaux] si constants, si solidement fixés dans leurs traits caractéristiques, paraissent aussi anciens que la religion égyptienne. Ils remontent à ses origines mêmes, s'il est permis de parier d'un temps que personne ne connaîtra jamais directement ». Et plus loin : « (p. 54) Voilà donc, en Égypte, les caractères de la zoolâtrie ; des dieux ayant la forme animale et des chefs humains qui sont leurs descendants directs. Comment s'était formée cette conception ? Elle était née des croyances des Égyptiens et de leurs idées sur le monde sensible au milieu duquel ils se mouvaient ». Ainsi ces braves gens commencèrent par faire une théorie du monde sensible et créèrent ensuite leurs dieux. C'est la manie des interprétations logiques. Et quelle théorie subtile ils avaient, suivant l'auteur ! « (p, 54) À leurs yeux, tout vivait dans la nature, même les objets que nous appelons inanimés. Elle se composait de deux éléments [ils connaissaient aussi les éléments !] : une enveloppe matérielle qui était le corps et un autre élément plus subtil, invisible, mais également matériel, auquel on donnait des noms divers : âme, esprit, double. Leur union était indispensable pour qu'un être fût vivant ». Il ne manque plus à ces hommes vivant en un temps très reculé, « que personne ne connaîtra jamais directement », que d'avoir aussi inventé l'algèbre, et le tableau sera parfait. Cfr. § 1701, 695-1.
[FN: § 720-1]
Série et limite sont pris ici au sens mathématique.
[FN: § 720-2]
On voit bien ce contraste des deux genres, dans le passage suivant, Doctrine S. Simonnienne. Expos., p. 82 : « Nous devons montrer à un siècle qui se dit, pardessus tout, raisonneur, que nos croyances sur l’avenir de l'humanité révélées, par une vive sympathie, par un ardent désir de contribuer à son bonheur, sont justifiées par l'observation la plus rigoureuse des faits... (p. 68) Nous avons dit dès le début que la conception de SAINT-SIMON était vérifiable par l'histoire ; n'attendez de nous ni la discussion des faits partiels, ni l'éclaircissement des détails consignés dans d'obscures chroniques ». C'est la façon habituelle de raisonner : on feint d'admettre l'expérience, pour la repousser aussitôt, « Nous ne porterons nos regards que sur les lois générales qui dominent tous ces faits ; lois simples et constantes comme celles qui régissent l'organisation de l’homme... SAINT-SIMON eut pour mission de découvrir ces lois, et il les légua au monde comme un sublime héritage. Notre mission, à nous qui sommes ses disciples, est de continuer sa révélation, de développer ses hautes conceptions, et de les propager ». [Les termes soulignés le sont aussi dans le texte.]
[FN: § 723-1]
Le Père MARIE JOSEPH LAGRANGE, des Frères prêcheurs; Études sur les religions sémitiques, Paris. 1903 ; avec imprimatur de l'Archevêque de Paris : « (p. 1) En étudiant la religion des Sémites, nous nous proposions seulement d'éclairer quelques points obscurs de la religion des peuples voisins ou parents d'Israël. Ce domaine est encore peu exploré et cependant les découvertes épigraphiques l'étendent chaque jour davantage. Le plus sage serait donc assurément de se borner à recueillir les faits nouveaux et à tirer les conclusions particulières les plus certaines. Pour notre part nous nous sommes efforcé d'éloigner de notre esprit toute idée préconçue. Nous ne nous croyons pas tenu de faire entrer en ligne la Révélation primitive, puisque l'Écriture qui nous l'enseigne ajoute qu'elle a été oblitérée [théorie de la décadence du type]. Jamais nous n'avons cédé à la tentation d'insister plus que de raison sur les symptômes de décadence religieuse ». Nous n'avons pas à vérifier ici comment cette promesse a été tenue ; en tout cas, on voit par le livre du P. Lagrange que l'auteur était de bonne foi en la faisant.
Comparez maintenant ce programme avec celui de l'historiographe officiel de la Révolution française: M. Aulard. A. AULARD ; Hist. polit. de la Rév. franç. : « (p. v.) Dans cette histoire politique de la Révolution française, je me propose de montrer comment les principes de la Déclaration des droits furent, de 1789 à 1904, mis en oeuvre dans les institutions, ou interprétés dans les discours, dans la presse, dans les actes des partis, dans les diverses manifestations de l'opinion publique ». M. Aulard ne s'aperçoit peut-être pas qu'il imite Bossuet. Celui-ci; dans son Discours sur l'histoire universelle, déclare avoir pour but de montrer comment les desseins de la Providence ont gouverné les institutions et les mœurs. « Ainsi tous les grands empires que nous avons vus sur la terre, ont concouru par divers moyens au bien de la religion et à la gloire de Dieu, comme Dieu même l'a déclaré par ses prophètes ». (IIIe partie, chap. 1) M. Aulard continue : « La conséquence logique du principe de l'égalité, c'est la démocratie. La conséquence logique du principe de la souveraineté nationale, c'est la république [pauvre logique ! que de sottises on t'attribue !] Ces deux conséquences ne furent pas tirées tout de suite [voilà le malheur des hommes de ce temps-là, qui n'ont pas eu un savant logicien comme M. Aulard]. Au lieu de la démocratie, les hommes de 1789 établirent un régime censitaire bourgeois. Au lieu de la république, ils organisèrent une monarchie limitée ». M. Bayet a publié, dans la collection de M. Aulard, pour l'enseignement élémentaire, un petit manuel intitulé : Leçons de morale, Cours moyen, Paris, 1909. Il nous avertit (p. I) qu'il montre « la différence entre les vérités scientifiques que l'ignorant seul peut refuser d'admettre, et les croyances religieuses et métaphysiques (p. II) que chacun de nous a le droit d'accepter, de rejeter ou de modifier à sa guise ». C'est là la métaphysique de la Science ; car on méconnaît le caractère essentiellement contingent des vérités scientifiques. Si M. Bayet avait quelque connaissance de la science expérimentale, il saurait qu'elle est dans un continuel devenir, et il aurait appris que la science, progresse justement parce que des hommes de science « refusent d'admettre » certains principes tenus jusqu'à eux pour des « vérités scientifiques ». Parmi ces « vérités scientifiques » de M. Bayet, se trouve une belle théorie de la religion et une non moins belle théorie de son origine.
« Comme on ne peut pas savoir scientifiquement ce qu'il y aura après la mort, les hommes ont essayé de le DEVINER [c'est M. Bayet qui souligne], et ils ont fait à ce sujet, un grand nombre de SUPPOSITIONS. Les uns ont dit qu'après la mort il N'ARRIVAIT RIEN DU TOUT. Mais d'autres ont cru qu'après la mort les hommes se trouvaient en présence d'un être éternel, souverainement bon, souverainement juste : DIEU. Ils ont cru que Dieu jugeait les hommes, les récompensait ou les punissait. À cause de cela, ils ont dit que les hommes devaient honorer et prier Dieu, et ils ont fixé les prières qu'il faut dire pour le prier, et les cérémonies qu'il faut célébrer pour l'honorer. Ainsi, ils ont fondé un certain nombre de religions ». Cet auteur aurait un besoin urgent de lire quelque manuel, même très élémentaire, d'histoire des religions. Avant d'enseigner aux autres, il est bon d'apprendre pour son propre compte. Il est remarquable que ces éminentes personnes, ne pouvant persuader autrui par le raisonnement, font des procès à qui n'admire pas leur profonde science.
[FN: § 726-1]
A. ERMAN ; La religion égypt.
[FN: § 728-1]
Cette limite est semblable à l'asymptote d'une courbe géométrique.
[FN: § 729-1]
H. SPENCER; Principes de Sociologie, t. I, § 150.
[FN: § 731-1]
J. DE MORGAN; Les prem. civ.: « (p. 45) L'Homo (Pithecanthropus) alalus, privé encore de la parole, l'Homo stupidus d'Haeckel, les Anthropopithecus Bourgeoisi et Ribeiroi de Mortillet sont des êtres hypothétiques, dont l'existence ne repose que sur des suppositions, sans bases scientifiques précises. Cette théorie implique l'unité originelle de l'espèce humaine ; ce qui semble vrai pour les races vivant aujourd'hui, mais peut aussi ne pas l'avoir été pour d'autres disparues. Ces hypothèses, dont la gratuité ne fait absolument aucun doute, ont cependant pris, dans la pensée de beaucoup, la valeur d'axiomes sur lesquels s'échafaudèrent, en ces dernières années, nombre de théories où la fantaisie tient lieu de raisonnement scientifique *. Il ne manque pas de savants, ou de soi-disant tels, qui considèrent le Pithecanthropus comme notre ancêtre ; alors que rien ne prouve cette ascendance ; qu'aucune donnée ne permet d'affirmer que ce fut une forme ancestrale de l'homme ; qu'il est apparenté, même d'une façon très éloignée, à notre espèce** ».
Notes de Morgan :
* « Cf. entre autres El. Reclus qui, dans l’Homme et la terre, a poussé les choses à l'extrême ridicule. Il va jusqu'à considérer les animaux domestiques (se basant sur leurs perfectionnements) comme des candidats à l'humanité... ».
** « Une autre théorie tend à considérer les Simiens comme des branches dégénérées de la race humaine. Cf. J. H. F. KOHLBRUGGE, Die Morphologische Abstammung des Menschen, Stuttgart, 1908 ».
[FN: § 732-1]
Doctrin. S. SIMON ; Expos. : « (p. 18) Mais quelle est cette nouvelle manière d'envisager l'histoire, de faire, pour ainsi dire, raconter au passé l'avenir de l'humanité ? De quelle valeur est donc cette preuve apportée par nous à l'appui de nos rêves d'avenir ? Une science nouvelle, une science tout aussi positive que toutes celles qui méritent ce titre, a été conçue par SAINT-SIMON : Cette science est celle de l'espèce humaine : sa méthode est la même que celle qui est employée en astronomie, en physique ; les faits y sont classés par séries de termes homogènes, enchaînés par ordre de généralisation et de particularisation, de manière à faire ressortir leur TENDANCE, (p. 19) c'est-à-dire à montrer la loi de croissance et de décroissance à laquelle ils sont soumis ».
[FN: § 734-1]
PETR.; p. 109. SERVIUS; Ad. Virg. Aen., III 57.
[FN: § 735-1]
LUCIEN BIART ; Les Aztèques, p. 125-126. – A. RÉVILLE; Les rel. du Mex., etc.: « (p. 135) On lui avait endossé les insignes et les vêtements de Tezeatlipoca, et, lorsqu'il parcourait la ville, escorté de huit pages à la livrée royale, le peuple l'adorait comme s'il eût été la divinité elle-même. On prenait de lui les soins les plus attentifs, on le baignait, on le parfumait, on le coiffait, on renouvelait son uniforme divin, et on lui donnait pour compagnes quatre belles jeunes filles, portant des noms de déesses et qui recevaient pour instruction de ne rien négliger pour rendre leur divin époux aussi heureux que possible. Dans les vingt jours qui précédaient la fête, ces marques d'honneur allaient encore en augmentant... Mais la veille du dernier jour de fête, le substitut de Tezeatlipoca était embarqué sur un canot royal, lui, ses huit pages et ses quatre déesses, et conduit de l'autre côté du lac. Le soir ses déesses quittaient leur pauvre dieu, et les huit pages le menaient à deux lieues de là vers un teocalli solitaire dont il gravissait les degrés en brisant ses flûtes. Au sommet il était (p. 186) saisi par les prêtres qui l'attendaient, étalé brusquement sur la pierre du sacrifice, éventré, et son cœur palpitant était offert au soleil ».
[FN: § 737-1]
FRAZER; Le rameau d'or, t. II. – S. REINACH; Cultes, Mythes et Religions, I.
[FN: § 737-2]
JACOB; Curiosités de l'histoire de France. Beletus appelle la fête des fous « (p. 14) la liberté de décembre, à l'instar des Saturnales païennes. Cette liberté consistait à intervertir les rôles et les rangs du clergé, qui, pendant les fêtes de Noël et de l'Épiphanie, commettait toutes sortes de folies dans l'intérieur des églises : les clercs, diacres et sous-diacres officiaient à la place des prêtres ; ceux-ci dansaient et jouaient aux dés, à la paume, à la boule et à d'autres jeux de hasard devant l'autel ; les enfants de chœur, masqués et couverts de chapes, occupaient les stalles des chanoines ; la veille des Innocents, ils (p. 15) élisaient un évêque parmi eux, le revêtaient d'habits épiscopaux, le sacraient et le promenaient par la ville au son des cloches et des instruments. (p. 17)... le jour de la Circoncision les gens d'Église assistaient à l'office, les uns en habit de femmes, de fous, d'histrions ; les autres en chape et en chasubles mises à l'envers [remarquez le principe du contraste]; la plupart avec des masques de figure monstrueuse: ils élisaient un évêque ou un archevêque des Fous... (p. 31)... à Antibes... les acteurs de cette fête, semblables à des fous furieux, se revêtaient d'ornements sacerdotaux mis à l'envers [toujours le contraste] ou déchirés, pour occuper les stalles du chœur ; ils tenaient des livres d'heures à rebours, et faisaient semblant de lire avec des lunettes dont les verres étaient remplacés par des écorces d'oranges ; ils s'encensaient avec de la cendre ou de la farine... ». – DUCANGE ; s. r. Kalendae. L'auteur cite des lettres de Charles VII, roi de France, données le 17 avril 1445. « Charles, etc. Notre amé et féal conseiller l'évesque de Troyes nous a fait exposer en complaignant, que combien que... par le decret (du Concile de Basle) est expréssement deffendu aux gens et ministres de l'église certaine dérisoire et scandaleuse feste, qu'ils appellent la feste aux fols, laquelle en plusieurs églises cathédrales et autres, collégiales estoit accoustumé de faire, environ les festes et octave de Noël, en laquelle faisant iceux gens d'église irrévérences et dérisions de Dieu nostre créateur, et de son saint et divin office, au très grand vitupere et diffame de tout l'estat ecclésiastique, faisoient toutes églises et lieux saints, comme dehors et mesmement durant le divin office plusieurs grandes insolences, dérisions mocqueries, spectacles publics, de leurs corps déguisements, en usant d'habits indécents et non appartenants à leur estat et profession, comme d'habits et vestements de fols, de gens d'armes et autres habits séculiers, et les aucuns usants d'habits et vestements de femmes, aucuns de faux visages... »
[FN: § 737-3]
S. REINACH ; Orpheus, p. 337 : «Enfin et surtout, les circonstances de la Passion ressemblent, d'une manière tout à fait suspecte, à des rites usités fort antérieurement dans certaines fêtes. À celle dite des Sacaea, en Babylonie et en Perse, on promenait en triomphe un condamné habillé en roi ; à la fin de la fête, il était dépouillé de ses beaux vêtements, flagellé, pendu ou crucifié. Nous savons par Philon que la populace d'Alexandrie qualifiait de Karabas un de ces rois improvisés, qu'on accablait d'honneurs dérisoires pour le maltraiter ensuite. Mais Karabas n'a de sens ni en araméen, ni en grec : il faut (p. 838) restituer Barabas, qui signifie en araméen, « le fils du père »... Il résulte de ces rapprochements que Jésus aurait été mis à mort, non de préférence à Barabas, mais en qualité de Barabas. Les Évangélistes n'ont compris ni la cérémonie qu'ils racontaient, ni la nature des honneurs dérisoires rendus à Jésus... ».
[FN: § 738-1]
MARDRUS; Le livre des mille et une nuits, t. X; Histoire du dormeur éveillé, p. 179-263. Le Calife endort Aboul-Hassân et le met à sa place. Aboul-Hassân « (p. 195) se vit d'abord dans un lit magnifique dont la couverture était recouverte d'un brocart d'or rouge... Et il jeta les yeux autour de lui et se vit entouré de jeunes femmes et de jeunes esclaves inclinés, d'une beauté ravissante... Et tout près de lui, sur tabouret, il reconnut, à leur couleur, les habits, le manteau et le turban de l'émir des Croyants ». Le lendemain, Aboul-Hassân est reconduit à sa maison; et comme il persiste à se croire le Calife, on le traite de fou « (p. 221)... le porteur de l'hôpital des fous, suivi de deux solides gardiens, arriva avec tout un attirail de chaînes et de menottes, et tenant à la main une cravache en nerf de bœuf... le portier commença par lui appliquer sur l'épaule deux ou trois coups de son nerf de bœuf. Après quoi... (p. 222) ils le chargèrent de chaînes de fer et le transportèrent à l'hôpital des fous, au milieu d'un grand rassemblement de passants qui lui donnaient les uns un coup de poing et les autres un coup de pied... »
[FN: § 738-2]
LAGRANGE ; Quelques remarques sur l'Orpheus de M. Salomon Reinach, p. 39 à 52.
[FN: § 739-1]
FRIEDLAENDER ; Mœurs romaines, t. II, parle de représentations théâtrales dans l'arène, où figuraient des condamnés. « (p. 161) On les instruisait et exerçait spécialement pour leur rôle, dans lequel ils ne feignaient pas de subir, mais souffraient bien réellement la mort et les tourments. Ils paraissaient couverts de tuniques somptueuses et brochées d'or... quand soudain s’échappaient de ces magnifiques vêtements, comme de ceux de Médée, des flammes destructives qui consumaient ces malheureux, au milieu d'horribles souffrances. ...(p. 162) Des chrétiens furent obligés de subir le martyre en costume de prêtre de Saturne... des chrétiennes travesties en prêtresses de Cérès. Il n'y avait guère de forme de torture et de supplice, mentionnée avec effroi par l'histoire ou la littérature, qui ne fût employée, pour l'amusement du peuple, à ces représentations. …(p. 163) Ces exécutions, à Rome, avaient généralement lieu de bon matin, et nous savons, par Philon, qu'il n'en était pas autrement à Alexandrie ». Voir en outre Martial, L’âne de Lucien, le livre X des Métamorphoses d'Apulée.
[FN: § 743-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. MICHEL REVON ; Anthol. japonaise, des orig. au XXe siècle. L'auteur donne entre autres la traduction de plusieurs passages du Kojiki (Livre des choses anciennes), qui est en quelque sorte la Bible du Japon. Pages 39-42, IX, Le pays des ténèbres, M. Revon note, au cours de sa traduction, des ressemblances frappantes entre le mythe japonais et le mythe grec, mais il ne se croit pas obligé d'en conclure à une imitation. Le dieu Izanaghi, désolé de la mort d'Izanami, qui est à la fois sa sœur et son épouse, descend aux Enfers. « Désirant revoir sa jeune sœur l'auguste Izanami, il la suivit au Pays des Ténèbres... Alors l'auguste Izanami répondit : „ Il est lamentable que tu ne sois pas venu plus tôt : j'ai mangé à l'intérieur des Enfers ! * Néanmoins, ô mon auguste et charmant frère aîné, touchée de l'honneur de ton entrée ici, je voudrais revenir ; et je vais en conférer avec les divinités des Enfers. Ne me regarde pas ! “ ** ». Izanaghi n'a pu s'empêcher de regarder son épouse. Mais l'aspect de la déesse est affreusement repoussant. « Alors, comme l'auguste Izanaghi, terrifié à cette vue, s'enfuyait en arrière, sa jeune sœur, l'auguste Izanami : „ Tu m'as remplie de honte ! ” Et ce disant, aussitôt elle lança à sa poursuite les Hideuses-Femelles des Enfers... *** Ensuite, elle lança à sa poursuite les huit espèces de dieux du Tonnerre, avec mille cinq cents guerriers des Enfers. Mais, tirant le sabre de dix largeurs de main dont il était augustement ceint, et de sa main le brandissant derrière lui ****, il fuyait en avant ; ... (p. 41) C'est pourquoi l'auguste Izanami est appelée la Grande-divinité-des-Enfers ***** ». Par ci par là, dans le Kojiki, M. Revon relève encore d'autres ressemblances entre la mythologie des Japonais et celle des Grecs, des Hébreux ou d'autres peuples éloignés du Japon. C'est ainsi qu'on rencontre le dieu forgeron Ama-tsou-ma-ra qui, comme les Cyclopes, n'a qu'un seul œil. Page 54, note 3, l'auteur fait la remarque suivante : « D'une manière générale, les descentes aux Enfers peuvent se ramener à deux motifs principaux : désir de revoir un être aimé (Orphée, Izanaghi), ou désir de consulter un personnage fameux, de préférence un ancêtre (Ulysse, Oh-kouni-noushi) ».
[NOTES DE M. REVON].
* Lorsqu'un vivant avait goûté aux aliments du monde souterrain, il ne pouvait plus revenir à la lumière. Comp. la grenade de Perséphone on de Proserpine.
** Cette défense est aussi le nœud du mythe d'Orphée, qui doit remonter au jour sans se retourner, tandis qu'Eurydice marche derrière lui.
*** Les Erinnyes du mythe japonais.
**** Il a soin de ne pas se retourner. Comp. l'attitude des anciens Grecs sacrifiant aux dieux souterrains.
***** De même que Proserpine devient la reine des Enfers ou elle a été retenue.
[FN: § 744-1]
M. J. LAGRANGE; Quelq. rem. sur l'Orph., fait les objections suivantes : 1° Il ne faut pas confondre l'épisode de Karabas et le rite des Sacées. « (p. 38) Quand le jeune roi Agrippa Ier... passa à Alexandrie, les indigènes de cette ville résolurent de lui donner un charivari... (p. 39) On s'empara donc d'un pauvre fou, nommé Karabas. Philon, n'étant point un évangéliste, n'a pas dû se tromper en lui donnant ce nom... On pousse le pauvre idiot au gymnase, on le met bien en vue... Quand il est revêtu des insignes de la royauté, « à la façon des mimes au théâtre », des jeunes gens se font ses gardes du corps... La populace l'acclame Marin, c'est-à-dire Seigneur, en syriaque, pour bien montrer qu'elle se jouait d'Agrippa. Ce fut, on le voit, une scène de bouffons, attentatoire au respect dû à une pauvre créature humaine, mais du moins il n'y eut ni coups, ni sang versé ». Ce fait, raconté par Philon, in Flaccum, paraît vraiment étranger à l'argumentation que veut faire Reinach. « (p. 39) Néanmoins, dira-t-on, cela ressemble beaucoup (p. 40) à la scène du corps de garde de Jérusalem. – Je le crois bien ! aussi depuis que Grotius a signalé ce passage de Philon, en 1641, il traîne dans tous les commentaires. Rien de plus propre à mettre dans son jour historique la conduite des soldats de Pilate. Des deux côtés on veut se moquer des Juifs et des prétentions d'un Juif à la couronne [c'est-à-dire que nous avons des branches d'un même tronc, comme dans la fig. 15]. À Alexandrie Agrippa n'est maltraité pour ainsi dire qu'en effigie, dans la personne de Karabas, dit Barabbas – ; à Jérusalem, c'est un prétendant à la couronne qui est livré aux soldats, au moment où cette prétention est un crime capital ; il est déjà condamné. Aussi, tandis qu'à Alexandrie on s'amuse, à Jérusalem la plaisanterie se termine dans le sang ». Le fait des Sacées rentre au contraire dans la catégorie dont Reinach peut faire état. Le P. Lagrange dit : « (p. 40) Cette fête des Sacées nous est connue par Bérose (ATHEN.; XIV, p. 639 c). Elle durait cinq jours avec des allures de carnaval. Les maîtres obéissaient à (p. 41) leurs domestiques, on promenait solennellement un individu habillé en roi. Quoique Bérose ne donne pas beaucoup de détails, il est assez piquant qu'il nous fasse connaître le sobriquet imposé au roi de comédie. Ce « Barabas » se nommait Zoganés !... Plus tard, Strabon nous montre la fête des Sacées intimement liée avec le culte de la (p. 42) déesse persane Anaïtis (STRAB.; XI, 8, 5) ». Le P. Lagrange rappelle que, suivant Dion Chrysostôme (De Regno, IV, 66), Diogène aurait fait à Alexandre la description de cette fête. « (p. 42) Les Perses prennent un prisonnier condamné à mort et le font asseoir sur le trône du roi ; on le revêt de l'habit royal ; on le laisse commander, boire, s'amuser, en prendre à son aise pendant ces journées avec les concubines du roi, et personne ne l'empêche de faire tout ce qui lui plaît. Après cela on le dépouille, on le flagelle et on le pend ». « (p. 117) Le texte de Dion avait été cité en marge de l'évangile par Wetstein en 1752. Personne n'avait exagéré l'importance du rapprochement. Ce qui lui a donné un regain de nouveauté, c'est la publication, par M. Cumont, des actes de saint Dasius. Ce soldat chrétien refusa de jouer le rôle de roi des Saturnales, et dut à cause de cela subir le martyre. Or ce roi prétendu représentait Saturne, et, s'il pouvait, pendant trente jours, se permettre tous les excès, il devait, au jour de la fête, s'immoler sur l'autel du dieu ».
[FN: § 745-1]
HÉROD. ; II, 62 : « Quand, dans la ville de Sain, les gens se réunissent pour des sacrifices, une nuit déterminée, tous allument des lanternes, en plein air autour des maisons. Ces lanternes sont de petits vases pleins de sel et d'huile, surmontés d'un lumignon qui brûle toute la nuit. Ils donnent à cette fête le nom de lampes allumées † ».
† (NOTE DE LARCHER) : Cette fête qui ressemble beaucoup à celle des lanternes établie à la Chine depuis un temps immémorial, pourrait servir à confirmer le sentiment de M. de Guignes, qui a soupçonné l'un des premiers que la Chine n'était qu'une colonie de l'Égypte ».
Voilà l'une des nombreuses idées erronées, que donne le principe qui attribue une origine commune aux choses semblables.
[FN: § 747-1]
DIONYS. HAL.; II, 66.
[FN: § 747-2]
OVID.; Fast., VI :
(289) Quid mirum, virgo si virgine laeta ministra
Admittit castas in sua sacra manus ?
Nec tu allud Vestam, quamn vivam intellige flammam :
Nataque de flamma corpora nulle, vides.
Iure igitur virgo est, quae semina nulle remittit,
Nec capitm; et comites virginitatis habet.
[FN: § 747-3]
CIC ; De leg., II, 12, 29 : Cumque Vesta, quasi focus urbis, ut graeco nomine est appellata (quod nos prope idem graecum interpretatum nomen tenemus) consepta sit, ei colendae virgines praesint, ut advigiletur facilius ad castodiam ignis, et sentiant mulieres in natura feminarum omnem castitatem pati [al. peti]. Si l'on admet la leçon : peti, les femmes devraient être chastes, en voyant que la chasteté plaît aux dieux. Duruy parait être de cet avis. Hist. rom., 1 : « (p. 103) Mais à l'idée religieuse qui avait d'abord déterminé les conditions imposées aux prêtresses s'était ajouté, comme conséquence, une idée morale. Cette flamme éternelle qui symbolisait la vie même du peuple romain, des vierges seules pouvaient l'entretenir ; l'institution du collège des vestales était donc une glorification involontaire de la chasteté, et, en des temps de ferveur, cette croyance devait avoir une influence heureuse sur les mœurs ». L'histoire écrite de cette manière devient un recueil de fables morales à l'usage des enfants.
[FN: § 747-4]
PLUTARCH. ; Numa, IX.
[FN: § 747-5]
Plutarque ajoute : « (6) Et, à la vérité, en Grèce, là où l'on conserve le feu inextinguible, comme à Delphes et à Athènes, ce ne sont pas des vierges qui le gardent, mais des femmes qui ont cessé d'être aptes aux rapports sexuels ».
[FN: § 747-6]
PLUTARCH. ; Camillus , XX.
[FN: § 748-1]
DIOD. SIC.; XVI, 26, 6.
[FN: § 748-2]
PLUTARCH. ; De Pyth. orac., 22 : ![]()
![]() . »Ainsi la Pythie qui sert le dieu est née de famille régulière et bonne autant que toute autre, et vit avec décence ». L'auteur continue en disant que cette jeune fille est selon le désir de Xénophon, qui voulait que lorsque l'épouse allait habiter chez son mari, elle eût vu et entendu le moins de choses possible. C'est peut-être pourquoi BOUCHÉ-LECLERC ; Hist. de la div., III p. 98, dit : « Le dieu qui devait être désormais son seul époux, la voulait belle et chaste. Toute souillure l'eût rendue indigne de l'union mystique que les polémistes chrétiens se sont trop complus à ridiculiser par leurs allusions indécentes... » Ainsi voilà une nouvelle explication logique !
. »Ainsi la Pythie qui sert le dieu est née de famille régulière et bonne autant que toute autre, et vit avec décence ». L'auteur continue en disant que cette jeune fille est selon le désir de Xénophon, qui voulait que lorsque l'épouse allait habiter chez son mari, elle eût vu et entendu le moins de choses possible. C'est peut-être pourquoi BOUCHÉ-LECLERC ; Hist. de la div., III p. 98, dit : « Le dieu qui devait être désormais son seul époux, la voulait belle et chaste. Toute souillure l'eût rendue indigne de l'union mystique que les polémistes chrétiens se sont trop complus à ridiculiser par leurs allusions indécentes... » Ainsi voilà une nouvelle explication logique !
[FN: § 749-1] PAUS.; VIII, 5 :
[FN: § 750-1]
PAUS.; VIII, 13.
[FN: § 750-2]
PAUS.; VII, 25.
[FN: § 751-1]
PAUS.; VII, 19; VII, 26; II, 33.
[FN: § 751-2]
PAUS.; VIII, 47.
[FN: § 751-3]
AUCTOR. (DEMOSTH.); C. Near. 75.
[FN: § 751-4]
Levit., 21, 13.
[FN: § 752-1]
GELL. ; I, 12, nous donne, suivant Labéon, les conditions que devait remplir la jeune fille que le pontifex maximus prenait pour être Vestale : Qui de [vestali] virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius, minorem quam annos VI, maiorem quam annos X natam, negaverunt capi fas esse ; item quae non sit patrima et matrima ; item quae lingua debili sensuve aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit ; item quae ipsa aut cuius pater emancipatus sit, etiam si vivo patre in avi potestate sit ; item cuius parentes alter ambove servitute servierunt ; aut in negotiis sordidis diversantur.
[FN: § 752-2]
On sait que les prêtres catholiques doivent vivre dans la chasteté et ne pas avoir de défauts corporels importants. P. LANCELLOTTO ; Institutiones iuris canonici, I, 25 : § 19 Bigamus [qui s'est marié deux fois de suite régulièrement], et qui uxorem duxit viduam, eiectam, vel meretricem, ordinari non possunt. § 22. Corpore vitiatus, nisi modica sit laesio, ordinari non potest. Corp. iur. can. Dec. Grat. pars I, dist. 33, c. 2 : Maritum duarum post baptismum matronarum Clericum non ordinandum, neque eum, qui unam quidem, sed concubinam, non matronam habuit : nec illum, qui viduam, aut repudiatam, vel meretricem in matrimonium assumserit ; nec eum, qui semetipsum quolibet corporis sui membro indignatione aliqua, vel iusto, vel iniusto timore superatus truncaverit : nec illum qui usuras accepisse convincitur aut in scena lusisse dignoscitur : nec eum, qui publica poenitentia mortalia crimina deflevit : neque illum, qui in furiam aliquando versus insanivit, vel afflictione diaboli vexatus est : neque eum, qui per ambitionem ad imitationem Simonis magi pecuniam obtulerit. Ibid. Dist. 32, c. 12 : Nemo ad sacrum Ordinem permittatur accedere, nisi aut virgo, aut probatae sit castitatis, et qui usque ad Subdiaconatum unicam, et virginem uxorem habuerit. Cette dernière disposition est la même que celle en vigueur pour l'archonte-roi, à Athènes. RABB.; Leg. crim. du Tal., p. 190 : « Mischnah. Sont condamnés à la peine du fouet... un grand-prêtre qui prend une veuve (Levit., XXI, 14); un prêtre qui prend une femme divorcée ou celle qui a pratiqué la cérémonie du déchaussement (Deut., XXV, 9)... ». Decr. Grat., pars. 1, dist. 55, c. 4: Si quis abscidit semetipsum, id est, si quis amputavit sibi virilia, non fiat Clericus : quia sui est homicida, et Dei conditionis inimicus. § 1. Si quis cum. Clericus fuerit, absciderit semetipsum, omnino damnetur ; quia sui est homicida. C.5: Hi, qui se, carnali vitio repugnare nescientes, abscindunt ; ad Clerum pervenire non possunt. Au contraire les prêtres de Cybèle étaient eunuques.
[FN: § 754-1]
MARQUARDT ; Le Culte, t. II.
[FN: § 754-2]
PLUTARCH ; Quaest rom., 96. Il donne aussi ce motif et le suivant, indiqué dans le texte.
[FN: § 755-1]
RÉVILLE ; Les relig. du Mex. etc., p. 367. FEST. ; Probrum Virginis Vestalis, ut capite puniretur, vir qui eam incestavisset, verberibus necaretur, lex fixa in atrio Libertatis cum multis aliis legibus incendio consumpta est, ut ait M. Cato in ea oratione, quae de Auguribus inscribitur. Adicit quoque virgines Vestales sacerdotio exauguratas, quae incesti damnatae, vivae defossae sunt, quod sacra Vestae matris polluissent : nec tamen, licet nocentes, extra urbem obruebantur, sed in campo proxime portam Collinam, qui Sceleratus appellatur.
[FN: § 756-1]
DION. HAL.; II, 67.
[FN: § 757-1]
DION. HAL.; VIII, 89. Une autre légende nous donne l'étymologie du Campus sceleratus, ainsi nommé parce qu'en l'an 331 av. J.-C., on y ensevelit vive la Vestale Minucia, coupable d'avoir perdu sa virginité. Liv.VIII, 15: Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiorem iusto cultum, insimulata deinde apud pontifices ab indice servo ; cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere, familiam que in potestate habere ; facto iudicio, viva sub terram ad portam Collinam dextra via strata defossa Scelerato campo ; credo, ab incesto id el loco nomen factum.
[FN: § 757-2]
DION, HAL.; IX, 40.
[FN: § 758-1]
LIV.; XXII, 57.
[FN: § 760-1]
PLUTARCH.; Numa, 10, 8. L'auteur donne comme cause de cette façon de procéder, qu'il serait impie de laisser mourir de faim des corps consacrés par des cérémonies sacrées.
[FN: § 760-2]
SOPH.; Antig., 773-780. Créon dit d'Antigone : « Conduite en un lieu désert et sans trace d'hommes, je l'enfermerai vivante dans une caverne, avec assez de vivres pour parer au sacrilège, et pour que la cité évite le crime ». Le scoliaste observe que c'était une ancienne coutume, « afin qu'il ne parût pas qu'on faisait mourir de faim ; ce qui est impie » – ... ![]()
[FN: § 760-3]
ZONAR. ; VII, 8. Il raconte comment Tarquin l'Ancien fit ensevelir vivante, avec une couchette, une lanterne, une table et de la nourriture, une Vestale qui avait perdu sa virginité ; et il ajoute : « Et c'est ainsi que dès lors, il devint de règle de punir celles des prêtresses qui n'avaient pas gardé leur virginité ».
[FN: § 761-1]
SUET.; Domit.; 8. – DIO CASS.; LXVII, 3. Il raconte un peu différemment la punition des Vestales. PLIN. ; Epist., IV, 11 : Nam cum. Corneliam, maximam Vestalem, defodere vivam concupisset, ut qui illustrari saeculum suum eiusmodi exemplo arbitraretur,...
[FN: § 761-2]
DIO CASS.; LXXVII, 16. – HEROD.; IV, 6 :
« Il fit enterrer vives des Vestales comme si elles n'avaient pas gardé leur virginité ».
[FN: § 762-1]
DIO CASS.; LXXIX, 9. – HEROD.; V, 4. Il s'en excusa dans une lettre au Sénat, en disant : « qu'il était soumis aux passions humaines, et qu'il avait été pris par l'amour de la jeune fille ; que l'union d'un prêtre et d'une prêtresse était bien assortie ». – RÉVILLE ; Les rel. du Mex., etc., p. 366: « les Vierges du Soleil vivaient cloîtrées, dans une retraite absolue, sans aucun rapport avec le reste de la société, (p. 367) surtout avec les hommes. Seuls, l'Inca, et sa principale épouse, la Coya pouvaient pénétrer dans le couvent. Or ces visites de l'Inca n'étaient pas précisément désintéressées. C'est là, en effet, qu'il recrutait ordinairement son sérail. Fils du Soleil et pouvant épouser ses sœurs, il choisissait ainsi dans sa famille. Pourtant les jeunes vierges étaient astreintes à la chasteté la plus rigoureuse et s'engageaient par serment à n'y jamais manquer. Mais leur vœu consistait en ceci qu'elles n'auraient jamais d'autre époux que le Soleil ou celui à qui le Soleil les donnerait».
[FN: § 763-1]
GARCILLASSO DE LA VEGA ; Hist. des Incas, II; (p. 147) « La principale des quatre fêtes du Soleil que les Rois Incas célébroient, se nommoit Raymi ; elle arrivoit au mois de juin... (p. 149) Les prêtres Incas qui devoient faire les sacrifices, préparoient la veille de la fête les moutons et les agneaux qui devoient y servir, aussi bien que les vivres et le breuvage que l'on devoit présenter au Soleil... Les femmes du Soleil employoient cette même nuit à pétrir une pâte nommée Cancu ; elles en faisoient des petits pains de la grosseur d'une pomme... (p. 150) Les Vierges élues pouvoient seules pétrir la farine dont on faisoit les pains, principalement ceux que l'Inca et les Princes du Sang devoient manger ; elles accommodoient aussi toutes les autres viandes : car il était supposé que ce jour-là le Soleil traitoit ses enfans ». SERVIUS; ad. Egl., VIII, 82 Sparge molam. Far et salem. Hoc nomen de sacris tractum est : far enim pium id est, mola casta, salsa (utrumque enim significat) ita fit : virgines Vestales tres maximae ex Nonis Maiis ad pridie Idus Maias [date très peu différente de celle de la fête du Pérou, simplement parce que c'étaient des fêtes de printemps] alternis diebus spicas adoreas in corbibus messuariis ponunt ; easque spicas ipsae virgines torrent, pinsunt, molunt, atque ita molitum condunt. Ex eo farre virgines ter in anno molam faciunt : Lupercalibus, Vestalibus, Idibus Septembribus : adiecto sale cocto, et sale duro.
[FN: § 765-1]
G. SOREL; Quelques prétentions juives, dans l'Indépendance, 15 mai 1912 ; « (p. 292) Au cours du XIXe siècle le catholicisme a singulièrement renforcé sa situation, en suivant une voie toute différente de celle que lui conseillaient de prendre les hommes habiles ; il a développé sa théologie, il a multiplié ses instituts monastiques, il a accordé au miracle une importance qu'on ne lui avait pas reconnue depuis le Moyen-Âge... » G. Sorel ajoute en note : « (p. 193) Bernard Lazare s'était terriblement trompé quand il avait écrit : „ La religion chrétienne disparaît comme la religion juive, comme toutes les religions, dont nous voyons la très lente agonie. Elle meurt sous les coups de la raison et de la science... Nous perdons de jour en jour le sens et le besoin de l'absurde, par conséquent le besoin religieux, surtout le besoin pratique, et ceux qui croient encore à la divinité ne croient à la nécessité, ni surtout à l'efficacité du culte ”. (L'antisémitisme, pages 359-360). Bernard Lazare a paraphrasé ici des textes de Renan, sans examiner personnellement la question ; d'ailleurs les choses ont bien changé depuis 1894 ! » Le passage transcrit ici de Bernard Lazare est en absolu et complet désaccord avec les faits.
[FN: § 767-1]
GROTE ; t. II.
[FN: § 768-1]
HERACLIDIS PONTICI ; allegortae Homeri.
[FN: § 770-1]
J. HUGON ; Vera historia romana, seu origo Latii, vel Italiae, ac Romanae Urbis, e tenebris longae vetustatis in lucem, producta, Romæ 1655.
[FN: § 770-2]
Homerus Hebraeus, sive historia Hebraeorum ab Homero hebraicis nominibus ac sententiis conscripta in Odyssea et Iliade, exposita, illustrataque studio ac opera GERARDI CROESI. Dordreci, 1704.
[FN: § 771-1]
COMPARETTI ; Virg. net medio evo, I, p. 134 et sv.
[FN: § 772-1]
COMPARATTI; Virg. nel medio evo, I, p. 144 et sv. – FULGENT. ; Exp. Virg. cont. (Mythographorum latinorum tomus alter, p. 147 – ed. Teubner., R. Helm, p. 89-90). L'auteur feint que Virgile lui parle et dit : ... trifarius in vita humana gradus est, Primum habere : deinde regere quod habeas : tertium vero ornare quod regis. Ergo tres gradus istos in uno versu nostro, considera positos : id est, Arma, virum et primus. Arma, id est virtus, pertinet ad substantiam corporalem : Virum, id est sapientia, pertinet ad substantiam sensualem ; Primus vero, id est princeps, pertinet ad substantiam ornantem. Quo sit huiusmodi ordo : habere, regere, ornare. Ergo sub figuralitate historiae plenum hominis monstravimus statum ; ut sit prima natura : secunda doctrina, tertia felicitas. Il y a trois degrés dans la vie humaine : le premier, c'est avoir ; le second, c'est régir ce qu'on a ; le troisième, orner ce qu'on régit. Ces trois degrés, tu les retrouves dans mon vers. Arma, c'est-à-dire la force, se rapporte à la substance corporelle. Virum, c'est-à-dire le savoir, se rapporte à la substance intellectuelle. Primus, c'est-à-dire le principe, se rapporte à la substance ornante. De sorte que tu as ici par ordre : avoir, régir, orner. Ainsi, nous avons esquissé, dans le symbole d'un récit, la condition normale de la vie humaine : d'abord la nature, puis la doctrine, troisièmement le bonheur ».
[FN: § 774-1]
PHIL. IUD.; Sacr. leg. alleg., (éd. Richter, II, 16 éd.; Mang., p. 78; éd. Par., p. 1098):
[FN: § 774-2]
A. LOISY ; Simples réflexions, etc., p. 52 et sv. Plus loin, l'auteur se plaint de ce que son idée est travestie par le Saint-Office ; il dit : « (p. 55) Je fais entendre que Jean pouvait se dire le témoin du Christ, étant le témoin de sa vie dans l'Église. La S. Congrégation me fait dire que Jean n'aurait pas dû se présenter en témoin du Christ, puisqu'il n'était qu'un témoin de la vie chrétienne. Sous la ressemblance des textes, les deux idées sont différentes ». Pour se faire comprendre, notre autour ne ferait pas mal de s'expliquer mieux. Au point de vue historico-expérimental, il semble en effet que si l'on dit : « Pline le Jeune est un témoin de Trajan ; Suétone est un témoin de plusieurs empereurs ; Jean est un témoin du Christ », on entend que Pline a connu, vu Trajan, Suétone, les empereurs, Jean, le Christ. Si l'on veut dire autre chose, il faut le faire clairement comprendre.
[FN: § 774-3]
Un autre auteur nous explique l'allégorie des noces de Cana. JEAN D'ALMA ; La contr. du quatr. évang., « (p. 59), 6. Il y a six urnes de pierre posées à terre selon le mode de purification des Juifs, et d'une capacité d'environ deux ou trois mesures. Si l'on veut chercher encore quel sens l'évangile spirituel accorde à ce symbole, il (p. 60) faut rapprocher le festin de Cana de celui que Jésus fit, après avoir rassemblé ses cinq premiers apôtres dans la maison de Lévi-Matthieu. C'est là que, répondant à une question des Pharisiens sur la différence de sa discipline et de celle des disciples de Jean, il se donne comme l'époux qui vit avec ses amis et qui ne met pas son vin dans de vieilles outres (Marc II, 22). Or les cinq disciples qu'il vient de réunir et qui, avec l'époux de Cana, sont portés au nombre de six, ne sont point des outres de cuir, mais bien des urnes de pierre, fondements de l'Église ». Si les disciples avaient été au nombre de six, on n'aurait pas tenu compte de l'époux, et l'on aurait eu également les six urnes. Si les disciples avaient été quatre, il n'y aurait pas eu grand mal : on leur ajoutait l'époux et l'épouse, et l'on avait encore le nombre six. «(p. 62), 11. Tel fut, dit l'évangéliste, le début des miracles de Jésus... Il serait étrange que le christianisme eût un miracle matériel de ce genre pour point de départ... » Avec des preuves de ce genre, on démontre tout ce qu'on veut.
[FN: § 775-1]
JEAN D'ALMA ; La contr. du quatr. évang. L'auteur reconnaît que l'histoire et l'allégorie s'entrecroisent, dans l'évangile selon Saint-Jean. « (p. 25), 19 Ayant achevé son prologue, l'évangéliste entre aussitôt dans l'exposition du drame qu'il vient d'annoncer. Voici la première rencontre des ténèbres et de la lumière. Ce n'est pas que Jean soit la lumière, mais c'est un témoin, un flambeau ardent et brillant. Il baptise : les Juifs envoient vers lui, de Jérusalem, ceux qui sont officiellement chargés parmi eux de la religion, c'est-à-dire les prêtres et les lévites. Faut-il prendre à la lettre ce récit ? Ou est-il absolument allégorique ? Il peut être historique à la fois et allégorique ». L'auteur a raison. Mais c'est justement pourquoi il est inutile de chercher, comme il le fait, à séparer l'histoire, de l'allégorie et, ajouterons-nous, de l'invention et de l'imagination.
[FN: § 776-1]
A. LOISY ; Autour d'un petit livre.
[FN: § 777-1]
PIEPENBRING ; Jésus historique. L'auteur loue beaucoup l'abbé Loisy. Il cherche à deviner ce qu'était l'Évangile primitif, et ne s'aperçoit pas que, dans son œuvre entièrement hypothétique, il ne trouve que ce qu'il lui plaît d'y mettre. C'est ainsi qu'il peut conclure « (p. 181) Si maintenant nous jetons encore un coup d'œil rétrospectif sur le ministère de Jésus, il convient de dire que, dans les sources de nos Évangiles, les miracles ne jouent qu'un rôle minime et se réduisent à quelques guérisons opérées par Jésus. La prédication fut donc de beaucoup l'élément principal de son ministère. Il en est tout autrement dans les parties récentes des Évangiles. Une comparaison attentive de celles-ci avec les sources premières prouve que les miracles sont allés en augmentant dans l'histoire évangélique, et qu'ils ont pris un caractère toujours plus extraordinaire ». Où sont ces « sources » ? De l'aveu de Piepenbring lui-même, elles se réduisent aux Logia, dont il dit : « (p. 40) On voit que les Logia nous sont parvenus dans un état décousu et que certains textes n'y sont plus tout à fait primitifs, mais portent déjà l'empreinte de la théologie apostolique... » C'est un proto-Marc, que personne n'a jamais vu, et dont beaucoup mettent l'existence en doute. C’est sur ces fondements fragiles que l'auteur élève tout son édifice. « (p. 75) Comme il n'est pas à supposer qu'en dehors des Logia et du proto-Marc, il n'y ait aucun autre élément authentique dans nos Évangiles synoptiques, il y a lieu de les examiner attentivement pour recueillir ceux de ces éléments qui s'y trouvent réellement ». C'est la même opération qu'on a tentée pour l'Iliade et pour d'autres récits légendaires, mais avec peu ou point de succès. Il n'y a pas moyen de résoudre ces devinettes. Parmi les plus belles transformations d'un texte connu en un prétendu texte primitif entièrement inconnu, il faut placer celle accomplie par Bascoul, pour le texte de la célèbre ode de Sapho. Il affirme que le texte que nous connaissons est une parodie. Jusque-là, passe encore : mais ensuite, sans l'aide d'aucun autre document que du même texte, il trouve le texte primitif qui a été parodié, et qui est de nature entièrement différente de celui que nous connaissons ! Espérons que cet auteur emploiera sa méthode pour nous donner une Iliade primitive, grâce à laquelle nous connaîtrons la véritable histoire de la guerre de Troie, et qu'il mènera ainsi à bonne fin l'audacieuse entreprise tentée en vain par Thucydide, par Dion Chrysostome et par tant d'autres auteurs. I. M. F. BASCOUL ; La chaste Sappho. L'ode n'est plus érotique, au contraire, elle est « (p. 30)... la description... des émotions que provoquent l'apparition et les chants d'un poète-musicien, rival de Sappho et de son école. Ici l'histoire nous indique Stésichore. [C'est vraiment une bien belle chose que de pouvoir deviner si facilement l'histoire!] C'est lui qui, en sa qualité de grand poète, et de rénovateur de la poésie lyrique, devait fatalement [quand on sait ce qui doit arriver, on sait aussi ce qui est arrivé] produire une grande impression sur Sappho qui, proscrite avec sa fille, le rencontra en Sicile [quel dommage que l'auteur ne nous dise pas le jour précis] ; et c'est pour émouvoir l'indifférence de sa fille, que Sappho lui chanta ce chef-d'œuvre de description naturelle et sublime des émotions que provoque : D'abord l'apparition des Dieux... (p. 31) Ensuite l'inspiration... Enfin l’enthousiasme... »,
[FN: § 778-1]
La dispute a aujourd'hui tourné principalement à la politique ; et il ne s'agit pas tant de critique historique, que d'attaquer ou de défendre l'Église romaine. S. REINACH. Orpheus, p. 328 : « La comparaison de nos Évangiles et la distinction des couches successives qui les ont formés prouvent que même la légende de Jésus, telle que l'enseigne l'Église, n'est pas appuyée dans toutes ses parties parles textes, qu'elle allègue ». Reinach a raison ; mais les interprétations qu'il admet, de l'abbé, Loisy, ne valent pas mieux. Elles manquent de preuves autant que les interprétations d'Homère par Héraclide. Nous ne sommes pas enfermés dans le dilemme : ou d'accepter l'Iliade comme un récit historique, ou d'y substituer les interprétations d'Héraclide.
[FN: § 779-1]
G. FOUCART; La méth. comp. dans l'hist. des relig. « (p. 18) Au siècle dernier, la découverte de la littérature védique suscita dans le monde savant un enthousiasme dont il est difficile de se faire aujourd'hui une idée. On s'imagina posséder, transmis fidèlement par la tradition, les chants des pasteurs de la première humanité, célébrant leurs dieux en menant paître leurs troupeaux. C'étaient, croyait-on, les (p. 19) ancêtres des races aryennes, et dans leurs monuments on allait trouver la clef de toutes les langues, de toutes les religions des peuples indo-européens. Celles de la Grèce eurent particulièrement à souffrir de cette illusion ; pendant cinquante ans, la méthode philologique, qui avait la prétention de révéler la nature véritable des dieux helléniques, les mythes salaires, les phénomènes météorologiques empêchèrent tout progrès sérieux, Le mythe solaire, surtout, semble la maladie inévitable que traversent, pendant leur croissance, les sciences religieuses en formation. L'Égyptologie est encore infectée des rêveries fumeuses de la première école, dont on vit se perpétuer jusqu'en ces dernières années le galimatias mystique. Pour les religions helléniques, les traités les plus récents sont encore tout imprégnés des vieilles erreurs propagées par Max Muller et son école ». Malheureusement la méthode « comparative » de Foucart a aussi de graves défauts, comme toute méthode a priori.
[FN: § 781-1]
MAX MULLER ; Ess. sur la méth. comp., p. 111 et sv. Dans le texte, j'ai ajouté la forme grecque de Prokris. L'auteur continue : « (p. 113) Le second élément est : “Éos aime Képhalos”. Ceci n'a point besoin d'explication ; c'est le vieux conte répété cent fois dans la mythologie aryenne ; “L'Aurore aime le Soleil”. Le troisième élément est : “Prokris est infidèle ; cependant son nouvel amant, quoique sous, une autre forme, est toujours Képhalos”. On peut interpréter ceci comme une expression poétique des rayons du soleil réfléchis en diverses couleurs par les gouttes de rosée. Prokris est embrassée par beaucoup d'amants ; cependant tous sont Képhalos, déguisé, puis enfin reconnu. Le dernier élément est : “Prokris est tuée par Képhalos”, c'est-à-dire la rosée est absorbée par le soleil. Prokris meurt à cause de son amour pour Képhalos, et il doit la tuer parce qu'il l'aime. L'absorption graduelle et inévitable de la rosée par les rayons brûlants du soleil est exprimée, avec beaucoup de vérité, par le trait fatal de Képhalos, lancé (p. 114) sans intention sur Prokris, cachée dans la buisson de la forêt ». N'oublions pas que de semblables interprétations ont été admises et admirées par un grand nombre de gens.
[FN: § 781-2]
Je ne sais pas le sanscrit, et n'ai par conséquent rien à dire sur les assertions étymologiques de Muller. Je les accepte, les yeux fermés ; mais malheureusement, même si on les accepte sans conditions, le raisonnement auquel elles servent de prémisses vaut peu de chose ou rien.
[FN: § 782-1]
A. MAURY ; Hist. des rel. de la Gr., I, p. 12, note.
[FN: § 782-2]
Dict. DAREMBERG SAGLIO, s. r. Centaures, p. 1010.
[FN: § 782-3]
Dict. DAREMBERG SAGLIO, s. r. Centaures, p. 1010.
[FN: § 782-4]
Dict. DAREMBERG SAGLIO, s. r. Centaures, p. 1010.
[FN: § 783-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Ce besoin de longues démonstrations est parfois plus ou moins conscient. EDWARD A. KIMBALL ; Christian Science, Ses Bienfaits Pour l'Humanité, p. 47 : « ... tandis que les « Christian Scientists » sentent que seules les longues études et de longues démonstrations leur permettent d'expliquer la Science ». [C'est nous qui soulignons].
[FN: § 784-1]
A. MAURY ; Hist. des rel. de la Gr., I. BERGAIGNE ; Les dieux souv. de la rel. véd. : « (p. 65) ...il semble permis d'induire qu'au moins dans la pensée de l'auteur de cet hymne, le personnage de Gandharva est équivalent à celui de Savitri... On peut se demander si Gandharva ne joue pas comme Tvashtri, le rôle d'un ennemi d'Indra... Gandharva ne peut guère, dans un pareil mythe, représenter que le gardien du Soma, ou le Soma lui-même, et dans le second cas il ferait double emploi avec Kutsa... (p. 66) D'après le vers IX, 113, 3, ce sont les Gandharvas, déjà assimilés sans doute à des sacrificateurs dans l'hymne III, 38 (vers 6), qui ont reçu le taureau grandi dans les nuages (Soma) et en ont fait le suc du Soma (de la plante du Soma terrestre). Ils jouent alors un rôle bienfaisant en communiquant le Soma aux hommes... (p. 67) En somme, le personnage de Gandharva est un exemple incontestable de la confusion qui s'est souvent opérée, sous un même nom, d'attributs appartenant au Père et au fils ». OLDENBERG ; La relig. du Véda, « (p. 205) Le type de Gandharva remonte, y compris son nom (p. 206) védique, jusqu'à ta période indo-éranienne ; mais il est extraordinairement obscur, [en note : Manhardt et d'autres, – avec raison, je crois, – ont condamné le rapprochement des Gandharvas et des Centaures]. Le Rig-Véda le mentionne, tantôt au singulier, tantôt au pluriel, mais il ne fournit sur lui que des indications confuses et ambiguës. Les traits en sont effacés et fort altérés, probablement parce qu'on a confondu sous un seul nom toutes sortes d'êtres mythiques. Bref, rien de précis ni de sûr ne se laisse entrevoir ».
[FN: § 784-2]
V. HENRY: dans le Journal des Savants , 1899, pp. 22-26.
[FN: § 786-1]
E. PAIS ; Stor. di Roma, I, I, p. 477. «Nous attribuons, au contraire, de l'importance au renseignement d'après lequel Junius Brutus, précisément parce qu'il était un héros rattaché au culte de Junon, était aussi rattaché à celui d'Apollon ou du Soleil... Zaleucos aussi, le législateur des Locriens, était devenu célèbre par sa sévérité... À propos du législateur Charondas aussi, on racontait quelque chose de semblable, et en général, tant de Charondas que de Zaleucos, on racontait les mêmes aventures... (478) Le récit de Zaleucos perd toute valeur, par le fait que ce personnage, qui aurait reçu sa législation de Minerve, n'a jamais existé. Zaleucos était une divinité, et sa nature est expliquée par son nom même qui veut dire : qui est tout à fait lumineux. En un mot, Zaleucos était le soleil, et l’œil dont il aurait privé sa propre personne et son fils, symbolisent le Soleil nouveau et le Soleil ancien ».
[FN: § 788-1]
Un opuscule publié sur ce sujet est fameux. La première édition est anonyme ; elle a pour titre : Comme quoi Napoléon n'a jamais existé, grand erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe, siècle. Paris 1827. La 5e édition, publiée après la mort de l'auteur, porte son nom : J. B. PÉRÈS, bibliothécaire de la ville d'Agen. La 10e édition est de 1864. Enfin, une nouvelle édition a été publiée en 1909, avec des notes bio-bibliographiques de GUSTAVE DAVOIS. Les raisonnements contenus dans cette petite brochure sont tout à fait semblables à ceux des auteurs qui interprètent la mythologie par les mythes solaires. « (p. 15) On prétend que sa mère [de Napoléon] se nommait Letitia. Mais sous le (p. 16) nom de Letitia, qui veut dire la joie, on a voulu désigner l'aurore, dont la lumière naissante répand la joie dans toute la nature... Encore est-il bien remarquable que, suivant la mythologie grecque, la mère d'Apollon s'appelait Leto, ou Létô (En Grec). Mais si de Leto les Romains firent Latone, mère d'Apollon, on a mieux aimé, dans notre siècle, en faire Letitia, parce que laetitia est le substantif du verbe laetor ou de l'inusité laeto (p. 17) qui voulait dire inspirer la joie. Il est donc certain que cette Letitia est prise, comme son fils, dans la mythologie grecque ». « (p. 17) On dit que ce moderne Apollon avait quatre frères. Or, ces quatre frères sont les quatre saisons de l'année... », « (p. 25) On dit que Napoléon mit fin à un fléau dévastateur qui terrorisait toute la France, et qu'on nomma l'hydre de la Révolution. Or, une hydre est un serpent, et peu importe l'espèce, surtout quand il s'agit d'une fable. C'est le serpent Python, reptile énorme qui était pour la Grèce l'objet d'une extrême terreur, qu'Apollon dissipa en tuant ce monstre... ».
[FN: § 789-1]
COMPARETTI ; loc., Cit. 668, 1, t. II.
[FN: § 790-1]
P. JENSEN ; Das Gilgamesh.
[FN: § 793-1]
H. SPENCER ; Principes de Sociologie, t. I.
[FN: § 802-1]
JHERING ; L'esprit du droit romain, t. I : ( «p. 30) Si grande qu'ait été l'habileté des jurisconsultes classiques de Rome, il existait cependant, même de leur temps, des règles du droit qui leur restèrent inconnues, et qui furent mises en lumière la première fois, grâce aux efforts de la jurisprudence actuelle : je les nomme les règles latentes du droit. Cela est-il possible, nous demandera-t-on, en objectant que pour appliquer ces règles il fallait les connaître ? Pour toute réponse, nous pouvons nous borner à renvoyer aux lois du langage. Des milliers de personnes appliquent chaque jour ces lois dont elles n'ont jamais entendu parler, [actions non-logiques], dont le savant lui-même n'a pas toujours pleine conscience ; mais ce qui manque à l'entendement est suppléé par le sentiment, par l'instinct grammatical ».
[FN: § 805-1]
F. GIRARD; Manuel élémentaire de droit romain.
[FN: § 805-*]
« Mais cette théorie est hors de cause quand il a simplement teint une étoffe, ou, quoi qu'en dise maladroitement Justinien, Inst., 2, 1, De R. D., 25, quand il a simplement tiré du blé des épis qui le contenaient : cf. D., 41, 1. De A. R. D., 7, 7 in fine. »
[FN: § 815-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Les théories juridiques de l'abus du droit sont un bon exemple de cette façon de raisonner.
[FN: § 818-1]
Sumner Maine a parfaitement compris, en ce qui concerne le droit, l'antagonisme existant entre les concepts métaphysiques d'un idéal parfait, et l'étude des faits, qu'il confond avec la « méthode historique ». Il dit « (p. 91) Je crois... qu'elle [la philosophie fondée sur un état de nature] est le plus grand adversaire de la méthode historique; et chaque fois que, toute objection religieuse mise de côté, on verra quelqu'un rejeter cette façon d'étudier ou la condamner, on trouvera généralement qu'il est, consciemment ou non, sous l'impression ou le préjugé qu'il existe un état naturel et non historique de la société et de l'individu ». (Ancient law, ch. IV). Mais il oublie cela, quand il traite de la morale. Il semble croire qu'elle est un modèle de perfection dont la morale actuelle approche plus que celle du passé; par exemple, quand il dit que les jurisconsultes anglais croient que l'Équité anglaise a pour fondement les règles de la morale ; « (p. 69) mais ils oublient que ce sont des règles des siècles passés... et que, si elles ne diffèrent pas beaucoup du credo éthique de notre temps, elles ne sont pas nécessairement (p. 70) à son niveau (they are not necessarily on a level with it). – Ancient law, chap. III.
[FN: § 821-1]
J. J. ROUSSEAU ; Disc. sur l'orig. et les fond. de l'inég. parmi les homm. Il dit dans la préface : «Laissant donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu'à voir les hommes tels qu'ils se sont faits, et méditant sur les premières et plus simples opérations de l'âme humaine, j'y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison... » Notez que Rousseau est le Saint-Père d'une Église qui prétend représenter la Raison et la Science, contre l'Église catholique, que ces messieurs disent représenter la « superstition ».
[FN: § 821-2]
Ici, sans s'en apercevoir, Rousseau se prend à ses propres filets. Oui, il a raison : ses recherches sont semblables aux élucubrations où l'on recherche l’origine du Monde, dans l'humide, dans le feu, etc.; elles sont avec la science sociale dans le même rapport que ces élucubrations étaient avec l'astronomie, telle qu’elle existait de son temps déjà.
[FN: § 822-1]
F. ENGELS ; L'orig. de la fam. : « (p. 2) 1° Stade inférieur. C'est l'enfance du genre humain qui, vivant, tout au moins en partie sur les arbres – ce qui explique seul qu'il ait pu continuer d'exister en présence des grands fauves – se tenait encore dans ses demeures primitives, les forêts tropicales ou sous-tropicales. Les fruits, les noix, les racines servaient de nourriture ; l'élaboration d'un langage articulé est le produit principal de cette époque... Bien qu'il ait pu durer [cet état primitif] des milliers d'années, nous ne pouvons pas davantage en démontrer l'existence [par des témoignages directs ; cependant, une fois accordé que] l’humain est issu du règne animal, on est obligé d'accepter cette transition ». – 2° Stade moyen. Il commence avec l'emploi des poissons (parmi lesquels nous comptons aussi les crustacés, les coquillages et d'autres animaux aquatiques) pour la nourriture, et avec l'usage du feu. Les deux vont ensemble, le feu seul permettant de rendre le poisson parfaitement comestible ». Voyez donc combien de belles choses sait notre auteur ! Les savants discutent pour savoir si la race humaine a une ou plusieurs origines, et où doivent être placées cette origine ou ces origines ; et notre auteur sait que l'homme vient de l'animal, et que cette transformation a eu lieu dans les régions tropicales ou sous-tropicales. Et puis il sait que les hommes commencèrent par manger des poissons ; et cela ne suffit pas : il sait aussi que « (p. 3) des peuples exclusivement chasseurs, tels qu'ils figurent dans (p. 4) les livres, c'est-à-dire ne vivant que de la chasse, il n'y en a jamais eu, le produit de la chasse étant beaucoup trop incertain ».
[FN: § 823-1]
BURLAMAQUI ; Princ. du dr. nat., II 5, 3.
[FN: § 825-1]
Notez que cela se produit à cause de la définition qu'on donne de l'économie pure, et que les définitions sont toujours arbitraires, entre certaines limites (§ 119). Dans le Manuel, nous donnons de l'économie politique la définition suivante : « (P. 145) Nous étudierons les actions logiques, répétées, en grand nombre, qu'exécutent les hommes pour se procurer les choses qui satisfont leurs goûts ».
[FN: § 834-1]
J'emploie ici le terme fiction dans un sens général, comme le fait SUMNER MAINE; Ancient law : «(p. 25) I employ the word «fiction» in a sense considerably wider than that in wich English lawyers are accustomed to use it, and with a meaning much more extensive than that wich belonged to the Roman « fictiones». Fictio, in old Roman law, is properly a term of pleading, and signifies a false averment on the part of the plaintiff wich the defendant was not allowed to traverse ; such, for exemple, as an (p. 26) averment that the plaintiff was a Roman citizen, when in thruth he was a foreigner. The object of these « fictiones » was, of course, to give jurisdiction, and they therefore strongly resembled the allegations in the writs of the English Queen's Bench and Exchequer, by which those Courts contrived to usurp the jurisdiction of the Common Pleas : – the allegation that the defendant was in custody of the King's marshal, or that the plaintiff was the King’s debtor, and could not pay his debt by reason of the defendant's default. But now I employ the expression « Legal Fiction » to signify any assumption wich conceals, or affects to conceal, the fact that a rule of law bas undergone alteration, its letter remaining unchanged, its operation being modified ». « J'emploie le terme « fiction» dans un sens beaucoup plus large que celui en usage parmi les jurisconsultes anglais, et dans un sens plus large que les fictiones romaines. Fictio, dans l'ancienne législation romaine, est proprement un terme de procédure, et signifie une fausse assertion de la part du demandeur, que le défendeur ne peut repousser : par exemple, que le demandeur est citoyen romain, tandis qu'en réalité, il est étranger. L'objet de ces fictiones était d'accorder la juridiction. Elles ressemblent beaucoup aux assertions faites dans les actes devant les Cours de la Reine et de l'Échiquier, grâce auxquelles ces cours imaginèrent d'usurper la juridiction des cours de Common Pleas. Par exemple : l'affirmation que le défendeur est sous la garde du maréchal du roi, ou que le demandeur est débiteur du roi et ne peut pas payer sa dette, par la faute du défendeur. Mais j'emploie maintenant l'expression fiction légale, pour indiquer une affirmation quelconque, qui dissimule ou feint de dissimuler le fait que la règle juridique a été altérée, tandis qu'elle reste la même dans la lettre, les conséquences étant changées ». Le sens peut être encore plus large, et indiquer une assertion évidemment fausse, qu'on accepte pour laisser intacte une règle quelconque, une doctrine, un théorème, tout en en changeant les conséquences.
[FN: § 835-1]
F. GIRARD ; Man... de Dr. Rom., p. 40.
[FN: § 837-1]
SUMNER MAINE ; Ancient law. – LAMBERT; La fonct. du droit civ. comp ., I, p. 180 et sv.
[FN: § 840-1]
E. ROGUIN ; Traité de droit civil comparé, t. I, Le mariage. L'auteur ajoute: « (p. 10) Maintenant, comment faut-il apprécier ces tendances (p. 11) législatives ? Nous n'avons pas eu souci de donner toujours notre opinion, et le présent volume ne contient que quelques appréciations critiques clairsemées ».
[FN: § 841-1]
Gardons-nous bien de croire que ces sentiments et ces préjugés n'étant pas « raisonnables » n'ont aucune valeur sociale. Au contraire, ils représentent une force dont les effets se manifestent toutes les fois qu'elle elle n'est pas contrecarrée par une force plus puissante (§ 2148 et sv.). Ainsi, si les règles du droit pénal ont peu ou point de valeur dans les procès passionnels ou politiques, c'est simplement parce qu'en ce cas elles sont écartées par la passion ; mais elles retrouvent leur valeur dans les procès où la passion n'intervient que faiblement ou pas du tout.
Notes du Chapitre VI. – Les résidus (§842 à §1088), pp. 450-577↩
[FN: § 871-1]
MACR. ; Satur., VII. Les nombres entre parenthèses indiquent les chapitres : (VI) Et alios quidem medicos idem dicentes semper audivi, vinum inter calida censendum ; sed et nunc Eustathius, cum causas ebrietatis attingeret, praedicabat vini calorem. On saisit clairement l'idée : celui qui s'enivre a chaud ; donc le vin est chaud. «Mihi autem hoc saepe mecum reputanti visa est vini natura frigori propior, quam calori... » Remarquez que la chaleur n'est pas un caractère propre du vin, mais est accidentelle : Dabo aliud indicium accidentis magis vino, quam ingeniti caloris. Toutes les choses chaudes incitent à l'acte sexuel ; pas le vin ; donc il est froid, Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant, et generationi favent : hausto autem mero plurimo, flunt viri ad coitum pigriores. Là, l'idée de chaud se rapporte à l'acuité du sentiment amoureux. Le vinaigre est encore plus froid que le vin. Quid aceto frigidius, quod culpatum vinum est ? En outre : Nec hoc praetereo, quod ex fructibus arborum illi sunt frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut mala seu simplicia, seu granata, vel cydonia, quae cotonia vocat Cato. Il semble ici que le terme chaud se rapporte à certaines saveurs. Les femmes s'enivrent moins facilement que les hommes; et l'on cherche les motifs de ce fait, qui est faux. Quelqu'un dit que C'est parce que le corps de la femme est très humide : Mulier humectissimo est corpore, et à cause de ses règles. Un autre ajoute qu'on a oublié le motif pour lequel le corps des femmes est froid (VII) : ita unum ab eo praetermissum est, nimio frigore, quod in earum corpore est, frigescere haustum vinum... Mais un autre encore objecte : Tu vero, Symmache, frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam ego calidiorem virili, si tibi volenti erit, facile probabo. Quis ergo dicat frigidas, quas nemo potest negare plenas caloris, quia sanguinis plenae sunt ? deinde, licet urendi corpora defunctorum usus nostro seculo nullus sit : lectio tamen docet, eo tempore, quo igni dari honor mortuis habebatur, si quando usu venisset, ut plura corpora simul incenderentur, solitos fuisse funerum ministros denis virorum corporibus adiicere singula muliebria ; et unius adiutu, quasi natura flammei, et ideo celeriter ardentis, cetera flagrabant. Ita nec veteribus calor mulierum habebatur incognitus. (VII) Les femmes supportent mieux le froid que les hommes, grâce à la chaleur qu'elles ont dans le corps : Quid plura ? nonne videmus mulieres, quando nimium frigus est, mediocri veste contentas, nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri solent ; scilicet naturali calore, contra frigus, quod aer ingerit, repugnante ? Au contraire, objecte un autre, c'est parce que le froid convient au froid : Quod frigus aeris tolerabilius viris ferunt, facit hoc suum frigus : similibus enim similia gaudent. Ideo ne corpus earum frigus horreat, facit consuetudo naturae, quam sortitae sunt frigidiorem.
[FN: § 871-2]
On n'oublie naturellement pas l'histoire habituelle de l'eau des puits. chaude en hiver, froide en été : (VIII) Usu tibi, Albine compertum est, aquas, quae vel de altis puteis, vel de fontibus hauriuntur, fumare hieme, aestate frigescere.
[FN: § 873-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] PAUL JANET ; Princip. de Métaphys. et de Psychol.. t. I, p. 22 : « Pascal disait que, tout ayant rapport à tout, toutes choses étant causées et causantes, celui qui ne sait pas tout ne sait rien. Ne peut-on pas dire, au contraire, en retournant la proposition, que tout ayant rapport à tout, toutes choses étant causées et causantes, celui qui sait quelque chose, si peu que ce soit, sait par là même quelque chose du tout ? » Pourquoi pas ? on en dit bien d'autres, dans cette « science » que Paul Janet définit ainsi (Ibid., p. 23) : « ... la philosophie est pour nous la science de l'esprit libre, et la science libre de l'esprit ».
[FN: § 886-1]
CIC.; Brut., 46. – QUINT.: VITI, I.
[FN: § 892-1]
Voir, par exemple : Il libro dei sogni ovvero l'eco della fortuna, Firenze, A. Salani editore, 672 pagine. Quand la loterie existait en France, on ne manquait pas de livres semblables. «Liste générale des rêves (Paris, 1787, in-12), avec les noms des choses rêvées et leurs numéros correspondans pour les tirages de la Loterie Royale de France ; ouvrage traduit de l'italien de Fortunato Indovino ; enrichi de quantité de figures analogues à la dite loterie. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée avec les tables des tirages de la même loterie ».
[FN: § 893-1]
Un auteur s'imagine que les actions non-logiques proviennent de l'« escogitation», qui est toujours logique, et que c'est seulement après avoir oublié ces motifs logiques, que les hommes inventent des explications qui font paraître non-logiques les actions.
[FN: § 894-1]
PLIN ; Nat. Hist. Les livres et les paragraphes sont indiqués dans le texte.
[FN: § 894-2]
Voir de nombreux détails, dans HUMBERT DE GALLIER ; Les mœurs et la vie .privée d'autrefois.
[FN: § 894-3]
On a voulu voir l'origine de la civilisation dans les jeux de hasard. Il y a un peu de vrai dans ce paradoxe, en ce sens que le jeu de hasard est l'une des très nombreuses manifestations de l'instinct des combinaisons , qui a été effectivement et demeure un très puissant facteur de civilisation.
[FN: § 895-1]
P. DU CHAILLU ; Voy... dans l’Afrique mérid., pp. 74-75.
[FN: § 898-1]
S. REINACH; Cultes, Mythes et Religion; t. I.
[FN: §901-1]
COWPER ROSE ; dans Biblioth, univ, des voy .; t. 29.
[FN: § 904-1]
S. REINACH ; loc., cit., § 898-1.
[FN: § 908-1]
GELL. ; IV, 9 : Religiosi enim dies dicuntur tristi omine infames impeditique ; in quibus et res divinas facere et rem quampiam novam. exordiri temparandum est ; quos multitudo imperitorum.prave et perperam nefastos appellant. Comme on le sait, aux jours néfastes, le préteur ne pouvait prononcer les mots : do, dico, addico. – VARRO ; De ling. lat., VI, 29: Dies fasti, per quos praetoribus omnia verba sine piaculo licet fari. (30) Contrarii horum. vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem do, dico, addico ; itaque non potest agi, necesse enim aliquo eorum uti verbo, cum lege quid peragitur. L'inverse pourrait aussi s'être produit, à l'origine. Les auteurs de l'époque historique ne savent pas pourquoi certains jours étaient fastes, d'autres néfastes. Le préteur qui, par inadvertance, prononçait les mots do, dico, addico, devait se purifier par des sacrifices. S'il les avait prononcés, sachant que c'était défendu, Q. Mucius disait, qu'il ne pouvait expier. (30) Praetor qui tum fatus est, si imprudens fecit, piaculari hostia facta piatur ; si prudens dixit, Quintus Mucius ambigebat eum expiari, ut impium non posse.
[FN: § 908-2]
MACROB. ; Satur., I, 16 : Sunt praeterea ferias propriae familiarum ; ut familiae Claudiae, vel Aemiliae, seu Iuliae, sive Corneliae, et si quas ferias proprias quaeque familia ex usu domesticae celebritatis observat. Sunt singulorum ; ut natalium fulgurumque susceptiones, item funerum atque expiationum : apud veteres quoque, qui nominasset Salutem, Semoniam, Seiam, Segetiam, Tutilinam, ferias observabat. Item Flaminica, quoties tonitrua audisset, feriata erat, donec placasset Deos.
[FN: § 908-3]
Luc. ; Pseudolog., 12-13.
[FN: § 909-1]
MURATORI ; Dissert. LIX, p. 70 et sv. : (p. 70) Inter superstitiones numerantur quoque observatio temporum, sive dierum. Frequentissima haec olim fuit, reclamantibus frustra Ecclesiae Pastoribus, ac Patribus... (p. 71) Sed quam pertinax impia haec observatio etiam inter Christi fideles fuerit, exemplo erunt dies Aegyptiaci a remota antiquitate ad Saeculum usque XVI Christianae Aerae diligentissime a plerisque servati, et publicis etiam Kalendariis inscripti... Videlicet singulis mensibus dies duo adeo infausti, adeoque mali ominis, atque ii suis sedibus designati, decurrere putabantur, ut nihil nisi adversi tunc operanti formidandum foret. Non vulgus dumtaxat, sed et homines politioris Minervae, iis diebus sibi religiose cavebant, rati traditionem hanc tanta antiquitate stipatam gravibus fundamentis niti, quae tamen unice in nubibus, sive in impostorum phantasia olim fabricata fuit. C'est l’erreur habituelle qui substitue les actions logiques aux actions non-logiques. (p. 72) Profecto ne heic quidem. Maiorum nostrorum mores se improvidam credulitatem, sive superstitionem mirari nobis licet, quum ne nostra quidem aetas careat, hominibus, et fortasse plus sibi sapientiae tribuentibus, quam rudium saeculorum mentes sibi tribuerunt : qui die Veneris nullum iter inchoarent, veriti, ne exemplo suo verum. comprobarent adagium. quoddam Hispanicum nempe : Die Hartis, aut Veneris neque nuptias, neque iter institue. Qui etiam horrent, si quando ad mensam cum duodecim aliis convivis se sedere deprehendunt : opinio enim invaluit, non excessurum annum integrum, quin ex iis tredecim unum mors insidiosa surripiat. Qui denique, ut plura alia praeteream, si forte sal in mensa effundi conspiciunt, infortunium aliquod imminere sibi continuo persuadent.
[FN: § 909-2]
SUET.; Oct. 92: Auspicia et omina quaedam pro certissimis observabat... Observabat et dies quosdam, ne aut prostridie nundinas quoquam proficisceretur, aut Nonis quicquam rei seriae inchoaret ; nihil in hoc quidem aliud devitans, ut ad Tiberium scribit, quam ![]() nominis. « il [Auguste] observait certains jours ; il ne se mettait pas en route le jour suivant ceux du marché, et ne commençait aux nonnes aucune chose importante ; il n'avait en cela d'autre répugnance, comme il l'écrivit à Tibère, que le mauvais augure du nom ». – M. BUSH ; Les mém. de Bismarck, t. II, p. 24 : « Jules Favre vient de télégraphier qu'il serait vendredi à Francfort. Le chef [Bismarck], lui, n'y sera que samedi, parce qu'il a peur que le vendredi ne lui porte malheur ». Il se peut encore que ce fût une excuse diplomatique, mais le fait de l'avoir employée montre qu'il y avait des gens qui y croyaient.
nominis. « il [Auguste] observait certains jours ; il ne se mettait pas en route le jour suivant ceux du marché, et ne commençait aux nonnes aucune chose importante ; il n'avait en cela d'autre répugnance, comme il l'écrivit à Tibère, que le mauvais augure du nom ». – M. BUSH ; Les mém. de Bismarck, t. II, p. 24 : « Jules Favre vient de télégraphier qu'il serait vendredi à Francfort. Le chef [Bismarck], lui, n'y sera que samedi, parce qu'il a peur que le vendredi ne lui porte malheur ». Il se peut encore que ce fût une excuse diplomatique, mais le fait de l'avoir employée montre qu'il y avait des gens qui y croyaient.
[FN: § 912-1]
RICARDUS HEIM ; Incantamenta magica graeca latina. V. Similia similibus. (p. 481) Opinio de vi algue potestate similium, quae his verbis « similia similibus » breviter explicari potest, cura in universa arte magica tum in medicinali multum valebat. De hac re antiqui scriptores superstitiosi multum scripserunt et finxerunt, veluti Ps. Democritus et Nepualius quorum libri adhuc extant : ![]()
![]() . Per fictam quandam similitudinem vera mala depelli posse credebant homines, qui decipi volebant. [Voilà l'explication logique de l'instinct qui pousse à unir des choses semblables ou contraires]. Multa exempla affert Kopp (pal. crit. III, § 511, 512, 516 sq.: Wuttke, § 477). Mira sunt commenta quae hic superstitio et cogitatio vana creavit, veluti Geop. II, 42, 2... (p. 485) De quibus Hercolis leonem suffocantis imaginibus in tabulis gemmisque haud raro repertis iam antea... dixi...
. Per fictam quandam similitudinem vera mala depelli posse credebant homines, qui decipi volebant. [Voilà l'explication logique de l'instinct qui pousse à unir des choses semblables ou contraires]. Multa exempla affert Kopp (pal. crit. III, § 511, 512, 516 sq.: Wuttke, § 477). Mira sunt commenta quae hic superstitio et cogitatio vana creavit, veluti Geop. II, 42, 2... (p. 485) De quibus Hercolis leonem suffocantis imaginibus in tabulis gemmisque haud raro repertis iam antea... dixi...
[FN: § 913-1]
RÉVILLE; Les religions des peuples non civilisés, t. I (p. 152) Le Cafre... n'est pas fétichiste, n'est donc pas idolâtre comme le Nègre, mais il a, s'il est possible, plus encore d'amulettes de toute forme et de tout nom... (p. 153) C'est l'idée que les qualités ou les défauts d'un objet quelconque se transmettent par le simple contact, et que l'analogie de deux faits, l'un accompli, l'autre désiré, équivaut à un rapport de cause à effet ». C'est là l'erreur habituelle de supposer des raisonnements logiques où ils n'existent pas. Songez donc si un Cafre est capable de raisonnements métaphysiques sur la cause et l'effet ! En réalité, il y a un sentiment non-logique. qui fait croire que choses et actes s'unissent avec d'autres choses et d'autres actes semblables. « (p. 153) Un collier de Cafre, par exemple, tient enfilés un os de mouton, un anneau de fer, une griffe de lion, une patte de milan. Pourquoi ? C'est pour que son possesseur puisse fuir avec la rapidité du milan, qu'il ait la force du lion, la dureté d'un os et la solidité du fer, S'il se voit menacé de mort, un Cafre se fixe sur la poitrine un de ces insectes qui vivent longtemps encore, bien que percés d'une aiguille, pour lui emprunter sa faculté de longue résistance à la mort. S'il veut adoucir le cœur de celui dont il désire acheter le bétail ou la fille, il mâche un morceau de bois jusqu'à ce qu'il soit réduit en pulpe... ».
[FN: § 913-2]
Il convient d'observer ici comment on arrive au même point avec la méthode inductive et avec la méthode déductive. Au chapitre précédent (§ 733 et sv.), nous avons étudié directement des phénomènes où apparaissaient des faits semblables, et nous avons cherché si cela se produisait toujours par imitation. La réponse a été négative, et nous avons vu qu'il y a des cas où l'imitation est exclue ; et, par induction, nous avons été conduits à envisager une autre cause de la similitude des faits, c'est-à-dire les sentiments qui poussent les hommes à unir certaines choses. En suivant au contraire la voie déductive, on commencerait par reconnaître, comme nous le faisons ici, l'existence de ces sentiments. Ensuite, de cette existence, on déduirait que des hommes ayant les mêmes sentiments, peuvent, en certains cas, agir d'une façon semblable, sans s'imiter réciproquement le moins du monde. Alors les faits cités au chapitre précédent, au lieu de servir à l'induction, serviraient à vérifier les conclusions de la déduction. D'une manière ou de l'autre, on opère rigoureusement d'après la méthode expérimentale, puisque, ou par induction, ou par déduction, les faits gouvernent toujours tout le raisonnement.
[FN: § 914-1]
THÉOCR.; II, 24-31. - *Le scoliaste note : «Comme le laurier mis au feu disparaît tout à coup, que de même aussi le corps de Delphis soit consumé dans la flamme de l'amour ». Plus loin (58), la magicienne dit qu'elle écrase un lézard pour Delphis, et qu'elle lui portera un mauvais breuvage. Là, il n'y a aucune ressemblance : nous sommes dans le cas des résidus (a). – VIRGILE, Egl., VIII, imite Théocrite et ajoute quelque chose, tiré des superstitions populaires.
(79) Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim.
Limus ut hic durescit, et haec ut cers, liquescit
Uno eodemque igni : sic nostro Daphnis amore.
« Comme cette argile durcit et cette cire se fond dans le même feu, qu'ainsi fasse mon amour à Daphnis ». SERVIUS explique : Fecerat illa duas imagines, alteram ex limo, qui ex igne fit durior : alteram ex cera, quae igne solvitur ; ut videlicet mens amatoris ita duresceret ad illam, quam tunc amabat, omnesque alias, sicut ad ignem limus ; et ad se ita molliretur et solveretur amore, ut cera ad ignem liquescit. En un mot, son amant devait, tel l'argile au feu, devenir dur aux autres femmes et, tel que la cire, se fondre à son amour à elle. Virgile continue :
(82) Sparge molam, et fragilis incende bitumine lauros.
Daphnis me malus urit: ego hanc in Daphnide laurum.
« Répands cette farine sacrée et brûle avec le bitume les lauriers fragiles. Le perfide Daphnis me fait brûler, moi je fais brûler Daphnis dans ce laurier ». – SERVIUS observe : In Daphnide laurum. Aut archaïsmos est, pro in Daphniden : aut intelligamus supra Daphnidis effigieni eam laurum, incendere, propter nominis similitudinem. Il est mieux d'entendre : in hac lauro uro Daphnidem. La similitude devient plus complète, dans Virgile, par l'opération faite sur les dépouilles de Daphnis. La magicienne les enterre sous le seuil de la porte, pour rappeler Daphnis à cette porte.
(92) Pignora cara sui ; quae nunc ego limine in ipso,
Terra, tibi mando ; debent hæc pignora Daphnim.
[FN: § 914-2]
OVID. ; Epist. VI. Hypsipyle Iasoni,
(91) Devovet absentes simulacraque cerea figit,
Et miserum tenues in iecur urget acus.
[FN: § 914-3]
TARTAROTTI ; Del congresso notturno delle Lamie, lib. II, cap. 17, 2.
[FN: § 914-4]
FERNAND HAYEM ; La Maréchale d'Ancre et Leonora Galigai ; p. 280. Interrogatoire de L. Galigai. L'accusée répond : « Ne scayt ce qu'on luy veult dire des images de cire, et que c'est à faire à des sorciers, n'ayant jamais esté autre que chrestienne et qu'il ne se trouvera jamais cela d'elle. – A quoi elle se servoit de ces images de cire ? – A dict que Dieu la punisse si elle scayt que c'est desd images de cire... ». (p. 281) « Dans sa maison, lorsqu'elle fut ravagée, pillée et démolie, elle avait eu une chambre haulte en forme de galetas en lad maison un cercueil, sur une table et en icelle une effigie de cire couverte d'un poille de velours noir, quatre chandeliers aux coings avec des cierges blancs. – A dict qu'elle vouldroit plustôt mourir que de veoir une telle chose que cela... » Reg. crim. du Chat de Paris ; t. II. Procès contre Jehenne de Brigue, en 1390 : « (p. 287) Et lors lui qui deppose demanda à ycelle Jehennete se elle savoit bien qui estoit la femme qui lui faisoit souffrir tel tourment, laquele lui respondi que se faisoit ladite Gilete,... et que elle avoit fait un voult de cire où elle avoit mis des cheveux de lui qui depose, et que toutes fois que il estoit ainsi malade, elle mettoit sur le feu, en une paelle d'arain, le dit voult, et le tournoit à une cuillier d'arain, laquelle paelle et cuillier il lui avoit donnée. Et lors lui qui deppose lui demanda comment elle le savoit, et elle lui respondi que elle le savoit parce que elle avoit parlé à ses choses, et que oncques homs n'avoit esté si fort envoultés, et que, pour le guérir, avoit souffert moult de paine, et autant que elle avoit oncques souffert ».
[FN: § 915-1]
M. PSELLI ; De operatione daemonum, p. 85. L'auteur s'en prend aux médecins qui ne veulent pas reconnaître l'œuvre du démon et qui veulent expliquer les phénomènes par des faits expérimentaux. (p. 85) ![]()
![]()
![]() . « Il n'y a pas lieu de s'étonner si les médecins parlent ainsi : ils ne voient rien au delà de ce qui tombe sous les sens, et ne s'occupent que du corps ». C'est précisément ce que, de nos jours encore, les métaphysiciens, admirateurs de Kant et de Hegel ou des beautés sublimes « du droit des gens », reprochent aux personnes qui veulent demeurer dans le domaine des réalités expérimentales.
. « Il n'y a pas lieu de s'étonner si les médecins parlent ainsi : ils ne voient rien au delà de ce qui tombe sous les sens, et ne s'occupent que du corps ». C'est précisément ce que, de nos jours encore, les métaphysiciens, admirateurs de Kant et de Hegel ou des beautés sublimes « du droit des gens », reprochent aux personnes qui veulent demeurer dans le domaine des réalités expérimentales.
[FN: § 915-2]
WIER ; Hist. disp. et disc., I « (p. 339) Ie proposerai en cest endroit une esmerueiable histoire... laquelle a esté escrite par Hector Boece... Le Roy Dussus tomba en vne maladie, laquelle de soy mesme n'étoit si dangereuse que dificile a conoistre par les plus doctes medecins... Car il suoit toute nuit, et ne pouuoit dormir, et de iour il se reposoit, à peine soulagé de la douleur qu'il auoit enduree toute la nuit... » Finalement, en Écosse, on a vent, sans savoir comment, « (p. 340) que le Roy estoit detenu par vue si longue espace de temps en langueur... non par maladie naturelle, mais au moyen de l'art diabolique des sorcieres, lesquelles exerçoient contre luy l'art de Magie et sorcellerie, en vne ville de Morauie, nommee Forres ». Le roi envoie des messagers dans cette ville, et découvre que les soldats soupçonnaient déjà la chose, à cause des propos de la maîtresse d'un soldat, laquelle était fille d'une sorcière. Les soldats vont à sa maison, de nuit, « (p. 341) lesquels entrans de force en la maison fermee, trouuèrent vne sorciere qui tenoit une image de cire, representant la figure de Dussus, laquelle estoit faicte, comme il est vraysemblable, par art Diabolique, et attachee à vn pau de bois deuant le feu, là où elle se fondoit, ce pendant que vne autre sorcière en recitant quelques charmes, distilloit peu à peu vne liqueur (p. 342) par dessus l'effigie. Ces sorcières doncques etant prises... et interroguees... elles respondirent que le Roy Dussus fondoit en sueur, pendant que son effigie estoit devant le feu : et que tandis que lon prononçoit les charmes il ne pouuoit dormir, tellement qu'à mesure que la cire fondoit, il tomboit en langueur, et qu'il mourroit incontinent qu’elle seroit du tout fondue. Elles dirent aussi que les Diables les auoyent ainsi apprises... » Ils brûlent les sorcières et « ce pendant que ces choses se faisoyent... le Roy commença à se reuenir, et passa la nuict sans suer, si bien que le iour suyuant il reprit ses forces... » Wier dit que c'est peut-être le démon qui a fait celav; mais il ajoute ensuite « (p. 343) Ie dis ceci encores que l'histoire fust vraye, ce que ie ne pense... ».
[FN: § 917-1]
Geopont., II. 42 – † il y a une variante que nous rapportons pour montrer comment s'allongent les légendes nées d'un résidu. Au lieu de dire simplement quelqu'un, l'un des manuscrits porte : « Une vierge à l'âge nubile, pieds nus, nue, n'ayant rien sur elle, les cheveux défaits, portant un coq dans ses mains, etc. » Il y a là un résidu du genre (β 2). Cette vierge qui se promène nue autour du champ est une chose exceptionnelle, qui s'unit à la chose rare qu'est la disparition de l'orobanche. Notez qu'on dit qu'elle doit être d'âge nubile, – ![]() – car si c'était une fillette, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce qu'elle allât nue.
– car si c'était une fillette, il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce qu'elle allât nue.
[FN: § 919-1]
ARNOB.; Adv. gentes, VI1, 19 : Sed erras, inquit, et laberis : nam Diis fœminis fœminas, mares maribus hostias immolare, abstrusa et interior ratio est, vulgique a cognitione dimota. – VIRG.; Aen., III :
(118) Sic fatus, meritos aris mactavit honores,
Taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo ;
Nigram Hiemi pecudem, Zephyris felicibus albam.
– SERV., (118) : Ratio enim victimarum. fit pro qualitate numinum : nam aut hae immolantur, quae obsunt eorum muneribus, ut porcus Cereri ; quia obest frugibus : hircus Libero ; quia vitibus nocet. Aut certe ad similitudinem : ut inferis nigras pecudes ; superis albas immolent ; tempesti atras ; candidas serenitati,... – SCHOEM ; Ant. grecq., II : « (p. 292) Nulle part ailleurs qu'à Sparte on n'offrait des chèvres à Héra. Athéna les réprouvait aussi, et l'on pensait que cette rancune venait des dégâts qu'elles causaient aux oliviers. [Dérivation pour expliquer un résidu (I-α)] Pour la même raison, ces animaux ne pouvaient être conduits sur l'Acropole pour être sacrifiés à aucune des divinités dont les temples avoisinaient celui de la déesse protectrice de la ville. On prêtait sans doute à Dionysos un raisonnement contraire [c'est le fait habituel des dérivations: une même dérivation peut servir pour et contre (§ 587, 1416, 1774)] ; on croyait être particulièrement agréable à ce dieu en lui offrant des boucs, à cause des ravages qu'ils faisaient dans les vignes ». Qu’y a-t-il là de constant ? Le résidu de la combinaison (α). Qu'y a-t-il de variable ? Les raisonnements ayant pour but de donner une apparence logique au résidu, les dérivations. – DAREMB. SAGL., s. r. Sacrificium: « (p. 959) Quant aux raisons pour lesquelles les anciens expliquaient préférences ou répugnances de telle divinité vis-à-vis de telle ou telle victime, elles sont parfois futiles [Résidus (α)] ; en tout cas elles ne se ramènent point à un seul et unique principe. Ce sont parfois de simples jeux de mots [Résidu (γ)]. Le rouget ![]() disait Apollodore et répète Athénée, s'offrait à Hécate parce que son nom rappelait des épithètes courantes de la déesse :
disait Apollodore et répète Athénée, s'offrait à Hécate parce que son nom rappelait des épithètes courantes de la déesse : ![]()
![]() ; le porc, insinue le Mégarien d'Aristophane, est une victime qui convient certainement à Aphrodite, parce que son nom
; le porc, insinue le Mégarien d'Aristophane, est une victime qui convient certainement à Aphrodite, parce que son nom ![]() désigne aussi les parties sexuelles de la femme. D'autres fois, on arguait d'une ressemblance, plus ou moins réelle, entre l'humeur du dieu et celle de la victime... Ici, la prétendue hostilité d'un dieu ou d'une déesse à l'égard d'une espèce d'animaux engageait, prétendait-on, à les lui sacrifier... Là, cette hostilité servait, tout au contraire, à motiver l'exclusion de telles ou telles victimes... Dans les sacrifices aux morts, la victime, quand il y en avait une, paraît avoir été d'ordinaire une brebis, et de même dans les sacrifices aux héros, exception faite pour les braves tombés sur le champ de bataille et à qui l'on rendait des honneurs héroïques ; à ceux-là on sacrifiait des taureaux. » [Résidu (β 1)].
désigne aussi les parties sexuelles de la femme. D'autres fois, on arguait d'une ressemblance, plus ou moins réelle, entre l'humeur du dieu et celle de la victime... Ici, la prétendue hostilité d'un dieu ou d'une déesse à l'égard d'une espèce d'animaux engageait, prétendait-on, à les lui sacrifier... Là, cette hostilité servait, tout au contraire, à motiver l'exclusion de telles ou telles victimes... Dans les sacrifices aux morts, la victime, quand il y en avait une, paraît avoir été d'ordinaire une brebis, et de même dans les sacrifices aux héros, exception faite pour les braves tombés sur le champ de bataille et à qui l'on rendait des honneurs héroïques ; à ceux-là on sacrifiait des taureaux. » [Résidu (β 1)].
[FN: § 920-1]
FESTUS ; s. r. Cingulum : Cingulo nova nupta praecingebatur, quod vir in lecto, solvebat, factum ex lana ovis, ut, sicut illa in glomos sublata coniuncta inter se sit, sic vir suus secum cinctus vinctusque esset. Hunc Herculeaneo nodo vinctum vir solvit ominis gratia, ut sic ipse felix sit in suscipiendis liberis, ut fuit Hercules, qui septuaginta liberos reliquit.
[FN: § 921-1]
SUET ; Oct., 91 : Ex nocturno visu, etiam stipem quotannis die certo emendicabat a populo, cavam manum asses porrigentibus praebens. – DIO CASS. : LIV, 35.
[FN: § 923-1]
SUET. ; Nero, 56 : Alia superstitione captus, in qua sola pertinacissime haesit. Siquidem icunculam puellarem, cum quasi remedium insidiarum a plebeio quodam et ignoto muneri accepisset, detecta confestim coniuratione, pro summo numine, trinisque in die sacrificiis, colere perseveravit ; volebatque credi monitione eius futura praenoscere. Il y avait là concours de circonstances exceptionnelles. – Voilà une chose simplement rare. ÉMILE OLLIVIER; L'emp. lib., II Leprince Louis Napoléon (le futur Napoléon III) trouva dans l'héritage maternel « (p. 55) de précieux souvenirs ; un surtout dont il ne se sépara jamais, le talisman. C'était un bijou contenant un morceau de la vraie croix, trouvé au cou de Charlemagne dans son tombeau et envoyé lors du couronnement à Napoléon Ier – . Dans la famille on attachait à sa possession une promesse de protection divine. Joséphine, non sans peine, obtint d'en rester la dépositaire ; après le divorce on ne le lui retira pas ; Hortense le recueillit ».
[FN: § 925-1]
SUET. ; Galb., 1. – PLIN. ; XV, 40. – DIO CASS. ; XLVIII, 52. Ces deux derniers auteurs ne disent pas que les lauriers se desséchèrent ; Pline dit même que, de son temps, il y en avait encore.
[FN: § 925-2]
PLIN. ; Nat. Hist., VIII, 69 : Est in Annalibus nostris, peperisse saepe [mulas] ; verum prodigii loco habitum.
[FN: § 925-3]
LIV.; XXXVII, 3.
[FN: § 925-4]
SUET.; Oct., 94.
[FN: § 925-5]
Les grandes chroniques de France, publ. par P. Paris ; t. II, Le sixiesme livre des fais, etc. : « (p. 285) Plusieurs signes avindrent par trois ans devant qui apertement signifloient sa mort et son deffinement. Le premier fu que le soleil et la lune perdirent leur couleur naturelle par trois jours, et furent ainsi comme tous noirs, un pou (p. 286) avant ce qu'il mourust... le cinquiesme si fu quant il chevauchoit un jour de lieu en autre, le jour devint ainsi comme tout noir, et un grant brandon de feu courut soudainement de la destre partie en la senestre par devant luy... ».
[FN: § 926-1]
La conception de Bouddha fut accompagnée de tant de prodiges, qu'il serait trop long – et peu utile –d'en rapporter ici ne fût-ce qu'une partie importante. L'exemple suivant suffira. – H. KERN ; Hist. du Boudh., I, p. 23-24. La vertueuse reine Mâyâ a rêvé que « (p. 23) les quatre souverains divins des points cardinaux l'enlevèrent avec son lit et la portèrent sur l'Himâlaya, où ils la déposèrent sous l'ombrage d'un arbre à larges branches... (p. 24) le Bodhisatva prit la forme d'un éléphant blanc, quitta la Montagne d'Or sur laquelle il se trouvait, monta sur la Montagne d'Argent, entra avec un lis d'eau blanc dans sa trompe, et accompagné d'un bruit formidable, dans la grotte d'or, et après avoir fait trois fois le tour du lit de repos, en prenant la droite, en signe de respect, il ouvrit le flanc droit de la reine et entra ainsi dans son sein... Au moment de la conception du Bodhisatva dans le sein de sa mère, la nature entière fut en mouvement et l'on aperçut trente-deux présages : une lumière incomparable illumina tout l'Univers, etc. ». Les Latins ne donnent pas dans ces extravagances orientales. Suétone, Oct., 94, raconte, suivant Asclépiade Mendès, comment Atia conçut Auguste. Elle était venue au temple d'Apollon, pour y sacrifier. « La litière ayant été déposée à terre, tandis que les autres matrones se retirèrent, elle s'endormit. Tout d'un coup, un serpent s'introduisit auprès d'elle ; puis il s'en alla peu après. Elle se purifia comme après les embrassements de son mari. Dès ce moment, elle eut sur le corps une tache en forme de serpent, et l'on ne put jamais l'enlever ; c'est pourquoi Atia dut toujours s'abstenir des bains publics ». Les serpents, soit dit sans vouloir faire tort à celui qui séduisit Ève, notre mère, paraissent avoir fréquemment et volontiers des rapports avec les femmes. L'un d'eux, soit pour son propre compte, soit pour celui de Zeus, engrossa Olympie, mère d'Alexandre le Grand. – IUST. ; XII, 16. Qua nocte eum mater Olympias concepit, visa per quietem est cum ingenti serpente volutari ; nec decepta somnio est : nam profecto maius humana mortalitate opus utero tulit. « La nuit dans laquelle sa mère Olympie conçut, il sembla à celle-ci, dans son sommeil, coucher avec un énorme serpent ; et elle ne fut pas trompée par le sommeil, car elle n'était certainement pas enceinte des œuvres d'un mortel ». – Idem ; XI, 11. Il raconte comment Alexandre ad Iovem deinde Hammonem pergit, consulturus et de eventu faturorum, et de origine sua. Namque mater eius Olympias confessa viro suo, Philippo fuerat : Alexandrum non ex eo se, sed ex serpente ingentis magnitudinis concepisse. Denique Philippus ultimo prope vitae suae tempore, filium suum non esse palam praedicaverat. Qua ex causa Olympiadem, velut stupri compertam, repudio demiserat. Puis la légende croît et s'étend. PLUTARQUE, Alex., 2, raconte que Philippe vit un serpent qui dormait auprès de sa femme. Il ajoute que d'autres disent qu'Olympie gardait près d'elle des serpents apprivoisés. Puis (3) il rapporte que Philippe perdit un œil « qu'il avait mis à l'entrebâillement de la porte, pour voir le dieu coucher avec sa femme, sous la forme d'un dragon » En réalité, Philippe perdit son œil au siège de Métone. De nouvelles enjolivures produisent ensuite le roman de la naissance d'Alexandre, dans le Pseudo-Callisthène. Il ne nous importe pas du tout de rechercher quelle part de croyance naïve et quelle part d'artifice il pourrait y avoir dans ces légendes, et pas même si elles pourraient tirer leur origine d'un fait réel, comme celui, cité aussi par Lucien, Pseudomant., 6, des serpents apprivoisés, que des femmes macédoniennes gardaient auprès d'elles. Mais le seul fait de l'existence de ces légendes, et mieux encore de l'accueil favorable qu'elles ont rencontré, démontre qu'elles correspondaient à certains sentiments. C'est cela seul qu'il nous importe de mettre en lumière. Notez de plus, comme d'habitude, l'existence d'un noyau autour duquel s'étend la nébuleuse des dérivations. P. Scipion, le premier Africain, eut aussi pour père un serpent, très gros, cela s'entend, et qui, de plus, devait être divin. – Liv. XXVI, 19. Le genre de vie de P. Scipion fit croire stirpis eum divinae virum esse ; retulique famam, in Alexandro Magno prius vulgatam, et vanitate et fabula parem, anguis immanis concubitu conceptum, et in cubiculo matris eius persaepe visam prodigii eius speciem, interventuque hominum. evolutam repente, atque ex oculis elapsam. – Cfr. GELL ; VII, 1. Servius Tullius ne pouvait pas, ne devait pas être fils d'esclaves. Tite-Live assigne à ce personnage l'origine la moins merveilleuse (I, 39), en supposant que sa mère était déjà enceinte des œuvres de son mari, chef de Corniculus, lorsqu'elle fut faite prisonnière. Denys raconte aussi cela, IV, 1. Mais à un si grand homme, le résidu du présent genre devait faire trouver plus et mieux. Aussi Denys lui-même, IV, 2, nous dit-il qu'il a trouvé dans les annales du pays, et chez nombre d'historiens romains, une autre origine, qui se rapproche de la fable, et raconte-t-il une longue histoire, reproduite ensuite par Ovide et par Pline, suivant laquelle Vulcain aurait engendré Servius Tullius d'une manière un peu bizarre. – PLINE, XXXVI, 70, raconte le fait comme s'il y croyait, mais enlève la paternité à Vulcain pour l'attribuer au foyer. Non praeteribo et unum, foci exemplum romanis litteris clarum. Tarquinio Prisco regnante tradunt repente in foco eius comparuisse genitale e cinere masculini sexus, eamque, quae insederat ibi, Tanaquilis reginae ancillam Ocrisiam captivam, consurrexisse gravidam. Ita Servium Tullium natum, qui regno successit. – OVID.; Fast., VI, 627 et sv., restitue la paternité à Vulcain, qui opéra par le moyen du prodige noté par Pline.
(627) Namque pater Tulli Vulcanus, Ocresia mater,
Praesignis facie, Corniculana fuit.
Hanc secum Tatiaquil, sacris de more paratis,
Jussit in ornatum fundere vina focum.
Hic inter cineres obscaeni forma virilis
Aut fuit, aut visa est : sed fuit illa magis.
Iussa loco captiva fovet conceptus ab illa
Servius a coelo semina gentis habet.
Un fait est remarquable : quelle que fût sa pensée intime, Ovide montre qu'il ne croit pas que ce fut une vaine apparence (sed fait illa magis). ARNOBE, Ad. gent., V, 18. n'est frappé que par l'obscénité du fait, et la reproche aux païens. – On peut assigner une origine divine, même aux philosophes, quand ils sont éminents. – ORIGENE (Contra Celsum, I) dit : « (p. 29) Quelques-uns, non pas dans les histoires antiques ou héroïques, mais dans celles qui contiennent des faits récents, estimèrent rapporter comme une chose possible, que Platon naquit de sa mère Amphiction, avec laquelle il avait été interdit à Ariston [son mari] d'avoir des rapports, avant qu'elle eût enfanté le fruit d'Apollon. Mais ce sont là de pures fables, qui sont produites par la croyance que les hommes réputés supérieurs aux autres pour leur sagesse, devaient tirer leur origine de quelque semence divine, comme il convient à une nature supérieure à celle des hommes ». C'est exactement cela, mais sans tant de raisonnements ; simplement parce que, dans l'esprit, les choses excellentes s'associent à d'autres choses excellentes ; les très mauvaises, à d'autres très mauvaises.
[FN: § 926-2]
GROTE ; Hist. de la Gr., t. I : « (p. 96)... ainsi la généalogie était composée en vue de satisfaire à la fois le goût des Grecs pour les aventures romanesques, et leur besoin d'une ligne non interrompue de filiation entre eux-mêmes et les dieux. Le personnage éponyme, de qui la communauté tire son nom, est quelquefois le fils du dieu local, quelquefois un homme indigène né de la terre, qui est en effet divinisée elle-même. On verra par la seule description de ces généalogies qu'elles renfermaient des éléments humains et historiques, aussi bien que des éléments divins et extra-historiques... À leurs yeux [des Grecs]... non seulement tous les membres étaient également réels, mais les dieux et les héros au commencement étaient en un certain sens les plus réels ; du moins ils étaient les plus estimés et les plus indispensables de tous ».
[FN: § 927-1]
OVID. ; Fast., V :
(231) Sancta Iovem Iuno, nata sine matra Minerva
Officio doluit non eguisse suo.
Flore lui enseigne comment devenir mère sans avoir de rapports avec un être masculin, et lui raconte l'histoire d'une fleur reçue en cadeau.
(253) Qui dabat, Hoc, dixit, sterilem quoque tange iuvencam,
Mater erit : tetigi ; nec mora mater erat
Protinus haerentem decerpsi pollice florem
Tangitur ; et tacto concipit illa sinu.
La légende d’Héphaistos (Vulcain) se trouve déjà dans Hésiode, Théog., 927 ; mais Homère, Il., I, 578, le fait fils de Zeus et de Héra. Apollodore suit la tradition d'Hésiode, I, 3, 5 : ![]() . « Héra conçut Héphaistos, sans embrassements ».
. « Héra conçut Héphaistos, sans embrassements ».
[FN: § 927-2]
Gen. (trad. SEGOND) ; 6... (2) les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes... (4) Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants ; ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. [Voir Addition A18 par l’auteur] – D. HIERONYM. ; t. III : Questiones sive traditiones hebraicae in Genesim : (p. 855) Videntes autem filii Dei filias hominum quia bonae sunt. Verbum Hebraicum eloim... communis est numeri : et Deus quippe, et dii similiter appellantur : propter quod Aquila plurale numero, filios deorum ausus est dicere, deos intelligens, sanctos, sive angelos...
[FN: § 927-3]
Dans l'édition Panckoucke, d'Ovide, l'observation suivante de Desaintange est transcrite dans une note « (t. VIII, p. 327) ... Si nous étions tentés de nous moquer de cette fable légendaire qu'Ovide nous a transmise... rappelons-nous qu'un grave docteur anglais... publia, au dix-huitième siècle, une brochure intitulée Lucina sine concubitu (Lucine affranchie des lois du concours), dans laquelle il cherche à prouver qu'une femme peut concevoir et accoucher sans avoir de commerce avec aucun homme, comme (p. 328) les jumens des Géorgiques (liv. III, v. 271) de Virgile, devenues fécondes sans autre étalon que le Zéphyr ou vent du couchant... Voilà précisément le charme qu'opère le Zéphyr sur les femmes qui préfèrent ses baisers à un plaisir vulgaire : témoin la dame d'Aiguemère, accouchée en l'absence de son mari d'un fils déclaré légitime par un arrêt du parlement de Grenoble en date du 13 février 1637. Cette dame, une belle nuit d'été que sa fenêtre était ouverte, son lit exposé au couchant et sa couverture en désordre, s'était imaginé que son mari était de retour d'Allemagne, et qu'elle avait reçu ses caresses. Elle avait pris l'air du couchant : c'est cet air qu'elle avait respiré... ». Burette ajoute, et il ne semble pas qu'il plaisante : « (p. 328)... Il y a certainement dans la nature des forces occultes et mystérieuses que la science n'a pas encore soumises à son empire. Il y a dans l'imagination une puissance que les miracles du magnétisme ont fait éclater ». Et le livre où cela est écrit a été publié en 1835 !
PLIN. ; Nat. hist. VIII, 67 : « Il est manifeste qu'en Lusitanie, près de la ville de Lisbonne et du Tage, les juments qui se tiennent contre le vent de Favonius conçoivent de par le vent, et deviennent grosses ; les poulains qui naissent sont très rapides, mais ne vivent pas plus de trois ans ». – Varron y ajoute aussi les poules, et dit que le fait est notoire. VARR. ; De agric., II : In foetura res incredibilis est in Hispania, sed est vera, quod in Lusitania ad oceanum in ea regione, ubi est oppidum Olysippo, monte Tagro, quaedam e vento certo tempore concipiunt equae, ut hic gallinae quoque solent, quarum ova ![]() appellant. Sed ex his equis, qui nati pulli, non plus triennium vivunt. – PAUSANIAS, VII, 17, a une longue histoire de la naissance d'Attis, qu'il est inutile de rapporter ici. Il suffit de savoir qu'Agdistis naquit de Zeus, d'une manière étrange ; que d'une partie du corps d'Agdistis, se développa un amandier ; qu'enfin, la fille du fleuve Sangaris, ayant mis dans son sein des fruits de cet arbre, ils disparurent, et elle enfanta Attis. C'est ainsi qu'on a l'un des nombreux exemples d'une suite de générations et de faite étranges, pour arriver à une naissance. – Des légendes semblables, on en a tant qu'on veut, toujours avec un noyau de résidus et autour une nébuleuse d'imaginations poétiques ou simplement fantaisistes.
appellant. Sed ex his equis, qui nati pulli, non plus triennium vivunt. – PAUSANIAS, VII, 17, a une longue histoire de la naissance d'Attis, qu'il est inutile de rapporter ici. Il suffit de savoir qu'Agdistis naquit de Zeus, d'une manière étrange ; que d'une partie du corps d'Agdistis, se développa un amandier ; qu'enfin, la fille du fleuve Sangaris, ayant mis dans son sein des fruits de cet arbre, ils disparurent, et elle enfanta Attis. C'est ainsi qu'on a l'un des nombreux exemples d'une suite de générations et de faite étranges, pour arriver à une naissance. – Des légendes semblables, on en a tant qu'on veut, toujours avec un noyau de résidus et autour une nébuleuse d'imaginations poétiques ou simplement fantaisistes.
[FN: § 927 note 3b]
Note ajoutée à l’édition française par l’auteur: ARISTOTE, De animal. hist., rapporte, sans en prendre la responsabilité, la croyance que les juments peuvent être fécondées par le vent.
[FN: § 927-4]
Comme descendante de Persée, Alcmène aussi remontait à Zeus. Suivant APOLL, II, 4, 6, Electryon, père d'Alcmène, la donna avec le royaume à Amphitryon, en convenant que celui-ci la garderait vierge, jusqu'au retour de l'expédition qu'Electryon devait faire contre les Téléboens. Electryon mourut, et Amphitryon, après diverses aventures, fit l'expédition contre les Téléboens. À son retour, Zeus le précéda, et, prenant les traits d'Amphitryon il jouit d'Alcmène, en une nuit qu'il fit durer autant que trois autres : ![]() . C'est pourquoi Lycophron, 33 appelle Héraclès « lion des trois nuits ». –RICH. WAGNER ; Epitoma vaticana Apollodori bibliotheca: (p. 23) ...
. C'est pourquoi Lycophron, 33 appelle Héraclès « lion des trois nuits ». –RICH. WAGNER ; Epitoma vaticana Apollodori bibliotheca: (p. 23) ...![]()
![]() « ... quintuplant, ou selon d'autres, triplant une nuit. » – PALLAD.; Anth., IX (Epig. demonstr.), 441, donne à Héraclès l'épithète de
« ... quintuplant, ou selon d'autres, triplant une nuit. » – PALLAD.; Anth., IX (Epig. demonstr.), 441, donne à Héraclès l'épithète de ![]() . – STATIUS ; Theb., XII. Junon adresse à la lune ces paroles :
. – STATIUS ; Theb., XII. Junon adresse à la lune ces paroles :
(299) Da mibi poscenti munus breve, Cynthia, si quis
Est Iunonis honos : certe Iovis improba iussu
Ternoctem Herculeam : veteres sed mitte querelas
Lact.; Comm., v. 301, note à ce propos : ... ne adventu diei concubitus minueretur voluptas, iussit Iuppiter illam noctem triplicem fieri, qua triplices cursus Luna peregit. Ex quo compressu Alcmenae Hercules dicitur natus. Merito erge noctem Herculeam dixit, in qua conceptus est Hercules. – DIOD. ; IV, 9, 2, rend très clair le résidu dont nous parlons. Il dit : « En s'unissant à Alcmène, Zeus rendit triple la nuit et par la longueur du temps employé à la procréation, il démontra dès l'abord de quelle force devait être l'enfant ». Diodore ajoute que Zeus rechercha Alcmène, non poussé par un désir amoureux, mais avec le but de procréer un fils. – SERV. ; Ad Aen., VIII, 103 : Amphitryo rex Thebanorum fuit, cuius uxorem Alemenam, Iuppiter adamavit, et dum vir eius Oechaliam civitatem oppugnaret, de trinoctio facta una nocte, cum ea, coucubuit : quae post duos edidit filios ; unum de Iove id est Herculem ; alterum de marito, qui Iphiclus appellatus est. Pour ce dernier, il fallut moins de peine que pour Hercule. SCHOL. AD. ILIAD, XIV 323. Après avoir dit que Zeus fit un fils à Alcmène, il ajoute : « De même Amphitryon, dans la même nuit ». Apollodore fit Iphiclus plus jeune qu'Hercule d'une nuit. Certains auteurs, surtout les Latins, doublent la nuit de la conception d'Hercule, au lieu de la tripler : OVID.; Amor. I, 13, 45.– PROPERT. ; II, 22, 25-26. – MART. CAPELL. ; II, 157. – SENEC., Agam., 814-815. – HIERON. ; Adversus vigilantium, t. II : (p. 409) In Alemenae adulterio duas noctes Iuppiter copulavit, ut magnae fortitudinis Hercules nasceretur. – HYGIN. ; Fab., XXIX. – Il y a des Pères de l'Église qui sont plus généreux, et qui accordent neuf nuits aux plaisirs amoureux de Zeus : CLEMENT. ; Protrept.. p. 28. Pott. – 21. Par. –ARNOB.; Ad. gent., IV, 26 : Iuppiter ipse rex mundi, nonne a vobis infamatus est... Quis illum in Alcmena novem noctibus fecit pervigilasse continuis ?... Et sane adiungitis beneficia non parva : siquidem vobis deus Hercules natus est, qui in rebus huiusmodi patris sui transiret exuperaretque virtutes. Ille noctibus vix novem unam potuit prolem extundere, concinnare, compingere... – CIRILL,.; Adv. Iulan., VI.
[FN: § 927-5]
DELRIO ; Disq. Magic., t. I; I. II, q. 15. « (p. 180 Dicimus ergo, ex concubito incubi cum muliere aliquando prolem nasci posse : et tum prolis verum patrem non fore daemonem, sed illum hominem cuius semine daemon abusus fuerit. Negarunt hoc Plutarchus in Numa... sed hoc olim affirmarunt Aegyptii teste Plutarcho et affirmant communiter Scholastici, qui omnes etiam optimi philosophi fuere... Accedunt plurima exempla ab illis et aliis narrata, quae si vera sunt, haud dubie iuxta has conclusiones explicanda sunt. Vetustas obtrudit suos semideos, Hercules. Sarpedones, Aeneas, Servios Tullos ;. Anglia, Merlinum ; Pannonia, Hunnos ex Arlunis strigibus Gothicis et Faunis natos, ...nec desunt qui Lutherum in hanc classem retulerint (§ 927-6). Et ante sexennium in primario Brabantiae oppido punita fuit mulier, quod ex daemone peperisset : et nostris temporibus id contigisse etiam Lud. Molina ex nostrae societatis Theologis prodidit, et complures alii gentium diversarum scriptores allatis exemplis confirmarunt.– IORNAND.; De reb. Goth., 24 (8) : Filimer rex Gothorum, ...qui et terras Scythicas cum sua gente introisset... reperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas patrio sermone aliorumnas is ipse cognominat ; easque habens suspectas, de medio sui proturbat, longeque ab exercitu suo fugatas, in solitudinem coegit terrae. Quas spiritus immundi per eremum vagantes dum vidissent, et earum se complexibus in coitu miscuissent genus ferocissimun edidere : ... Naturellement ; telle devait être l'origine de ce peuple féroce et détesté. Même l'excellent Saint Augustin se montre aussi bien renseigné sur la génération des démons que sur la question des antipodes, et sur tant d'autres semblables (§ 1488). – D. AUGUST. ; De civ. dei, XV, 23 : Et quoniam creberrima fama est, multique se expertos, vel ab eis qui experti essent, de quorum fide dubitandum non est, audisse confirmant, Silvanos, et Faunos, quos vulgo ineubos vocant, improbos saepe exstitisse mulieribus, et earum appetisse ac peregisse concubitum : et quosdam daemones, quos Dusios Galli nuncupant, hanc assidue immunditiam et tentare et efficere, plures talesque asseverant, ut hoc negare impudentiae videatur. C'est bien cela : « en sorte qu'il y aurait de l'impudence à le nier ». – BODIN ; De la demonomanie des sorciers, II, 7 : « p. 104 a) Si les sorciers ont copulation avec les dœmons. – (p. 104 b) J'ai aussi leu l'extraict des interrogatoires faicts aux Sorciers de Longny en Potez, qui furent aussi bruslees vives, que maistre Adrian de Fer, Lieutenant general de Laon m'a baillé. J'en mettrais quelques confessions sur ce poinct icy ». Suivent divers faits de femmes qui avouent avoir connu charnellement le diable. « (p. 105 a) En cas pareil nous lisons au XVI liure de Meyer... que l'an MCCCCLIX grand nombre d'hommes et femmes furent bruslees en la ville d'Arras, accusees les uns par les autres, et confesserent qu'elles estoyent la nuict transportées aux danses, et puis qu'ils se couployent auecques les Diables... Jacques Spranger, et ses quatre compagnons inquisiteurs des sorcieres, escriuent qu'ils ont faict le procés à vne infinité de Sorcieres, en ayant faict executer fort grand nombre en Alemagne... et que toutes generalement sans exception, confessoient que le Diable auoit copulation charnelle avec elles... Henry de Coulongne (p. 105 b)... dit qu'il n'y a rien plus vulgaire en Alemaigne, et non pas seulement en Alemaigne, ains celà estoit notoire en toute la Grece et Italie. Car les Faunes, Satyres, Syluains ne sont rien autre chose que ces Dæmons, et malins esprits. Et par prouerbe le mot de Satyrizer, signifie paillarder. (p. 106 a) Nous lisons aussi en l'histoire sainct Bernard, qu'il y eut vne Sorciere, qui auoit ordinairement compagnie du Diable aupres de son mary, sans qu'il s'en apperceut. Ceste question (à sauoir si telle copulation est possible) fut traictee devant l'Empereur Sigismond, et. à sçavoir si de telle copulation il pouuoit naistre quelque chose : Et fut resolu contre l'opinion de Cassianus, que telle copulation est possible, et la generation aussi. Nous lisons aussi au liure premier chap. XXVII des histoires des Indes Occidentales, que ces peuples là tenoyent pour certain, que leur Dieu Cocoto couchoit avec les femmes : Car les Dieux de ce pays là n'estoient autres que Diables ». Voir la suite au § 928-1. – Dans un livre publié en 1864, un auteur moderne rapporte, en y prêtant créance, une partie des innombrables absurdités qui furent écrites à propos de la génération des démons, et conclut qu'il n'est pas possible de nier l'existence de l'union objective des démons et des êtres humains. – G. DES MOUSSEAUX ; Les hauts phénomènes de la magie : « (p. 297) Nier ces faits étranges, dit «un magistrat distingué et intègre » [En note : A. DE GASPARIN, Surn., vol. II, p. 154. Autre bel exemplaire !] le très savant et très expérimenté de Lancre [qui a fait mourir des centaines de sorciers et de sorcières], « ce serait détruire ce que l'antiquité et NOS PROCÉDURES nous ont fait voir » [C'est l'auteur qui souligne]. Et. je le répète, ce serait détruire, en outre, ce dont autrefois – et de nos jours [c'est l'auteur qui souligne] – la chair et le sang ont témoigné ; ce que l'inspection médicale et la science théologique ont constaté chacune par les moyens qui leur sont propres ». Voilà un bel exemple de la valeur expérimentale du consentement universel, aujourd'hui transformé en sentences du suffrage universel. Mais peut-être cette nouvelle divinité est-elle exempte des erreurs où tombèrent ses prédécesseurs ?
[FN: § 927-6]
DELRIO ; Magiq. disq., t. I, p. 180 (lib. II, quaest. 15) (§ 927-5). À propos de cette origine de Luther, il cite : Fontan. in hist. sacra de stal. religion. Il ne suffit pas que le démon intervienne à la naissance, il devait aussi intervenir à la mort. Le même Delrio, ibidem, t. II, p. 76 (lib. III, pars prior., quaest. 7) : Sane fuit animaduersum, et quo tempore Lutherus obiit, in Geila Brabantiae, ab obsessis daemones ad Lutheri funus aduolasse. Luther, lui-même, a dit tant de fois, pendant sa vie, avoir vu des démons, qu'il n'est pas si étrange que ces vénérables personnages soient allés à ses funérailles. – I. WIER ; Hist. disp. et disc., t. I, p. 418 et sv. (liv. III, chap. 25). Il raconte une longue histoire de la génération diabolique de Luther, et ajoute (p. 420) : « L'histoire Catholique de l’estat de la Religion en nostre temps escrite en françois par vn certain docteur en Theologie nommé S. Fontaines, dit que ceste opinion publiee par liures imprimez est vraysemblable, asauoir que Marguerite mere de Luther fut engrossee de lui par le diable. qui auoit eu sa compagnie autresfois autant qu'elle fust mariee à Iean Luther ». – MAINBOURG ; Hist. du Luth., I, p. 22-24, croit devoir réfuter ces fables : « Il [Luther] naquit à Islebe, ville du comté de Mansfeld l'an 1483, non pas d'un Incube, ainsi que quelques uns, pour le rendre plus odieux, l'ont écrit sans aucune apparence de vérité, mais comme naissent les autres hommes, et l'on n'en a jamais douté que depuis qu'il devint hérésiarque... ».
[FN: § 928-1]
Cette question : les démons peuvent-ils, et comment peuvent-ils rendre mères les femmes, a été résolue en divers sens par les Pères de l'Église. SAINT THOMAS en disserte doctement dans la Summa theol., Ia, q. LI, 3 : Si tamen ex coitu daemonum aliqui interdum nascuntur, hoc non est per semen ab eis decisum, aut a corporibus assumptis ; sed per semen alicuius hominis ad hoc acceptum, utpote quod idem daemon, qui est succubus ad virum, fiat incubus ad mulierem : sicut et aliarum rerum semina assumunt ad aliquarum rerum generationem, ut Augustinus dicit † ; ut sic ille qui nascitur, non sit filius daemonis, sed illius hominis cuius est semen acceptant – BODIN ; De la demonomanie... Suite de la citation § 927-5: « (p. 106 a) Aussi les Docteurs ne s'accordent pas en cecy : entre lesquels les vns tiennent, que les Diemons Hyphialtes, ou Succubes reçoiuent la semence des hommes, et s'en servent enuers les femmes en Daemons Ephialtes, ou Incubes, comme (p. 106 b) dit Thomas d'Aquin, chose qui semble incroyable : mais quoy qu'il en soit. Spranger escript que les Alemans (qui ont plus d'esperience des Sorciers, pour y en auoir eu de toute ancienneté, et en plus grand nombre que és autres pays) tiennent que, de telle copulation il en vient quelquesfois des enfans, qu'ils appellent Vechselkind, on enfans changez, qui sont beaucoup plus pesans que les autres, et sont toujours maigres, et tariroient trois nourrices sans engresser. Les autres sont Diables en guise d'enfans, qui ont copulation avec les nourrices Sorcieres, et soutient on ne sçait qu'ils deuiennent.
† Le livre cité de Saint Augustin est De trinitate lib. quind., III, c. VIII et IX. On y apprend beaucoup de belles choses ; entre autres : (13) : Et certe apes semina filiorum non coeundo concipiunt sed tanquam sparsa per terras ore colligunt.
[FN: § 929-1]
SALLUST.; Bell. Catil., XXII, trad. NISARD. – FLOR., IV, 1, dit simplement : Additum est pignus coniurationis, sanguis humanus, quem circumlatum pateris bibere : summum nefas, nisi amplius esset, propter quod biberunt. « Le gage de la conjuration fut le sang humain qu'on but, présenté à la ronde dans les coupes : crime abominable, mais pas plus grand que celui pour lequel ils buvaient ». Ces derniers mots manifestent le résidu pur.
[FN: § 929-2]
PLUT. ; CIC., X, 2.
[FN: § 929-3]
DIO CASS.; XXXVII, 30 (p. 30) : ![]()
![]() E. GROS observe avec justesse : «
E. GROS observe avec justesse : « ![]() » La version de Xylander, Ea deinde ipse cum aliis comedit, reproduite par Reimarus et par Sturz a été suivie par Wagner et par M. Tafel. Mais tel n'est pas le sens de
» La version de Xylander, Ea deinde ipse cum aliis comedit, reproduite par Reimarus et par Sturz a été suivie par Wagner et par M. Tafel. Mais tel n'est pas le sens de ![]() , comme l'a très bien remarqué M. Mérimée dans une note de son Histoire de la Conjuration de Catilina, p. 113. La véritable signification est donnée par H. Etienne :
, comme l'a très bien remarqué M. Mérimée dans une note de son Histoire de la Conjuration de Catilina, p. 113. La véritable signification est donnée par H. Etienne : ![]() – Exta in manus assumo et attrecto, ut quum coniurati se iureiurando et religione astringebant... Cf. Duncan, Lexic Homer. – Pindar, p. 1042 ; Eusthate, Comment. sur l'Iliade, I, v. 464 ».
– Exta in manus assumo et attrecto, ut quum coniurati se iureiurando et religione astringebant... Cf. Duncan, Lexic Homer. – Pindar, p. 1042 ; Eusthate, Comment. sur l'Iliade, I, v. 464 ».
[FN: § 929-4]
DIO CASS. ; XLIII, 24.
[FN: § 929-5]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. C'est ce qu'exprime l'adage : aux grands maux les grands remèdes.
[FN: § 929-6]
MARQUARDT, Le culte chez les Rom., I, p. 315, nous fait connaître un de ces prétextes : « César fit mettre à mort un des émeutiers ; deux autres furent sacrifiés au champ de Mars par les pontifes et par le flamen Martialis et l'on exposa leurs têtes à la Regia. Si tant est que ces faits soient vrais, le sacrifice accompli à cette occasion était un piaculum ; il avait été nécessité par l'opposition égoïste des soldats à ce que l'on accordât aux dieux les sacrifices et les actions de grâce qui leur étaient dus. Mais comment ce piaculum consistait-il dans un sacrifice humain ? Cela est bien surprenant, pour l'époque de César, quoi que l'on puisse penser d'ailleurs, des sacrifices humains à Rome ». – La réponse à la question de Marquardt est simple. Que le sacrifice des deux hommes soit ou non un piaculum, que l'histoire soit ou non inventée, celui qui fit mettre à mort les hommes, ou celui qui inventa l'histoire, trouvait convenable d'unir une chose terrible au fait de la rébellion des soldats, qui devaient tant de reconnaissance à César.
[FN: § 930-1]
FESTI epit., s. r. ver sacrum : Ver sacrum vovendi mos fuit Italis. Magnis enim periculis adducti vovebant, quaecunque proximo vere nata essent apud se animalia immolaturos. Sed cum crudele videretur pueros ac puellas innocentes interficere, perductos in adultam aetatem velabant atque ita extra fines suos exigebant. – FESTI frag. ; s. r. Mamertini. – STRAB. V, p. 250. – DIONYS.; I, 16.– SERV. ; Ad Aen. VII, 796. –NONN. ; XII, p. 522.
[FN: § 930-2]
LIV. XXII, 10. Il faut lire avec quelles précautions ingénieuses sont fixées les prescriptions du pacte. En voici quelques-unes. Il dit des animaux gardés pour le sacrifice : Si id moritur, quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto, si quis rumpet occidetve insciens, ne fraus esto : si quis clepsit, ne populo scelus esto, neve cui cleptum erit : si atro die faxit insciens, probe factum esto...
[FN: § 930-3]
LIV. ; XXXIII, 44.
[FN: § 930-4]
LIV.; XXXIV, 44.
[FN: § 931-1]
CIC. ; In Vatin., VI, 14 : ... quae te tanta pravitas mentis tenuerit, qui tantus furor, ut, cum, inaudita ac nefaria sacra susceperis, cum inferorum animas elicere, cum puerorum extis deos manes mactare soleas... – QUINT.; Declam., 8. –LUCAN.,VI, 558. – LAMPRID.; Eliog., 8. – EUSEB. ; Hist. eccl.,VIII, 14, 5 IX, 9 ; Vit. Costant., I, 36. – AMMIAN, MARC.; XXIX, 2, 17– THEODORET. ; Eccl. hist.,III, 26. – IUV. ; VI :
(551) Pectora pullorum rimabitur, exta catelli,
Interdum et pueri : faciet, quod deferat ipse.
[FN: § 931-2]
F. FUNCK BRENT. ; Le drame des poisons : « (p. 171) Au jour dit se rencontrèrent à Villebousin, Mme de Montespan, l'abbé Guibourg, Leroy, « une grande personne », qui est certainement Mlle Desœillets, et un personnage au nom inconnu, qui se disait attaché à l'archevêque de Sens. Dans la chapelle du château, le prêtre dit la messe sur le corps nu de la favorite couchée sur l'autel. À la consécration, il récita la conjuration, dont il donna le texte aux commissaires de la Chambre : « Astaroth, Asmodée, princes de l'Amitié, je vous conjure d'accepter le sacrifice, que je vous présente de cet enfant pour les choses que je vous demande, qui soit que l'amitié du Roi, de monseigneur le Dauphin, me soit (p. 172) continuée, et, honorée des princes et princesses de la Cour, que rien ne me soit dénié de tout ce que je demanderai au Roi, tant pour mes parents que serviteurs ». – « Guibourg avait acheté un écu (quinze francs d'aujourd'hui) l'enfant qui fut sacrifié, à cette messe, écrit la Reynie... Les détails de la messe du Mesnil furent déclarés par Guibourg, et d'autre part, confirmés par la déposition de la Chanfrain, sa maîtresse. La seconde messe sur le corps de Mme de Montespan eut lieu quinze jours ou trois semaines après la première, la ... troisième eut lieu, dans une maison, à Paris... ».
[FN: § 932-1]
GEORGES GAULIS ; La révolte des Albanais, dans Journ. de Genève, 7 mai 1910 : « Il y a des progrès qui ne s'imposent qu'à coups de fusils dans les masses ignorantes où le mot progrès n'a pas le sens presque mystique que nous lui attribuons ». C'est vrai des Albanais ; mais en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, « les masses ignorantes » ont un profond sentiment mystique du progrès.
[FN: § 934-1]
Leurs prédécesseurs de 1848 avaient d'ailleurs suivi la même voie, imitant en cela les gouvernements monarchiques auxquels ils succédaient. Voir les preuves dans DUGUÉ DE LA FAUCONNERIE, Souvenirs d'un vieil homme, p. 299 à 330.
[FN: § 935-1]
Par exemple, M. PAUL DOUMER, n'ayant pas été réélu aux élections générales de mai 1910, écrivit à ses électeurs : « Au moment où je sors du Parlement, après avoir consacré an service exclusif du pays tout ce que je pouvais avoir de forces et de connaissance des affaires de l'État, je ne veux prononcer ni parole d'amertume, ni récrimination. Le suffrage universel est souverain et sa volonté doit être respectée, quels que soient les sentiments qui la dictent et lors même qu'elle s'exprime par un mode de scrutin qui déforme et abaisse tout, qui tend à faire de l'élu, non le représentant de l'intérêt général, mais le prisonnier d'intérêts particuliers souvent les moins défendables ». Et ces gens méprisent les catholiques, parce qu'ils se soumettent à la volonté du Pape ! Pourtant un catholique ne dit pas que « la volonté du Pape doit être respectée, quels que soient les sentiments qui la dictent » ; mais il croit que cette volonté est inspirée par Dieu, et c'est pourquoi il s'y soumet.
[FN: § 935-2]
En France, au mois de mars 1910, plusieurs savants et professeurs d'universités publièrent un manifeste, où on lit le passage suivant : « Nous voulons la réforme électorale pour fortifier la république et pour améliorer notre régime parlementaire... L'usage du scrutin d'arrondissement a perpétré des mœurs électorales et politiques intolérables : la candidature officielle, l'arbitraire dans les actes administratifs, l'arbitraire même dans l'application des lois, la faveur substituée à la justice, le désordre dans les services publics, le déficit dans les budgets, où les intérêts privés et de clientèle prévalent sur l'intérêt général. Il faut affranchir les députés de la servitude qui les oblige à satisfaire des appétits pour conserver des mandats. Il faut mettre plus de dignité et de moralité dans l'exercice du droit de suffrage ». Il ne leur vient pas à l'esprit que le suffrage universel et la démocratie pourraient être pour quelque chose dans ces maux. Ces divinités sont essentiellement bonnes ; elles sont même « le bien » ; et par conséquent, elles ne peuvent jamais, en aucune manière, faire mal.
[FN: § 938-1]
Le vers est peut-être interpolé ; mais cela importe peu à notre sujet. HESIOD.; Theog. :
![]()
Comme on le sait, Athéna sortit ensuite de la tête de Zeus. APPOLLOD.; I, 3,6.
[FN: § 938-2]
OLDENBERG; La relig. du Veda : « (p. 147) Sôma, la boisson divine. – La boisson qui donne à Indra la force d'accomplir ses hauts faits, c'est le suc extrait par pressurage de la plante à sôma. L'idée d'une boisson enivrante, appartenant aux dieux, paraît remonter jusqu'à l'époque indo-européenne. La liqueur qui verse à l'homme une vigueur mystérieuse et une excitation extatique, doit être de nature divine, être la propriété exclusive des dieux. C'est ainsi que, chez les indigènes d'Amérique, le tabac qui leur cause une sorte d'inspiration surnaturelle, est dit « herbe sacrée », et ils pensent que les dieux fument aussi pour se livrer à cette extase. Les Indo-Européens donc semblent avoir déjà placé au ciel la patrie de la boisson divine... Mais de la cachette céleste, où la garde un vigilant démon, la liqueur est emportée par un oiseau... (p. 152) Les poètes louent la sagesse, la splendeur, la sublimité de Sôma ; mais rarement ils lui assignent une forme ou des actions humaines... On le loue de donner la joie aux hommes : « Nous avons bu le sôma, nous voici devenus immortels ; nous avons pénétré jusqu'à la lumière et trouvé les dieux ; que peut maintenant nous faire, ô immortel, la haine on la malignité du mortel ? » (R. V., VIII, 48, 3) ».
[FN: § 939-1]
APOLLOD. ; III 13, 6. Pour plus de détails, voir BAYLE ; Dict. hist., s. r. Achille.
[FN: § 939-2]
DUMONT D'URVILLF; dans : Bibl. unir. des voy., t. XVIII « (p. 276) Les Nouveaux-Zélandais pensent qu'après la mort l'âme ou l'esprit qu’ils nomment waidoua, est un souffle intérieur, entièrement distinct de la matière corporelle. Les deux substances jusqu'alors unies se séparent ; le waidoua demeure trois jours à planer autour du corps, puis se rend au fameux rocher de Reinga, mot qui signifie départ ; rocher que nous avons cité comme le Ténare de ces sauvages, et d'où un atoua emporte le waidoua au séjour de la gloire ou de la honte, pendant que le corps ou la partie impure de l'homme s'en va dans les ténèbres... ». Cette première partie du récit est donnée comme explication de la seconde que nous allons transcrire ; mais elle a peu de valeur, car dévorer « un souffle intérieur » reste tout de même une chose étrange ; et l'on voit que cette première partie a été inventée pour donner une explication quelconque de la seconde. « (p. 276) C'est avec ces idées superstitieuses qu'ils sont naturellement portés à dévorer le corps de leurs ennemis ; ils croient qu'en agissant ainsi, ils absorberont l'âme de cet ennemi, la joindront à la leur et donneront à celle-ci plus de force. Aussi pensent-ils que plus un chef a dévoré d'ennemis d'un (p. 277) rang distingué dans ce monde, plus dans l'autre son waidoua triomphant sera heureux et digne d'envie. Au surplus ce bonheur futur ne consiste que dans de grands festins en poissons et en patates, et dans ces combats acharnés où les waidouas élus seront toujours vainqueurs. Comme les Nouveaux-Zélandais croient que le waidoua se tient dans l'œil gauche, un guerrier qui vient de terrasser son rival ne manque jamais de lui arracher cet œil et de l'avaler ». L'auteur ajoute : « (p. 277) Il boit en outre le sang de cet ennemi pour éviter la fureur du waidoua vaincu ; car celui-ci retrouve de la sorte dans l'assimilation qui vient de s'opérer une portion de l'aliment qui le nourrissait et qui dès lors l'empêche de nuire ». Comme d'habitude, le résidu est constant (assimilation d'une partie de l'ennemi) ; les dérivations sont variables (souffle, aliment).
[FN: § 939-3]
I. G. FRAZER ; Le ram. d'or, t. II : « (p. 115) Le sauvage croit qu'en mangeant la chair d'un animal ou d'un homme, il acquiert les qualités physiques, morales ou intellectuelles qui distinguent cet animal ou cet homme. Par exemple, dans l'Amérique du Nord, les Creeks, les Cherokee et d'autres Indiens de même race « croient que la nature a le pouvoir de transmettre aux hommes et aux animaux les qualités soit des aliments dont ils se nourrissent, soit des objets que perçoivent leurs divers sens. Celui qui vit de gibier est donc, d'après ce système, plus vif que celui qui mange de l'ours, de la volaille, du bétail ou du porc... » (JANES ADAIR, History of the American Indian, p. 133)... (p. 116) Les Namaquas ne mangent pas de lièvre pour ne pas devenir poltrons. Mais ils mangent la chair du lion, ils boivent son sang et celui du léopard, pour acquérir le courage et la vigueur de ces animaux (THEOPHILUS HAN ; Tsuni-Goam, the supreme Being of the Khi-Khoi, p. 106). D'autres tribus guerrières du sud-est de l'Afrique observent les mêmes coutumes (J. MACDONAL ; Light in Africa, p. 174; id. dans : Journal of the Anthropological Institute, XIX, 1890, p. 282)... (p. 117) Parfois lorsqu'un Zoulou tue une bête fauve, un léopard par exemple, il fait boire le sang de l'animal à ses enfants et leur fait manger son cœur ; il espère les rendre ainsi braves et audacieux... Quand une épidémie désole un Kraal zoulou, le médecin de la tribu prend un os d'un vieux chien, d'une vieille vache, ou de n'importe quel autre animal, pourvu qu'il soit très vieux ; il le broie et en administre la poudre à ses concitoyens, afin qu'ils vivent aussi vieux que l'animal dont provient l'os ». CHARD1N ; Voy. de Paris à Ispahan, t. VII : « (p. 115) Ils [les Persans] estiment le mouton par-dessus toutes les bêtes de boucherie, disant qu'il n'a nulle mauvaise habitude, et qu'on n'en peut, par conséquent, contracter de mauvaises en s'en nourrissant ; car leurs médecins tiennent unanimement que l'homme devient tel que les animaux dont il se nourrit ».
[FN: § 940-1]
IUST. ; Apol., I, 65, 3 et sv. L'auteur ajoute « (66, 4) Les méchants démons ont imité cette institution dans les mystères de Mithra, où l'on offre à ceux qui veulent se faire initier du pain et une coupe d'eau, et l'on profère certaines paroles que vous savez ou que vous pouvez savoir ». Là, nous avons l'erreur habituelle, consistant à supposer que deux dérivations d'un résidu ont au contraire été produites en imitation l'une de l'autre.
[FN: § 940-2]
![]() est proprement l'aliment consacré et qui renferme la grâce du Seigneur.
est proprement l'aliment consacré et qui renferme la grâce du Seigneur.
[FN: § 940-3]
On pourrait traduire, d'une manière plus libre : « ... À cause des paroles de sa prière, nous savons que l'aliment consacré est de la chair et du sang de Jésus incarné, et que notre sang et nos chairs sont nourris par cet aliment, grâce à une transformation ».
[FN: § 942-1]
CLEMENT. ALEX. ; Cohort. ad. gent., p. 18 Potter –p. 14 Paris : ![]()
![]()
![]()
* ![]() –ayant opéré – ne donne pas un sens très satisfaisant. Dans l'édition Migne, on propose «
–ayant opéré – ne donne pas un sens très satisfaisant. Dans l'édition Migne, on propose « ![]() - id est postquam inspexi sacrum illum
- id est postquam inspexi sacrum illum ![]() , et secretam mercem ». Ainsi, le sens est bon.
, et secretam mercem ». Ainsi, le sens est bon.
ARN. ; Adv. gent., V, 26 : Ieiunavi, atque ebibi cyceonem : ex cista sumpsi,,et in calathum misi : accepi rursus, in cistulam transtuli.
[FN: § 942-2]
ORPH.; Argon., 323-330. Le cicéon est composé de farine, de sang de taureau, d'eau de mer, et l'on y ajoute de l'huile. – HESYCH.. ; s. r. ![]()
![]() . « Boisson composée d'un mélange de vin, de miel, d'eau et de farine. Le scoliaste de l'Odyss., X, 290, y ajoute du fromage.
. « Boisson composée d'un mélange de vin, de miel, d'eau et de farine. Le scoliaste de l'Odyss., X, 290, y ajoute du fromage.
[FN: § 943-1]
J. F. Davis ; La Chine, II : « (p. 92) Les amulettes dont les Chinois se servent consistent en des assemblages mystiques de caractères ou de mots divers... Tantôt on porte ces amulettes sur soi, tantôt on les colle contre les murs de sa maison. Pour les employer à la guérison des malades, on les trace sur des feuilles qu'on laisse infuser dans la boisson préparée pour eux, ou bien sur du papier que l'on brûle, et dont on leur fait avaler les cendres dans un liquide quelconque ».
[FN: § 947-1]
Gazette de Lausanne, mai 1910.
[FN: § 949-1]
D. GREGOR. TUR.; Hist. Franc., VIII, 16: ... sed tamen Deus ubique est, et virtus eius ipsa est forinsecus, quae habetur intrinsecus.
[FN: § 949-2]
PERT.; Stor. d. dir. ital., VI, I : « (p. 372) Malgré ces solennités et ces précautions, les parjures étaient cependant toujours très fréquents. Dans le but de diminuer les maux causés par cet abus des choses saintes, le roi Robert fit construire des reliquaires vides ou avec de fausses reliques, pour qu'on prêtât serment dessus ».
[FN: § 950-1]
W. MARSDEN ; Rist. de Sumatra, t. II « (p. 9) Le lieu où le serment se fait avec le plus de solennité, est le crammat, ou tombeau de leurs ancêtres ; et l'on y observe plusieurs cérémonies superstitieuses. En général, les habitans de la côte, par leur longue fréquentation avec les Malais, ont une idée du Koran, par lequel ils jurent pour l'ordinaire ; cérémonie dont les prêtres ne manquent pas de tirer parti en leur faisant payer une certaine somme ; mais les habitans de l'intérieur conservent dans leurs maisons certaines vieilles reliques,... qu'ils produisent quand il est question de faire un serment. La personne qui a perdu sa cause et qui (p. 10) oblige sa partie adverse au serment, demande souvent deux ou trois jours pour disposer l'appareil du serment, soompatan, ou la chose sur laquelle ils jurent, qui peut être plus ou moins sacrée, plus ou moins efficace. C'est un vieux cris rouillé, ou un canon de fusil rompu, ou quelque ancienne arme, à laquelle le hasard ou le caprice a attribué une vertu extraordinaire. Dans la cérémonie du serment, ils la plongent dans l'eau, et celui qui fait le serment boit cette eau après avoir prononcé la formule ci-dessus rapportée ». Plus loin : « (p. 10) Le soompatan le plus ordinaire, est le cris, sur la lame duquel ils répandent quelquefois du suc de limon, qui imprime une tache sur les lèvres de celui qui boit l'eau ; (p. 11) circonstance qui ne peut que faire impression sur un esprit faible et coupable, qui doit s'imaginer que la tache extérieure offre aux spectateurs une image de la tache intérieure ». La formule du serment : « (p. 5) Si ce que je déclare ici expressément (alors il expose le fait) est vrai et réellement ainsi, que je sois libre et délivré de mon serment : si ce que j'avance est faux, que mon serment soit la cause de ma mort ».
[FN: § 952-1]
CHARDIN ; Voy., VII : « (p. 11) Ils [les Persans] croient que les prières de tous les hommes sont bonnes et efficaces et ils acceptent, et même ils recherchent dans leurs maladies, et en d'autres besoins, la dévotion des gens de différentes religions, chose que j'ai vu pratiquer mille fois ». – Ibidem, VIII : « (p. 149) Ils [les Persans] se servent beaucoup de ces remèdes magiques et d'autres semblables dans les maladies durant lesquelles ils se vouent non seulement (p. 150) à tous leurs saints, mais aussi à des saints de toutes religions ; ils s'adressent aux gentils, aux juifs, aux chrétiens, à tout le monde. Les chrétiens lisent sur les malades l'évangile de saint Jean, qu'on lit à la messe ; et les missionnaires latins, encore plus que les chrétiens orientaux, font métier de lire cet évangile sur les hommes, les femmes et les enfants ; ce qui ne peut passer que comme un acte magique, car vous concevez bien que les Persans n'entendent pas plus le latin que les Européens n'entendent le persan ; mais de plus cela doit être regardé comme une grande profanation, puisque les mahométans ne croient pas au Verbe éternel annoncé dans cet évangile ; mais ils croient, au contraire, notre religion la plus fausse et la plus damnable ». Chardin raisonne comme si les actions étaient logiques.
FRASER, dans Bibl. univ. des voy., t. 35. L'auteur raconte l'histoire d'un vieillard qui portait, suspendue au cou une boîte de cuivre renfermant deux figurines, « (p. 469) dont l'une était une lame de cuivre, idole ordinaire des adorations du Grand-Lama, et que l'on donne à ceux qui vont en pèlerinage à son temple ; l'autre était une petite image chinoise peinte sur de la porcelaine ou de la terre cuite. Ces deux reliques étaient enveloppées dans un morceau de soie jaune. Il dit qu'il les avait reçues du Grand-Lama à l’Hassa, où il avait fait quelques années auparavant un pèlerinage. Cet homme était hindou de religion et adorait ces idoles à la manière des Hindous. Cependant elles lui venaient du chef d'une autre croyance, et que probablement il avait été visiter dans un but religieux. Cet homme offrait ainsi un exemple curieux de tolérance et d'ignorance à la fois ».
[FN: § 952-2]
Actus apostolorum, XIX, 11-12: (12)
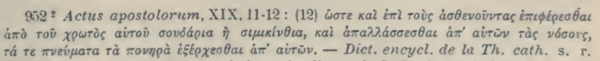
– Dict. encycl. de la Th. cath. s. r. Reliques : « (p. 103) Si les mouchoirs et les linges de S. Paul, qui étaient extérieurs à sa personne, guérissaient les maladies, à plus forte raison cette vertu devait-elle être attribuée aux corps mêmes des (p. 104) saints ayant servi de demeure aux âmes dont découlaient ces vertus. S. Basile dit dans son homélie sur Ste Julitte : – “Son corps repose maintenant sous le splendide vestibule d'un temple de la ville et sanctifie le lieu où il se trouve et ceux qui viennent l'y visiter”. “Dans l'ancienne alliance – dit-il ailleurs (Homil. in Ps. 115) – on tenait les corps des morts pour impurs ; il en est autrement dans la nouvelle alliance. Quiconque touche les ossements des saints, obtient par ce contact quelque chose de la grâce sanctifiante qui demeure dans ces corps, ![]() ” ».
” ».
[FN: § 952-3]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Il suffisait même de moins que cela. Act. des ap., V, 15 : « en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux ». L'imposition des mains avait aussi les vertus les plus inattendues. Ibid. XIX, 6 : « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient ».
[FN: § 954-1]
Decret. Grat., Pars. sec., Ca. 26, Qu. V, c. 3. Non liceat Christianis tenere traditiones Gentilium. 1. Nec in collectionibus herbaram, quae medicinales sunt, aliquas observationes, aut incantationes liceat attendere : nisi tantum cum symbolo divine, aut oratione Dominica, ut tantum Deus creator omnium, et Dominus honoretur. 3 Mulieribus quoque Christianis non liceat in suis lanificiis vanitatem observare, sed Deum invocent adiutorem, qui eis sapientiam texendi donavit. L. FERRARIS; Bibl. Canonica, t. VIII, s. r. Superstitio, 49, (p. 514). Observantia sanitatum, est superstitio, qua media inania, et inutilia adhibentar ad sanitatem hominum, aut brutorum conservandam vel recuperandam... Sic huius superstitionis rei evadunt qui certa ignota nomina, certa determinata verba, certos characteres, certas scripturas, certa involucra, certa signa, certain numeram Crucium, et Orationum, et alia huiusmodi inutilia adhibent, et applicant ad sanandas infirmitates, ad curanda vulnera, ad mitigandos dolores, ad sistendum sanguinem, ad se vel alios reddendos impenetrabiles, seu invulnerabiles telis, ensibus, globerum ictibus, ut sint immunes ab hostium laesionibus, et ab omni infortunio, et qualibet infirmitate liberi, quia supradicta omnia, et similia, nec a Deo, nec a natura, nec ab Ecclesia saut ad id ordinata, (p. 515). Unde huius superstitionis rei evadunt, qui in ludo mutant locum, aut chartas ad evitandam malam ludi fortunam ; qui ferunt lignum particulare ad lucrandum in ludo : qui nolunt adire convivium, in quo cum suo interventu sint tresdecim. Qui in nocte S. Ioannis orant, ut in somno appareant illi quibus nubere debeant. Qui credunt se non dacturos uxorem eo anno, quo coram se ignis fuit coopertus cineribus. Qui scopas invertunt, ut mulier de qua suspicantur, quod sit Saga, si talis sit, abire non possit, nisi gressu averse, seu cancrino. Aut certain schedam affigunt ianuae, ut ad eam cogatur venire fur. Qui cum gallina instar galli cantat, credunt male imminere. Qui credunt praenanciari alicui mortem, vel infortunium, dum avis moestum canit, corvas crocitat, lepus occurrit. Qui aliquid infaustum metuunt, si videant duos sacerdotes simul elevantes hostiam in Missa. Qui credunt gallinas fore liberas ab accipitre, si primum suum ovum detur pauperi. Qui conservant ova die Parasceves a gallinis exclusa ad extinguendum incendium, et sic de aliis fere infinitis similibus superstitionibus... On remarquera que tout cela est vraiment une bien petite partie des innombrables façons dont, en ces matières, se manifestent les résidus des combinaisons.
[FN: § 954-2]
D. THOM. ; Summa theol., 2a « 2ae, Q. 96, ad 4 : Conclusio. Verba divina ad collum, suspendere, nisi aliquid falsitatis vel dubii contineant, non illicitum omnino est quanquam landabilius esset ab his abstinere. Pour expliquer cela, le saint dit (ad. 3) ce que nous citons dans le texte. (Concl.) Similiter etiam videtur esse cavendum, si contineat ignota nomina, ne sub illis aliquid illicituni lateat.
[FN: § 955-1]
TERTULL. : De virgin. velandis , XV : Nam est aliquid etiam apud ethnicos metuendam, quod fascinum vocant, infeliciorem laudis et gloriae enormioris eventum. Hoc nos interdum diabolo interpretamur, ipsius est enim boni odium ; interdum deo deputamus, illius est enim superbiae iudicium, extollentis humiles et deprimentis elatos.
[FN: § 955-2]
D. BASILII Hom. de invidia, 4 (p. 95, A – GAUME, t. II, I, p. 132)

[FN: § 955-3]
M. DELRIO ; Magic. disq., t. II, 1. III, p. I, q. IV, s. 1 : De fascinatione (p. 25) Sit ergo conclus. I. Fascinatio proprie dicta (prout illam vulgo sumunt) est aliquid, non naturale, sed fabulosum superstitiosumque. Hanc conclus optime docent, Leonard. Vairus, Laurent. Ananias, Francis. Valesius, et Iulius Schalig. Probatur auctoritate magni Basilii, qui spernit ut muliebrem nugacitatem (homil. de Invidia). Secunda conclusio. Restat, fascinatio nascatur ex pacto ; ita, ut aspiciente malefico vel laudante, Diabolus modis sibi (p. 26) notis laedateum quem dicimus fascinari. Suit la définition donnée dans le texte.
[FN: § 955-4]
PLUTARCH.; Symph. , V, 7
[FN: § 955-5]
HELIODOR. ; Aethiop ., III, 7.
[FN: § 956-1]
HESIOD.; Op. et d., 348 :
![]()
[FN: § 956-2]
COLUM. : 1, 3.
[FN: § 956-3]
CATULL. ; 5 :
Aut ne quis malus invidere possit,
Cum tantum sciat esse basiorum.
M. A. MURETI op omm., t.II in Catul.comm. On observe à propos de ce passage : (p. 727) Putabatur enim fascinatio eis rebus nocere non posse, quarum vel nomen, vel numerus ignoraretur [comme d'habitude, c'est l'instinct des combinaisons]. Nostrates quidem rustici, poma in novellis arboribus crescentia numerare, hodieque religioni habent.
[FN: § 956-4]
VIRG. ; Egl., III, 103:
Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.
Egl., VII :
(27) Aut, si ultra placitum laudarit, baccare frontem
Cingite, ne vati noceat mala lingua ftituro.
SERVIUS note : Mala lingua. Fascinatoria, nocendi scilicet studio, HORAT. : Epist., I, 14 :
(37) Non istic obliquo oculo mea commoda quisquam
Limat, non odio obseuro morsuque venenat :
[FN: § 956-5]
PLIN. ; Nat. hist ., VII, 2.
[FN: § 956-6]
Si l'on observe attentivement comment s'établit la renommée de jettatore ou de jettatrice, on verra qu'il en va comme de la semence répandue sur la terre : une partie germe, une partie meurt. On dit : A, B, C sont jettatori. Pour A, B, les choses en restent là ; pour C, elles se confirment souvent par des motifs absurdes. À ce propos, je me souviens d'un fait. Une dame, âgée et laide, cela s'entend, fut appelée jettatrice. Le hasard voulut qu’un lustre tombât dans un bal où cette dame se trouvait. On dit aussitôt : « Voyez si elle n'est pas jettatrice! » ; et l'on ne faisait pas attention que ce motif pouvait s'appliquer également à toutes les autres personnes qui assistaient à cette fête. Toutes ces personnes, y compris la jettatrice, allèrent, suivant l'usage, rendre visite à la dame qui avait donné le bal et il arriva que peu après, les enfants de cette dame prirent la rougeole. Ce fut la dernière et la plus convaincante preuve que la personne supposée jettatrice l’était vraiment ; elle endura tant et de telles persécutions qu'elle dut quitter la ville où ces fait se passèrent.
[FN: § 957-1]
Voir dans le Dict. DAREMB. SAGLIO. s. r. Fascinum, les nombreux moyens employés autrefois, dont une partie continuèrent à être en usage jusqu'à notre époque. « (p. 985,) Les Romains avaient placé les enfants sous la protection d'une divinité, spéciale, Cunina, qui avait pour fonction de veiller sur leur berceau (cunae) et de les soustraire à l'influence du mauvais œil. Enfin on se figurait que les animaux sauvages eux-mêmes pouvaient en souffrir et que leur instinct les portait à s'en garantir en plaçant dans leur gîte des plantes et des pierres dont ils connaissaient la vertu secrète... L'insecte que nous appelons mante religieuse ![]()
![]() passait pour avoir le mauvais œil et pour ensorceler non seulement les hommes, mais les animaux. Au contraire par une association d'idées qui est constante dans ce genre de superstitions, son image était considérée comme très propre à éloigner les sortilèges ; Pisistrate en avait fait mettre une sur l'Acropole d'Athènes en guise de préservatif ». Ce n'est pas seulement dans « ce genre de superstitions » ; c'est en général, qu'un résidu s'applique aussi bien pour que contre, et le contraire du pour n'est pas le contre, ni vice-versa, mais bien l'absence de toute action (§ 911).
passait pour avoir le mauvais œil et pour ensorceler non seulement les hommes, mais les animaux. Au contraire par une association d'idées qui est constante dans ce genre de superstitions, son image était considérée comme très propre à éloigner les sortilèges ; Pisistrate en avait fait mettre une sur l'Acropole d'Athènes en guise de préservatif ». Ce n'est pas seulement dans « ce genre de superstitions » ; c'est en général, qu'un résidu s'applique aussi bien pour que contre, et le contraire du pour n'est pas le contre, ni vice-versa, mais bien l'absence de toute action (§ 911).
[FN: § 960-1]
ARIST.; Metaph., 1, 5, 3. Il écrit : ![]() « La décade semble être parfaite ». – CLEMENT. ALEX. ; Strom. ; VI, 11, p. 782 Potter – p. 656, Paris. 7
« La décade semble être parfaite ». – CLEMENT. ALEX. ; Strom. ; VI, 11, p. 782 Potter – p. 656, Paris. 7![]() « La décade est parfaite d'un consentement unanime ».
« La décade est parfaite d'un consentement unanime ».
[FN: § 960-2]
PHILOL. in Frag. philosoph. graec., Didot, II, p. 4 (13).
[FN: § 960-3]
HIEROCLIS commentarius in aureum carmen dans Frag.philosoph. graec. ,Didot, I, p. 464-465.
[FN: § 960-4]
– CHALCIDII commentarius in Timaeum Platonis. 36 Frag. phil. graec., t. II). L'auteur s'arrête longuement à montrer les belles propriétés du nombre 7. (p. 188) Deinde alia quoque septenarii numeri proprietas consideratur, quam caeteri numeri non habent. Si quidem cum alii, qui finibus decumani numeri continentur, partim alios ipsi pariant, partim ab aliis pariantur, partim et pariant alios, et pariantur ab aliis ; solus septenarius numerus, neque gignat ex se alium numerum infra decumanum limitem, neque a quoquam ipse nascatur... (p. 189) Proptereaque Minerva est a veteribus cognominatus, item ut illa, sine matre, perpetuoque virgo.
[FN: § 960-5]
ARIST.: De coel.. I, 1. 2.
[FN: § 960-6]
SUID. ; s. r.
« ![]() Le sacrifice parfait de trois victimes : un porc, un bélier, un bouc ».
Le sacrifice parfait de trois victimes : un porc, un bélier, un bouc ».
[FN: § 960-7]
Ou bien solitaurilia qui, suivant Festus (s. r.), est ainsi nommé parce qu'on sacrifie trois animaux qui ne sont pas châtrés.
[FN: § 960-8]
VIRG.; Egl., VIII. 75 : ...numero deus impare gaudet. – SERV. : Aut quicomque superorum (iuxta Pythagoreos, qui ternarium numerum perfectum summo Deo assignant, a quo initium, et medium, et finis est), aut revera Hecaten dicit, cuius triplex potestas esse perhibetur... (quamvis omnium prope deorum potestas triplici signo ostendatur ; ut Iovis trifidani fulmen ; Neptuni tridens ; Plutonis canis triceps. Apollo, idem Sol, idem Liber : vel quod omnia ternario numero continentur, ut Parcae, Furiae ; Hercules etiam trinoctio conceptus : Musae ternae. Aut impare, quemadmodumcumque : nam septem chordae, septem planetae, septem dies nominibus deorum, septem stellae in Septentrione, et multa his similia ; et impar numerus immortalis quia dividi integer non potest [quelle belle raison !]; par numerus mortalis, quia dividi potest ; licet Varro dicat Pythagoreos putare imparem numerum habere finem, parem esse infinitum : ideo medendi causa multarumque rerum impares numeros servari : nam, ut supra dictum est, superi dii impari, inferi pari gaudent).
[FN: § 960-9]
MARQUARDT ; Le culte chez les Rom., t I : « (p. 316) On rédigeait par écrit les vota publica avec l'aide des pontifes et l’on pouvait évaluer en les faisant, à une certaine somme les offrandes, les jeux et les sacrifices qui avaient été, voués » En note : « LIV. : XXII, 10, 7: Eiusdem rei causa ludi magni voti aeris trecentis triginta tribus milibus trecentis triginta tribus triente. Le nombre 333 333 1/3 est un nombre sacré : on le retrouve encore du temps de l'empire. V. l'inscription d'Éphèse, C. I. L. III, 6065), où un Romain dédie cette somme, en substituant au triens gravis aeris, qui n'avait plus cours, 1/2 sesterce ».
[FN: § 961-1]
A. COMTE ; Syst. de polit. posit., t. III.
[FN: § 961-2]
Loc. cit. 961-1 : « (p. 130) Une existence quelconque, dynamiquement considérée, offre trois états successifs, un commencement, un milieu, une fin. [Comte aurait au moins pu citer quelque auteur qui a dit cela avant lui, § 960-5]. Statiquement envisagée, sa constitution résulte du concours permanent entre deux éléments opposés mais comparables, [celui qui comprend cela est bien doué]. Conçue dans son ensemble, elle se présente toujours comme une [tautologie]. Ainsi, toute construction, où ne prévaut pas l'unité de principe, toute composition plus que binaire, et toute succession dépassant trois degrés, sont nécessairement vicieuses, l'opération étant mal instituée ou restant inachevée [ainsi parle le souverain pontife du positivisme ; il n'y arien à ajouter]. Une synthèse pleinement subjective dispose les penseurs fétichistes à sentir ces propriétés fondamentales des seuls nombres que l'on conçoive sans signes [notre savant auteur se trompe : le nombre quatre se conçoit fort bien sans signes, et d'autres aussi, suivant les personnes], surtout quand la numération naissante concentre l'attention vers les rudiments arithmétiques. Toutes les spéculations philosophiques sur les nombres résultent de la subordination des autres envers ceux-là. Elles doivent donc concerner surtout ceux qui, ne comportant aucun partage [il pouvait au moins citer quelque auteur comme Hiéroclès, § 960] sont justement qualifiés de premiers, comme racines universelles. On explique ainsi la prédilection spontanée qu'ils inspirent partout [vraiment partout ? Comte a-t-il fait une enquête ?]. Il suffit ici de la spécifier envers le nombre sept, qui dérive doublement des trois radicaux, en faisant suivre ou précéder d'une synthèse, tantôt un couple de progressions, tantôt une progression de couples, suivant que sa destination est statique ou dynamique ». Ce long discours doit vouloir dire simplement que 7 = 3 + 3 + 1, et que 7 = 2 + 2 + 2 + 1. C'est un bel exemple de raisonnement par accord de sentiments.
[FN: § 961-3]
A. COMTE : Synthèse subjective.
[FN: § 962-1]
PHIL. IUD. ; De mundi opificio, 30, p. 20 Paris – p. 21 Mang.
[FN: § 962-2]
[FN: § 962-3]
PHIL. IUD. ; Sacrae legis allegoriarum post sex dierum opus, I, 2, p. 41 Paris. – p. 44 Mang. Exactement, il s'agit de la dyade, de la triade, de l'ebdomade, etc., au lieu du 2, du 3, du 7, etc.
[FN: § 962-4]
Loc. cit. , § 962 3.
[FN: § 962-5]
Loc., cit. § 962 3, I, 4, p. 41 Paris. – p. 45 Mang. ![]()
[FN: § 962-6]
PHIL. IUD. ; De decalogo, 5, p. 746 Paris. – p. 183 Mang. Il s'agit du très parfait nombre dix. – De congressu quaerendae eruditionis gratia, 16, p. 437 Paris. – p. 532 Mang. – De septenario et festis, 23, p. 1195 Paris. – p. 296-297 Mang. Voyez aussi : D. EPH., t. II, p. 304-309, De Numerorum mysteriis. L'auteur commence par traiter des mystères du nombre trois ; il fait voir ensuite l'excellence du double du nombre trois, c'est-à-dire du nombre six. Il démontre aisément que le nombre sept est parfait, et fait une longue énumération des choses sacrées ou simplement importantes qui sont au nombre de sept.
[FN: § 963-1]
D. AUG. ; De genesi ad litteram, IV, 2, 2 : Proinde istum senarium ea ratione perfectum diximus, quod suis partibus compleatur, talibus dumtaxat partibus, quae multiplicatae possint consummare numerum cuius partes sunt. – 6 est égal à 1 plus 2, plus 3 ; et 1 multiplié par 2, multiplié par 3, donne 6.
[FN: § 963-2]
Loc. cit. § 963 1, IV, 2, 6 : Perfecto ergo numero dierum, hoc est senario, perfecit Deus opera sua quae fecit. – Plus clairement encore : 7, 14 : Quamobrem non possumus dicere, propterea senarium numerum esse perfectum, quia sex diebus perfecit Deus omnia opera sua : sed propterca Deum sex diebus perfecisse opera sua, quia senarius numerus perfectus est. Itaque etiam si ista non essent, perfectus ille esset : nisi autem ille perfectus esset, ista secundum eum perfecta non fierent.
[FN: § 964-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Qu'on nous permette encore un exemple, qui a trait à la Chine. LAO-TSEU ; Le livre de la Voie et de la Vertu. p. XXVI : « Lao-tseu changea plusieurs fois de nom. Tous les hommes, disent quelques livres des Tao-sse, se trouvent souvent dans des circonstances périlleuses. Si alors le sage change de nom, pour se conformer aux changements qui arrivent dans la nature, il peut échapper aux dangers et prolonger sa vie. Beaucoup d'hommes de notre temps qui possèdent le Tao [Vérité, Voie, Absolu, etc.] se soumettent aussi à cette nécessité ».
[FN: § 970-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. SCHÆFFLE ; La Quintessence du Socialisme, p. 29 : « …le capital est vraiment un vampire, un spoliateur, un voleur ». Ce petit livre abonde en exemples de résidus des genres (I-δ) et (I-ε).
[FN: § 973-1]
Manuel, I, 48, p. 37.
[FN: § 977-1]
Manuel , I, 51, p. 88.
[FN: § 985-1]
On a des exemples tant qu'on veut. Dans les Chroniques, on en trouve à foison – FOULCHER DE CHARTRES, dans GUIZOT ; Collect. de mém. : « (p. 33) Quand nous eûmes atteint la ville d'Héraclée, nous vîmes un prodige dans le ciel ; il y parut en effet une lueur brillante et d'une blancheur resplendissante, ayant la figure d'un glaive, dont la pointe était tournée vers l'Orient. Ce que ce signe annonçait pour l’avenir nous l'ignorions ; mais le futur comme le présent nous le remettions entre les mains de Dieu ». – « (p. 155) Dans l'année 1106, nous vîmes une comète se montrer dans le ciel... Ce signe ayant commencé à briller dans le mois de février, le jour même où la lune était nouvelle, présageait évidemment des événemens futurs : n'osant toutefois porter la présomption jusqu'à tirer quelque pronostic de ce phénomène, nous nous remîmes, sur tout ce qu'il pouvait amener, au jugement de Dieu ». – « (p. 217... Balak eut alors, par un songe, révélation d'un certain malheur qui le menaçait. Il crut voir en effet Josselin lui arracher les yeux, ainsi que lui-même le raconta dans la suite aux siens. Ses prêtres [c'était un infidèle] auxquels il fit sur-le-champ connaître ce songe, et demanda l'interprétation, lui dirent „que ce malheur ou quelque autre équivalent lui arriverait certainement, si le hasard voulait qu'il tombât quelque jour entre les mains de Josselin“ ». Balak est tué ensuite dans un combat contre Josselin, et on lui coupe la tête. « Josselin commanda de la porter sur-le-champ à Antioche comme témoignage de la victoire qu'il venait de remporter ». – « (p. 233)... C'est ainsi que s'accomplit le songe rapporté ci-dessus, et que Balak, triste prophète de son, propre sort, avait raconté dans le temps où Josselin s'évada si miraculeusement de sa prison : alors, en effet, il vit en songe celui-ci lui arracher les yeux ; et certes Josselin les lui arracha bien, puisqu'il lui ravit et sa tête et l'usage de tous ses membres ».
[FN: § 987-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Une brochure qu'on distribue en 1913, inspirée par la première guerre balkanique, explique ou prédit l'histoire de l'Islam par la Bible. Voici qui annonce la fin de la Turquie pour 1913. Remarquons en passant que le commentateur a retranché de la citation (Apocalypse, IX, 13-17) deux passages qui l'embarrassaient par trop. Il ne signale que le second par quelques petits points. Nous les rétablissons entre parenthèses : PAUL STEINER; La Question d'Orient et la portée mondiale de sa solution : « “(p. 6-7) Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix [venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et] disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés... [afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades : j'en entendis le nombre.] Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ; et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée et du soufre (v. 13-21)”. La description là encore est si précise qu'on ne peut s'y méprendre, ce sont bien les Tares. C'est en premier lieu leur localité géographique qui est désignée par cette expression „sur le grand fleuve d'Euphrate“– puis c'est leur cavalerie si redoutable, leurs couleurs nationales, – le rouge, le bleu et le jaune qui sont encore à présent des couleurs sacrées chez les Turcs, – leur terrible artillerie dont le feu et la fumée sont expressément désignés, leur cruauté dans la guerre, leurs étendards de queues de cheval, et par-dessus tout, le temps exact qui devait s'écouler depuis le moment où ils furent virtuellement reconnus les maîtres de l'empire byzantin, dont la capitale était Constantinople, jusqu'à celui où eux-mêmes, après 391 ans de domination, cessent d'exister comme nation indépendante ».
[FN: § 996-1]
E. DE RUGGIERO ; Diz. Epigr., s. r. Annona (dea) : « inscription urbaine C. VI, 22) [Orelli, 1810] Annonae sanctae Aelius Vitalio mensor perpetuus dignissimo corporis pistorum siliginiariorum d(ono) d(edit);– d'Ostie (G. VIII, 7960) [Orelli-Henzen, 5320] M. Aemilius Ballator praeter (sestertium) X m(illia) n(ummum), quae in opus cultumve theatri postulante populo dedit, statuas duas, Genium patriae n(ostrae) et Annonae sacrae urbis sua pecunia posuit, etc. Son culte se développa davantage, à Rome et hors de Rome, après que, dans l'empire, et grâce à la réorganisation de la cura annonae, Rome eut été largement pourvue de vivres, et à bon marché ».
[FN: § 997-1]
G. SOREL ; Le syst. hist. de Renan, t. IV, IIIe partie, c. I : La vie posthume de Jésus et les traces qu'elle a laissées. L'auteur traite des apôtres après la mort de Jésus : « (p. 341) Durant cette période ils se croyaient en présence d'un Jésus aussi réel que celui qu'ils avaient connu en Galilée et ils continuaient leur ancienne existence auprès de lui. Il n'est pas douteux que cela n'ait duré longtemps ; ainsi on prétendait rattacher à une révélation faite par Jésus ressuscité les règles du jeûne et de la Pâque chrétienne (Didascalie, XXI). Cela suppose que d'après de très anciennes traditions la vie posthume de Jésus se serait assez prolongée pour que des lois ecclésiastiques aient eu le temps de se former de ce temps. Je crois qu'il faut la considérer comme ayant subsisté jusqu'au martyre de saint Jacques l'apôtre : cette hypothèse se, fonde sur beaucoup de détails qui sans elle seraient inintelligibles ».
[FN: § 1001-1]
E. B. TYLOR ; La civil. prim., 1, p. 81.
[FN: § 1002-1]
L. DUCHESNE ; Orig. du culte chrét., I.
[FN: § 1004-1]
D. AUG. : Epist. XXIX, Il raconte qu’il voulait faire cesser les banquets qu'on faisait dans les églises pour honorer les morts. Ceux qui l'écoutaient n'étaient pas persuadés. Ils disaient : (8) Quare modo : non enim, antea qui haec non prohibuerunt, Christiani non erant ? – Le saint eut un moment de découragement et se disposait déjà à se retirer, quand ses contradicteurs vinrent le trouver ; c'est pourquoi il leur exposa comment l'Église avait dû tolérer ces banquets. (9) ... scilicet post persecutiones tam multas tamque vehementes, cum facta pace, turbae gentilium in Christianum nomen venire cupientes hoc impedirentur, quod dies festos cum idolis suis solerent in abundantia epularum et ebrietate consumere, nec facile ab his perniciosissimis et tara vetustissimis voluptatibus se possent abstinere, visum fuisse maioribus nostris, ut huic infirmitatis parti interim parceretur, diesque festos, post eos quos relinquebant. alios in honorem sanctorum Martyrum vel non simili sacrilegio, quamvis simili luxu celebrarentur. – Il exhorte ses auditeurs à imiter les Églises d'outre-mer, qui repoussaient ces désordres. Remarquez que, dans les Confessions, VI, 2, il loue Saint Ambroise d'avoir défendu, à Milan, de porter des vivres en l'honneur des saints, « pour ne pas fournir l'occasion aux intempérants de s'enivrer, et parce que cela était semblable aux superstitions des Parentalia des païens – ne ulla occasio se ingurgitandi daretur ebriosis ; et quia illa quasi parentalia superstitioni gentilium essent simillima ». – Et comme on lui objectait, Epist., XXIX, l'existence « (10) des banquets qu'on faisait chaque jour dans la basilique du bienheureux apôtre Pierre, il répondit qu'il savait qu'on les avait souvent défendus, mais qu'ils avaient lieu loin de l'habitation de l'évêque et que, dans cette grande ville, il y a beaucoup d'hommes charnels, spécialement des étrangers, qui arrivent tous les jours et qui suivent cet usage d'autant plus qu'ils sont plus ignorants, à tel point qu'on n'avait pu jusqu'alors réprimer ni détruire ce fléau ». Voir aussi du même auteur : De moribus eeclesiae catholicae et de moribus manichaeorum, I 24, 75, où il parle des mauvais chrétiens : Novi multos esse sepulcrorum et picturarum adoratores : novi multos esse, qui luxuriosissime super mortuos bibant, et epulas cadaveribus exhibentes, super sepultos seipsos sepeliant, et voracitates ebrietatesque suas deputent religioni. Ailleurs, Epist., XXII, il parle des banquets qu'on faisait dans les cimetières, et conseille à Aurélius de les réprimer. On voit manifestement la persistance des anciens usages, quand Saint Augustin observe : (6) Sed quoniam istae in coemeteriis ebrietates et luxuriosa convivia, non solum honores Martyrum a carnali et imperita plebe credi solent, sed etiam solatia mortaorum,... – Il est donc évident que l'Église faisait ce qui était en son pouvoir pour supprimer de semblables usages, et les tolérait seulement quand elle ne pouvait faire autrement. À ce propos, il convient de lire toute la lettre de GRÉGOIRE LE GRAND ; liber IX, Epist., 71 : Gregorius Mellito abbati. Il donne des prescriptions sur la conduite à tenir avec les Anglais. D'abord, il observe qu'on peut se servir des temples païens. Aqua benedicta flat in eisdem fanis aspergatur, altaria construantur, reliquiae ponantur : quia si fana eadem bene constructa sunt, necesse est ut a cultu daemonum in obsequium veri Dei debeant commodari ; ut dum gens ipsa eadem fana sua non virlet destrui, de corde errorem deponat, et Deum verurn cognoscens, ac adorans, ad loca quae consuevit, familiarius concurrat. Il est donc évident qu'on veut profiter de l'usage qu’avaient les gens, de se rassembler en certains lieux. Grégoire continue : Et qui boves solent in sacrificio daemonuin multos occidere, debet his etiain hac de re aliqua solennitas immutari ; ut die dedicationis vel natalicio sanctorum martyrum quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem. Ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt, de ramis arborum faciant, et religiosis conviviis solennitatem celebrent... Nam duris mentibus simul omnia abscindere impossibile esse non dubium, est...
MURATORI ; Ant. Ital., Dissert. 7-5, p. 453, t. III, parte II : « Et c'est pourquoi, dans ces Réunions [des Confraternités], on croit parfois célébrer plus solennellement les Fêtes par quelque festin et de bon vin ; en outre, assez souvent il y éclate des rixes et des inimitiés : il convient d'écouter de nouveau Hincmar, qui atteste qu'il arrivait la même chose de son temps, et semble décrire les coutumes de notre époque. Pastos autem, et commessationem, quas Divina auctoritas vetat, ubi et gravedines et indebitae exactiones, et turpes ac inanes laetitiae, et rixae, saepe etiam, sicut experti sumus, usque ad homicidia, et odia, et dissentiones accidere solent, adeo, interdicimus... ».
[FN: § 1006-1]
A. MAURY ; La magie et l'astrologie... Cfr. SAINTYVES ; Les saints successeurs des dieux.
[FN: § 1008-1]
BEECHEY ; dans Bibl. univ. des voy., t. 19 : L'auteur parle des Indiens qui étaient instruits dans les missions de San Francisco : « (p. 314) Les néophytes s'étant agenouillés, l'orateur (p. 315) commença : « Très Sainte-Trinité, Jésus-Christ, le Saint-Esprit... » ; faisant une pause entre chaque mot pour s'assurer si ces pauvres Indiens, qui n'avaient jamais prononcé un mot d'espagnol, articulaient correctement, ou s'ils laissaient quelques fautes à reprendre... Ils ne me paraissaient pas grandement pénétrés de l'acte auquel on les préparait, et je fis remarquer au père que les personnes chargées de leur instruction religieuse avaient là une tâche bien difficile. Il me répondit qu'au contraire, on ne rencontrait jamais d'obstacles de leur part ; qu'ils étaient accoutumés à changer de dieux, et que la conversion était en quelque sorte pour eux une affaire d'habitude. Je ne pus m'empêcher de sourire à cette réflexion du père, mais je ne doute pas qu'elle fût conforme à la vérité, et que les Indiens que j'avais sous les yeux apostasieraient une seconde fois avec tout autant d’indifférence, s'ils trouvaient un jour l'occasion de retourner dans leur tribu ».
[FN: § 1010-1]
LEA ; Hist. de l'Inquis., t. I, p. 399; trad. Reinach.
[FN: § 1011-1]
Un correspondant du Journal de Genève, 11 juillet 1913, qui se montre pourtant très favorable la « répression de la traite des blanches », est toutefois contraint par l'évidence des faits, d'avouer qu'il y a un peu de comédie dans cette entreprise. Il parle du Congrès contre la traite des blanches, qui eut lieu à Londres, du 30 juin au 5 juillet 1913 ; et, après avoir dit : « Son importance égalera certainement celle du congrès de Madrid en 1910, qui fit époque dans la lutte contre le nouveau fléau [ce brave homme appelle nouveau ce qui a toujours existé, depuis les temps où les hétaïres grecques inspiraient des poètes et des auteurs comiques, jusqu'à nos jours] révélé au monde il y a moins d'un demi-siècle par la sagacité de quelques philanthropes et de spécialistes en morale sexuelle [ces spécialistes le sont même parfois trop] », il ajoute candidement : « Ces hommes eurent de la peine à convaincre leurs contemporains de la réalité de l'abominable trafic qu'ils dénonçaient ; puis, lorsque l'authenticité de certains faits ne put plus être démentie, on passa de l'extrême défiance à une crédulité qui accepta sans contrôle et avec une sorte d'empressement des récits aussi dramatiques qu'imaginaires. Le cinématographe lui-même vint ajouter à ces dépositions sensationnelles le témoignage truqué de ses films, à tel effet que les gens cultivés, à l'esprit critique et qui ne s'en laissent point conter, ont recommencé à poser la question préalable. Aussi, dans ce domaine plus que dans tout autre, importe-t-il d'établir des organisations très sérieuses d'information et de contrôle ; ces organisations-là existent et se complètent peu à peu par les soins du bureau central international de Londres et des comités nationaux dits : « contre la traite des blanches ». Des rapports présentés par les délégués, il ressort avec une évidence indéniable que, si la traite ne s'exerce pas dans les proportions fantastiques voulues par certains écrivains, elle existe, elle agit partout ; il n'y a pas de grande ville au monde qui n'ait ses traitants, son organisation occulte et son marché de jeunes filles. Seulement – et c'est ce qui explique l'attitude négative ou dubitative de certains de nos magistrats en face des dénonciations des sociétés de surveillance, – la traite des blanches ne s'opère plus ordinairement par les moyens brutaux, tombant directement sous le code pénal, mais par une série savamment agencée d'influences, de contacts, de tentations, de dégradations progressives, qui livrent, quasi consentante à sa perte, la jeune fille hier encore pure et fière ». Habemus confitentem reum.
[FN: § 1012-1]
On observe maintenant des phénomènes qui sont semblables à ceux qu'on observait aux temps de l'Inquisition, si l'on tient compte de la réduction générale des peines, réduction profitant aussi aux voleurs et aux assassins. Pour éviter le scandale, les inquisiteurs anciens acceptaient des dénonciations secrètes et taisaient les noms des témoins. B. GUIDONIS ; Practica inquisitionis hereticepravitatis : (p. 189) ... si inquisitoribus videtur testibus deponentibus periculum imminere ex publicatione nominum eorumdem, possunt coram aliquibus personis eorumdem testium nomina exprimere non publice, set secrete. De hoc habetur in littera Innocentii papa IIII ti inquisitoribus fratribus ordinis Predicatorum : Cum negocium fidei catholice. Et infra : Sane volumus ut nomina tam accusantium pravitatem hereticam quam testificantium super ea nullatenus publicentur propter scandalum vel periculum quod ex publicatione huiusmodi sequi posset... Et maintenant, sinon légalement, du moins en fait, on procède de même contre la « littérature immorale » et d'autres délits semblables de l'hérésie moderne. Beaucoup de gens veulent bien espionner, mais désirent garder l'anonyme, et leurs dénonciations sont faites de seconde main, par quelque chef ou secrétaire des « ligues pour le relèvement de la morale ». Celles-ci obtiennent de journalistes complaisants qu'ils ne racontent pas les procès pour « littérature immorale » ou pour « traite des blanches», et cela précisément pour le même motif invoqué par le pape Innocent IV ; c'est-à-dire « à cause du scandale ou du péril qu'il peut résulter de cette publication ». Les conséquences de cette procédure secrète sont que maintenant, comme alors, on ne s'aperçoit pas des vices de ces procès. – LEA ; Hist. de l'Inq., p. 406; trad. Reinach, t. I, p. 457 : « Si la procédure avait été publique, l'infamie de ce système aurait été sans doute atténuée ; mais l'Inquisition s'enveloppait d'un profond mystère [comme aujourd'hui nos vertuistes] jusqu'après le prononcé de la sentence ». Maintenant même les jugements ne sont pas publiés par les journaux politiques. Il faut aller les chercher dans des publications spéciales. Ainsi, la majeure partie du public les ignore. Il ne faut pas oublier que, parmi les inquisiteurs modernes ou parmi ceux qui les admirent, beaucoup détestent les inquisiteurs anciens et les tiennent pour absolument iniques ; et ils croient se justifier en disant que la foi de ceux-ci était « fausse », et que la leur est « vraie ».
[FN: § 1015-1]
I. F. DAVIS ; La Chine, trad. franç., t. I : « (p. 248) Le système en vertu duquel les familles forment des espèces de clubs ou de tribus, a sans doute produit ce respect sacré pour la parenté... C'est encore de cette source que provient l'amour des Chinois pour les lieux qui l'ont vu naître, et ce sentiment est si vif chez lui, qu'il lui fait souvent abandonner les honneurs et les profits d'un emploi élevé pour se retirer dans son village natal. Ils ont une maxime populaire dont le sens est „celui qui parvient aux honneurs ou à la richesse, et qui ne retourne jamais au lieu de sa naissance, est comme un homme splendidement vêtu qui marche dans les ténèbres” ; tous deux agissent en vain ».
[FN: § 1025-1]
SÉNART ; Les castes dans l'Inde « (p. 94) De tous temps, les sectes ont pullulé dans l'Inde ; cette végétation est loin d'être arrêtée. Il en naît presque d'année en année. Il est vrai que c'est pour s'absorber bien vite dans la marée montante de l'hindouisme qui, malgré son caractère composite, est réputé orthodoxe. En général ces mouvements religieux, très circonscrits, donnent naissance seulement à des groupes d'ascètes qui, étant voués à la pénitence et au célibat, excluent la condition première de la caste, l'hérédité. Ils se recrutent par des affiliations volontaires ou s'adjoignent des enfants empruntés à d'autres castes. Cependant, nombre de ces confréries étant composées d'associés des deux sexes, tournent plus ou moins en castes héréditaires... (p. 95). Les mouvements qui se produisent ainsi dans les castes et en modifient incessamment l'assiette, sont individuels ou sont collectifs. Certaines gens trouvent moyen, grâce à des protections puissantes ou à des subterfuges, à des fictions ou à la corruption, de s'introduire isolément dans des castes diverses ; le fait est fréquent surtout dans les pays frontières, d'une observance moins stricte. On a vu des hommes de toute caste créés brâhmanes par le caprice d'un chef. Telle caste peu sévère, sous certaines conditions, ouvre (p. 96) aisément ses rangs à tout venant. Telles tribus nomades ou criminelles, moyennant payement, s'adjoignent volontiers des compagnons ». Des faits semblables se sont toujours produits. Il n'est pas de plus grande erreur que de croire que la réalité corresponde toujours précisément aux abstractions des littérateurs et des légistes.
[FN: § 1029-1]
FUSTEL DE COULANGES ; La cité antique.
[FN: § 1037-1]
J. FLACH. ; Les orig. de Vanc. France ; t. II. – FUST. DE COUL., La cité ant., « (p. 96) Grâce à la religion domestique, la famille était un petit corps organisé, une petite société qui avait son chef et son gouvernement ». Qu'on supprime les mots : « Grâce à la religion domestique », et cette description s'applique à la maisnie féodale comme à la famille antique. Il faut modifier les mots supprimés en ce sens qu'ils doivent indiquer que la religion confirmait le fait, et lui donnait une nouvelle force. Ainsi le parallèle entre la famille antique et la maisnie féodale est complet. Fustel de Coulanges dit encore : « p. 126) Mais cette famille des anciens âges n'est pas réduite aux proportions de la famille moderne. Dans les grandes sociétés la famille se démembre et s'amoindrit, mais en l'absence de toute autre société elle s'étend, elle se développe, elle se ramifie (p. 127) sans se diviser. Plusieurs branches cadettes restent groupées autour d'une branche aînée [jusque là il en est parfaitement de même pour la famille féodale ; la différence apparaît seulement dans les mots suivants], près du foyer unique et du tombeau commun. Un autre élément encore entra dans la composition de cette famille antique [et de la collectivité féodale]. Le besoin réciproque que le pauvre a du riche et que le riche a du pauvre fit des serviteurs. Mais dans cette sorte de régime patriarcal serviteurs ou esclaves c'est tout un. On conçoit, en effet, que le principe d'un service libre, volontaire, pouvant cesser au gré du serviteur, ne peut guère s'accorder avec un état social où la famille vit isolée. [Cette observation s'applique aussi à la famille féodale.] Il faut donc que par quelque moyen le serviteur devienne un membre et une partie intégrante de cette famille ». La famille antique et la maisnie féodale y ont précisément pourvu.
[FN: § 1037-2]
Dig. ;L. 16, 195 § 2 : Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filiura non habeat.
[FN: § 1038-1]
PERTILE : St. del dir. ital. . I.
[FN: § 1040-1]
Odyss., XIV, 63-64.
[FN: § 1047-1]
CUNNINGHAM ; Voyage à la Nouvelle-Galles du Sud, dans Biblioth. univ. des voy., t. 43. L'auteur parle des criminels déportés en Australie : « (p. 151) Les termes qui servent à qualifier le caractère de chaque individu ont, parmi les convicts, un sens tout-à-fait différent de celui qu'on y attache dans la société des honnêtes gens. Un bon garçon est celui qui partage loyalement avec son complice ce qu'ils ont volé de compagnie, et qui n'avoue jamais un vol et se garde de rendre témoignage contre un associé. Un adroit garçon est un coquin téméraire, entreprenant, habile à toute chose, tandis qu'un grand coquin est celui qui est assez vil pour avouer son crime ou dénoncer son complice ». De même aujourd'hui, pour certaines personnes, le bon juge est celui qui rend un jugement contraire aux lois ; le Mauvais juge celui qui les applique loyalement.
[FN: § 1050-1]
ARIST.; Polit., 1, 2, 9-0.
[FN: § 1050-2]
À part les enquêtes officielles et une infinité de documents, voir A. CONAN DOYLE; Le crime du Congo. Voici un autre exemple, pris au hasard parmi tant d'autres qu'on pourrait citer : « La Liberté, 9 août 1912. – Pour répondre aux accusations de cruauté dirigées contre les planteurs portugais de l'Angola, un de ceux-ci a publié un volumineux ouvrage dans lequel il vante les bons traitements dont les nègres engagés par contrat, sont, au contraire, l'objet de la part de ses compatriotes de la colonie. M. René Claparède, secrétaire général du Comité international des Ligues du Congo, réfute cette assertion dans la France d'Outre-Mer. Il explique que ces prétendus engagés par contrats sont de véritables esclaves, les contrats étant automatiquement renouvelables, ce qui transforme l'engagement en servage à vie. Quant aux bons traitements dont se vantent les Portugais, leur efficacité est telle que la mortalité des noirs est de plus de 10 pour cent dans les îles sous leur dépendance, alors qu'elle ne dépasse pas 2,6 pour cent à la Jamaïque et 2,5 à la Trinidad. Aussi les malheureux nègres essaient à qui mieux mieux de fuir les plantations et de gagner les forêts ; mais alors ont lieu des chasses à l'homme dont M. Claparède nous donne une idée d'après le récit qui lui fut fait par un des planteurs qui y ont pris part. – Les chasseurs (dit-il) avaient été conduits par des guides en un endroit où l'on savait que les fugitifs s'étaient dirigés. Ils arrivèrent près de huttes qui venaient d'être abandonnées. Tout près, caché dans l'herbe, ils trouvèrent un vieillard. – Nous le prîmes (dit le planteur) et nous le forçâmes à nous dire où étaient les autres. Tout d'abord nous ne pûmes rien tirer de lui; après un long moment, sans dire un mot, il leva la main vers les arbres les plus élevés, et là nous vîmes les esclaves, hommes et femmes, accrochés comme des chauves-souris, sous les branches. Ce ne fut pas long, je vous assure, avant que nous les eussions descendus à travers le feuillage. Ma parole, quelle merveilleuse journée de sport nous eûmes là ! » On écrit ces choses contre de petits pays tels que la Belgique ou le Portugal, et l'on tait ce que font également et d'une manière pire, les Anglais, les Allemands et les autres peuples civilisés qui ont des colonies. Ajoutez que le gouvernement belge corrigea en grande partie l'oppression de l'administration du roi Léopold, au Congo, et que la république portugaise corrigea aussi l'oppression tolérée par la monarchie, tandis que les grands États dits « civilisés » continuent à conquérir les terres des peuples dits « barbares », ou à y maintenir leur domination habituelle, en semant dans ces contrées la mort, le pillage et les ruines. Les très civilisés Américains n'agissent pas autrement à l'égard des malheureux habitants des îles Philippines, et des malheureux survivants des Peaux-Rouges, qu'ils ont dépouillés de leur territoire héréditaire. Des preuves, il y en a assez pour remplir un volume. Il nous suffira d'indiquer un document publié tandis que cet ouvrage était sous presse. « La Liberté, 21 juillet 1913. Le sort des Peaux-Rouges. ... Une récente enquête du New-York Herald a précisé les méfaits de l'administration yankee et voici l'opinion d'un spécialiste, M. Robert G. Valentine, ex-commissaire des affaires indiennes » „Il est étonnant de constater que les blancs s'inspirent d'une morale différente quand il s'agit de leurs rapports entre eux ou de leurs relations avec les Peaux-Rouges. Des gens qui n'oseraient pas voler leurs semblables à face pâle trouvent tout naturel de dépouiller les Indiens. Ils savent, d'ailleurs, que ce faisant ils ne courent aucun risque ; et l'on peut conclure que les pillards ne sont pas tant à blâmer que la population américaine qui encourage si complaisamment leurs délits. J'en ai la preuve entre les mains et les faits dont je suis saisi sont tellement abominables qu'un jury ne manquerait pas de les flétrir...“ On raconte ensuite les diverses façons dont les blancs, gens certainement très civilisés et non moins certainement un peu voleurs et parfois assassins, dépouillent les Indiens : „Une combinaison souvent employée pour les priver de leur argent consiste à les obliger de déposer leur avoir dans des banques qui, au bout de quelques mois, se déclarent frauduleusement en faillite. Les agents gouvernementaux et les banquiers véreux partagent ensuite les bénéfices. Ils ont neuf chances sur dix de rester impunis. Bien mieux, des Indiens qui résistaient aux prétentions des envahisseurs blancs ont été assassinés. Ce cas s'est produit l'an dernier dans le comté de Johnston, en Oklahoma, où deux Cherokees qui ne voulaient point lâcher prise furent exécutés sans pitié. La justice dut tout de même intervenir et l'on découvrit que le juge du district était l'associé d'une bande de malfaiteurs occupés à voler les Peaux-Rouges de la région ! Ce juge fut révoqué et trois ou quatre condamnations furent prononcées. Néanmoins, le zèle des tribunaux est, en général, fort lent et la procédure infiniment tortueuse dans les procès qu'engagent les tribus... Citons encore un cas, celui des Pimas. Cette tribu auparavant se montrait industrieuse et vivait largement de son travail. Par la faute des Américains, elle a été amenée à la paresse, à l'indigence, à la décrépitude. Les marchands de biens ont manœuvré de telle sorte que les forêts, les pâturages, les mines des Pimas ont été rachetés pour des sommes insignifiantes. À peine l'État d'Arizona a-t-il été admis dans la Confédération, que déjà les spéculateurs américains commencent à tracasser les Navajos – gens pacifiques et dignes – parce que leurs propriétés ont augmenté de valeur. C'est toujours la même méthode d'intimidation et d'accaparement“. Tout cela n'est rien en comparaison des innombrables autres faits qu'on pourrait citer, et auxquels il y aurait lieu d'ajouter les lynchages de nègres et autres semblables menus faits. Les missionnaires américains, qui voient si bien la paille des autres pays, feraient bien de regarder la poutre du leur.
[FN: § 1051-1]
Le prof. Colajanni a fort bien montré, la vanité de toutes ces déclamations. – NAPOLEONE COLAJANNI ; Latini e Anglo-Sassoni (Razze inferiori e razze superiori). – ARCANGELO GHISLERI, en plusieurs de ses écrits, a crevé ces ballons d'hypocrisie.
[FN: § 1052-1]
COOK, dans Bibl. univ. des voy., t. 10 – 3e voyage. L'auteur décrit les phénomènes, sous le voile des dérivations, qui d'ailleurs ne dissimule pas trop les résidus. Il s'agit des habitants de Taïti : « (p. 239)... S'ils croient les âmes dépouillées de quelques-unes des passions qui les animaient tandis qu'elles se trouvaient réunies au corps, ils ne supposent pas qu'elles en soient absolument affranchies. Aussi les âmes qui ont été ennemies sur la terre se livrent-elles des combats lorsqu'elles se rencontrent ; mais il paraît que ces démêlés n'aboutissent à rien, puisqu'elles sont réputées invulnérables. Ils ont la même idée de la rencontre d'un homme et d'une femme. Si le mari meurt le premier, il reconnaît l'âme de son épouse, dès le moment où elle arrive dans la terre des esprits ; il se fait reconnaître dans une maison spacieuse, appelée Tourova, où se rassemblent les âmes des morts, pour se divertir avec les dieux. Les deux époux vont ensuite occuper une habitation séparée, où ils demeurent à jamais et où ils font des enfants ; au reste ils ne procréent que des êtres spirituels, car (p. 240) leur mariage et leurs embrassements ne sont pas les mêmes que ceux des êtres corporels ». Les dérivations sont illogiques, absurdes, simplement parce qu'elles sont accessoires ; les résidus seuls sont importants.
[FN: § 1052-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Comme on sait, l'histoire – ou la légende – veut que les généraux athéniens, vainqueurs sur mer aux îles Arginuses, fussent empêchés par une mer démontée de donner la sépulture à leurs morts. De retour à Athènes, les généraux furent condamnés à la peine capitale.
[FN: § 1054-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. La littérature pseudo-scientifique publiée par la Société des Recherches Psychiques, à Paris, fournit une abondante moisson d'exemples de ce genre. Il semble que le but de chaque publication soit de battre le record de l'extravagance. D'une façon générale, les « études » sur la Télépathie, la Force-Pensée, l'Hypnotisme, la Thérapie magnétique, le Zoïsme, la science Occulte de la Respiration, etc., offrent de nombreux exemples de résidus de la IIe classe. Le spiritisme est une exaltation de l'espèce (II-β).
[FN: § 1061-1]
A. ERMAN ; La relig. égypt.– E. NAVILLE ; La relig. des anc. Egypt. : « (p. 45)... à l'époque historique nous pourrons constater chez les Égyptiens des idées très arrêtées, qui ont conduit à la momification à laquelle ils donnaient une grande importance, et qui était si bien ancrée dans leur esprit, que cette coutume a duré jusqu'à l'époque chrétienne, et a même provoqué les reproches sévères de certains Pères de l'Église [Cfr. 1004-1]. La momie (p. 46) est devenue l'expression consacrée pour le défunt de la Terre d'Égypte, et il semble qu'il n'en ait jamais été autrement. Aussi, grand a été l'étonnement des premiers explorateurs qui ont trouvé qu'à l'époque très ancienne, préhistorique ou primitive comme on veut l'appeler, il n'en avait point été ainsi. Bien au contraire, les modes de sépulture paraissent avoir répondu à une idée tout autre que celle qui prévalut plus tard [ou mieux : les modes de sépulture changèrent en même temps que les idées avec lesquelles ils étaient en rapport de mutuelle dépendance]. Dans les nécropoles de cette population indigène qui a été subjuguée par les conquérants étrangers, nous trouvons de petites tombes rectangulaires ou ovales ; le cadavre y est placé tout entier sans aucune trace de momification, les genoux ramenés contre la poitrine... On a appelé cette position embryonnaire, et l'on y a vu comme une attitude préparatoire à une seconde naissance, la meilleure pour un corps qui allait renaître à une vie nouvelle [abus habituel des explications logiques]. Il me semble que cette explication est un peu savante pour la population dont il s'agit ; et (p. 47) qu'il y en a une autre beaucoup plus simple, qui nous est fournie par le père de l'histoire Hérodote ». En somme, l'auteur croit que cet usage vient de peuples comme les Nasamons qui tiennent le moribond assis à la mode orientale.
[FN: § 1070-1]
S. REINACH; Cult., myth. et rel., t. III, p. 186-196. Après avoir rappelé une petite image portant cette inscription : TEPMANIA, publiée par Mommsen, il cite une mosaïque et observe : « (p. 186) l'inscription TAAAIA qui l'entoure permet d'y saluer la première image certaine de la Gaule que nous ait léguée l'art gréco-romain. Le médaillon qui décore ce buste fait partie d'une mosaïque considérable, datant des Sévères... (p. 189) On connaissait déjà quelques exemples de provinces ou de villes représentées sur les mosaïques du IIe siècle. La tradition de ces personnifications topiques ne s’est pas perdue pendant le haut moyen âge... ». Il y a un grand nombre d'exemples de ces personnifications, sur les monnaies, les médailles, etc. ; de Rome.
[FN: § 1070-2]
F. ROBIOU ; L'état relig. de la Gr. et de l'Or., p. 22 : « ... si dans Pindare et, un peu après, dans l'Électre de Sophocle, Némésis est personnifiée, ni Eschyle ni même Hérodote, dans l'œuvre de qui elle joue un rôle important, n'en font un être anthropomorphique proprement dit ; en d'autres termes, cette conception paraît avoir flotté alors entre le sens abstrait et le sens mythologique ». – Société biblique de Paris; Les livres apocryphes de l'Ancien Testament. L'auteur du livre dit : La sagesse de Jésus, fils de Sirach (L'Ecclésiastique), « (p. 390) personnifie parfois la Sagesse, comme les écrivains de son peuple l'avaient fait avant lui, mais il se laisse ramener insensiblement à une représentation plus concrète, et l'on ne sait plus, en bien des cas, (p. 391) lorsqu'il parle de la sagesse, s'il pense à l'entité, métaphysique ou à la vertu pratique. Ce qu'il en dit est assez incohérent : Elle est la première des créatures, éternelle et partout répandue. Tout homme y a part... Dieu lui a ordonné d'habiter avec Jacob et elle a fait de Jérusalem sa capitale. Elle est parfois identifiée plus ou moins complètement avec la crainte de Dieu et même avec la Loi ». – TOUTAIN ; Les cultes païens dans l'emp. rom., t. I : « (p. 415) Si nous exceptons les deux déesses Fortuna et Victoria, qui méritent, en raison de leur importance, une étude particulière, les divinités abstraites dont nous avons relevé les noms sur des documents épigraphiques sont : Aequitas, Bonus Eventus, Concordia, Copia, Disciplina, Fama (?), Felicitas, Fides publica, Gloria, Honos, Iuventus, Libertas, Mens ou Bona Mens, Pax, Pietas, Prosperitas (p. 416) Deorum, Providentia, Salus Generis Humani, Sanctitas, Virtus ».
[FN: § 1074-1]
Dict. DAREMB. SAGLIO ; s. r. Roma, Rome personnifiée ou déifiée (E. Maynial) : « (p. 875) La plus ancienne représentation de Roma, comme personnification symbolique de l'État, apparaît au droit des premiers deniers de la République à partir de 269 av. J.-C. (p. 876) En gravant cette tête sur leurs monnaies, les Romains n'avaient aucunement l'idée de représenter Roma comme une divinité ; mais seulement de créer un emblème de leur cité, sous les traits d'une femme armée, à l'exemple de tant de villes grecques. Ce sont les peuples étrangers qui, par flatterie ou par reconnaissance, donnèrent à la personnification de Roma le caractère et les attributs d'une divinité. En même temps qu'ils divinisaient Rome, les Grecs donnaient à cette nouvelle déesse une histoire et une personnalité définies. La plus ancienne tradition relative à Roma, celle de l'historien Gallias rapportée par Denys d'Halicarnasse, la représente comme une Troyenne... Sous l'Empire le culte de Roma se développa et se régularisa. (p. 877) L'empereur Hadrien consacra définitivement et reconnut officiellement dans Rome même le culte qui s'adressait à l'État divinisé... » – TOUTAIN ; loc. cit. 1070-2 : « (p. 41) Le culte de la déesse Rome a donc survécu en divers point du monde romain pendant presque tout le haut empire. Séparé du culte impérial, il ne semble pas avoir été très répandu dans les provinces latines. »... « (p. 74) Le culte de la puissance romaine sous les diverses formes qu'il revêtit, fut général dans les provinces latines. Si la déesse Rome y eut moins d'adorateurs qu'elle n'en avait eu en Grèce et en Asie pendant les deux derniers siècles de la République, la divinité impériale du moins y reçut des hommages innombrables. Outre l'Auguste lui-même, vivant ou mort, on honora d'un véritable culte ses proches, sa maison, ses qualités, ses exploits ». L'auteur démontre ensuite que ce culte naquit spontanément, qu'il ne fut pas imposé. En grand, les peuples adoraient Rome et l'Empereur ; en petit, parfois en tout petit, des collectivités et des individus adoraient ce qui leur était profitable. « p. 376) Les molinarii de Guntia étaient des meuniers qui rendaient un culte au dieu du fleuve, parce que le fleuve faisait marcher leurs moulins ».
[FN: § 1074-2]
Les Chalcidiens, sauvés par Titus Quintus Flaminius, lui consacrèrent les plus beaux édifices de leur ville. PLUTARQUE ; T. Q. Flam., XVI, 4-5, nous fait connaître deux inscriptions de ces édifices. La première dit : « Le peuple [consacre] ce gymnase à Titus et à Héraclès » ; et la seconde : «Le peuple à Titus et à Apollon Delphien ». Au temps de Plutarque, on élisait encore un prêtre de Titus, et l'on chantait un péan qui se terminait ainsi :
Nous vénérons la foi des Romains,
Foi ardemment désirée, que nous jurons de conserver,
Chantez, vierges,
Zeus et la grande Rome, et Titus et avec eux la foi des Romains.
Io ! Paian ! Oh ! Titus sauveur !
À peu près en ce temps, à Locres, un autel était ainsi consacré : « Les Locriens à Jupiter optimus maximus, aux dieux et aux déesses immortels, et à Rome Éternelle ». – ORELLI ; 1799 : Iovi optimo maximo diis deabusque immortalibus et Romae Aeternae Locrenses. – Le peuple de Mélos dédia une statue et une couronne de bronze à Rome. – LIV.; XLIII, 6 : Alabandenses templum urbis Romae se fecisse commemoraverunt, ludosque anniversarios ei divae instituisse... –TACIT. ; Ann., IV. Onze cités se disputaient pour obtenir l'autorisation d'élever un temple à Tibère. Les Smyrniotes rappelèrent leur antiquité, leur fidélité au peuple romain, et ajoutèrent : (56) Seque primos templum urbis Romae statuisse, M. Porcio consule, magnis quidem iam populi romani rebus, nondum tamen ad summum elatis, stante adhuc punica urbe, et validis per Asiam regibus : « Qu'ils avaient, les premiers, décerné un temple à Rome, sous le consulat de M. Porcins, alors que le peuple romain avait déjà fait de grandes choses, sans avoir encore atteint la suprême grandeur, Carthage étant toujours debout et des rois puissants régnant en Asie ». DIO CASS. ; II, 20 : « Parmi les autres choses que César [Auguste] édicta, il permit à Éphèse et à Nicée d'élever un temple à Rome et à César, son père, qu'il appela le héros Julius ». –ORELLI, 155. On mentionne des individus sacerdoti Romae et Aug. P. H. C. (Provinciae Hispaniae citerioris). – Idem ; 488 ; 606 : Romae et Augusto. Caesari divi F. patri patriae. – 732 ; 1800; 3674 : ... mun. L. (Lyciorum) restitutae in maiorum libert. Roma (i. e. Statuam Deae Romae dedicavit). Iovei Capitolino et poplo romano V. M. (virtutis, Sirmond.) benivolentiae beneficiq. caussa. – 5211 : ... sacerdos Romae et Aug. – 7172 : in aede Romae et Augusti. –-MART. ; XII, 8 :
Terrarum Dea gentiumque Roma,
Cui par est nihil, et nihil secundum,
…………………………………….
Plus tard, RUTILIUS ; I, dira :
(47) Exaudi, Regina tui pulcherrima mundi,
Inter sidereos Roma recepta polos ;
Exaudi, genetrix hominum, genetrixque Deorum,
Non procul a caelo per tua templa sumus.
[FN: § 1076-1]
D. HIERONYM.: c. Iovan., II, in fine : t. II, p. 380 : Urbs potens, urbs orbis domina, urbs Apostoli voce laudata, interpretare vocabulum tuum, Roma aut fortitudinis nomen est apud Graecos, aut sublimitatis iuxta Hebraeos,...
[FN: § 1078-1]
Le Mouvement pacifiste. Correspondance bimensuelle du bureau international de la paix à Berne, 15 avril 1912, n. 7. Tout l'article est un prêche comme on en a dans d'autres religions ; il semble même être une réminiscence de quelque prêche chrétien : « (p. 101) Il n'y a pas de miracles sans la foi. Le pacifisme, doctrine mondiale, accomplira des miracles s'il règne dans votre cœur ». La souplesse des dérivations se voit bien au fait de certains pacifistes italiens, qui prêchèrent la guerre au nom de la paix ! (1705 et sv.) Il semble qu'il y ait contradiction, et c'est vrai au point de vue logique, mais pas à celui des sentiments. Ces pacifistes donnaient le nom de pacifisme à un agrégat de sentiments de bienveillance et d'amour pour d'autres hommes ; le même agrégat de sentiments existe dans le patriotisme. Il y a donc deux noms pour une même chose, et l'on ne s'aperçoit pas de la contradiction, en cédant aux diverses impulsions de cet agrégat unique de sentiments. De même, que de guerres a-t-on faites au nom de la religion chrétienne, qui prêche la paix !
[FN: § 1082-1]
HOVELACQUE ; Les nègres : « (p. 897) La religion des noirs sus-équatoriaux est le fétichisme le plus rudimentaire. La vue d'un être quelconque, d'un objet, d'un phénomène, émeut particulièrement l'individu, et celui-ci attribue à cet être, à cet objet, à ce phénomène une puissance particulière. On n'en est pas encore au spiritualisme et au spiritisme, on ne croit pas encore à des êtres immatériels, mais on est sur la voie de l'animisme ».
[FN: § 1082-2]
A. LYALL; Mœurs relig. et soc. de l'ext. Orient, t. I.
[FN: § 1083-1]
L'auteur continue : « (p. 18)... le sentiment qui pousse l'Indien non-initié à adorer des troncs d'arbres et des pierres, ou ce que l'on appelle les caprices de la nature, est tout uniment dans son essence, cette frayeur sainte de l'extraordinaire, qui n'est particulière à aucune religion. Elle survit encore de nos jours en Angleterre dans l'habitude d'attribuer les accidents grotesques ou frappants du paysage, les antiquités énigmatiques, au diable, qui se trouve ainsi légataire universel de (p. 19) toutes les superstitions païennes démodées en pays chrétien. Dans n'importe quel district de l'Inde, des objets ou des configurations locales, telles que les Palets du Diable (près de Stanton)... recevraient un véritable culte ; des particularités analogues sont actuellement adorées par tout le Bérar, et, dans chaque cas, une signification mystique ou symbolique a été imaginée ou sanctionnée par quelque brahmane expérimenté, pour justifier et autoriser cette coutume [voilà la dérivation très bien décrite]. Pourtant il semble certain qu'en principe, le vulgaire n'a aucune arrière-pensée et n'attache aucun sens secondaire à son acte d'adoration [Voilà une bonne description du résidu]. L'adorateur n'a nul besoin d'un motif de ce genre ; il ne demande aucun signe, n'offre aucune prière, n'attend aucune récompense. Il prête une attention respectueuse à une chose inexplicable, à l'expression alarmante d'un pouvoir inconnu, puis il passe son chemin ». Puis viennent les dérivations : « Il n'est pas difficile de voir comment ce culte original et élémentaire [résidus] se modifie en pénétrant dans la sphère supérieure des superstitions créées par l'imagination [comment naissent les dérivations]. D'abord la pierre est la demeure d'un esprit ; sa forme ou sa situation curieuse trahit la possession. (p. 20) Plus tard, cette forme ou apparence étrange dénote un dessein préconçu, une intervention manuelle des êtres surnaturels, à moins qu'elle ne soit un dernier vestige de leur présence sur la terre. Un pas de plus, et nous entrons dans le vaste monde de la mythologie et des légendes héroïques, où les traits naturellement remarquables d'une colline, d'une brèche dans un roc,... rappellent les miracles et les hauts faits d'un saint, d'un demi-dieu, ou même d'une divinité tout épanouie. Le Bérar nous fournit de ces fables en abondance, et par delà, nous arrivons, je crois, au point où l'on regarde les pierres comme des emblèmes d'attributs mystérieux ; ... (p. 21) en un mot, à toute cette catégorie de notions qui séparent entièrement l'image extérieure de la puissance réellement adorée. De sorte que nous émergeons enfin dans le pur symbolisme, comme il advient quand on choisit arbitrairement un objet quelconque pour servir de but visible à l’adoration spirituelle ». Voir la suite de la citation au § 1090.
[FN: § 1084-1]
On trouve beaucoup d'autres cas semblables. Par exemple, PALLAS ; V « (p. 151) Les Ostiaks vénèrent aussi certaines montagnes et des arbres, qui ont frappé leur imagination, ou qui ont été déclarés comme sacrés par leurs devins. Ils ne passent jamais devant sans y décocher une flèche ; c'est la marque de vénération que l'on rend à ces objets. Mon récit ne regarde que le culte particulier. Le culte public est adressé à des idoles de la première classe, bénites par leurs devins... (p. 152) Les Ostiaks vénéraient autrefois beaucoup d'arbres de cette forêt ; ils y appendaient les fourrures et les peaux d'animaux immolés. (p. 153) Mais comme les Kosaques s'emparaient de ces fourrures, ils se sont déterminés à couper les arbres dont ils ont formé des troncs et de gros rondins. Après les avoir ornés de chiffons et de plaquettes, ils les ont placés dans des lieux sûrs, où ils vont aujourd'hui déposer leurs offrandes ».
[FN: § 1086-1]
Un même homme peut aussi, dans sa vie, gravir une semblable échelle. En juillet 1913, fut inauguré à Paris un monument au Père Hyacinthe, sur lequel on lit : « Le père Hyacinthe, prêtre de Saint-Sulpice, puis carme déchaussé, prêcha dans la chaire de Notre-Dame de 1864 à 1869, puis quitta l'Église, et se maria le 3 septembre 1872. Pendant vingt ans il prêcha la réforme catholique et l'union des Églises (1873-1890) ; pendant les vingt années suivantes, il s’éleva au-dessus de toutes les Églises, et mourut en libre-croyant monothéiste ». Ce fait n'est pas singulier. Il est bien connu qu'en général, beaucoup de gens commencèrent par se détacher de l'Église catholique, en disant qu'ils voulaient seulement s'attacher à un autre catholicisme, meilleur et plus libéral. Mais ils s'arrêtèrent bien rarement à ce point. Leur évolution continue et, peu à peu, leur catholicisme devient du théisme. Parfois, le théisme devient ensuite du matérialisme. Parfois encore, l'évolution s'arrête à un certain point ; il y a recul, et l'homme meurt dans la religion catholique de son enfance.
Notes du Chapitre VII. – Les résidus (suite) (§1089 à §1206) Examen des IIIe et IVe classes. pp. 578-648 ↩
[FN: § 1095-1]
J. LUBOCK : Les orig. de la civ.
[FN: § 1098-1]
On donne ce nom à des accès de ferveur religieuse qui frappent de temps en temps les habitants du Pays de Galles ou d'autres populations.
[FN: § 1098-2]
H. Bois ; Le Réveil au Pays de Galles : « (p. 147) Les incrédules sont dans les galeries. Sidney Evans [c'est l'apôtre, le prophète du Réveil] conseille aux ouvriers chrétiens (christian workers) de ne pas discuter avec les incrédules, de témoigner, d'attester, de montrer la vie qui est en eux, de prier. Au premier rang de l'assemblée, une femme désire se convertir, n'arrive pas à se décider. Un chrétien qui est à côté d'elle, prie à haute voix pour elle. Elle ne se décide toujours pas. Le meeting arrive à sa fin. Elle ne bouge pas. Et le chrétien reste, lui aussi, à côté d'elle à lui parler, à l'exhorter ».
[FN: § 1098-3]
H. Bois ; loc. cit. : « (p. 179)... tandis que la Mission Torrey est plus dogmatique, plus doctrinale, le Réveil gallois est plus émotif, plus affectif, plus vibrant, plus vital. Dans la Mission Torrey, les allocutions sont un très gros et très important morceau : Torrey est si didactique qu'il n'est pas rare de voir des auditeurs prendre des notes pendant qu'il parle... Les allocutions sont, au contraire, à l'arrière-plan dans le Réveil gallois où l'importance suprême est accordée au chant et à la prière... L'émotion qui déborde partout an Réveil gallois, ne joue aucun rôle dans les discours de Torrey... »
[FN: § 1098-4]
L'auteur explique ce que vent dire ce fameux hwyl (prononcez houïl). Ce terme signifie « (p. 268) plein vent dans les voiles ». Il ajoute : « (p. 268) Si parfois les Gallois prient en chantant, il est vrai aussi de dire qu'ils chantent en priant ; c'est ce qui se produit dans ce qu'on appelle en gallois le hwyl ». – I. ROGUES; Un mouv. myst. cont. : « (p. 140)... le mot hwyl ne désigne pas seulement un procédé oratoire, mais un état de conscience particulier dont la mélopée plaintive susmentionnée est ou est censée être la traduction. Psychologiquement il est constitué par une émotion intense avec perte de la conscience du monde extérieur et amnésie consécutive ». On ne saurait décrire autrement le shamanisme.
[FN: § 1099-1]
H. Bois ; loc. cit. § 10981: « (p. 227) J'ai vu un jeune homme couché tout de son long sur les marches de l'escalier conduisant à la chaire, la figure crispée, les poings raidis, et dans cette posture il a lancé une véhémente prière, restant dans la même attitude après avoir prié. J'ai vu des hommes empoignés par l'émotion au fur et à mesure que la réunion se prolongeait et se développait, fermer leurs poings, boxer pour ainsi dire en cadence, tout en restant assis et sans mot dire, ou bien se frapper la tête, se prendre la tête à deux mains, faire de grands gestes tout en restant silencieux. J'ai vu des femmes, des jeunes filles, sous l'empire de la contagion émotive et nerveuse s'abstraire de plus en plus de leur entourage, les joues rouges, l'œil fixe, parfois les paupières fermées. Ceux ou celles chez qui cela devient trop fort éclatent presque inconsciemment en prières ou en cantiques ». Plus loin : « (p. 2111) À côté des prières d'actions de grâces, il y a les prières qui sont de véritables cris. Crier à Dieu, lutter avec Dieu, agoniser dans la prière. ces expressions deviennent tout à fait, littéralement exactes. On peut entendre effectivement les cris déchirants de pécheurs qui s'estiment perdus et qui supplient le Dieu de miséricorde d'avoir pitié d'eux : (p. 242) Seigneur sois miséricordieux envers moi ! moi !moi !... ».
[FN: § 1101-1]
G. SOREL dans L’Indépendance, 1er mai 1912 « (p. 230) De ce que les chefs de soulèvement populaire aient, soit au cours du Moyen-Âge, soit au début des (p. 231) temps modernes, prétendu fonder leurs révoltes sur des paroles prononcées par des prophètes d'Israël, il ne faudrait pas en conclure que ces prophètes ont été des révolutionnaires. C'est bien le cas d'appliquer ces remarques judicieuses que fait Renan : « En histoire religieuse, un texte vaut, non pas ce que l'auteur a voulu dire, mais ce que le besoin du temps lui fait dire ». En note : « RENAN ; Histoire du peuple d'Israël, tome IV, p. 193 » – « Cette remarque s'applique aussi fort bien à l'histoire profane ; ainsi la social-démocratie a fait d'effroyables contresens pour se donner l'air de suivre les enseignements hégéliens ». Très juste. Le fait est encore plus général et dépend de ce que la dérivation est secondaire, et qu'on trouve toujours autant de dérivations qu'on veut pour justifier des résidus, des tendances, des intérêts. On remarquera la phraséologie habituelle, dans le passage de Renan, qui parle des « besoins du temps ». Que peut bien être cette nouvelle entité ? Pour rester dans le domaine de l'expérience, il faut rectifier en disant : « ... mais ce que les hommes en tirent pour justifier leurs sentiments, leurs inclinations, leurs intérêts, en un temps donné ».
[FN: § 1102-1]
BINET SANGLÉ : Les proph. juifs. « (p. 76) Le nabi iahvéiste est un dégénéré, dont l'écorce cérébrale, incomplètement développée, ne contient qu'un nombre restreint de neurones mnésiques, c'est-à-dire de clichés à images et à idées. De ce fait le champ de sa pensée est limité. De plus, en raison de l'arrêt de développement de ces neurones et de l’hypercontractilité qui en est la conséquence, il présente une disposition particulière à la dissociation cérébrale, à la formation de ces groupes neuroniens indépendants, qui sont (p. 77) le théâtre des courts circuits mnésiques, conditions des hallucinations et des obsessions ». L'auteur parle de l'antique prophétisme. Plusieurs auteurs protestants avouent qu'il y avait là quelque chose de pathologique. Par exemple PIEPENBRING; Théol. de l’anc. test. : « (p. 16) C'est évidemment parce qu'il se mêlait à l'ancien prophétisme toutes sortes d'excentricités, que les prophètes sont parfois (p. 17) traités de fous ou d'hommes en délire. Ce qui a pu contribuer également à leur faire cette réputation, ce sont les actes symboliques, assez curieux, qu'ils employaient pour exprimer leur pensée d'une manière plastique ». Mais ayant fait ainsi la part du feu, ils veulent au moins sauver le nouveau prophétisme ; et ils ne peuvent faire autrement, parce que celui-ci se rattache à l'Évangile. Notre auteur dit du nouveau prophétisme : « (p. 73) Il apparaît... dans toute sa pureté. dégagé des usages traditionnels que nous rencontrons parmi les autres peuples de l'antiquité et qui exerçaient une puissante influence sur les anciens prophètes d'Israël. Ceux-ci se livraient encore à l'art de la divination et leur activité n'était pas exempte d'une exaltation plus ou moins maladive ; les prophètes de notre période au contraire sont des prédicateurs, parlant sous l'influence de l'inspiration divine, sans toutefois perdre conscience d'eux-mêmes, et se laissant guider par les événements politiques, qu'ils observent avec attention ». On ménage ainsi la chèvre et le chou. Les croyants se contentent de l'inspiration divine, et les pseudo-expérimentaux de la constatation de leurs succès politiques. « (p. 79) Tout cela prouve incontestablement que, parmi les prophètes israélites, il existait quelque chose de semblable à la glossolalie, ce degré inférieur de l'inspiration chrétienne [notez que l'auteur ne la rejette pas absolument ; il la place seulement à un degré inférieur], et à d'autres phénomènes analogues qui se sont produits depuis dans l'Église, principalement sous l'influence du méthodisme américain ; mais cela ne prouve pas que tous [quelques-uns oui ; tous non] étaient dans cet état quand ils recevaient la parole divine ». « (p. 81) Les deux sortes d'inspiration chrétienne que saint Paul décrit, 1 Cor. 14, ont évidemment une grande analogie avec les deux sortes de prophétisme de l'ancien Israël. Et de même que l'apôtre place la simple prédication évangélique au-dessus de la glossolalie, de même nous devons placer la simple prédication prophétique, faite sous l'inspiration de l'esprit de Dieu, bien au-dessus de l'ancien prophétisme extatique ». L'auteur ne définit pas ce qu'il entend par un prophétisme supérieur à un autre. Par conséquent, nous ne pouvons ni admettre ni rejeter son théorème. Il ne donne et ne peut donner aucune preuve expérimentale que les dits prophètes « fussent inspirés par l'esprit de Dieu ». On ne peut y croire que moyennant un acte de foi, et l'on ne sait pourquoi l'acte de foi doit s'arrêter à la proposition générale, et ne pas aller jusqu'à croire vrais aussi tous les détails du prophétisme, soit ancien soit nouveau. On ne nous donne aucun critère pour savoir où doit cesser la foi et commencer la recherche expérimentale.
[FN: § 1105-1]
BOUCHÉ-LECLERCQ ; Hist. de la div. dans l'ant., t. III. La pudique retenue de notre auteur qui – dans un ouvrage scientifique en quatre volumes ! – n'ose pas décrire l'extase de la Pythie, est vraiment caractéristique de la stupide phobie sexuelle qui règne de nos jours. Van Dale, qui vivait en un temps où les savants n'étaient pas affectés de cette maladie, expose clairement et simplement ce dont il s'agit. En résumé, on disait qu'un méchant démon entrait par les parties sexuelles de la Pythie, et répondait par sa bouche. Voilà le grand mystère qu'on ne peut dévoiler sans offenser les bigots de la vertu. Je le regrette pour eux ; mais je veux citer ce que dit Van Dale. – VAN DALE ; De orac. vet. ethn. : (p. 153) Quod apud ipsos Ethnicos nullibi legimus ; se quod non nisi nuda assertatione affirmant veteres nonnulli Christiani, eosque secure hie secuti multi ex recentioribus Theologis, est, Pythiam, dum sic in Tripode sederet, recepisse non tantum intra corpus Cacodaemonen, seu Diabolum ; verum et per ipsius muliebria, seu membra pudenda, in ipsum corpus intrasse, ac per os illius Responsa, quae Ethnici Divina Christiani vero Diabolica, appellabant. Primus autem qui inter Christianos, quod sciam, illud asseruit est Origines : qui lib. 7. Contra Celsum. ita loquitur : ...(p. 154) Certe de Pythia, quo non aliud manteion est celebrius, narratur vatem illam Apollinis desidere super foramen specus Castalii, et ascendentem inde spiritum per muliebre gremium recipere, quo repleta profert ista praeclara et Divina, ut putantur Oracula... Hunc sequitur Chrysostomus ; qui Hom. XX in I Cor. 22 ita, (aeque haesitanter tamen quam. Origines per narrant ac dicunt loquifur Dicitur Pythia (mulier quaedam) insidere Tripodi quandoque Apollinis, ac quidem cruribus apertis : sicque malignum Spiritum inferne in corpus eius penetrantem, ipsam implere furore... Ex hoc vero Chrysostomo sua mutuatus videtur Aristophanis Scholiastes, qui pene iisdem. verbis tititur. La scolie citée par Van Dale est celle du Plutus, v. 39.
[FN: § 1106-1]
MICHAUD ; Hist. des cr., I « (p. 121). au temps dont nous parlons, la dévotion du pèlerinage, qui devenait plus vive en se communiquant, et qu'on pouvait appeler, selon l'expression de Saint Paul, la folie de la croix, était une passion ardente et jalouse qui parlait plus haut que toutes les autres. (p. 122) Les femmes, les enfants, les clercs, s'imprimaient des croix sur le front ou sur d'autres parties de leur corps, pour montrer la volonté de Dieu. …(p. 123) Ce qu'on aura peine à croire, les voleurs, les brigands quittaient leurs retraites inconnues, venaient confesser leurs forfaits [exactement ce qui arrive dans les Réveils et les Missions de l'Armée du Salut ; mais, alors comme aujourd'hui, ces conversions étaient et sont éphémères] et promettaient en recevant la croix, d'aller les expier dans la Palestine ». – LEA ; Hist. de l’inq., t. I, p. 147, tract. Reinach, p. 165-166 : « (p. 165) Pendant que l'on prêchait cette croisade [contre les Albigeois], certaines villes et bourgades d'Allemagne se remplissaient de femmes qui, faute de pouvoir satisfaire leur ardeur religieuse en prenant la croix (p. 166) se déshabillaient et couraient toutes nues par les rues et par les routes. Un symptôme plus éloquent encore de la maladie de cette époque [l’auteur pouvait observer des maladies semblables dans son pays. Cette mégère qui détruisait à coups de hache les débits de boissons alcooliques, reproduisait en elle un exemple de la maladie des croisades], fut la Croisade des Enfants, qui désola des milliers de demeures. Sur de vastes étendues de territoire, on vit des foules d'enfants se mettre en marche, sans chefs ni guides, pour aller à la recherche de la Terre Sainte ; ... Le petit nombre de ceux qui revinrent ne purent donner aucune explication du désir frénétique qui les avait emportés ».
[FN: § 1107-1]
HORAT. ; Od., I, 16 :
Non Dindyrnene, non adytis quatit
Mentem sacerdotum incola Pythius,
Non Liber aeque, non acuta
Sic geminant Corybantes aera
Tristes ut irae.
« Non, Dindyméné [Cybèle], non, dans le sanctuaire, ni le dieu pythique [Apollon], inspirateur, ni Liber [Bacchus] ne troublent l'esprit du prêtre ; les Chorybantes ne frappent pas, de coups répétés, le bronze sonore, comme la funeste fureur [trouble l'homme].
[FN: § 1108-1]
EURIP., Bacch. : « (215-216) M'étant absenté de cette terre, j'entends les nouveaux malheurs de cette cité : (217) Nos femmes ont abandonné les maisons, (218-220) poussées par un enthousiasme simulé, et parcourent les montagnes ombreuses, célébrant par des danses ce nouveau dieu, Bacchus, quel qu'il soit. (221-223). Au milieu des thyases, sont placés des cratères pleins, et chacune de son côté se retire dans la solitude, pour jouir des embrassements des hommes, (224) sous le prétexte qu'elles sont des Ménades qui sacrifient ; (225) mais elles se préoccupent plus d'Aphrodite que de Bacchus. (226-227) Toutes celles que j'ai pu saisir, les gardes les tiennent, les mains liées, dans les maisons publiques. (228) Celles qui ont échappé, je les capturerai sur les montagnes et les conduirai ici... » – CICÉRON ; De leg., II, ne s'exprime pas autrement. Il est manifeste qu'il condamne les réunions déréglées, anarchiques, tandis qu'il admet tout ce qui est réglé par le pouvoir public. 14, 35 Att. Quid tandem id est ? – Marc. De nocturnis sacrificiis mulierum. – Att. Ego vero assentior ; excepto praesertim in ipsa lege sollemni sacrifcio ac publico. – Mais cela ne lui suffit pas : Marc. Quid ergo aget Iacchus, Eumolpidaeque nostri, et augusta illa mysteria, si quidem sacra nocturna tollimus ? Non enim populo Romano, sed omnibus bonis firmisque populis leges damus. – (36) Att. Excipis, credo, illa, quibus ipsi initiati sumus. – Marc. Ego vero excipiam. – Il ne veut pas qu'ils aient lieu à Rome : il permet seulement que les femmes soient initiées aux mystères de Cérès, d'après les rites romains : 15, 37 Quo in genere severitatem maiorum senatus vetus auctoritas de Bacchanalibus, et consulum, exercitu adhibito, quaestio animadversioque declarat. Atque omnia nocturna, ne nos duriores forte videamur, in media Graecia Diagondas Thebanus lege perpetua sustulit. En somme, tout besoin religieux peut être satisfait au moyen d'un culte bien organisé par l'État : Publicus autem sacerdos imprudentiam consilio expiatam metu liberet audaciam in admittendis religionibus fœdis damnet, atque impiam iudicet.
[FN: § 1109-1]
S. REINACH; Cultes, myth., et relig., III, ne croit pas aux accusations portées contre les gens qui célébraient les Bacchanales. Il dit fort bien : « (p. 269) Toutes les accusations répandues contre la moralité des mystères sont des inventions grossières ou ridicules. analogues à celles qui furent propagées à Rome même contre les premiers chrétiens, puis, dans le monde chrétien, contre les Manichéens, les Juifs, les Templiers et beaucoup d'autres. La malignité humaine est peu inventive ; en tête des griefs contre les sectaires qu'elle veut perdre, on trouve toujours le meurtre, la sodomie et le viol ». Mais ensuite, il laisse libre cours à sa fantaisie, et donne une version du fait des Bacchanales, qui va entièrement au delà des documents que nous possédons. Ainsi l'on cherche simplement à deviner l'histoire, et non pas à l'écrire.
[FN: § 1112-1]
J. LUBBOCK ; Les orig. de la civ. [L'ouvrage cité de Williams est Fiji and the Fijians, vol. 1, p. 224] : « (p. 389) Il se fait alors un profond silence, le prêtre, s'absorbe dans ses pensées, tous les yeux sont fixés sur (p. 340) lui. Au bout de quelques minutes, il se met à trembler ; on voit des tiraillements sur son visage, ses membres sont agités de soubresauts nerveux. Ces soubresauts s'augmentent, tous les muscles de son corps s'agitent, et le prêtre se met à frissonner comme s'il avait un violent accès de fièvre. Quelquefois ce tremblement est accompagné de murmures et de sanglots ; les veines se gonflent et la circulation du sang s'accélère. Le prêtre est actuellement possédé de son dieu, aussi ses paroles et ses actions ne sont-elles plus les siennes propres, mais celles dé la divinité qui s'est emparée de lui ».
[FN: § 1112-2]
H. Bois ; loc. cit., § 1098-1 : « (p. 493) Evan (p. 494) Roberts, presque aussitôt arrivé se dresse dans la chaire, arrête le chant et demande : “Est-ce que ce lieu est clair ? J'ai peur que non. Est-ce que nous sommes venus ici pour voir seulement, au lieu de venir pour adorer le Dieu vivant ? Est-ce que nous sommes venus ici pour être divertis, au lieu de venir pour être sanctifiés ? ” – Une pause – “ Non, ce lieu n'est pas clair. Qu'est-ce, mes amis ? ” demande le revivaliste sauvagement. Et il se penche sur la chaire, la figure toute rouge, congestionnée, les veines gonflées. – “ Il y a, déclare-t-il, quelque chose d'extraordinaire qui ne va pas ” Quelqu'un commence une prière : “ S'il y a ici quelque chose qui pèse sur ce... ” – “ Ne dites pas si, interrompt Roberts, ne dites pas si ”. Et il s'assied pleurant et criant : – “ Ô Seigneur, courbe-les !” Ses grands sanglots sont terribles à entendre. Le Dr M'Affee... se précipite à son secours. “ Ô Seigneur, s'écrie Evan Roberts avec désespoir, C'est plus que je ne puis porter !” Puis il dit à l'assemblée : – “ C'est le fardeau le plus pesant que j'aie encore porté ” et il s'arrête. On prie partout dans l'édifice. Evan Roberts, au milieu de violents sanglots, s'écrie : – “ Il est difficile d'obéir toujours à Dieu... L'obstacle, dit-il un peu plus tard, est le môme qu’hier soir ; je dois donner le message... ” Et il succombe de nouveau à son émotion. À la fin, comme s'il faisait appel à toute son énergie, pour se vaincre lui-même, il dit : “Dieu m'a confié ce message, il y a plusieurs jours, mais c'est seulement ce soir qu'il doit être révélé. Voici le message. Faites-en ce que vous voudrez. Il vient directement de Dieu : Les fondations de cette Église ne sont pas sur le Roc ” (sensation)... ».
[FN: § 1119-1]
Voir sur ce sujet: FAUSTO SQUILLACE ; La Moda. L'auteur observe avec raison que « (p. 21) on peut grouper les courants ou tendances collectives, propres à un laps de temps plus ou moins court, sous le nom générique et compréhensif de modes, c'est-à-dire de façon de penser, de sentir à un moment déterminé, en certaines conditions, en pleine conformité avec d'autres individus du même temps et de la même société ». Parfois, ces façons ont des causes générales qui agissent sur beaucoup d'individus, un grand nombre d'autres les employant ensuite par simple imitation. Parfois, ce peut être le caprice d'un seul individu, qui donne naissance à une mode, suivie ensuite par d'autres individus. Par exemple, la façon dont se vêtait Édouard VII d'Angleterre créait la mode masculine.
[FN: § 1123-1]
PALGRAVE ; Voyage dans l'Arabie. t. II.
[FN: § 1123-2]
PALGRAVE ; loc. cit. 1123-1 « (p. 80) Le fondateur de la secte wahabite et son disciple Saoud (p. 81) n'avaient pas moins en vue l'établissement d'un grand empire que le prosélytisme religieux ; ces deux hommes, – le premier plus encore peut-être que le second, – voulaient non seulement convertir leurs voisins, mais les soumettre... Il leur fallait trouver à la conquête un motif plausible, et avoir un signe de ralliement qui servit à reconnaître les partisans de leur doctrine. Croire à l'unité de Dieu, s'acquitter régulièrement des prières prescrites... tout cela ne suffisait pas à tracer une ligne de démarcation. ...Il était besoin d'imaginer quelque chose de plus : le tabac fournit un excellent prétexte ».
[FN: § 1125-1]
J. G. FRAZER; Le ram. d'or, I : « (p. 255) Chez les Indiens Creeks, tout jeune homme, lors de son initiation, devait s'abstenir pendant douze lunes de curer ses oreilles et de se gratter la tête avec les doigts ; il devait se servir d'un petit bâton. Pendant quatre lunes, il devait avoir un feu qui lui fût propre, et c'était une vierge qui lui préparait sa nourriture. La cinquième lune, n'importe qui pouvait préparer ses repas, mais il devait se servir le premier et n'employer qu'une cuiller et une poêle. Le cinquième jour de la douzième lune, il recueillait de la balle de blé, la brûlait et se frottait le corps avec les cendres... Pendant tout le temps que durait l'initiation, il ne (p. 256) pouvait toucher que les jeunes gens qui se faisaient initier comme lui. Une coutume analogue existait chez les Cafres, lors de la circoncision des garçons ». Le même auteur cite une infinité d'autres exemples analogues.
[FN: § 1127-1]
Le 22 juillet 1913, à Paris, un inspecteur de police tenta d'assassiner une dame Roudier, pour la voler. Il fut arrêté et, interrogé, il avoua le crime. « „Je suis un misérable“, s'écria-t-il, après avoir décliné son identité et sa qualité. „J'ai voulu me procurer de l'argent à tout prix, mais c'est le besoin qui m'a poussé. J'ai un petit garçon d'un an à peine, et ma femme attend la venue d'un autre enfant. J'étais à bout de ressources ; il me restait juste treize sous en poche. J'habite depuis huit jours seulement la rue Nationale ; les frais de mon déménagement puis le terme ont épuisé toutes mes ressources.“ – „ Pourquoi“, lui demanda-t-on, „ n'avez-vous pas demandé un secours à l'administration ? Elle vous l'aurait certainement accordé.“ – „ Je n'ai pas osé “, répondit l'inspecteur, „ étant trop jeune dans le service, et d'ailleurs je craignais qu'une semblable démarche ne me valût de mauvaises notes... J'avais fait la connaissance de Mme Roudier il y a un an. Me voyant dans une telle gêne, j'ai tout de suite pensé à cette dame avec l'idée d'aller lui emprunter cinquante francs. Mais, quand je me suis trouvé en sa présence, je n'ai pas ose risquer ma requête. J'allais me retirer quand tout à coup je pensai à ma petite famille qui, bientôt, n'aurait plus de pain... Une idée infernale a germé dans mon esprit... J'ai vu rouge... Je me suis alors précipité sur cette femme ; comme elle criait, je l'ai prise à la gorge, pour ne plus entendre ses appels déchirants, puis j'ai compris que j'étais perdu, et je me suis sauvé... Ah ! je suis bien coupable... Mais ce fut, je vous le jure, un moment de folie...“ (La Liberté, 23 juillet 1913) ». Or une question se pose. Cet homme a-t-il bien ou mal fait d'avoir deux fils, alors qu'il ne pouvait les entretenir ? Nous ne voulons ici nullement résoudre cette question dans un sens ou dans l'autre ; mais il est évident que si l'on veut l'examiner, il faut pouvoir parler d'anti-malthusianisme, de malthusianisme et même de pratiques anti-fécondatrices ; car, en somme, qui veut la fin veut les moyens. S'il est défendu de le faire, si l'on ne peut discuter ces questions, nous revenons au temps où il était défendu de discuter les dogmes de l'Église catholique. Ceux qui admirent cette époque peuvent, sans contradiction, vouloir y faire retour ; mais ceux qui la condamnent sont ridiculement illogiques de vouloir en imiter les usages.
[FN: § 1127-2]
Parmi de nombreux exemples qu'on pourrait citer, le suivant suffira « La Liberté, 13 juin 1912. – Hier matin a comparu devant le tribunal de Newington le sieur Henri James Brown, 22 ans, qui persistait, malgré les injonctions des policemen, à flaner sur les trottoirs de Piccadilly en offrant aux passants des photographies obscènes. Le magistrat, M. Lawrie, a agrémenté sa sentence d'un petit discours : – Je regrette vivement de ne pouvoir vous condamner aussi sévèrement que vous le méritez. Je crois, en tout cas, faire de mon mieux. Vous recevrez 25 coups du chat à 9 queues et vous ferez 9 mois de travaux forcés... » Espérons que ce magistrat émérite publiera, lui aussi, son Malleus maleficarum. Mais peut-être n'est-il pas même assez intelligent pour le faire. Ceux qui croient à la métempsycose peuvent s'imaginer que l'âme de Mélitos qui accusa Socrate de corrompre les jeunes Athéniens, après avoir fait une petite pause dans le corps de ce Pierre de Lancre qui fit brûler tant de sorcières, au « pays de Labour », est allée ensuite finir dans ce digne magistrat anglais.
[FN: § 1127-3]
JOINVILLE : « 138 § 685 (p. 379) Le roi aimait tant Dieu et sa Douce Mère, que tous ceux qu'il pouvait convaincre d'avoir dit sur Dieu ou sa Mère chose déshonnête ou vilain jurement, il les faisait punir grièvement. Ainsi je vis qu'il fit mettre un orfèvre à l'échelle à Césarée, en caleçon et en chemise, les boyaux et la fressure d'un porc autour du cou, et en si grande foison qu'ils lui arrivaient jusqu'au nez. J'ai ouï dire que depuis que je revins d'outre-mer, il fit brûler pour cela le nez et la lèvre à un bourgeois de Paris ; mais je ne le vis pas. Et le saint roi dit : „ Je voudrais être marqué d'un fer chaud, à condition que tous vilains jurements fussent ôtés de mon royaume “ ».
[FN: § 1127-4]
JOINVILLE : « 10, § 51, (p. 31) il [le roi] me conta qu'il y eut une grande conférence de clercs et de Juifs au monastère de Cluny. Il y eut là un chevalier... et dit qu'on lui fit venir le plus grand clerc et le plus grand maître des Juifs : et ainsi firent-ils. Et il lui fit une demande qui fut telle : „ Maître – fit le chevalier – je vous demande si vous croyez que la Vierge Marie, qui porta Dieu en ses flancs et en ses bras, ait enfanté vierge, et qu'elle soit mère de Dieu “. (52) Et le Juif répondit que de tout cela il ne croyait rien. Et le chevalier lui répondit qu'il avait vraiment agi en fou, quand ne croyant en elle ni ne l'aimant il était entré en son église et en sa maison. „ Et vraiment –fit le chevalier – vous le payerez “. Et alors, il leva sa béquille et frappa le Juif près de l'oreille, et le jeta par terre. Et les Juifs se mirent en fuite, et emportèrent leur maître tout blessé : et ainsi finit la conférence. (53) Alors l'abbé vint au chevalier, et lui dit qu'il avait fait une grande folie. Et le chevalier répondit que l'abbé avait fait une plus grande folie encore d'assembler une telle conférence ; car avant que la conférence fût menée à fin, il y avait céans grande foison de bons chrétiens qui fussent partis de là tous mécréans, parce qu'ils n'eussent pas bien entendu les Juifs. „ Aussi vous dis-je – fit le roi – que nul, s'il n'est très-bon clerc, ne doit disputer avec eux ; mais un laïque, quand il entend médire de la loi chrétienne, ne doit pas défendre la loi chrétienne, sinon avec l'épée, dont il doit donner dans le ventre, autant qu'elle peut y entrer “ ». Ces disputes étaient fréquentes, dans les temps anciens, et continuèrent jusqu'à la Réforme. Saint Grégoire de Tours en raconte une qui eut lieu avec un Juif, devant le roi Chilpéric. Le saint dit de fort belles choses au mécréant, mais ne put le persuader, et le roi le laissa aller en paix sans que personne ne lui fît tort. Hist., VI, 5... Haec et alia nobis dicentibus, numquam compunctus est miser ad credendum. Tunc rex, silente illo, cam videret eum his sermonibus non compungi, ad me conversus, postulat ut, accepta benedictione, discederet.
[FN: § 1127-5]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Le Journal, 12 août 1913, URBAIN GOHIER, Deux
Morales : « Pendant que Luther se cachait, fuyant les vengeances de l'Église romaine, il adjurait les Allemands de brûler les synagogues et de couper la langue aux juifs « jusqu'au fond du gosier », pour leur démontrer le mystère d'un Dieu en trois personnes. Les protestants, qui se plaignaient des dragonnades de Louvois, avaient dragonné les catholiques en Angleterre, en Écosse, en Irlande, avec une impitoyable férocité.
» Échappé des bûchers de France, Calvin s'était empressé de brûler Servet. Le pasteur Jurien, réfugié à l'Université de Rotterdam après la révocation de l'édit de Nantes, et retrouvant dans cet asile son coreligionnaire et collègue Bayle, n'avait point eu de cesse qu'il ne le fit chasser comme incrédule. Les Jansénistes persécutés souffraient les pires violences avec résignation ; tout ce qu'ils demandaient au gouvernement, c'était un redoublement de rigueur contre les huguenots. Aujourd'hui, les dépêches de Varsovie nous apprennent que les Polonais font rôtir des juifs accusés d'avoir jeté des pierres au saint sacrement, et que les juifs font griller vifs des Polonais accusés d'avoir surpris les délibérations du Bund ».
[FN: § 1128-1]
Nombreux sont les faits qu'on pourrait citer pour montrer ce contraste. Nous en avons d'ailleurs relevé plusieurs. Ajoutons-y les suivants : Corriere della Sera. 12 janvier 1913. – À Boston, les dames et les demoiselles qui emplissaient ce théâtre de l'Opéra, pour la première représentation de la Tosca de Puccini, furent... grandement scandalisées de la scène dite du sofa, au second acte, entre Scarpia et la protagoniste. Qu'il suffise de dire que le chef de la police intervint, en ordonnant par raison de moralité, que, dans les représentations suivantes, cette scène fût retranchée ou transformée radicalement ». Les acteurs résistèrent. « On télégraphia à Puccini, qui répondit que la scène devait être jouée intégralement, sinon le spectacle serait supprimé, sans autre ». On en vint à une transaction : la Tosca resta debout. « Et les Bostoniens, ainsi que le chef de la police furent satisfaits ». Voici le revers : « Gazette de Lausanne, 21 janvier 1913. – „ Le sabotage de l'estomac“ –. M. Ettor, un des leaders du syndicat international des „ travailleurs industriels du monde“, récemment acquitté de complicité criminelle dans les violences des grévistes des filatures de Lawrence (Massachusetts), conseille aux garçons d'hôtel et de restaurant en grève à New-York d'empoisonner les capitalistes ou tout au moins de saboter leurs repas. „ Si vous êtes forcés de reprendre le travail dans de mauvaises conditions – leur dit-il – faites-le avec la résolution bien arrêtée de rendre inquiétant pour les capitalistes de manger les mets préparés par votre syndicat “. Les grands hôtels et restaurants de New-York engagent des détectives privés qui surveillent les cuisines et les salles de restaurant ». À ce qu'il paraît, suivant ces excellents législateurs, on fait moins de tort à un homme en l'empoisonnant, qu'en lui laissant voir, au théâtre, un chanteur et une cantatrice assis sur le même canapé. Il y a mieux encore, si nous sortons du Massachusetts. On a découvert, à New-York, une association qui avait incendié plus d'un millier de maisons, pour toucher des primes d'assurance. Pendant que s'accomplissent ces faits louables, la police veille à ce qu'on n'introduise pas, d'Europe à New-York, des livres obscènes ou même seulement sensuels. Le procès d'Indianapolis, au sud de Chicago, contre ceux qui faisaient sauter en l'air, à la dynamite, des établissements industriels et des maisons, et tuaient des personnes, a donné l'occasion au juge fédéral Anderson, de déclarer que si les autorités locales avaient fait leur devoir, ces crimes auraient pu être évités. Il semblerait que ç'eût été plus utile à la société, que de donner la chasse aux jeunes gens qui font l'amour avec les jeunes filles. On peut bien appeler traite la corruption des députés américains, si l'on emploie ce nom pour la corruption de femmes consentantes, avec cette seule différence que les députés vendent le bien d'autrui et les femmes le leur. Les vertuistes américains qui s'occupent avec tant de sollicitude de la seconde traite, n'ont plus le temps de s'occuper de la première ; et l'on sait que la « traite des législateurs » prospère, fleurit, fructifie, aux États-Unis. Dernièrement encore, un certain Mulhall a publiquement accusé de corruption un grand nombre de législateurs, se déclarant prêt à prouver ses accusations par d'innombrables documents ; et il fit allusion à plus de 20 000 lettres et télégrammes. La Commission parlementaire du travail semble avoir été surtout victime de cette « traite des législateurs » ; victime comme la plus grande partie des femmes sujettes à la « traite des blanches », cela s'entend.
[FN: § 1135-1]
PAUTHIER ; Confucius et Mencius. Meng-Tseu dit au roi ; « (p. 209)... c'est l'humanité qui vous a inspiré ce détour. Lorsque vous aviez le bœuf sous vos yeux, vous n'aviez pas encore vu le mouton. Quand l'homme supérieur a vu les animaux vivans, il ne peut supporter de les voir mourir ; quand il a entendu leurs cris d'agonie, il ne peut supporter de manger leur chair. C'est pourquoi l'homme supérieur place son abattoir et sa cuisine dans des lieux éloignés ».
[FN: § 1136-1]
Voici comment il est raconté par le Journal de Genève, 3 juillet 1910. « Le 26 février 1907, il [Liabeuf] est condamné pour vol par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à quatre mois de prison ; le 7 juin 1907, il est condamné par le même tribunal et pour le même délit à trois mois de prison : le 14 août 1909, il est condamné par le tribunal correctionnel de la Seine, pour vagabondage spécial [euphémisme qui, dans le jargon d'un siècle hypocrite, sert à désigner ce qu'on nomme en français le métier de souteneur] à trois mois de prison et cent francs d'amende ; le 4 mai 1910, il est condamné à mort par la Cour d'Assises... Après avoir participé aux exploits d'une bande de voleurs et s'être compromis avec des malfaiteurs avérés, Liabeuf avait quitté Saint-Étienne et était venu à Paris. Ici, loin de s'amender, il avait encore fréquenté des souteneurs et des filles. Condamné à la prison pour vagabondage spécial, il avait juré une haine mortelle aux inspecteurs Vors et Maugras, dont les témoignages formels l'avaient accablé. Pour se venger, il avait confectionné des brassards et des poignets de cuir hérissés de pointes métalliques, et un soir, revêtu de cette redoutable armure, il s'était mis, au sortir d'un bar, à la recherche des deux inspecteurs. Or ce ne furent pas ces derniers qui tombèrent sous ses coups, mais d'autres agents que le bandit ne connaissait même pas. On n'a pas oublié l'effroyable boucherie : le gardien de paix Deray mortellement atteint d'une balle et de coups de tranchet ; ses collègues Fournès, Février et d'autres, criblés de blessures »... « Liabeuf, il est vrai, protesta toujours contre la condamnation infligée pour vagabondage spécial. Mais au cours des débats qui se déroulèrent devant le jury, aucun fait, aucun élément nouveau ne permit de mettre positivement en doute la réalité du fait ».
[FN: § 1136-2]
Carducci écrivit au sujet de ces dames, à propos du procès Fadda. On les a vues reparaître dans les procès de Musolino et d'autres brigands, ainsi que d'exploiteurs de femmes. Ces vers de Junéval restent toujours vrais, VI :
(110) Sed gladiator erat, facit hoc illos Hyacinthos.
Hoc pueris patriaeque, hoc praetulit illa sorori
Atque viro ; ferrum est, quod amant...
Le scoliaste observe avec justesse : sed gladiator Crudelitas tantam deformitatem decorabat, atque illi formosum et pulchrum exhibebat.
[FN: § 1136-3]
Le journal La Liberté dit à propos de la veuve Deray : « Cette innocente victime de la tragédie de la rue Aubry-le-Boucher a mené une vie atroce depuis le jour où son mari a trouvé la mort. Déjà frappée dans son affection la plus chère, Mme Deray dut subir chaque jour les injures des Apaches. La polémique qui survint au sujet du sort de l'assassin réveillait à chaque instant ses souffrances et ravivait sa douleur. Depuis l'exécution, ce que la malheureuse a supporté est inimaginable, et elle a dû abandonner le logement où tant de souvenirs l'attachaient. Sur le conseil même du commissaire de police de son quartier, elle va déménager. Elle a trouvé heureusement une modeste situation de femme de ménage, qui lui permettra de vivre et de subvenir aux besoins de son garçonnet : le pauvre petit a été tellement bouleversé par la disparition de son père, qu'il est tombé malade et qu'il est à peine remis aujourd'hui ». Il y eut même quelqu'un pour dire qu'on ne devait pas pleurer la victime de Liabeuf, car se faire tuer appartient au métier de l'agent de police. Notez que la même personne veut que le risque professionnel de l'ouvrier soit à la charge du patron. Nous avons là un nouveau cas de l'existence de deux résidus contradictoires chez un même individu.
[FN: § 1136-4]
« La Liberté, 6 mai 1912. – Toute la presse a approuvé le geste du gendarme qui, à Bougival, tua un cambrioleur qui faisait mine de sortir un revolver de sa poche... Toute la presse, sauf l'Humanité, qui déclare : „ Nous estimons que ce bon geste est exécrable et dangereux “. Dangereux évidemment... pour le malfaiteur, mais exécrable, non pas ! »
[FN: § 1140-1]
Le Matin, 5 juillet 1912, a publié le « carnet » de Garnier, où ce criminel exprime ses sentiments au moyen des dérivations employées par les littérateurs du temps où il vivait. Il écrit : « Tout être venant au monde a droit à la vie. Cela est indiscutable puisque c'est une loi de la nature. [Il aura lu cela dans quelque journal, qui l'aura pris de quelque littérateur de second ordre, qui l'aura pris de maîtres tels que Victor Hugo, Anatole France, L. Bourgeois, etc.]... » Dès mon plus jeune âge, je connus déjà l'autorité du père et de la mère, et avant d'avoir l'âge de comprendre, je me révoltais contre cette autorité, ainsi que celle de l'école [simple expression de sentiments]. J'avais alors treize ans, je commençais à travailler ; la raison me venant, je commençais à comprendre ce que c'était que la vie et l'engeance sociale. Je vis les individus mauvais, je me suis dit : il faut que je cherche un moyen de sortir de cette pourriture qu'étaient patrons, ouvriers, bourgeois, magistrats, policiers et autres [autre dérivation prise par lui dans les journaux socialistes]. Tous ces gens-là me répugnaient, les uns parce qu'ils étaient autoritaires, les autres parce qu'ils supportaient de faire tous ces gestes. Ne voulant pas être exploité et non plus exploiteur, je me mis à voler à l'étalage, ce qui ne rapportait pas grand' chose. [Toutes ces dérivations pour dire qu'il voulait jouir de la vie sans travailler. En somme, il n'était ni meilleur ni pire que d'autres gens, comme la Tarnowska, pour laquelle les excellents humanitaires ont tant de pitié.] » Une première fois je fus pris ; pour la première fois, j'avais alors dix-sept ans, je fus condamné à trois mois de prison. Quand je sortis de prison, je rentrai chez mes parents, qui me firent des reproches assez violents ; mais d'avoir subi tout ce qu'on appelle la justice, la prison m'avait rendu encore plus révolté. Je devins alors anarchiste : j'avais environ dix-huit ans. Je ne voulus plus retourner travailler [voilà le véritable motif de tous ces bavardages ; de pareilles gens ne peuvent demeurer dans une société civilisée ; mais les bons humanitaires s'opposent à ce qu'on les élimine], et je recommençai encore la reprise individuelle [dérivation copiée comme d'habitude, dans quelque feuille de chou, qui l'aura prise de quelque maître]. Mais pas plus de chance que la première fois. Au bout de trois ou quatre mois, j'étais encore pris. Je fus condamné à deux mois ». Il raconte comment il connut les anarchistes et partagea leurs théories. « Mon opinion fut vite formée, je devins comme eux [c'est-à-dire qu'il trouva cette expression pour des sentiments qui préexistaient en lui], je ne voulus plus du tout aller travailler pour d'autres, je voulus aussi travailler pour moi ; mais comment m'y prendre ? Je n'avais pas grand'chose, mais j'avais acquis un peu plus d'expérience, et plein d'énergie, résolu à me défendre contre cette meute pleine de bêtise et d'iniquité qu'est la présente société [dérivation semblable à celle employée par les maîtres, quand ils disent vouloir préparer « une humanité meilleure, avec un peu plus de justice ». C'est pourquoi ils voudraient que les Garniers les élisent députés ; et les Garniers trouvent plus expéditif et plus raisonnable de réaliser directement ce un peu plus de justice]. « Je quittai Paris vers dix-neuf ans et demi, car j'entrevoyais avec horreur le régiment [à un être de cette trempe, la discipline militaire répugne encore plus que la discipline civile]. Peut-être cette masse inconsciente et fourbe changera-t-elle ; peut-être ! Je l'espère, mais moi je ne veux pas me sacrifier pour elle : c'est maintenant que je suis sur la terre, c'est maintenant que j'ai le droit de vivre, et je m'y prendrai par tous les moyens que la science [le dieu de sa religion] met à ma disposition... À la ruse, je répondrai par la ruse ; à la force, je répondrai par la force ». Il raconte diverses aventures de délinquant, en Belgique. Recherché par la police à Bruxelles, il retourne à Paris, « où j'allai m'installer au journal l'Anarchie, pour lequel je me mis à l'œuvre. J'y travaillai presque tous les jours, et comme l'ordinaire était un peu maigre, je fis, en compagnie de quelques camarades, une quantité de cambriolages, mais cela ne rapportait pas beaucoup. Je fis l'émission de fausse monnaie, mais cela ne rapportait pas beaucoup, et je risquais autant que d'aller faire un cambriolage, qui me rapportait plus. [Messieurs les humanitaires peuvent dire ce qu'ils veulent ; mais il est évident que si l'on éliminait ces gens de la société, on mettrait un terme à leurs exploits ; tandis que la douceur de la répression leur permet de les continuer] ». Il s'associe à d'autres et raconte de nombreux cambriolages faits en leur compagnie. « ... En septembre, octobre, pendant ces deux mois, le principal cambriolage fut celui du bureau de poste de Chelles,... qui nous rapporta 4000 francs, et quelques autres de moindre importance. Enfin vers le commencement de novembre, nous en faisions encore un à Compiègne, qui nous rapporta 3500 francs ». Garnier s'unit à Bonnot, apprend à conduire les automobiles. Il raconte le premier gros coup : il tue un huissier qui portait l'argent d'une banque. « Arrivé à trois pas environ du garçon, je sors mon revolver et froidement je tire une première balle, puis une deuxième ; il tombe, pendant que celui qui l'accompagne s'enfuit en courant, transi de peur. Je ramasse un sac, mon copain en ramasse un autre que cet imbécile ne veut pas lâcher, car il n'est pas tué ; mais il finit par lâcher prise, car il perd connaissance ». Les humanitaires pleurent les pauvres malheureux tels que Garnier... mais ils ne s'occupent pas du tout de leurs victimes. Dans son numéro du 6 juillet, le Matin rapporte la suite de ces mémoires, où sont racontés beaucoup d'autres crimes qu'il est inutile de mentionner ici. Voyons seulement comment il tue un pauvre diable de chauffeur. « ... je ramassai un gros morceau de bois... et j'en frappai un formidable coup sur la tempe gauche du chauffeur qui tomba à terre sans pousser un cri. Il était mort ou peu s'en fallait. Pour ne pas qu'il reprenne ses sens quelquefois, un copain va chercher un cric qui pèse 60 kilogrammes et lui pose cet objet sur la poitrine, et quelques minutes après le corps ne bouge plus, il est mort ». M. Anatole France vend beaucoup de livres où il démontre que ces assassins sont... malheureux (§ 1638-1). Il est bon de noter ensemble les sentiments exprimés par Garnier et ceux des gens qui achètent ces livres et s'en repaissent.
[FN: § 1142-1]
La Liberté, 8 mai 1912 : « Dans un pavillon situé au milieu d'un jardin, 8 rue de Bagneux, à Sceaux, habite une rentière, Mme Herbuté de Bute, âgée de 51 ans, qui, sourde et à moitié aveugle, y vit seule. Elle passait pour avoir quelque fortune, et une de ses anciennes domestiques l'apprit au mécanicien Gabriel Gaugnon, âgé de 18 ans, habitant Fontenay-aux-Roses. Gaugnon résolut de la dévaliser et il proposa à ses camarades Fernand Le Bas, 17 ans, habitant Bourg-la-Reine, et Fernand Léard, 21 ans, habitant Sceaux, de l'accompagner. Ils acceptèrent. Le 10 janvier dernier, Léard se présenta chez Mme Herbuté, se disant employé d'un grand épicier parisien et proposant une livraison. Léard constata que la dame était sourde et il avertit ses deux complices. Tous trois revinrent le lendemain, 11 janvier, à 6 heures du soir, Léard enfonça la porte de clôture du jardin, fermée à clef ; puis, avec l'aide de Gaugnon, enfonça la porte de la maison. Le Bas resta dehors pour faire le guet et les deux jeunes gens pénétrèrent à l'intérieur de l'habitation. Mme Herbuté lisait son journal dans sa chambre à coucher ; elle n'entendit aucun bruit. Brusquement, Léard l'empoigna au cou et s'efforça de la maintenir et d'étouffer ses cris tandis que Gaugnon fouillait les divers meubles de la chambre. Mais Mme Herbuté tenta de se dégager ; elle tomba sur les genoux et parvint à tirer de sa poche un poignard dont elle chercha à frapper Léard qui s'écarta instinctivement. La quinquagénaire put alors se sauver et s'emparer d'un revolver. Cependant, s'étant rendue dans le jardin, elle y fut saisie par Le Bas, qui la jeta et la maintint à terre. Mme Herbuté ne perdit point son sang-froid ; elle tira un coup de revolver dans la direction de Le Bas, tout en criant au secours ! Les trois malandrins furent arrêtés peu après et, cet après-midi, ils ont comparu devant la Cour d'Assises de la Seine. Tous trois ont fait des aveux complets et Mme Herbuté de Bute, entendue comme témoin, a réclamé l'indulgence du jury en leur faveur. Le jury, à la stupéfaction générale, rapporte un verdict négatif. Les trois malandrins sont acquittés... Ce verdict n'est ahurissant qu'en apparence. Il s'explique, d'un côté, par la terreur que répand encore la bande Bonnot-Garnier et ses vengeurs, car il est malheureusement trop certain que jusqu'à présent ce sont surtout ceux qui devraient être exécutés qui exécutent. D'autre part, les jurés assez lâches pour avoir peur trouvent encore une excuse dans ce fait que la législation répressive et pénitentiaire, en ces dernières années, s'est inspirée uniquement de la sympathie croissante dont jouissent auprès du régime les anarchistes et les malandrins, d'où cette conclusion, en somme assez logique, que le : „ Soyez bons pour les animaux “ Il est une consigne humanitaire conforme aux indications d'en haut. Enfin, troisième facteur essentiel, la politique du : „ Pas d'ennemis à gauche ! “ ayant aussi sévi contre l'institution du jury dans le sens d'une adjonction des incapacités, a doté les Cours d'Assises de jurés nouveaux et, parmi ces prolétaires conscients, il en est sans doute qui ne sont pas loin d'admirer Bonnot dont l'unifié Hervé a fait un professeur d'énergie... » – La Liberté, 9 mai 1912 : « Le jury de la Seine a acquitté hier trois jeunes cambrioleurs particulièrement distingués qui, un soir de janvier dernier, après s'être introduits par effraction dans la petite maison où vivait seule une vieille rentière de Sceaux, sourde et à moitié aveugle, ont fait de leur mieux pour la supprimer afin de la dévaliser. S'ils n'ont pas réussi dans cette double et louable entreprise ce n'est assurément pas leur faute, mais parce que la victime a eu le mauvais goût de ne pas se laisser chouriner sans pousser les hauts cris. Les jurés, cependant, ont décidé qu'il était bon et juste de rendre ces doux adolescents à la liberté de leurs chères études sur le vol et l'assassinat. Stupéfaction générale ! Les avocats eux-mêmes n'en sont pas encore revenus et, sans doute, leurs clients en reviendront encore moins..., sauf un jour prochain, entre deux autres gendarmes, et, cette fois ayant grandi, ils n'auront pas raté leur coup ».
[FN: § 1148-1]
TACIT.; Germ., 14: lam vero infame in omnem vitam ac probrosum superstitem principi suo ex acie recessisse. Des sentiments analogues régnaient à Sparte, entre les citoyens. C'était une honte que de revenir seul vivant, quand ses compagnons avaient été tués. – HÉRODOTE, VII, 229, rapporte comment deux Spartiates, Euritos et Aristodémos, furent renvoyés par Léonidas, des Thermopyles à Sparte, parce que, gravement malades des yeux, ils s'arrêtèrent à Alpéné. La nouvelle étant parvenue que les Spartiates étaient entourés par les Perses, Euritos se fit conduire par son ilote au champ de bataille et mourut en combattant. Aristodémos resta à Alpéné. D'autres disent que tous les deux avaient été envoyés en mission, que l'un revint promptement et que l'autre s'attarda. « (231) Rentré à Lacédémone, Aristodémos fut noté d'infamie et d'ignominie ». – PLUTARCH. ; Lacaenarum apopht., 21 : « Un homme racontait à sa sœur comment le fils de celle-ci était mort glorieusement. Elle répondit : „ Je suis heureuse pour lui, autant que j'éprouve de douleur à cause de toi qui as abandonné cette vertueuse compagnie „ – Ibidem, 5 : « Un homme racontait à sa mère comment son frère à lui était mort glorieusement. „ N'as-tu pas honte –lui dit-elle – d'avoir abandonné une telle compagnie ? „ ». HÉRODOTE, V, 87, rapporte encore comment un seul homme, revenu d'une expédition des Athéniens, à Égine, arrivé à Athènes, fut tué par les femmes des morts, « indignées que seul d'entre tous, il se fût sauvé » : ![]()
![]() Que tout cela soit de l'histoire ou de la légende, peu importe, étant donné le but auquel nous visons : simplement mettre en lumière certains sentiments.
Que tout cela soit de l'histoire ou de la légende, peu importe, étant donné le but auquel nous visons : simplement mettre en lumière certains sentiments.
[FN: § 1152-1]
Ce terme, maintenant d'un usage courant, ne sera peut-être plus compris, dans quelques années. Il est donc bon de savoir qu'en France, M. Clemenceau ayant publié un journal intitulé : Le Bloc, dans lequel il prêchait à tous les « républicains » de se resserrer comme en un bloc, pour s'opposer aux réactionnaires, il fut singé, dans son pays et en Italie, par de braves gens qui s'associèrent pour grimper au gouvernement de la chose publique, et en cueillir les fruits savoureux.
[FN: § 1152-3]
A. FRADELETTO; Dogini ed illusioni della democrazia « (p. 35) Aujourd'hui, nous assistons aux palinodies imprévues qui – voyez quel singulier concours de circonstances ! – ne coïncident jamais avec un sacrifice ou un péril, mais toujours ou presque toujours avec une fortune ébouriffante. Tel qui poussait récemment des cris séditieux, pour pouvoir se lancer dans la vie publique aux applaudissements des révolutionnaires, donne des avis prudents, afin de réussir à la diriger par le vote des conservateurs... (p. 37) Mais plus stupéfiante encore pour les naïfs doit être la volte-face collective, le rayon de grâce qui illumine subitement une assemblée et la convertit. Ici, la documentation est proche, dans le temps et dans l'espace. Domestica facta. Avant le 6 avril 1911, combien étaient, au Parlement italien, les partisans du suffrage universel ? La réforme proposée par le ministre Luzzatti, fondée sur la preuve donnée qu'on sait lire et écrire, et qui aurait étendu le droit de vote à un peu plus d'un million de nouveaux électeurs, avait paru à un très grand nombre prématurée, intempestive, non souhaitée par le pays, fruit d'une concession dangereuse aux partis extrêmes. Après le 6 avril, après le coup de grâce de quelques phrases du chef du gouvernement, les dévots du suffrage universel deviennent légion (p. 38), et parmi les plus ardents néophytes, se trouvent ceux qui repoussaient la. réforme prudente de M. Luzzatti. Mais il y a plus. En été 1910, durant la discussion de la loi Daneo-Credaro, l'analphabétisme était solennellement proclamé notre pire plaie, notre honte, notre fléau [le lecteur prendra garde qu'il n'est pas du tout démontré que ceux qui exprimaient ces opinions eussent raison], notre titre permanent de discrédit, en présence des étrangers. Deux ans plus tard, durant la discussion de la nouvelle loi électorale, nous entendîmes, à certains moments, une espèce d'hymne idyllique à l'analphabétisme, considéré tout à fait par quelques-uns comme une présomption de bon sens instinctif, non entaché de culture fragmentaire [le lecteur prendra garde qu'il n'est pas du tout démontré que ceux qui exprimaient ces opinions eussent tort] ».
La raison de ce phénomène est très simple. Elle a été donnée par Sir Edward Grey, à propos d'un phénomène parfaitement semblable, qui est celui de la politique extérieure. Le 1er août 1918, il fut accablé de questions aux Communes, à propos des affaires balkaniques. On lui demanda s'il existait un principe quelconque du droit des gens, qui interdisait à la Turquie de dénoncer le traité de paix et de reprendre Andrinople et la Thrace. Le ministre répondit que non. On lui rappela qu'au début de la guerre balkanique, les puissances avaient très gravement déclaré que, quelle que fût l'issue de la guerre, le statu quo territorial devait absolument être maintenu dans les Balkans ; et on lui demanda si les puissances avaient d'autres raisons que celles des victoires des alliés, pour démentir leur déclaration solennelle. Le ministre répondit qu'effectivement il n'y avait pas d'autre motif. Suivirent beaucoup d'autres questions qu'il est inutile de rappeler ici. En fin de compte, Sir Edward Grey eut un moment de vraie franchise et dit : « Toutes ces questions paraissent dictées par la supposition que l'action des puissances est réglée par la logique et le droit des gens. Au contraire, chaque puissance suit la voie qui lui est conseillée par ses intérêts spéciaux ; et toutes, collectivement, sont unies par le désir de maintenir la paix en Europe ». Pourtant sa franchise n'alla pas jusqu'à rappeler les puissants intérêts financiers qui guidaient tous les États, unis ou séparés.
Cette longue note peut se résumer en peu de mots : BEAUMARCHAIS ; Le barbier de Séville, acte IV, scène VIII. Don Bartholo s'étonne que Bazile ait exécuté une volte-face tout à fait semblable à celles qui viennent d'être relevées « Bartholo. Comment, Bazile ! vous avez signé. – Bazile. Que voulez-vous ? Ce diable d'homme a toujours ses poches pleines d'arguments irrésistibles ».
[FN: § 1156-1]
Parmi un très grand nombre de faits où l'on voit des particularités insignifiantes donner de l'autorité et du respect, il suffira de citer le suivant: LANDOR ; Voyage... L'auteur fut fait prisonnier au Thibet et allait être tué, quand il fut sauvé par une disposition particulière des doigts de ses mains « (p. 228) Le Lama... examina mes mains et écarta mes doigts, en exprimant une grande surprise. En un instant tous les lamas et les soldats vinrent tour à tour examiner mes mains... Le Pombo lui-même, ayant été informé, vint regarder mes doigts, et toutes les opérations furent immédiatement suspendues. Lorsque je fus relâché, quelques semaines plus tard, je pus apprendre des Thibétains la raison de leur étonnement. J'ai les doigts liés plus haut que ce n'est le cas chez la plupart des gens. Cela est très considéré au Thibet ; un charme règne sur la vie d'un possesseur de doigts pareils ; quoi qu'on lui fasse, il ne lui arrivera aucun mal ».
[FN: § 1158-1]
MACHIAVEL ; La Mandragore, acte II, scène II – « Callimaque... Nam causae sterilitatis sunt, aut in semine, aut in matrice... aut in causa extrinseca ». « Nicias. Cet homme est le plus respectable qu'on puisse trouver ». Si Callimaque s'était exprimé en langage vulgaire, Messire Nicias, qui sait aussi le latin, n'aurait pas consenti avec une si vive admiration.
[FN: § 1158-2]
Les Gr. chr. de Fr., t. I, préface de PAULIN PARIS. Après avoir relevé que la chronique fabuleuse du pseudo-Turpin fut la première à être traduite en français, l'auteur observe que : « (p. XV)... nul ne s'avisa d'en contester l'authenticité. Il nous est aujourd'hui bien aisé de le faire ; comment, disons-nous, serait-elle sincère, quand les historiens précédents n'en parlent pas, quand les contemporains de Charlemagne racontent les faits d'une manière toute différente et tout autrement vraisemblable ? Mais personne alors, dans le monde, ne connaissait ces historiens contemporains ; on ne savait qu'une chose ; c'est que la chronique de Turpin était rédigée dans la langue latine, et cela suffisait pour justifier la confiance des plus scrupuleux ». Dans une autre dissertation, t. II, il dit : « (p. x)... quand le monument des Grandes Chroniques de Saint-Denis fut érigé, tout ce qui était écrit dans un latin de quelque antiquité avait, par cela seul, droit à la crédulité de tout le monde ». DAVIS ; La Chine, t. II : « La visite du dieu du foyer à Yu-Kong, trad. de ST. JULIEN ». Le dieu fait des reproches à Yu-Kong. qui disait avoir suivi avec respect les règles qui lui étaient tracées: (p. 370)... parmi ces préceptes, il en est un qui commande de respecter les caractères écrits, et cependant vos élèves et vos condisciples se servent souvent des feuillets de livres anciens pour revêtir les murs de leur chambre et faire des enveloppes. Il y en a même qui les emploient à essuyer leur table. Puis, ils s'excusent en disant que, s'ils salissent ce papier (p. 371), ils le brûlent immédiatement. Cela se passe tous les jours sous vos yeux, et cependant, vous ne leur adressez jamais une parole pour les en empêcher. Vous même, si vous trouvez dans la rue un morceau de papier écrit, vous le rapportez chez vous et vous le jetez au feu ».
[FN: § 1159-1]
BLACKSTONE ; 1. IV, c. 28.
[FN: § 1160-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Le souci que l'individu a de sa réputation est un degré de ce sentiment. Il ne faut pas le confondre avec l'honneur, qui appartient à la Ve classe (intégrité de l'individu et de ses dépendances). Tandis que la réputation est l'opinion qu'autrui a de l'individu en question, l'honneur est l'opinion que cet individu a lui-même de sa propre personne. Il va sans dire que nous n'insistons pas sur la terminologie, qui n'a aucune importance, mais sur la distinction entre les deux sentiments.
[FN: § 1164-1]
MONTET : De l'ét. pr. et de l'av. de l'Islam : « (p. 59) On a observé que si le musulman qui aspire à devenir marabout cherche à se faire remarquer par son ascétisme, une fois proclamé saint, il se relâche assez aisément de ses actes de continence, qui n'ont eu qu'un but, lui servir d'échelle à la dignité de marabout. On cite pourtant des saints ayant pratiqué ou pratiquant l'ascétisme et la continence... (p. 60) Et comme la licence des mœurs a plus d'une fois servi de compagne à l'austérité la plus rigoureuse, ainsi qu'on en voit des exemples dans les religions les plus diverses... Il y a donc des saints obscènes, des saints impudiques, des saints débauchés. Des témoins authentiques ont raconté leurs frasques et leurs scandales publics... Il y a enfin... des degrés dans la sordidité (p. 61) et la saleté. Il n'est pas rare de rencontrer des marabouts mal vêtus ou malpropres ; il en est d'autres qui se font un mérite de leurs souillures. C'est à ce groupe que se rattachent les saints pouilleux, circulant à moitié nus, vêtus de loques sordides et affectant le plus grand mépris pour les biens de ce monde... Saints continents, saints ascètes, saints antinomiens forment, comme il est aisé de l'imaginer, une armée véritable dans l'Islam ». FRASER: Voyage dans les provinces persanes, dans Biblioth. univ. des voy., t. 35 : « (p. 355)... j'eus une autre visite. C'était un derviche encore que j'avais rencontré la veille dans la rue, et qui m'avait fait entendre qu'il me connaissait ; j'avais donc désiré le voir: il me (p. 356) raconta alors qu'il était né à Schiraz, mais que, paresseux de sa nature, il avait pris goût à une vie d'errante oisiveté pour éviter les misères du travail, et il se trouvait forcé de vivre de son esprit. Il avait beaucoup vu de monde, et ayant découvert qu'il était facile et profitable de le duper, il mettait en œuvre, dans la portée de ses talents, ce que l'expérience lui avait appris... Mon ami, le derviche, était donc devenu tout à fait communicatif quand Zeïn-el-Abedin et quelques autres personnes entrèrent par malheur, et il retomba tout à coup dans son jargon et ses grimaces : (p. 357) une conversation mystique s'ensuivit... » Les Pères de l'Église se plaignaient souvent de ce qu'il y eût des moines qui usurpaient l'apparence de l'ascétisme pour duper les gens. Cassien, qui vivait au IVe siècle, en forme tout un genre, qu'il appelle le quatrième genre des moines, et dit qu'il est apparu depuis peu. CASS. ; Collat., XVIII. 8. – Saint Nilus ; De monastica exercitatione, VIII, en parle aussi. Il dit qu'ils fuient la discipline des monastères, qu'ils ne peuvent supporter, et que, comme des parasites, ils assiègent les riches.
[FN: § 1166-1]
Il ne sera peut-être pas inutile de répéter, en ce cas particulier, une observation qui est de portée générale. Nous ne cherchons pas « ce qu'est l'ascétisme » (§ 118) ; nous cherchons s'il y a un genre de faits présentant certains caractères communs, et auquel nous donnerions ce nom uniquement par analogie ; car, parmi ces faits, il s'en trouve que le langage vulgaire appelle ascétisme. De même, le botaniste cherche, non pas « ce que sont les renonculacées », mais s'il y a un groupe de plantes présentant certains caractères communs, et auxquelles il donne le nom de renonculacées, parce que, parmi elles, se trouve la plante nommée vulgairement renoncule. Mais il pourrait tout aussi bien désigner le genre par un autre nom quelconque.
[FN: § 1168-1]
Dom J. M. BESSE: Les moines d'orient : « (p. 48) Il y eut en Orient un genre de vie monastique beaucoup plus extraordinaire encore... Ses adeptes, unis par un sentiment d'humilité (p. 49) profonde, contrefaisaient la folie. L'abbé Or semble inciter l'un de ces disciples à pousser jusque-là le mépris du monde. « Éloigne-toi par la fuite de la société des hommes, disait-il : moque-toi du monde et de ceux qui suivent ses maximes, en te montrant fou sur plusieurs points » Il y eut à Tabenne une moniale que tout le monde prenait pour une folle. Ses compagnes ne lui ménageaient guère les mauvais traitements. Jamais cependant elle ne laissa échapper une parole d'impatience, donnant à tous les plus beaux exemples d'humilité et de charité. Aussi arriva-t-elle à une éminente sainteté. Ce n'est là qu'un fait isolé. Mais dans le siècle suivant on vit en Palestine plusieurs moines qui contrefaisaient la folie. C'était en règle générale des hommes avancés en âge et d'une vertu consommée. Ils donnaient à l'oraison un temps considérable et aimaient à soigner les infirmes et les pèlerins. L'austérité de leur vie leur conciliait l'estime générale ». On remarquera que ceux-ci étaient ascètes pour eux-mêmes, tandis que nos dominicains de la vertu, non moins dépourvus de sens, veulent imposer leur folie à autrui, par l'amende et la prison.
[FN: § 1172-1]
En tout temps, on releva dans la littérature des contrastes semblables. Dorens, qui vivait sous Louis XIII, écrivit dans une satire :
Gardez-vous bien de lui les jours qu'il communie.
Tout le monde connaît les vers que Molière met dans la bouche d'Orgon, converti par Tartufe, acte I, sc. VI :
Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien ;
De toutes amitiés il détache mon âme :
Et je verrois mourir frère, enfans, mère et femme,
Que je m'en soucierois autant que de cela.
De même, un grand nombre de femmes humanitaires contemporaines emploient leurs journées au relèvement des prostituées plus ou moins assagies, des voleurs plus ou moins corrigés, ou à d'autres œuvres semblables, tandis qu'elles ne se soucient pas de raccommoder le linge, ni de nettoyer les vêtements de leur mari et de leurs enfants, auxquels, par incurie, elles offrent, sur la table de famille, des mets dont les chiens même ne se contenteraient pas. – Sorberiana, s. r. Dévot : « (p. 96) Il n'y a rien plus à craindre qu'un dévot irrité ; c’est un animal fort colérique et vindicatif, parce qu'il estime que Dieu lui doit de retour, que la Religion est blessée en sa personne, et que ses fureurs sont divines ». On peut répéter exactement la même chose de notre humanitaire contemporain. Rien n'égale les fureurs de cet « animal », quand il croit qu'on a offensé en lui le Progrès, la Démocratie ou la Solidarité.
[FN: § 1177-1]
Des personnes qui connaissent bien certains cas particuliers peuvent pour ceux-ci nous donner au moins quelque idée de cette classification, ROMOLO MURRI, dans La Voce, 7 décembre 1911 : « Au point de vue du célibat, le clergé d'aujourd'hui peut être divisé en trois catégories. La première comprend les prêtres auxquels une vocation d'idéalisme intense, de lutte et de sacrifice rend impossible intérieurement la vie de famille, et fait taire ou dormir profondément les sentiments charnels. Ceux-là sont peu nombreux : ils se comptent sur les doigts, dans chaque génération. La seconde comprend ceux qui acceptent le célibat comme une condition nécessaire ou supposée telle, d'une vie de piété ou du sacerdoce professionnel. Mais chez eux la piété et les aspirations religieuses ont une force suffisante pour empêcher le regret des choses auxquelles ils ont renoncé, et les maintenir dans la chasteté. Je crois que le nombre de ces prêtres n'est pas inférieur au dix pour cent ni supérieur au vingt. Les autres sont ceux qui tombent ; chez lesquels et pour lesquels le sacerdoce devient donc, au moins pendant une certaine période de leur vie, une hypocrisie et un sacrilège... »
[FN: § 1177-2]
Le Mythe vertuiste.
[FN: § 1178-1]
On peut répéter ce que nous disons ici de l'ascétisme, pour un très grand nombre d'autres cas de phénomènes concrets, dépendant d'autres résidus.
[FN: § 1179-1]
DIOG. LAERT. : VI, c. 2, 26 : Foulant les tapis de Platon, un jour que celui-ci avait invité des amis de Denys, Diogène dit : « Je foule aux pieds la vanité de Platon ». À cela Platon répondit : « Combien, ô Diogène ! tu laisses entrevoir de fumée d'orgueil, en voulant te faire voir sans orgueil ». D'autres rapportent que Diogène dit : « Je foule le vain orgueil de Platon », et que Platon répondit : « Avec, un autre vain orgueil, Diogène ».
[FN: § 1180-1]
HEBER, dans Bibl., univ. des voy., t. 36 « (p. 38)... j'ai vu un jour un grand et beau vieillard presque nu, qui portait l'écharpe distinctive des prêtres de Brahma, se promener avec trois ou quatre autres personnes, et celles-ci s'arrêtant soudain, s'agenouiller l'une après l'autre pour lui baiser révérentieusement le pied. Le prêtre d'un air fort grave, suspendit sa marche pour les laisser faire, et ne prononça pas un seul mot. Une autre fois, dans la rue, près de moi passa un homme qui allait à cloche-pied, et je le perdis de vue avant qu'il eût posé à terre son second pied. J'appris que cet individu avait, quelques années auparavant, fait vœu de ne plus jamais se servir que du pied gauche ; et son autre jambe avait si bien pris le pli nécessaire qu'il ne pouvait plus l'étendre pour faire usage du pied droit. On me montra un (p. 39) dévot du même genre qui tenait ses mains au-dessus de sa tête, et qui avait ainsi perdu la possibilité de baisser les bras. Enfin, à la fête de Churruck-Poujah, les Hindous courent la ville en procession, précédés par une troupe de musiciens, couronnés de fleurs, leurs longs cheveux tombant sur les épaules, la langue et les bras transpercés de petites broches, surtout appuyant contre leurs flancs des barres de fer rouge. De temps en temps, lorsqu'ils passaient devant des chrétiens ou des musulmans, ils faisaient mine de vouloir danser ; mais en général leur démarche était lente, leurs visages exprimaient une patiente résignation à souffrir, et ils n'avaient aucunement l'air de gens qui fussent ivres ou privés de raison ». La cérémonie finit par un supplice volontaire que l'auteur décrit ainsi : « (p. 39) La victime, je parle du héros de la fête, fut conduite le sourire sur les lèvres au pied de l'arbre. Là des crocs suspendus au bout d'une corde qui se rattachait à une des extrémités de la poutre transversale, lui furent enfoncés dans les flancs, ce qu'il endura sans proférer la moindre plainte, et un large bandage fut noué (p. 40) autour de sa ceinture pour empêcher que la pesanteur de son corps n'en fît sortir les crocs. Puis, au moyen d'une seconde corde liée à l'autre extrémité de la poutre, et que saisirent deux hommes vigoureux, on l'éleva en l'air et on le fit tourner. Le mouvement fut d'abord lent, mais peu à peu il devint extrêmement rapide. Toutefois il cessa après quelques minutes, et les spectateurs se préparaient à détacher le patient lorsqu'il pria d'un signe qu'on le laissât continuer. Cette résolution fut accueillie par la foule avec de grands applaudissements, et après avoir bu quelques gouttes d'eau il recommença ses tours. Mais... ces cruelles absurdités sont moins fréquentes à Calcutta qu'on ne s'est plu à le dire ». Dom J. M. BESSE ; Les moines d'Orient : « (p. 496) Parmi les privations que s'imposaient quelques solitaires, saint Épiphane signale l'abstention des bains... Il y en eut qui allaient plus loin encore, en se refusant les soins de la propreté la plus élémentaire. De ce nombre furent saint Hilarion et le reclus Abraam, qui ne se lava jamais les pieds ni le visage ». Cet homme était peut-être un grand saint, mais c'était certainement aussi un grand saligaud. Dieu veuille qu'il ne vienne pas à l'esprit de quelque émule du sénateur Bérenger, de nous imposer aussi ce genre d'austérité ! « (p. 496) Saint Pakhôme permettait d'oindre le corps entier seulement en cas de maladie. Pour rendre ce service à un frère, il fallait y être autorisé soit par ses fonctions soit par l'obéissance... Saint Ephrem recommandait à ceux qui remplissaient ce devoir de veiller attentivement sur leurs yeux, sur leurs mains et sur leur langue... (p. 497) Il y eut des religieux qui se condamnèrent à ne jamais regarder autour d'eux, pas même le mobilier de leur cellule, à passer un certain nombre de nuits dans les épines, à vivre près d'une eau infecte, etc. Ils recouraient à ces moyens pour se débarrasser des tentations importunes. Ammon, toutes les fois qu'il ressentait l'aiguillon de la chair, traitait son corps avec une sévérité impitoyable. Un de ses traitements favoris consistait à se brûler avec un fer rouge. Pour chasser une tentation impure, Macaire d'Alexandrie se jeta tout nu dans un marais. L'eau stagnante y attirait quantité de moustiques. Il y en a, dit Pallade, de gros comme des guêpes, capables de percer la peau d'un sanglier. Le saint supporta ce cilice d'un nouveau genre six mois durant. On devine en quel état fut mis son corps ; il ressemblait à celui d'un lépreux. – Quelques-uns imaginèrent de se charger de chaînes ou de pièces de bois. C'était un excellent moyen d'accabler son corps ». En occident aussi, ce genre de pénitence fut fréquent. Parmi les très nombreux exemples qu'on pourrait citer, le suivant suffira : D. GREG. TUR. ; Hist. eccl., VI, 6 : « Il y avait en ce temps, dans la ville de Nice, un reclus du nom d'Hospitius, très abstinent, qui chargé de chaînes de fer sur son corps nu, et recouvert par dessus d'un cilice, ne se nourrissait de rien d'autre que de simple pain et de quelques dattes... » Les envahisseurs longobards en le voyant ainsi, au fond d'une tour, pensèrent que c'était un malfaiteur. L'un d'eux voulut le tuer ; mais son bras resta paralysé et ne guérit qu'après que le saint homme eut fait dessus le signe de la croix.
[FN: § 1180-2]
BURCKHARDT ; dans Bibl. des voy., t. 32. L'auteur parle des dévots hindous qui assiègent un mendiant, ceux qui font le pèlerinage de la Mecque (hadji) : « (p. 199) Les portes de la mosquée sont assiégées par eux, et chaque café ou chaque fontaine est leur station : un hadj ne peut rien acheter dans les marchés sans être importuné par les sollicitations des Indiens qui demandent leur part. Je vis parmi eux un de ces dévots si communs dans le nord de l'Inde et dans la Perse ; il tenait un de ses bras droit au-dessus de la tête, et la longue habitude l'avait fixé dans cette position au point qu'il ne pouvait en prendre une autre ». – LAFITAU ; Mœurs des sauvages, t. II : « (p. 274) Le supplice des Esclaves chez les Nations de l'Amérique Septentrionale, que nous connoissons, est de les brûler à petit feu. Mais cette scène se passe avec tant de circonstances d'une barbarie énorme, que la seule idée en fait frémir ». Suit la description des souffrances incroyables auxquelles sont soumis ces malheureux. « (p 280) Ainsi finit cette sanglante tragédie, pendant laquelle je ne sçais ce qu'on doit admirer davantage, ou l'excès de la brutale férocité de ces inhumains, qui traitent avec tant de cruauté de pauvres Esclaves... ou bien la constance de ces mêmes Esclaves, lesquels, au milieu des tourmens les plus affreux, conservent une grandeur d'âme et un héroïsme, qui a quelque chose d'inimaginable ». Tandis qu'ils sont brûlés, torturés de mille manières, les prisonniers « (p. 284) chantent leurs hauts-faits d'armes, et ceux de leur Nation ; ils vomissent mille imprécations contre leurs tyrans, ils tâchent de les intimider par leurs menaces : ils appellent leurs amis à leur secours pour les venger ; ils insultent ceux qui les tourmentent, comme s'ils ne sçavoient pas leur métier ; ils leur apprennent comment il faut brûler pour rendre la douleur plus sensible ; ils racontent ce qu'ils ont fait eux-mêmes à l'égard des prisonniers, qui ont passé par leurs mains ; et si par hazard il s'est trouvé entre ces prisonniers quelqu'un de ceux de la Nation qui les fait mourir, ils entrent dans le détail le plus exact de tout ce qu'ils leur ont fait souffrir, sans craindre les suites d'un discours, lequel ne peut qu'aigrir extrêmement ceux qui l'écoutent... (p. 285) Dans le fort des tourmens, lors même que (p. 286) l'excès de la douleur les fait écumer, et paroître comme des forcenés, il ne leur échappe pas une parole de lâcheté. Les femmes ont cet héroïsme aussi bien que les hommes. J'en ai vû une à qui on arracha deux ongles en ma présence... elle ne jetta pas un cri, ni un soupir, et je ne remarquai sur son visage qu'une légère marque d'ennui. Il s'en trouve qui ne font que rire pendant leur supplice ; qui s'y prêtent agréablement, et qui remercient de bonne grâce ceux qui leur ont fait le plus de mal ». « (p. 280) Les Sauvages... semblent se préparer à cet évenement [le supplice des prisonniers dès l'âge le plus tendre. On a vû des enfants accoller leurs bras nuds l'un contre l'autre, mettre entre deux des charbons ardents, se défiant à qui soûtiendroit la gageure avec plus de fermeté, et la soutenir avec constance. J'ai vû moi même un enfant de cinq à six ans, dont le corps avoit été brûlé par un accident funeste d'eau bouillante répandue sur lui, qui toutes les fois qu'on le pançoit, chantoit sa chanson de mort avec un courage incroyable, quoiqu'il souffrit alors de très-cuisantes douleurs ».
[FN: § 1181-1]
SONNERAT; Voyage... t. I : « (p. 256) Le Saniassi [ou Sanachi] est ou Brame ou Choutre : il se dévoue entièrement à la divinité ; les vœux qu'il fait sont d'être pauvre, chaste et sobre ; ne possédant rien, ne tenant à rien ; il erre de tous côtés, presque nud, la tête rasée, n'ayant qu'une simple toile jaune qui lui couvre le dos ; il ne vit que d'aumônes et ne mange que pour s'empêcher de mourir ». C'est là un type commun dans un grand nombre de sociétés. « (p. 256) Les Pandarons ne sont pas moins révérés que les Saniassis. Ils sont de la secte de Chiven, se barbouillent toute la figure, la poitrine et les bras avec des cendres de bouze de vache. Ils parcourent les rues, demandent l'aumône, et chantent les louanges de Chiven, en portant un paquet de plumes de paon à la main... (p. 257) Le Caré Patrépandaron est une espèce de Pandaron ; il fait vœu de ne plus parler [cfr. les Trappistes] ; il entre dans les maisons et demande l'aumône en frappant des mains sans rien dire... Son nom est significatif : Caré veut dire main, et Patré, assiette... (p. 258) Le Tadin va mendier de porte en porte en dansant et en chantant les louanges et les métamorphoses de Vichenou... (p. 260) Enfin les Indiens ont des religieux Pénitens... ils sont chez les Gentils, ce que les Fakirs sont chez les Mogols ; le fanatisme leur fait tout abandonner, biens, famille, etc., pour aller traîner une vie misérable... les seuls meubles qu'ils puissent avoir sont un Lingam, auquel ils offrent (p. 261) continuellement leurs adorations, et une peau de tigre sur laquelle ils se couchent. Ils exercent sur leur corps tout ce qu'une fureur fanatique peut leur faire imaginer : les uns se déchirent à coups de fouet [cfr. la discipline des catholiques], ou se font attacher au pied d'un arbre par une chaîne que la mort seule peut briser ; d'autres font vœu de rester toute la vie dans une posture génante, telle que de tenir les poings toujours fermés, et leurs ongles, qu'ils ne coupent jamais, leur percent les mains par succession de tems ; on en voit qui ont toujours les bras croisés sur la poitrine, ou bien les mains élevées au-dessus de la tête, de sorte qu'il ne leur est plus possible de les plier... Plusieurs s'enterrent et ne respirent que par une petite ouverture... quelques-uns moins fanatiques se contentent de s'enterrer seulement jusqu’au col. On en trouve qui ont fait vœu de rester toujours debout sans se coucher ; ils dorment appuyés contre une muraille ou contre un arbre, et pour s'ôter les moyens de dormir commodément, ils s'engagent le col dans de certaines machines qui ressemblent à une espèce de grille... D'autres se tiennent des heures entières sur un seul pied les yeux fixés sur le soleil... quelques-uns pour avoir plus de mérite se tiennent un pied en l'air, et ne s'appuient de l'autre que sur l'orteil, ayant de plus les deux bras élevés, ils sont placés au milieu de quatre vases pleins de feu, et contemplent le soleil avec des yeux immobiles. Il y en a qui paroissent tout (p. 262) nuds devant le peuple, et cela pour lui montrer qu'ils ne sont plus susceptibles d'aucune passion, qu'ils sont rentrés dans l'état d'innocence, depuis qu'ils ont abandonné leur corps à la Divinité. Le peuple persuadé de leur vertu, les regarde comme des saints [phénomène général chez un grand nombre de peuples], et pensent qu'ils obtiennent de Dieu tout ce qu'ils lui demandent : chacun croyant faire une œuvre très-pieuse, s'empresse de leur porter à manger [autre phénomène général], à mettre les morceaux dans la bouche de ceux qui se sont interdits l'usage de leurs mains, et à les nettoyer ; quelques femmes vont jusqu'à baiser leurs parties naturelles et à les adorer, tandis que le Pénitent est dans un état de contemplation... (p. 262) Le caractère de ces Pénitens est d'avoir un grand fond d'orgueil, d'être pleins d'estime d'eux-mêmes, et de se croire des saints. Ils évitent surtout d'être touchés par les gens de basse Caste et les Européens, de crainte d'être souillés ; ils ne laissent même pas toucher leurs meubles : si on s'approche d'eux ils s'éloignent aussitôt. Ils ont un souverain mépris pour tous ceux qui ne sont pas de leur état, et les regardent comme profanes ; ils n'ont rien sur eux qui ne passe pour renfermer quelque mystère, et qui ne soit digne d'une grande vénération ».
[FN: § 1182-1]
H. KERN ; Hist. du bouddh., t. II : « (p. 3) C'est un de ses devoirs les plus stricts de rester absolument chaste ; défense de toucher, de regarder une femme, s'il y a danger pour sa chasteté. Il doit s'efforcer sérieusement de dominer sans cesse sa langue, son estomac et ses mains. Le jeu, les travaux serviles, l'appropriation d'objets qui ne lui ont pas été offerts, les mauvais traitements infligés à des êtres vivants, les paroles blessantes, tout cela lui est absolument défendu ; de même, l'usage des liqueurs fortes et du vin, du moins s'il s'agit de brahmanes. Il doit s'abstenir de sel, de miel, de viande, d'épices ; il ne doit pas dormir pendant la (p. 11) journée, ni faire usage de parfumeries, ni s'orner ou se servir d'onguents : il doit éviter en général tout ce qui pourrait être favorable à la mollesse, de même la danse, le chant et la musique instrumentale... Un des devoirs les plus caractéristiques de l'étudiant, c'est qu'il doit mendier chaque jour sa subsistance ». L'étude de chaque Vedda doit durer douze ans ; mais il suffit d'en étudier un. Ensuite l'étudiant peut retourner parmi les laïques et se marier. Il peut aussi rester étudiant toute sa vie. Le moine mendiant ou bhikshu diffère de l'étudiant en ce qu'il n'obéit pas à un maître. « (p. 5) Les règles de conduite du bhikshu peuvent être résumées ainsi : il n'a ni maison ni biens meubles ; il mène une vie errante, sauf pendant la saison des pluies, pendant laquelle il doit avoir un séjour fixe ; il mendie sa nourriture dans les villages, une fois par jour ; il doit abandonner tout désir, dominer sa langue, ses yeux, ses actions ; et observer la continence la plus absolue ; il porte un vêtement pour couvrir sa nudité, ou bien des haillons abandonnés qu'il a lavés d'abord ; il doit se raser la tête et ne porter qu'une touffe au sommet... » Il diffère peu du Franciscain. « (p. 14) On ne doit pas confondre avec les moines mendiants proprement dits, Bhikshus..., les ermites qui mènent une vie de mortification dans la solitude, afin de s'habituer au renoncement du monde, et de se préparer au Ciel [comme les ermites chrétiens]. Quoiqu'il leur soit permis de mendier leur nourriture, ils ne le font que par exception... L'ermite vit dans la forêt, se nourrissant de racines et de fruits, et pratiquant l'ascétisme... (p. 15) Les Bouddhistes possèdent un ensemble complet de règles de la vie ascétique dans les Dhutângas, au nombre de treize chez les Bouddhistes du Sud, de douze chez ceux du Nord ». Kern les résume de la façon suivante : « (p. 16) I. Porter un habit composé de haillons ramassés sur un fumier ou un tas de sable. Les moines, en général, ne suivent nullement cette règle... II. La possession de trois vêtements... III. Ne prendre d'autre nourriture que celle qu'on a reçue comme aumône... IV. En mendiant sa nourriture aller régulièrement de maison en maison, chez les pauvres aussi bien que chez les riches, sans négliger personne... V. Rester assis, pendant le repas, à la même place... VI. Ne manger que dans une seule écuelle ou pot à aumône... VII. Défense de prendre un second repas après celui de la matinée... VIII. Vivre dans la solitude... IX. Vivre au pied d'un arbre... X. Coucher à la belle étoile... XI. Vivre dans un cimetière ... XII. Passer la nuit là où l'on a été conduit par le hasard... XIII. Dormir assis... Dans la liste septentrionale... on ne trouve pas les articles IV et VI ; par contre elle a un autre article... qui prescrit l'emploi du feutre... » .
[FN: § 1182-2]
PAUL SABATIER ; Vie de Saint François d'Assise « (p. 165) Un jour frère Jean... qui avait été chargé tout spécialement d'un lépreux, l’amena en se promenant à la Portioncule, comme s'il n'eût pas été atteint d'une maladie contagieuse. – Les reproches ne lui furent point épargnés ; le lépreux les entendit, et ne put cacher son trouble et sa tristesse... François n'eut pas de peine à remarquer tout cela et à sentir de cuisants remords : la pensée d'avoir contristé un malade du bon Dieu, lui était insupportable ; non seulement il lui demanda pardon, mais il fit servir à manger, s'assit à côté de lui et puisant dans la même écuelle partagea son repas ».
[FN: § 1183-1]
RUTIL. ; Itiner., I :
(439) Processu pelagi iain se Capraria tollit.
Squalet lucifugis insola plena viris.
Ipsi se monachos Graio cognomine dicunt,
Quod soli nullo vivere teste volunt
Munera fortunae metuunt, dum damna verentur.
Quisquam sponte miser, ne miser esse queat ?
Quaenam perversi rabies tam stulta cerebri,
Dum mala formides, nec bona posse pati ?
« Comme nous avancions, déjà Capraria surgit de la mer. Cette île est infestée d'hommes qui fuient la lumière. Eux-mêmes se donnent le nom grec de moines, parce qu'ils veulent vivre seuls, sans témoins. Ils craignent les dons de la fortune, et en craignent aussi les coups. Qui se rend volontairement misérable pour éviter de l'être ? Quelle rage insensée et perverse de l'esprit est-ce donc que craindre les maux et ne pouvoir supporter les biens ? »
[FN: § 1183-2]
Luc.; De morte Peregr. : « (1) Le misérable Peregrinos, ô Protée (ainsi voulait-il être appelé), a fait comme le Protée d'Homère : étant devenu toute chose pour acquérir de la renommée, et s'étant transformé de mille façons, il est finalement devenu feu : tant il avait la manie de faire parler de lui. Et maintenant, le voilà carbonisé, le pauvre,... (2) Il me semble déjà te voir rire de ce vieillard radoteur, et déjà je t'entends t'écrier, comme tu en as l'habitude : ô sottise ! ô vaine ostentation ! et d'autres ô que nous disons habituellement, dans ces cas. Tu les dis de loin et à l'abri ; mais moi je les disais près du feu, et au milieu d'une grande multitude d'auditeurs dont plusieurs me regardaient de travers, admirant la folie de ce vieillard. Il y en avait aussi qui en riaient, mais il s'en est peu fallu que je ne fusse mis en pièces par les cyniques, comme Actéon par les chiens... »
[FN: § 1184-1],
DIOG. LAERT. VI, 23.
[FN: § 1184-2]
JACOBI A VORAGINE ; Legenda aurea, c. CXLIX, de Sancto Francisco : (p. 666) Cernens autem hostis antiquus, quia sic non praevaluit, gravem carnis tentationem eidem immisit; quod vir Dei sentiens veste deposita cordula durissima se verberat dicens : eya, frater asine, sic te manere decet, sic subire ilagellum. Sed cum tentatio nequaquam discederet, foras exiens in magnam nivem se nudum demersit accipiensque nivem in modum pilae septem glebas compingit, quas sibi proponens coepit alloqui corpus : ecce, inquit, haec maior uxor tua, istae quatuor duo sunt filii et duae filiae tuae, reliquae duae sunt servus et ancilla, festina ergo omnes induere, quoniam frigore moriuntur, si autem earum multiplex sollicitudo te molestat, uni domino sollicitus servi. Illico dyabolus confusus abscessit et vir Dei Deum glorificans in cellam rediit.
[FN: § 1184-3]
On trouve déjà dans Épictète l'équivalent du dicton : l'habit ne fait pas le moine. Epict., Diss., IV, 8, 4. « Il n'est pas facile de juger les opinions, de l'extérieur... Celui-ci est philosophe. Pourquoi ? Parce qu'il porte un manteau grossier et une longue barbe. Et les prestidigitateurs, que portent-il ? (5) C'est pourquoi, si l'on voit l'un d'eux faire une chose honteuse, on dit aussitôt : Voilà ce que fait le philosophe ! Tandis qu'on devrait plutôt dire qu'il n'est pas un philosophe, puisqu'il fait une chose honteuse ». Dans la dissertation, III, 22, Épictète oppose le vrai au faux cynique, qu'il accuse de tous les vices. – On voyait encore des cyniques, au temps où vivait Saint Augustin. D. AUG. ; De civ. Dei, XIV, 20. Et nunc videmus adhuc esse philosophos Cynicos : hi enim sunt, qui non solum amiciuntur pallio, verum etiam clavam ferunt... – Lucien blâme vivement les soi-disant philosophes, et ses scoliastes les comparent aux moines. LUC. ; Pisc., 11, dit n'avoir pas trouvé la philosophie parmi ceux qui vont, enveloppés dans des manteaux et portent de longues barbes. Le scoliaste observe qu'on peut dire la même chose des moines de son temps. – Dans les Dialogues des morts (10, 7) Hermès oblige un philosophe à déposer son vêtement, puis s'écrie : « Ô Zeus ! quelle jactance il cache dessous, quelle ignorance, quelles disputes et quelle vanité !... Et cet autre ? Oui, il y a de l'or, de la paillardise, de l'impudence, de la colère, du luxe et de la mollesse. Ne cache rien, que je voie tout... » À l'exclamation sur la jactance, le scoliaste observe qu'elle convient aux moines de son temps. LUC.; Mort. dial., 10, 8 : ![]() – Ô Zeus ! quelle jactance tu portes ». Scoliaste :
– Ô Zeus ! quelle jactance tu portes ». Scoliaste : ![]() « Cela convient à nos moines ». Une épigramme de l'Anthologie de Planude (19) plaisante à propos du mot Irène, qui, en grec, signifie paix, et qui était le nom de la concubine d'un évêque. « Irène (la paix) soit avec vous, dit l'évêque en arrivant. Mais comment peut-elle être avec tout le monde, s'il l'a chez lui pour lui seul ? »
« Cela convient à nos moines ». Une épigramme de l'Anthologie de Planude (19) plaisante à propos du mot Irène, qui, en grec, signifie paix, et qui était le nom de la concubine d'un évêque. « Irène (la paix) soit avec vous, dit l'évêque en arrivant. Mais comment peut-elle être avec tout le monde, s'il l'a chez lui pour lui seul ? »
[FN: § 1186-1]
PLIN.; Nat. hist., V, 15, 17, (trad. LITTRÉ, t. I).
[FN: § 1186-2]
FLAV. Ios. ; Ant. iud., XVIII, 1, 5.
[FN: § 1187-1]
Théodoret dit avoir vu ce saint. Voir principalement TREODORETI Religiosa historia, XXVI, Symeones. THEOD. LECT.; Eccles. hist., H. VALESIUS, II, p. 565. EVAGR.; Eccl. hist., I, 13. ANTONIUS; Vita apud ROSWEI.
[FN: § 1187-2] THEODORET. ; Relig. hist., XXVI, Symeones, pp. 1277-1278. – « Je fus non seulement présent à ses miracles, mais aussi auditeur de ses prédictions de choses futures ; car il prédit deux ans à l'avance une grande sécheresse, ainsi qu'une stérilité intense, suivie de famine et d'épidémies... »
[FN: § 1187-3] THEODORET.; loc. cit. § 1187 2, p. 1273. – Migne 1556.
[FN: § 1187-4]
BARON. ; Annal. eccles., t. VIII, ann. 1160. Note de PAG. : Garnerius in Auctario Oper. Theodoreti Dissert. II, cap. 5, examinat celebrem quaestionem de anno quo Simeon Stylita in colamnam ascendit, et de tempore quo in ea stetit, observatque Baronium tria narrare de Simeone, quae non solum cum omnibus Vitae eius Scriptoribus, et cum Theodoreto, sed et cum ipsomet Baronio pugnant. Après une longue dissertation, l'auteur conclut que Saint Siméon doit être resté environ quarante ans sur sa colonne. Avant d'y monter, il s'était enfermé dans un étroit espace muré, une grosse chaîne au pied.
[FN: § 1187-5]
BARON. ; Annal. eccles., t. VIII, ann. 460, xx : At sicut Elias Elisaeum Spiritus reliquit haeredem et virtutum imitatorem; ita Simeon Danielem monachum, quem praedictionibus et divinis visionibus ad eiusmodi angelicum arripiendum vitae institutum, adhortatus est, sibi substituisse visus est spiritualis haereditatis legitimum successorem. Paulo enim ante eius obitum idem Daniel instar Elisaei, sicut ille pallium est conseculus Eliae, ipse cucullum Simeonis per Sergium discipulum ad Leonem Imperatorem missum, sed ab illo non acceptum, accipere meruit; ita plane Divino consilio factum est, utpote quod Simeonis haeres spiritus et virtutis in editione signorum esset : accidit autem in eodem die quo idem Simeon ex hac vita decessit. Ubi vero illum Daniel accepit a Sergio, eidem decessum Simeonis sibi revelatum patefecit; et magna fiducia, ceu paternam aditurus hoereditatem, constructam apud Ostia Ponti columnam ascendit : cum adversantem sibi mox expertus est inter alios S. Gennadium Constantinopolitanum Antistitem, rei novitate perculsum, subverentem quidem, ne inflatus homo superbia, aemulatione magni Simeonis impulsus, inde humanam captaret auram, et ea arte sibi gloriolam compararet : sed signis divinitus editis satis tandem persuasus est, Danielem Dei amicum, non humana id tentasse praesumptione, sed Dei consilio niti, eiusque imperio regi, Spiritu agi, et eius ope fulciri. Il resta de longues années sur sa colonne, y fit de grands et beaux miracles.
[FN: § 1187-6] BARON. ; Annal. eccles., t. XIII, ann. 806, V : Epistola Theodori Studitae ad Nicephorum imperatorent... ex praepositis, et ex stylitis, et ex inclusis...
[FN: § 1189-1]
LUCIAN.; De Syria Dea : « (28). L'atrium du temple est tourné au nord, grand d'environ cent coudées. Dans cet atrium se trouvent les phallus qui y ont été mis par Bacchus. Ils ont une hauteur de trois cents coudées. Un homme monte deux fois l'an, sur l'un de ces phallus, et reste au sommet du phallus pendant sept jours. On dit que la raison de cette ascension est la suivante. Le vulgaire croit qu'à cette hauteur, cet homme s'entretient avec les dieux, prie avec ferveur pour toute la Syrie, et que les dieux entendent les prières de tout près [première dérivation]. D'autres estiment qu'il le fait pour Deucalion, en mémoire de cette calamité dans laquelle les hommes montaient sur les montagnes et sur les arbres les plus hauts, épouvantés par les grandes eaux [seconde dérivation]. Je n'admets pas cela, et je crois qu'on le fait pour Bacchus. Je raisonne ainsi. Ceux qui dressent des phallus à Bacchus placent sur les phallus des hommes de bois, assis ; pourquoi ne le dirais-je pas : je crois donc qu'ils y montent pour imiter cet homme de bois [troisième dérivation] ». Ajoutons, maintenant, comme quatrième dérivation, que le stylite fait pénitence. Nous avons ainsi les nombreuses dérivations, qui constituent la partie variable et secondaire du phénomène, tandis que la partie constante et principale est le résidu qu'on tente d'expliquer par ces dérivations. L'auteur continue : « (29) Et la manière dont l'homme monte est la suivante. Il s'entoure lui-même et le phallus d'une grande chaîne ; puis il monte par des chevilles qui sont fichées dans le phallus, de sorte qu'on n'y puisse poser que la pointe des pieds ; et, en montant, il tire sur une chaîne, des deux côtés, comme s'il tenait deux rênes. Si quelqu'un n'a pas vu cela, il a vu du moins ceux qui montent sur le palmier, en Arabie, en Égypte ou ailleurs, et comprend ce que je dis [la description paraît bien être d'un témoin oculaire]. Quand il arrive au faîte, il jette en bas une autre petite chaîne qu'il apporte avec lui, très longue, et fait monter ce qu'il veut : du bois, des vêtements, des ustensiles, avec lesquels, formant un siège comme un nid, il s'y accommode, et y reste pendant les jours que j'ai dit. Les gens viennent et apportent de l'or et de l'argent, et aussi du cuivre. L'ayant déposé en un endroit où cet homme le voit, ils le laissent, après avoir dit chacun son nom. Un autre, qui se trouve présent, l'annonce à celui qui est en haut, et celui-ci ayant entendu le nom, fait la prière pour chacun. En priant, il frappe un certain objet de cuivre qui, en remuant, rend un son fort et dur [on notera la similitude suivante : de toute part, des hommes venaient à la colonne de Saint Siméon. L'empereur Léon fit édifier, près de la colonne de Daniel, un monastère pour les disciples du saint]. Il ne dort pas ; et s'il est parfois surpris par le sommeil, un scorpion monte et le réveille, en le mordant à l'endroit où cela lui fait le plus mal. C'est là sa peine, s'il s'endort. Le récit du scorpion est sacré et tient du miracle. Est-il vrai ? je ne saurais dire. Il me semble que c'est la peur de tomber qui l'empêche de dormir ».
[FN: § 1191-1]
S. REINACH ; Cult., myth. et rel., t. I.
[FN: § 1194-1]
G. CASATI ; Dix années en Equatoria : « (p. 48) Les danses s'ouvrent le premier jour par une cérémonie fort curieuse et fort typique. Les jeunes gens, filles d'un côté et garçons de l'autre, font entendre des chants de joie et d'amour, puis l'une des jeunes filles se lève et va présenter un fouet en cuir d'hippopotame à l'un des jeunes gens, qui l'accepte avec des remerciements. Celui-ci promène un regard autour de lui en disant : „ Qui désire être aimé et admiré ? “– „ Moi,“ répond l'un de ses compagnons qui s'avance les (épaules nues. Alors le premier lui cingle le dos de quinze coups de fouet consciencieusement appliqués, qui, pour obéir aux usages, doivent y laisser des traces bien marquées. Les deux acteurs recommencent l'opération, en intervertissant les rôles, et se retirent ensuite, fiers d'avoir étalé aux yeux des belles leur force physique et morale ». Comparez avec la description de Casati celle que Plutarque donne de la flagellation à Sparte. – PLUTARCH.; Inst. lac., 40. Lyc., 18. Cfr. LUC. ; Anach., 38. LACTANTII PLACIDI qui dicitur commentarios in STATII Thebaida, IV, 227: Eurotae cur dixerit, ipse enarravit. Iuxta hunc fluvium Lacones vapulando contendunt. Gloriosor tamen ille est, qui ultra praescriptum numerum plagarum animae non pepercit ; quod, cum devoverit spiritum, publice funeratus capite coronatur.
[FN: § 1196-1]
B. DAMIANI ; Epist., V, 8, Ad Clericos florenti os. Un peu plus loin : (p. 69) Optime poenitet, qui dum carnem verberibus mactat, lucrum, quod delectatione carnis amiserat, afflictionibus recompensat : et salubrem illi nunc amaritudinem ingerit, cuius olim noxia delectatione peccavit. Nihil differt quibus poenis caro poenitentis addicitur, dummodo voluptas praecedentis illecebrae vicaria repressi corporis afflictione mutetur. Quod si non facientibus nova, ac proinde reprehensibilis videtur disciplina virgarum, et ad lividae persuasionis ineptiam indicatur destructio canonum, abolitio decretorum : numquid venerabilis Beda redarguendus est videbitur, qui post antiquorum sententiam canonum, quosdam poenitentes ferreis asserit circulis astringendos ? Numquid sanctorum Patrum vita iure conspuitur quem alios per ogdoadas, et pentadecas in vepribus stando, alios de sole in solem rigidas ulnas in aëra suspendendo, alios in defossis specubus iugiter latitando, reatus sui poenitentiam peregisse testatur ? Numquid et beatus ille Macharius digne ridebitur, qui dum se minimum quid admisisse poenituit, acutissimis culicum rostris, quae videlicet apros transfigerent, per sex menses membra sua nudus exposuit ? Cfr. Opusc., LI, 9.
[FN: § 1197-1]
B. DAMIANI ; Opuse., LI, 8 : Centum autem annorum poenitentia, sicut ipso auctore didicimus, sic expletur. Porro cum tria scoparum millia unum poenitentiae annum apud nos regulariter expleant ; decem autem Psalmorum modulatio, ut saepe probatam est, mille scopas admittat ; dum centum quinquaginta Psalmis constare Psalterium non ambigitur, quinque annorum poenitentia in huius Psalterii disciplina recte supputantibus invenitur. Sed sive quinque vicies ducas, sive viginti quinquies, centum fiunt. Consequitur ergo, ut qui viginti Psalteria cum disciplina decantat, centum annorum poenitentiam se peregisse confidat. Cela ne fait pas un pli. – Ibidem, 9 : Memini quoque, quia cuiusdam Quadragesimae imminentis initio mille annos imponi sibi per nos ad poenitentiani petiit : quos certe omnes ferme antequam ieiunii tempus transigeretur, explevit.
[FN: § 1198-2]
Un certain monsieur Cannon, Américain, à l'occasion de Noël 1911, dépêcha à ses concitoyens quatre-vingt-dix-sept orateurs, pour leur persuader de s'abstenir de la femme et du vin. Aucune comparaison n'est possible entre ce monsieur Cannon et Saint Dominique. Le premier, après avoir gagné de belles sommes à la Bourse, lieu qui ne passe assurément pas pour être un temple de vertu, garde pour lui les plaisirs et attribue généreusement les pénitences aux autres gens. Le second vécut très pauvre, dans la misère, et s'imposait des pénitences pour compenser les plaisirs d'autrui. Mais la comparaison s'établit entre les admirateurs de chacun d'eux, parce qu'ils étaient mus également par le sens ascétique qui repousse les plaisirs de la vie et en recherche les douleurs.
[FN: § 1199-1]
MURATORI ; Ann, d'Italia, t. VII : « (p. 282) Célèbre fut encore l'année présente [1260], par une pieuse nouveauté, qui vit le jour à Pérouse, et vint, les uns disent d'un enfant, les autres d'un ermite, qui affirma en avoir eu la révélation de Dieu. Cet homme prêcha la pénitence aux gens du peuple, en leur représentant l'imminence d'un très grave fléau du Ciel, s'ils ne se repentaient pas et ne faisaient la paix entre eux. Aussi des hommes et des femmes de tout âge instituèrent-ils des processions où l'on administrait la discipline (p. 283) et où l'on invoquait la protection de la Vierge, mère de Dieu. De Pérouse, cette dévotion populaire passa à Spoleto, accompagnée d'une componction admirable, et de là vint en Romagne. Le peuple d'une ville se portait en procession à la ville voisine, parfois jusqu'au nombre de dix et de vingt mille personnes, et là, dans la cathédrale, s'administrait la discipline jusqu'au sang, criant miséricorde à Dieu et paix parmi les hommes [voilà le résidu de sociabilité mis à nu]. Ému, le peuple de cette autre ville allait ensuite en une autre, de manière qu'avant la fin de l'hiver, cette nouveauté se répandit même au delà des montagnes et arriva en Provence, en Allemagne et jusqu'en Pologne [tel est le cours habituel de ces épidémies; on a pu le voir de nos jours, dans les actes de l'Armée du Salut]. Le 10 octobre, les gens d'Imola la portèrent à Bologne, et vingt mille Bolonais vinrent successivement à Modène. Autant de Modénais allèrent à Reggio et à Parme ; et ainsi, de proche en proche, les autres portèrent le rite jusqu'à Gènes et par tout le Piémont [le Réveil du Pays de Galles s'est répandu de nos jours, dans des proportions beaucoup moindres, mais d'une façon semblable]. Mais le marquis Oberto Pelavicino et les Torriani ne permirent pas que ces gens entrassent dans les territoires de Crémone, de Milan, de Brescia et de Novare ; et le roi Manfred lui aussi leur interdit l'entrée de la Marche d'Ancône et de la Pouille ; car ils craignaient quelque piège politique sous le couvert de la dévotion ; ce dont le moine padouan se plaint amèrement. Les effets produits par cette pieuse émotion des peuples furent d'innombrables paix faites entre les citoyens en discorde, avec restitution de leur patrie aux bannis, les confessions et les communions, qui étaient si négligées en des temps si barbares, et les conversions, – durables, je ne sais – des courtisanes, des usuriers et d'autres malandrins et ribauds [effets habituels et éphémères de cette épidémie, comme on peut aussi le voir dans celle du Réveil du Pays de Galles] ». Le même Muratori, dans ses Dissert. sopra le Antichità italiane, LXXV, (cité au § 1192-2), dit : « (p. 363) Ce rite passait d'une ville à la voisine. C'est-à-dire que les gens d'une ville, deux par deux, vêtus de sacs et les pieds nus, l'image du Crucifié en avant, allaient en procession à une autre ville ; et de nouveau l'autre peuple à une autre ville, en semblable pénitence, implorant la paix et la rémission des offenses. Les Bolonais, par exemple, au nombre de plus de vingt mille personnes, vinrent à Modène, vers la fin d'octobre, avec leurs gonfalons, se frappant et chantant les louanges de Dieu et quelques chansons grossières. Les Modénais allèrent jusqu'à Castello-Leone pour les recevoir, et les introduisirent en ville. Dans la cathédrale, ils renouvelèrent leurs coups de discipline, leurs prières et leurs cris ; puis, ayant reçu un repas des citoyens, ils s'en retournèrent chez eux ». (MURATORI; Antiq. ital., t. VI, p. 469-470.
[FN: § 1199-2]
MURATORI ; Dissertazioni sopra le Antichità italiane, t. III, IIe partie, LXXV.
[FN: § 1200-1]
RAYN. ; Annal. eccles., t. III, anno 1260, VIII : Penetrasse flagellantium ritum in Germaniam tradit Henricus Stero se rem Perusii emersisse, cum monacho Patavino consentit, ac supplicationis obeundae modum ita describit : Erat modus ipsius poenitentiae ad patiendum durus, horribilis, et miserabilis ad videndum ; nam ab umbilico sursum corpora denudantes, quadam veste partem corporis inferiorem usque ad talos tegentem habebant, et ne quis eorum agnosceretur, cooperto capite et facie incedebant. Procedebant etiam bini, terni, tanquam clerici, vexillo praevio vel cruce, flagellis semetipsos bis in die per triginta tres dies, et deinde in memoriam temporis humanitatis Domini nostri Iesu Christi super terram apparenlis tamdiu cruciantes [ici, Jésus-Christ intervient, comme Artémis, dans la flagellation des Spartiates, parce que tout peuple croyant rapporte ses coutumes à ses dieux], quousque ad quasdam cantilenas, quas de passione ac morte Domini dictaverant, duobus, vel tribus praecinentibus circa ecclesiam vel in ecclesia compleverunt, nunc in terram corruentes, nunc ad coelum nuda brachia erigentes, non obstante luto vel nive, frigore vel colore. Miserabiles itaque gestus ipsorum, et dira verbera multos ad lacrymas et ad suscipiendam eandem poenitentiam provocabant.
[FN: § 1200-2]
RAYN.; Annal. eccles., t. VI, anno 1349, XVIII. L'auteur cite Albertus Argentinensis : Incipiente paulatim pestilentia in Alemannia, coeperunt se populi flagellare, transeuntes per terram : et venerunt ducenti de Suevia Spiram anno predicto quadragesimo nono [1349] in medio iunii, habentes inter se unum principalem, et duos alios magistros, quorum mandatis omnino parebant. Et cum hora prima Rhenum transissent, accurente populo fecerunt circulum in civitate Spira ante monasterium, latum valde, in cuius medio se exuentes, depositis vestibus et calceamentis, habentes in modum braccae camisias a femore ad talos praetensas, circumiverunt unusque post alium in circulo se in modum crucifixi prostravit, quilibetque eorum super quoslibet transeuntes passibus, et leniter prostratos flagellis tangentes. Ultimi, qui se primo straverunt, primo surgentes se flagellaverunt flagellis habentibus nodos cum quatuor aculeis ferreis transeuntes cantu vulgari invocationis dominicae, habente multas invocationes ; et steterunt tres in medio circuli sonori valde praecinentes flagellando se : post quos alii canebant. In quo diu immorantes, ad unum praecentum omnes genuflexi in modum crucifixi in facies suas corruerunt, cum singultu orantes ; transierunt iuxta circulum magistri monentes eos, ut orarent ad Dominum pro clementia super populum, item super omnes eoram. benefactores et malefactores, et omnes peccatores et in purgatorio existentes, et pluribus aliis. Le même Albert parle des lettres lues par ces gens : Cuius literae tenor similis in sententia esse dicebatur, in ecclesia S. Petri in lerusalem per angelum praesentatae, in qua narrat angelus, Christum offensum contra mundi pravitates, plurima exprimens crimina violationum diei dominicae, et quod non ieiunetur feria sexta, blasphemias, usuras, adulteria, Christumque rogatum per B. Verginem et angelos pro misericordia, respondisse quemlibet per triginta quatuor dies se debere exulando flagellare, ut misericordiam Dei consequantur.
[FN: § 1202-1]
PIERRE DE L'ESTOILE ; Régistre-journal de Henri III: « (p. 159) L'an présent 1583, en ce mois de mars, le Roy institua et erigea une nouvelle confrairie qu'il fist nommer des Penitents, de laquelle lui et ses deux mignons se firent confreres, et y fist entrer plusieurs seingneurs gentilshommes et autres de sa cour, y conviant les plus apparans de son parlement de Paris, chambre des Comptes, et autres Cours et jurisdictions, avec un bon nombre des plus notables bourgeois de la Ville. auquel jour [25 mars 1583, fête de l'Annonciation] fut faite la solennelle procession desdits Confrères Penitents, qui vindrent sur les quatre heures après midi au couvent des Augustins... deux à deux, vestus de leurs accoustremens tels que des Battus de Rome, Avignon, Thoulouze, et semblables. (p. 160) Le Jeudi Saint, 7 avril, sur les neuf heures du soir, la procession des Penitents, où le Roy estoit avec tous ses mignons, alla toute la nuit par les ruës et aux églises, en grande magnificence de luminaire et musique excellente, faux-bourdonnée. Et y en eust quelques uns, mesme des mignons à ce qu'on disoit, qui se fouettèrent en ceste procession, ausquels on voioit le pauvre dos tout rouge des coups qu'ils se donnoient ». Les gens riaient de ces bouffonneries et après la première procession, on fit le quatrin suivant (p. 160
Après avoir pillé la France,
Et tout son peuple despouillé,
Est-ce pas belle pénitence
De se couvrir d'un sac mouillé !
[FN: § 1203-1]
OVID.; Fast., II:
(425) Nupta, quid exspectas ? non tu pollentibus herbis,
Nec prece, nec magico carmins mater eris.
Excipe fecundae patienter verbera dextrae :
Iam socer optati nomen habebit avi.
Il raconte ensuite une légende et un oracle de Junon :
(441) Italidas matres, inquit, caper hirtus inito
Obstupuit dubio territa turba sono.
Augur erat : nomen longis intercidit annis ;
Nuper ab Etrusca venerat exsul humo.
Ille caprum mactat : iussae sua terga maritae.
Pellibus exsectis percutienda dabant.
Luna restimebat decimo nova cornua motu ;
Virque pater subito, nuptaque mater erat.
[FN: § 1204-1]
Pratica del Confessionale, t. III.
[FN: § 1205-1]
Num.; VI, 4, (Vulg.) Cunetis diebus quibus ex voto Domino consecrantur, quidquid ex vinea esse potest, ab uva passa usque ad acinum. non comedent.
[FN: § 1205-2]
SCHWAB ; Le Talmud de Jérusalem, t. IX « (p. 188) (Mishnâ) Trois objets essentiels sont interdits au Nazir : l'impureté, la taille des cheveux, et la consommation de ce qui provient de la vigne. Tout ce qui provient d'elle (p. ex. la peau, les pépins, les grains secs) sera joint pour constituer le minimum réglementaire, et l'on n'est coupable d'infraction à l'abstinence qu'en ayant mangé des raisins une quantité égale à une olive... ». Le commentaire contient de belles discussions. Il est défendu de manger la chair d'un animal dépecé. De là le problème : « (p. 141) La consommation d'une fourmi, que dans la bouche on a coupée en deux, puis mangée, fait aussi l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch (le premier en fait l'objet d'une pénalité ; le second en dispense). R. Mescha demanda à R. Zeira : est-ce que la consommation d'un grain de raisin, qu'un Nazir a divisé en deux parts l'ayant déjà dans la bouche, puis l'a mangé, fait aussi l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch ? ». Un de nos anti-alcooliques modernes s'abstient de manger du risotto, parce qu'il a appris qu'en le cuisant on y ajoute un verre de vin blanc. « (p. 143)... Celui qui mange cinq fourmis [quel beau plat !], même à la fois, et fût-ce dans le même état d'ignorance, sera condamné pour chaque insecte ainsi consommé, qui (malgré son exiguïté) constitue une individualité à part ; mais si après les avoir écrasées il les mange, il ne sera qu'une fois coupable, et encore faut-il que le total corresponde à l'équivalence d'une olive ». « (p. 146) (Mischnâ). Le naziréat indéterminé est de trente jours. L'acte de s'être rasé pendant ce temps (de plein gré), ou de l'avoir été par violence des brigands, renverse la période des trente jours (et il faut la reprendre). Dès qu'un Nazir s'est rasé soit avec des ciseaux, soit avec un rasoir, ou s'il a arraché des poils, si peu que ce soit, il est coupable. Il lui est permis de se frotter, même de se gratter, non de se peigner (de crainte d'arracher un cheveu) ». Qui n'observe pas les prescriptions du naziréat est puni. « (p. 148) R. Il a dit devant R. Yossé : on est passible des coups de lanières dès que l'on a coupé un cheveu pendant la période du Naziréat ». Aujourd'hui, on est plus indulgent. En plusieurs États d'Amérique, il n'y a que la prison, pour qui fait les yeux doux à une femme.
[FN: § 1206-1]
Le fait suivant est remarquable. Je connais un anti-alcoolique qui est athée et ne se préoccupe pas du tout de la Bible. Il pousse l'horreur des boissons alcooliques jusqu'à s'abstenir même de vinaigre ; il assaisonne sa salade avec du citron. Il ne mange pas de poisson qui ait été cuit au vin blanc, ni de civet de lièvre, parce qu'on met du vin rouge dans la sauce. Le résidu est le même ; les dérivations changent.
Notes du Chapitre VIII. – Les résidus (suite) (§1207 à §1396) Examen des Ve et VIe classes. pp. 649-784 ↩
[FN: § 1211-1]
CIC. ; De off ., I, 14, 42-43. Il ajoute : Quare L. Sullae et G. Caesaris pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri.
[FN: § 1214-1]
Un exemple emprunté à la mécanique fera mieux comprendre la chose. Supposons un point matériel en équilibre, et admettons que, s'il s'écarte de la position d'équilibre, il naît une force proportionnelle à l'écart, laquelle agit de manière à ramener le point matériel à la position d'équilibre. Si le point est déplacé de peu, cette force sera petite aussi, et le point pourra s'éloigner beaucoup de la position d'équilibre. Supposons ensuite que, en plus de la force précédente, tout écart de la position d'équilibre fasse naître une force constante, quel que soit l'écart, et d'une intensité notable. En ce cas, le moindre écart est aussitôt contrarié par une force considérable ; il ne peut croître, et le point est ramené aussitôt à la position d'équilibre. Le lecteur prendra bien garde que c'est là une analogie et non une identité (§ 121).
[FN: § 1217-1]
De même, en 1913, en Angleterre les attentats des suffragettes provoquèrent des sentiments de vive opposition dans le peuple, qui sentait instinctivement qu'accorder le droit de troubler l'ordre social à quiconque veut employer la force mène tôt ou tard à la dissolution de la société. Les fanatiques et mystiques humanitaires qui gouvernaient le pays ne le comprenaient pas aussi bien, et cela ne doit pas surprendre, parce que c'est un caractère propre du fanatisme et du mysticisme que de faire sortir de la réalité. Le ministre lut à la Chambre des Communes une statistique dont il ressortait que les méfaits des suffragettes ne se comptaient que par dizaines, et il conclut que la répression pouvait continuer à être douce comme par le passé. Peu de jours après, on lisait deux nouvelles dans les journaux : la première était que l'une de ces mégères, condamnée à la prison pour ses méfaits, avait été mise en liberté, à la suite de son refus de se nourrir ; la seconde, qu'à Englefield-Green, près de Londres, les suffragettes avaient incendié, au moyen de la paraffine, la maison Treytom, qui avait été entièrement détruite. Cette maison était la propriété de lady White, veuve du général sir George White, défenseur de Ladysmith. Le dommage fut estimé 4000 livres sterling (100 000 francs). Près des ruines, on trouva des écriteaux portant l'inscription : « Cessez de tourmenter nos compagnes en prison, et donnez le droit de vote aux femmes ». On ne sait pas précisément pourquoi le distingué ministre a oublié de dire combien d'autres méfaits semblables sont nécessaires pour que l'arithmétique humanitaire permette de protéger les braves gens, en ôtant la faculté de mal faire aux mégères hystériques qui s'amusent à commettre des crimes. En attendant, le gouvernement s'occupe, non pas de mettre ces femmes en prison, mais de faire tenir les pompiers jour et nuit auprès des pompes, prêts à courir là où quelque nouvel incendie des suffragettes éclaterait.
[FN: § 1222-1]
Manuel, II.
[FN: §1223-12]
La Ragione, 16 juin 1911. Le député PIO VIAZZI écrit : « ... qui ne sait que tout tribunal a son avocat prince, habituellement le plus grand faiseur de dupes monopolisateur des clients les plus riches, plein de ressources en matière de témoignages de la dernière heure, ami de tous les juges, auquel on accorde les renvois refusés aux autres, dont les douteux traits d'esprit d'audience font volontiers sourire, envers les clients duquel on fait preuve de quelque bienveillante disposition, qui n'est pas inutile, si même elle n'est pas injuste et tout à fait inique ? »
[FN: § 1224-1]
En 1911, les États-Unis d'Amérique dénoncèrent le traité de commerce qu'ils avaient avec la Russie, parce que celle-ci voulait interdire l'entrée de son territoire aux Israélites porteurs d'un passeport américain ; ce qu'on tenait pour une offense à l'égalité. Mais les États-Unis repoussent de leur territoire beaucoup de sujets asiatiques de la Russie, et cela n'offense pas le moins du monde l'égalité.
[FN: § 1225-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] En Suisse, lorsqu'on a éliminé du peuple successivement les étrangers, les Suissesses, les Suisses mineurs, les citoyens non électeurs, on constate que le droit de prendre part aux votations populaires n'appartient qu'à un peu plus du quart de la population. Suivant l'Annuaire statistique de la Suisse, 1913, p. 8, la population totale de la Suisse, calculée pour le milieu de l'année 1912, s'élevait à 3 831 220 habitants. Pour la votation populaire du 4 mai 1913 sur la révision de deux articles de la constitution fédérale, le même Annuaire p. 322) donne 844 175 citoyens ayant droit de vote. On voit ainsi que le Peuple souverain, les Égaux, constituent une classe privilégiée, jouissant seule du droit d'exprimer ce qu'on appelle la volonté du suffrage universel ou volonté populaire. Cette volonté résultera du vote de la majorité des électeurs qui auront pris part au scrutin. Comme cette majorité est variable, mais toujours sensiblement inférieure au nombre des électeurs inscrits, ce ne sera jamais qu'une partie de la classe des électeurs qui révélera la volonté populaire. Ainsi, dans la votation citée plus haut, le 33 % des électeurs inscrits participa aux votes, et la révision fut acceptée par 169 012 votants contre 111 163. Autrement dit, la volonté populaire fut exprimée par le 61,3 % des suffrages valables contre le 39,7 % ; elle fut imposée à 3 831 220 individus par 169 012 d'entre eux. L'art. 4 de la Constitution fédérale proclame : « Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de famille ». or, le droit de vote constitue, à l'égard de l'étranger, un privilège de naissance, et à l'égard des Suisses non électeurs, en tout cas un privilège de sexe et d'âge. C'est là un fait évident ; mais à l'exprimer on courrait le risque d'offenser l'Égalité, le Peuple, le Suffrage universel, ou quelque autre divinité tout aussi susceptible. Par crainte de porter atteinte à leur intégrité, le fidèle use de fictions et de formules favorables.
[FN: § 1231-1]
L'Iliade, I, présente un fait légendaire qui est le type de beaucoup d'autres faits réels. C'est à propos de la peste qui avait frappé le camp grec « (313-314) Atride ordonna aux peuples de se purifier. Ceux-ci se purifient, et jettent les immondices dans la mer ». Eustathe note à propos de ce passage : ![]()
![]()
![]() – « Et la purification et le lavage par ablutions. Et cette expression était très opportune dans les purifications qui se faisaient avec les sacrifices ». Il continue : « Pourquoi dans la mer ? Est-ce parce que, de sa nature, l'eau de mer est apte à laver ? Ils jetèrent l'immondice dans la mer, où il n'y a pas d'immondice, comme on dit. C'est pourquoi le proverbe dit : La mer enlève tous les maux des hommes ». C'est là le vers 1193 de l'Iphigénie en Tauride d'EURIPIDE. – DIOG. LAERT. ; III, Plat., 6, dit que ce vers fait allusion au fait que Platon, étant tombé malade en Égypte où il était allé avec Euripide, fut guéri par les prêtres avec l'eau de la mer. Toute la scène de l'Iphigénie en Tauride est à lire pour voir comment des idées fantaisistes se mêlaient à des idées qui pourraient être de propreté ou de répugnance. Iphigénie dit (1171) que les deux étrangers venus vers elle sont souillés par un homicide domestique, et que (1177) elle porte la statue de la déesse dehors, pour la soustraire à la contagion de l'homicide. Elle ajoute (1191) qu'avant de les sacrifier, elle doit les purifier. « (1192) Dans l'eau de la fontaine ou dans celle de la mer ? » – demande le roi – et Iphigénie répond que « l'eau de la mer enlève [lave] tous les maux des hommes ». – En outre, « (1199) elle doit aussi purifier la statue de la déesse ». Le roi le confirme : « (1200) Effectivement, la souillure du matricide l'a atteinte ». Et cela ne suffit pas ; il faut encore voiler les deux prisonniers, pour ne pas souiller la lumière du soleil. Afin de n'être pas souillé, aucun citoyen ne doit les voir, et le roi doit mettre un voile devant ses yeux.
– « Et la purification et le lavage par ablutions. Et cette expression était très opportune dans les purifications qui se faisaient avec les sacrifices ». Il continue : « Pourquoi dans la mer ? Est-ce parce que, de sa nature, l'eau de mer est apte à laver ? Ils jetèrent l'immondice dans la mer, où il n'y a pas d'immondice, comme on dit. C'est pourquoi le proverbe dit : La mer enlève tous les maux des hommes ». C'est là le vers 1193 de l'Iphigénie en Tauride d'EURIPIDE. – DIOG. LAERT. ; III, Plat., 6, dit que ce vers fait allusion au fait que Platon, étant tombé malade en Égypte où il était allé avec Euripide, fut guéri par les prêtres avec l'eau de la mer. Toute la scène de l'Iphigénie en Tauride est à lire pour voir comment des idées fantaisistes se mêlaient à des idées qui pourraient être de propreté ou de répugnance. Iphigénie dit (1171) que les deux étrangers venus vers elle sont souillés par un homicide domestique, et que (1177) elle porte la statue de la déesse dehors, pour la soustraire à la contagion de l'homicide. Elle ajoute (1191) qu'avant de les sacrifier, elle doit les purifier. « (1192) Dans l'eau de la fontaine ou dans celle de la mer ? » – demande le roi – et Iphigénie répond que « l'eau de la mer enlève [lave] tous les maux des hommes ». – En outre, « (1199) elle doit aussi purifier la statue de la déesse ». Le roi le confirme : « (1200) Effectivement, la souillure du matricide l'a atteinte ». Et cela ne suffit pas ; il faut encore voiler les deux prisonniers, pour ne pas souiller la lumière du soleil. Afin de n'être pas souillé, aucun citoyen ne doit les voir, et le roi doit mettre un voile devant ses yeux.
[FN: § 1242-1]
G. BRUNET ; Les propos de table de Martin Luther, « (p. 261) Maître Kinneck répondit [à Luther] : „ Si vous dites que l'Esprit saint est une certitude vis-à-vis de Dieu, alors tous les sectaires qui ont une persuasion certaine de leur religion ont l'Esprit saint „ Le docteur Luther répondit : „ Ils n'ont aucune certitude ; Mahomet, les papistes, les sacramentaires ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, mais sur leur foi personnelle „ ». Tous les sectaires raisonnent de cette façon.
[FN: § 1242-2]
STURT; Voyage dans l'intérieur de l'Australie méridionale, dans Biblioth. univ. des voy., t. 43 : « (p. 299) Il n'y a que les vieillards qui jouissent du privilège (p. 300) de manger de l'ému, et les jeunes sont tellement soumis à cette interdiction que si, par suite d'une faim impérieuse, ou dans d'autres circonstances pressantes, un d'eux l'enfreint pendant son éloignement de la tribu, il y revient avec la conscience du crime, et le révèle par sa contenance, s'asseyant à part, et avouant au chef, dès la première occasion, la faute en expiation de laquelle il est obligé de subir une légère punition ».
[FN: § 1246-1]
D. AUG. De mor. eccl. cath. et de moribus Manich., 1, 34, 76 : Sed quicumque illorum bona voluntate Deique auxilio corriguntur, quod amiserant peccando, paenitendo recuperant.
[FN: § 1246-2]
OLDENBERG ; La relig. du Veda : « (270) D'une part... le péché est une transgression de la volonté des dieux, qui a provoqué leur colère : l'expiation dans cet ordre (p. 271) d'idées, s'adresse à eux, s'efforce de les satisfaire et de les apaiser ; le suppliant leur apporte ses dons, s'humilie devant eux. Mais, d'autre part, le péché est une sorte de fluide qui adhère au pécheur, à la façon d'une substance morbide : dès lors le culte expiatoire comporte des opérations magiques, propres à dissoudre ce fluide, à le détruire ou à le reléguer à une distance où il cesse d'être nocif, de telle sorte que le coupable redevienne libre et pur, „ comme l'homme couvert de sueur se défait de ses souillures en se baignant, comme l'oiseau ailé se dégage de son œuf...“ Ce dernier point de vue lui-même n'est pas entièrement inconciliable avec une action divine : il se peut que l'évacuation de la matière peccante soit conçue, non comme l'effet direct du charme, mais comme due à l'art et à la puissance du dieu dont on a imploré l'assistance ». Les faits sont bien décrits, et de légères modifications suffisent pour enlever le vernis habituel des actions logiques.
[FN: § 1246-3]
DUBOIS ; Mœurs... des peuples de l'Inde, t. II: « (p. 257) Comme ces solitaires [les vanaprasta], confondant les souillures de l'âme avec celles du corps, étaient persuadés que l'une communiquait les siennes à l'autre, et réciproquement, ils croyaient que les bains, en lavant le corps, avaient aussi la vertu de purifier l’âme, surtout lorsqu'ils étaient pris dans les eaux du Gange ou autres eaux réputées sacrées. Le feu complétait la purification ; et c'est pour cela qu'on brûlait le corps de ces pénitents, lorsqu'ils avaient cessé de vivre ».
[FN: § 1246-4]
D'abord, nous avons les eaux des fontaines, des fleuves, de la mer. Philon le Juif a écrit tout un livre pour expliquer quelles victimes on pouvait offrir suivant le rite judaïque, qui, pour lui, est un rite rationnel, et qui, à la vérité, concorde en beaucoup de points avec ceux des Gentils. – PHIL. IUD. ; De victimas offerentibus seu de sacrificantibus : « (p. 251 M, p. 848 P, § 1) La victime doit être irréprochable, absolument exempte de blâme, de qualité choisie, approuvée par le jugement incorruptible des prêtres et par leur regard sagace [ce sont aussi des règles pour les Gentils]. Cette règle n'est pas dépourvue de sens, mais conforme à l'intelligence et à la raison. Cependant on ne s'occupe pas seulement des victimes, mais aussi des sacrificateurs, afin qu'il [le sacrifice] ne soit vicié par aucun accident. Vraiment, comme je l'ai dit, on purifie le corps par des lavages et des aspersions, et l'on ne permet pas que celui qui s'est aspergé ou lavé une seule fois dépasse l'enceinte du temple : il est ordonné qu'il reste sept jours en dehors... (p. 252 M, § 2). Presque tous s'aspergent avec l'eau pure ; beaucoup avec de l'eau de mer ; quelques-uns avec de l'eau de fleuve ; d'autres avec de l'eau de fontaine, puisée dans des vases ». Chez les Gentils aussi, on pratiquait de semblables aspersions. POLL.; I, 1, 8. – HESYCH., s. r. ![]() . – D. EPIPH.; Ad haer., 1. I, t. II, haer. 30, p. 126. Il dit que les Ebionites sont semblables aux Juifs samaritains qui, «s'ils ont eu contact avec un étranger, et chaque fois qu'ils ont eu des rapports avec une femme et la quittent, se baptisent [se lavent] avec l'eau de mer ou d'une autre qualité, suivant la quantité qu'ils en ont. Mais ensuite si, après s'être plongés dans l'eau et baptisés [lavés], ils rencontrent quelque chose qui porte malheur, aussitôt ils retournent se baptiser à nouveau [se laver], souvent avec leurs vêtements ». – PLUTARCH, De solert. anim., XX, 4, dit des prêtres égyptiens : « Ils emploient, pour se purifier, de l'eau que boit l'Ibis, car il n'use jamais d'eau infecte ou autrement malsaine ». Les Romains se servaient beaucoup de l'eau des fleuves. VIRG. ; Aen., II, 719 : donec me flumine vivo abluero. SERVIUS note : Flumine vivo] Perenni... Est autem augurale verbum. – IV, 635: Dic corpus properet fluviali spargere lympha. SERVIUS note : Spargere lympha] Sacrificantes diis inferis aspergebantur aqua, ut VI, 230 : Spargens rore levi, et ramo felicis olivae : superis, abluebantur, ut II, 719. Donec me flumine vivo abluero. Modo autem inferis sacrificat, ut : Sacra Iovi Stygio. – VI, 635 : Occupat Aeneas aditum, corpusque recenti Spargit aqua. SERVIUS : Recenti] Semper fluenti... Spargit aqua] Purgat se, nam inquinatus fuerat, vel aspectu Tartari : vel auditu sceleram atque poenarum : et Spargit, quia se Inferis purgat. – OVID., Fast., IV, 778 : et in vivo perlue rore manus. Fast., V : (431) Ille memor veteris ritus. (435) Terque manus puras fontana perluit unda. « Celui qui observe les rites anciens... se purifie les mains trois fois dans l'eau pure et jaillissante ». – PROP., III, 10, dit à sa maîtresse : (12) Surge et poscentes iusta precare deos. || Ac primum pura somnum tibi discute lympha.... III, 3, 51 : Calliope asperge le poète avec de l'eau puisée à une fontaine. – TIBULLE, II, 1, parle de la lustration des camps, suivant l'ancien rite transmis par les ancêtres : « (11-14) Je vous ordonne aussi de vous en aller ; éloignez-vous des autels, vous qui, la nuit passée, avez joui des plaisirs de Vénus ; les gens chastes plaisent aux divinités d'en haut ; venez avec des vêtements propres, et plongez des mains pures dans l'eau des fontaines ». – APOLL. ; Argonaut., III, 1030 : Médée recommande à Jason de « se laver dans le courant d'un fleuve ». Les Grecs employaient aussi l'eau de mer. – ARISTOPH.; Plut., 656-657. Carios conduit Plutus à la mer, pour le purifier. Le scoliaste note : « Les anciens avaient coutume d'y [dans la mer] laver ceux qui devaient être purifiés... » – PAUSANIAS, IX, 20, dit que les femmes de Tanagre, Célébrant les mystères de Dionysos, se baignent dans la mer. – Quelquefois on ajoutait du sel à l'eau pure. Pour composer l'eau lustrale, on y éteignait des flambeaux. Scholia in Pacem, 959 : ...
. – D. EPIPH.; Ad haer., 1. I, t. II, haer. 30, p. 126. Il dit que les Ebionites sont semblables aux Juifs samaritains qui, «s'ils ont eu contact avec un étranger, et chaque fois qu'ils ont eu des rapports avec une femme et la quittent, se baptisent [se lavent] avec l'eau de mer ou d'une autre qualité, suivant la quantité qu'ils en ont. Mais ensuite si, après s'être plongés dans l'eau et baptisés [lavés], ils rencontrent quelque chose qui porte malheur, aussitôt ils retournent se baptiser à nouveau [se laver], souvent avec leurs vêtements ». – PLUTARCH, De solert. anim., XX, 4, dit des prêtres égyptiens : « Ils emploient, pour se purifier, de l'eau que boit l'Ibis, car il n'use jamais d'eau infecte ou autrement malsaine ». Les Romains se servaient beaucoup de l'eau des fleuves. VIRG. ; Aen., II, 719 : donec me flumine vivo abluero. SERVIUS note : Flumine vivo] Perenni... Est autem augurale verbum. – IV, 635: Dic corpus properet fluviali spargere lympha. SERVIUS note : Spargere lympha] Sacrificantes diis inferis aspergebantur aqua, ut VI, 230 : Spargens rore levi, et ramo felicis olivae : superis, abluebantur, ut II, 719. Donec me flumine vivo abluero. Modo autem inferis sacrificat, ut : Sacra Iovi Stygio. – VI, 635 : Occupat Aeneas aditum, corpusque recenti Spargit aqua. SERVIUS : Recenti] Semper fluenti... Spargit aqua] Purgat se, nam inquinatus fuerat, vel aspectu Tartari : vel auditu sceleram atque poenarum : et Spargit, quia se Inferis purgat. – OVID., Fast., IV, 778 : et in vivo perlue rore manus. Fast., V : (431) Ille memor veteris ritus. (435) Terque manus puras fontana perluit unda. « Celui qui observe les rites anciens... se purifie les mains trois fois dans l'eau pure et jaillissante ». – PROP., III, 10, dit à sa maîtresse : (12) Surge et poscentes iusta precare deos. || Ac primum pura somnum tibi discute lympha.... III, 3, 51 : Calliope asperge le poète avec de l'eau puisée à une fontaine. – TIBULLE, II, 1, parle de la lustration des camps, suivant l'ancien rite transmis par les ancêtres : « (11-14) Je vous ordonne aussi de vous en aller ; éloignez-vous des autels, vous qui, la nuit passée, avez joui des plaisirs de Vénus ; les gens chastes plaisent aux divinités d'en haut ; venez avec des vêtements propres, et plongez des mains pures dans l'eau des fontaines ». – APOLL. ; Argonaut., III, 1030 : Médée recommande à Jason de « se laver dans le courant d'un fleuve ». Les Grecs employaient aussi l'eau de mer. – ARISTOPH.; Plut., 656-657. Carios conduit Plutus à la mer, pour le purifier. Le scoliaste note : « Les anciens avaient coutume d'y [dans la mer] laver ceux qui devaient être purifiés... » – PAUSANIAS, IX, 20, dit que les femmes de Tanagre, Célébrant les mystères de Dionysos, se baignent dans la mer. – Quelquefois on ajoutait du sel à l'eau pure. Pour composer l'eau lustrale, on y éteignait des flambeaux. Scholia in Pacem, 959 : ... ![]() . (928)… « car le feu est apte à tout purifier, comme Euripide dans Héraclès, 928... ». – Outre le feu, on employait le soufre, le bitume, etc. – OVID. ; Metam. VII, 261 Terque senem flamma, ter aqua, ter sulfure lustrat. – Theocr., XXIV, 94-98 « Mais purifiez d'abord la maison par le feu, par le soufre pur : ensuite, mêlant l'eau de sel, selon l'usage, aspergez d'eau pure avec un rameau vert. Ensuite, sacrifiez à Zeus très haut un porc mâle ». Cfr. Odyss., XXII, 481-482 ; XXIII, 50. L'usage de la cendre mêlée à l'eau était aussi très répandu (1266). Le culte, si connu, des fontaines et des fleuves, peut avoir été en rapport avec la vertu purificatrice attribuée à leurs eaux, Il est remarquable qu'à une époque récente, comme celle de Néron, on croyait que les dieux punissaient celui qui manquait de respect aux fontaines. TACITE rapporte, Ann., XIV, 22, que Néron se baigna dans la fontaine Marcia, ce qui fut considéré comme une profanation, « et une maladie [qui frappa Néron] confirma la colère des dieux ».
. (928)… « car le feu est apte à tout purifier, comme Euripide dans Héraclès, 928... ». – Outre le feu, on employait le soufre, le bitume, etc. – OVID. ; Metam. VII, 261 Terque senem flamma, ter aqua, ter sulfure lustrat. – Theocr., XXIV, 94-98 « Mais purifiez d'abord la maison par le feu, par le soufre pur : ensuite, mêlant l'eau de sel, selon l'usage, aspergez d'eau pure avec un rameau vert. Ensuite, sacrifiez à Zeus très haut un porc mâle ». Cfr. Odyss., XXII, 481-482 ; XXIII, 50. L'usage de la cendre mêlée à l'eau était aussi très répandu (1266). Le culte, si connu, des fontaines et des fleuves, peut avoir été en rapport avec la vertu purificatrice attribuée à leurs eaux, Il est remarquable qu'à une époque récente, comme celle de Néron, on croyait que les dieux punissaient celui qui manquait de respect aux fontaines. TACITE rapporte, Ann., XIV, 22, que Néron se baigna dans la fontaine Marcia, ce qui fut considéré comme une profanation, « et une maladie [qui frappa Néron] confirma la colère des dieux ».
[FN: § 1246-5]
SPENCERI de legibus hebraeorum ritualibus, t. II, lib. III, sec. II, (p. 783) Quod olim opinio illa passim obtinuerit, Diluvium. nempe magnum Mundi ![]() fuisse ; a Deo missum ut terram ipsam lustraret, et labem ab impuris incolarum moribus haustam elueret et expiaret. Haec enim opinio veterum Iudaeoram, Philosophorum, et Christianorum quorundam, animis inhaerebat. Hanc opinionem inter antiquos Iudaeos fautores invenisse, coniicere licet e Philonis verbis (quod deterior potior. insid. p. 186 A, Par.)... Quando igitur aqua terram purgare statuit SUMMUS opifex, etc. Eadem fide Christianos imbutos testatur Origenes (Contra Cels., 1. 4, p. 173), cum ait... Nescio autem cur Diluvio, quo terram purgatam Iudaei pariter et Christiani asserunt, Celsus putet turris deiectionem similem esse. Ea sententia Philosophos etiam fuisse, idem Origenes (ibidem, p. 316) testatum reddidit : ... Interitus autem hominum per diluvium terrae lustratio est; quemadmodum etiam tradunt Graecorum non contemnendi philosophi, his verbis : ...Quando vero Dii, terram (p. 784) aquis purgantes, inducunt diluvium [PLAT. ; Timae, p. 22].
fuisse ; a Deo missum ut terram ipsam lustraret, et labem ab impuris incolarum moribus haustam elueret et expiaret. Haec enim opinio veterum Iudaeoram, Philosophorum, et Christianorum quorundam, animis inhaerebat. Hanc opinionem inter antiquos Iudaeos fautores invenisse, coniicere licet e Philonis verbis (quod deterior potior. insid. p. 186 A, Par.)... Quando igitur aqua terram purgare statuit SUMMUS opifex, etc. Eadem fide Christianos imbutos testatur Origenes (Contra Cels., 1. 4, p. 173), cum ait... Nescio autem cur Diluvio, quo terram purgatam Iudaei pariter et Christiani asserunt, Celsus putet turris deiectionem similem esse. Ea sententia Philosophos etiam fuisse, idem Origenes (ibidem, p. 316) testatum reddidit : ... Interitus autem hominum per diluvium terrae lustratio est; quemadmodum etiam tradunt Graecorum non contemnendi philosophi, his verbis : ...Quando vero Dii, terram (p. 784) aquis purgantes, inducunt diluvium [PLAT. ; Timae, p. 22].
[FN: § 1247-1]
D'une façon générale, on peut dire qu'il y a une classe étendue d'actions humaines non-logiques, qui ont rapport avec la propreté, semblables à celles des animaux, par exemple des pigeons qui se lavent tous les jours, du chat qui nettoie son pelage. Ces actions humaines ont revêtu parfois une forme fétichiste, comme il arrive d'habitude pour un grand nombre d'autres actions logiques. S'en rapprochent d'autres actions analogues dans la forme et dans l'apparence, ou provenant de dérivations diverses, et qui n'ont rien à voir avec la propreté. Les gens civilisés modernes ont l'habitude de se laver le matin ; c'est un simple acte de propreté. Chez les anciens, cet acte prend un caractère religieux. VIRG. ; Aen., VIII, 67-70. Énée s'éveille et prend de l'eau du fleuve dans le creux de ses mains (69)... Undam de flumine palmis || Sustulit. SERVIUS : Quia dicitur nox etiam solo somno polluere : unde est Et noctem flumine purgat [PERS. ; Sat., II, 16, mais il y a purgas, au lieu de purgat]. Or voici qu'à cette conception s'en ajoute une autre, où la propreté n'a plus aucune part, IV :
(6) Postera Phœbea lustrabat lampade terras.
SERVIUS : Lustrabat] ... id est purgabat : nam nox quodammodo polluit mundum. – Les Israélites croyaient que la nuit souillait l'eau dans les vases, SURHENHUSIUS ; Legum mischnicarum, t. II. Note de SHERINGAMIUS : (p. 224) Tradunt siquidem Hebraei aquam in vase sacro nocte pollui : ideoque machinam labro, quia vas sacrum erat, fecerunt, ne in ipso aquae pernoctarent. Maimonides in Hilcoth Beth Habbechira... Fecerunt ei machinam, in qua aquae iugiter inessent, et ea prophana erat, ne aquae eius nocte polluerentur ; quia labrum vas sacrum erat et sanctificabat, quicquid autem sanctificatur in vase sacro, si pernoctat polluitur. Manus quoque nocte pollui traditur in Gemara Sevachim, fol. 19... Et propterea aiunt Talmudici, quod licet Sacerdotes manus et pedes abluissent cum templo exissent, iisdem tamen postridie cum redissent opus erat lotione, tametsi insomnes fuissent... quia manus nocte polluuntur. L'auteur croit que les Israélites prirent cette superstition aux Gentils mais c'est l'erreur habituelle de vouloir considérer comme des imitations les productions d'un même sentiment (§ 733 et sv.) Les Israélites et les Gentils avaient d'autres genres d'impuretés qu'on peut, du moins en partie, mettre en rapport avec la propreté. L'impureté de la lèpre, chez les Israélites, peut être considérée comme semblable à celle des maladies contagieuses, chez les modernes. L'impureté contractée en touchant des corps morts peut, en partie, faire éviter le péril d'empoisonnement par les toxines, ou être une mesure de propreté ; mais en outre, elle a des fioritures absolument fantaisistes. L'impureté des accouchées peut aussi passer pour une mesure de propreté. Mais ensuite, quand la Bible (Lévit., 12, 2) assigne sept jours d'impureté à la femme, si elle a mis au monde un enfant mâle, et quatorze jours (ibid., 12, 5) si elle est accouchée d'une fille, tout motif rationnel de propreté pour expliquer cette différence disparaît. Suivent d'autres impuretés que nous nommerons en latin. Immundities menstruatae – concubitus coniugalis – somni, seminis fluxum procurantis – ex alvo aut vesica levata.
[FN: § 1249-1]
MARC. ; VII, 15 :
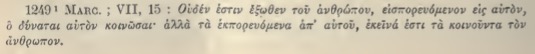
permet pas l'absolution d'un péché futur [FN: § 1252 note 3] ; mais elle rencontre des difficultés dans l'instinct qui pousse les croyants à attribuer de l'efficacité aux actes matériels du culte, indépendamment de l'élément moral.
[FN: § 1250-1]
DIOG. LAERT. ; VI, c. 2, 30. – PLUTARCH., De aud. poet., 4, rapporte le même fait avec une variante. Après avoir cité les vers de Sophocle : « Trois fois heureux, quand ils viendront dans l'Hadès, ces hommes auxquels il fut donné d'être initiés ; car, eux seulement vivront ; les autres souffriront toutes sortes de maux », il dit que Diogène observait à ce propos : « Que dis-tu ? Après sa mort et parce qu'il est initié, le brigand Patécion aura donc un sort meilleur qu'Épaminondas ? » – DIOG. LAERT., VI, c. 2, 42, raconte que Diogène, « voyant quelqu'un qui se purifiait avec de l'eau, dit : Malheureux ! Ne sais-tu pas que, comme tu ne pourrais effacer par la purification de l'eau les erreurs de grammaire, de même [tu ne pourrais effacer] non plus celles de la vie ? » – EURIPIDE, qui sentait le contraste existant entre l'ancienne religion formaliste et les nouvelles conceptions rationalistes, fait dire à Iphigénie parlant d'Artémis, dans le drame d'Iphigénie en Tauride : « (380-386) Je blâme les prescriptions artificieuses de la déesse, elle qui repousse de l'autel comme impur un mortel, s'il est souillé par un homicide ou même par un enfantement, ou si ses mains ont touché un cadavre, tandis qu'elle se réjouit de sacrifices humains. D'aucune façon, Latone, épouse de Zeus, ne peut avoir enfanté une si grande absurdité ». En effet, c'est absurde au point de vue logique; mais ce sentiment est postérieur à celui qui, sans raisonner, mettait ensemble des actions non-logiques, comme de simples fétichismes.
[FN: § 1252-1]
DE RIENZI ; Océanie, t. III. Dans l'île Tonga, « (p. 53) toute personne qui touche un chef supérieur devient tabouée, mais cette interdiction n'a pas de suites fâcheuses si elle a recours au moë-moë ». Elle doit le faire « (p. 53) avant de pouvoir se servir de ses mains pour (54) manger. Cette cérémonie consiste à appliquer d'abord la paume et ensuite le dos de la main à la plante des pieds d'un chef supérieur, et à se laver ensuite les mains dans de l'eau, ou à se les frotter avec des feuilles de bananier ou de plantain ; on peut alors manger en toute sûreté. Celui qui a eu le malheur de se servir de mains tabouées est obligé d'aller s'asseoir devant un chef, de prendre son pied et de se l'appliquer contre l'estomac pour que les aliments qu'il a pris ne lui fassent aucun mal, autrement son corps s'enflerait et il s'ensuivrait une mort certaine. On se taboue aussi en mangeant en présence d'un parent supérieur, à moins qu'on ne lui tourne le dos, et en prenant des aliments qu'un chef aura maniés. Si l'on est taboué pour avoir touché le corps où le vêtement du touï-tonga, lui seul peut en remettre la peine, parce qu'il n'existe pas de chef aussi grand que lui. Il a pour cet effet, à sa porte, un plat d'étain qui lui a été donné par le capitaine Cook, et qu'il suffit de toucher pour s'ôter le tabou ». Ici, l'on voit bien l'adjonction des résidus des combinaisons. Ce plat d'étain est arrivé aux îles Tonga, alors que le tabou existait depuis longtemps ; il ne peut donc avoir eu, à l'origine, aucun rapport avec ce tabou ; et c'est seulement parce que c'était une chose étrange et précieuse (§ 922) qu'il a eu part aux cérémonies du tabou. Notez que le vol aussi est considéré comme une transgression du tabou. « (p. 53) Si un homme commet un vol, on dit qu'il a rompu le tabou ; et comme on croit que les requins attaquent les voleurs de préférence aux honnêtes gens, on fait baigner les individus suspects dans un endroit fréquenté par ces animaux, et tous ceux qu'ils mordent ou dévorent sont réputés coupables ». Pour ces indigènes, on transgresse le tabou en mangeant certains aliments et en volant. Il faut y remédier par certains actes. Pour les catholiques, c'est un péché que de manger certains aliments, certains jours, et de voler. Il faut y remédier par certains actes. L'indigène des îles Tonga va chez l'un de ses chefs, le catholique chez un prêtre. Pour le premier, il y a des cas réservés au chef suprême; pour le second, il en est de réservés au pape.
[FN: § 1252-2]
OVID.; Fast., V :
(681) Ablue praeteriti periuria temporis, inquit.
Ablue praeterita perfida verba die. Sive ego te feci testem, faisove citavi
Non audituri numina magna Iovis
Sive Deum prudens alium Divamve fefelli ;
Abstulerint celeres improba dicta Noti.
Et pereant veaiente die periuria nobis :
Nec eurent Superi, si qua locutus ero.
[FN: § 1252-3]
Inferno, XXVII :
(118) Ch'assolver non si può chi non si pente,
Nè pentére e volere insieme puossi
Per la contradizion che nol consente.
(118) Sans repentir nus n'est assous dès or;
Voloir ensemble pecher et se pentir
Se contredit, au dam du pecheor.(Trad. LITTRÉ.
[FN: § 1254-1] À la lettre : «le petit d'une truie dont les mamelles saillent encore du ventre qui a mis bas ». À propos de cette victime, le scoliaste note : « ![]() dit [l'auteur] „ ce qui purifie “. C'est un petit cochon. Ceux qui sacrifient pour purifier mouillent du sang de ce porc les mains de la personne qui se fait purifier ».
dit [l'auteur] „ ce qui purifie “. C'est un petit cochon. Ceux qui sacrifient pour purifier mouillent du sang de ce porc les mains de la personne qui se fait purifier ».
[FN: § 1255-1]
APOLL.; III, 13. 2. Pélée, purifié par Eurytion et croyant décocher une flèche au sanglier de Calidon, frappe Eurytion par mégarde et le tue. Il est purifié par Acaste. – DIOD. SIC. ; IV, 72. Dans un jeu, Pélée tue par mégarde un frère consanguin, puis est purifié par Actor.
[FN: § 1255-2]
PLUTARCH. ; Thes., 11, 4. ![]() . C'est ainsi que Thésée poursuivait, châtiant les méchants... » Continuant son chemin, il parvient près du Céphyse (12, 1), où il arrive chez les Phytalides, qui le saluent ; et il les prie de le purifier, ce qu'ils font avec les rites en usage.
. C'est ainsi que Thésée poursuivait, châtiant les méchants... » Continuant son chemin, il parvient près du Céphyse (12, 1), où il arrive chez les Phytalides, qui le saluent ; et il les prie de le purifier, ce qu'ils font avec les rites en usage.
[FN: § 1255-3]
PLUTARCH.; Quaest. graec., 12. On commémorait, à Delphes, le meurtre du serpent et la purification d'Apollon, conséquence du meurtre. Idem; De defect. orac., 15 : « Car il est absolument ridicule, mes amis, qu'après avoir tue la bête féroce, Apollon se soit enfui aux confins de Grèce, ayant besoin de purifications... »
[FN: § 1255-4]
SOPH. ; Ajax, 654-655.
[FN: § 1255-5]
ARRIAN.; De venat., 32, 3 : « Après une chasse fructueuse, on doit aussi sacrifier et offrir les prémices du gibier à la déesse, pour purifier les chiens et les chasseurs, suivant l'usage de la patrie ».
[FN: § 1255-6]
PAUS.; V, Eliac., 1, 27.
[FN: § 1256-1]
PAUS ; III, 17.
[FN: § 1257-1]
DIOG. LAERT. ; VIII, 43. – CLEMENT. ALEX. ; Strom., IV, p. 619 éd. Potter. –STOBAEUS ; Flor., LXXIV, 55. – THEODORIT.; Serm., XII.
[FN: § 1258-1]
HOVELACQUE ; Les nègres : « (p. 311) Durant la période du flux menstruel les femmes vivent généralement à part, parfois – comme en quelques contrées de la Côte de l'Or – dans des huttes destinées à cette relégation ». L'auteur cite BOSMAN, t. II, p. 371, qui dit : « On tient ici (à la Côte des Esclaves) les femmes qui ont leurs ordinaires pour si souillées, qu'elles n'oseraient pendant ce temps-là entrer dans la maison du roi ni de quelque grand, et on punit de mort, ou du moins par un esclavage éternel, celles qui contreviennent à ces ordres ». Et ailleurs encore : « Les femmes qui ont leurs ordinaires sont tenues pour si souillées, qu'il ne leur est pas permis d'entrer dans la maison de leur mari, ni de toucher la moindre chose, soit pour préparer à manger, soit pour nettoyer la maison (ibid., p. 475) ». – LAFITAU ; Mœurs des sauvages, t. I : « (p. 262) Elles [les séparations des femmes et des filles, au temps de leurs ordinaires et de leurs purifications] sont très rigoureuses en Amérique, où on leur fait [aux femmes] des Cabanes à part, comme à ceux qui étaient attaqués de la lèpre parmi les Juifs. Elles passent alors pour être si immondes, qu'elles n'osent toucher à rien qui soit d'usage. La première fois que cela leur arrive, elles sont trente jours séparées du reste du peuple, et chaque fois on éteint le feu de la Cabane d'où elles sortent ; on en emporte les cendres, qu'on jette hors du Village, et on allume un feu nouveau, comme si le premier avait été souillé par leur présence. Chez les Peuples, qui (p. 268) habitent les bords de la Rivière de la Plata, on les coud dans leur Hamach, comme si elles étaient mortes, sans y laisser qu'une petite ouverture à la bouche pour ne pas leur ôter l'usage de la respiration. Elles restent dans cet état tandis que cela dure : après quoi elles entrent dans les épreuves par où doivent passer toutes celles qui ont atteint l'âge de puberté,... Chez les Gaures (TAVERNIER, Voyage de Perse, liv. 4, chap. 8) „ dès que les femmes ou filles sentent qu'elles ont leurs ordinaires, elles sortent promptement de leur logis, et vont demeurer seules à la campagne dans une petite hutte, faite de clayes avec une toile pendue au-devant, et qui sert de porte. Pendant le temps que cela dure, on leur porte tous les jours à boire, et à manger ; et quand elles en sont quittes, chacune, selon ses moyens, envoie au Prêtre un Chevreau, ou une Poule, ou un Pigeon pour offrande ; après quoi elles vont aux bains... “ ».
[FN: § 1258-2]
Levit., 15, 2. Vir, qui patitur fluxum seminis, immundus erit... (16) Vir de quo egreditur semen coitus, lavabit aqua omne corpus suum; et immundus erit usque ad vesperum... (18) Mulier, cum qua coierit, lavabitur aqua, et immunda erit usque ad vesperum. (19) Mulier, quae redeunte mense patitur fluxum sanguinis, septem diebus separabitur. (20) Omnis qui tetigerit eam, immundus erit usque ad vesperum... (23) Omne vas, super quo illa sederit, quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua; et ipse lotus aqua, pollutus erit usque ad vesperum. (24) Si coierit cum ea vir tempore sanguinis menstrualis, immundus erit septem diebus, et omne stratum, in quo dormierit, polluetur. On a l'habitude de dire que ce sont des mesures de propreté ; mais si c'était le cas, l'impureté devrait cesser lorsqu'on a exécuté le lavage prescrit, tandis qu'au contraire, elle continue à exister (§ 1247-1).
[FN: § 1259-1]
POLLUC. ; VIII, 7, 65-66. –- HESYCH. ; s. r. ![]() . – SUID. ; s. r.
. – SUID. ; s. r. ![]() . – EUSTATET. ; Ad. Il., VIII, v. 187.
. – EUSTATET. ; Ad. Il., VIII, v. 187.
[FN: § 1259-2]
VIRG. . Aen., VI. Enea,
(229) Idem ter socios pura circumtulit unda,
Spargens rore levi et ramo felicis olivae.
SERV. ; Ter sociosi] Aut saepius, aut re vera ter : licet enim a funere contraxerint pollutionem, tamen omnis purgatio ad superos pertinet : unde et ait imparem numerum : aut quia hoc ratio exigit lustrationis, Circumtulit] Purgavit. Antiquum verbum est. Plautus in fragm. Pro larvato te circumferam, id est, purgabo: nam lustratio a circumlatione dicta est vel taedae, vel victimae in quibusdam, vel sulphuris.
[FN: § 1260-1]
THEOPHR.; Charact., XVI. J'ai écrit d'une façon générale : s'il fait une rencontre réputée mauvaise, pour ne pas entrer dans la discussion suscitée par cette partie très altérée du texte. Coray veut qu'il s'agisse là du mauvais œil. – PLUTARCH. ; De superst., 3. Le superstitieux qui a fait un mauvais rêve va chez des charlatans qui lui disent : « Appelle la vieille qui purifie; baptise-toi toi-même dans la mer, et passe la journée, assis sur la terre » – ![]()
![]() – APUL. ; Métamorph., raconte une purification, XI. Iamque tempore, ut aiebat sacerdos, id postulante, stipatum me religiosa cohorte deducit ad proximas balneas : et prius sueto lavacro traditum, praefatus deum veniam, purissime circumrorans abluit…
– APUL. ; Métamorph., raconte une purification, XI. Iamque tempore, ut aiebat sacerdos, id postulante, stipatum me religiosa cohorte deducit ad proximas balneas : et prius sueto lavacro traditum, praefatus deum veniam, purissime circumrorans abluit…
[FN: § 1260-2]
PROP. ; IV, 8, 83-86 : « ... elle soumet à des fumigations tous les endroits que les filles avaient touchés, et lave le seuil de la porte avec de l'eau pure. Elle m'ordonne de changer entièrement de vêtements, et fait trois fois le tour de ma tête avec la flamme du soufre ». – Tibulle dit avoir fait les lustrations à sa maîtresse qui était infirme, portant trois fois le soufre autour d'elle. – TIBULL. ; I, 5
(11) Ipseque ter ciroum lustravi sulfure puro.
Le « soufre pur », ![]() , des Grecs, est le soufre qui purifie.
, des Grecs, est le soufre qui purifie.
[FN: § 1260-3] IUVEN. ; VI :
(522) Hibernum fracta glacie descendet in amnem,
Ter matutino Tiberi mergetur et ipsis
Vorticibus timiduin caput abluet ;....
[FN: § 1261-1]
LOISELEUR DESLONGCHAMPS ; Lois de Manou, V : « (74) Telle est la règle de l'impureté causée par la mort d'un parent, lorsqu'on se trouve sur le lieu même ; mais en cas d'éloignement, voici quelle est la règle que doivent suivre les sapindas et les samânodakas. (75) Celui qui apprend, avant l'expiration des dix jours d'impureté, qu'un de ses parents est mort dans un pays éloigné, est impur pendant le reste des dix jours. (76) Mais si le dixième jour est passé, il est impur pendant trois nuits ; et s'il s'est écoulé une année, il se purifie en se baignant. (77) Si, lorsque les dix jours sont expirés, un homme apprend la mort d'un parent ou la naissance d'un enfant mâle, il devient pur en se plongeant dans l'eau avec ses vêtements ». Ce ne sont pas seulement des prescriptions théoriques ; elles sont mises aussi en pratique. – DUBOIS ; Mœurs... des peuples de l'Inde, t. I : « (p. 244) ...les Indiens se regardent comme souillés pour avoir simplement assisté à des funérailles ; ils vont se plonger dans l'eau immédiatement après la cérémonie funèbre, et personne n'oserait rentrer chez soi avant de s'être ainsi purifié. La seule nouvelle du décès d'un parent, fût-il mort à cent lieues de là, produit les mêmes effets, et oblige à la même purification tous les membres de sa famille qui en sont informés. Toutefois la souillure n'atteint point les amis et les simples connaissances du défunt ».
[FN: § 1262-1]
FARJENEL ; La morale chinoise : « (p. 243) ... la personnalité des individus [dans le droit chinois] y disparaît dans la puissance paternelle du chef de famille, du magistrat et du prince qui sont en théorie les frères aînés et le père de tous les sujets. Le terrible principe de la solidarité pénale était une (p. 244) preuve manifeste de cette notion, pour nous étrange, de la personnalité humaine. Certains grands crimes ne pouvaient être vengés que par la décapitation de tous les ascendants et descendants du coupable, bien que ceux-ci fussent ignorants du crime perpétré ou seulement préparé, parce que l'esprit de la loi chinoise est que la famille seule, considérée in globo, est le véritable individu. Jusqu'au 25 avril 1905, cette prescription a figuré dans les lois ».
[FN: § 1263-1]
LOISELEUR DESLONGCHAMPS; Lois de Manou, IX : « (45) Celui-là seul est un homme parfait qui se compose de trois personnes réunies, savoir : sa femme, lui-même et son fils ; et les Brahmanes ont déclaré cette maxime : „ Le mari ne fait qu'une même personne avec son épouse “. (48) Le propriétaire du mâle qui a engendré avec des vaches, des juments, des chameaux femelles, des filles esclaves, des buffles femelles, des chèvres et des brebis, n'a aucun droit sur la progéniture ; la même chose a lieu pour les femmes des autres hommes. (58) Le frère aîné qui connaît charnellement la femme de son jeune frère, et le jeune frère la femme de son aîné, sont dégradés, bien qu'ils y aient été invités par le mari ou par les parents, à moins que le mariage ne soit stérile. (59) Lorsqu'on n'a pas d'enfants, la progéniture que l'on désire peut être obtenue par l'union de l'épouse, convenablement autorisée, avec un frère ou un autre parent (sapinda). (60) Arrosé de beurre liquide et gardant le silence, que le parent chargé de cet office, en s'approchant, pendant la nuit, d'une veuve ou d'une femme sans enfants, engendre un seul fils, mais jamais un second. (61) Quelques-uns de ceux qui connaissent à fond cette question, se fondant sur ce que le but de cette disposition peut n'être pas parfaitement atteint par la naissance d'un seul enfant, sont d'avis que les femmes peuvent légalement engendrer de cette manière un second fils. (127) Celui qui n'a point d'enfant mâle peut charger sa fille, de la manière suivante, de lui élever un fils, en se disant : “ que l'enfant mâle qu'elle mettra au monde devienne le mien et accomplisse en mon honneur la cérémonie funèbre ”. (128) C'est de cette manière qu'autrefois le Pradjâpati Dakcha lui-même destina ses cinquante filles à lui donner des fils, pour l'accroissement de sa race ». Aussi a-t-on encore la prescription suivante, III « (11) Un homme de sens ne doit pas épouser une fille qui n'a pas de frère, ou dont le père n'est pas connu ; dans la crainte, pour le premier cas, qu'elle ne lui soit accordée par le père que dans l'intention d'adopter le fils qu'elle pourrait avoir, ou, pour le second cas, de contracter un mariage illicite ». Cfr. IX, 136.
[FN: § 1264-1] SURENHUSIUS ; Legum Mischnicarum liber qui inscribitur ordo puritatum, t. VI. Praefatio . (C 2) Caeterum immundities mortui novem continet immunditiei patres, et ipsius caro in copia olivae polluit immunditie mortui, ita quoque olivae copia de carne ipsius avulsa, et copia cochlearis de putredine, et tantundem de ossibus et sanguine ipsius; totum vero mortui cadaver est... avus immunditiei.
[FN: § 1264-2]
SURENHUSIUS, loc.. cit. : (D) Omnes vero patres immunditiei ex lege, sunt triginta duo, videlicet, reptile, cadaver animantis, cadaver humanum, homo cadaver humano pollutus, vasa quae hominem cadavere humano pollutum tetigerunt, vasa quae cadavere humano polluta surit, vasa quae tetigerunt alia vasa quae cadavere humano polluta sunt, tentorium, sepulchrum, eiectio seminis aqua expiatoria, vacca rufa, iuvenci, et hirci qui comburendi erant, hircus emissarius, vir gonorrhoea affectus, et foemina gonorrhoea affecta, menstruosa, puerpera, equitatio et sessio utriusque sexus, qui cum menstruosa corpus miscuit, sanguis foeminae immundae, saliva eius, urina, profluvium seminis, eiectio seminis illius, leprosus in diebus numerationis suae, leprosus in diebus leprae ipsius indabitate, vestis lepra affecta, et denique domiciliura lepra affectum ; hi inquam vocantur... patres immunditiei ex lege.
[FN: § 1264-3]
Levit., XI, 29-82.(Edit. Tischendorf):
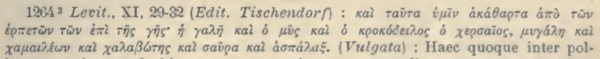
(Vulgata) ; Haec quoque inter polluta reputabantur de his quae moventur in terra : mustella et mus et crocodilus, singula iuxta genus suum, mygale et chamaeleon, et stellio, et lacerta, et talpa. – SURENHUSIUS, loc. cit. : (C 2) Per ...reptilia, intelligenda sunt octo in lege memorata reptilium. genera, cuiusmodi sunt mustela, mus, testudo, attelabus, lacerta stellio, limax, et talpa. Sanguis vero reptilium, et ipsorum caro atque adeps eundem tenent immunditiei gradum. Quatuor reptiliurn pellis carni similis est ratione immunditiei, videlicet attelabi lacertae, stellionis atque limacis; ossa vero reptilib us adempta non poluunt. Caetera vero reptilia et abominabilia, scilicet rana, rubeta, vipera, serpens, atque id genus alia nun pollunt. (Trad. SEGOND) : « ... la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon ». (Trad. CRAMPON) « ...la belette, la souris et toute espèce de lézards; la musaraigne, le caméléon, la salamandre, le lézard vert et la taupe ».
[FN: § 1264-4]
SURENHUSIUS ; loc. cit. : (D 2) Iam vero si omnes immunditiei patres ex institutis Sapientum recenseamus, comperiemus eos esse viginti novem, cuiusmodi sunt os cadaveris in copia grani hordeacei, sanguis conculcationis, terra gentilium, ager in quo cadaverum ossa latent, tentorium quod supra sanguine conculcationis exstructum est, homo qui hisce pollutus est, vasa quae haec tetigerunt, vel hisce polluta sunt, homo qui vasa tetigit, vasa quae hominem tetigerunt, vasa quae tetigerunt alia vasa hisce polluta, gentilis, foemina praepostere menstrualis, foemina quae maculam sanguinis praepostere vidit, foemina quae in accessu menstruali se non visitavit praepostere, puerpera quae aliquod foetus membrum peperit, ipsius accubitus, equitatio, saliva, urina, et immunditiei sanguis ; porro quoque vir qui cum foemina immunda rem habuit quae gonorrhoea laborabat, gentilis, idolatra, cultus idolatricus, quod a gentili mactatum est, et tandem cadaver avis mundae.
[FN: § 1264-5]
SURENHUSIUS ; loc. cit., § 1264 (E).
[FN: § 1266-1]
ARISTOPH. ; Ecclesiaz., 128.
[FN: § 1266-2]
Nombr., 19, 19-22. « Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur (immonde), le troisième ou le septième jour, et le purifiera le septième jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau ; le soir venu, il sera pur. Un homme qui est immonde et ne se purifiera pas sera retranché du peuple, parce qu'il a souillé le sanctuaire de l'Éternel; puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est immonde. Ce sera pour eux [pour les Israélites] une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera immonde jusqu'au soir. Tout ce qui touchera celui qui est immonde sera souillé, et la personne qui le touchera sera immonde jusqu'au soir ».
[FN: § 1266-3]
OVID. ; Fast., IV
(639) Igne cremat vitulos, quae natu maxima,Virgo ;
Luce Palis populos purget ut ille cinis.
[FN: § 1266-4]
FEST ; in PAUL. DIAC., s. r. October. October equus appellabatur, qui in campo Martio mense Octobri Marti immolabatur. De cuius capite magna erat contentio inter Suburanenses et Sacravienses, ut hi in regiae pariete, illi ad turrem Mamiliam id figerent. Coins cauda, ut ex ea sanguis in focum distillaret, magna celeritate perferebatur in regiam.
[FN: § 1266-5]
OVID. ; Fast., IV :
(728) Certe ego transilui positas ter in ordine flammas ;
Virgaque roratas laurea misit aquas
.........................................................
(731) I, pete virginea, populus, suffimen ab ara;
Vesta dabit : Vestae munere purus eris.
Sanguis equi suffimen erit, vitulique favilla ;
Tertia res, durae culmen inane fabae.
.........................................................
(739) Caerulei fiant vivo de sulphure fumi
(781) Moxque per ardentes stipulas crepitantis acervos
Traiicias celeri strenua membra pede.
[FN: § 1266-6]
Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Cendres (mercredi des) « (p. 159) La cendre qu'on répand sur la tête des fidèles est tirée de l'incinération des palmes de l'année précédente et elle est bénite, immédiatement avant la Messe du Mercredi des Cendres, d'après un rite particulier ».
[FN: § 1267-1]
Legum Mischnicarum... pars VI. Tract. de Vasis. C. 1, 2, (p. 16) commentaire de Bartenora. Voir aussi ce qui suit : C. 1, 1 : (p. 15) Patres impuritatum sunt reptile, semen concubitus, mortuo pollutus et leprosus in diebus numerationis ipsius, et aquae expiatoriae, in quibus non est quantum sufficit ad spargendum, haec omnia polluunt hominem et vasa tactu, et vasa testacea aëre, sed non onere. – Comm. de BART. : Et semen concubitus, duntaxat semen concubitus Israëlitae, et adulti viri, sed gentilis semen concubitus non polluit [on trouvera des distinctions analogues aux § 1278 et sv.], ne quidem ex institutis Sapientium, nam semen gentilis purum est omnino; nec adolescentuli semen concubitus polluit.., Sed vasa testacea, cibi et potus, quae tetigerint mortuum, non fiunt immunditiei patres. Sed Israëlita duntaxat fit immunditiei pater quando is mortuum tetigerit ; gentilis vero et abortus qui excidit post octo dies non recipiunt immunditiem, si tetigerint mortuum... Et aquae expiatoriae in quibus non est quantum sufficit ad spargendum, tum istae polluunt tactu, at si in illis fuerit quantum sufficit ad sparsionem, etiam onere polluunt, ad hominem et vasa polluenda, uti scriptum est Num., 19, 21. Doctores vero nostri docent purum esse, eum qui sparsit ; Legem duntaxat mensuram velle stattiere ei qui portat, nempe ut sit quantitas aquae sufficiens ad spargendum. Etenim Lex dividit inter aquas et aquas, scilicet inter aquas in quibus est quantum sufficit ad (p. 16) spargendum, quae polluunt hominem ad polluondum vestes, et inter aquas in quibus non est quanto sufficit ad spargendum, polluantes hominem ad polluendos cibos et potus, et non ad vestes polluendas. C. 1, 2 : (p. 16) His superius est cadaver, et aquae expiatoriae in quibus est quantum ad sparsionem sufficit, polluunt hominem onere, ut is denuo polluat vestes tactu, et subtractas veste tactu. – (MAIM.) : ... polluit portatione, eius sensus est quod si homo elevaverit pondus rei impurae pollutus sit, etsi is ipsum corpus non tetigerit quod pollutum erat... Sed huic simile est inclinatio, qua lignum aliquod summitate parietis paratum est, et immundities est in extremitate tigni, si quis ergo secundae extremitati innixus fuerit, et elevaverit istam extremitatem in qua immundities est, pollutus est inclinatione ligni istius. – (BARTEN.) : Et subtractas veste tactu... intelliguntur vestes immunditiei subtractae, et in his tactus obtinet absque portatione, qui enim attigerit cadaver vel menstruae aquas, easque non portaverit, non polluit, ne quidem vestes indutas...
[FN: § 1268-1]
Legum Mischnicarum... pars VI. De vasis, c. 8, 5 (p. 48).
[FN: § 1268-2]
Loc. cit ; De vasis, c. 8, 11 (p. 51).
[FN: § 1268-3]
Loc. cit ;. De puritatibus, c. 4, 2 (p. 327) c. 4, 3 (p. 327).
[FN: § 1268-4]
Loc. cit. ; De puritatibus, c. 4, 6 (p. 329) c. 5, 7 (p. 330) ; c. 5, 8 (p. 330).
[FN: § 1268-5]
Legum Mischnicarum.... pars. VI De lavacris, 8, 4 (p. 381) : Si gentilis eiecerit semen ab Israëlita immissum, immunda est. Si filia Israëlitae eiecerit semen a gentili iniectum, munda est. Si uxor domi coitum passa sit, et postea se laverit, sed puderida non purgaverit, perinde est ac si non lavisset se. Si is qui semen emisit, se immerserit, sed non prius minxerit, tum postquam urinam reddiderit, immundus est. R. Iose dicit aegrotus et senex immundus est, sed infans et sanus mundus est. (BART.) : In iuvene et sano mundus est, quia fortissimo emittunt semen, ita ut nihil remaneat... – Il y a pis encore, c. 8, 3 (p. 380). – On possède un traité entier : De fluxu menstruo, avec une casuistique très copieuse.
[FN: § 1268-6]
Legum Mischnicarum..., pars VI. De lavacris, c. 9, 1 (p. 382) : Haec in homine dividunt, fila lanae et lini, et corrigiae in capitibus filiarum. R. Ieuda dicit, fila e lana et e pilis non dividunt, quia ad illa perveniunt aquae. – Suivent des considérations peu propres, c. 9, 2; c. 9, 3 : Haec non dividunt, capilli, pili axillae, locus occultus in viro. R. Eliezer dicit, perinde se res habet in viro et in foemina, quidquid quis curat, id dividit, sin minus, non dividit. (BART.) : Et locus secretus in viro, nam vir istius loci non tam accuratam curam gerit, imo ne quidem foemina, nisi maritata sit, uti expositum est; si ergo quis talia loca non curat, ipsa nec dividunt, si nempe ea non sint in maxima corporis parte. – Suivent un grand nombre d'autres commentaires.
[FN: § 1272-1]
DUBOIS: Mœurs... des peuples de l'Inde, t. I « (p. 245) Le flux menstruel et celui qui accompagne l'enfantement impriment passagèrement aux femmes... un caractère immonde. L'accouchée vit entièrement séquestrée l'espace d'un mois... Les femmes sont soumises au même isolement pour tout le temps que durent leurs souillures périodiques... (p. 246). Lorsque les jours d'expiation des souillures de ce genre sont accomplis, on donne au blanchisseur les vêtements que la femme avait sur le corps. On évite avec grand soin que ces vêtements n'entrent dans la maison, et personne n'aurait même le courage de porter les yeux dessus... Cependant les femmes des linganistes, pour se purifier des mêmes souillures, se contentent de se frotter le front avec de la fiente de vache réduite en cendres ; et par cette simple cérémonie... elles sont censées purifiées... (p. 247) Les vases de terre sont de nature à contracter une souillure ineffaçable, qui ne s'attache pas aux vases de métal : il suffit de laver ces derniers pour les purifier ; mais les autres, devenus hors d'usage doivent être détruits... Il en est des vêtements comme des vases ; les uns sont susceptibles de souillures et les autres ne le sont pas... (p. 249) Un brahme scrupuleux doit encore bien regarder où il pose les pieds en marchant ; il serait souillé et obligé de se baigner, si par mégarde ses pieds venaient à toucher un os, un tesson, une guenille, une feuille sur laquelle on aurait mangé, un morceau de peau ou de cuir, des cheveux, et autres choses immondes. La place ou il veut s'asseoir demande aussi toute son attention... La manière de manger n'est pas non plus sans conséquence... (p. 250). Ils ont pour la salive une horreur insurmontable... pour un Indien, c'est moins l'idée de propreté qui le domine à cet égard, que son éternelle appréhension des souillures... (p. 252) L'attouchement de plusieurs espèces d'animaux, et surtout du chien, souille la personne des brahmes : il est curieux d'observer les mouvements qu'ils font, et les précautions qu'ils prennent, pour éviter les caresses familières d'un de ces fidèles compagnons de l'homme. Si, quoi qu'ils aient pu faire, le chien vient à les toucher, ils n'ont d'autre parti à prendre que d'aller en grande hâte se plonger tout habillés dans l'eau, afin d'effacer la souillure que l'attouchement de cet animal immonde a imprimée à leur personne et à leurs habits ».
[FN: § 1276-1]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, t. III,.c. 48 : «(p. 396) Je dis donc que tous les aliments que la Loi nous a défendus forment une nourriture malsaine. Dans tout ce qui nous a été défendu, il n'y a que le porc et la graisse qui ne soient pas réputés nuisibles, mais il n'en est point ainsi, car le porc est (une nourriture) plus humide qu'il ne faut et d'une trop grande exubérance. La raison principale pourquoi la Loi l'a en abomination, c'est qu'il est très malpropre et qu'il se nourrit de choses malpropres... (p. 397) De même, les graisses des entrailles sont trop nourrissantes, nuisent à la digestion et produisent du sang froid et épais... Quant aux signes caractéristiques (d'un animal pur), à savoir, pour les quadrupèdes, de ruminer et d'avoir le sabot divisé, et, pour les poissons, d'avoir des nageoires et des écailles, il faut savoir que l'existence de ces signes n'est pas la raison pourquoi il est permis de s'en nourrir, ni le manque de ces signes la raison pourquoi ces animaux sont défendus. Ce sont simplement des signes qui servent à faire reconnaître la bonne espèce et à la distinguer de la mauvaise ». Cet auteur explique et justifie toutes les prescriptions de la Bible par des motifs tirés de l'expérience et de la logique. Pourtant, en des cas très rares, il avoue ne pas réussir à trouver ces motifs. « (p. 394) La raison pourquoi la purification se faisait avec du bois de cèdre, de l'hysope, de la laine cramoisie et deux oiseaux, a été indiquée dans les Midraschôt ; mais elle ne convient pas à notre but, et jusqu'à présent je n'ai su me rendre compte de rien de tout cela. Je ne sais pas non plus pour quelle raison on emploie dans la cérémonie de la vache rousse le bois de cèdre, l'hysope et la laine cramoisie, ni pourquoi on se sert d'un bouquet d'hysope pour faire l'aspersion avec le sang de l'agneau pascal ; je ne trouve rien par quoi justifier la préférence donnée à ces espèces ». Les explications logiques des prescriptions concernant les animaux impurs continuent jusqu'à notre époque. – CH. MILL. ; Hist. du Mahomét. : « (339) La nature du climat, dans les pays orientaux, (p. 340) contribue à rendre certains aliments nuisibles à la santé ; c'est pour cette raison que les législateurs, tantôt ont distingué les animaux en purs, ou impurs, c'est-à-dire, ceux qui offrent et ceux qui n'offrent point une nourriture salutaire, et tantôt, en ont spécialement interdit quelques-uns, en laissant l'usage du reste à la discrétion des peuples [tout cela est fantaisiste et provient de ce qu'on veut voir en toute chose des actions logiques]. Moïse appartient à la première, et Mahomet à la seconde classe de ces législateurs. C'est un fait généralement connu que la chair de l'animal immonde... engendre des maladies cutanées, et plus particulièrement dans les pays chauds. La malpropreté de ce quadrupède suffit pour en donner le dégoût, et nous voyons en effet que les Égyptiens, les Arabes et les autres peuples orientaux l'ont toujours abhorré : la nécessité des circonstances en dictait la prohibition... » S. Reinach montre fort bien la vanité de ces explications. S. REINACH ; Cultes, mythes et religions, t. I : « (p. 11) Très souvent la défense de tuer des (p. 12) animaux d'une ou de plusieurs espèces subsiste à l'état de tabou, c'est-à-dire d'interdiction non motivée, ou motivée après coup par des considérations d'un ordre tout différent (hygiéniques, par exemple) : c'est ce qui se constate encore chez les Musulmans et chez les Juifs ». Mais il a tort de voir dans ces prescriptions exclusivement des conséquences du totémisme. Lui-même fait voir qu'elles peuvent avoir diverses origines ; par exemple : « (p. 13, note) Aujourd'hui même, le paysan russe ne tue jamais une colombe, parce que c'est l'oiseau du Saint-Esprit, et l'on enseigne aux enfants, même en France, à ne pas écraser les insectes dits bêtes du bon Dieu ». Il n'y a pas la moindre preuve que ces insectes aient jamais été des totem. C'est ainsi qu'il dit encore : « (p. 91) Une des formes les plus anciennes et les plus répandues de la religion [en vérité, il faudrait dire des actions non-logiques] est le scrupule de tuer ou de manger un animal. Ces scrupules sont encore très répandus. Les Musulmans et les Juifs ne mangent pas de porc, les Russes ne mangent pas de pigeon, les Européens, du moins en général, ne mangent pas de chien et beaucoup éprouvent encore, pour la viande (p. 92) de cheval, une répugnance instinctive fondée sur une ancienne religion ». Cela peut être ; mais il y a d'autres faits semblables pour lesquels disparaît toute explication religieuse ou de totétisme, Tandis qu'en France et en Angleterre, le mouton passe pour une viande excellente, beaucoup de personnes de l'Italie centrale ne veulent en manger en aucune façon. Mais que le mouton ait vraiment été pour eux un totem, que ce soit là une prescription religieuse, par quels documents pourrait-on en donner la preuve ? Beaucoup d'Anglais s'étonnent de voir les Français manger des grenouilles. Dans tous les pays, il y a des personnes qui ont une répugnance absolue pour les huîtres. Les Arabes mangent les sauterelles. Essayez un peu (1) d'en faire manger à un Européen ! En tous ces faits ou en d'autres semblables manque le motif du totem, de la religion, ou, si l'on veut, le motif hygiénique. Ce sont simplement des actions non-logiques, comme on en voit tant dans la race humaine.
[FN: § 1277-1]
BURCKARDT, dans : Bibl. univ. des voy., t. 32. Voyage en Arabie... (1814-1817). On sait que le chien est aussi réputé impur chez les musulmans : « (p. 325) Il n'est pas indigne de remarque que Médine, autant que je puis le savoir, est la seule ville d'Orient d'où les chiens soient exclus. On ne leur permet jamais de passer la porte de l'intérieur, et ils doivent rester dans les faubourgs. La crainte qu'un chien n'entre dans la mosquée et n'en souille la sainteté les a probablement fait exclure. On les tolère cependant à la Mecque ». – CH. MILLS ; Hist. du Mahomét. : « (p. 510) La bienfaisance des Musulmans s'étend jusqu'à la création animale, et c'est un des articles établis de la foi musulmane que les animaux irrationnels seront jugés au dernier jour et seront mutuellement vengés des injures qu'ils se sont faites l'un à l'autre dans cette vie. Un sentiment de pitié a consacré, parmi les Turcs, une aversion prononcée pour la chasse, et les oiseaux sont rarement privés de leur liberté. Selon la tradition populaire, Mahomet affectionnait principalement le chat, parmi les (p. 511) animaux domestiques †. La gravité de sa démarche et son indifférence indépendante s'accordent bien avec la solennité sombre et l'orgueil du caractère des Turcs : et quoiqu'ils soient d'une propreté trop recherchée pour permettre qu'il touche leur personne, ils le reçoivent familièrement dans leurs maisons. Le chien n'est pas traité avec une attention aussi bienveillante. son attouchement est regardé comme contagieux, et son nom même est l'expression la plus énergique du mépris parmi les Turcs. ». Ces différences entre le chien et le chat ne sont pas explicables par le totémisme.
† [Note de Mill] : « LABAT ; Mémoires du chevalier d'Arvieux, t. III, p. 227. Les chats ne sont point des animaux impurs, et ils peuvent boire et manger des mêmes choses que les fidèles. Mais si un chien boit dans la coupe d'un croyant, elle doit être lavée sept fois. MISCHAT, vol. I, p. 108 p.
[FN: § 1277-2]
Lévit., XI, 12. (Vulgata) : Cuncta quae, non habent pinnulas et squamas in aquis, poiltita erunt . « (SEGOND) : Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles ».
[FN: § 1278-1]
RABBINOWICZ; Légis. crim., du Talmud, préface : « (p. XXXIII) Les Juifs ne les enterraient [les morts] jamais sur les routes publiques, en outre ils indiquaient les sépultures par une marque appelée tzijon. Les païens ne le faisaient pas. Il en résultait, à une époque où les Juifs étaient partout entourés de païens, que les premiers ne pouvaient pas observer les lois de la pureté concernant les morts païens, dont ils ne pouvaient pas reconnaître les tombeaux, et l'on a fini par croire que ces tombeaux ne rendaient pas impurs ». Lui-même nous donne un moyen de réfuter cette explication ; car il nous montre qu'elle concerne un cas particulier d'une théorie générale, à laquelle elle ne s'applique certainement pas. Il fait cela en voulant réfuter une autre théorie qu'il tient à juste titre pour erronée. « (p. XXXIII) On avait donc une tradition, qui s'est développée... d'après laquelle le tombeau d'un païen ne rendait pas impur. Cette tradition fut attachée, selon l'habitude talmudique, à un mot de la Bible. L'écriture dit qu'un adam, un homme, qui meurt rend impur... Ce mot adam, dit-on, s'applique seulement aux Juifs. Ce passage a été mal compris par certains commentateurs et incriminé par les ennemis du judaïsme encore dans le siècle passé [en note : „ On n'a pas remarqué que le mot ysch, homme, exclut aussi les païens à propos d'une autre impureté “]... (p. XXXIV) Ils ne savaient pas que le passage en question n'a été trouvé qu'après que les Juifs se furent habitués pendant des siècles à ne pas appliquer la loi de la pureté aux tombeaux païens. C'est ainsi que le passage du Cantique des Cantiques qui défendait aux Juifs de se révolter contre les païens... n'a été découvert qu'après la dernière révolution de Bar Khokhbah, quand toute insurrection était devenue impossible... » Le même auteur, dans la Législation civile du Talmud, t. V, p. 381, rappelle la disposition qui fait disparaître l'impureté du mort païen ; et il ajoute : «Rab dit : Si un mort doit, sous le rapport de certaines lois de l'impureté, être considéré comme un individu vivant, c'est pour éviter qu'on ne le considère pas comme un cadavre quand il n'y a qu'une mort apparente ». Comme d'habitude, les dérivations sont la partie variable du phénomène, dont les résidus sont la partie constante. Ajoutez-y les considérations du § 1279-2.
[FN: § 1279-1]
RABINOWICZ ; Législation civile du Talmud, t. V, p. 411.
[FN: § 1279-2]
Nous avons déjà indiqué l'un de ces problèmes à la note 1278-1. Ajoutons-y les suivants : Legum Mischnicarum..., pars VI. De puritatibus, c. 2, 8 : (p. 385) Si in urbe sit una stulta, vel peregrina, Ivel Cuthaea, tum omnia sputa in urbe inventa, sunt immunda... (MAIM.) : Iam exposuimus ab initio libri quod gentiles sint pro seminifluis habendi in omnibus rebus. Praeterea capite quarto codicis de Menstruis diximus quod foemina Cuthaea versetur in suspicione quod semper sit menstrua. Notum vero est quod foemina stulta non custodiat se, nec, observet menstrui sui tempora, secundum id quo in Lege definitum est. De fluxu Menstruo, c. 4, 3 : (p. 400) Sanguis peregrinae et sanguis puritatis leprosae, mundus est secundum scholam. Schammai, schola Hillelis dicit, est instar sputi et urinae... (BART.) : Sanguis foeminae gentilis, secundum scholam Schammai est mundus, licet respectu sputi et urinae conveniant inter se schola Schammai et Hillel... (MAIM.) : Iam exposuimus in praefatione huiusce libri, quod gentiles nullatenus polluant secundum Legem, sed Sapientes decreverunt cos pro seminifluis habendos esse in omnibus rebus. C. 7, 3 : (p. 415) Omnes maculae venientes a Racam, mundae sunt, at immundae secundum. R. Iehudam, quia proselyti sunt, et errant. Quae venerint a gentilibus, eae mandae sunt ; quae vero ab Israëlita et a Cuthaeis, eae secundum. R . Meir immundae sunt, et secundum Sapientes mundae, quia ii non suspecti sunt de maculis ipsorum. (BART.) : Qui veniunt a Racam, cuius loci incolae sunt peregrini, et eorum sanguis immundus est. (MAIM.) : Iam tibi aliquoties exposuimus quod gentes non polluant fluxu seminis vel sanguinis, nec fluxu menstruo, attamen Sapientes de illis decreverunt, sed de illorum maculis non decreverunt... (BART.) : ... E. Racam, nam in Targum illa verba, inter Cades et Sur, exponuntur per inter RacaM et inter Chagra. Quia proselyti sunt, quorum sanguis immundus est... errant, ac si dixisset, non sunt valde casti, neque contegunt maculas sanguineas eorum, proinde suspicamur eas forsan foeminae menstruae maculas esse. Qui veniunt a gentilibus, ii mundi sunt, quia Sapientes de ipsorum maculis nihil decreverunt, cum eorum sanguis omnino mundis sit ex Lege... C. 10, 4: (p. 424) Seminifluus, seminiflua, menstrua, puerpera, et leprosus qui obierunt, polluunt si ferantur, donec caro tabescat. Gentilis si obierit, mundus est a pollutione si is feratur.
[FN: § 1280-1]
Levit. XI, 43. (Tischendorf) :
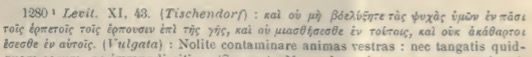
(Vulgata) : Nolite contaminare animas vestras : nec tangatis quidquam eorum, ne immundi sitis. « (SEGOND) : Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent ; ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux ».
[FN: § 1280-2]
Lévit., XV, 31. IX (SEGOND) : Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux ».
[FN: § 1281-1]
De même dans l'Exode, 29, 18, on explique l'holocauste du bouc en disant : « Tu brûleras le bouc tout entier, sur l'autel; c'est un holocauste à l'Éternel et un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel ». C'est, en gros, le motif des sacrifices païens.
[FN: § 1281-2]
SAINT PAUL, Ep. aux Héb., X, 5-14, dit que le sacrifice de Christ suffit à lui seul pour tous les péchés. Hébr., IX : « (12) Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. (18) Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair (14), combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ».
[FN: § 1282-1]
Dict. encycl. de théol. cath., t. XX, s. r. Réconciliation des pénitents : « (p. 23) ...acte par lequel, au temps où régnait une (p. 24) sévère discipline dans l'Église, des pénitents publics, après avoir achevé leur pénitence, étaient officiellement réconciliés avec l'Église et solennellement admis dans son giron... Le pape Innocent Ier écrit à Décentius, évêque de Gubbio, que les pénitents de l'Église romaine reçoivent l'absolution le jeudi saint et sont admis à la communion de l'Église. Cette admission se faisait avec une solennité propre à remuer les cœurs... ». Ibidem, s. r. Réconciliation des églises et des cimetières : « (p. 25) Quand une église a une fois été destinée au culte divin et a été bénite... elle ne peut plus perdre le caractère d'une chose sacrée,... mais elle peut être profanée par des actes qui atteignent son caractère sacré ». Voilà bien l'altération de l'intégrité d'une chose. « (p. 25) Ni l'église ni le cimetière ne peuvent continuer à servir à leurs saints usages tant qu'ils restent profanés. Il faut, pour les remettre en état, l'intervention d'un acte religieux qu'on nomme la réconciliation [rétablissement de l'intégrité]. Cet acte a ses motifs profonds dans les exigences du sentiment religieux [très juste ; les résidus du genre que nous étudions maintenant agissent] et dans la conviction qu'il donne [dérivation] que Dieu se retire du lieu où il a été outragé, et qu'il faut qu'il y ait expiation pour que le Seigneur puisse être rappelé dans son sanctuaire... si l'homme qui a souillé par le péché son âme, temple consacré au Saint-Esprit, peut être réconcilié avec Dieu par la pénitence, l'église profanée peut également redevenir la résidence de Dieu par une cérémonie solennelle ».
[FN: § 1285-1]
BOUCHÉ-LECLERCQ ; Hist. de la div. dans l'ant., t. IV « (p. 80) Tout prodige, quel qu'il fût et le sens en restât-il impénétrable, exigeait des cérémonies expiatoires. Il est naturel que l'homme effrayé par le miracle mette entre lui et le malheur qu'il appréhende, les sacrifices et les prières [en général, des actes quelconques ; l'animal aussi s'effraie à la vue d'une chose insolite, et s'agite : le chien aboie, le cheval fait un écart, le lion se bat les flancs avec sa queue]. Les Grecs et les Romains n'allaient guère au-delà de cette procuration empirique, mise à la portée des plus ignorants. Au lieu de chercher à savoir quelle volonté avait produit le miracle et dans quel but elle l'avait fait [dérivation étendue], ils invoquaient les „ dieux qui détournent “ les maux ![]() ] (p. 81) – Dii Averrunci] et se rassuraient en pensant qu'ils avaient opposé à des ennemis inconnus des amis sûrs [dérivation plus restreinte que la précédente]. Quelque cérémonie, sacrifice, offrande, récitation de formules magiques, ou telle autre démonstration extérieure [voilà la manifestation simple du résidu] achevait l'œuvre d'apaisement commencée par la prière [il est au contraire probable que la prière est venue ensuite]. Les Romains avaient appris de Numa la procuration d'un certain nombre de prodiges pour ainsi dire usuels, et l'expérience leur avait permis d'ajouter à l'ancien rituel quelques recettes empiriques ; ainsi, ils savaient depuis le règne de Tullus Hostilius que les pluies de-pierres étaient suffisamment « procurées » par neuf jours de féries ». Au contraire, les aruspices s'attachaient davantage à la doctrine de la purification. « (p. 82) Ils considéraient, en général, les prodiges moins comme des avertissements regardant l'avenir que comme des réclamations concernant le passé. Le caractère anormal de ces signes indiquait à leurs yeux des exigences impérieuses, motivées d'ordinaire par quelque offense faite aux dieux et non réparée. Le prodige une fois attribué à ses véritables auteurs, il devenait plus aisé de savoir de quelle injure ceux-ci se plaignaient et à quel prix ils consentaient à l'oublier. Une enquête scrupuleuse manquait rarement de révéler quelque inadvertance ignorée ou mal réparée, cause première des accidents prodigieux. Si rien de semblable ne se découvrait, les devins pouvaient conclure à leur gré ou que l'enquête était insuffisante ou que le sens du prodige concernait l'avenir. Souvent les aruspices, pour plus de sûreté, cherchaient dans les deux sens et trouvaient des récriminations mêlées aux prophéties... ».
] (p. 81) – Dii Averrunci] et se rassuraient en pensant qu'ils avaient opposé à des ennemis inconnus des amis sûrs [dérivation plus restreinte que la précédente]. Quelque cérémonie, sacrifice, offrande, récitation de formules magiques, ou telle autre démonstration extérieure [voilà la manifestation simple du résidu] achevait l'œuvre d'apaisement commencée par la prière [il est au contraire probable que la prière est venue ensuite]. Les Romains avaient appris de Numa la procuration d'un certain nombre de prodiges pour ainsi dire usuels, et l'expérience leur avait permis d'ajouter à l'ancien rituel quelques recettes empiriques ; ainsi, ils savaient depuis le règne de Tullus Hostilius que les pluies de-pierres étaient suffisamment « procurées » par neuf jours de féries ». Au contraire, les aruspices s'attachaient davantage à la doctrine de la purification. « (p. 82) Ils considéraient, en général, les prodiges moins comme des avertissements regardant l'avenir que comme des réclamations concernant le passé. Le caractère anormal de ces signes indiquait à leurs yeux des exigences impérieuses, motivées d'ordinaire par quelque offense faite aux dieux et non réparée. Le prodige une fois attribué à ses véritables auteurs, il devenait plus aisé de savoir de quelle injure ceux-ci se plaignaient et à quel prix ils consentaient à l'oublier. Une enquête scrupuleuse manquait rarement de révéler quelque inadvertance ignorée ou mal réparée, cause première des accidents prodigieux. Si rien de semblable ne se découvrait, les devins pouvaient conclure à leur gré ou que l'enquête était insuffisante ou que le sens du prodige concernait l'avenir. Souvent les aruspices, pour plus de sûreté, cherchaient dans les deux sens et trouvaient des récriminations mêlées aux prophéties... ».
[FN: § 1286-1]
GELL. ; IV, 6.
[FN: § 1288-1]
Dict. DAREMB. SAGL., s. r. Orphici : « (p. 251) Les Orphiques croyaient à la nature divine de l'âme, et à une déchéance, à un péché originel. L'âme, créée par les dieux, avait d'abord vécu au ciel ; elle avait été exilée à la suite d'un péché, le ![]() dont parle Pindare, les
dont parle Pindare, les ![]() auxquels fait allusion Jamblique. Nous ne savons en quoi consistait cette faute. D'après l'explication vulgaire, l'homme était né du sang des Titans, meurtriers de Zagreus ; de par sa naissance, il était l'ennemi des dieux ; mais, en même temps, il avait en lui quelque chose de divin, qu'il tenait des Titans. Outre la souillure commune à tout être humain, on admettait une souillure particulière et héréditaire dans certaines familles ».
auxquels fait allusion Jamblique. Nous ne savons en quoi consistait cette faute. D'après l'explication vulgaire, l'homme était né du sang des Titans, meurtriers de Zagreus ; de par sa naissance, il était l'ennemi des dieux ; mais, en même temps, il avait en lui quelque chose de divin, qu'il tenait des Titans. Outre la souillure commune à tout être humain, on admettait une souillure particulière et héréditaire dans certaines familles ».
[FN: § 1288-2]
PLAT.; De rep., II p. 364. Ils emploient les livres de Musée et d'Orphée, et font croire, non seulement aux particuliers, mais aussi aux cités, qu'ils peuvent laver et purifier ![]() les fautes des vivants et des morts.
les fautes des vivants et des morts.
[FN: § 1288-3]
OVID., Métam ., I, raconte comment Jupiter foudroya les Géants, et comment la Terre anima leur sang, et « le changea en hommes ; race méprisant les dieux, cruelle, très avide de sang et violente, montrant qu'elle est née du sang » (160-162).
[FN: § 1289-1]
Le fait est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'en donner de nombreuses preuves. Les citations suivantes suffiront. Dans les œuvres authentiques de Saint Augustin, on trouve des affirmations de ce fait, en beaucoup d'endroits. Par exemple : D. AUG ; Sermo LVI, in Evangel., in Matth. (alias : de diversis, XLVIII), c. IX, 13 . Baptizandi estis,... Sic intrate, et certi estote, omnia prorsus vobis dimitti, quae contraxistis, et parentibus nascendo secundum Adam cum originali peccato, propter quod peccatum cum parvulis curritis ad gratiam Salvatoris, et quidquid vivendo, addidistis, dictis, factis, coffitationibus, omnia dimittuntur... Le saint voit dans le déluge l'image du baptême. Contra Faust. Manich., XII, 17 « il plut pendant quarante jours et quarante nuits, parce que toute souillure de péché est comprise dans les limites des dix commandements de la loi, au sein de l'univers qui compte quatre parties ; or, quatre multiplié par dix égalent quarante. Or, cette souillure qui résulte des jours prospères ou adverses en rapport avec les nuits, est effacée par le sacrement du baptême qui nous vient du ciel ». – I. GOUSSET ; Theol. dogm., t. II, p. 415 : « Cette grâce [du baptême] détruit le péché originel que les enfants apportent en naissant ; il [le baptême] efface en outre, dans les adultes, les péchés actuels qu'ils ont commis avant le baptême, et remet toutes les peines spirituelles dues au péché, quel qu'il soit... » – Canones et decreta conc. Trident., sessio V, decretum de peccato originali, 5 . Si quis per Iesu Christi Domini nostri gratiam, quae in baptismate confertur, reatum originalis peccati remitti negat, aut etiam asserit, non tolli totum id, quod veram et propriam peccati rationem habet, sed illud dicit, tantum radi aut non imputari : anatema sit. – Les derniers mots, suivant lesquels le baptême n'effacerait pas entièrement le péché, mais le raserait seulement de manière à ce qu'il ne soit pas imputé, font allusion à une hérésie que les pélagiens attribuaient aux catholiques. – D. AUG.; Contra duas epistolas Pelagianorum, I, 13; « (26) Dicunt etiam-inquit-baptisma non dare omnem indulgentiam peccatorum, nec auferre crimina, sed radere, ut omnium peccatoram radices in mala carne teneantur ». Quis hoc adversus Pelagianos, nisi infidelis affirmet ? – CALVIN ; Inst. de la relig. chrestienne, t. II, 1. IV, c. XV, p. 477 : « (1) ... il [le baptême] nous est envoyé de luy, [de Dieu] comme une lettre patente signée et scellée, par laquelle il nous mande conferme et asseure que tous nos péchez nous sont tellement remis, couverts, abolis et effacez, qu'ils ne viendrons jamais à estre regardez de luy, ne seront jamais remis en sa souvenance, et ne nous serons jamais de luy imputez... (2) ...le Baptesme nous promet autre purification que par l'aspersion du sang de Christ, lequel est figuré par l'eau, pour la similitude qu'il a avec icelle de laver et nettoyer... (3) Et ne devons estimer que le Baptesme nous soit donné seulement pour le temps passé, tellement que pour les péchez ausquels nous rechéons après le Baptesme, il nous fale chercher autre nouveau remède. Je sçay que de cest erreur est provenu qu'aucuns anciennement ne vouloyent estre baptisez, sinon en la fin de leur vie et à l'heure de leur mort : afin qu'ainsi ils obtinssent rémission plénière pour toute leur vie : laquelle folle fantasie est souvent reprinse des Evesques en leurs escrits. Mais il faut sçavoir qu'en quelque temps que nous soyons baptisez, nous sommes une fois lavez et purgez pour tout le temps de nostre vie ».
[FN: § 1289-2]
D. AUGUST. ; De symbolo. Ad catechumenos sermo alius, c. X. Le pape Eugène IV, dans le Décret pour les Arméniens, écrit : Baptismi sacramenti effectus est remissio omnis culpae originalis et actualis, omnis quoque poenae, quae pro ipsa culpa debetur. Propterea baptizatis nulla pro peccatis praeteritis iniungenda est satisfactio ; sed morientes, antequam culpam aliquam committant, statim ad regnum coelorum et Dei visionem perveniunt. – D. CYRILLI HIEROS ; Cathech., III, de baptismo, 15, nomme, parmi tous les péchés qui sont pardonnés, la fornication et l'adultère.
[FN: § 1290-1]
D. GREG. NAZ.; oratio 40, XX : « Mais quelqu'un dit : À quoi me sert d'être lié avant le baptême, et de me priver par cet empressement des plaisirs de la vie, tandis qu'il est possible d'en jouir et de recevoir la grâce à la fin ? Car ceux qui travaillèrent les premiers à la vigne n'eurent pas des conditions meilleures, en recevant un salaire égal à celui de ceux qui vinrent les derniers ». Le saint explique que l'on ne doit pas interpréter la parabole de cette façon. D'abord, elle ne traite pas du baptême ; ensuite, si les derniers venus ne travaillèrent pas autant que les premiers, leur bonne volonté ne fut pas moindre. On sait qu'on tire ce qu'on veut des paraboles.
[FN: § 1290-2]
D. EPIPH.: Panarii adversus haereses, 1. I, t. 1 : « (p. 37) Contre les hémérobaptistes. Quatrième hérésie des Juifs, dix-septième par ordre »... « Ce qui appartient surtout à cette hérésie c'est que l'on croit qu'au printemps, en automne, en hiver, en été, journellement, il faut se baptiser ![]() ; d'où le nom des hémérobaptistes.
; d'où le nom des hémérobaptistes. ![]()
![]()
![]() . « Car elle affirmait que l'homme ne pouvait vivre que s'il se baptisait chaque jour, dans l'eau, en se lavant et en se purifiant de tout péché ». Saint Épiphane l'admoneste et dit, en substance, que ni les eaux de l'Océan, ni celles de toutes les mers, des fleuves, des fontaines, de la pluie, réunies ensemble, ne peuvent laver les péchés des hommes, qui doivent se purifier par la pénitence. À cela les hérétiques auraient pu répondre : « Pourquoi donc employez-vous l'eau dans votre unique baptême ? ». En réalité, il y a une opération externe et une opération interne, et l'une ou l'autre prévaut, suivant la force des sentiments qui y correspondent. – DIONYSII PETAVII ; ...Appendix ad Epiphanianas animadversiones : (p. 19) Eos vero qui in aegritudine baptizati forent, a Sacerdotio reiectos esse, docet Canon ille Neocaesar. XII, et Cornelius Papa Epist. ad Fabium Antiochiae Episcopum, qui extat apud Eusebium lib. VI, cap. XXXV, ubi de Novato scribit... (p. 20) « Quoniam nefas erat eum, qui ob morbum in lectulo perfusus est, cuiusmodi fuerat iste, in Clerum cooptari ».
. « Car elle affirmait que l'homme ne pouvait vivre que s'il se baptisait chaque jour, dans l'eau, en se lavant et en se purifiant de tout péché ». Saint Épiphane l'admoneste et dit, en substance, que ni les eaux de l'Océan, ni celles de toutes les mers, des fleuves, des fontaines, de la pluie, réunies ensemble, ne peuvent laver les péchés des hommes, qui doivent se purifier par la pénitence. À cela les hérétiques auraient pu répondre : « Pourquoi donc employez-vous l'eau dans votre unique baptême ? ». En réalité, il y a une opération externe et une opération interne, et l'une ou l'autre prévaut, suivant la force des sentiments qui y correspondent. – DIONYSII PETAVII ; ...Appendix ad Epiphanianas animadversiones : (p. 19) Eos vero qui in aegritudine baptizati forent, a Sacerdotio reiectos esse, docet Canon ille Neocaesar. XII, et Cornelius Papa Epist. ad Fabium Antiochiae Episcopum, qui extat apud Eusebium lib. VI, cap. XXXV, ubi de Novato scribit... (p. 20) « Quoniam nefas erat eum, qui ob morbum in lectulo perfusus est, cuiusmodi fuerat iste, in Clerum cooptari ».
[FN: § 1292-1]
Dictionn. SAGLIO; s. r. Taurobolium : « (50) Nous avons vu que le premier taurobole daté est celui de l'an 134, non à la Mère des dieux, mais à la Vénus Céleste de Carthage. Vient ensuite, en ancienneté, un taurobole de Lyon, pour la conservation d'Antonin le Pieux et de ses enfants et pour le maintien de la colonie. Le plus récent est de l'an 390 ; il a été reçu pour lui-même, par un sénateur. Dans l'intervalle de nombreux tauroboles publics durent avoir lieu... Quant aux tauroboles particuliers, on en peut suivre la trace, dans les inscriptions, depuis le second siècle jusqu'au dernier temps du paganisme ; mais c'est surtout après le règne de Julien qu'ils se multiplièrent. Ainsi que l'a dit Marquardt, il semblerait que ce soit vers le taurobole qu'aient convergé finalement tous les cultes païens ».
[FN: § 1292-2]
ORELLI; 23,52 : ... Taurobolio criobolioque in aeternum renatus... 2355 ; ... iterato viginti annis ex perceptis tauroboliis VI aram constituit. On faisait le sacrifice du Taurobole. – ORELLI-HENZEN ; 6082 : Pro salute imp. L. Septimi Severi ... taurobolium fecerunt... – PRUDENT ; Peri stephanon liber. X, 1011-1050
(1016) Tabulis superne strata texunt pulpita,
Rimosa rari pegmatis compagibus.
Scindunt subinde vel terebrant aream,
Crebroque lignum perforant acumine,
Pateat minutis ut frequens hiatibus.
« Au-dessus [de la fosse], ils construisent un plancher de tables, puis ils écartent les nombreuses commissures du plancher ou en percent la surface, et font de nombreux trous dans le bois, afin qu'il présente de fréquentes petites ouvertures ». Ils amènent un taureau sur le plancher et lui ouvrent le poitrail avec le fer sacré. Le sang tombe sur le plancher sacré. « Alors, par les fréquentes et nombreuses fissures, le sang pleut comme une rosée infecte, et le prêtre qui est dans la fosse le reçoit, exposant à chaque goutte sa tête ignominieuse, son vêtement et son corps corrompu ». – Anth. vet. lat. epigr... , ed. BURMANN ; t. I, p. 83.
Quis tibi Taurobolus vestern inutare süasit,
Inflatus dives subito mendicus ut esses :
Obsitus et pannis modicis tepefactus****
Sub terra missus, pollutus sanguine tauri.
Sordidus, infectus, vestes servare cruentas,
Vivere cura speras viginti mundus in annos.
[FN: § 1292-3]
TERTULL. ; De praese.haer., 40.
[FN: § 1292-4]
TERTULL.; De Bapt., 5.
[FN: § 1294-1]
DIOG. LAERT.; 1, 110, Epim .
[FN: § 1294-2]
IUV.; VI, 511-568.
[FN: § 1295-1]
ZOZIM.; 11, 29.
[FN: § 1295-2]
SUET. ; Nero , 34 – DIO. CASS.(XPHIL.), LXIII, 14, dit que Néron n'alla pas à Athènes « à cause de la tradition des Érinyes »: ![]() .
.
[FN: § 1295-3]
EUSEB. ; De vita Const., I, 27...
« ... cherche attentivement quel dieu il lui convient d'appeler à son secours ».
[FN: § 1297-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Le blasphème affecte l'intégrité de la divinité. L'exemple suivant appartient à l'espèce (V-γ 2), en ce que le sujet qui a souffert l'altération est imaginaire ou abstrait ; il se rattache au genre (V-δ), en ce que l'intégrité est rétablie par des opérations se rapportant à ceux qui l'ont altérée. Confession criminelle faicte par Jaquemaz Mestraux originelle de Hermenges balliage de Mouldon a present femme de Pierre Chuet residant rière la Chastelanie et mandement de Dompmartin, détenue es prisons... Chasteau de Lausanne...(Archives cantonales vaudoises. Pièce non classée. – Année 1637). L'accusée s'est rendue coupable de dire à des voisins qui négligeaient leurs moissons : « Que Dieu avoit faict péché de leur avoir envoyé tant de biens ». « Desquels propos par ladicte détenue comme dessus confessés icelle en est grandement pénitente, et repentante, dont elle en demande pardon a Dieu a Leurs Excellences etalhonnorable Justice, declarant voulloir vivre et mourir en sadicte confession. En vigueur de laquelle confession le prénommé seigneur chastelain a demandé que pour sestre ladicte détenue, de tant oubliée que d'avoir professé semblables parolles blasphematoires contre la deité, et parce commis acte exorbitant et digne de mort, icelle pourtant en vigueur de sadicte confession debvoir estre remise entre les mains de lexecuteur de la haute Justice, lequel lui ayant lié bras et mains, et mis la corde au col, la doibgt mener et conduire au lieu accoustumé supplicier semblables mal faicteurs, et delinquants, et icelle debvoir avoir la langue percée, et puis en apprès la teste couppée entant que son ame soit separée de son corps, et iceluy mis en terre, et ce pour chastiment de son malefice et forfaict, et pour estre en exemple atous autres semblables malfaicteurs et delinquants, Ses biens confisqués... » Leurs Excellences de Berne grâcièrent la malheureuse, et lui imposèrent une pénitence à l'église de son village.
[FN: § 1301-1]
Les « savants » parlent avec dédain de l'émotion éprouvée par le public à l'égard de ce crime, qui leur paraît être l'effet des « préjugés » et de l'ignorance où l'on serait de leurs sublimes théories. – RAYMOND HESSE ; Les criminels peints par eux-mêmes : « (p. 146) Crime subit et non prémédité, accompli par un homme que ses antécédents et ses vices prédisposaient à ces attentats, voilà ce que nous révèlent les mémoires de Soleilland. La débauche, les excès, l'alcoolisme et la violence naturelle ont été favorisés par de malheureuses circonstances. Combien d'actes immoraux et de meurtres d'enfants sont commis dans de semblables conditions et par des criminels analogues [ici, l'auteur va un peu au delà de la vérité ; la statistique ne révèle pas tant de meurtres de fillettes après viol]. L'affaire Soleilland, on ne sait trop pourquoi, a frappé davantage l'opinion publique. Peut-être la découverte dramatique de la victime à la consigne d'une gare ? Peut-être les recherches dirigées pendant plusieurs jours par le coupable lui-même ? (p. 147) Peut-être la période des vacances où se localisa ce crime qui remplit les colonnes vides des journaux ont contribué à cette célébrité. …Le portrait de Soleilland complète cette galerie d'anormaux, dont l'étude relève plus de la médecine mentale que de la criminologie ». Si l'auteur ne sait vraiment pas pourquoi « l'affaire Soleilland a frappé davantage l'opinion publique », cela signifie que la métaphysique de ses théories lui a ôté la compréhension des réalités de la vie. L'acte du public est instinctif, comme celui de la poule qui défend ses poussins, de la chienne ou de la lionne qui défendent leurs petits. Le public ne voulait pas que, protégés par les idéologies abstruses des médecins et de leurs alliés les jurisconsultes, les brutes semblables à Soleilland continuassent à violer et à tuer les fillettes. Notre auteur doit comprendre que les motifs pour lesquels ces criminels sont poussés à agir importent peu ou point ; tandis qu'il importe énormément de détruire ces criminels, comme on détruit les rats qui portent la peste, les vipères et les chiens enragés ; et pour porter au paroxysme sa sainte colère, nous lui dirons que les circonstances que lui et ses semblables estiment atténuantes, « la débauche, les excès, l'alcoolisme et la violence naturelle », auxquelles on peut ajouter aussi, pour lui faire plaisir, l'atavisme d'ascendants alcooliques ou aliénés, sont au contraire des circonstances aggravantes, au point de vue de la défense sociale ; car elles accroissent, elles ne diminuent pas la probabilité que les éminentes personnes chez lesquelles on observe ces caractères commettront des crimes. Le public comprit d'instinct que tous ces vains discours sur les « anormaux, dont l'étude relève plus de la médecine mentale que de la criminologie », avaient pour unique effet pratique de permettre aux dits « anormaux » de continuer à commettre des crimes aux dépens des « normaux » ; ce que ceux-ci ne veulent pas tolérer ; et ils tâchent de se défendre comme fait tout animal dont la vie est attaquée. Après cela, si la métaphysique des criminalistes en souffre, c'est vraiment fort dommage ; mais peut-être un peu moins que de laisser impunément violer et assassiner les fillettes.
[FN: § 1301-2]
« La Liberté, 6 mai 1912. – M. Herriot, maire de Lyon, a rejeté, lui aussi, l'humanitarisme, né vers 1898 et mort en 1912. Il écrit ce matin : “ Nous demandons qu'on en finisse avec cette fausse sentimentalité qui n'est que la caricature de la bonté virile. Nous demandons que la grâce ne soit plus, comme l'a écrit un magistrat courageux, une prime à l'assassinat. On abuse des circonstances atténuantes ; on abuse du sursis ; le délai de révocation devrait être porté de cinq à huit ans. Au lieu de couvrir de fleurs les tombes des policiers victimes du devoir, ne pourrait-on pas se montrer plus sévère pour les auteurs de coups et outrages aux agents ? “ Vous verrez que ces sentimentaux d'hier inaugureront demain, en France, le régime de la trique... »
[FN: § 1302-1]
N. COLAJANNI ; Rivista popolare, 31 décembre 1911 : « (p. 653) Dans le numéro précédent, nous avons signalé l'esprit nouveau dont les magistrats italiens sont animés, depuis que sévit le nationalisme... Pourtant, les optimistes objectaient que les cas alors mentionnés par nous pouvaient être considérés comme un effet accidentel de l'idiosyncrasie de magistrats particuliers. Aujourd'hui, l'objection demeure sans fondement, parce que arrêts, procès et condamnations continuent partout, pour délits de presse, pour excitation à la grève et à la haine des classes et à d'autres délits essentiellement politiques, essentiellement élastiques. On condamne pour ces chefs d'accusation à Ferrare ; on arrête De Ambris et Zocchi à Parme ; on arrête Giusquiano à Pise ; on lance un mandat d'arrêt contre Lori à Florence... Certains ont attribué cette soudaine fureur réactionnaire aux ordres partis du Ministre de Grâce et Justice. Nous ne le croyons pas, car nous connaissons le ministre Finocchiaro-Aprile, exempt de tout esprit réactionnaire. L'explication est autre. Les magistrats... se sont montrés larges, spécialement envers les socialistes, quand ils crurent que ceux-ci étaient omnipotents dans les hautes sphères. Aujourd'hui, ils croient que la direction du gouvernement est changée ; aujourd'hui, ils espèrent faire carrière en se mettant dans les bonnes grâces du nationalisme, du cléricalisme ; ils font des procès, arrêtent et condamnent... ». Soit ; mais pourquoi « la direction du gouvernement est-elle changée ? » Le professeur Colajanni nous le dit lui-même : « (p. 653) Les nationalistes qui, jusqu'à hier, se bornaient à écrire des hymnes patriotiques, ont à leur tour exalté le public [voilà la cause principale du phénomène], et leur police et leurs gendarmes recourent à la violence, en raison directe de la protection qu'ils accordent... Ils conspuèrent et bâtonnèrent le professeur Bonfigli ; ils insultèrent un magistrat qui crut avoir le droit de se lever quand bon lui semblait, dans un théâtre ; à la Scala, aidés de commissaires de police et de gendarmes, ils ont expulsé, en l'enlevant de son fauteuil, le critique de l'Avanti, qui ne voulut pas se lever au son de la marche royale... ».
[FN: § 1303-1]
PLAT. ; Timae, p. 90 : ![]() .
. ![]() Ceux des hommes créés qui furent efféminés et menèrent une vie injuste furent vraisemblablement transformés en femmes, dans la seconde existence ». Cet excellent homme continue et nous dit : « (p. 91) qu'alors, les dieux s'occupèrent de créer le désir de s'accoupler »,
Ceux des hommes créés qui furent efféminés et menèrent une vie injuste furent vraisemblablement transformés en femmes, dans la seconde existence ». Cet excellent homme continue et nous dit : « (p. 91) qu'alors, les dieux s'occupèrent de créer le désir de s'accoupler », ![]() ; et il nous raconte longuement comment cet accouplement a lieu. Il nous apprend aussi d'autres merveilles : (p. 91) que les oiseaux sont la transformation des hommes simples et innocents, parmi lesquels Platon range ceux qui ne se contentent pas de ses divagations métaphysiques. (p. 92) Les animaux qui marchent et les bêtes féroces sont la transformation des hommes étrangers à la philosophie. Les plus mauvais n'ont pas de pieds et rampent sur la terre. Les imbéciles et les sots sont transformés en poissons, parce que les dieux ne les estimèrent pas dignes de respirer un air plus pur.
; et il nous raconte longuement comment cet accouplement a lieu. Il nous apprend aussi d'autres merveilles : (p. 91) que les oiseaux sont la transformation des hommes simples et innocents, parmi lesquels Platon range ceux qui ne se contentent pas de ses divagations métaphysiques. (p. 92) Les animaux qui marchent et les bêtes féroces sont la transformation des hommes étrangers à la philosophie. Les plus mauvais n'ont pas de pieds et rampent sur la terre. Les imbéciles et les sots sont transformés en poissons, parce que les dieux ne les estimèrent pas dignes de respirer un air plus pur.
[FN: § 1304-1]
Iliad., XXIII, 71-74 : «Ensevelis-moi promptement, afin que je puisse passer les portes de l'Hadès. Les âmes des morts me repoussent au loin et ne me permettent pas de me mêler à elles, sur le fleuve, et j'erre autour de l'Hadès ». Le scoliaste note, au vers 73, XXIII, Iliad. : « Il y a un signe critique, parce que les âmes des gens morts sans sépulture restent en dehors du fleuve, et ne se mêlent pas à celles qui sont dans l'Érèbe. Ce signe critique se rapporte aussi aux vers qui doivent être supprimés [Odyss. XI, 51 et sv.] ». Il semblerait donc que cette tradition ne serait pas homérique ; mais cela nous importe peu : il nous suffit qu'elle ait existé dans l'ancienne Grèce. – VIRGILE imite ces passages d'Homère, Aen., VI, 325 et sv., et y ajoute que les morts sans sépulture errent pendant cent ans, voltigeant sur les rives de l'Achéron :
(329) Centum errant annos, volitantque haec litora circum
Tura demum admissi stagna exoptata revisunt.
Plus haut :
(325) Haec omnis, quara cernis, inops inhumataque turba est ;
SERVIUS note : Duo dicit, id est, nec legitimam sepulturam habet, neque imaginariam. Inopem enim dicit sine pulveris iactu (nam ops terra est) id est, sine humatione. Vult autem ostendere tantum valere inanem, quantum plenam sepulturam... – Et DANTE ; Purg., III :
(136) Ver è che quale in contumacia more
Di santa Chiesa, ancor che alfLn si penta,
Star gli convien da questa ripa in fuore
Per ogni tempo ch'egli è stato, trenta,
In sua presunzion, se tal decreto
Più corto per buon preghi non diventa.
[FN: § 1304-2]
Odyss., XI, 51 et sv.
[FN: § 1305-1]
LUCIAN.; Philopseudes, 27.
[FN: § 1306-1]
PLIN. ; Epist., VII, 27. – SUET. ; Calig., 59 : « Son cadavre [de Caligula] fut transporté clandestinement dans les jardins de Lamia, brûlé à la hâte sur un bûcher, et recouvert de quelques mottes de terre ; puis exhumé, incinéré et enseveli par ses sœurs revenues de l'exil. Il est notoire qu'avant cette opération, le gardien des jardins était tourmenté par des fantômes... ».
[FN: § 1307-1]
DOM CALMET ; Diss. sur les appar., XLIII « (p. 129) On doit se défier des Revenans qui demandent des Prières. Pour l'ordinaire les défunts apparoissans demandent des prières, des Messes, des pèlerinages, des restitutions ou des payemens de quelques dettes, auxquels ils n'avoient pas satisfaits. Ce qui prouveroit qu'ils sont en purgatoire, et qu'ils ont besoin du secours des vivans pour être soulagés dans leurs souffrances... Mais on doit beaucoup se défier de ces apparitions et de ces demandes... (p. 130) Bodin dans sa Démonomanie (1. 3, c. 6, fol. 157), cite plus d'un exemple de Démons qui se sont apparus, demandant des prières, et se mettant même en posture de personnes qui prient sur la fosse d'un mort, pour faire croire que ce mort a besoin de prière ».
[FN: § 1307-2]
TERTULL.; De corona, (3) Oblationes pro defunctis, pro natiliciis annua die facimus. (4) Harum. et aliarum eiusmodi disciplinarum, si legem expotules scripturarum, nullam invenies. Traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix.
[FN: § 1308-1]
En Annam, on fait des cérémonies pour délivrer des peines les âmes des défunts. – E. DIGUET; Les Annamites : « (p. 192) Rites du „ Lam Chay ” ou jeûne solennel pour la délivrance des âmes en détresse. – Ces rites n'ont d'autre but que de faire sortir des Enfers des âmes qui, pour une cause quelconque, y sont retenues et peuvent, par suite de leur mécontentement, devenir malfaisantes pour leur ancienne famille. Lorsque le défunt est mort en un jour néfaste ou lorsque sa tombe est placée dans un lieu mal choisi, ou encore si une seule des mille règles rituelles auxquelles sont soumises les funérailles a été omise, les Annamites sont convaincus que c'est à cette fâcheuse circonstance qu'ils doivent tous les malheurs qui échoient à leur famille. ...Parmi les raisons qui peuvent mettre les âmes en détresse, il faut citer encore les péchés de toute nature, pour lesquels elles ont à purger un châtiment aux Enfers... (p. 193) Les rites du jeûne sont dirigés par le sorcier ou „ Thay phu thuy “... (maître-bois-eau), dont le nom vient de ce qu’il se sert pour officier d'un bâton et d'eau bénite. ...La délivrance des âmes prend quelquefois le caractère d'une grande fête funéraire à laquelle quelques centaines de personnes sont invitées ».
[FN: § 1308-2]
DOM CALMET ; Diss. sur les appar., LXXX, p. 239.
[FN: § 1309-1]
Can. et deer. Concil. Trid., sessio XXV : Decretum de Purgatorio. Cum catholica ecclesia... docuerit, purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum, vero acceptabili altaris sacrificio iuvari... – Sessio VI, de iustificatione, can. 30 : Si quis post acceptam iustificationis gratiam cuilibet peccatori poenitenti ita culpam remitti et reatum aeternae poenae deleri dixerit, ut nulius remaneat reatus poenae temporalis exsolvendae vel in hoc saeculo, vel in futuro in purgatorio, antequam ad regna coelorum aditus patere possit : anathema sit.
[FN: § 1311-1]
GREGORII M., Dialogi, II, 22. Deux religieuses étaient médisantes. On le rapporta à Benoît : (p. 970) Vir autem Dei haec de illis audiens sis protinus mandavit dicens : Corrigite linguam vestram : quia si non emendaveritis excommunico vos. Quam videlicet excommunicationis sententiam non proferendo intulit sed minando. Illae autem a pristinis moribus nihil mutatae, intra paucos dies defunctae sunt, atque in Ecclesia sepultae. Cumque in eadem Efflesia Missarum solennia celebrarentur, atque ex more diaconus clamaret. Si quis non communicat, det locum : nutrix earum quae pro eis oblationem Domino offerre consueverat, eas de sepulchris suis progredi, et exire videbat. Quod dum saepius cerneret, quia ad vocem diaconi clamantis exibant foras, atque intra Ecclesiam permanere non poterant, ad memoriam reduxit quae vir Dei illis adhuc viventibus mandavit. Ras quippe se communione privare dixerat, nisi mores suos et verba corrigerent. Tunc servo Dei cum gravi moerore indicatum est, qui manu sua protinus oblationem dedit dicens : Ite et hanc oblationem pro eis offerri Domino facite, et ulterius excommunicatae non erunt. Quae dum oblatio pro eis fuisset immolata, et a diacono iuxta morem clamatum est, ut non communicantes ab Ecclesia exirent, illae exire ab Ecclesia ulterius visas non sunt. – L'intégrité fut ensuite rétablie par l'oblation, et les corps ne durent plus sortir du sépulcre. – Dans la même œuvre, II, 24 (p. 971), se trouve l'histoire d'un petit moine qui mourut en état de désobéissance à l'abbé. Il fut enterré ; mais chaque fois qu'on le mettait sous terre, la terre le rejetait. Saint Benoît fit placer une hostie consacrée, sur la poitrine du cadavre, qui, ensuite, ne fut plus rejeté par la terre. – Les admirateurs de la « science » médiévale ne devraient pas oublier qu'en ce temps qui leur est cher, tout le monde croyait à ces historiettes. Aujourd'hui, le jugement qu'on leur applique est plus en accord avec les faits.
[FN: § 1311-2]
DOM CALMET ; Diss. sur les appar. Plus loin : « (p. 346) Ils [les Grecs modernes] racontent que sous le Patriarche de Constantinople, Manuël, ou Maxime, qui vivait au quinzième siècle, l'Empereur Turc de Constantinople voulut savoir la vérité de ce que les Grecs avançoient touchant l'incorruption des hommes morts dans l'excommunication. Le Patriarche fit ouvrir le tombeau d'une femme, qui avoit eu un commerce criminel avec un Archevêque de Constantinople. On trouva son corps entier, noir et très-enflé, les Turcs l'enfermèrent dans un coffre sous le sceau de l'Empereur, le Patriarche fit sa prière, donna l'absolution à la morte, et au bout de trois jours le coffre ayant été ouvert, l'on vit le corps réduit en poussière ». HUET, évêque d'Avranches, dit, à propos de ces croyances : « Je n'examine point ici si les faits que l'on rapporte sont véritables, ou si c'est une erreur populaire : mais il est certain qu’ils sont rapportés par tant d'Auteurs. habiles et dignes de foi, et par tant de témoins oculaires, qu'on ne doit prendre parti sans beaucoup d'attention ». Cité de LENGLET DUFRESNOY; Traité... sur les app., les visions, etc., t. II, p. 175.
[FN: § 1312-1] CUNNINGHAM ; Voyage à la Nouvelle-Galles du Sud ; dans Biblioth. univ. des voy., t. 43 : « (p. 93) La vengeance chez eux, comme chez la plupart des sauvages, n'est jamais assouvie tant qu'elle ne s'est pas éteinte dans le sang d'un adversaire. Ainsi que les Chinois, ils s'inquiètent peu de la personne, mais si un blanc les a offensés, ils passent généralement leur colère sur le premier individu de cette couleur qu'ils trouvent à leur portée ».
Note ajoutée à l’édition française par l’auteur: Les sentiments complexes auxquels on donne le nom de haine appartiennent en partie à ce genre. La crainte est très souvent l'origine de la haine, chez l'homme et chez l'animal. La haine, en de nombreux cas, se change en mépris lorsque la crainte disparaît. En général la haine naît du désir de repousser une atteinte à l'intégrité. Une foi vive fait partie de cette intégrité, et cela explique la violence des haines théologiques. Elles s'atténuent lorsque la foi diminue, ou lorsque l'individu ne la considère plus comme essentielle à sa propre personnalité. Pour un artiste, un littérateur, un poète, non seulement la vanité, mais aussi un sentiment profond de leur art, font voir dans toute manifestation contraire, parfois même dans le simple silence, une offense à l'intégrité. Souvent tout changement à l'état de choses existant est aussi estimé une offense, qui est repoussée par l'attachement à la tradition, la néophobie.
[FN: § 1317-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Le droit fournit plusieurs exemples de ce sentiment. Ainsi, dans la notion de peine infamante, dans la notion d'infamie des Romains, dans la déclaration qu'un soldat est indigne de servir sa patrie. D'autre part, beaucoup de punitions infligées aux enfants affectent le même sentiment : le bonnet d'âne, qu'on met parfois encore aux petits écoliers, la mise au banc des ânes ou au coin, etc. Suivant le cas, le sentiment d'intégrité prend le nom d'honneur, d'amour-propre, de dignité, de fierté, de réputation, de crédit, etc.
[FN: § 1318-1]
CAES.; De bello gallico, VI, 13. Il dit des druides : Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt; et, si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de hereditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt : praemia poenasque constituunt : si qui aut privatus sait publicus eorum decreto, non stetit, sacrificiis interdicunt [ce fut aussi la seule arme du sacerdoce chrétien, quand la religion était persécutée, et n'avait pas encore gagné l'appui des pouvoirs publics]. Haec poena apud eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, ii numero impiorum ac sceleratorum habentur [voilà l'effet principal de la déclaration ou sentence : l'altération de l'intégrité] iis omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant : neque iis petentibus ius redditur, neque honos ullus communicatur [conséquences indirectes de l'altération de l'intégrité].
[FN: § 1318-2]
JHERING ; L'esp. du dr. rom., t. I « (p. 280) L'homo sacer, vivait dans un état de proscription religieuse et temporelle. Voué à la vengeance de la divinité qu'il avait outragée par son méfait (sacer), exclu, comme conséquence de toute communion humaine, privé de tous ses biens au profit des dieux, le coupable pouvait être mis à mort par le premier venu. Être sacer était-ce avoir encouru une peine ? Non, à mon avis. Certes, si l'on entend par peine un mal qui s'attache à la perpétration d'un délit, être devenu sacer était la peine la plus grave que l'on puisse imaginer, car il n'y a point de mal que cette situation ne renfermât ; elle constituait en fait le dernier degré de la persécution et de l'humiliation. L'ennemi aussi était privé de droit, mais ce qui aggravait la position de l'homo sacer, c'était l'élément psychologique ; c'était la conscience d'être pour les dieux et pour les hommes un objet d'horreur, de malédiction et d'exécration, d'être, comme un pestiféré [c'est-à-dire la très grave altération de l'intégrité], d'être fui et évité par (p. 281) tout le monde [conséquences de l'altération des intégrités]... (p. 282) Le sacer esse, une fois existant, pouvait être utilisé par la législation, mais il n'a pas été introduit par elle, pas plus que l'infamie qui se trouve dans le même cas [les résidus font naître la législation ; ils ne naissent pas de la législation, excepté en un petit nombre de cas particuliers]. Aucun législateur n'imagine des institutions telles que la peine du sacer et l'infamie, ou, s'il les essaie, comme dans la peine de la privation de la cocarde nationale, il manque complètement son but. De pareilles institutions n'émanent que du sein même du peuple : elles contiennent l'expression spontanée du sentiment moral de la généralité [juste, si l'on supprime ce moral] elles sont un jugement de condamnation prononcé et exécuté par le peuple lui-même ». Non ; elles sont l'expression du sentiment du plus grand nombre, et voilà tout.
[FN: § 1318-3]
SUMNER MAINE ; Early history of institutions, trad. DURIEU DE LEYRITZ : « (p. 57)... La force publique [en Irlande] fut-elle jamais mise en jeu systématiquement, suivant la volonté d'un ou de plusieurs gouvernants, par le mécanisme des cours de justice ? C'est tout au moins douteux. Au contraire, les institutions qui remplaçaient les corps judiciaires ne fonctionnaient, on peut le soutenir, que grâce à la soumission volontaire des plaideurs qui y recouraient ». C'est vrai, si nous traduisons en langue juridique moderne les faits anciens ; mais si nous voulons parler la langue de ce temps-là, nous dirons que les réponses des brehons (légistes irlandais) avaient autorité pour déclarer ce qu'était un homme, quelle était la nature de ses actions ; et c'est cette déclaration qui, grâce à l'aide de l'opinion publique, frappait plus ou moins gravement l'homme dont l'intégrité venait ainsi à être altérée. L'auteur dit des brehons : « (p. 68) Il est impossible de comparer une autorité quelconque de notre époque avec celles d'hommes qui, dans un temps de crédulité aveugle, disaient simplement d'une règle légale : „ Elle a été établie par les docteurs “, ou se servaient de la formule sans réplique : „ C'est écrit ! “ ». Mais les jurys d'honneur de notre époque agissent exactement de cette façon, et des règles qu'ils suivent ils peuvent dirent seulement : « On fait ainsi », ce qui vaut le motif : « C'est écrit ».
[FN: § 1320-1]
LETOURNEAU ; L'évol. relig. L'auteur note que morimo « (p. 70) est un terme général servant à désigner les esprits et les ombres... C'est aux morimos qu'on attribue toutes les calamités ; on a l'habitude de les accabler d'injures, aussi les missionnaires ne réussissaient-ils pas à persuader aux indigènes qu'il pouvait déplaire à Dieu, au Dieu chrétien, qu'on l'insultât. Pour les Cafres, les morimos sont simplement des hommes invisibles, et on les tuerait bien volontiers si la chose était possible : „ Que ne puis-je l'atteindre et le percer de ma lance ! “ (p. 71) disait un chef en parlant d'un morimo ». Notre auteur dit que les Cafres ont un autre nom, Thiko, qui, selon Moffat, « (p. 71) désigne un esprit malveillant, démoniaque, parfois la mort. C'est à lui que pensent les Hottentots quand, durant les orages, ils lancent vers le ciel leurs flèches empoisonnées ; et ils le font évidemment avec l'espérance de l'atteindre et de le tuer ».
[FN: § 1321-1]
LETOURNEAU ; L’évol. relig. :. « (p. 95) D'ailleurs, à moins qu'on ait peur de son fétiche, on le délaisse, dès qu'il tarde à vous satisfaire. Le nègre de Guinée traite son fétiche exactement comme un homme ; avant d'en changer, il le bat pour le forcer à obéir. Veut-il dérober à son fétiche la connaissance de ses actions ? Il le cache dans sa ceinture ».
[FN: § 1321-2]
Iliade, V, 383-402. Achille parle à Apollon comme un nègre à son fétiche, quand il dit (XXII, 20) : « Certes, je me serais vengé de toi, si j'en avais eu le pouvoir ».
[FN: § 1321-3]
Iliade, III, 399 et sv. Aphrodite veut amener auprès de Pâris Hélène récalcitrante, qui se fâche contre la déesse. Le scoliaste s'en scandalise ; il dit :
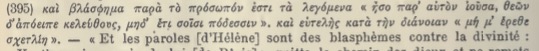
– « Et les paroles [d'Hélène] sont des blasphèmes contre la divinité : ,,Va t'asseoir auprès de lui [de Pàris] ; quitte le chemin des dieux et ne remets plus les pieds dans l'Olympe.“ Et [la réponse d'Aphrodite] est inconvenante „ Ne m'irrite pas, misérable ! “ »
[FN: § 1321-4]
NONN. ; Dionys., XLVIII, 690 et sv. La nymphe Aura, indignée d'avoir été violée par Dionysos, va dans le temple d'Aphrodite et fouette la statue de la déesse. Au chant XXX, 194 et sv., on raconte la mort d'Alkimakéia, qui avait osé flageller la statue de Héra.
[FN: § 1322-1]
PLAT ; De rep., 1. II, p. 378; 1. III, p. 389 et sv.
[FN: § 1322-2]
Bebel, mort en 1913, laissa un patrimoine atteignant presque le million. En tout cas, même en admettant les réductions des amis, il était certainement de plusieurs centaines de mille francs.
[FN: § 1323-1]
ARR.; De exp. Alex., VII, 14.
[FN: § 1323-2]
SUET. ; Calig., 5 : Quo defunctus est die, lapidata sunt templa, subversae Deum arae, Lares a quibusdam familiares in publicum abiecti, partus coniugum expositi.
[FN: § 1323-3]
Par exemple, le sentiment de la solidarité, dont quelques humanitaires ont imaginé l'existence entre Dieu et l'homme. On est allé plus loin. Un pasteur protestant fait rassurer Dieu par l'homme, qui lui dit de pas avoir peur ! W. MONOD ; Un athée. L'auteur exprime l'opinion que si le mal existe dans le monde, c'est parce que Dieu ne peut l'empêcher : « (p. 26) Eh bien ! ce Dieu vaincu est celui qui parle à mon cœur !... Dieu s'efforce [d'empêcher le mal] et ne réussit pas toujours... (p. 87) Et alors, devant les spectacles de l'iniquité, ou de la douleur inexplicable, notre foi pourrait s'exprimer de la sorte, en un sublime entretien avec le Père : „ Ne crains rien ! Je ne te soupçonne point. Je sais que tu n'as pas trempé là-dedans. Si je le croyais, je serais désespéré ! “ Prier Dieu quand même... c'est associer sa propre impuissance à l'impotence divine, c'est dire au Père : „ Si nous sommes vaincus, nous le serons ensemble ! Rien n'est perdu; je reste ton enfant! “ » Ceux qui croient à ces choses peuvent aussi croire sans autre que Diomède frappa Aphrodite.
[FN: § 1325-1]
DEMOSTH. (?); in Neeram, 122, p. 1386 :
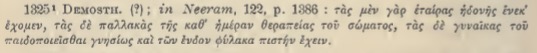
[FN: § 1325-2]
MOMMSEN ; Le droit pénal rom., t. II : « (p. 414) La femme libre romaine est obligée par la loi morale de s'abstenir de tout commerce charnel avec un homme avant son mariage et de n'en avoir après son mariage qu'avec son mari ; par contre, l'homme n'est soumis à la même loi morale qu’autant qu'en portant atteinte à la chasteté d'une vierge ou de l'épouse d'autrui il se rend complice de celle-ci ». La République se préoccupa peu de légiférer sur ce point ; elle laissa le soin de réprimer ces délits aux tribunaux domestiques ; mais Auguste et ses successeurs firent en sorte que la répression fût l'œuvre de lois de L’État. « (p. 417) Le droit ne tient compte des manquements à la chasteté que s'ils sont commis par une femme libre soumise au devoir de (p. 418) l'honnêteté (matrona, materfamilias), mais ici la répression s'étend toujours au complice mâle. Les esclaves du sexe féminin ne tombent pas sous le coup de cette loi : il n'en est pas de même des femmes mariées ou non mariées dont on n'exige pas l'honnêteté à raison de leur condition de vie : ce sont les filles publiques aussi longtemps qu'elles persistent dans leur profession, les tenancières de maisons publiques, les actrices, les tenancières de locaux ouverts au public, les femmes vivant dans un concubinage indécent. Mais le simple fait de mener une vie dissolue ne soustrait pas la femme romaine libre aux conséquences juridiques de ses manquements à la chasteté ». En note : « L'impunité n'est assurée que par l'inscription sur la liste des filles publiques ou par le fait d'embrasser une profession qui donne la même liberté ». Ici l'on voit bien le caractère proprement civil de la législation. Et encore, vers la fin de l'Empire romain, Saint Augustin pouvait écrire que la fornication et l'ivrognerie n'étaient pas défendues par les lois humaines, mais seulement par les lois de Dieu. – D. AUG.; Serm., 158, c. 5, 6 : Invenis hominem concupiscentias suas carnales sectantem... aucupari undique, voluptates, fornicari, inebriari (non dico amplius) fornicari, inquam, inebriari. Haec dixi quae licite committuntur, sed non Dei legibus. Quis enim aliquando ad iudicem ductus est, quia meretricis lupanar intravit ? Quis aliquando in publicis tribunalibus accusatus est, quia per suas lyristrias lascivus immundusque defluxit ? Quis aliquando habens uxorem, quia ancillam suam vitiavit, crimen invenit ? Sed in foro, non in coelo ; in lege mundi, non in lege Creatoris mundi. Ici, le saint établit très bien une séparation, qui trop tôt fut supprimée, entre le droit et la morale. – En poursuivant notre étude, nous voyons ensuite que l'usage établissait diverses catégories entre les femmes publiques. – NONIUS MARCELLUS en mentionne deux, V, p. 423 : Inter Meretricem et Prostibulum hoc interest. Meretrix honestioris loci est et quaestus ; nam meretrices a merendo dictae sunt, quod copiam sui tantummodo noctu facerent ; prostibula, quod ante stabula stent, quaestus diurni et nocturni causa. – Le prix aussi donnait lieu à des différences. – FESTUS (P. DIAC.) : Diobolares meretrices dicuntur, quae duobus obolis ducuntur. – Celius appela Clodia quadrantaria, pour l'insulter comme une vile femme publique.
[FN: § 1325-3]
OVIDE a grand soin de dire et de répéter qu'il ne chante que des amours licites. Art. amat., I :
(31) Este procul vittae tenues, insigne pudoris ;
Quaeque tegis medios, instita longs, pedes.
Nos Venerem tutam, concessaque furta, canemus.
«Allez au loin, bandelettes [vittae], signe de pudeur, et vous, longs pans qui couvrez à demi les pieds. Nous chanterons une Vénus sûre et des larcins permis ». Les vittae étaient portées par les vestales, les matrones et les jeunes filles ingénues. – SERV. ; Ad Aen., VII, 403 : [Crinales vittas]. Quae solarum matronarum erant : nam meretricibus non dabantur. – OVID ; Trist., II, répète les vers 31, 32, et au lieu du 33, il écrit :
(249) Nil, nisi legitimum concessaque furta, canemus.
Cfr. Remed. amor.,385-386. – Pont., III, 8, 51. – TIBULL. ; 1, 6, 67. – PLAUT. Mil.
glor., 791 (788). – OVID. ; Art. amat.,III, répète :
(57) Dum facit ingenium; petite hinc praecepta, puellae,
Quas pudor, et leges, et sua iura sinunt.
(483) Sed quoniam, quamvis vittae careatis honore,
Est vobis vestros fallere cura viros ;
(613) Nupta virum timeat : rata sit custodia nuptae.
Hoc decet : hoc leges iusque pudorque lubent.
Te quoque servari, modo quara vindicta redemit,
Quis ferat ? ut fallas, ad mea sacra veni.
« Qu'une épouse craigne son mari ; que la garde de l'épouse soit regardée comme valable ; voilà qui est convenable ; voilà ce que les lois, le droit et la pudeur ordonnent ; mais qui pourrait tolérer que toi aussi, tu sois asservie, toi que la verge prétorienne a affranchie naguère ? Viens, par mes vers, apprendre à tromper ».
[FN: § 1325-4]
Corp., IV, 2689. Sur la pierre est représenté un voyageur qui tient un mulet par la bride et règle ses comptes avec une femme. – Copo, computemus – Habes vini (sextarium) unum, panem, assem unum ; pulmentarium, asses duos – Convenit – Puellam, asses octo – Et hoc convenit – Faenum malo, asses duos – Iste mulus me ad factum. – ULPIEN ; dans le Dig., XXIII, 2, 43 : Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit. (1) Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu : non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet... (9) Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuaria habet (ut multae adsolent sub praetextu instramenti cauponii prostitutas mulieres habere), dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri. – Cod. Iust., IV, 56, 3, Imp. Alexan der... Eam, qaae ita venit, ne corpore quaestum faceret, nec in caupona sub specie ministrandi prostitui, ne fraus legi dictae fiat, oportet. – Une loi de Constantin distingue la tenancière du cabaret, des femmes qui servent les clients. La première peut être accusée d'adultère ; non les dernières, à cause de leur condition ignoble. Cod. Iust., 1X, 9, 28. – Cfr. VIRG. ; Copa.–- PHILOSTR. ; Epist., 32 (25), 33 (24), 60 (23). – La distinction de la loi de Justinien est en opposition avec le tabou chrétien, qui est bien exprimé par SAINT CHRYSOSTOME : Homil. V in I ad Thessal. L'auteur ne veut aucune distinction. Il dit que suivant Saint Paul, non seulement il ne faut pas avoir de rapports avec la femme du frère chrétien « mais qu'il ne faut pas avoir non plus d'autres femmes, ni celles qui ne sont pas mariées ni les femmes publiques. Il faut s'abstenir de toute fornication ». – ULP.; dans le Dig., III, 2, 4 : ... lenocinium. facit qui quaestuaria mancipia habuerit : sed et qui in liberis hunc quaestum. exercet, in eadem causa est. Sive autem principaliter hoc negotium gerat sive alterius negotiationis accessione utatur (ut puta si caupo fuit vel stabalarius et mancipia talia habuit ministrantia et occassione ministerii quaestum facientia : sive balneator fuerit, velut in quibusdam provinciis fit, in balineis ad custodienda vestimenta conducta habens mancipia hoc genus observantia in officina), lenociDii poena tenebitur. – S'il y avait des prostituées en tous ces lieux, elles devaient abonder.
[FN: § 1325-5]
Dig., V, 3, 27, § 1. Sed et pensiones, quae ex locationibus praediorum urbanorum perceptae sunt, venient, licet a lupanario perceptae sint : nam et in multorum honestorum virorum praediis lupanaria exercentur.
[FN: § 1326-1]
Mgr GUERIN ; Les conciles, t. I. Concile d'Ancyre en Galatie, l'an 314 : « (p. 55) Le 14e [canon] ordonne aux prêtres et aux diacres, qui s'abstenaient de manger de la viande, de ne le pas faire par mépris, comme si la viande était immonde. Il leur enjoint ensuite de la toucher et de manger des herbes cuites avec elle pour montrer que, s'ils s'en abstiennent, ce n'est pas qu'ils l'aient en horreur ni qu'ils la regardent comme mauvaise... Cette ordonnance du Concile est une sage précaution contre les Ébionites, les Manichéens et quelques autres hérétiques qui condamnaient, comme mauvais, l'usage de la viande, de crainte que les fidèles ne fussent portés à croire que les prêtres et les diacres, dont il est parlé dans ce canon, voulussent favoriser les erreurs de ces hérétiques. L'usage de la viande n'est donc pas mauvais en soi, quoiqu'il y ait du mérite de s'en abstenir par un esprit de pénitence ou par devoir quand l’Église l'ordonne ». Si l'Église n'avait pas protégé de cette manière la liberté de nourriture, il y aurait peut-être aujourd'hui des vertuistes qui obtiendraient des gouvernements de faire mettre en prison ceux qui mangent de la viande.
[FN: § 1326-2]
FRA BARTOLOMMEO DI SAN CONCORDIO ; Ammaestramenti degli antichi, Dist. XXIV : « (c. 3) La bouche est une cause de luxure... (c. 4) Non seulement l'usage de la nourriture, mais aussi celui du vin doit être modéré... (c. 5) Auteur. Le vin, sans aucun doute, est une nourriture de luxure ».
[FN: § 1327-1]
RENAN; Marc-Aurèle: « (p. 570) Il est si doux de s'envisager comme une petite aristocratie de la vérité, de croire que l'on possède, avec un groupe de privilégiés, le trésor du bien ! L'orgueil y trouve sa part ; le juif, le métuali de Syrie, humiliés, honnis de tous, sont au fond impertinents, dédaigneux ; aucun affront ne les atteint ; ils sont si fiers entre eux d'être le peuple d'élite ! »
[FN: § 1329-1]
On a maintenant reconnu qu'il y a beaucoup de vrai dans les Mémoires de Casanova. On y peut voir que dans les pays par lui parcourus, il y avait, en fait de mauvaises mœurs, de grandes différences dans la forme, de légères dans le fond. – S. DI GIACOMO ; dans Giornale d'Italia, 11 février 1913 : « Giacomo Casanova a-t-il, oui ou non, été véridique, lorsque, durant sa solitude laborieuse, dans la bibliothèque que le bon comte de Waldstein avait confiée aux soins patients et savants de sa réorganisation, il a raconté, entre autres, les choses qu'il a vues à Naples ou qui lui sont arrivées, dans les séjours qu'il y a faits ? Les noms de ceux qu'il a connus là sont-ils bien ceux qu'il indique ? Et la société parthénopéenne de ces années, la plèbe, l'armée, le clergé, la noblesse extravagante, le tempérament léger et cette merveilleuse et presque inconcevable fluctuation de nobles idées, d'études économiques, de philosophie élevée et nouvelle, dont certains des justes et austères programmes éthiques paraissaient déjà être un signe des temps, à ceux qui y prêtaient attention, tout cela n'était-il peut-être pas tel que l'a décrit et illustré l'observateur aventurier ? Nous verrons. Si, en attendant, je puis émettre sur les grandes lignes le jugement que je me suis fait des récits parthénopéens du chevalier, je dirai sans autre qu'il m'a surpris, non seulement par le souvenir qui lui est resté de ces événements et de leurs moindres détails, après un si long espace de temps, mais aussi par l'exactitude de son récit, qui m'a poussé à poursuivre, non des ombres de sa fantaisie exercée, mais des personnes et des choses qui ont vraiment existé, qui sont presque encore vivantes ».
[FN: § 1330-1]
DUBOIS ; Mœurs... des peuples de l’Inde, t. I. Après avoir raconté l'incontinence des Brahmes, l'auteur ajoute : « (p. 440) Cependant, qui pourrait le croire après ce qu’on vient de lire ; il n'est aucun pays du monde où la décence extérieure, proprement dite, soit plus régulièrement observée. Ce que nous appelons galanterie leur est tout à fait inconnu : ces badinages un peu libres, ces fades quolibets, ces éloges sans fin, ces soins empressés et sans mesure dont nos petits maîtres sont si prodigues, (p. 441) paraîtraient des insultes aux dames indiennes, même les moins chastes, si elles en étaient publiquement l'objet. Un mari même qui se permettrait quelques familiarités avec son épouse légitime, passerait pour un homme ridicule et de mauvais ton ». On pourrait répéter à la lettre les observations de Dubois, pour nombre de pays d'Europe et d'Amérique, où les paroles sont hypocritement morales et les actions laissent beaucoup à désirer. Une autre observation de Dubois s'applique aussi à ces pays: « (p. 487) L'adultère de la part des femmes, quoique infamant et condamné par les règlements des brahmes, n'est cependant pas puni, dans leur caste, avec autant de rigueur que dans la plupart des autres. S'il est secret, ils n'y attachent qu'une légère importance : la publicité seule les inquiète ; et dans ce cas, les maris sont les premiers à contredire les bruits qui circulent sur (p. 438) l'honneur de leurs moitiés, afin de prévenir les suites d'un éclat ». Toutefois, il est un point sur lequel, aux Indes, l'hypocrisie qu'on observe en nos contrées fait défaut : « (p. 437) Tout commerce avec une courtisane, ou avec une personne non mariée, n'est pas une faute aux yeux des brahmes ; ces hommes, qui ont attaché l'idée de péché à la violation des pratiques les plus indifférentes, n'en voient aucun dans les derniers excès de la luxure. C'est principalement à leur usage que furent destinées, dans l'origine, les danseuses ou les prostituées attachées au service des temples ; on leur entend souvent réciter en chantant ce vers scandaleux : ... dont le sens est : „ Le commerce avec une prostituée est une vertu qui efface les péchés ” ».
[FN: § 1330-2]
Justement à propos des plaisirs de l'amour, OVIDE ; Amor., III, 4, 17 : Nitimur in vetitum semper cupimusque negata. « Nous désirons toujours ardemment ce qui est défendu, et nous avons envie de ce qu'on nous refuse ». Et plus haut : (9) Cui peccare licet, peccat minus (§ 17511). – Art. amat., III, 603 : Quae venit ex tuto, minus est accepta voluptas. « La volupté dont nous jouissons sans péril nous est moins agréable ».
[FN: § 1330-3]
La Liberté, 14 février 1912 : « Berlin, 12 février. – Il y a six ans, la veuve d'un capitaine prussien installait dans le voisinage de sa villa, à Teltow, une petite bergerie où vivaient en paix deux brebis, un poney, trois canards, quelques lapins, des poules et un coq. Pendant six années consécutives, bipèdes et quadrupèdes ne connurent que les agréments d'une existence facile et heureuse. Mais, l'autre jour, les foudres de la justice faillirent s'abattre sur eux. L'affaire vaut d'être contée. Près de la bergerie, se trouve une école primaire et, pendant la récréation, les petits Prussiens suivaient d'un œil amusé les ébats des poules, canards et brebis. Le maître d'école suivit un jour ses élèves jusqu'à l'enclos de la bergerie. Et ce qu'il vit l'indigna profondément. Il prit sa plus belle plume de magister, et voici ce qu'il écrivit au bourgmestre de Teltow : „ Le spectacle permanent des penchants inesthétiques et sexuels de la gent emplumée exerce la plus néfaste influence sur la morale des enfants “. Les ébats d'un coq entreprenant avaient froissé le digne homme dans sa pure esthétique ! Ce qu'il y a de plus drôle, c'est que le bourgmestre, à coup sûr un brave homme, avisa la veuve du capitaine, par ordonnance de police, d'enfermer le coq à huis clos. Mais la veuve n'entendit pas de cette oreille et porta le différend devant les tribunaux. Le procureur donna raison au maire et condamna en un réquisitoire sévère la dépravation croissante des mœurs. L'avocat qui défendait la veuve s'appliqua à faire ressortir le côté comique de la question et lorsqu'il demanda aux juges, „ de procéder à une visite de la bergerie et de convoquer le maître d'école afin que celui-ci fit une démonstration sur l'impudeur du coq ”, l'auditoire partit d'un vaste éclat de rire. Les juges eurent le bon esprit d'annuler l'ordonnance de police établie par le maire et mirent tous les frais à la charge de l'État ». La Gazette de Lausanne, 1er janvier 1913, rapporte un autre cas de pudeur absurde et hypocrite : « Peut-on embrasser sa femme dans un train, en Angleterre ? Le gouvernement bavarois a récemment condamné à l'amende un homme qui, dans un train, avait embrassé sa femme légitime. Justement ému, un grand journal anglais envoya un de ses meilleurs reporters consulter un des hauts fonctionnaires des chemins de fer britanniques, afin de savoir si les voyageurs pouvaient être en Angleterre exposés à de pareilles vexations. Voici la réponse, assez rassurante, de cet important personnage : „ Les voyageurs circulant sur les chemins de fer anglais n'ont rien à craindre. Un homme peut, dans la plupart des circonstances, sur le quai ou dans le train, embrasser sa femme ou toute autre dame dûment autorisée, lors d'une rencontre ou d'un départ ou pendant un voyage ; il lui est permis de tenir la main de sa compagne ou même de serrer cette dernière contre lui ; il a aussi le droit de permettre à sa femme de reposer la tête contre son épaule lorsqu'elle se sentira fatiguée “. Heureux Anglais, qui ont enfin la Charte des libertés nécessaires ! » On a l'habitude de prendre des anecdotes semblables pour de simples plaisanteries, mais elles n'en sont pas. Elles sont la manifestation extrême du résidu sexuel qui, en certains esprits, prend des proportions gigantesques, les fascine et leur enlève le sens du réel et du ridicule qui subsiste dans les esprits moins hantés. On observe ces phénomènes en tout temps. Ils sont habituels chez les ascètes chrétiens, et ne font pas défaut chez les Israëlites. On en peut citer un grand nombre du Talmud. Les suivants suffiront. SCHWAB ; Talm., t. VI, traité Taanith : «(p. 149)... lors de l'entrée de Noë dans l'arche, la cohabitation lui fut interdite, comme il est dit (Genèse VI, 18),... (p. 150) mais à la sortie elle lui fut permise, selon ces mots (ib., VIII, 16)... R. Hiya b. Aba dit : L'expression ils quittèrent l'arche selon leurs familles (ib.) signifie que, pour avoir conservé leur généalogie (sine coïtu), ils ont eu le bonheur d'échapper au déluge. Ce qui prouve qu'il faut l'entendre ainsi, c'est que les 3 qui ont agi contre nature dans l'arche, Cham, le chien, le corbeau, en ont été punis... » Un rabbin nous donne un renseignement plaisant au sujet de ce corbeau. SCHERZERI; Selecta rabinicophilologica ; comment. Rasche in cap. VIII, Gen., p. 196, VIII, 7 : Exeundo et redeundol] Ivit et volitavit cirea arcam, et non ivit in missione sua, quia eum (Noachum) suspectum habebat, propter consortem sua (ne coiret cum illa in absentia). Ce n'est déjà pas mal ; mais il y a mieux. Le même SCHERZERI traduit le commentaire d'un autre rabbin, sur la Genèse, où l'on dit : (p. 18) Docet (scriptura) quod Adam venerit ad omnia animantia et bestias, et non saciatus fuerit ipsius appetitus per illa. Il ajoute en note (p. 66) Reuchlinus, Cabbal., 1. I, fol. 626, ita Raschi citat verba... et ita reddit Venit Adam ad omne iumentum et animal, et non commovebatur sensus eitis, in illis, usque dum venisset ad uxorem. Quae ultima verba in meo exemplari (p. 67) non extant. Hic iam Capnio sub persona Simeonis Iudaei... ex his verbis, inquit, diaboli incarnati, larvaeque furiales potius, quam homines, seditionem Christianitatis adversum nos excitare parati... hoc dictum sic exposuerunt : quasi Adam tunc cum omnibus bestiis et animalibus foede coiverit. Nam, qui fieri, possit ut tantus Vir et tain magnus Adam cum cimice, pulice, musca et cicada feminaliter coivisse intelligatur ? – Il semble impossible que l’homme puisse atteindre un tel degré de sottise, et que cette race de niais ait survécu jusqu'à notre époque. – SCHWAB ; Talm. de Babyl., traité des Berakhoth : « (p. 260) En suçant le lait de sa mère, il [David] aperçoit ses seins, et il chante en ces termes [Ps. CIII, 2-3] : „ Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. “ – „ Quels sont-ils ? “ – „ C'est, répondit R. Abahou, d'avoir placé les seins de la mère au siège de l'intelligence “. – „ Pourquoi ? “ – „ Pour que l'enfant, répondit R. Iuda, ne voie pas la nudité, “ (comme chez les femelles des animaux), ou, selon R. Matna, „ pour que l'allaitement n'ait pas lieu dans un endroit malpropre “ ». Attendons-nous à ce que nos honnêtes et intelligents vertuistes fassent des lois pour prescrire l'attitude des nourrissons, quand ils prennent le sein de leur mère. – La Liberté, 6 décembre 1912 : « La pudique Australie. – Sur l'initiative du gouvernement australien, les douanes fédérales d'Australie viennent de prohiber l'introduction des cartes postales illustrées indécentes. Jusque-là, rien de plus naturel. Mais les agents des douanes australiennes ont été invités à interpréter le mot indécent dans son sens le plus large, c'est-à-dire de l'étendre à tout ce qui peut présenter un caractère blasphématoire, indélicat, immodeste et grossier. Immodeste ! voilà un terme bien élastique et grâce auquel la reproduction en cartes postales du Baiser de Rodin, d'Enfin seuls !, de l'Amour et Psyché, pour ne citer que ces œuvres artistiques, sera interdite en Australie. On disait autrefois : „ la pudique Albion “. Quel qualificatif donner à l'Australie ? » On dit que dans ce pays si bien protégé fleurissent des amours qui ne sont pas naturelles. – Journal de Genève, 31 mars 1911 : « Une condamnation prononcée contre M. Robert Siévier, rédacteur en chef d'une feuille hebdomadaire londonienne, montre avec quelle énergie l'Angleterre entend poursuivre sa campagne contre la littérature pornographique. M. Muskett, au nom de la couronne, déclara au président du tribunal, M. Marsham, qu'un numéro de la feuille dirigée par M. Siévier contenait un paragraphe d'un caractère obscène. M. Marsham, après avoir très durement admonesté M. Siévier, le condamna à une amende de 250 francs et aux frais ». Mais les voleurs du continent trouvent un asile sûr en Angleterre, à cause des difficultés de la procédure.
[FN: § 1331-1]
RENAN; Marc-Aurèle « (p. 245) Un des mystères le plus profondément entrevus par les fondateurs du christianisme, c'est que la chasteté est une volupté et que la pudeur est une des formes de (p. 246) l'amour. Les gens qui craignent les femmes sont, en général, ceux qui les aiment le plus. Que de fois on peut dire avec justesse à l'ascète : Fallit te incautum pietas tua ». Là, il n'y a aucun mystère : c'est simplement la théorie dite des voiles. Renan décrit mieux qu'il n'interprète, quand il dit plus loin : « (p. 247) Ainsi s'explique ce mélange singulier de pudeur timide et de mol abandon qui caractérise le sentiment moral dans les Églises primitives ». C'est tout bonnement le résidu sexuel ; mais l'auteur estime de son devoir d'ajouter une déclamation : « Loin d'ici les vils soupçons de débauchés vulgaires, incapables de comprendre une telle innocence ! Tout était pur dans ces saintes libertés : mais aussi qu'il fallait être pur pour pouvoir en jouir ! » On dirait que notre auteur s'est trouvé présent et a vu que tout était pur. Il dit ensuite : « (p. 247) La légende nous montre les païens jaloux du privilège qu'a le prêtre d'apercevoir un moment dans sa nudité baptismale celle qui, par l'immersion sainte, va devenir sa sœur spirituelle. Que dire du saint baiser, qui fut (p, 247) l'ambroisie de ces générations chastes ? ... » Pourtant les chrétiens eux-mêmes s'aperçurent bientôt que le saint baiser, entre hommes et femmes, présentait quelque danger. – ATHENAG. ; Supplic. pro christ., 3-9, éd. Oxon, p. 128- p. 169-170, éd. Ienae. L'auteur cite d'un autre auteur que nous ne connaissons pas : ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() « „ Si quelqu'un donne un second baiser, parce qu'il y trouve plaisir [il pèche] “ » et il ajoute : « „ Ainsi donc, il convient d'être prudent avec le baiser, et plus encore avec le salut, car si la pensée est tant soit peu entachée, nous sommes exclus de la vie éternelle “ ». – CLEM. ALEX. ; Paed., III, 11, p. 301 Pott., 257 Par. Il veut que le baiser ne soit pas impudique, mais mystique, et qu'il soit donné « d'une bouche pudique et fermée » :
« „ Si quelqu'un donne un second baiser, parce qu'il y trouve plaisir [il pèche] “ » et il ajoute : « „ Ainsi donc, il convient d'être prudent avec le baiser, et plus encore avec le salut, car si la pensée est tant soit peu entachée, nous sommes exclus de la vie éternelle “ ». – CLEM. ALEX. ; Paed., III, 11, p. 301 Pott., 257 Par. Il veut que le baiser ne soit pas impudique, mais mystique, et qu'il soit donné « d'une bouche pudique et fermée » : ![]()
![]() . Renan peut dire ce qu'il voudra : cette dernière observation n'est pas si pure ! Cf. § 1394.
. Renan peut dire ce qu'il voudra : cette dernière observation n'est pas si pure ! Cf. § 1394.
[FN: § 1332-1]
H. BOIS; Le rév. au Pays de Gall. L'auteur transcrit un récit de Evan Roberts. Les personnes dont on y fait mention sont les suivantes : « (p. 437) Mary désigne une Miss Mary Davies de Gorseinon, qui n'est pas parente des deux demoiselles Davies plus connues (Annie et Maggie, les deux sœurs de Maesteg). Dan est le frère d'Evan Roberts ». Evan Roberts rapporte : « ... À ce moment une voix me dit : „Vous devez rester silencieux pendant sept jours “. Les soeurs venaient d'arriver à ce moment-là, et après que Mr. Mardy Davies fut parti, je leur demandai par écrit de chanter le cantique de Newmann (Lead, Kindly light). Le chant fut tendre et solennel : elles pleuraient en chantant ; „ Un seul pas, c'est assez pour moi ! ” Elles chantèrent ensuite le cantique : „ J'ai besoin de toi à chaque heure… “. L'une d'elles demanda : „ Qu'allons-nous faire ? “ La réponse fut : ,, Attendez jusqu'à ce que je reçoive un message explicite du ciel. Il a suggéré (ce mot était souligné par deux traits dans le cahier où Evan Roberts a écrit ses réponses) que l'une d'entre vous retournerait chez elle et que l'autre resterait avec moi “. Au bout d'un certain temps, et après beaucoup de prières, la réponse vint : ,, Annie doit demeurer ici pour me soigner, et Mary ira à la maison pour se reposer, ou bien rejoindra Maggie et Dan Il “. Miss Annie Davies reste et Evan Roberts lui donne ses instructions par écrit : « (p. 438) Il n'y a personne d'autre que vous qui doive me voir pendant la semaine prochaine, – pas même mon père et ma mère ». Et la jeune fille soigna le prophète pendant une semaine, sans entendre une parole de lui. L'auteur ajoute : « (p. 459) Un trait est de nature à étonner, voire même à choquer le lecteur français, c'est l'assurance avec laquelle Evan Roberts désigne comme un message explicite du ciel l'ordre prétendu de garder auprès de lui une jeune fille, une seule, Annie Davies, alors que les autres sont renvoyées et qu'il se refuse à voir personne pendant sept jours... Il est bien vrai que le Saint-Esprit défendait à Roberts de parler, mais non pas d'écouter et d'écrire et de lire. Et assurément d'autres qu'Evan Roberts auraient pu voir dans cette suggestion plutôt une tentation qu'un ordre divin ».
[FN: § 1333-1]
Journal des GONCOURT, t. III, p. 6 : « En France, la femme se perd bien plus par le romanesque que par l'obscénité de ce qu'elle lit ».
[FN: § 1334-1] La poésie de Carducci A proposito del processo Fadda, n'est pas seulement une production poétique c'est une description de faits sociaux qui sont communs.
[FN: § 1339-1]
Nous suivons l'énumération que fait MARQUARDT ; Le culte chez les Romains, t. I, p. 14 à 22.
[FN: § 1339-2]
MART. CAPELL. ; II, 149 (voir le commencement de la citation 1339-3) : Interducam et Domiducam, Unxiam, Cinxiam mortales puellae debent in nuptias convocare, ut earum et itinera protegas, et in optatas domos ducas, et cum postes ungant faustum omen affligas. – [Dans MARQUARDT on propose ; funestum omen affligas] et cingulum ponentes in thalamis non relinquas. – Les Romains, de même que les Grecs, attribuaient un sens religieux à l'acte de délier la ceinture de la vierge. P. FESTUS ; De verb. sign., s. r. Cinxiae Iunonis nomen sanctum habebatur in nuptiis, quod initio coniugii solutio erat cinguli, quo nova nupta erat cincta. SUID. ; s. r. ![]() : « Celle qui a commerce avec l'homme. Étant donné que les vierges approchant le moment de se marier dédiaient leurs ceintures virginales à Artémis ». Le scoliaste dit dans APOLL., Argonaut., 1, 288, qu'il y avait à Athènes, un temple à Arthémis qui délie la ceinture :
: « Celle qui a commerce avec l'homme. Étant donné que les vierges approchant le moment de se marier dédiaient leurs ceintures virginales à Artémis ». Le scoliaste dit dans APOLL., Argonaut., 1, 288, qu'il y avait à Athènes, un temple à Arthémis qui délie la ceinture :
– Cfr. ORPH. ; Hymn., 35, 5. – CALLIMACH.; Hymn., in Iov., 21. – Odyss., XI, 245 (mais Zénodote n'admet pas le vers). – De là l'expression zonam solvere, ![]() , pour la femme qui a commerce avec l'homme. La femme qui s'était mariée une seule fois disait avoir délié sa ceinture pour un seul homme. Anth., ep. sepuler., 324 :
, pour la femme qui a commerce avec l'homme. La femme qui s'était mariée une seule fois disait avoir délié sa ceinture pour un seul homme. Anth., ep. sepuler., 324 : ![]() . « Ayant délié sa ceinture pour un seul homme ». On le disait aussi des femmes qui accouchaient, THÉOCR. ; XVII, 60.
. « Ayant délié sa ceinture pour un seul homme ». On le disait aussi des femmes qui accouchaient, THÉOCR. ; XVII, 60.
[FN: § 1339-3]
Principalement : Mutinus, Subigus, Prema, Pertunda, Perfica, Ianus consivus, Liber et libera, Fluonia, Nona, Decima, Partula, Vitumnus, Sentinus. Nous en avons d'amples notions grâce aux Pères de l'Église. – Au passage de Saint Augustin, déjà cité (§ 177-4), il faut ajouter les suivants. D. AUGUST.; De civ. Dei, VII, 2. L'auteur dit que les dieux choisis de Varron sont confondus avec d'autres auxquels sont assignées d'humbles fonctions : Nam ipse primum Ianus, cum puerperium concipitur, unde cuncta opera illa sumunt exordium, minutatim minutis distributa numinibus, aditum aperit recipiendo semini : ibi est et Saturnus propter ipsum semen : ibi Liber qui marem effuso semine liberat : ibi Libera, quam et Venerem volunt, quae hoc idem beneficium conferat feminae, ut etiam ipsa emisso semine liberetur. Omnes hi ex illis sunt, qui selecti appellantur. Sed ibi est et dea Mena, quae rnenstruis fluoribus praeest, quamvis Iovis filia, tamen ignobilis. Et hanc provinciam fluorum menstraorum in libro selectorum deorum ipsi Iunoni idem auctor assignat, quae in diis selectis etiam regina est : et hic tanquam Iuno Lucina cum eadem Mena, privigna sua, eidem cruori praesidet. Ibi sunt et duo, nescio qui obscurissimi, Vitumnus et Sentinus ; quorum alter vitam, alter sensus puerperio largiuntur. – Saint Augustin a raison ; ç'aurait été une grande sottise des Romains que d'assigner de si humbles fonctions à des dieux préexistants ; mais on ne descend pas des dieux aux actes : on monte des actes aux dieux. Il est induit en erreur, parce qu'il veut rendre logiques des actions essentiellement non-logiques : (VII, 3) Inter selectos itaque deos Vitumnus vivificator et Sentinus sensificator magis haberi debuerunt, quam Ilanus seminis admissor et Saturnus seminis dator vel sator, et Liber et Libera seminum commotores vel emissores; quae semina indignum est cogitare, nisi ad vitam sensumque pervenerint. – Idem, ibidem, IV, 11. L'auteur dit que Jupiter peut bien être tout ce qu'on veut, ... ipse sit postremo etiam in illa turba quasi plebeiorum deorum : ipse praesit nomine Liberi virorum seminibus; et nomine Liberae feminarum : ipse sit Diespater, qui parfum perducat ad diem ; ipse sit dea Mena, quam praefecerunt menstruis feminarani ; ipse Lucina, quae a parturientibus invocetur : ipse opem ferat nascentibus, excipiende eos sinu terrae, et vocetur Opis... de pavore infantum Paventia nuncupefur; de spe quae venit, Venilia ; de voluptate Volupia; de actu Agenoria; de stimulis, quibus ad nimium actum homo impellitur, dea Stimula nominetur; Strenia dea sit, strenuum faciendo, Numeria, quae numerare doceat; ... ipse in Iugatino deo coniuges iungat; et cum virgini uxori zona solvitur, ipse invocetur, et dea Virginiensis vocetur : ipse sit Mutunus vel Tutunus, qui est apud Graecos Priapus : si non pudet, haec omnia quae dixi, et quaecumque non dixi, non enim omnia dicenda arbitratus sum, hi omnes dii deaeque sit unus Iupiter : sive sint, ut quidam volunt, omnia ista partes eius, sive virtutes eius... On voit ici réunis les dieux entre lesquels les chrétiens firent ensuite l'hiatus. – TERTULL.; Ad. nat.,II, 11. L'auteur parle de ces dieux ... dividentes omnem statum hominis singulis potestatibus ab ipso quidem uteri conceptu, ut sit deus Consevius quidam, qui consationibus concubitalibus praesit, et Fluviona, quae infantem in utero retineat, hinc Vitumnus et Sentinus, per quem viviscat infans et sentiat primum, dehinc Diespiter, qui puerum perducat ad partum. Cum primum pariebant, et Candelifera, quoniam ad candelae lurnina pariebant, et quae aliae deae sunt ab officiis partus dictae. Perverse natos adiuvandi Postvertae, recte natos Prosae Carmentis esse provinciam voluerunt... Si de nuptialibus disseram, Afferenda est ab afferendis dotibus ordinata [on voit bien comment l'hiatus fait défaut] sed sunt, proh pudor! et Mutunus et Tutanus et dea Pertunda et Subigus et Prema dea et Perfica [maintenant, voilà que l'hiatus apparaît chez Tertullien]. Parcite dei impudentes ! Luctantibus sponsis nemo intervenit. – Idem ; de anima, 37 : ... superstitio Romana deam finxit Alemonam alendi in utero fetus, et Nonam et Decimam a sollicitioribus mensibus, et Partalam, quae parfum gubernet, et Lucinam quae producat in lucem. Nos officia divina angelos credimus. Remarquez cette dernière observation ; au fond, ce sont simplement deux théologies en opposition. – ARNOB.; Ad. gent., IV, 7 : ...Etiamne Perfica una est e populo numinum, quae obscoenas illas et luteas voluptates ad exituin perticit dulcedine inoffensa procedere ? Etiamne Pertunda, quae in cubiculis praesto est, virginalem scrobem effodientibus maritis ? Etiamne Tutunus, cuius immanibus pudendis, horrentique fascino, vestras inequitare matronas, et auspicabile ducitis, et optatis ? – Idem;III, 30 : ... Iam vero Iunonem opinatio nonne consimilis Deorum tollit et censu ? Nam si aer illa est, quemadmodum vos ludere ac dictitare consuestis, Graeci nominis praeposteritate repetita, nulla soror et coniux omnipotentis reperietur Iovis, nulla Fluonia, nulla Pomona, nulla Ossipagina, nulla Februtis, Populonia, Cinxia, Caprotina : atque ita reperietur inanissima esse istius nominis fictio, opinionis vacuae celebritate vulgata. – C'est l'erreur habituelle de considérer comme logiques les actions non-logiques. – P. FESTUS; De sign. verb. s. r. Fluoniam Iunonem : mulieres colebant, quod eam sanguinis fluorem in conceptu retinere putabant. – M. CAPELLAE de nupt. phil., II, 149: ... Iuno pulchra, licet aliud nomen tibi consortium coeleste tribuerit et nos a iuvando Iunonem... nam Fluoniam, Februalemque ac Februam mihi poscere non necesse est, cum nihil contagionis corporeae sexu intemerata pertulerim ; (voir la suite de la citation 1339-2). – LACT. ; De falsa relig.,XX, 36 : Colitur... et Cunina, quae infantes in cunis tuetur, ac fascinum submovet : et Sterculus, qui stercorandi agri rationem primus induxit, et Mutinus, in cuius sinu pudendo nubentes praesident [vel prius sedent. D. AUG. ; De civ. dei, VI, 9], ut illarum pudicitiam prior deus delibasse videatur... – Cfr. ARNOB. ; Ad gent., IV, 11. – TERTULL. ; Apol., 25. – P. FESTUS ; De verb. sign., s. r. Mutini Titini sacellum fuit Romae, cui mulieres velatae togis praetextatis solebant sacrificare.
[FN: § 1341-1]
PERRENS ; Les libertins en France au XVIIe siècle : « (p. 5) Le XVIe siècle donnait le nom de libertinage à l'esprit d'incrédulité, esprit très ancien en France... (p. 7) Dans les enfans de Genève le grand hérésiarque [Calvin] combattait tout ensemble la hardiesse des pensées, la licence des mœurs, le parti conservateur... Malheureusement l'opposition donnait au mot de liberté, en même temps que son sens politique, le sens voluptueux qui plait à la jeunesse... Les écarts étaient-ils graves ? C'est peu probable, puisqu'on s'en prenait aux doctrines pour allumer les bûchers ». De même aujourd'hui, les dominicains de la vertu substituent la prison et l'amende aux raisonnements qu'ils sont incapables de tirer de leur esprit chétif. « (p. 7) Désormais, aux imputations doctrinales il [Calvin] joignait les imputations morales : ses victimes désignées étaient des „ débauchés, chrétiens déchus, livrés au démon de la chair“, des anabaptistes, l'abomination de la désolation ». On croit entendre M. Bérenger ou quelque autre semblable bel esprit. « (p. 8) Dans son abondant vocabulaire d'injures, nous rencontrons l’appellation de libertins, dont il semble bien avoir, le premier, enrichi notre langue. Ce mot, on ne le trouve pour désigner ses ennemis, dans aucun manuscrit du XVIe siècle. Nos plus anciens lexiques, en effet, ne portent point ces deux vocables : libertins et libertinage... Le jésuite Philibert Monet se décide avant tout autre (1635) à faire jouir du droit de cité ces deux nouveaux venus du langage parlé... (p. 9) Au fond, c'est l'indépendance religieuse que l'hérésiarque [Calvin] flétrit du nom de libertinage : en user à son exemple, ce serait en mésuser ; derrière lui il a coupé les ponts. Mais, à la longue, les ponts détruits se reconstruisent. Les hommes du XVIIe siècle qui prétendent y passer forcent la main à leur temps... Pour la conduite de la vie, l'acception honorable est nouvelle ; mais les exemples abondent. ,, Je suis tellement libertine quand j'écris – lisons-nous dans Mme de Sévigné – que le premier tour que je prends règne tout du long de ma lettre... Furetière, qui reproduit les sens d'usage, déclare libertins l'écolier qui fripe ses classes, qui désobéit à son maître, la fille, la femme indocile... l'homme qui hait la contrainte, qui suit son inclination, sans pourtant s'écarter des règles de l'honnêteté et de la vertu. Il tient même, tout autant que Richelet... à cette restriction significative, car il ajoute qu'une femme peut dire de soi, dans un bon sens et dans une signification délicate, qu'elle est née libertine. Pour Voltaire aussi le libertin est un homme désireux d'indépendance”. (p. 10) Mais il était inévitable, dans un siècle croyant, que l'esprit d'indépendance fit scandale, s'il s'étendait aux matières de la foi. D'où une signification dérivée, qui devint aisément la principale ».
[FN: § 1343-1]
Une épigramme de l'Anthologie grecque nous présente un cas de fétichisme identique à ceux qu'on observe aujourd'hui chez les nègres. Epig. demonstrativa, 263 : « Quand la vieille Eubule avait quelque chose en l'esprit, elle prenait, comme oracle de Phoebus, le premier caillou qui se trouvait devant ses pieds, et le soupesait dans sa main. Elle le trouvait lourd, si elle ne voulait pas une certaine chose ; plus léger qu'une feuille, si elle voulait cette chose. Ainsi, faisant ce qui lui plaisait, si cela tournait mal, elle rejetait sur Phœbus la faute de l'œuvre de ses mains ». Les anciens héros juraient par leur lance. – IUST. ; Hist., XLIII, 3 : .. ab origine rerum, pro diis immortalibus veteres hastas coluere ob cuius religionis memoriam adhuc deorum simulacris hastae adduntur. –ESCH. ; Sept. advers. Theb., 514-515 (529-530). On dit d'un guerrier :
« Il jure par la lance qu'il possède, et qu'on doit vénérer plus qu'un dieu ». – Cfr. VIRG. ; Aen., XII, 95. – V. FLACC. ; Argonaut., III, 707-711. – Iliad., I, 233-234. – Les fétichismes dont Priape est l'objet sont exactement du même genre. La littérature et les inscriptions ne manquent pas d'exemples nombreux de ce culte, qui n'ont aucune signification obscène. – Corp., 3565 : Genio numin(i)s Pria(pi) poten(t)is polle(nti)s (invi)cti Iul(ius) Agathemerus Aug(usti) libertus a cura amicorum. somno monitus. – In parte postica : Salve sancte pater Priape rerum, Salve. Da mihi floridam iuventam, Da mihi... ut puellis Fascino placeam bonis procaci, Lusibusque frequentibus iocisque Dissipem curas animo nocentes, Nec gravem timeam nimis senectam, Angar haud (miser)ae pavore mortis, Quae ad domu(s) trahet invida(s Aver)n(i) Fabulas Manes ubi rex coercetd, Unde fata negant redire quemquam. Salve, sancte pater Priape, salve. – In latere : Convenite simul quot est(is om)nes, Quae sacrum colitis (ne)mus puellae, Quae sacras colitis a(q)uas puellaee,... – In allero latere : ... O Priape potens, amice, salve : Te vocant prece virgi(nes pudi)cae, Zonulam ut solvas diu ligatam. Teque nupta vocat... – DE RUGGIERO; Syll. epig., vol. II, p. 23-24: d) Intellige = quae mors trahet me ad perosas domus Averni, ubi rex i. e. Pluto cohibet vinclis poenisque castigat Manes fabulosos i. e. inanes... e) Puellae quae sacrum nemus et sacras colunt aquas, sunt Dryades et Naiades... – DESSAU ; 3581 : Faustus Versenni P. ser. Priapum et templum d. s. peculi f. c. 3582. Priepo Pantheo P. P. Aelii Ursio et Antonianus aediles col. Apul. dicaverunt Severo et (Q)uin(t)iano cos. – D. AUGUST. ; De civ. dei, VII, 24 : Iam quod in Liberi sacris honesta matrona pudenda virilia coronabat, spectante multitudine, ubi rubens et sudans, si est ulla frons in hominibus, adstabat forsitan et maritus ; et quod in celebratione nuptiarum, super Priapi scapum nova napta sedere iubebatur. – Tout cela n'est rien en comparaison des mystères indécents de la Grande Mère. – Ibidem., VII, 21. Les chastes matrones couronnaient publiquement un phallus pour obtenir de bonnes moissons. ...in Italiae compitis quaedam dicit sacra Liberi celebrata cum tanta licentia turpitudinis, ut in eius honorem pudenda virilia colerentur ; nam saltem aliquantum verecundiore secreto, sed in propatulo exsultante nequitia. Nam hoc turpe membrum per Liberi dies festos cum honore magno plostellis impositum, prius rure in compitis, et usque in urbem postea vectabatur. In oppido autem Lavinio unus Libero totus mensis tribuebatur, cuius diebus omnes verbis flagitiosissimis uterentur, donec illud membrum per forum transvectum esset, atque in loco suo quiesceret. Cui membro inhonesto matremfamilias honestissimam palam coronam necesse erat imponere. Sie videlicet Liber deus placandus fuerat proventibus seminum : sic ab agris fascinatio repellanda, ut matrona facere cogeretur in publico, quod nec meretrix, si matronae spectarent, permitti debuit in theatro. – Et pourtant, lorsqu'en des temps plus reculés encore, ces rites étaient en usage, Rome dominait le monde alors connu, tandis qu'au temps du mysticisme de Saint Augustin, Rome succombait sous les coups des Barbares. – LACT. ; De fat. relig., XXI, 25 : Apud Lampsacum Priapo litabilis victima est asellus... Et il en donne une raison obscène qui aura été probablement inventée pour expliquer le fait. – ARNOB. ; Adgent., IV, 11, dit : «Parce que nous ne nous prosternons pas en suppliants devant Mutunus et Tutunus, toute chose devrait-elle tomber en ruine, et le monde lui-même changer d'ordre et de lois ? » Il a raison ; et il est certain que le fait d'adorer ou de ne pas adorer ces divinités ou d'autres était parfaitement indifférent pour la prospérité de Rome. – Cf. PAUS. ; VI, 26; IX, 31. – DIODORE DE SICILE, IV, 6, dit que Priape est adoré non seulement dans les temples, mais aussi dans les campagnes, comme leur gardien ; et l'on croit aussi qu'il agit contre les maléfices. Le culte du Phallus dura longtemps. On en trouve encore des traces au VI, siècle. – EVAGRIUS; Eccl. hist., I, 11, parlant des Gentils, dit : Riserit etiam non immerito quispiam Phallos eorum, et Ithifallos, ac Phallagogia, et enormem Priapum, ac Panem, qui turpi colitur membro (Trad. Valesius). NICÉPHORE CALLISTHÈNE en traite aussi. Eccl. hist., XIV, 48. – Cf. SUID.; s. r. ![]() . – HESYCH. ; s.r.
. – HESYCH. ; s.r. ![]() . – HARPOCR., s. r.
. – HARPOCR., s. r.
![]() – DEMOSTH. ; c. Conon., 20, p. 1263. – ATH.; IV, c. 3, p. 129 d ; – XIV, c. 16, p. 622f. – EUSTATH. ; in Odyss., I, v. 226, 1413 r., p. 50-51 b. – Si nous voulons prêter attention à l'auteur des Philosophumena, Priape jouait un rôle important dans l'hérésie de Justin. Ce dieu aurait été ainsi nommé parce qu'il a été créé avant toute chose. « Aussi est-il placé dans tous les temples, honoré par toute la création, et porte-t-il sur lui, au bord des chemins, les fruits de la création, étant cause de la création » (Philosoph., V, 4, p. 237 Cruice). – On sait assez que Priape a été placé comme gardien des jardins. – VIRG. ; Georg., IV :
– DEMOSTH. ; c. Conon., 20, p. 1263. – ATH.; IV, c. 3, p. 129 d ; – XIV, c. 16, p. 622f. – EUSTATH. ; in Odyss., I, v. 226, 1413 r., p. 50-51 b. – Si nous voulons prêter attention à l'auteur des Philosophumena, Priape jouait un rôle important dans l'hérésie de Justin. Ce dieu aurait été ainsi nommé parce qu'il a été créé avant toute chose. « Aussi est-il placé dans tous les temples, honoré par toute la création, et porte-t-il sur lui, au bord des chemins, les fruits de la création, étant cause de la création » (Philosoph., V, 4, p. 237 Cruice). – On sait assez que Priape a été placé comme gardien des jardins. – VIRG. ; Georg., IV :
(110) Et custos furum atque avium cum falce saligna
Hellespontiaci servet tutela Priapi.
Eglog., VII :
(83) Sinum lactis, et haec te liba, Priape, quot annis
Exspectare sat est : custos es pauperis horti.
Nunc te marmoreum pro tempore fecimus ; at tu,
Si foetura gregem suppleverit, aureus esto.
OVID. ; Fast.,I :
(415) At ruber, hortorum decus et tutela Priapus...
Cfr. TIBULL. ; I, 1, v. 17-18. – COLUM. ; X, 29-34. – HORAT. ; Satur.,I, 8. – Anth.
gr. ; Appendix Planudea, 286 à 243. – Nous trouvons le culte de Priape là où il est impossible de lui donner une signification obscène, par exemple comme gardien des sépulcres. – DESSAU ; 3585 : Romae rep. ad viam Appiam inter sepulcrorum rudera, nunc Parisiis) custos sepulcri pene destricto deus Priapus ego sum. Mortis et vitai locus. – 3586: (Veronae) dis manibus... Locus adsignatus monimento in quo est aedicla Priapi. – Anth. palat. ; Epigr. dedicatoria, 33. Priape est désigné comme protecteur de la plage. – Cfr. ibid. ; 89, 198; Epigr. exhortatoria, 1, 2. Cette dernière épigramme contient une exhortation à naviguer, et se termine ainsi :
« Je vous le dis, moi Priape fils de Bromios, qui suis dans le port ». – Sur les monnaies de Lampsaque, on voyait l'effigie de Priape. – STRABON ; VIII, c. 6, 24 p. 587, (p. 382) parle d'une ville qui s'appelle Priape parce qu'on y adore ce dieu. F. LAJARD ; Rech. sur le culte... de Vénus : « (p. 52) La présence de l'organe même du pouvoir générateur femelle parmi les attributs placés autour de la figure androgyne que je prends pour la Vénus assyrienne ou Mylitta, est un fait important... Un autre cône, ..., nous offre même la représentation d'un prêtre revêtu d'un costume asiatique et accomplissant un acte d'adoration devant un autel sur lequel on voit un ![]() et l'étoile de Vénus ou le soleil. Ici le ctéis semble devenir l'emblème de la déesse elle-même... Sur les uns comme sur les autres de ces divers monuments, un pareil attribut me semble caractériser le culte de la Vénus orientale avec cette énergie, cette naïve grossièreté, dont, sans doute, furent empreintes, (p. 53) à leur origine, les doctrines religieuses qui avaient cours chez les Assyriens et les Phéniciens. Ces doctrines, à travers une longue série de siècles et de révolutions religieuses ou civiles, ont laissé sur le sol de l'Asie occidentale des traces si profondes, qu'en étudiant les coutumes et les mœurs des populations actuelles, on acquiert la triste conviction que, malgré les efforts successifs du christianisme et de l'islamisme, l'adoration du ctéis n'a pas cessé d'être en usage chez certaines sectes religieuses de l'orient, et notamment dans une localité célèbre autrefois par le culte dont Vénus y était honorée. De nos jours, en effet, les Druzes du Liban, dans leurs vêpres secrètes, rendent un véritable culte aux parties sexuelles de la femme, et le leur rendent chaque vendredi soir, c'est-à-dire le jour qui fut consacré à Vénus, le jour auquel, de leur côté, les musulmans trouvent dans le code de Mahomet la double obligation d'aller à la mosquée et d'accomplir le devoir conjugal... Nous lisons même, au sujet de ces vêpres. que chaque (p. 54) initié,. est obligé de faire une confession générale, et que le plus grand de tous les péchés est la fornication avec les sœurs ou les initiées. Mais chez les Nozaïriens, qui ont aussi conservé la cérémonie de l'adoration du ctéis, la cohabitation charnelle est considérée comme le seul moyen par lequel puisse s'accomplir parfaitement l'union spirituelle ». – ATHEN. ; XIV, 56, p. 647. –
et l'étoile de Vénus ou le soleil. Ici le ctéis semble devenir l'emblème de la déesse elle-même... Sur les uns comme sur les autres de ces divers monuments, un pareil attribut me semble caractériser le culte de la Vénus orientale avec cette énergie, cette naïve grossièreté, dont, sans doute, furent empreintes, (p. 53) à leur origine, les doctrines religieuses qui avaient cours chez les Assyriens et les Phéniciens. Ces doctrines, à travers une longue série de siècles et de révolutions religieuses ou civiles, ont laissé sur le sol de l'Asie occidentale des traces si profondes, qu'en étudiant les coutumes et les mœurs des populations actuelles, on acquiert la triste conviction que, malgré les efforts successifs du christianisme et de l'islamisme, l'adoration du ctéis n'a pas cessé d'être en usage chez certaines sectes religieuses de l'orient, et notamment dans une localité célèbre autrefois par le culte dont Vénus y était honorée. De nos jours, en effet, les Druzes du Liban, dans leurs vêpres secrètes, rendent un véritable culte aux parties sexuelles de la femme, et le leur rendent chaque vendredi soir, c'est-à-dire le jour qui fut consacré à Vénus, le jour auquel, de leur côté, les musulmans trouvent dans le code de Mahomet la double obligation d'aller à la mosquée et d'accomplir le devoir conjugal... Nous lisons même, au sujet de ces vêpres. que chaque (p. 54) initié,. est obligé de faire une confession générale, et que le plus grand de tous les péchés est la fornication avec les sœurs ou les initiées. Mais chez les Nozaïriens, qui ont aussi conservé la cérémonie de l'adoration du ctéis, la cohabitation charnelle est considérée comme le seul moyen par lequel puisse s'accomplir parfaitement l'union spirituelle ». – ATHEN. ; XIV, 56, p. 647. – ![]() . HERACLIDES SYRACUSIUS, in libro De Ritibus, ait : Syracusis praecipuo Thesmophoriorum die confici ex sesamo et melle pudenda muliebria, quae tota Sicilia mylli adpellentur ; eaque in honorem Dearum circumferri (trad. SCHWEIGHAEUSER). – Cfr. MART.; IX, 3, V. 3 ; XIV, 69.
. HERACLIDES SYRACUSIUS, in libro De Ritibus, ait : Syracusis praecipuo Thesmophoriorum die confici ex sesamo et melle pudenda muliebria, quae tota Sicilia mylli adpellentur ; eaque in honorem Dearum circumferri (trad. SCHWEIGHAEUSER). – Cfr. MART.; IX, 3, V. 3 ; XIV, 69.
[FN: § 1343-2]
Voir, par exemple, Doct. CABANÈS ; mœurs intimes du passé, 3e série. La faune monstrueuse des cathédrales : « (p. 20) Les représentations dites indécentes ont... subsisté très tard même sur nos monuments religieux, et en maints endroits on en a signalé, plus ou moins mutilées, mais suffisamment visibles, pour qu'on ne puisse mettre en doute leur existence antérieure. La preuve qu'elles existent encore en nombre respectable, c'est qu'en 1901, le pape envoyait à son clergé des instructions, pour que celui-ci procédât à une sévère inspection des églises, à seule fin de „ détruire ou de corriger toutes les peintures dévêtues ou trop peu vêtues, “. Les peintures, le Souverain Pontife aurait pu ajouter les sculptures ; mais il est juste de bien préciser... que les édifices du culte ne sont pas les seuls qui reflètent dans leurs figurations obscènes les mœurs du temps. Sans parler des priapes ailés des arènes de Nîmes, du monolithe de grès, à forme phallique, de la place publique de Préciamont (Oise), on a relevé un peu (p. 23) partout, des naturalia d'un art doublement inférieur. (p. 110) Le pinceau des enlumineurs ne fut ni plus chaste, ni plus réservé que l'ébauchoir des sculpteurs. (p. 111) Il existe une Bible, dont les peintures, assez habilement exécutées, furent longtemps attribuées au célèbre Jean de Bruges, et où est représenté, sans le moindre fard, l'épisode biblique de Loth et ses filles ». Et passim. – Cfr. § 1380. Ce ne sont pas des faits rares et bizarres, mais au contraire nombreux et habituels. Le Dr WITKOWSKI a pu en faire l'objet de trois gros volumes: L’art profane à l'Église... France; L’art profane à l'Église... Étranger ; L’art Chrétien, ses licences.
[FN: § 1344-1]
Voulant rétablir la discipline dans son camp, en Espagne, P. C. Scipion en chassa les trafiquants et les prostituées, au nombre de deux mille. – VAL. MAX.; II 7, 1 : ... nam constat, tum maximum inde institorum et lixarum numerum cum duobus millibus scortorium abisse. – Un fait semblable eut lieu, quand les Dix mille de Xénophon voulurent se défaire des bouches inutiles. XENOPH ; Cyr. exp., IV, 1, 14.
[FN: § 1344-2]
SUET. ; Iulius. (65) Militem neque a moribus, neque a fortuna probabat, sed tantuM a viribus ; tractabatque pari severitate atque indulgentia. « Il n'estimait les soldats ni d'après leurs mœurs ni d'après les hasards de la guerre, mais seulement d'après leur énergie, et il les traitait avec une sévérité et une indulgence égales ». (67) ... sed desertorum ac seditiosorum et inquisitor et punitor acerrimus, connivebat in ceteris. Ac nonnumquam post magnam pugnam atque victoriam, remisso officiorum. munere, licentiam omnem passim lasciviendi permittebat ; iactare solitus, milites suos etiam unguentatos bene pugnare posse. « ... mais il recherchait et punissait très durement les déserteurs et les séditieux ; il fermait les yeux sur le reste. Parfois, après un grand combat et une grande victoire, ayant déchargé les soldats de leurs travaux, il leur permettait toute licence, car il avait coutume de dire que, même parfumés, ses soldats étaient capables de bien se battre. » – Cfr. Dio. CASS.; XLII, 55.
[FN: § 1344-3]
HORAT.; Epod., VIII, 18 : Minusve languet fascinum ? Ubi Porphyrio : aeque pro virili parte posuit, quoniam prae fascinandis rebus haec membri defor mitas adponi solet. – PLIN.; Nat. hist., XXVIII, 7: (4) ... extranei interventu, aut si dormiens spectetur infans, a nutrice terna. adapui : quamquam illos religions tutatur et Fascinus, imperatorum quoque, non solum infantium custos, qui deus inter sacra romana a vestalibus colitur, et currus triumphantium, sub his pendens, defendit medicus invidiae... « Un étranger survenait-il ou regardait-on dormir un enfant, la nourrice crachait trois fois, bien qu'il soit déjà protégé par le dieu Fascinus, protecteur non seulement des enfants, mais aussi des généraux. Ce dieu est vénéré par les Vestales, parmi les dieux romains, et suspendu au char des triomphateurs, il les défend comme un médecin de l'envie... ». VARR.; De ling. lat., VII, 97 : « Il se pourrait encore qu'on les appelle ainsi [les choses obscènes], à cause des figurines indécentes qu'on suspend au cou des petits enfants, pour les garder du mauvais œil... ». – Dict. DAREMB. SAGL.; s. r. Fascinum, Fascinus : « (p. 986) On le sculptait [le Phallus] en bas-relief sur les murs des villes et sur toute espèce d'édifices publics et privés ; un exemplaire trouvé à Pompéi est accompagné de l'inscription : hie habitat Félicitas, affirmation de bon augure destinée surtout à empêcher le malheur d'entrer. Enfin le phallus était un des éléments les plus ordinaires des amulettes que l'on portait sur sa personne; les objets de cette (p. 987) catégorie où on l'a représenté sont innombrables, il n'est point de collection d'antiques qui n'en possède. Quelquefois, pour augmenter l'efficacité de l'amulette, on y a réuni l'image de plusieurs phallus en les groupant de façon à en former une espèce de corps monstrueux ; ou bien on a ajouté au phallus des ailes et des pattes ; de là des compositions grotesques, où la fantaisie licencieuse des anciens s'est donné libre carrière. (p. 985 Lorsqu'on se trouvait en danger immédiat [du mauvais œil], on pouvait se défendre en faisant promptement le geste qui est aujourd'hui connu en Italie et dans d'autres contrées sous le nom de la figue. Ce geste simulait l'union des organes génitaux des deux sexes, qui, représenté chacun à part, passaient pour de puissants prophylactiques ». – PLIN. ; Nat. hist., XI, 109 (49), dit des parties génitales : Nec non aliqua gentium quoque in hoc discrimina, et sacrorum etiam. D. AUG. De civ. dei, VII, 21 : ... Cui membro inhonesto matremfamilias honestissimam palam coronam necesse erat imponere. Et il dit de ce culte : ista sacrilegia sacra nominaret. – THEODORETI graecarum, affectionum curatio, p. 783-784. Migne, t. IV, p. 890: et parvum illud animal, Priapum dico, cum ingenti et exporrecto membro honoratum, phallumque Liberi patris in Phallagogiae festo ab iis qui orgia célébrant adoratum. Nec minus et muliebrem pectinem (sic enim mulieris pudenda vocant), in Thesmophoriis ab initiatis mulierculis divino honore affectum.
[FN: § 1345-1]
La Liberté, 9 janvier 1913 : « Depuis l'été de 1905 jusqu'au mois de février 1912 dernier, où l'on procéda à des arrestations en masse, les dynamiteurs trade-unionistes cherchèrent en effet, par une tactique pulvérisante, à décourager les patrons hostiles aux syndicats. De l'État de New-York à la Californie, leurs opérations jetèrent l'alarme dans les chantiers. L'hôtel du Los Angeles Times ayant sauté le 1er octobre 1910, en causant la mort de vingt-deux linotypistes non syndiqués, il fallut se décider enfin à une action énergique. C'est alors que l'on découvrit que l'International Association of Bridge and Structural Ironworkers ordonnait cette destruction systématique des ateliers, des usines, des manufactures où l'on méconnaissait les décisions du syndicalisme. Il est amplement démontré – par les quarante mille pièces qui figurent au procès aussi bien que par les dépositions des témoins – que l'International Association of Bridge and Structural Ironworkers avait organisé une agence de chambardement qui fonctionnait avec une rare discipline. Un budget secret de cinq mille francs par mois servait à l’achat de la dynamite. Dans tous les grands centres industriels existait un service de renseignements qui fournissait au comité directeur les indications nécessaires pour une prompte et directe action. Quand une société refusait d'augmenter les salaires ou bien acceptait la main-d'œuvre des jaunes, quand un patron prétendait garantir l'indépendance de ses employés, ou quand il fallait ruiner une entreprise dont la concurrence eût été susceptible de déprécier le travail des syndiqués, les dynamiteurs entraient en scène. Un de leurs délégués était envoyé sur les lieux et une bombe éclatait. L'un de ces audacieux terroristes, Ortie Mac Manigal, a raconté ses expéditions aux juges avec force détails. Il participa à plus de cinquante complots (dont la plupart réussirent) depuis cinq ans qu'il commença la propagande par le fait. Mais laissons-lui la parole : „ En 1907 – a-t-il dit – Herbert S. Hockin, secrétaire-trésorier de l'Association des Constructeurs de ponts, vint me trouver à Détroit : Vous êtes habitué à travailler dans les carrières, me dit-il, par conséquent vous savez vous servir des explosifs. Désormais, vous serez payé par le syndicat qui a besoin de vous. J'essayai de protester, mais il me fit comprendre que si je refusais, le Comité exécutif me boycotterait et que je serais pris par la famine. Finalement j'obéis “. Dès lors, commença pour Mac Manigal une vie fort mouvementée. Dans l'Ohio, l'Illinois, le Massachusetts, le New-York, il se mit à la besogne. Les dépenses lui étaient largement payées par les chefs syndicalistes. Cependant, à plusieurs reprises ses bombes n'ayant point éclaté ou la mèche ayant été découverte avant l'explosion, il ne toucha que ses frais de route. Il ne correspondait avec les leaders que par des dépêches en apparence insignifiantes, et quand le coup avait réussi, il envoyait en haut lieu le compte-rendu qu'en donnaient les journaux... Ortie Mac Manigal conte ces anecdotes avec beaucoup de flegme. Sa confession – un véritable roman-feuilleton – ne comprend pas moins de sept cents pages. En voici encore un échantillon : „ En juin 1908, j'étais occupé à Evanston, dans l'Illinois, lorsque Hockin me rejoignit. Il m'annonça qu'il était en possession d'une nouvelle invention qui ferait merveille. C'était une espèce de bombe à horloge, chargée de nitro-glycérine, qui éclatait à volonté, une heure, cinq heures, dix heures même après qu'on l'avait allumée. Elle était d'un fonctionnement simple et, grâce à ce système, on avait le temps de s'éloigner suffisamment pour prouver un alibi. Il m'engageait à l'utiliser tout de suite. Je refusai. Mais nous l'avons essayée à Stenbenville, à Cincinnati, à Indianapolis, insista-t-il ; ça marche à ravir ! “ ». Innombrables sont les faits qui démontrent la corruption de la police – pour ne parler que de cette autorité – et qui nous transportent bien loin de la morale idéale. L'un des faits les plus récents est ainsi raconté par le Journal de Genève, 1er mars 1913 : « M. Gaynor, maire de New-York, déposant devant la commission d'enquête sur les actes de corruption de la police, a déclaré : „Quand je suis arrivé aux affaires, les chefs de police se retiraient millionnaires. Quelques-uns ont des maisons en ville, des maisons de campagne, des yachts et des automobiles. La police percevait par an quinze millions de francs de pots-de-vin, extorqués aux maisons mal famées. Il n'en est plus de même aujourd'hui, sauf peut-être pour un ou deux cas isolés. Mais De croyez pas que la presse ait en rien à faire avec les pots-de-vin. Voilà vingt-cinq ans qu'elle y est jusqu'au cou “. À Albany, devant la Commission parlementaire d'enquête, un homme d'affaires a déclaré avoir reçu une provision de cent vingt-cinq mille francs pour le cas où il ferait sortir le millionnaire Harry Taw de l'asile d'aliénés où il est détenu depuis l'assassinat de M. Stanford White. Il a ajouté que le directeur de l'asile a refusé de faciliter quoi que ce fût dans ce sens, si on ne lui donnait pas un pot-de-vin ».
[FN: § 1345-2]
La dérivation par laquelle on veut revêtir d'utilités pratiques des prescriptions religieuses, est habituelle. C'est ainsi qu'on a voulu prendre pour une prescription hygiénique l'interdiction de la viande de porc aux Israëlites. De même, on veut nous faire croire que la propagande malthusienne est condamnée uniquement comme antipatriotique, parce qu'elle diminue le nombre des défenseurs de la patrie. Si c'était vrai, ces quatre cent soixante-onze députés qui ont condamné la propagande malthusienne auraient dû a fortiori condamner la propagande en vue d'enlever à l'armée le moyen de résister à l'ennemi. Il est quelque peu comique de vouloir faire naître des défenseurs de la patrie pour les faire tuer par leurs soldats, s'ils deviennent officiers. Les femmes allemandes qui, plagiant Lysistrata, prêchent « la grève des mères », pour enlever de futurs ouvriers aux « bourgeois » et des soldats à l'empire, sont beaucoup plus logiques. Il est certain que les causes de semblables votations aux Chambres sont complexes, et qu'il ne faut pas y chercher la logique. C'est pourquoi, si ce fait était isolé, il ne prouverait rien ; mais il acquiert de la valeur, parce qu'il fait partie d'une classe très nombreuse.
[FN: § 1352-1]
DUBOIS ; Mœurs... des peuples de l'Inde, t. I.
[FN: § 1352-2]
Les Cathares se donnaient le baiser de paix ; mais leurs Parfaits ne devaient pas toucher les femmes ; aussi le leur transmettaient-ils par le moyen de l'Évangile. – I. GUIRAUD ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I : « (p. CXCIX) Les Parfaits baisaient sur les deux joues chacun des Croyants... C’était de la plus grande simplicité quand la cérémonie ne se passait qu'entre hommes ; mais elle se compliquait lorsqu'il y avait des femmes dans l'assistance. En aucun cas, un Parfait ne pouvait toucher ni même effleurer du doigt une femme ; à plus forte raison lui était-il absolument interdit de l'embrasser. On était si rigoureux sur ce point que, dans le rite de l'imposition des mains pendant lequel le parfait devait poser les mains sur la tête du néophyte, il était bien recommandé que s'il s'agissait d'une femme, les mains devaient être tenues au-dessus de sa tête, sans la toucher, tenendo manum super caput infirmi, non tamen tangendo si sit mulier. On dut tourner la même difficulté dans le rite du baiser, et pour cela on employa ce que la liturgie catholique appelle un instrument de paix. Sur un objet particulièrement vénérable on dépose le baiser que vient y chercher, en le baisant à son tour la personne que, pour n'importe quelle raison, on ne peut directement embrasser... le Parfait qui présidait la cérémonie, baisait le livre des Évangiles et le donnait aussitôt à baiser aux femmes... puis celles-ci s'embrassaient les unes les autres ». Nos vertuistes contemporains, quelque peu niais, diffèrent des Cathares dans leurs dogmes, mais non dans le résidu sexuel.
[FN: § 1353-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] On ne s'attendrait guère à voir la pudeur proscrire des mots français courants d'un « dictionnaire encyclopédique ». Le Petit Larousse illustré, présenté en première page comme étant « à la fois le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires manuels », peut affronter les censures vertuistes les plus rigoureuses. Pourtant il accepte avec une étonnante facilité beaucoup de néologismes empruntés à l'argot le plus vulgaire.
[FN: § 1355-1]
Ad. Corinth., I, 5, 12 et sv.. Pour les vertuistes chrétiens, on peut avoir des doutes, en séparant le résidu sexuel du résidu simplement religieux ; mais ce dernier fait défaut chez les vertuistes libres penseurs. L'excellent Saint Ambroise dit : Castitas enim angelos fecit. Qui eam servavit angelus est, qui perdidit diabolus (t. V, De virginibus, I, p. 536 c). Cet argument manque aux libres penseurs qui n'ont – ou disent n'avoir – ni anges ni diables.
[FN: § 1355-2]
La plaisanterie d'une légende est, comme il arrive souvent, une description pittoresque du fait. Sorberiana : « (p. 175) Un certain moine ayant quité le froc, demandoit quelque assistance au feu Prince Maurice [on raconte la même histoire avec d'autres noms ; elle est d'ailleurs probablement inventée], qui lui dit Cuius causa hue venisti ? Le Moine répondit Religionis. Le Prince ajouta Religio cuius generis ? À quoi le Moine répartit Foeminini.– Ergo, conclut le Prince d'Orange, tu huC venisti propter genere foemininum ». – Un ami du Père Hyacinthe raconte, dans le Journal de Genève, 17 septembre 1913, un entretien entre ce Père et le prince Balthasar Odescalchi. Celui-ci dit : « Mais, mon Père, puisque vous continuez à vous dire prêtre catholique, pourquoi ne reviendriez-vous pas au catholicisme romain ? – Mais, prince, repartit M. Loyson (je tiens tous ces détails à la fois de M. Loyson lui-même et du prince Odescalchi), vous oubliez qu'il y a à cela certaines difficultés. – Lesquelles ? – D'abord la question de l'infaillibilité. – Oh ! l'infaillibilité, répondit le prince Odescalchi, il y a manière de s'entendre et de l'interpréter, ce ne serait pas là un obstacle insurmontable. – Mais il y a aussi mon mariage, répliqua M. Loyson. – Votre mariage, oui sans doute, répondit le prince, présente quelques difficultés, mais elles ne sont pas non plus insolubles, vous savez aussi bien que moi que les prêtres catholiques de rite oriental sont mariés. On pourrait vous faire passer dans un rite oriental ». Léon XIII délégua le Père capucin Vives pour traiter cette affaire, mais l'on ne parvint à aucune conclusion. « M. Loyson a affirmé à mainte reprise que ce fut surtout l'impossibilité de sa part d'admettre le dogme de l'infaillibilité qui fit échouer les négociations, mais la question de son mariage constituait une difficulté plus sérieuse que ne se l'imaginait le prince Odescalchi ».
[FN: § 1356-1]
BAYLE ; Dict. hist., t. II, s. r. Junon . « (p. 894) J'oserois dire que les excès où les Chrétiens se sont portez envers la Vierge Marie, excès qui surpassent tout ce que les Paiens ont pu inventer en l'honneur de Junon [parce qu'ils avaient dans leur religion, plus que les chrétiens, d'autres manières différentes de manifester les résidus sexuels] sont sortis de la même source, je veux dire de l'habitude que l'on a d'honorer les femmes, et de leur faire la cour avec beaucoup plus d'attachement et de respect qu'à l'autre sexe [c'est-à-dire en réalité aux résidus sexuels]. On ne sauroit se passer de femmes, ni dans la vie civile, ni dans la vie religieuse. Qui auroit ôté à la Communion de Rome ses dévotions pour les Saintes, et sur tout pour celle qu'on y qualifie la Reine du Ciel, la Reine des Anges, on y verroit des vides affreux ; le reste s'en iroit en pièces, et seroit arena sine calce, scopae dissolutae ».
[FN: § 1357-1]
ATHEN., XIII, p. 557 : « Quelqu'un disant à Sophocle qu'Euripide était misogyne : Dans les tragédies certes, dit Sophocle, mais au lit, il est philogyne ».
[FN: § 1359-1]
FRA BARTOLOMMEO DI SAN CONCORDIO ; Ammaestramenti degli Antichi, dist. XXV, c. 10 : « S'entretenir avec des femmes, c'est s'exposer à des dangers de luxure. – Ecclés., 42. Ne demeure pas au milieu des femmes, car de même que la teigne provient des vêtements, l'iniquité de l'homme provient de la femme. Hierony mus ad Oceanum. Je t'avertis surtout d'y regarder attentivement : les clercs ont la tentation d'aller souvent avec des femmes... – Hieronymus, ibidem. Conversation de femme : porte du démon, voie d'iniquité, piqûre de scorpion. – Hieronymus, ibidem. La femme attaque d'un feu brûlant la conscience de celui qui habite avec elle. – Hieronymus, ibidem. Or, crois-moi, celui qui s'entretient avec une femme ne peut marcher avec Dieu de tout son cœur... es-tu chaste ? Tu dis un grand mensonge si tu cherches la chasteté, pourquoi avec des femmes ? La femme que tu vois si bien parler, rend malade par l'esprit et non par des rapports charnels. Gregorius 3, dialog. Que ceux qui veulent que leur corps soit continent n'aient pas la présomption d'habiter avec des femmes. – Gregorius, in registro. On lit que le bienheureux Augustin ne consentit pas à demeurer même avec sa sœur, et disait : celles qui sont avec ma sœur ne sont pas mes sœurs. Donc la prudence d'un homme si docte doit nous être un grand enseignement. – Sanct. Isidorus in synonym., lib., 2. Si tu veux être à l'abri de la fornication, tiens ton corps et tes regards éloignés de la femme ; car, près du serpent, tu ne vivras pas longtemps séparé de lui ; en te tenant au devant du feu, étant près du danger, tu ne seras pas longtemps en sûreté ; bien que tu sois de fer, tu fondras à la chaleur. – IOAN. PLANTAVITII.. florilegium rabbinicum : « (p. 458) Sapiens alius conspicatus mulierem parvam, sed formosam, dixit, Parva quidem, pulchritudo, malum autem magnum ; et le commentaire ajoute : Malum magnum, imo quovis malo peius si fuerit improba, ut praeclare notavit Chrysost. apud Anton. in Melissa, p. 2, cap. 84, et nos alibi monuimus : « O malum – inquit – quovis malo peius mulierem improbam! Asperi sunt dracones, aspides maleficae; sed mulieris asperitas acerbior, quam ferarum. Improba mulier nunquam mansuefiet : si durius tractetur, furit; si blandius, tollitur et elata est. Ferrum coquere, quam mulierem castigare facilius. Qui habet uxorem malam, suorum se peccatorum mercedem accepisse intelligat. Nulla in Mundo bellua est, quae cum muliere improba conferatur. Quid leone inter quadrupedes ferocius ? Nihil quam mulier improba. Quid crudelius dracone inter serpentia ? Nihil quam mulier improba ». Cfr. ATH. ; XIII, p. 558-559. – Ce sont là les déclamations habituelles de ceux qui médisent des femmes, parce qu'ils les aiment trop.
[FN: § 1362-1]
L'erreur provenait du fait que, dans leur lutte contre la religion chrétienne, les libres-penseurs faisaient alors appel aux sentiments sexuels, toujours vifs. Lorsqu'ils eurent remporté la victoire, ils firent plus et pis que leurs adversaires de jadis. Même un auteur d'une très grande valeur, comme Buckle, n'est pas exempt de cette erreur. BUCKLE ; Hist. de la civ. en Angl., t. V. Après avoir observé, très judicieusement que : « (p. 117) Le bonheur qui provient de la satisfaction des sens, s'étendant sur un plus large espace et contentant, à un moment donné, un nombre d'êtres plus grand que ne pourrait le faire l'autre forme de bonheur, possède, à ce compte, une importance que force gens qui s'intitulent philosophes ne veulent pas reconnaître. Trop souvent, par leurs absurdes déclamations contre ces plaisirs, les penseurs philosophes et spéculatifs ont fait tout en leur pouvoir pour amoindrir la somme de bonheur dont l'humanité est susceptible », il observe que « (p. 118) les notions ascétiques des philosophes, telles, par exemple, que la doctrine des stoïciens et autres théories semblables de mortification n'ont pas entraîné le mal auquel on eût pu s'attendre et ne sont pas parvenues à amoindrir, d'une manière sensible tout au moins, le bonheur substantiel du genre humain... Cependant, si les philosophes ont échoué à diminuer les plaisirs du genre humain, il y a une autre classe d'hommes dont les tentatives au même effet ont eu plus de succès. J'entends naturellement les théologiens qui, à les prendre en corps, en tous pays et en tous siècles, se sont opposés de propos délibéré aux jouissances qui sont essentielles au bonheur d'une immense majorité de la race humaine. Créant un dieu à leur fantaisie [cela exclut les libres-penseurs], qu'ils représentent comme entiché de pénitence [cela exclut au moins en partie les païens], de sacrifice et de mortification, ils interdisent (p. 119) sous ce prétexte des jouissances non seulement innocentes mais encore dignes de louange. Car toute jouissance qui ne fait de tort à personne est innocente, et partant louable... Les théologiens, toutefois, pour des raisons que j'ai déjà établies, cultivent l'esprit contraire ; et chaque fois qu'ils ont joui du pouvoir, ils n'ont jamais manqué de prohiber une foule d'actions agréables, parce que, disent-ils, elles offensent la divinité ». Ce n'est pas la cause logique de leurs actions, qui sont non-logiques, mais bien la dérivation par laquelle ils veulent les justifier. Cela est démontré par le fait que les libre-penseurs, qui n'ont pas de divinité qu'ils puissent considérer comme offensée, agissent pourtant de la même façon, et emploient des dérivations différentes, en parlant d' « offenses à la pudeur, à la morale » ou à quelque autre de leurs fétiches. Les observations de Buckle s'écartent donc de la réalité, si, par « théologiens » on entend ceux de la religion chrétienne ou d'une autre semblable ; elles s'accordent entièrement avec la réalité, si par « théologiens » on entend les fanatiques de toutes sortes, qui trouvent plaisir à ennuyer leur prochain.
[FN: § 1365-1]
Enf. XXX, v. 64 et sv. :
Li ruscelletti, che dei verdi colli
Del Casentin discendon giuso in Arno,
Facendo i lor canali freddi e molli,
Sempre mi stanno innanzi, e non indarno ;
Chè l'imagine lor vie più m'ascinga
Che il male ond'io nel volto mi discarno.
[FN: § 1366-1]
I Corinth. : 7 (1)
« Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. (2) Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari ». Ce passage a donné beaucoup à faire aux chrétiens. Les uns voulurent l'entendre dans ce sens, manifestement faux, qu'il s'appliquait aux prêtres seuls ; d'autres l'atténuèrent en expliquant que si la virginité avait la première place, l'état conjugal obtenait la seconde ; d'autres encore l'expliquèrent en observant que la loi ancienne imposait de croître et de multiplier, quand la terre n'était pas encore peuplée, mais que depuis qu'elle avait été peuplée, cela n'était plus nécessaire. Au fond, le passage est très clair : c'est l'élan d'un vertuiste qui a la phobie de l'acte charnel, et qui permet le mariage comme un moindre mal. À propos de ce passage, Saint Jérôme remarque (Comm. in epist. I ad Cor., t. VIII, p. 199) : « Bonum fuerat illud quod vobis in primordio praedicavi, hoc est sectindum coniugii usum, non tangere mulierem. Sed quoniam multos incontinentes huic doctrinae scripsistis refragari concedatur remedium, ne fornicando moriantur. Ergo hoc Apostoli exemplo, in primis virginitas et continentia praedicatur. Et si quis se incontinentem non erubuerit confiteri, in languorem incontinentiae reclamanti, non denegetur remedium nuptiarum. Quomodo si peritus medicus inquieto aegro, et neganti se posse a pomis omnibus abstinere, concedat aliquantum, ne ille peniosa praesumat... Sed obiicere amatores luxuriae solent. Ut quid ergo prima Dei benedictio, crescere et multiplicare concessit ? Ut terra scilicet repleretur : quia iam impleta debemus ab incontinentia temperare. – D. ANSELM., t. II, Comm in Epist. I ad Cor. L'auteur assimile la femme au feu qui brûle à peine on l'a touché : ... (p. 139) animadvertenda est Apostoli prudentia; non dixit, Bonum est uxorem non habere : sed, Bonum est mulierem non tangere : quasi in tactu periculum sit, quasi qui illam tetigerit, non evadat. Quemadmodum enim qui ignem tetigerit statim aduritur, ita viri tactus et foeminae sentit naturam suam et diversitatem sexus intelligit. Bonum est non tangere. Sed propter fornicationem vitandam unusquisque suam uxorem legitimam habeat, non concubinam, et unaquaeque virum suum habeat. Solus fornicationis metus facit haec concedi. – Canones et decreta CONCILII TRIDENTINI ; sessio XXIV, can. X : Si quis dixerit, statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel caelibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut caelibatu, quam iungi matrimonio : anathema sit.
[FN: § 1367-1]
D. CYPRIANI De disciplina et habitu virginum... Nunc nobis ad virgines sermo est, quarum quo sublimior gloria est, maior et cura est. Flos est ille Ecclesiastici germinis, decus atque ornamentum gratiae spiritalis, laeta indoles, laudis et honoris opus integrum atque incorruptum, Dei imago respondens ad sanctimoniam Domini, illustrior portio gregis Christi. Gaudet per illas atque in illis largiter floret Ecclesiae matris gloriosa fecunditas : quantoque plus copiosa virginitas numero suo addit, tanto plus gaudium matris augescit. – SAINT AUGUSTIN, De docirina christiania, IV, c. 21, 47, cite ce passage de Saint Cyprien comme exemple de style. On trouve, chez les Pères de l'Église, beaucoup d'autres expressions très vives du même genre ; à les lire, une épigramme de l'Anthologie grecque vient à l'esprit ; et l'idée surgit que ces sentiments seraient moins vifs chez des écrivains qui auraient goûté les plaisirs de l'amour. – Ant. V, 77 : 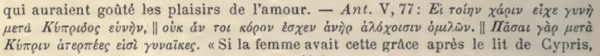 . Si la femme avait cette grâce après le lit de Cypris, l'homme ne serait certainement pas rassasié de rapports avec sa femme : car toutes les femmes déplaisent après Cypris ». Cfr. Ach. Tatius, IV, 8.
. Si la femme avait cette grâce après le lit de Cypris, l'homme ne serait certainement pas rassasié de rapports avec sa femme : car toutes les femmes déplaisent après Cypris ». Cfr. Ach. Tatius, IV, 8.
[FN: § 1368-1]
D. AUG. ; Soliloq., I 17. La Raison s'entretient avec le saint : R. Quid uxor? Nonne te delectat interdum pulchra, pudica, morigera, litterata.... ? – A. Q uantumlibet velis eam pingere atque cumulare bonis omnibus, nihil mihi tam fugiendum quam concubitum esse decrevi : nihil esse sentio quod magis ex arce deiiciat animum virilem, quam blandimenta feminea, corporumque ille contactus, sine quo uxor haberi non potest. – D. AUG. : Contra Iulianum, 1. III, c, 21, 42 : Concupiscientiae carnalis qui modum tenet, malo bene utitur ; qui modum non tenet, malo male utitur; qui autem etiam ipsum modum sanctae virginitatis amore contemserit, malo melius non utitur...
[FN: § 1369-1]
D. HIERONYM. ; Pro libris adversus Iovinianum. Apologia ad Pammachium, II. p. 390, g : Sed eo loco, ubi de Apocalipsi testimonium posuimus, nonne manifestum est, quid de virginibus, et viduis, et coniugibus senserimus : Hi sunt qui cantant canticum novum : quod nemo potest cantare, nisi qui virgo est... Hi sunt primitiae Dei, et agni, et sine macula. Si virgines primitiae Dei sunt : ergo viduae, et in matrimonio continentes, erunt post primitias, hoc est, in secundo et tertio gradu. In secundo et tertio gradu viduas ponimus et maritatas : et haeretico furore dicimus damnare nuptias. – Plus loin, il fait appel à l'indulgence du lecteur et invoque les circonstances atténuantes. (p. 391, b) ... debuerat prudens et benignus lector, etiam ea, quae videntur dura, aestimare de caeteris, et non, in uno atque eodem libro, criminari, me diversas sententias protulisse. Quis enim tain hebes, et sic in scribendo rudis est, ut idem laudet et damnet ? Le saint oublie précisément ce que fait celui qui a une idée et ne peut la manifester entièrement parce qu'il est contraint à certains égards.
[FN: § 1370-1]
D. HIERONYM. ; Ad Eustochium de custodia virginitatis. ep. XXII, t. I, p. 140, c : ... ner enumeraturum molestias nuptiarum, quomodo uterus intumescat, infans vagiat, cruciet pellex, domus cura solicitet, et omnia quae putantur bona, mors extrema praecidat. Adversus Helvidium, de perpetua virginitate B. Mariae, t. II, p. 816. – Il fait voir comment les femmes mariées sont distraites des préoccupations religieuses par les devoirs de famille. – (e) Idem tu putas esse diebus et noctibus vacare orationi, vacare ieiuniis, et ad adventum mariti expolire faciem, gressum frangere, simulare blanditias ? ... Inde infantes garriunt, familia perstrepit : liberi ab osculis et ab ore dependent : (f) computantur sumptus : impendia praeparantur, hinc cocorum accinta manus carnes terit : hinc textricum turba commurmurat: nunciatur interim vir venire cum sociis. Illa ad hirundinis modum lustrat universa penetralia, si torus rigeat, si pavimenta verrerint, si ornata sint pocula, si prandium praeparatum. Responde, quaeso, inter ista ubi sit Dei cogitatio : Et hae felices domus. Remarquez le contraste entre cette civilisation et celle de la Rome antique. Tout ce que le saint méprise était à l'honneur et à la louange de la matrone des beaux temps de Rome.
[FN: § 1370-2]
D. HIERONYM.; Ad Laetam de institutione filiae, Epist. VII, t. I, p. 51 f-g: « Sur l'ordre de son mari, Imettius, qui fut le grand-père de la vierge Eustochia, Praetestata, femme très noble, changeait le costume et les ornements, et tressait selon l'usage mondain la chevelure négligée [de la jeune fille], désireuse de déjouer les desseins de la vierge et le désir de la mère. Et voici que, la même nuit, elle voit venir à elle un ange, dont la voix terrible la menaçait de châtiments et l'atterrait par ces paroles : „ As-tu l'audace de préférer l'autorité de ton mari à celle du Christ ? et de toucher la tête de la vierge de Dieu avec tes mains sacrilèges ? Celles-ci sécheront bientôt, afin qu'elles subissent la peine de ce qu'elles ont fait. Dans cinq mois, tu iras en Enfer. Si tu persévères dans ta faute, tu perdras à la fois ton mari et tes fils “. Tout cela eut lieu ponctuellement, et la mort de la pauvre femme manifesta le trop peu d'empressement de sa pénitence ».
[FN: § 1371-1]
D. HIERON. ; De custodia virginitatis, Ep. XXII, t. I, p. 141, e.
[FN: § 1371-2]
Un exemple pris au hasard suffira, parmi tant d'autres qu'on pourrait citer. D. HIERONYM. ; Vita sancti Hilarionis, t. I, p. 248 d ; Multae sunt tentationes eius, et die noctuque variae daemonum insidiae : quas si omnes narrare velim, modum excédam voluminis. Quoties illi nudae mulieres cubanti, quoties esurienti largissimae appartiere dapes? – Une jeune femme et un peu de bonne nourriture auraient suffi à mettre en fuite tous ces démons. – Un très grand nombre de saints, pour ne pas parler de Saint Antoine, dont l'exemple est trop connu, furent tentés d'une manière analogue ou identique. Il arriva aussi à Saint François de souffrir de ces tentations (§ 1184-2), et ses disciples n'en furent pas exempts. Sur l'une de ces tentations, les protestants, ennemis de Saint François, font une observation pleine de bon sens, bien que recouverte d'une des dérivations habituelles. – L'Alcoran des Cordeliers, t. II, p. 186: Apud Spoletum dum esset frater Aegidius, audiens vocem unius mulieris tantum sensit tentationem (a), quantam nunquam fuerat passus : quam orationibus, verberibus (b) et operibus divinis a se expulit, et sic fuit plenarie liberatus.
Notes de l'éditeur de l'Alcoran :
(a) « Se faut-il esbahir si ces presomptueux caphars bruslent journellement au dedans par des flammes secretes de paillardise, veu qu'ils ont méprisé le sainct mariage, donné de Dieu pour remede à telles tentations ! »
(b) « Ces batures sont de l'invention de Satan, et nulle part approuvees de Dieu ».
[FN: § 1371-3]
D. HIERONYM. ; Hieronymus Asellae, Epist. XCIX, t. II, p. 657, g-h.
[FN: § 1372-1]
D. HIERONYM. ; Ad Eustochium de custodia virginitatis, Epist. XXII, t. I, p. 143, h. Voir plus loin, p. 146, b-g, une longue comparaison entre l'époux céleste et l'époux terrestre, avec des citations du Cantique des Cantiques. (146, b) Semper te cubiculi fui secreta custodiant : Semper tecum sponsus laudat intrinsecus. Oras, loqueris ad sponsum : legis, et ille tibi loquitur : et cum te somnus oppresserit, veniet post parietem, et mittet manum suam per foramen, et tanget ventrem tuum [remarquez toutes ces images matérielles d'actes spirituels] ; Et expergefacta consurges, et dices : Vulnerata caritate ego sum. Et rursus ab eo audies : Hortus conclusus, soror mea sponsa hortus conclusus, fons signatus. (Cant. 4)... (d) Zelotypus est Iesus, non vult ab aliis videri faciem tuam.
[FN: § 1374-1]
D. AUG. ; De haeresibus ad Quodvultdeus. Relevons succinctement les accusations du saint : Les Simoniens. Ils enseignaient cette détestable turpitude, qu'il est indifférent d'avoir commerce avec des femmes. – Les Saturniens. Ils imitaient les turpitudes des Simoniens. – Les Nicolaïtes. Leur chef, Nicolas, blâmé de son amour pour sa femme, qui était fort belle, et voulant se laver de cette accusation, permit, dit-on, à n'importe qui d'avoir commerce avec elle. – Les Gnostiques, dits Borborites, à cause de leur grande immoralité. – Les Carpocratiens. Ils enseignaient toutes sortes d'œuvres perverses. – Les Cérinthiens. Ils enseignaient qu'après la résurrection, on devait passer mille ans sous le règne terrestre de Christ, au milieu de la volupté charnelle du ventre et de toutes sortes de luxure. Les Sécondiens. Ils ne diffèrent des Valentiniens que par les turpitudes. – Les Caïaniens. Ils honorent Caïn et les habitants de Sodome. – Les Tatiens. Ils condamnent le mariage et l'assimilent aux fornications et aux autres corruptions, et ne reçoivent parmi eux personne qui se marie, ni homme, ni femme. – Les Cataphryges. Ils tiennent les secondes noces pour des fornications. On dit qu'ils ont des mystères coupables. Les Pépuziens ou Quintiliens. Ils donnent un grand pouvoir aux femmes. – Les Adamiens, ainsi nommés d'Adam, dont ils imitent la nudité dans le Paradis, avant le péché. Aussi condamnent-ils le mariage, parce qu'Adam ne connut charnellement sa femme ni avant de pécher ni avant d'être chassé du Paradis. Ils croient donc qu'il n'y aurait pas eu de mariage si personne n'avait péché. C'est pourquoi hommes et femmes se réunissent nus, écoutent nus les prêches, célèbrent nus les sacrements, et c'est pourquoi ils considèrent leur Église comme le Paradis. – Les Elcéséens ou Sampséens. Ils adoraient deux femmes. – Les Valésiens. Ils se castraient. – Les Cathares. Ils condamnent les secondes noces. – Les Apostoliciens. Ils repoussent ceux qui se marient. – Les Origéniens. Ils s'adonnent à d'infâmes corruptions. – Les Manichéens ou Cathares. Voir § 1374-2 – Les Riéracites. Ils ne reçoivent que des célibataires. – Les Antidicomarites. Ils sont contraires à la virginité de Marie, qui, disent-ils, après avoir enfanté le Christ, eut commerce avec son mari. – Les Priscillianistes. Ils ne mangent pas de viande et séparent le mari et la femme, parce qu'ils disent que la chair fut créée par les mauvais anges et non par Dieu. – Les Paterniens. « Ils estiment que les parties inférieures du corps de l'homme ne furent pas créées par Dieu, mais par le diable ; et, permettant à ces parties toute licence perverse, ils vivent très impurement ». – Les Abéloïtes. Saint Augustin en parle comme les ayant vus. « Ils n'avaient pas commerce avec leurs femmes, et cependant les dogmes de leur secte ne leur permettaient pas de vivre sans leur femme. Homme et femme habitaient ensemble, sous condition de continence ; ils adoptaient un garçon et une fille, qui devaient leur succéder, suivant le pacte de leur union ».
[FN: § 1374-2]
J. GUIRAUD ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I : « (p. CII) Les prescriptions de la morale manichéenne étaient fort austères ; par la loi absolue du célibat et les rigueurs de ses abstinences, elle dépassait les plus sévères des règles monastiques. On s'explique que ceux qui les observaient n'aient par tardé à se faire, au milieu des mœurs faciles du Midi, une réputation de sainteté... (p. CIII) Ne pouvant pas en nier les effets étonnants, les prédicateurs catholiques en étaient réduits à déclarer que ce puritanisme n'était qu'hypocrisie et que sous ces dehors austères se cachaient les vices les plus honteux. Certains écrivains catholiques de nos jours ont repris cette thèse, et, sans prouver le moins du monde leurs affirmations, ils ont déclaré, eux aussi, que la vertu des Cathares était toute d'emprunt et faite pour en imposer aux simples... Point n'est besoin, pour expliquer l'austérité cathare, de recourir à ces suppositions aussi gratuites que faciles. Il suffit de remarquer qu'au lieu de s'imposer aux foules, sans acception de personnes et de conditions, la morale manichéenne n'était pratiquée que par une élite restreinte, bien préparée pour la recevoir et l'appliquer... ». Remarquez que Guiraud est favorable aux catholiques et adversaire des Cathares.
[FN: § 1374-3]
D. AUG. ; loc. cit. (1374-1). 1° Ascétisme des Manichéens (Cathares) : Nam his duabus professionibus, hoc est Electorum et Auditorum, ecclesiam suam, constare voluerunt. In caeteris autem hominibus, etiam in ipsis Auditoribus suis, hanc partem bonae divinaeque substantiae quae mixta et colligata in escis et potibus detinetur, maximeque in eis qui generant filios, artius et inquinatius colligare putant... Nec vescuntur tamen carnibus... Nec ova saltem sumunt... Sed nec alimonia lactis utuntur... Nam et vinum non bibunt, dicentes fel esse principum tenebrarum ; cum vescantur uvis : nec musti aliquid, vel recentissimi, sorbent... Herbas enim atque arbores sic putant vivere, ut vitam quae illis inet, et sentire credant, et dolere, cum laeduntur... Propter quod, agrum etiam spinis purgare, nefas habent... Unde nuptias sine dubitatione condemnant, et quantum in ipsis est, prohibent, quando generare prohibent, propter quod coniugia copulanda sunt. – 2° Corruption des Manichéens (Cathares) : Qua occasione, vel potius execrabilis superstitionis quadam necessitate, coguntur Electi eorum velut eucharistiam conspersam cum semine humano sumere, ut etiam inde, sicut de aliis cibis quos accipiunt, substantia illa divina purgetur. Sed hoc se facere negant, et alios nescio quos sub nomine Manichaeorum facere affirmant. – Mais le saint oppose que deux jeunes filles avouèrent avoir pris part à cette cérémonie obscène, et il ajoute : Et recenti tempore nonnulli eorum reperti, et ad ecclesiam ducti, sicut Gesta episcopalia quae nobis misistis ostendunt, hoc non sacramentum, sed execramentum, sub diligenti interrogatione confessi sunt.
[FN: § 1375-1]
D. IREN. ; Advers. haereses, 1. I, 12 : Quidam autem et carnis voluptatibus insatiabiliter inservientes, carnalia carnalibus, spiritalia spiritalibus reddi dicunt. Et quidam quidem ex ipsis clam eas mulieres, quae discunt ab eis doctrinam hanc corrumpunt : quemadmodum multae saepe ab iis suasae, post conversae mulieres ad Ecclesiam Dei, cum reliquo errore et hoc confessae sunt. Alii vero et manifeste, ne quidem erubescentes, quascunque adamaverint mulieres, has a viris suis abstrahentes, suas nuptas fecerunt. Alii vero valde modeste initio, quasi cum sororibus fingentes habitare, procedente tempore manifestati sunt, gravida sorore a fratre facta.
[FN: § 1379-1] Pourtant le même TACITE raconte, Germ., 15, que les Germains, quand ils ne sont pas en guerre, passent beaucoup de temps à la chasse, « mais davantage dans l'oisiveté, adonnés au sommeil et aux repas ». Dans les Annales, XII, 27, il raconte comment les Romains surprirent les Gaulois somnolant après avoir employé, le butin en bombances.
[FN: § 1379-2]
SALV. ; De gubernatione Dei et de iusto Dei praesentique iudicio, III : Iubet Deus ut omnis qui Christianus est, etiam oculos castos habeat quotas quisque est qui non se luto fornicationis involvat ? Et quid plura ? Grave et luctuosum est quod dicturus sum. Ipsa Ecclesia, quae in omnibus esse debet placatrix Dei, quid est aliud cum exacerbatrix Dei ? aut praeter paucissimos quosdam, qui mala fugiunt, quid est aliud pene omnis coetus Christianorum, quam sentina vitiorum ? Quotum enim quemque invenies in Ecelesia non aut ebriosum, aut helluonem, aut adulterum, sui fornicatorem, aut raptorem, aut ganeonem, aut latronem, aut homicidam? – Ces vices ne sont pas le propre des esclaves, des gens du peuple, des militaires, mais aussi des nobles : Videamus si vel a duobus illis quasi capitalibus malis ullus immunis est; id est, vol ab homicidio, vel a stupro. Quis enim est aut humano sanguine non cruentus, aut coenosa impuritate non sordidus? – IV. Quotus enim quisque est divitum connubii sacramenta conservans, quem non libidinis furor rapiat in praeceps, cui non domus ac familia sua scortum sit, et qui non, in quamcumque personam cupiditatis improbae calor traxerit, mentis sequatur insaniam. ? Secundum illud scilicet quod de talibus dicit sermo divinus : Equi insanientes in foeminas facti sunt (Jerem., V, 8). Quid enim aliud quam de se dictum hoc probat qui totum pervadere vult concubitu quicquid concupierit aspectu ? Nam de concubinis quippiam dici forsitan etiam. iniustum esse videatur : quia hoc in comparatione supradictorum flagitiorum quasi genus est castitatis, uxoribus paucis esse contentum, et intra certum coniugum numerum fraenos libidinum continere. Coniugum dixi ; quia ad tantum res imprudentiam venit, ut ancillas suas multi uxores putent. Atque utinam sicut putantur esse quasi coniuges, ita solae haberentur uxores! – Comme d'habitude, il cherche des contrastes et les trouve en opposant les mœurs des maîtres et celles des esclaves : Ecce enim ab hoc scelere vel maximo prope omnis servorum numerus immunis est. Numquid enim aliquis ex servis turbas concabinarum habet ? nuinquid multarum uxorum labe polluitur, et canum vel suum more tantas putat coniuges suas esse, quantas potuerit libidini subiugare ? – Salvien compare les Romains aux Barbares : IV. Duo enim genera in omni gente omnium barbarorum sunt, id est, aut haereticorum, aut paganorum. His ergo omnibus, quantum ad legem divinam pertinet, dico nos sine comparatione meliores ; quantum autein ad vitam et vitae acta, doleo ac plango esse peiores. Quamvis id ipsum tamen, ut ante iam diximus, non de omni penitus Romani populi universitate dicamus. Excipio enim primum omnes religiosos, deinde nonnullos etiam seculares religiosis pares. Caeteros vero aut omnes, aut pene omnes, magis reos esse quam barbaros. – Pourtant il admet que les Barbares ne valaient pas grand'chose non plus. Iniusti saut barbari, et nos hoc sumus ; avari sunt barbari, et nos hoc sumus : infideles sunt barbari, et nos hoc sumus ; cupidi sunt barbari, et nos hoc sumus ; impudici saut barbari, et nos hoc sumus ; omnium denique improbitatem atque impuritatem pleni sunt barbari, et nos hoc sumus. – Puis, sans s'inquiéter de la contradiction, il dit que ses concitoyens sont pires que les Barbares. Il commence par porter des accusations acerbes contre les Aquitains. VII. Minoris quippe esse criminis etiam lupanar puto. Meretrices enim quae illic sunt, foedus connubiale non norunt. Ac per hoc, non maculant quod ignorent. Impudicitiae quidem piaculo saut obnoxiae ; sed reatu tamen adulterii non tenentur, Adde huc, quod et pauca ferma sunt lupanaria, et paucae quae in his vitam infelicissimam damnavere meretrices. Apud Aquitanicos vero, quae civitas in locupletissima ac nobilissima sui parte non quasi lupanar fuit. Quis potentum ac divitum non in luto libidinis vixit ? Quis non se barathro sordissimae colluvionis immersit ? Quis coniugi fidem reddidit ? – Il accuse les maîtres de corrompre les femmes esclaves : Ex quo intelligi potest quantum coenum impudicarum sordium fuerit, ubi sub impurissimis dominis castas esse, etiamsi voluissent, foeminas non licebat. – À ce qu'il paraît, c'est en raison de ces offenses à la chasteté, que le Seigneur soumit les Romains aux Barbares. Cumque ob impurissimam vitam traditi a Deo barbaris fuerint, impuritates tamen ipsas etiam inter barbaros non relinquunt. – Poussé par la manie déclamatoire, il attribue toutes les vertus aux Barbares : Inter pudicos barbaros impudici sumus. Plus adhuc dico. Offenduntur barbari ipsi impuritatibus nostris. – On dirait vraiment un visionnaire comme le sénateur Bérenger : Esse inter Gothos non licet scortatorem Gothum ; soli inter eos praeiudicio nationis ne nominis permittuntur impuri esse Romani. Et quae nobis, rogo, spes ante Deum est ? Impudicitiam nos diligimus, Gothi execrantur. Puritatem nos fugimus, illi amant. Fornicatio apud illos crimen nique discrimen est, apud nos decus. – En résumé, Salvien vivait en un temps où les mœurs n'étaient pas pires que dans le passé, quand Rome avait vaincu les Barbares ; et sans y prendre garde, il se figure que c'est à cause de leurs mauvaises moeurs que les Romains ont été vaincus.
[FN: § 1379-3]
La vie dissolue des rois francs, racontée par SAINT GRÉGOIRE, dans son histoire, est trop connue pour qu'il soit nécessaire de la rappeler. Contentons-nous de glaner quelques faits dans cette histoire et dans sa suite, connue sous le nom de FRÉDÉGAIRE. S. GREG. ; Hist. eccl. franc., II, 12 : Childerieus vero cum esset nimia in luxuria dissolutus, et regnaret super Francorum gentem, coepit filias eorum stuprose detrahere. – II, 20. On dit du duc Victor : Romam aufugit, ibique similem tentans exercere luxuriam, lapidibus est obrutus. – II, 42 : Erat autem tunc Ragnacharius rex apud Camaracum, tam effrenis in luxuria, ut vix vel propinquis quidem parentibus indulgeret. Is habebat Farronem consiliarium, simili spurcitia lutulentum ;... – III, 21 à 26. Théodebert s'unit à une certaine Deuteria, qui se trouvait au château de Capraria : (22) Deuteria vero ad occursum eius venit ; at ille speciosam eam cernens, amore eius capitur, suoque eam copulavit stratui. – Quelque temps après, il l'épouse. Elle, craignant que son mari n'abusât d'une fille qu'elle avait, la fit tuer : (26) Deuteria vero cernens filiam suam adultam valde esse, timens ne eam concapiscens rex sibi adsumeret, in basterna positam, indomitis bobus coniunctis, eam de ponte praecipitavit... – IV, 13 : Chramnus vero his diebus apud Arvernum residebat : multae enim causae tunc per eum inrationabiliter gerebantur... Nullum autem hominem diligebat, a quo consilium bonum utileque posset accipere ; nisi collectis vilibus personis aetate iuvenili fluctuantibus, eosdem tantummodo diligebat, eorumque consilium audiens, ils, ut filias senatorum, datis praeceptionibus, eisdem vi detrahi iuberet. – V, 21. Il dit de deux évêques que, parvenus à l'épiscopat, coeperunt in pervasionibus, caedibus, homicidiis, adulteriis,... et ajoute : (21) Sed nec mulieres deerant cum quibus polluerentur. – VI, 36 : Clericus quidam exstitit ex Cenomannica urbe, luxuriosus nimis amatorque mulierum, et gulae ac fornicationis, omnique immunditiae valde deditus. Hic mulieri cuiusdam. saepius scorto commixtus,... – VI, 46. Il dit de Chilpéric : Iam de libidine atque luxuria non potest reperiri in cogitatione, quod non perpetrasset in opere... – VIII, 19 : Cum autem saepius Dagulfus abbas pro celeribus suis argueretur, quia furta et homicidia plerumque faciebat, sed et in adulteriis nimium dissolutus erat ; quodam tempore cum, uxorem vicini sui concupiscens, misceretur cum ea, requirens occasiones diversas, qualiter virum adulterae intra monasterii huius saepta deberet obprimere, ad extremum contestatus est ei dicens, quod si uxorem suam accederet, puniretur. – IX, 13 –. Uxor quoque ipsius Wiliulfi tertio copulatur viro, filio seilicet Beppoleni ducis ; qui et ipse duas iam, ut celebre fertur uxores vivas reliquerat. Erat enim levis atque luxuriosus ; et dum nimio ardore fornicationis artarétur, ac, relicta coniuge, cura famulabus accubaret, exhorrens legitimum connubium, aliud expetebat. – IX, 20. Le roi convoque un grand nombre d'évêques ; on lui demande pourquoi ; il répond : Sunt multa, quae debeant discerni, quae iniuste gesta sunt, tam de incestis,... – IX, 27: Amalo quoque dux dum coniugem in aliam villam pro exercenda utilitate dirigit, in amorem puellulae cuiusdam ingenuae ruit. Et facta nocte, crapulatus a vino, misit pueros, ut detrahentes puellulam, eam thoro eius adscirent... – IX, 33. Un homme dit à un évêque : Abstulisti uxorem meam cum famulis eius. Et ecce, quod sacerdotem non decet, tu cum ancillis meis, et illa cum famulis tuis, dedecus adulterii perpetrasti. – FREDEG.; Chron., 36. Le roi Théodéric [Thierry] va rendre visite à Saint Colomban – Ad quem saepissime cum veniret, coepit vir Dei eum increpare, cur concubinarum adulteriis misceretur, et non potius legitimi coniugii solaminibus frueretur. – 42. On dit du roi Clotaire : Venatione ferarum nimia assiduitate utens, et postremum mulierum et puellarum suggestionibus nimium annuens... – 48 : Chuni ad hiemandum annis singulis in Sclavos veniebant; uxores Sclavorum et filias eorum stratu sumebant. Voilà donc les vertus et la chasteté des Barbares ! – 60. On dit du roi Dagobert : Luxuriae supra modum deditus tres habebat ad instar Salomonis reginas, maxime et plurimas concubinas. Reginae vero hae erant... Nomina concubinarum eo quod plures fuissent, increvit huic Chronicae inseri. – Qui croira que, le roi ayant de pareilles mœurs, celles de ses sujets étaient très chastes ? – 70. On dit du roi Chrotaire : Chrotarius per concubinas debacchabatur assidue.
[FN: § 1380-1]
Par exemple, dans le Malleus maleficarum, il y a des descriptions obscènes ; mais, au fond, elles ne le sont pas, dans l'intention de l'auteur. Les termes des vers 12 386-12 486 du Roman du Renart (édit. MÉON) sont aussi obscènes. On peut encore tout au plus admettre l'excuse qui place l'obscénité surtout dans l'expression. Mais cela est impossible pour beaucoup de fabliaux.
[FN: § 1381-1]
Anno 305. Ex concilio Eliberitano : 12. Mater vel parentes vel quaelibet fidelis, si lenocinium exercuerit, placuit, eos nec in fine accipere communionem. – 71. Stupratoribus puerorum nec in fine dandam esse communionem. – Anno 314. Ex concilio Ancyrano : 15. Masculorum et pecorum concubitores... – 16. Masculorum vel pecorum concubitores inter hyemantes, seu daemoniacos tantum orent. – 20. Feminae, quae partus suos ex fornicatione necant, decennio poeniteant. – Anno 693. Ex concilio Toletano XVII : 3 Quicumque sodomiticae actionis patratores extiterint, quique in his turpitudinibus saepe implicari permiserint, si quidem Episcopus, presbyter, aut diaconus fuerit... – Anno 742. Ex concilio Ratisbonensi 1 : 13. Quisquis servorurn Dei vel ancillarum Christi in crimen fornicationis lapsus fuerit,... – Anno 813. Ex concilio Turonensi III : 41. Incestuosi, parricidae, homicidae multi apud nos reperiuntur, quorum aliquos iam excommunicavimus ; sed illi hoc parvipendentes in eisdem perdurant criminibus, quamobrem vestra decernat mansuetudo, quid de talibus deinceps agendurn sit. – Anno 895. Ex concilio Triburiensi – 43. Si quis cum qualibet fornicatus fuerit, et eo nesciente, filius eius vel frater eiusdem. rei inscius cum. eadem se polluerit... – Anno 1565. Ex concilio Mediolanensi. Parte II : 66. Ut meretrices ab honestis mulieribus omnino internoscantur, curent Episcopi ut aliquem. amictum. palam indutae sint....
[FN: § 1381-2]
PERTILE ; storia del dir. ital., IIe vol, Ie part., p. 435 ... Bandi Lucchesi, n. 313, où il y a un contrat de location du lupanar, pour 120 florins d'or par année, de 1351. – Parfois on cherchait à pallier l'immoralité de ces revenus, en leur donnant un but d'utilité publique. – 1404. Catherine, duchesse de Milan, régente pour son fils : sentimus quod denarii intrate datiorum baratarie et postribuli cornunis Mediolani, que intrata est specialiter deputata ad solutionem expensarum occurrentium pro reparatione fortititiorum ipsius civitatis, etiam pro consignationibus luporum et vulpium (c'est-à-dire pour prime à ceux qui les tuaient), expenduntur in alias diversas causas ; et elle veut qu'ils soient de nouveau destinés à leur but primitif. Osio, I, 257. – Pour que le lupanar rendît davantage, le Stat. iud. dacior. Com. Mant., c. 143, ordonnait quod emptores dicti dacii non habeant a comuni precium limitatum quod exigere debent pro eorum, mercibus, sed per comune concessum est eis posse vendere merces suas pro maiore precio quo possunt, et secundum quod clientulos et aventores invenerint ».
[FN: § 1381-3]
Laissons de côté ce que disent les musulmans, car la source est suspecte. Par exemple : Rec. des hist. des crois. : Hist. orientaux, t. IV : « (p. 433) Un bâtiment avait amené (chez les Francs) [devant Saint Jean d'Acre ; an 585 de l'hégire, 1189-1190 de notre ère] trois cents femmes remarquables par leur beauté. Recueillies dans les îles (de la Méditerranée), elles s'étaient enrôlées pour ces hontes, exilées pour la consolation des exilés ; elles étaient parties afin de s'offrir à ces misérables. Loin de refuser leurs faveurs aux célibataires, elles se donnaient spontanément comme la plus méritoire offrande et croyaient que nul sacrifice ne surpassait le leur, surtout si celui à qui elles s'abandonnaient réunissait la double condition d'étranger et de célibataire [c'est évidemment inventé]. Plusieurs mamlouks pervertis désertèrent notre camp [c'est plus croyable] ; ces êtres misérables et ignorants, aiguillonnés par le désir charnel, suivirent cette voie de perdition ». Mais on ne peut également rejeter les témoignages des auteurs chrétiens. – MICHAUD ; Biblioth. des Croisades, Ire partie. Histoire des guerres d’Antioche par Gauthier le Chancelier (de 1115 à 1119). L'auteur parle des chrétiens en Syrie : « (p. 104) Les uns, ennemis du jeûne et courant après les plaisirs de la table, s'appliquaient à imiter la vie et les mœurs, non point de ceux qui vivent bien, mais de ceux qui paissent bien. Les autres, par amour pour l'inceste, fréquentaient les tavernes des impudiques, et dépassaient les bornes de toute pudeur... Ils employaient l'or de l'Arabie et les pierres précieuses à parer et à couvrir avec art les parties sexuelles de leurs épouses ; et ils agissaient ainsi non point pour dérober aux yeux les parties honteuses, ni pour éteindre la flamme de la débauche, mais afin que quibus (p. 105) ingratum. erat quod licebat, eos acrius ureret quod non licebat, qui cum hoc modo suam vellent imitare libidinem, mulieres dealbare et eis satisfacere, putarent, ut praelibaremus, augebant crimina criminibus. Les femmes, dans leur manière de jouir des plaisirs de la chair, n'avaient rien de saint, rien de prudent. Méprisant la couche de leur mari, elles allaient dans les lieux de prostitution pour y commettre des incestes. Elles passaient la nuit et le jour au milieu des plaisirs, des divertissements et des banquets... » Il est impossible que le temps où l'on écrivait ces choses, fussent-elles inventées en partie, ait été un temps d'innocence telle qu'on ne savourait pas le sel des figures et des récits obscènes. ROBERT LE MOINE ; Collection GUIZOT : Hist. de la première Croisade. L'auteur raconte comment Jésus-Christ apparut, en songe, a un prêtre, et se plaignit des mauvaises mœurs des chrétiens. «(p. 407)... j'ai consenti à toutes les tribulations et les obstacles qu'ils ont à subir, parce qu'il s'est fait, avec les femmes chrétiennes et païennes, beaucoup de choses criminelles qui me blessent grandement les yeux ». – FOULCHER DE CHARTRES ; ibidem. Il raconte qu'au siège d'Antioche, les croisés souffrirent beaucoup, en punition des mauvaises mœurs. « (p. 40) ... grand nombre, en effet, se livraient lâchement et sans pudeur à l'orgueil, à la luxure et au brigandage. On tint donc un conseil et l'on renvoya de l'armée toutes les femmes, tant les épouses légitimes que les concubines, afin d'éviter que nos gens, corrompus par les souillures de la débauche, n'attirassent sur eux la colère du Seigneur ». – Ce récit se trouve aussi dans Ghibert de Novigent. – GUIBERTI Abb. St. Variae de Novigento, Gesta dei per Francos, 1. V, c. III (XVII). – JACQUES DE VITRY : Collection GUIZOT, I. II « De la corruption des contrées de l'Occident et des péchés des Occidentaux... (p. 271) La continence, chérie des demeures célestes et agréable à Dieu, était méprisée comme une chose vile. Les hommes se livraient indistinctement et sans honte à la luxure, tels que le cochon dans la boue, trouvaient des délices dans cette puanteur... (p. 272) Les liens du mariage n'avaient aucune sûreté entre les parens et les alliés, et la licence effrénée n'était pas même arrêtée par la différence des sexes ». – Chronique d'Ernoul et de Bernard le trésorier (années 1180-1184) : « (p. 86) Or vous dirai de sa vie [du Patriarche de Jérusalem]. Quant il fu venus de Rome, si ama le femme à un merchier, qui manoit à Naples, à XII lieues de Jherusalem. Et il le mandoit souvent ; et celle i aloit, et il li donnoit assés de sen avoir pour estre bien de sen baron. Ne demoura gaires apriès que ses barons fu mors. Apriès vint li patriarches, si le fist venir manoir aveuques lui en Jherusalem, et li acata bonne maison de piere ». Les mœurs des Grecs n'étaient pas meilleures : « (p. 91) Or vous dirons d'Androine, qui empereres fu de Constantinople. Il ne demouroit biele nonne en toute le tiere, ne fille à chevalier, ne fille à bourgeois, ne femme... por que elle li seist bele, que il ne le presist et gisoit à li à force... ». Quand Jérusalem est assiégée par Saladin, les habitants prient ; mais « (p. 216) Nostres sires Dame Diex ne pooit oïr lor clamour ne proiiere c'on li fesist en la cité, car l'orde puans luxure et l'avoltere qui en le cité estoit ne laissoit monter orison ne proiiere c'on (p. 217) fesist devant Diu, et li puans peciés contre nature ». Aussi comprend-on que les gens aient trouvé qu'on revenait des croisades pire que quand on y était allé, Rutebeuf a écrit, au temps de Saint Louis, un dialogue entre un individu qui veut aller et un autre, qui ne veut pas aller à la croisade ; il y juge sévèrement les croisés. – RUTEBEUF : Œuv. comp., recueillies par A. JUBINAL, t. I, La desputizons dou Croisié et dou Descroisié : « p. 156) (186) Mult vont outre meir gent menue (187) Sage large, de grant aroi,... (191) Si ne valent ne ce ne quoi (192) Quant ce vient à la revenue ». – Chronique de GUILLAUME DE NANGIS, GUIZOT, année 1120 : « (p. 7) ... Guillaume et Richard, fils de Henri, roi des Anglais, la fille et la nièce de ce roi, et beaucoup de grands et de nobles d'Angleterre, ayant voulu quitter la Normandie pour passer en Angleterre, furent submergés dans la mer, quoiqu'aucun vent n'en troublât le calme. On disait, et c'était avec vérité, qu'ils étaient presque tous souillés du crime de sodomie ». Vie de GUIBERT DE NOGENT, dans GUIZOT, 1. III, c. 5 : « (p. 5) Il y avait en effet un certain homme... Enguerrand de Boves... Libéral, prodigue et dépensier sans mesure, cet homme affectait pour les églises un respect et une munificence sans bornes, choses dans lesquelles seulement il avait appris à faire consister la religion ; mais d'un autre côté il était tellement adonné à l'amour du sexe, qu'il avait toujours autour de sa personne quelques femmes achetées ou empruntées, et ne faisait généralement rien que ce à quoi (p. 6) le poussait leur effronterie. Ayant toujours échoué dans ses projets pour se marier, il se mit à courir les femmes d'autrui, parvint à séduire furtivement l'épouse d'un certain comte de Namur son parent, et, a près l'avoir sollicitée secrètement au crime, finit par vivre publiquement avec elle comme avec une légitime épouse... Cette femme était la fille de Roger, comte de Portian... (p. 7) Tous ceux... qui l'ont connue sont d'opinion que nous aurions trop à rougir, non seulement de détailler le cours de ses déportemens, mais même de les rappeler dans notre mémoire ». – RIGORD : Vie de Philippe-Auguste, GUIZOT: « (p. 139) L'an du Seigneur 1198, ce Foulques s'associa, pour l'aider dans ses prédications, un prêtre... Tous les jours, en accompagnant les diverses prédications, il retirait quelques âmes du péché d'usure, et plus encore des fureurs de la luxure. Il sut même ramener à la continence conjugale des femmes qui vivaient dans des lieux de prostitution, et s'y livraient, à vil prix et sans pudeur, à tous les passans ; car elles ne choisissaient pas même leurs complices ». – MATHIEU PARIS; t. III, année 1229; p. 400-402. On raconte une rébellion des étudiants de Paris, qui accusaient la reine Blanche d'avoir des relations charnelles avec le légat du pape ; et les gens chantaient (p. 402): Heu ! morimur strati, vincti, mersi, spoliati Mentula legati nos facit ista pati. – MURATORI ; Ant. ital., t. II, diss. 20 : (p. 141) Et Saeculo quidem vulgaris Ærae Decimo, quo nullum corruptius Italia Christiana vidit, tam enormiter libidini frena laxata sunt, ut ipsae principes feminae palam in omne intemperantiae genus sese effunderent. Prae ceteris vero circiter Annum DCCCCXXV ex huiusmodi licentia famam sibi grandem conquisiere apud Longobardos Ermengardis Adelberti Eporediae Marchionis uxor, et apud Romanos, Marozia Johannis XI Papae mater, et Alberici Marchionis senioris conjux, ejusque mater Theodora, ac soror altera Theodora : quarum vitia ad posteros transmisit liberiore stilo Liutprandus illorum temporum Historicus Eodemque Saeculo,... coepit ipse Clerus observatam in Occidente ab exordio Ecclesiae continentiam contemnere, eoque tamdem evasit malesanus ardor, ut Presbyteri, nedum Diaconi et Subdiaconi, feminas sub omnium oculis loco uxoris haberent, illud caussati, cur non sibi liceret, quod apud Graecos minime nefas erat ? Longe utique facilius pullulant Vitia, quam Virtutes : quare pestilentia haec universas fere Italiae Civitates, ipsamque Urbem, sensim invasit. Connivebant mali Praesules, obsistebant boni ;... In margine vetustissimi Sacramentarii MSti apud Canonicos Mutinenses haec deprehendi : Ego Andrea Presbiter promitto coram Deo et omnibus Sanctis, et tibi Guarino Episcopo, quod carnalem, comistionem non faciam ; et si fecero, et onoris mei et beneficio Ecelesiae perdam... Succedit alterum simile jusjurandum : Ab hac ora in antea promitto ego Johannes Archipresbiter tibi Warino Episcopo, quod diebus vitae meae cum muliere alierius adulterium non faciam, neque cum inlicita meretrice fornicationem. Et si fecero, me ipsum confirmo in periculum...
[FN: § 1382-1]
Il suffit de rappeler que les courtisanes avaient part au culte romain, pourtant très sévère en général. Dans les Fastes de Préneste, on lit : Robigalia. Feriae Robigo via Claudia ad milliarum (quintum), ne robigo frumentis noceat. Sacrificium et ludi cursoribus maioribus minoribusq(ue) fiunt. Festus et puerorum lenoniorum, quia proximus superior meretricum est. – La fête Vinalia était célébrée par les courtisanes. OVID. ; Fast., IV :
(865) Numina vulgares Veneris celebrate puellae :
Multa professarum quaestibus apta Venus.
Poscite ture dato formam, populique favorem ;
Poscite blanditias, dignaque verba ioco ;
…………………………………………………..
Pour les fêtes de Flora, 1. V :
(331) Quaerere cônabar, quare lascivia maior
His foret in ludis, liberiorque iocus :
Sed mihi succurrit, numen non esse severum
Aptaque deliciis munera ferre Deam
……………………………..…………...
(349) Turba quidem cur hos celebret meretricia ludes
Non ex difficili causa petenda subest.
On sait assez qu'à Corinthe les courtisanes priaient Aphrodite pour la cité, et lui adressèrent des supplications, au temps de l'invasion perse. Une scolie de PINDARE, nous raconte l'histoire d'un individu qui, heureux d'avoir vu ses vœux accomplis, conduit cent jeunes courtisanes dans le bois sacré de la déesse. –ATHEN. : L. XIII, c. 33, p. 573-574. – Dans le même livre, p. 573, on rappelle les temples et les fêtes qui empruntaient leurs noms aux hétaïres.
[FN: § 1382-2]
D'un côté, le Deut., XXIII, 17, défend clairement la prostitution ; d'un autre côté, il ne manque pas d'allusions dans la Bible, qui en montrent l'existence chez le peuple d'Israël. Pour concilier la loi et le fait, on a supposé que la première défendait seulement la prostitution sacrée, et que le fait se rapportait à la prostitution vulgaire. – I. SPENCER a défendu vaillamment cette opinion. De legibus Hebraeorum, ritualibus, II 35. Après avoir cité le passage du Deut., il observe : (p. 561) Quibus verbis, non scorta vulgaria, quaestus aut voluptatis solius cupidine corporum suorum copiam facientia prohibentur ; sed scorta (quae vocant) sacra, foedo alicui gentium Numini dicata, et turpitudinem omnem in illius honorem exercentia. – Il se peut bien qu'il en fût ainsi ; mais il se peut aussi qu'à l'instar de ce qui a lieu dans ce domaine chez tous les peuples, il y eût divergence entre la prohibition théorique de la loi et la tolérance pratique, dans les faits. En tout cas, il y avait des courtisanes dans le peuple d'Israël : autrement, la défense faite au prêtre de se marier avec une courtisane (Levit.. XXI, 7) n'aurait aucun sens. Dans Jug., 11, 1, il est fait allusion a un Israëlite qui était fils d'une prostituée. Le célèbre jugement de Salomon (I Rois, III, 16) fut rendu sur le conflit de deux prostituées. Le cas de Tamar est très connu (Genèse XXXVIII) et n'aurait pu être écrit là où n 'existait pas de prostituées. L'auteur raconte, sans ajouter aucune parole de blâme, que « (15) Juda la vit, la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage », et qu'il eut commerce avec, elle. Dans les Prov.,VI, 26, il est dit que « pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain ». Samson (Jug., XVI, l) se rendit à Gaza chez une prostituée, et n'en est blâmé en aucune façon par l'Écriture Sainte. De nombreux passages du Talmud montrent l'écart entre la théorie et la pratique de la chasteté. – M. SCHWAB ; Traité des Berakhoth. Talmud de Jérusalem, c. III. On traite de la thébila, soit du bain de purification après l'acte charnel : « (p. 65) Comment la thébila nous empêche-t-elle de pécher ? En voici un exemple : Il est arrivé qu'un surveillant de jardins était prêt à commettre un péché avec, une femme mariée ; mais ils voulaient d'abord s'assurer de pouvoir se purifier immédiatement après [remarquez la purification mécanique, § 1257] ; pendant ce temps, des étrangers arrivèrent et ils furent empêchés de commettre le péché. Un autre, ayant voulu séduire une esclave du Rabba, reçut d'elle cette réponse et ce refus : .„ Je ne puis prendre la thébila que quand ma maîtresse en prend “.– „ Toi (esclave) tu n'es considérée que comme une bête “, lui dit le séducteur ; „ donc tu n'as pas besoin de thébila “. – „ As-tu oublié “ (répondit celle-ci) „ qu'il est écrit : celui qui pèche avec une bête doit être mis à mort (lapidé) ? “ (Et ils ne péchèrent point) ». – Plus loin, nous avons une anecdote à propos des phylactères que portaient les Israëlites. Talmud de Babylone, c. III : « (p. 313) Les rabbins ont enseigné que, avant d'entrer aux cabinets, on retire ses phylactères à la distance de quatre coudées... il faut les tenir à la main ainsi enveloppés, puis les placer dans des trous à proximité des cabinets, mais ne donnant pas sur la rue, de crainte que les passants ne les prennent et ne donnent lieu à de faux soupçons ; car il arriva ceci à un étudiant : ayant laissé ses phylactères dans des trous situés sur la rue, une femme de mauvaise vie vint les prendre et les apporter à la salle d'étude, en disant que cet étudiant les lui avait donnés pour récompense (de son libertinage). Le jeune homme, en entendant ces mots, monta sur le toit et se jeta en bas par désespoir ».
[FN: § 1382-3]
La tradition voulait que Solon eût institué les lupanars, à Athènes,
« à cause de la vigueur des jeunes gens ». – ATH. ; XIII, p. 569. Horat. Sat, I, 2
(31) Quidam notus homo, cum exiret fornice, « macte
Virtute esto » , inquit, sententia dia Catonis.
Nam simul ac venas inflavit tetra libido,
Huc iuvenes aequum est descendere ; non alienas
Permolere uxores.
PSEUDACRONIS Scholia in Horat. : Catone transeunte quidam exiit de fornice ; quem, cum fugeret, revocavit et laudavit. Postea cum frequentius eum exeuntem de eodem lupanari vidisset, dixisse fertur : adulescens, ego te laudavi, tamquam huc intervenires, non tamquam hic habitares. – L'anecdote montre que les Romains excusaient l'usage et réprouvaient l'abus.– P. PORPHYRIONIS Commentarii in Horat : Marcus Cato ille Censorius cum vidisset hommeni honestum e fornice exeuntem, laudavit existimans libidinem compescendam esse sine crimine. – Cfr. ATH. : XIII, p. 568-569, où le poète Xénarque s'en prend à des jeunes gens qui poursuivent de leurs assiduités les femmes mariées, au lieu de se contenter des prostituées :
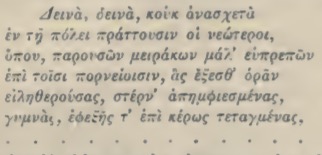
« Indignes, indignes et intolérables sont les choses que les plus jeunes font dans la cité, où il y a, dans les lupanars, de fort belles filles qu'on peut voir se chauffant au soleil, la poitrine découverte, nues et disposées en ordre par file » : et il s'étonne qu'ils puissent oublier les lois de Dracon contre l'adultère. –CICÉRON, Pro M. Coelio, 20, 48, excuse son client d'avoir eu commerce avec des courtisanes. Verum si quis est, qui etiam meretriciis amoribus interdictum iuventuti putet, est ille quidem valde severus ; negare non possum : sed abhorret non modo ab huius saeculi licentia, verum etiam a maiorum consuetudine [notez cela], atque concessis. Quando enim hoc factum non est ? quando reprehensum ? quando non permissum ? quando denique fuit, ut, quod licet, non liceret ? – A. SÉNÈQUE. Controv., II, 12, 10, excuse aussi un jeune homme d'avoir aimé des courtisanes : Nihil - inquit - peccaverat ; amat meretricem ; solet fieri : adulescens est, expecta, emendabitur, ducet uxorem. – Cfr. TERENT.; Adelph., 102-103. – PRUD. : Contra Simmach., I, 134-138. – La loi protégeait la dignité des matrones romaines, mais laissait toute liberté aux courtisanes et à ceux qui avaient commerce avec elles. – SUET. – Tib., 35 : Feminae famosae ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsolverentur, lenocinium profitrri coeperant ;... « Des femmes déshonnêtes, afin d'être exemptées du droit et de la dignité des matrones, pour éviter les peines des lois, se faisaient inscrire parmi les courtisanes... » – TACIT.; Ann., II, 85 : « Le sénat fit cette année des règlements sévères pour réprimer les dissolutions des femmes. On interdit le métier de courtisane à celles qui auraient un aïeul, un père, ou un mari chevalier romain ; car Vistilia, d'une famille prétorienne, pour avoir toute licence, avait été chez les édiles se faire inscrire sur le rôle des prostituées, d'après un ancien usage de nos pères, qui pensaient qu'une femme serait assez punie par la seule déclaration de son impudicité. » (Trad. NISARD). – PAPINIEN ; Dig., XLVIII, 5, 10 : Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii acusari damnarique ex senatus consulto potest. – TITE-LIVE, XXXIX, 9, rapporte comment les Bacchanales furent découvertes : Une célèbre courtisane, l'affranchie Ispala Fecenia, digne d'un meilleur sort, continuait pour s'entretenir, même après avoir été affranchie, le métier auquel elle était habituée quand elle était esclave. Elle entra en relations, à cause du voisinage, avec Aebutius, sans que cela nuisit ni à la fortune, ni à la réputation de celui-ci. Spontanément, elle l'avait aimé et recherché ; et comme l'avarice des parents d'Aebutius le laissait dans le besoin, la générosité de la courtisane l'aidait ». Même des Pères de l'Église reconnurent la prostitution comme un mal nécessaire. – D. AUG. ; De ordine, II 4, 12. Le saint remarque qu'il y a des maux nécessaires, comme les femmes publiques et les entremetteurs : Quid sordidius, quid inanius decoris et turpidinis plenius meretrieibus, lenonibus, caeterisque hoc genus pestibus dici potest ? Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus. Constitue matronarum loco, labe ac dedecore dehonestaveris. Sic igitur hoc genus hominum per suos mores impurissimum vita, per ordinis leges conditions vilissimum. – D. THOM.; Summa theol., IIa, IIae, q. 10, a. 11. De même que Dieu permet certains maux pour en éviter de pires, sic ergo et in regimine humano illi qui praesunt, recte aliqua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala peiora incurrantur; sicut Augustinus dicit, et il cite le passage rapporté plus haut. – Des empereurs païens instituèrent, à Rome, un tribut sur les prostituées, et des empereurs chrétiens les imitèrent, à Constantinople. SUET., Calig., 110 : Vectigalia nova atque inaudita, primum per publicanos, deinde... per centuriones tribunosque praetorianos exercuit. Il exigeait ex capturis prostitutarum, quantum quaeque uno concubitu mereret. Additumque ad caput legis, ut tenerentur publico, et quae meretricium, et qui lenocinium fecissent... HIST. AUG. –LAMP. – A. Severus, 24 : Lenonum vectigal et meretricum et exoletorum in sacrum aerarium inferri vetuit, sed sumptibus publicis ad instaurationem theatri, circi, amphitheatri, et aerarii deputavit. – ZONABA, XIV, 8, D. III, p. 259; P. II, p. 54, dit du Chrysargyre, imposé par Anastase, qu'il était payé « par tous les mendiants, les pauvres, et par toutes les courtisanes... ». – ![]() La Novelle XIV de Justinien, De lenonibus, déplore que de toutes les parties de l'empire on amenât des prostituées à Constantinople, et que « maintenant elle [la ville de Constantinople] et tous les lieux circonvoisins sont pleins de pareils maux [de maisons de prostitution] –
La Novelle XIV de Justinien, De lenonibus, déplore que de toutes les parties de l'empire on amenât des prostituées à Constantinople, et que « maintenant elle [la ville de Constantinople] et tous les lieux circonvoisins sont pleins de pareils maux [de maisons de prostitution] –
L'empereur veut apporter un remède à une si grande perversité ; c'est pourquoi il commande à ses sujets que « tous, suivant leur pouvoir, se conduisent chastement ». –
.– Qu'il était bien placé pour prêcher la Vertu !
[FN: § 1382-4]
Lex Wisigothorum, 1. III, 4, 17, De meretricibus ingenuis vel ancillis, aut si earum scelus iudices perquirere vel corrigere noluerint. Si aliqua puella ingenua sive mulier, in civitate publice fornicationem exercens, meretrix agnoscatur, et frequenter deprehensa in adulterio, nullo modo erubescens, iugiter multos viros perturpem suam consuetudinem adtrahere, cognoscitur, huiusmodi a Comite civitatis comprehensa...
[FN: § 1382-5]
Capitulare de ministerialibus Palatinis, 1 : Ut unusquisque ministerialis palatintis diligentissima inquisitione discutiat primo homines suos, et postea pares suos, si aliquem inter eos vel apud nos ignotum hominem vel meretricem latitantem invenire possit...
[FN: § 1382-6]
Capitularium, lib. VII, 143 : ... Sed quia, Deo auxiliante, per merita et intercessionem sanctorum servorumque Dei, quos sublimare et honorare curavimus atque curamus, hactenus nos et successores nostri regna et regiones adquisivimus, et victorias multas habuimus, deinceps summopere omnibus nobis providendum est, ne pro dictis inlicitis et spurcissimis luxuriis, his, quod absit, careamus. Nam multae regiones, quae rerum Ecclesiarum invasiones, vastationes, alienationes, vexationesque, et sacerdotum reliquorumque servorum Dei oppressiones vel quascunque iniurias, quae iamdicta inlicita et adulteria vel sodomiticam luxuriam vel commixtionem meretricum sectalae fuerunt, nec in bello seculari fortes, nec in fide stabiles perstiterunt. Et qualiter Dominus talium criminum patratoribus ultrices poenas per Sarracenos et alios populos venire et servire permisit, cunctis earum esta legentibus liquet. Et nisi nos ab his caveamus similia nobis supervenire non dubitamus ; quia vindex est Deus de his omnibus. – Capitularium, additio quarta, 160. On répète à peu près les mêmes choses et l'on ajoute : ...Quia dum illae meretrices, sive monasteriales, sive seculares, male conceptas soboles in peccatis genuerunt, saepe maxima ex parte occidunt ; non implentes Christi Ecclesias filiis adoptivis, sed tumulos corporibus, et inferos miseris animabus satiant. Absit enim ut pro talibus pereatis (Leg. forte peccatis) et nos simul cum regno cadamus... – Comme nous le verrons (1391-3), Charlemagne observe que le haut et le bas clergé péchaient même avec les femmes en compagnie desquelles les Canons leur permettaient d'habiter, parce qu'on ne les croyait pas dangereuses. Les mœurs du reste du peuple n'étaient pas meilleures. – Capitularium, lib. VII, 336 : De concubinis non habendis. Qui uxorem habet, eo tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinae. – 356 : De his qui cum pecoribus coitu mixti sunt, aut more pecorum usque affinitatis lineam cum consanguineis incestum commiserunt, sive cum masculis concubuerunt. – Capitularium, lib., VI, 27.
[FN: § 1382-7]
Constitutiones Regni Siculi, 1. I, tit. XX. De violentia meretricibus illata, 1. Rex Guilielmus : Miserabiles itaque mulieres, quae turpi quaestu prostitutae cernuntur, nostro gaudeant beneficio, gratalantes, ut nullus eas compellat invitas suae satisfacere voluntati... – 1 III, t. LIII. De poena matris filiam publicae prostituentis – Imp. Frider. – Matres quae publice prostituunt filias, poenae nasi truncati a divo Rege Rogerio statutae subiacere sancimus : alias etiam consentientes, et filias, quas forte propter inopiam, nedum maritare, sed etiam nutrire non possunt, alicuius voluptatibus exponentes, a quo et sustentationem vitae, et gratiam praestolantur, poenae subiacere non tam iniustum credimus, quam severum.
[FN: § 1383-1]
JOINVILLE « (171) Li communs peuples se prist aus foles femmes ; dont il avint que li roys donna congié à tout plein de ses gens, quant nous revenimes de prison. Et je li demandai pourquoi il avoit ce fait ; et il me dist que il avoit trouvei de certein que au giet d'une pierre menue, entour son paveillon, tenoient cil lour bordiaus à cui il avoit donnei congié, et ou temps don plus grant meschief que li os eust onques estei ».
[FN: § 1383-2]
L. PICHON ; Le roy des ribauds. Dissertations de plusieurs auteurs. – CLAUDE FAUCHET « (p. 25) ... l'on dit que les filles de joyes qui suivoient la Cour estoient tenuës en May, venir faire le fief du Prevost de l'Hostel : et lesquelles pour leur hardiesse impudente et impudique estoient renommees Ribaudes... » – PIERRE DE MIRAUMONT cite Bouteiller, qui écrivait vers l'année 1459, et qui dit que le roy des Ribauds « (p. 37) sur tous les logis des bourdeauz et des femmes bordelieres doit avoir deux sols la sepmaine ». Plus loin, il est fait mention d'une ordonnance du 13 juillet 1558 « (p. 41) par laquelle il est très-expressement enjoint et commandé à toutes filles de joye et autres non estans sur le roolle de la Dame desdictes filles, vuider la Cour incontinent apres la publication de la presente, avec deffenses à celles estans sur le roolle de ladicte Dame, d'aller par les villages : et aux chartiers, muletiers, et autres les mener, retirer, ni loger, jurer et blasphemer le nom de Dieu... » – ESTIENNE PASQUIER cite Du TILLET qui dit du roy des Ribauds : « (p. 48) Les filles de joye suyvantes la Court, sont sous sa charge, et tout le mois de May sont sujettes d'aller faire sa chambre ». – Du CANGE . « (p. 78)... Ce sont les droits du Roy des ribauds en Cambray : 1° ledit Roy doit avoir, prendre, cueillir et recepvoir sur chascune femme, qui s'accompagne de homme carnelement, en wagnant son argent, pour tant qu'elle ait tenu ou tiengne maison à lowage en le cité cinq solz Parisis pour une fois. Item sur toutes femmes qui viennent en le cité, qui sont de l'ordonnance pour la premiere fois deux solz Tournois. Item sur chascune femme de le dite ordonnance qui se remue et va demourer de maisons ou de estuves en aultre, ou qui va hors de le ville et demeure une nuit, douze deniers... ». – GOUYE DE LONGUEMARE, faisant des observations sur le passage déjà cité de Bouteiller, confirme d’autre part l'existence des prostituées «(p. 96) À l'égard de ce que Boutellier dit de la Jurisdiction sur les Bourdeaux et femmes bordelières, on doit aussi entendre que sa fonction se réduisoit à des visites en ces endroits-là, pour y faire observer une certaine police... que ces (p. 97) Maisons de débauche, et les personnes qui les habitoient, lui devoient payer une rétribution de deux sols par semaine... ». L'auteur observe qu'il semblerait « (p. 97) que la débauche étoit alors permise à la suite (p. 98) de nos Rois ; il est cependant à remarquer qu'elle n'étoit que tolérée, de même que l'étoient à Paris les mauvais lieux... Il paroît même que cette tolérance n’avoit pour but que d'éviter de plus grands désordres... » Quelles que soient les causes du fait, cela n'exclut pas son existence. – P. L. JACOB : « (p. 163) La royauté des ribauds étant tombée en (p. 164) quenouille après la mort du bon seigneur de Grignaux, „ ce fut une dame, et une grande dame quelquefois, dit M. Rabataux dans son curieux mémoire sur la Prostitution en Europe au moyen âge, qui resta chargée de la police des femmes de la cour “. En 1535, elle se nommait Olive Sainte, et recevait de François 1er un don de quatre-vingt-dix livres, „ pour lui aider, et aux susdites filles, à vivre et supporter les despenses qu'il leur convient faire à suivre ordinairement la Cour... “. On a conservé plusieurs ordonnances du même genre, rendues entre les années 1539 et 1546, et ces ordonnances font foi que, chaque année, au mois de mai, toutes les filles suivant la cour étaient admises à l'honneur de présenter au roi le bouquet du renouveau ou du valentin, qui annonçait le retour du printemps et des plaisirs de l'amour ».
[FN: § 1383-3]
DELAMARE ; Traité de la Police, t. I, 1. III, titre V, c. 6 : « (p. 521) Saint Louis voulut entreprendre de les chasser [les prostituées] ; c'est par cette réforme que commence son Ordonnance de l'an 1254. Elle porte que toutes les femmes et filles qui se prostituent seront chassées : tant des Villes que des Villages... (p. 522) Une longue et triste experience fit enfin connoître qu'il était impossible d'abolir totalement le vice des prostitutions, sans tomber dans d'autres desordres incomparablement plus dangereux à la Religion, aux mœurs et à l'Etat... L'on prit donc le party de tolerer ces malheureuses victimes de l'impureté... Ordonnance du Prevôt de Paris du dixhuitième Septembre 1367 qui enjoint à toutes les femmes de vie dissoluë, d'aller demeurer dans les bordeaux et lieux publics qui leur sont destinés, sçavoir... Fait défense à toutes personnes de leur loüer des maisons en aucun autre endroit, à peine de perdre le loyer ; et à ces sortes de femmes d'acheter des maisons ailleurs, à peine de les perdre ».
[FN: § 1387-1]
Il n'y a aucun juste motif pour douter que Ninzatti (Ligorio) ne soit de bonne foi, quand il manifeste de la répugnance à s'occuper des péchés contre le sixième et le neuvième commandements du Décalogue. – NINZATTI (S. ALPH. MAR. DE LIGORIO) ; Theologia moralis, t. I: (p. 228) Tractatus de sexto et nono decalogi praeeepto. Nunc aegre materiam illam tractandam aggredimur, cuius vel solum nomen hominum mentes inficit. Utinam brevius aut obscurius explicare me potuissem ! Sed cum sit frequentior ac abundantior eonfessionum materia, et propter quam maior animarum numerus ad infernum delabitur, imo non dubito asserere ob hoc unum impudicitiae vitium, aut saltem non sine eo, omnes damnari quicumque damnantur, hinc opus mihi fuit, ad instructionem eorum qui moralem scientiam cupiunt addiscere, ut clare (licet quo castissime fieri potuit) me explicarem, et plurima particularia discuterem.
[FN: § 1390-1]
AMM. MARCEL. ; XXVII,4 – D. HIERONY.; Ad Pammachium adversus errores Ioan.. Hierosoly., t. II : (p. 454 e) Miserabilis Praetextatus, qui designatus consul est mortuus. Homo sacrilegus, et idolorum cultor, solebat ludens B. Papae Damaso dicere : Facite me Romanae urbis Episcopum, et ero protinus Christianus.
[FN: § 1391-1]
THEOD. COD. ; XVI, 2, 20 : Imppp. Valentinianus, valens et Gratianus AAA. ad Damasum Episcopum urbis Romae, Ecclesiastici aut ex ecclesiasticis vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum ac pupillarum domos non adeant, sed publicis exterminentur iudiciis, si posthac eos affines earum vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de eius mulieris, cui se privatim sub praetexta religionis adiunxerint, liberalitate quacunque vel extremo iudicio possint adipisci, et omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum, ut nec per subiectam personam valeant aliquid vel donatione vel testamento percipere. – Godefroy observe : Continentes igitur dicti, qui privato perfectioris vitae studio ducti, veto severioris vitae suscipiendae, legitimis connubii solatiis seiuncti, ![]() coelibem vitam affectabant,
coelibem vitam affectabant, ![]() id est Temperantes.
id est Temperantes.
[FN: § 1391-2]
THEOD. COD., XVI, 2, 44, ann. 420 : Eum, qui probabilem saeculo disciplinam agit, decolorari consortio Sororiae appellationis non decet. Quicunque igitur, cuiuscumque gradus Sacerdotio fulciuntur vel clericatus honore censentur, extranearum sibi mulierum interdicta consortia cognoscant... Interpretatio. Quicunque clericatus utuntur officio extranearum mulierum familiaritatem habere prohibentur ; matrum, sororum vel filiarum sibi solatia intra domum suam noverint tantura esse concessa, quia nihil turpe in talibus personis fieri vel cogitari lex liaturae permittit. Illae vero mulieres sunt in solatio retinendae, quae in coniugio fuerunt ante officium clericatus. – Voir la longue note de GODEFROY.
[FN: § 1391-3]
Capitularium. lib. VII, 376 : Quod feminae cum Presbyteris vel reliquis Clericis non debeant habitare, nec eis ministrare, nec intra cancellos stare, neque ad altare accedere. – Il défend d'habiter même avec celles qui étaient permises par les anciens canons, quia, instigante diabolo, etiam in illis scelus frequenter perpetratum reperitur. – Idem, 452. – Additio tertia, 117: De subintroductis mulieribus. Omnibus igitur Clericis feminam secum in domibus suis habere ultra licentiam canonum firmiter sit contradictum.
[FN: § 1392-1]
D. C PR.; Ad Pomponium, de virginibus.
[FN: § 1392-2]
Je laisse le reste en latin. – C. CYPR. ; Ad Pomnponium, de virginibus : ..:Nec aliqua putet se hac excusatione defendi, quod inspici, et probari possit ; an virgo sit ; cum et manus obstetricum et oculus saepe fallatur. Et si incorrupta inventa fuerit virgo ea parte sui, qua mulier potest esse : potuerit tamen ex alia corporis parte peccasse, quae violari potest, et tamen inspici non potest. Certe ipse coucubitus, ipse complexus ; ipsa confabulatio et osculatio, et coniacentium duorum turpis et foeda dormitio quantum dedecoris et criminis eonfitetur? (1394-6). – La matrone romaine était beaucoup plus chaste que ces femmes, nonobstant les images qui préservaient ses enfants du fascinum, et aucun paterfamilias des beaux temps de Rome n'aurait permis ces obscènes inspections sur ses filles. – Le saint ajoute l'argument de la jalousie divine : Superveniens maritus sposam suam iacentem cum altero videat nonne indignatur et fremit ? Et per zeli livorem fortassis et gladium in marinai sumi t? Quid ? Christus Dominus et index noster, cum virginem suam sibi dicatam, et sanctitati suite destinatam facere cum altero cernit, quam indignatur et irascitur ? Et quas poenas incestis eiusmodi coniunctionibus coniminatur ?
[FN: § 1392-3]
D. HYERONYM : Ad Eustochium de custodia virginitatis, Epist. XXII. I. p. 1143 f. L'auteur parle de veuves qui affectent la chasteté : Plena adulatoribus domus, plena convivis. Clerici ipsi. quos et Magisterio esse oportuerat pariter et timori, osculantur capita matronarum, et extenta manu, ut benedicere eos putes velle, si nescias, pretia accipiunt salutandi. Illae interim quae sacerdotes suo viderint indigere praesidio, eriguntur in superbiam : et quia maritorum expertae dominatum, viduitatis praeferunt libertatem ; castae vocantur, et Nonnae, et, post caenam dubiam, apostolos somniant.
[FN: § 1393-1]
Ce cardinal dénonça au pape les mauvaises mœurs et les vices de quelques religieux. BEATI PETRI DAMIANI, opera, omnia, t. III, Liber Gomorrhianus, ad Leonem IX Rom. Pont. – Argumentum. – Nefandum et detestabile crimen, in quod Deo dicati sui temporis prolabebantur, deplorat : cosque utpote indignos a sacris Ordinibus removendos esse contendit : Leonemque Pontificem Romanum implorat, ut tam foede peccantes sua auctoritate coerceat (p. 63-77). – BURCHARD.; Diarium, t. II, mai 1493 : (p. 79) Alexander consuetudinem jam ceptam per Innocentium de maritanda prole feminina prosequutus est et ampliavit. Incumbit igitur clerus omnis, et quidem cum diligentia, circa sobolem procreandam. Itaque a majore usque ad minimum concubinas in figura matrimonii, et quidem publice, attinent. Quod nisi a Deo provideatur, transibit hec corruptio usque ad monachos et religiosos, quamvis monasteria Urbis quasi omnia jam facta sint lupanaria, nemine contradicente. – L'éditeur THUASNE note : « Cette assimilation des lupanars aux couvents de jeunes filles revient souvent sous la plume des écrivains du XVe siècle » ; et il en cite plusieurs exemples. – INFESSURA ; Diario : (p. 259) Inter alla quoque quae istis temporibus [ann. 1490] ascribi possunt est quod reverendus pater vicarius papae in Urbe et eius districtu volens, ut decet bonum virum, custodire oves gregis sibi commissi, fecit unum edictum probibitorium laycis et clericis cuiuscumque conditionis existentibus, ut de coetero sub excomunicationis poena et suspensionis ac privationis beneficiorum etc. non auderent retinere concubinas nec publice nec secrete ; cum diceret id verti in praeiudicium divinae legis et contra honestatem sacerdotalem : cum multi et quasi infiniti eam retinerent, tam magni praelati, quam etiam semplices clerici, propter quod bene vivendi modus in his non iudicabatur, minuebantque laicis fidem et devotionem. Quod cum S. D. N. audivit, accito ad se dicto episcopo eodemque vicario, eum de praemisso interdicto acriter momordit fecitque incontinenti illud removeri, cum diceret id prohibitum non esse ; propter quod talis effecta est vita sacerdotum et curialium, quod vix reperitur qui concubinam non retineat, vel saltem meretricem, ad laudem Dei et fidei christianae. E t ea forte de causa numeratae sunt meretrices, quae (p. 260) tunc publice Romae sunt, ut ex vero testimonio habetur, ad numerum, sex millium et octingentarum meretricum ; exceptis illis quae in concubinatu sunt et illis quae non publice sed secreto cum quinque vel sex earum exercent artificium, et unaquaeque earum, vel unum vel plures habent lenones. – BURCHARD. ; Diarium, t. II. Il décrit une cérémonie du mois d'août 11197 : (400) ... meretrices et alie viles persone steterunt ab omni parte, inter altare et cardinales. – Tout le monde connait le banquet des cinquante courtisanes donné par le pape Borgia ; t. III : (p. 167) In sero fecerunt cenam cum duce Valentinense in camera sua, in palatio apostolico, quinquaginta meretrices honeste, cortegiane nuncupate, que post cenam coreaverunt cum servitoribus et aliis ibidem existentibus, primo in vestibus suis; deinde nude. Post cenam posita fuerunt candelabra communia mense in candelis ardentibus per terram, et proiecta ante candelabra per terram castanee quas meretrices ipse super manibus et pedibus, nude, candelabra pertranseuntes, colligebant, Papa, duce et D. Lucretia sorore sua presentibus et aspicientibus. Tandem exposita dona ultima, diploides de serico, paria caligarum, bireta et alia pro illis qui pluries dictas meretriees carnaliter agnoscerent; que fuerunt ibidem in aula publice carnaliter tractate arbitrio presentium, dona distributa victoribus. – Note de THUASNE : « Le banquet des cinquante courtisanes est confirmé, par Matarazzo qui substitue des dames et des seigneurs de la cour aux courtisanes et aux valets du récit de Burchard (Arch. Stor. Ital., t. XVI, p. 189), par la lettre de Silvio Savelli reproduite plus loin... et insérée par Sanuto dans son journal, enfin par l'orateur florentin Francesco Pepi... Au commencement du XVIIIe siècle, le régent de France donnait au petit Luxembourg douze bals, où danseurs et danseuses complètement nus, renouvelaient les fêtes galantes du Vatican... » – MACHIAVELLI ; Vita di Castruccio Castracani. Après la défaite que Castruccio infligea aux Florentins : « (p. 249) ... il se plaça avec ses gens sur le plateau de Peretola... où il passa plusieurs jours à partager le butin et à fêter la victoire, faisant battre monnaie, au mépris des Florentins, courir le palium à des chevaux, à des hommes et à des courtisanes ». BURCHARD.; Diarium. t. III, 19 juin 1501 : (p. 146) Deputatus fuit locus apud Aquam Traversam, ...pro alloggiamento gentium regis Francorum euntium ad regnum Neapolitanum. Ibidem fact fuerunt presepia. ordinata provisio panis, carnium, ovorum, casei, fructuum et omnium aliorum necessariorum, et ordine sexdecim meretrices, que necessitati illorum providerent. – Il est bien connu qu'au moyen âge, le concubinage des prêtres était très répandu, et que souvent les autorités laïques ou religieuses vendaient pour une certaine somme la permission d'avoir des concubines. Le mal est ancien et il en est fait mention dans un grand nombre de chroniques. On lit, par exemple, dans celle de MATHIEU PARIS, t. I, année 1129 : « (p. 293) Cette même année, le roi Henri tint un grand concile à Londres aux calendes d'Août, pour interdire le concubinage aux prêtres. Guillaume, archevêque de Cantorbéry, Turstan, archevêque d'York et leurs suffragants, étaient présents à ce concile. Henri trompa tous les prélats, grâce à l'imprévoyance malhabile de l'archevêque de Cantorbéry. En effet, le roi obtint haute justice sur les concubines des prêtres : mais cette affaire devait se terminer par un grand scandale, car le roi gagna beaucoup d'argent en vendant aux prêtres le droit de garder leurs concubines ». – Aujourd'hui, là où les vertuistes ont fait passer dans la loi la prohibition du concubinage, de semblables gains reviennent à la police qui sait pratiquement le tolérer. – On lit, dans la même chronique: « (p. 286.) L'an du Seigneur 1125, Jean de Crème, cardinal du Saint-Siège apostolique, vint en Angleterre avec la permission du roi, et alla d'évêchés en évêchés, d'abbayes en abbayes, non sans recueillir partout de grands présents. Il tint un concile solennel à Londres le jour de la Nativité de la (p. 287) bienheureuse Marie. Là il s'éleva avec force contre le concubinage des prêtres, disant que c'était un crime abominable de coucher côte à côte avec une courtisane, puis de se lever et de prendre le corps de Jésus-Christ : mais lui-même, après avoir communié ce jour-là, fut surpris le soir avec une courtisane ». – Cette aventure aussi est semblable à d'autres qui, chaque jour, arrivent à nos vertuistes. Les siècles passent, mais la nature de l'homme demeure. CORNELIUS AGRIPPA a un passage dans lequel il va certainement au delà de la vérité, mais qui, non moins certainement, est en partie conforme aux faits. Ce passage se trouve dans l'édition d'Anvers de 1530, et fut supprimé dans l'édition des œuvres de cet auteur, faite à Lyon. Voir à ce propos BAYLE ; Dict. hist., s. v. Agrippa, p. 111. L'exemplaire que nous possédons porte, au commencement : Splendidae nobilitatis viri et armatae militiae Equitis aurati... Henrici Cornelij Agrippae ab Nettesheym De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artium atque excellentia Verbi Dei Declamatio. A la fin : IOAN. GRAPHEVS excudebat anno Christo nato MDXXX, mense Septemb. Antuerpiae. Les pages ne sont pas numérotées; il y a seulement un registre des feuilles d'imprimerie. Au chapitre De arte lenonia. l'auteur déclame vertement contre les mauvaises mœurs de son temps : (feuille Z. recto, dernière page) Auro placatur zelotipus maritus, auro mollitur inexorabilis riualis, auro acuratissimi vincantur custodes, auro quaeque ianua panditur, aure, omnis thalamus conscenditur, auro vectes et saxa, et insolubilia matrimonii vincula franguritur. Quid mirum quod auro virgines, puellae, matronae, viduae, vestales vaeneunt si auro Christus ipse venditur. Denique hac lenociniorum duce, plurimi ab infima sorte ad summum prope nobilitatis gradum conscenderunt. Prostituit hic uxorem factus est Senator, Prostituit ille filiam creatus est comes, hic aliam quamuis matronam in adulteri Principis sollicitauit amplexum, mox amplo stipendio dignus fit regius cubicularius : (verso) Alii ob desponsata regia scorta spectabiles facti sunt, publicisque muneribus praefecti, eisdem artibus abs Cardinalibus et pontificibus multi multa perpinguia venantur beneficia, nec est via ulla compendiosior. – L'auteur rapporte des exemples anciens de maquerelages sous le couvert de la religion, et ajoute : ... nec desunt mihi si referre velim eognita recentia exempla, habent enim Sacerdotes, monachi, fraterculi, moniales, et quas vocant sorores, specialem lenociniorum praerogatiuam, quum illis religionis praetextu liberuni sit quocumque peruolare, et quibuscunque quantum et quoties libet sub specie visitationis et consolationis, aut confessionis secreto sine testibus loqui tam pie personata sunt illorum lenocinia, et sunt ex illis quibus pecuniam tetigisse piaculum est, et nihil illos mouent verba Pauli dicentis: Bonum est mulierem non tangere, quas illi non raro impudicis contrectant manibus, et clanculum confluunt ad lupanaria, stuprant sacras virgines, viciant viduas et hospitum suorum adulterantes vxores... – Vient ensuite (feuille a, première page, recto) le passage mentionné par BAYLE : Iam vero etiam Lonociniis militant leges atque canones, cum in potentum fauoreni pro iniquis nuptiis pugnant, et itista matrimonia dirimunt. Sacerdotesque sublatis honestis nuptiis turpiter scortari compellunt, malueruntque illi legislatores Sacerdotes sues cum infamia habere concubinas, quam cum honesta fama uxores, forte quia ex concubinis prouentus illis est amplior : De quo legimus gloriatum in conuiuio quendam Episcopum habere se vndecini milia Sacerdotum concubinariorum, qui in singulos annos illi aureum pendant. – Dans une traduction française, publiée en 1603, sans nom de lieu, le passage est traduit : « (p. 394) Les loix et canons sont aussi enroolles en cette gendarmerie, et servent au maquerelages lors qu'en faveur des grands seigneurs ils valident et approuvent les iniques mariages, et rompent et separent ceux qui sont iustes et legitimes, et contraignent les prestres à paillarder vilainement, leur defendant de se marier honnestement. Ces legislateurs ont estimé meilleur que les gens d'Eglise menassent une vie infame avec des concubines, que de vivre en honneur et bonne reputation avec (les femmes espousees, possible pour ce que le proffit et commodité qui leur vient des concubines est plus grand : dont nous lisons qu'un certain Evesque se glorifloit en un banquet, disant qu'il avoit onze mille prestres en son diocese concubinaires qui lui payoyent à raison de ce tous les ans un escu chacun ».
[FN: § 1394-1]
EUSEB. ; Eccles. hist., VII, 30 12. L'auteur parle contre Paul de Samosate :
« Quant à ses sœurs spirituelles (sous- introduites), comme les appellent les habitants d'Antioche, à celles des prêtres et des diacres qui sont autour de lui... »,...
,… « ... et nous n'ignorons pas combien [de clercs] tombèrent pour avoir introduit des femmes auprès d'eux... » – NICEPHORI CALLISTI eccl. hist., VI, 30. – D. HIERON. ; Ad Eustochium de custodia virginitatis, Epist. XXII, c. 5; t. I, p. 143, b. Pudet dicere, pro nefas : triste, sed verum est : Unde in ecclesias Agapetarum pestis introiit ? unde sine nuptiis aliud nomen uxorum ? Immo unde concubinarum genus ? Plus inferam. Unde meretrices univirae ? Eadem domo, uno cubiculo, saepe une, tenentur et lectulo : et suspiciosos nos vocant, si aliquid extimenus. Frater sororem virginem deserit, coelibem spernit virgo germanum, fratrem quaerit extraneum ; et cum in eodem proposito esse se simulent, quaerunt alienorum spiritale solatium, ut demi habeant carnale commercium.
[FN: § 1394-2]
D. IOANN. CHRYSOST. ; ![]() . L'interprète paraphrase : adversus eos qui apud se fovent sorores adoptivas, quas subintroductas vocant.
. L'interprète paraphrase : adversus eos qui apud se fovent sorores adoptivas, quas subintroductas vocant.
[FN: § 1394-3]
[FN: § 1394-4]
[FN: § 1394-5]
![]() . – Adversus eas qui vires introductitios habent (Savil.).
. – Adversus eas qui vires introductitios habent (Savil.).
[FN: § 1394-6]
Il suffira de donner la traduction latine de ce passage : (3) Obstetricis enim ars et sapientia hoc solum potest videre, an congressum viri corpus tulerit : an liberum, et adulterium ex osculis et corruptionum amplexibus effugerit, dies illa tunc declarabit, quando verus Dei sermo, qui occulta hominis in medium adducit, et praesens nunc his quae clam fiunt, omnia et exuta ante omnium oculos ponet : tunc sciemus bene an ab his sit purum, et undequaque incorruptum corpus (§ 1392-2].
[FN: § 1395-1]
Voir DU CANGE ; Gloss. ad. scrip. m. et inf. latinitatis, s. v. Subintroductae. – Du CANGE ; Gloss. ad scrip, m. et inf. graecitatis, s. v. ![]() .
.
[FN: § 1395-2]
En plusieurs pays, la moralité du clergé est aujourd'hui meilleure qu'elle ne l'a jamais été par le passé ; mais cela est dû au choix que l'on fait, en refusant les candidats qui ne donnent pas de sérieuses garanties de leur vocation.
Notes du Chapitre IX. – Les dérivations (§1397 à §1542), vol. 2, pp. 785-886 ↩
[FN: § 1397-1]
BENTHAM-DUMONT; Tact. des assembl. législ., Traité des sophismes politiques, t. II. L'auteur blâme l'orateur politique qui fait usage de raisonnements sophistiques, et ajoute: « (p. 129) Heureusement toutefois un orateur de ce caractère, de quelque talent qu'il brille, ne figurera jamais en première ligne dans une assemblée ; il peut éblouir, il peut surprendre, il peut avoir un succès passager, mais il n'inspire aucune confiance, même à ceux qu'il défend ; et plus on a l'expérience des assemblées politiques, plus on sent combien Cicéron est fondé à définir l'orateur : un homme de bien versé dans l'art de la parole : Vir bonus dicendi peritus ». Si, comme il le semble, tout cela tend à affirmer que seul l'orateur sincère, loyal, honnête, obtient du succès, on a une proposition mille fois démentie par l'expérience, et l'exemple même de Cicéron, donné par l'auteur, peut être cité à ce propos. Dans une note, Fox est vivement loué, justement pour les qualités indiquées, que doit avoir l'orateur ; et comme il est incontestable qu'il arriva à Fox d'avoir le dessous au parlement anglais, voilà un nouvel exemple qui dément l'affirmation. Après cela, si cette affirmation vise l'estime que certaines personnes, appelées les honnêtes gens, peuvent avoir pour un orateur, cela peut être vrai ou non, suivant le sens que l'on donne à ce terme honnêtes gens. En outre, on dévierait de la question, qui était le succès politique. Ailleurs Bentham blâme ceux qui luttent contre les ministres en s'opposant à des mesures dont eux-mêmes reconnaissent l'innocuité, et qui s'excusent en disant qu'ils font cela pour faire tomber du pouvoir des personnes qu'ils tiennent pour nuisibles au pays. « (p. 213) Si ceux que vous combattez sont tels que vous les supposez, ils ne tarderont pas à vous fournir des occasions de les combattre sans aucun préjudice de votre sincérité. Si ces occasions légitimes vous manquent, l'imputation d'incapacité ou de malversation paraît être ou fausse ou prématurée. Si, parmi ces mesures, il en est plus de mauvaises que de bonnes, l'opinion publique doit tourner nécessairement en votre faveur [qu'elle est belle, mais éloignée de la réalité, cette opinion publique !] Car on ne saurait douter qu'une mauvaise mesure ne soit beaucoup plus facile à attaquer qu'une bonne ». C'est peut-être vrai dans un monde idéal, où tout est pour le mieux ; mais cela ne semble vraiment pas être vérifié par l'expérience, dans notre monde réel. Bentham écrit un traité entier sur les sophismes politiques, et ne s'aperçoit pas qu'à chaque instant, involontairement il emploie celui qui consiste à donner l'expression de ses sentiments et de ses désirs pour le fruit de l'expérience. On nous dit, dans l'introduction: « (p. 3) Les sophismes fournissent une présomption légitime contre ceux qui s'en servent. Ce n'est qu'à défaut de bons arguments qu'on peut avoir recours à ceux-là ». Ici, il y a cette proposition implicite, que les arguments de bonne logique persuadent mieux les hommes que les arguments sophistiques. Or l'expérience est bien loin de confirmer cette proposition. « Par rapport à de bonnes mesures ils sont inutiles : du moins, ils ne peuvent pas être nécessaires ». Là aussi, la proposition indiquée tout à l'heure est, implicite, et là aussi on peut observer que l'expérience ne concorde nullement avec cette affirmation. « Ils supposent de la part de ceux qui les emploient ou qui les adoptent, un défaut de sincérité ou un défaut d'intelligence ». Ici est implicite la proposition suivant laquelle celui qui emploie un sophisme s'en rend compte (défaut de sincérité), ou s'il ne s'en rend pas compte, c'est parce qu'il manque d'intelligence. Au contraire, un grand nombre de sophismes qui ont cours dans une société sont répétés avec une parfaite sincérité par des hommes très intelligents, qui expriment de cette façon des sentiments qu'ils estiment utiles à la société. Il y a, une autre proposition implicite suggérée par l'affirmation de notre auteur : c'est que le défaut de sincérité ou le défaut d'intelligence sont toujours nuisibles à la société. Bien au contraire, il y a un grand nombre de cas, ne serait-ce que dans la diplomatie, où trop de sincérité peut nuire, et d'autres dans lesquels l'homme très intelligent qui se trompe de route peut, en imposant certaines actions logiques, être nuisible à la société, à laquelle est au contraire utile l'ignorant qui continue à accomplir des actions non-logiques conseillées par une longue expérience.
[FN: § 1407-1]
ARIST., Reth., II, 21, 6 : ![]() .
.
[FN: § 1408-1]
ARIST. ; Rhet., 1, 2, 7.
[FN: § 1408-2]
ARIST. ; Rhet., II, 21, 3.
[FN: § 1409-1]
ARIST. ; Rhet., I, 2, 7.
[FN: § 1410-1]
MILL ; Logique, V, 1, 3.
[FN: § 1415-1]
BAYLE ; Dict. hist., 1, s. r. Augustin, p. 393: « Il est si manifeste à tout homme qui examine les choses sans préjugé, et avec les lumières nécessaires, que la doctrine de St. Augustin et celle de Jansenius Évêque d'Ipres sont une seule et même doctrine, qu'on ne peut voir sans indignation que la Cour de Rome se soit vantée d'avoir condamné Jansenius, et d'avoir néanmoins conservé à Saint Augustin toute sa gloire. Ce sont deux choses tout-à-fait incompatibles. Bien plus : le Concile de Trente, en condamnant la doctrine de Calvin sur le franc arbitre, a nécessairement condamné celle de Saint Augustin... » « ... Il y a des gens, pour qui c'est un grand bonheur, que le peuple ne se soucie point de se faire rendre compte sur la doctrine, et qu'il n'en soit pas même capable. Il se mutineroit plus souvent contre les Docteurs, que contre les Maltotiers. Si vous ne connoissez pas, leur diroit-on, que vous nous trompez, votre stupidité mérite qu'on vous envoie labourer la terre ; et si vous le connoissez, votre méchanceté mérite qu'on vous mette entre quatre murailles au pain et à l'eau. » Bayle se trompe. On peut êre très intelligent et accepter de bonne foi des dérivations contradictoires. Cela a lieu tous les jours, par exemple à propos du « libre arbitre ». Puis Bayle ajoute avec raison : « Mais on n'a rien à craindre : les peuples ne demandent qu'à être menez selon le train accoutumé ; et, s'ils en demandoient davantage, ils ne seroient pas capables d'entrer en discussion : leurs affaires ne leur ont pas permis d'acquérir une aussi, grande capacité ».
[FN: § 1416-1]
C'est là un cas particulier de la théorie générale de l'action réciproque des résidus et des dérivations, action dont nous parlerons aux § 1735 et sv.
[FN: § 1425-1]
SENEC., Epist., XCIV traite de l'utilité des préceptes. Nous n'avons pas à en parler ici ; mais une partie de ses observations s'applique à la nature et aux effets des affirmations. Adiice nunc, quod aperta quoque apertiora fieri solent. « Ajoutez que les choses évidentes deviennent encore plus évidentes ». On lui objecte que si les préceptes sont douteux, on devra les démontrer, et que par conséquent c'est la démonstration et non le précepte qui sera utile. Il répond : Quid quod, etiam sine probationibus, ipsa monentis auctoritas prodest ? sic quomodo iurisconsultorum valent responsa, etiam si ratio non redditur. Praeterea ipsa, quae praecipiuntur, per se multum habent ponderis, utique si aut carmini intexta sunt, aut prosa oratione in sententiam coarctata ; sicut illa Catoniana : « Emas, non quod opus est, sed quod necesse est. Quod non opus est, asse carum est ». Qualia saut illa, aut reddita oraculo, aut similia : « Tempori parce ! Te nosci ! » Numquid rationem exiges, cum tibi aliquis hos dixerit versus :
Iniuriarum remedium est oblivio.
Audentes fortuna iuvat.
Piger ipse sibi obstat.
Advocatum ista non quaerunt ; affectus ipsos tangunt, et natura vim suam exercente proficiunt. Omnium honestarum rerum semina animi gerunt, quae admonitione excitantur ; non aliter quam scintilla, flatu levi adiuta, ignem suum explicat. Il est nécessaire de modifier quelque peu cette dernière partie. Sénèque dit : « Ces choses ne demandent pas d'avocat ; elles agissent sur les sentiments mêmes, et produisent un effet utile par leur propre force naturelle. Dans l'esprit se trouvent les germes de toute chose honnête, germes que l'avertissement développe tout comme une étincelle, aidée par un souffle léger, communique son feu ». On doit dire au contraire : « Ces choses ne demandent pas d'avocat ; elles agissent sur les sentiments mêmes, et produisent un effet utile, par leur propre force naturelle. Dans l'esprit se trouvent les germes de certaines choses ; les affirmations les développent, tout comme une étincelle, etc. ». Sénèque ajoute ensuite : Praeterea quaedam sunt quidem in animo, sed parum prompta ; quae incipiunt in expedito esse, cum dicta sunt. Quaedam diversis locis iacent sparsa, quae contrahere inexercitata mens non potest. Itaque in unum couferenda sunt et iungenda, ut plus valeant, animumque magis allevent. « En outre, certaines choses se trouvent dans l'esprit, mais sont informes ; elles prennent forme quand on les dit. Certaines choses gisent éparses en divers lieux ; un esprit inexpérimenté ne peut les rassembler. C'est pourquoi il faut les rassembler et les unir, pour qu'elles aient plus de valeur et qu'elles profitent davantage à l'esprit ». C'est bien cela, et les effets des affirmations sont bien décrits.
[FN: § 1426-1]
Par exemple, Levit., XTX, 3 : ![]()
![]() . (Vulgata) Unusquisque patrem suum, et matrem suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.
. (Vulgata) Unusquisque patrem suum, et matrem suam timeat. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.
NOTE DU TRADUCTEUR.] LAO-TSEU ; Le livre de la Voie et de la Vertu : « (Chap. XXI, p. 75). Voici quelle est la nature du Tao [Vérité, Voie, Absolu, etc.]. Il est vague, il est confus. Qu'il est confus, qu'il est vague ! Au dedans de lui il y a des images. Qu'il est vague, qu’il est confus ! Au dedans de lui il y a des êtres. Qu'il est profond, qu'il est obscur ! » – La poésie donne toutes sortes de formes à cette affirmation de renfort. La ballade notamment fournit de nombreux exemples dans le refrain de ses couplets. Ainsi la Ballade que feit Villon à la requeste de sa mère pour prier Nostre Dame : « En ceste foy je vueil vivre et mourir ». Cependant tous les refrains de ballade ne sont pas de simples affirmations de renfort. Ainsi, dans la Ballade des dames du temps jadis : « Mais où sont les neiges d'antan ? », le refrain n'est pas une affirmation indépendante de l'enchaînement logique des idées exprimées par le contexte ; c'est plutôt une conclusion répétée et en vue de laquelle sont faits les couplets.
[FN: § 1431-1]
Journal des Goncourt, 2e série, 2d vol., tome V, 1872-1877, p. 9 : « Aujourd'hui, chez le français, le journal a remplacé le catéchisme. Un premier Paris de Machin ou de Chose devient un article de foi, que l'abonné accepte avec la même absence de libre examen que chez le catholique d'autrefois trouvait le mystère de la Trinité [sic] ».
[FN: § 1435-1]
BENTHAM-DUMONT, loc. cit., § 1397-1 émet une opinion entièrement erronée. « (p. 23) C'est par l'autorité que se soutiennent depuis tant de siècles les systèmes les plus discordans, les opinions les plus monstrueuses [ces opinions se soutiennent grâce aux résidus, et sont expliquées au moyen des dérivations, parmi lesquelles se trouve celle de l'autorité]. Les religions (p. 24) des Brames, de Foë, de Mahomet, n'ont pas d'autre appui [ce n'est pas du tout cela ; l'autorité n'est qu'une des nombreuses dérivations employées pour expliquer ces persistances d'agrégats]. Si l'autorité a une force imprescriptible, le genre humain, dans ces vastes contrées, n'a pas l'espoir de sortir jamais des ténèbres ». Là, il y a d'abord l'erreur habituelle de supposer logiques toutes les actions humaines, et d'admettre que les croyances sont imposées par le raisonnement, tandis qu'elles sont au contraire dictées par le sentiment. Ensuite, il est implicitement établi une opposition entre la religion du Progrès, acceptée par l'auteur, et la « superstition » de l'autorité, superstition qu'il combat. Accepter cette dernière signifierait renoncer à toute espérance de progrès pour les peuples indiqués par l'auteur ; et comme on ne peut renoncer à cette espérance, on doit repousser la superstition. Ainsi, comme d'habitude, on confond l'utilité d'une doctrine et son accord avec les faits expérimentaux.
[FN: § 1435-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] On trouve un mélange de cette considération logico-expérimentale avec d'autres considérations logiques et le résidu de la vénération, dans la fameuse loi des citations, en droit romain ; loi par laquelle les empereurs Théodose II et Valentinien III graduèrent l'autorité des jurisconsultes les plus éminents. On trouve un mélange semblable dans la doctrine théologique des opinions probables. entre lesquelles elle est expérimentalement valide (§ 1881-1). En tout temps on a pu répéter : Sutor, ne ultra crepidam.
[FN: § 1436-1]
C'étaient là en grande partie des actions logiques, parce qu'on croyait alors que M. Roosevelt serait de nouveau président des États-Unis, et l'on avait en vue d'obtenir de lui quelques avantages. En opposition avec ces flatteries, il convient de rappeler que le pape ne reçut pas M. Roosevelt; qu'un patricien gênois lui refusa l'accès de son palais, et que Maximilien Harden écrivit un article où il tournait en dérision les adulateurs de M. Roosevelt en Allemagne.
[FN: § 1436-2]
ANDREW LANG; La Jeanne d'Arc de M. Anatole France. Le chapitre IX a pour titre : La forêt des erreurs. A. France affirmait que « (p. 94) l'impôt prélevé... sur le peuple de Domrémy ne montait pas à moins de deux-cent-vingt écus d'or », Lang démontra, antérieurement à la publication de son livre, que « pour que vraiment l'impôt atteignît une telle somme, nous aurions à supposer que la population de Domrémy égalait au moins celle d'Orléans ». Et il ajoute : « J'avais déjà signalé l'erreur : elle est restée intacte dans l'édition „ corrigée “. (p. 95) Obstinément, M. France maintient qu'une certaine jeune femme, dont le fils était le filleul de Jeanne, „ blasonnait celle-ci à cause de sa dévotion “ : de quoi il nous donne pour preuve le témoignage de cette femme. Or il n'y a pas un mot de cela dans le témoignage qu'il invoque ; et je ne suis pas le seul à le lui avoir rappelé. C'est ainsi qu'il va, „ puisant aux meilleures sources “, suivant l'expression de sa nouvelle préface, et les interprétant „ avec la sagacité critique d'un véritable érudit “, à en croire le bienveillant M. Gabriel Monod ». Lang relève aussi des erreurs de moindre importance, mais qui montrent que A. France en prenait un peu à son aise en écrivant son livre. « (p. 97) Dans un petit passage de l'écrit célèbre de Gerson, on pourrait dire que chaque phrase traduite est un contresens. Un vers proverbial de Caton : Arbitrii nostri non est quod quisque loquatur † devient chez M. France : „ Nos arbitres, ce n'est pas ce que chacun dit “. Gerson écrit, à propos des faux bruits qui courent sur la Pucelle : Si multi multa loquantur pro garrulitate sua et levitate, aut dolositate, aut alio sinistro favore vel odio... ; ce que M. France interprète ainsi : „ Si plusieurs apportent divers témoignages sur le caquet de Jeanne, sa légèreté, son astuce... “. Dans la phrase suivante, Gerson rappelle le mot de l'apôtre : Non oportet servum dei litigare ; et M. France traduit : „ On ne doit pas mettre en cause le serviteur de Dieu “». L'auteur cite une grave erreur d'A. France et ajoute : « (p. 102) Que M. France, en même temps qu'il découvrait dans le témoignage de Dunois certaines choses qui n'y étaient point, ait négligé de découvrir ailleurs que d'Aulon faisait partie du Conseil Royal, et avait été appelé par le roi, avec les autres conseillers, à examiner la première requête de Jeanne, c'est ce qui désormais doit nous paraître tout naturel. Mais que, après avoir été averti sur ce point par „ les louables scrupules de M. Andrew Lang “, il ait répété son invention dans son édition „ corrigée “ il y a là un procédé vraiment regrettable ».
Bien que S. REINACH se montre très favorable à A. France, il est obligé de reconnaître les erreurs de l'écrivain. Cultes, mythes et religions, t. IV: « p. 311) M. Lang, je veux le dire tout de suite, a souvent raison contre M. France, bien (p. 312) qu'il lui arrive d'attribuer beaucoup d'importance à des vétilles ». Plus loin, il reconnaît que, dans la 28e édition de son livre, A. France a maintenu des erreurs qui lui avaient été indiquées. « (p. 320) Malgré les améliorations ainsi apportées par l'auteur, l'ouvrage reste fort incorrect... Peut-être faut-il penser qu'il a divisé sa tâche, qu'il a employé ce qu'on appelle „ un nègre “ et que ce nègre, par malheur, n'était pas un bon nègre ».
† A. France ne s'est pas rappelé que dans les Dicta Calonis, si connus et admirés aux siècles passés, il est écrit, III. 2 :
Cum recte vivas, ne cures verba malorum :
Arbitrii non est nostri, quid quisque loquatur.
« Quand tu vis droitement, ne prends pas garde aux paroles des méchants : nous ne sommes pas maîtres de ce que chacun dit ».
[FN: § 1437-1]
MAIMBOURG ; Hist. de l'Arian., t. 1 (p. 17) Je sçay bien qu'on n'est pas toûjours obligé de croire ces sortes de choses qui sont si extraordinaires, et qu'on appelle visions, particulièrement quand elles n'ont pas pour garant quelque Auteur célèbre, dont le nom seul puisse servir de preuve authentique. Mais je n'ignore pas aussi que l'Histoire, en laissant la liberté d'en croire ce que l'on voudra, ne peut, sans un peu trop de délicatesse, et même sans quelque sorte de malignité, supprimer celles qui ont esté (p. 18.) receùës, depuis tant de siècles, par des gens qu'on ne sçauroit accuser de foiblesse, sans se ruiner de réputation ».
[FN: § 1438-2]
Loc. cit., § 1438, : (c. 5, 1) Non itaque pergo per plurima quae mandata sunt litteris [dérivation explicite d'autorité], non gesta atque transacta sed in locis quibusque manentia ; quo si quisquam ire voluerit et potuerit, utrum vera sint, explorabit, sed pauca commemoro. C'est là une dérivation implicite d'autorité. Dire que n'importe qui pouvait aller voir que ces faits étaient vrais, revient à dire que l'on croyait cette vérification possible ; mais, en réalité celui qui serait effectivement allé n'aurait pu voir des faits qui n'existaient pas.
[FN: § 1438-1]
D. AUG.; De civ. Dei, XXI, c. 2. D'abord, l'auteur affirme qu'il se placera dans le domaine expérimental : (3) Nolunt enim hoc ad Omnipotentis nos referre potentiam, sed aliquo exemplo persuadere sibi flagitant. « Car ils [les incrédules] ne veulent pas que nous rapportions cela à la puissance du Tout-Puissant, mais demandent qu'on les persuade par quelque exemple ». Et il se met en devoir de le faire. Mais les incrédules sont si obstinés et pervers, qu'ils veulent avoir les preuves de ses affirmations. « Si nous leur répondons qu'il y a des animaux certainement corruptibles, parce que mortels, et qui néanmoins vivent au milieu du feu, et qu'il se trouve aussi un genre de vers dans les fontaines chaudes dont personne ne peut impunément supporter la chaleur, tandis que non seulement ces vers y vivent sans en souffrir, mais qu'ils ne peuvent vivre ailleurs, ou bien ils [les incrédules] ne veulent pas nous croire, si nous ne sommes pas en mesure de leur faire voir ces choses [quels obstinés !] : ou bien, si nous pouvons les leur mettre sous les yeux ou en donner la preuve par des témoins dignes de foi, cela ne suffit pas à les arracher à leur incrédulité, et ils objectent que ces animaux ne vivent pas toujours et qu'ils vivent sans souffrir, dans cette chaleur... ». Si vraiment cette objection a été, faite au saint, il a raison de la repousser; mais reste à prouver le fait de ces animaux ! L'autorité vient à son secours : « (c. 4, l) Donc si, comme l'ont écrit des auteurs qui étudièrent plus curieusement la nature des animaux, la salamandre vit dans les flammes,... », et si l'âme peut souffrir sans périr, on conclut qu'en vérité les damnés peuvent souffrir éternellement dans le feu de la géhenne. On ajoute que Dieu peut bien donner à la chair la propriété de ne pas se consumer dans le feu puisqu'il a donné à la chair du paon la propriété de ne pas se corrompre. Là-dessus. le saint fit aussi une expérience ! Il mit de côté un morceau de la poitrine d'un paon cuit. Au bout d'un certain temps, tel que toute autre chair cuite aurait été putréfiée, ce morceau lui fut présenté, et son odorat ne fut en rien offusqué. Au bout de trente jours, le morceau de chair fut trouvé dans le même état ; de même après un an, seulement il était alors un peu sec et ratatiné : nisi quod aliquantum corpulentiae siccioris et contractioris fuit. Une autre merveille est celle du diamant, qui résiste au fer, au feu, à n'importe quelle force, excepté au sang de bouc. Quand on met un diamant auprès d'une magnétite, celle-ci n'attire plus le fer. Ensuite, l'auteur observe que les incrédules insistent et veulent connaître la raison des faits miraculeux qu'il affirme : (c. 5, 1) Verumtamen homines infideles, qui cum divina vel praeterita, vel future, miracula praedicamus, quae illis experienda non valemus ostendere, rationem a nobis earum flagitant rerum ; quam quoniam non possumus reddere (excedunt enim vires mentis humanae), existimant falsa esse quae dicimus : ipsi de tot mirabilibus rebus, quas vel yidere possumus, vel videmus, debent reddere rationem. Jusque là, le saint a raison. Ne pas connaître la cause d'un fait ne prouve rien contre sa réalité. Mais reste toujours à prouver directement le fait, et c'est en quoi Saint Augustin est en défaut. Presque tous les faits qu'il donne pour certains sont fantaisistes. 1° Le sel d'Agrigente, en Sicile, se dissout dans le feu comme dans l'eau ; dans l'eau, il crépite comme dans le feu : cum fuerit admotus igni, velut in aqua fluescere : cum vero ipsi aquae, velut in igne crepitare. PLINE. XXXI, 41, 2, diffère un peu : Agrigentinus ignium patiens, ex aqua exsilit. 2° Chez les Garamantes, il y a une fontaine dont les eaux sont si froides, de jour, qu'on ne peut les boire, si chaudes, de nuit, qu'on ne peut les toucher (PLIN.; V, 5, 6 : itemque Debris, afiaso fonte, a medio die ad mediam noctem aquis ferventibus, totidemque horis ad medium diem rigentibus). 3° En Épire, il y a une fontaine où, comme dans les autres fontaines, les torches allumées s'éteignent, mais où, contrairement à ce qui a lieu dans les autres fontaines, les torches s'allument si elles sont éteintes. (POMP. MELA, 11, 3 : PLIN., II, 106, 7 : LUCR., De rer. nat., VI, 880 et sv., veut expliquer un fait analogue). 4° L'asbeste est une pierre d'Arcadie, ainsi nommée, parce qu'une fois allumée. elle ne peut jamais plus s'éteindre (PLIN., XXXVII. 54, 7, dit seulement que c'est une pierre d'Arcadie : SOLIN., 13, ajoute : accensus semel, extingui nequit). 5° En Égypte, le bois d'un figuier ne flotte pas sur l'eau : il va au fond, et au bout d'un certain temps, il revient à la surface (PLIN., XIII, 14, 2). 6° Au pays de Sodome, il y a des fruits qui, lorsqu'ils semblent mûrs, s'évanouissent en fumée et en cendres si on les touche avec la bouche ou avec la main (SOLIN., 38 ; IOSEPH., De bello iud., IV. 8, 4 (27). 7° En Perse, il y a une pierre qui brûle si on la presse fortement avec la main. et qui, de ce fait. porte le nom de pyrite (PLIN., XXXVII, 73, 1). 8° En Perse aussi, il y a une pierre nommée sélénite, dont la blancheur intérieure augmente et diminue avec la lune (PLIN., XXXVII, 67, 1). 9° En Cappadoce, les cavales conçoivent des œuvres du vent, mais leurs poulains ne vivent pas plus de trois ans (§ 927-3). 10° L'île de Tilo, aux Indes, est préférée à toutes les autres, parce que les arbres n'y perdent pas leurs feuilles. Ce dernier fait est le seul qui ait une lointaine apparence de réalité, pourvu qu'on ne l'applique pas à une île, mais à toute la région tropicale.
[FN: § 1438-3]
Loc. cit. § 1438-1, XXI, c. 6, 1 : « À cela, ils répondront peut-être sans autre que ces choses [celles dont il est question au § 1438-1] n'existent pas ; qu'ils n'y croient pas, qu'on en parle et qu'on en écrit faussement, et, ayant recours au raisonnement, ils ajouteront que s'il faut croire ces choses, vous devez, vous aussi, croire ce qui est rapporté dans les mêmes ouvrages, c'est-à-dire qu'il y a eu ou qu'il y a un certain temple de Vénus, où existe un candélabre avec une lampe à ciel ouvert, qu'aucune tempête, aucune pluie ne peuvent éteindre ». Ainsi, on voulait placer Saint Augustin dans l'alternative, ou de nier cela, et par conséquent de refuser créance aux témoignages dont il se prévalait pour les autres faits, ou d'admettre l'existence des dieux du paganisme. Mais il s’en tire en observant qu'il n'est pas obligé de croire tout ce qui se trouve dans les histoires des païens – non habemus necesse omnia credere quae continet historia gentium – parce que, comme le dit Varron, sur de nombreux faits, ils ne sont pas d'accord. Nous croyons, dit-il, à ceux sur lesquels ils ne sont pas en désaccord – quae non adversantur libris – et que nous pouvons prouver par de bons témoins. Pourtant, ces témoins, il ne les nomme pas, de même que les fidèles de la Sainte Science ne les nomment pas, quand ils affirment que tous les hommes sont égaux ou solidaires. Puis Saint Augustin reprend l'offensive. À la lampe de Vénus, il ajoute tous les miracles de la magie, lesquels on ne saurait nier sans aller à l'encontre des Saintes Écritures : « Donc, ou bien cette lumière est machinée par l'art humain, avec l’asbeste, ou bien ce qu'on voit dans le temple est l'œuvre de la magie, ou bien, sous le nom de Vénus, un démon s'est manifesté avec tant d'efficace, que ce prodige est apparu à tous les hommes et a duré ». Il conclut (c. 6, 2) que si les magiciens ont tant de pouvoir, on doit à plus forte raison croire que Dieu, qui est tellement plus puissant qu'eux, peut faire bien d'autres miracles : – quanto magis Deus potens est facere quae infidelibus sunt incredibilia, sed illius facilia potestati ; quandoquidem ipse lapidum aliarumque vim rerum et hominum ingenia, qui es miris utuntur modis, angelicasque naturas omnibus terrenis potentiores animantibus condidit. – Il faut observer ici le raisonnement en cercle, qui manque rarement aux dérivations concrètes du genre de celles de Saint Augustin. Opposer les Saintes Écritures à qui en nie l'autorité, les miracles du démon Vénus à qui nie les miracles, la puissance du Dieu des chrétiens à qui nie l'existence de ce Dieu, c'est proprement prendre la conclusion pour les prémisses.
[FN: § 1438-4]
Loc. cit. § 1438-1 : (c. 7, 2) Nam nec ego volo temere credi cuncta quae posui, quia nec a me ipso ita creduntur tanquam nulla de illis sit in mea cogitatione dubitatio, exceptis his quae vel ipse sum expertus, et cuivis facile est experiri. Excellente intention, à laquelle malheureusement l'auteur ne reste guère fidèle. Outre des faits en partie vrais, il excepte justement deux des récits les moins croyables : celui de la fontaine d'Épire où s'allument les torches, et celui des fruits du pays de Sodome. Il avoue n'avoir pas connu de témoins oculaires de la fontaine d'Épire, mais il en a connu qui avaient vu une fontaine semblable à Gratianopolis (Grenoble). « Quant aux fruits des arbres de Sodome, non seulement des lettres dignes de foi en ont fait mention, mais de plus, ceux qui en parlent pour les avoir vus sont si nombreux que je ne puis douter du fait – ut hinc dubitare non possim ». Remarquez cette façon de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre, procédé habituel en beaucoup de ces dérivations, et qui naît du besoin d'agir sur le sentiment, sans se soucier des contradictions qui apparaîtraient dans un raisonnement logico-expérimental. Saint Augustin commence par nous donner pour certaines les merveilles qu'il a racontées ; il dit même que quiconque veut peut les voir. Il appelle aussi comme témoins du fait du diamant les joailliers de son pays, puis, quand l'effet désiré est produit, il émet quelque doute, pour ménager la chèvre et le chou. De même, les admirateurs de la solidarité commencent par invoquer la solidarité-fait, et quand ils s'en sont bien servis, ils daignent reconnaître qu'elle est l'opposé de la solidarité-devoir (§ 450-1).
[FN: § 1439-1]
LUC.; Philopseudes. L'incrédule Tykhiadès dit ironiquement : « Oh, comment ne pas croire, dis-je à Eucratès fils de Dinon, homme d'un si grand âge, et qui, en sa maison, parle avec autorité de ce qui lui plaît ? » Plus loin : « Comme Arignôtos, qui était un savant célèbre et inspiré, avait dit cela, il n'y eut personne de la compagnie qui ne me traitât de fou, parce que je ne croyais pas à ces choses, dites par un Arignôtos. Mais moi, sans respect pour sa grande chevelure ni sa grande renommée : „ Et comment, Arignôtos, lui dis-je, toi aussi tu es un homme qui fais espérer la vérité, et puis tu donnes de la fumée et de vaines apparences ? Tu confirmes le proverbe : „ Nous cherchons un trésor et nous trouvons des charbons “. – „ Eh bien, répondit Arignôtos, si tu ne crois ni à mes paroles, ni à Dinomakos, ni à Kléodèmos, ni à Eukratès lui-même, eh bien cite un homme de plus grande autorité, qui dise le contraire de nous “. Et moi je répondis : „ Si, par Zeus, cet admirable homme de Démocrite d'Abdère “... ».
[FN: § 1439-2]
Après avoir cité une infinité d'exemples d'hommes devenus loups et redevenus hommes, Bodin s'étonne qu'on puisse douter d'une chose qui a pour elle le consentement universel. BODIN; De la démonomanie des sorciers, II, 6 : « (p. 99)... Nous lisons aussi en l'histoire de Ian Tritesme, que l'an neuf-cens LXX, il y auoit vn Iuif nommé Baian, fils de Simeon, qui se transformoit en loup, quand il vouloit, et se rendoit inuisible quand il vouloit. Or c'est chose bien estrange : Mais ie trouue encores plus estrange, que plusieurs ne le peuuent croire, veu que tous peuples de la terre, et toute l'antiquité en demeure d'accord. Car non seulement Herodote l'a escript il y a deux mil deux cens ans, et quatre cens ans au parauant Homere : ains aussi Pomponius Mela, Solin, Strabo, Dionysius Afer, Marc Varron, Virgile, Ouide, et infinis autres ». Le Père Le Brun veut se tenir dans un juste milieu entre la crédulité et l'incrédulité. Certes, on ne doit pas tout croire, «(p. 118) mais une obstination à ne croire, vient ordinairement d'un orgueil excessif qui porte à se mettre au-dessus des autorités les plus respectables et à préférer ses lumières à celles des plus grands hommes et des Philosophes les plus judicieux » (LE BRUN ; Hist. crit. des prat. superst., t. I). Dom Calmet, suivant ces principes, observe que « (p. 63) Plutarque dont on connoît la gravité et la sagesse, parle souvent de Spectres et d'apparitions, il dit par exemple que dans la fameuse bataille de Marathon contre les Perses, plusieurs soldats virent le phantome de Thésée qui combattoit pour les Grecs contre les ennemis » (DOM CALMET ; Dissert. sur les apparitions).
[FN: § 1440-1]
Collection A. Aulard. – Morale, par A. BAYET, Cours moyen. – Ce M. Aulard est le même qui reprochait à Taine de n'ètre pas assez rigoureux et précis. Il faut remarquer que la loi proposée à la Chambre, pour « la défense de l'école laïque » punit ceux qui ont l'audace de détourner les jeunes gens d'ajouter foi à de si belles doctrines.
[FN: § 1440-2]
Journal de Genève, 29 avril 1909 : « En collaboration avec plus de cent médecins de Suisse et de l'étranger [voilà l'autorité qui doit s'imposer à tout le monde] il a examiné 2051 familles. Sur la foi d'un matériel considérable, il a conclu ce qui suit : „ Lorsque le père est un buveur, la fille perd la faculté d'allaiter son enfant, et cette faculté est irrémédiablement perdue pour les générations suivantes il ne peut avoir connaissance du passé, mais peut-être connaît-il l'avenir par une somnambule]. De même chez les buveurs modérés (moins d'un litre de vin ou deux litres de bière par jour) l'alcoolisation du père est la cause principale de l'impuissance de la femme à allaiter ses enfants “ ». En Allemagne, les femmes qui peuvent allaiter doivent être bien rares, car peu nombreux sont les hommes des classes aisées qui ne boivent pas au moins deux litres de bière par jour. Comme d'habitude, les dérivations servent à démontrer aussi bien le pour que le contre. Quand on veut engager les mères à allaiter leurs bébés, le discours change, et la statistique complaisante démontre également bien que les mères ont ou qu'elles n'ont pas la faculté d'allaiter. – Journal de Genève, 27 octobre 1910 : « ... Mlle Louise-Hedwige Kettler, a fait plus de 1700 observations à la maternité et elle aboutit à d'intéressantes conclusions. Nous nous garderons d'entrer dans le détail. Qu'il nous suffise de dire que l'impossibilité absolue pour la mère de nourrir son enfant doit être considérée comme très rare, que le 93,42 % des femmes observées pendant ces trois dernières années étaient capables de remplir leurs devoirs, et que les raisons physiques empêchant l'allaitement sont en somme peu nombreuses. Que les mères y prennent garde, en recourant à l'alimentation artificielle elles risquent de créer une génération incapable d'allaiter ». Il suffit de connaître même très superficiellement Genève, pour être certain que le 93 % des femmes ne sont pas filles de parents qui ne boivent ni vin ni autres boissons alcooliques. Mais, dans la logique des dérivations, deux propositions contradictoires peuvent être vraies en même temps.
[FN: § 1441-1]
Le Journal de Genève rapporte en ces termes une conférence faite par un médecin de la ville : « Sérieusement documenté, et se basant sur les recherches de l'École de Heidelberg …, le Dr, Audéoud a démontré que la quantité d'alcool absolu contenu dans un demi-litre de vin ou deux litres de bière environ suffisait à faire diminuer de 25 à 40 % la capacité de travail cérébral. Cette déperdition est due à l'influence paralysante et stupéfiante de l'alcool, influence qui se fait sentir plusieurs jours encore après l'absorption du poison... Ce résultat est le fruit d'années entières de laborieuses expériences et scrupuleuses observations ».
[FN: § 1441-2]
BUSCH.; Les mém. de Bism., t. I, p. 43: « Il y avait sur la table du COGnac, du bordeaux et un petit vin mousseux de Mayence. Quelqu'un regretta qu'il n'y eût pas de bière. „ Il n'y a pas de mal ! “ s'écria M. de Bismarck. „ Une consommation excessive de bière est déplorable à tous les points de vue. Cela rend les hommes stupides, paresseux et propres à rien. C'est la bière qui est responsable de toutes les idioties démocratiques que l'on débite autour des tables de cabaret. Croyez-moi, un bon verre d'eau-de-vie vaut bien mieux ! “ » T. II, p. 307. Tombé du pouvoir, Bismarck se retire à Friedrichsruh. Il charge Busch d'y transporter ses effets : « „ Tenez “, fit-il, „ ce sont des cartes de géographie. Mettez les lettres entre les cartes et roulez le tout... Cela partira avec le reste dans le déménagement. J'ai près de 300 caisses ou malles et plus de 13 000 bouteilles de vin “. Il me raconta qu'il avait beaucoup de bon sherry qu'il avait acheté, quand il était riche... ». – PALAMENGHI-CRISPI ; Carteggi,.. di Francesco Crispi : « (p. 446) Ottone di Bismarck a Crispi. Friedrichisruh, le 7 janvier 1890. Cher ami et collègue, J'ai été vivement touché de la nouvelle preuve de Votre amitié en apprenant que Vous m'avez fait expédier une caisse de Votre excellent vin d'Italie, que j'apprécie d'autant plus que la qualité supérieure du vin de l'année dernière m'en fait anticiper les avantages. Les bons vins ne sont jamais sans influence sur la qualité de la politique du buveur ». Pauvre Bismarck, combien peu de capacité de « travail intellectuel » il devait avoir !
[FN: § 1442-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] L'argument d'autorité joue un grand rôle dans la vulgarisation de la science, laquelle dissimule souvent des visées pratiques ou de propagande. Voici ce qu'on raconte, sous l'autorité de la Science, à certaines populations, éclairées. La Terre vaudoise, journal agricole... 18 septembre 1915. Utilisons nos fruits (signé E. P.). « On peut dire que l'acide urique, résidu fatal de l'excès alimentaire des viandes, est le plus grand ennemi de l'humanité ; c'est lui qui engendre les arthritismes, les maladies de Bright, les néphrites, la goutte, les maladies du foie, le rhumatisme, l'alcoolisme, le cancer, les affections de l'estomac... Le sucre aliment devrait tuer l'alcool poison. Les mangeurs de fruits n'ont jamais soif. Dans lus fruits frais, les frugivores trouvent à la fois boisson et nourriture solide, satisfaisant ainsi les deux besoins de l'organisme ».
[FN: § 1447-1]
À ce genre appartiennent les 4e, 5e, 6e et 7e, dérivations de l'exemple suivant. Nous avons vu (§ 1266-5) qu'Ovide rapporte les usages suivis pour les purifications, aux fêtes Palilies. Il veut trouver leur « origine », les expliquer; c'est-à-dire qu'il cherche des dérivations, et il n'en trouve pas moins de sept (Fast., IV, 783-806). En peu de mots, elles sont les suivantes : « 1° Le feu purifie tout. 2° L'eau et le feu sont les principes contraires de toutes les choses. 3° Les principes de la vie sont dans ces éléments. 4° Le feu et l'eau rappellent Phaéton et le déluge de Deucalion. 5° Les bergers découvrirent le feu grâce à la pierre à feu. 6° Énée s'enfuit à travers les flammes, qui ne-le brûlèrent pas. 7° Un souvenir de la fondation de Rome, quand les cabanes où les Romains habitaient primitivement furent brûlées. Et Ovide préfère cette dernière explication. Les trois premières dérivations puisent leur force dans certains sentiments métaphysiques (genre III-epsilon) ; les quatre dernières, dans la tradition (genre II-β). Il est évident qu'on pourrait encore trouver d'autres dérivations analogues : c'est la partie variable du phénomène. Le besoin de purification (résidus V-γ) et l'instinct des combinaisons (résidus de la Ire classe) constituent la partie constante et de majeure importance, puisque c'est d'elle que la partie variable tire ensuite son origine. Notez que dans cette partie constante, le besoin de purification est un élément principal, tandis que les combinaisons en vue de le satisfaire sont subordonnées. Nous avons donc, dans l'ensemble : 1° les résidus, constitués par (a) des résidus principaux (purification), (b) des résidus secondaires (combinaisons) ; 2° les dérivations qui visent à expliquer cet ensemble de résidus, et qui sont en général destinées à « expliquer » les résidus (b).
[FN: § 1454-1]
L. GAUTIER ; Introd. à l'anc. Test. L'auteur a écrit un livre rempli de science et de critique historique. Dans la conclusion, il répond à ceux qui le blâment sur plusieurs points; t. II : « (p. 507) Enfin je veux relever encore une dernière phrase, qui revient avec insistance dans les polémiques actuelles : La critique, dit-on, „ attaque et ruine l'autorité des Écritures “. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il s'agit avant tout de s'entendre sur le sens du mot „ autorité “. S'il est question de l'autorité extérieure [euphémisme pour indiquer des propositions objectives] l'assertion ci-dessus est fondée ; mais si l'autorité en cause est du domaine intérieur [euphémisme pour indiquer des propositions subjectives ; de cette façon, on dissimule la pétition de principe que fait le croyant, en acceptant de la Bible ce qu'il y met lui-même, ce qui est déjà dans son esprit] et de l'ordre spirituel, on peut hardiment affirmer qu'elle n'est compromise en rien [très juste : une tautologie n'est jamais fausse]. Le tout c'est d'être au clair sur ce point fondamental : l'autorité en matière religieuse, c'est celle de Dieu, et sur le terrain plus spécial de la vérité évangélique, c'est celle du Christ [très juste ; mais il faut nous apprendre comment on parvient à connaître ces volontés ; si nous les connaissons par des critères qui nous sont extrinsèques, elles peuvent être indépendantes de nous ; si nous ne les connaissons que par des critères qui nous sont intrinsèques, nous baptisons notre volonté du nom de volonté divine]. Cette autorité s'exerce sur le cœur et sur la conscience, tout en faisant appel à l'ensemble de nos facultés, en vertu même de l'unité de notre être. Elle est au-dessus des discussions de l'ordre littéraire et historique ; elle ne saurait être ébranlée, ni consolidée, par des arguments purement intellectuels [très juste, mais seulement dans ce sens que les résidus sont indépendants de la logique ; resterait ensuite à démontrer que ces résidus sont divins ; et s'il y en avait de diaboliques, comme le veulent certains hérétiques ?]. Elle n'est point atteinte par le fait que, sur des questions d'authenticité et d'historicité, on aboutit à des solutions autres que les données traditionnelles ».
[FN: § 1456-1]
Il est vraiment singulier de voir l'importance que les « libres-penseurs », adorateurs de la déesse Science, donnent à cet argument. On comprend que pour qui croit à la mission divine de Jeanne d'Arc, chaque détail de sa vie soit de la plus haute importance ; de même pour qui en fait une sainte de la religion patriotique ; mais pour qui prétend cultiver uniquement la science expérimentale, le fait de Jeanne d'Arc est un fait historique semblable à tant d'autres, et les problèmes posés à propos des plus menus détails ont une importance minime.
[FN: § 1459-1]
Summ. Theol., Suppl., quaes., I, Sed attritionis principium est timor servilis,contritionis autem timor filialis.– Can. et dec. Conc.Tridentini, sessio XIV, c. IV : Contritio... animi dolor se detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero... Illam vero contritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione vel ex gehennae et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, declarat non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem, verum etiam donum Dei esse et Spiritus sancti impulsum,... quo poenitens adiutus viam sibi ad iustitiam parat. – GURY ; Casus consc., II : (p. 182) Albertus, peracta confessione, interrogatur a Confessario quonam motivo ad dolendum de peccatis moveatur. Respondet poenitens : «Doleo de peccatis, quia timeo ne Deus me puniat in hac vita aerumnis, vel morte subitanea, et post mortem aeternis cruciatibus. – Numquid, mi bone, ait Confessarius, eodem modo doluisti de peccatis in antecessum, quando ad confitendum accedebas ? » Affirmat Albertus. Quapropter iudicat Confessarius invalidas fuisse illius confessiones, utpote amore divino destitutas et solo timore peractas... Hinc : Quaer. 1° An attritio sufficiat ?... (p 183), 405, – R. ad Im Quaes. Attritio sufficit, nec requiritur contritio perfecta ad iustificationem in Sacramento Poenitentiae. – Menag., IV, p. 157 : « M. Boileau Despréaux était un jour chez feu M. le Premier Président à Basville. Il y avoit là des Casuistes qui soûtenoient hardiment qu'un certain Auteur connu, avoit eu raison de faire un livre exprès pour prouver que nous n'étions point obligez d'aimer Dieu, et que ceux qui soûtenoient le contraire, avoient tort et imposoient un joug insupportable au Chrétien, dont Dieu l'avoit affranchi par la nouvelle Loi. Comme la dispute sur ce sujet s'échauffoit, M. Despréaux qui avoit gardé jusqu'alors un profond silence : Ah ! la belle chose, s'écria-t-il en se levant, que ce sera au jour du dernier Jugement, lorsque notre Seigneur dira à ses Elûs : Venez, les bien-aimez de mon Pere, parce que vous ne m'avez jamais aimé de votre vie, que vous avez toûjours défendu de m'aimer, et que vous vous êtes toûjours fortement opposez à ces hérétiques, qui vouloient obliger les Chrétiens de m'aimer. Et vous au contraire, allez au Diable et en Enfer, vous les maudits de mon Pere, parce que vous m'avez aimé, de tout votre cœur, et que vous avez sollicité et pressé tout le monde de m'aimer .... ». – BOILEAU ; Épître, s. XII, Sur l'amour de Dieu.
[FN: § 1462-1]
TACIT. ; Germ., 14 : Si civitas in qua orti sunt longa pace et otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes quae tum bellum aliquod gerunt. – MICHAUD ; Hist. des Crois., t. I : « (p. 117) L'assurance de l'impunité, l'espoir d'un meilleur sort, l'amour même de la licence et l'envie de secouer les chaînes les plus sacrées, firent accourir la multitude sous les bannières de la croisade. (p. 119) L'ambition ne fut peut-être pas étrangère à leur dévouement pour la cause de Jésus-Christ. Si la religion promettait ses récompenses à ceux qui allaient combattre pour elle, la fortune leur promettait [aux chevaliers] aussi les richesses et les trônes de la terre. Ceux qui revenaient d'Orient parlaient avec enthousiasme des merveilles qu'ils avaient vues, des (p. 120) riches provinces qu'ils avaient traversées. On savait que deux ou trois cents pèlerins normands avaient conquis la Pouille et la Sicile sur les Sarrasins ». En note : « Robert-le-Frison, second fils des comtes de Flandre, ne pouvant avoir de part dans les biens de sa maison, dit à son père : „ Donnez-moi des hommes et des vaisseaux, et j'irai conquérir un état chez les Sarrasins d'Espagne “. Cette interpellation se rencontre souvent dans les romans du moyen-âge, expression fidèle des mœurs contemporaines : „ Beau sire, baillez-moi hommes suffisans, pour me faire téat ou royaume. – Beau fils, aurez ce que vous demandez “ ».
[FN: § 1463-1]
Gazette de Lausanne, 29 mars 1912 : « Du Figaro [sous la signature de ÉMILE DE SAINT-AUBAN]. Un instituteur, qui donne une claque à un morveux, paraît aujourd'hui un sauvage ; il a violé les droits du mioche et du citoyen : il pèche contre le type admis de civilisation ; il encourt un blâme plus sérieux que celui de ses collègues qui nie, en pleine école, la Patrie. Mais l'écraseur qui, au mépris du piéton négligeable, cultive le cent-quarante, ne commet qu'une peccadille ; on absout, ou peu s'en faut, l'auto dont les péchés ne sont mortels que pour les braves gens qu'ils tuent. J'ai noté l'exploit d'un terrible autobus qui zigzaguait comme un pochard, rue Notre-Dame-de-Victoires, et malmena deux gamins ; des passants se fâchèrent ; un monsieur s'étonna : „ Ce n'est pas la faute du wattman ! observa-t-il ; cet homme apprend à conduire ! ... “ L'autobus faisait ses études ! L'autobus jetait sa gourme ! On s'amusa de la réponse ; un souriant fait divers retint l'explication. Quel religieux souci de la vie humaine ! »
[FN: § 1463-2]
Le Parlement italien a le plus grand soin des intérêts des industriels et des trusts ;c'est pourquoi, en 1912, il approuva une loi qui supprime le peu de protection accordée jusqu'alors aux piétons contre les conducteurs et les propriétaires d'automobiles.
[FN: § 1470-1]
GOUSSET ; théol.dogmat., t. I p. 325 : « Toutes les nations ont conservé une idée plus ou moins distincte de l'unité de Dieu. „ Il faut, dit Bergier, ou que cette idée ait été gravée dans tous les esprits par le Créateur lui-même, ou que ce soit un reste de tradition qui remonte jusqu'à l'origine du genre humain, puisqu'on la trouve dans tous les temps aussi bien que dans tous les pays du monde “ (Dictionnaire de Théologie, art. Dieu) ». – Idem. Ibidem : « (p. 309) Les prophéties sont possibles... les juifs et les chrétiens ont toujours cru aux prophéties : les patriarches et les gentils ont eu la même croyance ; tous les peuples ont conservé quelque souvenir des prédictions qui annonçaient un Libérateur, qui a été l'attente des nations... Il faut donc admettre la possibilité des prophéties. Il en est des prophéties comme des miracles ; jamais les peuples ne se seraient accordés à les croire possibles, si cette croyance n'était fondée sur la tradition, sur l'expérience, et sur la raison ». – Idem, Ibidem, t. I : « (p. 342) La croyance de, l'immortalité de l'âme remonte jusqu'au premier âge du monde... l'immortalité de l'âme a toujours été un dogme fondamental de la religion chez les chrétiens, les hébreux et les patriarches. On trouve la même croyance chez les autres peuples, même chez les peuples les plus barbares... (p. 343) Et cette croyance s'est transmise aux peuples modernes : lorsque les voyageurs européens ont découvert l'Amérique et d'autres pays lointains, ils n'ont trouvé aucune nation qui frit privée de la notion d'un état à venir».
[FN: § 1470-2]
SEXT. EMP. : IX, Adv. phys., p. 565 (60) : ![]()
![]()
![]() . « Ceux donc qui estiment qu'il y a des dieux, s'efforcent de prouver leur affirmation par quatre raisons, dont l'une est le consentement de tous les hommes ». Il continue : « La seconde est d’ordre du monde ; la troisième est l'absurde dans lequel tombent ceux qui suppriment les dieux ; la quatrième et dernière, la réfutation de ceux qui soutiennent l'opinion contraire. (61) Et ils arguent de l'opinion commune que tous les hommes, Hellènes ou Barbares, estiment que les dieux existent... ». La seconde raison a pour fondement un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats). – PLAT. ; De leg., X, p. 886. Les preuves de l'existence des dieux sont : « D'abord, la terre, le soleil et toutes les étoiles, le bel ordre des saisons, la distinction des années et (les mois ; et puis, que tous, Hellènes et Barbares, estiment qu'il y a des dieux ». Il faut remarquer qu'en un grand nombre d'autres passages des œuvres attribuées à Platon, on trouve au contraire exprimé que l'opinion du plus grand nombre a peu ou point de valeur ; par exemple, dans Alcib., I, p. 110-111 ; Lach., p. 184 ; SOCRATE :
. « Ceux donc qui estiment qu'il y a des dieux, s'efforcent de prouver leur affirmation par quatre raisons, dont l'une est le consentement de tous les hommes ». Il continue : « La seconde est d’ordre du monde ; la troisième est l'absurde dans lequel tombent ceux qui suppriment les dieux ; la quatrième et dernière, la réfutation de ceux qui soutiennent l'opinion contraire. (61) Et ils arguent de l'opinion commune que tous les hommes, Hellènes ou Barbares, estiment que les dieux existent... ». La seconde raison a pour fondement un résidu de la IIe classe (Persistance des agrégats). – PLAT. ; De leg., X, p. 886. Les preuves de l'existence des dieux sont : « D'abord, la terre, le soleil et toutes les étoiles, le bel ordre des saisons, la distinction des années et (les mois ; et puis, que tous, Hellènes et Barbares, estiment qu'il y a des dieux ». Il faut remarquer qu'en un grand nombre d'autres passages des œuvres attribuées à Platon, on trouve au contraire exprimé que l'opinion du plus grand nombre a peu ou point de valeur ; par exemple, dans Alcib., I, p. 110-111 ; Lach., p. 184 ; SOCRATE : ![]()
![]() . «Car C'est par la science, je pense, et non par le nombre, qu'il convient de juger ce qui doit être correctement jugé ». – MELESIAS ; « Certainement »». – CICERON met dans la bouche de Balbus, De nat. deor., II, 2, 4 et sv., des arguments semblables à ceux des Lois. – ARTEMID. ; Oneicr., I, 8. Après avoir distingué la coutume générale de la coutume particulière, l'auteur dit :
. «Car C'est par la science, je pense, et non par le nombre, qu'il convient de juger ce qui doit être correctement jugé ». – MELESIAS ; « Certainement »». – CICERON met dans la bouche de Balbus, De nat. deor., II, 2, 4 et sv., des arguments semblables à ceux des Lois. – ARTEMID. ; Oneicr., I, 8. Après avoir distingué la coutume générale de la coutume particulière, l'auteur dit : ![]()
![]() « Voici des coutumes générales : vénérer et honorer les dieux, car aucune nation n'est athée, de même qu'aucune n'est sans gouvernement ». il met cette coutume sur le même pied que la suivante : élever ses enfants, aimer les femmes, être éveillé de jour et dormir la nuit, se nourrir, etc. – Saint Augustin est amusant : il écrit contre les donatistes, et s'imagine que le monde entier a son opinion sur l'efficacité du baptême. Cet éminent docteur ignorait que le plus grand nombre des hommes qui vivaient sur la terre ne soupçonnaient même pas l'existence de cette question théologique. – D. AUGUST. ; Epist., 89, 5 : Nisi forte quemquam prudentium permovebit, quod de baptismo solent dicere... cum et hinc teneat orbis terrarum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Johannes ait, etc.
« Voici des coutumes générales : vénérer et honorer les dieux, car aucune nation n'est athée, de même qu'aucune n'est sans gouvernement ». il met cette coutume sur le même pied que la suivante : élever ses enfants, aimer les femmes, être éveillé de jour et dormir la nuit, se nourrir, etc. – Saint Augustin est amusant : il écrit contre les donatistes, et s'imagine que le monde entier a son opinion sur l'efficacité du baptême. Cet éminent docteur ignorait que le plus grand nombre des hommes qui vivaient sur la terre ne soupçonnaient même pas l'existence de cette question théologique. – D. AUGUST. ; Epist., 89, 5 : Nisi forte quemquam prudentium permovebit, quod de baptismo solent dicere... cum et hinc teneat orbis terrarum evidentissimam et evangelicam veritatem, ubi Johannes ait, etc.
[FN: § 1470-3]
MAX. TYR. ; Dissert., XVII. Suivant PLUTARQ.; De plac. philosoph I, 6, 9, nous tenons de trois sources la notion du culte des dieux : des philosophes par la nature, des poètes par la poésie, du consentement des lois des cités.
[FN: § 1471-1]
Ce procédé est aujourd'hui encore d'un usage fréquent. Il y en a des exemples tant qu'on en veut. TOLSTOÏ ; Les quatre Évangiles. « (p. 10) J'ai trouvé de braves gens non dans une seule religion mais dans différentes, et chez tous la vie était basée sur la doctrine du Christ ». Reste à savoir ce que Tolstoï entend par le terme « braves gens ». S'il lui donne le sens qu'il a ordinairement, il ne peut ignorer qu'il y a des « braves gens » qui ne pensent pas du tout comme lui, et qui, par exemple, refusent de donner leur consentement à ses doctrines condamnant toutes les guerres, incitant à refuser de faire le service militaire, et voulant, sous prétexte de ne pas « résister au mal », qu'on laisse le champ libre aux malfaiteurs. Comme il prétend que ses idées ont pour fondement la doctrine du Christ, il devient évident qu'on ne peut affirmer que tous ceux qui portent le nom de « braves gens » vivent selon la doctrine du Christ. Il faut donc changer le sens de ce terme, si l'on veut conserver la proposition de Tolstoï. Pour qu'elle ait un sens, il faut qu'on nous donne la définition de cette catégorie qui porte le nom de « braves gens », et, en outre, il est nécessaire que cette définition soit indépendante de l'acceptation ou du rejet de cette doctrine ; parce que si l'on fait entrer dans la définition, d'une manière ou d'une autre, même implicitement, la condition que les « braves gens » sont ceux qui vivent selon la doctrine du Christ, telle que l'interprète Tolstoï, il est vrai qu'il ne sera pas difficile de démontrer que tous ceux qui rentrent dans la catégorie des « braves gens » vivent suivant cette doctrine ; mais il n'est pas moins vrai que ce sera là une simple tautologie. En réalité, Tolstoï et ses admirateurs ne se soucient pas de tout cela : chez eux, le sentiment supplée à l'observation des faits et à la logique. Ils ont certaines conceptions de ce qui leur paraît « bon ». D'une part, ils excluent naturellement de la catégorie des « braves gens » ceux qui ont des conceptions différentes, lesquelles leur paraissent nécessairement « mauvaises ». D'autre part, ils croient, ils s'imaginent tenir ces conceptions de la doctrine d'un homme qu'ils révèrent, aiment, admirent : tandis qu'en réalité ils façonnent cette doctrine suivant leurs propres conceptions. Dans le cas de Tolstoï et de ses adeptes, cet homme est le Christ ; mais ce pourrait être un autre, sans la moindre difficulté ; par exemple Bouddha, Mahomet, Socrate, etc. La proposition de Tolstoï signifie donc simplement : « J'appelle braves gens ceux qui suivent des doctrines où il me semble retrouver celle du Christ, telle qu'il me plait de l'imaginer ».
[FN: § 1471-2]
MAX. TYR. ; Diss., XVII, 5. Platon aussi s'en tire en injuriant ses adversaires. – PLAT.; De leg., X, p. 887. Il dit de ceux qui, niant les dieux, le mettent dans la nécessité d'en prouver l'existence, qu'on ne peut les tolérer et qu'il faut les haïr. Il est plein de colère contre eux ; pourtant il contient son indignation, et tâche d'amener la discussion sur ces individus corrompus par la volupté et privés d'intelligence : ![]() (p. 888). Parmi cette maudite engeance, il y a (p. 886) ceux qui disent que les astres ne sont pas divins, mais sont de la terre et de la pierre ! C'est là un bel exemple de la différence qui existe entre la connaissance des choses en elles-mêmes, qu'avait le divin Platon, et que conservent ses adeptes modernes, et la connaissance expérimentale des astronomes modernes. Les néo-hégéliens nous feraient une insigne faveur, s'ils nous apprenaient comment ils concilient l'absolu de leurs connaissances avec ces changements. Mais peut-être conservent-ils la conception de Platon, et admettent-ils que les astres sont des divinités ?
(p. 888). Parmi cette maudite engeance, il y a (p. 886) ceux qui disent que les astres ne sont pas divins, mais sont de la terre et de la pierre ! C'est là un bel exemple de la différence qui existe entre la connaissance des choses en elles-mêmes, qu'avait le divin Platon, et que conservent ses adeptes modernes, et la connaissance expérimentale des astronomes modernes. Les néo-hégéliens nous feraient une insigne faveur, s'ils nous apprenaient comment ils concilient l'absolu de leurs connaissances avec ces changements. Mais peut-être conservent-ils la conception de Platon, et admettent-ils que les astres sont des divinités ?
[FN: § 1471-3]
BAYLE, Cont. des pens. div. , t. 1, § XVIII, p. 65, cite le Père RAPIN, Comp. de Platon et dAristote, ch. dernier, n. 11, p. m. 425, qui dit ; « Ce consentement si général de tous les peuples, dont il ne s'est jamais trouvé aucun sans la creance d'un Dieu, est un instinct de la nature qui ne peut-être faux, estant si universel. Et ce seroit une sottise d'ecouter sur cela le sentiment de deux ou trois libertins tout au plus, qui ont nié la Divinité dans chaque siecle, pour vivre plus tranquillement dans le desordre ». Un peu plus haut il avait dit : « Cette verité... n'est contestée que par des esprits corrompus par la sensualité, la presomption et l'ignorance... Il n'y a rien de plus monstrueux dans la nature que l'atheisme : c'est un déreglement d'esprit conceu dans le libertinage : ce ne sera point un homme sage, reglé, raisonnable, qui s'avisera de douter de la Religion ». Dans le Journal de Genève, 11 juin 1913, on lit, à propos du prix décerné par l'Académie française à Romain Rolland : « L'adversaire le plus intraitable de M. Romain Rolland aurait été, dit-on, un académicien qui eut jadis une des intelligences les plus souples et les plus libres de son temps, et qui, en avançant en âge, est devenu à tel point sectaire qu'il ne voit plus dans Tolstoï qu'un malheureux ayant abouti à une faillite morale et digne, tout au plus, de pitié ». Nous sommes donc, enfermés dans le dilemme, ou d'accepter les raisonnements de Tolstoï, estimés cependant peu sensés par beaucoup de personnes, ou d'être déclarés sectaires. Mais pourquoi se trouve-t-il des gens pour employer cette artillerie de carton ? Évidemment parce qu'il y a des personnes qui la craignent comme si elle était sérieuse, et qui, entendant ses coups, dignes tout au plus de provoquer le rire, se tâtent les côtes pour savoir s'ils sont blessés.
[FN: § 1472-1]
CIC. ; De nat. deor., I, 23, 62. Gotta répond à Velleius qui avait donné le consentement général pour preuve de l'existence des dieux : Quod enim omnium gentium generumque hominibus ita viderelur, id satis magnum esse argumentum dixisti, cur esse Deos confiteremur. Quod cum leve per se, tum etiam falsum est. Primum enim unde notae tibi sunt opiniones nationum ? Equidem arbitror multas esse gentes sic immanite efferatas, ut apud eas nulla suspicio deorum sit. (63) Quid ? Diagoras, atheos qui dictus est, posteaque Theodorus, nonne aperte deorum naturam sustulerunt ? – DIOD. SIC., III, 9, affirme qu'une partie des Éthiopiens nient l'existence des dieux. – Dans ses notes à la traduction de DIODORE DE SICILE, MIOT observe à ce propos : « Les anciens étaient persuadés qu'il n'y avait, sur la surface de la terre, aucune nation qui fit profession d'athéisme : et c'est sur ce consentement unanime de tous les peuples, qu'une des principales preuves de l'existence de Dieu a toujours été établie ». Le livre a été publié en 1833 ! – En deux passages, STRABON cite des peuples sans religion : III, c. 4, 16, p. 164, 250. ![]() « Quelques-uns disent que les K. sont athées ». XVII, c. 2, 3, p. 822, 1177.
« Quelques-uns disent que les K. sont athées ». XVII, c. 2, 3, p. 822, 1177. ![]()
![]() . « Quelques [peuples] de la zone torride sont réputés athées ». Ces deux passages de Strabon ont été souvent cités par ceux qui voulaient contester la preuve de l'existence des dieux, trouvée dans le consentement universel ; mais cette objection a peu ou point de valeur. D'abord, il faut observer que Strabon s'exprime d'une manière dubitative :
. « Quelques [peuples] de la zone torride sont réputés athées ». Ces deux passages de Strabon ont été souvent cités par ceux qui voulaient contester la preuve de l'existence des dieux, trouvée dans le consentement universel ; mais cette objection a peu ou point de valeur. D'abord, il faut observer que Strabon s'exprime d'une manière dubitative : ![]() –
– ![]() ; et même s'il était tout à fait affirmatif, il resterait à savoir quelles sont ses sources. Ensuite, et c'est l'argument qui a le plus de poids, le défaut ou l'existence du consentement universel ne prouveraient également rien en cette matière.
; et même s'il était tout à fait affirmatif, il resterait à savoir quelles sont ses sources. Ensuite, et c'est l'argument qui a le plus de poids, le défaut ou l'existence du consentement universel ne prouveraient également rien en cette matière.
[FN: § 1475-1]
CIC., De nat. deor., emploie les deux procédés. Velleius dit :(I, 17,44) De quo autem omnium natura consentit, id verum esse necesse est. « Ce à quoi tout le monde consent naturellement est vrai nécessairement ». Cela pourrait suffire ; et puisqu'il a commencé par dire que tous les hommes ont la notion des dieux, il en résulte la conclusion que : Esse igitur Deos confitendum est. « Il faut donc reconnaître qu'il y a des dieux ». Mais Velleius n'est pas satisfait : il veut encore expliquer comment et pourquoi les hommes ont cette notion. Il loue Épicure d'avoir démontré l'existence des dieux par un moyen expérimental, opposé aux vains songes des autres philosophes : (I, 16, 43) Solus enim vidit primum esse Deos, quod in omnium animis eorum notionem impressisset ipsa natura. Notez qu'il exprimerait la même chose, en disant simplement que cette notion est dans tous les esprits ; mais il appelle à son aide madame Nature, parce que cette entité métaphysique confère de l'autorité au raisonnement. Cela ne suffit pas ; cette notion est même une prénotion : (I, 16, 43) Quae est enim gens, aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quamdam Deorum ? quam appellat ![]() Epicurus, id est, anteceptam animo rei quamdam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. De là, et grâce au principe d'après lequel ce qui est consacré par le consentement universel est vrai, Velleius déduit aussi que les dieux sont immortels et bienheureux. Il pourrait encore déduire bien des merveilles, s'il voulait : (I, 17, 45) Hanc igitur habemus, ut Deos beatos et immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem Deoram ipsorum dedit [on fait parler cette dame Nature comme on veut], eadem insculpsit in mentibus, ut eos aeternos et beatos haberemus. – Balbus répète (II, 4, 12) que « parmi tous les hommes de toutes les nations, il est admis qu'il existe des dieux, car c'est inné chez tout le monde, et presque imprimé dans l'esprit » ; il dit que l'existence des dieux est tout à fait évidente (II, 2, 4) et que personne ne la nie : (II, 5, 13) Quales sint, varium est : esse nemo negat ; cependant il se laisse entraîner à la démontrer, et observe : (II, 9, 23) Sed quoniam coepi sechs agere, atque initio dixeram : negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum, Deos esse : tamen id ipsum rationibus physicis confirniari volo. – Cotta remarque, et c'est une observation à répéter dans tous les cas semblables, que Balbus apporte tant de preuves nouvelles, parce qu'il voyait que sa démonstration était incertaine. (III, 4, 9) Sed quia non confidebas, tam esse id perspicuum, quam tu velis ; propterea multis argumentis Deos esse docere voluisti. Puis il nie carrément qu'il faille accepter l'opinion du plus grand nombre ou de tout le monde : (III, 4, 11) Placet igitur, tantas res opinione stultorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis ? Cet exemple est important, parce qu'il a une portée générale, et sert à un grand nombre d'autres cas semblables.
Epicurus, id est, anteceptam animo rei quamdam informationem, sine qua nec intelligi quidquam, nec quaeri, nec disputari potest. De là, et grâce au principe d'après lequel ce qui est consacré par le consentement universel est vrai, Velleius déduit aussi que les dieux sont immortels et bienheureux. Il pourrait encore déduire bien des merveilles, s'il voulait : (I, 17, 45) Hanc igitur habemus, ut Deos beatos et immortales putemus. Quae enim nobis natura informationem Deoram ipsorum dedit [on fait parler cette dame Nature comme on veut], eadem insculpsit in mentibus, ut eos aeternos et beatos haberemus. – Balbus répète (II, 4, 12) que « parmi tous les hommes de toutes les nations, il est admis qu'il existe des dieux, car c'est inné chez tout le monde, et presque imprimé dans l'esprit » ; il dit que l'existence des dieux est tout à fait évidente (II, 2, 4) et que personne ne la nie : (II, 5, 13) Quales sint, varium est : esse nemo negat ; cependant il se laisse entraîner à la démontrer, et observe : (II, 9, 23) Sed quoniam coepi sechs agere, atque initio dixeram : negaram enim hanc primam partem egere oratione, quod esset omnibus perspicuum, Deos esse : tamen id ipsum rationibus physicis confirniari volo. – Cotta remarque, et c'est une observation à répéter dans tous les cas semblables, que Balbus apporte tant de preuves nouvelles, parce qu'il voyait que sa démonstration était incertaine. (III, 4, 9) Sed quia non confidebas, tam esse id perspicuum, quam tu velis ; propterea multis argumentis Deos esse docere voluisti. Puis il nie carrément qu'il faille accepter l'opinion du plus grand nombre ou de tout le monde : (III, 4, 11) Placet igitur, tantas res opinione stultorum iudicari, vobis praesertim, qui illos insanos esse dicatis ? Cet exemple est important, parce qu'il a une portée générale, et sert à un grand nombre d'autres cas semblables.
[FN: § 1479-1]
Ici, nous envisageons exclusivement sous l'aspect des dérivations un cas particulier d'une théorie générale qui sera exposée plus loin (§ 1897 et sv.).
[FN: § 1481-1]
Les Européens sont souvent induits en erreur, et prennent le tabou pour une conséquence de l'intervention divine, tandis qu'au contraire, c'est celle-ci qui est la conséquence de celui-là. – DE RIENZI : Océanie, t. I : « (p. 53) Plus que tout autre habitant de la Polynésie, le Zeelandais est aveuglément soumis aux superstitions du tapou [tabou], et cela sans avoir conservé en aucune façon l'idée du principe de morale sur lequel cette pratique était fondée ». Il ne l'a pas conservée, parce qu'elle n'a jamais existé en lui. « Il croit seulement que le tapou est agréable à l'atoua (Dieu), et cela lui suffit comme motif déterminant [dérivation ajoutée au tabou] : en outre il est convaincu que tout objet, soit être vivant, soit matière inanimée, frappé d'un tapou par un prêtre, se trouve dès lors au pouvoir immédiat de la divinité, et par là même interdit à tout profane contact ». Là apparaît le préjugé religieux de l'Européen ; il parle d'un prêtre, et peu après nous apprend que tout chef peut imposer le tabou : « (p. 54) On sent bien que le tapou sera d'autant plus solennel et plus respectable qu'il émanera d'un personnage plus important. L'homme du peuple, sujet à tous les tapous des divers chefs de la tribu, n'a guère d'autre pouvoir que de se l'imposer à lui-même ». Puis : « (p. 54) Il est bien entendu que les chefs et les arikis, ou prêtres, savent toujours se concerter ensemble pour assurer aux tapous toute leur inviolabilité. D'ailleurs les chefs sont le plus souvent arikis eux-mêmes, ou du moins les arikis tiennent de très près aux chefs par les liens du sang ou des alliances ».
[FN: § 1482-1]
S. REINACH : Cultes, mythes et religions, t. I.
[FN: § 1483-1]
Collection A. Aulard. Morale, par A. BAYET, p. 57 : « Pour être heureux, il faut aimer tous les hommes. Mais avant tout il faut aimer ses parents ». Notez bien que c'est une morale laïque et scientifique, qu'on dit très supérieure à la morale religieuse ; et notez aussi que la morale de ce bon M. Aulard ne plagie jamais la morale biblique.
[FN: § 1484-1]
DE RIENZI ; Océanie, t. II : « (p. 89) L'abolition définitive de l'idolâtrie et du tabou fut... l'œuvre de Rio-Rio, fils et successeur du grand Tamea-Mea... (p. 40) L'abolition du tabou, cet antique symbole d'inviolabilité, demanda à Rio-Rio encore plus d'adresse. Il s'adressa d'abord au grand-prêtre... et il fut assez heureux pour le mettre dans son parti. Pour accomplir cette innovation, le tabou qui pesait sur les femmes fut frappé le premier. Le roi attendit un jour de grande fête, où les indigènes venaient en foule entourer le palais et assister au royal festin. Les nattes ayant été disposées, et les mets destinés aux hommes mis sur une natte, et ceux des femmes sur d'autres nattes, le roi arriva, choisit parmi ses aliments plusieurs mets interdits aux femmes, passa de leur côté, se mit à en manger et à leur en faire manger. Aussitôt le peuple de pousser des cris d'horreur et de crier : „ Tabou ! Tabou ! “ Mais Rio-Rio, ne tenant nul compte de leurs cris continua à manger. Les prêtres, prévenus par la foule, accoururent du moraï, et simulèrent d'abord une grande indignation. „ Voilà, en effet, dirent-ils une violation manifeste au tabou ; mais pourquoi les dieux offensés ne s'en vengent-ils pas eux-mêmes ?... Ce sont donc des dieux impuissants ou des faux dieux “. Venez, habitants d'Haouaï (s'écria le grand-prêtre), débarrassons-nous d'un culte incommode, absurde et barbare “. Et, armé d'un flambeau, il mit lui-même le feu au moraï principal ». Les missionnaires applaudissaient ; mais étaient-ils certains que leurs tabous à eux auraient mieux supporté l'épreuve ? – DRAPER ; Les conf. de la science et de la relig. Après les victoires d'Héraclée : « (p. 55) Quoique l'Empire romain eût relevé l'honneur de ses armes et reconquis son territoire, il y eut une chose qu'il ne put reconquérir. La foi religieuse était irréparablement perdue. Le magisme avait insulté le christianisme à la face du monde, en profanant ses sanctuaires – Bethléem, Gethsémani, le calvaire – en brûlant la sépulture du Christ... en enlevant, au milieu de cris de triomphe, la croix du Sauveur. Les miracles avaient autrefois abondé en Syrie, en Égypte, en Asie Mineure. Il s'en était fait dans les occasions les moins importantes et pour les objets les plus insignifiants ; et pourtant, dans ce moment suprême, aucun miracle ne s'était accompli ! Les populations chrétiennes de l'Orient furent remplies d'étonnement quand elles virent les sacrilèges des Perses, perpétrés avec impunité... Dans la terre classique du miracle, l'étonnement fut suivi de la consternation et la consternation s'éteignit dans le doute ».
[FN: § 1486-1]
BENTHAM-DUMONT : traités de lég. civ. et pén., t. I. Plus loin : « (p. 317) Il est absurde de raisonner sur le bonheur des hommes autrement que par leurs propres désirs et par leurs propres sensations : il est absurde de vouloir démontrer par des calculs, qu'un homme doit se trouver heureux, lorsqu'il se trouve malheureux... » Et pourtant c'est justement ce que fait l'auteur. – BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. II : « (p. 113) Chacun est le meilleur juge de la valeur de ses plaisirs et de ses peines ».
[FN: § 1488-1]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. I : « (p. 103)... il pourrait arriver que l'acte qui nous promet un plaisir actuel fût préjudiciable à ceux qui font partie de la société à laquelle nous appartenons : et ceux-ci, ayant éprouvé un dommage de notre part, se trouveraient portés par le sentiment seul de la conservation personnelle, à chercher les moyens de se venger de nous, en nous infligeant une somme de peine égale ou supérieure à la somme de plaisir que nous aurions goûtée ». Le sophisme gît dans la conséquence supposée : 1° il ne suffit pas d'être disposé à se venger ; il faut encore pouvoir. L'auteur ramène les deux choses à une seule. 2° Qui lui a dit que « la somme de peine » que peuvent infliger ceux que nous avons offensés, sera « égale ou supérieure » à la «somme de plaisir que nous aurions goûtée ? ». Que fait-il du cas où cette somme serait moindre ? 3° Et si quelqu'un disait : « Le plaisir présent que me procure l'acte que vous voulez me persuader de ne pas accomplir est, à mon avis, plus grand que la peine future et seulement probable qui en sera la conséquence ; donc, suivant votre principe même, il est absurde de vouloir m'en priver, en raisonnant sur mon bonheur autrement que par mes propres désirs et mes propres sensations ». Que pourrait opposer Bentham, sans tomber en contradiction avec lui-même ?
[FN: § 1488-2]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. I : « (p. 143) Timothée et Walter sont deux apprentis. Le premier est imprudent et étourdi ; l'autre est prudent et sage. Le premier se livre au vice de l'ivrognerie ; le second s'en abstient. Voyons maintenant les conséquences : 1° Sanction physique. Un mal de tête punit T. de chaque excès nouveau. Pour se refaire, il se met au lit jusqu'au lendemain ; sa constitution s'énerve par ce relâchement ; et, quand il retourne au travail, son ouvrage a cessé d'être pour lui une source de satisfaction ». Au contraire, W., dont la santé était faible, la fortifie ; il est heureux : « 2° Sanction sociale. T. a une sœur qui prend un vif intérêt à son bonheur. Elle lui fait d'abord des reproches, puis le néglige, puis l'abandonne. Elle était pour lui une source de bonheur. Cette source, il la perd ». Et s'il n'avait pas de sœur ? Et si, ayant une sœur, elle restait avec lui ? Et si c'était une de ces personnes qu'il vaut mieux perdre que trouver ? W. a, au contraire, un frère qui d'abord s'occupait peu de lui, et qui devient ensuite son meilleur ami. « (p. 1411) 30 Sanction populaire. T. était membre d'un club riche et respecté. Un jour il s'y rend en état d'ivresse ; il insulte le secrétaire, et est expulsé par un vote unanime. Les habitudes régulières de W. avaient attiré l'attention de son maître. Il dit un jour à son banquier : Ce jeune homme est fait pour quelque chose de plus élevé. Le banquier s'en (p. 145) souvient, et à la première occasion, il l’emploie dans sa maison. Son avancement est rapide : sa position devient de plus en plus brillante ; et des hommes riches et influents le consultent sur des affaires de la plus haute importance ». L'auteur devait vivre dans le pays de Cocagne, où tous ceux qui avaient une conduite régulière étaient récompenses de cette façon. « 4° Sanction légale ». T. est condamné à la déportation : W. devient magistrat. Bentham vivait vraiment dans un bien beau pays, où le vice était ainsi puni et la vertu récompensée. Il y a d'autres pays, où les choses ne vont pas si facilement ; « 5° Sanction religieuse ». T. craint la vie future. W. la considère avec des sentiments d'espérance et de paix.
[FN: § 1489-1]
BENTHAM-LAROCHE: Déontologie, t. I : « (p. 66) Nul doute qu'accidentellement la bonne renommée ne puisse tomber en partage à l'homme déméritant, et la mauvaise à l'homme méritant. Mais si ce funeste état de chose est possible, si on en est quelquefois témoin, il est rare qu'il dure longtemps ; cet argument, fût-il même plus vrai, sied mal à un moraliste... ». Donc, même s'il est vrai, il ne faut pas le dire. Cela peut être : mais il faut que Bentham choisisse son but. Veut-il faire un prêche ou exposer un théorème scientifique ?
[FN: § 1489-2]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. 1. Bowring, qui recueillit et publia les théories de Bentham, met à la fin du premier volume un essai sur le principe « du plus grand bonheur ». « Coup d'œil sur le principe de la maximisation du bonheur, son origine et son développement. (p. 355) Le docteur Priestley publia, en 1768, son Essai sur le Gouvernement. C'est dans cet ouvrage qu'il désigna en italiques, „ le plus grand bonheur du plus grand nombre “, comme le seul but juste et raisonnable d'un bon gouvernement ». On remarquera que les épithètes juste, raisonnable, bon gouvernement, nous font rentrer dans cette métaphysique dont Bentham avait cru s'échapper. « (p. 355) Cette formule laissait bien loin derrière elle tout ce qui l'avait précédé. Ce n'est pas seulement le bonheur qu'elle proclamait, mais encore sa diffusion ; elle l'associait à la majorité, au grand nombre ». Comment elle l'associait ! Elle le remplaçait ; puisque ce second principe, en de nombreux cas, s'oppose manifestement au premier. « (p. 379) Ce fut en 1882 dans son Projet de codification, que Bentham fit usage pour la première fois de cette formule „ Le plus grand bonheur du plus grand nombre “. Tout ce qui est proposé dans cet ouvrage y est subordonné à une nécessité fondamentale, „ le plus grand bonheur du plus grand nombre “ ». C'est très bien ; mais, dans ce cas, pourquoi vient-on nous dire que chaque homme est seul juge de son bonheur, ou bien : « (II, p. 16) Qu'on fasse retentir tant qu'on voudra des mots sonores et vides de sens, ils n'auront (p. 17) aucune action sur l'esprit de l'homme, rien ne saurait agir sur lui, si ce n'est l'appréhension du plaisir et de la peine » ? Pourtant, il semble que Bentham n'était pas entièrement satisfait de sa formule : « (I, p. 388) Bentham, dans les dernières années de sa vie, après avoir soumis à un examen plus approfondi cette formule : „ Le plus grand bonheur du plus grand nombre “, crut ne pas y trouver cette clarté et cette exactitude qui l'avaient d'abord recommandée à son attention... (p. 391) Bien que cette formule : „ Le plus grand bonheur du plus grand nombre “ ne satisfît pas Bentham, on peut douter cependant qu'il N ait réellement des raisons suffisantes pour la rejeter ».
[FN: § 1490-1]
BENTHAM-DUMONT ; Traité de lég. civ. et pén., t. I. Il avait dit d'abord « (p. 318) Quoi qu'il en soit, si l'esclavage étoit établi dans une telle proportion qu'il n'y eût qu'un seul esclave pour chaque maître, j'hésiterois peut-être, avant de prononcer, sur la balance entre l'avantage de l'un et le désavantage de l'autre. Il seroit possible qu'à tout prendre, la somme du bien, dans cet arrangement, fût presque égale à celle du mal. Ce n'est pas ainsi que les choses vont. Dès que l'esclavage est établi, il devient le lot du plus grand nombre... L'avantage est du côté d'un seul, les désavantages sont du côté de la multitude ». Au nom de ce principe, on devrait approuver l'anthropophagie du plus grand nombre, parce qu'elle ferait le malheur de peu de gens et le bonheur de beaucoup.
[FN: § 1490-2]
BENTHAM-DUMONT ; Traités de lég. civ. et pén., t. I. L'auteur proscrit le « principe arbitraire » de la sympathie ou de l'antipathie. Il blâme ceux qui invoquent (p. 11) la « conscience ou sens moral », le « sens commun ». En 1789, quand il publia son Introduction aux principes de la morale et de la législation, Bentham admettait les principes de sympathie et d'antipathie ; mais ensuite il changea d'avis et les exclut.
[FN: § 1491-1]
BENTHAM-LAROCHE ; Déontologie, t. II (Préface de BOWRING.) « (p. 3) Il n'y a, à proprement parler, que deux partis en morale ou en politique, de même (p. 4) qu'en religion. L'un pour, l'autre contre l'exercice illimité de la raison. Je l'avoue, j'appartiens au premier de ces partis ».
[FN: § 1492-1]
BENTHAM-LAROCHE : Déontologie, t. I, p. 20-22. – JOHN STUART MILL Logique, trad. PEISSE, 1. VI, c. 12, § 7. – Voir Manuel, I, 29, p. 56-57, pour une théorie de Spencer, qui tend à confondre le principe égoïste avec le principe altruiste.
[FN: § 1493-1]
B. DE SPINOZA ; Opera, Eth., IV, Prop. XVIII, Scholium : Si enim duo ex. gr. eiusdem prorsus naturae individua invicem iunguntur, individuum componunt singulo duplo potentius. Homini igitur nihil homine utilius ; nihil, inquam, homines praestantius ad suum esse conservandum optare possunt, quam quod omnes in omnibus ita conveniant... ex quibus sequitur, homines, qui Ratione gubernantur, hoc est homines, qui ex ductu Rationis suum utile quaerunt, nihil sibi appetere, quod reliquis hominibus non cupiant, atque adeo eosdem iustos, gidos, atque honestos esse.
[FN: § 1493-2]
B. DE SPINOZA : loc. cit. 1493-1 traduct. de CH.. APPUHN.
[FN: § 1493-3]
D'HOLBACH ; Syst. de la nat., t. II. Le vrai sens du système de la nature, c. IX : « (p. 436) Le but de l'homme de se conserver et de rendre son existence heureuse. L'expérience lui apprend que les autres lui sont nécessaires. Elle lui indique la façon de les faire concourir à ses desseins. Il voit ce qui est approuvé, et ce qui déplaît : ces expériences lui donnent l'idée du juste. La vertu comme le vice ne sont point fondés sur des conventions, mais sur les rapports qui sont entre les êtres de l'espèce humaine. Les devoirs des hommes entre eux dérivent de la nécessité d'employer les moyens qui tendent à la fin que leur nature se propose. C'est en concourant au bonheur d'autrui, que nous l'engageons à faire le nôtre ».
[FN: § 1494-1]
BURLAMAQUI : Élém.du dr. nat. I, c. VI : « (p. 322) La première remarque que l'on peut faire... c'est que l'observation exacte des lois naturelles est ordinairement accompagnée de plusieurs avantages très considérables, tels que sont la force et la santé du corps, la perfection et la tranquillité de l'esprit, l'amour et la bienveillance des autres hommes. Au contraire, la violation de ces mêmes lois est pour (p. 323) l'ordinaire suivie de plusieurs maux, comme le sont la faiblesse, les maladies, les préjugés les erreurs, le mépris et la haine des hommes. Cependant ces peines et ces récompenses naturelles ne paraissent pas suffisantes pour bien établir la sanction des lois naturelles ; car 1° les maux qui accompagnent ordinairement la violation des lois naturelles ne sont pas toujours assez considérables pour retenir les hommes dans le devoir. 2° Il arrive souvent que les gens de bien sont malheureux dans cette vie, et que les méchants jouissent tranquillement du fruit de leur crime. 3° Enfin il y a même des occasions où l'homme vertueux ne saurait s'acquitter de son devoir et satisfaire aux lois naturelles sans s'exposer au plus grand des maux naturels, je veux dire à la mort ». L'auteur démontre longuement l'immortalité de l’âme, la nécessité d'admettre que Dieu récompense les bons et punit les méchants ; il conclut : « (p. 327) Concluons donc que tout ce que nous connaissons de la nature de l'homme, de la nature de Dieu, et des vues qu'il s'est proposées en créant le genre humain [qui donc a révélé ces vues à notre auteur ?], concourt (p. 328) également à prouver la réalité des lois naturelles, leur sanction et la certitude d'une vie à venir, dans laquelle cette sanction se manifestera par des peines et des récompenses ».
[FN: § 1495-1]
NOVICOW ; La morale et l'intérêt : « (p. 20) La base fondamentale de la morale est le respect absolu des droits du prochain. Mais ce n'est nullement par amour du prochain qu'il faut respecter ses droits, c'est uniquement par amour de soi ». L'auteur dit : « (p. 49) L'idée qu'on s'enrichit plus vite en spoliant le voisin qu'en travaillant, idée qui paraît vraie n'est pas vraie en réalité. Le fait justement opposé, qu'on s'enrichit le plus vite possible, en respectant scrupuleusement les droits du voisin, est seul conforme à la réalité des choses ». Donc, on n'a jamais vu quelqu'un s'enrichir par des moyens qui ne fussent tout à fait moraux ! « (p. 50) Toutes les fois qu'un ouvrier use de la violence pour se faire payer un salaire supérieur au prix naturel du marché [que peut bien être ce prix naturel ?], il se vole lui-même. Toutes les fois qu'un patron emploie la violence pour payer à l'ouvrier un salaire inférieur au prix naturel du marché, il se vole lui-même. (p. 51) Essayons de nous représenter ce que serait le monde si les hommes, ne trouvant plus conforme à leurs intérêts de spolier le voisin, s'abstenaient de le faire sous n'importe quelle forme. Immédiatement il n'y aurait plus ni serrures, ni coffres-forts, ni forteresses, ni cuirassés. Il n'y aurait non plus ni gardiens, ni avocats, ni juges, ni police, ni soldats, ni marins militaires. [En note : « Bien entendu pour les causes civiles, car les crimes passionnels continueraient à se produire »]. Dans cette société, il ne se ferait ni procès, ni grèves, ni sabotages, ni lock-outs, ni spéculations véreuses... (p. 51) En un mot, dans la société antispoliatrice, la production serait la plus grande et la plus rapide qui (p. 52) puisse se réaliser sur le globe ; donc la richesse atteindrait son point culminant. Maintenant, richesse, bien-être, bonheur et intérêt sont des termes synonymes. D'autre part, respect absolu des droits du prochain et morale sont aussi des notions identiques. Lors donc que notre intérêt sera le mieux satisfait lorsque nous nous conduirons de la façon la plus morale, comment peut-on contester l'identité de la morale et de l'intérêt ? » Le sophisme du raisonnement général apparaît mieux encore en un cas particulier. « (p. 56) Un juge a-t-il véritablement intérêt à se vendre ? Certes non, et, quand il se vend, c'est faute de comprendre qu'il n'a aucun avantage à le faire... l'expérience montre que les juges ont les traitements les plus élevés, précisément dans les pays où ils ne vendent pas leur conscience. L'incorruptibilité des juges contribue, dans une forte mesure, à augmenter la richesse sociale, et, plus la richesse sociale est considérable, mieux peuvent être payés les fonctionnaires publics. Ainsi un juge mal informé croit qu'il aura plus de revenu en vendant la justice ; un juge bien informé sait que c'est le contraire. Mais un juge qui sait qu'il gagnera plus en restant incorruptible comprend qu'il est conforme à son intérêt de rester incorruptible ». Supposons vraie l'affirmation quelque peu arbitraire suivant laquelle les juges sont mieux payés quand ils sont incorruptibles, et occupons-nous uniquement des erreurs de logique. l° Le dilemme posé par l'auteur n'existe pas : il n'y a pas à choisir uniquement entre un état où tous les juges sont corruptibles, et un autre état où. ils sont tous incorruptibles. Il y a les états intermédiaires. Par exemple, si tous sont incorruptibles moins un, celui-ci jouit de l'avantage général supposé par l'auteur, et en outre, de l'utilité particulière qu'il obtient en se laissant corrompre. Si tous sont corruptibles moins un, celui-ci souffre du mal général, et il a en plus son mal particulier, en refusant les avantages de la corruption. 2° Il ne suffit pas de prouver que les juges incorruptibles sont mieux payés que les juges corruptibles ; il faut encore démontrer que quantitativement cet avantage général dépasse l'utilité particulière de la corruption. Par exemple, les juges incorruptibles reçoivent 30 000 fr. par année ; les corruptibles 6 000 fr. On offre à l'un de ces derniers 100 000 fr. pour le corrompre ; il ferait une perte, s'il refusait dans l'espérance lointaine, très lointaine et incertaine, de recevoir à l'avenir 30 000 fr. par an.
[FN: § 1496-1]
Une plaisanterie qui a pris diverses formes, selon les différents auteurs, est ainsi racontée par POGGE ; (éd. LISEUX, t. II) : « (p. 61), 158. Un religieux de grande autorité, et qui prêchait continuellement au peuple, était souvent exhorté par un usurier vicentin, à flétrir énergiquement les usuriers, et à condamner fortement ce grand vice, qui sévissait particulièrement dans la ville ; et l'usurier insistait au point d'ennuyer le religieux. Surpris de ce qu'il insistait continuellement pour faire châtier le métier qu'il exerçait lui-même, quelqu'un lui demanda la raison de tant de sollicitude. „ Ceux qui exercent le métier d'usurier sont si nombreux en cette contrée, dit-il, qu'il me vient très peu de clients ; en sorte que je ne gagne rien. Mais si les autres usuriers étaient dissuadés d'exercer leur métier, c'est à moi que reviendraient tous leurs gains “ ».
[FN: § 1497-1]
Pour plus détails, voir Systèmes socialistes , t. II, p. 225 et sv.
[FN: § 1501-1]
Dict. SAGLIO, s. r. Noxalis actio : « (p. 114). Le propriétaire est, dans certains cas, responsable du dommage causé par ses animaux. D'après les Douze Tables, il faut que l'animal soit un quadrupède... La jurisprudence étendit plus tard cette règle aux dommages causés par les bipèdes. La victime est autorisée à poursuivre le propriétaire de l'animal par une action spéciale appelée de pauperie. Le propriétaire a le choix entre deux partis : faire l'abandon de l'animal ou réparer le dommage. En lui donnant la faculté de faire un abandon noxal, on applique le principe d'après lequel le propriétaire d'une chose qui a causé un dommage à autrui ne saurait être obligé au delà de la valeur de cette chose ». – GIRARD ; Mon. él. de dr. rom., remarque excellemment comment, au moyen des dérivations, les jurisconsultes se sont efforcés de remédier à certaines conséquences, tenues pour nuisibles, de cette persistance d'agrégats : « (p. 395, note 1) Il est piquant de relever les efforts infructueux faits par les jurisconsultes de la fin de la République pour accommoder ces vieilles actions à la notion moderne de l'imputabilité, en décidant que le dommage doit avoir été causé par l'animal contra naturam... et en appliquant aux batailles des animaux le principe de la légitime défense ». L'abandon de l'animal se trouve aussi dans la Lex Burgundionum, XVIII, 1 : Ita ut si de animalibus subito caballus caballum occiderit, atit bos bovem percusserit, aut canis momorderit, ut debilitetur, ipsum animal aut canis, per quem damnum videtur admissum, tradatur illi, qui damnam pertulit.
[FN: § 1501-2]
BEAUCHET ; Hist. du dr. pr. de la rép. ath., t. IV : « (p. 391) ... à Athènes, l'action [![]() qui correspond à l'action de pauperie des XII tables] paraît plutôt donnée contre l'animal que contre le maître, et dans le but de permettre à la victime du dommage l'exercice de la vindicta privata sur l'animal lui-même ». Les Athéniens attribuaient à Solon la loi qui prescrivait de consigner à la partie lésée l'animal coupable. – PLUTARCHI. ; Sol., 24, 3, où il est parlé d'un chien qui mord.
qui correspond à l'action de pauperie des XII tables] paraît plutôt donnée contre l'animal que contre le maître, et dans le but de permettre à la victime du dommage l'exercice de la vindicta privata sur l'animal lui-même ». Les Athéniens attribuaient à Solon la loi qui prescrivait de consigner à la partie lésée l'animal coupable. – PLUTARCHI. ; Sol., 24, 3, où il est parlé d'un chien qui mord.
[FN: § 1501-3]
DEM. ; c. Aristocr. , 76, p. 645 : ![]()
![]() « Si donc les choses inanimées et ne jouissant pas de la raison sont sujettes à cette accusation [d'homicide], il n'est pas permis de priver d'un jugement... »
« Si donc les choses inanimées et ne jouissant pas de la raison sont sujettes à cette accusation [d'homicide], il n'est pas permis de priver d'un jugement... »
[FN: § 1501-4]
AESCH. ; In Ctesiph., p. 88, 244. – Schol. veter. AESCH.; Septem ad. Th., v. 197. PAUS.; VI, Eliac., II, 11. – SUID.; s. r. ![]() . Les causes de ce genre, étant archaïques, avaient un caractère religieux et se jugeaient au Prytanée. – DEMOSTH C. Aristocr., 76, p. 645. – PAUS. – I, Att., 28. L'auteur observe qu'on dit que des choses inanimées punirent automatiquement certains délits. – POLLUX, VIII, 9, 90, et 10, 120.
. Les causes de ce genre, étant archaïques, avaient un caractère religieux et se jugeaient au Prytanée. – DEMOSTH C. Aristocr., 76, p. 645. – PAUS. – I, Att., 28. L'auteur observe qu'on dit que des choses inanimées punirent automatiquement certains délits. – POLLUX, VIII, 9, 90, et 10, 120.
[FN: § 1501-5]
PLAT. De leg., IX, p. 873.
[FN: § 1501-6]
PAUS. VI, Eliac. II, 11. - SUID., s. r. ![]() , substitue ce nom à celui de
, substitue ce nom à celui de ![]() – EUSEB ; Praep. evang., V, 34, p. 230-231.
– EUSEB ; Praep. evang., V, 34, p. 230-231.
[FN: § 1501-7]
C'était une cérémonie appelée ![]() . Sur ce sujet, nous avons d'abondants renseignements dans PORPHYR. ; De abstinentia ab esu animalium, II, 29-30. D'autres auteurs en parlent aussi. En peu de mots, un bœuf mangeait des offrandes déposées sur l'autel. On tuait le bœuf, puis l'on faisait un procès devant le tribunal qui jugeait les homicides occasionnés par des objets inanimés. Chacun des acteurs du drame rejetait successivement sur un autre la faute du fait, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que la hache avec laquelle le bœuf avait été tué. Cette hache était condamnée et jetée à la mer. PAUSANIAS, 1, 24, dit qu'il ne rapportera pas quelle cause on attribue à ce fait. On a voulu deviner cette cause, et plusieurs explications ont vu le jour, parmi lesquelles celle du totémisme. À vrai dire, on ne peut rien savoir de certain ou même seulement de très probable. Chercher à deviner les combinaisons qui ont donné naissance à une dérivation est une entreprise sans espoir de succès, quand des renseignements directs font défaut, et très difficile encore, si l'on en possède quelques-uns. Pour nous, il suffit ici de remarquer le procès que l'on faisait autrefois à des hommes et à une hache.
. Sur ce sujet, nous avons d'abondants renseignements dans PORPHYR. ; De abstinentia ab esu animalium, II, 29-30. D'autres auteurs en parlent aussi. En peu de mots, un bœuf mangeait des offrandes déposées sur l'autel. On tuait le bœuf, puis l'on faisait un procès devant le tribunal qui jugeait les homicides occasionnés par des objets inanimés. Chacun des acteurs du drame rejetait successivement sur un autre la faute du fait, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que la hache avec laquelle le bœuf avait été tué. Cette hache était condamnée et jetée à la mer. PAUSANIAS, 1, 24, dit qu'il ne rapportera pas quelle cause on attribue à ce fait. On a voulu deviner cette cause, et plusieurs explications ont vu le jour, parmi lesquelles celle du totémisme. À vrai dire, on ne peut rien savoir de certain ou même seulement de très probable. Chercher à deviner les combinaisons qui ont donné naissance à une dérivation est une entreprise sans espoir de succès, quand des renseignements directs font défaut, et très difficile encore, si l'on en possède quelques-uns. Pour nous, il suffit ici de remarquer le procès que l'on faisait autrefois à des hommes et à une hache.
[FN: § 1501-8]
PLIN. : Nat. hist., VIII, 18, 2 : Polybias Aemiliani comes, in senecta hominem appeti ab iis refert... Tunc obsidere Africae urbes : eaque de causa crucifixos vidisse se cum Scipione, quia caeteri metu poenae similis absterrerentur eadem noxa.
[FN: § 1501-8]
PLIN. : Nat. hist., VIII, 18, 2 : Polybias Aemiliani comes, in senecta hominem appeti ab iis refert... Tunc obsidere Africae urbes : eaque de causa crucifixos vidisse se cum Scipione, quia caeteri metu poenae similis absterrerentur eadem noxa.
[FN: § 1501-9]
Gen., IX, 5. (Vulg.) Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum ; et de manu hominis, de manu viri et fratris eius, requiram animam hominis. (Sept.) ![]()
![]() . Ex., XXI, 28. L'inculpation de l'animal est entièrement séparée de celle du maître : l'animal homicide est coupable et puni comme tel ; le maître est innocent. (Vulg.) Si bos corna percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur, et non comedentur carnes eius, dominus quoque bovis innocens erit. – Lev., XX, 15 (Vulg.) Qui cum iumento et pecore coierit, morte moriatur ; pecus quoque orcidite. (Sept
. Ex., XXI, 28. L'inculpation de l'animal est entièrement séparée de celle du maître : l'animal homicide est coupable et puni comme tel ; le maître est innocent. (Vulg.) Si bos corna percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur, et non comedentur carnes eius, dominus quoque bovis innocens erit. – Lev., XX, 15 (Vulg.) Qui cum iumento et pecore coierit, morte moriatur ; pecus quoque orcidite. (Sept ![]()
![]() (seg. : avec une bête),
(seg. : avec une bête), ![]() (16) Mulier, quae succubuerit cuilibet iumento, simul interficietur cum eo ; sanguis eorum sit super eos. (Seg.) « leur sang retombera sur eux ». Donc, sur la femme et sur l'animal. – Cet excellent PHILON LE JUIF a trouvé une belle dérivation. Il s'imagine qu'on tue l'animal pour qu'il n'en naisse pas une progéniture monstrueuse, comme il en naquit une de l'union de Pasiphaé avec le taureau ! De spec. leg., 8, p. 73-74, t. 5, Rich., p. 783-784, P. (p. 784) Proinde sive vir ineat quadrupedem, sive mulier eam admittat, necabuntur et homines et quadrupedes : illi quia per intemperantiam transgressi sunt praescriptos terminos comminiscendo nova genera libidinum, et voluptatem insuavem captando e rebus etiam dictu turpissimis : hae vero quia se praebuerunt probris talibus, et ne pariant abominandum aliquid, qualia nasci solent ex huiusmodi piaculis detestabilibus...
(16) Mulier, quae succubuerit cuilibet iumento, simul interficietur cum eo ; sanguis eorum sit super eos. (Seg.) « leur sang retombera sur eux ». Donc, sur la femme et sur l'animal. – Cet excellent PHILON LE JUIF a trouvé une belle dérivation. Il s'imagine qu'on tue l'animal pour qu'il n'en naisse pas une progéniture monstrueuse, comme il en naquit une de l'union de Pasiphaé avec le taureau ! De spec. leg., 8, p. 73-74, t. 5, Rich., p. 783-784, P. (p. 784) Proinde sive vir ineat quadrupedem, sive mulier eam admittat, necabuntur et homines et quadrupedes : illi quia per intemperantiam transgressi sunt praescriptos terminos comminiscendo nova genera libidinum, et voluptatem insuavem captando e rebus etiam dictu turpissimis : hae vero quia se praebuerunt probris talibus, et ne pariant abominandum aliquid, qualia nasci solent ex huiusmodi piaculis detestabilibus...
[FN: § 1501-10]
GREGOROVIUS ; Storia della città di Roma (Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter), t. III.
[FN: § 1502-1]
Mémoires de la société des antiquaires de France. Rapport et recherches sur les procès et jugements relatifs aux animaux. Il serait trop long et peu utile de reproduire ici tout le catalogue: nous en transcrivons seulement le commencement et la fin :
Table 5
[FN: § 1502-2]
CABANÈS ; Les indiscrétions de l'histoire, 5e série : « (p. 34) Il était procédé contre l'animal par voie criminelle, et voici quelle était la marche de la procédure mise en usage : dès qu'un méfait était signalé, l'animal délinquant était saisi et conduit à la prison du siège de la justice criminelle où le procès devait (p. 35) être instruit. Des procès-verbaux étaient dressés et l'on procédait... à une enquête minutieuse. Le fait étant établi sans conteste, le procureur, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions de ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après avoir ouï les témoins, et sur leurs dépositions affirmatives, le procureur faisait des réquisitions, sur lesquelles le juge rendait sa sentence, déclarant l'animal coupable d'homicide et le condamnant à être étranglé et pendu, par les deux pieds de derrière, à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays... Telle était, en certains endroits, la rigueur apportée dans l'observation des formalités en matière de procédure criminelle, que la sentence n'était exécutée qu'après que signification en avait été faite à l'animal lui-même dans sa prison ». – BEAUMANOIR ; Coutumes de Beauvaisis, édit. Beugnot, LXIX, 6 ; édit. Salmon, t. II, 1944 : « (p. 481) Li aucun qui ont justices en leur terres si font justices de bestes quant eles metent aucun a mort : si comme se une truie tue un enfant, il la pendent et trainent, ou une autre beste. Mes c'est nient a fere, car bestes mues n'ont pas entendement qu'est biens ne quest maus, et pour ce est ce justice perdue ». – C. TRUMELET ; Les saints de l’Islam : « (p. 132 note) On raconte... qu'un jour le khalife Omar-ben-El-Koththab, cousin au troisième degré de Mahomet, ayant trouvé un scorpion sur le tapis qui lui servait de couche, fut pris de scrupule relativement à son droit de tuer une créature de Dieu. Dans le doute et pour se mettre d'accord avec sa conscience, il alla consulter le Prophète, son parent, à qui il exposa son cas. Après avoir réfléchi pendant quelques instants, Mahomet lui répondit qu'il ne pouvait s'arroger le droit de destruction qu'à la troisième désobéissance de l'insecte, c'est-à-dire après les trois sommations d'avoir à se retirer ».
[FN: § 1502-3]
ETIENNE DE, BOURBON ; Anecdoteshistoriques (§ 303,p.255) Sentenciam excommunicacionis docent timere et cavere animalia, exemplo et divino miraculo hoc agente. Audivi quod, cum papa Gregorius nonus esset ante papatum legatus sedis apostolice in Lumbardia, et invenisset in quadam civitate quosdam maiores compugnantes, qui processum eius impediebant, ... cum excommunicasset capitaneum illius dissensionis, qui solus pacem impediebat, et ille excommunicacionem contempneret, ciconie multe, que nidificaverant super turres et caminos domus eius, a domo eius recesserunt, et nidos suos transtulerunt, ad domum alterius capitanei dicte guerre, qui paratus erat stare mandato dicti legati ; quod videns ille contumax, humiliavit cor suum ad absolucionem procurandam et ad voluntatem dicti legati faciendam. Dans ce cas, les animaux innocents fuient l'homme excommunié ; dans les cas suivants, les animaux sont eux-mêmes excommuniés. (§ 304, p. 255) Item audivi quod in ecclesia Sancti Vincencii Matisconensis... multi passeres solebant intrare et (p. 256) ecclesiam fedare et officium impedire. Cum autem non possent excludi, episcopus illius loci... eas excommunicavit, mortem comminans si ecclesiam ulterius intrarent ; que, ab ecclesia recedentes, nunquam postea eamdem ecclesiam intraverunt. [Ainsi, les pauvres petits moineaux furent, sans procès, frappés d'excommunication ; et comme témoin oculaire de l'efficacité de cette condamnation, nous avons l'auteur]. Ego autem vidi multitudinem earum circa ecclesiam nidificantes, et super dictam ecclesiam volantes et manentes ; nullam autem earum vidi in dicta ecclesia. Est eciam ibi communis opinio quod, si aliquis unam capiat et eam in dicta eeclesia violenter intromittat, quam cito intromittitur, moritur. Non moins merveilleux que l'effet de cette excommunication, est celui du contrat social de Rousseau, qui continue à avoir des croyants, bien que tout témoignage oculaire fasse défaut. (§ 305, p. 256) Item audivi a pluribus fratribus nostris quod, cum quidam episcopus Lausanensis haberet piscatores in lacu, cum quadam nocte misisset eos piscari ad anguillas, proicientes recia sua in lacu, ceperunt serpentes cum anguillis. Quidam autem eorum caput dentibus attrivit, credens anguillas, ... in mane autem, cum vidisset quod erant serpentes, ita abhorruit, quod pre abominacione mortuus est. Quod audiens episcopus, excommunicavit dictas anguillas si de cetero in dicto lacu morarentur. Omnibus autem inde recedentibus, postea, ut dicitur, in dicto lacu non remanserunt.
[FN: § 1502-4]
L. MENABREA : De l'origine, de la forme et de l'esprit des jugements rendus au moyen âge contre les animaux. Chambéry, 1846. Dans ce livre, l'auteur publie une procédure instruite en 1587, contre un certain insecte (Rynchites auratus) qui détruisait les vignes de Saint-Julien, près Saint Jean de Maurienne. Cette, procédure est reproduite en partie et résumée dans le livre : Curiosités des traditions, des mœurs et des légendes. Je cite aussi ce livre, dont les pages seront désignées par la lettre C, pour faciliter le lecteur, parce qu’il est difficile de se procurer le livre de Menabrea, dont les pages seront désignées par la lettre M. « (p. 429-431 C ; p. 7 M) Ces vignobles [de St. Julien] ... sont sujets à être dévastés, à de certains intervalles par un charançon de couleur verte à qui les naturalistes donnent le nom de Rynchites auratus, et le vulgaire celui d'amblevin ou de verpillon ». (p. 8 M) Les actes du procès de 1587 « nous apprennent que déjà 42 ans auparavant, c'est-à-dire en 1545, une instance semblable avait existé, entre les mêmes parties, et que les insectes destructeurs ayant disparu, les demandeurs ne s'étaient pas souciés de la poursuivre. On y voit qu'alors une première comparution eut lieu, à fins conciliatoires, devant spectable François Bonnivard, docteur en droit : le procureur Pierre Falcon représentait les insectes, et l'avocat Claude Morel leur prêtait son ministère. L'inutilité de cette tentative d'accommodement fit que les syndics de St. Julien se pourvurent à l'Official de St. Jean de Maurienne, et engagèrent une contestation en forme ». On fit une tentative. La cause fut débattue, « (p. 8 M) l'Official rendit une ordonnance, dans laquelle, écartant provisoirement les conclusions des habitants de (p. 9 M) St. Julien, qui requéraient que les pyrales fussent excommuniées, il se borna à prescrire des prières publiques... (p. 10 M) L'instance de 1545, restée en suspens pendant plus de 40 ans par suite de la retraite des insectes dévastateurs, fut reprise en 1587, lorsque ces malheureux coléoptères eurent fait sur les vignobles de la commune, une nouvelle irruption plus alarmante peut-être que les précédentes. Ce second procès... est intitulé : De actis Scindicorum, communitatis Sancti Julliani agentium contra Animalia brula ad formam muscarum volantia coloris viridis communi voce appellata Verpillions seu Amblevins ». Les syndics de Saint Julien demandent que « (p. 11 M) il plaise au révérend Official constituer aux insectes un nouveau procureur en remplacement de l'ancien, passé de vie à trépas, députer préparatoirement un commissaire idoine pour visiter les vignes (p. 12 M) endommagées, partie adverse sommée d'assister à l'expertise, si bon lui semble [sic !] ; après quoi il sera progressé à l'expulsion des animaux susdits par voie d'excommunication ou interdit, et de toute autre due censure ecclésiastique ; étant eux syndics, prêts à relâcher à ces mêmes animaux, au nom de la Commune, un local où ils aient à l'avenir pâture suffisante... ». La cause suit son cours ; les avocats présentent leurs mémoires ; il y a répliques et dupliques ; enfin, « (p. 19 M) il fallait que les syndics de St. Julien n'eussent pas grande confiance en la bonté de la cause qu'ils poursuivaient, puisqu'ils jugèrent à propos d'adopter d'une manière principale le mezzo termine qu'ils n'avaient proposé au commencement de l'instance que par mode (p. 20 M) subsidiaire ». Ils convoquent les habitants de la Commune, « à l'effet de réaliser les offres précédemment faites, en relâchant aux amblevins un local où ces bestioles pussent trouver à subsister... Chacun des assistants ayant manifesté son opinion, tous furent d'avis d'offrir aux amblevins une pièce de terre située au-dessus du village de Claret... contenant environ cinquante sétérées, et de la quelle les sieurs advocat et procureur d'iceulx animaulx se veuillent comptenter... ladicte pièce de terre peuplée de plusieurs espesses de boès, plantes et feulliages, comme foulx. allagniers, cyrisiers, chesnes... oultre l’erbe et pasture qui y est en assez (p. 21 M) bonne quantité... En faisant cette offre, les habitants de St. Julien crurent devoir se réserver le droit de passer par la localité dont il s'agit, tant pour parvenir sur des fonds plus éloignés, sans causer touttefoys aulcung préjudice à la pasture desdict-animaulx, que pour l'exploitation de certaines mynes de colleur, c'est-à-dire d'ocre, qui existaient non loin de là. Et parce que, ajoutent-ils, ce lieu est une seure retraicte en temps de guerre, vu qu'il est garny de fontaynes qui aussi serviront aux animaulx susdicts, ils se réservent encore la faculté de s'y réfugier en cas de nécessité, promettant à ces conditions, de faire dresser en faveur des insectes ci-dessus nommés, contrat de la pièce de terre en question, en bonne forme et vallable à perpetuyté. Le 24 juillet, Petremand Bertrand, procureur des demandeurs, produisit une expédition du procès-verbal de la délibération prise... ». Il demande que, si les défendeurs n'acceptent pas, « il plût an révérend juge lui adjuger ses conclusions, tendantes à ce que lesdits défendeurs soient déclarés tenus de déguerpir les vignobles de la Commune, avec inhibition de s'y introduire à l'avenir, sous les peines du droit ». Le procès continue, et, le 3 septembre, « (p. 22 M) Antoine Filliol, procureur des insectes, déclara ne pas vouloir accepter au nom de ses clients l'offre faite par les demandeurs, attendu que la localité offerte était stérile et ne produisait absolument rien, cum sit locus sterilis et nuilius redditus... (p 23 M) De son côté, Petremand Bertrand fit observer, que, loin d'être de nul produit, le lieu en question abondait en buissons et en petits arbres très propres à la nourriture des défendeurs... Sur quoi l'Official ordonne le dépôt des pièces. Une portion du feuillet sur lequel se trouvait écrite la sentence... est devenue la proie du temps... ce qui en reste suffit néanmoins pour faire voir que l'Official, avant de prononcer en définitive, nomma des experts aux fins de vérifier l'état du local offert aux insectes... » L'idée d'abandonner aux insectes un lieu où ils puissent vivre n'est pas particulière au présent procès. On en a d'autres exemples. Hemmerlein, cité par Menabrea, raconte comment, après un procès régulier, les habitants de Coire pourvurent certaines cantharides d'un lieu où elles pussent vivre. « (p. 93) Et aujourd'hui encore, ajoute Hemmerlein, les habitants de ce canton passent chaque année un bon contrat avec les cantharides susdites, et abandonnent à ces insectes une certaine étendue de terrain : si bien que les scarabées s'en contentent, et ne cherchent point à sortir des limites convenues ».
[FN: § 1503-1]
D. THOM.; Summ. theol., IIa IIae, q. 76, art. 2 : Conclusio. Creaturis irrationalibus maledicere, ut Dei creaturae sunt, ad rationalem creaturam ordinatae, blasphemia est : eis autem maledicere, ut in seipsis sunt, illicitum est, cum sit hoc, otiosum. et vanum. – Corp. iuris can. ; decr. Grat., pars sec., caus. XV, q. 1, c. 4 : Non propter culpam, sed propter memoriam facti pecus occiditur, ad quod mulier accesserit. Unde Augustinus super Leviticum ad c. 20, q. 74..., § 1. Quaeritur, quomodo sit reum pecus : cum sit irrationale, nec ullo modo legis capax. Et infra : Pecora inde credendum est iussa interfici, quia tali fiagitio contaminata indignam refricant facti memoriam. Menabrea a reproduit, dans son livre, le Discours des Monitoires, avec un plaidoyer contre les insectes, de l'avocat GASPARD BALLY de Chambéry, qui vivait dans la seconde moitié du XVIIe siècle. On y peut lire des modèles de plaidoyers contre les insectes et en leur faveur, ainsi que des conclusions du procureur de l'évêque et de la sentence du juge ecclésiastique. Le procureur des insectes produit de nombreuses citations de textes divins et légaux, et conclut : « (p. 138) Par les quelles raisons on voit, que ces animaux sont en nous absolutoires, et doivent estre mis hors de Cour et de Procès, à quoy on conclud ». Mais le procureur des habitants réplique : « (p. 138) Le principal motif qu'on a rapporté pour la deffense de ces animaux, est qu'estans privés de l'usage de la raison, ils ne sont soumis, à aucunes Loix, ainsi que le dit le Chapitre cum mulier 1, 5, q. 1. la l. congruit in fin et la Loix suivante. ff. de off. Praesid. sensu enim carens non subiicitur rigori Iuris Civilis. Toutesfois, on fera voir que telles Loys ne peuvent militer au fait qui se présente maintenant à juger ; car on ne dispute pas de la punition d'un delict commis ; Mais on tasche d'empescher qu'ils n'en commettent par cy-après... ». Il continue avec de copieuses citations de tout genre ; « (p. 141) Et pour responce à ce qu'escrit S. Thomas qu'il n'est loisible de maudire tels animaux, si on les considere en eux mesmes, on dit qu'en l'espece qu'on traitte, on ne les considere pas comme animaux simplement : mais comme apportans, du mal aux Hommes, mangeans et détruisans les fruits qui servent à son soutient, et nourriture. Mais à quoy, nous arrestons-nous depuis qu'on voit par des exemples infinis que quantité de saints Personnages, ont Excommunié des animaux apportans du dommage aux Hommes ... ». La sentence du juge ecclésiastique conclut : « (p. 147) In nomine, et virtute Dei Omnipotentis, Patris, et Filij, a Monitione in vini sententiae huius, a vineis, et territoriis huius loci discedant, nullum ulterius ibidem, nec alibi nocumentum, praestitara, quod si infra praedictos dies, iam dicta animalia, huic nostrae admonitioni non paruerint, cum effectu. Ipsis sex diebus elapsis, virtute et auctoritate praefatis, illa et Spiritus sancti... Authoritateque Beatorum Apostolorum, Petri et Pauli, necnon ea qua fungimur in hac parte, praedictos Bronchos, et Erucas, et animalia praedicta quocunque nomine censeantur, monemus in his scriptis, sub poenis Maledictionis, ac Anathematisationis, ut infra sex dies, in his scriptis, Anathematizamus, et maledicimus ». Notez que l'auteur nous dit avoir obtenu du Sénat de Savoie l'autorisation de faire imprimer son travail, « (p. 121) ayant esté veu et examiné par les seigneurs de ce célèbre corps qui en ont fait leur rapport avec éloge».
[FN: § 1503-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR.] Cela n'empêche pas non plus que tant de juristes débattent encore, dans des discussions ou des ouvrages juridiques, des questions telles que celles-ci : l'homme a-t-il le droit d'infliger la peine de mort à son semblable ? Quelle est la véritable conception de l'État ? etc.
[FN: § 1505-1]
Essai d'une phil. de la Solidarité. L. BOURGEOIS dit de la solidarité : « (p. 46) Alors, va-t-on dire, c'est le contrat social ? – Je le veux bien et je conserve le mot [il a raison ; ce ne sont là que des variations sur le même thème musical], à la condition toutefois qu'on ne confonde pas ce contrat social avec celui dont Rousseau a exposé la théorie. L'hypothèse de Rousseau – car dans sa pensée il ne s'agit que de cela et non d'un fait historique, – place le contrat à l'origine des choses, tandis que nous le plaçons au terme ».
[FN: § 1508-1]
Les fidèles du dieu Progrès voulaient nous faire croire que les temps étaient désormais passés, où, comme en 1815, les congrès européens disposaient du sort des peuples. Précisément, en 1913, un congrès à Londres dispose du sort des peuples balkaniques, interdit à la Serbie l'accès de l'Adriatique, oblige le Monténégro à abandonner Scutari qu'il avait conquis, dispose du sort des malheureux habitants des Îles de l'Égée, et ainsi de suite. Si le Monténégro avait été plus fort que l'Autriche, c’eût été non pas celle-ci qui eût obligé le Monténégro d'abandonner des territoires, mais le Monténégro qui eût obligé l'Autriche. Quelle règle peut-on imaginer, qui puisse également bien démontrer que l'Autriche a le « droit » d'occuper la Bosnie et l'Erzégovine, et que le Monténégro n'a pas le droit d'occuper Scutari ? La vénérable théorie de l' « équilibre », invoquée jadis pour maintenir l'Italie divisée et sujette, sert de même à la nouvelle Italie, avec la complicité de l'ancien oppresseur, pour maintenir divisés et sujets les peuples des Balkans. Par quel miraculeux sophisme peut-on démontrer que l'Italie a aujourd'hui le « droit », pour maintenir « l'équilibre de l'Adriatique », de défendre à la Grèce d'occuper des territoires de nationalité grecque, tandis qu'en vertu de la même règle de « droit », la Grèce n'avait pas « le droit », pour maintenir ce vénérable équilibre, de défendre l'occupation de Tarente et de Brindisi par les troupes piémontaises, et de s'opposer à la constitution du royaume d'Italie ? Il n'y a qu'un seul motif pour expliquer les faits : la force. Si la Grèce avait été plus forte que l'Italie et que les États qui protégeaient le nouveau royaume, elle aurait maintenu à son avantage « l'équilibre » de l'Adriatique, de môme que l'Italie, étant aujourd'hui plus forte que la Grèce, maintient cet équilibre à son avantage. Parce qu'un souverain puissant entendit « le cri de douleur qui arrive vers nous de toute l'Italie [FN*]», et parce que la fortune favorisa ses armes, l'Italie fat délivrée du joug autrichien ; et ce n'est pas à cause d'une différence de « droit » ; mais seulement parce qu'aucun souverain puissant n'entendit le cri de douleur des Balkans et de l'Égée, qu'il ne fut pas donné à ces nations d'avoir un sort semblable à celui de l'Italie. Le poète Leopardi a chanté, dans la langue de Dante, les hauts faits des « crabes » autrichiens occupés à maintenir « l'équilibre» en Italie [FN**] ; et maintenant, un poète grec pourrait chanter, dans la langue d'Homère, les hauts faits non moins admirables des « crabes » austro-italiens occupés à maintenir « l'équilibre » de l'Adriatique et d'autres régions. Celui qui juge les faits avec des sentiments nationalistes dit, s'il est Italien, que l'Italie a « raison » et que la Grèce a « tort » ; s'il est Grec, il retourne ce jugement. Celui qui juge les faits avec des sentiments internationalistes ou pacifistes donne tort à celui qu'il estime être l'agresseur, raison à celui qu'il croit être l'attaqué. Celui qui, au contraire, veut rester dans le domaine objectif, voit simplement, dans les faits, de nouveaux exemples de ces conflits qui se produisirent toujours entre les peuples ; et il voit dans les jugements la manière habituelle de traduire par l'expression « il a raison », le fait que certaines choses s'accordent avec le sentiment de celui qui juge, et par l'expression « il a tort », le fait que certaines choses répugnent à ce sentiment. C'est-à-dire qu'il y a là uniquement des résidus et des dérivations.
[FN*] Paroles de l'empereur Napoléon III.
[FN**] Paralipomeni della Batracomiemachia, II, st. 30 à 39.
[FN: § 1510-1]
On peut aussi joindre la tradition religieuse à la tradition métaphysique poussée à l'extrême. Par exemple, on pourrait définir la Christian Science (§ 1695-1) un hégélianisme biblique.
[FN: § 1511-1]
A. WEBER ; L'enseignement de la prévoyance, Paris, 1911. Parlant de certaines gens qui s'occupent de sociétés de secours, de coopératives, de caisses mutuelles, il dit : « (p. 101) ... pour eux – comme pour l'immense majorité de leurs affiliés – la Mutualité et la Prévoyance sont des dogmes qu'on ne doit même pas chercher à comprendre, des choses qui ont des vertus spéciales, des vertus en soi et qui sont douées d'un pouvoir mystérieux pour la guérison des misères humaines ! Ils estiment, en quelque sorte, qu'il importe surtout à leur sujet d'être un adepte et un croyant : après quoi il suffit d'apporter aux Œuvres une offrande, une maigre contribution personnelle pour obtenir des résultats extraordinaires : la Retraite gratuite ou l'Assurance à un taux dérisoire, par exemple ».
[FN: § 1514-1]
E. KANT ; La métaph. des mœurs (Édit. J. Tissot). L'auteur nous avertit que : « (p. 58) Dans cet impératif catégorique ou loi de la moralité (p. 59), la raison de la difficulté (d'en apercevoir la possibilité) est, en second lieu, très grande. C'est un principe a priori synthétiquement pratique ; et comme il est si difficile, dans la connaissance théorique, d'apercevoir la possibilité des principes de cette espèce, on pense bien qu'elle n'est pas moins difficile à connaître dans la connaissance pratique. Nous rechercherons d'abord, dans ce problème, si la simple notion d'un impératif catégorique n'en fournit pas aussi la formule [bien sûr qu'elle la fournit ! La simple notion de la Chimère en fournit aussi la formule !], contenant la proposition qui peut seule être un impératif catégorique ; ... Quand je conçois un impératif hypothétique en général, je ne sais pas encore ce qu'il contiendra, jusqu'à (p. 60) ce que la condition me soit donnée. Mais si je conçois un impératif catégorique, je sais ce qu'il contient [et si j'imagine un hippogriphe, je sais comment il est fait]. Car l'impératif ne renferme, outre la loi, que la nécessité de la maxime d'être conforme à cette loi. Mais la loi ne contient aucune condition à laquelle elle soit subordonnée ; en sorte qu'il ne reste que l'universalité d'une loi en général, à laquelle doit être conforme la maxime de l'action. Or cette conformité seule présente l'impératif proprement comme nécessaire. Il n'y a donc qu'un seul impératif catégorique, celui-ci : N'agis que d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle ». Texte allemand : « Zweitens ist bei diesem kategorischen Imperativ oder Gesetze der Sittlichkeit der Grund der Schwierigkeit (die Möglichkeit desselben einzusehen) auch sehr gross. Er ist ein synthetisch-praktischer Satz a Priori, und da die Möglichkeit der Sätze dieser Art einzusehen so viel Schwierigkeit im theoretischen Erkentnisse hat, so lässt sich leicht abnehmen, dass sie im praktischen nicht weniger haben werde. Bei dieser Aufgabe wollen wir zuerst versuchen, ob nicht vielleicht der blosse Begriff eines kategorischen Imperativs auch die Formel desselben an die Hand gebe, die den Satz enthält, der allein ein kategorischer Imperativ sein kann : denn wie ein solches absolutes Gebot möglich sei, wird noch besondere und schwere Bemühung erfordern, die wir aber zum letzten Abschnitte aussetzen.
Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiss ich nicht zum voraus was er enthalten werde : bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so weiss ich sofort, was er enthalte. Denn da der Imperativ ausser dem Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime enthält, diesem Gesetze gemäss zu sein, das Gesetz aber keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt, war, so bleibt nichts, als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlang gemäss sein soll, und welche Gemässheit allein den Imperativ eigentlich als nothwendig vorstellt. Der kategorische Imperativ ist also ein einziger, und zwar dieser : handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde ».
[FN: § 1517-1]
E. KANT ; loc. cit., § 1514-1 « (p. 61) Un homme réduit au désespoir et au dégoût de la vie par une série d'infortunes, possède encore assez de raison pour pouvoir se demander s'il n'est pas contraire au devoir de s'ôter l'existence. Or, il examine si la maxime de son action peut être une loi universelle de la nature ». Texte allemand : « Einer, der durch eine Reihe von Uebeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen Ueberdruss am Leben empfindet, ist noch so weit im. Besitze seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Nun versucht er : ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz werden könne ». Si l'on admet des conditions, la réponse devrait être affirmative. On dirait en effet : « Tous ceux des hommes – et c'est de beaucoup le plus grand nombre – qui préfèrent la vie à la mort, s'efforceront de rester en vie aussi longtemps qu'ils le pourront; et le petit nombre de ceux qui préfèrent la mort à la vie se tueront. Qu'est-ce qui empêche que ce soit une loi universelle ? Si peu de chose, que c'est ce qui arrive et ce qui est toujours arrivé. Kant résout négativement la question, parce qu'il ne sépare pas ces deux classes d'hommes. Il continue : « Mais sa maxime est de se faire, par amour pour soi, un principe d'abréger sa vie, si elle est menacée, dans sa courte durée, de plus de maux qu'elle ne promet de biens. Il s'agit donc uniquement de savoir si ce principe de l'amour de soi peut être une loi universelle de la nature. Or on aperçoit bientôt qu'une nature dont la loi serait d'inciter par la sensation même, dont la destination est l'utilité et la durée de la vie, à la destruction de la vie même, serait contradictoire, et ne subsisterait par conséquent pas comme nature ; qu'en conséquence, la maxime en question n'est point possible comme loi universelle de la nature, entièrement opposée qu'elle est au principe suprême de tout devoir ». Texte allemand : « Seine Maxime aber ist : ich mache es mir aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner längern Frist mehr Uebel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukürzen. Es fragt sich nur noch, ob dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, dass eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne, und folglich dem obersten Prinzip gänzlich widerstreite ». Il y a lieu de remarquer d'abord cette manière impersonnelle de s'exprimer, habituelle à qui veut engendrer la confusion. De plus, pour celui qui veut se suicider, il ne s'agit pas de la vie en général, mais de sa vie en particulier. Ensuite, on voit que pour rendre valable ce raisonnement, il faut supprimer toute condition ; car ce sentiment pourrait avoir pour « destination d'inciter au développement de la vie ». quand elle « promet plus de biens que de maux », et pas autrement. La contradiction en laquelle, selon Kant, la Nature tomberait, n'existe que s'il n'y a pas de conditions ; elle disparaît si l'on admet qu'il peut y avoir des conditions. Malgré l'admirable discours de Kant, celui qui voudra se tuer, tirera sa révérence à notre cher, illustre et non moins impuissant Impératif catégorique,... et s'ôtera la vie.
[FN: § 1519-1]
Texte, allemand : 1710.« Ein Dritter findet in sich ein Talent, welches vermittelst einiger Kultur ihn zu einem in allerlei Absicht brauchbaren Menschen machen könnte. Er sieht sich aber in bequemen Umständen, und zieht vor, lieber dem Vergnügen nachzuhängen, als sich mit Erweiterung und Verbesserung seiner glücklichen Naturanlagen zu bemühen ».
[FN: § 1519-2]
Texte allemand : 1712.« Da sieht er nun, dass zwar eine Natur nach einem solchen allgemeinen Gesetze immer noch bestehen könne, obgleich der Mensch (sowie der Südsee-Einwohner) sein Talent rosten liesse und sein Leben bloss auf Müssiggang, Ergötzlichkeit, Fortpflanzung, mit einem Wort, auf Genuss zu verwenden bedacht wäre... » .
[FN: § 1519-3]
Texte allemand. « ... allein er kann unmöglich wollen, dass dieses ein allgemeines Naturgesetz werde oder als ein solches in uns durch Naturinstinkt gelegt sei. Denn als ein vernünftiges Wesen will er nothwendig, dass alle Vermögen in ihm entwickelt werden, weil sie ihm doch zu allerlei möglichen Absichten dienlich und gegeben sind ».
[FN: § 1521-1]
Quand les métaphysiciens éprouvent le besoin de disserter sur les sciences naturelles, ils devraient se souvenir du proverbe : la parole est d'argent, mais le silence est d'or, et ils feraient bien de rester dans leur domaine, sans envahir celui d’autrui. YVES DELAGE ; La struct. du prot. et les théor. de l'héréd., p. 827, note : « Il est probable que bon nombre des dispositions qui nous paraissent inutiles ou mauvaises ne nous semblent telles que par notre ignorance de leur utilité ; mais il est probable aussi que leur inutilité ou leurs inconvénients sont quelquefois réels. En tout cas, c'est à ceux qui sont d'avis contraire à prouver leur dire ». Bien entendu, s'ils sont naturalistes, parce que les métaphysiciens ont le privilège d'affirmer sans preuve. « p. 830) C'est ainsi [tant bien que mal], en effet, que vivent la plupart des espèces, bien loin d'être, comme on le dit, un rouage admirablement travaillé et adapté à sa place dans le grand mécanisme de la nature. Les unes ont la chance que les variations qui les ont formées leur ont créé peu d'embarras. Telle est la Mouche, par exemple, qui n'a qu'à voler, se reposer, se brosser les ailes et les antennes, et trouve partout les résidus sans nom où elle pompe aisément le peu qu'il lui faut pour vivre. Aux autres, ces mêmes variations aveugles ont créé une vie hérissée de difficultés : telle est l'Araignée, toujours aux prises avec ces terribles dilemmes, pas d'aliment sans toile et pas de toile sans aliments, aller à la lumière que recherche l'Insecte, fuir la lumière par peur de l'Oiseau. Comment s'étonner que, dans de pareilles conditions, soit né chez elle l'instinct absurde qui pousse la femelle à dévorer son mâle après l'accouplement, sinon même avant [excellente Nature kantienne, quelles erreurs commets-tu donc ?], instinct que, par parenthèse, la Sélection de l'utile à l'espèce serait fort embarrassée d'expliquer ». Cet excellent Saint Augustin aussi, se mêlant de parler d'entomologie, dit, après plusieurs autres philosophes, que beaucoup d'insectes naissent de la putréfaction : Nam pleraque eorum, aut de vivorum corporum vitiis, vel purgamentis, exhalationibus, aut cadaverunt tabe gignuntur; quaedam etiam de corruptione lignorum et herbarum... , et il recherche comment ils ont bien pu être créés : (23) Cetera vero quae de animalium gignuntur corporibus, et maxime mortuorum, absurdissimum est dicere tunc creata, uni animalia ipsa creata sunt... (De Genesi ad litteram, III, 14, 22).
[FN: § 1521-2]
Texte allemand : In den Naturanlagen eines organisirten, d.i. zweckmässig zum Leben eingerichteten Wesens nehmen wir es als Grundsatzen, dass kein Werkzeug zu irgend einem Zwecke in demselben angetroffen werde, als was auch zu demselben das schicklichste und ihm am meisten angemessen ist. Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhallung, sein Wohlergehen, mit einem. Worte seine Glückseligkeit der eigentliche Zweck der Natur, so hätte sic ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht getroffen, sich die Vernunft des Geschöpfs zur Ausrichterin dieser ihrer Absicht, zu ersehen. L'auteur continue et nous donne les motifs de cette affirmation : « (p. 15) car toutes les actions qu'elle exécuterait dans cette intention et toutes les règles de sa conduite ne vaudraient certainement pas l'instinct [Kant le sait ; mais il ne nous apprend pas comment il le sait, et il supprime la démonstration], et ce but pourrait être bien plus sûrement atteint par l'impulsion instinctive qu'il ne peut l'être jamais par la raison. Et si la raison devait être donnée par surcroît à une créature déjà privilégiée, elle n'aurait dût lui servir qu'à contempler les heureuses dispositions de sa nature, pour les admirer, pour s’en réjouir, et en rendre grâce à la cause bienfaisante [autre belle entité] de son être... En un mot, la nature [qui, paraît-il, s'appelle aussi Cause bienfaisante] aurait empêché que la raison ne trébuchât dans l'usage pratique,…. Aussi trouvons-nous dans le fait, que plus une raison cultivée s'applique à la jouissance de la vie et du bonheur plus l'homme s'éloigne de la vraie satisfaction [attention à ce vraie ; grâce à ce terme, Kant choisit la « satisfaction » qui lui plaît ; l'autre est fausse] ». Texte allemand : Denn alle Handlungen, die es in dieser Absicht auszuüben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens würden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet und jener Zweck weit sicherer dadurch haben erhalten werden können, als es jemals durch Vernunft geschehen kann ; und sollte diese ja obenein dem begünstigten Geschöpf ertheilt worden sein, so würde sic ihm nur dazu haben dienen müssen, uni über die glückliche Anlage seiner Natur Betrachtungen anzustellen, sie zu bewundern, sich ihrer zu erfreuen und der wohlthätigen Ursache dafür dankbar zu. sein... mit einem Worte, sic [die Natur] würde verhütet haben, dass Vernunft nicht in praktischen Gebrauch ausschlüge... In der That finden wir auch, dass, jemehr eine kültivirte Vernunft sich mit der Absicht auf den Genuss des Lebens und der Glückseligkeit abgiebt, desto weiter der Mensch von der wahren Zufriedenheit abkomme .. » L’auteur nous apprend ensuite que si ceux qui font le plus usage de la raison calculent les avantages des arts et même des sciences, « (p. 16) ils trouvent, en effet, qu'ils ont eu par là plus d'embarras et de peine que de bonheur, et sont enfin plus portés à envier qu'à mépriser cette manière de vivre toute commune des hommes qui se rapproche davantage de la direction purement instinctive de la nature, et qui donne peu d'influence à la raison sur l'inconduite ». Texte allemand : « den noch finden, dass sic sich in der That nur mehr Mühseligkeit auf den Hals gezogen, ais an Glückseligkeit gewonnen haben, und darüber endlich den gemeineren Schlag der Menschen, welcher der Leitung des blossen Naturinstinkts näher ist und der seiner Vernunft nicht viel Einfluss auf sein Thun und Lassen verstattet, eher beneiden, als geringschätzen ». Comment Kant a-t-il jamais pu faire cette statistique ? Cette partie de la dérivation sert à contenter les nombreuses personnes qui, au temps où écrivait Kant, admiraient l'homme naturel et déclamaient contre la civilisation. Les dérivations visent le sentiment, non pas les faits et la logique. « (p. 16) En effet, bien que la raison ne soit pas assez habile pour guider plus sûrement la volonté, par rapport à ses objets et à la satisfaction de tous nos besoins..., que ne pourrait le faire l'instinct mis en nous par la nature pour cette fin ; cependant, comme faculté pratique, c'est-à-dire, en tant qu'elle doit avoir de l'influence sur la volonté, et puisqu'elle nous a été donnée en partage, sa véritable destination [remarquez l'épithète véritable. Il y a une fausse destination, qui est celle qui ne plaît pas à Kant] doit être de produire une volonté bonne en soi, et non une volonté bonne comme moyen par rapport à d'autres fins ». Texte allemand : « Denn da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ist, uni den Willen in Ansehung der Gegenstände desselben und der Befriedigung aller unserer Bedürfnisse... sicher zu leiten, als zu. welchem Zwecke ein eingepflanzter Naturinstinkt viel gewisser geführt haben würde, gleichwohl aber uns Vernunft als praktisches Vermögen, d. i. als ein solches, das Einfluss auf den Willen haben soll, dennoch zugetheilt ist; so muss die wahre Bestimmung derselben sein, einem nicht etwa in anderer Absicht als Mittel, sondern an sich selbst guten Willen hervorzubringen ».
[FN: § 1524-1]
Le 24 janvier 1913, à la Chambre française, M. Briand, président du Conseil, dit : « Le problème le plus urgent est celui de la réforme électorale. À aucun moment je n'ai jeté l'anathème au scrutin d'arrondissement. J'ai reconnu les services du scrutin d'arrondissement, mais j'ai ajouté que c'était un instrument faussé. Je ne considère pas que la réforme électorale procède d'une question de principe, c'est une question de tactique. Le parti au pouvoir doit chercher à y rester dans l'intérêt du pays et de la nation qui l'ont envoyé au pouvoir (mouvements sur divers bancs.) C'est par ses propres moyens que le parti au pouvoir doit réaliser l'instrument de justice et d'équité ».
[FN: § 1536-1]
A. COMTE ; Cours de philosophie positive, t. V. « (p. 14) Néanmoins, il reste encore à ce sujet une incertitude secondaire, que je dois d'abord dissiper rapidement, et provenant de la progression nécessairement inégale de ces différents ordres de pensées, qui, n'ayant pu marcher du même pas... ont dû faire jusqu'ici [remarquez cette façon de s'exprimer du prophète qui vient de régénérer le monde] fréquemment coexister, par exemple, l'état métaphysique d'une certaine catégorie intellectuelle, avec l'état théologique d'une catégorie postérieure, moins générale et plus arriérée, ou avec l'état positif d'une autre antérieure, moins complexe et plus avancée, malgré la tendance continue de l'esprit humain à l'unité de méthode et à l'homogénéité de doctrine. Cette apparente confusion [lui-même vient de faire voir qu'elle n'est pas apparente, mais réelle] doit, en effet, produire, chez ceux qui n'en ont pas bien saisi le principe [lisez : qui n'acceptent pas comme article de foi les élucubrations de Comte] une fâcheuse hésitation sur le vrai caractère philosophique des temps correspondants. Mais, afin de la prévenir ou de la dissiper entièrement, il suffit ici (p. 15) de discerner, en général, d'après quelle catégorie intellectuelle doit être surtout jugé le véritable état spéculatif d'une époque quelconque ». Et maintenant nous galopons en dehors du domaine expérimental. Laissons de côté les petites imperfections. Il appelle « fâcheuse » l' « hésitation ». Pourquoi donc faut-il la déplorer ? Il nomme « vrai » le « caractère philosophique », « véritable » l'« état spéculatif ». Quelqu'un voudra-t-il nous dire comment on les distingue de ceux qui sont « faux » ? Mais il est une observation plus importante. Notre auteur suppose précisément ce qu'il faut démontrer, c'est-à-dire qu'il y a un état spéculatif unique pour une époque, car s'il en était plusieurs de coexistants, on ne voit pas pourquoi l'un devrait être appelé « véritable » plutôt que l'autre.
[FN: § 1536-2]
Loc. cit., § 1536-1. Dans le passage suivant, c'est nous qui soulignons : (p. 15) Or tous les motifs essentiels concourent spontanément, à cet égard, pour indiquer avec une pleine évidence [c'est lui qui le dit et cela suffit], l'ordre de notions fondamentales, le plus spécial et le plus compliqué, c'est-à-dire celui des idées morales et sociales, comme devant toujours fournir la base prépondérante d'une telle décision : non seulement en vertu de leur propre importance, nécessairement très supérieure dans le système mental de presque tous les hommes [mais si c'est justement ce qu'il faut démontrer !], mais aussi chez les philosophes eux-mêmes, par suite de leur position rationnelle à l'extrémité de la vraie hiérarchie encyclopédique, établie au début de ce traité ».
[FN: § 1537-1]
A. COMTE ; Cours de phil. posit., t. I. Dans le passage suivant, c'est A. comte qui souligne : Avertissement. « (p. XIII) Je me bornerai donc... à déclarer que j'emploie le mot philosophie, dans l'acception que lui donnaient les anciens, et particulièrement Aristote, comme désignant le système général des conceptions humaines ; et, en ajoutant le mot positive, j'annonce que je considère cette manière spéciale de philosopher qui consiste à envisager les théories, dans quelque ordre d'idées que ce soit, comme ayant pour objet la coordination des faits observés [ce serait donc proprement la méthode logico-expérimentale], ce qui constitue le troisième et dernier état de la philosophie générale, primitivement théologique et ensuite métaphysique ». Qu’on y ajoute les passages suivants : « (p. 3) Enfin, dans l'état positif, l'esprit humain reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers, et à connaître les causes intimes des phénomènes, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de succession et de similitude ». Telle est la définition de la méthode logico-expérimentale. Peut-être y aurait-il lieu d'observer que si l'on veut pousser la rigueur à l'extrême, au lieu de dire « par l'usage du raisonnement et de l'observation », il vaudrait mieux dire : « par l'usage de l'observation et du raisonnement » ; et il serait bon de biffer l'épithète d' « invariables » aux relations. Mais si c'est là le point de départ, le point où l'on arrive, dans le même Cours, pour ne pas parler des autres ouvrages, est celui d'une foi qui, au fond, diffère peu ou pas du tout des autres croyances. Voir, par exemple, t. VI : « (p. 530) Une saine appréciation de notre nature où d'abord prédominent nécessairement les penchants vicieux ou abusifs [qui détermine ceux qui sont tels ? Le sentiment de l'auteur] rendra vulgaire l'obligation [imposée par qui ? D'où sort cet impératif ? Ce n'est certes pas une relation expérimentale] unanime d'exercer, sur nos diverses inclinations une sage discipline contenue, destinée à les stimuler et à les contenir selon leurs tendances respectives. Enfin la conception fondamentale, à la fois scientifique et morale [morale est ici ajouté à la recherche exclusivement scientifique du premier passage cité], de la vraie situation générale [que peut bien être cette entité ?], comme chef spontané de l'économie réelle, fera toujours nettement ressortir la nécessité de développer sans cesse, par un judicieux exercice, les nobles attributs, non moins affectifs qu'intellectuels, qui nous placent à la tête de la hiérarchie vivante ». [Les mots soulignés le sont par nous]. Ce bavardage sera tout ce qu'on voudra, hormis la recherche d'une uniformité expérimentale.
[FN: § 1537-2]
A. COMTE ; Cours de philosophie positive, t. VI. Par exemple, traitant des recherches mathématiques, il dit : « (p. 286) Ce premier exercice scientifique des sentiments abstraits de l'évidence et de l'harmonie, (p. 287) quelque limité qu'en dût être d'abord le domaine, suffit pour déterminer une importante réaction philosophique, qui, immédiatement favorable à la seule métaphysique, n'en devait pas moins annoncer de loin l'inévitable avènement de la philosophie positive, en assurant la prochaine élimination de la théologie prépondérante ». Ici l'auteur pense évidemment à Newton et à ses continuateurs ; il oublie l'époque de scepticisme religieux de la fin de la République romaine. Les observations contenues dans le De natura deorum de Cicéron ou le De rerum natura de Lucrèce ne sont nullement issues de recherches mathématiques, et pourtant elles tendent à détruire le polythéisme et toute religion. Sextus Empiricus écrit en même temps contre les mathématiciens et contre les polythéistes. Mais laissons cela de côté ; c'est une erreur de faits. D'où l'auteur a-t-il tiré que l'« avènement » de la philosophie positive était « inévitable » ? Si cela n'est pas une simple tautologie pour exprimer que ce qui arrive devait arriver, c'est-à-dire du pur déterminisme, cela veut dire que l'auteur soumet les faits à certains dogmes. Il continue. « (p. 287) Par là se trouve irrévocablement rompue l'antique unité de notre système mental, jusqu'alors uniformément théologique... » Laissons de côté les erreurs habituelles déjà relevées ; mais de quelle « coordination de faits » l'auteur peut-il déduire que la rupture de cette uniformité est irrévocable ? Lucrèce aussi le croyait, et il attribuait le mérite de la destruction de la religion à Épicure. Pourtant la religion ressuscita – à supposer, par hypothèse invraisemblable, qu'elle fût morte – et elle recommença à prospérer. Pourquoi A. Comte doit-il être meilleur prophète que Lucrèce ? Et puis la distinction que A. Comte essaie de faire entre la foi théologique et la foi positiviste est imaginaire : « (p. 331) La foi théologique, toujours liée à une révélation quelconque [erreur de faits ; l'auteur pense uniquement à la théologie judéo-chrétienne ou à une autre semblable], à laquelle le croyant ne saurait participer, est assurément d'une tout autre espèce que la foi positive, toujours subordonnée à une véritable démonstration, dont l'examen est permis à chacun sous des conditions déterminées [admirez cette restriction ; mais l'Église catholique aussi permet un semblable examen, sous les conditions déterminées par elle], quoique l'un et l'autre résultent également de cette universelle aptitude à la confiance [autorité ; A. Comte veut substituer la sienne à celle du pape, tout simplement] sans laquelle aucune société réelle ne saurait subsister ». C'est bien ; pourtant cela doit uniquement s'entendre en ce sens que les actions non-logiques dont est issue l'autorité sont utiles, indispensables dans une société ; mais il n'est nullement démontré qu'elles donnent des théories en accord avec les faits. La foi positiviste peut être plus ou moins utile à la société que l'autre foi, à laquelle seule A. Comte octroie le nom de théologique ; c'est une chose à voir ; mais toutes deux sont en dehors du domaine logico-expérimental.
[FN: § 1538-1]
Iliad., 1, 5 et passim.
[FN: § 1541-1]
D. AUG. : De Genesi ad litteram, II, 1, 2.
[FN: § 1542-1]
Les innombrables objections « scientifiques » contre la religion appartiennent à ce genre. La seule conclusion qu'on en puisse tirer est que le contenu de la Bible et la réalité expérimentale sont des choses qu'on ne doit pas confondre. – Abbé E. LEFRANC ; Les conflits de la science et de la Bible, Paris, 1906 [nous citons ce livre seulement à cause de la date de sa publication] : « (p. 143) Si Dieu a évoqué du néant les espèces vivantes en pleine activité, avec leurs organismes actuels, demeurés essentiellement invariables, la création a dû être foudroyante et complète du premier coup [on ne sait pas ce qu'est la création, et l'on sait comment elle doit avoir eu lieu !] . Dixit et facta sunt. Deus creavit omnia simul. On ne conçoit pas [il y a tant de choses qu'on ne conçoit pas !]que le Tout Puissant se soit d'abord timidement essayé [qui lui dit qu'il y eut de timides essais, et non pas l'exécution d'un sage dessein ? Notre auteur était donc présent à la création ?] à construire de simples ébauches très humbles d'aspect et de structure, et qu'il ait procédé par une suite ininterrompue de brusques coups de force, remettant sans cesse son œuvre sur le métier, s'y reprenant mille et mille fois pour la perfectionner au jour le jour, tel un ouvrier malhabile à réaliser ses conceptions, – créant et recréant à jet continu jusqu'à 600 000 types divers, pour le seul règne animal, l'un après l'autre, pendant (p. 144) des siècles et des siècles. Ce, système enfantin porte en lui-même sa propre réfutation ».
[FN: § 1542-2]
Le 31 décembre 1912, dans une séance du Conseil communal de Milan, un conseiller socialiste attaqua vivement l'enseignement de la doctrine chrétienne, qui, disait-il, contient « des assertions absurdes démenties par la science ». Parmi ces assertions, il cita que la lumière fut d'abord et le soleil ensuite. Il apparaît de là qu'il sait qu'au contraire le soleil exista d'abord, et qu'ensuite vint la lumière ; par conséquent, le soleil doit avoir été créé avant toutes les autres étoiles. Cela peut bien être, mais qui le lui a dit ? Toutefois, supposons qu'en nommant le soleil, il ait entendu nommer toutes les étoiles, tous les corps lumineux. Il semble, en effet, naturel qu'il y ait eu d'abord les corps lumineux et qu'ensuite soit venue la lumière ; mais, à vrai dire. nous n'en savons absolument rien. Nous ignorons ce que sont les « corps » et ce qu'est la « lumière », et nous connaissons encore moins le rapport qui peut avoir existé à l' « origine » entre ces deux entité. La « science » chrétienne donne une solution ; la « science » socialiste en donne une autre, à ce qu'il paraît ; la science logico-expérimentale ignore l'une et l'autre.
Notes du Chapitre X – Les dérivations (suite) Examen de la IVe classe. (§1543 à §1686), vol. 2, pp. 887-1009 ↩
[FN: § 1550-1]
CIC ; Acad. quaest., II – ULP. ; De verborum significatione, 177 : Natura cavillationis, quam Graeci ![]() appellaverunt haec est, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae evidenter falsa sunt, perducatur. – Bien connu est le passage d'Horace, Epist., II, 1, où, par le moyen de ce sophisme, l'auteur montre qu’on ne peut fixer la limite entre ancien et moderne, et que, sans qu'il y paraisse, on prive un cheval de toute sa queue en lui enlevant un crin à la fois. Le scoliaste (Pseudoacron.) dit en note : (45) Crisippi sillogismi sunt seu dominos (leg. pseudomenos) et sorites...
appellaverunt haec est, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae evidenter falsa sunt, perducatur. – Bien connu est le passage d'Horace, Epist., II, 1, où, par le moyen de ce sophisme, l'auteur montre qu’on ne peut fixer la limite entre ancien et moderne, et que, sans qu'il y paraisse, on prive un cheval de toute sa queue en lui enlevant un crin à la fois. Le scoliaste (Pseudoacron.) dit en note : (45) Crisippi sillogismi sunt seu dominos (leg. pseudomenos) et sorites...
[FN: § 1550-2]
CIC. ; Acad. quaest., II, 29, 92.
[FN: § 1550-3]
SEXT. EMPIR. Pyrrh. hypot., II, c. 22, § 253 : « Donc, quand on nous proposera ainsi un argument, à chaque proposition nous tiendrons en suspens notre consentement. Ensuite, tout l'argument ayant été proposé, nous objecterons ce qui nous semblera à propos. Car si les sectateurs dogmatiques de Chrysippe, quand on leur propose le sorite, disent, au cours du raisonnement, qu'ils doivent s'arrêter pour ne pas tomber dans l'absurde ; à plus forte raison, à nous qui sommes sectateurs du scepticisme et craignons les absurdités, convient-il de ne pas nous laisser prendre aux interrogations des prémisses, mais de demeurer en suspens à chacune d'elles, jusqu'à ce qu'on nous ait, proposé tout le raisonnement ».
[FN: § 1550-4]
SEXT. EMP. : Adv. math., IX (adv. physicos), 190, (p. 593).
[FN: § 1551-1]
Systèmes, t. I, c. VI, p. 338 à 340.
[FN: § 1552-1]
ARIST., Rhet., III, 2, (p. 1405).
[FN: § 1552-2]
Dans la guerre italo-turque de 1912, les Arabes qui fournissaient aux Italiens des renseignements du camp turco-arabe étaient appelés informateurs ; ceux qui fournissaient aux Turco-Arabes des renseignements du camp italien étaient appelés espions. BENTHAM-DUMONT ; Tact. des ass. lég. suivie d'un traité des soph. polit., t. II : « (p. 178) Le mot persécution n'est pas dans le dictionnaire des persécuteurs. Ils ne parlent que de zèle pour la religion. Lorsque l'abbé Terray faisait une banqueroute aux créanciers publics, il lui donnait le nom de retenue ». En Italie, la réduction au 4 % de l'intérêt du 5 % de la dette publique fut dissimulée sous le nom d'impôt de la richesse mobilière. « (p. 163) Dans la nomenclature des êtres moraux, il est des dénominations qui présentent l'objet pur et simple, sans y ajouter aucun sentiment (p. 164) d'approbation ou de désapprobation. Par exemple : désir, disposition, habitude... J'appelle ces termes, neutres. Il en est d'autres qui, à l'idée principale, joignent une idée générale d'approbation : Honneur, piété... D'autres joignent à l'idée principale une idée habituelle de désapprobation : Libertinage, avarice, luxe... (p. 165) En parlant de la conduite, ou des penchants, ou (p. 166) des motifs de tel individu, vous est-il indifférent ? vous employez le terme neutre. Voulez-vous lui concilier la faveur de ceux qui vous écoutent ? vous avez recours au terme qui emporte un accessoire d'approbation. Voulez-vous le rendre méprisable ou odieux ? vous usez de celui qui emporte un accessoire de blâme ». « (p. 175) Celui qui parle du bon ordre, qu'entend-il par là ? rien de plus qu'un arrangement de choses auquel il donne son approbation et dont il se déclare le partisan ». Mais après que tant d'auteurs, d'Aristote à Bentham, ont mis en lumière les erreurs de ces sophismes, comment se peut-il qu'on persiste à en faire un si abondant usage ? Parce que – vérité banale – leur force ne réside pas dans le raisonnement, mais dans les sentiments qu'ils suscitent. Si l'on démontre qu'un théorème de géométrie est faux, la question est tranchée, on n'en parle plus. Au contraire, si l'on démontre qu'un raisonnement portant sur des matières sociales est absurde, cela n'a aucun effet : on continue à s'en servir abondamment. Le motif de cette différence consiste en ce que, dans le premier cas, c'est la raison qui agit, tandis que dans le second, c’est le sentiment, auquel s'ajoutent presque toujours différents intérêts. Par conséquent, au point de vue social, ces sophismes doivent être jugés, non pas d'après leur valeur logique, mais suivant les effets probables des sentiments et des intérêts qu'ils recouvrent.
[FN: § 1552-3]
Les discours de M. le prince de Bismarck, t. I, p. 233 – Séance du 22 janvier 1864.
[FN: § 1552-4]
Le Congrès national de la Libre-Pensée, assemblé à Paris, en octobre 1911, approuva une résolution qui dit : « Le Congrès des libres-penseurs, fidèle à l'idéal international de progrès et de justice [c'est là une foi ; elle est peut-être bonne et les autres mauvaises, mais c'est toujours une foi, qui n'a rien à faire avec la liberté de la pensée] invite toutes les sociétés de libre pensée à réclamer constamment l'application intégrale des conventions internationales signées à la Haye [quel rapport peuvent bien avoir ces conventions avec la liberté de la pensée ? Une pensée libre devrait pouvoir être favorable ou opposée à ces conventions, suivant ce qu'elle juge le mieux]. Les sociétés de libre pensée devront inviter les élus républicains à demander au gouvernement de la République de prendre l'initiative de négociations tendant à la conclusion de conventions nouvelles pour limiter les budgets militaires et navals et assurer le désarmement ». En attendant, voilà un beau lien imposé au nom de la liberté. Celui dont la pensée est libre doit vouloir le désarmement ; et si, au contraire, il croit le désarmement nuisible à son pays, son esprit est esclave. Ce sont là de telles absurdités qu'elles dispensent de toute réfutation. Et pourtant, il y a des gens qui s'y laissent prendre. Comment cela ? Simplement parce qu'on a changé le sens des mots, qui agissent non par leur sens propre, mais par les sentiments qu'ils suscitent. Les mots libre pensée suscitent les sentiments d'une pensée liée à une foi humanitaire et anti-catholique ; c'est pourquoi ils servent d'étiquette aux théories de cette religion.
[FN: § 1553-1]
En 1912, le patriarche de Venise, suivant la doctrine des Pères de l'Église, blâma vertement les femmes qui s'habillaient d'une façon qu'il jugeait immodeste et effrontée, annonça qu'il ne les admettrait pas à tenir les enfants sur les fonts baptismaux, ni à la communion ; et, eu effet, il repoussa de celle-ci une dame qui se présentait avec une robe qu'il jugea trop décolletée. Il y eut alors des journaux qui le comparèrent au sénateur Bérenger. Au contraire, les cas sont entièrement différents, et font partie de catégories qui ne peuvent être confondues. Pour que la confusion soit possible, il faudrait que les pouvoirs publics obligeassent les femmes à exercer les fonctions religieuses auxquelles préside le patriarche de Venise. Mais il n'en est rien. Y prend part qui veut, et le patriarche n'a pas le moindre pouvoir sur qui ne se soucie pas de lui. Au contraire, le sénateur Bérenger fait mettre en prison ou condamner à l'amende ou fait saisir les livres et les journaux des gens qui ne se soucient pas de lui. En somme, ce sont deux choses différentes que dire : « Si vous voulez que je fasse A, vous devez faire B, ou bien : « Que vous le vouliez ou non, je vous oblige par la force à faire B ». Le sentiment ne s'arrête pas à de telles analyses, et voit la chose synthétiquement. L'anticlérical blâme l'« intolérance » du patriarche de Venise, et admire le sénateur Bérenger. C'est là une dérivation qui signifie simplement que le premier déplaît à l’anti-clérical, et que le second lui plaît.
[FN: § 1553-2]
En Allemagne, le pasteur Jatho, qui professe un christianisme tout à fait spécial, a fait sur Goethe une série de sermons qui ont scandalisé les croyants. Le consistoire de la province du Rhin et le conseil supérieur de l'Église évangélique sont intervenus. Journal de Genève, 23 février 1911 : « Le Consistoire a demandé à M. Jatho de déclarer que ses sermons incriminés ont été inexactement rapportés et de prendre l'engagement qu'il ne songeait pas à en faire entendre à l'avenir de semblables. Le pasteur a refusé cette double déclaration. Il affirme être la victime d'une dénonciation anonyme et se retranche derrière l'incorrection de ce procédé pour se dérober à toute concession. À la suite de ces faits une procédure a été introduite contre lui devant le Conseil supérieur de l'Église Évangélique ... Une coïncidence, malheureusement, encore complique le cas. Tous les protestants ont cru devoir prendre vigoureusement parti contre le serment antimoderniste. M. Jatho et ses organes n'ont pas manqué de dire qu'on exigeait de lui un serment antimoderniste, et ils ont voulu obtenir de la presse évangélique qu'elle décernât au pasteur de Cologne les mêmes éloges démesurés dont elle couvre la demi-douzaine de prêtres réfractaires au serment moderniste. Il va sans dire que les journaux protestants se sont dérobés ; qu'ils ont cherché et trouvé des différences ». Qui cherche trouve et, en des cas semblables, trouve toujours toutes les différences qu'il peut désirer.
[FN: § 1554-1]
LA FONTAINE ; VIII, 2, Le savetier et le financier. Le pauvre savetier se plaint qu'on l'oblige à ne pas travailler :
… le mal est que toujours
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes),
Le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours
Qu’il faut chômer ; on nous ruine en fêtes ;
L'une fait tort à l'autre ; et monsieur le curé
De quelque nouveau saint charge toujours son prône.
À Milan, quand on imposa le « repos hebdomadaire », qui n'est autre que le repos dominical, un pauvre savetier, chassé de sa boutique, mit sur ses épaules une ficelle avec des savates, et alla de ci de là, pour trouver les clients, disant : « Je mange le dimanche comme les autres jours ». Au temps passé, le gouvernement et les prêtres imposaient le chômage ; aujourd'hui, c'est le gouvernement et les associations de divers genres qui l'imposent ; et, aux jours de chômage imposés par la loi s'ajoutent ceux qui sont imposés par la force aux renards, les grèves politiques, « de protestation », de « solidarité » et autres. Il y a cette différence qu'aujourd'hui un individu est contraint d'agir contrairement à sa volonté, au nom de la « liberté », qui acquiert ainsi un sens exactement opposé à celui qu'il avait auparavant.
[FN: § 1554-2]
P. L. COURIER ; Œuvres complètes. Pétition à la Chambre des députés pour les villageois que l'on empêche de danser : « (p. 84) Messieurs ; ceux qui haïssent tant le travail du dimanche veulent des traitements, envoient des garnisaires, augmentent le budget. Nous devons chaque année, selon eux, payer plus et travailler moins ».
[FN: § 1554-3]
E. OLLIVIER ; L'Empire libéral, t. IV.
[FN: § 1554-4]
Si l'on voulait montrer, au moyen de la réduction à l'absurde, la vanité, d'un tel raisonnement, on pourrait observer qu'il s'applique dans tous les cas où les facultés qu'ont plusieurs individus de faire quelque chose sont en conflit. Par exemple, « l'État » devrait obliger les professeurs de violon à donner des leçons gratis, parce qu'en se faisant payer, ils « lèsent » la liberté de ceux qui veulent apprendre à jouer du violon et n'ont pas de quoi payer les leçons. C'est donc à l'État qu'il appartient de créer cette liberté d'apprendre à jouer du violon. De même, si une femme refuse de se donner à celui qui l'en sollicite, elle enlève la faculté de faire l'amour avec elle à cet homme dont elle lèse la « liberté » : et il faut, pour créer la liberté des amoureux, que l'État s'empresse d'obliger la femme de se donner à celui qui la désirs. Mais, objectera-t-on, de telles « libertés » ne sont pas respectables comme celle de ceux qui ne veulent pas travailler certains jours, et qui devraient le faire si d'autres travaillaient. Très bien ; mais cette réponse nous, entraîne à examiner s'il est utile, en vue de certaines fins déterminées, ou si nous voulons, pour un motif quelconque, favoriser la faculté de faire – ou de ne pas faire – des uns ou des autres ; et nous sortons entièrement du domaine où se trouve celui qui parle d'« offenses à la liberté » ou de « création de la liberté ».
[FN: § 1555-1]
Parmi les belles métamorphoses du terme libéralisme, remarquable est celle qu'on observe dans un discours du ministre Salandra. Le 6 avril 1,914, exposant à la Chambre le programme de son gouvernement, il dit : « À mon avis, libéralisme, en Italie, signifie patriotisme (vives approbations) ». C'est là une adjonction à faire à un futur dictionnaire des synonymes. Mais le ministre a peut-être seulement voulu dire que libéral et patriote étaient des termes employés pour désigner un certain parti, et, en ce cas, il ne s'écartait pas trop de la vérité : ce sont, en effet, des euphémismes dont le parti des « spéculateurs », en Italie, se complaît à tirer son nom (§ 2235).
[FN: § 1556-1]
La tradition pythagoricienne paraît avoir donné pour règle morale de s'efforcer d'être semblable aux dieux, (THEMIST. ; Orat. ; XV, p. 192). C'est là que HIEROCL. ; Comm. in aur. car., XXVII, Didot, p. .188, place la perfection. STOB. ; Eglog., II, 8, p. 66, rapporte comme étant une parole de Pythagore : « ![]() : « Suis dieu ». Si ce dieu était celui du vulgaire, la règle précédente ajouterait quelque chose à la simple affirmation d'un précepte : elle exprimerait que celui-ci est d'accord avec la nation que le vulgaire a du dieu. De même, si l'on connaissait la volonté de ce dieu par des livres sacrés, par la tradition ou d'une autre manière analogue, quelque chose serait aussi ajouté à la simple affirmation du précepte. Mais quand l'auteur même du précepte détermine aussi la nature et la volonté du dieu, invoquer ce dieu n'a d'autre effet que d'allonger la voie qui mène au but. Que l'auteur affirme directement le précepte, ou qu'il affirme indirectement qu'il tire son origine d'une similitude ou d'une volonté par lui déterminée, c'est exactement la même chose. La tradition pythagoricienne établit précisément une différence entre les dieux du vulgaire et ceux de Pythagore. Dans DIOGÈNE, VIII, 1, 21, Hiéronyme rapporte que Pythagore vit aux Enfers, « l'âme d'Hésiode enchaînée à une colonne de bronze et grinçant des dents, et celle d'Homère attachée à un arbre, entourée de serpents, à cause des choses qu'ils avaient dites au sujet des dieux ». De même, Platon corrige à sa manière la notion que le vulgaire, les poètes, d'autres auteurs, ont de dieu ; et dans le livre III de la République, il repousse et condamne plusieurs des opinions qui avaient cours au sujet des dieux ; il blâme les récits de certains faits, contenus dans Homère, et conclut : « (p. 388) Si donc, ami Adimante, les jeunes gens écoutaient attentivement de tels faits et ne s'en moquaient pas, comme de choses dites d'une manière indigne, quelqu'un d'entre eux, étant homme, les estimera difficilement indignes de lui et les blâmera ». Puis, dans le livre IV des Lois, p. 716, il dit que le semblable plaît à son semblable, et que par conséquent, pour se faire aimer de dieu, il faut que l'homme s'efforce de lui ressembler ; « et selon cette maxime, l'homme tempérant est ami de dieu, parce qu'il lui est semblable ; l'homme intempérant ne lui est pas semblable, et il est injuste ». Mais à quel dieu l'homme doit-il être semblable ? Pas au dieu d'Homère ; mais au dieu tel qu'il plaît à Platon de se le façonner. Le Zeus d'Homère n'est certes pas tempérant lorsque, au chant XIV de l'Iliade, il veut avoir commerce avec Héra, sur le mont Ida, sans se retirer dans son palais. C'est uniquement parce que Platon rejette, condamne le récit de ces aventures et d'autres semblables de Zeus, qu'il peut dire ce dieu tempérant. En sorte que son raisonnement est du type suivant : « L'homme doit faire cela, parce qu'il doit être semblable au dieu que j'imagine faire cela ». La valeur logico-expérimentale de ce raisonnement n'est pas du tout supérieure à la simple affirmation : « L'homme doit faire cela ». Il n'en est pas ainsi au point de vue du sentiment, pour lequel il est utile d'allonger autant que possible la dérivation, afin d'éveiller un grand nombre de sentiments ; de même que dans une œuvre musicale on fait de nombreuses variations sur un même motif. Voici, par exemple, STOBÉE ; loc. cit., p. 66, qui, après avoir cité Homère qu'il est bon d'avoir de son côté, quand on peut, ajoute : « Ainsi, Pythagore aussi a dit : suis dieu, ; évidemment pas avec la vue et comme guide, mais avec l'esprit et en harmonie avec la belle ordonnance du monde. Cela est exposé par Platon, selon les trois parties de la philosophie : dans le Timée physiquement.... dans la République éthiquement, dans le Théétète logiquement ». Ainsi, on satisfait tous les désirs.
: « Suis dieu ». Si ce dieu était celui du vulgaire, la règle précédente ajouterait quelque chose à la simple affirmation d'un précepte : elle exprimerait que celui-ci est d'accord avec la nation que le vulgaire a du dieu. De même, si l'on connaissait la volonté de ce dieu par des livres sacrés, par la tradition ou d'une autre manière analogue, quelque chose serait aussi ajouté à la simple affirmation du précepte. Mais quand l'auteur même du précepte détermine aussi la nature et la volonté du dieu, invoquer ce dieu n'a d'autre effet que d'allonger la voie qui mène au but. Que l'auteur affirme directement le précepte, ou qu'il affirme indirectement qu'il tire son origine d'une similitude ou d'une volonté par lui déterminée, c'est exactement la même chose. La tradition pythagoricienne établit précisément une différence entre les dieux du vulgaire et ceux de Pythagore. Dans DIOGÈNE, VIII, 1, 21, Hiéronyme rapporte que Pythagore vit aux Enfers, « l'âme d'Hésiode enchaînée à une colonne de bronze et grinçant des dents, et celle d'Homère attachée à un arbre, entourée de serpents, à cause des choses qu'ils avaient dites au sujet des dieux ». De même, Platon corrige à sa manière la notion que le vulgaire, les poètes, d'autres auteurs, ont de dieu ; et dans le livre III de la République, il repousse et condamne plusieurs des opinions qui avaient cours au sujet des dieux ; il blâme les récits de certains faits, contenus dans Homère, et conclut : « (p. 388) Si donc, ami Adimante, les jeunes gens écoutaient attentivement de tels faits et ne s'en moquaient pas, comme de choses dites d'une manière indigne, quelqu'un d'entre eux, étant homme, les estimera difficilement indignes de lui et les blâmera ». Puis, dans le livre IV des Lois, p. 716, il dit que le semblable plaît à son semblable, et que par conséquent, pour se faire aimer de dieu, il faut que l'homme s'efforce de lui ressembler ; « et selon cette maxime, l'homme tempérant est ami de dieu, parce qu'il lui est semblable ; l'homme intempérant ne lui est pas semblable, et il est injuste ». Mais à quel dieu l'homme doit-il être semblable ? Pas au dieu d'Homère ; mais au dieu tel qu'il plaît à Platon de se le façonner. Le Zeus d'Homère n'est certes pas tempérant lorsque, au chant XIV de l'Iliade, il veut avoir commerce avec Héra, sur le mont Ida, sans se retirer dans son palais. C'est uniquement parce que Platon rejette, condamne le récit de ces aventures et d'autres semblables de Zeus, qu'il peut dire ce dieu tempérant. En sorte que son raisonnement est du type suivant : « L'homme doit faire cela, parce qu'il doit être semblable au dieu que j'imagine faire cela ». La valeur logico-expérimentale de ce raisonnement n'est pas du tout supérieure à la simple affirmation : « L'homme doit faire cela ». Il n'en est pas ainsi au point de vue du sentiment, pour lequel il est utile d'allonger autant que possible la dérivation, afin d'éveiller un grand nombre de sentiments ; de même que dans une œuvre musicale on fait de nombreuses variations sur un même motif. Voici, par exemple, STOBÉE ; loc. cit., p. 66, qui, après avoir cité Homère qu'il est bon d'avoir de son côté, quand on peut, ajoute : « Ainsi, Pythagore aussi a dit : suis dieu, ; évidemment pas avec la vue et comme guide, mais avec l'esprit et en harmonie avec la belle ordonnance du monde. Cela est exposé par Platon, selon les trois parties de la philosophie : dans le Timée physiquement.... dans la République éthiquement, dans le Théétète logiquement ». Ainsi, on satisfait tous les désirs.
[FN: § 1557-1]
Essai d'une philosophie de la Solidarité.
[FN: § 1557-2]
M. Croiset continue : « (p. VI) La solidarité dont parlent couramment aujourd'hui les moralistes et les politiques est une chose assez différente, ou du moins c'est une chose plus complexe ». Ces malins le disent maintenant, mais pendant un certain temps, ils ont cherché à maintenir la confusion. À présent que cela ne leur réussit plus, ils changent l'air de la chanson. « (p. VII) Lorsqu'on parle, comme M. Léon Bourgeois, de la dette sociale des individus, il ne s'agit pas d'une dette commune envers un débiteur étranger, mais d'une dette réciproque des associés, ce qui est tout différent ». Parfait ; mais longtemps messieurs les solidaristes voulaient nous faire croire que les deux choses étaient identiques. « Et lorsqu'on invoque l'exemple de la solidarité biologique, on se garde d'en conclure que, dans la société, les individus sont soumis, comme les cellules d'un organisme vivant, à une sorte de fatalité extérieure et naturelle qu'il suffise de constater [mais que deviennent, ainsi, ces beaux discours sur la solidarité universelle des animaux avec les végétaux, et de ceux-ci avec les minéraux ?] En réalité, on envisage l'idée de solidarité comme un principe d'action, et d'action morale ; comme un moyen de provoquer chez les individus le souci d'une justice plus haute [Dieu sait comment on mesure, en mètres et centimètres, la hauteur de la justice ?], et comme une règle propre à leur permettre d'y atteindre ». Que de choses, dans ce seul mot de solidarité ! C'est vraiment un terme magique ; et encore M. Croiset a-t-il oublié une partie de son contenu, car en celui-ci se trouve aussi le désir des politiciens d'acquérir des partisans, et les adulations des métaphysiciens démocrates à la plèbe. L'auteur conclut, et il a bien raison : « Il est donc évident que le mot de solidarité a pris ici un sens tout nouveau, et que la solidarité morale diffère profondément, malgré l'identité des termes, de la solidarité biologique ou juridique ». Lesquelles, nous venons de le voir, sont des choses différentes.
[FN: § 1557-3]
Loc. cit. 1557-1 « (p. X) Le mot de « solidarité », emprunté à la biologie, répondait merveilleusement à ce besoin-obscur et profond [l'union des individus en un tout : (p. IX)]. Je ne parle pas d'« altruisme », trop barbare pour avoir jamais pénétré dans le langage courant [il y a un autre motif. c'est qu'avec altruisme il n'est pas possible de faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire de faire passer la théorie de la solidarité pour une théorie scientifique]. Comme le terme de « solidarité » était d'ailleurs assez vague, étant transporté d'un domaine où il avait un sens précis à un autre domaine où il s'agissait justement de l'acclimater, on restait libre de faire entrer peu à peu dans sa signification toutes les idées encore flottantes que les vieux mots, rendus trop précis par l’usage se prêtaient mal à exprimer ».
[FN: § 1559-1]
Au congrès de la paix, à Genève, en septembre 1912, quelques pacifistes français voulaient que l'emploi des aéroplanes en temps de guerre fût admis, tandis que les pacifistes d'autres pays voulaient qu'il fût interdit. Par une coïncidence qui pourrait ne pas être fortuite, la France était alors justement le pays que l'on disait être le mieux préparé à la guerre aérienne. Les pacifistes anglais qui réprouvaient la conquête de la Libye, faite par l'Italie, s'indignèrent profondément, parce que le congrès exprima le vœu de voir l'Angleterre se retirer de l'Égypte. Quel logicien sera assez subtil pour nous expliquer, à nous autres simples mortels, pourquoi la conquête de l'Égypte est « selon le droit », et celle de la Libye contraire au droit ? Les pacifistes belliqueux de 1911 avaient prêché ou simplement cru que Jules-César, Napoléon Ier et autres conquérants, étaient de simples « assassins » ; qu'il n'y avait pas de guerres « justes », sauf, peut-être, pour la défense de la patrie ; et puis, un beau jour, ils tournèrent casaque, et voulurent qu'on admirât comme des héros d’autres conquérants, qu'on acceptât comme « justes » des guerres de conquête ; cela sans nous apprendre comment on peut et l'on doit distinguer les conquérants et les guerres blâmables, des conquérants et des guerres louables. Au lieu d'instruire les dissidents, ils les injurient. Au moins notre Sainte Mère l'Église catholique instruisait-elle les hérétiques par le catéchisme, avant de les brûler. Les pacifistes belliqueux italiens s'indignèrent contre leurs concitoyens pacifistes-pacifiste à tel point que, s'ils l'avaient pu, ils leur auraient fait une guerre à mort. Ils faisaient cela, disaient-ils, pour défendre l'honneur de leur pays. Mais n'est-ce pas là justement la cause d'un très grand nombre des guerres qu'ils blâmaient auparavant ? – ÉMILE OLLIVIER écrit, pour justifier la guerre de 1870 (L'Emp. lib., t. XIV) : « Placés entre une guerre, douteuse et une paix déshonorée, bellum anceps an pax inhonesta, nous étions obligés de nous prononcer pour la guerre : nec dubitatum de bello.„ Pour les peuples comme pour les individus, il y a des circonstances où la voix de l'honneur doit parler plus haut que celle de la prudence “ (Cavour à Arese, 28 février 1860).Les gouvernements ne succombent pas seulement aux revers ; le déshonneur les détruit aussi. (p. 559) Un désastre militaire est un accident qui se répare.La perte acceptée de l'honneur est une mort dont on ne revient pas ». Pourquoi cet auteur, si haï des pacifistes, avait-il tort ? et pourquoi ceux-ci ont-ils raison, quand il leur devient avantageux de répéter exactement ses paroles ? En somme, peut-on savoir si Rome avait tort ou raison de faire la guerre aux nations qui occupaient les rives africaines de la Méditerranée, et de conquérir ces contrées ? Si elle avait raison, qu'en est-il de la belle doctrine du pacifisme, et comment est-il désormais possible de la distinguer de celle qui n'est pas pacifiste ? Si elle avait tort, comment donc se peut-il qu'aujourd'hui ceux qui essaient de faire précisément la même chose aient raison ? Répondre par des vivats ou en injuriant ses adversaires est peut-être un bon moyen d'exciter les sentiments, mais n'a pas moindre valeur logique, ni même vaguement raisonnable.
[FN: § 1562-1]
CICÉRON déjà, Acad. quaest., II, 46, 142, note plusieurs sens du terme vrai, et, depuis ce temps-là, le nombre de ces sens est allé toujours croissant. Aliud iudicitim. Protagorae est, qui putet id cuique verum esse, quod culque videatur : aliud Cyrenaicorum, qui praeter permotiones intimas, nihil putant esse iudicii : aliad Epicuri, qui omme iudicium in sensibus, et in rerum notitiis, et in voluptate constituit. Plato autem omne iudicium veritatis, veritatemque ipsam, adductam ab opinionibus et a sensibus, cogitationis ipsitis et mentis esse voluit...
[FN: § 1564-1]
D. AUGUST. ; Serm. 327 : In natali Martyrum, III. (4) Omnes haeretici etiam pro falsitate patiuntur, non pro veritate : quia mentiuntur contra ipsum Christum. Omnes pagani, impii quaecumque patiuntur, pro falsitate patiuntur. Mais comment distingue-t-on les vrais martyrs ? D'une façon très simple : À ce qu'ils sont morts pour la vérité : (2) Ergo ostendamus illos veraces. Iam ipsi se ostenderunt, quando pro veritate etiam mori voluerunt. De cette manière, les martyrs prouvent la vérité de la foi, ils en sont les témoins ; et la foi prouve la vérité des martyrs.
[FN: § 1564-2]
BAYLE ; Comm. philosoph., t. II : « (p. 85) On ne fait Mal, quand on force, que quand on force ceux qui sont dans la Vérité à passer dans l'Erreur. Or nous n'avons pas forcé ceux qui étaient dans la Vérité à passer dans l’Erreur ; (car, nous, qui sommes Orthodoxes, vous avons forcez, vous, qui étiez Schismatiques, ou Hérétiques, à passer dans notre Parti). Donc, nous n'avons pas mal fait. Et ce seroit vous seulement qui feriez Mal, si vous nous forciez. N'est-ce point là le Sophisme qu'on appelle Petitio Principii ? auquel en cette rencontre, il n'y a point de meilleure Réponse à faire, que de convertir la Mineure, de Négative en Affirmative, et de conclure directement contre celui qui s'en est servi ».
[FN: § 1564-3]
Les socialistes excluent de leur parti, et par conséquent excommunient ceux qui ne se conforment pas à la doctrine du parti. En vérité cela leur est indispensable, comme à toutes les personnes qui veulent constituer un parti. Mais ensuite il en est parmi eux qui veulent exclure de l'enseignement les prêtres catholiques, parce qu'ils ne sont pas « libres » de penser ce qu'ils croient, mais « doivent » suivre les enseignements de l'Église. Ce « devoir » du prêtre catholique est identique à celui du socialiste. Tous deux « doivent » suivre la doctrine de la collectivité à laquelle ils appartiennent, sous peine d'être exclus de cette collectivité. Si donc ce « devoir » est en opposition avec l'efficacité de l'enseignement, pour accroître cette efficacité, il est utile d'exclure à la fois le prêtre et le socialiste ; et si cette opposition n'existe pas, il est utile d'admettre à la fois le prêtre et le socialiste. Mais le sentiment fait une distinction. Ceux qui sont amis des prêtres et ennemis des socialistes, disent qu'on doit admettre les premiers, exclure les seconds. C'est ce qui arrive plus ou moins en Allemagne. Ceux qui sont ennemis des prêtres et amis des socialistes disent qu'on doit exclure les premiers, admettre les seconds. C'est ce qu'on veut faire en France. Aux naïfs, aux niais, aux pauvres d'esprit, on raconte que tout cela se fait par amour de « l'État éthique » ou de dame « Liberté ».
[FN: § 1567-1]
Les personnes qui ont la foi religieuse ou métaphysique disent que la vérité » qui se trouve à cet extrême est « supérieure » à celle qui se trouve à l'autre. C’est une conséquence logique de leur croyance que la religion, la métaphysique, la « science » des Hégéliens (§ 19 et sv.) sont « supérieures » à l'expérience. Les matérialistes invertissent cette proposition; mais leur « expérience » n'est qu'un genre de religion. Ils comparent en réalité deux « vérités » du second extrême.
[FN: § 1567-2]
Voici un exemple entre tant d'autres : MERLE D'AUBIGNÉ : Histoire de la Réformation, Genève, 1860, t. I : « (p. 17) Le monde (a), affaibli, chancelait sur ses bases quand le christianisme parut (b). Les religions nationales, qui avaient suffi aux pères, ne satisfaisaient plus les enfants... (c). Les dieux de toutes les nations, transportés dans Rome, y avaient perdu leurs oracles (d), comme les peuples y avaient perdu leur liberté... (e). (p. 18) Bientôt les étroites nationalités tombèrent avec leurs dieux. Les peuples se fondirent les ans dans les autres (f). En Europe, en Asie, en Afrique, il n'y eut plus qu'un empire (g). Le genre humain (h) commença à sentir son universalité et son unité ». Si l'on fixe son attention sur la réalité historique, les observations suivantes surgissent spontanément : (a) Qu'entend cet auteur par le terme tout le monde ? Parfois il semble qu'il entende le monde romain, c'est-à-dire la région méditerranéenne ; parfois il semble qu'il fasse allusion au globe terrestre. Quand il dit que le monde était affaibli, il est probable qu'il pense au monde romain, car il ne semble pas possible qu'il pense à la Chine, au Japon, à la Germanie et à tant d'autres pays. (b) Affaibli, pourquoi ? Le christianisme parut en un temps où l'empire romain était prospère et très fort. C'est plutôt après le triomphe du christianisme que l'empire s'affaiblit. Nombre d'empereurs païens imposèrent par le fer la paix aux Barbares ; nombre d'empereurs chrétiens l'achetèrent à prix d'or. (c) L'auteur oublie que si le christianisme voulait, en effet, ne pas être une religion nationale, en fait, il l'est devenu. Au contraire, l'islamisme est proprement sans nationalité, même de notre temps. De lui, mieux que du christianisme, on peut dire qu'il parut quand le monde (romain) était affaibli. (d) L'oracle de Delphes était très célèbre dans l'antiquité. Mais a-t-il vraiment disparu, parce que son dieu avait été transporté à Rome ? Où l'auteur peut-il bien avoir trouvé mention de ce transport ? (e) L'auteur veut faire une belle phrase, littérairement parlant, en mettant d'un côté les oracles des dieux et de l'autre la liberté des peuples. Il ne se soucie pas plus que cela de la réalité historique. (f) Quels peuples ? L'auteur ne pense probablement qu'aux peuples vaincus et subjugués par les Romains , il oublie les Barbares, les Chinois, les Japonais, les Hindous, les Africains, les Américains : une misère, quoi ! (g) Ici, l'auteur nomme certainement la partie pour le tout : il ne peut ignorer que l'empire romain était bien loin de s'étendre sur toute l'Europe, toute l'Asie, toute l'Afrique. (h) Mais si l'observation précédente est exacte, comment peut-il bien lui venir maintenant à l'idée de nommer le genre humain ? Et si ce que nous avons supposé dans l'observation précédente n'est pas exact, c'est-à-dire si l'auteur a vraiment voulu faire allusion à toute l'Europe, à toute l'Asie, à toute l'Afrique, – négligeons l'Amérique et l'Océanie – il est vrai qu'à la rigueur il peut tant bien que mal parler du « genre humain », mais il est non moins vrai qu'il a dit une chose fantaisiste. Celui qui lit cette histoire et partage la foi de l'auteur, n'aperçoit pas ces flagrantes contradictions avec la réalité ; de même que l'amoureux n'aperçoit pas les défauts de la femme qu'il aime. À leur sujet, LUCRÈCE, (IV, 1156. 1136, 1160, selon les éditions) écrivait déjà :
(1156) Nigra
; est, immunda ac fetida,
Caesia, [nervosa et lignea,

Parvola, pumilio,tota merum sal ;
...
(1166) Cetera de genere hoc, longum est, si dicere coner.
Molière a imité ces vers, Le misanthrope, acte II, scène VI. Il dit des amoureux :
Ils comptent les défauts pour des perfections,
Et savent y donner de favorables noms.
La pâle est au jasmin en blancheur comparable ;
La noire à faire peur, une brune adorable ;
etc.
[FN: § 1569-1]
Pourtant il blâme (XII, 25 m) l'usage trop abondant que Timée fait des discours, et, au fond (XII, 25 n), il semble que pour lui cet usage soit admissible uniquement comme moyen de faire connaître les sentiments et les mœurs. Comp. Thucyd I, 22.
[FN: § 1570-1]
JEAN RÉVILLE ; Le quatr. Évang. : « (p. 114 note). M. Loisy, à la fin de son étude sur Le Prologue du IVe évangile, p. 266 (Rev. d'hist. et de litt. rel., 1897), dit de l'évangéliste : „ Il n'écrit pas une histoire de Jésus, mais plutôt un traité de la connaissance de Jésus “. Je maintiens qu'il se propose bien d'écrire une histoire mais telle que la comprend un alexandrin, ce qui diffère du tout an tout de l'histoire telle que nous l'entendons ».
[FN: § 1570-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. LAO-TSEU ; Le Livre de la Voie et de la Vertu : « (Ch. XLVII – p. 174) Sans sortir de ma maison, je connais l'univers ; sans regarder par ma fenêtre, je découvre les voies du ciel. Plus l'on s'éloigne et moins l'on apprend. C'est pourquoi le sage arrive (où il veut) sans marcher ; il nomme les objets sans les voir ; sans agir, il accomplit de grandes choses ».
[FN: § 1571-1]
A. Loisy ; Études sur la religion chaldéo-assyrienne, dans la Revue des Religions, 1892. – On trouve une dérivation semblable dans un autre ouvrage de notre auteur. A. Loisy; Études bibliques : (« p. 131) Il ne faut pas dire néanmoins que la Bible contient des erreurs astronomiques. Ce serait à la fois une injustice et une naïveté. Pour qu'on fût en droit de reprocher à la Bible une erreur de ce genre, il faudrait que, dans un passage quelconque, un auteur inspiré manifestât l'intention d'imposer à son lecteur, comme vérité certaine [autre genre de vérité ! qu'ils sont donc nombreux !], telle ou telle conception sur le système du monde. Mais aucun des écrivains (p. 132) sacrés n'a laissé entrevoir la volonté d'écrire une leçn d'astronomie ». L'auteur ne veut pas que les sentiments défavorables entraînés par le mot erreur, puissent être éveillés, quand on parle de l'Écriture Sainte. C'est pourquoi il fait une dérivation, en confondant l'erreur objective et l'erreur subjective, et en donnant un seul nom à ces choses différentes. S'il avait voulu s'exprimer clairement, il aurait dû dire : « Parce qu'il y a dans la Bible des affirmations qui ne correspondent pas aux faits, c'est-à-dire des erreurs objectives, il n'est pas permis d'en conclure que l'écrivain ait voulu nous faire croire que ces affirmations correspondissent aux faits, ni qu'il en fût lui-même persuadé (erreur subjective) ». Mais ainsi on admet l'existence des erreurs objectives, ce qu'au fond A. Loisy ne veut pas nier ; pourtant il ne veut pas non plus se servir du terme erreur. La proposition de A. Loisy, laquelle est en somme celle de nombreux exégètes modernes, n'est, en vérité, pas très probable ; mais si l'on veut être très rigoureux, on ne peut la contester. Supposez un naturaliste qui discute avec sa femme du menu d'un dîner, et qui dise : « Comme poisson, au lieu de rouget, je propose de mettre une langouste ». Il y a, dans cette proposition, une erreur objective, parce que la langouste n'est pas un poisson ; il n'y a pas d'erreur subjective, parce que le naturaliste le sait fort bien ; mais il ferait rire sa femme s'il disait en pédant : « Comme plat de poisson, au lieu du poisson rouget, nous mettrons le crustacé langouste ». Pourtant, cela étant admis, il n'en demeure pas moins que dans la première proposition il y a une erreur objective.
[FN: § 1571-2]
X. ROUSSELOT ; Étude sur la philosoph. dans le moyen-âge, II : « (p. 111) En ces temps où apparut le christianisme, le sentiment chez les peuples était étouffé ou vicié ; ... Vint enfin le christianisme avec tous ses bienfaits, qui réchauffa les âmes, et fit résonner la (p. 15) corde religieuse devant laquelle se turent les deux autres ; mais le vrai ne pouvant être que dans une réalité complète [proposition inintelligible], le moment arriva où l'intelligence et aussi la volonté, après avoir, pour ainsi dire, expié leurs fautes, par une longue soumission, demandèrent à reprendre la place qui leur appartient ». En conséquence, parce que le vrai ne peut être que dans une réalité complète, il s'en suit que l'intelligence et la volonté demandent une certaine place qui leur appartient ! « (p. 15) Alors se forma chez les nouveaux penseurs, le nominalisme d'abord, cette manifestation première de l'intelligence indépendante, on sait ce qu'il en faut penser ; puis le réalisme, manifestation plus haute et plus digne [pourquoi plus haute ? quant à la dignité, qui en est juge ?], mais également exclusive, et qui, par conséquent, ne pouvait pas donner une formule exacte de la vérité, car celle-ci veut l'harmonie, et il n'y avait alors qu'antagonisme ». Mais quand et où la vénérable dame Vérité a-t-elle exprimé qu'elle voulait l'harmonie ? Et que peut bien signifier cela ?
[FN: § 1572-1]
L. DUCHESNE ; Hist. anc. de l'Église, t. III.
[FN: § 1575-1]
D. AUGUST. ; Epist., 93, Vicentii, c. 1, 2.
[FN: § 1575-2]
idem ; Ibidem : (c. 2, 5) Putas neminem debere cogi ad iustitiam.
[FN: § 1575-3]
Idem ; Ibidem : (c. 3, 10) ... ut coercitione exsiliorum atque damnorum admoneantur considerare quid, quare patiantur, et discant praeponere rumoribus et calumniis hominum Scriptura quas legunt.
[FN: § 1575-4]
Idem ; Ibidem : (10) Et hoc quidem, vel de omnibus haereticis, qui Christianis sacramentis imbuuntur, et a Christi veritate, sive unitate dissentiunt, vel Donatistis omnibus dixerim. Le saint dit ensuite que l'on ne doit pas rechercher si l'on est ou non contraint, mais bien si l'on est contraint au bien ou au mal : (c. 5, 16) ... sed quale sit illud quo cogitur, utrum bonum an malum. C'est toujours la même histoire. Je veux vous contraindre à faire ce qui me plaît : j'appelle bien ce qui me plaît, mal ce qui vous plaît, et je dis ensuite que vous ne devez pas vous plaindre si je vous contrains au bien. – Cfr. Epist., 175, 185. Il est plaisant de lire que saint Augustin, après avoir exposé un grand nombre de considérations théologiques sur le baptême, ajoute : (Epist., 89, 6). Et tamen cum tam perspicua veritas [c'est ainsi que le saint homme appelle ses divagations] aures et corda hominum feriat, tanta quosdam malae consuetudinis vorago submersit, ut omnibus auctoritatibus rationibusque resistere, quam consentire malint. Resistunt autem duobus modis, aut saeviendo aut pigrescendo. C'est pourtant bien clair ; et cependant on veut nous faire croire que les catholiques ne faisaient que se défendre ! Il faut un certain courage pour prétendre que celui qui résiste « pigrescendo », attaque autrui !
[FN: § 1575-5]
BAYLE ; Comment. philosoph., t. II : « (p. 11) Examinons donc les deux Lettres de cePère [de Saint Augustin], que l'Archevêque de Paris a fait imprimer à part, selon la nouvelle Version Françoise... (p. 12) Tout le Livre est intitulé, Conformité de la Conduite de l'Église de France, pour ramener les protestans, avec celle de l'Église d’Afrique, pour ramener les Donatistes à l'Église Catholique ». Aujourd'hui, M. Combes aurait pu faire imprimer un autre livre, en ajoutant à ces deux « conformités » celle de l'œuvre des anti-cléricaux, tendant à ramener les catholiques à l'église radicale-socialiste. Les admirateurs de Saint Augustin ne doivent pas oublier le proverbe : on récolte ce qu'on a semé. Pourtant le saint ne voulait pas la mort du pécheur. Epist., 100 : Augustinus Donato proconsuli Africae, ut Donatistas coerceat, non occidat. Ses successeurs ne furent pas si doux. Lui-même ne s'émeut pas si les donatistes se donnent la mort pour fuir la persécution qu'il a approuvée et suscitée. Epist., 185, c. 3 : (14) Si autem seipsos occidere voluerint, ne illi qui liberandi sunt liberentur [c'est-à-dire pour nous empêcher de persécuter les autres]... Quid agit ergo fraterna dilectio ; utrum dum paucis transitorios ignes metuit caminorum, dimittit omnes acternis ignibus gehennarum. Ces quelques mots contiennent tout le programme de l'Inquisition. Cfr. Contra Gaudentium, 1. I. c. 24 et sv.
[FN: § 1576-1]
D. AUGUST. ; Epist., 85, c. 9 : (35) Quod autem nobis obiiciunt, quod res eorum concupiscamus et auferamus... (36)Quidquid ergo nomine ecclesiarum partis Donati possidebatur, Christiani Imperatores legibus religiosis cum ipsis ecclesiis ad Catholicam transire iusserunt. C'est ainsi que, de nos jours, en France, les biens des congrégations passèrent au gouvernement... et aussi, paraît-il, en grande partie aux liquidateurs et aux politiciens, leurs complices. Il y a un aveu indirect des spoliations, dans ce que dit le saint, après avoir cité un exemple biblique. « Au jour du jugement : (c. 9, 41) Eodem modo non stabit paganus adversus Christianum, qui abstulit labores eius, quando idolorum exspoliata vol diruta sunt templa; sed stabit Christianus adversus paganum, qui abstulit labores eius, quando Martyrum strata sunt corpora [quelle remarquable puissance on trouve dans cette métaphore, pour s'approprier le bien d'autrui!]. Sic ergo non stabit haereticus adversus catholicum, qui abstulit labores eius, quando praevaluerunt leges catholicorum Imperatorum; sed stabit catholicus adversus haereticum, qui abstulit labores eius, quando furores praevalebant impiorum Circumcellionum.L'évêquedonatisteGaudentiusditdes catholiques ; (Contra Gaud., 1. I, c. 36, 46) Sed hoc non sciunt, inquit, alienarum rerum incubatores... Dans sa réponse, le saint ne nie pas le fait, mais insiste seulement sur ce point : que les donatistes ne sont pas les justes de l'Écriture. Il dit : (c. 28, 51) De iustitia certamen est, non de pecunia. Oui, mais en attendant ils leur prenaient leur argent ! et il paraît que les donatistes devaient en être contents, parce qu'il est écrit : Labores impiorum iusti edent (Sap., X, 19), et parce que les catholiques étaient poussés par le désir de dissiper l'erreur, et non par la cupidité. In talibus quippe omnibus factis, non rapina concupiscitur, sed error evertitur. Ensuite, les catholiques ont pris les biens des hérétiques, pour les leur restituer... lorsqu'ils seront convertis.
[FN: § 1576-2]
D. AUGUST. ; Epist., 98, c. 5, 19 : Ita sane huic provisioni contradicere debui, ne res quas dicitis vestras, perderetis, et securi Christum proscriberetis : ut iure Romano testamenta, conderetis, et iure divino patribus conditum Testamentum, ubi scriptum est : « In semine tuo benedicentur omnes gentes (Gen., XXVI, 4) », calumniosis criminationibus rumperetis : ut in emptionibus et venditionibus liberos contractus haberetis, et vobis dividere quod Christus emit venditus auderetis...
[FN: § 1578-1]
RENAN ; Vie de Jésus, p. XXX.
[FN: § 1578-2]
RENAN ; Vie de Jésus : « (p. XLVII) Dans presque toutes les histoires anciennes, même dans celles qui sont bien moins légendaires que celles-ci, le détail prête à des doutes infinis. Quand nous avons deux récits d'un même fait, il est extrêmement rare que les deux récits soient d'accord. N'est-ce pas une raison, quand on n'en a qu'un seul, de concevoir bien des perplexités? On peut dire que parmi les anecdotes, les discours, les mots célèbres rapportés par les historiens, il n'y en a pas un de rigoureusement authentique. Y avait-il des sténographes pour fixer ces paroles rapides ? Y avait-il un annaliste toujours présent pour noter les gestes, les allures, les sentiments des acteurs ? Qu'on essaye d'arriver au vrai sur la manière dont s'est passé tel ou tel fait contemporain ; on n'y réussira pas. Deux récits d'un même événement faits par des témoins oculaires diffèrent (p. XLVIII) essentiellement. Faut-il pour cela renoncer à toute la couleur des récits et se borner à l'énoncé des faits d'ensemble ? Ce serait supprimer l'histoire ».
[FN: § 1578-3]
Il y a tant d'autres belles vérités ! Par exemple, ANTONIO Fogazzaro, dans le Corriere della Sera, 21 novembre 1910, parlant de Tolstoï, dit : « Il créa des vérités et ne sembla jamais se soucier de créer des beautés. Il sembla presque dédaigner l'art, comme inférieur, comme humain et non divin. Mais de l'entière Vérité, il fut presque la voix et la flamme. Non de la seule vérité qui, palpitante, poursuit l'artiste, mais bien aussi de la vérité morale resplendissant dans la conscience qui s'en est pénétrée. Vrai et Bien furent un pour lui. Certes, tout ce qui lui parut Bien et Vrai ne me parait pas Bien et Vrai, à moi, à une infinité d'autres qui ont la passion du Bien et du Vrai ». Le mot vrai est écrit tantôt avec une majuscule initiale, tantôt avec une minuscule ; mais on ne voit pas très clairement si les deux choses sont différentes ni quelle serait cette différence. Dame Vérité possède une voix et une flamme, ce qui doit lui être bien agréable, mais est quelque peu obscur pour nous. Il existe une certaine vérité morale « resplendissant dans la conscience qui en est pénétrée ». On le comprend, parce qu'il semble à chacun que ce dont il est pénétré resplendit ; mais le malheur est que chacun n'est pas pénétré ! Que veut dire « créer des vérités » ? Habituellement, on les découvre, on les affirme, on les fait connaître, tandis qu'on crée facilement des fables et des sornettes. On pourrait objecter que nos critiques ne s'adressent pas avec raison à ce qu'écrit ici Fogazzaro. parce que nous examinons au point de vue logico-expérimental des expressions qui ont pour but unique d'agir sur le sentiment. Cela est vrai ; mais précisément notre critique n'a d'autre but que de démontrer cette dernière proposition. Des écrits de ce genre sont ridicules, au point de vue logico-expérimental, tandis qu'ils peuvent être très efficaces pour éveiller les sentiments. C'est là que gît la valeur des dérivations.
[FN: § 1579-1]
Abbé DE BROGLIE ; Les prophètes et la prophétie d'après les travaux de Kuenen dans Revue des Religions, 1895).
[FN: § 1579-2]
GOUSSET ; Théol. dog., t. I, commence par dire (p. 312) Mais pour qu'une prophétie fasse preuve, il faut, premièrement, qu'elle ait désigné l'événement prédit d'une manière nette et précise ; en sorte que l'application de la prophétie ne soit pas arbitraire ». Parfait ; c'est raisonner suivant la méthode logico-expérimentale. Mais, hélas, on ne tardera pas à nous retirer la concession qu'on nous avait faite. « (p. 313) Toutefois il n'est pas nécessaire que la prophétie soit de la plus grande clarté ; il suffit qu’elle soit assez claire pour exciter l'attention des hommes, et pour être comprise lorsqu'elle est accomplie ».
[FN: § 1579-3]
Histoire des ducs de Normandie par GUILLAUME DE JUMIÈGE, publiée par GUIZOT ; Caen, 1826. On demande à un homme mystérieux si la descendance du comte Rollon durerait longtemps « (p. 313) Il ne voulut rien répondre, et se mit seulement à tracer des espèces de sillons sur les cendres du foyer avec un petit morceau de bois qu'il tenait à la main. L'hôte alors ayant voulu très obstinément lui faire dire ce qui arriverait après la septième génération, l'autre, avec le petit morceau de bois qu'il tenait toujours à la main, se mit à effacer les sillons qu'il avait faits sur la cendre. Par où l'on pensa qu'après la septième génération le duché serait détruit, ou bien qu'il aurait à souffrir de grandes querelles et tribulations : choses que nous voyons déjà accomplies en grande partie, nous qui avons survécu à ce roi Henri, lequel a été, comme nous pouvons le montrer, le septième au rang dans cette lignée ». – PAULIN PARIS ; Les romans de la table ronde, II. Le magicien Merlin dit que « (p. 56) à l'avenir il ne fera plus que des prédictions dont on ne reconnaîtra le sens qu'après leur accomplissement.„ Je ne parlerai plus devant le (p. 57) peuple ne en cort, se obscurément non ; que il ne sauront que je dirai devant que il le verront “. Merlin a tenu parfaitement sa parole, et tous les devins, ses devanciers ou successeurs, ont imité son exemple ». En effet, c'est une excellente précaution qu'on peut, en toute sécurité, recommander à messieurs les devins et aux prophètes.
[FN: § 1579-4]
GUYNAUD) ; La concordance des prophéties de Nostradamus avec l'histoire depuis Henry II jusqu'à Louis le Grand, Paris, 1712. Voici, au hasard, une des vérifications de notre auteur (p. 115). Centurie III, Quatrin 91.
L'arbre qu'avoit par long temps mort seiché,
Dans une nuit viendra à reverdir :
Chron. Roi malade : Prince pied attaché,
Craint d'ennemis fera voiles bondir.
« Explication : Les Historiens sont bien d'accord de la vérité du sujet de cette Prophetie (p. 116) mais ils ne conviennent pas du jour ni du mois qu'elle s'est accomplie. Favin... rapporte que le lendemain de la Saint Barthelemi, 25 Août 1572. ... un vieux arbre qu'on appelloit l'Aubespine, qui étoit tout sec et mort depuis longtemps, se trouva dans l'intervale de la nuit du Dimanche au lundi tout verd le matin... C'est ce qui justifie aujourd'hui la verité des deux premiers Vers : L’arbre qu'avoit par longtemps mort seché; dans une nuit viendra à reverdir. Cependant Janus Gallicus dit que cela n'arriva qu'en Septembre de la môme année 1572... Mais que ce prodige soit arrivé le lendemain de la saint Barthelemi, ou qu'il ne soit arrivé que sept ou huit jours après, il n'importe aujourd'hui ; il suffit que Nostradamus l'avoit prédit. Les deux (p. 117) Vers poitent : Chron. Roi malade; Prince pied attaché: Craint d'ennemis fera voiles bondir. C'est encore ici les signes ordinaires de la vérité des prédictions de Nostradamus ; en ce que Charles IX, quelque temps après que ce prodige fut arrivé, se trouva indisposé... d'une maladie chronique, c'est-à-dire d'une espèce de fievre quarte. Prince pied attaché : cela vouloit dire que M. le Duc d'Anjou s'attacheroit, comme il fit, aussi environ ce même temps là, au pied des murailles de la Rochelle,... et que par la crainte des ennemis de la France, le Roi mettroit aussi une Armée Navale sur pied, suivant ce dernier Vers : Craint d'ennemis fera voiles bondir ». Voir aussi CHARLES NICOULAUD ; Nostradamus et ses prophéties, 1914, Paris, Boussus. Swift plaisante agréablement ces faiseurs de prophéties. Il feint, sous le nom de Bickerstaff, de faire plusieurs prédictions ; entre autres il annonce, pour des jours indiqués, la mort du faiseur d'almanachs Partridge et celle du cardinal de Noailles. Il suppose qu'on conteste que ces prophéties se soient avérées, et il répond. Opuscules humoristiques de SWIFT, traduits par LÉON DE WAILLY – Paris, 1859 : (p. 219) En dépit de tous mes efforts, je n'ai pas pu découvrir plus de deux objections contre l'exactitude de mes prophéties de l'année dernière : la première est celle d'un Français à qui il a plu de faire savoir au monde, « que le cardinal de Noailles était encore en vie, malgré la prétendue prophétie de (p. 220) M. Biquerstaffe (sic) » : mais jusqu’à quel point un Français, un papiste et un ennemi, est croyable dans sa propre cause, contre un protestant anglais, fidèle au gouvernement, j'en ferai juge le lecteur candide et impartial [des arguments de ce genre ont continué à être très sérieusement employés]. L'autre objection... a trait à l’article de mes prédictions qui annonça la mort de M. Partridge pour le 29 mars 1708. Il lui plaît de contredire formellement ceci dans l'almanach qu'il a publié pour la présente année... Sans entrer dans des critiques de chronologie au sujet de l'heure de sa mort, je me bornerai à prouver que M. Partridge n'est pas en vie ». Suivent des arguments qui sont des parodies de ceux en usage en pareilles occasions. Entre autres : « (p. 221) Deuxièmement, la mort est définie, par tous les philosophes, une séparation de l'âme et du corps. Or il est certain que sa pauvre femme, qui doit le savoir mieux que personne va depuis quelque temps de ruelle en ruelle dans son voisinage, jurant à ses commères que son mari est un corps sans âme. C'est pourquoi, si un ignorant cadavre continue d'errer parmi nous, et qu'il lui plaise de s'appeler Partridge, M. Bickerstaff ne s'en croit aucunement responsable ». Au sujet du moment précis de la mort de Partridge, « (p. 228) plusieurs de mes amis... m'assurèrent que j'étais resté en deçà d'une demi-heure : ce qui (j'exprime ma propre opinion) est une erreur de trop peu d'importance pour qu'il y ait lieu à se tant récrier ». C'est à peu près ce que dit Guynaud à propos de l'arbre mort.
Ce fut aussi après l'événement que l'on comprit le sens de l'oracle d'Apollon : Aio, te, Aeacida, Romanos vincere posse. Pyrrhus croyait vaincre les Romains, et, au contraire, ce fut lui qui fat vaincu ; tout cela parce qu'en latin la proposition infinitive a deux accusatifs : celui du sujet et celui du complément direct. Mais ces maudits sceptiques, qui ignorent le caractère des vrais oracles, objectent que la Pythie n'a jamais parlé latin dans ses oracles : Primum latine Apollo nunquam locutus est. Deinde ista sors inaudita Graecis est. Praeterea Pyrrhi temporibus iam Apollo versus facere desierat. Postremo, quanquam semper fuit, ut apud Ennium est,
… Stolidum genus Aeacidarum,
Bellipotentes sunt magi', quam sapientipotentes :
tamen hanc amphiboliam versus intelligere potuisset, « vincere te Romanos », nihilo magis in se, quam in Romanos valere (CIC.; De div., 11, 56, 116).
[FN: § 1579-5]
ABBÉ DE BROGLIE ; loc. cit. § 1579-1 : « p. 121) Kuenen fait une constatation plus étrange encore. Quand il arrive aux auteurs du Nouveau Testament de se servir d'un texte de l'Ancien dans un sens contraire au sens naturel des termes, ils ne craignent pas d'altérer le texte et de supprimer les phrases, les incises et les mots qui fixaient le sens de l'original ». L'auteur cite un exemple où Saint Paul a certainement altéré un texte biblique : « (p. 122) Ce passage est extrêmement étrange et embarrassant. Il semble que Saint Paul déclare que Moïse ait dit une (p. 123) chose qu'il n'a évidemment pas dite. Néanmoins en examinant la chose avec attention, la difficulté diminue ». Suivent des explications fort subtiles, pour prouver qu'en somme Saint Paul a raison. Pourtant, l'auteur n'est pas satisfait. « (p. 124) Malgré ces explications il reste toujours une difficulté. La manière dont Saint Paul cite l'Ancien Testament est certainement d'une étrange liberté et il est clair qu'il donne un enseignement dogmatique et non un commentaire grammatical du texte ». Loin d'être un « commentaire grammatical », c'est un texte faux qu'on nous présente. L'auteur dit qu'on peut chercher des solutions à cette difficulté ; cependant « (p. 124) si ces solutions nous paraissent imparfaites, nous avons une ressource que le Pape lui-même nous indique, c'est de suspendre notre jugement cunctandum a sententia. Nous nous demandons même si ce dernier parti n'est pas le plus sage en présence du texte cité plus haut ».
[FN: § 1580-1]
Le maréchal de Moltke a écrit l'histoire de la guerre de 1870, et dans la préface, on nous donne son avis sur le but qu'il s'est proposé en écrivant cet ouvrage. DE MOLTKE ; La guerre de 1785.1870 : « (p. II) Ce qu'on publie dans une histoire militaire reçoit toujours un apprêt, selon le succès plus ou moins grand qui a été obtenu, mais le loyalisme et l'amour de la patrie nous imposent l'obligation de ne pas détruire certains prestiges dont les victoires de nos armées ont revêtu telle ou telle personne ». Parfaitement. On déclare ainsi le but, qui est d'exposer les faits, mais en tenant compte de l'utilité sociale que peut avoir ce récit.
[FN: § 1580-2]
Manuel I, 40.
[FN: § 1580-3]
Bien que cela puisse paraître étrange, il est pourtant certain qu'en un même pays il peut y avoir en même temps des histoires de différents genres. Par exemple, l'histoire du Risorgimento qu'on enseigne dans les écoles Italiennes diffère sur plusieurs points de l'histoire réelle, qui est bien connue. En février 1913, l'empereur allemand fit un discours, à l'Aula de l'université de Berlin, et dit : « Il a été donné au peuple prussien de se relever des malheurs, grâce à sa foi. Aujourd'hui, on ne veut croire que ce qu'on peut voir et toucher ; et l'on veut susciter toujours de nouvelles difficultés à la religion. Or, peu après le règne de Frédéric le Grand [Frédéric II], la Prusse ayant perdu la foi, la catastrophe de 1806 eut lieu. Il faut y voir la main de Dieu et non celle des hommes. De cette crise est née la nation allemande. Dieu a montré qu'il protégeait l'Allemagne. Que notre jeunesse forge ses armes au feu de la foi ; et avec de telles armes, nous pourrons aller de l'avant, pleins de confiance en la puissance divine ». Le Berliner Tageblatt observe : « L'empereur a dit que la Prusse perdit la foi peu après la mort de Frédéric II et que c'est pour cette raison qu'elle fut vaincue en 1806. Il faut remarquer que le victorieux Frédéric Il ne fut certainement pas un héros en matière de foi, et que la Prusse fut défaite sous le règne d'un prince très pieux. Il est vraiment difficile d'employer le compas de la religion pour les faits historiques ». Au point de vue des faits expérimentaux, c'est bien, mais non s'il s'agit de donner de la force aux sentiments d'un pays ; et c'est ce dernier but que visait exclusivement l'empereur. Au point de vue des faits expérimentaux, le discours impérial est si étrange, qu'il rappelle une poésie de Fucini, dans laquelle une aurore boréale est nommée « le doigt du Tout Puissant ». Mais quel poids aura, dans la balance, la vérité expérimentale, le jour où les armées iront au-devant de la mort ? Il faut ajouter que là où l'on croit à tort faire usage de cette vérité expérimentale, en réalité, on a simplement une autre religion ; et celle de l'empereur allemand semble meilleure que beaucoup d'autres, en cela qu'elle fortifie, au lieu de déprimer, les sentiments qui sont utiles à celui qui tombera sur le champ de bataille. Voici, par exemple, les fidèles de la religion « dreyfusarde », en France, qui se croient, mais bien à tort, des fidèles de la science expérimentale. M. Millerand était incontestablement le meilleur ministre de la guerre que la France avait eu depuis nombre d'années. De tout son pouvoir, il s'efforçait de préparer la victoire, de même que le général André préparait la défaite. Mais M. Millerand offensa la sacro-sainte religion dreyfusarde, en nommant M. du Paty de Clam à un poste d'officier de réserve. Au point de vue expérimental, ce fait compte vraiment pour zéro dans la préparation à la guerre. Mais au point de vue de la religion des intellectuels, c'est un délit très grave ; et pour l'expier, M. Millerand dut donner sa démission de ministre. Donc, d'une façon générale, que tout ministre de la guerre sache qu'il peut ou non s'occuper de la défense du pays, on n'y attachera pas beaucoup d'importance, et, de fait, le général André demeura longtemps ministre ; mais il ne doit pas toucher aux dogmes sublimes de la sacro-sainte religion dreyfusarde, ni de la religion humanitaire. En somme, l'histoire officielle de ces intellectuels ne se rapproche pas beaucoup plus de la vérité expérimentale que l'histoire de l'empereur allemand. La Liberté, 2 février 1913, écrit à propos de l'incident du Paty de Clam (§ 1749-3) et de la discussion qui eut lieu, sur ce sujet, à la Chambre : « Comment nous nous préparons. Encore une journée de perdue... Nous défions qu'on trouve une bonne raison pour justifier le débat d'hier qui a si fort excité la Chambre. Il s'agissait de savoir si tel officier de la territoriale resterait affecté en cas de guerre à la garde d'une petite gare de banlieue. Voilà à quoi nos six cents représentants se sont amusés, tandis que restent en suspens des projets du plus haut intérêt pour la défense nationale. Le gouvernement allemand presse l'organisation nouvelle et formidable de son armée ; chez nous on s'attarde sur le cas intime de M. du Paty de Clam. L'affaire est pourtant bien simple. M. Millerand l'a exposée, à la tribune, avec une entière franchise. La mesure qu'il a prise était une simple mesure administrative préparée par son prédécesseur ; il a cru qu'il était de son devoir de tenir un engagement pris par celui-ci. C'est tout ». L'histoire officielle des intellectuels qui donnent en ces travers et celle de l'empereur allemand, égales au point de vue expérimental, diffèrent uniquement en ce que la première nuit à la défense de la patrie, et que la seconde y est utile.
[FN: § 1584-1]
CIC. ; Acad. quaest., II, 43, 132, dit qu'il faut se décider sur ce qu'est le souverain bien, « parce que toute règle de la vie est contenue dans la définition du souverain bien : ceux qui sont en désaccord avec elle sont en désaccord avec toute règle de la vie ». De telle sorte que nous voilà maintenant dans une belle situation, si nous voulons connaître les règles de la vie ! Il y a environ deux mille ans que Cicéron exposait ses doutes, et ils ne sont pas encore dissipés ! Qui sait s'ils le seront dans deux autres mille ans ? En attendant, il faut pourtant vivre, et les hommes vivent sans trop se soucier du souverain bien, qui demeure une belle entité à l'usage des métaphysiciens.
[FN: § 1585-1]
En général, les commentateurs des philosophes pourraient répéter ce que, suivant CICÉRON, Clitomaque disait de Carnéade. Acad. quaest., II, 45, 140 : Quamquam Clitomachus affirmabat, nunquam se intelligere potuisse, quid Carneadi probaretur.
[FN: § 1594-1]
L'Anthologie grecque contient une épigramme à laquelle CIC. ; Tusc., V, 35, 101, fait allusion, en ajoutant : Quid aliud, inquit Aristoteles, in bovis, non in regis sepulcro inscriberes ? On feint que ce qui suit est l'épigramme funéraire de Sardanapale : (Epigr. sepulcr., 325) « Je possède ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait d'excès, et les charmantes choses que j'ai connues avec les Amours. Tout le reste, y compris les choses heureuses, est perdu ». À cela, Cratès le Thébain répond : (Epigr. sepulcr., 326) « Je possède ce que j'ai appris, ce que j'ai médité, et les vénérables choses que j'ai connues avec les Muses. Tout le reste, y compris les choses heureuses, s'est envolé en fumée ». Polyarque (apud ATH., XII, c. 64, p. 545), discutant avec Archytas, disait qu'il lui semblait que la doctrine de celui-ci s'écartait beaucoup de la nature. « Car la nature, lorsqu'elle peut faire entendre sa voix, nous enjoint de céder à la volupté, et nous dit que c’est le fait des hommes sages ».
[FN: § 1595-1]
Il est difficile de savoir, par les différents témoignages que nous possédons, quelle était précisément l'opinion d'Aristippe ; mais il est incontestable que les auteurs anciens admettaient l'existence d'une opinion philosophique qui mettait le souverain bien dans le plaisir présent ; que ce fût là l'opinion d'Aristippe ou d'un autre, peu importe, étant donné notre but. AELIAN. ; Var. hist ., XIV, 6, dit aussi clairement que possible qu'Aristippe conseillait de s'occuper uniquement du présent, sans se soucier du passé ni de l'avenir. Ce qu'était ce présent, ATHEN. ; XII, p. 544, nous le fait connaître en parlant d'Aristippe, « lequel, approuvant la vie voluptueuse, dit qu'elle est le but et qu'en elle on trouve la vie bienheureuse », et il ajoute qu'Aristippe connaissait uniquement la volupté du présent. – DIOC,. LAERT. ; II. 87, dit que suivant les cyrénaïques, « le but est une volupté particulière, le bonheur est l'union de plaisirs particuliers ». Il ajoute que, selon Hippobotos : « (88) la volupté est un bien môme si elle tire son origine de choses très honteuses ». Et Aristippe disait : « (93) Rien n'est juste, honnête ou honteux selon la nature, mais bien suivant les lois et les mœurs ».
[FN: § 1595-2]
ATHEN. ; XII, 6, 3, (p. 514) : ![]() DIOG. LAERT. ; II, 75 :
DIOG. LAERT. ; II, 75 : ![]() . Ménage subtilise en voulant entendre
. Ménage subtilise en voulant entendre ![]() dans le sens de
dans le sens de ![]() « vaincre » ; Hoc igitur dicit Aristippus, ipsius pecunia superatam Laidem, ad quam scimus fuisse aditum difficillimum... sui corporis ipsi fecisse copiam : se vero a voluptatibus non esse superatum : quod accidere solet
« vaincre » ; Hoc igitur dicit Aristippus, ipsius pecunia superatam Laidem, ad quam scimus fuisse aditum difficillimum... sui corporis ipsi fecisse copiam : se vero a voluptatibus non esse superatum : quod accidere solet ![]() (aux intempérants). Le sens est, au contraire, très clair. En grec,
(aux intempérants). Le sens est, au contraire, très clair. En grec, ![]() veut dire posséder, dans le double sens que ce mot a aussi en français et en italien, d’être maître, d'occuper, et d'avoir des rapports charnels avec une femme, de l'avoir pour épouse, pour amante. Le passif
veut dire posséder, dans le double sens que ce mot a aussi en français et en italien, d’être maître, d'occuper, et d'avoir des rapports charnels avec une femme, de l'avoir pour épouse, pour amante. Le passif ![]() a les sens correspondants de l'actif ; et Platon, De Rep., III, p. 390, l'emploie justement au sens qu'il a dans les paroles d'Aristippe. Platon admoneste Homère, parce qu'il nous montre Zeus, brûlant de s'unir à sa femme, « et disant qu'il était plus possédé par la passion qu'il ne l'avait jamais été précédemment, lorsqu'ils s'unirent „ à l'insu de leurs chers parents “ » (Il., XIV, 296) :
a les sens correspondants de l'actif ; et Platon, De Rep., III, p. 390, l'emploie justement au sens qu'il a dans les paroles d'Aristippe. Platon admoneste Homère, parce qu'il nous montre Zeus, brûlant de s'unir à sa femme, « et disant qu'il était plus possédé par la passion qu'il ne l'avait jamais été précédemment, lorsqu'ils s'unirent „ à l'insu de leurs chers parents “ » (Il., XIV, 296) : ![]()
![]() . Donc Aristippe n'était pas possédé de cette façon par la passion pour Laïs. – LACTANCE (III, 15, 15) cite le mot d'Aristippe, mais n'y a rien compris. – CIC. Epist. ad famil., IX, 26 : Audi reliqua. Infra Eutrapelum Cytheris accabuit. In eo igitur, inquis, convivio Cicero ille... Non, meher. cule, suspicatus sum illam affore : sed tamen Aristippus quidem ille Socraticus non erubuit, cum esset obiectum, habere eum Laida : « Habeo, inquit, non habeor a Laide ». Graece hoc melius. – DIOG. LAERT., II, 69. « Entrant [Aristippe] dans la maison d'une courtisane, et l'un des jeunes gens qui étaient avec lui ayant rougi : « Ce n'est pas d'entrer, dit Aristippe, qui est honteux, mais de ne pas pouvoir en sortir ». – PERS., V, appelle aussi libre l'homme qui sort de chez une courtisane intact et n'y retourne pas :
. Donc Aristippe n'était pas possédé de cette façon par la passion pour Laïs. – LACTANCE (III, 15, 15) cite le mot d'Aristippe, mais n'y a rien compris. – CIC. Epist. ad famil., IX, 26 : Audi reliqua. Infra Eutrapelum Cytheris accabuit. In eo igitur, inquis, convivio Cicero ille... Non, meher. cule, suspicatus sum illam affore : sed tamen Aristippus quidem ille Socraticus non erubuit, cum esset obiectum, habere eum Laida : « Habeo, inquit, non habeor a Laide ». Graece hoc melius. – DIOG. LAERT., II, 69. « Entrant [Aristippe] dans la maison d'une courtisane, et l'un des jeunes gens qui étaient avec lui ayant rougi : « Ce n'est pas d'entrer, dit Aristippe, qui est honteux, mais de ne pas pouvoir en sortir ». – PERS., V, appelle aussi libre l'homme qui sort de chez une courtisane intact et n'y retourne pas :
(173) ... Si totus et integer illinc
Exieras, ...
[FN: § 1595-3]
DIOG. LAERT. ; II, 93. Néanmoins, cela contredit ce qu'il répondit, dit-on, à celui qui lui demandait ce que les philosophes avaient de bon : « Si toutes les lois étaient supprimées, ils vivraient de la même manière » (Idem, ibidem, II, 68). Mais ici nous ne recherchons pas ce que pensait vraiment Aristippe ; nous examinons certaines dérivations ; qu'elles soient de lui ou d'un autre, peu importe.
[FN: § 1596-1]
CIC. ; De fin. bon. et mal.
[FN: § 1596-2]
CIC. ; De fin. bon. et mal . II, 8, 24 : Hos ego asotos bene quidem vivere aut beate, nunquam dixerim. Ex quo efficitur, non ut voluptas ne sit voluptas, sed ut voluptas non sit summum bonum (édit. Verbugius).
[FN: § 1596-3]
Il y a cinq parties dans l'argumentation de Cicéron. 1° Une question philologique. Il dit (II, 4, 13) que ![]() doit être rendu en latin parle terme voluptas. « Dans ce terme, tous ceux, où qu'ils soient, qui savent le latin, comprennent deux choses : une joie dans l'âme et une sensation suave d'agrément dans le corps ». Sur ce point, il semble effectivement qu'il a raison, et que les termes
doit être rendu en latin parle terme voluptas. « Dans ce terme, tous ceux, où qu'ils soient, qui savent le latin, comprennent deux choses : une joie dans l'âme et une sensation suave d'agrément dans le corps ». Sur ce point, il semble effectivement qu'il a raison, et que les termes ![]() , en grec, voluptas, en latin, ont cette signification. 2° Une question concernant la manière de s'exprimer d'Épicure. Celui-ci emploie le terme
, en grec, voluptas, en latin, ont cette signification. 2° Une question concernant la manière de s'exprimer d'Épicure. Celui-ci emploie le terme ![]() en un sens différent de celui indiqué tout à l'heure (II, 5, 15) ex quo efficitur, non ut nos non intelligamus, quae vis sit istius verbi, sed ut ille suo more loquatur, nostrum negligat ». Sur ce point encore, Cicéron a raison ; mais il a même trop raison pour sa thèse, car le défaut d'Épicure est celui de tous les métaphysiciens, y compris Cicéron, qui, lui aussi suo more loquitur, nostrum negligit, lorsque par notre manière on entend celle des gens dissolus. 3° Une question de rapports de sentiments suscités chez certaines personnes par certains termes. Les sentiments suscités par les deux termes : volupté, souverain bien, ne coïncident pas chez Cicéron ; sur ce point, son affirmation suffit. Ils ne coïncident pas non plus chez certaines personnes ; c'est là un fait que l'expérience vérifie. Donc, en cela aussi Cicéron a raison. 4° Une question de rapport de sentiments de tous les hommes, ou bien de choses. Cicéron passe du contingent à l'absolu, non pas explicitement, mais implicitement, à la manière d'un grand nombre de métaphysiciens. Pour la même raison que l'affirmation de Cicéron suffit à établir qu'en lui les termes volupté et souverain bien n'éveillent pas des sensations identiques, l'affirmation d'une personne qui est d'un autre avis doit suffire pour établir qu'en elle ces deux termes suscitent des sensations égales ; et de la même façon que l'observation nous fait connaître que beaucoup de personnes pensent comme Cicéron, elle nous fait connaître aussi que bon nombre pensent différemment. Cicéron a donc tort de donner une valeur universelle, absolue, à une proposition qui n'a qu'une valeur particulière, contingente. 5° Une argumentation sophistique pour exclure les personnes d'un autre avis et revenir du contingent à l'absolu. Là aussi, le raisonnement est plein de sous-entendus, comme c'est l'usage général des métaphysiciens. On insinue qu'il y a des choses auxquelles on a donné le nom de volupté, souverain bien ; nous devons les connaître par le témoignage du plus grand nombre de gens ; et s'il est quelque mauvaise tête qui les nie, nous n'avons pas à tenir compte de son affirmation, de même que nous ne tiendrions pas compte de l'affirmation d'un esprit bizarre auquel il prendrait fantaisie de nier l'existence de Carthage. En d'autres termes, on insinue l'universalité de la proposition en recherchant ce qu'on dit. Ce on désigne tout le monde ; et quand tous parlent de la même façon, la chose doit être de cette façon, comme quand tout le monde dit que le soleil réchauffe. On ajoute enfin autant de considérations accessoires que la rhétorique en peut fournir. Donc, ici Cicéron a tort, mais ni plus ni moins que les autres métaphysiciens.
en un sens différent de celui indiqué tout à l'heure (II, 5, 15) ex quo efficitur, non ut nos non intelligamus, quae vis sit istius verbi, sed ut ille suo more loquatur, nostrum negligat ». Sur ce point encore, Cicéron a raison ; mais il a même trop raison pour sa thèse, car le défaut d'Épicure est celui de tous les métaphysiciens, y compris Cicéron, qui, lui aussi suo more loquitur, nostrum negligit, lorsque par notre manière on entend celle des gens dissolus. 3° Une question de rapports de sentiments suscités chez certaines personnes par certains termes. Les sentiments suscités par les deux termes : volupté, souverain bien, ne coïncident pas chez Cicéron ; sur ce point, son affirmation suffit. Ils ne coïncident pas non plus chez certaines personnes ; c'est là un fait que l'expérience vérifie. Donc, en cela aussi Cicéron a raison. 4° Une question de rapport de sentiments de tous les hommes, ou bien de choses. Cicéron passe du contingent à l'absolu, non pas explicitement, mais implicitement, à la manière d'un grand nombre de métaphysiciens. Pour la même raison que l'affirmation de Cicéron suffit à établir qu'en lui les termes volupté et souverain bien n'éveillent pas des sensations identiques, l'affirmation d'une personne qui est d'un autre avis doit suffire pour établir qu'en elle ces deux termes suscitent des sensations égales ; et de la même façon que l'observation nous fait connaître que beaucoup de personnes pensent comme Cicéron, elle nous fait connaître aussi que bon nombre pensent différemment. Cicéron a donc tort de donner une valeur universelle, absolue, à une proposition qui n'a qu'une valeur particulière, contingente. 5° Une argumentation sophistique pour exclure les personnes d'un autre avis et revenir du contingent à l'absolu. Là aussi, le raisonnement est plein de sous-entendus, comme c'est l'usage général des métaphysiciens. On insinue qu'il y a des choses auxquelles on a donné le nom de volupté, souverain bien ; nous devons les connaître par le témoignage du plus grand nombre de gens ; et s'il est quelque mauvaise tête qui les nie, nous n'avons pas à tenir compte de son affirmation, de même que nous ne tiendrions pas compte de l'affirmation d'un esprit bizarre auquel il prendrait fantaisie de nier l'existence de Carthage. En d'autres termes, on insinue l'universalité de la proposition en recherchant ce qu'on dit. Ce on désigne tout le monde ; et quand tous parlent de la même façon, la chose doit être de cette façon, comme quand tout le monde dit que le soleil réchauffe. On ajoute enfin autant de considérations accessoires que la rhétorique en peut fournir. Donc, ici Cicéron a tort, mais ni plus ni moins que les autres métaphysiciens.
[FN: § 1599-1]
CIC. ; De fin. bon. et malorum.
[FN: § 1600-1]
D. AUGUST. ; De civ. dei, XIX, c. 1 et sv. : (c. 4) Si ergo quaeratur a nobis, quid civitas Dei de his singulis interrogata respondeat, ac primum de finibus bonorum malorumque quid sentiat, respondebit aeternam vitam esse summum bonum, aeternam vero mortem summum malum. – D. THOM. ; Summ. theol., 2a, 2ae, XXVII, 6: ... quia ultimum bonum hominis consistit in hoc quod anima Deo inhaereat...
[FN: § 1602-1]
D. AUGUST., Retractationum I, 10, 3, Observe que sa Proposition : il n'y a pas de mal naturel : nullum esse malum naturale pourrait être mal interprétée par les pélagiens. Mais le terme naturel se rapportait à la nature qui a été créée sans péché. Donc cette nature est dite : vraie et propre nature de l'homme : ipsa enim ivere ac proprie natura hominis dicitur. Par analogie, nous employons aussi ce terme pour désigner la nature qu'a l'homme en naissant.
[FN: § 1602-2]
CLEMENTIS epistola ad Corinthios, I, 20 : ![]()
![]() . « Et les plus petits animaux s'associent dans la paix et la concorde ».
. « Et les plus petits animaux s'associent dans la paix et la concorde ».
[FN: § 1602-3]
Très connu est le passage des Géorgiques , IV, dans lequel VIRGILE dit des abeilles :
(67) Sin autem ad pugnam exierint ; (nam saepe duobus
Regibus incessit magno discordia motu),
Continuoque animos volgi et trepidantia bello
Corda licet longe praesciscere ;
Etc.
[FN: § 1603-1] Œuvres... de Cicéron, édit. NISARD, t. IV, p. 411.
[FN: § 1604-1]
ARIST. ; Natur. Auscult., II (p. 192-193 Bekk.). Nous n'avons pas à rechercher ici si ce traité est authentique ou non. Nous le mettons sous le nom d'Aristote, parce qu'on fait ainsi dans les éditions ; mais, au lieu d'Aristote, qu'on mette un X quelconque, et notre raisonnement demeure également, car il ne porte que sur la dérivation objectivement. – PLUTARCH., De plac. phil., I, 1, 1, commence par observer judicieusement qu'il serait absurde de disserter sur la Nature, si l'on n'expliquait pas auparavant ce que signifie ce mot. Pour faire cela, il dit : (2) ![]()
![]() La Nature, suivant Aristote, est donc le principe du mouvement et du repos, dans les corps où il se trouve primitivement et non par accident ». Nous voilà bien renseignés : maintenant nous savons ce qu'est la Nature ! Mais ensuite, le même auteur, dans le même traité, nous donne d'autres définitions. « (I, 30, 1) Empédocle dit que la Nature n'est pas autre chose que mélange et séparation d'éléments... (2) De même, Anaxagore dit que la Nature est combinaison et dissolution, c'est-à-dire naissance et destruction ».
La Nature, suivant Aristote, est donc le principe du mouvement et du repos, dans les corps où il se trouve primitivement et non par accident ». Nous voilà bien renseignés : maintenant nous savons ce qu'est la Nature ! Mais ensuite, le même auteur, dans le même traité, nous donne d'autres définitions. « (I, 30, 1) Empédocle dit que la Nature n'est pas autre chose que mélange et séparation d'éléments... (2) De même, Anaxagore dit que la Nature est combinaison et dissolution, c'est-à-dire naissance et destruction ».
[FN: § 1604-2]
ARIST. ; Natur. Auscult., II, 1, 10 : ![]()
![]() . Il n'est pas facile de comprendre ce que cela veut dire. Au fond, il semble qu'on discute pour savoir si la « nature » est la matière ou la forme, et il semble qu'on conclut qu'elle est la forme « (I, 1, 15) Donc la forme est la nature –
. Il n'est pas facile de comprendre ce que cela veut dire. Au fond, il semble qu'on discute pour savoir si la « nature » est la matière ou la forme, et il semble qu'on conclut qu'elle est la forme « (I, 1, 15) Donc la forme est la nature – ![]() . Pourtant on ne tarde pas à ajouter que forme et nature ont deux sens, car la privation est une certaine forme. Tout cela est du pur verbiage. D. THOM., Summ. theol., la 2 ae, q. XXXI, 7, explique Aristote : « Respondeo dicendum quod naturale dicitur „ quod est secundum naturam “, ut dicitur (Physic. lib. II, text. 4 et 5). Natura autem in homine dupliciter sumi potest. Uno modo, prout intellectus et ratio est potissima hominis natura, quia secundum eam homo in specie constituitur ; et secundum hoc naturales delectationes hominum dici possunt quae sunt in eo quod convenit homini secundum rationem ; sicut delectari in contemplatione veritatis et in actibus virtuum est naturale homini [il est regrettable que les malfaiteurs ne l'entendent pas ainsi]. Alio modo potest sumi natura in homine secundum quod condividitur rationi, scilicet id quod est commune homini et aliis, praecipue quod rationi non obedit... Donc natura veut dire blanc et noir ; cela ne suffit pas encore. Des deux espèces de plaisirs, une partie sont naturels en un sens, mais pas naturels en un autre : Secundum utrasque autem delectationes contiligit aliquas esse innaturales, simpliciter loquendo, sed connaturales secundum quid. On ne peut vraiment rien faire de plus pour ôter toute précision à ce terme. Il faut savoir se contenter. Saint Thomas aussi a eu ses commentateurs. En voici un : FR. ANTOINE GOUDIN ; Phil. suiv. les princ. de Saint Thomas, trad. TH. BOURARD, t. II : « (p. 198) Le mot nature peut donc se comprendre de quatre manières : 1e dans le sens de nativité, ainsi le premier-né est le chef de ses frères par nature, c'est-à-dire par l'ordre même de la naissance, et l'Apôtre dit que par nature nous sommes fils de colère, c'est-à-dire d'après la conception et la nativité, dont nous tirons le péché ; 2e dans le sens de matière et de forme, ainsi l'homme est dit se composer de deux natures partielles ; 3e dans le sens de l'essence de la chose : ainsi nous disons que la nature ou l'essence angélique est supérieure à la nature humaine ; 4e enfin, en Physique, la nature est prise pour le principe intrinsèque du mouvement et du repos dans les choses qui sont près de nous... » Il ne vient à l'idée d'aucun de ces auteurs que donner le même nom à des choses si diverses, est le meilleur moyen de ne pas se faire comprendre.
. Pourtant on ne tarde pas à ajouter que forme et nature ont deux sens, car la privation est une certaine forme. Tout cela est du pur verbiage. D. THOM., Summ. theol., la 2 ae, q. XXXI, 7, explique Aristote : « Respondeo dicendum quod naturale dicitur „ quod est secundum naturam “, ut dicitur (Physic. lib. II, text. 4 et 5). Natura autem in homine dupliciter sumi potest. Uno modo, prout intellectus et ratio est potissima hominis natura, quia secundum eam homo in specie constituitur ; et secundum hoc naturales delectationes hominum dici possunt quae sunt in eo quod convenit homini secundum rationem ; sicut delectari in contemplatione veritatis et in actibus virtuum est naturale homini [il est regrettable que les malfaiteurs ne l'entendent pas ainsi]. Alio modo potest sumi natura in homine secundum quod condividitur rationi, scilicet id quod est commune homini et aliis, praecipue quod rationi non obedit... Donc natura veut dire blanc et noir ; cela ne suffit pas encore. Des deux espèces de plaisirs, une partie sont naturels en un sens, mais pas naturels en un autre : Secundum utrasque autem delectationes contiligit aliquas esse innaturales, simpliciter loquendo, sed connaturales secundum quid. On ne peut vraiment rien faire de plus pour ôter toute précision à ce terme. Il faut savoir se contenter. Saint Thomas aussi a eu ses commentateurs. En voici un : FR. ANTOINE GOUDIN ; Phil. suiv. les princ. de Saint Thomas, trad. TH. BOURARD, t. II : « (p. 198) Le mot nature peut donc se comprendre de quatre manières : 1e dans le sens de nativité, ainsi le premier-né est le chef de ses frères par nature, c'est-à-dire par l'ordre même de la naissance, et l'Apôtre dit que par nature nous sommes fils de colère, c'est-à-dire d'après la conception et la nativité, dont nous tirons le péché ; 2e dans le sens de matière et de forme, ainsi l'homme est dit se composer de deux natures partielles ; 3e dans le sens de l'essence de la chose : ainsi nous disons que la nature ou l'essence angélique est supérieure à la nature humaine ; 4e enfin, en Physique, la nature est prise pour le principe intrinsèque du mouvement et du repos dans les choses qui sont près de nous... » Il ne vient à l'idée d'aucun de ces auteurs que donner le même nom à des choses si diverses, est le meilleur moyen de ne pas se faire comprendre.
[FN: § 1604-3]
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE ; Physique d'Aristote, t. I. Peu avant il avait dit : « (p. III) La théorie du mouvement est si bien l'antécédent obligé de la physique, que, quand à la fin du XVIIe siècle, Newton pose les principes mathématiques de la philosophie naturelle, il ne fait dans son livre immortel qu'une théorie du mouvement [en note : Newton le dit lui-même dans sa Préface à la première édition des Principes... ]. Descartes, dans les Principes de la Philosophie, avait également placé l'étude du mouvement en tête de la Science de la nature. Ainsi, deux mille ans passés avant Descartes et Newton, Aristote a procédé tout comme eux ; et si l'on veut considérer équitablement son œuvre, on verra qu'elle est de la même famille, et qu'à plus d'un égard, elle n'a rien à redouter de la comparaison ». Passe pour Descartes, mais quant à Newton, ses Principia sont à la Physique d'Aristote, ce que le jour est à la nuit. Par malheur, par ci par là dans les Principia, apparaît un peu de métaphysique. C'est comme la roche stérile qui renferme l'or expérimental. On comprend que les métaphysiciens s'emparent de la roche et laissent l'or. Dans la préface, Newton dit : Cum autem artes Manuales in corporibus movendis praecipue versentur, fit ut Geometria ad magnitudinem, Mechanica ad motum vulgo referatur. Quo sensu Mechanica rationalis erit Scientia Motuum qui ex viribus quibuscunque resultant, et Virium quae ad motus quoscunque requiruntur, accurate proposita ac demonstrata. Aristote ne parle de rien de cela, mais bien de tout autre chose.
[FN: § 1605-1]
STOB. ; Egl., II, 7, p. 132-134 : ![]()
![]() . Le mot
. Le mot ![]() signifie proprement : convenablement, harmoniquement, d'une manière concordante, conforme. Il est par conséquent quelque peu indéterminé, si l'on n'ajoute pas la chose avec laquelle existe la convenance, l'harmonie, etc. La sentence de Zénon serait donc : vivre convenablement, harmoniquement, etc. ; et peut-être pourrait-on dire aussi : vivre régulièrement, d'une manière réglée.
signifie proprement : convenablement, harmoniquement, d'une manière concordante, conforme. Il est par conséquent quelque peu indéterminé, si l'on n'ajoute pas la chose avec laquelle existe la convenance, l'harmonie, etc. La sentence de Zénon serait donc : vivre convenablement, harmoniquement, etc. ; et peut-être pourrait-on dire aussi : vivre régulièrement, d'une manière réglée.
[FN: § 1605-2]
Idem, Ibidem, p. 134. ![]()
![]() .
.
[FN: § 1606-1]
DIOG. LAERT. : VII, 88, trad. L. LECHI. Clément d'Alexandrie s'imagine que la nature des stoïciens c'est Dieu. – CLEM. ALEX. ; Strom., II, c. 19, p. 483, Potter, 404 Paris : ![]()
![]() « En conséquence, remplaçant convenablement le nom de nature par celui de Dieu, les stoïciens jugent que la fin, c'est vivre selon la nature ».
« En conséquence, remplaçant convenablement le nom de nature par celui de Dieu, les stoïciens jugent que la fin, c'est vivre selon la nature ».
[FN: § 1608-1]
J. J. ROUSSEAU ; Le contrat social. Après avoir dit comment s'établit le contrat social, l'auteur ajoute (1. II, c. 1) : « La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun ». Comment cela ? « (c. IV) Si l'État ou la Cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres, et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au Corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, et c'est ce même pouvoir, qui, dirigé par la volonté générale, porte... le nom de souveraineté. – (c. IV) Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux, si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? » Voilà qu'est établie la proposition générale X = A, c'est-à-dire que la volonté générale X est toujours droite, A. Remarquez qu'avec le procédé habituel et cher au métaphysicien, on affirme une propriété de la volonté générale, avant de savoir ce qu'est précisément cette entité. Maintenant procédons à la modification de X. (l. II, c. III) : « Il s'ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique : mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours : jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal [remarquez la modification du sens d'erreur ; nous en parlerons incessamment]. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous [une des formes de X, et la volonté générale [autre forme de X] : celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières : [attention à la muscade, qui passe d'un gobelet dans l'autre] mais ôtez de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entredétruisent, [pour cela, il serait nécessaire que les moins fussent égaux aux plus, sinon il reste un résidu ; mais le divin Rousseau ne s'arrête pas à ces vétilles], reste pour la somme des différences la volonté générale ». Voilà que la muscade a passé du gobelet de droite dans celui de gauche. Attention, vous allez voir un nouveau et plus beau tour de passe-passe. On décrit un état réel B, pour en faire l'égal de l'une des abstractions indéterminées X, indiquées tout à l’heure. « Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n’avaient aucune communicationentreeux[commentpeuvent-ilsêtreinformés,sansavoirde communication ? Ce doit être une communication interne et spontanée], du grand nombre de petites différences [qui lui a dit qu'elles étaient petites ?] résulterait toujours la volonté générale X, et la délibération serait toujours bonne [même quand le peuple délibère de brûler les sorcières ?] Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l'État... Enfin quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier ». Une personne sait ce qui lui est agréable ou désagréable, mais peut se tromper par ignorance. On pourvoit à l'élimination de ce cas en demandant qu'on ne trompe pas le peuple, et qu'il soit suffisamment informé. L'erreur vient ainsi toujours du dehors. Si les citoyens n'étaient pas induits en erreur, ils jugeraient toujours sainement ; mais le plus grand nombre est dans l'erreur parce qu’il est incapable de discerner le vrai. Il suffit qu'ils soient informés pour qu'ils comprennent. Des gens qui ne comprennent pas, il n'en existe pas dans la cité de Rousseau. Ayant ainsi démontré : 1° que la volonté générale est toujours droite, 2° qu'elle est exprimée par le vote des citoyens bien informés et sans communication entre eux, on conclut logiquement que cette délibération est toujours droite.
[FN: § 1610-1]
FLEURY ; Hist. ecclés., 1. 69, t. 14, p. 619-620.
[FN: § 1612-1]
PLUTARCH. ; De def. orac., 15, p. 417 : ![]()
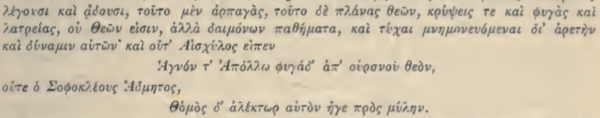
« Et assurément tout ce que l'on raconte et l'on chante, dans les mythes et dans les hymnes : les enlèvements, les courses errantes des dieux, le fait de se cacher et d'aller en exil et d'être esclave, ne sont pas choses qui arrivèrent aux dieux, mais aux démons ; et on les rapporte pour montrer la vertu et la puissance de ceux-ci. C'est pourquoi Eschyle ne devait pas dire :
Chaste Apollon, dieu exilé du ciel ;
ni l'Admète de Sophocle :
Mon coq [mari] l'a traîné [le dieu] au moulin. »
Ce dernier passage de Plutarque est certainement altéré ; ce ne peut être Admète, ce doit être Alceste, sa femme, qui parle.
[FN: § 1613-1]
GROTE ; Hist. de la Grèce, t. II : « (p. 153) Cette distinction entre les dieux et les démons semblait sauver à un haut degré et la vérité des vieilles légendes et la dignité des dieux. Elle obviait à la nécessité de prononcer ou que les dieux étaient indignes, ou les légendes mensongères. Cependant, bien qu'imaginée dans le but de satisfaire une sensibilité religieuse plus scrupuleuse, elle fut trouvée incommode dans la suite, quand il s'éleva des adversaires contre le paganisme en général. En effet, tandis qu'elle abandonnait comme insoutenable une grande portion de ce qui avait été jadis une foi sincère, elle conservait encore le même mot démons avec une signification entièrement altérée. (p. 154) Les écrivains chrétiens dans leurs controverses trouvaient d'abondantes raisons chez les anciens auteurs païens pour regarder tous les dieux comme des démons, et des raisons non moins abondantes chez les païens postérieurs pour dénoncer les démons en général comme des êtres méchants ».
[FN: § 1613-2]
MINUC. FELIX, 26: ... quid Plato, qui invenire Deum negotium credidit, nonne et angelos sine negotio narrat et daemonas ? et in Symposio etiam suam naturam daemonum exprimere conititur ? vult enim esse substantiam inter mortalem immortalemque, ici est inter corpus et spiritum mediam, terreni ponderis et caelestis levitatis admixtione concretam, ex qua monet etiam nos procupidinem amoris, et dicit informari et inlabi pectoribus humanis et sensum movere et adfectus fingere et ardorem cupiditatis infundere. 27. Isti igitur impuri spiritus, daemones, ut ostensum a magis, a philosophis et a Platone, sub statuis et imaginibus consecratis delitescunt ed adflatu suo auctoritatem quasi praesentis numinis consequuntur, dura inspirant interim vates, dum fanis inmorantur, dura nonnumquam extorum fibras animant, avium volatus gubernant, sortes regunt, oracula efficiunt, falsis pluribus involuta.
[FN: § 1613-3]
LACT. ; Div. instit., IV, De vera sapientia, 27 : Si nobis credendum esse non putant, credant Homero, qui summum ilium Iovem daemonibus aggregavit : sed et aliis poetis ac philosophis, qui eosdem modo daemonas, modo deo s nuncupant : quorum alterum verum, alterum falsum est.
[FN: § 1613-4]
TATIANI ; Orat. ad Graec., 8 : ![]()
![]()
[FN: § 1617-1]
FLEURY ; Hist. Eccl., 1. 69, t. 14 : « (p. 581) Cette allégorie des deux glaives, si célèbre dans la suite, avait déjà été marquée dans un écrit de Geoffroi abbé de Vendôme. Saint Bernard l'étend ici davantage... ». – Le passage de la lettre de Saint Bernard, auquel on fait allusion, est le suivant : D. BERN. ; Epist., 256, Ad Dominum Papam Eugenium :... Exserendus est nunc uterque gladius in passione Domini, Christo denuo patiente, ubi et altera vice passus est. Per quem autem nisi per vos ? Petri uterque est : alter suo nutu, alter sua manu, quoties necesse est, evaginandus. Et quidem de quo minus videbatur, de ipso ad Petrum dictum. est : « Converte gladium tuum in vaginam ». Ergo suus erat et ille, sed non sua manu utique educendus. – Saint Bernard exhorte le pape à se servir de l'épée matérielle : D. BERN. ; De consideratione ad Eugenium, Pontificem maximum, 1. IV, 3, tu denuo usurpare gladium tentes, quem semel iussus es reponere in vaginam ? Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbam Domini dicentis : Converte gladium tuum in vaginam. Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullo modo ad te pertineret et is, dicentibus Apostolis : Ecce gladii duo hic; non respondisset Dominus : satis est : sed : nimis est. Uterque ergo Ecclesiae, et spiritalis scilicet gladius, et materialis ; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus : ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et iussum Imperaratoris.
[FN: § 1617-2]
FLEURY ; Hist. Eccl., 1, 65), t. 14, p. 76.
[FN: § 1617-3]
J. ZELLER : Hist. d’Allem. ; t. III, p. 321.
[FN: § 1617-4]
YVES CARNOT. ; Epist. ad Henric. Angliae reg. ...Sicut enim sensus animalis subditus debeat esse rationi; ita potestas terrena subdita esse debet Ecclesiastico regimini. Et quantum valet corpus, nisi regatur ab anima, tantum valet terrena potestas nisi informetur et regatur Ecelesiastica disciplina. – D. THOM.; De reg. princ., III, 10. Il bataille contre qui voudrait que les paroles du Christ qui donnent à Pierre la faculté de lier et de délier, ne s'appliquassent qu'au spirituel. Quod si dicatur ad solam referri spiritualem potestatem, hoc esse non polest, quia corporale et temporale ex spirituali et perpetuo dependet, sicut corporis operatio ex virtute animae.
[FN: § 1618-1]
G. PHILLIPS ; Dit dr. eccl., t. II (p. 473) Dans ces derniers temps, on a fréquemment assimilé la position de l'Église et de l'État à l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. Cette comparaison présente certainement des aperçus nombreux et parfaitement justes... seulement il faut se garder de prendre le change, ce qui ne manquerait pas d'arriver si, trompé par l'analogie des mots... on considérait l'Église comme l'élément féminin, et l’État comme l'élément masculin, tandis que c'est précisément le contraire qui doit avoir lieu ». La création de la femme correspond à la formation de l'ordre temporel. L'ordre divin « n'apparaît d'abord que dans l'arrière-scène et comme endormi [voilà une belle métaphore]. Pendant son sommeil, l'ordre temporel est tiré de lui. (p. 474) Le genre humain se réveille dans le nouvel Adam, et l'ordre divin salue l'ordre temporel comme la chair de sa chair et l'os de ses os. Dès lors, tous les deux, unis l'un à l'autre, comme l'épouse à l'époux, doivent régner ensemble sur le monde ». Mais quel pouvoir a la métaphore ! Voilà pourquoi, messieurs les hérétiques, vous devez être brûlés ou du moins emprisonnés. Suit, avec ces métaphores, la description de l'histoire des rapports de l'Église et de l'État. D'abord, l'Église demande à l'État de s'unir à elle : « (p. 474) c'est en quelque sorte le temps de la demande en mariage ». Dans la seconde période, Église et État sont unis et vivent en bon accord. « (p. 474) il peut y avoir, comme dans le mariage, des malentendus passagers ; ... mais, les deux conjoints ayant l'intention sincère de rester unis en Jésus-Christ, ces malentendus sont bientôt dissipés. Enfin le pouvoir temporel se détache de la foi de l'Église et de l'obéissance qu'il lui doit dans les choses divines : c'est la troisième phase, c'est l'état de séparation ». On distingue trois cas : « (p. 474) 1e L'épouse s'affranchit entièrement de la dépendance de son mari, en brisant de son côté le lien conjugal. 2e Elle rompt le mariage en convolant à de secondes (p. 475) noces, en élevant son nouveau mari à l'autorité domestique et en opprimant, avec son secours, l'époux légitime. 3e Elle ne veut plus de l'autorité absolue de celui qui l'a détachée de son époux, mais elle reste indifférente pour ce dernier, ou bien, si elle se rapproche de lui, elle exige la reconnaissance de l'autre au même titre ». C'est un cas de polyandrie.
[FN: § 1618-2]
PHILIPS ; Du Droit ecclés., t. I : « (p. 58) Cette parole Tu es Pierre, a fait de Simon le fondement de l'Église, le roc qui sert de pierre angulaire à l'édifice divin... ». Malheureusement cette métaphore a donné lieu à de nombreuses discussions. « (p. 54)... à combien d'interprétations diverses n'ont pas donné lieu les mots Petrus et Petra, dont s'est servie la traduction grecque pour rendre celui de Céphas, seul employé dans l'original syriaque, ainsi que dans les traductions que nous fournissent le persan, l'arménien et le copte ! Cette différence tient à ce que dans le grec le mot ![]() , du genre féminin, ne pouvant être appliqué à un homme, le traducteur s'est trouvé forcé, par le génie de sa langue, à changer la physionomie du mot pour l'approprier à l'usage qu'il était obligé d'en faire ; de là
, du genre féminin, ne pouvant être appliqué à un homme, le traducteur s'est trouvé forcé, par le génie de sa langue, à changer la physionomie du mot pour l'approprier à l'usage qu'il était obligé d'en faire ; de là ![]() , au lieu de
, au lieu de ![]() , deux fois répété. Cette explication, si plausible en elle-même, a été admise même par les plus acharnés adversaires de la primauté, de saint Pierre. Quelle induction donc peut-on tirer d'une différence purement syllabique et matérielle ? (p. 55) Dira-t-on, pour la faire pénétrer dans le sens même des mots, que
, deux fois répété. Cette explication, si plausible en elle-même, a été admise même par les plus acharnés adversaires de la primauté, de saint Pierre. Quelle induction donc peut-on tirer d'une différence purement syllabique et matérielle ? (p. 55) Dira-t-on, pour la faire pénétrer dans le sens même des mots, que ![]() signifie un gros roc, tandis que
signifie un gros roc, tandis que ![]() n'éveille que l'idée d'une petite pierre ? Cette interprétation, adoptée par de récents lexicographes est... dénuée de tout fondement. Nous l'admettrons cependant, si l'on veut, mais sous la réserve d'une condition que l'on ne peut nous contester : c’est que si
n'éveille que l'idée d'une petite pierre ? Cette interprétation, adoptée par de récents lexicographes est... dénuée de tout fondement. Nous l'admettrons cependant, si l'on veut, mais sous la réserve d'une condition que l'on ne peut nous contester : c’est que si![]() signifie une petite pierre, cette petite pierre devient, par la transmutation que lui fait subir Jésus-Christ en la convertissant en
signifie une petite pierre, cette petite pierre devient, par la transmutation que lui fait subir Jésus-Christ en la convertissant en ![]() , un roc volumineux et solide... ».
, un roc volumineux et solide... ».
[FN: § 1619-1]
VAN DEN BERG ; Principes du Droit musulman : « (p. 3) Le Coran ou „ le livre “ (al-Kitâb) est, pour les Musulmans, la loi suprême, la loi fondamentale... Les principes fondamentaux du droit ont dû être déduits par les juristes des décisions relativement peu nombreuses que renferme le Coran. Ces décisions, toujours rendues pour un cas spécial, conduiraient souvent à des conséquences absurdes, si la rigueur des déductions n'était éludée par toutes les subtilités de la casuistique [dérivations]. L'on ne peut se faire une idée des bizarreries, des absurdités auxquelles se heurtent ceux qui s'en tiennent à la lettre du Coran, au lieu de chercher l'esprit de tel ou tel passage... (p. 4) Le Coran n'est pas seulement un livre inspiré par Allâh : c'est le livre, comme Allâh lui-même, incréé et éternel, et dont il n'a été révélé au Prophète qu'une copie [en note : c'est Allâh lui-même qui est réputé parler dans le Coran ...] D'où cette conséquence que non seulement le fond, mais aussi la forme est sacrée et infaillible, et que toute critique en est interdite. Cette doctrine a rencontré, il est vrai, depuis longtemps déjà des adversaires dans I'Islâm même [en note : La secte des Mo'tazilites... ]. Elle est, néanmoins, généralement admise aujourd'hui, et engendre naturellement d'étranges conséquences ».
[FN: § 1622-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Beaucoup de francs-maçons sont libres-penseurs et se rient des métaphores, des allégories, des symboles de toute religion. Pourtant, sous ce rapport, le catéchisme et les rites maçonniques ne le cèdent en rien au catéchisme ni aux rites d'une autre religion. Instructions du XXXe grade, Lausanne, 1899 : « (Catéchisme, p. 9) Demande : Es-tu Chev. · . Kad. · . ? [Chevalier Kadosch]. – Réponse : Tu l'as dit. Son nom fut autre et le même pourtant. – D : Je te comprends, frère. Quel âge as-tu ? – R : Un siècle au plus. D : Que cherches-tu ? – R : Lumière. – D : Quelle lumière et pourquoi ? R : Celle de la liberté pour ceux qui n'en abuseront pas. – D : Cherches-tu autre chose ? – R :Vengeance. – D : Contre qui ? – R : Contre tous les tyrans temporels et spirituels. – D : Où t'es-tu prosterné en versant des larmes ? R : Devant le tombeau d'un innocent assassiné. – D : Qu'ont foulé tes pieds ? – R : Des couronnes royales et des tiares papales. – Pourquoi faire sommes-nous Kadosch ? – R : Pour combattre à outrance et sans cesse toute injustice et toute oppression, qu'elles procèdent de Dieu, du Roi ou du Peuple. – D : En vertu de quel droit ? R : Mischor. – D : Que veux-tu dire ? – R : En vertu de notre droit de maîtres par excellence. – D : Où as-tu acquis ce droit ? – R : En montant et en descendant l'échelle mystérieuse ». – Pour être initié au grade de Chev. · . Kad. · ., il faut passer par quatre chambres. La 1re est noire, la 2e blanche, la 3e bleue, la 4e rouge. Afin d'abréger, nous ne citerons que la description de la 1e chambre. Ibidem, p. 2: « La 1re est la chambre noire ; une lampe sépulcrale l’éclaire seule : au centre, un sépulcre ; sur ce sépulcre un cercueil : dans ce cercueil un Chev. · . dans son linceul ; aux pieds, trois têtes de morts ; celle du milieu représentant celle du G. · . M. · . [Grand Maître] Jacques de Molay est couronnée d'immortelles et de lauriers et repose sur un coussin en velours noir. Celle de droite porte la couronne royale fleurdelysée de Philippe-le-Bel, celle de gauche la tiare de Bertrand de Goth Pape Clément V. Tout cela symbolise les victimes du despotisme civil et militaire et de l'intolérance religieuse. A angle droit avec le sépulcre se trouve un banc pour le candidat : en face, un transparent avec les mots : „ Celui qui saura surmonter les terreurs de la mort s'élèvera au-dessus de la sphère terrestre et aura droit à être initié aux plus grands mystères “ ».
[FN: § 1623-1]
D. AUGUST. ; Retractationum, 1, 28 : Cum de Genesi duos libros contra Manichaeos condidissem, quoniam secundum allegoricam significationem Scripturae verba tractaveram, non ausus naturalium rerum tanta secreta ad litteram. exponere... – Idem, Ibidem, II, 24, ... Titulus eorum librorum inscribitur de Genesi ad litteram : id est non secundum allegoricas significationes, sed secundum rerum gestarum proprietatem.
[FN: § 1623-2]
D. AUGUST. ; De Genesi ad litteram.
[FN: § 1624-1]
D. AUGUST. ; Sermo XCVIII – De verbis Evangelii Lucae, VII, et de tribus mortuis, quos Dominus suscitavit.
[FN: § 1624-2]
Parmi tant d'exemples qu'on pourrait citer, le suivant suffira. Dans le livre Le violier des histoires romaines, se trouvent mélangés des fables et des faits que l'auteur estime historiques, et il donne l'interprétation allégorique des unes et des autres, sous le titre : L'exposition moralle sur le propos. Par exemple, c. 22, il dit que, selon Saint Augustin, il advint que le cœur du cadavre d'un empereur romain ne put être consumé par le bûcher, parce que l'empereur était mort empoisonné. « (p. 74) Lors le peuple tira le cueur du feu et mist dessus du triacle. Par ce moyen fut le poison chassé, et dès aussitost que de rechief le cueur fut mis au feu, il fut bruslé ». Pour l'auteur, c'est un fait historique. Il continue : « L'exposition moralle sur le propos. Quant à parler morallement, les cueurs des pecheurs de peché mortel empoisonnez ne peuvent estre du feu du Sainct Esperit esprins et illuminez, fors que par le triaele, qui est penitence ».
[FN: § 1625-1]
ROCQUAN ; Notes et fragm. d'hist. – Du style révolutionnaire. L'auteur parle des écrits des hommes de la. révolution de 1789 « (p. 128) Par les qualificatifs qu'il ajoute ordinairement aux termes dont il se sert, il donne à ceux-ci un caractère, un signe qui les représente d'une manière plus frappante à l'esprit. Parle-t-on du devoir ? Il est sacré ; de l'égoïsme, il est aveugle ; de la perfidie, elle est noire ; du patriotisme, il est brûlant... (p. 129) Par un effet de la même tendance, pour exprimer un état quelconque de l'esprit, on choisit toujours les mots les plus forts... De là à donner la vie aux mots, ou, pour mieux dire, à rendre vivantes les idées qu'ils traduisent, il n'y a qu'un pas. Ce pas est franchi à tout instant dans les écrits. C'est ainsi qu'en se servant de l'expression „ corps politique, corps social “ empruntée par la Révolution aux temps qui l'ont précédée, on ne se contente pas de la froide dénomination que représentent ces deux termes assemblés. Le (p. 130) corps social vit ; il a „ des artères, des veines “, dans lesquelles circule lin sang vigoureux ou impur... On fait plus que donner la vie aux idoles ; on les personnifie. Les termes abstraits, dont j'ai constaté l'usage alors si fréquent, tels que la justice, la liberté, la raison, et d'autres termes du même genre, désignent des êtres qui vivent, regardent, parlent et agissent... (p. 131) Ce n'est pas uniquement à des abstractions de ce genre, et qui sont comme les emblèmes divins de la Révolution qu'est attribuée la personnalité. À ce moment où la France, en proie à la guerre étrangère, est encore déchirée par les discordes civiles, la patrie est souvent évoquée et se montre dans les écrits avec toutes les apparences de la vie... On comprend (p. 132) d'ailleurs que, sous l'influence de tant de passions qui l'agitent, la Révolution personnifie ce qu'elle hait, aussi bien que ce qu'elle aime. – „ Le Fanatisme est là, écrit le Comité de salut public en parlant des prêtres réfractaires qu'il accuse de soulever l'opinion ; il est là, il veille la palme du martyre à la main ; il attend ses crédules victimes “. J'ajoute que le fanatisme, le fédéralisme et d'autres objets de la haine révolutionnaire apparaissent ordinairement comme des „ monstres “ ; ces monstres habitent des „ repaires “, et c'est dans ces repaires que la Révolution, telle que l'Hercule moderne, doit aller les saisir et les abattre. De cette propension à vivifier, à personnifier les idées, il résulte que les écrits offrent, non pas seulement des tableaux, mais de véritables scènes animées ».
[FN: § 1626-1]
En voici exemple. A COMTE ; Synthèse subjective : « (p. 8) Ne devant jamais aspirer aux notions absolues, nous pouvons instituer la conception relative des corps extérieurs en douant chacun d'eux des facultés de sentir et d'agir, pourvu que nous leur ôtions la pensée, en sorte que leurs volontés soient toujours aveugles ». Ensuite, sous le prétexte de notre ignorance de l'absolu, mettons ensemble la fiction et la réalité. L'auteur continue : « (p. 8) Bornée au Grand-Être, assisté de ses dignes serviteurs et de leurs libres auxiliaires, l'intelligence, poussée par le sentiment, (p. 9) guide l'activité de manière à modifier graduellement une fatalité dont tous les agents tendent constamment au bien sans pouvoir en connaître les conditions. En dissipant les préjugés théologiques qui représentaient la matière comme essentiellement inerte, la science tendit à lui rendre l'activité que le fétichisme avait spontanément consacrée ». Ainsi, la fiction se confond avec la réalité. Pour justifier cela, l'auteur ajoute : « (p. 9) On ne saurait jamais prouver qu'un corps quelconque ne sent pas les impressions qu'il subit et ne veut pas les actions qu'il exerce, quoiqu'il se montre dépourvu de la faculté de modifier sa conduite suivant sa situation, principal caractère de l'intelligence ». Ainsi, la métaphore devient réalité, parce qu'on ne peut prouver qu'elle n'est pas réalité ! On ne peut démontrer que Zeus n'existe pas ; donc Zeus existe. Que peuvent bien être la sensation qu'un corps éprouve des impressions, sa volonté, sa conduite ? On ne peut démontrer que la mer ne sent pas l'impression d'un navire, ni que la mer ne veut pas les actions qu'elle exerce sur ce navire, simplement parce qu'il est impossible de démontrer l'incompréhensible et l'absurde. Lancé sur cette voie, A. Comte y galope, et parle d'une manière moins poétique, mais tout aussi mythologique qu'Hésiode : « (p. 10) Obligée de subir constamment les lois fondamentales de la vie planétaire [que peut bien être cette vie ?], la Terre, quand elle était intelligente [c'était peut-être au temps où les bêtes parlaient], pouvait développer son activité physico-chimique de manière à perfectionner l'ordre astronomique en changeant ses principaux coefficients. Notre planète put ainsi rendre son orbite moins excentrique, et dès lors plus habitable, en concertant une longue suite d'explosions analogues à celles d'où proviennent les comètes, suivant la meilleure hypothèse. Reproduites avec sagesse, les mêmes secousses, secondées par la mobilité végétative [que peut bien être cette autre merveille ?], purent aussi rendre l'inclinaison de l'axe terrestre mieux conforme (p. 11) aux futurs besoins du Grand Être ». Et l'auteur continue à divaguer ainsi, durant des pages et des pages.
[FN: § 1627-1]
L. GAUTIER ; Intr. à l’anc. Test., t. II : « (p. 126)... Cantique des Cantiques veut dire le plus beau, le plus parfait des cantiques, le cantique par excellence. C'est donc un hommage rendu à la supériorité de ce poème sur les autres ».
[FN: § 1627-2]
Gautier est protestant. Écoutons aussi un auteur catholique. Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Cantique des Cantiques, t. 3 : « (p. 508) ...on explique le Cantique des cantiques, soit littéralement, soit typiquement, soit allégoriquement ». L'auteur, on le comprend, repousse les deux premières interprétations. « (p. 508) Théodore de Mopsueste a le premier mis en avant l'explication littérale : mais Théodoret l'en blâme, et son explication (p. 509) a été rejetée par le second concile de Constantinople... L'interprétation typique, qui consiste à conserver le texte littéral et sensible, mais à considérer et à interpréter les événements décrits comme symboles de vérités plus hautes, n'a pas été tentée pour la première fois par Hugo Grotius... elle se trouve déjà dans Honorius d'Autun, appliquant littéralement le cantique à la fille de Pharaon et allégoriquement à l'Église chrétienne. Grotius considère l'amour de Salomon pour la fille du roi d'Égypte comme le sujet accidentel du Cantique, mais en même temps comme le type de l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël ». L'auteur démontre qu'on ne peut accepter cela. « (p. 509) Il ne reste donc que le sens allégorique. Mais les défenseurs de l'interprétation allégorique, suivent de leur côté des voies diverses. Les uns trouvent dans le Cantique l'amour de Salomon pour la sagesse, les autres son amour pour le peuple d'Israël, d'autres encore le désir d'Ezéchias de voir la réconciliation des royaumes séparés ; les anciens interprètes juifs, l'amour de Jéhova pour Israël, et les plus anciens commentateurs chrétiens, presque unanimement, l'amour du Christ pour son Église ». – D. AUGUST : Speculum – De Cantico Canticorum : Restat ille liber Salomonis, cuius inscriptio est : Canticum Canticorum. Sed de illo in hoc opus quid transferre possumus, cum totus amores sanctos Christi et Ecclesiae figurata locutione commendet, et prophetica pronuatiet altitudine ?
[FN: § 1627-3]
GAUTIER examine aussi les interprétations qui voient dans le Cantique un drame, et conclut : « (p. 138) ...cette reconstruction dramatique du Cantique des Cantiques me parait inacceptable. Je ne crois pas qu'on puisse jamais tirer de ce poème, d'une façon quelque peu vraisemblable, ce que les partisans du drame prétendent y trouver ». Il remarque, à propos des partisans de cette interprétation : « (p. 138) À défaut du sens allégorique, de plus en plus abandonné, ils se demandent si l'on ne peut pas discerner dans le Cantique, interprété comme un drame, une tendance sinon religieuse, du moins morale. Glorification de l'amour vrai, opposition aux passions sensuelles et aux jouissances vulgaires, supériorité de la monogamie sur la polygamie, éloge du mariage, de la constance en amour, de la fidélité conjugale, triomphe d'un sentiment sincère et profond sur les attraits de la richesse et de la pompe royale, voilà autant de thèmes qui ont paru dignes d'être célébrés, et que l’on a indiqués comme ayant inspiré le poète du Cantique ». L'auteur est favorable à la solution qui voit dans le Cantique des cantiques une collection de chants nuptiaux. Cette solution a pour elle un argument de grand poids, puisqu'elle est obtenue par la méthode comparative (§ 547, 548), en expliquant le passé par les usages observés aujourd'hui. Pourtant un point demeure douteux : a-t-on vraiment deviné l'origine et le caractère de ce morceau de littérature ? Heureusement l'humanité peut vivre sans éclaircir ce doute.
[FN: § 1627-4]
RENAN ; Le Cant. des Cant. : « (p. XI) Je sais que plusieurs passages de la (p. XII) traduction paraîtront un peu choquants à deux classes de personnes, d'abord à celles qui n'admirent de l'antiquité que ce qui ressemble plus ou moins aux formes du goût français ; en second lieu, à celles qui n'ont connu le Cantique qu'à travers le voile mystique dont la conscience religieuse des siècles l'a entouré. Ces dernières sont naturellement celles dont il me coûte le plus de froisser les habitudes. Ce n'est jamais sans crainte que l'on porte la main sur ces textes sacrés qui ont fondé ou soutenu les espérances de l'éternité... » Ce sont là quelque peu des larmes de crocodile. Renan a de ces égards à profusion. Plus loin, il n'ose même pas citer la Bible ! « (p. 43) Sulem ou Sunem était un village de la tribu d'Issachar, patrie d'une certaine Abisag la Sunamite, dont les aventures racontées (Vulg., III) Reg., I, 3; II, 17 et sv., ne sont pas sans analogie avec celles qui forment le canevas de notre poëme. Nous lisons, en effet, au premier des passages précités, que les gens de David, dans une circonstance trop éloignée de nos mœurs pour être rapportée ici, firent chercher dans toutes les tribus d'Israël la plus belle jeune fille... » Nous voilà bien lotis, si les historiens ne rapportent que les circonstances qui ne s'écartent pas trop de nos mœurs ! Il est plaisant que Renan taise ce que tout le monde sait. Segond n'a pas de ces scrupules de littérateur élégant, et traduit : « Rois I, 1, 2) Ses serviteurs [de David] lui dirent : Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne, et qu'elle couche dans ton sein et mon seigneur le roi se réchauffera ». Quelquefois Renan pousse plus loin : G. SOREL ; Le syst. hist. de Renan, I : « (p. 118) Il y a quelques années, M. Pascal, professeur à Catane, a fait connaître un curieux exemple des traductions artificieuses de Renan (Carlo Pascal, L'incendie de Rome et les premiers chrétiens, p. 30) ». Il s'agit d'une série d'équivoques voulues par Renan, sur les termes domus transitoria, qui désignent certains édifices de Néron.
[FN: § 1627-5]
PIEPENBRING ; Hist. du peuple d'Isr. « (p. 704 note) Wildboer, p. 488. Comp. Cornill, p. 256 ». Pourtant Piepenbring conclut : « (p. 705) Nous reconnaissons sans peine que notre recueil ne renferme rien d'immoral ni même d'indécent... Nous croyons néanmoins que ceux-là ont raison qui, parmi les anciens et les modernes, ont pensé ou pensent encore que cet opuscule est déplacé dans un recueil sacré, dans un livre d'édification ». En notre temps moral – en paroles – et démocratique, les interprétations morales et démocratiques devaient naturellement être en faveur. Piepenbring cite (p. 703) Reuss, qui dit : « Enfin, pour ce qui est de la morale prêchée au public, l'auteur [du Cantique des cantiques] a voulu proscrire la polygamie ; il a voulu faire l'éloge de la fidélité conjugale ; il a voulu faire admirer la vertu, victorieuse de la séduction ; il a voulu se rendre l'organe de l'indignation démocratique en face de la corruption de la cour ». Que de belles choses on trouve dans ce texte ! Pourquoi n'y pas ajouter les louanges du suffrage universel et de l'antimilitarisme ? Pour une autre composition, qui fait partie de la Bible, le livre de Ruth, notre auteur, à la suite d'autres auteurs, veut montrer qu'il doit y avoir un but moral. Ces auteurs cherchent donc une voie pour passer du texte à ce but, c'est-à-dire une dérivation ; et puisque qui cherche ces dérivations les trouve toujours, ils découvrent aisément que le livre de Ruth tend à une religion humaine et universelle. Piepenbring commence par dire : « (p. 606) Le vrai but du livre de Ruth n'a été compris que de nos jours ». En note : « (p. 607) Le but et le sens du livre de Ruth n'ont même pas été compris par nombre d'exégètes modernes qui suivent la méthode strictement grammaticale et historique. Reuss en particulier a complètement fait fausse route à cet égard et appliqué à ce livre une interprétation tout à fait artificielle. L'explication que nous en avons donnée et la date de composition que nous lui assignons, sont fort bien justifiées dans les ouvrages spécieux déjà fréquemment cités de Kuenen, Cornill et Wildeboer ». Sans doute, ce livre a peut-être tous les mérites possibles ; mais il doit lui manquer celui de la clarté, s'il a fallu environ deux mille ans pour savoir ce qu'il signifiait ! Maintenant enfin, il nous est donné de connaître le sens de cet écrit. « (p. 606) C'est en réalité un complément fort précieux de la réforme d'Esdras. Il montre que le monde juif tout entier ne se laissa pas entraîner par l'esprit intolérant et exclusif de ce scribe... Nous apprenons par là que les mariages mixtes, combattus en bloc et avec acharnement par Esdras et ses collaborateurs, furent justifiés, non seulement du point de vue de la passion ou des intérêts, mais aussi de celui de la justice et de l'équité. L'auteur de notre livre plaçait au fond les liens spirituels de la religion au-dessus de ceux du sang ; il accordait plus d'importance à une conduite vraiment pieuse qu'à une généalogie correcte ; il devança le point de (p. 607) vue évangélique, en vertu duquel il n'est pas nécessaire de descendre d'Abraham pour être un vrai fidèle ». Ce n'est peut-être pas le hasard seul qui a fait que ce sens ait été découvert justement en un temps comme le nôtre, d'humanitarisme et de démocratie. – GAUTIER (loc. cit. 1627-1, dit avec beaucoup de bon sens : « (p. 152) Pour discerner la raison d'être et le but du livre de Ruth, il n'est donc point nécessaire de recourir à des suppositions ingénieuses et quelque peu lointaines. Il suffit de se rappeler le goût des Orientaux pour les histoires dramatiques, piquantes ou touchantes, qu'on se raconte d'une génération à l'autre ». Mais c'est une chose trop simple pour messieurs les interprètes.
[FN: § 1629-1]
D. BERNARDI In cantica sermo 28, 13 : Adiiciens siquidem, Filii matris meae pugnaverunt contra me ; persecutionem passam se esse aperte significat. – Serm. 29, 1: Filii matris meae pugnaverunt contra me. Annas et Caiphas et Iudas Iscarioth, filii synagogae fuerunt et hi contra Ecclesiam, aeque synagogae filiam, in ipso exortu ipsius acerbissime pugnaverunt, suspendentes in ligno collectorem ipsius Iesum. Iam tunc siquidem Deus implevit per eos, quod olim praesignaverat per Prophetam, dicens : „ Percutiam pastorem, et dispergentur oves “... De his ergo et aliis, qui de illa gente Christiano nomini contradixisse sciuntur, puta dictum a sponsa : Filii matris meae pugnaverunt contra me.
[FN: § 1629-2]
Dans l'introduction à la traduction de l'Eclésiastique (La sagesse de Jésus fils de Sirach) publiée par la Société biblique de Paris, on lit : « (p. 391)... le fils de Sirach n'est pas exempt d'égoïsme. Ses conseils de prudence, si abondants dans son livre, dénotent une préoccupation trop absorbante de l'intérêt personnel. Même l'amour du plaisir trouve quelque écho dans son cœur, et il s'exprime en maints endroits comme un disciple d'Épicure... (p. 892) Il ne faudrait pourtant pas exagérer ces taches. Dans l'ensemble, notre livre est rempli de bon sens, de droiture, de charité et de piété » (Les livres apocryphes de l'Ancien Testament).
[FN: § 1629-3]
D. HIERONYM. comment. in Ecclesiasien, IX, 7 (t. V, p. 23). Vade et comede in laetitia panem tuum, et bibe in corde bono vinum tuum... Et haec, inquit, aliquis loquatur Epicurus, et Aristippus, et Cyrenaici, et ceteri pecudes philosophorum. Ego autem mecum diligenter retractans, invenio, non ut quidam aestimant male, omnia fortuito geri, et variam in rebus humanis fortunam ludere, sed cuncta iudicio Dei fieri.
[FN: § 1629-4]
D. HIERONYN. comment. in Ecclesiasten, VIII, 15 [trad. SEGOND : « J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir »]. D. HIERONYM. (t. V, p. 22) Et laudavi ego laetitiam : quia non est bonum homini sub sole nisi comedere, et bibere, et laetari...] Hoc plenius supra interpretati sumus, et nunc strictim dicimus : licet brevem et cito finiendam praeferre eum vescendi et bibendi voluptatem angustiis sacculi, ... Verum haec interpretatio ieiunantes, esurientes, sitientes, atque lugentes quos beatos in evangelio dominus vocat, si accipitur, ut scriptum est, miseros approbabit. Et cibum itaque et potum spiritualiter aceipiamus... – Idem, ibidem, p. 9, III, 11-13 : ... Porro quia caro domini, verus est cibus, et sanguis eius, Verus et potus...
[FN: § 1629-5]
D. HIERONYM. ; loc. cit. § 1629-1. Eccl., III, 5 [trad. SEGOND « (1) Il y a un temps pour tout... (5) un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements »]. D. HIERONYM. (p. 8) : Tempus amplexandi, et tempus longe fieri ab amplexu. Iuxta simplicem intelligentiam manifestus est sensus (Apostolo in eadem verba congruent : nolite fraudare invicem ...) liberis dandam operam, et rursus continentiae. [Puis vient une autre explication encore plus étrange] Vel quod tempus fuerit amplexandi, quando vigebat illa sententia : Crescite et multiplicamini, et replete terram. Et tempus procul a complexu fieri, quando successit. [Mais voici mieux encore] Si autem voluerimus ad altiora conscendere, videbimus sapientiam amplexari amatores suos... intraque ulnas suas et gremium strictiori tenebit complexu.
[FN: § 1630-1]
Il Programma dei Modernisti. Risposta all' Enciclica di Pio X „ Pascendi Dominici gregis “ : « (p. 121) Les modernistes, comme nous l'avons déjà dit, en plein accord avec la psychologie contemporaine, distinguent nettement la science de la foi. Les procédés de l'esprit, qui aboutissent à l'une et à l'autre, apparaissent aux modernistes comme tout à fait étrangers et indépendants entre eux ». Parfaitement. Mais comment concilier cela avec la peine énorme que se donnent les modernistes pour mettre d'accord la science et la foi ? L'un des principaux chefs des modernistes, l'abbé Loisy, dit clairement : « (L’Évang. et l'Égl., p. XXXIII). La conscience pourra-t-elle garder bien longtemps un Dieu que la science ignore, et la science respectera-t-elle toujours un Dieu qu'elle ne connaît pas ? »
[FN: § 1630-2]
Loc. cit., § 1630-1 Ils disent de l’Église : « p. 123) Quelle popularité peuvent lui donner ces oligarchies nobiliaires, petites et décrépites, qui, en échange d'un peu de faste, lui imposent des habitudes en contraste manifeste avec les tendances du monde ? Nous comprenons cela, et nous le disons franchement. Nous sommes las de voir l’Église réduite à une bureaucratie jalouse des pouvoirs qui lui restent et avide de regagner ceux qu'elle a perdus... (p. 124) L’Église doit éprouver la nostalgie de ces courants, encore inconsciemment religieux, qui alimentent l'ascension de la démocratie ; elle doit trouver la manière de se fondre avec celle-ci, pour la rendre vraiment capable de succès, par le moyen de la force des freins et l'aiguillon de son ministère moral, qui, seul sait donner des leçons d'abnégation et d'altruisme. L’Église doit reconnaître loyalement que dans la démocratie se prépare précisément une affirmation plus haute de sa catholicité. Alors, la démocratie aussi éprouvera la nostalgie de l’Église, qui contient la continuation de ce message chrétien dont elle, démocratie, tire ses origines reculées mais authentiques ». Et l'on peut ajouter : alors la démocratie récompensera largement les déserteurs de l’Église catholique. Pourtant les curés français qui, en un dessein analogue, s'unirent au Tiers État, pour constituer l'Assemblée Nationale, et qui préparèrent ainsi la Révolution, furent entièrement déçus. Plusieurs de ces braves gens n'eurent pas même les trente deniers de Juda, mais l'exil, la prison, la guillotine furent leur unique récompense.
[FN: § 1630-3]
A. Loisy ; Autour d'un petit livre : « p. 93) Ce Christ, sans doute, n'est pas une abstraction métaphysique, car il est vivant dans l'âme de l'évangéliste. Mais ce Christ de la foi, tout spirituel et mystique, c'est le Christ immortel qui échappe aux conditions du temps et de l'existence terrestre... Les récits de Jean ne sont pas une histoire, mais une contemplation mystique de l’Évangile ; ses discours sont des méditations théologiques sur le mystère du salut... (p. 94) L’Église chrétienne, qui allégorisait l'Ancien Testament, ne se défendait pas d'allégoriser les récits évangéliques... (p. 95) On ne doit donc pas être surpris que l'exégèse critique découvre des allégories dans le quatrième Évangile... L'allégorie n'était-elle pas, pour Philon d'Alexandrie, la clef de l'Ancien Testament, la forme naturelle de la révélation divine, et l'influence du philonisme sur Jean n'est-elle pas incontestable ? ».
[FN: § 1630-4]
A. Loisy ; Simples réflexions sur le décret du Saint-Office, Lamentabili sane exitu, et sur l'Encyclique Pascendi Dominici gregis.
[FN: § 1630-5]
Acta pontificia, oct. 1907. De Modernistarum doctrinis... Pascendi dominici gregis. (p. 379) Atque haec... de modernista ut philosopho. – Iam si, ad credentem progressus, nosse quis velit unde hic in modernistis a philosopho distinguatur, illud advertere necesse est etsi philosophus realitatem divini ut fidei obiectum admittat, hanc tamen ab illo realitatem non alibi reperiri nisi in credentis animo, in obiectum sensus est et affirmationis atque ideo phaenomenorum ambitum non excedit : utrum porro in se illa extra sensum existat quae affirmationem huiusmodi, praeterit philosophus ac negligit. « Et jusqu'ici,... [il a été question] du moderniste considéré, comme philosophe. – Si maintenant, venant à le considérer dans sa qualité de croyant, on veut connaître de quelle façon, chez les modernistes, le croyant se distingue du philosophe, il est nécessaire d'observer que, bien que le philosophe admette la réalité divine comme objet de la foi, il ne trouve cependant cette réalité nulle part ailleurs que dans l'esprit du croyant, comme objet du sentiment et de l'affirmation, sans que pour cela il dépasse le cercle des phénomènes [naturels] ; mais que cette réalité existe ou non en elle-même, hors du sentiment et de l'affirmation, cela importe peu au philosophe ». Ainsi l'attitude de celui qui veut demeurer dans le domaine de la science logico-expérimentale est fort bien expliquée, excepté cette allusion à la réalité divine, qui dépasse l'expérience. Mais le moderniste ne peut demeurer dans le domaine expérimental, car il n'y rencontrerait pas la sainte Démocratie tant désirée : elle ne se promène pas en ces contrées. C'est pourquoi le moderniste est croyant, et l'encyclique expose comment le moderniste oppose le croyant au « philosophe ». Et contra modernistae credenti ratum ac certum est, realitatem divini reapse in se ipsam existere nec prorsus a credente pendere. Quod si postules, in quo tandem haec credentis assertio nitatur ; reponent : in privata culusque hominis experientia. – In qua affirmatione, dum equidem hi a rationalistis dissident, in protestantium tamen ac pseudo-mysticorum opinionent discendunt. « Au contraire, le croyant moderniste estime et tient pour certain que la réalité divine existe bien en elle-même, et qu'elle ne dépend en rien du croyant. Que si l'on demande sur quoi enfin s'appuie cette assertion du croyant, ils [les modernistes] répondront : sur l'expérience particulière de chaque homme. – Mais en cette affirmation, tandis qu'ils s'écartent certainement des rationalistes, ils tombent toutefois dans l'opinion des protestants et des pseudo-mystiques ». Selon M. Loisy, il semble qu'en cela l'encyclique se trompe, et qu'elle ne donne pas l'opinion des modernistes ; mais nous ne pouvons pas savoir ce qu'est réellement cette opinion, si M. Loisy ne s'explique pas un peu plus clairement, en ôtant les voiles qui enveloppent la « science en elle-même, le travail scientifique en tant qu'émanant d'un être moral », et beaucoup d'autres entités semblables. L'encyclique ajoute que la science doit être soumise à la foi. Comme cette affirmation est claire, claire aussi peut-être la réponse de qui voulant demeurer dans le domaine de la science logico-expérimentale, déclare ne se soucier en aucune façon de ce que voudrait lui prescrire, toujours dans ce domaine, la foi catholique, protestante, musulmane, humanitaire, démocratique, ou toute autre foi, quel que soit son nom. Pourtant, cela ne signifie pas du tout qu'en certaines circonstances, il ne puisse être utile de croire que la science doit être subordonnée à la foi.
[FN: § 1631-1]
Essai d'une philosophie de la Solidarité. M. L. BOURGEOIS « (p. 65) Il faut expressément reconnaître que l'homme ne peut se libérer définitivement, pour l'avenir aussi bien que pour le passé. Il se doit acquitter sans cesse. Au jour le jour il contracte une dette nouvelle qu'au jour le jour il doit payer. C'est à chaque instant que l'individu se doit libérer et c'est ainsi qu'à chaque instant il reconquiert sa liberté ». Une personne désignée dans le texte par X fut prise de la crainte que si ses « débiteurs » se libéraient, elle n'en pourrait plus rien obtenir ; ce qui irait directement à l'encontre du but pratique de la solidarité ; et elle objecta : « (p. 77) L'idée du rachat de la dette sociale ne conduit-elle pas, ou ne risque-t-elle pas de conduire, au point de vue moral, à l'égoïsme ? Quand j'aurai payé cette dette, je serai libéré ; mais ne le serais-je pas surtout à l'égard de la charité, de la bonté ? Cette conviction ne produira-t-elle pas surtout une certaine sécheresse de cœur ? ». Rassurez-vous, bonnes gens. La dette de vos débiteurs est d'une nature si merveilleuse que s'ils payaient autant de millions qu'il y a de grains de sable dans les mers, ils ne pourraient jamais, jamais se libérer. M. L. BOURGEOIS : (p. 77) Il en pourrait être ainsi si la libération devait jamais être obtenue totalement et pour toujours [le lecteur voudra bien observer qu'il n'y a ici aucune restriction de somme, petite ou grande]. Mais, je l'ai dit, nul être n'est définitivement libéré ; par cela même qu'il continue de vivre, il devient de nouveau débiteur, et toujours doit renaître en lui le sentiment qu'il est obligé envers ses semblables, qu'il a en eux des créanciers ». C'est déjà quelque chose, que cette dette ne subsiste pas au-delà de la mort qui, en ce cas, peut bien être qualifiée de libératrice ! Et si le débiteur ne voulait pas payer et envoyait promener la sainte Démocratie et ses prophètes ? On emploierait la force. Mais alors pourquoi n'y pas recourir immédiatement, et faire de si longs détours ? Est-ce peut-être que la fraude est plus facile à employer que la force ?
[FN: § 1632-1]
TERTULL. ; De baptismo, 1 : Atque adeo nuper conversata istic quaedam de Gaiana haeresi vipera venenatissima doctrina sua plerosque rapuit [l'hérésie est venimeuse ; la vipère est venimeuse ; donc l'hérétique est une vipère], imprimis baptismum destruens. Plane secundum naturam [la femme, égalée à la vipère, agit comme la vipère]. Nam fere viperae et aspides ipsique reguli serpentes arida et inaquosa sectantur. [Expressions plus efficaces que s'il avait nommé la vipère seule. Grâce aux sentiments accessoires (IV-β), l'adjonction de l'aspic et d'autres serpents à la vipère, suggère qu’on doit y ajouter aussi le serpent hérétique]. Sed nos pisciculi [pour le baptême]. Le même auteur dit, De resurr. carnis, 52 : Alia caro volatilium, id est martyrum, qui ad superiora conantur, alia piscium, id est quibus aqua baptismatis sufficit] secundum IXOYN nostrum. Iesum Christum in aqua nascimur [l'eau nous fait chrétiens, nous fait naître spirituellement], nec aliter quant in tiqua permanendo salvi sumus [autre métaphore : « demeurer dans l'eau » veut dire demeurer dans l'état de grâce conféré par le baptême]. Itaque illa monstrosissima, cui nec integre quidem docendi ius erat, optime norat pisciculos necare de aqua auferens [conclusion des raisonnements métaphoriques].
[FN: § 1633-1]
TERTULL. ; De bapt., II. Plus loin, V, il revient sur le même sujet, mais remarque que les eaux des Gentils n'ont pas l'efficacité de celles des chrétiens (§ 1292). L'autorité sert donc à établir qu'en général les eaux sont efficaces, mais qu'en particulier, toutes n'ont pas cette efficacité.
[FN: § 1633-2]
Pourtant, peu après, il ne peut résister au plaisir de relever d'autres nobles caractères de l'eau, et fait remarquer, IX, que « l'eau était d'un grand prix auprès de Dieu et de son Christ ». L'eau sert au baptême du Christ ; celui-ci change l'eau en vin ; il dit à ses disciples de se désaltérer à l'eau éternelle ; il met parmi les œuvres de charité le fait de donner le calice d'eau au pauvre, etc.
[FN: §1633- 3]
TERTULL. ; De bapt., III.
[FN: § 1638-1]
ANATOLE FRANCE ; Opinions sociales, II, La justice civile et militaire : « (p. 196) ...je réprouve à ce point le vol et l'assassinat, que je n'en puis souffrir même la copie régularisée par les lois, et il m'est pénible de voir que les juges n'ont rien trouvé de mieux, pour châtier les larrons et les homicides, que de les imiter [ici, il y a aussi une dérivation du genre (IV-γ)] ; car, de bonne foi, Tournebroche, mon fils, qu'est-ce que l'amende et la peine de mort, sinon le vol et l'assassinat perpétrés avec une auguste exactitude ? Et ne voyez-vous point que notre justice ne tend, dans toute sa superbe, qu'à cette honte de venger un mal par un mal, une misère par une misère, et de doubler, pour l'équilibre et la symétrie les délits et les crimes ». L'auteur suppose qu'il répond au reproche qu'on lui adresse « (p. 196) d'être du parti des voleurs et des assassins » ; et là commence déjà la dérivation. Il importe peu au public que A. France et ses amis humanitaires veuillent être de tel ou tel parti ; mais il lui importe beaucoup que les dits larrons et assassins n'aient pas, grâce à l'indulgence de ces messieurs, la faculté de se promener. Plus loin, A. France exprime ses opinions par la bouche d'un directeur de prison, et reproduit les axiomes répétés déjà un nombre de fois infini par les humanitaires. Il nous apprend ainsi que « (p. 209) plus je vis, plus je m'aperçois qu'il n'y a pas de coupables et qu'il n'y a que des malheureux ». Cela peut être vrai ; mais il faudrait savoir ce que l'auteur entend par coupable et par malheureux. Supposons un individu qui veuille laisser courir librement les chiens enragés et les rats pestiférés, qui feigne, comme A. France, qu'on l'accuse de tenir le parti de ces bêtes. Il répond : « Je réprouve à ce point la mort donnée par le chien enragé ou le rat pestiféré, qu'il m'est pénible de voir que les hommes n'ont rien trouvé de mieux, pour se mettre en sûreté, que d'imiter les chiens enragés et les rats pestiférés en donnant la mort à ces animaux ». Ensuite il conclut : « Plus je vis plus je m'aperçois qu'il n'y a pas d'animaux coupables et qu'il n'y a que des animaux malheureux ». Appelez tant qu'il vous plaira coupables ou malheureux les chiens enragés et les rats pestiférés, pourvu que vous nous laissiez nous en débarrasser; alors nous sommes d'accord. Donnez le nom que vous voudrez à messieurs les larrons et à messieurs les assassins; dites que ce sont des innocents; pourvu que vous nous permettiez de ne pas vivre en compagnie de ces innocents, nous ne vous demandons pas autre chose. Il suffit d'ouvrir un journal pour y trouver la description des louables exploits de ces malheureux, pour lesquels A. France a tant de bienveillance. Voici un exemple pris au hasard : La Liberté, 14 janvier 1913 : « Une gamine sert de cible à des apaches. Au numéro 42 de l'avenue des Batignolles, à Saint-Ouen, s'ouvre un étroit passage, bordé de masures habitées par des ménages de modestes travailleurs chargés de famille. La famille Pache est une des plus intéressantes, car le père, victime d'un accident du travail, ne peut faire que de menus travaux. Cependant, il fait vivre sa famille, quatre enfants, et il a réussi à se construire une maisonnette sur un minuscule terrain, tout au fond de l'impasse. L'aînée des enfants, Marcelle, qui vient d'atteindre sa quinzième année, réalise en tout point le type de la „ petite maman “ que l'on rencontre fréquemment dans les familles pauvres et nombreuses. Levée dès la pointe du jour, elle prépare le déjeuner des bambins ; puis elle les conduit, bien propres, à l'école maternelle ; ensuite, elle se rend à l'atelier où elle travaille toute la journée ; enfin, elle rentre à la maison et prépare le dîner de toute la famille. Hier soir, la „ petite mère “ se rendit, à 7 heures, au bout de l'allée pour y prendre de l'eau à la fontaine. À ce moment, plusieurs jeunes gens s'arrêtèrent à quelques pas du groupe que la jeune Marcelle formait avec les gosses. – Attention, dit l’un des apaches... Ce fut là un signal ; coup sur coup, plusieurs détonations retentirent... „ Petite mère “ atteinte au milieu du front par une balle s'affaissa en poussant un grand cri... Les rôdeurs l'avaient choisie comme cible pour essayer leurs revolvers. Des voisins accoururent. On releva la pauvre petite qui perdait le sang abondamment. Tandis que les uns relevaient la victime de cet odieux attentat, d'autres allaient prévenir le docteur Perraudeau... Le médecin déclara que l'état de la malheureuse enfant était grave et il la fit conduire à l'hôpital Bichat, où elle fut admise ». Il faut bien comprendre que, d'après la théorie de A. France, ce n'est pas la fillette presque tuée qui est malheureuse ; ce sont ses agresseurs qui sont malheureux. Il n'est pas nécessaire que les gens se préoccupent de cette enfant, et moins encore qu'ils prennent des mesures pour que des faits semblables ne se renouvellent pas ; seuls les agresseurs doivent jouir des tendres attentions de la « société ».
[FN: § 1639-1]
BAYLE, s. r. Tanaquil, t. IV, p. 317, cite un passage de Pline (VIII, 74, 1) : « M. Varron rapporte, comme témoin oculaire, que de la laine sur la quenouille et le fuseau de Tanaquil, qui fut aussi appelée Caïa Caecilia, se voyait encore de son temps dans le temple de Sangus ; et dans le temple de la Fortune une robe royale ondée qu'elle avait faite, et que Servius Tullius avait portée. C'est pour cela que les jeunes filles qui se marient ont avec elles une quenouille garnie et un fuseau chargé. Tanaquil trouva l'art de faire une tunique droite (tissée de haut en bas), telle que celle que les jeunes gens et les nouvelles mariées prennent avec la toge sans bordure ». [Trad. LITTRÉ]. Bayle rappelle incidemment un passage de PLUTARQUE (Quaest. rom., XXX), qui, proposant une seconde réponse à la question : «Pourquoi, introduisant la fiancée, lui impose-t-on de dire : „ Où tu seras Gaïus, je serai Gaïa “ ? », dit : « Est-ce parce que Gaïa Caecilia, femme d'un des fils de Tarquin, fut belle et sage ? Sa statue d'airain a été placée dans le temple de Santus [ce nom a différentes orthographes] ; anciennement il y avait aussi ses sandales et ses fuseaux : celles-là étaient le symbole de ses habitudes casanières ; ceux-ci, de son activité industrieuse ». Après avoir traité d'autre chose, Bayle dit : « Un Auteur François, qui vivoit au XVIe siècle, débite une chose qu'il n'eût su prouver. Les Tarquins, dit-il, * avoient fait ériger une statue au milieu de leur logis qui avoit des souliers de chambre seulement, une quenouille et son fuseau, afin que ceus qui suivroient leur famille imitassent leur assidue assiduité en mesnageant sans partir de la maison. Voilà l'état où l'on a réduit ce que j'ai cité de* Pline touchant la Statue de Tanaquil. Chacun se mêle de changer quelque circonstance dans ce qu'il cite : par ce moien les faits se gâtent, et se pervertissent bientôt entre les mains de ceux qui les citent ».
* Franc. Tillier, Tourangeois, dans son Philogame, pag. 120. Edit. de Paris, 1578.
[FN: § 1641-1]
RENAN ; Hist. du peup. d'Israël, t. V, p. 70 : « Des ressemblances ne sont pas des preuves d'imitation voulue. Le cercle de l'imagination religieuse n'est pas fort étendu ; les croisements s'y produisent par la force des choses ; un même résultat peut avoir des causes tout à fait différentes. Toutes les règles monastiques se ressemblent. Le cycle des créations pieuses offre peu de variété ». Ce que Renan dit ici des institutions religieuses, on peut le répéter des autres institutions.
[FN: § 1641-2]
Employons, comme d'habitude, la méthode indiquée au § 547. Journal de Genève, 26 février 1913 : « Les chroniqueurs littéraires de la Suisse allemande Viennent de livrer une grande bataille... contre des moulins à vent ! Ils ont été victimes d'un mystificateur, M. Loosli, qui avait déclaré gravement, dans un long article de revue, que le véritable auteur des œuvres de Jérémias Gotthelf n'était pas Albert Bitzius, mais son ami J.-U. Geissbühler. Cette affirmation avait causé une vive agitation parmi les critiques les plus autorisés, et la « question Gotthelf » était devenue un sujet de discussions passionnées dans les journaux. Dans le dernier numéro de Heimat und Fremde, M. Loosli raconte que l'idée de sa supercherie lui est venue au cours d'une conversation avec un ami. L'entretien avait roulé sur l'hypothèse Bacon Shakespeare, et M. Loosli avait fait remarquer à son compagnon combien il était facile de contester l'authenticité de l'œuvre littéraire de n'importe quel écrivain mort depuis cinquante ans. Il suffisait de lancer d'un air d'augure n'importe quelle affirmation absurde pour que le monde de pontifes littéraires s'en emparât et la discutât avec une gravité imperturbable. Comme l'interlocuteur de M. Loosli restait sceptique, celui-ci fit la gageure de mettre son idée à exécution et envoya, en plein carnaval, à la revue bernoise, l'article qui a mis en branle toute la presse suisse. Il prit la précaution, avant de publier son article, de déposer chez un notaire, sous enveloppe scellée, la déclaration suivante : „ Bümplitz, le 4 janvier 1913. Sous le titre Jérémias Gotthelf, une énigme littéraire, j'ai rédigé aujourd'hui une esquisse que j'ai l'intention de publier, et dans laquelle je fais la preuve que le véritable auteur des œuvres de Jérémias Gotthelf n'est pas Albert Bitzius, mais son contemporain et ami J.-U. Geissbühler. J'ai agi dans l'intention de prouver, par un exemple pratique, combien il est facile, dans le domaine de la philologie, de faire des hypothèses qui sont invraisemblables, et afin de me procurer le plaisir de rire aux dépens des savants qui attaqueront mon article. Je veux donner une leçon aux philologues, parce que j'estime qu'ils trahissent l'art et la poésie. Je dépose aujourd'hui cette explication chez M. le notaire Gfeller, à Bümplitz, et la publierai quand le temps en sera venu. Je le fais afin d'éviter que ma façon d'agir soit mal comprise, et pour protéger la mémoire d'Albert Bitzius contre des philologues trop zélés. C.-A. LOOSLI “. À cette pièce en est jointe une autre, que voici : „ Le soussigné certifie que cet écrit est resté consigné sous scellé dans mon bureau, du 4 janvier 1913 jusqu'à aujourd'hui. Bümplitz, 15 février 1913, Bureau du notaire Gfeller : LUTHI, notaire “. L'hypothèse émise par l'un des mystifiés, que M. Loosli s'était trompé et avait, après coup, afin de masquer sa défaite, prétendu qu'il n'avait voulu faire qu'une farce, doit donc être écartée. Dans son nouvel article, l'auteur de la mystification s'ébaudit aux dépens de ses victimes. „ Mon article humoristique, écrit-il, contenait autant d'absurdités que de mots. Il est incapable de supporter l'examen et d'être pris au sérieux par un homme sensé. Toute personne qui n'est pas complètement bornée devait reconnaître de suite qu'il s'agissait d'une mystification. En dépit de tout cela, j'ai devant moi des articles contenant les appréciations suivantes : – L'auteur émet l'hypothèse, qui n'est pas invraisemblable... etc. (Gazette de Francfort). Peut-être Bitzius comme homme ne sera-t-il pas atteint par les assertions de M. Loosli ; le poète le sera certainement, car de même qu'Homère n'était pas celui qui.... etc. (National Zeitung). – La Nouvelle Gazette de Zurich et le Bund, poursuit M. Loosli, ont naturellement consacré des feuilletons entiers à cette farce et la question a été longuement commentée dans toute la presse suisse et même à l'étranger. Le public en a eu pour ses besoins sensationnels et le nom de Gotthelf, dont en temps ordinaire il se soucie comme d'une guigne, est aujourd'hui dans toutes les bouches. Comme je l'avais prévu, la vanité nationale s'est rebiffée et un nombre imposant de connaisseurs tout spéciaux de Gotthelf ont eu l'occasion de montrer leur profond savoir dans cette bataille contre un fantôme “ ».
[FN: § 1644-1]
IL BUONAIUTI ; Lo gnosticismo, c. IV : Gli gnostici nella leggenda : (« p. 124) Le gnosticisme est un immense phénomène de psychologie religieuse exaltée d'une façon morbide [c'est-à-dire qu'il montre en de plus grandes proportions les idées qu'on trouve en beaucoup d'autres manifestations religieuses], et qui, partant d'humbles origines, a pris peu à peu des proportions alarmantes, dans un milieu aussi favorable que l'atmosphère intellectuelle romaine du IIe et du IIIe siècles. Il est par conséquent inutile de le fractionner, de le sectionner, de l'analyser dans ses éléments : c'est un phénomène complexe, qui tire ses éléments de mille sources, qui jette ses tentacules insinuantes en mille dispositions psychologiques diverses ».
[FN: § 1644-2]
Idem.
[FN: § 1645-1]
Nous connaissons les doctrines gnostiques presque exclusivement par ce qu'en rapportent leurs adversaires chrétiens. Mais, par le peu qu'il est possible de tirer d'autres documents, il semble qu'en gros, ces adversaires ont été des interprètes fidèles. Cela est du moins confirmé par les récentes découvertes de fragments gnostiques. Nous n'entendons nullement ici nous occuper des questions difficiles et en partie actuellement insolubles qui se posent à l'égard de la Gnose et des gnostiques : nous cherchons seulement des exemples de dérivations ; nous ne faisons pas l'histoire d'une doctrine. – AMÉLINEAU ; Les traités gnostiques d'Oxford : « (p. 39) La publication de ces deux traités me semble donc de tout point importante : nous y possédons deux œuvres gnostiques du second siècle, deux œuvres authentiques malgré l'absence du nom de l'auteur et quelle que soit la solution qu'on adopte ; nous pouvons y étudier le gnosticisme sur lui-même, contrôler les assertions des Pères, voir qu'ils ont été le plus souvent des abréviateurs intelligents et toujours de bonne foi ; mais que souvent aussi ils n'ont pas saisi les idées des gnostiques et les ont parfois détournées de leur sens, sans parti pris, par simple erreur de jugement... ». On peut remarquer que les Pères ont donné un aspect plus raisonnable, ou mieux moins absurde, aux divagations qu'on lit dans les documents publiés par Amélineau. Par exemple : « (p. 9) Or de quoi s'agit-il dans tout ce second traité ? Il s'agit tout d'abord de l'initiation que Jésus donne à ses disciples pour les rendre parfaits dans la possession de la Gnose, et des mots de passe qu'il leur apprend pour pouvoir traverser chaque monde et arriver au dernier, où réside le Père de toute Paternité, le Dieu de vérité. Le mot mystère doit ici s'entendre soit des mystères de l'initiation, soit de chaque Æon qui est composé de plusieurs régions mystérieuses, lesquelles sont elles-mêmes habitées par une foule de puissances, toutes plus mystérieuses les unes que les autres... ici le mot Logos doit s'entendre, non pas de l'Æon Logos, mais des mots de passe, des grands et mystérieux mots de passe que le Verbe donne aux gnostiques pour arriver jusqu'au séjour du Dieu de vérité, après avoir passé à travers tous les aeons, sans avoir eu le moins du monde à souffrir de la conduite de leurs habitants. Il y a tout simplement dans le titre de ce second traité un de ces jeux de mots si chers aux Égyptiens ».
[FN: § 1645-2]
Le sens principal de ![]() parait être un grand, un immense espace de temps, de l'éternité. Nous disons le sens principal et non le sens primitif, parce qu'ici nous classons ; nous ne cherchons pas les origines. HES. ; Theog., 609,
parait être un grand, un immense espace de temps, de l'éternité. Nous disons le sens principal et non le sens primitif, parce qu'ici nous classons ; nous ne cherchons pas les origines. HES. ; Theog., 609, ![]() , « depuis les temps les plus reculés ». – PLATON, dans le Timée, dit que Dieu créa le ciel pour en faire une image mobile de l'éternité : (p. 37) « Il décida de faire une image mobile de l'éternité ». ARIST. ; De caelo, I, 9, 11 (p. 279) : ...
, « depuis les temps les plus reculés ». – PLATON, dans le Timée, dit que Dieu créa le ciel pour en faire une image mobile de l'éternité : (p. 37) « Il décida de faire une image mobile de l'éternité ». ARIST. ; De caelo, I, 9, 11 (p. 279) : ... ![]()
![]() « ... il est aeon, ayant pris ce nom du fait d'être toujours ». On trouve des sens abstraits analogues à des expressions signifiant de longs espaces de temps, d'un siècle, de la vie de l'homme. Dans un chapitre
« ... il est aeon, ayant pris ce nom du fait d'être toujours ». On trouve des sens abstraits analogues à des expressions signifiant de longs espaces de temps, d'un siècle, de la vie de l'homme. Dans un chapitre ![]() , SAINT JEAN DAMAS. CÈNE note ces divers sens. On trouve une légère trace de personnification, dans EURIPIDE, Heraclid., 895 (900), où
, SAINT JEAN DAMAS. CÈNE note ces divers sens. On trouve une légère trace de personnification, dans EURIPIDE, Heraclid., 895 (900), où ![]() est appelé « fils de Saturne » ; et l'on peut aussi entendre : « la suite des âges qui naissent du temps : (898)
est appelé « fils de Saturne » ; et l'on peut aussi entendre : « la suite des âges qui naissent du temps : (898) ![]() (899)
(899) ![]() (900)
(900) ![]() . « Car la Parque qui-mène-à-la-fin – et l'âge, fils de Kronos, enfantent beaucoup de choses ». C'est là une personnification poétique, semblable à celles dont use CLAUDIEN, dans l'Éloge de Stilicon, II :
. « Car la Parque qui-mène-à-la-fin – et l'âge, fils de Kronos, enfantent beaucoup de choses ». C'est là une personnification poétique, semblable à celles dont use CLAUDIEN, dans l'Éloge de Stilicon, II :
(424) Est ignota procul, nostraeque impervia menti,
Vix adeunda Deis, annorum squalida mater,
Immensi spelunea aevi, quae tempora vasto
Suppeditat revocalque sinu...
Sous le nom d'aeon, ARRIEN semble entendre un être immortel Epicteti dissertationes II, 5, 13 : ![]() . « Car je ne suis pas un immortel, mais je suis un homme ». – TATIEN mentionne les
. « Car je ne suis pas un immortel, mais je suis un homme ». – TATIEN mentionne les ![]() de telle façon qu'on ne sait pas bien de quoi il veut parler ; mais en tout cas, il semble que ce soit des mondes, des régions. Orat. ad Graecos, 20, p. 35 ; « Car le ciel n'est pas infini, ô homme, mais fini et circonscrit. Au-dessus de lui sont les Æons, meilleurs, n'ayant pas les changements de saison, changements qui engendrent les diverses maladies, jouissant entièrement d'un climat agréablement tempéré, ayant des jours perpétuels : et une lumière inaccessible aux hommes d'ici ». Nous avons deux types de traduction. Par exemple : A. PUECH ; Le disc. de Tatien... : « (p. 134) Le ciel n'est pas infini, ô homme, il est fini et a des limites. Au-dessus de lui, ce sont les mondes [en note : Le mot dont se sert Tatien
de telle façon qu'on ne sait pas bien de quoi il veut parler ; mais en tout cas, il semble que ce soit des mondes, des régions. Orat. ad Graecos, 20, p. 35 ; « Car le ciel n'est pas infini, ô homme, mais fini et circonscrit. Au-dessus de lui sont les Æons, meilleurs, n'ayant pas les changements de saison, changements qui engendrent les diverses maladies, jouissant entièrement d'un climat agréablement tempéré, ayant des jours perpétuels : et une lumière inaccessible aux hommes d'ici ». Nous avons deux types de traduction. Par exemple : A. PUECH ; Le disc. de Tatien... : « (p. 134) Le ciel n'est pas infini, ô homme, il est fini et a des limites. Au-dessus de lui, ce sont les mondes [en note : Le mot dont se sert Tatien ![]() (siècles, mondes) est un de ceux qu'il a en commun avec les Gnostiques... ] ». – L'autre type de traduction accepte le sens de siècles ; par exemple, OTTO : (p. 91) Non enim infinitum est coelum, o homo, sed finitum et terminis circumscriptum ; quae autem supra eum sunt, saecula, praestantiora... Dans l'édition Migne, on traduit aussi saecula praestantiora, et l'on ajoute en note : Agit enim hic de paradiso, quem in terra longe praestantiore, quam haec nostra est, situm fuisse pronuntiat. C'est pourquoi, même si l'on traduit saecula, on peut entendre une région. Chez les gnostiques, les aeons deviennent des personnes et des régions, et sont aussi considérés sous divers aspects. – TERTULL. ; Adversus Valentinianos, 7 (édit. OEHLER, II, p. 389), dit du dieu des valentiniens : Hunc substantialiter quidem
(siècles, mondes) est un de ceux qu'il a en commun avec les Gnostiques... ] ». – L'autre type de traduction accepte le sens de siècles ; par exemple, OTTO : (p. 91) Non enim infinitum est coelum, o homo, sed finitum et terminis circumscriptum ; quae autem supra eum sunt, saecula, praestantiora... Dans l'édition Migne, on traduit aussi saecula praestantiora, et l'on ajoute en note : Agit enim hic de paradiso, quem in terra longe praestantiore, quam haec nostra est, situm fuisse pronuntiat. C'est pourquoi, même si l'on traduit saecula, on peut entendre une région. Chez les gnostiques, les aeons deviennent des personnes et des régions, et sont aussi considérés sous divers aspects. – TERTULL. ; Adversus Valentinianos, 7 (édit. OEHLER, II, p. 389), dit du dieu des valentiniens : Hunc substantialiter quidem ![]() appellant, personaliter vero
appellant, personaliter vero ![]() et
et ![]()
![]() , etiam Bython, quod in sublimibus habitanti minime congruebat. « Considéré en sa substance, ils l'appellent aeon parfait, en sa personnalité, : premier principe, le principe, et abîme, nom qui ne convenait nullement à qui habitait des régions sublimes ». – AMÉLINEAU ; Les traités gnostiques d'Oxford. Jésus enseigne à ses disciples comment, après la mort, ils traverseront les aeons : « (p. 23) Ici... nous avons les chiffres qui correspondent à chaque monde des sceaux, c'est-à-dire les amulettes qu’il faut avoir et connaître pour entrer dans chaque aeon. …Nous avons en outre les apologies que l'on devait réciter, c'est-à-dire les mots de passe qu'il fallait prononcer pour convaincre les aeons que la possession du chiffre et du sceau n'était pas subreptice... L'emploi de ce chiffre, de ce talisman avait un effet merveilleux : lorsque l'âme se présentait dans un monde, aussitôt accouraient à elle tous les Archons de l'aeon, toutes les Puissances, tous les habitants en un mot, prêts à lui faire tout le mal qu'aurait encouru sa témérité : elle disait le chiffre, montrait le talisman, récitait la formule, et tout d'un coup, Archons, Puissances, habitants de l'aeon, tous lui faisaient place et s'enfuyaient à l'Occident ». – AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce, texte et traduction... : « (p. 194) Jésus dit à ses disciples : « Je vous donnerai l'apologie de tous ces lieux dont je vous ai donné le mystère et les baptêmes... (p. 195) Lorsque vous serez sortis du corps et que vous ferez ces mystères à tous les aeons et à tous ceux qui sont en eux, ils s'écarteront (devant vous) jusqu'à ce que vous arriviez à ces six grands aeons. Ils s'enfuiront à l'Occident, à gauche, avec tous leurs archons et tous ceux qui sont en eux ». En conclusion, chez les gnostiques, ce terme d'aeons paraît avoir trois significations : 1° une signification métaphysique concernant l'éternité ; 2° une signification qui les fait ressembler à des personnes ; 3° une signification qui les fait ressembler à des lieux. Mais ces significations ne demeurent pas distinctes : le caractère métaphysique s'étend aux personnes et aux lieux ; les personnes ressemblent aux lieux, et les lieux agissent comme des personnes.
, etiam Bython, quod in sublimibus habitanti minime congruebat. « Considéré en sa substance, ils l'appellent aeon parfait, en sa personnalité, : premier principe, le principe, et abîme, nom qui ne convenait nullement à qui habitait des régions sublimes ». – AMÉLINEAU ; Les traités gnostiques d'Oxford. Jésus enseigne à ses disciples comment, après la mort, ils traverseront les aeons : « (p. 23) Ici... nous avons les chiffres qui correspondent à chaque monde des sceaux, c'est-à-dire les amulettes qu’il faut avoir et connaître pour entrer dans chaque aeon. …Nous avons en outre les apologies que l'on devait réciter, c'est-à-dire les mots de passe qu'il fallait prononcer pour convaincre les aeons que la possession du chiffre et du sceau n'était pas subreptice... L'emploi de ce chiffre, de ce talisman avait un effet merveilleux : lorsque l'âme se présentait dans un monde, aussitôt accouraient à elle tous les Archons de l'aeon, toutes les Puissances, tous les habitants en un mot, prêts à lui faire tout le mal qu'aurait encouru sa témérité : elle disait le chiffre, montrait le talisman, récitait la formule, et tout d'un coup, Archons, Puissances, habitants de l'aeon, tous lui faisaient place et s'enfuyaient à l'Occident ». – AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce, texte et traduction... : « (p. 194) Jésus dit à ses disciples : « Je vous donnerai l'apologie de tous ces lieux dont je vous ai donné le mystère et les baptêmes... (p. 195) Lorsque vous serez sortis du corps et que vous ferez ces mystères à tous les aeons et à tous ceux qui sont en eux, ils s'écarteront (devant vous) jusqu'à ce que vous arriviez à ces six grands aeons. Ils s'enfuiront à l'Occident, à gauche, avec tous leurs archons et tous ceux qui sont en eux ». En conclusion, chez les gnostiques, ce terme d'aeons paraît avoir trois significations : 1° une signification métaphysique concernant l'éternité ; 2° une signification qui les fait ressembler à des personnes ; 3° une signification qui les fait ressembler à des lieux. Mais ces significations ne demeurent pas distinctes : le caractère métaphysique s'étend aux personnes et aux lieux ; les personnes ressemblent aux lieux, et les lieux agissent comme des personnes.
Les caractères vagues et flottants du terme aeons sont analogues à ceux des termes justice (celle-ci a été aussi personnifiée, comme les aeons), vérité, liberté, bien, mal, etc. L'analogie n'est pas fortuite ; elle provient de ce que tous ces termes sont des créations du sentiment. C'est ce qui, d'une part, éloigne ces termes de la réalité expérimentale, et, de l'autre, assure leur influence sur l'esprit humain.
[FN: § 1646-1]
IRENAEUS ; Contra Haereses, I, 1, p. 5, éd. Massuet. ![]()
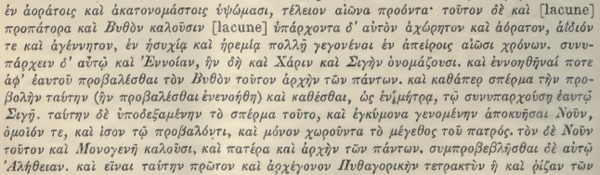
![]() – GRABE note :
– GRABE note : ![]() Synesius, Episcopus Ptolernaïdis, sicut in Hymnis Poetica licentia abusus, omnem fere Valentinianorum mataeologiam verae Theologiae adaptavit, ac haeretica voce orthodoxam cecinit fidem ; ita haec duo quoque nomina vero Deo Patri attribuit. Sie Hymno, II, 27 :
Synesius, Episcopus Ptolernaïdis, sicut in Hymnis Poetica licentia abusus, omnem fere Valentinianorum mataeologiam verae Theologiae adaptavit, ac haeretica voce orthodoxam cecinit fidem ; ita haec duo quoque nomina vero Deo Patri attribuit. Sie Hymno, II, 27 : ![]() , Profundum paternum. Hymno, III, 47 :
, Profundum paternum. Hymno, III, 47 : ![]() , Primus pater, sine patre. Hymno IV, 69 :
, Primus pater, sine patre. Hymno IV, 69 : ![]() , Immensa pulchritudo. Il est bon de comparer cette description avec celle du papyrus de Bruce. AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce… : « (p. 89) C'est le premier père de toutes choses, c'est le premier éternel (?), c'est le roi de ceux que l'on ne peut toucher,... (p. 90) c'est l'abîme de toutes choses... ils ne l'ont point nommé parce qu'il est innommable et qu'on ne peut le penser... Le second lieu est celui qu'on appelle Démiurge, Père, Logos, Source, Nous, Homme, Éternel, Infini. C'est la colonne ; c'est le surveillant, c'est le père de toutes choses... (p. 91) C'est l'Ennéade qui est sortie du Père, sans commencement, qui seul a été son propre (p. 92) père et sa mère, celui dont le Plérôme entoure les douze abîmes. Le premier abîme, c'est la Source universelle, dont toutes les sources sont sorties. Le second abîme, c'est la Sagesse universelle, dont toutes les sagesses sont sorties... ». Et ainsi de suite, on nomme les autres abîmes : le Mystère universel, la Gnose universelle, la Pureté universelle, le Silence, l'Universelle Essence avant (toute essence), le Propator, le Pantopator ou l'Autopator, la Toute-Puissance, l'Invisible, la Vérité. – Voilà une nouvelle vérité, qu'il faut ajouter à toutes celles que nous avons déjà trouvées.
, Immensa pulchritudo. Il est bon de comparer cette description avec celle du papyrus de Bruce. AMÉLINEAU ; Notice sur le papyrus gnostique de Bruce… : « (p. 89) C'est le premier père de toutes choses, c'est le premier éternel (?), c'est le roi de ceux que l'on ne peut toucher,... (p. 90) c'est l'abîme de toutes choses... ils ne l'ont point nommé parce qu'il est innommable et qu'on ne peut le penser... Le second lieu est celui qu'on appelle Démiurge, Père, Logos, Source, Nous, Homme, Éternel, Infini. C'est la colonne ; c'est le surveillant, c'est le père de toutes choses... (p. 91) C'est l'Ennéade qui est sortie du Père, sans commencement, qui seul a été son propre (p. 92) père et sa mère, celui dont le Plérôme entoure les douze abîmes. Le premier abîme, c'est la Source universelle, dont toutes les sources sont sorties. Le second abîme, c'est la Sagesse universelle, dont toutes les sagesses sont sorties... ». Et ainsi de suite, on nomme les autres abîmes : le Mystère universel, la Gnose universelle, la Pureté universelle, le Silence, l'Universelle Essence avant (toute essence), le Propator, le Pantopator ou l'Autopator, la Toute-Puissance, l'Invisible, la Vérité. – Voilà une nouvelle vérité, qu'il faut ajouter à toutes celles que nous avons déjà trouvées.
[FN: § 1646-2]
Dans les manuscrits de Bruce, AMÉLINEAU croit pouvoir reconnaître trois plérômes différents. Les traités gnostiques d'Oxford : « (p. 24) Ce mot Plérôme a, je crois, trois sens fort différents : il en a tout au moins deux qui sont certains. Je crois tout d'abord qu'il désigne l'ensemble des mondes y compris notre terre, mais que seulement il s'applique sur notre terre aux psychiques qui peuvent être admis à jouir d'une partie des prérogatives du vrai gnostique et aux pneumatiques qui jouissent de toutes ces prérogatives par essence : les hyliques n'en font pas partie, parce qu'ils appartiennent à la mauvaise création, sont essence de gauche, selon le terme employé, et doivent être détruits, anéantis. Je ne veux pas affirmer cette compréhension du mot Plérôme ; elle n'est pas péremptoirement établie, mais elle semble bien ressortir des textes, surtout de ces deux traités. Quoi qu'il en soit, il est certain (p. 25) que le mot Plérôme désigne le monde du milieu et le monde supérieur dans leur ensemble, c'est-à-dire tous les aeons intermédiaires entre notre terre et le Plérôme supérieur, avec les aeons de ce Plérôme lui-même. Enfin le mot Plérôme est souvent employé pour désigner seulement le monde supé rieur. Or ce monde supérieur est appelé ici l'aeon du Trésor, et ce trésor, comme tous les trésors, contient plusieurs pièces précieuses : dans l'espèce il contient soixante aeons ».
[FN: § 1646-3]
Philosophumena ; VI, 2, 30. C'était le dernier des 28 Aeons, « étant du genre féminin et dénommé Sophia ». – ![]() . Ici l'attribution du sexe ne laisse aucun doute.
. Ici l'attribution du sexe ne laisse aucun doute.
[FN: § 1646-4]
Philosophumena : VI, 2, 30. D'autres récits diffèrent de celui-ci et sont beaucoup plus allégoriques. Irénée, et Tertullien, qui le suit, nous disent que la Sophia voulait comprendre l'immensité de son Père ; et comme elle ne pouvait atteindre son but, elle se consumait et aurait disparu si la Limite ![]() ne l'avait arrêtée. Quelques valentiniens disent que dans cette recherche pénible elle enfanta la Réflexion (ou la Passion :
ne l'avait arrêtée. Quelques valentiniens disent que dans cette recherche pénible elle enfanta la Réflexion (ou la Passion : ![]() ). D'autres lui font mettre au monde la matière informe, qui est un être féminin (IRAEN. ; I, 2, 3).
). D'autres lui font mettre au monde la matière informe, qui est un être féminin (IRAEN. ; I, 2, 3).
Il y avait encore – paraît-il – des Gnostiques au XIXe siècle. JULES BOIS ; Les petites religions de Paris. L'auteur fait parler ainsi un Gnostique, Jules Doinel : « (p. 176) Savez-vous pourquoi nous souffrons et sommes mauvais si souvent ? m'a dit l’Apôtre ; le Démiurge – non pas Dieu lui-même – créa le monde : ce Démiurge, mauvais ouvrier au service de la Sophia, l'âme de l'univers déchue par son noble désir de trop connaître, nous fabriqua à sa propre image trop peu belle ; mais Sophia eut pitié. Par sa volonté, une larme d'elle-même et du ciel habita notre argile. Démiurge s'en vengea en liant l’homme à la chair, dont il ne se délivrera que par la connaissance de sa destinée, par la Gnose ».
[FN: § 1646-5]
Philosophum. ; VI, 2, 30.
[FN: § 1647-1]
Tertullien compare les mystères des valentiniens aux mystères d'Éleusis. TERTULL. ; Adv. Valent., 1 : ... Eleusinia Valentiniani fecerunt lenocinia.
[FN: § 1647-2]
Dans le papyrus de Bruce, il y a de comiques détails de personnification. AMÉLINEAU ; loc. cit. 1846-1. On dit de la personnification qui y est mentionnée : « (p. 91) La lumière de ses yeux pénètre jusqu'aux lieux du Plérôme extérieur et le Verbe sort de sa bouche... Les cheveux de sa tête sont en nombre égal aux mondes cachés ; les traits (?) de son visage sont le type des aeons, les poils de sa barbe sont en nombre égal à celui des mondes extérieurs... ». Tous les noms deviennent des choses. « (p. 97) Il y a aussi un autre lieu que l'on nomme abîme, où il y a trois Paternités... dans la seconde Paternité il y a cinq arbres, au milieu desquels est une table. Un verbe Monogénès se tient sur cette table, ayant les douze visages du Nous de toutes choses ; et les prières de tous les êtres, on les place devant lui... (p. 99) Et ce Christ porte douze visages... Chaque Paternité a trois visages... » – Cfr. BUONAIUTI ; Lo Gnosticismo, p. 211.
[FN: § 1648-1]
L'une des théogonies orphiques a quelques points de ressemblance avec celles des gnostiques ; mais cela ne suffit pas pour savoir si et jusqu'à quel point elle fut imitée. Dict. DAREMB. SAGLIO ; s. r. Orphici, p. 249 : « La rédaction définitive de cet ouvrage [la Théogonie des Rhapsodes] paraît être d'époque assez basse. Mais les éléments essentiels du système peuvent être fort anciens et remonter en partie jusqu'au VIe siècle. Voici l'analyse sommaire de la Théogonie des Rhapsodes... À l'origine était Chronos ou le Temps. Il produisit l'Ether et le Chaos, dont l'union eut pour résultat l'apparition de l'œuf cosmique, un œuf énorme en argent. De l'œuf sortit un dieu, qui avait de nombreuses têtes d'animaux : à la fois mâle et femelle, il contenait le germe de tout. Ce dieu était Phanès ; mais on lui donne aussi d'autres noms : Protogonos, Ericapaeos, Mêtis, Éros. Quand le dieu fut né, la partie supérieure de l'œuf cosmique devint le ciel ; la partie inférieure devint la terre... ».
[FN: § 1648-2]
Aristobule, philosophe hébreux, cité par EUSEB., Praep. evang., XIII, 12, dit que Platon a évidemment suivi les livres de la loi hébraïque. – JUSTIN, Apol., I, 59, 60, cite les enseignements que Platon tira de la Bible. IUST., Cohort., 14, croit que, par l'intermédiaire des Égyptiens, Orphée, Homère, Solon, Pythagore et Platon tirèrent parti des histoires de Moïse. Cet Aristobule était un grand faussaire. Il cite les auteurs à sa façon, et pousse l'impudence jusqu'à altérer un vers d'Homère. Ce poète, dans l'Odyssée, V, raconte comment les préparatifs d'Ulysse pour quitter l'île de Calypso furent terminés le quatrième jour :
(262)
« C'était le quatrième jour, et par lui tout avait été terminé ». Aristobule, qui veut démontrer que même les païens sanctifiaient le septième jour, remplace avec désinvolture ![]() par
par ![]() , et il fait dire ainsi à Homère que le septième jour tout était terminé. Cette bonne âme d'Eusèbe, qui cite l'ouvrage d'Aristobule, fait semblant de ne pas s'apercevoir de la falsification. Aristobule fait mieux encore. Il invente entièrement des vers qui lui sont utiles, et Eusèbe les rapporte sans sourciller. N'oublions pas que ces gens parlaient sans cesse de « morale ».
, et il fait dire ainsi à Homère que le septième jour tout était terminé. Cette bonne âme d'Eusèbe, qui cite l'ouvrage d'Aristobule, fait semblant de ne pas s'apercevoir de la falsification. Aristobule fait mieux encore. Il invente entièrement des vers qui lui sont utiles, et Eusèbe les rapporte sans sourciller. N'oublions pas que ces gens parlaient sans cesse de « morale ».
[FN: § 1649-1]
D. EPIPHANII adversus haereses, 1. I. Ex Valentiniano libro, V, p. 168-169. L'auteur rapporte un fragment de Valentin, qui, parlant d'un mâle et d'une femelle aeons, dit : « ... et eux s'unirent par une copulation non corrompue et un mélange impérissable » :![]() . Peu avant, parlant d'une autre union, il dit :
. Peu avant, parlant d'une autre union, il dit : ![]() : « et celle-ci s'unit avec lui ». Le verbe
: « et celle-ci s'unit avec lui ». Le verbe ![]() est celui qu'on emploie pour exprimer que l'homme a commerce avec la femme. Dans un opuscule intitulé : Adversus omnes haereses, qu'à tort on supposa être de Tertullien, on lit, c. 1 : Hic [Nicolaus] dicit tenebras in concupiscentia luminis et quidem foeda et obscoena fuisse ; ex hac permixtione pudor est dicere quae foetida et immunda. Sunt et cetera obscoena. Aeones enim refert quosdam turpitudinis natos, et complexus et permixtiones exsecrabiles obscoenasque coniunctas, et quaedam ex ipsis adhuc turpiora.
est celui qu'on emploie pour exprimer que l'homme a commerce avec la femme. Dans un opuscule intitulé : Adversus omnes haereses, qu'à tort on supposa être de Tertullien, on lit, c. 1 : Hic [Nicolaus] dicit tenebras in concupiscentia luminis et quidem foeda et obscoena fuisse ; ex hac permixtione pudor est dicere quae foetida et immunda. Sunt et cetera obscoena. Aeones enim refert quosdam turpitudinis natos, et complexus et permixtiones exsecrabiles obscoenasque coniunctas, et quaedam ex ipsis adhuc turpiora.
[FN: § 1649-2]
Dict. DAREMB-SAGLIO ; s. r. Orphici, p. 250 : « Non contents de transformer les mythes en symboles, les Orphiques inventèrent et adoptèrent des dieux tout abstraits, sans légende, sans figure, sans personnalité, simples expressions métaphysiques de leurs conceptions cosmogoniques. De ce nombre étaient quelques-uns de leurs dieux les plus vénérés : l'Eros cosmique, Protogonos, ... Mêtis, Misé, Mnémosyne, Phanès. Il suffit de considérer l'étymologie de tous ces noms, pour s'apercevoir que ce sont de purs symboles, sans consistance ni réalité concrète. On a simplement divinisé des termes de métaphysique ».
[FN: § 1650-1]
Philosophumena, V, 4, 26. « Il y a trois principes de tout, non engendrés, deux mâles et un qui est femelle. Des mâles, l'un est appelé Bon ; lui seul est ainsi nommé et prescient de tout. L'autre, père de toutes les choses engendrées, lequel ne prévoit pas [est imprévoyant] ne sait pas, ne voit pas. La femelle est imprévoyante, irascible, trompeuse [double], de corps biforme, en tout semblable au monstre d'Hérodote †, fille jusqu'au pubis, serpent au-dessous, comme le dit Justin. Cette jeune fille est appelée Edem et Israël. Tels sont, dit-il, les principes de tout, racine et source, dont naquirent toutes les choses ; il n'y a rien d'autre. Le Père imprévoyant voyant la semi-jeune fille, se prit à la désirer ardemment ; Eloïm – dit-il – est appelé le Père, et Edem aussi s'éprit d'un désir de lui, non moins grand. Le désir les unit en un seul commerce amoureux. De cette union avec Edem, le Père engendra pour lui douze anges. Les noms des anges paternels sont... Les noms des anges maternels dont Edem se fit également des sujets, sont... ». Sachez aussi que les arbres du Paradis de la Bible sont des allégories de ces anges. L'arbre de vie est Baruch, troisième des anges paternels ; l'arbre de la science du bien et du mal est Naas, troisième des anges maternels. Eloïm et Edem produisirent toute chose : les hommes sont nés de la partie humaine de Edem, au-dessus de l'aine ; les animaux et le reste, de la partie bestiale, au-dessous de l'aine.
† HEROD.; IV, 8 et s.v.
[FN: § 1650-2]
HESIOD. ; Theog., 116 et sv. : « Donc d'abord fut le Chaos, ensuite la Terre à la large poitrine, toujours siège sûr de tout ††, et le Tartare ténébreux, dans les profondeurs de la Terre spacieuse, et l'Amour qui est très beau parmi les dieux immortels, qui dissipe les soucis [ou délie les membres], et qui dompte dans la poitrine l'esprit de tous les dieux et des hommes... Du Chaos et de l'Érèbe naquit la Nuit noire ; puis, de la Nuit l'Éther et le Jour sont nés, enfantés par la Nuit enceinte après s'être unie avec l'Érèbe. Certes, la Terre enfanta d'abord, afin qu'il l'enveloppât, Ouranos [le Ciel] étoilé, égal à elle... S'étant unie avec Ouranos, elle enfanta l'Océan aux gouffres profonds, et Kœos, Kreios, Hypérion, Iapétos, Théia, Rhéa, Thémis et Mnèmosynè, Phœbè à la couronne d'or, et l'aimable Thétis... ».
Ces vers ont taillé beaucoup d'ouvrage aux interprètes d'Hésiode et aux philosophes. Diogène Laërce nous dit (X, 2) qu'Épicure s'appliqua à la philosophie parce que ni les sophistes ni les grammairiens n'avaient su lui expliquer ce qu'était le chaos d'Hésiode. Sextus Empiricus (adv. math.), X, 18, p. 636) rapporte le même fait, en ajoutant quelques détails. Selon lui, Hésiode nomme chaos le lieu qui contient toute chose. L'ancien scoliaste d'Hésiode rapporte plusieurs opinions à propos de ce chaos : entre autres une interprétation étymologique qui le fait dériver de ![]() (s'amasser, s'accumuler, se répandre) :
(s'amasser, s'accumuler, se répandre) : ![]() . Une interprétation, donnée comme étant de Zénodote, suppose que le chaos est l'atmosphère
. Une interprétation, donnée comme étant de Zénodote, suppose que le chaos est l'atmosphère ![]() . Venons à des commentateurs plus récents. Guietus note : «
. Venons à des commentateurs plus récents. Guietus note : « ![]() ] Hoc est coelum, aer, aeris vastitas, immensitas quaqua versum, spatium universum. Deux autres auteurs, qui ont la manie de lire Hésiode la Bible à la main, ont un débat à propos de ce chaos. A-t-il été créé, ou est-il incréé ? Clericus penche pour la seconde opinion, car, si l'on adoptait la première, on pourrait demander au poète : par qui le chaos a-t-il été créé ? « Clementinarum Homiliarum Scriptor interpretatur quidem
] Hoc est coelum, aer, aeris vastitas, immensitas quaqua versum, spatium universum. Deux autres auteurs, qui ont la manie de lire Hésiode la Bible à la main, ont un débat à propos de ce chaos. A-t-il été créé, ou est-il incréé ? Clericus penche pour la seconde opinion, car, si l'on adoptait la première, on pourrait demander au poète : par qui le chaos a-t-il été créé ? « Clementinarum Homiliarum Scriptor interpretatur quidem ![]() , quasi dixisset Hesiodus
, quasi dixisset Hesiodus ![]() , genitum est Chaos, sed est inanis argutia. Allato hoc Hesiodi loco, ita loquitur Homil. Vl, § 3 ... „ factum fuit clarum est significare elementa, ut genita, ortum habuisse, non semper fuisse ut ingenita “. Sed si hoc cogitasset Poeta, causam aliquam commentus esset, a qua genitum Chaos dixisset. Dicenti enim factum est, illico obiicitur, a quo ? Nihil enim fit, sine factore ». Mais Th. Robinson est d'un avis contraire. Il note : «
, genitum est Chaos, sed est inanis argutia. Allato hoc Hesiodi loco, ita loquitur Homil. Vl, § 3 ... „ factum fuit clarum est significare elementa, ut genita, ortum habuisse, non semper fuisse ut ingenita “. Sed si hoc cogitasset Poeta, causam aliquam commentus esset, a qua genitum Chaos dixisset. Dicenti enim factum est, illico obiicitur, a quo ? Nihil enim fit, sine factore ». Mais Th. Robinson est d'un avis contraire. Il note : « ![]()
![]() ] Verte, Primum quidem Chaos genitum est, ut infra 137, 930. Ita enim Veteres hunc locum intellexerunt, non ut Clericus, fuit ». Là-dessus il cite des auteurs et conclut : « En de telles ténèbres s'agitent ceux qui, la cause de toute chose étant exclue, entreprennent, par d'autres hypothèses, d'expliquer l'origine du monde. La même question doit nécessairement se reproduire à perpétuité : „ Par quoi cela a-t-il été produit ? “ jusqu'à ce qu'on arrive à quelque cause suprême et incréée ». Nous rions de ces vaines subtilités, dissipées maintenant par les sciences expérimentales. Si jamais le domaine de ces sciences vient à s'étendre sur la « Sociologie » et l'«Économie politique », on rira de même de bien des élucubrations métaphysiques, éthiques, humanitaires, patriotiques, etc., que l'on trouve actuellement en ces genres de littérature.
] Verte, Primum quidem Chaos genitum est, ut infra 137, 930. Ita enim Veteres hunc locum intellexerunt, non ut Clericus, fuit ». Là-dessus il cite des auteurs et conclut : « En de telles ténèbres s'agitent ceux qui, la cause de toute chose étant exclue, entreprennent, par d'autres hypothèses, d'expliquer l'origine du monde. La même question doit nécessairement se reproduire à perpétuité : „ Par quoi cela a-t-il été produit ? “ jusqu'à ce qu'on arrive à quelque cause suprême et incréée ». Nous rions de ces vaines subtilités, dissipées maintenant par les sciences expérimentales. Si jamais le domaine de ces sciences vient à s'étendre sur la « Sociologie » et l'«Économie politique », on rira de même de bien des élucubrations métaphysiques, éthiques, humanitaires, patriotiques, etc., que l'on trouve actuellement en ces genres de littérature.
†† Un vers interpolé ajoute : « des immortels qui possèdent les cimes neigeuses de l'Olympe »
[FN: § 1650-3]
CH. FOURIER ; Traité de l'association domestique-agricole, t. I « (p. 521) Les planètes étant androgynes comme les plantes, copulent avec elles-mêmes et avec les autres planètes. Ainsi la terre, par copulation avec elle-même, par fusion de ses deux arômes typiques, le masculin versé du pôle nord, et le féminin versé du pôle sud, engendra le Cerisier, fruit sous-pivotal des fruits rouges, et accompagné de 5 fruits de gamme ; savoir : La terre copulant avec Mercure, son principal et 5e satellite, engendra la fraise, – avec Pallas, son 4e satellite, la groseille noire ou cassis – avec Cérès, son 3e satellite, la groseille épineuse... » Voici les qualités de ces créations. « (p. 525) La cerise, fruit sous-pivotal de cette modulation est créée par la terre copulant avec elle-même – de pôle nord, en arôme masculin – avec pôle sud, en arôme féminin. La cerise, image des goûts de l'enfance, est le premier fruit de la belle saison. Elle est dans l'ordre des récoltes ce que l'enfance est dans l'ordre des âges... (p. 526) La fraise, donnée par Mercure, est le plus précieux des fruits rouges, elle nous peint l'enfant élevé dans l'Harmonie, dans les groupes industriels... La groseille épineuse à fruits isolés, est un produit de Cérès. Elle dépeint l'enfant contraint, privé de plaisir, harcelé de morale, et élevé isolément aux études... (p. 527) La groseille noire, dite cassis, est donnée par Pallas ou Esculape, qui module toujours en arômes amers. La plante représente les enfants pauvres et grossiers ; aussi son fruit noir, emblématique de la pauvreté, est-il d'une saveur amère et désagréable... ».
[FN: § 1651-1]
Ouvrages inédits d'ABÉLARD... publ. par V. Cousin.PETRI ABAELARDI de gencribus et speciebus : (p. 513) Diversi diversa sentiunt... Alii vero quasdam essentias universales fingunt, quas in singulis individuis totas essentialiter esse credunt... (p. 524) Unumquodque individuum ex materia et forma compositum est, ut Socrates ex homine materia et Socratitate forma ; sic Plato, ex simili materia, scilicet homine, et forma diversa, scilicet Platonitate, componitur ; sic et singuli homines. Et sicut Socratitas, quae forrnaliter constituit Socratem, nusquam est extra Socratem, sic illa hominis essentia, quae Socratitatem sustinet in Socrate, nusquam est nisi in Socrate. Ita de singulis. Speciem igitur dico esse non illam essentiam hominis solum quae est in Socrate, vel quae est in aliquo alio individuorum, sed totam illam collectionem ex singulis aliis (p. 525) huius naturae conjunctam. Quae tota collectio, quamvis essentialiter multa sit, ab auctoritatibus tamen una species, unum universale, una natura appellatur, sicut populus, quamvis ex multis personis collectus sit, unus dicitur. –Abélard explique une opinion réaliste : « (p. 513) D'autres supposent des essences universelles qu'ils croient exister toutes essentiellement chez les divers individus ». C'est la doctrine des universaux, dont sont formés les individus. « (p. 524) Chaque individu est composé de matière et de forme, comme Socrate, de la matière homme et de la forme socratite ; ainsi Platon est composé d'une semblable matière, c'est-à-dire de [matière] homme, et d'une forme différente, c'est-à-dire platonicienne ; de même chaque homme en particulier. Et de même que la socratité qui constitue formellement Socrate, ne se trouve en aucun lieu en dehors de Socrate, ainsi cette essence d'homme que régit la socratité chez Socrate, ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Socrate. Il en est ainsi de chacun. Je dis donc que l'espèce n'est pas seulement cette essence d'homme qui est en Socrate, ou qui se trouve en n'importe quel autre individu, mais toute cette masse de chaque individu de même nature, mise ensemble. Bien que cette masse soit essentiellement multiple, toutefois, elle est d'autorité appelée une espèce, un des universaux, une nature ; de même que le peuple est dit un, bien qu'il soit formé d'un grand nombre de personnes. »
[FN: § 1652-1]
HAURÉAU ; De la phil. scol., t. I : « (p. 234) ...nous plaçons Guillaume de Champeaux au nombre des docteurs scolastiques qui ont manifesté le goût le plus vif pour les abstractions réalisées. Alors même que l'on pose au-delà des êtres vrais un ou plusieurs êtres problématiques, (p. 235) ou fictifs, on peut n'être encore qu'un réaliste modéré ; mais ce qui est l'excès le plus grave, la thèse la plus absolue, la plus intempérante du réalisme, c'est de refuser les conditions de l'être à tout ce qui est, pour les attribuer uniquement à ce qui n'est pas. Et Guillaume de Champeaux n'a fait, à notre avis, rien moins que cela... (p. 243) Au dire des nominalistes, les universaux in re ne sont que les attributs plus ou moins généraux des choses individuelles : ce qu'il y a de semblable entre les substances est la manière d'être de ces substances... Au dire de Guillaume, l'universel in re, considéré comme ce qu'il y a de plus général, est la substance ou l'essence première, unique, qui ne contient pas en elle-même le principe de distinction, mais qui reçoit, comme accidents extrinsèques, les formes individuelles ». Que peut bien être l'essence première ? Serait-ce un quid simile de l'Abîme des gnostiques ? – ROUSSELOT ; Étud. sur la phil. dans le m. âge, t. 1 « (p. 253) Rappelons, en deux mots, la thèse du nominalisme. Roscelin avait dit : Les individus seuls sont des réalités, et constituent l'essence des choses, le reste n'est qu'une abstraction, un jeu de langage, un son de voix, flatus vocis. Choqué, à bon droit, de cette proposition, Guillaume de Champeaux... combat cette doctrine, et lui en substitue une autre entièrement opposée et tout aussi exclusive. …(p. 255) L'universel par excellence, l'universel absolu [qu'est-ce que cela peut bien être ?], qu'on me permette cette expression, est une réalité substantielle [qu'on trouve dans le monde comme le monstre moitié jeune fille, moitié serpent, de Justin], car, avec Guillaume de Champeaux, il ne faut pas séparer l'idée de substance de celle de réalité [avant de savoir si elles sont unies ou séparées, il serait nécessaire de savoir ce qu'elles sont], et c'est du haut de ce principe ontologique qu'il proclame la réalité des universaux, et qu'il nie celle de l'individu ». Il y a aujourd'hui encore des gens qui raisonnent de cette manière.
[FN: § 1652-2]
DIOG. LAERC. ; VI, 53 : « Platon discutant des idées et nommant la ![]() [essence de la table, qualité d'être une table, table en soi] et la
[essence de la table, qualité d'être une table, table en soi] et la ![]() [essence de la tasse, qualité d'être une tasse, tasse en soi] „ Moi, ô Platon – dit [Diogène] – je vois la table et la tasse ; mais nullement la
[essence de la tasse, qualité d'être une tasse, tasse en soi] „ Moi, ô Platon – dit [Diogène] – je vois la table et la tasse ; mais nullement la ![]() et la
et la ![]() “.
1893.Sur ce, Platon : „ Avec raison, dit-il, car tu as les yeux avec lesquels on voit la table et la tasse, mais tu n'as pas ceux avec lesquels on voit la
“.
1893.Sur ce, Platon : „ Avec raison, dit-il, car tu as les yeux avec lesquels on voit la table et la tasse, mais tu n'as pas ceux avec lesquels on voit la ![]() et la
et la ![]() Tous deux avaient raison. Que les disciples de Platon voient ce qu'ils veulent : leurs discours seront utiles comme dérivations ; ils sont vains et absurdes pour tout ce qui concerne la science expérimentale.
Tous deux avaient raison. Que les disciples de Platon voient ce qu'ils veulent : leurs discours seront utiles comme dérivations ; ils sont vains et absurdes pour tout ce qui concerne la science expérimentale.
[FN: § 1653-1]
P. DHORME ; Choix de textes rel. Assyro-Babyloniens : « (p. X) Comment et par qui le monde a-t-il été fait ? Les diverses cosmogonies répondent à cette question. L'on reconnaît dans chacune d'elles l'influence du milieu où elle a pris naissance. L'intervention de la divinité est revêtue de traits plus ou moins mystiques qui servent à fixer la conception théologique dans les imaginations populaires [en vérité, c'est le contraire]. Le Poème de la création qui ouvre la série de nos textes est, à ce point de vue, d'intérêt majeur. Non content de rechercher la genèse du ciel et de la terre, il remonte au moment où „ aucun des dieux n'était créé “ et nous fait assister à une véritable théogonie. Par couples successifs [la personnification mâle et femelle fait rarement défaut] les dieux sortiront d'un couple primitif constitué par Apsou, l'océan qui entoure notre sol, et Tiâmat, la mer „ tumultueuse “, dont „ les eaux se confondaient en un “. (p. XI) ... si le „ Poème de la création “ est tout imprégné d'idées mythologiques et populaires, la „ Cosmogonie chaldéenne “ présente un récit de la création plus abstrait et théologique. Le monde sort encore de la mer, mais nous n’assistons pas à la naissance des dieux... (p. XII) Si, pour les Babyloniens, le dieu national Mardouk, est considéré comme l'auteur du monde et des hommes, il est tout naturel que les Assyriens aient confié ce rôle à Assour, leur dieu... Qu'il existât d'autres légendes relatives à la création, c'est ce que prouve le fragment sur la „ Création des êtres animés “, où nous voyons les dieux collaborer ensemble à la formation du ciel et de la terre. À côté de ces cosmogonies savantes et traditionnelles circulaient d'autres hypothèses sur les origines du monde. Il en est qui rentrent dans le folklore général... ».
[FN: § 1656-1]
FOURIER ; Théor. des quatre mouv. : « (p. 57) C'est pour Dieu une jouissance que de créer, et il va de son intérêt de la prolonger ». C'est là simplement un récit dépourvu de métaphores ; mais ensuite, il suscite une analogie à l'esprit : « Si les temps de conception, gestation et enfantement d'un homme, emploient une durée de neuf mois, Dieu dut employer un espace de temps proportionnel pour créer les trois règnes ». Suit un récit arbitraire : « La théorie évalue ce temps à la cent quatre-vingt-douzième partie de la carrière sociale, ce qui donne approximativement quatre cent cinquante ans pour la durée de la première création ». Puis vient un passage où s'entremêlent métaphores, analogies, récits, sans que l'auteur paraisse le moins du monde distinguer ces choses différentes. (p. 57) Toute création s'opère par la conjonction d'un fluide boréal, qui est mâle, avec un fluide austral, qui est femelle. [En note : ,, L'astre peut copuler : 1° avec lui-même de pôles nord et sud, comme les végétaux ; 2° avec un autre astre par versements tirés de pôles contrastés ; 3° avec intermédiaire : La Tubéreuse est engendrée de trois arômes : Terre-Sud, Herschel-Nord et Soleil-Sud “]. Une planète est un être qui a deux âmes et deux sexes, et qui procrée comme l'animal ou végétal par la réunion de deux substances génératrices. Le procédé est le même dans toute la nature... »
[FN: § 1659-1]
Relig. Saint-Simonienne, Réunion générale de la famille : (p. 69) Lorsque Eugène et moi, nous jetâmes les premières bases du dogme trinaire, sous sa forme théologique, nous n'avions pas compris encore combien ce dogme avait été profondément SENTI par SAINT-SIMON dans le NOUVEAU CHRISTIANISME. Votre père RODRIGUES était le seul qui nous répétât sans cesse que ce livre renfermait l'enseignement le plus élevé qu'il fût donné à l'homme de recevoir. Et nous, conduits par nos travaux à faire des recherches sur la constitution scientifique du dogme trinaire chrétien, sur celle des dogmes anciens, nous justifiâmes bientôt à nos propres yeux ce problème de la trinité, comme étant le plus élevé que l'homme puisse se poser. L'un de nous laissa échapper cette phrase, qui fut depuis répétée dans les Lettres d'Eugène : Qui ne comprend pas la Trinité ne comprend pas Dieu. Ce mot fut une vraie révélation pour la doctrine. Tous ceux qui l'entendirent, et en particulier votre père RESSÉGUIER, eurent peine à en comprendre la portée. C'est alors seulement qu'en relisant le NOUVEAU CHRISTIANISME, nous reconnûmes que l'idée de la Trinité y était reproduite à toutes les pages, sous une foule de formes différentes, telles que celles-ci : MORALE, Dogme, Culte ; BEAUX-ARTS, Science, Industrie. Nous nous étonnions d'avoir passé si longtemps devant ce problème éternel de l'humanité, sans nous être aperçus qu'il devait être résolu par nous : en même temps toutes les phrases, toutes les indications qui ne nous avaient pas (p. 70) frappés à l'époque du Producteur, nous affermissaient, Eugène et moi, dans la croyance que notre formule du dogme panthéiste trinaire était la vraie formule Saint Simonienne ». Les termes soulignés le sont ainsi dans le texte.
[FN: § 1660-1]
EINHARDI historia translationis beatorum Christi martyrum Marcellini et Petri, c. IV. Eginhard raconte comment, parti de la basilique où reposaient les cendres des saints Marcellin et Pierre, il se mit en route pour se rendre à la Cour. Parvenu en un certain lieu, près du Rhin, il lui arriva l'aventure suivante : « (44) Après le souper, qui avait pris une partie de la nuit, je m'étais retiré avec mes gens dans la chambre où je devais me reposer, lorsque le serviteur qui nous versait habituellement à boire, entra tout à coup, comme s'il avait à raconter quelque nouvelle. L'ayant regardé : „ Qu'as-tu à raconter, dis-je ? car tu me sembles avoir je ne sais quoi à nous annoncer “. – Alors : „ Deux miracles – dit-il – ont été faits devant nous ; c'est pour vous les rapporter que je suis venu “. Et comme je lui demandai de dire ce qu'il voulait : „ Lorsque ayant quitté le repas, dit-il, tu entras dans la chambre, moi, je descendis avec mes compagnons au garde-manger qui est sous la salle à manger. Là, tandis que nous nous mettions à donner de la bière aux serviteurs qui nous en demandaient, survint un serviteur envoyé par l'un de nos compagnons, et apportant une cruche qu'il priait de remplir. Quand ce fut fait, il demanda qu'on lui donnât, à lui aussi, un peu de cette bière, pour la boire. On lui en donna dans un vase qui se trouvait, par hasard, vide, sur le tonneau où était la bière. Mais comme il l'approchait de ses lèvres pour boire, il s'écria, avec une grande surprise, que c'était du vin et non de la bière. Et comme celui qui avait rempli la cruche et qui avait tiré du même robinet ce qui avait été donné au domestique, se mit à l'accuser de mensonge : „ Prends, dit-il, et goûte ; tu verras alors que je n'ai pas dit ce qui est faux, mais bien ce qui est vrai. “ L'autre prit alors, goûta et témoigna de même que ce liquide avait le goût de vin, non de bière. Alors un troisième et un quatrième et les autres qui étaient là chacun goûtant et s'étonnant, ils burent tout ce qui était dans le tonneau. Chacun de ceux qui goûtèrent attesta que le goût était celui du vin et non de la bière “ ». Suit le récit d'un autre miracle : celui d'un cierge qui, tombé d'abord sans que personne ne le touchât, et éteint, se ralluma de lui-même ensuite spontanément, une fois qu'on eut invoqué les saints Marcellin et Pierre. Puis, l'auteur dit : « (45) J'ordonnai à celui qui m'avait raconté ces choses de se retirer dans sa chambre. Quant à moi, m'étant mis au lit pour me reposer, je commençai, en roulant une foule de pensées dans ma tête, à rechercher tout en m'émerveillant, ce que signifiait ou pouvait présager cette transformation de bière en vin, c'est-à-dire d'un liquide inférieur en un autre, meilleur ; ou bien pourquoi ce prodige s'était accompli de cette façon, en ce lieu, c'est-à-dire dans une maison royale, plutôt que là où reposaient les très saints corps des saints martyrs qui avaient opéré ces miracles par la vertu du Christ. Mais bien que je le recherchasse longuement et soigneusement, il ne me fut pas donné de résoudre la question avec certitude ; toutefois je tins, et je tiendrai toujours pour certain, que cette divine et suprême vertu, grâce à laquelle, on l'admet, ces miracles et d'autres semblables se produisent, ne fait jamais rien ou qu'elle ne permet pas qu'il se produise quoi que ce soit sans cause, dans les créatures qui, je n'en doute pas, sont confiées à sa providence et à son gouvernement ».
[FN: § 1662-1]
D. CYPRIAN. ; Ad. Caecilium, De sacramento Domini calicis : ...Christus autem docens et ostendens gentium populum succedere, et in locum quem Iudaei perdiderant, nos postmodum merito fidei pervenire, de aqua vinum fecit, id est, quod ad nuptias Christi et Ecclesiae, Iudaeis cessantibus, plebs magis gentium conflueret, et conveniret, ostendit.
[FN: § 1664-1]
D. CYPRIAN. ; De unitate ecclesiae: Idcirco et in columba venit Spiritus sanctus. Simplex animal et laetum est, non felle amarum, non morsibus saevum, non unguium laceratione violentum : hospitia humana diligere, unius domus consortium nosse, cum generant simul filios edere, eum commeant volatibus invicem cohaerere, etc. – D. AUGUST. ; De symbolo, sermo ad catechumenos, X, 20 : Ita et Spiritus in columba apparuit, sed non columba erat Spiritus. Ainsi, on ménage la chèvre et le chou ; c'était et ce n'était pas une colombe. Ensuite, on peut pousser plus avant, et voir dans la colombe une simple allégorie.
[FN: § 1670-1]
Le texte grec est donné dans la note 1646-1. L'ancien traducteur latin l'interprète ainsi : (Iraen., I, 1) Prolationem hanc praemitti volunt, et eam deposuisse quasi in vulva eius quae cum eo erat Sige. Hanc autem suscepisse semen hoc, et praegnantem [comment donc une abstraction pourrait-elle bien devenir enceinte ? Tous ces termes se rapportent à la femme] factam generasse Nan... – TERTULL. ; Adt. Valent., VII : Hoc vice seminis in Sigae suae veluti genitalibus vulvae locis collocat. Suscipit illa statim et praegnans efficitur et parit... Il paraît que tous les valentiniens n'étaient pas tous du même avis. – Philosoph. ; VI, 2, 29 : On trouve beaucoup de différences entre eux. Afin de conserver intact en toutes ses parties le dogme pythagoricien de Valentin, quelques-uns d'entre eux estiment que le Père est sans sexe, sans conjoint et seul. D'autres, estimant impossible que toutes les choses engendrées tirent leur origine d'un mâle seul, donnent nécessairement Sigè (le Silence, f) comme épouse au Père de toute chose, afin qu'il puisse engendrer ».
[FN: § 1672-1]
PIEPENBR. ; Théol. de l'anc. test. : (p. 129) 4° Le maleach de Dieu. Si le Dieu révélé est identifié avec la gloire, le nom ou la face de Dieu, il l'est également avec le maleach, c'est-à-dire, d'après la traduction ordinaire, avec l'ange de Dieu ou de Jéhova. ...Il est facile de se convaincre qu'il existe une grande analogie entre le maleach de Dieu et sa face... (p. 120) L'analogie qui existe entre le maleach de Dieu et sa face explique parfaitement l'identification du maleach avec Dieu lui-même... Il existe pourtant des passages où Dieu et son maleach sont distingués l'un de l'autre, comme s'ils étaient deux personnes différentes. L'identification et la distinction se trouvent une fois dans le même récit. Un ange de Jéhova, appelé aussi homme de Dieu, apparaît aux parents de Samson (Jug., 13, 3, 6 et sv.) ; il est nettement distingué de Jéhova (V, 8 et sv., 16, 18 et sv.) ; et cependant, après sa disparition, Manoha dit à sa femme : Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu (V, 22). Les théologiens se sont beaucoup occupés de la question de savoir ce qu'est en réalité le maleach de Dieu ; mais ils sont arrivés à des résultats très divergents. » Il ne peut en être autrement, lorsqu'on cherche une chose objective là où il y en a seulement beaucoup de subjectives. – DUGAS-MONTBEL, Obs. sur l'Iliade, III, 105-6, observe qu'Homère dit : « Amenez la force de Priam pour : amenez Priam. C'est ainsi qu'Homère dit, la force herculéenne, ![]() pour Hercule. Cette tournure est fréquente dans Homère. Plusieurs autres poètes l'ont imitée de lui... Les Latins ont des tournures analogues ; c'est-à-dire qu'ils employaient une qualité distinctive de la personne pour exprimer la personne elle-même... C'est de là que nous sont venues sans doute ces manières de parler usitées dans nos langues modernes : sa majesté, son éminence, sa grâce, son altesse, etc. »
pour Hercule. Cette tournure est fréquente dans Homère. Plusieurs autres poètes l'ont imitée de lui... Les Latins ont des tournures analogues ; c'est-à-dire qu'ils employaient une qualité distinctive de la personne pour exprimer la personne elle-même... C'est de là que nous sont venues sans doute ces manières de parler usitées dans nos langues modernes : sa majesté, son éminence, sa grâce, son altesse, etc. »
[FN: § 1673-1]
Essai d'une Philosoph. de la Solid., p. 38 : « Je le répète, nous ne changeons rien à ces principes généraux de la morale et du droit ; mais, suivant un terme que j'ai retenu et qui exprime admirablement ce qui est dans notre pensée, les notions que nous avons tirées de la constatation de l'interdépendance entre les hommes, remplissent – c'est le mot employé par M. Darlu – remplissent d'un contenu tout nouveau l'idée morale ». Donc, on ne change rien aux principes généraux de la morale, et cependant l'idée morale est remplie d'un contenu tout nouveau. S'il est nouveau, il semblerait que l'ancien doit avoir été changé ; et s'il n'est pas changé, comment peut-il être nouveau ? Bien malin qui y comprend quelque chose. L'auteur explique ensuite : « Il y a dans ces faits quelque chose qui précise et qui étend les anciennes notions du droit, du devoir, de la justice ». Donc on dit que rien n'y a été changé, et voilà un changement, qui consiste justement dans la dite extension.
[FN: § 1676-1]
Ce parce que et les suivants doivent s'entendre comme désignant des causes importantes, mais non exclusives. Cette manière elliptique de s'exprimer et d'autres semblables sont indispensables pour éviter des longueurs fastidieuses ; mais elles ne peuvent jamais être très précises. On ne court pas le danger de tomber dans l'erreur, si l'on garde toujours présent à l'esprit le fait de la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux.
[FN: § 1683-1]
Pourtant il en reste encore quelques traces, dues à ce que les personnes qui s'occupent des sciences naturelles, vivant dans le même milieu que les autres hommes, ne peuvent se soustraire entièrement à l'influence des oscillations qui agitent ce milieu. Ainsi, actuellement, on observe, dans les théories de la mécanique, un retour offensif de la métaphysique. La théorie dite du principe de relativité en est entachée. Elle peut être un instrument de recherches, elle n'est certes pas un moyen de démonstration. Voir, par exemple, LÉMERAY ; Le principe de relativité, Paris, 1916. L'auteur expose un cas hypothétique de deux observateurs en mouvement, échangeant des signaux au moyen de pigeons voyageurs, et il ajoute : « (p. 28) Or, ce que nous venons de conclure pour les pigeons, le principe se refuse de l'admettre pour la lumière [il ne reste donc qu'à se soumettre à la volonté de monsieur le principe]. En effet, les deux relations (1) nous font connaître T1, et T2 en fonction de T et de v ; nous pourrions décider lequel des observateurs serait en repos par rapport à l'espace, ce qui n'aurait aucun sens [C’est précisément ce qu'on disait autrefois de plusieurs phénomènes qu'on connaît aujourd'hui], de même que dans le cas des pigeons, les relations (1) nous font savoir quel est l'observateur immobile par rapport à la terre... » Ce raisonnement est du même genre que celui de bien d'autres raisonnements métaphysiques dont nous avons cité quelques exemples (§ 492 à 506) ; on y a seulement ajouté des développements mathématiques ; mais ceux-ci ne peuvent pas, à eux seuls, donner de la réalité aux hypothèses qui en manquent. Parmi les conséquences du principe de relativité, nous trouvons « (p. 31) que différents observateurs d'un système [un des deux systèmes en mouvement] voyant passer un même observateur de l'autre système le verront vieillir moins vite qu'eux ; et un observateur voyant passer successivement les différents observateurs de l'autre, les verra vieillir plus vite ». Le système où l'on est vu vieillir moins vite sera fréquenté surtout par les dames : il y aura encombrement. Il est évident que lorsque l'on se permet de telles excursions en dehors du monde expérimental, on peut démontrer tout ce que l'on veut.
[FN: § 1684-1]
SINNETT ; Le bouddh. ésot. : « (p. 71) Quel instinct prophétique inspirait Shakespeare, lorsqu'il prit le nombre sept comme celui qui convenait le mieux à sa fantastique classification des âges de l'homme ? C'est, en effet, par périodes de sept que se partage l'Évolution des races humaines, et le nombre actuel de mondes, qui constitue notre système, est également de sept. N'oublions pas que la Science occulte est aussi sûre de ce fait, que la science physique est sûre des sept couleurs du spectre solaire et des sept notes ou tons de la gamme. Il y a sept règnes dans la nature, et non pas trois, comme l'enseigne à tort la science moderne... (p. 72) ...il faut sept rondes pour que les destinées de notre monde soient accomplies. La Ronde dont nous faisons partie actuellement est la quatrième... Une monade individuelle, arrivant pour la première fois, sur une planète, pendant le cours d'une Ronde, doit travailler à la rude besogne de la Vie, dans sept races, sur cette même planète, avant de passer sur une planète voisine, et chacune de ces races dure un temps considérable ». Que ces messieurs savent de belles choses ! Mais les néo-hégéliens nous disent qu'il « n'existe pas de pensée qui soit une erreur » (§ 1686-1) ; donc, la « pensée » de ces bouddhistes ne peut être une erreur. Et si quelqu'un affirmait, au contraire, qu'une telle « pensée » est erronée, et voulait la remplacer par la pensée néo-hégélienne, qui donc pourrait trancher la question ?
[FN: § 1685-1]
RENAN ; L'Egl. chr. :« (p. 175) Il y a sûrement quelque chose de grand dans ces mythes étranges [au lieu de cette assertion objective, on devait dire : il y a des gens qui trouvent quelque chose de grand dans ces mythes, et ceux qui les tiennent pour de vaines absurdités doivent pourtant tenir compte de cette opinion]. Quand il s'agit de l'infini, de choses qu'on ne peut savoir que partiellement et à le dérobée, qu'on ne peut exprimer sans les fausser [divagation pour faire semblant de revenir au domaine expérimental, tandis qu'on demeure en dehors], le pathos même a son charme [oui pour certaines personnes ; non pour d'autres] ; on s'y plaît comme à ces poésies un peu malsaines, dont on blâme le goût, mais qu'on ne peut se défendre d'aimer [c'est peut-être vrai pour Renan et pour qui pense comme lui ; c'est faux pour Lucien, par exemple, et pour qui pense comme lui ; c'est l'erreur habituelle de donner pour objectif ce qui est subjectif]. L'histoire du monde, conçue comme l'agitation d'un embryon qui cherche la vie, qui atteint péniblement la conscience, qui trouble tout par ses agitations, ces agitations elles-mêmes devenant la cause du progrès et aboutissant à la pleine réalisation des vagues instincts de l'idéal, voilà des images peu éloignées de celles que nous choisissons par moments pour exprimer nos vues sur le développement de l'infini ». Qui est ce nous ? Certainement pas tous les hommes : il y en a tant qui ne se soucient pas du « développement de l'infini » ; tant d'autres qui ne savent pas ce que peut bien être ce monstre ; tant d'autres qui rient rien qu'à l'entendre nommer.
[FN: § 1686-1]
La Voce, 28 gennaio 1914. V. FAZIO-ALLMAYER écrit une analyse de l'ouvrage La Riforma della dialettica hegeliana, de GIOVANNI GENTILE « (p. 41) Sa philosophie [de Gentile] est une philosophie vivante ; c'est une vision éthique du monde ; c'est pourquoi il n'a pas même éprouvé le besoin d'éclaircir cette signification de l'identité de l'histoire et de la philosophie. La philosophie qui est identique à l'histoire est la philosophie qui est vie, et la vie est la vie éthique, et la vie éthique est la réalisation de la liberté, et la liberté est l'affirmation du réel comme auto-conscience. (p. 42) La thèse fondamentale, en cette nouvelle histoire, est que la pensée est acte, c'est-à-dire concrétisation, et que par ce fait il n'existe pas une pensée qui soit erreur ni une nature qui ne soit pas pensée. La pensée acte, actualité de la pensée, idéalisme actuel, sont désormais des termes que chacun croit comprendre facilement [oh non ! il y a tant de gens auxquels il semble vraiment impossible de rien comprendre à tous ces termes mis ensemble], mais qui malheureusement se trouvent épars et privés de sens dans le monde philosophique d'aujourd'hui. La facilité avec laquelle on croit les avoir critiqués en est un signe ».
[FN: § 1686-2]
Histoire ou fable, on raconte qu'un jour l'académicien Népomucène Lemercier répondit à une dame de la halle qui l'injuriait : « Tais-toi, vieille catachrèse » À l'ouïe de ce mot si terrible, la mégère resta interdite et ne sut que répondre.
[FN: § 1686-3]
Un seul exemple suffira, parmi un très grand nombre qu'on pourrait citer. V. FAZIO-ALLMAYER, dans La Voce, 19 déc. 1912 « (p. 960) Hegel a distingué : la logique, l'histoire de la philosophie, la philosophie de l'histoire. Il a ainsi distingué Dieu, l'esprit humain, le monde des nations. Ainsi, l'immanence et la liberté ne sont pas vraiment conquises, parce qu'elles se conquièrent seulement si le monde des nations et le monde humain dans leur développement, c'est-à-dire dans leur autocréation, sont la création de Dieu même, l'être absolument existant, la liberté ». Jusqu'ici, c'est un discours incompréhensible. La suite se comprend : « Et Hegel voulait démontrer proprement cela. S'il n'y a pas réussi, cela ne veut pas dire que l'entreprise soit à abandonner ; cela signifie simplement qu'il faut y travailler encore. Et nous devons y travailler, nous autres Italiens ». Ici apparaît le caractère habituel des dérivations métaphysiques : on connaît le point auquel la démonstration doit aboutir, et l'on ne cherche que cette démonstration. On ne voit pas bien comment l'auteur fait pour savoir que sa proposition subsiste, si ni Hegel ni d'autres ne l'ont démontrée jusqu'à présent. Serait-ce un article de foi ?
[FN: § 1686-4]
Dans La Voce, 19 décembre 1912, G. NATOLI écrit « (p. 963) Peu d'auteurs ont autant que Croce provoqué, si tôt après la publication de leurs ouvrages, en même temps que l'admiration, un sentiment indéfini de mécontentement et une vague, une presque abstraite volonté de dépassement (superamenio). Et en faveur de Croce, lui-même, ces considérations sur le dépassement (superamento), qu'il nous donna, il y a quelque temps, dans La Voce, ainsi que peut le faire un auteur d'un si grand talent, trouveraient leur application très à propos contre l'attitude de ses dépasseurs (superatori) ». Ces beaux termes : dépasseurs, dépassement, ont tout autant de sens que le « funiculi, funicula » de la chanson napolitaine ; mais la chanson est plus agréable.
[FN: § 1686-5]
G. PLATON, dans L'Indépendance, février 1913 : « (p. 85) Que M. Sabatier s'exalte au spectacle de l'histoire : qu'il s'écrie, tout plein de contentement et tout plein de lui-même (SABATIER ; L'orientation religieuse de la France actuelle) : „ (p. 153 *) Nous avons introduit la notion de la Vie dans l'histoire et cette simple introduction de la Vie dans l’Histoire la socialise dans toutes les directions, fait d'elle une philosophie, une morale, une religion [encore une chose qui n'a pas de sens], la base par excellence de l'éducation individuelle et de l'éducation politique ; “ ou encore : „ (p. 156*) Nous sommes de la Vérité, de la Vie, de la Révélation, ou : „ (p. 159 *) L'Église nous avait parlé de la tradition et de sa valeur dans l'enseignement religieux ; la vie nous en découvre la puissance dans tous les domaines ; et, en nous montrant ce que nous sommes, nous suggère ce que nous devons et ce que nous pouvons devenir “. Que M. Sabatier s'exalte, nous n'y trouvons pas à redire : c'est de l'esthétisme ! Qu'il prétende faire „ de l'histoire une philosophie, une morale, une religion “, c'est une autre affaire, et c'est justement la question qui s'agite entre lui et la papauté. La thèse (p. 86) de cette dernière c'est justement que c'est l'histoire qui a besoin d'une philosophie, d'une morale, d'une religion, pour être une histoire acceptable ; une histoire digne de l'homme et de l'humanité ». La science logico-expérimentale demeure entièrement étrangère à cette controverse, ne serait-ce que parce qu'il manque un juge qui la tranche (§ 17 et sv.). Outre les deux genres d'histoire indiqués tout à l'heure, il en est un troisième, dont la science expérimentale s'occupe uniquement, et qui a pour but exclusif de décrire les faits et d'en rechercher les uniformités. Prenons bien garde que notre but est de séparer, non pas de comparer. Nous ne disons nullement que ce troisième genre soit meilleur que les deux autres ; pour nous, cette proposition n'aurait même aucun sens. Nous disons seulement qu'il nous plaît de nous occuper de ce troisième genre. Si quelqu'un d'autre a aussi ce dessein, il peut faire route avec nous, et s'il n'a pas ce dessein, qu'il cherche une autre compagnie, et allons chacun de notre côté. Le lecteur observera que Vie est écrit avec une lettre parfois majuscule, parfois minuscule. Les choses auxquelles correspondent ces deux termes pourraient donc être différentes. Mais quelle est cette différence, je ne saurais le dire... et peut-être l'auteur qui emploie ces termes ne le sait-il pas non plus. Mais je suppose que la Vie à laquelle on fait l'honneur d'une, majuscule, doit être meilleure que la vie qui est privée de cette majuscule. Peut-être y a-t-il une différence analogue entre Histoire et histoire. Quant à la Vérité, c'est pour nous une vieille connaissance ; nous l'avons souvent rencontrée en ces dernières pages. C'est une entité qui n'a rien de commun avec la vérité expérimentale, mais qui est d'une nature si sublime que sa beauté surpasse toute chose.
* Les nombres indiqués avec cet astérisque sont ceux des pages du livre de Sabatier, cité dans le texte de l'Indépendance.
[FN: § 1686-6]
RABELAIS ; édit. Jacob, Paris, 1854, p. 110 à 113.
[FN: § 1686-7]
Par exemple, on pourrait supposer le dialogue suivant : « Deux et deux font cinq. – Pardon, je croyais que cela faisait quatre. – Désormais, cette théorie est dépassée. C'est une doctrine „ renfermée dans la formule chimique de la préparation solidifiante et congelante “. – Je ne comprends pas. – Cela ne fait rien. Vous avez mécanisé, matérialisé l'addition, et vous vous contentez d'un mesquin formalisme de calcul. – Excusez-moi, j'y comprends encore moins qu'avant. –Je m'explique mieux. L'addition de deux et deux qui font quatre est morte : elle gît dans la stase de la pensée ; nous voulons une addition vivante qui avec la dynamique, s’élève à l'œuvre plus haute de la pensée humaine “ ; et „ pour typiser (tipizzare) un peu l'histoire “… » – Dieu nous soit en aide, si maintenant ce typiser vient à la rescousse !
Notes du Chapitre XI. – Propriétés des résidus et des dérivations (§1687 à §2059), vol. 2, pp. 1010-1305 ↩
[FN: § 1689-1]
Pour justifier l'interdiction signifiée au Monténégro d'occuper Scutari, un communiqué officiel du gouvernement russe s'exprime ainsi : « Du reste, la population de Scutari est en majorité albanaise et cette ville est le siège d'un évêché catholique. Il faut remarquer aussi à ce propos que les Monténégrins ont été incapables d'assimiler plusieurs milliers d'Albanais catholiques ou musulmans qui sont établis sur les frontières du Monténégro ». Remplacez, dans ce raisonnement, Monténégro par Russie, Albanie par Pologne, et il conservera toute sa valeur. La Russie est orthodoxe, la Pologne catholique. La Russie a été, incapable de s'assimiler les Polonais. Mais bien que le raisonnement soit identique, les conclusions changent : le Monténégro n'a pas le « droit » d'occuper Scutari ; la Russie a le « droit » d'occuper la Pologne.
[FN: § 1689-2]
C'est cela seul que nous voulons exprimer, quand nous disons que le « droit naturel », n'existe pas. En d'autres termes, nous voulons dire que cette entité ne peut pas faire partie de raisonnements d'une façon semblable à celle dont en font partie le chlorure de sodium ou d'autres choses analogues. Mais nous n'entendons nullement faire nôtres, comme étant équivalentes à cette assertion, ou comme en étant la conséquence, les propositions suivantes : La notion de droit naturel n'existe pas dans l'esprit de certains hommes. Cette notion ne joue aucun rôle dans la détermination de la forme de la société. Il serait utile aux hommes de s'en débarrasser, parce que c'est une notion de chose vaine et insaisissable. Nous estimons, au contraire, que des propositions opposées à celles-ci concordent avec les faits. C'est-à-dire : la notion de droit naturel existe (se trouve), bien qu'indéterminée, dans l'esprit de certains hommes. Cette notion (ou mieux : le fait que cette notion se trouve dans l'esprit de certains hommes) joue un rôle dans la détermination de la forme de la société. En beaucoup de cas, le fait que cette notion se trouve dans l'esprit de certains hommes a été utile à la société. Nous ajoutons que la croyance en l'existence du droit naturel (ou la croyance qu'il peut jouer dans le raisonnement un rôle identique à celui que jouent des notions semblables à celles du chlorure de sodium) a été souvent utile à la société, bien qu'elle soit en complet désaccord avec les faits.
[FN: § 1689-3]
Les métaphysiciens et les économistes littéraires ont découvert une belle dérivation pour répondre aux objections de cette sorte. Ils disent que les « lois » économiques, morales, sociales, diffèrent des « lois naturelles », en ce que les premières souffrent des exceptions, et que les dernières n'en ont pas. Ne nous arrêtons pas à cette considération qu'une « loi » à exceptions, c'est-à-dire une uniformité non uniforme, n'a pas de sens (§101), et ne prêtons notre attention qu'à la force du raisonnement. Il faut reconnaître que, dans la forme, elle l'emporte. En effet, si l'on accorde à celui qui énonce une loi que celle-ci peut avoir des exceptions, à chaque fait qu'on lui opposera, il pourra toujours répondre que c'est une « exception » ; et il sera impossible de le prendre en faute. C'est bien ainsi que les économistes littéraires, les moralistes, les métaphysiciens, énoncent des « lois », dont ils font ensuite ce qu'ils veulent, les pliant à leur volonté et à leur caprice, grâce à l'indétermination des termes, aux exceptions et à d'autres subterfuges. Malheureusement pour leur thèse, de cette façon ils ont même trop raison : une loi de ce genre ne signifie rien, et il est inutile de la connaître. Quelqu'un peut dire qu'il pleut seulement les jours de date paire, et objecter aux observations contraires que ce sont des exceptions. Quelqu'un d'autre peut affirmer qu’il ne pleut, au contraire, que les jours de date impaire, et répondre de la même manière aux objections. En raisonnant de cette façon, tous deux ont raison, et aucun d'eux ne nous apprend quoi que ce soit. Pour que nous apprenions quelque chose, il faut qu'il y ait quelque obstacle, quelque restriction à la libre adaptation de ces « lois » ; qu'on affirme, par exemple, que les faits contraires sont en beaucoup plus petit nombre que les faits favorables ; que l'énoncé ait quelque précision, en sorte qu'il puisse être interprété par d'autres personnes que par l'auteur ; que les conditions réputées nécessaires à la vérification de la loi soient au moins mentionnées, et ainsi de suite.
[FN: § 1690-1].
De même, l'économie pure emploie le terme ophélimité, la mécanique le terme force, qui, dans leurs rapports avec l'équilibre économique ou avec l'équilibre mécanique, correspondent au terme sentiment (résidu) dans ses rapports avec l'équilibre social. La théorie des choix, donnée dans le Manuel, correspond aux observations faites tout à l'heure, pour éliminer le terme sentiment (§2404).
[FN: § 1690-2]
Entre les expressions D et les actes A, il peut y avoir un rapport direct DA, et c'est même le seul que supposent ceux qui réduisent tout phénomène social à des actions logiques. Mais en réalité, le rapport est habituellement différent ; c'est à-dire qu'il provient d'une origine O commune aux expressions et aux actes. À cette commune origine, qui nous est généralement inconnue, on peut donner le nom de « sentiment », d' « état psychique » ou un autre analogue. Mais attribuer un nom à une chose inconnue ne sert nullement à nous la faire connaître. On pourrait encore supposer que D sont les résidus, A les dérivations, et répéter les observations précédentes. Résidus et dérivations ont une commune origine O, qui nous est inconnue. Pour trouver les résidus, nous avons établi théoriquement un rapport AD ; puis, pour déduire des résidus les dérivations, nous avons établi de la même manière le rapport DA ; mais le rapport effectif est OD, OA. Revenant aux analogies indiquées précédemment (§879) de la langue avec les autres faits sociaux, nous pouvons supposer que D sont les racines et A les mots de la langue. D'une manière semblable à ce qui a été dit pour les résidus et les dérivations, le philologue pose théoriquement un rapport AD, en déduisant des mots les racines, puis, de la même manière, un rapport DA, en déduisant des racines les mots. Mais, en pratique, les langues n'ont pas été constituées en déduisant des racines les mots ; en revanche, quand elles sont constituées, cela peut arriver quelquefois par le fait des grammairiens ou des hommes de science. En général, les mots sont nés spontanément dans le peuple, et la même force qui les produisait faisait naître en même temps les racines ; c'est-à-dire qu'on avait effectivement le rapport OA, OD. Parfois, comme dans le cas des onomatopées, nous réussissons à avoir quelque idée de l'origine O d'une famille de mots A et de sa racine D ; mais, dans le plus grand nombre des cas, cette origine nous est parfaitement inconnue ; nous connaissons seulement la famille de mots, et les philologues en tirent la racine. On a fait des études sur l'« origine » des langues, études qui visaient à découvrir O, mais jusqu'à présent, elles n'ont servi à rien, ni à la grammaire ni au vocabulaire, qui ont au contraire tiré profit de la connaissance des racines. Par exemple, dans la langue grecque, la grammaire et le vocabulaire s'arrêtent aux racines, et n'auraient pas même pu être constitués scientifiquement si, pour ce faire, on avait voulu attendre de connaître les « origines ». De même, en sociologie, il peut y avoir des cas où nous acquérons une connaissance, peut-être lointaine et imparfaite, de l'origine O, tant des résidus D que des dérivations ou des actes A ; mais, dans le plus grand nombre des cas, nos connaissances sont semblables à celles du philologue : nous ne connaissons que les dérivations ou les actes A. Théoriquement, nous en déduisons les résidus D ; puis, réciproquement, des résidus D nous déduisons les dérivations et les actes ; c'est-à-dire que nous attachons notre esprit aux rapports AD et DA ; mais, effectivement, le rapport est OA, OD. Un très grand nombre d'études de sociologie sont semblables à celles qui ont été faites pour déceler les « origines » des langues, c'est-à-dire qu'elles eurent en vue de trouver l'« origine » des phénomènes sociaux, et profitèrent peu à la science. Tâchons maintenant de constituer celle-ci, en nous arrêtant aux résidus, de même que le philologue s'arrête aux racines, de même que le chimiste s'arrête aux corps simples ; de même, que celui qui étudie la mécanique céleste s'arrête à l'attraction universelle, etc. Quant à la manière de nous exprimer, lorsque nous disons elliptiquement que les résidus déterminent les actes, nous substituons, pour faciliter l'exposé, le rapport DA, qui n'est que théorique, au rapport pratique OA, OD. Nous opérons comme le philologue quand il dit qu'une famille de mots A tire son origine d'une racine D, ou quand il dit que certains temps des verbes se forment du radical de l'indicatif, certains autres du radical de l'aoriste, etc. Personne n'a jamais entendu cela au sens que les Grecs s'étaient assemblés, un jour, pour fixer certains radicaux des aoristes, et avaient ensuite déduit de ces radicaux les formes verbales des aoristes. On ne doit pas davantage tirer une conséquence semblable de la proposition suivant laquelle les résidus déterminent les actes.
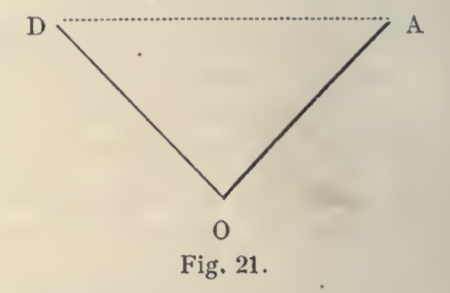
Figure 21
Si l'on avait suivi la voie déductive, la matière traitée en cette note aurait dû faire partie du texte et se trouver au commencement de l'ouvrage. Mais à cette place, elle aurait été difficilement comprise, à cause de sa nouveauté. La voie déductive convient spécialement à des doctrines déjà en partie vulgarisées et connues ; lorsqu'il s'agit de sujets entièrement nouveaux, seule la voie inductive permet de préparer le lecteur à les bien saisir et comprendre. C'est pour cela que l'on trouve la voie inductive employée en des traités tels que la Politique d'Aristote, les œuvres politiques de Machiavelli, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations de Adam Smith, et autres ouvrages analogues de tous genres.
[FN: 1691-1].
La difficulté provient de l'ambiguïté du terme fort, qui peut qualifier l'intensité d'un résidu, chez un individu, comparée à celle des autres résidus du même individu, ou bien comparée à l'intensité du même résidu, chez d'autres individus.
[FN: § 1695-1]
Nous en avons déjà cité de nombreux exemples. En voici un autre, qui peut servir de type à une classe très étendue et dans lequel nous voyons employer des dérivations qui s'appliquent à une infinité de cas, en général. En Suisse, l'usage de l'absinthe a été prohibé. Les fanatiques de la tempérance récriminaient parce que les magistrats ne se montraient pas très sévères dans la répression des contraventions. Un journal écrit à ce propos : « Sous le régime de la monarchie absolue, la volonté d'un seul est imposée à une nation tout entière. Cette volonté unique peut froisser le sentiment du peuple ; elle peut heurter des traditions et des habitudes légitimes ; elle peut être arriérée ou au contraire en avance sur l'époque à laquelle elle se manifeste. Lorsqu'une divergence de vues existe entre un monarque et son peuple, l'application de la loi est difficile. Il en est tout autrement dans une république. Le souverain, c'est le peuple. Ses magistrats ne lui sont pas imposés : il les choisit lui-même. Et, sous le régime de la démocratie directe, qui est le nôtre, les citoyens décident eux-mêmes les principes constitutionnels qui régissent le pays. La Constitution ne peut-être modifiée sans l'assentiment de la majorité des électeurs, qui sont toujours consultés à ce sujet. Les lois elles-mêmes, élaborées par les corps législatifs après des débats publics et dans les limites de la Constitution, ne deviennent obligatoires que si le peuple les a approuvées, tacitement ou formellement : il peut user de son droit de referendum. Il possède même le droit d'initiative législative. Toutes les dispositions de droit qui règlent les conditions de la vie sociale sont ainsi soumises au crible de la discussion publique. Seules prennent force de loi celles qui répondent à la volonté du peuple à l'époque où elles sont proposées. Les conceptions vieillies sont écartées; les réformes prématurées sont différées ; seuls sont imposés au respect de tous les principes constitutionnels et les lois qui ont trouvé grâce devant la majorité des électeurs ». Il faut observer ici différentes choses. 1° La négligence habituelle avec laquelle les religions considèrent les faits expérimentaux. Acceptons, pour un moment, la comparaison que l'on établit entre les mauvaises lois, c'est-à-dire les lois qui « froissent les sentiments du peuple, qui heurtent les traditions, etc. », qui sont propres aux monarchies absolues, à ce qu'il paraît, et les bonnes lois, c'est-à-dire les lois qui ne froissent pas les sentiments, qui ne heurtent pas les traditions, etc., qui, suivant l'auteur de cet article, sont propres aux démocraties. Il suit de là que le droit romain, tel qu'on le trouve dans les constitutions impériales, doit être très inférieur au droit athénien. Mais en est-il vraiment ainsi ? En France, la loi de 1790, établissant la constitution civile du clergé, ne pouvait donc pas froisser les sentiments du « peuple », ni heurter des traditions et des habitudes (légitimes), ni être en avance sur son époque. On apprend tous les jours quelque chose ; mais la révolte qui, sur une partie considérable du territoire, accueillit cette loi demeure inexplicable. Il faut pourtant remarquer que traditions et habitudes sont caractérisées par l'épithète : légitimes. Celle-ci, comme celle de vrai (§1562), sert de parachute. Si on ne peut nier que des traditions et des habitudes ont été heurtées, on en est quitte pour déclarer qu'elles ne sont pas légitimes ; et il est alors évident que les traditions et les habitudes légitimes ne peuvent pas être « heurtées ». 2° Le sophisme très usité, qui confond le « peuple » avec la « majorité du peuple », et pis encore avec la « majorité des votants ». En fait, la prohibition de l'absinthe n'a pas été votée par la majorité du peuple suisse, mais bien par la majorité d'une petite fraction de ce peuple, qui seule prit part à la votation. Comment ce nombre, bien moindre que la majorité du « peuple », devient-il égal à cette majorité. C'est là un mystère qui peut aller de pair avec celui de la très sainte Trinité. Comment la volonté de ce petit nombre se confond-elle avec la « volonté » du « peuple » entier, c'est là un autre mystère qui, tout en étant moins insondable que le précédent, demeure pourtant remarquable. On peut dire que ceux qui n'ont pas pris part à la votation ont eu tort. Cela se peut ; mais ce n'est pas la question. Qu'ils soient coupables tant qu'on voudra, et qu'il y ait d'excellentes raisons légales pour qu'on ne tienne pas compte de leur volonté : tout cela ne change pas une minorité du « peuple » en une majorité, et ne nous fait pas connaître non plus quel était effectivement la volonté de ceux qui ne l'ont pas exprimée, quel que fût leur tort. 3° La dérivation qui suppose que celui qui fait partie d'une collectivité peut être opprimé uniquement par un souverain absolu, et jamais par une majorité à laquelle il n'appartient pas. On ne peut trouver la raison de cette distinction qu'en un droit divin de la majorité, ou en quelque chose de semblable. Si un individu répugne absolument à faire une certaine chose, et si l'on fait abstraction des sentiments de révérence grâce auxquels il soumet sa volonté à celle d'autrui, que lui importe si cette chose lui est imposée par un empereur romain, par un roi du moyen âge, par un parlement ou par une autre autorité ? « Lorsqu'une divergence de vues existe entre un monarque et son peuple [sophisme habituel, par lequel on considère le peuple comme une unité] l'application de la loi est difficile ». Et quand cette divergence existe entre la majorité et la minorité ? « Il en est tout autrement dans une république » : les maux qui viennent d'être notés n'y existent pas. Vraiment ? Dans la république athénienne et dans la république romaine, l'histoire nous dit au contraire que de semblables maux ont été observés. C'est peut-être l'histoire qui a tort, de même que c'était la géologie qui avait tort contre la Bible. « Le souverain c'est le peuple ». Ne serait-ce pas plutôt sans parler des abus – la majorité des votants ? « Ses magistrats ne lui sont pas imposés : il les choisit lui-même ». Dans l'article, ce pronom il se rapporte, au peuple ; dans la réalité – toujours sans parler des abus – à la majorité souvent assez faible, des votants. 4° La dérivation d'après laquelle celui qui est contraint d'agir selon la volonté, de la majorité – si toutefois nous admettons que c'est elle qui fait les lois – agit selon sa volonté à lui, parce que cette volonté est celle du peuple dont il fait partie. Soit une collectivité de 21 individus ; 11 d'entre eux décident de manger les 10 autres. (Il s'est passé des faits semblables dans les naufrages.) Dirons-nous que cette décision « répond à la volonté du peuple » ? que le peuple est autophage, et que chacun des individus mangés devra aussi dire cela avant d'être mis à mort, et devra penser que la « volonté » du peuple est sa « propre volonté » ? 5° Dans le cas que nous examinons, et plus encore en un grand nombre d'autres, on voit apparaître une théorie semblable à celle de la contrition et de l'attrition (§1459) : c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le citoyen se soumette à la volonté de la majorité, par crainte des châtiments que celle-ci peut lui infliger : il doit aussi adorer cette divine volonté. – Comme d'habitude, pour éviter des équivoques, ajoutons que tout cela n'a rien à voir avec le problème essentiellement différent, qui recherche s'il peut être utile à la collectivité de faire croire au public que ces droits divins existent, et s'il est utile que le public en soit persuadé.
[FN: § 1695-2]
La Christian Science est une belle théorie, qui guérit peut-être toutes les maladies, et a certainement enrichi sa fondatrice, Mary Baker Eddy. Nous mettons sous les yeux du lecteur l' »explication » de la doctrine, que donne un auteur qui lui est favorable. Ainsi, nous évitons le danger de la travestir. – CHARLES BYSE : La science chrétienne : « (p. 22) Nous avons tous affaire à trois ennemis principaux : le péché, la souffrance et la mort. Non seulement ils nous menacent incessamment et parfois nous accablent, mais leur existence même est une énigme pour notre raison et un scandale pour notre foi. Comment, sous ces trois formes, le mal qui règne dans le monde peut-il remonter à la création ? Comment le concilier avec un Dieu tout bon et tout puissant ? Toutes les hypothèses auxquelles on a recouru pour résoudre cet angoissant problème montrent l'embarras des penseurs plus qu'elles ne satisfont l'intelligence. Survient Mme Eddy qui, d'un seul coup d'épée, tranche le nœud gordien. Ces adversaires formidables sont des fantômes. Pour les voir disparaître, comme un nuage, il suffit de leur arracher leur masque effrayant, de dire à chacun d'eux : „ Tu n'existes pas “ ». Suit une longue divagation théologique. Passons et voyons ce qui a lieu dans le monde réel. « (p. 26) Les guérisons de la Christian Science se comptent par centaines ou par milliers, pour ne pas dire par dizaines de mille... Leur authenticité a d'ailleurs pour elle toutes les garanties qu'on peut raisonnablement demander. [Tout aussi nombreuses et authentiques étaient les œuvres des sorcières, de la magie, des fantômes, etc.] Aussi ne provoquent-elles, dans les pays anglo-saxons, ni la raillerie, ni l'incrédulité... Cependant, depuis le troisième siècle, la chrétienté a négligé son droit et son devoir à l'égard de la maladie. Il s'agit de nous réveiller. Aussi Science and Health [le chef d'œuvre de cette dame Eddy] porte-t-il sur sa couverture l'inscription suivante autour d'une couronne que traverse une croix : „ Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons “. Mme Eddy a pris au sérieux cet ordre surprenant et se voit récompensée de sa fidélité. Elle guérit, à l'instar de son Maître, „ toutes sortes de maladies et d'infirmités “, et ses (p. 27) étudiants ont appris à faire de même ». Pourtant elle n'apprit pas bien cet art pour elle-même, et mourut bel et bien ! Medice, cura te ipsum. Certains de ses disciples, plus naïfs ou plus logiques que d'autres, dirent qu'elle ne pouvait pas être morte, car cela eût été un démenti à sa doctrine, qui nie l'existence de la mort. Ils attendaient donc qu'elle ressuscitât. Inutile d'ajouter qu'ils attendent encore. Peut-être par crainte de la concurrence, William James n'était pas favorable à. Mme Eddy. Notre auteur le reprend « (p. 35) Je suis fâché de le dire, le célèbre psychologue traite ce vaste et délicat sujet d'une manière superficielle... » Peut-être par crainte de l'esprit railleur des peuples latins, M. Byse ne nous donne pas de détails sur la manière dont se guérissent les maladies. Il nous faut donc recourir à d'autres auteurs. Un correspondant du Resto del Carlino (XXVe année, n° 330) a vu à Berlin les fidèles de la nouvelle science : gens qui croient à des contes bleus de ce genre-ci : « Tu dis qu'une tumeur te fait éprouver de grandes douleurs. La tumeur révèle uniquement ta croyance en des douleurs provoquées par l'inflammation et par l'enflure, et cette croyance-là, tu l'appelles tumeur ». Cette dame Eddy était une parfaite hégélienne, mais seulement pour les maladies, non pour l’argent : Figure-toi donc que tu n'es pas malade, mais paie en monnaie non « figurée ». – A. MAYOR ; Mary Baker Eddy : « (p. 123) Le traitement, qui a pour but de détruire la fausse croyance du malade, doit donc être purement mental, en partie silencieux, et il peut même se faire à distance (en note : On cite, le cas de malades qui ont été guéris sans même se douter qu'ils étaient en traitement)… (p. 124) Mais le guérisseur n'évoque la maladie que pour la nier, n'a d'autre but que de réaliser son irréalité... (p. 126) [citation de ce qu'écrit Mme Eddy] tumeurs, ulcères, inflammations, tubercules, articulations déformées, souffrances de toutes espèces ne sont que de sombres images créées par l'esprit de mort et dissipées par l'Esprit divin »... Autre citation : « (p. 127) Appelé pour la naissance d'un enfant, c'est-à-dire d'une idée (p. 128) divine, on s'efforcera d'écarter les notions matérielles, afin que tout se passe d'une manière naturelle... Né de l'Esprit, né de Dieu, l'enfant ne peut faire souffrir sa mère ». Mme Eddy donne largement des idées. Voyons ce qu'elle reçoit. « (p. 224) Tous ces ouvrages se vendent à des prix qui sembleront d'autant plus élevés que les frais de publication sont réduits à leur minimum, ...(p. 225) la presse [qui auparavant n'était pas favorable] a d'ailleurs changé de ton et se montre en général pleine de déférence pour la Mère des Scientistes, qui sait de son côté récompenser les services qu'on lui rend... (p. 228) ...le produit brut de la vente du Livre „ donné aux affamés “ [c'est ainsi que Mme Eddy appelle ses dupes] peut-être évalué actuellement à 10,000,000 de francs environ, le bénéfice de l'auteur à 5,000,000, celui de l'Église à 3 ou 4,000,000... (p. 229) il n'est sans doute pas d'auteur qui ait réalisé des bénéfices aussi élevés que la Prophétesse de l'ascétisme idéaliste ». Elle a plus d'habileté ou plus de chance que tant de somnambules qui guérissent aussi toutes sortes de maladies, plus de chance que le pauvre Cagliostro et que tant d'autres aventuriers. Bien des siècles se sont écoulés depuis que Lucien a écrit son Faux Prophète ; pourtant c'est une histoire toujours actuelle, toujours vraie, bien que les fidèles du dieu Progrès veuillent nous faire croire que leur divinité, a détruit la « superstition ».
[FN: § 1696-1]
Nous ne pouvons parler de toutes ; il suffira d'en rappeler une encore. La Liberté, 27 octobre 1913 : « Le culte Antoiniste. Le „ Père “ Antoine était un ,, guérisseur “ dans le genre du zouave Jacob. Il opérait des cures prodigieuses. Il mourut l'an dernier à Jemmapes-lez-Liége, en Belgique. De ses cendres est née une religion. Le culte „ Antoiniste “ a ses desservants et ses adeptes, de plus en plus nombreux. La „ Mère “, veuve du „ Père“ Antoine, a hérité des vertus curatives de son mari et continue son commerce, secondée par un homme chevelu et barbu qui s'est fait une tête de prophète. C'est le père. Il est chargé d'évangéliser les masses, car la „ Mère “ se contente de faire des gestes. Les Antoinistes ont construit à Paris, à l'angle des rues Vergniaud et Wurtz, quartier de la Maison-Blanche, un petit temple. Les vitraux y sont remplacés par des carreaux blancs. Il n'y a ni croix, ni statues, ni tableaux, ni symboles religieux d'aucune sorte. À l'extérieur comme à l'intérieur, les murs sont nus, On y lit des inscriptions comme celles-ci. Sur la façade : „ 1919. Culte Antoiniste “. Dans le temple, à l’entrée, et mise là comme une enseigne, cette autre : « Le père Antoine, le grand guérisseur de l'humanité, pour celui qui a la foi“. Dans le fond, cette pensée philosophique : „ Un seul remède peut guérir l'humanité : la foi. C'est de la foi que naît l'amour. L'amour qui nous montre dans nos ennemis Dieu lui-même. Ne pas aimer ses ennemis, c'est ne pas aimer Dieu, car c'est l'amour que nous avons pour nos ennemis qui nous rend dignes de le servir ; c'est le seul amour qui nous fait vraiment aimer, parce qu'il est pur et de vérité “. Il n'y a point d'autels dans ce temple. Au fond, s'élève une chaire en bois très simple. Cloué au panneau de face, un cadre renferme sous vitrine, peint en blanc, un petit arbre semblable à un arbre japonais. Une inscription en lettres blanches avertit que c'est „ l'arbre de la science de la vie et du mal “, unique symbole du culte antoiniste. Cet arbre reparaît, découpé sur une plaque d'acier ajustée à une hampe que tient à deux mains un desservant, faisant office de bedeau. Les desservants ont un uniforme complètement noir : longue redingote austèrement boutonnée jusqu'au menton, chapeau demi haute-forme à bords plats : il a à peu près la forme de ce petit chapeau illustré par M. Alexandre Duval, avec le chic en moins. Ce matin, il y avait un grand nombre de curieux pour l'inauguration du temple, d'autant plus que la „ Mère“ devait opérer des guérisons. Une vieille femme, soutenue par deux de ses amies, se dirige vers la place destinée aux malades au pied de la chaire. Chaque pas qu'elle fait lui coûte un effort et lui arrache une plainte. Ses yeux brillent d'un éclat fiévreux. Elle marche le corps plié. On l'installe sur une chaise. Un desservant donne trois coups de sonnette espacés comme à la messe à l'élévation. Une porte s'ouvre et la „ Mère “ paraît, vieille dame toute vêtue de noir, propre et décente. À son chapeau est épinglé le voile des veuves. Elle monte, les mains jointes, l'escalier qui conduit à la chaire. Là, elle se raidit dans une pose extatique. Puis, lentement, ses bras se lèvent et s'écartent, tandis que ses lèvres murmurent des mots incompréhensibles. Elle joint les mains, les porte à droite puis à gauche ; enfin elle se prosterne. C'est fini. Reprenant sa figure normale, la Mère descend l'escalier de la chaire et sort. Suivie du père qui, pendant cette consultation mystique, s'était immobilisé auprès de la chaire dans une attitude inspirée, elle va s'enfermer dans une baraque en planches placée derrière le temple et pareille à ces baraques où les terrassiers de la Ville rangent leurs outils. La malade s'est levée dans un effort de toute sa volonté. Mais cette ardeur s'est éteinte aussitôt et elle part comme elle est venue, soutenue par ses compagnes. Une jeune femme prend sa place. Elle tient dans ses bras une fillette de 4 à 5 ans, d'une maigreur douloureuse. Toute la vie semble s'être réfugiée dans les yeux. Ses bras et ses jambes pendent inertes. Le corps, plié sur le bras gauche de la mère, a la souplesse d'une étoffe. Indifférente à ce qui se passe autour d'elle, elle tient ses regards fixés vers le cintre. Le trouble de la jeune femme apparaît à la pâleur cireuse du visage. À tout moment, elle essuie avec son mouchoir la sueur froide qui perle à son front. La même cérémonie se reproduit : coups de sonnette du desservant, apparition de la vieille dame, même jeu de scène sans la moindre modification. Il s'applique à tous les cas. La mère remporte son enfant qui a gardé son aspect de loque vivante. Dans l'assistance, pas la moindre manifestation. On regarde tout cela avec stupeur. L'impression d'angoisse qu'on éprouve de ce spectacle arrête l'ironie. Dehors, des groupes se forment. J'écoute un gros homme dont l'haleine fleure le rhum dire à un desservant : „ Pourquoi qu'on n'irait pas, si on a la foi ?“. Passant son bras sous le sien il ajoute : „ Allons prendre un verre, ça nous remettra “. SÉRIS ». De temps à autre se produit quelque cas qui montre la vanité de ces croyances. Par exemple, en décembre 1913, mourut à Berlin l'actrice Nuscha Butze-Beermann. Corriere della Sera, 13 décembre 1913 : « La Nuscha souffrait de diabète depuis l'été dernier. Elle suivit le traitement d'un médecin, et observait le régime prescrit ; puis elle tomba entre les mains d'une gesundbeterin, c'est-à-dire d'une de ces guérisseuses qui traitent les maladies par la prière. L'actrice négligea le traitement médical, et s'en remit à la force de la volonté et de la prière. Ainsi, le mal alla en s'aggravant, et quelques jours plus tard la Nuscha se sentit si faible qu'elle ne put se rendre au théâtre. Néanmoins, la guérisseuse lui dit de ne pas se laisser abattre ainsi, et de penser toujours que l'intelligence ne connaît pas de douleurs. Elle devait simplement prier et aller à la représentation. L'actrice y alla, mais elle perdit connaissance sur la scène et ne revint plus à elle ».
[FN: 1697-1].
Il y avait et il y a toujours des prêtres, de même que des médecins, dignes de toute estime, de toute considération et de tout respect. Ils sont parmi ceux qui donnent leurs conseils à qui les leur demandent, et qui ne cherchent pas à imposer leur volonté, par la force ou des artifices, à ceux qui ne sont pas de leur avis. Ce que nous disons des morticoles ne doit en aucune façon être appliqué aux bons et braves docteurs qui, modestement, avec science, diligence et honnêteté, soignent les malades et atténuent les maux de l'humanité souffrante.
[FN: 1697-2].
Voir, par exemple : Dr BOURGET, prof. à l'Univ. de Lausanne ; Quelques erreurs et tromperies de la science médicale moderne. Cet auteur, réelleme nt scientifique, relève la superstition du public. BOURGET ; Beaux dimanches : « (p. 178) Le bon public croit le pouvoir du médecin beaucoup plus étendu qu'il ne l'est en réalité, et voilà pourquoi il demande des choses impossibles à ce médecin qu'il est bien près de considérer comme un sorcier. Pour les personnes ayant réellement la foi religieuse, il serait plus logique de demander une (p. 179) telle guérison au Dieu qu'elles adorent, au pouvoir duquel, je suppose, elles doivent croire aveuglément, car dans un bon nombre de maladies des organes, la guérison réelle ne pourrait dépendre que d'un miracle. Le médecin, lui, est incapable de faire des miracles ; demandons-lui donc seulement ce qu'il est capable de faire ». – Parmi beaucoup d'exagérations, il y a aussi plusieurs vérités dans CHARLES SOLLER ET Louis GASTINE ; Défends ta peau contre ton médecin.
[FN: § 1697-3]
On peut appliquer, mutatis mutandis, à l'hypocrisie de nos morticoles humanitaires et thaumaturges la nouvelle de Boccace, dans laquelle « un honnête homme confond par un bon mot la méchante hypocrisie des religieux ». L'Académie de médecine de Paris demande une loi qui interdise au pharmacien d'exécuter plus d'une fois une même ordonnance. Les malins qui approuvent cette mesure disent qu'ils veulent « protéger l'hygiène » ; ils veulent plutôt protéger la bourse des thaumaturges. Ceux-ci se feront payer ainsi une visite chaque fois que le malade aura besoin de refaire usage de l'ordonnance. Pour gagner de l'argent, il n'est sorte de malice qu'ils n'inventent. En Italie, une loi de 1913 permet aux pharmaciens d'exploiter les malades ; et ce fut un ministre qui eut le front de dire qu'on faisait cela afin d'assurer aux malades des remèdes de bonne qualité, entre autres les « spécialités étrangères », qui sont mauvaises, paraît-il, si elles sont vendues par les droguistes, excellentes, si elles sont vendues par les pharmaciens. N'importe qui peut s'assurer qu'à Genève, par exemple, le coût des produits pharmaceutiques est de 20 à 50 % plus bas qu'en Italie ; et à qui fera-t-on croire que la qualité en est moins bonne ? De telles affirmations si évidemment contraires à la vérité sont bien à leur place dans la bouche d'un ministre, chef de « spéculateurs » ; elles sont dignes d'être crues par un vulgaire superstitieux ; mais à vrai dire, en tout cela on voit renaître, sous des dehors nouveaux, de vieilles superstitions au moyen desquelles on soutire de l'argent aux naïfs.
[FN: 1697-4]
Nombre de bons et braves docteurs savent et disent ce qu'il y a d'incertain dans leur art, et ils suivent des principes rigoureusement scientifiques. Mais il est remarquable que plusieurs d'entre eux n'osent pas s'opposer à leurs confrères qui veulent imposer cet incertain. Cela a lieu parce que le culte du dieu État, non seulement est accepté par les fidèles, mais aussi toléré par les indifférents.
[FN: § 1697-5]
En certains pays où sévit la législation anti-alcoolique, les morticoles trouvent une source abondante de bénéfices dans les ordonnances de boissons alcooliques prescrites sous un prétexte médicinal. C'est là un des motifs pour lesquels tant de morticoles sont anti-alcoolistes. – FELICE FERRERO, dans le Corriere della Sera, 2 juin 1913. L'auteur parle des États-Unis d'Amérique. « La persévérance des buveurs d'eau est si agressive, et la mauvaise réputation qu'ils ont su créer à l'alcool est si profondément enracinée, que tout le pays en est pénétré [exactement comme de l'hypocrisie religieuse autrefois ; la réaction se produira, mais le moment n'est pas encore venu, et aucun Molière n'a encore écrit le Tartufe de l'anti-alcoolisme]. Cela ne veut pas dire qu'aux États-Unis on ne boit pas de produits alcooliques. Bien au contraire. On y boit, et l'on y boit beaucoup plus que cela n'est à conseiller, même à qui ne saurait admettre que l'alcool soit un poison. Mais ceux qui boivent s'entendent toujours appeler à donner des explications et presque à présenter des excuses, quand ils se préparent à perpétrer l'acte criminel. Il n'est pas un individu sur mille, hors de l'intimité des clubs où, entre quatre murs amis, on commet nombre de choses qu'on n'ose pas commettre au grand jour, il n'est pas un individu sur mille – disais-je – qui ait le courage de dire franchement comme Anacréon „ Que les amis ne m'ennuient pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent ; moi, je bois “ y a des gens qui boivent parce que „ le médecin le leur a ordonné “ ; de ceux qui ne refusent pas un petit verre, „ pour tenir compagnie “, et de ceux qui boivent „ une gorgée de sept en quatorze “ mais apparemment il n'est personne qui trinque pour la raison la plus plausible de toutes... parce que cela lui plaît ».
[FN: § 1698-1]
Les théosophes sont assez nombreux en Europe ; ils ont une abondante littérature. Beaucoup de gens croient aux esprits, au dédoublement de la personne, etc. – J. DARLÈS ; Glossaire raisonné de la Théosophie, s. r. Extériorisation : « (p. 93) Le corps de l'homme comporte une sorte d'enveloppe subtile, dénommée périsprit par les spirites et fluide aithérique par les occultistes, lequel fluide relie pendant la vie le corps à l'âme. Après la mort, (p. 94) quand le corps matériel, le corps physique est dissous, désagrégé, oxydé, l'individualité possède un corps aithéré que les occultistes dénomment double aithérique. C'est aussi la force extériorisée. Quand nous dormons d'un profond sommeil, notre astral (le fluide aithérique) se dégage et va où le pousse notre désir, notre volonté. Ce dégagement s'accomplit chez tous les hommes d'une façon inconsciente ; seulement certains hommes ne s'en doutent point et ne se le rappellent pas, par conséquent, tandis que certains se le rappellent et considèrent comme un rêve les scènes, les travaux ou les promenades accomplis en astral, car l'homme vit sur le plan astral comme sur le plan physique. „ Des sensitifs, des médiums avancés, des psychomètres, des occultistes, nous dit Ernest (p. 95) Bose (dans Dictionnaire d'orientalisme, d'occultisme et de psychologie), peuvent même éveillés, dégager leur astral (leur double aithérique) de leur corps physique et ceux, parmi les adeptes ou initiés de l'occultisme, qui sont avancés, peuvent même à l'aide du fluide aithérique, matérialiser leur corps physique passer du plan sthulique au plan astral) et se montrer fort loin de leur corps à des amis, à des connaissances, à des étrangers “ ». Ajoutons un brin d'explication pour ceux qui ignorent ce que sont ces plans : « (p. 220) Sthula ou Sthule – La matière – Le Plan Sthulique est le Plan Physique. (p. 192) Le Kosmos se compose de sept Plans, divisés chacun en sept sous-plans ». Il serait trop long de les indiquer tous ; le lecteur qui voudra les connaître peut recourir aux ouvrages spéciaux. Il nous suffit de noter ce qu'est le plan astral : « (p. 192) Le Plan Astral, qu'on dénomme aussi (p. 198) plan formatif, duquel l'homme tire son corps astral ; c'est sur ce plan que se trouve le Kamaloka ou le lieu des passions ou des désirs, c'est sur ce plan que va l'homme, après sa mort : il correspond au purgatoire des catholiques ». À côté de ces nouvelles formes de divagations persistent aussi çà et là quelques formes anciennes ; et à chaque instant on lit dans les journaux des histoires de sorcières, de charlatans, et autres semblables. Par exemple, Corriere della Sera, 31 août 1913 : « Une mystérieuse pluie de cailloux arrêtée par l'holocauste de deux chats. À Termo d'Arcola, près de la Spezia, s'est manifesté, ces jours derniers.un phénomène étrange, qui a fait beaucoup parler ces bons villageois. Le 21 juillet écoulé, une certaine Irma Dal Padulo, âgée de onze ans, sortait de l'école pour rentrer à la maison, lorsqu'elle vit tomber autour d'elle, le long du chemin rural tout à fait désert, des cailloux qui avaient l'étrange particularité d'être très chauds.Toutefois, le matin suivant le fait se répéta, à peine la fillette se fut-elle levée, et, malgré la vigilance de ses parents et d'autres voisins, il dura presque toute la journée. Partout où la fillette passait, des cailloux toujours chauds tombaient autour d'elle, sans toutefois la frapper. Durant plusieurs jours le phénomène se répéta... et même diverses personnes étaient accourues pour constater le phénomène : parmi elles, le conseiller communal de Vezzano Ligure, M. Luigi Parioli, deux femmes et un frère d'Irma... » On dirait un récit du Malleus maleficarum ; mais avec les années le démon s'est retiré et a fait place aux esprits : « Quelqu'un conseilla de recourir aux exorcismes du prêtre [c'était peut-être un clérical], mais sans résultat [pauvre démon, quelle décadence !] et la famille ne savait plus à quel saint se vouer, lorsqu'un habitant de l'endroit [c'était peut-être un anticlérical, ou tout au moins une personne qui avait le sens de la modernité] conseilla de tenir une assemblée spirite, dans la maison de Dal Padulo. Le conseil fut suivi, et la table aurait parlé en son langage, exigeant le sacrifice de deux chats et leur enfouissement en un lieu indiqué ; ce qui fut fait, et alors le phénomène cessa ».
[FN: 1701-1].
[NOTE DU TRADUCTEUR]. HENRI-F. SECRÉTAN ; La population et les mœurs, p. 204 : « ils [les chrétiens] remplacèrent par des anges les divinités poliades si chères aux anciens, tant le polythéisme, qui est toujours vivant, que rajeunissent même quelques penseurs contemporains, est l'expression naturelle de la métaphysique populaire ».
[FN: § 1702-1]
Pour beaucoup de fidèles de cette religion, le Christ, auquel ils enlèvent tout caractère divin, n'est plus à admirer que comme un chef socialiste et humanitaire. Il y a des gens qui vont même plus loin. En novembre 1912, tandis que se déchaînait la guerre balkanique, par laquelle les chrétiens de la Turquie cherchaient à s'affranchir de l'oppression des musulmans, un congrès socialiste international se réunit à Bâle pour condamner sévèrement cette guerre. Jaurès y fut très écouté. Il avait publié déjà divers articles pour défendre la Turquie. Le conseil de paroisse mit à la disposition des défenseurs du croissant contre la croix... la cathédrale de Bâle. Sans doute, la lâcheté bourgeoise joua un rôle en ce fait : elle qui poussé beaucoup de gens à se prosterner devant les socialistes et à les aduler. Mais on ne peut l'admettre comme cause unique, surtout si l'on prend garde à l'approbation avec laquelle un grand nombre de personnes accueillirent cette mesure. Un correspondant de Bâle écrit à son journal : « Ce qui caractérisera le Congrès socialiste de Bâle, ce ne sera pas l'humanité extérieure de ses résolutions ; ce sera l'assemblée de la cathédrale ; ce sera ce geste noble et confiant de notre communauté politique et religieuse adressé aux partisans de la paix... il a symbolisé l'attachement... non pas à l'Internationale révolutionnaire, mais à la paix internationale et à la paix sociale entre les classes des divers États » (Journal de Genève, 27 novembre 1912). On remarquera que les congressistes de la cathédrale de Bâle sont des partisans de la « lutte des classes », qui pour eux est un dogme, et les favoriser nous est donné comme un symbole « d'attachement à la paix sociale » ! Parmi les nombreuses dérivations absurdes qu'il nous est arrivé de remarquer, celle-ci ne tient certainement pas le dernier rang. Les Arméniens chrétiens, qui subirent d'abord les massacres d'Abdul-Hamid, puis ceux des « Jeunes Turcs », trouveront peut-être que la paix des Turcs, prêchée dans la cathédrale encore chrétienne de Bâle, ne diffère pas beaucoup de celle des Romains, dont Galgacus disait : ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (TACIT. ; Agric., 30).
[FN: § 1702-2]
On pouvait prévoir ce fait, précisément à cause du peu de variabilité de toute une classe de résidus. Systèmes socialistes, t. 11, p. 419 : « Il se pourrait, par exemple, qu'en certain pays, les nationalistes, les impérialistes, les agrariens, fassent les seuls partis capables de s'opposer au socialisme, et vice versa ; le choix serait alors restreint à ces partis ».
[FN: § 1702-3]
Par ce terme, il faut entendre la doctrine de l'ancien parti libéral, qui visait à restreindre le nombre des liens de l'individu, et non celle du parti libéral moderne, qui veut l'augmenter, et qui, sous l'ancien nom, professe une doctrine entièrement nouvelle, en comparaison de celle qui, naguère, se disait libérale.
[FN: § 1702-4]
On peut lire, en quatrième page des journaux, de coûteux avis de magiciens, d'astrologues, et de gens qui prétendent être en mesure d'indiquer les numéros qui sortiront au tirage de la loterie, en Italie. Comme il est d'ailleurs certain que ces personnes ne continueraient pas à faire de tels frais, si elles n'en retiraient un bénéfice, il apparaît clairement que beaucoup de gens mordent à l'hameçon. On publie des catalogues spéciaux de livres de magie et d'astrologie, et chaque jour de nouveaux livres de ce genre s'ajoutent aux anciens. Voici, parmi tant d'autres, un exemple de publication psychique : « Conseils infaillibles à la portée de tous pour semer l'amour et la sympathie autour de soi; pour obtenir le bonheur et le propager. – Cabinet psychique, 98, rue Blanche. –Paris, 1e édition, 25 000 exemplaires. (p. 2) Les moyens que nous voulons dévoiler à nos lecteurs pour acquérir amour et bonheur, sont obtenus par les Parfums magiques et les Pierres astrologiques... Les principaux parfums magiques sont au nombre de sept. Chacun d'eux correspond à un astre essentiel... Soleil : Héliotrope – Lune : Iris – Mercure : Genièvre – ...Nos lecteurs et nos lectrices savent déjà de quelle importance il est pour eux de faire usage du parfum même de l'astre qui a sur leur destinée une influence dominante. Le temps n'est plus où la science astrologique était dédaignée et méprisée. Notre époque a vu se produire dans cette branche de la connaissance de l'occulte, comme dans toutes les autres, une magnifique renaissance. Personne à présent ne s'aviserait de (p. 3) mettre en doute l'influence des planètes sur la terre, sur ses habitants, sur tout ce qu'elle porte et sur tout ce qu'elle contient ». Cette dérivation est semblable à celle de Hegel, qui voulait que les comètes eussent une influence sur la vendange (§510). « Qu'il soit question de la reproduction des animaux, de la floraison des plantes ou de certaines maladies de l'homme, on est forcé de reconnaître l'influence du soleil. Qui songerait à mettre en doute le pouvoir de la lune sur les marées [ce brave homme doit avoir là-dessus une notion semblable à celle des Chinois et de Hegel] sur les indispositions périodiques de la femme, sur certaines maladies mentales, et l'effet néfaste de la lune rousse sur les pousses des jeunes plantes ? » C'est là le raisonnement habituel des métaphysiciens, qui cherchent dans le « moi » les rapports expérimentaux des faits. « Nous entendons souvent des personnes attribuer au hasard leurs préférences. Elles diront par exemple : C'est singulier, mais pourquoi je déteste la couleur blanche. Pourquoi la fleur que je préfère est-elle la rose ? Pourquoi mon parfum de prédilection est-il la verveine ? Il n'y a là aucun hasard, c'est que ces personnes se rendent compte d'une façon obscure et instinctive de ce qui leur convient le mieux. Une voix mystérieuse les avertit de ce qui leur convient le mieux ». Ce raisonnement semble imité de ceux par lesquels Bergson veut retrouver le « moi instinctif » ; il parle d'une manière plus obscure, mais expérimentalement identique à celle de notre auteur. « (p. 7) Ce que nous avons dit au sujet des parfums s'applique également aux pierres précieuses. De toutes les substances terrestres il n'en est pas qui aient plus de sympathies pour les substances sidérales que les véritables pierres précieuses. Tout le monde sait que la pierre aimantée est despotiquement influencée par l'étoile polaire ». Voilà Hegel « dépassé » (§1686) dans ses divagations sur le diamant (§ 5011). – Les pratiques magiques de la magicienne de Théocrite se reproduisent jusqu'à nos jours. Voir, par exemple, PAPUS ; Peut-on envoûter ? Paris, 1893.
[FN: § 1703-1]
À propos du congrès d'Iéna, en septembre 1913, on lit dans le Giornale d'Italia, 15 septembre 1913, sous la signature G. CABASINO-RENDA : « Le parti socialiste allemand est en décadence. La Direction le constate franchement dans le rapport long et détaillé qu'elle présente aujourd'hui au Congrès, et qui est empreint d'un profond pessimisme. L'inscription de nouveaux prosélytes est stagnante, ce qui n'était jamais arrivé depuis que le parti existe. L'an dernier, il n'a eu que 12 000 nouveaux inscrits, chiffre relativement dérisoire, puisque les nouveaux inscrits ont toujours dépassé les 130 000. Il faut considérer une autre circonstance assez intéressante : c'est que des 12 000 nouveaux inscrits de cette année, 10 000 sont des femmes. Cela remplira d'un orgueil légitime les féministes, mais enthousiasme assez peu la Direction du parti, laquelle ne trouve ainsi parmi ces nouveaux prosélytes, que deux mille individus d'utilisables, du moins au sens électoral du mot. En beaucoup de districts – plus de cent – le nombre des inscrits a nettement diminué. Le phénomène s'est manifesté dans toute l'Allemagne, mais particulièrement en Prusse. Les chefs socialistes cherchent à donner des explications réconfortantes de ce phénomène très grave, et disent qu'il est peut-être attribuable à la crise économique traversée cette année par l'Allemagne. Mais le raisonnement est un peu tiré par les cheveux, car, tout à l'opposé, l'histoire du parti socialiste prouve exactement le contraire ; c'est-à-dire qu'en temps de crises économiques, le nombre des socialistes croît en raison directe du malaise et du mécontentement. Ils disent aussi : ,, La propagande de la presse du parti est négligée “. Mais vice versa, dans une autre partie du même rapport, on affirme que les frais de propagande ont été cette année bien plus élevés que les années précédentes. En ce qui concerne les journaux socialistes, il se manifeste un autre phénomène, qui est en parfaite harmonie avec la stagnation dans l'inscription des membres : les abonnés diminuent sensiblement. À lui seul, le Vorwaerts en a perdu 8400, dans les neuf derniers mois. Les journaux de moindre importance en ont perdu plus de 5000. Un autre phénomène complète la démonstration du recul du parti socialiste allemand : le nombre des votes pour ses candidats aux élections politiques a sensiblement diminué. Tandis que dans les années passées le nombre de ces votes était en augmentation continue (jusqu'à atteindre presque le chiffre fabuleux de quatre millions : votes de sympathie, car le parti compte moins d'un million de membres inscrits), dans les treize élections partielles de cette année-ci, les socialistes ont eu, sauf un cas isolé, beaucoup moins de suffrages que les années passées. En effet, ils ont été presque toujours battus. Déduire de tout cela que le parti socialiste allemand soit en décomposition, serait sans doute une grave erreur ; mais on peut affirmer avec assurance qu'après avoir atteint l'apogée de sa puissance aux élections de 1911, la parabole commence à descendre. Pour excuser leur vote favorable aux mesures financières en vue des armements, les chefs socialistes disent que « s'ils avaient renforcé de leurs votes l'opposition, les projets gouvernementaux eussent été menacés d'un rejet, et que ce rejet aurait provoqué la dissolution immédiate du Reichstag ». Donc, les socialistes n'ont pas voulu la dissolution du Reichstag ; ils n'ont pas voulu les élections générales sur une plate-forme qui, logiquement, devait leur être favorable : un milliard de nouvelles dépenses militaires ! On ne pourrait avoir une démonstration plus évidente du niveau élevé atteint actuellement par l'esprit national allemand et de la situation du parti socialiste, qui sent que même en des circonstances exceptionnellement favorables, il ne pourrait, dans un nouveau conflit, maintenir la position conquise aux dernières élections générales, grâce à un concours de circonstances qui ne se représenteront jamais plus ». C'est ce qu'on ne peut savoir ; tout dépendra des circonstances de l'évolution sociale.
[FN: § 1703-2]
DE LA MAZELIÈRE ; Le Japon, t. 5 : « (p. 7) Dans ce pays où un moment tout sembla s'écrouler, une seule institution subsistait, grandie de l'écroulement de tout le reste, la monarchie, fortifiée par la haine del'étranger, les passions révolutionnaires, qui avaient identifié sa cause avec celle des réformes démocratiques, le caractère mystique qu'avait pris la Restauration. Ces trente millions d'hommes, qui n'avaient plus de religion et qui en voulaient une, adoraient leur empereur... (p. 8) Ainsi l'amour de l'empereur se fortifiait de tous les autres amours, l'adoration de l'empereur se fortifiait de toutes les autres adorations... (p. 9) Et c'est ainsi qu'au milieu des déchirements et des haines suscités par les discordes et les guerres civiles, le culte de l'empereur devint le seul sentiment où pussent s'unir tous les Japonais... (p. 10) Les officiers étrangers qui ont vu monter à l'assaut les soldats de Nogi devant Port-Arthur, les soldats d'Oku devant Liao-yang se servent de la même expression : c'était du fanatisme ». L'auteur écrivait en 1910. Deux ans plus tard, en se tuant ensuite de la mort du Mikado, le général Nogi ajoutait une nouvelle confirmation à ces observations.
[FN: § 1704-1]
Corriere della Sera, 25 février 1912 : « À l'appel nominal, il y eut 38 votes contraires, dont exactement 33 des socialistes, deux des constitutionnels... trois des républicains... Au scrutin secret, il y eut seulement 9 votes contraires, bien qu'y eussent participé, d'après ce qui résulte du compte-rendu officiel de la séance, 22 des députés qui, à l'appel nominal, s'étaient prononcés contre le projet. On ne connaît naturellement pas les noms des neuf qui ont voté contre ; mais il est évident que treize de ceux qui s'étaient d'abord montrés opposés, ont changé d'opinion, et ont approuvé le projet, dans le secret de l'urne, libres de tout contrôle de groupe qui liât leur conscience ». Ailleurs, dans le même journal : « Le fait est singulier, sans précédent ; il est l'indice d'un état d'esprit extraordinairement significatif. Il est évident que ces treize n'eurent pas le courage d'exprimer leur véritable opinion... Le groupe exigeait qu'ils se montrassent contraires, et, en apparence, ils sacrifièrent leurs convictions. Dans le secret de l'urne, ils pouvaient être sincères, et alors seulement ils furent sincères [qui sait ? ils auraient pu aussi ne pas prendre part à la votation ; en réalité ils tournaient comme des girouettes] ; le masque maintenu sur le visage, par un artifice fut levé. Mais que d'humiliation, dans ce courage caché ! Quel aveu de faiblesse, dans cet acte de sincérité ! » Après les élections de 1913, une vague de foi vint, comme d'habitude, du peuple, et les nouveaux députés se montrèrent de violents défenseurs de leur parti.
[FN: § 1705-1]
Plus tard, en 1912, les pacifistes italiens demandaient au ministre de l'instruction publique que « pour la fête de la paix qu'on célèbre le 22 février, il invitât le personnel enseignant à montrer, ce jour-là, comment le sentiment de la paix peut et doit concorder avec le sentiment de la patrie » (Corriere della Sera, 3 février 1912). Le ministre comprit combien il eût été étrange de vouloir faire célébrer la guerre... au nom de la paix ! Peut-être fut-il retenu aussi par le sentiment de l'atteinte qu'il aurait portée à la liberté de pensée du personnel enseignant, en voulant le contraindre à parler à ses élèves d'une manière si sophistique. Enfin, il répondit ainsi au prof. De Gubernatis : « Certainement, le noble idéal de la paix entre les peuples – paix honorable et juste, cela s'entend – sourit à notre esprit, maintenant aussi que l'Italie doit protéger par la force des armes ses intérêts vitaux et en même temps ceux de la civilisation [c'est ainsi « qu'il souriait » aux Romains, tandis qu'ils conquéraient le monde méditerranéen, et à Napoléon Ier, quand ses armées parcouraient toute l'Europe]. Mais il ne peut échapper à votre esprit sagace qu'une manifestation publique faite en ce moment pour la paix, se prêterait, malgré toute réserve, à des interprétations inexactes et nuisibles ». C'est ainsi que le ministre repousse la dérivation du professeur ; mais ensuite il en fait une pour son propre compte : « Les Romains fermaient le temple de Janus, seulement quand les ennemis étaient vaincus [peut-être le ministre est-il ici quelque peu ironique ? il rappelle la phrase de Tacite : ubi solitudinem faciunt, pacem appellant] nous célébrerons de nouveau la fête de la paix, dès que le sang de nos soldats, fleur de la jeunesse d'Italie, aura apporté à la patrie la reconnaissance de son bon droit et le respect de tout le monde. Ce sera une fête sincère et sentie par tous ». Dépouillée de ses fioritures de rhétorique, l'idée du ministre est, au fond, qu'on louera la paix quand la guerre aura rapporté tout ce qu'on en désire et qu'on en espère. C'est une idée d'ailleurs très juste ; mais elle est vieille comme le monde, familière même a des peuples très belliqueux, et il était vraiment inutile d'invoquer les belles théories du pacifisme pour nous la révéler.
[FN: § 1705-2]
Parmi ceux qui gardèrent fidélité à leur doctrine et ne se laissèrent pas emporter comme la feuille au vent, par la bourrasque des enthousiasmes belliqueux, il faut rappeler, à leur honneur, le prof. Napoleone Colajanni, l'avocat Edoardo Giretti et le prof. Arcangelo Ghisleri.
[FN: § 1708-1]
On pourrait encore remonter plus haut. Dans la Grèce ancienne, on disait que les Hellènes ne devaient pas se faire la guerre entre eux, mais la faire seulement aux Barbares.
[FN: § 1710-1]
En 1912, le gouvernement italien refusa l'exequatur à Mgr. Caron, nommé par le pape archevêque de Gênes. Il paraît que cette affaire a des dessous. On soupçonna Mgr. Caron d'avoir contribué à faire éloigner de Gênes le Père Semeria, qui avait une légère teinte de modernisme, et était protégé en haut lieu ; mais comme nous n'avons pas de preuves de ce dernier fait, nous ne devons pas en tenir compte. Arrêtons-nous seulement aux raisons que, pour justifier le refus de l'exequatur, le ministre Finocchiaro-Aprile donna à la séance de la Chambre, le 10 février 1913. Il fit allusion à des journaux qui étaient favorables au pouvoir temporel du pape, accusa, mais sans trop en donner des preuves, Mgr. Caron d'être leur complice, et conclut qu' « en présence de circonstances comme celles dont on a parlé aujourd'hui, ce qui devait prévaloir sur tout et sur tous, c'était la suprême raison d'État, en vertu de laquelle l'État ne peut accorder une autorisation civile à qui, espérant des restaurations impossibles, ne rend pas à l'État l'hommage qui est dû à l'État ». Voilà un principe général, et si on l'avait entendu de la bouche d'un ministre prussien, il n'y aurait rien à ajouter, car en Prusse, le gouvernement exclut des fonctions publiques, y compris celles de professeur d'université, tous ceux qui « ne rendent pas à l'État l'hommage qui est dû à l'État ». Mais il est impossible qu'un ministre italien ignore que l’État italien a, parmi ses employés, des socialistes qui déclarent et répètent publiquement qu'ils veulent détruire l'État bourgeois ; et s'ils ne « rêvent pas des restaurations », ils rêvent au contraire des destructions. Le ministre a donc dit une chose qui n'est pas très véridique, en affirmant que ses actes étaient déterminés par ce principe général. Quand ce principe lui est politiquement utile, il s'en souvient ; quand il lui est nuisible, il l'oublie.
[FN: § 1712-1]
Les partis adversaires de la « bourgeoisie » publient continuellement dans des livres, des opuscules, des journaux, qu'ils veulent l'anéantir, la détruire. Or il n'y a aucun « bourgeois » qui oserait répondre, pas même dans un moment de colère, ni seulement pour plaisanter : « Vous dites que vous voulez nous détruire ? Venez-y donc. C'est nous qui vous détruirons ». Le Dieu des chrétiens a des blasphémateurs parmi ses fidèles ; le dieu du Peuple n'a aucun blasphémateur, non seulement parmi ses fidèles, mais encore parmi ceux qui n'ont pas foi en lui. L'Humanité a ses misanthropes. Le peuple n'a pas de ![]() ; il n'a personne qui ose manifester de la haine contre lui, ou seulement de la répugnance, ni même de l'indifférence. Tout cela semble si commun, si naturel, que personne n'y fait attention, et le rappeler semble aussi inutile que de dire que l'homme marche sur deux pieds.
; il n'a personne qui ose manifester de la haine contre lui, ou seulement de la répugnance, ni même de l'indifférence. Tout cela semble si commun, si naturel, que personne n'y fait attention, et le rappeler semble aussi inutile que de dire que l'homme marche sur deux pieds.
[FN: § 1713-1]
R. MICHELS ; Les partis politiques, chap. IV. Le besoin de vénération chez les masses ; « (p. 42) ...L'adoration des militants pour leurs chefs demeure généralement latente. Elle se révèle par des symptômes à peine perceptibles, tels que l'accent de vénération avec lequel on prononce le nom du chef... (p. 43) En 1864 les habitants de la région rhénane ont accueilli Lassalle comme un dieu... Lorsque les Fasci, ces premières organisations des ouvriers agricoles, se furent formées en Italie (1892), hommes et femmes avaient dans les chefs du (p. 44) mouvement une foi presque surnaturelle. Confondant, dans leur naïveté, la question sociale avec les coutumes religieuses, ils portaient souvent dans leurs cortèges le crucifix à côté du drapeau rouge et de pancartes sur lesquelles étaient inscrites des sentences empruntées aux ouvrages de Marx... (p. 45) En Hollande, l'honorable Domela Nieuwenhuis, en sortant de prison, reçut du peuple, d'après ce qu'il raconte lui-même, des honneurs comme jamais souverain n'en avait reçu de pareils... Et une pareille attitude de la masse ne s'observe pas seulement dans les pays dits „ arriérés “... Nous n'en voulons pour preuve que l'idolâtrie dont la personne du prophète marxiste Jules Guesde est l'objet dans le Nord, c'est-à-dire dans la région la plus industrielle de la France. Même dans les districts ouvriers de l'Angleterre, il arrive encore de nos jours que les masses font à leurs chefs un accueil qui rappelle le temps de Lassalle. La vénération des chefs persiste après leur mort. Les plus grands d'entre eux sont tout simplement sanctifiés... Karl Marx lui-même n'a pas échappé à cette sorte de canonisation socialiste, et le zèle fanatique avec lequel certains marxistes le défendent encore aujourd'hui (p. 46) se rapproche beaucoup de l'idolâtrie dont Lassalle a été l'objet dans le passé ».
[FN: § 1713-2]
MAURICE SPRONCK ; dans La Liberté, 17 novembre 1912. En France, les instituteurs se révoltent contre les politiciens : ceux-ci ont réchauffé un serpent dans leur sein. À propos d'une séance de la Chambre où l'on a parlé de cette crise, l'auteur écrit : « De la plaidoirie éloquente, mais légèrement obscure de M. Paul-Boncour, un point cependant se dégage qui nous paraît d'une vérité frappante ; et nous, prendrons volontiers à notre compte tout ce qu'a dit l'orateur sur les auteurs responsables de la présente crise scolaire. „ Ces groupements d'instituteurs (déclara-t-il) sont nés non seulement sous la surveillance du pouvoir, mais avec sa pleine approbation ; et l'époque n'est pas loin où leurs fêtes annuelles se déroulaient sous la présidence des plus hautes personnalités républicaines “. Rien de plus rigoureusement exact. Et ces hautes personnalités républicaines non seulement toléraient, non seulement encourageaient la transformation du vieux et brave maître d'école en courtier politique, mais elles le faisaient encore en des termes qui excusent dans une certaine mesure, on doit le reconnaître, les pires aberrations et les plus absurdes désordres des pauvres gens qu'on voudrait aujourd'hui ramener au bon sens et à la discipline. Jamais souverains des plus lointaines régions de l'ancienne Asie n'ont été flattés, courtisés, encensés, flagornés comme le furent les malheureux garçons qui, pour le plus grand dommage de leur hygiène cérébrale, avaient choisi l'honorable profession d'éducateurs des enfants, et devant lesquels s'aplatissaient en permanence les innombrables politiciens ou aspirants politiciens. Pour gagner leurs services électoraux, on a littéralement rampé à leurs pieds : remarquez du reste que ces mœurs se continuent et que, en ce moment même où se manifestent pourtant quelques velléités de réagir contre un intolérable état de choses, on nous prépare une loi qui, sous le fallacieux prétexte de défendre l'école laïque, érige ses desservants en une espèce de caste sacerdotale, sacro-sainte et intangible ». Dans cette séance de la Chambre, un député socialiste reprocha au gouvernement de ne pas avoir continué à aduler les instituteurs : « M. Compère-Morel. Tant que les instituteurs ont servi le parti radical, vous les avez couverts de fleurs. Aujourd'hui qu'ils vous abandonnent, vous les traitez en ennemis (bruit, applaudissements) ». En Italie, le gouvernement paie par des faveurs pécuniaires aux coopératives socialistes les votes de plusieurs députés de ce parti ; et à Rome, un député socialiste est élu grâce aux votes des employés de la Maison Royale. – Journal des GONCOURT, t. VIII « (p. 22) Je lis ce soir [28 février 1889] dans le Temps, cette phrase adressée aux ouvriers par le président Carnot... „ Je vous remercie profondément de l'accueil que vous venez de faire à ma personne, mes chers amis, car vous êtes des amis puisque vous êtes des ouvriers “ [on sait que Carnot fut assassiné par un « ouvrier », qui n’était pas un « ami », à ce qu'il paraît]. Je demande, s'il existe en aucun temps de ce monde, une phrase de courtisan de roi ou d'empereur qui ait l'humilité de cette phrase de courtisan du peuple ».
[FN: § 1713-3]
PAUL Louis COURIER ; Simple discours... à l'occasion d'une souscription... pour l'acquisition de Chambord : « (p. 49) ...La Chambre, l'antichambre et la galerie répétèrent : Maître, tout est à vous, qui, dans la langue des courtisans, voulait dire tout est pour nous, car la cour donne tout aux princes, comme les prêtres tout à Dieu... » Aujourd'hui, les politiciens, descendants légitimes des courtisans, disent au Peuple les mêmes choses que le roi a jadis entendues ; et l'on peut dire avec Courier : « La Chambre, le Sénat, la Presse, répétèrent : Maître, tout est à vous, qui, dans la langue des politiciens, voulait dire tout est pour nous, car les politiciens donnent tout au Peuple, comme les anciens courtisans tout aux princes et comme les prêtres tout à Dieu ».
[FN: § 1713-4]
Montecitorio. Noterelle di uno che c'è stato [E. CICCOTTI] « (p. 56) Mais la bourgeoisie italienne [l’auteur, étant socialiste, attribue à la bourgeoisie ce qui est le fait de tous], dont provient la majeure partie des députés, comme classe et comme émanation... ne ressent pas le besoin, et n'a peut-être pas la possibilité de développer en elle-même ces tendances et ces exigences qui la diviseraient en partis ; et si elle le fait, elle vit dans un état de torpeur politique, à l'ombre de divisions plus nominales que réelles... Dans cette condition de vie politique et sociale et avec cette disposition d'esprit, étant donné la nécessité de se trouver un centre, on le cherche et on le trouve naturellement dans le pouvoir constitué, dans le gouvernement, qui existe inévitablement... et qui, ayant la haute main sur tout un engrenage d'intérêts, a la possibilité de (p. 57) satisfaire des appétits, de flatter des ambitions, et de façonner des majorités. Mais chercher un centre hors de soi-même signifie se créer une condition de servitude, telle qu'on la trouve précisément dans les majorités de Montecitorio, chez les ministres qui semblent créés par elles et, à leur tour, les créent et les dominent. La très nombreuse catégorie des ministériels avec tous les ministres... vit dans l'oubli plus ou moins complet de la politique (ce mot étant entendu dans son sens de bon et utile au pays), confiante en le Ministère et dévouée à lui, par un ensemble de reconnaissance, d'espérances, de craintes, de préoccupations de ses propres affaires... » Voir aussi ETTORE CICGOTTI ; Come divenni e conte cessai di essere deputato di Vicaria.– ROBERTO MARVASI : Cosi parlo Fabroni. L'auteur raconte comment Naples fut livrée aux camorristes par le gouvernement : « (p. 10) ...dans le but d'empêcher que le collège de Vicaria ne confirmât dans (p. 11) sa charge de député Ettore Ciccotti... Un grand nombre de camorristes furent autorisés à ne pas se conformer aux obligations qui leur étaient imposées par la « surveillance spéciale » dont ils étaient l'objet. D'autres se virent octroyer le port d'armes et des licences commerciales ; d'autres enfin furent extraits de prison avec la liberté conditionnelle, ou même quelques grâces. Ce furent là les soldats qui livrèrent la bataille que l'on dit avoir été donnée pour la défense des institutions... Pour l'inavouable entreprise, les malandrins se confondirent avec les soldats d'infanterie et de cavalerie : celle-ci, ayant déferré ses chevaux, bivouaqua dans les rues et sur les places et chargea les électeurs suspects... (p, 13) Une „ camorra d'État “ est certainement une chose originale, et un État qui s'associe aux délinquants par un contrat régulier, et leur ordonne... une partie de délits [c'est l'auteur qui souligne], est certainement un phénomène qui cause la stupéfaction ». L'auteur conclut : « (p. 283) J'avoue avoir voulu dénoncer la situation actuelle du pays, en rapport avec le système capitaliste et la constitution politique qui le ronge ». Ici, il confond deux choses entièrement distinctes : 1° la description des faits, qui semble être exacte et bonne, au moins en grande partie ; 2° la cause des faits, qu'il trouve dans le « système capitaliste » ; c'est là une affirmation qui n'est pas appuyée par des preuves scientifiques, et qui ne peut prendre place que dans la théologie socialiste. – Innombrables sont les faits qui montrent comment, pour un grand nombre de gens de la classe gouvernante, la politique est simplement l'art de pourvoir aux intérêts de certains électeurs et de leurs élus. Les résidus de la Ie classe prédominent absolument, et ceux de la IIe s'affaiblissent. Beaucoup de députés se disent anticléricaux et se font élire par les votes des cléricaux. Voici un fait qui peut servir de type d'une nombreuse catégorie. En février 1913, un député fit un discours férocement anticlérical à la Chambre italienne, et l'on découvrit qu'il avait été élu par les votes des cléricaux. À ce propos, le Giornale d'Italia, 18 février 1913, écrit : « Le Président de l'Union électorale catholique, comte Gentiloni, a maintenant révélé ce fait curieux : que l'honorable ***, élu à **** surtout par les votes des catholiques et la faveur de l'évêque, faisait à Rome l'anticlérical, par des accords spéciaux précisément avec Ernest Nathan, et, en homme de bon sens qu'il est, le comte Gentiloni avertissait l'évêque de mettre plus de diligence à surveiller la conduite de son député. Cette semonce du Comte Gentiloni a provoqué, entre cléricaux, une dispute dont il est inutile de s'occuper. Ce qui intéresse, c'est le fait du député de ****, parce qu'il n'est autre chose qu'un des épisodes quotidiens auxquels nous fait assister l'attitude politique de quelques députés changeant de personnalité dans le train qui les conduit du chef-lieu de leur collège à Rome. Ces gens sont, en province, tout ce qu'il y a de plus obséquieux envers les catholiques, les programmes catholiques et les autorités catholiques. Mais à peine débouchent-ils de la gare de Rome sur la Piazza Termini, qu'ils se sentent enflammés du plus pur anticléricalisme, et, tout en continuant à recommander, s'il le faut, au Ministère tous les curés du collège qui ont quelque chose à demander à l'Administration des cultes ou à la Minerva [ministère de l'instruction publique], ils s'associent politiquement à toute manifestation anticléricale, surtout – cela s'entend – si elle n'est qu'oratoire... Car une autre spécialité des anticléricaux de profession est exactement la suivante : d'exterminer les cléricaux... en paroles ; mais de bien se garder de faire quelque chose qui puisse vraiment nuire à leur œuvre et à leur propagande. Par exemple, l’anticléricalisme de l’honorable Finocchiaro est aussi fait de la sorte : ses discours sont nombreux, impétueux et féroces ; mais des faits administratifs – et législatifs, en particulier – on n'en voit point ; à moins que se présente la bonne occasion de faire de l'anticléricalisme en refusant l'exequatur à Mgr. Caron, et en faisant ainsi plaisir à la grande majorité des catholiques gênois... et italiens... Le Président de l'„ Union électorale catholique “ voudrait donc, à ce qu'il paraît, ramener un peu de sincérité et de loyauté dans nos coutumes électorales, et je le loue. Mais je ne crois pas qu'il y réussisse. L'équivoque convient trop, tant aux députés qu'aux cléricaux. Aux premiers, parce qu'ils s'assurent les votes, aux derniers parce qu'ils s'assurent la tranquillité ». À ces faits généraux, chacun cherche une cause particulière, et la trouve selon ses sentiments. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens, en France, accusent du mal l'élection par la simple majorité des députés, et estiment que la représentation proportionnelle est un remède efficace. – G. BERTHOULAT, dans La Liberté, 18 février 1913, après avoir remarqué que la Chambre ne réussit jamais à approuver le budget à temps, écrit : « Quel réquisitoire dressé contre elle-même par l'assemblée du petit scrutin ! Ainsi, elle n'est pas capable en huit mois de bâcler un mauvais budget ? Il est vrai qu'il s'agit du budget des dépenses, celui des recettes n'étant même pas encore abordé, et que, pour les députés d'arrondissement, réclamer encore et toujours plus de dépenses afin de gaver leur clientèle, c'est toute la politique... Cependant, l'essentielle et permanente raison d'être du Parlement, n'est-ce pas celle des anciens États-Généraux, qui avaient, eux, le mandat intermittent de défendre les contribuables contre les exigences d'argent du Prince ? Or, par suite de l'étrange et lamentable confusion des pouvoirs que consacre le présent régime, les députés sont devenus les princes. Aussi ont-ils le constant souci de desserrer les cordons de notre bourse pour y puiser mieux. Le maintien de leurs principautés étant au contraire, grâce aux mœurs du scrutin pourri, lié aux plus saines traditions du pillage organisé, ils travaillent infatigablement à piller. C'est ainsi que, depuis l'été dernier, le gouvernement ayant pris la précaution de déposer son budget de très bonne heure, les hommes des mares siègent pour dépecer la France. Et comme presque tous en veulent un morceau pour leur meute particulière, comme il faut à chacun des Chevaliers bannerets de la féodalité électorale de quoi alimenter son ban, tous, interminablement, défilent à la tribune afin de participer à la curée de cinq milliards et demi ». L'ouvrage de M. CICCOTTI serait à transcrire presque en entier, tant il est plein d'observations qui sont excellentes pour la science expérimentale. Les limites de cet ouvrage nous obligent à nous borner aux passages suivants : « (p. 58) Mais à travers ces crises ministérielles plus fréquentes on trouve l'homme le plus rusé, le plus énergique ou le plus fourbe, qui met à profit les inépuisables ressources du gouvernement ; qui se crée de plus fortes attaches dans la presse, avec un plus savant emploi des fonds secrets ; qui se montre plus arrangeant et plus expert pour organiser la chaîne de clientèles ; qui va du ministre au député, du député aux collèges électoraux, enregistre, collectionne, forme des dossiers des tares (p. 59) d'adversaires et d'amis, de manière à pouvoir les dominer et même les faire chanter à l'occasion ; qui plante des jalons à la Cour ; et qui réussit ainsi à se montrer habile, omnipotent, indispensable, et à se constituer une raison de domination presque absolue, laquelle, sous une forme de dictature plus ou moins dissimulée, se prolonge pendant des années, sous son nom et sous celui de ses substituts... En attendant, tout ce qui peut et doit venir à la lumière dans ce jeu de combinaisons et d'expédients, la forme visible que doivent prendre ces démêlés et ces embûches pour se concrétiser, s'expliquer et se dissimuler, la façon dont les divers intérêts doivent se colorer, se combattre et s'accorder aux yeux du public, tout cela est donné par le débat parlementaire, par l'usage qu'on y fait de la parole... La parole est le moyen de capter la faveur du public [d’une façon générale, la dérivation est le moyen d'émouvoir les sentiments] et d'attirer comme de distraire l'attention, et encore plus le moyen de simuler et de dissimuler, de blesser et de défendre. Tout cela, avec la conscience ou la semi-conscience que ce tournoi est au fond comme une cérémonie et une représentation. À les interroger, tous disent que les discours ne changeront pas une situation [ils reconnaissent pratiquement ce que nous avons exposé théoriquement dans le présent ouvrage], et qu'ils ne déplaceront pas un vote et ne tireront pas de l'huile d'un mur. Pourtant on fait des discours et parfois des discours intéressants [depuis que le monde existe, on fait usage des dérivations]. Les naïfs peuvent, quelquefois aussi, se faire illusion sur leur effet immédiat, tandis que les hommes de foi s'illusionnent ou se réconfortent en pensant que tout finit, dans la forme où il se manifeste (p. 60) ; mais en définitive, rien ne se perd... Mais la grande majorité des orateurs parlementaires sentent, consciemment ou non, qu'ils font leurs discours à la Chambre, comme l'acteur joue son rôle au théâtre... » N'oublions pas le ministre Rouvier qui, aux accusations qu'on lui adressait, à propos de l'argent extorqué à la compagnie du Panama pour un usage politique, répondit aux députés : « Si je n'avais pas fait cela, vous ne seriez pas ici ». On sait assez qu'en France, les grandes banques sont obligées de contribuer aux dépenses électorales du parti qui est au pouvoir. Quelques-unes donnent aussi de l'argent au parti d'opposition qu'on estime près d'arriver au pouvoir. Elles ont pour cela certains fonds secrets, ce qui leur permet de nier quand les journaux dénoncent les faits.
[FN: § 1713-5]
SALLUST. ; Bell. Iugurth., 35 : Urbem venalem, et mature perituram, si emptorem invenerit. – La Liberté, 16 février 1913 « M. Colly, qui ne mâche pas ses mots, disait hier à ses collègues de la Chambre „ Ah ! nous ne sommes guère bien notés dans le pays. Mais quand les électeurs me disent que la Chambre est pourrie et que les députés sont des viveurs et des jouisseurs, je leur réponds : Si les députés ne valent rien, c'est que les électeurs qui les nomment ne valent pas davantage “ ». Ainsi que nous l'avons souvent remarqué, ces formules littéraires employées pour décrire un phénomène ont l’avantage d'en donner une image vive, qui toutefois n'est pas précise et dépasse les limites de la vérité expérimentale.
[FN: § 1713-6]
Voir, par exemple : TOMASSO PALAMENGHI CRISPI ; Giolitti. Saggio Storico-biografico. En France, le ministre Rouvier redevint ministre après le Panama, et put dire aux députés que s'il n'avait pas fait ce qu'il fit après le Panama, eux n'auraient pas été à la Chambre. En Angleterre, Lloyd George reste ministre, après l'enquête sur les spéculations de bourse effectuées et niées par lui, de sorte qu’il dut reconnaître lui-même n'avoir pas dit la vérité.
[FN: § 1713-7]
Parfois aussi cela se passe ouvertement. Aux accusations portées par Cavallotti à Crispi, la Chambre italienne objecta qu'« elle n'avait pas à s'occuper de la question morale ». Aux accusations lancées contre Lloyd George, la Chambre anglaise objecta, en recouvrant à peine son intention du voile de la dissimulation, que frapper ce ministre eût été faire du tort au parti qui gouvernait le pays.
[FN: § 1714-1]
On sait assez que plusieurs collèges électoraux du midi de l'Italie sont de véritables fiefs. Un phénomène semblable se remarque en France. Gazette de Lausanne, 22 novembre 1912 (F. C.) : « Le procès qui vient de se dérouler devant les assises de l'Yonne jette un jour lamentable sur nos mœurs politiques départementales... Dans le petit chef-lieu de canton de Coursons-les-Carrières, deux listes sont en présence à l'occasion des dernières élections municipales : celle du maire sortant, M. Bouquet, conseiller général, et celle de M. Jobier père, conservateur des hypothèques à Paris. La veille du scrutin, M. Jobier est allé tenir une réunion dans un hameau de la commune, il rentre chez lui, croise dans la nuit des groupes plus ou moins menaçants, s'écarte un instant de ses amis, et reçoit traîtreusement un coup de gourdin qui l'étend à terre, gravement blessé. Son fils se précipite, le trouve ensanglanté, poursuit les malfaiteurs et décharge dans l'obscurité un revolver qu'il portait sur lui. Un ouvrier boulanger, qui répond au nom de Saligot, est tué net. Les jurés de l'Yonne ont acquitté le fils Jobier, qui avait passé plusieurs mois en prison préventive. ...Dans tous les domaines, c'est la même chose. Hier, au conseil municipal, un membre de la droite a mis en cause la discussion de l'Assistance publique à propos des agissements du médecin des enfants assistés de la commune d'Étang-sur-Arroux (bon nom pour une mare stagnante). Il a été établi que ce médecin avait exercé une pression sur les électeurs, en les menaçant de leur retirer les enfants qui lui étaient confiés, s'ils votaient mal. Cela a été tellement établi que le conseil de préfecture a dû casser l'élection, quoique ce ne soit pas beaucoup dans ses habitudes. Naturellement, quand M. Billard a porté ces faits à la tribune, les membres de la gauche ont crié à la calomnie. Malheureusement pour eux, un socialiste, qui se trouvait par hasard originaire de la commune en question, s'est levé de son banc et a déclaré que les faits déclarés étaient rigoureusement exacts. M. Mesureur a dû battre en retraite, plaidailler, demander qu'on ne généralisât pas ces faits exceptionnels, affirmer que la plupart des médecins étaient rigoureusement fidèles à leurs devoirs professionnels. Ce n'est pas exact. Le placement des enfants assistés est un procédé connu, cyniquement pratiqué, souvent avoué, de pression électorale : et l'Assistance publique, dirigée par un des grands francs-maçons de l'époque, est devenue une simple officine politique... Ce jeune homme a agi dans l'un de ces moments où l'on ne discute pas, où on laisse parler l'instinct, dans ce qu'il a parfois de plus spontané et de plus respectable. Dans une circonstance analogue, je crois bien que tout le monde aurait agi comme lui. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, et il y a des conclusions à tirer de ce drame. Les débats ont révélé que les passions politiques étaient poussées jusqu'à leur paroxysme. Il a été établi que les partisans du conseiller général chantaient des chansons dans lesquelles le père Jobier était traité de choléra, que plusieurs d'entre eux ne se gênaient pas pour dire : „ Il faut tuer les Jobier “. D'autre part, le procureur de la République a représenté le chef de cette dynastie comme un assez vilain merle, comme un vieillard tyrannique et dévoré d'ambition. Pourquoi donc tous ces gens-là luttaient-ils avec tant d'acharnement ? Pour des opinions ? Pas du tout ; ils avaient la même ! Ils étaient radicaux-socialistes les uns et les autres, et il parait même que le plus à gauche était le conservateur... des hypothèques. Ils luttaient tout simplement pour la possession du pouvoir, pour la possession de la mairie. Mais c'est une corvée, la mairie ! C'est entendu ; mais, dans un régime qui a été façonné de telle sorte qu'il faut être tyran ou tyrannisé, la mairie, c'est aussi la forteresse d'où l'on exerce avec sécurité ses déprédations. C'est le burg féodal où l'on case ses vassaux et où l'on entasse ses rapines. C'est l'arche sainte du clan et de la tribu. L'avoir ou ne pas l'avoir, c'est être ou ne pas être ». Ces deux faits ne sont que des types de milliers et de milliers d'autres semblables, qu'on observe en France et en Italie.
[FN: § 1714-2]
Le Giornale d'Italia, 10 octobre 1913, donne la liste des revenus professionnels des députés, empruntée à la Riforma Sociale. Il y a 22 avocats avec un revenu de 10 000 fr. et plus ; le plus gros revenu est de 30 000 fr... Viennent ensuite 42 avocats, qui gagnent de 5000 à 9000 fr. 42 autres avocats gagnent de 2000 à 4800 fr. 21 autres avocats ne gagnent que 700 à 1900 fr. (pauvres gens !). 7 autres ne figurent pas aux rôles de la fortune mobilière. Il y a 17 médecins. « Les autres revenus n'y sont pas représentés. Un seul touche 10 000 fr. ; trois autres atteignent 6000 et plus. De là, on descend tout à coup au-dessous de 4000, jusqu'à un minimum de 1000 fr. ». Ingénieurs et architectes : « Ils sont peu nombreux, et parmi eux un seul a un revenu important (25 000 fr.) ». Plusieurs des députés mentionnés dans la liste sont très connus, et tout le monde sait qu'ils retirent de leur profession beaucoup plus que la somme déclarée : le double, le triple et peut-être même le quintuple. On peut faire des observations analogues pour les sénateurs. Comment se fait-il donc que les parlementaires puissent faire accepter la déclaration de ces revenus pour le paiement de l'impôt ? Un correspondant du même journal (12 octobre 1913) va nous le dire : « À propos de la reproduction que nous avons donnée des résultats de l'intéressante enquête que la Riforma sociale publiera dans son prochain numéro, M. Antonio Corvini, président du Comité provincial de Rome des employés aux contributions directes, écrit une lettre dont nous donnons les passages importants. La voici : „ Les agents des contributions, dans l'accomplissement de leur tâche difficile, n'ont eu et n'ont pas de faiblesses ou de craintes révérencielles pour les députés et les sénateurs. Si donc, pour beaucoup d'entre eux, il faut regretter une taxation trop basse, c'est en divers systèmes et chez d'autres personnes qu'il faut rechercher et déplorer la faute. Il faut savoir, en effet, que si l'agent propose la détermination du revenu dans une mesure donnée, le contribuable peut recourir à des commissions spéciales, qui sont les juges de la controverse, lesquels ne sont pas toujours dépourvus de passions ni désintéressés. Malheureusement, en Italie, ces commissions communales et provinciales émanent directement des partis locaux, lesquels, à leur tour, ne sont que l'expression de monsieur le député, ou de monsieur le sénateur, qui, par ce fait, même sans l'angélique bonté de l'agent des contributions, obtiennent tout ce qu'ils veulent ou croient être justice à leur égard. C'est là un défaut commun à toute l'organisation administrative de notre pays : l'autorité politique qui s'impose et se superpose aux organes du pouvoir exécutif “... ». À la Chambre, dans la séance du 25 juin 1914, l'honorable E. Chiesa rappela que plusieurs députés payaient l'impôt de fortune mobilière sur un revenu évidemment inférieur à la vérité. On lui répondit par des propos malveillants ou des observations entièrement étrangères au sujet, mais personne n'osa nier, ou seulement mettre en doute la vérité des faits.
[FN: § 1715-1]
En Italie, en 1910, le commandeur Calabrese, substitut du procureur du roi et rapporteur d'une sous-commission chargée de préparer un projet de loi sur la presse, proposait d'exiger une caution de 500 fr. à 10 000 fr. de quiconque voudrait publier un journal. Le directeur du journal devait avoir la licence gymnasiale. Enfin, il devait y avoir des commissions de surveillance chargées de surveiller les journaux, afin qu'ils n'imprimassent rien de « contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à l'éducation civique et familiale ». Ces commissions auraient notifié, par l'intermédiaire d'huissiers, leurs décisions aux directeurs et aux gérants du journal, lesquels auraient dû insérer ces décisions dans le numéro suivant du même journal, sous peine de 200 fr. d'amende. Le commandeur Calabrese se donnait même la peine d'enseigner à ces commissions leur métier, et écrivait : « Au lieu d'exercer une influence calmante sur le public, au lieu d'en être le modérateur, le journal spécule sur l'émotivité des lecteurs. Ainsi, il me semble qu'il donne un relief excessif à tout ce qui est dramatique, passionnel, romantique, aux procès, aux assassinats, même s'ils ont lieu à l'intérieur de la Chine ou de la Patagonie ». On pourrait observer qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, et qu'il n'y a pas lieu de faire cas des fantaisies qui peuvent passer par la tête d'un esprit bizarre. Mais à l'occasion de ces plaisantes inventions du commandeur Calabrese, une enquête fut faite par le Corriere d'Italia, et beaucoup de personnes d'autorité, tout en divergeant d'opinion d'avec le commandeur Calabrese sur les moyens, partageaient son avis sur le but à atteindre. Les hirondelles étaient donc tout un vol. Pour ne pas trop allonger cette note, nous nous bornerons à citer l'opinion du sénateur Filomussi Guelfi, professeur de philosophie du droit : « Mon œuvre de philosophe et de juriste s'inspire de cette conception fondamentale que le droit a sa base dans la morale, et que, par conséquent, il est logique que tout attentat à la moralité doive être réprimé par le droit. Et comme la presse ne néglige, de nos jours, aucune occasion ni aucun prétexte de violer les règles des mœurs, l'œuvre de la presse doit être soumise aussi à une sanction nouvelle et plus efficace. La censure a un passé odieux, une tradition ingrate pour nous autres Italiens. Elle nous rappelle de vieilles erreurs, de vieilles oppressions, de vieilles et curieuses intempérances ; elle évoque à nouveau pour nous l'Espagne et le régime espagnol ; en un mot, elle a une efficacité toujours discutable. Il s'agirait au contraire, à mon avis, d'imaginer de plus énergiques mesures répressives : d'infliger, dans les cas les plus caractéristiques d'attentat aux règles et aux lois tutélaires de la moralité, des punitions et des condamnations exemplaires. À mon avis, on devrait exercer une action éminemment répressive, qui ensuite, par la nature même du facteur juridique, deviendrait naturellement et spontanément préventive ». En juin 1914, un journal républicain d'Ancône publia un article dans lequel il paraît qu'il offensait la mémoire de Victor-Emmanuel II, dont vraiment la vie appartient maintenant à l'histoire. Si l'on prenait l'article pour ce qu'il était, c'est-à-dire politique, on ne pouvait saisir le journal ; et si on voulait le poursuivre, il fallait le traduire en Cour d'assises, où, selon toute probabilité, il aurait été acquitté. Par un tour de passe-passe, le gouvernement voulut considérer l'article comme coupable d'« offense à la pudeur », changeant ainsi pour le moins l'accessoire en principal. De la sorte, il put saisir le journal, le faire condamner par ses juges, et par-dessus le marché faire le procès à huis clos. Il faut prendre garde au fait que, dans des conditions analogues, la Restauration, en France, n'osa pas faire à huis clos le procès de P.-L. Courier, accusé lui aussi d'« offense à la morale publique », pour un opuscule évidemment politique.
[FN: § 1715-2]
Il y a trois rapports de la censure, qui concluent à l'interdiction de la représentation, laquelle fut ensuite accordée par le ministre Morny. – La censure sous Napoléon III. La Dame aux Camélias. Premier rapport : « (p. 10) …Cette analyse, quoique fort incomplète sous le double rapport des incidents et des détails scandaleux qui animent l'action, suffira néanmoins pour indiquer tout ce que cette pièce a de choquant au point de vue de la morale et de la pudeur publiques. C'est un tableau dans lequel le choix des personnages et la crudité des couleurs dépassent les limites les plus avancées de la tolérance théâtrale ». Et pourtant, aujourd'hui, on joue ce drame partout sans le moindre inconvénient. L'histoire de la Dame aux Camélias est un exemple remarquable des efforts que tentent parfois les gouvernements pour agir sur les mœurs en s'attaquant aux dérivations, et de la parfaite inanité de cette oeuvre (§1883). HALLAYS-DABOT ; loc. cit. §1749-1 : « (p. 15) La Dame aux Camélias fut longtemps interdite. Elle ne put être représentée qu'à la faveur d'une révolution. Le coup d'État du 2 décembre et l'avènement de M. de Morny au ministère décidèrent de son sort. Aujourd'hui [en 1871] le public est familiarisé avec le spectacle du monde interlope qui, depuis dix-huit ans, a envahi et, pour ainsi dire, absorbé le théâtre... Mais il y a vingt ans le vice avait des allures moins effrontées et plus casanières ; il gardait jusqu'à un certain point la pudeur de sa dégradation. Les réhabilitations sans nombre du drame et du roman ne lui avaient point fait un piédestal ». Il faudrait dire, en intervertissant les termes, que les changements des mœurs avaient provoqué l'éclosion des drames et des romans. L'auteur nous en donne lui-même des preuves dans son ouvrage cité §1747-1. Après thermidor « (p. 196) la censure laisse s'opérer dans les spectacles un mouvement de réaction des plus prononcé. Le théâtre, suivant toutes les fluctuations de l'opinion et tous les revirements de la politique, sera tantôt royaliste, tantôt républicain, selon le parti qui tiendra le pouvoir. » « (p. 220) La censure, sous l'Empire [de Napoléon 1er], était secondée par le public dans son travail d'épuration morale des théâtres. Il s'était fait une singulière réaction. Après toutes les débauches d'imagination, après tous les dévergondages d'esprit qui s'étaient produits sur les théâtres parisiens pendant plus de dix années, la lassitude et le dégoût s'étaient emparés des spectateurs ; se laissant emporter rapidement sur une pente contraire, ils en étaient arrivés à une pudibonderie intolérante [comme les vertuistes de nos jours]. Les gens éclairés gardaient toutes leurs admirations pour les grandes douleurs tragiques, le peuple n'avait d'oreilles que pour les lourds et larmoyants mélodrames. On ne voulait plus rire. Il est curieux de voir les censeurs s'inquiéter de cette pruderie des spectateurs ». La Dame aux Camélias a été la bête noire de bon nombre d'auteurs, qui s'imaginent que la morale peut être imposée par la suppression de certaines dérivations. – Mémoires du comte HORACE DE VIEL CASTEL, t. II, mercredi 11 février [1852] : « (p. 311) J'ai assisté hier à la représentation d'un drame d'Alexandre Dumas fils, joué au Vaudeville. Les théâtres sont soumis à la censure établie pour les forcer à respecter la morale, la pudeur publique, les bonnes mœurs [dans ses mémoires, Viel Castel décrit ces bonnes mœurs de son temps comme fort mauvaises]. La Dame aux Camélias, le drame d'Alexandre Dumas fils, est une insulte à tout ce que la censure devrait faire respecter. Cette pièce est une honte pour l'époque qui la supporte [c'est ce que répètent, pour d'autres productions, nos vertuistes contemporains], (p. 35) pour le gouvernement qui la tolère, pour le public qui l'applaudit [on a dit cela aussi du public qui applaudit le Phalène et d'autres semblables productions dramatiques] ...Toute cette pièce sur le vice et la débauche ; tous les acteurs en sont monstrueux, ceux-mêmes sur lesquels l'auteur a voulu répandre de l'intérêt sont ignobles... Il n'y a, pas à analyser une telle turpitude, c'est ignoble, mais le spectacle que présente la salle l'est encore plus... (p. 86) La police, le gouvernement tolèrent tous ces scandales, ils semblent ignorer que c'est ainsi qu'on achève la démoralisation d'un peuple ». En 1913, l'Académie française refusa de prendre part à la fête du bicentenaire de Diderot. Rendons-lui grâce de ce qu'elle ne réclame pas qu'on brûle les oeuvres de cet écrivain, et qu'on mette en prison quiconque les préfère aux ouvrages insipides de plusieurs académiciens.
[FN: § 1715-3]
Il est remarquable que les hommes pratiques, lorsqu'il ne s'agit pas de leur propre foi, voient à l'occasion très clairement ces phénomènes. BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II : « (p. 183) Dans la politique comme sur le terrain de la foi religieuse, il ne peut jamais être opposé d'autre (p. 184) argument par le conservateur au libéral, par le royaliste au républicain, par le croyant à l'incrédule que ce thème rebattu dans les mille variations de l'éloquence [il y a, dans cette observation, le germe de toute la théorie des résidus et des dérivations] „ Mes convictions politiques sont justes et les tiennes sont fausses ; ma croyance est agréable à Dieu, ton incrédulité mène à la damnation “. Il est donc explicable que des guerres de religion sortent des divergences d'opinions religieuses et que les luttes politiques des partis, si toutefois elles ne se vident pas par la guerre civile, aboutissent du moins à la suppression des bornes que maintiennent dans la vie sociale, étrangère à la politique, la décence et l'honneur des gens de bonne compagnie ». Bismarck ne pensait qu'à la politique, mais son observation s'applique à la religion, à la morale, etc. Il conclut fort bien : « Mais, dès que devant sa conscience et devant le groupe on peut alléguer qu'on agit dans l'intérêt du parti [ou de sa propre foi, d'une façon générale], toute infamie passe pour permise ou du moins pour excusable ».
[FN: § 1716-1a]
Un livre excellent sur le sujet traité ici a été publié après que ces lignes ont été écrites. Voir : DANIEL BELLET ; Le mépris des lois et ses conséquences sociales, Paris, Flammarion éditeur, 1918.
[FN: § 1716-1]
Qu'on examine un catalogue de livres et d'opuscules de notre temps : on en trouvera un très grand nombre qui cherchent le moyen d'être utiles aux délinquants ; de réaliser leur « relèvement moral », d'inventer de nouvelles mesures en leur faveur, telles que la « loi du pardon », la condamnation conditionnelle, la libération conditionnelle, la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire, et ainsi de suite. Qu'on cherche ensuite les livres et les opuscules ayant pour but de sauvegarder les honnêtes gens des assassinats, des vols et d'autres délits, et l'on n'en trouvera que peu, très peu. La non-inscription de la condamnation au casier judiciaire est un excellent moyen d'induire en erreur l'honnête homme, qui prendra chez lui l'honorable malfaiteur ou l'emploiera d'une façon quelconque, et lui permettra ainsi de renouveler ses louables exploits. Mais cela importe peu : le désir d'être utile au malfaiteur, d'en protéger l'intégrité personnelle, domine toute autre considération. – Union Suisse pour la sauvegarde des Crédits, à Genève. Rapport du 233 février 1910 : « (p. 34) Nous avons eu plusieurs fois déjà à signaler dans nos rapports la position difficile qui nous est faite au sujet des antécédents judiciaires. Les négociants qui sont sur le point d'entrer en relations avec quelqu'un pour de l'emploi ou pour autre chose exigeant qu'on puisse avoir entière confiance, veulent savoir à qui ils ont affaire. D'autre part, les juristes écrivant sur la question prétendent que les méfaits ne doivent plus leur être rappelés, et leur point de vue est admis aussi par des personnes généralement en dehors des affaires, qui s'occupent de sociologie et de patronage. Il n'y a guère moyen de s'entendre, les uns, les commerçants, étant exposés à souffrir en donnant sans le savoir la préférence au candidat qui a des antécédents ; tandis que les autres, généralement des gens de profession libérale, ne sont jamais appelés à prendre les intéressés à leur propre service ».
[FN: § 1716-2]
A. BAYET ; Leçons de Morale, dans la collection AULARD : « (p. 114) Certaines personnes prétendent qu'il est permis de voler les gens très riches qui possèdent une grande fortune, bien qu'ils n'aient jamais travaillé... Ceux qui parlent ainsi ont tort. Sans doute il N'EST PAS JUSTE [ces termes et les suivants sont soulignés par l'auteur] qu'on puisse être riche sans travailler ; il n'est pas juste non plus que ceux qui travaillent soient pauvres, et tout le monde doit désirer que cela change. Mais pour que cela change, il suffit d'élire des députés et des sénateurs qui soient les amis des travailleurs pauvres ; et ces députés feront des lois pour que chacun soit plus ou moins riche, selon son travail. En attendant, il ne faut pas voler les gens riches ». On prendra bien garde que le motif qui doit détourner de faire cela est uniquement d'opportunité : il ne convient pas de faire maintenant et directement ce qu'on pourra bientôt obtenir de la loi. L'opinion exprimée dans le manuel de Bayet est importante, parce que ce manuel est généralement en usage dans les écoles primaires, en France, et parce qu'on a proposé une loi pour punir d'une peine de six jours à un mois de prison et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. ceux qui oseraient blâmer trop ouvertement l'enseignement de l'école laïque. – G. BERTHOULAT, dans La Liberté, 10 novembre 1912, dit en parlant de cette loi proposée par le ministre Viviani : « En somme, M. Viviani, fougueux libertaire, supprime froidement, sous prétexte de défense laïque, la liberté d'écrire, de parler et de penser. Il y aurait désormais un Syllabus primaire duquel il sera interdit de mal parler, ainsi que de ses pontifes, sous peine d'avoir affaire aux gendarmes ». Nous n'avons pas à rechercher ici si cela est utile ou nuisible à la société. Nous rappelons ces faits uniquement comme preuve de l'intensité de certains sentiments.
[FN: § 1716-3]
La plus grande partie des experts médecins – ou psychiatres, comme ils veulent qu'on les appelle – nommés par la défense, dans les procès criminels, s'évertuent à accuser la « Société », qui n'a pas eu tous les égards voulus envers le pauvre délinquant. Ces braves gens confondent l'étude des aliénés avec celle des conditions des sociétés humaines. Comme type de ce genre d'élucubrations, voici, selon le Giornale d'Italia, 18 mai 1913, comment parla devant les assises l'expert de la défense de la Farneris (Yvonne de Villespreux), laquelle avait tué son amant : « Suivez-la un peu dans son jeune âge : son enfance n’a été éclairée par aucune affection de famille, par aucune éducation, par aucun sentiment élevé. Le professeur P. a dit que le sens moral lui fait défaut. Et comment l'aurait-elle ? Elle ne peut posséder ce sens, si elle manque de tous les éléments qui sont nécessaires a le développer et à le faire évoluer. Dans la vie, elle a trouvé toujours des obstacles à tout ce qui était ses sentiments intimes mais non encore développés, et par conséquent elle n'a connu que l'idéal (sic) de la société, mais non l'amour. Elle est tombée comme tombent toutes les femmes et tous les hommes qui ont vécu comme elle. Il existe en elle un grand nombre de signes anthropologiques de dégénérescence ; ils ont une valeur limitée. Il est très probable cependant, qu'ils ont une part dans le genre de vie de la Villespreux ; et son impulsivité est précisément en rapport avec ce faible développement du sens moral, qui est la meilleure expression du (sic) sentiment. Le sens moral implique pourtant un grand respect envers la société et un grand amour. Quel respect et quel amour pouvait avoir la Villespreux pour la société ? Qu'avait-elle eu de celle-ci ? Généralement, le sens moral fait défaut toujours (sic) par la faute de la société, c'est-à-dire par un effet biologique. On sent en elle aussi l'hystérie, et précisément en ce sens large, comme dit le professeur P., qu'elle la rend changeante en toutes ses idées, parce qu'il n'y a pas d'organisation, et que ses produits mentaux sont précisément le résultat de cette désorganisation ». Donc, c'est entendu : chaque fois que le sens moral fait défaut à quelque délinquant, c'est la « faute » de dame « Société » ; mais est-ce aussi sa faute, si le sens scientifique fait défaut dans les discours des experts ? (§1766-1). L'expert de l'accusation, lui aussi, parlait de tout autre chose que de science médicale, tant et si bien qu'il fut remis à l'ordre par le président : « J'aurais voulu ne pas prendre part à cette discussion ; mais puisque je n'ai pu obtenir d'en être dispensé, je suis contraint de vous faire préalablement un tableau qui fasse ressortir la figure morale de cette malheureuse, et qui mette dans sa vraie lumière l'ambiance dans laquelle elle a vécu. Vous avez entendu comment elle a été, élevée par une certaine Giordano, qui la gardait en sa maison et lui tenait lieu de marâtre. Cette femme n'avait aucune des tendresses maternelles, et souvent, la pauvre Farneris souffrait de jeûnes et de mauvais traitements de tout genre, sentant la honte ignominieuse de n'être qu'une bâtarde. – Président. Mais, prof. P ., vous ne pouvez continuer ainsi, parce que vous devez nous dire de quelles preuves vous avez tiré ces éléments. – Prof. P. Mais, monsieur le Président... – Prés. Non, non, vous ne pouvez continuer ainsi. Vous devez nous dire sur quels faits vous vous fondez. – Prof. P. Mais ces faits sont résultés des débats. Il m'importe que vous ayez un tableau complet de l'accusée. – Prés. Mais cela ne peut être permis que sur la base de faits assurés. – Prof. P. Bien, laissons de côté les premières années. Nous savons qu'à treize ans, elle se trouva désemparée, et tout secours et tout guide lui fit défaut sur le chemin de la vie. Elle se trouva ainsi seule au milieu de la société, et dès le premier jour, elle se recommanda à une amie, pour qu'elle la fît aller en France, à la recherche d'un oncle maternel. Mais cela, elle ne put l'obtenir. Elle se rendit, au contraire, à Turin où elle trouva de l'emploi comme femme de chambre. Mais la Farneris n'avait rien de la femme de chambre. – Prés. Mais ces choses, qui vous les a dites ? – Prof. P. La Farneris. – Prés. Bien. – Prof. P. (continuant). La patronne était très violente. Un jour, elle jeta un chandelier contre la Farneris. Celle-ci s'échappa de la maison, et rencontra un homme dans l'escalier. – Prés. Mais cela, vous ne pouvez pas le dire. Comment continuer ainsi ? » – Reste ensuite à savoir pourquoi il doit être permis à ces gens, auxquels, par la « faute » de la « Société », le sens moral fait défaut, de se promener librement par le monde, et de tuer qui bon leur semble, faisant ainsi payer à un seul la « faute » qui est celle de tous les membres de la « Société ». Si du moins messieurs les humanitaires voulaient permettre que ces excellentes personnes, auxquelles, par la « faute » de la « Société », le sens moral fait défaut, fussent contraintes de porter quelque insigne bien visible sur leur vêtement, les gens pourraient les éviter, quand ils les verraient venir. Le fait raconté tout à l'heure a un épilogue. La « Société » si coupable envers la Farneris, racheta sa faute, au moins en partie, en la pourvoyant d'experts qui surent si bien la défendre, et de jurés qui, pour faire justice, l'acquittèrent entièrement. De plus, le président du tribunal lui fit, après l'acquittement, une belle allocution paternelle, l'exhortant a se « racheter par le travail ». Afin de lui donner le moyen de le faire, d'excellentes dames du beau monde vinrent la prendre en automobile, pour la conduire dans un refuge. Il est de pauvres mères de famille qui préfèrent élever honnêtement leurs enfants, au lieu de s'adonner à la vie joyeuse en accusant la « Société ». Si quelqu'une d'entre elles a entendu et vu tout cela, elle a peut-être pensé que dans les « fautes » de la « Société », à quelque chose malheur est bon : et si elle a entendu et vu la suite, elle a peut-être compris que si jadis le pécheur qui se convertissait pouvait être préféré au juste, aujourd'hui, grâce a la religion nouvelle du dieu Progrès, la conversion n'est même plus nécessaire. En effet, voici comment le Giornale d'Italia cité, enregistre la fin du drame : « Naples, 30 mai. – Les lecteurs se souviendront des paroles par lesquelles le président de la Cour d'assise, immédiatement après le verdict d'acquittement, exhortait la Villespreux à commencer une vie de travail qui puisse la racheter. Ils se souviendront aussi qu'un comité de nobles dames s'était intéressé à ce que la Farneris fût admise dans l'hospice qui reçoit les détenues libérées. Ce jour-là, après avoir prononcé quelques paroles de remerciements, la Villespreux s'excusa, disant qu'elle devait aller à la prison pour y prendre ses vêtements. Mais au retour de la prison, elle ne voulut plus suivre ces messieurs du patronat, et s'en alla sans qu'on n'eût plus de nouvelles d'elle. Le lendemain, on sut qu'elle était retournée via Chiaia, dans la maison contiguë à celle où fut tué Ettore Turdò, et précisément dans la maison de ce témoin qui, à l'audience, dit que Yvonne était une bonne fille, et qu'elle allait toujours chez lui, en venant à Naples, après les voyages qu'elle faisait en fille joyeuse. Elle est revenue dans cette maison, après avoir été acquittée d'un délit, et après avoir pleuré, comme elle disait, durant trente-huit mois la mort du pauvre Turdò. Et pourquoi tout cela devrait-il être un mal, ou mieux pourquoi tout cela devrait-il l'exprimer ? La Farneris a encore du temps pour se livrer au travail, et pour commencer sa vie de rédemption, peut-être dans la maison même où elle aurait dû terminer celle du déshonneur. Mais nous manquerions à l'un de nos devoirs, si nous n'enregistrions pas ce dernier acte du drame, de même que nous avons enregistré tout ce qui put absoudre cette femme. La nouvelle répandue en ville a causé une grande surprise ». Ceux qui ont été si surpris étaient probablement très humanitaires ou un peu naïfs. Il se peut aussi que ces deux caractères se trouvassent réunis en eux.
[FN: § 1716-4]
On observe des faits semblables dans d'autres pays aussi. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué (§1638), beaucoup de gens cherchent un condamné à « réhabiliter », dans le but de se faire connaître et de gagner de l'argent. À propos de la « réhabilitation » tentée en faveur de la Lafarge, MAURICE SPRONCK écrit dans La Liberté, 5 février 1913 : « Dans les pays musulmans, il existe ainsi des moines, les derviches hurleurs et tourneurs, dont l'occupation principale consiste, en certaines occasions, à pivoter de plus en plus rapidement sur eux-mêmes comme des toupies en poussant des cris éperdus de : Allah ou ! Allah ou ! Dans un délai plus ou moins long, ceux qui se livrent à ces exercices rotatifs et tumultueux tombent en un pieux délire ; ils voient les jardins et les sources fraîches du paradis de Mahomet et les houris qui attendent les fidèles. Chacun peut se rendre compte, en effet, que, après avoir suffisamment tourné et hurlé, on doit voir à peu près tout ce qu'on veut. De même, quand on a abondamment trépidé et crié à propos d'un procès quelconque, sur lequel on ne possède que des notions vagues, il semble infiniment probable qu'on se trouve dans un état de béatitude où toutes les hallucinations sont possibles ; la Justice et la Vérité descendent sur les nuages ; la Lumière se met en marche ; c'est la forme laïque de l'extase, la seule qui convienne à des esprits scientifiques et émancipés de toutes superstitions surannées. L'unique question intéressante serait maintenant de savoir si Mme Lafarge constitue un bon sujet pour la culture des crises extatiques. Nous n'en sommes pas sûrs. D'abord, elle est morte depuis longtemps ; on possède d'elle à peine quelques portraits qui nous la montrent habillée selon des modes désuètes ; et puis, il sera difficile de déchaîner, à propos de ses aventures, de profondes passions politiques ou religieuses ; elle était fâcheusement cléricale, savez-vous, si nous en croyons sa correspondance avec des curés, que vient de publier une de nos revues littéraires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une femme qui n'est pas même une victime des jésuites ? Un examen sérieux de son affaire aurait pu éveiller l'attention de ceux qui s'intéressent à l'histoire des mœurs et aux études de psychologie. C'était déjà là un groupe restreint. La révision de son procès, menée à coups de meetings, n'attirera plus que quelques intellectuels de l'anarchisme, – mince phalange ; d'autant plus mince que ces intellectuels ont vraiment, dans les faits de notre vie quotidienne, d'autres occasions autrement palpitantes d'exercer leurs facultés et de s'échauffer le tempérament. En ce moment même, quelques-uns d'entre eux ont déjà fondé une association qui a pour but d'accorder à tout citoyen le droit de transformer son habitation en lieu d'asile pour les assassins et les cambrioleurs, dès l'instant où ceux-ci font profession d'anarchie. Par le temps qui court, avec la parfaite sécurité dans les rues que nous a value l'énervement de la répression pénale, il n'y a évidemment pas d'idée plus opportune ; il est excellent que les protecteurs et amis des plus redoutables escarpes sachent que la loi les protège et qu'ils ne peuvent être inquiétés par la police. Et, comme un de ces philanthropes au moins se trouve actuellement sur les bancs de la cour d'assises, sous prévention de complicité dans un assassinat, on comprend, si le jury le déclare coupable, à quel point ce sera une besogne plus urgente de réhabiliter ce sympathique personnage, que de s'occuper de Mme Lafarge et de discuter la quantité d'arsenic contenue dans les viscères de son mari ! »
[FN: § 1716-5]
Les faits qu'on pourrait citer sont en nombre infini. En voici deux comme types : le premier d'un délinquant particulier, le second d'une collectivité : « La Liberté, 29 mars 1913. Creil. – La gendarmerie de Creil vient d'arrêter un individu dont l'odyssée est loin d'être banale, André Pavier, jeune homme de 27 ans, qui, en 1911, s'évada du pénitencier de Douera (Algérie). Pavier est originaire de Saint-Denis. À l'âge de la conscription, il fut incorporé dans l'infanterie coloniale, commit des frasques qui le conduisirent en conseil de guerre, gifla le colonel qui présidait la séance, fut condamné à mort, bénéficia d'une commutation de la peine en 5 ans de prison et fut envoyé au pénitencier de Douera. Il n'avait plus que deux années à faire, lorsqu'un jour, profitant d'un moment d'inattention du sergent, il assomma le soldat indigène préposé à la garde des prisonniers, s'enfuit vers le rivage, sauta dans la chaloupe du poste et gagna la haute mer sans être atteint par les projectiles qui lui étaient destinés. Des pêcheurs espagnols le recueillirent deux jours après, plus mort que vif, et le déposèrent sur la côte près de Valence. Pavier vécut alors de vols et de rapines. Il ne tarda pas à passer la frontière, traversa la France en évitant avec soin Saint-Denis et arriva à Lille vers juin 1912.
Il fut arrêté en cette ville sous l'inculpation de filouterie d'aliments et condamné à six jours de prison, mais on ignora tout de son passé. Depuis trois mois Pavier s'était fixé à Villers-Saint-Paul, près de Creil. Il y travaillait dans une usine voisine située sur la ligne de Creil à Compiègne. C'est à Villers qu'il a été arrêté. Il y a quelques jours – Pavier se flatte d'avoir de hautes relations – il écrivit à un député, lui demandant si une amnistie n'avait pas été votée intéressant les gens dans son cas. Très complaisamment, le député lui répondit qu'aucune amnistie n'était intervenue et termina sa lettre en conseillant très vivement à son correspondant de redoubler de précautions s'il ne voulait pas se faire arrêter. La lettre du député parvint aux mains de la police et c'est ainsi que Pavier fut découvert ». – La Liberté, 6 avril 1912 : La grâce des émeutiers de la Marne. L'article est trop long pour que nous le transcrivions en entier, ce qui pourtant serait utile pour faire connaître les caractères généraux de ces faits, qu'on observe souvent, non seulement en France, mais aussi en Italie et en d'autres pays. Nous supprimons les noms propres, parce que la principale erreur, en cette matière, consiste précisément à rendre un homme responsable de ce qui est l'effet d'organisations sociales. On dit, en parlant d'un ministre : « Après avoir surveillé la marche de l'instruction judiciaire, après avoir rétréci le cercle des sévérités pénales autour de quelques têtes qui avaient surgi en trop évidente clarté dans la flambée des châteaux et des celliers, il lui restait à sauver les derniers soldats de l'émeute condamnés par les tribunaux de la Marne et la Cour d'Assises de Douai. C'est fait. Plus un éventreur de tonneaux, plus un pillard n'est enfermé dans les geôles de la République. M. le sénateur *** a payé aux émeutiers la dette de sa reconnaissance politique... Ce fut un douloureux calvaire judiciaire que l'instruction de ces troubles et de ces crimes. Par ordre, la procédure fut communiquée le 20 mai 1911 à M. le garde des sceaux, qui était alors M. Perrier ; les pièces ne retournèrent au parquet que huit ou dix jours après, puisque l'ordonnance du juge d'instruction n'a été rendue que le 3 juin. En quel état le dossier fit-il retour au greffe du parquet de Reims ? Le gouvernement, qui avait empêché, plusieurs documents importants d'arriver au cabinet du juge d'instruction pendant l'enquête, ne prit-il pas ses sûretés en ce qui concerne la preuve des responsabilités politiques engagées dans l'affaire ? Quoi qu'il en soit, en dépit des manœuvres de M. Vallé et de la pression gouvernementale qui en répercutait l'écho aux portes de l'instruction, quelques douzaines d'émeutiers furent renvoyés en Cour d'Assises ou traduits devant les tribunaux correctionnels. Sept furent condamnés par la Cour d'Assises de Douai à des peines variant entre 4 ans et un mois de prison. De son côté, la Cour d'Appel confirma treize condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels de la Marne et pour sept d'entre elles éleva la peine de 10 mois à 18 mois... Que faut-il penser des actes qui amenèrent leurs auteurs devant la justice criminelle ? Les arrêts de renvoi en Cour d'Assises et l'acte d'accusation concernant les émeutiers condamnés vont nous le rappeler. Le premier est accusé d'avoir volontairement mis le feu à la maison Gallois et d'avoir commis le crime de pillage dans la maison Bissinger. On le voit sur le toit de la maison Gallois ; il enlève les tuiles et jette à l'intérieur des sarments enflammés [c'est l'auteur qui souligne ce passage et les suivants]. Le feu s'est déclaré aussitôt et la maison a été consumée. Le second est accusé du crime de pillage dans les maisons... Le drapeau rouge à la main, il guide les émeutiers vers les portes de ces maisons qui sont enfoncées. Le troisième s'acharna pendant deux heures à la destruction du coffre-fort de la maison Bissinger. Après l'avoir défoncé à l'aide d'une pince en fer, il brûla les titres, les pièces de comptabilité et tous les papiers de commerce. Le quatrième a également pris part au sac de la maison Bissinger. Le cinquième sonne le tocsin pour donner le signal du pillage de la maison Ayala et de la maison Deutz. Il brise une palissade pour pénétrer dans la maison... Les décrets de grâce sont rendus le 9 février. Le 15 on signale des sabotages à Pommery ; le 21, le 22 et le 25, d'autres sabotages sont commis à Hautvilliers, à Cumières, etc. ». C'est là la monnaie dont les politiciens paient leurs électeurs, précisément comme autrefois les chefs de bandes payaient leurs hommes.
[FN: § 1716-6]
Laissons de côté certains procès comme celui de la Steinheil, où l'accusée jouit de hautes protections ou de complicités politiques. Ceux-là sont étrangers aux sujets. Mais en d'autres procès, où ces protections ou complicités n'existent pas, on voit l'accusé le prendre de haut avec le président de la Cour d'assises. Parmi beaucoup d'exemples, le suivant suffira. En février 1913, eut lieu, devant la Cour d'assises de la Seine, le procès de la bande de malfaiteurs connue sous le nom de bande Bonnot et Garnier. Voici quelques fragments de l'interrogatoire des accusés : D. (Président) Vous êtes poursuivi dans votre pays à l'occasion de vos idées. – R. (Callemin, dit Raymond la Science). Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas ici d'un procès politique, et vous ne parlez que de politique et d'anarchie. – D. Vous voulez dire que je manque de logique. Cela m'est égal. Je conduis mon interrogatoire comme il me plaît. – R. Eh bien, je ne vous répondrai pas, quand cela me plaira, voilà tout ! – D. C'est votre affaire. – En fait, Callemin laisse passer quelques questions sans fournir de réponse ». Suivent d'autres demandes, auxquelles l'accusé répond avec l'insolence habituelle, et après l'une d'elles, « comme le président conteste la véracité de cette explication, Callemin s'emporte. Le Président. Je fais mon devoir ! – Callemin. Pas de la bonne façon. Un individu a écrit : „ J'appelle un chat un chat et Rollet un fripon “. Vous agissez, vous, avec la plus entière mauvaise foi. – Président. Vos injures ne m'atteignent pas. Continuons ». En d'autres temps, on aurait procédé séance tenante à la répression des injures aux magistrats. À un certain point de l'interrogatoire d’un autre accusé, l'avocat intervient aussi pour remettre à l'ordre ce pauvre président. « Comme dans la salle se font entendre quelques rumeurs dont il est impossible de préciser le sens, M. le président Coninaud s'élève contre cette manifestation : „ Je ne veux pas qu'on manifeste contre les accusés “. „ C'est contre vous qu'on manifeste “, réplique M. de Moro-Giafferi. Nous avons un public d'une générosité [sic, non pas imbécillité] admirable. – „ Je ne veux pas “, reprend M. Coninaud, „ qu'on manifeste ni pour moi, ni pour ni contre vous “ ». La vérité nous oblige d'ajouter que le président ne fut pas conduit en prison par les gendarmes.
[FN: § 1718-1]
Manuel, VII, 47, p. 397.
[FN: § 1718-2]
On peut souvent pousser plus loin les recherches, et séparer les diverses parties d'un phénomène. Un grand nombre de phénomènes sont constitués par des variations de diverses entités. Par exemple, si le phénomène concret est figuré par mnpqrstv, on observe : 1° que cette ligne oscille autour de la ligne ondulée MNPQ ; 2° que cette ligne oscille, à son tour, autour de la ligne AB. En d'autres termes, il y a des oscillations d'ampleur différente ; soit : 1° des oscillations de courte durée indiquées par la ligne mnpqrstv ; 2° des oscillations d'ampleur moyenne, indiquées par la ligne MNPQ ; 3° des oscillations de plus grande ampleur, indiquées par la ligne AB ; et ainsi de suite. L'interpolation nous permet de séparer ces diverses espèces d'oscillations. V. PARETO ; Quelques exemples d'application des méthodes d'interpolation à la statistique, dans Journal de la Société de Statistique de Paris, novembre 1897 : « Lorsqu'on applique cette formule aux chiffres que donne la statistique, on observe, en général, que les courbes simples qu'on obtient successivement ne vont pas en se rapprochant d'une manière uniforme de la courbe réelle, la précision commence d'abord par augmenter rapidement ; ensuite il y a une période où elle augmente lentement, de nouveau elle augmente rapidement, et ainsi de suite. Ces périodes pendant lesquelles la précision augmente lentement séparent les grands groupes de sinuosités dont nous avons parlé ; en d'autres termes elles séparent les groupes d'influences de plus en plus particulières qui s'exercent sur le phénomène ». Suit un exemple, qui est celui de la population de l'Angleterre, et l'on conclut : « On voit que les indices de précision croissent rapidement jusqu'à celui qui correspond ![]() ; ensuite ils croissent beaucoup plus lentement. Dans le cas que nous examinons, on trouve donc que sur la population agit un premier groupe de forces, qui donnent au phénomène la forme indiquée par les quatre premiers termes de la formule (2) : les autres termes représentent des perturbations, des irrégularités ». On trouvera d'autres exemples dans la suite (§2213 et sv.).
; ensuite ils croissent beaucoup plus lentement. Dans le cas que nous examinons, on trouve donc que sur la population agit un premier groupe de forces, qui donnent au phénomène la forme indiquée par les quatre premiers termes de la formule (2) : les autres termes représentent des perturbations, des irrégularités ». On trouvera d'autres exemples dans la suite (§2213 et sv.).
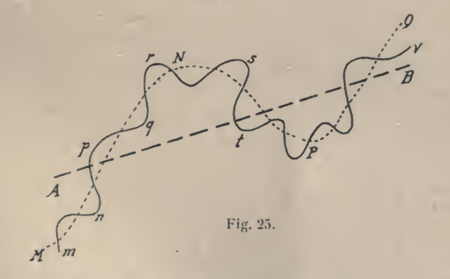
Figure 25
[FN: § 1719 bis-1]
Ces sentences ont donné lieu à beaucoup de paradoxes et de fantaisies littéraires ; souvent elles ont été entendues dans le sens qu'il n'y a pas de faits nouveaux, ce qui est faux. C'est là le défaut et le danger de ces sortes d'assertions qui manquent de précision : on en peut, tirer tout ce que l'on veut(§1558 et sv.,1797 et sv.). Comme exemple de paradoxes, on peut citer les deux volumes : Le vieux-neuf. Histoire ancienne des inventions et découvertes modernes par ÉDOUARD FOURNIER – Paris – 1859. L'auteur, par des rapprochements forcés et des analogies lointaines, souvent imaginaires, démontre que « p. 1) Il n'y a de nouveau que ce qui est oublié ». Parmi les nombreux exemples qu'on pourrait citer, de fantaisies littéraires, le suivant suffira. ÉMILE BERGERAT ; Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance– Paris – 1879 : « (p. 118) ...[Bergerat] La langue du XVIe siècle vous parait-elle suffisante à tout exprimer ? En un mot, admettez-vous les néologismes ? – [Gautier] Veux-tu parler de la nécessité de dénommer les soi-disant inventions et les prétendues découvertes modernes ? Oui, on dit cela : „ à choses nouvelles, mots nouveaux “. Tu connais mon avis là-dessus. Il n'y a pas de choses nouvelles. Ce qu'on appelle un progrès n'est que la remise en lumière de quelque lieu commun délaissé. J'imagine qu'Aristote en savait aussi long que Voltaire, et Platon que M. Cousin. Archimède avait très certainement trouvé l'application de la vapeur à la locomotion bien avant Fulton et Salomon de Caus. Si les Grecs ont dédaigné de s'en servir, c'est qu'ils avaient leurs raisons pour cela... »
[FN: § 1719 bis-2]
DUGAS MONTBEL ; Obs. Sur l'Iliade d'Hom., t. I : « (p. 70 – chant II, v. 38) ...Ici j'observerai que presque toujours le poète latin [Virgile] prend le mouvement de la phrase homérique, parce que c'est là qu'est l'expression de l'âme, qui ne change jamais. Les mœurs, les usages, les habitudes des hommes, sont sans cesse modifiés par la civilisation ; mais les passions ne varient pas selon les siècles, et la voix du cœur est la même dans tous les temps.
Il en est ainsi de tous les poètes. Lorsque Racine imite Homère, il suit aussi le même mouvement de phrase, quoique sa poésie soit empreinte (p. 71) des mœurs de son siècle, et qu'on y retrouve toutes les idées d'une société différente ». À propos des vers 116-117 du Ve chant, l'auteur cite des imitations de Virgile et de Boileau, et il ajoute : « (p. 280) Virgile et Boileau ne parlent point des cuisses des brebis et des chèvres, ni de la graisse qui les recouvre; leurs idées sont celles de leur siècle. Mais ils prennent à Homère tout ce qui tient à l'expression de l'âme ; voilà la véritable imitation, la seule que se permette le génie ». Plus loin : « (p. 296 – chant VI, v. 303) ...J'ai déjà fait observer bien souvent que si les imitateurs d'Homère diffèrent de lui pour les détails de mœurs, de coutumes, d'usages, ils s’attachent à le suivre avec une heureuse fidélité dans tout ce qui tient à l'expression des sentiments, expression qui ne peut varier, parce que le fond du cœur humain est toujours le même ».
[FN: § 1719-bis3]
Les utopistes qui veulent donner la « nature » de l'homme comme fondement à leurs études sur la société et sur les réformes suggérées par leur fertile imagination, cherchent, sans parfois s'en rendre bien compte, une partie constante que l'instinct les pousse à reconnaître dans les phénomènes sociaux : un terrain solide pour y développer leurs rêveries. Mais ils atteignent ce but à peu près comme l'homme qui s'imagine que le soleil se plonge chaque soir dans l'Océan, arrive à se rendre compte du mouvement des corps célestes.
[FN: § 1726-1]
CAT. : De re rust. – EURIP. ; Orest. L'auteur oppose aux politiciens, peste de la cité, un brave agriculteur. « (918) Il n'est pas de belle apparence, mais c'est un homme viril (919), qui fréquente peu la ville et le cercle de la place publique, (920) un de ces paysans qui seuls sauvent leur pays... ». Aristote aussi parle longuement d'un semblable sujet.
[FN: § 1728-1]
D. CYRILL. ; Contra Iulianum, 1, IV : « (p. 148) c'est pourquoi nous disions donc que si Dieu n'avait pas assigné à chaque peuple un gouverneur qui fût son sujet [à Dieu], ange ou démon, préposé à la réglementation et à la protection d'un genre particulier d'âmes, de façon à pouvoir établir des différences dans les lois et les mœurs, en ce cas il faudrait nous expliquer de quelle autre cause cela peut tirer son origine ». L'empereur discute avec ceux qui voulaient expliquer par la confusion des langues, survenue après la construction de la tour de Babel, la diversité des lois et des mœurs. Il dit qu'on voit aussi de semblables différences dans les corps ; « si l'on observe combien les Germains et les Scythes diffèrent des Libyens et des Éthiopiens, peut-on attribuer cela à un simple ordre, sans que ni l'air, ni la situation de la terre et les dispositions du ciel y aient part ? » Saint Cyrille répond que les chrétiens attribuent comme causes à la différence de la vie et des mœurs, des tendances de la volonté et les enseignements des ancêtres.
[FN: § 1731-1]
PH. HATT ; Des marées : « (p. 9) Newton a donné la première explication précise de la cause des marées : les considérations qu'il a développées sont de deux sortes. En concevant un canal circulaire entourant toute la terre, il analyse sommairement le mouvement horizontal des molécules qui s'y trouvent contenues sous l'influence des attractions des astres et observe qu'il doit entraîner une élévation et un abaissement successifs du niveau. Mais il envisage la question de plus haut pour arriver (p. 10) à la théorie analytique du phénomène ; sans se préoccuper du mouvement des molécules, Newton cherche la figure momentanée d'équilibre que prendrait la masse des eaux sous l'influence de la force attractive d'un astre et détermine la forme et la dimension de la surface, qui serait celle d'un ellipsoïde dont le grand axe serait constamment dirigé vers l'astre ; par suite du mouvement de la terre, la déformation en fait le tour en 24 heures ; le niveau monte donc et descend en chaque point deux fois par jour. Mais l'hypothèse sur laquelle repose la théorie de Newton est inconciliable avec la rapidité de ce mouvement [ce qui n'a pas été un motif pour repousser les théories mathématiques des marées, mais a été au contraire un motif de les perfectionner] ; les molécules liquides, sollicitées à chaque instant vers une nouvelle position d'équilibre, ont évidemment une tendance à la dépasser et à accomplir des oscillations régies par les lois de la dynamique. Le problème des marées exige donc l'intervention de la théorie du mouvement des liquides sur laquelle repose l'analyse de Laplace [c'est ainsi qu'en économie mathématique, on est passé de la théorie de Cournot aux théories modernes, et qu'on passera de celles-ci aux théories futures]. Le livre IV de la Mécanique Céleste est tout entier consacré à l'étude théorique, et pratique des oscillations de la mer, et l'on peut dire que la théorie pure n'a pas subi de modifications sensibles depuis qu'elle a été établie sur ses bases par le grand analyste ; la (p. 11) solution générale de ce difficile problème est encore à découvrir. Malgré tous les efforts des géomètres, la théorie a été jusqu'à présent impuissante non seulement à se plier à l'infinie variété des conditions terrestres, mais même à aborder la question autrement que dans les conditions très simples d'un sphéroïde entièrement recouvert d'eau. Mais si nous envisageons le point de vue pratique, l'analyse a été d'une extraordinaire fécondité. Le principe général de correspondance entre les forces périodiques et le mouvement de la mer qu'il a mis en lumière [en économie mathématique : le principe de la mutuelle dépendance, que nous étendons ici aux phénomènes sociologiques] a servi de point de départ pour l'étude des marées de Brest, à laquelle est consacrée la fin du quatrième livre et la presque totalité du treizième livre de Mécanique Céleste. C'est sur ce même principe qu'a été fondée en Angleterre, par sir William Thomson, la méthode de l'analyse harmonique, aussi remarquable par sa simplicité que par son inflexible logique, et qui paraît devoir servir de couronnement à l'édifice de l'étude empirique de la marée, en offrant le plus puissant moyen d'investigation pour la décomposition en ses éléments du mouvement complexe de la mer ».
[FN: § 1731-2]
Un même auteur peut développer la théorie dans les deux sens. LAPLACE ; Traité de mécanique céleste, Paris, an VII – t. II, 1. IV. Après avoir établi la formule abstraite des marées, en de certaines hypothèses, l'auteur fait la remarque suivante à propos d'une des conséquences de cette formule : « (p. 216) ...or nous verrons dans la suite, que ce résultat est contraire aux observations ; ainsi quelque étendue que soit la formule précédente, elle ne satisfait pas encore à tous les phénomènes observés. L'irrégularité de la profondeur de l'océan, la manière dont il est répandu sur la terre, la position et la pente des rivages, leurs rapports avec les côtes qui les avoisinent, les résistances que les eaux éprouvent, toutes ces causes qu'il est impossible de soumettre au calcul, modifient les oscillations de cette grande masse fluide. Nous ne pouvons donc qu'analyser les phénomènes généraux qui doivent résulter des attractions du soleil et de la lune, et tirer des observations, les données dont la connaissance est indispensable, pour compléter dans chaque port, la théorie du flux et du reflux de la mer... » Plus loin, après avoir établi ses formules : « (p. 241) Comparons les formules précédentes aux observations. Au commencement de ce siècle, et sur l'invitation de l'Académie des Sciences, on fit dans nos ports, un grand nombre d'observations du flux et du reflux de la mer : elles furent continuées chaque jour à Brest, pendant six années consécutives, et quoiqu'elles laissent à désirer encore, elles forment par leur nombre, et par la grandeur et la régularité des marées dans ce port, le recueil le plus complet et le plus utile que nous ayons en ce genre. C'est aux observations de ce recueil, que nous allons comparer nos formules ». Nous avons là un exemple de la méthode à suivre : ajouter, perfectionner, et non détruire (§1732).
[FN: § 1731-3]
Par exemple, les dérivations protectionnistes se prêtant beaucoup mieux que les théories scientifiques de l'Économie, à la défense du système protecteur, il y a un excellent motif subjectif pour que les personnes tirant ou espérant tirer quelques avantages directs ou indirects de ce régime donnent la préférence aux dérivations ; mais un tel motif n'existe pas pour qui se place simplement au point de vue objectif de la recherche des rapports qu'ont entre eux les faits.
[FN: § 1732-1]
Très souvent, l'ordre chronologique des trois procédés est différent de celui indiqué tout à l'heure, dans lequel, partant du plus erroné on va au plus parfait. L'ordre chronologique se rapproche de l'ordre (1), (2b), (2a). On a pu l'observer en économie. L'ancienne économie employait le procédé (1) ; puis on fit un saut jusqu'au procédé (2b), avec l'économie mathématique ; et maintenant, grâce aux enseignements de celle-ci, on peut employer le procédé (2a). Deux ouvrages d'économie dans lesquels on fait usage de considérations de cause à effet peuvent différer entièrement. Si ces considérations ne s'achèvent pas par celles de la mutuelle dépendance, si l'on ne fait pas suivre l'étude des actions de celle des réactions, et surtout si l'on ne sépare pas celles qui sont principales de celles qui sont secondaires, on a une étude suivant le procédé (l) : elle est donc presque toujours entachée de graves erreurs. Si, au contraire, instruit par les résultats de l'économie mathématique (2b), on raisonne néanmoins en se servant de considérations de cause à effet, mais en tenant compte de la mutuelle dépendance, grâce à l'étude des actions et des réactions, et en séparant les principales des secondaires, on a une étude suivant le procédé (2a), étude qui peut se rapprocher beaucoup de la réalité.
[FN: § 1732-2]
Manuel, III, 217, 218, p. 233-234. Plusieurs économistes sont tombés dans l'erreur de supposer que les théories de l'économie pure pouvaient s'appliquer directement au phénomène concret, et Walras croyait pouvoir réformer ainsi la société. À ce propos, voir : P. BOVEN ; Les applications mathématiques à l'économie politique.
[FN: § 1732-3]
Manuel, III, 228 « (p. 247) La principale utilité que l'on retire des théories de l'économie pure est qu'elle nous donne une notion synthétique de l'équilibre économique, et pour le moment nous n'avons pas d'autre moyen pour arriver à cette fin. Mais le phénomène qu'étudie l'économie pure diffère parfois un peu, parfois beaucoup du phénomène concret ; c'est à l'économie appliquée à étudier ces divergences. Il serait peu raisonnable de prétendre régler les phénomènes économiques par les seules théories de l'économie pure ». Très souvent, aux théories de l'économie appliquée il faut ajouter celles de la sociologie. « 217 (p. 233) Les conditions que nous avons énumérées pour l'équilibre économique nous donnent une notion générale de cet équilibre... pour savoir ce qu'était l'équilibre économique, nous avons dû rechercher comment il était déterminé. Remarquons d'ailleurs que cette détermination n'a nullement pour but d'arriver à un calcul numérique des prix. Faisons l'hypothèse la plus favorable à un tel calcul ; supposons que nous ayons triomphé de toutes les difficultés pour arriver à connaître les données dit problème... C'est là déjà une hypothèse absurde, et pourtant elle ne nous donne pas encore la possibilité pratique de résoudre ce problème… si l'on pouvait vraiment connaître toutes ces équations [de l'équilibre], le seul moyen accessible aux forces humaines pour les résoudre, ce serait d'observer la solution pratique que donne le marché ».
Comme nous l'avons fait voir (Encyclopédie des sciences mathématiques), une infinité de fonctions-indices sont propres à faire voir comment est déterminé l’équilibre économique. Le choix qu'on en fait est une simple question d'opportunité. En particulier, le choix des lignes d'indifférence n'a pas le moins du monde pour but de mesurer pratiquement l'ophélimité ; son but est seulement de mettre en rapport, avec les conditions de l'équilibre et les prix, certaines quantités, que l'on peut supposer théoriquement mesurables.
Des observations analogues doivent être faites au sujet de la sociologie. Celle-ci n'a nullement pour but de nous dévoiler le détail des événements futurs ; elle n'a pas repris la suite des affaires de l'oracle de Delphes et ne fait aucune concurrence aux prophètes, sibylles, devins et voyantes ; elle vise seulement à connaître, en général, les uniformités qui ont existé par le passé, et celles qui ont quelque probabilité d'exister dans l'avenir, ainsi que les caractères généraux et les rapports de toutes ces uniformités.
[FN: § 1732-4]
Ces erreurs sont très bien mises en lumière dans l'ouvrage de G. SENSINI La Teoria della Rendita.
[FN: § 1732-5]
V. PARETO ; Le mie idee, dans Il Divenire Sociale, 16 juillet 1910 : « (p. 195) ...l'économie pure n'est qu'une espèce de comptabilité ; et la comptabilité d'un commerce ne peut nous donner la physionomie véritable de ce commerce... L'économie est une petite partie de la sociologie, et l'économie pure est une petite partie de l'économie. Par conséquent, l'économie pure seule ne peut nous donner de normes pour régler pratiquement un phénomène concret ; elle ne peut pas non plus nous faire connaître entièrement la nature de ce phénomène ».
[FN: § 1737-1]
BAYLE ; Dict. hist., s. r. Lubienietzki, rem. (E). L'auteur parle d'une persécution religieuse. «Je ne sai s'il y eut jamais de matiere plus féconde que celle-ci en repliques et en dupliques : on la peut tourner plusieurs fois de chaque sens : et de là vient qu'un même Auteur vous soutiendra aujourd'hui que la vérité n'a qu'à se montrer pour confondre Mérésie, et demain que si l'on souffroit, à l'Hérésie d'étaler ses subtilitez, elle corromproit bientôt tous les habitans. [Le premier groupe de résidus est constitué principalement par l'autorité de la religion du sujet, par la vénération que celui-ci a pour elle ; le second, par le besoin d'uniformité.] Un jour on vous représentera la vérité comme un roc inébranlable ; un autre jour on vous dira qu'il ne faut point la commettre au hazard de la Dispute, et que c'est un choc où elle se briseroit par rapport aux auditeurs ».
[FN: § 1744-1]
Cette erreur était coutumière chez les gouvernements du passé, et l'on peut encore la remarquer en des temps plus rapprochés des nôtres, en France, comme propre au gouvernement de la Restauration et à celui du Second Empire. À cette erreur s'en joint habituellement une autre : celle de croire qu'en usant de la force et en condamnant les dissidents, on peut faire naître le sentiment religieux là où il n'existe pas, et le fortifier là où il existe. Souvent, il s'y ajoute encore une autre erreur, qui consiste à confondre le sentiment religieux en général avec le sentiment d'une certaine religion particulière. C'est pourquoi les gouvernements épuisent leurs forces à vouloir imposer à leurs sujets la religion X ; et, en supposant même qu'ils obtiennent quelque effet, c'est uniquement celui d'imposer l'hypocrisie et de favoriser par conséquent les nombreux vices qu'elle entraîne. Mais quand bien même on obtiendrait en partie l'effet désiré, cela serait peu ou pas du tout utile, étant donné le but qu'on se proposait en voulant imposer la religion X : faire croître l'honnêteté des mœurs et la fidélité des sujets. Cela n'empêche pas que, lorsque ce sentiment religieux est une manifestation spontanée de l'honnêteté des mœurs et de la fidélité des sujets, il convient de ne pas l'offusquer, si l'on veut favoriser cette honnêteté et cette fidélité (§1753). Les gouvernements modernes qui suivent la religion du Progrès repoussent dédaigneusement tout appui de l'ancienne religion a, pour régler la vie civile ; mais ils lui substituent d'autres religions. Beaucoup d'entre eux sont portés à faire jouer ce rôle à la religion sexuelle f, renouvelant ainsi une erreur commise aussi par les gouvernements passés. On peut remarquer, en effet, que celui qui est honnête et modéré dans les diverses manifestations de son activité, l'est aussi en celles de l'activité sexuelle : par conséquent, il n'est pas difficile de montrer qu'en général, pour le plus grand nombre, l'observation des règles de la religion sexuelle f est liée à l'observation des règles d'une religion a, de l'honnêteté b, des bonnes mœurs c, de l'honorabilité d, etc. De là provient l'erreur de considérer f comme la cause, au moins partielle, de a, b, c, d... C'est justement parce que cette erreur est très commune, que nous avons nombre de fois apporté des preuves pour démontrer que f n'est nullement la cause, même partielle, de a, b, c, d... À cette erreur, on en ajoute une autre, plus grande, et qui en est proprement la conséquence. On admet qu'en agissant sur f, on agit de ce fait aussi sur a, b, c, d. et l'on atteint un extrême où, lorsqu'on s'imagine, qu'en imposant par la loi
l'hypocrisie sexuelle, on atteint le but d'avoir de bons, d'honnêtes et sages citoyens. Les très nombreux et très évidents démentis donnés par l'expérience historique sont impuissants à ôter aux sectaires et vulgaire cette opinion entièrement fausse.
[FN: § 1747-1]
On peut trouver des exemples tant qu'on en veut. En voici un typique. Une même pièce de théâtre, La Partie de chasse de Henri IV, de Collé, fut interprétée, selon les époques, par les sentiments, en des sens directement contraires. VICTOR HALLAYS-DABOT ; Histoire de la censure théâtrale en France, Paris, 1862 : « (p. 85) Il est une mesure rigoureuse que l'on ne saurait comprendre, si l'on ne se pénétrait bien de l'état des esprits à la fin du règne de Louis XV et de la marche pénible du gouvernement : c'est l'interdiction de la Partie de chasse de Henri IV. La pièce de Collé est inoffensive entre toutes.Cette comédie, à peine soumise à l'examen, devient une affaire des plus graves. Chacun s'en préoccupe ; on trouve inconvenant de mettre à la scène un aïeul du roi, un souverain, dont on n'est séparé (p. 86) que par un espace de cinquante ans ». Voilà donc la pièce jugée anti-monarchique. En outre elle est estimée contraire au gouvernement de ce temps. « (p. 87) L'effet produit par les vers de Théagène et Chariclée trahit l'état d'animation et d'hostilité de la ville. Une sorte de succès avait naguère encore entouré une tragédie médiocre, mais pleine de déclamations contre les rois, le Manco-Capac, de Leblanc, et, pour être jouée à la cour, la pièce avait dû être allégée de près de quatre cents vers [Remarquez le fait d'une cour qui veut entendre une pièce dirigée contre les rois. Quand un fort courant de sentiments se dessine, il est général et entraîne même les gens qui ont tout à en redouter.] Le gouvernement, éclairé par ces précédents, vit dans la pièce de Collé ce que le public y chercherait, une allusion par contraste, un prétexte à manifestation. Henri IV était alors ce qu'il a été plus tard, un drapeau, emblème de la royauté débonnaire, libérale, démocratique. Henri IV deviendra le roi du théâtre à trois époques différentes : au début du règne de Louis XVI, au lendemain de la prise de la Bastille et du serment constitutionnel, à la rentrée des Bourbons en 1814. À ces époques, on saluera en lui le souverain que rêve et qu'espère l'imagination populaire. En d'autres temps, au contraire, sous Louis XV, par exemple, au lieu d'être une flatterie, la personnalité d'Henri IV sera une épigramme : on opposera ses idées aux idées du jour, et l'enthousiasme pour le Béarnais ne sera qu'une machine de guerre de l'opposition. Là seulement il faut chercher la vraie cause du grand succès de la Partie de chasse, et en même temps le motif de son interdiction ». Sous l'Empire, « (p. 222) maintes fois (p. 223) on voulut reprendre Édouard, et surtout la Partie de chasse de Henri IV. Henri IV, pendant les dernières années du règne de Louis XV, servait, nous l'avons vu, de masque monarchique aux philosophes, qui méditaient le renversement de la monarchie. Aujourd'hui, Henri IV, sur une scène de Paris, ç'aurait été le drapeau blanc, autour duquel se seraient pressés tous les mécontents ». H. WELSCHINGER ; La censure sous le premier Empire. – Paris, 1882 : « (p. 226) De près comme de loin, Napoléon veillait sur le théâtre. Il écrivait de Mayence, le 3 octobre 1804, à Fouché : „ Je vois qu'on a joué à Nantes la Partie de chasse de Henri IV. Je ne vois pas à quoi cela aboutit. “ La pièce séditieuse fut immédiatement interdite ». Mais vint la Restauration, et, nous dit HALLAYS-DABOT, loc. cit., on reprit « avec solennité » la Partie de chasse de Henri IV. « (p. 235) Toutes les pièces défendues naguère, les États de Blois, Henri IV et d'Aubigné, les comédies sur le Béarnais doivent être autorisées aujourd'hui. Il serait difficile de dire combien de fois, à cette époque, Henri IV a été mis au théâtre. Tous les soirs, il paraissait sur quelque scène. De la Comédie Française à Franconi, c'était un concert d'adulations, dont les événements nous ont déjà révélé le secret. Henri IV, c'était le drapeau de la monarchie ; de plus, il avait eu à subir les rigueurs du précédent gouvernement ». Ensuite le public se fatigue. « (p. 239) le 30 mai 1814, avait lieu la représentation des États de Blois. La tragédie de Raynouard n'obtint qu'un demi-succès... On en était déjà à une période moins enthousiaste. Les lois sur la presse se préparaient ; de plus le public, commençait à se fatiguer des dithyrambes qui, depuis le mois d'avril, se déclamaient, se chantaient, se dansaient, se mimaient sur tous les théâtres de Paris ». (§1749). Voici le règne de Louis-Philippe : « (p. 291) Napoléon devient pour les théâtres ce qu'Henri IV avait été en 1755, en 1790, en 1814 et en 1815. On le retrouve simultanément sur toutes les scènes, et, comme jadis le panache blanc du Béarnais, la redingote grise de l'Empereur soulève les passions populaires ». Parlant de la Veuve du Malabar, représentée sous Louis XVI, l'auteur dit : « (p. 123) Jadis on n'avait vu dans cette tragédie qu'une peinture assez ennuyeuse des mœurs indiennes. On n'avait pas cherché les prêtres catholiques sous le masque des brahmines. Maintenant que les esprits surexcités sont à l'affût de chaque mot, de chaque trait qu'ils puissent saisir, tout devient allusion. Le clergé s'émeut et M. de Beaumont va trouver le roi... »
[FN: § 1748-1]
VICTOR HALLAYS-DABOT ; loc. cit., §1747-1. « (p. 275) De cette époque [vers 1827] date une suppression [faite par la censure] que, d'année en année, on voit maintes petites feuilles raconter avec bonheur, comme le modèle de l'ineptie innée des censeurs. Il paraîtrait que dans un vaudeville où il était question de salade en vogue, l'auteur avait mis de la barbe de capucin ; la censure aurait demandé qu'il fût question de toute autre salade et aurait impitoyablement rayé la barbe de capucin. L'histoire est plaisante ; mais si minutieuse que soit cette coupure, nous avouerons ne l'avoir jamais trouvée aussi ridicule que l'on se plaît à le dire. Voyons ce qu'est (p. 276) la guerre d'épigrammes, de mots à double entente, de piqûres d'aiguilles, de plaisanteries niaises, qui s'engage à certains jours entre l'autorité et l'opposition et dont cette époque de la Restauration est restée comme un des exemples les plus complets ; songeons que chaque matin dix journaux déclamaient contre les capucinades de la cour de Charles X, c'était le mot en usage, et demandons-nous si l'auteur était aussi innocent que l'on veut bien le dire, de toute pensée hostile en citant la barbe de capucin, comme la salade à la mode ; demandons-nous si le ministre, en approuvant cette coupure, qui, vue en soi, est puérile, avait tort de se méfier d'un public, qui, dans le simple énoncé du quai Voltaire, trouvait le prétexte d'une manifestation bruyante ». L'auteur parvient ainsi à justifier le ministre du reproche d'imbécillité ; reste celui de défaut d'habileté : et l'auteur aurait dû se rappeler ce que, précisément à propos du quai Voltaire, il disait sur l'effet de semblables prohibitions. LAS CASES ; Mémorial de Sainte-Hélène – Paris 1840, t. II : « (p. 107) En parlant des ouvrages cartonnés ou défendus par la police, sous son règne, l'Empereur disait que, n'ayant rien à faire à l'île d'Elbe, il s'y était amusé à parcourir quelques-uns de ces ouvrages, et souvent il ne concevait pas les motifs que la police avait eus dans la plupart des prohibitions qu'elle avait ordonnées. De là il est passé à discuter la liberté ou la limitation de la presse. C'est, selon lui, une question interminable et qui n'admet point de demi-mesures.
Ce n'est pas le principe en lui-même, dit-il, qui apporte la grande difficulté, mais bien les circonstances sur lesquelles on aura à faire l'application de ce principe pris dans le sens abstrait. L'Empereur serait même par nature, disait-il, pour la liberté illimitée ». Ce n'est pas un fait isolé. Beaucoup d'hommes pratiques, quand ils regardent les choses d'un peu haut, s'aperçoivent de la vanité de la chasse aux dérivations, ce qui ne les empêche pas de la pratiquer lorsqu'ils sont entraînés par la passion du moment. WELSCHINGER ; loc. cit., §1747-1 :« (p. 235) Il est curieux de constater que le théâtre préoccupait Napoléon presque autant que la politique. Quels sujets, d'ailleurs, n'embrassait pas cet esprit universel et à quels moindres détails ne s'arrêtait pas, détails qui feraient (p. 236) peut-être encore aujourd'hui sourire nos hommes d'État ? Ainsi, par une lettre de Potsdam, en date du 25 octobre 1806, il approuve le relevé, de la dépense du ballet Le Retour d'Ulysse ; il prescrit à Fouché de se faire rendre un compte minutieux de ce divertissement, et d'assister à la première représentation pour s'assurer qu'il ne s'y trouve rien de mauvais ». Voilà de belles occupations pour un Empereur et son ministre ! Notre auteur, parlant des vers de Marie-Joseph Chénier, dans lesquels Tacite est nommé, dit : « (p. 149) Tacite !... Ce nom avait, en effet, le don d'irriter l'Empereur. La désapprobation donnée publiquement par lui à la traduction de Dureau de Lamalle, l'interdiction de la tragédie de Tibère, indiquaient assez l'antipathie de Napoléon pour l'historien romain ». Napoléon voulait faire mettre en prison Chénier ; Fouché l'en dissuada, en lui disant : « (p. 149) „ Tout Paris va travailler à le faire sortir. On ne l'aime pas, mais on le plaindra quand on le verra en prison. Sire, ne rendons pas nos ennemis intéressants...“ ». Les classiques n'étaient pas ménagés par la censure impériale. « (p. 223) On fit faire, dit Bourienne, par des poètes à gages d'étranges changements aux pièces de nos grands maîtres, et Héraclius ne parut plus que mutilé ». « (p. 231) Le censeur Lemontey disait à l'un de ses amis venu pour le visiter : „ Irez-vous ce soir an Théâtre Français entendre Racine corrigé par Lemontey ? “ Ce n'était pas une spirituelle boutade, c'était l'exacte vérité. Le grand poète de Louis XIV avait subi, comme les petits poètes de l'Empire, les atteintes de la Censure. Un exemplaire d'Athalie, qui figure aujourd'hui dans la bibliothèque du souffleur de la Comédie française, en porte les traces les plus évidentes, et nous laisse à penser quelles coupures ont dû être faites dans les autres tragédies de Racine ». L'auteur cite plusieurs exemples de ces coupures. Mais il y a pis. Le censeur remplace par ses vers ceux de Racine ! « (p. 232) ...Le censeur biffe ces quatre vers [Athalie, acte II, sc. VII, v. 116-119] dans la crainte d'une (p. 233) allusion au prétendant ; puis pour relier ce passage avec ce qui suit, il supprime l'hémistiche : „ Que Dieu voit et nous juge “ et le remplace par cet hémistiche de sa composition : „ Je connais votre attente “ ; de telle sorte qu'Athalie peut s'écrier au vers suivant :
Mais nous nous reverrons. Adieu ! Je sors contente ».
Plus loin : « (p. 233) Vingt-cinq vers [acte IV, sc. III] tombent sous les ciseaux du censeur. Mais comme il n'y a plus de rime pour marcher avec ce vers :
Prêtres saints, c'est à vous de prévenir sa rage,
le censeur invente ce vers qui suivra le précédent : (p. 234)
De proclamer Joas pour signal du carnage»
Le temps qu'employait Napoléon à surveiller le théâtre, la presse et Mme de Staël, aurait été certes mieux employé à s'occuper de son empire. Mais le travers en lequel il donnait est celui de beaucoup d'autres hommes d'État, qui ne savent pas que l'art de gouverner consiste à savoir employer les résidus existants, et non à les vouloir changer. Si, écartant leurs préjugés, ils daignaient tenir compte de l'histoire, ils verraient qu'à donner la chasse aux dérivations pour modifier les résidus, les gouvernements ont dépensé des sommes énormes d'énergie, infligé de grandes souffrances à leurs sujets, compromis leur puissance, le tout pour n'obtenir que des résultats fort insignifiants.
[FN: § 1749-1a]
Carpenteriana, Paris 1741 : « (p. 237). La Mothe-le-Vayer aïant fait un Livre de dur débit, son Libraire vint lui en faire ses plaintes, et le prier d'y remedier par quelque autre Ouvrage. Il lui dit de ne se point mettre en peine ; qu'il avoit assez de pouvoir à la Cour pour faire défendre son Livre ; et qu'étant défendu, il en vendroit autant qu'il voudroit. Lorsqu'il l'eut fait défendre, ce qu'il prédît arriva ; chacun courut acheter ce Livre, et le Libraire (p. 338) fut obligé de le réimprimer promptement, pour pouvoir en fournir à tout le monde ».
[FN: § 1749-1]
E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. VI. L'auteur parle des vives attaques du clergé contre la Vie de Jésus, de Renan « (p. 346) L'effet qu'ils obtinrent [les évêques] ne fut pas celui qu'ils souhaitaient. Lesseps m'a raconté que le chiffre le plus élevé de la note des frais de sa propagande [c'est là un euphémisme] en Angleterre en faveur du Canal de Suez était celui des sommes payées pour se faire attaquer [c'est Ollivier qui souligne]. Il se récria. – „ Vous avez tort“, lui répondit-on, „ les attaques seules sollicitent l'attention ; on les oublie et il n'en reste que le souvenir du nom ou de l'acte attaqué “. – Chaque mandement [des évêques] augmenta la diffusion de l'ouvrage et plus d'un, qui n'y eût pris garde, de dire : Décidément, si ce livre est si mauvais, je le lirai ! Loin d'éteindre le flambeau incendiaire, ils l'avaient attisé ».
Procès faits aux chansons de P.-J. Béranger. – Paris, 1828. Plaidoirie du défenseur DUPIN. « (p. 74) On veut arrêter le cours d'un recueil de chansons, et (p. 75) l'on excite au plus haut point la curiosité publique ! On voudrait effacer des traits qu'on regarde comme injurieux, et, de passagers qu'ils étaient par leur nature, on les rend éternels comme l'histoire à laquelle on les associe... Si l'on pouvait en douter, il serait facile d'interroger l'expérience : elle attesterait que toutes les poursuites de ce genre ont produit un résultat contraire à celui qu'on s'en était promis. M. de Lauraguais écrivait au Parlement de Paris : Honneur aux livres brûlés ! Il aurait dû ajouter, profits aux auteurs et aux libraires ! Un seul trait suffira pour le prouver. En 1715, on avait publié contre le chancelier Maupeou des couplets satiriques... (76) Faire une chanson contre un chancelier, ou même contre un garde-des-sceaux, c'est un fait grave. Maupeou, piqué au vif, fulminait contre l'auteur, et le menaçait de tout son courroux s'il était découvert. Pour se mettre à l'abri de la colère ministérielle, le rimeur se retira en Angleterre, et de là il écrivit à M. de Maupeou, en lui envoyant une nouvelle pièce de vers : „ Monseigneur, je n'ai jamais désiré que 3000 francs de revenu. Ma première chanson, qui vous a tant déplu, m'a procuré, uniquement parce qu'elle vous avait déplu, un capital de 30 000 francs, qui, placé à cinq pour cent, fait la moitié de ma somme. De grâce, montrez le même courroux contre la nouvelle satire que je vous envoie ; cela complétera le revenu auquel j'aspire, et je vous promets que je n'écrirai plus. “ » J. P. BELIN ; Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789 – Paris, 1913 : « (p. 109) Il était facile de constater que proscrire un „ ouvrage, c'était le faire connaître, que la défense réveillait la curiosité et ne servait qu'à multiplier les éditions furtives, dangereuses par les conséquences qu'on tirait du mystère “. Ainsi, une petite brochure intitulée Tant mieux pour elle, que Choiseul hésita quelques jours à condamner, se vendit sous le manteau à quatre mille exemplaires pendant les premiers quinze jours, mais cessa de faire du bruit dès qu'on eut permis de l'exposer publiquement en vente (Favart à Durazzo, 1760, I, 99). De même les Mémoires secrets disaient en 1780 : „ On recherche beaucoup une brochure intitulée Essai sur le jugement qu’on peut porter sur Voltaire depuis qu'elle a été supprimée par arrêt du Conseil “(XVI, 4). Voltaire avait bien raison de dire : „ Une censure de ces messieurs fait seulement acheter un livre. Les libraires devraient les payer pour faire brûler tout ce qu'on imprime. “ (À Voisenon, 211 juillet 1756). „ La brûlure, était pour un livre ce qu’était le titre d'académicien pour un homme de lettres “ (Extrait du Pot pourri. Étrennes aux gens de lettres, cité par Métra, IV, 293) „ Plus la proscription était sévère, plus elle (p. 110) haussait le prix du livre, plus elle excitait la curiosité de le lire, plus il était acheté, plus il était lu, ...Combien de fois le libraire et l'auteur d'un ouvrage privilégié, s'ils l'avaient osé, n'auraient-ils pas dit aux magistrats : Messieurs, de grâce, un petit arrêt qui me condamne à être lacéré et brûlé au pied de votre grand escalier ? Quand on criait la sentence d'un livre, les ouvriers de l'imprimerie disaient : Bon, encore une édition “. (Did., Lettre sur le commerce de la librairie, p. 66). » VICTOR HALLAYS-DABOT ; La censure dramatique et le théâtre. Histoire des Vingt dernières années. (1850-1870) – Paris 1871. Parlant d'un drame de M. Claretie : Les Gueux, l'auteur dit : « ... (p. 61) La censure jugea le drame inoffensif. Cette pièce, autour de laquelle une partie de la presse avait fait grand bruit à l'avance, dut donc se présenter devant le public sans être entourée de la sympathie préventive qui accompagne les victimes de la censure. D'ailleurs elle réussit peu ». Il a suffi de la suppression de quelques vers de Marion Delorme pour rendre populaires des vers qu'on supposait les résumer. Nous disons : « qu'on supposait », parce que les vers populaires sont :
De l’autre Marion rien en moi n'est resté,
Ton amour m'a refait une virginité.
tandis que le poète, en une note, (acte V, scène II) dit ; « ... il y avait dans le manuscrit de l'auteur quatre vers qui ont été supprimés à la représentation, et que nous croyons devoir reproduire ici ; Marion aux odieuses propositions de Laffemas, se tournait sans lui répondre vers la prison de Didier.
…………………………………………………………
Mon Didier ! près de toi rien de moi n'est resté,
Et ton amour m’a fait une virginité ! »
Il est probable que, si l'on n'avait pas supprimé ces vers, personne ne s'en serait souvenu.
[FN: § 1749-2]
Par exemple, aux siècles passés, beaucoup de libertins étaient plus excités, s'ils avaient des relations avec une religieuse qu'avec une femme laïque ; si bien qu'il arrivait parfois que l'amant faisait porter à la femme laïque, sa maîtresse, des habits de religieuse. Aujourd'hui, en Angleterre, on cite des faits singuliers, où la perversité est un puissant stimulant pour se soustraire à certaines règles que la loi veut imposer, et qui seraient peut-être respectées, en l'absence de la prohibition.
[FN: § 1749-3]
En beaucoup de religions, on a pour règle de taire les faits qui pourraient provoquer un scandale. Inutile d'en donner des exemples pour les religions chrétiennes et autres semblables, parce qu'ils sont trop connus. En voici un pour la religion dreyfusarde de certains intellectuels. Au sujet de Du Paty de Clam, réintégré par le ministre Millerand dans l'armée territoriale (§1580-3), le correspondant de la Gazette de Lausanne, 3 février 1913, écrit : « ...la vérité est qu'on avait brocanté la promesse faite à M. Du Paty de le réintégrer, contre l'engagement pris par lui de se désister d'un pourvoi qui était gênant, parce qu'il reposait sur une allégation exacte. M. Jaurès s'est écrié avec fougue, aux acclamations de la gauche, qu'il ne fallait pas faire cette négociation, qu'il fallait dire à M. Du Paty : „ Vous ferez votre preuve comme vous l'entendrez ! “– Distinguons : Qu'il ne fallût pas faire cette négociation, c'est très possible, et le trafic auquel on s'est livré n'avait rien de reluisant ; mais qu'il fallût laisser à M. Du Paty le soin de „ faire sa preuve “, non, non et non ! Il suffisait d'une minute pour savoir si oui ou non M. Du Paty avait été frappé grâce à la production d'un document falsifié ; et si c'était oui, – et c'était oui – il fallait lui faire rendre justice. L'esprit se refuse à admettre que les hommes qui se sont honorés par leur attitude dans une campagne tragique n'aient pas compris qu'il n'était pas plus tolérable que M. Du Paty de Clam fût victime de la production d'une pièce falsifiée, qu'il n'avait été tolérable que le capitaine Dreyfus eût été victime de la production secrète de documents apocryphes et criminels ». Qu'on lise aujourd'hui les correspondances faites en ce temps là par un grand nombre de journaux appartenant à la foi dreyfusarde ou humanitaire, et l'on verra qu'en général elles passent scrupuleusement sous silence le fait du document falsifié. Elles pouvaient contester qu'il le fût ; elles pouvaient le déclarer parfaitement authentique : pour défendre sa foi, tout est permis ; elles préférèrent se taire. Voici, en un genre entièrement différent, un exemple qui est le type d'un très grand nombre de faits. Dans les années 1912 et 1913, on estima patriotique, en Italie, de faire apparaître au budget un excédent qui, en réalité, n'existait pas. Plusieurs grands journaux étrangers reproduisirent avec soin les assertions des ministres, au sujet de cet excédent, et les illustrèrent copieusement par des correspondances de gens de bourse, qui chantaient les louanges de finances si prospères. Ces journaux gardèrent le silence, lorsque des savants comme MM. Giretti et Einaudi (§2306-1) démontrèrent que cet excédent était fictif, et firent voir qu'il y avait au contraire un déficit. Jusque-là, passe encore : ces études pouvaient avoir échappé aux journalistes. Mais, soit en raison de l'autorité de l'homme, soit en raison du lieu où elles étaient exprimées, les critiques convaincantes faites à la Chambre par le député Sonnino ne pouvaient leur échapper ! et pourtant, même celles-là furent passées sous silence. Mais voyez donc quelle étrange coïncidence ! on dit qu'à ces journaux sont intéressés des « spéculateurs » qui avaient ainsi un intérêt de Bourse à ce que le silence fût gardé.
[FN: § 1749-4]
E. OLLIVIER ; L'emp. libéral, t. V : « (p. 138) Le rabâchage doit être un des démons familiers de l'homme qui veut agir sur une foule distraite ou indifférente. Une idée ne commence, je ne dis pas à être comprise, mais perçue, que lorsqu'elle a été répétée des milliers de fois. Alors un jour arrive où le bon Panurge démocratique, ayant enfin entendu et compris, exulte, vous félicite d'avoir si bien deviné, exprime ce qu'il pense, et vous voilà populaire. Le journaliste qui connaît son métier refait pendant des années le même article ; l'orateur de parti doit agir de même ».
[FN: § 1749-5]
Cela a lieu aussi pour les critiques d'ouvrages de science sociale ou économique, écrites par des personnes qui ignorent entièrement les éléments de ces sciences, et dont bon nombre ont aussi usurpé la réputation d'y être compétents. Elles usent de certains types de dérivations, toujours les mêmes, qui conviennent bien à leur ignorance et à celle des gens qu'elles peuvent persuader. Voici quelques-uns de ces types : 1° L'ouvrage est mal écrit. Il est facile de trouver, en toute langue, un cas douteux de l'emploi d'un mot, et de le baptiser erreur. Même si c'est manifestement vrai, quel rapport cela a-t-il avec la valeur logico-experimentale d'une proposition ? Un théorème d'Euclide écrit en langue barbare cesse-t-il peut-être d'être vrai ? Non, mais pour l'attaquer, il faut connaître la géométrie, et pour dire que la langue est barbare, il suffit... d'être un pauvre en esprit. 2° L'ouvrage ne contient rien de nouveau. Dans la forme extrême de la dérivation, on accuse l'auteur de plagiat. Il serait difficile de trouver un auteur de quelque mérite et de quelque renommée contre lequel on n'ait pas porté cette accusation. Même Dante a été accusé d'avoir imité, d'un auteur très obscur, son immortel poème. Dans la nouvelle de Boccace, messire Erminio de Grimaldi voudrait que Guglielmo Borsiere lui enseignât « une chose qui n'eût jamais été vue » et qu'il pût faire peindre. À quoi Borsiere répond : « Une chose qui n'eût jamais été vue, je ne crois pas que je pourrais vous l'enseigner, à moins que ce ne fût des éternuements ou des choses semblables à celles-là ; mais si vous le désirez, je vous en enseignerai bien une, que vous, je le crois, vous n'avez jamais vue ». On pourrait donner une réponse analogue à un grand nombre de ces critiques. La chose qui, en cette occasion, leur fait défaut est le bon sens et parfois la bonne foi. 3° Il y a beaucoup d'erreurs ; et l'on a soin de ne pas dire lesquelles, dans l'idée que les gens croiront à l'affirmation, et ne la vérifieront pas. D'autres fois, on indique de prétendues erreurs, et lorsque quelqu'un démontre qu'elles n'existent pas, on se tait avec l'espoir que les gens ignoreront la rectification ou n'y prendront pas garde. C'est ce qui arriva à cet excellent M. AULARD. Dans son livre Taine historien de la révolution française, il accuse Taine d'innombrables erreurs. M. AUGUSTIN COCHIN, dans son livre La Crise de l'histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard, montre que c'est, au contraire, « l'historiographe officiel » de la révolution qui se trompe dans la plupart de ses accusations ; ce qui permet à M. Cochin de conclure : « (p. 18) Ainsi le bloc de faits et de témoignages assemblés par Taine reste entier. Ce qu'il raconte est vrai ». M. Aulard se tait, dans l'espoir que les sectaires ne liront pas le livre de M. Cochin, et que, même parmi ceux qui ne sont pas sectaires, beaucoup ne prendront pas garde à ce livre. 4° Attaques personnelles à l'auteur, critiques de choses qui n'ont rien et voir avec la question qu'on examine, et autres divagations semblables. 5° Intromission, en matière scientifique, de considérations sentimentales d'ordre politique, ou d'autres du même genre. Un tel, qui se croit « économiste », se montrait adversaire de l'économie mathématique, parce qu'il était convaincu qu'elle ne pourrait jamais devenir « démocratique ». Un autre repoussait une certaine manière de l'exposer, parce que, de cette manière, elle n'était pas en mesure d'apporter « un peu plus de justice dans le monde ». Un autre, qui semble passablement étranger à la matière dont il traite, invente une école d'économie mathématique, qui part de considérations « individuelles » [c'est le démon, pour ces gens-là], et l'oppose à une autre, qu'il imagine, et qui part de considérations « collectives ». 6° L'auteur n'a pas tout dit : il a omis de citer certains ouvrages, certains faits. Comme nous l'avons déjà observé, la critique serait excellente, si ces ouvrages et ces faits étaient de nature à modifier les conclusions ; elle est vaine lorsqu'ils sont peu ou pas du tout importants pour les conclusions. Les gens qui n'ont pas l'habitude des recherches scientifiques n'arrivent pas à comprendre qu'une grande quantité de détails peut nuire, au lieu d'être utile, pour trouver la forme générale, moyenne, des phénomènes, qui est la seule dont s'occupent les sciences sociales (§537 et sv.) 7° On fait dire à l'auteur ce qu'il n'a jamais eu l'idée de dire, parce qu'on interprète dans un sens sentimental, de parti politique, de prêche éthique, etc., ce qu'il a dit seulement dans un sens scientifique. Chacun est porté à juger les autres par soi-même, et celui qui n'a pas l'habitude des raisonnements scientifiques n'arrive pas a comprendre que d'autres personnes puissent en tenir.
[FN: § 1751-1]
On en a un très grand nombre d'exemples en tout temps. TACITE déjà Ann., XIV, 50, en cite un. F. Veientus avait composé une satire contre les sénateurs et les pontifes. Il fut jugé par Néron « et Veientus, convaincu fut exilé d'Italie, et l'on ordonna que ses livres fussent brûlés ; ceux-ci, recherchés et lus souvent, lorsqu'il y avait du danger à les acquérir, tombèrent dans l'oubli, sitôt qu'on eut la permission de les posséder ». (§1330-1). VICTOR HALLAYS-DABOT : loc. cit. §1747-1. Sous la Restauration « p. 265) le gouvernement... s'était laissé entraîner à interdire d'une façon absolue le personnage de Voltaire. Ses œuvres ne devaient jamais être nommées... Une exclusion aussi radicale était fâcheuse : bien plus, elle n'était pas habile. Qu'arriva-t-il ? On avait passé quatre années à surveiller avec grand soin l'ennemi signalé, on avait couru sus à la moindre allusion. Un jour à l'Odéon en 1826, on laisse ces mots dans la bouche d'un valet traçant un itinéraire :
Le pont Royal. Fort bien !...
D'un écrivain fameux voici le domicile :
De Voltaire ! À ce nom, le monde entier... Mais chut ! La maison de Voltaire est loin de l'Institut.
Le voici !
Voltaire ! la maison de Voltaire ! ces deux mots suffisent pour mettre le feu aux poudres. Le parterre tapageur bondit : la pièce est interrompue par des salves d'applaudissements ».
[FN: § 1751-2]
Le premier numéro de La Lanterne de Rochefort commence ainsi : « La France contient, dit l'Almanach impérial, trente-six millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement ». Ce calembour devint populaire, et fut répété en France par tout le monde. Aujourd'hui, qui prendrait garde à une plaisanterie semblable lancée contre le gouvernement français ? On sait que La Lanterne avait des admirateurs même parmi les gens de l'entourage du souverain. –DE GONCOURT ; Journal, année 1878 : « (p. 11) Flaubert, parlant de l'engouement de tout le monde impérial, à Fontainebleau, pour la Lanterne de Rochefort, racontait un mot de Feuillet. Après avoir vu un chacun, porteur du pamphlet, et apercevant, au moment du départ pour la chasse, un officier de la vénerie, en montant à cheval, fourrer dans la poche de son habit la brochurette, Flaubert, un peu agacé, demanda à Feuillet : „ Est-ce que vraiment vous trouvez du talent à Rochefort ? “ Le romancier de l'Impératrice, après avoir regardé à gauche, à droite, répondit : „ Moi, je le trouve très médiocre, mais je serais désolé qu'on m'entendit, on me croirait jaloux de lui ! “ »
[FN: § 1755-1a] Au commencement du mois d'octobre 1918, on put lire dans les journaux la note suivante : « Le grand organe libéral anglais le Daily Chronicle a été acheté par sir Henry Dalziel et quelques sociétaires pour la somme de 87 millions de francs... Le nouveau propriétaire, M. Dalziel, est un journaliste riche et député libéral, qui est surtout connu comme l'ami intime et le fidèle appui de M. Lloyd George tant au Parlement que dans la presse. En cela consiste principalement la signification politique de l'achat du Daily Chronicle, lequel paraissait récemment peu enclin à appuyer Lloyd George et penchait davantage vers les tendances du parti libéral, qui accepte Asquith comme chef. On annonce que la politique du journal ne changera pas, mais il est probable que sous le nouveau propriétaire il soutiendra vigoureusement Lloyd George ».
[FN: § 1755-1]
ROBERT DE JOUVENEL : La république des camarades : « (p. 248) Ce sont, dit-on, les journaux qui font l'opinion publique. La réciproque n'est pas moins vraie. Le lecteur est tout prêt à accepter l'opinion de son journal. Mais le journal choisit l'opinion qui lui semble la mieux faite pour plaire à son lecteur. (p. 252) Heureusement les questions sur lesquelles le public se prononce sont rares. Les lecteurs peuvent avoir des opinions très arrêtées, mais ils en ont très peu. Du moment qu'on ne heurte jamais celles-là, on peut aisément les guider dans toutes les autres ».
[FN: § 1755-2]
Bismarck était fort habile en l'art de se servir des journaux nationaux et étrangers. – ÉMILE OLLIVIER ; L'emp. lib., t. XIV. L'auteur veut justifier son ministère de n'avoir pas su se servir des journaux : « (p. 49) Bismarck y avait bien plus d'influence, puisque, dans chaque journal, il comptait au moins un écrivain soldé tout à ses ordres. Comme nous savions le nom de quelques-uns d'entre eux, ce nous était un moyen de connaître les intentions de leur soudoyeur. [Ollivier est fort naïf. Les intentions de Bismarck pouvaient être entièrement différentes de ce qu'il faisait dire aux gens qui étaient dans sa dépendance.] De plus, Bismarck tenait dans sa main, non seulement presque toute la presse prussienne, mais une grande partie de la presse allemande et de la presse autrichienne, et il avait ainsi, plus que nous, les moyens de déterminer, soit en France, soit en Europe, le mouvement d'opinion qui lui plaisait ». – Idem ; loc. cit., t. XII : « (p. 304) Le système de Bismarck était des plus ingénieux ; le gouvernement français avait eu parfois à l'étranger un journal à sa solde ; il en avait tiré peu de profit ; on ne tardait pas à savoir la vénalité de la feuille achetée, et on n'attachait plus d'importance à ce qui y était contenu [c'étaient d'autres temps ; aujourd'hui, cela ne discrédite pas un journal]. Bismarck n'achetait pas un journal, mais il achetait un ou des journalistes dans chaque journal important, le rédacteur en chef, lorsque c'était possible [aujourd'hui, on ne les achète pas directement : on agit indirectement, par l'intermédiaire des financiers qui détiennent les actions de la société anonyme possédant le journal], ou, à défaut, un simple rédacteur dont nul ne soupçonnait les attaches. Ce vendu se signalait par le caractère farouche (p. 305) de son patriotisme [remarquez ce fait : il est l'équivalent de l'opposition du journal, dans la politique intérieure] ; très opportunément suivant qu'il convenait à la politique prussienne, il calmait ou excitait l'opinion [on trouve une organisation semblable pour la politique intérieure] : le système était beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique... Je connais les noms des malheureux employés par eux [des agents de Bismarck], je préfère ne pas les divulguer ». Ces opérations par le moyen des journaux continuèrent aussi après 1870. – M. BUSCH ; Les Mém. de Bismarck, t. II : « (p. 57) 120 février [1873] Il résulte d'un rapport D'Arnim du 17 du mois dernier qu'il a engagé un certain L. pour lui fournir des rapports détaillés sur la presse française. Dans une dépêche du 8 courant, l'ambassadeur dit que L. a demandé à ne pas renoncer à la collaboration de B... Arnim soutient cette demande uniquement „ dans l'intérêt du service “, L., dit-il, devant avoir à sa disposition quelqu'un qui s'occuperait de la partie la plus compromettante de cet emploi. Mais ni L. ni aucun autre fonctionnaire de l'ambassade ne paraissent être en état de faire face à cette masse de matériaux, de fournir des rapports détaillés et bien informés sur la (p. 58) presse et en même temps d'écrire des articles pour les journaux allemands, italiens et russes ». Bismarck refusa d'employer ce moyen, ce qui signifie simplement qu'il en préférait un autre. Avec sa manière rude, Bismarck ne dissimule pas les dépenses qu'il faisait pour la presse française. – BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II. Parlant de D'Arnim et du procès qu'on fit à celui-ci, l'auteur dit : « (p. 195) Je n'ai jamais fait mention au cours des débats judiciaires, que certaines sommes destinées à faire défendre notre politique dans la presse française, et qui s'élevaient à 6000 ou 7000 thalers, étaient employées par lui à attaquer notre politique et ma situation dans la presse allemande ». Celle-ci apparaît aussi vénale qu'une partie de la presse française. Ces aveux d'hommes politiques éminents sont précieux, parce qu'ils confirment des faits qui, autrement, demeurent toujours douteux tant qu'ils ne sont connus que sous forme de bruits qui courent. Par exemple, en 1913-1914, on disait avec insistance que le gouvernement allemand payait largement certaines attaques des journaux français contre les lois militaires de leur pays ; mais nous n'avons aucun moyen de savoir ce qu'il y a là de vrai. Peut-être le saura-t-on, dans plusieurs années, s'il se fait des publications semblables à celles que nous possédons maintenant d'Ollivier et de Bismarck, et quand on les aura. – Busch nous donne des détails sur la manière dont Bismarck savait se servir de la presse. Busch ; loc. cit., t. II. Bismarck parle du journal de l'empereur Frédéric : « (p. 209) Personnellement, je crois encore plus que vous à l'authenticité du journal... L'empereur Frédéric était loin d'être aussi habile que son père, et son père était déjà loin d'être un politicien de première force. C'est ce qui fait que pas une minute je n'ai douté de l'authenticité du journal publié. Mais ça ne fait rien, il faut le traiter comme un faux !... (p. 215) En ce qui concernait la publication de la Deutsche Rundschau, le chancelier a maintenu son premier plan de campagne. „ Vous direz d'abord que c'est un faux “, m'a-t-il répété, „ et que vous êtes indigné de voir attribuer de pareilles calomnies au noble défunt... Puis, si on vous prouve que le journal était authentique, vous réfuterez les erreurs et les absurdités qu'il contient... “ ».
[FN: § 1755-3]
M. BUSCH ; Les Mém. de Bismarck, t. II. L'auteur cite une lettre (8 avril 1866) du roi Guillaume Ier à Bismarck, dans laquelle le souverain se plaint d'un article contre le duc de Cobourg, publié dans la Gazette de la Croix. Bismarck répond : « (p. 235) ...j'avoue franchement que la majeure partie de cet article a été écrite sous mon inspiration, parce que si je n'ai aucune influence sur la Gazette de la Croix pour empêcher de passer certains entrefilets qui me déplaisent, j'en ai assez pour faire insérer certains articles qui me conviennent ». – En France, le Siècle, qui était l'un des deux journaux républicains tolérés après le coup d'État de 1851, obtenait protection et subsides de l'empereur Napoléon III. E. OLLIVIER ; L'emp. libéral, t. IV : « (p. 17) Le Siècle n'appartenait pas à un homme d'affaires, mais il constituait une affaire importante donnant de gros bénéfices. Cela imposait à son directeur le souci perpétuel, en faisant une opposition qui était sa raison d'être, d'éviter la suspension qui serait la ruine de ses actionnaires ». Aujourd'hui les journaux ne craignent pas la suspension, mais bien la suppression des subsides indirects et directs qu'ils reçoivent des puissances financières, et la diminution de la vente, s'ils vont contre les passions du public. L'auteur continue : « M. Havin était créé pour cette manœuvre difficile.nullement irréconciliable avec l'empire. ». En 1858 « (t. IV, p. 69) le Siècle ne fut sauvé que par une démarche d'Havin auprès de l'empereur. (t. XI, p. 122) Havin était un esprit très avisé.en rapports presque amicaux avec les ministres, ne faisant l'anticlérical que pour se dispenser d'être antidynastique. » (1755 4).
[FN: § 1755-4]
Je préfère des exemples du passé, parce qu'ils sont moins aptes que ceux du présent à émouvoir les sentiments des lecteurs contemporains. – E. OLLIVIER ; L'emp. libéral, t. VI : « (p. 212) Ils [les commissaires du gouvernement, au Corps législatif] eurent moins beau jeu pour réfuter l'accusation portée contre les agiotages que, d'accord avec le Crédit mobilier, la Compagnie du Midi avait opérés sur ses propres actions ». Vient ensuite la description de cette fraude, qu'il n'y a pas lieu de rapporter ici. « (p. 213) Je dénonçai ce coup de Jarnac financier... Le commissaire du gouvernement, Dubois, fort honnête homme, se noya dans des explications confuses qui n'expliquèrent rien et continrent, au contraire, l'aveu de la plupart des faits révélés... Les administrateurs de la Compagnie du Midi eurent le crédit d'empêcher tous les journaux de Paris, sans exception, de reproduire le compte rendu analytique de cette séance ».
[FN: § 1755-5]
HENRY DE BRUCHARD [1896-1901] ; Petits mémoires du temps de la Ligue. L'auteur parle de certains journaux démocrates, défenseurs de Dreyfus. Nous supprimons les noms, parce que nous traitons ici de phénomènes sociaux et non de personnes. L'une des plus grandes erreurs, en cette matière, consiste justement à accuser certaines personnes de ce qui est un fait général. L'auteur dit donc de ceux qui, de bonne foi, écrivaient dans ces journaux : « (p. 209) Je pense qu'ils ont aussi le sentiment de la façon dont ils furent dupes et de leur imprudence. Ils ont pu en tout cas éprouver, ces mandarins de lettres, ce que la dignité de leur condition pesait peu auprès de leurs maîtres anonymes. À ces fiers indépendants demandez qui dirigeait [le journal], et pourquoi ils s'avisèrent si tard que le directeur en était toujours choisi sans qu'ils aient connaissance de ceux qui faisaient ce choix. Ils savent aujourd'hui que le (p. 210) fondateur et bailleur de fonds était M. L., ancien chef de la sûreté, et organisateur de la ligue de défense des juifs. Et dire que certains se prétendaient encore révolutionnaires ! Mais ils avaient là leur pain ; d'autres éprouvaient le besoin d'écrire, la maladie de mettre leur nom au bas d'un article : C’est une forme de cabotinisme ; et on subissait tout. On admettait la direction d'un M. P... M. P. est un des gros porteurs d'actions de l'Humanité. Représente-t-il encore L. et ses héritiers ? Question qui ne fut pas posée au dernier (p. 211) congrès socialiste ; c'était cependant la vraie question à poser ». À quoi bon ? Si ce n'est l'un, c'est l'autre. L'organisation subsistant, les individus ne manqueront jamais. En 1913, Jaurès, président d'une commission, fit tous ses efforts pour sauver le ploutocrate et démagogue Caillaux du blâme mérité à la suite des pressions exercées sur la magistrature, par l'intermédiaire de son compère Monis, et qui avaient pour but de favoriser Rochette. Tous les partis se servent des journaux à leurs fins particulières ; et de la sorte obtiennent des faveurs, en menaçant les ministres ou en promettant de les défendre. Celui qui veut avoir un journal dans sa manche doit supporter d'énormes dépenses, qui constitueraient une perte brute, s'il n'obtenait ensuite des compensations : en honneurs seulement, comme c'est le cas d'un très petit nombre d'hommes politiques ; en argent plus les honneurs, comme c'est le cas de la plupart des politiciens, des financiers politiques, des membres des trusts, des avocats politiques, des « spéculateurs ». – T. PALAMENGHI-CRISPI ; Giolitti : « (p. 76 note) Crispi fut singulier parmi les hommes politiques de son temps, en ceci aussi. Attribuant au journal la grande importance qu'il a dans la vie moderne, il voulut toujours en avoir un où il pût manifester ses idées ; mais au lieu d'en faire payer les frais à des hommes d'affaires, (p. 77) comme tant d'autres ont fait (il serait facile de citer des noms), il paya toujours de sa poche ; rarement un ami l'aida. Il arriva ainsi que souvent il se trouva en présence de dettes qu'il avait peine à payer, et qu'ainsi il dut parfois recourir à l'escompte en banque d'effets de change, qu'il acquitta cependant toujours. Tout le monde sait ce que coûtent les journaux exclusivement politiques. La Riforma seule, journal de la Gauche historique, qui défendit les idées et les hommes du parti libéral durant une trentaine d'années, absorba environ un million deux cent mille francs des revenus du labeur acharné de Crispi [cette épithète est peut-être exagérée] ». – Giornale d'Italia, 23 novembre 1913 : « Une autre nomination [en qualité de sénateur] dont on parle, – nous ne savons sur quels fondements et si elle ferait plaisir aux réformistes, – serait celle du banquier milanais Della Torre, lequel fut et reste magna pars finanziaria de journaux socialistes ou démocratiques, à la manière réformiste. Della Torre est en somme le dieu de la haute banque blocarde, et pourra se dire un jour un précurseur, lorsque la haute banque, ayant pris le vent, se mettra du côté du bloc, à l'instar de ce que fit sa sœur aînée française ». Della Torre fut effectivement nommé sénateur, avec deux autres socialistes, et le Corriere della Sera. 25 novembre 1913, écrit : « L'honorable Giolitti ouvre aujourd'hui les portes du Sénat à Karl Marx, qui faisait un peu trop de tapage au grenier [Giolitti avait dit à la Chambre que désormais les socialistes « avaient relégué Marx au grenier »], et devenait menaçant pour la tranquillité de ceux qui croyaient avoir opéré un judicieux séquestre de personnes... Trois socialistes ne sont, au fond, pas un groupe puissant... et ne causeront pas de gros ennuis au gouvernement, envers lequel ils ont de si grandes obligations de reconnaissance [et vice versa], ni à la bourgeoisie... Le Sénat étant une institution législative, doit avoir, lui aussi, des représentants de tous les courants politiques ; et il n'est pas dommage que, les radicaux y étant déjà suffisamment nombreux, les socialistes y aient aussi leur place ; au moins les socialistes de cette fraction qui connaît déjà les marches du Quirinal, et qui se montre en pratique disposée à « traiter ». Il est vraiment regrettable qu'on ne puisse aussi introduire au Sénat un brin de république ; mais heureusement les républicains ne font pas peur, et malheureusement ils sont obstinés dans leur chasteté préjudicielle † [et c'est pourquoi ils ne réussissent pas à avoir un journal : parce qu'ils veulent le payer eux-mêmes]... Il faut rajeunir le Sénat. Disons plus clairement : il faut se servir aussi du Sénat ; ce qui est l'expression la plus juste, celle qui répond le mieux à la réalité des choses [très vrai]. Si l'on voulait vraiment, d'une conscience honnêtement démocratique, donner au Sénat aussi le caractère de représentant des courants d'idées nationales, il n'y aurait qu'une conséquence logique : affronter le problème du Sénat électif... Il est vrai qu'en ce cas l'entrée des socialistes au Palais Madame [siège du Sénat] serait plus large, et que la munificence du gouvernement n'aurait plus à affirmer ses sympathies intéressées pour les partis extrêmes ».
† En Italie, les républicains posent la question préjudicielle de la forme du gouvernement.
[FN: § 1755-6]
La C. G. T.. comme on l'appelle en France, réunit un congrès à Paris, le 24 novembre 1912, pour s'opposer à la guerre. On y décida ce qui suit : « Le congrès, reconnaissant qu'il faut à tout prix paralyser la mobilisation, déclare qu'il est nécessaire d'essayer les moyens les plus efficaces pour atteindre ce but Le Congrès décide : ... 3° Pour empêcher le travail nocif de la presse bourgeoise, il engage les imprimeurs et les ouvriers à détruire les rotatives des journaux, à moins qu'elles ne puissent être utilisées pour notre cause ».
[FN: § 1755-7]
En mai 1913, un journal de Florence, qui cessait ses publications, raconta comment en trente-trois ans de vie il avait été soutenu par les différents gouvernements qui s'étaient alors succédé. Presque tous les grands journaux italiens gardèrent un silence pudique et sacré sur ce fait, qui aurait pu cependant intéresser les lecteurs beaucoup plus qu'un grand nombre de faits divers insignifiants. Mais peut-être plusieurs de ces journaux se sont-ils souvenus opportunément de la parole : de te fabula narratur. – Le gouvernement belge a publié une liste des journaux qui reçurent un subside du roi Léopold, pour louer son administration au Congo, ou du moins en taire les méfaits. L'historien futur qui étudiera le régime ploutocratique présent des peuples civilisés pourra en tirer d'utiles renseignements.
[FN: § 1755-8]
En Italie, on s'en rendit fort bien compte pour la presse étrangère qui était contraire à l'Italie ; mais naturellement, on ne mentionna pas celle qui était favorable. Les motifs d'agir étaient pourtant identiques dans les deux cas.
[FN: § 1756-1]
Souvent, on dit aussi : « Un tel, qui aujourd'hui adopte la proposition A, y était naguère opposé » ; et l'on croit ainsi avoir démontré qu'il ne faut pas accepter la proposition A. Négligeons le fait que l'homme peut honnêtement changer suivant les circonstances. À ce propos, Bonghi avait coutume de remarquer que seul l'animal ne change jamais. Mais encore s’il était démontré que le changement de celui qui propose A a lieu, non en vertu de la valeur intrinsèque de A, mais seulement pour quelque avantage qu'en peut espérer celui qui le propose, on n'en pourrait rien conclure contre A ; et l'on reviendrait simplement à la dérivation indiquée dans le texte. Le fait que ces dérivations ne sont d'aucune importance pour le jugement qu'on doit porter sur A, constitue ce qu'il y avait de vrai dans la défense de Caillaux, faite par ses amis, contre les attaques du Figaro. Il est certain que l'utilité ou le dommage, pour une société donnée, de l'impôt sur le revenu, n'a rien, absolument rien à faire avec les qualités familiales, morales, ni même politiques de celui qui propose cet impôt. Mais il faut ajouter qu'infliger la peine de mort à qui emploie ces dérivations erronées, semble quelque peu excessif ; et si cela devenait une règle générale qu'il serait permis à chaque citoyen de mettre en pratique, peu de journalistes et même peu d'autres écrivains resteraient en vie.
[FN: § 1757-1]
Sorberiana : « (p. 18) Anabaptistes. On raconte des Anabaptistes, qui sont (p. 19) pourtant de bonnes gens, mile choses extravagantes, même dans la Hollande, comme entre autres qu'il y en a qui s'assemblent de nuit et à la faveur des ténèbres se mêlent indiferemment. Ce qui est entièrement faux, et n'a de fondement que sur l'histoire de Jean de Leyde, Roi de Munster, et sur la folie de quelques-uns, qui cent ans y a s'imaginèrent qu'il faloit pour être sauvé, aler tout nud, comme faisoit Adam en l'état d'innocence, d'où ils furent nommez Adamistes... (p. 21) Je ne sçache point que depuis ce temps-là il y ait eu rien de pareil, et les gens d'esprit à Amsterdam se moquent des bourdes qu'on a semé (sic). Cependant il me souvient qu'à Paris un certain Soubeyran disoit, qu'en une de ces assemblées nocturnes où il assistoit, il avoit jouï de la fille de son hôte, qui lui refusa après à la maison ce qu'alors elle lui avoit accordé charitablement. Ce n'est pas merveille qu'il se trouvent quelques personnes qui mentent impudemment : mais il y a de quoi s'étonner qu'une imposture s'étende si aisément dans la créance de tout un peuple, comme il arrive en cette affaire-ci, et en la fable de la (p. 22) fille qui avoit un groin de pourceau, de laquelle à Paris et en Hollande tous les Cordoniers ont acheté la planche, et de laquelle à Amsterdam on disoit en général que la maison étoit au Reysser-graft ; mais personne ne l’osoit indiquer ce qui en marquoit la fausseté ».
[FN: § 1760-1]
Prof. L. EINAUDi, dans La Riforma Sociale, décembre 1913. L'auteur parle des journaux protectionnistes anglais : « (p. 856) Ils peuvent d'écrire ainsi l'agriculture anglaise d'aujourd'hui,... le Times, malheureusement tombé aux mains du même grand journaliste jaune, qui est à la tête du Daily Mail et du trust des journaux impérialistes et protectionnistes, le Ridder Haggard, journaliste sensationnel du genre de ceux qui, en Italie, décrivirent les merveilles agricoles de la Libye, avant la guerre et dans ses premiers temps... »
[FN: § 1760-2]
ROBERT DE JOUVENEL ; La république des camarades « (p. 201) Le directeur d'un journal est rarement un journaliste [cela dépasse peut-être un peu la vérité] ; ce n'est presque jamais un homme politique ; c’est, le plus souvent, un entrepreneur de travaux publics ; c'est toujours un industriel ». Ainsi que nous l'avons souvent remarqué d'une manière générale, il y a du vrai sous ces formes un peu paradoxales. « Quelquefois le journalisme constitue sa seule industrie, quelquefois il ne constitue que la branche annexe d'une industrie principale. Mais, dans l'un ou l'autre, le journalisme implique l'exploitation d'une grosse maison de commerce [cela est conforme à la vérité pour les grands pays où domine la ploutocratie]. Le chiffre d'affaires de certains journaux dépasse trente millions de francs. Une feuille quotidienne de troisième ordre exige un déplacement de fonds de quinze (p. 202) cent mille francs par an. On conçoit que, pour administrer de pareils budgets, il ne suffise pas d'avoir de la fantaisie, de l'esprit, ni même du talent... En 1830, un journal paraissait sur quatre petites pages de papier à chandelles (p. 203) ; il contenait quelques articles peu ou point payés, pas de dépêches, pas d'informations coûteuses, pas d'illustrations. Il coûtait cinq sous. Aujourd'hui la plupart des journaux paraissent sur six, huit, dix et douze pages. Ils sont illustrés de clichés onéreux ; ils publient les articles chèrement payés ou de personnalités en renom, des colonnes de dépêches dont certaines au tarif de plusieurs francs le mot – et ils sont vendus trois centimes et demi aux entrepositaires. Comment vivent-ils donc ? Ils vivent de leur publicité – à moins, bien entendu, qu'ils ne vivent de leurs trafics. Un journal peut se passer de journalistes, il peut même se passer de paraître [paradoxe expliqué dans une note : „ Il existe quelque part une nécropole des journaux qui ne paraissent plus. Un industriel ingénieux, qui en détient les titres, les fait inscrire de temps en temps en tête des colonnes d'une autre feuille et touche le montant d'anciens traités de publicité. Son industrie prospère “]. Il ne peut se passer de publicité. ...(p. 205) Avant de prendre une détermination quelconque, le directeur responsable d'un journal – fût-il un saint – est contraint d'envisager ces deux termes : 1° Ne pas froisser ceux qui détiennent les informations, c'est-à-dire toutes les puissances politiques et administratives ; 2° Ne pas heurter ceux qui détiennent la publicité, c'est-à-dire toutes les puissances commerciales et financières [pas toutes, à vrai dire, mais seulement celles dont dépend le journal]... (p. 209) On appelle les journaux gouvernementaux quand ils sont serviles. On les appelle indépendants quand ils ne sont que gouvernementaux. On appelle journaux d'opposition ceux qui sont en coquetterie avec le pouvoir. Il existe encore quelques rares organes qui ne sont reliés au Gouvernement par rien, par personne. Mais il est entendu qu'on ne doit pas les prendre au sérieux ».
[FN: § 1766-1]
Il y a quelques siècles, presque toutes les dérivations en matière sociale ou pseudo-scientifique, étaient unies à des considérations de théologie chrétienne. Aujourd'hui, elles se lient avec des considérations de théologie humanitaire. Les considérations de théologie chrétienne nous semblent souvent absurdes ; celles de la théologie humanitaire le sembleront aux hommes des temps futurs, où une autre théologie aura pris la place de la théologie humanitaire. Il y a quelques siècles, on expliquait tout par « le péché originel » ; aujourd'hui, on l'explique par la « faute de la société » (§1716-3-) ; dans l'avenir, on aura quelque autre explication, également théologique et vide de sens, au point de vue expérimental.
[FN: § 1767-1]
RENAN ; Hist. du peupl. d'Isr., t. V. : « (p. 349) Comment avec cela Philon reste-t-il Juif ? C'est ce qu'il serait assez difficile de dire, s'il n'était notoire que, dans ces questions de religion maternelle, le cœur a des sophismes touchants pour concilier des choses qui n'ont aucun rapport entre elles [ce n'est pas un cas particulier, ainsi que l'auteur semble le croire : cela se produit d'une façon générale : laissons touchants de côté] Platon aime à éclairer ses philosophèmes par les mythes, les plus gracieux du génie grec, Proclus et Malebranche se croient dans la religion de leurs pères, le premier en faisant des hymnes philosophiques à Vénus, le second en disant la messe. La contradiction, en pareille matière, est un acte de piété. Plutôt que de renoncer à des croyances chères, il n'y a pas de fausse identification, de biais complaisant qu'on n'admette. Moïse Maimonide, au XIIe siècle, pratiquera la même méthode, affirmant tour à tour la Thora et Aristote, la Thora entendue à la façon des talmudistes, et Aristote entendu à la façon matérialiste d'Ibn-Roschd. L'histoire de l'esprit humain est pleine de ces pieux contresens. Ce que faisait Philon il y a dix-neuf cents ans, c'est ce que font de nos jours tant d'esprits honnêtes, dominés par le parti pris de ne pas abdiquer les croyances qui se présentent à (p. 350) eux comme ayant un caractère ancestral [l’auteur présente encore comme particulier ce qui est général pour toutes sortes de dérivations]. On risque les tours de prestidigitation les plus périlleux pour concilier la raison et la foi [d'une manière générale : des dérivations de résidus hétérogènes]. Après avoir obstinément nié les résultats de la science, quand on est forcé par l'évidence, on fait volte-face et l'on dit avec désinvolture : Nous le savions avant vous ».
[FN: § 1775-1]
Un ensemble de dérivations a la prétention de pouvoir résoudre cette question en la transformant en un problème des « droits » de l'individu. en rapport avec les « droits » de l'« État ». Cette solution ressemble, à celle qui expliquait l’ascension de l'eau dans les pompes par l'horreur de la Nature pour le vide. C'est-à-dire qu'elle explique les faits, non par d'autres faits, mais par des entités fantaisistes. Ce qu'est cet « État », personne ne peut le dire avec précision ; moins encore ce que peuvent bien être ses « droits » et ceux de l'individu. L'obscurité et le mystère augmentent, si l'on recherche le rapport de ces « droits » avec les diverses utilités. Enfin, la question supposée résolue dans les termes indiqués, personne ne peut dire comment on pourra appliquer la solution théorique dans le domaine concret. Cette solution théorique apparaît donc seulement comme l'expression d'un pieux désir de son auteur, qui pouvait vraiment nous la donner immédiatement, sans faire tant de détours et invoquer ces belles mais fort obscures entités.
[FN: § 1776-1]
EUSTATHII commentarii in Dionysium periegetes, p. 245, Didot, v. 157 : « Il faut savoir que comme l'Euxin est assimilé à un arc, ainsi d'autres lieux nombreux sont aussi figures diversement par quelque ressemblance. Ainsi l'histoire dit que le delta égyptien est triangulaire... Ainsi Alexandrie est représentée par une chlamyde militaire ; l'Italie par le lierre : l'Espagne par une peau de bœuf ; l’île de Naxos par une feuille de vigne ; le Péloponèse par une feuille de platane ; la Sardaigne par la trace d'un pied humain ; Chypre par une peau de mouton ; la Libye par un trapèze ; et les anciens représentent d'autres [contrées] autrement ».
[FN: § 1778-1]
Cette conclusion expérimentale se rapproche, dans la forme, de celle de certains métaphysiciens qui, pour connaître la « vérité », se servent de l'intuition avec ou sans l'intellect ; mais la conclusion expérimentale diffère de l'autre quant au fond. 1° D'abord, il y a divergence au sujet du terme « vérité ». Pour le métaphysicien il désigne quelque chose d'indépendant de l'expérience, au delà de l'expérience. Pour l'adepte des sciences expérimentales, il désigne seulement un accord avec l'expérience. Pour mieux faire voir la chose, recourons à une image grossière mais expressive. L'individu est comme une plaque photographique qui, exposée en un lieu donné, en reçoit l'impression de choses et de faits ; les dérivations par lesquelles l'individu exprime cette impression correspondent à l'opération qu'on appelle développement de la plaque photographique. Le métaphysicien veut que cette opération fasse apparaître des choses et des faits qui n'existaient pas dans le lieu où la plaque a été exposée, et qui sont également « réels » ; certains disent même qu'ils constituent seuls la « réalité ». L'adepte des sciences expérimentales n'attend de cette opération que l'apparition de choses et de faits existant dans le lieu où la plaque a été exposée. 2° Ensuite, il y a la divergence habituelle entre l'absolu métaphysique et le relatif expérimental. Le métaphysicien estime que ses opérations intuitives le conduisent à la « vérité absolue » ; l'adepte des sciences expérimentales les accepte seulement comme un indice de ce que peut être la réalité ; indice qu'il appartient à l'expérience seule de confirmer ou de rejeter. Pour revenir à l'image dont nous nous sommes servis tout à l'heure le métaphysicien, quand la plaque est développée, considère comme parfaite la correspondance avec la réalité ; l'adepte des sciences expérimentales sait qu'il y a une infinité de divergences. Laissons de côté celles qui proviennent du fait que la plaque reproduit sur un plan ce qui existe dans l'espace, les objets colorés sans couleurs, et autres divergences semblables ; mais il y en a d'autres, plus spéciales : par exemple si un être vivant a bougé, si une feuille a été agitée par le vent, tandis que la plaque, était découverte. Notons comme coïncidence tout à fait singulière, qu'il y a un fait réel correspondant précisément à la comparaison que nous avons établie uniquement pour nous faire comprendre. Plusieurs personnes crurent avoir photographié le « double astral » d'hommes et d'animaux. Ils montraient la photographie d'un homme avec une tache à côté, celle d'un faisan avec une autre tache, et disaient : « Voilà le double astral de l'homme et du faisan ». Le prof. Kronecker, de Zurich, remarqua que ces photographies sont celles que font tous les commençants, lorsqu'ils ne savent pas encore reproduire et développer sans taches le sujet qu'ils veulent photographier. Combien de ces taches ont été prises pour réalité par les métaphysiciens et par les théologiens !
[FN: § 1793-1] « C'est à l'idéologie, à cette ténébreuse métaphysique, qui, en recherchant avec subtilité les causes premières, veut sur ces bases fonder la législation des peuples, au lieu d'approprier les lois à la connaissance du cœur humain et aux leçons de l'histoire, qu'il faut attribuer tous les malheurs qu'a éprouvés notre belle France. Ces erreurs devaient et ont effectivement amené le régime des hommes de sang. En effet, qui a proclamé le principe d'insurrection comme un devoir ? Qui a adulé le peuple en le proclamant à une souveraineté qu'il était incapable d'exercer ? Qui a détruit la sainteté et le respect des lois, en les faisant dépendre non des principes sacrés de la justice, de la nature des choses et de la justice civile, mais seulement de la volonté d'une assemblée, composée d'hommes étrangers à la connaissance des lois civiles, criminelles, administratives, politiques et militaires ? Lorsqu'on est appelé à régénérer un État, ce sont des principes constamment opposés qu'il faut suivre. L'histoire peint le cœur humain ; c'est dans l'histoire qu'il faut chercher les avantages et les inconvénients des différentes législations ».
[FN: § 1794-1]
TAINE ; L'ancien régime.
[FN: § 1794-2]
Taine ne distingue pas entre une « donnée simple » tirée de l'expérience, et une « donnée simple » tirée du sentiment. Et pourtant cette distinction est indispensable, parce qu'elle fixe la limite qui sépare les sciences logico-expérimentales de la littérature sentimentale, de la métaphysique, de la théologie (§55, 56). Adam Smith et Rousseau tirent tous deux des conséquences de principes simples ; mais le premier emploie des principes qui, ne fût-ce qu'en une faible mesure, résument l'expérience ; le second, de propos délibéré (§821-1), les maintient étrangers à l'expérience. Il suit de là que les déductions qu'on peut tirer des principes dont s'est servi Adam Smith, ont avec l'expérience une partie, petite ou grande, qui est commune : et les déductions que l'on tire des principes de Rousseau appartiennent à de nébuleuses régions sentimentales, éloignées du domaine de l'expérience. On doit faire une observation identique pour d'autres principes que certains auteurs veulent faire passer pour expérimentaux, tandis qu'ils ne le sont pas.
[FN: § 1798-1]
Ils objectent parfois à leurs adversaires que ceux-ci ne raisonnent pas suivant les règles de la métaphysique. De la même façon, les astrologues pourraient objecter aux astronomes qu'ils ne raisonnent pas suivant les règles de l'astrologie. Celui qui admet l'existence d'une science donnée S, et veut seulement en changer certaines conclusions, doit évidemment raisonner suivant les règles de cette science S. Mais celui qui, au contraire, l'estime non-concluante, vaine, fantaisiste, doit non moins évidemment s'abstenir de raisonner suivant les règles qu'il a ainsi repoussées ; et il est puéril de l'accuser de les ignorer, parce qu'il ne s'en sert pas. On comprend que celui qui défend des théories fantaisistes ait avantage à prétendre qu'on ne peut les combattre si l'on n'en accepte pas les règles et les principes, parce qu'ainsi, il se met dans une position inexpugnable. Mais le choix des moyens de combattre appartient à qui les emploie, et non pas à celui contre lequel ils sont dirigés. Évidemment, il conviendrait à messieurs les astrologues qu'on ne puisse les combattre qu'en employant les règles et les principes de l'astrologie ; mais il est nécessaire qu’ils se résignent à ce qu'on fasse voir la vanité de leur pseudo-expérience, de ses règles, de ses principes, en en comparant les résultats avec les faits expérimentaux.
[FN: § 1799-1]
La religion chrétienne était à l'origine une religion de pauvres, d'imprévoyants, de gens qui méprisaient les biens matériels, de pacifistes. Puis elle s'adapta très bien à des sociétés où il y avait des riches, des prévoyants, des gens avides de biens matériels, des guerriers. Cela fut obtenu grâce aux dérivations. Mais celles-ci eurent aussi quelque effet sur le fond des phénomènes, et en produisirent de nouveaux : par exemple celui de l'Inquisition et de plusieurs persécutions religieuses. Nous manquons encore d'une bonne histoire de ces événements, faite sans intentions polémiques pour ou contre la religion chrétienne ou l'une de ses sectes, et sans avoir pour but de louer ou de blâmer certaines institutions sociales et morales. La religion marxiste condamne absolument l'intérêt du capital ; mais cette condamnation n’a pas un effet pratique beaucoup plus grand que celle fulminée déjà par la religion chrétienne. Dans l'une de ces religions comme dans l'autre, il y a des personnes qui, vivant loin du monde, gardent la foi aux dogmes ; mais les gens qui prennent part au gouvernement de la chose publique savent très bien concilier ces dogmes avec les nécessités de la pratique. Aussi bien que les princes catholiques, les papes se firent prêter de l'argent et en payèrent l'intérêt ; et aujourd'hui, dans les pays où les socialistes prennent une part petite ou grande au gouvernement dd la chose publique, ils ne s'opposent nullement à des augmentations souvent énormes de la dette publique. Il ne manque pas de communes administrées par des socialistes, et qui contractent des dettes dont elles paient l'intérêt. Dans l’un et l'autre cas, les dérivations viennent à l'aide, pour justifier les transgressions des dogmes. Les catholiques ont imaginé la très ingénieuse dérivation des trois contrats. Les socialistes, moins ingénieux ou plus modestes, se contentent de dire qu'ils ne peuvent renoncer aux emprunts, tant que l'abolition de l'intérêt de l'argent n'est pas générale ; et, avec cette excuse commode, ils peuvent aller jusqu'au jugement dernier. La religion humanitaire amènerait directement la destruction des sociétés humaines, si ses dogmes étaient suivis à la lettre ; mais lorsque messieurs les humanitaires prennent part au gouvernement, ils savent les oublier d'une manière opportune. Par exemple, ils détruisent sans le moindre scrupule les peuples qu'ils appellent barbares, ou les tiennent dans un dur servage, plus dur souvent que celui qui porta le nom d'esclavage. Mais le dieu Progrès veut ses victimes, comme les voulurent déjà les dieux qui le précédèrent dans le panthéon des peuples civilisés. Si l'égalité, qui est un dogme de la moderne religion démocratique, était effective, il est probable que les sociétés humaines retourneraient à l'état sauvage. Mais l'égalité demeure parmi les dérivations, où elle règne, tandis que, dans la pratique, il y a des inégalités très grandes et non moindres, fût-ce sous une autre forme, que celles qu'on a observées dans le passé.
[FN: § 1800-1]
MATTH. Il y a plusieurs variantes, mais qui ne changent pas foncièrement le sens. « Trad. SEGOND (VI, 19) Ne vous amassez pas des trésors † sur la terre, où la teigne et la rouille †† détruisent, et où les voleurs percent et dérobent... (25) C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? (26) Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?... (28) Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent... (31) Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? (32) Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin... (34) Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine ».
† Le terme ![]() a un sens plus large que thésauriser, en français. Il signifie proprement amasser pour conserver. Théophraste l'emploie pour le blé, Hist. plant., VIII, 11, 6. On pourrait citer d'autres exemples semblables.
a un sens plus large que thésauriser, en français. Il signifie proprement amasser pour conserver. Théophraste l'emploie pour le blé, Hist. plant., VIII, 11, 6. On pourrait citer d'autres exemples semblables.
†† ![]() « Proprement,
« Proprement, ![]() « est la teigne qui détruit les habits. HESYCH. s. r. Quant à
« est la teigne qui détruit les habits. HESYCH. s. r. Quant à ![]() , presque tout le monde traduit par rouille. Cela peut aller pourvu qu'on prenne ce terme, non au sens restreint de la rouille du fer, mais comme signifiant tout ce qui ronge et qui consume. RILLIET, Les livres du Nouveau Testament, traduit : « (p. 19) ...où la teigne et la vermoulure détruisent ». Ainsi cela va bien.
, presque tout le monde traduit par rouille. Cela peut aller pourvu qu'on prenne ce terme, non au sens restreint de la rouille du fer, mais comme signifiant tout ce qui ronge et qui consume. RILLIET, Les livres du Nouveau Testament, traduit : « (p. 19) ...où la teigne et la vermoulure détruisent ». Ainsi cela va bien.
[FN: § 1800-2]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Les fictions juridiques ont précisément pour but de corriger par des interprétations certaines règles légales. Au fur et à mesure que de nouvelles nécessités écartent la pratique de la théorie, le législateur éprouve le besoin d'opérer un raccordement, pour maintenir la correspondance entre le fait et la lettre. La jurisprudence tout entière est une adaptation perpétuelle et mobile d'un texte qui demeure à des circonstances et des sentiments qui changent. On sait assez que, fréquemment, d'un même texte, les juristes tirent des conclusions très différentes, quelquefois opposées, suivant le temps et les lieux. Tandis que les uns déclarent s'en tenir strictement à la lettre, les autres soutiennent, chacun pour leur compte, que leurs thèses sont conformes à l'esprit de la loi. Ce que l'on entend par esprit de la loi, c'est tantôt l'intention présumée du législateur, tantôt l'opinion courante ou celle de qui l'invoque ; mais le but est toujours le même : atténuer la rigueur du précepte juridique par rapport à certaines fins que poursuit l'interprète. Pour cela, il est bon d'avoir recours à des dérivations quelque peu indéterminées, afin de laisser du jeu à l'interprétation et de ménager une certaine réserve d'arguments nouveaux. (Voir §229 et 834 à 836.)
[FN: § 1801-1]
D. HIERONY.; In Matth., c. VI, t. VI : « (p. 9) Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra : ubi aerugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur... Ideo a) dico vobis : Ne soliciti sitis animae vestrae, quid manducetis : neque corpori vestro, quid induamini. Nonne b) anima plus est quam esca, et corpus plus est quam vestimentum ? Respicite c) volatilia coeli : quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, et pater vester coelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis, illis d) ... Considerate lilia agri quo modo crescunt : non laborant neque nent. ...Nolite e) ergo soliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur ? Haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim pater vester, quia his omnibus indigetis... Nolite ergo soliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies solicitus erit sibi ipsi. Sufficit f) diei malitia sua ».
a) In nonnullis codicibus additum est : neque quid bibatis. Ergo quod omnibus natura tribuit, et iumentis ac bestiis, hominibusque commune est, huius cura non penitus liberamur. Sed praecipitur nobis ne soliciti simus quid comedamus : quia in sudore vultus praeparamus nobis panem. Labor exercendus est : solicitudo tollenda. Hoc quod dicitur : Ne soliciti sitis animae vestrae quid comedatis : neque corpori vestro quid induamini, de carnali cibo et vestimenio accipiamus. Caeterum de spiritualibus cibis et vestimentis semper debemus esse soliciti.
b) Qond dicit istiusmodi est : Qui maiora praestitit, utique et minora praestabit.
c) Apostolus praecipit, ne plus sapiamus, quam oportet sapere. Istud testimonium et in praesenti capitulo conservandum est. Suut enim quidam, qui volunt terminus patrum excedere, et ad alta volitare, in ima merguntur : volatilia dicentes caeli angelos esse, caeterasque in Dei ministerio fortitudines. quae absque cura sui, Dei alantur providentia. Si hoc ita est, ut intelligi volunt, quo modo sequitur dictum ad homines: Nonne vos magis pluris estis illis ? Simpliciter ergo accipiendum : quod si volatilia absque cura et aerumnis, Dei aluntur providentia : quae bodie sunt, et cras non erunt : quorum anima mortalis est, et cum esse cessaverint, semper non erunt quanto magis homines quibus aeternitas promittitur, Dei reguntur arbitrio ?
d) Sicut animam plus esse quam cibum, comparutione avium demonstravit : sic corpus plus esse quam vestem, ex consequentibus rebus ostendit dicens...
e) De presentibus ergo concessit debere esse solicitos qui futura probibet cogitare. Unde et Apostolus (I Thess., II, 9) : Nocte et die, inquit, manibus nostris operantes : ne quem vestrum gravaremus. Cras in scripturis futurum tempus intelligitur...
f) Hic et malitiam non contrariam virtuti posuit, sed laborem et afflictionem, et angustias saeculi... Sufficit ergo nobis praesentis temporis cogitatio : futurorum curam, quae incerta est, relinquamus.
[FN: § 1803-1]
D. AUGUST. ; De sermone Domini in monte secundum Matthaeum, II, 17, 57. Après avoir montré que Saint Paul s'est préoccupé de l'avenir, et avoir cité les paroles de l'apôtre, Saint Augustin ajoute : Male intelligentibus non videtur servare praeceptum Domini, quo ait : « Respicite volatilia coeli, quoniam non serunt neque metunt, neque congregant in horrea » ; et : « Considerate lilia agri quomodo crescunt, non laborant neque nent ». Cum istis praecipit ut laborent, operantes manibus suis, ita ut habeant quod etiam aliis possint tribuere (I Thess., II, 9). Et quod saepe de seipso dicit, quod manibus suis operatus sit, ne quem gravaret (II Thess., III, 8) : et de illo scriptum est, quod coniunxerit se Aquilae propter artis similitudinem, ut simul operarentur unde victum transigerent (Act., XVIII, 3), non videtur imitatus aves coeli et lilia agri. À vrai dire, cela paraît tout à fait évident ; et pourtant, il n'en est pas ainsi ! His et huiusmodi Scripturarum locis, satis apparet Dominum nostrum non hoc improbare, si quis humano more ista procuret : sed si quis propter ista Deo militet, ut in operibus suis non regnum Dei, sed istorum acquisitionem intueatur. C'est-à-dire : « Il apparaît suffisamment par ces passages et par d'autres semblables des Écritures que notre Seigneur ne réprouve pas cela, si quelqu'un recherche ces choses par des moyens humains ; mais bien si quelqu'un sert Dieu en vue de ces choses, de telle sorte qu'il tende par ses œuvres, non au règne de Dieu, mais à l'acquisition de ces choses ». Si Saint Matthieu a vraiment voulu dire cela, il faut reconnaître, que tout en ayant de beaux talents, il n'avait pas celui d'exprimer clairement sa pensée.
[FN: § 1803-2]
D. AUGUST. ; Retractat., II, 21 : La nécessité me contraignit d'écrire le livre Du travail des moines, parce que lorsque les monastères commencèrent à exister à Carthage, les uns se subvenaient par les travaux manuels, obéissant à l'apôtre, les autres voulaient vivre des oblations des gens religieux, en ne faisant rien pour se procurer ou compléter leur nécessaire, estimant mieux pratiquer, et s'en vantant, le précepte évangélique où le Seigneur dit (Matth., VI, 26) : Respicite volatilia coeli et lilia agri. C'est pourquoi, même parmi les simples laïques, mais qui étaient animés d'une foi fervente, des disputes tumultueuses commencèrent à se produire, qui troublaient l'Église... » – D. AUGUST. ; De opere monachorum, 23, 27. Le saint dit : « En vérité, ils invoquent maintenant l'Évangile du Christ contre l'apôtre du Christ. Elles sont surprenantes les actions de ces paresseux, qui veulent faire au nom de l'Évangile un obstacle de ce que l’apôtre prescrivit et fit précisément afin que l'Évangile même n'eût pas d'obstacles. Et pourtant, si nous voulions les contraindre à vivre suivant les paroles mêmes de l'Évangile, telles qu'ils les comprennent, ils seraient les premiers à tâcher de nous persuader qu'elles ne doivent pas être comprises comme ils les comprennent. Ils disent, en effet, ne pas devoir travailler parce que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, eux que le Seigneur nous donna comme exemple, afin que nous ne nous inquiétions pas de ces choses nécessaires. Pourquoi ne font-ils pas attention à ce qui suit ? car il n'est pas dit seulement : parce qu'„ ils ne sèment ni ne moissonnent, “ mais il est ajouté „ et ils n'amassent pas dans les greniers “. Ces greniers peuvent être des greniers proprement dits ou des crédences. Pourquoi donc ces gens veulent-ils avoir les mains oisives et les crédences pleines ? Pourquoi ce qu'ils recueillent grâce au travail d'autrui l'amassent-ils et le conservent-ils pour leurs besoins journaliers ? Pourquoi moulent-ils et cuisent-ils ? Vraiment, les oiseaux ne font pas cela ».
[FN: § 1803-3]
D. AUGUST. ; De sermone Domini in monte sepundum Matthaeum, II 17, 58. Un sermon de Saint Augustin, qui paraît apocryphe, se rapproche un peu plus du sens littéral. Le précepte évangélique est entendu en ce sens qu'il condamne seulement l'avarice, et qu'il promet que Dieu aura soin de procurer les biens matériels aux fidèles. – Serm. CCCX (alias XLVII ex 50 homil.), Eleemosinae efficacia – Inanis est avarorum providentia, 3. ...Fac misericordiam. Quid dubitas ? Non te deserit, qui te praerogatorem constituit. Ipsitis est enim vox in Evangelio arguentis incredulos et dicentis : « Considerate volatilia caeli, quoniam rien seminant neque metunt », quibus non sunt cellaria ; « et Pater vester caelestis pascit illa ». C'est possible, mais quand la neige recouvre la terre, les pauvres oiseaux souffrent de la faim, et beaucoup meurent. Ceux qui vivent près des habitations des hommes sont bien contents d'être nourris de ce que la prévoyance humaine a mis en réserve.
[FN: § 1803-4]
D. ANSELMI ; Enarrationum in Evangelium Matthaei, c. VI : [Ideo dico vobis : Ne soliciti sitis, etc.] Et quia non potestis Deo servire et mammonae, ideo nolite esse soliciti de divitiis temporalibus causa vietus et vestitus. Duae enim sunt sollicitudines, alia est rerum, alia vitio hominum. Ex rebus ipsis oritur sollicitudo, quia panem habere non possumus nisi seminemus, laboremus et similia. Hanc sollicitudinem non prohibet quia Dominus ait : In sudore vultus tui vesceris pane tuo. – Cela prouve qu'il y a des passages contradictoires dans l'ancien et dans le nouveau Testament, mais ils ne détruisent pas le sens de SaintMatthieu. – Conceditur ergo nobis providentia et labor. Sed est quaedam sollicitudo ex vitio hominum superflua, quando ipsi desperantes de, bonitate Dei frumentum, plusquam est necessarium, et pecuniam reservant, et dimissis spiritualibus, illis intenti sunt hoc prohibetur. – Saint Anselme fait cette distinction : mais on n'en voit pas trace dans les paroles de Matthieu. – Saint Jean Chrysostôme s'en lire aussi d'une manière semblable. D. IOANN. CHRYS. ; hom. XXI in c. Matth., VI. Après avoir rappelé que le Seigneur dit des oiseaux qu'ils ne sèment ni ne moissonnent. Saint Jean Chrysostôme ajoute : « (3) Quoi donc ? Dit-il qu'on ne doit pas semer ? Il ne dit pas qu'on ne doit pas semer, mais qu'on ne doit pas s'inquiéter, ni qu’on ne doit pas travailler, mais qu'il ne faut pas se décourager ni se rendre malheureux en se tourmentant ».
[FN: § 1803-5]
D. THOM. ; Summa theol., IIa IIae, q. 55, art. 7. Conclusio. Oportet hominem tempore congruenti atque opportuno, non autem extra illud tempus, de futuris esse sollicitum.
[FN: § 1804-1]
D. EPIPHANII. ; adversus haereses : haeresis LXXX, 1 : ![]()
![]() ... « mais étant seulement des Grecs ». (2) Ensuite, ils prirent le nom de chrétiens.
... « mais étant seulement des Grecs ». (2) Ensuite, ils prirent le nom de chrétiens.
[FN: § 1804-2]
THEODORET. : Eccles. hist., IV, 11. – IOAN. DAMASC. ; De haeresibus « Ils fuient tout travail manuel, comme non convenable à un chrétien, et indigne de lui ». – THEODORET. ; Hacret. fab., IV., 11. – D. AUGUST. ; De haeres., 57 : Dicuntur Euchitae opinari, monachis non licere sustentandae vitae suae causa aliquid operari, atque ita se ipsos monachos profiteri, ut omnino ab operibus vacent.
[FN: § 1807-1]
F. TOCCO ; L'eresia nel medio evo. Parlant des franciscains intransigeants, l'auteur dit : « (p. 518) Sous ces prétextes mesquins, les intransigeants visaient bien plus haut : à déclarer que la vie prescrite par la règle ne diffère pas de la vie évangélique, et que Jésus et les apôtres s'y sont conformé ; que par conséquent non seulement les Frères mineurs, mais tous les chrétiens qui doivent faire de l'Évangile la règle de leur vie, devraient s'y conformer ; ce qui revient à dire que non seulement le clergé, mais toute la chrétienté devrait se transformer en un vaste couvent franciscain ».
[FN: § 1810-1]
Nous avons une longue lettre de Jean XXII, dans laquelle il se plaint vivement de l'œuvre perverse des Minorites, et leur reproche de vouloir se soustraire à l'autorité du Saint-Siège. – BARIONIUS (RAYNALDO) ; Ann. eccl., ann. 1318, XLV. Il transcrit la lettre de Jean XXII : ... Verum quia sic sunt casus mentis, ut primo quidem infelix animus per superbiam intumescat, et inde in contentionem, de contentione in schisma, de schisinate in haeresim, et de haeresi in blasphemias infelici gradatione, immo praecipiti ruina descendat ;...
[FN: § 1812-1]
F. Tocco ; L'eresia nel medio evo. – FLEURY ; Hist. eccl., t. XX. L'auteur dit des franciscains : « (p. XII) Il eût été, ce semble, plus utile à l'église que les évêques et les papes se fussent appliquez sérieusement à réformer le clergé séculier, et le rétablir sur le pied des quatre premiers siècles, sans appeller au secours ces troupes étrangeres ; en sorte qu'il n'y eût que deux genres de personnes consacrées à Dieu, des clercs destinez à l'instruction et à la conduite des (p. XIII) fidèles et parfaitement soumis aux évêques ; et des moines entièrement séparez du monde, et appliquez uniquement à prier et travailler en silence. Au treizième siècle l'idée de cette perfection étoit oubliée, et l'on étoit touché des désordres que l'on avoit devant les yeux : l'avarice du clergé, son luxe, sa vie molle et voluptueuse, qui avoit aussi gagné les monasteres rentez ».
[FN: § 1813-1]
Prêcher le retour à la « pauvreté évangélique » fut toujours l'arme préférée des ennemis de la papauté. Frédéric II, lui-même, s'en servit. F. TOCCO ; L'eres. nel med. evo, p. 447, remarque : « À l'égard du clergé séculaire, le langage de Frédéric II n'est pas différent de celui des franciscains intransigeants. Voyez la lettre au roi d'Angleterre, dans Bréholles, III, 37-38, p. 50 : In paupertate quidem et simplicitate fundata erat Ecclesia primitiva, cum, sanctus, quos catalogus sanctorum commemorat, fecunda parturiret : sed (p. 448) olim fundamentum. nemo potest ponere praeter illud quod positum est a Domino et stabilitum. Porro quia in divitiis navigant, in divitiis volutantur, in divitiis aedificant, timendum ne paries inclinetur Ecclesiae, ne maceria depuisa ruina subsequatur ». – Pour combattre Frédéric II, Grégoire IX favorisa le parti intransigeant des franciscains. F. TOCCO ; loc. cit. : « (p. 445)
Je crois probable que le pape rompit avec le général franciscain pour des motifs politiques. Nous avons dit déjà que celui-ci était également bien vu de Grégoire et de Frédéric, et Salimbene nous dit qu'il jouait souvent le rôle de médiateur entre eux. Peut-être, dans ces négociations se montra-t-il plus favorable à la cause impériale... Pour ces raisons, Grégoire déclara cette cause liée à celle du parti intransigeant, et non seulement il déposa le malencontreux (p. 446) général, mais l'ayant fait expulser de l'ordre, il l'excommunia solennellement ; et il lui serait certainement arrivé pis, si Frédéric ne l'eût pris sous sa protection. L'avisé empereur, accusé d'hérésie, tirait grand avantage d'avoir de son côté le compagnon de saint François, qui, peu d'années auparavant, jouissait d'un grand respect de la part du pape lui-même ».
[FN: § 1814-1]
Plus tard, en 1311, on trouve définie une différence analogue, dans une bulle de Clément V. CLEMENT., V, 11, De verborum significatione, 1, Exivi de paradiso... Ex praemissis auteni succrevit non parum scrupulosa quaestio inter fratres : videlicet utrum ex suae professione regulae obligentur ad arctum, et tenuem, sive pauperem usum rerum : quibusdam ex ipsis credentibus, et dicentibus, quod sicut quoad dominium rerum habent ex voto abdicationem arctissimam ; ita ipsis quoad usum arctitudo maxima, et exilitas est indicta. Aliis in contrarium asserentibus, quod ex professione sua ad nullum usum pauperem, qui non exprimatur in regula, obligantur : licet teneantur ad usum moderatum temperantiae, sicut et magis ex concedenti, quam ceteri Christiani.
[FN: § 1814-2]
F. TOCCO ; I, p. 500, note : Liber sententiarum inquis. tholos., p. 326 : Dixit tamen quod audivit ab aliquibus fratribus minoribus de illis vocatis spiritualibus de Narbona et ita fore credidit quod ordo fratrum minorum debebat dividi in tres partes, scilicet in communitate ordinis, quae vult habere granaria et cellaria, et in fratissellis et fratribus, qui sunt in Sicilia sub fratre Henrico de Ceva, et fratribus vocatis spiritualibus vel pauperibus et etiam beguinis. Et dicebant quod prime due partes, quia non observant regulam beati Francisci debebant cadere et cassari, sed tercia pars quia observabat regulam evangelicam debebat remanere usque ad finem mundi...
[FN: § 1814-3]
FLEURY ; Hist. eccl., t. XVIII « (p. 535) Ceux d'entre les frères mineurs qui se pretendoient les plus zélés pour l'étroite observance, ne manquèrent pas de profiter de la disposition favorable du pape (p. 536) Célestin pour l'austérité et la réforme. Ils lui envoyèrent donc frère Libérat et frère Pierre de Macérata... Ils vinrent le trouver... et lui demandèrent que sous son autorité, à laquelle personne n'oseroit s'opposer, il leur fût permis de vivre selon la pureté de leur règle et l'intention de saint François : ce qu'ils obtinrent facilement. Mais de plus le pape leur accorda la faculté de demeurer ensemble partout où il leur plairoit, pour y pratiquer en liberté la rigueur de leur observance... il voulut qu'ils ne s'appellassent plus frères Mineurs, mais les pauvres hermites, et on les appela ensuite les hermites du pape Célestin... (p. 537) Ainsi, quoique les intentions de Célestin fussent très pures, la simplicité dans laquelle il avoit passé sa vie, le défaut d'expérience, la foiblesse de l'âge, lui firent commettre bien des fautes... (p. 543) Boniface commença son pontificat par la révocation des grâces accordées par Célestin, de la simplicité duquel on avoit abusé... ».
[FN: § 1817-1]
Sexti decret., V, 12, De verborum significatione, 3, Exiit qui seminat. Il continue ainsi : Ne talium rerum sub incerto videatur esse dominium, cum patri filius suo modo, servus domino, et monachus monasterio res sibi oblatas, concessas, vel donatas acquirant, omnium ustensilium, et librorum, ac eorum mobilium praesentium, et futurorum, quae, et quorum usumfructum scilicet Ordinibus, vel fratribus ipsis licet habere, proprietatem, et dominiurn (quod et fel. record. Innoc. Papa IV praedec. noster fecisse dignoscitur) in nos, et Romanam Ecclesiam plene, et libere pertinere hac praesenti constitutione in perpetuum valitura sancimus.
[FN: § 1817-2]
Clementinarum, V, 11, De verborum significatione, 1 : Exivi de paradiso... Rursus cum praedictus sanctus [Franciscus] tam in exemplis vitae, quam verbis regulae ostenderit se velle, quod fratres sui, et filii divinae providentiae innitentes suos in Deum iacerent cogitatus, qui volucres caeli pascit, quae non congregant in horrea, nec seminant, nec metunt : non est verisimile voluisse ipsum eos habere granaria, vel cellaria, ubi quotidianis mendicationibus deberent sperare posse transigere vitam suam.
[FN: § 1817-3]
Extravag. Ioan. XXII, 14, De verborum significatione, : Quorundam exigit. La constitution fut répétée : c'est pourquoi elle a différentes dates postérieures à 1317. Nosque nihilominus praefatorum ministrorum, custodum, et gardaniorum iudicio praesentium auctoritate committimus, determinare videlicet, arbitrari, atque praecipere, cuuas longitudinis, et latitudinis, grossitiei, et subtilitatis, formae, sive figurae, alque similium accidentium esse debeant tam habitus, ipsorumque caputia, quam interiores tunicae, quibus fratres omnes Minores dicti ordinis induuntur, ...Nos de praedictorum fratrum nostrorum consilio eorumdem ministrorum, et custodum sub eadem forma iudicio praesentium auctoritate committimus, determinare videlicet, arbitrari, atque praecipere eo casu qualiter, ubi, et quando, et quoties granum, panem, et vinum pro vitae fratrum necessariis fratres ipsi quaerere debeant, conservare, sive reponere, etiamsi reponenda sint in praedictis granariis, et cellariis conservanda.Religio namque perimitur, si a meritoria subditi obedientia subtrahantur : magna quidem paupertas, sed maior integritas, bonum est obedientia maximum, si custodiatur illaesa : nam prima rebus, secunda carni, tertia vero menti dominatur, et animo quos velut eflraenes, et liberos ditioni alterius, humilis iugo propriae voluntatis adstringit.
[FN: § 1817-4]
En 1318, à Marseille quatre frères Mineurs préférèrent se laisser brûler, plutôt que d'obéir au pape. Dans la sentence de condamnation, il est dit de ces Frères : Asseraerunt quod sanctissimus Pater Iohannes XXII non habuit nec habet potestatem faciendi quosdam declarationes, commissiones et praecepta contenta in quadam constitutione sive decretali... quae incipit Quorundam, et quod ipsi Domino Papae non tenebantur obedire. Et insuper corarn nobis constituti protestati sunt verbo et in scriptis quod stabant et stare intendunt usque in diem iudicii in protestationibus... videlicet quod illud quod est contra regulae fratrum minorum observantiam et intelligentiam est per consequens contra evangelium et fidem, alias non esset penitus quod regula evangelica, et quod nullus mortalis potest eos cogere ad deponendum ipsos habitos curtos et strictos (Citat. de Tocco, loc. cit., p. 516). – Extravag. Ioann. XXII, XIV, De verborum significatione,5 : Quia quorundam mentes. Le pape réprouve et condamne l'opinion de ceux qui n'acceptaient pas sa constitution Quorundam exigit, et dit des Mineurs : Ad impugnandas autem constitationes praedictas suprascripta ratione, tam verbo, quam scripto usi sunt publice, sicut fertur : illud, inquiunt, quod per clavem scientiae in fide, ac moribus semel definierunt Romani Pontifices, adeo immutabile perseverat, quod illud successori revocare non licet in dubium, nec contrarium affirmare licet de iis, quae per clavem potestatis ordinaverint, asserant secus esse. In confirmatione autem regulae ordinis fratrum Minorum Honorii tertii, Gregorii noni, Innocentii quarti, Alexandri quarti, Nicolai quarti, praedecessorum nostrorum summorum Pontificum haec verba asserunt contineri :Haec est regula Evangelica Christi, et Apostolorum imitatrix, quae nihil in hoc mundo habet proprium, vel commune ; sed in rebus, quibus utuntur, habent simplicem usum facti ; his addere praesumentes praefatos summos Pontifices, et multa Concilia generalia per clavem scientiae definisse, paupertatem Christi, et Apostolorum constitisse perfecte in expropriatione cuiuslibet temporalis dominii civilis, et mundani, et sustentationem eorum in solo, et nudo usu facti etiam constitisse : ex quibus nituntur concludere, non licuisse, nec licere ipsorum successoribus contra praemissa aliquid immutare...
[FN: § 1817-5]
Extravag. Ioan. XXII, XIV, 3, Ad conditorem canonum. Dans les Inst. iur. canon., on donne ce sommaire de la constitution : Dominium rerum, quae perveniebant ad fratres Minores, retentum ab Ecclesia Romana, simplici usu facti fratribus ipsis reservato in c. Exiit qui seminat eod. tit., 1. 6, summus Pontifex refutat : multiplici ratione probans eos non posse habere in re aliqua simplicem usum facti ; et statuit, quod de cetero nullum ius, nullumque dominium habeat Ecclesia Romana in huiusmodi rebus, quae in posterum conferentur, vel offerentur ipsis fratribus. Sur les genres d'objpts de consommation, le pape dit : Quis enim sanae mentis credere poterit quod intentio fuerit tanti patris unius ovi, seu casei, aut frusti panis, et aliorum usa consuratibilium, quae saepe fratribus ipsis ad consumendum e vestigio conferuntur, dominium Romanae Ecclesiae, et usum fratribus retinere ?
[FN: § 1817-6]
Extravag. Ioan. XXII, XIV, 3. Ad conditorem canonum. Le pape dit qu'il veut revenir à la vérité, des faits, et laisser de côté les simulations, qui pourraient obscurcir la gloire de l'Église. Il conclut, par conséquent : De fratrum, nostrorum consilio hoc edicto in perpetuum valituro sancimus, quod in bonis, quae in posterum conferentur, vel offerentur, aut alias quomodolibet obvenire continget fratribus, seu ordini supradicti (exceptis Ecclesiis, oratoriis, officinis, et habitationibus, ne vasis, libris et vestimentis divinis officiis dedicatis, vel dedicandis, quae ad ipsos obvenient in futurum, ad quae se non extendunt adeo inconvenentia supradicta, propter quod constitutionem istam ad illa extendi nolumus) nullum ius, seu dominium aliquod occasione ordinationis praedictae, seu cuiusvis alterius a quocumque praedecessorum nostrorum super hoc specialiter editae, Romanae Ecclesiae acquiratur ; sed quoad hoc habeantur prorsus ordinationes huiusmodi pro non factis. Il y eut, sur ce point, une longue et âpre polémique entre le pape et les franciscains, soutenus par Louis de Bavière ; car, sous les dérivations, se dissimulait, comme d'habitude, une discussion de fond qui, dans le présent cas, était celle divisant la papauté et l'Empire. Le pape déposa Michel de Cesena, général des franciscains, et l'excommunia. Il publia ensuite la célèbre bulle Quia vir reprobus, où il réfute longuement et subtilement les critiques de Michel de Cesena. Cette bulle apparaît comme un traité complet de la matière. Il est remarquable que le pape ait vu la vanité du droit naturel ou des gens, comme fondement du droit ; mais comme il voulait pourtant conserver ce droit naturel, il se mit à la recherche d'une dérivation propre à faire atteindre ce but, et, ainsi qu'il arrive toujours, il la trouva aisément. Il fit du droit humain une conséquence du droit divin : Adhuc quod nullo iure humano, sed solum divino dominium rerum temporalium potuit dari hominibus, patet ; constat enim, quod rem aliquam aliquis dare non potest nisi cuius est, vel alias eius voluntate : nec dubium quin Deus omnium temporalium vel iure creationis, quia illa de nihilo creaverat, vel iure factionis, quia de sua materia illa fecerat, dominus esset. Ergo nulus Rex de illarum dominio, nisi de voluntate Dei potuit ordinare. Si l'on admet les prémisses, le syllogisme est parfait ; et si la logique pouvait avoir sa place en ces matières, il serait nécessaire de reconnaître que le raisonnement du pape ne fait pas un pli. Unde patet, quod nec iure naturali primaevo, si ponatur pro illo iure, quod omnibus animantibus est commune ; cum illud ius nihil statuat, sed inclinat, seu dirigit ad aliqua omnibus animantibus communia facienda. Nec iure gentium, nec iure Regum, seu Imperatorum fuit dominium rertim temporalium introductum ; sed per Deum, qui est et erat earum rerum dominus, fuit collatum primis parentibus...
[FN: § 1818-1]
Voir : YVES GUYOT ; La question de l'alcool. Allégations et réalités. Paris, F. Alcan, 1917. Ce livre expose fort bien la question et renferme un grand nombre de documents précieux.
[FN: § 1819-1] « Rien de nouveau sous le soleil ». Ce type se retrouve chez les dévots de tout temps et de tout pays. Les dévots des siècles passés et nos humanitaires sont de la même trempe. – Sorberiana : « p. 96) Dévot Il n'y a rien plus à craindre qu'un dévot irrité ; c’est un animal fort colérique et vindicatif, parce qu'il estime que Dieu lui doit de retour, que la Religion est blessée en sa personne et que ses fureurs sont divines ».
[FN: § 1820-1]
EUSEBII ; Evang. praep., XIV, 7 (p. 736).
[FN: § 1821-1]
BAYLE ; Dict. hist.,s. r. Gedicus, (A) : « L'auteur de la dissertation n'en veut point principalement aux femmes ; ce n’est que par accident et fort indirectement qu'il les maltraite : son principal but est de tourner en ridicule le Système des Sociniens, et leur méthode de se jouer des textes les plus formels de la parole de Dieu touchant la Divinité du Verbe. Il y a longtemps qu'un journaliste l'a remarqué. Voici ses paroles : „ Pourquoi ne pas permettre à tout le monde de se convaincre que les Sociniens ne payent que de chicaneries si méchantes, qu'on leur a fait voir qu'avec leurs Gloses on éluderoit tous les passages de l’Écriture qui prouvent que les femmes sont des creatures humaines, je veux dire de même espece que les hommes. Ce fut le sujet d'un petit livre qui parut sur la fin du dernier siècle : mulieres homines non esse, auquel un nommé Simon Gediccus, Ministre du pais de Brandebourg repondit fort serieusement, n'ayant pas pris garde au but de l'Auteur, qui étoit de faire une Satire violente contre les Sociniens ; car en effet que peut imaginer de plus propre à les tourner en ridicule, ou de plus mortifiant, que de leur montrer, que les Gloses, avec lesquelles ils combattent la consubstantialité du Fils de Dieu, sont capables d’empêcher qu'on ne prouve par l’Écriture que les femmes sont des creatures humaines ? " a). Cochleus employa la même machine, mais fort inutilement contre Luther ; il fit des livres où en se servant de la méthode Luthérienne, il prouvoit par des passages de l'Ecriture que Jésus-Christ n'est point Dieu, que Dieu doit obéir au Diable, et que la Sainte Vierge ne garda point sa virginité ». Bayle ajoute que : Theoph. Raynaudus « venoit de donner un grand exemple du pouvoir de la chicane : il avoit montré qu'en se servant des principes de certains Censeurs, le Symbole des Apôtres ne contenoit aucun article que l'on ne pût fulminer ».
a) Nouvelles de la République des lettres, mois de juillet 1685, page 802.
[FN: § 1823-1]
T. MARTELLO ; dans le Journal des Économistes, mai 1913 : « (p. 491) J'ai dit que le jeu du loto est le jeu de la spoliation. Je ne l'ai pas dit par métaphore. Il en est réellement ainsi. C'est un jeu de spoliation, parce qu'il ne règle pas les numéros sortants comme le fait la roulette, (jeu de pur hasard), mais qu'il garde à son propre avantage 85 numéros sur 90 qu'il met dans l’urne. À la roulette, celui qui met un écu sur une couleur, gagne un écu ; sur 6 numéros, il en gagne 5 et retire le sien ; sur la douzaine ou la colonne (12 numéros) il en gagne 11 et retire le sien. Celui qui joue un écu en plein, ou qui met un écu sur l'un quelconque des 36 numéros, en gagne 35 et retire le sien. Celui qui veut faire le jeu de la banque met sur zéro. Au contraire, le loto royal paie 10 fois et demi la mise à celui qui gagne l'extrait simple. S'il procédait comme la roulette, il devrait en payer 18, soit autant de mises en plus qu'il y a de probabilités favorables en plus (17 + 1). À celui qui gagne l'extrait déterminé, le loto royal paie 52 fois et demi sa mise, au lieu de 90 fois (spoliation 41,67 %). Ensuite, la spoliation continue en proportions énormes. À celui qui gagne l'ambe, il paie 250 fois sa mise au lieu de 400,50 (spoliation 37,58%) ; au gagnant du terne, il paie 4250 fois sa mise, au lieu de 11 748 (spoliation 63,82 %) ; il paie 60 000 fois la mise au gagnant du quaterne (p. 492) au lieu de 511 038 (spoliation 88,26 %)... Mais on remarquera encore que, quelle que puisse être la mise du jeu (terne, quaterne, quine), le loto royal ne paie pas plus de 400 000 francs au même billet : Ainsi celui qui mettrait 100 francs sur un quaterne devrait avoir 511 038 fois sa mise, soit 51 103 800 ; mais le quaterne n'étant payé qu'à raison de 60 000 fois la mise, il devrait avoir 6 000 000 de francs ; et, au contraire, à cause de la limite sus-indiquée, il ne retirerait que 400 000 francs, et la spoliation atteindrait, par conséquent, 93,33 %. Ce n'est pas tout : le loto royal ne paie pas plus de six millions de francs pour chaque tirage sur tous les jeux de tous les bureaux du royaume ; et si, au total, les jeux gagnants emportaient, pour le loto royal, une dépense supérieure aux six millions, le gain de tous les jeux serait réduit en proportion correspondante, et, en ce cas, la spoliation n'a pas de pour cent fixe, mais oscille au delà des pour cent sus-indiqués, suivant le chiffre plus ou moins haut, au delà de la limite des six millions. Par ces artifices, l'État prélève sur les maigres ressources des gens les plus nombreux et les moins fortunés du royaume, plus de quatre-vingt-dix millions de francs par an... ». C'est là l'« État éthique » ou de « droit » des théoriciens.
[FN: § 1824-1]
Manuale, p. 75 : « Sembat. Vous avez parlé, vous aussi, monsieur le procureur général, de l'intérêt supérieur. Il y a donc une raison d'État devant laquelle un magistrat est obligé, de s'incliner ? – Bulot. Sous peine d'être révoqué, évidemment (rires) ». En 1914, une commission d'enquête parlementaire révéla qu'un procureur général et un président de Cour d’appel s'étaient inclinés devant « la raison d'État », à eux manifestée par le ministre Monis, et avaient, contre leur volonté favorisé Rochette. Il y eut alors un grand nombre de gens qui s'étonnèrent, d'autres qui s'indignèrent de voir mettre ainsi en pratique une théorie formulée tant d'années auparavant par Bulot, théorie bien connue d'eux, et qui est appliquée à chaque instant par les partis qui sont au gouvernement.
[FN: § 1832-1]
Des observations analogues abondent dans la littérature. Elles rappellent les vers bien connus :
class="poem"
[FN: § 1833-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Exode, I, 11-12 « Et l'on établit sur lui [Israël] des chefs de corvées, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l’on prit en aversion les enfants d'Israël ». Il est facile, de trouver un grand nombre d'exemples analogues : il suffit de songer à l'enthousiasme frénétique des martyrs de toute religion, au patriotisme farouche de plusieurs peuples opprimés, à l'énergie croissante de telle ou telle classe sociale tenue en servitude ou en dépendance.
[FN: § 1839-1]
Voici deux exemples se rapportant l'un à la France, l'autre à l'Italie. Dans le premier de ces pays, en 1911, le plus grand nombre de ceux qui étaient adultes, au temps de la guerre de 1870, avaient disparu. Cela fut, au moins en partie, la cause du réveil de nationalisme en France. Dans le second de ces pays, en 1913, la plus grande partie de ceux qui avaient souffert au temps de la domination autrichienne sur l'Italie avaient disparu. Cela rendit plus facile l'œuvre du gouvernement, qui traitait de « rebelles » les Arabes défendant leur pays, et qui, pour maintenir « l'équilibre de l'Adriatique », voulaient que les Grecs de l'Épire fussent soumis à la domination albanaise, exactement comme les Italiens du Lombard-Vénitien étaient soumis jadis à la domination autrichienne.
[FN: § 1843-1]
LEFEBVRE DE BÉHAINE ; Léon XIII et le prince de Bismarck. En 1871, quand apparaît, en Bavière, la secte des « vieux catholiques », et que le ministre bavarois Lutz commence les hostilités contre la cour de Rome : « (p. 19) Quoique, depuis, le prince de Bismarck eût en maintes circonstances décliné la responsabilité de cette politique agressive, il est bien difficile d'admettre qu'il ait éprouvé quelque déplaisir de la voir inaugurée par le ministre des cultes du plus important des pays catholiques d'Allemagne... (p. 48) Dès 1874, c'est-à-dire avant la fin de la troisième année où avait commencé la campagne contre Rome, les observateurs attentifs prévoyaient que le résultat de cette campagne devenait douteux, et on constatait que le prince de Bismarck marquait moins de zèle pour soutenir l'idée d'une Église nationale allemande... (p. 51) Cette situation violente [le conflit entre le gouvernement allemand et Rome] devait durer plusieurs années, et il fallut des circonstances que n'avaient pas prévues les nationaux-libéraux pour détacher complètement le prince de Bismarck d'un programme qui avait d'abord séduit son esprit, mais dont l'insuccès était devenu certain depuis que les populations catholiques de l'Empire avaient répondu aux menaces dont elles étaient l'objet en se faisant représenter au Reichstag par une minorité qui avait pris, sous le nom de fraction du centre, une grande importance, tandis qu'au contraire les nationaux-libéraux étaient chaque jour combattus avec plus d'ardeur par les progressistes et les socialistes ». – BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II : «(p. 366) Qu'on se rappelle l'époque où le Centre, fort de l'appui des jésuites plus que de celui du pape, soutenu par les Guelfes (et pas uniquement par ceux de Hanovre), par les Polonais, les Alsaciens francophiles, le parti démocratique radical, les démocrates socialistes, les libéraux et les particularistes, tous unis dans un seul et même sentiment d'hostilité contre l'empire et sa dynastie, possédait, sous la direction de ce même Windthorst, qui avant et après sa mort est devenu un saint national, une majorité sûre et impérieuse faisant échec à l'empereur et aux gouvernements confédérés ».
[FN: § 1843-2]
À vrai dire, l'erreur de Bismarck paraît avoir été de tactique politique plutôt que d'évaluation de la force des résidus ou de l'art de s'en servir. En effet, avant et après le Kulturkampf, il fit voir qu'il savait se servir des résidus sans le moindre scrupule. Les « intellectuels » fanatiques du Kulturkampf croyaient que Bismarck était partisan de leurs croyances, tandis qu'il se servait de ces bonnes gens, uniquement comme d'instruments. – BUSCH ; Les mém. de Bism., t. I En octobre 1870, on parlait du départ de Rome, du pape : « p. 189) Mais, observa Hatzfeldt, ce serait pourtant l'intérêt des Italiens qu'il restât à Rome. (p. 190) Parfaitement, répliqua le chancelier. Mais il peut tout de même être obligé de s'en aller. Et, alors, où ira-t-il ? En France ? Il y a Garibaldi qui y est en ce moment. En Autriche ? Ça ne lui dit guère ! Il ne lui reste que la Belgique... ou l'Allemagne. Et, de fait, il m'a déjà demandé si nous consentirions à lui accorder asile. Je n'y ai pas d'objection : nous avons Cologne ou Fulda. Ce serait peut-être bizarre, mais, après tout, pas si inexplicable ! Et quel profit ! Nous montrerions aux catholiques que nous sommes les seuls capables de protéger le chef de leur Église. Stofflet et Charette, avec leurs zouaves, pourraient retourner à leurs affaires. Nous aurions pour nous les Polonais ; l'opposition des ultramontains cesserait aussitôt en Bavière [Voilà l'homme d'État qui sait se servir des résidus]... Seulement il y a le roi ! Il ne voudra jamais y consentir. Il a une peur du diable ! Il croit que toute la Prusse va être pervertie et que lui-même va être obligé de se faire catholique... Je lui ai expliqué que non... (p. 191) Et puis, quand bien même quelques personnes se feraient catholiques (vous pouvez être sûr que ce ne sera pas moi !) où serait le mal ? Ce qui importe, ce n'est pas la secte : c'est la croyance ! Il faut être plus tolérant que cela ! » Il faut remarquer cette opinion d'un homme pratique : elle est rigoureusement scientifique ! (1851) « Et, après s'être égayé encore quelque temps à la pensée de l'émigration du pape et de ses cardinaux vers Fulda, M. de Bismarck conclut : Évidemment le roi ne veut pas voir le côté humoristique de l'affaire ! Mais si seulement le pape me reste fidèle, je me charge bien de Sa Majesté... ». – 30 janvier 1871 : « (p. 295) Il paraît que, entre autres choses, le chancelier a dit aux Français que c'était une faute d'être trop conséquent en politique. Il faut savoir se modifier selon les événements et les circonstances... et non pas en suivant ses propres opinions... Un véritable homme d'État ne doit pas imposer ses préférences à son pays ». – LEFEBVRE DE BÉHAINE ; Léon XIII et le prince de Bismarck. L'auteur raconte le début du Kulturkampf : « (p. 25) L'heure n'était-elle pas propice pour commencer à Berlin le Culturcampf, dont les premières lignes venaient d'être tracées par M. Lutz ? Rome ainsi avertie n'allait-elle pas reculer ? Tout porte à croire que tel était, au début de l'année 1872, l'espoir du prince de Bismarck. Cette pensée se fit jour dans les discours qu'il prononça les 30 et 31 janvier à la Chambre des députés de Prusse lors des débats sur le budget du ministère des cultes. À côté du reproche adressé au parti clérical d'avoir travaillé à la mobilisation du groupe du centre en vue de mieux faire la guerre au nouvel état de choses [voilà le motif réel de la guerre que Bismarck est sur le point de faire] à côté aussi des anathèmes habituels à l'adresse de l'ancienne confédération du Rhin, certaines paroles du chancelier purent être interprétées comme l'indice d'une disposition à entrer en pourparlers avec le Vatican ». Le pape ne se montra pas assez conciliant, et Bismarck essaya de le combattre. Mais, en homme sage et pratique, il ne tarda pas à s'apercevoir qu'il avait mieux à faire que de se perdre en absurdes disputes théologiques. En 1885, il déférait au pape l'arbitrage, dans le conflit avec l'Espagne, au sujet des îles Carolines. « (p. 198) Le 21 mai 1886, le roi de Prusse décrétait une loi en quinze articles qui abrogeait un certain nombre de dispositions des lois antérieures, dites Maigesetze, et datant pour la plupart des années 1813, 1874, 1875... (p. 220) Aujourd'hui, l'Église catholique jouit en Allemagne d'une paix profonde, libre dans ses enseignements, dégagée de toutes les entraves qu'elle avait été si sérieusement menacée de subir, il y a vingt-cinq ans... »
[FN: § 1843-3]
En cela aussi, Bismarck semble avoir eu, à un moment donné, des idées justes. BUSCH ; Les mém. de Bism., t. I : « (p. 237) Vous n'avez aucune idée, déclara le chancelier, du plaisir qu'ils [les Polonais] éprouvent à voir qu'on connaît leur langue maternelle. Dernièrement à l'hôpital, j'ai rencontré comme cela quelques pauvres diables. Lorsque je leur ai parlé polonais, j'ai vu immédiatement leur face blême s'éclairer d'un sourire. C'est dommage que leur général en chef ne connaisse pas leur langue. Ce reproche indirect s'adressait au Kronprinz (p. 238) en personne qui avait les troupes polonaises sous ses ordres. Il releva, en riant, la pointe du chancelier : „ Je vous reconnais bien là, Bismarck, fit-il, vous en revenez toujours au même point. Mais je crois vous avoir dit pourtant plusieurs fois que je n'aime pas cette langue et que je ne veux pas l'apprendre “. – „ Les Polonais sont pourtant de bons soldats, Monseigneur, répliqua M. de Bismarck, et de bons garçons...“ – ». Les grands capitaines, par exemple César et Napoléon, étaient passés maîtres dans l’art d'utiliser les sentiments de leurs soldats.
[FN: § 1847-1]
En vertu de l'omertà, un membre de la Maffia ou d'autres semblables associations doit assistance et fidélité à ses coassociés. S'ils ont des démêlés avec l'autorité ou avec la justice, il ne doit rien faire qui puisse leur nuire ; encore moins demander aux tribunaux de trancher les différends qu'il peut avoir avec eux. Même victime d'une tentative d'assassinat, il s'en vengera si c'est possible, mais ne la dénoncera en aucun cas à l'autorité.
[FN: § 1850-1]
C'est ce qu'ignorait ou négligeait le gouvernement de la république actuelle, en France, lorsqu'en agissant contre certains sentiments religieux considérés par lui comme nuisibles, il frappait, sans le vouloir, les autres sentiments du même groupe, parmi lesquels celui du patriotisme, qu'il n'avait, à coup sûr, nullement l'intention de détruire. Lorsqu'en 1912 les instituteurs, assemblés à Chambéry, manifestèrent des sentiments hostiles au patriotisme, un grand nombre de politiciens s'étonnèrent d'une chose qu'ils auraient facilement pu prévoir, en tenant compte de l'action qu'eux-mêmes avaient accomplie. Mais si le bacille inoculé par les « intellectuels » trouva un terrain de culture favorable chez nombre d'instituteurs, il tomba au contraire dans un terrain défavorable à son développement, chez une grande partie de la population, spécialement parmi les classes populaires, où les sentiments religieux se conservent plus longtemps, sous des formes diverses. C'est de ces classes que nous voyons à chaque instant, dans l'histoire, partir la marée de religiosité qui envahit les classes supérieures ; et c'est précisément ce qui arriva, en France, pour les sentiments de patriotisme, dans les années 1911 et 1912.
[FN: § 1851-1]
On peut se rendre compte de la déformation subie par l'esprit religieux, à Rome, vers 1830, en lisant : I sonetti romaneschi di G. G. BELLI, pubblicati... ,a cura di LUIGI MORANDI. Città di Castello, 1896.
[FN: § 1853-1]
C'est là un phénomène dépendant des résidus de la IIIe classe. Les hommes, comme les animaux, éprouvent le besoin de manifester leurs sentiments par des actes qu'il est impossible d'unir par un lien logique ou raisonnable aux sentiments mêmes. Le chien qui retrouve son maître remue la queue ; mais il est impossible de fixer un lien logique entre ces mouvements de queue et l'affection du chien pour son maître. Si les chiens avaient des moralistes, ceux-ci démontreraient peut être par de belles homélies que ces mouvements de queue sont ridicules ; mais les chiens laisseraient dire et continueraient à témoigner à leur manière leur affection pour leur maître. Les hommes agissent d'une façon analogue.
[FN: § 1853-2]
Par exemple, les manifestations des pangermanistes allemands sont souvent insensées et ridicules au delà de toute expression. Les Allemands de bon sens peuvent désirer que la liaison qui unit ces démonstrations au patriotisme devienne plus lâche, de manière que le patriotisme demeure tout aussi fort, et que ces démonstrations diminuent ou disparaissent. Mais tant que cette liaison subsiste, celui qui veut le patriotisme doit se résigner à voir subsister aussi ces démonstrations. En France, le réveil du patriotisme, qu'on observa en 1912, et qui dure encore (mai 1914) est accompagné de bruyantes démonstrations littéraires et théâtrales. Plusieurs moralistes s'en scandalisent, et s'élèvent contre ce « patriotisme bruyant », supposant ainsi que parce que les manifestations sont de vains discours, les sentiments qui leur donnent naissance sont de même vains. C'est là une erreur digne de ces personnes qui se montrent à chaque instant ignorantes des rapports entre les faits sociaux. Il est certes permis de désirer que, les sentiments puissants ne s'accompagnent pas de manifestations non rigoureusement raisonnables, et que par conséquent les sentiments manifestés par les résidus de la IIIe classe s'affaiblissent ; mais tant que ces sentiments conservent la même force, celui qui veut les sentiments doit se résigner à accueillir aussi les manifestations. il est vrai qu'un grand nombre de ces moralistes sont aussi des humanitaires qui ne veulent pas ces sentiments. Ils n'osent pas le dire, parce qu'ils craignent le blâme du public, mais dans leur for intérieur ils repoussent le patriotisme, parfois consciemment, parfois sans trop s'en apercevoir, et ils rêvent à la fraternité universelle. Ne pouvant combattre trop ouvertement les sentiments de patriotisme, ils se contentent d'en combattre les manifestations.
[FN: § 1858-1]
Par exemple, cela est arrivé en Italie, aux élections de 1913. Un cas caractéristique est celui de Rome, où le socialiste transformiste Bissolati fut élu député, grâce à l'appui du gouvernement et au vote des gens de la Maison royale, contre le révolutionnaire Cipriani. Bissolati avait déjà eu les mêmes suffrages, à l'élection précédente, contre Santini, qui était conservateur.
[FN: § 1859-1]
G. BOISSIER : La fin du paganisme, t. II. L'auteur observe que l'on demeure surpris à voir que Macrobe ne parle nullement du christianisme alors envahissant. « (p. 243) Notre surprise redouble quand nous retrouvons le même silence chez presque tous les écrivains païens de ce temps, chez les grammairiens, chez les orateurs, chez les poètes, et même chez les historiens, quoiqu'il paraisse bien singulier qu'on puisse omettre, dans le récit du passé, un événement comme le triomphe de l’Église. Ni Aurelius Victor ni Eutrope ne mentionnent la conversion de Constantin, et il semble, à les lire, que tous les princes du IVe, siècle persistent à pratiquer l'ancien culte. Ce n'est certainement pas un hasard qui les amène tous à ne pas prononcer le nom d'une religion qu'ils détestent : c'est une entente, un parti pris, dont la signification ne pouvait échapper à personne. Ce silence, un silence hautain et insolent, est devenu pour eux la dernière protestation du culte proscrit. Du reste, cette façon d'agir n'était pas à Rome une nouveauté. La haute société, dès le premier jour, y avait pris l'habitude de combattre le christianisme par le (p. 244) mépris... »
[FN: § 1861-1]
Nous avons cité (§1716 6) l'un des si nombreux cas où les sentiments d'humanitarisme permettent aux malfaiteurs d'injurier les magistrats qui les jugent, et à leurs défenseurs d'admonester le président de la cour d'assises. Voici le contre-pied, en un temps où ces sentiments n'agissaient pas sur les magistrats. DE GONCOURT, Journal, t. I, rapporte comment son frère et lui furent accusés et traduits devant le tribunal, pour avoir reproduit dans un journal des vers imprimés impunément dans un livre couronné par l'Académie : « (p. 42) Enfin on appela notre cause. Le président dit un passez au banc qui fit une certaine impression dans le public. Le banc c'était le banc des voleurs. Jamais un procès de presse, même en Cour d'assises, n'avait valu à un journaliste de passer au banc... (p.43) Le substitut prit la parole... pris d'une espèce de furie d'éloquence, nous représenta comme des gens sans foi ni loi, comme des sacripants sans famille, sans mère, sans sœur, sans respect pour la femme, et, pour péroraison dernière de son réquisitoire – comme des apôtres de l'amour physique ». Les vers qui excitaient pareillement la furie de ce personnage étaient les suivants (p. 35) :
Croisant ses beaux membres nus
Sur son Adonis qu'elle baise ;
Et lui pressant le doux flanc ;
Son cou douillettement blanc, Mordille de trop grand aise.
C'est bien autrement grave que les crimes de la bande Bonnot, Garnier et Cie ! « (p. 43) Alors notre avocat se leva. Il fut complètement le défenseur que nous attendions. Il se garda bien de répéter ce qu'avait osé dire Paillard de Villeneuve, l'avocat de Karr [autre prévenu d'un délit de presse] demandant au tribunal comment on osait requérir contre nous, à propos d'un article non incriminé, et dont l'auteur n'était pas avec nous sur le banc des accusés. Il gémit, il pleura sur notre crime, nous peignit comme de bons jeunes gens, un peu faibles d'esprit, un peu toqués… » La conclusion fut que le tribunal blâma l'article, mais acquitta les prévenus, parce qu'ils n'avaient pas eu « (p. 45) l'intention d'outrager la morale publique et les bonnes mœurs ». De Goncourt ajoute : « (p. 45) En dépit de tout ce qu'on écrira, de tout ce qu'on dira, il est indéniable que nous avons été poursuivis en police correctionnelle, assis entre les gendarmes, pour une citation de cinq vers de Tahureau imprimés dans le Tableau historique et critique de la poésie Française par Sainte Beuve, couronné par l'Académie ». Les personnes du genre de celles qui se réunissent dans les sociétés pour le relèvement de la morale peuvent tenir la publication de ces vers ou le meurtre et le pillage pour des crimes d'égale gravité, mais on ne peut vraiment l'admettre au point de vue de l'utilité sociale. Voici maintenant un exemple en matière politique : ÉMILE OLLIVIER ; L'Empire libéral, t. IV. L'auteur défend Vacherot, accusé d'avoir excité la haine et le mépris contre le gouvernement, dans son livre La Démocratie : « (p. 373) Je commençai ma réponse [au ministère public] par ces mots : „ Messieurs, dans les affaires de cette nature, la première condition est une modération extrême. Aussi ne répondrai-je pas aux parties irritantes du réquisitoire. Cet appel aux passions est mauvais. En entrant dans cette enceinte, vous qui nous jugez, comme nous qui avons à défendre le livre à juger, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que les organes, les interprètes de la loi “. Le président m'interrompt : „ Maître Ollivier, vous venez de dire une inconvenance, rétractez-la “. Je répondis du ton le plus calme et le plus surpris : „ Monsieur le président, je n'ai rien dit d'inconvenant j'étais sous l'impression des paroles que je venais d'entendre “. Le président reprit : „ Maître (p. 347) Ollivier, vous avez dit que le ministère public a fait un appel aux passions. C'est une inconvenance, rétractez-la... “. Le tribunal se retira et revint quelques instants après... » On redemande à Maître Ollivier de rétracter ce qu'il a dit. Il refuse, et alors : « Sans même se lever de son siège, le tribunal me condamna à trois mois de suspension et remit à huitaine Vacherot pour qu'il pût se choisir un défenseur ». Si l'on ne peut obtenir que les faits tenus pour crimes uniquement par le fanatisme sectaire et la servilité, des magistrats soient séparés de ceux que tient pour tels le désir qu'a tout homme de n'être pas assassiné ni saccagé ni volé, il se peut, en de nombreux cas, que l'indulgence de l'humanitarisme envers les uns et les autres soit un moindre mal.
[FN: § 1868-1]
Georges SOREL ; Réflexions sur la violence : « (p. 164) L'expérience nous prouve que des constructions d'un avenir indéterminé dans les temps peuvent avoir une grande efficacité et n'avoir que bien peu d'inconvénients, lorsqu'elles sont d'une certaine nature ; cela a lieu quand il s'agit de mythes dans lesquels se retrouvent les tendances les plus fortes d'un peuple, d'un parti ou d'une classe, tendances qui viennent se présenter à l'esprit avec l'insistance d'instincts dans toutes les circonstances de la vie et qui donnent un aspect de pleine réalité à des espoirs d'action prochaine sur lesquels se fonde la réforme de la volonté. Nous savons que ces mythes sociaux (p. 165) n'empêchent d'ailleurs nullement l'homme de savoir tirer profit de toutes les observations qu'il fait au cours de sa vie et ne font point obstacle à ce qu'il remplisse ses occupations normales [composition des forces sociales]. C'est ce qu'on peut montrer par de nombreux exemples. Les premiers chrétiens attendaient le retour du Christ et la ruine totale du monde païen, avec l'instauration du royaume des saints, pour la fin de la première génération. La catastrophe ne se produisit pas, mais la pensée chrétienne tira un tel parti du mythe apocalyptique que certains savants contemporains voudraient que toute la prédication de Jésus eût porté sur ce sujet unique... On peut reconnaître facilement (p. 166) que les vrais développements de la Révolution ne ressemblent nullement aux tableaux enchanteurs qui avaient enthousiasmé ses premiers adeptes : mais sans ces tableaux la Révolution aurait-elle pu vaincre ?… (p. 167) Il faut juger les mythes comme des moyens d'agir sur le présent et toute discussion sur la manière de les appliquer matériellement sur le cours de l'histoire est dépourvue de sens ».
[FN: § 1876-1]
Ces problèmes seront considérés ici qualitativement (§144 1). Les considérations quantitatives seront introduites au chapitre suivant (§2121 et sv.). C'est aussi dans ce chapitre-là que se trouvera la définition du terme utilité, qu'il suffira en attendant, de considérer comme indiquant une certaine entité en rapport avec les autres faits sociaux, et qui peut croître et diminuer. Si l'on voulait suivre la voie déductive et passer du général au particulier, on devrait commencer par les considérations du chapitre XII, pour traiter ensuite les sujets que nous allons exposer. Mais cette voie n'est pas la meilleure pour bien comprendre la matière. Dans le monde concret, ce sont les problèmes qualitatifs qui, en cette matière, se présentent à nous, et ce sont même les seuls qui furent envisagés par le passé, et qui continuent à l'être chez presque tous les auteurs. De même, la notion d'utilité se présente à nous d'une manière quelque peu incertaine et confuse, ainsi qu'il arrive pour toutes les notions de ce genre ; et, jusqu'à il y a peu de temps, les auteurs n'éprouvaient pas le besoin d'une précision plus grande. Pour une utilité spéciale, celle que considère l'économie politique, ce besoin fut ressenti il n'y a qu'un petit nombre d'années, et donna naissance aux théories de l'économie pure. Nous étendons ici une précision analogue aux autres utilités, et nous le faisons d'une manière semblable à celle adoptée pour l'économie, c'est-à-dire en passant du plus connu au moins connu, du plus imparfait au moins imparfait, du moins défini au plus défini. Cette exposition est moins élégante que celle de la déduction, qui parcourt la voie en sens inverse ; mais elle est beaucoup plus aisée, facile, avantageuse à qui veut s'initier à la matière.
[FN: § 1881-1]
Un chimiste ou un physicien riraient d'un amateur qui, sans avoir jamais spécialement étudié la chimie ou la physique, voudrait porter des jugements sur l'une de ces sciences. Pourtant, sans avoir jamais étudié les sciences sociales, de tels savants entreprennent d'en trancher les questions les plus difficiles (§1435 et sv.). En voici un, par exemple, qui proclame avec une grande assurance que ce serait un malheur extrême pour l'humanité, si l'Allemagne ne dominait pas sur l'Europe, en faisant prévaloir sa « civilisation » sur la barbarie « russe ». Ce brave homme ne paraît pas même soupçonner, que connaître les effets de la domination de l'Allemagne ou de la Russie sur l'évolution de l'humanité est aussi difficile que connaître la constitution de la matière. Cette attitude provient du fait que le savant, qui emploie la méthode objective en chimie ou en physique, se laisse inconsciemment entraîner par la méthode subjective dans les sciences sociales. Lorsqu'il nous parle de la constitution de l'atome, il nous rapporte ce que l'expérience lui a enseigné, et fait abstraction de ses sentiments. Lorsqu'il tranche des questions sur le socialisme, sur l'impérialisme, sur la « civilisation » germanique et la « barbarie » russe, il exprime seulement les sentiments que lui font éprouver ces concepts, et il se soucie peu ou point de l'expérience (observation historique et autre) qu'en réalité il ignore presque toujours. Ce contraste apparaît encore davantage, quand on voit des littérateurs, des poètes et des dramaturges prononcer des jugements avec une grande autorité, sur les matières économiques et sociales qu'ils ignorent absolument. Quel rapport peut-il bien y avoir entre le fait d'avoir écrit des drames ou des comédies qui obtiennent la faveur du public, et le fait de résoudre objectivement des questions de sciences sociales ? Mais le rapport existe au point de vue des sentiments, car on exprime sur ces sciences des notions expérimentalement absurdes, stupides et vaines, lesquelles néanmoins plairont au public admirateur des pièces de théâtre. Ce public est la plupart du temps incapable de comprendre des raisonnements logico-expérimentaux, et se repaît de discours sentimentaux convenant à sa mentalité. Le monde est ainsi fait, et l'on ne voit pas comment ni quand il pourrait changer.
[FN: § 1883-1]
Voyons un exemple, qui peut servir de type à un très grand nombre de ces raisonnements. Le 20 janvier 1914, le ministère français proposait aux Chambres et faisait approuver un crédit de 20 000 francs pour les funérailles nationales du général Picquart. Un sénateur demanda quels services ce général avait rendus au pays. À quoi le président du Conseil, Doumergue, répondit : « Vous avez demandé quels services a rendus le général Picquart : il a cru à la justice et à la vérité immanentes ». Qu'est-ce que la « justice et la vérité immanentes » ? Personne ne le sait précisément, et peut-être le ministre Doumergue moins que d'autres ; mais il existe tant d'espèces de vérités, que parmi elles peut bien se trouver une belle vérité immanente. Ne nous arrêtons pas à ces questions subtiles. Admettons sans autre l'existence des respectables entités qui portent le nom de « justice et de vérité immanentes », et voyons les sens que comporte l'affirmation du ministre Doumergue. Nous pouvons les classer à peu près comme suit. (a) Il existe implicitement un principe dont on peut déduire que l'on obtiendra une utilité réelle, soit la prospérité, de la nation. – (a-I) L'utilité consiste à remporter la victoire en cas de guerre. – (a-I 1) Un général qui croit à la « justice et à la vérité immanentes » est plus capable qu'un autre d'exercer sa fonction, qui est de conduire ses soldats à la victoire. Le général Picquart avait cette croyance ; par conséquent il aurait contribué à assurer la victoire à sa patrie, en cas de guerre. On remarquera que le ministre Doumergue ne mentionna nullement cette croyance comme s'ajoutant aux mérites militaires du général Picquart. Il se tut au sujet de ces mérites, et il fit bien, car ce qu'on en pourrait dire de plus favorable est peu de chose, en vérité. Le correspondant de la Gazette de Lausanne, 21 janvier 1914, qui est pourtant très bienveillant envers le général Picquart, écrit : « On peut se demander – et la question a été discutée avec passion – si le héros de l'affaire Dreyfus a été aussi bien inspiré en acceptant les compensations que la brusque évolution des événements lui a offertes. Le prestige d'une nature particulière qui entourait cette séduisante et un peu énigmatique figure n'a pas pu ne pas subir quelque atteinte, lorsque l'homme a accepté de devenir un ministre comme un autre, et de subir, au moins dans une certaine mesure, les servitudes qu'impose aux hommes le fait d'être enrôlé dans un parti politique. Cependant ceux qui ont suivi de près l'activité du général Picquart au ministère de la guerre savent que son passage à la rue Saint-Dominique fut pour lui l'occasion d'une sorte de perpétuel confit, où l'indépendance naturelle de son caractère vint plus d'une fois à bout des mots d'ordre de l'esprit de parti. Il faudrait, pour apprécier complètement et équitablement son rôle à cette époque, faire un départ exact entre ce qu'il a dû céder aux exigences de ses amis, notamment la déplorable réduction des périodes d'instruction des réservistes, et les services qu'il a rendus à l'armée, et dont le plus signalé a été l'extrême décision dont il a fait preuve dans la discussion de la loi sur le matériel d'artillerie. Il apparaît, d'autre part, qu'il n'a pas complètement réussi dans l'exercice du grand commandement qui lui était confié. Il lui avait manqué, par le fait des circonstances, d'avoir exercé des commandements intermédiaires, et il s'est brusquement trouvé de plain-pied avec des difficultés auxquelles il n'était pas rompu. Il était d'ailleurs, par sa science technique et par la prodigieuse information de son esprit, beaucoup plus fait pour diriger certains des services de l'état-major que pour exercer la direction de grandes unités. Ce galant homme, dont le sourire était si fin et la pensée si ornée, avait plutôt les allures d'un savant que celles d'un soldat. Et l'on avait, à le voir, l'impression que la destinée sur laquelle son courage moral a jeté tant d'éclat n'était pas tout à fait celle pour laquelle il était fait ». Il semblerait donc que la croyance à « la justice et à la vérité immanentes » soit le mérite principal d'un général. Est-ce parce qu'ils avaient cette croyance, que Philippe de Macédoine vainquit les Athéniens à Chéronée, qu'Alexandre le Grand défit les Perses, qu'Annibal fut victorieux à Cannes ? Si Annibal fut ensuite défait à Zama, c'était peut-être qu'il avait perdu cette foi; mais de Moltke l'avait à un degré éminent ; c'est pourquoi il remporta la victoire de Sedan. Tout cela paraît un peu difficile à admettre. Alors le fondement expérimental de notre raisonnement tombe. (a-I 2) On peut présenter comme plus générale et moins personnelle l'influence de la croyance en la justice et la vérité immanentes. Ces dignes entités prennent alors la place des dieux qui protègent un peuple. Enfin, si les Israëlites furent protégés par leur Dieu, si Rome dut la victoire à ses dieux, si le Dieu des chrétiens protégea ses fidèles contre les musulmans, et si le Dieu de Mahomet protégea ceux-ci contre ceux-là, on peut aussi admettre que les déesses Justice Immanente et Vérité Immanente puissent, elles aussi, protéger un peuple. Pourtant, il ne semble pas que cette conception de l'intervention divine ait pu trouver place explicitement parmi les théories athées du ministre Doumergue. (a-I 3) La croyance en ces entités peut pousser les hommes à accomplir des actes qui assurent la victoire. Cela a lieu effectivement pour des croyances analogues, mais il ne semble vraiment pas que celle-là puisse être rangée parmi celles-ci ; elle apparaît seulement comme une croyance du domaine de la rhétorique des littérateurs. En tout cas, ce n'est certainement pas ce que voulait dire Doumergue. Ne pouvant obtenir une démonstration d'une utilité pour remporter la victoire, cherchons une autre utilité. (a-II) L'utilité qu'obtient le pays est autre que l'utilité guerrière. (a-II 1) Il est plus utile de suivre certains principes « moraux » que de tendre à la prospérité matérielle. (a-II 2) Utilité d'une certaine forme de gouvernement, supérieure à l'utilité de la victoire à la guerre. Ces deux principes peuvent avoir trouvé place dans l'esprit du ministre Doumergue et de ceux qui l'applaudissaient; mais il eût été difficile d'obtenir qu'ils les exprimassent avec précision. En passant à un autre genre de conceptions, on peut faire disparaître les difficultés qui s'opposent à la démonstration de l'utilité du principe : (β) l'observation du principe posé et sa propre fin, indépendamment de tout autre genre d'utilité. (β 1) Nous ne devons nous occuper que de satisfaire « la justice et la vérité immanentes ». Fais ce que dois, advienne que pourra. En somme, c’est la règle de toute foi très vive ; c'était la règle des martyrs chrétiens ; mais il ne semble pas que le ministre Doumergue et ses amis leur ressemblent beaucoup. (β 2) Nous ne devons pas nous occuper de la guerre, qui ne viendra pas de si tôt : par conséquent, il importe peu d'avoir des généraux qui soient de bons capitaines ; il importe au contraire d'en avoir qui suivent les principes « moraux » du parti dominant. À un habile général, on doit préférer un croyant en la « justice et en la vérité immanentes » ; à un Napoléon 1er, on doit préférer, pour commander l'armée, un Saint François d'Assise du parti radical. Quelque conception semblable peut avoir trouvé place dans l'esprit des amis du ministre Doumergue. Il faut, en effet, rappeler qu'ils voulurent comme ministre de la guerre le général André, et comme ministre de la marine M. Pelletan, qui désorganisèrent entièrement la défense nationale. En outre, le parti du ministre Doumergue s'opposait à la loi dont le but était de prolonger le service militaire jusqu'à trois ans, et en tout cas, il se montrait opposé à l'armée. Ainsi, nous nous approchons des réalités recouvertes par la dérivation que nous examinons: (γ) La justice et la vérité immanentes sont un simple euphémisme pour désigner les intérêts d'une collectivité de politiciens et de « spéculateurs » (§2235). Ceux-ci trouvèrent dans l'affaire Dreyfus un moyen d'acquérir pouvoir, argent, honneurs, aidés par un petit nombre « d'intellectuels » qui mordirent à l'hameçon qu'on leur tendait, et qui prirent pour des réalités les euphémismes employés. Ainsi la dérivation indiquée doit se traduire de la façon suivante : « Le général Picquart a servi nos intérêts. Nous l'honorons afin d'engager d'autres personnes à nous servir également. Nous ne nous soucions guère de la défense de la patrie. Advienne que pourra : nous nous préoccupons de notre avantage personnel et de celui de notre parti ».
[FN: § 1884-1]
Au XIXe siècle, nous avons eu une abondante moisson de ces dérivations, nées du conflit entre les « travailleurs » et les « capitalistes » qui, en réalité, sont des entrepreneurs. La partie fondamentale du phénomène est la lutte habituelle qu'on observe entre deux concurrents, en matière économique ; c'est-à-dire que chacun tâche d'amener l'eau à son moulin, chacun s'efforce d'agrandir sa part. Tels sont les buts m auxquels on vise. Mais en apparence on a dit, on dit encore, et beaucoup de gens ont cru et croient encore viser à des buts idéaux T. Du côté des entrepreneurs, il n'y eut pas trop de raisonnements subtils. Ces personnes invoquèrent le soin qu'elles prenaient du bien-être des ouvriers, la rémunération « légitime » due à qui, par l'art des combinaisons, faisait prospérer l'entreprise, l'utilité de la liberté économique, dont elles se souvenaient pour fixer les salaires, et qu'elles oubliaient pour fixer les prix des produits. Du côté des ouvriers, il y eut un débordement de théories subtiles, produites par les « intellectuels », et acceptées, sans les bien comprendre, par les ouvriers, avec une foi aveugle. Des utopies socialistes au marxisme, au radicalisme démocratique ou socialiste, on a des doctrines en très grand nombre, qui toutes revêtent de voiles aux couleurs variées cette conception très simple : « Nous voulons avoir une part plus grande à la production économique ». Mais dire cela sans autre affaiblit les demandes, parce que cela leur enlève la force qui vient de l'idéalité de la fin, et les prive de l'alliance des braves gens qui se laissent prendre à la glu de ces théories. – Dans les dérivations, comme d'habitude, nous ferons appel aux sentiments. Nous nommerons donc « revendications » les demandes des ouvriers, afin d'insinuer qu'ils demandent uniquement ce qui leur appartient. Ainsi nous profiterons de l'appoint des résidus de la Ve classe. Pourtant, une suggestion si simple ne suffit pas. Il conviendra d'utiliser les résidus (I ε). Aussi ferons-nous des théories sur le « produit intégral du travail », sur la « plus value », sur la nécessité d'avoir « un peu plus de justice dans le monde », et d'autres semblables. Plus toutes ces théories seront longues et abstruses, plus nous conférerons d'idéalité à la fin que nous disons vouloir atteindre. – Mais si, voulant comprendre les faits, on néglige la forme vide de sens des raisonnements pour s'attacher au fond, on ne tardera pas à s'apercevoir qu'il a été avantageux aux ouvriers de viser ainsi à des fins imaginaires ; car, grâce à l'œuvre tenace qu'autrement ils n'auraient peut-être pas accomplie, et grâce à l'appui efficace des auxiliaires que leur a procurés l’idéalité des fins, les ouvriers ont obtenu, au XIXe, siècle, de grandes améliorations de leur sort. Quant à la nation entière, il est beaucoup plus difficile de dire si cette œuvre a été avantageuse ou non. Une réponse affirmative paraît plus probable ; mais pour la démontrer, il faut considérer synthétiquement le problème de l'évolution économique et sociale ; ce que nous pourrons faire seulement au chapitre suivant.
[FN: § 1890-1]
On sait assez qu'il y a des femmes mariées, jouissant de gros revenus, qui se vendent pourtant, afin d'ajouter au luxe dont elles jouissent déjà. On répond que la misère et l'opulence, produites par le capitalisme, ont le même effet. Cela pourrait être. Voyons un peu. Si cette explication est valable, le, phénomène ne devrait pas se produire chez les gens qui jouissent seulement d'une modeste aisance. Malheureusement il n'en est pas ainsi. La petite bourgeoise se vend pour avoir un chapeau à la mode, comme la grande dame se vend pour avoir un splendide collier de perles ; mais elles se vendent également. Il est donc probable que si toutes les personnes d'une collectivité avaient exactement les mêmes revenus, il y aurait encore des femmes qui consentiraient à être les maîtresses des hommes disposés à leur donner ce qu'elles peuvent bien désirer. Il est vrai qu'on objecte que notre société est corrompue, parce que le capitalisme y existe. À cela, on ne peut rien répondre, parce que c'est un article de foi, et que la foi dépasse l'expérience. D'autres fanatiques, comme ceux qui s'assemblent dans les ligues contre la pornographie, contre la « traite des blanches », pour « le relèvement moral », ferment volontairement les yeux à la lumière de semblables faits. Par exemple, pour ces braves gens, c'est un article de foi que seul l'homme séduit la femme, qui doit donc être seule protégée. Pourtant, quiconque veut bien prendre la peine de lire les faits divers des journaux, et de suivre les procès qui se déroulent devant les tribunaux, trouvera plus nombreux les cas dans lesquels c'est la femme qui séduit l'homme. Partout, dans les cas de l'employé infidèle, du caissier qui dérobe, du financier qui escroque, de l'officier qui espionne, et ainsi de suite, on trouve la femme, et l'on vérifie la règle donnée par un magistrat : « Cherchez la femme ». Les besoins de ces femmes ne sont nullement ceux d'une vie honnête et modeste, mais bien ceux du luxe et du faste ; et c'est pour satisfaire ces besoins que beaucoup d'hommes volent, trahissent, et parfois tuent. Si l'on a la manie de protéger, pourquoi s'occuper uniquement des femmes séduites, et négliger les hommes séduits ? Pourquoi n'invente-t-on pas quelque autre expression absurde, comme celle de « traite des blanches », qui s'appliquerait aussi aux « blancs » ? Il faut avoir l'esprit malade et puéril pour croire que seuls les besoins matériels de la vie poussent les femmes à la prostitution. Pour beaucoup de femmes, c'est la vanité, le besoin du luxe ; pour bon nombre d'autres, c'est la paresse qui leur fait préférer ce métier ; et dans la haute prostitution, il ne manque pas de femmes qui aiment leur métier comme le chasseur aime la chasse, et le pêcheur la pêche. Là encore, les faits ne manquent pas à qui veut bien les voir. Combien de prostituées que de bons naïfs avaient voulu relever, et auxquelles ils assuraient une vie honnête et aisée, n'ont pas tardé à abandonner leurs protecteurs, pour reprendre le métier accoutumé, dont elles avaient la nostalgie ? Mais un grand nombre de gens ne veulent pas voir ces faits-là ni d'autres semblables, parce qu'ils ne disent pas la vérité lorsqu'ils affirment vouloir combattre la prostitution afin d'être utiles aux femmes, afin de détruire la « traite des blanches », afin d'être utiles aux « blanches ». En réalité, ils ne sont animés que d'une haine théologique contre les plaisirs des sens.
[FN: § 1897-1]
Il faut répéter ici les considérations de la note 1876-1.
[FN: § 1897-2]
Souvent on s'efforce de confondre les deux genres de solutions, parce qu'on ne veut pas que le devoir flotte ainsi en l'air, sans aucun rapport avec le monde réel. Les solutions (B 2), ( B 3), ( B4) du §1902 ont précisément pour but de faire naître cette confusion.
[FN: § 1905-1]
DIOG. LAERT. ; VII, 101-102 : ![]()
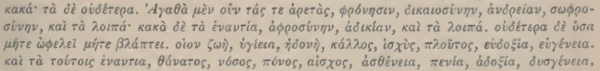
![]() – CIC., De fin. bon. et mal., III, 8, 27, expose la doctrine des stoïciens comme suit : Concluduntur igitur eorum argumenta sic : Quod est bonum, omne laudabile est : quod autemk laudabile est, omne honestum est. Bonum igitur quod est, honestum est. Satisne hoc conclusam videtur ?... (28) Deinde quaero, quis aut de misera vita possit gloriari, aut non de beata ? De sota igitur beata. Ex quo efficitur, gloratione, ut ita dicam, dignam esse beatam vitam : quod non possit quidem nisi honestae vitae iure contingere. Ita fit, ut honesta vita beata vita sit. – TACIT. ; Hist., IV, 5 : [Helvidius Priscus] doctores sapientiae secutus est, qui sola bona quae honesta, mala tantum quae turpia ; potentiam, nobilitatem, ceteraque extra animum, neque bonis neque malis annumerant. – PLUTARCH ; De Stoicorum repugnantis, XIII, II Il cite Chrysippe, qui dit : « Le bon est désirable ; le désirable est agréable ; l'agréable est louable ; le louable est beau [honnête] ».
– CIC., De fin. bon. et mal., III, 8, 27, expose la doctrine des stoïciens comme suit : Concluduntur igitur eorum argumenta sic : Quod est bonum, omne laudabile est : quod autemk laudabile est, omne honestum est. Bonum igitur quod est, honestum est. Satisne hoc conclusam videtur ?... (28) Deinde quaero, quis aut de misera vita possit gloriari, aut non de beata ? De sota igitur beata. Ex quo efficitur, gloratione, ut ita dicam, dignam esse beatam vitam : quod non possit quidem nisi honestae vitae iure contingere. Ita fit, ut honesta vita beata vita sit. – TACIT. ; Hist., IV, 5 : [Helvidius Priscus] doctores sapientiae secutus est, qui sola bona quae honesta, mala tantum quae turpia ; potentiam, nobilitatem, ceteraque extra animum, neque bonis neque malis annumerant. – PLUTARCH ; De Stoicorum repugnantis, XIII, II Il cite Chrysippe, qui dit : « Le bon est désirable ; le désirable est agréable ; l'agréable est louable ; le louable est beau [honnête] ». ![]()
![]() . Le raisonnement tire sa force des nombreux sens du terme
. Le raisonnement tire sa force des nombreux sens du terme ![]() , qui signifie en même temps : beau, noble, honnête, honorable, glorieux. Plutarque ajoute une autre citation, qui se rapporte aux solutions verbales (A). Il dit : « Le bien est réjouissant, le réjouissant est digne d'honneur, ce qui est digne d'honneur est beau ».
, qui signifie en même temps : beau, noble, honnête, honorable, glorieux. Plutarque ajoute une autre citation, qui se rapporte aux solutions verbales (A). Il dit : « Le bien est réjouissant, le réjouissant est digne d'honneur, ce qui est digne d'honneur est beau ». ![]() . Là encore les sens accessoires des termes qu'on emploie servent au raisonnement.
. Là encore les sens accessoires des termes qu'on emploie servent au raisonnement. ![]() est tout ce dont on est ou l'on doit être content ; et l'on suppose que personne n'osera nier qu'on doive être content du bien ;
est tout ce dont on est ou l'on doit être content ; et l'on suppose que personne n'osera nier qu'on doive être content du bien ; ![]() a un sens qui, de vénérable, honorable, digne d'honneur, passe à magnifique, très beau. Qui serait assez insensé pour nier que ce qui est magnifique, célèbre
a un sens qui, de vénérable, honorable, digne d'honneur, passe à magnifique, très beau. Qui serait assez insensé pour nier que ce qui est magnifique, célèbre ![]() est beau
est beau ![]() ?
?
[FN: § 1907-1]
ATHEN. ; III, p. 104. C'est un dialogue où l'un des interlocuteurs dit que les richesses ne sont rien, et l'autre le plaint d'avoir de telles idées, et lui dit entre autres :
[FN: § 1907-2]
HORAT. ; Sat., I, 8 :
(124)Si dives, qui sapiens est,
Et sutor bouus, et solus formosus, et es rex,
Cur optas, quod habes ?
(133)Vellunt tibi barbam
Lascivi pueri, quos tu nisi fuste coerces,
Urgeris turba circum te stante, miserque
Rumperis et latras, magnorum maxime regum !
« Si celui qui est sage est riche, et bon cordonnier et seul beau, et encore roi, pourquoi recherches-tu ce que tu as ? » Horace se fait répondre que le sage est bon cordonnier comme le chanteur, quand il se tait est aussi bon chanteur, c'est-à-dire que le sage possède l'état latent toutes les meilleures qualités. Et de rechef : « Les polissons te tirent la barbe, si tu ne les chasses pas avec ton bâton, ils t'assaillent en t'entourant, et comme un malheureux, tu pousses des cris et des hurlements, ô très grand parmi les rois ! » Il ajoute qu’il va se baigner pour le vil prix d'un quart d'as.
[FN: § 1911-1]
EPICT. ; Manuel, c. 1.
[FN: § 1915-1]
CIC. ; De fin., II, 16,51 : Itaque, Torquate, cum diceres, clamare Epicurum, non posse iucunde vivi, nisi honeste et sapienter et iuste viveretur, tu ipse mihi gloriari, videbare. Tanta vis inerat in verbis, propter earum rerum, quae significabantur his verbis, dignitatem, ut altior fieres... (53) Sunt enim levia et perinfirma, quae dicebantur a te, animi conscientia improbos excruciari, tum etiam poenae timore ; qua aut afficiantur, aut semper sint in metu ne afficiantur aliquando. Non oportet timidum, aut imbecillo animo fingi : non bonum illum virum, qui, quidquid fecerit, ipse se cruciet, omniaque formidet : sed omnia callide referentem ad utilitatem, acutum, versutum, veteratorem, facile ut excogitet, quo occulte, sine teste, sine ullo conscio, fallat.
[FN: § 1919-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Parlant de l'impôt progressif, dans son Traité de la Science des finances, PAUL LEROY-BEAULIEU veut justifier les moyens employés par les contribuables pour se soustraire à l'effet de la progression, ou du moins pour en atténuer la rigueur. Il est partagé entre sa répulsion pour la fraude et son aversion pour le régime progressif. Afin de concilier ces deux sentiments en conflit, il a naturellement recours aux dérivations ; il interprète les règles de la morale courante, et juge qu'elles ne s'appliquent pas au cas qui le gêne, Tome I, p. 219 : « L'impôt progressif n'oblige pas la conscience : tout contribuable a le droit moral de se soustraire à la progression et n'est tenu de supporter que la proportionnalité »
[FN: § 1920-1]
MOMMSEN ; Hist. rom., trad. franc., t. IV. Les Romains assiégeaient Numance : « (p. 303) Sur une simple et fausse rumeur que les Cantabres et les Vaccéens marchaient au secours de Numance, l'armée évacua ses campements durant la nuit, sans en avoir reçu l'ordre, et alla se cacher derrière les lignes que Nobilior avait construites seize ans avant. Aussitôt les Numantins, avertis de cette fuite, se lancent après les Romains qu'ils enveloppent ; il ne reste plus à ceux-ci qu'à s'ouvrir la route l'épée au poing, ou à conclure la paix aux conditions dictées aujourd'hui par l'ennemi. Le consul était un honnête homme, faible de caractère et de nom obscur ; heureusement Tiberius Gracchus était questeur à l'armée. Digne héritier de l'influence de son père, l'ancien et sage ordonnateur de la province de l'Èbre, il pesa sur les Celtibères, et, persuadés par eux, les Numantins se tinrent pour satisfaits d'une paix équitable que jurèrent tous les hauts officiers des légions. Mais le Sénat de rappeler aussitôt son général, et de porter devant le peuple, après un long délibéré, la motion qu'il convenait d'agir comme à l'époque du traité des Fourches Caudines. La ratification sera refusée, et la responsabilité du traité sera rejetée sur ceux qui l'ont souscrit. Dans la règle du droit, tout le corps des officiers, sans exception, aurait dû être frappé : mais grâceàleursrelations,Gracchusetlesautressontépargnés;Mancinusqui, malheureusement pour lui, ne tenait point à la haute aristocratie est seul désigné et paye pour sa faute et pour la faute commune. On vit en ce jour un consulaire romain dépouillé de ses insignes et traîné jusqu'aux avant-postes ennemis ; et comme (p. 304) les Numantins ne voulaient pas le recevoir (c'eût été admettre la nullité du traité), le général dégradé resta tout un jour, nu et les mains attachées derrière le dos, devant les portes de la ville ». – Rappelant les Numantins, qui pouvaient détruire l'armée romaine, FLORUS dit, II, 18 Foedus tamen maluerunt, cum debellare potuissent. Hostilium deinde Mancinum : hunc quoque assiduis caedibus ita subegerunt, ut ne oculos quidem aut vocem Numantini viri quisquam sustineret. Tamen cum hoc quoque foedus maluere, contenti armorum manubiis, cum ad internecionem saevire potuissent. Sed non minus Nurnantini, quam Caudini illius foederis flagrans ignominia ac pudore populus Romanus, dedecus quidem praesentis flagitii deditione Mancini expiavit... L'auteur est tellement persuadé de l’honnêteté de ce procédé, qu'il ajoute aussitôt.
(19) Hactenus populus Romanus pulcher, egregius, pius, sanctus, atque magnificus... En vérité, s’il est permis d'interpréter de façon semblable les règles du juste et de l'honnête, il est évident que jamais on ne pourra causer le moindre préjudice à la prospérité matérielle d'un peuple en les observant. –VELL. PATERC. : II, 1 : Haec urbs [Numantia]... vel ferocia ingenii, vel inseitia nostrorum ducum, vel fortunae indulgentia, cum alios duces, tum Pompeium, magni nominis virum, ad turpissinia deduxit foedera (hic primus e Pompeiis consul fuit), nec minus turpia ac detestabilia Mancinum Hostilium consulem. Sed Pompeium gratia impunitum habuit, Mancinum verecundia ; quippe non recusando perduxit huc, ut per Feciales nudus, ac post tergum religatis manibus, dederetur hostibus, quem illi recipere se negaverunt, sicut quondam Caudini fecerunt, dicentes, publicam violationem fidei non debere unius Iui sanguine.
Il faut avouer que vraiment ces gens ne faisaient pas usage de la casuistique !
[FN: § 1920-2]
DIGEST. : L, 7, 17 (18).
[FN: § 1921-1]
E. PAIS ; Storia di Roma, v. I, p. II. L'auteur estime faux le document, cité par Tite-Live, de la paix des Fourches Caudines. « (p. 498) Il fut inventé pour atténuer la responsabilité morale des Romains, accusés plus tard d'avoir manqué à cette traditionnelle bonne foi dont ils avaient l'habitude de se vanter. Le long récit de Tite-Live n'est que l'un des nombreux ornements de la rhétorique ou de la pseudo-pragmatique des annalistes, par lesquels on s'efforça de rendre moins déshonorantes, d'abord la défaite, puis la mauvaise foi romaine... (p. 449) Mais il est inutile d'insister pour démontrer que le récit de ces tractations n'est pas historique, car, à notre époque, un critique savant et sagace a remarqué que tous ces détails furent empruntés à l'histoire (p. 500) postérieure, surtout à la paix conclue par le consul Hostilius Mancinus avec les Numantins (137 av. C.) ».
[FN: § 1921-2]
CIC : De off., III, 30, 109. Il parle des consuls. T. Veturius et Sp. Postumius et des tribuns livrés aux Samnites. « ... dediti saut, ut pax Samnitium repudiaretur. Atque huius deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et auctor fuit. Quod idem multis annis post C. Mancinus : qui, ut Numantinis, quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, dederetur, rogationem suasit eam, quam P. Furius, Sex. Atilius ex senatus consulto ferebant : qua accepta est hostibus deditus. Honestius hic, quam Q. Pompeius, quo, cum in eadem causa esset, deprecante accepta lex non est. On croyait pouvoir justifier cette interprétation par des analogies juridiques. – CIC ; Pro A. Caec., 34, 99 : Ut religione civitas solvatur, civis Romanus traditur : qui cu est acceptus, est eorum, quibus est deditus ; si non accipiunt, ut Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius civitatis.
[FN: § 1922-1]
WELSCHINGER ; La guerre de 1870, t. I. Bismarck apparaît comme un homme de forte volonté et de vues étendues, lorsqu'il se glorifie d'avoir accommodé la dépêche, de manière à rendre la guerre inévitable. Sans le vouloir, Welschinger fait la louange de Bismarck, lorsqu'il écrit : « (p. 124) Les Nouvelles de Bambourg, journal du prince, reconnaissaient hautement que Bismarck, en modifiant la dépêche, avait contraint la France à prendre l'initiative et la responsabilité de la guerre et qu'il avait ainsi bien mérité de la patrie. S'il eût agi autrement, la guerre n'eût pas eu lieu. „ Cette guerre était indispensable pour fonder l'unité allemande. Si on avait laissé échapper cette occasion, on aurait été obligé de trouver un autre prétexte, moins adroit peut-être, qui aurait aliéné à l'Allemagne les sympathies de l'Europe “. C'était le mot de Bismarck à un journaliste qui s'étonnait de son expédient : „ Ah ! si celui-là avait raté, on en eût trouvé un autre ! “ (p. 121) Bénie soit, dit Hans Delbrück, la main qui a falsifié la dépêche d'Ems ! » – DE HOHENLOHE ; Mémoires, t. II, 6 mai 1874 « (p. 267) À table, Bismarck rappela des souvenirs de 1870, sa discussion avec Roon et Moltke, que la renonciation du prince de Hohenzollern et la condescendance du roi mettaient hors d'eux-mêmes. Puis la dépêche d'Abeken, et la publication abrégée que lui, Bismarck, en avait faite et qui rendait la guerre inévitable ». Mais les rhéteurs, les sophistes, les casuistes, sont utiles parce qu'ils cuisent un pain fait exprès pour les dents d'une grande partie de la population.
[FN:§ 1922-2]
Cet historien doit être plein d'indulgence pour les restrictions mentales.
[FN: § 1923-1]
Parmi ces personnes, il faut noter le grand nombre de celles qui croient, implicitement peut-être, que les dieux de l'éthique vengent les injures comme les dieux de la théologie. Pour autant que les dérivations peuvent produire quelque effet, l'influence de ces personnes est nuisible à leur parti, à leur nation, dans la mesure où les dites personnes entravent une préparation convenable à l'usage de la force, laquelle, en fin de compte, est toujours l’ultima ratio, dans ces luttes, et pour autant qu'elles gaspillent en bavardages l'énergie qui devrait être dépensée en action. Malheur au parti qui compte sur l'éthique pour être respecté de ses adversaires ! Malheur surtout à la nation qui se fie au droit des gens plus qu'à ses armes pour défendre son indépendance ! Persuader aux gens que dans les luttes civiles ou internationales on l'emporte seulement par la vertu et non par le dol, c'est les entraîner à la ruine, en les empêchant de se mettre à l'abri du dol et de pourvoir à la longue et laborieuse préparation qui seule petit mener à la victoire. En un mot, c'est une œuvre semblable à celle de celui qui persuaderait à une armée d'employer des canons de bois peints, au lieu de canons d'acier. Mais les « intellectuels » se complaisent à ces vains discours, parce qu'ils ne sont producteurs que de canons de bois peints, et non de canons d'acier.
[FN: § 1925-1]
Aeneid., II :
(390)... Dolus, an virtus, quis in hoste requirat ?
SERVIUS : Videtur deesse aliquid, ut puta : Dolus an Virtus in bello proficiat, quis in hoste requirat ?
[FN: § 1926-1]
PLUTARCH. : Agésil., 23 (Trad. E TALBOT) « Quand Phébidas eut commis l'acte odieux de s'emparer de la Cadmée, au mépris des conventions et de la paix, tous les Grecs s'indignèrent, les Spartiates mêmes en furent peinés, et particulièrement les adversaires d'Agésilas. Ils demandaient avec colère à Phébidas par quel ordre il avait agi, voulant faire tomber le soupçon sur Agésilas. Agésilas n'hésita point à venir ouvertement en aide à Phébidas, disant qu'il fallait examiner dans ce fait s'il était utile, vu que tout ce qui est avantageux à Lacédémone, il est beau de le faire spontanément, même sans ordre. Malgré cela, dans tous ses discours, il ne cessait de proclamer la justice la première des vertus, le courage n'étant d'aucune utilité sans la justice... Non content d'avoir sauvé Phébidas, il décida sa patrie à prendre sur elle l'injustice du fait, à garder pour elle la Cadmée... (24) Cela fit soupçonner tout d'abord que, si Phébidas avait exécuté la chose, c'était Agésilas qui l'avait conseillée... ». – XÉNOPH. ; Hell.,, V, 22, 32 : « Toutefois Agésilas disait que si quelqu'un faisait une chose qui fût nuisible à Lacédémone, il serait condamné à juste titre ; et que, si cette chose était bonne [pour Lacédémone], c'était une loi des ancêtres qu'il la fît spontanément ». – Et pourtant, le même auteur dit qu'Agésilas était le type de l'homme vertueux. XÉNOPH. ; Agesil., 10, 2 : ... ![]()
![]()
![]() . « Il me semble que la vertu d'Agésilas est un excellent modèle pour ceux qui veulent être vertueux ; car, qui, imitant l'homme pieux, serait impie, [imitant] le juste, [serait] injuste... ? » – Dans les affaires privées aussi, Agésilas faisait bon marché des scrupules. PLUTARCH. ; Agesil,. 13 (Tract. TALBOT) : « Dans tout le reste, en effet, il se montrait scrupuleux et esclave de la loi ; mais il pensait que, dans les relations amicales, trop de justice n'est qu'un prétexte. On cite, à ce propos, un billet adressé par lui à Hidriée de Carie ; le voici : „ Si Nicias n'est point coupable, relâche-le ; s'il est coupable, relâche-le pour l'amour de nous ; dans tous les cas, relâche-le ! “ »
. « Il me semble que la vertu d'Agésilas est un excellent modèle pour ceux qui veulent être vertueux ; car, qui, imitant l'homme pieux, serait impie, [imitant] le juste, [serait] injuste... ? » – Dans les affaires privées aussi, Agésilas faisait bon marché des scrupules. PLUTARCH. ; Agesil,. 13 (Tract. TALBOT) : « Dans tout le reste, en effet, il se montrait scrupuleux et esclave de la loi ; mais il pensait que, dans les relations amicales, trop de justice n'est qu'un prétexte. On cite, à ce propos, un billet adressé par lui à Hidriée de Carie ; le voici : „ Si Nicias n'est point coupable, relâche-le ; s'il est coupable, relâche-le pour l'amour de nous ; dans tous les cas, relâche-le ! “ »
[FN: § 1926-2]
Judith, IX. Elle prie Dieu : ... (10) ![]()
![]() ... « Frappe par le mensonge de mes lèvres l'esclave avec le maître, le chef avec son serviteur...» (13)
... « Frappe par le mensonge de mes lèvres l'esclave avec le maître, le chef avec son serviteur...» (13) ![]()
![]() ... « et donne à mon discours de tromper pour les blesser et leur nuire ». Pourquoi ce livre ne doit-il pas avoir sa place parmi ceux où se trouve l'expérience du chrétien ? Il y a tant de gens qui, en guerre, pensent de cette façon !
... « et donne à mon discours de tromper pour les blesser et leur nuire ». Pourquoi ce livre ne doit-il pas avoir sa place parmi ceux où se trouve l'expérience du chrétien ? Il y a tant de gens qui, en guerre, pensent de cette façon !
[FN: § 1927-1]
Récits de Conon (dans Photius), narr. XXXIX. – Voir aussi Scholia in Acharnenses, 146. Scholia in Pacem, 890. SUIDAS ; s. r. ![]() . Harpocr. ; s.r.
. Harpocr. ; s.r. ![]() . POLYAEN. ; Strateg., I, 19. – PAUS., II, 33, parle d'un temple d'Athéna trompeuse, érigé par Etra qui, trompée par la déesse, eut commerce avec Poséidon. – STRAB. : XI, p. 495, fait allusion à un temple d'Aphrodite Trompeuse. Les géants voulaient faire violence à la déesse. Celle-ci appela à son aide Héraclès ; elle le cacha dans une grotte où elle promit aux géants de se donner à eux, tour à leur, et au fur et à mesure que l'un entrait dans la grotte, Héraclès le tuait par fraude
. POLYAEN. ; Strateg., I, 19. – PAUS., II, 33, parle d'un temple d'Athéna trompeuse, érigé par Etra qui, trompée par la déesse, eut commerce avec Poséidon. – STRAB. : XI, p. 495, fait allusion à un temple d'Aphrodite Trompeuse. Les géants voulaient faire violence à la déesse. Celle-ci appela à son aide Héraclès ; elle le cacha dans une grotte où elle promit aux géants de se donner à eux, tour à leur, et au fur et à mesure que l'un entrait dans la grotte, Héraclès le tuait par fraude ![]() .
.
[FN: § 1928-1]
Odyss., XIII, 291-299.
[FN: § 1928-2]
MONTAIGNE ; Essais, II, 12 : « (p. 262) Les uns font accroire au monde qu'ils croyent ce qu'ils ne croyent pas ; les aultres, en plus grand nombre, se le font accroire à eux-mesmes, ne scachants pas penetrer que c'est que croire : et nous trouvons estrange si, aux guerres qui pressent à cette heure nostre estat, nous voyons flotter les evenements et diversifier d'une maniere commune et ordinaire ; c'est que nous n'y apportons (p. 263) rien que le nostre. La iustice, qui est en l'un des partis, elle n'y est que pour ornement et couverture : elle y est bien alleguee : mais elle n'y est ni receue, ni logee ni espousee : elle y est comme en la bouche de l'advocat, non comme dans le cœur et affection de la partie... Ceulx qui l'ont prinse [la religion] à gauche, ceulx qui l'ont prinse à droicte, ceulx qui en disent le noir, ceulx qui en disent le blanc, l'employent si pareillement à leurs violentes et ambitieuses entreprinses, s'y conduisent d'un progrez si conforme en desbordement et iniustice, qu'ils rendent doubteuse et malaysée à croire la diversité qu'ils pretendent de leurs opinions... Voyez l'horrible impudence de quoy nous pelotons les raisons divines ; et combien irreligieusement nous les avons et reiectees, et reprinses, selon que la fortune nous a changé de place en ces orages publicques. Cette proposition si solenne, „ S'il est permis au subiect de se rebeller et armer contre son prince pour la deffense de la religion “ : souvienne vous en quelles bouches, cette annee passee, l'affirmative d'icelle estoit l'arc boutant (p. 264) d'un party ; la negative, de quel autre party c'estoit l'arc boutant : et oyez à present de quel quartier vient la voix et instruction de l'une et de l'autre : et si les armes bruyent moins pour cette cause que pour celle là. Et nous bruslons les gens qui disent qu'il fault faire souffrir à la Verité le ioug de notre besoing : et de combien faict la France pis que de le dire ? »
[FN: § 1929-1]
MACHIAVEL ; Discours sur la première décade de Tite-Live, 1. III, Cfr. §1975-2.
[FN: § 1929-2]
Aujourd'hui, on peut le dire des Allemands.
[FN: § 1931-1]
Maïmonide exprime assez bien la différence de diverses doctrines, telles qu'il les connaissait. – MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, trad. S. MUNK, IIIe part. XVII, t. III : « (p. 125) Voici donc le résumé succinct de ces différentes opinions : Toutes les conditions variées dans lesquelles nous voyons les individus humains, Aristote n'y reconnaît que le pur hasard ; les Ascharites y voient l'effet de la seule volonté divine) ; les Mo'tazales, l'effet de la sagesse (divine), et nous autres (Israélites), nous y voyons l'effet de ce que l'individu a mérité selon ses œuvres. C'est pourquoi il se pourrait, selon les Ascharites, que Dieu fît souffrir l'homme bon et vertueux dans ce bas monde et le condamnât pour toujours à ce feu qu'on dit être dans l'autre monde ; car, dirait-on, Dieu l'a voulu ainsi. Mais les Mo'tazales pensent que ce serait là une injustice, et que l'être qui a souffert, fût-ce même une fourmi, comme je l'ai dit [voir citation 1967 1], aura une compensation ; car c'est la sagesse divine qui a fait qu'il souffrît, afin qu'il eût une compensation. Nous autres enfin, etc. » [voir la suite § 917 1]. La théorie des causes finales entreprend de faire disparaître de telles contradictions. Appliquée aux actions de l'individu, elle affirme que ces actions ont toujours pour but, que l'individu s'en rende compte ou non, le « bien » de l'individu, ou de la communauté ; et par des raisonnements parfois ingénieux, souvent absurdes et puérils, elle découvre ce « bien » là où il n'existe nullement. Il est clair que, de la sorte, il est aisé de démontrer que, puisque toutes les actions visent à un seul et même but, elles ne peuvent jamais être contradictoires.
Cette théorie a la vie dure. Détruite sur un point, elle reparaît sur un autre et prend les formes les plus diverses. Le Darwinisme a dégénéré – ainsi qu'on l'a souvent remarqué – en une application de la théorie des causes finales aux formes des êtres vivants. Les métaphysiciens font un usage aussi étendu que varié de cette théorie, appliquée aux actes (§1521), et les théologiens sont loin de la dédaigner. Pour l'employer, des auteurs modernes ont imaginé d'avoir recours à l' « excogitation », ou ont inventé d'autres beaux artifices.
[FN: § 1932-1]
Il convient de prendre garde que le problème n'est ici résolu que qualitativement (§1876-1, 1897-1]. Les considérations quantitatives seront introduites au chapitre XII.
[FN: § 1932-2]
Nous avons souvent montré la vanité logico-expérimentale, l'absurdité même de certaines dérivations ; mais nous avons aussi mis en garde le lecteur sur le fait que par là nous ne n’entendions point infirmer l'utilité sociale des résidus dont elles étaient la manifestation. Cette utilité demeure intacte, lorsqu'on fait voir l'inconvénient qu'il y a à vouloir imposer certaines dérivations. Par exemple, ce que nous avons dit de la vanité expérimentale des dérivations de certaines religions et des inconvénients qu'il y a à vouloir imposer certaines de ces dérivations, ne doit nullement être entendu, comme c'est ordinairement le cas, en ce sens que les persistances d'agrégats qui se trouvent dans ces religions seraient, non pas utiles, mais nuisibles. Parmi ces religions, nous rangeons aussi la religion sexuelle, dont nous avons dû souvent nous occuper, à propos de dérivations absurdes et nuisibles.
[FN: § 1934-1]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, trad. S. MUNK, IIIe, part., c. XVII, t. III : « (p. 125) Nous autres [les Israélites] enfin, nous admettons que tout ce qui arrive à l'homme est l'effet (p. 126) de ce qu'il a mérité, que Dieu est au-dessus de l'injustice et qu'il ne châtie que celui d'entre nous qui a mérité le châtiment. C'est là ce que dit textuellement la loi de Moïse, notre maître, (à savoir) que tout dépend du mérite ; et c'est aussi conformément à cette opinion que s'expriment généralement nos docteurs. Ceux-ci, en effet, disent expressément : „ Pas de mort sans péché, pas de châtiment sans crime “† ; et ils disent encore : „ On mesure à l'homme selon la mesure qu'il a employée lui-même “, ce qui est le texte de la Mischnâ. Partout ils disent clairement que, pour Dieu, la justice est une chose absolument nécessaire, c'est-à-dire qu'il récompense l'homme pieux pour tous ses actes de piété et de droiture, quand même ils ne lui auraient pas été commandés par un prophète, et qu'il (p. 127) punit chaque mauvaise action qu'un individu a commise, quand même elle ne lui aurait pas été défendue par un prophète... ». – IUSTI LIPSIUS ; Politicorum, 1. I, c. 3, p. 35. L'auteur cite en l'approuvant un passage de Tite-Live, qui dit : Omnia prospera eveniunt colentibus deos, adversa spernentibus. On trouve de semblables idées chez un très grand nombre d'auteurs du passé. Que ce fût là ou non leur opinion, ils estimaient opportun et utile de la manifester. Le passage de TITE-LIVE se trouve : V, 51 : une vérification expérimentale y est ajoutée. Lipsius l'a passée sous silence. Camille parle aux Romains et dit : Intuemini enim horum deinceps annorum vel secundas res, vel adversas ; invenietis omnia prospere evenisse sequentibus deos, adversa spernentibus. « Considérez donc ensuite les événements favorables ou contraires de ces années-ci. Vous trouverez que tout a été prospère, quand on obéissait aux dieux, contraire quand on les négligeait ». Il continue en citant la guerre de Véies et l'invasion des Gaulois, et il dit que la première fut heureuse, parce que les Romains furent attentifs aux enseignements des dieux, la seconde malheureuse, parce qu'ils négligèrent ces enseignements.
† (Note de S. MUNK : « ... Le commentateur Schem-Tob fait observer avec raison que cette opinion est réfutée au même endroit par le Talmud lui-même, et qu'il s'agit ici d'une doctrine populaire enseignée au vulgaire, mais que les Talmudistes ne prétendaient pas donner pour une vérité incontestable... ».
[FN: § 1937-1]
Nous avons déjà cité un grand nombre d'exemples de semblables dissertations. Ajoutons-en encore un, qui se rattache à un type extrêmement répandu.
Les Grandes Chroniques de France, publiées par PAULIN PARIS, Paris 1837, t. II. On y rapporte une légende au sujet de Charlemaines (Charlemagne). Un certain Agoulant vient chez Charlemaines pour se faire baptiser. « (p. 232) Lendemain, en droit l’eure de tierce, vint Agoulant à Charlemaines pour recevoir baptesme. A l’eure qu'il vint estoit Charlemaines assis a mangier luy et sa gent... „ Ceulx –– dit Charlemaines – que tu vois vestus de drap de soie et d'une couleur sont les évesques et les prestres de notre loy qui nous preschent et exposent les commands nostre Seigneur : ceux nous absolvent de nos péchiés et nous donnent la bénéiçons nostre Seigneur. Ceulx que tu vois en noir habit, ce sont moines et abbés ... Ceulx que tu vois après qui sont en blanc habit, il sont appellés chanoines réglés ... “ Entre autre chose regarda Agoulant d'autre part, et vit trèze povres vestus de povres draps, qui mengeoient à terre sans nappe et sans table, si avoient pou à manger et pou à boire. Lors demanda à Charlemaines quels gens c'estoient. „ Ce sont – dist-il – les gens Dieu, messages nostre sire Jhésu-Crist, que nous paissons chaque jour en l'onneur des douze apostres. “ Lors respondit Agoulant : „ Ceulx qui sont autour toy sont beneurés, et largement (p. 233) mengent et boivent, et sont bien vestus et noblement; et ceulx que tu dis qui sont messages de ton Dieu. pourquoy souffres-tu qu'ils aient faim et mesaise, et qu'ils soient si povrement vestus et si loing de toy assis né si laidement traitiés ? Mauvaisement sert son Seigneur qui ses messages reçoit si laidement. Grant honte fait à son Seigneur qui ainsi ses messages sert. Ta loy que tu disoies qui estoit si bonne monstre bien, par ce, qu'elle soit faulse. “ Après ces paroles se départit de Charlemaines, et s'en retourna à sa gent, et refusa le saint baptesme qu'il vouloit recevoir. Lendemain manda bataille à Charlemaines. Lors entendit bien l'empereur qu'il eut baptesmes refusé pour les povres qu'il vit si laidement traités. Pour ce commanda Charlemaines que les povres de l’ost feussent honnourablement vestus et suffisamment repeus de vins et de viandes ».
Du contraste entre la pureté évangélique et les mauvaises mœurs de la Cour de Rome, Boccace (I, 2) tire la conclusion que la foi chrétienne doit être vraiment divine, puisqu'elle résiste à ces causes de dissolution. Le juif qui était allé à Rome et qui avait observé ces contradictions entre la foi chrétienne et les mœurs, prend un parti contraire à celui qu'avait adopté Agoulant, et demande le saint baptême.
Ce sont là des légendes et des contes ; mais celui qui serait tenté de croire que le fond révélé par ces formes n'existe plus de nos jours, n'a qu'à regarder autour de lui, et il trouvera aisément des contradictions de ce genre. Les noms seuls ont changé. Du crépuscule des dieux anciens surgissent les nouvelles divinités : le radieux soleil de la Science, du Progrès, de la Démocratie ; les brillantes planètes qui se nomment Vérité, Justice, Droit, Patriotisme exalté, et autres semblables : les lumineux satellites qui tirent leurs noms de l'Organisation, de la Civilisation, du Nationalisme, de l'Impérialisme, de la Xénophobie, de la Solidarité, de l'Humanitarisme, etc. ; et ces nouvelles religions abondent en contradictions tout autant que les anciennes.
[FN: § 1942-1]
Op. et dies. Vient un vers qui parait être une glose introduite dans le texte et qui dit : « (273) Mais je ne pense pas que ce soit la volonté de Zeus fulminant ». Que ce soit ou non la volonté de Zeus, le fait relevé par l'auteur subsiste toujours. D'autres vers se contredisent. En de nombreux endroits, l'auteur insiste en disant que celui qui commet une injustice n'échappe pas au châtiment mérité, et que celui qui est juste est récompensé ; tandis qu'en décrivant l'âge de fer où nous vivons, il dit : « (190-193) L'homme fidèle à son serment, ni le juste, ni le bon ne trouveront plus grâce ; mais on honorera plutôt l'homme coupable de maléfices et d'injure. De justice et de pudeur, il n'y en aura plus ».
[FN: § 1943-1]
Société biblique de Paris ; Les livres apocryphes de l'Ancien Testament, La, sagesse de Jésus fils de Sirach, (L'Ecclésiastique) : « (p. 406) I, 16. La plénitude de la sagesse appartient à ceux qui craignent le Seigneur ; elle les rassasie (litt. les enivre ; les, ce sont ceux qui craignent le Seigneur). – 17. Elle remplit toute leur maison de choses désirables et leurs greniers de ses produits ». – « (p. 434), XI, 1. La sagesse du pauvre (de l'humble, c'est-à-dire de celui qui est d'humble condition) le relève (litt. : relève sa tête) et le fait asseoir parmi les grands. Le texte grec dit : ![]()
[FN: § 1944-1]
PIEPENBRING ; Théol. de l'Anc. Test. : « (p. 208) Il ressort clairement de ce qui précède et de tous les documents des deux premières périodes que les Israélites ne croyaient qu'à une rémunération terrestre des actions humaines. Il n'y a pas la moindre trace chez les prophètes, où le châtiment du péché, d'un côté, et l'espérance du salut futur, de l'autre, jouent un si grand rôle, de l'idée que le péché pourrait être châtié et la vertu récompensée dans une autre vie. D'après l'opinion générale des Hébreux, Dieu récompense le bien et punit le mal dans ce monde; tout malheur est un châtiment divin, attiré par l'infidélité, et toute bénédiction une récompense divine, méritée par la fidélité; en un mot, il y a une relation exacte entre le malheur et la culpabilité, entre le bonheur et le mérite ». Voir le reste de la citation à la note 1976-1.
[FN: § 1944-2]
RENAN ; Vie de Jésus « (p. 180) Les prophètes, vrais tribuns (p. 181) et en un sens les plus hardis tribuns, avaient tonné sans cesse contre les grands et établi une étroite relation d'une part entre les mots de riche, impie, violent, méchant, de l'autre entre les mots de pauvre, deux, humble, pieux ».
[FN: § 1944-3]
BAYLE ; Dict. hist., s. r. Malherbe, rem. (C). L'auteur cite RACAN ; Vie de Malherbe, p. 15 : « Quand les pauvres luy disoient qu'ils prieroient Dieu pour luy, il leur répondoit qu'il ne croyoit pas qu'ils eussent grand credit au Ciel, veu le mauvais estat auquel il les laissoit en ce monde ; et qu'il eust mieux aimé que Monsieur de Luyne, ou quelqu'autre favory, luy eust fait la mesme promesse ».
[FN: § 1947-1]
GUILLAUME DE TYR, dans GUIZOT, Collection de mém., t. III : « (p. 10) …Il semblait en effet que la ville ne pût manquer de tomber promptement au pouvoir du peuple chrétien, moyennant la protection de la Divinité. Mais celui qui est terrible (p. 11) dans ses desseins sur les fils des hommes (Psaume 65, 4) en avait autrement décidé. Je viens de dire que la ville était serrée de très près, et que les citoyens avaient perdu tout espoir de défense et de salut... lorsqu'en punition de nos péchés ils en vinrent à fonder quelque espérance sur la cupidité des nôtres... (p. 17) Cependant l'empereur Conrad, voyant que le Seigneur lui avait retiré sa grâce et qu'il était hors d’état de rien faire pour l'avantage de notre royaume, fit préparer ses navires, prit congé de Jérusalem et retourna dans ses propres États ». Du côté des musulmans, le Livre des Jardins dit : « (p. 59) La population musulmane témoigna une joie très vive du succès que Dieu venait de lui accorder ; elle rendit de nombreuses actions de grâce au ciel qui avait accueilli avec faveur les prières qu'elle lui avait adressées durant ces jours d'épreuves. Dieu soit loué et béni ! Peu de temps après cette marque de la protection divine, Nour ed-Dîn vint au secours de Mo'in ed-Dîn et le rejoignit dans un bourg des environs de Damas ».
[FN: § 1948-1]
DRAPER ; Les confl. de la sc. et de la rel. Parlant de la conquête de Jérusalem, faite par Kosroès, l'auteur dit : « (p. 55) Le magisme avait insulté le christianisme à la face du monde, en profanant ses sanctuaires – Bethléem, Gethsémani, le Calvaire – en brûlant le sépulcre du Christ, en dépouillant et détruisant ses églises, en jetant ses reliques au vent, en enlevant, au milieu de cris de triomphe, la croix du Sauveur. Les miracles avaient autrefois abondé en Syrie, en Égypte, en Asie Mineure. Il s'en était fait dans les occasions les moins importantes et pour les objets les plus insignifiants ; et pourtant, dans ce moment suprême, aucun miracle ne s'était accompli ! Les populations chrétiennes de l'Orient furent remplies d'étonnement quand elles virent les sacrilèges des Perses, perpétrés avec impunité. Le soleil aurait dû rebrousser sa marche, la terre entrouvrir ses abîmes, l’épée du Tout-Puissant lancer ses éclairs et le sort de Sennachérib eût dû être celui de l'envahisseur. Cependant il n'en avait rien été ». Plus loin, parlant de la conquête de Jérusalem, faite par les Sarrasins : « (p. 65) La chute de Jérusalem ! la perte de la métropole chrétienne ! Dans les idées du temps, les deux religions avaient passé par l'ordalie des armes ; elles avaient subi le jugement de Dieu ! La victoire avait adjugé au mahométisme Jérusalem le prix du combat (1) Et malgré les succès temporaires des croisés, après mille ans écoulés, elle est encore dans ses mains ! » L'auteur se trompe en croyant qu'on ait conclu de cette victoire que le mahométisme fut jugé meilleur que le christianisme, parce qu'il avait remporté la victoire. Jamais, jamais les hommes n'ont fait usage de tant de logique. – BAYLE ; Dict. hist, s. r. Mahomet, rem. (P) : « Iis [Bellarmin et d'autres controversistes] ont eu même l'imprudence de mettre la prospérité entre les marques de la vraie Église. Il étoit facile de prévoir qu'on leur répondroit, qu'à ces deux marques l'Église Mahométane passera plus justement que la Chrétienne pour la vraie Église ». – A. BAYET ; Collect. Aulard ; Morale. Probablement pour discréditer la religion chrétienne, l'auteur cite des données statistiques qui ont vraiment peu de rapports avec un traité de morale. « (p. 156) La religion qui a le plus grand nombre de fidèles est le bouddhisme : il y a environ 500 millions de bouddhistes. [Vraiment ? M. Bayet les a-t-il pu compter ?] Puis vient le christianisme qui est divisé en trois branches... il y a 217 millions de catholiques et 127 millions de protestants ; enfin, il y a 120 millions d'hommes qui font partie de l'église russe ».– BAYLE ; Dict. hist., s. r. Mahomet II, rem. (D) : « J'ai marqué qu'en matière de triomphes l'étoile du Mahométisme a prévalu sur l'étoile du Christianisme [aujourd’hui on ne pourrait plus dire cela], et que s'il faloit juger (le la bonté de ces Religions par la gloire des bons succès temporels, la Mahométane passeroit pour la meilleure. Les Mahométans sont si certains de cela, qu'ils n'allèguent point de plus forte preuve de la justice de leur cause, que les prospéritez éclatantes dont Dieu l'a favorisée... ». L'auteur cite ensuite HOTTINGER, Hist. Oriental, p. 338, qui dit : « L'heureux succès des armes de ces Infidèles est un autre argument dont ils se servent pour appuyer la vérité de leur Religion. Car comme ils croyent que Dieu est l'auteur de tous les bons évenemens, ils concluent, que plus ils réussissent dans leurs guerres, et plus aussi Dieu fait paroître qu'il approuve leur zèle et leur Religion ».
[FN: § 1949-1]
BAYLE. ; Dict. hist., s. r. Guise (Charles de Lorraine, duc de), rem. (F).
[FN: § 1950-1]
M. BUSCH ; Les mémoires de Bismarck, édit. franç., t. I, p. 64 : « Le comte de Waldersee, lui, souhaita de „ voir cette Babel [Paris] entièrement détruite “. Le Chancelier intervint : Cela. ne serait, en effet, pas une mauvaise chose du tout, mais cela est impossible pour beaucoup de raisons. La principale est qu'un trop grand nombre d'Allemands de Cologne et de Francfort y ont placé des fonds considérables ! ». « (p. 67) Un peu après Saint-Aubin, je [Busch] remarquai sur le bord une borne kilométrique avec ces mots : „ Paris, 241 kilomètres “. Nous n'étions donc déjà plus qu'à cette distance de la Babel gigantesque ! ». « (p. 172) Elle [la comtesse de Bismarck] se porte tout à fait bien maintenant, a répondu le ministre [Bismarck]. Elle souffre pourtant encore de sa haine féroce contre les Gaulois. Elle voudrait (p. 173) les voir tous morts, jusqu'aux enfants en bas âge, qui ne peuvent pourtant s'empêcher d'avoir d'aussi abominables parents ». Il ne faut pas oublier que la comtesse de Bismarck et son mari se croyaient et étaient peut-être de bons chrétiens.
[FN: § 1951-1]
ÉMILE OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. I. On remarquera que cet ouvrage fait partie d'une histoire en seize [ensuite dix-sept] volumes, qui a la prétention d'être scientifique, et qui est par conséquent d'un genre entièrement différent de celui des proclamations mentionnées tout à l'heure, de Guillaume 1er et de Napoléon III, ou d'autres semblables écrits qui visent, non pas à une étude scientifique, mais seulement à émouvoir les sentiments populaires et à les diriger dans la voie qu'on estime convenable.
[FN: § 1951-2]
Bismarck part d'autres principes pour juger les actions de Napoléon III. BUSCH ; Les mém. de Bismarck, t. I : « (p. 30) Sa politique [de Napoléon III a toujours été stupide. La guerre de Crimée était diamétralement opposée aux intérêts de la France, qui réclamait une alliance ou, tout au moins, une bonne entente avec la Russie. il en (p. 31) est de même de la guerre pour l'Italie. Il s'est créé là un rival dans la Méditerranée, le nord de l'Afrique, la Tunisie, etc. [on remarquera qu'il disait cela en 1870 : Bismarck voyait loin et juste], qui, un jour, sera peut-être dangereux. La guerre du Mexique et l'attitude qu'a prise la France en 1866 sont encore des fautes, et nul doute que, dans la tempête qui éclate aujourd'hui, les Français ne sentent eux-mêmes qu'ils sont en train de commettre une dernière faute ». Bismarck avait raison, mais il négligeait certaines circonstances qui peuvent expliquer ces faits et les atténuer. Il est très juste que la guerre de Crimée était une erreur de politique extérieure, mais elle était très avantageuse à la politique intérieure : elle donnait au gouvernement de Napoléon III l'auréole de gloire qui manquait à celle de Louis-Philippe, et l'erreur de politique extérieure pouvait aisément être corrigée par une alliance après la victoire. La guerre d'Italie eut pour origine une combinaison entre les sentiments humanitaires de Napoléon III et les intérêts des « spéculateurs » internationaux, qui donnèrent alors naissance à des entreprises aujourd'hui si étendues et si puissantes. La guerre du Mexique fut principalement une manifestation d'humanitarisme pathologique. L'attitude de Napoléon III en 1866 n'a aucune excuse. Comme d'habitude, c'est celle d'un humanitaire de peu de bon sens. Ensuite, les événements se précipitent, et la France semble un navire sans direction, dans une mer en fureur. La République eut une politique extérieure bien meilleure que celle de Napoléon III, précisément parce qu'elle se rangea à la politique réaliste de Bismarck. Cela suffirait pour faire préférer, et de beaucoup, en France, la République à l'Empire. La politique intérieure de la République ne va pas de pair avec la politique extérieure. De là le danger que celle-ci soit affaiblie par celle-là. Mais si la République néglige la préparation militaire, l'Empire la négligea plus encore, et sa faute fut plus grande, car il pouvait imposer ce que des républicains clairvoyants comme Poincaré ne peuvent obtenir.
[FN: § 1951-3]
H. WELSCHINGER ; La guerre de 1870, t. II.
[FN: § 1952-1]
GROTE ; Hist. de la Gr., trad. SADOUS. t. XV.
[FN: § 1955-1]
PIEPENBRING ; Hist. du peuple d'Isr. : « (p. 245) Jahvé fait en réalité grâce ou miséricorde à qui il veut, par suite de son pouvoir suprême, à la manière des anciens souverains despotiques de l'Orient, qui se plaisaient aussi à manifester leur pouvoir... »
[FN: § 1956-1]
A. MAURY ; Hist. des relig. de la Gr. ant., t. III. Les vers 1621-1622 du Chœur d'Ion s'expriment ainsi : « Car à la fin les bons obtiennent ce dont ils sont dignes ; les méchants, comme il est naturel, ne peuvent jamais être heureux ». Maury cite aussi les vers 882-887 du Chœur des Bacchantes : « La force des dieux vient, lente mais sûre; elle châtie les hommes qui honorent l'iniquité et qui, en insensés, ne vénèrent pas les dieux ». Là encore, il s’agit en somme de ceux qui savent obtenir la faveur des dieux ou qui tombent sous leur colère ; mais on ne voit pas clairement si c'est par vertu ou par vice.
[FN: § 1958-1]
Helen., 1137-1143. « Lequel des mortels, ayant scruté l'ultime fin des événements, peut affirmer y avoir trouvé quelque chose qui soit dieu, non-dieu ou être intermédiaire [démon], en considérant que les desseins des dieux s'orientent tantôt ici, tantôt là, et sont de nouveau contraires, apparaissant dans des événements inespérés ? »
[FN: § 1958-2]
Hercul. fur. Aux vers 655-668, il dit que les bons devraient avoir une double jeunesse et renaître après leur mort, tandis que les méchants vivraient une fois seulement. Puis il ajoute, 669-670 « Or, par aucun signe des dieux on ne distingue les méchants des bons ».
![]()
[FN: § 1961-1]
Hipp., 47-50.
[FN: § 1963-1]
SCHŒMANN ; Ant. grecq., trad. GALUSKI, t. II.
[FN: § 1964-1]
P. DECHARME ; La crit. des trad. relig. chez les Grecs.
[FN: § 1965-1]
ÆSCH. ; Eum., 658-666. Suivant Apollon, la mère n'est que la nourrice de l'enfant ; celui qui l'engendre véritablement, c'est le père. Apollon donne pour preuve de cette affirmation un argument mythologique : qu'on peut être père sans avoir besoin d'une femme, puisqu'Athéna est née de Zeus sans avoir été nourrie dans une matrice.
[FN: § 1966-1]
AESCH. ; Agam., 1475-1480.
[FN: § 1966-2]
AESCH. ; Coeph., 48 : ![]() .
.
[FN: § 1966-3]
AESCH. ; Agam., 1562 : ![]() .
.
[FN: § 1966-4]
AESCH. ; Coeph., 119-121 :
(121)
[FN: § 1966-5]
AESCH. ; Agam. 750-760. Le chœur continue en paraphrasant ce qui précède.
[FN: § 1966-6]
AESCH. ; Eum., 430 : ![]() .
.
[FN: § 1966-7]
Eum. :
(445)
« Je ne suis pas souillé d'un délit ; mes mains ne sont pas tachées, tandis que je suis assis auprès de ta statue » : et il le prouve : (417) « Je te donnerai un témoignage important de ces choses ». En somme, ce témoinage est le suivant : (448-452) La loi impose le silence à qui ne s'est pas purifié, et lui a été purifié par le sang et par l'eau. Il s'agit exclusivement d'une action mécanique des victimes expiatoires et de l'eau.
[FN: § 1967-1]
AESCH. ; Coeph., 59-64.
[FN: § 1967-2]
AESCH. ; Eum., 313 820. – Idem. ; Suppl. :
(732)
« Au temps et au jour fixés, le mortel, contempteur des dieux, subira le châtiment ». – EUR. Bacch., 882-890, déjà cité §1856 SOLON ; XIII (IV), (§1980-6).
[FN: § 1968-1]
AESCH. ; Agam., 338-340.
[FN: § 1968-2]
Dans un fragment de la Niobé d'ESCHYLE (NAUCK, 151), il est dit que : « Dieu met de mauvaises pensées dans l'esprit des hommes, quand il veut détruire entièrement une maison ».
[FN: § 1969-1]
AESCH. ; Agam., 946-947.
[FN: § 1969-2]
AESCH. ; Agam., 1001-1007.
[FN: § 1970-1]
Odyss., I, 32-41 : « Car ils disent que les maux viennent de nous ; et d'autre part eux-mêmes, par leur folie, ont des maux contrairement au destin. Ainsi, maintenant encore Égisthe, contrairement au destin, s'est uni à la femme légitime de l'Atride [Agamemnon] et a tué celui-ci de retour ; tout en connaissant la terrible ruine [qui l'attendait]. Pourtant, lui ayant envoyé Hermès, le clairvoyant meurtrier d'Argus, nous l'avions averti de ne pas tuer Agamemnon et de ne pas rechercher l'épouse de celui-ci, car il se serait ainsi exposé à la vengeance de l'Atride Oreste, quand celui-ci, devenu adulte, aurait désiré revoir son pays ». Dans ce discours, il y a une contradiction formelle ; mais elle disparaît, si l'on adopte le sens : « Car ils disent que tous les maux viennent de nous ; tandis qu'eux aussi, par leur folie, ont des maux contrairement au destin ». Ainsi disparaît la contradiction entre cette affirmation et celle qui attribue l'origine des malheurs d'Ulysse à la colère de Poséidon ; mais elle subsiste quant au fond ; car enfin, même si ce n'est qu'une partie des maux des hommes qui viennent des dieux, cela n'empêche pas que, pour cette partie, les hommes aient raison de se plaindre des dieux. Cfr. Iliad., XXIV, 527-532, et les observations de PLATON à ce sujet, De Rep., II, p. 379. Cet auteur conclut (p. 380) qu'on ne doit pas laisser dire que Zeus est l'auteur des maux qui accablent les mortels ; que s'il en est l'auteur, il n'a rien fait que de juste et de bon, corrigeant les hommes pour leur faire du bien : on ne doit permettre à aucun poète de dire que quiconque est ainsi puni est malheureux. Chez Platon, la métaphysique se superpose à la théologie. et Zeus n'est que l'exécuteur des sentences de la métaphysique.
[FN: § 1970-2]
Odyss.. I, 45-62.
[FN: § 1970-3]
Odyss., I, 63-75.
[FN: § 1971-1]
J. Girard ; Le sent. relig. en Grèce.
[FN: § 1971-2]
EUSTATH. ; Comm. in Odyss., I, v. 34, p. 15 Basil., p. 1387 Rom. Il cite comme exemple de maux indépendants de l'action humaine : « Hippolyte qui souffrit injustement des maux par le fait de Cypris : Héraclès persécuté par la colère d'Héra » ; Bellérophon, Eukhènôr, Ulysse. Comme exemples d'hommes qui s'attirèrent à eux-mêmes des maux, il cite Égisthe, les compagnons d'Ulysse, qui se nourrirent des bœufs du Soleil ; Achille, qui avait le choix entre vieillir à Phthia ou mourir jeune devant Troie ; Alexandre (Pâris), qui négligea Oenone pour enlever Hélène ; Elpénor qui, gorgé de vin, se tua [on tombant du toit de la demeure de Circé].Tous ces gens souffrirent par leur imprudence ou leur folie : ![]()
![]() . Il convient de remarquer qu'Eustathe met ensemble des délinquants comme Égisthe et Pâris, de simples imprudents, comme Elpénor, et même des ambitieux, comme Achille.
. Il convient de remarquer qu'Eustathe met ensemble des délinquants comme Égisthe et Pâris, de simples imprudents, comme Elpénor, et même des ambitieux, comme Achille.
[FN: § 1973-1]
IULIANUS apud CYRILL. ; V (p. 160) : ![]()
![]() ; « Quoi de plus futile que la cause pour laquelle Dieu se met en colère, ainsi que le rapporte faussement l’écrivain ? » Il s'agit du fait raconté, Nombr., 25, où Dieu fait mourir plusieurs milliers d'Israélites, parce que quelques-uns d'entre eux s'étaient unis aux femmes moabites, et avaient adoré les dieux de ces femmes.
; « Quoi de plus futile que la cause pour laquelle Dieu se met en colère, ainsi que le rapporte faussement l’écrivain ? » Il s'agit du fait raconté, Nombr., 25, où Dieu fait mourir plusieurs milliers d'Israélites, parce que quelques-uns d'entre eux s'étaient unis aux femmes moabites, et avaient adoré les dieux de ces femmes.
[FN: § 1974-1]
A. BAYET ; Leçons de morale, p. 1. Les passages soulignés ici le sont aussi dans le texte de l'auteur. Il nous enseigne – suivant Hésiode, dit-il – que « (p. 6) ceux qui écoutent ce que dit la morale sont toujours heureux. La paix règne dans leur pays. Ils n'ont pas à supporter les maux effroyables de la guerre [donc aucun peuple moral n'a jamais subi l'agression d'un autre état]... la terre leur fournit une nourriture abondante : les abeilles leur donnent le miel ; les moutons leur donnent la laine : ils sont toujours riches et sans chagrins [il semble vraiment que la Sainte Science fait ici une concurrence déloyale à l'ancienne superstition (§1984)]. Mais quand les hommes n'écoutent pas la morale, le malheur vient les frapper... ». Plus loin, p. 163, il d’écrit les malheurs des protestants sous le règne de Louis XIV. Si l'on admet que « ceux qui écoutent ce que dit la morale sont toujours heureux », il en résulte nécessairement que les protestants, qui étaient malheureux, n'avaient pas écouté ce que dit la morale. Les contradictions formelles ne manquent pas non plus. Ainsi, on lit dans la même page : « (p. 146) ON SE DÉVOUE lorsqu'on accepte d'être malheureux pour que les autres soient heureux... En se dévouant, on ne rend pas seulement les autres hommes heureux : ON SE REND HEUREUX SOI-MÊME ». Donc, le même homme est à la fois heureux et malheureux.
[FN: § 1975-1]
Dans l'Anti-Machiavel, qui est attribué à Frédéric II de Prusse, on affirme que l'histoire ne devrait pas parler des mauvais princes. L'Antimachiavelli ou Examen du Prince de Machiavel ; Avant-Propos : « (p. VIII) On ne devroit conserver dans l'histoire que les noms des bons Princes, et laisser (p. IX) mourir à jamais ceux des autres, avec leur indolence, leurs injustices et leurs crimes. Les livres d'histoire diminueroient à la vérité de beaucoup, mais l'humanité y profiteroit, et l'honneur de vivre dans l'histoire, de voir son nom passer des siècles futurs jusqu'à l'éternité, ne seroit que la recompense de la vertu : Le Livre de Machiavel n'infecteroit plus les Ecoles de Politique, on mépriseroit les contradictions dans lesquelles il est toujours avec lui-même ; et le monde se persuaderoit que la véritable politique des Rois, fondée uniquement sur la justice, la prudence et la bonté, est préferable en tout sens au sistème décousu et plein d'horreur que Machiavel a en l'impudence de présenter au Publicq ». En effet, supprimer la connaissance des faits contraires à une thèse est un bon moyen de la défendre. –BAYLE ; Dict. hist., s. r. Machiavel, t. III, note E« (p. 246) Boccalin prétend, que puis qu'on permet, et qu'on recommande la lecture de l'Histoire, on a tort de condamner la lecture de Machiavel. C'est dire que l'on apprend dans l'Histoire les mêmes Maximes que dans le Prince de cet Auteur. On les voit là mises en pratique : elles ne sont ici que conseillées. C'est peut-être sur ce fondement que des personnes d'esprit jugent, qu'il seroit à souhaiter qu'on n'écrivit point d'Histoire (Voiez Mascardi, de Arte Historica) ». En effet, si l'on supprime le terme de comparaison de la réalité avec la théorie, on peut construire celle-ci à volonté. « Prenez garde qu'on accuse notre Florentin de s'être enrichi des dépouilles d'Aristote... Gentillet l'accuse d'être le Plagiaire de Bartole. Je m'étonne qu'on ne dise pas qu'il a dérobé ses Maximes au Docteur Angélique le grand Saint Thomas d'Aquin. Voiez dans les Coups d'Etat de Naudé un long passage du commentaire de Thomas d'Aquin sur le V Livre de la Politique d'Aristote. Mgr Amelot prouve que Machiavel n'est que le Disciple ou l'Interprete de Tacite... ».
[FN: § 1975-2]
Parmi les nombreux passages qui se rapportent à notre cas, rappelons tout d'abord les deux fragments de MACHIAVEL, cités ait §1929. Voir aussi l'ARIOSTE dans le Roland furieux :
IV (1 Quantunque il simular sia le più volte
Ripreso, e dia di mala mente indici,
Si trova pur in molte cose e molte
Aver fatti evidenti benefici
E danni e biasmi e morti aver già tolte ;
Che non conversiam sempre con gli aimici
In questa assai più oscura che serena
Vita mortal, tutta d'invidia piena.
Puis nous avons encore dans MACHIAVEL ; Disc. sur la pr. déc. de T. L., 1. II, c. 13 (Trad. PÉRIÈS) : « Rien à mon avis n'est plus vrai que les hommes s'élèvent rarement d'une basse fortune au premier rang, si cela même est arrivé quelquefois, sans employer la force ou la fourberie, à moins que ce rang, auquel un autre est parvenu, ne leur soit donné ou laissé par héritage. Je ne crois pas que jamais la force seule ait suffi, tandis que la seule fraude a cent fois réussi... Les actions auxquelles les princes sont contraints dans les commencements de leur élévation sont également imposées aux républiques, jusqu'à ce qu'elles soient devenues puissantes et que la force leur suffise : ... On voit donc que les Romains eux-mêmes, dès, les premiers degrés de leur élévation, ne s'abstinrent pas de la fourberie : elle fut toujours indispensable à ceux qui, du plus bas degré, veulent monter au rang le plus élevé ; mais plus cette fraude se dérobe aux regards, comme celle qu'employèrent les Romains, moins elle mérite le blâme ». – Le Prince, c. 15 (trad. PÉRIÈS) : « Mais, dans le dessein que j'ai d'écrire des choses utiles pour celui qui me lira, il m'a paru qu'il valait mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à de vaines spéculations. Bien des gens ont imaginé des républiques et des principautés telles qu'on n'en a jamais vu ni connu. Mais à quoi servent ces imaginations ? Il y a si loin de la manière dont on vit à celle dont on devrait vivre, qu'en n'étudiant que cette dernière on apprend plutôt à se ruiner qu'à se conserver ; et celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants ». À cela l'Anti-Machiavel, loc. cit. §1975 I, répond : « (p. 167) Machiavel avance qu'il n'est pas possible d'être tout à fait bon dans ce monde, aussi scélérat et aussi corrompu que l'est le genre humain, sans que l'on périsse. Et moi je dis, que pour ne point périr il faut être bon et prudent. Les hommes ne sont d'ordinaire ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants [l'auteur ignore ou feint d'ignorer que c'est précisément ce que dit MACHIAVEL ; Discours sur la première décade de Tite-Live, 1. I, c. 27 : « Les hommes savent très rarement être ou tout mauvais ou tout bons »] ; mais et méchants, et bons, et médiocres s'accorderont tous à ménager un Prince puissant, (p. 168) juste et habile. J'aimerais mieux faire la guerre à un Tiran qu'à un bon Roi, à un Louis onze qu'à un Louis douze, à un Domitien qu'à un Trajan ; car le bon Roi sera bien servi, et les sujets du Tiran se joindront à mes troupes... Jamais Roy bon et sage n'a été détrôné en Angleterre par de grandes Armées, et tous les mauvais Rois ont succombé (p. 169) sous des compétiteurs qui n'ont pas commencé la guerre avec quatre mille hommes de troupes réglées. Ne sois donc point méchant avec les méchants, mais sois vertueux et intrépide avec eux, tu rendras ton peuple vertueux comme toy, tes voisins voudront t'imiter et les méchants trembleront ».
[FN: § 1975-2-bis]
Il Principe, c. II : Io lascevô indietro il ragionare delle repubbliche, perchè altre volte ne ragionai a lungo. Volterommi solo ai principale, e anderô ritessendo gli ordini sopra descritti, e disputerô come questi principati si possano, governare e mantenere. « Je ne m'occuperai pas des républiques, parce qu'en d'autres occasions j'en ai parlé longuement. Je tournerai mon attention seulement vers les principautés, et je rappellerai leur manière d'être, et je discuterai comment ces principautés peuvent être gouvernées et conservées ». Il est impossible de s'exprimer plus clairement ; mais cela n'empêche pas les perroquets de répéter indéfiniment que Machiavel est un ennemi de la liberté du peuple, et qu'il donne des préceptes aux despotes pour la détruire. À ce titre, on pourrait dire aussi que les chimistes donnent des préceptes aux empoisonneurs.
[FN: § 1975-3]
En voici quelques-uns. Nous répétons que nous ne discutons pas les affirmations d'Ollivier. Nous les admettons sans autre, afin de les envisager à titre d'hypothèses. E. OLLIVIER ; L'emp. lib., t. V « (p. 61) Napoléon III était revenu d'Italie se croyant obligé à un acte de grande vigueur et d'importance capitale, la réorganisation de son armée. Il y avait urgence à corriger les défectuosités que le prestige de la victoire cachait au public, et qu'il avait en quelque sorte touchées de la main. C'était un rude labeur. Le laisser aller dans la tenue dû aux habitudes africaines était facile à remédier... L'augmentation de l'effectif pour le cas de guerre offrait bien plus de difficultés ». L'auteur explique les tentatives faites en ce sens, et dit qu'on avait songé à une excellente réorganisation de l'armée. « (p. 63) Mais pour opérer cette réforme fondamentale, (p. 64) il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Or le ministre des Finances, la commission du budget, le Corps législatif recommandaient l'économie... Si l'Empereur était venu demander de nouveaux crédits considérables, il y aurait eu un tolle, et non seulement sur les bancs de l'opposition. Il eût retrouvé dans le Corps législatif une résistance aussi acharnée que celle qui commençait en Prusse contre le projet de réorganisation militaire du Régent tendant au même but que celui de Randon [le ministre français qui avait préparé la réorganisation projetée de l'armée]. Il y avait dans les situations cette seule différence qu'en Prusse la résistance disposait de plus de forces qu'en France : il fallait un effort long et puissant, dont le succès était incertain pour venir à bout du soulèvement des députés du Landtag. L'Empereur, au contraire, sans grande peine pouvait mater le mauvais vouloir du Corps législatif : il eût crié, mais fini par voter. Cependant, tandis que le Régent de Prusse se jetait tête baissée, à tout risque dans le combat parlementaire, l'Empereur s'arrêta tout court devant la seule perspective de s'engager. Le pourquoi de cette différence de conduite contient le secret des événements futurs ». Ces événements futurs furent incontestablement favorables à la Prusse, nuisibles au plus haut point à la France. Il est donc évident qu'il eût été avantageux à la France que les rôles fussent intervertis, c'est-à-dire que ses gouvernants eussent agi comme le Régent de Prusse, et les gouvernants prussiens comme l'Empereur des Français. Ollivier nous apprend ensuite quelles furent, selon lui, les causes de cette différence dans la manière d'agir. « (p. 65) Guillaume préparait la guerre qu'il désirait pour établir la suprématie de la Prusse en Allemagne. Napoléon III ne croyait pas qu'une guerre nouvelle lui fût nécessaire pour maintenir en Europe sa suprématie morale [sic], la seule qu'il désirât ». Ce fut vraiment un malheur pour la France que son souverain oubliât à tel point la force pour ne penser qu'à la « morale ». « (p. 65) De quelque côté qu'il regardât, l'Empereur n'entrevoyait pas de cause de guerre... (p. 66) L'Allemagne était malveillante mais impuissante [bel homme d'État, qui ne sait pas qu'il faut se fier, non à la faiblesse présumée de ses ennemis, mais à sa propre force !] Lui seul pouvait créer une cause de guerre en essayant de prendre la Belgique ou le Rhin. S'il avait nourri cette arrière-pensée, il eût certainement bravé les résistances du Corps législatif à une réorganisation dispendieuse de l'armée. Mais moins que jamais il pensait à des agrandissements ou à des agressions [mais d'autres y pensaient, et n'en pas tenir compte peut être très moral, mais est aussi très imprévoyant]. Il exprimait le fond même de sa pensée dans son discours au Corps législatif : „ Je veux sincèrement la paix et ne négligerai rien pour la maintenir “ ». Quel dommage qu'un député ne l'ait pas alors interrompu en lui criant : Si vis pacem, para bellum ! Dans son exposé, Ollivier se montre homme privé excellent et homme d'État détestable. Ses affirmations font la louange du premier et condamnent le second (§2376. Ce n'est pas tout. Voici l'expédition du Mexique. Ollivier lave l'empereur de l'accusation d'avoir décidé l'expédition pour des motifs financiers, et il ajoute « (p. 257) Aucun motif ambitieux non plus » Pas même l'influence de l'impératrice ; « (p. 257) L'influence de l'Impératrice a été, plus spécieusement alléguée... (p. 258) Son imagination tournée au chevaleresque s'enflamma à ces perspectives de gloire et d'honneur ; elle employa sa force d'éloquence et de séduction à convaincre l'Empereur. Celui ci, d'autant plus accessible à son ascendant qu'il avait des torts intimes à se faire pardonner [ce remords est louable ; ce qui l'est moins, c'est de faire payer le rachat de ses fautes à son pays. Henri IV aimait aussi les femmes, mais cela ne l'empêchait pas d'être un bon politique et un bon général], ne le subissait toutefois pas aveuglement, pas plus que celui de qui que ce soit ». Mais voici enfin, suivant Ollivier, le pourquoi de l'expédition. « (p. 258) Son véritable motif est autre, Inconsolable de n'avoir pas réalisé son programme „ des Alpes à l'Adriatique “ et de n'avoir pas effacé de l'histoire de sa race la tache de Campo-Formio [quelle conscience timorée ! Il ne lui suffit pas d'avoir du remords à cause de ses propres fautes ; il en a aussi à cause des fautes de ses ancêtres, et en fait pénitence, ou plutôt non, il en fait faire pénitence au pays sur lequel il règne], résolu cependant à ne plus (p. 259) redescendre en Italie, il était en quête de moyens pour obtenir ce qu'il ne songeait plus à arracher [quel homme bon et doux, mais quel imbécile !]. Il avait proposé au cabinet anglais de conseiller de concert avec lui la vente de la Vénétie... Dans l'octroi d'un trône à l'archiduc Maximilien, Napoléon III entrevit un acheminement inattendu à l'affranchissement de la province captive. Il espéra que, satisfait du don qu'il offrait à sa famille, François-Joseph consentirait peut-être plus tard à lâcher la Vénétie en échange d'un agrandissement sur le Danube. „ Le spectre de Venise erre dans la salle des Tuileries “, écrivait Nigra à Ricasoli. „ C'est ce spectre qui a pris la main de Napoléon III et lui a fait signer (p. 260) l'ordre de renverser Juarez pour faire place à l'archiduc autrichien “ ». Ce spectre doit lui avoir dit : „ Au revoir à Philippe “, c'est-à-dire à Sedan. Bismarck connaissait l'art très profitable, pour les peuples qu'il gouvernait, de conjurer ces sortes de spectres. Cela ne suffit pas encore. Survient la guerre de 1866, et Napoléon III y reste neutre ; de la sorte il laisse la puissance prussienne devenir formidable. Il avait oublié l'avertissement donné par MACHIAVEL ; Discours sur la première décade de Tite-Live, c. 22 (trad. PÉRIÈS) : « Cependant le pape [Léon X] ne voulut point se rendre aux désirs du roi ; mais ses conseillers lui persuadèrent, à ce qu'on dit, de demeurer neutre, et lui firent voir que ce parti seul promettait la victoire, parce qu'il était de l'intérêt de l'Église de n'avoir pour maître en Italie ni le roi ni les Suisses ; mais que, s'il voulait rendre à cette contrée son antique liberté, il était nécessaire de la délivrer et de l'un et de l'autre... Il était impossible de trouver une occasion plus favorable que celle qui se présentait : les deux rivaux étaient en campagne ; le pape, avec son armée, se trouvait en mesure de se transporter sur les frontières de la Lombardie, ... il y avait lieu de croire que cette bataille serait sanglante pour chacun, et laisserait le vainqueur tellement affaibli, qu'il serait aisé au pape de l'attaquer et de le battre. Ainsi, le pape devait demeurer glorieusement le maître de la Lombardie et l'arbitre de toute 1'Italie. L'événement fit voir combien cette opinion était erronée. Les Suisses furent défaits après une bataille opiniâtre, et les troupes du pape ni celles d'Espagne n'osèrent assaillir le vainqueur : loin de là, elles se disposèrent à la fuite... » (§2389). À propos des événements de 1866, Ollivier a quelque lueur de la réalité ; il écrit, t. VIII « (p. 189) Après la déconvenue qui avait succédé au programme retentissant de la guerre d'Italie, il semblait au moins imprudent de régler aussi bruyamment d'avance les résultats d'une guerre à laquelle on ne participerait pas ». Mais aussitôt il retombe dans la nuit et se remet à rêver. Il cite un de ses articles où il expose des conceptions qu'il conserva toujours dans la suite. « (p. 189) Le droit est manifeste. En Italie, il est avec l'armée qui s'avance pour délivrer Venise. En Allemagne, il est avec l'armée qui, guidée par l'Autriche, s'avance pour protéger Francfort et délivrer Dresde. Le Droit ne nous permet pas de mettre la main sur les provinces rhénanes ; il interdit à la Prusse de s'emparer du Hanovre, de la Hesse et des Duchés, et à l'Autriche de garder Venise ». Que de contrées où ce vénérable Droit se promenait ! Mais il disparut ensuite, quand tonna le canon de Sedan, de Metz et de Paris ; et comme personne ne s'était soucié de ses « interdictions » au sujet du Hanovre et d'autres pays, il laissa se consommer sans autre l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à ajouter ici ; mais cette note est déjà trop longue, et il convient d'y mettre un terme. Plus loin (§2374 et sv.), nous retrouverons les faits mentionnés ici, et nous les étudierons sous un autre aspect.
[FN: § 1975-4]
Le même Ollivier montre qu'en un grand nombre d’occasions l'empereur fut dépourvu de toute prévoyance. E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. V : « (p. 67) Tenant néanmoins à réaliser cette décentralisation militaire qui hantait sa pensée depuis la guerre de Crimée, et qui seule pouvait amener le passage rapide du pied de paix au pied de guerre, Napoléon III prescrivit à Randon de l'opérer sans aucune augmentation de crédit et, comme dans ces termes c'était impossible, c'était en réalité y renoncer. Et, en effet, à partir de ce moment ni empereur ni ministre ne s'en occupèrent plus ». C'est le fait d'un homme privé de bon sens d'estimer une chose indispensable, et de prescrire de l'exécuter dans des conditions que l'on sait être impossibles. Pourtant Napoléon III était un homme intelligent ; mais s'il voyait son avantage, il agissait en sens contraire, mû par les sentiments existant chez lui, et qui correspondaient aux résidus de la IIe classe (§2370-1].
[FN: § 1976-1]
PIEPENBRING ; Théol. de l'anc. Test. Suite de la citation faite au §1944 1 « (p. 208) Pendant longtemps, ces conceptions semblent n'avoir soulevé aucune objection sérieuse ; car on n'en rencontre pas dans les plus anciens documents. Mais, à mesure qu'on observait mieux les événements de la vie individuelle et de l'histoire et qu'on y réfléchissait davantage [c'est moins l'observation des faits que la réflexion, qui faisait défaut ; l'auteur ne devrait pas employer le pronom indéfini on : ceux qui réfléchissaient et ceux qui ne réfléchissaient pas étaient différents], on s'apercevait que l'expérience démentait à chaque instant cette théorie de la rémunération, que beaucoup de méchants étaient heureux et beaucoup de justes malheureux. De là un grand embarras pour celui qui ne fermait pas les yeux à l'évidence [voilà la distinction qu'il faut faire], un piège qui pouvait faire broncher les (p. 209) croyants et les jeter dans le doute. Cette difficulté se faisait surtout sentir à partir de l'exil. Aussi fit-on dès lors les efforts les plus sérieux pour la surmonter ». Voir la suite de la citation dans la note 1979 1. Après avoir cité de nombreux exemples, CIC., De nat. deor., III, 32, 81, ajoute : Dies deficiat, si velim numerare quibus bonis male evenerit : nec minus, si commemorem, quibus improbis optime. Dans son traité Sur la vengeance tardive de la divinité, PLUTARQUE accumule des dérivations pour montrer que l'œuvre de la divinité est toujours juste, et il n'oublie pas (IV, p. 549-550) cette échappatoire : que les voies de Dieu sont insondables (B 4).
[FN: § 1979-1]
PIEPENBRING ; Théol. de l'anc. Test. Suite de la citation de la note 1976 1 : « (p. 209) Peut-être que plus anciennement déjà on avait entrevu la difficulté et qu'on cherchait à la lever en disant que Dieu punit les fautes des pères sur les enfants et qu'il récompense les enfants pour la fidélité des ancêtres ». Remarquons la tentative de justification qui suit : « Il faut dire que ce principe est en partie fondé sur la loi de la solidarité et de l'hérédité, constatée par l'expérience de chaque jour : les enfants pâtissent souvent des fautes de leurs parents ou benéficient de leurs vertus ». Piepenbring ne s'aperçoit pas que ce qu'il démontre n'est pas du tout ce qu'il voudrait démontrer. Il démontre qu'il existe un rapport entre l'état de l'enfant et les actes du père, tandis qu'il voudrait démontrer que ce rapport est d'un certain genre déterminé. Nous pouvons admettre que les vices et les vertus des pères ont des conséquences pour les enfants, mais il n'est nullement, vrai que les vices des pères aient toujours des conséquences fâcheuses pour leurs enfants. Par exemple, un père usurier ou délinquant peut laisser son enfant dans la richesse. Il n'est pas vrai non plus que les vertus des pères aient des conséquences heureuses pour leurs enfants. Par exemple, un père bienveillant, qui se sacrifie pour le bien d'autrui, peut laisser son enfant dans la misère. Pour démontrer que les fautes des pères sont punies sur les enfants, les vertus récompensées de même, il faudrait exclure ces derniers cas, ce dont notre auteur n’a cure. Il donne ainsi un nouvel exemple du défaut de logique en ces matières. Il continue : « p. 209) Mais ce principe, relativement ancien, soulevait lui aussi des objections et donnait lieu au proverbe sarcastique, „ les pères ont mangé du verjus et les dents des fils ont été agacées “ (Jér., 31, 29 ; Ez., 18, 2). On lui opposait la pensée que chacun portait la peine de son propre péché (Jér., 31, 29 ; Ez., 18, 2 ss). C'était maintenir le point de vue traditionnel et écarter une explication qui atténuait au moins la difficulté qu'il soulève. Mais comment dès lors résoudre cette difficulté ? On faisait entendre que l'homme n'a pas le droit de contester avec Dieu, la créature avec le créateur, l'ouvrage avec celui qui l'a fait (Es., 29, 16 ; 45, 9 s. Jér., 18, 6) [B 4] ; on déclarait que loin d'être juste, l'homme est en réalité coupable (Ez., 18, 29 ss. ; 33, 17 ss. ; Es., 58, 3 ss.) [A] ; ou bien on soutenait que le bonheur des méchants n'est que passager et aboutit toujours à une fin (p. 210) malheureuse, tandis que l'infortune des justes ne peut être que momentanée (Ps., 73, 16-24 ; 9, 18 s. ; 37 ; 49, 55, 23 s. ; 64 ; 94, 8-23 ; Prov., 23, 17 s.) [B 2] ; dans quelques passages, on s'élevait [on remarquera cette considération éthique : on s'élevait, étrangère au domaine expérimental] même à l'idée que le malheur a un effet salutaire pour l'homme, comme la correction est salutaire pour l'enfant (Prov., 3, 11, s. ; Deut., 8, 2-5 ; Lam., 2, 27-30) [B 2] ; dans le second Esaïe, enfin, se trouve la pensée que les justes peuvent être appelés à souffrir pour les coupables et à leur épargner ainsi les châtiments mérités Es., 53) [B 2]... Le problème dont nous parlons préoccupait et embarrassait tellement les penseurs israélites que l'un d'eux sentit le besoin de le traiter à fond et d'en faire le sujet de tout un livre, celui de Job [B 4] ». Dans une si grande diversité de dérivations, on voit un cas de la recherche d'une voie permettant d'arriver à un point préventivement fixé (§1414, 1628).
[FN: § 1980-1]
HÉROD. ; I, 91.
[FN: § 1980-2]
VAL. MAX. ; I, I, Externa exempla, 3. – HORAT., Carm., I, 28, fait parler un mort nommé Archytas, qui demande à un marin de recouvrir ses restes d'un peu de sable, et lui dit que s'il refuse, il laissera à ses enfants un crime à expier :
(30)Negligis immeritis nocituram Postmodo te natis fraudem committere forsan.
Note de Pseudacron : Fraudem committere. Seu studio commercandi fraudem, quae redundet in posteros, capiat, seu certe inhumanitatis piaculum eius filios laedat, aut, ne longum putaret, etiam ipsum delicti subiturum poenas minatur. Un autre scoliaste, Porphyrion, dit : Neglegis immeritis nocituram. Ordo est : neglegis fraudem committere. Sensus autem est : neglegis me et fraudem in me committere facile esse putas : atqui haec expetet in eos, qui ex te nati sunt, id est in filios tuos. Il n'y aucun doute sur le fait que le châtiment peut frapper les enfants.
[FN: § 1980-3]
SENEC. ; Cons. ad Marc., 12 : A felicissimo incipiam. L. Sulla filium amisit, nec ea res aut militiam eius, et acerrimam virtutem in hostes civesque contudit, aut effecit, ut cognomen illud usurpasse salvo videretur, quod amisso filio assumpsit : nec odia hominum veritus, quorum malis illius nimis secundae res constabant nec invidiam deorum, quorum illud crimen erat, Sulla tam felix. – PLIN. : Nat. hist., VII. 44 : Unus hominum ad hoc, aevi, Felicis sibi cognomen asseruit L. Sulla, civili nempe sanguine, ac patriae oppugnatione adoptatum. Pourtant Pline ajoute qu'il mourut malheureux, à cause de la haine de ses concitoyens et des souffrances de sa dernière maladie. – DURUY tourne autour du pot, Hist. des Rom., II : « (p. 712) Dans les affaires humaines, la justice saute parfois une génération [voilà une belle uniformité, que l'auteur oublie de prouver]. C'est trente ans plus tard [après la mort de Sulla, à Pharsale, que la noblesse expia les proscriptions de Sylla ». Ces déclamations éthiques continuent à porter le nom d'histoire. Duruy se préoccupe aussi des remords que Sulla aurait du avoir, mais que, paraît-il, il n'eut pas. Duruy observe que pour les Romains le succès justifiait tout, et il ajoute : « (p. 715) Voilà pourquoi le terrible dictateur mourait sans remords ; il en sera ainsi de tous ceux qui, entre leur conscience et leurs actes, mettront un faux principe ». La conséquence, – que certes Duruy ne veut pas tirer – serait que pour être heureux, il est avantageux d'avoir de «faux principe ». Mais le problème à résoudre n'est pas de savoir si l’homme est heureux grâce a de « faux principes », mais bien de savoir si, nonobstant ses mauvaises actions, il peut être heureux, laissant payer le prix de ses fautes à d'autres personnes de sa famille, de sa caste, de sa nation, peut être même à l'humanité entière.
[FN: § 1980-4]
PLIN. ; Nat. Hist., XXXIII, 24.
[FN: § 1980-5]
HEROD. ; I, 91. LARCHER met en note à sa traduction de ce passage l'observation de Cicéron (De nat. deor., III, 38) : Dicitis eam vim Deorum esse, ut etiam si quis morte poenas sceleris effugerit, expetanLur eae poenae a liberis, a nepotibus, a posteris. O miram acquitatem Deorum ! ferretne civitas ulla latorem istiusmodi legis, ut condemnaretur filius autnepossipaterautavusdeliquisset ? Larcher ajoute : « Le philosophe Bion (PLUTARCH. ; De sera num. vind.) avait mieux aimé tourner cela en ridicule : „ Le dieu, dit-il, qui puniroit les enfans pour les crimes de leur père, seroit plus ridicule qu'un médecin qui donneroit un remède à quelqu'un pour la maladie de son père ou de son grand-père.“ On n'avait pas encore du temps de notre Historien, des idées saines de la divinité. On n'en trouve que chez les Juifs ». Il cite Deut., XXIV, 16 ; Ezech., XVIII, 20, mais oublie un grand nombre d'autres passages en sens contraire ; par exemple : Exod., XX. 5 : « ...car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent... » Voilà un nouvel exemple de la façon dont un sentiment prédominant induit en erreur les auteurs. Larcher connaissait certainement ce passage et d’autres semblables de la Bible, mais, égaré par le sentiment, il les néglige.
[FN: § 1980-6]
SOLON ; XIII (IV), 27-32 : « Celui qui a un cœur malfaisant ne demeure pas indéfiniment caché : enfin il se découvre. L'un subit le châtiment mérité plus tôt, l'autre plus tard. Si quelques-uns paraissent échapper et n'être pas atteints par le destin imminent des dieux, ils en sont finalement frappés. Ce sont leurs enfants innocents, ou plus tard leurs petits-enfants, qui paient le tribut de leurs actions.
[FN: § 1982-1]
PLUTARCH. ; De sera numinis vindicta, XV et XVI, p. 559.
[FN: § 1983-1]
GLOTZ : La solidar. de la fam.en Grèce : « (p. 563) Qu'une ville soit châtiée sans retard pour la faute d'un citoyen ou d'un roi, cela n'est que juste et se conçoit aisément. L'État, responsable devant les dieux, n'avait qu'à se libérer (p. 564) par une mesure de salut public, un abandon noxal par la mort ou l'exil ».
[FN: § 1983-2]
II., I, 117 :
Dugas-Montbel note, à propos de ce vers : « (p. 23) Zénodote supprimait ce vers comme n'exprimant qu'une idée trop commune ; mais, en la liant avec ce qui précède, cette pensée est relevée par le sacrifice que fait Agamemnon, puisqu'il ne consent à renvoyer sa captive qu'en faveur de son peuple. Je ne crois point qu'on doive souscrire à la critique de Zénodote, qui n'est admise par aucun des éditeurs modernes ». Ces considérations d'idées trop communes ou d'idées élevées sont étrangères aux temps homériques. Agamemnon ne pouvait pas parler autrement : il dit pourquoi il fait ce que personne ne pouvait l'obliger à faire.
[FN: § 1983-3]
SOPH. ; Oed. rex, 96-98 : « Le roi Phoibos nous ordonne de repousser et de ne pas conserver, tant qu'elle est inexpiable, une souillure ![]() que cette terre recèle ».
que cette terre recèle ».
[FN: § 1984-1]
HES. ; Op. et dies :
(260)
Un auteur, Élie Reclus, qui ne comprend pas grand'chose à l'antiquité, s'imagine que le roi grec était comme le roi nègre, qui, par des opérations magiques, procure à ses sujets la pluie et toutes sortes de biens. Il dit : « (p. 271) Les hommes ne demanderaient [selon certains auteurs anciens] qu'à se vautrer dans les excès et à rouler dans le crime, n'étaient les monarques pour réprimer cupidités et violences, pour imposer aux nations le frein des lois. Dans ces conceptions-là, il n'est pas toujours facile de distinguer entre le dieu qui délègue ses pouvoirs à l'homme, et l'homme qui reçoit du dieu ses pouvoirs. Voilà pourquoi la doctrine indoue enseignait qu'Indra ne pleut point dans un royaume qui a perdu son roi. Ulysse, le prudent Ulysse, expliquait à la sage Pénélope : „ Sous un prince vertueux, la terre porte orge et froment en abondance, les arbres se chargent de fruits, les brebis ont plusieurs portées, et la mer s'emplit de poissons. Un bon dirigeant nous vaut tout (p. 272) cela (Odyssée, XIX, 108) “ ». (Les Primitifs). Si notre auteur avait regardé, ou compris, le texte qu'il cite, il aurait vu qu'il ne dit pas « un bon dirigeant nous vaut tout cela », mais qu'il attribue pour origine à ces biens : ![]()
![]() ce qui veut dire incontestablement : « grâce à un bon gouvernement ». D'abord le texte explique que ce roi « gouverne avec justice » :
ce qui veut dire incontestablement : « grâce à un bon gouvernement ». D'abord le texte explique que ce roi « gouverne avec justice » : ![]() ; et c'est pourquoi «les peuples prospèrent sous lui » :
; et c'est pourquoi «les peuples prospèrent sous lui » : ![]() .
.
[FN: § 1985-1]
CIC. ; De nat. deor., III, 37 : Ideinque [Diagoras], cum ei naviganti vectores adversa tempestate timidi et perterriti dicerent, non iniuria sibi illud accidere, qui illum in eamdem navem recepissent : ostendit eis in eodem cursu multas alias laborantes ; quaesivitque, num etiam iis navibus Diagoram vehi crederent. – HORAT. ; Carm., III, 2 :
(29)……… Saepe Diespiter
Neglectus, incesto addidit integrum
Baro antecedentem scelestum
Deseruit pede Poena claudo.
[FN: § 1986-1]
PLUTARCH. ; De Herodot. malign., XV, p. 858.
[FN: § 1986-2]
PLUTARCH ; Aemilius Paulus (Trad. TALBOT). Plutarque rapporte que Paul-Émile parlant au peuple romain après avoir exposé comment la fortune leur avait été extrêmement favorable, à lui et à l'armée, dans la guerre contre Persée, et jusqu'à leur retour dans leur patrie, il ajouta : « (36) J'arrive cependant sain et sauf parmi vous, je vois la ville remplie de joie, de fêtes et de sacrifices ; mais je n'en soupçonne pas moins la fortune, sachant qu'elle n'accorde aux hommes aucune grande faveur qui soit sincère et sans arrière-pensée. Mon âme n'a donc été délivrée de cette crainte, qui la faisait souffrir et envisager avec terreur l'avenir de Rome, que quand ce coup de foudre est venu frapper ma maison, lorsque deux fils, ma plus belle espérance, que je m'étais gardés pour uniques héritiers, ont été, l'un après l'autre, ensevelis de mes mains durant ces jours sacrés ».
[FN: § 1987-1]
Comme d'habitude (§587), par les dérivations, on prouve également bien le pour et le contre. Chez PLUTARQUE, De se num. vind., XVI, p. 559, les vices du père nuisent au fils dont ils justifient la punition, parce que – dit l'auteur – les fils héritent plus ou moins du tempérament du père. Chez les humanitaires modernes, les vices du père profitent au fils : ils lui procurent, s'il a commis un crime, une diminution de peine ou le complet acquittement, parce que – disent les humanitaires – ces vices diminuent la « responsabilité » du fils.
[FN: § 1987-2]
Le cas classique est celui de l'affamé qui dérobe un pain. On comprend qu'on l'acquitte, mais on comprend moins bien pourquoi la dette de la « société », qui a le devoir de ne pas laisser mourir de faim ce malheureux, doit être payée par un boulanger pris au hasard, et non par la société entière. La solution logique semblerait devoir être que l'affamé soit acquitté, et que la société paye le pain dérobé au boulanger. Il est arrivé parfois qu'une femme ait tiré sur son amant, lequel n'a pas été atteint, tandis qu'un tiers, totalement étranger à ce conflit, était frappé : et la femme a été acquittée par des jurés pitoyables. Admettons qu'on la juge excusable parce qu'elle aurait été poussée au crime par les mauvaises actions de son amant. Mais pourquoi le tribut de ces mauvaises actions doit il être payé par un tiers tout à fait innocent ? Afin de satisfaire des sentiments de pitié absurdes, des législateurs humanitaires approuvent la « loi du pardon », grâce à laquelle celui qui a commis un premier vol est aussitôt mis en mesure d'en commettre un second. Pourquoi ce luxe de pitié humanitaire doit-il être payé précisément par la malheureuse victime du second vol, et non par la société entière ? D'une manière générale, à supposer que le crime soit le fait de la société plus que du criminel, comme le prétendent certaines personnes, il est compréhensible qu'on en tire pour conséquence l'acquittement du criminel, ou sa condamnation à une peine très légère ; mais le même raisonnement a aussi pour conséquence que la victime du crime doit être dédommagée, dans les limites du possible, par la société. Au contraire, on ne songe qu'au criminel, et personne ne se soucie de la victime du crime.
[FN: § 1991-1]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés, t. III : « (p. 122) Si un homme est infirme de naissance, quoiqu'il n'ait pas encore péché, ils disent que cela est l'effet de la sagesse divine et qu’il vaut mieux pour cet individu d'être ainsi fait plutôt que d'être bien constitué [B 2, §1968]. Nous ignorons en quoi consiste ce bienfait [B 4], quoique cela lui soit arrivé, non pas pour le punir, mais pour lui faire le bien [B 2]. Ils répondent de même, lorsque l'homme vertueux périt, que c'est afin que sa récompense soit d'autant plus grande dans l'autre monde [B 3]. Ils sont même allés plus loin : quand on leur a demandé pourquoi Dieu est juste envers l'homme sans l'être aussi envers d'autres créatures, et pour quel péché tel animal est égorgé, ils ont eu recours à cette réponse absurde, (p. 123) que cela vaut mieux pour lui (l'animal), afin que Dieu le récompense dans une autre vie [B 3]. Oui (disent-ils), même la puce et le pou qui ont été tués doivent trouver pour cela une récompense auprès de Dieu, et de même, si cette souris qui est innocente, a été déchirée par un chat ou par un milan, c'est la sagesse divine, disent-ils, qui a exigé qu'il en fût ainsi de cette souris, et Dieu la récompensera dans une autre vie pour ce qui lui est arrivé » (§ 1934-1).
[FN: § 1993-1]
ETIENNE DE BOURBON ; A necd. hist., §396, p. 346-349. L'éditeur (A. LECOY DE LA MARCHE) note : « (p. 349) Une variante de cet apologue célèbre a été publiée par Thomas Wright d'après des manuscrits anglais (Latin stories, etc., n. 7. On le retrouve encore dans les Gesta Romanorum, recueil du XIVe siècle (chap. 80), dans les Fabliaux et contes édités par Méon (II, 216), dans les sermons d'Albert de Padoue, orateur du XIVe, siècle, dans les poésies anglaises de Thomas Parnell, et dans le Magnum speculum exemplorum, édité à Douai en 1605 (I, 152). Il a fourni le sujet d'un épisode de Zadig, conte de Voltaire, qui a remplacé l'ange par un hermite. M. Victor Le Clerc croit pouvoir en rattacher l'origine aux anciennes vies des Pères du désert (Hist. litt., XXIII, 128 et av.) : Il paraît en effet venu de l'Orient, car on le rencontre dans plusieurs recueils orientaux, et jusque dans le Koran (XVII, I, 64). V. aussi Luzel, Légendes chrétiennes de la Bretagne (Saint-Brieuc, 1874), p. 14 ».
[FN: § 1995-1]
DANTE ; Parad., XIX :
(79)Or tu chi se', che vuoi sedere a scranna
Per giudicar da lungi mille miglia,
Con la veduta corta d'una spanna ?
[FN: § 1995-2]
MAÏMONIDE ; Le guide des égarés. trad. S. MUNK, IIIe partie, C. XVII, t. III : « (p. 121) Les gens de cette secte [la secte musulmane des Ascharites] prétendent qu'il a plu à Dieu d'envoyer des prophètes, d'ordonner, de défendre, d'inspirer la terreur, de faire espérer ou craindre, quoique nous n'ayons aucun pouvoir d'agir ; il peut donc nous imposer même des choses impossibles, et il se peut que, tout en obéissant au commandement, nous soyons punis, ou que, tout en désobéissant, nous soyons récompensés. Enfin, il s'ensuit de cette opinion que les actions de Dieu n'ont pas de but final. Ils supportent le fardeau de toutes ces absurdités pour sauvegarder cette opinion, et ils vont jusqu'à soutenir que, si nous voyons un individu né aveugle ou lépreux, à qui nous ne pouvons attribuer aucun péché antérieur par lequel il ait pu mériter cela, nous devons dire : „ Dieu l'a voulu ainsi “, et il n'y a en cela aucune injustice ; car, selon eux, il est permis à Dieu d'infliger des peines à celui qui n'a point péché et de faire du bien au pécheur ».
[FN: § 1995-3]
Dans toutes les œuvres de Saint Augustin, c'est un perpétuel louvoiement entre l'affirmation que les voies du Seigneur sont insondables, et la prétention de les connaître. D. AUG. ; Contra adversarium legis et profetarum, I, 21, 45 : Apostolus clamat (Rom. XI, 33-34) O altitude divitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam inscrutabilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius. Quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius eins fuit ? De civ. dei, XX, 2. Tout le chapitre expose que les voies du Seigneur sont insondables. Le saint commence par observer que les bons comme les méchants participent aux biens terrestres. Il ajoute que « nous ignorons vraiment par quel jugement de Dieu ce bon-ci est pauvre, et ce méchant-là est riche, celui-ci est heureux, alors qu'il nous semblerait devoir être tourmenté, à cause de ses mœurs débauchées, celui-là est affligé, alors qu'il semblerait devoir être heureux à cause de sa vie louable... » Il continue en citant un grand nombre d'autres cas semblables. Il dit que si cela arrivait toujours, et que tous les méchants fussent heureux, et tous les bons malheureux, on pourrait supposer que la cause en est un juste jugement de Dieu, qui compense les biens et les maux terrestres par les biens et les maux éternels ; mais comme il arrive aussi que les bons ont des biens terrestres, et les méchants des maux, « les jugements de Dieu sont plus inscrutables encore, et ses voies plus insondables ». Cela dit, ce devrait être suffisant, et le saint ne devrait plus chercher à connaître les desseins de Dieu. Au contraire, dans tout l'ouvrage, il les scrute et les sonde, comme s'il pouvait les connaître. Déjà à la fin du chapitre cité, il fait sienne l'une des solutions (B 3), et dit qu'au jour du jugement dernier, nous reconnaîtrons combien justes sont les jugements de Dieu, même ceux dont la justice nous échappe aujourd'hui. – Remarquables sont les efforts de Saint Augustin pour trouver des justifications au fait que les invasions barbares avaient frappé les bons comme les méchants. D'abord il recourt à l'une des solutions (B 2) ; il dit (I, 1) que les maux « sont attribuables à la divine Providence, qui corrige et réprime habituellement par la guerre les mœurs corrompues des hommes ». Aussitôt après, il ajoute une autre solution (B 3), en disant que la Providence afflige parfois les justes, afin de les faire passer dans un monde meilleur, ou bien afin de les faire demeurer sur la terre et de les garder pour un autre usage. (B 4). Il expose longuement que les temples païens ne sauvèrent pas leurs fidèles, tandis qu'au contraire les temples chrétiens sauvèrent les leurs. Ainsi nous sortons complètement des rapports entre les bonnes ou les mauvaises actions et les récompenses ou les châtiments : les temples semblent produire un effet par leur vertu propre, comme le feraient des paratonnerres, dont les uns ne sont pas et les autres sont efficaces. Ensuite il revient au problème difficile des biens aux méchants et des maux aux bons, et il dit : « (I, 8) Il plut à la divine Providence de préparer dans l'avenir aux bons des biens dont ne jouiront pas les impies, et aux impies des maux dont les justes seront exempts (B 3). Il n'abandonne pas entièrement les solutions (B 1), et dit qu'enfin les bons ne sont pas exempts de tout péché : « Ils sont frappés avec les méchants, non parce qu'ils mènent également une mauvaise vie, mais parce qu'ils aiment également la vie temporelle ». Il montre, en outre, (I, 10) que les saints ne perdent rien à perdre les biens temporels (A 1), et que les bons chrétiens ne peuvent se plaindre de cette perte, sans manifester la tendance au péché. Les païens observaient que même des femmes consacrées à Dieu avaient été violées par les barbares. Le saint en traite longuement, louvoyant, comme d'habitude, entre les différentes solutions de notre problème.
Il distingue (I, 26) entre la virginité matérielle et la virginité spirituelle (A 1). La première seule a pu être affectée par les barbares ; la seconde non. Saint Augustin se demande (I, 28) pourquoi Dieu a permis un tel outrage des saintes femmes. Il commence par une solution (B 4), et dit que les « jugements de Dieu sont inscrutables, et ses voies insondables ». Cela ne l'empêche d'ailleurs nullement de scruter et de sonder. En cherchant, il trouve aussitôt une solution (B 1). Il demande aux saintes femmes si elles n'ont pas péché par orgueil de leur virginité. Verumtamen interrogate fideliter animas vestras, ne forte de isto integritatis et continentiae vel pudicitiae bono vos inflatius extulistis, et humanis laudibus delectatae in hoc etiam aliquibus invidistis. Ensuite, que celles qui n'ont pas péché considèrent que parfois Dieu permet le mal pour le punir au jour du jugement universel (B 3). Mais peut-être n'est-il pas entièrement persuadé par cette réponse, car il revient à l'une des solutions (B 1), et dit que peut-être les femmes qui se glorifiaient de leur chasteté ont eu quelque faiblesse secrète dont aurait pu naître de la vaine gloire, si, dans les calamités, elles avaient échappé à l'humiliation qu'elles éprouvèrent. En louvoyant ainsi entre diverses solutions, sans jamais trouver moyen de s'attacher à quelque notion, si peu précise soit-elle, Saint Augustin nous présente un modèle dont nous trouvons une infinité de copies, jusqu'à notre temps. D'autres copies ne feront certainement pas défaut à l’avenir. – Nous avons donné (§1951) une citation d'E. OLLIVIER, qui veut que tôt ou tard l'ingratitude soit punie. Cette théorie est claire et précise : tu ne dois pas être ingrat, parce que tu seras puni. Si, nonobstant l'ingratitude, tu as aujourd'hui du succès, ne t'y fie pas ; Dieu – ou quelque entité métaphysique – te l'accorde pour te punir demain. Nous avons ainsi une solution du genre (B 2). À part les différences existant entre celui qui est récompensé pour ses propres actions, et celui qui est puni pour les actions d'autrui (§1975), cette solution a le mérite de justifier des divergences éventuelles entre les bonnes actions et la réalisation du bonheur. Mais plus tard, l'auteur change de solution. Il dit, t. III : « (p. 590) De même que le mai est quelquefois couronné d'un succès insultant à la justice, parfois aussi le bien ne conduit qu'aux revers immérités. Il y a là une prédestination providentielle dont le motif se dérobe à notre raison ». C'est là une solution du genre (B 4). Donc, lorsque cela lui convient, l'auteur connaît les desseins de la Providence, et sait qu'elle punit toujours tôt on tard. Quand cela lui convient autrement, il dit ignorer les desseins de la Providence. S'il les ignore, comment sait-il qu'elle punira dans l'avenir ? S'il sait qu'elle punira, pourquoi dit-il qu'il ignore ses desseins ?
[FN: § 1999-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Ainsi de LA ROCHEFOUCAULD, dont l'éthique paraît se résumer en cette parole bien connue de ses Réflexions ou Sentences et Maximes morales : « Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés ».
[FN: § 2002-1]
XENOPH. ; Mem., I, 1, 11.
[FN: § 2004-1]
Aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, on voyait partout l'influence de Satan. S'il grêlait, si un être humain ou un animal tombaient malades, ou, qui pis est, mouraient en des circonstances réputées étranges, quelque sorcière ou quelque sorcier ne devait pas y être étranger. Celui qui avait chez lui un chien ou un chat noir était l'hôte du diable. Si par malheur il avait un crapaud, on ne pouvait émettre aucun doute raisonnable sur ses pratiques magiques. Aujourd'hui, on entend encore des sornettes de ce genre. Après le procès Eulenbourg, en Allemagne, si deux hommes se promenaient ensemble, on les soupçonnait d'avoir des relations illicites. En Italie, après le procès Paternô, tout homme qui faisait la cour à une dame risquait de passer pour un exploiteur de femme, Un procès qui eut lieu à Milan, en 1913, nous fait voir des officiers qui, sous l'empire de cette idée, accusaient un de leurs camarades de faits dont le procès démontra l'inanité absolue. S'ils avaient vécu au XVIe siècle, ils l'auraient accusé, avec une conviction et une raison égales, d'avoir reçu de l'argent de Satan. Un suicide qui s'est produit en août 1913 a donné lieu à des considérations du Giornale d'Italia, qui montrent assez bien les fluctuations de l'opinion publique. Nous les reproduisons ici en supprimant, comme d'habitude, les noms, parce que nous voulons considérer uniquement les faits à un point de vue abstrait. – Giornale d’Italia, 27 août 1913 : « Ce ne fut pas un suicide passionnel... Ce qui est arrivé à cette occasion mérite vraiment l'attention de ceux qui étudient la psychologie des foules. Au début, tout le monde fut pris d'une pitié profonde, autant envers la femme qui avait ainsi brisé tragiquement son existence, qu'envers l'homme qui restait pour la pleurer. Le drame intime exhalait un parfum de poésie qui excitait l'âme sensible du public, et suscitait son émotivité. Puis, le bruit courut que X [le dernier amant] s'était montré indifférent au départ violent de l'objet aimé, et un véritable revirement se manifesta dans l'opinion publique : toutes les sympathies se concentrèrent sur la femme, tous les soupçons tombèrent sur le jeune homme. On commença à se demander pourquoi Z [la femme qui s'était suicidée] s'était donne la mort, et l'on en accusa X qui, par sa cruelle indifférence, l'aurait poussée au suicide, peut-être pour se débarrasser d'elle. Puis on alla plus loin, et l'on insinua, fût-ce sous une forme voilée, qu'il avait exploité la pauvre défunte, et l'on se livra aux conjectures les plus étranges et les plus inattendues. Pour augmenter la confusion, survint l'intervention du représentant de la famille Z. Il jouit pendant quelques jours d'une véritable popularité, et fut l'objet de chaleureuses démonstrations de sympathie, dont lui-même se montra surpris. Mais la vérité commença à se faire jour : les lettres de Z qu'on découvrit firent voir que la cause du suicide n'avait pas été l'amour, parce que peu de jours avant de se décider à faire le pas fatal, elle-même déclarait n'aimer personne. On pensa alors qu'il s'agissait de questions d'intérêt ; mais des renseignements positifs donnés par la famille X et l'accord conclu avec [le représentant de la famille Z] ont encore démontré l'inanité de cette hypothèse. De quoi s'agit-il donc ? Du caprice d'une femme hystérique, avide de plaisirs, de luxe et d'une vie changeante et aventureuse, qui n'a pas su résister à un moment de découragement non fondé. Toutes les recherches de l'autorité judiciaire n'aboutiront à rien, et il restera seulement à la charge de X cet acte de faiblesse : de n'avoir pas enlevé à temps l'arme homicide des mains de cette femme qui avait l'âme et l'intelligence d'une fillette ».
[FN: § 2008-1]
Nous avons tenu compte de cette observation dans le Manuel, en considérant pour chaque phénomène un aspect objectif et un aspect subjectif.
[FN: § 2022-1]
Nous avons ici un des nombreux cas où le langage mathématique permet d'atteindre une précision et une rigueur qui sont refusées au langage ordinaire.
Soient x, y, ... s, u, v,... des indices de la grandeur de A, B, C,... ; les rapports (ainsi que nous les nommons dans le texte) entre A, B, C nous sont donnés par certaines équations :
(1) rho 1(x, y, ... ) = 0, rho2 (x, y…) = 0,…
Toutes ces quantités x, y,. peuvent être fonction du temps t, lequel peut en outre figurer
explicitement dans le système d'équations (1). Ce système, si nous supposons le temps variable, représente les rapports de A, B, C,. , et l'évolution de ces rapports. Ce n'est que la
connaissance, même très vague, très imparfaite, du système (1) d'équations qui nous permet d'avoir une connaissance quelconque des rapports et de leur évolution. La plupart des auteurs ne s'en rendent pas compte, ignorent jusqu'à l'existence de ce système, mais cela n'empêche pas que leurs raisonnements aient ce système comme prémisses, sans qu'ils en aient conscience.
Si l'on suppose que les équations du système (1) soient en nombre égal à celui des inconnues, celles-ci sont toutes déterminées. Si l'on suppose qu'elles soient en moindre nombre, ce qui revient à supprimer par hypothèse quelques-unes des conditions (§130) qui existent réellement, on peut prendre comme variables indépendantes s, u, v,.... en nombre égal à celui des équations supprimées, et supposer que x, y,.., sont fonction de ces variables indépendantes. Si nous différentions les équations (1) par rapport aux variables indépendantes, nous aurons le système :
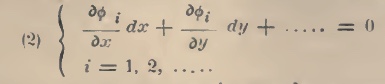
Les différentielles totales dx, dy,... représentent des mouvements virtuels, lesquels ont lieu lorsqu'on suppose que les variables indépendantes s, u, v,... se changent en s + ds, u + du,... Ces mouvements virtuels sont déterminés par les équations (2).
Au point de vue mathématique, les systèmes (1) et (2), ou ceux en lesquels on peut les supposer transformés, sont équivalents. On passe du premier au second par la différentiation, du second u premier par l'intégration. Très souvent le second système est plus facile à établir directement que le premier.
Qui tout ignore de l'un et de l'autre de ces deux systèmes, ignore aussi tout des rapports que peuvent avoir A, B, C,... Qui connaît quelque chose de ces rapports, connaît, par là même, quelque chose des systèmes (1) et (2). Qui établit ces rapports par la considération, non de ce qui est, mais de ce qui « doit » être, substitue aux systèmes (1) et (2) donnés par l'expérience, le produit de son imagination, et bâtit sur les nuages.
S'il n'y a qu'une seule variable indépendante, s, celle-ci, très généralement, est nommée la cause des effets x, y,.... et c'est son accroissement ds qui est dit la cause des mouvements virtuels dx, dy,... Lorsqu'on ne considère que des rapports de cause à effet, on opère, au point de vue mathématique, en réduisant les systèmes (1) et (2) aux suivants ou à d'autres équivalents :
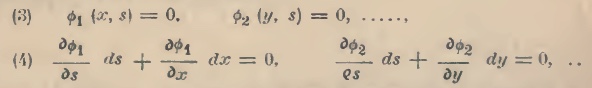
Ces deux systèmes d'équations sont bien plus faciles à traiter que les systèmes (1) et (2), soit par le langage vulgaire, soit même par les mathématiques (§2092 1). Il est donc bon, toutes les fois que cela est possible, de les substituer aux systèmes (1) et (2). Il est des cas où l'on a ainsi une solution au moins grossièrement approchée du problème que l'on s'est posé ; il en est d'autres où cela est impossible, et alors la substitution des systèmes (3) et (4) aux systèmes (1) et (2) ne peut pas s'effectuer, car elle ne donnerait que des résultats n'ayant rien à voir avec la réalité.
Au point de vue mathématique, on sait que l'intégration du système (2) ne reproduit pas seulement le système (1), mais qu'elle donne des solutions beaucoup plus étendues, parmi lesquelles se trouve compris le système (1). Pour déterminer entièrement celui-ci, il faut donc ajouter d'autres considérations. De même L’intégration du système (4) ne reproduit pas seulement le système (3), mais elle introduit des constantes arbitraires, qu'il faut déterminer par d'autres considérations. C'est d'ailleurs un fait très général dans l'application des mathématiques aux faits concrets. Même dans les tout premiers éléments de l’algèbre, quand la solution d'un problème est donnée par une équation du second degré, il y a fort souvent une racine qui convient au problème, et l'autre qui n'y convient pas et qui doit être rejetée. Cette observation est faite ici à cause de l'objection inepte d'un auteur qui s'imagine que des équations du type (2) ne peuvent pas représenter la solution d'un problème économique parce qu'elles donnent des solutions multiples, tandis que la solution réelle ne peut être qu'unique.
Pour mieux comprendre la théorie très générale que nous venons d'exposer, on peut en étudier un cas particulier, qui est celui de la détermination de l'équilibre économique, au moyen d'un système du type (2). On le trouvera exposé dans l'Appendice du Manuel et dans l'article déjà cité de l'Encyclopédie des sciences mathématiques.
Au point de vue exclusivement mathématique, on peut changer la variable indépendante en (3) et (4), et prendre, par exemple, pour variable indépendante x, au lieu de s. En ce cas, la terminologie du langage vulgaire ferait correspondre s à l'effet et x à la cause. Un tel changement parfois est admissible et parfois ne l'est pas, car cause, dans le langage vulgaire, a d'autres caractères outre celui d'être variable indépendante ; par exemple, elle doit nécessairement être antérieure à son effet. Ainsi on peut considérer le prix de vente comme effet, et le coût de production comme cause ; ou bien invertir ce rapport et considérer le coût de production comme effet, et le prix de vente comme cause ; car en ce cas il y a une suite d'actions et de réactions, qui permettent de supposer, à volonté, que l'offre du produit précède la demande, ou que la demande précède l'offre (§2092 1). En réalité il y a une mutuelle dépendance entre l'offre et la demande ; et cette mutuelle dépendance peut, à un certain point de vue théorique, être exprimée par les équations de l'économie pure. On ne pourrait pas, au point de vue de la terminologie, invertir d'une manière analogue le rapport selon lequel on nomme cause le gel de l'eau et effet la rupture du tuyau qui la renferme, et dire que cette rupture est la cause du gel. Mais si, mettant à part la terminologie, on s'occupe seulement du rapport expérimental entre ces deux faits, supposés isolés de tous les autres, on peut parfaitement déduire l'existence de la rupture, de celle du gel, ou vice versa. En réalité, il y a une mutuelle dépendance entre la température qui fait passer l'eau à l'état solide, et la résistance du vase qui la contient. La thermodynamique, grâce au langage mathématique, exprime cette mutuelle dépendance d'une manière rigoureuse ; le langage vulgaire l'exprime d'une manière imparfaite.
[FN: § 2022-2]
Si de nombreux « économistes » ont reproduit et reproduisent encore la théorie de la monnaie-signe (Cours, §276), ce n'est pas tant à cause de leur ignorance de la science économique, que parce qu'ils sont entraînés par le désir de plaire aux gouvernements et aux partis qui font de l'émission de la monnaie un moyen subreptice de lever des impôts.
[FN: § 2022-3]
Très souvent, ils défendent leur opinion au moyen du sophisme dit de l’ignoratio elenchi. Si l'on émet des doutes sur la réalité des rapports qu'ils prétendent établir entre A et B, C, .... ils répondent que ces doutes sont le fait d'hérétiques de la religion dominante : autrefois de la religion chrétienne, de la foi monarchique, actuellement de la religion du progrès, de la foi démocratique ; ou bien le fait de mauvais citoyens, de mauvais patriotes, d'hommes immoraux, malhonnêtes, etc. Or la question n'est nullement de savoir de qui ces doutes sont le fait, mais bien de connaître si l'expérience les accepte ou les rejette.
Le sophisme disparaîtrait si l'on admettait l'identité de la réalité expérimentale et des croyances des nombreuses religions, des non moins nombreuses morales, des différents patriotismes, croyances qui souvent sont nécessairement contradictoires, des conceptions variées que les hommes ont de l'honnêteté, etc. Mais une proposition de ce genre n'est pas toujours énoncée, et quand elle l'est, on n'en donne et n'en peut donner aucune preuve expérimentale ; tandis que des preuves semblables abondent pour la proposition contraire.
[FN: § 2022-4]
Un savant de beaucoup de mérite, G. DE MOLINARI, rédacteur en chef du Journal des Économistes, ne cessait de répéter à ses collaborateurs : « Surtout, pas de politique ! »
[FN: § 2022-5]
L'auteur de ces lignes est tombé autrefois en cette erreur et doit réciter son mea culpa; mais au moins il a tâché de ne pas persévérer : errare humanum est, perseverare diabolicum.
[FN: § 2025-1]
Une première et imparfaite ébauche de la théorie qui va être exposé a été publiée par l'auteur dans ses Systèmes socialistes.
[FN: § 2025-2]
Même si l'on pouvait faire cela, il serait bon de ne pas étendre les recherches au-delà d'une certaine limite ; cela pour les motifs indiqués déjà (§540). Quand plusieurs éléments A, B, C,... P, Q, R, S, … agissent sur un phénomène, il faut d'abord avoir une idée, fût-elle grossièrement approximative, de l'action quantitative de ces éléments, puis considérer uniquement les éléments A, B,... P dont l'action est considérable, en négligeant les autres éléments Q, R,... On a ainsi une première approximation, à laquelle d'autres peuvent faire suite, s'il est quelqu'un qui veuille, qui sache, qui puisse les réaliser. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Leur ignorance a plusieurs causes, parmi lesquelles il est utile de noter les suivantes. 1° L'habitude de considérations absolues, métaphysiques, de dérivations verbales semblables à celles mentionnées, dans le cours de cet ouvrage, à propos du droit naturel ou d'autres matières similaires. Ces considérations et ces dérivations sont entièrement étrangères aux notions quantitatives des sciences expérimentales. 2° La tendance à rechercher dans l'histoire surtout l'anecdote et le jugement éthique. Un élément Q, qui a un effet presque nul sur le phénomène que l'on veut étudier, peut avoir un indice quantitatif considérable, au point de vue anecdotique ou éthique. Par exemple, à l'origine, le protestantisme a des indices anecdotiques, moraux, théologiques, considérables ; mais il eut, sur l'élite gouvernementale, un effet presque nul en France, et considérable en Prusse. On doit donc le laisser de côté, dans une étude sur l'élite gouvernementale en France, tandis qu'on en devrait tenir compte dans une étude de cette classe en Prusse. Il est des gens qui vont plus loin dans cette voie erronée, et qui font aller de pair, dans une étude de science historique ou sociale, une aventure scandaleuse de César et sa campagne des Gaules, les mauvaises mœurs, prétendues ou réelles, de Napoléon Ier et son génie militaire. Ces gens sont précisément ceux qui, durant tant de siècles, ont voulu faire croire que les grands et profonds changements sociaux avaient souvent pour origine le caprice d'un souverain, d'une favorite, ou autres semblables futilités presque ou entièrement dépourvues d'importance. Au XIXe siècle, il semblait que ces gens eussent perdu leur crédit. Aujourd'hui, ils recommencent à se manifester : et sous leur grandiloquence, ils dissimulent le vide de leurs dérivations. 3° Le préjugé d'après lequel, pour avoir la théorie d'un phénomène, il est nécessaire d'en connaître tous les détails les plus infimes. Si cela était vrai, il n'y aurait pas lieu de faire des distinctions dans la série A, B,... P, Q,... ; et ces éléments devraient tous être mis au même niveau. Une autre conséquence serait qu'aucune science naturelle n'existerait, car toutes sont dans un perpétuel devenir, et se sont constituées alors qu'on ignorait une infinité de termes de la série établie, dont tous les termes ne sont pas connus aujourd'hui et ne le seront jamais. On peut admettre ce préjugé chez les hégéliens, qui refusent le nom de science à l'astronomie de Newton ; au contraire ce préjugé devient quelque peu ridicule chez ceux qui reconnaissent la qualité de science à l'astronomie, et qui devraient savoir, ou qui devraient apprendre avant d'en parler, s'ils l'ignorent, que Newton fonda l'astronomie moderne précisément en un temps où, parmi un très grand nombre de choses alors inconnues et aujourd'hui connues, il n'y avait rien de moins que l'existence d'une grande planète, Neptune, et de beaucoup de petites. Mais les gens qui ignorent ou qui oublient les principes des sciences expérimentales lorsqu'ils traitent de sciences sociales, ont beaucoup de difficulté à comprendre ces considérations. Ainsi que nous l'avons annoncé déjà (§20), notre but est ici de constituer la sociologie sur le modèle des sciences expérimentales, et non sur celui de la science de Hegel, de Vera, ou d'autres métaphysiciens, dont nous voulons, au contraire, nous tenir aussi éloignés que possible. 4° Enfin la paresse intellectuelle, qui induit à parcourir la voie la moins rude et la moins fatigante. La fatigue qu'il faut pour rattacher à une théorie les faits importants A, B, ...P, ou même seulement pour en reconnaître l'importance, est déjà beaucoup plus grande que celle qu'exige la découverte de l'un de ces faits. Elle est aussi beaucoup, beaucoup plus grande que celle dont on a besoin pour découvrir l'un des faits Q, R,... de moindre importance. Il est même tels de ces faits que l'on connaît d'autant plus facilement qu'ils ont moins d'influence sur le phénomène considéré. Pour ajouter une observation à celles dont se servit Kepler, dans son étude sur la planète Mars, nous avons besoin d'infiniment moins de fatigue intellectuelle et de talent que pour découvrir, comme le fit Kepler, la forme approximative de l'orbite de Mars. Au temps de Newton, pour ajouter une nouvelle observation à toutes celles qu’on possédait des corps célestes, assez peu d'effort était nécessaire. Pour découvrir la théorie de la gravitation universelle, il fallait le génie d'un Newton. On endure peu de fatigue pour découvrir, en sciences sociales, quelque détail négligé par un auteur. Des encyclopédies commodes viennent en aide au vulgaire, – et nombre de personnes qui, en d'autres matières, sont des savants, en celle-ci se rattachent au vulgaire, – les textes originaux servent aux rats de bibliothèque. Celui qui étudie l'histoire suivant les principes d'une éthique dictée par son propre sentiment, et qui critique ceux qui ne suivent pas cette voie, n'endure pas beaucoup plus de fatigue. Mais il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de découvrir une théorie expérimentale qui, dans une première approximation, relie les faits les plus importants A, B,... P. Celui qui est incapable de faire cela s'occupe de quelque chose de plus facile.
[FN: § 2025-3]
On trouvera une théorie générale, dont celle-ci n'est qu'un cas particulier, dans GUIDO SENSINI ; Teoria dell' equilibrio di composizione delle classi sociali, dans Rivista italiana di Sociologia, settembre-décembre 1913.
[FN: § 2026-1]
M. KOLABINSKA ; La circulation des élites en France : « (p. 5) La notion principale du terme élite est celle de supériorité ; c'est la seule que je retiens ; je laisse entièrement de côté les notions accessoires d'appréciation et d'utilité de cette supériorité. Je ne recherche pas ici ce qui est désirable ; je fais une simple étude de ce qui existe. En un sens large j'entends par élite d'une société les gens qui ont à un degré remarquable des qualités d'intelligence, de caractère, d'adresse, de capacité clé tout genre... Par contre j'exclus entièrement toute appréciation sur les mérites et l'utilité de ces classes ».
[FN: § 2032-1]
M. KOLABINSKA ; loc. cit. §2026-1 : « (p. 6) Nous venons d'énumérer différentes catégories des individus composant l'élite ; on peut encore les classer de bien d'autres manières. Pour le but que je me propose en cette étude, il convient de diviser l'élite en deux parties : une, que j'appellerai M, contiendra les individus de l'élite qui ont part au gouvernement de l'État, qui constituent ce que l'on nomme plus ou moins vaguement, „ la classe gouvernante “; l'autre partie N sera constituée par ce qui reste de l'élite, lorsqu'on en a séparé la partie M ».
[FN: § 2044-1]
M. KOLABINSKA ; loc. cit. §2026-1 : « (p. 10) L'insuffisance du recrutement de l'élite ne résulte pas d'une simple proportion numérique entre le nombre des membres nouveaux et celui des anciens ; mais il faut faire entrer en ligne de compte le nombre de personnes ayant les qualités requises pour faire partie de l'élite gouvernementale et qui en sont repoussées ; ou bien, en un sens opposé, le nombre de nouveaux membres dont aurait besoin l'élite et qui lui font défaut. Par exemple, dans le premier sens, la production de personnes ayant des qualités remarquables d'instruction peut dépasser de beaucoup le nombre de ces personnes pouvant trouver place dans l'élite, et l'on a alors la formation de ce qu'on a appelé un prolétariat intellectuel ».
[FN: § 2048-1]
2048 1 Plusieurs auteurs, faute d'avoir cette conception générale, tombent souvent en des contradictions : tantôt l'évidence des faits s'impose à eux ; tantôt des préjugés obscurcissent leur vue. Voyez, par exemple, TAINE. Dans L'ancien régime, il note très bien (chap. III) comment l'esprit du peuple est dominé par les préjugés : en d'autres termes, comment il est sous l'empire des résidus de la IIe classe. Cela posé, il n'y a qu'à conclure que la Révolution française n'a été qu'un cas particulier des révolutions religieuses, lesquelles nous montrent la foi populaire submergeant le scepticisme des hautes classes. Mais, soit volontairement, soit à son insu, Taine cède à l'influence du principe qui fait des hommes des hautes classes les éducateurs du peuple. Il met donc, l'incrédulité, l'impiété des nobles, du tiers et du haut clergé, parmi les causes principales de la Révolution. Il note, à ce sujet, la différence entre la France et l'Angleterre, et ne paraît pas loin d'attribuer, au moins en partie, à cette circonstance, le fait que la révolution qui s'est produite en France n'a pu avoir lieu en Angleterre. « (p. 363) En Angleterre, elle [la haute classe] s'aperçoit très vite du danger. La philosophie a beau y être précoce et indigène ; elle ne s'y acclimate pas. En 1729, Montesquieu écrivait sur son carnet de voyage : „ Point de religion en Angleterre... Si quelqu'un parle de religion, tout le monde se met à rire... “ Cinquante ans plus tard, l'esprit public s'est retourné ; „ tous ceux qui ont sur leur tête un bon toit et sur leur dos un bon habit “ [en note : Mot de Macaulay] ont vu la portée des nouvelles doctrines. En tout cas, ils sentent que des spéculations de cabinet ne doivent pas devenir des prédications de carrefour [donc eux et notre auteur croient à l'efficacité de ces prédications]. L'impiété leur semble une indiscrétion ; ils considèrent la religion comme le ciment de l'ordre public. C'est qu'ils sont eux-mêmes des hommes publics, engagés dans l'action, ayant part au gouvernement, instruits par l'expérience quotidienne et personnelle ». Pourtant, quelques lignes plus haut, Taine s'était réfuté lui-même. « (p. 362) Quand vous parlez à des hommes de religion ou de politique, presque toujours leur opinion est faite : leurs préjugés, leurs intérêts, leur situation les ont engagés d'avance ; ils ne vous écoutent que si vous leur dites tout haut ce qu'ils pensent tout bas ». S'il en est ainsi, les « prédications de carrefour » dont parle Taine ne doivent pas avoir beaucoup d'efficacité ; et si elles en ont, on ne peut pas dire que les gens « ne vous écoutent que si vous leur dites tout haut ce qu'ils pensent tout bas ». En réalité, ce sont précisément ces hypothèses qui se rapprochent le plus de l'expérience. L'état d'esprit du peuple français a été très peu atteint, vers la fin du XVIIIe siècle, par l'impiété des hautes classes, pas plus que l'état d'esprit romain n'avait été atteint par l'impiété des contemporains de Lucrèce, de Cicéron, de César ; pas plus que l'état d'esprit des peuples européens, au temps de la Réforme, n'avait été atteint par l'impiété du haut clergé et d'une partie de la noblesse. J. P. BELIN ; Le commerce des livres prohibés, à Paris de 1750 à 1789 : « (p. 104) Mais on peut affirmer que les ouvrages philosophiques n'atteignirent pas directement le peuple ni la petite bourgeoisie. Les artisans, les ouvriers ne connurent Voltaire et Rousseau qu'au moment de la Révolution, quand leurs tribuns les leur commentèrent dans des discours enflammés ou réduisirent leurs maximes en textes de lois. Au moment de leur apparition, ils ignorèrent certainement les grands ouvrages du siècle, encore qu'ils n'aient pas pu être complètement indifférents au bruit des querelles littéraires les plus retentissantes. Mais les véritables disciples des philosophes, les clients fidèles des colporteurs clandestins, ce furent les nobles, les abbés, les privilégiés, mondains désœuvrés qui, en quête de distractions pour tromper leur ennui implacable, se jetèrent avec passion dans les discussions philosophiques et se laissèrent vite gagner par l'esprit nouveau [tout cela concorde avec l'expérience, ce qui suit, moins], sans voir les conséquences dernières des prémisses qu'ils adoptaient avec tant d'enthousiasme ». Notre auteur observe avec raison que : « (p. 105) Ils [les privilégiés] étaient d'ailleurs les seuls à pouvoir se permettre les dépenses excessives auxquelles était contraint tout amateur de livres prohibés ».
[FN: § 2049-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] HENRI-F. SECRÉTAN ; La population et les mœurs : « (p. 206) Une nouvelle religion ne peut naître que dans les masses, qui l'imposent à l’élite du lendemain ».
Notes du Chapitre XII. – Forme générale de la société (§2060 à §2411), vol. 2, pp. 1306-1600 ↩
[FN: § 2062-1]
Resterait la difficulté pratique de la résolution de ces équations. Elle est si grande qu'on peut bien la qualifier d’insurmontable, si l'on veut considérer le problème dans toute son étendue. Dans le Manuel, III, § 217-218, nous avons déjà relevé le fait pour le phénomène économique, qui n'est qu'une petite partie du phénomène social. Donc, au point de vue de la résolution complète et générale du problème de la position d'équilibre, ou d'un autre problème analogue, la connaissance de ces équations ne servirait à rien. Au contraire, elle serait très utile à d'autres problèmes particuliers, comme elle l'a déjà été à l'économie pure. En d'autres termes, une connaissance même imparfaite de ces équations nous permettrait d'avoir au moins quelque idée de la solution des problèmes suivants. 1° Connaître certaines propriétés du système social, comme nous avons pu déjà connaître certaines propriétés du système économique. 2° Connaître les variations de certains éléments, à proximité d'un point réel auquel on connaît à peu près les équations du système. En somme, ce sont là les problèmes que nous nous proposons de résoudre dans ce chapitre ; et à la connaissance précise qui nous manque des équations, nous substituons la connaissance que nous pouvons avoir de leur nature et des rapports qu'elles établissent entre les éléments du système social.
[FN: § 2067-1]
Depuis que l'économie pure a considéré un état d'équilibre, beaucoup d'auteurs parlent de cet équilibre sans en avoir la moindre idée précise. Comme ils sont accoutumés à ne pas définir rigoureusement les termes qu'ils emploient, on comprend qu'ils n'éprouvent pas non plus le besoin d'une définition rigoureuse pour ce nouveau terme. Pire encore est l'attitude de ceux qui s'imaginent pouvoir apprendre par le sentiment ce qu’est cet équilibre; ils rangent ainsi ce terme dans la classe des expressions métaphysiques, où trônent le bon, le vrai, le beau, etc. De cette façon surgissent des conceptions étranges et ridicules. Inutile d'ajouter que nous employons ici ce terme uniquement comme une étiquette destinée à désigner certaines choses que nous définirons rigoureusement.
[FN: § 2068-1]
Il est des changements analogues aux changements artificiels ; ce sont les changements accidentels d'un élément qui surgit, agit pour peu de temps sur un système, y produisant une légère déviation de l'état d'équilibre, puis disparaît. Par exemple, les guerres courtes pour un pays riche, les épidémies, les inondations, les tremblements de terre et autres semblables calamités, etc. Les statisticiens avaient déjà remarqué que ces événements interrompaient pour peu de temps seulement le cours de la vie économique et sociale ; mais nombre de savants auxquels faisait défaut la notion d'équilibre, se mirent à la recherche de causes imaginaires. C'est ce qui arriva à Stuart Mill recherchant pourquoi un pays éprouvé pour peu de temps par la guerre, ne tarde pas à revenir à son état primitif. Au contraire, d'autres, comme Levasseur, invoquèrent une mystérieuse « loi de compensation » (Manuel, VII, § 79). L'équilibre d'un système social est semblable à celui d'un organisme vivant. Or, depuis des temps reculés, on a observé dans l'organisme vivant le rétablissement de l'équilibre accidentellement et légèrement troublé. Comme d'habitude, on a voulu donner une teinte métaphysique à ce phénomène, en invoquant la vis medicatrix naturae.
[FN: § 2069-1]
C'est le cas du troc entre deux individus dont l'un possède zéro de vin et une quantité donnée de pain, tandis que l'autre a zéro de pain et une quantité donnée de vin. Ce problème élémentaire a donné naissance aux théories de l'économie pure. Nous le considérons ici uniquement pour faciliter l'exposé ; mais ce que nous disons peut facilement être étendu aux problèmes beaucoup plus complexes qu'étudie l'économie pure.
[FN: § 2069-2]
Plusieurs des économistes qui commencèrent l'étude de l'économie pure se préoccupèrent seulement de déterminer la ligne aX1, sans même avertir qu'elle ne devait être considérée que dans l'unité de temps. Il ne faut pas leur en faire un reproche, parce que c'est un phénomène général dans l'évolution de toute science, que l'on commence par considérer les parties principales du phénomène, et qu'ensuite on complète les raisonnements et on leur donne plus de rigueur.
[FN: § 2069-3]
Dans l'exemple choisi, l'individu parcourt successivement les espaces aX1, bX2, ..., mais on pourrait trouver d’autres exemples où il parcourrait effectivement les espaces GX1 , X1 , X2 , X2 X3, de la ligne MP. Celle-ci serait alors, non plus la ligne qui unit les points extrêmes X1 , X2 , X3,…, qu'atteint l'individu au terme de chaque unité de temps, mais bien la ligne effectivement parcourue par l’individu. Mais, en matière économique et sociale, les phénomènes ont généralement lieu d'une manière analogue à celle des exemples indiqués dans le texte.
[FN: § 2072-1]
C'est ce que n'a pas compris ce brave homme qui, on ne sait trop pourquoi, s'imagina que l'équilibre économique était un état d'immobilité, par conséquent condamnable pour tout fidèle du dieu Progrès. Nombre de gens dissertent de même au hasard, lorsqu'ils se mettent en tête de juger les théories de l'économie pure. Le motif en est qu'ils ne se donnent pas la peine d'étudier la matière dont ils veulent traiter, et qu'ils croient pouvoir la comprendre, rien qu'en lisant à la hâte et négligemment des livres qu'ils comprennent à rebours, parce qu'ils ont l'esprit bourré de préjugés, et parce qu'ils n'appliquent pas leur attention aux froides recherches scientifiques, mais n'ont souci que de favoriser leur foi sociale. De cette façon, ils perdent d'excellentes occasions de se taire, et de ne pas révéler leur insuffisance. Plusieurs livres, opuscules, préfaces, articles, publiés depuis un certain temps sur l'économie pure, ne méritent même pas d'être lus.
[FN: § 2073-2]
Cet équilibre est évidemment un équilibre dynamique. Si la biologie était aussi arriérée que les sciences sociales, quelque savant personnage pourrait écrire un traité de biologie positive, où il exprimerait son étonnement et sa désapprobation, parce que l'on considère un état d'équilibre, c'est-à-dire d'immobilité, alors que la vie est mouvement.
[FN: § 2073-1]
Cette matière n'est pas facile. Je crois donc devoir ajouter que j'estime indispensable au lecteur désireux d'acquérir une idée claire des états sociologiques X1 , X2 , ..., et des façons possibles de les déterminer, qu'il étudie d'abord le phénomène semblable considéré par les théories de l'économie pure. Il faut procéder toujours du moins difficile au plus difficile, du plus connu au moins connu.
[FN: § 2078-1]
Il y a des auteurs qui considèrent l'économie comme une branche de la psychologie. Il y en a qui, au contraire, veulent exclure de l'économie la psychologie « individuelle », qu'ils estiment être une espèce de métaphysique, et n'entendent porter leur attention que sur les faits « collectifs » du troc et de la production. Cette question porte généralement plus sur des mots que sur des faits. Toute action de l'homme est une action psychologique : par conséquent, à ce point de vue, non seulement l'étude de l'économie, mais aussi celle de toute autre branche de l'activité humaine est une étude psychologique, et les faits de toutes ces branches d'activité, sont des faits psychologiques. La distinction que l'on veut faire pour le troc économique, entre le fait « individuel » et le fait « collectif », est puérile. Chaque être humain consomme du pain pour son propre compte, et il est ridicule d'imaginer que cent individus mangent « collectivement » du pain et s'en rassasient, tandis qu'aucun d'eux ne mange de pain et ne s'en rassasie « individuellement ». D'autre part, toutes les études de l'activité humaine, qu'on les appelle psychologiques ou non, sont des études de faits, puisque seuls les faits nous sont connus ; et la psychologie d'un être humain nous demeure inconnue tant qu'elle ne se manifeste pas par des faits. Les principes de la psychologie économique, ou de n'importe quelle autre psychologie, ne peuvent qu'être déduits des faits, comme en sont également déduits les principes de la physique, de la chimie, de l'attraction universelle, etc. Les principes une fois obtenus de cette manière, ou aussi seulement par voie d'hypothèses, on cherche leurs conséquences ; et si elles sont vérifiées par les faits, les principes sont confirmés (§ 2397 et sv.). Une vue très générale de faits usuels et communs a donné aux auteurs anglais la notion du degré final d'utilité, et à Walras celle de la rareté. Les conséquences tirées de ces principes se sont trouvées concorder à peu près avec les faits, en de certaines circonstances ; par conséquent les principes ont été estimés acceptables, entre certaines limites expérimentales. De la notion du degré final d'utilité, le prof. Edgeworth a tiré la considération des lignes d'indifférence, qui représentent de simples faits économiques. Nous-mêmes avons inverti le problème ; et de la considération des lignes d'indifférence, nous avons tiré les notions qui correspondent au degré final d'utilité, à la rareté, à l'ophélimité. Nous avons eu soin de rappeler qu'au lieu des lignes d'indifférence, on pouvait considérer d'autres faits économiques, tels que les lois de l'offre et de la demande, et en tirer la notion de l'ophélimité, dont on pouvait aussi supposer que ces faits sont des conséquences. Mais en ces déductions réciproques il faut beaucoup de précautions, que nous avons indiquées, et que semblent ignorer entièrement un grand nombre de personnes qui dissertent de cette matière, dont elles n'ont qu'une très vague connaissance. Les résidus et les dérivations que nous avons étudiés en sociologie doivent être considérés, au moins en partie, comme des notions analogues à celle de l'ophélimité en économie. L'examen des faits nous a conduits, par induction, à établir ces notions. Ensuite, parcourant la voie inverse, de ces notions nous avons tiré des conséquences. C'est parce qu'elles se sont trouvées concorder approximativement avec les faits, que les notions dont elles étaient déduites ont été confirmées.
[FN: § 2079-1]
C'est précisément pour démontrer cela que nous avons dû nous livrer à une longue étude des résidus et des dérivations. Peut-être, en la lisant, quelqu'un l'a-t-il trouvée superflue ? Elle était, au contraire, indispensable, parce que la conclusion à laquelle elle nous a conduits est aussi un fondement indispensable de la théorie que nous sommes en train d'exposer, au sujet de la forme générale de la société. En outre, comme cette conclusion diverge en nombre de points de celle qui est généralement reçue, il était nécessaire de l'étayer par un très grand nombre de faits.
[FN: § 2092-1]

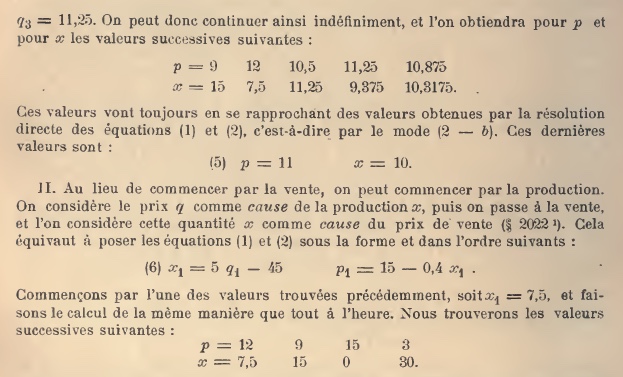
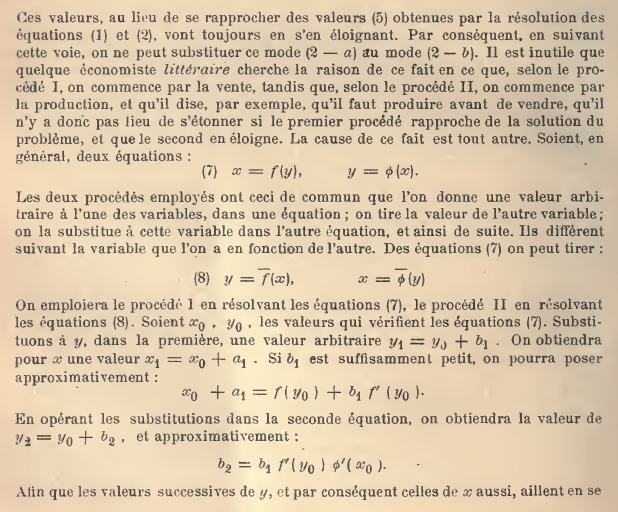
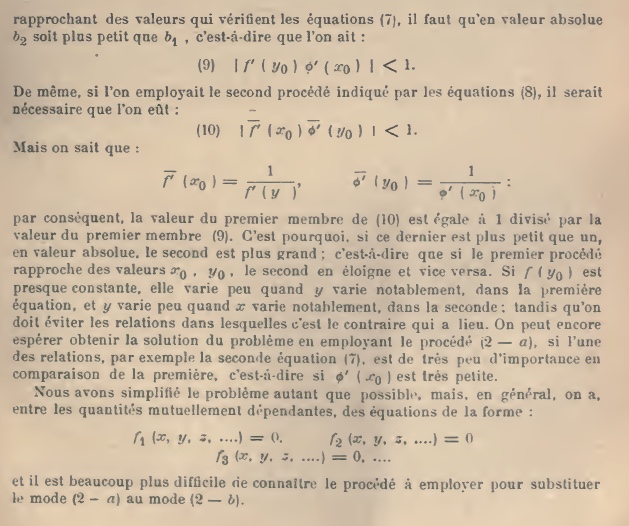
[FN: § 2096-1]
N'importe quelle proposition de modifier d'une manière quelconque l'organisation sociale existante, est en somme une proposition de modifier certaines des conditions qui déterminent cette organisation, et les recherches sur la possibilité de cette modification de l'organisation sociale sont des recherches sur la possibilité de modifier les conditions qui la déterminent. Celui qui prêche vise à modifier les résidus. On n'atteint jamais ou presque jamais ce but : mais on en atteint assez facilement un autre, qui est celui de modifier les manifestations de résidus existants. Soit une collectivité profondément mécontente de son gouvernement ; mais le mécontentement est indistinct et se manifeste de différentes façons qui, souvent, se contrecarrent. Surgit un prédicateur qui donne une forme distincte et précise à ce résidu, et qui en concentre les manifestations sur un point. De cette façon, les liaisons et les conditions sont changées, et l'organisation est formée par les nouvelles liaisons et les nouvelles conditions. Ceux qui légifèrent et font exécuter les lois se proposent parfois de modifier les résidus. En cela, ils font souvent œuvre entièrement vaine. S’ils disposent de la force, ils peuvent modifier certaines liaisons et en imposer d'autres, mais seulement en de certaines limites. Même le despote les rencontre. Il doit tout d'abord faire en sorte que ses mesures soient acceptées de ceux qui le soutiennent par la force : autrement il n'est pas obéi, ou bien il est détrôné. Pas plus qu'un gouvernement libre, un gouvernement despotique ne peut imposer des mesures qui heurtent trop les résidus existants chez ses sujets. Il ne suffit pas d'édicter une loi ; il faut la faire exécuter, et l'observation montre qu'il y a beaucoup de lois qu'on n'exécute pas, parce que la résistance qu'elles rencontrent est plus forte que la volonté de la faire exécuter. À ce point de vue, un despote a souvent beaucoup moins de pouvoir qu'un gouvernement libre, car les mesures édictées par celui-ci sont, habituellement, l'expression de la volonté d'un parti ; et par conséquent, elles trouvent beaucoup de partisans qui en surveillent l'exécution, tandis que les mesures du despote peuvent avoir peu, très peu de partisans. En certains cas particuliers, grâce à une énorme dépense d'activité et d'énergie, le despote peut bien imposer sa volonté : mais il ne peut pas le faire en des cas trop nombreux, parce que c'est une œuvre qui dépasse de beaucoup les forces d'un seul homme. C'est pourquoi, autour de lui, les gens s'inclinent, mais n'obéissent pas, et ses prescriptions demeurent lettre morte. C'est aussi ce qui arrive, en de beaucoup moindres proportions, dans les relations d'un ministre et de ses fonctionnaires. Voici un exemple qui peut servir de type. Di PERSANO ; Diario, 3e partie. Nous sommes en octobre 1860. Persano est reçu en audience par Cavour. Le dialogue suivant a lieu : « (p. 88) [Cavour] Je voudrais que vous vinssiez aujourd'hui à la Chambre. Il pourrait y avoir des interpellations, et il serait bon que vous y fussiez ; mais par votre promotion, vous avez cessé d'être député. C'est là un contretemps qui m'ennuie. – [Persano] Quelle promotion, Excellence? – Celle à vice-amiral. – Mais je n'en ai jamais été informé. – Jamais ? – Non, jamais, Excellence. – Nous ne pouvions vraiment pas nous expliquer votre silence à cet égard, et le fait que vous signiez toujours contre-amiral. Mais comment les choses se sont-elles passées depuis que nous vous avons annoncé votre promotion, lorsque vous étiez encore à Naples ? – Eh! Excellence. Ce sont les manèges habituels des subalternes ». Cavour sut tirer parti du contretemps : ce qui est précisément le fait d'un homme d'État avisé et habile. « (p. 90) [Cavour] J'ai écrit à Lanza [le président de la Chambre] de ne pas annoncer votre promotion, puisque vous ne l'avez pas reçue : ainsi vous viendrez aujourd'hui à la Chambre : on peut avoir besoin de donner quelques, explications ; il est bon que vous soyez là ». On remarquera que l'homme qui n'avait pas été obéi était Cavour, et c'était au temps où, grâce à son œuvre, le royaume d'Italie se constituait. À toutes ces liaisons, si nombreuses, si variées, si diverses, si compliquées, les adorateurs de la déesse Raison en substituent une, seule et unique : l'état des connaissances et leurs conséquences logiques. Ils s'imaginent donc que c'est par le raisonnement que se déterminent les modes et les, formes de la société, ce qui plaît beaucoup aux intellectuels, car ils sont producteurs de raisonnements, et tout producteur vante et loue sa marchandise. Ils tombent ainsi dans une erreur vraiment puérile. Négligeons le fait que d'habitude ces raisonnements sont des dérivations, et que, de ce fait, le peu d'efficacité qu'ils peuvent avoir est dû exclusivement aux résidus qui servent à dériver. Mais, quand bien même ces dérivations seraient de bons raisonnements logico-expérimentaux, elles seraient presque ou tout à fait impuissantes à modifier les formes sociales, qui sont en rapport avec bien d'autres faits beaucoup plus importants.
[FN: §2097-1]
C'est ce que font implicitement les réformateurs qui imaginent des utopies. Celui qui petit disposer à son gré des sentiments humains, peut aussi, entre les limites déterminées par les autres conditions, disposer de la forme de la société.
[FN: § 2110-1]
Dans sa préoccupation de rechercher quelle était la « meilleure république », ARISTOTE s'aperçut fort bien qu'il y avait là de tels problèmes à résoudre. Polit., VII, 2, 1 : « Il nous reste à savoir si l'on doit attribuer la même félicité à un homme qu'à la Cité, ou non. Mais évidemment chaque homme avoue qu'elle est la même. Quiconque veut qu'un particulier soit heureux, s'il est riche, admet aussi que la Cité soit heureuse, quand elle est opulente ; et celui qui vante comme heureuse la vie tyrannique, tiendra de même pour bienheureuse la Cité qui règne sur le plus grand nombre de peuples ; et s'il est quelqu'un qui veuille dire heureux un seul homme, s'il est vertueux, le même dira extrêmement heureuse la Cité, si elle est vertueuse ». Nous nous arrêtons sur ce point, c'est-à-dire que nous notons ces opinions et d'autres semblables, touchant l'état vers lequel on veut acheminer la cité, et que nous étudions des caractères communs à tous ces états. Aristote va plus loin : il détermine l'état qu'on doit préférer : (VII, 1, 1) ![]()
![]()
![]() . « Qui veut se mettre à rechercher convenablement quelle est la meilleure république doit d'abord déterminer quelle est la meilleure vie ». Ainsi, l'on sort du domaine du relatif expérimental, pour aller vagabonder dans le domaine de l'absolu métaphysique. En réalité, Aristote ne détermine pas cet absolu, parce que c'est impossible. Il ne trouve d'autre solution au problème que celle qui concorde le mieux avec ses sentiments et avec ceux des gens qui pensent comme lui ; cela avec l'adjonction habituelle, plus ou moins implicite dans les dérivations, que tout le monde pense comme lui, ou du moins devrait penser de cette façon, et de plus la tautologie suivant laquelle un homme respectable pense ainsi, car celui qui que pense pas ainsi n'est pas respectable. Mais chez Aristote, outre le métaphysicien, il y a aussi l'homme de science qui tient compte de l'expérience. Aussi, au livre IV, revient-il du domaine de l'absolu dans celui du relatif. Il remarque (IV, 1, 2) que la plupart des peuples ne peuvent pas s'organiser selon la meilleure république, et qu'il est nécessaire de trouver la forme de gouvernement adaptée aux peuples qui existent en réalité. Ensuite il ajoute excellemment (IV, 1, 3)
. « Qui veut se mettre à rechercher convenablement quelle est la meilleure république doit d'abord déterminer quelle est la meilleure vie ». Ainsi, l'on sort du domaine du relatif expérimental, pour aller vagabonder dans le domaine de l'absolu métaphysique. En réalité, Aristote ne détermine pas cet absolu, parce que c'est impossible. Il ne trouve d'autre solution au problème que celle qui concorde le mieux avec ses sentiments et avec ceux des gens qui pensent comme lui ; cela avec l'adjonction habituelle, plus ou moins implicite dans les dérivations, que tout le monde pense comme lui, ou du moins devrait penser de cette façon, et de plus la tautologie suivant laquelle un homme respectable pense ainsi, car celui qui que pense pas ainsi n'est pas respectable. Mais chez Aristote, outre le métaphysicien, il y a aussi l'homme de science qui tient compte de l'expérience. Aussi, au livre IV, revient-il du domaine de l'absolu dans celui du relatif. Il remarque (IV, 1, 2) que la plupart des peuples ne peuvent pas s'organiser selon la meilleure république, et qu'il est nécessaire de trouver la forme de gouvernement adaptée aux peuples qui existent en réalité. Ensuite il ajoute excellemment (IV, 1, 3) ![]()
![]() . « Car on ne doit pas seulement rechercher théoriquement la meilleure [république], mais aussi celle qui est possible, et qui, de même, peut être commune à toutes [les Cités]. » Il voit aussi qu'il ne suffit pas d'imaginer la meilleure république, mais qu'il faut encore trouver moyen de faire accepter la forme que l'on propose (IV, 1, 4). Pourtant il dévie aussitôt, pour la cause habituelle : il donne la prédominance aux actions logiques, et s'imagine qu'un législateur peut modeler une république à son gré. Toutefois ensuite la pratique qu'il avait de la vie politique l'oblige à ajouter « que corriger une république n'est pas une œuvre moins importante qu'en fonder une nouvelle » (IV, 1, 4).
. « Car on ne doit pas seulement rechercher théoriquement la meilleure [république], mais aussi celle qui est possible, et qui, de même, peut être commune à toutes [les Cités]. » Il voit aussi qu'il ne suffit pas d'imaginer la meilleure république, mais qu'il faut encore trouver moyen de faire accepter la forme que l'on propose (IV, 1, 4). Pourtant il dévie aussitôt, pour la cause habituelle : il donne la prédominance aux actions logiques, et s'imagine qu'un législateur peut modeler une république à son gré. Toutefois ensuite la pratique qu'il avait de la vie politique l'oblige à ajouter « que corriger une république n'est pas une œuvre moins importante qu'en fonder une nouvelle » (IV, 1, 4).
[FN: § 2111-1]
Si l'on pouvait savoir ce que les métaphysiciens veulent désigner, lorsqu'ils parlent de la « fin » d'un être humain, on pourrait prendre cette « fin » pour l'un des états X. Ensuite, toujours par analogie, on pourrait substituer à la lettre X le nom de « fin », et dire que l'état X est la « fin » vers laquelle tendent ou « doivent » tendre les individus et les collectivités. Cette « fin » peut être absolue, comme l'estiment habituellement les métaphysiciens ; mais elle pourrait aussi être relative, si on laisse au jugement de certaines personnes le soin de la déterminer. Un état qui se rapproche davantage de cette « fin » aurait un indice plus élevé qu'un autre état, qui s'en rapproche moins.
[FN: § 2113-1]
L'auteur a peut-être eu tort. Il se peut que toute conciliation soit impossible entre la manière littéraire et la manière scientifique d'étudier la sociologie. Du moment que l'on se propose d'édifier celle-ci sur le modèle de la physique, de la chimie et d'autres sciences semblables, il vaut peut-être mieux accepter franchement la terminologie que l'expérience a démontrée nécessaire en de telles sciences. Toute personne qui veut se livrer à leur étude doit se familiariser avec une foule de néologismes. Par exemple, elle doit connaître le système de mesures qui s'y emploie et savoir ce que sont les unités nommées : dyne, barye, erg, Joule, Gauss, Poncelet, etc. ; ce qui est bien autrement compliqué que de se rappeler en quel sens on emploie les termes : résidus et dérivations. Même en de simples études littéraires, il est sage de ne pas imiter les auteurs dont parle Boileau, lesquels blâment
… la métaphore et la métonymie,
Grands mots que Pradon croit des termes de chymie. (Epître X.)
Il ne faut pas confondre l'énergie mécanique avec l'énergie du langage vulgaire, ni s'imaginer que la force vive mécanique est une force qui est vivante. Pour savoir ce qu'est l'entropie, il est bon d'ouvrir un traité de thermodynamique. Quant à la chimie, c'est par centaines qu'elle emploie de nouveaux termes, et parfois on est obligé de leur donner des synonymes pour l'usage courant. C'est ainsi que le nom harmonieux d'Hexamethylenetramine est remplacé, dans les pharmacies, par le terme d'Eurotropine, qui a au moins le mérite d'être plus court. Pour étudier la chimie, il faut avoir recours à un traité de chimie ; se laisser guider par le bon sens et l'étymologie des termes ne sert absolument de rien. C'est malheureux, mais il en est ainsi. La race des chimistes littéraires n'existe pas. Pour étudier la sociologie, il faut avoir recours à un traité de cette science, et se résigner à ne pas se fier à l'étymologie ni au simple bon sens. C'est malheureux, et cela empêche la très nombreuse race des économistes et des sociologues littéraires de comprendre la science. D'ailleurs cette race se perpétuera longtemps encore, car son existence répond à une certaine utilité sociale (§ 2400 1).
[FN: § 2128-1]

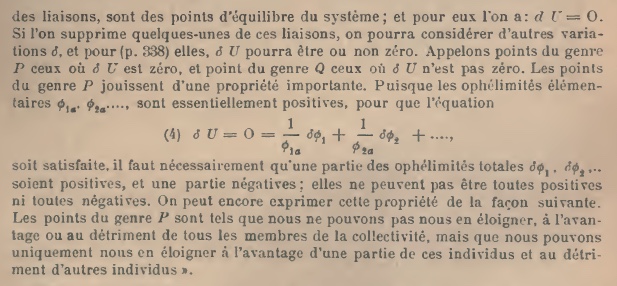
[FN: § 2129-1]
Le fait d'avoir confondu le maximum d'ophélimité pour la collectivité avec le maximum d'ophélimité de chaque individu de la collectivité, a été la cause de l'accusation de raisonnement en cercle, portée contre les démonstrations des théorèmes sur le maximum d'ophélimité pour la collectivité. En effet, dans le cas de la libre concurrence, les équations de l'équilibre économique s'obtiennent en posant la condition que chaque individu obtienne le maximum d'ophélimité ; par conséquent, si, après cela, on voulait déduire de ces équations que chaque individu obtient le maximum d'ophélimité, on ferait évidemment un raisonnement en cercle. Mais au contraire, si l'on affirme que l'équilibre déterminé par ces équations jouit de la propriété de correspondre à un point d'équilibre pour la collectivité, C'est-à-dire à l'un des points que nous avons désignés tout à l'heure par P, on énonce un théorème qui doit être démontré. Nous avons donné cette démonstration d'abord dans le Cours, puis dans le Manuel. Il faut reconnaître que l'erreur de ceux qui supposaient un raisonnement en cercle a sa source dans les œuvres de Walras, qui, en effet, n'a jamais parlé du maximum d'ophélimité pour la collectivité, mais a toujours considéré exclusivement le maximum d'ophélimité pour chaque individu. – PIERRE BOVEN ; Les applications mathématiques à l'économie politique : « (p. 111) ... Walras développe ce qu'il appelle le Théorème de l'utilité maxima des marchandises. Cette soi-disant démonstration est un illustre exemple de cercle vicieux. Qu'on en juge. Il s'agit de savoir dans quelles conditions les deux échangeurs obtiendront la satisfaction maxima de leurs besoins. Et voici d'où nous partons : „ En supposant qu'il opère l'échange de manière à satisfaire la plus grande somme totale de besoins possibles, il est certain que pa étant donné, da est déterminé par la condition que l'ensemble des deux surfaces... soit maximum. Et cette condition est que le rapport des intensités ra1 , rb1 , des derniers besoins satisfaits par les quantités da et y, ou des raretés après l'échange, soit égal au prix pa.« Supposons-la remplie...“ Etc. (p. 77, WALRAS, Éléments). S'il est certain que cette équation s'impose, et si on l'admet comme hypothèse, il est parfaitement inutile de couvrir quatre pages de calculs, pour découvrir que : „ Deux marchandises étant données sur un marché, la satisfaction maxima des besoins, ou le maximum d'utilité effective, a lieu, pour chaque porteur, lorsque le rapport des intensités des derniers besoins satisfaits, ou le rapport des raretés est égal au prix “. (p. 112) Sans doute, il n'y a rien de faux, dans cette discussion, rien qui sape la théorie, puisque la solution trouvée est précisément l'hypothèse d'où l'on est parti ; mais il est extraordinaire que Walras ait été dupe d'une pareille illusion. On serait tenté de croire que c'est par inadvertance. Il n'en est rien. La tautologie que nous relevons a été signalée plusieurs fois à son auteur, et par les critiques les plus bienveillants ; mais Walras n'a jamais rien voulu entendre. Nous touchons ici à un fait intéressant : la violence des sentiments qui poussaient l'illustre économiste à prêcher une doctrine pratique. Il voulait à tout prix que l'intérêt de la société fût démontré mathématiquement. Il tenait à prouver que la libre concurrence était bonne et le monopole mauvais... » Ces observations n'enlèvent rien au grand mérite qu'eut Walras d'avoir, le premier, donné les équations de l'équilibre économique en un cas particulier ; de même que les critiques que l'on peut faire quant à la théorie de la lumière de Newton, ou mieux encore, à ses commentaires sur l'Apocalypse, n'enlèvent rien à l'admiration que l'on doit à l'immortel créateur de la mécanique céleste. C'est ce que ne comprennent pas ceux qui confondent le prophète avec l'homme de science. Bien entendu, les dogmes d'une religion étant réputés absolus, ils ne changent pas avec le cours des années. Au contraire, les doctrines scientifiques sont dans un perpétuel devenir, et parfois leur auteur lui-même, ensuite toujours d'autres auteurs, les modifient, les augmentent, leur donnent une forme nouvelle et même un fond nouveau. Ceux qui croient à l'Apocalypse peuvent vouloir accorder une place parmi eux à Newton; ceux qui croient à la religion humanitaire ou socialiste peuvent se démener pour faire leur profit du nom de Walras. Ces prétentions n'atteignent ni l'un ni l'autre de ces savants.
[FN: § 2131-1]
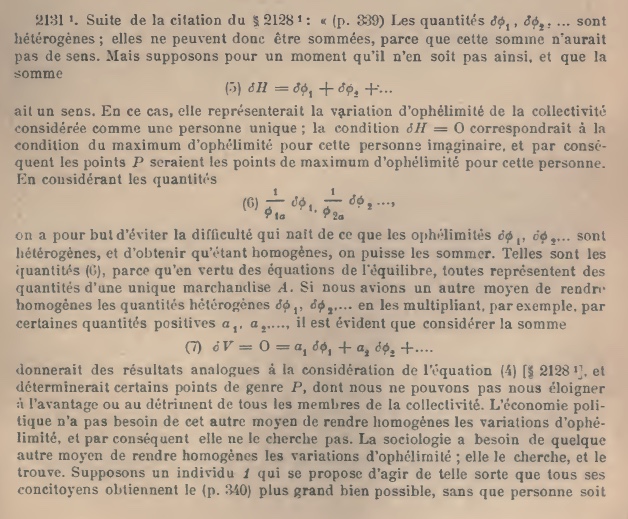
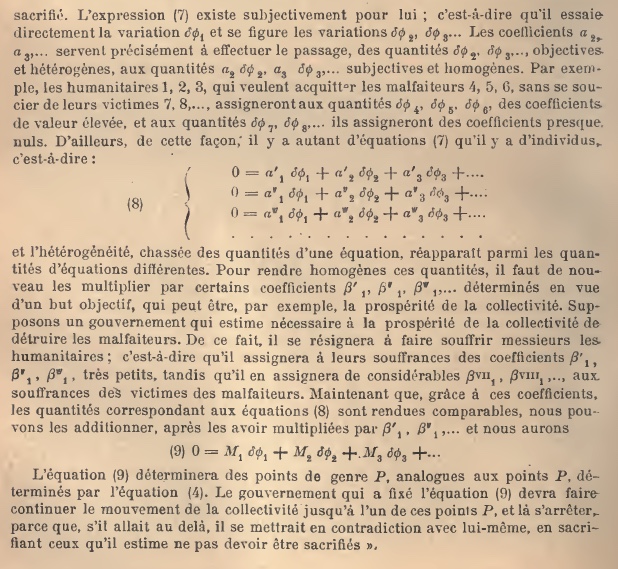
[FN: § 2131-2]
Comme d'habitude, on fait cette comparaison au moyen de dérivations, en opposant des buts idéaux plutôt que des positions réelles. Pour faire pencher la balance du côté des honnêtes gens, on dira, par exemple, que « le criminel ne mérite pas la pitié », par quoi l'on exprime, en somme, qu'il convient d'assigner à ses souffrances un coefficient nul ou presque nul. Vice versa, pour faire pencher la balance du côté du criminel, on dira que « tout comprendre serait tout pardonner », que « la société est plus responsable du crime que le délinquant » ; par quoi l'on néglige, en somme, les souffrances des honnêtes gens, en assignant à ces souffrances un coefficient voisin de zéro, et l'on fait prévaloir, au moyen d'un coefficient élevé, les souffrances du délinquant. On peut traduire d'une manière analogue un très grand nombre de dérivations dont on fait habituellement usage, en traitant de matières sociales.
[FN: § 2134-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] Le fait n’a pas échappé à Malthus, et c'est l'un des motifs pour lesquels beaucoup de personnes ont porté contre lui des accusations analogues à celles dont Machiavel a été l'objet. Bien que Malthus n'eût pas encore une vue générale du problème de l'utilité en sociologie, il se rendit assez bien compte de la distinction à établir entre l'utilité de et l'utilité pour la collectivité. Une des idées maîtresses de l'Essai sur le principe de population est précisément la distinction, et parfois l'opposition de ces deux genres d'utilité, en ce qui concerne le problème de la population. Malthus s'est efforcé de montrer qu'une augmentation de la population n'est pas utile d'une façon absolue, mais qu'il y a différents points de vue à considérer, et qu'en certains cas une diminution de population peut être utile pour la collectivité.
[FN: § 2138-1]
Dans les cas de transgressions aux règles de la morale, si les transgressions sont le fait des gouvernants, il peut se présenter de nombreux cas où, pour la position des points q, t, la réalité ressemble à la figure. Si les transgressions sont le fait des gouvernés, nombreux sont les cas où la position des points q, t, est inverse de celle de la figure, c'est-à-dire que le point q est plus proche de B que le point t.
[FN: § 2142-1]
Il existe de nombreuses études concernant le darwinisme social, soit en faveur, soit contre cette doctrine, qui parfois, sans même être nommée, a inspiré des ouvrages importants, tels que ceux de G. de Molinari. Les critiques que nous adressons ici au darwinisme social ne tendent pas le moins du monde à en méconnaître l'importance. C'est d'ailleurs une obser- vation qu'il faut répéter à propos de beaucoup d'autres théories dont nous avons l'occasion de nous occuper ici (§ 41).
Ce Traité de sociologie générale n'est pas un exposé ni une histoire des doctrines sociolo- giques, philosophiques, scientifiques, ou autres quelconques. Nous ne nous en occupons qu'occasionnellement quand nous avons besoin d'exemples nous permettant de séparer les dérivations et la réalité expérimentale, ou d'éclaircir quelque point d'une recherche scientifique. Nous n'aurions nul besoin de faire cette observation si l'étude de la sociologie avait atteint le niveau des études des autres sciences logico-expérimentales. Celui qui lit Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste, de H. POINCARRÉ, ne s'attend pas à y trouver un exposé ou une histoire des théories de l'astronomie, depuis le temps d'Hipparque jusqu'à notre époque ; et celui qui lit les Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne, de PAUL TANNERY, ne s'attend pas à y trouver un traité de mécanique céleste.
Dans notre essai sur Les systèmes socialistes, nous avons tâché de faire une étude des dérivations connues sous le nom de ces systèmes. Un critique a observé que l'auteur s'était arrêté à la forme, sans arriver jusqu'au fond ; il est parti de là pour adresser un blâme sévère à l'ouvrage. L'observation est juste, le blâme est mérité, tout autant que celui qu'on pourrait adresser à Paul Tannery, pour ne pas avoir mis un traité de mécanique céleste dans son livre que nous venons de citer. L'imperfection des Systèmes socialistes est d'un tout autre genre que celui visé par ce blâme ; elle est surtout la conséquence du fait que l'auteur ne possédait pas alors la théorie des dérivations, théorie qu'il a développée dans le présent Traité ; il l'a appliquée par anticipation, sans en avoir encore une conception bien rigoureuse, et il en est résulté un certain flottement. On devrait maintenant refondre cette étude, en tenant compte des théories plus précises que nous venons d'exposer. Il serait très utile d'avoir d'autres études de ce genre, sur les doctrines politiques, philosophiques et autres, en somme sur les diverses manifestations de l'activité intellectuelle des hommes, lesquelles, avec les doctrines des systèmes socialistes, constituent le vaste ensemble des doctrines sociales. Ici, c'est de propos délibéré que nous ne nous en sommes pas occupé.
De ce fait, il ne faudrait pas tirer la conclusion que nous avons l'absurde présomption de ne rien devoir à ces doctrines telles qu'on les a exposées jusqu'à présent (§ 41) ; autant vaudrait dire qu'un homme de l'âge de la pierre était en mesure de disserter sur un sujet scientifique, tout aussi bien qu'un homme cultivé vivant dans une société intellectuellement aussi avancée que la nôtre. L'influence d'une doctrine sur une autre ne se fait pas seulement sentir dans les concordances, elle apparaît aussi dans les divergences. Aristote doit quelque chose à Platon, même lorsqu'il le critique ; sans la géométrie euclidienne, nous n'aurions probablement pas eu les géométries non-euclidiennes. La théorie de Newton, sur l'attraction universelle, n'aurait probablement pas existé, sans les théories antérieures qu'elle contredit. Quelle a été sur l'esprit de Newton l'influence de ces théories, et quelle a été celle de l'expérience directe ? Nous l'ignorons, et Newton n'en savait pas plus que nous ; peut-être en savait-il moins. Bien fin serait celui qui saurait faire la part des influences extrêmement nombreuses et variées qui agissent sur un auteur : même et surtout celui-ci ne s'en rend pas bien compte. Ce sont là d'ailleurs des recherches qui peuvent être intéressantes au point de vue psychologique ou anecdotique, mais qui n'ont que peu d'importance pour l'étude logico- expérimentale des lois des phénomènes sociaux.
[FN: § 2145-1]
Ajoutons qu'en envisageant uniquement le point de vue objectif, le terme meilleur a besoin de définition (§ 2110-1), c'est-à-dire qu'il faut énoncer ce que signifie précisément ce nom. Cela revient à fixer quel état on veut exactement considérer parmi tous ceux que désigne X au § 2111. L'équivoque signalée tout à l'heure, des réformateurs, et un grand nombre d'autres semblables proviennent du fait que l'on croit à l'existence d'un état unique X, tandis qu'il y en a un nombre infini.
[FN: § 2147-1]
BASTIAT ; Oeuvres complètes, t. V, p 43-63. Le rabot. On suppose deux menuisiers, nommés Jacques et Guillaume. Jacques fait un rabot : Guillaume le lui emprunte, et, en échange de ce « service », consent à lui donner l'une des planches faites avec le rabot.
[FN: § 2147-2]
BASTIAT ; Œuvres compl., t. V. Gratuité du crédit, lettre de Bastiat : (« p. 119) Voilà un homme qui veut faire des planches. Il n'en fera pas une dans l'année, car il n'a que ses dix doigts. Je lui prête une scie et un rabot, – deux instruments, ne le perdez pas de vue, qui sont le fruit de mon travail et dont je pourrais tirer parti pour moi-même. – Au lieu d'une planche, il en fait cent et m'en donne cinq. Je l'ai donc mis à même, en me privant de ma chose, d'avoir (p. 120) quatre-vingt-quinze planches au lieu d'une, – et vous venez dire que je l'opprime et le vole ! Quoi ! grâce à une scie et à un rabot que j'ai fabriqués à la sueur de mon front, une production centuple est, pour ainsi dire, sortie du néant, la société entre en possession d'une jouissance centuple, un ouvrier qui ne pouvait pas faire une planche en a fait cent : et parce qu'il me cède librement et volontairement, un vingtième de son excédent, vous me représentez comme un tyran et un voleur ! »
[FN: § 2147-3]
Loc. cit., § 2147 2 : « (p. 133) Bastiat à Proudhon. Monsieur, vous me posez sept questions. Veuillez vous rappeler qu'entre nous il ne s'agit en ce moment que d'une seule : „ L'intérêt du capital est-il légitime ? “ (p. 148) Proudhon à Bastiat. Vous demandez : „ L'intérêt du capital est-il légitime oui ou non ? Répondez à cela. sans antinomie et sans antithèse “. Je réponds : „ Distinguons, S'il vous plaît. Oui, l'intérêt du capital a pu être considéré comme légitime dans un temps : non, il ne peut plus l'être dans un autre “ ».
[FN: § 2147-4]
La polémique avait lieu en 1849, en un temps d'effervescence républicaine. Loc. cit. § 2147-1. Proudhon à Bastiat : « (p. 120) La révolution de Février a pour but, dans l'ordre politique (p. 121) et dans l'ordre économique, de fonder la liberté absolue de l'homme et du citoyen. La formule de cette Révolution est, dans l'ordre politique, l'organisation du suffrage universel, soit l'absorption du pouvoir dans la société ; – dans l'ordre économique, l'organisation de la circulation et du crédit, soit encore l'absorption de la qualité de capitaliste dans celle de travailleur. Sans doute, cette formule ne donne pas, à elle seule, l'intelligence complète du système : elle n'en est que le point de départ, l'aphorisme. Mais elle suffit pour expliquer la Révolution dans son actualité et son immédiateté ; elle nous autorise, par conséquent, [cette conséquence vaut un Pérou], à dire que la Révolution n'est et ne peut être autre chose que cela ».
[FN: § 2147-5]
Loc. cit. § 2147-1. Proudhon à Bastiat : « (p. 125) D'un côté, il est très vrai, ainsi que vous l'établissez vous-même péremptoirement, que le prêt est un service. Et comme tout service est une valeur [que veut dire cela ?], conséquemment comme il est de la nature [affirmation gratuite] de tout service d'être rémunéré, il s'ensuit que le prêt doit avoir son prix, ou, pour employer le mot technique, qu'il doit porter intérêt ».
[FN: § 2147-6]
Cela se voit bien dans tous les ouvrages, tant de Bastiat que de Proudhon. Pour le pre- mier, la citation suivante suffira. BASTIAT ; Œuvr. compl., t. VI. Harmonies économiques. Richesse : « (p. 201) Il faut d'abord reconnaître que le mobile qui nous pousse vers elle [vers la richesse] est dans la nature [bravo ! Et le motif qui pousse au crime n'est-il pas aussi dans la nature ?] ; il est de création providentielle [qu'est-ce que cela ?] et par conséquent moral. Il réside dans ce dénuement primitif et général, qui serait notre lot à tous, s'il ne créait en nous le désir de nous en affranchir. – Il faut reconnaître, en second lieu, que les efforts que font les hommes pour sortir de ce dénuement primitif, pourvu qu'ils restent dans les limites de la justice [mais c'est précisément sur ces limites qu'il y a discussion entre ceux qui affirment, et ceux qui nient que le capitaliste qui reçoit une partie du produit dépasse ces limites] sont respectables et estimables, puisqu'ils sont universellement estimés et respectés [dérivations de la IIe classe]. Il n'est personne d'ailleurs qui ne convienne que le travail porte en lui-même un caractère moral... Il faut reconnaître, en troisième lieu, que l'aspiration vers la richesse devient immorale quand elle est portée au point de nous faire sortir des bornes de la justice [mais qui les fixe ? elles sont évidemment différentes pour qui affirme que la propriété c'est le vol, et pour qui dit que la propriété est légitime]... Tel est le jugement porté, non par quelques philosophes, mais par l'universalité des hommes [ceux qui ne sont pas de l'avis de Bastiat ne sont donc pas des hommes ?], et je m'y tiens ». Que de discours pour arriver à exprimer son sentiment ! Il pouvait le manifester sans autre, et voilà tout.
[FN: § 2147-7]
C'est le but de toute l'œuvre de Bastiat. Il y vise surtout dans les Harmonies économiques. Beaucoup d'autres auteurs ont aussi écrit pour démontrer l'identité des conclusions de l'économie et de la « morale ». Proudhon démontre que ses conceptions économiques sont une conséquence de la « justice ». Chez presque tous les auteurs, cette identité s'établit non entre l'économie et la morale du monde réel, mais entre une économie et une morale futures, telles qu'elles se réaliseront suivant les idées de l'auteur, ou telles qu'elles seront déterminées par l'évolution et au terme, fort peu connu, il est vrai, de cette évolution. Habituellement, l'identité obtenue de cette façon paraît évidente, car on suppose implicitement que l'économie et la morale doivent être ou seront des conséquences logiques de certaines prémisses, et il est incontestable que les diverses conséquences logiques des mêmes prémisses ne peuvent être en désaccord. Les théories de l'organisation providentielle de la société, des causes finales, du darwinisme social et autres semblables, aboutissent aux mêmes conclusions.
[FN: § 2147-8]
Loc. cit. § 2147-1 : « p. 46) J'affirme d'abord que le Sac de blé [autre exemple analogue à celui du rabot] et le rabot sont ici le type, le modèle, la représentation fidèle, le symbole de tout Capital, comme les cinq litres de blé et la planche sont le type, le modèle, la représentation, le symbole de tout intérêt ».
[FN: § 2147-9]
Parfois l'on croit résoudre le problème, au point de vue de l'utilité, en disant : « L'héritage est utile, parce qu'il pousse les hommes à être économes et à ne pas dilapider leur patrimoine ». Même si l'on accepte cette affirmation à titre d'hypothèse, le problème est résolu qualitativement et non quantitativement. Il reste, en effet, à considérer toutes les autres utilités, et à voir quelle est la résultante. De plus, en pratique, les droits fiscaux toujours plus lourds que l'on impose aux successions vont à l'encontre du principe énoncé tout à l'heure. Et là nous nous trouvons en présence d'une autre séparation de phénomènes, que veulent effectuer un grand nombre d'économistes, en mettant à part et en dehors de leur raisonnement les droits fiscaux ; par quoi l'on aboutit à une simple question de mots. Pourvu que l'hérédité subsiste de nom, si les droits fiscaux la suppriment presque en entier de fait, l'économiste s'incline avec respect et ne dit rien. De même, un grand nombre sont opposés à un droit protecteur sur les grains, et n'ont rien à objecter à un droit dit fiscal dont l'effet est en réalité identique. Ces dérivations sont favorisées par le désir qu'ont beaucoup d'économistes de ne pas se mettre en opposition avec leur gouvernement. Ils acceptent avec révérence ses décisions fiscales et politiques, demandant seulement de pouvoir argumenter sur leurs théories abstraites. Les socialistes échappent à cette cause d'erreurs, grâce à leurs démêlés avec les gouvernements ; ils refusent dédaigneusement de séparer des parties sociales, politiques, fiscales, la partie économique des phénomènes ; et, en cela, ils se rapprochent de la réalité plus que les économistes mentionnés tout à l'heure.
[FN: § 2147-10]
Il est nécessaire de rappeler ici l'observation faite au § 75. Dans un écrit où l'on fait usage de dérivations, on peut bien supposer implicites les propositions qui s'y trouvent habituellement sous cette forme ; c'est pourquoi si l'auteur démontre qu'il est absurde de tirer une conclusion Q des prémisses P, il est permis, en de très nombreux cas, d'admettre qu'il juge absurde aussi la conclusion Q. il n'en est pas ainsi dans un écrit qui vise à être exclusivement scientifique : il n'y a rien à supposer ; il n'y a pas à aller au-delà de l'affirmation que le raisonnement qui unit P à Q ne se soutient pas, puisque Q peut exister indépendamment de ce raisonnement. Si quelqu'un disait : « La circonférence du cercle ne peut avoir de commune mesure avec son diamètre, parce qu'elle n'a pas d'angles », et si quelqu'un d'autre observait que cette démonstration ne tient pas debout, il ne faudrait nullement croire que cette personne affirme ainsi que la circonférence a une commune mesure avec son diamètre. On peut donner une démonstration fausse d'un théorème vrai.
[FN: § 2147-11]
En outre, dans l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme et le sémitisme jouèrent certainement un rôle considérable, mais beaucoup moins qu'il ne paraît à première vue et qu'un grand nombre de personnes le croient encore, car, en plusieurs cas antisémitisme et sémitisme n'étaient que le voile d'autres sentiments et d'intérêts. En effet, on remarquera que l'antisémitisme et le sémitisme n'étaient vraiment pour rien dans les faits de Saverne : ils leur étaient absolument étrangers ; pourtant tous les journaux dreyfusards, d'un commun accord, se montrèrent hostiles aux autorités militaires allemandes. Cela prouve avec, évidence qu'outre le sentiment qui, pouvait exister chez quelques-uns d'entre eux, à l'égard de Dreyfus en tant que sémite, il y avait aussi d'autres sentiments, d'autres intérêts, communs à eux tous, et qui les poussaient à prendre le parti de Dreyfus, de même qu'ils les poussèrent à se montrer hostiles aux autorités militaires, dans les faits de Saverne. C'est là ce qu'il y a de commun entre l'affaire Dreyfus et les faits de Saverne. Voyons maintenant les différences, qui proviennent surtout des diverses organisations sociales et politiques de la France et de l'Allemagne. Ces différences sont bien exprimées dans l'article suivant de la Gazette de Lausanne, 26 janvier 1911 : « Quand éclata l’affaire de Saverne, il se trouva dans toute l'Europe des journaux libéraux pour annoncer que l'Allemagne allait avoir son „ affaire Dreyfus “. C'était bien mal connaître l’Allemagne. De longtemps, „ une affaire Dreyfus “ est impossible en Allemagne, bien que le militarisme y soit autrement puissant et envahissant qu'il n'était en France dans les dernières années du siècle dernier. C'est la Chambre des députés française qui naguère amorça l'affaire. Or, le Reichstag le voudrait-il que les pouvoirs lui manquent pour provoquer autour des jugements de Strasbourg l'agitation révisionniste qui naguère aboutit si complètement en France. An surplus, la majorité du Reichstag paraît déjà fatiguée de son attitude opposante. Nationaux-libéraux et membres du centre ne demandent qu'à revenir du côté du manche. Demain, ce sera chose faite. Devant la débandade des partis bourgeois jetant leurs fusils, le Vorvœrts écrivait très justement samedi dernier : „ Force et lutte, voilà deux mots qui n'existent pas dans le dictionnaire de la bourgeoisie allemande “. Cette classe, docile entre toutes, respectueuse et timide, ne demande au fond qu'à se laisser mener par les dépositaires de la force, par ceux que Guillaume II appelle „ les meilleurs de la nation “. Telle la femme de Sganarelle, la bourgeoisie d'outre-Rhin trouve douces les violences qui lui viennent de son supérieur hiérarchique. Il faut la funeste puissance d'illusion d'un Jaurès, il faut se repaître de chimères comme fait le directeur de l'Humanité, cet internationaliste aveuglé sur les questions internationales, pour croire à la mission du Reichstag, à son influence sur les destinées allemandes. Saluer dans les événements dont l'Allemagne vient d'être le théâtre un gage de paix entre la France et l'Allemagne, c'est sacrifier à une dangereuse erreur. Nombre de socialistes français, encore imbus de l'esprit de la Révolution de quarante-huit, partagent cette illusion. Elle peut devenir funeste non seulement à la France, mais à toute l'Europe ». Au contraire, un bon dreyfusard écrivait de Paris à son journal ; « Naturellement on suit ici avec un intérêt extrêmement vif les événements politiques allemands. On se réjouit de constater que l’immense majorité de l'opinion s'insurge contre un militarisme brutal. Peut-être même d'aucuns s'exagèrent-ils un peu les conséquences heureuses qui pourraient résulter, en ce qui concerne les relations franco- allemandes, de ce conflit entre ce que le Temps appelle les deux Allemagne ». Bien plus qu'« exagéré », l'effet de l' « immense majorité de l’opinion allemande » fut à peu près nul.
[FN: § 2147-12]
Ce fait est absolument nié dans les dérivations auxquelles l'affaire Dreyfus continue à donner lieu. Les dreyfusards accusent leurs adversaires d'avoir été mus exclusivement par le désir de faire condamner un innocent. À leur tour les anti-dreyfusards accusent leurs adversaires d'avoir été mus exclusivement par le désir de sauver un traître. Passons sur le fait que, d'une manière implicite, on suppose ainsi résolue précisément la question sur laquelle on discute. En effet, parmi les anti-dreyfusards, il y avait certainement des personnes qui tenaient Dreyfus pour un traître, et l'on pouvait bien les accuser d'avoir une opinion fausse, mais non de vouloir faire condamner un innocent ; et vice versa pour les dreyfusards. Mais, dans ces accusations, on néglige un fait beaucoup plus important, au point de vue scientifique : on ignore on l'on feint d'ignorer que, tant parmi les dreyfusards que parmi les anti-dreyfusards, il y avait des personnes qui laissaient de côté la question de savoir si Dreyfus était innocent ou coupable. Elles raisonnaient à peu près ainsi : « Le procès Dreyfus est désormais devenu une bannière, laquelle guide vers un but qui, si on l'atteint, sera nuisible, disaient les anti-dreyfusards, – utile, disaient les dreyfusards, – au pays, ou seulement à notre parti. S'opposer à ces raisonnements au nom de la légalité, du respect de la chose jugée ou de quelque autre principe, suppose résolus les très graves problèmes auxquels il est fait allusion, § 1876 et sv. Les croire résolus, seulement par l'indignation que provoque la condamnation d'un « innocent » est puéril, à moins que l'on ne veuille atteindre à l'extrême de l'ascétisme, et se refuser à toute défense de sa patrie, parce que la guerre envoie à la mort des milliers et des milliers d' « innocents ».
[FN: § 2147-13]
Bismarck tourne fort bien en dérision l'usage de semblables entités en politique. BUSCH ; Les mém. de Bismarck, t. II : « (p. 196) En 1877, quand la guerre russo-turque était imminente, l'Angleterre nous poussait à nous servir de notre influence à Saint-Pétersbourg pour empêcher les hostilités. Le Times nous démontrait que c'était dans l'intérêt de l'humanité ! La reine Victoria tâchait de poser sur le vieil empereur : elle lui écrivait une lettre qu'elle lui faisait remettre par Augusta ; elle m'écrivait à moi [Bismarck], deux lettres coup sur coup pour me conjurer d'intervenir. L'humanité, la paix, la liberté, voilà les mots qu'ils ont à la bouche et qui leur servent de prétextes quand ils n'ont pas affaire à des peuplades sauvages et qu'ils ne peuvent pas invoquer les bienfaits de la civilisation. [C'est pour avoir ajouté foi à ces belles phrases que Napoléon III, E. Ollivier, J. Favre, J. Simon, etc., ont causé la ruine de leur pays ; c'est pour n'y avoir prêté aucune attention que Bismarck a rendu le sien grand et puissant.] C'est au nom de l'humanité que la reine Victoria voulait nous faire prendre en main les intérêts de l'Angleterre, qui n'avaient rien de commun avec les nôtres. C’est au nom de la paix qu'elle cherchait à nous brouiller avec la Russie ! »
[FN: § 2147-14]
BUSCH : Les mém. de Bismarck, t. 1 « (p. 78) Il [Bismarck] me fit ensuite observer que, lorsque les officiers saluaient notre voiture, je n'avais pas, moi [Busch], à leur rendre leur salut. (p. 79) Moi-même, ce n'est pas comme ministre ou comme chancelier qu'on me salue, mais bien comme officier général. Sachez donc que des soldats pourraient s'offenser à bon droit qu'un civil prenne leur salut pour lui ».
[FN: § 2147-15]
On peut voir cela aux dérivations dont on fait usage dans les parlements latins, en toute occasion où a éclaté un conflit entre la force publique et des grévistes ou des manifestants (§ 2147-18) ; c'est le vrai moyen de ceux qui veulent faire et ne pas dire. Au contraire, les syndicalistes mettent d'accord les faits et les paroles, et se rapprochent ainsi beaucoup plus de la réalité. Ils disent qu'ils veulent faire emploi de la force, parce qu'ils sont en guerre avec la bourgeoisie. En vérité, à cet emploi de la force, il n'y a qu'à opposer un autre emploi de la force en sens inverse, et non des argumentations vaines et non concluantes comme font les « spéculateurs ». Ceux-ci, du domaine où l'on fait usage de la force et où ils savent être ou craignent d'être inférieurs à leurs adversaires, s'obstinent à vouloir les attirer dans le domaine où l'on fait usage de la ruse, et dans lequel ils savent de toute certitude que personne ne peut se mesurer avec eux.
[FN: § 2147-16]
Après les incidents de Saverne et les discussions auxquelles ils donnèrent lieu au Reichstag, une ligue se constitua, à Berlin, pour défendre l'organisation prussienne. Journal de Genève, 21 janvier 1914 : La nouvelle Ligue prussienne (Preussenbund) a tenu hier à Berlin sa première assemblée. Cette association se propose de maintenir et d'assurer dans l'empire l'hégémonie de la Prusse et surtout la prépondérance en Allemagne des aspirations prussiennes, des méthodes prussiennes et des manières de penser prussiennes. Sa tendance est essentiellement conservatrice. Son but est la réaction contre la démocratisation lente de l'empire. L'affaire de Saverne a réussi, entre autres conséquences indirectes, à mettre en opposition la Prusse et l'empire. La Ligue prussienne est sortie de ce conflit. Les adhérents se recrutent parmi les hauts fonctionnaires, les officiers, les députés conservateurs et les membres de la Ligue des agriculteurs. Bien des symptômes se sont manifestés au cours des dernières semaines, qui permettent de penser qu'en haut lieu on regarde d'un œil favorable la constitution de la Ligue prussienne : „ Les discours prononcés à l'assemblée d'hier méritent d'être lus avec attention. Ils sont fort caractéristiques, dit le Temps, d'un certain état d'esprit qui règne à cette heure dans les plus hautes sphères du pouvoir “. M. Rocke, président de la chambre de commerce de Hanovre, prononça l'allocution d'ouverture : „ La Prusse, dit-il, est le rempart de l'empire. Cet empire ne doit donc pas se développer aux dépens de la Prusse “. M. de Heydebrandt prit ensuite la parole : „ Bien des gens, dit-il, se demandent si le moment n'est pas venu de défendre en Allemagne la Prusse, son esprit, ses manières d'être. Quel est le trait caractéristique du Prussien ? C'est l'esprit d'ordre, le sentiment du devoir, l'amour de son armée, la fidélité, envers la dynastie. Ce serait une catastrophe sans lendemain si cet esprit prussien cessait de dominer “. Le général de Wrochen fait l’éloge du colonel de Reuter : „ Le rôle du colonel de Reuter a été pour tous un réconfort. Il s'est conduit en Prussien de vieille roche. Nous aurons de tels hommes tant que l'armée continuera d'être monarchiste. Le jugement du 10 janvier fut un soufflet bien mérité à ceux qui avaient parlé trop haut “. Le général de Rogge lui succéda à la tribune. Il déplora les tendances démocratiques de l'empire : „ La mission de la Prusse, dit-il, n'est pas terminée. Il est nécessaire d'infuser au sang allemand une bonne dose de fer prussien “. Un surintendant ecclésiastique, M. de Rodenbeck, a déclaré que la mission de la Prusse comme tutrice de l'Allemagne était voulue par la Providence. Il s'est répandu ensuite en reproches contre les gens du bord du Rhin, „ à qui le vin donne trop d'esprit “. À la fin de la séance, l'assemblée accepta à l'unanimité la résolution suivante : „ La première assemblée de la Ligue prussienne estime que certaines tendances de notre temps cherchent à affaiblir par une démocratisation croissante de nos institutions les fondements de la monarchie. La Prusse ne peut accomplir sa mission allemande que si elle est forte et que si elle est libre de toutes entraves que pourrait lui imposer une trop étroite union avec l'empire. On doit repousser avec énergie tous les assauts de la démocratie contre la Prusse et contre l'indépendance des États confédérés. Il est donc impérieusement nécessaire que tous ceux qui veulent défendre la Prusse contre les attaques de la démocratie s'unissent et travaillent d'un commun accord “ ».
[FN: § 2147-17]
Le 4 décembre 1913, le Reichstag, après discussion sur les incidents de Saverne, approuvait par 293 voix contre 5 un ordre du jour de blâme au chancelier de l'Empire. Celui- ci ne se le tint nullement pour dit et resta à son poste ; l'organisation de l'armée n'éprouva pas la moindre, la plus légère secousse. Le 2 décembre, la Chambre française rejetait par 290 voix contre 265 la proposition Delpierre, acceptée par le ministre, d'inscrire sur les titres de rente à émettre l'immunité fiscale de la rente, et le ministère tomba. La véritable cause de sa chute était qu'il avait voulu renforcer l'armée, et qu'il avait fait approuver la loi qui, de deux ans, portait à trois ans le service militaire. C'est pourquoi, à l'annonce du résultat de la votation, le député Vaillant, illustre antimilitariste, put crier : « À bas les trois ans ! » Voici comment la Gazette de Lausanne, 3 décembre 1913, résume les opinions des journaux français, à re sujet : « La Petite République écrit : „ En saluant le départ des ministres du cri de À bas les trois ans ! M. Vaillant a souligné d'une façon bien humiliante pour plusieurs la signification du vote “. – L'Éclair dit qu'une partie de la Chambre a voulu se venger du vote de la loi de trois ans en refusant l'argent sans lequel l'effort de reconstitution militaire est irréalisable. – Le Matin dit que les adversaires de M. Barthou lui rendront cette justice que sur la question du crédit de la France, il est tombé avec honneur. Le Matin prévoit que le nouveau cabinet sera un ministère d'entente et d'union républicaine. – Le Gaulois dit que la victoire de M. Caillaux, c'est la revanche du bloc sur le congrès de Versailles. Demain peut- être ce sera sa revanche contre l'élu de ce congrès. – La République française réprouve le cri de À bas les trois ans ! Mais, dit-elle, il est logique que ceux qui n'ont pas craint d'exposer la France à la ruine, la désarment devant l'invasion. – L'Action se demande combien de temps durera la coalition de la démagogie révolutionnaire avec la ploutocratie radicale qui vient de renverser M. Barthou aux cris de À bas les trois ans ! – L'Écho de Paris dit que ce n'est pas seulement contre le crédit public que les radicaux ont commis une faute impardonnable en marchant la main dans la main avec les unifiés, c'est encore contre la force nationale. S'il est vrai qu'une nouvelle majorité doit se former, c'est contre la France qu'elle se formera. – Le Journal remarque que les adversaires de la loi de trois ans se sont retrouvés groupés contre la réforme électorale et contre l'immunité de la rente. – La Libre Parole dit que le partage des dépouilles est l'unique souci de la majorité d'hier. Aux chefs on offre les portefeuilles ; aux uns la réforme électorale est jetée en pâture, aux autres la loi de trois ans. – L'Homme libre écrit : ,, Toute faute se paie. Une longue série de défaillances politiques a causé des difficultés financières qui ne peuvent être résolues que si tous les républicains reviennent à la discipline et à l'abnégation “ ». La conséquence fut que l'armée et la marine retombèrent sous la direction de ministres qui cherchaient beaucoup plus à contenter une clientèle démagogique qu'à préparer la défense de la patrie.
[FN: § 2147-18]
Un autre exemple de dérivations très usitées est le suivant. Le but de chacun des partis aux prises est d'obtenir des avantages et de soigner ses intérêts, même en agissant à l'encontre des règles généralement acceptées, que l'on veut feindre de respecter. Voici comment on s'y prend. – Du côté des révolutionnaires : Premier acte. Tandis que se produit le conflit entre eux et la force publique. Celle-ci ne doit pas faire usage de ses armes ; elle doit laisser faire le « peuple », les grévistes, les rebelles. Si jamais – par hypothèse – il arrive aux révolutionnaires de commettre des délits, il y a des tribunaux pour les juger. La force publique doit uniquement les conduire devant le tribunal ; il ne lui est pas permis de faire autre chose En tout cas, ces délits, ou du moins la majeure partie d'entre eux, ne méritent certainement pas la peine de mort, laquelle serait, au contraire, infligée à celui qui aurait été frappé par les armes de la force publique. À qui jette des pierres, on ne peut opposer des coups de fusil. [On a vu, en Italie, des gendarmes auxquels il était défendu de faire usage de leurs armes, ramasser les pierres que leur avaient jetées les grévistes, et s'en servir pour se défendre de la lapidation.] En somme, la force publique ne peut qu'opposer une résistance patiente et passive. Avec de telles dérivations s'affaiblissent les sentiments de ceux qui supporteraient difficilement l'impunité totale des grévistes ou d'autres révolutionnaires qui frappent, parfois tuent et saccagent. Deuxième acte. Après le conflit. Désormais, ce qui est fait, est fait. Une amnistie est nécessaire (la grâce est trop peu de chose), pour effacer tout souvenir de discordes civiles, pour pacifier les esprits, par amour pour la patrie. La mémoire du public n'est pas longue ; il a bientôt oublié les crimes commis ; celui qui est mort, est mort, et celui qui est vivant fait à sa guise ; il tâche d'avoir la paix, et mieux encore de gagner de l'argent, sans trop se soucier du passé ni de l'avenir ; aussi se contente-t-il de ces dérivations, qu'il fait siennes à l'occasion. – Troisième acte. Les conséquences. Les délits n'ont pas été, empêchés ni réprimés par la force, parce que la répression « devait » être effectué par les tribunaux. Ceux-ci ne l'ont pas accomplie, grâce à l'amnistie. Reste uniquement l'impunité pour le passé et une promesse d'impunité semblable pour l'avenir. Tel était précisément le but auquel on tendait par les dérivations. – Du côté des gouvernants. Premier acte. Tandis qu'on veut imposer quelque chose par la force. Ce n'est pas le moment de décider si cette chose est légale ou non, juste ou injuste. Que le citoyen obéisse, et ensuite, s'il croit avoir raison, qu'il s'adresse aux tribunaux. Cette dérivation et d'autres semblables satisfont le sentiment de ceux auxquels il répugnerait trop de consentir à des actes arbitraires et des injustices au détriment des citoyens. Il ne peut y avoir d'arbitraire ni d'injustices, puisque enfin les tribunaux demeurent juges du fait. – Second acte. Après le fait accompli. Si quelque naïf suit le conseil qu'on lui a donné et s'adresse aux tribunaux, il s'entend répondre qu'ils ne sont pas compétents, et qu'il doit recourir à l'autorité, laquelle est seule juge des faits et gestes de ses agents. Et s'il pousse la naïveté jusqu'à suivre cette voie, il apprend à ses dépens que les loups ne se mangent pas entre eux, et tout est dit. Il en doit être ainsi pour sauvegarder la majesté du gouvernement, le respect de la loi, l'ordre public. La raison d'État doit l'emporter, de droit ou de force, sur les intérêts particuliers. Ces dérivations sont acceptées par le sentiment de ceux qui estiment que le pouvoir public ne doit pas être entravé par le caprice de quelques citoyens, et par ceux qui savent combien il importe, à l'utilité sociale que l'ordre soit maintenu. – Troisième acte. Les conséquences. La classe gouvernante a pu commettre impunément actes arbitraires et injustices ; elle pourra les renouveler quand bon lui semblera. Tel était le but des dérivations. – Le lecteur prendra garde, pourtant, que dans ce cas comme dans le précédent, les dérivations ne sont pas la cause principale des phénomènes, mais qu'elles ne sont en très grande partie que le voile sous lequel agissent les forces qui produisent les phénomènes.
[FN: § 2147-19]
Celui qui croit cela peut raisonner de la façon suivante : « Si le chancelier était tombé du pouvoir, comme conséquence du vote de blâme du Reichstag, l'Allemagne se serait engagée dans une voie qui inévitablement ou seulement même très probablement conduit à avoir un ministre comme Lloyd George, en Angleterre, et pis encore, à confier l'armée et la marine à des ministres qui les désorganisent, tels André et Pelletan, en France : ce qui exposerait l'Allemagne a être vaincue et détruite, dans une guerre avec ses ennemis. À cette effrayante catastrophe, nous préférons le petit mal qui consiste à laisser impunis quelques actes arbitraires de certains militaires. Nous ne voulons pas entrer dans une voie qui mène aux désastres : principiis obsta ». Le point faible de ce raisonnement ne peut se trouver que dans l'affirmation inévitablement, très probablement. En d'autres termes, il faut que les adversaires démontrent par de bonnes raisons que l'analogie entre un mouvement possible en Allemagne et les mouvements effectivement observés, en Angleterre et en France, n'existe pas, et que l'Allemagne, entrée dans la voie de l'omnipotence du Reichstag, ne continuera pas jusqu'à l'état de choses latin, mais s'arrêtera en un point intermédiaire entre le présent état de choses latin et le présent état de choses germanique. Mais opposer à ce raisonnement des principes abstraits d'une foi quelconque est, au point de vue scientifique, aussi vain que recourir à l’oracle de Delphes.
[FN: § 2154-1]
Par exemple, beaucoup de médecins ont la tendance de réduire la société en un troupeau de moutons dont ils seraient les bergers bien payés et très vénérés. Les oppositions raisonnées à cette oppression et à cette exploitation demeurent souvent vaines, parce que les gens s'effraient des discours absurdes de certains médecins, comme le Malade imaginaire de Molière tremblait aux menaces du docteur Purgon. On peut, au contraire, parfois opposer avec efficacité à ces discours absurdes d'autres discours absurdes, tels que ceux de la christian science ou de la médecine naturelle. En 1913, afin de ramener à l'obéissance les cantons suisses qui s'obstinaient à faire preuve d'indépendance, les médecins et leurs partisans proposèrent une adjonction à la constitution fédérale, pour donner à l'autorité fédérale le pouvoir d'édicter des lois sur un très grand nombre de maladies, même non contagieuses. À la votation populaire, la presque unique opposition efficace fut celle des fidèles de la médecine naturelle. – Journal de Genève, 8 mai 1913 : « L'article constitutionnel sur les „ maladies fédérales “ s'est heurté de même que dans la Suisse orientale à une opposition silencieuse mais décidée. Deux ou trois districts du canton de Zurich l'ont rejeté. C'est que le nombre est grand, dans cette région de notre pays, des partisans des méthodes thérapeutiques naturelles, auxquels la science médicale officielle ne dit rien qui vaille et qui en redoutent les empiétements. Ils craignent que la nouvelle modification constitutionnelle n'ouvre la porte à des contraintes dont ils ne veulent pas entendre parler, telles que la vaccination obligatoire ». Il se peut que ceux qui sont opposés à la vaccination aient tort ; mais lorsqu'on voit, en Italie, les partisans de la vaccination aller jusqu'à faire un procès à un homme de science qui expose honnêtement sur ce sujet une opinion scientifique, on est tenté de conclure que les antivaccinistes accomplissent une oeuvre sociale utile, en s'opposant à l'œuvre de ceux qui voudraient imposer par le code pénal une science officielle.
[FN: § 2160-1]
FUSTEL DE COULANGES ; Questions historiques. – Paris 1893 : « (p. 8) Si vous cherchez quel est le principe qui donne cette unité et cette vie à l'érudition allemande, vous remarquerez que c'est l'amour de l'Allemagne. Nous professons en France que la science n'a pas de patrie [cela n'est pas si vrai] ; les Allemands soutiennent sans détour la thèse opposée : Il est faux [abus habituel des termes faux, vrai, dont on ne comprend pas la signification] dit M. de Giesebrecht, que la science n'ait point de patrie et qu'elle plane au-dessus des frontières la science ne doit pas être cosmopolite [autre abus du terme doit ; que signifie-t-il et si quelqu'un fait fi du devoir que lui impose le très respectable M. Giesebrecht, qu'arrivera-t- il ?], elle doit être nationale, elle doit être allemande “. Les Allemands ont tous le culte de la patrie, et ils entendent le mot patrie dans le sens vrai [salut à l'épithète vrai!] : c'est le vaterland, la terra patrum, la terre des ancêtres, c'est le pays tel que les ancêtres l'ont eu et l'ont fait. Ils n'en parlent que comme on parle d'une chose sainte ». C'est ainsi que les Athéniens parlaient du soleil, et ils furent pris d'une grande indignation contre l'impiété d'Anaxagore, qui disait que le soleil était une pierre incandescente. « (p. 9) L'érudition en France est libérale ; en Allemagne, elle est patriote ». L'une et l'autre peuvent être utiles ou nuisibles au pays, mais elles sont également différentes d'une érudition qui serait exclusivement expérimentale. Sous l'impression de la guerre de 1870, Fustel de Coulanges écrit : « (p. 16) Mais nous vivons aujourd'hui dans une époque de guerre. Il est presque impossible que la science conserve sa sérénité d'autrefois ». Heureusement pour l'histoire scientifique, Fustel de Coulanges fit preuve de cette sérénité dans beaucoup de ses ouvrages, qui, de cette façon, se rapprochent assez de l'histoire expérimentale ; et nonobstant l'émotion qu'il éprouve, il a assez de force de caractère pour s'écrier : « (p. 16) Nous continuons à professer, en dépit des Allemands, que l'érudition n'a pas de patrie ». Du reste, pour être exact, il faudrait dire « l'érudition scientifique », afin de faire bien ressortir la différence entre cette érudition et celle qui a un but d'utilité sociale.
[FN: § 2163-1]
K. WALISZEWSKI ; Le roman d'une impératrice : Catherine II. L'auteur observe que l'on se demande si l'empereur Pierre fut tué par Orlof ou par Tieplof : « (p. 190) Orlof ou Tieplof, la question peut paraître secondaire et de mince importance. Elle ne l'est pas. Si Tieplof a été l'instigateur du crime, c'est que Catherine en a été la suprême inspiratrice. Car, comment admettre qu'il ait agi sans son consentement ? Il en va autrement pour Orlof. Lui et son frère Grégoire étaient, devaient rester quelque temps encore maîtres jusqu'à un certain point d'une situation qu'ils avaient faite... Ils n'avaient pas pris l'avis de Catherine pour commencer le coup d'État ; ils peuvent bien ne pas l'avoir consulté cette fois encore ». Il importe beaucoup de résoudre ce problème pour porter un jugement éthique sur Catherine. Cela n'importe pas le moins du monde, pour porter un jugement sur l'utilité sociale des faits. Que le problème soit résolu dans un sens ou dans un autre, on ne voit pas que cela puisse avoir le moindre rapport avec la prospérité de la Russie.
[FN: § 2164-1]
Voir, à ce propos, AUGUSTIN COCHIN ; La crise de l'histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard : « (p. 16) Résumons cet inventaire [des erreurs de Taine] : sur plus de 550 références données dans les 140 pages de l'Anarchie spontanée, M. Aulard relève 28 erreurs matérielles, qu'il faut réduire à 15,6 erreurs de copie, 4 erreurs de page, 2 de dates et 3 coquilles d'imprimerie – moyenne honorable, en somme, et que M. Aulard lui-même, au moins dans son livre sur Taine, est fort loin d'atteindre, puisqu'il se trompe, dans ses rectifications, à peu près une fois sur deux... (p. 17) Il [Taine] ouvrit le premier les cartons des archives, se trouva dans une forêt vierge, prit à brassée les faits et les textes. Il n'eut pas le temps d'être pédant, ni d'être complet. – Eut-il celui d'être exact ? Ses amis n'osaient trop en jurer. Ses adversaires le niaient d'abondance, par exemple M. Seignobos [lequel ne sait pas distinguer de l'histoire scientifique les divagations de sa théologie démocratique] : „ Taine, dit-il, est probablement le plus inexact des historiens de ce siècle “. Le livre de M. Aulard donne un démenti à M. Seignobos. L'œuvre de Taine a cette rare fortune de recevoir d'un adversaire aussi partial que savant [M. Cochin veut faire preuve de grande courtoisie] le baptême du feu. Elle y gagne la seule consécration qui lui manque : celle des trente ans d'érudition de M. Aulard. Chaque fait avancé par Taine aura désormais deux garants : la science de l'auteur qui l'affirme, la passion du critique qui ne le conteste pas ».
[FN: § 2165-1]
A. COCHIN ; La crise de l’hist. révol. : « (p. 99) Verrons-nous la fin de cette crise [ de l'histoire de la révolution] ? Je le crois, mais à deux conditions : La première est de nous mieux garder du fléau de toute curiosité, l'indignation... (p. 100) La seconde condition est que la critique nous débarrasse enfin du fétiche révolutionnaire, le Peuple ; qu'elle le renvoie à la politique, comme la Providence à la théologie, et donne à l'histoire de défense, dans le musée des mythes religieux, la place dont elle n'aurait pas dû sortir. Si nos historiens ne l'ont pas fait encore, c'est que, l'anthropomorphisme du peuple est plus récent, plus spécieux aussi que celui de la Providence. Il en imposait encore du temps où l'on distinguait mal, au revers des „ principes “ le jeu de la machine sociale, et les lois de la démocratie pratique. Taine, et M. Aulard sont des historiens de ce temps-là, des historiens d'ancien régime ».
[FN: § 2166-1]
Nous pouvons voir, à chaque instant, en de beaucoup moindres proportions, des faits et des jugements analogues, lorsqu'un conflit a lieu entre la force publique et des grévistes, et qu'il y a des morts ou des blessés. Ceux qui défendent la force publique disent que cela est arrivé par la faute des grévistes, qui voulaient se livrer à des actes que la force publique interdisait. Ceux qui défendent les grévistes disent que cela est arrivé par la faute de la force publique, qui a manqué de patience, et qui a voulu s'opposer aux grévistes. Pour savoir qui a raison ou tort, il est nécessaire de connaître quel sens on veut donner au terme faute. Si l'on admet que les ordres de la force publique doivent toujours être respectés, et que quiconque ose y désobéir le fait à ses risques et périls, c'est le défenseur de la force publique qui a raison. Si l'on admet que la force publique doit toujours respecter les grévistes, et que quiconque ose leur faire violence commet un crime, c'est le défenseur des grévistes qui a raison. Mais ainsi nous avons résolu un problème éthique, non pas un problème concernant les rapports des phénomènes sociaux, et il nous reste à connaître par quels sentiments, par quels intérêts sont mus les partis en lutte, et quelles seront les conséquences des différentes solutions que l'on peut donner à la discussion, eu égard à l'organisation sociale et aux diverses utilités. La force publique est employée dans tous les pays, pour imposer des mesures que l'on peut diviser en deux catégories : (A) Mesures favorables ou au moins indifférentes à la collectivité : (B) mesures nuisibles à cette collectivité. Quiconque admet que la résistance à la force publique est toujours nuisible à la collectivité, admet par ce fait que l'un des deux cas suivants se réalise : 1° que (A) ne peut jamais être séparé de (B), et que l'utilité de (A) l'emporte sur le dommage de (B) ; 2° que (A) peut toujours être séparé de (B) autrement que par la résistance à la force publique. Cette dernière proposition est contredite par l'histoire. Un grand nombre de transformations utiles ou très utiles aux sociétés humaines ont été obtenues seulement par la résistance à la force publique, à laquelle on a opposé une autre force. Vice versa, quiconque envisage favorablement, dans tous les cas, la résistance à la force publique, admet : 1° que (A) ne peut être en aucune façon séparé de (B), et que le dommage de (B) l'emporte sur l'utilité de (A) ; 2° que (A) ne peut jamais être séparé de (B autrement que par la résistance à la force publique. Même cette dernière proposition est contredite par l'histoire, qui nous montre qu'un grand nombre de transformations utiles ou très utiles aux sociétés humaines ont été obtenues autrement que par la résistance à la force publique. Il suit donc de là que ces problèmes ne peuvent être résolus a priori en un sens ou en l'autre, mais qu'il est nécessaire d'examiner quantitativement, en chaque cas particulier, de quel côté se trouve l'utilité ou le dommage. C'est précisément un caractère des dérivations éthiques, de substituer a priori, en ces cas, une solution unique et qualitative aux solutions multiples et quantitatives que l'expérience donne a posteriori. C'est pourquoi les solutions éthiques ont, auprès du vulgaire, plus de succès que celles de l'expérience, car elles sont plus simples et plus faciles à comprendre sans une longue et fatigante étude d'un grand nombre de faits (§ 2147-18).
[FN: § 2169-1]
Beaucoup de personnes ont dit et répété ce qu'exprime BARRAS dans Ses Mémoires, II: « (p. 446) ... telle est l'illusion des passions, qu'en s'occupant le plus d'un intérêt particulier, elles s'imaginent souvent qu'elles ne travaillent que pour l'intérêt public ».
[FN: § 2174-1]
Voir G. SOREL ; Réflexions sur la violence. Paris, 1910.
[FN: § 2174-2]
Par exemple, les mêmes journaux se montraient profondément indignés des « actes arbitraires » des militaires, à Saverne (§ 2147), et très indulgents envers les actes arbitraires et de sabotage commis exactement au même moment par des ouvriers grévistes. Vice versa, ceux qui approuvaient l’emploi de la force à Saverne, étaient profondément indignés si leurs adversaires usaient de la force.
[FN: § 2180-1]
Les exemples du passé sont trop nombreux et trop connus, pour être cités ici. Relevons seulement un exemple tout récent. En 1913, à Orgosolo, en Sardaigne, certains citoyens substituèrent leur action à celle de la justice, laquelle faisait défaut. Le fait mérite d'être rapporté, parce qu'il est typique pour le passé, et démontre comment, avec d'autres moyens et sous d'autres formes, il peut en être à l'avenir. Deux familles, celle des Succu et celle des Corraine, étaient en conflit, dans cette contrée, pour des raisons particulières. La première sut se concilier la faveur du gouvernement, et par conséquent celle de la justice. La seconde, s'estimant de ce fait opprimée, recourut aux armes. – Giornale d'Italia, 5 octobre 1913 : « Orgosolo, 3 octobre. La bande de brigands qui infeste le territoire d'Orgosolo a commis un nouveau crime atroce. En effet, on a retrouvé aujourd'hui, dans la région de La Mela, les cadavres de deux messieurs et de leur domestique, tués par la bande. Les trois personnes assassinées sont Succu Giuseppe, Succu Giovanni et leur domestique, Michele Picconi. Les trois cadavres sont criblés de coups et horriblement mutilés. Picconi a une oreille coupée. Giovanni Corraine tient ses promesses : an fur et à mesure que s'acharnent contre lui les efforts des soldats et des gendarmes lancés à sa poursuite, il donne une nouvelle preuve de sa force et de sa vengeance. Le crime d'aujourd'hui était prévu dans le pays : dans l'une de mes entrevues avec Piredda Egidio, l'un des principaux persécutés, celui-ci m'avouait en tremblant que chacun d'eux se levait le matin avec la frayeur de ne pas voir le soir ; et il ajoutait, en présence des fonctionnaires qui assistaient à la conversation, que, nonobstant la protection que la force publique accordait aux persécutés en les faisant escorter par les gendarmes, chaque fois qu'ils faisaient un pas hors de chez eux, ils s'étaient tous préparés à mourir. Et sur le visage de cet homme se lisait l'angoisse de celui qui vit sous une menace invincible, de celui qui comprend l'inutilité de la lutte contre une force diabolique absolument supérieure. Piredda avait raison. La nuit où les gendarmes fondirent sur sa maison et arrêtèrent sa mère et sa sœur, fleur admirable de jeunesse, Giovanni Corraine était à quelques mètres d'elles, dissimulé dans l’ombre, et, serrant son fusil, il jurait de se venger. On le sait, le frère de Giovanni Corraine me l'a avoué, le jour où, avec sa face malingre et pâle d'enfant, il me déclarait d'une voix ferme qu'on ferait justice à ceux qui cachaient au fond de la prison deux femmes innocentes, en se servant d'amitiés supérieures. Car, telle est l'opinion arrêtée des bandits et de tous les habitants d'Orgosolo, qu'ils sacrifieraient leur sang et leur liberté pour les aider ; que les Cossu, ennemis jurés des Corraine, réussissent à commettre leurs exactions et leurs injustices, en se prévalant des protections qu'ils ont en « haut lieu », et que, suivant la mentalité des opprimés, ils empêchent l'application sereine de la justice. C'est ce qu'ils pensèrent, le jour où les jurés d'Oristano acquittèrent l'assassin de l'un des frères Corraine ; c'est ce qu'ils pensèrent, la nuit où la police secrète, espérant couper les vivres aux bandits par une arrestation en masse de la faction Corraine, traîna aux prisons de Nuoro tous les représentants les plus en vue de cette faction. Et quand, devant la maison des Cossu, Medda Corraine, la plus belle enfant d'Orgosolo, passait menottée entre les gendarmes, son imprécation contenait l'avertissement féroce et tragique qui a aujourd'hui son épilogue sanglant : „ Dieu vous maudira pour le mal que vous faites à notre famille, et il ne vous permettra pas de jouir de cette vie d'infamie... “ Et elle agitait, dans un geste inhumain d'imprécation, ses poignets serrés par les menottes. Aujourd'hui, son frère recueille cette imprécation et tue. Les assassins d'aujourd'hui sont les deux frères Giuseppe et Giovanni Succu, de cette malheureuse famille qui peuple de dizaines de croix funéraires le petit cimetière tranquille d'Orgosolo. Ils disparurent tous un à un, sous le plomb infaillible des bandits. Le pays regarde en silence le carnage, et continue à envoyer du pain, des munitions et de l'argent aux abili, comme on les appelle, à ceux qui vivent en sauvages dans le bois, respirant la vengeance ». Peu de temps après, le même journal (9 octobre 1913) publie une conversation avec un « haut personnage » ; elle explique bien le phénomène : « La haine profonde qui divise les familles connues d'Orgosolo, et qui fut déjà cause de tant de crimes, provient d'un ensemble de causes. Pour être clair, commençons par spécifier que les familles « menacées » sont les familles Cossu, Pinedda, Podda et Pisano, et que celles auxquelles appartiennent et que favorisent les défaillants, sont les familles Succo, Corraine, Moro, De Vaddis. [Ces noms ne correspondent pas précisément à ceux qui sont indiqués plus haut, mais cela n'a que faire avec le fond des faits, qui seul nous importe.] Et les causes qui ont vraiment et immédiatement déterminé les crimes ? – Voici. La cause première et la plus reculée doit être cherchée dans une obscure question d'héritage, au sujet de laquelle il est désormais trop difficile de se retrouver. Mais une cause grave et moins lointaine fut la suivante. Une demande en mariage faite au nom d'une jeune fille des Cossu fut refusée par les Corraine. Peu de temps après, l'affront était rendu ; un jeune homme du „ second groupe “ de familles, lequel avait demandé la main d'une jeune fille du „ premier groupe “, fut également refusé. La haine commença à s'allumer violente. Mais peu de temps après, ce fut pis : l'un des Corraine fut trouvé noyé dans un puits. Ensuite d'une instruction dans les formes, la police secrète et la police judiciaire admirent d'une manière concordante que Corraine s'était suicidé ; mais les Corraine et leurs partisans estimèrent et estiment encore que leur parent avait été assassiné par leurs ennemis, et que l'autorité, pour protéger les Cossu, avait inventé la petite histoire du suicide. – Tristes suggestions de la passion ! – Mais il est une autre suggestion, je ne dis pas plus triste, mais encore plus étrange. Dans un conflit entre les gendarmes et les détaillants, un De Vaddis fut tué. Eh bien, les De Vaddis et leurs partisans estimèrent et estiment encore que leur parent fut tué par le „ groupe “ des Cossu, et que l'autorité, toujours pour protéger les Cossu, avait inventé cette fois le conflit avec les gendarmes. – Mais pourquoi, même dans l'idée erronée des Corraine et des autres, l'autorité protégerait-elle les Cossu ? – Parce que les Cossu étaient la plus vieille et la plus riche famille d'Orgosolo. Je dis « étaient », parce que maintenant la famille est détruite, hommes et biens, et que le vieil Antonio Cossu a dû se réfugier à Nuoro où, pour le protéger, sa maison est constamment gardée par des gendarmes de planton. Continuons. Le „ groupe “ des Corraine avait donc désormais à venger, outre les offenses anciennes, deux offenses nouvelles : ses deux morts ; car aucune force de persuasion n'arrivera jamais à ôter de la tête aux Corraine que leurs deux parents n'ont pas été assassinés par leurs ennemis. Alors commença la terrible œuvre de vengeance : les écuries et les bois brûlés, le bétail dérobé et coupé aux jarrets, les enfants séquestrés, les hommes tués. – Et les défaillants ?... – Justement. Il y a environ un mois, la police secrète, outre qu'elle poursuivait sans trêve les défaillants, arrêta leurs complices ; et il y eut, entre hommes et femmes, trente personnes. Le groupe des Corraine frémit, et crut à une nouvelle machination de l'autorité, parce que tous les gens arrêtés étaient des siens. Et en cela non plus, personne ne réussit à les persuader que les complices des méfaits commis par eux ne pouvaient certainement pas être recherchés dans le groupe des familles ennemies, qui, désormais terrorisées, n'osaient plus sortir de chez elles. – Et les arrestations turent-elles maintenues ? – Oui. L'autorité judiciaire, après une longue et minutieuse instruction, conclut à les renvoyer en jugement pour « association en vue de commettre un crime ». Ce fut le coup final qui déchaîna la fureur. Les deux mois que dura l'instruction furent deux mois de trêve : on n'entendit pas parler des défaillants, aucun attentat ni aucun vol ne furent commis dans la campagne. Évidemment, le groupe qui était à la tête des gens arrêtés espérait que les arrestations ne seraient pas maintenues, et ne voulait pas indisposer les juges. Mais à peine eut-on connaissance du renvoi en tribunal, que la tempête éclata... – Et malheureusement, depuis quinze jours, les crimes succèdent aux crimes... – Et la force publique est impuissante à les empêcher ou à les réprimer. – Et cette impuissance dérive ? – De nombreuses causes ; mais surtout de celle-ci : que toute la population du territoire d'Orgosolo, je dis toute, est favorable aux défaillants. – Et pourquoi ? – Parce que la persuasion est répandue qu'à l'origine eux ou leurs familles n'ont pas obtenu justice, et qu'ils ne sont donc pas des criminels, mais des opprimés qui se font justice eux- mêmes. En Sardaigne aussi, et spécialement dans la circonscription de Nuoro „ se faire justice soi-même “ par n'importe quel moyen et à n'importe quel prix ne passe jamais pour déshonorer personne. C'est pourquoi, „ dans toute la population de la circonscription “ où surabondent pourtant les honnêtes gens, les gendarmes ne trouvent pas le moindre appui ou la moindre information sur les mouvements des défaillants ; tandis que ceux-ci sont parfaitement et rapidement informés de tout mouvement de la force publique, et que le ravitaillement en vivres et en munitions ne leur fait pas défaut. Vous, qui connaissez le territoire de Nuoro, ne fût-ce que pour l'avoir vu en passant, vous devez comprendre que la force publique se trouve e n présence de difficultés vraiment insurmontables ». Et maintenant écoutons ce que disent, non plus des populations pauvres et ignorantes, mais les magistrats mêmes auxquels est confié l'exercice de la justice. Le Giornale d'Italia, 2 septembre 1913, renferme le compte-rendu suivant du congrès de Naples des magistrats judiciaires italiens : « Le magistrat Giulio Caggiano poursuit ainsi son rapport sur le déni de justice. L'histoire enseigne que le défaut et la faiblesse des organes juridictionnels est un retour, lent peut-être, à des époques reculées de barbarie ; que la teppa, la camorra, la maffia, le brigandage, sont des formes de criminalité, collective, tirant précisément leur origine de la méfiance envers la justice officielle. Les lois les meilleures deviennent des sornettes, comme les fameuses „ grida “ du temps de don Rodrigo [allusion aux Promessi sposi de Manzoni], si les organes pour en imposer le respect et l'exécution font défaut. Et il ne faut pas oublier une autre face de la question ; elle concerne plus directement la dignité de notre ordre : si une partie du public est capable de comprendre que ce n'est pas par incapacité ou par inactivité des juges que se développe le germe funeste du déni de justice, la majorité n'hésite pas à l'attribuer généralement à la paresse, à l'incompétence ou au mauvais vouloir des personnes ». Le public croit aussi, et avec raison, que souvent l'intromission des politiciens et du gouvernement qui les protège, enlève aux sentences des tribunaux tout caractère de droit et de justice. Dans les cas très graves, les fiers et énergiques habitants de la Sardaigne et de la Sicile s'arment d'un fusil, tandis qu'en des cas semblables, les populations plus douces du continent courbent la tête. C'est ainsi que même parmi des populations très civilisées, la justice privée commence à se substituer à la justice publique. – La Liberté, 8 novembre 1913 : « Le geste fatal. C'était à prévoir ; un jour ou l'autre, un acte violent devait répondre à une de ces extraordinaires fantaisies par quoi, depuis un certain nombre d'années, se signale le jury. Le geste fatal a été accompli en pleine cour d'assises : un individu était accusé par ses deux fils d'avoir tué leur mère, dont on avait trouvé le cadavre dans un puits avec une corde au cou ; le jury venait de déclarer l'accuse non coupable et la cour de prononcer son acquittement, lorsque le plus jeune des fils accusateurs se précipite vers son père et le blesse d'un coup de revolver en s'écriant : „ La Justice peut acquitter ce coquin, moi, jamais ! “ Cris, tumulte ; les assistants se jettent sur le justicier volontaire et s'apprêtent à le lyncher ; les gardes parviennent à l'arracher aux mains de la foule et le conduisent en prison, tandis que l'acquitté, dont la blessure est légère, va signer la levée d'écrou et est remis en liberté. En plein prétoire, un individu s'est cru le droit de se substituer à la justice défaillante pour réformer son arrêt, tandis que la foule se croyait pareillement le droit de se substituer à la justice pour la répression de l'attentat. Voici ce qui s'est passé, il y a quelques jours, à la cour d'assises du Cher ; l'événement est trop grave pour ne pas attirer l'attention de tous les honnêtes gens qui s'imaginent encore vivre dans une société organisée. N'hésitons pas à le dire : si de pareils faits sont possibles, la faute en est sans contestation aux innombrables acquittements que prononce le jury dans des cas où une répression s'impose. Nombre de ces acquittements ont fait scandale et donné une singulière valeur à la parole de cet avocat qui, résumant une longue expérience, déclarait que, „ coupable, il ne voudrait pas d'autre juridiction que le jury “ ». L'auteur n'a raison qu'en partie. La « faille » – nous dirons mieux la cause – de ces faits ne doit pas être recherchée uniquement dans le jury. Souvent les magistrats font encore pis. Elle ne doit pas non plus être recherchée exclusivement dans l'organisation judiciaire, laquelle vaut ce que valent les hommes qui la mettent en œuvre. Elle dépend principalement de ce que, par un concours de nombreuses circonstances, l'autorité publique abandonne son office d'assurer la justice.
[FN: § 2180-2]
APPIANI lib. I, de bellis civil., 104, raconte qu'après avoir abdiqué la dictature, respecté encore par tout le monde, à cause de la crainte qu'il continuait à inspirer, Sulla ne fut insulté que par un jeune homme auquel il dit : « que cet adolescent empêcherait un autre homme qui aurait le pouvoir [de la dictature], de le déposer. Peu de temps après, il en advint ainsi aux Romains, lorsque Caius César ne voulut pas déposer le commandement ». L'anecdote a été probablement inventée pour expliquer ce dernier fait ; mais ceux qui l'inventèrent et ceux qui l’acceptèrent avaient bien vu où l'œuvre de Sulla était en défaut. En effet, sitôt qu'il fut mort, les Romains retournèrent à leurs dissensions habituelles, et les deux consuls s'attaquèrent l'un l'autre avec acharnement. C'est le phénomène habituel, qui nous montre que là où la force publique faiblit, la force des factions ou des particuliers s'y substitue.
[FN: § 2180-3]
Les humanitaires se complaisent à répéter ce mot : « On peut tout faire, avec des baïonnettes, excepté s'asseoir dessus » ; mais ils ne nous disent pas si, à leur avis, le pouvoir d'Auguste et de ses successeurs ne reposait pas, au moins en partie, sur la force des prétoriens et des légionnaires. Il est vrai que tous ces soldats se servaient d'épées et non de baïonnettes; mais l'un vaut l'autre.
[FN: § 2180-4]
AULARD ; Hist. pol. de la rév. franç. : « (p. 177) Le 29 novembre [1791], l'Assemblée législative décréta, entre autres mesures, que les ecclésiastiques qui avaient refusé d'accepter la constitution civile seraient tenus de prêter, dans la huitaine, le serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, ou serment civique... Le roi ne voulut pas donner sa sanction à ce décret... De même, le veto royal s'était opposé à un décret du 9 novembre, par lequel étaient menacés de la peine de mort les émigrés qui ne rentreraient pas et continueraient à conspirer contre la patrie... Une subtile politique d'attente, d'intrigue au dedans et au dehors, était masquée par un ministère sans cohésion, sans programme, où il y (p. 178) avait des intrigants, des contre-révolutionnaires décidés... (p. 179) Le roi se résigna à licencier sa garde, mais il refusa sa sanction aux décrets sur les prêtres et sur le camp... ». Sulla avait une autre politique. Il se souciait peu d'offenser les dieux des temples, qu'il dépouillait pour entretenir ses soldats, et n'obéissait pas au Sénat, qui voulait lui enlever les légions. Duruy observe avec justesse que lorsque Sulla marcha sur Rome, « (t. II, p. 576) du moment qu'il se décidait à tirer l'épée contre des gens qui n'avaient qu'un plébiscite pour se défendre, le succès était certain », Plus tard, Jules César aussi s'en remit à l'épée contre les décrets du Sénat, et eut la victoire. M. Aulard, qui certes ne peut être suspecté de favoriser la monarchie, avoue qu'après la manifestation du 20 juin 1792, « (p. 187) il y eut dans la classe bourgeoise et dans une partie de la France une recrudescence de royalisme. Vingt mille pétitionnaires et un grand nombre d'administrations départementales protestèrent contre l'insulte faite à la majesté royale, insulte que l'on présenta comme une tentative d'assassinat ». Il fallait autre chose que des pétitions ! C'était des armes qui étaient nécessaires. Mais messieurs les humanitaires ont-ils donc l'esprit si obtus qu'ils ne comprennent rien à l'histoire ? Puis M. Aulard nous rapporte l'histoire du célèbre « baiser Lamourette » (7 juillet 1792), et conclut « (p. 188) Ainsi tous les défenseurs du système bourgeois se trouvaient groupés et d'accord pour défendre le trône, pour empêcher le retour des scènes du 20 juin et pour en punir les auteurs ». Belle défense, de discours et d'intrigues ! Il ne manquait à ces bravos gens que la foi en leur force : l'énergie pour combattre, le courage de tomber dans la bataille, les armes à la main... rien d'autre. « (p. 189) On a vu qu'elle [l’assemblée législative] avait dissous la garde du roi, et le roi avait sanctionné ce décret. Après avoir ôté au roi ses moyens de défense contre une insurrection populaire, elle avait elle-même cherché à former une force militaire pour déjouer les projets du roi ou de la cour ». Ensuite il arriva ce qui est toujours arrivé : celui qui savait faire usage de la force vainquit celui qui ne savait pas s'en servir : et ce fut alors un bonheur pour la France, ainsi qu'il en avait été pour d'autres pays par le passé ; car la domination des forts est généralement meilleure que celle des faibles.
[FN: § 2187-1]
Par exemple, en Italie, il est admis que le gouvernement doit payer aux industriels qui fournissent du matériel aux chemins de fer un prix tel qu'il soit égal au coût plus un modeste surplus. Il est donc évident que si, par suite de grèves, le coût devient plus grand, ce sont les contribuables qui ont à payer l'augmentation, et les industriels qui continuent à toucher leur bénéfice. On a vu plusieurs fois ces industriels et d'autres, parmi lesquels les constructeurs de navires, provoquer eux-mêmes une grève de leurs ouvriers, ou du moins en faire la menace, pour exercer une pression sur le gouvernement et en obtenir des commandes aux prix qui leur convenaient. Les coopératives qui se chargent de travaux publics procèdent d'une manière analogue, eu se passant de la médiation des patrons.
[FN: § 2190-1]
Presque toujours, le fait d'avoir étudié ces phénomènes au point de vue éthique a empêché les auteurs de voir les uniformités que ces phénomènes présentent pourtant d'une manière évidente. Quand un historien raconte une révolution, son principal souci est de rechercher si elle est « juste » ou « injuste » ; et comme ces termes ne sont pas définis, cette recherche se confond avec celle de l'impression que l'auteur éprouve de la connaissance des faits. Dans l'hypothèse la plus favorable, si l'auteur n'a aucun préjugé auquel il subordonne délibérément l'histoire, il se laisse guider par certaines conceptions métaphysiques au sujet du « juste » et de l'« injuste », et il décide suivant ces conceptions. Mais plus souvent, il a une foi qui ne laisse aucune place au doute. S'il est favorable à la monarchie ou à l'oligarchie, il donne toujours « tort » au peuple qui s'insurge ; et vice versa, s'il est « démocrate », il donne toujours « raison » au peuple qui s'insurge. Quand il lui vient à l'idée de rechercher les causes de l'insurrection, ce qui n'arrive pas toujours, on peut être certain qu'il s'arrête aux causes éthiques. S'il est opposé au peuple, il dira que celui-ci est poussé à s'insurger par les machinations des démagogues ; s'il est favorable au peuple, il dira qu'il est mu par l'oppression intolérable de la classe gouvernante. Que de papier et d'encre n'a-t-on pas employés à répéter sans fin ces inutiles billevesées !
[FN: § 2191-1]
Les détracteurs de la révolution française l'accusent d'avoir fait largement emploi de la force ; ses admirateurs s'efforcent d'excuser cet emploi. Les uns et les autres ont raison, s'ils cherchent à trouver des dérivations, lesquelles agissent sur les gens qui éprouvent une répugnance instinctive, et non raisonnée, pour les souffrances (résidus IV-γ 2). Ils se trompent, s'ils ont objectivement en vue les conditions de l'utilité de la société : et, à ce point de vue, il faut reconnaître que l'emploi de la force fut le principal mérite de la Révolution, et non une faute.
[FN: § 2193-1]
Georges SOREL, Réflexions sur la violence, a fort bien montré la vanité de ces dérivations : « (p. 91) On éprouve beaucoup de peine à comprendre la violence prolétarienne quand on essaie de raisonner au moyen des idées que la philosophie bourgeoise a répandues dans le monde : suivant cette philosophie, la violence serait un reste de la barbarie et elle serait appelée à disparaître sous l'influence du progrès des lumières... (p. 92) Les socialistes parlementaires ne peuvent comprendre les fins que poursuit la nouvelle école ; ils se figurent que tout le socialisme se ramène à la recherche des moyens d'arriver au pouvoir ». Ces socialistes-là sont en train de s'assimiler à la classe gouvernante, et le nom de transformistes qu'ils prennent quelquefois correspond assez bien au fond du phénomène. « (p. 93) Une agitation, savamment canalisée, est extrêmement utile aux socialistes parlementaires, qui se vantent, auprès du gouvernement et de la riche bourgeoisie, de savoir modérer la révolution ; ils peuvent ainsi faire réussir les affaires financières auxquelles ils (p. 94) s'intéressent, faire obtenir de menues faveurs à beaucoup d'électeurs influents [et en Italie, faire distribuer de l'argent aux coopératives]... (p. 271) La férocité ancienne tend à être remplacée par la ruse, et beaucoup de sociologues estiment que c'est là un progrès sérieux ; quelques philosophes qui n'ont pas l'habitude de suivre les opinions du troupeau, ne voient pas très bien en quoi cela constitue un progrès au point de vue de la morale.(p. 83) Il ne manque pas d'ouvriers qui comprennent parfaitement que tout le fatras de la littérature parlementaire ne sert qu'à dissimuler les véritables motifs qui dirigent les gouvernements [ce sont des dérivations]. Les protectionnistes réussissent en subventionnant quelques gros chefs de parti [et même des petits, non seulement avec de l'argent, mais aussi en leur procurant des satisfactions d'amour propre, des éloges dans les journaux, des honneurs, le pouvoir] en entretenant des journaux qui soutiennent la politique de ces chefs de parti : les ouvriers n'ont pas d'argent, mais ils ont à leur disposition un moyen d'action bien plus efficace : ils peuvent faire peur... ».
[FN: § 2193-2]
Un très grand mérite de G. SOREL a été d'abandonner ces billevesées, dans son livre Réflexions sur la violence, pour s'élever aux régions de la science. Il n'a pas été bien compris de ceux qui cherchaient des dérivations là où il y a des raisonnements logico-expérimentaux. Certains « universitaires », qui confondent la science avec la pédanterie (§ 1749 5), et qui, dans une théorie, s'arrêtent à des détails insignifiants ou à d'autres absurdités semblables, manquent entièrement des capacités intellectuelles nécessaires à la compréhension de l'ouvrage d'un savant tel que Sorel.
[FN: § 2200-1]
Ces trois hommes étaient ennemis, mais chacun d'eux disposait de légions ; le Sénat n'en avait pas. Par conséquent les triumvirs se persuadèrent facilement qu'il leur était avantageux de se mettre d'accord, et de faire payer les frais de l'accord aux partisans du Sénat. À ce propos, Duruy remarque : DURUY ; Hist. des Rom., t. III : « p. 458) Par cette inexorable fatalité des expiations historiques que nous avons si souvent signalée dans le cours de ces récits, le parti sénatorial allait subir la loi qu'il avait faite au parti contraire [L'auteur passe prudemment sous silence les proscriptions de Marius]. Les proscriptions et les confiscations de Sylla vont recommencer, mais c'est la noblesse qui payera de sa tête et de sa fortune le crime des ides de mars et le souvenir des flots de sang dont, quarante années auparavant, l'oligarchie avait inondé Rome et l'Italie ». Si Duruy était un fidèle de Iuppiter optimus maximus, on comprendrait facilement à qui il confie le soin de réaliser cette « inexorable fatalité » ; mais comme il ne recourt pas à des considérations théologiques de cette sorte, il faut croire que cette « fatalité » est une entité métaphysique, laquelle, à vrai dire, semble fort mystérieuse, en elle-même et dans ses manifestations. Toutefois, les personnes qui désireraient en avoir quelque notion la trouveront chez les auteurs anciens qui racontent les faits dont parle Duruy. APPIAN. ; De bellis civ., IV, 3. Après avoir conclu le pacte entre eux, les triumvirs décidèrent « de promettre aux soldats, comme prix de la victoire, outre les cadeaux, dix-huit villes italiennes à occuper comme colonies, qui seraient excellentes par leur opulence, leur sol, leurs édifices, et qui seraient partagées entre les soldats, fonds ruraux et édifices, comme si elles avaient été conquises à la guerre ». Cfr. DIO CASS. ; XLVI, 56. – TAC. ; Ann., I, 10. – PATERC. ; II, .64. – FLOR. ; IV, 6. Ne serait-ce pas le cas d'expliquer ainsi quelle est la belle entité de Duruy : payer, acheter ceux qui constituent la force, et s'en servir à son propre avantage ? Cette entité doit avoir enfanté, car celle qui protège nos politiciens, lorsqu'ils s'assurent le pouvoir en achetant les électeurs, semble bien être une de ses descendantes.
[FN: § 2201-1]
E. OLLIVIER ; L'emp. lib., t, XVI : « (p. 1) L'étude des faits dans l'Histoire m'a amené à cette conviction expérimentale qu'aucun gouvernement n'a été anéanti par ses ennemis ; les ennemis sont comme les arcsboutants des églises gothiques : ils soutiennent l'édifice. Il n'y a pour les gouvernements qu'une manière de périr : le suicide ». C'est un peu trop absolu. Il y a des gouvernements qui peuvent succomber en présence d'une force qui l'emporte. C'est ce qui arriva à Pompée, à Charles Ier d'Angleterre, à tant d'autres qu'il est inutile de rappeler. « Depuis 1789, tous les pouvoirs se sont détruits eux-mêmes : les Constituants s'excluent de leur œuvre ; les Girondins se livrent ; les Jacobins s'anéantissent entre eux ; les principaux Directeurs mettent leur République aux enchères ; Napoléon Ier abdique deux fois ; Charles X abdique et s'en va ; Louis-Philippe abdique et s'enfuit ».
[FN: § 2207-1]
Nombre d'économistes littéraires sont portés à considérer exclusivement le cycle (b), (c) – (c), (b). De l'étude des intérêts (b), dont s'occupe leur science, ils tirent certaines conclusions (c), et croient ensuite que par la diffusion des doctrines (c), on pourra modifier l'activité économique (b). Un exemple très important est celui du libre échange. De l'étude du phénomène économique (b), on tire la démonstration (c) de l'utilité du libre échange. Cette doctrine (c), étant ensuite répandue, doit modifier le phénomène économique (b), et faire instituer réellement le libre échange. En général, quand les économistes se trouvent en présence de quelque sentiment (a) qu'ils doivent considérer, ils ont coutume de supposer que ce sentiment existe par vertu propre, sans rapport avec (b). Par exemple le « juste » et l'« injuste » sont absolus, et non en rapport avec (b). Marx se rapprocha beaucoup de la science logico-expérimentale, en remarquant le rapport entre (a) et (b) ; mais il se trompa en croyant que ce rapport était entre la cause (b) et l'effet (a), tandis que si (b) agit sur (a), cet élément réagit, à son tour, sur (b). Parmi les nombreuses causes pour lesquelles la combi- naison IV est très souvent négligée, il faut ranger celle-ci : on considère des sentiments, des intérêts, des dérivations, d'une manière absolue, indépendamment des individus. On a ainsi des abstractions, et non des propriétés de certains individus. C'est pourquoi l'on croit qu'il n'est pas nécessaire de considérer comment varient les différentes classes de ces individus.
[FN: § 2208-1]
Les dérivations suivantes ont aussi été très en usage. Se plaçant dans le domaine de l'éthique, les libre-échangistes disaient : la protection est un mal, parce qu'elle dépouille les non-protégés en faveur des protégés. Les protectionnistes répliquaient : On peut supprimer le mal en protégeant également tout le monde. À quoi les libre-échangistes opposaient que protéger également tout le monde revient à ne protéger personne. Ainsi, l'on admet la possibilité de deux positions d'équilibre identiques avec des prix différents (§ 2207 1). Aussi bien les libre-échangistes que les protectionnistes substituaient, volontairement ou non, des dérivations aux considérations sur la réalité. Pour rester dans le domaine logico-expéri- mental, les libre-échangistes auraient dû dire : « Grâce à une destruction de richesse, la protection transporte une certaine quantité de richesse de certains individus à certains autres. Ce transport est précisément l'effet auquel vous visez, vous autres protectionnistes : par conséquent, vous vous contredisez, si vous parlez de protection égale pour tout le monde. Si elle était possible, la cause pour laquelle vous êtes protectionnistes disparaîtrait. Quand vous parlez de protection égale pour tout le monde, vous entendez, bien que vous ne le disiez pas, une protection égale, non pas pour tous les citoyens, parmi lesquels se trouvent les simples possesseurs d'épargne, mais pour toute une classe de citoyens, laquelle sera composée d'un nombre plus ou moins considérable de producteurs industriels et agricoles. C'est précisément cela que nous estimons nuisible au pays ». À quoi les protectionnistes auraient dû répliquer : « Les faits sont bien tels que vous les décrivez : nous visons précisément à transporter la richesse, d'une partie des citoyens à une autre partie. Nous savons que cette opération coûte une certaine destruction de richesse ; cependant nous l'estimons utile au pays ». Après cela, l'expérience, l'expérience seule, pouvait établir qui se rapprochait le plus de la réalité. Mais encore, avant de pouvoir procéder à cette investigation, il faudrait savoir avec une plus grande précision ce qu'indiquaient les termes « nuisible » et « utile », employés tantôt.
[FN: § 2208-2]
Cette démonstration, ainsi qu'une autre, plus générale, ont été données pour la première fois dans le Cours, § 862 et sv., § 730. Cfr. l'Appendice du Manuel.
[FN: § 2208-3]
Le Cours contient, au moins implicitement, des erreurs de cette sorte. Dans le Manuale, l'auteur s'est efforcé de les éviter. Dans la préface du Manuale, on lit : « (p. VII) .. Il se trouve par-ci par-là dans le Cours des procédés erronés. Ces erreurs proviennent de deux sources principales. La première est une synthèse incomplète, ayant pour but de revenir de l'analyse scientifique à la doctrine concrète [c'est précisément pour avoir reconnu la nécessité d'une synthèse moins incomplète, que l'auteur a été amené à entreprendre le long travail dont les résultats sont exposés dans le présent ouvrage]. L'auteur a remarqué la nécessité de cette synthèse complète ; mais ensuite, sans s'en apercevoir, il l'a parfois négligée [dans le Cours] en partie, sinon explicitement, du moins implicitement. Il suffit de citer l'exemple du libre- échange et de la protection. On peut démontrer scientifiquement que la protection provoque d'habitude une destruction de richesse. L'étude des faits passés et présents démontre que la protection est instituée en grande partie grâce à l'influence de ceux qui en profitent pour s'approprier le bien d'autrui. Mais cela suffit-il à condamner la protection dans le monde concret ? Assurément pas ; il faut prendre garde à d'autres conséquences sociales de cette organisation [mais pour cela, il était nécessaire d'avoir une théorie du genre de celle que nous exposons ici], et ne se décider qu'après avoir accompli cette étude. Je crois que l'auteur du Cours aurait aussi donné cette réponse. L'erreur n'est donc pas proprement explicite ; mais l'auteur s'exprime souvent comme si, en réalité, le libre-échange était bon dans tous les cas, et la protection dans tous les cas mauvaise. Ces affirmations supposent que l'on part de quelque proposition entachée de l'erreur indiquée ».
[FN: § 2214-1]
Lorsqu'on se place exclusivement au point de vue de la correspondance des théories avec les faits, on peut dire que, dans l'étude indiquée, un grand nombre d'économistes ont eu le malheur de ne pas comprendre qu'en un état de libre concurrence, les entrepreneurs ne font, en moyenne, ni gain ni perte, si l'on tient compte du revenu des capitaux et du salaire de l'entrepreneur. Au contraire, lorsque les entrepreneurs bénéficient d'un monopole, ils peuvent faire en moyenne un gain qui s'ajoute à ce revenu et à ce salaire. De même aussi un grand nombre de socialistes ont eu le malheur de confondre le revenu du capital avec le gain de l'entrepreneur ; gain qui n'existe, en moyenne, que dans les états de monopole temporaires ou permanents. Ainsi plusieurs observations des socialistes, exactes à cet égard, deviennent fausses, si on les étend au revenu du capital. Ils ont eu le malheur encore de ne pas distinguer les deux catégories de personnes (§ 2231 et sv.) confondues par eux sous le nom de « capitalistes ».
[FN: § 2218-1]
En Prusse, il existe une classe nombreuse de petits propriétaires nobles. C'est de cette classe que viennent en grande partie les employés du gouvernement et les officiers de l'armée. C'est la cause principale de la grande honnêteté de la bureaucratie prussienne, et de la solidité de l'armée. Quelque chose de semblable existait au Piémont avant la constitution du royaume d'Italie ; et l'on observait des effets analogues, qui se sont en tout cas beaucoup évanouis, en même temps que s'évanouissait la cause dans le nouveau royaume. Il suit de là que la protection agricole favorable à ces classes de propriétaires, a des effets bien différents en Allemagne et en Italie, car il manque, en Italie, une classe correspondant à celle des Junker prussiens.
[FN: § 2221-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] JEAN CRUET : La Vie du Droit et l'impuissance des lois. Dans un paragraphe intitulé : Théorie juridique des révolutions et des coups d'États, l'auteur traite en sous-titre de la tradition française : la Révolution comme mode normal d'abrogation des Constitutions : « (p. 108) C'est en vérité plus qu'une tradition française, c'est une tradition latine. Chacun songe à l'Espagne, terre classique des pronunciamentos, au Portugal, où la dictature vient périodiquement rétablir l'ordre compromis par l'application même d'une Constitution mal adaptée au tempérament national, aux Républiques sud-américaines enfin, où l'on pouvait, en 1894, sur dix-sept Présidents, en compter onze issus d'une révolution ou d'un coup d'État ».
[FN: § 2227-1]
Il arrive souvent que la classe gouvernante provoque elle-même sa propre ruine. Elle accueille volontiers dans son sein les hommes chez lesquels prédominent les résidus de l'instinct des combinaisons, et qui s'adonnent à des entreprises économiques et financières, parce que ces hommes produisent habituellement beaucoup de richesse, et augmentent, par conséquent, l'aisance de la classe gouvernante. Aux temps de la monarchie absolue, ils procuraient le luxe aux souverains ; aujourd'hui, ils procurent le luxe à la démocratie ; et souvent ils peuvent être utiles à tout le pays. Les premiers effets de leur arrivée au pouvoir sont donc utiles à un grand nombre de gens, et renforcent la classe gouvernante ; mais ensuite, peu à peu, ils agissent comme des vers rongeurs, détruisant dans cette classe les éléments riches en résidus de la persistance des agrégats et capables d'user de la force. C'est ainsi que les « spéculateurs » (§ 2235), en France, préparèrent le triomphe de la monarchie absolue, puis sa ruine (§ 2383 1). Aujourd'hui, en plusieurs pays, ils ont contribué au triomphe du régime qu'on appelle « démocratique », et qui s'appellerait plus proprement régime de ploutocratie démagogique ; maintenant, ils sont en train de préparer la ruine de ce régime.
[FN: § 2231-1]
Ces capitalistes et ces entrepreneurs du langage vulgaire ne sont nullement les capitalistes et les entrepreneurs que considère l'économie pure (Cours, § 87 et passim) ou, en général, l'économie scientifique. L'analyse scientifique sépare des mélanges que l'on observe dans les cas concrets.
[FN: § 2231-2]
C'est ce que comprirent les économistes qui opposèrent les consommateurs aux producteurs. Mais avec raison on leur objecta que, dans les cas concrets, ces deux qualités se confondent souvent, et que le plus grand nombre de personne, sont en même temps consommateurs et producteurs. La différence que les économistes avaient ainsi intuitivement aperçue existe, en réalité, entre ceux qui subissent tranquillement le mouvement économique, politique, social, et ceux qui s’en servent ingénieusement.
[FN: § 2232-1]
Si plusieurs économistes ne s'en sont pas aperçus, cela tient au fait qu'ils ont été induits en erreur par le désir de trouver un principe dont on pût logiquement déduire la théorie de l'épargne, et aussi au fait que, lancés sur cette voie, ils ont abandonné, le domaine des observations expérimentales, pour errer dans celui des spéculations théoriques. Il serait utile à la théorie que la quantité d'épargne produite dans l'unité de temps fût fonction, exclusi- vement, ou au moins principalement, du revenu qu'on peut obtenir de cette épargne. Mais malheureusement il n'en est pas ainsi, et l'on ne peut, par amour pour la théorie, fermer les yeux sur l'évidence des faits, ni substituer à l'observation directe que chacun peut faire, des divagations théoriques sur les statistiques. Les statistiques de l'épargne sont très imparfaites. Non seulement elles ne peuvent pas tenir compte de la somme, au total assez considérable, que les petits industriels, les petits commerçants, les petits agriculteurs, emploient dans leur propre entreprise : mais encore elles ne peuvent apporter aucun renseignement quelque peu précis sur l'épargne nouvelle qu'on emploie en titres d'État ou en d'autres. Enfin, et c'est là le motif principal pour lequel des théories de ce genre peuvent induire en erreur sur le sujet dont nous traitons, elles se rapportent à un phénomène très compliqué, dans lequel de nombreuses causes agissent, outre la tendance des hommes à épargner. Quelle part avait en cette tendance le revenu qu'on aurait pu retirer de l'épargne, quand les gens épargnaient des monnaies d'or et d'argent, et les cachaient chez eux ? Quelle était cette part, au temps où, en France, on parlait toujours du bas de laine à propos de l'épargne des paysans ? Et aujourd'hui, interrogez les bonnes ménagères qui épargnent sou par sou le petit magot qu'elles porteront à la caisse d'épargne, et demandez-leur si elles épargneraient davantage, au cas où l'intérêt servi par la caisse d'épargne serait plus élevé. Si vous arrivez à vous faire comprendre, ce sera déjà beaucoup ; et si, par hasard, vous y arrivez, la bonne ménagère rira de votre naïveté. Il est ridicule d'appeler auto-observations celles que l'on fait ainsi sur d'autres personnes. Si ensuite, les statistiques savamment manipulées disent le contraire, cela signifie simplement, ou bien qu'elles sont erronées, ou bien qu'elles ont été mal manipulées, comme le seraient les statistiques qui nous diraient que les hommes marchent sur les mains, et non sur les pieds. L'avarice est l'excès de l'épargne. Des temps anciens à nos jours, le type de l'avare a souvent été décrit par les littérateurs. Mais lequel d'entre eux s'est jamais mis en tête d'établir un rapport entre l'épargne de l'avare et l'intérêt qu'il peut retirer de cette épargne ? On ne voit certainement pas cela chez Théophraste ni chez Molière. L'avare épargne tout ce qu'il peut, et se fait payer le plus possible d'intérêt pour ce qu'il prête. Ce sont deux maxima qui ne sont pas mis en rapport. Au temps de Théophraste, il n'y avait pas de statistiques. Par conséquent, elles ne peuvent pas nous apprendre avec certitude si les Athéniens mangeaient, buvaient et se vêtaient ; mais cela semble probable, de même que l'existence, parmi eux, de gens prévoyants et d'imprévoyants ; et les descriptions d'un excellent observateur tel que Théophraste valent plus et mieux que les nébuleuses dissertations de certains de nos statisticiens. En décrivant l'homme adonné aux épargnes sordides (Charact. X), Théophraste ne mentionne nullement que ces épargnes soient en rapport avec le revenu que l'on en pourra retirer. Il est évident que ce sont là des actes instinctifs qui manifestent la passion d'accumuler. Ils apparaissent aussi comme tels dans les conseils que donne Caton le Censeur, qui était passé maître en l'art d'épargner, et n'était pas novice en celui d'être avare. Nous avons déjà remarqué (Cours § 30) que l'épargne, différente en cela des autres biens écono- miques, n'a pas d'ophélimité élémentaire décroissant avec la quantité. Là aussi, l'observation directe montre que beaucoup de gens, lorsqu'ils n'ont pas d'épargne, n'éprouvent nullement le besoin d'épargner, tandis que ce besoin naît et augmente lorsqu'ils ont une certaine somme d'épargne. On sait assez que le fait de donner un livret de caisse d'épargne à un ouvrier qui ne possède pas d'épargne est souvent un moyen de l'engager à épargner. Mais il est inutile de continuer à rappeler des faits si connus, et que chacun, s'il le veut bien, peut aisément vérifier. Quiconque n'en veut pas tenir compte n'a qu'à garder son opinion, comme ce don Ferrante des Fiancés de Manzoni. Tandis que la peste sévissait à Milan, il démontrait par de savantes considérations théoriques que la peste n'existait pas, si ce n'était sous forme d'influence maligne des corps célestes. Il en mourut en s'en prenant aux étoiles. Cfr. Cours, § 419 ; Manuel ,VIII, 11, p. 438.
[FN: § 2232-2]
Deux savants d'une renommée aussi grande que méritée, Bodio, en Italie, et De Foville, en France, ont fait voir opportunément avec quelle prudence, quelle discrétion, et quelles précautions il faut faire usage des statistiques. Leurs enseignements ne doivent jamais être perdus de vue.
[FN: § 2232-3]
Parmi les faits les plus certains, où les actions logiques interviennent pour déterminer l'épargne, il y a celui de personnes qui cessent d'exercer leur profession, lorsqu'elles ont épargné ce qui est nécessaire pour pourvoir convenablement à leurs besoins pendant les années qui leur restent à vivre. Il est remarquable qu'en ce cas l'action logique est contraire à celle que l'on aurait si la quantité d'épargne croissait avec le revenu qu'on en peut retirer. On remarquera encore qu'en ce cas très simple aussi, le phénomène est compliqué. La somme d'épargne nécessaire pour pouvoir se retirer des affaires dépend non seulement de l'intérêt de l'épargne, mais aussi du prix de ce qui est nécessaire à la vie, et aussi du genre de vie en usage au moment où l'on abandonne sa profession. Viennent s’ajouter un grand nombre d'autres circonstances, qui se rapportent à l'état de famille, aux us et coutumes du temps. Enfin, tout cela se superpose aux actions non-logiques, et ne s'y substitue pas. L'imprévoyant n'a pas à se soucier de l'intérêt de l'épargne, parce qu'il n'en possède point. L'avare ne s'en soucie pas non plus, parce qu'il amasse tant qu'il peut. Aux degrés intermédiaires c'est en partie l'instinct et en partie le raisonnement qui agissent.
[FN: § 2233-1]
Elle a été mentionnée pour la première fois dans V. PARETO ; Rentiers et spéculateurs. (Voir l’Indépendance, 1er mai 1911.)
[FN: § 2234-1]
Des monographies du genre de celles de Le Play seraient fort utiles pour bien connaître la nature des personnes appartenant à la catégorie (S), et celle des personnes appartenant à la catégorie (R). En voici une qui nous est fournie par GIUSEPPE PREZZOLINI ; La Francia ed i Francesi del secolo XX osservati da un italiano, Milano, 1913. Nous la trouvons citée par E. CESARI, dans La vita italiana, 15 octobre 1917, p. 367-370. Il s'agit d'un parlemen- taire très connu. Comme d'habitude, nous supprimons les noms propres : ce n'est pas d'une personne, c'est d'un type qu'il s'agit. Les chiffres que donne M. Prezzolini sont ceux que le parlementaire en question a lui-même avoués publiquement.
Ses rentes fixes donnent un total de 17 500 francs ; soit : indemnité parlementaire : 15 000, intérêt de la dot de sa femme : 2500. Ceux-ci seulement peuvent appartenir à la catégorie (R) ; l'indemnité parlementaire appartient plutôt à la catégorie (S), car pour l'avoir il faut posséder l'habileté et la chance de se faire élire.
Les dépenses de notre parlementaire donnent un total de 64 200 fr., décomposé ainsi : dépenses pour la maison : 33 800 fr., pour le bureau : 22 550 fr., pour le collège électoral (dépenses avouables) : 7850 fr. Il y aurait donc un déficit de 45 700 fr., qui non seulement est comblé, mais se change en un boni, grâce aux revenus suivants : collaboration à des journaux et autres publications : 12 500 fr. ; honoraires d'agent général de la maison *** : 12 000 fr., plus un tant pour cent sur les ventes, 7500 fr. À ce propos, M. Prezzolini note : « Mais voilà que M. X, rapporteur du budget de la guerre, y inscrit 100 000 fr. pour des fournitures qui sont passées au même M. X, agent général de la maison *** », ce qui procure à M. X un tant pour cent. Enfin, notre parlementaire, grâce à l'influence dont il jouit, est appointé par un journal, et de ce chef il touche 18 000 fr. En tout, ces revenus, qui appartiennent manifes- tement à la catégorie (S), donnent un total de 50 000 fr. M. Prezzolini ajoute que ce parlementaire n'est « ni le seul ni le moindre » de son espèce, mais qu'il en est uniquement un type « mieux connu et plus sincère ».
[FN: § 2235-1]
Beaucoup de personnes jugent que de tels faits suffisent pour condamner notre organisa- tion sociale et lui attribuer la plupart des maux dont nous souffrons. D'autres personnes croient ne pouvoir défendre cette organisation qu'en niant les faits ou en leur enlevant toute importance. Les uns et les autres ont raison au point de vue éthique (§ 2162, 2262), tort au point de vue expérimental de l'utilité sociale (§ 2115).
Il est évident que si l'on pose comme axiome que les hommes doivent, quoi qu'il arrive, suivre certaines règles, il s'en suit nécessairement qu'il faut condamner ceux qui ne les suivent pas. Un tel raisonnement, si on veut lui donner une forme logique, a pour prémisses quelques propositions du genre de celles que nous avons déjà notées (§ § 1886, 1896, 1897). Si l'on ajoute que l'organisation condamnée est en somme nuisible à la société, il faut logiquement avoir recours à quelques prémisses du genre de celles qui confondent la morale et l'utilité § § 1495, 1903 à 1998). En revanche, si l'on admet de semblables prémisses et que l'on veuille néanmoins défendre, approuver l'organisation de nos sociétés, on n'a d'autre ressource que de nier les faits ou, du moins, de les supposer négligeables.
Le point de vue expérimental est entièrement différent. Qui s'y place n'admet pas d'axiomes indépendants de l'expérience, et se trouve, par conséquent, dans la nécessité de discuter les prémisses des raisonnements précédents. Ce faisant, il est conduit à reconnaître qu'il se trouve en présence de deux phénomènes, lesquels ont certains points communs, mais ne coïncident pas entièrement (§ 2001), et qu'il faut en chaque cas particulier demander à l'expérience de décider s'il s'agit d'un point de contact ou d'un point de divergence.
La moindre réflexion suffit à faire voir que celui qui accepte certaines conclusions adopte, par là même, les prémisses auxquelles elles sont liées indissolublement. Mais la force du sentiment et l'influence d'une manière habituelle de raisonner sont telles que l'on néglige entièrement la force de la logique, et que l'on établit les conclusions sans se soucier des prémisses, ou que, tout au plus, on les admet comme des axiomes qui sont soustraits à toute discussion. Cette puissance et cette influence ont aussi pour conséquence que, malgré l'avis donné et maintes fois répété (table III-III-m) il se trouvera presque certainement des personnes pour étendre au delà du sens rigoureusement limité les observations que l'on va lire au sujet des classes (R) et (S) : pour interpréter tout ce qui est signalé à la charge d'une de ces classes comme impliquant le jugement que l'action de cette classe est, dans son ensemble, nuisible à la société, et la classe elle-même « condamnable » : tout ce qui est dit en sa faveur, comme preuve que l'action de cette classe est, en général, utile à la société, et la classe elle- même digne de louanges. Nous n'avons ni le moyen, ni même le moindre désir d'empêcher de semblables interprétations de se produire ; il nous suffit de les noter comme un genre de dérivations (§ 1119 - I-β).
[FN: § 2235-2]
Comme d'habitude, il faut se rappeler qu'il n'y a rien à déduire du sens vulgaire ou de l'étymologie de ces noms, et que nous les emploierons exclusivement dans le sens défini aux § 2233-2234 auxquels il conviendra toujours de se reporter, chaque fois que l'on rencontrera ces noms dans la suite de l'ouvrage.
[FN: § 2236-1]
Comme d'habitude, nous pouvons nous demander : « Si ce phénomène social est si important, comment se peut-il que les gens ne s'en soient pas aperçus jusqu'à présent ? » Comme d'habitude aussi, la réponse est que les gens s'en sont aperçus, mais qu'ils l'ont recouvert du voile des dérivations. L'antisémitisme a pour substratum un mouvement contre les « spéculateurs ». On dit que les Sémites sont plus spéculateurs que les Ariens ; c'est pourquoi ils passent pour représenter la classe entière des spéculateurs. Qu'on prête attention, par exemple, à ce qui se passe avec les grands magasins, les bazars. Ils sont attaqués, spécialement en Allemagne, par les antisémites. Il est vrai que beaucoup de ces commerces sont dirigés par les Sémites ; mais ceux qui sont dirigés par des chrétiens ne font pas défaut. Les premiers comme les seconds sont nuisibles au petit commerce, que veulent protéger les antisémites, qui, en ce cas, sont simplement anti-spéculateurs. Il en est de même des syndicats financiers et des autres formes que prend la spéculation. Les socialistes s'en prennent aux « capitalistes », et théoriquement il est vrai que ceux-ci ne se confondent pas avec les « spéculateurs ». Mais pratiquement, les foules qui suivent les chefs socialistes n'ont jamais rien compris aux belles théories de Marx sur la plus-value. Elles sont mues exclusivement par l'instinct de s'approprier une partie au moins des richesses qui appartien- nent aux « spéculateurs ». Même les théoriciens, lorsqu'ils parlent du « capitalisme » dans l'histoire, le confondent, au moins en partie, avec le domaine des « spéculateurs ». Enfin, quiconque voudrait remonter plus haut dans l'histoire trouverait des traces abondantes d'observations et de doctrines où apparaît le conflit entre les « spéculateurs » et le reste de la population. À Athènes, les hommes du Pirée sont en conflit avec les agriculteurs, et Platon veut placer sa République loin de la mer, précisément afin de la soustraire à l'influence des « spéculateurs ». En cela, il est le précurseur de nos antisémites contemporains. Dans toute l'histoire, en tout temps, se manifeste l'influence des « spéculateurs ». Les formes sous lesquelles elle se manifeste varient ; les noms qu'on lui donne varient encore plus, ainsi que les dérivations qu'elle provoque ; mais le fond demeure.
[FN: § 2240-1]
Le meilleur gouvernement qui existe aujourd'hui, meilleur même que tous ceux qu'on a pu observer jusqu'ici, est celui de la Suisse ; spécialement sous la forme qu'il assume dans les petits cantons : la démocratie directe. C'est un gouvernement « démocratique »; mais il n'a que le nom de commun avec les gouvernements qui se disent aussi « démocratiques », dans d'autres pays. Tels ceux de la France et des États-Unis d'Amérique.
[FN: § 2247-1]
Souvent les hommes pratiques saisissent cela par intuition, mais ils sont empêchés de l'appliquer à cause de raisonnements pseudo-théoriques, ou bien par des obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin. – BUSCH ; Les mém. de Bismarck, t. I. Il s'agit des territoires qu'il pouvait être avantageux à l'Allemagne de se faire céder par la France : « (p. 64) D'Alvensleben, lui, voulait qu'on gardât tout le pays jusqu'à la Marne. M. de Bismarck dit qu'il avait une autre idée, mais que, malheureusement, elle était impossible à réaliser. – Mon idéal aurait été, fit-il, une sorte de colonie allemande, un État neutre de huit ou dix millions d'habitants, exonérés de tout service militaire, mais dont les impôts, dès qu'ils n'auraient pas été appliqués aux besoins locaux, auraient été payés à l'Allemagne. La France aurait de la sorte perdu une province dont elle tirait ses meilleurs soldats et aurait été rendue inoffensive ». Que l'on compare cette vue large à l'oppression actuelle, tendant à changer à propos de futilités souvent insignifiantes les sentiments de la population sujette.
[FN: § 2253-1]
ROBERT DE JOUVENEL ; La rép. des camarades : « (p. 56) Sans doute, on s'obstine, probablement à cause d'une vieille tournure d'esprit, à (p. 57) avoir des programmes, mais on tient rarement à les faire aboutir... Et cela tient à ce que les programmes ne sont pas faits pour aboutir. Les principes de la bourgeoisie républicaine datent de 1789. Le socialisme de Marx date de 1848. Le programme radical date de 1869. Soyez assurés qu'ils serviront longtemps encore. La lutte entre ces diverses conceptions de tout repos n'en constitue pas moins ce qu'on appelle : „ la politique moderne “. (p. 58) Un programme qui aboutit cesse par là même d'exister... (p. 59) Presque toutes les lois importantes ont été soumises aux discussions du Parlement par des ministres qui n'y croyaient pas, ou qui même s'en étaient proclamés les adversaires irréductibles ». Mais comme ce sont aussi des gens intelligents et rusés, on est obligé de reconnaître qu'il doit y avoir une force puissante qui les pousse dans cette voie. On ne peut trouver cette force que dans l'organisation sociale qui a donné le gouvernement aux « spéculateurs ». L'auteur continue : « (§ 59) Lisez les confidences de Waldeck-Rousseau. Vous y verrez qu'après avoir poursuivi devant la Haute-Cour un complot dont il n'était pas très sûr, il a rendu nécessaires les retraites ouvrières dont il n'attendait rien et l'impôt sur le revenu dont il redoutait tout. „ Nous avons été condamnés, écrivait-il, à adopter comme une règle supérieure à tout le reste la nécessité de ne pas tomber. Nous avons dû faire des concessions de principe, tout en nous efforçant d'en éviter la réalisation “ » Mais pourquoi a- t-il fait tout cela ? Parce qu'il voulait réhabiliter Dreyfus. Et pourquoi voulait-il réhabiliter Dreyfus ? Parce qu'un mouvement intense avait envahi le pays, mouvement provoqué au moins en partie par une presse largement payée par des gens qui espéraient se récupérer ensuite de leurs dépenses. Les spéculateurs voulaient en tirer profit, de même qu’ils tirent profit de l'existence de mines, d'inventions, etc. Ce fut la source du courant qui entraîna Waldeck-Rousseau, déjà défenseur et ami des spéculateurs et ses collaborateurs. Il porta sur ses flots limoneux le vaisseau des nouveaux Argonautes, partant pour la conquête de la toison d'or ; et finalement, nos Argonautes obtinrent en abondance richesses, pouvoir, honneurs. – « (p. 60) Un président du Conseil qui ne croyait pas à la séparation des Églises et de l'État l'a rendue inévitable. Un autre l'a signée qui ne l'avait jamais voulue. La plupart des radicaux aujourd'hui sénateurs ont jadis lutté pour la suppression du Sénat et beaucoup de députés coloniaux se sont prononcés dans leur jeunesse contre la représentation coloniale. Le Sénat, qui fut à peu près tout entier hostile au rachat de l'Ouest et à l'impôt sur le revenu, a voté le rachat de l'Ouest et votera l'impôt sur le revenu ». C'est ainsi que l'on paie aux sentiments populaires la rançon des opérations lucratives qu'effectuent en attendant des financiers retors, des entrepreneurs et d'autres spéculateurs. En Italie, une Chambre qui était contraire à l'extension du droit de vote, qui repoussa la proposition très modérée du ministre Luzzatti, approuva la proposition beaucoup plus hardie de Giolitti, parce que cette Chambre ne pouvait s'opposer à qui était si expert dans l'art de protéger les trusts et les intrigues électorales. Quant à Giolitti, il voulut l'extension du droit de vote, afin de payer ainsi l'appui des socialistes transformistes et d'autres démocrates, et pour atténuer de la sorte l'opposition qu'ils auraient pu faire à ses entreprises, parmi lesquelles il faut ranger la guerre de Libye. Il ne la voulut pas, au début, mais elle lui fut imposée par les sentiments d'un grand nombre de citoyens.
[FN: § 2254-1]
Le phénomène est très bien décrit dans le discours que fit le ministre Briand à Saint- Étienne, le 20 décembre 1913. « il y a dans notre démocratie des impatiences fébriles, il y a des ploutocrates démagogues qui courent vers le progrès d'une course si frénétique que nous nous essoufflons à vouloir les suivre. Ils veulent, ceux-là, le tout ou le rien. Dans le moment même où ils s'enrichissent avec une facilité scandaleuse, dans ce moment même, ils ont le poing tourné vers la richesse, dans un geste si menaçant, si désordonné, si excessif, que nous avons le droit de nous demander si c'est bien pour l'atteindre, si ce n'est pas plutôt pour la protéger ». Mais les financiers auxquels le ministre Briand fait allusion laissent dire et continuent à gagner de l'argent.
Le phénomène est de tous les temps et de tous les pays où dominent les « spéculateurs ». – La Liberté, 14 avril 1913 : « Le banquier Carbonneau et ses amis politiques. Chaque fois que la police met la main au collet d'un financier véreux, elle fait sûrement de la peine à un député bloquard, qui, c'est une fatalité, est l'ami et l'avocat-conseil de tous les lanceurs d'affaires qui tournent mal. Ils sont un certain nombre qui ont cette spécialité. Un surtout, dont le nom vient spontanément à l'esprit dès qu'on arrête un Carbonneau quelconque. Lorsque les Duez, les Martin-Gauthier, les Rochelle, les Carbonneau ont besoin d'un bon avocat-conseil, c'est au député X..., qu'ils s'adressent spontanément, parce qu'ils sont assurés d'avance que comme conseilleur il ne les empêchera pas de tondre les payeurs ; et que, comme député, jouissant d'une grosse influence au Parlement et dans les Loges, il couvrira le bateau et les pilotes de son pavillon » (§ 2256 1).
[FN: § 2255-1]
M. PANTALEONI, dans le Giornale degli Economisti, septembre 1912 : « (p. 260) Le monopole attribué à l'Institut [des assurances sur la vie] a un double but. D'un côté, on confie à l'État l'exercice de l'Industrie des assurances sur la vie; de l'autre, on donne à l'État un Instrument qui lui procure la disponibilité de moyens financiers considérables... L'Instrument financier au moyen duquel l'État réussit à avoir pour un grand nombre d'années la disponibilité de capitaux considérables, qu'on forme avec les annuités que les assurés paient, et dont la restitution, sous forme de sommes assurées par les personnes qui contractent avec l'Institut, n'interviendra que d'ici à un grand nombre d'années [et que l'État paiera ou ne paiera pas, selon l'intérêt de ceux qui auront alors la haute main, et selon l'excédent de recettes au budget], cet Instrument financier a été dissimulé au Parlement et aux contribuables, comme de raison, car on n'avoue pas l'existence d'une dette hors budget [et même si on l'avait avouée, ç'aurait été la même chose ; la ploutocratie démagogique se soucie peu de l'avenir]... (p. 261) Le gouvernement parlementaire a d'innombrables mérites, mais aussi plusieurs défauts. Parmi ces défauts, il en est trois qui ressortent. D'un côté, la culture politique défectueuse de la grande masse des membres du Parlement est manifeste... D'un autre côté, c'est un phénomène universel que la division des Chambres en partis de niveau moral très bas. En raison de cette division, tout acte du gouvernement, destiné à surmonter quelque grave difficulté politique, n'est pas discuté à des points de vue généraux et embrassant des intérêts communs..., mais considéré comme une occasion propice et largement ouverte pour renverser ou racheter le gouvernement. En fin de compte, la publicité des discussions est une règle canonique... Ces caractères du régime parlementaire, qui n'entraînaient pas de graves inconvénients, tant que les Chambres avaient des fonctions de contrôle financier seulement … obligent le gouvernement à passer sous silence ou ne pas pouvoir dire clairement la moitié de ce qu'il veut obtenir à s'efforcer de masquer les moyens qu'on met en œuvre, et à payer, tantôt à ce groupe parlementaire, tantôt à cet autre, un droit de péage, ou, pour le dire sans euphémisme, la rançon ». D'autre part, l'auteur approuve l'opération parce qu'elle pourrait servir à procurer les fonds nécessaires à une guerre future. Mais il est bon de remarquer que si elle pouvait servir à cela, de fait, elle n'y servit point, et que l'argent alla aux clientèles de la classe dominante, tandis que flotte et armée demeurèrent aussi peu préparées que possible.
[FN: § 2256-1]
Les descriptions faites par des hommes du métier qui suivent les méthodes empiriques, sans s'embarrasser de théories, sont très utiles pour bien connaître les faits, car elles échappent au danger, toujours menaçant, de plier, même involontairement, la description des faits à la théorie. C'est pourquoi nous citons ici la description que The Financial Times, 27th March 1914, donne des phénomènes auxquels nous faisons allusion. Nous rappelons que cette description s'applique non seulement à la France, mais aussi à d'autres pays où dominent les « spéculateurs ». Par exemple, pour les États-Unis d'Amérique, il y aurait beaucoup à ajouter, plutôt que de retrancher quoi que ce soit à cette description : « Paris, 24th March. – We have heard a good deal of late about „ plutocratic democrats “ and „ democratic plutocrats “ by which is meant either a wealthy financier who becomes a demagogue for the sake of political influence rather than from any real conviction, or – and this is more widely the case in France – a demagogue who has no objection to become a wealthy financier if circumstances permit. M. Barthou, M. Briand and their friends have freely used the expression in connection with M. Caillaux, to whom they are politically opposed, and it is a fact that certain prominent Republican politicians belonging to all sections of the Republican party have of late years turned their political influence to considerable personal advantage ». Suit un long récit d'exploits accomplis par des hommes d'État d'accord avec les financiers. Nous le laissons de côté, non seulement en raison de son étendue, mais aussi parce que nous préférons ne pas citer des noms propres, car, en les citant, on détourne facilement l'attention des uniformités générales, pour l'amener à s'arrêter sur des considérations éthiques, de parti, de bienveillance ou de malveillance particulière. La conclusion de l'article nous ramène aux faits généraux, qui importent davantage à une étude scientifique. « Need of a political protector. – As a matter of fact, it bas long been the fashion with French financial and other companies to provide themselves with a „ paratonnerre “ or „ lightning rod “ in the shape of a person of political influence who can act more or less as a mediator in high places, and who, on occasion, can help to shield financiers who may be liable to get into trouble or protect interests that may be in danger from threatened legislation. As a rule politicians are very chary of being openly connected with any but concerns of very high reputation ; but there are others. Thus, there are many barristers who are both clever pleaders and brilliant politicians. Many are the concerns, which willingly pay huge annual fees to a political barrister in order to secure his services as „ legal adviser “. The legal adviser is paid quite as much for his political influence as for his legal advice, and he runs no risk, not being openly connected with the concern. It is natural, perhaps, in a country where kissing goes by favour – ad show me the country in which it does not ! – that people interested in important business schemes should endeavour to obtain a hearing with the powers that be by securing as influential a political intermediary as they can get, but the practice undoubtedly has its drawbacks » 2254-1).
[FN: § 2256-2]
GUGLIEMO EMANUEL ; dans le Corriere della Sera, 9 février 1914 : « L'épisode suivant est caractéristique du système [en Angleterre]. Je l'ai entendu raconter un soir, dans une conférence politique, par un homme du parti libéral. Étant décoré et député, il en savait certainement long. Avant les élections de 1906, qui donnèrent aux libéraux la majorité et le gouvernement, il discutait avec un ami, devenu ministre par la suite, le scandale de la « vente » de titres honorifiques à laquelle se livrait le ministère unioniste d'alors. Encore ingénu et ignorant des intrigues politiques, il soutenait chaudement : „ Quand nous serons au pouvoir, nous devrons mettre fin à cette indécence “. – „ En vérité, – répondit avec calme le futur ministre, – je crois, au contraire, que lorsque nous serons au pouvoir, il faudra vendre autant de titres honorifiques que possible, pour remplir le coffre-fort du parti. “ À en croire ce qu'affirment les journaux d'opposition, il paraît que le projet du ministre en herbe a été réalisé sans réticences. Les mauvaises langues disent qu'on a établi un tarif. On ne payerait pas moins de 125 000 francs, pour obtenir un knighthood, titre qui correspond à celui de chevalier. Une donation de 625 000 francs serait nécessaire pour posséder un baronetey, soit le titre de baronnet. Quant au titre de lord, ou pair du royaume, on ne payerait pas moins d'un million et demi... L'argent produit parles « ventes », est versé au « trésor de guerre ». C'est le Chiefwhip qui l'administre ». Telle est l'origine du gouvernement d'« un État éthique ou de droit », admiré par les naïfs. Dans d'autres pays, il se produit des faits analogues. En Autriche-Hongrie, le trafic des décorations et des titres nobiliaires est très actif. Dans tous les pays civilisés, le gouvernement dispose de subventions considérables, qui servent à des fins électorales. La Liberté, 10 mai 1914 : « Les naïfs s'imaginent que le gouvernement n'a, pour „ faire “ les élections, que la maigre ressource des douze cent mille francs inscrits au chapitre des fonds secrets. La caisse noire est infiniment plus abondante que cela. On cite un ministre de l'agriculture blocard qui disait : „ Je dispose de 30 millions par an que je puis distribuer à ma guise et sans contrôle pour les besoins de la politique gouvernementale “, sous prétexte de subventions agricoles. Il y a aussi le produit des jeux (cagnotte des cercles et pari mutuel des courses de chevaux). Le gouvernement a la libre disposition, hors budget, de cette véritable caisse noire. Or, le produit des jeux dans les casinos et au pari mutuel a permis d'effectuer, en 1912, un prélèvement pour les œuvres de bienfaisance supérieur à 24 millions de francs. Ce total s'est accru encore en 1913. Ces oeuvres de bienfaisance ont avant tout un caractère électoral. C'est ce qui permet à un X [nous supprimons le nom] de dire à ses électeurs : „ En huit ans, je vous ai fait accorder pour un million de subventions ! “ ».
[FN: § 2257-1]
Il reste à accomplir une étude de ces moyens, considérés techniquement, par rapport à leur efficacité et à leur coût, en laissant de côté les divagations éthiques, la recherche de « remèdes » et les prêches, qui sont aussi inutiles que si on les adressait au phylloxéra pour l'engager à ne pas dévaster les vignes. Nous ne pouvons nous en occuper ici. Le lecteur trouvera de précieux renseignements pour les collectivités anglo-saxonnes, dans l'ouvrage classique d'OSTROGORSKI, La démocratie et les partis politiques, et, pour l'Italie, dans l'excellent livre de GIRETTI, I trivellatori della nazione.
[FN: § 2257-2]
Le procédé consistant à payer directement le vote des électeurs fut un moyen largement employé partout, et continue à l'être encore, bien que peut-être en de moindres proportions. Celui qui est vaincu par ce moyen le condamne sévèrement, et souvent de bonne foi. Celui qui en profite feint parfois de le condamner, mais quelquefois aussi prend franchement la défense des avantages procurés aux électeurs. Voici un exemple. Parlant de l'élection qu'on préparait à Cuneo, la Rivista popolare, 15 juin 1913, rapporte un passage d'un journal gouvernemental, emprunté à l'Unità de G. SALVEMENI, 16 mai 1913 : « (p. 288) Indépendamment de l'idée de la corruption électorale que nous ne pouvons même concevoir (sic ! remarque la personne qui cite cette prose), c'est un fait que les élections générales mettent en circulation beaucoup d'argent [ce n'est pas de la corruption, mais c'est tout comme]. Et quand l'argent circule, il circule pour tout le monde. C'est pourquoi on veut faire durer le plaisir. Nous le comprenons, ce sont des sacrifices, et des sacrifices très lourds, parce qu'ils ont un caractère financier. Mais la noble ambition de servir son pays doit bien impliquer quelque sacrifice. D'autre part, aucune loi n'oblige nos hommes politiques à courir la chance des élections. S'ils n'ont pas (p. 284) d'argent et ne savent pas en trouver, s'ils en ont et ne veulent pas faire de dépenses, qu'ils restent chez eux. Nous le répétons, personne ne les oblige à se mettre sur les rangs. L'honorable Giolitti, d'accord avec le chef de l'État, fixera les nouvelles élections quand il le jugera opportun, et quoi qu'il fasse, il fera bien. Pour notre compte, interprètes sûrs de l'immense majorité [des habitants] du pays, nous désirons que la campagne électorale soit longue, très longue. On glosera beaucoup, mais beaucoup d'argent circulera aussi ; il descendra jusqu'aux dernières couches sociales. En sorte que, – pour conclure,– que les candidats anciens et nouveaux ne se préoccupent pas de la date précise des élections, mais qu'ils se souviennent de l'avertissement du Seigneur : Estote parati. Qu'ils soient prêts, car ils ne savent ni le jour ni l'heure du fameux décret. Qu'ils soient prêts c'est-à- dire munis de tout, spécialement de viatique ». Le journal aurait pu ajouter que ce viatique est fourni à ses maîtres par les contribuables, tandis que les adversaires doivent le tirer de leur poche. Un honnête homme, comme il en est encore plusieurs, fait cette dépense, et voilà tout. Un autre homme, moins honnête, et il en est un très grand nombre, considère cette dépense comme un capital qu'il fait fructifier, lorsqu'il est élu. Et parfois, dans ce but, il pactise avec ses adversaires de naguère.
[FN: § 2257-3]
Toutes ne se font pas avec de l'argent ; les plus économiques sont celles que l'on fait en accordant des faveurs honorifiques ou autres. Elles rapportent parfois même de l'argent, que l'on peut ensuite employer à d'autres corruptions. Un exemple qui peut servir de type est celui dont on eut connaissance en Autriche, en 1913, et que le correspondant du journal La Liberté décrit très bien. La Liberté, 26 décembre 1913 : « M. Stapinski, chef du parti populaire polonais, a reçu de M. de Dlugosz, membre du cabinet en qualité de ministre pour la Galicie, des sommes importantes pour la presse et pour les opérations électorales du parti. C'est M. de Dlugosz lui-même qui le lui a reproché. Mais il se trouve que M. Stapinski est infiniment moins blâmable qu'on ne le crut tout d'abord. M. de Dlugosz, qui est polonais comme lui, est ami politique de son parti et possesseur d'une fortune considérable. En s'adressant à lui pour les besoins du parti, le député agissait correctement, et les sommes qu'il a reçues, il a cru les recevoir du coreligionnaire politique, du Polonais riche, généreux et dévoué à la cause. Or, il n'en était pas ainsi. M. de Dlugosz a mis à profit sa situation de membre du cabinet pour se faire accorder ces sommes par le président du conseil. L'argent provenait des fonds secrets. M. Stapinski ne le savait pas, et il n'a pas su non plus que M. de Dlugosz lui versait moins qu'il ne se faisait donner par la caisse des fonds secrets... Le cas du président du conseil, bien que très limpide au point de vue de l'honorabilité personnelle, n'est guère moins fâcheux au point de vue de l'exercice correct de sa fonction : il a disposé des fonds secrets dans un but de corruption parlementaire. À vrai dire, on sait bien que le gouvernement a des disponibilités pour influer sur les députés ou sur des groupes, mais on le sait sans le savoir : tant pis pour le ministre qui laisse saisir manifestement sa main dans une opération de ce genre. Il ne lui reste qu'à disparaître. Cette affaire a donné lieu à de longs débats au cours desquels la Chambre a entendu de belles vérités. M. Daszynski, par exemple, certifie que, depuis sept ans, les élections de Galicie ont coûté quatre millions aux fonds secrets de l'intérieur. Or, l'intérieur ne dispose, sous ce titre, que de 200 000 couronnes par an, soit en sept ans 1 400 000 couronnes. Où a-t-il trouvé le surplus de 2 600 000 ? Un interrupteur a répondu – Et les dons pour but humanitaire ? – Voici ce que signifie cette observation : Dans les heures critiques de l'ancienne Rome, on nommait un dictateur ; ici, on crée des barons ; ce sont des financiers et des industriels richissimes ; le décret mentionne comme titres à la nomination : services à l'économie nationale, à l'industrie, au commerce, donations humanitaires. C'est une croyance solidement établie ici que les services les plus spécialement récompensés sont ceux dont le décret ne parle pas. Ainsi s'explique l'énorme disproportion qui existe entre les libéralités de la caisse des fonds secrets, soit du ministère de l'intérieur, soit des affaires étrangères, et la modicité de la dotation régulière de ces deux départements pour leurs opérations discrètes. N'a-t-on pas établi qu'un seul journal, la R., [nous supprimons le nom] coûtait à l'intérieur près de cent mille francs par an de plus que l'allocation totale des fonds secrets ? Je ne parle que de l'intérieur. Si nous nous occupions des opérations de l'autre département, la chose nous mènerait trop loin, puisqu'elle nous engagerait dans des excursions à l'intérieur [il faut probablement lire extérieur]. Le député Tusar a fait remarquer avec beaucoup d'à propos que, depuis quelque temps, on ne sortait pas des affaires vilaines : c'est vrai. Nous avons eu l'affaire Prohazka, l'affaire de la Société des jeux en Hongrie et maintes autres, mais surtout celle du Canadian Pacific, qui est un des scandales les plus surprenants dont on ait jamais eu le spectacle. Là, je dois le dire, le fonctionnarisme autrichien apparaît dans un rôle sympathique, honorable et presque touchant. Le ministère du commerce voit le port de Trieste boycotté et la navigation nationale étranglée par le puissant syndicat des compagnies allemandes qui travaillent pour Brême et Hambourg, et opèrent avec un sans-gêne aussi brutal que celui du sous-lieutenant Forstner et de son colonel. En conséquence, et afin de briser ce monopole, il s'entend avec une compagnie anglaise assez puissante pour soutenir la lutte, le Canadian Pacific, qui favorisera le port de Trieste en y dirigeant l'émigration. J'estime, disait avec émotion à, la commission d'enquête un chef de division de ce ministère, j'estime que le fonctionnarisme autrichien a bien le droit de servir les intérêts de l'Autriche ! Mais le puissant syndicat allemand met en mouvement un journal, la Reichspost, et des émissaires qui obtiennent l'aide de l'autorité militaire, et par ordre de celle-ci, tout le personnel du Canadian Pacific est arrêté, ses bureaux sont fermés et ses services suspendus. On a vu par conséquent des intérêts étrangers triompher des intérêts nationaux, et la direction de l'armée autrichienne se faire, à son insu sans doute, l'agent instrumentaire du syndicat allemand contre le gouvernement autrichien. Il a fallu l'intervention de la Chambre et l'enquête parlementaire pour ramener dans le droit chemin l'autorité militaire dévoyée par la Reichspost et les autres agents du grand syndicat allemand. Quelle fut dans ces rôles divers la part de l'inintelligence et celle de la vénalité ? Que ceux-là le disent qui le savent, mais tout n'est pas imputable à la maladresse ni à la simplicité, car le cas du candide député Stapinski, vendu sans le savoir, doit être une exception assez rare à notre époque peu naïve » (ACHILLE PLISTA). – En Angleterre, les élections faites par le ministre Asquith pour déposséder la Chambre des Lords coûtèrent des sommes énormes, fournies en grande partie par de riches industriels et commerçants. En Italie, et plus encore en France, la distribution des décorations est un moyen de gouvernement qui a le mérite de ne pas coûter de l'argent. L'invention du « mérite agricole », souvent décerné à qui ne sait pas même distinguer l'orge du froment, celle des « palmes académiques », souvent données à qui est en guerre avec la grammaire, et d'autres titres honorifiques, ont fait épargner des millions et des millions au pays. En Italie, le gouvernement se sert aussi de son pouvoir d'accorder ou de refuser le port d'armes. Il l'accorde à ses partisans, le refuse à ses adversaires. Surtout en temps d'élections, il arrive que là où la lutte est la plus vive, il l'accorde à la clique enrôlée, qui soutient le candidat du gouvernement par des procédés qui ne sont pas toujours licites, tandis qu'il le refuse au parfait honnête homme qui se montre favorable au candidat d'opposition. Depuis le temps où Aristophane étalait au grand jour, sur la scène, la corruption des politiciens athéniens, jusqu'au temps où l'enquête du Panama et d'autres semblables dévoilaient la corruption des politiciens contemporains, bien des siècles se sont écoulés, on a écrit force traités de morale et fait d'innombrables prêches dans le but de ramener les hommes à une conduite honnête et droite. Comme tout cela a été vain, il est évident que les théories éthiques et les prêches ont été absolument impuissants à faire disparaître, ou seulement à diminuer la corruption politique, et il est très probable qu'ils demeureront tels à l'avenir. Tout autres sont les faits avec lesquels le phénomène est en relation étroite. On remarquera encore que la connaissance désormais certaine et très étendue de tant de ces faits de corruption politique, est impuissante à ébranler la foi de certains intellectuels en « l'État éthique », et celle du vulgaire dans les gouvernements qui doivent, au moins en partie, leur existence et leur pouvoir à cette corruption. De même, au moyen âge, la simonie et les mauvaises mœurs de beaucoup de papes n'entamèrent nullement la foi catholique. Bien plus, dans une de ses nouvelles, Boccace montre par une belle dérivation qu'elles devaient la confirmer. À chaque pas, nous trouvons des faits semblables, qui font voir que, dans les populations, il existe deux courants : l'un de raisonnements logiques ou pseudo-logiques, l'autre de conceptions non- logiques, de croyances, de foi dont les hommes ne perçoivent pas les contradictions ; ou s’ils les perçoivent, aussitôt ils les repoussent comme chose importune, et les oublient. Ces deux courants coulent parallèlement, sans mêler leurs eaux, et sont, au moins en partie, indépendants.
[FN: § 2259-1]
Plusieurs gros volumes ne suffiraient pas pour citer ne fût-ce qu'une partie des faits très nombreux, observés à diverses époques et dans tous les pays. En Italie, parmi tant d'autres exemples, on peut citer celui de la construction du Palais de Justice, à Rome. Pour les détails, voir EUGENIO CHIESA ; La corruzione politica. L'inchiesta sul Palazzo di Giustizia, avec préface de NAPOLEONE COLAJANNI. Entre autres conclusions, la Commission d'enquête tire celle-ci : « 4. L'intromission de l'autorité politique dans la construction du Palais, très intense et nuisible même dans la période des travaux en régie, pour lesquels on dépensa 937 328 francs, nominalement pour des travaux de conservation et de préparation, en fait pour donner de l'ouvrage à 400 ouvriers appelés les tailleurs de pierre d'État, à cause de leur immutabilité et de leur maigre productivité. Il est intéressant de remarquer que cela est écrit sous un gouvernement dont c'était un artifice habituel que d'accorder des subsides à certaines coopératives, pour se concilier les bonnes grâces des socialistes. Aussi bien que les tailleurs de pierre, ces coopératives méritaient le nom de coopératives d'État (§ 2261 1) ». L'œuvre du ministre Branca avait été blâmée par la Commission. La veuve du ministre écrivit très justement au Giornale d'Italia (30 avril 1913) : « ... permettez-moi... de protester vivement contre ce que la dite Commission reproche à mon défunt mari, Ascanio Branca. Je me souviens très bien que lorsqu'il fut ministre des Travaux Publics, il dut donner suite à la convention en question sur les injonctions du ministre de l'intérieur d'alors, le marquis Di Rudini, lequel, préoccupé de responsabilités d'ordre public [quand on ne peut employer la force, il faut avoir recours à l'artifice], pour éviter une grève très grave, crut devoir régler de cette manière sa conduite politique ». De même, c'est en toute justice que le fils du défunt ministre Ferraris défendit efficacement son père, en citant et en prouvant les nombreuses pressions exercées sur celui-ci, qui était garde des sceaux, dans l'affaire du Palais de Justice. Entre autres lettres, remarquable est celle que le garde des sceaux écrivait le 11 juillet au Président du Conseil (Giornale d'Italia, 3 mai 1913) : « Avant de céder, comme vous dites – et c'est la vérité – qu'il me soit permis de dire ce que je pense de la question des travaux publics de Rome. Depuis 1879, le Gouvernement et la Commune se sont fait illusion ou ont voulu se faire illusion : ils ont certainement fait illusion au Parlement, au Pays [à vrai dire, ce ne fut pas une illusion, mais une conséquence d'un certain procédé de gouvernement]. Au lieu de prendre résolument sur lui aussi bien les frais que la direction des travaux nécessaires à la transformation de la capitale,... l'État les céda ou feignit d'en abandonner la charge à la Commune. Celle-ci s'en chargea, en partie sans savoir ce qui se faisait, et peut-être encore plus parce qu'elle acceptait, en attendant, le concours de l'État, sauf à régler les comptes plus tard. En tout cas, la Commune accepta le subside. Le Gouvernement, complice ou impuissant, la laissa faire... En attendant, la Commune fit tout de travers, et sera toujours dans l'impossibilité de bien faire, parce qu'elle n'a pas de traditions, parce que la politique s'en mêle [et dans le gouvernement ? La politique fait plus que de s'en mêler ! elle y domine !], parce que dans les élections ce ne sont pas les véritables intérêts communaux qui prédominent; enfin parce qu'elle est entraînée ou par connivence, ou par faiblesse, ou par incapacité [c'est exactement, précisément ce que l'Enquête a démontré être arrivé pour le gouvernement]. Le comble des erreurs fut la loi du 20 juillet 1890. Maintenant je vois que les mêmes erreurs se produisent avec cette loi par dessus le marché. Le Gouvernement veut se ménager la bienveillance de la Commune ; il veut éviter la crise municipale. Il n'a ni système ni courage pour trancher la question ouvrière [c'est toujours l'artifice qui remplace la force]. Il en résulte par conséquent que tous sont comme l'homme qui s'enfonce dans la fange [c'est dans la fange que les anguilles et les politiciens se trouvent bien] ; plus il s'agite, plus il s'enfonce. Pendant ce temps, Commune, Entreprise, agitateurs en profitent... Cela dit, moi qui suis d'une opinion contraire à celle que je vois l'emporter au Cabinet, je cède pour beaucoup, et même pour toutes les raisons ; mais vouloir que je choisisse comme représentant un magistrat romain, c'en est trop. Au sujet de la pression qu'on avait exercée sur moi [n'oublions pas que c'est le ministre chef de la magistrature qui écrit, et sur lequel on exerce des pressions ; mais alors quelles pressions doit-on exercer sur les simples magistrats, quand on veut obtenir d'eux des services politiques !], j'avais déjà donné des instructions au conseiller Gargiulo. Je le relèverai de cette fonction. Mais il ne fera pas d'autre désignation. À vous de m'indiquer qui je dois nommer, et je ferai la nomination en sachant que du moins je n'aurai aucune responsabilité de ce que fera ou ne fera pas mon délégué ». (La minute de la lettre est tout entière de la main de Ferraris.) Il est regrettable q ne nous n'ayons pas toutes les lettres que se sont écrites les ministres, en France et en Angleterre, à propos d'affaires : il y en aurait certainement de semblables. Il ne manque d'honnêtes gens dans aucun pays ; mais ils sont impuissants à résister aux artifices des politiciens. Ils sont broyés par cette puissante machine du régime politique. Parmi tant de documents qu'on pourrait citer, voir Atti della Commissione d'Inchiesta parlamentare sulle Banche, Roma 1894. Interrogatorii. Interrogatoire de Pietro Antonelli, p. 8 à 11. Interrogatoire de Carlo Cantoni, p. 38 à 39. En général, on voit les hommes politiques et les journalistes tournoyer autour des banques comme les mouches autour du miel.
[FN: § 2261-1]
À ce point de vue, entre beaucoup de partis il existe une différence de force plutôt que de programme. Il y en a des exemples à foison. L'Iniziativa, 19 avril 1913 : « Qui a oublié le concert de protestations qui s’élevèrent du camp socialiste – en première ligne celles de l'Avanti – lorsque quelqu'un éleva la voix contre la dégénérescence du mouvement ouvrier coopératiste socialiste ? On nia même ce qui était une vérité évidente : à savoir que grâce aux concessions des travaux publics, les coopératives socialistes étaient en train de préparer le vasselage des députés socialistes au gouvernement. De fait, aujourd'hui les liens entre le socialisme parlementaire et le gouvernement de Giolitti sont si étroits, et les rapports entre les coopératives socialistes et le ministère si intenses, qu'il sera absolument impossible de briser les uns et les autres. Naturellement, le ministère ne néglige aucune occasion de favoriser les coopératives socialistes contre toute règle de justice distributive. Vain aussi sera l’espoir que les députés socialistes – même ceux qui seront sur le point d'être élus par le suffrage universel – reviennent à un anti-ministérialisme sérieux et décidé. Relevant une récente déclaration de M. Nino Mazzoni, qui, une fois pourtant, a reconnu la dégénérescence des coopératives, que nous a préparée en Italie le socialisme officiel ou non officiel, l'Unità de Florence dit fort bien : „ Le dommage le plus funeste est causé par la nécessité où les coopératives mettent les députés ou les candidats députés, de monter ou de descendre continuellement les marches des ministères, avant d'obtenir qu'une œuvre publique soit discutée, puis que l'exécution en soit sollicitée, puis qu'elle soit effectivement confiée à telle coopérative, même contre l'avis des corps consultants, ensuite que, durant les travaux, on accorde toutes les facilités dont la nécessité se manifeste au jour le jour, et qui n'étaient pas prévues dans le contrat, et ainsi de suite (§ 2548). Un député contraint de suivre cette voie pourra-t-il jamais être sérieusement antiministériel ? Et la future Banque du travail ne sera-t- elle pas une source de corruption morale, d'asservissement des députés et des coopératives au gouvernement, et de ministérialisme chronique obligatoire ? Pour chaque prêt qu'il faudra obtenir, et pour chaque paiement qu'il faudra retarder, combien de fois les députés ne devront-ils pas s'humilier devant le président de la Banque, solliciter l'intervention du ministre ou du sous-secrétaire, et promettre tacitement quelque vilenie ? “ » – Corriere della Sera, 6 janvier 1914. La commission de la Chambre du Travail de Milan approuva l'ordre du jour suivant : « ... [la Chambre du Travail] proteste énergiquement contre la tentative de la Fédération milanaise des Coopératives de production et de travail, qui, au mépris de toute dignité syndicale, cherche à accaparer les travaux publics en Libye, fournis comme pot de vin par le gouvernement, après qu'il a donné le fallacieux prétexte de vouloir favoriser les coopératives ouvrières, dans l'unique but, au contraire, de compromettre et de briser la vive opposition de la classe laborieuse, à l'entreprise coloniale... ». Les provinces méridionales n'ont pas obtenu des faveurs aussi larges que les coopératives de la Romagne, dans le but d'apprivoiser le socialisme. C'est pourquoi leurs députés parlent sévèrement des dépenses faites en Romagne. Le député Tasca di Cutô, qui pourtant est socialiste, en fait mention à la séance de la Chambre du 4 mars 1914. Compte rendu du Giornale d'Italia : « Tasca... L'État ne peut, par suite de préoccupations de nature électorale et doctrinale, continuer à être un immense laboratoire d'instruments orthopédiques pour les divers rachitismes économiques qui ont besoin de son aide ; et l'on ne peut permettre qu'il protège et subventionne des privilégiés, que ceux-ci appartiennent à la haute banque, ou à certaines classes de travailleurs qui s'endorment déjà dans un coopératisme économique de bas étage ! Tandis que le nombre de nos émigrants croît d'une manière inquiétante, l'État subventionne des spéculations erronées, qu'elles soient parties de groupes d'ouvriers ou de groupes capitalistes qui aboutissent à la haute banque (très vives approbations ; commentaires ; protestations sur quelques bancs de l'extrême) ». Nous empruntons la suite au Corriere della Sera : « Marchesano s'adressant aux socialistes : „ Le gouvernement n'accorde des faveurs que contre des faveurs (commentaires). – Tasca. Ne serait-il pas temps de mettre un frein à ce système dans lequel les dépenses que nous appelons civiles vont prenant tout à fait l'aspect de celles que nous définissions tantôt comme improductives ? Je demande si nous devons persévérer en une politique de travaux qui est son propre but, et qui résulte de préoccupations électorales et d'ordre public ? ; en une politique qui, sous le prétexte de remédier au chômage, fait une culture intensive du chômage même (approbations très vives sur les bancs de la majorité ; très violentes protestations des socialistes) ». Peu avant, une séance tumultueuse avait eu lieu à la Chambre. Il s'agissait de savoir si le gouvernement était ou non engagé par la promesse du ministre Sacchi, d'accorder les « bonifications » de l'Italie Septentrionale, à raison de 30 à 40 millions par année, somme tirée de la Caisse de Dépôts et Prêts. Les dépenses pour les dites « bonifications » ont principalement pour but de bien payer les coopératives, et d'apprivoiser leurs protecteurs. En France, les dépenses faites dans des buts politiques analogues portent différents noms, mais ne sont pas moindres ; au contraire, elles sont plus grandes. Il suffira de rappeler l'exemple de l'exploitation des chemins de fer de l'Ouest-État ; elle a pour but principal de recruter des électeurs au parti radical-socialiste dominant. – La Liberté, mars 1914, emprunte au rapport du député Thomas l'indication des déficits de cette exploitation. ils sont, en millions de francs : 1909, 88 – 1910, 58 – 1911, 68 – 1912, 76 – 1913, (prévu) 84. Le journal ajoute : « Le système d'exploitation des chemins de fer de l'État aboutit nécessairement à la ruine par le gaspillage. Ce n'est assurément pas la faute des ingénieurs... Mais ils sont prisonniers d'un système qui n'est lui-même que l'expres- sion d'abus, d'erreurs et d'intérêts politiques. Dans ce système, le plus urgent bénéficiaire de l'exploitation n'est pas le public qu'il s'agit de servir, mais le personnel dont il importe de s'assurer les votes. Certes la Compagnie a le devoir de veiller au bien-être de ses agents... Mais à l'Ouest-État, ce ne sont pas les services du travail que l'on rémunère le plus, ce sont les dettes électorales des députés, à la fois protecteurs et obligés de celui-ci ou de celui-là, que l'on acquitte avec le plus de générosité ». En Italie, il est des causes semblables, parmi celles du mauvais fonctionnement des chemins de fer, des retards des trains, des fréquents accidents, des vols de marchandises et de bagages.
[FN: § 2262-1]
Pour avoir un exemple concret, reportons-nous à l'affaire Rochette, en France. Elle peut servir de type à une classe très étendue de faits. Il faut, pour cela, faire abstraction du pays où elle s'est déroulée – il s'en passe de semblables en d'autres pays ; – du régime politique – les monarchies et les républiques sont sur le même pied ; – des partis – ils n'agissent pas très différemment ; – des hommes – si ce n'étaient ceux dont il s'agit, d'autres accompliraient les mêmes actions, qui sont proprement la conséquence de l'organisation sociale. Afin de puiser nos renseignements à une source non suspecte, écoutons le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire. Journal officiel, Chambre des députés, 2e séance du 3 avril 1914 : « (p. 2282) Il est acquis qu'en mars 1911, entre le 22 et le 30 mars, – je déclare que pour moi les dates importent peu, le fait seul importe [réponse aux dérivations qui, en discutant l'accessoire, voulaient faire oublier le principal] – M. Monis, ministre de l'intérieur et président du conseil a, sur la demande de son collègue, M. Caillaux, fait appeler M. le procureur général Fabre. M. Monis, président du conseil et ministre de l'intérieur, étranger aux choses de la justice par la constitution même du ministère auquel il appartenait, a donné, appelez cela des ordres, appelez cela des instructions, appelez cela l'expression d'un désir, les nuances importent peu [réponse à une autre dérivation du genre de la précédente], il a donné à M. Fabre des indications lui faisant connaître que le Gouvernement voulait arriver à obtenir la remise de l'affaire Rochette, affaire qui durait déjà depuis quatre ans [durant lesquels, grâce à la protection des politiciens, Rochette Continuait à constituer des sociétés fictives et à empocher de l'argent, dont la majeure partie allait d'ailleurs à la presse et aux politiciens]… En 1911, qu'est-ce qu'on attaquait ? Qu'est-ce que l'on critiquait ? L'on blâmait la mainmise brutale et excessive de la police sur la personne de Rochette, à l'aide d'un témoin payé et fictif [les A contre les B ; dans le second acte du drame, on voit les B contre les A]. (p. 2283) M. Jules Delahaye : ...Oui, on a beaucoup reproché aux magistrats d'avoir été trop pressés, trop brutaux comme vous dites... Oui ou non, y avait-il eu des avis donnés à la bourse pour faire un coup de bourse sur les valeurs Rochette ? Oui ou non, avant que les magistrats arrêtassent Rochette, cinq jours avant, y avait-il eu avis de M. Y, D., par exemple, puisque certains boursiers ont été prévenus de l'arrestation ? ... M. le rapporteur... [Il lit le procès-verbal que Fabre fit de sa conversation avec le ministre Monis]. Le mercredi 22 mars 1911, j'ai été mandé par M. Monis, président du conseil. Il voulait me parler de l'affaire Rochette ; il me dit que le Gouvernement tenait à ce qu'elle ne vint pas devant la cour le 27 avril, date fixée depuis longtemps ; qu'elle pouvait créer des embarras au ministre des finances au moment où celui-ci avait déjà les affaires de liquidation des congrégations religieuses, celle du crédit foncier et autres du même genre [ce genre consiste simplement à s'approprier l'argent du public, grâce à l'appui bien rétribué des politiciens et de la presse]. Le président du conseil me donna l'ordre d'obtenir du président de la chambre correctionnelle la remise de cette affaire après les vacances judiciaires d'août-septembre. J'ai protesté avec énergie... Le président du conseil maintient ses ordres... Je sentais bien que c'étaient les amis de Rochette qui avaient monté ce coup invraisemblable... J'ai fait venir M. le président Bidault de l'Isle. Je lui ai exposé avec émotion la situation où je me trouvais. Finalement, M. Bidault de l'Isle a consenti, par affection pour moi, a la remise demandée. Le soir même, le jeudi 30 mars, je suis allé chez M. le président du conseil et je lui ai dit ce que j'avais fait. Il a paru fort content... Dans l'antichambre, j'avais vu M. du Mesnil, directeur du Rappel, journal favorable à Rochette et m'outrageant fréquemment ; il venait sans doute demander si je m'étais soumis ». Le rapporteur continue : « voilà la situation ; et j'ai le droit de dire que, quand on lit ce document, quand on voit les sentiments qui ont animé le procureur général lorsqu'il l'a rédigé, on a la pensée inévitable qu'il y a là un document exact, reproduisant les faits tels qu'ils se sont passés... M. Bidault de l'Isle... a cédé. Il a accordé la remise, et tout ce que vous savez s'en est suivi. Rochette a pu continuer ses opérations, il a pu exploiter l'épargne... depuis avril 1911 jusqu'à février 1912 et, plus généralement, jusqu'à l'époque de sa fuite à l'étranger. Voilà le fait brutal, le fait matériel qu'on a nié pendant si longtemps, quand on n'en avait pas encore la preuve, mais qui est aujourd'hui éclatant comme la lumière qui nous éclaire... À mes yeux, l'œuvre républicaine qui s'impose impérieusement à l'heure actuelle, je le dis nettement, moi républicain de gauche, c'est de rétablir l'indépendance de la magistrature ». C’est précisément ce qu'on n'a pas fait, pas même dans une mesure minime, parce qu'on ne peut le faire sans altérer profondément l'organisation sociale. Depuis le temps où le procureur général Baudoin proclamait que le magistrat devait s'incliner devant le « fait du prince » (§ 1824), on n'a rien, absolument rien fait pour que le magistrat puisse au contraire demeurer indépendant. Cela montre la puissance des forces qui s'y opposent. Briand disait très justement « (p. 2288) Ah ! la magistrature manque d'indépendance !... Mais d'où vient le mal, messieurs, comment voulez-vous qu'ils soient pleinement indépendants ces magistrats ? Leur nomination, leur avancement, leur déplacement, leur carrière, leur vie, tout cela est entre nos mains ! – M. Maurice Violette: Vous l'avez eu quelquefois, vous, le pouvoir [dérivation : les B ne sont pas meilleurs que les A] ». Le rapporteur indique les motifs pour lesquels la magistrature devait obéir aux politiciens poussés par les financiers, « (p. 2282) Mais voilà : tous les magistrats ne sont pas des héros ! J'ajoute même, pour être juste, que tous ne sont pas tenus de l'être et que certains, chargés de famille, peuvent se trouver dans la situation de ne pouvoir faire de l'héroïsme. M. Fabre s'est peut-être souvenu de la disgrâce de l'un de ses prédécesseurs, M. Bertrand, qui fut victime de sa courageuse résistance aux exigences gouvernementales. Et puis, ce n'était pas la première fois qu'on faisait pression sur lui. Il avait connu les mêmes difficultés, notamment à l'époque des troubles de Champagne (§ 1716-5). De son côté, M. Bidault de l'Isle, arrivé à la fin de sa carrière, n'a pas voulu se compromettre ni exposer la situation et l'avenir de M. le procureur général ». Après cela, on croirait que le rapporteur conclut que les faits blâmés par lui sont la conséquence de la faculté laissée au gouvernement de donner des ordres aux magistrats. Au contraire, il dit : « C’est encore un exemple, messieurs, des inconvénients de cette camara- derie qui existe partout... » Nous avons ainsi l'une des dérivations habituelles, où, pour faire dévier l'attention, on parle de l'accessoire et l'on passe sous silence le principal.
[FN: § 2262-2]
Parfois il se trouve quelqu'un pour faire un pas dans la voie qui conduirait à une solution scientifique, mais aussitôt il s'arrête, retenu par la crainte de heurter certains principes ou certains dogmes. Journal officiel, loc. cit., § 2262-1-. « (p. 2308) M. le président de la commis- sion [Jaurès]... j'ai le droit de dénoncer pour le pays l'universelle conspiration de silence et d'équivoque. Et c'est à elle que vous devez qu'au lieu d'avoir résolu à son heure et réglé par une commission d'enquête nommée par vous il y a deux ans, le mystère se soit traîné d'intrigue en intrigue. fournissant à ceux que le procureur général appelait les „ frères ennemis “ des moyens réciproques de négociations ou d'intimidation [c'est la lutte des A et des B, à laquelle Jaurès oublie d'ajouter que les socialistes prirent aussi part, soit tenant eux aussi les puissances financières]. Eh bien, messieurs, je dis que l'heure est venue, pour le pays, de sortir de ce régime des intrigues des groupes et des clientèles... l'heure est venue pour nous de voir en face le grand et formidable péril qui le menace ; une puissance non pas nouvelle, mais grandissante plane sur lui, la puissance de cette finance haute et basse [il faut ajouter les entrepreneurs, et prendre garde que cette puissance a de solides fondements dans les œuvres socialistes] ». Après avoir comparé cette puissance à celle de la féodalité, Jaurès dit : « La nouvelle puissance, elle est aussi subtile que formidable, elle conquiert sans faire de bruit [jusqu'à la presse et aux associations socialistes], elle entre dans les intérêts, dans les consciences [sans exclure celles des socialistes], et il arrive une heure où une nation qui se croit souveraine, et qui accomplit avec solennité le rite du vote [voici l'un des dogmes qui barrent la route à l'orateur] est soudainement menée en captivité par les puissances, d'argent. Cette puissance, elle triomphe dans la décomposition des partis [observation contredite par les faits] ; elle triomphe par le pullulement de cette presse qui, n'étant pas rattachée à des centres d'idées, ne peut vivre que par des subventions occultes [la presse de partis bien déterminés estime elle aussi utile et agréable d'avoir sa part des bénéfices des puissances financières et des politiciens]… » Ici, Jaurès s'arrête dans la recherche des causes expérimen- tales du phénomène : il quitte la terre et s'envole dans les nuées : « Non ! l'organisation de la démocratie doit [doit ! et si elle ne le fait pas ?] se dresser en face de l'organisation de la finance [pour le moment elle la sert, plutôt que de la combattre : comment et quand verrons- nous le contraire ?], mais il faut [toujours l'expression d'un désir, au lieu de la recherche des rapports entre les faits] que ce soit une organisation active, ayant pour centre une idée, peut- flamme une conviction et une foi, et pour force de ralliement une doctrine et un program- me ». Sunt verba et voces praetereaque nihil. Là où Jaurès fait allusion aux politiciens auxquels le procureur général donne le nom de « frères ennemis », il s'en réfère à la déposition du procureur général, devant la commission d'enquête. « J'ai servi treize ministres de la justice. Puisse ce treizième ne pas me porter malheur ! Croyez-vous que ce soit facile de vivre, de durer au milieu d'hommes politiques qui se déchirent ? [quand les A et les B sont aux prises, les autres en profitent]. Je me suis maintenu comme j'ai pu entre ces frères ennemis ». – La Liberté, 20 avril 1914 : « L'Association amicale de la magistrature, dans un Congrès auquel assistaient 400 délégués représentant 1900 membres participants, a adopté un certain nombre de vœux, parmi lesquels il faut signaler ceux qui ont rapport à la situation morale et matérielle du magistrat, et à la nécessité de protéger les magistrats contre les ingérences des politiciens dans l'administration de la justice. Au banquet qui clôtura le Congrès, 200 magistrats prirent part, groupés autour de MM. Bienvenu-Martin, garde des sceaux ... ... Au dessert, M. Braibant, dans une allocution très applaudie, a parlé de l'ingé- rence profondément regrettable des représentants du pouvoir législatif dans l'administration de la justice. Il a signalé aussi la légende qui court dans la magistrature et d'après laquelle, pour obtenir de l'avancement et pour arriver à une situation acceptable, il faut avoir de l'entregent, il faut s'entourer d'amitiés et ne pas craindre d'entrer dans la clientèle de hauts et puissants protecteurs : „ L'Association amicale des magistrats, s'est écrié M. Braibant, a été fondée justement dans le but d'assurer à nos collègues des garanties contre cette ingérence et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif “. M. Willm, député de la Seine, a rappelé lui aussi les incidents qui coûtèrent à M. Fabre son poste de procureur général : „ Il est parti, a-t- il dit, en emportant l'estime et le respect de tous ses collaborateurs “. M. Bienvenu-Martin interrompit alors l'orateur par ces mots : „ C'est une critique de ma politique personnelle “. M. Willm se défendit de toute critique à l'adresse du garde des sceaux et termina ainsi au milieu d'applaudissements répétés : „ La justice doit être hors de toute atteinte, en dehors et au-dessus de tous les partis, et le meilleur moyen de sauver la République, c'est encore de donner aux justiciables l'impression que la justice ne connaît aucune défaillance “ ». – ROBERT DE JOUVENEL ; La rép. des camarades : « (p. 178) D'ailleurs, si le magistrat a besoin du gouvernement le gouvernement a souvent besoin de la magistrature. Toute l'histoire scandaleuse de la troisième République est celle des compromissions et des conflits qui sont intervenus entre le pouvoir exécutif et l'autorité (p. 179) judiciaire (§ 2548). Le krach de l'Union générale, Panama, l'affaire Dreyfus, l'affaire Humbert, l'affaire Rochette ne sont que les épisodes de la vie du parquet de la Seine, depuis trente ans. Le ministre de la Justice, qui demande à un procureur général de lui désigner un juge d'instruction ou un président „ sûrs “, sait fort bien dans quel sens il sera entendu. Le magistrat qui vient d'être promu est généralement beaucoup moins „ sûr “ que celui qui attend un avancement. Celui qui vient d'atteindre l'âge de la retraite est plus indépendant que celui qui redoute une révocation sans pension ». En Italie le danger d'être déplacé d'une bonne résidence à une médiocre ou mauvaise agit puissamment sur l'esprit des juges qui ne sont pas des héros. Or, de tout temps les héros furent rares. « (p. 181) Il n'y a, pour ainsi dire, pas un dossier de magistrat qui ne contienne au moins dix recommandations politiques. C'est en pesant ces recommandations, que les ministres font les mouvements judiciaires ».
[FN: § 2262-3]
Ce fut de cette manière que le socialiste Sembat sauva ses amis radicaux compromis dans l'affaire Rochette. Gazette de Lausanne, 6 avril 1914. Le correspondant raconte la séance de la Chambre où fut approuvé l'ordre du jour sur l'affaire Rochette : « On y a substitué [aux conclusions de la commission d'enquête] un texte assez anodin, qui se bornait à „prendre acte des constatations “ de la commission, et à réprouver l'intervention de la politique dans la justice, intervention qui a été l'une des principales industries de la majorité qui éprouvait le besoin de la « réprouver » avant de s'en aller. Ce texte avait l'avantage de mettre hors de cause MM. Briand et Barthou, et de n'atteindre MM. Monis et Caillaux que dans les termes les plus impersonnels et les plus généraux. C'est ici que M. Sembat est intervenu avec une habileté supérieure. M. Sembat se rendait parfaitement compte du discrédit auquel s'exposait le parti socialiste en s'associant à la politique „ épongiste “ de M. Jaurès. Il a donc réclamé des poursuites judiciaires. Seulement, il les a réclamées à la fois contre MM. Caillaux, Monis, Briand et Barthou. C'était un moyen très sûr de ne les obtenir contre personne, et de pouvoir dire ensuite que le parti socialiste avait été seul à les vouloir. M. Sembat est un homme ingénieux et subtil ». En Angleterre, Lloyd George et lord Muray furent sauvés par l'indulgence des chefs du parti opposé, lesquels comptent naturellement sur une indulgence analogue en faveur de leurs amis.
[FN: § 2262-4]
Journal officiel, loc. cit., § 22621 : « (p. 2291) M. Maurice Barrès... Il y avait [dans la commission d'enquête de l'affaire Rochette] des hommes attachés, liés, dominés, commandés par leur amitié, par leur fidélité dans le malheur. Sur ceux-là je ne ferai aucun commentaire. D'autres jugeaient que M. Caillaux, en se faisant l'interprète du désir d'un avocat son ami... avait voulu être obligeant, avait donné un témoignage de bienveillance naturelle, une preuve de camaraderie, que M. Monis, d'autre part, en cédant au désir de M. Caillaux, était entré dans le même esprit de bienveillance, de camaraderie, de facilité. Mais les mêmes commissaires trouvaient, au contraire, que c'étaient de grands coupables, les Briand et les Barthou, que c'étaient eux les méchants qui s'acharnaient sur ces hommes véritablement bons et tombés dans l'embarras à cause de leur bonté même, les Caillaux et les Monis [dérivation de la contre-attaque des A contre les B]. Facilitons-nous la vie aux uns les autres, voilà le sentiment qui dominait les esprits dans la commission [non pas dans la commission seule, non pas dans un pays plus que dans un autre, mais chez tous ceux qui composent l'état-major de la spéculation, et partout où celle-ci est souveraine], et cela s'accorde singulièrement à la définition qu'Anatole France donne de notre régime, quand il écrit : „ C'est le régime de la facilité “... Le problème n'est pas un problème restreint, médiocre, vous n'aurez pas à juger des défaillances individuelles, vous aurez à vous prononcer et à dire si vous acceptez la défaillance même du régime. – M. Jules Guesde. Pas celle du régime républicain, puisque les mêmes faits se passent dans l'Angleterre monarchiste et dans l'Allemagne impérialiste. C'est le régime capitaliste qui en est cause ». Il y a du vrai dans cette observation de M. Guesde, pourvu qu'à l'organisation « capitaliste » on substitue l'organisation dans laquelle ce sont les « spéculateurs » qui gouvernent. Ceux-ci pourraient encore gouverner avec un régime socialiste ; ils agissent même déjà puissamment sur la presse socialiste et sur les chefs du parti.
[FN: § 2262-5]
Il n'est pas facile de connaître la somme d'argent que la presse prélève sur les financiers, et grâce à laquelle elle leur témoigne sa bienveillance, ainsi qu'aux politiciens leurs amis. L'aventure du Panama a montré que cette somme est parfois très grande, et beaucoup d'autres indices confirment que ce n'est point là un fait exceptionnel. Les frais dits « de publicité » sont, pour un grand nombre d'entreprises, très importants. Devant la commission d'enquête sur l'affaire Rochette, l'agent de publicité, M. Rousselle, a déposé. Il faut tenir compte de ce qu'il a dit, car c'est un des rares documents qui mettent en lumière des faits peu ou point connus du public. « M. de Folleville. Vous êtes agent de publicité. Vous avez spécialement été mêlé aux affaires Rochette. – M. Rousselle. J'ai fait de la publicité pour les affaires Rochette comme pour quantité d'autres banquiers. Quand un banquier désire faire une émission ou introduire des valeurs sur le marché, il est indispensable qu'il en fasse connaître les avantages comme s'il s'agissait d'une marchandise. Pour obtenir ce résultat, il a recours à la publicité des journaux. L'agent de publicité discute dans quelles conditions le concours des journaux sera donné, c'est-à-dire dans quelles conditions les renseignements seront publiés. Une rémunération est convenue en cours de publicité ; l'agent de publicité verse la somme convenue. Le mode de paiement varie suivant le crédit des banquiers. – M. de Folleville. À quel chiffre se sont élevées les dépenses de publicité de Rochette ? – M. Rousselle. Il y a un certain nombre d'affaires dites Rochelle qui sont postérieures à son arrestation. Pour les affaires qui sont réellement des affaires Rochette, c'est-à-dire qui sont antérieures à son arrestation, de façon approximative, j'ai distribué deux millions, je crois. Dans les affaires qui ont suivi, à peu près un million. – M. de Folleville. Teniez-vous une comptabilité de ces distributions ? – M. Rousselle. Dans les affaires de publicité financière, j'agis comme un mandataire. Quand l'affaire est terminée, je rends compte au banquier avec qui j'ai traité de l'emploi des sommes qui m'ont été confiées et je lui rends compte des documents afférant à l'affaire. – M. de Folleville. Conservez-vous une comptabilité susceptible d'établir l'emploi que vous avez fait ? – M. Rousselle. Ces affaires sont trop anciennes pour qu'il me soit possible actuellement de reconstituer le détail. Je pourrais reconstituer les totaux. Les bénéficiaires, je crois que c'est impossible. – M. Leboucq. Traitez-vous directement avec les directeurs de journaux ? – M. Rousselle. Je ne traite pas généralement avec le directeur politique du journal, mais avec un représentant. – M. Leboucq. Vous êtes agent de publicité pour votre compte ? Quand vous traitez avec un journal, comment procédez-vous ? – M. Rousselle. Certains journaux traitent directement. Certains sont affermés. Il y a une tendance actuelle à l'affermage. À l'époque Rochette, c'était plutôt l'exception. – M. Leboucq. Quand vous traitez, avez-vous un prorata établi d'avance pour chaque journal ? – M. Rouselle. Oui. – M. Leboucq. Dans les affaires Rochette avez-vous forcé le pourcentage d'un journal quelconque ? – M. Rousselle. Les prix ont été dans l'ensemble les mêmes que ceux que je donnais pour des affaires qui n'étaient pas des affaires Rochette. – M. Leboucq. Quel est le pourcentage des distributions que vous avez faites eu égard au chiffre global des affaires ? - M. Rousselle. Cela représente 3 %. - M. Delahaye. On a dit 10 %. - M. Rousselle. À côté de la publication dans les journaux, Rochette dépensait beaucoup d'argent en circulaires et en publications de journaux spéciaux. - M. Leboucq. Ne trouvez-vous pas que ce complément de 7 % est exagéré ? - M. Rousselle. Il faudrait voir les comptes. Rochette dans sa façon de placer le papier employait le procédé de publicité par lettres. - M. de Folleville. Avait-il beaucoup de démarcheurs ? - M. Rousselle. Je le crois. Il avait des succursales en province. Il avait à côté des banques qui travaillaient pour lui ». Le bon public paie tout cela, admire et encense ceux qui le tondent ainsi, accorde créance aux journaux qui les défendent, appelle « éthique » l'État qui les favorise.
[FN: § 2262-6]
Déposition de M. Barthou devant la Commission d'enquête sur l'affaire Rochette : « Je dis à M. Caillaux : „ Il se passe au Ministère de l'intérieur des choses qui m'étonnent. Le président du conseil a fait venir le procureur général pour lui dire de faire remettre l'affaire Rochette “. M. Caillaux me répondit que c'était lui qui était intervenu auprès de M. Monis pour demander la remise. Il me dit que Rochette avait la liste des frais d'émission relatifs à certaines de ses affaires antérieures, qu'il se proposait de les publier, que cette publication pourrait entraîner une grande émotion et qu'il était intervenu auprès de M. Monis pour lui dire d'empêcher cette révélation ». Déposition de M. Monis : « Il [M. Caillaux] ajouta ,, que si le renvoi était refusé, il [l'avocat] ferait une plaidoirie retentissante faisant allusion à des émissions ayant entraîné des pertes pour l'épargne qui n'avaient jamais été poursuivies “ ». Par conséquent, il y a un certain nombre de pirates, et celui qui devrait les détruire tous en sauve un, pour que les autres demeurent impunis. – Journal officiel. Chambre des députés, 2e séance du 3 avril 1914 : « (p. 2288) M. Aristide Briand... L'affaire Rochelle une fois terminée, mon intention était de faire venir le procureur général ; je l'aurais prié d'apporter l'original du document ; j'en aurais pris la copie et j'aurais brûlé les deux pièces sous mes yeux. Voilà ! On me dira : Vous auriez ainsi empêché la nation de connaître la vérité sur une affaire grave. Messieurs, cette affaire qui n'avait pas entraîné les conséquences juridiques que je redoutais, mais qui pouvait très bien, sans sanction possible, prendre les proportions d'un scandale, je me félicite de ne l'avoir pas éveillée (très bien très bien ! au centre et sur divers bancs à gauche). Je m'en félicite, et comme homme de gouvernement, et comme Français, et comme républicain. Je m'en félicite d'autant plus que, depuis j'ai lu les journaux de l'extérieur, et j'ai vu le cas qu'on peut faire au dehors de semblables affaires ». Ces sentiments étant ceux d'un grand nombre de personnes, nous pouvons conclure que seule une petite partie de faits analogues nous est connue, et que nous connaissons uniquement quelques types d'une classe nombreuse.
[FN: § 2262-7]
MACHIAV. ; La mandragola, acte IV, scène VI.
[FN: § 2264-1]
Diog. Laert., VI, 2, 45 : ![]()
![]() . Les
. Les ![]() étaient certains magistrats dont il est souvent fait mention, sous des noms différents.
étaient certains magistrats dont il est souvent fait mention, sous des noms différents.
[FN: § 2264-2]
En Italie, en 1913, l'enquête sur le Palais de Justice mit en lumière un document qui résume les règles que les entreprises contractant avec l'État doivent suivre, tant que subsistent les institutions actuelles. Ce document est cité de la façon suivante, dans la Rivista popolare, 15 mai 1913 : « (p. 233) L'intérêt de l'entreprise serait : 1° de continuer à supporter comme aujourd'hui ; 2° de poser en attendant les questions, pour les faire discuter ensuite ; 3° de s'acclimater au personnel. En avertissant le ministre, l'entreprise se prive de sa faveur, et fait un saut dans la nuit. Le ministre sera-t-il assez honnête, assez au-dessus de toute attaque, pour protéger l'entreprise contre toutes les éventualités indiquées plus haut, et contre les gens qui rôdent autour ?... Étudier : si l'affaire est menée comme aujourd'hui, quels en seront les résultats financiers, au cas où l'entreprise se soumettrait sans émettre de prétentions ? Avec le gouvernement, il ne peut y avoir d'entreprises de bonne foi, mais des entreprises de mauvaise foi, qui, fortes du dommage qu'elles causent, attendent et assistent aux exactions de la bureaucratie, e t puis vont discuter ». La Rivista ajoute : « La Commission d'enquête qualifia ce plan diabolique d'acte blâmable et peu correct [si la Commission ne savait pas que ce plan est celui que suivent et doivent suivre presque toutes les entreprises qui ont affaire avec l'État, elle faisait preuve d'une grande ignorance ; si elle le savait, elle témoignait une belle hypocrisie]. C'était le moins qu'elle pouvait dire [non : elle devait ajouter que la faute n'en était pas à qui écrivait dans ce plan des choses connues de tout le monde, mais aux institutions dont elle provenait nécessairement]. Mais dans sa propre défense, l'honorable Abignente affirma, avec un rare courage, qu'il suffit de le lire [le plan] pour en comprendre l'esprit et la corruption. Cette affirmation, nous le répétons, prouve la grande audace de son auteur [simplement audace de répéter publiquement ce que tout le monde dit en particulier]. Il est d'ailleurs dans le vrai, lorsqu'ayant terminé sa lecture, il ajoute : Ce trait est l'histoire de toutes les entreprises de travaux publics de notre État [c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité], toutes menées ainsi par la faute des institutions ; institutions dont le député Abignente dénonça la défectuosité à la Chambre, ainsi qu'il l'affirma, le 5 juin 1905 ». Il faut d'ailleurs ajouter qu'on ne peut changer ces institutions sans les remplacer par d'autres semblables, parce qu'elles sont nécessaires aux politiciens et à leurs partisans pour qu'ils en fassent leur profit Les électeurs du député Abignente comprirent bien qu'on ne pouvait rejeter sur un homme la faute qui provient des institutions. Comme il avait donné sa démission, ensuite du blâme de la Commission d'enquête et de la Chambre, ils le réélurent non seulement pour la même législature, mais encore pour la suivante, lorsqu'eurent lieu les élections générales de 1913.
[FN: § 2265-1]
En septembre 1918, recherchant comment et pourquoi de semblables faits se produisaient, l'Iniziativa écrivait : « Ce ne sont pas les députés qui sont mauvais ; ce sont les électeurs, et spécialement les grands électeurs, qui sont très mauvais. C'est la façon dont on choisit et dont on élit les députés qui est défectueuse. Un article de l'Avanti s'arrête quelque peu sur les critères d'après lesquels les candidatures sont préparées et proclamées en beaucoup d'endroits. „ Par exemple, écrit le journal socialiste, – chez les méridionaux, on est persuadé un peu partout (ou l'on agit comme si l'on était persuadé) que lors même qu'on ne demande pas la reconnaissance d'un droit par un bureau quelconque de l'État... l'appui du député, la recommandation du personnage influent est nécessaire (§ 2268 2). Naturellement, c'est là le système breveté pour la production des députés ministériels à outrance ! En effet, même si le député assumant la représentation d'un collège avait des intentions de correction et d'indépendance, il est obligé, au bout de quelque temps, de se livrer pieds et poings liés au gouvernement, dont ses électeurs eux-mêmes le rendent vassal, par la demande à jet continu d'appui et de recommandations. Je pourrais citer – dit l'auteur de l'article – les noms, très connus dans l'entourage de Montecitorio, de collèges dont les représentants électoraux sont venus à Rome pour chercher un candidat, auquel ils ne demandaient ni la foi politique, ni un programme, mais seulement... d'obtenir l'appui du gouvernement. D'autres collèges du Midi ont demandé au gouvernement... un candidat, besogne à laquelle il semble que se soit employé plusieurs fois le comm. Peano, l'alter ego du député Giolitti qui, avec raison, la jugeait une besogne à l'usage de consciences abjectes ! Il est naturel que dans la députation politique d'une région, qui recrute par ces procédés un grand nombre de ses représentants, il s'insinue des hommes sans scrupules et même de vulgaires forbans ! Mais on n'a pas le droit de s'en étonner et de s'en plaindre, surtout si l'on n'a rien fait pour l'empêcher, et si, au contraire, on a soi-même contribué volontairement à produire et à perpétuer le hideux phénomène “ ».
[FN: § 2267-1]
La corruption de la police de New-York est en partie la conséquence du fait qu'on veut stupidement imposer la vertu par la loi. Sans la bienveillance achetée d'une police qui sait fermer les yeux, la vie à New-York deviendrait impossible. Ce célèbre Gaynor, qui fit tant parler de lui, et certes pas à son avantage, ne voulait même plus laisser danser les habitants. La Liberté, 6 avril 1913 : « Une orgie de vulgarité, telle est, selon l'expression du maire de New-York, Mr. Gaynor, le mal dont souffre actuellement la haute société américaine. L'obsédant tango et le despotique turkey trot sévissent si furieusement cette saison chez les Transatlantiques que l'ordre de la ville en est gravement troublé ; et ce mal, de forme épidémique, est pour l'honorable magistrat un véritable cauchemar. La mode des soupers- tango, soupers qui généralement se prolongeaient jusqu'à l'aube, était devenue si rapidement dangereuse pour le maintien des bonnes mœurs, que Mr. Gaynor dut prendre récemment, pour enrayer le fléau, des mesures draconiennes. Il prescrivit la fermeture à minuit de tous les restaurants de nuit et appliqua ce décret avec une impitoyable rigueur. Il y a quelques jours, plusieurs fêtards des plus en vue ayant voulu narguer la loi furent expulsés manu militari au moment précis où sonnait l'heure de fermeture ; les policemen intraitables refusèrent même de leur laisser prendre leurs chapeaux et pardessus, qu'on leur apporta sur le trottoir. Les soupers devenus impossibles, les Américains – les Américaines surtout – se rabattent sur les five-o'clock. De cinq à sept, dans les établissements en vogue, on ferme soigneusement les rideaux, on allume l'électricité et, cet artifice donnant l'illusion de la nuit, on se livre aux douceurs du turkey trot ou du grizzly-bear. Mr. Gaynor a fait surveiller ces établissements par ses agents, et les rapports de police lui ont révélé, paraît-il, d'horribles détails. Estimant que cette désinvolture des mœurs n'est pas compatible avec le régime d'austérité démo- cratique inauguré par Mr. Wilson à la Maison-Blanche, Mr. Gaynor a présenté hier au corps législatif de l'État de New-York un projet de loi qui doit porter aux danses excentriques un coup mortel. À l'avenir, la danse sera formellement interdite dans tous les établissements publics. L'infortuné maire cependant n'est pas au bout de ses peines. Il est un dernier rempart où se réfugie le tango : le salon privé. Et on vient de lancer dans le plus mondain des salons de Washington une mode qui va le mettre au désespoir. L'électricité éteinte, on danse dans l'obscurité complète ; les couples, pour se guider, n'ont que la lueur d'une petite lampe de poche que tient le cavalier. C'est d'un effet très curieux, et c'est le tout dernier cri ».
[FN: § 2267-2]
Vers la fin de l'année 1912, Huerta était président du Mexique. Le gouvernement des États-Unis faisait preuve d'une grande hostilité à son égard, tandis que le gouvernement anglais avait commencé par le favoriser, puis l'avait abandonné, uniquement pour n'avoir pas de conflit avec les États-Unis. En somme, le conflit était d'ordre exclusivement financier. Porfirio Diaz, président du Mexique en 1900, avait alors accordé à Henry Clay Pierce des droits sur un grand territoire pour en extraire le pétrole. Ensuite il les vendit à la très puissante Standard Oil Cy. Mais surgit une société anglaise, la Eagle Oil Cy (Compania Mexicana de Petroleo Aguila), qui se mit à faire concurrence à la première. Le président Madeiro, qui avait succédé à Porfirio Diaz, favorisait, non sans profit, la société américaine, et avait médité de décréter que les concessions à la société anglaise étaient nulles. Huerta, au contraire, les confirma. C'est de là que naquit contre Huerta la colère de la Standard Oil, de ses clients et de ses amis. D'autres sociétés ou trusts américains s'unirent à eux, désireux d'exploiter le Mexique, avec l'aide du gouvernement des États-Unis. Le président des États- Unis, Wilson, ne souffla mot de tout cela, mais dit qu'il ne pouvait reconnaître Huerta, parce qu'il n'avait pas été „ régulièrement “ élu, et témoigna d'une grande indignation, parce qu'il s'était emparé du pouvoir ensuite d'une révolution, foulant ainsi aux pieds le dogme sacré de l'élection populaire. En somme, de cette façon, le président Wilson défendait les trusts à l'étranger, et dans le pays il disait en être l'adversaire. Ajoutons qu'en voulant intervenir au Mexique, lui qui s'était fait élire comme pacifiste et anti-impérialiste, il entrait dans la voie qui conduit à la guerre et à l'impérialisme, Il est impossible de savoir s'il était ou non conscient de la contradiction. D'une part, il est impossible d'admettre que lui seul ignore ce que tout le monde sait des visées cupides des trusts américains, au Mexique; et si ce n'est pas de l'impérialisme que de vouloir imposer, à un état indépendant comme le Mexique, le gouvernement qui plaît aux États-Unis, on ne sait vraiment pas ce que peut bien être l'impérialisme. D'autre part, nous avons déjà vu qu'il peut y avoir des pacificistes-belliqueux (§ 1705 et sv.) ; et il y a de nombreuses preuves que la foi de certains humanitaires- démocrates est assez grande pour leur faire fermer les yeux à la lumière de faits tout à fait évidents, et accepter des conceptions plus qu'absurdes et de véritables billevesées. Il se peut que le président Wilson soit l'une de ces personnes, mais le moyen de nous en assurer nous fait défaut. On remarquera d'ailleurs que ce problème peut bien présenter de l'importance pour les éthiques, mais qu'il n'en a vraiment aucune pour la recherche des uniformités des faits sociaux.
[FN: § 2268-1]
ROBERT DE JOUVENEL ; La rép. des camarade : « (p. 135) Il y a de graves ministres qui se croient des honnêtes gens, parce qu'ils n'ont jamais détourné un sou pour eux-mêmes, et qui ont pillé le budget au profit de leurs familles et de leurs familiers [il faut ajouter : de leurs électeurs, de la presse et des financiers leurs amis]. Circonstance touchante, la sympathie du (p. 136) public est le plus souvent avec eux. On leur sait presque également gré de n'avoir point volé personnellement et d'avoir prodigué la joie dans leur entourage. Cette indulgence a de fâcheuses conséquences : car les besoins des politiciens ont, malgré tout, des limites et nous connaissons, en Gascogne, des familles qui n'en ont pas. Ce serait une assez bonne loi que celle qui aurait pour conséquence de substituer d'une manière régulière la prévarication au népotisme... ».
[FN: § 2268-2]
Séance de la Chambre italienne, du 8 mars 1913. Compte-rendu du Giornale d'Italia. Partant de la Tripolitaine, le député BEVIONE dit : „...la population arabe est organisée d'une manière oligarchique, et même patriarcale. Elle obéit dévotement, presque superstitieusement à certains chefs... Les chefs prêtent main forte à leurs subordonnés, les soutiennent dans leurs rapports avec les autorités, leur accordent l'hospitalité, les présentent, en cas de voyage, par des lettres aux autres chefs, et reçoivent en échange hommage et obéissance aveugle “. Un peu plus loin, il ajoute : „ Les choses les plus simples, que l'on obtenait sous les Turcs par la recommandation d'un notable, ne s'obtiennent aujourd'hui qu'après des mois et des mois d'insistance et d'attente “. Nos honorables collègues observeront qu'en Tripolitaine, les notables remplissent, ou du moins remplissaient envers la bureaucratie locale, des fonctions d'intermédiaires, lesquelles sont identiques à celles que nos députés italiens remplissent dans les rapports du public avec la bureaucratie du Royaume. Cette comparaison de notre état social avec un état presque féodal est importante, parce qu'elle vient d'une personne qui décrit les faits sans se laisser entraîner par des préjugés et des théories (§ 2307 1).
[FN: § 2268-3]
Parfois les (B) se divisent en partis qui entrent en conflit. Quand cela se produit, leurs contestations jettent un jour sur quelques-uns de leurs artifices qui, autrement, demeureraient cachés. Chez nos contemporains, le nationalisme a produit l'une de ces divisions. G. PREZIOSI ; La Germania alla conquista dell' Italia. L'auteur décrit sous une forme particulière un phénomène qui est général. Après avoir fait allusion au grand nombre de sociétés industrielles qui, en Italie, dépendent de la Banque Commerciale, l'auteur dit : „ (p. 66) Si, outre la question économique, on considère aussi la question politique, on voit que toutes les sociétés sus indiquées et d'autres encore – dans lesquelles des établissements plus ou moins importants, éparpillés dans toute l'Italie, donnent du travail à des dizaines de mille ouvriers et employés – sont effectivement de colossales agences électorales, dont l'action se déroule en même temps que celle, indiquée déjà, des multiples agences disséminées dans tout le pays par les compagnies de navigation. Il est manifeste que l'influence de telles sociétés, sur les élections politiques et administratives, s'exerce conformément à leurs propres intérêts. Cela explique pourquoi un grand nombre d'hommes politiques et de représentants italiens peuvent, directement ou non, avoir des attaches avec, la „ Commerciale “ et indirectement avec la politique germanique. En Italie, comme en toute autre nation à régime parlementaire, les députés sont, saut quelques exceptions, les très humbles serviteurs de leurs électeurs, et ne peuvent se soustraire aux influences locales. Il est facile d'en déduire, par conséquent, quels efforts doivent faire, et à quels compromis doivent se prêter ces députés dont l'élection dépend de semblables institutions. Celles-ci, sachant que l'argent est aujourd'hui plus que jamais le nerf des luttes politiques, participent aux dépenses électorales, et se garantissent de la sorte la reconnaissance déférente des hommes parlementaires gratifiés “. L'auteur cite ensuite un passage du livre : Rivelazoni postume alle Memorie di un questore, publié en 1913, par l'ex-questeur de Milan, et il observe que la presse a gardé le silence sur ce passage, dont voici la teneur : ,, (p. 75) La Banque Commerciale... est connue pour l'influence inestimable qu'elle a toujours eue sur la vie politique, économique et financière de la nation. Grâce à l'œuvre assidue du défunt sénateur Luigi Rossi, depuis de longues années jusqu'à nos jours, elle a pu directement ou indirectement, selon les circonstances, mettre la main à la formation de divers ministères, ou pour le moins elle a passé pour les avoir tenus sous sa protection “. On remarque un état semblable de ploutocratie démagogique vers la fin de la République romaine. Nous en parlerons au chapitre XIII. Notre auteur dit encore : „ (p. 81) Malheureusement la presse aussi est à ce point-là asservie à l'œuvre de la Banque Commerciale. Une bonne partie du journalisme italien est tributaire de la „ Commerciale “ et des sociétés qui en dépendent. C'est une chose trop connue pour que de longues démonstrations soient nécessaires à cet égard. Qui ne sait que l'organe constamment fidèle à tous les gouvernements de toute couleur qui se succèdent au pouvoir, est à ce point inspiré par un avocat-prince [c'est ainsi qu'on appelle en Italie les avocats très renommés et très puissants] très connu, lequel est lié à la „ Commerciale “, aux sociétés de navigation et au (p. 82) trust ternaire... ? Ab uno disce omnes “ : La méthode de la „ Commerciale “est en définitive toujours la même. Chacune des sociétés dépendantes doit souscrire une part du capital d'un journal ou périodique déterminé. Celui-ci se trouve en conséquence lié, tant à l'égard de l'établissement qui est l'un de ses copropriétaires, qu'à l'égard de ceux qui ont une communauté d'intérêts avec l’établissement. Les journaux reçoivent en outre des subventions sous diverses formes, le plus souvent sous forme de contrats pour avis et insertions, en faveur des industries existant dans les régions où ils sont publiés et répandus... Quelques industries ont leurs journaux propres... “ Cfr. § 1755.
[FN: § 2272-1]
Les « spéculateurs » sont en général opposés aux libertés locales, à la diversité des lois, parce que la centralisation et l'uniformité de la législation leur rendent plus faciles l'emploi de leurs artifices et la possibilité de les imposer au pays. Mais ils n'expriment pas ce motif réel : ils y substituent des dérivations. Par exemple, si A et B sont deux partis d'un même pays, ils proclament simplement qu'on ne peut admettre des lois différentes en A et en B ; cela sans donner la raison de cette affirmation, et sans dire si on peut l'étendre à des pays différents, ce qui conduirait à une législation uniforme sur tout le globe terrestre. Actuellement, ils ont trouvé une autre belle dérivation ; ils disent : „ Aujourd'hui on vise principalement à l'économie des forces ; donc il ne faut pas parler aux citoyens de nouveaux devoirs politiques ; il faut mettre fin à toutes les complications politiques existant encore, et réduire l'État à un simple État commercial régi par des règles uniformes “.On croirait assister à une réunion de cambrioleurs de coffres-forts, où l'on dirait „ Aujourd'hui on vise principalement à l'économie des forces ; donc il ne faut pas entretenir des gardes ni des chiens pour surveiller les coffres-forts. Ceux-ci doivent être tous du même type, afin d'épargner de la fatigue aux pauvres diables qui veulent les forcer. De la sorte, quiconque a appris à en forcer un sait les forcer tous.“
[FN: § 2273-1]
M. PANTALEONI ; dans le Giornale degli Economisti, septembre 1912 : « (p. 262) Qui ne se rappelle le truc des Caisses-pensions ? ,, Le Gouvernement doit une rente annuelle aux pensionnés. Cette annuité, dans des finances bien ordonnées, est prise sur les recettes ordinaires du budget “. Voilà la première position dans laquelle se trouve le prestidigitateur politique. Vient la seconde : „ Comme l'annuité est à tout prendre toujours la même, ou encore, comme il est facile de dire quel en sera le montant total maximum tant que les organes ne changeront pas, capitalisons cette annuité, c'est-à-dire créons autant de rentes publiques qu'il en faut pour que (p. 263) le coupon annuel rapporte exactement cette annuité. L'annuité est alors consolidée “. Vient ensuite le troisième acte : „ Vendons cette rente ; le produit servira à des chemins de fer, à des routes, à des ports, à des fortifications, à retirer des bons du trésor qui, à leur tour, ont servi à cent choses diverses, et reportons l'annuité à la page des recettes ordinaires du budget, soit à leur poste naturel. “. Les trois actes de la comédie nécessitent, on le comprend, un certain espace de temps. Ce n'est pas le même gouvernement qui les joue, ni la même Chambre ; et la presse qui vantait naguère comme un financier éminent celui qui consolida l’annuité, vante aujourd'hui comme un financier plus grand encore celui qui fait l'opération inverse. – Mais ces opérations peuvent-elles vraiment se faire sans tous les faux frais que nécessitent les chemins détournés et secrets ? Il semble que non. Mundus vult decipi ».
[FN: § 2282-1]
On trouvera sur ce sujet une excellente étude dans RICCARDO BACHI ; Metodi di previsioni economiche, dans la Rivista delle scienze commerciali, fascic. 8-9.
[FN: § 2282-2]
On remarque ce fait en beaucoup de calculs techniques, et les ingénieurs savent qu'il est inutile d'avoir une approximation uniquement formelle. Supposons que l'on veuille connaître le diamètre d'un tronc d'arbre, et qu'on en mesure avec une ficelle le périmètre, que l'on suppose être celui d'un cercle parfait. Il serait vraiment ridicule de donner la valeur de pi avec 10 décimales. On peut prendre sans autre 22/7, et mieux encore, il suffit de diviser par 3 la longueur de la circonférence obtenue avec la ficelle.
[FN: § 2282-3]
On doit faire des observations analogues au sujet des prix des marchandises qui sont l'objet du commerce international. Négligeons le fait que l'évaluation de ces prix est imparfaite et incertaine. Si même elle était parfaite, on ne devrait pas diviser les totaux du commerce des marchandises par le prix de ces marchandises, lorsqu'on a en vue d'obtenir un indice de la prospérité économique. On sait assez que les périodes de prospérité industrielle sont aussi des périodes de prix élevés, et que vice-versa, dans les dépressions économiques, les prix sont bas. Il se présente des cas particuliers où ce rapport devient encore plus évident. Par exemple, si nous voulons avoir un indice de la prospérité du Brésil, il faut porter notre attention sur le prix total du café exporté. Si l'on divisait ce total par le prix de l'unité de poids du café, on aurait les quantités de café exporté, qui sont bien loin d'être, avec la prospérité du pays, dans le même rapport que le prix total du café exporté. De même, pour la prospérité des mines de diamant du Cap, il importe beaucoup plus de vendre des diamants à un prix total élevé, que de vendre beaucoup de diamants à un prix total bas. C'est pourquoi ces mines se sont groupées en un syndicat, et s'efforcent de vendre les diamants à un prix tel qu'il donne un total élevé. Il est à présumer qu'elles connaissent mieux les critères de leur prospérité économique que certains auteurs disposant des statistiques d'une manière peu judicieuse.
[FN: § 2292-1]
Cette étude est ici reproduite en partie de V. PARETO ; Alcune relazioni tra lo stato sociale e le variazioni della prosperità economica, dans la Rivista italiana di Sociologia, anno XVII, fasc. V-VI, settembre-dicembre 1913. Les extraits de cet article furent publiés précédemment, en septembre 1913, et antérieurement encore le Giornale d'Italia, 3 août 1913, en donna un résumé.
[FN: § 2293-1]
Tout ce qui se trouve ici jusqu'à la fin du paragraphe est contenu dans l'article de la Rivista italiana di Sociologia, cité au § 2292 1.
[FN: § 2294-1]
Depuis lors, de nouvelles et nombreuses vérifications ont été obtenues. Voir : Rivista di Scienza Bancaria – Roma, agosto-settembre 1917 : V. PARETO ; Forme di fenomeni economici e previsioni.
[FN: § 2300-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR]. Voir à ce propos l'ouvrage remarquable de G. LE BON : La Révolution française et la Psychologie des Révolutions.
[FN: § 2306-1]
En Italie, ces artifices furent largement usités au temps OU M. MAGLIANI était ministre. L'usage en diminua dans la suite sans disparaître entièrement ; il augmenta de nouveau fortement au temps de la guerre de Libye. Le député EDOARDO GIRETTI a fait voir comment les dettes étaient transformées en recettes par un artifice de comptabilité. Le professeur LUIGI EINAUDI démontra clairement que le boni artificiel du budget correspondait à un déficit réel. Enfin, à la séance de la Chambre, du 14 février 1914, le député SIDNEY SONNINO démontra avec une admirable clarté les artifices du budget. Ce discours serait à citer in extenso, parce qu'il dépasse de beaucoup les cas particuliers, et nous montre les procédés généraux par lesquels on manipule les budgets ; mais, pour éviter des longueurs, citons ici uniquement quelques passages très importants. « ... Expliquons-nous clairement : Je n'entends pas agiter des questions de légalité ou d'illégalité ; je n'entends pas non plus examiner aujourd'hui si nous avons ou non un boni ou un déficit, ni pour quels chiffres : je m'occupe uniquement d'une question de clarté et de sincérité financière. Aujourd'hui, par une série d'articles qu'on a fait voter dans une quantité de lois spéciales disparates, et grâce à une interprétation de plus en plus élastique, en fait on en est arrivé à laisser à l'absolue discrétion du ministre du Trésor le soin d'engager de très nombreuses dépenses effectives, en les faisant figurer dans un exercice quelconque, et souvent même dans la catégorie qu'il préfère, et même de ne pas les porter en compte tels que le ministre les expose à la Chambre, dans le budget où ils ont été alloués. Dans son rapport financier, le ministre ne tient pas compte de ces dépenses, aux premières évaluations des résultats de l'exercice. Il peut ainsi toujours proclamer l'existence d'un gros boni effectif ; après cela il obère ce boni apparent d'une série d'autres dépenses nouvelles ou d'augmentations de dépenses ; et souvent même les unes et les autres sont déjà engagées et payées. Il arrive ainsi qu'au moyen d'un budget de l'exercice écoulé, lequel budget présente un déficit de 257 millions dans la catégorie I, et où l'on fait abstraction complète de tout chiffre pour la Libye, soit de plus de 7 millions, on continue à répandre dans le pays l'impression fausse que l'exercice 1912-1913 a produit un boni effectif de plus de 100 millions, et que le budget ordinaire a pu faire face, cette année-là, à plus de 49 millions de dépenses pour la Libye. Depuis trois ans, les artifices de comptabilité du budget se sont tellement multipliés qu'ils ont rendu fort malaisé au Parlement de se rendre clairement compte du véritable état de choses. En premier lieu, dans les budgets des divers dicastères, on voit apparaître aujourd'hui une série nombreuse de dépenses effectives, pour lesquelles le ministre est autorisé à recourir à des comptes-courants avec la Caisse des dépôts et avec des Instituts spéciaux ou des personnalités juridiques locales, ou bien à ce qu'on appelle des anticipations du Trésor ; et l'on alloue seulement une annuité fixe pour un nombre plus ou moins grand d'années, tandis que la dépense s'effectue entre des limites de temps bien inférieures à ce que permet le budget... Il y a ensuite diverses catégories importantes de dépenses extraordinaires, pour lesquelles, dans des lois spéciales (ou même dans quelque article furtif du budget, le ministre s'est réservé la faculté d'anticiper par décret ministériel la répartition, dans plusieurs exercices, de la dépense fixée par ces lois ou ces articles. Dans la loi du budget de la Marine pour 1914-1915, on arrive même à demander de pouvoir en faire autant pour le capital ordinaire de la Manutention de la flotte, jusqu'à concurrence de 20 millions par année, anticipant, jusqu'à 4 ans à l'avance, les répartitions fixées pour les exercices postérieurs. Peut- on sérieusement mettre à la charge d'un futur et éventuel boni du budget, une dépense déjà engagée et parfois même payée, au lieu de l'inscrire dans le budget de l'année où elle est engagée ou faite ? Que signifie le fait d'inscrire aux recettes de 1914-1915 une somme provenant d'un budget antérieur ? Et de la contrebalancer, aux dépenses, par une somme égale, provenant d'une avance fictive du Trésor, c'est-à-dire, en réalité, d'un déficit dissimulé ou d'un moindre boni réel d'un compte antérieur ? Absolument rien, étant données les conceptions qui sont à la base de nos institutions budgétaires. Ce sont des formes vides, des artifices capables seulement de troubler toute clarté d'écriture et de calcul. Le ministre Magliani inventa en son temps les dépenses ultra-extraordinaires pour les travaux publics, auxquelles on devait pourvoir par une augmentation de dettes. De cette manière, il soustrayait ces dépenses au compte des bonis et des déficits effectifs. Aujourd'hui tout cela semble primitif et suranné ; on recourt à des méthodes plus spécieuses et raffinées. On fait voter, dans une loi quelconque, voire budgétaire, ou bien l'on dispose par un décret-loi un article qui dise plus ou moins explicitement que l'on fera face à telles ou telles dépenses par prélèvements sur la Caisse, ou bien par les moyens ordinaires de la Trésorerie, ou moyennant un compte-courant avec la Caisse des Dépôts. Dès ce moment, on peut, si l'on veut, faire toutes ces dépenses sans en porter le chiffre en compte dans les résultats du budget d'après lequel elles sont engagées, telles qu'elles sont données dans les rapports financiers. On se met ainsi en mesure de déclarer un boni au budget, et puis, sur ce boni, on attribue à volonté une somme, soit à d'autres dépenses nouvelles, soit au remboursement du Trésor pour d'autres anticipations faites sous diverses formes. On rend ainsi plus aisé, le jeu du boni rotatif. Qu'on suppose une série d'exercices pour lesquels on autorise une dépense extraordinaire, par exemple de 150 millions pour des constructions navales, dépense à diviser en cinq versements égaux. La première année, supposons que le ministre du Trésor réussisse à faire apparaître, d'une façon ou d'une autre, un boni effectif de 30 millions. Après avoir- proclamé ce résultat, il anticipe l'inscription du versement de l'année suivante, en l'imputant sur ce premier boni. Ainsi le budget de la législature se trouve allégé de 30 millions; et si, par hypothèse, le budget s'était équilibré sans l'anticipation, il présenterait, an contraire, un excédent d'actif de 30 millions. Le ministre proclamera l'année suivante aussi, un second boni de 30 millions., pour anticiper ensuite le versement de l'année suivante. On continuera de même, d'année en année ; de telle sorte qu'ayant disponible un seul boni initial de 30 millions, le ministre peut proclamer dans ces rapports financiers cinq bonis successifs de 30 millions chacun, donnant l'illusion d'un budget du Trésor de 150 millions, tandis qu'en réalité il n’est que de 30 millions, au terme des cinq années, si toutefois le boni initial était réel. Dans le cas où l'on ne réussit pas à porter au compte d'un boni réel de la catégorie I la première anticipation de versements futurs, fixés par des lois spéciales, on peut également recourir avec avantage au jeu de ces anticipations ; cela en inscrivant au compte du premier exercice, dans la catégorie I, la quote-part anticipée, mais en la contrebalançant par une somme correspondante aux recettes, dans la catégorie III, à titre de prélèvement de la Caisse. On obtient ainsi plusieurs avantages, outre celui de contenter les personnes qui demandaient la dépense : 1° de ne pas altérer les résultats généraux de la gestion dans le compte du Trésor, en sommant les résultats des diverses catégories ; 2° de ne pas porter du tout en compte, dans le prochain rapport financier, cette dépense au préjudice du boni effectif, cela en argumentant spécieusement qu'il s'agit simplement d'une anticipation d'allocation ; 3° de pouvoir faire apparaître l'année suivante le poste correspondant, comme un remboursement au Trésor dans la catégorie III, c'est-à-dire comme une augmentation du patrimoine de l'État. En somme, cette dépense n'est jamais donnée pour ce qu'elle est, ni avant ni après, dans la mise en scène parlementaire... J'ai fini. Que l'on ne cherche pas more solito à fermer la bouche à toute critique, aussi pondérée soit-elle, en l'accusant de nuire au crédit de l'État à l'étranger... » Le ministre TEDESCO répondit, non pas en niant les faits, qui, à vrai dire, sont indéniables, mais en observant que depuis 1910, on avait employé des procédés analogues aux siens ; en quoi il n'avait pas tort : on ne pouvait discuter que du plus ou moins. Pour les parlementaires, le fait est important : il fournit un motif d'accuser ou d'encenser tels ou tels hommes. Cela importe peu ou point à la recherche des uniformités que seules nous avons maintenant en vue. En somme, la défense du ministre confirme l'existence de l'uniformité relevée. Parlant au Sénat français, le député RIBOT fit des reproches analogues au budget de son pays, et les ministres ne purent pas lui prouver le contraire. Mais tout cela est inutile, parce que ces faits ne sont pas uniquement le résultat de la faute de certains hommes politiques, mais surtout la conséquence des institutions ploutocratiques et démagogiques auxquelles on donne aujourd'hui le nom de démocraties. Le député RIBOT a cultivé avec amour et fait croître vivace la plante qui porte les fruits dont il s'étonne ensuite, on ne sait trop pourquoi.
[FN: § 2307-1]
A. DE PIETRI TONELLI ; Il socialismo democratico in Italia, p. 22 : „ Dans les régimes démocratiques modernes, on remarque uniformément que le pouvoir politique décisif est réparti de façons diverses entre les classes bureaucratiques, qui comprennent les employés, grands et petits, civils et militaires, et les politiciens de haut et de bas étage. Ces deux catégories de personnes sont liées entre elles et avec les affaristes de toute espèce, par des rapports de soutien mutuel, jusqu'à constituer une indissoluble trinité. La réussite et l'avancement dans les emplois sont presque toujours facilités par l'appui des hommes politiques (§ 2268 2). Le gouvernement, sous diverses formes d'appui, et les hommes d'affaires qui alimentent les dépenses du gouvernement, ont une grande influence sur l'issue des luttes électorales (§ 2268 3). Les politiciens sont d'autant plus influents qu'ils peuvent obtenir davantage des faveurs pour leurs électeurs, d'autant plus qu'ils sont plus épaulés par les gens d'affaires “. Plus loin, p. 24-25 : „ Du reste, là où les socialistes ou les représentants populaires ont le pouvoir dans les administrations locales, le favoritisme consistant à donner, voire à créer des emplois, n'a pas diminué. Seule la couleur des favoris a changé. Autrefois, ils étaient noirs ; aujourd'hui, ils sont rouges. Parfois, il faut le remarquer, ce sont les mêmes personnes qui ont changé de couleur, par raison d’opportunité, et parce qu'elles n'avaient jamais montré une couleur politique nette qui ne fût celle de ceux qui avaient le pouvoir. Qu'on ait créé partout des emplois, tant qu'on a pu, cela est hors de doute. À ce propos, le chef d'une administration populaire me faisait même naïvement observer, il n'y a pas longtemps, que s'il avait pu créer chaque année une vingtaine d'emplois à distribuer, il aurait certainement réussi à faire taire les partisans de l'opposition, non seulement amis, mais aussi ennemis “. En effet, c'est à peu près ainsi qu'on gouverne, non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays. Seulement, pour suivre cette voie, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Un cas particulier, celui de la guerre, a été étudié par le prof. FEDERIGO FLORA, dans son ouvrage : Le finanze della guerra ; il conclut : „ Le Trésor la commence, l'emprunt la soutient, l'impôt la liquide “. Il est évident qu'il se produit des phénomènes différents, si cette liquidation a lieu dans une période de rapide accroissement de prospérité économique, ou bien dans une période d'accroissement lent, ou encore, ce qui est pire, dans une période de régression. Les gouvernements qui s'en remettraient trop aux liquidations futures pourraient se trouver un jour dans de grands embarras. – ROBERT MICHELS ; Les partis politiques : « (p. 189) Toutes les fois que le parti ouvrier fonde une coopérative ou une banque populaire qui (p. 190) offrent aux intellectuels le pain assuré et une situation influente, on voit s'y précipiter une foule d'individus dépourvus de tout sentiment socialiste et qui ne cherchent qu'une bonne affaire ». En Italie et dans d'autres pays, ces coopératives et ces banques populaires ont besoin de l'appui des politiciens pour prospérer ; par conséquent, non seulement ceux qui tirent avantage de ces institutions, mais aussi ceux qui espèrent en profiter, viennent s'ajouter à la clientèle des politiciens, les favorisent, les défendent, leur procurent honneurs et pouvoir, et en retirent des bénéfices en compensation. Cette organisation coûte beaucoup, parce que souvent, pour faire gagner un peu d'argent à ceux que l'on veut favoriser, il faut que l'État dépense de grosses sommes, qui sont en partie dilapidées.
[FN: § 2313-1]
On a aujourd'hui la tendance à ranger parmi ceux-ci les petits actionnaires des sociétés anonymes, lesquelles sont exploitées surtout par les conseillers d'administration et par un petit nombre de gros actionnaires. Ces administrateurs usent de divers artifices suivant les pays, naturellement toujours avec la complicité du législateur. En Angleterre, ils emploient beaucoup la „ reconstruction “, qui consiste en somme en ce que la société est dissoute et immédiatement reconstituée sous un autre nom, à la condition que les actionnaires de l'ancienne société reçoivent des actions de la nouvelle, pourvu qu'ils paient un tantième. Ainsi, ils se trouvent en présence du dilemme, ou de tout perdre, ou de faire de nouvelles dépenses ; et il n'est pas permis à l'actionnaire qui refuse de faire partie de la nouvelle société, de réclamer simplement sa part de l'actif de la société ancienne. Il y a des sociétés qui se ,, reconstruisent “ plusieurs fois de la sorte. Le conseil d'administration amène certains compères qui „ garantissent “ underwriting l'opération. Autrement dit, recevant en paiement une somme, souvent considérable, ils prennent l'engagement de retirer pour leur compte les nouvelles actions qui n'auraient pas été, acceptées par les anciens actionnaires. Il existe des sociétés qui n'ont jamais payé un sou de dividende à leurs actionnaires, et qui, tous les deux ou trois ans, procurent de cette façon de respectables bénéfices à leurs administrateurs. Dans un petit nombre de cas, l'opération peut être avantageuse pour les actionnaires aussi ; mais il ne leur est pas donné de distinguer ces cas des autres, car la loi n'accorde pas à chaque actionnaire en particulier le droit de se retirer en recevant sa part de l'actif. En Italie, le législateur avait commis l',, erreur “ d'accorder ce droit. Mais il la corrigea pour complaire à certains rois de la finance, amis des politiciens. – Avanti, 12 mars 1915 : Grosses spéculations de banques. Nous sommes informés que trois grandes banques ont fusionné ces jours derniers... Pour faciliter l'affaire, le gouvernement a fait, comme nous l'avons signalé, un accroc au code civil et au code commercial, en présentant un projet de loi qui suspend pour une année le droit de se retirer appartenant aux actionnaires des sociétés anonymes ,, . Il faut ajouter que, même quand les actionnaires ont ce droit, les difficultés et les dépenses nécessaires pour l'exercer sont si grandes, qu'il demeure presque toujours lettre morte. De cette façon, on s'efforce de barrer tous les chemins par lesquels le simple producteur ou possesseur d'épargne pourrait échapper à la poursuite des „ spéculateurs “. Le projet de loi auquel l'Avanti fait allusion fut approuvé par le Parlement et promulgué. – Giornale d'Italia, 1er avril 1914 „ Compte rendu de l'assemblée des actionnaires de la Banque de Rome. – L'actionnaire T.. L'année dernière, les conditions de la banque étaient florissantes. Où sont allés les millions dont on avoue maintenant la perte ? L'unique justification qu'il trouve est la perte occasionnée par la Libye. Mais est-ce une perte de cette année-ci ou des années précédentes ? Vous avez fait là-bas une œuvre patriotique, et comme Italien je vous en adresse mes plus vives félicitations. Mais je ne suis pas seulement italien : je suis aussi un modeste épargneur, et je demande quel usage vous avez fait de mes épargnes... Quand on parla de fusion entre des Instituts – dit [l'orateur] – il eut la grande espérance de pouvoir se servir du droit de retraite ; mais les modifications introduites dans le code commercial... [les points se trouvent dans l'original]. – Le Président. Je tiens à déclarer que la Banque de Rome n'a été pour rien dans les pratiques employées pour arriver à la modification du droit de retraite “.
[FN: § 2313-2]
Dans ce domaine, l'une des plus belles trouvailles des spéculateurs latins a été celle de l'anticléricalisme. Afin de distraire l'attention loin de leurs opérations lucratives, ils ont su se servir avec une grande habileté des sentiments opposés au clergé, sentiments qui existaient chez le peuple. Tandis que le bon public discutait à perdre haleine sur le pouvoir temporel des papes, sur l'infaillibilité du pape, sur les congrégations religieuses et sur d'autres semblables sujets, les spéculateurs remplissaient leurs poches. En cela ils furent aidés par la naïveté de leurs adversaires, qui leur opposèrent l'antisémitisme, sans s'apercevoir que de la sorte ils demeuraient précisément dans le domaine le plus avantageux aux spéculateurs, et qu'ils les aidaient à distraire de leurs exploits l'attention du public. Depuis tant d'années que les antisémites combattent avec, acharnement, qu'ont-ils obtenu ? Rien, absolument rien. Qu'ont obtenu leurs adversaires ? Pouvoir, argent, honneurs. – Parfois l'anticléricalisme n'est que le prétexte des bénéfices et des vengeances des politiciens. La Liberté, 13 mars 1915 : « „ Brimades, injustices, vexations, injures, souffrances ! “ M. Barrès résume ainsi le tableau des scandales auxquels donne lieu dans toute la France l'allocation des indemnités aux familles des mobilisés. Les haines locales, les rancunes politiques et les combinaisons électorales inspirent la plupart des fonctionnaires ou des délégués de la préfecture. „ La commission “, écrit une femme du département du Jura, „ m'a fait savoir que je ne recevrai rien parce que mon mari était un catholique pratiquant “. – „ On a rejeté ma demande parce que mon mari n'est pas du parti du maire “, écrit une femme de l'Ariège. „ Vous êtes pour les curés “, m'a-t-on répondu, écrit une femme du Lot. De son côté, un journal révolutionnaire publie ce matin des réclamations du même genre avec cette conclusion : „ Des libres- penseurs soutirent par la volonté des fonctionnaires cléricaux “. Cela prouve, en tout cas, que la distribution des allocations est, de tous côtés, l'occasion de scandales et de vives protestations ».
[FN: § 2313-3]
En France, au temps de l'affaire Dreyfus, les spéculateurs étaient presque tous dreyfusards. Le sémitisme leur rapportait beaucoup moins que le « dreyfusisme ». Il est remarquable que chez les anti-dreyfusards les sentiments de persistance des agrégats existaient en abondance, tandis que les instincts des combinaisons, l'habileté politique manquaient grandement. Ces gens engageaient la lutte dans des conditions telles que la victoire ne pouvait leur procurer que peu ou point d'avantages, et la défaite leur causer un très grave désastre ce qui effectivement arriva. De fait, en cas de victoire, ils obtenaient seulement de garder en prison un malheureux, peut-être innocent, et en cas de défaite, ils avaient à craindre l'oppression de leurs adversaires. On pourrait comprendre leur action, si l'affaire Dreyfus avait été un moyen de s'assurer l'appui de l'armée et de faire un coup d'État ; mais elle demeure inconcevable en tant que but. Il est manifeste que, par manque de courage, ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas faire un coup d'État ; aussi allaient-ils à tâtons dans l'obscurité. Ils ne surent pas non plus dépenser les millions des congrégations, et les gardèrent précieusement pour en faire profiter leurs ennemis. Les gens craintifs et respectueux de la légalité ne se lancent pas dans de semblables aventures. On voit bien l'influence de la persistance des agrégats chez ceux qui croyaient Dreyfus coupable, et qui, ne voulant rien entendre d’autre, affrontaient tous les dangers pour le faire demeurer en prison, sans penser que lorsque tant de coupables savent se soustraire au danger, il importe peu qu'un de plus ou de moins soit parmi ceux qui échappent. Chez leurs adversaires, il y avait aussi des personnes qui ne voyaient autre chose que l'innocence présumée de Dreyfus, et qui sacrifiaient tout pour sauver un innocent. La différence entre les deux partis consistait en ce que l'un d'eux savait mettre à profit cette innocence présumée. Du côté des anti-dreyfusards, on manquait de toute direction habile. Celle qu'ils avaient était bien loin de pouvoir aller de pair avec la direction très avisée dont les spéculateurs dotaient le parti dreyfusard. Pour citer un seul exemple, quel est le chef du parti anti-dreyfusard qui puisse être comparé en habileté à Waldeck-Rousseau ? Avocat retors auquel les moyens de se rendre utile à son client étaient indifférents, il donna la victoire au parti dreyfusard. Il est vraiment un type de chef des spéculateurs. Il avait toujours été l'adversaire des socialistes, et se fit leur allié. Il avait toujours été patriote, et confia l'armée de son pays à un André, et la marine à un Pelletan. Il avait toujours défendu la propriété, et livra comme butin à ses troupes le milliard des congrégations. Il avait toujours été conservateur, et se fit le chef des plus audacieux révolutionnaires. En vérité, ni les sentiments ni les scrupules ne l'embarrassaient, et ils ne l'empêchaient pas de travailler à son profit.
[FN: § 2313-4]
Les romans de GYP contiennent à ce propos de nombreuses et fines observations de faits. Par exemple, Cotoyan, dans Un mariage chic, est le type d'une classe très nombreuse d'individus.
[FN: § 2313-5]
ROBERT DE JOUVENEL : La rép. des camarades : « (p. 53) Au-dessus de toutes les coteries de partis [des députés], de toutes les brouilleries d'homme à homme, il y a une règle impérieuse et qui domine : respecter l'esprit de la maison et ne pas se nuire. Entre camarades, on se dispute, on ne se déteste pas ; on veut bien se battre, mais l'on n'aime pas à se faire de mal. Si fort qu'on soit fâché, on ne peut oublier qu'on est fâché contre un collègue [qui est souvent un complice]. Même lorsque la discussion cesse d'être courtoise, elle ne cesse point pour cela d'être confraternelle. Les circonstances, qui vous mettent aux prises aujourd'hui passeront et l'on sait (p. 54) bien que demain on aura encore besoin les uns des autres; alors, pourquoi prononcer des paroles irréparables ? ». Ailleurs l'auteur décrit les relations entre ministres et députés. Sa description s'applique à l'Italie comme à la France, comme à tout pays possédant un gouvernement parlementaire. « (p. 115) Lorsqu'un député a passé sa matinée à faire des démarches dans les cabinets ministériels, il emploie son après-midi à contrôler les actes des ministres. Pendant la moitié de la journée, il a demandé des services ; pendant l'autre moitié, il demande des garanties. S'il a obtenu beaucoup de garanties, il ne demande (p. 46) pas pour cela moins de services, mais quand il a obtenu beaucoup de services, il se montre quelquefois moins sévère pour les garanties – et c'est très humain ». – Avanti, 12 mars 1915 : « Le budget électoral. Il est naturellement du même genre que celui des Postes et que celui des Travaux publics. L'un des députés veut un pont, l'autre une route, un autre un chemin de fer, un autre encore une route à automobiles..., sauf à se plaindre plus tard parce que les dépenses croissent ainsi que les travaux inutiles, et cela sans avoir jamais la sincérité d'avouer que les profits de leur député croissent aussi aux yeux des électeurs naïfs. Ce député peut être un malfaiteur, mais il ne néglige pas les intérêts locaux » (§ 2562 1).
[FN: § 2314-1]
Parfois même ils s'en réjouissent. Tous ceux qui vendent des marchandises se plaignent si le prix de vente diminue. La seule exception est celle des producteurs d'épargne, qui se réjouissent si l'intérêt de l'argent diminue, c'est-à-dire le prix de l'usage de la marchandise qu'ils produisent. Les ouvriers dont on voudrait réduire le salaire de 4 fr. à 3 fr. 50 pousseraient les hauts cris, feraient grève se défendraient. Au contraire, les possesseurs d'épargne auxquels, grâce à la conversion de la rente, l'État paie seulement 3 fr. 50 au lieu de 4 fr., ne lèvent pas le petit doigt pour se défendre, et peu s'en faut qu'ils ne remercient celui qui les dépouille. Il faut relever encore une étrange illusion des producteurs d'épargne, lesquels se réjouissent quand haussent les prix des titres de la dette publique qu'ils achètent avec leur épargne, et se lamentent s'ils baissent ; tandis que celui qui achète les titres doit désirer les acheter au plus bas prix possible. Parmi les causes de cette illusion, il y a peut-être la suivante. Soit un producteur d'épargne qui possède déjà 20 000 fr. de titres de la dette publique, et qui épargne chaque année 2000 fr., avec lesquels il achète d'autres titres. Si le prix en bourse des titres de la dette publique monte de 10 %, les 20 000 fr. de notre individu deviennent 22 000 fr., et il s'imagine s'être enrichi de 2000 fr. Ce serait le cas, seulement s'il vendait les titres ; s'il les conserve, il n'a pas un sou de plus, et il reçoit la même rente annuelle. D'autre part, les 2000 fr. qu'il épargne chaque année, et qu'il emploie à acheter des titres de la dette publique, lui rapportent moins : il reçoit le 10 % de moins que ce qu'il aurait touché, si le prix des titres de la dette publique n'était pas monté. En conclusion, il est dans une moins bonne position qu'avant.
[FN: § 2316-1]
BOUCHÉ-LECLERCQ ; Hist. de la div., t. III. Vers 590 av. J.-C., « (p. 158) l'oracle de Delphes est en train de devenir la plus grande banque du monde. Autour du temple s'élèvent de toutes parts des Trésors, remplis d'ex-voto envoyés par (p. 159) différents peuples, princes et cités, athlètes heureux, criminels repentis, riches bienfaiteurs du temple, vaniteux de toute espèce empressés de mettre leur nom en évidence. Avec le produit des biens-fonds, les dîmes, argent et esclaves, prélevées sur le butin de guerre, sur les colonies, avec les amendes imposées, les intérêts produits, tout cela constituait un capital énorme qu'une gestion intelligente accroissait rapidement. En outre, comme il n'y avait pas en Grèce de lieu plus sûr que Pytho, les États comme les individus apportaient là les documents précieux, testaments, contrats, créances, même de l'argent monnayé, dépôts que les prêtres se chargeaient de garder en récompensant même la confiance des déposants par des privilèges honorifiques... L'oracle tenait ainsi entre ses mains d'immenses intérêts et se montrait jaloux d'accroître cette nombreuse clientèle... Les moyens d'acquérir ne manquaient pas : mais comme il n'est pas moins important de conserver, on inspirait à ceux qui auraient été tentés de voler le dieu une terreur superstitieuse. Il était arrivé qu'un malfaiteur de cette espèce avait été indiqué aux prophètes – d'autres disaient dévoré – par un loup dont on montrait la statue à Delphes ». L'histoire des déprédations du temple commence par des légendes qui, probablement, ainsi que cela arrive d'habitude, projettent dans le passé des impressions du temps où ces légendes se sont formées. Parmi les ravisseurs, on trouve Hercule. Bouché-Leclercq rapporte (p. 109) la légende qui n'établit qu'une lutte entre Hercule et Apollon pour le trépied prophétique ; mais il en existait une autre, laquelle indiquait nettement le pillage. APOLLOD. II, 6, 2 : ... ![]()
![]() « ... et il commença à piller le temple ». Une légende, rapportée par le scholiaste de l'Iliade (XIII, 302), d'après Phérécyde, nous montre les Phlegyes,
« ... et il commença à piller le temple ». Une légende, rapportée par le scholiaste de l'Iliade (XIII, 302), d'après Phérécyde, nous montre les Phlegyes, ![]() incendiant le temple de Delphes, et, pour ce méfait, détruits par Apollon. Dans les temps historiques, la série des guerres sacrées, entreprises pour punir les atteintes au temple et aux propriétés du dieu, s'ouvre par la guerre contre les Criséens (600 à 590 avant J.-C.). La seconde guerre sacrée (355 à 346 av. J.-C.) fut dirigée contre les Phokiens. Leur chef, Philomélos, à la tête d'une troupe de mercenaires richement payés (DIOD. ; XVI, 28 et 30), s'empara de Delphes. Il commença à mettre à contribution les plus riches Delphiens ; ensuite, ces ressources ne lui suffisant plus, il étendit ses déprédations aux trésors du temple ; mais, peut-être de bonne foi, il prétendit que ce n'était là qu'un emprunt. Il se peut que, semblablement à ce qui s'observe de nos jours, il y ait eu des gens naïfs qui ont cru alors à ces belles promesses. À ce propos, Grote observe (XVII) : « (p. 68 note 2)... Une proposition semblable avait été émise par les envoyés corinthiens dans le congrès à Sparte, peu de temps avant la guerre du Péloponèse ; ils suggérèrent comme l'un de leurs moyens et l'une de leurs ressources un emprunt aux trésors de Delphes et d'Olympia, qui serait rendu plus tard (THUCYD. : I, 121). Périklès fit la même proposition dans l'assemblée athénienne ; „ dans des vues de sécurité “, on pouvait employer les richesses des temples pour défrayer les dépenses de la guerre, sous condition de rendre le tout après (... THUCYD. ; II, 13). Après le désastre subi devant Syracuse, et pendant les années de lutte qui s'écoulèrent depuis cet événement jusqu'à la fin de la guerre, les Athéniens furent forcés par des embarras financiers de s'approprier pour des desseins publics beaucoup de riches offrandes renfermées dans le Parthénon, objets qu'ils ne furent jamais plus tard en état de remettre ». La promesse faite par le gouvernement français de rembourser ses assignats, et une infinité d'autres promesses analogues, faites par d'autres gouvernements, eurent un sort semblable. CURTIUS ; t. V, c. 1, observe que la force de Philomélos reposait sur des mercenaires. « (p. 66) Dans ces circonstances, c'eût été un miracle si Philomélos avait pu observer la modération dont il s'était fait une loi publiquement proclamée. [Il en est de même pour les gouvernements modernes dont la force repose sur les avantages qu'ils procurent à leurs partisans.] La tentation était trop grande. On était le maître absolu du Trésor le plus riche de la Grèce : devait-on, faute d'argent, abandonner le pays à ses ennemis les plus acharnés ? À vrai dire, après être allé si loin, on n'avait plus le choix. On créa donc une Trésorerie (DIOD. ; XVI, 56), sous la responsabilité de laquelle on puisa dans la caisse du temple, d'abord, sans doute, sous la forme d'emprunt, mais ensuite on y mit toujours plus de hardiesse et moins de scrupules [comme, dans les temps modernes, pour les émissions de papier-monnaie et les emprunts publics]. Des objets qui depuis des siècles avaient reposé sous le « seuil » du temple, s'en allèrent aux quatre vents du ciel... On n'envoya pas seulement l'or à la Monnaie, mais on porta la main même sur les saintes reliques, et l'on vit des joyaux de l'âge héroïque (p. 67) briller au cou des femmes des officiers mercenaires. On dit que 10 000 talents (environ 58 940 600 fr.) furent ainsi mis en circulation. On n'employa pas cette somme seulement pour payer la solde de l'armée, mais on la fit servir à l'étranger pour gagner des personnages influents, comme Dinicha, l'épouse du roi de Sparte Archidamos (THÉOPOMPE, frag. 258, ap. PAUS. III, 3, accuse Archidamos et Dinicha de s'être laissé corrompre), et pour modifier favorablement l'opinion dans le camp des ennemis ».
incendiant le temple de Delphes, et, pour ce méfait, détruits par Apollon. Dans les temps historiques, la série des guerres sacrées, entreprises pour punir les atteintes au temple et aux propriétés du dieu, s'ouvre par la guerre contre les Criséens (600 à 590 avant J.-C.). La seconde guerre sacrée (355 à 346 av. J.-C.) fut dirigée contre les Phokiens. Leur chef, Philomélos, à la tête d'une troupe de mercenaires richement payés (DIOD. ; XVI, 28 et 30), s'empara de Delphes. Il commença à mettre à contribution les plus riches Delphiens ; ensuite, ces ressources ne lui suffisant plus, il étendit ses déprédations aux trésors du temple ; mais, peut-être de bonne foi, il prétendit que ce n'était là qu'un emprunt. Il se peut que, semblablement à ce qui s'observe de nos jours, il y ait eu des gens naïfs qui ont cru alors à ces belles promesses. À ce propos, Grote observe (XVII) : « (p. 68 note 2)... Une proposition semblable avait été émise par les envoyés corinthiens dans le congrès à Sparte, peu de temps avant la guerre du Péloponèse ; ils suggérèrent comme l'un de leurs moyens et l'une de leurs ressources un emprunt aux trésors de Delphes et d'Olympia, qui serait rendu plus tard (THUCYD. : I, 121). Périklès fit la même proposition dans l'assemblée athénienne ; „ dans des vues de sécurité “, on pouvait employer les richesses des temples pour défrayer les dépenses de la guerre, sous condition de rendre le tout après (... THUCYD. ; II, 13). Après le désastre subi devant Syracuse, et pendant les années de lutte qui s'écoulèrent depuis cet événement jusqu'à la fin de la guerre, les Athéniens furent forcés par des embarras financiers de s'approprier pour des desseins publics beaucoup de riches offrandes renfermées dans le Parthénon, objets qu'ils ne furent jamais plus tard en état de remettre ». La promesse faite par le gouvernement français de rembourser ses assignats, et une infinité d'autres promesses analogues, faites par d'autres gouvernements, eurent un sort semblable. CURTIUS ; t. V, c. 1, observe que la force de Philomélos reposait sur des mercenaires. « (p. 66) Dans ces circonstances, c'eût été un miracle si Philomélos avait pu observer la modération dont il s'était fait une loi publiquement proclamée. [Il en est de même pour les gouvernements modernes dont la force repose sur les avantages qu'ils procurent à leurs partisans.] La tentation était trop grande. On était le maître absolu du Trésor le plus riche de la Grèce : devait-on, faute d'argent, abandonner le pays à ses ennemis les plus acharnés ? À vrai dire, après être allé si loin, on n'avait plus le choix. On créa donc une Trésorerie (DIOD. ; XVI, 56), sous la responsabilité de laquelle on puisa dans la caisse du temple, d'abord, sans doute, sous la forme d'emprunt, mais ensuite on y mit toujours plus de hardiesse et moins de scrupules [comme, dans les temps modernes, pour les émissions de papier-monnaie et les emprunts publics]. Des objets qui depuis des siècles avaient reposé sous le « seuil » du temple, s'en allèrent aux quatre vents du ciel... On n'envoya pas seulement l'or à la Monnaie, mais on porta la main même sur les saintes reliques, et l'on vit des joyaux de l'âge héroïque (p. 67) briller au cou des femmes des officiers mercenaires. On dit que 10 000 talents (environ 58 940 600 fr.) furent ainsi mis en circulation. On n'employa pas cette somme seulement pour payer la solde de l'armée, mais on la fit servir à l'étranger pour gagner des personnages influents, comme Dinicha, l'épouse du roi de Sparte Archidamos (THÉOPOMPE, frag. 258, ap. PAUS. III, 3, accuse Archidamos et Dinicha de s'être laissé corrompre), et pour modifier favorablement l'opinion dans le camp des ennemis ».
Onomarchos et ensuite Phaylos, qui succédèrent à Philomélos, firent pis encore. Enfin les Phokiens, vaincus par Philippe de Macédoine, furent condamnés à payer annuellement une amende très considérable. La compensation entre le pillage et sa punition était ainsi établie au point de vue éthique, mais elle n'existait pas au point de vue économique ; car les mercenaires ne restituèrent pas l'argent de leur haute paye, et l'amende fut payée, en petite partie par des restitutions, mais en grande partie par de nouvelles atteintes à la propriété privée.
La troisième guerre sacrée (339-338 av. J.-C.) est en dehors de notre sujet. Nous n'avons guère de renseignements sur l'occupation de Delphes par les Locriens et les Étoliens, en 290 av. J.-C. En 278 av. J.-C. les Gaulois attaquèrent Delphes, en vain disait la tradition grecque, le dieu s'étant chargé de défendre son sanctuaire ; avec succès disait une autre tradition, rapportée par TITE-LIVE : (XXXVIII, 48) etiam Delphos quondam commune humani generis oraculum, umbilicum orbis terrarum, Galli spoliaverunt...
Après chaque nouveau pillage, le trésor de Delphes était reconstitué par la piété des fidèles (§ 2316 5). Sulla le trouva donc bien garni quand il s'en empara à son tour (PLUTARQUE ; Sulla, 12). Lors de sa campagne de Grèce, « (12,4) comme il fallait beaucoup d'argent pour la guerre, il viola les asiles sacrés de la Grèce et envoya chercher, à Épidaure et à Olympie, les plus belles et les plus riches offrandes. (5) Il écrivit aux Amphictyons, à Delphes, qu'on ferait bien de mettre en lieu sûr, auprès de lui, les trésors du dieu ; car il les garderait très sûrement, ou, s'il les employait, il les rendrait intégralement ». C'est ce que disent généralement les puissants quand ils font des emprunts, de gré ou de force. Parfois ils tiennent leurs promesses, parfois ils les oublient, ou bien ils payent en monnaie de singe. Sulla fit peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup. Après la bataille de Chéronée, « (19) il mit il part la moitié du territoire [des Thébains] et la consacra à Apollon Pythien et à Zeus Olympien, ordonnant d'employer les revenus pour rendre à ces dieux l'argent dont il s'était emparé ». BOUCHÉ-LECLERCQ, loc. cit., observe à ce propos : « (p. 197) Apollon savait ce que vaudrait, Sulla une fois parti, sa créance sur les Thébains ». Ces spoliations successives et continuelles finirent par appauvrir entièrement le temple. STRABON ; IX, 3, 8, p. 420. Le texte est corrompu. DE LA PORTE DU THEIL (p. 458) entend : « Objet de la cupidité, les richesses, même les plus sacrées, sont difficiles à conserver : aussi le temple de Delphes est-il maintenant fort pauvre ; car si le plus grand nombre des objets que l'on y avait successivement consacrés s'y trouve encore, tous ceux qui avaient une valeur réelle ont été enlevés. Mais jadis il (p. 459) fut très riche »., Dans la collection Didot, on traduit : Ceterum divitiae, quia invidiae sunt obnoxia, difficulter custodiuntur, etiamsi sacrae sint. Nunc quidem pauperrimum est Delphicum templum quod pecuniam attinet, donarium autem pars quidem sublata est, pars vero adhuc restat. Constantin consomma la ruine de l'oracle de Delphes en enlevant les objets d'art qui s'y trouvaient, dont il orna sa ville de Constantinople.
Bornons-nous à citer un seul exemple des très nombreuses opérations modernes Semblables à l’emprunt fait par Sulla au trésor de Delphes. RENÉ STOURM : Les finances de l'ancien régime et de la Révolution, t. II : « (p. 338) Après avoir poursuivi jusqu'au retour de l'ordre l'histoire des banqueroutes partielles, pratiquées chaque semestre par le gouvernement de la Révolution sur les arrérages de rentes, nous arrivons à celle qu'il consomma d'une manière officielle et définitive sur le capital de la dette publique, en 1797. Combien il est pénible, en abordant cette faillite tristement célèbre du tiers consolidé de rappeler les fières déclarations de l'assemblée constituante, au début de la Révolution : la loi du 17 juin 1789 « mettant les créanciers de l'État sous la garde de l'honneur et de la loyauté de la nation française ; celle du 13 juillet 1789 par laquelle, „ l'assemblée déclare que la dette publique ayant été mise sous la garde de l'honneur et de la loyauté française, nul pouvoir n'a le droit de prononcer l’infâme mot banqueroute, nul pouvoir n'a le droit de manquer à la foi publique, sous quelque forme et quelque dénomination que ce puisse être “... (p. 341) La loi du 30 septembre 1797 (9 vendémiaire an VI), connue sous le nom de loi du tiers consolidé, votée par les deux conseils, raya définitivement du grand-livre les deux tiers des rentes. Elle stipula leur remboursement en bons des deux tiers mobilisés et maintint seulement un tiers du (p. 342) montant de chaque inscription. Rappelons que les arrérages de ce dernier tiers furent eux-mêmes payés en papier-monnaie jusqu'en 1801 ». C'est d'ailleurs là une pratique suivie par un grand nombre d'États modernes. On vous doit 100 fr., on vous donne un morceau de papier avec de jolies vignettes, sur lequel est inscrite cette somme ; qu'avez-vous à réclamer ? Les puissants aiment, tout en violant les lois de leur éthique, paraître les respecter, et il ne manque jamais d'auteurs complaisants qui leur fournissent, et enseignent du haut de la chaire, autant de dérivations que ces puissants en peuvent désirer pour leur justification.
[FN: § 2316-2]
Cours, § § 449 à 453, p. 324 à 332. L'auteur a eu le tort de ne pas se dégager entièrement des considérations éthiques. Par exemple : « (450) Il faut se débarrasser du préjugé qui porte à croire qu'un vol n'est plus un vol quand il s'exécute dans les formes légales ». (Dérivation I-β). Il s'était, au contraire, résolument écarté de telles considérations, lorsqu'il écrivait « (441) Il n'est presque pas d'économiste qui n'éprouve le besoin de décider si „ l'intérêt “ (le loyer de l'épargne) est juste, équitable, légitime, moral, naturel. Ce sont là des questions qui sortent du domaine de l'économie politique, et qui, d'ailleurs, n'ont aucune chance d'être résolues si l'on ne daigne pas auparavant définir les termes qu'on emploie ». En ces observations se trouve le germe du présent Traité de Sociologie.
[FN: § 2316-3]
Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Biens ecclésiastiques « (p. 124) Les Judéo-Chrétiens... ne voulaient pas, en tant que chrétiens, rester au-dessous de ce qu'ils faisaient autrefois par devoir comme Juifs. Ils vendirent ce qu'ils possédaient et en déposèrent le prix aux pieds des Apôtres. Les Pagano-Chrétiens s'empressaient d'imiter ce zèle dévoué, d'autant plus que les religions païennes elles-mêmes faisaient à leurs adeptes une loi d'offrir des sacrifices aux dieux et des présents aux prêtres ; et, comme parmi les nouveaux convertis il y en avait beaucoup de riches, des sommes considérables furent versées dans cette communauté de biens volontaire formée par les premiers chrétiens ». Maintenant ce sont les fidèles des différentes sectes humanitaires, impérialistes, patriotiques, qui imitent les adeptes des religions païennes et des chrétiennes.
[FN: § 2316-4]
Denys de Syracuse plaisantait agréablement les dieux qu'il dépouillait. CIC. ; De nat. deor., III, 34 ; entre autres : in quibus quod more veteris Graeciae inscriptum esset, bonorum deorum, uti se eorum bonitate velle dicebat. Selon JUSTIN, XXIV, 6, le chef des Gaulois justifiait le pillage du temple de Delphes en disant : « Il est bon que les dieux, étant riches, donnent aux hommes », et aussi : « Les dieux n'ont pas besoin de biens, puisqu'ils les prodiguent aux hommes ». Les spoliateurs modernes pensent probablement de même, mais, sauf exception, ils s'expriment avec moins de cynisme.
[FN: § 2316-5]
Ainsi, par exemple, depuis les temps légendaires jusqu'au temps présent, les spoliations des biens sacrés des païens se continuent très régulièrement par les spoliations des biens sacrés des chrétiens ; il est impossible de ne pas voir en ces phénomènes les effets d'une seule et même force, qui opère depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dict. encycl. de la théol. cath., s. r. Biens ecclésiastiques : « (p. 126)... il est certain que l'Église possédait des propriétés immobilières vers l'an 300 ; car, en 802, Dioclétien s'en empara, et cinq ans après Maxence les restitua... L'édit de Licinius, promulgué d'accord avec Constantin, qui accorda toute liberté à la religion nouvelle (313), ordonna en même temps la restitution de tous les biens enlevés aux communautés chrétiennes. Les biens des temples païens furent attribués à l'Église en même temps que certaines contributions du fisc... Ce système bienveillant de l'empereur fut à plusieurs reprises interrompu ou troublé, notamment sous Julien l'Apostat, qui enleva tout à l'Église, jusqu'à ses vases sacrés ; mais le zèle des successeurs de Julien dédommagea l'Église des pertes qu'elle venait de faire ». Depuis lors, on trouve dans l'histoire une suite indéfinie de ces flux et reflux des biens ecclésiastiques, comme on voit se succéder les flux et reflux des marées de l'Océan.
MURATORI ; Antiq. ital., diss. LXXIII: De Monasteriis in beneficium concessis. (p. 301) Ad Ecclesias, sive ad eorum Prœsules ac Rectores, multam, ut supra vidimus, facultatum affluentiam detulit Christianorum pietas atque Religio : reliquum, opum atque potentiae ipsi Ecclesiastici viri quantis potuere viribus ac studiis in sacrorum locorum sibi commendatorum utilitatem, simulque propriam intenti sensim sibi peperere. Nunc addendum, contra fuisse et aliam Christifidelium partem, unoquoque Saeculo, cui nihil antiquius fuit, quam Ecclesiarum patrimonia aut expilare aut quibus poterant artibus sua efficere. Metebant iugi labore in Saecularium campis Clerici, ac praecipue Monachi ; vicissim vero et Saeulares nihil intentatum relinquebant, ut Messem ab Ecclesiasticis congestam, in horrea sua leviori interdum negotio deducerent... Caussas aliquot huiusce excidii in praecedenti Dissertatione aperui ; nunc unam, quae superfuit, tantum persequar, nonnullorum videlicet Regum impiam cousuetudinem, qui ut Magnatum animos in sua fide ac dilectione confirmarent, sive ut remuneratione quapiam Militares viros ad maiores in bello labores sustinendos accenderent, terras Ecclesiae, ac praecipue Monasteriorum, iis in Beneficium largiebantur, liberalitatis et grati animi famam facili rei alienae profusione captantes. C'est exactement ce que l'on voit encore de nos jours.
Les biens ecclésiastiques s'accroissent non seulement par la piété des fidèles, mais aussi par l'espoir que ceux-ci nourrissent d'être récompensés de leurs dons, dans cette vie ou dans une autre. Ce sentiment d'une sorte de contrat avec la divinité : do ut des, prépondérant chez les Romains, ne disparaît pas avec l'avènement du christianisme. FUSTEL DE COULANGES ; La monarchie franque : « (p. 566) Tout homme, à cette époque, était un croyant. La croyance, pour la masse des laïques, n'était ni très étendue ni très élevée, peu réfléchie, nullement abstraite ni métaphysique ; elle n'en avait que plus de force sur l'esprit et la volonté [des résidus et des intérêts, avec un minimum de dérivations]. Elle se résumait en ceci, que la plus grande affaire de chacun en ce monde était de se préparer une place dans un autre monde. Intérêts privés et intérêts publics, personnalité, famille, cité, État, tout s'inclinait et cédait devant cette conception de l'esprit [il y avait pourtant alors des exceptions, comme de nos jours pour la foi humanitaire ou patriotique ; de tout temps de rusés compères ont su tirer parti de la foi d'autrui] ». « (p. 598) La crédulité n'avait pas de limites. C'était trop peu de croire à Dieu et au Christ, on voulait croire aux saints... C'était une religion fort grossière et matérielle. Un jour, saint Colomban apprend qu'on a volé son bien dans le moment même où il était en prières au tombeau de saint Martin ; il retourne à ce tombeau et s'adressant au saint : „ Crois tu donc que je sois venu prier sur tes reliques pour qu'on me vole mon bien ? “ Et le saint se crut tenu de faire découvrir le voleur et de faire restituer les objets dérobés. Un vol avait été commis dans l'église de Sainte-Colombe à Paris ; Éloi court au sanctuaire et dit : „ Écoute bien ce que j'ai à te dire, sainte Colombe ; si tu ne fais pas rapporter ici ce qui a été volé, je ferai fermer la porte de ton église avec des tas d'épines, et il n'y aura plus de culte pour toi. “ Le lendemain, les objets volés étaient rapportés ». (§ 1321). De nos jours, C'est la « justice immanente », ou autre entité de ce genre, qui se charge de besognes analogues. « (p. 574) Les donations furent nombreuses. Elles avaient leur source dans l'état des esprits et des âmes... (p. 575) Dès que l'homme croyait fermement à un bonheur à venir qui devait être une récompense, l'idée lui venait spontanément d'employer tout ou partie de ses biens à se procurer ce bonheur. Le mourant calculait que le salut de son âme valait bien une terre. Il supputait ses fautes, et les payait d'une partie de sa fortune... Regardez en quel style sont rédigées presque toutes ces donations. Le donateur déclare qu'il veut „ racheter son âme “, qu'il donne une terre „ en vue de son salut“, „ pour la rémission de ses péchés “, ,, pour obtenir l’éternelle rétribution “. On voit par là que, dans la pensée de ces hommes, la donation n'était pas gratuite. Elle était un échange, un don contre un don ; donnez, était-il dit, et il vous sera donné, date et dabitur ». C'est ce que de nos jours pensent les souscripteurs à de chanceux emprunts publics.
Les fidèles donnaient, et les puissants prenaient. Cela commença dès les temps où la foi était profonde. D. GREG. ; Hist. eccl. franc., IV, 2, (trad. BORDIER). « Le roi Chlothachaire avait récemment ordonné que toutes les églises de son royaume payeraient au fisc le tiers de leurs revenus ; tous les évêques avaient, bien contre leur gré, consenti et souscrit le décret ; mais le bienheureux Injuriosus, s'en indignant, refusa courageusement de souscrire, et il disait : „ Si tu veux enlever ce qui est à Dieu, le Seigneur t'enlèvera bientôt ton royaume...“ Et, irrité contre le roi, il se retira sans lui dire adieu. Le roi ému, craignant d'ailleurs la puissance du bienheureux Martin, envoya après l'évêque avec des présents, lui demanda pardon, et le pria de supplier en sa faveur la puissance du bienheureux pontife Martin ».
Les Conciles s'évertuaient à fulminer des peines ecclésiastiques contre les usurpateurs des biens de l'Église. En l'au 504, un Concile fut tenu à Rome, principalement en cette intention. Il renouvela les règlements des Conciles précédents et décréta, en son can. I : Quicumque res Ecclesiae confiscare, aut competere, aut pervadere, periculosa aut sua infestatione praesumpserit, nisi se citissime per Ecclesiae, de qua agitur, satisfactionem correxerit, anathemate feriatur. Similiter et hi qui Ecclesiae, iussu, vel largitione principum, vel quorumdam potentum, aut quadam invasione, aut tyrannica potestate retinuerint, et filiis vel haeredibus suis quasi haereditarias relinquerint, nisi cite, res Dei, admoniti a Pontifice, agnita veritate reddiderint, perpetao anathemate feriantur. La malice des usurpateurs était grande ; ils avaient imaginé de se mettre en possession des biens de l'Église, sous prétexte de les conserver pendant les interrègnes. Le Concile les condamne. Les patrons aussi se servaient des biens ecclésiastiques, les abbayes étaient usurpées. En l'an 909 fut tenu un Concile à Troslé près de Soissons. FLEURY ; Hist. eccl., t. XI. Dans la préface des décrets de ce Concile on dit : « (p. 615) Les villes sont dépeuplées, les monastères ruinés ou brûlés, les campagnes réduites en solitudes... (p. 616) Dans la suite on décrit ainsi la décadence des monastères. Les uns ont été ruinés ou brûlés par les païens, les autres dépouillés de leurs biens, et presque réduits à rien : ceux dont il reste quelques vestiges ne gardent plus aucune forme de vie régulière... (p. 617) Le Concile s'étend ensuite sur le respect dû aux personnes ecclésiastiques, les mépris et les outrages auxquels ils étaient alors exposés, et le pillage des biens consacrés à Dieu ». Plus loin, t. XII, au 956 : « (p. 115) Nous avons encore un traité d'Atton de Verceil touchant les souffrances de l'église, divisé en trois parties... (p. 118) La troisième partie est touchant les biens des églises. Nous ne pouvons passer sous silence, dit l'auteur, qu'après la mort ou l'expulsion d'un évêque, les biens de l'église sont donnez au pillage-à des séculiers. Car qu'importe qu'on les pille de son vivant ou après sa mort ? et à quoi sert de garder le trésor de l'église, si on pille les granges, les celliers et tout le reste ? On dissipe tout ce qui se trouve en nature, on vend les fruits à recueillir sous le nom de l'évêque futur, on diffère son ordination jusqu'à ce que l'on ait tout consumé ; et enfin on donne l'évêché à celui qui en offre le plus. En sorte qu'il n'y a point de terres si souvent pillées et vendues que celles de l'église ». L'Église d'Orient n'était pas mieux partagée que celle d'Occident. Ibidem, t. XV, (an 1115) : (p. 17)... l'empereur Manuel Comnème fit une constitution par laquelle il renouvela la défense que son père avait faite de prendre les biens des évêchés vacants. Nous avons appris, dit-il, qu'à la mort des évêques, quelquefois même avant qu'ils soient enterrés, les officiers des lieux entrent dans leurs maisons, dont ils emportent tout ce qu'ils y trouvent, et se mettent en possession des immeubles de leurs églises... »
Si ce n'était pas seulement la piété qui poussait aux dons, ce n'était pas non plus la seule impiété qui poussait à la spoliation. Le besoin d'argent était souvent la cause principale. Il est fort probable que Sulla croyait en Apollon tout en dépouillant le temple. De pieux monarques chrétiens n'agirent pas différemment. De nos jours, de sincères humanitaires savent s'enrichir grâce à leur religion. Charles Martel était certes un prince pieux ; pourtant on l'accuse d'avoir dépouille l'Église. FRAN IN ; Annales du Moyen-Âge, t. VI : « (p. 455) Les capitaines de Charles furent donc les premiers vassaux ; et le nouveau fisc qu'il créa, si l’on peut parler ainsi, fut formé des biens des églises dont il leur livra la dépouille... Non seulement les biens des églises, mais les églises même, les monastères, les chaires, furent la proie de sa libéralité sacrilège. Il livra, dit un contemporain, les sièges épiscopaux aux laïcs et ne laissa aucun pouvoir aux évêques. Un de ses capitaines, après la victoire, reçut à lui seul pour récompense les sièges de Reims et de Trèves. Les monastères furent envahis, ruinés ou détruits ; les moines chassés, vivant sans discipline, et cherchant des asiles où ils pouvaient. Charles, dit un autre, détruisit par toute la France les petits tyrans qui s'arrogeaient l'empire ; après quoi voulant récompenser ses soldats, il attribua au fisc les biens des églises et leur en fit le partage. Cette violente usurpation du patrimoine ecclésiastique eut lieu dans toute la suite de ses longues guerres. „ Enfin, dit la chronique de Verdun, Charles dispensa avec une monstrueuse profusion, le patrimoine public à ses guerriers que l'on commença à appeler du nom de soldats ou (p. 456) soudoyés, et qui accouraient vers lui de toutes les parties du monde, attirés par l'appât du gain... Le pillage du trésor royal, le sac des villes, le ravage des royaumes étrangers, la spoliation des églises et des monastères, les tributs des provinces, suffirent à peine à sa convoitise. Ces ressources épuisées, il s'empara des terres des églises. Il donna les évêchés à ses capitaines, soit clercs, soit laïcs, et des sièges se virent plusieurs années sans pasteurs ».
La légende, qui s'était déjà chargée de la punition des spoliateurs du temple de Delphes, se chargea aussi de la punition de Charles. Les spoliateurs de Delphes eurent des peines terrestres, Charles, des peines en l'autre monde. Saint Eucher d'Orléans vit aux enfers l'âme de Charles Martel. Les évêques signalent le fait en une lettre adressée à Louis le Pieux. Dec. Grat., pars. sec., ca. 16, qu. 1, can. 59 : Quia vero Carolus Princeps, Pipini Regis Pater, qui primus inter omnes Francorum Reges, ac Principes res Ecclesiarum ab eis separavit, atque divisit, pro hoc solo maxime est aeternaliter perditus. Nam s. Eucherius Aurelianensis Episcopus, ...in oratione positus, ad alterum seculum raptus, et inter cetera, quae Domino sibi ostendente conspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri. L'ange qui le guidait en cette excursion lui dit que Charles souffrait cette peine à cause de ses rapines, et qu'il fallait distribuer ses biens aux églises et aux pauvres. Qui [s. Eucherius] in se reversus s. Bonifacium, et Fuldradum Abbatem monasterii s. Dionysii... ad se vocavit, eisque talia dicens in signum dedit, ut ad sepulcrum illius irent, et si corpus eius ibidem non reperissent, ea, quae dicebat, vera esse concrederent. Ipsi autem pergentes ad praedictum monasterium, ubi corpus ipsius Caroli humatum fuerat, sepulcrumque ipsius aperientes, visus est subito exiisse Draco, et totum illud sepulcrum interius inventum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos vidimus, qui usque ad nostram aetatem duraverunt, qui huic rei interfuerunt, et nobis viva voce veraciter sunt testati quae audierunt, atque viderunt. Quod cognoscens filius eius Pipinus, synodum apud Liptinas congregari fecit... Nam et synodum ipsam habemus, et quantumcumque de rebus Ecclesiasticis, quas pater suus abstulerat, potuit, Ecclesiis reddere procuravit. Gratien ajoute : Huius historiae mentio etiam est in vita beati Eucherii... Qualis vero esset huiusmodi Ecclesiasticorum bonorum divisio, quani Carolus Martellus induxit, Pipinus autem, et Carolus Imperator prohibuerunt, eod. lib. primo Capitularium ante capitulum istud 83 sic exponitur : „ ... in Aquis fuit factura istud capitulum, propter hoc, quia Laici homines solebant dividere Episcopia, et monasteria ad illorum opus, et non remansisset ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissae, nisi tantum, ut velut Canonici, et Monachi viverent. “
Depuis lors, ces phénomènes se reproduisent jusqu'au temps présent, en lequel nous trouvons la suppression des corporations religieuses en Italie, et tout récemment en France. Les biens des églises furent distribués ostensiblement aux soldats de Charles Martel, le « milliard des congrégations » fondit et se dissipa entre les mains des partisans des politiciens. En l'un et l'autre cas, il se peut que l'opération ait eu, somme toute, un effet utile pour le pays, en assurant la stabilité d’un régime politique.
THOROLD ROGERS a fort bien décrit les prodigalités de Henri VIII, en Angleterre, et leurs conséquences. Interprétations économiques de l'histoire : « (p. 45) Jamais l'Angleterre n'eut de souverain aussi follement dépensier que Henri VIII. Grâce à l'esprit d'économie de son père, il avait hérité d'une fortune considérable pour l'époque. Il l'eut bientôt dissipée. Ses guerres, ses alliances et ses subsides à l'empereur d'Allemagne... lui coûtèrent gros sans rien lui rapporter ; même en temps de paix ses dépenses étaient prodigieuses... (p. 46) Sa méfiance et son goût pour l'apparat le poussaient à enrichir sa noblesse qu'il avait installée dans ses nombreux palais... S'il l'avait pu, il aurait dépensé toute la fortune particulière de ses sujets et essaya de tout pour s'en emparer. Cependant il fut populaire, car les prodigues sont toujours populaires, même lorsqu'ils gaspillent ce qui ne leur appartient pas [cette observation s'applique aussi aux politiciens de notre temps]. Il confisqua les biens des petits monastères et vit bientôt le bout de leurs richesses. Il épargna quelque temps les grands, déclarant qu'ils étaient les asiles de la piété, de la religion. Puis il s'engagea à ne plus frapper son peuple d'impôts nouveaux, même en cas de guerres légitimes, à condition que les dépouilles des monastères lui seraient attribuées. Prévoyant la tempête, les moines avaient loué leurs terres par baux à long terme, de sorte qu'une grosse part du butin ne lui revint que plus tard, mais les trésors accumulés pendant des siècles tombèrent dans ses griffes. Une longue file de chariots emporta l'or, l'argent et les pierres précieuses, que quatre siècles avaient amassés autour de la châsse de Becket, le sanctuaire le plus riche de l'Angleterre, peut-être de la chrétienté. Mais Wincester, Westminster, cent autres lieux consacrés étaient presque aussi riches... leurs trésors équivalaient probablement à toute la monnaie en circulation à l'époque et les terres des couvents occupaient, dit-on, le tiers de la superficie du royaume. Le tout s'évanouit comme neige (p. 47) en été... Après ces exploits, il semble n'avoir plus osé demander d'argent à son peuple. Toutefois il s'avisa d'un moyen sûr de s'attaquer à sa bourse et se mit à émettre de la monnaie altérée... »
Il est inutile de continuer, pour d'autres pays, cette analyse qui ne ferait que reproduire des faits analogues à ceux que nous venons de rappeler. En Allemagne, la guerre des Investitures, la Réforme, la sécularisation des principautés ecclésiastiques, au temps de la Révolution française ; en France les abbayes distribuées, aux abbés de cour, les expro- priations de la première république, celles de la troisième, sont de nouveaux exemples des grandes oscillations de la courbe des spoliations.
[FN: § 2316-6]
Cours, § § 344 à 363. Il faut écarter quelques considérations éthiques, qui apparaissent, au moins implicitement, çà et là.
[FN: § 2316-7]
ARISTOPH. : Equites, (1127-1130) Peuple « ... Je veux nourrir un démagogue [conducteur du peuple] voleur ; quand il est gorgé, je le frappe, lorsqu'il est porté en haut. ... (1147-1149)... je les force [les démagogues voleurs] à vomir ce qu'ils m'ont volé ». À Rome, vers la fin de la République, les provinces étaient livrées à des « spéculateurs », qui, par des largesses faites au peuple romain, acquéraient le droit de les pressurer. Les despotes asiatiques et les africains faisaient dépouiller leurs sujets par des agents qu'ils dépouillaient à leur tour. Les rois chrétiens laissaient les juifs, les usuriers, les banquiers s'enrichir, et, ensuite s'appropriaient leur argent. En France, la Régence laissa bon nombre de personnes s'enrichir par de scandaleuses spéculations qu'elle avait créées et favorisées, puis les força à rendre gorge, avec des exceptions plus scandaleuses encore. Voir sur la spéculation à laquelle donna lieu le système de Law : FERRARA : Della Moneta e dei suoi surrogati – Raccolta delle prefazioni... vol. II, parte I. Cet auteur conclut : « (p. 499) La simulation des Compagnies de commerce, la cabale financière, la banqueroute à laquelle lui [Law] et le Régent s'acheminaient, voilà tout le (p. 500) secret de Law ; et tous ces artifices n'ont rien à voir avec les institutions de crédit, et encore moins avec la liberté des banques ». Les admirateurs de l'État éthique et les défenseurs plus ou moins gratuits des « spéculateurs » ont tenté, de défendre le système de Law et le Régent. Les dérivations qu'ils ont produites sont de celles qui s'emploient généralement en de telles occasions. Le 26 janvier 1721, on soumit à un visa tous les détenteurs d'effets relatifs au Système, y compris les contrats de rente acquis avec des billets. Les contemporains des banqueroutes et des visas de 1716 et de 1721 se rendaient compte de la nature de ces spoliations. J. BUVAT : Journal de la Régence, édité par E. CAMPARDON, Paris 1865, t. I : « (p. 201) Le 10 [décembre 1716], on vit une médaille frappée à l'occasion de la recherche des gens d'affaires et des agioteurs, par la chambre de justice, sur laquelle était d'un côté le portrait du roi Louis XIV, au bas duquel était la légende : Esurientes implevit bonis, et de l'autre côté était celui du roi Louis XV, avec ces mots au bas : Divites dimisit inanes. Plus loin, t. II, à propos du visa de 1721 : « (p. 273) „ Ne parlez point de taxe, reprit le prince [le Duc de Bourbon] ; on sait trop les malversations qui se sont faites dans la dernière chambre de justice ; ainsi dans celle que l'on prétend créer de nouveau, il arrivera le même inconvénient. La moindre femme obtiendra ce qu'elle voudra de M. le duc d'Orléans, pour faire décharger ceux dont elle espérera récompense, afin de les favoriser. Ne croyez pas que je dise ceci parce qu'il n'est pas ici présent, je le soutiendrais à lui-même “ ». H. MARTIN, Hist. de Fr., t. XVII : « (p. 228) On établit des catégories qui perdirent du sixième aux dix-neuf vingtièmes [opération analogue à celle des impôts progressifs, de nos jours], immense travail par lequel on tâcha, comme en 1716, d'observer dans la (p. 229) violation de la foi publique une sorte de justice relative. Cinq cent onze mille personnes déposèrent pour deux milliards cinq cent vingt-et-un millions de papiers, qu'on réduisit de cinq cent-vingt-et-un millions ; restaient environ dix-sept cents millions, qu'on admit comme capital de rentes viagères et perpétuelles... Une très petite partie de la dette (quatre-vingt- deux millions et demi) fut acquittée en argent ». Cette banqueroute avait été précédée par une autre analogue, en 1715. H. Martin observe, à ce propos « (p. 161) L'histoire financière de l'ancien régime n'offre qu'une alternative de déprédations des financiers sur le peuple, et de violences du pouvoir sur les financiers ; c'était un cercle dont on ne pouvait sortir ». Il est singulier qu'un historien de valeur, comme l'était H. Martin, n'ait pas vu qu'il ne s'agissait là, en somme, que d'un cas particulier d'un phénomène général.
Les hommes pratiques ont souvent des vues plus justes que les théoriciens. Saint-Simon a bien vu que, pour interrompre le cycle des spoliations, il faudrait empêcher de se produire le flux d'argent qui fournit la matière des appropriations ; mais il s'est trompé sur l'efficacité des moyens. SAINT-SIMON ; Mémoires, édition in-18, t. VII, p. 403 à 407. Il propose la banqueroute pure et simple, et y voit l'avantage qu'on ne prêtera plus au gouvernement, et que celui-ci sera bien obligé de modérer ses dépenses. « (p. 404) Plus il [l'édit de la banqueroute] excitera de plaintes, de cris, de désespoirs par la ruine de tant de gens et de tant de familles, tant directement que par cascade, conséquemment de désordres et d'embarras dans les affaires de, tant de particuliers, plus il rendra sage chaque particulier pour l'avenir ». Saint-Simon se trompe. L'expérience faite en un grand nombre de siècles a démontré que la naïveté des épargneurs est tout aussi tenace que la passion du jeu. « De là deux effets d'un merveilleux avantage : impossibilité au roi de (p. 405) tirer ces sommes immenses pour exécuter tout ce qui lui plaît, et beaucoup plus souvent qu'il plaît à d'autres de lui mettre dans la tête pour leur intérêt particulier ; impossibilité qui le force à un gouvernement sage et modéré, qui ne fait pas de son règne un règne de sang et de brigandages et de guerres perpétuelles contre toute l'Europe bandée sans cesse contre lui, armée par la nécessité de se défendre... L'autre effet de cette impossibilité délivre la France d'un peuple ennemi, sans cesse appliqué à la dévorer par toutes les inventions que l'avarice peut imaginer et tourner en science fatale [ce qui est devenu la science des finances de notre époque] par cette foule de différents impôts [encore plus nombreux de nos jours], dont la régie, la perception et la diversité, plus funeste que le taux des impôts mêmes, pour ce peuple nombreux dérobé à toutes les fonctions utiles de la société, qui n'est occupé qu'à la détruire, à piller tous les particuliers, à intervertir commerce de toute espèce... » C'est un « rentier » qui parle : il voit une des faces de la médaille, un « spéculateur » aurait vu l'autre face.
[FN: § 2316-8]
Nous employons le terme nécessaire uniquement dans le sens expérimental, pour exprimer, sans adjonction d'aucune conception d'absolu métaphysique ou autre, le simple fait que, dans les limites d'espace et de temps à nous connues, un phénomène s'observe constamment uni à un autre.
[FN: § 2316-9]
Cours, t. I, § § 469 à 472, p. 340 à 343.
[FN: § 2316-10]
Pourquoi un même auteur s'est-il d'abord arrêté à ce point, et l'a-t-il ensuite dépassé ? S'il ne s'agissait là que d'un cas individuel, ce problème ne vaudrait pas la peine qu'on s'en occupât ; mais il est d'une portée bien plus générale, et peut nous fournir des considérations utiles pour l'étude des phénomènes sociaux.
L'auteur du Cours ayant insisté longuement sur la nécessité de tenir compte de la mutuelle dépendance des phénomènes, on ne saurait voir en un oubli général de cette mutuelle dépendance la source principale de son erreur. Pourtant on peut dire que, en particulier, la mutuelle dépendance des phénomènes économiques et des phénomènes sociaux est parfois un peu négligée par lui. Mais son erreur a surtout pour cause le fait qu'il ne tâche de soumettre que les phénomènes économiques à une rigoureuse analyse scientifique. Quand il s'agit des phénomènes sociaux, il accepte souvent les théories toutes faites que lui fournissent l'éthique courante et les jugements a priori de la société et du temps où il vit. C'est d'ailleurs là un principe qui a guidé et qui continue à guider le plus grand nombre des économistes, et c'est pour cela qu'il est utile d'en signaler l'erreur.
L'auteur du Cours paraît croire, au moins implicitement, que ce qui est contraire à l'éthique est nuisible à la société, et que ce qui est déclaré blâmable par les opinions courantes, qu'il fait siennes, doit être évité. On voit là d'abord l'influence des résidus et principalement de ceux du genre II-dzéta. Les résidus du genre IV-ε 3 interviennent aussi. L'auteur a étudié avec tout le soin possible les phénomènes économiques ; il croit, à tort ou à raison, avoir obtenu des démonstrations scientifiques, il a l'impression, lorsqu'il traite de ces phénomènes, d'être sur un terrain solide, ne se soucie nullement du blâme que peut lui infliger le sentiment, et n'a cure des opinions régnantes si elles ne sont pas justifiées par l'expérience. Mais, arrivé sur le terrain des phénomènes sociologiques, il comprend qu'il ne les a pas encore étudiés avec une rigoureuse analyse expérimentale, et qu'il se trouve sur un terrain mouvant ; il hésite à rompre en visière avec certaines opinions dont il ne se sent pas encore en mesure de démontrer la fausseté expérimentale, et soumet alors son jugement à celui des sentiments d'autrui ou des siens propres. On voit ensuite apparaître des dérivations du genre II-α. Par exemple, des économistes d'une renommée aussi grande que méritée voyaient dans la falsification des monnaies une simple fraude, œuvre d'un pouvoir malhonnête. L'auteur du Cours, à son insu peut-être, est sous l'influence de cette idée, que lui ont inculquée ses maîtres ; il cède à des dérivations du genre III-α, et probablement aussi du genre III-ε. Au point de vue de la seule logique, il y trouve d'ailleurs, à juste titre, une incontestable réfutation des rêveries des adulateurs de l'État éthique. C’est encore là un phénomène général : une dérivation erronée appelle une réfutation qui, parfaitement fondée sous l'aspect de la pure logique, paraît l'être aussi sous l'aspect expérimental. Marx donne une théorie absurde de la valeur, théorie qui exagère fortement l'erreur de celle de Ricardo ; on la réfute et on croit, par là, avoir réfuté son socialisme. C'est une erreur. La polémique au sujet des dérivations n'atteint pas la nature expérimentale des phénomènes.
Le changement qui s'observe dans la Sociologie provient principalement de ce que l'auteur a étendu la méthode expérimentale aux phénomènes sociaux ; qu'il a tâché, pour autant que sa connaissance et ses forces le lui permettaient, de ne plus rien admettre a priori, ou en se soumettant à l'autorité, aussi respectable fût-elle, de ne plus se fier en aucune manière au sentiment, que ce fût le sien propre ou celui d'autrui, de pourchasser, autant que faire se pourrait, toute intrusion de la métaphysique et des différentes théologies, et en somme de tout soumettre au critérium exclusif de l'expérience.
[FN: § 2316-11]
Cours, § § 466, 4711. La description du phénomène est telle que nous pouvions la donner alors que nous n'avions pas encore la théorie générale de la forme ondulée des phénomènes sociaux (§ § 1718, 2293, 2330). Elle a pourtant le mérite d'être opposée à la théorie optimiste de la diminution du taux de l'intérêt ; théorie qui régnait en ce temps, et que les faits qui se sont vérifiés depuis lors se sont chargés de réfuter.
[FN: § 2316-12]
Un exemple d'une de ces oscillations, en Angleterre, est indiqué dans Cours, § 471-1.
[FN: § 2316-13]
Les systèmes socialistes, t. I, chap. IV : Systèmes réels.
[FN: § 2317-1]
Journal de la Société de statistique de Paris, avril 1914, p. 191. Suivant M. A. NEYMARCK, il y avait, dans le monde, à la fin de l'année 1912, une somme de 850 milliards de valeurs mobilières : titres d'État, actions et obligations de sociétés industrielles, etc. En France, il y en avait 115 à 120 milliards, dont 80 milliards en titres français. Le passé ne nous appartient plus. Si l'on pouvait accomplir l'opération sans que les futurs producteurs d'épargne s'en aperçoivent, ou en somme, sans qu'ils aient des craintes pour eux-mêmes, on pourrait enlever ces 850 milliards à leurs possesseurs, sans altérer beaucoup la productivité économique du monde. On aurait simplement un transfert de richesse de certains individus à certains autres, avec les perturbations que peut produire dans la production la diversité des goûts et des besoins des possesseurs anciens et nouveaux. Il n'en serait pas ainsi, si l'opération effrayait les futurs producteurs d'épargne, lesquels pourraient alors cesser partiellement d'épargner, et, au demeurant, cacher les épargnes faites. Ils priveraient ainsi la production de ses moyens d'extension, et provoqueraient la ruine économique. Le problème que nos gouvernants ont eu à résoudre, particulièrement les gouvernants spéculateurs, consistait donc à trouver un moyen de dépouiller les producteurs actuels de l'épargne, sans effrayer les producteurs futurs. Ce problème a été résolu, non par la théorie, mais par empirisme, et, guidés par l'instinct, les gouvernants ont trouvé la meilleure solution du problème. Elle consiste à n'avancer que pas à pas, en donnant de temps en temps un petit coup de dent dans le gâteau. Ainsi, bien loin d'éveiller la crainte chez les futurs producteurs d'épargne, on les encourage ; car, au fur et à mesure que croissent les charges pesant sur l'épargne déjà existante, l'épargne future acquiert une plus grande valeur. Par exemple, en 1913, on parlait d'établir un impôt sur la rente française, ce qui fit baisser en bourse le prix de la rente. Dans un phénomène si compliqué, il est impossible de trouver un rapport précis entre le taux de l'impôt et le cours de la rente. Mais faisons une hypothèse, uniquement pour donner une forme concrète à des considérations abstraites. Supposons que l'impôt soit du 5 % sur le coupon, lequel par conséquent, au lieu de 3 fr. pour 100 de capital, sera seulement de 2,85 fr. Si le prix de la rente baisse précisément de 5 % comme le coupon, et si, du prix de 92, par exemple, elle descend à 87,40, les anciens possesseurs d'épargne perdent une certaine somme ; les nouveaux producteurs ne perdent ni ne gagnent, et continuent à employer leur épargne avec le même intérêt qu'ils auraient, si la rente était demeurée à 92, sans impôt sur le coupon. Il y a deux autres cas: 1° si la rente demeure au-dessus de 87,40, les anciens possesseurs d'épargne perdent moins et les nouveaux quelque peu ; il y a une baisse générale de l'intérêt du capital ; 2° si la rente tombe au-dessous de 87,40, les anciens possesseurs d'épargne perdent davantage, et les nouveaux gagnent ; il y a une hausse générale de l'intérêt du capital. On remarque le premier cas assez généralement dans les périodes de stagnation, le second dans les périodes d'activité économique. D'une manière générale, dans ce second cas, les spéculateurs gagnent de deux façons : 1° ils s'approprient une partie de l'argent enlevé aux anciens possesseurs d'épargne; 2° ils reçoivent un intérêt du capital supérieur pour leurs épargnes. lesquelles sont faciles à amasser grâce à l'augmentation des bénéfices. Ce mouvement ne peut continuer indéfiniment, non par suite de la résistance de ceux auxquels on enlève leurs biens, mais à cause de la réduction de la production, par suite de l'accroissement de l'intérêt des capitaux ; en outre, parce que la facilité de gagner qu'ont les spéculateurs induit les gens à dépenser plus qu'à épargner. Il est facile de comprendre qu'avec la somme totale de 850 milliards de francs d'épargne existant dans le monde, cet effet ne peut être que très lent. Avant qu'il modifie profondément le phénomène, des forces d'un effet plus prompt peuvent intervenir, comme celle que produit la concurrence internationale, celle de l'usage que l'on fait de l'épargne, et celle de l'emploi de la force pour arracher leur proie aux spéculateurs.
[FN: § 2320-1]
Le phénomène est très connu, et les ouvrages qui le décrivent sont innombrables ; mais il ne doit pas être disjoint des autres phénomènes du régime politique actuel. Depuis une centaine d'années, on n'entend que lamentations sur l'accroissement de la bureaucratie, en nombre et en pouvoir ; et celle-ci, d'un mouvement toujours plus rapide, continue à croître en nombre et en pouvoir, et envahit des pays qu'elle avait jusqu'à présent épargnés, comme par exemple l'Angleterre. Il est donc évident qu'il existe des forces puissantes poussant dans cette voie, et brisant les résistances qui tenteraient d'empêcher qu'on ne la parcoure. Un fait contribue à rendre ces résistances inefficaces : les différents partis politiques blâment une augmentation générale de la bureaucratie, en nombre et en pouvoir, tandis qu’ils louent et invoquent une augmentation partielle de cette fraction de la bureaucratie qui sert à certaines de leurs fins politiques, et même personnelles, et qu'ils restreignent leurs blâmes à la fraction qui ne leur est pas utile. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, les gouvernements modernes sont irrésistiblement poussés à augmenter les dépenses pour leurs employés, afin d'acquérir la faveur de ceux qui profitent de ces dépenses et de leurs protecteurs. Dans l'Avanti du 29 mars 1915, CLAUDIO TREVES dit : « ... Savez-vous que le budget des colonies, 1915-1916, prévoit 7 577 900 fr. pour payer les employés : L'éléphantiasis bureaucratique trouve aux colonies son paradis. [Sic.] Cela explique bien des choses, entre autres l'indulgence démocratique pour l'impérialisme, sauveur, bienfaiteur des classes misérables de la petite bourgeoisie intellectuelle, satellite du gros capitalisme financier, auquel il procure des prébendes honorifiques, et qu'il empêche d'aller s'unir au prolétariat des usines ». On n'a qu'à généraliser ces observations, limitées aux intérêts d'un parti, et l'on aura la description du phénomène que l'on observe aujourd'hui dans presque tous les pays civilisés.
[FN: § 2326-1]
Au sujet de certains motifs sociaux qui attirent dans le parti socialiste ou dans le parti « démocratique » plusieurs personnes qui ne sont pas des spéculateurs, voir ROBERT MICHELS ; Les partis politiques : « (p. 186) Il est des personnes bonnes et charitables qui, pourvues en abondance de tout ce dont elles ont (p. 187) besoin, éprouvent parfois le besoin de se livrer à une propagande en rapport à leur situation spéciale... Dans les cerveaux malades de quelques personnes, dont la richesse n'égale que leur amour du paradoxe, est née cette croyance fantastique que, vu l'imminence de la révolution, elles ne pourront préserver leur fortune qu'en adhérant préventivement au parti ouvrier et en gagnant ainsi la puissante et utile amitié de ses chefs [ces personnes suivent, sans avantage direct, la même voie que parcourent les spéculateurs avec un gros avantage pour eux-mêmes]. D'autres encore, parmi les riches, crurent devoir s'inscrire au parti socialiste, parce qu'ils le considèrent comme un refuge contre l'exaspération des pauvres. Très souvent encore, l'homme riche est amené à se rapprocher du socialisme, parce qu'il éprouve la plus grande difficulté... à se procurer dorénavant de nouvelles jouissances... (p. 188). Mais il existe, parmi les socialistes d'origine bourgeoise, d'autres éléments... Il y a avant tout la phalange de ceux qui sont mécontents „ par principe “... Plus nombreux encore sont ceux dont le mécontentement tient à des raisons personnelles... Beaucoup détestent consciemment ou non, l'autorité de l'État, parce qu'elle leur est inaccessible... Il existe encore d'autres types qui se rapprochent de ceux que nous avons énumérés. Les excentriques d'abord... Mais il est des gens qui sont en haut et éprouvent un besoin irrésistible de descendre en bas... Qu'on ajoute encore à toutes ces catégories celle des déçus et des désenchantés... »
[FN: § 2326-2]
V. PARETO ; Rentiers et spéculateurs, dans L'Indépendance, 1er mai 1911 : « En France, les « progressistes » sont contraires à l'impôt progressif sur le revenu parce qu'ils savent que ce n'est pas à eux qu'ira le produit de cet impôt ; à Milan, les « libéraux » ont établi cet impôt, parce que, ayant le pouvoir, ce sont eux qui en dépensent le produit ; et que ce produit ira à eux et à leurs troupes. Les « libéraux » milanais ont un état-major composé principalement de personnes de la deuxième catégorie [spéculateurs] ; les « radicaux » s'appuient, en partie, sur des électeurs de la première catégorie [rentiers] ; il est donc naturel que, dans ces conditions, les « libéraux » soient favorables, et les « radicaux » contraires à un impôt progressif. En d'autres circonstances, par exemple, pour un impôt d'État, il pourrait ne pas en être de même ».
[FN: § 2328-1]
Il faut se rappeler ce que nous avons dit au § 2254 : que les spéculateurs ne doivent pas être considérés comme une seule et unique personne accomplissant des actions logiques en vue de desseins prémédités (§ 2542). Les faits sont une conséquence de l'organisation plus que de certaines volontés délibérées. En 1912, la guerre des Balkans n'était pas voulue par la plupart des financiers européens, mais elle avait été préparée par leur action qui, épuisant les forces de la Turquie, devait nécessairement faire de ce pays la proie de ceux qui l'attaqueraient. Parmi ceux-ci, les financiers italiens furent alors les premiers : en poussant à la guerre de Libye, ils préparèrent directement la guerre des Balkans, préparée indirectement par l'action de tous les financiers et spéculateurs européens. Ensuite, ils s'occupèrent et s'occupent encore (en 1913), de se partager économiquement la Turquie d'Asie. Ils préparent ainsi, indirectement peut-être et sans la vouloir, une nouvelle guerre dont le but sera de transformer le partage économique en un partage politique. Il se peut que cette guerre n'ait pas lieu ; mais si elle se produit, elle aura été préparée par les spéculateurs, bien qu'au moment où elle éclatera, un petit ou un grand nombre d'entre eux y soient peut-être opposés.
[FN: § 2330-1]
Cours, t. II, § 925 : « (p. 277) Les molécules dont l'ensemble représente l'agrégat social oscillent perpétuellement. Nous pouvons bien, dans un but d'analyse, considérer certains états économiques moyens, de la même manière que nous considérons le niveau moyen de l'océan ; mais ce ne sont là que de simples conceptions, qui, pas plus l'une que l'autre, n'ont d'existence réelle ».
[FN: § 2330-2]
Depuis le songe du Pharaon (Gen., 41), qui vit sept vaches grasses et sept vaches maigres, sept épis gras et beaux et sept épis maigres et brûlés, jusqu'à la théorie de Jevons mettant en rapport les crises économiques avec les périodes de stérilité aux Indes, on a une infinité de conceptions semblables. Il faut remarquer que le Pharaon voit les vaches maigres manger les grasses, les sept épis maigres manger les pleins, et non vice versa. De même, encore de nos jours, un grand nombre d'économistes réservent le nom de crise à la période descendante de l'ondulation économique, et ne paraissent pas se rendre compte que la période ascendante amène la période descendante, et vice versa.
[FN: § 2330-3]
La doctrine d'une série de créations et de destructions du monde paraît avoir été soutenue par Anaximandre, Anaximène et Héraclite, bien que l'on ait voulu interpréter différemment les passages qui nous restent de ces auteurs. L'un d'eux au moins était passablement obscur, même pour Cicéron, qui dit (De nat. deor., III, 14, 35) que, puisque Héraclite n'a pas voulu se rendre intelligible, on peut l'omettre.
Au fond, ces questions d'interprétation sont indifférentes pour les recherches que nous faisons en ce moment ; il nous suffit qu'il y ait des philosophes anciens ayant eu une semblable conception et cela résulte sûrement de passages tels que ceux d’ARISTOTE, De Coelo, I, 10, 2 ; Phys., I, 1 ; DIOG. LAERT., IX, 8. Ce dernier auteur attribue à Héraclite l'assertion que « le Monde est un ; il naît du feu, et de nouveau est incendié, selon certaines périodes, alternativement chaque siècle [ou : espace de temps]. Cela est déterminé par le destin ». EUSEB. Praep. evang., XIII, 18, p. 676. Les Stoïciens, qu'ils l'aient ou non empruntée à des philosophes antérieurs, avaient une doctrine analogue. EUSEB. ; Praep. evang., XV, 18; CIC. ; De nat. deor., II, p. 46, 118. On a ainsi l'un des extrêmes que nous avons indiqués dans le texte ; l'autre est fourni par HERBERT SPENCER. Dans la 2e partie des Premiers principes, l'auteur a tout un chapitre intitulé : Rythme du mouvement. Après avoir noté plusieurs exemples de ce rythme, il ne se contente pas de conclure, ainsi que le veut la science expérimentale, que c'est là une propriété assez générale ; sa métaphysique le porte à rechercher ce qui est absolu, nécessaire, et il conclut : « (p. 291) Ainsi donc le rythme est une propriété nécessaire de tout mouvement. Étant donnée la coexistence universelle de forces antagonistes, postulat nécessité comme nous l'avons vu par la forme de notre expérience, le rythme est un corollaire forcé de la persistance de la force ».
[FN: § 2330-4]
PLAT. : De rep., VIII, p. 546 : « Il est difficile que la cité [celle qu'il a imaginée] ainsi constituée change. Mais puisque toutes les choses qui naissent dépérissent, cette constitution ne pourra pas toujours durer : elle se dissoudra. La dissolution se fera ainsi. Non seulement pour les plantes qui naissent de la terre, mais aussi pour l'âme et le corps des animaux qui habitent la terre, il y a des périodes de fertilité, et de stérilité, lorsque les révolutions de chaque cercle s'accomplissent ; ces périodes sont courtes pour les espèces dont la vie est courte, longues pour celles dont la vie est longue ». Ensuite vient la phrase citée dans le texte.
[FN: § 2330-5]
ARISTOTE cite (Polit. V, 10, 1) la phrase de Platon, et paraît l'avoir comprise. Il reproche ensuite (V, 10, 2) à Platon de faire changer toutes les choses à la fois, même celles qui ne sont point nées ensemble ; mais c'est une critique formelle, qu'on peut lever facilement pour toutes les théories de ce genre, en substituant les variations continues réelles aux variations discontinues que considèrent les auteurs pour faciliter l'exposé de leurs doctrines. Il faut seulement tenir compte du fait, et ne pas prendre cet exposé à la lettre. FR. PAULHAN (Le nouveau mysticisme – Paris, 1891) parlant des transformations de sentiments qu'il avait sous les yeux, dit : « (p. 51) (Ce dernier esprit n'en sera pas moins une combinaison des dernières croyances régnantes et des anciennes croyances plus ou moins évincées, mais encore résistantes (p. 52), c’est cette synthèse qui lui donne son caractère de nouveauté... L'ancien état d'esprit ne revient pas ; il n'y a pas de complet retour à un état antérieur, pas plus dans la vie intellectuelle des sociétés que dans leur vie politique. L'enfance des vieillards ne ressemble pas à l'enfance des enfants, la restauration n'a pas été semblable à l'ancien régime, en même temps qu'une réaction se produisait contre l'œuvre révolutionnaire, une grande part de cette œuvre se consolidait et tirait une force nouvelle des anciennes idées auxquelles elle était associée ». Ces considérations conduisent à abandonner la conception des révolutions en cercle, à périodes discontinues, et nous rapprochent de la forme ondulée, à variations continues, que l'expérience nous révèle en certains phénomènes. G. FERRARI (Teoria dei periodi politici) ne se dissimule pas la difficulté « (p. 15) de séparer une génération de celle qui la précède » ; mais il croit pouvoir résoudre ce problème en considérant les changements de gouvernement, et il arrive « (p. 16) à la conséquence que chaque trente ans les générations se renouvellent avec les gouvernements ; chaque trente ans commence une nouvelle action, chaque trente ans un nouveau drame se présente avec de nouveaux personnages, enfin chaque trente ans s'élabore un nouvel événement ». Ces affirmations dépassent de beaucoup les résultats de l'expérience.
[FN: § 2330-6]
POLYB. ; VI, fr. III, 5. Plus loin, fr. VII, 57, il observe, pour expliquer les changements des républiques, que « toutes les choses qui existent sont sujettes à la corruption et au changement » ; mais il n'a pas nécessairement pris cette conception de Platon, car elle est générale et traduit les impressions que nous recevons des changements du monde où nous vivons.
[FN: § 2330-7]
G. B. VICO : Principi di Scienza Nuova, L'Ape, Milano, per Gaspare Truffi. Les volumes de cette édition seront indiqués par I et II, les pages par p. G. B. Vico ; La Scienza Nuova... a cura di Fausto Nicolini, Bari. 1911-1916. Les volumes seront indiqués par I*, II*, III*, les pages par p*. Le style de l'auteur n'est pas toujours clair et facile. Michelet a donné de cet ouvrage une traduction ou paraphrase française, dans laquelle la clarté est parfois achetée aux dépens de la fidélité. Au commencement du IVe livre, Vico résume la matière exposée dans les livres précédents, sur l'« histoire idéale éternelle » [nouveau genre d'histoire à ajouter aux très nombreux genres existants, dont nous avons noté une partie]. Il dit : « (II, p. 225 – III*, p. 785)... Nous ajouterons le cours que font les nations ; toutes leurs coutumes [« costumi » ; on peut traduire aussi mœurs], tellement variées et diverses, procédant avec une constante uniformité sur la division des trois âges que les Égyptiens disaient s'être écoulés (p. 226) avant dans (III, p.* 786) leur Monde : [c'est-à-dire] des Dieux, des Héros et des Hommes, car sur elle [,, essa “. Ce pronom se rapporte probablement à la division des trois âges. Vient ensuite l'expression : „ si vedranno reggere “, dans laquelle le verbe demande un sujet au pluriel. Si l'auteur écrivait franchement en latin, on pourrait peut-être trouver ce sujet, mais dans le texte italien, on en est réduit aux hypothèses. Il est probable qu'il faut entendre les trois âges] seront vus dominer avec un ordre constant et jamais interrompu de causes et d'effets, toujours allant [„ andante ”]dans les Nations, par trois espèces de Natures ; et [l'on verra que] de ces Natures sont issues trois espèces de coutumes [ou de mœurs] ; de ces coutumes ont été pratiquées trois espèces de Droits Naturels des Gens, et, en conséquence de ces Droits, ont été organisées trois espèces d'États Civilisés ou de Républiques. [Ensuite on verra que], pour que les hommes venus à la Société Humaine pussent se communiquer ces dites trois espèces de choses éminentes [„ massime “], se sont formées trois espèces de Langues et autant de Caractères ; et pour les justifier [les choses éminentes], [se sont formées] trois espèces de Jurisprudences, assistées par trois espèces d'Autorités, et par autant de Raisons, [« Ragioni »], en autant d'espèces de Jugements ; lesquelles Jurisprudences furent célébrées [„ si celebrarono “] en trois Périodes des Temps [„ tre Sette, dei Tempi “ : sectae temporum] que professent dans tout le Cours de leur vie les Nations. Ces trois unités spéciales, avec beaucoup d'autres qui viennent à leur suite, et qui seront aussi dénombrées en ce livre, aboutissent toutes à une Unité générale, qui est l'Unité de la Religion d'une Divinité Providentielle [,, Provvedente “], laquelle [Unité] est l'unité de l'esprit qui donne la forme [,, che informa “] et qui donne la vie à ce Monde des Nations. Ayant déjà parlé de ces choses séparément, on fait voir ici l'Ordre de leur Cours ». Les termes soulignés le sont par notre auteur. MICHELET ; Principes de la Philosophie de l'Histoire traduits de la Scienza Nuova de J. B. Vico, Bruxelles, 1885 : « (p. 317)... nous allons dans ce quatrième livre esquisser l'histoire idéale indiquée dans les axiomes et exposer la marche que suivent éternellement les nations. Nous les verrons, malgré la variété infinie de leurs mœurs, tourner, sans en sortir jamais, dans ce cercle des trois âges, divin, héroïque et humain. Dans cet ordre immuable, qui nous offre un étroit enchaînement de causes et d'effets, nous distinguerons trois sortes de natures, desquelles dérivent trois sortes (p. 318) de mœurs ; de ces mœurs elles-mêmes découlent trois espèces de droits naturels, qui donnent lieu à autant de gouvernements. Pour que les hommes déjà entrés dans la société, pussent se communiquer les mœurs, droits et gouvernements dont nous venons de parler, il se forma trois sortes de langues et de caractères. Aux trois âges répondirent encore trois espèces de jurisprudences, appuyées d'autant d'autorités et de raisons diverses, donnant lieu à autant d'espèces de jugements, et suivies dans trois périodes (sectae temporum). Ces trois unités d'espèces, avec beaucoup d'autres qui en sont une suite, se rassemblent elles-mêmes dans une unité générale, celle de la religion honorant une Providence ; c'est là l'unité d'esprit qui donne la forme et la vie au monde social ». Notons en passant les trois espèces de mœurs ou de coutumes. « (l. IV-p.* 789-p. 228) Les premières coutumes [furent] toutes aspergées [„ aspersi “] de religion et de piété, comme on dit que [furent] celles de Deucalion et de Pyrrha, venus tout de suite après le Déluge. Les secondes furent colériques et pointilleuses, comme on nous les raconte d'Achille. Les troisièmes sont de devoirs [,, officiosi “] « enseignés pour le propre point des devoirs civils ». L'auteur, traitant des trois périodes des temps, explique que, „ sous les Empereurs, les écrivains latins nommèrent officium civile le devoir des sujets (p. 262-p.* 858) ». Les trois espèces de caractères sont (p. 231-p.* 799) : 1° Les caractères divins, que l'on nomma hiéroglyphes, dont, à leur origine, se servirent toutes les nations. 2° Les caractères héroïques. 3° Les caractères vulgaires, qui appartiennent aux langues vulgaires. Nous ferons grâce au lecteur d'autres élucubrations semblables, mais il serait regrettable d'omettre toute mention de la foi robuste qu'a notre auteur en l'histoire du déluge universel et en l'existence des géants. Il a même (1. II, Del dilavio universale e dei giganti) des preuves expérimentales de cette dernière, et il les trouve dans le fait « (I, p. 212-I*, p.* 208) des armes d'une grandeur démesurée des vieux héros, qu'Auguste, d'après Suétone, conservait dans son musée, avec les os et les crânes des anciens géants ». À vrai dire, Suétone (Oct., 72) s'exprime un peu différemment. Il parle des villas d'Auguste ; sua vero, quamvis modica, non tam statuarum tabularumque pictorum ornatuquam xystis et nemoribus excoluit, rebusque vetustate ac raritate notabilibus : qualia sunt Capreis immanium belluarum ferarumque membra praegrandia, quae dicuntur Gigantum ossa, et arma heroum. « ... tels que sont les ossements énormes des animaux féroces et des animaux sauvages que l'on trouve à Caprée et que l'on appelle des os de géants et des armes de héros ».
En fait de dérivations, il y a lieu de remarquer l'usage du nombre ternaire et ce qui se rapporte aux propriétés mystiques des nombres, chères aux métaphysiciens et aux théologiens (§ 1659 1).
Dans le Ve livre, Vico traite des « retours » [,, ricorsi “] des choses humaines, dans la « résurrection des nations ». Résumant et complétant ce qu'il en a dit dans les livres précédents, « (p. 321-p* 959):pour éclairer d'une plus vive lumière les Temps de la seconde barbarie [le moyen âge] qui gisaient plus obscurs que ceux de la première barbarie [de l'antiquité]... et pour démontrer aussi comment l'Excellent Très-Grand Dieu [ce doit être une réminiscence de Iuppiter optimus maximus] (p. 322) a fait servir les conseils de sa Providence, avec lesquels il a conduit les choses humaines de toutes les Nations,, aux ineffables décrets de sa Grâce. (p.* 960) Car ayant par des voies surhumaines éclairé et établi la Vérité de la Religion Chrétienne, avec la Vertu des Martyrs, (p.* 961) contre la Puissance Romaine, et avec la doctrine [,, dottrina “] des Pères et avec les miracles, contre la vaine Science Grecque, des nations armées devant ensuite surgir pour combattre de tous côtés la vraie Divinité de son Auteur ; [Dieu] permit la naissance d'un Nouvel Ordre d'Humanité parmi les nations, pour que, selon le Cours Naturel des mêmes choses humaines, elle [,, essa “ ; probablement la Vérité déjà nommée de la religion chrétienne] fût fermement établie. Par ce Conseil Éternel, il [Dieu] ramena les Temps vraiment Divins, dans lesquels, partout, les Rois Catholiques, pour défendre la Religion Chrétienne, dont ils sont les Protecteurs, revêtirent la dalmatique des Diacres (p.* 962) et consacrèrent leurs Personnes Royales... » On arrive enfin à la conclusion. « (p. 358-p.* 1036) Concluons donc cet ouvrage avec Platon, qui établit une quatrième espèce de République, dans laquelle les hommes honnêtes et sages sont les suprêmes seigneurs, et qui serait la vraie Aristocratie Naturelle. Cette République, qui fut comprise par Platon, fut ainsi guidée par la Providence dès les premiers commencements des Nations... » Notre métaphysicien s'imagine avoir de la sorte détruit les doctrines opposées à la sienne. Il dit : « (p. 371-p.* 1049) Donc sont en fait [„ di fatto “] réfutés Épicure, qui abandonne le monde au hasard, et ses disciples Hobbes et Machiavel... Au contraire, il est de fait confirmé, en faveur des Philosophes Politiques, dont est Prince le Divin Platon, que les choses humaines sont réglées par la Providence ». De telles élucubrations planent bien au-dessus des nuages, en des régions extrêmement élevées où l'on n'aperçoit plus distinctement les faits ; elles n'ont rien à faire avec d'humbles réalités terrestres et expérimentales, telles que la forme ondulée de certains phénomènes.
[FN: § 2330-8]
GIUSEPPE FERRARI ; Teoria dei periodi politici, Milano, 1874 « (p. 7) Pour nous, la génération sera le premier élément de chaque retour. Semblable au lever du soleil, elle demeure toujours la même, elle répète continuellement le même drame, dans toutes les époques, avec toutes les civilisations,... (p. 9) la durée moyenne de la vie individuelle n'est aucunement la durée moyenne de la génération politique [ou pensante]... On détermine la durée moyenne de la génération (p. 10) politique en prenant les hommes au moment de leur vraie naissance, quand ils s'emparent de la famille, du gouvernement, de l'armée... Alors commence la vie intellectuelle [pensante ou politique] et elle dure à peu près 30 ans... (p. 11) Les naissances varient, les uns se révèlent de 20 à 25 ans, ce sont les poètes, les peintres, les sculpteurs, les compositeurs de musique ; les autres arrivent plus tard ; tels sont les philosophes, les jurisconsultes, les historiens, mais ils ne demandent pas moins de 30 ans pour concevoir leurs desseins, multiplier les recherches, appliquer les idées, rectifier les erreurs inévitables, et enfin entraîner avec eux la génération qui doit les acclamer ». Des hommes exceptionnels ont deux vies. « (p. 75) Cela arriva à Voltaire, qui demeura sous les yeux du public depuis 1718, l'année où l'on représenta son Œdipe, jusqu'en 1778, l'année de sa mort; mais il a vécu deux vies, qui ne peuvent être confondues ». Les générations s'allongent (p. 105) ou se raccourcissent (p. 108) ; on en compte qui n'ont que 19 ans (p. 109). Il y a les générations des précurseurs (p. 113), les générations « révolutionnaires » (p. 184), les « réactionnaires » (p. 150), les « résolutives » (p. 167). Les périodes politiques ont lieu en quatre temps. « (p. 113) Chaque nouveau principe se sert de quatre générations qu'il domine en sorte de former un seul drame ; et puisque les principes succèdent toujours jours aux principes, les générations se suivent quatre à quatre, à des intervalles d'une durée moyenne de 125 ans. C'est pourquoi le christianisme s'établit en 115 ans, de l'avènement de Dioclétien, qui dégrade Rome, jusqu'à la mort de Théodose, qui confirme pour toujours la chute du monde païen. La France accorde quatre temps à la réforme, religieuse, de 1514 à 1620 ; quatre à rendre moderne l'aristocratie, de 1620 à 1750 ; quatre à la révolution proprement dite, qui s'épuise (p. 114) de nos jours ».
[FN: § 2330-6]
POLYB. ; VI, fr. III, 5. Plus loin, fr. VII, 57, il observe, pour expliquer les changements des républiques, que « toutes les choses qui existent sont sujettes à la corruption et au changement » ; mais il n'a pas nécessairement pris cette conception de Platon, car elle est générale et traduit les impressions que nous recevons des changements du monde où nous vivons.
[FN: § 2335-1]
Cours, t. II, § 926 : « (p. 278) À vrai dire, on réserve le plus souvent ce nom [de crise] à la période descendante de l'oscillation, quand les prix diminuent, mais, en réalité, cette période est étroitement liée à la période ascendante, quand les prix augmentent ; l'une ne peut subsister sans l'autre, et c'est à leur ensemble qu'il convient de réserver le nom de crise ».
[FN: § 2337-1]
Manuel, IX, 82 : « (p. 532) Les faits concomitants des crises ont été considérés comme les causes des crises. Pendant la période ascendante, quand tout est en voie de prospérité, la consommation augmente, les entrepreneurs accroissent la production ; pour cela ils transforment l'épargne en capitaux mobiliers et immobiliers, et ils font un large appel au crédit ; la circulation est plus rapide. Chacun de ces faits a été considéré comme la cause exclusive de la période descendante, à laquelle on donnait le nom de crise. Ce qui est vrai c'est simplement qu'on observe ces faits dans la période ascendante, qui précède toujours la période descendante ». « § 83, p. 533) C'est pure rêverie que de parler d'un excès permanent de la production. S'il en était ainsi, il devrait y avoir quelque part, comme nous l'avons déjà dit, des dépôts toujours croissants des marchandises dont la production dépasse la consommation : c'est ce qu'on ne constate nullement ».
[FN: § 2338-1]
Cours, t. II, § 926 : « (p. 278) Il ne faut pas se figurer une crise comme un accident qui vient interrompre un état de choses normal. Au contraire, ce qui est normal, c'est le mouvement ondulatoire ; la prospérité économique amenant la dépression, et la dépression ramenant la prospérité. L'économiste qui suppose que les crises économiques sont des phénomènes anormaux fait la même erreur qu'un physicien qui s'imaginerait que les nœuds et les internœuds d'une verge en vibration sont des accidents sans aucun rapport avec les vibrations des molécules de la verge ». Manuel, IX, 75 : « (p. 529) La crise n'est qu'un cas particulier de la grande loi du rythme, laquelle domine tous les phénomènes sociaux (Systèmes, t. I. p. 30). L'organisation sociale donne sa forme à la crise, mais n'agit pas sur le fond, qui dépend de la nature de l'homme et des problèmes économiques. Il y a des crises non seulement dans le commerce et dans l'industrie privée, mais aussi dans les entreprises publiques ».
[FN: § 2341-1]
Draper a eu des conceptions qui se rapprochent de cette doctrine. DRAPER ; Hist. du développ. intellect. de l'Europe, t. I « (p. 34) Le progrès intellectuel de l'Europe étant d'une nature analogue à celui de la Grèce, et ce dernier étant à son tour semblable à celui d'un individu, nous pouvons donc, pour faciliter nos recherches, le partager en périodes arbitraires et distinctes l'une de l'autre, bien que se perdant d'une manière imperceptible l'une dans l'autre. À ces périodes successives, j'appliquerai les désignations suivantes : 1. âge de crédulité ; 2. âge d'examen ; 3. âge de foi ; 4. âge de raison ; 5. âge de décrépitude... » L'auteur a saisi par intuition l'existence d'une ample oscillation ; mais il n'a pas vu qu'il y en a une suite indéfinie, ni que les plus grandes oscillations coexistent avec d'autres plus petites, en très grand nombre. Il s'est laissé induire en erreur par une analogie fausse entre la vie des nations et celle des individus. En outre, il est singulier qu'il fasse commencer à Socrate l'âge de la „ foi “ en Grèce, qui ferait suite à l'âge de l’ „ examen “. « (p. 209) Les sophistes avaient causé une véritable anarchie intellectuelle. Il n'est point dans la nature humaine de pouvoir se contenter d'un tel état de choses ; aussi, déçu dans les espérances qu'il avait mises en l'étude de la nature matérielle, l'esprit grec se tourna vers la morale. Dans le progrès de la vie, il n'y a qu'un pas de l'âge d'examen à l'âge de foi. Socrate, qui le premier s'avança dans cette voie, était né en 469 avant J.-C... » Les auteurs qui rangent Socrate parmi les sophistes se rapprochent beaucoup plus de la réalité.
[FN: § 2345-1]
À Athènes, durant la guerre médique, on croit encore communément à l'intervention directe des dieux.
[FN: § 2345-2]
ARISTOT. : ![]() , 25.
, 25.
[FN: § 2345-3]
Les Euménides, particulièrement, semblent écrites pour défendre l'Aréopage et la tradition contre les innovations.
[FN: § 2345-4]
IUST. ; II, 14 : ...nam victus Mardonius, veluti ex naufragio, cum paucis profugit. Castra referta regalis opulentiae capta : unde primum Graecos, diviso inter se auro persico, divitiarum luxuria cepit.
[FN: § 2345-5]
PLUTARCH. ; Pericl., 6. L'auteur dit que parmi les avantages qu'il retira de ses relations avec Anaxagore, il y eut „ celui-ci aussi : qu'il [Périclès] semble être devenu supérieur à la superstition “. THUCYDIDE, II, 53, voudrait accuser la peste du progrès de l'incrédulité à Athènes ; mais c'est l'une des erreurs habituelles des raisonnements éthiques. L'incrédulité avait commencé à se développer avant la peste, et continua à augmenter lorsque tout effet de la peste eut disparu.
[FN: § 2345-6]
La loi de Diopithe contre l'impiété (PLUTARCH. ; Pericl., 32, 2) est de ce temps. Elle frappe ceux qui, „ ne reconnaissent pas les dieux ou qui raisonnent des phénomènes célestes “. Elle apparaît comme la manifestation du sentiment populaire hostile à la prédominance des instincts des combinaisons qui poussaient à l'étude de la nature.
[FN: § 2345-7]
Le conflit politique aussi cessa bientôt. On ne le retrouve plus dans la comédie moyenne, et surtout pas dans la nouvelle ; mais déjà Aristophane avait eu à s'en abstenir. On a dit que c'était à cause des dispositions légales qui empêchaient d'attaquer sur scène les magistrats ou les citoyens ; mais cela n'est vrai qu'en partie, car l'auteur pouvait bel et bien parler de politique sans citer des noms d'hommes vivants. Au contraire, dans l'Assemblée des femmes, la simple plaisanterie remplace les virulentes invectives des Acharniens, des Chevaliers, des Nuées. Négligeons les Oiseaux (414 av. J.-C.) comme étant une exception ; mais ni dans les Grenouilles (406 av. J.-C.), ni dans Plutus (409 av. J.-C.), on ne trouve trace de l'âpre discussion qui apparaît dans les trois comédies nommées plus haut. Il semble que désormais le poète s'est résigné à ce qu'il ne peut empêcher, et qu'il rit des vainqueurs, comme plus tard les Grecs riront des Romains qui avaient conquis leur patrie, comme, dans les salons légitimistes, on riait de Napoléon III, comme dans les salons conservateurs, après la chute du parti conservateur, on riait de la République démocratique. Ce rire apparaît comme la consolation des vaincus.
[FN: § 2345-8]
Il faut lire dans Thucydide, V, 85-111, la longue conversation entre les Athéniens et les Méliens. En somme, les Athéniens insistent sur le fait que la raison du plus fort est toujours la meilleure, et que les dieux eux-mêmes la secondent. Les Athéniens observent (89) qu'il est connu des Méliens que, dans les conflits humains, on décide selon la justice, entre ceux qui sont de forces égales, mais que les puissants font ce qu'ils peuvent, et que les faibles s'y soumettent. C'est là une observation expérimentale, vraie en tout temps et en tout lieu ; et si depuis le temps de Thucydide jusqu'au nôtre, elle continue à être contestée par un grand nombre de dérivations, c'est parce que, comme nous l'avons tant de fois rappelé, on accepte des dérivations contredites absolument par l'expérience, si elles concordent avec certains sentiments. Parfois elles peuvent être utiles, parfois nuisibles. Dans le présent cas, elles concordent avec les sentiments dits de „ justice “, et ont souvent été utiles ; d'abord, parce qu'elles servirent à atténuer les souffrances de beaucoup de gens, en leur faisant espérer un avenir meilleur et en les faisant vivre en pensée dans un monde „ meilleur “ que le monde expérimental ; ensuite, parce que le fait d'exprimer les sentiments par les dérivations sert à les renforcer. Les sentiments dits de „ justice “ peuvent quelquefois pousser les hommes à atténuer, ne fût-ce que légèrement, les maux occasionnés par l' „ injustice “, bien que les premiers de ces sentiments soient facilement neutralisés par les intérêts et par d'autres sentiments ; tels, dans les circonstances dont nous parlons, les sentiments dépendant des résidus de la Ve classe, parmi lesquels il faut surtout relever le nationalisme. Les Athéniens emploient aussi un raisonnement (91) qui continue à être usité dans les conflits internationaux, surtout dans ceux d'ordre civil, pour persuader aux Méliens que s'ils étaient sujets des Athéniens, ce serait avantageux aux deux peuples. Les Méliens (94) demandent s'ils ne pourraient pas être acceptés comme neutres. Les Athéniens refusent (95) ; ils disent que cela leur nuirait. Là aussi nous avons une observation expérimentale, vraie en tout lieu et en tout temps, depuis celui de la conférence des Méliens jusqu'à celui du traité de Campo- Formio, observation qui s'applique non seulement aux conflits internationaux, mais aussi et surtout aux conflits civils. Nombreuses sont les dérivations qui la contredisent. Elles sont acceptées pour des motifs semblables à ceux que nous avons exposés tout à l'heure, mais sont habituellement nuisibles et souvent cause de ruine complète pour les États et pour les classes sociales, parce qu'elles écartent les uns et les autres de la seule chance de salut : préparer ses armes et savoir, vouloir, pouvoir faire usage de la force.
[FN: § 2345-9]
Le procès de Socrate est le plus connu d'une série qui eurent lieu vers ce temps, et qui indiquent une réaction populaire contre l'irréligion des classes intellectuelles. P. DECHARME ; La crit. des trad. relig. : « (p. 140) Aussi voit-on, à la fin du Ve siècle, se multiplier les procès d'impiété dont les âges précédents offrent à peine quelques traces. Ces procès, qui témoignent des progrès nouveaux de l'incrédulité, méritent que nous nous y arrêtions… » Ils ne témoignent pas seulement du progrès de l'incrédulité, mais aussi de l'intensité des sentiments populaires qui s'y opposent. Il faut noter que, dans ces procès, l'accusation d'impiété n'est pas la seule : il s'y ajoute des accusations politiques, privées, et généralement d'immoralité. Dans le livre des vertus et des vices, sur lequel on met le nom d'ARISTOTE, l'impiété, ![]() est définie de la façon suivante : (p. 1251 – Didot II, p. 246, VII, 2)
est définie de la façon suivante : (p. 1251 – Didot II, p. 246, VII, 2) ![]()
![]() . «
. « ![]() est le fait d'être coupable envers les dieux, envers les démons, ou aussi envers les morts, les parents, la patrie ». On pourrait donc dire que ce terme signifie : l'offense aux principales persistances d'agrégats.
est le fait d'être coupable envers les dieux, envers les démons, ou aussi envers les morts, les parents, la patrie ». On pourrait donc dire que ce terme signifie : l'offense aux principales persistances d'agrégats.
[FN: § 2349-1]
Un long passage de cette tragédie, dans lequel Sisyphe parle, nous a été conservé par SEXTUS EMPIRICUS ; Adversus physicos, IX, 54, p. 563-564. Il en résume bien le sens en ces termes : « Critias, l'un des tyrans d'Athènes, semble appartenir à la classe des athées, en disant que les anciens législateurs imaginèrent le dieu comme surveillant des œuvres vertueuses et des œuvres coupables des hommes, afin que personne n'offensât en secret son prochain, par crainte du châtiment des dieux ». Les deux derniers vers du discours de Sisyphe sont (NAUCK ; Trag. graec. frag., p. 599) : « Ainsi, à l'origine, je crois que quelqu'un persuada aux hommes de croire à la race des démons [dieux] ». Et avant : « (v. 24-26) En tenant ces discours, il enseigna très agréablement des règles, dissimulant la vérité sous le faux ». Maintenant écoutons PLATON ; De republ., II : « (p. 377) Adimante... Mais je ne comprends pas quelles sont les plus grandes [fables] que tu dis. Socrate. Celles qu'Hésiode et Homère nous racontaient, et aussi les autres poètes ; car, composant des mythes mensongers, ils les racontaient et les racontent encore aux hommes ». Mais, puisque la mythologie de ces poètes est aussi la mythologie populaire, le Socrate de la République est d'accord avec le Sisyphe de Critias, en la tenant pour fabuleuse. Il est d'accord aussi sur le but, qui est de faire en sorte que la mythologie soit utile aux hommes. Platon reprend les vers de l'Iliade où l'on dit que Zeus est dispensateur du bien et du mal (p. 379). Il vent qu'on dise que Zeus fait uniquement le bien, et que les maux qu'il inflige aux hommes sont pour leur bien. De cette façon il expose l'une des réponses affirmatives que nous avons relevées aux § 1903 et sv. (cfr. § 1970) ; mais, en bon métaphysicien, il s'abstient avec le plus grand soin d'apporter la moindre preuve de son affirmation, à laquelle nous devons donc croire seulement parce que les interlocuteurs dont Platon imagine les discours l'acceptent. En somme, il la tire de son « expérience du métaphysicien », comme nos contemporains tirent tant d'autres belles propositions de leur « expérience du chrétien ». Pourquoi « l'expérience de l'athée » ne peut- elle pas prendre place en si bonne compagnie ? Cela demeure un mystère impénétrable.
[FN: § 2350-1]
Il faut se garder de l'erreur que l'on commettrait en supposant que la conduite cruelle des Athéniens envers les Méliens fût en rapport avec la prédominance, chez les Athéniens, des résidus de la IIe classe. Au contraire, en un grand nombre d'autres occasions, les Athéniens se montrèrent plus humains que les Spartiates, chez lesquels prédominaient les résidus de la IIe classe. La différence réside surtout dans l'usage des dérivations, qui sont plus développées et mieux composées par les Athéniens, plus brèves et moins bien ordonnées, parfois même effrontément trompeuses, lorsqu'elles sont employées par les Spartiates. À ce point de vue, le massacre des habitants de Platée, raconté par Thucydide, est un fait remarquable. Les Platéens se rendirent aux Lacédémoniens qui leur promettaient que « (III, 52) quiconque était coupable serait puni ; personne d'autre contrairement à la justice ». Voici quelle fut la « justice » des Lacédémoniens. Ils demandèrent aux Platéens « si, dans la présente guerre, ils avaient fait quelque chose en faveur des Lacédémoniens et de leurs alliés ». Les Platéens s'étonnèrent de cette question, substituée au jugement promis. Ils discoururent longuement, furent réfutés non moins longuement par les Thébains, après quoi les Lacédémoniens (III, 52) répétèrent à chaque Platéens la même question, et comme ceux-ci ne pouvaient y répondre par oui, ils les égorgèrent sans autre. On peut ajouter cet exemple à une infinité d'autres qui montrent qu'en s'engageant à agir selon la « justice », on ne s'engage vraiment à rien, car la « justice » est comme le caoutchouc : on l'étire comme on veut.
[FN: § 2351-1]
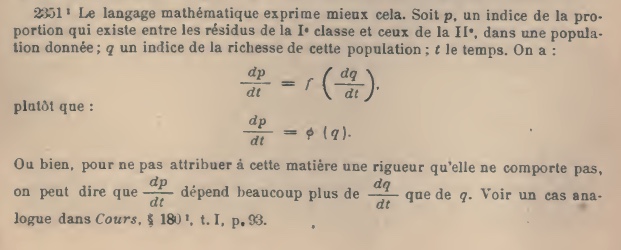
[FN: § 2354-1]
Polybe est notre meilleure autorité à ce propos, pourvu que nous nous arrêtions aux faits qu'il raconte, sans nous soucier des causes qu'il leur attribue. On peut résumer ces faits de la façon suivante. 1° Au temps où vivait Polybe, les persistances d'agrégats étaient encore beaucoup plus grandes à Rome qu'en Grèce. POLYB. ; VI, 56, passage capital déjà cité, § 239 ; VI, 46 ; XX, 6 ; XVIII, 37 ; XXIV, 5. – Cfr. PLUTARCH. ; Philop., 17. – POLYB. ; XXVIII, 9 ; XXXIII, 2 ; V, 106. – 2° On observe un rapide affaiblissement de ces persistances d'agrégats. POLYB. ; IX, 10, après le sac de Syracuse, an de Rome 542, 212 av. J.-C. ; XXXII, 11, après la conquête de la Macédoine, an de Rome 586, 168 av. J.-C. – Il s'y ajoute d'autres auteurs d'autorité diverse. VAL. MAx. ; IX, 1, 3 : Urbi autem nostrae secundi belli Punici finis, et Philippus rex Macedoniae devictus, licentioris vitae fiduciam dedit (an de Rome 558, 196 av. J.-C.). – PLIN. ; Nat. hist., XVII, 38 (25). L'auteur rappelle le cens de l'an 600 de Rome, et ajoute : A quo tempore pudicitiam subversam Piso gravis auctor prodidit. – Idem, ibidem, XXXIII, 53, trad. Littré : « En effet, L. Scipion dans son triomphe fit montre de mille quatre cent cinquante livres pesant d'argent ciselé et de quinze cents en vases d'or, l'an de Rome 565. Mais ce qui porta un coup encore plus rude aux mœurs, ce fut la donation qu'Attale fit de l'Asie : le legs de ce prince mort fut plus funeste que la victoire de Scipion ; car dès lors il n'y eut plus de retenue à Rome pour l'achat des objets de prix qui se vendirent à l'encan d'Attale. C'était l'an 622 ; et pendant les cinquante-sept années intermédiaires la ville s'était instruite à admirer, que dis-je ? à aimer les richesses étrangères. Les mœurs reçurent aussi un choc violent de la conquête de l'Achaïe, qui dans cet intervalle même, l'an de Rome 608, amena, afin que rien ne manquât, les statues et les tableaux. La même époque vit naître le luxe et périr Carthage ; et, par une coïncidence fatale, on eut à la fois et le goût et la possibilité de se précipiter dans le vice ». – FLORUS, III, 12. Non sans quelque exagération, l'auteur dit que les cent ans qui précédèrent le temps où les Romains traversèrent la mer par leurs conquêtes furent des années de vertu extraordinaire : Cuius aetatis superiores centum anni, sancti, pii, et, ut diximus, aurei, sine flagitio, sine scelere, dum sincera adhuc et innoxia pastoriae illius sectae integritas... Il ajoute que les cent années suivantes furent celles d'une grande prospérité militaire, mais aussi celles de grands maux intérieurs, et il émet des doutes sur l'utilité des conquêtes pour la république : Quae enim res alia furores civiles peperit, quam nimia felicitas ? Syria prima nos victa corrupit, mox Asiatica Pergameni regis hereditas. Illae opes atque divitiae afflixere saeculi mores, mersamque vitiis suis, quasi sentina rempublicam pessumdedere (§ 2548 5). Unde regnaret iudiciariislegibus divulsus a senatu, eques, nisi ex avaritia, ut vectigalia reipublicae, atque ipsa iudicia in quaestu haberentur ? – VELL. PATTERC. ; II, 1 : Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior aperuit. Quippe remoto Carthaginis metu, sublataque imperii aemula, non gradu, sed praecipiti cursu, a virtute descitum, ad vitia transcursum ; vetus disciplina deserta, nova inducta ; in somnum a vigiliis, ab armis ad voluptates, a negotiis in otium conversa civitas. – Cfr. DIO. CASS. ; fr. 227 Gros, t II. p. 27 ; 71 Reimar. – SALL, ; Iug., 41 (§ 2548 6) ; Cat., 10. – LIV. ; XXXIX, 6 : Luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu asiatico invecta in urbem est ;. – IUST. ; XXXVI, 4 : Sic Asia Romanorum facta, cum opibus suis vitia quoque Romam transmisit. Cfr. § 2548.
[FN: § 2356-1]
DURUY ; Hist. des Rom., t. II.
[FN: § 2356-2]
Ici Duruy est excusable, parce qu'il y a, en effet, un grand nombre d'« économistes » qui débitent ces absurdités. Telle que beaucoup l'enseignaient au temps de Duruy, et telle que beaucoup continuent à l'enseigner, l'économie politique s'écarte de la réalité expérimentale pour se confondre avec un genre de littérature éthique.
[FN: § 2356-3]
Duruy continue « (p. 225) L'Europe, à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, a vu une pareille inondation d'or provenant des placers d'Amérique et d'Australie. Mais ces capitaux produits par le travail lui servirent à refaire son outillage industriel, et il en résulta un énorme accroissement de la richesse publique, comme du bien-être de chacun ». Donc, ce fut avec l'or de l'Amérique et de l'Australie que l'on construisit les machines des industries européennes, les chemins de fer, etc. Belle transformation, en vérité ! Là Duruy est moins excusable que précédemment, car enfin, de son temps, peu, très peu d'« économistes » commettaient encore l’erreur du système mercantile, qui confond l'or avec la richesse, et l’or avec les capitaux. La plupart des « économistes » se rapprochaient un peu plus de la réalité. Mais un grand nombre d'historiens ignorent tout de la science économique, et connaissent assez peu l'économie littéraire qu'on enseigne usuellement. Ils croient suppléer à leur ignorance par des considérations éthiques ; aussi, lorsqu'ils veulent disserter en cette matière, ils se mettent à débiter les plus lourdes absurdités qu'on puisse imaginer. Duruy continue : « (p. 225) Ce fut, au contraire, par la guerre, le pillage et le vol que Rome passa subitement de la pauvreté à la fortune, et l'or de la conquête ne servit qu'au luxe stérile de ceux qui le possédaient ». La force de la persistance des agrégats éthiques est si grande qu'ici Duruy oublie des choses qu'il connaît très bien, et qu'il peut même enseigner à d'autres personnes. Il oublie que si la conquête était en effet l'une des sources principales de la richesse de Rome, celle du commerce n'était pas négligeable, et que les mercatores, les negotiatores romains apparaissent toujours dans l'histoire nombreux, actifs et riches. Il oublie les travaux publics des Romains, entre autres les routes, qui servirent aussi à accroître la richesse.
[FN: § 2360-1]
FRIEDLAENDER ; Civilis. et mœurs rom, t. IV : « (p. 156) Nous avons, pour la connaissance de la situation religieuse de l'antiquité, dans les premiers siècles de notre ère, deux sources, de nature très différente et souvent (p. 157) même contradictoires à bien des égards, l'une dans la littérature, l'autre dans les monuments, notamment dans les pierres portant des inscriptions ». La contradiction disparaît si l'on fait attention que la première de ces sources nous fait connaître spécialement les conceptions de la classe cultivée la plus élevée, et la seconde les sentiments de l'ensemble de la population ; par conséquent, surtout de la partie la plus nombreuse, qui est celle du peuple. « La littérature est principalement issue de cercles gagnés par l'incrédulité et l'indifférence, ou dans lesquels on s'appliquait à spiritualiser, à épurer et à transformer les croyances populaires, par la réflexion et l'interprétation. Les monuments, au contraire, proviennent, en grande partie du moins, des couches de la société le moins influencées par la littérature et les tendances qui y dominaient, d'un milieu dans lequel on n'éprouvait pas le besoin et l'on n'était souvent même pas en état de bien exprimer ses convictions en pareille matière ; aussi témoignent-ils, en majeure partie, d'une croyance positive aux divinités du polythéisme, d'une foi exempte de doute ainsi que de subtilité, c'est-à-dire toute naïve et irréfléchie ».
[FN: § 2361-1]
FRIEDLAENDER ; Civilis, et mœurs rom., t. IV « (p. 166) Ainsi, pas même au premier siècle, les personnes (p. 167) ayant reçu une éducation philosophique n'avaient pris une attitude absolument hostile à la religion nationale. Et, bien que dans la littérature de ce temps, comme dans celle du dix-huitième siècle, les dispositions et les tendances hostiles à la foi prédominent, elles ne conservèrent, en aucun cas, leur empire au-delà de la limite du premier siècle de notre ère. De même que le flux des tendances anti-chrétiennes du siècle dernier baissa rapidement, après avoir atteint son maximum d'élévation, et fut suivi d'un puissant reflux, qui entraîna, irrésistiblement aussi, une grande partie de la société instruite, de même nous voyons dans le monde gréco-romain, après les tendances qui avaient prédominé dans la littérature du premier siècle, une forte réaction vers la foi positive prendre le dessus et s'emparer, là aussi, des mêmes cercles, ainsi que la foi dégénérer, sous des rapports multiples, en superstition grossière, soit de miracles, piétisme et mysticisme ». La description des phénomènes est bonne. Il faut seulement ajouter que ce mouvement général n'a pas lieu d'une manière uniforme, mais qu'il est ondulatoire.
[FN: § 2366-1]
GUIZOT ; Hist. de la civil. en France, t. II « p. 1) En étudiant l'état intellectuel de la Gaule au IVe et Ve siècle, nous y avons trouvé deux littératures, l'une sacrée, l'autre profane. La distinction se marquait dans les personnes et dans les choses ; des laïques et (p. 2) des ecclésiastiques étudiaient, méditaient, écrivaient, et ils étudiaient, ils écrivaient, ils méditaient sur des sujets laïques et sur des sujets religieux. La littérature sacrée dominait de plus en plus, mais elle n'était pas seule : la littérature profane vivait encore. Du VIe, au VIIIe siècle, il n'y a plus de littérature profane, la littérature sacrée est seule ; les clercs seuls étudient ou écrivent ; et ils n'étudient, ils n'écrivent plus, sauf quelques exceptions rares, que sur des sujets religieux. Le caractère général de l'époque est la concentration du développement intellectuel dans la sphère religieuse ».
[FN: § 2367-1]
Saint Bernard a bien vu cette invasion de l'instinct des combinaisons. D. BERNARDI opera. Tractatus de erroribus Abaelardi ; Ad Innocentium II, pontificem, c. I, 1 : Habemus in Francia novum de veteri magistro Theologum, qui ab ineunte aetate sua in arte dialectica lusit, et nunc in Scripturis sanctis insanit. Olim damnata et sopita dogmata, tam sua videlicet, quam aliena, suscitare conatur, insuper et nova addit. Qui dum omnium quae sunt in coelo sursum, et quae in terra deorsum, nihil, praeter solum „ Nescio “ nescire dignatur... « Nous avons eu en France un homme qui, d'ancien magister, est devenu théologien nouveau. Dans sa jeunesse, il jouait à l'art de la dialectique, et maintenant, il débite des insanités sur les Saintes Écritures. Il ose préconiser des doctrines condamnées jadis et oubliées, à savoir des siennes ou de celles d'autrui, et en plus, il en ajoute de nouvelles. Tandis que de toutes les choses qui sont en haut dans le ciel, et qui sont en bas sur la terre, il estime indigne d'en ignorer une seule excepté „ j'ignore “.. » Epist. 330 : Nova fides in Francia cuditur, de virtutibus et vitiis non moraliter, de Sacramentis non fideliter, de mysterio sanctae Trinitatis non simpliciter ac sobrie, sed praeter ut accepimus, dispatatur. « Une nouvelle foi est forgée en France : on ne dispute pas moralement des vertus et des vices, ni fidèlement des Sacrements, ni simplement et modérément du mystère de la sainte Trinité, mais contrairement à ce que nous admettons ». En somme, sous une autre forme, c'est précisément ce que l'on reprochait à Socrate.
[FN: § 2368-1]
D. ANSELM. ; ed. Gerberon: (p. 41) Illi utique nostri temporis dialectici, imo dialectice haeretici, qui non nisi flatum vocis putant esse universales substantias.
[FN: § 2371-1]
V. COUSIN ; Ouvrages inédits d'Abélard.
[FN: § 2372-1]
À regarder un thermomètre plongé dans un liquide nous pouvons connaître la température, l'état thermique, un caractère de ce liquide, le classer avec d'autres, semblables à ce point de vue. À entendre nommer des « universaux » ou des entités abstraites, par certains hommes, nous pouvons connaître les concepts, l'état psychique, un caractère de ces hommes, les classer avec d'autres, semblables à ce point de vue. Si l'on veut, on peut dire que l'expression « vingt degrés centigrades » est un vain « souffle de voix », de même que cette autre expression « justice ». Mais toutes deux sont des indices d'un certain état : la première est l'indice de l'état thermique d'un liquide ; la seconde, de l'état psychique de certains hommes. Ces indices diffèrent en ce que le premier est précis, semblable à un noyau défini, et que le second est en partie indéterminé, semblable à une nébuleuse. Le premier peut fournir des prémisses à des raisonnements rigoureux ; le second ne s'y prête pas. Si, au lieu de la température marquée par un thermomètre, on considérait l'entité abstraite « chaud », comme le faisaient les anciens philosophes, cette entité serait tout à fait analogue à celle qu'on appelle la « justice ». Toutes les deux sont en partie indéterminées. Semblables à des nébuleuses, et ne peuvent servir de prémisses à des raisonnements rigoureux.
[FN: § 2377-1]
Saint-Bernard est délégué par le pape Innocent pour corriger les débordements des citoyens de Milan, de Pavie et de Crémone. Ayant obtenu peu ou point d'effet, il écrit au pape : « Les gens de Crémone se sont endurcis, et leur prospérité les perd. Les Milanais sont arrogants, et leur présomption les séduit. Mettant leur espérance dans les chars et les chevaux, ils ont trompé la mienne et rendu vain mon labeur ».. D. BERNARDI opera, epist. 314 : Cremonenses induruerunt, et prosperitas eorum perlit eos : Mediolanenses contemnunt, et confidentia ipsorum seducit eos. Hi in curribus et in equis spem sua ponentes, meam frustraverunt et laborem meura exinanierunt.
[FN: § 2379-1]
DECRET. GRAT. ; Pars prim., distinct., XXXII, c. 5 : Non audiatur Missa Presbyteri concubinam habentis. Nicolaus Papa II e omnibus Episcopis. Nullus Missam audiat Presbyteri, quem scit concubinam indubitanter habere, aut subintroductam mulierem. C'est là le canon 3 du concile romain XXIV, sous Nicolas II Cette prohibition est répétée par le pape Alexandre II, en 1063. BARONII annales eccl., t. XVII, p. 245 ; DECRET. GRAT., loc. cit., c. Vl. Gratien remarque à ce propos : Verum principia harum auctoritatum contraire videntur Hieronymo, et Augustino, et ceteris, qui Christi sacramenta neque in bono, neque in malo homine fugienda ostendunt, sicut subsequens causa Simoniacorum plenius demonstrat. Sed Urbanus II in epist. destinata praeposito sancti Iventii hanc contrarietatem determinat dicens. § I. Ad hoc I vero, quod subiungitur in eadem epistola, idest utrum sit utendum ordinationibus, et reliquis Sacramentis a criminosis exhibitis, ut ab adulteris, vel sanctimonialium violatoribus, vel huiusmodi. Ad hoc, inquam, ita, respondemus. Si schismate, vel haeresi ab Ecclesia non separantur, eorumdem ordinationes et reliqua Sacramenta, sancta, et veneranda non negamus, sequentes beatum Augustinum, etc. De même, les socialistes amis des ploutocrates pourraient répondre à un doute analogue : « Si le capitaliste ploutocrate n'est pas excommunié par nous, mais qu'il nous soutient et nous aide, nous ne nions pas que ses « opérations » soient bonnes et louables. MONETA ; Adversus Catharos et Valdenses, 1. V, c. III : (p. 1433) An mali Praelati possint Sacramenta ministrare, et praedicare, et eis sit obediendum... videamus, utrum mali Praelati possint conferre Sacramenta Ecclesiae, et utrum possint praedicare, et an eis obediendum sit. Quod autem non possint ministrare Sacramenta volunt probare haeretici, qui Cathari dicuntur, et etiam pauperes Lombardi his modis : ... L'auteur réfute longuement les preuves que les hérétiques croyaient pouvoir tirer de l'Écriture Sainte ; on arrive ainsi au chap. IV : (p. 436) Hic incipit pars quarta, in qua ostenditur, quod Praelati, quamvis mali sint, tamen et officium praedicandi, et ministerium Sacramentorum habent, et quod eis obediendum est. – BERNARDO GUIDONIS ; Practica inquisitionis heretice pravitatis. Il dit des Cathares : (p. 242) Item, confessionem factam sacerdotibus Ecclesie Romane dicunt nichil valere, quod cum sint peccatores, non possunt solvere nec ligare, et cum sint immundi, nallum alium possunt mundare.
[FN: § 2381-1]
BARONII annoles ecclesiastici, LXVIII : (p. 584) Sed haud ingratum erit Guntherum Ligurinum versibus ita canentem audire, huius temporis scriptorem eximium. Cuius origo mali, tantaeque voraginis auctor || Extitit Arnoldus, quem Brixia protulit ortu || Pestifero, tenui nutrivit Gallia sumptu, || Edocuitque diu : tandem natalibus oris || Redditus, assumpta sapientis fronte, diserto || Fallebat sermone rudes, Clerumque procaci || Insectans odio, monachorum acerrimus hostis, || Plebis adulator, gaudens popularibus auris, || Pontifices, ipsumque gravi corrodere lingua || Audebat Papam, scelerataque dogmata vulgo || Diffundens, variis implebat vocibus aures. || Nil proprium Cleri fundos et praedia, nullo || Iure sequi monachos, nulli Fiscalia iura || Pontificum, nulli curae popularis honorem || Abbatum, sacras referens concedere leges. || Omnia principibus terrenis subdita, tantum || Committenda viris popularibus atque regenda. || Illis primitias, et quae devotio plebis || Offerat, et decimas castos in corporis usus, || Non ad luxuriam, sive oblectamina carnis || Concedens, mollesque cibos, cultusque nitorem, || Illicitosque thoros, lascivaque gaudia Cleri, || Pontificum fastus, Abbatum denique laxos || Damnabat penitus mires, monachosque superbos. || L'auteur cite OTTO FRISINGENSIS qui dit (p. 583) ...Arnaldus iste ex Italia, civitate Brixia oriundus, eiusdemque Ecclesiae clericus, ac tantum Lector ordinatus. Petrara Abailardum olim praeceptorem habuerat : vir quidem naturae non hebetis plus tamen verborum profluvio, quam sententiarum pondere copiosus, singularitatis amator, novitatis cupidus, cuiusmodi hominum ingenia ad fabricandas haereses schismatumque perturbationes sunt prona. Is a studio a Galliis in italiam revertens, religiosum habitum quo amplius decipere posset, induit, omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens, clericorum ac Episcoporum derogator, monachorum persecutor, laicis tantum adulans. [Ici, on voit bien la forme populaire du mouvement, qui n'a vraiment rien à faire avec le problème de l'existence des universaux.] Dicebat enim nec clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec (p. 584) monachos possessiones habentes aliqua ratione posse salvari, cunctaque haec Principis esse, ab eiusque beneficentia in usum tantum laicorum cedere opportere. C'est la raison habituelle qui pousse les gouvernants à dépouiller les institutions religieuses. Elle a servi aux gouvernements païens puis aux gouvernements chrétiens, puis aux gouvernements révolutionnaires ; enfin, le très moral Waldeck-Rousseau l'a faite sienne.
[FN: § 2384-1]
Dans son histoire de la Réforme en Allemagne, Janssen voit les faits colorés par sa foi ; mais au fond il ne les décrit pas mal. Il résume l'état de l'Allemagne, lorsque le protestantisme était sur le point de naître. I. JANSSEN ; L'Allemagne et la Réforme, t. I ; L'Allemagne à la fin du moyen âge : « p. 571) L'état florissant de la culture des champs, des bois, des vignes ; l'essor extraordinaire de l'industrie ; les grandes richesses minières du sol ; un commerce prospère, dominant celui de presque toutes les nations chrétiennes [ici l'on va au delà de la vérité ; l'auteur oublie l'Italie] tout avait contribué à faire de l'Allemagne le pays le plus riche de l'Europe. Les journaliers cultivateurs et industriels des villes et des campagnes sont pour la plupart, au commencement du seizième siècle, dans une excellente situation matérielle. Mais, peu à peu, l'équilibre et l'action mutuelle des principaux groupes de travail s'ébranlent. Le commerce étouffe le travail productif de valeur [dérivation éthique qui exprime l'importance croissante des spéculateurs]. Les enchérissements, les accaparements, se produisent de toutes parts malgré les mesures prises par le gouvernement, et donnent lieu, sur une large échelle, à l'exploitation de la classe laborieuse par le capital [autre dérivation semblable à celle de tout-à-l'heure]. Des plaintes sur les monopoleurs, sur les accapareurs, sur les grands entrepreneurs et capitalistes [description au moyen de dérivations de la prédominance des spéculateurs], sur „ l’enchérissement de l'argent “, la hausse de prix des denrées de nécessité première [phénomènes que nous voyous se reproduire tous aujourd'hui], la falsification des produits alimentaires, en un mot la tyrannie exercée par ceux qui possèdent sur ceux qui ne possèdent pas [une des nombreuses formes sous lesquelles on exprime la prédominance des spéculateurs], se font entendre de tous côtés. Ces abus produisent un effet d'autant plus désastreux, que les riches étalent sous les yeux des malheureux un luxe effréné... D'autre part, les ouvriers, les cultivateurs, subissent l'influence mauvaise du luxe qui règne autour d'eux. (p. 572) La prospérité matérielle avait engendré le luxe et la volupté, le luxe et la volupté, à leur tour, développent une soif toujours plus ardente d'acquérir des bénéfices toujours plus beaux, et alimentent dans toutes les conditions la passion de posséder, de jouir [on croirait lire la description de ce que nous voyons se produire sous nos yeux : en somme, c'est le débordement de la spéculation] ». On observe les mêmes faits en France. IMBART DE LA, TOUR ; Les origines de la Réforme, t. I; La France moderne : « (p. 421)... Le marchand ne se borne pas à vendre sur place un produit déterminé ; il est l'intermédiaire qui se procure, qui débite les produits les plus divers... Il trafique sur tout... Dans ces conditions nulle entrave à ses progrès indéfinis. Grâce au développement des besoins, du bien-être, des échanges, il va capter (p. 422) à son profit toutes les sources de la richesse et sur les ruines des uns, la médiocrité des autres, les grandes fortunes commencent à s'établir... (p. 423) Aussi bien, la seconde moitié du siècle voit-elle éclore tous ces gros trafiquants, vrais spéculateurs et brasseurs d'affaires qui vont drainer toutes les richesses du travail et du sol [préjugé habituel des éthiques ; ces spéculateurs produisent des sources énormes de richesses]. Ce qui distingue le marchand de cette époque c'est qu'il est surtout, comme on l'appelle, „ l'accapareur “. Il opère sur des masses qu'il concentre entre ses mains... (p. 425) ...On achète pour revendre et on revend ce qu'on n'a pas [cela provoque les indignations des éthiques, mais est souvent très utile économiquement]. En 1517, le nombre de ces marchés fictifs est devenu d'un usage si général que l'échevinage d'Orléans demande aux pouvoirs publics d'intervenir. (p. 426) Ils interviennent en vain... (p. 427) Rien de plus remarquable, par exemple, que ces Barjots, naguère inconnus en Beaujolais, qui ont commencé leur fortune dans les mines de vitriol et qui deviennent „ marchans publicques... de blez et vins, et pour ladicte marchandise mieulx excercer... tiennent à tiltre de ferme et loyer plusieurs gros bénéfices tant séculiers que régulliers, plusieurs héritages de gentilzhommes du pais “. Ce cas n'est pas isolé. À plusieurs reprises les documents nous signalent ces spéculateurs qui font main basse sur ,, toutes les fermes d'un pays “ dénoncés par les rancunes et les jalousies exaspérées des populations... (p. 433) Négociant, spéculateur, fermier des revenus privés ou publics, agioteur, banquier, prêteur sur gages, habile à amasser l'argent comme à le faire valoir, le marchand en arrive ainsi à tourner à son profit cette force immense qui gouverne le monde ; le capital... (p. 446) Semblançay n'est pas seulement un exemple, mais un symbole. En lui, se résume l'histoire de ces parvenus prodigieux que les transformations sociales ont fait jaillir des profondeurs. Leur avènement fut sans doute l'œuvre personnelle de Louis XI qui aimait les contrastes, la récompense de leurs services, de leur aptitude professionnelle, de leur formation spéciale. Il fut surtout l'œuvre des circonstances qui poussaient alors au premier rôle l'homme d'argent, comme jadis, l'homme de guerre [c'est ce qui a lieu aujourd'hui encore]. Mais à son tour, ce progrès de leurs richesses ajoutait aux progrès de leur influence [comme aujourd'hui]. Leur prospérité privée importait à la prospérité publique. La royauté [aujourd'hui : la démocratie] avait en eux des bailleurs de fonds toujours nantis, et, dans l'embarras où se trouvait fréquemment le trésor [exactement comme aujourd'hui], toujours nécessaires », Les spéculateurs servaient alors la monarchie, comme ils servent aujourd'hui la démocratie, comme ils serviront demain le socialisme, et après demain l'anarchie, toujours prêts à servir quiconque leur fait gagner de l'argent. Ils sont poussés à ce manège par l'instinct des combinaisons et la faiblesse des résidus de la IIe classe. « (p. 461) Bourgeoisie et absolutisme [aujourd'hui : démocratie] s'étaient élevés ensemble. L'une agrandie par lui, comme l'autre s'est affermie par elle. Ils s'attachèrent (p. 462) d'autant plus à l'absolutisme [aujourd'hui à la démocratie], qu'en le servant, ils se servaient eux-mêmes [les Caillaux de ce temps-là] ». Les souverains qui donnèrent ce pouvoir aux spéculateurs préparèrent la révolution de 1789, et par conséquent la ruine de la monarchie (§ 2227 1).
[FN: § 2385-1]
J. A. PORRET, pasteur ; Le réveil religieux du XVIIIe siècle en Angleterre. Sous le voile de nombreuses dérivations théologiques et éthiques, les faits sont assez bien décrits. « (p. 11) Vers la fin du XVIIe siècle, le Christianisme raisonnable du philosophe Locke, déiste en théologie, et sensualiste en psychologie, régnait en Angleterre. L'Évangile n'était pris que comme une morale, et cette morale était abâtardie. L'évêque Koadly professait ouvertement le déisme. Selon le juge Blakstone, il n'y avait pas plus de christianisme dans les discours des prédicateurs les plus renommés de Londres, que dans les oraisons de Cicéron. Bien rentés, et dès lors ne tenant pas, comme certains de leurs prédécesseurs, de tavernes pour vivre, les pasteurs qui s'enivraient. „ sans scandale “ n'étaient point de rares exceptions. D'autres étaient simplement gens de plaisirs ; d'autres encore se vouaient à la culture des lettres, de la poésie surtout... Avec, plus de décence, les églises séparées ne possédaient guère plus de sève... (p. 12) Au témoignage d'Addison (1712), „ l'apparence même du christianisme avait disparu “. Selon Leibniz (1715), même „ la religion naturelle s'affaiblissait en Angleterre “... La haute société était pourrie. L'incrédulité s'y affichait, allant du rationalisme le plus radical à l'athéisme effronté. À l'incrédulité appartenaient les succès de librairie, puisque les discours contre les miracles, de Woolston, se vendirent à trente mille exemplaires. Le matérialisme de Hobbes comptait de nombreux adhérents... ».
[FN: § 2386-1]
J. A. PORRET ; loc. cit., § 2385 : « (p. 18).Edmond Burke... s'écriait vers 1790 : „ Aucun des hommes nés chez nous depuis 40 ans n'a lu un mot de Collins, de Toland (auteur du Christianisme sans mystère, mort en 1722), de Tindal (apôtre de la religion naturelle, vanté par Voltaire, mort en 1783), et de tout ce troupeau qui prenait le nom de libres penseurs. L'athéisme n'est pas seulement contre notre raison, il est contre nos instincts “. Quel changement d'orientation ! ... (p. 19) Cinquante ans avaient suffi pour amener cette incroyable volte-face. Quelles en furent les causes ?... Je ne conteste point qu'Addison, le fondateur de ce Spectator, qui se distribuait chaque semaine à 3000 exemplaires... ait exercé une influence heureuse au début du siècle. Berkeley, un penseur vigoureux, put, en professant l'idéalisme,... ruiner le matérialisme un temps triomphant... Plus tard, Samuel Johnson, ...ne doit pas être oublié ! Mais j'affirme qu’il serait chimérique d'attribuer à aucun d'eux, ou même à eux tous réunis, une influence déterminante... (p. 20) La transformation religieuse et morale de l'Angleterre, de 1735 à 1775, ne s'explique pas par quelques livres de noble inspiration. Elle suppose un fait, ou mieux un ensemble de faits, un mouvement puissant [très juste], qui, entraînant les âmes en grand nombre, les a comme arrachées à elles- mêmes, et enfantées à une vie nouvelle [dérivation éthique et théologique], celles qui demeuraient réfractaires ayant été, à défaut d'amour, obligées au respect. Cette transformation ne s'explique que par une action exercée dans la conscience religieuse et la conscience morale, centre de la personnalité humaine [dérivation éthique et théologique. .. Elle ne s'explique que par une œuvre du Dieu puissant et miséricordieux [dérivation de pure théologie] ». Il est remarquable que cet auteur ait perçu, sous les voiles de ses dérivations éthiques et théologiques, la puissance des actions non-logiques, dont proviennent les mouvements ondulatoires que nous avons observés.
[FN: § 2389-1]
Ensuite, le prince de Bismarck se ravisa. BISMARCK ; Pensées et souvenirs, t. II : « (p. 365) Vers 1878-1879, la conviction que je m'étais trompé, que je n'avais pas eu une haute idée du sentiment national des dynasties, que j'en avais eu une trop haute du sentiment national des électeurs allemands ou pour le moins du Reichstag, cette conviction n'avait pas encore pu s'imposer à moi, quelque grande que fût la mauvaise volonté que j'eus à combattre au Reichstag, à la cour dans le parti conservateur et chez ses „déclarants “. Aujourd'hui je dois faire amende honorable aux dynasties... »
[FN: § 2391-1]
[NOTE DU TRADUCTEUR] JEAN CRUET ; La Vie du Droit et l'impuissance des lois : « (p. 268) On se demande ce qu'il y a de plus remarquable dans les révolutions: l'intensité du bouleversement législatif, ou la médiocrité des transformations sociales. C'est à peine, en effet, si la permanence des mœurs et la continuité de leur évolution se trouvent affectées par l'amplitude de l'oscillation imprimée à tout l'appareil gouvernemental et juridique ; la révolution terminée, on s'aperçoit qu'elle a été surtout une grande émotion publique. Il est vrai que, dans l'histoire, les transformations sociales prennent la date, en quelque sorte symbolique, des révolutions politiques. Car rien ne ressemble plus à une société nouvelle, surgissant de toutes pièces, par l'action soudaine des lois, qu'une société préexistante faisant brusquement et violemment tomber en poussière les derniers liens politiques et juridiques du passé, pour traduire librement ses besoins et ses aspirations au grand jour d'une légalité entièrement refondue, sous un gouvernement renouvelé. Mais il est certain que les révolutions, en apparence les plus profondes, se passent en quelque manière à la surface de la société ».
[FN: § 2400-1]
JEAN PERRIN ; Les atomes, Paris, 1913. Après avoir fait mention d'une théorie qui, crue un moment fausse avait ensuite été reconnue vraie, l'auteur écrit : « (p. 173) J’ai compris par là combien est au fond limité le crédit que nous accordons aux théories, et que nous y voyons des instruments de découvertes plutôt que de véritables démonstrations ». C'est précisément ainsi que nous considérons les théories que nous avons exposées dans ce traité.
W. OSTWALD ; L'évolution d'une science. La Chimie, Paris, 1916 « (p. 147) En suivant jusqu'à nos jours le sort des théories chimiques, voici ce qu'on observe régulièrement. D'abord une théorie se développe pour représenter par des modifications d'un certain schéma la variété des combinaisons existantes. Naturellement on choisit un schéma qui s'accorde avec les faits connus, aussi toutes ces théories expriment-elles plus ou moins complètement l'état de la science à leur époque [cela est bon pour les sciences qui sont étudiées expérimentalement. Pour les sciences sociales, qui, jusqu'à présent, ont été étudiées surtout avec le sentiment, il faut dire : « L'état des sentiments et des intérêts, avec une adjonction plus ou moins grande d'expérience »]. Mais la science s'accroît sans cesse [pour les sciences sociales : « mais l'expérience gagne plus ou moins de terrain »], il se produit tôt ou tard un désaccord entre la multiplicité réelle des faits observés et la multiplicité artificielle de la théorie [pour les sciences sociales le désaccord apparaît surtout entre les faits et les déductions des sentiments]. La plupart du temps, on essaie d'abord de plier les faits si la théorie, dont il est plus facile d'embrasser d'un coup d'œil toutes les possibilités, ne peut plus rien céder. Mais les faits sont plus durables et plus résistants que toutes les théories, ou, tout au moins, que les hommes qui les défendent. Et ainsi, il devient nécessaire d'élargir convenablement la vieille doctrine ou de la remplacer par de nouvelles idées mieux adaptées ».
Plusieurs catégories de personnes ne peuvent pas comprendre ces choses ; entre autres : les personnes qui créent ou adoptent des théories pour défendre leurs intérêts : auro suadente, nil potest oratio ; les très nombreuses personnes qui se laissent guider par le sentiment, la foi, les croyances; les « intellectuels » qui enseignent une « science sociale », en ne sachant que peu ou point ce qu'est au juste une science expérimentale. Toutes ces personnes et d'autres encore peuvent être utiles au point de vue social ; elles ne comptent pas, lorsqu'il s'agit uniquement de la recherche de la réalité expérimentale (§ 2113 1).
[FN: § 2400-2]
JEAN PERRIN : loc. cit. 2400 1. Après avoir noté la concordance des résultats obtenus pour déterminer, en des circonstances très différentes, le nombre d'Avogadro N, l'auteur ajoute : « (p. 290) Pourtant, et si fortement que s'impose l'existence des molécules ou des atomes, nous devons toujours être en état d'exprimer la réalité visible sans faire appel à des éléments invisibles. Et cela est en effet très facile. Il nous suffirait d'éliminer l'invariant N entre les 13 équations qui ont servi à le déterminer pour obtenir 12 équations où ne figurent que des réalités sensibles, qui expriment des connexions profondes entre des phénomènes de prime abord aussi complètement indépendants que la viscosité des gaz, le mouvement brownien, le bleu du ciel, le spectre du corps noir ou la radioactivité... Mais, sous prétexte de rigueur, nous n'aurons pas la maladresse d'éviter l'intervention des éléments moléculaires dans l'énoncé des lois que (p. 291) nous n'aurions pas obtenues sans leur aide. Ce ne serait pas arracher un tuteur devenu inutile à une plante vivace, ce serait couper les racines qui la nourrissent et la font croître ».
Nous pouvons répéter des considérations semblables pour la théorie des résidus. Ceux-ci représentent une partie constante de phénomènes très nombreux et variés. Pourtant – dirons- nous – nous devons toujours être en état d'exprimer la réalité concrète, sans faire appel à des abstractions. C'est ce que nous pouvons faire, en éliminant les invariants nommés résidus entre les très nombreuses équations qui ont servi à les obtenir, et où ne figurent plus que des réalités concrètes. Mais nous n'aurons pas la maladresse d'éviter, sous prétexte de rigueur, l'intervention d'éléments abstraits dans l'énoncé de lois que nous avons obtenues grâce à leur aide. Il convient de ne pas renoncer aux services importants qu'ils peuvent encore nous rendre, jusqu'à ce que les progrès de la science les remplacent par d'autres, qui, à leur tour, devront être conservés tant qu'ils rendent des services ; et ainsi de suite, indéfiniment.
[FN: § 2408-1]
V. PARETO ; Économie mathématique, dans Encyclopédie des sciences mathématiques : « (p. 597) Au point de vue exclusivement mathématique, il est indifférent, pour la détermination de l'équilibre, de connaître les actions de l'individu au moyen des fonctions d'offre et de demande ou au moyen des fonctions-indices. (p. 596, note 9). Ce n'est que graduellement que, nous dégageant des conceptions de l'ancienne économie politique, nous avons substitué la notion des fonctions-indices à la notion d'ophélimité. Celle-ci est encore exclusivement employée dans V. PARETO, cours d'économie politique professé à l'université de Lausanne... ; elle est remplacée par la notion des indices d'ophélimité, dans V. PARETO, Manuale di economia politica ; et elle devient encore plus générale dans V. PARETO, Manuel d'économie politique. (p. 606) A. A. COURNOT a pris p F (p) comme fonction-indice ; il serait arrivé exactement au même résultat s'il avait pris F [p F (p)], F étant une fonction arbitraire. Il s'est servi de fonctions-indices sans s'en rendre compte. A. A. COURNOT a voulu étendre sa méthode au cas de la libre concurrence, mais il s'est complètement trompé dans ses déductions, et la considération des indices déduits des quantités qu'on échange à certains prix, a été abandonnée pour une autre méthode... Pourtant, en raisonnant correctement, nous pouvons... déduire les fonctions-indices de la considération des quantités échangées à certains prix ». V. PARETO ; Manuel. Après avoir indiqué (p. 542) une équation (9) qui pourrait résulter directement de l'expérience, et dans laquelle ne figurent que des quantités de marchandises, on ajoute : « L’équation (9) est la seule dont à proprement parler nous avons besoin pour établir la théorie de l’équilibre économique : or cette équation ne renferme rien qui (p. 543) corresponde à l'ophélimité, ou aux indices d'ophélimité : toute la théorie de l'équilibre économique est donc indépendante des notions d'utilité (économique), de valeur d'usage, d'ophélimité, elle n'a besoin que d'une chose, C'est- à-dire de connaître les limites des rapports 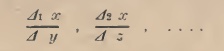
... On pourrait donc écrire tout un traité d'économie pure, en partant de l'équation (9) et d'autres équations analogues, et il se peut même qu'il convienne un jour de le faire. [En note „ C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles nos théories se séparent absolument de celles dites de l'École Autrichienne “. On peut ajouter qu'en cela elles diffèrent aussi des théories de Walras, que nous avons suivies de plus près dans le Cours, et qui ont pour fondement indispensable la notion de la rareté]. (p. 570) Au lieu de faire des expériences pour déterminer les lignes ou les variétés d'indifférence, faisons des expériences pour savoir quelles quantités de marchandises l'individu achètera à certains prix donnés ». Suit l'exposé mathématique des expériences à faire, et l'on conclut : « (p. 571) La difficulté plus ou moins grande, l'impossibilité même, qu'on peut trouver à réaliser pratiquement ces expériences, importe peu ; leur seule possibilité théorique suffit pour prouver, dans les cas que nous avons examinés, l'existence des indices de l'ophélimité, et pour nous en faire connaître certains caractères ». De la sorte, les indices d'ophélimité et les lois de l'offre et de la demande sont liés ensemble ; on peut aller des uns aux autres, ou vice versa : « (p. 571) On pourrait, des expériences qui viennent d'être indiquées, tirer directement la théorie de l'équilibre économique [par conséquent, sans faire usage des notions d'ophélimité, d'indices d'ophélimité ou d'autres analogues] ». Pour trouver les lois de l'offre et de la demande, le prof. Walras a considéré le troc de deux seules marchandises, et il a bien fait, parce que les difficultés sont résolues l'une après l'autre. Mais ensuite, il convient de pousser petit à petit les études, et de résoudre des problèmes nouveaux. C'est ce que nous avons fait en considérant le cas du troc de plusieurs marchandises ; en supposant d'abord la consommation de ces marchandises indépendantes (Giornale degli Economisti, août 1892), puis en supposant que les consommations sont dépendantes (Manuel et Encyclopédie des sciences mathématiques, loc. cit. p. 630-631).
[FN: § 2409-1]
V. PARETO ; L'écon. et la soc. au point de vue scient. « (p. 13) Cet équilibre [l'équilibre économique] ayant d'abord été étudié dans le cas de la libre concurrence, beaucoup de personnes se sont imaginé, que l'économie pure ne considérait que ce cas. Cette erreur est du genre de celle que pourrait faire une personne qui, ayant commencé par étudier, en dynamique, le mouvement d'un point matériel, s'imaginerait que la dynamique ne peut pas étudier les mouvements d'un système de points assujettis à des liaisons. L'économie pure peut étudier, et étudie, toutes sortes d'états économiques outre celui de la libre concurrence ; et par la rigueur de ses méthodes, elle donne une signification précise aux termes : libre concurrence, monopole, etc., employés jusqu'à présent d'une manière plus ou moins vague. Parmi les groupes d'équations qui déterminent l'équilibre économique, il en est un en lequel se trouvent les ophélimités des marchandises consommées. Cette circonstance a été l'origine d'une autre erreur. On s'est imaginé que les théories de l'économie pure étaient étroitement liées à la conception de l'ophélimité (rareté, marginal utility, etc.), et que par conséquent, celles-là ne pouvaient subsister sans celles-ci. Il n'en est rien. Si nous le désirons, nous pouvons, entre les équations données, éliminer les ophélimités, et nous aurons un nouveau système, qui déterminera également bien l'équilibre économique. Dans ce nouveau système, il y aura un groupe d'équations qui exprimera d'une manière précise la conception autrefois vague et parfois erronée, à laquelle on donnait le nom de loi de l'offre et de la demande ».
[FN: § 2409-2]
Manuale, IV, 11 : « (p. 253) Quelques-uns des auteurs qui ont constitué l'économie pure ont été amenés, pour rendre plus simples les problèmes qu'ils voulaient étudier, à admettre que l'ophélimité d'une marchandise ne dépendait que de la quantité de la marchandise à la disposition de l'individu. On ne peut pas les blâmer, parce qu'en somme il faut résoudre les questions les unes après les autres, et qu'il vaut mieux ne jamais se hâter. Mais il est temps maintenant de faire un pas en avant et de considérer aussi le cas dans lequel l'ophélimité d'une marchandise dépend des consommations de toutes les autres ». Le chapitre indiqué plus haut et l'Appendice mathématique traitent longuement de ce sujet. L'édition italienne du Manuel a été publiée en 1906 déjà. Le lecteur s'imaginera-t-il qu'un auteur reprocha aux théories de l'économie pure de ne considérer que les consommations indépendantes des marchandises ? Telle est la passion qui aveugle certaines personnes, telle est l'ignorance dont elles font preuve. – Au point de vue théorique, il faut prendre garde aussi à l'ordre des consommations. Une observation juste et avisée du prof. VITO VOLTERRA nous a déterminé à faire, sur ce sujet, une étude, publiée dans le Giornale degli Economisti, juillet 1906, et résumée dans le Manuel, p. 546-556.
[FN: § 2410-1]
C'est précisément en suivant ce principe et ceux de la sociologie scientifique en général, qu'a été écrit l'ouvrage que nous avons souvent cité, sur la circulation des élites en France : M. KOLABINSKA ; La circulation des élites en France...Si les rôles étaient renversés entre les classes des résidus et les dérivations presque constantes, toute l'évolution des sociétés humaines serait entièrement différente de ce qu'on observe en réalité ; les observations générales des historiens devraient prendre une autre et nouvelle forme, dans laquelle, parmi les éléments déterminants des phénomènes sociaux, les démonstrations occuperaient la place que tiennent aujourd'hui les sentiments et les intérêts. Les ouvrages des auteurs qui considèrent surtout ou exclusivement les actions logiques, et ceux des auteurs qui voient les faits à travers leur éthique absolue, prennent une forme analogue d'études historiques, qui écartent de la réalité, et parfois en éloignent beaucoup. En effet, cette éthique et la logique étant constantes, les dérivations auxquelles elles donnent naissance doivent aussi être considérées comme telles, et la variabilité des phénomènes devient presque ou entièrement dépendante de la variabilité supposée des résidus, et de celle des arts et des sciences, vérifiée par l'expérience (§ 356). Pourtant, on place d'habitude cette dernière variabilité dans la dépendance des résidus parmi lesquels se trouvent les sentiments qui empêchent l'homme de faire un usage convenable de sa raison.
[FN: § 2410-2]
À d'excellents ouvrages de sociologie on a reproché de ne pas tenir compte de tous les faits, ni de tous les détails des faits auxquels ils faisaient allusion. D'un mérite, on faisait ainsi un défaut. Pour que l'objection eût de la valeur, elle devait avoir la forme suivante : « Vous ne tenez pas compte de ce fait, qui exerce une grande influence sur la partie principale du phénomène dont vous recherchez les uniformités, ni de ces détails qui ont le même caractère ». En outre, eu égard au fond, il serait nécessaire de donner une démonstration adéquate de ces affirmations. Mais tout cela ne peut être compris que de ceux qui apportent dans les sciences sociales les méthodes qui ont été si utiles aux sciences expérimentales.
[FN: § 2411-1]
Il faut aussi se garder du désir, de la manie d'applications pratiques. V. PARETO ; loc. cit., § 2409-1: « (p. 21) La plupart des sociologies se sont annoncées comme une substitution du raisonnement scientifique, aux préjugés „ religieux et politiques “ et ont fini par constituer de nouvelles religions. Le fait est particulièrement remarquable pour Auguste Comte ; il s'observe aussi pour Herbert Spencer et pour le très grand nombre de sociologies humanitaires que chaque jour voit éclore [§ 6]. On tâche parfois de le dissimuler sous un vernis scientifique, mais ce vernis est transparent et laisse facilement apercevoir le dogme qu'on voulait dissimuler. ...Les sociologues qui n'en arrivent pas jusqu'à constituer un système religieux, veulent au moins tirer de leur ,, science “ des applications pratiques immédiates. Des applications pratiques seront possibles un jour, mais ce jour est encore loin. Nous commençons à peine à entrevoir les uniformités que présente la mutuelle dépendance des phénomènes sociaux ; une somme énorme de travail est encore nécessaire avant que nous ayons acquis une connaissance de ces uniformités assez étendue pour nous permettre de prévoir, avec quelque probabilité, les effets sur les faits sociaux d'une modification apportée (p. 22) à une catégorie de ces faits. Jusqu'à ce que ce jour soit venu, l'empirisme synthétique des hommes d'États se trouve encore très supérieur, quant aux résultats pratiques, à la plus savante analyse sociologique qui soit à notre portée ». Ce qui précède était écrit en 1907 ; eh bien, il y a encore des personnes qui s'imaginent que les recherches scientifiques auxquelles nous nous livrons ont pour but de prophétiser, et de faire une concurrence déloyale à Mme de Thèbes. De même, dans le passé, il y avait des personnes qui supposaient que l'économie politique pouvait prédire le prix des marchandises. Une opinion analogue se manifesta de nouveau lorsque apparut l'économie mathématique. Il y eut alors des gens qui demandèrent : « Avec tous vos calculs, pouvez-vous prévoir le prix du blé l'année prochaine ? » Ces gens ne savent pas distinguer les mouvements virtuels des mouvements réels, un raisonnement logico-expérimental d"une dérivation, une proposition scientifique d'une prophétie. La forme d'un raisonnement logico-expérimental sur les mouvements virtuels est la suivante : « Si les circonstances A. B, C,... se réalisent, X se produira ». Le fond consiste en ce que A, B, C, … sont effectivement des faits expérimentaux, et que le raisonnement qui les unit à X est rigoureusement logique. Si, de l'observation du passé, on peut déduire avec une certaine probabilité que A, B, C,... existeront à l'avenir, on peut conclure avec la même probabilité qu'on observera aussi X. C'est là une prévision scientifique (§ 77), conséquence des uniformités qui unissent A, B, C,... à X, mais qui demeurent bien distinctes de cette uniformité ; à tel point qu'il peut arriver que l'uniformité subsiste, tandis que la prévision faite sur X ne se vérifie plus. Cela a lieu, non parce que le lien entre A, B,... et X disparaîtrait, mais parce que les prévisions sur la vérification de A, B,...., à l'avenir, sont erronées. On a des dérivations, si la forme du raisonnement que nous venons d'indiquer subsiste, mais que le fonds change, parce que A, B,... ne sont pas expérimentaux, ne fût-ce qu'en partie, ou bien que le raisonnement qui les unit à X n'est pas logico-expérimental. Ces dérivations n'ont aucune valeur démonstrative, et n'accroissent nullement la probabilité de la simple affirmation. « X se produira ». Si cette affirmation découle de l'induction non-logique d'un homme pratique, elle peut acquérir une probabilité notable en sa faveur. Si elle est la prophétie d'un croyant qui vit dans les nuages, ou d'une personne qui exploite la crédulité d'autrui, il est bon de ne pas s'y fier beaucoup ; il faut l'envoyer tenir compagnie aux prévisions de ces hommes remarquables qui devinent les numéros du loto. Si au prix de 81, la demande de titres de la dette publique est plus grande que l'offre, l'économiste peut vous dire que le prix montera. C'est là un cas particulier d'une uniformité étudiée par sa science. Si vous voulez savoir quel prix auront ces titres dans 15 jours, ne vous adressez pas à l'économiste : il ne peut rien vous dire à ce sujet. Adressez-vous à un homme d'État qui consente à vous faire part de renseignements ignorés du public, dont vous pourrez déduire, avec une probabilité plus ou moins grande, que la demande croîtra ou diminuera en regard de l'offre. Ou bien demandez conseil à un homme de bourse rompu aux affaires. Il se peut qu'il devine ; il se peut aussi qu'il se trompe. S'il a souvent gagné de l'argent en spéculant à la Bourse, la probabilité, du premier cas est plus grande que celle du second ; mais en font cas c'est une probabilité qui n'a rien à voir avec la science économique. Si vous vous adressez ensuite à une personne « confiante dans les destinées de la patrie », et qui en conclut que le prix des titres de la dette publique doit « nécessairement » monter, demandez-lui aussi les numéros du loto qu'elle a rêvé et qui vous porteront bonheur, et souvenez-vous que ces prophéties occupent un rang honorable parmi celles de Nostradamus et de Mme de Thèbes. Les affirmations d'un grand nombre de « sociologues » sont semblables à celles-là. Ils s'imaginent naïvement énoncer une uniformité sociologique en manifestant leurs désirs, leurs sentiments, les visions de leur religion humanitaire, patriotique, ou autre.
Notes du Chapitre XIII. – L’équilibre social dans l’histoire (§2412 à §2612), vol. 2, pp. 1601-1761 ↩
[FN: § 2415-1]
PAUL BOSQ ; Souvenirs de l'Assemblée nationale: « (p. 339, note) Dans le train qui, pour la dernière fois, ramenait à Paris les membres de l'Assemblée nationale, M. Laurier prononçait... l'oraison funèbre de cette majorité... „ Nous sommes flambés ! Ces gredins de républicains prendront nos sièges. Voilà ce que c'est de s'être toujours demandé au moment de prendre une décision : Qu'en dira la duchesse *** ? Et nous faisions une sottise “. Il aurait fallu répondre : Zut ! à la duchesse, et faire de la bonne politique. (p. 340) Nous n'en serions pas où nous sommes si nous nous étions moins préoccupés de l'opinion des salons ». On sait assez que les classes supérieures françaises préparèrent dans leurs salons la première Révolution, qui devait les détruire.
[FN: § 2420-1]
E. CURTIUS ; Hist. grecq., t. IV : « (p. 68) La santé morale d'une cité hellénique tenait avant tout à la fidélité avec laquelle la génération présente s'attachait à la tradition du passé, à sa foi aux dieux de ses pères, à son dévouement à la chose publique, et à l'observation scrupuleuse de ce que la coutume et la législation avaient établi comme règle de la vie sociale ». Cela est vrai, pourvu qu'on l'entende, non pas des gouvernants et des gouvernés, mais principalement des gouvernés ; autrement, sous le gouvernement d'un Nicias, qui suivait précisément ce programme, les Athéniens auraient dû jouir d'une prospérité plus grande que sous le gouvernement d'un Périclès, qui ne se souciait guère de la tradition ni des dieux. On sait que ce fut le contraire qui arriva.
[FN: § 2421-1]
GROTE ; Hist. de la Gr., t. X : « (p. 136) ... il parut au peuple athénien, – comme il aurait paru aux éphores à Sparte, ou aux chefs de toute ville oligarchique en Grèce, – que son premier, son impérieux devoir était d'en découvrir les auteurs et de les punir. Tant que ces derniers allaient librement inconnus et impunis, les temples étaient souillés par leur présence, et toute la ville regardée comme étant sous le coup du mécontentement des dieux, qui la frapperaient de graves malheurs publics ». C'est bien : si ces sentiments avaient été assez puissants chez le peuple athénien, il aurait renvoyé la discussion sur l'expédition en Sicile, ce qui l'aurait sauvé de terribles aventures.
[FN: § 2421-2]
THUCYD. ; VI, 29, 2 : ![]()
![]()
[FN: § 2421-3]
CURTIUS ; Hist. grecq., t. III : « (p. 382) Ils [les Athéniens] se lancent dans une entreprise hasardeuse qui demandait un chef sans scrupules, déterminé, habile, et ils font du seul homme qui eût ces qualités un ennemi de la cité, acharné à la ruine de son propre ouvrage ; ils confient la continuation de la guerre à un général malade [un honnête homme, comme Napoléon III à Sedan], timoré et agissant à contre-cœur, et ils vont affronter un ennemi plus dangereux que tous les précédents... »
[FN: § 2422-1]
En décembre 1908, l'amiral Germinet disait publiquement : « La plupart des navires de l'escadre n'ont pas le stock nécessaire pour trois heures de combat ». Le gouvernement de ploutocrates démagogues qui avait réduit la marine à cet état n'entreprit pas d'augmenter les munitions, mais mit à disposition l'amiral Germinet.
[FN: § 2423-1]
Le 28 décembre 1913, le député radical-socialiste André Lefèvre dit sans qu'on puisse le démentir : « À la suite de l'incident de Tanger, nous avons dû subir une injonction parce que l'armée française n'avait pas plus de 700 coups par pièce. Il y a des économies qui coûtent cher. Si nous avions eu une armée et une marine répondant à notre politique étrangère, nous n'aurions pas été amenés à la situation où nous sommes ». Le président du Conseil, Caillaux, dit : « Il est malheureusement vrai qu'on n'a pas toujours fait l'effort qu'il fallait accomplir, et qu'il a fallu rattraper le temps perdu ». À propos de ce discours de Lefèvre, GEORGES BERTHOULAT écrit dans la Liberté, 30 novembre 1913 : « M. André Lefèvre n'est certes pas de nos amis politiques. Mais l'impartialité nous oblige à reconnaître que, lorsqu'il parle, c'est toujours pour dire quelque chose, compliment bien rare avec les parlementaires d'aujourd'hui. M. Lefèvre avait prononcé dans la discussion de la réforme militaire un discours hors de pair : celui d'hier n'est pas moins décisif, et il était aussi non moins opportun de prouver à la Chambre devant le pays que, si les ministres du Bloc n'avaient pas constamment traité la défense nationale par abandon, la France ne serait pas obligée de faire aujourd'hui un si grand effort financier et militaire. L'indignation effarée des jacobins en face de cette démonstration a été vraiment comique. Était-ce donc une révélation ?.Tout le monde ne sait-il pas qu'au moment d'Algésiras, M. Rouvier, éperdu, débarquait M. Delcassé sur les injonctions allemandes en disant dans les couloirs, à des députés dont j'étais, que, „ puisqu'il n’y a plus d'armée française grâce à André et à Pelletan, il fallait bien s'incliner “ ? N'est-ce pas aussi un fait historique, corroboré par M. Berteaux lui-même, qu'il fallut alors refaire fiévreusement les plus urgents des approvisionnements ruinés, et engager pour cela deux cents millions de dépenses occultes ? Les divulgations de M. Lefèvre n'étaient donc pas inédites. Mais c'est la première fois qu'on a le courage de les apporter à la tribune. Et les 700 coups seulement par pièce, ainsi révélés par un homme de gauche mettant son pays au-dessus de son parti, ont été un coup rude pour les survivants du „ régime abject “. Là-dessus, le Radical a un mot exquis : il rappelle M. Lefèvre „ aux convenances “. Quelles convenances ? Celles des coupables ? Un rappel à la vérité serait seul efficace. Mais M. Lefèvre a dressé un réquisitoire irréfutable. Et c'est évidemment l'homme que le journal exécutif appelle „ le chef du parti républicain “ qui doit en prendre sa grande part, attendu que M. Caillaux, chaque fois qu'il fut ministre des finances, a collaboré diligemment aux gaspillages de la politique alimentaire, mais ses seules économies furent réalisées au détriment de l'armée, c'est-à-dire celles qu'il n'aurait jamais dû faire et dont l'addition constitua en grande partie le présent déficit ». Cfr. § 2463-1.
[FN: § 2426-1]
HEROD. ; IX, 52. Cet auteur dit qu'Amopharétès était le chef de la localité de Pitana. Parlant des erreurs historiques qui sont usuelles, Thucydide (I, 20) observe qu'il n’a jamais existé une localité du nom de Pitana. Cela pourrait mettre en doute tout le récit d'Hérodote. Mais quand bien même il serait légendaire, en tout ou partie, cela importerait peu au but que nous nous proposons, lequel est uniquement de rechercher les sentiments des Spartiates. Il est en effet évident qu'une légende acceptée comme histoire doit concorder avec les sentiments qu'elle manifeste.
[FN: § 2427-1]
Sans avoir le moins du monde en vue notre théorie, CURTIUS, Hist. grecq., t. IV, nous donne un autre exemple, qui nous reporte aux Dix Mille guidés par Xénophon : « (p. 170). Chez ces hommes. l'inquiétude du présent entretenait une effervescence exaltée et avait détruit en eux l'amour de la terre natale [voilà certains résidus qui font défaut, mais d'autres les compensent] ; mais avec quelle fermeté ne restaient-ils pas attachés à leurs plus vieilles traditions ! Des (p. 171) rêves et des présages envoyés par les dieux dictent, comme dans le camp homérique, les plus graves résolutions (2440-1) ; c'est avec un zèle pieux qu'on chante les péans, qu'on allume le feu des sacrifices, qu'on dresse des autels aux dieux sauveurs et qu'on célèbre un tournoi quand à la fin l'aspect de la mer, de la mer tant désirée, vient ranimer les forces et le courage... La rivalité des tribus y est sensible, mais le sentiment de la communauté, la conscience de l'unité nationale garde la haute main, et la masse possède assez de raison [disons au contraire : de résidus de la IIe classe] et d'abnégation [bien : voilà le résidu] pour se soumettre à ceux que leur expérience, leur intelligence [voilà les résidus de la Ie classe] et leur force morale désignent comme propres au commandement. Et, chose merveilleuse [point merveilleuse du tout ; c'est la conséquence de l'existence des résidus remarquée par l'auteur] dans cette multitude bigarrée de Grecs, c'est un Athénien qui, par ses capacités, les dépasse tous et devient le véritable sauveur de l'armée entière [exactement comme Périclès à Athènes, Épaminondas à Thèbes, Philippe en Macédoine]. L'Athénien avait seul cette supériorité de culture nécessaire pour donner de l'ordre et de la tenue à ces colonnes de soldats assauvagis par l'égoïsme, pour leur servir, dans les circonstances les plus diverses, d'orateur, de général et de (p. 172) négociateur ; c'est à lui surtout qu'il faut savoir gré si, en dépit d'indicibles souffrances, au milieu de peuplades hostiles et de montagnes couvertes de neiges et désolées, huit mille Grecs pourtant touchèrent enfin à la côte, après avoir erré par de nombreux détours ». Plus précisément, on doit cela, ainsi qu'il ressort de l'exposé même de Curtius, à l'instinct des combinaisons de Xénophon, combiné avec l'existence, chez ses soldats, des sentiments de persistance des agrégats, fort bien notés par Curtius.
[FN: § 2428-1]
CURTIUS ; Hist. grecq., t. IV : « (p. 379) L'art militaire des Spartiates, en dépit de quelques réformes isolées, avait toujours pour base l'ancienne disposition en lignes ; ils avaient leur ancienne phalange, c'est-à-dire la ligne de bataille rangée en profondeur égale, avec laquelle ils (p. 380) s'avançaient contre l'ennemi ».
[FN: § 2429-1]
Il paraît qu'à la bataille de Cannes, Annibal aurait été un précurseur des tacticiens allemands modernes. Voir SCHLIEFFEN ; Cannae. Les Romains inventaient peu, mais ils savaient se servir de l'expérience d'autrui ; c'est ce qu'ils firent pour l'art naval des Carthaginois.
[FN: § 2431-1]
XENOPH. ; Hellen., VI, 3, 20 : ... ![]()
![]()
![]() -- DIOD. ; XV, 51. « Les Lacédémoniens, donc, décidèrent d'attaquer les Thébains, ainsi abandonnés de tous, et de les réduire en servitude. Et parce qu'on savait que les Lacédémoniens faisaient des préparatifs énormes, et que personne ne se remuait pour les Thébains, chacun pensait
-- DIOD. ; XV, 51. « Les Lacédémoniens, donc, décidèrent d'attaquer les Thébains, ainsi abandonnés de tous, et de les réduire en servitude. Et parce qu'on savait que les Lacédémoniens faisaient des préparatifs énormes, et que personne ne se remuait pour les Thébains, chacun pensait ![]() , que ceux-ci auraient été défaits sans grandes difficultés. C'est pourquoi ceux qui leur étaient favorables, prévoyant les désastres au-devant desquels ils allaient, déploraient leur sort, et leurs ennemis jubilaient ».
, que ceux-ci auraient été défaits sans grandes difficultés. C'est pourquoi ceux qui leur étaient favorables, prévoyant les désastres au-devant desquels ils allaient, déploraient leur sort, et leurs ennemis jubilaient ».
[FN: § 2431-2]
PLUTARCH ; Pelop. 20.
[FN: § 2432-1]
DIOD. SIC ; XV, 50, 6 : ![]()
![]()
[FN: § 2432-2]
DIOD. SIC. ; loc. cit., § 2432-1.
[FN: § 2433-1]
GROTE ; Hist. de la Grèce, XV, c. 1, p. 5 : « Ce prince [Cléombrote] avec un degré de talent militaire rare dans les commandants spartiates, déjoua tous les calculs thébains. Au lieu de marcher par la route régulière de Phokis en Bœôtia, il tourna au sud par un chemin dans la montagne jugé à peine praticable, défit la division thébaine sous Chereas qui le gardait, et traversa la chaîne de l'Helikôn pour gagner le port bœôtien de Kreusis, sur le golfe Krissaen. Arrivant sur cette place par surprise, il l'enleva d'assaut, et captura douze trirèmes thébaines qui se trouvaient dans le port ».
[FN: § 2434-1]
XENOPH. ; Hell., IV, 5 – CORN. NEP. ; Iphicr. : Iphicrates, Atheniensis, non tam magnitudine rerum gestarum, quam disciplina militari nobilitatus est. Fuit enim talis dux, ut non solum aetatis suae cum primis compararetur, sed ne de maioribus natu quidem quisquam anteponeretur. Multum vero in bello est versatus ; saepe exercitibus praefuit ; nusquam culpa sua male rem gessit ; semper consilio vicit, tantumque eo valuit, ut multa in re militari partim nova attulerit, partim meliora fecerit... – GROTE, Hist. de la Gr., t. XIV, c. 1, croit pouvoir tirer de CORN. NEP. et de DIOD. SIC. la description suivante des perfectionnements introduits par Iphicrate : « (p. 67) Il allongea de moitié et la légère javeline et la courte épée, que les peltastes thraces portaient habituellement ; il inventa une espèce de grandes guêtres, connues plus tard sous le nom d’Iphicratides, et il combina ainsi, mieux qu'on ne l'avait jamais fait auparavant, des mouvements rapides, – le pouvoir d'agir sur un terrain difficile et en déployant les rangs, – une attaque efficace soit au moyen de traits, soit corps à corps, – et une retraite habile en cas de besoin ». Par conséquent « (p. 68) les succès de (p. 69) ses troupes légères furent remarquables. Attaquant Phlionte, il fit tomber les Phliasiens dans une embuscade, et leur infligea une défaite si destructive qu'ils furent obligés d'invoquer l'aide d'une garnison lacédaemonienne pour protéger leur cité. Il remporta une victoire près de Sikyôn, et poussa ses incursions sur toute l'Arkadia, jusqu'aux portes mêmes des villes ; faisant tant de mal aux hoplites arkadiens, qu'ils finirent par craindre de le rencontrer en rase campagne ».
[FN: § 2434-2]
XENOPH ; Hell., VI,4, 12. Les Lacédémoniens avaient rangé les énomoties [compagnies de 25, 32 ou 36 hommes, selon les auteurs] sur trois files ; ce qui donnait au maximum douze hommes de profondeur, tandis que les Thébains avaient une profondeur d'au moins cinquante boucliers. – En un temps très postérieur, Végèce décrit, en le louant, un semblable ordre de bataille. VEG. ; III, 20 : Depugnationum septem sunt généra vel modi, cara infesta ex utraque parte signa confligunt. Una depugriatio est fronte longa, quadro exercitu, sicut etiam nunc et prope semper solet proelium fieri. Sed hoc genus depuguationis periti armorum non optimum iudicant... Secunda depugnatio est obliqua, quae plurimis melior : in qua si paucos strenuos loco idoneo ordinaveris, etiamsi multitudine hostium et virtute turberis, tamen poteris reportare victoriam. Huius talis est modus : Cum instructae acies ad congressum veniunt, tunc tu sinistram alam tuam a dextra adversarii longius separabis, ne vel missilia ad eam, vel sagittae perveniant : dextram autem alam tuam sinistrae alae illius iunge, et ibi primum inchoa proelium : ita, ut cum equitibus optimis, et probatissimis peditibus sinistram partem illius, ad quam te iunxeris, aggrediaris atque circumeas, et detrudendo atque supercurrendo ad hostium terga pervenias. Quod si semel adversarios exinde pellere coeperis, accedentibus tuis indubitatam victoriam consequeris, et pars exercitus tui, quam ab hoste submoveris, secura durabit.
[FN: § 2434-3]
DIOD. Sic. ; XV, 55.
[FN: § 2434-4]
POLYB. ; XII, 25 g , dit à propos de la bataille de Mantinée : ![]()
![]() ... « la bataille de Mantinée où l'on vit tant de variété et de science de commandement... ».
... « la bataille de Mantinée où l'on vit tant de variété et de science de commandement... ».
[FN: § 2436-1]
DIOD. SIC. ; XV, 52.
[FN: § 2436-2]
DIOD. SIC. ; XV, 52, 5.
[FN: § 2434-3]
DIOD. SIC. ; XV, 52, 7. L'auteur observe qu'en cela « Épaminondas ayant été instruit dans la philosophie, et mettant en pratique les sages leçons qu'il avait reçues dans sa jeunesse, s'attira le blâme de beaucoup de gens ». On voit ici que les préjugés existaient chez le vulgaire, mais qu'ils cédaient devant l'autorité d'Épaminondas. Cfr. PLUTARCH. ; Pélop., 3.
[FN: § 2436-4]
FRONT. ; Strateg., I, 12,5 : Épaminondas Thebanus, contristatis militibus, quod ex hasta eius ornamentum [circonstance un peu différente de celle que rapporte Diodore], infulae more dependens, ventus ablatum in sepulcrum Lacedaemonii cuiusdam depulerat : Nolite, inquit, milites, trepidare; Lacedaemoniis signifiratur interitus. Sepulcra enim funeribus ornantur. Il continue en rapportant deux autres cas semblables.
[FN: § 2436-5]
XENOPH. ; Hell., VI, 4, 7.
[FN: § 2436-6]
XENOPH. ; Hell., VI, 4, 7 : ![]()
![]() .
.
[FN: § 2436-7]
L'inverse se produisit pour le peuple athénien. On voit bien là combien est importante la considération de la quantité des résidus. D'abord, il fut nuisible au peuple athénien de posséder des résidus de la IIe classe en quantité trop petite pour qu'il fût attentif aux prudents conseils de Nicias, et qu'il s'abstînt de l'entreprise de Syracuse ; tandis qu'ils étaient en assez grande quantité pour faire de Nicias un des chefs de l'entreprise. Pour n'avoir pas fait cette distinction, GROTE, Hist. de la Grèce, t. X, commet une grave erreur. Après avoir rappelé le jugement bienveillant de Thucydide sur Nicias, il dit : « (p. 347) Thucydide est ici d'autant plus instructif qu'il représente exactement le sentiment du public athénien en général à (p. 348) l'égard de Nikias pendant qu'il vivait. Ses compatriotes ne pouvaient supporter l'idée de condamner un citoyen si respectable et si religieux, de se défier de lui, de le destituer et de se passer de ses services [résidus de la IIe classe] ». C'est bien cela, en ce qui concerne la seconde partie de l'activité de Nicias, c'est-à-dire pour le commandement de l'expédition de Sicile ; mais non pour la première partie, lorsqu'il conseillait au peuple de ne pas faire cette expédition, et qu'on n'y fut pas attentif. « (p. 348) Non seulement on considérait les qualités privées de Nikias comme lui donnant droit à l'explication la plus indulgente de ses fautes publiques [parmi celles-ci n'était certainement pas le conseil de s'abstenir d'aller en Sicile !], mais elles lui assuraient pour sa capacité politique et militaire un crédit complètement disproportionné à ses mérites [oui, si l'on ne s'attache qu'au commandement de l'expédition en Sicile ; non, si l'on envisage le conseil de ne pas la faire]... Jamais dans l'histoire politique d'Athènes le peuple ne se trompa aussi fatalement en plaçant sa confiance [il faut répéter ici l'observation précédente] ». Grote saisit l'occasion de ce fait pour justifier les démagogues : « (p. 349) Les artifices ou l'éloquence démagogiques n'auraient jamais créé dans le peuple une illusion aussi profondément établie que le caractère respectable et imposant de Nikias [Pourtant lui-même se dément, en racontant comment les artifices et l'éloquence d'Alcibiade créèrent précisément dans le peuple l'illusion de l'utilité de l'expédition de Sicile, contrairement à l'opinion de Nicias, qui la prévoyait malheureuse]. Or, c'était contre le présomptueux ascendant de cette incompétence bienséante et pieuse, aidée par la richesse et des avantages (p. 350) de famille, que l'éloquence des accusateurs démagogiques aurait dû servir comme obstacle et correctif naturel ». Il eût certainement été très utile que cela se produisît pour la seconde partie de l'activité de Nicias ; mais ce fut un grand malheur pour Athènes que cela soit, au contraire, arrivé pour la première. Le même Grote dit : « (p. 117) La position de Nikias, par rapport à la mesure, est remarquable. (p. 118) Comme conseiller disposé à avertir et à dissuader, il s'en fit une idée juste ; mais en cette qualité il ne put entraîner le peuple avec lui ». Il est vrai que Grote affirme que l'expédition de Sicile aurait été utile à Athènes si elle avait été bien conduite ; mais les preuves de ces hypothèses font défaut. Ensuite, en ce qui concerne la foi aux présages, elle peut être avantageuse si elle sert à un chef avisé pour déterminer le vulgaire à accomplir une action utile ; elle peut être nuisible, si le chef a les mêmes préjugés que le vulgaire, et si les présages sont acceptés en vertu d'un prétendu mérite intrinsèque, au lieu d'être employés comme moyen. Les présages furent favorables, quand on préparait l'expédition de Sicile. Les Athéniens le déplorèrent amèrement, lorsque celle-ci tourna mal. – THUC. ; VIII, 1. – EURIP. ; Helena, 744-760, se fait l'interprète des sentiments de scepticisme et de mépris à l'égard des prophéties. Il conclut : ![]() . « Prudence et bon conseil sont le meilleur présage ». Nicias ne put peut-être pas, il ne voulut certainement pas tourner, par une interprétation opportune, ces oracles et ces prophéties en faveur du conseil qu'il donnait, de s'abstenir de l'expédition. Il l'aurait fait, s'il avait été comme Épaminondas ; et les Athéniens auraient pu lui accorder créance, s'ils avaient été comme les Thébains. De nouveau se manifestent les présages, lorsqu'il s'agit de décider si la flotte athénienne quitterait le port de Syracuse (§ 2440-1), et de nouveau se manifeste le désavantage de la foi que Nicias avait en eux.
. « Prudence et bon conseil sont le meilleur présage ». Nicias ne put peut-être pas, il ne voulut certainement pas tourner, par une interprétation opportune, ces oracles et ces prophéties en faveur du conseil qu'il donnait, de s'abstenir de l'expédition. Il l'aurait fait, s'il avait été comme Épaminondas ; et les Athéniens auraient pu lui accorder créance, s'ils avaient été comme les Thébains. De nouveau se manifestent les présages, lorsqu'il s'agit de décider si la flotte athénienne quitterait le port de Syracuse (§ 2440-1), et de nouveau se manifeste le désavantage de la foi que Nicias avait en eux.
[FN: § 2437-1]
POLYAEN., Strateg ., II 3, 8, mentionne clairement l'artifice. Après avoir dit que les Thébains étaient effrayés, il ajoute : ![]()
![]() . « Épaminondas leur donna du courage par deux artifices ». Il parle d'un message de Trophônios, qui promettait la victoire à qui commencerait la bataille, et il raconte qu'Épaminondas alla avec ses soldats dans le temple d'Héraclès où, suivant l'ordre qu'il avait donné, le prêtre avait fourbi les armes et laissé le temple ouvert, ce qui passa pour un présage de victoire. Cfr. FRONT. ; I, 11, 16.
. « Épaminondas leur donna du courage par deux artifices ». Il parle d'un message de Trophônios, qui promettait la victoire à qui commencerait la bataille, et il raconte qu'Épaminondas alla avec ses soldats dans le temple d'Héraclès où, suivant l'ordre qu'il avait donné, le prêtre avait fourbi les armes et laissé le temple ouvert, ce qui passa pour un présage de victoire. Cfr. FRONT. ; I, 11, 16.
[FN: § 2437-2]
DIOD. SIC. ; XV, 53.
[FN: § 2437-3]
DIOD. SIC. ; XV, 54.
[FN: § 2437-4]
PLUTARQUE ; Pélop. (trad. TALBOT), 20 : « Dans la plaine de Leuctres se trouvent les tombeaux des filles de Skédasus, que l'on appelle, à cause du lieu, les Leuctrides [récit légèrement différent de celui de Diodore, mais concordant avec celui de Pausanias]... Depuis lors, des oracles et des prédictions ne cessaient de recommander aux Spartiates de se garantir et de se garder de la vengeance de Leuctres : avertissement que le peuple ne comprenait pas bien et qui laissait des doutes sur le lieu. Il y a, en effet, dans la Laconie, près de la mer, une petite ville nommée Leuctres, et prés de Mégalopolis, en Arcadie, un autre endroit du même nom... (21) Pélopidas dormait dans le camp, lorsqu'il croit voir les filles de Skédasus se lamenter autour de leurs tombeaux, en lançant des imprécations contre les Spartiates, puis Skédasus, qui lui ordonne d'immoler à ses filles une vierge rousse s'il veut vaincre les ennemis ». Il communiqua les choses aux devins et aux chefs. Une partie d'entre eux voulaient que la prescription fût exécutée à la lettre, et rappelaient de nombreux exemples de tels sacrifices. « Ceux d'un avis opposé soutenaient qu'un sacrifice aussi barbare, aussi contraire aux lois de l'humanité, ne pouvait être agréable à aucun des êtres supérieurs qui nous gouvernent... (22) Tandis que ces conversations ont lieu entre les chefs et que Pélopidas, surtout, est dans le plus grand embarras, une jeune cavale, échappée d'un troupeau, passe en galopant à travers les armes, arrive auprès d'eux et s'arrête tout court. Tous les regards sont attirés par la couleur de sa crinière, d'un rouge très-vif,... Le devin Théocrite, par une heureuse conjecture, crie à Pélopidas : „ Voici votre victime, heureux mortel ! N'attendons pas d'autre vierge, mais prenez et immolez celle que le dieu nous donne “. On saisit la cavale, on la conduit aux tombeaux des jeunes filles, on invoque les dieux après l'avoir couronnée de guirlandes, on immole joyeusement la victime, et l'on répand ensuite dans le camp le bruit de la vision de Pélopidas et la nouvelle du sacrifice ». Pausanias (IX, 13) sait le nom des jeunes filles ; elles s'appelaient Molpia et Ippo. En toute bonne foi il rapporte les présages comme des faits réels.
[FN: § 2439-1]
CURTIUS ; Hist. grecq., t. IV, compare Athènes et Thèbes, Périclès et Épaminondas : « (p. 477). Chez ces deux hommes, c'est leur culture si haute et si variée qui est la raison même de leur ascendant ». Ce n'est pas cela : à Athènes et à Thèbes, des démagogues ignorants obtinrent pleine et entière confiance de leurs concitoyens. Mais ensuite Curtius se rapproche de la vérité expérimentale : « (p. 477) Nous découvrons donc aussi à Thèbes, an sein d'un régime démocratique, une direction tout aristocratique [ici l'on fait allusion, sous d'autres termes, à la combinaison que nous avons indiquée dans le texte], un pouvoir personnel aux mains de l'homme qui est le premier par (p. 478) l'intelligence [ou mieux l'instinct des combinaisons]. Épaminondas aussi gouverne son pays, comme l'homme de confiance du peuple [qui ne comprend pas grand'chose, et qui, en ne le réélisant pas béotarque, met en danger le sort de la patrie], à titre de stratège réélu d'année en année [très grave dommage de la combinaison intrinsèquement avantageuse]. Dans cette position, il eut à éprouver l'inconstance de ses concitoyens et l'hostilité d'une opposition qui considère l'égalité garantie par la Constitution comme violée. Des hommes comme Ménéclidas jouent le rôle de Cléon [les termes de la combinaison sont intervertis : ceux qui ont les qualités pour obéir gouvernent ceux qui ont les qualités pour commander, ce qui détruit Athènes et fait courir un grave danger à Thèbes ; la Macédoine s'en tire parce qu'elle n'est pas atteinte de cette maladie]. Épaminondas aussi supporta avec le calme des grandes âmes toutes les attaques et les humiliations.. À la guerre, il fut, comme Périclès, toujours heureux dans toutes les entreprises importantes, parce qu'il savait également unir à la plus haute prudence la plus entière énergie, et surtout parce qu'il s'entendait à élever l'âme de ses soldats et à les animer de son esprit [mais beaucoup plus parce qu'il savait se servir de leurs préjugés]. Il leur apprit, comme fit Périclès à l'égard des Athéniens, à surmonter les préjugés superstitieux... ». Ici, l'auteur cite Diodore, XV, 53, qui raconte des faits arrivés avant la bataille de Leuctres (§ 2437). Mais ce récit ne montre nullement qu'Épaminondas enseignait aux Thébains de ne pas se laisser aller à leurs préjugés ; au contraire, il les encouragea et s'en servit à ses fins. Il ne dit nullement à ses soldats que les oracles étaient de vaines fables ; mais aux oracles défavorables, il en opposa d'autres, favorables. DIODORE parle pourtant clairement à l'endroit cité par Curtius, XV, 53 ; il dit : « (4) Épaminondas, voyant les soldats envahis d'une crainte superstitieuse, à cause des présages qui s'étaient manifestés, s'efforçait, par l'intelligence et l'artifice [MIOT traduit : „ dans son esprit éclairé et dans ses conceptions militaires “] de dissiper les terreurs du vulgaire ». ![]()
![]() [ici, c'est proprement des artifices de guerre]
[ici, c'est proprement des artifices de guerre] ![]() . L'auteur continue en rapportant précisément les artifices employés par Épaminondas. L'erreur d'un historien aussi éminent que Curtius est remarquable, parce qu'elle procède de la manie qu'ont les historiens de vouloir, non seulement décrire des faits et des rapports entre les faits, mais encore faire œuvre éthique. Souvent, même sans s'en apercevoir, l'historien est persuadé qu'il doit montrer l'excellence du savoir comparé à l'ignorance, de la vertu comparée au vice. Aussi Curtius exalte-t-il sans autre le savoir d'Épaminondas, et sans prendre garde qu'il produisit un effet favorable, précisément à cause de l'ignorance des gens persuadés et commandés par ce capitaine. – GROTE, t. XV, raconte le désespoir des soldats après la mort d'Épaminondas, à Mantinée : « (p. 209) Toutes les espérances de cette armée, composée d'éléments si divers, étaient concentrées dans Épaminondas ; toute confiance des soldats dans un succès, toute leur sécurité contre une défaite, avaient leur source dans l'idée qu'ils agissaient sous ses ordres ; tout leur pouvoir, même celui d'abattre un ennemi défait, parut disparaître lorsque ces ordres cessèrent. Nous ne devons pas, il est vrai, parler d'une pareille conduite avec éloge ». Et nous voilà retombés dans l'éthique ! Laissons de côté la louange ou le blâme, qui n'ont pas grand'chose ou rien à faire ici, et relevons seulement le fait que ces sentiments des soldats montrent combien puissante était en eux la persistance des agrégats ; en ce cas particulier, elle prenait la forme d'une confiance illimitée dans le chef, presque d'un culte pour lui. Nous verrons alors se confirmer la proposition suivant laquelle on obtient l'effet utile maximum, lorsque le chef a l'instinct des combinaisons, utile pour commander, et que les soldats ont les sentiments et les préjugés grâce auxquels l'obéissance devient une religion.
. L'auteur continue en rapportant précisément les artifices employés par Épaminondas. L'erreur d'un historien aussi éminent que Curtius est remarquable, parce qu'elle procède de la manie qu'ont les historiens de vouloir, non seulement décrire des faits et des rapports entre les faits, mais encore faire œuvre éthique. Souvent, même sans s'en apercevoir, l'historien est persuadé qu'il doit montrer l'excellence du savoir comparé à l'ignorance, de la vertu comparée au vice. Aussi Curtius exalte-t-il sans autre le savoir d'Épaminondas, et sans prendre garde qu'il produisit un effet favorable, précisément à cause de l'ignorance des gens persuadés et commandés par ce capitaine. – GROTE, t. XV, raconte le désespoir des soldats après la mort d'Épaminondas, à Mantinée : « (p. 209) Toutes les espérances de cette armée, composée d'éléments si divers, étaient concentrées dans Épaminondas ; toute confiance des soldats dans un succès, toute leur sécurité contre une défaite, avaient leur source dans l'idée qu'ils agissaient sous ses ordres ; tout leur pouvoir, même celui d'abattre un ennemi défait, parut disparaître lorsque ces ordres cessèrent. Nous ne devons pas, il est vrai, parler d'une pareille conduite avec éloge ». Et nous voilà retombés dans l'éthique ! Laissons de côté la louange ou le blâme, qui n'ont pas grand'chose ou rien à faire ici, et relevons seulement le fait que ces sentiments des soldats montrent combien puissante était en eux la persistance des agrégats ; en ce cas particulier, elle prenait la forme d'une confiance illimitée dans le chef, presque d'un culte pour lui. Nous verrons alors se confirmer la proposition suivant laquelle on obtient l'effet utile maximum, lorsque le chef a l'instinct des combinaisons, utile pour commander, et que les soldats ont les sentiments et les préjugés grâce auxquels l'obéissance devient une religion.
[FN: § 2440-1]
En abandonnant le port de Syracuse, les Athéniens pouvaient éviter la destruction totale qu'ils subirent. Tout était déjà prêt pour le départ, qui pouvait s'effectuer aisément ; « mais la veille du départ, à la tombée de la nuit, la lune s'éclipsa. C'est pourquoi Nicias, rendu plus craintif par scrupule superstitieux et à cause de la peste [qui sévissait] dans l'armée, convoqua les devins. La réponse de ceux-ci fut que, suivant l'usage, on devait attendre trois jours avant de mettre à la voile. Démosthène, [qui était favorable au départ] et ceux qui étaient avec lui durent donner leur consentement, par crainte des dieux ». – THUC. ; VII, 50, 4 : « ...la plupart des Athéniens exhortaient les stratèges à surseoir [au départ], poussés par un scrupule de conscience. Nicias (il était aussi trop superstitieux et adonné à ces choses), dit qu'on ne devait pas délibérer sur le départ, avant d'avoir attendu, comme le disaient les devins, trois fois neuf jours ». Cfr. POLYB. ; IX, 19. – Si Nicias avait été dépourvu de préjugés comme Épaminondas ou Pélopidas, il aurait trouvé facilement les dérivations capables de persuader à l'armée que l'éclipse était un signe favorable au départ. On les trouva après l'événement, pour sauver le crédit des prophéties. – PLUTARCH. ; Nicias, 23 (tract. TALBOT) : « Car ce phénomène, comme le dit Philochorus, n'était point mauvais pour des gens qui voulaient fuir ; il leur était même très favorable. Et de fait, les actes qu'on accomplit avec crainte ont besoin d'obscurité, et la lumière en est ennemie ». En de semblables circonstances, Dion et Alexandre le Grand surent interpréter les éclipses favorablement à leurs desseins. PLUTARQUE ; Dion, 24 (trad. TALBOT). Tandis que Dion est sur le point de marcher contre Denys, « après les libations et les prières d'usage, la lune s'éclipse. Cela n'a rien d'étonnant pour Dion, qui connaît les périodes écliptiques, et qui sait que l'ombre est causée par la rencontre de la terre avec la lune et son interposition entre elle et le soleil. Mais les soldats troublés ont besoin d'une explication, et le devin Miltas, se plaçant au milieu d'eux, les engage à prendre courage et à s'attendre au plus grand succès. La divinité montre par ce signe qu'il y aura éclipse d'un objet éclatant. Or, il. n'y a rien de plus éclatant que la tyrannie de Denys, et c'est son éclat qu'ils vont éclipser en mettant le pied en Sicile ». Tandis qu'Alexandre marchait contre Darius, il y eut une éclipse de lune. Mais Alexandre sacrifia aussitôt à la lune, au soleil, à la terre, et trouva, ou imagina un présage qui lui était favorable. – ARR. ; De exp. Alex., III, 7, 6 : « Il sembla à Aristandre que cet accident de la lune était favorable aux Macédoniens et à Alexandre, et qu'en ce mois aurait lieu la bataille, pour laquelle les sacrifices présageaient la victoire à Alexandre. – Q. CURT. ; IV, 10. Effrayés par l'éclipse de lune, les soldats murmuraient : Iam pro seditione res erat, cum ad omnia interritus, duces principesque militum frequentes adesse praetorio, Aegyptiosque vates, quos coeli ac siderum peritissimos esse credebat, quid sentirent, expromere iubet. At illi, qui satis scirent, temporum orbes implere destinatas vices, lunamque deficere, cum aut terram subiret, aut sole premeretur, rationem quidem ipsis perceptam non edocent vulgus : ceterum affirmant, solem Graecorum, lunam esse Persarum. : quoties illa deficiat, ruinam stragemque illis gentibus portendi; veteraque exempla percensent Persidis regum, quos adversis diis pugnasse lunae ostendisset defectio. Nulla res efficacius multitudinem regit quam superstitio : alioquin impotens, saeva, mutabilis, ubi vana religione capta est... Nos intellectuels oublient cette fonction séculaire de l'expérience. Aujourd'hui on ne croit plus que les éclipses lunaires ou solaires aient le moindre pouvoir sur les événements d'une guerre ; mais beaucoup de gens croient que ce pouvoir est détenu par la « justice » ou par l’« injustice » de la cause remise au sort des armes. C'est pourquoi les gouvernants modernes n'ont plus à se soucier des éclipses ; mais il est bon qu'ils se soucient de faire passer pour « juste » la cause pour laquelle ils combattent. Il est bon aussi qu'ils n'y aient pas trop foi, qu'ils n'imitent pas Nicias, lequel croyait à l'influence des éclipses lunaires, ou Napoléon III et son ministre Ollivier, lesquels se fiaient, pour vaincre, à la « justice » de leur cause. Il est bon qu'ils imitent plutôt Thémistocle, Épaminondas, Dion, Alexandre, qui savaient interpréter les présages en faveur de leurs desseins, ou bien Bismarck, qui parlait aux autres de justice, et en lui-même se préoccupait d'être fort par les armes. Quand Bismarck fut sur le point de falsifier la célèbre dépêche d'Ems, il ne prit pas conseil d'un moraliste, mais demanda à de Moltke et à de Roon si l'armée était prête et capable de remporter la victoire.
[FN: § 2441-1]
PLUTARQUE ; Pélop. (trad. TALBOT) : « Il [Pélopidas]... reçoit pour otages Philippe, frère du roi, avec trente autres enfants des plus illustres familles, et les conduit à Thèbes... Ce Philippe était celui qui fit plus tard la guerre aux Grecs pour les assujettir. Ce n'était alors qu'un enfant, vivant à Thèbes dans la maison de Pamménès. Cette circonstance fit croire qu'il avait pris Épaminondas pour modèle. Sans doute il avait compris son activité à la guerre et à la tête des armées, mais ce n'était là qu'une faible partie de la vertu de ce grand homme : quant à sa tempérance, sa justice, sa grandeur d'âme et sa bonté, qui l'ont fait réellement grand, Philippe n'en eut jamais rien ni de sa nature, ni par imitation ». – GROTE, Hist. de la Gr., t. XVII, c. 1, dit avec justesse de Philippe : « (p. 16) Son esprit fut enrichi de bonne heure des idées stratégiques les plus avancées de l'époque, et jeté dans la voie de la réflexion, de la comparaison et de l'invention, sur l'art de la guerre ». forces qui persistent longtemps, d'autres qui sont accidentelles et de courte durée ; mais enfin les premières finissent par l'emporter.
[FN: § 2442-1]
Bien qu'admirateur inlassable de la démocratie athénienne, GROTE, Hist. de la Gr., t. XVII, c. 1, ne cesse de déplorer la perte des meilleurs généraux, stupidement destitués par le peuple athénien : « (p. 39) La perte d'un citoyen tel que Timotheos [parti pour l'exil] était un nouveau malheur pour elle. Il avait conduit ses armées avec un succès signalé, maintenu l'honneur de son nom dans les mers orientales et occidentales, et grandement étendu la liste de ses alliés étrangers. Elle [Athènes] avait récemment perdu Chabrias dans une bataille, un second général, Timotheos, lui était actuellement enlevé, et le troisième, Iphikratès, bien qu'acquitté dans le dernier procès, semble, autant que nous pouvons le savoir, n'avoir jamais été employé dans la suite pour un commandement militaire. Ces trois hommes furent les trois derniers citoyens d'Athènes qui se firent distinguer à la guerre ; car Phokiôn, quoique brave et méritant, ne fut à comparer avec aucun d'eux. D'autre part, Charès, homme d'un grand courage personnel, mais n'ayant pas d'autre mérite, était alors en plein essor de réputation. La récente lutte judiciaire entre les trois amiraux athéniens (p. 40) avait été doublement funeste pour Athènes, d'abord en ce qu'elle avait décrédité Iphikratès et Timotheos, ensuite en ce qu'elle avait élevé Charès, auquel le commandement fut maintenant confié sans partage ».
[FN: § 2446-1]
Parmi les dérivations employées pour défendre le régime monarchique, il en est une remarquable. En réponse à l'objection de certains dommages incontestables survenus en certains faits historiques, elle répond que ces dommages n'auraient pas eu lieu si le souverain avait été bon, capable, apte au commandement. À cet égard, il n'y a en effet aucun doute ; mais l'objection est tout autre et consiste en ce qu'avec le régime monarchique, on n'est pas sûr d'avoir un monarque possédant ces qualités, ni que, s'il les a possédées un certain temps, il les conservera toujours. Par exemple, DUGUÉ DE LA FAUCONNERIE, Souv. d'un vieil homme, veut innocenter le régime impérial des terribles défaites de 1870. Voici comment il raisonne : « (p. 178) Pour faire acte d'Empereur, il eût fallu que l'Empereur fût encore Empereur comme il l'était du temps de la Constitution de 1852 ou que du moins il fût resté ce qu'il était en 1863... (p. 179) Malheureusement nous n'en étions plus là ! Peu à peu le pauvre Empereur avait cédé aux exigences du Parlement et cela pour arriver finalement à abdiquer entre les mains, non pas seulement d'Ollivier, mais d'orléanistes comme Buffet et comme Daru, l'autorité qu'il tenait de la nation ! Il n'y avait plus rien à faire ! » Ne nous arrêtons pas à examiner les faits. Acceptons les yeux fermés tout ce qu'affirme Dugué de la Fauconnerie. Lui-même condamne sa thèse, puisqu'il nous montre un empereur qui détenait le pouvoir absolu et la force nécessaire à le conserver, et qui se laisse déposséder par des politiciens parlementaires. Si, comme le veut cet auteur, les maux arrivés furent causés par ces parlementaires, la première origine doit en être recherchée dans la faiblesse du souverain qui donna le pouvoir à ces parlementaires ; et puisque le régime impérial ne nous garantit nullement qu'il n'y aura pas de temps à autre un empereur de ce genre, l'origine des maux remonte encore plus haut et va jusqu'à ce régime. Tout cela doit être entendu comme une hypothèse fondée uniquement sur les affirmations de Dugué de la Fauconnerie. Les excuses qu'Émile Ollivier cherche pour son ministère sont d'un genre analogue : tout d'abord la mauvaise foi des Hohenzollern et de Bismarck, comme si la fonction principale d'un ministre n'était pas précisément de pourvoir à ce que la mauvaise foi des ennemis ne cause aucun dommage à son pays ; puis l'opposition de la droite, qui l'empêcha de connaître les véritables conditions de la santé de l'Empereur, et qui par conséquent le détermina, lui Ollivier, à consentir à ce que l'Empereur se rendit au camp et prît le commandement en chef de l'armée ; comme si ce n'était pas le rôle d'un ministre de s'informer de faits si essentiels, et comme si ce n'était pas son devoir de se retirer, lorsqu'on le met dans l'impossibilité d'accomplir ce qui est nécessaire pour la défense du pays. De même, ni les excuses de Lamarmora ni celles de Baratieri ne sont dignes d'être prises en considération. Un chef doit savoir et prévoir. Celui qui ne sait pas et ne prévoit pas fait mieux de remettre le commandement à un autre et de rentrer chez lui. Émile Ollivier a montré les graves dommages subis par le pays, du fait de la régence de l'impératrice, au temps de la guerre de 1870. Sous le gouvernement de la République, personne ne songerait à confier le sort du pays à une telle femme. Dans la Lanterne du 8 août 1868, ROCHEFORT écrivait : « (p. 34) Sa Majesté l'Impératrice des Français a présidé hier le conseil des ministres. Quelle ne serait pas ma surprise si j'apprenais que madame Pereire a présidé le conseil d'administration du Crédit mobilier ! » Parfois, on peut recevoir un bon conseil, même d'un ennemi. Si Napoléon III avait été attentif à cette observation très juste de Rochefort, il aurait peut être évité, ou du moins rendu plus difficile la chute de son gouvernement, lequel, comme l'a dit Ollivier, finit par un suicide auquel prit part l’impératrice-régente.
[FN: § 2446-2]
LIV ; XXII, 61 : Quo in tempore ipso, adeo, magno animo civitas fuit, ut consuli, ex tanta clade, cuius ipse causa magna fuisset, redeunti, et obviam itum frequenter ab omnibus ordinibus sit, et gratiae actae, quod de republica non desperasset ; cui, si Carthaginiensium ductor fuisset, nihil recusandum supplicii foret.
[FN: § 2447-1]
Baron COLMAR VONDER GOLTZ ; Rosbach et Iéna.
[FN: § 2450-1]
Georges SOREL ; La rév. dreyf. : « (p 35) Pour pouvoir se maintenir jusqu'à cette époque des élections, Waldeck-Rousseau fut obligé d'accepter de nombreux compromis qui durent paraître bien cruels à l'ancien collaborateur de Jules Ferry. C'est ainsi qu'il lui en coûta beaucoup de laisser traduire en Conseil de guerre les gendarmes qui étaient entrés en collision avec des grévistes à Chalon ; il lui fallut donner cette satisfaction aux députés socialistes parce que ceux-ci avaient grand'peur d'être accusés de trahison par leurs comités électoraux et que les voix de ces députés étaient nécessaires pour former une majorité gouvernementale dans certains jours difficiles. Après la démission de Galliffet, Waldeck-Rousseau voulait se retirer et il ne demeura sans doute que dans l'espoir de tirer une vengeance éclatante de ses ennemis à l'heure des élections ; il était certainement fixé sur la nullité militaire d'André, qui n'était devenu général que par la protection de Brisson ; il accepta cependant ce grotesque comme ministre de la Guerre, parce qu'il lui était imposé par Brisson et Léon Bourgeois (JOSEPH REINACH ; Hist. de l'aff. Dreyf., t. VI, p. 121) ce dernier venait de sauver le gouvernement à la séance du 28 mai. Autrefois les démissions du chef d'état-major et du généralissime auraient épouvanté Waldeck-Rousseau, qui avait, comme tous les gambettistes, une grande préoccupation des choses de l'armée ; il devait maintenant laisser opérer les radicaux et le „ céphalopode empanaché “ (l'expression est de Clémenceau), dont ils avaient fait leur ministre favori ». Heureusement pour la France et pour tous les peuples latins, il manquait à l'Allemagne un Bismarck et un Guillaume Ier. « (p. 36) Il fallait beaucoup de corruption pour conserver cette majorité provisoire, en attendant les élections. Waldeck-Rousseau avait pris pour secrétaire général de son ministère un homme qui ne pouvait être arrêté par aucun scrupule... Il y eut une prodigieuse curée, dans laquelle les socialistes parlementaires ne furent pas les moins cyniques... » Pourtant il y a encore des gens qui, de bonne foi, croient que le ministère Waldeck-Rousseau a fait triompher « l'honnêteté » politique et sociale.
[FN: § 2451-1]
Dès 1866, Stoffel, parlant de Moltke, relevait l'utilité d'un chef d'état-major puissant et compétent. STOFFEL ; Rapp. milit. ; Rapp, du 25 oct. 1866, p. 39.
[FN: § 2452-1]
Gazette de Laus., 3 août 1911. À propos d'une réforme destinée à donner la haute main a l'élément civil dans le « conseil supérieur de la défense nationale », l'auteur dit : « ... dans le conseil supérieur de la défense nationale, il fallait, non pas admettre sur un strapontin les commandants des forces de terre et de mer, mais faire entrer, toutes portes ouvertes, tous les membres des conseils supérieurs de la guerre et de la marine. „ Tendance à la réaction, s'exclame M. Messimy. Elle voudrait noyer le gouvernement sous un flot de généraux et d'amiraux ! “ Peut-être nous sera-t-il permis, à notre tour, de dénoncer cette incurable défiance qui hypnotise les hommes du bloc devant les périls que font courir les militaires au malheureux pouvoir civil perpétuellement menacé. Quand cette défiance se borne à empêcher de dormir ceux qu'elle possède, il n'y a pas grand mal ! C'est plus grave quand elle conduit à des mesures qui peuvent affaiblir la défense nationale. Est-ce encore à ce soupçon démocratique que M. Messimy a voulu faire une part, quand il a supprimé le titre, non pas de généralissime, puisqu'il n'a jamais existé légalement, mais de vice-président du conseil supérieur de la guerre... Il est bien entendu, au surplus, qu'en pareille matière, les questions de personnes priment toutes les autres. Avec le général Pau, l'armée aurait accepté n'importe quelle cacophonie de titres ou quelle combinaison de préséances. Avec le général Joffre, elle aurait pu y regarder d'un peu plus près. Il n'est pas douteux aujourd'hui – je vous l'avais fait pressentir immédiatement – que ce sont les pires raisons politiques qui ont déterminé le refus du général Pau. Il paraît que, ce soldat énergique et éminent avait revendiqué un droit de contrôle sur la nomination des commandants des corps, non seulement pour l'avenir mais pour le passé ; et il n'avait pas caché qu'il méditait quelques exécutions, notamment celle de l'officier général aussi scandaleusement incapable que grossièrement infatué que les caprices de la politique ont placé à la tête d'un de nos principaux corps d'armée. C'est ce qu'il fallait à tout prix éviter ; c'est ce qui n'était pas à craindre avec le général Joffre, homme d'une haute intelligence, mais assez politicailleur, et à ce qu'on m'assure franc-maçon. Heureusement que l'intelligence sauve bien des choses... » Ce n'est pas tout. Les politiciens voulaient mieux encore. Ils inventèrent une combinaison très ingénieuse, grâce à laquelle, en rejetant sur l'État-major la faute dont ils étaient eux-mêmes responsables, ils visaient à remettre le commandement de l'armée à leurs amis. Le 13 juillet 1914, le sénateur Charles Humbert, rapporteur de la commission de l'armée, exposa au Sénat les conditions absolument insuffisantes des armements. Il s'en suivit une discussion à la Chambre. La Liberté, 17 juillet 1914 : « Après les accusations de M. Humbert, la Chambre a compris qu'elle ne pouvait faire autrement que de paraître partager l'émotion du Sénat. Il n’est rien de ce qu'on a dit devant la haute assemblée que les députés ne connaissent... La Chambre, ou plutôt la majorité radicale qui gouverne à peu près sans interruption depuis quinze années, avait d'autant moins besoin d'ouvrir une enquête sur les insuffisances du matériel de guerre qu'elle est elle-même responsable de cette insuffisance. Elle a refusé les crédits demandés par l'État-major.Il y a les faits, les dates et les chiffres. Trois ministres de la guerre, incarnant les sentiments de la majorité avec une particulière fidélité, n'ont pas craint de prendre parti contre leur propre département pour ménager mieux les antimilitaristes et les retenir dans la majorité ministérielle ». À la Chambre, le député Driant dévoila les dessous du mouvement produit au Sénat. « Ce qui est étonnant c'est l'étonnement du Sénat. Si quelque chose peut étonner davantage, ce sont les indignations de M. Clémenceau. Il a été président du conseil pendant trois ans. Il nous a donné un ministre de la guerre mou et insuffisant. La campagne qui se prépare a pour but de préparer un changement du haut commandement et de lui substituer une coterie politico-militaire ». Personne ne démentit cela. Le député André Lefèvre compta que, de 1900 à 1912, la France avait dépensé pour ses armements 1056 millions de moins que l'Allemagne. Le journal La Liberté remarque à ce propos : « En 1898 notre armée était sans rivale.Vers 1900, la politique change et viennent des ministres de la guerre qui s'appellent le général André et le général Picquart. C'est à partir de ce moment que tous les besoins de l'armée sont systématiquement réduits et que l'armée allemande prend une avance accrue d'année en année.
[FN: § 2453-1]
ISOCR. ; Antidos., 26-7.
[FN: § 2454-1]
En général les gouvernements de « spéculateurs » non seulement souffrent du défaut de certains résidus de la IIe classe, mais encore ne savent pas se servir opportunément de ceux qui sont intenses chez leurs gouvernés. Cela vient de ce que l'homme a la tendance de juger autrui selon sa propre mentalité, et comprend mal des sentiments qu'il n'éprouve pas. On eut un exemple remarquable de ce fait dans la guerre de Libye, entreprise par l'Italie. Giolitti, chef d'un gouvernement de « spéculateurs », ne la voulait pas. Poussé irrésistiblement à la faire, par l'intensité des sentiments correspondant aux résidus de la IIe classe qui se manifestaient dans le pays, il sut la préparer politiquement (non pas militairement) avec un art consommé, vraiment digne d'un maître en l'art des combinaisons (Ie classe). Mais il ne sut pas la diriger de manière à raffermir ces sentiments dans le pays, ni à en obtenir, sans résistance, les sacrifices nécessaires. Il donna la forme d'une opération économique, la seule que comprennent bien les « spéculateurs », à ce qui aurait dû être une opération soutenue par des sentiments nationaux, opération qui appartient à un genre en grande partie étranger à la mentalité des « spéculateurs ». Quand l'enthousiasme pour la guerre était au paroxysme, en Italie, si le gouvernement avait demandé des sacrifices pécuniaires au pays, celui-ci les aurait accordés avec joie ; et loin de nuire à l'enthousiasme pour la nouvelle entreprise, ces sacrifices l'auraient peut-être accru. Il n'est pas rare, en effet, dans des circonstances semblables que les peuples aiment leur patrie en proportion des sacrifices qu'ils accomplissent pour elle. Cela demeure inconcevable pour les « spéculateurs ». Ils ne peuvent se persuader qu'il y ait des gens qui jugent une opération autrement qu'en faisant le compte du doit et de l'avoir. C'est pourquoi, préoccupés uniquement de ce fait, les « spéculateurs » furent convaincus que le seul moyen de pousser le peuple italien à la guerre de Libye était de le persuader que cette guerre constituait une excellente opération économique ; qu'on la ferait sans lever de nouveaux impôts, sans que diminuassent les dépenses pour les travaux publics, sans écorner le moins du monde le budget. Dans ce but, ils recoururent à divers artifices, présentant même des budgets truqués de telle sorte qu'un boni figurait là où il y avait, en réalité, un déficit (§ 2306-1). Ils furent aussi poussés par un autre caractère de leur mentalité : la tendance à ne se soucier que du présent, et à négliger l'avenir. En effet, ces artifices réussirent quelque temps, mais ils furent d'autant plus nuisibles, lorsqu'on ne put finalement plus cacher la vérité. En agissant ainsi, les spéculateurs ne surent pas utiliser, comme c'eût été possible, la grande force de l'enthousiasme existant dans le pays ; aussi, négligée de la sorte, elle s'éteignit peu à peu.
[FN: § 2454-1]
À Athènes, bien que tous deux démocratiques, au temps de Thémistocle et à celui de Démosthène, les régimes politiques étaient en partie différents ; mais pas au point d'expliquer comment il se fait que, pour résister aux Perses, les Athéniens affrontèrent volontiers les énormes sacrifices conseillés par Thémistocle, tandis que, pour résister à Philippe de Macédoine, ils n'acceptaient en aucune façon les sacrifices bien moindres conseillés par Démosthène. On ne peut trouver l'explication que dans la différence de proportions des résidus de la IIe classe chez les Athéniens.
[FN: § 2454-3]
Chaque fois, par exemple, qu'un peuple A, chez lequel les résidus de la IIe classe sont affaiblis, et chez lequel, par conséquent, les intérêts matériels et temporaires prédominent, se trouvera menacé par les armements d'un peuple B, chez lequel les résidus de la IIe classe sont puissants, et chez lequel, par conséquent, il existe des tendances à sacrifier les intérêts matériels et temporaires à d'autres intérêts de nature plus abstraite et à des intérêts futurs, chaque fois l'on pourra adresser au peuple A les avertissements qu'en des circonstances analogues Démosthène adressait au peuple athénien. Celui-ci, pour sauver l'intégrité du fond théorique et s'amuser dans les fêtes, négligeait les armements contre Philippe, et préparait la défaite de Chéronée. Pour sauvegarder les dépenses en faveur des « réformes sociales » et d'autres qui procurent aux clientèles des politiciens leurs aises et des jouissances matérielles, les peuples modernes négligent les dépenses qui seraient indispensables pour sauvegarder l'indépendance de la patrie. – DEMOSTH : In Phil., Il : « (3) ... tous ceux qui sont poussés par la soif de dominer doivent être repoussés par les actes et par les faits, non par les discours ; et d'abord, nous autres orateurs, nous nous abstenons de les proposer et de les conseiller, craignant votre colère contre nous ». In, Phil., IV : « (55) ... s'il arrive qu'on parle des agissements de Philippe, aussitôt quelqu'un se lève. Il dit qu'il ne faut pas déraisonner et proposer la guerre. Là-dessus il continue en représentant combien il est doux de vivre en paix, et combien il est pénible d'entretenir une armée puissante. Il ajoute : „ Il en est qui veulent s'approprier l'argent “, et d'autres fables qui ont l'apparence de la vérité ». L'erreur principale des dérivations par lesquelles on tente de justifier la veulerie et la soif de jouissances matérielles de ceux qui se dérobent aux sacrifices nécessaires pour conserver l'indépendance de leur pays, consiste principalement en ce qu'on oublie que la guerre peut être imposée même à qui ne la veut pas, et que si celui-là n'y est pas préparé, elle peut causer sa ruine définitive. – GROTE ; Hist. de la Gr., t. XVII : « (p. 111) ...Démos au logis en était venu à croire que la cité marcherait sûrement toute seule sans aucun sacrifice de sa part, et qu'il était libre de s'absorber dans ses biens, sa famille, sa religion et ses divertissements. Et Athènes aurait en réalité pu marcher ainsi, en jouissant de la liberté, de la fortune, des raffinements et de la sécurité individuelle, si le monde grec avait pu être garanti contre le formidable ennemi macédonien du dehors ». Si l'on ne savait pas que Grote a écrit son histoire longtemps avant la guerre de 1870, on se demanderait s'il n'avait pas en vue la France de la fin de l'Empire, quand, à propos des Athéniens, il écrivait : « (p. 97) La supériorité de force fut d'abord tellement du côté d'Athènes [de la France au temps de la guerre de 1866], que si elle avait voulu l'employer, elle aurait pu retenir assurément Philippe au moins dans les limites de la Macédoine [la Prusse, dans les limites qu'elle avait avant la guerre avec l'Autriche]. Tout dépendait de sa volonté, de la question de savoir si ses citoyens avaient l'esprit préparé à subir la dépense et la fatigue d'une politique étrangère vigoureuse [et si l'empereur Napoléon III était disposé à la subir, au lieu de rêver à son humanitarisme], s'ils voudraient saisir leurs piques, ouvrir leurs bourses et renoncer au bien-être du foyer, pour défendre la liberté grecque et athénienne contre un destructeur qui grandissait, mais auquel on pouvait encore résister. Les Athéniens ne purent se résoudre à se soumettre à un pareil sacrifice ; et par suite de cette répugnance, ils finirent par être réduits à un sacrifice beaucoup plus grave et plus irréparable : la perte de la liberté, de la dignité et de la sécurité ». Le désastre de la guerre de 1870 fut beaucoup moindre ; mais on ne peut pas savoir quelle serait la gravité d'un désastre analogue, si, dans un avenir très prochain, les mêmes causes agissant, des effets analogues se produisaient.
[FN: § 2454-2]
Prince de BISMARCK ; Pensées et souvenirs, trad. franç., t. I.
[FN: § 2458-1]
BUSCH ; Les mém. de Bism., t. 1, p. 240 : « La conversation est tombée à table sur Napoléon III, et le chef [Bismarck] a déclaré que c'était un homme médiocre. „ il est meilleur qu'on ne le croit “, nous a-t-il dit, „ mais il est moins fort qu'on ne le suppose “. „ Oui “, dit Lehndorff, „ un brave homme, mais un imbécile “. „ Non “, répliqua le chef sérieusement, „ malgré tout ce qu'on peut penser de son coup d'État, c'est un homme bon, sensible, sentimental, mais son intelligence ne va guère plus loin que son instruction “ ». Dans ce jugement sur l'instruction, Bismarck s'est trompé ou a voulu se tromper. Napoléon III était très instruit, beaucoup plus que Bismarck ; mais il était humanitaire, rêveur, l'instrument d'un ramassis de gens qui s'enrichissaient par des spéculations. À quoi sert d'être intelligent, si l'on emploie son intelligence à son propre détriment ? Ainsi lorsque vint à Napoléon III l'idée stupéfiante d'aider les nationalités à se constituer en Europe ; ce qui était le meilleur moyen de préparer la ruine de son pays. Un souverain moins intelligent serait demeuré attaché à la tradition (résidus de la IIe classe), et aurait usé de tout son pouvoir pour que les voisins de la France, unie depuis des siècles, demeurassent désunis. On serait peut-être tenté de conclure que si Bismarck avait eu la mentalité de Napoléon III, et vice-versa, les sorts de la Prusse et de la France auraient aussi été intervertis. Ce serait une erreur, parce que sur la mentalité du pays, un Napoléon III, mis à la place d'un Bismarck, aurait en peu ou point d'action en Prusse et vice-versa en France, un Bismarck mis à la place d'un Napoléon III.
[FN: § 2461-1]
MAUPAS. Mém. sur le sec. emp., t. II. Au temps de Sadowa : « (p. 188) on sait à quel point il [1'Empereur] était obsédé par la pensée que nous aurions inévitablement, un jour, la guerre sur le Rhin ».
[FN: § 2461-2]
E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. X. L'auteur a un chapitre entier (p. 264-279) intitulé : « Comment la guerre avec la Prusse apparaît inévitable ». – GRANIER DE CASSAGNAC ; Souv. du sec. emp., t. III, p. 256 :
« Personne ne le niera : la guerre devint imminente dès la fin de l'année 1866, après la défaite de l’Autriche à Sadowa,... »
[FN: § 2461-3]
Peut-être écrira-t-on un jour quelque chose de semblable du président Poincaré, qui, vers la fin de 1913, dut se résigner à accepter le ministère Doumergue, lequel désorganisait la défense nationale. Eu égard aux hommes, il y a cette différence que Napoléon III pouvait et ne voulut pas, tandis que certainement Poincaré ne pouvait pas, et que nous ne savons pas s'il voulut ou non. Mais eu égard aux effets des formes de régime, il en fut somme toute de même avec le régime impérial et avec le régime républicain.
[FN: § 2463-1]
E. OLLIVIER ; L'Emp. lib., t. X : « (p. 382) ...nous ne devions plus songer qu'à jouir des bienfaits du repos, à nous enrichir, et à n'avoir plus d'autre ennemi que cette tuberculose, produit des vices de la paix, qui, dans une année, fait plus de victimes que des mois de guerre. Aucun idéal sous aucune forme ! Comment demander à un peuple ainsi endoctriné d'avoir l'esprit militaire et de s'estimer heureux d'être enfermé dans des casernes ? Pour défendre son indépendance ? Mais il ne voulait pas la croire menacée. D'ailleurs, une, crainte vague, sans réalité tangible, ne suffit pas à allumer dans des âmes jouisseuses la passion des servitudes et des sacrifices de la vie militaire »,.. « (p. 351) Garnier-Pagès avait dit : „ L'influence d'une nation dépend de ses principes. Les armées, les rivières, les montagnes ont fait leur temps. La vraie frontière c'est le patriotisme. (p. 352) Tous ces thèmes furent repris, amplifiés dans la discussion, et ce fut à qui déclamerait le plus éloquemment contre les armées permanentes dont la fin était proche (Magnin, 20 et 21 septembre 1867), qui créent au milieu de nous une race d'hommes séparée du reste de leurs concitoyens (Jules Simon, 19 décembre 1867) ; ce fut à qui maudirait la paix armée, pire, avec ses énervements et ses sacrifices, que la guerre, „ car elle ne finit pas et elle ne donne pas la seule chose qui puisse consoler des batailles, cette énergie, cette virilité des peuples qui se retrempent dans le sang versé “ (Jules Simon, 23 décembre 1867) »... « (p. 353) Selon Garnier-Pagès, il ne fallait ni soldats, ni matériel, la levée en masse suffisait à tout : „ Lorsque nous avons fait la levée en masse “ disait-il, „ nous avons vaincu la Prusse et nous sommes allés à Berlin ; lorsque les Prussiens ont fait la levée en masse, ils sont venus à Paris “ (discours du 24 décembre 1867) »... Jules Favre disait : « (p. 558) „ Vous parlez de frontières, mais elles ont été renversées, les frontières ! Savez-vous qui les abaissées ? C'est la main de nos ingénieurs, c'est le ruban de fer qui circule autour de ces vallées, c'est la civilisation ! “ »... Quand cet éminent phraseur s'en vint larmoyer devant Bismarck, à Versailles, il s'est peut-être aperçu qu'outre la civilisation, il y avait une autre chose, appelée la force, qui avait quelque influence sur la fixation des frontières. Bismarck riait de semblables bouffonneries. – BUSCH ; Les mém. de Bism., t. I, p. 312. Bismarck disait des programmes des candidats à l'Assemblée Nationale : « Trop d'éloquence... C'est comme Jules Favre : il est deux ou trois fois monté avec moi sur ses grands chevaux ; mais quand il a vu que je le blaguais, il a aussitôt mis pied à terre » (§ 2387-1). Jules Favre a pu gouverner le pays qu'il avait contribué à faire marcher à sa ruine. On a de nouveau entendu les mêmes absurdités en 1913, contre les mesures de défense, rendues nécessaires par les armements allemands. De nouveau l'on a entendu prêcher que c'était non par les armes, mais par les principes humanitaires et pacifistes qu'on résiste à l'ennemi. Par concession extrême, on parlait de la « nation armée », exactement comme au moment où la guerre de 1870 était imminente, tandis qu'il y avait aussi des Français, toujours comme avant la guerre de 1870, qui prêchaient le désarmement et la paix à leur pays. Cependant l'ennemi armait et se préparait à la guerre d'une manière formidable. Nous ne devons pas nous étonner de tout cela : les dérivations sont et demeurent de la nature qui convient le mieux au vulgaire qui les écoute et les admire. Les charlatans modernes usent des mêmes moyens que les charlatans de la Grèce antique et de la Rome antique, et nos démagogues ressemblent aussi aux démagogues grecs et romains.
[FN: § 2464-1]
E. OLLIVIER ; L'emp. lib., t. X.
[FN: § 2465-1]
MAUPAS ; Mém. sur le sec. Emp., t. II Au temps de Sadowa, il paraît que Napoléon III et son ministre Drouyn de Lhuys avaient l'intention d'envoyer un corps d'observation sur le Rhin ; ce qui aurait pu changer le sort de la guerre. « (p. 189) Un instant... on put croire que la politique de prévoyance et d'énergie franchement acceptée par M. Drouyn de Lhuys et le maréchal Randon avait fini par prévaloir aux Tuileries. Le 5 juillet, les décrets pour la convocation des Chambres, pour la mobilisation de notre armée étaient préparés, signés peut-être, et ils allaient être envoyés au Journal Officiel quand de hautes influences, qui avaient accès près du Souverain, tentèrent sur lui un dernier effort. Au nombre des personnalités marquantes agissant à la dernière heure de cet émouvant épisode se trouvait M. Rouher... À quel mobile pouvait donc obéir, en particulier, le ministre d'État, pour s'opposer à la mise en marche d'un corps d'observation sur le Rhin ? Il n'en faut pas chercher la cause dans des considérations d'un ordre supérieur... M. Rouher céda (p. 190) à l'influence de ceux des amis fanatiques de l'Italie qui appartenaient à son intimité, et il subit encore la pression de ce groupe de financiers et de grands industriels qui n'avaient cessé de l'entourer depuis son passage au ministère des travaux publics. Ces hommes, chez lesquels la passion des affaires paralysait le sentiment du patriotisme, voyaient, dans l'envoi d'un corps d'observation sur le Rhin, ce qui était la conséquence évidente de la mobilisation de notre armée, l'essor des affaires pour longtemps compromis, et ils avaient réussi à persuader à M. Rouher que le véritable intérêt du pays, c'était la neutralité absolue, c'était l'inaction ». Un phénomène analogue se produisit en 1905, lorsque Rouvier, digne représentant des brasseurs d'affaires, renvoya Delcassé, pour obéir à une injonction de l'Allemagne. C'était aussi l'un des motifs pour lesquels Giolitti ne voulait pas la guerre de Libye.
[FN: § 2465-2]
STOFFEL ; Rapp. milit., rapp. du 23 avril 1868.
[FN: § 2466-1]
Si A est un indice de la valeur de l'ensemble des résidus de la Ie classe, et si B est un indice semblable pour les résidus de la IIe classe, il est important que nous connaissions, fût-ce d'une manière grossièrement approximative, comment varie :
q = B / A
L'une des plus grandes difficultés, pour acquérir cette connaissance, consiste en ce qu'il ne suffit pas de savoir, par exemple, que l'indice I s'est accru, pour pouvoir en conclure que q s'est aussi accru ; parce que si l'indice A s'est aussi accru, cette augmentation peut être assez forte pour compenser l'augmentation de l'indice B, et par conséquent pour faire que q change peu ou point ; ou bien elle peut être telle que q s'accroisse ; ou encore qu'il diminue. Il faut donc prêter attention aux variations, non pas d'un seul des indices, mais de tous les deux, et s'efforcer de les évaluer tant bien que mal. L'un des cas les plus favorables à ces recherches se présente lorsqu'on peut trouver des phénomènes qui dépendent directement de q, et qui, de ce fait, nous permettent d'avoir quelque idée de la manière dont varie q.
[FN: § 2467-1]
Les disc. de M. le prince de Bism., t. II, p. 382. Discours du 4 février 1868 à la Chambre prussienne.
[FN: § 2469-1]
BARON COLMAR VON DER GOLTZ : Rosbach et Iéna, trad. franç.
[FN: § 2469-2]
De même, les socialistes-pacifistes français de 1913 disent : « Pour préparer la guerre, il est nécessaire de renoncer aux dépenses des lois sociales. Nous n'en voulons rien. Concluons donc une alliance avec l'Allemagne, en quittant toute rancune pour la perte de l'Alsace-Lorraine ». Ces éminentes personnes oublient que dans l'histoire on voit à chaque instant se vérifier le proverbe : « Qui se fait agneau, le loup le mange ». Les bassesses volontaires de Carthage devant les Romains ne la sauvèrent pas de la destruction. L'attitude humble de Venise eut pour épilogue le traité de Campo-Formio. Les radicaux anglais du type de Lloyd George disent que les dépenses de la guerre doivent être payées uniquement par les riches, parce qu'eux seuls en retirent avantage pour la défense de leurs biens ; comme si, dans les territoires occupés par l'ennemi, le menu peuple n'était pas exposé à perdre, outre ses salaires, la vie, car il n'a pas d'argent pour se mettre en lieu sûr. Mais ces propos sont simplement des dérivations qui recouvrent le désir de jouissances obtenues aux frais d'autrui.
[FN: § 2470-1]
Journal des Goncourt, t. V, p. 59 : « Je déjeune, à Munich, avec de Ring, premier secrétaire d'ambassade à Vienne. C'est lui qui a été le cornac diplomatique de Jules Favre, à Ferrières. Il nous entretient de la naïveté de l'avocat, de la conviction qu'il avait de subjuguer Bismarck, avec le discours qu'il préparait sur le chemin. Il se vantait, l'innocent du Palais, de faire du Prussien un adepte de la fraternité des peuples, en lui faisant luire, en récompense de sa modération, la popularité qu'il s'acquerrait près des générations futures, réunies dans un embrassement universel. L'ironie du chancelier allemand souffla vite sur cette enfantine illusion » (§ 2380-1). Maintenant, il y a de nouveau des gens qui se repaissent de semblables sornettes. Elles atteignent le comble de l'absurde dans les discours de d'Estournelle de Constant. Cet auteur a du moins le mérite de manifester clairement sa pensée, tandis que le doute subsiste au sujet de la sincérité d'un grand nombre d'autres auteurs qui usent de dérivations analogues.
[FN: § 2474-1]
Exactement comme en Italie et en France, à l'époque présente. On a là un caractère spécifique des gouvernements faibles. Parmi les causes de faiblesse, il faut surtout en relever deux : l'humanitarisme, la lâcheté naturelle des aristocraties en décadence, et la lâcheté en partie naturelle, mais aussi en partie voulue, des gouvernements de spéculateurs (§ 2480-1), visant à des gains matériels. L'humanitarisme rentre dans les résidus de la IIe classe ; mais, comme nous l'avons déjà expliqué (§ 1859), il est parmi les plus faibles et les moins efficaces. C'est proprement une maladie des hommes manquant d’énergie et possédant en quantité certains résidus de la Ie classe, auxquels ils donnent un vernis sentimental.
[FN: § 2480-1]
En juin 1914, eurent lieu, un peu partout en Italie, mais surtout en Romagne, des troubles révolutionnaires qui nous offrent un excellent exemple, bien que dans une proportion très réduite, des faits rappelés dans le texte. Au moment où la révolte atteignait sa plus grande intensité, le 10 juin, le président du Conseil, Salandra, envoyait aux préfets la circulaire suivante : « Des faits regrettables se sont passés dans quelques villes du Royaume. Les esprits en sont attristés. Il importe avant tout d'éviter qu'ils ne se répètent. Vous voudrez bien y employer tous vos efforts, tout votre zèle. Le Gouvernement n'est pas un ennemi ; il a des devoirs à remplir, dont le premier est le maintien de l'ordre public. Mais il faut qu'en le maintenant, si l'usage de la force est indispensable, il soit appliqué avec la plus grande prudence. Le Gouvernement compte avoir, dans le rétablissement de la paix, l'appui de tous les citoyens patriotes, qui attendent de bons effets du respect commun de la loi et des libertés publiques ». À ce discours si humble et soumis du chef du gouvernement, qui semble presque s'excuser auprès de ses adversaires d'oser leur résister, comparons l'article que l'Avanti, journal officiel des socialistes, imprimait le 12 juin : « Trêve d'armes. La grève générale, qui a pris fin hier soir, est le mouvement populaire le plus grave qui ait secoué un tiers de l'Italie depuis 1870 à aujourd'hui. En comparaison de 1898, il y a eu un plus petit nombre de morts ; mais la grève d'aujourd'hui dépasse en étendue et en profondeur la révolte du mois de mai tragique. Deux éléments essentiels distinguent la récente grève générale de toutes les précédentes : l'extension et l'intensité. Il n'y a qu'une seule page sombre dans ces journées de feu et de sang. C'est la Confédération générale du Travail qui a voulu l'écrire, en décrétant inopinément et arbitrairement, à l'insu de la direction du parti, la cessation de la grève. Une autre page sombre est celle des chemineaux, auxquels il a fallu trois jours pour s'apercevoir de la grève ; et ils s'en sont aperçus pour... s'abstenir de faire grève. Mais tout cela n'efface pas la beauté du mouvement dans ses lignes grandioses. Nous comprenons, en présence d'une situation qui deviendra toujours plus difficile, les peines et les terreurs du réformisme et de la démocratie. L'honorable Salandra, libéral-conservateur, et l'honorable Sacchi, qui vote contre lui, sont pour nous exactement sur le même pied. Nous le constatons avec un peu de cette joie légitime que met l'artiste à contempler son œuvre. Nous revendiquons certainement notre part de responsabilité dans les événements et dans la situation politique qui se dessine. Si, le cas échéant, au lieu de l'honorable Salandra, c'eût été l'honorable Bissolati qui fût à la présidence du Conseil, nous aurions cherché à rendre la grève générale de protestation encore plus violente et nettement insurrectionnelle. Depuis hier soir, une autre période de trêve sociale a commencé. Quelle sera sa durée ? Nous l'ignorons. Nous en profiterons pour continuer notre activité socialiste multiforme, pour consolider nos organismes politiques, pour recruter de nouveaux ouvriers dans les organisations économiques, pour obtenir d'autres positions dans les communes et dans les provinces, pour préparer, en somme, un nombre toujours plus grand de conditions morales et matérielles favorables à notre mouvement ; de sorte que, quand retentira de nouveau la diane rouge, le prolétariat soit éveillé, prêt et décidé au plus grand sacrifice, à la plus grande et la plus décisive des batailles ». Ce langage de l'Avanti est confirmé par d'autres journaux socialistes. Par exemple, la Scintilla, 18 juin 1914 : « Les cataractes des sentiments humanitaires se sont ouvertes. Tous les cœurs tendres y versent maintenant leurs lamentations onctueuses, sur « toute violence », et les larmes de crocodile de la pitié « pour toutes les victimes ». Les journaux de la démocratie, qui ont surtout peur des contre-coups de la grève sur leurs « blocs » électoraux, se remplissent maintenant de sermons pathétiques, d'homélies mielleuses sur le dogme de l'évolution, et gémissent sur la sinistre inutilité de la violence. Nous sommes fiers de constater que le parti socialiste n'a pas contribué et ne contribue pas à cette salade de révoltantes hypocrisies... Nous n'avons rien à répudier et personne à renier, pas même ce qu'on appelle la „ Teppa “ ! Naturellement, nous ne conseillerons jamais à personne, comme nous ne l'avons jamais conseillé, l'emploi des pierres contre les cordons de la police. Nous n'aimons pas les révoltes à coups de pierres : elles sont stupides. Surtout, ce qui nous exaspère, c'est l'imbécillité de ceux qui s'imaginent pouvoir affronter avec des pierres les fusils „ dernier modèle “. C'est donc une question purement pratique de mesure entre l'offense et la réaction, que nous soulevons contre la révolte, frondeuse... ». On assiste tout à fait à la lutte du renard et du lion. D'un côté, on ne fait allusion qu'à la ruse pour vaincre : pas un mot où l'on voie l'esprit viril, courageux, de qui a une foi. De l'autre côté, des caractères opposés. Au Gouvernement qui ne veut pas être appelé l'ennemi de ses adversaires, ceux-ci répondent qu'ils sont et demeureront ses ennemis, à lui et à tout autre gouvernement semblable ; et vraiment, pour ne pas comprendre cela, il faut être aveugle et sourd. De la sorte, les hommes de l'Avanti font preuve des qualités de virilité et de loyauté qui tôt ou tard assurent la victoire, et qui, en fin de compte, sont utiles à la nation entière. Le renard, usant de ses artifices, pourra échapper assez longtemps ; mais il viendra peut-être un jour où le lion atteindra le renard d'un coup de griffe bien ajusté, et la lutte sera terminée. En attendant, une partie des socialistes, spécialement les réformistes, s'en remettent encore à la pitié de leurs veules adversaires, et invoquent les circonstances atténuantes. Ils disent que les révoltes sont occasionnées par la misère, que les révoltés sont doux comme des agneaux, et que si parfois ils usent de la violence, ils y sont entraînés malgré eux par les provocations du gouvernement, de la force publique, de la bourgeoisie. D'une façon générale, la force d'un gouvernement ou d'un parti d'opposition est en rapport avec les dérivations qu'il emploie ; de telle sorte que celles-ci peuvent souvent servir à évaluer celle-là. Là où la force est plus grande, moindre est l'appel à la pitié des adversaires ou des indifférents, et vice versa. Le Gouvernement se déroba devant la violence de la place ; il se déroba de nouveau devant la violence d'une minorité restreinte au Parlement. Le ministre Salandra avait fait siennes les mesures fiscales déjà proposées par Giolitti. Grâce à l'obstruction, une trentaine de députés socialistes tint en échec une majorité de plus de quatre cents députés. Les premiers étaient soutenus par le courage et par un idéal ; les seconds se préoccupaient surtout des affaires de leurs clients. Le Gouvernement dut entrer en composition avec la poignée d'hommes qui faisait l'obstruction. Le traité de paix fut favorable aux deux camps. Les spéculateurs, représentés par le Gouvernement, obtenaient de pouvoir établir temporairement les impôts : c'était tout ce qui leur importait ; ils ne se souciaient guère du reste. La minorité socialiste obtenait le grand avantage de prouver sa force, et de montrer que, sans sa bonne volonté, on ne pouvait pas gouverner.
[FN: § 2480-2]
La faiblesse du Gouvernement, qui n'ose pas maintenir en prison les suffragettes qui jeûnent, est la cause principale de la persistance de leur rébellion. Lorsque se produisirent, en Italie, les troubles de juin 1914, les journaux anglais se mirent en quête de motifs plus ou moins fantaisistes pour les expliquer. Ils n'avaient qu'à regarder autour d'eux. La cause principale des mouvements insurrectionnels en Italie est tout à fait identique à celle du mouvement rebelle des suffragettes en Angleterre. On n'observe pas des faits semblables en Allemagne, parce que là où la cause fait défaut, l'effet disparaît aussi.
[FN: § 2480-3]
Le 7 juin 1914, à Ancône, quelques personnes sortaient d'un comité privé, substitué à une réunion publique interdite par la questure. La police voulut les empêcher de se rendre à la Piazza Roma, où jouait la musique. Il s’en suivit une bagarre dans laquelle, parmi les manifestants, il y eut trois morts et cinq blessés ; parmi les gendarmes, dix-sept blessés. Ce fut le point de départ d'une série de mouvements insurrectionnels, dans lesquels il y eut plusieurs morts et de nombreux blessés. Le Gouvernement ne sut et ne voulut pas les réprimer. Par conséquent, il. s'opposa à une promenade qui pouvait être inoffensive, ou tout au plus occasionner quelques désordres ; et il ne s'opposa pas efficacement à des actes de véritable rébellion à main armée. Il se montra fort, lorsqu'il se trouva en présence d'adversaires faibles, et faible, lorsqu'il rencontra des adversaires forts. Le ministre Salandra dit à la Chambre, le 9 juin, qu'il avait interdit la réunion d'Ancône parce que « l'intention d'inciter les soldats à manquer à leur devoir était manifeste, ainsi que le dessein d'exciter le peuple au mépris de l'armée. La coïncidence du jour choisi pour les réunions avec la fête solennelle du Statut, révélait le dessein de troubler les fêtes civiles et militaires qui sont célébrées à cette occasion ». Le ministre opposa donc la force des armes à ceux qui voulaient offenser l'armée par des paroles. Il permit qu'impunément des officiers fussent frappés, désarmés, et même qu'un général fût fait prisonnier sans qu'on fit usage des armes. Il faut croire que l'offense des paroles qu'on prévoyait, offensait l'armée plus que les actes effectivement commis. Le ministre interdit que « l'on troublât les fêtes civiles et militaires » ; il permit que l'on saccageât et que l'on incendiât impunément des édifices publics. Il faut croire que le fait de « troubler » une fête est un plus grand crime que le sac et l'incendie.
[FN: § 2480-4]
Le Corriere della Sera, 13 juin 1914, disait très justement : « Et alors il nous reste à demander si cette lâcheté bourgeoise est un moyen, un système, une ressource, une tactique, ou seulement une humiliante disposition à laisser les destins de l'Italie sous la coupe d'une infime minorité [elle n'est pas beaucoup plus petite que celle qui gouverne] rendue très forte par son audace et par la balourdise innée de ses adversaires [en réalité on devrait dire : par l'artifice dont ils usent pour gouverner par la ruse, en évitant de recourir à la force]. Devons-nous vraiment admettre, pour essayer d'apaiser les clameurs des députés socialistes, que la présence de la force publique dans les lieux qu'envahit la foule enivrée par les orateurs des réunions populaires, soit une provocation ? Que ce soit une provocation d'exposer des agents et des soldats durant trois ou quatre jours aux sifflets, aux insultes, aux lapidations ? [Oui, tout cela doit être admis par qui n'est pas disposé à recourir à l'usage de la force, laquelle est l’ultima ratio pour décider des luttes]. Voyons la preuve. La force publique était très peu considérable en Romagne. Eh bien, durant trois jours (et il paraît que le spectacle n'a pas encore cessé), la criminalité a régné en maîtresse [c'est là l'exagération habituelle consistant à appeler criminels ses adversaires ; en réalité, dans toute révolution, y compris celles que fit la bourgeoisie italienne contre les gouvernements passés, il surgit des criminels qui cherchent à pêcher en eau trouble]. On a fendu le crâne à un commissaire qui parlementait, qui voulait recommander le calme. On s’est acharné sur ceux qui étaient tombés. On a mis le feu à des églises monumentales [dans les révolutions, comme dans les guerres, on endommage les monuments]… Un général et deux officiers ont été – disons le mot – faits prisonniers [ces faits n'arrivent pas en Prusse ; pourquoi ? Parce qu'il y a un gouvernement différent de ceux qui existent en Italie et en France. Il n'y a pas de raison pour que les révoltés s'abstiennent de faire prisonniers leurs adversaires]. On a fait largement usage des revolvers, en outre des traditionnels poignards [mais avec quoi doit-on faire la guerre, si ce n'est avec les armes ?]. C'est là pour les hymnes socialistes un sujet de gloire. À leur point de vue, ils ont raison [observation très juste, qui suffit à elle seule à donner un caractère de réalité à l'article] : qui veut la fin veut les moyens, et les révolutions ne se déchaînent pas en Arcadie [mais en Arcadie, on écrit des circulaires comme celle du ministre Salandra, citée au § 2280-1]. Seulement, quand il s'agit, en particulier, d'établir qui a tiré, ce n'est jamais le manifestant qui a frappé. Cela aussi est naturel. Le héros révolutionnaire alterne avec l'avocat retors [tandis que chez les adversaires, il y a seulement l'«avocat retors » et que le héros fait défaut]. Mais pourquoi devons-nous instituer en Arcadie la défense de notre existence ?... Sachons bien qu'on ne peut prononcer de semblables paroles sans entendre les adversaires, surtout ce parti de la bourgeoisie qui veut faire son petit commerce [et aussi les spéculations moyennes, grandes, très grandes] jusque dans les crises les plus douloureuses de la patrie et ultra, parler de réaction, de captation, de nostalgie de 98, et ainsi de suite ». Il paraît que le « parti de la bourgeoisie » a été de nouveau entendu, car, deux jours après, le même journal fait volte-face et justifie la faiblesse du Gouvernement. – Corriere della Sera, 15 juin 1914 : « L'honorable Salandra n'a pas contesté que, par des mesures plus énergiques, on aurait évité certaines violences révolutionnaires. „ On cherche, en Romagne, a-t-il dit à la Chambre – à rétablir l'ordre avec la plus grande prudence. Nos collègues comprennent qu'il serait facile de le rétablir violemment. Mais si les mesures du Gouvernement n'ont pas obtenu un effet immédiat, on le doit précisément à la prudence avec laquelle la force est employée “... Ici, la ligne de conduite de l'honorable Salandra apparaît clairement. Il a voulu éviter à tout prix de répandre du sang [pour cette fois, cela a réussi, mais il est certain qu'à la longue, la ligne de conduite indiquée est celle qui conduit à la défaite, à la destruction] ». Le journal examine quelles auraient été les conséquences d'une répression énergique : « Aurions-nous évité une grève générale beaucoup plus longue, plus générale, plus violente que celle que nous avons surmontée ? [précisément ce qu'il importait d'épargner à la bourgeoisie qui veut faire son petit commerce, et à laquelle on fait allusion dans le premier article.] Aurions-nous évité une grève des chemineaux beaucoup plus étendue, plus intense, et plus désastreuse pour l'économie nationale [et pour celle des spéculateurs] que celle qui a eu lieu ? » Ce sont là les raisons habituelles de ceux qui veulent s'arrêter à mi-chemin, et qui craignent, comme le plus grand malheur, de devoir aller jusqu'au bout. C'est ainsi que raisonne toujours le renard, mais non le lion ; et c'est le principal motif pour lequel le lion finit par tuer le renard. Le journal termine par une approbation pleine et entière de l'œuvre de Salandra. Il a raison, si on considère que le but suprême du gouvernement est de protéger l'ordre de la production économique sans se soucier d'autre chose. Mais il ne faut pas oublier quelles sont, dans d'autres domaines, les conséquences de cette œuvre. Elles sont bien exposées par le Giornale d'Italia, 16 juin 1914 : « Le but a été une révolution politique, une véritable révolution, et, ce qui est plus grave, une révolution qui a réussi pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures, et non sans quelque ridicule. En effet, on peut appeler réussi ce mouvement qui bouleverse et met sens dessus dessous villes et campagnes, qui veut changer la forme de gouvernement, qui efface et annihile l'autorité existante, et y substitue une autorité de fortune dans le commandement et dans le symbole extérieur. Ajoutons que cela a été prémédité, et non sans une certaine science technique. Elle commença par l'isolement de chaque ville ou village, par la destruction des moyens de transport ferroviaire des troupes, par l'interruption des téléphones et des télégraphes. On réussit ainsi à créer le terrain apte à la propagation des plus fausses et des plus absurdes nouvelles. L'assaut des armureries, l'invasion des marchés, la séquestration des automobiles et la confiscation de la benzine complétaient l’exploit révolutionnaire. La composition des comités exécutifs particuliers, tous choisis avec représentation simultanée d'un républicain, d'un socialiste, d'un syndicaliste, d'un anarchiste, dit l'accord concerté des groupes subversifs. La force publique était paralysée, peu nombreuse, prise à l'improviste, contrainte de laisser passer la tourmente, obligée de livrer les culasses des fusils et de se confiner dans les casernes. Aussi la révolution triomphante a-t-elle pu aussitôt abattre les armoiries royales, hisser des drapeaux rouges, interdire la circulation à qui n’avait pas le visa du Comité révolutionnaire, confisquer des denrées, élaborer des listes de gens désignés pour verser des contributions en argent ou en nature, fermer des églises, brûler des gares et des bureaux d'octroi, et, en certains lieux, recruter même une espèce de garde nationale révolutionnaire, milice embryonnaire du nouvel état de choses ». Cette fois, ce ne fut qu'une tentative de révolution. Une autre fois, cela pourra être une révolution complète ; et peut-être sera-t-elle utile au pays. Le journal continue en remarquant qu'on ne doit pas, comme certains l'ont fait, négliger de prendre au sérieux ces faits : « Songez quel grand dommage représente pour notre vie nationale cette parenthèse rouge, cette tourmente de folie qui, pendant quelques jours, a tenu différentes cités de l'Italie centrale dans un enfer, et les a séparées du monde. Et quelle stupeur, que de débordements, que d'équivoques, fruits d'une longue période de transactions, de compromis et de dissolution, qui ont mortifié, avili, ralenti tous les organes du gouvernement ! Nous avons soif d'ordre, et l'ordre est au contraire représenté comme étant la réaction, et cela non seulement par les subversifs. Nous invoquons la protection raisonnable de la liberté pour tous de la part de la force publique, et la présence des soldats est au contraire représentée par des tribuns rhéteurs comme une provocation ! On se met à l'abri, hésitant et tremblant, tandis que cet abri apparaît urgent et sûr ; de telle sorte qu'il semble presque que dans les conditions où ont été réduits – depuis nombre d'années – le prestige de la loi et l'autorité de l'État, ce qui paraît une prudence superflue est désormais une inéluctable nécessité. Par conséquent, le tort moral, le coup violent porté à l'esprit public, la banqueroute de toute confiance en l'autorité de l'État, sont non moins ruineux que les dommages matériels, dont peu à peu les traces apparaîtraient dans quelques jours... Aujourd'hui, on n'attend pas l'injonction de la loi, mais celle des comités, des ligues, des fédérations, des chambres de travail, des syndicats. En somme, lorsque nous entendons des députés se féliciter à la Chambre de l'ordre rétabli – nous ne savons par quel éminent comité de salut public – parce que le mouvement subversif cesse, et que le pays rentre dans l'ordre, involontairement se fait jour dans notre esprit la conviction que, par une dégénérescence fatale, aujourd'hui, au-dessus du pouvoir exécutif, au-dessus du pouvoir législatif, nous avons laissé prendre racine à un pouvoir impératif supérieur de la démagogie, qui est le suprême arbitre des destinées nationales ». Depuis que le monde existe, ce sont toujours les forts et les courageux qui commandent, les faibles et les lâches qui obéissent ; et, comme d'habitude, il est utile à la nation qu'il en soit ainsi. « Maintenant, quelles sont les conséquences de cette nouvelle façon de considérer le néo-droit constitutionnel italien ? Les populations des Marches et de la Romagne le savent, elles sur qui s'est faite, dans ces jours, l'expérience pratique des finalités subversives. Si nous réfléchissons que les difficultés fiscales et internationales exigeront bientôt du pays des preuves amères de sacrifice et d'abnégation, nous sommes amenés à douter que l'on surmonte ces difficultés si, en même temps, on ne restaure pas le prestige de l'État, en renforçant le principe d'autorité, et en préférant le rétablissement de la loi, simplement de la loi, à une popularité artificieuse qui a été, pendant tant d'années, le porro unum, ministériel ». Mais cela est absolument impossible, si l'on ne veut pas faire usage de la force. Faire respecter la loi sans faire usage des armes contre qui veut la violer est un rêve humanitaire qui ne correspond à rien dans le monde réel. Les difficultés fiscales auxquelles on fait allusion sont dues en grande partie au gouvernement des « spéculateurs », qui extorquent autant d'argent que possible. Ils sont passés maîtres en fait d'astuce, mais il leur manque la volonté et le courage de se défendre par la force.
[FN: § 2480-5]
S'ils se souciaient de l'avenir, ils trouveraient facilement dans l'histoire où aboutissent de semblables voies. À la longue, les agents d'un gouvernement, ses troupes, se lassent d'être toujours sacrifiés. C'est pourquoi ils le défendent mollement ou même ne le défendent plus du tout. Parfois une partie d'entre eux trouve avantageux de se tourner contre lui et de s'unir à ses adversaires. Telle est la manière dont se sont produites un grand nombre de révolutions, et telle pourrait être aussi la manière dont prendrait fin la domination de la classe gouvernante qui règne aujourd'hui dans presque tous les pays civilisés. Mais comme cela n'arrivera certainement pas de sitôt, nos « spéculateurs » s'en soucient peu ou point ; de même que celui qui spécule à la Bourse se préoccupe bien de la prochaine liquidation, et tout au plus de quelques autres qui suivront ; mais il se soucie peu ou point des prix qui se pratiqueront en bourse dans plusieurs années.
[FN: § 2480-6]
Pour comprendre comment l'humanitarisme et la lâcheté des gouvernants peuvent paralyser la force d'une armée, considérons les faits suivants, qui eurent lieu en Italie, au mois de juin 1914. Corriere della Sera, 11 juin : « Gênes, 10 juin... Une colonne de syndicalistes et de grévistes a désarmé hier un lieutenant et un capitaine d'infanterie ». – Même journal, 13 juin : « Parme, 12 juin. Voici comment l'autorité raconte les faits qui se sont passés hier soir. Trois sous-lieutenants de l'École d'application revenaient, vers neuf heures du soir, d'accompagner un de leurs camarades chez lui,... lorsqu'ils furent en butte à des insultes, à des coups de pierres et de revolver. Les trois sous-lieutenants firent volte-face pour réagir, mais un nombre assez fort de jeunes gens les suivait. Aussi estimèrent-ils prudent (sic) de continuer jusqu'à la place Garibaldi, où ils racontèrent à leurs camarades, réunis en cet endroit, ce qui leur était arrivé ». Suivent différentes péripéties qu'il est inutile de rapporter « ... ils furent accueillis à coups de pierres et de feu, auxquels ils répondirent par des décharges en l'air ». Celles-ci, naturellement, n'étaient pas prises au sérieux. Arriva la troupe, et, comme d'habitude, elle tire en l'air, ce qui ne produit aucun effet : « La troupe et les agents avançaient, recevant toujours des insultes, des coups de revolver... ». La règle était précisément que soldats et gendarmes ne devaient pas faire usage de leurs armes, et que, lorsqu'ils étaient contraints d'y recourir, ils devaient tirer en l'air. En plusieurs endroits, ils perdirent patience, et comme il leur était défendu de faire usage de leurs armes, ils ramassèrent les pierres qu'on leur avait jetées et les renvoyèrent à leurs agresseurs. À ce qu'il paraît, ce duel à armes égales n'est pas interdit. Au Sénat, le sénateur Garofalo observa que « en Italie, l'usage s'est désormais implanté de laisser la troupe sans défense contre la violence des malfaiteurs » ; et le sénateur Santini dit que « lorsqu'on doit donner pour consigne à l'armée de se faire malmener et de s'exposer aux insultes... il vaut mieux la laisser dans ses casernes » (Corriere della Sera, 11 juin). Mais, à la Chambre, aucun député n'osa parler dans ce sens. Au contraire, un député conservateur – notez bien ce caractère – raconta divers épisodes dans lesquels les soldats avaient fait preuve d'une patience vraiment angélique. Il ajouta : « On a parlé des officiers ; eh bien, j'ai entendu raconter par un lieutenant qu'il avait été couvert de crachats, et était demeuré le revolver au poing, tandis que le sang lui montait à la tête ». À l'ouïe de ce récit, d'autres députés conservateurs crient : « Ce sont des héros ». Il conclut : « Ces pauvres soldats ont été admirables de longanimité, d'altruisme et d'esprit de sacrifice ». Tous les auditeurs présents, y compris les ministres, applaudissent. Il n'y a pas d'exemple d'une scène même très vaguement semblable au Reichstag allemand. Aucun ministre de la guerre, en Allemagne, n'aurait toléré de semblables louanges, bonnes pour des ascètes ou pour des moines, mais qui constituent des offenses, quand elles sont adressées à des officiers et à des soldats. Cette différence entre le gouvernement italien et le gouvernement allemand dépend surtout du fait que les « spéculateurs » ont beaucoup plus de pouvoir dans le premier que dans le second. Le cas du général Agliardi est très connu. Voici comment le raconta au Sénat le ministre de la guerre, répondant à une interpellation. Giornale d'Italia, le 12 juin 1914 : « Le général Agliardi et les officiers qui étaient avec lui se rendaient, le matin du 11, de Ravenne à Servia pour une manœuvre avec les cadres (manœuvre qui, étant données les circonstances, aurait dû être suspendue, et dont nous ne supportons pas la responsabilité). Ils furent gardés pendant cinq heures en otage, et ce qui est pis, le général et les autres officiers livrèrent leurs sabres à ceux qui les avaient faits prisonniers ». Il faut remarquer que le général Agliardi avait fait preuve de valeur à la guerre, ce qui exclut qu'il ait déposé les armes par manque de courage. Il fut mis en disponibilité. S'il s'était défendu à main armée contre ses agresseurs, il aurait facilement pu en tuer quelques-uns ; et, en ce cas, il eût été encore plus puni ; en sorte qu'il ne pouvait échapper en aucune manière à l'infortune qui le menaçait. Il semble qu'il y ait quelque contradiction chez un gouvernement qui ne veut pas qu’on fasse usage de ses armes contre ses agresseurs, et qui ne veut pas non plus qu'on les leur livre ; pourtant, l'unique moyen de ne pas les livrer est de s'en servir. Mais en somme, la contradiction disparaît, lorsqu'on remarque que le seul but du gouvernement est de vivre en paix, et qu'à ce but il sacrifie tout. Le ministre de la guerre répondit à l'interpellation qui lui avait été faite au Sénat sur le cas du général Agliardi, parce qu'il savait que, dans cette assemblée, il ne risquait pas de vifs débats. Le ministre Salandra ne voulut pas qu'on répondît, à la Chambre, à une interpellation analogue, parce qu'il craignait précisément ces vifs débats.
[FN: § 2480-7]
Il Se manifeste déjà quelques signes à peine perceptibles, qui montrent que plusieurs de ces défenseurs commencent à vouloir se soustraire à ces inconvénients. Dans le Giornale d'Italia, 15 juin 1914, MARIO MISSIROLI écrit : « Cet épisode [du général Agliardi] m'en rappelle un autre analogue. Il y a un an, durant la grève des fonderies de Imola, les grévistes furent remplacés par des travailleurs libres, qui devaient être protégés et défendus par les soldats. Ceux-ci, pour remplir leur devoir, ne trouvèrent rien de mieux à faire que de conseiller aux travailleurs libres de s'en aller, en les menaçant pendant la nuit, pour le cas où ils refuseraient. Les travailleurs libres s'en allèrent. Aujourd'hui il arrive souvent, dans les cas de grève générale, que les agents de police conseillent, forcent les commerçants à obéir aux grévistes et à fermer leurs magasins ».
[FN: § 2484-1]
En fait de signe précurseur, on remarquera la facilité avec laquelle la menace de violence dans l'Ulster tint en échec la ploutocratie démagogique anglaise, en 1914. On remarquera aussi, comme un phénomène beaucoup moins important mais cependant appréciable, que la violence des suffragettes eut pour effet qu'on leur permit d'incendier impunément des édifices, et de causer ainsi des dommages de plusieurs millions de livres sterling. En Italie, la violence des ouvriers romagnols s'imposa au gouvernement, et leur permit de constituer un État dans l'État, avec ses lois propres, mieux obéies que celles du gouvernement. Ajoutons l'exemple des troubles de Romagne, en juin 1914 (§ 2480).
[FN: § 2491-1]
PLUTARCH. ; Lycurg., 28.
[FN: § 2491-2]
SHŒMANN ; Ant. grec., I, p. 230 « ... Ces embuscades ![]() étaient dirigées surtout contre les Hilotes, et plus d'une fois sans doute il arriva que l'on fit disparaître, sans forme de procès, ceux dont on redoutait les complots. Ces patrouilles donnèrent à des écrivains postérieurs occasion de dire que tous les ans on organisait une chasse aux Hilotes ou que l'on en faisait une boucherie, exagération trop absurde pour mériter d'être contredite ». – Dict. DAREMBERG, s. r.
étaient dirigées surtout contre les Hilotes, et plus d'une fois sans doute il arriva que l'on fit disparaître, sans forme de procès, ceux dont on redoutait les complots. Ces patrouilles donnèrent à des écrivains postérieurs occasion de dire que tous les ans on organisait une chasse aux Hilotes ou que l'on en faisait une boucherie, exagération trop absurde pour mériter d'être contredite ». – Dict. DAREMBERG, s. r. ![]() (P. GIRARD) : « ... Qu'en même temps elle ait été un service de police destiné à maintenir l'ordre en Laconie, qu'en leur qualité de surveillants et de gardiens du territoire, les jeunes gens chargés de ce service aient eu fréquemment affaire aux hilotes et se soient montrés, dans certaines circonstances, particulièrement sévères et même cruels à leur égard, c'est ce qui est très vraisemblable ».
(P. GIRARD) : « ... Qu'en même temps elle ait été un service de police destiné à maintenir l'ordre en Laconie, qu'en leur qualité de surveillants et de gardiens du territoire, les jeunes gens chargés de ce service aient eu fréquemment affaire aux hilotes et se soient montrés, dans certaines circonstances, particulièrement sévères et même cruels à leur égard, c'est ce qui est très vraisemblable ».
[FN: § 2491-3]
THUC. ; IV, 80 : « (3) ... On prit toujours chez les Lacédémoniens des mesures pour se mettre à couvert de l'hostilité des Ilotes. Alors les Lacédémoniens proclamèrent que, parmi les Ilotes, ceux qui estimaient avoir été valeureux dans les combats eussent à se séparer des autres, pour recevoir la liberté. Les Lacédémoniens visaient ainsi à les découvrir et à connaître leurs sentiments, car ils jugeaient que ceux qui se croyaient dignes de recevoir les premiers la liberté auraient été aussi les mieux disposés à les attaquer. (4) Deux mille Ilotes ayant été ainsi rassemblés, ils les menèrent, couronnés comme des affranchis, autour des temples ; mais, après peu de temps, ils les firent disparaître, et personne ne sut de quelle manière on les avait détruits ». –DIOD ; XII, 67, 4 : ![]()
![]() « Deux mille s'étant inscrits, il fut prescrit aux plus puissants [citoyens] de les tuer, chacun dans sa maison ». Si les Spartiates avaient été humanitaires, comme l'aristocratie française de la fin du XVIIIe siècle, c'eût été les Ilotes qui eussent tué les Spartiates.
« Deux mille s'étant inscrits, il fut prescrit aux plus puissants [citoyens] de les tuer, chacun dans sa maison ». Si les Spartiates avaient été humanitaires, comme l'aristocratie française de la fin du XVIIIe siècle, c'eût été les Ilotes qui eussent tué les Spartiates.
[FN: § 2493-1]
THUCYD., VIII, 40.
[FN: § 2493-2]
ATHEN. ; VI, p. 265.
[FN: § 2493-3]
ATHEN ; VI, p. 267. De là vint, dit-on, le proverbe : ![]() : « Chio acheta le maître ».
: « Chio acheta le maître ».
[FN: § 2494-1]
ARISTOT. ; Po1it ., II, 6, 12 : ![]() ... « On dit... » La prévoyance supposée de parer au danger d'une trop grande réduction du nombre des Spartiates est suspecte. Elle a probablement été imaginée après que le fait se fut produit ; mais cela n'enlève rien à la probabilité des mesures ainsi expliquées.
... « On dit... » La prévoyance supposée de parer au danger d'une trop grande réduction du nombre des Spartiates est suspecte. Elle a probablement été imaginée après que le fait se fut produit ; mais cela n'enlève rien à la probabilité des mesures ainsi expliquées.
[FN: § 2494-2]
STRAB. ; VIII, 5, 4, p. 364. Après une lacune, vient le passage : ... ![]()
![]()
![]()
![]()
[FN: § 2495-1]
HÉROD. ; IX, 35 : Suivant Platon (De leg., I, p. 629), Tyrtée aussi aurait reçu le droit de cité spartiate. Il importe peu qu'il en soit vraiment ainsi. Il nous suffit de constater que l'octroi du droit de cité était une chose tout à fait exceptionnelle. Il s'agit ici uniquement des étrangers.
[FN: § 2495-2]
SCHŒMANN, Ant. grecq., t. I, décrit bien les faits : « (p. 244) Il est dit expressément, et nous devons admettre, qu'au début les Spartiates accueillirent volontiers dans leurs rangs les étrangers qu'ils rencontraient en Laconie, c'est-à-dire des Achéens... Ce fut seulement après avoir affermi leur autorité qu'ils se laissèrent gouverner par un esprit plus exclusif. Le droit de bourgeoisie, qui créait une classe à part en face du reste de la population, fut dès lors si rarement concédé qu'Hérodote cite comme le seul exemple (p. 245) connu la naturalisation de deux Éléens (§ 2495-1) ...Il n'est pas présumable que les Spartiates en aient usé plus libéralement dans les temps qui suivirent la mort d'Hérodote. On a vu que le droit de Cité avait été, refusé aux Néodamodes. Les Mothaques qui l'obtinrent quelquefois étaient des fils de Spartiates légitimés par leurs pères, et n'auraient pas obtenu cet honneur, s'ils s'étaient bornés à le mériter par leur conduite, sans justifier de ressources suffisantes. Il paraît que dans un temps où l'éducation était fort négligée ailleurs, des étrangers faisaient élever leurs enfants à Sparte. Quelques-uns de ces jeunes gens purent être admis plus tard dans les rangs de la bourgeoisie, mais il fallait qu'ils s'en fussent montrés dignes, et encore pour ceux qui n'avaient pas trouvé moyen de prendre racine à Sparte et d'y acquérir des biens-fonds, ce n'était là qu'un honneur stérile qui ne leur assurait pas l'exercice des droits essentiels ». Au contraire, CURTIUS, Hist. grecq., t. I, va manifestement un peu au delà de la réalité, quand il écrit : « (p. 231) D'autre part, le législateur de Sparte avait sagement pourvu à ce que la communauté spartiate pût se compléter avec des recrues d'un autre sang et des forces fraîches [il est certain que cela n'est pas arrivé, puisque aux temps historiques, il est indéniable que le nombre des Spartiates va toujours en diminuant] ; car il pouvait se faire que même des individus qui ne provenaient pas d'un mariage purement dorien, des enfants de périèques ou d'hilotes, s'ils avaient fait consciencieusement jusqu'au bout leur éducation militaire, fussent admis dans la communauté dorienne et mis en possession des lots vacants. Mais il fallait pour cela le consentement des rois ; c'est devant eux qu'avait lieu l'adoption solennelle du récipiendaire par un Dorien (p. 232) pourvu de son majorat. C'est ainsi que l'État recrutait de nouveaux citoyens [bien peu, en tout cas], et c'est à cette institution que Sparte dut une bonne partie de ses plus grands hommes d'État et de ses meilleurs généraux. Ainsi, c'était l'éducation, la discipline qui faisaient le Spartiate, et non le sang des aïeux ». Comme preuve, l'auteur cite PLUTARCH. Inst. Lacon., 22, et XENOPH., Hellen., V, 3, 9. Mais vraiment ces textes ne prouvent pas grand' chose. Plutarque parle de temps légendaire et n'est pas trop affirmatif non plus. ![]()
![]() .« Certains disent que, celui des étrangers qui consentait à vivre selon l’usage de la cité était mis à part de la répartition originaire du territoire, par une loi de Lycurgue ». – XENOPH., Hell., V, 3, 9, raconte comment Agésilopolis fut envoyé contre Olynthe avec trente Spartiates auxquels s'unirent volontairement des métèques et des bâtards
.« Certains disent que, celui des étrangers qui consentait à vivre selon l’usage de la cité était mis à part de la répartition originaire du territoire, par une loi de Lycurgue ». – XENOPH., Hell., V, 3, 9, raconte comment Agésilopolis fut envoyé contre Olynthe avec trente Spartiates auxquels s'unirent volontairement des métèques et des bâtards ![]() de caractère remarquable et n'ignorant pas la discipline spartiate. Le fait que l'auteur les nomme à part des Spartiates, suffit pour montrer qu'ils n’avaient pas tous les droits de ceux-ci.
de caractère remarquable et n'ignorant pas la discipline spartiate. Le fait que l'auteur les nomme à part des Spartiates, suffit pour montrer qu'ils n’avaient pas tous les droits de ceux-ci.
[FN: § 2495-3]
À propos de la tentative de révolte d'Agis, DROYSEN, Hist. de l'hellén., III, note : « (p. 407) La démocratie, la tyrannie, la domination étrangère, la révolution n'ont pas à Sparte, comme dans la plupart des autres États, balayé un amas confus d'organismes irrationnels, n’ayant qu'une valeur de fait, et laissé le champ libre pour une poussée nouvelle ». En somme, c'est le défaut de circulation des élites. – En l'an 227 av. J.-C., le coup d'État de Cléomène eut un meilleur sort, parce qu'il était fait en partie avec la force des mercenaires. Mais le nouvel ordre de choses dura peu, et en l'an 221 av. J.-C., Antigone rétablit le pouvoir de l'oligarchie à Sparte. Cléomène supprima les fonctions des éphores, excepté une seule qu'il garda pour lui (PLUTARCH. ; Cleom., 10). Ce fait ressemble à celui des empereurs romains, qui gardèrent pour eux-mêmes la tribunicia polestas. Dans les deux cas, on tint compte de l'intensité de la persistance des agrégats chez le peuple.
[FN: § 2496-1]
XENOPH. ; Laced. reip., X, 7 : ![]()
![]() .
.
[FN: § 2497-1]
ARIST. ; Polit., III, 7, 4.
[FN: § 2498-1]
CICER. ; Tusc ., II, 14, 34 : Spartae vero pueri ad aram sic verberibus accipiuntur, ut multus e visceribus sanguis exeat ; nonnumquam etiam, ut, cum ibi essem, audiebam, ad necem : quorum non modo nemo exclamavit unquam, sed ne ingemuit quidem. – Voilà la déposition d'un témoin du fait. Au temps de Cicéron, l'indépendance de Sparte n'existait plus, et l'on y conservait encore cet usage.
[FN: § 2500-1]
VETTOR SANDI ; Principj di Storia Civile della Repubblica di Venezia, 2e partie, vol. I, liv. V : « (p. 1) Ce livre comprendra un siècle entier : siècle important au point de vue de la police intérieure, beaucoup plus que dans les actions accomplies à l'extérieur... Et en effet : quelle question de gouvernement plus grave que l'établissement d'une aristocratie d'essence héréditaire par descendance mâle, dont l'existence soit perpétuée, et qui maintienne pure la Noblesse Dominante ? « (p. 5) Donc, le fait qu'en cette année le Conseil Majeur s'était renouvelé pour presque cinquante ans – on l'a déjà écrit – avait donné l'occasion d'en méditer une réforme. Mais ces méditations se prolongèrent jusque vers l'an 1286. On comprit alors finalement que l'on ne pouvait se mettre plus sagement à l'abri de la cabale, des factions, des autres mésaventures civiles, qu'en formant un premier Conseil toujours fixe de citoyens d'entre les plus qualifiés, et en nombre si grand que, sans rien ôter ou changer par un excès de nombre au dessein primitif d'avoir un gouvernement aristocratique, on satisfit aux vœux communs des gens de l'époque ; de telle sorte qu'ainsi formé, ce gouvernement fût sûr, stable et permanent. Pour l'obtenir, il ne pouvait y avoir de moyen plus sûr et plus pacifique que de le faire passer pour un caractère et une essence primitive chez les descendants légitimes des premiers nobles en ligne masculine, par succession perpétuelle ». « (p. 10) ...Quand enfin, au dernier jour de février de l'année vénitienne, le doge proposa la célèbre loi de 1296, qu'on appela vulgairement et par tradition la serrata del Consiglio maggiore, à laquelle la République doit en effet sa durée... »
[FN: § 2502-1]
Cette force provint exclusivement de l'extérieur pour la République de Venise, et en partie des mercenaires de Cléomène pour la République de Sparte. – POLYBE (IV, 41) remarque très justement : « (12) Ainsi donc, après la législation de Lycurgue, les Lacédémoniens eurent une excellente république et une très grande puissance, jusqu'à la bataille de Leuctres. Depuis que la fortune leur fut défavorable, leur république alla toujours de mal en pis (13). Enfin de nombreux troubles et des séditions civiles les frappèrent ; ils furent soumis à de nombreuses répartitions nouvelles de terres et à des exils, ils subirent des servitudes très dures, jusqu'à la tyrannie de Nabis... ».
[FN: § 2503-1]
MALAMANI ; La satira del costume a Venezia, nel secolo XVIII . Comme presque tous les historiens modernes, notre auteur confond l'énergie d'une classe sociale avec sa morale et, qui pis est, avec sa morale sexuelle, jugée selon les idées chrétiennes. Mais il est facile d'écarter cette erreur, et il reste de bonnes observations.
[FN: § 2505-1]
PIETRO GIUSTINANO ; Dell' historie venetiane : « (p. 668) Et dans la première rencontre [de la bataille de Lépante], les grosses galères des Vénitiens se lancèrent courageusement contre les ennemis. Grâce à leur valeur, la voie fut ouverte à la victoire des chrétiens ; en sorte que les galères des ennemis, s'avançant, serrées les unes contre les autres, pour attaquer les nôtres, furent de cette manière fracassées et détruites par les coups des artilleries des grosses galères, qui tiraient de terribles canonnades. Mis en déroute, les Barbares de ce côté prirent presque la fuite, car, voyant les dégâts que faisaient à elles seules six galères, ils s'en allaient, se figurant ce que pouvaient faire les autres, chose que les Turcs ne s'étaient jamais imaginée ». « (p. 672) Mais, parmi tous les capitaines de la flotte vénitienne... seul, Francesco Duodo, capitaine des grosses galères, obtint une louange unique et singulière... parce qu'avec les artilleries (comme je l'ai dit plus haut), il avait rompu la formation des Turcs. Cela contribua grandement à la victoire, ainsi qu’en font foi les patentes que lui firent Don Juan d'Autriche et Marc Antonio Colonna… ». L'auteur remarque ensuite que, pour réparer les navires « (p. 678) on envoya de Venise à Pola, où les dites grosses galères avaient été mises à sec, de nombreux maîtres de l'Arsenal, pour les radouber, en sorte que celles-ci ont une grande force en mer. Les vieux Vénitiens furent les inventeurs de ces machines navales, eux qui avaient une très grande pratique de la mer et de l'invention de vaisseaux maritimes. Les Vénitiens dépassèrent toutes les nations étrangères ».
[FN: § 2505-2]
P. DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. V, p. 216 : « À cette époque les forces de la république consistaient en huit ou dix vaisseaux de ligne, quelques frégates et quatre galères, qui tenaient la mer, et dans une vingtaine de bâtiments en construction ; mais ces bâtiments on ne les achevait jamais. Lorsque les Français entrèrent dans Venise, en 1797, ils trouvèrent sur les chantiers treize vaisseaux et sept frégates ; il n'y avait pas de matériaux suffisants pour les terminer, et de ces treize vaisseaux, deux étaient commencé depuis 1752, deux depuis 1743, deux enfin depuis 1732, c'est-à-dire qu'avant d'être en état de sortir du chantier ils avaient déjà soixante-cinq ans. Cet appareil de constructions navales n'était qu'un moyen d'entretenir l'illusion : ces vaisseaux étaient d'un faible échantillon ; ils ne portaient que du canon de (p. 217) vingt-quatre à leur batterie basse ; ils ne pouvaient sortir du port avec leur artillerie ; on était obligé de les armer dehors. Les officiers n'avaient eu depuis longtemps aucune occasion d'acquérir de l'expérience, et une marine marchande qui n'occupait que quatre ou cinq cents vaisseaux ne pouvait fournir des marins pour armer une escadre formidable ».
[FN: § 2506-1]
M. MACCHI ; Storia del Consiglio dei Dieci, t. IV : « (p. 30) Malgré tant de précautions, la bulle d'excommunication arriva à Venise par la voie de Mantoue. Il convient pourtant de dire que le patriarche Maffeo Gerardo, obéissant aux ordres du gouvernement, envoya au Conseil des Dix le message encore fermé et cacheté. Comme lui, le plus grand nombre des prêtres fit acte d'obéissance au gouvernement, et le petit nombre de ceux qui se crurent obligés par leur conscience de se soumettre aux ordres du pape furent bannis [en note : „ Le pape envoya cette bulle à Don Maffeo Girardo, patriarche de Venise, qui la fit publier sub poena excommunicationis, maledietionis, suspensionis et interdicti. Ayant entendu cela, la Seigneurie, avec les chefs du Conseil des Dix, auctoritate sua, envoya chercher le bref et l'excommunication, et ils ne voulurent en aucune façon qu'on la vît ni qu'on la publiât. Voyant que cette injuste excommunication ne devait pas être obéie, ils ordonnèrent, eux les chefs (p. 31) des Dix, qu'on célébrât comme d'habitude, dans toutes les églises, sous peine de notre disgrâce... SANUTO “] ». Venise en appela à un concile général ; le pape répondit par un autre Monitoire. « (p. 32) Les Vénitiens, à vrai dire, ne se soucièrent pas beaucoup de ces excommunications ». – MALIPIERO ; Annali Veneti : « (p. 282) Il ne se passa pas beaucoup de jours que le pape n'envoyât un de ses massiers auprès de D. Maffio Ghirardo, patriarche de cette Terre, avec son bref, lui commandant de signifier l'interdit au doge et à la Seigneurie... Le patriarche a feint d'être malade, et a fait savoir la chose au doge et aux conseillers des Dix. Il lui fut ordonné de tenir le tout secret et de ne l'exécuter en aucune façon... (p. 283). L'appellation a été rédigée dans la forme officielle en trois copies, et a été présentée au doge et à la Seigneurie, laquelle l'a envoyée à Rome par Traversin Bergamasco, courrier très fidèle, avec l'ordre d'en afficher une sur la porte de l'église de Saint-Celsus. Ce courrier est allé et a exécuté diligemment sa commission. Le 9 juillet, il est revenu. Le matin du 13 juillet, on parla au pape de l'appellation de la Seigneurie, affichée la nuit précédente, et on lui dit que toute la ville de Rome était en rumeur. Quelle que fût la diligence dont on usa, on ne put savoir, si ce n'est longtemps après, de quelle manière la chose avait transpiré ».
[FN: § 2506-2]
DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. III : « (p. 331) Toutes ces menaces n'étaient que vaines formules, objets de mépris, même pour le clergé ».
[FN: § 506-32]V. SANDI. ; Principj di st. civ. della rep. di Venezia, IIIe partie, v. II, 1. XX, c. VII, art. 3.
[FN: § 2506-4]
DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. IV : « (p. 218) ...il n'y eut dans toute la (p. 219) république qu'un grand-vicaire de Padoue, qui osa dire au podestat qui venait lui notifier ces ordres, qu'il ferait ce que le Saint-Esprit lui inspirerait ; à quoi le magistrat répondit qu'il le prévenait que le Saint-Esprit avait déjà inspiré au conseil des Dix de faire pendre les réfractaires ». Le Sénat de Venise ne dédaignait pas les dérivations à opposer au pape, et afin d'en être pourvu, il institua l'office de théologien consultant, auquel il nomma d’abord fra Paolo Sarpi. Même le pouvoir de l'Inquisition fut contenu dans d'étroites limites par le gouvernement vénitien. À ce sujet, SARPI écrivit, par ordre du doge, le Discours sur l'origine, la forme, les lois, et l'usage de l'office de l'Inquisition, dans la cité et puissance de Venise. Il parle très librement de la cour de Rome : « (p. 34) La Sérénissime République de Venise ne put être persuadée par les instances des Souverains Pontifes Innocent, Alexandre, Urbain et Clément, et par sept autres Papes qui les suivirent, de recevoir l'Office des frères inquisiteurs, institué par le Souverain Pontife. L'office séculaire qu'elle avait elle-même institué avec profit pour le service de Dieu lui suffisait. Ils [les Vénitiens] avaient devant les yeux les fréquents désordres que provoquait le nouvel Office, dans les autres cités où il existait, parce que les frères Inquisiteurs excitaient souvent le peuple dans leurs prédications ; et quand les gens prenaient la croix, ils causaient des troubles. De ce fait, un grand nombre de Croisés exerçaient leurs vengeances contre leurs ennemis, qu'ils qualifiaient d'hérétiques ; et d'autres gens également innocents, étaient, sous ce nom, opprimés par ceux qui voulaient les dépouiller... (p. 35) Mais, lorsque Nicolas IV monta sur le trône pontifical,... il insista tellement, qu'on résolut de recevoir l'Office, toutefois dans des conditions telles qu'il ne pourrait provoquer du scandale... (p. 36) Ici, il est nécessaire de s'arrêter pour considérer que l'Office de l'Inquisition, dans cette Puissance, ne dépend pas de la Cour de Rome, mais bien de la Sérénissime République, qu'il est indépendant, érigé et constitué par elle-même... ». L'auteur continue en citant plusieurs cas dans lesquels les papes abusèrent de leur pouvoir spirituel à des fins temporelles. Il conclut : « p. 47) Ces choses font voir que la malice de certaines personnes de cet Office s'applique à des intérêts humains et peu honnêtes : qu'il est donc nécessaire de bien examiner comment il fonctionne, et de ne pas laisser ces gens se mettre en mesure de pouvoir en abuser ». Plus loin : « (p. 55) Depuis plusieurs centaines d'années, les ecclésiastiques n'ont d'autre but que d'usurper la juridiction temporelle dont ils ont acquis déjà une grande partie, au grand détriment des gouvernements ».
[FN: § 2506-5]
DARU ; Hist. de la rép. de Ven., t. IV : « (p. 174) Pour être parfaitement assurée contre les envahissements de la puissance ecclésiastique, Venise commença par lui ôter tout prétexte d'intervenir dans les affaires de l'État ; elle resta invariablement fidèle au dogme. Jamais aucune des opinions nouvelles n'y prit la moindre faveur ; jamais aucun hérésiarque ne sortit de (p. 175) Venise. Les conciles, les disputes, les guerres de religion, se passèrent sans qu'elle y prit jamais la moindre part. Inébranlable dans sa foi, elle ne fut pas moins invariable dans son système de tolérance. Non-seulement ses sujets de la religion grecque conservèrent l'exercice de leur culte, leurs évêques et leurs prêtres, mais les protestants, les Arméniens, les Mahométans, les Juifs, toutes les religions, toutes les sectes qui se trouvaient dans Venise, avaient des temples, et la sépulture dans les églises n'était point refusée aux hérétiques ». Le peuple romain avait une manière analogue de gouverner au temps de la République. Il convient ici de répéter l'observation, faite tant de fois déjà, que l'art de gouverner consiste à savoir tirer parti des résidus existants, et non à s'attaquer à l'entreprise malencontreuse et souvent désespérée de vouloir les changer. Daru ajoute en note : « (p. 175) On raconte qu'en présence d'un Vénitien un étranger se permit de reprocher au gouvernement de la république l'état de nullité dans lequel il tenait les prêtres, accusant la nation, ou au moins les grands, d'incrédulité, d'irréligion. „ C'est tout au plus “ disait-il, „ s'ils croient au (p. 176) mystère de la sainte Trinité. “ Le Vénitien l'interrompit en lui demandant : „ Et cela vous paraît peu de chose, Seigneur ?“ » – SARPI ; loc. cit., § 2506-4 :« (p. 12). Chap. XXIV. Ils ne permettront pas qu'à l'Office on procède contre des Juifs pour une cause quelconque, ni contre toute autre sorte d'infidèles, de n'importe quelle secte, sous l'inculpation de délit commis en paroles ou en faits... ». « Chap. XXV. Pareillement, ils ne devront pas permettre que l'Office de l'Inquisition procède contre une personne appartenant à une nation chrétienne, laquelle vit tout entière avec ses rites propres, différents des nôtres, et se range sous ses propres prélats, comme les Grecs et autres peuples semblables, même si l'inculpation porte sur des articles reconnus par les deux parties... ». L'auteur explique ensuite ces chapitres : « Chap. XXIV (p. 95) ...L'infidélité n'est pas hérésie, et les transgressions que les infidèles commettent par offense et outrage à la foi n'ont pas besoin d'enquête ecclésiastique... Chap, XXV. En dehors de cet État, l'Office de 1'Inquisition prétend juger les chrétiens orientaux sur n'importe quel article, même là où toute la nation est d'un autre avis que la cour de Rome. Dans cette Sérénissime Puissance, eu égard à la protection que le Prince accorde à la nation grecque, les Inquisiteurs n'étendent pas leurs prétentions si loin. Ils disent seulement qu'on peut tolérer chez les Grecs les trois opinions sur lesquelles ils sont en désaccord avec les Occidentaux, mais que si l'un d'eux émet une opinion inadmissible au sujet des points capitaux sur lesquels leur nation s'accorde avec nous, cela doit être soumis à l'Inquisition. Cette distinction est abusive et non moins contraire à la protection du Prince, que si ces gens étaient jugés sur les trois points où il y a divergence ».
[FN: § 2509-1]
ARIST. ; Rep. Athen., 26.
[FN: § 2509-2]
BFAUCHET ; Hist. du dr. pr. de la rép. Ath., t. I, p. 488 : « Parmi les affranchis faits citoyens, on peut citer, dans la première moitié du IVe siècle avant J. C., les deux banquiers célèbres par les plaidoyers de Démosthène, Pasion et son successeur Phormion... Toutefois la rareté des textes prouve que le droit de cité devait être accordé assez difficilement aux métèques et aux affranchis ».
[FN: § 2511-1]
ARISTOT. ; Polit., III, 1, 10 : ... ![]()
![]() « ... car il inscrivit [parmi les citoyens] beaucoup d'étrangers et d'esclaves métèques ». Cfr. ARISTOT. ; De Rep. Athen., 26.
« ... car il inscrivit [parmi les citoyens] beaucoup d'étrangers et d'esclaves métèques ». Cfr. ARISTOT. ; De Rep. Athen., 26.
[FN: § 2512-1]
Dict. DAREMBERG, s. r. Areopagus: « (p. 397) Les aréopagites se transmettaient les uns aux autres des règles d'honneur et de vertu auxquelles les nouveaux venus s'empressaient de se conformer. Aussi Eschyle n'exagérait pas lorsqu'il parlait de cet auguste sénat, „ envié des Scythes et des Pélopides, véritable boulevard du pays qu'il protège contre l'anarchie et le despotisme, collège d'hommes désintéressés et sévères, graves et honorés,... ».
[FN: § 2512-2]
ARISTOT. ; De Rep. ath. : (23) ![]()
![]() « À cause de ce bienfait [accompli avant la bataille de Salamine], ils se firent déférents envers lui [les Athéniens envers l'Aréopage], et les Athéniens furent gouvernés excellemment et à leur avantage ».
« À cause de ce bienfait [accompli avant la bataille de Salamine], ils se firent déférents envers lui [les Athéniens envers l'Aréopage], et les Athéniens furent gouvernés excellemment et à leur avantage ».
[FN: § 2513-1]
GROTE ; Hist. de la Gr., t. VIII. L'auteur parle du célèbre discours que Thucydide met dans la bouche de Périclès « (p. 180) À cette indulgence réciproque pour les diversités individuelles se rattachait non seulement l'accueil hospitalier qu'Athènes faisait à tous les étrangers, accueil que Periklès met en contraste avec la xenêlasia, ou expulsion jalouse pratiquée à Sparte, – mais encore avec l'activité variée, corporelle et intellectuelle, visible dans la première [résidus de la Ie classe, si opposée à ce cercle étroit de pensée, de discipline exclusive, d'éducation guerrière sans fin [résidus de la IIe, classe], qui formait le système de la seconde... (p. 181) Un idéal si compréhensif d'un développement social à mille faces... serait assez remarquable même si nous en supposions l'existence dans l'imagination d'un philosophe seulement ; mais il le devient bien davantage si nous nous rappelons que les traits principaux du moins en furent empruntés des concitoyens de l'orateur. Toutefois on doit le regardercommeappartenantparticulièrementàl'AthènesdePeriklèsetdeses contemporains. Il n'aurait convenu ni à la période de la guerre des Perses, cinquante ans auparavant, ni à celle de Démosthène, soixante-dix ans après. À la première époque, l'art, les lettres et la philosophie, auxquels Periklès fait allusion avec orgueil, étaient encore en arrière, tandis même que l'énergie active et le stimulant démocratique, bien que très puissants, n'étaient pas encore parvenus au point qu'ils atteignirent plus tard ; à la seconde époque, bien que les manifestations intellectuelles d'Athènes subsistent dans toute leur vigueur et même avec une force accrue, nous verrons l'esprit personnel d'entreprise et l'ardeur énergique de ses citoyens considérablement affaiblis ». L'auteur veut expliquer cela par la guerre du Péloponèse. En réalité, la cause principale est la disparition de l’antique aristocratie, qui est remplacée par celle des démagogues et des sycophantes. Ce n'est pas la guerre du Péloponèse qui obligea les Athéniens à donner la succession de Périclès à un Cléon.
[FN: § 2514-1]
Collect. GUIZOT ; Chronique de GUILLAUME DE PUY-LAURENS : « (p. 206) Or, il y, en avait [des hérétiques] qui étaient Ariens, d'autres Manichéens, d'autres même Vaudois ou Lyonnais ; lesquels, bien que dissidents entre eux, conspiraient tous néanmoins pour la ruine des âmes contre la foi catholique (et disputaient ces Vaudois très subtilement contre les autres : d'où vient qu'en haine de ceux-là, ceux-ci étaient admis par des prêtres imbéciles) ». L'instinct des combinaisons se tournait vers la théologie. Les croisés qui venaient du Nord ne songeaient pas à disputer sur tout cela. « (p. 206) D'abondant, les capelans [les prêtres] étaient auprès des laïques (p. 207) en si grand mépris, que leur nom était par plusieurs employé en jurement comme s'ils eussent été juifs. Ainsi, de même qu'on dit : „ J'aimerais mieux être juif “ ; ainsi, disait-on : „ J'aimerais mieux être capelan que faire telle ou telle chose “ ».
[FN: § 2515-1]
SCHMIDT ; Hist. et doct. de la secte des Cathares ou Albigeois, t. I : « (p. 66) Les hautes classes de la société étaient arrivées à un degré de civilisation unique alors dans l'Europe ; la vie chevaleresque y fleurissait comme nulle part ailleurs, les nombreux et puissants seigneurs partageaient leurs jours entre les chances des combats, et les luttes plus frivoles de l'amour mondain ; poussés plutôt par un besoin irrésistible d'aventures extraordinaires que par une profonde ardeur religieuse, ils se croisaient fréquemment pour la Terre-Sainte, d'où ils rapportaient, au lieu d'émotions plus chrétiennes, une imagination nourrie des splendeurs orientales... (p. 67) D'ailleurs le clergé lui-même était entraîné par cet esprit léger et mondain qui dominait chez les nobles... Dans les villes régnaient des dispositions semblables. Après une lutte vive et longue pour s'affranchir de la domination féodale, les bourgeois finirent généralement, dès la fin du douzième siècle, par triompher de leurs anciens oppresseurs. Enrichies, les unes par leur commerce avec les ports d'Orient, les autres par leur industrie, les villes étaient fières de leur aisance, et défendaient avec un succès croissant leurs libertés municipales. Les bourgeois imitaient les mœurs des nobles ; ils rivalisaient avec eux de courtoisie et de bravoure ; ils étaient poètes comme eux, et devenaient chevaliers, s'ils le voulaient ;... (p. 68) De tout cela était résulté un esprit de liberté et de tolérance religieuse, dont nul autre pays de la chrétienté ne donnait alors l'exemple. Toutes les opinions pouvaient se manifester sans obstacles... ». « (p. 188) À la fin du douzième siècle l'état social et politique du midi de la France était encore le même qu'à l'époque où l'église cathare, sortant de son mystère, s'était publiquement organisée dans ces contrées... Dans les villes, la prospérité croissante des habitants avait développé de plus en plus leur esprit de liberté ; forts de leurs institutions municipales, ils étaient décidés à défendre leur indépendance contre quiconque oserait y porter atteinte. Aux cours des princes, dans les châteaux des nobles, aussi bien que dans les villes, la politesse extérieure des mœurs était arrivée à un point qui remplissait d'orgueil les méridionaux, tandis que les barons plus rudes et plus pauvres du Nord ne jetaient que des regards d'envie sur la vie joyeuse et poétique des chevaliers et sur l'opulence des bourgeois de la Provence. Cette civilisation plus avancée du Midi, jointe à la longue (p. 189) habitude de liberté civile et politique, avait donné naissance à cet esprit de tolérance religieuse qui déjà dans la période précédente avait favorisé à un si haut degré la propagation de doctrines contraires à celles de Rome. Cet esprit avait fini par prédominer au point que non-seulement l'Église cathare existait presque librement à côté de l'Église catholique, mais que les Vaudois avaient pu organiser à leur tour des communautés florissantes ; il y avait des familles nobles, comme celle de Foix, où se rencontraient des membres des deux sectes... La vie frivole et mondaine des laïques avait trouvé des imitateurs dans les ministres de l'Église... Le pape ainsi que les synodes provinciaux ne cessaient de se plaindre de cette décadence ; mais leurs plaintes restaient sans effet... (p. 190) L'anarchie en était venue au point que les veilles des (p. 191) fêtes des saints, le peuple se livrait dans les églises à des danses qu'il accompagnait de chants profanes... Les plus grands scandales étaient donnés par les prélats eux-mêmes ».
[FN: § 2515-2]
RAOUL DE CAEN ; dans la Collect. de mém.... GUIZOT ; Hist. de Tancr: « (p. 129) ...De même que la poule est en tout point le contraire du canard, de même les Provençaux diffèrent des Français par les mœurs, par l'esprit, par toutes les habitudes et la manière de vivre... Du temps de la disette ils rendirent par leur activité beaucoup plus de services que ne le faisaient d'autres races d'hommes plus empressées à combattre... (p. 130) En un seul point cependant ils se livraient beaucoup trop, et d'une manière honteuse pour eux, à leur cupidité ; ils vendaient aux autres peuples de la viande de chien en guise de lièvre, ou d'âne en guise de chèvre... ». L'auteur continue par le récit du cheval ou du mulet, que nous citons dans le texte.
[FN: § 2516-1]
Les auteurs favorables aux croisés du Nord ne peuvent passer sous silence leur cupidité et leur cruauté ; mais, comme d'habitude, ils en rejettent la faute sur la faiblesse humaine. Collect. GUIZOT ; Chronique de GUILLAUME DE PUY-LAURENS : « (p. 264) Il advint l'hiver suivant que Foucaud de Brigier, et Jean, son frère, avec plusieurs autres chevaliers, coururent de rechef par le même pays qu'ils avaient déjà pillé une fois (p. 265) et y firent beaucoup de butin... Ce Foucaud était un homme très cruel et plein d'orgueil, qui s'était, disait-on, fait une règle de mettre à mort tout prisonnier de guerre qui ne lui paierait pas cent sous d'or, lui faisant endurer les tortures de la faim dans une fosse souterraine, et voulant, quand on l'apportait on moribond ou mort, qu'il fût jeté dans un égout... Au demeurant, on ne doit ni ne peut raconter à quelles infamies se livraient les serviteurs de Dieu ; la plupart avaient des concubines et les entretenaient publiquement ; ils enlevaient de vive force les femmes d'autrui, et commettaient impunément ces méfaits et mille autres de ce genre. Or ce n'était bien sûr dans l'esprit qui les avait amenés qu'ils en agissaient ainsi ; la fin ne répondait pas au commencement, et ils n'offraient pas en sacrifice la queue avec la tête de la victime. Somme toute, ils n'étaient ni chauds ni froids, mais parce qu'ils étaient tièdes, le Seigneur commença à les vomir de sa bouche, et à les chasser du pays qu'ils avaient conquis ». Oui, mais en attendant, il le leur avait laissé conquérir ! – H. MARTIN ; Hist. de la Fr., t. IV, p. 204 : « Les pardons pontificaux consistaient dans la rémission de tous les péchés commis depuis la naissance du croisé, et dans l'autorisation de ne payer l'intérêt d'aucune dette, l'eût on promis par serment, pendant la durée de l'entreprise. L'espoir de ne pas payer leurs dettes, et surtout de piller les beaux manoirs et les riches villes de la langue d'oc, était plus que suffisant pour ameuter tous les nobles aventuriers de la chrétienté : qu'on juge de ce que dut soulever le levier du fanatisme ajouté à un si puissant mobile : tout ce que le cœur humain recèle de passions cupides et sanguinaires fut déchaîné avec une épouvantable violence ».
[FN: § 2517-1]
JEAN GUIRAUD ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I « p. CCLXIV) Il y avait donc antagonisme entre la noblesse ecclésiastique et la noblesse laïque, celle-ci essayant de dépouiller celle-là, et celle-là essayant de reprendre à la première les biens usurpés à son détriment. L'hérésie albigeoise tira parti de cet état de choses assez général ».
[FN: § 2518-1]
ÉTIENNE DE BOURBON ; Anecd. hist., § 251 : (p. 213) Audivi a fratribus Provincie quod in terra Albigensium, cum, heretici convincuntur scripturis et racionibus, non habent forcius argumentum ad defensionem erroris sui et subversionem simplicium quam exempla mala catholicorum. et maxime prelatorum ; unde, cum eis deficiunt alia argumenta, adhuc recurrunt dicentes : « Videte quales sunt isti vel illi, et maxime prelati ; videte quomodo vivunt et incedunt, nec sicut antiqui, ut Petrus et Paulus et alii, ambulantes ». Cfr. § 83, p. 79. Ces braves gens qui se plaignaient du clergé corrompu furent emprisonnés, torturés, brûlés par le clergé ascète. Ils gagnèrent beaucoup au changement, en vérité !
[FN: § 2519-1]
JEAN GUIRAUD ; Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I : « (p. CCLXXXVIII)
Relâchement du haut clergé. À vrai dire, c'était par le relâchement de sa discipline et de ses mœurs que le haut clergé favorisait le développement de l'hérésie, beaucoup plus que par une adhésion plus ou moins hypocrite à ses doctrines. Les essais de réforme tentés par les conciles nous montrent toute l'étendue du mal auquel il fallait remédier pour rendre à l'Église, avec des vertus surnaturelles, le moyen de résister à l'ascendant moral que les Parfaits exerçaient sur les foules ». – « (P. CCLXXXIX) Chapelains et hérétiques. Un autre chapelain, celui de Cadenal, habita pendant deux ans, avec un Parfait, l'écuyer Pons, prenant avec lui tous ses repas. Il savait fort bien qu'il était ainsi le commensal d'un hérétique vêtu, mais peu lui importait. Un curé servait de socius à un Parfait ! Le cas n'était pas banal ». Sans les Albigeois et la réaction qu'ils provoquèrent, peut-être aurait-on joui de la liberté de conscience depuis ce temps-là, au moins dans l'Europe méridionale. À peine l'a-t-on obtenue maintenant. – BRUCE WHYTE ; Hist. des langues romanes, trad. franç., t. II : « (p. 193) La conduite des prélats n'était pas seulement une violation flagrante de tout principe de morale ; elle montrait encore manifestement qu'ils regardaient le christianisme comme un simple rituel de cérémonies, comme un masque à la plus vile hypocrisie, comme un dépôt de spécifiques pour le succès ou l'absolution de tous les crimes ». Mais en attendant, sous ces prélats, on souffrait peu ou point de persécution pour ses croyances. Il y en eut, au contraire, une terrible et très cruelle, sous leurs très moraux successeurs. Quant aux crimes, il semble qu'ils furent moins nombreux sous les premiers que sous les seconds. En tout cas, on n'a aucune preuve qu'ils se soient accrus.
[FN: § 2519-2]
DARU ; Hist. de la rép. de Venise, t. IV « (p. 181) La politique du gouvernement parut juger que pour rester soumis il était bon que les gens d'église eussent besoin d'indulgence ; en conséquence on toléra chez eux cette liberté de mœurs dont toute la population de Venise fut toujours en possession ». En note : « (p. 181) Les religieux se permettent ces choses qui ne leur conviennent pas et qui, dans un autre pays, ne seraient pas tolérées de leur part. Ils se soustraient à l'obédience des supérieurs qui ne peuvent les contraindre, et l'autorité des messages apostoliques est sans force contre eux... Au temps des interdits (§ 2506), si la république avait eu tous ses religieux observant leur règle et obéissant à leurs supérieurs, non seulement elle n'aurait pas pu les contraindre à célébrer les offices divins, mais encore il se serait trouvé des prêtres par centaines qui, par les prédications et les harangues, auraient excité la plèbe contre elle. Mais les religions plus haut nommées étant délaissées, tous ses frères et ses prêtres prirent le parti du gouvernement (Relazione della cità Repubblica di Venezia...) ».
[FN: § 2520-1]
Collect. GUIZOT ; PIERRE DE VAULX-CERNAY ; Hist. de la guerre des Albigeois : « (p. 8) Ils disaient de l'église romaine presque tout entière qu'elle était une caverne de larrons, et la prostituée dont il est parlé dans l'Apocalypse... Ils attestaient de plus que la confirmation et la confession sont deux choses frivoles et du tout vaines, disant encore que le sacrement de mariage est une prostitution, et que nul ne peut être sauvé en lui en engendrant fils ou filles... (p. 9) Il faut savoir en outre que certains entre les hérétiques étaient dits parfaits ou bons, et d'autres croyants. Les parfaits portaient vêtements noirs, se disaient faussement [ce faussement semble être une calomnie de l'auteur] observateurs de chasteté, détestaient l'usage des viandes, œufs et fromage, et affectaient de paraître ne pas mentir... Étaient appelés croyants ceux qui vivaient dans le siècle, et bien qu'ils ne cherchassent à imiter les parfaits, espéraient, ce néanmoins qu'ils seraient sauvés en la foi de ceux-ci... (p. 11) Il y avait encore d'autres hérétiques appelés Vaudois, du nom d'un certain Valdo, Lyonnais... Pour ne rien dire de la plus grande partie de leurs erreurs, elles consistaient principalement en quatre points, à savoir : porter des sandales à la manière des apôtres ; dire qu'il n'était permis en aucune façon de jurer ou de tuer, et, en cela, surtout, qu'ils assuraient que le premier venu d'entre eux pouvait, en (p. 12) cas de besoin et pour urgence, consacrer le corps du Christ sans avoir reçu les ordre de la main de l'évêque, pourvu toutefois qu'il portât sandales ».
[FN: § 2520-2]
F. TOCCO ; L'er. nel. m. e., p. 88, 89. – Notes de l'auteur. * MONETA, p. 513 : Isti etiam haeretici omne bellum detestantur tanquam illicittum, dicentes quod non sit licitum se defendere,... p. 515. Obiiciunt etiam illud Matt., V, 38 : « Audistis quia dictum est oculum pro oculo et dentem pro dente. Ego autem dico vobis non resistere malo » ; p. 516. Obiiciunt Matt., XXII, 7 : « Perdidit homicidas illos » ; p. 517 : et illud. Matt., V, 44 : « Benefacite his qui oderant vos ». – SACCONI, dans la Summa, p. 486 : Item quod potestates seculares pecant, mortaliter puniendo malefactores vel haereticos. « Qu'on doive rapporter mortaliter à puniendo et non à peccant, cela est prouvé par Ebard, qui raconte, à p. 157, que les hérétiques avaient l'habitude d'objecter : dictum est non occides ».
[FN: § 2522-1]
SCHMIDT ; loc. cit. § 2515-1, t. II. L'auteur rapporte les divagations des Cathares : « (p. 68) …l’opinion la plus accréditée était que les âmes des premiers hommes ont été des anges. Le démon les enferma dans des corps matériels, pour les empêcher de s'en retourner au ciel ; mais il fallut aussi un moyen de les enchaîner à perpétuité au monde mauvais ; ce moyen, le démon crut le trouver dans la propagation du genre humain par l'union des sexes. Par Ève il se proposa de séduire Adam ; il voulut les faire pécher tous les deux, afin de les rendre ainsi à jamais ses esclaves, et de les ravir au monde céleste. Les ayant donc introduits dans son faux paradis, et leur ayant défendu, pour mieux les exciter, de manger de l'arbre de la science, il entra lui-même dans un serpent, et commença par séduire la femme ; de là l'éveil (p. 69) de la mauvaise volonté, de la concupiscence charnelle et ses suites. Suivant le dualisme mitigé, la pomme défendue n'a pas été autre chose que le commerce de l'homme avec la femme... Le péché de la chair, la „ fornicatio carnalis “ est le vrai péché originel ; c'est le plus grand de tous, car non seulement il a été commis par un effet du libre arbitre, et constitue ainsi une révolte volontaire de l'âme contre Dieu ; mais il est aussi le moyen de perpétuer une race mauvaise, et d'agrandir ainsi le règne du démon. À la fin du douzième siècle quelques partisans du dualisme mitigé en Italie croyaient qu'après avoir formé Ève, le démon eut commerce avec elle, et que Caïn fut leur fils ; du sang de celui-ci naquirent les chiens, dont le fidèle attachement aux hommes doit prouver qu'ils sont d'origine humaine ». Ces gens étaient les dignes prédécesseurs de nos vertuistes. – MONETA ; Adv. Cath. et Vald. : (p. 111) Nunc videndum, est, quod fuerit peccatum Adae secundum ipsos. Ad quod melius intelligendum, sciendum est secundum eos, quod Sathan alium Angelum inclusit in corpore muliebri facto de latere Adae dormientis, cum qua percavit Adam ; fuit autem peccatum Adae, ut asserunt, fornicatio carnalis, dicunt enim, quod semper accessit ad mulierem, et cum cauda corrupit eam, et ex eius coitu cum ipsa natum esse Cain... En note l'auteur cite MOSES BAR-CEPHA, qui écrit : Sunt quidam qui existiment non fuisse arborem id, de quo gustavit Adam, sed venereum amplexum, quo cura uxore ille corpus miscuit... MONETA continue : Dicunt etiam, quod mulier in luxuria assuefacta ad Adam ivit, et qualiter cum ipsa coiret, ostendit, et suasit, et sicut Eva suasit ei, sic Adam opere complevit, et istud esse esum ligni scientiae boni, et mali asserunt... – On trouve aussi des dérivations analogues chez les écrivains catholiques. Des plus étranges est celle qui attribue pour cause à certains péchés sexuels le déluge universel et qu'on lit dans SANCHEZ De sancto matrimonii sacramento disputationum : lib. IX, disp. XVI, p. 215.
Collect. GUIZOT, PIERRE DE VAULX-CERNAY ; Hist. de la guerre des Alb. L'auteur exagère certainement. Son témoignage doit être retenu seulement dans ce sens qu'il existait une grande disproportion entre le nombre des combattants de Montfort et ceux des Provençaux et des Aragonais. « (p. 268) Or, tous les nôtres, tant chevaliers que servants à cheval, n'étaient plus de huit cents, tandis qu'on croyait les ennemis monter à cent mille, outre que nous n'avions que très peu de gens de pied et presque nuls, auxquels même le comte avait défendu de sortir pendant la bataille ».
[FN: § 2523-1]
Collect. GUIZOT ; loc. cit. § 2523-1: « (p. 341) Au moment même où les ennemis faisaient cette sortie, un exprès vint trouver le comte qui... entendait la messe, le pressant de venir sans délai au secours des siens ; auquel ce dévot personnage : „ Souffre, dit-il, que j'assiste aux divins mystères...“, Il parlait encore qu'arriva un autre courrier... ». Le comte voulut demeurer jusqu'à la fin de la messe et dit : « (p. 342) Allons, et, s'il le faut, mourons pour celui qui a daigné mourir pour nous ».
[FN: § 2524-1]
Collect. GUIZOT ; Chronique de GUILLAUME DE PUY-LAURENS. En l'an 1229, le comte Raymond VII se mit à la discrétion du légat du pape et du roi de France. Il accepta un traité de paix tel que l'auteur croit la protection de Dieu sur le royaume de France seule capable de l'avoir suscité. « (p. 282) Mais je ne veux pas manquer de dire que, quand le royaume tomba dans les mains d'une femme et d'enfants, ce que le roi Philippe, leur aïeul, redoutait après la mort de son fils, n'arriva que par la volonté d'en-haut et la bonté du Roi des cieux, protecteur des Français [l'auteur aurait pu ajouter : et des assassins et des voleurs]. En effet, pour les premiers auspices du règne du jeune prince, Dieu voulut à tel point honorer son enfance à l'occasion d'une si longue guerre avec le susdit comte, que, de plusieurs clauses contenues au traité, chacune eût été à elle seule suffisante en guise de rançon, pour le cas où le roi aurait rencontré le dit comte en champ de bataille et l'aurait fait prisonnier ». Ce n'est pas tout : « (p. 281) Le comte fut réconcilié à l'Église la veille de Pâques (12 avril 1229) ; en même temps ceux qui étaient avec lui furent déliés de la sentence d'excommunication. Et c'était pitié que de voir un si grand homme, lequel, par si grand espace de temps, avait pu résister à tant et de si grandes nations, conduit nu en chemise, bras et pieds découverts, jusqu'à l'autel ».
[FN: § 2524-2]
PAUSANIAS (IV, 14) : « Accablés sous le faix, comme des ânes, ils sont dans la dure nécessité d'apporter à leurs maîtres la moitié de tous les fruits produits par leurs champs…. Ils se lamentent, eux et leurs femmes, lorsque la Parque funeste atteint quelqu'un de leurs maîtres ».
[FN: § 2527-1]
Journal de Genève, 17 juillet 1911. On commente et l'on reproduit en partie une étude du Dr E. Labat, sur la natalité en Gascogne. « On tient moins à s'élever qu'à jouir. On songe moins à la destinée du domaine familial, à l'avenir de sa descendance [résidu de la IIe classe] ; on songe beaucoup plus à soi-même. La femme, même la paysanne, redoute les sujétions, les fatigues, les dangers de la maternité, [parce qu'ils sont demeurés les mêmes, tandis que les sentiments qu'on leur opposait ont diminué d'intensité] ; l'homme fuit les préoccupations et les charges. Chacun tient à vivre pour soi, à utiliser à son profit le temps et les ressources dont il dispose [les résidus de la IIe classe ayant disparu, ces buts restent seuls]. Si cette vie est modeste et même étroite, on s'en consolera ; c'est surtout la vie facile, plénière, sans aléa, qui apparaît comme désirable ». « (E. Labat) Il est difficile de ne voir qu'une coïncidence entre la diminution de la moralité et l'affaiblissement du sentiment religieux [c'est la façon ordinaire dont on présente la considération des résidus de la IIe classe], à moins d'écarter les faits ou de leur faire subir quelque violence. Les différents centres de la vie psychique, les modes divers de l'activité de l'âme sont d'ailleurs trop étroitement solidaires pour que des changements aussi importants puissent s'y produire simultanément sans être dans une relation de dépendance. On n'a jamais été très religieux en Gascogne... Malgré tout, jusqu'à ces dernières années, l'imprégnation religieuse était générale, profonde et déterminante... La grossièreté et la misère de l'existence étaient soulevées, éclairées et embellies par un idéal dont on pouvait reconnaître l'origine et le caractère religieux non seulement dans les moments solennels, comme la mort, le mariage, les naissances, mais encore dans la conception de la famille, la notion générale du devoir, la fidélité aux engagements, la gravité du serment, le respect des vieillards, l'accueil réservé aux pauvres [description littéraire du fait des résidus de la IIe classe]. L'inculture morale des jeunes est troublante... Ce qui est précisément inattendu et pénible, c'est le contraste du progrès intellectuel [résidus de la Ie classe] et du recul moral [résidus de la IIe classe]. L'âme du petit paysan offre le spectacle d'un champ dont la moitié serait cultivée et l'autre presque en friche [disproportion entre les résidus de la Ie classe et ceux de la IIe] ».
[FN: § 2530-1]
J. BURCKHARDT ; La civilisat. en Italie au temps de la Renaiss., t. I : « (p. 124) L'Italie... a été la première à employer le système des mercenaires... Elle s'adressa d'abord aux Allemands ; mais à l'époque de la Renaissance, il se forma, au milieu des mercenaires étrangers, de bons soldats italiens. …(p. 125) En somme, les inventions nouvelles [des armes à feu] firent leur chemin, et on les utilisa de son mieux ; aussi les Italiens devinrent~ils les maîtres de toute l'Europe en ce qui concernait la balistique et la fortification. Des princes comme Frédéric d'Urbin et Alphonse de Ferrare acquirent dans ces connaissances spéciales une supériorité qui faisait pâlir même la réputation d'un Maximilien I. C'est l'Italie qui la première (p. 126) a fait de la guerre une science et un art complets et raisonnés ».
[FN: § 2531-1]
J. BURCKHARDT ; La civilisat. en Italie au temps de la Renaiss., t. I : « p. 120) Il n'y a pas ici [en Italie] de système féodal dans le genre de celui du Nord, avec des droits fondés sur des théories respectées [dérivations des résidus de la IIe classe] ; mais la puissance que chacun possède, il la possède généralement, de fait, tout entière. il n'y a pas ici de noblesse domestique qui travaille à maintenir dans l'esprit du prince l'idée du point d'honneur abstrait avec toutes ses bizarres conséquences [autres résidus de la IIe classe et leurs dérivations], mais les princes et leurs conseillers sont d'accord pour admettre qu'on ne doit agir que d'après les circonstances et d'après le but à atteindre [seuls des résidus de la Ie classe, et leurs dérivations]. Vis-à-vis des hommes qu'on emploie, vis-à-vis des alliés, de quelque part qu'ils viennent, il n'y a point cet orgueil de caste qui intimide et qui tient à distance ; surtout l'existence de la classe des condottieri, dans laquelle l'origine est une question parfaitement indifférente [aucune persistance des agrégats], atteste que la puissance est quelque chose de concret, de réel ».
[FN: § 2544-1]
Les termes de la science expérimentale correspondent à la réalité, en des limites plus ou moins étendues ; les termes de la théologie et de la métaphysique n'y correspondent en aucune manière ; ou, si l'on veut, les limites sont tellement écartées que l'approximation devient illusoire. Il existe certainement des choses qui correspondent au terme argile, des individus qui sont jeunes, vieux, des classes sociales, etc. Le doute ne peut porter que sur la limite à laquelle certaines matières n'appartiennent plus à la catégorie des argiles, certains individus à la catégorie des jeunes, certaines personnes à une classe sociale donnée. Mais quant à Zeus, à la justice, au bien, etc., toute correspondance avec la réalité expérimentale fait défaut ; et ce n'est plus de limites qu'il est question.
[FN: § 2546-1]
Ce terme est parmi les plus indéterminés de la sociologie. Nous l'employons ici exclusivement pour désigner un état de fait, sans vouloir le moins du monde en rechercher les causes. Nous ne voulons pas résoudre ce problème : Y a-t-il plusieurs races humaines différentes, et combien ? Comment se mélangent-elles, comment se constituent-elles, comment disparaissent-elles, etc. ? Dans l'antiquité, il y avait des hommes qui s'appelaient eux-mêmes et que d'autres appelaient : Romains, Samnites, Italiens, Hellènes, Carthaginois, Gaulois, etc. De nos jours, il y a des hommes qui s'appellent eux-mêmes et que d'autres appellent : Français, Italiens, Allemands, Slaves, Grecs, etc. C'est exclusivement ce fait, et aucun autre, que nous voulons désigner, quand nous parlons de différences ethniques. Chacun de ces noms désigne un certain nombre d'individus qui, dans une mesure plus ou moins grande, possèdent habituellement en commun certains caractères de sentiments, de pensée, de langue, parfois de religion, etc. Ici, nous acceptons sans autre le fait tel quel. Nous ne voulons nullement en rechercher les causes ou les origines. Nous répétons cela parce qu'il est nécessaire que le lecteur l'ait toujours présent à l'esprit, afin qu'il n'attribue pas au terme ethnique un sens différent de celui dans lequel nous l'employons.
[FN: § 2547-1]
Cours, t. II, 1. II, c. II. Il faut remarquer que l'auteur ne connaissait pas encore la théorie de la mutuelle dépendance des ondulations des phénomènes sociaux exposée ici (§ 2552, 2553), et dont il est nécessaire de tenir compte dans l'histoire de l'évolution des corporations romaines.
[FN: § 2548-1]
MOMMSEN ; Le dr. pub. rom. ; VI-2 ; « (p. 99) [sous la république]. L'individu de la plus basse naissance peut légalement recevoir les droits de chevalier. Mais, dans l'usage, le cheval équestre était donné de préférence aux enfants des vieilles familles... Le droit et le fait subsistent sans changement sous l'Empire ».
[FN: § 2548-2]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., VI-2 : « (p. 111) L'ordo publicanorum n'est jamais identifié avec l'ordo equester, et il ne peut pas l'être. Mais ils sortaient l'un et l'autre de cette classe moyenne formée par l'exclusion des sénateurs des marchés publics et par l'exclusion des centuries équestres du Sénat, et les chefs étaient, en grande partie, les mêmes dans les deux. En ce sens, la direction politico-commerciale des chevaliers appartenait aux publicains, et en outre leur unité les rendait aptes par excellence à la formation de grandes compagnies de commerce ». Voir la suite § 2549-7.
[FN: § 2548-3]
La circulation commence par les esclaves ; elle continue par les affranchis, par les pérégrins, par les étrangers ; elle se poursuit par les chevaliers, par les sénateurs, et arrivera jusqu'aux empereurs. Vers la fin de la République, l'esclave pouvait acquérir la liberté en peu d'années. CIC. ; Phil. VIII, 11 : Etenim, patres conscripti, cum in spem libertatis, sexenio post simus ingressi, diutiusque servitutem perpessi, quam captivi frugi et diligentes solent... Il ne faut pas prendre à la lettre ce terme de six ans. Il était simplement commode pour Cicéron, dans son discours ; mais il ne l'aurait pas employé, si le terme au bout duquel l'esclave sobre et laborieux obtenait la liberté avait été très long au lieu d'être court. Dans un autre passage de Cicéron, il est fait allusion à la rapidité de la circulation en général. Pro L. Cornelio Balbo, 7 : « Avant de traiter du droit et de la cause de Cornelius, il semble utile de rappeler brièvement notre condition commune à tous, afin d'éloigner de la cause la malveillance. Si, juges, chacun de nous devait conserver, de la naissance à la vieillesse, la condition dans laquelle il est né ou a été placé par la fortune, et si tous ceux que la fortune éleva ou qui furent illustrés par leurs labeurs et par leurs œuvres devaient être punis, cette loi ni ces conditions de vie ne paraîtraient plus graves pour L. Cornelius que pour un grand nombre d’hommes sages et énergiques. Si au contraire, par vertu, intelligence et connaissances, un grand nombre se sont élevés du dernier degré des classes et de la fortune, et ont conquis non seulement des amitiés et des richesses, mais de très grandes louanges, des honneurs, de la gloire, de la dignité, je ne comprends pas pourquoi l'envie pourrait offenser la vertu de Lucius Cornelius, plutôt que votre équité venir au secours de sa modestie ». – MOMMSEN explique bien la nature de la noblesse. Le dr. pub. rom., t. VI-2 : « (p. 52) La nobilitas n'est pas sans doute un droit de gentilité comme le patriciat ; mais elle est aussi héréditaire : elle est acquise à la personne, mais elle se transmet à la descendance agnatique du premier acquéreur, ou plutôt c'est chez ses descendants qu'elle commence ; car celui qui n'entre pas dans ce cercle par droit de succession, l'homo novus, n'est pas lui-même nobilis, et il anoblit ses (p. 53) descendants ». « (p. 54) Depuis que les magistratures curules ordinaires de la cité... devinrent accessibles aux plébéiens,... le magistrat acquit avec la magistrature pour lui et sa descendance agnatique les droits... que l'on réunit sous le nom de nobilitas ; .„ l'homme nouveau “ créa dans sa postérité une nouvelle famille de noblesse romaine ». « (p. 56) L'avantage le plus important que procure la nobilitas est aussi celui qui est le moins susceptible d'être déterminé juridiquement. Il consiste en ce que les descendants de l' „ homme nouveau “ sont, comme appartenant à la noblesse héréditaire, sur le pied d'égalité avec les nobles pour la brigue des magistratures et des sacerdoces ».
[FN: § 2548-4]
Le souvenir ne nous a été conservé que de quelques faits, mais il est probable que beaucoup d'autres se sont passés. – PLUTARCH. ; Sulla, 8. L'auteur parle de Sulpicius : « (2) ... il vendait le droit de cité romain aux affranchis et aux étrangers, comptant publiquement le prix devant une table placée sur le forum ». – Marius fit citoyen, en une seule fois, mille habitants de Camerinum. Comme on le lui reprochait, il dit : « que le bruit des armes l'avait empêché d'entendre la loi » (PLUTARCH. ; Marius, 28, 3). – Sulla et Pompée firent citoyens ceux qui leur plaisaient. APP. ; De bell. civil., 1, 100 « [Sulla] ... fit entrer dans le peuple plus de dix mille esclaves des proscrits, choisis parmi les plus jeunes et les plus vigoureux. En leur donnant la liberté, il les fit citoyens romains. On les appela Corneliani, de son nom [qui était celui de leur patron] ». Une loi décréta « que ceux que Pompée avait fait citoyens en particulier, selon l'avis de son conseil, seraient citoyens romains » (CIC. ; Pro L. C. Balbo, 8). – À ce propos, Cicéron insiste beaucoup sur l'utilité pour le peuple romain d'accorder le droit de cité aux gens qui le méritaient. On objectait à Cicéron que les alliés ne pouvaient être faits citoyens sans le consentement de leur nation. Entre autres choses, il répond qu'il serait dur de ne pouvoir récompenser ainsi les alliés, alors qu'on accordait le droit de cité à tant d'autres gens. (9) Nam et stipendiarios ex Africa, Sicilia, Sardinia, ceteris provinciis, multos civitate donatos videmus : et qui hostes ad nostros imperatores perfugissent, et magno usui reipublicae nostrae fuissent, scimus civitate esse donatos : servos denique, quorum ius et fortunae conditio infima est, bene de republica meritos, persaepe libertate, id est, civitate, publice donari videmus. Cicéron cite de nombreux cas où le droit de cité romain fut accordé. Il lui arrive même de dire incidemment : (23) Multi in civitatem recepti ex liberis foederatisque populis, sunt liberati... Ailleurs, (Pro Archia, 10, 25), il dit que si Archias n'avait pas été citoyen romain de par la loi, il aurait facilement pu le devenir par quelque imperator. Pro Archia, 10, 25 : Itaque, credo, si civis romanus Archias legibus non esset, ut ab aliquo imperatore civitate donaretur, perficere non potuit ? Sulla, cum Hispanos et Gallos donaret, credo, hunc petentem repudiasset ?... 10, 26 : Quid ? a Q. Metello Pio, familiarissimo suo, qui civitate multos donavit, neque per se, neque per Lucullos impetravisset ? APP. ; De bell. civil., I, 53, dit qu'à la fin de la guerre sociale, tous les alliés obtinrent le droit de cité, excepté les Lucaniens et les Samnites, qui le reçurent plus tard. Plus loin (55), il remarque que les nouveaux citoyens étaient plus nombreux que les anciens. – FLOR. ; III, 19, remarque avec justesse que les alliés et les Romains ne formaient qu'un seul peuple : quippe cum populus romanus Etruscos, Latinos, Sabinosque miscuerit, et unum ex omnibus sanguinem ducat, corpus fecit ex membris, et ex omnibus unus est... Cependant toutes les cités n'acceptèrent pas le droit de cité. Dans d'autres, un petit nombre de citoyens accomplirent les formalités nécessaires pour l'acquérir. Par exemple, Brundusium devait être demeuré exclus du droit de cité, car Sulla, après son retour de la guerre contre Mithridate, l'exempta d'impôts (APP. ; De bell. civil., I, 79). Carbon créa aussi de nouveaux citoyens. LIV. ; Epit. 1. LXXXIV : Novis civibus senatusconsulto suffragium datum est. – Il est probable que dans toute cette période ce furent surtout les intrigants, les spéculateurs et leurs auxiliaires qui obtinrent le droit de cité. Les gens tranquilles et laborieux, les petits propriétaires, n'auront pas pris la peine nécessaire pour l'obtenir. César fut très large dans l'octroi du droit de cité et des honneurs. SUET. ; Iul. 76 : Civitate donatos et quosdam e semibarbaris Gallorum recepit in curiam. Le triumvirat d'Octave, d'Antoine et de Lépide appela à faire partie du Sénat un grand nombre d'alliés, de soldats, de fils d'affranchis, et jusqu'à des esclaves (DIO CASS., XLVIII, 34, p. 552). Plus tard, Octave, devenu seul maître sous le nom d'Auguste, voulut restreindre le nombre des esclaves auxquels on donnait la liberté ; ce qui faisait partie de son plan de rendre à Rome ses mœurs antiques (DIO CASS. ; LV, 13, p. 786 – SUET. ; Aug., 40). Dans son testament, il recommanda à Tibère de ne pas trop accorder la liberté aux esclaves, et de ne pas trop donner le droit de cité romain (DIO. CASS. ; LVI, 33, p. 832). Mais ces recommandations n'empêchèrent guère que le mouvement ne continuât sous ses successeurs.
[FN: § 2548-5]
DION. HALIC. ; Rom. ant., IV, 24 : « Ils obtenaient [anciennement] la liberté : le plus grand nombre gratuitement, à cause de leur courage et de leur probité. C'était là le meilleur moyen de se soustraire au pouvoir des maîtres. Le plus petit nombre payait son rachat, gagné par un travail licite et juste. Il n'en est pas ainsi de notre temps. Si grande est la confusion et si déshonorantes et viles sont devenues les bonnes mœurs de la République romaine, que certains gagnent par les vois, par les effractions, par la prostitution et par d'autres mauvaises actions, le nécessaire pour racheter la liberté et devenir bientôt citoyens romains. D'autres gens, devenus les témoins et les complices de leurs maîtres dans des empoisonnements, des homicides et des crimes contre les dieux et la République, sont récompensés par leurs patrons avec la liberté ; ... ».
[FN: § 2548-6]
Ce sénat de la République, dont Marcius Philippus dit qu'avec lui on ne pouvait pas gouverner, était le digne précurseur des sénats de l’Empire. – CIC. ; De oratore, III, 1 : Ut enim [L. Crassus] Romam rediit extremo scenicorum ludorum die, vehementer commotus ea oratione, quae ferebatur habita esse in concione a Philippo ; quem dixisse constabat, videndum sibi aliud esse consilium, illo senatu se rempublicain gerere non posse... Les « spéculateurs » et les gens vils, contents de leur état, s'accordent en cela qu'ils évitent l'emploi de la force.
[FN: § 2548-7]
Vers la fin de la République, la classe des chevaliers était en très grande partie composée de « spéculateurs ». Sa puissance et ses déprédations dans les provinces sont bien connues. – FLOR. ; III, 18 : Equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata fortunasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus, peculabantur suo iure rempublicam. Cfr. 2354 1. – CIC. ; In Verrem, III, 72, 168 : Certe huic homini nulla salutis esset, si publicani, hoc est, si equites romani iudicarent. 41, 94 : « Précédemment, quand l'ordre équestre jugeait, même les magistrats déshonnêtes et rapaces, dans les provinces, respectaient les publicains, honoraient tous ceux qui fonctionnaient avec eux. N'importe quel chevalier romain qu'ils voyaient en province, ils le comblaient de bienfaits et de libéralités.. Ils estimaient alors [les chevaliers], je ne sais comment, presque d'un commun vouloir, que quiconque avait cru digne d'offense un chevalier romain, devait être jugé digne d'un mauvais sort par tout l'ordre ». Il n'en est pas autrement aujourd'hui pour nos ploutocrates soutenus par les parlementaires, par les gouvernements et par la magistrature qui en dépend (§ 2262-1).
[FN: § 2548-8]
SALL ; Iug., 41 : Paucorum arbitrio belli domique agitabatur ; penes eosdem aerarium, provinciae, magistratus, gloriae triumphique erant : populus militia atque inopia urgebatur [ceux qui n'étaient ni « spéculateurs » ni auxiliaires des « spéculateurs »]. Praedas bellicas imperatores cum paucis diripiebant : interea parentes, aut parvi liberi militum, ut quisque potentiori confinis erat, sedibus pellebantur. Ita cum potentia avaritia [dérivation éthique habituelle. Mais d'où venait cette puissance ? Elle était achetée dans les comices] sine modo modestiaque invadere, polluere et vastare omnia, nihil pensi neque sancti habere [déclamations éthiques habituelles], quoad semet ipsa praecipitavit [voilà finalement un fait]. – DIOD. ; XXXVI, 3. Ayant fait demander à Nicomède, roi de Bithynie, des auxiliaires pour l'expédition contre les Cimbres, Marius reçut pour réponse que la plupart des sujets de Nicomède avaient été réduits en servitude par les publicains. CIC. ; Pro lege Manilia, 22, 65 : Difficile est dictu, Quirites, quanto in odio simus apud exteras nationes, propter eorum, quos ad eas per hos annos cum imperio misimus, iniurias ac libidines. Quod enim fanum putatis in illis terris nostris magistratibus religiosum, quam civitatem sanctam, quam domum satis clausam ac munitam fuisse ? Urbes iara locupletes ac copiosae requiruntur, quibus causa belli propter diripiendi cupiditatem inferatur. Dans ce discours, Cicéron se montre favorable à Pompée. Dans un autre, le De provinciis consularibus, il veut se concilier les bonnes grâces de César et défend les publicains opprimés – dit-il – par Gabinius ; mais ainsi il confirme indirectement le pouvoir de ces « spéculateurs » : (5, 10) Iam vero publicanos miseros (me etiam miserum, illorum ita de me meritorum miseriis ac dolore) tradidit in servitutem Iudaeis et Syris, nationibus natis servituti. On voit qu'au temps de Cicéron on croyait que les Juifs et les Syriens étaient nés pour être esclaves, et devaient être par conséquent impunément exploités par les publicains. Aujourd'hui, les peuples civilisés ont une opinion semblable pour les peuples qu'ils traitent de sauvages ou de barbares. Ils les abandonnent à leurs « spéculateurs ». Statuit ab initio et in eo perseveravit, ius publicano non dicere ; pactiones sine ulla iniuria factas rescidit : custodias sustulit ; vectigales multos ac stipendiarios liberavit ; quo in oppido ipse esset, aut quo veniret, ibi publicanum, aut publicani servum esse vetuit... Cicéron conclut que le Sénat doit secourir ces bons publicains, malgré la pauvreté du fisc – in his angustiis aerarii. Pourtant Cicéron connaissait bien la mentalité de ses bons amis les publicains. Dans l'une de ses lettres à Quintus, il voudrait que, sans les heurter trop, on empêchât leur avidité de s'étendre démesurément. On croirait entendre quelque brave homme de notre époque écrivant à l'un de ses amis magistrats, et lui conseillant de ménager la chèvre et le chou. – Ad Quint, I, 1, 2 : Quod ego, dum saluti sociorum consulo, dum impudentiae nonnullorum negotiatorum resisto... « (I, 1, 11, 25) Ta volonté et ta sollicitude rencontrent chez les publicains une grande difficulté. Si nous nous tournons contre eux, nous repoussons loin de nous et de la République un ordre qui a bien mérité de nous, et qui par nous est attaché à la République. D'autre part, si nous sommes complaisants envers eux en toutes choses, nous supportons qu'on ruine entièrement les gens que nous devons sauver et protéger ». (§ 2300, 2268, 1713-5, 2178). Illa causa publicanorum quantam acerbitatem afferat sociis, intelleximus ex civibus... – LIV. ; XLV, 18. L'auteur parle des difficultés de percevoir les impôts en Macédoine, et dit de l'impôt des mines : nam neque sine publicano exerceri posse ; et, ut publicanus esset, ibi aut ius publicum vanum, aut libertatem sociis nullam esse. Il fallait de l'argent pour acheter les votes aux comices, et il fallait trouver une manière de s'en procurer. On avait des dons volontaires des provinciaux, le produit des rapines par la ruse, par les armes, par l'usure, etc. Quand on n'achetait pas les votes à Rome, c'était une exception extraordinaire. Cicéron approuve certaines libéralités ; et s'il en condamne d'autres, il paraît être poussé par le désir de faire voir qu'il y a des gens qui s'en abstiennent, ce qui, entre autres, est son propre cas. – CIC. ; De officiis, II, 17, 58. Il commence par dire qu'il faut éviter le soupçon d'avarice. Vitanda tamen est suspicio avaritia. En effet, l'idéal est le spéculateur qui, gagnant beaucoup, dépense beaucoup : tel est aussi notre ploutocrate. Il cite Mamercus, qui fut blackboulé aux élections consulaires, parce qu'il n'avait pas demandé premièrement l'édilité, fonction dans laquelle les dépenses étaient plus grandes. Il dit ensuite qu'on peut aussi faire des dépenses qui ne sont pas approuvées par les gens sages : Quare et, si postulatur a populo, bonis viris si non desiderantibus, attamen approbantibus, faciendum est, modo pro facultatibus, nos ipsi ut fecimus ; et, si quando aliqua res maior atque utilior populari largitione acquiritur, ut Oresti nuper prandia in semitis decumae nomine magno honori fuerunt. Il raconte que L. Philippus, Cotta et Curius se vantaient d'avoir obtenu les premiers honneurs sans frais, et il dit que la même chose luiarriva, qu'il avait fait seulement de modiques dépenses.
[FN: § 2548-9]
CIC. ; Pro M. Fonteio, IV.
[FN: § 2548-10]
Plutarque nous rapporte un fait tout semblable à ceux qui se sont passés de nos jours. Ce fait témoigne de la grande augmentation du prix des immeubles ; augmentation qui est un indice certain de l'accroissement de la prospérité économique. PLUTARCH. ; Marius, 34 Près de Misène, Marius possédait une belle maison, qui avait été achetée par Cornélie pour 75 000 drachmes, et revendue peu après à Lucius Lucullus pour 2 500 000 drachmes. ![]()
![]() « Ainsi s'accrurent rapidement les grandes dépenses, et la prospérité provoqua le luxe en proportion ».
« Ainsi s'accrurent rapidement les grandes dépenses, et la prospérité provoqua le luxe en proportion ».
[FN: § 2548-11]
Caton le Censeur s'en prend aux « spéculateurs », poussé par des motifs éthiques. Comme il arrive habituellement dans des cas semblables, ce fut en vain. Le Sénat défendit les « spéculateurs », comme le font de nos jours les assemblées législatives. PLUTARCH. ; Cat. m ., 19. Caton diminua le prix des travaux affermés ; il accrut celui du fermage des impôts. Le Sénat déclara nuls ces contrats, et les tribuns firent condamner Caton à une amende.
[FN: § 2548-12]
MOMMSEN ; Le droit publ. rom., t. II : « (p. 156) À l'époque de Polybe, c'est-à-dire au commencement du VIIe siècle, la loi voulait, avant l'acquisition du tribunat militaire, au moins cinq et, avant celle d'une magistrature civile, en particulier de la questure, au moins dix années de service accomplies ; ce qui, puisque c'est là la durée générale du service obligatoire dans la cavalerie et que les personnes dont il s'agit servaient sans exception dans la cavalerie, peut encore s'exprimer en disant que la carrière politique ne (p. 157) pouvait commencer qu'après qu'il avait été satisfait au service militaire ». Les dix années pouvaient n'être pas effectives. Suivant Mommsen, « (p. 159) l'âge de quarante-six ans accomplis marquant en principe le terme de l'obligation du service militaire, la (p. 160) preuve du temps de service requis ne doit plus désormais être demandée, et par suite celui qui n'a pas servi pendant les dix années ou qui même n'a pas servi du tout est, à partir de ce moment, éligible ». Cette condition du service militaire cesse d'être légalement obligatoire vers la fin de la République, mais « (p. 162) il était encore d'usage à la fin de la République, chez ceux qui aspiraient à la carrière politique, de ne pas se soustraire complètement au service militaire ». Voir au § 2463-4 la comparaison entre cet état de choses et celui qui régna sous l'Empire.
[FN: § 2548-13]
Le mouvement commence avec Marius, qui composa les légions en grande partie de prolétaires. SALL. ; Iug., 86 : Ipse interea milites scribere, non more maiorum, neque ex classibus, sed uti cuiusque lubido erat, capite censos plerosque. Id factum alii inopia bonorum, alii per ambitionem consulis memorabant ; quod ab eo genere celebratus auctusque erat : et homini potentiam quaerenti egentissumus quisque opportunissumus ; cui neque sua curae, quippe quae nulla sunt, et omnia cum pretio honesta videntur. « ... Certains disaient qu'il avait fait cela parce que les gens aisés manquaient ; d'autres à cause de l'ambition du consul [Marius], car il avait été illustré et élevé aux honneurs par ces hommes. À qui recherche le pouvoir, l'homme le plus nécessiteux convient parfaitement, parce que, ne possédant rien, il ne se soucie pas de ses biens, et tout ce dont on lui donne un prix lui semble honnête ». Cette semence germa et produisit l'Empire. Si l'on s'arrête à ce fait que Marius, chef des prolétaires, ouvrît les milices aux prolétaires et fut le précurseur de César, on a volontiers l'opinion, qui autrefois avait cours, que l'Empire a été le triomphe du peuple luttant contre l'aristocratie. De même, si l'on s'arrête au fait qu'Auguste enleva tout pouvoir aux comices, et qu'il voulait restaurer les coutumes antiques, on estime que l'Empire a été une réaction contre les libertés populaires. Mais si l'on ne s'arrête pas à la surface des choses, et si l'on pénètre un peu plus ces phénomènes si compliqués (§ 2542), on voit aussitôt que les récompenses distribuées aux prolétaires étaient des moyens, et non un but des chefs militaires ; qu'un Marius démocrate en usa aussi bien qu'un Sulla aristocrate, qu'un César et un Octave qui n’appartenaient ni à l'un ni à l'autre de ces partis. Les chefs militaires se servirent à leurs fins des mercenaires, du peuple, du Sénat, des chevaliers, de tous ceux qui pouvaient leur être utiles et qui consentaient à se mettre à leur service. Si, au milieu d'une si grande variété de faits, nous voulons arriver à quelque chose d'un peu constant, nous le trouverons dans la lutte entre les « spéculateurs » et ceux qui détiennent la force, qui savent, qui veulent en faire usage. Ce sont les « spéculateurs » qui triomphent, au temps où Cicéron réprime la révolte de Catilina. Ce sont ceux qui font usage de la force qui triomphent, d'abord avec César, puis avec Auguste.
[FN: § 2549-1]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., VI-2 : « (p. 48) L'ancien système, selon lequel toutes les fonctions publiques étaient ouvertes à tous les citoyens, fut renversé : les magistratures et les sacerdoces furent complètement fermés à ceux qui n'appartenaient pas à une des deux noblesses [la nobilitas, héréditaire, et l’ordre équestre, personnelle ; ou bien : Ordo senatorius, Ordo equester, constituant l’uterque ordo], et, parmi les deux noblesses, il n’y eut qu’une moitié des magistratures et des sacerdoces d'accessibles à chacune ». « (p. 56) La nobilitas devint [sous Auguste]... un ordre sénatorial légalement fermé, une pairie héréditaire ». « (p. 58) L’ancienne nobilitas de la république se maintient en fait à côté de l'ordre sénatorial sous la dynastie Julio-Claudienne. Mais les vieilles familles s'éteignirent rapidement ou furent détruites... à partir des Flaviens, la nobilitas républicaine a, dans l'État romain, une place encore plus restreinte que celle occupée par le patriciat à l'époque moderne de la République ». « (p. 82 1) Les ex-tribuns militaires jouent un rôle saillant dans la chevalerie des derniers temps de la République avant la réforme d'Auguste ». – WALTZING ; Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, t. II : « (p. 7) L'administration romaine fut créée presque tout entière par l'Empire. La république, même à l'époque où elle dominait déjà le monde, n'administrait pas ; elle n'avait que peu de fonctionnaires ou d'agents financiers... Avec l'Empire, l'administration prit un développement rapide et extraordinaire... »
[FN: § 2549-2]
Dict. DAREMB. SAGL. ; s. r. Senatus (CH. LÉCRIVAIN ; « (p. 1195) Auguste constitue définitivement et officiellement un ordre sénatorial, une sorte de pairie héréditaire, ouverte seulement par la concession du laticlave ou l’allectio, qui a le monopole des anciennes magistratures... La nouvelle nobilitas acquiert un nom spécial probablement dès le milieu du Ier siècle, en tout cas officiellement à l'époque de Marc-Aurèle et de Vérus, le nom de clarissimus... appliqué aux hommes, femmes et enfants. Elle comprend les sénateurs, leurs femmes et leurs descendants agnats jusqu'au troisième degré ».
[FN: § 2549-3]
WALTZING ; loc. cit., t. II : (p. 255) Ainsi l'initiative privée fut longtemps [du Ier au IIe siècle] seule à fonder les collèges, même ceux dont les membres étaient au service public ; l'État intervint peu à peu, d'abord pour encourager, ensuite pour établir lui-même les corporations [on observe des faits analogues dans nos sociétés civilisées, au XIXe siècle et au commencement du XXe]... Il faut distinguer deux périodes : l'une de liberté, qui dura à peu près deux siècles, l'autre de servitude, qui commence dans le cours du troisième [périodes ascendantes et descendantes d'une oscillation (§ 2553), analogues à celles que nous observons aujourd'hui]... Durant deux à trois siècles l'État n'usa d'aucune contrainte ; le collège était avant tout une association privée ; il s'organisait avec une liberté presque entière... ». « (p. 258) En résumé, ce qui distingue cette période, c'est un service librement accepté et l'absence de toute contrainte ».
[FN: § 2549-4]
MARQUARDT ; La vie priv. des rom., t. I : « (p. 193) Dans l'ancien droit le commerce était interdit aux sénateurs, le (p. 194) prêt à intérêt était mal famé ; mais Caton l'Ancien déjà faisait le commerce maritime, et qui avait de l'argent le prêtait à intérêt. Les gains, même les plus sordides, n'entraînèrent plus la perte de la considération : on les faisait toutefois réaliser par des fermiers, des affranchis ou des esclaves, et les capitaux des gens riches trouvaient, grâce à ces intermédiaires, des débouchés jusqu'alors inconnus. Cette raison, entre tant d'autres,... peut servir à expliquer comment sous l'Empire l'activité industrielle et commerciale se trouva presque tout entière concentrée aux mains des esclaves et des affranchis ». En note : « Les Grecs et les Orientaux avaient une aptitude toute particulière pour les opérations commerciales. La fortune d'un affranchi (patrimonium libertini, SEN. ; Ep. XXVII, 5) a passé en proverbe sous l'Empire » (§ 2597-3).
[FN: § 2549-5]
DURUY ; Hist. rom., t. V : « (p. 329) ...dans la hiérarchie sociale, beaucoup d'ingénus descendent, beaucoup d'esclaves montent, et ils se rencontrent à mi-chemin de la servitude à la liberté : déchéance pour les uns, progrès pour les autres ». « (p. 636) ...des inscriptions, des enseignes de magasin, des débris parfois informes... attestent cette transformation : la société agricole de Caton l'Ancien devenant la société industrielle de l'Empire [l'auteur oublie les chevaliers et les negotiatores de la fin de la République]. Ce n'était pas moins qu'une révolution économique, par conséquent sociale [pas une révolution, mais une transformation graduelle], qui... (p. 637) modifia profondément la loi civile. La même révolution s'opérait dans toutes les provinces. Voyez au musée de Saint-Germain les nombreux monuments funéraires d'hommes de métiers que les seules fouilles de la Gaule ont déjà mis au jour. Ces monuments attestent deux faits : l'aisance de ces industriels, assez riches pour se construire de coûteux tombeaux, et la fierté de ces représentants du travail libre... ». DION. CASSIUS (LII, 37, p. 690) suppose que Mécène disait à Auguste : « Honore les artisans et ceux qui travaillent utilement ».
[FN: § 2549-6]
FRIEDLÆNDER ; Mœurs rom., t. I : « (p. 60) Jusqu'à Vitellius, les affranchis eurent, en quelque sorte, le monopole des offices de cour, qui avait fait passer dans leurs mains presque tout le pouvoir, depuis Caligula. Vitellius fut le premier qui conféra quelques-unes de ces charges à des chevaliers ». « (p. 63) C'est dans les contrées de l'Orient... la Grèce, l'Asie Mineure, la Syrie et l'Égypte, que se recrutait presque exclusivement, à cette époque, la domesticité du palais impérial, ainsi que celle des autres grandes maisons de Rome. Tandis que le Nord et l'Occident fournissaient surtout les gardes du corps, auxquels les empereurs confiaient la défense de leur personne, ce furent des Grecs et des Orientaux qu'ils choisissaient de préférence pour leur service particulier et la gestion de leurs affaires. On vit ainsi continuellement (p. 64) reparaître au faîte du pouvoir des hommes sortis du sein des nations que l'orgueil romain méprisait le plus profondément, entre toutes. C'est que les Orientaux, comme un des leurs, Hérodien (III, 8, 11), s'est complu à le faire sonner, avaient le plus de sagacité... ». « (p. 80) Les richesses qui affluaient dans leurs mains [des affranchis], par suite de leur position privilégiée, étaient une des principales sources de leur pouvoir. Il est certain qu'à cette époque, où l'opulence des affranchis était devenue proverbiale, (p. 81) très peu de particuliers pouvaient rivaliser, à cet égard, avec cette classe de serviteurs de la maison impériale... Indépendamment de ce que leur rapportaient des postes lucratifs, les affranchis avaient dans les provinces comme à Rome, dans les administrations fiscales comme au service particulier de l'empereur, mille occasions d'accroître leur fortune, en profitant habilement des circonstances, même sans précisément commettre des rapines et des exactions... (p. 83) Possesseurs de si énormes richesses, les affranchis de la maison impériale éclipsaient tous les grands de Rome par leur luxe et leur magnificence ».
[FN: § 2549-7]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : « (p. 103) Pour participer, sous l'Empire, au service avantageux des légionnaires, le détenteur du cheval équestre devait le résigner. Cela s'est souvent produit sous la forme d'une concession immédiate du centurionat de légion faite aux personnes qui sortaient pour cette raison de l'ordre privilégié ».
[FN: § 2549-8]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : Suite de la note du § 2548-2- : « (p. 111) Sous le Principat, la condition (p. 112) juridique des publicani est, dans l'ensemble, restée la même ; mais leur condition pratique se transforma complètement. La réorganisation monarchique de l'État fit de la chevalerie par ses chefs un ordre de fonctionnaires ; sa réorganisation financière permit en principe à l'État de se passer des intermédiaires pour la perception des recettes comme pour les dépenses, et elle enleva par conséquent le terrain à la grande spéculation pratiquée par les chevaliers sous la République ».
[FN: § 2549-9]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : « (p. 162) L'exclusion jalouse de l'ordre sénatorial des fonctions militaires, qui caractérise le Principat depuis les Sévères, est étrangère au système d'Auguste ».
[FN: § 2549-10]
MOMMSEN ; Le dr. publ. rom., t. VI-2 : « (p. 148) Auguste a sans doute retiré aux contubernales, que l'on rencontre encore dans les derniers temps de la République, ce qu'il leur restait du caractère militaire ». En note : « Nous avons montré, dans la théorie de la Capacité d'être magistrat, au sujet du service militaire, que le service en qualité de contubernales s'est maintenu jusqu'à César. Mais il doit avoir perdu de plus en plus son caractère militaire, non pas seulement parce que le service d'un cavalier qui n'était plus dans les rangs n'était pas sérieux, mais parce qu'il y avait, dans la cohors amirorum, de plus en plus des gens. qui ne servaient même pas nominalement... ». « (p. 170) L'accomplissement du service d'officier a pendant longtemps été, sous le Principat, la seule voie donnant accès aux fonctions équestres... (p. 171) Avec le temps, il s'ouvrit, pour entrer dans cette carrière, à côté de la voie militaire, une voie civile. L'existence ne peut en être établie au premier siècle ; mais depuis Hadrien, le service administratif, commencé par le bas de l'échelle, peut conduire, sans service d'officier, aux postes supérieurs... (p. 172) Les objections qui étaient encore opposées du temps d'Antonin le Pieux aux nominations de scribes et d'avocats, s'effacent peu à peu ; le temps où une période préalable d'instruction militaire était imposée aux fonctionnaires administratifs n'est plus ». T. II : « (p. 164)... ce tribunat (p. 165) a essentiellement perdu son importance militaire sous l'Empire, et... s'il n'est pas une fonction nominale,ilyestcependantplutôtunefonctionadministrativequ'unvéritable commandement ». En note : « La rédaction de la loi Julia Municipa1is et les dispositions rapportées [divers exemples cités par l'auteur] montrent que le séjour en province près du gouverneur était tenu pour un service ». L'auteur continue : « Le lien rigoureux établi sous l'Empire entre le service d'officier et la carrière politique est plus apparent que réel ; quant au fond, le service et le commandement militaire ont été un élément beaucoup plus essentiel de cette carrière sous la République, même à sa fin, que sous l'Empire ». MARQUARDT ; L'organ. milit. Sous l'Empire, « (p. 64) le tribunat militaire était donc une sorte de fonction honorifique donnant rang de chevalier ; on comprend que les empereurs aient conféré cette dignité à des personnes qui n'avaient pas l'intention de se vouer à la carrière militaire ; elles se contentaient de servir pendant un semestre (tribunatus semestris), (p. 6,5) puis elles rentraient dans la vie privée, en possession du titre qu'elles avaient ainsi obtenu ».
[FN: § 2550-1]
C'est surtout la sortie de certaines de ces castes qui est interdite ; ainsi celle des décurions et des corporations, parce qu'elles impliquent, dans l'État, des charges très lourdes. Les décurions jouissent de privilèges judiciaires et d'honneurs : cependant, vers la fin de l'Empire, ils fuient la curie autant qu’ils peuvent. Ce mouvement commence bientôt, avec la cristallisation de la société. – ULPIEN, dans le Dig., L, 2, 1 : Decuriones quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis in alia loca transmigrasse probabitur, praeses, provinciae in patrium solum revocare et muneribus congruentibus fungi curet. – Ibidem, 2, 7, (2) : Is, qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurionum honoribus plebeii fungi prohibentur. – WALTZING ; loc. cit. § 2549-1 : « p. 7) Si les empereurs rompirent avec les traditions de la république, c'est qu'ils y furent forcés. L'administration dépend de la constitution politique [rapports de cause à effet substitués à ceux de mutuelle dépendance]. Or, la révolution qui était en germe dans les réformes d'Auguste, quoiqu'elle ait mis trois siècles pour arriver à son complet développement ; ou mieux, pour se débarrasser de ses apparences demi-républicaines, peut se résumer ainsi : tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'Empereur ». « (p. 260) À Rome, l'absence de liberté économique fut une conséquence du manque de liberté politique. Ce fut le despotisme et la centralisation excessive qui tuèrent la liberté du travail ». Il n'est pas du tout certain que l'absence de liberté économique soit une conséquence de l'absence de liberté politique ; souvent, au contraire, la diminution de la première liberté coïncide avec une augmentation de la seconde. Pour le prouver, il suffit de citer l'exemple des peuples civilisés de notre époque, chez lesquels la liberté politique s'accroît, tandis que la liberté économique diminue (§ 2553-1). Notre ploutocratie démagogique a appris à se servir de la « liberté » et peut-être aussi de l'anarchie politique comme d'un instrument profitable. Nombre d'auteurs du temps présent sont poussés à rejeter la faute de la décadence de l'Empire romain sur le « despotisme » impérial, parce qu'ainsi ils détournent leurs regards d’une décadence analogue, à laquelle pourrait conduire le régime ploutocratique démagogique. Les corporations fermées de l'Empire romain et les monopoles d'État étaient un mal ; les syndicats obligatoires qu'on veut imposer aujourd'hui, et les monopoles d'État qu'on institue en nombre toujours croissant sont un bien. La cause de la différence, c'est le « despotisme » impérial. On a trouvé le bouc émissaire. L’auteur réfute lui-même sa thèse d'une organisation imposée par le despotisme impérial. « (p. 17) Est-ce à dire que le service de ces collèges fut dès le début une véritable corvée imposée et exigée comme l'impôt ? Non, ce système se développa lentement [on parcourt la courbe descendante d'une des oscillations mentionnées au § 2553]. Dans les premiers siècles, les dignités municipales n'étaient pas imposées non plus : elles étaient recherchées, au contraire, parce que l'honneur compensait la peine et la dépense [§ 2607-3]. Pour les corporations aussi, les avantages l'emportèrent au commencement sur les charges, et c'est sans répugnance que leurs membres acceptèrent, soit collectivement, soit individuellement, de servir l'État ou les villes, et consentirent à remplir une fonction spéciale que l'État aurait pu imposer à tous les contribuables ». Donc, s'ils ont « accepté » cette organisation et s'ils ont donné leur « consentement », on ne peut pas dire que cela leur a été imposé par le despotisme impérial. Aujourd'hui aussi, les citoyens « acceptent » ; ils veulent même les chaînes dont la ploutocratie démagogique profite. Ce que dit Waltzing dans le passage suivant, de l'Empire en décadence, on peut le répéter mot pour mot de l'état de choses vers lequel s'acheminent les peuples civilisés : « (p. 261) Peu à peu, cette administration si fortement organisée, qui avait ses agents partout [qu'on la compare avec l'énorme augmentation du nombre d'employés de nos gouvernements] et se mêlait de tout [pourtant pas de ce que mangeaient et buvaient les citoyens ; l'antialcoolisme est une maladie moderne] couvrit l'Empire tout entier. La population tout entière fut soumise à des fonctionnaires sans responsabilité sérieuse. S'occupant elle-même de tout, l'administration impériale commença par tuer le peu d'initiative privée que l'état social des Romains rendait possible, parce que là où le pouvoir fait tout, le citoyen ne fait plus rien et se désintéresse ». Il continue en disant : « Puis elle anéantit toute liberté, parce que personnes, et biens étaient à sa merci [comme ils sont à la merci des majorités parlementaires manipulées par nos ploutocrates démagogues], et elle facilite cette épouvantable oppression financière qui est restée célèbre [et qui peut-être sera dépassée par celle à laquelle s'acheminent nos sociétés] ». Ici, il y a une erreur. Ce n'est pas l'administration impériale qui anéantit la liberté des citoyens. C'est plutôt parce que celle-ci avait disparu que celle-là put exister. Tibère entrevoyait le fait quand il disait des sénateurs : « Oh ! hommes disposés à la servitude ! » – Memoriae proditur Tiberium, quoties curia egreditur, graecis verbis in hunc modum eloqui solitum : « 0 homines ad servitutem paratos ! » (TACIT. ; Ann., III, 65). – La liberté meurt le jour où les citoyens acceptent, invoquent les chaînes, et non celui où on leur impose ce qu'ils ont demandé, ni celui où ils en subissent les conséquences. Parmi les forces qui agissent sur l'homme, il en est une qui le pousse à conserver la liberté de ses actes, et beaucoup d'autres qui le poussent à les entraver, par intérêt, par ascétisme, par désir d'uniformiser les lois, les mœurs, etc. Suivant l'intensité diverse de ces forces, les peuples disposent de plus ou moins de liberté. Si les ascètes et les jurisconsultes ont été et sont encore parmi les plus grands destructeurs de la liberté, c'est parce que les citoyens se laissent amorcer par le désir d'imposer à tout le monde un genre de vie uniforme, au prix de n'importe quelles souffrances physiques et morales ; et ils ne se rendent pas compte, ils ne veulent pas se rendre compte que ceux qui sont aujourd'hui les oppresseurs demain seront les opprimés.
[FN: § 2550-2]
Remarquables sont les analogies entre cet état social et celui de la Chine quand elle fut conquise par les Tartares. Mais ceux-ci s'assimilèrent aux vaincus beaucoup plus que les Barbares qui envahirent l'empire romain. Ils adoptèrent leurs institutions au lieu de les détruire et de faire disparaître la rigidité sénile de la nation. C'est pourquoi la Chine continua à être un pays pacifique. Cela explique en partie son sort actuel, si différent de celui du Japon. Les Européens contemporains qui rêvent de « la paix par le droit », qui imaginent un état social où « civilisation, justice, droit » assureront les nations contre l'oppression de leurs voisins, sans qu'elles aient besoin de défendre leur indépendance par les armes, ces braves gens peuvent trouver dans l'histoire de la décadence de l'empire romain, surtout dans celle de l'empire d'Orient et dans celle de la Chine, de nombreux indices de ce que sera réellement l'état auquel ils veulent acheminer leurs nations. On sait que les Chinois, tout comme nos pacifistes, estimaient qu'un peuple devait faire plus grand cas de sa civilisation que de sa puissance militaire. C'est pourquoi, dans leur histoire légendaire, ils parlent de peuples soumis à la Chine, non par la force des armes, mais par respect pour les vertus du gouvernement chinois. Par exemple, Hist. gén. de la Chine ou Annales de cet Empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, t. I « (p. 49) La cinquième année du règne de Yao, Yuei-chang-chi, prince d'un pays situé au midi de la Chine, sur la seule réputation de l'empereur, et charmé des grandes choses qu'il entendoit dire de lui, se fit une gloire de venir se soumettre à ses loix, et de le reconnoître pour son souverain... ». « (p. 221) La sixième année du règne de Cao-Tsong, six royaumes étrangers, dont la langue était inconnue à la Chine, envoyèrent des ambassadeurs, qui avoient avec eux chacun leur interprète, pour rendre hommage à Cao-Tsong, et se soumettre à ses loix ». Cfr. p. 274, 316, et passim. La légende veut aussi que des rebelles aient été soumis par la vertu seule. Un certain Yeou-miao se révolta contre l'Empereur, qui envoya contre lui Yu avec la troupe : « (p. 105) Yu partit à la tête de ses troupes, et comme il vouloit éviter d'en venir aux mains, pour épargner le sang, il se contenta de le tenir assiégé dans son gouvernement ; il se passa plus d'un mois sans qu'il parût que Yeou-miao, ni les révoltés se disposassent à se soumettre, ce qui causoit du chagrin à Yu. Pé-y qui accompagnoit Yu dans cette expédition, s'en apercevant, lui tint ce discours : „ La seule vertu peut toucher le Ciel, il n'y a point de lieu, quelque éloigné qu'il soit, où elle ne pénètre... “ ». C'est ainsi que dissertent aujourd'hui nos humanitaires, sauf qu'ils invoquent le droit, la justice, la démocratie, au lieu du Ciel. « (p. 106) Yu, pénétré de la sublimité de ces paroles, pour témoigner à Pé-y combien il en étoit touché, ordonna, sur le champ, à ses troupes de se retirer et les fit camper dans un endroit fort éloigné de Yeou-miao [c'est ainsi qu'agissent nos humanitaires en cas de grève ; mais la réalité leur est habituellement moins favorable que la légende ne le fut à Yu]... Au bout de soixante-dix jours, Yeou-miao, et les autres rebelles vinrent se soumettre ». – En des temps plus historiques, en l'an 731 de notre ère, le roi Tsan-pou envoya une ambassade à l'empereur Hiuen-Tsong, pour lui demander les livres sacrés de la Chine. « (t. VI, p. 220) Yu-hiou-lieï, qui avoit soin de ces livres, lui représenta, à cette occasion, que quoique le prince de Tong-ping fût parent assez proche de la famille des Han, cependant ils lui avoient refusé les livres d'histoire qu'il demandoit ; qu'à plus forte raison on ne devoit pas en accorder au prince de Tou-san, ennemi de la Chine, parce que ce seroit lui procurer les moyens d'apprendre la manière de bien gouverner, et lui fournir des armes contre l'empire. Hiuen-Tsong, arrêté par cette objection, proposa l'affaire à son conseil, qui fut d'avis de donner ces livres au roi Tsau-pou, afin qu’il pût s'instruire des sages maximes qu'ils renferment, et il décida que non seulement il n'y avoit point d'inconvénient, mais qu'il étoit même nécessaire de les accorder, afin que ce prince y puisât les grands principes de droiture, de bonne foi et de vertu qu'on doit chercher à faire connoître à tout le monde. L'empereur suivit la décision de son conseil ». Cette controverse sur la vertu des livres de morale, qu'on estime capables de donner force et pouvoir à une nation, est digne de nos « intellectuels », qui substituent simplement les maximes de leur « droit international », ou d'autres semblables, à celles des livres chinois.
[FN: § 2551-1]
WALTZING ; loc. cit. § 2549-1, t. II « (p. 263) Le mouvement ascensionnel, qui renouvelle et maintient la classe moyenne et la classe supérieure, était arrêté ». « (p. 303) ...bientôt [après Constantin] les hommes seront partout liés à leur condition avec leurs biens et leur famille. Ce furent probablement les curiales qui se virent d'abord soumis à cette loi ; peu à peu, elle fut appliquée à toutes les conditions [de même aujourd'hui on a commencé à exploiter les gens aisés ou riches ; plus tard on exploitera les autres]. On naissait curiale, membre d'une corporation, employé d'un bureau, soldat d'une cohorte, colon d'un champ. On était forcé de succéder aux charges de ses pères. Presque tous les habitants de l'Empire sont assujettis de par leur naissance à une condition déterminée : obnoxii condicioni, condicionales, originarii ». Ainsi disposait la loi, mais en pratique la faveur de l'empereur permettait une certaine circulation : « (p. 318) Ces faveurs spéciales ne devaient pas être rares ; ce qui le prouve, c'est le grand nombre de lois où les princes défendent de leur adresser des suppliques pour obtenir un pareil rescrit [qui dispensait de la condition imposée par la loi]. C'est surtout par la protection des grands [aujourd'hui : la protection des politiciens] que l'on parvenait à les arracher au prince, soit que l'empereur cédât à leurs sollicitations, soit qu'il se laissât tromper par les ruses des corporati et de leurs protecteurs ».
[FN: § 2552-1]
Après avoir tenté d'expliquer par des considérations sur les mœurs les changements du luxe à Rome (§ 2585-3-), TACITE émet un doute qui le rapproche beaucoup de la réalité. Ann., III 55 : Nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis, ut, quemadmodum temporum vices, ita morum vertantur : nec omnia apud priores meliora... « à moins que ce ne soit peut-être le propre de toutes les choses de parcourir un cycle, de telle sorte que les mœurs changent comme les vicissitudes des temps ; tout n'était pas meilleur chez les anciens... ».
[FN: § 2553-1]
Ainsi que nous l'avons dit si souvent, les faits du présent servent à comprendre ceux du passé, et vice-versa. C'est pourquoi il est bon de prêter attention à l'exemple contemporain de la Suisse. Cet État fédéral est admirable en ce qu'il a fait vivre en parfaite harmonie et en parfait accord trois races ailleurs hostiles ; l'allemande, la française, l'italienne. On le doit non seulement aux mœurs du peuple, qui sont les meilleures d'Europe, mais surtout à l'indépendance des Cantons. Elle a supprimé les contrastes qui, en d'autres États, apparaissent entre différentes nationalités ; elle a permis à chacune de vivre selon ses goûts, sans être gênée par ceux des autres. Mais, depuis quelques années, il se dessine un mouvement qui s'accélère toujours plus, de centralisation politique et administrative, d'affaiblissement de la liberté des Cantons et des individus, d'entreprises et de monopoles fédéraux, de cristallisation des institutions judiciaires, économiques, sociales. Ce mouvement est en partie semblable à celui qui s'accomplit en France, en Angleterre, en Italie, sous les auspices et en faveur de la ploutocratie démagogique. Pour le moment, on ne perçoit que son premier effet : celui d'accroître la prospérité des pays où il se produit, en absorbant la somme d'énergies sociales et économiques accumulées par les efforts des particuliers, dans la période de liberté. Précisément à cause de cet effet, le mouvement est bien accueilli, favorisé par la majorité des personnes auxquelles on impose de nouveaux liens. Pour l'Empire romain de la décadence, on peut se demander s'il en a vraiment été de même, et si les liens n'ont pas été imposés par les empereurs qui gouvernaient avec la force des légions. Pour la France, l'Angleterre, l'Italie, ce doute disparaît en partie ; mais il n'est pas entièrement dissipé, car on peut objecter que les parlements ne représentent pas précisément les tendances des citoyens. Pour la Suisse, aucun doute n'est possible. On remarquera, en effet, que dans ce pays aucun changement ne peut être apporté à la Constitution fédérale, s'il n'est approuvé par la majorité des citoyens électeurs et des Cantons. C'est donc avec le plein consentement des uns et des autres que se désagrège l'ancienne organisation, qui apporta tant de prospérité, tant de paix, tant d'harmonie au pays, et c'est avec ce consentement qu'on en institue une nouvelle. Si le sens du mouvement demeurait toujours le même, ce qui peut encore ne pas arriver, cette organisation nouvelle aboutirait à un État centralisé, gouverné par la partie la plus nombreuse, la partie allemande, avec des procédés de gouvernement analogues à ceux de l'Empire allemand. Peut-être aussi ferait-elle surgir l'irrédentisme, qui, jusqu'ici, est parfaitement inconnu dans le pays. Ces faits, qui se passent sous nos yeux, confirment la conclusion à laquelle nous a conduit l'examen direct de l'histoire de la décadence de l'Empire romain : que la cristallisation des institutions fut voulue, ou du moins consentie par la population, plutôt qu'imposée par le gouvernement impérial.
[FN: § 2553-2]
L'analogie est peu frappante, mais pourtant notable, entre la façon dont certains empereurs romains achetèrent le pouvoir des prétoriens ou des légions, et la façon dont les politiciens achètent le pouvoir des électeurs, dans la ploutocratie démagogique contemporaine. Pourtant, aujourd'hui, ces opérations se recouvrent du moins de certains voiles ; à Rome, ils furent au contraire brutalement déchirés, lorsque après l'assassinat de Pertinax, les prétoriens mirent l'Empire aux enchères. DIO CASS. ; LXXIII, 11, p. 1234 : ![]()
![]()
![]()
![]() . « Alors se passa une chose honteuse et indigne de Rome. Comme sur une place publique et dans un marché, elle et tout son empire furent mis aux enchères ». Didius Julianus acheta l'Empire. Dion dit de lui qu'il « était toujours disposé à de nouvelles entreprises » (p. 1233). En cela il était semblable à nos ( spéculateurs ».
. « Alors se passa une chose honteuse et indigne de Rome. Comme sur une place publique et dans un marché, elle et tout son empire furent mis aux enchères ». Didius Julianus acheta l'Empire. Dion dit de lui qu'il « était toujours disposé à de nouvelles entreprises » (p. 1233). En cela il était semblable à nos ( spéculateurs ».
[FN: § 2553-3]
Les grosses dépenses s'étendaient à toute l'administration. LUIGI LUZZATTI ; Corriere della Sera, 3 septembre 1915 : « ... Lorsqu'il était chancelier de l’Échiquier, Lloyd George ne faisait pas d'économies. Il taxait avec facilité, mais augmentait trop l'administration et ses organismes. Ce fut lui qui permit que, des 400 livres sterling d'indemnité accordée à chaque membre de la Chambre des Communes, 100 livres fussent défalquées pour l'impôt sur le revenu, ce qu'on ne voulut pas faire en Italie. Ensuite, les dépenses pour les ministres s'accrurent notablement aussi. Au lieu d'un seul, on ajouta un second fauteuil ministériel, avec 5 000 livres sterling de traitement, etc., etc. On rapporte des cas singuliers, ressemblant un peu aux dépenses pour la péréquation des impôts fonciers en Italie. La commission qui évalue les revenus fonciers, dans le but de taxer ce qui n'est pas le produit du travail ou du capital, mais des circonstances favorables, coûte déjà 676 mille livres sterling, et a recueilli jusqu'à présent un produit de 50 mille livres ! [On institue de semblables commissions pour faire gagner ses amis et pour donner une satisfaction aux instincts démagogiques. En cela, la commission mentionnée a atteint son but]. Le 29 juin, cette énormité fut mise en lumière à la Chambre des Communes, et discutée sans aucune conclusion [parce que les loups ne se mangent pas entre eux]. Les administrations locales imitent le gouvernement. Par exemple, – chose excellente, mais en des temps de paix profonde – on crée des réseaux complets de routes indépendantes pour les automobiles ; et le subside de l'État au budget atteint presque un million et demi de livres sterling par année... ».
[FN: § 2553-4]
C'est à peu près ce que semble avoir compris Foscolo, lorsque, dans I sepolcri , il écrit que Machiavel « fait connaître aux gens les larmes et le sang dont dégoûte le sceptre des souverains ».
[FN: § 2553-5]
[NOTE DU TRADUCTEUR] G. LE BON ; Les Opinions et les croyances ; « (p. 136) En économie politique, par exemple, les convictions sont tellement inspirées par l'intérêt personnel qu'on peut généralement savoir d'avance, suivant la profession d'un individu, s'il est partisan ou non du libre-échange ».
D'une façon générale, la lecture des ouvrages de G. Le Bon sur la psychologie des collectivités sera des plus profitables, en particulier pour l'étude des résidus et des dérivations. La méthode vraiment scientifique de cet auteur, son originalité, sa pénétration, ainsi que la clarté et la concision de ses écrits, le placent tout à fait en dehors de la foule des sociologues-métaphysiciens de nos temps.
[FN: § 2556-1]
LIV. XLII, 32 : ... et multi voluntate nomina dabant, quia locupletes videbant, qui priore macedonico bello, aut adversus Antiochum in Asia, stipendia fecerant.
[FN: § 2557-1]
Cicéron nous parle d'un cas dans lequel il y avait une telle concurrence pour acheter les suffrages, que l’intérêt de l'argent monta du 4 au 8 %. – CIC. ; Ad. Att. ; IV, 15 : Sequere nunc me in campum. Ardet ambitus ; ![]() : fenus ex triente idibus Quinctilibus factum erat bessibus. Dices, istuc quidem. non moleste fero. O virum ! o civem ! (§ 2257 2, 2256 2]. – PLUTARCH. ; Sulla, 5, 4 : « Quand il [Sulla] exerçait la préture, parlant avec indignation contre César, il dit qu'il userait contre lui du pouvoir de sa fonction. César répondit en riant : „ Tu dis avec justesse ta fonction, puisque tu l'as achetée “ ». – Marius fat aussi accusé d'avoir acheté les suffrages pour obtenir la préture. PLUTARCH. ; Marius, 5, 2. – APP. ; De bell. civil.., II 19 : « ... et le peuple lui-même était aux marchés comme une marchandise ». Cfr. 2548-8.
: fenus ex triente idibus Quinctilibus factum erat bessibus. Dices, istuc quidem. non moleste fero. O virum ! o civem ! (§ 2257 2, 2256 2]. – PLUTARCH. ; Sulla, 5, 4 : « Quand il [Sulla] exerçait la préture, parlant avec indignation contre César, il dit qu'il userait contre lui du pouvoir de sa fonction. César répondit en riant : „ Tu dis avec justesse ta fonction, puisque tu l'as achetée “ ». – Marius fat aussi accusé d'avoir acheté les suffrages pour obtenir la préture. PLUTARCH. ; Marius, 5, 2. – APP. ; De bell. civil.., II 19 : « ... et le peuple lui-même était aux marchés comme une marchandise ». Cfr. 2548-8.
[FN: § 2558-1]
DIOD. SIC. ; XXXV11, 2 : L'auteur parle de la guerre marsique : « La première cause de la guerre fut que les Romains passèrent de la vie ordonnée, frugale et continente, qui leur procura une si grande prospérité, au luxe funeste et à l'insolence ». Cela se répète dans tous les temps où un peuple s'enrichit. Cfr. DANTE ; Parad., XV, 97 et sv. ; Boccace, VI, 10 : « pource que les raffinements du luxe d'Égypte n'étaient pas encore, sinon en petite partie, passés en Toscane, comme ils y sont venus depuis en foule, au grand dommage de l'Italie » (Trad. F. REYNARD).
[FN: § 2560-1]
DURUY ; Hist. des Rom., t. II. Il continue : « (p. 283) Voilà le grand fait de cette période et la cause de tous les bouleversements qui vont (p. 284) suivre [très bien, pourvu qu'on entende le changement de proportion des deux classes indiquées] ; car, avec cette classe, disparurent le patriotisme, la discipline et l'austérité des anciennes mœurs... » C'est là. une dérivation éthique renfermant un brin de vérité : une allusion à la prédominance des résidus de la Ie classe.
[FN: § 2561-1]
MARQUARDT ; La vie privée des R., t. II : (p. 15) Tandis que l'acquisition des provinces causait en Italie cette crise agricole, elle imprimait en même temps au commerce de l'argent et à la spéculation une extraordinaire impulsion. De tout temps les Romains eurent du goût pour les profits de cette sorte : ils avaient beau les juger indécents et odieux, ils ne pouvaient s'empêcher de les trouver abondants à souhait... À plus forte raison le scrupule moral s'est-il apaisé quand les provinces s'ouvrent à ce genre d'exploitation : à peine une nouvelle province est-elle conquise, qu'elle voit s'abattre une nuée de traitants romains... (p. 16) La noblesse fait fortune en administrant les provinces ; les chevaliers, en prenant à ferme les impôts et les faisant rentrer par d'atroces exactions : grands et petits pressurent à l'envi les pays conquis. La spéculation est encore encouragée par les concessions d'entreprises, ouvertes par les censeurs au nom de l'État, ou même par les communes et les simples particuliers : perception des impôts, construction de temples, de routes et d'aqueducs, entretien des édifices publics, des ponts et des égouts, fournitures à l'usage du culte et des jeux publics, puis encore affaires privées de toutes sortes, construction d'une maison, enlèvement d'une récolte, liquidation d'une masse successorale ou d'une distribution entre créanciers, cérémonie des obsèques ; autant de travaux concédés à forfait et riches de profit pour le spéculateur qui les prend à entreprise ». Ici Marquardt tombe dans l'erreur habituelle des éthiques qui s'imaginent que l'odieux spéculateur gagne toujours. Oui, ces travaux procurent des gains et la prospérité au spéculateur expert, habile dans les combinaisons ; ils provoquent des pertes et la ruine au spéculateur inexpérimenté, qui n'a pas d'aptitudes pour trouver et utiliser les combinaisons. De la sorte, il se fait un choix. Les individus possédant des résidus de la Ie classe et une grande ingéniosité s'élèvent ; les autres sont éliminés.
[FN: § 2561-2]
DELOUME ; Les manieurs d'argent à Rome : « (p. 45) ...Les chevaliers surtout, qui avaient quelques avances et que les préjugés aristocratiques n'arrêtaient pas, s'enrichissaient par les entreprises ou les fermages de l'État dont ils se rendaient adjudicataires. L'or des vaincus entrait sans mesure dans les coffres des negotiatores et des publicains. Les patriciens de race fidèles aux anciennes mœurs, dont le nombre diminuait tous les jours, étaient réduits aux seuls bénéfices de l'agriculture ; ils furent débordés de toutes parts. Ils abandonnaient, après des résistances héroïques et des prodiges d'habileté, chaque jour un nouveau privilège à la plèbe [en réalité : aux bandes dirigées par les spéculateurs]. Leurs patrimoines perdaient leur valeur relative, et les droits enlevés à la naissance, la fortune les conquérait par le fait des mœurs, autant que par celui des lois. Le siège de l'autorité et de l'influence se déplaçait ainsi ; il passait... des patriciens aux riches, aux homines novi. La morale de l'intérêt menaçait de n'être plus tempérée par les traditions de famille et de race [la proportion des résidus de la Ire et de la IIe classe change]. Aussi, on a pu appliquer aux assemblées politiques de Rome, ce que M. Guizot a écrit de celles de l'Angleterre : „ Dans un des premiers parlements du règne de Charles I, on remarquait avec surprise que la Chambre des communes était trois fois plus riche que la Chambre des lords... Les simples gentilshommes, les francs-tenanciers, les bourgeois, uniquement occupés de faire valoir leurs terres, leurs capitaux, croissaient en richesse, en crédit, s'unissaient chaque jour plus (p. 46) étroitement, attiraient le peuple entier sous leur influence...“ … À Rome, la révolution fut plus complète encore qu'en Angleterre ».
[FN: § 2562-1]
M. Emilius Scaurus est un type de spéculateur romain qui, mutatis mutandis, présente cependant des ressemblances avec les nôtres. Il était gendre de Sulla, et il semble qu'il n’a pas abusé de cette parenté pour s'enrichir. CIC. ; Pro M. Aemilio Scauro Argumentum ; M. Scaurus, M. Securus filius, qui princeps senatus fuit, vitricum habuit Sullam : quo victore et munifico in socios victoriae, ita abstinens fuit, ut nihil neque donare sibi voluerit, neque ab hasta emerit. Plusieurs de nos spéculateurs agissent de même et sont honnêtes dans les affaires privées. Parvenu à l'édilité, il fit comme les spéculateurs romains et les nôtres qui sèment pour moissonner. Aedilitatem summa magnificientia gessit, adeo ut in eius impensas opes suas absumpserit, magnumque aes alienum contraxerit. Les spéculateurs romains dépensaient leur argent. Les nôtres dépensent celui des contribuables ; mais en cela ils ont été devancés par Périclès. ARIST. ; ![]() , 27. L'auteur nous dit que Périclès n’étant pas suffisamment riche pour lutter de libéralité avec Cimon (lutte habituelle entre les parvenus et ceux qui possèdent une fortune de famille), imagina de faire des cadeaux aux citoyens avec leur propre argent. Pline décrit la magnificence d'un théâtre édifié par Scaurus pendant son édilité. Contrairement à ce qui est dit plus haut, il semble faire remonter à Sulla la puissance de Scaurus. – PLIN. ; Nat. hist., XXXVI, 24, 10 (XV) Non patiar istos duos Nerones, ne hac quidem gloria famae frui : docebimusque etiam insaniam eorum victam privatis operatibus M. Scauri, cuius nescio an aedilitas maxime prostraverit mores [toujours le fait particulier substitué au fait général, l'anecdote aux uniformités générales, le rapport de cause à effet à la mutuelle dépendance], maiusque sit Sullae malum, tanta privigni potentia, quam proscriptio tot milium. Hic fecit in aedilitate sua opus maximum omnium, quae umquam fuere humana manu facta, non temporaria mora, verum etiam aeternitatis destinatione. Theatrum hoc fuit. Le grain produit la moisson. – Arg. cit. : Ex praetura provinciam Sardiniam obtinuit – puis on récolte –in qua neque satis abstinenter se gessisse existimatus est et valde arroganter : quod genus morum in eo paternum videbatur, cum cetera industria nequaquam esset par. Accusé de ce fait à Rome, il fut défendu par Cicéron, qui le savait pourtant coupable. Quand cet orateur s'apprêtait à le défendre, il écrivaità Atticus (IV, 15) que, si Scaurus n’était pas élu consul, il s'en tirerait difficilement. Le procès eut lieu et Scaurus fut acquitté à une grande majorité. (Asc. ; Pro M. Scaur., s. r. L. ipse Metellus). Se souvenant de ses libéralités et en espérant probablement d'autres nouvelles, le peuple le favorisait. –Asc. ; loc. cit. : Cato praetor, cum vellet de accusatoribus in consilium mittere, multique e populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini, ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. De même aujourd'hui, les électeurs se montrent reconnaissants envers nos ploutocrates pour les profits passés, dans l'espérance de profits futurs (§ 2262).
, 27. L'auteur nous dit que Périclès n’étant pas suffisamment riche pour lutter de libéralité avec Cimon (lutte habituelle entre les parvenus et ceux qui possèdent une fortune de famille), imagina de faire des cadeaux aux citoyens avec leur propre argent. Pline décrit la magnificence d'un théâtre édifié par Scaurus pendant son édilité. Contrairement à ce qui est dit plus haut, il semble faire remonter à Sulla la puissance de Scaurus. – PLIN. ; Nat. hist., XXXVI, 24, 10 (XV) Non patiar istos duos Nerones, ne hac quidem gloria famae frui : docebimusque etiam insaniam eorum victam privatis operatibus M. Scauri, cuius nescio an aedilitas maxime prostraverit mores [toujours le fait particulier substitué au fait général, l'anecdote aux uniformités générales, le rapport de cause à effet à la mutuelle dépendance], maiusque sit Sullae malum, tanta privigni potentia, quam proscriptio tot milium. Hic fecit in aedilitate sua opus maximum omnium, quae umquam fuere humana manu facta, non temporaria mora, verum etiam aeternitatis destinatione. Theatrum hoc fuit. Le grain produit la moisson. – Arg. cit. : Ex praetura provinciam Sardiniam obtinuit – puis on récolte –in qua neque satis abstinenter se gessisse existimatus est et valde arroganter : quod genus morum in eo paternum videbatur, cum cetera industria nequaquam esset par. Accusé de ce fait à Rome, il fut défendu par Cicéron, qui le savait pourtant coupable. Quand cet orateur s'apprêtait à le défendre, il écrivaità Atticus (IV, 15) que, si Scaurus n’était pas élu consul, il s'en tirerait difficilement. Le procès eut lieu et Scaurus fut acquitté à une grande majorité. (Asc. ; Pro M. Scaur., s. r. L. ipse Metellus). Se souvenant de ses libéralités et en espérant probablement d'autres nouvelles, le peuple le favorisait. –Asc. ; loc. cit. : Cato praetor, cum vellet de accusatoribus in consilium mittere, multique e populo manus in accusatores intenderent, cessit imperitae multitudini, ac postero die in consilium de calumnia accusatorum misit. De même aujourd'hui, les électeurs se montrent reconnaissants envers nos ploutocrates pour les profits passés, dans l'espérance de profits futurs (§ 2262).
[FN: § 2566-1]
Que l'on compare la révolte des Jacques, en 1358, et la révolution française de 1789. Il est impossible d'admettre que les souffrances du peuple fussent plus grandes au temps de la seconde qu'à celui de la première. Cela ne prouve pas que ces souffrances ne soient pas l'une des forces agissantes : cela montre qu'elles ne sont pas la seule ni la plus efficace. On trouve une autre différence entre ces deux révoltes, dans l'emploi de la force par la classe gouvernante. Cet emploi apparaît puissant et sûr dans la première, faible et incertain dans la seconde. Là encore, nous dirons qu'on n'en peut pas conclure que l'emploi de la force suffise à réprimer les révoltes ; mais on peut voir sans peine qu'étant donné ce but, cet emploi est parmi les causes les plus efficaces. Que serait-il arrivé si les gouvernants de 1789 avaient combattu avec l'énergie dont ont fait preuve ceux de 1358 ? Nous ne pouvons le dire avec certitude (§ 139), mais nous, pouvons affirmer que les gouvernants auraient eu de plus grandes probabilités de victoire qu'il ne leur en restait avec la résignation humble et vile qu'ils manifestèrent. Toute l'histoire démontre que si l'on peut être vainqueur ou vaincu en combattant vaillamment, on est sûrement vaincu lorsqu'on fuit le combat ; et l'on voit se vérifier toujours le proverbe : Qui se fait agneau, le loup le mange. Pour la Jacquerie, voir dans SIMÉON LUCE la description des souffrances des gouvernés et les odieuses cruautés des gouvernants. S. LUCE ; Hist. de la Jacq. L'auteur décrit le combat de Meaux. « (p. 141) Si l'on en croyait Froissart, depuis le commencement jusqu'à la fin du combat, les nobles n'eurent que la peine de tuer, sans courir eux-mêmes le moindre danger. Jamais on ne frappa plus en plein ni à la fois avec plus d'acharnement et de mépris dans la chair humaine. Il faut lire dans le chroniqueur l'expressive et vivante peinture qu'il nous a tracée de cette épouvantable boucherie ». Suit une citation de Froissart ; puis : « (p. 142) Toutefois, la victoire dut être plus chèrement achetée que Froissart ne semble ici le dire ; car les assaillants parvinrent jusqu'à la barrière et au delà. Plusieurs nobles furent tués, notamment [suivent des noms de gens tués]. Il est certain, d'autre part, que bon nombre de gens d'armes de Paris, ainsi que beaucoup de bourgeois de Meaux, réussirent à s'échapper, comme l'attestent encore aujourd'hui les nombreuses lettres de rémission qui leur furent délivrées plus tard (p. 143) sur le fait de leur participation à l'attaque du marché de Meaux. Quoi qu'il en soit, la vengeance que les nobles exercèrent après l'issue de la lutte ne fut pas moins impitoyable que la lutte elle-même. Toute la ville fut mise au pillage. Non seulement les habitations des particuliers, mais les églises elles-mêmes furent saccagées : on n'y laissa rien qui pût avoir quelque valeur. Une partie de la population de Meaux fut massacrée. Ceux des habitants qui eurent la vie sauve furent emmenés prisonniers dans la citadelle. Le maire Soulas, pris pendant le combat, fut pendu. Cela fait, les nobles mirent le feu à la ville. L'incendie dura quinze jours ; il consuma le château royal et un grand nombre de maisons, entre autres, quelques-unes de celles des chanoines. Tous les vilains qui y étaient enfermés périrent dans les flammes... De telles rigueurs auraient dû, ce semble, assouvir (p. 44) le ressentiment des nobles. Il ne se trouva point encore satisfait... Les nobles se ruèrent ensuite, comme des furieux, sur les campagnes, environnantes, égorgeant tous les vilains qu'ils pouvaient atteindre et mettant le feu à leurs villages. Les désastres furent tels, que, s'il faut en croire un chroniqueur, les nobles causèrent en cette occasion plus de maux au royaume que les Anglais eux-mêmes, ces ennemis-nés de la France, n'auraient pu lui en faire ». Ce carnage fait par le parti alors victorieux peut aller de pair avec les massacres de septembre accomplis par l'autre parti, qui fut victorieux au temps de la Révolution française. Il faut sans doute s'abstenir du raisonnement post hoc, propter hoc, mais on ne doit pourtant pas négliger de semblables rapprochements de faits, d'autant plus que l'histoire nous en fait connaître un grand nombre.
[FN: § 2566-2]
Dans l'ouvrage connu sous le nom de Testament politique du Cardinal de Richelieu, on répète une maxime courante en ces temps-là. Recueil des Testamens politiques; t. I, ch. IV, sec. V. Du peuple: « (p. 211) Tous les politiques sont d'accord que si les Peuples étoient trop à leur aise, il seroit impossible de les contenir dans les règles de leur devoir ».
[FN: § 2566-3]
Par exemple, la thèse de DE TOQUEVILLE et de TAINE est que la classe gouvernante française fut dépossédée par la Révolution, parce qu'elle conservait ses privilèges et négligeait ses « devoirs ». Il y a là une part de vérité ; mais il y a aussi une grande part qui diffère de ce que nous enseigne l'expérience. Celle-ci nous montre des gouvernants qui maintiennent leur pouvoir en opprimant les gouvernés. DE TOQUEVILLE nous fournit lui-même des arguments qui contredisent sa thèse. L'ancien régime et la Révolution : « (p. 33) Une chose surprend au premier abord : la Révolution, dont l'objet propre était d'abolir partout le reste des institutions du moyen âge, n'a pas éclaté dans les contrées où ces institutions, mieux conservées, faisaient le plus sentir au peuple leur gêne et leur rigueur, mais, au contraire, dans celles où elles les lui faisaient sentir le moins ; de telle sorte que leur joug a paru le plus insupportable là où il était en réalité le moins lourd. Dans presque aucune partie de l'Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, le servage n'était encore complètement aboli et, dans la plupart, le peuple demeurait positivement attaché à la glèbe, comme au moyen âge... ». TAINE met clairement en rapport la récompense avec les bonnes actions. L'ancien régime : « (p. 108) Juste et fatal [dérivation éthique] effet du privilège que l'on exploite à son profit au lieu de l'exercer au profit d'autrui. Qui dit sire ou seigneur, dit „ le protecteur qui nourrit, l'ancien qui conduit “ [dérivation verbale] ; à ce titre et pour cet emploi, on [qui peut bien être ce, messire on ?] ne peut lui donner trop, car il n'y a pas d'emploi plus difficile et plus haut. Mais il faut qu'il le remplisse ; sinon, au jour du danger, on le laisse là [en vérité, les troupes de Sulla, de Marius de César. d'Octave et beaucoup d'autres demandaient surtout de l'argent et des terres]. Déjà, et bien avant le jour du danger, sa troupe n'est plus à lui ; si elle marche, c'est par routine ; elle n'est qu'un amas d'individus, elle n'est plus un corps organisé ». Taine oublie que précisément un « amas d'individus » peut être facilement gouverné par qui dispose d'un petit nombre d'hommes armés, fidèles parce que bien pavés avec l’argent pris à 1'« amas d'individus ». « (p. 109) Déjà avant l'écroulement final, la France est dissoute, et elle est dissoute parce que les privilégiés ont oublié leur caractère d'hommes publics ». Si ce qu'expose Taine était une uniformité expérimentale, les « Jacques » auraient dû vaincre, car les nobles de ce temps, beaucoup plus que les nobles du temps de la révolution de 1789, avaient négligé leurs « devoirs » envers leurs sujets. – S. LUCE : Hist. de la Jacq. : « (p. 33) Quelle qu'en fût la source, ces revers répétés [de Courtray et de Crécy] eurent pour la noblesse française deux conséquences également désastreuses. D’abord ils la dépouillèrent d'un prestige qui était la plus grande partie de sa force, le prestige militaire [observation juste parce qu'elle concorde avec l'expérience en tout pays et en tout temps]. En second lieu, faits prisonniers en masse dans toutes ces batailles, les seigneurs, pour trouver l'argent nécessaire à leur rançon, durent recourir à des exactions qui poussèrent à bout la patience de leurs vassaux [autre observation expérimentalement juste]. Déjà méprisés, ils devinrent encore plus odieux [la force qui maintenait les vassaux dans l'obéissance diminue, celle qui les poussait à la révolte s'accroît]. La noblesse ne pouvait même plus, d'ailleurs. revendiquer le mérite du désintéressement dans la défense du pays. Commençant à vivre loin de leurs châteaux, près du roi, les chevaliers se mirent à prendre en retour les allures serviles et mercenaires des courtisans. (p. 34) Ils ne voulurent plus servir gratis... J'ajoute que, par une singulière coïncidence, les nobles choisissaient, pour exiger une solde qui était une innovation, le moment même où, par leurs fautes et leurs insuccès militaires, ils la méritaient le moins... (p. 36) „ Après la bataille de Poitiers “, dit le second continuateur de Nangis, „ les affaires du royaume commencèrent à prendre une fâcheuse tournure ; l'État fut en proie à l'anarchie ; les brigands se répandirent par tout le royaume. Les nobles, redoublant de haine et de mépris envers les vilains [belle façon de remplir ses devoirs ! En 1789, il n'y avait ni mépris ni haine, il y avait l'humanitarisme], se mirent à faire bon marché des intérêts de la Couronne et de ceux de leurs vassaux : ils pillaient et opprimaient leurs hommes et en général les gens de campagne...“ (p. 39) Souvent encore, sans se confondre intimement, gentilshommes et brigands s'associaient et marchaient tous ensemble à la proie de compte à demi... À cette époque, dit ce chroniqueur [Guillaume de Nangis], ceux qui auraient dû protéger le peuple ne lui faisaient pas subir moins de vexations que ses ennemis... ». Ceux qui commirent de si mauvaises actions furent vainqueurs, se tirèrent d'affaire, détruisirent leurs ennemis. Leurs successeurs, en 1789, dont les actions étaient, au contraire, humaines, honnêtes, bienveillantes, furent vaincus, marchèrent à leur perte, furent détruits. Il est probable qu'au point de vue de l'utilité sociale, il est bon de ne pas mettre en lumière ce contraste. mais expérimentalement, on ne peut le nier. On trouve dans un très grand nombre d'auteurs contemporains des conceptions analogues à celles qu'exprime Taine. En voici un exemple. MARIO MISSIROLI ; Satrapia : « (p. 13) Raffermir le sentiment du devoir et la liberté morale, même au prix de sacrifices – surtout à ce prix – [dérivation métaphysique], signifie résoudre la question économique, dans la mesure où les biens économiques sont évalués, lorsqu'ils sont considérés comme un moyen et non comme une fin [dérivation de l'âge d'or placé dans l'avenir]. Tant que toute la vie se déroulera dans la catégorie de l'économie et de l'intérêt personnel [à l'auri sacra fames, on donne ici le nom de catégorie], le problème économique (p. 14) sera prédominant et insoluble [il l'est depuis les temps les plus reculés dont le souvenir nous ait été conservé ; il le sera peut-être encore quelque temps]. Tout le monde voudra concourir aux jouissances matérielles et se déposséder tour à tour [c'est en effet ce que rapporte l'histoire]. L'histoire ne peut heureusement pas conclure [l'histoire a-t-elle une conclusion ?] à un échange de portefeuilles. Mais qui doit [dérivation métaphysique] donner cet exemple le premier ? C'est clair : ceux qui occupent le haut de l'échelle sociale : les bourgeois. J'en reviens involontairement aux idées exprimées au début. La bourgeoisie doit rénover le concept de la propriété et la regarder comme un devoir plutôt que comme un droit, et accepter tous les sacrifices, toutes les douleurs qui sont inhérentes à son idée ».
[FN: § 2570-1]
On a fait usage exactement des mêmes dérivations à l’occasion des troubles de Romagne, en juin 1914. Les « spéculateurs » et leurs satellites les jugèrent une œuvre néfaste des ennemis de la patrie, ou du moins de pauvres ignorants « abusés » par les chefs des « partis subversifs ». Ces partis les proclamèrent au contraire « une juste revendication du prolétaire opprimé ».
[FN: § 2573-1]
SALL. ; De bell. Cat., XIV. Puis il accuse Catilina d'avoir tué l'un de ses fils, et émet l'opinion que les remords ont peut-être hâté l'entreprise de Catilina. (XV) Quae quidem res mihi in primis videtur causa fuisse facinus maturandi. Namque animus impurus, dis hominibusque infestus, neque vigiliis neque quietibus sedari poterat : ita conscientia mentem excitam vastabat. Igitur color ei exanguis, foedi oculi, citus modo, modo tardus incessus ; prorsus in facie vultuque vecordia inerat. Notre auteur passe sous silence la quatrième Catilinaire de Cicéron, et dissimule les attaques de Caton contre César. APPIEN, lui aussi, De bell. civ., II, 2, rappelle l'accusation lancée contre Catilina d'avoir tué son fils. Cfr. VAL. MAX., IX, I, 9 ; PLUTARCH. ; Sulla, 32.
[FN: § 2575-1]
APP. ; De bell. civ., II, 2 : ![]()
![]() . Ici
. Ici ![]() doit être pris dans le sens expliqué par PLUTARQUE, De unius in rep. domin., II, p. 826, et signifie l'acte de prendre part aux honneurs de la république ; par conséquent l'auteur veut dire que Catilina renonça à rechercher d'autres magistratures. – DIO CASS., XXIX, fait allusion à un décret du Sénat que Catilina crut – et avec raison, dit Dion – avoir été rendu contre lui, et qui le détermina à tenter de détruire les comices par la force.
doit être pris dans le sens expliqué par PLUTARQUE, De unius in rep. domin., II, p. 826, et signifie l'acte de prendre part aux honneurs de la république ; par conséquent l'auteur veut dire que Catilina renonça à rechercher d'autres magistratures. – DIO CASS., XXIX, fait allusion à un décret du Sénat que Catilina crut – et avec raison, dit Dion – avoir été rendu contre lui, et qui le détermina à tenter de détruire les comices par la force.
[FN: § 2575-2]
CIC. ; Pro Flacc ., XXXVIII, 95 : Oppressus est C. Antonius... cuius damnatione sepulcrum L. Catilinae, floribus ornatum, hominum audacissimorum ac domesticorum hostium conventu epulisque celebratum est : iusta Catilinae facta sunt.
[FN: § 2576-1]
NAPOLÉON III ; Hist. de J. César, t. I : « (p. 338) Certes Catilina était coupable de tenter le renversement des lois de son pays par la violence ; mais il ne faisait que suivre les exemples de Marius et de Sylla. Il rêvait une dictature révolutionnaire, la ruine du parti oligarchique, et, (p. 339) comme le dit Dion Cassius, le changement de la constitution de la République et le soulèvement des alliés. Son succès néanmoins eût été un malheur ; un bien durable ne peut sortir de mains impures ». Oh ! qu'elles étaient pures les mains d'Octave, qui fonda l'Empire romain ! Et celles de César qui le précéda ! Il est vraiment remarquable que la passion puisse à tel point oblitérer la raison.
[FN: § 2577-1]
APP. ; De bell. civ., 11, 2 : ![]()
![]() ... « il envoya de ci de là en Italie, chez les partisans de Sulla qui avaient dilapidé les biens enlevés par la violence, et qui aspiraient à des opérations semblables... ». SALL., De bell. Cat., XVI, confirme ce fait. Après avoir parlé des scélérats qui se groupaient autour de Catilina, il ajoute : Eis amicis sociisque confisus Catilina, simul quod aes alienum per omnis terras ingens erat, et quod plerique sullani milites, largius suo usi, rapinarum et victoriae veteris memores, civile bellum exoptabant, opprimundae reipublicae consilium cepit. – PLUTARCH. ; Cic., XIV, parle aussi des anciens soldats de Sulla « désireux de nouveau de butin et de pillages ». – DIO CASS. ; XXXVII, 30, dit la même chose. Ou bien les textes n'ont plus aucune valeur, ou bien il est impossible de ne pas voir en tant de semblables témoignages la trace du conflit entre la force et la ruse en politique.
... « il envoya de ci de là en Italie, chez les partisans de Sulla qui avaient dilapidé les biens enlevés par la violence, et qui aspiraient à des opérations semblables... ». SALL., De bell. Cat., XVI, confirme ce fait. Après avoir parlé des scélérats qui se groupaient autour de Catilina, il ajoute : Eis amicis sociisque confisus Catilina, simul quod aes alienum per omnis terras ingens erat, et quod plerique sullani milites, largius suo usi, rapinarum et victoriae veteris memores, civile bellum exoptabant, opprimundae reipublicae consilium cepit. – PLUTARCH. ; Cic., XIV, parle aussi des anciens soldats de Sulla « désireux de nouveau de butin et de pillages ». – DIO CASS. ; XXXVII, 30, dit la même chose. Ou bien les textes n'ont plus aucune valeur, ou bien il est impossible de ne pas voir en tant de semblables témoignages la trace du conflit entre la force et la ruse en politique.
[FN: § 2577-2]
CIC. ; Pro M. Coelio, IV, 10 : Nam quod catilinae familiaritas obiecta Coelio est ... quanquam multi boni adolescentes illi homini nequam atque improbo studuerunt ... Plus loin, Cicéron loue Catilina de ce dont on put aussi louer César : (V, 12) Erant apud illum illecebrae libidinum multae ; erant etiani industriae quidam stimuli, ac laboris. Flagrabant vitia libidinis apud illum ; vigebant etiam studia rei militaris... (VI, 13) Quis clarioribus viris quodam tempore iucundior ? Quis turpioribus coniunctior ?... (VI, 14) Hac ille tam varia multiplicique natura, cum omnes omnibus ex terris homines improbos audacesque collegerat : tum etiam multos fortes viros et bonos specie quadam virtutis assimulatae tenebat.
[FN: § 2577-3]
Un jour peut-être, lorsque le règne actuel de la ploutocratie aura été détruit par les anarchistes ou par les syndicalistes, ou par les militaristes, ou enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne, par ceux qui opposent la force à la ruse triomphante, on rappellera des propos semblables à ceux que SALLUSTE, De bell. Cat., 20, met dans la bouche de Catilina : « Ainsi, toute faveur, toute puissance, tout honneur, toute richesse sont à eux [les puissants d'alors, auxquels correspondent en partie nos « spéculateurs »] ou à ceux qu'ils veulent. À nous, ils nous ont laissé les refus, les dangers, les condamnations, la pauvreté. Ces faits, jusqu'à quand les souffrirez-vous, hommes intrépides ? Ne vaut il pas mieux mourir en faisant preuve de courage, que perdre avec infamie une vie misérable et méprisée, après avoir été le jouet de l'insolence d'autrui ? mais certainement par la foi des dieux et des hommes, la victoire est entre nos mains ! Notre âge est celui de la vigueur, notre courage est grand. Au contraire, eux, les années, les richesses, tout les affaiblit ».
[FN: § 2578-1]
SALL. ; De bell. Cat., XXXVI : Namque duobus senati decretis, ex tanta multitudine neque praemio inductus coniurationem patefecerat, neque ex castris Catilinae quisquam omnium discesserat. – Après la bataille de Fésules (Fiesole) : (LXI). Sed confecto proelio, tum vero cerneres, quanta audacia quantaque animi vis fuisse in exercitu Catilinae. Nam fere quem quisque vivos pugnando locum ceperat, eum, amissa anima, corpore tegebat. Pauci autem, quos medios cohors praetoria disiecerat paullo divorsius, sed omnes tamen advorsis volneribus conciderant.
[FN: § 2579-1]
SALL. ; De bell. Cat ., XXXIII.
[FN: § 2579-2]
SALL. ; De bell. Cat., XLIX : ... ut nonnulli equites romani, qui praesidii causa cum telis erant circum aedem Concordiae [où s'assemblait le Sénat], seu periculi magnitudine, seu animi nobilitate impulsi, quo studium suum in rempublicam clarius esset, egredienti ex senatu Caesari gladio minitarentur. – SUETONE (Caes.. XIV) ajoute d'autres détails. Après avoir dit que César s'opposa à la sentence de mort contre Catilina et ses complices, il ajoute : Ac ne sic quidem impedire rem destitit, quoad usque manus equitum romanorum, quae arata praesidii causa circumstabat, immoderatius perseveranti necem comminata est : etiam strictos gladios usque eo intentans, ut sedentem una proximi deseruerint, vix pauci complexu togaque obiecta protexerint. Tunc plane deterritus, non modo cessit, sed etiam, in reliquum anni tempus curia abstinuit. Si les chevaliers avaient continué à faire ainsi usage de la force, ils eussent été eux-mêmes vainqueurs ; mais leur tempérament s'y opposait ; c'est, d'une façon générale, celui des « spéculateurs ». Cfr. PLUTARCH. ; Caes., VIII. Dans son discours in toga candida, dont nous n'avons conservé qu'un petit nombre de fragments, CICÉRON dit que Catilina ne peut demander le consulat ni aux principaux citoyens, qui s'opposèrent à sa candidature, ni au Sénat, qui le condamna, ni à l'ordre des chevaliers dont Catilina fut l'assassin : ab equestri ordine ? quem trucidasti. - ASCONIUS note à ce propos : Equester ordo pro Cinnanis partibus contra Sullam steterat, multasque pecunias abstulerant : ex quo saccularii erant appellati : multique ob eius rei invidiam post Sullanam victoriam erant interfecti. Là, on voit bien les « spéculateurs » qui remplirent leur sac et ne furent réprimés que par la force. Cfr. Q. CIC. ; De pet. cons., II.
[FN: § 2581-1]
PLUTARQ. ; Cic., X.
[FN: § 2582-1]
NAPOLÉON III ; Hist. de J. Cés ., t. I, p. 339.
[FN: § 2582-2]
À cela notre auteur, loc. cit., p. 339, objecte : « On peut légitimement violer la légalité, lorsque, la société courant à sa perte, un remède héroïque est indispensable pour la sauver, et que le gouvernement, soutenu par la masse de la nation, se fait le représentant de ses intérêts et de ses désirs [c'est exactement ce que Cicéron pensait de la conjuration de Catilina, de même que Napoléon III de son Coup d'État]. Mais, au contraire, lorsque, dans un pays divisé par les factions, le gouvernement ne représente que l'une d'elles, il doit, pour déjouer un complot, s'attacher au respect le plus scrupuleux de la loi... »
[FN: § 2584-1]
Crassus est un type de ploutocrate et de politicien de la fin de la République ; il est semblable à nos ploutocrates et nos politiciens. Il en diffère surtout en ce qu'il était d'origine sénatoriale, tandis que nos ploutocrates et nos politiciens sortent généralement des classes moyennes ou inférieures de la population. Crassus, comme ceux-ci, a en abondance extraordinaire les résidus de la Ie classe et fort peu, presque pas du tout ceux de la IIe classe. Crassus était d'une race de spéculateurs ; tels sont aussi plusieurs de nos ploutocrates. – PLIN. ; Nat. hist., XXXIII, 47 (10) : Postea Divites cognominati : dummodo notum sit, eum qui primus acceperit hoc cognomen, decoxisse creditoribus suis. Ex eadem gentes M. Grassus negabat locupletem esse, nisi qui reditu annuo legionem tueri posset. – MOMMSEN décrit excellemment Crassus. Hist. rom., t. VI : « (p. 139) Du côté des dons de l'esprit, de la culture littéraire et des talents militaires, il restait loin en arrière de beaucoup de ses pareils : il les dépassait tous par son activité infatigable, par son ardeur opiniâtre à vouloir tout posséder, et à marquer en tout [exactement comme nos ploutocrates]. Il se jeta à corps perdu dans les spéculations [c'est ainsi que s'enrichissent nos ploutocrates]. Des achats de terres pendant la révolution (p. 140) furent la base de son énorme fortune [pour nos ploutocrates, les sources de la richesse sont généralement, outre la protection douanière, les fournitures au gouvernement, les concessions gouvernementales et autres faveurs qu'ils achètent des politiciens] sans qu’il négligeât d'ailleurs les autres moyens de s'enrichir, élevant dans la capitale des constructions grandioses autant que prévoyantes ; s'intéressant avec ses affranchis [ils correspondent aux partisans de nos ploutocrates] dans les sociétés et les compagnies commerciales ; tenant banque dans Rome et hors de Rome, avec ou sans le concours de ses gens ; prêtant son or à ses collègues du Sénat [comme Berteaux faisait en France avec les députés], et entreprenant pour leur compte et selon l'occasion, tantôt des travaux, tantôt l'achat des collèges de justice [de nos jours : des politiciens dont dépend la justice]... Attentif d'ailleurs à ne point entrer en lutte ouverte avec le juge criminel, il savait vivre simplement, bourgeoisement, en vrai homme d'argent qu'il était. C'est ainsi qu’en peu d'années on le vit, naguère possesseur d'un patrimoine sénatorial ordinaire, amasser de monstrueux trésors ; peu de temps avant sa mort, malgré des dépenses imprévues, inouïes, on estimait encore son avoir à 170 000 000 sesterces (48 750 000 francs)... Il n'était point de peine qu'il ne se donnât pour étendre ses relations... (p. 141)... La moitié des sénateurs étaient ses débiteurs [en France, un très grand nombre de députés étaient les débiteurs de Berteaux ; en Italie, l'enquête sur les banques a révélé que beaucoup de députés étaient les débiteurs de la ploutocratie] : il tenait une foule d’hommes considérables dans sa dépendance... Homme d'affaire avant tout, il prêtait sans distinction de partis, mettait la main dans tous les camps [exactement comme nos ploutocrates, qui soutiennent même des ennemis acharnés de la bourgeoisie, des financiers, des capitalistes], et donnait volontiers crédit à quiconque était solvable, ou pouvait devenir utile. Quant aux meneurs, même les plus hardis, quant à ceux dont les attaques n'épargnaient personne, ils se seraient gardés d'en venir aux mains avec Crassus... Depuis que Rome était Rome, les capitaux y avaient joué le rôle d'une puissance dans l'État : au temps actuel, on arrivait à tout par l'or aussi bien que par le fer [pour soutenir la comparaison avec notre temps, il faut supprimer le fer]... (p. 142) Ce fut alors (signe trop caractéristique des temps !) que l'on vit un Crassus, orateur et capitaine médiocre, un politique ayant l'activité et non l'énergie [on dirait la description des ploutocrates qui gouvernent aujourd'hui les pays civilisés], les convoitises et non l'ambition, ne se recommandant par rien si ce n'est sa colossale fortune et son habileté commerciale, étendre partout ses intelligences, accaparer la toute puissante influence des coteries et de l'intrigue [pour nos ploutocrates il faut ajouter : et des journaux], s'estimer l’égal des plus grands généraux, des plus grands hommes d'État de son siècle, et lutter avec eux pour la palme la plus haute qui puisse attirer les convoitises de l'ambitieux ! » – PLUTARCH. ; Crass., 2, 2 : « Au début, il ne possédait pas plus de trois cents talents ; puis, lorsqu’il fut au pouvoir, il consacra à Hercule la dîme de sa fortune, invita le peuple, distribua à chaque citoyen du grain pour trois mois. Toutefois, avant son expédition contre les Parthes, ayant fait le compte de sa fortune, il trouve la somme de 7 100 talents ». Plutarque raconte les entreprises de Crassus : il achetait à vil prix des maisons en mauvais état et les reconstruisait ; il possédait des mines d'argent, des fonds à la campagne donnant de gros revenus ; « (2, 7) toutefois cela semblerait peu de chose, si on le comparait avec l'argent qu'il retirait du travail des esclaves ; il possédait une quantité de ceux-ci et de toute espèce : des lecteurs, des copistes, des experts en métaux, des administrateurs, des maîtres d'hôtel ». Crassus faisait le démocrate comme nos ploutocrates font les socialistes ; il savait capter les bonnes grâces des puissants, toujours comme nos ploutocrates. Quand César était sur le point de se rendre en Espagne, Crassus le libéra de ses créanciers, en se portant sa caution pour au moins 830 talents (loc. cit., 7, 7). Après avoir remarqué qu'il y avait à Rome trois factions, celle de Pompée, celle de César, celle de Crassus, Plutarque ajoute : « (7, 8) Crassus tenant le milieu [entre les deux factions] profitait de toutes les deux, et changeant souvent dans la ville, il se mettait tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Il n'était ni un ami sûr, ni un ennemi implacable, mais abandonnait facilement la bienveillance ou la colère, suivant que cela lui était utile [exactement comme nos ploutocrates]. Souvent on le vit en peu de temps tantôt défenseur, tantôt adversaire des mêmes hommes ou des mêmes lois ». Ainsi fut le ministre Caillaux pour l'impôt sur le revenu et le ministre Giolitti pour le suffrage universel. Immédiatement après avoir repoussé comme excessive la modeste extension du suffrage, proposée par le ministre Luzzatti, la Chambre italienne approuve l'extension beaucoup plus considérable voulue par le ministre Giolitti. Les ploutocrates et leurs représentants se préoccupent de l'argent ; ils ne se soucient guère d'autre chose.
[FN: § 2585-1]
SENEC. ; Controv., II, 1 : (p. 124) census senatorium gradum ascendit, census equitem Romanum a plebe discernit, census in castris ordinem promovet, census indices in foro legit. Cfr. § 2548-3.
[FN: § 2585-2]
FUSTEL DE COULANGES : L'emp. rom. : « (p. 219) Toutes ces distinctions sociales étaient héréditaires. Chaque homme avait de plein droit le rang dans lequel la naissance l'avait placé. Toutefois on devait déchoir si l'on devenait pauvre, et l'ont pouvait aussi s'élever par degrés à mesure qu'on devenait riche. Monter les échelons de cette hiérarchie était l'ambition de tout ce qui était actif et énergique. Le gouvernement impérial ne s'opposa pas à cette sorte d'ascension continuelle vers laquelle tous les efforts tendaient. Il veilla seulement à ce qu'elle ne fût pas trop rapide ; il fixa les conditions et les règles suivant lesquelles elle était permise. Il prit soin d'empêcher, autant qu'il était possible, qu'une famille ne franchît deux degrés dans une seule vie d'homme. L'esclave pouvait, par l'affranchissement (p. 280) complet, s'élever à la plèbe ; mais il lui était défendu de monter au rang des curiales. Le plébéien devenait curiale à la condition de posséder vingt-cinq arpents de terre et de supporter sa part des charges municipales. Le curiale, à son tour, pouvait passer au rang des principaux s'il avait une fortune qui lui permît de faire les frais des hautes magistratures et si ses concitoyens les lui conféraient ; mais le gouvernement impérial exigeait que l'on remplît toutes les fonctions inférieures avant d'arriver aux plus élevées, ce qui était un premier obstacle et tout au moins un long retard pour les parvenus ». L'auteur cite le code théodosien. Il est vrai que c'était la loi écrite, mais il aurait du ajouter qu'en pratique les exceptions étaient nombreuses (§ 2551-1). Cfr. TAC. ; Ann., XIII, 27. « Quand la carrière municipale avait été parcourue tout entière, alors seulement une famille pouvait aspirer au titre de sénateur romain. Ici la richesse était encore nécessaire, mais elle ne suffisait plus. La règle était qu'il fallût obtenir du prince une magistrature romaine... »
[FN: § 2585-3]
Encore sous Tibère, à Rome, le luxe était extravagant. TACIT. ; Ann. II, : 38. Plus loin, III, 52 : C. Sulpicius, D. Haterius consules sequuntur : inturbidus externis rebus annus ; domi suspecta severitate adversum luxum, qui immensum proruperat ad cuncta quis pecunia, prodigitur. Les édiles voulaient diminuer ces dépenses, et le Sénat demanda à Tibère de décider sur ce qu'il y avait à faire. Tibère montra la difficulté de l'entreprise : « (p. 53) Que faut-il vraiment d'abord interdire pour entreprendre ensuite de revenir aux mœurs antiques ? Les vastes villas le nombre et la race des familles, la somme d'or et d'argent, les merveilles du bronze et des tableaux, les vêtements confondus des hommes et des femmes, et ceux qui sont bien ceux des femmes, lesquelles portent notre argent aux étrangers ou aux ennemis, pour acquérir des pierres précieuses ? » Les voiles habituels des dérivations éthiques une fois ôtés, ce que dit Tibère est juste : (54) Externis victoriis aliena, civilibus etiam nostra consumere didicimus. « Par les victoires remportées à l'extérieur, nous avons appris à dépenser les biens des étrangers ; par les victoires des guerres civiles, nous avons aussi appris à dépenser nos biens ». Tibère conclut au laisser-faire. Tacite observe (55) que cependant le luxe diminua. Il en attribue le mérite à l'élite qui, des provinces venait à Rome, et au bon exemple donné par Vespasien. Il fait ensuite allusion au doute que nous avons rapporté au § 2552-1. Les causes indiquées précédemment peuvent se trouver parmi les secondaires et non parmi les principales, parce qu'après Vespasien la première avait produit tout son effet possible, et que la seconde disparut entièrement; car parmi les successeurs de Vespasien, pour ne nommer que ceux-là, ce n'est pas un Commode, un Caracalla, un Eliogabale qui auront donné l'exemple de l'économie dans leur vie. Pourtant le luxe des particuliers et la prospérité économique continuèrent à diminuer.
[FN: § 2585-4]
MARQUARDT ; De l’organisation financière chez les Romains : « p. 121) Les prétoriens, qui formaient neuf cohortes de 1000 hommes, touchaient par an, sous Tibère, 720 deniers, mais sans fournitures en nature ; ils les obtinrent à partir de Néron... ». La somme totale des frais pour 25 légions, les prétoriens et les cohortes urbaines, est, suivant notre auteur, de 46 710 000 deniers, soit 50 625 000 fr. .(p. 121). Mais il y avait d'autres frais dont les donativa n'étaient pas les derniers, qu'on ne peut évaluer, et qui augmentèrent avec le temps.
[FN: § 2587-1]
VOPISCUS ; Aurel., nous raconte la mort d'Aurélien, l'interrègne et le règne de Tacite. Il cite la lettre des légions (41) où elles demandent au Sénat un empereur : ... et de vobis aliquem, sed dignum vestro iudicio, principem mittite. Tacite qui était consul, estima dangereux l'honneur fait au Sénat, et dit ; Nam de imperatore, deligendo ad eundem exercitum censeo esse referendum. Etenim in tali genere sententiae, nisi fiat quod dicitur, et electi periculum erit, et eligentis invidia. Le Sénat approuva cet avis ; mais comme on continuait à insister des deux côtés, il finit par nommer précisément Tacite : attamen cum iterum atque iterum mitterent, ex. S. C. quod in Taciti vita dicemus, Tacitus factus est imperator. Dans la vie de Tacite, notre auteur dit : « (2) Ergo quod rarum et difficile fuit, S. P. Q. R. perpessus est ut imperatorem per sex menses, dura bonus quaeritur, respub. non haberet. Mais il était nécessaire que l'armée eût un chef. Le consul Gordien dit au Sénat : (3) ... Imperator est deligendus : exercitus sine principe recte diutius stare non potest, simul quia cogit necessitas. Nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur... Il ne se trouva aucun démagogue de la trempe de nos Jaurès, Caillaux, Edward Grey, etc., pour dire qu'on n'avait pas à se soucier des Germains belliqueux. Mais Rome n'y gagna pas grand'chose, parce que les Pères Conscrits, en bons humanitaires, estimèrent qu'on repoussait les ennemis par les vertus privées et civiques. Pour tant, le pauvre Tacite, refusant l'honneur qu'on voulait lui faire, dit avec beaucoup de bon sens : (4) ... Miror. P. C., in locum Aureliani fortissimi imperatoris senem velle principem facere... Un sénateur consulaire exprima délicieusement les rêveries humanitaires qui conseillaient le choix de Tacite : (6) Seniorem principem fecimus, et virum qui omnibus quasi pater consulat [Clémenceau aurait dit : qui sera un pur républicain]. Nihil ab hoc immaturum, nihil perperum, nihil asperum formidandum est.Scit enim qualem sibi principem semper optaverit : nec potest aliud nobis exhibere quam quod ipse desideravit et voluit. On dirait tout à fait une idylle. Il ne manque que la bergère et les moutons ornés de beaux rubans. Ce brave homme régna six mois. (13) ... Gessit autem propter brevitatem temporum nihil magnum. Interemptus est enim insidiis militaribus, ut alii dicunt, sexto mense : ut alii, morbo interiit. Tamen constat, factionibus eum oppressum, mente atque anime defecisse.
[FN: § 2590-1]
Par exemple PLIN. ; Nat. hist ., XIV, 5, (4), Summam ergo adeptus est gloriam Acilius Sthenelus e plebe libertina, LX iugerum [15 hectares] non amplius vineis excultis in Nomentano agro, atque C C C C nummum venumdatis. Magna fama et Vettileno Aegialo perinde libertino fuit, in Campaniae rure Liternino, maiorque etiam favore hominum, quoniam ipsum Africani colebat exsilium. Mais la renommée de Remnius Palemon, le grammairien, fut plus grande encore. Avec l'aide du même Acilius Sthenelus, il acheta une vigne pour 600 000 sesterces (126 000 fr.). Il sut si bien l'améliorer que la vendange d'une année fut payée 400 000 sesterces 84 000 fr.). Il revendit la vigne à Annœus Seneca quatre fois autant qu'il l'avait payée. – XII, 5. On fait allusion à un affranchi très riche.
[FN: § 2590-2]
TACIT. ; Ann ., XI, 21.
[FN: § 2591-1]
PETR. ; 76.
[FN: § 2591-2]
PETR. ; 77 : Crrdite mihi : assem habeas, assem valeas ; habes, habeberis. Sic amicus vester, qui fuit rana, nunc est rex.
[FN: § 2591-3]
PETR. ; 59. Ce bon Trimalcion est des plus comiques lorsqu'il dit : Diomedes et Ganymedes duo fratres fuerunt. Horum soror erat Helena. Agamemnon illam rapuit et Dianae cervam subiecit. Ita nunc Homeros dicit, quemadmodum, inter se pugnent Troiani et Parentini.
[FN: § 2591-4]
PETR. ; 67.
[FN: § 2592-1]
PETR. ; 67 : Sed narra, mihi, Gai, rogo, Fortanata quare non recumbit ? – Quomodo ? nosti, inquit, illam, Trimalchio, iiisi argentum composuerit, nisi reliquias pueris diviserit, aquam in os suum non coniciet... Venit [Fortunata] ergo galbino succincta cingillo, ita ut infra cerasina appareret tunica et periscelides tortae phaecasiaeque inauratae. Tunc sudario manus tergens, quod in collo liabebat...
[FN: § 2592-2]
PETR. ; 76.
[FN: § 2593-1]
PETR. ; 65. Cet Abinna va vêtu de blanc, avec un licteur et un nombreux cortège. Inter haec triclinii valvas lictor percussit, amictusque veste alba cum ingenti frequentia comissator intravit. Ego maiestate conterritus praetorem putabam venisse. Itaque temptavi assurgere et nudos pedes in terram deferre. Risit hanc trepidationem Agamemnon et contine te, inquit, homo stultissime. Habinas sevir est idemque lapidarius, qui videtur monumenta optime facere. Ces sévirs provenant en très grande partie de la classe des affranchis, étaient pour le moins aisés, car ils étaient tenus à de lourdes prestations – E. DE RUGGIERO ; Diz. Epig., I, s. r. Augustales. D'abord, il y a la « (p. 833) Summa honoraria. Panhormus (sic) C. X 7269 : aram Victoriae Sex. Pompeius Mercator VI vir Aug(ustalis) praeter summ(a)m pro honore d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) s(ua) p(osuit) ». Puis il y a les dépenses pour les jeux. « (p. 834). À l'origine, leur activité se concentrait sur l'organisation des spectacles... ». À Narbonne, (Orelli, 2489), les sévirs sacrifiaient deux fois l'an, à leurs frais, et fournissaient, quatre fois l'an, de l'encens et du vin à tous les coloni et à tous les incolae. - MARQUARDT ; Organ. de l'emp. rom. : « (p. 304) Les attributions des seviri comprenaient, d'une part, l'accomplissement des sacrifices ordinaires... et de festins populaires, dont les frais étaient couverts par l'argent qu'ils avaient payé, lorsque les décurions ne l'avaient pas employé en bâtiments publics de toute nature ». Un hasard singulier veut que parmi les inscriptions qui nous sont restées, il y en ait justement une d'un marmorarius qui était Augustalis. On nomme aussi des negotiatores, un argentarius, un mercator suarius, un vestiarius tenuiarius, purpurarius, pistor, etc. Cela montre comment de la plus basse classe sortait l'aisance.
[FN: § 2593-2]
PETR. ; 46 : ...vides Phileronem catisidicum : si non didicisset, hodie famem a labris non abigeret. Modo, modo collo suo circumferebat onera venalia, nunc etiam adversus Norbanum se extendit. Litterae thesaurum est, et artificium nunquam moritur.
[FN: § 2593-3]
PETR. : 38 : Reliquos autem collibertos eius cave contemnas. Valde sucossi sunt. Vides illum qui in imo imus recumbit : hodie sua octingenta possidet. De nihilo crevit.
[FN: § 2593-4]
MART :
III (59) Sutor cerdo dedit tibi, culta Bononiit, munus.
Fullo dedit Mutinae : nunc ubi caupo dabit ?
III (16) Das gladiatores, sutorum regule, cerdo,
Quodque tibi tribuit subula, sica rapit.
Ebrius es : nec enim faceres id sobrius unquam,
Ut velles corio ludere, cerdo tuo. ...
Tacite rapporte qu'un affranchi avait donné un spectacle de gladiateurs. TACIT. : Ann., IV, 62, ...Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret…
[FN: § 2594-1]
IUVEN. :
I (24).Patricios omnes opibus quum provocet unus,
Quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat.
X (225). Percurram citius, quot villas possideat nunc,
Quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat.
Le scholiaste note : (225) Percurram citius : quot villas habeat extonsor, eo die, qui me tutundit, senator factus. (226) Quo tondente gravis : Licinius ex tonsore senator factus.
[FN: § 2595-1]
Juvénal montre, d'une part les « descendants des Troyens » qui, tombés dans la misère, demandent la sportule, et de l'autre, un affranchi enrichi qui veut aller au-devant des Romains.
1 (102)Prior, inquit, ego adsum :
Cur timeani, dubitemve locum defendere, quamvis
Natus ad Euphraten, molles quod in aure fenestrae
Arguerint, licet ipse negem ? sed quinque tabernae
Quadringenta parant : quid confert purpura maior
Optandum, si Laurenti custodit in agro
Conductas Corvinus oves ? ego possideo plus
Pallante et Licinis ? Exspectent ergo tribuni ;
Vincant divitiae, sacro nec cedat honori,
Nuper in hanc urbem pedibus qui venerat albis :
« Cinq tavernes » pourrait être le nom d'un lieu ; mais cela n'est nullement probable. On blanchissait au gypse les pieds de l'esclave récemment importé d'outre mer, lorsqu'on le mettait en vente.
[FN: § 2595-2]
IUVEN. ; III :
(60) Non possum ferre, Quirites,
Graecam urbem : quamvis quota portio faecis Achaei ?
Iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes,
Et linguam, et mores, et cum tibicine chordas
Obliquas, nec non gentilia tympana secum
Vexit, et ad circum iussas prostare puellas :
Ite, quibus grata est pirta lupa barbara mitra.
[FN: § 2595-3]
IUVEN. ; III :
(158) ... Exeat, inquit,
Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,
Cuius res legi non sufficit ; et sedeaut hic
Lenonum pueri, quocunque in fornice nati.
Hic plaudat nitidi praeconis filius, inter
Pinnirapi cultos iuvenes, iuvenesque lanistae.
Le scholiaste note : nitidi praeconis filius : divitis degenere gladiatoris. Pinnirapi : a pinna. Pinnis pavonum ornari solent gladiatores, si quando ad pompam descendunt.
[FN: § 2597-1]
BELOT : Hist. des ch. rom., t. II : « (p. 385) Mais ce fut Claude qui fit faire le plus grand pas au pouvoir de ses affranchis, nommés à Rome procurateurs (p. 386) du fisc. Dominé par une camarilla, il ordonna que les sentences de ses affranchis fussent respectées comme les siennes. Il leur livra ainsi la justice extraordinaire et personnelle que l'empereur se plaisait à substituer à l'action des tribunaux. Ces causes de péculat, ces accusations de repetundis, pour lesquelles les partis républicains s'étaient livré tant de batailles, étaient maintenant décidées à huis-clos par le comptable Pallas, successeur de l'affranchi Ménandre. Les armées et les provinces se ressentirent de la faveur nouvelle des affranchis. L'affranchi Félix fut nommé tribun de cohorte, et préfet d’aile de cavalerie... et, au sortir de ces commandements militaires, il fut chargé de gouverner la Judée, où Claude envoyait indifféremment des procurateurs chevaliers ou des procurateurs affranchis ». L'auteur note d'autres provinces gouvernées par des procurateurs. « Tacite compte, à la mort de Néron, entre autres provinces gouvernées par les procurateurs, les deux Mauritanies, la Rhétie, la Norique, la Thrace. Bientôt les Alpes maritimes, la Cappadoce (p. 387), obéirent à la juridiction pacifique des procurateurs ».
[FN: § 2597-2]
DION CASS., LXXVIII, 13. L'auteur raconte que Macrin envoya comme lieutenants Agrippa en Dacie, Decius Triccianus en Pannonie. Le premier avait été esclave. Le second avait été simple soldat et portier du gouvernement de la Pannonie.
[FN: § 2597-3]
SENEC. ; Epist., 27 : Calvisius Sabinus memoria nostra fuit dives ; et patrimonium habebat libertini, et ingenium... Idem; Epist., 86 : ... Et adhuc plebeias listulas loquor : quid, cum ad balnea libertinorum pervenero ?... Idem; De benef., II, 27 : Cn. Lentulus augur, divitiarum maximum exemplum, antequam illum libertini pauperem facerent... Idem; Nat. quaest., I, 17 : Iam libertinorum virgunculis in unum speculum non sufficit illa dos, quam dedit populus romanus Scipioni.
[FN: §2597-4]
TACIT. ; Ann., II, 48, parle d'une riche affranchie morte sans avoir fait de testament, et dont Tibère fit attribuer le patrimoine à Æmilius Lepidus, auquel il paraissait qu'elle eût appartenu.
[FN: § 2597-5]
TACIT. ; Ann., XIII, 27 (trad. (Nisard).
[FN: § 2597-6]
SUET. ; Nero, 37. Néron disait qu'il voulait détruire l'ordre sénatorial ac provincias et exercitus equiti romano ac libertis permissurum. TACIT. ; Hist., I, 58 Vitellius ministeria principatus, per libertos agi solita, in equites romanos disponit. - PLINE LE JEUNE loue Trajan de n'avoir pas imité plusieurs de ses prédécesseurs, qui se laissaient gouverner par les affranchis. Paneg., 88 : Plerique principes, cum essent civium domini, libertorum erant servi : horum consiliis, horum nutu regebantur ; per hos audiebant, per hos loquebantur, per hos praeturae etiam et sacerdotia et consulatus, immo et ab his petebantur. Tu libertis tuis summum quidem honorem sed tanquam libertis, habes ; abundeque sufficere his credis, si probi et frugi existimentur. - Hist. Aug. ; A ntoninus Pius, 11 : Amicis suis in imperio suo non aliter usus est quam privatus : quia et ipsi nunquam de eo cum libertis suis per fumum aliquid vendiderunt : siquidem libertis suis severissime usus est. Pertinax, 7. Cet empereur fit vendre ceux qui avaient appartenu à Commode, mais et de his quos vendi iussit, multi postea reducti ad ministerium, oblectaverunt senem, qui per alios principes usque ad senatoriam dignitatem pervenerunt.
[FN: § 2598-1]
DIO CASS. ; LII, 42, p. 693. L'auteur observe : ![]()
![]() . « Puisque rien comme la noblesse ne périt dans les guerres civiles ». En Angleterre, la guerre des Deux Roses eut un effet semblable.
. « Puisque rien comme la noblesse ne périt dans les guerres civiles ». En Angleterre, la guerre des Deux Roses eut un effet semblable.
[FN: § 2598-2]
TACIT. Ann., III, 55.
[FN: § 2598-3]
TACIT. Ann., XI, 23. On objectait : ... non adeo aegram Italiam, ut senatara suppeditare urbi suae nequiret : suffecisse olim indigenas, consanguineis populis ; nec poenitere veteris reipublicae. Quin adhuc memorari exempla quae priscis moribus ad virtutem et gloriam romana indoles prodiderit. An parum quod Veneti et Insubres curiam irruperint, nisi coetus alienigenarum, velut captivitas, inferatur ? Quem ultra honorem residuis nobilium, aut si quis pauper e Latio senator, fore ? Oppleturos omnia divites illos quorum avi proavique, hostilium nationum duces, exercitus nostros ferro vique ceciderint... Mais Claude tint bon et conclut sa réponse au Sénat en disant : (24) Omnia, patres conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere : plebei magistratus post patricios : Latini post plebeios ; ceterarum Italiae gentium post Latinos. Inveterascet hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur inter exempla erit. Ainsi, il décrit bien la circulation des élites.
[FN: § 2598-4]
SUET. ; Vesp., 9 : Amplissimos ordines, et exhaustos caede varia, et contaminatos veteri neglegentia, purgavit, supplevitque, recenso Senatu et Equite ; sum motis indignissimis, et honestissimo quoque Italicorum se provincialium allecto. - AUR. VICT. ; De Caesar., 9. ... simul censu more veterum exercito, senatu motus probrosior quisque ; se, lectis undique optimis viris, mille gentes compositae, cum ducentas aegerrime reperisset, extinctis saevitia tyrannorum plerisque. Ainsi que le remarqua déjà Causabon (ad SUET. ; Caes., 41), gentes doit être entendu dans le sens de patriciens.
[FN: § 2600-1]
DION. CASS. ; LII, 14 à 40, p. 670 à 692. Dion met simplement dans la bouche de Mécène les principes idéaux de l'Empire de son temps. Il insiste (27, p. 681) sur l'opportunité de séparer entièrement les fonctions civiles des fonctions militaires.
[FN: § 2600-2]
DION. CASS. ; LXXIV, 2, p. 1243. L'auteur ajoute que ce fut la cause de la perte de la jeunesse italienne, qui se livra au brigandage et aux luttes des gladiateurs.
[FN: § 2600-2600-3]
MARQUARDT. ; Organ. de l’emp. rom., t. II, p. 585.
[FN: § 2602-1]
PLIN. ; Epist., VII, 31. Il parle d'un individu qu'il a connu lorsqu'il faisait son service militaire : Hunc cum simul militaremus, non solum ut commilito inspexi. Pracerat alae militari : ego iussus a legato consulari rationes alarum et cohortium excutere... Il paraît aussi qu'il trouvait le temps de s'occuper de philosophie et de littérature. - Epist., I, 10. Il parle du philosophe Euphrate : Hunc ego in Syria, cum adolescentulus militarem, penitus et domi inspexi, amarique ab eo laboravi, etsi non erat laborandum. - Epist., III, 11. Il parle d'un autre philosophe : ... et Artemidorum ipsum iam tum, cum in Syria tribunus militarem, arcta familiaritate complexus sum... D'ailleurs, ceux qui voulaient pouvaient aussi faire autrement, et, comme Trajan, faire réellement le service militaire. Paneg., 15 : Neque enim prospexisse castra, brevemque militiam quasi transisse contentus, ita egisti tribunum, ut esse statim dux posses, ... Tacite loue Agricola de n'avoir pas imité les jeunes gens qui passaient dans les plaisirs le temps du service militaire. - TACIT. ; Agric., V : Nec Agricola licenter, more iuvenum qui militiam in lasciviam vertunt, neque segniter, ad voluptates et commeatus titulum tribunatus et inscitiam retulit.
[FN: § 2602-2]
SUET. ; Claud., 25.
[FN: § 2603-1]
DION. CASS. ; LII, 42, p. 694. L'auteur remarque ensuite (LIII, 12, p. 703) que le véritable motif de la division des provinces entre Auguste et le Sénat fut qu'Auguste voulait être seul à avoir des soldats sous son commandement. En outre (LIII, 13, p. 705), il défendit aux sénateurs délégués pour gouverner les provinces de porter l'épée et le vêtement militaire, ce qu'il permit au contraire à ses gouverneurs.
[FN: § 2603-2]
TACIT. ; Ann., II, 59 : ... nam Augustus, inter alia dominationis arcana, vetitis, nisi permissu, ingredi senatoribus, aut equitibus romanis illustribus, seposuit Aegyptum : ne fama urgeret Italiam, quisquis eam provinciam, claustraque terrae ac maris, quamvis levi praesidio adversum ingentes exercitus, insedisset.
[FN: § 2603-3]
Hist. Aug.; Trigint, Tyr., 21 ... qui cum Theodoto vellet imperiu proconsulare decernere, a sacerdotibus est prohibitus, qui dixerunt fasces consulares ingredi Alexandriam non licere... Fertur enim apud Memphim in aurea columna Aegyptiis literis scriptum, tunc demum Aegyptum liberam fore cum in eam venissent Romani fasces, et praetexta Romanorum.
[FN: § 2604-1]
HERODIEN ; II, 11. L'auteur relève aussi le contraste entre les Italiens, au temps de la République, et ceux du temps de Septime Sévère. Il remarque que ce fut Auguste qui leur ôta leurs armes.
[FN: § 2605-1]
Zosim. ; I, 37.
[FN: § 2605-2]
AUREL. VICT. ; De Caesaribus, 33 : Quia primus ipse, metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia vetuit, etiam adire exercitum. La séparation entre les optimales et l'armée continua à devenir toujours plus rigide. Iust. Cod., X, 82 (31), 55 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Isidoro pp. Si quis decurio aut subiectus euriae ausus fuerit ullam adfectare militiam, nulla praescriptione temporis muniatur, sed ad condicionem propriam retrahatur, ne ipse vel eius liberi post talem ipsius stafum procreati quod patriae debetur valeant declinare. - D. III non. April Constantinopoli Isidoro et Senatore conss. [a. 436]. Cfr. Ibidem, XII, 33 (24), 2. - Theod. Cod., VIII, 4, 28. Le service militaire était aussi interdit à d'autres classes de la population. - Iust. Cod., XII, 34 (35). 1. Imp. Iustinianus A. Menae pp. Eos, qui vel in hac alma urbe vel in provinciis cuidam ergasterio praesunt, militare de cetero prohibemus. D'ailleurs, il en excepte les banquiers, auxquels il interdit seulement d'entrer dans la troupe armée, ainsi qu'aux armuriers, à cause de leur utilité pour l'armée. Negotiantes etenim post hanc sanctionera huiusmodi militia privabuntur : illis, qui ad armorum structionem. suam professionem contulerint, minime prohibendis ad competentem suae professionis venire militiam et huiusmodi negotiationem nihilo minus retinere [an. 528-529]. Aux colons aussi l'accès de l'armée était interdit. - Iust. Cod., XII, 33 (34), 3. Impp. Arcadius et Honorius AA. Pulchro magistro utriusque militiae. Cura pervigili observare debebit sublimitas tua, ne coloni vel saltuenses aut ultro se offerentes ad militiam suscipiantur armatam aut cogantur inviti.
[FN: § 2605-3]
Hist. Aug. ; Alex. Sev., 45.
[FN: § 2606-1]
VEGET. ; I, 7. Plus loin : I, 28 : Sed longae securitas pacis homines partim ad delectationem otii, partim ad civilia traduxit officia. Ita cura exercitii militaris primo negligentius agi, postea dissimulari, ad postremum olim in oblivionem perducta cognoscitur... On put observer des faits semblables en Chine ; on en peut observer maintenant, en 1913, chez quelques peuples (§ 2423-1) qui manifestent leur mentalité, par l'humanitarisme démocratique.
[FN: § 2607-1]
Hist. Aug., Alex. Sev., 32 ; Corpora omnium constituit vinariorum, lupinariorum, caligariorum, et omnino omnium artium : hisque ex sese defensores dedit, et iussit quid ad quos indices pertineret. – Cours, t. II, § 803 : «(p. 144) D'une manière générale et sans attacher trop d'importance à des dates qui sont assez incertaines, on peut distinguer une période d'Auguste à Alexandre Sévère, dans laquelle les corporations autorisées par le gouvernement se recrutent librement. Les empereurs interviennent quelquefois pour donner des encouragements à certaines corporations qui ont des buts d'utilité publique. Une seconde période commence avec Alexandre Sévère, qui organisa, ou peut-être réorganisa les corporations... Dans (p. 145) la troisième période, qui va de Constantin à Théodose, le caractère coercitif des corporations s'accentue. L'équilibre est rompu ; les privilèges ne compensent plus les charges. Enfin, de Théodose à Honorius, la corporation établit ne sorte de servitude et les hommes font tous leurs efforts pour s'y soustraire. Le recrutement est forcé, comme le dit Serrigny (Droit pub., I, p. 170) : „ Cette interdiction de changer sa condition est un des traits le plus caractéristique de la législation impériale. Elle s'appliquait à un si grand nombre d'états ou de professions, qu'on peut la considérer comme une règle générale pour la masse des habitants de l'empire romain“ ».
[FN: § 2607-2]
Il faut entendre cela au point de vue de la production, qui est celui dont il s'agit maintenant. Au point de vue de la répartition des richesses, une organisation dans laquelle les corporations sont exploitées diffère entièrement d'une autre où ce sont elles qui exploitent le pays.
[FN: § 2607-3]
La cristallisation s'étend à l'ordre des augustales, qui était au-dessous de celui des décurions. DE RUGGIERO ; loc. cit. § 2583-1 : « (p. 851) Depuis la fin, de la troisième décade du IIe, siècle, une transformation radicale s'accomplit dans les institutions augustales. Elle s'étend d'une manière spéciale à ces communautés dans lesquelles il y avait eu jusqu'alors un collège annuel de sexviri Augustales... Mais dans les communes mêmes où jusqu'alors il n'y avait eu que des Augustales... on rencontre maintenant à leur place bon nombre de sexviri Augustales, organisés en corporations... Là même où le culte d'Auguste de la plèbe n'avait d'abord pas été admis... surgit actuellement une corporation organisée en collège qu'on désigne par le nom de sexviri Augustales ». Au temps de la prospérité de l'Empire, c'était un honneur très recherché de faire partie des sexviri Augustales. Au temps de la décadence, pour beaucoup de personnes cela devient un fardeau insupportable auquel on tâche d'échapper de toute façon. - BOUCHÉ-LECLERCQ, cité dans MARQUARDT ; Le culte chez les Romains : « (p. 233) Comme tous les honneurs sous l'empire, ceux-ci étaient onéreux et il vint un moment où ils ne furent plus guère qu'un impôt ajouté à tant d'autres... on rendit à la corporation quelques-uns des droits qu'elle avait perdus en cessant d'être une association privée, la capacité civile ou faculté de recevoir des legs et donations, la gestion de ses deniers et le choix de ses comptables... C'était un moyen de rendre un peu de vie à des organes menacés d'atrophie. Et cependant il fallut, vers la fin du IIIe siècle, appliquer à ce sacerdoce le système de l'investiture forcée au moyen duquel on maintenait au complet les conseils municipaux et les municipalités (C. I. L., X, 114. Cfr. II, 4514). Les décurions qui nommaient les Augustales exerçaient ainsi sur d'autres la contrainte qu'ils subissaient eux-mêmes ».
[FN: § 2609-1]
Guizot, en peu de mots, décrit bien l'état de la société, au temps de saint Grégoire de Tours. GUIZOT : Grég. de Tours, t. II : « (p. 265) Ce qu'était l'administration en ces temps de confusion, on pourrait l'imaginer, ne le sût-on pas par les documents. Les institutions procédant du pouvoir central se sont effacées ; les institutions municipales ont été en partie conservées par les villes, à l'existence desquelles elles étaient nécessaires, et tolérées par leurs nouveaux maîtres. Ceux-ci ont ramassé quelques-uns des rouages de la grande machine administrative créée par les Romains et les ont utilisés, mais en leur laissant subir les altérations qui devaient résulter du contact des habitudes germaines. Le désordre s'est étendu des institutions administratives aux circonscriptions géographiques qui leur répondaient... ».
[FN: § 2610-1]
Cours, t. II, § 802 : « (p. 144) La mauvaise organisation économique de l'Empire romain, la destruction systématique des capitaux mobiliers, affectaient de plus en plus la production. Au lieu de tâcher de remonter le courant qui conduisait à d'aussi funestes résultats, on s'enfonça de plus en plus dans la protection, et le gouvernement s'occupa d'organiser la production économique. On commença par donner des privilèges aux corporations d'arts et métiers, on finit par les réduire en une sorte de servage ». Voir : JULES NICOLE, Le livre du préfet ou l'Édit de l'Empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople, pour savoir jusqu'où put arriver, en ce temps là, la cristallisation sociale, l'organisation, et par conséquent pour avoir une lointaine idée de la limite analogue vers laquelle s'acheminent aujourd'hui nos sociétés. La description faite par l'auteur du Cours, de l'évolution économique de l'Empire romain, n'est pas exempte des erreurs indiquées aux § 2334 et 2385. Ce fait est remarquable, parce que la théorie des crises économiques du même auteur non seulement les évite, mais encore les dévoile. Ce fait est peut-être en rapport avec les suivants (§ 2547-1). 1° L'auteur cédait, au moins en partie, au préjugé des économistes qui estiment qu'on peut séparer entièrement le phénomène économique des autres phénomènes sociaux. Ce n'est qu'après avoir achevé les études exposées ici qu'il se rendit pleinement compte de cette erreur. En attendant, celle-ci l'avait empêché de faire le petit pas qui, de la théorie particulière des crises économiques, conduit à la théorie générale des phénomènes sociaux, indiquée aux § 2330 et sv. – 2° Il cédait aussi, sans trop s'en rendre compte, à la tendance habituelle aux économistes et aux sociologues, qui ne veulent pas se borner à la recherche et à la découverte des uniformités (lois) que contiennent les rapports des faits, mais qui, bien que disposant seulement de connaissances assez rudimentaires et assez imparfaites, croient pouvoir connaître le but vers lequel la société « doit » et peut marcher, et qui s'imaginent que leurs discours ont la vertu de contribuer à changer les faits et le pouvoir de rapprocher de ce but. Ils n'ont pas encore réussi à donner une forme tant soit peu bonne à l'étude des mouvements réels (§ 129), et ils s'imaginent pouvoir accomplir l'étude beaucoup plus difficile des mouvements virtuels (§ 130, 2653 : II-a). Il ne leur suffit pas de se livrer à des recherches scientifiques : ils veulent aussi conseiller et prêcher. – 3° L'auteur s'efforçait de substituer partout l'expérience scientifique à la foi, et ne s'apercevait pas qu'il restait en lui un vestige de foi, manifestée par une certaine inclination pour la liberté. Cette inclination dépasse la science pure, qui recherche les rapports des faits, sans aucune idée préconçue. Nous relevons cela dans le but de donner un exemple des obstacles qui, dans les sciences sociales, s'opposent à la recherche de la vérité expérimentale.
[FN: § 2610-2]
PRISCUS PANITES, dans Fragm. hist. graec., t. IV, p. 86-87. Si la période ascendante de notre ploutocratie démagogique se prolonge un certain temps, et amplifie le mouvement dont nous voyons le début, on peut imaginer qu'un homme ayant réussi à fuir l'oppression de ce temps-là, et réfugié chez certains X, répète sans y changer beaucoup le discours de l'interlocuteur de Priscus. Il dira que « ceux qui se trouvent chez les X ont la vie tranquille, après avoir travaillé, pour faire quelques épargnes : chacun jouit de ses biens, et n'est molesté en aucune façon par qui que ce soit ; tandis que là où il était avant, de toute manière, il était dépouillé et opprimé. De lourds impôts l'accablaient, établis par le vote du plus grand nombre, lequel ne les payait pas ; c'était un nombre toujours plus restreint de gens qui les payaient ; et ils étaient augmentés sans mesure, pour faire face aux dépenses énormes du gouvernement de la ploutocratie démagogique. En outre, il subissait les vexations de ceux qui font partie de ce gouvernement ou en sont les suppôts. Les lois ne sont pas égales pour tout le monde. Si quelque violateur de la loi appartient d'une manière ou d'une autre à la classe dominante, son délit n'encourt aucune peine ; si c'est quelqu'un qui, comme le contrebandier, attente aux privilèges fiscaux de cette classe, on lui applique la peine prévue par la loi. Un sort meilleur n'attend pas l'innocent accusé à tort, qui ne porte préjudice à personne, et voudrait qu'on ne lui en portât pas non plus, en traînant en longueur les procès, en lui faisant dépenser son argent, grâce aux caprices des « bons juges », et aux menées de ceux qui veulent se concilier la faveur des politiciens et des avocats-princes. Il y a, en effet, une manière absolument inique d'obtenir par protection ce qui ressortit à la loi ; cela en se mettant au service des gouvernants, et en leur étant utile aux élections, par lesquelles ils accaparent le pouvoir ».
[FN: § 2610-3]
PRISC. PAN. ; loc. cit. § 2610-2, p. 77.
[FN: § 2610-4]
PRISC. PAN. ; loc. cit. § 2610-2, p. 97.
[FN: § 2611-1]
SYNESII epistolae, dans Epist. graeci (Didot), p. 708, (252-253) epist. CX. ![]() . Voir, epist. CXXVII, p. 714-715, (262), ce qu'on dit d'un certain Euctale, préfet d'Égypte et brigand très brave.
. Voir, epist. CXXVII, p. 714-715, (262), ce qu'on dit d'un certain Euctale, préfet d'Égypte et brigand très brave.
[FN: § 2611-2]
Au temps de la guerre européenne de 1914, la bureaucratie russe renouvela exactement les erreurs commises dans la guerre contre le Japon. Elle sembla n'avoir rien appris de l'expérience. Un discours prononcé à la séance de la Douma, le 14 août 1915, par M. Maklakov, frère d'un ex-ministre de l'Intérieur, offre sous une forme modérée une vue synthétique de cet état social. « ... Cela nous amène à la question la plus épineuse de notre vie politique. Ce n'est un secret pour personne que la Russie est, par malheur, le modèle classique de l'État où beaucoup de gens ne sont pas à leur place [sénilité d'une bureaucratie qui autrefois fut bonne] (approbations à gauche et au centre). C'est le pays où l'on se plaint de manquer d'hommes et où l'on ne fait aucun cas de ceux qui y sont. Nous savons que, par malheur, ce sont surtout les gens complaisants qui réussissent, les nullités aimables (approbations), les causeurs agréables, les gens qui savent descendre le courant et deviner où le vent va souffler ; et ceux qui ne réussissent pas sont tous les hommes de caractère et de volonté et de science réelle [cette description de la circulation de la classe gouvernante est remarquable : elle est faite par un homme pratique]. Les choses en sont là, messieurs, qu'une carrière rapide et parfois brillante est un mauvais point pour un homme ; nous savons que derrière une belle carrière il n'y a pas des talents, des mérites et des services, mais des complaisances, des complicités, des protections et des faveurs (approbations à gauche et au centre). Nombre de nominations sont un scandale public, un défi à l'opinion publique ; et quand on s'aperçoit de l'erreur, il est trop tard pour éloigner ces créatures, le prestige du pouvoir ne le permet pas. Le nouveau gouvernement, dont la tâche est de vaincre les Allemands, verra bien vite qu'il est plus difficile encore de vaincre la résistance de ses subordonnés. Le grand obstacle contre lequel sont venues se briser tant d'initiatives, c'est le personnel administratif ». Un orateur socialiste avait rejeté sur le régime « despotique » la faute du manque de préparation de la Russie. M. Markov répondit très bien : « Mr. Adjemov a dit très justement que, dans cette affreuse guerre, l'Allemagne était prête. Il nous a dit aussi, en manière de reproche, que la France l'était aussi. Les Français étaient encore plus mal préparés que nous, et la guerre a montré que l'allié le plus fort c'est la Russie. À gauche, on dit que si nous ne sommes pas prêts, c'est qu'on a enchaîné la liberté ; mais les gouvernements français, anglais et belge ne l'ont pas enchaînée, et pourtant ils n'étaient pas prêts, ils l'étaient moins que la Russie ». (Journal de Genève, 3 septembre 1915). Ajoutons que, comparé au gouvernement russe actuel, le gouvernement de la grande Catherine était plutôt plus que moins autocratique, ce qui ne l'empêcha pas d'être victorieux en différentes guerres.
Les Tables analytique, des auteurs, et des ouvrages cités
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÉRES
contenues dans les deux volumes↩
Les chiffres arabes indiquent les paragraphes.
Ceux qui sont munis d'un * se rapportent aux paragraphes les plus importants.
I GÉNÉRALITÉS
(I-a)
Les règles suivies dans un ouvrage n'ont rien d'absolu (II-l) ; elles sont établies suivant le but de l'ouvrage. Exposé de ces règles et de ce but [Chap. I, §4*, §5*, §6*, §70*, §71 ; voir Sociologie logico-expérimentale, Étude à laquelle nous procédons].
(I-b)
Pour faciliter l'étude, nous divisons les faits observés dans les sociétés humaines en deux catégories : (M) Les manifestations, par actes ou paroles, des instincts, des sentiments, des tendances, des appétits, etc., des intérêts, et les conséquences logiques ou pseudo-logiques tirées de ces manifestations. Cette catégorie comprend donc les actions non-logiques et les actions logiques [Ch. II]. On peut diviser en deux autres catégories la partie qui concerne les actions non-logiques, soit : Une partie (d), qui ne donne naissance à aucune manifestation verbale : une autre partie, (c), qui donne naissance à des manifestations verbales [§851* à §854, §1690*, §2083]. (N) Tous les autres faits du milieu dans lequel se trouvent les sociétés humaines. Cette division des faits est exclusivement expérimentale. Les deux catégories (M) et (N) ne correspondent nullement au « monde interne » et au « monde externe » des métaphysiciens [95* ; voir Concepts] ; ce sont de simples catégories de faits. Chez les animaux, la partie (c) fait défaut ; il ne reste que la partie (d) [voir : Actions non-logiques] ; chez les hommes, on néglige, on ne prend pas garde, on ignore que de nombreux groupes constituant (c) sont uniquement des manifestations d'instincts, de tendances, etc. [voir : Actions non-logiques, Dérivations]. L'un des buts du présent ouvrage est d'ôter ces voiles de la réalité [Ch. II, III, IV, V].
(I-c)
La partie (c) prédomine chez les hommes, puisqu'ils ont l'habitude d'exprimer verba- lement instincts, sentiments, etc., et qu'ils se complaisent à y ajouter des développements logiques ou pseudo-logiques. Elle se sépare facilement et spontanément des faits dont elle n'est qu'une manifestation, et paraît alors avoir une existence propre [§1690 ; voir : III. Langage]. La partie (c) se divise en deux autres : (a) une partie peu variable [résidus] ; (b) une partie très variable [dérivations] – §798* à §841 ; Ch. V, VII, VIII, IX, XI.
(I-d)
Nous avons à étudier les rapports suivants entre les catégories (M) et (N) de faits : (α) Les rapports mutuels entre (M) et (N) ; Les rapports de (M) et de (N) avec les théories, les doctrines, les propositions ; (γ) Les rapports de (M) et de (N) avec la constitution des sociétés humaines. Dans une première approximation, on peut, en de très nombreux cas, réduire la partie (M) à la partie (c), spécialement dans l'étude des théories [Ch. II, III, IV, V].
(I-e)
(α) Rapports mutuels entre (M) et (N). Il existe un certain rapport, qui n'est pas une correspondance parfaite, entre (M) et (N) ; de même entre les diverses parties de (M) et de (N), soit, en général, entre diverses catégories de faits [voir : Mutuelle dépendance]. Tout être vivant est adapté en une certaine mesure, au milieu où il vit, et aussi bien au point de vue des formes matérielles qu'à celles de l'instinct, des sentiments, etc., il se trouve dans une certaine dépendance avec ce milieu. Par exemple, l'instinct des animaux qui vivent de proie est en corrélation avec l'existence de cette proie [§1768 à §1770]. Plus brièvement, on peut dire qu'il peut y avoir certaines corrélations entre ces groupes de faits de (M) et les groupes de faits de (N). Nous avons surtout à nous occuper des corrélations entre (c) et (N). On peut comparer les groupes de (c) à des nébuleuses ayant chacune un noyau entouré d'un amas. Dans quelques-unes de ces nébuleuses, il y a, tant bien que mal, une certaine correspondance entre le noyau et les faits (N) ; mais avec l'amas cette correspondance fait défaut. Dans d'autres nébuleuses, la correspondance fait défaut avec le noyau et avec l'amas [§1767]. En d'autres termes : certains groupes de (c) sont semblables à une mauvaise photographie de (N) [§1778-1*, (III-f] ; certains autres n'ont que peu de chose ou rien de commun avec (N) [Ch. XI, XII].
(I-f)
Parmi les groupes de (c) qui n'ont rien de commun avec (N) se trouvent ceux qui correspondent entièrement à un monde dit surnaturel ou métaphysique, en somme à un monde non-expérimental ; et aussi ceux dans lesquels cette correspondance n'est que partielle. Les sciences logico-expérimentales ne s'occupent pas de ces rapports [voir : (II-g), (II-h), (II-i).
(I-g)
(β) Rapports de (M) et de (N) avec les théories. Au lieu de (M) nous pouvons, pour une première approximation, considérer (c). Au point de vue indiqué, la catégorie (c) peut être divisée en deux sous-catégories : (c1) celle qui réside en l'auteur de la théorie ; (c2) celle qui réside en d'autres hommes, avec lesquels il est en relations ; (c1) et (c2) ont des parties communes. Toute théorie dépend évidemment de (c1). Les différences entre les diverses théories proviennent des variétés de cette dépendance et des divers modes suivant lesquels on tient compte de (c2) et de N [voir : Objectif et Subjectif, Dérivations, Résidus ; Ch. I, III, IV, V].
(I-h)
Il existe une partie commune à la sous-catégorie (c1) et à la sous-catégorie (c2), chez les individus de la collectivité à laquelle appartient l'auteur. Ce fait explique l'illusion des personnes qui, dans leurs raisonnements, partant de (c1), croient partir d'une entité impersonnelle, et atteindre à l'absolu en s'élevant au-dessus du contingent [voir : Dérivations, Esprit humain, Consentement].
(I-i)
(γ) Rapports de (M) et de (N) avec la constitution des sociétés humaines. À ce point de vue, on peut diviser (M) en deux parties : (Ms) Instincts, sentiments, etc. [voir Résidus] ; (Mr) Raisonnements [voir Dérivations]. Théoriquement, à l'un des extrêmes, on a des sociétés déterminées par (Ms) et par (N) : telles sont probablement les sociétés animales. À l'autre extrême, on aurait des sociétés déterminées par (Mr) et par (N). Mais ces sociétés n'existent pas dans le monde concret [2143]. Croire qu'elles peuvent exister, est l'un des dogmes qui divinisent la Raison ou la Science [voir : Religion et métaphysique de la Raison, Idem de la Science]. Les sociétés humaines occupent des degrés intermédiaires [2146]. Pour autant que nous pouvons le savoir, l'ensemble de (M) et de (N) paraît déterminer la constitution de ces sociétés [Ch. XII].
(I-l)
Parmi les rapports de (M) et de (N) avec la constitution des sociétés, une place très importante appartient aux rapports avec les diverses utilités des individus, des collectivités, des sociétés, de la race humaine, etc. [voir : Utilité]. La science logico-expérimentale ne peut en avoir connaissance que par l'examen des faits (II-b) ; les sciences non-logico-expéri- mentales fixent habituellement a priori tous ces rapports ou une partie d'entre eux. Elles les réduisent très souvent à une identité entre certaines utilités et une de leurs entités à laquelle elles donnent le nom de « vérité » [Ch. XI, XII, XIII ; voir : Métaphysique et Théologie, Vérité et Utilité].
(I-m)
La société humaine est hétérogène. La théologie de l'égalité nie cette hétérogénéité, comme autrefois la théologie chrétienne nia les antipodes. La science logico-expérimentale ne peut se soucier ni de l'une ni de l'autre, lorsqu'elle recherche les uniformités des faits ainsi travestis. Elle s'en occupe, au contraire, pour connaître comment ces théologies se sont constituées, et à quels sentiments, tendances, etc., elles correspondent [voir : Dérivations, Résidus.] En une première approximation, certains phénomènes peuvent être considérés en moyenne, pour une société donnée ; mais il est presque toujours indispensable de procéder à une seconde approximation qui tienne compte de l'hétérogénéité. Nous devons dès l'abord considérer certains autres phénomènes en rapport avec l'hétérogénéité sociale, afin de ne pas nous éloigner trop de la réalité. Pour étudier cette hétérogénéité, on peut diviser la société en différentes classes ou castes, suivant divers critères. Il faut considérer ces classes ou castes, non seulement à l'état statique, mais aussi à l'état dynamique. De là les études sur la circulation des élites, sur la circulation des classes de rentiers, de spéculateurs, et d'autres encore. Enfin, il faut tenir compte des caractères différents de ces classes, pour étudier la forme et l'évolution de l'ensemble social (I-r) [voir : Classes sociales ou castes, Démocratie, Évolution, Proportion des résidus, etc., Résidus, Répartition et changement dans l'ensemble d'une société, Utilité des doctrines, Spéculateurs, Vérité].
(I-n)
La société humaine est considérée comme un système de molécules [§2066*] qui ont certaines propriétés, dans l'espace et dans le temps, sont soumises à certaines liaisons, présentent certains rapports. Les raisonnements [dérivations], les théories, les croyances qui ont cours dans cet agrégat, sont considérés comme des manifestations de l'état de cet agrégat, et sont étudiés comme des faits, à l'égal de tous les autres faits sociaux (II-e). Nous en recherchons les uniformités, et nous nous efforçons de remonter à d'autres faits dont ceux-ci procèdent. Nous n'entendons nullement opposer une dérivation à une autre dérivation, une croyance à une autre croyance. Il nous importe seulement de savoir en quel rapport se trouvent les dérivations et les croyances entre elles et avec les autres faits, dans le temps et dans l'espace [voir : Apostolat, Applications pratiques, Actions, Ensemble social, Économie, Phénomène économique, Éléments qui déterminent l'équilibre économique et l'équilibre social, Équilibre social et équilibre économique, Expérience, Formes sociales, Lois expé- rimentales, Utilité, Maximum d'utilité, Méthode historique, Morale, Objectif et Subjectif, Système social, Résidus, Dérivations, Sentiment, Société, Sociologie logico-expérimentale, Étude à laquelle nous procédons, Histoire, Spéculateurs, Théories].
(I-o)
Les phénomènes sociaux présentent habituellement une forme ondulée, oscillatoire. Les ondes sont de divers genres et de diverses intensités. Elles peuvent, par conséquent, être divisées en différentes catégories, qui indiquent certaines périodes des phénomènes [voir : Ondes, Périodes économiques et sociales ; Ch. XIII].
(I-p)
Mutuelle dépendance. Les molécules du système social sont mutuellement dépendantes dans l'espace et dans le temps. La mutuelle dépendance dans l'espace apparaît dans les rapports des phénomènes sociaux. Soient A, B, C... , les diverses parties en lesquelles, pour faciliter notre étude, nous estimons utile de diviser l'ensemble du phénomène social. La science logico-expérimentale qui étudie A [par exemple l'économie] tient compte directement de la mutuelle dépendance des molécules de A. Les sciences logico-expérimentales qui étudient B, C.... procèdent de même (voir : Mutuelle dépendance]. Ensuite, la science logico- expérimentale qui étudie l'ensemble A, B, ou A, B, C, ou A, B, C, D..., etc., doit tenir compte de la mutuelle dépendance de A et de B, ou de A, de B, de C, etc. On exprime ce fait en disant que la science logico-expérimentale sépare l'analyse de la synthèse, et fait succéder celle-ci à celle-là (II-q) ; et aussi en observant que la science qui étudie A ne peut donner une théorie complète des phénomènes concrets dont se compose apparemment A (II-r). En réalité, A se compose uniquement d'abstractions de ces phénomènes, dont on a précisément éliminé toutes les parties qui dépendent de B, C, D,... La synthèse, qui fait suite à l'analyse, a pour but de rendre à ces parties leur place. Les personnes qui, en sciences sociales, suivent les méthodes des sciences non logico-expérimentales, ne peuvent comprendre cela, parce qu'elles raisonnent sur des concepts [94, 95*] plus que sur des faits ; et les concepts sont non seulement beaucoup plus simples que les faits, mais apparaissent en outre beaucoup plus indépendants [voir : Juste, Injuste, Moral, Immoral, Pratique et Théorie, Prescriptions]. De l'incapacité de ces auteurs à comprendre la réalité expérimentale, il résulte que lorsqu'on observe que la théorie logico-expérimentale qui étudie A ne peut expliquer un phénomène concret apparemment compris dans A, ils concluent qu'il faut rejeter cette science, tandis qu'au contraire il faut seulement la compléter en y ajoutant d'autres études (II-s). Ou bien ils font pis, et usent d'une dérivation verbale qui révèle leur grande ignorance de la réalité expérimentale ; ils affirment que les lois économiques et sociales souffrent des exceptions, et ils ne s'aperçoivent pas du ridicule qu'il y a à affirmer l'existence d'uniformités non- uniformes [§109*, §1689-3*, §1792*].
(I-q)
Mutuelle dépendance. Si l'on considère les phénomènes dans le temps, aux observations précédentes il faut en ajouter d'autres. La forme des phénomènes sociaux est essentiellement oscillatoire (I-o). Pour un phénomène A, nous avons une suite d'oscillations ; de même pour les phénomènes B, C, D,... Il faut considérer : 1° la mutuelle dépendance des oscillations de A, et de même celle des oscillations de B, C, D,... séparément pour chaque phénomène ; la mutuelle dépendance des oscillations des différents phénomènes [§2552*]. Cette dernière étude se rapproche beaucoup plus que la première de l'étude de la mutuelle dépendance dans l'espace (I-p). L'action des oscillations précédentes sur les suivantes pourrait apparaître dans l'étude de l'évolution, si l'on accomplissait cette étude en tenant compte de la forme oscillatoire des phénomènes [§2585]. Beaucoup de personnes sont empêchées de le faire, parce qu'elles recherchent, afin de la faire disparaître, la cause des maux de la société [§2541] ; ou bien parce qu'au lieu d'étudier comment sont les faits, elles prêchent en vue de les modifier ; ou parce qu'à l'histoire logico-expérimentales, elles substituent des histoires éthiques, théologiques, etc. [voir : Histoire]. En réalité, la succession des oscillations peut, pour un grand nombre de phénomènes, se produire d'une manière grossièrement analogue à la succession des divers âges de la vie humaine [§2541]. De même que la naissance est pour l'homme l'origine de la jeunesse, et qu'avec la jeunesse elle est l'origine de l'âge mûr, et enfin de la vieillesse et de la mort, de même les périodes précédentes des phénomènes sociaux peuvent, dans une certaine mesure, être considérées comme l' « origine » des périodes suivantes, et certains faits peuvent favoriser d'abord la prospérité, ensuite la décadence [2541, 2585*]. Tout cela est contraire aux résultats des théories et des histoires non logico- expérimentales, qui, de l'éthique, de la métaphysique ou de quelque théologie, se flattent de tirer un jugement absolu (II-m) sur la valeur des faits [voir : Théories, Religions, Métaphysique, Sociologie].
(I-r)
Proportions des résidus dans les diverses classes sociales. Si, parmi les innombrables éléments qui sont en rapport avec les formes sociales et leurs évolutions, on recherche les faits principaux, on y trouvera la proportion des résidus dans les diverses classes sociales, et surtout la proportion des résidus de la Ie et de la IIe classes, dans la partie gouvernante et dans la partie gouvernée. L'histoire confirme qu'on obtient une première et grossière image des phénomènes, en portant son attention principalement sur ces proportions, et d'une manière subordonnée à d'autres circonstances importantes [Ch. XII, XIII].
II THÉORIES LOGICO-EXPÉRIMENTALES ET THÉORIES NON LOGICO-EXPÉRIMENTALES
Sauf indication contraire, par « expérience » il faut entendre « expérience et observation ».
(II-a)
Pour trancher un différend, il faut un juge [§17 *, §27, §28, §961]. Dans les sciences logico-expérimentales, ce juge est exclusivement l'expérience objective, dont on tire les preuves [§16, §17, §42, §69*-7, §475]. Dans les sciences non logico-expérimentales, on peut avoir divers autres juges. Tels seraient les livres sacrés pour les croyants de certaines religions, la « conscience » pour certains métaphysiciens, l'auto-observation pour d'autres, les principes « nécessaires » pour d'autres encore, etc. [voir : Vérité, Auto-observation, Néo- chrétiens, Droit naturel, Droite raison, Nature, Bien, Métaphysique, etc.]. Très souvent les sciences non logico-expérimentales ont pour juge l'accord avec les sentiments [§42, §49, §581 : voir Logique des sentiments, Persuader.] On fait en outre intervenir la considération de l'utilité : une doctrine passant pour « vraie » parce qu'elle est « utile » [voir : Vérité] – [§423, §473, §474, §475, §581, §593, §594, §961 : voir : Étude à laquelle nous procédons. Sociologie].
(II-b)
Les théories logico-expérimentales se laissent guider uniquement par les faits ; elles sont constituées par des propositions descriptives qui affirment des uniformités expérimentales, et par des conséquences logiques de ces propositions [voir : Théories]. Les théories non-logico- expérimentales visent à dominer les faits, et renferment des propositions qui ajoutent quelque chose aux uniformités expérimentales [§55, §56, §521, §524 ; voir : Lois (uniformités), Principes, Métaphysique].
(II-c)
Les sciences logico-expérimentales déduisent les principes des faits [2078-1], auxquels les principes sont toujours subordonnés. Les sciences non-logico-expérimentales posent a priori certains principes dont les faits dépendent [§10, §11, §22, §23*, §24, §54* à §56, §57*, §63*, §90 à §93, §343, §514, §521, §638*, §642*, §643*, §665, §976, §1532, §2397, §2398].
(II-d)
Les théories logico-expérimentales raisonnent sur les faits, c'est-à-dire sur les catégories (c2) et (N) de (I-g) ; elles tiennent compte des éléments (c1) uniquement comme de simples faits, jamais comme de sentiments qui s'imposent ; elles s'occupent exclusivement de mettre en rapport certains faits avec d'autres faits [voir : Explications] ; tout ce qui dépasse l'expérience leur est étranger [Ch. IV, VI ; les abstractions sont des parties communes à certains faits. Les théories non logico-expérimentales raisonnent au moyen de sentiments (c1) de l'auteur (I-g), et surtout grâce à l'impression que produisent sur lui certains mots [voir : Langage] ; elles s'occupent non seulement des faits, mais aussi de certaines entités qui dépassent l'expérience [Ch. IV, V], et avec lesquelles elles mettent en rapport les faits. Pour de telles théories les abstractions ne sont pas seulement des résumés de certaines parties des faits : elles ont une existence propre et indépendante. La différence entre les théories logico- expérimentales et celles qui ne le sont pas consiste avant tout en ce que les premières ont pour but de réduire à zéro la partie contenant exclusivement (c1) [§2411 * ; Ch. I] ; les secondes attribuent, souvent implicitement, parfois explicitement, un rôle plus ou moins prépondérant et dominant à (c1) [voir : [Classification, Théories]. À l'un des extrêmes se trouvent les théories qui s'efforcent de combattre la prédominance du groupe (c1), pour ne s'attacher qu'à (c2) et à (N) ; du moins autant que possible, car il est bien difficile d'éviter entièrement (c1). À l'autre extrême se trouvent les théories qui attribuent un rôle prédominant aux sentiments exprimés par (c1) ; du moins autant qu'elles le peuvent, car il est de même bien difficile d'ignorer entièrement (c2) et (N) [§142*, §143, §170] – [§9, §10, §69, §75, §76*, §108, §170, §514-2, 521, 803, §804, §977* à §979, §2411 ; Ch. I, III, IV, V ; voir : Objectif et subjectif, Hypothèses expérimentales et hypothèses non-expérimentales, Économie en partie non logico-expérimentale, Sociologie en partie non logico-expérimentale].
(II-e)
Les sciences logico-expérimentales étudient comme de simples faits sociaux (I-n) les théories, les doctrines, les propositions, etc., qui ont cours dans la société, même si ces théories, doctrines, etc., ne sont pas logico-expérimentales, ou si elles sont fantaisistes, absurdes, etc. [§7, §12, §69*-6°, §81, §145, §466, §514-2, §838, §843, §845]. Analogies avec l'étude de la philologie [§346, §468, §469, §659, §879* à §883 ; voir : Dérivations].
(II-f)
Chronologiquement, les sciences non-logico-expérimentales précèdent d'habitude les sciences logico-expérimentales [§57].
(II-g)
Le domaine des théories logico-expérimentales est nettement distinct de celui des théories non logico-expérimentales, et n'a aucun point de contact avec lui. L'étude du monde expérimental n'a rien de commun avec l'étude du monde non-expérimental [§16, §43, §69*- 2°, §70, §97, §474, §477, §481, §973]. Chaque étude est souveraine dans son domaine, et l'on ne saurait admettre qu'elle envahisse celui de l'autre [§16, §43, §69*-3°, §70*, §477].
(II-h)
Les dieux, les êtres divinisés sont en dehors de la réalité expérimentale à l'égal des abstractions métaphysiques [voir : Métaphysique et théologie], ou des abstractions pseudo- expérimentales [voir : Théories, Néo-chrétiens]. Pour la science logico-expérimentale, autant vaut une simple abstraction métaphysique qu'une abstraction divinisée [§1667 ; voir Gnose]. Au point de vue de l'approximation de la réalité expérimentale, autant valent les entités et les principes métaphysiques que les entités et les principes théologiques, et en général les entités et les principes non-expérimentaux [§67, §616, §928, §1667, §1767 ; voir : Entités, Religion, Métaphysique]. Il n'y a pas de religion plus ou moins scientifique qu'une autre [§16-2, §43, §309, §377, §569, §570, §616, §630*, §765, §928, §1533, §1767 ; voir : Néo-chrétiens, Modernistes]. La métaphysique n'est pas plus « scientifique », plus près de la réalité que la théologie [§67, §378*, §928, §1533, §1538 ; voir : Impératif catégorique, Droite Raison, Nature, etc.].
(II-i)
La science logico-expérimentale ne peut accepter de théorèmes établissant des rapports entre des choses qui, toutes ou en partie, sont en dehors du monde expérimental (§479, §1667). De même elle ne peut accepter, si la vérification expérimentale fait défaut, des théorèmes qui établissent des rapports uniquement entre des choses du monde expérimental, mais qui sont obtenus grâce à l'élimination d'entités non-expérimentales [§479, §480* à §482, §1540, §1607*, §1608]. Enfin, elle repousse aussi la conclusion qu'on voudrait tirer du fait que ces théorèmes sont ou ne sont pas vérifiés par l'expérience, pour démontrer l'existence ou la non-existence hors du monde expérimental, de l'entité éliminée [§481*, §487, §516 ; voir : Religions, Prophéties, Miracles, Entités, etc.]. Toutes ces propositions sont des conséquences de (II-g).
(II-l)
Étant donné qu'on ne peut comparer d'une manière absolue l'étude logico-expérimentale avec des études non logico-expérimentales, on ne peut dire laquelle est la « meilleure », la « moins bonne », la pire. On pourrait le dire d'une manière contingente, en indiquant le but que l'on veut atteindre [§70*, §71 voir : Casuistique, Fin, Vérité, etc.].
(II-m)
Les sciences logico-expérimentales sont entièrement contingentes ; les sciences non logico-expérimentales visent à l'absolu [voir : Absolu et contingent]. Les premières n'ont pas de conclusions « certaines », « nécessaires » [§1531], « absolues », mais seulement probables, très probables [voir : Probabilité]. Ces conclusions sont toujours énoncées avec la restriction : dans les limites du temps, de l'espace et de l’expérience à nous connus [§69-5°]. Les secondes ont des conclusions « certaines » « nécessaires », « absolues », sans conditions restrictives [§47, §69*-5°, §97, §408, §529-2, §976, §1068, §1531*, §1532, (I-r)].
(II-n)
Les sciences logico-expérimentales n'ont pas de principes « certains ». Les sciences non- logico-expérimentales ont de tels principes, auxquels elles donnent le nom de « principes naturels » ou « nécessaires », de « lois » considérées comme différentes des uniformités expérimentales, d'axiomes théologiques ou métaphysiques, etc. [§55, §56, §90, §91, §642, §1068 ; voir : Lois (uniformités), Métaphysique, Religion, etc.].
(II-o)
Les personnes qui cultivent les sciences non logico-expérimentales ne saisissent habituellement pas le caractère contingent des sciences logico-expérimentales, et raisonnent comme si ces sciences avaient aussi en vue un « absolu » quelconque, simplement différent de celui des sciences non logico-expérimentales [§973]. Par conséquent elles s'imaginent que les sciences logico-expérimentales ont des dogmes, tels que celui-ci : le « vrai » ne peut être connu que par l'expérience [§16] ; ou bien : le « vrai » expérimental est supérieur à d'autres « vrais » [§26, §46*, §69] ; ou encore : les théorèmes des sciences logico-expérimentales donnent la « certitude » ; ils nous font connaître des « lois » et non de simples uniformités expérimentales ; « tout » peut s'expliquer par l'« expérience » [déterminisme]. On ne parvient pas à leur faire comprendre qu'un tel énoncé suffit pour montrer qu'il ne peut être celui d'un théorème logico-expérimental, dans lequel il n'y a jamais aucune place pour l'absolu que renferme le terme « tout » [§88, §528* à §532, §976, §1531* ; voir : Lois (uniformités), Vérité, Dérivations, Déterminisme, etc.].
(II-p)
Les théories logico-expérimentales sont dans un continuel DEVENIR ; elles procèdent par approximations successives. Les théories non-logico-expérimentales atteignent habituellement du premier coup un état qui paraît à leurs fidèles devoir être immuable, bien qu'en fait il change avec les auteurs et les fidèles [§69*-9°, §91, §92, §106, §107, §144, §826, §1531*, 2410 ; voir : Approximations successives, Faits, Concret, Ondulations, etc.].
(II-q)
Les sciences logico-expérimentales séparent l'analyse de la synthèse (I-p). Chacune d'entre elles est essentiellement analytique : elle détache les différentes parties d'un phéno- mène concret, et les étudie séparément. On procède à la synthèse en unissant les conclusions de plusieurs de ces parties (I-p). Les mouvements réels sont toujours considérés séparément des mouvements virtuels, l'étude de ce qui est, de l'étude de ce qui doit être [pour atteindre un but déterminé]. Les sciences non logico-expérimentales tendent à unir l'analyse et la synthèse, à les confondre, sans même que les auteurs de ces sciences se rendent compte qu'il y a lieu de considérer à part l'analyse et la synthèse. Ils ne distinguent pas ou distinguent mal les mouvements réels des mouvements virtuels [voir : Mouvements]. Chacune de ces sciences prétend connaître entièrement, d'un seul coup, certains phénomènes ; et lorsque l'expérience démontre que cette prétention est vaine, cette science recourt à des subterfuges souvent puérils, tels que changer le sens des mots [voir : Valeur] ; ou bien admettre, au moins implicitement, que ce qui n'est pas devrait être ; ou encore chercher délibérément ce qui doit être, L'élément non-expérimental réside dans le terme doit, employé d'une manière absolue, sans indication d'un but expérimental [§10, §28* à §32, §33 à §40, §69*, §253, §265, §277, §279, §297 à §299, §346, §483, §518, §605, §613, §701, §711, §804, 817*, §818, §845, §966* à §975, §1459, §1687, §1689, §2016, §2017, §2147, §2214, §2411, §2219 ; voir : Devoir, Empirisme, Pratique et théorie, Applications pratiques, Absolu et contingent, etc.].
(II-r)
À elle seule, l'économie ne peut donner une théorie de la valeur, du capital, de l'intérêt, de la protection, etc., si par ces termes on entend des phénomènes concrets. Il est nécessaire d'ajouter les conclusions d'autres sciences (I-p). De même, la comptabilité ne peut, à elle seule, donner une théorie du commerce concret, ni la thermodynamique une théorie des machines à vapeur concrètes, etc. §135, §36, §38, §2022* à §2024, §2219*].
(II-s)
Dans les sciences non logico-expérimentales, pour la connaissance du phénomène concret, la synthèse doit suivre l'analyse. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive que l'une des sciences logico-expérimentales n'explique pas entièrement un phénomène, il est nécessaire de la compléter à l'aide d'autres théories, et non de la rejeter ni de tenter de la compléter au moyen d'une synthèse arbitraire en changeant le sens des termes employés, ou en divaguant dans le domaine non-expérimental. Au contraire, cette voie est habituellement suivie par les personnes qui ne sont pas accoutumées à raisonner suivant les méthodes des sciences logico- expérimentales, et parfois aussi par les personnes auxquelles ces méthodes sont familières dans les sciences naturelles, mais qui se laissent entraîner par le sentiment et par les intérêts, dans les sciences économiques ou sociales [§33* à §39, §2017* à §2024 ; voir : Dérivations].
(II-t)
Les théories logico-expérimentales visent au perfectionnement de la méthode quantitative ; les théories non logico-expérimentales sont habituellement qualitatives [§108, §144*, §2091* à §2104, §2107, §2122*, §2155*, §2175, §2467 et sv. ; voir : Quantitatif et qualitatif].
(II-u)
La réalité expérimentale et l'utilité sociale sont deux choses entièrement distinctes, parfois opposées. Dans les théorèmes des sciences logico-expérimentales, on trouve la première, et l'on peut ne pas trouver la seconde. Dans les théorèmes des sciences non logico- expérimentales, habituellement on ne trouve pas la première, mais on y peut trouver la seconde. En somme, une théorie peut être d'accord avec l'expérience et nuisible à la société, ou bien en désaccord avec l'expérience et utile à la société [voir : Vérité, Religion et métaphysique de la Raison, Morale, Religion, Fins idéales].
III LANGAGE ET DÉFINITIONS
LANGAGE
(III-a)
Langage scientifique et langage vulgaire [§108*, §109, §113* à §118, §245, §266, §331, §366, §396, §408, §815, §960*, §1545, §2240].
(III-b)
Dans les sciences logico-expérimentales, on s'efforce de rendre le langage aussi précis que possible ; les termes sont d'autant meilleurs qu'ils sont mieux déterminés. Dans les sciences non logico-expérimentales, on s'efforce de laisser le langage indéterminé, pour tirer avantage de ce caractère : les termes sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus indéterminés [§9, §18, §21, 26, §69*-9°, §108, §171, §408, §499 à §506, §507*, §508, §515*, §586, §595, §596*, §640, §965, §1546*, §1522 à §1554, §1686 ; voir : Dérivations, Contradictoires, Persuader, Logique].
(III-c)
Au point de vue logico-expérimental, toute discussion est vaine, où l'on use de termes tels qu'on ne sait pas avec précision à quoi ils correspondent réellement §127*, §69, §108, §119, 380, §442, §490, §965 ; voir : (II-i)
(III-d)
Les sciences logico-expérimentales ne discutent jamais sur les noms ; elles discutent sur les choses désignées par les noms. Un raisonnement logico-expérimental conserve entière- ment sa valeur, si l'on substitue des lettres de l'alphabet ou des nombres, aux noms usuels des choses. Pourvu que les choses soient désignées sans aucun doute ni équivoque, il importe peu ou point comment elles le sont. Les sciences non logico-expérimentales discutent sur les noms. Il convient qu'elles suivent cette voie, car, en ces sciences, lorsque les noms ne désignent pas des choses entièrement fantaisistes, ils ajoutent pour le moins quelque chose de non-expérimental aux choses qu'ils doivent désigner. Cette adjonction consiste très souvent en sentiments de l'auteur ou d'autres personnes (II-d). Les controverses des sciences non logico-expérimentales tendent donc à devenir des logomachies. Elles perdent leur valeur et leur sens, si l'on substitue des lettres de l'alphabet ou des nombres aux noms usuels des choses, car ces lettres ou ces nombres n'agissent pas sur les sentiments comme le font les noms usuels [§16, §21*, §113 à §116*, §119, §124, §128, §380, §514, §580, §642*, §2002*].
(III-e)
Dans les sciences logico-expérimentales, le langage, étant arbitraire (III-r), n'exerce aucune influence sur les choses. Dans les sciences non logico-expérimentales, le langage, ayant une existence indépendante des choses, peut paraître exercer sur elles une influence plus ou moins grande, et en exerce certainement une sur les théories que l'on fait au sujet de ces choses. L'une et l'autre influences peuvent être légères, puis, graduellement, atteindre à un extrême où les mots paraissent exercer un pouvoir occulte sur les choses (magie), ou bien où ils servent à édifier des théories entièrement en dehors de la réalité (métaphysique, théologie) [voir : Concepts et faits, Dérivations, Religions, etc. ; §182*, §183, §227, §514, §958 à §965]. Mots transformés en choses [§658, §660, §691, §698, §1548, §1686].
(III-f)
Le langage reflète les faits extérieurs, dans la meilleure hypothèse, comme une photographie mal faite, voire très mal faite, et qui, dans les cas défavorables, peut même devenir entièrement imaginaire. Quiconque raisonne sur les noms agit comme celui qui, de ces photographies, croirait tirer la connaissance précise des choses qu'elles représentent mal [§108-1, §118, §600, §691, §694, §695, §1767, §1769, §1772].
(III-g)
Dans les conditions les plus favorables, en peut tirer quelque chose du langage vulgaire pour constituer une théorie, de même que, dans les conditions les plus favorables, on peut tirer quelque chose des photographies pour connaître les choses qu'elles représentent mal. Comme le langage vulgaire est habituellement synthétique, lorsqu'on en use, on tient compte, bien que rarement et mal il est vrai, de la mutuelle dépendance des phénomènes. Ce peut être utile si, pour cela, on ne dispose d'aucun autre moyen qui soit meilleur [§108, §109, §117, §118*, §1767].
(III- h)
Dans la vie pratique, pour constituer des théories, on peut tirer bien davantage du langage vulgaire, précisément parce que l'adjonction de sentiments (III-d), est un élément important des décisions pratiques [113*, 815, 817 ; voir : Empirisme, Pratique et théorie, Dérivations].
(III-i)
Conséquences de l'indétermination du langage vulgaire [§266, §267, §365, §366, §376, §1545, §1546*, §1552, §1556, §1797, §1857, §1904 à §1912, §1937, §2240].
(III-l)
Le langage comme manifestation d'actions non-logiques [§158* ; voir : (III-h)].
(III-m)
Étant donné que les sciences logico-expérimentales usent d'un langage objectif et précis, il ne faut jamais rien entendre au delà de ce qu'il exprime ; il faut repousser toute adjonction que le sentiment serait porté à faire. Étant donné que les sciences non logico-expérimentales usent d'un langage en partie subjectif et dépourvu de précision, on peut souvent entendre ce qui va au delà de ce qu'il exprime, ou ce qui diffère du sens rigoureux. Les adjonctions ou les modifications faites de cette manière par le sentiment concordent très souvent avec celles que l'auteur entendait faire à son exposé. Par conséquent, l'interprétation qui n'est pas rigoureuse se rapproche souvent de l'idée de l'auteur plus que l'interprétation rigoureuse. [§41*, §74*, §75*, §171, §311, §1678 et sv. ; voir : Pratique et théorie.]
DÉFINITIONS
(III-n)
Dans les sciences logico-expérimentales, étant donnée la chose, on détermine arbitrairement (III-r) le nom. Dans les sciences non logico-expérimentales, étant donné le nom, on cherche souvent la chose à laquelle il devrait correspondre, ou bien la chose à laquelle correspondent les sentiments suscités par le nom ; et si on ne la trouve pas parmi les choses réelles, on recourt aux choses imaginaires [§26, §109, §118*, §119, §150, §371, §578, §638, §639, §686 à §691, §960 à §963, §965].
(III-o)
Il résulte de ce qui précède que, sauf le cas d'erreurs involontaires, les sciences logico- expérimentales ont des termes qui correspondent au réel. Au contraire, les sciences non logico-expérimentales ont des termes qui, ou par la volonté de l’auteur, ou à cause des règles suivies en use, ne correspondent pas au réel, et souvent ne correspondent qu'à des choses entièrement imaginaires [§108, §109, §171, §371, §408, §442*, §509 à §511, §515, §579, §640].
(III-p)
Dans les sciences logico-expérimentales, les définitions sont des simples ÉTIQUETTES qui ne servent qu'à désigner certaines choses. Dans les sciences non logico-expérimentales, les définitions renferment un élément non-expérimental, très souvent en rapport avec le sentiment [§119*, §150, §236, §245, §577, §578, §638, §642*, §798*, §868*, §960, §965 ; voir : Définitions].
(III-q)
Dans les sciences logico-expérimentales, les définitions sont arbitraires ; c'est pourquoi, à part quelques considérations de convenance (III-r), on ne peut rien y faire entrer de ce qui doit faire l'objet d'un théorème [§381, §382* à §388, §442, §963].
(III-r)
Conditions pour les définitions logico-expérimentales [§387, §388*].
IV TABLE DE SUJETS PARTICULIERS
L'ordre alphabétique est double : 1° celui des sujets ; 2° celui des parties de ces sujets.
A
Absolu et contingent §6, §9 à §11, §16, §19, §28, §69*-5°, §97*, §108*, §408, §447, §488, §528, §540, §1531, §2144, §2155.
Abstrait et concret. Voir : Concret et abstrait.
Actions concrètes. Leurs éléments §148, §798*.
Actions dépendant d'un état psychique, supposées l'effet de certaines doctrines (dérivations), tandis qu'au contraire doctrines et actions sont des manifestations de l'état psychique (résidus). Croyances et actions sont dépendantes, non pas directement, mais indirectement, parce qu'elles forment deux branches du même tronc §162* à §164, §166, §176 à §178, §184, §211, §217, §261, §267*, §268*, §284, §1690-2*.
Actions théories et état psychique (Actions, dérivations, résidus) §165 à §172, §267*, §268*, §269 à §279, §283 à §296. Voir : Résidus, Dérivations, Religion.
Actions logiques et actions non-logiques – Rôle qu'elles jouent dans les actes humains. Ch. II, III, §283* à §290, §698, §707 à §711, §1127, §1242, §2141* à §2146, §2271.
Actions logiques §150, §152*, §157*, §160, §161, §1478, §1498.
Actions logiques, ou supposées telles, chez les animaux §156, §706.
Actions logiques. Forme logique ou juridique donnée aux rapports avec les dieux §220, §221, §1320.
Actions logiques. Erreur de les considérer exclusivement §183, §212, §261, §706 à §711, §793, §794, §1491, §1847, §2552, §2566.
Actions logiques en économie politique §263.
Actions non-logiques Ch. I, II, §150, §151, §153* à §162, §249, §280, §289, §698, §980, §1148, §1273*, §1322, §1729, §2119.
Actions non-logiques. Elles ne sont nullement illogiques ; au contraire, elles peuvent être parfaitement appropriées à certains buts. Elles proviennent de tendances, d'états psychiques, etc., qui donnent naissance aux résidus et aux dérivations, lorsqu'ils sont manifestés par le langage §146, §154*, §160 à §162*, §217, §260, §282, §1127, §1761 à §1763.
Actions non-logiques. En général, les hommes ont la tendance de leur donner l'apparence d'actions logiques §212, §218, §220, §223, §249*-2°, §253, §255, §256*, §261, §281*, §282, §289, §290, §292, §295, §296, §306*, §694, §696, §698 à §711, §793, 794, §1057 à §1064, §1121, §1122, 1123* à §1125, §1142, §1146, §1274 à §1276, §1425, §1690, §1744, §1894, §2232, §2271.
Actions non-logiques. Pour leur donner une apparence logique, on les suppose instituées en vue d'atteindre artificieusement un but §211, §217-6°, §312* à §318, §1990, §1997.
Actions non-logiques. Pour produire leurs théories, les théoriciens ont intérêt à les supposer logiques §262*, §264, §291, §710.
Actions non-logiques. Les hommes pratiques en tiennent compte implicitement ou les voilent en partie §308, §358 à §366. Voir : Empirisme, Pratique et théorie.
Actions non logiques. Considérées comme absurdes §265, §309, §310, §1679.
Actions non-logiques chez les animaux §155 à §157, §160, §162, §705, §1148, §2119.
Actions non-logiques. Dans les arts en général §159.
Actions non-logiques. Dans la magie §149, §160, §175, §179, §182 à §185, §194 à §199, §202 à §206, §208 à §215, §913 à §917, §953 à §956.
Actions non-logiques. Dans la politique §159, §160, §200, §201, §254, §270* à §275, §278, §279.
Actions non-logiques. Dans la religion §149, §150, §160, §167, §174, §176, §195 à §199, §202 à §206, §208 à §215, §221 à §225, §254, §304.
Albigeois 2382, 2514* à 2525*. « Parfaits » Albigeois §1186.
Allégories et métaphores §351, §352, §764* à §785*, §1614* à §1685.
Anarchistes §1156.
Animisme §693 à §711.
Annona §996, §997, §1085.
Anti-alcoolisme §1102, §1166, §1441-1, §1442, §1715, §1818, §1819, §1994.
Anti-militarisme et anti-patriotisme §1129, §1302, §1781, §1818.
Antipodes §67, §70, §485* à §489.
Apostolat séparé de la recherche des uniformités (lois) logico-expérimentales §76, §77, §86, §87*, §141, §287.
Apothéose des empereurs romains §999.
Apparition de morts §1054, §1055.
Applications pratiques. La recherche d'applications pratiques prématurées nuit à l'investigation scientifique. §275-2, §277, §287, §288, §641.
Appropriation des biens d'autrui §1716*.
Approximations successives §69-§90, §91, §105 à §107, §144, §2092*.
Ascétisme §1163 à §1206, §1799, §1858, §2520, §2522.
Assimilation des peuples sujets §1843, §2246 à §2248.
Automobile §1463.
Auto-observation §69, §109, §111*, §431, §434, §488, §493*, §581, §599*, §600 à §602, §604, §997.
Auteur. Il peut arriver qu'il n'y ait pas unité d'idées chez un auteur §541, §1739*, §1972.
Autorité §583 à §590, §652*, §984, §1156 à §1159, §1434 à §1463.
B
Bacchanales §1108, §1109, §1110.
Bibliographies complètes §538.
Bien du plus grand nombre §1489.
Bien et souverain bien §478, §479, §1513, §1546, §1584* à §1606, §1906, §1913, §1976, §2067-1.
C
Cantique des Cantiques §1452, §1627*.
Capital §118, §2022.
Capitalisme §1890, §1884-1 §2559.
Capitalistes §2231* et sv.
Casuistique §226, §816, §1268, §1799, §1919 à §1929.
Castes hindoues §1044.
Christian Science §184, 1503, §1695* à §1697, §1909, §2050, §2154-1.
Chronologies fabuleuses §652, §653.
CLASSES SOCIALES OU CASTES.
Élites et leur circulation §278, §279, §1143, §1152, §2025 à §2046, §2205, §2209, §2213 à §2219, §2221 à §2230, §2233 à §2236, §2300 et sv. §2309 à §2319, §2324, §2477 et sv.
Classe gouvernante §2033, §2034, §2047 à §2059, §2175, 2177, §2178, §2180 à §2202, §2209, §2211, §2215 à §2236, 2239 à §2278, §2306, §2326 à §2328, Ch. XIII.
Classe gouvernée §2034, §2047 à §2049, §2055 à §2059, §2175, §2179, §2180, §2202, §2209, §2215 à §2236, §2239 à §2278, Ch. XIII.
Classe supérieure et classe inférieure §2047 à §2059, Ch. XIII.
CLASSIFICATION. – Dans les classifications, nous nous efforçons de suivre les principes des classifications dites naturelles des roches, des plantes, des animaux, etc. §12, §147*, §149, §186.
CLASSIFICATIONS DIVERSES.
Actions logiques et actions non-logiques §151*. Dérivations §1419.
Buts idéaux §1876.
Ondulations ou oscillations §2552.
Moyens pour éliminer les actions non-logiques §306.
Propositions qui ajoutent quelque chose à l'uniformité expérimentale, ou qui la négligent §575.
Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait de réaliser son bonheur §1902.
Résidus §888. Théories §13.
Utilité §2115.
Clientèle §1026, §1027, §1037 à §1040.
Composition des résidus et des dérivations §2087 à §2104.
Composition des utilités, des résidus et des dérivations §2148 à §2155,
Concepts abstraits, étrangers aux peuples peu civilisés, §469, §695, §702*.
Concepts et faits §94, §95*, §469, §488, §499, §514-2*, §1798, §1909*, §1910, §2206.
Conclusions opposées tirées du même principe §587*, §873.
Concret et abstrait. Les hommes procèdent, en général, du concret à l'abstrait, §177, §181.
Concret. On ne peut connaître aucun phénomène concret dans ses moindres détails §106.
Consentement §591 à §612, §1471, §1473, §1476.
Consentement d'un grand nombre ou de tous ; il n'est pas une preuve de la réalité expérimentale §593, §651*.
Consentement universel §402 à §406, §462, §574, §1470.
Contradictoires. Propositions contradictoires tirées d'un même principe §587*, §873, §1416*, §1800 et sv. Voir : Dérivations non concordantes et dérivations contradictoires.
Contrat social §6, §270, §463, §1029, §1504* à §1507.
Contrition et attrition §1459.
Corruption politique §2265 à §2267.
Croisades d'enfants §1106.
Curiosité. Faible chez les sauvages §702.
Cycles de mutuelle dépendance 2203 à §2230, §2299 à §2328.
D
Darwinisme et darwinisme social §828, §1770, §2005.
Définitions. Dans les sciences logico-expérimentales, elles sont de simples étiquettes pour désigner les choses §119*, §958, §959. Voir : Index III.
DÉFINITIONS LOGICO-EXPÉRIMENTALES DIVERSES.
Actions logiques et actions non-logiques §150.
Capitalistes. Catégories de capitalistes. Rentiers et spéculateurs 2231, §2233 à §2235.
Cycles de mutuelle dépendance §2206.
Circulation des élites §2042.
Conditions §131.
Dérivées §868.
Dérivations §868.
Effet direct et effet indirect d'un élément de l'équilibre social §2204.
Effets immédiats et effets médiats dans les cycles de mutuelle dépendance §2207.
Éléments de l'équilibre social §2060.
Élite §2026 à §2031.
Élite de gouvernement §2032.
Équilibre statistique §2074.
Équilibre. État d'équilibre §2068 à §2070.
Forces §121.
Histoire scientifique §2158.
Impossible §134.
Liaisons §126.
Mutuelle dépendance du premier genre, et mutuelle dépendance du second genre §2088.
Maximum d'utilité D'une collectivité §2121 à §2127.
Maximum d'utilité Pour une collectivité §2131 à §2139.
Mouvements §129.
Mouvements réels §129.
Mouvements virtuels §130.
Possible §134.
Qualitatif §144-1
Quantitatif §144-1
Résidus §868.
Sociologie §1, §2.
Spéculateurs et rentiers §2235.
Système social §2066.
Théories logico-expérimentales §13.
Utilité §2111.
Déifications 994 et suiv., §1082 à §1085.
Délit privé et délit politique §2177.
Démocratie §2240, §2253, §2259, §2260, §2261.
Démocratie. Gouvernements de la démocratie moderne §2228, §2236.
Démons et dieux païens 213, 610, 1612*, 1613*.
Démonstration et invention §50, §977* §2397* à §2407.
DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS Ch. XII, XIII.
Dépenses pour l'entretien des gouvernements §2256-1, §2257-3, §2258, §2306 à §2319.
Dépenses de l'État §2269 à §2278. Science des finances §2273.
DÉRIVÉES ET DÉRIVATIONS.
En général. Sous un autre nom §119, §162 (C désigne résidus et dérivations, ou dérivées) : §165 (la théorie C est une dérivation) ; §167, §169, §180 (adjonction de développements logiques) ; 186, 189 (ramifications) ; §210, §216 (partie variable) ; §217 (interprétations) ; §218, §304, §305, §357, §408, §409 à §515, §574 à §796.
Dérivations indiquées par (b) §798 à §867, §1722.
Dérivations. En général. Sous leur nom Ch. IX, X, §868*, §1401 à §1403, §1688 à §1690, §1716, §1722, §2410.
Dérivations proprement dites et dérivations-manifestations §1688, §1826.
Influence des dérivations. Les dérivations ont peu d'influence sur les faits sociaux, mais cette influence peut ne pas être nulle §167, §168*, §239, §356, §359, §360, §801*, §802, §1453, §1706 à §1710, §1755, §1843 à §1849, §2201, §2206, §2211, §2239, §2514 à §2520, §2553 et sv.
Influence. Conséquences de dérivations §162, §168*, §171*, §826, §833.
Influence. Les dérivations ont de l'importance, moins par les conséquences qu'on en tire que par les résidus dont elles sont l'indice §177, §184, §218, §259, §800, §801, §1703, §1706 à §1710, §1800, §1859, §1867, §2081, §2520.
Influence. Souvent nous nous imaginons que les dérivations se sont transformées en résidus, tandis qu'il est arrivé le contraire §1747, §1751 à §1763.
Influence. Composition des résidus et des dérivations §2087 à §2104.
Influence. Souvent, au lieu d'être la cause des actes, les dérivations en sont la conséquence ; ou bien elles sont, avec les actes, une conséquence commune des résidus §200, §298, §1414, §1416, §1507, §1590, §1619, §1628, §1689, §1761, §1844, §2085, §2086.
Influence. Faible effet produit en modifiant les dérivations, pour changer les actions qui en sont apparemment la conséquence §168*, §299, §356, §1415, §1416, §1843, §1844, §2086-2°.
Influence. Pour agir sur les hommes, il faut que les raisonnements se transforment en sentiments §168, §877, §1449, §1463, §1746*, §2082.
Influence. Un seul résidu peut avoir un grand nombre de dérivations. Si ce résidu demeure, le fait de détruire une dérivation n'a d'autre effet que d'en faire surgir une autre, laquelle remplit la même fonction que la première §184, §195, §1416, §1843, §1844, §1851, §2004 à §2007, §2086*.
Influence. Dérivations multiples qui réunissent un point de départ (souvent des résidus ou des intérêts) à un but §184, §195 à §197, §217, §1300, §1414*, §1416, §1504, §1507, §1590, §1619, §1628, §1705, §1716, §2004, §2086.
Influence. Les dérivations permettent de démontrer tout ce qu'on veut §237, §491, §512, §587*, §670, §799, §873, §1416, §1450, §1474, §1504, §1542, §1573, §1590, §1619, §1628, §1716, §1816 à §1824, §2193, §2194, §2262, §2571.
Influence. Grâce aux dérivations, les actions non-logiques prennent la forme d'actions logiques §176, §180, §218*, §223, §304 à §367, §514, §694, §1233, §1297, §1415, §2206 et sv.
Influence des dérivations sur les dérivations §1766, §1767. Voir : Réfutations.
Influence des dérivations sur les résidus §1746 à §1765, §2206 et sv.
Nature des dérivées et des dérivations.
Presque tous les raisonnements dont on use en matière sociale sont des dérivations §367, §476, §486, §1397, §1403, §1499, §2147, §2199 et sv.
Nature. Très souvent, les dérivations sont acceptées par accord de sentiments, et parce qu'elles expriment d'une façon claire des conceptions qui étaient à l'état confus dans l'esprit de qui les accepte ; ou bien parce qu'elles donnent une forme précise, en apparence, aux sentiments manifestés par les résidus §437, §445, §491, §1747*, §2192 et sv.
Nature. Plusieurs dérivations peuvent appartenir à un même individu sans qu'il se rende compte des contradictions en lesquelles elles peuvent se trouver §184, §217, §1901, §1941 et sv.
Nature. Comment les dérivations s'amplifient §196, §217, §649, §676 à §680, §1398, §1639.
Nature. Propagation des dérivations §2004 à §2008.
Nature. L'homme a la tendance d'ajouter des développements logiques ou pseudo- logiques à des actions non-logiques 180, 218, 223, 307, 514, 1690-2, 2086-4°. Voir : Influence. Grâce aux dérivations, les actions non-logiques prennent la forme d'actions logiques.
Nature. Dérivations non-concordantes et dérivations contradictoires. Avec les dérivations on peut prouver le pour et le contre §184, §587*, §873, §1416*, §1474, §1556, §1573, §1677, §1706 à §1710, §1716, §1737* à §1739, §1800, §1819, §1941 et sv., §2086-4°. Voir : Influence. Les dérivations permettent de démontrer tout ce qu'on veut.
Nature. Les dérivations dépassent souvent la réalité §1772.
Nature. Les dérivations ne correspondent pas précisément aux résidus dont elles proviennent §1767 et sv., §1780 et sv., §2083.
Nature. Périodes des dérivations §1683 Ch. XIII. Voir : Périodes économiques et sociales.
Nature. Les faits apparaissent comme voilés par les dérivations. Pour les connaître, il faut ôter ces voiles §169, §253, §256, §259, §369, §466, §541, §545, §635 à §640, §1141, §1403*, §1498, §1522* à §1529, §1555, §1684, §1713*, §1716, §1733, 1734, §1859, §1901, §2081, §214718, §2174, §2181* à §2189, §2192 à §2194, §2199 et sv., §2357 et sv., §2476, §2514, §2516, §2517, §2539 à §2541, §2560. Le présent ouvrage est principalement une recherche de la réalité cachée sous les dérivations que nous font connaître les documents.
Déterminisme §132 à §134. Additions §132a.
DEVOIR.
Dans les propositions métaphysiques et théologiques §299, §324, §336, §338, §483, §518; §1580, §1589, §2147, §2411.
Dans les propositions scientifiques §326*, §338.
Divination §224, §225, §1457. Domestication des animaux §897 à §904.
DROIT
Droit-fait et droit théorie §256, §466*.
Droit naturel ou des gens §241, §401* à §446, §453 à §463, §576, §965, §1689, §1778.
Droit et morale §398 à §400.
Droit sans sanction §1318-1.
Théories juridiques §838 à §841, §2572.
Droite raison §402 à §406, §409 à §417, §422*, §423 à §444, §457, §1513, §1540, §1546, §1563, §1605, §1606, §1630.
E
Échelle des pénalités. Elle est réduite, de nos jours §1127.
ÉCONOMIE.
Économie appliquée §263, §1731, §1732, §2014, §2207.
Économistes classiques §2016.
Économie logico-expérimentale §35* à §37, §39, §76*, §99, §104, §110, §144, §159, §263, §824, §825, §1732, §2129, §2408, §2409.
Économie en partie logico-expérimentale §35* à §37, §50, §77*, §110, §117*, §118*, §144, §514-3, §1415, §1592, §1731, §1732, §1786, §2207-1, §2208, §2214.
Économie nationale 2015.
Économie pure §35, §61, §263, §824, §825, §1690-1, §1731, §1732, §2107, §2207, §2208.
Phénomène économique §2010.
Éléments qui déterminent l'équilibre économique et l'équilibre social Ch. XII, §851, §861, §1690, §2060* à §2066, §2099* à §2101.
Éléments. Action et réaction des trois éléments : état psychique (résidus) doctrines (dérivations), actions §165*, §168, §217, §261, §267*, §293 à §295, §1218, §1322, §1690-2. Voir : Dérivations, Résidus, Actions.
Élimination d'une entité non-expérimentale ou indéterminée §479, §480*, §1540, §1607*, §1608.
Empirisme §1776* à §1789, §2176, §2256-1, §2397.
Ensemble social §2396 à §2411.
Enthymème §1405 à §1409.
ENTITÉ
Entités juridiques §1501 à §1509.
Entités non-expérimentales et entités expérimentales §470, §472 à §476.
Entités surnaturelles §1533 à §1542.
Entrepreneurs §2231 et sv.
Épargneurs §2228, §2232, §2234, §2312* à §2318. Voir : Rentiers.
équilibre social et équilibre économique Ch. XII, §121 à §125, §1208 à §1219. État d'équilibre §2067 à §2078.
Esclavage naturel §274, §1050.
Esprit humain ou esprit d'une personne abstraite §434, §493, §592, §594*, §595, §1798.
Étérogénéité sociale et circulation entre les différentes parties §2025 à §2059, §2172. Voir :
Classes sociales ou castes (I-m).
Étymologie. Comment du nom d'une chose on croit pouvoir acquérir la connaissance de la chose §686, §687* à §691, §1548. Voir : Langage, Origine et étymologie.
Eucharistie §940 à §943.
Évhémérisme ancien §347, §682* à §684. Néo-évhémérisme §708* à §711.
ÉVOLUTION §93, §276, §278, §343 à §345.
Erreur de la considérer a priori comme unique §217*, §343*, §344*, §345, §346, §513, §576, §730, §737, §1018, §1534.
EXPLICATIONS
Logico-expérimentales §19, §533*, §534*.
Non logico-expérimentales §19, §1398, §1400, §1430, §1641. Voir : Logique des sentiments.
F
FAITS ET LEUR USAGE EN SOCIOLOGIE §80, §81*, §82.
Faits approchés. Ils servent à obtenir une moyenne §540, §2401*.
Faits. Compositions littéraires §544, §545.
Faits. Au point de vue logico-expérimental, il n'est pas question de les distinguer en plus ou moins en rapport avec la « dignité » de la science §80*.
Faits. Comment ils influent sur l'état d'esprit 108. Voir : Dérivations, Résidus.
Faits. Il faut aller du connu à l'inconnu ; ils convient d'interpréter le passé au moyen du présent, et vice-versa. Voir : Interprétations.
FAITS EN SOCIOLOGIE.
Interprétations §546 à §573.
Nombre §537.
Poids §538 à §545.
Études qui excluent explicitement les faits §700*, §701.
Étant donnés certains faits, le problème ayant pour but d'en trouver la théorie n'a pas une solution unique §53, §67, §106, §107.
Famille §254, §256, §1015 à §1031, §1037, §1146, §1262.
Féministes §1169.
Féodalité ancienne et féodalité moderne §1153, §1154, §1714*.
Fictions 229, §834 à §836.
FIN §478, §972, §974, §1513, §21111.
La fin justifie les moyens §1823, §1824. Voir : Casuistique.
Les fins idéales et leurs rapports avec les autres faits sociaux 1869 à 1896.
Flagellation §1190 à §1204.
FORCE ET SON EMPLOI DANS LA SOCIÉTÉ §2170 à §2202.
Force et consentement §2251, §2252, §2259.
Gouvernants et l'emploi de la force §214718, §2178, §2185 à §2189, §2192.
Gouvernés et l'emploi de la force §214718, §2179, §2182 à §2189, §2193.
L'action anarchique des gouvernés supplée à l'emploi insuffisant de la force par les gouvernants §2180, §2609.
Uniformités existant dans une société, en rapport avec l'emploi de la force §2175.
Forces. Ce qu'on entend par ce terme en économie politique et en sociologie §121, §124, §128, §131.
Formes sociales. Elles sont déterminées par les actions non-logiques plus que par les dérivations §360*, §770, §994, §1066, §1684, §1761 à §1765. Voir : Dérivations, Société.
G
Générations divines §926 à §928.
Gens et [mot grec] § 1023 à §1030.
Gnose §1644 à §1650.
GOUVERNEMENT.
Types de gouvernements 2274 à 2278. L'art de gouverner consiste à se servir des résidus existants, plutôt qu'à vouloir les modifier §1832, §1843, §2247* à §2249, §2255, §2435 et sv., §2455 et sv.
H
Hégélianisme §51, §111, §486, §1906, §2340.
HISTOIRE §2156 à §2169.
Logico-expérimentale §139, §644* à §649, §1580, § 2158, §2161*.
Non-logico-expérimentale §649* à §691, §776, §1570 à §1583, §1765, §2156, §2157, §2190-1, §2539 à §2544, §2558 et sv., §2569.
Histoires théologiques, métaphysiques, éthiques §257, §776, §1765, §2160, §2162, §2163, §2165 à §2167, §2355, §2356, §2539, §2558, §2569, §2571, §2573, §2576, §2582.
Histoire « vivante » §663.
Comment « on doit » écrire l'histoire §1580. Interprétation des faits §258, §259. Voir : Interprétations.
On ne peut refaire l'histoire §137, §139*, §140.
Prodiges, dans l'histoire §258.
HISTORIQUE. École historique §1790* à §1792.
Humanitarisme §6, §49, §52, §212, §1136 à §1141, §1638, §1716. Hypothèse §59* à §63.
Hypothèses expérimentales et hypothèses non-expérimentales §52, §55, §56, §59*, §60* à §63, §69*4°.
I
Idéologie de Napoléon 1er §1793.
Imitation §349, §733 à §763, §1117 à §1125, §1150, §2005.
Impératif catégorique §615, §1463, §1514* à §1521, §1998.
Implicites (parties). Les parties implicites des raisonnements non logico-expérimentaux en sont souvent la part la plus importante §337, §595, §819* à §822*, §1876, §2083, §2147*, §2155, §2162, §2208, §2239.
Indifférence. C'est le contraire de la pitié et de la cruauté §1133.
Inférieurs et supérieurs §1221 à §1228.
Instinct des combinaisons §157, §221. Voir : Résidus.
Intellectuels §970, §1779, §2229.
Intérêts §2009, §2146, §2205 à § 2236, §2254, §2299 et sv. §2420 et sv.
INTERPRÉTATIONS
Difficulté d'interpréter les conceptions de peuples peu connus §469, §551, §552, §694, §695, §907, §1641-2, §1956 à §1971.
Il faut aller du connu à l'inconnu ; il convient d'interpréter le passé an moyen du présent, et vice-versa §548, §571, §572, §887, §1656, §2449 à §2454.
Comment, de l'expérience, on peut tirer un critère pour estimer la probabilité des conclusions d'une méthode donnée d'interprétations §544, §547*, §649, §665, §666* à §670, §716, §717, §787 à §789, §1064, §1106, §1641-2, §1660, §1662.
Intuition §108-1.
J
Jalousie des dieux §1986.
Journaux §1755 à §1760.
Juste, injuste, moral, immoral, etc. §69-6°, §335, §965, §1210* à §1219, §1486, §1513, §1551, §1616, §1645-2, §1995, §2190-1.
« Justice immanente des choses » §1953.
Justice soumise à la politique 466, §1716 L
Latifundia §2355, §2557, §2559.
LÉGENDES. Comment elles se forment et se développent 675 à §680, §915, §928, §1656* à §1660, §1666 à §1677. Voir Allégories, Dérivations.
Légendes. Comment elles deviennent acceptables §657 et sv.
Légendes. Comment séparer la partie réelle de la partie imaginaire §672 à §674.
LÉGISLATION. Obstacles qu'on rencontre en voulant l'instituer §1863 à §1866.
Sentiments qui la font accepter §1864, §1867.
Libre arbitre §97.
Liberté §298, §299, §1553*, §1554, §1565.
Liberté de fait et liberté de droit §2609.
Liberté de pensée §2196.
Liens non-logiques des théories §13, §328, §337, §477, §479 et sv.
Limite. Hypothèse d'une limite des phénomènes sociaux §720 à §732, §831.
LOGIQUE.
Logique usuelle §29*, §42, §76*, §97*, §98, §477, §514, §1399, §1410, §1411, §1748, §1782.
Logique des sentiments §42, §45, § 69-6°, §76*, §78, §80, §84, §109, §113, § 118, §337, §338, §407, §408, §427, §437, §442, §471, §480, §490, §491, §513 à §516, §581, §586, §598, §636, §640, §802, §965, 972, 978 à 990, §1300 à §1302, §1315, §1316, §1397, §1416, §1471, §1492, §1555, §1673, 1748* à §1765, §1772, §1782, 1996, §2022, §2086, §2147, §2188, §2229.
Loi naturelle §406*, §410, §428 à §444, §455 à §463.
LOIS (UNIFORMITÉS) EXPÉRIMENTALES. Ce sont de simples uniformités contingentes ; elles ne sont pas « nécessaires » §52, §69*4°, §69*-5°, §96, §97*, §528, §976, §1068, §1424, §1531, §1532, §1792.
Par l'expérience (ici différente de l'observation), on peut séparer les effets de certaines lois ; on ne peut le faire pour d'autres §100*.
Les uniformités (lois) de la sociologie et de l'économie, et celles de la chimie, de la physique, de l'astronomie, etc. sont semblables. La distinction que certains veulent établir est du même genre, bien que moins raisonnable, que celle qu'on voulait faire entre les lois de la mécanique terrestre et celles de la mécanique céleste §97*, §1792.
Elles n'ont pas d' « exceptions ». Ce nom désigne seulement la superposition d'effets d'autres lois à ceux de la loi que l'on considère §101*, §1689-2*, §1792*. Voir : (1- q).
Lois (uniformités) non-logico-expérimentales. Comment elles sont créées §1429.
« Lutte de classes » §830, §1045.
M
Marxistes §309, §1045, §1416, §1859, 2006, §2021.
Matérialisme historique et matérialisme économique §829, §830, §1727, §2238.
MAXIMUM D’UTILITÉ.
D'un individu ou D'une collectivité 2121 à §2127, §2131.
Pour une collectivité §2131 à §2139.
Maximum d'ophélimité pour une collectivité §2128 à §2130.
Mesures pour atteindre un but §1825 à §1875.
Métaphore. Voir : Allégories, métaphores.
MÉTAPHYSIQUE.
Entités métaphysiques §103, §104, §257, §282, §332, §335, §336, §355, §471*, §477, §478, §497, §508, §510, §511, §579, §597, §598, §616, §928, §1510 à §1532, §1550, §1551, §1645-2.
Essences métaphysiques 19, 23, 24, 69, 97, 399, 400, 471*.
Métaphysique et théologie §19* à §28, §49, §111*, §435, §461, §477, §478, §490, §582, §593, §594, §613, §776, §928, §974, §1066, §1299, §1429, §1469, §1673, §1674, §1798.
Méthode historique §619, §857*, §858, §859.
Il ne faut pas la confondre avec la méthode expérimentale ; elle peut seulement y conduire §619, §2018* à §2020.
« Méthode mathématique » de Taine §1794, §1795.
Miracles §49, §98, §610, §620 à §623, §952, §1438.
Modernistes §309, §611, §773, §774, §1086, §1630, §1859. Voir : Néo-chrétiens.
MORALE §303-2, §354 à §356, §365, §1893, §1932*, §1897 à §2001.
Morale utilitaire §1893, §1935.
Rapport entre observer les règles de la religion et de la morale, et obtenir le bonheur de l'individu §1897 à §2001.
Mouvements réels §129, §483, §484 à §516, §1827, §1829, §1830, §1838 à §1862, §1975, §2262.
Mouvements virtuels §130, §134, §135*, §136, §137, §483, §517, §1825 à §1875, §1975, §2262.
Moyennes. Elles sont en partie arbitraires. Phénomènes moyens §102* à §104.
Mutuelle dépendance §96, § 99, §138, §254*,§ 255, §267, §1731, §1732*, §1767, §1861, §2023*, 2061, §2080, §2088* à §2104, §2161, §2202, §2203, 2207, §2336 à §2338, §2397 à §2410, 2547, 2552, §2557. Voir : Cycles de mutuelle dépendance.
MYTHES §650 à §660, §1868* à §1875.
Pour connaître l'équilibre social, il importe de savoir ce que les contemporains pensèrent d'un mythe, plus que de connaître le rapport du mythe avec la réalité expérimentale §541*, §545.
Mythes solaires §786 à §791, §793 à §796.
N
Nature §271 à §274, §282, §333, §336, §403 §404, §410 à §417, §419, §428, §429, §431, §434, §435, §443, §447, §448,451, §456, §459, §1513, §1521, §1546, §1600, §1602*, §1606.
Naziréat §1205.
Néfastes. Jours néfastes §908, §909.
Néo-chrétiens §43, §69-2°, §309, §336, §431, §570, §581, §592, §602, §626 à §630, §777, §925, §1859, §1917. Voir : Auto-observation.
Nombres parfaits §960* à §964, §1645.
Nominalisme et réalisme §64*, §65, §1651*, §1652, §2368*, §2373.
O
OBJECTIF ET SUBJECTIF §23, §94, §95*, §149 à §151, §368, §494, §777, §778, §994, §1467, §1577, §1581, §1586, §1689*, §1765, §1913 à §1918, §1930 et sv., §2168 à §2169.
« Existence » objective §1689.
Ophélimité §61, §119, §144-1, §1690-1, §2409.
Ondulations ou oscillations. Les phénomènes sociaux ont une forme ondulée §724 à §726, §1680* à 1683, 1694, 1702, 1715, §1718*, §1909, §2050, §2053 à §2059, §2221*, §2224 à §2229, §2291* à §2294, §2552 (I-o). Voir : Périodes économiques et sociales.
Oracles §1105.
Organisation 2610 et sv.
ORIGINE DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX, §23, §93, §345, §540, §619, §661, §693, §885* à §887, §1028, §1063, §1192, §1690-2*.
Les recherches sur l'origine ont souvent été, sans que leurs auteurs s'en aperçussent, des recherches sur les résidus §885.
Origine de la religion, suivant Spencer §292, §704 à §711.
Suivant Reinach §345. Suivant Taylor §694 à §699, §703.
Dans le totémisme §714.
Origine et étymologie §346, §659, §686, §779.
P
Paix par le droit §1508, §1559, §1560.
Palaephate §347, §661*.
Pangermanistes §1297.
Partis §1713, §2262 à §2264, §2268.
Patriotisme §1041, §1042, §1146.
Peine de mort §1637.
Pénates §1034.
PÉRIODES.
Des dérivations §2324 et §2325.
Oscillations des dérivations, en rapport avec les oscillations sociales §2329 à §2395.
Périodes économiques et périodes sociales §2279 à §2328. Voir : Ondulations.
Persécutions, réfutations §1749 à §1753, §1835 à §1853.
Persécutions religieuses §1297* à §1319.
Persistance des agrégats. Sous un autre nom §157, §172 (l'état désigné par A) §220, §221, §226, §227, §241. Sous son nom. Voir : Résidus.
Personnification §995 à §999, §1468.
PERSUADER §516, §598, §600, §603, §614, §765, §802, §1397, §1425, §1689, §1716, §1749 à §1760, §1772, §1800, §2159, §2438.
Motifs intérieurs de persuasion §581.
Persuader, dans les sciences logico-expérimentales §42, §78*, §108.
Persuader, dans les sciences non logico-expérimentales §42, §67, §76, §78*, §108, §512, §513, §586. Voir : Logique des sentiments.
PEUPLE
Peuples conservateurs §173 à §178, §226, §1721, §1722.
Peuples formalistes §173 à §178, §220, §223, §224, §226* à §247, §1721, §1722, §2089.
Peuples qui changent la forme et le fond §172, §173, §221, §224, §226*, §230, §232, §236, §239, §240, §241*, §243, §1721, §1722.
Peuples qui conservent le fond et la forme §226.
Volonté populaire §1695
Physiocrates §447*, §448.
Ploutocratie §1152, §1755, §1760, Ch. XIII.
Politique §242, §1786, §1787, §2238, §2239.
Pratique et théorie §469, §604, §1783 à §1790, §2008.
Précepte §321* à §333, §1480 à §1497, §1913 à §1919.
Présages §924, §925.
Prescriptions. Les prescriptions morales ou religieuses ne peuvent être suivies à la lettre §1797 à §1824. Voir : Casuistique.
Principe égoïste concilié avec le principe altruiste §1487 à §1493.
Principes dans les sciences logico-expérimentales et dans les sciences non logico- expérimentales §4, §54* à §56, §58*, §63, §64, §67, §90, §642*.
Probabilité §97, §540, §554* à §573. Voir : Interprétations.
Prodiges §924 à §926, §1285 à §1287.
Production des métaux précieux §2284 à §2292, §2295 à §2297.
Propagation des dérivations §2004 à §2008.
Prophéties et prophètes §620 à §623, §652, §1101 à §1103, §1579.
Proportion des résidus de la Ire classe et de ceux de la IIe, chez les gouvernants et chez les gouvernés §2048 à §2050, §2057, §2209, §2221, §2227 à §2229, §2232, §2254, §2268, §2274, §2300, §2311, §2324, §2326, §2351, §2354, §2359 à §2367, §2375, Ch. XIII, §2457* et sv.
PROPOSITIONS
Propositions contradictoires. Dans la logique des sentiments, elles peuvent subsister ensemble §1416, §2086. Voir : Dérivations, Logique des sentiments.
Propositions descriptives §523, §525.
Propositions qui affirment une uniformité expérimentale §523, §526 à §535. Voir : Lois (uniformités).
Propriété du système social §2105 à §2110.
Prospérité §2106 à §2110.
Protection §2208 à §2226, §2236.
Purifications §1229 à §1295.
Q
Quantitatif et qualitatif §108, §144*, §163, §2155, §2279 et sv., §2467 et sv. (II-t).
R
Races Inférieures et races supérieures §1049* à §1051.
Rapport entre le fait d'observer les règles de la religion et de la morale, et le fait, pour un individu, de réaliser son bonheur. Voir : Morale.
Réalisme. Voir : Nominalisme et réalisme. Réfutations §1748 à §1752, §1834, §1835. Régime politique §2237 à §2278.
Renaissance §2384, §2529 et sv.
RELIGION §69, §374 à §396, 4§64, §465, §697*, §1799, §1854*, §1857, §1932*, §2001, §2532 et sv.
Religion et théologie §49, §165*, §166, §167, §974, §1066*, §1767, §2337.
Religion, Morale, Droit §368, §369, §371, §373, §374, §464, §1883, §2001, §2571, §2572.
Religion et culte §165* à §167, §174, §288, §361, §365, §1128, §1747, §1832, §1854, §1855.
Religion. Sa valeur sociale dépend peu ou point de sa théologie §309, §365, §765, §1767, §1850 à §1855. Voir : Dérivations.
Religions, morales, droits, etc. pratiques ; religions, morales, droits, etc. théoriques §373 à §376, §464, §465.
Religions sans êtres surnaturels §377 à §379, §394, §395, §611, §1510, §1702, §1917.
Religio (Persistance des agrégats) §236 à §238, §243.
Religion des cités grecques et des romaines 1031 à 1036. Ch. I, §111.
RELIGIONS ET MÉTAPHYSIQUES DIVERSES.
Démocratiques §212, §304, §585, §928, §935*, §936, §1077, §1426, §1511, §1513, §1695-1, §1712, §1713, §1715, §1859, §1891, §2187, §2326, §2473.
De l'hygiène, de la Médecine. Phobie du microbe §1156, §1440*, §1695, §1697*, §1974, §2154-1.
Nationalistes §45, §1702 à §1704, §2255.
Pacifistes §45, §1078, §1079, §1704* à §1711, §1818, §1891, §2193, §2324, §2470.
Positivistes §6, §45, §112, §288, 616, §1536, §1537, §1702, §2005.
Du Progrès §301, §611, §933*, §1077, §1102, §1156, §1426, §1463, §1511, §1708, §1712, §1890*, §1891, §1896, §1935, §2001, §2072-1. 2147, §2213, §2394, §2470.
De la Raison §45, §265, §300* à §304, §1540, §1783, §1889, §1935, §2001, §2016, §2143, §2393.
De la Science §45, §353, §354 à §356, §452 à §454, §973, §1127, §1217, §1513, §1695, §1697, §1698, §1881, 1891, §1935, §1974, §2016, §2143, §2473.
Sexuelle §207 à §210, §366, §607, §608, §618, §911, §1010, §1011*, §1012, §1047, §1048, §1102, §1127, §1178, §1297, §1326*, §1330 à §1396, §1715, §1717, §1757, §1818, §1819, §1844, §1861-1, §1862, §1994, §2050, §2522.
Socialiste §1073, §1081, §1701, §1711, §1712, §1858.
De la Solidarité §418, §449* à §451, §479, §611, §1511, §1513.
Humanitaire §45, §302, §303, §353, §379, §585, §609, §611, §1047, §1080, §1087, §1102, §1156, §1301, §1426, §1511, §1513, §1701, §1711, §1712, §1716, §1847, §1848, §1859*, §1890, §1891, §2186, §2213, §2324, §2473. Voir : Humanitarisme.
De la Vérité §304, §1890, §1891.
Rentiers §2235, §2313 *, §2314, §2315 à §2317.
RÉSIDUS. Voir : Dérivations, Périodes économiques et sociales, Gouvernement, Classes sociales ou castes.
Composition des résidus et des dérivations §2087 à §2104.
Ils changent lentement §1701, §1702, §1712 à §1718*, §1719, §1720.
Ils ne sont pas seulement les effets ou les causes des faits §1014.
Influence des résidus correspondant à un même ensemble de sentiments §1240 à §1745.
Influence des résidus sur les résidus §1736.
Intensité §1691, §1703, §1711.
Rapports des résidus et des dérivations avec les autres faits sociaux §1690-2, §1768 à §1772, §1787, §1841, §1843, §1916, §2191, §2221 et sv., §2339* et sv. Voir :
Dérivations.
Rapports entre les résidus et les conditions de la vie §1725 à §1734, §2339 et sv., §2390.
Répartition et changements des résidus dans l'ensemble d'une société §1695 à §1772, §2191, §2229, §2390 et sv., §2415 et sv.
Répartition et changements des résidus dans les différentes couches d'une société §1723, §1724, §1733, §1734, §1853, §2199, §2300 et sv., §2364, §2365, §2418 et sv., §2521* et sv., Ch. XIII. Voir : Classes sociales ou castes.
Résidus et dérivations en rapport avec l'utilité §2140 à §2147. Voir : Dérivations.
Vérité et utilité.
Résidus non-concordants et leurs dérivations §1132, §1737 à §1739, §1937, §1943, §1944. Voir : Dérivations.
Résidus, sous un autre nom §119, §151, §160*, §162, §169, §189 (un tronc), §210 (partie constante), §217 (noyau), §218, §307, §308, §407, 409 et sv., §574 et sv., §798 et sv. (sous le nom de (a). Résidus sous leur nom. Ch. VI, VII, VIII, §868*, §869 à §1396, §1401, §1402, §1690, §1691, §2080, §2410.
Réveil au Pays de Galles §1098, §1102, §1107, §1112.
Ruse et force §2190, §2191, §2274 à §2278, §2320.
S
Sanction §329 à §331, §1478 à §1497. Schamanisme §1095, §1096, §1100.
« Science * métaphysique §19* à §21.
Science logico-expérimentale §16, §20, §21. Voir : Théories, Métaphysique. Index II :
Théories logico-expérimentales et théories non logico-expérimeniales.
Sectes 1047*, §1048.
Sociabilité et subordination §1713.
SOCIÉTÉ. Voir Système social.
Cristallisation de la société §2607 et sv.
Éléments §2060 à §2066, §2146*.
États fétichiste, théologique, métaphysique de A. Comte §1536.
Mobilité de la société §2235, §2236.
Stabilité de la société §2176, §2194 à §2196, §2235, §2236.
SOCIOLOGIE §1, §2.
Sociologie logico-expérimentale §50, §68*, §69*, §79, §80 à §83, §85 à §89, §99, §110, §144, §263, §277, §396, §2161, §2201, §2410.
L'étude de la sociologie à laquelle nous procédons ici est exclusivement logico- expétimentale. Voir Index II : Théories logico-expérimentales, et théories non logico-expérimentales §5, §17, §20, §21, §27, §28, §29*, §32, §65, §68*, §69*, §71, §79* à §89, §110, §114, §119*, §144, §370, §388, §396, §486, §496, §642, §723, §2410.
Sociologie en partie au moins non logico-expérimentale §6, §50, §75*, §76*, §80, §84, §93, §110, §277, §291*, §292, §476, §486, §522, §642, §849, §2229, §2411.
Solidarité §49, §854, §965, §1497, §1503, §1557*, §1562, §1563, §1631, §1988. Voir : Religion.
Sophisme de répartition §1495*, §1496.
Sorite §1550, §1551.
Spécification §805 à §814.
Spéculateurs Ch. XII, XIII, §1498, §2187, §2254, §2262, §2313, §2480, §2548 à §2550, §2561, §2565, §2593 à §2596.
Stylites §1187 à §1199.
Superstition §265, §301, §1127, §1242, §1890, §1987. Voir : Religion, Actions non- logiques, Dérivations.
Survivances §174, §1001* à §1009.
T
TABOU §321* à §323, §581, §712, §1122, §1125, §1241, §1280, §1326*, §1427, §1481 à §1484, §1558.
Du tabac chez les Wahabites §1123*, §1124.
Taurobole §1292.
Tautologies et raisonnements en cercles §592, §593, §605 *, §1471, §1556, §1562, §1563, §1904 à §1912.
Tempêtes. Résidus et dérivations dans la croyance suivant laquelle on peut, par certains artifices, provoquer ou éloigner les tempêtes §186 et sv.
théologies §334, §336, §974. Voir : Religion.
Entités théologiques 332 à 334.
Théologies en regard de l'emploi de la force §2147 exemple II, §2173.
THÉORIES Voir : Index II.
Comment il arrive qu'en de nombreux cas, dans les matières sociales, les théories et les raisonnements non logico-expérimentaux conduisent à peu près aux mêmes résultats que les raisonnements logico-expérimentaux §1768* à §1796. Voir : Pratique et théorie, Empirisme.
Comment les sciences logico-expérimentales se substituent aux sciences non logico- expérimentales, et vice-versa §58*, §64*, §68, §109, §615* à §618. Voir : Ondulations, Périodes économiques et périodes sociales, Dérivations.
Décomposition des théories §6, §35, §636*. Une théorie (c) se décompose en deux parties (a) et (b) §798*, §799 à §867. Voir : Dérivations.
Théories scientifiques §479, §519, §524, §803, §824, §826, §841, §2274 à §2278.
Éléments et liens des théories.
Éléments. Entités non-expérimentales
Entités expérimentales §13, §327, §470, §475.
Éléments. Entités non-expérimentales §13, §307 à §311, §319 à §352, §452, §470*, §474, §476, §478, §485, §486, §1645-2.
Éléments. Entités pseudo-expérimentales §13, §471*.
Théories. Aspect objectif §13, §304, §541, §855, §994.
Théories. Aspect subjectiif §13, §304, §541, §855, §994.
Théories acceptées pour des motifs autres que leur valeur logico-expérimentale §516, §581, §586, §597, §598, §815, §1747. Voir : Logique des sentiments, Vérité et utilité, Périodes économiques et sociales.
Théories des peuples sauvages imaginées avec nos conceptions §698, §699.
Théories et raisonnements non logico-expérimentaux. Voir : Index II, Ch. IV.
Théories pseudo-scientifiques §479*, §485, §486, §489 à §511, §521, §581, §599, §643, §821 à §823, §1276*, §1278, §1279, §1481 à §1497, §2271 à §2273, §2337, Ch. V.
Vérité expérimentale des théories §568, §1645-2.
Thérapeutes §1185.
Totémisme §712*, §713 à §719, §793, §794, §903 à §907, §937, §939, §940, §1191 à §1195, §1277.
Transgressions des règles d'uniformité matérielle et de celles d'uniformités intellectuelles §2176.
U
UTILITÉ Différentes espèces d'utilités §439, §2111 à §2119, §2271.
Utilité complexe §2120.
Utilité des doctrines. Elle varie suivant les différentes classes sociales §246, §247, §299-4*.
Utilité et Vérité. Voir : Vérité et Utilité.
Utopies §2145.
V
Valeur §38*, §62, §118, §1592, §2022*.
VÉRITÉ. Voir : Index II.
Vérité expérimentale et vérité non-expérimentale. Leurs critères §14, §16, §18, §26*, à §28, §69, §380, §570, §1567, §1578.
Vérité. Sens divers de ce mot §9, §10, §14, §16, §69, §376, §433, §435, §440, §441, §541, §570, §721, §1242, §1451, §1561*, §1564* à §1568, §1570 à §1572, §1575, §1578*, §1579, §1852, §1890, §1891, §2340. Additions §69a.
Le vrai §1513, §1601.
Vérité expérimentale confondue avec l'utilité §49, §72*, §73*, §440, §441.
Vérité expérimentale séparée de l'utilité §14, §78, §86*, §167, §171, §219, §249-3˚, §308, §311, §312, §351, §445, §568, §579, §598, §615 à §618, §843, §965, §1226, 1645-2, §1679* à §1683, §1896, §1897 et sv., §1932*, §2002*, §2339 à §2341, §2395. §2435.
Vérité. On laisse la « liberté » de la vérité, non celle de l' « l’erreur » §570, §1564*, §1566.
Vérité. Pour estimer vraie expérimentalement une théorie, il est presque nécessaire qu'on puisse la discuter librement 568.
TABLE DES AUTEURS ET DES OUVRAGES CITÉS [Vol. I]↩
Les chiffres arabes désignent les paragraphes. Pour les livres modernes, on a indiqué, lorsque cela a été possible, les traductions françaises ou italiennes. Dans les citations, les noms des saints sont uniformément précédés de la lettre D (Divus). Les chiffres entre parenthèses indiquent l'année de l'édition [FN1].
[FN1] Afin de ne pas allonger outre mesure, on n'a pas indiqué les éditions lorsqu'il s'agissait d'auteurs très connus, ou bien lorsqu'on en a utilisé plusieurs. Pour faciliter le lecteur et pour qu'en de nombreux cas il puisse utiliser l'édition qu'il a sous la main, on a indiqué, dans les citations, les chapitres et les paragraphes, qui sont les mêmes dans les différentes éditions, et souvent aussi les pages de plusieurs éditions.
A
ABÉLARD. Ouvrages inédits d'ABÉLARD pour servir à l'histoire de la philosophie scolastique en France, publiés par M. Victor COUSIN. Paris, Imprimerie royale (1836) - §1651-1.
ACTA PONTIFICIA et Decreta SS. RR., Congregationum. Romana mensualis ephemeris. Romae, October (1907) - §1630-5.
ACTUS APOSTOLORUM - §952. AELIANI opera - §1595-1.
AESCHINIS orationes, §1501-4.
AESCHYLI tragoediae - §239, §1343-1, §150l-4, §1612-1, §1994 à §1969, §2345. AGOBARDUS. Migne (1851) - §198, §201, §213.
AGRIPPA - §1393-1.
ALCORAN (L') DES CORDELIERS... A. Amsterdam. Aux dépens de la Compagnie (1734) - §1371-2.
ALMA (Jean d'). La controverse du quatrième Évangile. Paris (1907) - §775-1. Divi Ambrosii Mediolanensis episcopi opera... Parisiis (1536) - §1355-1.
AMÉLINEAU. Notice sur le papyrus gnostique Bruce. Texte et traduction... Paris (1896) - §1645-1, §1645-2, §1646-1, §1646-2, §1647-2.
AMMIANI Marcellini quae supersunt - §931-1, §1390-1.
ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA SUISSE, publié par le Département fédéral de l'intérieur. XXIle année : 1913. Berne (1914) - §1225-1.
Divi ANSELMI opera - §1366-1, §1803-4, §2368-1.
Epigrammatum ANTHOLOGIA Palatina... Didot. Parisiis (1864) - §239-2, §587-4, §927-4, §1184-3, §1339-2, §1343-1, §1367-1, §1594-1.
ANTHOLOGIA veterum latinorum epigrammatum et poëmatum... cura Petri Burmanni Secundi... Amstelaedami (1759) - §1292-2.
ANTOINE. Syntaxe de la langue latine. Paris (1885) - Grammaire de la langue latine - §2, §177-2.
ANTOINISTES - §1696-1.
APOLLODORI bibliotheca. - Epitoma vaticana ex APOLLODORI bibliotheca edidit Richardus Wagner. Lipsiae (1896) - §927-1, §927-4, §938-1, §939-1, §1253, §1254, §1255.
APOLLONII RHODII Argonautica - §193-2, §1246-4, §1339-2.
APPIANI Alexandrini romanarum historiarum quae supersunt - §2200-1, §2180-2, §2548-4, §2573-1, §2575-1, §2577-1.
APULEI opera - §739-1.
Caesaris AUGUSTI index rerum a se gestarum sive monumentum Ancyranum ex reliquiis graecae interpretationis restituit Ioannes FRANZIUS. Berolini (1845) - §233.
ARCHIVES CANTONALES VAUDOISES - §212-1, §1297-1.
ARIOSTO. Orlando furioso - §1975-2.
ARISTOPHANIS Comoediae, - Scholia graeca in Aristophanem. Didot - §192-1, §572, §919-1, §1246-4, §1266, §1927-1, §2345-7, §2348.
ARISTOTELIS opera omnia. - Traduction Barthélemy Saint-Hilaire - §270, §271, §272, §274, §275, §276, §278-1, §313-1, 410, 411, 431, 469, 474, §475, 490, §491, §492, §497, §501, §507, §509, §522, §648-1, §960, §1408, §1552, §1604, §1645-2, §1690-2, §2110-1, §2330-2, §2330-4, §2345, 2494, §2497-1, §2509, §2511-1, §2512-2, §2562-1.
ARNOBII Afri disputationum adversus gentes. Orellius. Lipsiae (1816) - §223-1, §684-1, §926-1, §927-4, §942-1, §1339-3, §1343-1.
ARRIANI quae exstant omnia - §1255-5, §1323, §1645-2, §2440-1. ARTEMIDORI oneirocritica. Lipsiae (1805) - §1470-2.
ATHENAGORAE philosophi atheniensis opera. I. C. Th. Otto Jenae (1857) - §1331-1.
ATHENAEI naucratitae deipnosophistarum libri quindecim. I. Schweighaeuser. Argentorati (1801) - Cfr. Poetarum comicorum graecorum fragmenta. Didot (1855) - §744-1, §1343-1, §1359-1, §1382-1, §1382-3, §1595-1, §1595-2, §1907-1, §2493.
Sancti Aurelii AUGUSTINI Hipponensis episcopi opera omnia. - Oeuvres complètes traduites en français et annotées par Péronne, Ecalle, Vincent, Charpentier, H. Barreau. Paris (1870) - §67, §70, §177-3, §177-4, §213, §485, §541, §583, §684, §927-5, §928-1, §963, §1004-1, §1184-3, §1246-1, §1289-1, §1289-1, §1325-2, 1339-3, 1343-1, §1367-1, 1368, §1374, §1382-3, §1438, §1470-2, §1521-1, §1541, §1564, §1575 à §1577, §1600, §1602-1, §1623, §1624, §1627-2, §1662, §1664-1, §1803, §1995-3.
AULARD. Histoire politique de la Révolution française (1901). - Taine historien de la Révolution française (1907) - §538-3, §723, §1749-5, §2180-4.
Sexti AURELII VICTORIS historia romana. Amstelodami (1733) - Liber de Caesaribus. Teubner (1911) - §235-2, §2598-4, §2605-2.
Avanti ! (journal) - §2313-1, §2320-1, §2480-1
B
BACHI (Riccardo). La Riforma Sociale. Supplemento al fascicolo VI-VII, gin. gno-luglio 1915. - L'ltalia economica nel 1914 - §2282-1.
BACONIS (Franc. de Verulamio, summi Angliae cancellarii. Novum Organum scientiarum - §508.
ANNALES ECCLESIASTICI auctore Caesare BARONIO, Lucae. - Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, ubi desinit cardinalis Baronius, auctore Odorico RAYNALDO, Lucae - §198-1, §1187, §1200, §1201, §1810-1, §2381-1.
BARRAS. Mémoires. Paris (1895) - §2169-1.
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE. Physique d'Aristote. Paris (1862) - §1604.
BARTOLOMMEO. Gli ammaestramenti degli antichi, raccolti e volgarizzati da Fra BARTOLOMMEO da San Concordio... Vincenzo Nannucci. Firenze (1861) - §1326-2, §1359.
BASCOUL. La chaste Sapphos de Lesbos. Paris (1911) - §777-1.
Sancti patris nostri BASILII Caesareae Cappadociae archiepiscopi opera omnia quae exstant... Gaume, Parisiis (1839) - §955.
BASTIAT. Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat. Paris (1855) - §2147.
BAYET. Enseignement primaire. Collection A. AULARD. Moi-ale par Albert BAYET. Cours moyen. Paris (1902) - §723, §1440, §1483-1, §1716-2, §1948-1, §1974-1.
BAYLE. Dictionnaire historique et critique par Mr. Pierre Bayle. Sixième édition. Basle (1741) - Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la Comète qui parut au mois de décembre 1680. Quatrième édition (1704) -Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: Contrain-les d'entrer, ou Traité de la Tolérance universelle. Rotterdam (1713) - §358 à §362, §365, §366, §679, §716-1, §939-1, §1356-1, §1393-1, §1415-1, §1471-3, §1564-2, §1575-5, §1639-1, 1737-1, §1821-1, §1944-3, §1948-1, §1949, §1975-1.
BEAUCHET. Histoire du droit privé de la république athénienne. Paris (1897) - §227, §1501-2.
BEAUMANOIR. Philippe de Beaumanoir. Coutumes de Beauvaisis. Texte critique publié... par Am. SALMON. Paris (1899) - §1502-2.
BEAUMARCHAIS - §1152-3. BEBEL - §1322-2.
BEECHEY. Bibliothèque universelle des voyages... ALBERT MONTÉMONT, tome XIX. Paris (1834) - §1008-1.
BELIN. Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789. Paris (1913) - §1749-1, §2048-1.
BELLI (G. G.). I sonetti romaneschi di) ; pubblicati a cura di Luigi MORANDI. Città di Castello (1896) - §1851-1.
BELOT. Histoire des chevaliers romains. Paris (1869) - §2597-1.
BENTHAM. Traités de législation civile et pénale. Ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham... par Et. DUMONT. Paris (1820). - Déontologie ou science de la morale. Ouvrage posthume de Jérémie Bentham ; revu, mis en ordre et publié par John BOWRING. Traduit sur le manuscrit par Benjamin LAROCHE. Genève (1834). - Théorie des peines et des récompenses... DuMONT. Paris (1818). -Tactique des assemblées législatives suivie d'un traité des sophismes politiques... DUMONT... Paris (1822) - §1397-1, §1435-1, §1488 à §1491, §1552-2.
BÉRENGER (Sénateur) - §6, §208, §1352.
BERG (L. W. C. van den), Principes du droit musulman selon les rites d'Abou Hanifah et de Chafi'i par L. W. C. Van den Berg. Traduit du hollandais... Alger (1896) - §1619-1.
BERGK. Poetae lyrici graeci recensuit Theodorus Bergk. Lipsiae (1882) - §541-2. Berliner Tageblatt (journal) - §1580-3.
Sancti BERNARDI abbatis Claraevallensis opera genuina iuxta editionem monachorum sancti Benedicti. Lyon-Paris (1854) - §1617, §1629, §2367-1, §2377-1.
BERRIAT SAINT PRIX - §1502. BERTHOULAT (La Liberté) - §466-2, §1716-2.
BERTRAND (Joseph). Les fondateurs de l'astronomie moderne. Paris (s. d.). - Calcul des probabilités. Paris (1889) - §540-1, §557, §558.
BESSE (Dom J. M.). Les moines d'Orient, antérieurs au Concile de Chalcédoine (451). Paris (1900) - §1168-1, §1180-1.
BIART (Lucien). Les Aztèques. Paris (1885) - §735.
BIBLE Vetus testamentum graece iuxta LXX interpretes... Costantinus de TISCHENDORF, editio septima. Lipsiae (1887). - Novum testamentum graece ex ultima Tischendorfii recensione edidit Oscar de Gebhardt. Lipsiae (1895) - Patrum apostolicorum opera...
Max. Dressel. Lipsiae (1863) - Les livres apocryphes de l'Ancien Testament. Société biblique de Paris (1909) - La Sainte Bible, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, traduits sur les textes originaux hébreu et grec par Louis Second. Paris (1901) - §188-2, §751-4, §752-2, §773, §927-2, §952-3, §987-1, §1017, §1205, §1247-1, §1258-2, §1264-2, §1265, §1266-2, §1277-2, §1280, §1327, §1382-2, §1426, 1457, §1482, §1501, §1502, §1650, §1926, §1943-1, §1980-5, §1995, - §1070-2, §1629-2, §2330-1.
BINET-SANGLÉ. Les prophètes juifs. Paris (1905) - §1102-1.
BISMARCK. Pensées et souvenirs par le prince de Bismarck. Paris (1889). - Les discours de
M. le prince de Bismarck. Nouvelle édition. Berlin (1885) - §1441, §1552, §1715-2, §1755-2 §1843-1, §2389-1, §2455, §2467.
BLACKSTONE - §1159-1.
BLANCHARD (Émile). Métamorphoses, mœurs et instincts des insectes, Paris (1868) - §155.
BOCCACCIO - Le Décaméron. Traduction nouvelle par Francisque Beynard. Paris (1879) - §6, §738, §741, §2558-1.
BODIN. De la demonomanie des sorciers. Paris (1580) - §206-1, §208, §914, §927-5, §928-1, §1439-2, §1697-3, §1708, §2558.
Bois (Henri). Le Réveil au Pays de Galles. Toulouse (1905) - §1098 à §1100, §1112, §1332 1.
Bois (Jules). Les petites religions de Paris - §1646-4.
BOISSIER (Gaston). La religion romaine Paris (1892). La fin du paganisme. Paris (1891) - §178-1, §180, §1859-1.
BOSQ (Paul). Souvenir de l'Assemblée nationale 1871-1875. Paris (1908) - §2415-1. BOUCHÉ-LECLERCQ. Histoire de la divination dans l'antiquité. Paris (1879-1882) - §224, §225, §1105, §1285-1.
BOURBON (Étienne de). Anecdotes historiques, Légende. et Apologues tirés du recueil inédit d'Étienne de Bourbon. Paris (1877) - §1502-3, §1993-1.
BOURGET (Dr). Quelques erreurs et tromperies de la science médicale moderne. Lausanne (1910) - Beaux dimanches. Lausanne (1910) - §1697-2.
BOURGEOIS (Léon). Solidarité. Paris (1902). - Essai d'une philosophie de la solidarité.
Conférences et discussions présidées par M. M. Léon Bourgeois... et Alfred CROISET. Paris (1902) - §449 à §453, §1503, 1505-1, §1557-2, §1631, §1673.
BOVEN (Pierre). Les applications mathématiques à l'Économie politique. Lausanne (1912) - §6-1, §61-1, §89, §119-3, §2129-1.
BRACHET. Grammaire historique de la langue française, par Auguste Brachet. Paris (1867) - §346-1.
BRÉAL. Pour mieux connaître Homère. Paris (1906) - §619-1.
BRÉAL et BAILLY. Dictionnaire étymologique latin, Paris (1885) - §236-1, §688-1. BRIANT - §1524-1.
BRIEUX - §1436.
BROGLIE (Abbé de). Revue des religions. Les prophètes et la prophétie d'après les travaux de KUENEN. Par l'abbé de Broglie. Mémoire présenté au congrès scientifique de Bruxelles (1894) - §1579.
BRUCHARD (Henri de) - (1896-1901). Petits mémoires du temps de la Ligue. Paris (1912) - §1755-5.
BRUN (Le). Histoire critique des pratiques superstitieuses... par le B. P. Pierre Le Brun. Paris (1132-1734) - §587, §956. §1439-2.
BRUNET. Les propos de table de Martin LUTHER. Paris (1844) - §1242-1.
BUCKLE. Histoire de la Civilisation en Angleterre. Paris (1865) - §354 à §356, §1362-1, §1729.
BUONAIUTI. Lo Gnosticismo. Roma (1907) - §1644-1, §1648-1.
BURCHARDI (Johannis)... Diarium sive rerum urbanarum commentarii. 1483 à 1506. Texte latin publié intégralement... par L. THUASNE. Paris (1883-1885) - §1393-1.
BURCHELL. Bibliothèque universelle des voyages... ALBERT MONTÉMONT, tome
XXVI. Paris (1834) - §702-1.
BURCKHARDT. La civilisation en Italie au temps de la Renaissance. Paris (1885) - §1180-2, §1277-1, §2530-1, §2531-1.
BURLAMAQUI. Principes du droit de la nature et des gens et du droit publie en général. - Élément du droit naturel. -Principes du droit politique... Co-TELLE. Paris (1821) - §425 à §440, §823, §1494.
BUSCH. Les mémoires de Bismarck, recueillis par Maurice Bush. Paris (1899) - §909-2, §1441-2, §1755-2, §1755-3, §1843-2, §1843-3, §1950-1, §1951-2, §2147-13, §2147-14, §2247-1, §2458-1, §2463-1.
BYSE (Charles). La science chrétienne (Christian science). Exposé objectif. Extrait de la Revue de théologie et de philosophie. Lausanne (1909) - §1695-2.
C
CABANÈS (Docteur). Moeurs intimes du passé. Troisième série. Paris (s. d.). - Les indiscrétions de l'histoire Cinquième série. Paris (S. d.) - §1343-2, §1502-2.
CABASINO BENDA (Giornale d'Italia) - §1703-1.
C. Iulii CAESARIS commentarii - §233, §1318. CALABRESE - §1715-1.
CALLIMACHI hymni - §684-1, §1339-2.
CALMET. Dissertations sur les apparitions des Anges, des Démons et des Esprits, et sur les Revenans et Vampires de Hongrie, de Bohème, de M avie et de Silésie. Par le B. P. Dom Augustin Calmet. Paris (1746) - §1307-1, §1308, §1311, §1439-2.
CALVIN (Jehan). Institutions de la religion chrestienne... par Jehan Calvin. Paris (1859) - §624, §625, §1289-1.
CANGE (Du). Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. Effigies recens cum vetere editione anni 1688 prorsus congruens. Vratislaviae (1891) - §1395-1.
CARDUCCI (Giosuè) - §49, §1076-1, §1136-1, §1297, §1334-1, §1343-1, §2254-1. CARNOT - §1713-2.
CARON - §1710-1.
CASANOVA - §1329-1.
CASATI (Gaetano). Dix années en Equatoria. Paris (1892) - §1194. CATONIS de re rustica - §184-1, §1726.
CATULLI carmina - §956.
CAUZONS. La magie et la sorcellerie en France - §212-1. CEDRENUS - §195-8.
CENSURE (La) sous Napoléon III. Paris (1892) - §1715-2.
CHAILLU (Paul du). Voyages et aventures dans l'Afrique équatoriale. Paris (1863) - §895. CHALCIDIUS. Fragmenta philosophorum graecorum, volumen II, Didot. Paris (1881) - §960-4.
CHARDIN. Nouvelle bibliothèque des voyages. Paris (1830) - §587, §939-3, §952-1. CHASSANÉE - §1502, §1503.
CHASSANG. Histoire du roman et de ses rapports avec l'histoire, dans l'antiquité grecque et latine. Paris (1862) - §671-2.
CHIESA (Eugenio) - §2259-1.
CHINE. Histoire générale de la Chine ou annales de cet empire ; traduites du Tong-Kang- Mou, Paris (1777) - §2550-2.
Divi Ioannis CHRYSOSTOMI opera omnia - §777-1, §1325-4, §1394. CICCOTTI (Ettore). Montecitorio. Noterelle di uno che c'è stato. Roma (1908).
M. T. CICERONIS opera quae supersunt omnia - §49-1, §160-3, §174-1, §175-1, §182-3, §182-9, §223-2, 225-1, §228-2, §230-2, §233-1, §236-1, §238-1, §243, §274, §296-3, §308, §307-2, §310-1, §313-1, §391-1, 393-1, 412 à 417, §498, §676, §684-1, §747, §931-1, §1108-1, §1211-1, 1382-2, 1470-1, 1472-1, §1475-1, §1550, §1562-1, §1579-4, §1584-1, 1585-1, 1594-1, §l595-2, §1596, §1599, §1603, §1915-1, §1921-2, §1976-1, §1985-1, §2330-2, §2359, §2498-1, §2548, §2557-1, §2562-1, §2575-2, §2577-2, §2579-2.
CLAPARÈDE - §1050-2. CLAUDIANI carmina - §195, §1645-2.
CLAVIER. Bibliothèque d'Apollodore. Paris (1805) - §660-2. CLEMENCEAU - §1152-1.
CLEMENTIS romani ad Corinthios quae dicuntur epistulae. - Patrum apostolicorum opera. Gebhardt. Harnack. Lipsiae (1876) - §1602-2.
CLEMENTIS alexandrini opera quae exstant omnia. Migne. Paris (1891) - §197, §652-2, §684-1, §927-4, §942-1, §960-1, 1257-1, §1331-1, §1606-1.
COCHIN (Augustin). La crise de l'histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard. Paris (1909) - §538-3, §1749-5, §2164-1, §2165-1.
COLAJANNI (Napoleone) - §1051-1, §1302-1, §1705-2, §2259-1. COLLÉ. Voir : HALLAYS-DABOT.
COLUMELLAE de re rustica - §188, §956, §1343-1.
COMPARETTI (Domenico). Virgilio Bel medio evo. Firenze (1896) - §668 à §772, §789. COMTE (Auguste) - §6, §283 à §295, §613, §732, §961, §1080, §1536, §1537, §1626-1, §1627, §1669, §1672, §1675.
CONCILI - MANSI. Sacrorurn conciliorum nova et amplissima collectio. (1759) - Epitome canonum conciliorum tum generalium tum provincialum, ab apostolis usque ad annum MDCIX, per alphabetum digesta a Fre Gregorio de RIVES. Editio novissima... Monteregali (1870) - GUERIN (l'abbé P.) Les conciles généraux et particuliers. Paris (1868) - Canones et decreta concilii Tridentini, ex editione romana A. MDCCCXXXIX. Neapoli (1859) - Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii vaticani in quatuor prioribus sessionibus. Romae (1872) - §605, §1289-1, §1309, §1326- 1, §1366-1, §1381, §1395, §1459-1.
CONDILLAC. Essai sur l'origine des connaissances humaines. Paris (1822) - §471. CONDORCET. Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain (1795) - §301, §302.
CONONIS narrationes. PHOTII myrobiblon sive Bibliotheca - §1927-1. COOK (capitaine) - §701-1, §1052-1.
CORNELIUS NEPOS - §1111.
CORPUS IURIS CANONICI. Augustae Taurinorum (1776) - §458-1, §752-2, §954-1,§1814-1, §1817, §2379-1.
Corriere della sera ('ournal) - §1128-1, §1696-1, §1697-5, §1698-1, §1705-1, §2256-2, §2261-1, §2480-4, §2480-6, §2553-3.
COSMAS INDICOPLEUSTES. The Christian Topography of Cosmas Indicopleustes, edited with geographical notes by E. O. WINSTEDT. Cambridge (1909) - §489.
COURIER (Paul Louis). Oeuvres complètes. Paris (1839) - §1554, §1713-3. COUSIN – Voir : Abélard.
COWPER ROSE. Bibliothèque universelle des voyages, tome XXIX. Paris (1835) - § 901. CRÉBILLON (fils). La nuit et le moment. Paris (1884) - §545-3.
CRISPI (Francesco) - §1713-7, §1755-5.
CROISADES. Recueil des historiens des Croisades. Historiens orientaux. Publié par les soins de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris - §649, §1381-3.
CROIZET. - Voir : Bourgeois. Essai d'une philosophie de la Solidarité - §1557. CUNNINGHAM. Bibliothèque universelle des voyages, tome XLIII. Paris (1836). - §1047-1, §1312-1.
CURIE (Mme) - §618-2. CURTIUS RUFUS (Q.) - §2440-1.
CURTIUS (Ernest). Histoire grecque. Paris - §2420-1, §2421-3, §2427-1, §2428-1, §2439-1, §2495-2.
Sancti Caecilii CYPRIANI opera - §684-1, §1367, §1392, §1662 à §1664.
CYRILLUS Alexandrinus. IULIANI Imp. opera quae supersunt omnia, et S. Cyrilli Alexandriae Archiepiscopi contra impium lulianum libri decem. Lipsiae (1696) - §927- 4, §1728-1, §1973-1.
CYRILLUS hierosolymitanus. S. Cyrilli Archiepiscopi Hierosolymitani opera quae exstant omnia. Parisiis (1720) - §1289-2.
D
Beati Petri DAMIANI opera omnia. Parisiis (1642) - §1196-1, §1197 à §1199, §1393. D'ANSSE DE VILLOISON. De triplici Theologia Mysteriisque Veterum commentatio - §1343-1.
DARLÈS (Jean). Glossaire raisonné de la Théosophie, du Gnosticisme et de l'Ésotérisme.
Paris (1910) - §1698-1.
DAREMBERG ET SAGLIO. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Paris - §537, §782, §919-1, §957-1, §1074-1, §1288-1, §1292-1, §1344-3, §1501-1, §1648-1, §1650, §2491-2, §2512-1, §2549-2.
DANTE - L'enfer, mis au vieux langage françois et en vers... par E. LITTRÉ. 2e édition. Paris (1879) - §6-2, §95, §647-1, §651, §685, §1252-3, §1304-1, §1365-1, §1508-1, §1799-1, §1928, §1995-1, §2190, §2558.
DARMSTETER. La vie des mots étudiés dans leurs significations. Paris (1887) - §158-1, §687-1.
DARU. Histoire de la République de Venise. Paris (1853) -§2505, §2506, §2519-2.
DAUZAT (Albert). La langue française d'aujourd'hui. Paris (1908) - §158-1. DAVANZATI (Bernardo). Le opere. Firenze (1852) - §1074-2.
DAVIS. La Chine. Paris (1837) - §195-5, §471-1, §505-2, §943-1, §1015-1, §1158-2.
DAVOIS (Gustave) - Voir. Pérès - §788-1.
DECHARME (Paul). La critique des traditions religieuses chez les Grecs. Paris (1904) - §1964, §2345-9.
DELAGE (Yves). La structure du protoplasme et les théories sur l'hérédité. Paris (1895) - §1521-1.
DELAGE ET HÉROUARD. Traité de zoologie concrète. Paris -§2166. DELAMARE. Traité de la Police. Paris (1722-1738) - §1383-3.
DELOUME (Antonin). Les manieurs d'argent à Rome, 2e édition - §2561.
DEL RIO ou DELRIO. Disquisitionum magicarum libri sex... auctore Martino Delrio.
Lovanii (1599-1600) - §203, §204, §927-5, §927-6, §955.
DEMOLINS (Edmond). Comment la route crée le type social. Paris - §1730. DEMOSTHENIS opera - §751-3, §1325, §1343-1, §1501, §2534-3.
DESCARTES - §599, §600.
DESCHAMPS (Émile). Carnet d'un voyageur. Au pays des Veddas. Ceylan. Paris (1892) - §175.
DESSAU. Inscriptiones latinae selectae - §1343-1.
DHORME (le P. Paul). Choix de textes religieux Assyro-Babyloniens. Paris (1907). - La religion Assyro-Babylonienne. Paris (1910) - §1653-1.
DICTIONNAIRE encyclopédique de la Théologie catholique. Gaume édit. Paris (1858-1866) - §211-1, §455, §456, §623-1, §952-2, §1266-6, §1282-1, §1470-1.
DIDEROT - §1715-2.
DIGESTA Iustiniani Augusti. THEOD. MOMMSEN. Berolini (1870) - §235-1, §813, §1037-
2, §1325, §1382-2, §1550-1, §1920, §2550-1.
DIGUET (Colonel E.). Les Annamites. Paris (1906) - §1308-1.
DIODORI SICULI bibliotheca - §188-2, §748-1, §927-4, §1343-1, §1472-1, §2432-1, §2432-2, §2434, §2436, §2437, §2439-1, §2491-3, §2548-8, §2558.
DIOGENIS LAERTII de clarorum philosophorum vitis, dogmatibus et apophthegmatibus libri decem. Didot. Parisiis (1878) - §188, §240, §393-1, §463-1, §1179-1, 1184-1, §1231-1, §1250, §1257-1, §1294-1, §1556-1, 1595-1, §l595-2, §1595-3, §1606, §1650-2, 1652-2, §1905-1, §2264-1, §2330-2.
DIONIS CASSII Cocceiani historia romana - §195, §233-1, §310-1, §674-2, §761-2, §762-1, §921-1, §929, §1074-2. §1295-2, §1344-2, §2200-1, §2354-1, §2548-4, §2549-5, §2553-2, §2575-1, §2577-1, §2597-2, §2598-1, §2600, §2603-1.
DIONYSII HALICARNASSENSIS antiquitates romanae - §230-2, §239-1, §747, §756, §757, §926-1, §930-1, §2548-5.
DOUMER - §935-1.
DOYLE (A. Conan). Le crime du Congo. Paris (1909) - §1050-2.
DRAPER (J. W.). Histoire du développement intellectuel de l'Europe. Paris (1868). - Les conflits de la science et de la religion. Paris (1882) - §620-2, §1948-1, §2341-1.
DROYSEN (J. G.). Histoire de l'Hlellénisme. Paris (1883-1886) - §2495-3.
DUBOIS (Abbé J. A.). Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde. Paris (1825)
- §1246-3, §1261-1, §1272-1, §1330-1, §1352.
DUCHESNE (L.). Origines du culte chrétien. Paris (1908) - Histoire ancienne de l'Eglise. Paris (1907-1910) - §1002, §1004, §1573 à §1576.
DUGAS-MONTBEL. Observations sur l'Iliade d'Homère. Paris (1830). - Observations sur l'Odyssée d'Homère. Paris (1833) - §648-1, §654-1, §691-1, §1672-1.
DUGUÉ DE LA FAUCONNERIE. Souvenir d'un vieil homme, 1866-1879, 2e édition. Paris - §934, §2446-1.
DUMONT d'URVILLE. Bibliothèque universelle des voyages, tome XVIII. Paris (1834) - §939.
DUPIN. Voir: Procès laits aux chansons de P.-J. Béranger.
DURUY (Victor). Histoire des Romains. Paris (1879-1886) - §257, §664, §667, §747-3, §1980-2, §2200-1, §2356, §2549-5, §2560.
DUVAL (César). Procès de sorciers à Viry. Genève (1881) - §209-1.
E
EDDY - Alfred MAYOR. Mary Baker Eddy et la science chrétienne (Scientisme). Neuchâtel (1912) - §1695-2.
EINAUDI (Luigi). La Riforma sociale (Rivista). - Corso di scienza delle finanze. Torino (1914) - §1749-3, §1760-1, §2306-1.
EINHARDI omnia quae exstant opera. Teulet. Parisiis (1840) - §201-2, §1659-1.
ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES. François MEYER. Paris-Leipzig - §2408-1.
EPICTETI dissertationes ab Arriano digestae - §1184-3, §1911.
S. EPIPHANII... Panaria. Oehler. Berolini (1859-1861) - De numerorum mysteriis. - §684-1, §963, §1246-4, §1290-2, §1375, §1649-1, §1804-1.
ERMAN (Adolphe). La religion égyptienne. Paris (1907) -§696-1, §726, §1061. ERNOUL. Chronique d'Ernoul et de Bernard le trésorier. - L. de Mas Latrie. Paris (1871) - §1381-3.
ESTOILE (Pierre de L'). - Michaud et Poujalat. Paris (1854-1857) - §1202-1. EUEMERUS - §682.
EUNAPII vitae philosophorum ac sophistarum. Didot, - §200-1.
EURIPIDIS tragoediae - §1108, §1231-1, §1246-4, §1645-2, §1726-1, §1956 à §1961, §2436- 7.
EUSEBII Pamphili Ecclesiastica historia. - Evangelicae praeparationis lib. XV - De vita imperatoris Constantin! lib. IV - §931, §1295, §1394-1, §1501-6, §1648-2, §1820, §2330-2.
EUSTATHIUS. Eustathii commentarii ad Homeri Iliadem. Lipsiae (1827-1829). - Eustathii commentarii ad Homeri Odysseam. Lipsiae (1825-1828). - Geographi graeci minores. Didot. Dionysii orbis descriptio. Eustathii commentarii. - §179-1, §770, §1231-1, §1259- 1, §1343-1, §1776-1, §1971-2.
EVAGRII Scholastici... ecclesiasticae historiae libri sex - §1187-1, §1343-1.
F
FABRE (J. H.). Souvenirs entomologiques. Paris - §155-2, §156, §157, §705, FARJENEL. La morale chinoise. Paris 1906) - §695, §1262-1.
FAZIO-ALLMAYER (La Voce) - §1686-1, §1686-3.
FRÉDÉRIC Il DE PRUSSE. Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques et politiques. Londres (1741) -§1975.
FERRARI (G.). Teoria dei periodi politici - §2330-4, §2330-7.
FERRARIS. Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica... Venetiis (1782-1794) - §954-1.
FERRERO (Felice). (Corriere della sera) - §1697-5.
FESTUS. Corpus grammaticorum. latinorum veterum. Fr. Lindemannus. Tomus II. Pauli Diaconi excerpta et Sex. Pompeii Festi fragmenta continens. Lipsiae (1832) - §196, §920, §930-1, §960-7, §1266-4, §1325-2, §1339-2, §1339-3.
FILOMUSI-GUELFI - §1715-1.
Financial Times - §2256-1. FINOCCHIARO-APRILE - §1710-1.
Firmicus MATERNUS (Iulius) - §1292.
FLACH. Les origines de l'ancienne France. Paris (1886-1904) - §1037. FLAVII IOSEPHII opera. Didot. Parisiis (1865) - §1186, §1438-1.
FLÉCHIER. Voir: Villemain.
FLEURY. Histoire ecclésiastique. Paris (1750-1758) - §1610, §1617, §1812-1, §1814-3. FLORUS (L. Annaeus) - §929-1, §1920-1, §2200-1, §2307-1, §2354-1, §2548-4, §2548-7. Voir : NISARD.
FOGAZZARO. (Corriere della sera) - §1578-3. FONTAINE (La) - §1554-1.
FONTENELLE - §610.
FORCELLINI. Totius latinitatis lexicon - §236-1. FOSCOLO (Ugo) - §2553-4.
FOUCART (George). La méthode comparative dans l'histoire des religions. Paris (1909) - §719, §779-1.
FOUILLÉE (Alfred). Critique des systèmes de Morale contemporains. Paris (1893) - §505.
FOURIER. Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Paris (1841). - Le nouveau monde industriel et sociétaire, ou les séries passionnées. Paris (1829) - Traité de l'Association domestique-agricole. Londres-Paris (1822) - §1650, §1656, §1666, §1672, §1675.
FOURNIER (Edouard). L'esprit dans l'histoire. Paris (1857). - L'esprit des autres. Paris (1856) - §647, §678.
FRADELETTO (Antonio). Dogmi e illusion! della democrazia. Milano (1913) - §1152-3. FRANCE (Anatole). Opinions sociales. Paris (1902). - Vie de Jeanne d'Arc. - §1436, §1638.
FRANCK. Dictionnaire des sciences philosophiques. Paris (1875). - §400, §478.
FRASER. Bibliothèque universelle des voyages, tome XXXV. Paris (1835) - §952-1, §1164-1.
FRAZER (G.). Le totémisme. Paris (1898) - §713-1, §737, 939-3, 1125.
FREDEGARIUS scholasticus. Migne. Parisiis (1879) - §654-1, §1379-3.
FRIEDLAENDER. Mœurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins (1865-1874) - §739-1, §2360-1, §2361-1, §2549-6.
FRONTINI strategematicon - §1925, §2436-4.
FUCINI (Renato). Le poesie di Neri Tanfucio, 10a edizione. Pistoia (1896) - §1580-3. FULGENTIUS. Fabii Planciadis Fulgentii V. C. opera Teubner (1898) - §196, §772. FULLIQUET (Georges). Les expériences du chrétien. Essai d'instruction religieuse. Genève-Paris (1908). - Jésus historique. Paris (1909) - §607-1.
FUNCK-BRENTANO (Frantz). Le drame des poisons. Paris (1900) - §931-2.
FUSTEL DE COULANGES. La cité antique. Paris (1885). Questions historiques. Paris (1893). Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Première partie. L'Empire romain. - Les Germains. - La royauté mérovingienne. Paris (1877) - §1028, §1029, §2160-1, §2585-2.
G
GAIUS - §235-1, §810.
GALILEO. Le opere di Galileo Galitei. Firenze (1842) - §318, §497. GALLIER (Humbert). Les mœurs et la vie privée d'autrefois - §894-2. GALLUPPI. Elementi di filosofia. Ancona (1842) - §623.
GARGILASSO DE LA VEGA. Histoire des Incas rois du Pérou. Paris (1744) - §763-1. GAULIS (Journal de Genève) - §932-1.
GAUSS - 69-4.
GAUTIER (Lucien). Introduction à l'ancien Testament. Lausanne (1914) - §1454-1,§1627. Gazette de Lausanne - §6881, §947, §1463-1, §1714-1, §1749-3, §1883-1, §2147-11, §2147-17, §2262-3, §2452-1.
GELLIUS (A.) - §222, §231-2, §236-1, §648-1, §752-1, §908, §926-1, §1286.
GEOPONTICORUM sive de re rustica libri XX. Lipsiae (1781) - §917.
GERASENI NICOMACHI arithmeticorum theologicarum libri II - §963. GHISLERI (Arcangelo) - §1051-1, §1705-2.
GIDE (Charles). Charles Gide et Charles Rist. Histoire des doctrines économiques depuis les Physiocrates jusqu'à nos jours. Paris (1909) - §87-1.
GIOLITTI (Giovanni) - §1713-6.
Giornale degli Economisti, Roma - §1823-1, §2408-1.
Giornale d'Italia, Roma - §299-1, §585-1, §1329-1, §1703-1, §1704-1, §1713-4, §1716-2, §2004-1, §2180-1, §2259-1, §2268-2, §2313-1, §2480-4, §2487-7.
GIRARD (Jules). Le sentiment religieux en Grèce d'Homère à Eschyle. Paris (1869) - §1971. GIRARD (Frédéric). Manuel élémentaire de droit romain. Paris (1906) - §228, §805 à §808, §811, §812, §835, §1501-1.
GiRETTI (Edoardo) - §1705-2, §1749-3, §2257-1, §2306-1.
GIUSTINIANO (Pietro). Dell'Historie vertetiane. Venetia (1671) - §2505-1.
GLOTZ (Gustave). La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce. Paris (1904) - §1983-1.
GODELMANN. Iohannis Georgii Godelmanni de Magis, Veneficis et Lamiis recte cognoscendis et puniendis libri tres. Francoforti (1591) - §205.
GOHIER (Urbain). Le Journal - §1127-5.
GOLTZ (Baron Colmar von der). Rosbach et Iéna. Paris (1896) - §2447, §2469. GONCOURT. Journal des Goncourt. Paris. - §1333-1, §1431-1, §1713-2, §1751-2, §1861-1, §2470-1.
GOUDIN (Antoine). Philosophie selon les principes de Saint Thomas. Paris (1844) - §1604- 2.
GRAEF (De) - §6.
GOUSSET (Thomas M. J.). Théologie dogmatique. Paris (1850) - §624-2, §1289-1, §1470-1, §1579-2.
GRANIER DE CASSAGNAC (A.). Souvenir du second Empire. Paris - §2461-2.
Divi GREGORII papae, huius nominis primi, cognomento Magni omnia quae extant opera. Parisiis (1571) - §1004-1, §1311-1.
GREGORIUS Nazianzenus. Sancti patris nostri Gregorii theologi, vulgo Nazianzeni... opera omnia. Parisiis (1842) - §1290-1.
GREGORIUS episcopus Nyssenus. Beati Gregorii Nysseni episcopi, fratris Basilii Magni opera quae exstant omnia §195-8.
GREGORIUS episcopus Turonensis. Migne. Parisiis (1879) -§197-2, §949, §1379. GREGOROVIUS. Storia della città di Roma nel medio evo. Venezia (1872-1876) - §1501. GROTE. Histoire de la Grèce. Paris (1864-1867) - §226, §656, §661-5, 767, 926-2, §1613-1, §1952, §2421-1, §2433-1, §2436-7, §2442-1, §2513.
GROTIUS. Le droit de la guerre et de la paix par Hugues Grotius. Jean Barbeyrac. Basle (1746) - §425 à §440, §461.
GUESDE (Jules) - §1713-1.
GUILLAUME II - §1522 à §1529, §1580-2.
GUIBERTI opera. Migne. Parisiis (1880) - §1381-3.
GUIDONIS. Practica inquisitionis heretice pravitatis, auctore Bernardo Guidonis. Paris (1886) - §1012-1, §2379-1.
GUIMET. Annales du musée Guimet, tome premier. Paris (1880) - §394.
GUIRAUD (Jean). Cartulaire de NotreDame de Prouille. Pari (1907) - §1352-2, §2517-1, §2519-1.
GURY. Casus conscientiae. Lugduni (1875) - §1459-1.
GUYNAUD. La concordance des propheties de Nostradamus avec l'histoire. depuis Henry II jusqu'à Louis le Grand. Paris (1712) - §1579-1.
GUIZOT. Collection de mémoires relatifs à l'histoire de France. Paris - §654, §985-1, §1381-3, §1579-3, §1947-1, §2514-1, §2515-2, §2516-1, §2520-1, §2523-1, §2523-2, §2524-1. - Grégoire de Tours - §2609-1.
GUIZOT. Histoire de la civilisation en France (1879) - §2366-1. Gyp - §2313-4.
H
HAGENMEYER (Henri). Le vrai et le faux sur Pierre l'Hermite. Paris (1883) - §649-1.
HALLAYS-DAI30T (Victor). La censure dramatique et le théâtre. Histoire des vingt dernières années (1850-1870). Paris (1871) - §1715-2, §1747-1, §1748-1, §1749-1, §1751-1.
HARDEN (Maximilien) - §1436-1.
HARPOCRATIONIS lexicon in decem oratores atticos ex recensione Gulielmi Dindorfii. Oxonii (1853) - §1343-1.
HATT (Ph.). Des marées - §1731-1.
HAUREAU. De la philosophie scolastique. Paris (1850) -§1652-1.
HAYEM (Fernand). Le Maréchal d'Ancre et Léonora Galigai. Paris (1910) - §1652-1. HEBER. Bibliothèque universelle des voyages. Albert Montémont, tome 36. Paris (1835) - §1180-1.
HEGEL. Philosophie de la nature. A. Vera. Paris (1863-1864) - §19-1, §20, §51, §69-4, §111, §486, §502 à §505, §510, §511, §514-1, §1682.
HEIM (Ricardus). Incantamenta magica graeca latina. Lipsiae (1892) - §912-1. HELIODORI Aethiopicorum libri decem. Erotici scriptores. Didot. Paris (1856) - §955. HENRY (Victor). Le Parsisme. Paris (1905). - Journal des Savants (1899) - §158-1, §587-1, §784.
HERACLIDIS Pontici allegoriae Homeri - §768. HERACLITI de incredibilibus - §661.
HERODIANI historiarum libri octo - §761-2, §762-1, §2604-1.
HERODOTI Halicarnassensi historiarum libri IX - §188-2, §193, §587, §745, §1148-1, §1253, §1980, §1986, §2426-1, §2495-1.
HERONDAE mimiambi. CRUSIUS. Lipsiae (1892) - §545, §572.
HESIODI Carmina - §154, §160, §185, §322, §661, §927-1, §938, §956, §1612, §1650, §1669, §1942, §1984.
HESYCHII lexicon - §942-2, §1246-4, §1259-1, §1343-1.
HESSE (Raymond). Les criminels peints par eux-mêmes. Paris (1912) - §1301-1.
HIEROCLIS commentarius in aureum carmen. Fragmenta philosophorum graecorum. Didot (1883) - §960, §1556-1.
HIERONYMI (Sancti) Stridoniensis opera omnia. Lutetiae Parisiorum. (1623-1624) - §927-2, §927-4, §1076-1, §1366-1, §1369 à §1372, §1390-1, §1392-3, §1394-1, §1629, §1801.
HIPPOCRATES - §1728.
HISTORIAI, AUGUSTAE scriptores - §195, §235, §1382-2, §2587-1, §2603-1, §2605-2, §2607-1.
HOBBES - §462, §1494, §1507.
HOHENLOHE. Mémoires du prince Clovis de Hohenlohe. Paris (1909) - §1922-1.
HOLBACH (D'). Système de la Nature ou des lois du monde physique et du monde moral ; par le Baron d'Holbach. Paris (1821) - §296-2, §303, §1493-2, §1751.
HOMERUS - §179, §333, §660-2, §695-1, §695-3, §768 à §770, §777-1, §927-1, §927-4, §942, §1040, §1059, §1060, §1231, §1304, §1321, §1399-2, 1343-1, §1538-1, §1556-1, §1595-2, §1612, §1613, §1625, 1648-2, §1666, §1928, §1970, §1971, §1983.
HORATIUS (Q. Flaccus). - §931, §956-4, §1343-1, §1344-3, §1352, §1382-3, §1550-1, §1907-2, §1980-2, §1985-1.
HOVELAQUE. Les nègres de l'Afrique sudéquatoriale. Paris (1889) - §701-1, §1082-1, §1258-1.
HUGO (Victor) - §37, §545-3, §1638. HUGON - §770.
HYACINTHE (le Père) - §1086-1.
HYGINUS (C. Iulius). Fabulae. - Astronomica - §188-2, §660-2, §927-4.
I
IMBART DE LA TOUR. Les origines de la Réforme. La France moderne. Paris (1905-1909) - §2384-1.
INFESSURA (Stefano). Diario della città di Roma. Tommasini. Roma (1890) - §1393-1. Iniziativa (L') - §2261-1, §2265-1.
Instructions du XXX grade - §1622-1.
IOANNIS CHRYSOSTOMI (Divi) opera ouinia - §1325-4, §1394, §1803-4. IOANNIS DAMASCENI (Beati) opera - §1645-2, §1804-1.
IRENAEI (S.)... contra omnes Haereses, libri quinque. Massuet. - I. E. Grabe. Londini (1702) - §1375-1, §1645, §1670.
ISIDORUS. Corpus grammaticorum latinorum veterum. Lindemannus. Tomus III. Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum libros XX continens. Lipsiae (1833) - §458-1.
ISOCRATES - §2453.
Iulianus - Voir : CYRILLUS alexandrinus. IUSTINIANI Institutiones - §419 à §421, §688-1.
IUSTINIANUS Codex. P. Krueger - §214-1, §1325-4, §2605-2.
IUSTINI historie philippicae. - §926-1, §1343-1, §2345-4, §2354-1.
IUSTINUS (S.) philosophus et Martyr. Migne. Parisiis (1884) -§195-8, §940, §1648-2. IUVENALIS - §931, §1260-3, §1294, §2594, §2595, §2596.
J
JACOB (P. L.). Curiosités de l'histoire de France. Paris - §737 -2.
JACOBI A 'VORAGINE legenda Aurea. Graesse Vratislaviae (1890) - §1184-2. JAMES (William) - §1439, §1695-2.
JANET (Paul). Principes de Métaphysique et de Psychologie. Paris (1897) - §873-1. JANSSEN. L'Allemagne et la Réforme. Paris (1887-1901) -§2384-1.
JATHO - §1553-2.
JHERING (R. von). L'évolution du droit. Paris (1901). -L'esprit du droit romain (1886-1888) - §227, §241, §802-1, §1318-1.
JOINVILLE (Jean sire de). Histoire de Saint Louis. Texte original accompagné d'une traduction. Natalis de Wailly. Paris (1874) - §1127, §1383-1.
Journal (Le) - §1127-5.
Journal de Genève - §466-3, §1011-1, §1330-3. §1355-2, §1440-1, §1441-1, §1641-2, §1702-1, §2147-16, §2154-1, §2527-1, §2611-2.
Journal officiel. Paris - §2262-1, §2262-2, §2262-4, §2262-5, §2262-6. Journal de la Société de Statistique de Paris - §2317-1.
JOUVENEL (Robert de). La république des camarades. Paris (1914) - §1755-1, §1760-2, §2253-1, §2262-2, §2268-1, §2313-5.
JULIEN (Stanislas). Voir LAO-TSEU. JUMIÈGE (Guillaume de) - §1579-3. JUNOD - §549-1.
K
KAHN (Zadoc). La Bible traduite du texte original par les membres du Rabbinat français sous la direction de M. Zadoc Kahn, grand Rabbin. Paris (1899) - §915.
KANT (Emanuele). Kritik der praktischen Vernunft (1788). - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). Edit J. H. VON KIRCHMANN (1870). - Principes métaphysiques de
la Morale. 3e édition corrigée et augmentée... par JOSEPH TISSOT. Paris (1854) - §597, §623-1, §1514 à §1521.
KARR (Alphonse). Contes et nouvelles. Michel Lévy éditeur - §544. KEPLERO - §69-4, §104, §365, §501, §540.
KERN (H.). Histoire du Bouddhisme dans l'Inde. Paris (1901-1903) - §926-1,§1182-1.
KIMBALL (Edward). Christian Science, Ses bienfaits pour l'Humanité. Trad. de l'anglais et publié par The Christian Science Publishing Society. Boston (1909) - §783-1.
KOLABINSKA (Marie). La circulation des élites en France - §69-5, §2026-1, §2032-1, §2044-1, §2410-1.
KROPOTKINE (Pierre). L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Paris (1896) - §316-1.
L
LACOMBE (Bernard de). La vie privée de Talleyrand. Paris (1910) - §678-1. LACTANTIUS (L. C. Firmianus). Institutionum, divinarum libri VII - §486, 684-1, §1339-3, §1343-1, §1595-2, §1613.
LACTANTIUS (Placidus). Lactantii Placidi qui dicitur commentarios in Statii Thebaida... recensuit R. Jahnke. Teubner (1898) - §927-4.
LAFITAU (le P.). Moeurs des sauvages américains, comparées aux mœurs des premiers temps. Paris (1724) - §1180-2, §1258-1.
LAGRANGE (R. P. M.-J.). Quelques remarques sur l'Orpheus de M. Salomon Reinach. Paris (1910). - Études sur les religions sémitiques par le P. Marie-Joseph Lagrange, des frères prêcheurs. Paris (1903) - §384, §390, §397, §723, §738, §744.
LA HARPE. Voir : VILLEMAIN.
LAJARD (Félix). Recherches sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figurés de Vénus en Orient et en Occident - §1343-1.
LAMBERT (Edouard). La fonction du droit civil comparé. Paris (1903) - §837-1. LANCELLOTTO - Voir : Corpus iuris Canonici - §752-2.
LANDOR (A. H. Savage). Voyage d'un Anglais aux régions interdites. Pays sacré des Lamas. Paris (1899) §1156-1.
LAO-TSEU. Lao-Tseu tao te king le livre de la Voie et de la Vertu, composé au VIe siècle avant l'ère chrétienne, traduit en français et publié avec le texte chinois et un commentaire perpétuel, par Stanislas JULIEN. Paris (1842) - §964-1, §1426-1, §1683-3.
LANG. La Jeanne d'Arc de M. Anatole France - §1436-2.
LAPLACE - §69-4, §492, §494, §495, §522, §1731-2.
LARCHER. Histoire d'Hérodote traduite du grec. Paris (1802) -§653, §661-1, §745-1. Larousse (Grand) illustré - §647-1.
Larousse (Petit) illustré - §1354-1.
LAS CASES. Mémorial de Sainte-Hélène. Paris (1840) - §1748-1.
LEA (Henry Charles). Histoire de l'Inquisition au moyen âge ; trad. Salomon REINACH. Paris (1900-1902) - §211, §1010, §1012-1, §1106-1.
LEFEVRE DE BÉHAiNE (Cte Edouard). Léon XIII et le prince de Bismarck. Paris - §1843- 1.
LEFRANC (L'abbé E.). Les conflits de la science et de la Bible. Paris (1906) - §1542-1. Barbarorum LEGES antiquae. CANCIANI - §200-1, §201-1, §1382, §1391.
LENGLET DUFRESNOY (L'abbé). Traité historique et dogmatique sur les Apparitions, les Visions, et les Révélations particulières. Paris (1751) - §1311-2.
LEOPARDI - §1508-1.
LETOURNEAU (Ch.). L'évolution religieuse dans les diverses races humaines. Paris (1892).
- La sociologie d'après l'ethnographie. Paris (1880) - §6, §1320-1, §1321-3.
LEX IULIA MUNICIPALIS. GIRARD. Textes de droit romain. Paris (1903) - §231-2. Liberté (La) - §466-1, §466-2, §466-3, §690-1, §1050-2, §1127-1, §1127-2, §1136-3, §1136-4, §1142-1, §1301-2, §1330-3, §1345-1, §1580-3, §1638-1, §1638-2, §1696-1, §1713-2, §1713-4, §1713-5, §1716-2, §1716-4, 1716-5, §2180-1, §2254-1, §2257-3, §2261-1, §2262-2, §2267-1, §2313-2, §2423-1, §2452-1.
LIGORIO (S. A. M. de). Theologia moralis S. Alphonsi Mariae de Ligorio summatim exposita. Cura et Studio JOANNIS NINZATTI. Augustae Taurinorum (1892) - §1387-1.
Lipsi (Iusti) politicorum sive civilis doctrinae libri sex. Lugduni Batavorum (1628) - §1934-1. LI-SI-TCHAÏ. Voir: Lao-Tseu.
LITTRÉ (E.). Voir : DANTE.
LIVIUS (T.) - §186-2, §225-1, §230-2, §231-2, §236-1, §237, §313-1, §758, §925-3, §926-1, §960-9, §1109, §1382-2, §1934-1, §2354-1, §2446-2, §2548-4, §2548-8, §2556.
LOCKE, (John). The works of Locke. London (1823) - §365, §460, §1494.
Loisy (L'abbé). Revue des religions (1892). - Autour d'un petit livre. Paris (1903). - Études bibliques. Paris (1903). - Simples réflexions sur le Décret du Saint-Office Lomentabili sane exitu et sur l'Encyclique Pascendi Dominici gregis. Paris (1908) - §618-2, §774, §776 à §778, §1571, §1630.
LOMBROSO (Cesare) - §1439.
LUBBOCK (Sir John). Les origines de la civilisation. Paris (1877) - §1095. LUCANUS (M. Annoeus) - §194-1, §654-1, §684-1, §931-1.
LUCE (Siméon). Histoire de la Jacquerie. Paris (1895) - §2566-1, §2566-2.
LUCIANI Samosatensis opera - §184-2, §684-1, §908, §926-1, §1183-2, §1184-3, §1189, §1194-1, §1305, §1439, §1681.
LUCIANUM (Scholia in) edidit Hugo Rabe. Lipsiae (1906) - §1184-3.
LUCRETIUS. Titi Lucretii Cari de rerum natura libri sex - §487, §615-1, §1438-1, §1567-1, §2359.
LUZZATI (Luigi) - §2553-1.
LYALL (Sir Alfred C.). Études sur les mœurs religieuses et sociales de l'Extrême-Orient. Paris (1885-1908) - §1082 à §1084.
LYCOPHRON - §684-1, §927-4.
M
MABLY (L'abbé de). Doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre essentiel des sociétés politiques. La Haye (1768) - §448.
MACCHI (Mauro). Storia del Consiglio del Dieci. Milano (1864) - §2506-1. MACHIAVELLI (Nicolò). Opere complete. Firenze (1843) - Oeuvres politiques de
Machiavel ; trad. PÉRIÈS. Paris - §1158, §1393-1, §1690-2, §1704, §1929, §1975, §2262, §2465, §2532 à 2537.
MACROBIUS - §221-1, §871, §908-2, §2363.
MAÏMONIDE. Le guide des égarés. S. Munk-Paris (1856-1866) - §1276-1, §1931-1, §1934-1, §1991-1, §1995-2.
MAINBOURG. Histoire de l'Arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin. Paris (1682) - §927-6, §1437-1.
MALAMANI (Vittorio). La satira del costume a Venezia nel secolo XVIII. Torino-Napoli (1886) - §2503-1.
MALIPIERO. Annali veneti dall'anno 1457 al 1500, del senatore Domenico Malipiere, ordinati e abbreviati dal senatore Francesco Longo. Firenze (1843) - §2506-1.
Malleus Maleficarum. Fr. lacobi SPRENGERI et Fr. HENRICI. Anno XX. Coloniae exeudebat Ioannes Gymnicus [L'approbatio du pape est de 1484. Cette édition ne contient pas d'indication de pages] - §197, §203, §215, §1380-1.
MANOU - §1261, §1263.
MANSION (Paul). Calcul des probabilités Sa portée objective et ses principes. Paris (1905) - §563, §564.
MARDRUS. Le livre des mille et une nuit. Paris (1899-1904) - §738-1. MARK TWAIN - §1488.
MARQUARDT. Manuel des antiquités romaines - §176-2, §177-1, §754, §929-5, §960, §1339, §2549-4, §2549-10, §2561-1, §2585-4, §2600-3, §2607-3.
MARSDEN (William). Histoire de Sumatra. Paris (1788) - §323, §950.
MARTELLO (Tullio). Giornale degli Economisti. - L'economia politica e la odierna crisi del Darwinismo. Bari (1912) - §706-2, §1823-1.
MARTIALIS (M. Valerius) - §1343-1, §2593. MARTIANUS CAPELLA - §927-4, §1339-2, §1339-3.
MARTIN (Henri). Histoire de France - §2516-1.
MARVASI (Roberto). Così parlò Fabroni. Roma (1914) - §1713-1. MARX (Karl) - §1669, §1713-1.
MATIGNON. Superstition, crime et misère en Chine. Paris (1899) - §176-1. Matin (Le) - §1140-1.
MAUPAS (De). Mémoires sur le second Empire. Paris (1884) - §2461-1, §2465-1. MAUPASSANT (Guy de). Bel Ami. Paris (1885) - §545-2.
MAURY (L. F. Alfred). Histoire des religions de la Grèce antique. Paris (1857-1859). - La magie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen âge. Paris (1860). - Croyances et légendes de l'antiquité. Paris (1863) - §190, §660, §695-1, §782, §784, §1006, §1956 à §1962.
MAXIMI TYRII dissertationes - §1470, §1471. MAYOR - Voir: Eddy.
MAZELIÈRE (De la). Le Japon. Histoire et civilisation. Paris (1910) - §1703-2.
MELA (Pomponius) - §189, §1438-1.
MENABREA (Léon). De l'origine, de la forme et de l'esprit des jugements rendus au moyen âge contre les animaux. Chambéry (1846) - §1502, §1503-1.
Menagiana ou les bons mots et remarques critiques, historiques, morales et d'érudition de monsieur MENAGE. Recueillies par ses Amis. Paris (1715) - §680-2, §1459-1.
MERCIER DE LA RIVIÈRE (Le) L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (1707). Réimpression. Paris 1910) - §447, §448.
MERLE D'AUBIGNÉ (J. H.). Histoire de la Réformation du XVIe siècle. Paris (1860) - §1567-1.
MICHAUD. Histoire des Croisades. Paris (1825-1829). -Bibliothèque des Croisades. Paris (1829) - §49-2, §1106-1, §1381-3, §1462-1.
MICHELET. Principes de la Philosophie de l'Histoire, traduits de la Scienza Nuova de J. B. Vico. Bruxelles (1835) - §2330-6.
MICHELS (Robert). Les partis politiques. Paris - Sociologia del partito politico moderno. Torino (1913) - §1713-1, §2307-1, §2326-1.
MILL (John Stuart) - §295 à §299, §1410, §1412, §1492, §1627.
MILLS (Charles). Histoire du Mahométisme. Paris (1825) -§1276-1, §1277-1. MILLERAND - §1580-3, §1749-3.
MINUCIUS Félix - §1613.
MISSIROLI (Mario). Giornale d'Italia. - Satrapia. Bologna (1914) - §2480-7, §2566-3. MOLIÈRE - §1172-1, §1567-1.
MOLTKE. La guerre de 1870 par le maréchal comte de Moltke. Paris (1891) - §1580-1.
MOMMSEN (Th.). Manuel des antiquités romaines. - Histoire romaine. Paris (1863-1872) - §159, §230, §231, §234, §656, §1325-1, §1920-1, §2548-1, §2548-2, §2548-3, §2548-12, §2549-1, §2549-7, §2549-10.
MONETA. Venerabilis patris Monetae... adversus Catharos et Valdenses libri quinque. Romae (1743) - §2379-1, §2522-1.
MONOD (Wilfred). Un Athée (1904) - §1323-3.
MONTAIGNE. Essais de Montaigne. Ch. LOUANDRE. Paris (1862) - §446, §1681, §1928-
2.
MONTESQUIEU - §314, §315, §363, §364.
MONTET (E.). De l'état présent et de l'avenir de l'Islam. Paris (1911) - §1164-1.
MORET (Jacques). L'emploi des mathématiques en Économie politique. Paris (1915) - §263a.
MORGAN (J. de). Les premières civilisations. Paris (1909) - §536-1, §618-2, §731-1. MOUSSEAUX (Des). La Magie au dix-neuvième siècle. Paris (1860) - §927-5.
Mouvement Pacifiste (Le). Berne - §1078, §1079.
MULLER (MAX). Essais sur la mythologie comparée. Paris (1873) - §351, §780, §781. MUNGO PARK. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Paris (an VIII) - §702-1.
MURATORI - §909, §1004-1, §1199.
MURRI (Romolo). La Voce - §1177-1.
MURETUS. M. Antonii Mureti opera omnia. Lugduni Batavorum (1739) - §956-3.
N
NAPOLÉON I - §1793.
NAPOLÉON III - §160, §1508-1, §1524, §2576-1, §2582.
NATOLI (Fabrizio) - §1686-4.
NAVILLE (Adrien). Revue de Théologie et de Philosophie - §69, §132.
NAVILLE Edouard. La religion des anciens Égyptiens. Paris (1906) - Journal de Genève - §549-1, §1061-1.
NEYMARCK - §2317-1.
NEWTON (Isaac). Philosophiae naturalis principia mathematica. Auctore Isaco Newton. AmstaeIodami (1723). - Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. In two parts. By sir Isaac Newton. London (1733) - Isaaci Newton!, eq. aur. ad Danielis profetae vaticinia, nec non Sancti Johannis ApocaIypsin observationes. Ex. anglica lingua in latinam. convertit... G. Suderman. Amstelodami (1137) - §20, §69-4, §142, §486-1, §522, §652, §1604-3.
NICEPHORI CALLISTI ecclesiasticae historiae libri decem et octo - §195-8, §1343-1. NICOLE (Jules). Le livre du préfet... - §2610-1.
NIDER (Fr. IOANNIS). Formicarium... Lugduni (1620). NIEBUHR. Histoire romaine. Paris (1830-1842) - §656, §664. NILUS (S.) abbas. Migne. Paris (1860) - §1164-1.
NISARD. Salluste, Jules César, C. Velleius Paterculus et A. Florus ; Oeuvres complètes avec la traduction en français, publiées sous la direction de M. Nisard. Paris (1857) Collection des auteurs latins, avec la trad. en français, publiée sous la direction de... ; Histoire naturelle de Pline. Paris (1851) - §929-1, §1186-1.
NONIUS MARCELLUS - §196, §930-1, §1321, §1325-2.
Novellae recognovit R. Schoell. Berolini (1895) - §214-1, §1382-2.
Novicow (J.). La morale de l'intérêt, dans les rapports individuels et internationaux. Paris (1912) - §1495-1.
O
OLDENBERG (H.). La religion du Véda. Victor HENRY. Paris (1903) - §587, §784-1, §938-2, §1246-2.
OLLIVIER (Émile). L'Empire libéral. Paris (1894-1915) - §923-1, §1554, §1559-1, §1749-1, §1749-4, §1755-2, §1755-3, §1755-4, §1861-1, §1951, §1975, §1995-3, §2201-1, §2461-2, §2463-1, §2464.
ORELLI-HENZEN. Inscriptionum latinarum selectarum amplissima collectio - §190, §1074-2, §1292-2.
ORIGENIS contra Celsum libri octo - §926-1.
OROSII (PAULI) adversus paganos historiarum libri septem. - §195-8, §652. ORPHICA - §942-2, §1288.
OSORIO (Antonio). Théorie mathématique de l'échange. Paris (1913) - §263. OSTROGORSKI. La démocratie et les partis politiques. Paris (1912) - §2257-1.
OVIDIUS (P.) Naso - §194-1, §465, §660-2, §747, §914-2, §926-1, §927-1, §927-3, §927-4, §1203-1, §1246-4, §1252, §1266, §1288-3, §1325-3, §1330-2, §1382-1, §1447-1, §1629.
P
PAIS (Ettore). Storia di Roma. Torino (1898-1899) - §656, §786-1, §1921-1. PALAEPHATI de incredibilibus historiis - §347, §661, §676.
PALAMENGHI-CRISPI. Carteggi politici inediti di Francesco Crispi (1860-1900). Roma (1913). - Giolitti, Saggio storico biografico (con documenti dell'archivio, Crispi). Roma - §1441-2, §1713-6, §1755-5.
PALGRAVE. Une année de voyage dans l'Arabie centrale (1862-1863). Paris (1866) - §1123.
PALLADINO (Eusapia) - §1439.
PALLADII de re rustica - §188-1.
PALLAS. Voyages du professeur Pallas dans plusieurs provinces de l'Empire de Russie et dans l'Asie septentrionale. Paris (lan II de la république) - §1084-1.
PAOLO (San) - §336-2, §456, §1281, §1355-1, §1366, §1644. PANTALEONI (Maffeo) - §2255-1, §2273-1.
PAPUS. Peut-on envoûter ? Paris - §1893.
PARETO (VILFREDO). Cours d'économie politique professé à l'Université de Lausanne (1896-1897). - Les systèmes socialistes. Paris (1902-1903). - Manuale di economia politica. Milano (1906). - Traduction française quelque peu imparfaite. L'appendice est de l'auteur. Paris (1909). - Le mythe vertuiste et la littérature immorale. Paris (1911). - Traduction italienne pas très bonne, mais contenant des adjonctions de l'auteur. Roma (1914). L'Indépendance, - Il Divenire, - Société de Statistique de Paris, - Giornale degli Economisti. - Rivista italiana di sociologia. - Voir aussi: Encyclopédie des sciences mathématiques... - Cours - §77, §89-1, §159-2, §540-2, §2208-2, §2208-3, §2232-1, §2330-1, §2335-1, §2338-1, §2547-1. - Manuale - Manuel - §3-1, §16-1, §16-2, §23-1, §35-1, §38-1, §50-1, §51-1, §69-1, §69-2, §69-3, §69-5, §77, §87, §89-1, §99-1, 100-1, §104-2, §106-1, §118-1, §119-2, §119-3, §144-1, §159-2, §167-1, §263-1, §355-1, §825-1, §973-1, §977-1, §1222-1, §1492-1, §1580-2, §1690-1, §1732-2, §1824-1, 2008-1, §2062-1, §2068-1, §2208-2, §2208-3, §2232-1, §2337-1, §2338-1, §2408-1, §2409-2, §2610-1. - Systèmes - §38-1, §51-1, §278-2, §1496-1, §1551-1, §1702-1, §2025. - Divers - §62-1, §85-1, §87-1, §538-3, §618-1, §1177-2, §1718-2, §1732-5, §2128-1, §2131-1, §2233-1, §2292, §2326-2, §2408-1, §2409-1, §2411-1.
PARIS (Gaston). Les romans de la Table ronde. Paris (1868). -Légendes du moyen âge. Paris (1903) - §668-1, §680.
PARIS (Paulin). Les grandes chroniques de France - §925-5, §1158-2, §1579-3.
PARIS (Mathieu). Grande chronique. HULLARD-BRÉHOLLES. Paris (1840-1841) - §1381-3, §1393-1.
PASCAL. Provinciales - §272.
PASQUIER. Les recherches de la France d'Estienne Pasquier. Paris (1643) - §654-1, §1383-2. PAULHAN. Le nouveau mysticisme. Paris (1891) - §2330-4.
PAUSANIAE Graeciae descriptio - §188-2, §189, §190, §193-4, §749 à §751, §927-3, §1203, §1246-4, §1255-6, 1256-1, §1323, §1343-1, §1501, §1927-1, §2524-2.
PAUTHIER. Confucius et Mencius. Paris (1845) - §1135-1. PAVLY (Jean de). Le Talmud de Babylone - §444-1.
PÉRÈS - Voir : DAVOIS.
PERRENS (F. T.). Les Libertins en France au XVIIIe siècle. Paris (1896) - §1341-1.
PERSANO (C. di). Diario privato politicomilitare dell'Ammiraglio C. di Persano nella campagna navale degli anni 1860 e 1861. Firenze (1869) - §2096-1.
PERTILE. Storia del diritto italiano, dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. Roma-Napoli-Milano (1896-1903) - §949, §1038, §1039, §1381-2.
PETRONII saturae. Buecheler, Berolini (1904) - §296-1, §734-1, §2591, §2592, §2593. PIETRI-TONELLI (De). Il socialisme democratico, in Italia - §2307-1.
PHILLIPS (Georges). Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux. Paris (1850- 1851). - Du droit ecclésiastique dans ses sources. Paris (1852) - §1618.
PHILOLAUS. Fragmenta philosophorum graecorum. Didot. Parisiis - §960.
PHILONIS IUDAEI opera omnia. Lipsiae (1828-1830) - §737, §739-1, §741, §744, §773, §774, §962, §1246-1, §1501-9.
PHILOSOPHUMENA sive Haeresium omnium confutatio. Cruice. Parisiis (1860) - §1343-1, §1647, §1650-1.
PHILOSTRATI. Vita Appollonii. Didot. Parisiis (1878) - Epistolae - §194-1, §1325-4. PICARD (H.). Rivista di Scienza - §496-2.
PIEPENBRING (Ch.). Théologie de l'Ancien Testament. Paris (1886). - Histoire du peuple d'Israël. Paris (1898). - Jésus historique. Paris (1909) - §336-1, §611, §628, §1627, §1672-1, §1944-1, §1955-1, §1976-1, §1979-1.
PINDARI carmina - §188-2, §938, §1382-1. - Scholia vetera in PINDARI Nemea et Isthmia edidit E. Abel. Berolini (1884) -Scholia vetera in Pindari carmina. Teubner (1903) - §188-2.
Pio X - §1630.
PLANIOL (M.). Traité élémentaire de droit civil. 5e édition. Paris (1909) - §639-1. PLANTAVITII loannis Florilegium rabinicum (1645) - §1359-1.
PLATON (G.) - §1686-5.
PLATONIS opera - §221, §240, §278, §279, §307, §491, §497, §612, §648-1, §1179, §1246-5, §1288-2, §1303, §1322, §1470-2, §1471-1, §1501, §1556-1, §1595-2, §1613, §1645-2, §1682, §1970-1, §2330-3, §2349-1.
PLAUTII comoediae - §1325-3.
PLINI naturalis historia. Littré. Paris (1851) - §176-3, §179-1, §182, §184-1, §185-2, §188-1, §223, §310-1, §587-4, §894, §906, §925-2, 926-1, §927-1, §927-3, §956, §1186-1, §1344-3, §1438-1, §1501, §1639-1, §1980, §2354-1, §2355, §2562-1, §2584-1, §2590-1.
PLINIUS (C.) Caecilius Secundus (Pline le Jeune) - §761-1, §1306, §2602-1.
PLUTARCHI vitae parallelae. - Eiusdem scripta moralia. Didot. Parisiis - Les vies des hommes illustres, traduites en français par E. TALBOT. 3e édition. Paris (1880) §188, §240, §310-1, §313-1, §477-1, §477-2, §674-2, §747, §748, §754, §760-1, §926-1, §929, 955, 1074-2, §1148-1, §1194-1, §1250-1, §1255, §1260-1, §1436, §1612-1, §1639-1, §1905-1, §1908, §1926-1, §1976-1, 1982, §1986, §1987-1, §2345-5, §2345-6, §2354-1, §2431-2, §2437-4, §2440-1, §2441-1, 2491-1, §2495-2, §2495-3, §2548-4, §2548-10, §2548-11, 2557-1, §2573-1, §2575-1, §2577-1, §2579-2, §2581-1.
POGGE. Les facéties de Pogge traduites en français avec le texte latin. Paris (1878) - §1496-1.
POINCARÉ (H.). Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste - §67, §69-4. POISSON (S. D.). Traité de mécanique. Paris (1833) - §496-1.
POLLUCIS Onomasticon - §1246-4, §1259-1, §1501-4.
POLYAENI strategematicon libri octo - §1925, §1927-1, §2437-1.
POLYBII historiae - §239, §313, §682, §683, §1569, §1578, §2330-5, §2434, §2354-1, §2440-1, §2502-1, §2548.
PORPHYRII philosophi de abstinentia ab esu animalium. Didot. Parisiis (1858) - §1507-1. PORRET (J. Alfred). Le réveil religieux du XVIIIe siècle en Angleterre. Genève (1907) - §2385-1, §2386-1.
PORTER. Bibliothèque universelle des voyages. ALBERT MONTÉMONT, tome XVI. Paris (1834) - §696-1, §701-1.
PRATICA DEL CONFESSIONALE compilata in quattro parti da un provetto confessore. Torino (1831) - §1204-1.
PRELLER. Römische Mythologie. Berlin (1858) - §176-2.
PREZIOSI. La Germania alla conquista dell'Italia. Libreria della Voce. Firenze (1915) - §2268-3.
PRISCUS PANITES - §2610-2, §2610-3, §2610-4.
Procès faits aux chansons de P.-J. Béranger. Paris (1828) §1749-1. PROPERTII elegiae §927-4, §1246-4, §1260-2.
PROUDHON - §2147.
PRUDENTIUS (M. Aurelius Clemens) - §1292-1, §1382-2. PSELLI. De operatione dœmonum. Kiloni (1688) - §915.
PUFENDORF (Samuel). De iure naturae et gentium. Amstaelodami (1729-1740). - De officie hominis et civis (1673) - §425 à §440, §451-1, §1494.
Q
QUINTILIANI declamationes. Teubner. Lipsiae - §931-1.
R
RABBINOWICZ. Législation criminelle du Talmud. Paris (1876) - §752-2, §1279. RABELAIS. Edit. Jacob. Paris (1854) - (Oeuvres de...) Paris. E. Flammarion, édit. - §689-1, §1686-6.
RAPIN (le Père). Comparaison de Platon et d'Aristote - §1471-3. RECLUS (Élie). Les primitifs. Paris (1903) - §303-2.
RECLUS (Élisée). L'Évolution, la Révolution et l'Idéal anarchique. Paris. P. V. Stock (1898) - §316-1.
REILLY (0'). Les deux procès de condamnation, les enquêtes et la sentence de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Paris (1868) -§179-1.
RIEINACH (Salomon). Cultes, mythes et religions. Paris (1905-1912). - Orpheus (1909) - Manuel de philologie - §189-1, §322, §383 à §391, §397, §469-2, §663-1, §712, §713, §717, §737, §744, §778-1, §884, §898, §903, §1070-1, §1108-1, §1191, §1276-1, §1436-2, §1482.
REMIGIUS (Nicolaus). Demonolatreiœ libri tres - §203-3. RÉMUSAT (Ch. de) - §1603.
RENAN (Ernest), - §541-4, §663-1, §1101-1, §1114, §1327-1, §1331-1, §1578, §1627, §1641-1, §1685, §1749-1, §1767-1, §1944-2.
Resto del Carlino. Bologna - §1695-2.
RÉVILLE (A.). Histoire des religions. Paris (1883-1885) -§735-1, §755, §762-1, §913-1, §1570-1.
REVON (Michel). Anthologie japonaise, des origines au XXe siècle. Paris - §743-1. RICHELIEU (Cardinal de). Recueil des Testamens politiques. Amsterdam (1749) - §2566-2. RIEMANN ET GOELZER. Grammaire comparée du grec et du latin. Paris (1897) - §177-2. RIENZI (De). Océanie. Paris (1837-1838) - §1252-1, §1481-1, §1484.
Riforma Sociale. Torino - §1714-2.
RITTER (Henri). Histoire de la philosophie ancienne. Paris (1835-1836) - §280-1, §612-3.
Rivista italiana di Sociologia. Roma - §145-1.
Rivista popolare. Napoleone Colajanni. Napoli - §2264-2.
ROBIOU (Félix). L'état religieux de la Grèce et de l'Orient au siècle d'Alexandre. Paris (1893) - §1070-2.
ROCHEFORT. La Lanterne - §1751-2.
ROCQUAIN (Félix). Notes et fragments d'histoire. Paris (1906) - §1625-1.
ROGUES (J.) de Fursac. Un mouvement mystique contemporain. Le Réveil religieux du Pays de Galles (1904-1905). Paris (1907) - §1098-4.
ROGUIN (Ernest). La règle de Droit. Lausanne (1889). - Traité de Droit civil comparé. Paris (1904-1912) - §839, §840.
ROMAN DE RENART. Le roman du Renart publié d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Roi... - par M. D. M. MÉON. Paris (1826). - Étude sur le roman de Renart.
Jonckbloet. LeipzigParis (1863) - §1380-1.
ROOSEVELT - §1436.
ROSTOPTCHINE (Lydie). Les Rostoptchine - §1047.
ROUSSEAU (J. J.) - §6, §365, §700, §701, §821, §822, §1436, §1507, §1608, §1681, §1763, §1794-2.
ROUSSELOT (Xavier). Études sur la philosophie dans le moyen âge. Paris (1840-1842) - §1571-2, §1652-1.
ROUVIER - §1713-4.
RUGGIERO (Ettore di). Dizionario epigrafico di Antichità romane. Roma - §996-1, §2593-1, §2607-3.
RUTEBEUF. Oeuvres complètes. Jubinal. Paris (1874-1875) -§1831-3. RUTILIUS - §1074-2, §1183-1.
S
SABATIER (A.). Les religions d'autorité et la religion de l'esprit - §337-1. SABATIER (Paul). Vie de Saint François d'Assise. Paris (1899) - §1182-2, §1686-5.
SAINTE-CROIX (de). Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des anciens peuples ou recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme. Paris (1784) -§1343-1.
SAINT-SIMON. Religion Saint-Simonienne. Réunion générale de la famille. Paris (1832). - Doctrine Saint-Simonienne. Exposition. Paris (1854) - §655, §720-1, §732, §960, §1659.
SAINTYVES. Les saints successeurs des dieux. Paris (1907) -§1006-1. SALANDRA (Antonio) - §1555-1, §2480-1.
SALLUSTIUS Crispus - §929, §1713-5, §2354-4, §2548-8, §2548-13, §2573-1, §2577-1, §2577-3, §2578-1, §2579-1, §2579-2.
SALVEMINI. L'Unità - §2257-2.
SALVIANI de gubernatione de et de iusto dei praesentique iudicio. - §1379-2.
SANCHEZ. R. Patris Thomae Sanchez... de sancto matrimonii Sacramento. Disputationum, tomi tres. Lugduni (1669) - §2522-1.
SAND (Georges) - §545-3.
SANDI (Vettor). Principj di storia civile della repubblica di Venezia scritti da Vettor Sandi. Venetia (1769-1771) - §2500-1, §2506.
SAN GIULIANO - §1708.
SARPI. Discorso dell'origine, forma, leggi, ed uso dell'ufficio dell'Inquisitione nella città e dominio di Venezia (1639) - §2506-4, §2506-5.
SCHAEFFLE. La Quintescence du Socialisme. Trad. Benoît Malon. Paris (1904) - §970-1. SCHEILL - §618-2.
SCHEIRZER-ABICHT. Selecta Rabbinico-Philologica. Lipsiae (1705) - §1330-3.
SCHMIDT (G.). Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois. ParisGenève (1849) - §2515, §2522-1.
SCHOEMANN (G. F.). Antiquités grecques. Galuski, Paris (1884-1885) - §919-1, §1963, §2491-2, §2495-2.
SCHWAB (Moïse). Le Talmud de Jérusalem. Paris - §444-1, §1205-2, §1330-3, §1382-2. Scintilla (La). Roma - §2480-1.
SEGOND (Louis). Voir - Bible.
SELDEN. Johannis Seldeni de jure naturali et gentium iuxta disciplinam ebraeorum libri septem. Argentorati (1665) - §443.
SENART (Émile). Les castes dans l'Inde. Les faits et le système. Paris (1896) - §1025-1. SENECAE (M. A.) excerpta ex controversarium libri X - §1382-2, §2585-1.
SENECAE (L. A.) opera quae supersunt - §185-2, §194, §927-4, §1425-1, §1980-3, §2549-4, §2597-3.
SENSINI (Guido). - §6-1, §77-6, §89, §118-1, §119-3, §514-3, §2025-3.
SEXTI EMPIRICI opera. Lipsiae (1841) - §313-1, §1470, §1550-3, §1550-4, §1650-2, §2349-1.
SINNETT (A. P.). Le Bouddhisme ésotérique ou Positivisme Hindou. Paris (1901) - §1684-1. SMITH (Adam). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations - §1690-2.
SOLINUS (C. Iulius) - §1438-1.
SOLLER (Charles) et Louis GASTINE. Défends ta peau contre ton médecin. Paris (1907) - §1697-21.
SOLON. Poetae Lyrici Graeci. Th. Bergk. Lipsiae (1882) - §1980-6. SOLVAY. Bulletin mensuel de l'Institut Solvay - §658-1.
SONNERAT. Voyage aux Indes orientales et à la Chine. Paris (1782) - §587, §1181-1. SONNINO (Sidney) - §2306-1.
SOPHOCLIS tragoediae - §239-2, §760, §1255-4, §1612-1, §1983.
SOR13ERIANA ou les pensées critiques de M. de Sorbière. Paris (1695) - §1172-1, §1355-2, §1757-1, §1819-1.
SOREL (Georges) - §538-2, §541, §671, §765-1, §997-1, §1101-1, §1627-4, §1638-3, §1868-1, §2193-1, §2193-2, §2450-1.
SPENCER (Herbert) - §6, §112, §283 à §295, §613, §706 à §711, §729, §732, §793, §794, §1627, §2330-2.
SPENCER (I.). De legibus Hebraeorum ritualibus et earum rationibus libri quator. Auctore Johanne Spencero, Cantabrigiae (1727) - §1246-5, §1382-2.
SPINOZA (B. de). Éthique. Ch. Appuhn. Œuvres de Spinoza. Paris - §601, §1493, §1495. SPRONCK (M.). La Liberté - §1713-2, §1716-4.
SQUILLACE (Fausto). La Moda. Milano (1912) - §1119-1. STATIUS (P. Papinius) - §296-1, §927-4.
STEINER (Paul). La Question d'Orient et la portée mondiale de sa solution - §987-1. STOBAEUS - §1257-1, §1556-1, §1605.
STOFFEL (Le colonel baron). Rapports militaires écrits de Berlin, 1866-1870. Paris (1871) - §2451-1, §2465.
STRABONIS geographica - §313-1, §594-1, §648-1, §682, §930-1, §1343-1, §1472-1, §1927-1, §2494.
STURT. Bibliothèque universelle des voyages. Albert Montémont, tome XLIII. Paris (1836) - §1242-2.
SUETONI TRANQUILLI opera - §310-1, §674-2, §761, §909-2, §921-1, §923-1, §925, §926-1, §1295, §1306-1, §1323, §1344-2, §1382-2, §2548-4, §2579-2, §2597-6, §2598-4, §2602-2.
SUIDAE lexicon - §195-1, §200-1, 960, §1259-1, §1343-1, §1501-4, §1501-6, §1927-1.
SUMNER MAINE (Sir Henry). Ancient Law. London (1890). - L'ancien droit. Paris (1874). - Early history of institutions. London (1885). - Études sur l'histoire des institutions primitives. Paris (1880). - Early law and custom. London (1883). - Études sur l'ancien droit et la coutume primitive. Paris (1884) - §241, §256, §365, §456-3, §550-1, §551-1, §619-1, §818-1, §834-1, §837, §1318.
SURENHUSIUS (Guilielmus). Mischna sive totius Hebraeorum Iuris, Rituum, Antiquitatum, ac Legum Oralium Systema. Amstelaedami (1698-1703) - §444-1, §1247-1, §1264, §1267, §1268, §1279-2.
SWIFT. Opuscules humoristiques. Paris (1859) - §1579-4.
SYNESII Epistolae. Epistolographi graeci. Didot. Parisiis (1873) - §2611-1.
T
TACITUS (C. Cornelius) - §1074-2, §1148-1, §1246-4, §1379, §1382-2, §1462-1, §1702-1, §1705-1, §1751-1, §1905-1, §2200-1, §2250-1, §2552-1, §2585-2, §2585-3, §2590, §2597, §2598, §2602-1, §2603-2.
TAINE - §538-3, §1794, §1795, §2048-1, §2566-3. TALBOT (E.). Voir : PLUTARQUE.
TARTAROTTI. Del congresso notturno delle Lamie, libri tre di Girolamo Tartarotti. Rovereto (1749) - §206, §914.
TATIANI oratio ad Graecos. Otto. lenae (1861) - §1613, §1645-2.
TATII (Achillis) alexandrini de Leucippes et Clitophontis amoribus libri octo. lacobs. Lipsiae (1821) - §1367-1.
TERENTIUS - §236-1, §1382-3.
Terre Vaudoise, journal agricole... - §1442-1.
TERTULLIANI (Quinti Septimi Florentis) quae supersunt, omnia. Oehler. Lipsiae (1853) - §195-8, §196, §213-1, §608, §620-1, §955, §1292, §1307, §1339-3, §1632 à §1634, §1645-2, §1647-1, §1668, §1670-1, §2363.
THEIL (Du). Dictionnaire complet d'Homère et des Homérides. Paris - §695-1. THEMISTIUS - §1556-1.
THEOCRITUS - §184, §914, §915, §1246-4, §1339-2.
THEODOSIANI Codex. Haenel. Bonnae (1842) - §200-1, §214-1, §1391.
THEOPHRASTI Eresii opera - §179-1, §1260.
THEODORETI Cyrensis episcopi opera omnia. Migne. Paris - §931-1, §1187, §1257-1, §1344-3, §1804-2.
THIERS. Traité des superstitions. Avignon - §182, §954-1.
THOMAE AQUINATIS (Divi) opera - §203, §213, §282, §457, §477, §506, §606, §608, §928-1, §954, §1382-2, §1459-1, §1503-1, §1677, 1803.
THUCYDIDIS de bello Peloponnesiaco - §243, §541, §1569-1, §2345-5, §2345-8, §2350-1, §2421-2, 2436-7, §2440-1, §249-3, §2493.
TIBULLI carmina - §194-1, §1246-4, §1260-2, §1325-3, §1343-1.
Tocco (Felice). L'eresia nel medio evo. Firenze (1884) - §1807-1, §1812, §1813-1, §1814-2, §1817-4, §2520-2.
TOCQUEVILLE (Alexis de). L'ancien Régime et la Révolution. Paris (1877) - §2566-3. TOLSTOI. Les quatre Évangiles - §1471-1.
TOUTAIN (J.). Les cultes païens dans l'Empire romain (1907-1911) - §1070-2, §1074-1. TREVES (Claudio) - §2320-1.
TRUMELET (Colonel C.). Les saints de l'islam - §1502-2.
TYLOR (Edward B.). La civilisation primitive. Paris (1876-1878) - §694, §697 à §699, §703, §1001.
TYRTAEUS. Poetae lyrici graeci. Bergk, Lipsiae (1882) -§2524-2. TZETZES - §684-1.
U
UHLENBECK - §784.
UNION Suisse pour la sauvegarde des crédits à Genève - §1716-1.
V
VALERII FLACCI Argonauticon libri VIII - §1343-1.
VALERIUS Maximus - §182-5, §231-2, §1344-1, §1980-2, §2354, §2573-1. VANGELO - §191-1, §773, §1249, §1364, §1800-1.
VAN DALE. Antonii van Dale polyatri Harlemensis de Oraculis veterum Ethnicorum dissertationes duae. Amstaelodami (1700) - §317, §610, §1105.
VARRO (M. Terentius) - §908-1, §927-3, §1344-3, §1600.
VATEL (De). Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Paris (1830) - §441.
VEGETIUS (Flavius) Renatus - §2606-1.
VELLEIUS (C.) PATERCULUS - §233-1, §233-3, §247-1, §1920-1, §2200-1, §2354-1. VERA - Voir : HEGEL.
VIAZZI (Pio). La Ragione - §1223-1.
VIEL CASTEL (De). Mémoires du Comte Horace de Viel Castel sur le règne de Napoléon III. Paris (1883-1885) - §1715-2.
Vico (G. B.). Principij di Scienza Nuova. - §2330-4. VIENNET (M.). Épitres et Satires. Paris (1845) - §661-1.
VILLANI. Chroniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. Trieste (1857-1858) - §716-1.
VILLEMAIN (M.) - Oraisons funèbres de Bossuet... suivies d'un choix d'oraisons funèbres de Fléchier et de Mascaron. Paris (1843) - §473-1.
VILLON (François) - §1426-1.
VIOLIER (LE) DES HISTOIRES ROMAINES, Ancienne traduction française des Gesta romanorum. Brunet. Paris (1868) - §674, §1624-2.
VIRGILIUS - §192-1, §221-2, §226, §310-1, §583, §668, §675, 734-1, §763-1, §914-1, §915, §919-1, §927-3, §956-4, §960, 1246-4, 1247-1, §1259-2, §1304-1, §1325-y, §1343-1, §1457, §1602-1, §1925.
VIVIANI - §1716-2.
Voce (La) - §1177-1, §1686-1, §1686-2.
VOLTAIRE - §310, §315, §691-1, §1681, §1751, §1763, §2344.
W
WAGNER (Richard). Epitoma vaticana ex Appolodori bibliotheca - §927-4. WALDECK-ROUSSEAU - §2381-1.
WALISZEWSKI (K.). Le roman d'une Impératrice : Catherine II de Russie, Paris (1893) - §2163-1.
WALRAS (Léon) - §61-1, §2026-1, §2129-1.
WALTZING (J. P.). Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident. Louvain (1895-1900) - §2549-1, §2549-3, §2550-1, §2551-1.
WEBER (A.). L'enseignement de la prévoyance. Paris (1911) - §1511-1.
WELSCHINGER (Henri). La guerre de 1870. Causes et responsabilités. Paris (1910) - La censure sous le premier Empire. Paris (1882) - §1747-1, §1748-1, §1922-1, §1951.
WIER (Iean). Histoires, disputes et discours... Paris (1885) -§206, §208, §915, §927-6.
WITKOWSKI (Dr G. J.). L'art chrétien. Ses licences. Paris (1912). - L'art profane à l'Eglise. Ses licences symboliques, satiriques et fantaisistes. France. Paris (1908). - Étranger. Paris (1908). - §1343-2.
X
XAVIER (Léon) - Voir : BOURGEOIS.
XENOPHONTIS opera - §307-2, §787, §1344-1, §1365, §1926-1, §2002, §2431, §2434-2, §2436, §2495-2, §2496.
Z
ZELLER (E.). Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt (1876) - Traduction française de Em. Boutroux. - Traduction anglaise, London, New- York and Bombay - §58-1, §280-1.
ZELLER (Jules). Histoire d'Allemagne. Paris (1872-1881) -§1617. ZOLA (Émile) - §545-2.
ZONARAE (loannis) epitome historiarum... edidit L. Dindorfius. Lipsiae (1868-1875) - §195-8, §760, §1382-2.
Zosimi historiae. Reitemeier. Lipsiae (1784) - §1295, §2605-1.
TABLE DES AUTEURS ET DES OUVRAGES
CITÉS DANS LE SECOND VOLUME DE L'ÉDITION FRANÇAISE DEPUIS LA PARUTION DU PREMIER VOLUME↩
APOLLODORE - §2316-1.
ARISTOPHANE. Equites - §2316-7.
ARISTOTE (?). De la production et de la destruction des choses.
Bible (SEGOND) - §1832-1, §1833-1.
BOUCHÉ-LECLERCQ. Histoire de la divination dans l'antiquité - §2316-1, §2330.
BRUCE-WHYTE. Histoire des langues romanes... Paris (1841) - §2519-1.
CICÉRON. De natura deorum - §2316-4.
CRUET (JEAN). La Vie du droit et l'impuissance des lois. Paris (1914). Flammarion édit. - §2221-1, §2391-1.
CURTIUS - §2316-1.
Decretales Gratiani - §2316-5.
DE LA PORTE DU THEIL - §2316-1.
Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique - §2316-3, §2316-5.
DIODORE - §2316-1.
Encyclopédie des sciences mathématiques - §1732-3, §2022-1.
FERRARA. Della Moneta e dei suoi surrogati. Raccolta delle prefazioni - §2316-7.
FERRARI (GIUSEPPE). Teoria dei periodi politici - §2330, §2330-4, §2330-7.
FLEURY. Histoire ecclésiastique - §2316-5.
FRANTIN. Annales du Moyen-Age - §2316-5
FUSTEL DE COULANGES. La monarchie franque - §2316-5.
GREGORIUS (Divus). Histoire ecclésiastique française (trad. BORDIER) - §2316-5.
HOMÈRE - §1970-1.
JUSTIN - §2316-4.
LA ROCHEFOUCAULD. Réflexions ou Sentences et Maximes morales - §1999-1.
LE BON (GUSTAVE). La Révolution française et la Psychologie des Révolutions. Paris (1916). Flammarion édition. - §2300-1. - Les Opinions et les Croyances. Paris (1913). Flammarion édit. - §2553-1.
LEROY-BEAULIEU (PAUL). Traité de la Science des finances - §1919-1.
MACHIAVEL - §1975 bis.
MALTHUS. Essai sur le principe de population - §2134-1.
MARTIN (H). Histoire de France - §2316-7.
MOLINARI (G. DE). Journal des Économistes - §2022-3.
MURATORI. Antiquit. ital. - §2316-5.
NONII MARCELLI. ... de compediosa doctrina. Parisiis (1872) - §930-1, §1325-2.
NONNI PANOPOLITANI. Dionysiacorum libri XLVIII, recensait Arminius Koechly Lipsiae (1857) - §1321, §1325-2.
PARETO. Cours §2022-1, §2316-2, §2316-9, §2316-11, §2316-12. Les Systèmes socialistes - §2142-1, §2316-13. - Forme di fenomeni economici e previsioni (dans Rivista di Scienza Bancaria) - §2294-1.
PAULIN. Les grandes chroniques de France (publiées par...). Paris (1837). - §1937-2.
PAUSANIAS - §2316-1, §2524-2.
PLUTARQUE. Sulla - §2316-1.
POINCARÉ (H.). Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste - §2142-1.
SAINT-SIMON. Mémoires - §2316-7.
SECRÉTAN (HENRI). La population et les mœurs. Lausanne (1913). Payot éditeur. - §1701-1, §2049-1.
STOURM (RENÉ). Les finances de l'ancien régime et de la Révolution - §2316-1.
STRABON - §2316-1.
TANNERY (PAUL). Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne - §2142-1.
TITE-LIVE - §2316-1.
THÉOPOMPE - §2316-1.
THOROLD ROGERS. Interprétations économiques de l'histoire - §2316-5.
THUCYDIDE - §2316-1.
VIGO (G. B.). Principi di Scienza nuova di Giambatista Vico, d'intorno alla comune natura delle nazioni. Milano (1831) - La scienza nuova. Bari (1911-1916) - §2330.