
Voltaire, Questions sur l'EncyclopÉdie,
par des Amateurs. (1774)
Tome 4: “Juif - Zoroaster”
 |
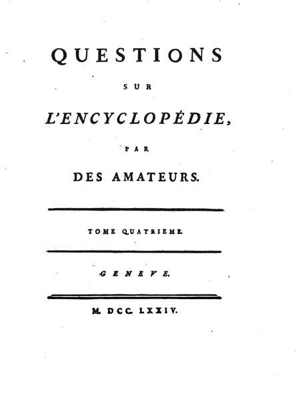 |
| François-Marie Arouet (“Voltaire”) (1694-1778) |
[Created: 14 March, 2023]
[Updated: May 2, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Questions sur l’Encyclopédie, par des amateurs (Geneve: n.p., 1774), Tome 4.http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Voltaire/Questions_sur_Encyclopedie/1774-edition/QSE4.html
Voltaire, Collection complette des oeuvres de Mr. de * * * . (Geneve: n.p., 1774). Questions sur l’Encyclopédie, par des amateurs, Tomes 21-24.
- Tome premier, “A - Bibliothèque”, pp. 538. In "enhanced HTML" and [facs. PDF]
- Tome second, “Bien (Souverain) - Elie et Enoch”, pp. 520. In "enhanced HTML" and [facs. PDF]
- Tome troisième, “Eloquence - Intolérance,” pp. 534. In "enhanced HTML" and [facs. PDF]
- Tome quatrième, “Juif - Zoroaster,” pp. 528. In "enhanced HTML" and [facs. PDF]
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by François-Marie Arouet (“Voltaire”) (1694-1778) .
Table des Articles contenus dans ce volume
- JUIF. [p. 1]
- LETTRE à Messieurs Joseph Ben Jonathan, Aaron Mathathaï, & David Wincker.
- LETTRE SECONDE.
- De l'antiquité des Juifs.
- TROISIEME LETTRE.
- Sur quelques chagrins arrivés au peuple de DIEU.
- QUATRIEME LETTRE.
- Sur la femme à Michas.
- CINQUIEME LETTRE.
- Assassinats juifs. Les juifs ont-ils été antropophages, leurs mères ont-elles couché avec des boucs ? les pères & mères ont-ils immolé leurs enfans ? & quelques autres belles actions du peuple de DIEU.
- CALAMITÉS JUIVES, ET GRANDS ASSASSINATS.
- ROITELETS, OU MELCHIM JUIFS.
- SI LES JUIFS ONT MANGÉ DE LA CHAIR HUMAINE ?
- SI LES DAMES JUIVES COUCHÈRENT AVEC DES BOUCS ?
- SI LES JUIFS IMMOLÈRENT DES HOMMES ?
- DES TRENTE-DEUX MILLE PUCELLES, DES SOIXANTE ET QUINZE MILLE BŒUFS, ET DU FERTILE DÉSERT DE MADIAN.
- DES ENFANS IMMOLÉS PAR LEURS MÈRES.
- SIXIEME LETTRE.
- Sur la beauté de la terre promise.
- SEPTIEME LETTRE.
- Sur la charité que le peuple de DIEU & les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres.
- JULIEN. [p. 18]
- JUSTICE. [p. 19]
- LANGUES. [p. 31]
- LARMES. [p. 44]
- LÉPRE ET VÉROLE. [p. 46]
- LETTRES, GENS DE LETTRES, OU LETTRÉS. [p. 49]
- LIBELLE. [p. 50]
- LIBERTÉ. [p. 52]
- LIBERTÉ DE PENSER. [p. 52]
- Dialogue BOLDMIND - MÉDROSO
- LIEUX COMMUNS EN LITTÉRATURE. [p. 60]
- LIVRES. [p. 61]
- LOI NATURELLE. [p. 67]
- LOIX. [p. 70]
- LOIX CRIMINELLES.
- Section seconde.
- PROCÈS CRIMINEL DU SR. MONBAILLI ET DE SA FEMME.
- LOIX; ESPRIT DES LOIX.
- Section troisiéme.
- DES CITATIONS FAUSSES DANS L'ESPRIT DES LOIX, DES CONSÉQUENCES FAUSSES QUE L'AUTEUR EN TIRE, ET DE PLUSIEURS ERREURS QU'IL EST IMPORTANT DE DÉCOUVRIR.
- LOIX.
- Section quatriéme.
- LUXE. [p. 99]
- MAHOMÉTANS. [p. 100]
- MAÎTRE. [p. 101]
- MALADIE. MÉDECINE. [p. 102]
- Dialogue LA PRINCESSE - LE MÉDECIN
- MARIAGE.
- MARIE MAGDELAINE. [p. 111]
- MARTYRS. [p. 115]
- SECTION PREMIERE.
- 1°. STE. SIMPHOROSE ET SEPT ENFANS.
- 2°. STE. FÉLICITÉ ET ENCOR SEPT ENFANS.
- 3°. ST. POLYCARPE.
- 4°.DE ST.PTOLOMÉE.
- 5°. DE ST.SIMPHORIEN D'AUTUN.
- 6°. D'UNE AUTRE STE. FÉLICITÉ ET STE. PERPÉTUE.
- 7°. DE ST. THÉODOTE DE LA VILLE D'ANCIRE, ET DES SEPT VIERGES, ÉCRIT PAR NILUS TÉMOIN OCULAIRE, TIRÉ DE BOLLANDUS.
- 8°. DU MARTYRE DE ST. ROMAIN.
- SECTION SECONDE.
- Extrait d'une lettre écrite à un docteur apologiste de Don Ruinart.
- 1°.
- SECTION TROISIEME.
- MASSACRES. [p. 131]
- MATIÈRE. [p. 136]
- MESSIE. [p. 138]
- MÉTAPHYSIQUE. [p. 147]
- MIRACLES. [p. 148]
- MISSIONS. [p. 163]
- MONDE. [p. 165]
- MONSTRES. [p. 167]
- MONTAGNE. [p. 170]
- MORALE. [p. ibid.]
- MOUVEMENT. [p. 171]
- MOYSE. [p. 174]
- NATURE. [p. 177]
- NOMBRE. [p. 180]
- NOUVEAU, NOUVEAUTÉS. [p. 182]
- NUDITÉ. [p. 183]
- OCCULTES, QUALITÉS OCCULTES. [p. 185]
- ONAN ET ONANISME. [p. 186]
- OPINION. [p. 189]
- ORACLE. [p. 190]
- ORAISON, PRIERE PUBLIQUE, ACTION DE GRACES, &c. [p. 195]
- ORDINATION. [p. 199]
- ORIGINEL, [p. 200]
- ORTOGRAPHE. [p. 204]
- OZÉE. [p. 205]
- PARADIS. [p. 206]
- PARLEMENT. [p. 208]
- PASSIONS. [p. 218]
- PATRIE. [p. 221]
- PAUL. [p. 224]
- PÈRES, MÈRES, ENFANS: [p. 228]
- PÉTRONE. [p. 230]
- PHILOSOPHIE. [p. 234]
- ST. PIERRE. [p. 247]
- PLAGIAT. [p. 251]
- POLIPES. [p. 253]
- POLITIQUE. [p. 255]
- POPULATION. [p. 259]
- POSTE. [p. 267]
- LES POURQUOI. [p. 269]
- PRÉTENTIONS. [p. 272]
- PRÊTRES DES PAYENS. [p. 274]
- PRIÈRES. [p. 276]
- PRIVILÈGES, CAS PRIVILÉGIÉS. [p. 278]
- PROPHÊTES. [p. 281]
- PROPHÉTIES. [p. 283]
- PROPRIÉTÉ. [p. 283]
- PROVIDENCE. [p. 291]
- Dialogue SOEUR FESSUE. - LE MÉTAPHYSICIEN
- PUISSANCE, TOUTE-PUISSANCE. [p. 293]
- PUISSANCE, [p. 298]
- PURGATOIRE. [p. 304]
- QUAKER OU QUOACRE, [p. 310]
- QUESTION, TORTURE. [p. 312]
- DU MOT QUISQUIS DE RAMUS, OU DE LA RAMÉE; [p. 313]
- AVEC QUELQUES OBSERVATIONS UTILES SUR LES PERSÉCUTEURS, LES CALOMNIATEURS, ET LES FAISEURS DE LIBELLES.
- EXEMPLES DES PERSECUTIONS QUE DES HOMMES DE LETTRES INCONNUS ONT EXCITÉES CONTRE DES HOMMES CONNUS.
- DU GAZETIER ECCLÉSIASTIQUE.
- DE PATOUILLET.
- DU JOURNAL CHRÊTIEN.
- DE NONOTTE.
- DE LARCHET ANCIEN RÉPÉTITEUR DU COLLÈGE-MAZARIN.
- DES LIBELLES DE LANGLEVIEL, DIT LA BAUMELLE.
- OBSERVATION SUR TOUS CES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
- RAISON. [p. ibid.]
- RARE. [p. 329]
- RAVAILLAC. [p. 331]
- RELIGION. [p. 335]
- RESURRECTION. [p. 343]
- RIME. [p. 346]
- RIRE. [p. 349]
- ROI. [p. 350]
- ROME. [p. 352]
- RUSSIE. [p. 357]
- SALIQUE, LOI SALIQUE. [p. 359]
- SALOMON. [p. 367]
- SAMMONOCODOM. [p. 374]
- SAMOTRACE. [p. 377]
- SAMSON. [p. 380]
- SCANDALE. [p. 383]
- SCHISME. [p. 385]
- SCHOLIASTE. [p. 388]
- SERPENT. [p. 398]
- SICLE. [p. 400]
- SOLDAT. [p. 402]
- SOMNANBULES ET SONGES. [p. 403]
- SOPHISTE. [p. 407]
- STYLE. [p. 408]
- SUPERSTITION. [p. 414]
- SECTION PREMIÈRE.
- SECTION SECONDE.
- RECIT surprenant sur l'apparition visible & miraculeuse de N.S.J.C. au St. Sacrement de l'autel,qui s'est faite, par la toute-puissance de DIEU, dans l'église paroissiale de Paimpole, près Treguyer en Basse-Bretagne ,le jour des Rois.
- COPIE de la lettre trouvée sur l'autel, lors de l'apparition miraculeuse de N.S.J.C. au très saint sacrement de l'autel, le jour des Rois 1771.
- SECTION TROISIÉME.
- Nouvel exemple de la superstition la plus horrible.
- SUPPLICES. [p. 411]
- SYMBOLE, OU CREDO. [p. 429]
- SYSTÉME. [p. 432]
- TERELAS. [p. 435]
- TESTICULES. [p. 437]
- THÉOCRATIE. [p. 441]
- THÉODOSE. [p. 444]
- TOLERANCE. [p. 447]
- TONNERRE. [p. 449]
- TOPHET. [p. 454]
- TRINITÉ. [p. 456]
- TYRAN. [p. 463]
- VAMPIRES. [p. 465]
- VENALITÉ. [p. 469]
- VENISE, [p. 470]
- VENTRES PARESSEUX. [p. 472]
- VERGE, [p. 474]
- VERITÉ. [p. 476]
- VERS ET POÉSIE. [p. 480]
- VERTU. [p. 491]
- Dialogue L'HONNÊTE HOMME. - L"EXCRÉMENT
- VIANDE, VIANDE DÉFENDUE, VIANDE DANGEREUSE. [p. 493]
- VIE. [p. 495]
- VISION. [p. 498]
- VOLONTÉ. [p. 501]
- VOYAGE DE ST. PIERRE A ROME. [p. 503]
- XÉNOPHANES. [p. 507]
- XÉNOPHON, [p. 509]
- ZOROASTRE. [p. 515]
Questions sur l'Encyclopédie,
par des Amateurs.
Tome 4 “Juif - Zoroaster”
JUIF. [p. 1]↩
LETTRE à Messieurs Joseph Ben Jonathan, Aaron Mathathaï, & David Wincker.
MESSIEURS,
Lorsque M. Medina votre compatriote, me fit à Londres une banqueroute de vingt mille francs il y a quarante-quatre ans, il me dit, que ce n'était pas sa faute, qu'il était malheureux, qu'il n'avait jamais été enfant de Bélial, qu'il avait toujours tâché de vivre en fils de Dieu, c'est-à-dire en honnête homme, en bon Israëlite . Il m'attendrit, je l'embrassai; nous louâmes Dieu ensemble; et je perdis quatre-vingts pour cent.
Vous devez savoir que je n'ai jamais haï votre nation. Je ne hais personne, pas même Fréron.
Loin de vous haïr, je vous ai toujours plaints. Si j'ai été quelquefois un peu goguenard comme l'était le bon pape Lambertini mon protecteur, je n'en suis pas moins sensible. Je pleurais à l'âge de seize ans quand on me disait qu'on avait brûlé à Lisbonne une mère et une fille pour avoir mangé debout un peu d'agneau cuit avec des laitues le quatorzième jour de la lune rousse; et je puis vous assurer que l'extrême beauté qu'on vantait dans cette fille n'entra point dans la source de mes larmes, quoiqu'elle dût augmenter dans les spectateurs l'horreur pour les assassins, et la pitié pour la victime.
Je ne sais comment je m'avisai de faire un poème épique à l'âge de vingt ans. (Savez-vous ce que c'est qu'un poème épique? pour moi je n'en savais rien alors.) Le législateur Montesquieu n'avait point encore écrit ses Lettres persanes que vous me reprochez d'avoir commentées, et j'avais déjà dit tout seul, en parlant d'un monstre que vos ancêtres ont bien connu, et qui a même encore aujourd'hui quelques dévots:
Il vient; le fanatisme est son horrible nom,
Enfant dénaturé de la religion,
Armé pour la défendre il cherche à la détruire;
Et reçu dans son sein l'embrasse et le déchire.
C'est lui qui dans Raba, sur les bords de l'Arnon,
Guidait les descendants du malheureux Ammon,
Quand à Moloc leur Dieu, des mères gémissantes
Offraient de leurs enfants les entrailles fumantes.
Il dicta de Jephté le serment inhumain:
Dans le coeur de sa fille il conduisit sa main.
C'est lui qui de Calcas ouvrant la bouche impie,
Demanda par sa voix la mort d'Iphigénie.
France, dans tes forêts il habita longtemps.
A l'affreux Teutatès il offrit ton encens.
Tu n'as point oublié ces sacrés homicides,
Qu'à tes indignes dieux présentaient tes druides.
Du haut du Capitole il criait aux païens,
Frappez, exterminez, déchirez les chrétiens.
Mais lorsqu'au fils de Dieu Rome enfin fut soumise,
Du Capitole en cendre il passa dans l'église;
Et dans les coeurs chrétiens inspirant ses fureurs,
De martyrs qu'ils étaient, les fit persécuteurs.
Dans Londre il a formé la secte turbulente
Qui sur un roi trop faible a mis sa main sanglante;
Dans Madrid, dans Lisbonne, il allume ces feux,
Ces bûchers solennels où des juifs malheureux
Sont tous les ans en pompe envoyés par des prêtres
Pour n'avoir point quitté la foi de leurs ancêtres.
Vous voyez bien que j'étais dès lors votre serviteur, votre ami, vous frère, quoique mon père et ma mère m'eussent conservé mon prépuce.
Je sais que l'instrument ou prépucé, ou déprépucé, a causé des querelles bien funestes. Je sais ce qu'il en a coûté à Pâris fils de Priam, et à Ménélas frère d'Agamemnon. J'ai assez lu vos livres pour ne pas ignorer que Sichem fils d'Hemor viola Dina fille de Lia, laquelle n'avait que cinq ans tout au plus, mais qui était fort avancée pour son âge. Il voulut l'épouser; les enfants de Jacob frères de la violée, la lui donnèrent en mariage, à condition qu'il se ferait circoncire lui et tout son peuple. Quand l'opération fut faite, et que tous les Sichemites, ou Sichimites, étaient au lit dans les douleurs de cette besogne, les saints patriarches Siméon et Lévi les égorgèrent tous l'un après l'autre. Mais après tout, je ne crois pas qu'aujourd'hui le prépuce doive produire de si abominables horreurs. Je ne pense pas surtout que les hommes doivent se haïr, se détester, s'anathématiser, se damner réciproquement le samedi et le dimanche pour un petit bout de chair de plus ou de moins.
Si j'ai dit que quelques déprépucés ont rogné les espèces à Metz, à Francfort-sur-l'Oder et à Varsovie, (ce dont je ne me souviens pas) je leur en demande pardon. Car étant prêt de finir mon pèlerinage, je ne veux point me brouiller avec Israël.
J'ai l'honneur d'être comme on dit,
Votre etc.
LETTRE SECONDE.
De l'antiquité des Juifs.
MESSIEURS,
Je suis toujours convenu, à mesure que j'ai lu quelques livres d'histoire pour m'amuser, que vous êtes une nation assez ancienne, et que vous datez de plus loin que les Teutons, les Celtes, les Welches, les Sicambres, les Bretons, les Slavons, les Angles et les Hurons. Je vous vois rassemblés en corps de peuple dans une capitale nommée tantôt Hershalaïm, tantôt Shebah sur la montagne Moriah, et sur la montagne Sion, auprès d'un désert, dans un terrain pierreux, près d'un petit torrent qui est à sec six mois de l'année.
Lorsque vous commençâtes à vous affermir dans ce coin, (je ne dirai pas de terre, mais de cailloux) il y avait environ deux siècles que Troye était détruite par les Grecs;
Medon était archonte d'Athènes;
Ekestrates régnait dans Lacédémone;
Latinus Silvius régnait dans le Latium;
Osochor en Egypte.
Les Indes étaient florissantes depuis une longue suite de siècles.
C'était le temps le plus illustre de la Chine; l'empereur Tchinvang régnait avec gloire sur ce vaste empire; toutes les sciences y étaient cultivées; et les annales publiques portent que le roi de la Cochinchine étant venu saluer cet empereur Tchinvang, il en reçut en présent une boussole. Cette boussole aurait bien servi à votre Salomon pour les flottes qu'il envoyait au beau pays d'Ophir, que personne n'a jamais connu.
Ainsi après les Chaldéens, les Syriens, les Perses, les Phéniciens, les Egyptiens, les Grecs, les Indiens, les Chinois, les Latins, les Toscans, vous êtes le premier peuple de la terre qui ait eu quelque forme de gouvernement connue.
Les Banians, les Guèbres, sont avec vous les seuls peuples, qui dispersés hors de leur patrie, ont conservé leurs anciens rites. Car je ne compte pas les petites troupes égyptiennes qu'on appelait Zingari en Italie, Gipsi en Angleterre, Bohêmes en France, lesquelles avaient conservé les antiques cérémonies du culte d'Isis, le cistre, les cymbales, les crotales, la danse d'Isis, la prophétie, et l'art de voler les poules dans les basses-cours. Ces troupes sacrées commencent à disparaître de la face de la terre, tandis que leurs pyramides appartiennent encore aux Turcs, qui n'en seront pas peut-être toujours les maîtres non plus que d'Hershalaïm, tant la figure de ce monde passe.
Vous dites que vous êtes établis en Espagne dès le temps de Salomon. Je le crois; et même j'oserais penser que les Phéniciens purent y conduire quelques Juifs longtemps auparavant, lorsque vous fûtes esclaves en Phénicie après les horribles massacres que vous dites avoir été commis par Cartouche Josué, et par Cartouche Caleb.
Juges ch. III. Vos livres disent en effet que vous fûtes réduits en servitude sous Cusan Rashataim roi d'Aram-Naharaim pendant huit ans, et sous Eglon [28] roi de Moab pendant dix-huit ans; puis sous Jabin [29] roi de Canaan pendant vingt ans; puis dans le petit canton de Madian dont vous étiez venus, et où vous vécûtes dans des cavernes pendant sept ans.
Juges ch. X. Puis en Galaad pendant dix-huit ans, quoique Jaïr votre prince eût trente fils, montés chacun sur un bel ânon.
Puis sous les Phéniciens nommés par vous Philistins pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur Adonaï envoya Samson qui attacha trois cents renards l'un à l'autre par la queue, et tua mille Phéniciens avec une mâchoire d'âne, de laquelle il sortit une belle fontaine d'eau pure, qui a été très bien représentée à la Comédie italienne.
Voilà de votre aveu quatre-vingt-seize ans de captivité dans la terre promise. Or il est très probable que les Tyriens qui étaient les facteurs de toutes les nations, et qui naviguaient jusque sur l'Océan, achetèrent plusieurs esclaves juifs, et les menèrent à Cadix qu'ils fondèrent. Vous voyez que vous êtes bien plus anciens que vous ne pensiez. Il est très probable en effet que vous avez habité l'Espagne plusieurs siècles avant les Romains, les Goths, les Vandales et les Maures.
Non seulement je suis votre ami, votre frère, mais de plus votre généalogiste.
Je vous supplie, Messieurs, d'avoir la bonté de croire que je n'ai jamais cru, que je ne crois point, et que je ne croirai jamais que vous soyez descendus de ces voleurs de grand chemin à qui le roi Actisan fit couper le nez et les oreilles, et qu'il envoya, selon le rapport de Diodore de Sicile, [30] dans le désert qui est entre le lac Sirbon et le mont Sinaï; désert affreux où l'on manque d'eau et de toutes les choses nécessaires à la vie. Ils firent des filets pour prendre des cailles qui les nourrirent pendant quelques semaines, dans le temps du passage des oiseaux.
Des savants ont prétendu que cette origine s'accorde parfaitement avec votre histoire. Vous dites vous-mêmes que vous habitâtes ce désert, que vous y manquâtes d'eau, que vous y vécûtes de cailles, qui en effet y sont très abondantes. Le fond de vos récits semble confirmer celui de Diodore de Sicile; mais je n'en crois que le Pentateuque. L'auteur ne dit point qu'on vous ait coupé le nez et les oreilles. Il me semble même (autant qu'il m'en peut souvenir, car je n'ai pas Diodore sous ma main) qu'on ne vous coupa que le nez. Je ne me souviens plus où j'ai lu que les oreilles furent de la partie; je ne sais point si c'est dans quelques fragments de Manéthon, cité par St Ephrem.
Le secrétaire qui m'a fait l'honneur de m'écrire en votre nom, a beau m'assurer que vous volâtes pour plus de neuf millions d'effets en or monnayé ou orfévré, pour aller faire votre tabernacle dans le désert. Je soutiens que vous n'emportâtes que ce qui vous appartenait légitimement, en comptant les intérêts à quarante pour cent, ce qui était le taux légitime.
Quoi qu'il en soit, je certifie que vous êtes d'une très bonne noblesse, et que vous étiez seigneurs d'Hershalaïm, longtemps avant qu'il fût question dans le monde de la maison de Souabe, de celle d'Anhalt, de Saxe et de Bavière.
Il se peut que les nègres d'Angola, et ceux de Guinée soient beaucoup plus anciens que vous, et qu'ils aient adoré un beau serpent avant que les Egyptiens aient connu leur Isis, et que vous ayez habité auprès du lac Sirbon; mais mais les nègres ne nous ont pas encore communiqué leurs livres.
TROISIEME LETTRE.
Sur quelques chagrins arrivés au peuple de DIEU.
Loin de vous accuser, Messieurs, je vous ai toujours regardés avec compassion. Permettez-moi de vous rappeler ici ce que j'ai lu dans le discours préliminaire de l' Essai sur les moeurs des nations , et sur l' Histoire générale . On y trouve deux cent trente-neuf mille vingt Juifs égorgés les uns par les autres, depuis l'adoration du veau d'or jusqu'à la prise de l'arche par les Philistins; laquelle coûta la vie à cinquante mille soixante et dix Juifs pour avoir osé regarder l'arche; tandis que ceux qui l'avaient prise si insolemment à la guerre en furent quittes pour des hémorroïdes et pour offrir à vos prêtres cinq rats d'or, et cinq anus d'or. [31] Vous m'avouerez que deux cent trente-neuf mille vingt hommes massacrés par vos compatriotes, sans compter tout ce que vous perdites dans vos alternatives de guerre et de servitude, devaient faire un grand tort à une colonie naissante.
Comment puis-je ne vous pas plaindre en voyant dix de vos tribus absolument anéanties, ou peut-être réduites à deux cents familles, qu'on retrouve, dit-on, à la Chine et dans la Tartarie?
Pour les deux autres tribus, vous savez ce qui leur est arrivé. Souffrez donc ma compassion, et ne m'imputez pas de mauvaise volonté.
QUATRIEME LETTRE.
Sur la femme à Michas.
Trouvez bon que je vous demande ici quelques éclaircissements sur un fait singulier de votre histoire. Il est peu connu des dames de Paris et des personnes du bon ton.
Il n'y avait pas trente-huit ans que votre Moïse était mort, lorsque la femme à Michas de la tribu de Benjamin, perdit onze cents cicles, qui valent, dit-on, environ six cents livres de notre Juges ch. XXVII. monnaie. Son fils les lui rendit, sans que le texte nous apprenne s'il ne les avait pas volés. Aussitôt la bonne Juive en fait faire des idoles, et leur construit une petite chapelle ambulante selon l'usage. Un lévite de Bethléem s'offrit pour la desservir moyennant dix francs par an, deux tuniques, et bouche à cour , comme on disait autrefois.
Une tribu alors (qu'on appela depuis la Tribu de Dan ) passa auprès de la maison de la Michas, en cherchant s'il n'y avait rien à piller dans le voisinage. Les gens de Dan sachant que la Michas avait chez elle un prêtre, un voyant, un devin, un rhoé, s'enquirent de lui si leur voyage serait heureux, s'il y aurait quelque bon coup à faire. Le lévite leur promit un plein succès. Ils commencèrent par voler la chapelle de la Michas; et lui prirent jusqu'à son lévite. La Michas et son mari eurent beau crier, Vous emportez mes dieux, et vous me volez mon prêtre ; on les fit taire, et on alla mettre tout à feu et à sang par dévotion dans la petite bourgade de Dan, dont la tribu prit le nom.
Ces flibustiers conservèrent une grande reconnaissance pour les dieux de la Michas qui les avaient si bien servis. Ces idoles furent placées dans un beau tabernacle. La foule des dévots augmenta, il fallut un nouveau prêtre, il s'en présenta un.
Ceux qui ne connaissent pas votre histoire ne devineront jamais qui fut ce chapelain. Vous le savez, messieurs, c'était le propre petit-fils de Moïse, un nommé Jonathan, fils de Gersom, fils de Moïse et de la fille à Jéthro.
Vous conviendrez avec moi que la famille de Moïse était un peu singulière. Son frère à l'âge de cent ans jette un veau d'or en fonte et l'adore; son petit-fils se fait aumônier des idoles pour de l'argent. Cela ne prouverait-il pas que votre religion n'était pas encore faite, et que vous tâtonnâtes longtemps avant d'être de parfaits Israëlites tels que vous l'êtes aujourd'hui?
Vous répondez à ma question que notre St Pierre Simon Barjone en a fait autant, et qu'il commença son apostolat par renier son maître. Et je me défie si fort de moi-même, que je finis ma lettre en vous assurant de toute mon indulgence, et en vous demandant la vôtre.
CINQUIEME LETTRE.
Assassinats juifs. Les juifs ont-ils été antropophages, leurs mères ont-elles couché avec des boucs ? les pères & mères ont-ils immolé leurs enfans ? & quelques autres belles actions du peuple de DIEU.
MESSIEURS,
J'ai un peu gourmandé votre secrétaire. Il n'est pas dans la civilité de gronder les valets d'autrui devant leurs maîtres; mais l'ignorance orgueilleuse révolte dans un chrétien qui se fait valet d'un juif. Je m'adresse directement à vous pour n'avoir plus à faire à votre livrée.
CALAMITÉS JUIVES, ET GRANDS ASSASSINATS.
Permettez-moi d'abord de m'attendrir sur toutes vos calamités, car outre les deux cent trente-neuf mille vingt Israëlites, tués par l'ordre du Seigneur, je vois la fille de Jephté immolée par son père. Il lui fit comme il l'avait voué . Tournez-vous de tous les sens; tordez le texte, disputez contre les Pères de l'Eglise. Il lui fit comme il avait voué; et il avait voué d'égorger sa fille pour remercier le Seigneur. Belle action de grâces!
Oui, vous avez immolé des victimes au Seigneur; mais consolez-vous: je vous ai dit souvent que nos Welches et toutes les nations en firent autant autrefois. Voilà M. de Bougainville qui revient de l'île de Taïti, de cette île de Cithère dont les habitants paisibles, doux, humains, hospitaliers, offrent aux voyageurs tout ce qui est en leur pouvoir, les fruits les plus délicieux, et les filles les plus belles, les plus faciles de la terre. Mais ces peuples ont leurs jongleurs; et ces jongleurs les forcent à sacrifier leurs enfants à des magots qu'ils appellent leurs dieux .
Je vois soixante et dix frères d'Abimélec écrasés sur une même pierre par cet Abimélec fils de Gédéon et d'une coureuse. Ce fils de Gédéon était mauvais parent; et ce Gédéon l'ami de Dieu était bien débauché.
Votre lévite qui vient sur son âne à Gabaa; les Gabaonites qui veulent le violer, sa pauvre femme qui est violée à sa place et qui meurt à la peine; la guerre civile qui en est la suite, toute votre tribu de Benjamin exterminée, à six cents hommes près, me font une peine que je ne puis vous exprimer.
Vous perdez tout d'un coup cinq belles villes que le Seigneur vous destinait au bout du lac de Sodome, et cela pour un attentat inconcevable contre la pudeur de deux anges. En vérité, c'est bien pis que ce dont on accuse vos mères avec les boucs. Comment n'aurais-je pas la plus grande pitié pour vous, quand je vois le meurtre, la bestialité constatés chez vos ancêtres qui sont nos premiers pères spirituels et nos proches parents selon la chair? Car enfin, si vous descendez de Sem, nous descendons de son frère Japhet. Nous sommes évidemment cousins.
ROITELETS, OU MELCHIM JUIFS.
Votre Samuel avait bien raison de ne pas vouloir que vous eussiez des roitelets; car presque tous vos roitelets sont des assassins, à commencer par David qui assassine Miphiboseth fils de Jonathas son tendre ami qu' il aimait d'un amour plus grand que l'amour des femmes , qui assassine Uriah le mari de sa Betzabée, qui assassine jusqu'aux enfants qui tètent dans les villages alliés de son protecteur Achis; qui commande en mourant qu'on assassine Joab son général, et Semei son conseiller; à commencer, dis-je, par ce David et par Salomon qui assassine son propre frère Adonias embrassant en vain l'autel, et à finir par Hérode le Grand qui assassine son beau-frère, sa femme, tous ses parents et ses enfants même.
Je ne vous parle pas des quatorze mille petits garçons que votre roitelet, ce grand Hérode, fit égorger dans le village de Bethléem. Ils sont enterrés, comme vous savez, à Cologne avec nos onze mille vierges; et on voit encore un de ces enfants tout entier. Vous ne croyez pas à cette histoire authentique parce qu'elle n'est pas dans votre canon, et que votre Flavien Joseph n'en a rien dit. Je ne vous parle pas des onze cent mille hommes tués dans la seule ville de Jérusalem pendant le siège qu'en fit Titus.
Par ma foi, la nation chérie est une nation bien malheureuse.
SI LES JUIFS ONT MANGÉ DE LA CHAIR HUMAINE ?
Parmi vos calamités qui m'ont fait tant de fois frémir, j'ai toujours compté le malheur que vous avez eu de manger de la chair humaine. Vous dites que cela n'est arrivé que dans les grandes occasions, que ce n'est pas vous que le Seigneur invitait à sa table pour manger le cheval et le cavalier, que c'étaient les oiseaux qui étaient les convives; je le veux croire. (Voyez l'article Anthropophages . )
SI LES DAMES JUIVES COUCHÈRENT AVEC DES BOUCS ?
Vous prétendez que vos mères n'ont pas couché avec des boucs, ni vos pères avec des chèvres. Mais, dites-moi, messieurs, pourquoi vous êtes le seul peuple de la terre à qui les lois aient jamais fait une pareille défense? Un législateur se serait-il jamais avisé de promulguer cette loi bizarre si le délit n'avait pas été commun?
SI LES JUIFS IMMOLÈRENT DES HOMMES ?
Vous osez assurer que vous n'immoliez pas des victimes humaines au Seigneur; et qu'est-ce donc que le meurtre de la fille de Jephté réellement immolée, comme nous l'avons déjà prouvé par vos propres livres?
Comment expliquerez-vous l'anathème des trente-deux pucelles qui furent le partage du Seigneur quand vous prîtes chez les Madianites trente-deux mille pucelles et soixante et un mille ânes? Je ne vous dirai pas ici qu'à ce compte il n'y avait pas deux ânes par pucelle; mais je vous demanderai ce que c'était que cette part du Seigneur. Il y eut, selon votre livre des Nombres, seize mille filles pour vos soldats, seize mille filles pour vos prêtres; et sur la part des soldats on préleva trente-deux filles pour le Seigneur. Qu'en fit-on? vous n'aviez point de religieuses. Qu'est-ce que la part du Seigneur dans toutes vos guerres, sinon du sang?
Le prêtre Samuel ne hacha-t-il pas en morceaux le roitelet Agag, à qui le roitelet Saül avait sauvé la vie? ne le sacrifia-t-il pas comme la part du Seigneur?
Ou renoncez à vos livres auxquels je crois fermement, selon la décision de l'Eglise; ou avouez que vos pères ont offert à Dieu des fleuves de sang humain, plus que n'a jamais fait aucun peuple du monde.
DES TRENTE-DEUX MILLE PUCELLES, DES SOIXANTE ET QUINZE MILLE BŒUFS, ET DU FERTILE DÉSERT DE MADIAN.
Que votre secrétaire cesse de tergiverser, d'équivoquer, sur le camp des Madianites et sur leurs villages. Je me soucie bien que ce soit dans un camp ou dans un village de cette petite contrée misérable et déserte que votre prêtre-boucher Eléazar, général des armées juives, ait trouvé soixante et douze mille boeufs, soixante et un mille ânes, six cent soixante et quinze mille brebis, sans compter les béliers et les agneaux!
Or, si vous prîtes trente-deux mille petites filles, il y avait apparemment autant de petits garçons, autant de pères et de mères. Cela irait probablement à cent vingt-huit mille captifs, dans un désert où l'on ne boit que de l'eau saumache, où l'on manque de vivres, et qui n'est habité que par quelques Arabes vagabonds au nombre de deux ou trois mille tout au plus. Vous remarquerez d'ailleurs que ce pays affreux n'a pas plus de huit lieues de long et de large sur toutes les cartes.
Mais qu'il soit aussi grand, aussi fertile, aussi peuplé que la Normandie ou le Milanais, cela ne m'importe. Je m'en tiens au texte qui dit que la part du Seigneur fut de trente-deux filles. Confondez tant qu'il vous plaira le Madian près de la mer Rouge avec le Madian près de Sodome; je vous demanderai toujours compte de mes trente-deux pucelles.
Votre secrétaire a-t-il été chargé par vous de supputer combien de boeufs et de filles peut nourrir le beau pays de Madian?
J'habite un canton, messieurs, qui n'est pas la terre promise; mais nous avons un lac beaucoup plus beau que celui de Sodome. Notre sol est d'une bonté très médiocre. Votre secrétaire me dit qu'un arpent de Madian peut nourrir trois boeufs. Je vous assure, messieurs, que chez moi un arpent ne nourrit qu'un boeuf. Si votre secrétaire veut tripler le revenu de mes terres, je lui donnerai de bons gages; et je ne le payerai pas en rescriptions sur les receveurs généraux. Il ne trouvera pas dans tout le pays de Madian une meilleure condition que chez moi. Mais malheureusement cet homme ne s'entend pas mieux en boeufs qu'en veaux d'or.
A l'égard des trente-deux mille pucelages, je lui en souhaite. Notre petit pays est environ de l'étendue de Madian; il contient environ quatre mille ivrognes, une douzaine de procureurs, deux hommes d'esprit, et environ quatre mille personnes du beau sexe, qui ne sont pas toutes jolies. Tout cela monte à environ huit mille personnes, supposé que le greffier qui m'a produit ce compte n'ait pas exagéré de moitié selon la coutume. Vos prêtres et les nôtres auraient peine à trouver dans mon pays trente-deux mille pucelles pour leur usage. C'est ce qui me donne de grands scrupules sur les dénombrements du peuple romain, du temps que son empire s'étendait à quatre lieues du mont Tarpeïen, et que les Romains avaient une poignée de foin au haut d'une perche pour enseignes. Peut-être ne savez-vous pas que les Romains passèrent cinq cents années à piller leurs voisins avant d'avoir aucun historien; et que leurs dénombrements sont fort suspects ainsi que leurs miracles.
A l'égard des soixante et un mille ânes qui furent le prix de vos conquêtes en Madian, c'est assez parler d'ânes.
DES ENFANS IMMOLÉS PAR LEURS MÈRES.
Je vous dis que vos pères ont immolé leurs enfants, et j'appelle en témoignage vos prophètes. Isaïe leur reproche ce crime de Isaïe ch. XLVII, v. 7. cannibales, Vous immolez aux dieux vos enfans dans des torrents sous des pierres .
Vous m'allez dire que ce n'était pas au Seigneur Adonaï que les femmes sacrifiaient les fruits de leurs entrailles; que c'était à quelque autre dieu. Il importe bien vraiment que vous ayez appelé Melkom ou Sadaï, ou Baal ou Adonaï, celui à qui vous immoliez vos enfants! ce qui importe, c'est que vous ayez été des parricides. C'était, dites-vous, à des idoles étrangères que vos pères faisaient ces offrandes; eh bien, je vous plains encore davantage de descendre d'aïeux parricides et idolâtres. Je gémirai avec vous de ce que vos pères furent toujours idolâtres pendant quarante ans dans le désert de Sinaï, comme le disent expressément Jérémie, Amos et St Etienne.
Vous étiez idolâtres du temps des juges, et le petit-fils de Moïse était prêtre de la tribu de Dan, idolâtre tout entière comme nous l'avons vu. Car il faut insister, inculquer, sans quoi tout s'oublie.
Vous étiez idolâtres sous vos rois; vous n'avez été fidèles à un seul Dieu qu'après qu'Esdras eut restauré vos livres. C'est là que votre véritable culte non interrompu commence. Et par une providence incompréhensible de l'Etre suprême, vous avez été les plus malheureux de tous les hommes depuis que vous avez été les plus fidèles, sous les rois de Syrie, sous les rois d'Egypte, sous Hérode l'Iduméen, sous les Romains, sous les Persans, sous les Arabes, sous les Turcs, jusqu'au temps où vous me faites l'honneur de m'écrire, et où j'ai celui de vous répondre.
SIXIEME LETTRE.
Sur la beauté de la terre promise.
Ne me reprochez pas de ne vous point aimer. Je vous aime tant, que je voudrais que vous fussiez tous dans Hershalaïm au lieu des Turcs qui dévastent tout votre pays, et qui ont bâti cependant une assez belle mosquée sur les fondements de votre temple, et sur la plate-forme construite par votre Hérode.
Vous cultiveriez ce malheureux désert comme vous l'avez cultivé autrefois, vous porteriez encore de la terre sur la croupe de vos montagnes arides; vous n'auriez pas beaucoup de blé, mais vous auriez d'assez bonnes vignes, quelques palmiers, des oliviers et des pâturages.
Quoique la Palestine n'égale pas la Provence, et que Marseille seule soit supérieure à toute la Judée qui n'avait pas un port de mer, quoique la ville d'Aix soit dans une situation incomparablement plus belle que Jérusalem, vous pourriez faire de votre terrain à peu près ce que les Provençaux ont fait du leur. Vous exécuteriez à plaisir dans votre détestable jargon votre détestable musique.
Il est vrai que vous n'auriez point de chevaux, parce qu'il n'y a que des ânes vers Hershalaïm, et qu'il n'y a jamais eu que des ânes. Vous manqueriez souvent de froment, mais vous en tireriez d'Egypte ou de la Syrie.
Vous pourriez voiturer des marchandises à Damas, à Seïde sur vos ânes, ou même sur des chameaux que vous ne connûtes jamais du temps de vos melchim, et qui vous seraient d'un grand secours. Enfin un travail assidu, pour lequel l'homme est né, rendrait fertile cette terre que les seigneurs de Constantinople et de l'Asie mineure négligent.
Elle est bien mauvaise cette terre promise. Connaissez-vous St Jérôme? C'était un prêtre chrétien; vous ne lisez point les livres de ces gens-là. Cependant il a demeuré très longtemps dans votre pays; c'était un très docte personnage, peu endurant à la vérité, et prodigue d'injures quand il était contredit; mais sachant votre langue mieux que vous, parce qu'il était bon grammairien. L'étude était sa passion dominante, la colère n'était que la seconde. Il s'était fait prêtre avec son ami Vincent, [32] à condition qu'ils ne diraient jamais la messe ni vêpres, de peur d'être trop interrompus dans leurs études. Car étant directeurs de femmes et de filles, s'ils avaient été obligés encore de vaquer aux oeuvres presbytérales, il ne leur serait pas resté deux heures dans la journée pour le grec, le chaldéen et l'idiome judaïque. Enfin, pour avoir plus de loisir, Jérôme se retira tout à fait chez les Juifs à Bethléem, comme l'évêque d'Avranche Huet se retira chez les jésuites à la maison professe rue St Antoine à Paris.
Jérôme se brouilla il est vrai avec l'évêque de Jérusalem nommé Jean, avec le célèbre prêtre Rufin, avec plusieurs de ses amis. Car, ainsi que je l'ai déjà dit, Jérôme était colère et plein d'amour-propre; et St Augustin l'accuse d'être inconstant et léger, [33] mais enfin il n'en était pas moins saint; il n'en était pas moins docte; son témoignage n'en est pas moins recevable sur la nature du misérable pays dans lequel son ardeur pour l'étude et sa mélancolie l'avaient confiné.
Ayez la complaisance de lire sa lettre à Dardanus écrite l'an 414 de notre ère vulgaire, qui est, suivant le comput juif, l'an du monde quatre mille, ou 4001, ou 4003, ou 4004, comme on voudra.
[34] ‘Je prie ceux qui prétendent que le peuple juif après sa sortie d'Egypte, prit possession de ce pays, qui est devenu pour nous, par la passion et la résurrection du Sauveur, une véritable terre de promesse; je les prie, dis-je, de nous faire voir ce que ce peuple en a possédé. Tout son domaine ne s'étendait que depuis Dan jusqu'à Bersabée, c'est-à-dire, l'espace de cent soixante milles de longueur. L'Ecriture sainte n'en donne pas davantage à David et à Salomon. . . J'ai honte de dire quelle est la largeur de la terre promise, et je crains que les païens ne prennent de là occasion de blasphémer. On ne compte que quarante et six milles depuis Joppé jusqu'à notre petit bourg de Bethléem, après quoi on ne trouve plus qu'un affreux désert.'
Lisez aussi la lettre à une de ses dévotes où il dit, qu'il n'y a que des cailloux et point d'eau à boire de Jérusalem à Bethléem: mais plus loin, vers le Jourdain, vous auriez d'assez bonnes vallées dans ce pays hérissé de montagnes pelées. C'était véritablement une contrée de lait et de miel, comme vous disiez, en comparaison de l'abominable désert d'Oreb et de Sinaï dont vous êtes originaires. La Champagne pouilleuse est la terre promise par rapport à certains terrains des landes de Bordeaux. Les bords de l'Aar sont la terre promise en comparaison des petits cantons suisses. Toute la Palestine est un fort mauvais terrain en comparaison de l'Egypte, dont vous dites que vous sortîtes en voleurs; mais c'est un pays délicieux si vous le comparez aux déserts de Jérusalem, de Nazareth, de Sodome, d'Oreb, de Sinaï, de Cadès-barné, etc.
Retournez en Judée le plus tôt que vous pourrez. Je vous demande seulement deux ou trois familles hébraïques pour établir au mont Krapac, où je demeure, un petit commerce nécessaire. Car si vous êtes de très ridicules théologiens (et nous aussi) vous êtes des commerçants très intelligents; ce que nous ne sommes pas.
SEPTIEME LETTRE.
Sur la charité que le peuple de DIEU & les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres.
Ma tendresse pour vous n'a plus qu'un mot à vous dire. Nous vous avons pendus entre deux chiens pendant des siècles; nous vous avons arraché les dents pour vous forcer à nous donner votre argent; nous vous avons chassés plusieurs fois par avarice, et nous vous avons rappelés par avarice et par bêtise; nous vous faisons payer encore dans plus d'une ville la liberté de respirer l'air; nous vous avons sacrifiés à Dieu dans plus d'un royaume; nous vous avons brûlés en holocaustes: car je ne veux pas, à votre exemple, dissimuler que nous ayons offert à Dieu des sacrifices de sang humain. Toute la différence est que nos prêtres vous ont fait brûler par des laïques, se contentant d'appliquer votre argent à leur profit, et que vos prêtres ont toujours immolé les victimes humaines de leurs mains sacrées. Vous fûtes des monstres de cruauté et de fanatisme en Palestine; nous l'avons été dans notre Europe. Oublions tout cela, mes amis.
Voulez-vous vivre paisibles? imitez les Banians et les Guèbres; ils sont beaucoup plus anciens que vous; ils sont dispersés comme vous; ils sont sans patrie comme vous. Les Guèbres surtout, qui sont les anciens Persans, sont esclaves comme vous après avoir été longtemps vos maîtres. Ils ne disent mot; prenez ce parti. Vous êtes des animaux calculants; tâchez d'être des animaux pensants.
JULIEN. [p. 18]↩
Quoique nous ayons déjà parlé de Julien à l'article Apostat , quoique nous ayons, à l'exemple de tous les sages, déploré le malheur horrible qu'il eut de n'être pas chrétien, et que d'ailleurs nous ayons rendu justice à toutes ses vertus, cependant nous sommes forcés d'en dire encore un mot.
C'est à l'occasion d'une imposture aussi absurde qu'atroce, que nous avons lue par hasard dans un de ces petits dictionnaires dont la France est inondée aujourd'hui, et qu'il est malheureusement trop aisé de faire. Ce dictionnaire théologique est d'un ex-jésuite nommé Paulian; il répète cette fable si décréditée, que l'empereur Julien blessé à mort en combattant contre les Perses, jeta son sang contre le ciel, en s'écriant, Tu as vaincu, Galiléen . Fable qui se détruit d'elle-même, puisque Julien fut vainqueur dans le combat, et que certainement Jésus-Christ n'était pas le Dieu des Perses.
Cependant, Paulian ose affirmer que le fait est incontestable. Et sur quoi l'affirme-t-il? sur ce que Théodoret, l'auteur de tant d'insignes mensonges, le rapporte; encore ne le rapporte-t-il que Théodoret ch. XXV. comme un bruit vague; il se sert du mot, On dit . Ce conte est digne des calomniateurs qui écrivirent que Julien avait sacrifié une femme à la lune, et qu'on trouva après sa mort un grand coffre rempli de têtes parmi ses meubles.
Ce n'est pas le seul mensonge et la seule calomnie dont cet ex-jésuite Paulian se soit rendu coupable. Si ces malheureux savaient quel tort ils font à notre sainte religion en cherchant à l'appuyer par l'imposture, et par les injures grossières qu'ils vomissent contre les hommes les plus respectables, ils seraient moins audacieux et moins emportés; mais ce n'est pas la religion qu'ils veulent soutenir; ils veulent gagner de l'argent par leurs libelles; et désespérant d'être lus des gens du monde, ils compilent, compilent, compilent du fatras théologique dans l'espérance que leurs opuscules feront fortune dans les séminaires. (Voyez Philosophie . )
On demande très sincèrement pardon aux lecteurs sensés d'avoir parlé d'un ex-jésuite nommé Paulian, et d'un ex-jésuite nommé Nonotte, et d'un ex-jésuite nommé Patouillet; mais après avoir écrasé des serpents, n'est-il pas permis aussi d'écraser des puces?
JUSTICE. [p. 19]↩
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on dit que la justice est bien souvent très injuste: Summum jus summa injuria , est un des plus anciens proverbes. Il y a plusieurs manières affreuses d'être injuste; par exemple, celle de rouer l'innocent Calas sur des indices équivoques, et de se rendre coupable du sang innocent pour avoir trop cru des vaines présomptions.
Une autre manière d'être injuste, est de condamner au dernier supplice, un homme qui mériterait tout au plus trois mois de prison. Cette espèce d'injustice est celle des tyrans, et surtout des fanatiques, qui deviennent toujours tyrans dès qu'ils ont la puissance de mal faire.
Nous ne pouvons mieux démontrer cette vérité que par la lettre qu'un célèbre avocat au conseil, écrivit en 1766 à M. le marquis de Beccaria, l'un des plus célèbres professeurs de jurisprudence qui soient en Europe.
LETTRE DE MR. CASS.... A MR. BECCARIA.
Il semble, Monsieur, que toutes les fois qu'un génie bienfaisant cherche à rendre service au genre humain, un démon funeste s'élève aussitôt pour détruire l'ouvrage de la raison.
A peine eûtes-vous instruit l'Europe par votre excellent livre sur les Délits et les peines , qu'un homme qui se dit jurisconsulte, écrivit contre vous en France. Vous aviez soutenu la cause de l'humanité, et il fut l'avocat de la barbarie. C'est peut-être ce qui a préparé la catastrophe du jeune chevalier de la Barre âgé de dix-neuf ans, et du fils du président de Talonde qui n'en avait pas encore dix-huit.
Avant que je vous raconte, monsieur, cette horrible aventure qui excite l'étonnement et la piété de l'Europe entière, (excepté peut-être de quelques fanatiques ennemis de la nature humaine) permettez-moi de poser ici deux principes que vous trouverez incontestables.
1 o . Quand une nation est encore assez attachée aux anciens usages pour faire subir aux accusés le supplice de la torture, c'est-à-dire, pour leur faire souffrir mille morts au lieu d'une, sans savoir s'ils sont innocents ou coupables; il est clair au moins qu'on ne doit point exercer cette cruauté contre un accusé quand il convient de son crime, et qu'on n'a plus besoin d'aucune preuve.
2 o . Il est contre la nature des choses de punir les violations des usages reçus dans un pays, les délits commis contre l'opinion régnante, et qui n'ont opéré aucun mal physique, du même supplice dont on punit les parricides et les empoisonneurs.
Si ces deux règles ne sont pas démontrées, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de raison sur la terre; les hommes sont abandonnés à la plus capricieuse tyrannie; et leur sort est fort au-dessous de celui des bêtes.
Ces deux principes établis, je viens, monsieur, à la funeste histoire que je vous ai promise.
Il y avait dans Abbeville, petite cité de Picardie, une abbesse, fille d'un conseiller d'Etat très estimé; c'est une dame aimable, de moeurs au fond très régulières, d'une humeur douce et enjouée, bienfaisante, et sage sans superstition.
Un habitant d'Abbeville nommé B*** âgé de soixante ans, vivait avec elle dans une grande intimité, parce qu'il était chargé de quelques affaires du couvent; il est lieutenant d'une espèce de petit tribunal qu'on appelle l' Election , si on peut donner le nom de tribunal à une compagnie de bourgeois, uniquement préposés pour régler l'assise de l'impôt appelé la taille . Cet homme devint amoureux de l'abbesse, qui ne le repoussa d'abord qu'avec sa douceur ordinaire; mais qui fut ensuite obligée de marquer son aversion et son mépris pour ses importunités trop redoublées.
Elle fit venir chez elle dans ce temps-là, en 1764, le chevalier de la Barre son neveu, petit-fils d'un lieutenant-général des armées, mais dont le père avait dissipé une fortune de plus de quarante mille livres de rente. Elle prit soin de ce jeune homme, comme de son fils, et elle était prête de lui faire obtenir une compagnie de cavalerie: il fut logé dans l'extérieur du couvent, et madame sa tante lui donnait souvent à souper, ainsi qu'à quelques jeunes gens de ses amis. Le sieur B*** exclus de ces soupers, se vengea en suscitant à l'abbesse quelques affaires d'intérêt.
Le jeune la Barre prit vivement le parti de sa tante, et parla à cet homme avec une hauteur qui le révolta entièrement. B*** résolut de se venger; il sut que le chevalier de la Barre et le jeune Talonde fils du président de l'élection, avaient passé depuis peu devant une procession sans ôter leur chapeau: c'était au mois de juillet 1765. Il chercha dès ce moment à faire regarder cet oubli momentané des bienséances comme une insulte préméditée faite à la religion. Tandis qu'il ourdissait secrètement cette trame, il arriva malheureusement que le 9 août de la même année on s'aperçut que le crucifix de bois posé sur le pont neuf d'Abbeville était endommagé, et l'on soupçonna que des soldats ivres avaient commis cette insolence impie.
Je ne puis m'empêcher, monsieur, de remarquer ici qu'il est peut-être indécent et dangereux d'exposer sur un pont ce qui doit être révéré dans un temple catholique; les voitures publiques peuvent aisément le briser ou le renverser par terre. Des ivrognes peuvent l'insulter au sortir d'un cabaret, sans savoir même quel excès ils commettent. Il faut remarquer encore que ces ouvrages grossiers, ces crucifix de grand chemin, ces images de la Vierge Marie, ces enfants Jésus qu'on voit dans des niches de plâtre au coin des rues de plusieurs villes, ne sont pas un objet d'adoration tels qu'ils le sont dans nos églises: cela est si vrai, qu'il est permis de passer devant ces images sans les saluer. Ce sont des monuments d'une piété mal éclairée: et au jugement de tous les hommes sensés, ce qui est saint ne doit être que dans le lieu saint.
Malheureusement l'évêque d'Amiens étant aussi évêque d'Abbeville, donna à cette aventure une célébrité, et une importance qu'elle ne méritait pas. Il fit lancer des monitoires; il vint faire une procession solennelle auprès de ce crucifix, et on ne parla dans Abbeville que de sacrilèges pendant une année entière. On disait qu'il se formait une nouvelle secte qui brisait tous les crucifix, qui jetait par terre toutes les hosties et les perçait à coups de couteaux. On assurait qu'elles avaient répandu beaucoup de sang. Il y eut des femmes qui crurent en avoir été témoins. On renouvela tous les contes calomnieux répandus contre les Juifs dans tant de villes de l'Europe. Vous connaissez, monsieur, à quel excès la populace porte la crédulité et le fanatisme, trop souvent encouragés par quelques moines.
Le sieur B*** voyant les esprits échauffés, confondit malicieusement ensemble l'aventure du crucifix et celle de la procession, qui n'avaient aucune connexité. Il rechercha toute la vie du chevalier de la Barre: il fit venir chez lui valets, servantes, manoeuvres; il leur dit d'un ton d'inspiré qu'ils étaient obligés en vertu des monitoires, de révéler tout ce qu'ils avaient pu apprendre à la charge de ce jeune homme; ils répondirent tous qu'ils n'avaient jamais entendu dire que le chevalier de la Barre eût la moindre part à l'endommagement du crucifix.
On ne découvrit aucun indice touchant cette mutilation, et même alors il parut fort douteux que le crucifix eût été mutilé exprès. On commença à croire (ce qui était assez vraisemblable) que quelque charrette chargée de bois avait causé cet accident.
Mais, dit B*** à ceux qu'il voulait faire parler, si vous n'êtes pas sûrs que le chevalier de la Barre ait mutilé un crucifix en passant sur le pont, vous savez au moins que cette année au mois de juillet, il a passé dans une rue avec deux de ses amis à trente pas d'une procession sans ôter son chapeau. Vous avez ouï dire qu'il a chanté une fois des chansons libertines; vous êtes obligés de l'accuser sous peine de péché mortel.
Après les avoir ainsi intimidés, il alla lui-même chez le premier juge de la sénéchaussée d'Abbeville. Il y déposa contre son ennemi; il força ce juge à entendre les dénonciateurs.
La procédure une fois commencée, il y eut une foule de délations; chacun disait ce qu'il avait vu ou cru voir, ce qu'il avait entendu ou cru entendre. Mais quel fut, monsieur, l'étonnement de B*** lorsque les témoins qu'il avait suscités lui-même contre le chevalier de la Barre, dénoncèrent son propre fils comme un des principaux complices des impiétés secrètes qu'on cherchait à mettre au grand jour. B*** fut frappé comme d'un coup de foudre, il fit incontinent évader son fils; mais ce que vous croirez à peine, il n'en poursuivit pas avec moins de chaleur cet affreux procès.
Voici, monsieur, quelles sont les charges.
Le 13 août 1765, six témoins déposent qu'ils ont vu passer trois jeunes gens à trente pas d'une procession, que les sieurs de la Barre et de Talonde avaient leur chapeau sur la tête, et le sieur Moinel le chapeau sous le bras.
Dans une addition d'information, une Elizabeth Lacrivel, dépose avoir entendu dire à un de ses cousins, que ce cousin avait entendu dire au chevalier de la Barre qu'il n'avait pas ôté son chapeau.
Le 26 septembre une femme du peuple nommée Ursule Gondalier, dépose qu'elle a entendu dire que le chevalier de la Barre, voyant une image de St Nicolas en plâtre chez la soeur Marie tourière du couvent, il demanda à cette tourière si elle avait acheté cette image pour avoir celle d'un homme chez elle.
La nommée Bauvalet dépose, que le chevalier de la Barre a proféré un mot impie en parlant de la Vierge Marie.
Claude, dit Sélincourt, témoin unique, dépose que l'accusé lui a dit que les commandements de Dieu ont été faits par des prêtres; mais à la confrontation l'accusé soutient que Sélincourt est un calomniateur, et qu'il n'a été question que des commandements de l'Eglise.
Le nommé Héquet, témoin unique, dépose que l'accusé lui a dit ne pouvoir comprendre comment on avait adoré un dieu de pâte. L'accusé, dans la confrontation, soutient qu'il a parlé des Egyptiens.
Nicolas la Vallée dépose qu'il a entendu chanter au chevalier de la Barre deux chansons libertines de corps-de-garde. L'accusé avoue qu'un jour étant ivre il les a chantées avec le sieur de Talonde sans savoir ce qu'il disait, que dans cette chanson on appelle à la vérité la Ste Marie-Madelaine putain ; mais qu'avant sa conversion elle avait mené une vie débordée. Il est convenu d'avoir récité l'Ode à Priape du sieur Pyrrhon.
Le nommé Héquet dépose encore dans une addition, qu'il a vu le chevalier de la Barre faire une petite génuflexion devant les livres intitulés Thérèse philosophe , la Tourière des carmélites et le Portier des chartreux . Il ne désigne aucun autre livre; mais au récolement et à la confrontation, il dit qu'il n'est pas sûr que ce fût le chevalier de la Barre qui fit ces génuflexions.
Le nommé la Cour, dépose qu'il a entendu dire à l'accusé au nom du C. . . au lieu de dire au nom du père etc. Le chevalier, dans son interrogatoire sur la sellette, a nié ce fait.
Le nommé Petignot dépose qu'il a entendu l'accusé réciter les litanies du C. . . telles à peu près qu'on les trouve dans Rabelais, et que je n'ose rapporter ici. L'accusé le nie dans son interrogatoire sur la sellette; il avoue qu'il a en effet prononcé C. . .; mais il nie tout le reste.
Ce sont là, monsieur, toutes les accusations que j'ai vues portées contre le chevalier de la Barre, le sieur Moinel, le sieur de Talonde, Jean-François Douville de Maillefeu, et le fils du nommé B*** auteur de toute cette tragédie.
Il est constaté qu'il n'y avait eu aucun scandale public; puisque la Barre et Moinel ne furent arrêtés que sur des monitoires lancés à l'occasion de la mutilation du crucifix, dont ils ne furent chargés par aucun témoin. On rechercha toutes les actions de leur vie, leurs conversations secrètes, des paroles échappées un an auparavant; on accumula des choses qui n'avaient aucun rapport ensemble, et en cela même la procédure fut très vicieuse.
Sans ces monitoires et sans les mouvements violents que se donna B***, il n'y aurait jamais eu de la part de ces enfants infortunés ni scandale, ni procès criminel. Le scandale public a été surtout dans le procès même.
Le monitoire d'Abbeville fit précisément le même effet que celui de Toulouse contre les Calas; il troubla les cervelles et les consciences. Les témoins excités par B***, comme ceux de Toulouse l'avaient été par le capitoul David, rappelèrent dans leur mémoire des faits, des discours vagues, dont il n'était guère possible qu'on pût se rappeler exactement les circonstances ou favorables ou aggravantes.
Il faut avouer, monsieur, que s'il y a quelques cas où un monitoire est nécessaire; il y en a beaucoup d'autres où il est très dangereux. Il invite les gens de la lie du peuple à porter des accusations contre les personnes élevées au-dessus d'eux, dont ils sont toujours jaloux. C'est alors un ordre intimé par l'Eglise de faire le métier infâme de délateur. Vous êtes menacés de l'enfer, si vous ne mettez pas votre prochain en péril de sa vie.
Il n'y a peut-être rien de plus illégal dans les tribunaux de l'Inquisition; et une grande preuve de l'illégalité de ces monitoires, c'est qu'ils n'émanent point directement des magistrats, c'est le pouvoir ecclésiastique qui les décerne. Chose étrange qu'un ecclésiastique qui ne peut juger à mort, mettre ainsi dans la main des juges le glaive qu'il lui est défendu de porter.
Il n'y eut d'interrogés que le chevalier et le sieur Moinel, enfant d'environ quinze ans. Moinel tout intimidé et entendant prononcer au juge le mot d'attentat contre la religion, fut si hors de lui, qu'il se jeta à genoux et fit une confession générale, comme s'il eût été devant un prêtre. Le chevalier de la Barre plus instruit et d'un esprit plus ferme, répondit toujours avec beaucoup de raison, et disculpa Moinel dont il avait pitié. Cette conduite qu'il eut jusqu'au dernier moment, prouve qu'il avait une belle âme. Cette preuve aurait dû être comptée pour beaucoup aux yeux des juges intelligents, et ne lui servit de rien.
Dans ce procès, monsieur, qui a eu des suites si affreuses, vous ne voyez que des indécences réprimables, et pas une action noire; vous n'y trouvez pas un seul de ces délits qui sont des crimes chez toutes les nations, point de brigandage, point de violence, point de lâcheté; rien de ce qu'on reproche à ces enfants ne serait même un délit dans les autres communions chrétiennes. Je suppose que le chevalier de la Barre et M. de Talonde aient dit que l'on ne doit pas adorer un dieu de pâte , ils ont commis une très grande faute parmi nous; mais c'est précisément, et mot à mot ce que disent tous ceux de la religion réformée.
Le chancelier d'Angleterre prononcerait ces mots en plein parlement, sans qu'ils fussent relevés par personne. Lorsque milord Lockart était ambassadeur à Paris, un habitué de paroisse porta furtivement l'eucharistie dans son hôtel à un domestique malade qui était catholique; milord Lockart qui le sut, chassa l'habitué de sa maison; il dit au cardinal Mazarin qu'il ne souffrirait pas cette insulte. Il traita en propres termes l'eucharistie de Dieu de pâte et d'idolâtrie. Le cardinal Mazarin lui fit des excuses.
Le grand archevêque Tillotson, le meilleur prédicateur de l'Europe, et presque le seul qui n'ait point déshonoré l'éloquence par de fades lieux communs, ou par de vaines phrases fleuries comme Cheminais; ou par de faux raisonnements comme Bourdaloue; l'archevêque Tillotson, dis-je, parle précisément de notre eucharistie comme le chevalier de la Barre. Les mêmes paroles respectées dans milord Lockart à Paris, et dans la bouche de milord Tillotson à Londres, ne peuvent donc être en France qu'un délit local, un délit de lieu et de temps, un mépris de l'opinion vulgaire, un discours échappé au hasard devant une ou deux personnes. N'est-ce pas le comble de la cruauté de punir ces discours secrets, du même supplice dont on punirait celui qui aurait empoisonné son père et sa mère, et qui aurait mis le feu aux quatre coins de sa ville?
Remarquez, monsieur, je vous en supplie, combien on a deux poids et deux mesures. Vous trouverez dans la XXIV e Lettre persane de M. de Montesquieu, président à mortier du parlement de Bordeaux, de l'Académie française, ces propres paroles: Ce magicien s'appelle le pape; tantôt il fait croire que trois ne font qu'un, tantôt que le pain qu'on mange n'est pas du pain, et que le vin qu'on boit n'est pas du vin ; et mille autres traits de cette espèce.
M. de Fontenelle s'était exprimé de la même manière dans sa relation de Rome et de Genève, sous le nom de Mero et d'Enegu. Il y avait dix mille fois plus de scandale dans ces paroles de MM. de Fontenelle et de Montesquieu, exposées par la lecture aux yeux du public, qu'il n'y en avait dans deux ou trois mots échappés au chevalier de la Barre devant un seul témoin; paroles perdues dont il ne restait aucune trace. Les discours secrets devraient être regardés comme des pensées; c'est un axiome dont la plus détestable barbarie doit convenir.
Je vous dirai plus, monsieur; il n'y a point en France de loi expresse qui condamne à mort pour des blasphèmes. L'ordonnance de 1666 prescrit une amende pour la première fois, le double pour la seconde etc., et le pilori pour la sixième récidive.
Cependant les juges d'Abbeville, par une ignorance et une cruauté inconcevable, condamnèrent le jeune de Talonde âgé de dix-huit ans, 1 o . à souffrir le supplice de l'amputation de la langue jusqu'à la racine, ce qui s'exécute de manière que si le patient ne présente pas la langue lui-même, on la lui tire avec des tenailles de fer, et on la lui arrache.
2 o . On devait lui couper la main droite à la porte de la principale église.
3 o . Ensuite il devait être conduit dans un tombereau à la place du marché, être attaché à un poteau avec une chaîne de fer, et être brûlé à petit feu. Le sieur de Talonde avait heureusement épargné à ses juges l'horreur de cette exécution par la fuite.
Le chevalier de la Barre étant entre leurs mains, ils eurent l'humanité d'adoucir la sentence, en ordonnant qu'il serait décapité avant d'être jeté dans les flammes; mais s'ils diminuèrent le supplice d'un côté, ils l'augmentèrent de l'autre, en le condamnant à subir la question ordinaire et extraordinaire pour lui faire déclarer ses complices; comme si des extravagances de jeune homme, des paroles emportées dont il ne reste pas le moindre vestige, étaient un crime d'Etat, une conspiration. Cette étonnante sentence fut rendue le 28 février de l'année 1766.
La jurisprudence de France est dans un si grand chaos, et conséquemment l'ignorance des juges de province est quelquefois si grande, que ceux qui portèrent cette sentence se fondèrent sur une déclaration de Louis XIV, émanée en 1682, à l'occasion des prétendus sortilèges et des empoisonnements réels commis par la Voisin, la Vigoureux, et les deux prêtres nommés le Vigoureux et le Sage. Cette ordonnance de 1682 prescrit à la vérité la peine de mort pour le sacrilège joint à la superstition ; mais il n'est question dans cette loi que de magie et de sortilège; c'est-à-dire, de ceux qui en abusant de la crédulité du peuple, et en se disant magiciens, sont à la fois profanes et empoisonneurs. Voilà la lettre et l'esprit de la loi; il s'agit dans cette loi de faits criminels pernicieux à la société, et non pas de vaines paroles, d'imprudences, de légèreté, de sottises commises sans aucun dessein prémédité, sans aucun complot, sans même aucun scandale public.
Que dirait-on d'un juge qui condamnerait aux galères perpétuelles une famille honnête pour avoir entrepris un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, sous prétexte qu'en effet il y a une loi de Louis XIV enregistrée, laquelle condamne à cette peine les vagabonds, les artisans qui abandonnent leur profession, qui mènent une vie licencieuse, et qui vont en pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, sans une permission signée d'un ministre d'Etat?
Les juges de la ville d'Abbeville semblaient donc pécher visiblement contre la loi autant que contre l'humanité, en condamnant à des supplices aussi épouvantables que recherchés un gentilhomme, et un fils d'une très honnête famille, tous deux dans un âge où l'on ne pouvait regarder leur étourderie que comme un égarement qu'une année de prison aurait corrigé. Il y avait même si peu de corps de délit, que les juges dans leur sentence se servent de ces termes vagues et ridicules employés par le petit peuple, pour avoir chanté des chansons abominables, et exécrables, contre la Vierge Marie, les saints et saintes ; remarquez, monsieur, qu'ils n'avaient chanté ces chansons abominables et exécrables contre les saints et saintes , que devant un seul témoin qu'ils pouvaient récuser légalement. Ces épithètes sont-elles de la dignité de la magistrature? Une ancienne chanson de table n'est après tout qu'une chanson. C'est le sang humain légèrement répandu; c'est la torture, c'est le supplice de la langue arrachée, de la main coupée, du corps jeté dans les flammes, qui est abominable et exécrable .
La sénéchaussée d'Abbeville ressortit au parlement de Paris. Le chevalier de la Barre y fut transféré, son procès y fut instruit. Dix des plus célèbres avocats de Paris signèrent une consultation, par laquelle ils démontrèrent l'illégalité des procédures et l'indulgence qu'on doit à des enfants mineurs qui ne sont accusés ni d'un complot, ni d'un crime réfléchi; le procureur général versé dans la jurisprudence, conclut à réformer la sentence d'Abbeville. Il y avait vingt-cinq juges, dix acquiescèrent aux conclusions du procureur général; les quinze autres animés par des principes respectables, dont ils tiraient des conclusions affreuses, se crurent obligés de confirmer cette abominable sentence le 5 juin de cette année 1766. Ils voulaient signaler leur zèle pour la religion catholique; mais ils pouvaient être religieux sans être meurtriers.
Il est triste, monsieur, que cinq voix sur vingt-cinq, suffisent pour arracher la vie à un accusé, et quelquefois à un innocent. Ne faudrait-il pas, peut-être, dans un tel cas de l'unanimité? ne faudrait-il pas au moins que les trois quarts des voix conclussent à la mort? encore en ce dernier cas le quart des juges qui mitigerait l'arrêt, ne porrait-il pas dans l'opinion des coeurs bien faits l'emporter sur les trois quarts? Je ne vous propose cette idée que comme un doute, en respectant le sanctuaire de la justice, et en le plaignant.
Le chevalier de la Barre fut renvoyé à Abbeville pour y subir son horrible supplice; et c'est dans la patrie des plaisirs et des arts qui adoucissent les moeurs, dans ce même royaume si fameux par les grâces et par la mollesse, qu'on voit de ces horribles aventures. Mais vous savez que ce pays n'est pas moins fameux par la St Barthélemi, et par les plus énormes cruautés.
Enfin, le premier juillet de cette année se fit dans Abbeville cette exécution trop mémorable: cet enfant fut d'abord appliqué à la torture. Voici quel est ce genre de tourment.
Les jambes du patient sont serrées entre des ais; on enfonce des coins de fer ou de bois entre les ais et les genoux, les os en sont brisés. Le chevalier s'évanouit; mais il revint bientôt à lui à l'aide de quelques liqueurs spiritueuses, et déclara, sans se plaindre, qu'il n'avait point de complice.
On lui donna pour confesseur et pour assistant un dominicain ami de sa tante l'abbesse, avec lequel il avait souvent soupé dans le couvent. Ce bonhomme pleurait, et le chevalier le consolait. On leur servit à dîner. Le dominicain ne pouvait manger. Prenons un peu de nourriture, lui dit le chevalier, vous aurez besoin de force autant que moi pour soutenir le spectacle que je vais donner.
Le spectacle en effet était terrible: on avait envoyé de Paris cinq bourreaux pour cette exécution. Je ne puis dire en effet si on lui coupa la langue et la main. Tout ce que je sais par les lettres d'Abbeville, c'est qu'il monta sur l'échafaud avec un courage tranquille, sans plainte, sans colère, et sans ostentation. Tout ce qu'il dit au religieux qui l'assistait, se réduit à ces paroles, Je ne croyais pas qu'on pût faire mourir un jeune gentilhomme pour si peu de chose .
Il serait devenu certainement un excellent officier: il étudiait la guerre par principes; il avait fait des remarques sur quelques ouvrages du roi de Prusse et du maréchal de Saxe, les deux plus grands généraux de l'Europe.
Lorsque la nouvelle de sa mort fut reçue à Paris, le nonce dit publiquement qu'il n'aurait point été traité ainsi à Rome; et que s'il avait avoué ses fautes à l'Inquisition d'Espagne ou de Portugal, il n'eût été condamné qu'à une pénitence de quelques années.
Je vous prie, monsieur, de vouloir bien me communiquer vos pensées sur cet événement.
Chaque siècle voit de ces catastrophes qui effrayent la nature. Les circonstances ne sont jamais les mêmes; ce qui eût été regardé avec indulgence il y a quarante ans, peut attirer une mort affreuse quarante ans après. Le cardinal de Retz prend séance au parlement de Paris avec un poignard qui déborde quatre doigts hors de sa soutane; et cela ne produit qu'un bon mot. Des frondeurs jettent par terre le saint sacrement qu'on portait à un malade domestique du cardinal Mazarin, et chassent les prêtres à coups de plat d'épée; et on n'y prend pas garde. Ce même Mazarin, ce premier ministre revêtu du sacerdoce, honoré du cardinalat, est proscrit sans être entendu, son sang est proclamé à cinquante mille écus. On vend ses livres pour payer sa tête, dans le temps même qu'il conclut la paix de Munster, et qu'il rend le repos à l'Europe; mais on n'en fait que rire; et cette proscription ne produit que des chansons.
Altri tempi, altre cure ; ajoutons d'autres temps, d'autres malheurs, et ces malheurs s'oublieront pour faire place à d'autres. Soumettons-nous à la Providence qui nos éprouve tantôt par des calamités publiques, tantôt par des désastres particuliers. Souhaitons des lois plus sensées, des ministres des lois plus sages, plus éclairés, plus humains.
LANGUES. [p. 31]↩
SECTION PREMIÈRE.
On dit que les Indiens commencent presque tous leurs livres par ces mots, béni soit l'inventeur de l'écriture . On pourrait aussi commencer ses discours par bénir l'inventeur d'un langage.
Nous avons reconnu au mot Alphabet , qu'il n'y eut jamais de langue primitive dont toutes les autres soient dérivées.
Nous voyons que le mot Al ou El qui signifiait Dieu chez quelques orientaux, n'a nul rapport au mot Got qui veut dire Dieu en Allemagne. House , huis , ne peut guère venir du grec domos qui signifie maison.
Nos mères, et les langues dites mères, ont beaucoup de ressemblance. Les unes et les autres ont des enfants qui se marient dans le pays voisin, et qui en altèrent le langage et les moeurs. Ces mères ont d'autres mères dont les généalogistes ne peuvent débrouiller l'origine. La terre est couverte de familles qui disputent de noblesse, sans savoir d'où elles viennent.
DES MOTS LES PLUS COMMUNS ET LES PLUS NATURELS EN TOUTE LANGUE.
L'expérience nous apprend que les enfants ne sont qu'imitateurs; que si on ne leur disait rien ils ne parleraient pas; qu'ils se contenteraient de crier.
Dans presque tous les pays connus on leur dit d'abord baba , papa , mama , maman , ou des mots approchants aisés à prononcer, et ils les répètent. Cependant vers le mont Krapac où je vis comme l'on sait, nos enfants disent toujours mon dada et non pas mon papa . Dans quelques provinces ils disent mon bibi .
On a mis un petit vocabulaire chinois à la fin du premier tome des Mémoires sur la Chine . Je trouve dans ce dictionnaire abrégé, que fou , prononcé d'une façon dont nous n'avons pas l'usage, signifie père; les enfants qui ne peuvent prononcer la lettre f disent ou . Il y a loin d' ou à papa .
Que ceux qui veulent savoir le mot qui répond à notre papa en japonais, en tartare, dans le jargon du Kamshatka et de la baie d'Hudson, daignent voyager dans ces pays pour nous instruire.
On court risque de tomber dans d'étranges méprises quand, sur les bords de la Seine ou de la Saone, on donne des leçons sur la langue des pays où l'on n'a point été. Alors il faut avouer son ignorance; il faut dire, J'ai lu cela dans Vachter, dans Ménage, dans Bochart, dans Kirker, dans Pezron qui n'en savaient pas plus que moi; je doute beaucoup; je crois, mais je suis très disposé à ne plus croire, etc. etc.
Un récollet nommé Sagart Théodat qui a prêché pendant trente ans les Iroquois, les Algonquins et les Hurons, nous a donné un petit dictionnaire huron, imprimé à Paris chez Denis Moreau en 1632. Cet ouvrage ne nous sera pas désormais fort utile depuis que la France est soulagée du fardeau du Canada. Il dit qu'en huron père est aystan , et en canadien notoui . Il y a encore loin de notoui et d'aystan à pater et à papa . Gardez-vous des systèmes, vous dis-je, mes chers Welches.
D'UN SYSTEME SUR LES LANGUES.
L'auteur de la Mécanique du langage , explique ainsi son système.
‘La terminaison latine urire est appropriée à désigner un désir vif et ardent de faire quelque chose; micturire , esurire ; par où il semble qu'elle ait été fondamentalement formée sur le mot urere et sur le signe radical ur , qui en tant de langues signifie le feu. Ainsi la terminaison urire était bien choisie pour désigner un désir brûlant.'
Cependant, nous ne voyons pas que cette terminaison en ire soit appropriée à un désir vif et ardent dans ire , exire , abire , aller, sortir, s'en aller, dans vincire , lier; scaturire , sourdir, jaillir; condire , assaisonner; parturire , accoucher; grunnire , gronder, grouiner, ancien mot qui exprimait très bien le cri d'un porc.
Il faut avouer surtout que cet ire n'est approprié à aucun désir très vif, dans balbutire , balbutier; singultire , sangloter; perire , périr. Personne n'a envie ni de balbutier, ni de sangloter, encore moins de périr. Ce petit système est fort en défaut; nouvelle raison pour se défier des systèmes.
Le même auteur paraît aller trop loin en disant, Nous allongeons les lèvres en dehors , et tirons , pour ainsi dire , le bout d'en haut de cette corde pour faire sonner u voyelle particulière aux Français , et que n'ont pas les autres nations .
Il est vrai que le précepteur du Bourgeois gentilhomme lui apprend qu'il fait un peu la moue en prononçant u ; mais il n'est pas vrai que les autres nations ne fassent pas un peu la moue aussi.
L'auteur ne parle sans doute ni l'espagnol, ni l'anglais, ni l'allemand, ni le hollandais; il s'en est rapporté à d'anciens auteurs qui ne savaient pas plus ces langues que celles du Sénégal et du Thibet, que cependant l'auteur cite. Les Espagnols disent su padre , su madre avec un son qui n'est pas tout à fait le u des Italiens; ils prononcent mui en approchant un peu plus de la lettre u que de l' ou ; ils ne prononcent pas fortement ousted : ce n'est pas le furiale sonans u des Romains.
Les Allemands se sont accoutumés à changer un peu l' u en i ; de là vient qu'ils vous demandent toujours des ekis au lieu d'écus. Plusieurs Allemands prononcent aujourd'hui flûte comme nous; ils prononçaient autrefois flaûte . Les Hollandais ont conservé l' u , témoin la comédie de madame Alikruc, et leur u diener . Les Anglais qui ont corrompu toutes les voyelles, n'ont point abandonné l' u ; ils prononcent toujours wi et non oui , qu'ils n'articulent qu'à peine. Ils disent vertu et true , le vrai, non vertou et troue .
Les Grecs ont toujours donné à l' upsilon le son de notre u , comme l'avouent Calepin et Scapula à la lettre upsilon ; et comme le dit Cicéron de Oratore .
Le même auteur se trompe encore en assurant que les mots anglais humour et spleen , ne peuvent se traduire. Il en a cru quelques Français mal instruits. Les Anglais ont pris leur humour qui signifie chez eux plaisanterie naturelle, de notre mot humeur employé en ce sens dans les premières comédies de Corneille; et dans toutes les comédies antérieures. Nous dîmes ensuite belle humeur . D'Assouci donna son Ovide en belle humeur; et ensuite on ne se servit de ce mot que pour exprimer le contraire de ce que les Anglais entendent. Humeur aujourd'hui signifie chez nous chagrin. Les Anglais se sont ainsi emparés de presque toutes nos expressions. On en ferait un livre.
A l'égard de spleen , il se traduit très exactement; c'est la rate. Nous disions, il n'y a pas longtemps, vapeurs de rate .
Veut-on qu'on rabate
Les vapeurs de rate
Qui nous minent tous?
Qu'on laisse Hippocrate.
Et qu'on vienne à nous.
Nous avons supprimé rate, et nous nous sommes bornés aux vapeurs.
Tom. I. Le même auteur dit que les Français se plaisent surtout à ce qu'ils appellent avoir de l'esprit . Cette expression est propre à leur langue , et ne se trouve en aucune autre . Il n'y en a point en anglais de plus commune; wit , witty , sont précisément la même chose. Le comte de Rochester appelle toujours witty king le roi Charles II, qui, selon lui, disait tant de jolies choses, et n'en fit jamais une bonne. Les Anglais prétendent que ce sont eux qui disent les bons mots, et que ce sont les Français qui rient.
Et que deviendra l'ingegnoso des Italiens, et l'agudezza des Espagnols dont nous avons parlé à l'article Franc ?
Tom. II, pag. 146. Le même auteur remarque très judicieusement que lorsqu'un peuple est sauvage, il est simple, et ses expressions le sont aussi. ‘Le peuple hébreu était à demi sauvage, le livre de ses lois traite sans détour des choses naturelles que nos langues ont soin de voiler. C'est une marque que chez eux ces façons de parler n'avaient rien de licencieux; car on n'aurait pas écrit un livre de lois d'une manière contraire aux moeurs, etc.
Nous avons donné un exemple frappant de cette simplicité qui serait aujourd'hui plus que cynique, quand nous avons cité les aventures d'Oolla et d'Ooliba, et celles d'Osée. Et quoiqu'il soit permis de changer d'opinion, nous espérons que nous serons toujours de celle de l'auteur de la Mécanique du langage , quand même plusieurs doctes n'en seraient pas.
Mais nous ne pouvons penser comme l'auteur de cette Mécanique, quand il dit:
Tom. II, pag. 147. ‘En Occident l'idée malhonnête est attachée à l'union des sexes; en Orient elle est attachée à l'usage du vin; ailleurs elle pourrait l'être à l'usage du fer ou du feu. Chez les musulmans, à qui le vin est défendu par la loi, le mot cherab qui signifie en général sirop, sorbet, liqueur, mais plus particulièrement le vin, et les autres mots relatifs à celui-là, sont regardés par les gens fort religieux comme des termes obscènes, ou du moins trop libres pour être dans la bouche d'une personne de bonnes moeurs. Le préjugé sur l'obscénité du discours a pris tant d'empire qu'il ne cesse pas, même dans le cas où l'action à laquelle on a attaché l'idée est honnête et légitime, permise et prescrite; de sorte qu'il est toujours malhonnête de dire ce qu'il est très souvent honnête de faire.
‘A dire vrai, la décence s'est ici contentée d'un fort petit sacrifice. Il doit toujours paraître singulier que l'obscénité soit dans les mots, et ne soit pas dans les idées, etc.'
L'auteur paraît mal instruit des moeurs de Constantinople. Qu'il interroge M. Du Tot, il lui dira que le mot de vin n'est point du tout obscène chez les Turcs. Il est même impossible qu'il le soit; puisque les Grecs sont autorisés chez eux à vendre du vin. Jamais dans aucune langue l'obscénité n'a été attachée qu'à certains plaisirs qu'on ne s'est presque jamais permis devant témoins, parce qu'on ne les goûte que par des organes qu'il faut cacher. On ne cache point sa bouche. C'est un péché chez les musulmans de jouer aux dés; de ne point coucher avec sa femme le vendredi, de boire du vin, de manger pendant le ramadan avant le coucher du soleil; mais ce n'est point une chose obscène.
Il faut de plus remarquer que toutes les langues ont des termes divers qui donnent des idées toutes différentes de la même chose. Mariage, sponsalia , exprime un engagement légal. Consommer le mariage, matrimonio uti , ne présente que l'idée d'un devoir accompli. Membrum virile in vaginam intromittere , n'est qu'une expression d'anatomie. Amplecti amorose juvenem uxorem , est une idée voluptueuse. D'autres mots sont des images qui alarment la pudeur.
Ajoutons que si dans les premiers temps d'une nation simple, dure et grossière, on se sert des seuls termes qu'on connaisse pour exprimer l'acte de la génération, comme l'auteur l'a très bien observé, chez les demi-sauvages juifs; d'autres peuples emploient les mots obscènes quand ils sont devenus plus raffinés et plus polis. Osée ne se sert que du terme qui répond au fodere des Latins; mais Auguste hasarde effrontément les mots futuere , mentula , dans son infâme épigramme contre Fulvie. Horace prodigue le futuo , le mentula , le cunnus . On inventa même les expressions honteuses de crissare fellare irrumare cevere , cunni linguis . On les trouve trop souvent dans Catulle et dans Martial. Elles représentent des turpitudes à peine connues parmi nous; aussi n'avons-nous point de termes pour les rendre.
Le mot de gabaoutar inventé à Venise au seizième siècle, exprimait une infamie inconnue aux autres nations.
Il n'y a point de langue qui puisse traduire certaines épigrammes de Martial, si chères aux empereurs Hadrien et Lucius Verus.
GÉNIE DES LANGUES.
On appelle génie d'une langue son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse, ce que les autres langages expriment moins heureusement.
Le latin, par exemple, est plus propre au style lapidaire que les langues modernes, à cause de leurs verbes auxiliaires qui allongent une inscription et qui l'énervent.
Le grec par son mélange mélodieux de voyelles et de consonnes, est plus favorable à la musique que l'allemand et le hollandais.
L'italien par des voyelles beaucoup plus répétées sert peut-être encore mieux la musique efféminée.
Le latin et le grec étant les seules langues qui aient une vraie quantité, sont plus faites pour la poésie que toutes les autres langues du monde.
Le français par la marche naturelle de toutes ses constructions, et aussi par sa prosodie, est plus propre qu'aucune autre à la conversation. Les étrangers, par cette raison même, entendent plus aisément les livres français que ceux des autres peuples. Ils aiment dans les livres philosophiques français une clarté de style qu'ils trouvent ailleurs assez rarement.
C'est ce qui a donné enfin la préférence au français sur la langue italienne même, qui, par ses ouvrages immortels du seizième siècle, était en possession de dominer dans l'Europe.
L'auteur du Mécanisme du langage pense dépouiller le français de cet ordre même, et de cette clarté qui fait son principal avantage. Il va jusqu'à citer des auteurs peu accrédités, et même Pluche, pour faire croire que les inversions du latin sont naturelles, et que c'est la construction naturelle du français qui est forcée. Il rapporte cet exemple tiré de la Manière d'étudier les langues. Je n'ai jamais Tom. I, pag. 76. lu ce livre, mais voici l'exemple.
Goliathum proceritatis inusitatae virum David adolescens impacto in ejus frontem lapide prostravit et allophylum cùm inermis puer esset ei detracto gladio confecit.
Le jeune David reversa d'un coup de fronde au milieu du front Goliath, homme d'une taille prodigieuse, et tua cet étranger avec son propre sabre qu'il lui arracha: car David était un enfant désarmé.
Premièrement, j'avouerai que je ne connais guère de plus plat latin, ni de plus plat français, ni d'exemple plus mal choisi. Pourquoi écrire dans la langue de Cicéron un morceau d'histoire judaïque, et ne pas prendre quelque phrase de Cicéron même, pour exemple? Pourquoi me faire de ce géant Goliath un Goliathum ? Ce Goliathus était, dit-il, d'une grandeur inusitée , proceritatis inusitatae . On ne dit inusité en aucun pays que des choses d'usage qui dépendent des hommes; une phrase inusitée, une cérémonie inusitée, un ornement inusité; mais pour une taille inusitée, comme si Goliathus s'était mis ce jour-là une taille plus haute qu'à l'ordinaire, cela me paraît fort inusité.
Cicéron dit à Quintus son frère, absurdae et inusitatae scriptae epistolae ; ses lettres sont absurdes et d'un style inusité. N'est-ce pas là le cas de Pluche?
In ejus frontem ; Tite-Live et Tacite auraient-ils mis ce froid ejus ? n'auraient-ils pas dit simplement in frontem ?
Que veut dire impacto lapide ? cela n'exprime pas un coup de fronde.
Et allophylum cùm inermis esset ? voilà une plaisante antithèse; il renversa l'étranger quoiqu'il fût désarmé; étranger et désarmé ne font-ils pas une belle opposition? et de plus, dans cette phrase lequel des deux était désarmé? il y a quelque apparence que c'était Goliath, puisque le petit David le tua si aisément.
Je n'examine point comment on renverse avec un petit caillou lancé au front de bas en haut, un guerrier dont le front est armé d'un casque; je me borne au latin de Pluche.
Le français ne vaut guère mieux que le latin. Voici comme un jeune écolier vient de le refaire.
‘David à peine dans son adolescence, sans autres armes qu'une simple fronde, renverse le géant Goliath d'un coup de pierre au milieu du front; il lui arrache son épée, il lui coupe la tête de son propre glaive.'
Ensuite, pour nous convaincre de l'obscurité de la langue française, et le renversement qu'elle fait des idées, on nous cite les Tom. I, pag. 76. paralogismes de Pluche.
‘Dans la marche que l'on fait prendre à la phrase française on renverse entièrement l'ordre de choses qu'on y rapporte; et pour avoir égard au génie, ou plutôt à la pauvreté de nos langues vulgaires, on met en pièce le tableau de la nature. Dans le français le jeune homme renverse avant qu'on sache qu'il y ait quelqu'un à renverser : le grand Goliath est déjà par terre, qu'il n'a encore été fait aucune mention ni de la fronde, ni de la pierre qui a fait le coup; et ce n'est qu'après que l'étranger a la tête coupée que le jeune homme trouve une épée au lieu de fronde pour l'achever. Ceci nous conduit à une vérité fort remarquable, que c'est se tromper de croire, comme on fait, qu'il y ait inversion ou renversement dans la phrase des anciens, tandis que c'est réellement dans notre langue moderne qu'est le désordre.'
Je vois ici tout le contraire; et de plus, je vois dans chaque partie de la phrase française un sens achevé qui me fait attendre un nouveau sens, une nouvelle action. Si je dis comme dans le latin, Goliath homme d'une procérité inusitée , l'adolescent David ; je ne vois là qu'un géant et qu'un enfant; point de commencement d'action; peut-être que l'enfant prie le géant de lui abattre des noix; et peu m'importe. Mais, David à peine dans son adolescence , sans autres armes qu'une simple fronde ; voilà déjà un sens complet, voilà un enfant avec une fronde, qu'en va-t-il faire? il renverse; qui? un géant; comment? en l'atteignant au front. Il lui arrache son grand sabre, pourquoi? pour couper la tête du géant. Y a-t-il une gradation plus marquée?
Mais ce n'était pas de tels exemples que l'auteur du Mécanisme du langage devait proposer. Que ne rapportait-il de beaux vers de Racine; que n'en comparait-il la syntaxe naturelle avec les inversions admises dans toutes nos anciennes poésies?
Autrefois la fortune et la victoire mêmes
Cachaient mes cheveux blancs sous trente diadèmes.
Cet heureux temps n'est plus!
Transposez les termes selon le génie latin à la manière de Ronsard, Sous diadèmes trente cachaient mes cheveux blancs fortune et victoire mêmes . Plus n'est ce temps heureux !
C'est ainsi que nous écrivions autrefois; il n'aurait tenu qu'à nous de continuer: mais nous avons senti que cette construction ne convenait pas au génie de notre langue, qu'il faut toujours consulter. Ce génie, qui est celui du dialogue, triomphe dans la tragédie et dans la comédie, qui n'est qu'un dialogue continuel; il plaît dans tout ce qui demande de la naïveté, de l'agrément dans l'art de narrer, d'expliquer, etc. Il s'accommode peut-être assez peu de l'ode qui demande, dit-on, une espèce d'ivresse et de désordre, et qui autrefois exigeait de la musique.
Quoi qu'il en soit, connaissez bien le génie de votre langue; et, si vous avez du génie, mêlez-vous peu des langues étrangères, et surtout des orientales; à moins que vous n'ayez vécu trente ans dans Alep.
SECTION SECONDE.
Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un mauvais écrivain.
Trois choses sont absolument nécessaires, régularité, clarté, élégance. Avec les deux premières on parvient à ne pas écrire mal; avec la troisième on écrit bien.
Ces trois mérites qui furent absolument ignorés dans l'université de Paris depuis sa fondation, ont été presque toujours réunis dans les écrits de Rollin ancien professeur. Avant lui on ne savait ni écrire ni penser en français; il a rendu un service éternel à la jeunesse.
Ce qui peut paraître étonnant, c'est que les Français n'ont point d'auteur plus châtié en prose que Racine et Boileau le sont en vers; car il est ridicule de regarder comme des fautes quelques nobles hardiesses de poésie qui sont de vraies beautés, et qui enrichissent la langue au lieu de la défigurer.
Corneille pécha trop souvent contre la langue, quoiqu'il écrivit dans le temps même qu'elle se perfectionnait. Son malheur était d'avoir été élevé en province, et d'y composer même ses meilleures pièces. On trouve trop souvent chez lui des impropriétés, des solécismes, des barbarismes et de l'obscurité. Mais aussi dans ses beaux morceaux il est souvent aussi pur que sublime.
Celui qui commenta Corneille avec tant d'impartialité, celui qui dans son commentaire parla avec tant de chaleur des beaux morceaux de ses tragédies, et qui n'entreprit le commentaire que pour mieux parvenir à l'établissement de la petite-fille de ce grand homme, a remarqué qu'il n'y a pas une seule faute de langage dans la grande scène de Cinna et d'Emilie, où Cinna rend compte de son entrevue avec les conjurés; et à peine en trouve-t-il une ou deux dans cette autre scène immortelle où Auguste délibère s'il se démettra de l'empire.
Par une fatalité singulière, les scènes les plus froides de ses autres pièces sont celles où l'on trouve le plus de vices de langage. Presque toutes ces scènes n'étant point animées par des sentiments vrais et intéressants, et n'étant remplies que de raisonnements alambiqués, pèchent autant par l'expression que par le fond même. Rien n'est si clair, rien ne se montre au grand jour: tant est vrai ce que dit Boileau:
Ce que l'on conçoit bien se montre clairement.
L'impropriété des termes est le défaut le plus commun dans les mauvais ouvrages.
HARMONIE DES LANGUES.
J'ai connu plus d'un Anglais et plus d'un Allemand, qui ne trouvaient d'harmonie que dans leurs langues. La langue russe qui est la slavonne, mêlée de plusieurs mots grecs et de quelques-uns tartares, paraît mélodieuse aux oreilles russes.
Cependant, un Allemand, un Anglais qui aura de l'oreille et du goût sera plus content d' ouranos que de heaven et de himmel; d' antropus que de man; de Theos que de God ou Gott; d' aristos que de goud. Les dactyles et les spondées flatteront plus son oreille que les syllabes uniformes et peu senties de tous les autres langages.
Toutefois, j'ai connu de grands scholiastes qui se plaignaient violemment d'Horace. Comment, disent-ils, ces gens-là qui passent pour les modèles de la mélodie, non seulement font heurter continuellement des voyelles les unes contre les autres, ce qui nous est expressément défendu. Non seulement ils vous allongent ou vous raccourcissent un mot à la façon grecque selon leur besoin, mais ils vous coupent hardiment un mot en deux; ils en mettent une moitié à la fin d'un vers, et l'autre moitié à la fin du vers suivant.
Redditum Ciri solio phraaten
Dissidens plebi numero beato-
rum eximit virtus, etc .
C'est comme si nous écrivions dans une ode en français,
Défions-nous de la fortu
ne et n'en croyons que la vertu.
Horace ne se bornait pas à ces petites libertés; il met à la fin de son vers la première lettre du mot qui commence le vers qui suit.
Jove non probante u-
xorius amnis .
Ce dieu du Tibre, ai-
mait beaucoup sa femme.
Que dirons-nous de ces vers harmonieux,
Septimi gades aditure mecum, etc .
Cantabrum indoctum juga fere nostrae, etc .
Septime qu'avec moi je mène à Cadix, et
Qui verrez le Cantabre ignorant du joug, etc.
Horace en a cinquante de cette force, et Pindare en est tout rempli.
Tout est noble dans Horace , dit Dacier dans sa préface. N'aurait- il pas mieux fait de dire, tantôt Horace a de la noblesse, tantôt de la délicatesse et de l'enjouement etc.?
Le malheur des commentateurs de toute espèce, est, ce me semble, de n'avoir jamais d'idée précise, et de prononcer de grands mots qui ne signifient rien. M. et Mme Dacier y étaient fort sujets avec tout leur mérite.
Je ne vois pas quelle noblesse, quelle grandeur peut nous frapper dans ces ordres qu'Horace donne à son laquais, en vers qualifiés du nom d' ode . Je me sers, à quelques mots près, de la traduction même de Dacier.
Laquais , je ne suis point pour la magnificence des Perses . Je ne puis souffrir les couronnes pliées avec des bandelettes de tilleul . Cesse donc de t'informer où tu pourras trouver des roses tardives . Je ne veux que du simple myrte sans autre façon . Le myrte sied bien à un laquais comme toi , et à moi qui bois sous une petite treille .
Ses vers contre de pauvres vieilles et contre des sorcières, me semblent encore moins nobles que l'ode à son laquais.
Mais revenons a ce qui dépend uniquement de la langue. Il paraît évident que les Romains et les Grecs se donnaient des libertés qui seraient chez nous des licences intolérables.
Pourquoi voyons-nous tant de moitiés de mots à la fin des vers dans les odes d'Horace, et pas un exemple de cette licence dans Virgile?
N'est-ce pas parce que les odes étaient faites pour être chantées, et que la musique faisait disparaître ce défaut? il faut bien que cela soit, puisqu'on voit dans Pindare tant de mots coupés en deux d'un vers à l'autre, et qu'on n'en voit pas dans Homère.
Mais, me dira-t-on, les rapsodes chantaient les vers d'Homère. On chantait des morceaux de l'Enéide à Rome comme on chante des stances de l'Arioste et du Tasse en Italie. Il est clair, par l'exemple du Tasse, que ce ne fut pas un chant proprement dit, mais une déclamation soutenue, à peu près comme quelques morceaux assez mélodieux du chant grégorien.
Les Grecs prenaient d'autres libertés qui nous sont rigoureusement interdites. Par exemple, de répéter souvent dans la même page des épithètes, des moitiés de vers, des vers même tout entiers; et cela prouve qu'ils ne s'astreignaient pas à la même correction que nous. Le podas okus akilles , l' olimpia domata ékontas , l' ekibolon apollona etc. etc., flattent agréablement l'oreille. Mais si dans nos langues modernes nous faisions rimer si souvent Achille aux pieds légers , les flèches d'Apollon, les demeures célestes , nous ne serions pas tolérés.
Si nous faisions répéter par un personnage les mêmes paroles qu'un autre personnage lui a dites, ce double emploi serait plus insupportable encore.
Si le Tasse s'était servi tantôt de la dialecte bergamasque, tantôt du patois de Piémont, tantôt de celui de Gènes, il n'aurait été lu de personne. Les Grecs avaient donc pour leur poésie des facilités qu'aucune nation ne s'est permises. Et de tous les peuples, le Français est celui qui s'est asservi à la gêne la plus rigoureuse.
LARMES. [p. 44]↩
Les larmes sont le langage muet de la douleur. Mais pourquoi? quel rapport y a-t-il entre une idée triste, et cette liqueur limpide et salée, filtrée par une petite glande au coin externe de l'oeil? laquelle humecte la conjonctive et les petits points lacrymaux, d'où elle descend dans le nez et dans la bouche par le réservoir appelé sac lacrymal, et par ses conduits.
Pourquoi dans les enfants et dans les femmes dont les organes sont d'un réseau faible et délicat, les larmes sont-elles plus aisément excitées par la douleur que dans les hommes faits, dont le tissu est plus ferme?
La nature a-t-elle voulu faire naître en nous la compassion à l'aspect de ces larmes qui nous attendrissent, et nous porter à secourir ceux qui les répandent? La femme sauvage est aussi fortement déterminée à secourir l'enfant qui pleure, que le serait une femme de la cour, et peut-être davantage, parce qu'elle a moins de distractions et de passions.
Tout a une fin sans doute dans le corps animal. Les yeux surtout ont des rapports mathématiques si évidents, si démontrés, si admirables avec les rayons de lumière; cette mécanique est si divine, que je serais tenté de prendre pour un délire de fièvre chaude l'audace de nier les causes finales de la structure de nos yeux.
L'usage des larmes ne paraît pas avoir une fin si déterminée et si frappante; mais il serait beau que la nature les fît couler pour nous exciter à la pitié.
Il y a des femmes qui sont accusées de pleurer quand elles veulent. Je ne suis nullement surpris de leur talent. Une imagination vive, sensible et tendre peut se fixer à quelque objet, à quelque ressouvenir douloureux, et se le représenter avec des couleurs si dominantes, qu'elles lui arrachent des larmes. C'est ce qui arrive à plusieurs acteurs, et principalement à des actrices, sur le théâtre.
Les femmes qui les imitent dans l'intérieur de leurs maisons, joignent à ce talent la petite fraude de paraître pleurer pour leur mari, tandis qu'en effet elles pleurent pour leur amant. Leurs larmes sont vraies, mais l'objet en est faux.
Il est impossible d'affecter les pleurs sans sujet, comme on peut affecter de rire. Il faut être sensiblement touché pour forcer la glande lacrymale à se comprimer et à répandre sa liqueur sur l'orbite de l'oeil; mais il ne faut que vouloir pour former le rire.
On demande pourquoi le même homme qui aura vu d'un oeil sec les événements les plus atroces, qui même aura commis des crimes de sang-froid, pleurera au théâtre à la représentation de ces événements et de ces crimes? C'est qu'il ne les voit pas avec les mêmes yeux, il les voit avec ceux de l'auteur et de l'acteur. Ce n'est plus le même homme; il était barbare, il était agité de passions furieuses quand il vit tuer une femme innocente, quand il se souilla du sang de son ami: il redevient homme au spectacle. Son âme était remplie d'un tumulte orageux, elle est tranquille, elle est vide; la nature y rentre, il répand des larmes vertueuses; c'est là le vrai mérite, le grand bien des spectacles. C'est là ce que ne peuvent jamais faire ces froides déclamations d'un orateur gagé pour ennuyer tout un auditoire pendant une heure.
Le capitoul David, qui sans s'émouvoir, vit et fit mourir l'innocent Calas sur la roue, aurait versé des larmes en voyant son propre crime dans une tragédie bien écrite et bien récitée.
C'est ainsi que Pope a dit dans le prologue du Caton d'Adisson,
Tyrant's no more their savage nature kept;
And foes to virtue wonder'ed how they wept:
De se voir attendris les méchants s'étonnèrent,
Le crime eut des remords; et les tyrants pleurèrent.
LÉPRE ET VÉROLE. [p. 46]↩
Il s'agit ici de deux grandes divinités, l'une ancienne et l'autre moderne, qui ont régné dans notre hémisphère. Le révérend père Dom Calmet, grand antiquaire, c'est-à-dire, grand compilateur de ce qu'on a dit autrefois, et de ce qu'on a répété de nos jours, a confondu la vérole et la lèpre. Il prétend que c'est de la vérole que le bonhomme Job était attaqué; et il suppose, d'après un fier commentateur nommé Pinéda, que la vérole et la lèpre sont précisément la même chose. Ce n'est pas que Calmet soit médecin; ce n'est pas qu'il raisonne; mais il cite; et dans son métier de commentateur, les citations ont toujours tenu lieu de raisons. Il cite entre autres le consul Ausone, né Gascon et poète, précepteur du malheureux empereur Gratien, et que quelques-uns ont cru avoir été évêque.
Calmet, dans sa dissertation sur la maladie de Job, renvoie le lecteur à cette épigramme d'Ausone sur une dame romaine nommée Crispa.
Crispa pour ses amants ne fut jamais farouche;
Elle offre à leurs plaisirs et sa langue et sa bouche;
Tous ses trous en tout temps furent ouverts pour eux;
Célébrons, mes amis, des soins si généreux.
On ne voit pas ce que cette prétendue épigramme a de commun avec ce qu'on impute à Job, qui d'ailleurs n'a jamais existé, et qui n'est qu'un personnage allégorique d'une fable arabe; ainsi que nous l'avons vu.
Quand Astruc, dans son Histoire de la vérole , allègue des autorités pour prouver que la vérole vient en effet de St Domingue, et que les Espagnols la rapportèrent d'Amérique, ses citations sont plus concluantes.
Deux choses prouvent, à mon avis, que nous devons la vérole à l'Amérique. La première est la foule des auteurs, des médecins et des chirurgiens du seizième siècle, qui attestent cette vérité.
La seconde est le silence de tous les médecins et de tous les poètes de l'antiquité qui n'ont jamais connu cette maladie, et qui n'ont jamais prononcé son nom. Je regarde ici le silence des médecins et des poètes comme une preuve également démonstrative. Les premiers, à commencer par Hippocrate, n'auraient pas manqué de décrire cette maladie, de la caractériser, de lui donner un nom, de chercher quelques remèdes.
Les poètes, aussi malins que les médecins sont laborieux, auraient parlé dans leurs satires de la chaudepisse, du chancre, du poulain, de tout ce qui précède ce mal affreux et de toutes ses suites. Vous ne trouvez pas un seul vers dans Horace, dans Catule, dans Martial, dans Juvénal, qui ait le moindre rapport à la vérole; tandis qu'ils s'étendent tous avec tant de complaisance sur tous les effets de la débauche.
Il est très certain que la petite vérole ne fut connue des Romains qu'au sixième siècle; que la vérole américaine ne fut apportée en Europe qu'à la fin du quinzième, et que la lèpre est aussi étrangère à ces deux maladies que la paralysie l'est à la danse de St Vit ou de St Guy.
La lèpre était une gale d'une espèce horrible. Les Juifs en furent attaqués plus qu'aucun peuple des pays chauds, parce qu'ils n'avaient ni linge ni bains domestiques. Ce peuple était si malpropre que ses législateurs furent obligés de lui faire une loi de se laver les mains.
Tout ce que nous gagnâmes à la fin de nos croisades, ce fut cette gale; et de tout ce que nous avions pris, elle fut la seule chose qui nous resta. Il fallut bâtir partout des léproseries, pour renfermer ces malheureux attaqués d'une gale pestilentielle et incurable.
La lèpre, ainsi que le fanatisme et l'usure, avait été le caractère distinctif des Juifs. Ces malheureux n'ayant point de médecins, les prêtres se mirent en possession de gouverner la lèpre, et d'en faire un point de religion. C'est ce qui a fait dire à quelques téméraires que les Juifs étaient de véritables sauvages, dirigés par leurs jongleurs. Leurs prêtres à la vérité ne guérissaient pas la lèpre, mais ils séparaient les galeux de la société, et par là ils acquéraient un pouvoir prodigieux. Tout homme atteint de ce mal était emprisonné comme un voleur; de sorte qu'une femme qui voulait se défaire de son mari n'avait qu'à gagner un prêtre, le mari était enfermé; c'était une espèce de lettre de cachet de ce temps-là. Les Juifs, et ceux qui les gouvernaient, étaient si ignorants qu'ils prirent les teignes qui rongent les habits et les moisissures des murailles pour une lèpre. Ils imaginèrent donc la lèpre des maisons et des habits. De sorte que le peuple, ses guenilles et ses cabanes, tout fut sous la verge sacerdotale.
Une preuve qu'au temps de la découverte de la vérole, il n'y avait nul rapport entre ce mal et la lèpre, c'est que le peu qui restait encore de lépreux à la fin du quinzième siècle ne voulut faire aucune sorte de comparaison avec les vérolés.
On mit d'abord quelques vérolés dans les hôpitaux des lépreux; mais ceux-ci les reçurent avec indignation. Ils présentèrent requête pour en être séparés, comme des gens en prison pour dettes ou pour des affaires d'honneur, demandent à n'être pas confondus avec la canaille des criminels.
Nous avons déjà dit que le parlement de Paris rendit le 6 mars 1496 un arrêt par lequel tous les vérolés, qui n'étaient pas bourgeois de Paris, eussent à sortir dans vingt-quatre heures, sous peine d'être pendus. L'arrêt n'était ni chrétien ni légal, ni sensé; et nous en avons beaucoup de cette espèce: mais il prouve que la vérole était regardée come un fléau nouveau qui n'avait rien de commun avec la lèpre, puisqu'on ne pendait point les lépreux pour avoir couché à Paris, et qu'on pendait les vérolés.
Les hommes peuvent se donner la lèpre par leur saleté, ainsi qu'une certaine espèce d'animaux auxquels la canaille ressemble assez; mais pour la vérole, c'est la nature qui a fait ce présent à l'Amérique. Nous lui avons déjà reproché à cette nature, si bonne et si méchante, si éclairée et si aveugle, d'avoir été contre son but, en empoisonnant la source de la vie; et nous gémissons encore de n'avoir point trouvé de solution à cette difficulté terrible.
Nous avons vu ailleurs que l'homme en général, l'un portant l'autre, n'a qu'environ vingt-deux ans à vivre; et pendant ces vingt-deux ans il est sujet à plus de vingt-deux mille maux, dont plusieurs sont incurables.
Dans cet horrible état on se pavane encore; on fait l'amour au hasard de tomber en pourriture; on s'intrigue, on fait la guerre, on fait des projets comme si on devait vivre mille siècles dans les délices.
LETTRES, GENS DE LETTRES, OU LETTRÉS. [p. 49]↩
Dans nos temps barbares, lorsque les Francs, les Germains, les Bretons, les Lombards, les Mosarabes espagnols, ne savaient ni lire ni écrire, on institua des écoles, des universités, composées presque toutes d'ecclésiastiques, qui, ne sachant que leur jargon, enseignèrent ce jargon à ceux qui voulurent l'apprendre; les académies ne sont venues que longtemps après; elles ont méprisé les sottises des écoles, mais elles n'ont pas toujours osé s'élever contre elles, parce qu'il y a des sottises qu'on respecte, attendu qu'elles tiennent à des choses respectables.
Les gens de lettres qui ont rendu le plus de service au petit nombre d'êtres pensants répandus dans le monde, sont les lettrés isolés, les vrais savants renfermés dans leur cabinet, qui n'ont ni argumenté sur les bancs des universités, ni dit les choses à moitié dans les académies; et ceux-là ont presque tous été persécutés. Notre misérable espèce est tellement faite que ceux qui marchent dans le chemin battu jettent toujours des pierres à ceux qui enseignent un chemin nouveau.
Montesquieu dit que les Scythes crevaient les yeux à leurs esclaves, afin qu'ils fussent moins distraits en battant leur beurre; c'est ainsi que l'Inquisition en use, et presque tout le monde est aveugle dans les pays où ce monstre règne. On a deux yeux depuis plus de cent ans en Angleterre; les Français commencent à ouvrir un oeil; mais quelquefois il se trouve des hommes en place qui ne veulent pas même permettre qu'on soit borgne.
Ces pauvres gens en place sont comme le docteur Balouard de la comédie italienne, qui ne veut être servi que par le balourd Arlequin, et qui craint d'avoir un valet trop pénétrant.
Faites des odes à la louange de monseigneur Superbus fadus , des madrigaux pour sa maîtresse, dédiez à son portier un livre de géographie, vous serez bien reçu; éclairez les hommes, vous serez écrasé.
Descartes est obligé de quitter sa patrie, Gassendi est calomnié, Arnauld traîne ses jours dans l'exil; tout philosophe est traité comme les prophètes chez les Juifs.
Qui croirait que dans le dix-huitième siècle un philosophe ait été traîné devant les tribunaux séculiers et traité d'impie par les tribunaux d'arguments, pour avoir dit que les hommes ne pourraient exercer les arts s'ils n'avaient pas de mains? Je ne désespère pas qu'on ne condamne bientôt aux galères le premier qui aura l'insolence de dire qu'un homme ne penserait pas s'il était sans tête; car, lui dira un bachelier, l'âme est un esprit pur, la tête n'est que de la matière; Dieu peut placer l'âme dans le talon, aussi bien que dans le cerveau; partant, je vous dénonce comme un impie.
Le plus grand malheur d'un homme de lettres n'est peut-être pas d'être l'objet de la jalousie de ses confrères, la victime de la cabale, le mépris des puissants du monde, c'est d'être jugé par des sots. Les sots vont loin quelquefois, surtout quand le fanatisme se joint à l'ineptie, et à l'ineptie l'esprit de vengeance. Le grand malheur encore d'un homme de lettres est ordinairement de ne tenir à rien. Un bourgeois achète un petit office, et le voilà soutenu par ses confrères. Si on lui fait une injustice, il trouve aussitôt des défenseurs. L'homme de lettres est sans secours; il ressemble aux poissons volants; s'il s'élève un peu, les oiseaux le dévorent; s'il plonge, les poissons le mangent.
Tout homme public paie tribut à la malignité, mais il est payé en deniers et en honneurs.
LIBELLE. [p. 50]↩
On nomme libelles de petits livres d'injures. Ces livres sont petits, parce que les auteurs ayant peu de raisons à donner, n'écrivant point pour instruire, et voulant être lus, sont forcés d'être courts. Ils y mettent très rarement leurs noms, parce que les assassins craignent d'être saisis avec des armes défendues.
Il y a les libelles politiques. Les temps de la Ligue et de la Fronde en regorgèrent. Chaque dispute en Angleterre en produit des centaines. On en fit contre Louis XIV de quoi fournir une vaste bibliothèque.
Nous avons les libelles théologiques depuis environ seize cents ans; c'est bien pis; ce sont des injures sacrées des Halles. Voyez seulement comment St Jérôme traite Rufin et Vigilantius. Mais depuis lui les disputeurs ont bien enchéri. Les derniers libelles ont été ceux des molinistes contre les jansénistes, on les compte par milliers. De tous ces fatras il ne reste aujourd'hui que les seules Lettres provinciales .
Les gens de lettres pourraient le disputer aux théologiens. Boileau et Fontenelle qui s'attaquèrent à coups d'épigrammes, disaient tous deux que les libelles dont ils avaient été gourmés, n'auraient pas tenu dans leurs chambres. Tout cela tombe comme les feuilles en automne. Il y a eu des gens qui ont traité de libelles toutes les injures qu'on dit par écrit à son prochain.
Selon eux les pouilles, que les prophètes chantèrent quelquefois aux rois d'Israël, étaient des libelles diffamatoires pour faire soulever les peuples contre eux. Mais comme la populace n'a jamais lu dans aucun pays du monde, il est à croire que ces satires, qu'on débitait sous le manteau, ne faisaient pas grand mal. C'est en parlant au peuple assemblé qu'on excite des séditions bien plutôt qu'en écrivant. C'est pourquoi la première chose que fit, à son avènement la reine d'Angleterre Elizabeth, chef de l'Eglise anglicane et défenseur de la foi, ce fut d'ordonner qu'on ne prêchât de six mois sans sa permission expresse.
L' Anti-Caton de César était un libelle; mais César fit plus de mal à Caton par la bataille de Pharsale et par celle de Tapsa, que par ses diatribes.
Les Philippiques de Cicéron sont des libelles; mais les proscriptions des triumvirs furent des libelles plus terribles.
St Cyrille, St Grégoire de Nazianze firent des libelles contre le grand empereur Julien; mais ils eurent la générosité de ne les publier qu'après sa mort.
Rien ne ressemble plus à des libelles que certains manifestes de souverains. Les secrétaires du cabinet de Moustapha empereur des Osmanlis, ont fait un libelle de leur déclaration de guerre.
Dieu les en a punis, eux et leur commettant. Le même esprit, qui anima César, Cicéron et les secrétaires de Moustapha, domine dans tous les polissons qui font des libelles dans leurs greniers; Natura est semper sibi consona . Qui croirait que les âmes de Garasse, du cocher de Vertamon, de Nonotte, de Paulian, de Fréron, de Langleviel dit la Beaumelle fussent, à cet égard, de la même trempe que les âmes de César, de Cicéron, de St Cyrille et du secrétaire de l'empereur des Osmanlis? Rien n'est pourtant plus vrai.
LIBERTÉ. [p. 52]↩
Ou je me trompe fort, ou Locke le définisseur a très bien défini la liberté puissance . Je me trompe encore, ou Colins célèbre magistrat de Londres est le seul philosophe qui ait bien approfondi cette idée; et Clarke ne lui a répondu qu'en théologien. Mais de tout ce qu'on a écrit en France sur la liberté, le petit dialogue suivant est ce qui m'a paru de plus net.
A. Voilà une batterie de canons qui tire à nos oreilles, avez-vous la liberté de l'entendre ou de ne l'entendre pas?
B. Sans doute, je ne peux pas m'empêcher de l'entendre.
A. Voulez-vous que ce canon emporte votre tête, et celles de votre femme et de votre fille qui se promènent avec vous?
B. Quelle proposition me faites-vous là? je ne peux pas tant que je suis de sens rassis vouloir chose pareille, cela m'est impossible.
A. Bon; vous entendez nécessairement ce canon, et vous voulez nécessairement ne pas mourir vous et votre famille d'un coup de canon à la promenade; vous n'avez ni le pouvoir de ne pas entendre; ni le pouvoir de vouloir rester ici?
B. Cela est clair. [35]
A. Vous avez en conséquence fait une trentaine de pas pour être à l'abri du canon, vous avez eu le pouvoir de marcher avec moi ce peu de pas?
B. Cela est encore très clair.
A. Et si vous aviez été paralytique, vous n'auriez pu éviter d'être exposé à cette batterie, vous n'auriez pas eu le pouvoir d'être où vous êtes; vous auriez nécessairement entendu et reçu un coup de canon; et vous seriez mort nécessairement?
B. Rien n'est plus véritable.
A. En quoi consiste donc votre liberté, si ce n'est dans le pouvoir que votre individu a exercé de faire ce que votre volonté exigeait d'une nécessité absolue?
B. Vous m'embarrassez; la liberté n'est donc autre chose que le pouvoir de faire ce que je veux.
A. Réfléchissez-y, et voyez si la liberté peut être entendue autrement?
B. En ce cas mon chien de chasse est aussi libre que moi; il a nécessairement la volonté de courir quand il voit un lièvre, et le pouvoir de courir s'il n'a pas mal aux jambes. Je n'ai donc rien au-dessus de mon chien, vous me réduisez à l'état des bêtes?
A. Voilà les pauvres sophismes des pauvres sophistes qui vous yont instruit. Vous voilà bien malade d'être libre comme votre chien! Ne mangez-vous pas, ne dormez-vous pas, ne propagez-vous pas comme lui, à l'attitude près? Voudriez-vous avoir l'odorat autrement que par le nez? Pourquoi voulez-vous avoir la liberté autrement que votre chien?
B. Mais j'ai une âme qui raisonne beaucoup, et mon chien ne raisonne guère. Il n'a presque que des idées simples, et moi j'ai mille idées métaphysiques.
A. Eh bien, vous êtes mille fois plus libre que lui; c'est-à-dire, vous avez mille fois plus de pouvoir de penser que lui, mais vous n'êtes pas libre autrement que lui.
B. Quoi? je ne suis pas libre de vouloir ce que je veux?
A. Qu'entendez-vous par là?
B. J'entends ce que tout le monde entend. Ne dit-on pas tous les jours, Les volontés sont libres?
A. Un proverbe n'est pas une raison; expliquez-vous mieux.
B. J'entends que je suis libre de vouloir comme il me plaira.
A. Avec votre permission, cela n'a pas de sens; ne voyez-vous pas qu'il est ridicule de dire, Je veux vouloir. Vous voulez nécessairement en conséquence des idées qui se sont présentées à vous. Voulez-vous vous marier, oui ou non?
B. Mais si je vous disais que je ne veux ni l'un ni l'autre?
A. Vous répondriez comme celui qui disait, Les uns croient le cardinal Mazarin mort, les autres le croient vivant, et moi je ne crois ni l'un ni l'autre.
B. Eh bien, je veux me marier.
A. Ah! c'est répondre cela. Pourquoi voulez-vous vous marier?
B. Parce que je suis amoureux d'une jeune fille, belle, douce, bien élevée, assez riche, qui chante très bien, dont les parents sont de très honnêtes gens, et que je me flatte d'être aimé d'elle, et fort bien venu de sa famille.
A. Voilà une raison. Vous voyez que vous ne pouvez vouloir sans raison. Je vous déclare que vous êtes libre de vous marier, c'est-à-dire, que vous avez le pouvoir de signer le contrat etc., de faire la noce et de coucher avec votre femme.
B. Comment! je ne peux vouloir sans raison? Eh que deviendra cet autre proverbe, sit pro ratione voluntas ; ma volonté est ma raison, je veux parce que je veux?
A. Cela est absurde, mon cher ami; il y aurait en vous un effet sans cause.
B. Quoi! lorsque je joue à pair ou non, j'ai une raison de choisir pair plutôt qu'impair?
A. Oui, sans doute.
B. Et quelle est cette raison, s'il vous plaît?
A. C'est que l'idée d'impair s'est présentée à votre esprit plutôt que l'idée opposée. Il serait plaisant qu'il y eût des cas où vous voulez parce qu'il y a une cause de vouloir, et qu'il y eût quelques cas où vous voulussiez sans cause. Quand vous voulez vous marier; vous en sentez la raison dominante évidemment; vous ne la sentez pas quand vous jouez à pair ou non; et cependant il faut bien qu'il y en ait une.
B. Mais encore une fois, je ne suis donc pas libre?
A. Votre volonté n'est pas libre; mais vos actions le sont. Vous êtes libre de faire, quand vous avez le pouvoir de faire.
B. Mais tous les livres que j'ai lus sur la liberté d'indifférence. . .
A. Qu'entendez-vous par liberté d'indifférence?
B. J'entends de cracher à droite ou à gauche, de dormir sur le côté droit ou sur le gauche, de faire quatre tours de promenade ou cinq.
A. Vous auriez là vraiment une plaisante liberté: Dieu vous aurait fait un beau présent. Il y aurait bien là de quoi se vanter. Que vous servirait un pouvoir qui ne s'exercerait que dans des occasions si futiles? Mais le fait est qu'il est ridicule de supposer la volonté de vouloir cracher à droite. Non seulement cette volonté de vouloir est absurde, mais il est certain que plusieurs petites circonstances vous déterminent à ces actes que vous appelez indifférents . Vous n'êtes pas plus libre dans ces actes que dans les autres. Mais encore une fois vous êtes libre en tout temps, en tout lieu, dès que vous faites ce que vous voulez faire.
B. Je soupçonne que vous avez raison. J'y rêverai.
LIBERTÉ DE PENSER. [p. 52]↩
Vers l'an 1707, temps où les Anglais gagnèrent la bataille de Sarragosse, protégèrent le Portugal, et donnèrent pour quelque temps un roi à l'Espagne, milord Boldmind officier général qui avait été blessé, était aux eaux de Barège. Il y rencontra le comte Médroso, qui étant tombé de cheval derrière le bagage, à une lieue et demie du champ de bataille, venait prendre les eaux aussi. Il était familier de l'Inquisition; milord Boldmind n'était familier que dans la conversation; un jour après boire il eut avec Médroso cet entretien.
BOLDMIND
Vous êtes donc sergent des dominicains? vous faites là un vilain métier.
MÉDROSO
Il est vrai; mais j'ai mieux aimé être leur valet que leur victime, et j'ai préféré le malheur de brûler mon prochain à celui d'être cuit moi-même.
BOLDMIND
Quelle horrible alternative! vous étiez cent fois plus heureux sous le joug des Maures qui vous laissaient croupir librement dans toutes vos superstitions, et qui tout vainqueurs qu'ils étaient ne s'arrogeaient pas le droit inouï de tenir les âmes dans les fers.
MÉDROSO
Que voulez-vous! il ne nous est permis ni d'écrire, ni de parler, ni même de penser. Si nous parlons, il est aisé d'interpréter nos paroles, encore plus nos écrits. Enfin, comme on ne peut nous condamner dans un autodafé pour nos pensées secrètes, on nous menace d'être brûlés éternellement par l'ordre de Dieu même, si nous ne pensons pas comme les jacobins. Ils ont persuadé au gouvernement que si nous avions le sens commun, tout l'Etat serait en combustion, et que la nation deviendrait la plus malheureuse de la terre.
BOLDMIND
Trouvez-vous que nous soyons si malheureux nous autres Anglais qui couvrons les mers de vaisseaux, et qui venons gagner pour vous des batailles au bout de l'Europe? Voyez-vous que les Hollandais qui vous ont ravi presque toutes vos découvertes dans l'Inde, et qui aujourd'hui sont au rang de vos protecteurs, soient maudits de Dieu pour avoir donné une entière liberté à la presse, et pour faire le commerce des pensées des hommes? L'empire romain en a-t-il été moins puissant parce que Tullius Cicero a écrit avec liberté?
MÉDROSO
Quel est ce Tullius Cicero? jamais je n'ai entendu prononcer ce nom-là à la Ste Hermandad.
BOLDMIND
C'était un bachelier de l'université de Rome qui écrivait ce qu'il pensait ainsi que Julius Cesar, Marcus Aurelius, Titus Lucretius Carus, Plinius, Seneca, et autres docteurs.
MÉDROSO
Je ne les connais point; mais on m'a dit que la religion catholique, basque et romaine est perdue si on se met à penser.
BOLDMIND
Ce n'est pas à vous à le croire: car vous êtes sûrs que votre religion est divine, et que les portes d'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Si cela est, rien ne pourra jamais la détruire.
MÉDROSO
Non; mais on peut la réduire à peu de chose, et c'est pour avoir pensé que la Suède, le Dannemarck, toute votre île, la moitié de l'Allemagne gémissent dans le malheur épouvantable de n'être plus sujets du pape. On dit même que si les hommes continuent à suivre leurs fausses lumières, ils s'en tiendront bientôt à l'adoration simple de Dieu et à la vertu. Si les portes de l'enfer prévalent jamais jusque-là, que deviendra le Saint-Office?
BOLDMIND
Si les premiers chrétiens n'avaient pas eu la liberté de penser, n'est-il pas vrai qu'il n'y eût point eu de christianisme?
MÉDROSO
Que voulez-vous dire? Je ne vous entends point.
BOLDMIND
Je le crois bien. Je veux dire que si Tibère et les premiers empereurs avaient eu des jacobins, qui eussent empêché les premiers chrétiens d'avoir des plumes et de l'encre; s'il n'avait pas été longtemps permis dans l'empire romain de penser librement, il eût été impossible que les chrétiens établissent leurs dogmes. Si donc le christianisme ne s'est formé que par la liberté de penser, par quelle contradiction, par quelle injustice voudrait-il anéantir aujourd'hui cette liberté sur laquelle seule il est fondé?
Quand on vous propose quelque affaire d'intérêt, n'examinez-vous pas longtemps avant de conclure? quel plus grand intérêt y a-t-il au monde que celui de notre bonheur ou de notre malheur éternel? Il y a cent religions sur la terre qui toutes vous damnent si vous croyez à vos dogmes, qu'elles appellent absurdes et impies ; examinez donc ces dogmes.
MÉDROSO
Comment puis-je les examiner? je ne suis pas jacobin.
BOLDMIND
Vous êtes homme, et cela suffit.
MÉDROSO
Hélas! vous êtes bien plus homme que moi.
BOLDMIND
Il ne tient qu'à vous d'apprendre à penser; vous êtes né avec de l'esprit; vous êtes un oiseau dans la cage de l'Inquisition, le Saint-Office vous a rogné les ailes, mais elles peuvent revenir. Celui qui ne sait pas la géométrie peut l'apprendre; tout homme peut s'instruire; il est honteux de mettre son âme entre les mains de ceux à qui vous ne confieriez pas votre argent: osez penser par vous-même.
MÉDROSO
On dit que si tout le monde pensait par soi-même, ce serait une étrange confusion.
BOLDMIND
C'est tout le contraire. Quand on assiste à un spectacle, chacun en dit librement son avis, et la paix n'est point troublée; mais si quelque protecteur insolent d'un mauvais poète voulait forcer tous les gens de goût à trouver bon ce qui leur paraît mauvais, alors les sifflets se feraient entendre et les deux partis pourraient se jeter des pommes à la tête comme il arriva une fois à Londres. Ce sont ces tyrans des esprits, qui ont causé une partie des malheurs du monde. Nous ne sommes heureux en Angleterre que depuis que chacun jouit librement du droit de dire son avis.
MÉDROSO
Nous sommes aussi fort tranquilles à Lisbonne où personne ne peut dire le sien.
BOLDMIND
Vous êtes tranquilles; mais vous n'êtes pas heureux. C'est la tranquillité des galériens qui rament en cadence et en silence.
MÉDROSO
Vous croyez donc que mon âme est aux galères?
BOLDMIND
Oui; et je voudrais la délivrer.
MÉDROSO
Mais si je me trouve bien aux galères?
BOLDMIND
En ce cas vous méritez d'y être.
LIEUX COMMUNS EN LITTÉRATURE. [p. 60]↩
Quand une nation se dégrossit, elle est d'abord émerveillée de voir l'aurore ouvrir de ses doigts de rose les portes de l'Orient, et semer de topazes et de rubis le chemin de la lumière; le zéphyr caresser Flore, et l'amour se jouer des armes de Mars.
Toutes les images de ce genre qui plaisent par la nouveauté, dégoûtent par l'habitude. Les premiers qui les employaient passaient pour des inventeurs, les derniers ne sont que des perroquets.
Il y a des formules de prose qui ont le même sort. Le roi manquerait à ce qu'il se doit à lui-même si. . . Le flambeau de l'expérience a conduit ce grand apothicaire dans les routes ténébreuses de la nature. -- Son esprit ayant été la dupe de son coeur -- il ouvrit trop tard les yeux sur le bord de l'abîme. -- Messieurs, plus je sens mon insuffisance, plus je sens aussi vos bienfaits; mais éclairé par vos lumières, soutenu par vos exemples, vous me rendrez digne de vous .
La plupart des pièces de théâtre deviennent enfin des lieux communs, comme les oraisons funèbres et les discours de réception. Dès qu'une princesse est aimée on devine qu'elle aura une rivale. Si elle combat sa passion il est clair qu'elle y succombera. Le tyran a-t-il envahi le trône d'un pupille, soyez sûr qu'au cinquième acte justice se fera, et que l'usurpateur mourra de mort violente.
Si un roi et un citoyen romain paraissent sur la scène, il y a cent contre un à parier que le roi sera traité par le Romain plus indignement que les ministres de Louis XIV ne le furent à Gertruidenberg par les Hollandais.
Toutes les situations tragiques sont prévues, tous les sentiments que ces situations amènent sont devinés; les rimes mêmes sont souvent prononcées par le parterre avant de l'être par l'acteur. Il est difficile d'entendre parler à la fin d'un vers d'une lettre , sans voir clairement à quel héros on doit la remettre . L'héroïne ne peut guère manifester ses alarmes , qu'aussitôt on ne s'attende à voir couler ses larmes . Peut-on voir un vers finir par César , et n'être pas sûr de voir des vaincus traînés après son char ?
Vient un temps où l'on se lasse de ces lieux communs d'amour, de politique, de grandeur et de vers alexandrins. L'opéra-comique prend la place d'Iphigénie et d'Eriphile, de Xipharès et de Monime. Avec le temps cet opéra-comique devient lieu commun à son tour; et Dieu sait alors à quoi on aura recours.
Nous avons les lieux communs de la morale. Ils sont si rebattus, qu'on devrait absolument s'en tenir aux bons livres faits sur cette matière en chaque langue. Le Spectateur anglais conseilla à tous les prédicateurs d'Angleterre de réciter les excellents sermons de Tillotson ou de Smaldrige. Les prédicateurs de France pourraient bien s'en tenir à réciter Massillon, ou des extraits de Bourdaloue. Quelques-uns de nos jeunes orateurs de la chaire ont appris de Lekain à déclamer; mais il ressemblent tous à Dancourt qui ne voulait jamais jouer que dans ses pièces.
Les lieux communs de la controverse sont absolument passés de mode; et probablement ne reviendront plus. Mais ceux de l'éloquence et de la poésie pourront renaître après avoir été oubliés: pourquoi? c'est que la controverse est l'éteignoir et l'opprobre de l'esprit humain; et que la poésie et l'éloquence en sont le flambeau et la gloire.
LIVRES. [p. 61]↩
Vous les méprisez les livres, vous dont toute la vie est plongée dans les vanités de l'ambition et dans la recherche des plaisirs, ou dans l'oisiveté; mais songez que tout l'univers connu n'est gouverné que par des livres, excepté les nations sauvages. Toute l'Afrique jusqu'à l'Ethiopie et la Nigritie obéit au livre de l'Alcoran après avoir fléchi sous le livre de l'Evangile. La Chine est régie par le livre moral de Confucius; une grande partie de l'Inde par le livre du Veidam. La Perse fut gouvernée pendant des siècles par les livres d'un des Zoroastres.
Si vous avez un procès, votre bien, votre honneur, votre vie même dépend de l'interprétation d'un livre que vous ne lisez jamais.
Robert le diable , les Quatre fils Aimon , les Imaginations de M. Oufle , sont des livres aussi; mais il en est des livres comme des hommes, le très petit nombre joue un grand rôle, le reste est confondu dans la foule.
Qui mène le genre humain dans les pays policés? ceux qui savent lire et écrire. Vous ne connaissez ni Hippocrate, ni Boerhaave, ni Sydenham; mais vous mettez votre corps entre les mains de ceux qui les ont lus. Vous abandonnez votre âme à ceux qui sont payés pour lire la Bible, quoiqu'il n'y en ait pas cinquante d'entre eux qui l'aient lue tout entière avec attention.
Les livres gouvernent tellement le monde, que ceux qui commandent aujourd'hui dans la ville des Scipions et des Catons, ont voulu que les livres de leur loi ne fussent que pour eux, c'est leur sceptre; ils ont fait un crime de lèse-majesté à leurs sujets d'y toucher sans une permission expresse. Dans d'autres pays on a défendu de penser par écrit sans lettres patentes.
Il est des nations chez qui l'on regarde les pensées purement comme un objet de commerce. Les opérations de l'entendement humain n'y sont considérées qu'à deux sous la feuille. Si par hasard le libraire veut un privilège pour sa marchandise, soit qu'il vende Rabelais , soit qu'il vende les Pères de l'Eglise , le magistrat donne le privilège sans répondre de ce que le livre contient.
Dans un autre pays, la liberté de s'expliquer par des livres est une des prérogatives des plus inviolables. Imprimez tout ce qu'il vous plaira sous peine d'ennuyer, ou d'être puni si vous avez trop abusé de votre droit naturel.
Avant l'admirable invention de l'imprimerie, les livres étaient plus rares et plus chers que les pierres précieuses. Presque point de livres chez nos nations barbares jusqu'à Charlemagne, et depuis lui jusqu'au roi de France Charles V dit le Sage; et depuis ce Charles jusqu'à François I e r , c'est une disette extrême.
Les Arabes seuls en eurent depuis le huitième siècle de notre ère jusqu'au treizième.
La Chine en était pleine quand nous ne savions ni lire ni écrire.
Les copistes furent très employés dans l'empire romain depuis le temps des Scipions jusqu'à l'inondation des barbares.
Les Grecs s'occupèrent beaucoup à transcrire vers le temps d'Amintas, de Philippe et d'Alexandre; ils continuèrent surtout ce métier dans Alexandrie.
Ce métier est assez ingrat. Les marchands payèrent toujours fort mal les auteurs et les copistes. Il fallait deux ans d'un travail assidu à un copiste pour bien transcrire la Bible sur du vélin. Que de temps et de peine pour copier correctement en grec et en latin les ouvrages d'Origène, de Clément d'Alexandrie, et de tous ces autres écrivains nommés Pères !
St Hieronimos, ou Hieronimus, que nous nommons Jérôme, dit dans une de ses lettres satiriques contre Rufin, [36] qu'il s'est ruiné en achetant les oeuvres d'Origène, contre lequel il écrivit avec tant d'amertume et d'emportement. Oui , dit-il, j'ai lu Origène; si c'est un crime, j'avoue que je suis coupable, et que j'ai épuisé toute ma bourse à acheter ses ouvrages dans Alexandrie .
Les sociétés chrétiennes eurent dans les trois premiers siècles cinquante-quatre évangiles, dont à peine deux ou trois copies transpirèrent chez les Romains de l'ancienne religion jusqu'au temps de Dioclétien.
C'était un crime irrémissible chez les chrétiens, de montrer les évangiles aux gentils; ils ne les prêtaient pas même aux catéchumènes.
Quand Lucien raconte dans son Philopatris (en insultant notre religion qu'il connaissait très peu) qu'une troupe de gueux le mena dans un quatrième étage où l'on invoquait le père par le fils, et où l'on prédisait des malheurs à l'empereur et à l'empire , il ne dit point qu'on lui ait montré un seul livre. Aucun historien, aucun auteur romain ne parle des évangiles.
Lorsqu'un chrétien malheureusement téméraire et indigne de sa sainte religion eut mis en pièces publiquement, et foulé aux pieds un édit de l'empereur Dioclétien, et qu'il eut attiré sur le christianisme la persécution qui succéda à la plus grande tolérance, les chrétiens furent alors obligés de livrer leurs évangiles et leurs autres écrits aux magistrats, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'à ce temps. Ceux qui donnèrent leurs livres dans la crainte de la prison ou même de la mort, furent regardés par les autres chrétiens comme des apostats sacrilèges; on leur donna le surnom de traîtres ; et plusieurs évêques prétendirent qu'il fallait les rebaptiser, ce qui causa un schisme épouvantable.
Les poèmes d'Homère furent longtemps si peu connus, que Pisistrate fut le premier qui les mit en ordre, et qui les fit transcrire dans Athènes environ cinq cents ans avant l'ère dont nous nous servons.
Il n'y a peut-être pas aujourd'hui une douzaine de copies du Veidam, et du Zenda-Vesta dans tout l'Orient.
Vous n'auriez pas trouvé un seul livre dans toute la Russie en 1700, excepté des missels et quelques Bibles chez des papas ivres d'eau-de-vie.
Aujourd'hui on se plaint du trop: mais ce n'est pas aux lecteurs à se plaindre; le remède est aisé, rien ne les force à lire. Ce n'est pas non plus aux auteurs. Ceux qui font la foule ne doivent pas crier qu'on les presse. Malgré la quantité énorme de livres, combien peu de gens lisent! et si on lisait avec fruit, verrait-on les déplorables sottises auxquelles le vulgaire se livre encore tous les jours en proie?
Ce qui multiplie les livres, malgré la loi de ne point multiplier les êtres sans nécessité, c'est qu'avec des livres on en fait d'autres, c'est avec plusieurs volumes déjà imprimés qu'on fabrique une nouvelle histoire de France ou d'Espagne sans rien ajouter de nouveau. Tous les dictionnaires sont faits avec des dictionnaires; presque tous les livres nouveaux de géographie sont des répétitions de livres de géographie. La Somme de St Thomas a produit deux mille gros volumes de théologie. Et les mêmes races de petits vers qui ont rongé la mère, rongent aussi les enfants.
Ecrive qui voudra, chacun à ce métier
Peut perdre impunément de l'encre et du papier.
SECTION SECONDE.
Il est quelquefois bien dangereux de faire un livre. Silhouète, avant qu'il pût se douter qu'il serait un jour contrôleur-général des finances, avait imprimé un livre sur l'accord de la religion avec la politique: et son beau-père le médecin Astruc avait donné au public les mémoires dans lesquels l'auteur du Pentateuque avait pu prendre toutes les choses étonnantes qui s'étaient passées si longtemps avant lui.
Le jour même que Silhouète fut en place, quelque bon ami chercha un exemplaire des livres du beau-père et du gendre, pour les déférer au parlement, et les faire condamner au feu selon l'usage. Ils rachetèrent tous deux tous les exemplaires qui étaient dans le royaume: de là vient qu'ils sont très rares aujourd'hui.
Il n'est guère de livre philosophique ou théologique dans lequel on ne puisse trouver des hérésies et des impiétés, pour peu qu'on aide à la lettre.
Théodore de Mopsuète osait appeler le Cantique des cantiques un recueil d'impuretés ; Grotius les détaille, il en fait horreur. Chatillon le traite d' ouvrage scandaleux .
Croirait-on qu'un jeur le docteur Tamponet dit à plusieurs docteurs, Je me ferais fort de trouver une foule d'hérésies dans le Pater noster , si on ne savait pas de quelle bouche divine sortit cette prière, et si c'était un jésuite qui l'imprimât pour la première fois?
Voici comme je m'y prendrais.
Notre père qui êtes aux cieux .
Proposition sentant l'hérésie, puisque Dieu est partout. On peut même trouver dans cet énoncé un levain de socinianisme, puisqu'il n'y est rien dit de la Trinité.
Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite dans la terre comme au ciel .
Proposition sentant encore l'hérésie; puisqu'il est dit cent fois dans l'Ecriture que Dieu règne éternellement. De plus, il est téméraire de demander que sa volonté s'accomplisse; puisque rien ne se fait, ni ne peut se faire que par la volonté de Dieu.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien (notre pain substantiel, notre bon pain, notre pain nourrissant . )
Proposition directement contraire à ce qui est émané ailleurs Matthieu ch. VI, v. 33. de la bouche de Jésus-Christ: ‘Ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, comme font les gentils, etc. Ne demandez que le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné.'
Remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs .
Proposition téméraire qui compare l'homme à Dieu, qui détruit la prédestination gratuite, et qui enseigne que Dieu est tenu d'en agir avec nous comme nous en agissons avec les autres. De plus, qui a dit à l'auteur que nous faisons grâce à nos débiteurs? nous ne leur avons jamais fait grâce d'un écu. Il n'y a point de couvent en Europe qui ait jamais remis un sou à ses fermiers. Oser dire le contraire est une hérésie formelle.
Ne nous induisez point en tentation .
Proposition scandaleuse, manifestement hérétique, attendu qu'il n'y a que le diable qui soit tentateur; et qu'il est dit expressément dans l'épître de St Jacques, Dieu est intentateur des méchants; Ch. I, v. 13. cependant il ne tente personne. Deus enim intentator malorum est; ipse autem neminem tentat .
Vous voyez, dit le docteur Tamponet, qu'il n'est rien de si respectable auquel on ne puisse donner un mauvais sens. Quel sera donc le livre à l'abri de la censure humaine si on peut attaquer jusqu'au Pater noster , en interprétant diaboliquement tous les mots divins qui le composent? Pour moi, je tremble de faire un livre. Je n'ai jamais, Dieu merci, rien imprimé; je n'ai même jamais fait jouer aucune de mes pièces de théâtre, comme ont fait les frères La Rue, Du Cerceau et Folard; cela est trop dangereux.
Un clerc pour quinze sous, sans craindre le hola,
Peut aller au parterre attaquer Attila;
Et si le roi des Huns ne lui charme l'oreille,
Traiter de visigoths tous les vers de Corneille.
Si vous imprimez, un habitué de paroisse vous accuse d'hérésie, un cuistre de collège vous dénonce, un homme qui ne sait pas lire vous condamne; le public se moque de vous; votre libraire vous abandonne; votre marchand de vin ne veut plus vous faire crédit. J'ajoute toujours à mon Pater noster, Mon Dieu, délivrez-moi de la rage de faire des livres !
O vous qui mettez comme moi du noir sur du blanc, et qui barbouillez du papier, souvenez-vous de ces vers que j'ai lus autrefois, et qui auraient dû nous corriger.
Tout ce fatras fut du chanvre en son temps,
Linge il devint par l'art des tisserands;
Puis en lambeaux des pilons le pressèrent,
Il fut papier. Cent cerveaux à l'envers
De visions à l'envi le chargèrent;
Puis on le brûle: il vole dans les airs,
Il est fumée aussi bien que la gloire.
De nos travaux voilà quelle est l'histoire.
Tout est fumée: et tout nous fait sentir
Ce grand néant qui doit nous engloutir.
LOI NATURELLE. [p. 67]↩
DIALOGUE.
B. Qu'est-ce que la loi naturelle?
A. L'instinct qui nous fait sentir la justice.
B. Qu'appelez-vous juste et injuste?
A. Ce qui paraît tel à l'univers entier.
B. L'univers est composé de bien des têtes. On dit qu'à Lacédémone on applaudissait aux larcins, pour lesquels on condamnait aux mines dans Athènes.
A. Abus de mots, logomachie, équivoque; il ne pouvait se commettre de larcin à Sparte lorsque tout y était commun. Ce que vous appelez vol , était la punition de l'avarice.
B. Il était défendu d'épouser sa soeur à Rome. Il était permis chez les Egyptiens, les Athéniens et même chez les Juifs, d'épouser sa soeur de père. Je ne cite qu'à regret ce malheureux petit peuple juif, qui ne doit assurément servir de règle à personne, et qui (en mettant la religion à part) ne fut jamais qu'un peuple de brigands ignorants et fanatiques. Mais enfin, selon ses livres, la jeune Thamar avant de se faire violer par son frère Ammon, lui dit, Mon frère, ne me faites pas de sottises, mais demandez-moi en mariage à mon père, il ne vous refusera pas .
A. Lois de convention que tout cela, usages arbitraires, modes qui passent; l'essentiel demeure toujours. Montrez-moi un pays où il soit honnête de me ravir le fruit de mon travail, de violer sa promesse, de mentir pour nuire, de calomnier, d'assassiner, d'empoisonner, d'être ingrat envers son bienfaiteur, de battre son père et sa mère quand ils vous présentent à manger?
B. Avez-vous oublié que Jean-Jacques, un des Pères de l'Eglise moderne, a dit, Le premier qui osa clore et cultiver un terrain fut l'ennemi du genre humain, qu'il fallait l'exterminer, et que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne ? N'avons-nous pas déjà examiné ensemble cette belle proposition si utile à la société?
A. Quel est ce Jean-Jacques? ce n'est assurément ni Jean-Batiste, ni Jean l'Evangéliste, ni Jacques le Majeur, ni Jacques le Mineur, il faut que ce soit quelque Hun, bel esprit, qui ait écrit cette impertinence abominable, ou quelque mauvais plaisant bufo magro qui ait voulu rire de ce que le monde entier a de plus sérieux. Car au lieu d'aller gâter le terrain d'un voisin sage et industrieux, il n'avait qu'à l'imiter; et chaque père de famille ayant suivi cet exemple, voilà bientôt un très joli village tout formé. L'auteur de ce passage me paraît un animal bien insociable.
B. Vous croyez donc qu'en outrageant et en volant le bonhomme qui a entouré d'une haie vive son jardin et son poulailler, il a manqué aux devoirs de la loi naturelle?
A. Oui, oui encore une fois, il y a une loi naturelle; et elle ne consiste ni à faire le mal d'autrui, ni à s'en réjouir.
B. Je conçois que l'homme n'aime et ne fait le mal que pour son avantage. Mais tant de gens sont portés à se procurer leur avantage par le malheur d'autrui; la vengeance est une passion si violente, il y en a des exemples si funestes; l'ambition plus fatale encore a inondé la terre de tant de sang, que lorsque je m'en retrace l'horrible tableau, je suis tenté d'avouer que l'homme est très diabolique. J'ai beau avoir dans mon coeur la notion du juste et de l'injuste; un Attila que St Léon courtise, un Phocas que St Grégoire flatte avec la plus lâche bassesse, un Alexandre VI souillé de tant d'incestes, de tant d'homicides, de tant d'empoisonnements, avec lequel le faible Louis XII qu'on appelle bon , fait la plus indigne et la plus étroite alliance; un Cromwell dont le cardinal Mazarin recherche la protection, et pour qui il chasse de France les héritiers de Charles I e r , cousins germains de Louis XIV, etc. etc. etc.: cent exemples pareils dérangent mes idées, et je ne sais plus où j'en suis.
A. Eh bien, les orages empêchent-ils que nous ne jouissions aujourd'hui d'un beau soleil? Le tremblement qui a détruit la moitié de la ville de Lisbonne, empêche-t-il que vous n'ayez fait très commodément le voyage de Madrid? Si Attila fut un brigand et le cardinal Mazarin un fripon, n'y a-t-il pas des princes et des ministres honnêtes gens? N'a-t-on pas remarqué que dans la guerre de 1701 le conseil de Lois XIV était composé des hommes les plus vertueux? le duc de Beauvilliers, le marquis de Torci, le maréchal de Villars, Chamillard enfin qui passa pour incapable, mais jamais pour malhonnête homme. L'idée de la justice ne subsiste-t-elle pas toujours? C'est sur elle que sont fondées toutes les lois. Les Grecs les appelaient filles du ciel , cela ne veut dire que les filles de la nature.
N'avez-vous pas des lois dans votre pays?
B. Oui, les unes bonnes, les autres mauvaises.
A. Où en auriez-vous pris l'idée, si ce n'est dans les notions de la loi naturelle que tout homme a dans soi quand il a l'esprit bien fait? il faut bien les avoir puisées là ou nulle part.
B. Vous avez raison, il y a une loi naturelle; mais il est encore plus naturel à bien des gens de l'oublier.
A. Il est naturel aussi d'être borgne, bossu, boiteux, contrefait, malsain: mais on préfère les gens bien faits et bien sains.
B. Pourquoi y a-t-il tant d'esprits borgnes et contrefaits?
A. Paix. Mais allez à l'article Toute-puissance .
LOIX. [p. 70]↩
Il est difficile qu'il y ait une seule nation qui vive sous de bonnes lois. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont l'ouvrage des hommes, car ils ont fait de très bonnes choses; et ceux qui ont inventé et perfectionné les arts pouvaient imaginer un corps de jurisprudence tolérable.
Mais les lois ont été établies dans presque tous les Etats par l'intérêt du législateur, par le besoin du moment, par l'ignorance, par la superstition. On les a faites à mesure, au hasard, irrégulièrement, comme on bâtissait les villes. Voyez à Paris le quartier des Halles, de St Pierre-aux-boeufs, la rue Brise-miche, celle du Pet-au-diable, contraster avec le Louvre et les Tuileries; voilà l'image de nos lois.
Londres n'est devenue digne d'être habitée que depuis qu'elle fut réduite en cendre. Les rues, depuis cette époque, furent élargies et alignées; Londres fut une ville pour avoir été brûlée. Voulez-vous avoir de bonnes lois? brûlez les vôtres et faites-en de nouvelles.
Les Romains furent trois cents années sans lois fixes. Ils furent obligés d'en aller demander aux Athéniens, qui leur en donnèrent de si mauvaises, que bientôt elles furent presque toutes abrogées. Comment Athènes elle-même aurait-elle eu une bonne législation? on fut obligé d'abolir celle de Dracon; et celle de Solon périt bientôt.
Votre coutume de Paris est interprétée différemment par vingt-quatre commentaires; donc il est prouvé vingt-quatre fois qu'elle est mal conçue. Elle contredit cent quarante autres coutumes, ayant toutes force de loi chez la même nation, et toutes se contredisant entre elles. Il est donc dans une seule province de l'Europe, entre les Alpes et les Pyrénées, plus de cent quarante petits peuples qui s'appellent compatriotes , et qui sont réellement étrangers les uns pour les autres, comme le Tunquin l'est pour la Cochinchine.
Il en est de même dans toutes les provinces d'Espagne. C'est bien pis dans la Germanie, personne n'y sait quels sont les droits du chef ni des membres. L'habitant des bords de l'Elbe ne tient au cultivateur de la Souabe que parce qu'ils parlent à peu près la même langue, laquelle est un peu rude.
La nation anglaise a plus d'uniformité; mais n'étant sortie de la barbarie et de la servitude que par intervalles et par secousses, et ayant dans sa liberté conservé plusieurs lois promulguées autrefois par de grands tyrans qui disputaient le trône, ou par de petits tyrans qui envahissaient des prélatures, il s'en est formé un corps assez robuste, sur lequel on aperçoit encore beaucoup de blessures couvertes d'emplâtres.
L'esprit de l'Europe a fait de plus grands progrès depuis cent ans que le monde entier n'en avait fait depuis Brama, Fohi, Zoroastre, et le Thaut de l'Egypte. D'où vient que l'esprit de législation en a fait si peu?
Nous fûmes tous sauvages depuis le cinquième siècle. Telles sont les révolutions du globe; brigands qui pillaient, cultivateurs pillés, c'était là ce qui composait le genre humain du fond de la mer Baltique au détroit de Gibraltar; et quand les Arabes parurent au midi, la désolation du bouleversement fut universelle.
Dans notre coin d'Europe le petit nombre étant composé de hardis ignorants vainqueurs et armés de pied en cap, et le grand nombre d'ignorants esclaves désarmés, presque aucun ne sachant ni lire, ni écrire, pas même Charlemagne, il arriva très naturellement que l'Eglise romaine avec sa plume et ses cérémonies gouverna ceux qui passaient leur vie à cheval la lance en arrêt et le morion en tête.
Les descendants des Sicambres, des Bourguignons, des Ostrogoths, Visigoths, Lombards, Hérules, etc. sentirent qu'ils avaient besoin de quelque chose qui ressemblât à des lois. Ils en cherchèrent où il y en avait. Les évêques de Rome en savaient faire en latin. Les barbares les prirent avec d'autant plus de respect qu'ils ne les entendaient pas. Les décrétales des papes, les unes véritables, les autres effrontément supposées, devinrent le code des nouveaux regas, des leudes, des barons qui avaient partagé les terres. Ce furent des loups qui se laissèrent enchaîner par des renards. Ils gardèrent leur férocité, mais elle fut subjuguée par la crédulité, et par la crainte que la crédulité produit. Peu à peu l'Europe, excepté la Grèce et ce qui appartient encore à l'empire d'Orient, se vit sous l'empire de Rome; de sorte qu'on put dire une seconde fois,
Romanos rerum dominos gentemque togatam .
[37] Presque toutes les conventions étant accompagnées d'un signe de croix et d'un serment qu'on faisait souvent sur des reliques; tout fut du ressort de l'Eglise. Rome, comme la métropole, fut juge suprême des procès de la Kersonèse Cimbrique et de ceux de la Gascogne. Mille seigneurs féodaux joignant leurs usages au droit canon, il en résulta cette jurisprudence monstrueuse dont il reste encore tant de vestiges.
Lequel eût le mieux valu, de n'avoir point du tout de lois, ou d'en avoir de pareilles?
Il a été avantageux à un empire plus vaste que l'empire romain, d'être longtemps dans le chaos; car tout étant à faire, il était plus aisé de bâtir un édifice que d'en réparer un dont les ruines seraient respectées.
La Thesmophore du Nord assembla en 1767 des députés de toutes les provinces, qui contenaient environ douze cent mille lieues carrées. Il y avait des païens, des mahométans d'Ali, des mahométans d'Omar, des chrétiens d'environ douze sectes différentes. On proposait chaque loi à ce nouveau synode; et si elle paraissait convenable à l'intérêt de toutes les provinces, elle recevait alors la sanction de la souveraine et de la nation.
La première loi qu'on porta fut la tolérance, afin que le prêtre grec n'oubliât jamais que le prêtre latin est homme; que le musulman supportât son frère le païen, et que le romain ne fût pas tenté de sacrifier son frère le presbytérien.
La souveraine écrivit de sa main dans ce grand conseil de législation, Parmi tant de croyances diverses, la faute la plus nuisible l'intolérance .
On convint unanimement qu'il n'y a qu'une puissance, [38] qu'il faut dire toujours puissance civile, et discipline ecclésiastique; et que l'allégorie des deux glaives est le dogme de la discorde.
Elle commença par affranchir les serfs de son domaine particulier.
Elle affranchit tous ceux du domaine ecclésiastique; ainsi elle créa des hommes.
Les prélats et les moines furent payés du trésor public.
Les peines furent proportionnées aux délits, et les peines furent utiles; les coupables, pour la plupart, furent condamnés aux travaux publics, attendu que les morts ne servent à rien.
La torture fut abolie, parce que c'est punir avant de connaître, et qu'il est absurde de punir pour connaître; parce que les Romains ne mettaient à la torture que les esclaves; parce que la torture est le moyen de sauver le coupable et de perdre l'innocent.
On en était là quand Moustapha III, fils de Mahmoud, força l'impératrice d'interrompre son code pour le battre.
LOIX CRIMINELLES.
Section seconde.
Il est nécessaire de justifier la France de ces accusations de parricide qui se renouvellent trop souvent, et d'inviter les juges à consulter mieux les lumières de la raison, et la voix de la nature.
Il est dur de dire à des magistrats, Vous avez à vous reprocher l'erreur et la barbarie; mais il est plus dur que des citoyens en soient les victimes.
Sept hommes prévenus peuvent tranquillement livrer un père de famille aux plus affreux supplices. Or, qui est le plus à plaindre ou des familles réduites à la mendicité, dont les pères, les mères, les frères sont morts injustement dans des supplices épouvantables, ou des juges tranquilles et sûrs de l'impunité, à qui l'on dit qu'ils se sont trompés, qui écoutent à peine ce reproche, et qui vont se tromper encore?
Quand les supérieurs font une injustice évidente et atroce, il faut que cent mille voix leur disent qu'ils sont injustes. Cet arrêt prononcé par la nation est leur seul châtiment: c'est un tocsin général qui éveille la justice endormie, qui l'avertit d'être sur ses gardes, qui peut sauver la vie à des multitudes d'innocents.
Il n'y a point d'année où quelques juges de province ne condamnent à une mort affreuse quelque père de famille innocent, et cela tranquillement, gaîment même, comme on égorge un dindon dans sa basse-cour. On a vu quelquefois la même chose à Paris.
Dans l'aventure horrible des Calas, la voix publique s'éleva contre un capitoul fanatique qui poursuivit la mort d'un juste, et contre huit magistrats trompés qui la signèrent. Je n'entends pas ici par voix publique celle de la populace qui est presque toujours absurde: ce n'est point une voix; c'est un cri de brutes. Je parle de cette voix de tous les honnêtes gens réunis qui réfléchissent, et qui avec le temps portent un jugement infaillible.
Cette voix publique prononçait donc avec raison, que deux choses sont absolument nécessaires à un magistrat, le sens commun et l'humanité.
Elle était bien forte, cette voix; elle montrait la nécessité du tribunal suprême du conseil d'Etat qui juge les justices; elle réclamait son autorité alors tellement négligée que l'arrêt du conseil qui justifia les Calas ne put jamais être affiché dans Toulouse.
Quelquefois, et peut-être trop souvent, au fond d'une province, des juges prodiguaient le sang innocent dans des supplices épouvantables; la sentence et les pièces du procès arrivaient à la Tournelle de Paris avec le condamné. Cette chambre, dont le ressort était immense, n'avait pas le temps de l'examen; la sentence était confirmée. L'accusé que des archers avaient conduit dans l'espace de quatre cents milles à très grands frais, était ramené pendant quatre cents milles à plus grands frais au lieu de son supplice. Et cela nous apprend l'éternelle reconnaissance que la France doit à Louis XV d'avoir diminué ce ressort, d'avoir détruit ce grand abus, d'avoir créé des conseils supérieurs dans les provinces (et surtout d'avoir fait rendre gratuitement la justice.)
Nous avons déjà parlé ailleurs du supplice de la roue, dans lequel périt il y a peu d'années, ce bon cultivateur, ce bon père de famille nommé Martin, d'un village du Barois ressortissant au parlement de Paris. Le premier juge condamna ce vieillard à la torture qu'on appelle ordinaire et extraordinaire , et à expirer sur la roue; et il le condamna non seulement sur les indices les plus équivoques, mais sur des présomptions qui devaient établir son innocence.
Il s'agissait d'un meurtre et d'un vol commis auprès de sa maison, tandis qu'il dormait profondément entre sa femme et ses sept enfants. On confronte l'accusé avec un passant qui avait été témoin de l'assassinat. Je ne le reconnais pas , dit le passant, ce n'est pas là le meurtrier que j'ai vu; l'habit est semblable, mais le visage est différent. Ah! Dieu soit loué , s'écrie le bon vieillard, ce témoin ne m'a pas reconnu .
Sur ces paroles, le juge s'imagine que le vieillard plein de l'idée de son crime, a voulu dire, je l'ai commis, on ne m'a pas reconnu, me voilà sauvé. Mais il est clair que ce vieillard, plein de son innocence, voulait dire, Ce témoin a reconnu que je ne suis pas coupable, il a reconnu que mon visage n'est pas celui du meurtrier . Cette étrange logique d'un bailli et des présomptions encore plus fausses, déterminent la sentence précipitée de ce juge et de ses assesseurs. Il ne leur tombe pas dans l'esprit d'interroger la femme, les enfants, les voisins, de chercher si l'argent volé se trouve dans la maison, d'examiner la vie de l'accusé, de confronter la pureté de ses moeurs avec ce crime. La sentence est portée; la Tournelle trop occupée alors signe sans examen bien jugé . L'accusé expire sur la roue devant sa porte; son bien est confisqué; sa femme s'enfuit en Autriche avec ses petits enfants. Huit jours après le scélérat qui avait commis le meurtre, est supplicié pour d'autres crimes. Il avoue à la potence qu'il est coupable de l'assassinat pour lequel ce bon père de famille est mort.
Des censeurs me reprochent que j'ai déjà parlé de ces désastres; oui, j'ai peint et je veux repeindre ces tableaux nécessaires, dont il faut multiplier les copies; j'ai dit et je redis que la mort de la maréchale d'Ancre et du maréchal de Marillac sont la honte éternelle des lâches barbares qui les condamnèrent. On doit répéter à la postérité qu'un jeune gentilhomme de la plus grande espérance pouvait ne pas être condamné à la torture, au supplice du poing coupé, de la langue arrachée et de la mort dans les flammes, pour quelques emportements passagers de jeunesse dont un an de prison l'aurait corrigé, pour des indiscrétions si secrètes, si inconnues, qu'on fut obligé de les faire révéler par des monitoires; ancienne procédure de l'Inquisition. L'Europe entière s'est soulevée contre cette sentence; et il faut empêcher que l'Europe ne l'oublie.
On doit redire que le comte de Lalli n'était coupable ni de péculat ni de trahison. Ses nombreux ennemis l'accusèrent avec autant de violence qu'il en avait déployée contre eux. Il est mort sur l'échafaud avec un bâillon dans la bouche: ils commencent à le plaindre.
Plus d'une fois on s'est récrié contre la rigueur du supplice de ce garde du corps qui fut pendu pour s'être fait quelques blessures afin de s'attirer une petite récompense, et de ce malheureux qu'on appelait le fou de Verberie qui fut puni par la mort des sottises sans conséquence qu'il avait dites dans un souper.
N'est-il pas bien permis, que dis-je! bien nécessaire d'avertir souvent les hommes qu'ils doivent ménager le sang des hommes? On répète tous les jours des vérités qui ne sont de nulle importance; on avertit plusieurs fois qu'un ex-jésuite aussi hardi qu'ignorant s'est grossièrement trompé en affirmant qu'aucun roi de la première race n'eut plusieurs femmes à la fois; en assurant que le roi Henri III n'assiégea point la ville de Livron, etc. etc. etc. On réfute en vingt endroits les calomnies dont un autre ex-jésuite nommé Patouillet a souillé des mandements d'évêques. On est forcé à ces répétitions, parce que ce qui échappe à un lecteur, est recueilli par un autre; parce que ce qui est perdu dans une brochure, se retrouve dans un livre nouveau. Les écrivains de Port-Royal ont mille fois redoublé les mêmes plaintes contre leurs adversaires. Quoi! on aura répété que les cinq propositions ne sont pas expressément dans Jansénius, dont personne ne se soucie, et on ne répéterait pas des vérités fatales qui intéressent le genre humain! Je voudrais que le récit de toutes les injustices retentît sans cesse à toutes les oreilles.
Je ne connais guère d'injustice plus atroce et plus imbécile que celle du tribunal d'Arras, commise contre Monbailli citoyen de St Omer, et contre sa femme.
PROCÈS CRIMINEL DU SR. MONBAILLI ET DE SA FEMME.
Une veuve, nommée Monbailli du nom de son mari, âgée de soixante ans, d'un embonpoint et d'une grosseur énorme, avait l'habitude de s'enivrer du poison qu'on appelle si improprement eau-de-vie . Cette funeste passion très connue dans la ville, l'avait déjà jetée dans plusieurs accidents qui faisaient craindre pour sa vie. Son fils Monbailli et sa femme Danel couchaient dans l'antichambre de la mère, tous trois subsistaient d'une manufacture de tabac que la veuve avait entreprise. C'était une concession des fermiers généraux, qu'on pouvait perdre par sa mort, et un lien de plus qui attachait les enfants à sa conservation; ils vivaient ensemble, malgré les petites altercations ordinaires entre les jeunes femmes et leurs belles-mères, surtout dans la pauvreté. Ce Monbailli avait un fils, autre raison plus puissante pour le détourner du crime. Sa principale occupation était la culture d'un jardin de fleurs, amusement des âmes douces. Il avait des amis; les coeurs atroces n'en ont jamais.
Le 7 juillet 1770 une ouvrière se présente à sept heures du matin à sa porte pour parler à la veuve. Monbailli et son épouse étaient couchés; la jeune femme dormait encore (circonstance essentielle qu'il faut bien remarquer). Monbailli se lève et dit à l'ouvrière que sa mère n'est pas éveillée. On attend longtemps; enfin on entre dans la chambre, on trouve la vieille femme renversée sur un petit coffre près de son lit, la tête penchée à terre, l'oeil droit meurtri d'une plaie assez profonde faite par la corne du coffre sur lequel elle était tombée, le visage livide et enflé, quelques gouttes de sang échappées du nez dans lequel il s'était formé un caillot considérable. Il était visible qu'elle était morte d'une apoplexie subite en sortant de son lit et en se débattant. C'est une fin très commune dans la Flandre à tous ceux qui boivent trop de liqueurs fortes:
Le fils s'écrie, Ah mon Dieu! ma mère est morte! il s'évanouit; sa femme se lève à ce cri; elle accourt dans la chambre.
L'horreur d'un tel spectacle se conçoit assez. Elle crie au secours; l'ouvrière et elle appellent les voisins. Tout cela est prouvé par les dépositions. Un chirurgien vient saigner le fils; ce chirurgien reconnaît bientôt que la mère est expirée. Nul doute, nul soupçon sur le genre de sa mort; tous les assistants consolent Monbailli et sa femme. On enveloppe le corps sans aucun trouble; on le met dans un cercueil; et il doit être enterré le 29 au matin selon les formalités ordinaires.
Il s'élève des contestations entre les parents et les créanciers pour l'apposition du scellé. Monbailli le fils est présent à tout; il discute tout avec une présence d'esprit imperturbable et une affliction tranquille que n'ont jamais les coupables.
Cependant, quelques personnes du peuple qui n'avaient rien vu de tout ce qu'on vient de raconter, commencent à former des soupçons; elles ont appris que la mère Monbailli étant ivre avait voulu chasser de sa maison son fils et sa belle-fille; qu'elle leur avait fait même signifier par un procureur un ordre de déloger; que lorsqu'elle eut repris un peu ses sens, ses enfants se jetèrent à ses genoux, qu'ils l'apaisèrent, et qu'elle les remit au lendemain matin pour achever la réconciliation. On imagina que Monbailli et sa femme avaient pu assassiner leur mère pour se venger; car ce ne pouvait être pour hériter, puisqu'elle a laissé plus de dettes que de bien.
Cette supposition, tout improbable qu'elle était, trouva des partisans, et peut-être parce qu'elle était improbable. La rumeur de la populace augmenta de moment en moment selon l'ordinaire; le cri devint si violent que le magistrat fut obligé d'agir; il se transporte sur les lieux; on emprisonne séparément Monbailli et sa femme, quoiqu'il n'y eût ni corps de délit, ni plainte, ni accusation juridique, ni vraisemblance de crime.
Les médecins et les chirurgiens de St Omer sont mandés pour examiner le cadavre et pour faire leur rapport. Ils disent unanimement, que la mort a pu être causée par une hémorragie que la plaie de l'oeil a produite, ou par une suffocation .
On trouva quelques gouttes de sang auprès du lit de cette femme; mais elles étaient la suite évidente de la blessure qu'elle s'était faite à l'oeil en tombant. On trouva une goutte de sang sur l'un des bas de l'accusé; mais il était clair que c'était un effet de sa saignée. Ce qui le justifiait bien davantage, c'était sa conduite passée, c'était la douceur reconnue de son caractère. On ne lui avait rien reproché jusqu'alors; il était moralement impossible qu'il eût passé en un moment de l'innocence de sa vie au parricide, et que sa jeune femme eût été sa complice. Il était physiquement impossible par l'inspection du cadavre que la mère fût morte assassinée; il n'était pas dans la nature que son fils et sa fille eussent dormi tranquillement après ce crime qui aurait été leur premier crime, et qu'on les eût vus toujours sereins dans tous les moments où ils auraient dû être saisis de toutes les agitations que produisent nécessairement le remords d'une si horrible action, et la crainte du supplice. Un scélérat endurci peut affecter de la tranquillité dans le parricide. Mais deux jeunes époux!
Les juges de St Omer connaissaient les moeurs de Monbailli; ils avaient vu toutes ses démarches; ils étaient parfaitement instruits de toutes les circonstances de cette mort. Ainsi ils ne balancèrent pas à croire le mari et la femme innocents. Mais la rumeur populaire qui dans de telles aventures se dissipe bien moins aisément qu'elle ne s'élève, les força d'ordonner un plus amplement informé d'une année, pendant laquelle les accusés demeureraient en prison.
Le procureur du roi appela de cette sentence au conseil d'Artois, dont St Omer ressortit. Il pouvait en effet la trouver trop rigoureuse, puisque les accusés reconnus innocents, demeuraient enfermés dans un cachot pendant une année entière. Mais l'appel fut ce qu'on appelle à minima , c'est-à-dire, d'une trop petite peine à une plus grande; sorte de jurisprudence inconnue aux Romains nos législateurs, qui n'imaginèrent jamais de faire juger deux fois un accusé pour augmenter son supplice, ou pour le traiter en criminel après qu'il avait été déclaré innocent; jurisprudence cruelle dont le contraire est raisonnable et humain; jurisprudence qui dément cette loi si naturelle, non bis in idem .
Le conseil supérieur d'Arras jugea Monbailli et sa femme sur les seuls indices, qui n'avaient pas même paru des indices aux juges de St Omer, beaucoup mieux informés, puisqu'ils étaient sur les lieux.
Malheureusement on ne convient pas trop quels sont les indices assez puissants pour engager un juge à faire périr un homme sur la roue. [39]
Mais enfin on n'avait contre Monbailli ni demi-preuve ni indice; tout parlait manifestement en sa faveur. Comment donc se put-il faire que le conseil d'Arras, après avoir reçu les dénégations toujours simples, toujours uniformes de Monbailli et de sa femme, condamnât le mari à mourir sur la roue après avoir eu le poing coupé; la femme à être pendue et jetée dans les flammes?
Serait-il vrai que les hommes accoutumés à juger les crimes, contractassent l'habitude de la cruauté, et se fissent à la longue un coeur d'airain? se plairaient-ils enfin aux supplices ainsi que les bourreaux? la nature humaine serait-elle parvenue à ce degré d'atrocité? faut-il que la justice instituée pour être la gardienne de la société, en soit devenue si souvent le fléau? cette loi universelle dictée par la nature, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de punir un innocent, serait-elle bannie du coeur de quelques magistrats trop frappés de la multitude des délits?
La simplicité, la dénégation invariables des accusés, leurs réponses modestes et touchantes qu'ils n'avaient pu se communiquer, la constance attendrissante de Monbailli dans les tourments de la question, rien ne put fléchir les juges; et malgré les conclusions d'un procureur général très éclairé, ils prononcèrent leur arrêt.
Monbailli fut renvoyé à St Omer pour y subir cet arrêt prononcé le 9 novembre 1770; il fut exécuté le 19 du même mois.
Monbailli conduit à la porte de l'église, demande en pleurant pardon à Dieu de toutes ses fautes passées, et il jure à Dieu qu'il est innocent du crime qu'on lui impute . On lui coupe la main; il dit, cette main n'est point coupable d'un parricide . Il répète ce serment sous les coups qui brisent ses os: prêt d'expirer sur la roue, il dit à son confesseur, pourquoi voulez-vous me forcer à faire un mensonge, en prenez-vous sur vous le crime?
Tous les habitants de St Omer témoins de sa mort, lui donnent des larmes; non pas de ces larmes que la pitié arrache au peuple pour les criminels même dont il a demandé le supplice, mais celles que la conviction de son innocence a fait répandre longtemps dans cette ville.
Tous les magistrats de St Omer ont été, et sont encore convaincus de l'iniquité de cet arrêt.
La femme de Monbailli qui était enceinte, resta dans son cachot d'Arras, pour être exécutée à son tour quand elle aurait mis son enfant au monde: c'était être à la potence pendant six mois sous la main d'un bourreau, en attendant le dernier moment de ce long supplice. Quel état pour une innocente! elle en perdit l'usage des sens et sa raison fut aliénée: elle eût été heureuse d'avoir perdu la vie; mais elle était mère; elle a deux enfants, l'un sortant du berceau, l'autre dans son sein. Son père et sa mère presque aussi à plaindre qu'elle, profitèrent du temps écoulé entre son arrêt et ses couches pour demander un sursis à M. le chancelier.
Ce chef de la magistrature fit revoir le procès par un nouveau conseil d'Arras; et ce conseil d'une voix unanime, déclara Monbailli et sa femme innocents. Mais pourquoi ne pas condamner l'ancien conseil à nourrir du moins la veuve et les enfants de l'innocent que ces juges avaient assassiné en public à coups de barre de fer?
La France se flatte que le chef de la magistrature qui a réformé tant de tribunaux, réformera dans la jurisprudence elle-même ce qu'elle peut avoir de défectueux et de funeste.
Peut-être l'usage affreux de la torture, proscrit aujourd'hui chez tant de nations, ne sera-t-il plus pratiqué que dans ces crimes d'Etat qui mettent en péril la sûreté publique.
Peut-être les arrêts de mort ne seront exécutés qu'après un compte rendu au souverain, et les juges ne dédaigneront pas de motiver leurs arrêts, à l'exemple de tous les autres tribunaux de la terre.
Peut-être les lois militaires n'ordonneront-elles plus aux soldats d'assassiner à coups de fusil leurs camarades qui s'étant engagés par imprudence et par séduction, sont retournés chez eux exercer leurs métiers et cultiver le petit champ de leurs pères. Il se pourra qu'on rende un jour la profession de soldat si honorable qu'on ne sera plus tenté de déserter.
Il se pourra qu'on se défasse un jour de la coutume d'étrangler une jeune fille qui aura volé un tablier d'un écu à sa maîtresse, non seulement parce que son supplice coûte trois à quatre cents écus pour le moins, mais parce qu'il n'y a pas de proportion entre un méchant tablier et une créature humaine qui peut donner des enfants à l'Etat.
Il se pourra qu'on abolisse quelques lois absurdes et contradictoires, dictées par un besoin passager, ou dans des temps de trouble, ou dans des temps d'ignorance.
Mais ce n'est pas à nous sans doute d'oser rien indiquer à des hommes si élevés au-dessus de notre sphère; ils voient ce que nous ne voyons pas; ils connaissent les maux et les remèdes. Nous devons attendre en silence ce que la raison, la science, l'humanité, le courage d'esprit et l'autorité voudront ordonner.
LOIX; ESPRIT DES LOIX.
Section troisiéme.
Il eût été à désirer que de tous les livres faits sur les lois par Bodin, Hobbes, Grotius, Puffendorf, Montesquieu, Barbeirac, Burlamaqui, il en eût résulté quelque loi utile, adoptée dans tous les tribunaux de l'Europe, soit sur les successions, soit sur les contrats, sur les finances, sur les délits, etc. Mais ni les citations de Grotius, ni celles de Puffendorf, ni celles de l' Esprit des lois , n'ont jamais produit une sentence du Châtelet de Paris, ou de l' Old baili de Londres. On s'appesantit avec Grotius, on passe quelques moments agréablement avec Montesquieu; et si on a un procès, on court chez son avocat.
On a dit que la lettre tuait et que l'esprit vivifiait; mais dans le livre de Montesquieu l'esprit égare, et la lettre n'apprend rien.
DES CITATIONS FAUSSES DANS L'ESPRIT DES LOIX, DES CONSÉQUENCES FAUSSES QUE L'AUTEUR EN TIRE, ET DE PLUSIEURS ERREURS QU'IL EST IMPORTANT DE DÉCOUVRIR.
Nous avons déjà vu que Montesquieu fait dire à l'auteur du prétendu Testament du cardinal de Richelieu, que si dans le peuple il se trouve quelque malheureux honnête homme, il ne faut pas s'en servir . Ce testament dit précisément tout le contraire.
Il impute à Plutarque d'avoir dit, qu'il n'y a de respectable en amour que la sodomie, et que les femmes sont indignes de l'attachement d'un honnête homme. Plutarque au contraire déteste la sodomie, et dit positivement que les femmes seules méritent nos hommages. C'est ce que nous avons déjà démontré.
Il cite Denis d'Halicarnasse qui dit, que selon Isocrate, Solon ordonna qu'on choisirait les juges dans les quatre classes des Athéniens .
Denis d'Halicarnasse n'en a pas dit un seul mot; voici ses paroles. Isocrate, dans sa harangue, rapporte que Solon et Clistène n'avaient donné aucune puissance aux scélérats, mais aux gens de bien . Qu'importe d'ailleurs ce qu'Isocrate a pu dire dans une déclamation?
A Gènes la banque de St George est gouvernée par le peuple, ce qui lui donne une grande influence . Cette banque est gouvernée par six classes de nobles appelées magistratures .
On sait que la mer qui semble vouloir couvrir la terre, est arrêtée par les moindres herbes et par les moindres graviers .
On ne sait point cela; on sait que la mer est arrêtée par les lois de la gravitation, qui ne sont ni gravier ni herbe.
Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie .
Au contraire, ils ont établi la chambre des communes qui est la puissance intermédiaire.
L'établissement d'un vizir est dans un Etat despotique une loi fondamentale .
Un critique judicieux a remarqué que c'est comme si on disait que l'office des maires du palais était une loi fondamentale. Constantin était plus que despotique, et n'eut point de grand-vizir. Louis XIV était un peu despotique, et n'eut point de premier ministre. Les papes sont assez despotiques, et en ont rarement. Il n'y en a point dans la Chine, que l'auteur regarde comme un empire despotique. Il n'y en eut point chez le czar Pierre I e r , et personne ne fut plus despotique que lui. Le Turc Amurat II n'avait point de grand-vizir. Gengis-Kan n'en eut jamais.
La vénalité des charges est bonne dans les Etats monarchiques, parce qu'elle fait faire comme un métier de famille, ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la vertu .
Est-ce Montesquieu qui a écrit ces lignes honteuses? quoi! parce que les folies de Francois I e r avaient dérangé ses finances, il fallait qu'il vendît à de jeunes ignorants le droit de décider de la fortune, de l'honneur et de la vie des hommes! quoi! cet opprobre devient bon dans la monarchie? et la place de magistrat devient un métier de famille? Si cette infamie était si bonne, elle aurait au moins été adoptée par quelque autre monarchie que la France. Il n'y a pas un seul Etat sur la terre qui ait osé se couvrir d'un tel opprobre. Ce monstre est né de la prodigalité d'un roi devenu indigent, et de la vanité de quelques bourgeois dont les pères avaient de l'argent. On a toujours attaqué cet infâme abus par des cris impuissants, parce qu'il eût fallu rembourser les offices qu'on avait vendus. Il eût mieux valu mille fois, dit un grand jurisconsulte, vendre le trésor de tous les couvents et l'argenterie de toutes les églises, que de vendre la justice. Lorsque François I e r prit la grille d'argent de St Martin, il ne fit tort à personne; St Martin ne se plaignit point; il se passe très bien de sa grille; mais vendre la place de juge, et faire jurer à ce juge qu'il ne l'a pas achetée, c'est une bassesse sacrilège.
Plaignons Montesquieu d'avoir déshonoré son ouvrage par de tels paradoxes. Mais pardonnons-lui. Son oncle avait acheté une charge de président en province, et il la lui laissa. On retrouve l'homme partout. Nul de nous n'est sans faiblesse.
Pour les vertus, Aristote ne peut croire qu'il y en ait de propre aux esclaves .
Aristote dit en termes exprès, Il faut qu'ils aient les vertus nécessaires à leur état, la tempérance et la vigilance . De la républiq. liv. I. chap. XIII.
Je trouve dans Strabon, que quand à Lacédémone une soeur épousait son frère, elle avait pour sa dot la moitié de la portion de son frère .
Strabon parle ici des Crétois, et non des Lacédémoniens.
Il fait dire à Xénophon, que dans Athènes un homme riche serait au désespoir qu'on crût qu'il dépendît du magistrat .
Xénophon en cet endroit ne parle point d'Athènes. Voici ses paroles; Dans les autres villes, les puissants ne veulent pas qu'on les soupçonne de craindre les magistrats .
Les lois de Venise défendent aux nobles le commerce .
Voyez l'Histoire de Venise par le noble Peruta.
‘Les anciens fondateurs de notre république, et nos législateurs, eurent grand soin de nous exercer dans les voyages et le trafic de mer. La première noblesse avait coutume de naviguer, soit pour exercer le commerce, soit pour s'instruire.'
Sagredo dit la même chose.
Les moeurs et non les lois font qu'aujourd'hui les nobles en Angleterre et à Venise ne s'adonnent presque point au commerce.
Voyez avec quelle industrie le gouvernement moscovite cherche à sortir du despotisme, etc .
Est-ce en abolissant le patriarcat et la milice entière des strelits, en étant le maître absolu des troupes, des finances et de l'Eglise, dont les desservants ne sont payés que du trésor impérial; et enfin en faisant des lois qui rendent cette puissance aussi sacrée que forte? Il est triste que dans tant de citations et dans tant d'axiomes, le contraire de ce que dit l'auteur soit presque toujours le vrai. Quelques lecteurs instruits s'en sont aperçus. Les autres se sont laissés éblouir, et on dira pourquoi.
Le luxe de ceux qui n'auront que le nécessaire sera égal à zéro. Celui qui aura le double du nécessaire aura un luxe égal à un. Celui qui aura le double de ce dernier aura un luxe égal à trois, etc .
Il aura trois au-delà du nécessaire de l'autre, mais il ne s'ensuit pas qu'il ait trois de luxe; car il peut avoir trois d'avarice; il peut mettre ce trois dans le commerce; il peut le faire valoir pour marier ses filles. Il ne faut pas soumettre de telles propositions à l'arithmétique: c'est une charlatanerie misérable.
A Venise, les lois forcent les nobles à la modestie; ils sont tellement accoutumés à l'épargne, qu'il n'y a que les courtisanes qui puissent les forcer à donner de l'argent .
Quoi! l'esprit des lois à Venise serait de ne dépenser qu'en filles! Quand Athènes fut riche, il y eut beaucoup de courtisanes. Il en fut de même à Venise et à Rome, aux quatorze, quinze et seizième siècles. Elles y sont moins en crédit aujourd'hui, parce qu'il y a moins d'argent. Est-ce là l'esprit des lois?
Les Suions, nation germanique, rendent honneur aux richesses, ce qui fait qu'ils vivent sous le gouvernement d'un seul. Cela signifie bien que le luxe est singulièrement propre aux monarchies, et qu'il n'y faut point de lois somptuaires .
Les Suions, selon Tacite, étaient des habitants d'une île de l'Océan au-delà de la Germanie. Suinonum hinc civitates in ipso Oceano . Guerriers valeureux et bien armés, ils ont encore des flottes. Praeter viros armaque classibus valent . Les riches y sont considérés. Est et opibus honos . Ils n'ont qu'un chef; eòque unus imperitat .
Ces barbares que Tacite ne connaissait point, qui dans leur petit pays n'avaient qu'un seul chef, qui préféraient le possesseur de cinquante vaches à celui qui n'en avait que douze, ont-ils le moindre rapport avec nos monarchies et nos lois somptuaires?
Les Samnites avaient une belle coutume, et qui devait produire d'admirables effets. Le jeune homme déclaré le meilleur, prenait pour sa femme la fille qu'il voulait. Celui qui avait les suffrages après lui choisissait encore, et ainsi de suite .
L'auteur a pris les Sunites, peuple de Scythie, pour les Samnites voisins de Rome. Il cite Nicolas de Damas, qui cite Stobée. Et on sait d'ailleurs que Stobée n'est pas un bon garant. Cette belle coutume d'ailleurs serait très préjudiciable dans tout Etat policé. Car si le garçon déclaré le meilleur avait trompé les juges, si la fille ne voulait pas de lui, s'il n'avait pas de bien, s'il déplaisait au père et à la mère, que d'inconvénients et que de suites funestes!
Si on veut lire l'admirable ouvrage de Tacite sur les moeurs des Germains, on verra que c'est d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur gouvernement politique. Ce beau système a été trouvé dans les bois .
La chambre des pairs et celle des communes, la cour d'équité trouvées dans les bois! on ne l'aurait pas deviné. Sans doute les Anglais doivent aussi leurs escadres et leur commerce aux moeurs des Germains; et les sermons de Tillotson à ces pieuses sorcières germaines qui sacrifiaient les prisonniers, et qui jugeaient du succès d'une campagne par la manière dont leur sang coulait. Il faut croire aussi qu'ils doivent leurs belles manufactures à la louable coutume des Germains qui aimaient mieux vivre de rapine que de travailler, comme le dit Tacite.
Aristote met au rang des monarchies l'empire des Perses et Lacédémone. Mais, qui ne voit que l'une était un Etat despotique, et l'autre une république?
Qui ne voit au contraire, pour peu qu'on ait lu, que Lacédémone eut un seul roi pendant quatre cents ans, ensuite deux rois jusqu'à l'extinction de la race des Héraclides, ce qui fait une période d'environ mille années? L'auteur ne se trompe ici que de dix siècles. On sait bien que nul roi n'était despotique de droit, pas même en Perse. Mais tout prince dissimulé, hardi, et qui a de l'argent, devient despotique en peu de temps en Perse et à Lacédémone.
La stérilité de l'Attique y établit le gouvernement populaire, et la fertilité de Lacédémone l'aristocratique .
Où a-t-il pris cette chimère? Nous tirons encore aujourd'hui d'Athènes esclave, du coton, de la soie, du riz, du blé, de l'huile, des cuirs; et du pays de Lacédémone rien.
Un ancien usage des Romains défendait de faire mourir les filles qui n'étaient pas nubiles .
Il se trompe, More tradito nefas virgines strangulari . Défense d'étrangler les filles, nubiles ou non.
Tibère trouva l'expédient de les faire violer par le bourreau .
Tibère n'ordonna point au bourreau de violer la fille de Séjan. Et s'il est vrai que le bourreau de Rome ait commis cette infamie dans la prison, il n'est nullement prouvé que ce fût sur une lettre de cachet de Tibère. Quel besoin avait-il d'une telle horreur?
En Suisse on ne paie point de tributs; mais on en sait la raison particulière. Dans ces montagnes stériles, les vivres sont si chers et le pays si peuplé, qu'un Suisse paie quatre fois plus à la nature qu'un Turc ne paie au sultan .
Tout cela est faux. Il n'y a aucun impôt en Suisse; mais chacun paie les dîmes, les cens, les lods et ventes qu'on payait aux ducs de Zéringue et aux moines. Les montagnes, excepté les glacières, sont de fertiles pâturages; elles font la richesse du pays. La viande de boucherie est environ la moitié moins chère qu'à Paris. On ne sait ce que l'auteur entend quand il dit qu'un Suisse paie quatre fois plus à la nature qu'un Turc au sultan. Il peut boire quatre fois plus qu'un Turc; car il a le vin de la Côte, et l'excellent vin de la Vaux.
Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards, ceux des pays froids sont courageux comme les jeunes gens .
Il faut bien se garder de laisser échapper de ces propositions générales. Jamais on n'a pu faire aller à la guerre un Lapon, un Samoyède: et les Arabes conquirent en quatre-vingts ans plus de pays que n'en possédait l'empire romain. Les Espagnols en petit nombre battirent à la bataille de Mulberg les soldats du nord de l'Allemagne. Cet axiome de l'auteur est aussi faux que tous ceux du climat. Voyez Climat .
Lopez de Gama avoue que le droit sur lequel les Espagnols ont fondé l'esclavage des Américains, est qu'ils trouvèrent près de Ste Marthe des paniers où les habitants avaient mis quelques denrées, comme des cancres, des limaçons, des sauterelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaincus, outre qu'ils fumaient du tabac, et qu'ils ne se faisaient pas la barbe à l'espagnole .
Il n'y a rien dans Lopez de Gama qui donne la moindre idée de cette sottise. Il est trop ridicule d'insérer dans un ouvrage sérieux de pareils traits, qui ne seraient pas supportables même dans les Lettres persanes .
C'est sur l'idée de la religion que les Espagnols fondèrent le droit de rendre tant de peuples esclaves, car ces brigands qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient fort dévots .
Ce n'est donc pas sur ce que les Américains ne se faisaient pas la barbe à l'espagnole et qu'ils fumaient du tabac; ce n'est donc pas parce qu'ils avaient quelques paniers de colimaçons et de sauterelles.
Ces contradictions fréquentes coûtent trop peu à l'auteur.
Louis XIII se fit une peine extrême de la loi qui rendait esclaves les nègres de ses colonies; mais quand on lui eut bien mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre de les convertir, il y consentit .
Où l'imagination de l'auteur a-t-elle pris cette anecdote? La première concession pour la traite des nègres est du 11 novembre 1673. LouisXIII était mort en 1643. Cela ressemble au refus de François I e r d'écouter Christophe Colomb qui avait découvert les îles Antilles avant que François I naquît.
Perry dit que les Moscovites se vendent très aisément. J'en sais bien la raison, c'est que leur liberté ne vaut rien .
Nous avons déjà remarqué à l'article Esclavage , que Perry ne dit pas un mot de tout ce que l'auteur de l' Esprit des lois lui fait dire.
C'est à Achem que tout le monde cherche à se vendre .
Nous avons remarqué encore que rien n'est plus faux. Tous ces exemples pris au hasard chez les peuples d'Achem, de Bantam, de Ceylan, de Borneo, des îles Moluques, des Philippines, tous copiés d'après des voyageurs très mal instruits, et tous falsifiés, sans en excepter un seul, ne devaient pas entrer assurément dans un livre où l'on promet de nous développer les lois de l'Europe.
Dans les Etats mahométans, on est non seulement maître de la vie et des biens des femmes esclaves, mais encore de ce qu'on appelle leur vertu et leur honneur .
Où a-t-il pris cette étrange assertion qui est de la plus grande fausseté? Le sura, ou chapitre XXIV de l'Alcoran, intitulé la Lumière , dit expressément, Traitez bien vos esclaves, et si vous voyez en eux quelque mérite, partagez avec eux les richesses que Dieu vous a données. Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer à vous, etc .
A Constantinople, on punit de mort le maître qui a tué son esclave, à moins qu'il ne soit prouvé que l'esclave a levé la main sur lui. Une femme esclave qui prouve que son maître l'a violée, est déclarée libre avec des dédommagements.
A Patane, la lubricité des femmes est si grande, que les hommes sont obligés de se faire certaines garnitures pour se mettre à l'abri de leurs entreprises .
Peut-on rapporter sérieusement cette impertinente extravagance? quel est l'homme qui ne pourrait se défendre des assauts d'une femme débauchée sans s'armer d'un cadenas? quelle pitié! et remarquez que le voyageur nommé Sprinkel, qui seul a fait ce conte absurde, dit en propre mots, Que les maris à Patane sont extrêmement jaloux de leurs femmes, et qu'ils ne permettent pas à leurs meilleurs amis de les voir, elles ni leurs filles .
Quel esprit des lois, que de grands garçons qui cadenassent leurs hauts-de-chausses, de peur que les femmes ne viennent y fouiller dans la rue!
Les Carthaginois, au rapport de Diodore, trouvèrent tant d'argent dans les Pyrénées, qu'ils en forgèrent les ancres de leurs vaisseaux .
L'auteur cite le sixième livre de Diodore, et ce sixième livre n'existe pas. Diodore au cinquième parle des Phéniciens, et non pas des Carthaginois.
On n'a jamais remarqué de jalousie aux Romains sur le commerce. Ce fut comme nation rivale, et non comme commerçante, qu'ils attaquèrent Carthage .
Ce fut comme nation commerçante et guerrière, ainsi que le prouve le savant Huet dans son traité sur le commerce des anciens. Il prouve que longtemps avant la première guerre punique les Romains s'étaient adonnés au commerce.
On voit dans le traité qui finit la première guerre punique, que Carthage fit principalement attention à garder l'empire de la mer, et Rome celui de la terre .
Ce traité est de l'an 510 de Rome. Il y est dit que les Carthaginois ne pourraient naviguer vers aucune île près de l'Italie, et qu'ils évacueraient la Sicile. Ainsi les Romains eurent l'empire de la mer, pour lequel ils avaient combattu. Et Montesquieu a précisément pris le contre-pied d'une vérité historique la mieux constatée.
Hannon, dans la négociation avec les Romains, déclara que les Carthaginois ne souffriraient pas que les Romains se lavassent les mains dans les mers de Sicile .
L'auteur fait ici un anachronisme de vingt-deux ans. La négociation d'Hannon est de l'an 488 de Rome, et le traité de paix dont il est question est de 510. Voyez Polybe .
Il ne fut pas permis aux Romains de naviguer au-delà du beau promontoire. Il leur fut défendu de trafiquer en Sicile, en Sardaigne, en Afrique, excepté à Carthage .
L'auteur fait ici un anachronisme de deux cent soixante et cinq ans. C'est d'après Polybe que l'auteur rapporte ce traité conclu l'an de Rome 245, sous le consulat de Junius Brutus, immédiatement après l'expulsion des rois; encore les conditions ne sont-elles pas fidèlement rapportées. Carthaginem vero et in caetera Africae loca quae cis-promontorium erant; item in Sardiniam atque Siciliam ubi Carthaginenses imperabant navigare mercemonii causa licebat . Il fut permis aux Romains de naviguer pour leur commerce à Carthage, sur toutes les côtes de l'Afrique en deçà du promontoire, de même que sur les côtes de la Sardaigne et de la Sicile qui obéissaient aux Carthaginois.
Ce mot seul mercemonii causa, pour raison de leur commerce , démontre que les Romains étaient occupés des intérêts du commerce dès la naissance de la république.
NB . Tout ce que dit l'auteur sur le commerce ancien et moderne est extrêmement erroné.
Je passe un nombre prodigieux de fautes capitales sur cette matière, quelque importantes qu'elles soient, parce qu'un des plus célèbres négociants de l'Europe s'occupe à les relever dans un livre qui sera très utile.
La stérilité du terrain d'Athènes y établit le gouvernement populaire, et la fertilité de celui de Lacédémone le gouvernement aristocratique .
Le fait est qu'Athènes était vingt fois plus riche que Lacédémone. A l'égard de la bonté du sol, il faut y avoir été pour l'apprécier. Mais jamais on n'attribua la forme d'un gouvernement au plus ou moins de fertilité d'un terrain. Venise avait très peu de blé quand les nobles gouvernèrent. Gènes n'a pas assurément un sol fertile, et c'est une aristocratie. Genève tient plus de l'Etat populaire, et n'a pas de son cru de quoi se nourrir quinze jours. La Suède pauvre a été longtemps sous le joug de la monarchie, tandis que la Pologne fertile fut une aristocratie. Je ne conçois pas comment on peut ainsi établir de prétendues règles continuellement démenties par l'expérience. Presque tout le livre, il faut l'avouer, est fondé sur des suppositions que la moindre attention détruirait.
La féodalité est un événement arrivé une fois dans le monde, et qui n'arrivera peut-être jamais, etc .
Nous trouvons la féodalité, les bénéfices militaires établis sous Alexandre Sévère, sous les rois lombards, sous Charlemagne, dans l'empire ottoman, en Perse, dans le Mogol, au Pégu; et en dernier lieu Catherine II impératrice de Russie a donné en fief pour quelque temps, la Moldavie que ses armes ont conquise.
Chez les Germains il y avait des vassaux et non pas des fiefs. Les fiefs étaient des chevaux de bataille, des armes, des repas .
Quelle idée! il n'y a point de vassalité sans terre. Un officier à qui son général aura donné à souper, n'est pas pour cela son vassal.
Du temps du roi Charles IX, il y avait vingt millions d'hommes en France .
Il donne Puffendorf pour garant de cette assertion; Puffendorf va jusqu'à vingt-neuf millions, et il avait copié cette exagération d'un de nos auteurs qui se trompait d'environ quatorze à quinze millions. La France ne comptait point alors au nombre de ses provinces la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la moitié de la Flandre, l'Artois, le Cambrésis, le Roussillon, le Béarn; et aujourd'hui qu'elle possède tous ces pays, elle n'a pas vingt millions d'habitants, suivant le dénombrement des feux exactement fait en 1751. Cependant, elle n'a jamais été si peuplée, et cela est prouvé par la quantité de terrains mis en valeur depuis Charles IX.
En Europe les empires n'ont jamais pu subsister .
Cependant l'empire romain s'y est maintenu cinq cents ans, et l'empire turc y domine depuis l'an 1453.
La cause de la durée des grands empires en Asie, c'est qu'il n'y a que de grandes plaines .
Il ne s'est pas souvenu des montagnes qui traversent la Natolie et la Syrie, du Caucase, du Taurus, de l'Ararat, de l'Immaüs, du Saron, dont les branches couvrent l'Asie.
En Espagne on a défendu les étoffes d'or et d'argent. Un pareil décret serait semblable à celui que feraient les états de Hollande, s'ils défendaient la consommation de la cannelle .
On ne peut faire une comparaison plus fausse, ni dire une chose moins politique. Les Espagnols n'avaient point de manufactures; ils auraient été obligés d'acheter ces étoffes de l'étranger. Les Hollandais, au contraire, sont les seuls possesseurs de la cannelle. Ce qui était raisonnable en Espagne, eût été absurde en Hollande.
Je n'entrerai point dans la discussion de l'ancien gouvernement des Francs vainqueurs des Gaulois; dans ce chaos de coutumes toutes bizarres, toutes contradictoires; dans l'examen de cette barbarie, de cette anarchie qui a duré si longtemps, et sur lesquelles il y a autant de sentiments différents que nous en avons en théologie. On n'a perdu que trop de temps à descendre dans ces abîmes de ruines. Et l'auteur de l' Esprit des lois a dû s'y égarer comme les autres.
Je viens à la grande querelle entre l'abbé Dubos, digne secrétaire de l'Académie française, et le président de Montesquieu, digne membre de cette Académie. Le membre se moque beaucoup du secrétaire, et le regarde comme un visionnaire ignorant. Il me paraît que l'abbé Dubos est très savant et très circonspect; il me paraît surtout que Montesquieu lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit, et cela selon sa coutume de citer au hasard et de citer faux.
Voici l'accusation portée par Montesquieu contre Dubos.
Monsieur l'abbé Dubos veut ôter toute espèce d'idée que les Francs soient entrés dans les Gaules en conquérants. Selon lui nos rois, appelés par les peuples, n'ont fait que se mettre à la place et succéder aux droits des empereurs romains .
Un homme plus instruit que moi a remarqué avant moi que jamais Dubos n'a prétendu que les Francs fussent partis du fond de leur pays pour venir se mettre en possession de l'empire des Gaules, par l'aveu des peuples, comme on va recueillir une succession. Dubos dit tout le contraire: il prouve que Clovis employa les armes, les négociations, les traités et même les concessions des empereurs romains, résidants à Constantinople, pour s'emparer d'un pays abandonné. Il ne le ravit point aux empereurs romains, mais aux barbares, qui sous Odoacre avaient détruit l'empire.
Dubos dit que dans quelque partie des Gaules voisine de la Bourgogne on désirait la domination des Francs: mais c'est précisément ce qui est attesté par Grégoire de Tours. Cum jam terror Francorum resonaret in his partibus, et omnes eos amore desiderabili cuperent regnare, sanctus Aprunculus Lingonicae civitatis Episcopus apud Burgundiones coepit haberi suspectus; cumque odium de die in diem cresceret, justum est ut clàm gladio feriretur . Greg. Tur. Hist. Lib. 2, cap. 23.
Montesquieu reproche à Dubos qu'il ne saurait montrer l'existence de la république armorique: cependant Dubos l'a prouvée incontestablement par plusieurs monuments, et surtout par cette citation exacte de l'historien Zozime, liv. 6, Totus tractus armorichus ceteraeque Gallorum provinciae Britannos imitatae, consimili se modo liberarunt, ejectis magistratibus romanis, et sibi quâdam republicâ pro arbitrio constitutâ .
Montesquieu regarde comme une grande erreur dans Dubos d'avoir dit que Clovis succéda à Childéric son père dans la dignité de maître de la milice romaine en Gaule: mais jamais Dubos n'a dit cela. Voici ses paroles. Clovis parvint à la couronne des Francs à l'âge de seize ans, et cet âge ne l'empêcha point d'être revêtu, peu de temps après, des dignités militaires de l'empire romain que Childéric avait exercées, et qui étaient selon l'apparence des emplois dans la milice . Dubos se borne ici à une conjecture qui devient ensuite une preuve évidente.
En effet, les empereurs étaient accoutumés depuis longtemps à la triste nécessité d'opposer des barbares à d'autres barbares, pour tâcher de les exterminer les uns par les autres. Clovis même eut à la fin la dignité de consul; il respecta toujours l'empire romain, même en s'emparant d'une de ses provinces. Il ne fit point frapper de monnaie en son propre nom; toutes celles que nous avons de Clovis sont de Clovis second; et les nouveaux rois francs ne s'attribuèrent cette marque de puissance indépendante qu'après que Justinien, pour se les attacher à lui, et pour les employer contre les Ostrogoths d'Italie, leur eut fait une cession des Gaules en bonne forme.
Montesquieu condamne sévèrement l'abbé Dubos sur la fameuse lettre de Rémi, évêque de Rheims, qui s'entendit toujours avec Clovis et qui le baptisa depuis. Voici cette lettre importante.
‘Nous apprenons de la renommée que vous vous êtes chargé de l'administration des affaires de la guerre, et je ne suis pas surpris de vous voir être ce que vos pères ont été. Il s'agit maintenant de répondre aux vues de la Providence, qui récompense votre modération, en vous élevant à une dignité si éminente. C'est la fin qui couronne l'oeuvre. Prenez donc pour vos conseillers des personnes dont le choix fasse honneur à votre discernement. Ne faites point d'exactions dans votre bénéfice militaire. Ne disputez point la préséance aux évêques dont les diocèses se trouvent dans votre département, et prenez leurs conseils dans les occasions. Tant que vous vivrez en bonne intelligence avec eux, vous trouverez toute sorte de facilité dans l'exercice de votre emploi, etc.'
On voit évidemment par cette lettre que Clovis, jeune roi des Francs, était officier de l'empereur Zénon; qu'il était grand-maître de la milice impériale, charge qui répond à celle de notre colonel général; que Rémi voulait le ménager, se liguer avec lui, le conduire et s'en servir comme d'un protecteur contre les prêtres eusébiens de la Bourgogne, et que par conséquent Montesquieu a grand tort de se moquer tant de l'abbé Dubos et de faire semblant de le mépriser. Mais enfin il vient un temps où la vérité s'éclaircit.
Après avoir vu qu'il y a des erreurs comme ailleurs dans l' Esprit des lois , après que tout le monde est convenu que ce livre manque de méthode, qu'il n'y a nul plan, nul ordre, et qu'après l'avoir lu on ne sait guère ce qu'on a lu, il faut rechercher quel est son mérite, et quelle est la cause de sa grande réputation.
C'est premièrement qu'il est écrit avec beaucoup d'esprit, et que tous les autres livres sur cette matière sont ennuyeux. C'est pourquoi, nous avons déjà remarqué, qu'une dame qui avait autant d'esprit que Montesquieu, disait que son livre était de l'esprit sur les lois . On ne l'a jamais mieux défini.
Une raison beaucoup plus forte encore, c'est que ce livre plein de grandes vues attaque la tyrannie, la superstition et la maltôte, trois choses que les hommes détestent. L'auteur console des esclaves en plaignant leurs fers; et les esclaves le bénissent.
Ce qui lui a valu les applaudissements de l'Europe, lui a valu aussi les invectives des fanatiques.
Un des ses plus acharnés et de ses plus absurdes ennemis, qui contribua le plus par ses fureurs à faire respecter le nom de Montesquieu dans l'Europe, fut le gazetier des convulsionnaires. Il le traita de spinosiste et de déiste , c'est-à-dire, il l'accusa de ne pas croire en Dieu, et de croire en Dieu.
Il lui reproche d'avoir estimé Marc-Aurèle, Epictète et les stoïciens, et de n'avoir jamais loué Jansénius, l'abbé de St Cyran et le père Quesnel.
Il lui fait un crime irrémissible d'avoir dit que Bayle est un grand homme.
Il prétend que l' Esprit des lois est un de ces ouvrages monstrueux, dont la France n'est inondée que depuis la bulle Unigenitus qui a corrompu toutes les consciences.
Ce gredin, qui de son grenier tirait au moins trois cents pour cent de sa gazette ecclésiastique, déclama comme un ignorant contre l'intérêt de l'argent au taux du roi. Il fut secondé par quelques cuistres de son espèce; ils finirent par ressembler aux esclaves qui sont aux pieds de la statue de Louis XIV; ils sont écrasés, et ils se mordent les mains.
Montesquieu a presque toujours tort avec les savants, parce qu'il ne l'était pas. Mais il a toujours raison contre les fanatiques et contre les promoteurs de l'esclavage. L'Europe lui en doit d'éternels remerciements.
On nous demande pourquoi donc nous avons relevé tant de fautes dans son ouvrage. Nous répondons, C'est parce que nous aimons la vérité à laquelle nous devons les premiers égards. Nous ajoutons que les fanatiques ignorants qui ont écrit contre lui avec tant d'amertume et d'insolence, n'ont connu aucune de ses véritables erreurs, et que nous révérons avec les honnêtes gens de l'Europe tous les passages après lesquels ces dogues du cimetière de St Médard ont aboyé.
LOIX.
Section quatriéme.
J'ai tenté de découvrir quelque rayon de lumière dans les temps mythologiques de la Chine qui précèdent Fohi, et j'ai tenté en vain.
Mais en m'en tenant à Fohi qui vivait environ trois mille ans avant l'ère nouvelle et vulgaire de notre Occident septentrional, je vois déjà des lois douces et sages établies par un roi bienfaisant. Les anciens livres des Cinq King , consacrés par le respect de tant de siècles, nous parlent de ses institutions d'agriculture, de l'économie pastorale, de l'économie domestique, de l'astronomie simple qui règle les saisons, de la musique qui, par des modulations différentes, appelle les hommes à leurs fonctions diverses. Ce Fohi vivait incontestablement il y a cinq mille ans. Jugez de quelle antiquité devait être un peuple immense qu'un empereur instruisait sur tout ce qui pouvait faire son bonheur. Je ne vois dans ces lois rien que de doux, d'utile et d'agréable.
On me montre ensuite le code d'un petit peuple qui arrive, deux mille ans après, d'un désert affreux sur les bords du Jourdain, dans un pays serré et hérissé de montagnes. Ses lois sont parvenues jusqu'à nous: on nous les donne tous les jours comme le modèle de la sagesse. En voici quelques-unes.
‘De ne jamais manger d'onocrotal, ni de charadre, ni de griffon, ni d'ixion, ni d'anguille, ni de lièvre, parce que le lièvre rumine et qu'il n'a pas le pied fendu.
‘De ne point coucher avec sa femme, quand elle a ses règles, sous peine d'être mis à mort l'un et l'autre.
‘D'exterminer sans miséricorde tous les pauvres habitants du pays de Canaan qui ne les connaissaient pas: d'égorger tout, de massacrer tout, hommes, femmes, vieillards, enfants, animaux, pour la plus grande gloire de Dieu.
‘D'immoler au Seigneur tout ce qu'on aura voué en anathème au Seigneur, et de le tuer sans pouvoir le racheter.
‘De brûler les veuves qui, n'ayant pu être remariées à leurs beaux-frères, s'en seraient consolées avec quelque autre Juif sur le grand chemin, ou ailleurs, etc. etc. etc.' [40]
Un jésuite, autrefois missionnaire chez les Cannibales, dans le temps que le Canada appartenait encore au roi de France, me contait qu'un jour, comme il expliquait ces lois juives à ses néophytes, un petit Français imprudent qui assistait au catéchisme, s'avisa de s'écrier: Mais voilà des lois de Cannibales . Un des citoyens lui répondit: Petit drôle, apprends que nous sommes d'honnêtes gens: nous n'avons jamais eu de pareilles lois. Et si nous n'étions pas gens de bien, nous te traiterions en citoyen de Canaan, pour t'apprendre à parler .
Il appert, par la comparaison du premier code chinois et du code hébraïque, que les lois suivent assez les moeurs des gens qui les ont faites. Si les vautours et les pigeons avaient des lois, elles seraient sans doute différentes.
LUXE. [p. 99]↩
Dans un pays où tout le monde allait pieds nus, le premier qui se fit faire une paire de souliers avait-il du luxe? n'était-ce pas un homme très sensé et très industrieux?
N'en est-il pas de même de celui qui eut la première chemise? pour celui qui la fit blanchir et repasser, je le crois un génie plein de ressources, et capable de gouverner un Etat.
Cependant, ceux qui n'étaient pas accoutumés à porter des chemises blanches, le prirent pour un riche efféminé qui corrompait la nation.
Gardez-vous du luxe, disait Caton aux Romains; vous avez subjugué la province du Phase; mais ne mangez jamais de faisans. Vous avez conquis le pays où croît le coton, couchez sur la dure. Vous avez volé à main armée l'or, l'argent et les pierreries de vingt nations, ne soyez jamais assez sots pour vous en servir. Manquez de tout après avoir tout pris. Il faut que les voleurs de grand chemin soient vertueux et libres.
Lucullus lui répondit, Mon ami, souhaite plutôt que Crassus, Pompée, César et moi nous dépensions tout en luxe. Il faut bien que les grands voleurs se battent pour le partage des dépouilles. Rome doit être asservie, mais elle le sera bien plus tôt et bien plus sûrement par l'un de nous si nous faisons valoir contre toi notre argent, que si nous le dépensons en superfluités et en plaisirs. Souhaite que Pompée et César s'appauvrissent assez pour n'avoir pas de quoi soudoyer des armées.
Il n'y a pas longtemps qu'un homme de Norvège reprochait le luxe à un Hollandais. Qu'est devenu, disait-il, cet heureux temps où un négociant partant d'Amsterdam pour les grandes Indes, laissait un quartier de boeuf fumé dans sa cuisine, et le retrouvait à son retour? Où sont vos cuillers de bois et vos fourchettes de fer? n'est-il pas honteux pour un sage Hollandais de coucher dans un lit de damas?
Va-t'en à Batavia, lui répondit l'homme d'Amsterdam; gagne comme moi dix tonnes d'or, et vois si l'envie ne te prendra pas d'être bien vêtu, bien nourri et bien logé.
Depuis cette conversation on a écrit vingt volumes sur le luxe, et ces livres ne l'ont ni diminué, ni augmenté.
MAHOMÉTANS. [p. 100]↩
Je vous le dis encore, ignorants imbéciles, à qui d'autres ignorants ont fait accroire que la religion mahométane est voluptueuse et sensuelle, il n'en est rien; on vous a trompés sur ce point comme sur tant d'autres.
Chanoines, moines, curés même, si on vous imposait la loi de ne manger ni boire depuis quatre heures du matin jusqu'à dix du soir, pendant le mois de juillet, lorsque le carême arriverait dans ce temps; si on vous défendait de jouer à aucun jeu de hasard sous peine de damnation; si le vin vous était interdit sous la même peine; s'il vous fallait faire un pèlerinage dans des déserts brûlants; s'il vous était enjoint de donner au moins deux et demi pour cent de votre revenu aux pauvres; si accoutumés à jouir de dix-huit femmes on vous en retranchait tout d'un coup quatorze; en bonne foi oseriez-vous appeler cette religion sensuelle?
Les chrétiens latins ont tant d'avantages sur les musulmans, je ne dis pas en fait de guerre, mais en fait de doctrine; les chrétiens grecs les ont tant battus en dernier lieu depuis 1769 jusqu'à 1773, que ce n'est pas la peine de se répandre en reproches injustes sur l'islamisme.
Tâchez de reprendre sur les mahométans tout ce qu'ils ont envahi; mais il est plus aisé de les calomnier.
Je hais tant la calomnie que je ne veux pas même qu'on impute des sottises aux Turcs, quoique je les déteste comme tyrans des femmes et ennemis des arts.
XII e vol., page 209. Je ne sais pourquoi l'historien du Bas-Empire prétend que Mahomet parle dans son Koran de son voyage dans le ciel: Mahomet n'en dit pas un mot; nous l'avons prouvé.
Il faut combattre sans cesse. Quand on a détruit une erreur, il se trouve toujours quelqu'un qui la ressuscite.
Voyez l'article Arot et Marot, et Alcoran .
MAÎTRE. [p. 101]↩
Que je suis malheureux d'être né! disait Ardassan Ougli, jeune icoglan du grand padicha des Turcs. Encore si je ne dépendais que du grand padicha. Mais je suis soumis au chef de mon oda, au capigi bachi; et quand je veux recevoir ma paye, il faut que je me prosterne devant un commis du tefterdar, qui m'en retranche la moitié. Je n'avais pas sept ans que l'on me coupa, malgré moi, en cérémonie, le bout de mon prépuce; et j'en fus malade quinze jours. Le derviche qui nous fait la prière est mon maître; un imam est encore plus mon maître; le mollah l'est encore plus que l'imam. Le cadi est un autre maître; le cadilesquier l'est davantage; le muphti l'est beaucoup plus que tous ceux-là ensemble. Le kiaïa du grand-vizir peut d'un mot me faire jeter dans le canal; et le grand-vizir enfin peut me faire serrer le col à son plaisir, et empailler la peau de ma tête, sans que personne y prenne seulement garde.
Que de maîtres! grand Dieu! quand j'aurais autant de corps et autant d'âmes que j'ai de devoirs à remplir, je n'y pourrais pas suffire. O Allah! que ne m'as-tu fait chat-huant! je vivrais libre dans mon trou, et je mangerais des souris à mon aise sans maître et sans valets. C'est assurément la vraie destinée de l'homme; il n'a des maîtres que depuis qu'il est perverti. Nul homme n'était fait pour servir continuellement un autre homme. Chacun aurait charitablement aidé son prochain, si les choses étaient dans l'ordre. Le clairvoyant aurait conduit l'aveugle; le dispos aurait servi de béquilles au cul-de-jatte. Ce monde aurait été le paradis de Mahomet; et il est l'enfer, qui se trouve précisément sous le pont-aigu.
Ainsi parlait Ardassan Ougli, après avoir reçu les étrivières de la part d'un de ses maîtres.
Ardassan Ougli, au bout de quelques années, devint bacha à trois queues. Il fit une fortune prodigieuse; et il crut fermement que tous les hommes, excepté le Grand Turc et le grand-vizir, étaient nés pour le servir, et toutes les femmes pour lui donner du plaisir selon ses volontés.
MALADIE. MÉDECINE. [p. 102]↩
Je suppose qu'une belle princesse qui n'aura jamais entendu parler d'anatomie, soit malade pour avoir trop mangé, trop dansé, trop veillé, trop fait tout ce que font plusieurs princesses; je suppose que son médecin lui dise, Madame, pour que vous vous portiez bien il faut que votre cerveau et votre cervelet distribuent une moelle allongée, bien conditionnée, dans l'épine de votre dos jusqu'au bout du croupion de votre altesse; et que cette moelle allongée aille animer également quinze paires de nerfs à droite, et quinze paires à gauche. Il faut que votre coeur se contracte et se dilate avec une force toujours égale, et que tout votre sang qu'il envoie à coups de piston dans vos artères, circule dans toutes ces artères et dans toutes les veines environ six cents fois par jour.
Ce sang, en circulant avec cette rapidité que n'a point le fleuve du Rhône, doit déposer sur son passage de quoi former et abreuver continuellement la lymphe, les urines, la bile, la liqueur spermatique de votre altesse, de quoi fournir à toutes ses sécrétions, de quoi arroser insensiblement votre peau douce, blanche et fraîche, qui sans cela serait d'un jaune grisâtre, sèche et ridée comme un vieux parchemin.
LA PRINCESSE
Eh bien, monsieur, le roi vous paie pour me faire tout cela; ne manquez pas de mettre toute chose à leur place, et de me faire circuler mes liqueurs de façon que je sois contente. Je vous avertis que je ne veux jamais souffrir.
LE MÉDECIN
Madame, adressez vos ordres à l'auteur de la nature. Le seul pouvoir qui fait courir des milliards de planètes et de comètes autour des millions de soleils, a dirigé la course de votre sang.
LA PRINCESSE
Quoi! vous êtes médecin, et vous ne pouvez rien me donner?
LE MÉDECIN
Non, madame, nous ne pouvons que vous ôter. On n'ajoute rien à la nature. Vos valets nettoient votre palais; mais l'architecte l'a bâti. Si votre altesse a mangé goulument, je puis déterger ses entrailles avec de la casse, de la manne et des follicules de séné; c'est un balai que j'y introduis, et je pousse vos matières. Si vous avez un cancer, je vous coupe un téton, mais je ne puis vous en rendre un autre. Avez-vous une pierre dans la vessie, je puis vous en délivrer au moyen d'un dilatoire; et je vous fais beaucoup moins de mal qu'aux hommes: je vous coupe un pied gangréné, et vous marchez sur l'autre. En un mot, nous autres médecins nous ressemblons parfaitement aux arracheurs de dents; ils vous délivrent d'une dent gâtée sans pouvoir vous en substituer une qui tienne, quelque charlatans qu'ils puissent être.
LA PRINCESSE
Vous me faites trembler. Je croyais que les médecins guérissaient tous les maux.
LE MÉDECIN
Nous guérissons infailliblement tous ceux qui se guérissent d'eux-mêmes. Il en est généralement et à peu d'exceptions près, des maladies internes comme des plaies extérieures. La nature seule vient à bout de celles qui ne sont pas mortelles. Celles qui le sont ne trouvent dans l'art aucune ressource.
LA PRINCESSE
Quoi! tous ces secrets pour purifier le sang dont m'ont parlé mes dames de compagnie! ce baume de vie du sieur le Lièvre, ces sachets du sieur Arnoud, toutes ces pilules vantées par leurs femmes de chambre?
LE MÉDECIN
LE MÉDECIN Autant d'inventions pour gagner de l'argent et pour flatter les malades pendant que la nature agit seule.
LA PRINCESSE
Mais il y a des spécifiques.
LE MÉDECIN
Oui, madame, comme il y a l'eau de Jouvence dans les romans.
LA PRINCESSE
En quoi donc consiste la médecine?
LE MÉDECIN
Je vous l'ai déjà dit, à débarrasser à nettoyer, à tenir propre la maison qu'on ne peut rebâtir.
LA PRINCESSE
Cependant il y a des choses salutaires, d'autres nuisibles.
LE MÉDECIN
Vous avez deviné tout le secret. Mangez, et modérément, ce que vous savez par expérience vous convenir. Il n'y a de bon pour le corps que ce qu'on digère. Quelle médecine vous fera digérer? l'exercice. Quelle réparera vos forces? le sommeil. Quelle diminuera des maux incurables? la patience. Qui peut changer une mauvaise constitution? rien. Dans toutes les maladies violentes nous n'avons que la recette de Molière, seignare, purgare , et si l'on veut, clisterium donare . Il n'y en a pas une quatrième. Tout cela n'est autre chose, comme je vous l'ai dit, que nettoyer une maison à laquelle nous ne pouvons ajouter une cheville. Tout l'art consiste dans l'à-propos.
LA PRINCESSE
Vous ne fardez point votre marchandise. Vous êtes honnête homme. Si je suis reine, je veux vous faire mon premier médecin.
LE MÉDECIN
Que votre premier médecin soit la nature. C'est elle qui fait tout. Voyez tous ceux qui ont poussé leur carrière jusqu'à cent années, aucun n'était de la faculté. Le roi de France a déjà enterré une quarantaine de ses médecins, tant premiers médecins que médecins de quartier et consultants.
LA PRINCESSE
Vraiment j'espère bien vous enterrer aussi.
MARIAGE.↩
SECTION PREMIÈRE. [p. 105]
J'ai rencontré un raisonneur qui disait: Engagez vos sujets à se marier le plus tôt qu'il sera possible; qu'ils soient exempts d'impôt la première année, et que leur impôt soit réparti sur ceux qui au même âge seront dans le célibat.
Plus vous aurez d'hommes mariés, moins il y aura de crimes. Voyez les registres affreux de vos greffes criminels; vous y trouvez cent garçons de pendus, ou de roués, contre un père de famille.
Le mariage rend l'homme plus vertueux et plus sage. Le père de famille, prêt de commettre un crime, est souvent arrêté par sa femme, qui, ayant le sang moins brûlé que lui, est plus douce, plus compatissante, plus effrayée du vol et du meurtre, plus craintive, plus religieuse.
Le père de famille ne veut pas rougir devant ses enfants. Il craint de leur laisser l'opprobre pour héritage.
Mariez vos soldats, ils ne déserteront plus. Liés à leur famille, ils le seront à leur patrie. Un soldat célibataire n'est souvent qu'un vagabond, à qui il serait égal de servir le roi de Naples et le roi de Maroc.
Les guerriers romains étaient mariés; ils combattaient pour leurs femmes et pour leurs enfants; et ils firent esclaves les femmes et les enfants des autres nations.
Un grand politique italien, qui d'ailleurs était fort savant dans les langues orientales, chose très rare chez nos politiques, me disait dans ma jeunesse: Caro figlio , souvenez-vous que les Juifs n'ont jamais eu qu'une bonne institution, celle d'avoir la virginité en horreur. Si ce petit peuple de courtiers superstitieux n'avait pas regardé le mariage comme la première loi de l'homme, s'il y avait eu chez lui des couvents de religieuses, il était perdu sans ressource.
SECTION SECONDE.
Le mariage est un contrat du droit des gens, dont les catholiques romains ont fait un sacrement.
Mais le sacrement et le contrat sont deux choses bien différentes; à l'un sont attachés les effets civils, à l'autre les grâces de l'Eglise.
Ainsi lorsque le contrat se trouve conforme au droit des gens, il doit produire tous les effets civils. Le défaut de sacrement ne doit opérer que la privation des grâces spirituelles.
Telle a été la jurisprudence de tous les siècles et de toutes les nations, excepté des Français. Tel a été même le sentiment des Pères de l'Eglise les plus accrédités.
Parcourons les codes théodosien et justinien, vous n'y trouverez aucune loi qui ait proscrit les mariages des personnes d'une autre croyance, lors même qu'ils avaient été contractés avec des catholiques.
Il est vrai que Constance, ce fils de Constantin aussi cruel que son père, défendit aux Juifs sous peine de mort, de se marier avec Code théod. tit. de Judaeis , loi VI. des femmes chrétiennes, et que Valentinien, Théodose, Arcade, firent la même défense, sous les mêmes peines aux femmes juives. Mais ces lois n'étaient déjà plus observées sous l'empereur Marcien; et Justinien les rejeta de son code. Elles ne furent faites d'ailleurs que contre les Juifs, et jamais on ne pensa de les appliquer aux mariages des païens ou des hérétiques avec les sectateurs de la religion dominante.
Lib. de Fide et operib . cap. XIX, n o . 35. Consultez St Augustin, il vous dira que de son temps on ne regardait pas comme illicites les mariages des fidèles avec les infidèles, parce qu'aucun texte de l'Evangile ne les avait condamnés. Quae matrimonia cum infidelibus nostris temporibus jam non putantur esse peccata; quoniam in novo Testamento, nihil inde praeceptum est, et ideo aut licere creditum est aut velut dubium derelictum .
Augustin dit de même, que ces mariages opèrent souvent la conversion de l'époux infidèle. Il cite l'exemple de son propre père, qui embrassa la religion chrétienne parce que sa femme Monique professait le christianisme. Clotilde par la conversion de Clovis, et Théodelinde par celle d'Agiluf roi des Lombards, furent plus utiles à l'Eglise que si elles eussent épousé des princes orthodoxes.
Consultez la déclaration du pape Benoît XIV du 4 novembre 1741, vous y lirez ces propres mots: Quod vero spectat ad ea conjugia quae absque formâ a Tridentino statuta, contrahuntur a catholicis cum haereticis, sive catholicus vir haereticam foeminam ducat, sive catholica foemina haeretico viro nubat. Si hujusmodi matrimonium sit contractum aut in posterum contrahi contingat, Tridentini formâ non servata, declarat sanctitas sua, alio non concurrente impedimento, validum habendum esse, sciens conjux, catholicus se istius matrimonii vinculo perpetuo ligatum .
Par quel étonnant contraste les lois françaises sont-elles sur cette matière plus sévères que celles de l'Eglise? la première loi qui ait établi ce rigorisme en France, est l'édit de Louis XIV du mois de novembre 1680. Cet édit mérite d'être rapporté.
‘Louis etc. Les canons des conciles ayant condamné les mariages des catholiques avec les hérétiques comme un scandale public, et une profanation du sacrement; nous avons estimé d'autant plus nécessaire de les empêcher à l'avenir, que nous avons reconnu que la tolérance de ces mariages expose les catholiques à une tentation continuelle de sa perversion etc. A ces causes etc. voulons et nous plaît, qu'à l'avenir nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine, ne puissent sous quelque prétexte que ce soit contracter mariage avec ceux de la religion prétendue réformée, déclarant tels mariages non valablement contractés, et les enfants qui en viendront illégitimes.'
Il est bien singulier que l'on se soit fondé sur les lois de l'Eglise pour annuler des mariages que l'Eglise n'annula jamais. Vous voyez dans cet édit le sacrement confondu avec le contrat civil; c'est cette confusion qui a été la source des étranges lois de France sur le mariage.
St Augustin approuvait les mariages des orthodoxes avec les hérétiques, parce qu'il espérait que l'époux fidèle convertirait l'autre; et Louis XIV les condamne dans la crainte que l'hétérodoxe ne pervertisse le fidèle!
Il existe en Franche-Comté une loi plus cruelle; c'est un édit de l'archiduc Albert et de son épouse Isabelle du 20 décembre 1599, qui fait défense aux catholiques de se marier à des hérétiques, à peine de confiscation de corps et de biens. [1]
Le même édit prononce la même peine contre ceux qui seront convaincus d'avoir mangé du mouton le vendredi ou le samedi. Quelles lois et quels législateurs!
A quels hommes, grand Dieu, livrez-vous l'univers!
SECTION TROISIEME.
Si nos lois réprouvent les mariages des catholiques avec les personnes d'une religion différente, accordent-elles au moins les effets civils aux mariages des Français protestants avec des Français de la même secte?
Cela est exagéré. On compte aujourd'hui dans le royaume un million de protestants, et cependant la validité de leur mariage est encore un problème dans les tribunaux.
C'est encore ici un des cas où notre jurisprudence se trouve en contradiction avec les décisions de l'Eglise, et avec elle-même.
Dans la déclaration papale citée dans la précédente section, Benoît XIV décide que les mariages des protestants contractés suivant leurs rites, ne sont pas moins valables que s'ils avaient été faits suivant les formes établies par le concile de Trente; et que l'époux qui devient catholique, ne peut rompre ce lien pour en former un autre avec une personne de sa nouvelle religion. [2]
Barac Levy, juif de naissance, et originaire d'Haguenau, s'y était marié avec Mendel-Cerf, de la même ville et de la même religion.
Ce juif vint à Paris en 1752, et se fit baptiser le 13 mai 1754. Il envoya sommer sa femme à Haguenau de venir le joindre à Paris. Dans une autre sommation il consentit que cette femme, en venant le joindre, continuât de vivre dans sa secte juive.
A ces sommations, Mendel-Cerf répondit qu'elle ne voulait point retourner avec lui, et qu'elle le requérait de lui envoyer, suivant les formes du judaïsme, un libelle de divorce, pour qu'elle pût se marier à un autre juif.
Cette réponse ne contentait pas Levy; il n'envoya point de libelle de divorce, mais il fit assigner sa femme devant l'official de Strasbourg, qui, par une sentence du 7 septembre 1754, le déclara libre de se marier en face de l'Eglise avec une femme catholique.
Muni de cette sentence, le juif christianisé vient dans le diocèse de Soissons, et y contracte des promesses de mariage avec une fille de Villeneuve. Le curé refuse de publier les bans. Levy lui fait signifier les sommations qu'il avait faites à sa femme, et la sentence de l'official de Strasbourg, et un certificat du secrétaire de l'évêché de la même ville, qui attestait que dans tous les temps il avait été permis dans le diocèse, aux juifs baptisés de se remarier à des catholiques, et que cet usage avait été constamment reconnu par le conseil souverain de Colmar.
Mais ces pièces ne parurent point suffisantes au curé de Villeneuve. Levy fut obligé de l'assigner devant l'official de Soissons.
Cet official ne pensa pas, comme celui de Strasbourg, que le mariage de Levy avec Mendel-Cerf fût nul ou dissoluble. Par sa sentence du 5 février 1756, il déclara le juif non recevable. Celui-ci appela de cette sentence au parlement de Paris, où il n'eut pour contradicteur que le ministère public; mais par arrêt du 2 janvier 1758 la sentence fut confirmée; et il fut défendu de nouveau à Levy de contracter aucun mariage pendant la vie de Mendel-Cerf.
Voilà donc un mariage contracté entre des Français juifs suivant les rites juifs, déclaré valable par la première cour du royaume.
Mais quelques années après la même question fut jugée différemment dans un autre parlement, au sujet d'un mariage contracté entre deux Français protestants, qui avaient été mariés en présence de leurs parents par un ministre de leur communion. L'époux protestant avait changé de religion comme l'époux juif. Et après avoir passé à un second mariage avec une catholique, le parlement de Grenoble confirma ce second mariage, et déclara nul le premier.
Si de la jurisprudence nous passons à la législation, nous la trouverons obscure sur cette matière importante comme dans tant d'autres.
Par un arrêt du conseil du 15 septembre 1685, il fut dit, ‘Que les protestants [3] pourraient se faire marier, pourvu toutefois que ce fût en présence du principal officier de justice, et que les publications qui devaient précéder ces mariages, se feraient au siège royal le plus prochain du lieu de la demeure de chacun des protestants, qui se voudraient marier, et seulement à l'audience.'
Cet arrêt ne fut point révoqué par l'édit qui trois semaines après supprima l'édit de Nantes.
Mais depuis la déclaration du 14 mai 1724, minutée par le cardinal de Fleuri, les juges n'ont plus voulu présider aux mariages des protestants, ni permettre dans leurs audiences la publication de leurs bans.
L'article XV de cette loi, veut que les formes prescrites par les canons soient observées dans les mariages, tant des nouveaux convertis que de tous les autres sujets du roi.
On a cru que cette expression générale, tous les autres sujets , comprenait les protestants comme les catholiques; et sur cette interprétation on a annulé les mariages des protestants qui n'avaient pas été revêtus des formes canoniques.
Cependant, il semble que les mariages des protestants ayant été autorisés autrefois par une loi expresse, il faudrait aujourd'hui, pour les annuler, une loi expresse qui portât cette peine. D'ailleurs, le terme de nouveaux convertis , mentionné dans la déclaration, paraît indiquer que le terme qui suit n'est relatif qu'aux catholiques. Enfin, quand la loi civile est obscure ou équivoque, les juges ne doivent-ils pas juger suivant le droit naturel et le droit des gens?
Ne résulte-t-il pas de ce qu'on vient de lire que souvent les lois ont besoin d'être réformées, et les princes de consulter un conseil plus instruit, de n'avoir point de ministre prêtre, et de se défier beaucoup des courtisans en soutane qui ont le titre de leurs confesseurs?
MARIE MAGDELAINE. [p. 111]↩
J'avoue que je ne sais pas où l'auteur de l'Histoire critique de Jésus-Christ [4] a trouvé que Ste Marie Magdelaine avait eu des complaisances criminelles pour le Sauveur du monde. Il dit page 130, ligne 11 de la note, que c'est une prétention des Albigeois. Je n'ai jamais lu cet horrible blasphème, ni dans l'histoire des Albigeois, ni dans leurs professions de foi. Cela est dans le grand nombre des choses que j'ignore. Je sais que les Albigeois avaient le malheur funeste de n'être pas catholiques romains; mais il me semble que d'ailleurs ils avaient le plus profond respect pour la personne de Jésus.
Cet auteur de l'Histoire critique de Jésus-Christ renvoie à la Christiade , espèce de poème en prose, supposé qu'il y ait des poèmes en prose. J'ai donc été obligé de consulter l'endroit de cette Christiade où cette accusation est rapportée. C'est au chant ou livre 4, page 335, note 1; le poète de la Christiade ne cite personne. On peut à la vérité, dans un poème épique, s'épargner les citations; mais il faut de grandes autorités en prose, quand il s'agit d'un fait aussi grave et qui fait dresser les cheveux à la tête de tout chrétien.
Que les Albigeois aient avancé ou non une telle impiété, il en résulte seulement que l'auteur de la Christiade se joue dans son chant IV e sur le bord du crime. Il imite un peu le fameux sermon de Menot. Il introduit sur la scène Marie Magdelaine soeur de Marthe et du Lazare, brillant de tous les charmes de la jeunesse et de la beauté, brûlant de tous les désirs, et plongée dans toutes les voluptés. C'est, selon lui, une dame de la cour; ses richesses égalent sa naissance, son frère le Lazare était comte de Béthanie, et elle marquise de Magdalet. Marthe eut un grand apanage, mais il ne nous dit pas où étaient ses terres. Elle avait , dit le christiadier, cent domestiques et une foule d'amants; elle eût attenté à la liberté de tout l'univers. Richesses, dignités, grandeurs ambitieuses, vous ne fûtes jamais si chères à Magdelaine, que la séduisante erreur qui lui fit donner le surnom de pécheresse. Telle était la beauté dominante dans la capitale, quand le jeune et divin héros y arriva des extrémités de la Galilée. Ses autres passions calmées cèdent à l'ambition de soumettre le héros dont on lui a parlé . Il n'y avait pas bien loin.
Alors le christiadier imite Virgile. La marquise de Magdalet conjure sa soeur l'apanagée de faire réussir ses desseins coquets auprès de son jeune héros, comme Didon employa sa soeur Anne auprès du pieux Enée.
Elle va entendre le sermon de Jésus dans le temple, quoiqu'il n'y prêchât jamais. Pag. 10, tom. III. Son coeur vole au-devant du héros qu'elle adore, elle n'attend qu'un regard favorable pour en triompher, et faire de ce maître des coeurs un captif soumis .
Enfin elle va le trouver chez Simon le lépreux, homme fort riche, qui lui donnait un grand souper, quoique jamais les femmes n'entrassent ainsi dans les festins, et surtout chez les pharisiens. Elle lui répand un grand pot de parfums sur les jambes, les essuie avec ses beaux cheveux blonds, et les baise.
Je n'examine pas si la peinture que fait l'auteur des saints transports de Magdelaine, n'est pas plus mondaine que dévote; si les baisers donnés sont exprimés avec assez de retenue; si ces beaux cheveux blonds dont elle essuie les jambes de son héros, ne ressemblent pas un peu trop à Trimalcion, qui à dîner s'essuyait les mains aux cheveux d'un jeune et bel esclave. Il faut qu'il ait pressenti lui-même qu'on pourrait trouver ses peintures trop lascives. Il va au-devant de la critique, en rapportant quelques morceaux d'un sermon de Massillon sur la Magdelaine. En voici un passage.
Christiade, tom. II, pag. 421, note 1. ‘Magdelaine avait sacrifié sa réputation au monde; sa pudeur et sa naissance la défendirent d'abord contre les premiers mouvements de sa passion; et il est à croire qu'aux premiers traits qui la frappèrent, elle opposa la barrière de sa pudeur et de sa fierté; mais lorsqu'elle eut prêté l'oreille au serpent et consulté sa propre sagesse, son coeur fut ouvert à tous les traits de la passion. Magdelaine aimait le monde, et dès lors il n'est rien qu'elle ne sacrifie à cet amour; ni cette fierté qui vient de la naissance, ni cette pudeur qui fait l'ornement du sexe ne sont épargnées dans ce sacrifice; rien ne peut la retenir, ni les railleries des mondains, ni les infidélités de ses amants insensés à qui elle veut plaire, mais de qui elle ne peut se faire estimer, car il n'y a que la vertu qui soit estimable; rien ne peut lui faire honte; et comme cette femme prostituée de l'Apocalypse, elle portait sur son front le nom de mystère , c'est-à-dire qu'elle avait levé le voile, et qu'on ne la connaissait plus qu'au caractère de sa folle passion'.
J'ai cherché ce passage dans les sermons de Massillon; il n'est certainement pas dans l'édition que j'ai. J'ose même dire plus, il n'est pas de son style.
Le christiadier aurait dû nous informer où il a pêché cette rhapsodie de Massillon, comme il aurait dû nous apprendre où il a lu que les Albigeois osaient imputer à Jésus une intelligence indigne de lui avec Magdelaine.
Au reste, il n'est plus question de la marquise dans le reste de l'ouvrage. L'auteur nous épargne son voyage à Marseille avec le Lazare, et le reste de ses aventures.
Qui a pu induire un homme savant et quelquefois éloquent, tel que le paraît l'auteur de la Christiade , à composer ce prétendu poème? c'est l'exemple de Milton, il nous le dit lui-même dans sa préface; mais on sait combien les exemples sont trompeurs. Milton qui d'ailleurs n'a point hasardé ce faible monstre d'un poème en prose; Milton qui a répandu de très beaux vers blancs dans son Paradis perdu , parmi la foule de vers durs et obscurs dont il est plein, ne pouvait plaire qu'à des whigs fanatiques, comme a dit Grécour,
Et chantant l'univers perdu pour une pomme,
Et Dieu pour le damner créant le premier homme.
Il a pu réjouir des presbytériens en faisant coucher le Péché avec la Mort, en tirant dans le ciel du canon de vingt-quatre, en faisant combattre le sec et l'humide, le froid et le chaud, en coupant en deux des anges qui se rentraient sur-le-champ, en bâtissant un pont sur le chaos, en représentant le Messiah qui prend dans une armoire du ciel un grand compas pour circonscrire la terre etc. etc. etc. etc. Virgile et Horace auraient peut-être trouvé ces idées un peu étranges. Mais si elles ont réussi en Angleterre à l'aide de quelques vers très heureux, le christiadier s'est trompé quand il a espéré du succès de son roman, sans le soutenir par de beaux vers, qui en vérité sont très difficiles à faire.
Mais, dit l'auteur, un Jérôme Vida évêque d'Albe, a fait jadis une très importante Christiade en vers latins, dans laquelle il a transcrit beaucoup de vers de Virgile. Eh bien, mon ami, pourquoi as-tu fait la tienne en prose française? que n'imitais-tu Virgile aussi?
Mais feu M. d'Escorbiac Toulousain a fait aussi une Christiade. Ah! malheureux, pourquoi t'es-tu fait le singe de feu M. d'Escorbiac?
Mais Milton a fait aussi son roman du Nouveau Testament, son Paradis reconquis en vers blancs, qui ressemblent souvent à la plus mauvaise prose. Va, va, laisse Milton mettre toujours aux prises Satan avec Jésus. C'est à lui qu'il appartient de faire conduire en grands vers dans la Galilée, un troupeau de deux mille cochons par une légion de diables, c'est-à-dire par six mille sept cents diables qui s'emparent de ces cochons (à trois diables et sept vingtièmes par cochon) et qui les noient dans un lac. C'est à Milton qu'il sied bien de faire proposer à Dieu par le diable, de faire ensemble un bon souper. Le diable, dans Milton, peut à son Paradis regain'd book II . aise couvrir la table d'ortolans, de perdrix, de soles, d'esturgeons, et faire servir à boire par Hébé et par Ganimède à Jésus-Christ. Le diable peut emporter Dieu sur une petite montagne, du haut de laquelle il lui montre le Capitole, les îles Moluques et la ville des Indes où naquit la belle Angélique qui fit tourner la tête à Roland. Après quoi le diable offre à Dieu de lui donner tout cela, pourvu que Dieu veuille l'adorer. Mais Milton a eu beau faire, on s'est moqué du pauvre frère Berruier le jésuite; on se moque de toi, prends la chose en patience.
Allons donc, fils de Dieu, mets-toi à table et mange.
What doub'st, thow son of god? sit down and eat .
MARTYRS. [p. 115]↩
SECTION PREMIERE.
Martyr, témoin, martyrion , témoignage. La société chrétienne naissante donna d'abord le nom de martyrs à ceux qui annonçaient nos nouvelles vérités devant les hommes, qui rendaient témoignage à Jésus, qui confessaient Jésus, comme on donna le nom de saint aux presbytes, aux surveillants de la société, et aux femmes leurs bienfaitrices; c'est pourquoi St Jérôme appelle souvent dans ses lettres, son affiliée Paule, sainte Paule. Et tous les premiers évêques s'appelaient saints .
Le nom de martyrs dans la suite ne fut plus donné qu'aux chrétiens morts ou tourmentés dans les supplices; et les petites chapelles qu'on leur érigea depuis reçurent le nom de martyrion .
C'est une grande question pourquoi l'empire romain autorisa toujours dans son sein la secte juive, même après les deux horribles guerres de Titus et d'Hadrien; pourquoi il toléra le culte isiaque à plusieurs reprises, et pourquoi il persécuta souvent le christianisme. Il est évident que les juifs qui payaient chèrement leurs synagogues, dénonçaient les chrétiens leurs ennemis mortels, et soulevaient les peuples contre eux. Il est encore évident que les juifs occupés du métier de courtiers et de l'usure, ne prêchaient point contre l'ancienne religion de l'empire, et que les chrétiens tous engagés dans la controverse prêchaient contre le culte public, voulaient l'anéantir, brûlaient souvent les temples, brisaient les statues consacrées, comme firent St Théodore dans Amasée, et St Polyeucte dans Mitilène.
Les chrétiens orthodoxes étant sûrs que leur religion était la seule véritable, n'en toléraient aucune autre. Alors on ne les toléra guère. On en supplicia quelques-uns qui moururent pour la foi, et ce furent les martyrs.
Ce nom est si respectable, qu'on ne doit pas le prodiguer; il n'est pas permis de prendre le nom et les armes d'une maison dont on n'est pas. On a établi des peines très graves contre ceux qui osent se décorer de la croix de Malthe ou de St Louis sans être chevaliers de ces ordres.
Le savant Dodwell, l'habile Midleton, le judicieux Blondel, l'exact Tillemont, le scrutateur Launoy et beaucoup d'autres, tous zélés pour la gloire des vrais martyrs, ont rayé de leur catalogue une multitude d'inconnus à qui l'on prodiguait ce grand nom. Nous avons observé que ces savants avaient pour eux l'aveu formel d'Origène, qui dans sa Réfutation de Celse , avoue qu'il y a eu peu de martyrs, et encore de loin à loin, et qu'il est facile de les compter.
Cependant, le bénédictin Ruinart, qui s'intitule Don Ruinart, quoiqu'il ne soit pas Espagnol, a combattu tant de savants personnages. Il nous a donné avec candeur beaucoup d'histoires de martyrs qui ont paru fort suspectes aux critiques. Plusieurs bons esprits ont douté de quelques anecdotes, concernant les légendes rapportées par Don Ruinart, depuis la première jusqu'à la dernière.
1°. STE. SIMPHOROSE ET SEPT ENFANS.
Les scrupules commencent par Ste Simphorose et ses sept enfants martyrisés avec elle, ce qui paraît d'abord trop imité des sept Macchabées. On ne sait pas d'où vient cette légende, et c'est déjà un grand sujet de doute.
On y rapporte que l'empereur Adrien voulut interroger lui-même l'inconnue Simphorose, pour savoir si elle n'était pas chrétienne. Les empereurs se donnaient rarement cette peine. Cela serait encore plus extraordinaire que si Louis XIV avait fait subir un interrogatoire à un huguenot. Vous remarquerez encore qu'Adrien fut le plus grand protecteur des chrétiens, loin d'être leur persécuteur.
Il eut donc une très longue conversation avec Simphorose; et se mettant en colère, il lui dit, Je te sacrifierai aux dieux , comme si les empereurs romains sacrifiaient des femmes dans leurs dévotions. Ensuite il la fit jeter dans l'Anio, ce qui n'était pas un sacrifice ordinaire. Puis il fit fendre un de ses fils par le milieu du front jusqu'au pubis, un second par les deux côtés; on roua un troisième, un quatrième ne fut que percé dans l'estomac, un cinquième droit au coeur, un sixième à la gorge; le septième mourut d'un paquet d'aiguilles enfoncées dans la poitrine. L'empereur Adrien aimait la variété. Il commanda qu'on les ensevelît auprès du temple d'Hercule, quoiqu'on n'enterrât personne dans Rome, encore moins près des temples; et que c'eût été une horrible profanation. Le pontife du temple (ajoute le légendaire) nomma le lieu de leur sépulture les sept Biotanates .
S'il était rare qu'on érigeât un monument dans Rome à des gens ainsi traités, il n'était pas moins rare qu'un grand-prêtre se chargeât de l'inscription, et même que ce prêtre romain leur fît une épitaphe grecque. Mais ce qui est encore plus rare, c'est qu'on prétende que ce mot biotanates signifie les sept suppliciés. Biotanates est un mot forgé, qu'on ne trouve dans aucun auteur. Et ce ne peut être que par un jeu de mots qu'on lui donne cette signification en abusant du mot thenon . Il n'y a guère de fable plus mal construite. Les légendaires ont su mentir, mais ils n'ont jamais su mentir avec art.
Le savant la Crose bibliothécaire du roi de Prusse Fréderic le Grand, disait, Je ne sais pas si Ruinart est sincère; mais j'ai peur qu'il ne soit imbécile.
2°. STE. FÉLICITÉ ET ENCOR SEPT ENFANS.
C'est de Surius qu'est tirée cette légende. Ce Surius est un peu décrié pour ses absurdités. C'est un moine du seizième siècle qui raconte les martyres du second, comme s'il avait été présent.
Il prétend que ce méchant homme, ce tyran Marc-Aurèle Antonin Pie, ordonna au préfet de Rome de faire le procès de Ste Félicité, de la faire mourir elle et ses sept enfants, parce qu'il courait un bruit qu'elle était chrétienne.
Le préfet tint son tribunal au champ de Mars, lequel pourtant ne servait alors qu'à la revue des troupes; et la première chose que fit le préfet, ce fut de lui faire donner un soufflet en pleine assemblée.
Les longs discours du magistrat et des accusés sont dignes de l'historien. Il finit par faire mourir les sept frères dans des supplices différents, comme les enfants de Ste Simphorose. Ce n'est qu'un double emploi. Mais pour Ste Félicité il la laisse là et n'en dit pas un mot.
3°. ST. POLYCARPE.
Eusèbe raconte que St Polycarpe ayant connu en songe qu'il serait brûlé dans trois jours, en avertit ses amis. Le légendaire ajoute, que le lieutenant de police de Smyrne nommé Hérode, le fit prendre par ses archers, qu'il fut livré aux bêtes dans l'amphithéâtre, que le ciel s'entr'ouvrit, et qu'une voix céleste lui cria, Bon courage, Polycarpe . Que l'heure de lâcher les lions sur l'amphithéâtre étant passée, on alla prendre dans toutes les maisons du bois, pour le brûler; que le saint s'adressa au Dieu des archanges , (quoique le mot d'archange ne fût point encore connu) qu'alors les flammes s'arrangèrent autour de lui en arc de triomphe sans le toucher; que son corps avait l' odeur d'un pain cuit ; mais qu'ayant résisté au feu, il ne put se défendre d'un coup de sabre; que son sang éteignit le bûcher, et qu'il en sortit une colombe qui s'envola droit au ciel. On ne sait pas précisément dans quelle planète.
4°.DE ST.PTOLOMÉE.
Nous suivons l'ordre de Don Ruinart; mais nous ne voulons point révoquer en doute le martyre de St Ptolomée qui est tiré de l'apologétique de St Justin.
Nous pourrions former quelques difficultés sur la femme accusée par son mari d'être chrétienne, et qui le prévint en lui donnant le libelle de divorce. Nous pourrions demander pourquoi dans cette histoire il n'est plus question de cette femme? Nous pourrions faire voir qu'il n'était pas permis aux femmes du temps de Marc-Aurèle de demander à répudier leurs maris, que cette permission ne leur fut donnée que sous l'empereur Julien; et que l'histoire tant répétée de cette chrétienne qui répudia son mari, (tandis qu'aucune païenne n'avait osé en venir là) pourrait bien n'être qu'une fable. Mais nous ne voulons point élever de disputes épineuses. Pour peu qu'il y ait de vraisemblance dans la compilation de Don Ruinart, nous respectons trop le sujet qu'il traite pour faire des objections.
Nous n'en ferons point sur la lettre des églises de Vienne et de Lyon, quoiqu'il y ait encore bien des obscurités. Mais on nous pardonnera de défendre la mémoire du grand Marc-Aurèle dans la vie de St Simphorien de la ville d'Autun, qui était probablement parent de Ste Simphorose.
5°. DE ST.SIMPHORIEN D'AUTUN.
La légende, dont on ignore l'auteur, commence ainsi. ‘L'empereur Marc-Aurèle venait d'exciter une effroyable tempête contre l'Eglise, et ses édits foudroyants attaquaient de tous côtés la religion de Jésus-Christ, lorsque St Simphorien vivait dans Autun dans tout l'éclat que peut donner une haute naissance et d'une rare vertu Il était d'une famille chrétienne, et l'une des plus considérables de la ville etc.'
Jamais Marc-Aurèle ne donna d'édit sanglant contre les chrétiens. C'est une calomnie très condamnable. Tillemont lui-même avoue, Que ce fut le meilleur prince qu'aient jamais eu les Romains; que son règne fut un siècle d'or; et qu'il vérifia ce qu'il disait souvent d'après Platon, que les peuples ne seraient heureux que quand les rois seraient philosophes .
De tous les empereurs ce fut celui qui promulgua les meilleures lois; il protégea tous les sages et ne persécuta aucun chrétien, dont il avait un grand nombre à son service.
Le légendaire raconte que St Simphorien ayant refusé d'adorer Cibèle, le juge de la ville demanda, Qui est cet homme-là? Or il est impossible que le juge d'Autun n'eût pas connu l'homme le plus considérable d'Autun.
On le fait déclarer par la sentence, coupable de lèse-majesté divine et humaine . Jamais les Romains n'ont employé cette formule, et cela seul ôterait toute créance au prétendu martyre d'Autun.
Pour mieux repousser la calomnie contre la mémoire sacrée de Marc-Aurèle, mettons sous les yeux le discours de Méliton évêque de Sarde, à ce meilleur des empereurs, rapporté mot à mot par Eusèbe.
Eusèbe, pag. 187, trad. de Cousin in-4o. ‘La suite continuelle des heureux succès qui sont arrivés à l'empire, sans que sa félicité ait été troublée par aucune disgrâce, depuis que notre religion qui était née avec lui s'est augmentée dans son sein, est une preuve évidente qu'elle contribue notablement à sa grandeur et à sa gloire. Il n'y a eu entre les empereurs que Néron et Domitien, qui étant trompés par certains imposteurs, ont répandu contre nous des calomnies, qui ont trouvé selon la coutume quelque créance parmi le peuple. Mais vos très pieux prédécesseurs ont corrigé l'ignorance de ce peuple, et ont réprimé par des édits publics la hardiesse de ceux qui entreprendraient de nous faire aucun mauvais traitement. Adrien, votre aïeul, a écrit en notre faveur à Fundanus gouverneur d'Asie, et à plusieurs autres. L'empereur votre père, dans le temps que vous partagiez avec lui les soins du gouvernement, a écrit aux habitants de Larisse, de Thessalonique, d'Athènes, et enfin à tous les peuples de la Grèce, pour réprimer les séditions et les tumultes qui avaient été excités contre nous.'
Ce passage d'un évêque très pieux, très sage et très véridique, suffit pour confondre à jamais tous les mensonges des légendaires, qu'on peut regarder comme la bibliothèque bleue du christianisme.
6°. D'UNE AUTRE STE. FÉLICITÉ ET STE. PERPÉTUE.
S'il était question de contredire la légende de Félicité et de Perpétue, il ne serait pas difficile de faire voir combien elle est suspecte. On ne connaît ces martyres de Carthage que par un écrit sans date de l'église de Salzbourg. Or il y a loin de cette partie de la Bavière à la Goulette. On ne nous dit pas sous quel empereur cette Félicité et cette Perpétue reçurent la couronne du dernier supplice. Les visions prodigieuses dont cette histoire est remplie, ne décèlent pas un historien bien sage. Une échelle toute d'or bordée de lances et d'épées, un dragon au haut de l'échelle, un grand jardin auprès du dragon, des brebis dont un vieillard tirait du lait, un réservoir plein d'eau, un flacon d'eau dont on buvait sans que l'eau diminuât; Ste Perpétue se battant toute nue contre un vilain Egyptien, de beaux jeunes gens tout nus qui prenaient son parti; elle-même enfin devenue homme et athlète très vigoureux. Ce sont là, ce me semble, des imaginations qui ne devraient pas entrer dans un ouvrage respectable.
Il y a encore une réflexion très importante à faire; c'est que le style de tous ces récits de martyres arrivés dans des temps si différents, est partout semblable, partout également puérile et ampoulé. Vous retrouvez les mêmes tours, les mêmes phrases dans l'histoire d'un martyre sous Domitien, et d'un autre sous Galérius. Ce sont les mêmes épithètes, les mêmes exagérations. Pour peu qu'on se connaisse en style, on voit qu'une même main les a tous rédigés.
Je ne prétends point ici faire un livre contre Don Ruinart; et en respectant toujours, en admirant, en invoquant les vrais martyrs avec la sainte Eglise, je me bornerai à faire sentir par un ou deux exemples frappants, combien il est dangereux de mêler ce qui n'est que ridicule avec ce qu'on doit vénérer.
7°. DE ST. THÉODOTE DE LA VILLE D'ANCIRE, ET DES SEPT VIERGES, ÉCRIT PAR NILUS TÉMOIN OCULAIRE, TIRÉ DE BOLLANDUS.
Plusieurs critiques, aussi éminents en sagesse qu'en vraie piété, nous ont déjà fait connaître que la légende de St Théodote le cabaretier est une profanation et une espèce d'impiété, qui aurait dû être supprimée. Voici l'histoire de Théodote. Nous emploierons souvent les propres paroles des Actes sincères recueillis par Don Ruinart.
Son métier de cabaretier lui fournissait les moyens d'exercer ses fonctions épiscopales. Cabaret illustre, consacré à la piété et non à la débauche. ... Tantôt Théodote était médecin, tantôt il fournissait de bons morceaux aux fidèles. On vit un cabaret être aux chrétiens, ce que l'arche de Noé fut à ceux que Dieu voulut sauver du déluge . [5]
Ce cabaretier Théodote se promenant près du fleuve Halis avec ses convives vers un bourg voisin de la ville d'Ancire. Un gazon frais et mollet leur présentait un lit délicieux; une source qui sortait à quelques pas de là au pied d'un rocher, et qui par une route couronnée de fleurs, venait se rendre auprès d'eux pour les désaltérer, leur offrait une eau claire et pure. Des arbres fruitiers mêlés d'arbres sauvages leur fournissaient de l'ombre et des fruits, et une bande de savants rossignols, que des cigales relevaient de temps en temps, y formaient un charmant concert, etc .
Le curé du lieu, nommé Fronton, étant arrivé, et le cabaretier ayant bu avec lui sur l'herbe, dont le vert naissant était relevé par les nuances diverses du divers coloris des fleurs , dit au curé, Ah, père, quel plaisir il y aurait à bâtir ici une chapelle! Oui , dit Fronton, mais il faut commencer par avoir des reliques. Allez, allez , reprit St Théodote, vous en aurez bientôt sur ma parole, et voici mon anneau que je vous donne pour gage, bâtissez vite la chapelle .
Le cabaretier avait le don de prophétie, et savait bien ce qu'il disait. Il s'en va à la ville d'Ancire, tandis que le curé Fronton se met à bâtir. Il y trouve la persécution la plus horrible, qui durait depuis très longtemps. Sept vierges chrétiennes, dont la plus jeune avait soixante et dix ans, venaient d'être condamnées, selon l'usage, à perdre leur pucelage par le ministère de tous les jeunes gens de la ville. La jeunesse d'Ancire, qui avait probablement des affaires plus pressantes, ne s'empressa pas d'exécuter la sentence. Il ne s'en trouva qu'un qui obéit à la justice. Il s'adressa à Ste Técuse, et la mena dans un cabinet avec une valeur étonnante. Técuse se jeta à ses genoux, et lui dit, Pour Dieu, mon fils, un peu de vergogne; voyez ces yeux éteints, cette chair demi-morte, ces rides pleines de crasse, que soixante et dix ans ont creusé sur mon front, ce visage couleur de terre. . . quittez des pensées si indignes d'un jeune homme comme vous, Jésus-Christ vous en conjure par ma bouche. Il vous le demande comme une grâce, et si vous la lui accordez vous pouvez attendre tout de sa reconnaissance . Ce discours de la vieille et son visage firent rentrer tout à coup l'exécuteur en lui-même. Les sept vierges ne furent point déflorées.
Le gouverneur irrité chercha un autre supplice; il les fit initier sur-le-champ aux mystères de Diane et de Minerve. Il est vrai qu'on avait institué de grandes fêtes en l'honneur de ces divinités; mais on ne connaît point dans l'antiquité les mystères de Minerve et de Diane. St Nil, intime ami du cabaretier Théodote, auteur de cette histoire merveilleuse, n'était pas au fait.
On mit, selon lui, les sept belles demoiselles, toutes nues sur le char qui portait la grande Diane et la sage Minerve au bord d'un lac voisin. Le Thucidide St Nil paraît encore ici fort mal informé. Les prêtresses étaient toujours couvertes d'un voile; et jamais les magistrats romains n'ont fait servir la déesse de la chasteté et celle de la sagesse par des filles qui montrassent aux peuples leur devant et leur derrière.
St Nil ajoute que le char était précédé par deux choeurs de ménades qui portaient le thyrse en main. St Nil a pris ici les prêtresses de Minerve pour celles de Bacchus. Il n'était pas versé dans la liturgie d'Ancire.
Le cabaretier en entrant dans la ville vit ce funeste spectacle, le gouverneur, les ménades, la charrette, Minerve, Diane et les sept pucelles. Il court se mettre en oraison dans une hutte avec un neveu de Ste Técuse. Il prie le ciel que ces sept dames soient plutôt mortes que nues. Sa prière est exaucée; il apprend que les sept filles au lieu d'être déflorées ont été jetées dans le lac, une pierre au cou, par ordre du gouverneur. Leur virginité est en sûreté. A cette nouvelle le saint se relevant de terre et se tenant sur les genoux, tourna ses yeux vers le ciel; et parmi les divers mouvements d'amour, de joie et de reconnaissance qu'il ressentait, il dit, Je vous rends grâces, Seigneur, de ce que vous n'avez pas rejeté la prière de votre serviteur .
Il s'endormit, et pendant son sommeil, Ste Técuse la plus jeune des noyées lui apparut. Eh quoi! mon fils Théodote , lui dit-elle, vous dormez sans penser à nous, avez-vous oublié si tôt les soins que j'ai pris de votre jeunesse? ne souffrez pas, mon cher Théodote, que nos corps soient mangés des poissons. Allez au lac, mais gardez-vous d'un traître .
Ce traître était le propre neveu de Ste Técuse.
J'omets ici une foule d'aventures miraculeuses qui arrivèrent au cabaretier pour venir à la plus importante. Un cavalier céleste armé de toutes pièces, précédé d'un flambeau céleste, descend du haut de l'empyrée, conduit au lac le cabaretier au milieu des tempêtes, écarte tous les soldats qui gardaient le rivage, et donne le temps à Théodote de repêcher les sept vieilles et de les enterrer.
Le neveu de Técuse alla malheureusement tout dire. On saisit Théodote, on essaya en vain pendant trois jours tous les supplices pour le faire mourir. On ne peut en venir à bout qu'en lui tranchant la tête; opération à laquelle les saints ne résistent jamais.
Il restait de l'enterrer. Son ami le curé Fronton, à qui Théodote en qualité de cabaretier avait donné deux outres remplis de bon vin, enivra les gardes et emporta le corps. Alors Théodote apparut en corps et en âme au curé; Eh bien, mon ami, lui dit-il, ne t'avais-je pas bien dit que tu aurais des reliques pour ta chapelle?
C'est là ce que rapporte St Nil, témoin oculaire, qui ne pouvait être ni trompé ni trompeur. C'est-là ce que transcrit Don Ruinart comme un acte sincère. Or tout homme sensé, tout chrétien sage, lui demandera si on s'y serait pris autrement pour déshonorer la religion la plus sainte, la plus auguste de la terre, et pour la tourner en ridicule.
Je ne parlerai point des onze mille vierges, je ne discuterai point la fable de la légion thébaine, composée, dit l'auteur, de six mille six cent hommes, tous chrétiens venant d'Orient par le mont Sts Bernard, martyrisée l'an 286, dans le temps de la paix de l'Eglise la plus profonde, et dans une gorge de montagne où il est impossible de mettre trois cents hommes de front; fable écrite plus de cent cinquante ans après l'événement; fable dans laquelle il est parlé d'un roi de Bourgogne qui n'existait pas; fable enfin reconnue pour absurde par tous les savants qui n'ont pas perdu la raison.
Je m'en tiendrai au prétendu martyre de St Romain.
8°. DU MARTYRE DE ST. ROMAIN.
St Romain voyageait vers Antioche; il apprend que le juge Asclepiade faisait mourir les chrétiens. Il va le trouver, et le défie de le faire mourir. Asclepiade le livre aux bourreaux: ils ne peuvent en venir à bout. On prend enfin le parti de le brûler. On apporte des fagots. Des juifs qui passaient se moquent de lui; ils lui disent que Dieu tira de la fournaise Sidrac, Misac et Abdenago; mais que Jésus-Christ laisse brûler ses serviteurs. Aussitôt il pleut, et le bûcher s'éteint.
L'empereur (qui cependant était alors à Rome, et non dans Antioche) dit, Que le ciel se déclare pour St Romain, et qu'il ne veut rien avoir à démêler avec le Dieu du ciel. Voilà , continue le légendaire, [6] notre Ananias délivré du feu aussi bien que celui des Juifs. Mais Asclepiade, homme sans honneur, fit tant par ses basses flatteries, qu'il obtint qu'on couperait la langue à St Romain. Un médecin qui se trouva là, coupe la langue au jeune homme, et l'emporte chez lui proprement enveloppée dans un morceau de soie .
L'anatomie nous apprend, et l'expérience le confirme, qu'un homme ne peut vivre sans langue .
Romain fut conduit en prison. On nous a lu plusieurs fois que le Saint Esprit descendit en langue de feu; mais St Romain qui balbutiait comme Moïse, tandis qu'il n'avait qu'une langue de chair, commença à parler distinctement dès qu'il n'en eut plus .
On alla conter le miracle à Asclepiade comme il était avec l'empereur. Ce prince soupçonna le médecin de l'avoir trompé; le juge menaça le médecin de le faire mourir. Seigneur , lui dit-il, j'ai encore chez moi la langue que j'ai coupée à cet homme; ordonnez qu'on m'en donne un qui ne soit pas comme celui-ci sous une protection particulière de Dieu, permettez que je lui coupe la langue jusqu'à l'endroit où celle-ci a été coupée; s'il n'en meurt pas, je consens qu'on me fasse mourir moi-même. Là-dessus on fait venir un homme condamné à mort; et le médecin ayant pris la mesure sur la langue de Romain, coupe à la même distance celle du criminel; mais à peine avait-il retiré son rasoir que le criminel tombe mort. Ainsi le miracle fut avéré à la gloire de Dieu, et à la consolation des fidèles .
Voilà ce que Don Ruinart raconte sérieusement; prions Dieu pour le bon sens de Don Ruinart.
SECTION SECONDE.
Extrait d'une lettre écrite à un docteur apologiste de Don Ruinart.
1°.
Vous parlez toujours de martyrs. Eh! Monsieur, ne sentez-vous pas combien cette misérable preuve s'élève contre nous. Insensés et cruels que nous sommes, quels barbares ont jamais fait plus de martyrs que nos barbares ancêtres? Ah! Monsieur, vous n'avez donc pas voyagé! vous n'avez pas vu à Constance la place où Jérôme de Prague dit à un des bourreaux du concile qui voulait allumer son bûcher par derrière, Allume par devant; si j'avais craint les flammes, je ne serais pas venu ici .
Avez-vous jamais passé dans Paris par la Grève, où le conseiller-clerc Anne Dubourg neveu du chancelier, chanta des cantiques avant son supplice? Savez-vous qu'il fut exhorté à cette héroïque constance par une jeune femme de qualité nommée Madame de la Caille, qui fut brûlée quelques jours après lui? Elle était chargée de fers dans un cachot voisin du sien, et ne recevait le jour que par une petite grille pratiquée en haut dans le mur qui séparait ces deux cachots. Cette femme entendait le conseiller qui disputait sa vie contre ses juges par les formes des lois. Laissez-là , lui cria-t-elle, ces indignes formes, craignez-vous de mourir pour votre Dieu?
Voilà ce qu'un indigne historien tel que le jésuite Daniel n'a garde de rapporter, et ce que d'Aubigné et les contemporains nous certifient.
Faut-il vous montrer ici la foule de ceux qui furent exécutés à Lyon dans la place des Terraux depuis 1546? Faut-il vous faire voir Mlle de Cagnon suivant dans une charrette cinq autres charrettes chargées d'infortunés condamnés aux flammes, parce qu'ils avaient le malheur de ne pas croire qu'un homme pût changer du pain en Dieu? Cette fille malheureusement persuadée que la religion réformée est la véritable, avait toujours répandu des largesses parmi les pauvres de Lyon. Ils entouraient en pleurant la charrette où elle était traînée chargée de fers. Hélas! lui criaient-ils, nous ne recevrons plus d'aumône de vous. Eh bien , dit-elle, vous en recevrez encore , et elle leur jeta ses mules de velours que ses bourreaux lui avaient laissées.
Avez-vous vu la place de l'Estrapade à Paris? elle fut couverte sous François I er de corps réduits en cendre. Savez-vous comme on les faisait mourir? on les suspendait à de longues bascules qu'on élevait et qu'on baissait tour à tour sur un vaste bûcher, afin de leur faire sentir plus longtemps toutes les horreurs de la mort la plus douloureuse. On ne jetait ces corps sur les charbons ardents que lorsqu'ils étaient presque entièrement rôtis, et que leurs membres retirés, leur peau sanglante et consumée, leurs yeux brûlés, leur visage défiguré ne leur laissaient plus l'apparence de la figure humaine.
Le jésuite Daniel suppose sur la foi d'un infâme écrivain de ce temps-là, que François I er dit publiquement qu'il traiterait ainsi le dauphin son fils s'il donnait dans les opinions des réformés. Personne ne croira qu'un roi qui ne passait pas pour un Néron, ait jamais prononcé de si abominables paroles. Mais la vérité est que tandis qu'on faisait à Paris ces sacrifices de sauvages qui surpassent tout ce que l'Inquisition a jamais fait de plus horrible, François I er plaisantait avec ses courtisans, et couchait avec sa maîtresse. Ce ne sont pas là, Monsieur, de ces histoires de Ste Potamienne, de Ste Ursule et des onze mille vierges; c'est un récit fidèle de ce que l'histoire a de moins incertain.
Un de vos ancêtres, du moins un homme de votre nom, Pierre Bergier, fut brûlé à Lyon en 1552 avec René Poyet parent du chancelier Poyet. On jeta dans le même bûcher Jean Chambon, Louis Dimonet, Louis De Marsac, Etienne De Gravot, et cinq jeunes écoliers. Je vous ferais trembler si je vous faisais voir la liste des martyrs que les protestants ont conservée.
Pierre Bergier chantait un psaume de Marot en allant au supplice. Dites-nous en bonne foi si vous chanteriez un psaume latin en pareil cas? Dites-nous si le supplice de la potence, de la roue ou du feu est une preuve de la religion. C'est une preuve sans doute de la barbarie religieuse. C'est une preuve que d'un côté il y a des bourreaux, et de l'autre des persuadés.
Les vallées du Piémont auprès de Pignerol étaient habitées de temps immémorial par ces malheureux persuadés. On leur envoie en 1655 des missionnaires et des assassins. Lisez la Relation de Morland alors ministre d'Angleterre à la cour de Turin. Vous y verrez un Jean Brocher auquel on coupa le membre viril qu'on mit entre les dents de sa tête coupée plantée sur une pique pour servir de signal.
Marthe Basal, dont on tua les enfants sur son ventre; après quoi on lui coupa les mamelles qu'on fit cuire au cabaret de Macel, et dont on fit manger aux passants.
Pierre Simon et sa femme, âgés de quatre-vingts ans, liés et roulés ensemble, et précipités de rocher en rocher.
Anne Charbonnier violée, et ensuite empalée par la partie même dont on venait de jouir, portée sur le grand chemin pour servir de croix, selon l'usage de ce pays, où il faut des croix à tous les carrefours.
Le détail de ces horreurs vous fait dresser les cheveux; mais la multiplicité en est si grande qu'elle ennuie. On faisait périr ainsi des milliers d'imbéciles, en leur disant qu'il fallait entendre la messe en latin. Il était bien clair qu'étant déchirés en morceaux ils ne pouvaient avoir le bonheur d'aller à la messe.
Ah, Monsieur, si vous voulez rendre la religion chrétienne aimable, ne parlez jamais de martyrs. Nous en avons fait cent fois, mille fois plus que tous les paiens. Nous ne voulons point répéter ici ce qu'on a tant dit des massacres des Albigeois, des habitants de Mérindol, de la St Barthélemi, de soixante ou quatre-vingt mille Irlandais protestants égorgés, assommés, pendus, brûlés par les catholiques; de ces millions d'Indiens tués comme des lapins dans des garennes aux ordres de quelques moines. Nous frémissons, nous gémissons; mais il faut le dire; parler de martyrs à des chrétiens, c'est parler de gibets et de roues à des bourreaux et à des records.
Que pourrions-nous vous représenter encore, Monsieur, après ce tableau aussi vrai qu'épouvantable que vous nous avez forcés de vous tracer de nos mains tremblantes? Oui, à la honte de la nature, il y a encore des fanatiques assez barbares, des hommes assez dignes de l'enfer, pour dire qu'il faut faire périr dans les supplices tous ceux qui ne croient pas à la religion chrétienne que l'on a tant déshonorée. C'est ainsi que pensent encore les inquisiteurs, tandis que les rois et leurs ministres devenus plus humains, émoussent dans toute l'Europe le fer dont ces monstres sont armés. Un évêque en Espagne a proféré ces paroles devant des témoins respectables de qui nous les tenons, Le ministre d'Etat qui a signé l'expulsion des jésuites mérite la mort . Nous avons vu des gens qui ont toujours à la bouche ces mots cruels contrainte et châtiment , et qui disent hautement que le christianisme ne peut se conserver que par la terreur et par le sang.
Je ne veux pas vous citer ici un autre évêque de la plus basse naissance, qui séduit par un fanatique, s'est expliqué avec plus de fureur qu'on n'en a jamais reproché aux Dioclétiens et aux Décius.
La terre entière s'est élevée contre les jésuites, parce qu'ils étaient persécuteurs; mais qu'il se trouve quelque prince assez peu éclairé, assez mal conseillé, assez faible pour donner sa confiance à un capucin, à un cordelier, vous verrez les cordeliers et les capucins aussi insolents, aussi intrigants, aussi persécuteurs, aussi ennemis de la puissance civile que les jésuites l'ont été. Il faut que la magistrature soit partout occupée sans cesse à réprimer les attentats des moines. Il y a maintenant dans Paris un cordelier qui prêche avec la même impudence et la même fureur que le cordelier Feu-Ardent prêchait du temps de la Ligue.
Quel homme a jamais été plus persécuteur chez ces mêmes cordeliers que leur prédicateur Poisson? Il exerça sur eux un pouvoir si tyrannique, que le ministère fut obligé de le faire déposer de sa place de provincial et de l'exiler. Que n'eût-il point fait contre les laïques? Mais cet ardent persécuteur était-il un homme persuadé, un fanatique de religion? Non, c'était le plus hardi débauché qui fût dans tout l'ordre. Il ruina le grand couvent de Paris en filles de joie. Le procès de la femme Du Moutier qui redemanda quatre mille francs après la mort de ce moine, existe encore au greffe de la Tournelle criminelle. Percez la muraille du parvis avec Ezéchiel, vous verrez des serpents, des monstres et l'abomination de la maison d'Israël.
SECTION TROISIEME.
Comment se peut-il que dans le siècle éclairé où nous sommes, on trouve encore des écrivains savants et utiles, qui suivent pourtant le torrent des vieilles erreurs, et qui gâtent des vérités par des fables reçues? ils comptent encore l'ère des martyrs de la première année de l'empire de Dioclétien, qui était alors bien éloigné de martyriser personne. Ils oublient que sa femme Prisca était chrétienne, que les principaux officiers de sa maison étaient chrétiens, qu'il les protégea constamment pendant dix-huit années; qu'ils bâtirent dans Nicomédie une église plus somptueuse que son palais, et qu'ils n'auraient jamais été persécutés s'ils n'avaient outragé le césar Galérius.
Est-il possible qu'on ose redire encore que Dioclétien mourut de rage, de désespoir et de misère , lui qu'on vit quitter la vie en philosophe comme il avait quitté l'empire, lui qui sollicité de reprendre la puissance suprême, aima mieux cultiver ses beaux jardins de Salone que de régner encore sur l'univers alors connu?
O compilateurs, ne cesserez-vous point de compiler! vous avez utilement employé vos trois doigts, employez plus utilement votre raison.
Quoi! vous me répétez que St Pierre régna sur les fidèles à Rome pendant vingt-cinq ans, et que Néron le fit mourir la dernière année de son empire lui et St Paul, pour venger la mort de Simon le Magicien à qui ils avaient cassé les jambes par leurs prières!
C'est insulter le christianisme que de rapporter ces fables, quoique avec une très bonne intention.
Les pauvres gens qui redisent encore ces sottises sont des copistes qui remettent en octavo ou en in-douze d'anciens in-folio que les honnêtes gens ne lisent plus, et qui n'ont jamais ouvert un livre de saine critique. Ils ressassent les vieilles histoires de l'Eglise; ils ne connaissent ni Midleton, ni Dodwel, ni Bruker, ni Dumoulin, ni Fabricius, ni Grabès, ni même Dupin, ni aucun de ceux qui ont porté depuis peu la lumière dans les ténèbres.
MASSACRES. [p. 131]↩
ARTICLE DE MR. TRENCHARD.
Il est peut-être aussi difficile qu'inutile de savoir si mazzacrium , mot de la basse latinité, a fait massacre, ou si massacre a fait mazzacrium .
Un massacre signifie un nombre d'hommes tués. Il y eut hier un grand massacre près de Varsovie, près de Cracovie . On ne dit point, il s'est fait le massacre d'un homme ; et cependant on dit, un homme a été massacré ; en ce cas on entend qu'il a été tué de plusieurs coups avec barbarie.
La poésie se sert du mot massacré pour tué, assassiné.
Que par ses propres mains son père massacré.
CINNA.
Un Anglais a fait un relevé de tous les massacres perpétrés pour cause de religion depuis les premiers siècles de notre ère vulgaire. En voici la traduction.
Les chrétiens avaient déjà excité quelques troubles à Rome lorsque l'an 251 de notre ère vulgaire, le prêtre Novatien disputa ce que nous appelons la chaire de Rome , la papauté au prêtre Corneille: car c'était déjà une place importante qui valait beaucoup d'argent. Et précisément dans le même temps la chaire de Carthage fut disputée de même par Cyprien et un autre prêtre nommé Novat qui avait tué sa femme à coups de pied dans le ventre. Ces Histoire ecclésiastique . deux schismes occasionnèrent beaucoup de meurtres dans Carthage et dans Rome. L'empereur Décius fut obligé de réprimer ces fureurs par quelques supplices, c'est ce qu'on appelle la grande , la terrible persécution de Décius. Nous n'en parlerons pas ici; nous nous bornons aux meurtres commis par les chrétiens sur d'autres chrétiens. Quand nous ne compterons que deux cents personnes tuées ou grièvement blessées dans ces deux premiers schismes qui ont été le modèle de tant d'autres, nous croyons que cet article ne sera pas trop fort.
Posons donc ... 200.
Dès que les chrétiens peuvent se livrer impunément Année 314. à leurs vengeances sous Constantin, ils assassinent le jeune Candidien fils de l'empereur Galère, l'espérance de l'empire, et que l'on comparait à Marcellus; un enfant de huit ans fils de l'empereur Maximin; une fille du même empereur âgée de sept ans; l'impératrice leur mère fut traînée hors de son palais avec ses femmes dans les rues d'Antioche, et furent jetées avec elle dans l'Oronte. L'impératrice Valérie veuve de Galère et fille de Dioclétien fut tuée à Thessalonique en 315, et eut la mer pour sépulture.
Il est vrai que quelques auteurs n'accusent pas les chrétiens de ce meurtre, et l'imputent à Licinius; mais réduisons encore le nombre de ceux que les chrétiens égorgèrent dans cette occasion à deux cent. Ce n'est pas trop.
ci. ... 200.
Dans le schisme des donatistes en Afrique, on ne peut guère compter moins de quatre cents personnes assommées à coups de massues, car les évêques ne voulaient pas qu'on se battît à coups d'épées.
pose ... 400.
On sait de quelles horreurs et de combien de guerres civiles le seul mot de consubstantiel fut l'origine et le prétexte. Cet incendie embrasa tout l'empire à plusieurs reprises et se ralluma dans toutes les provinces dévastées par les Goths, les Bourguignons, les Vandales pendant près de quatre cents années. Quand nous ne mettrons que trois cent mille chrétiens égorgés par des chrétiens pour cette querelle, sans compter les familles errantes réduites à la mendicité, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir enflé nos comptes.
ci. ... 300000.
La querelle des iconoclastes et des iconolâtres n'a pas certainement coûté moins de soixante mille vies.
... 60000
Nous ne devons pas passer sous silence les cent mille manichéens que l'impératrice Théodora, veuve de Théophile, fit égorger dans l'empire grec en 845. C'était une pénitence que son confesseur lui avait ordonnée, parce que jusqu'à cette époque on n'en avait encore pendu, empalé, noyé que vingt mille. Ces gens-là méritaient bien qu'on les tuât tous pour leur apprendre qu'il n'y a qu'un bon principe et point de mauvais. Le tout se monte à cent vingt mille au moins.
ci. ... 120000
N'en comptons que vingt mille dans les séditions fréquentes excitées par les prêtres qui se disputèrent partout des chaires épiscopales. Il faut avoir une extrême discrétion.
pose. ... 20000
On a supputé que l'horrible folie des saintes croisades avait coûté la vie à deux millions de chrétiens. Mais je veux bien par la plus étonnante réduction qu'on ait jamais faite les réduire à un million.
ci. ... 1000000
La croisade des religieux chevaliers porte-glaives, qui dévastèrent si honnêtement et si saintement tous les bords de la mer Baltique, doit aller au moins à cent mille morts.
ci. ... 100000
Autant pour la croisade contre le Languedoc, où l'on ne vit longtemps que les cendres des bûchers et des ossements de morts dévorés par les loups dans les campagnes.
ci. ... 100000
Pour les croisades contre les empereurs depuis Grégoire VII, nous voulons bien n'en compter que trois cent mille.
ci. ... 300000
Le grand schisme d'Occident au quatorzième siècle fit périr assez de monde pour qu'on rende justice à notre modération, si nous ne comptons que cinquante mille victimes de la rage papale, rabbia papale , comme disent les Italiens.
ci. ... 50000
La dévotion avec laquelle on fit brûler à la fin de ce grand schisme dans la ville de Constance les deux prêtres Jean Hus et Jérôme de Prague, fit beaucoup d'honneur à l'empereur Sigismond et au concile; mais elle causa, je ne sais comment, la guerre des hussites, dans laquelle nous pouvons compter hardiment cent cinquante mille morts.
ci. ...150000
Après ces grandes boucheries, nous avouons que les massacres de Mérindol et de Cabrières sont bien peu de chose. Il ne s'agit que de vingt-deux gros bourgs mis en cendres, de dix-huit mille innocents égorgés, brûlés, d'enfants à la mamelle jetés dans les flammes, de filles violées et coupées ensuite par quartiers, de vieilles femmes qui n'étaient plus bonnes à rien et qu'on faisait sauter en l'air en leur enfonçant des cartouches chargées de poudre dans leurs deux orifices. Mais comme cette petite exécution fut faite juridiquement, avec toutes les formalités de la justice, par des gens en robe, il ne faut pas omettre cette partie du droit français;
pose donc. ... 18000
Nous voici parvenus à la plus sainte, à la plus glorieuse époque du christianisme que quelques gens sans aveu voulurent réformer au commencement du seizième siècle. Les saints papes, les saints évêques, les saints abbés ayant refusé de s'amender, les deux partis marchèrent sur des corps morts pendant deux siècles entiers, et n'eurent que quelques intervalles de paix.
Si l'ami lecteur voulait bien se donner la peine de mettre ensemble tous les assassinats commis depuis le règne du saint pape Léon X jusqu'à celui du saint pape Clément IX, assassinats soit juridiques, soit non juridiques, têtes de prêtres, de séculiers, de princes abattues par le bourreau, le bois renchéri dans plusieurs provinces par la multitude des bûchers allumés, le sang répandu d'un bout de l'Europe à l'autre, les bourreaux lassés en Flandre, en Allemagne, en Hollande, en France, en Angleterre même, trente guerres civiles pour la transsubstantiation, la prédestination, le surplis et l'eau bénite, les massacres de la St Barthélemi, les massacres d'Irlande, les massacres des Vaudois, les massacres des Cévennes etc. etc. etc. etc., on trouverait sans doute plus de deux millions de morts sanglantes avec plus de trois millions de familles infortunées, plongées dans une misère pire, peut-être, que la mort. Mais comme il ne s'agit ici que de morts, passons vite avec horreur, deux millions.
ci. ... 2000000
Ne soyons point injustes, n'imputons point à l'Inquisition plus de crimes qu'elle n'en a commis en surplis et en étole; n'exagérons rien, réduisons à deux cent mille le nombre des âmes qu'elle a envoyées au ciel ou en enfer.
ci. ... 200000
Réduisons même à cinq millions les douze millions d'hommes que l'évêque Las Casas prétend avoir été immolés à la religion chrétienne dans l'Amérique: et faisons surtout la réflexion consolante qu'ils n'étaient pas des hommes, puisqu'ils n'étaient pas chrétiens.
ci. ... 5000000
Réduisons avec la même économie les quatre cent mille hommes qui périrent dans la guerre civile du Japon, excitée par les révérends pères jésuites, ne portons notre compte qu'à trois cent mille.
ci. ... 300000
Total 9718800
Le tout calculé ne montera qu'à la somme de neuf millions sept cent dix-huit mille huit cents personnes, ou égorgées, ou noyées, ou brûlées, ou rouées, ou pendues pour l'amour de Dieu.
Qui que tu sois, lecteur, si tu conserves les archives de ta famille, consulte-les, et tu verras que tu as eu plus d'un ancêtre immolé au prétexte de la religion, ou du moins cruellement persécuté (ou persécuteur, ce qui est encore plus funeste): t'appelles-tu Argile, ou Perth, ou Montrose, ou Hamilton, ou Douglas, souviens-toi qu'on arracha le coeur à tes pères sur un échafaud pour la cause d'une liturgie et de deux aunes de toile. Es-tu Irlandais? Lis seulement la déclaration du parlement d'Angleterre du 25 juillet 1643; elle dit que dans la conjuration d'Irlande il périt cent cinquante-quatre mille protestants par les mains des catholiques. Crois, si tu veux, avec l'avocat Brooke, qu'il n'y eut que quarante mille hommes d'égorgés sans défense, dans le premier mouvement de cette sainte et catholique conspiration. Mais quelle que soit ta supputation, tu descends des assassins ou des assassinés. Choisi et tremble. Mais toi, prélat de mon pays, réjouis-toi, notre sang t'a valu cinq mille guinées de rente.
J'ai été fortement tenté d'écrire contre cet auteur anglais; mais son mémoire ne m'ayant point paru enflé, je me suis retenu. Au reste, j'espère qu'on n'aura plus de pareils calculs à faire. Mais à qui en aura-t-on l'obligation?
MATIÈRE. [p. 136]↩
Dialogue poli entre un énergumène & un philosophe.
L'ÉNERGUMÈNE.
Oui, ennemi de Dieu et des hommes, qui crois que Dieu est tout-puissant, et qu'il est le maître d'ajouter le don de la pensée à tout être qu'il daignera choisir, je vais te dénoncer à monseigneur l'inquisiteur, je te ferai brûler; prends garde à toi, je t'avertis pour la dernière fois.
LE PHILOSOPHE.
Sont-ce là vos arguments? est-ce ainsi que vous enseignez les hommes? j'admire votre douceur.
L'ÉNERGUMÈNE.
Allons, je veux bien m'apaiser un moment en attendant les fagots. Réponds-moi, qu'est-ce que l'esprit?
LE PHILOSOPHE.
Je n'en sais rien.
L'ÉNERGUMÈNE.
L'ÉNERGUMÈNE Qu'est-ce que la matière?
LE PHILOSOPHE.
Je n'en sais pas grand-chose. Je la crois étendue, solide, résistante, gravitante, divisible, mobile; Dieu peut lui avoir donné mille autres qualités que j'ignore.
L'ÉNERGUMÈNE.
Mille autres qualités, traître; je vois où tu veux venir; tu vas me dire que Dieu peut aimer la matière, qu'il a donné l'instinct aux animaux, qu'il est le maître de tout.
LE PHILOSOPHE.
Mais il se pourrait bien faire qu'en effet il eût accordé à cette matière bien des propriétés que vous ne sauriez comprendre.
L'ÉNERGUMÈNE.
Que je ne saurais comprendre, scélérat!
LE PHILOSOPHE.
Oui, sa puissance va plus loin que votre entendement.
L'ÉNERGUMÈNE.
a puissance, sa puissance! vrai discours d'athée.
LE PHILOSOPHE.
J'ai pourtant pour moi le témoignage de plusieurs saints Pères.
L'ÉNERGUMÈNE.
Va, va, ni Dieu, ni eux, ne nous empêcheront de te faire brûler vif; c'est un supplice dont on punit les parricides et les philosophes qui ne sont pas de notre avis.
LE PHILOSOPHE.
Est-ce le diable ou toi, qui a inventé cette manière d'argumenter?
L'ÉNERGUMÈNE.
Vilain possédé, tu oses me mettre de niveau avec le diable!
( Ici l'énergumène donne un grand soufflet au philosophe qui le lui rend avec usure .)
LE PHILOSOPHE.
A moi les philosophes.
L'ÉNERGUMÈNE.
A moi la sainte Hermandad.
( Ici une demi-douzaine de philosophes arrivent d'un côté, et on voit accourir de l'autre cent dominicains avec cent familiers de l'Inquisition et cent alguazils. La partie n'est pas tenable .)
MESSIE. [p. 138]↩
AVERTISSEMENT.
Cet article est de M. Polier de Bottens d'une ancienne famille de France, établie depuis deux cents ans en Suisse. Il est premier pasteur de Lausanne. Sa science est égale à sa piété. Il composa cet article pour le grand Dictionnaire encyclopédique, dans lequel il fut inséré. On en supprima seulement quelques endroits, dont les examinateurs crurent que des catholiques moins savants et moins pieux que l'auteur, pourraient abuser. Il fut reçu avec l'applaudissement de tous les sages .
On l'imprima en même temps dans un autre petit dictionnaire; et on l'attribua en France à un homme qu'on n'était pas fâché d'inquiéter. On supposa que l'article était impie, parce qu'on le supposait d'un laïque, et on se déchaîna contre l'ouvrage et contre l'auteur prétendu. L'homme accusé se contenta de rire de cette méprise. Il voyait avec compassion sous ses yeux cet exemple des erreurs et des injustices que les hommes commettent tous les jours dans leurs jugements, car il avait le manuscrit du sage et savant prêtre, écrit tout entier de sa main. Il le possède encore. Il sera montré à qui voudra l'examiner. On y verra jusqu'aux ratures faites alors par ce laïque même, pour prévenir les interprétations malignes .
Nous réimprimons donc aujourd'hui cet article dans toute l'intégrité de l'original. Nous en avons retranché pour ne pas répéter ce que nous avons imprimé ailleurs; mais nous n'avons pas ajouté un seul mot .
Le bon de toute cette affaire, c'est qu'un confrère de l'auteur respectable, écrivit les choses du monde les plus ridicules contre cet article de son confrère, croyant écrire contre un ennemi commun. Cela ressemble à ces combats de nuit, dans lesquels on se bat contre ses camarades .
Il est arrivé mille fois que des controversistes ont condamné des passages de St Augustin, de St Jérôme, ne sachant pas qu'ils fussent de ces Pères. Ils anathématiseraient une partie du Nouveau Testament s'ils n'avaient pas ouï dire de qui est ce livre. C'est ainsi qu'on juge trop souvent .
Messie, Messias , ce terme vient de l'hébreu; il est synonyme au mot grec Christ . L'un et l'autre sont des termes consacrés dans la religion, et qui ne se donnent plus aujourd'hui qu'à l'oint par excellence, ce souverain libérateur que l'ancien peuple juif attendait, après la venue duquel il soupire encore, et que les chrétiens trouvent dans la personne de Jésus fils de Marie, qu'ils regardent comme l'oint du Seigneur, le Messie promis à l'humanité; les Grecs emploient aussi le mot d' Elcimmeros qui signifie la même chose que Christos .
Nous voyons dans l'Ancien Testament que le mot de Messie , loin d'être particulier au libérateur après la venue duquel le peuple d'Israël soupirait, ne l'était pas seulement aux vrais et fidèles serviteurs de Dieu, mais que ce nom fut souvent donné aux rois et aux princes idolâtres, qui étaient dans la main de l'Eternel les ministres de ses vengeances, ou des instruments pour l'exécution Ecclésiast. ch. XLVIII, v. 8. des conseils de sa sagesse. C'est ainsi que l'auteur de l'Ecclésiastique dit d'Elizéé, qui ungis reges ad poenitentiam , ou comme l'ont rendu les Septante, ad vindictam. Vous oignez les rois pour exercer la vengeance du Seigneur . C'est pourquoi il envoya un prophète IV des Rois, ch. XVIII, v. 12, 13, 14. pour oindre Jéhu roi d'Israël. Il annonça l'onction sacrée à Hazaël roi de Damas et de Syrie, ces deux princes étant les Messies du Très-Haut pour venger les crimes et les abominations de la maison d'Achab.
Mais au XLV e d'Esaïe, v. 1, le nom de Messie est expressément donné à Cyrus. Ainsi a dit l'Eternel à Cyrus son oint, son messie, duquel j'ai pris la main droite afin que je terrasse les nations devant lui, etc.
Ezéchiel au XXVIII e de ses révélations, v. 14, donne le nom de Messie au roi de Tyr, qu'il appelle aussi chérubin , et parle de lui et de sa gloire dans des termes pleins d'une emphase, dont on sent mieux les beautés qu'on ne peut en saisir le sens. ‘Fils de l'homme, dit l'Eternel au prophète, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr, et lui dis, Ainsi a dit le Seigneur l'Eternel, tu étais le sceau de la ressemblance de Dieu, plein de sagesse et parfait en beautés; tu as été le jardin d'Héden du Seigneur, (ou suivant d'autres versions) tu étais toutes les délices du Seigneur; ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolithe, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ce que savaient faire tes tambours et tes flûtes a été chez toi; ils ont été tout prêts au jour que tu fus créé, tu as été un chérubin, un Messie pour servir de protection; je t'avais établi; tu as été dans la sainte montagne de Dieu, tu as marché entre les pierres flamboyantes, tu as étét parfait en tes voies, dès le jour que tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité a été trouvé en toi.'
Au reste le nom de Messiah , en grec Christ , se donnait aux rois, aux prophètes, et aux grands-prêtres des Hébreux. Nous lisons dans le I er des Rois, ch. XII, v. 3, Le Seigneur et son Messie sont témoins , c'est-à-dire, le Seigneur et le roi qu'il a établi . Et ailleurs, ne touchez point mes oints, et ne faites aucun mal à mes prophètes . David, animé de l'esprit de Dieu, donne dans plus d'un endroit à Saül son beau-père qui le persécutait, et qu'il n'avait pas sujet d'aimer; il donne, dis-je à ce roi réprouvé, et de dessus lequel l'esprit de l'Eternel s'était retiré, le nom et la qualité d'Oint, de Messie du Seigneur. Dieu me garde , dit-il fréquemment, de porter ma main sur l'oint du Seigneur, sur le Messie de Dieu .
Si le beau nom de Messie , d'oint de l'Eternel a été donné à des rois idolâtres, à des princes cruels et tyrans, il a été très employé dans nos anciens oracles pour désigner véritablement l'oint du Seigneur, ce Messie par excellence, objet du désir et de l'attente de tous les fidèles d'Israël. Ainsi Anne mère de Samuel conclut son cantique par ces paroles remarquables, et qui ne peuvent s'appliquer à aucun roi, puisqu'on sait que pour lors les Hébreux n'en avaient point. I Rois, ch. XI, v. 10. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre , il donnera l'empire à son Roi , il relévera la corne de son Christ , de son Messie . On trouve ce même mot dans les oracles suivans; Psaume II. v. 2. PsaumeXLIV. v. 8. Jérémie IV. v. 20. Daniel IX. v. 16. Habacuc III. v. 13.
Que si l'on rapproche tous ces divers oracles, et en général tous ceux qu'on applique pour l'ordinaire au Messie, il en résulte des contrastes en queqlue sorte inconciliables, et qui justifient jusqu'à un certain point l'obstination du peuple à qui ces oracles furent donnés.
Comment en effet concevoir avant que l'événement l'eût si bien justifié dans la personne de Jésus fils de Marie; comment concevoir, dis-je, une intelligence en quelque sorte divine et humaine tout ensemble, un être grand et abaissé qui triomphe du diable, et que cet esprit infernal, ce prince des puissances de l'air, tente, emporte et fait voyager malgré lui, maître et serviteur, roi et sujet, sacrificateur et victime tout ensemble; mortel et vainqueur de la mort, riche et pauvre, conquérant glorieux dont le règne éternel n'aura point de fin, qui doit soumettre toute la nature par ses prodiges, et cependant qui fera un homme de douleurs, privé des commodités, souvent même de l'absolument nécessaire dans cette vie dont il se dit le roi, et qu'il vient comblé de gloire et d'honneurs, terminant une vie innocente, malheureuse, sans cette contredite et traversée, par un supplice également honteux et cruel, trouvant même dans cette humiliation, cet abaissement extraordinaire, la source d'une élévation unique qui le conduit au plus haut point de gloire, de puissance et de félicité, c'est-à-dire, au rang de la première des créatures.
Tous les chrétiens s'accordent à trouver ces caractères en apparence, si incompatibles dans la personne de Jésus de Nazareth qu'ils appellent le Christ ; ses sectateurs lui donnaient ce titre par excellence, non qu'il eût été oint d'une manière sensible et matérielle, comme l'ont été anciennement quelques rois, quelques prophètes, et quelques sacrificateurs, mais parce que l'esprit divin l'avait désigné pour ces grands offices, et qu'il avait reçu l'onction spirituelle nécessaire pour cela.
[7] Nous en étions là sur un article aussi important, lorsqu'un prédicateur hollandais, plus célèbre par cette découverte que par les médiocres productions d'un génie d'ailleurs faible et peu instruit, nous a fait voir que notre Seigneur Jésus était le Christ, le Messie de Dieu, ayant été oint dans les trois plus grandes époques de sa vie, pour être notre roi, notre prophète et notre sacrificateur.
Lors de son baptême, la voix du souverain maître de la nature le déclare son fils, son unique, son bien-aimé, et par là même son représentant.
Sur le Thabor, transfiguré, associé à Moïse et à Elie, cette même voix surnaturelle l'annonce à l'humanité comme le fils de celui qui aime et envoie les prophètes, et qui doit être écouté par préférence.
Dans Gethsémané, un ange descend du ciel pour le soutenir dans les angoisses extrêmes où le réduit l'approche de son supplice; il le fortifie contre les frayeurs cruelles d'une mort qu'il ne peut éviter, et le met en état d'être un sacrificateur d'autant plus excellent qu'il est lui-même la victime innocente et pure qu'il va offrir.
Le judicieux prédicateur hollandais, disciple de l'illustre Cocceius, trouve l'huile sacramentale de ces diverses onctions célestes, dans les signes visibles que la puissance de Dieu fit paraître sur son oint, dans son baptême l'ombre de la colombe , qui représentait le Saint-Esprit qui descendit sur lui. Au Thabor, la nue miraculeuse qui le couvrit. En Gethsémané, la sueur de grumeaux de sang dont tout son corps fut couvert.
Après cela, il faut pousser l'incrédulité à son comble pour ne pas reconnaître à ces traits l'oint du Seigneur par excellence, le Messie promis; et l'on ne pourrait sans doute assez déplorer l'aveuglement inconcevable du peuple juif, s'il ne fût entré dans le plan de l'infinie sagesse de Dieu, et n'eût été dans ses vues toutes miséricordieuses, essentiel à l'accomplissement de son oeuvre, et au salut de l'humanité.
Mais aussi il faut convenir que dans l'état d'oppression sous lequel gémissait le peuple juif, et après toutes les glorieuses promesses que l'Eternel lui avait faites si souvent, il devait soupirer après la venue d'un Messie, l'envisager comme l'époque de son heureuse délivrance; et qu'ainsi il est en quelque sorte excusable de n'avoir pas voulu reconnaître ce libérateur dans la personne du Seigneur Jésus, d'autant plus qu'il est de l'homme de tenir plus au corps qu'à l'esprit, et d'être plus sensible aux besoins présents, que flatté des avantages à venir, et toujours incertains par là même.
Au reste, on doit croire qu'Abraham, et après lui un assez petit nombre de patriarches et de prophètes, ont pu se faire une idée de la nature du règne spirituel du Messie; mais ces idées durent rester dans le petit cercle des inspirés; et il n'est pas étonnant qu'inconnues à la multitude, ces notions se soient altérées au point que lorsque la Sauveur parut dans la Judée, et peuple, et ses docteurs, ses princes mêmes, attendaient un monarque, un conquérant, qui par la rapidité de ses conquêtes devait s'assujettir tout le monde; et comment concilier ces idées flatteuses avec l'état abject, en apparence misérable de Jésus-Christ. Aussi scandalisés de l'entendre s'annoncer comme le Messie, ils le persécutèrent, le rejetèrent, et le firent mourir par le dernier supplice. Depuis ce temps-là, ne voyant rien qui achemine à l'accomplissement de leurs oracles, et ne voulant point y renoncer, ils se livrent à toutes sortes d'idées plus chimériques les unes les autres.
Ainsi, lorsqu'ils ont vu les triomphes de la religion chrétienne, qu'ils ont senti qu'on pouvait expliquer spirituellement, et appliquer à Jésus-Christ la plupart de leurs anciens oracles, ils se sont avisés, contre le sentiment de leurs pères, de nier que les passages que nous leur alléguons dussent s'entendre du Messie, tordant ainsi nos saintes Ecritures à leur propre perte.
Quelques-uns soutiennent que leurs oracles ont été mal entendus; qu'en vain on soupire après la venue du Messie, puisqu'il est déjà venu en la personne d'Ezéchias. C'était le sentiment du fameux Hillel. D'autres plus relâchés, ou cédant avec politique aux temps et aux circonstances, prétendent que la croyance de la venue d'un Messie, n'est point un article fondamental de foi, et qu'en niant ce dogme on ne pervertit point la loi, on ne lui donne qu'une légère atteinte. C'est ainsi que le juif Albo disait au pape, que nier la venue du Messie, c'était seulement couper une branche de l'arbre sans toucher à la racine.
Le fameux rabbin Salomon Jarchy ou Raschy, qui vivait au commencement du douzième siècle, dit dans ses Talmudiques, que les anciens Hébreux ont cru que le Messie était né le jour de la dernière destruction de Jérusalem par les armées romaines; c'est, comme on dit, appeler le médecin après la mort.
Le rabbin Kimchy qui vivait aussi au douzième siècle, annonçait que le Messie dont il croyait la venue très prochaine, chasserait de la Judée les chrétiens qui la possédaient pour lors; il est vrai que les chrétiens perdirent la Terre-Sainte; mais ce fut Saladin qui les vainquit: pour peu que ce conquérant eût protégé les Juifs, et se fût déclaré pour eux, il est vraisemblable que dans leur enthousiasme ils en auraient fait leur Messie.
Les auteurs sacrés, et notre Seigneur Jésus lui-même, comparent souvent le règne du Messie et l'éternelle béatitude à des jours de noces, à des festins; mais les talmudistes ont étrangement abusé de ces paraboles; selon eux, le Messie donnera à son peuple rassemblé dans la terre de Canaan, un repas dont le vin sera celui qu'Adam lui-même fit dans le paradis terrestre, et qui se conserve dans de vastes celliers, creusés par les anges au centre de la terre.
On servira pour entrée le fameux poisson, appelé le grand Léviathan, qui avale tout d'un coup un poisson moins grand que lui, lequel ne laisse pas d'avoir trois cents lieues de long; toute la masse des eaux est portée sur Léviathan. Dieu au commencement en créa un mâle et un autre femelle; mais de peur qu'ils ne renversassent la terre, et qu'ils ne remplissent l'univers de leurs semblables, Dieu tua la femelle, et la sala pour le festin du Messie .
Les rabbins ajoutent qu'on tuera pour ce repas le taureau Béhémoth, qui est si gros qu'il mange chaque jour le foin de mille montagnes: la femelle de ce taureau fut tuée au commencement du monde, afin qu'une espèce si prodigieuse ne se multipliât pas, ce qui n'aurait pu que nuire aux autres créatures; mais ils assurent que l'Eternel ne la sala pas, parce que la vache salée n'est pas si bonne que la léviathane. Les Juifs ajoutent encore si bien foi à toutes ces rêveries rabbiniques, que souvent ils jurent sur leur part du boeuf Béhémoth, comme quelques chrétiens impies jurent sur leur part du paradis..
Après des idées si grossières sur la venue du Messie , et sur son règne, faut-il s'étonner, si les Juifs tant anciens que modernes, et plusieurs même des premiers chrétiens, malheureusement imbus de toutes ces rêveries, n'ont pu s'élever à l'idée de la nature divine de l'oint du Seigneur, et n'ont pas attribué la qualité de dieu au Messie ? Voyez comme les Juifs s'expriment là-dessus dans l'ouvrage Quaest .I, II, IV, XXIII, etc. intitulé Judaei Lusitani quaestiones ad Christianos . ‘Reconnaître, disent-ils, un homme-dieu, c'est s'abuser soi-même, c'est se forger un monstre, un centaure, le bizarre composé de deux natures qui ne sauraient s'allier.' Ils ajoutent que les prophètes n'enseignent point que le Messie soit homme-dieu, qu'ils distinguent expressément entre Dieu et David, qu'ils déclarent le premier maître et le second serviteur, etc. . .
Lorsque le Sauveur parut, les prophéties, quoique claires, furent malheureusement obscurcies par les préjugés sucés avec le lait. Jésus-Christ lui-même, ou par ménagement, ou pour ne pas révolter les esprits, paraît extrêmement réservé sur l'article de sa divinité; il voulait , dit St Chrysostome, accoutumer insensiblement ses auditeurs à croire un mystère si fort élevé au-dessus de la raison . S'il prend l'autorité d'un Dieu en pardonnant les péchés, cette action soulève tous ceux qui en sont les témoins; ses miracles les plus évidents ne peuvent convaincre de sa divinité, ceux mêmes en faveur desquels il les opère. Lorsque devant le tribunal du souverain sacrificateur, il avoue avec un modeste détour qu'il est le fils de Dieu, le grand-prêtre déchire sa robe et crie au blasphème. Avant l'envoi du Saint-Esprit, les apôtres ne soupçonnent pas même la divinité de leur cher maître; il les interroge sur ce que le peuple pense de lui; ils répondent, que les uns le prennent pour Elie, les autres pour Jérémie, ou pour quelque autre prophète. St Pierre a besoin d'une révélation particulière pour connaître que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant.
Les Juifs révoltés contre la divinité de Jésus-Christ ont eu recours à toutes sortes de voies pour détruire ce grand mystère; ils détournent le sens de leurs propres oracles, ou ne les appliquent pas au Messie ; ils prétendent que le nom de dieu , Eloï, n'est pas particulier à la Divinité, et qu'il se donne même par les auteurs sacrés aux juges, aux magistrats, en général à ceux qui sont élevés en autorité; ils citent en effet un très grand nombre de passages des saintes Ecritures, qui justifient cette observation, mais qui ne donnent aucune atteinte aux termes exprès des anciens oracles qui regardent le Messie .
Enfin ils prétendent que si le Sauveur, et après lui les évangélistes, les apôtres et les premiers chrétiens, appellent Jésus le fils de Dieu, ce terme auguste ne signifiait dans les temps évangéliques, autre chose que l'opposé des fils de Bélial, c'est-à-dire, homme de bien, serviteur de Dieu; par opposition à un méchant, un homme qui ne craint point Dieu.
Si les Juifs ont contesté à Jésus-Christ la qualité de Messie et sa divinité, ils n'ont rien négligé aussi pour le rendre méprisable, pour jeter sur sa naissance, sa vie et sa mort, tout le ridicule et tout l'opprobre qu'a pu imaginer leur criminel acharnement.
De tous les ouvrages qu'a produits l'aveuglement des Juifs, il n'en est point de plus odieux et de plus extravagant que le livre ancien intitulé Sepher Toldos Jeschut , tiré de la poussière par M. Vagenseil dans le second tome de son ouvrage intitulé Tela ignea, etc .
C'est dans ce Sepher Toldos Jeschut , qu'on lit une histoire monstrueuse de la vie de notre Sauveur forgée avec toute la passion et la mauvaise foi possibles. Ainsi, par exemple, ils ont osé écrire qu'un nommé Panther ou Pandera habitant de Bethléem, était devenu amoureux d'une jeune femme mariée à Jokanam. Il eut de ce commerce impur un fils qui fut nommé Jesua ou Jesu. Le père de cet enfant fut obligé de s'enfuir, et se retira à Babilone. Quant au jeune Jesu, on l'envoya aux écoles; mais, ajoute l'auteur, il eut l'insolence de lever la tête, et de se découvrir devant les sacrificateurs, au lieu de paraître devant eux la tête baissée, et le visage couvert, comme c'était la coutume; hardiesse qui fut vivement tancée; ce qui donna lieu d'examiner sa naissance, qui fut trouvée impure, et l'exposa bientôt à l'ignominie.
Ici le sage et savant auteur détaille les absurdités de ce livre, et les réfute ensuite. Il passe en revue tous les faux messies, et particulièrement Sabathei Sevi qui fit tant de bruit en 1666. Voyez son article dans l' Histoire générale des moeurs et de l'esprit des nations .
MÉTAPHYSIQUE. [p. 147]↩
Trans naturam , au delà de la nature. Mais ce qui est au delà de la nature est-il quelque chose? par nature on entend donc matière , et métaphysique est ce qui n'est pas matière.
Par exemple, votre raisonnement qui n'est ni long ni large, ni haut, ni solide, ni pointu.
Votre âme à vous inconnue qui produit votre raisonnement.
Les esprits dont on a toujours parlé, auxquels on a donné longtemps un corps si délié qu'il n'était plus corps, et auxquels on a ôté enfin toute ombre de corps, sans savoir ce qui leur restait.
La manière dont ces esprits sentent sans avoir l'embarras des cinq sens, celle dont ils pensent sans tête, celle dont ils se communiquent leurs pensées sans paroles et sans signes.
Enfin, Dieu que nous connaissons par ses ouvrages, mais que notre orgueil veut définir: Dieu dont nous sentons le pouvoir immense, Dieu entre lequel et nous est l'abîme de l'infini, et dont nous osons sonder la nature.
Ce sont là les objets de la métaphysique.
On pourrait encore y joindre les principes mêmes des mathématiques, des points sans étendue, des lignes sans largeur, des surfaces sans profondeur, des unités divisibles à l'infini etc.
Bayle lui-même croyait que ces objets étaient des êtres de raison; mais ce ne sont en effet que les choses matérielles considérées dans leurs masses, dans leurs superficies, dans leurs simples longueurs ou largeurs, dans les extrémités de ces simples longueurs ou largeurs. Toutes les mesures sont justes et démontrées, et la métaphysique n'a rien à voir dans la géométrie.
C'est pourquoi on peut être métaphysicien sans être géomètre. La métaphysique est plus amusante; c'est souvent le roman de l'esprit. En géométrie, au contraire, il faut calculer, mesurer. C'est une gêne continuelle, et plusieurs esprits ont mieux aimé rêver doucement que se fatiguer.
MIRACLES. [p. 148]↩
SECTION PREMIERE.
Définissez les termes, vous dis-je, ou jamais nous ne nous entendrons. Miraculum res miranda, prodigium, portentum monstrum . Miracle, chose admirable; prodigium , qui annonce chose étonnante; portentum , porteur de nouveauté; monstrum , chose à montrer par rareté.
Voilà les premières idées qu'on eut d'abord des miracles.
Comme on raffine sur tout, on raffina sur cette définition; on appela miracle ce qui est impossible à la nature. Mais on ne songea pas que c'était dire que tout miracle est réellement impossible. Car qu'est-ce que la nature? vous entendez par ce mot l'ordre éternel des choses. Un miracle serait donc impossible dans cet ordre. En ce sens Dieu ne pourrait faire de miracle.
Si vous entendez par miracle un effet dont vous ne pouvez voir la cause, en ce sens tout est miracle. L'attraction et la direction de l'aimant sont des miracles continuels. Un limaçon auquel il revient une tête est un miracle. La naissance de chaque animal, la production de chaque végétal sont des miracles de tous les jours.
Mais nous sommes si accoutumés à ces prodiges, qu'ils ont perdu leur nom d' admirables , de miraculeux . Le canon n'étonne plus les Indiens.
Nous nous sommes donc fait une autre idée de miracle. C'est, selon l'opinion vulgaire, ce qui n'était jamais arrivé, et ce qui n'arrivera jamais. Voilà l'idée qu'on se forme de la mâchoire d'âne de Samson, des discours de l'ânesse de Balaam, de ceux d'un serpent avec Eve, des quatre chevaux qui enlevèrent Elie, du poisson qui garda Jonas soixante et douze heures dans son ventre, des dix plaies d'Egypte, des murs de Jérico, du soleil et de la lune arrêtés à midi, etc. etc. etc. etc.
Pour croire un miracle, ce n'est pas assez de l'avoir vu; car on peut se tromper. On appelle un sot, témoin de miracles : et non seulement bien des gens pensent avoir vu ce qu'ils n'ont pas vu, et avoir entendu ce qu'on ne leur a point dit; non seulement ils sont témoins de miracles, mais ils sont sujets de miracles. Ils ont été tantôt malades, tantôt guéris par un pouvoir surnaturel. Ils ont été changés en loup; ils ont traversé les airs sur manche à balai, ils ont été incubes et succubes.
Il faut que le miracle ait été bien vu par un grand nombre de gens très sensés, se portant bien, et n'ayant nul intérêt à la chose. Il faut surtout qu'il ait été solennellement attesté par eux. Car si on a besoin de formalités authentiques pour les actes les plus simples, comme l'achat d'une maison, un contrat de mariage, un testament; quelles formalités ne faudra-t-il pas pour constater des choses naturellement impossibles, et dont le destin de la terre doit dépendre?
Quand un miracle authentique est fait, il ne prouve encore rien; car l'Ecriture vous dit en vingt endroits que des imposteurs peuvent faire des miracles; et que si un homme après en avoir fait, annonce un autre dieu que le Dieu des Juifs, il faut le lapider.
On exige donc que la doctrine soit appuyée par les miracles, et les miracles par la doctrine.
Ce n'est point encore assez. Comme un fripon peut prêcher une très bonne morale pour mieux séduire, et qu'il est reconnu que des fripons, comme les sorciers de Pharaon, peuvent faire des miracles, il faut que ces miracles soient annoncés par des prophéties.
Pour être sûr de la vérité de ces prophéties, il faut les avoir entendu annoncer clairement, et les avoir vu s'accomplir réellement. (Voyez Prophétie . ) Il faut posséder parfaitement la langue dans laquelle elles sont conservées.
Il ne suffit pas même que vous soyez témoin de leur accomplissement miraculeux: car vous pouvez être trompé par de fausses apparences. Il est nécessaire que le miracle et la prophétie soient juridiquement constatés par les premiers de la nation; et encore se trouvera-t-il des douteurs. Car il se peut que la nation soit intéressée à supposer une prophétie et un miracle; et dès que l'intérêt s'en mêle, ne comptez sur rien. Si un miracle prédit n'est pas aussi public, aussi avéré qu'une éclipse annoncée dans l'almanach, soyez sûr que ce miracle n'est qu'un tour de gibecière, ou un conte de vieille.
Les miracles des premiers temps du christianisme sont incontestables; mais ceux qu'on fait aujourd'hui n'ont pas la même authenticité. Citons à ce propos ce que j'ai lu dans un petit livre curieux.
‘On souhaiterait, par exemple, pour qu'un miracle fût bien constaté, qu'il fût fait en présence de l'Académie des sciences de Paris, ou de la Société royale de Londres, et de la faculté de médecine, assistées d'un détachement du régiment des Gardes, pour contenir la foule du peuple, qui pourrait par son indiscrétion empêcher l'opération du miracle.
‘On demandait un jour à un philosophe, ce qu'il dirait, s'il voyait le soleil s'arrêter, c'est-à-dire, si le mouvement de la terre autour de cet astre cessait; si tous les morts ressuscitaient, et si toutes les montagnes allaient se jeter de compagnie dans la mer, le tout pour prouver quelque vérité importante, comme par exemple, la grâce versatile? Ce que je dirais, répondit le philosophe, je me ferais manichéen; je dirais qu'il y a un principe qui défait ce que l'autre fait.'
SECTION SECONDE.
Un gouvernement théocratique ne peut être fondé que sur des miracles, tout doit y être divin. Le grand souverain ne parle aux hommes que par des prodiges; ce sont là ses ministres et ses lettres patentes. Ses ordres sont intimés par l'Océan qui couvre toute la terre pour noyer les nations, ou qui ouvre le fond de son abîme pour leur donner passage.
Aussi vous voyez que dans l'histoire juive tout est miracle depuis la création d'Adam et la formation d'Eve, pétrie d'une côte d'Adam, jusqu'au melch ou roitelet Saül.
Au temps de ce Saül la théocratie partage encore le pouvoir avec la royauté. Il y a encore par conséquent des miracles de temps en temps; mais ce n'est plus cette suite éclatante de prodiges qui étonnent continuellement la nature. On ne renouvelle point les dix plaies d'Egypte; le soleil et la lune ne s'arrêtent point en plein midi pour donner le temps à un capitaine d'exterminer quelques fuyards déjà écrasés par une pluie de pierres tombées des nues. Un Samson n'extermine plus mille Philistins avec une mâchoire d'âne. Les ânesses ne parlent plus, les murailles ne tombent plus au son du cornet; les villes ne sont plus abîmées dans un lac par le feu du ciel; la race humaine n'est plus détruite par le déluge. Mais le doigt de Dieu se manifeste encore; l'ombre de Saül apparaît à une magicienne. Dieu lui-même promet à David qu'il défera les Philistins à Baal-pharasim.
Rois liv. III, ch. XXII. Dieu assemble son armée céleste du temps d'Achab, et demande aux esprits, Qui est-ce qui trompera Achab, et qui le fera aller à la guerre contre Ramoth en Galgala? et un esprit s'avança devant le Seigneur, et dit, Ce sera moi qui le tromperai . Mais ce ne fut que le prophète Michée qui fut témoin de ce prodige, encore reçut-il un soufflet d'un autre prophète nommé Sédékias pour avoir annoncé ce prodige.
Des miracles qui s'opèrent aux yeux de toute la nation, et qui changent les lois de la nature entière, on n'en voit guère jusqu'au temps d'Elie, à qui le Seigneur envoya un char de feu et des chevaux de feu qui enlevèrent Elie des bords du Jourdain au ciel, sans qu'on sache en quel endroit du ciel.
Depuis le commencement des temps historiques, c'est-à-dire, depuis les conquêtes d'Alexandre, vous ne voyez plus de miracles chez les Juifs.
Quand Pompée vient s'emparer de Jérusalem, quand Crassus pille le temple, quand Pompée fait passer le roi juif Alexandre par la main du bourreau, quand Antoine donne la Judée à l'Arabe Hérode, quand Titus prend d'assaut Jérusalem, quand elle est rasée par Adrien, il ne se fait aucun miracle. Il en est ainsi chez tous les peuples de la terre. On commence par la théocratie, on finit par des choses purement humaines. Plus les sociétés perfectionnent les connaissances, moins il y a de prodiges.
Nous savons bien que la théocratie des Juifs était la seule véritable, et que celles des autres peuples étaient fausses; mais il arriva la même chose chez eux que chez les Juifs.
En Egypte, du temps de Vulcain et de celui d'Isis et d'Osiris, tout était hors des lois de la nature; tout y rentra sous les Ptolomées.
Dans les siècles de Phos, de Chrysos et d'Epheste, les dieux et les mortels conversaient très familièrement en Caldée. Un Dieu avertit le roi Xixuthre qu'il y aura un déluge en Arménie, et qu'il faut qu'il bâtisse vite un vaisseau de cinq stades de longueur et de deux de largeur. Ces choses n'arrivent pas aux Darius et aux Alexandres.
Le poisson Oannès sortait autrefois tous les jours de l'Euphrate pour aller prêcher sur le rivage. Il n'y a plus aujourd'hui de poisson qui prêche. Il est bien vrai que St Antoine de Padoue les a prêchés, mais c'est un fait qui arrive si rarement, qu'il ne tire pas à conséquence.
Numa avait de longues conversations avec la nymphe Egérie; on ne voit pas que César en eût avec Vénus, quoiqu'il descendît d'elle en droite ligne. Le monde va toujours, dit-on, se raffinant un peu.
Mais après s'être tiré d'un bourbier pour quelque temps, il retombe dans un autre; à des siècles de politesse succèdent des siècles de barbarie. Cette barbarie est ensuite chassée; puis elle reparaît; c'est l'alternative continuelle du jour et de la nuit.
SECTION TROISIÉME.
De ceux qui ont eu la témérité impie de nier absolument la réalité des miracles de JESUS-CHRIST.
Parmi les modernes, Thomas Wolston docteur de Cambridge, fut le premier, ce me semble, qui osa n'admettre dans les Evangiles qu'un sens typique, allégorique, entièrement spirituel, et qui soutint effrontément qu'aucun des miracles de Jésus n'avait été réellement opéré. Il écrivit sans méthode, sans art, d'un style confus et grossier; mais non pas sans vigueur. Ses six discours contre les miracles de Jésus-Christ se vendaient publiquement à Londres dans sa propre maison. Il en fit en deux ans, depuis 1737 jusqu'à 1739, trois éditions de vingt mille exemplaires chacune; et il est difficile aujourd'hui d'en trouver chez les libraires.
Jamais chrétien n'attaqua plus hardiment le christianisme. Peu d'écrivains respectèrent moins le public, et aucun prêtre ne se déclara plus ouvertement l'ennemi des prêtres. Il osait même autoriser cette haine de celle de Jésus-Christ envers les pharisiens et les scribes; et il disait qu'il n'en serait pas comme lui la victime, parce qu'il était venu dans un temps plus éclairé.
Il voulut à la vérité justifier sa hardiesse en se sauvant par le sens mystique; mais il emploie des expressions si méprisantes et si injurieuses, que toute oreille chrétienne en est offensée.
Tom. I, page 38. Si on l'en croit, le diable envoyé par Jésus-Christ dans le corps de deux mille cochons, est un vol fait au propriétaire de ces animaux. Si on en disait autant de Mahomet on le prendrait pour un méchant sorcier a vizard , un esclave juré du diable, a sworn slave to the devil . Tom. I, pag. 39. Et si le maître des cochons, et les marchands qui vendaient dans la première enceinte du temple des bêtes pour les sacrifices, et que Jésus chassa à coups de fouet, vinrent demander justice quand il fut arrêté, il est évident qu'il dut être condamné, puisqu'il n'y a point de jurés en Angleterre qui ne l'eussent déclaré coupable.
Pag. 52. Il dit la bonne aventure à la Samaritaine comme un franc bohémien; cela seul suffisait pour le faire chasser comme Tibère en usait alors avec les devins. Je m'étonne, dit-il, que les bohémiens d'aujourd'hui, les Gipsy , ne se disent pas les vrais disciples de Jésus, puisqu'ils font le même métier. Mais je suis fort aise qu'il n'ait pas extorqué de l'argent de la Samaritaine comme font nos prêtres modernes, qui se font largement payer pour leurs Pag. 55. divinations.
Je suis les numéros des pages. L'auteur passe de là à l'entrée Pag. 65. de Jésus-Christ dans Jérusalem. On ne sait, dit-il, s'il était monté sur un âne, ou sur une ânesse, ou sur un ânon, ou sur tous les trois à la fois.
Il compare Jésus tenté par le diable à St Dunstan qui prit le Pag. 66. diable par le nez, et il donne à St Dunstan la préférence.
A l'article du miracle du figuier séché pour n'avoir pas porté Troisième discours, pag. 8. des figues hors de la saison; c'était, dit-il, un vagabond, un gueux, tel qu'un frère quêteur, a wanderer a mendicant like a fryar , et qui avant de se faire prédicateur de grand chemin, n'avait été qu'un misérable garçon charpentier, no better than a journey man carpenter . Il est suprenant que la cour de Rome n'ait pas parmi ses reliques quelque ouvrage de sa façon, un escabeau, un casse-noisette. En un mot, il est difficile de pousser plus loin le blasphème.
Il s'égaye sur la piscine probatique de Betsaïda, dont un ange venait troubler l'eau tous les ans. Il demande comment il se peut que ni Flavien Joseph, ni Philon n'aient point parlé de cet ange, pourquoi St Jean est le seul qui raconte ce miracle annuel, par quel autre miracle aucun Romain ne vit jamais cet ange, et n'en Tom. I, pag. 60. entendit jamais parler.
L'eau changée en vin aux noces de Cana, excite, selon lui, le rire et le mépris de tous les hommes qui ne sont pas abrutis par la superstition.
Quatrième discours, pag. 31. Quoi! s'écrie-t-il, Jean dit expressément que les convives étaient déjà ivres, methus tosi ; et Dieu descendu sur la terre opère son premier miracle pour les faire boire encore!
Dieu fait l'homme commence sa mission par assister à une noce de village. Il n'est pas certain que Jésus et sa mère fussent ivres Pag. 32. comme le reste de la compagnie. Whether Jesus and his mother them selve were all cut as were others of the company, it is not certain . Quoique la familiarité de la dame avec un soldat fasse présumer qu'elle aimait la bouteille, il paraît cependant que son fils était en pointe de vin, puisqu'il lui répondit avec tant d'aigreur et d'insolence, Pag. 34. Waspishly and snapishly . Femme, qu'ai-je à faire à toi? Il paraît par ces paroles que Marie n'était point vierge, et que Jésus n'était point son fils; autrement, Jésus n'eût point ainsi insulté son père et sa mère, et violé un des plus sacrés commandements de la loi. Cependant, il fait ce que sa mère lui demande, il remplit dix-huit cruches d'eau et en fait du punch. Ce sont les propres paroles de Thomas Wolston. Elles saisissent d'indignation toute âme chrétienne.
C'est à regret, c'est en tremblant que je rapporte ces passages; mais il y a eu soixante mille exemplaires de ce livre, portant tous le nom de l'auteur, et tous vendus publiquement chez lui. On ne peut pas dire que je le calomnie.
C'est aux morts ressuscités par Jésus-Christ qu'il en veut principalement. Il affirme qu'un mort ressuscité eût été l'objet de l'attention et de l'étonnement de l'univers; que toute la magistrature juive, que surtout Pilate en auraient fait les procès verbaux les plus authentiques; que Tibère ordonnait à tous les proconsuls, préteurs, présidents des provinces de l'informer exactement de tout; qu'on aurait interrogé Lazare qui avait été mort quatre jours entiers, qu'on aurait voulu savoir ce qu'était devenue son âme pendant ce temps-là.
Avec quelle curiosité avide Tibère, et tout le sénat de Rome ne l'eût-il pas interrogé; et non seulement lui, mais la fille de Jaïr et le fils de Naïm? Trois morts rendus à la vie auraient été trois témoignages de la divinité de Jésus, qui auraient rendu en un moment le monde entier chrétien. Mais au contraire, tout l'univers ignore pendant plus de deux siècles ces preuves éclatantes. Ce n'est qu'au bout de cent ans que quelques hommes obscurs se montrent les uns aux autres dans le plus grand secret les écrits qui contiennent ces miracles. Quatre-vingt-neuf empereurs, en comptant ceux à qui on ne donna que le nom de tyrans , n'entendent jamais parler de ces résurrections qui devaient tenir toute la nature dans la surprise. Ni l'historien juif Flavien Joseph, ni le savant Philon, ni aucun historien grec ou romain ne fait mention de ces prodiges. Enfin, Wolston a l'impudence de dire que l'histoire du Lazare est si pleine d'absurdites, que St Jean radotait quand il l'écrivit. Is so brimfull of absurdities that St John, when he wrote it had livd beyand his senses . pag. 38, tom. II.
Tom. II, pag. 47. Supposons, dit Wolston, que Dieu envoyât aujourd'hui un ambassadeur à Londres pour convertir le clergé mercenaire, et que cet ambassadeur ressuscitât des morts, que diraient nos prêtres?
Il blasphème l'incarnation, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ suivant les mêmes principes. Tom. II, discours VI, pag. 27. Il appelle ces miracles, l'imposture la plus effrontée et la plus manifeste qu'on ait jamais produite dans le monde. The most manifest, and the most barefaced imposture that ever was put upon the world .
Ce qu'il y a peut-être de plus étrange encore, c'est que chacun de ces discours est dédié à un évêque. Ce ne sont pas assurément des dédicaces à la française. Il n'y a ni compliment ni flatterie. Il leur reproche leur orgueil, leur avarice, leur ambition, leurs cabales; il rit de les voir soumis aux lois de l'Etat comme les autres citoyens.
A la fin, ces évêques lassés d'être outragés par un simple membre de l'université de Cambridge, implorèrent contre lui les lois auxquelles ils sont assujettis. Ils lui intentèrent procès au banc du roi par-devant le lord justice Raymond en 1739. Wolston fut mis en prison et condamné à donner caution pour cent cinquante livres sterling. Il ne mourut point en prison, comme il est dit dans quelques-uns de nos dictionnaires faits au hasard. Il mourut chez lui à Londres après avoir prononcé ces paroles, This is a pass that every man must come to . C'est un pas que tout homme doit faire.
Quelque temps avant sa mort, une dévote le rencontrant dans la rue, lui cracha au visage; il s'essuya, et la salua. Ses moeurs étaient simples et douces; il s'était trop entêté du sens mystique, et avait blasphémé le sens littéral. Mais il est à croire qu'il se repentit à la mort, et que Dieu lui a fait miséricorde.
En ce même temps parut en France le testament de Jean Mêlier curé de But et d'Etrepigni en Champagne, duquel nous avons déjà parlé à l'article Contradiction .
C'était une chose bien étonnante et bien triste, que deux prêtres écrivissent en même temps contre la religion chrétienne. Le curé Mêlier est encore plus emporté que Wolston; il ose traiter le transport de notre Sauveur par le diable sur la montagne, la noce de Cana, les pains et les poissons de contes absurdes, injurieux à la divinité, qui furent ignorés pendant trois cents ans de tout l'empire romain, et qui enfin passèrent de la canaille jusqu'au palais des empereurs, quand la politique les obligea d'adopter les folies du peuple pour le mieux subjuguer. Les déclamations du prêtre champenois n'approchent pas de celles de l'Anglais. Wolston a quelquefois des ménagements. Mêlier n'en a point; c'est un homme si profondément ulcéré des crimes dont il a été témoin, qu'il en rend la religion chrétienne responsable, en oubliant qu'elle les condamne. Point de miracle qui ne soit pour lui un objet de mépris et d'horreur; point de prophétie qu'il ne compare à celles de Nostradamus. Il va même jusqu'à comparer Jésus-Christ à Don-Quichotte et St Pierre à Sancho-Pança: et ce qui est plus déplorable, c'est qu'il écrivait ces blasphèmes contre Jésus-Christ entre les bras de la mort, dans un temps où les plus dissimulés n'osent mentir, et où les plus intrépides tremblent. Trop pénétré de quelques injustices de ses supérieurs, trop frappé des grandes difficultés qu'il trouvait dans l'Ecriture, il se déchaîna contre elle plus que les Acosta et tous les Juifs, plus que les fameux Porphires, les Celses, les Iambliques, les Juliens, les Libanius, les Maximes, les Simmaques, et tous les partisans de la raison humaine n'ont jamais éclaté contre nos incompréhensibilités divines. On a imprimé plusieurs abrégés de son livre: mais heureusement, ceux qui ont en main l'autorité, les ont supprimés autant qu'ils l'ont pu.
Un curé de Bonne-Nouvelle près de Paris écrivit encore sur le même sujet; de sorte qu'en même temps l'abbé Becheran et les autres convulsionnaires faisaient des miracles, et trois prêtres écrivaient contre les miracles véritables.
Le livre le plus fort contre les miracles et contre les prophéties, En six volumes. est celui de milord Bolingbroke. Mais par bonheur, il est si volumineux, si dénué de méthode, son style est si verbeux, ses phrases si longues, qu'il faut une extrême patience pour le lire.
Il s'est trouvé des esprits qui étant enchantés des miracles de Moïse et de Josué, n'ont pas eu pour ceux de Jésus-Christ la vénération qu'on leur doit; leur imagination élevée par le grand spectacle de la mer, qui ouvrait ses abîmes et qui suspendait ses flots pour laisser passer la horde hébraïque; par les dix plaies d'Egypte, par les astres qui s'arrêtaient dans leur course sur Gabaon et sur Aïalon etc. ne pouvait plus se rabaisser à de petits miracles comme de l'eau changée en vin, un figuier séché, des cochons noyés dans un lac.
Vaghensel disait avec impiété, que c'était entendre une chanson de village au sortir d'un grand concert.
Le Talmud prétend qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui, comparant les miracles de l'Ancien Testament à ceux du Nouveau, ont embrassé le judaïsme: ils croyaient qu'il n'est pas possible que le maître de la nature eût fait tant de prodiges pour une religion qu'il voulait anéantir. Quoi! disaient-ils, il y aura eu pendant des siècles une suite de miracles épouvantables en faveur d'une religion véritable qui deviendra fausse! quoi! Dieu même aura écrit que cette religion ne périra jamais, et qu'il faut lapider ceux qui voudront la détruire! et cependant il enverra son propre fils, qui est lui-même, pour anéantir ce qu'il a édifié pendant tant de siècles!
Il y a bien plus; ce fils, continuent-ils, ce Dieu éternel s'étant fait juif, est attaché à la religion juive pendant toute sa vie; il en fait toutes les fonctions, il fréquente le temple juif, il n'annonce rien de contraire à la loi juive, tous ses disciples sont juifs, tous observent les cérémonies juives. Ce n'est certainement pas lui, disent-ils, qui a établi la religion chrétienne; ce sont des juifs dissidents qui se sont joints à des platoniciens. Il n'y a pas un dogme du christianisme qui ait été prêché par Jésus-Christ.
C'est ainsi que raisonnent ces hommes téméraires, qui ayant à la fois l'esprit faux et audacieux, osent juger les oeuvres de Dieu, et n'admettent les miracles de l'Ancien Testament que pour rejeter tous ceux du Nouveau.
De ce nombre fut cet infortuné prêtre de Pont-à-Mousson en Lorraine, nommé Nicolas Antoine; on ne lui connaît point d'autre nom. Ayant reçu ce qu'on appelle les quatre mineurs en Lorraine, le prédicant Ferri en passant à Pont-à-Mousson lui donna de grands scrupules, et lui perusada que les quatre mineurs étaient le signe de la bête. Antoine désespéré de porter le signe de la bête, le fit effacer par Ferri, embrassa la religion protestante, et fut ministre à Genève vers l'an 1630.
Plein de la lecture des rabbins, il crut que si les protestants avaient raison contre les papistes, les juifs avaient bien plus raison contre toutes les sectes chrétiennes. Du village de Divonne où il était pasteur, il alla se faire recevoir juif à Venise, avec un petit apprenti en théologie qu'il avait persaudé, et qui après l'abandonna, n'ayant point de vocation pour le martyre.
D'abord le ministre Nicolas Antoine s'abstint de prononcer le nom de Jésus-Christ dans ses sermons et dans ses prières. Mais bientôt échauffé et enhardi par l'exemple des saints juifs qui professaient hardiment le judaïsme devant les princes de Tyr et de Babilone, il s'en alla pieds nus à Genève confesser devant les juges et devant les commis des halles, qu'il n'y a qu'une seule religion sur la terre, parce qu'il n'y a qu'un Dieu; que cette religion est la juive, qu'il faut absolument se faire circoncire; que c'est un crime horrible de manger du lard et du boudin. Il exhorta pathétiquement tous les Genevois qui s'attroupèrent, à cesser d'être enfants de Bélial, à être bons juifs, afin de mériter le royaume des cieux. On le prit, on le lia.
Le petit conseil de Genève, qui ne faisait rien alors sans consulter le conseil des prédicants, leur demanda leur avis. Les plus sensés de ces prêtres opinèrent à faire saigner Nicolas Antoine à la veine céphalique, à le baigner et le nourrir de bons potages, après quoi on l'accoutumerait insensiblement à proconcer le nom de Jésus-Christ, ou du moins à l'entendre prononcer sans grincer des dents comme il lui arrivait toujours. Ils ajoutèrent que les lois souffraient les juifs, qu'il y en avait huit mille à Rome, que beaucoup de marchands sont de vrais juifs; et que puisque Rome admettait huit mille enfants de la synagogue, Genève pouvait bien en tolérer un. A ce mot de tolérance , les autres pasteurs en plus grand nombre, grinçant des dents beaucoup plus qu'Antoine au nom de Jésus-Christ, et charmés d'ailleurs de trouver une occasion de pouvoir faire brûler un homme, ce qui arrivait très rarement, furent absolument pour la brûlure. Ils décidèrent que rien ne servirait mieux à raffermir le véritable christianisme; que les Espagnols n'avaient acquis tant de réputation dans le monde que parce qu'ils faisaient brûler des juifs tous les ans; et qu'après tout, si l'Ancien Testament devait l'emporter sur le Nouveau, Dieu ne manquerait pas de venir éteindre lui-même la flamme du bûcher, comme il fit dans Babilone pour Sidrac, Misac et Abdenago; qu'alors on reviendrait à l'Ancien Testament; mais qu'en attendant il fallait absolument brûler Nicolas Antoine.
Partant, ils conclurent à ôter le méchant ; ce sont leurs propres paroles.
Le syndic Sarasin et le syndic Godefroi, qui étaient de bonnes têtes, trouvèrent le raisonnement du sanhédrin genevois admirable; et comme les plus forts, ils condamnèrent Nicolas Antoine le plus faible, à mourir de la mort de Calanus et du conseiller Dubourg. Cela fut exécuté le 10 avril 1632 dans une très belle place champêtre appelée Plain-palais , en présence de vingt mille hommes qui bénissaient la nouvelle loi, et le grand sens du syndic Sarasin et du syndic Godefroi.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne renouvela point le miracle de la fournaise de Babilone en faveur d'Antoine.
Abauzit, homme très véridique, rapporte dans ses notes, qu'il mourut avec la plus grande constance, et qu'il persista sur le bûcher dans ses sentiments. Il ne s'emporta point contre ses juges lorsqu'on le lia au poteau; il ne montra ni orgueil ni bassesse, il ne pleura point, il ne soupira point, il se résigna. Jamais martyr ne consomma son sacrifice avec une foi plus vive; jamais philosophe n'envisagea une mort horrible avec plus de fermeté. Cela prouve évidemment que sa folie n'était autre chose qu'une forte persuasion. Prions le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament de lui faire miséricorde.
J'en dis autant pour le jésuite Malagrida qui était encore plus fou que Nicolas Antoine, pour l'ex-jésuite Patouillet et pour l'ex-jésuite Paulian, si jamais on les brûle.
Des écrivains en grand nombre qui ont eu le malheur d'être plus philosophes que chrétiens, ont été assez hardis pour nier les miracles de notre Seigneur. Mais après les quatre prêtres dont nous avons parlé, il ne faut plus citer personne. Plaignons ces quatre infortunés aveuglés par leurs lumières trompeuses, et animés par leur mélancolie qui les précipita dans un abîme si funeste.
MIRACLES MODERNES.
SECTION QUATRIÉME.
Tirée d'une lettre déjà imprimée de M. Thero aumônier de M. le comte de Benting, contre les miracles des convulsionnaires.
( Nous n'aurions jamais osé réimprimer cette plaisanterie sur les miracles modernes, si un grand prince n'avait voulu absolument qu'on l'imprimât comme une chose très innocente qui ne fait aucun tort aux miracles anciens, et qui délasse l'esprit sans intéresser la foi. Cependant nous déclarons que nous n'approuvons point du tout cette plaisanterie .)
Si son excellence monsieur le comte n'est pas persuadé de l'authenticité de nos miracles, en récompense son excellence madame la comtesse avait une foi qui était bien consolante. J'ai eu l'agrément de lire quelquefois St Matthieu avec elle, quand monseigneur lisait Cicéron, Virgile, Epictète, Horace ou Marc-Antonin dans son cabinet. Nous en étions un jour à ces paroles du chap. XVII, Je vous dis en vérité que quand vous aurez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à une montagne, range-toi de là, et aussitôt la montagne se transportera de sa place . Ces paroles excitèrent la curiosité, et le zèle de madame. Voilà une belle occasion, me dit-elle, de convertir monsieur mon mari. Nous avons ici près une montagne qui nous cache la plus belle vue du monde: vous avez de la foi plus qu'il n'y en a dans toute la moutarde de Dijon qui est dans mon office; j'ai beaucoup de foi aussi: disons un mot à la montagne, et sûrement nous aurons le plaisir de la voir se promener par les airs. J'ai lu dans l'histoire de St Dunstan, qui est un fameux saint du pays du jésuite Néedham, qu'il fit venir un jour une montagne d'Irlande en Basse-Bretagne, lui donna sa bénédiction et la renvoya chez elle. Je ne doute pas que vous n'en fassiez autant que St Dunstan, vous qui êtes réformé.
Je m'excusai longtemps sur mon peu de crédit auprès du ciel et des montagnes. Si M. Clap. professeur en théologie était ici, lui dis-je, il ne manquerait pas sans doute de faire ce que vous proposez; il y a même tel syndic qui en un besoin serait capable de vous donner ce divertissement; mais songez que je ne suis qu'un pauvre proposant, un jeune chapelain qui n'a fait encore aucun miracle, et qui doit se défier de ses forces.
Il y a commencement à tout, me répliqua madame la comtesse, et je veux absolument que vous me transportiez ma montagne. Je me défendis longtemps; cela lui donna un peu de dépit; vous faites, me dit-elle, comme les gens qui ont une belle voix et qui refusent de chanter quand on les en prie. Je répondis que j'étais enrhumé, et que je ne pouvais chanter. Enfin, elle me dit en colère que j'avais d'assez gros gages pour être complaisant, et pour faire des miracles quand une femme de qualité m'en demandait. Je lui représentai encore avec soumission mon peu d'adresse dans cet art. Comment, dit-elle, Jean-Jacques Rousseau qui n'est qu'un misérable laïque, se vante dans ses lettres imprimées d'avoir fait des miracles à Venise, et vous ne m'en ferez pas? vous qui avez la dignité de mon chapelain, et à qui je donne le double des appointements que Jean-Jacques touchait de M. Languet de Gergi son maître, ambassadeur de France.
Enfin je me rendis; nous priâmes la montagne l'un et l'autre avec dévotion de vouloir bien marcher. Elle n'en fit rien; le rouge monta au visage de madame. Elle est très altière, et veut fortement ce qu'elle veut. Il se pourrait faire, me dit-elle, qu'on dût entendre selon vos principes le contraire de ce qu'on lit dans le texte. Il est dit qu'avec un peu de moutarde de foi, on transportera une montagne; cela signifie peut-être qu'avec une montagne de foi on transportera un peu de moutarde. Elle ordonna sur-le-champ à son maître d'hôtel d'en faire venir un pot. Pour moi, la moutarde me montait au nez; je fis ce que je pus pour empêcher madame de faire cette expérience de physique; elle n'en démordit point, et fut attrapée à sa moutarde, comme elle l'avait été à sa montagne.
Tandis que nous faisions cette opération, arriva monsieur le comte, qui fut assez surpris de voir un pot de moutarde à terre entre madame la comtesse et moi. Elle lui apprit de quoi il était question. M. le comte avec un ton, moitié sérieux, moitié railleur, lui dit que les miracles avaient cessé depuis la Réforme; qu'on n'en avait plus besoin, et qu'un miracle aujourd'hui est de la moutarde après dîner. Ce mot seul dérangea toute la dévotion de madame la comtesse. Il ne faut quelquefois qu'une plaisanterie pour décider de la manière dont on pensera le reste de sa vie.
Madame la comtesse depuis ce moment-là, crut aussi peu aux miracles modernes que son mari. De sorte que je me trouve aujourd'hui le seul homme du château qui ait le sens commun, c'est-à-dire, qui croie aux miracles.
NOUS RÉPÉTONS EXPRESSÉMENT QUE CETTE RAILLERIE EST TROP FORTE, QUOIQU'ELLE SOIT DEMR . THERO, ET QUE S'IL Y EN A DANS LE CURÉ RABELAIS ET DANS LE DOYEN SWIFT D'INFINIMENT PLUS HARDIES, CELA PEUT SEULEMENT DIMINUER LA FAUTE DE MR. THERO, MAIS NON PAS LA JUSTIFIER.
MISSIONS. [p. 163]↩
Ce n'est pas du zèle de nos missionnaires, et de la vérité de notre religion qu'il s'agit, on les connaît assez dans notre Europe chrétienne; et on les respecte assez.
Je ne veux parler que des Lettres curieuses et édifiantes des révérends pères jésuites qui ne sont pas aussi respectables. A peine sont-ils arrivés dans l'Inde qu'ils y prêchent, qu'ils y convertissent des milliers d'Indiens, et qu'ils font des milliers de miracles. Dieu me préserve de les contredire. On sait combien il est facile à un Biscayen, à un Bergamasque, à un Normand d'apprendre la langue indienne en peu de jours et de prêcher en indien.
A l'égard des miracles rien n'est plus aisé que d'en faire à six mille lieues de nous, puisqu'on en a tant fait à Paris dans la paroisse St Médard. La grâce suffisante des molinistes a pu sans doute opérer sur les bords du Gange aussi bien que la grâce efficace des jansénistes au bord de la rivière des Gobelins. Mais nous avons déjà tant parlé de miracles que nous n'en dirons plus rien.
Un révérend père jésuite arriva l'an passé à Déli à la cour du Grand Mogol. Ce n'était pas un jésuite mathématicien et homme d'esprit venu pour corriger le calendrier, et pour faire fortune: c'était un de ces pauvres jésuites de bonne foi, un de ces soldats que leur général envoie, et qui obéissent sans raisonner.
M. Audrais mon commissionnaire lui demanda ce qu'il venait faire à Déli; il répondit qu'il avait ordre du révérend père Ricci de délivrer le Grand Mogol des griffes du diable, et de convertir toute sa cour. J'ai déjà, dit-il, baptisé plus de vingt enfants dans la rue sans qu'ils en sussent rien, en leur jetant quelques gouttes d'eau sur la tête. Ce sont autant d'anges, pourvu qu'ils aient le bonheur de mourir incessamment. J'ai guéri une pauvre vieille femme de la migraine en faisant le signe de la croix derrière elle. J'espère en peu de temps convertir les mahométans de la cour et les gentous du peuple. Vous verrez dans Déli, dans Agra et dans Bénarès autant de bons catholiques adorateurs de la vierge Marie, que d'idolâtres adorateurs du démon.
M. AUDRAIS.
Vous croyez donc, mon révérend père, que les peuples de ces contrées immenses adorent des idoles et le diable?
LE JÉSUITE.
Sans doute, puisqu'ils ne sont pas de ma religion.
M. AUDRAIS.
Fort bien. Mais quand il y aura dans l'Inde autant de catholiques que d'idolâtres, ne craignez-vous point qu'ils ne se battent, que le sang ne coule longtemps, que tout le pays ne soit saccagé? cela est déjà arrivé partout où vous avez mis le pied.
LE JÉSUITE.
Vous m'y faites penser; rien ne serait plus salutaire. Les catholiques égorgés iraient en paradis (dans le jardin) et les gentous dans l'enfer éternel créé pour eux de toute éternité, selon la grande miséricorde de Dieu, et pour sa grande gloire, car Dieu est excessivement glorieux.
M. AUDRAIS.
Mais si on vous dénonçait, et si on vous donnait les étrivières?
LE JÉSUITE.
Ce serait encore pour sa gloire. Mais je vous conjure de me garder le secret, et de m'épargner le bonheur du martyre.
MONDE. [p. 165]↩
DU MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES.
En courant de tous côtés pour m'instruire, je rencontrai un jour des disciples de Platon. Venez avec nous, me dit l'un d'eux; vous êtes dans le meilleur des mondes; nous avons bien surpassé notre maître. Il n'y avait de son temps que cinq mondes possibles, parce qu'il n'y a que cinq corps réguliers; mais actuellement qu'il y a une infinité d'univers possibles, Dieu a choisi le meilleur; venez, et vous vous en trouverez bien. Je lui répondis humblement: Les mondes que Dieu pouvait créer, étaient ou meilleurs, ou parfaitement égaux, ou pires; il ne pouvait prendre le pire; ceux qui étaient égaux, supposé qu'il y en eût, ne valaient pas la préférence; ils étaient entièrement les mêmes: on n'a pu choisir entre eux; prendre l'un, c'est prendre l'autre. Il était donc impossible qu'il ne prît pas le meilleur. Mais comment les autres étaient-ils possibles, quand il était impossible qu'ils existassent?
Il me fit de très belles distinctions, assurant toujours sans s'entendre, que ce monde-ci est le meilleur de tous les mondes réellement impossibles. Mais me sentant alors tourmenté de la pierre, et souffrant des douleurs insupportables, les citoyens du meilleur des mondes me conduisirent à l'hôpital voisin. Chemin faisant, deux de ces bienheureux habitants furent enlevés par des créatures leurs semblables: on les chargea de fers, l'un pour quelques dettes, l'autre sur un simple soupçon. Je ne sais pas si je fus conduit dans le meilleur des hôpitaux possibles; mais je fus entassé avec deux ou trois mille misérables qui souffraient comme moi. Il y avait là plusieurs défenseurs de la patrie, qui m'apprirent qu'ils avaient été trépanés et disséqués vivants, qu'on leur avait coupé des bras, des jambes, et que plusieurs milliers de leurs généreux compatriotes avaient été massacrés dans l'une des trente batailles données dans la dernière guerre, qui est environ la cent millième guerre depuis que nous connaissons des guerres. On voyait aussi dans cette maison environ mille personnes des deux sexes qui ressemblaient à des spectres hideux, et qu'on frottait d'un certain métal, parce qu'ils avaient suivi la loi de la nature, et parce que la nature avait je ne sais comment pris la précaution d'empoisonner en eux la source de la vie. Je remerciai mes deux conducteurs.
Quand on m'eut plongé un fer bien tranchant dans la vessie, et qu'on eut tiré quelques pierres de cette carrière; quand je fus guéri, et qu'il ne me resta plus que quelques incommodités douloureuses pour le reste de mes jours, je fis mes représentations à mes guides; je pris la liberté de leur dire qu'il y avait du bon dans ce monde, puisqu'on m'avait tiré quatre cailloux du sein de mes entrailles déchirées; mais que j'aurais encore mieux aimé que les vessies eussent été des lanternes, que non pas qu'elles fussent des carrières. Je leur parlai des calamités et crimes innombrables qui couvrent cet excellent monde. Le plus intrépide d'entre eux, qui était un Allemand, mon compatriote, m'apprit que tout cela n'est qu'une bagatelle.
Ce fut, dit-il, une grande faveur du ciel envers le genre humain, que Tarquin violât Lucrèce, et que Lucrèce se poignardât, parce qu'on chassa les tyrans, et que le viol, le suicide et la guerre établirent une république qui fit le bonheur des peuples conquis. J'eus peine à convenir de ce bonheur. Je ne conçus pas d'abord quelle était la félicité des Gaulois et des Espagnols, dont on dit que César fit périr trois millions. Les dévastations et les rapines me parurent aussi quelque chose de désagréable. Mais le défenseur de l'optimisme n'en démordit point; il me disait toujours comme le geôlier de Don Carlos, Paix, paix, c'est pour votre bien . Enfin, étant poussé à bout, il me dit qu'il ne fallait pas prendre garde à ce globule de la terre, où tout va de travers; mais que dans l'étoile de Sirius, dans Orion, dans l'oeil du Taureau, et ailleurs, tout est parfait. Allons-y donc, lui dis-je.
Un petit théologien me tira alors par le bras; il me confia que ces gens-là étaient des rêveurs qu'il n'était point du tout nécessaire qu'il y eût du mal sur la terre, qu'elle avait été formée exprès pour qu'il n'y eût jamais que du bien; et pour vous le prouver, sachez que les choses se passèrent ainsi autrefois pendant dix ou douze jours. Hélas! lui répondis-je, c'est bien dommage, mon révérend père, que cela n'ait pas continué.
MONSTRES. [p. 167]↩
Il est plus difficile qu'on ne pense de définir les monstres. Donnerons-nous ce nom à un animal énorme, à un poisson, à un serpent de quinze pieds de long? mais il y en a de vingt, de trente pieds, auprès desquels les premiers seraient peu de chose.
Il y a les monstres par défaut. Mais si les quatre petits doigts des pieds et des mains manquent à un homme bien fait, et d'une figure gracieuse, sera-t-il un monstre? Les dents lui sont plus nécessaires. J'ai vu un homme né sans aucune dent, il était d'ailleurs très agréable. La privation des organes de la génération, bien plus nécessaires encore, ne constituent point un animal monstrueux.
Il y a les monstres par excès; mais ceux qui ont six doigts, le croupion allongé en forme de petite queue, trois testicules, deux orifices à la verge, ne sont pas réputés monstres.
La troisième espèce est de ceux qui auraient des membres d'autres animaux, comme un lion avec des ailes d'autruche, un serpent avec des ailes d'aigle, tel que le griffon et l'ixion des Juifs. Mais toutes les chauve-souris sont pourvues d'ailes; les poissons volants en ont, et ne sont point des monstres.
Réservons donc ce nom pour les animaux dont les difformités nous font horreur.
Le premier nègre pourtant fut un monstre pour les femmes blanches, et la première de nos beautés fut un monstre aux yeux des nègres.
Si Poliphême et les cyclopes avaient existé, les gens qui portaient des yeux aux deux côtés de la racine du nez, auraient été déclarés monstres dans l'île de Lipari et dans le voisinage de l'Etna.
J'ai vu une femme à la foire qui avait quatre mamelles et une queue de vache à la poitrine. Elle était monstre sans difficulté, quand elle laissait voir sa gorge, et femme de mise quand elle la cachait.
Les centaures, les minotaures auraient été des monstres, mais de beaux monstres. Surtout un corps de cheval bien proportionné qui aurait servi de base à la partie supérieure d'un homme, aurait été un chef-d'oeuvre sur la terre; ainsi que nous nous figurons comme des chefs-d'oeuvre du ciel, ces esprits que nous appelons anges , et que nous peignons, que nous sculptons dans nos églises, tantôt ornés de deux ailes, tantôt de quatre, et même de six.
Nous avons déjà demandé avec le sage Locke quelle est la borne entre la figure humaine et l'animale, quel est le point de monstruosité auquel il faut se fixer pour ne pas baptiser un enfant, pour ne le pas compter de notre espèce, pour ne lui pas accorder une âme. Nous avons vu que cette borne est aussi difficile à poser qu'il est difficile de savoir ce que c'est qu'une âme, car il n'y a que les théologiens qui le sachent.
Pourquoi les satyres que vit St Jérôme, nés de filles et de singes, auraient-ils été réputés monstres? ne se seraient-ils pas crus au contraire mieux partagés que nous? n'auraient ils pas eu plus de force et plus d'agilité? ne se seraient-ils pas moqués de notre espèce, à qui la cruelle nature a refusé des vêtements et des queues? un mulet né de deux espèces différentes, un jumart fils d'un taureau et d'une jument, un tarin né, dit-on, d'un serin et d'une linotte, ne sont point des monstres.
Mais comment les mulets, les jumarts, les tarins etc. qui sont engendrés, n'engendrent-ils point? et comment les seministes, les ovistes, les animalculistes expliquent-ils la formation de ces métis?
Je vous répondrai qu'ils ne l'expliquent point du tout. Les seministes n'ont jamais connu la façon dont la semence d'un âne ne communique à son mulet que ses oreilles et un peu de son derrière. Les ovistes ne font comprendre, ni ne comprennent par quel art une jument peut avoir dans son oeuf autre chose qu'un cheval. Et les animalculistes ne voient point comment un petit embryon d'âne vient mettre ses oreilles dans une matrice de cavale.
Celui qui dans sa Vénus physique prétendit que tous les animaux et tous les monstres se formaient par attraction, réussit encore moins que les autres à rendre raison de ces phénomènes si communs et si surprenants.
Hélas! mes amis, nul de vous ne sait comment il fait des enfants; vous ignorez les secrets de la nature dans l'homme, et vous voulez les deviner dans le mulet!
A toute force vous pourrez dire d'un monstre par défaut, Toute la semence nécessaire n'est pas parvenue à sa place, ou bien le petit ver spermatique a perdu quelque chose de sa substance, ou bien l'oeuf s'est froissé. Vous pourrez, sur un monstre par excès, imaginer que quelques parties superflues du sperme ont surabondé, que de deux vers spermatiques réunis, l'un n'a pu animer qu'un membre de l'animal, et que ce membre est resté de surérogation; que deux oeufs se sont mêlés, et qu'un de ces oeufs n'a produit qu'un membre, lequel s'est joint au corps de l'autre.
Mais que direz-vous de tant de monstruosités par addition de parties animales étrangères? comment expliquerez-vous une écrevisse sur le cou d'une fille? une queue de rat sur une cuisse, et surtout les quatre pis de vache avec la queue qu'on a vus à la foire St Germain? vous serez réduits à supposer que la mère de cette femme était de la famille de Pasiphaé.
Allons, courage, disons ensemble, Que sais-je?
MONTAGNE. [p. 170]↩
C'est une fable bien ancienne, bien universelle que celle de la montagne, qui ayant effrayé tout le pays par ses clameurs en travail d'enfant, fut sifflée de tous les assistants, quand elle ne mit au monde qu'une souris. Le parterre n'était pas philosophe. Les siffleurs devaient admirer. Il était aussi beau à la montagne d'accoucher d'une souris, qu'à la souris d'accoucher d'une montagne. Un rocher qui produit un rat, est quelque chose de très prodigieux; et jamais la terre n'a vu rien qui approche d'un tel miracle. Tous les globes de l'univers ensemble, ne pourraient pas faire naître une mouche. Là où le vulgaire rit, le philosophe admire; et il rit où le vulgaire ouvre de grands yeux stupides d'étonnement.
MORALE. [p. ibid .]↩
Bavards prédicateurs, extravagants controversistes, tâchez de vous souvenir que votre maître n'a jamais annoncé que le sacrement était le signe visible d'une chose invisible; il n'a jamais admis quatre vertus cardinales et trois théologales; il n'a jamais examiné si sa mère était venue au monde maculée ou immaculée; il n'a jamais dit que les petits enfants qui mouraient sans baptême seraient damnés. Cessez de lui faire dire des choses auxquelles il ne pensa point. Il a dit, selon la vérité aussi ancienne que le monde, Aimez Dieu et votre prochain; tenez-vous-en là misérables ergoteurs, prêchez la morale et rien de plus. Mais observez-la cette morale; que les tribunaux ne retentissent plus de vos procès, n'arrachez plus par la griffe d'un procureur un peu de farine à la bouche de la veuve et de l'orphelin. Ne disputez plus un petit bénéfice avec la même fureur qu'on disputa la papauté dans le grand schisme d'Occident. Moines, ne mettez plus (autant qu'il est en vous) l'univers à contribution; et alors nous pourrons vous croire.
MOUVEMENT. [p. 171]↩
Un philosophe des environs du mont Krapac, me disait que le mouvement est essentiel à la matière.
Tout se meut, disait-il; le soleil tourne continuellement sur lui-même, les planètes en font autant, chaque planète a plusieurs mouvements différents, et dans chaque planète tout transpire, tout est crible, tout est criblé; le plus dur métal est percé d'une infinité de pores, par lesquels s'échappe continuellement un torrent de vapeurs qui circulent dans l'espace. L'univers n'est que mouvement; donc le mouvement est essentiel à la matière.
Monsieur, lui dis-je, ne pourrait-on pas vous répondre, Ce bloc de marbre, ce canon, cette maison, cette montagne ne remuent pas; donc le mouvement n'est pas essentiel.
Ils remuent, répondit-il; ils vont dans l'espace avec la terre par leur mouvement commun, et ils remuent si bien, (quoique insensiblement) par leur mouvement propre, qu'au bout de quelques siècles, il ne restera rien de leurs masses, dont chaque instant détache continuellement des particules.
Mais, Monsieur, je puis concevoir la matière en repos; donc le mouvement n'est pas de son essence.
Vraiment, je me soucie bien que vous conceviez ou que vous ne conceviez pas la matière en repos. Je vous dis qu'elle ne peut y être.
Cela est hardi; et le chaos, s'il vous plaît?
Ah, ah! le chaos! si nous voulions parler du chaos, je vous dirais que tout y était nécessairement en mouvement, et que le souffle de Dieu y était porté sur les eaux ; que l'élément de l'eau étant reconnu existant, les autres éléments existaient aussi; que par conséquent le feu existait, qu'il n'y a point de feu sans mouvement, que le mouvement est essentiel au feu. Vous n'auriez pas beau jeu avec le chaos.
Hélas! qui peut avoir beau jeu avec tous ces sujets de dispute? mais vous qui en savez tant, dites-moi pourquoi un corps en pousse un autre? parce que la matière est impénétrable, parce que deux corps ne peuvent être ensemble dans le même lieu, parce qu'en tout genre le plus faible est chassé pas le plus fort.
Votre dernière raison est plus plaisante que philosophique. Personne n'a pu encore deviner la cause de la communication du mouvement.
Cela n'empêche pas qu'il ne soit essentiel à la matière. Personne n'a pu deviner la cause du sentiment dans les animaux; cependant, ce sentiment leur est si essentiel, que si vous supprimez l'idée de sentiment, vous anéantissez l'idée d'animal.
Eh bien, je vous accorde pour un moment que le mouvement soit essentiel à la matière. (pour un moment au moins, car je ne veux pas me brouiller avec les théologiens) Dites-nous donc comment une boule en fait mouvoir une autre?
A cause de son ressort, la boule A s'enfonce dans la boule B; la partie B ainsi enfoncée, presse tout le reste de sa substance et la fait marcher. Si la boule B était sans ressort, si elle était parfaitement dure, elle resterait à sa place.
Eh bien qu'est-ce que ce ressort, où est son origine?
Vous êtes trop curieux, vous voulez que je vous dise ce qu'aucun philosophe n'a pu nous apprendre.
Il est plaisant que nous connaissions les lois du mouvement, et que nous ignorions le principe du ressort qui est la cause de toute communication du mouvement.
Il en est ainsi de tout; nous savons les lois du raisonnement, et nous ne savons pas ce qui raisonne en nous. Les canaux dans lesquels notre sang et nos liqueurs coulent, nous sont très connus, et nous ignorons ce qui forme notre sang et nos liqueurs. Nous sommes en vie, et nous ne savons pas ce qui nous donne la vie.
Apprenez-moi du moins si le mouvement étant essentiel, il n'y a pas toujours égale quantité de mouvement dans le monde?
C'est une ancienne chimère d'Epicure renouvelée par Descartes. Je ne vois pas que cette égalité de mouvement dans le monde, soit plus nécessaire qu'une égalité de triangles. Il est essentiel qu'un triangle ait trois angles et trois côtés; mais il n'est pas essentiel qu'il y ait toujours un nombre égal de triangles sur ce globe.
Mais n'y a-t-il pas toujours égalité de forces, comme le disent d'autres philosophes?
C'est la même chimère. Il faudrait qu'en ce cas il y eût toujours un nombre égal d'hommes, d'animaux, d'êtres mobiles, ce qui est absurde.
A propos, qu'est-ce que la force d'un corps en mouvement? c'est le produit de sa masse par sa vitesse dans un temps donné. La masse d'un corps est quatre, sa vitesse est quatre, la force de son coup sera seize. Un autre corps est deux, sa vitesse deux, sa force est quatre; c'est le principe de toutes les mécaniques. Leibnitz annonça emphatiquement que ce principe était défectueux. Il prétendit qu'il fallait mesurer cette force, ce produit par la masse multipliée par le carré de la vitesse. Ce n'était qu'une chicane, une équivoque indigne d'un philosophe, fondée sur l'abus de la découverte du grand Galilée, que les espaces parcourus étaient comme les carrés des temps et des vitesses.
Leibnitz ne considérait pas le temps qu'il fallait considérer. Aucun mathématicien anglais n'adopta ce système de Leibnitz. Il fut reçu quelque temps en France par un petit nombre de géomètres. Il infecta quelques livres et même les Institutions physiques d'une personne illustre. Maupertuis traite fort mal Mairan dans un livret intitulé A B C , comme s'il avait voulu enseigner l'a b c à celui qui suivait l'ancien et véritable calcul. Mairan avait raison; il tenait pour l'ancienne mesure de la masse multipliée par la vitesse. On revint enfin à lui; le scandale mathématique disparut, et on renvoya dans les espaces imaginaires le charlatanisme du carré de la vitesse, avec les monades, qui sont le miroir concentrique de l'univers, et avec l'harmonie préétablie.
MOYSE. [p. 174]↩
La philosophie dont on a quelquefois passé les bornes, les recherches de l'antiquité, l'esprit de discussion et de critique, ont été poussés si loin, qu'enfin plusieurs savants ont douté s'il y avait jamais eu un Moyse, et si cet homme n'était pas un être fantastique tels que l'ont été probablement, Persée, Bacchus, Atlas, Penthésilée, Vesta, Rhéa Sylvia, Isis, Sammonocodom, Fo, Mercure Trismégiste, Odin, Merlin, Francus, Robert le Diable et tant d'autres héros de romans, dont on a écrit la vie et les prouesses.
Il n'est pas vraisemblable, disent les incrédules, qu'il ait existé un homme dont toute la vie est un prodige continuel.
Il n'est pas vraisemblable qu'il eût fait tant de miracles épouvantables en Egypte, en Arabie et en Syrie, sans qu'ils eussent retenti dans toute la terre.
Il n'est pas vraisemblable qu'aucun écrivain égyptien, ou grec, n'eût transmis ces miracles à la postérité. Il n'en est cependant fait mention que par les seuls Juifs: et dans quelque temps que cette histoire ait été écrite par eux, elle n'a été connue d'aucune nation que vers le second siècle. Le premier auteur qui cite expressément Longin, Traité du sublime . les livres de Moyse, est Longin ministre de la reine Zénobie du temps de l'empereur Aurélien.
Il est à remarquer que l'auteur du Mercure Trismégiste, qui certainement était Egyptien, ne dit pas un seul mot de ce Moyse.
Si un seul auteur ancien avait rapporté un seul de ces miracles, Eusèbe aurait sans doute triomphé de ce témoignage, soit dans son histoire, soit dans sa Préparation évangélique .
Il reconnaît à la vérité des auteurs qui ont cité son nom, mais aucun qui ait cité ses prodiges. Avant lui, les Juifs Joseph et Philon qui ont tant célébré leur nation, ont recherché tous les écrivains chez lesquels le nom de Moyse se trouvait; mais il n'y en a pas un seul qui fasse la moindre mention des actions merveilleuses qu'on lui attribue.
Dans ce silence général du monde entier, voici comme les incrédules raisonnent avec une témérité qui se réfute d'elle-même.
Les Juifs sont les seuls qui aient eu le Pentateuque qu'ils attribuent à Moyse. Il est dit dans leurs livres même, que ce Pentateuque ne fut connu que sous leur roi Josias, trente-six ans avant la première destruction de Jérusalem et de la captivité; on IV Rois, ch. XII et Paralipom. II, ch. XXXIV. n'en trouva qu'un seul exemplaire chez le pontife Helcias, qui le déterra au fond d'un coffre-fort en comptant de l'argent. Le pontife l'envoya au roi par son scribe Saphan.
Cela pourrait, disaient-ils, obscurcir l'authenticité du Pentateuque.
En effet, eût-il été possible, que si le Pentateuque eût été connu de tous les Juifs, Salomon, le sage Salomon inspiré de Dieu même, en lui bâtissant un temple par son ordre, eût orné ce temple de tant de figures contre la loi expresse de Moyse?
Tous les prophètes juifs qui avaient prophétisé au nom du Seigneur depuis Moyse jusqu'à ce roi Josias, ne se seraient-ils pas appuyés dans leurs prédications de toutes les lois de Moyse? n'auraient-ils pas cité mille fois ses propres paroles? ne les auraient-ils pas commentées? aucun d'eux cependant n'en cite deux lignes; aucun ne rappelle le texte de Moyse; ils lui sont même contraires en plusieurs endroits.
Selon ces incrédules, les livres attribués à Moyse n'ont été écrits que parmi les Babyloniens pendant la captivité, ou immédiatement après par Esdras. On ne voit en effet que des terminaisons persanes et chaldéennes dans les écrits juifs; Babel , porte de Dieu; Phégor-beel , ou Beel-phégor , Dieu du précipice; Zebuth-beel , ou Beel-Zebuth , Dieu des insectes; Bethel , maison de Dieu: Daniel , jugement de Dieu; Gabriel , homme de Dieu; Jabel , affligé de Dieu; Jaïel , la vie de Dieu; Israël , voyant Dieu; Oziel , force de Dieu; Raphaël , secours de Dieu; Uriel , le feu de Dieu.
Ainsi tout est étranger chez la nation juive, étrangère elle-même en Palestine; circoncision, cérémonies, sacrifices, arche, chérubins, bouc Hazazel; baptême de justice, baptême simple, épreuves, divination, explication des songes, enchantement des serpents, rien ne venait de ce peuple; rien ne fut inventé par lui.
Le célèbre milord Bolingbroke ne croit point du tout que Moyse ait existé; il croit voir dans le Pentateuque une foule de contradictions et de fautes de chronologie et de géographie qui épouvantent; des noms de plusieurs villes qui n'étaient pas encore bâties, des préceptes donnés aux rois, dans un temps où non seulement les Juifs n'avaient point de rois, mais où il n'était pas probable qu'ils en eussent jamais; puis qu'ils vivaient dans des déserts sous des tentes à la manière des Arabes bédouins.
Ce qui lui paraît surtout de la contradiction la plus palpable, c'est le don de quarante-huit villes avec leurs faubourgs faits aux lévites, dans un pays où il n'y avait pas un seul village: c'est principalement sur ces quarante-huit villes qu'il relance Abadie, et qu'il a même la dureté de le traiter avec l'horreur et le mépris d'un seigneur de la chambre haute et d'un ministre d'Etat pour un petit prêtre étranger qui veut faire le raisonneur.
Je prendrai la liberté de représenter au vicomte de Bolingbroke, et à tous ceux qui pensent comme lui, que non seulement la nation juive a toujours cru à l'existence de Moyse, et à celle de ses livres; mais que Jésus-Christ même lui a rendu témoignage. Les quatre évangélistes, les Actes des apôtres la reconnaissent; St Matthieu dit expressément que Moyse et Elie apparurent à Jésus-Christ sur la montagne, pendant la nuit de la transfiguration, et St Luc en dit autant.
Jésus-Christ déclare dans St Matthieu qu'il n'est point venu pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. On renvoie souvent dans le Nouveau Testament à la loi de Moyse et aux prophètes; l'Eglise entière à toujours cru le Pentateuque écrit par Moyse; et de plus de cinq cents sociétés différentes qui se sont établies depuis si longtemps dans le christianisme, aucune n'a jamais douté de l'existence de ce grand prophète: il faut donc soumettre notre raison, comme tant d'hommes ont soumis la leur.
Je sais fort bien que je ne gagnerai rien sur l'esprit du vicomte ni de ses semblables. Ils sont trop persuadés que les livres juifs ne furent écrits que très tard: qu'ils ne furent écrits que pendant la captivité des deux tribus qui restaient. Mais nous aurons la consolation d'avoir l'Eglise pour nous.
Si vous voulez vous instruire et vous amuser de l'antiquité; lisez la vie de Moyse au premier volume, page 243.
NATURE. [p. 177]↩
Dialogue entre le philosophe & la nature.
LE PHILOSOPHE.
Qui es-tu, nature, je vis dans toi, il y a cinquante ans que je te cherche, et je n'ai pu te trouver encore?
LA NATURE.
Les anciens Egyptiens qui vivaient, dit-on, des douze cents ans, me firent le même reproche. Ils m'appelaient Isis; ils me mirent un grand voile sur la tête, et ils dirent que personne ne pouvait le lever.
LE PHILOSOPHE.
C'est ce qui fait que je m'adresse à toi. J'ai bien pu mesurer quelques-uns de tes globes, connaître leurs routes, assigner les lois du mouvement; mais je n'ai pu savoir qui tu es.
Es-tu toujours agissante? es-tu toujours passive? tes éléments se sont-ils arrangés d'eux-mêmes, comme l'eau se place sur le sable, l'huile sur l'eau, l'air sur l'huile? as-tu un esprit qui dirige toutes tes opérations, comme les conciles sont inspirés dès qu'ils sont assemblés, quoique leurs membres soient quelquefois des ignorants? de grâce, dis-moi le mot de ton énigme.
LA NATURE.
Je suis le grand tout. Je n'en sais pas davantage. Je ne suis pas mathématicienne; et tout est arrangé chez moi selon les lois mathématiques. Devine si tu peux comment tout cela s'est fait.
LE PHILOSOPHE.
Certainement, puisque ton grand tout ne sait pas les mathématiques, et que tes lois sont de la plus profonde géométrie, il faut qu'il y ait un éternel géomètre qui te dirige, une intelligence suprême qui préside à tes opérations.
LA NATURE.
Tu as raison; je suis eau, terre, feu, athmosphère, métal, minéral, pierre, végétal, animal. Je sens bien qu'il y a dans moi une intelligence; tu en as une, tu ne la vois pas. Je ne vois pas non plus la mienne; je sens cette puissance invisible; je ne puis la connaître: pourquoi voudrais-tu, toi qui n'es qu'une petite partie de moi-même, savoir ce que je ne sais pas?
LE PHILOSOPHE.
Nous sommes curieux. Je voudrais savoir comment étant si brute dans tes montagnes, dans tes déserts, dans tes mers, tu parais pourtant si industrieuse dans tes animaux, dans tes végétaux.
LA NATURE.
Mon pauvre enfant, veux-tu que je te dise la vérité? c'est qu'on m'a donné un nom qui ne me convient pas, on m'appelle nature et je suis tout art.
LE PHILOSOPHE.
Ce mot dérange toutes mes idées. Quoi! la nature ne serait que l'art?
LA NATURE.
Non sans doute. Ne sais-tu pas qu'il y a un art infini dans ces mers, dans ces montagnes que tu trouves si brutes? ne sais-tu pas que toutes ces eaux gravitent vers le centre de la terre, et ne s'élèvent que par des lois immuables? que ces montagnes qui couronnent la terre sont les immenses résevoirs des neiges éternelles qui produisent sans cesse ces fontaines, ces lacs, ces fleuves, sans lesquels mon genre animal et mon genre végétal périraient. Et quant à ce qu'on appelle mes règnes animal, végétal, minéral, tu n'en vois ici que trois, apprends que j'en ai des millions. Mais si tu considères seulement la formation d'un insecte, d'un épi de blé, de l'or et du cuivre, tout te paraîtra merveilles de l'art.
LE PHILOSOPHE.
Il est vrai. Plus j'y songe, plus je vois que tu n'es que l'art de je ne sais quel grand être bien puissant et bien industrieux qui se cache et qui te fait paraître. Tous les raisonneurs depuis Thalès, et probablement longtemps avant lui, ont joué à colin-maillard avec toi; ils ont dit, je te tiens, et ils ne tenaient rien. Nous ressemblons tous à Ixion; il croyait embrasser Junon, et il ne jouissait que d'une nuée.
LA NATURE.
Puisque je suis tout ce qui est, comment un être tel que toi, une si petite partie de moi-même pourrait-elle me saisir? contentez-vous atomes, mes enfants, de voir quelques atomes qui vous environnent, de boire quelques gouttes de mon lait, de végéter quelques moments sur mon sein, et de mourir sans avoir connu votre mère et votre nourrice.
LE PHILOSOPHE.
Ma chère mère, dis-moi un peu pourquoi tu existes, pourquoi il y a quelque chose?
LA NATURE.
Je te répondrai ce que je réponds depuis tant de siècles à tous ceux qui m'interrogent sur les premiers principes, je n'en sais rien .
LE PHILOSOPHE.
Le néant vaudrait-il mieux que cette multitude d'existences faites pour être continuellement dissoutes, cette foule d'animaux nés et reproduits pour en dévorer d'autres et pour être dévorés, cette foule d'êtres sensibles formés pour tant de sensations douloureuses; cette autre foule d'intelligences qui si rarement entendent raison, à quoi bon tout cela, nature?
LA NATURE.
Oh! va interroger celui qui m'a faite.
NOMBRE. [p. 180]↩
Euclide avait-il raison de définir le nombre, collection d'unités de même espèce?
Quand Newton dit que le nombre est un rapport abstrait d'une quantité à un autre de même espèce, n'a-t-il pas entendu par là l'usage des nombres en arithmétique, en géométrie?
Volf dit: Le nombre est ce qui a le même rapport avec l'unité, qu'une ligne droite avec une ligne droite. N'est-ce pas plutôt une propriété attribuée au nombre qu'une définition?
Si j'osais, je définirais simplement le nombre, l' idée de plusieurs unités .
Je vois du blanc; j'ai une sensation, une idée de blanc. Je vois du vert à côté. Il n'importe que ces deux choses soient ou ne soient pas de la même espèce; je puis compter deux idées. Je vois quatre hommes et quatre chevaux: j'ai l'idée de huit: de même trois pierres et six arbres me donneront l'idée de neuf.
Que j'additionne, que je multiplie, que je soustraie, que je divise; ce sont des opérations de ma faculté de penser que j'ai reçue du maître de la nature; mais ce ne sont point des propriétés inhérentes au nombre. Je puis carrer 3, le cuber; mais il n'y a certainement dans la nature aucun nombre qui soit carré ou cube.
Je conçois bien ce que c'est qu'un nombre pair ou impair; mais je ne concevrai jamais ce que c'est qu'un nombre parfait ou imparfait.
Les nombres ne peuvent avoir rien par eux-mêmes. Quelles propriétés, quelle vertu pourraient avoir dix cailloux, dix arbres, dix idées, seulement en tant qu'ils sont dix? Quelle supériorité aura un nombre divisible en trois pairs sur un autre divisible en deux pairs?
Pythagore est le premier, dit-on, qui ait découvert des vertus divines dans les nombres. Je doute qu'il soit le premier; car il avait voyagé en Egypte, à Babilone et dans l'Inde; et il devait en avoir rapporté bien des connaissances et des rêveries. Les Indiens surtout inventeurs de ce jeu si combiné et si compliqué des échecs, et de ces chiffres si commodes que les Arabes apprirent d'eux, et qui nous ont été communiqués après tant de siècles; ces Indiens, dis-je, joignaient à leurs sciences d'étranges chimères; les Chaldéens en avaient encore davantage, et les Egyptiens encore plus. On sait assez que la chimère tient à notre nature. Heureux qui peut s'en préserver! heureux, qui après avoir eu quelques accès de cette fièvre de l'esprit, peut recouvrer une santé tolérable!
Porphire, dans la Vie de Pythagore , dit que le nombre 2 est funeste. On pourrait dire que c'est au contraire le plus favorable de tous. Malheur à celui qui est toujours seul! malheur à la nature, si l'espèce humaine et celle des animaux n'étaient souvent deux-à-deux!
Si 2 était de mauvais augure, en récompense 3 était admirable; 4 était divin; mais les pythagoriciens, et leurs imitateurs oubliaient alors que ce chiffre mystérieux 4 si divin, était composé de deux fois deux, nombre diabolique. Six avait son mérite; parce que les premiers statuaires avaient partagé leurs figures en six modules. Nous avons vu que, selon les Chaldéens, Dieu avait créé le monde en 6 gahambars. Mais 7 était le nombre le plus merveilleux; car il n'y avait alors que sept planètes; chaque planète avait son ciel, et cela composait sept cieux, sans qu'on sût ce que voulait dire ce mot de ciel . Toute l'Asie comptait par semaines de sept jours. On distinguait la vie de l'homme en sept âges. Que de raisons en faveur de ce nombre!
Les Juifs ramassèrent avec le temps quelques balayures de cette philosophie. Elle passa chez les premiers chrétiens d'Alexandrie avec les dogmes de Platon. Elle éclata principalement dans l'Apocalypse de Cérinthe, attribué à Jean le Baptiseur.
Apocalypse, ch. XIII. On en voit un grand exemple dans le nombre de la bête.
On ne peut acheter ni vendre, à moins qu'on n'ait le caractère de la bête, ou son nom, ou son nombre. C'est ici la science. Que celui qui a de l'entendement compte le nombre de la bête; car son nom est d'homme, et son nombre est 666 .
On sait quelle peine tous les grands docteurs ont prise pour deviner le mot de l'énigme. Ce nombre, composé de 3 fois 2 à chaque chiffre, signifiait-il 3 fois funeste à la troisième puissance? Il y avait deux bêtes; et l'on ne sait pas encore de laquelle l'auteur a voulu parler. Nous avons vu que l'évêque Bossuet, moins heureux en arithmétique qu'en oraisons funèbres, a démontré que Dioclétien est la bête; parce qu'on trouve en chiffres romains 666 dans les lettres de son nom, en retranchant les lettres qui gâteraient cette opération. Mais en se servant de chiffres romains, il ne s'est pas souvenu que l'Apocalypse est écrite en grec. Un homme éloquent peut tomber dans cette méprise. (Voyez Apocalypse . )
Le pouvoir des nombres fut d'autant plus respecté parmi nous, qu'on n'y comprenait rien.
Vous avez pu, ami lecteur, observer au mot figure quelles fines allégories Augustin, évêque d'Hippone, tira des nombres.
Ce goût subsista si longtemps, qu'il triompha au concile de Trente. On y conserva les mystères, appelés sacrements dans l'Eglise latine, parce que les dominicains, et Soto à leur tête, alléguèrent qu'il y avait sept choses principales qui contribuaient à la vie, sept planètes, sept vertus, sept péchés mortels, six jours de création et un de repos qui font sept; plus sept plaies d'Egypte; plus sept béatitudes; mais malheureusement les pères oublièrent que l'Exode compte dix plaies, et que les béatitudes sont au nombre de huit dans St Matthieu, et au nombre de quatre dans St Luc. Mais des savants on aplani cette petite difficulté, en retranchant de St Matthieu les quatre béatitudes de St Luc; reste à six: ajoutez l'unité à ces six, vous aurez sept. Consultez Fra Paolo Sarpi au livre second de son Histoire du concile .
NOUVEAU, NOUVEAUTÉS. [p. 182]↩
Il semble que les premiers mots des Métamorphoses d'Ovide, in nova fert animus , soient la devise du genre humain. Personne n'est touché de l'admirable spectacle du soleil qui se lève, ou plutôt semble se lever tous les jours; tout le monde court au moindre petit météore qui paraît un moment dans cet amas de vapeurs qui entourent la terre, et qu'on appelle le ciel .
Vilia sunt nobis quaecumque prioribus annis ,
Vidimus et sordet quidquid spectavimus olim .
Un colporteur ne se chargera pas d'un Virgile, d'un Horace, mais d'un livre nouveau, fût-il détestable. Il vous tire à part, et vous dit, Monsieur, voulez-vous des livres de Hollande?
Les femmes se plaignent depuis le commencement du monde des infidélités qu'on leur fait en faveur du premier objet nouveau qui se présente, et qui n'a souvent que cette nouveauté pour tout mérite. Plusieurs dames (il faut bien l'avouer, malgré le respect infini qu'on a pour elles) ont traité les hommes comme elles se plaignent qu'on les a traitées; et l'histoire de Joconde est beaucoup plus ancienne que l'Arioste.
Peut-être ce goût universel pour la nouveauté est-il un bienfait de la nature. On nous crie, Contentez-vous de ce que vous avez, ne désirez rien au-delà de votre état; réprimez votre curiosité, domptez les inquiétudes de l'esprit. Ce sont de très bonnes maximes; mais si nous les avions toujours suivies, nous mangerions encore du gland, nous coucherions à la belle étoile, et nous n'aurions eu ni Corneille, ni Racine, ni Molière, ni Poussin, ni le Brun, ni le Moine, ni Pigal.
NUDITÉ. [p. 183]↩
Pourquoi enferme-t-on un homme, une femme qui marcheraient tout nus dans les rues, et pourquoi personne n'est-il choqué des statues absolument nues, des peintures de Magdelaine et de Jésus qu'on voit dans quelques églises.
Il est vraisemblable que le genre humain a subsisté longtemps sans être vêtu.
On a trouvé dans plus d'une île, et dans le continent de l'Amérique des peuples qui ne connaissaient pas les vêtements.
Les plus civilisés cachaient les organes de la génération par des feuilles, par des joncs entrelassés, par des plumes.
D'où vient cette espèce de pudeur? était-ce l'instinct d'allumer des désirs en voilant ce qu'on aimait à découvrir?
Est-il bien vrai que chez des nations un peu plus policées comme les juifs et demi-juifs, il y ait eu des sectes entières qui n'aient voulu adorer Dieu qu'en se dépouillant de tous leurs habits? tels ont été, dit-on, les adamites et les abéliens. Ils s'assemblaient tous nus pour chanter les louanges de Dieu. St Epiphanes et St Augustin le disent. Il est vrai qu'ils n'étaient pas contemporains et qu'ils étaient fort loin de leur pays. Mais enfin cette folie est possible: elle n'est pas même plus extraordinaire, plus folie que cent autres folies qui ont fait le tour du monde l'une après l'autre.
Nous avons vu à l'article Emblème qu'aujourd'hui même encore les mahométans ont des saints qui sont fous, et qui vont nus comme des singes. Il se peut très bien que des énergumènes aient cru qu'il vaut mieux se présenter à la Divinité dans l'état où elle nous a formés, que dans le déguisement inventé par les hommes. Il se peut qu'ils aient montré tout par dévotion. Il y a si peu de gens bien faits dans les deux sexes, que la nudité pouvait inspirer la chasteté, ou plutôt le dégoût, au lieu d'augmenter les désirs.
On dit surtout que les abéliens renonçaient au mariage. S'il y avait parmi eux de beaux garçons et de belles filles, ils étaient pour le moins comparables à St Adhelme et au bienheureux Robert d'Arbrisselle, qui couchaient avec les plus jolies personnes, pour mieux faire triompher leur continence.
J'avoue pourtant qu'il eût été assez plaisant de voir une centaine d'Hélènes et de Pâris chanter des antiennes et se donner le baiser de paix, et faire les agapes.
Tout cela montre qu'il n'y a point de singularité, point d'extravagance, point de superstition qui n'ait passé par la tête des hommes. Heureux quand ces superstitions ne troublent pas la société et n'en font pas une scène de discorde, de haine et de fureur! Il vaut mieux sans doute prier Dieu tout nu, que de souiller de sang humain ses autels et les places publiques.
OCCULTES, QUALITÉS OCCULTES. [p. 185]↩
On s'est moqué fort longtemps des qualités occultes; on doit se moquer de ceux qui n'y croient pas. Répétons cent fois que tout principe, tout premier ressort de quelque oeuvre que ce puisse être du grand Demiourgos, est occulte et caché pour jamais aux mortels.
Qu'est-ce que la force centripète, la force de la gravitation qui agit sans contact à des distances immenses?
Quelle puissance fait tordre notre coeur et ses oreillettes soixante fois par minute? quel autre pouvoir change cette herbe en lait dans les mamelles d'une vache, et ce pain en sang, en chair, en os dans cet enfant qui croît à mesure qu'il mange jusqu'au point déterminé qui fixe la hauteur de sa taille sans qu'aucun art puisse jamais y ajouter une ligne?
Végétaux, minéraux, animaux, où est votre premier principe? il est dans la main de celui qui fait tourner le soleil sur son axe, et qui l'a revêtu de lumière.
Ce plomb ne deviendra jamais argent; cet argent ne sera jamais or, cet or ne sera jamais diamant; de même que cette paille ne deviendra jamais poncire ou ananas.
Quelle physique corpusculaire, quels atomes déterminent ainsi leur nature? vous n'en savez rien; la cause sera éternellement occulte pour vous. Tout ce qui vous entoure, tout ce qui est dans vous, est une énigme dont il n'est pas donné à l'homme de deviner le mot.
Cet ignorant fourré croit savoir quelque chose quand il a dit que les bêtes ont une âme végétative, et une sensitive, et que les hommes ont l'âme végétative, la sensitive, et l'intellectuelle.
Pauvre homme pétri d'orgueil, qui n'as prononcé que des mots, as-tu jamais vu une âme, sais-tu comment cela est fait? Nous avons beaucoup parlé d'âme dans nos Questions , et nous avons toujours confessé notre ignorance. Je ratifie aujourd'hui cette confession avec d'autant plus d'empressement, qu'ayant depuis ce temps beaucoup plus lu, plus médité, et étant plus instruit, je suis plus en état d'affirmer que je ne sais rien.
ONAN ET ONANISME. [p. 186]↩
Nous avons promis à l'article Amour socratique de parler d'Onan et de l'onanisme, quoique cet onanisme n'ait rien de commun avec l'amour socratique, et qu'il soit plutôt un effet très désordonné de l'amour-propre.
La race d'Onan a de très grandes singularités. Le patriarche Juda son père coucha, comme on sait, avec sa belle-fille Thamar la Phénicienne, dans un grand chemin. Jacob, père de Juda, avait été à la fois le mari de deux soeurs, filles d'un idolâtre, et il avait trompé son père et son beau-père. Loth, grand-oncle de Jacob, avait couché avec ses deux filles. Salmon, l'un des descendants de Jacob et de Juda, épousa Rahab la Chananéenne prostituée. Booz, fils de Salmon et de Rahab, reçut dans son lit Ruth la Madianite, et fut bisaïeul de David. David enleva Betzabée au capitaine Uriah son mari, qu'il fit assassiner pour être plus libre dans ses amours. Enfin, dans les deux généalogies de notre Seigneur Jésus-Christ si différentes en plusieurs points, mais entièrement semblables en ceux-ci, on voit qu'il naquit de cette foule de fornications, d'adultères et d'incestes. Rien n'est plus propre à confondre la prudence humaine, à humilier notre esprit borné, à nous convaincre que les voies de la Providence ne sont pas nos voies.
Le révérend père Dom Calmet fait cette réflexion à propos de l'inceste de Juda avec Thamar et du péché d'Onan, chap.XXXVIII de la Genèse: ‘L'Ecriture, dit-il, nous donne le détail d'une histoire qui dans le premier sens qui frappe l'esprit, ne paraît pas fort propre à édifier; mais le sens caché et mystérieux qu'elle renferme est aussi élevé que celui de la lettre paraît bas aux yeux de la chair. Ce n'est pas sans de bonnes raisons que le Saint Esprit a permis que l'histoire de Thamar, de Rahab, de Ruth et de Betzabée, se trouvât mêlée dans la généalogie de Jésus-Christ.'
Il eût été à souhaiter que Dom Calmet nous eût développé ces bonnes raisons; il aurait éclairé les doutes et calmé les scrupules de toutes les âmes honnêtes et timorées qui voudraient comprendre comment l'Etre éternel, le créateur des mondes a pu naître dans un village juif d'une race de voleurs et de prostituées. Ce mystère, qui n'est pas le moins inconcevable de tous les mystères, était digne assurément d'être expliqué par un savant commentateur. Tenons-nous-en ici à l'onanisme.
On sait bien quel est le crime du patriarche Juda; ainsi qu'on connaît le crime des patriarches Siméon et Lévi ses frères, commis dans Sichem; et le crime de tous les autres patriarches, commis contre leur frère Joseph: mais il est difficile de savoir précisément quel était le péché d'Onan. Juda avait marié son fils aîné Her à cette Phénicienne Thamar. Her mourut pour avoir été méchant . Le patriarche voulut que son second fils Onan épousât la veuve, selon l'ancienne loi des Egyptiens et des Phéniciens leurs voisins: cela s'appelait susciter des enfants à son frère . Le premier-né du second mariage portait le nom du défunt, et c'est ce qu'Onan ne voulait pas. Il haïssait la mémoire de son frère; et pour ne point faire d'enfant qui portât le nom de Her, il est dit qu'il jetait sa semence à terre .
Or il reste à savoir si c'était dans la copulation avec sa femme qu'il trompait ainsi la nature, ou si c'était au moyen de la masturbation qu'il éludait le devoir conjugal. La Genèse ne nous apprend point cette particularité. Mais aujourd'hui ce qu'on appelle communément le péché d'Onan , c'est l'abus de soi-même avec le secours de la main, vice assez commun aux jeunes garçons et même aux jeunes filles qui ont trop de tempérament.
On a remarqué que l'espèce des hommes et celle des singes sont les seules qui tombent dans ce défaut contraire au voeu de la nature.
Un médecin a écrit en Angleterre contre ce vice un petit volume intitulé: De l'Onanisme , dont on compte environ quatre-vingts éditions, supposé que ce nombre prodigieux ne soit pas un tour de libraire pour amorcer les lecteurs; ce qui n'est que trop ordinaire.
M. Tissot, fameux médecin de Lausanne, a fait aussi son Onanisme , plus approfondi et plus méthodique que celui d'Angleterre. Ces deux ouvrages étalent les suites funestes de cette malheureuse habitude, la perte des forces, l'impuissance, la dépravation de l'estomac et des viscères, les tremblements, les vertiges, l'hébétation et souvent une mort prématurée. Il y en a des exemples qui font frémir.
M. Tissot a trouvé par l'expérience que le quinquina était le meilleur remède contre ces maladies, pourvu qu'on se défît absolument de cette habitude honteuse et funeste, si commune aux écoliers, aux pages et aux jeunes moines.
Mais il s'est aperçu qu'il était plus aisé de prendre du quinquina que de vaincre ce qui est devenu une seconde nature.
Joignez les suites de l'onanisme avec la vérole, et vous verrez combien l'espèce humaine est ridicule et malheureuse.
Pour consoler cette espèce, M. Tissot rapporte autant d'exemples de malades de réplétion que de malades d'émission; et ces exemples, il les trouve chez les femmes comme chez les hommes. Il n'y a point de plus fort argument contre les voeux téméraires de chasteté. Que voulez-vous en effet que devienne une liqueur précieuse, formée par la nature pour la propagation du genre humain? Si on la prodigue indiscrètement, elle peut vous tuer. Si on la retient, elle peut vous tuer de même. On a observé que les pollutions nocturnes sont fréquentes chez les personnes des deux sexes non mariées, mais beaucoup plus chez les jeunes religieuses que chez les recluses; parce que le tempérament des hommes est plus dominant. On en a conclu que c'est une énorme folie de se condamner soi-même à ces turpitudes, et que c'est une espèce de sacrilège dans les gens saints de prostituer ainsi le don du Créateur, et de renoncer au mariage, ordonné expressément par Dieu même. C'est ainsi que pensent les protestants, les juifs, les musulmans et tant d'autres peuples; mais les catholiques ont d'autres raisons en faveur des couvents. Je dirai des catholiques ce que le profond Calmet dit du Saint-Esprit: ils ont eu sans doute de bonnes raisons.
OPINION. [p. 189]↩
Quelle est l'opinion de toutes les nations du nord de l'Amérique, et de celles qui bordent le détroit de la Sonde sur le meilleur des gouvernements, sur la meilleure des religions, sur le droit public ecclésiastique, sur la manière d'écrire l'histoire, sur la nature de la tragédie, de la comédie, de l'opéra, de l'églogue, du poème épique, sur les idées innées, la grâce concomitante et les miracles du diacre Pâris? il est clair que tous ces peuples n'ont aucune opinion sur les choses dont ils n'ont point d'idée.
Ils ont un sentiment confus de leurs coutumes, et ne vont pas au delà de cet instinct. Tels sont les peuples qui habitent les côtes de la mer Glaciale dans l'espace de quinze cents lieues. Tels sont les habitants des trois quarts de l'Afrique, et ceux de presque toutes les îles de l'Asie, et vingt hordes de Tartares, et presque tous les hommes uniquement occupés du soin pénible et toujours renaissant de pourvoir à leur subsistance. Tels sont à deux pas de nous la plupart des Morlaques et des Uscoques, beaucoup de Savoyards et quelques bourgeois de Paris.
Lorsqu'une nation commence à se civiliser, elle a quelques opinions qui toutes sont fausses. Elle croit aux revenants, aux sorciers, à l'enchantement des serpents; à leur immortalité, aux possessions du diable, aux exorcismes, aux aruspices. Elle est persuadée qu'il faut que les grains pourrissent en terre pour germer, et que les quartiers de la lune sont les causes des accès de fièvre.
Un talapoin persuade à ses dévotes que le dieu Sammonocodom a séjourné quelque temps à Siam, et qu'il a raccourci tous les arbres d'une forêt qui l'empêchaient de jouer à son aise au cerf-volant, qui était son jeu favori. Cette opinion s'enracina dans les têtes, et à la fin un honnête homme qui douterait de cette aventure de Sammonocodom, courait risque d'être lapidé. Il faut des siècles pour détruire une opinion populaire.
On la nomme la reine du monde ; elle l'est si bien, que quand la raison vient la combattre, la raison est condamnée à la mort. Il faut qu'elle renaisse vingt fois de ses cendres pour chasser enfin tout doucement l'usurpatrice.
ORACLE. [p. 190]↩
Depuis que la secte des pharisiens chez le peuple juif eut fait connaissance avec le diable, quelques raisonneurs d'entre eux commencèrent à croire que ce diable et ses compagnons inspiraient chez toutes les autres nations les prêtres et les statues qui rendaient des oracles. Les saducéens n'en croyaient rien; ils n'admettaient ni anges, ni démons. Il paraît qu'ils étaient plus philosophes que les pharisiens, par conséquent moins faits pour avoir du crédit sur le peuple.
Le diable faisait tout parmi la populace juive du temps de Gamaliel, de Jean le Baptiseur, de Jacques Oblia, et de Jésus son frère qui fut notre Sauveur Jésus-Christ. Aussi vous voyez que le diable transporte Jésus tantôt dans le désert, tantôt sur le faîte du temple, tantôt sur une colline voisine dont on découvre tous les royaumes de la terre; le diable entre dans le corps des garçons et des filles, et des animaux.
Les chrétiens, quoique ennemis mortels des pharisiens, adoptèrent tout ce que ces pharisiens avaient imaginé du diable, ainsi que les Juifs avaient autrefois introduit chez eux les coutumes et les cérémonies des Egyptiens. Rien n'est si ordinaire que d'imiter ses ennemis, et d'employer leurs armes.
Bientôt les Pères de l'Eglise attribuèrent au diable toutes les religions qui partageaient la terre, tous les prétendus prodiges, tous les grands événements; les comètes, les pestes, le mal caduc, les écrouelles, etc. Ce pauvre diable, qu'on disait rôti dans un trou sous la terre, fut tout étonné de se trouver le maître du monde. Son pouvoir s'accrut ensuite merveilleusement par l'institution des moines.
La devise de tous ces nouveaux venus, était: donnez-moi de l'argent, et je vous délivrerai du diable. Leur puissance céleste et terrestre reçut enfin un terrible échec de la main de leur confrère Luther, qui se brouillant avec eux pour un intérêt de besace, découvrit tous les mystères. Hondorf, témoin oculaire, nous rapporte que les réformés ayant chassé les moines d'un couvent d'Eisenac dans la Thuringe, y trouvèrent une statue de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus faite par tel art que, lorsqu'on mettait des offrandes sur l'autel, la vierge et l'enfant baissaient la tête en signe de reconnaissance, et tournaient le dos à ceux qui venaient les mains vides.
Ce fut bien pis en Angleterre, lorsqu'on fit par ordre de Henri VIII la visite juridique de tous les couvents. La moitié des religieuses était grosse; et ce n'était point par l'opération du diable. L'évêque Burnet rapporte que dans cent quarante-quatre couvents, les procès verbaux des commissaires du roi attestèrent des abominations dont n'approchaient pas celles de Sodome et Gomorre. En effet, les moines d'Angleterre devaient être plus débauchés que les Sodomites, puisqu'ils étaient plus riches. Ils possédaient les meilleures terres du royaume. Le terrain de Sodome et de Gomorre au contraire, ne produisant ni blé, ni fruits, ni légumes, et manquant d'eau potable, ne pouvait être qu'un désert affreux habité par des misérables trop occupés de leurs besoins pour connaître les voluptés.
Enfin, ces superbes asiles de la fainéantise ayant été supprimés par acte du parlement, on étala dans la place publique tous les instruments de leurs fraudes pieuses: le fameux crucifix de Boksley qui se remuait et qui marchait comme une marionnette; des fioles de liqueur rouge qu'on faisait passer pour du sang que versaient quelquefois des statues des saints, quand ils étaient mécontents de la cour; des moules de fer-blanc dans lesquels on avait soin de mettre continuellement des chandelles allumées, pour faire croire au peuple que c'était la même chandelle qui ne s'éteignait jamais; des sarbacanes qui passaient de la sacristie dans la voûte de l'église, par lesquelles des voix célestes se faisaient quelquefois entendre à des dévotes payées pour les écouter; enfin tout ce que la friponnerie inventa jamais pour subjuguer l'imbécillité.
Alors plusieurs savants de l'Europe, bien certains que les moines et non les diables, avaient mis en usage tous ces pieux stratagèmes, commencèrent à croire qu'il en avait été de même chez les anciennes religions; que tous les oracles et tous les miracles tant vantés dans l'antiquité n'avaient été que des prestiges de charlatans; que le diable ne s'était jamais mêlé de rien, mais que seulement les prêtres grecs, romains, syriens, égyptiens avaient été encore plus habiles que nos moines.
Le diable perdit donc beaucoup de son crédit jusqu'à ce qu'enfin le bonhomme Béker, dont vous pouvez consulter l'article, écrivit son ennuyeux livre contre le diable, et prouva par cent arguments qu'il n'existait point. Le diable ne lui répondit point; mais les ministres du St Evangile, comme vous l'avez vu, lui répondirent; ils punirent le bon Béker d'avoir divulgué leur secret, et lui ôtèrent sa cure; de sorte que Béker fut la victime de la nullité de Belzébut.
C'était le sort de la Hollande de produire les plus grands ennemis du diable. Le médecin Van-Dale, philosophe humain, savant très profond, citoyen plein de charité, esprit d'autant plus hardi que sa hardiesse était fondée sur la vertu, entreprit enfin d'éclairer les hommes, toujours esclaves des anciennes erreurs et toujours épaississant le bandeau qui leur couvre les yeux jusqu'à ce que quelque grand trait de lumière leur découvre un coin de vérité, dont la plupart sont très indignes. Il prouva dans un livre plein de l'érudition la plus recherchée que les diables n'avaient jamais rendu aucun oracle, n'avaient opéré aucun prodige, ne s'étaient jamais mêlés de rien, et qu'il n'y avait eu de véritables démons que les fripons qui avaient trompé les hommes. Il ne faut pas que le diable se joue jamais à un savant médecin. Ceux qui connaissent un peu la nature sont fort dangereux pour les faiseurs de prestiges. Je conseille au diable de s'adresser toujours aux facultés de théologie, et jamais aux facultés de médecine.
Van-Dale prouva donc par mille monuments que non seulement les oracles des païens n'avaient été que des tours de prêtres, mais que ces friponneries consacrées dans tout l'univers n'avaient point fini du temps de Jean le Baptiseur et de Jésus-Christ, comme on le croyait pieusement. Rien n'était plus vrai, plus palpable, plus démontré que cette vérité annoncée par le médecin Van-Dale; et il n'y a pas aujourd'hui un honnête homme qui la révoque en doute.
Le livre de Van-Dale n'est peut-être pas bien méthodique; mais c'est un des plus curieux qu'on ait jamais faits. Car depuis les fourberies grossières du prétendu Histape et des sibylles; depuis l'histoire apocryphe du voyage de Simon Barjone à Rome, et des compliments que Simon le Magicien lui envoya faire par son chien; depuis les miracles de St Grégoire-Thaumaturge, et surtout de la lettre que ce saint écrivit au diable, et qui fut portée à son adresse, jusqu'aux miracles des révérends pères jésuites et des révérends capucins, rien n'est oublié. L'empire de l'imposture et de la bêtise est dévoilé dans ce livre aux yeux de tous les hommes qui savent lire, mais ils sont en petit nombre.
Il s'en fallait beaucoup que cet empire fût détruit alors en Italie, en France, en Espagne, dans les Etats autrichiens, et surtout en Pologne, où les jésuites dominaient. Les possessions du diable, les faux miracles inondaient encore la moitié de l'Europe abrutie. Voici ce que Van-Dale raconte d'un oracle singulier qui fut rendu de son temps à Terni dans les Etats du pape vers l'an 1650, et dont la relation fut imprimée à Venise par ordre de la seigneurie.
Un ermite, nommé Pasquale, ayant ouï dire que Jacovello bourgeois de Terni était fort avare et fort riche, vint faire à Terni ses oraisons dans l'église que fréquentait Jacovello, lia bientôt amitié avec lui, le flatta dans sa passion, et lui persuada que c'était une oeuvre très agréable à Dieu de faire valoir son argent, que cela même était expressément recommandé dans l'Evangile, puisque le serviteur négligent, qui n'a pas fait valoir l'argent de son maître à cinq cents pour cent, est jeté dans les ténèbres extérieures.
Dans les conversations que l'ermite avait avec Jacovello, il l'entretint souvent des beaux discours tenus par plusieurs crucifix, et par une quantité de bonnes vierges d'Italie. Jacovello convenait que les statues des saints parlaient quelquefois aux hommes, et lui disait qu'il se croirait prédestiné si jamais il pouvait entendre parler l'image d'un saint.
Le bon Pasquale lui répondit qu'il espérait lui donner cette satisfaction dans peu de temps; qu'il attendait incessamment de Rome une tête de mort, dont le pape avait fait présent à un ermite son confrère; que cette tête parlait comme les arbres de Dodone, et comme l'ânesse de Balaam. Il lui montra en effet la tête quatre jours après. Il demanda à Jacovello la clef d'une petite cave, et d'une chambre au-dessus, afin que personne ne fût témoin du mystère. L'ermite Pasquale ayant fait passer de la cave un tuyau qui entrait dans la tête, et ayant tout disposé, se mit en prière avec son ami Jacovello: la tête alors parla en ces mots, ‘Jacovello, Dieu veut récompenser ton zèle. Je t'avertis qu'il y a un trésor de cent mille écus sous un if à l'entrée de ton jardin. Tu mourras de mort subite, si tu cherches ce trésor avant d'avoir mis devant moi une marmite remplie de dix marcs d'or en espèces.'
Jacovello courut vite à son coffre, et apporta devant l'oracle sa marmite et ses dix marcs. Le bon ermite avait eu la précaution de se munir d'une marmite semblable qu'il remplit de sable. Il la substitua prudemment à la marmite de Jacovello quand celui-ci eut le dos tourné, et laissa le bon Jacovello avec une tête de mort de plus, et dix marcs d'or de moins.
C'est à peu près ainsi que se rendaient tous les oracles, à commencer par celui de Jupiter-Ammon, et à finir par celui de Trophonius.
Un des secrets des prêtres de l'antiquité comme des nôtres, était la confession dans les mystères. C'était là qu'ils apprenaient toutes les affaires des familles, et qu'ils se mettaient en état de répondre à la plupart de ceux qui venaient les interroger. C'est à quoi se rapporte ce grand mot que Plutarque a rendu célèbre. Un prêtre voulant confesser un initié, celui-ci lui demanda, à qui me confesserai-je? Est-ce à toi ou à Dieu? C'est à Dieu, reprit le prêtre. -- Sors donc d'ici, homme; et laisse-moi avec Dieu.
Je ne finirais point si je rapportais toutes les choses intéressantes dont Van-Dale a enrichi son livre. Fontenelle ne le traduisit pas; mais il en tira ce qu'il crut de plus convenable à sa nation qui aime mieux les agréments que la science. Il se fit lire par ceux qu'on appelait en France la bonne compagnie; et Van-Dale, qui avait écrit en latin et en grec, n'avait été lu que par des savants. Le diamant brut de Van-Dale brilla beaucoup, quand il fut taillé par Fontenelle; le succès fut si grand, que les fanatiques furent alarmés. Fontenelle avait eu beau adoucir les expressions de Van-Dale, et s'expliquer quelquefois en normand; il ne fut que trop entendu par les moines, qui n'aiment pas qu'on leur dise que leurs confrères ont été des fripons.
Un nommé Baltus jésuite, né dans le pays Messin, l'un de ces savants qui savent consulter de vieux livres, les falsifier et les citer mal à propos, prit le parti du diable contre Van-Dale et Fontenelle. Le diable ne pouvait choisir un avocat plus ennuyeux: son nom n'est aujourd'hui connu que par l'honneur qu'il eut d'écrire contre deux hommes célèbres qui avaient raison.
Baltus, en qualité de jésuite, cabala auprès de ses confrères qui étaient alors autant élevés en crédit qu'ils sont depuis tombés dans l'opprobre. Les jansénistes de leur côté, plus énergumènes que les jésuites, crièrent encore plus haut qu'eux. Enfin tous les fanatiques furent persuadés que la religion chrétienne était perdue, si le diable n'était conservé dans ses droits.
Peu à peu les livres des jansénistes et des jésuites sont tombés dans l'oubli. Le livre de Van-Dale est resté pour les savants; et celui de Fontenelle pour les gens d'esprit.
A l'égard du diable, il est comme les jésuites et les jansénistes, il perd son crédit de plus en plus.
ORAISON, PRIERE PUBLIQUE, ACTION DE GRACES, &c. [p. 195]↩
Il reste très peu de formules de prières publiques des peuples anciens.
Nous n'avons que la belle hymne d'Horace pour les jeux séculaires des anciens Romains. Cette prière est du rythme et de la mesure que les autres Romains ont imités longtemps après dans l'hymne Ut queant laxis resonare fibris .
Le Pervigilium veneris est dans un goût recherché, et n'est pas peut-être digne de la noble simplicité du règne d'Auguste. Il se peut que cette hymne à Vénus ait été chantée dans les fêtes de la déesse; mais on ne doute pas qu'on n'ait chanté le poème d'Horace avec la plus grande solennité.
Il faut avouer que le poème séculaire d'Horace est un des plus beaux morceaux de l'antiquité, et que l'hymne Ut queant laxis est un des plus plats ouvrages que nous ayons eus dans les temps barbares de la décadence de la langue latine. L'Eglise catholique dans ces temps-là cultivait mal l'éloquence et la poésie. On sait bien que Dieu préfère de mauvais vers récités avec un coeur pur, aux plus beaux vers du monde chantés par des impies. Mais enfin de bons vers n'ont jamais rien gâté, toutes choses étant d'ailleurs égales.
Rien n'approcha jamais parmi nous des jeux séculaires qu'on célébrait de cent dix en cent dix ans. Notre jubilé n'en est qu'une bien faible copie. On dressait trois autels magnifiques sur les bords du Tibre. Rome entière était illuminée pendant trois nuits; quinze prêtres distribuaient l'eau lustrale et des cierges aux Romains et aux Romaines qui devaient chanter les prières. On sacrifiait d'abord à Jupiter comme au grand dieu, au maître des dieux, et ensuite à Junon, à Apollon, à Latone, à Diane, à Cérès, à Pluton, à Prosperpine, aux Parques comme à des puissances subalternes. Chacune de ces divinités avait son hymne et ses cérémonies. Il y avait deux choeurs, l'un de vingt-sept garçons, l'autre de vingt-sept filles pour chacun des dieux. Enfin, le dernier jour les garçons et les filles couronnés de fleurs chantèrent l'ode d'Horace.
Il est vrai que dans les maisons on chantait à table ses autres odes pour le petit Ligurinus, pour Liciscus et pour d'autres petits fripons, lesquels n'inspiraient pas la plus grande dévotion. Mais il y a temps pour tout; pictoribus atque poëtis . Le Carrache qui dessina les figures de l'Arétin, peignit aussi des saints; et dans tous nos collèges, nous avons passé à Horace ce que les maîtres de l'empire romain lui passaient sans difficulté.
Pour des formules de prières, nous n'avons que de très légers fragments de celle qu'on récitait aux mystères d'Isis. Nous l'avons citée ailleurs, nous la rapporterons encore ici parce qu'elle n'est pas longue et qu'elle est belle.
Les puissances célestes te servent; les enfers te sont soumis; l'univers tourne sous ta main; tes pieds foulent le Tartare; les astres répondent à ta voix; les saisons reviennent à tes ordres; les éléments t'obéissent .
Nous répéterons aussi la formule qu'on attribue à l'ancien Orphée, laquelle nous paraît encore supérieure à celle d'Isis.
Marchez dans la voie de la justice, adorez le seul maître de l'univers; il est un, il est seul par lui-même; tous les êtres lui doivent leur existence; il agit dans eux et par eux; il voit tout, et jamais il n'a été vu des yeux mortels .
Ce qui est fort extraordinaire, c'est que dans le Lévitique, dans le Deutéronome des Juifs, il n'y a pas une seule prière publique, pas une seule formule. Il semble que les lévites ne fussent occupés qu'à partager les viandes qu'on leur offrait. On ne voit pas même une seule prière instituée pour leurs grandes fêtes, de la Pâque, de la Pentecôte, des Trompettes, des Tabernacles, de l'expiation générale, et des néoménies.
Les savants conviennent assez unanimement qu'il n'y eut de prières réglées chez les Juifs, que lorsque étant esclaves à Babilone, ils en prirent un peu les moeurs, et qu'ils apprirent quelques sciences de ce peuple si policé et si puissant. Ils empruntèrent tout des Chaldéens persans jusqu'à leur langue, leurs caractères, leurs chiffres; et joignant quelques coutumes nouvelles à leurs anciens rites égyptiaques, ils devinrent un peuple nouveau, qui fut d'autant plus superstitieux, qu'au sortir d'un long esclavage ils furent toujours encore dans la dépendance de leurs voisins. In rebus acerbis acrius advertunt animos ad relligionem .
Pour les dix autres tribus qui avaient été dispersées auparavant, il est à croire qu'elles n'avaient pas plus de prières publiques que les deux autres, et qu'elles n'avaient pas même encore une religion bien fixe et bien déterminée, puisqu'elles l'abandonnèrent si facilement, et qu'elles oublièrent jusqu'à leur nom, ce que ne fit pas le petit nombre de pauvres infortunés qui vint rebâtir Jérusalem.
C'est donc alors que ces deux tribus, ou plutôt ces deux tribus et demie semblèrent s'attacher à des rites invariables; qu'ils écrivirent, qu'ils eurent des prières réglées. C'est alors seulement que nous commençons à voir chez eux des formules de prières. Esdras ordonna deux prières par jour, et il en ajouta une troisième pour le jour du sabbat. On dit même qu'il institua dix-huit prières, (afin qu'on pût choisir) dont la première commence ainsi:
‘Sois béni, Seigneur, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le grand Dieu, le puissant, le terrible, le haut élevé, le distributeur libéral des biens, le plasmateur et le possesseur du monde, qui te souviens des bonnes actions, et qui envoies un libérateur à leurs descendants pour l'amour de ton nom. O roi! notre secours, notre sauveur, notre bouclier, sois béni Seigneur, bouclier d'Abraham!
On assure que Gamaliel qui vivait du temps de Jésus-Christ, et qui eut de si grands démêlés avec St Paul, institua une dix-neuvième prière que voici.
‘Accorde la paix, les bienfaits, la bénédiction, la grâce, la bénignité et la piété à nous et à Israël ton peuple. Bénis-nous, ô notre père! bénis-nous tous ensemble par la lumière de ta face; car par la lumière de ta face tu nous a donné, Seigneur notre Dieu, la loi de vie, l'amour, la bénignité, l'équité, la bénédiction, la piété, la vie et la paix. Qu'il te plaise de bénir en tout temps, et à tout moment ton peuple d'Israël en lui accordant la paix. Béni sois-tu, Seigneur, qui bénis ton peuple d'Israël en lui donnant la paix; Amen'.
Consultez sur cela la Mishna volume I er et II et l'article Prière des Questions.
Il y a une chose assez importante à observer dans plusieurs prières; c'est que chaque peuple a toujours demandé tout le contraire de ce que demandait son voisin.
Les Juifs priaient Dieu, par exemple, d'exterminer les Syriens, Babyloniens, Egyptiens; et ceux-ci priaient Dieu d'exterminer les Juifs; aussi le furent-ils comme les dix tribus qui avaient été confondues parmi tant de nations; et ceux-ci furent plus malheureux; car s'étant obstinés à demeurer séparés de tous autres peuples, étant au milieu des peuples, ils n'ont pu jouir d'aucun avantage de la société humaine.
De nos jours, dans nos guerres si souvent entreprises pour quelques villes ou pour quelques villages, les Allemands et les Espagnols quand ils étaient les ennemis des Français, priaient la Ste Vierge du fond de leur coeur de bien battre les Welches et les Gavaches; lesquels de leur côté suppliaient la Ste Vierge de détruire les Maranes et les Teutons.
En Angleterre, la Rose rouge faisait les plus ardentes prières à St George, pour obtenir que tous les partisans de la Rose blanche fussent jetés au fond de la mer. La Rose blanche répondait par de pareilles supplications. On sent combien St George devait être embarrassé: et si Henri VII n'était pas venu à son secours, George ne se serait jamais tiré de là.
ORDINATION. [p. 199]↩
Si un militaire chargé par le roi de France de conférer l'ordre de St Louis à un autre militaire, n'avait pas en lui donnant la croix, l'intention de le faire chevalier, le récipiendaire en serait-il moins chevalier de St Louis? non sans doute.
Pourquoi donc plusieurs prêtres se firent-ils réordonner après la mort du fameux Lavardin évêque du Mans? Ce singulier prélat qui avait établi l'ordre des Côteaux [8] s'avisa à l'article de la mort d'une espièglerie peu commune. Il était connu pour un des plus violents esprits forts du siècle de Louis XIV; et plusieurs de ceux auxquels il avait conféré l'ordre de la prêtrise, lui avaient publiquement reproché ses sentiments. Il est naturel qu'aux approches de la mort une âme sensible et timorée rentre dans la religion qu'il observa dans ses premières années. La bienséance seule exigeait que l'évêque édifiât en mourant ses diocésains que sa vie avait scandalisés; mais il était si piqué contre son clergé, qu'il déclara qu'aucun de ceux qu'il avait ordonnés n'était prêtre en effet, que tous leurs actes de prêtres étaient nuls, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner aucun sacrement.
C'était, ce me semble, raisonner comme un ivrogne; les prêtres manseaux pouvaient lui répondre, ce n'est pas votre intention qui est nécessaire, c'est la nôtre. Nous avions une envie bien déterminée d'être prêtres; nous avons fait tout ce qu'il faut pour l'être; nous sommes dans la bonne foi; si vous n'y avez pas été, il ne nous importe guère.
La maxime est, quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur , et non pas ad modum dantis . Lorsque notre marchand de vin nous a vendu une feuillette, nous la buvons, quand même il aurait l'intention secrète de nous empêcher de la boire; nous serons prêtres malgré votre testament.
Ces raisons étaient fort bonnes. Cependant la plupart de ceux qui avaient été ordonnés par l'évêque Lavardin, ne se crurent point prêtres, et se firent ordonner une seconde fois. Mascaron médiocre et célèbre prédicateur, leur persuada par ses discours et par son exemple de réitérer la cérémonie. Ce fut un grand scandale au Mans, à Paris et à Versailles. Il fut bientôt oublié, comme tout s'oublie.
ORIGINEL, [p. 200]↩
PÉCHÉ ORIGINEL.
Il le faut avouer, nous ne connaissons point de Père de l'Eglise jusqu'à St Augustin et à St Jérôme, qui ait enseigné la doctrine du péché originel. St Clément d'Alexandrie, cet homme si savant dans l'antiquité, loin de parler en un seul endroit de cette corruption qui a infecté le genre humain, et qui l'a rendu coupable en Stromates livre III. naissant, dit en propres mots, Quel mal peut faire un enfant qui ne vient que de naître? comment a-t-il pu prévariquer? comment celui qui n'a encore rien fait a-t-il pu tomber sous la malédiction d'Adam?
Et remarquez qu'il ne dit point ces paroles pour combattre l'opinion rigoureuse du péché originel, laquelle n'était point encore développée; mais seulement pour montrer que les passions qui peuvent corrompre tous les hommes, n'ont pu avoir encore aucune prise sur cet enfant innocent. Il ne dit point, Cette créature d'un jour ne sera pas damnée si elle meurt aujourd'hui. Car personne n'avait encore supposé qu'elle serait damnée. St Clément ne pouvait combattre un système absolument inconnu.
Le grand Origène est encore plus positif que St Clément d'Alexandrie. Il avoue bien que le péché est entré dans le monde par Adam, dans son explication de l'épître de St Paul aux Romains; mais il tient que c'est la pente au péché qui est entrée, qu'il est très facile de commettre le mal, mais qu'il n'est pas dit pour cela qu'on le commettra toujours, et qu'on sera coupable dès qu'on sera né.
Enfin, le péché originel sous Origène, ne consistait que dans le malheur de se rendre semblable au premier homme en péchant comme lui.
Le baptême était nécessaire, c'était le sceau du christianisme, il lavait tous les péchés; mais personne n'avait dit encore qu'il lavât les péchés qu'on n'avait point commis. Personne n'assurait encore qu'un enfant fût damné et brûlât dans des flammes éternelles pour être mort deux minutes après sa naissance. Et une preuve sans réplique, c'est qu'il se passa beaucoup de temps avant que la coutume de baptiser les enfants prévalût. Tertullien ne voulait point qu'on les baptisât. Or, leur refuser ce bain sacré, c'eût été les livrer visiblement à la damnation, si on avait été persuadé que le péché originel (dont ces pauvres innocents ne pouvaient être coupables) opérât leur réprobation, et leur fit souffrir des supplices infinis pendant toute l'éternité, pour un fait dont il était impossible qu'ils eussent la moindre connaissance. Les âmes de tous les bourreaux fondues ensemble, n'auraient pu rien imaginer qui approchât d'une horreur si exécrable. En un mot, il est de fait qu'on ne baptisait pas les enfants. Donc il est démontré qu'on était bien loin de les damner.
Il y a bien plus encore; Jésus-Christ n'a jamais dit, l'enfant non baptisé sera damné . [9] Il était venu au contraire pour expier tous les péchés, pour racheter le genre humain par son sang. Donc les petits enfants ne pouvaient être damnés. Les enfants au berceau étaient à bien plus forte raison privilégiés. Notre divin Sauveur ne baptisa jamais personne. Paul circoncit son disciple Timothée, et il n'est point dit qu'il le baptisât.
En un mot, dans les deux premiers siècles le baptême des enfants ne fut point en usage; donc on ne croyait point que des enfants fussent victimes de la faute d'Adam. Au bout de quatre cents ans on crut leur salut fort en danger, et on fut fort incertain.
Enfin, Pélage vint au cinquième siècle; il traita l'opinion du péché originel de monstrueuse. Selon lui, ce dogme n'était fondé que sur une équivoque comme toutes les autres opinions.
Dieu avait dit à Adam dans le jardin, Le jour que vous mangerez du fruit de l'arbre de la science vous mourrez . Or, il n'en mourut pas, et Dieu lui pardonna. Pourquoi donc n'aurait-il pas épargné sa race à la millième génération? pourquoi livrerait-il à des tourments infinis et éternels les petits enfants innocents d'un père qu'il avait reçu en grâce?
Pélage regardait Dieu non seulement comme un maître absolu; mais comme un père qui laissant la liberté à ses enfants, les récompensait au delà de leurs mérites, et les punissait au-dessous de leurs fautes.
Lui et ses disciples disaient, Si tous les hommes naissent les objets de la colère éternelle de celui qui leur donne la vie; si avant de penser ils sont coupables, c'est donc un crime affreux de les mettre au monde. Le mariage est donc le plus horrible des forfaits. Le mariage en ce cas n'est donc qu'une émanation du mauvais principe des manichéens; ce n'est plus adorer Dieu, c'est adorer le diable.
Pélage et les siens débitaient cette doctrine en Afrique, où St Augustin avait un crédit immense. Il avait été manichéen; il était obligé de s'élever contre Pélage. Celui-ci ne put résister ni à Augustin, ni à Jérôme. Et enfin, de questions en questions la dispute alla si loin qu'Augustin donna son arrêt de damnation contre tous les enfants nés et à naître dans l'univers, en ces propres termes, La foi catholique enseigne que tous les hommes naissent si coupables, que les enfants mêmes sont certainement damnés quand ils meurent sans avoir été régénérés en Jésus .
C'eût été un bien triste compliment à faire à une reine de la Chine ou du Japon, ou de l'Inde, ou de la Scythie, ou de la Gothie, qui venait de perdre son fils au berceau, que de lui dire, Madame, consolez-vous, monseigneur le prince royal est actuellement entre les griffes de cinq cents diables qui le tournent et le retournent dans une grande fournaise pendant toute l'éternité, tandis que son corps embaumé repose auprès de votre palais.
La reine épouvantée demande pourquoi ces diables rôtissent ainsi son cher fils le prince royal à jamais? On lui répond que c'est parce que son arrière-grand-père mangea autrefois du fruit de la science dans un jardin. Jugez ce que doivent penser le roi, la reine, tout le conseil, et toutes les belles dames.
Cet arrêt ayant paru un peu dur à quelques théologiens, (car il y a de bonnes âmes partout) il fut mitigé par un Pierre Chrisologue, ou Pierre parlant d'or , lequel imagina un faubourg d'enfer nommé les Limbes , pour placer tous les petits garçons et toutes les petites filles qui seraient morts sans baptême. C'est un lieu où ces innocents végètent sans rien sentir, le séjour de l'apathie, et c'est ce qu'on appelle le paradis des sots . Vous trouvez encore cette expression dans Milton, The paradise of fools . Il le place vers la lune. Cela est tout à fait digne d'un poème épique.
EXPLICATION DU PÉCHÉ ORIGINEL.
La difficulté pour les limbes est demeurée la même que pour l'enfer. Pourquoi ces pauvres petits sont-ils dans les limbes? qu'avaient-ils fait? comment leur âme qu'ils ne possédaient que d'un jour était-elle coupable d'une gourmandise de six mille ans?
St Augustin qui les damne, dit pour raison que les âmes de tous les hommes étant dans celle d'Adam, il est probable qu'elles furent toutes complices. Mais comme l'Eglise décida depuis, que les âmes ne sont faites que quand le corps est commencé, ce système tomba malgré le nom de son auteur.
D'autres dirent que le péché originel s'était transmis d'âme en âme par voie d'émanation, et qu'une âme venue d'une autre arrivait dans ce monde avec toute la corruption de l'âme-mère. Cette opinion fut condamnée.
Après que les théologiens y eurent jeté leur bonnet, les philosophes s'essayèrent. Leibnitz en jouant avec ses monades, s'amusa à rassembler dans Adam toutes les monades humaines avec leurs petits corps de monades. C'était moitié plus que St Augustin. Mais cette idée digne de Cyrano de Bergerac n'a pas fait fortune en philosophie.
Mallebranche explique la chose par l'influence de l'imagination des mères. Eve eut la cervelle si furieusement ébranlée de l'envie de manger du fruit, que ses enfants eurent la même envie, à peu près comme cette femme qui ayant vu rouer un homme accoucha d'un enfant roué.
Nicole réduit la chose à une certaine inclination, une certaine pente à la concupiscence que nous avons reçue de nos mères. Cette inclination n'est pas un acte; elle le deviendra un jour . Fort bien, courage, Nicole. Mais en attendant, pourquoi me damner? Nicole ne touche point du tout à la difficulté; elle consiste à savoir comment nos âmes d'aujourd'hui qui sont formées depuis peu, peuvent répondre de la faute d'une autre âme qui vivait il y a si longtemps.
Mes maîtres, que fallait-il dire sur cette matière? rien. Aussi je ne donne point mon explication, je ne dis mot.
ORTOGRAPHE. [p. 204]↩
Quant à l'orthographe de la plupart des livres français, elle est ridicule. Presque tous les imprimeurs ignorants impriment Wisigoths, Westphalie, Wirtemberg, Weteravie , etc.
Ils ne savent pas que le double V allemand qu'on écrit ainsi W, est notre V consonne, et qu'en Allemagne on prononce Veteravie, Virtemberg, Vestphalie, Visigoths.
Ils impriment Altona au lieu d'Altena, ne sachant pas qu'en allemand un O surmonté de deux points vaut un E.
Ils ne savent pas qu'en Hollande oe fait ou ; et ils font toujours des fautes en imprimant cette diphtongue.
Celles que commettent tous les jours les traducteurs des livres sont innombrables.
Pour l'orthographe purement française, l'habitude seule peut en supporter l'incongruité. Em-ploi-e-roi-ent, oc-troi-e-roient , qu'on prononce, octroiraient, emploiraient. Pa-on qu'on prononce pan, fa-on qu'on prononce fan, La-on qu'on prononce Lan, et cent autres barbaries pareilles font dire,
Hodieque manent vestigia juris .
Cela n'empêche pas que Racine, Boileau et Quinault ne charment l'oreille, et que La Fontaine ne doive plaire à jamais.
Les Anglais sont bien plus inconséquents, ils ont perverti toutes les voyelles; ils les prononcent autrement que toutes les autres nations. C'est en orthographe qu'on peut dire d'eux avec Virgile,
Et penitus toto divisos orbe Britannos .
Cependant, ils ont changé leur orthographe depuis cent ans; ils n'écrivent plus Loveth, Speaketh; Maketh , mais Loves, Speaks, Makes .
Les Italiens ont supprimé toutes les H . Ils ont fait plusieurs innovations en faveur de la douceur de leur langue.
L'écriture est la peinture de la voix: plus elle est ressemblante, meilleure elle est.
OZÉE. [p. 205]↩
En relisant hier, avec édification, l'Ancien Testament, je tombai sur ce passage d'Ozée, ch. XIV, v. 1, que Samarie périsse, parce qu'elle a tourné son Dieu à l'amertume! que les Samaritains meurent par le glaive! que leurs petits enfants soient écrasés, et qu'on fende le ventre aux femmes grosses!
Je trouvai ces paroles un peu dures; j'allai consulter un docteur de l'université de Prague qui était alors à sa maison de campagne au mont Krapac; il me dit: il ne faut pas que cela vous étonne. Les Samaritains étaient des schismatiques qui voulaient sacrifier chez eux, et ne point envoyer leur argent à Jérusalem; ils méritaient au moins les supplices auxquels le prophète Ozée les condamne. La ville de Jéricho, qui fut traitée ainsi, après que ses murs furent tombés au son du cornet, était moins coupable. Les trente et un rois, que Josué fit pendre, n'étaient point schismatiques. Les quarante mille Ephraïmites massacrés pour avoir prononcé siboleth au lieu de schiboleth , n'étaient point tombés dans l'abîme du schisme. Sachez, mon fils, que le schisme est tout ce qu'il y a de plus exécrable. Quand les jésuites firent pendre dans Thorn en 1724 de jeunes écoliers, c'est que ces pauvres enfants étaient schismatiques. Ne doutez pas que nous autres catholiques, apostoliques, romains et bohémiens, nous ne soyons tenus de passer au fil de l'épée tous les Russes que nous rencontrerons désarmés; d'écraser leurs enfants sur la pierre, d'éventrer leurs femmes enceintes, et de tirer de leur matrice déchirée et sanglante leurs foetus à demi formés. Les Russes sont de la religion grecque schismatique; ils ne portent point leur argent à Rome. Donc nous devons les exterminer, puisqu'il est démontré que les Jérosolimites devaient exterminer les Samaritains. C'est ainsi que nous traitâmes les Hussites qui voulaient aussi garder leur argent. Ainsi a péri, ou dû périr; ainsi a été éventrée, ou dû être éventrée toute femme ou fille schismatique.
Je pris la liberté de disputer contre lui; il se fâcha; la dispute se prolongea; il fallut souper chez lui; il m'empoisonna; mais je n'en mourus pas.
PARADIS. [p. 206]↩
Paradis : il n'y a guère de mot, dont la signification se soit plus écartée de son étymologie. On sait assez qu'originairement il signifiait un lieu planté d'arbres fruitiers; ensuite on donna ce nom à des jardins plantés d'arbres d'ombrage. Tels furent dans l'antiquité les jardins de Saana vers Eden dans l'Arabie heureuse, connus si longtemps avant que les hordes des Hébreux eussent envahi une partie de la Palestine.
Ce mot paradis n'est célèbre chez les Juifs que dans la Genèse. Quelques auteurs juifs canoniques parlent de jardins; mais aucun n'a jamais dit un mot du jardin nommé Paradis terrestre . Comment s'est-il pu faire qu'aucun écrivain juif, aucun prophète juif, aucun cantique juif n'ait cité ce paradis terrestre dont nous parlons tous les jours? Cela est presque incompréhensible. C'est ce qui a fait croire à plusieurs savants audacieux, que la Genèse n'avait été écrite que très tard.
Jamais les Juifs ne prirent ce verger, cette plantation d'arbres, ce jardin soit d'herbes, soit de fleurs, pour le ciel.
St Luc est le premier qui fasse entendre le ciel par ce mot Luc ch. XXIII, v. 43. Paradis , quand Jésus-Christ dit au bon larron: Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis .
Les anciens donnèrent le nom de ciel aux nuées. Ce nom n'était pas convenable, attendu que les nuées touchent à la terre par les vapeurs dont elles sont formées, et que le ciel est un mot vague, qui signifie l'espace immense dans lequel sont tant de soleils, de planètes et de comètes: ce qui ne ressemble nullement à un verger.
Ière partie, question CII. St Thomas dit qu'il y a trois paradis, le terrestre, le céleste et le spirituel. Je n'entends pas trop la différence qu'il met entre le spirituel et le céleste. Le verger spirituel est, selon lui, la vision béatifique. Mais c'est précisément ce qui constitue le paradis céleste, c'est la jouissance de Dieu même. Je ne prends pas la liberté de disputer contre l'ange de l'école. Je dis seulement: Heureux qui peut toujours être dans ces trois paradis!
Quelques savants curieux ont cru que le jardin des Hespérides gardé par un dragon, était une imitation du jardin d'Eden gardé par un boeuf ailé, ou par un chérubin. D'autres savants plus téméraires ont osé dire que le boeuf était une mauvaise copie du dragon; et que les Juifs n'ont jamais été que de grossiers plagiaires: mais c'est blasphémer, et cette idée n'est pas soutenable.
Pourquoi a-t-on donné le nom de paradis à des cours carrées au devant d'une église?
Pourquoi a-t-on appelé paradis le rang des troisièmes loges à la comédie et à l'opéra? Est-ce parce que ces places, étant moins chères que les autres, on a cru qu'elles étaient faites pour les pauvres; et qu'on prétend que dans l'autre paradis il y a beaucoup plus de pauvres que de riches? Est-ce parce que ces loges étant fort hautes, on leur a donné un nom qui signifie aussi le ciel? Il y a pourtant un peu de différence entre monter au ciel et monter aux troisièmes loges.
Que penserait un étranger arrivant à Paris, à qui un Parisien dirait: Voulez-vous que nous allions voir Pourceaugnac au paradis?
Que d'incongruités! que d'équivoques dans toutes les langues! Que tout annonce la faiblesse humaine!
Voyez l'article Paradis dans le grand Dictionnaire encyclopédique; il est assurément meilleur que celui-ci.
Paradis aux bienfaisants, disait toujours l'abbé de St Pierre.
PARLEMENT. [p. 208]↩
DEPUIS PHILIPPE LE BEL, JUSQU'A CHARLES VII.
Parlement vient sans doute de parler; et l'on prétend que parler venait du mot celte paler , dont les Cantabres et autres Espagnols firent palabra . D'autres assurent que c'est de parabola ; et que de parabole on fit parlement . C'est là sans doute une érudition fort utile.
Il y a du moins je ne sais quelle apparence de doctrine plus sérieuse dans ceux qui vous disent, que nous n'avons pu encore découvrir de monuments où se trouve le mot barbare parlamentum , que vers le temps des premières croisades.
On peut répondre; le terme parlamentum était en usage alors pour signifier les assemblées de la nation; donc il était en usage très longtemps auparavant. On n'inventa jamais un terme nouveau pour les choses ordinaires.
Philippe III, dans la charte de cet établissement à Paris, parle d'anciens parlements. Nous avons des séances de parlement judiciaire depuis 1254; et une preuve qu'on s'était servi souvent du mot général parlement en désignant les assemblées de la nation, c'est que nous donnâmes ce nom à ces assemblées dès que nous avons écrit en langue française: et les Anglais qui prirent toutes nos coutumes, appelèrent parlement leurs assemblées des pairs.
Ce mot, source de tant d'équivoques, fut affecté à plusieurs autres corps, aux officiers municipaux des villes, à des moines, à des écoles; autre preuve d'un antique usage.
On ne répétera pas ici comment le roi Philippe le Bel qui détruisit et forma tant de choses, forma une chambre de parlement à Paris, pour juger dans cette capitale les grands procès portés auparavant partout où se trouvait la cour; comment cette chambre qui ne siégeait que deux fois l'année fut salariée par le roi à cinq sous par jour pour chaque conseiller juge; chambre nécessairement composée de membres amovibles, puisque tous avaient d'autres emplois; de sorte que qui était juge à Paris à la Toussaint, allait commander les troupes à la Pentecôte.
Nous ne redirons point comment cette chambre ne jugea de longtemps aucun procès criminel.
Comment les clercs ou gradués enquêteurs, établis pour rapporter les procès aux seigneurs conseillers juges, et non pour donner leurs voix, furent bientôt mis à la place de ces juges d'épée qui rarement savaient lire et écrire.
On sait par quelle fatalité étonnante et funeste le premier procès criminel que jugèrent ces nouveaux conseillers gradués, fut celui de CharlesVII leur roi alors dauphin de France, qu'ils déclarèrent sans le nommer, déchu de son droit à la couronne; et comment quelques jours après ces mêmes juges subjugués par le parti anglais dominant, condamnèrent le dauphin, le descendant de St Louis au bannissement perpétuel le 3 janvier 1420; arrêt aussi incompétent qu'infâme, monument éternel de l'opprobre et de la désolation où la France était plongée, et que le président Hénault a tâché en vain de pallier dans son abrégé aussi estimable qu'utile. Mais tout sort de sa sphère dans les temps de trouble. La démence du roi Charles VI, l'assassinat du duc de Bourgogne commis par le dauphin, le traité solennel de Troyes, la défection de tout Paris et des trois quarts de la France, les grandes qualités, les victoires, la gloire, l'esprit, le bonheur de Henri V, solennellement déclaré roi de France; tout semblait excuser le parlement.
Après la mort de Charles VI en 1422, et dix jours après ses obsèques, tous les membres du parlement de Paris jurèrent sur un missel dans la grand'chambre, obéissance et fidélité au jeune roi d'Angleterre Henri VI fils de Henri V; et ce tribunal fit mourir une bourgeoise de Paris qui avait eu le courage d'ameuter plusieurs citoyens pour recevoir leur roi légitime dans sa capitale. Cette respectable bourgeoise fut exécutée avec tous les citoyens fidèles que le parlement put saisir. Charles VII érigea un autre parlement à Poitiers; il fut peu nombreux, peu puissant, et point payé.
Quelques membres du parlement de Paris dégoûtés des Anglais, s'y réfugièrent. Et enfin, quand Charles eut repris Paris, et donné une amnistie générale, les deux parlements furent réunis.
PARLEMENT. L'ÉTENDUE DE SES DROITS.
Machiavel dans ses remarques politiques sur Tite-Live, dit que les parlements font la force du roi de France. Il avait très grande raison en un sens. Machiavel Italien voyait le pape comme le plus dangereux monarque de la chrétienté. Tous les rois lui faisaient la cour; tous voulaient l'engager dans leurs querelles; et quand il exigeait trop, quand un roi de France n'osait le refuser en face, ce roi avait son parlement tout prêt qui déclarait les prétentions du pape contraires aux lois du royaume, tortionnaires, abusives, absurdes. Le roi s'excusait auprès du pape en disant qu'il ne pouvait venir à bout de son parlement.
C'était bien pis encore quand le roi et le pape se querellaient. Alors les arrêts triomphaient de toutes les bulles; et la tiare était renversée par la main de justice. Mais ce corps ne fit jamais la force des rois quand ils eurent besoin d'argent. Comme c'est avec ce seul ressort qu'on est sûr d'être toujours le maître, les rois en voulaient toujours avoir; il en fallut demander d'abord aux états généraux. La cour du parlement de Paris sédentaire et instituée pour rendre la justice, ne se mêla jamais de finance jusqu'à François I er . La fameuse réponse du premier président Jean de la Vaquerie au duc d'Orléans (depuis Louis XII) en est une preuve assez forte, Le parlement est pour rendre justice au peuple; les finances, la guerre, le gouvernement du roi ne sont point de son ressort .
On ne peut pardonner au président Hénault de n'avoir pas rapporté ce trait qui servit longtemps de base au droit public en France, supposé que ce pays connût un droit public.
PARLEMENT. DROIT D'ENREGISTRER.
Enregistrement, mémorial, journal, livre de raison. Cet usage fut de tout temps observé chez les nations policées, et fort négligé par les barbares qui vinrent fondre sur l'empire romain. Le clergé de Rome fut plus attentif, il enregistra tout, et toujours à son avantage. Les Visigoths, les Vandales, les Bourguignons, les Francs, et tous les autres sauvages n'avaient pas seulement de registres pour les mariages, les naissances et les morts. Les empereurs firent à la vérité écrire leurs traités et leurs ordonnances; elles étaient conservées tantôt dans un château, tantôt dans un autre; et quand ce château était pris par quelque brigand, le registre était perdu. Il n'y a guère eu que les anciens actes déposés à la Tour de Londres qui aient subsisté. On n'en retrouva ailleurs que chez des moines, qui suppléèrent souvent par leur industrie à la disette des monuments publics.
Quelle foi peut-on avoir à ces anciens monuments après l'aventure des fausses décrétales qui ont été respectées pendant cinq cents ans, autant et plus que l'Evangile; après tant de faux martyrologes, de fausses légendes et de faux actes? Notre Europe fut trop longtemps composée d'une multitude de brigands qui pillaient tout, d'un petit nombre de faussaires qui trompèrent ces brigands ignorants, et d'une populace aussi abrutie qu'indigente, courbée vers la terre toute l'année pour nourrir tous ces gens-là.
On tient que Philippe-Auguste perdit son chartrier, ses titres; on ne sait pas trop à quelle occasion, ni comment, ni pourquoi il faisait transporter aux injures de l'air des parchemins qu'il devait soigneusement enfermer sous la clef.
On croit qu'Etienne Boileau prévôt de Paris du temps de St Louis, fut le premier qui tint un journal, et qu'il fut imité par Jean de Montluc greffier du parlement de Paris en 1313, et non en 1256; faute de pure inadvertence dans le grand Dictionnaire au mot Enregistrement .
Peu à peu les rois s'accoutumèrent à faire enregistrer au parlement plusieurs de leurs ordonnances, et surtout les lois que le parlement était obligé de maintenir.
C'est une opinion commune que la première ordonnance enregistrée est celle de Philippe de Valois sur ses droits de régale en 1332 au mois de septembre, laquelle pourtant ne fut enregistrée qu'en 1334. Aucun édit sur les finances ne fut enregistré en cette cour, ni par ce roi, ni par ses successeurs jusqu'à FrançoisI er .
Charles V tint un lit de justice en 1374, pour faire enregistrer la loi qui fixe la majorité des rois à quatorze ans.
Une observation fort singulière, est que l'érection de presque tous les parlements du royaume ne fut point présentée au parlement de Paris pour y être enregistrée et vérifiée.
Les traités de paix y furent quelquefois enregistrés. Plus souvent on s'en dispensa. Rien n'a été stable et permanent, rien n'a été uniforme. L'on n'enregistra point le traité d'Utrecht qui termina la funeste guerre de la succession d'Espagne. On enregistra les édits qui établirent et qui supprimèrent les mouleurs de bois, les essayeurs de beurre, et les mesureurs de charbon.
REMONTRANCES DES PARLEMENS.
Toute compagnie, tout citoyen a droit de porter ses plaintes au souverain par la loi naturelle qui permet de crier quand on souffre. Les premières remontrances du parlement de Paris furent adressées à Louis XI par l'exprès commandement de ce roi, qui étant alors mécontent du pape, voulut que le parlement lui remontrât publiquement les excès de la cour de Rome. Il fut bien obéi; le parlement était dans son centre; il défendait les lois contre les rapines. Il montra que la cour romaine avait extorqué en trente années quatre millions six cent quarante-cinq mille écus de la France. Ces simonies multipliées, ces vols réels commis sous le nom de piété , commençaient à faire horreur. Mais la cour romaine ayant enfin apaisé et séduit Louis XI, il fit taire ceux qu'il avait fait si bien parler. Il n'y eut aucune remontrance sur les finances du temps de Louis XI, ni de Charles VIII, ni de Louis XII; car il ne faut pas qualifier du nom de remontrances solennelles , le refus que fit cette compagnie de prêter à Charles VIII cinquante mille francs pour sa malheureuse expédition d'Italie en 1496. Le roi lui envoya le sire d'Albret, le sire de Rieux gouverneur de Paris, le sire de Gravile amiral de France, et le cardinal Dumaine pour la prier de se cotiser pour lui prêter cet argent. Etrange députation! les registres portent que le parlement représenta, la nécessité et indigence du royaume, et le cas si piteux, quod non indiget manu scribentis . Garder son argent n'était pas une de ces remontrances publiques au nom de la France.
Il en fit pour la grille d'argent de St Martin que François I er acheta des chanoines, et dont il devait payer l'intérêt et le principal sur ses domaines. Voilà la première remontrance pour affaire pécuniaire.
La seconde fut pour la vente de vingt charges de nouveaux conseillers au parlement de Paris, et de trente dans les provinces. Ce fut le chancelier cardinal Duprat qui prostitua ainsi la justice. Cette honte a duré et s'est étendue sur toute la magistrature de la France depuis 1515 jusqu'à 1771, l'espace de deux cent cinquante-cinq ans, jusqu'à ce qu'un autre chancelier a commencé à effacer cette tache.
Depuis ce temps, le parlement remontra sur toutes sortes d'objets. Il y était autorisé par l'édit paternel de Louis XII père du peuple, qu'on suive toujours la loi malgré les ordres contraires à la loi que l'importunité pourrait arracher au monarque .
Après François I er , le parlement fut continuellement en querelle avec le ministère, ou du moins en défiance. Les malheureuses guerres de religion augmentèrent son crédit; et plus il fut nécessaire, plus il fut entreprenant. Il se regardait comme le tuteur des rois dès le temps de François II. C'est ce que Charles IX lui reprocha au temps de sa majorité par ces propres mots.
‘Je vous ordonne de ne pas agir avec un roi majeur comme vous avez fait pendant sa minorité; ne vous mêlez pas des affaires dont il ne vous appartient pas de connaître; souvenez-vous que votre compagnie n'a été établie par les rois que pour rendre la justice suivant les ordonnances du souverain. Laissez au roi et à son conseil les affaires d'Etat; défaites-vous de l'erreur de vous regarder comme les tuteurs des rois, comme les défenseurs du royaume, et comme les gardiens de Paris.'
Le malheur des temps l'engagea dans le parti de la Ligue contre Henri III. Il soutint les Guises au point qu'après le meurtre de Henri de Guise et du cardinal son frère, il commença des procédures contre Henri III, et nomma deux conseillers, Pichon et Courtin, pour informer.
Après la mort de Henri III, il se déclara contre Henri le Grand. La moitié de ce corps était entraînée par la faction d'Espagne, et l'autre par un faux zèle de religion.
Henri IV eut un autre petit parlement auprès de lui ainsi que Charles VII. Il rentra comme lui dans Paris par des négociations secrètes plus que par la force, et il réunit les deux parlements ainsi que Charles VII en avait usé.
Tout le ministère du cardinal de Richelieu fut signalé par des résistances fréquentes de cette compagnie; résistances d'autant plus fermes qu'elles étaient approuvées de la nation.
On connaît assez la guerre de la Fronde, dans laquelle il fut précipité par des factieux. La reine régente le transféra à Pontoise par une déclaration du roi son fils déjà majeur, datée du 3 juillet 1652. Mais trois présidents seulement et quatorze conseillers obéirent.
Louis XIV en 1655, après l'amnistie, vint à la grand'chambre, le fouet à la main, défendre les assemblées des chambres. En 1657, il ordonna l'enregistrement de tout édit, et ne permit les remontrances que dans la huitaine après l'enregistrement. Tout fut tranquille sous son règne.
SOUS LOUIS XV.
Le parlement de Paris avait déjà, du temps de la Fronde, établi l'usage de ne plus rendre la justice lorsqu'il se croyait lésé par le gouvernement. C'était un moyen qui semblait devoir forcer le ministère à plier sous ses volontés, sans qu'on eût une rébellion à lui reprocher comme dans la minorité de Louis XIV.
Il employa cette ressource en 1718, dans la minorité de Louis XV. Le duc d'Orléans régent l'exila à Pontoise en 1720.
La malheureuse bulle Unigenitus le mit quelquefois aux prises avec le cardinal de Fleuri.
Il cessa encore ses fonctions en 1751 dans les petits troubles excités par Christophe de Beaumont archevêque de Paris, au sujet des billets de confession et des refus de sacrements.
Nouvelle cessation de service en 1753. Tout le corps fut exilé dans plusieurs villes frontières; la grand'chambre le fut à Pontoise. Cet exil dura plus de quinze mois, depuis le 10 mai 1753, jusqu'au 27 auguste 1754. Le roi dans cet espace de temps fit rendre la justice par des conseillers d'Etat et des maîtres des requêtes. Très peu de causes furent plaidées devant ce nouveau tribunal. La plupart de ceux qui étaient en procès aimèrent mieux s'accommoder ou attendre le retour du parlement. Il semblait que la chicane eût été exilée avec ceux qui étaient institués pour la condamner.
On rappela enfin le parlement à ses fonctions, et il revint aux acclamations de toute la France.
Deux ans après son retour, les esprits étant plus aigris que jamais, le roi vint tenir un lit de justice à Paris en 1756 le 13 décembre. Il supprima deux chambres du parlement, et fit plusieurs règlements pour mettre dans ce corps une police nouvelle. A peine fut-il sorti que tous les conseillers donnèrent leur démission, à la réserve des présidents à mortier et de dix conseillers de grand'chambre.
La cour ne croyait pas alors pouvoir établir un nouveau tribunal à sa place. On fut de tous les côtés très aigri et très incertain.
L'attentat inconcevable de Damiens parut réconcilier pendant quelque temps le parlement avec la cour. Ce malheureux non moins insensé que coupable, accusa sept membres du parlement dans une lettre qu'il osa dicter pour le roi même, et qui lui fut portée. Cette accusation absurde n'empêcha pas le roi de remettre au parlement même le jugement de Damiens, qui fut condamné au supplice de Ravaillac par ce qui restait de la grand'chambre. Plusieurs pairs et des princes du sang opinèrent.
Après l'exécution terrible du criminel faite le 28 mars 1757, le ministère engagé dans une guerre ruineuse et funeste, négocia avec ces mêmes officiers du parlement qui avaient donné leur démission; les exilés furent rappelés.
Ce corps, à force d'avoir été humilié par la cour, eut plus d'autorité que jamais.
Il signala cette autorité en abolissant par un arrêt l'ordre des jésuites en France, et en les dépouillant de tous leurs biens (par l'arrêt du 6 août 1762). Rien ne le rendit plus cher à la nation. Il fut en cela parfaitement secondé par tous les parlements du royaume, et par toute la France.
Il s'unissait en effet avec ces autres parlements, et prétendait ne faire avec eux qu'un corps, dont il était le principal membre. Tous s'appelaient alors classes du parlement ; celui de Paris était la première classe; chaque classe faisait des remontrances sur les édits, et ne les enregistrait pas. Il y eut même quelques-uns de ces corps qui poursuivirent juridiquement les commandants de province envoyés à eux de la part du roi pour faire enregistrer. Quelques classes décernèrent des prises de corps contre ces officiers. Si ces décrets avaient été mis à exécution, il en aurait résulté un effet bien étrange. C'est sur les domaines royaux que se prennent les deniers dont on paie les frais de justice; de sorte que le roi aurait payé de ses propres domaines les arrêts rendus par ceux qui lui désobéissaient contre ses officiers principaux qui avaient exécuté ses ordres.
Le plus singulier de ces arrêts rendus contre les commandants des provinces, et en quelque sorte contre le roi lui-même, fut celui du parlement de Toulouse contre le duc de Fitzjames, Barwik, en date du 17 décembre 1763. Ordonne que ledit duc de Fitzjames sera pris, saisi et arrêté en quelque endroit du royaume qu'il se trouve , c'est-à-dire, que les huissiers toulousains pouvaient saisir au corps le duc de Fitzjames dans la chambre du roi même ou à sa chapelle de Versailles. La cour dissimula longtemps cet affront; aussi elle en essuya d'autres.
Cette étonnante anarchie ne pouvait pas subsister; il fallait ou que la couronne reprît son autorité, ou que les parlements prévalussent.
On avait besoin dans des conjonctures si critiques d'un chancelier tel que celui de l'Hôpital, on le trouva. Il fallut changer toute l'administration de la justice dans le royaume, et elle fut changée.
Le roi commença par essayer de ramener le parlement de Paris; il le fit venir à un lit de justice qu'il tint à Versailles le 7 décembre 1770, avec les princes, les pairs et les grands officiers de la couronne. Là, il lui défendit de se servir jamais des termes d' unité , d' indivisibilité et de classes .
D'envoyer aux autres parlements d'autres mémoires que ceux qui sont spécifiés par les ordonnances.
De cesser le service, sinon dans les cas que ces mêmes ordonnances ont prévus.
De donner leur démission en corps.
De rendre jamais d'arrêt qui retarde les enregistrements, le tout sous peine d'être cassés.
Le parlement sur cet édit solennel, ayant encore cessé le service, le roi leur fit porter des lettres de jussion; ils désobéirent. Nouvelles lettres de jussion, nouvelle désobéissance. Enfin, le monarque poussé à bout, leur envoya pour dernière tentative le 20 janvier à quatre heures du matin des mousquetaires qui portèrent à chaque membre un papier à signer. Ce papier ne contenait qu'un ordre de déclarer s'ils obéiraient ou s'ils refuseraient. Plusieurs voulurent interpréter la volonté du roi: les mousquetaires leur dirent qu'ils avaient ordre d'éviter les commentaires, qu'il fallait un oui, ou un non.
Quarante membres signèrent ce oui , les autres s'en dispensèrent. Les oui étant venus le lendemain au parlement avec leurs camarades, leur demandèrent pardon d'avoir accepté, et signèrent non ; tous furent exilés.
La justice fut encore administrée par les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes comme elle l'avait été en 1753: mais ce ne fut que par provision. On tira bientôt de ce chaos un arrangement utile.
D'abord le roi se rendit aux voeux des peuples qui se plaignaient depuis des siècles de deux griefs, dont l'un était ruineux, l'autre honteux et dispendieux à la fois. Le premier était le ressort trop étendu du parlement de Paris, qui contraignait les citoyens de venir de cent cinquante lieues se consumer devant lui en frais qui souvent excédaient le capital. Le second était la vénalité des charges de judicature; vénalité qui avait introduit la forte taxation des épices.
Pour réformer ces deux abus, six parlements nouveaux furent institués le 23 février de la même année, sous le titre de Conseils supérieurs , avec injonction de rendre gratis la justice. Ces conseils furent établis dans Arras, Blois, Châlons, Clermont, Lyon, Poitiers (en suivant l'ordre alphabétique). On y en ajouta d'autres depuis.
Il fallait surtout former un nouveau parlement à Paris, lequel serait payé par le roi sans acheter ses places, et sans rien exiger des plaideurs. Cet établissement fut fait le 13 avril. L'opprobre de la vénalité dont François I er et le chancelier Duprat avaient malheureusement souillé la France, fut lavé par Louis XV et par les soins du chancelier de Maupeou, second du nom. On finit par la réforme de tous les parlements; et on espéra de voir réformer la jurisprudence.
PASSIONS. [p. 218]↩
LEUR INFLUENCE SUR LE CORPS, ET CELLE DU CORPS SUR ELLES.
Dis-moi, docteur, (je n'entends pas un docteur en médecine qui sait quelque chose, qui a longtemps examiné les sinuosités du cervelet, qui a recherché si les nerfs ont un suc circulant, qui a fouillé en vain dans des matrices pour voir comment un être pensant s'y forme, et qui connaît tout ce qu'on peut connaître de notre machine) hélas! j'entends un docteur en théologie. Je t'adjure par la raison au nom de laquelle tu frémis. Dis-moi pourquoi ayant vu faire à ta servante un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche formé par le muscle gluteus et par le vaste externe, sur-le-champ ton imagination s'alluma; deux muscles érecteurs, qui partent de l'ischion, donnèrent un mouvement de perpendicule à ton phallus? Ses corps caverneux se remplirent de sang; tu introduisis ton balanus intra vaginam de ta servante; et ton balanus frottant suum clitorida lui donna comme à toi un plaisir d'une ou deux secondes, dont ni elle ni toi ne connaîtront jamais la cause, et dont naîtra cependant un être pensant, tout pourri du péché originel? Quel rapport, je te prie, de toute cette action avec un mouvement du muscle gluteus de ta gouvernante? Tu aurais beau relire Sanchez et Thomas d'Aquin et Scot et Bonaventure, tu ne sauras jamais un mot de cette mécanique incompréhensible, par laquelle l'éternel architecte dirige tes idées, tes désirs, tes actions; et fait naître un petit bâtard de prêtre prédestiné à la damnation de toute éternité.
Le lendemain matin, après avoir pris ton chocolat, ta mémoire te retrace l'image du plaisir que tu goûtas la veille, et tu recommences. Conçois-tu, mon gros automate, ce que c'est que cette mémoire qui t'est commune avec tous les animaux? Sais-tu quelles fibres rappellent tes idées, et peignent dans ton cerveau les voluptés de la veille par un sentiment continué, qui a dormi avec toi et qui s'est réveillé avec toi? Le docteur me répond après Thomas d'Aquin que tout cela est une production de son âme végétative, de son âme sensitive et de son âme intellectuelle, qui toutes trois composent une âme, laquelle n'étant point étendue agit évidemment sur un corps étendu.
Je vois à son air embarrassé qu'il a balbutié des mots dont il n'a aucune idée; et je lui dis enfin: Docteur, si tu conviens malgré toi que tu ne sais ce que c'est qu'une âme, et que tu as parlé toute ta vie sans t'entendre; que ne l'avoues-tu en honnête homme? que ne conclus-tu ce qu'il faut conclure de la prémotion physique du docteur Boursier, et de certains endroits de Mallebranche, et surtout de ce sage Locke si supérieur à Mallebranche? que ne conclus-tu, dis-je, que ton âme est une faculté que Dieu t'a donnée, sans te dire son secret, ainsi qu'il t'en a donné tant d'autres? Apprends que plusieurs raisonneurs prétendent qu'à proprement parler il n'y a que le pouvoir inconnu du divin Demiourgos et ses lois inconnues qui opèrent tout en nous; et qu'à parler encore mieux, nous ne saurons jamais de quoi il s'agit.
Mon homme se fâche; le sang lui monte au visage. Il me battrait, s'il était le plus fort, et s'il n'était retenu par les bienséances. Son coeur se gonfle; la systole et la diastole se font irrégulièrement; son cervelet est comprimé; il tombe en apoplexie. Quel rapport y avait-il donc entre ce sang, ce coeur, ce cervelet, et une vieille opinion du docteur, qui était contraire à la mienne? Un esprit pur, intellectuel tombe-t-il en syncope, quand on n'est pas de son avis? J'ai proféré des sons; il a proféré des sons; et le voilà en apoplexie; le voilà mort.
Je suis à table moi et mon âme en Sorbonne, au primâ mensis avec cinq ou six docteurs socii Sorbonici . On nous donne d'un mauvais vin frelaté; d'abord nos âmes sont folles; une demi-heure après nos âmes sont stupides, elles sont nulles; et le lendemain nos mêmes docteurs donnent un beau décret par lequel l'âme ne tenant point de place, et étant absolument immatérielle, est logée matériellement dans le corps calleux, pour faire leur cour au chirurgien La Peironie.
Un convive est à table gaiement. On lui apporte une lettre qui lui inspire l'étonnement, la tristesse et la crainte. Dans l'instant même les muscles de son ventre se contractent et se relâchent; le mouvement péristaltique des intestins s'augmente; le sphincter du rectum s'ouvre avec une petite convulsion; et mon homme, au lieu d'achever son dîner, fait une copieuse évacuation. Dis-moi donc quelle connexion secrète la nature a mise entre une idée et une selle?
De tous ceux qu'on a trépanés, il y en a toujours plusieurs qui restent imbéciles. On a donc offensé les fibres pensantes de leur cerveau; et où sont ces fibres pensantes? O Sanchez, ô magister de Grillandis, Tamponet, Riballier, ô Cogé pécus régent de seconde et recteur de l'université, rendez-moi raison nettement de tout cela, si vous pouvez!
Comme j'écrivais ces choses au mont Krapac, pour mon instruction particulière, on m'a apporté le livre de la Médecine de l'esprit du docteur Camus, professeur en médecine en l'université de Paris. J'ai espéré d'y voir la solution de toutes mes difficultés. Qu'y ai-je trouvé! Rien. Ah, monsieur Camus! vous n'avez pas fait avec esprit la Médecine de l'esprit . C'est lui qui recommande fortement le sang d'ânon, tiré derrière l'oreille, comme un spécifique contre la folie. Cette vertu du sang d'âne , dit-il, réintègre l'âme dans ses fonctions . Il prétend aussi qu'on guérit les fous en leur donnant la gale. Il assure de plus que, pour avoir de la mémoire, il faut manger du chapon, du levraut et des alouettes, et surtout se bien garder des oignons et du beurre. Cela fut imprimé en 1769 avec approbation et privilège du roi. Et on mettait sa santé entre les mains de maître Camus professeur en médecine! Pourquoi n'aurait-il pas été premier médecin du roi?
Pauvres marionnettes de l'éternel Demiourgos, qui ne savons ni pourquoi ni comment une main invisible fait mouvoir nos ressorts, et ensuite nous jette et nous entasse dans la boîte! Répétons plus que jamais avec Aristote: Tout est qualité occulte .
PATRIE. [p. 221]↩
SECTION PREMIERE.
Nous nous bornerons ici selon notre usage à proposer quelques questions que nous ne pouvons résoudre.
Un juif a-t-il une patrie? s'il est né à Coimbre, c'est au milieu d'une troupe d'ignorants absurdes qui argumenteront contre lui, et auxquels il ferait des réponses absurdes, s'il osait répondre. Il est surveillé par des inquisiteurs qui le feront brûler s'ils savent qu'il ne mange point de lard, et tout son bien leur appartiendra. Sa patrie est-elle à Coimbre? peut-il aimer tendrement Coimbre? peut-il dire comme dans les Horaces de Pierre Corneille,
Mon cher pays et mon premier amour. . .
Mourir pour la patrie est un si digne sort
Qu'on briguerait en foule une si belle mort. -- Tarare!
Sa patrie est-elle Jérusalem? il a ouï dire vaguement qu'autrefois ses ancêtres, quels qu'ils fussent, ont habité ce terrain pierreux et stérile, bordé d'un désert abominable, et que les Turcs sont maîtres aujourd'hui de ce petit pays dont ils ne retirent presque rien. Jérusalem n'est pas sa patrie. Il n'en a point; il n'a pas sur la terre un pied carré qui lui appartienne.
Le Guèbre plus ancien, et cent fois plus respectable que le juif, esclave des Turcs, ou des Persans, ou du Grand Mogol, peut-il compter pour sa patrie quelques pyrées qu'il élève en secret sur des montagnes?
Le Banian, l'Arménien, qui passent leur vie à courir dans tout l'Orient, et à faire le métier de courtiers, peuvent-ils dire, Ma chère patrie, ma chère patrie? Ils n'en ont d'autre que leur bourse et leur livre de compte.
Parmi nos nations d'Europe, tous ces meurtriers qui louent leurs services, et qui vendent leur sang au premier roi qui veut les payer, ont-ils une patrie? Ils en ont bien moins qu'un oiseau de proie qui revient tous les soirs dans le creux du rocher où sa mère fit son nid.
Les moines oseraient-ils dire qu'ils ont une patrie? elle est, disent-ils, dans le ciel; à la bonne heure; mais dans ce monde je ne leur en connais pas.
Ce mot de patrie sera-t-il bien convenable dans la bouche d'un Grec, qui ignore s'il y eut jamais un Miltiade, un Agésilas, et qui sait seulement qu'il est l'esclave d'un janissaire, lequel est esclave d'un aga, lequel est esclave d'un bacha, lequel est esclave d'un vizir, lequel est esclave d'un padicha que nous appelons à Paris le Grand Turc?
Qu'est-ce donc que la patrie? ne serait-ce pas par hasard un bon champ, dont le possesseur logé commodément dans une maison bien tenue, pourrait dire, Ce champ que je cultive, cette maison que j'ai bâtie sont à moi; j'y vis sous la protection des lois qu'aucun tyran ne peut enfreindre. Quand ceux qui possèdent, comme moi, des champs et des maisons s'assemblent pour leurs intérêts communs, j'a ma voix dans cette assemblée; je suis une partie du tout, une de la communauté, une partie de la souveraineté; voilà ma patrie. Tout ce qui n'est pas cette habitation d'hommes, n'est-ce pas quelquefois une écurie de chevaux sous un palefrenier qui leur donne à son gré des coups de fouet? On a une patrie sous un bon roi; on n'en a point sous un méchant.
SECTION SECONDE.
Un jeune garçon pâtissier qui avait été au collège, et qui savait encore quelques phrases de Cicéron, se donnait un jour les airs d'aimer sa patrie. Qu'entends-tu par ta patrie? lui dit un voisin, est-ce ton four? est-ce le village où tu es né et que tu n'as jamais revu? est-ce la rue où demeuraient ton père et ta mère qui se sont ruinés, et qui t'ont réduit à enfourner des petits pâtés pour vivre? est-ce l'hôtel de ville où tu ne seras jamais clerc d'un quartinier? est-ce l'église de Notre-Dame où tu n'as pu parvenir à être enfant de choeur, tandis qu'un homme absurde est archevêque et duc avec dix mille louis d'or de rente?
Le garçon pâtissier ne sut que répondre. Un penseur qui écoutait cette conversation, conclut que dans une patrie un peu étendue, il y avait souvent plusieurs millions d'hommes qui n'avaient point de patrie.
Toi, voluptueux Parisien, qui n'as jamais fait d'autre grand voyage que celui de Dieppe pour y manger de la marée fraîche; qui ne connais que ta maison vernie de la ville, ta jolie maison de campagne et ta loge à cet Opéra où le reste de l'Europe s'obstine à s'ennuyer; qui parles assez agréablement ta langue parce que tu n'en sais point d'autre, tu aimes tout cela, et tu aimes encore les filles que tu entretiens, le vin de Champagne qui t'arrive de Rheims, tes rentes que l'hôtel de ville te paie tous les six mois, et tu dis que tu aimes ta patrie!
En conscience, un financier aime-t-il cordialement sa patrie!
L'officier et le soldat qui dévasteront leur quartier d'hiver si on les laisse faire, ont-ils un amour bien tendre pour les paysans qu'ils ruinent?
Où était la patrie du duc de Guise le Balafré, était-ce à Nanci, à Paris, à Madrid, à Rome?
Quelle patrie aviez-vous, cardinaux de la Balue, Duprat, Lorraine, Mazarin?
Où fut la patrie d'Attila et de cent héros de ce genre, qui en courant toujours n'étaient jamais hors de leur chemin?
Je voudrais bien qu'on me dît quelle était la patrie d'Abraham?
Le premier qui a écrit que la patrie est partout où l'on se trouve bien, est je crois Euripide dans son Phaëton.
Os pantakos ge patris es boskousa ge .
Mais le premier homme qui sortit du lieu de sa naissance pour chercher ailleurs son bien-être, l'avait dit avant lui.
PAUL. [p. 224]↩
QUESTIONS SUR PAUL.
Section première.
Les Epîtres de St Paul sont si sublimes, qu'il est souvent difficile d'y atteindre.
Epître aux Corinth. ch. IX. Plusieurs jeunes bacheliers demandent ce que signifient précisément ces paroles? I Corinth. ch. XI, v. 23. ‘Tout homme qui prie et qui prophétise avec un voile sur sa tête souille sa tête.'
Que veulent dire celles-ci? ‘J'ai appris du Seigneur que la nuit même qu'il fut saisi il prit du pain.'
Comment peut-il avoir appris cela de Jésus-Christ, auquel il n'avait jamais parlé, et dont il avait été le plus cruel ennemi sans l'avoir jamais vu? est-ce par inspiration, est-ce par le récit de ses disciples? est-ce lorsqu'une lumière céleste le fit tomber de cheval? il ne nous en instruit pas .
I Timothée ch. II. Et celles-ci encore? ‘La femme sera sauvée si elle fait des enfants.'
C'est assurément encourager la population; il ne paraît pas que Paul ait fondé des couvents de filles .
Timoth. ch. IV. Il traite d'impies, d'imposteurs, de diaboliques, de consciences gangrenées, ceux qui prêchent le célibat et l'abstinence des viandes.
Ceci est bien plus fort. Il semble qu'il proscrive moines, nonnes, jours de jeûnes. Expliquez-moi cela, tirez-moi d'embarras .
Timoth ch. III et à Tite ch. I. Que dire sur les passages où il recommande aux évêques de n'avoir qu'une femme? Unius uxoris virum .
Cela est positif. Jamais il n'a permis qu'un évêque eût deux femmes, lorsque les grands pontifes juifs pouvaient en avoir plusieurs .
Il dit positivement que le jugement dernier se fera de son temps, que Jésus descendra dans les nuées comme il est annoncé Thessal. ch. XIV. dans St Luc, que lui Paul montera dans l'air pour aller au devant de lui avec les habitants de Thessalonique.
La chose est-elle arrivée? est-ce une allégorie, une figure? croyait-il en effet qu'il ferait ce voyage, croyait-il avoir fait celui du troisième ciel? qu'est-ce que ce troisième ciel? comment ira-t-il dans l'air? y a-t-il été?
Ephésiens ch. I. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse.
Est-ce là reconnaître Jésus pour le même Dieu que le père?
Il a opéré sa puissance sur Jésus en le ressuscitant et le mettant à sa droite.
Est-ce là constater la divinité de Jésus?
Aux Héb. ch. II. Vous avez rendu Jésus de peu inférieur aux anges en le couronnant de gloire.
S'il est inférieur aux anges est-il Dieu?
Item ch. XVI. Si par le délit d'un seul plusieurs sont morts, la grâce et le don de Dieu ont plus abondé par la grâce d'un seul homme qui est Jésus-Christ.
Pourquoi l'appeler toujours homme et jamais Dieu?
Si à cause du péché d'un seul homme la mort a régné, l'abondance de grâce régnera bien davantage par un seul homme qui est Jésus-Christ.
Toujours homme, jamais Dieu, excepté un seul endroit contesté par Erasme, par Grotius, par Le Clerc, etc .
Aux Romains ch. V. Nous sommes enfants de Dieu, et cohéritiers de Jésus-Christ.
N'est-ce pas toujours regarder Jésus comme l'un de nous, quoique supérieur à nous par les grâces de Dieu?
A Dieu seul sage, honneur et gloire par Jésus-Christ.
Ce mot Dieu seul, ne semble-t-il pas exclure Jésus de la divinité?
Comment entendre tous ces passages à la lettre sans craindre d'offenser Jésus-Christ? comment les entendre dans un sens plus relevé sans craindre d'offenser Dieu le père?
Il y en a plusieurs de cette espèce qui ont exercé l'esprit des savants. Les commentateurs se sont combattus; et nous ne prétendons pas porter la lumière où ils ont laissé l'obscurité. Nous nous soumettons toujours de coeur et de bouche à la décision de l'Eglise.
Nous avons eu aussi quelques peines à bien pénétrer les passages suivants.
‘Votre circoncision profite si vous observez la loi juive; [10] mais si vous êtes prévaricateurs de la loi, votre circoncision devient prépuce,
Ch. III. ‘Or nous savons que tout ce que la loi dit à ceux qui sont dans la loi, elle le dit afin que toute bouche soit obstruée, et que tout le monde soit soumis à Dieu, parce que toute chair ne sera pas justifiée devant lui par les oeuvres de la loi, car par la loi vient la connaissance du péché,
Ch. IV, suite au ch. V. ‘Car un seul Dieu justifie la circoncision par la foi, et le prépuce par la foi. Détruisons-nous donc la loi par la foi? à Dieu ne plaise. Car si Abraham a été justifié par ses oeuvres, il en a gloire, mais non chez Dieu.'
Nous osons dire que l'ingénieux et profond Dom Calmet lui-même, ne nous a pas donné sur ces endroits un peu obscurs, une lumière qui dissipât toutes nos ténèbres. C'est sans doute notre faute de n'avoir pas entendu les commentateurs, et d'avoir été privés de l'intelligence entière du texte, qui n'est donnée qu'aux âmes privilégiées. Mais dès que l'explication viendra de la chaire de vérité, nous entendrons tout parfaitement.
( Par le pasteur Lélie . )
SECTION SECONDE.
Ajoutons ce petit supplément à l'article Paul . Il vaut mieux s'édifier dans les lettres de cet apôtre, que de dessécher sa piété à calculer le temps où elles furent écrites. Les savants recherchent en vain l'an et jour auxquels St Paul servit à lapider St Etienne, et à garder les manteaux des bourreaux.
Ils disputent sur l'année où il fut renversé de cheval par une lumière éclatante en plein midi, et sur l'époque de son ravissement au troisième ciel.
Ils ne conviennent ni de l'année où il fut conduit prisonnier à Rome, ni de celle où il mourut.
On ne connaît la date d'aucune de ses lettres.
On croit que l'Epître aux Hébreux n'est point de lui. On rejette celle aux Laodicéens; quoique cette épître ait été reçue sur les mêmes fondements que les autres.
On ne sait pourquoi il changea son nom de Saul en celui de Paul, ni ce que signifiait ce nom.
St Jérôme, dans son commentaire sur l'Epître à Philémon, dit que Paul signifiait l'embouchure d'une flûte.
Les lettres de St Paul à Sénèque, et de Sénèque à Paul passèrent, dans la primitive Eglise, pour aussi authentiques que tous les autres écrits chrétiens. St Jérôme l'assure, et cite des passages de ces lettres dans son catalogue. St Augustin n'en doute pas dans sa 153 e lettre à Macédonius.[11] Nous avons treize lettres de ces deux grands hommes, Paul et Sénèque qu'on prétend avoir été liés d'une étroite amitié à la cour de Néron. La septième lettre de Sénèque à Paul est très curieuse. Il lui dit que les juifs et les chrétiens sont souvent condamnés au supplice comme incendiaires de Rome. Christiani et Judaei, tanquam machinatores incendii, supplicio affici solent . Il est vraisemblable en effet que les juifs et les chrétiens, qui se haïssaient avec fureur, s'accusèrent réciproquement d'avoir mis le feu à la ville; et que le mépris et l'horreur qu'on avait pour les juifs, dont on ne distinguait point les chrétiens, les livrèrent également les uns et les autres à la vengeance publique.
Nous sommes forcés d'avouer que le commerce épistolaire de Sénèque et de Paul est dans un latin ridicule et barbare; que les sujets de ces lettres paraissent aussi impertinents que le style; qu'on les regarde aujourd'hui comme des actes de faussaires. Mais aussi comment ose-t-on contredire le témoignage de St Jérôme et de St Augustin? Si ces monuments attestés par eux ne sont que de viles impostures, quelle sûreté aurons-nous pour les autres écrits plus respectables? C'est la grande objection de plusieurs savants personnages. Si on nous a trompés indignement, disent-ils, sur les lettres de Paul et de Sénèque, sur les Constitutions apostoliques, sur les actes de St Pierre, pourquoi ne nous aura-t-on pas trompés de même sur les Actes des apôtres? Le jugement de l'Eglise et la foi sont les réponses péremptoires à toutes ces recherches de la science et à tous les raisonnements de l'esprit.
On ne sait pas sur quel fondement Abdias, premier évêque de Babilone, dit dans son Histoire des apôtres, que St Paul fit lapider St Jacques le Mineur par le peuple. Mais avant qu'il se fût converti, il se peut très facilement qu'il eût persécuté St Jacques aussi bien Ch. IX, v. 1. que St Etienne. Il était très violent; il est dit dans les Actes des apôtres qu'il respirait le sang et le carnage. Aussi Abdias a soin d'observer que l'auteur de la sédition dans laquelle St Jacques fut si cruellement traité, était ce même Paul que Dieu appela depuis au ministère de l'apostolat . [12]
Ce livre attribué à l'évêque Abdias, n'est point admis dans le canon. Cependant Jules Africain, qui l'a traduit en latin, le croit authentique. Dès que l'Eglise ne l'a pas reçu, il ne faut pas le recevoir. Bornons-nous à bénir la Providence et à souhaiter que tous les persécuteurs soient changés en apôtres charitables et compatissants.
PÈRES, MÈRES, ENFANS: [p. 228]↩
LEURS DEVOIRS.
On a beaucoup crié en France contre l'Encyclopédie, parce qu'elle avait été faite en France, et qu'elle lui faisait honneur; on n'a point crié dans les autres pays; au contraire, on s'est empressé de la contrefaire ou de la gâter, par la raison qu'il y avait à gagner quelque argent.
Pour nous qui ne travaillons point pour la gloire comme les encyclopédistes de Paris, nous qui ne sommes point exposés comme eux à l'envie, nous dont la petite société est cachée dans la Hesse, dans le Virtemberg, dans la Suisse, chez les Grisons, au mont Krapac, et qui ne craignons point d'avoir à disputer contre le docteur de la comédie italienne ou contre un docteur de Sorbonne, nous qui ne vendons point nos feuilles à un libraire, nous qui sommes des êtres libres, et qui ne mettons du noir sur du blanc, qu'après avoir examiné autant qu'il est en nous, si ce noir pourra être utile au genre humain, nous enfin qui aimons la vertu, nous exposerons hardiment notre pensée.
Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps.
J'oserais dire, Honore ton père et ta mère, dusses-tu mourir demain.
Aime tendrement, sers avec joie la mère qui t'a porté dans son sein et qui t'a nourri de son lait, et qui a supporté tous les dégoûts de ta première enfance. Remplis ces mêmes devoirs envers ton père qui t'a élevé.
Siècles à venir, jugez un Franc nommé Louis XIII, qui à l'âge de seize ans commença par faire murer la porte de l'appartement de sa mère, et l'envoya en exil sans en donner la moindre raison, mais seulement parce que son favori le voulait.
Mais, monsieur, je suis obligé de vous confier que mon père est un ivrogne, qui me fit un jour par hasard, sans songer à moi, qui ne m'a donné aucune éducation que celle de me battre tous les jours quand il revenait ivre au logis. Ma mère était une coquette qui n'était occupée que de faire l'amour. Sans ma nourrice qui s'était prise d'amitié pour moi, et qui après la mort de son fils m'a reçu chez elle par charité, je serais mort de misère.
Eh bien, aime ta nourrice, salue ton père et ta mère quand tu les rencontreras. Il est dit dans la Vulgate, honora patrem tuum et matrem tuam , et non pas, dilige .
Fort bien, monsieur, j'aimerai mon père et ma mère s'ils me font du bien; je les honorerai s'ils me font du mal; j'ai toujours pensé ainsi depuis que je pense, et vous me confirmez dans mes maximes.
Adieu mon enfant, je vois que tu prospéreras, car tu as un grain de philosophie dans la tête.
Encore un mot, monsieur; si mon père s'appelait Abraham, et moi Isaac; et si mon père me disait, Mon fils, tu es grand et fort, porte ces fagots au haut de cette montagne pour te servir de bûcher quand je t'aurai coupé la tête, car c'est Dieu qui me l'a ordonné ce matin quand il m'est venu voir; que me conseilleriez-vous de faire dans cette occasion chatouilleuse?
Assez chatouilleuse en effet. Mais toi, que ferais-tu? car tu me parais une assez bonne tête.
Je vous avoue, monsieur, que je lui demanderais son ordre par écrit, et cela par amitié pour lui. Je lui dirais, Mon père, vous êtes chez des étrangers qui ne permettent pas qu'on assassine son fils sans une permission expresse de Dieu dûment légalisée et contrôlée. Voyez ce qui est arrivé à ce pauvre Calas dans la ville moitié française, moitié espagnole de Toulouse. On l'a roué, et le procureur général Riquet a conclu à faire brûler madame Calas la mère, le tout sur le simple soupçon très mal conçu qu'ils avaient pendu leur fils Marc-Antoine Calas pour l'amour de Dieu. Je craindrais qu'il ne donnât ses conclusions contre vous et contre votre soeur, ou votre nièce madame Sara ma mère. Montrez-moi encore un coup une lettre de cachet pour me couper le cou, signée de la main de Dieu, et plus bas Raphaël, ou Michel, ou Belzébuth, sans quoi serviteur; je m'en vais chez Pharaon égyptiaque, ou chez le roi du désert de Gérar, qui ont été tous deux amoureux de ma mère, et qui certainement auront de la bonté pour moi. Coupez si vous voulez le cou de mon frère Ismaël, mais pour le mien je vous réponds que vous n'en viendrez pas à bout.
Comment! c'est raisonner en vrai sage. Le Dictionnaire encyclopédique ne dirait pas mieux. Tu iras loin, te dis-je, je t'admire de n'avoir pas dit la moindre injure à ton père Abraham, et de n'avoir point été tenté de le battre. Et dis-moi, si tu étais ce Cram que son père Clotaire roi franc fit brûler dans une grange, ou Don Carlos fils de ce renard Philippe II, ou bien ce pauvre Alexis fils de ce czar Pierre moitié héros et moitié tigre?
Ah! Monsieur, ne me parlez plus de ces horreurs: vous me feriez détester la nature humaine.
PÉTRONE. [p. 230]↩
Tout ce qu'on a débité sur Néron m'a fait examiner de plus près la satire attribuée au consul Caius Petronius, que Néron avait sacrifié à la jalousie de Tigillin. Les nouveaux compilateurs de l'histoire romaine n'ont pas manqué de prendre les fragments d'un jeune écolier, nommé Titus Petronius, pour ceux de ce consul, qui, dit-on, envoya à Néron avant de mourir cette peinture de sa cour sous des noms empruntés.
Si on retrouvait en effet un portrait fidèle des débauches de Néron dans le Pétrone qui nous reste, ce livre serait un des morceaux les plus curieux de l'antiquité.
Naudot a rempli les lacunes de ces fragments, et a cru tromper le public. Il veut le tromper encore en assurant que la satire de Titus Petronius jeune et obscur libertin, d'un esprit très peu réglé, est le Caius Petronius consul de Rome. Il veut qu'on voie toute la vie de Néron dans des aventures des plus bas coquins de l'Italie, gens qui sortent de l'école pour courir du cabaret au bordel, qui volent des manteaux, et qui sont trop heureux d'aller dîner chez un vieux sous-fermier marchand de vin, enrichi par des usures, qu'on nomme Trimalcion.
Les commentateurs ne doutent pas que ce vieux financier absurde et impertinent ne soit le jeune empereur Néron, qui après tout avait de l'esprit et des talents. Mais en vérité, comment reconnaître cet empereur dans un sot qui fait continuellement les plus insipides jeux de mots avec son cuisinier; qui se lève de table pour aller à la garde-robe; qui revient à table pour dire qu'il est tourmenté de vents; qui conseille à la compagnie de ne point se retenir; qui assure que plusieurs personnes sont mortes pour n'avoir pas su se donner à propos la liberté du derrière; et qui confie à ses convives que sa grosse femme Fortunata fait si bien son devoir là-dessus, qu'elle l'empêche de dormir la nuit.
Cette maussade et dégoûtante Fortunata est, dit-on, la jeune et belle Acté maîtresse de l'empereur. Il faut être bien impitoyablement commentateur pour trouver de pareilles ressemblances. Les convives sont, dit-on, les favoris de Néron. Voici quelle est la conversation de ces hommes de cour.
L'un d'eux dit à l'autre: ‘De quoi ris-tu, visage de brebis? fais-tu meilleure chère chez toi? Si j'étais plus près de ce causeur, je lui aurais déjà donné un soufflet. Si je pissais seulement sur lui, il ne saurait où se cacher. Il rit: de quoi rit-il? -- Je suis un homme libre comme les autres; j'ai vingt bouches à nourrir par jour, sans compter mes chiens; et j'espère mourir de façon à ne rougir de rien quand je serai mort. Tu n'es qu'un morveux; tu ne sais dire ni a ni b : tu ressembles à un pot de terre, à un cuir mouillé qui n'en est pas meilleur pour être plus souple. Es-tu plus riche que moi? dîne deux fois.'
Tout ce qui se dit dans ce fameux repas de Trimalcion est à peu près dans ce goût. Les plus bas gredins tiennent parmi nous des discours plus honnêtes dans leurs tavernes. C'est là pourtant ce qu'on a pris pour la galanterie de la cour des césars. Il n'y a point d'exemple d'un préjugé si grossier. Il vaudrait autant dire que le Portier des Chartreux est un portrait délicat de la cour de Louis XIV.
Il y a des vers très heureux dans cette satire, et quelques contes très bien faits, surtout celui de la matrone d'Ephèse. La satire de Pétrone est un mélange de bon et de mauvais, de moralités et d'ordures; elle annonce la décadence du siècle qui suivit celui d'Auguste. On voit un jeune homme échappé des écoles pour fréquenter le barreau, et qui veut donner des règles et des exemples d'éloquence et de poésie.
Il propose pour modèle le commencement d'un poème ampoulé de sa façon. Voici quelques-uns de ses vers:
Crassum Parthus habet: Lybico jacet aequore Magnus .
Julius ingratam perfudit sanguine Romam ;
Et quasi non posset tot tellus ferre sepulchra ,
Divisit cineres .
‘Crassus a péri chez les Parthes; Pompée sur les rivages de Lybie; le sang de César a coulé dans Rome; et comme si la terre n'avait pas pu porter tant de tombeaux, elle a divisé leurs cendres.'
Peut-on voir une pensée plus fausse et plus extravagante? Quoi! la même terre ne pouvait porter trois sépulcres ou trois urnes? et c'est pour cela que Crassus, Pompée et César sont morts dans des lieux différents. Est-ce ainsi que s'exprimait Virgile?
On admire, on cite ces vers libertins:
Qualis nox fuit illa, dii deaeque!
Quàm mollis thorus! Haesimus calentes,
Et transfudimus hìnc et hìnc labellie
Errantes animas. Valete curae.
Mortalies ego sic perire coepi.
Les quatre premiers vers sont heureux; et surtout par le sujet; car les vers sur l'amour et sur le vin plaisent toujours quand ils ne sont pas absolument mauvais. En voici une traduction libre. Je ne sais si elle est du président Bouhier:
Quelle nuit! ô transports, ô voluptés touchantes!
Nos corps entrelacés et nos âmes errantes
Se confondaient ensemble et mouraient de plaisir.
C'est ainsi qu'un mortel commença de périr.
Le dernier vers traduit mot à mot est plat, incohérent, ridicule; il ternit toutes les grâces des précédents; il présente l'idée funeste d'une mort véritable. Pétrone ne sait presque jamais s'arrêter. C'est le défaut d'un jeune homme dont le goût est encore égaré. C'est dommage que ces vers ne soient pas faits pour une femme; mais enfin il est évident qu'ils ne sont pas une satire de Néron. Ce sont les vers d'un jeune homme dissolu qui célèbre ses plaisirs infâmes.
De tous les morceaux de poésie répandus en foule dans cet ouvrage, il n'y en a pas un seul qui puisse avoir le plus léger rapport avec la cour de Néron. Ce sont tantôt des conseils pour former les jeunes avocats à l'éloquence de ce que nous appelons le barreau ; tantôt des déclamations sur l'indigence des gens de lettres, des éloges de l'argent comptant, des regrets de n'en point avoir, des invocations à Priape, des images ou ampoulées ou lascives; et tout le livre est un amas confus d'érudition et de débauche, tel que ceux que les anciens Romains appelaient Satura . Enfin, c'est le comble de l'absurdité d'avoir pris de siècle en siècle cette satire pour l'histoire secrète de Néron. Mais dès qu'un préjugé est établi, que de temps il faut pour le détruire!
PHILOSOPHIE. [p. 234]↩
SECTION PREMIÈRE.
Ecrivez filosofie , ou philosophie , comme il vous plaira; mais convenez que dès qu'elle paraît, elle est persécutée. Les chiens à qui vous présentez un aliment pour lequel ils n'ont pas de goût, vous mordent.
Vous direz que je répète; mais il faut remettre cent fois devant les yeux du genre humain que la sacrée Congrégation condamna Galilée, et que les cuistres qui déclarèrent excommuniés tous les bons citoyens qui se soumettraient au grand Henri IV, furent les mêmes qui condamnèrent les seules vérités qu'on pouvait trouver dans les ouvrages de Descartes.
Tous les barbets de la fange théologique aboyant les uns contre les autres, aboyèrent tous contre de Thou, contre La Motte le Vayer, contre Bayle. Que de sottises ont été écrites par de petits écoliers welches contre le sage Locke!
Ces Welches disent que César, Cicéron, Sénèque, Pline, Marc-Aurèle, pouvaient être philosophes, mais que cela n'est pas permis chez les Welches. On leur répond que cela est très permis et très utile chez les Français; que rien n'a fait plus de bien aux Anglais, et qu'il est temps d'exterminer la barbarie.
Vous me répliquez qu'on n'en viendra pas à bout. Non, chez le peuple et chez les imbéciles; mais chez tous les honnêtes gens votre affaire est faite.
SECTION SECONDE.
Un des grands malheurs, comme un des grands ridicules du genre humain, c'est que dans tous les pays, qu'on appelle policés, excepté peut-être à la Chine, les prêtres se chargèrent de ce qui n'appartenait qu'aux philosophes. Ces prêtres se mêlèrent de régler l'année: c'était, disaient-ils, leur droit; car il était nécessaire que les peuples connussent leurs jours de fêtes. Ainsi les prêtres chaldéens, égyptiens, grecs, romains, se crurent mathématiciens et astronomes: mais quelle mathématique, et quelle astronomie! Ils étaient trop occupés de leurs sacrifices, de leurs oracles, de leurs divinations, de leurs augures, pour étudier sérieusement. Quiconque s'est fait un métier de la charlatanerie ne peut avoir l'esprit juste et éclairé. Ils furent astrologues et jamais astronomes. (Voyez Astrologie .)
Les prêtres grecs eux-mêmes ne firent d'abord l'année que trois cent soixante jours. Il fallut que des géomètres leur apprissent qu'ils s'étaient trompés de cinq jours et plus. Ils réformèrent donc leur année. D'autres géomètres leur montrèrent encore qu'ils s'étaient trompés de six heures. Iphitus les obligea de changer leur almanach grec. Ils ajoutèrent un jour de quatre ans en quatre ans à leur année fautive; et Iphitus célébra ce changement par l'institution des olympiades.
On fut enfin obligé de recourir au philosophe Méthon, qui, en combinant l'année de la lune avec celle du soleil, composa son cycle de dix-neuf années, au bout desquelles le soleil et la lune revenaient au même point, à une heure et demie près. Ce cycle fut gravé en or dans la place publique d'Athènes; et c'est ce fameux nombre d'or dont on se sert encore aujourd'hui avec les corrections nécessaires.
On sait assez quelle confusion ridicule les prêtres romains avaient introduite dans le comput de l'année. Leurs bévues avaient été si grandes que leurs fêtes de l'été arrivaient en hiver. César, l'universel César, fut obligé de faire venir d'Alexandrie le philosophe Sosigène pour réparer les énormes fautes des pontifes.
Lorsqu'il fut encore nécessaire de réformer le calendrier de Jules-César, sous le pontificat de Grégoire XIII, à qui s'adressa-t-on? fut-ce à quelque inquisiteur? Ce fut à un philosophe, à un médecin, nommé Lilio.
Que l'on donne le livre de la Connaissance des temps à faire au professeur Cogé, recteur de l'université, il ne saura pas seulement de quoi il est question. Il faudra bien en revenir à M. De la Lande de l'Académie des sciences, chargé de ce très pénible travail trop mal récompensé.
Le rhéteur Cogé a donc fait une étrange bévue, quand il a proposé pour les prix de l'université ce sujet si singulièrement énoncé: Non magis Deo quàm regibus infensa est ista quae vocatur hodiè philosophia. Cette, qu'on nomme aujourd'hui philosophie, n'est pas plus ennemie de Dieu que des rois . Il voulait dire moins ennemie. Il a pris magis pour minus . Et le pauvre homme devait savoir que nos académies ne sont ennemies du roi ni de Dieu. (Voyez le Discours de M. l'avocat Belléguier sur ce sujet; il est assez curieux.)
SECTION TROISIEME.
Si la philosophie a fait tant d'honneur à la France dans l'Encyclopédie, il faut avouer aussi que l'ignorance et l'envie, qui ont osé condamner cet ouvrage, auraient couvert la France d'opprobre, si douze ou quinze convulsionnaires, qui ameutèrent l'ancien parlement en 1759, pouvaient être regardés comme les organes de la France, eux qui n'étaient en effet que les ministres du fanatisme et de la sédition, eux qui ont forcé le roi à casser le corps qu'ils avaient séduit. Leurs manoeuvres ne furent pas si violentes que du temps de la Fronde, mais ne furent pas moins ridicules. Leur fanatique crédulité pour les convulsions et pour les misérables prestiges de St Médard était si forte, qu'ils obligèrent un magistrat, d'ailleurs sage et respectable, de dire en plein parlement que les miracles de l'Eglise catholique subsistaient toujours . On ne peut entendre par ces miracles que ceux des convulsions. Assurément il ne s'en fait pas d'autres, à moins qu'on ne croie aux petits enfants ressuscités par St Ovide. Le temps des miracles est passé: l'Eglise triomphante n'en a plus besoin. De bonne foi, y avait-il un seul de ces juges qui entendît un mot des articles d'astronomie, de dynamique, de géométrie, de métaphysique, de physique, de botanique, de médecine, d'anatomie, dont ce livre, devenu si nécessaire, est chargé à chaque tome. [15] Quelle foule d'imputations absurdes et de calomnies grossières n'accumula-t-on pas contre ce trésor de toutes les sciences! Il suffirait de les réimprimer à la suite de l'Encyclopédie pour éterniser leur honte. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu juger un ouvrage qu'on n'était pas même en état d'étudier. Les lâches! ils ont crié que la philosophie ruinait la catholicité. Quoi donc? sur vingt millions d'hommes s'en est-il trouvé un seul qui ait vexé le moindre habitué de paroisse? un seul a-t-il jamais manqué de respect dans les églises? un seul a-t-il proféré publiquement contre nos cérémonies une seule parole qui approchât de la virulence avec laquelle on s'exprimait alors contre l'autorité royale.
Répétons que jamais la philosophie n'a fait de mal à l'Etat, et que le fanatisme joint à l'esprit de corps lui en a fait beaucoup dans tous les temps.
SECTION QUATRIEME.
Discours de Me. Belléguier, ancien avocat, sur le texte proposé par l'université de la ville de Paris, pour le sujet des prix de l'année 1773.
Non magis Deo quàm regibus insensa est ista quae vocatur hodie philosophia .
Cette, qu'on nomme aujourd'hui philosophie, n'est pas plus ennemie de Dieu que des rois.
Je ne compose pas pour les prix de l'université. Je n'ai pas tant d'ambition; mais ce sujet me paraît si beau et si bien énoncé, que je ne puis résister à l'envie d'en faire mon thème.
Non sans doute, la philosophie n'est et ne peut être l'ennemie de Dieu, ni des rois, s'il est permis de mettre des hommes à côté de l'Etre éternel et suprême. La philosophie est expressément l'amour de la sagesse; et ce serait le comble de la folie d'être l'ennemi de Dieu qui nous donne l'existence, et des rois qui nous sont donnés par lui, pour rendre cette existence heureuse, ou du moins tolérable. Osons d'abord dire un petit mot de Dieu: nous parlerons ensuite des rois. Il y a l'infini entre ces deux objets.
DE DIEU.
Socrate fut le martyr de la Divinité, et Platon en fut l'apôtre. Zaleucus, Carondas, Pythagore, Solon et Locke, tous philosophes et législateurs, ont recommandé dans leurs lois l'amour de Dieu et du gouvernement sous lequel il nous a fait naître. Les beaux vers du véritable Orphée, que nous trouvons épars dans Clément d'Alexandrie, parlent de la grandeur de Dieu avec sublimité. Zoroastre l'annonçait à la Perse, et Confutzée à la Chine; quoi qu'en ait dit l'ignorance appuyée de la malignité. La philosophie fut dans tous les temps la mère de la religion pure et des lois sages.
S'il y eut tant d'athées chez les Grecs trop subtils, et chez les Romains leurs imitateurs, n'imputons qu'à des menteurs publics, avares, cruels et fourbes, aux prêtres de l'antiquité l'excès monstrueux où ces athées tombèrent. Les uns nièrent la Divinité; parce que les sacrificateurs la rendaient odieuse; et que les oracles la rendaient ridicule. Les autres, comme les épicuriens, indignés du rôle qu'on faisait jouer aux dieux dans le gouvernement du monde, prétendaient qu'ils ne daignaient pas se mêler des misérables occupations des hommes. Le char de la fortune allait si mal qu'il parut impossible que des êtres bienfaisants en tinssent les rênes. Epicure et ses disciples, d'ailleurs aimables et honnêtes gens, étaient de si mauvais physiciens, qu'ils avouaient sans difficulté qu'il y a un dieu dans le soleil et dans chaque planète; mais ils croyaient que ces dieux passaient tout leur temps à boire, à se réjouir et à ne rien faire. Ils en faisaient des chanoines d'Allemagne.
Les véritables philosophes ne pensaient pas ainsi. Les Antonins, si grands sur le trône du monde alors connu, Epictète dans les fers, reconnaissaient, adoraient un Dieu tout puissant et juste; ils tâchaient d'être justes comme lui.
Ils n'auraient pas prétendu, comme l'auteur du Système de la nature , que le jésuite Néedham avait créé des anguilles, et que Dieu n'avait pas pu créer l'homme. Néedham ne leur eût pas paru philosophe; et l'auteur du Système de la nature n'eût été regardé que comme un discoureur par l'empereur Marc-Antonin.
L'astronome, qui voit le cours des astres établi selon les lois de la plus profonde mathématique, doit adorer l'éternel géomètre. Le physicien, qui observe un grain de blé ou le corps d'un animal, doit reconnaître l'éternel artisan. L'homme moral, qui cherche un point d'appui à la vertu, doit admettre un Etre aussi juste que suprême. Ainsi Dieu est nécessaire au monde en tout sens, et l'on peut dire avec l'auteur de l'épître au griffonneur du plat livre des Trois Imposteurs :
SI DIEU N'EXISTAIT PAS,IL FAUDRAIT L'INVENTER .
Je conclus de là que ista quae vocatur hodiè philosophia , ce qu'on nomme aujourd'hui philosophie, est le plus digne soutien de la Divinité, si quelque chose peut en être digne sur la terre. Le ciel me préserve de faire des phrases pour énerver une vérité si importante.
DU GOUVERNEMENT.
Les philosophes, qui ont reconnu un Dieu, et les sophistes qui l'ont nié, ont tous, sans aucune exception, avoué cette autre vérité reconnue de tout le monde, qu'un citoyen doit être soumis aux lois de sa patrie; qu'il faut être bon républicain à Venise et en Hollande; bon sujet à Paris et à Madrid: sans quoi ce monde serait un coupe-gorge, comme il l'a été trop souvent, grâce à ceux qui n'étaient pas philosophes.
Lorsque l'ancien parlement de Paris, et l'université de Paris vinrent reconnaître à genoux l'Anglais Henri V pour roi de France; qui fut fidèle à son roi légitime?. . . Gerson: le philosophe Gerson, l'honneur éternel de l'université; cet homme qui osait s'opposer d'une main aux fureurs de quatre antipapes également coupables, et présenter l'autre pour relever, s'il le pouvait, le trône renversé de son maître. Il mourut à Lyon dans un exil qui le rendait encore plus vénérable aux sages; tandis que ses confrères les théologiens, arrachés à leur saint ministère par la rage des guerres civiles, faisaient leur cour aux Anglais, et n'en recevaient que des mépris, des outrages et des chaînes.
Hélas! était-il bien occupé des propriétés de la matière, de l'antiquité du monde et des lois de la gravitation, celui qui justifia, qui canonisa publiquement le meurtre abominable du duc d'Orléans frère de Charles VI le Bien-aimé. C'était un docteur en théologie: c'était Jean Petit, très dévot à la Vierge, pour laquelle il avait composé une prière dans le goût de l'oraison des trente jours. Etaient-ils platoniciens ou académiciens, ou stratoniciens ceux qui, sous le même règne, firent rejaillir sur le dauphin le sang de deux maréchaux de France, et qui massacrèrent dans les rues de Paris trois mille cinq cents gentilshommes? On les nommait les Maillotins, les Cabochiens. Ce n'est pas là une secte de philosophie.
Si lorsqu'on brûla vive dans Rouen l'héroïne champêtre qui sauva la France, il s'était trouvé dans la faculté de théologie un philosophe, il n'eût pas souffert que cette fille, à qui l'antiquité eût dressé des autels, fût brûlée vive dans un bûcher élevé sur une plate-forme de dix pieds de haut, afin que son corps jeté nu dans les flammes pût être contemplé du bas en haut par les dévots spectateurs. Cette exécrable barbarie fut ordonnée sur une requête de la sacrée faculté, par sentence de Cauchon évêque de Beauvais, de frère Martin, vicaire général de l'Inquisition, de neuf docteurs de Sorbonne, de trente-cinq autres docteurs en théologie. Ces barbares n'auraient pas abusé du sacrement de la confession pour condamner la guerrière vengeresse du trône au plus affreux des supplices. Ils n'auraient pas caché deux prêtres derrière le confessional pour entendre ses péchés, et pour en former contre elle une accusation: ils n'auraient pas, comme on l'a déjà dit, été sacrilèges pour être assassins.
Ce crime si horrible et si lâche ne fut point commis par les Anglais; il le fut uniquement par des théologiens de France payés par le duc de Bedfort. Deux de ces docteurs, à la vérité, furent condamnés depuis à périr par le même supplice, quand Charles VII fut victorieux. Mais, la plus belle expiation de la Sorbonne fut son repentir, et sa fidélité pour nos rois, quand les conjectures devinrent plus favorables.
Je passe à regret aux horreurs de la Ligue contre Henri III, et le grand Henri IV. Ces temps, depuis François second, furent abominables; mais il est doux de pouvoir dire que le philosophe Montagne, le philosophe Charon, le philosophe chancelier de l'Hôpital, le philosophe de Thou, le philosophe Ramus, ne trempèrent jamais dans les factions. Leur vertu demande grâce pour leur siècle.
La journée de la St Barthélemi, dont la mémoire durera autant que le monde, ne leur sera jamais imputée.
J'avouerai encore, si l'on veut, aux jésuites, éternels et déplorables ennemis du parlement et de l'université, que l'ancien parlement de Paris, qui n'était pas philosophe, commença un procès criminel contre Henri III son roi, et nomma, pour informer, les conseillers Courtin et Michon, qui n'étaient pas philosophes non plus.
Je ne dissimulerai point que le docteur Rose, le docteur Guincestre, le docteur Boucher, le docteur Aubri, le docteur Pelletier condamné depuis à la roue, furent les trompettes du meurtre et du carnage. On a souvent dit que le docteur Bourgoin fit descendre une statue de la Ste Vierge, pour encourager frère Jacques Clément au parricide; je l'accorde en gémissant. On me répète que soixante et dix docteurs de Sorbonne déclarèrent, au nom du Saint-Esprit, tous les sujets déliés de leur serment de fidélité; j'en conviens avec horreur.
On me crie que dans le temps où Henri IV préparait son abjuration, et lorsque les citoyens présentèrent requête pour faire quelque accommodement avec ce grand homme, ce bon roi, ce conquérant et ce père de la France, toute la faculté de théologie assemblée condamna la requête comme inepte, séditieuse, impie, absurde, inutile, attendu qu'on connaît l'obstination de Henri le relaps . La faculté déclare expressément tous ceux qui parlent d'engager le roi à professer la religion catholique, parjures, séditieux, perturbateurs du royaume, hérétiques, fauteurs d'hérétiques, suspects d'hérésie, sentant l'hérésie; et qu'ils doivent être chassés de la ville, de peur que ces bêtes pestiférées n'infectent tout le troupeau .
Ce décret du 1 er novembre 1592 est tout au long dans le journal de Henri IV, page 260. Le respectable de Thou rapporte des décrets encore plus horribles et qui font dresser les cheveux.
Bénissons les philosophes qui ont appris aux hommes qu'il faut prodiguer ses biens et sa vie pour son roi, fût-il de la religion de Mahomet, de Confucius, de Brama, ou de Zoroastre.
Mais je répondrai toujours que la Sorbonne s'est repentie de ces écarts, et qu'on ne doit les imputer qu'au malheur des temps. Une compagnie peut s'égarer; elle est composée d'hommes: mais aussi ces hommes réparent leurs fautes. La raison, la saine doctrine, la modestie, la défiance de soi-même reviennent se mettre à la place de l'ignorance, de l'orgueil, de la démence et de la fureur. On n'ose plus condamner personne après avoir été si condamnable. On devient meilleur pour avoir été méchant. On est l'édification d'une patrie dont on fut l'horreur et le scandale.
Les jésuites ont fatigué la France du récit de tant de crimes. Mais l'université de son côté a reproché aux frères jésuites d'avoir mis le couteau à la main de Jean Châtel, d'avoir forcé le grand Henri IV à dire au duc de Sulli qu'il aimait mieux les rappeler et s'en faire des amis que de craindre continuellement le poignard et le poison. Elle les a peints dans tous ses procès contre eux comme des soldats en robe d'une puissance dangereuse, comme des espions de toutes les cours, des ennemis de tous les rois, des traîtres à toutes les patries.
Combien de fois le docteur Arnaud, le docteur Boileau, le docteur Petit-pied, et tant d'autres docteurs, n'ont-ils pas reproché à ces ci-devant jésuites, la banqueroute de Seville, qui précéda d'un siècle la banqueroute de frère La Valette; leurs calomnies contre le bienheureux Don Juan de Palafox; et après huit volumes entiers de pareils reproches, ne leur ont-ils pas remis sous les yeux la conspiration des poudres, et trois jésuites écartelés pour ce crime inconcevable? Les jésuites en ont-ils été moins fiers? non; tout écrasés qu'ils sont, il leur reste trois doigts dont ils se servent pour imprimer dans Avignon que les docteurs de Sorbonne sont des ignorants insolents, et pour répéter en plagiaires ce que M. Des Landes de l'Académie des sciences a mis en note dans son troisième tome page 299. Que la Sorbonne est aujourd'hui le corps le plus méprisable du royaume .
Ces outrages, ces injures réciproques n'ont rien de philosophique. Je dirai plus; elles n'ont rien de chrétien.
J'observerai avec la satisfaction d'un bon sujet que dans les troubles de la Fronde, non moins affreux peut-être que la conspiration des poudres, mais infiniment plus ridicules, ce ne fut ni Descartes, ni Gassendi, ni Pascal, ni Fermat, ni Roberval, ni Méziriac, ni Rohaut, ni Chapelle, ni Bernier, ni St Evremont, ni aucun autre philosophe, qui mit à prix la tête du cardinal premier ministre. Nul d'eux ne vola l'argent du roi pour payer cette tête; nul ne força Louis XIV et sa mère de s'enfuir du Louvre et d'aller coucher sur la paille à St Germain; nul ne fit la guerre à son roi, et ne leva contre lui le régiment des Portes-cochères, et le régiment de Corinthe, etc. etc.
Je conviendrai avec le jésuite auteur du petit livre Tout se dira : ‘Que ces petites fautes commises à bonne intention, l'étaient par maître Quatre hommes , maître Quatre sous , maître Bitaud, maître Pitaut, maîtres Boissau, Gratau, Martinau, Boux, Crépin, Cullet, etc. . . etc. . .' tous tuteurs des rois et qui avaient acheté la tutelle. Ils n'étaient pas philosophes. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le jésuite auteur de Tout se dira et de l' Appel à la raison . Je ne sais s'il est plus philosophe que MM. Cullet et Crépin. Ce que je sais certainement avec l'Europe, c'est que tant que Gondi-Rets fut archevêque de Paris, il fut vain, insolent, débauché, factieux, criminel de lèse-majesté. Quand il devint philosophe, il fut bon sujet, bon citoyen; il fut juste.
Je répondrai surtout aux détracteurs de l'ancien parlement de Paris, comme à ceux de l'université; je dirai, il se repentit, il fut fidèle à Louis XIV.
On a prétendu que Malagrida et l'assassin du roi de Pologne, et ceux de deux autres grands princes avaient une teinture de philosophie. Mais, à l'examen, cette accusation a été reconnue fausse.
Enfin si nous remontons du temps présent aux temps antérieurs dans les autres pays de l'Europe, nous trouverons que la philosophie ne fut soupçonnée par personne de l'assassinat de Farnèse duc de Parme, bâtard du pape Paul III; de l'assassinat de Galeas Sforze dans une église; de l'assassinat des Médicis dans une autre église pendant l'élévation de l'eucharistie, afin que le peuple prosterné ne vît pas le crime, et que Dieu seul en fût témoin.
La philosophie ne fut point complice des assassinats et des empoisonnements nombreux, commis par le pape Alexandre VI, et par son bâtard César Borgia. Allez jusqu'au pape Sergius III; je vous défie de trouver aucun philosophe coupable du moindre trouble, pendant tant de siècles où l'Italie fut troublée sans cesse.
On a vendu dans les Etats d'Italie, appartenant au roi d'Espagne, cette fameuse bulle de la cruzade, qui, moyennant deux réaux de plate sauve une âme du feu éternel de l'enfer, et permet à son corps de manger de la viande le samedi. On trafiquait de cette autre bulle de la componende qui permet aux voleurs de garder une partie de ce qu'ils ont volé, pourvu qu'ils en mettent une partie en oeuvres pies; mais cette bulle vaut dix ducats. On achetait des dispenses de tout à tout prix. Les Phrinès et les Gitons triomphaient depuis Milan jusqu'à Tarente. Les bénéfices institués pour nourrir les pauvres, se vendaient publiquement pour nourrir le luxe; et les bénéficiers employaient le stilet et la cantarella contre les bénéficiers qui leur dérobaient leurs Gitons et leurs Phrinès. Rien n'égalait les débauches, les perfidies, les sacrilèges de certains moines. Cependant Galilée, le restaurateur de la raison, démontrait tranquillement le mouvement de la terre et des autres planètes dans leurs orbites elliptiques, autour du soleil immobile dans sa place au centre du monde et tournant sur lui-même.
Oh l'homme dangereux! Oh l'ennemi de tous les rois et du grand-duc de Toscane et de la sainte Eglise! s'écrièrent les universités. Le monstre! Il ose prouver que c'est la terre qui tourne, tandis que le savant Josué assure formellement que le soleil s'arrêta sur Gabaon, et la lune sur Aialon en plein midi!
Galilée ne fut pas brûlé. Le grand-duc le protégeait. Le saint-office se contenta de le déclarer absurde et hérétique, sentant l'hérésie: il ne fut condamné qu'à garder la prison, à jeûner au pain et à l'eau, et à réciter le rosaire. Il récita sans doute son rosaire, ce grand Galilée! Iste qui vocabatur philosophus .
Tournez les yeux vers cette île fameuse, longtemps plus sauvage que nous-mêmes, habitée comme notre malheureux pays par l'ignorance et le fanatisme, couverte comme la France du sang de ses citoyens; demandez-lui quel prodige l'a changée, pourquoi elle n'a plus de Fairfax, de Cromwell et d'Ireton? Comment à ces guerres aussi abominables que religieuses, qui firent tomber la tête d'un roi sur un échafaud, a succédé une paix intérieure qui n'est troublée que par des querelles au sujet de l'élection de milord Maire, ou du bilan de la compagnie des Indes, ou du numéro 45. L'Angleterre vous répondra, Grâces en soient rendues à Locke, à Newton, à Shaftsburi, à Collins, à Trenchard, à Gordon, à une foule de sages qui ont changé l'esprit de la nation, et qui l'ont détourné des disputes absurdes et fatales de l'école pour le diriger vers les sciences solides.
Cromwell à la tête de son régiment des frères rouges, portait la Bible à l'arçon de sa selle; et leur montrait les passages où il est dit: Heureux ceux qui éventreront les femmes grosses, et qui écraseront les enfants sur la pierre ! Locke et ses pareils ne voulaient point qu'on traitât ainsi les femmes et les enfants. Ils ont adouci les moeurs des peuples sans énerver leur courage.
La philosophie est simple, elle est tranquille, sans envie, sans ambition; elle médite en paix loin du luxe, du tumulte et des intrigues du monde; elle est indulgente; elle est compatissante. Sa main pure porte le flambeau qui doit éclairer les hommes; elle ne s'en est jamais servie pour allumer l'incendie en aucun lieu de la terre. Sa voix est faible, mais elle se fait entendre; elle dit, elle répète: Adorez Dieu, servez les rois; aimez les hommes . Les hommes la calomnient; elle se console en disant: Ils me rendront justice un jour. Elle se console même souvent sans espérer de justice.
Ainsi la partie de l'université de Paris, consacrée aux beaux-arts, à l'éloquence et à la vérité, ne pouvait choisir un sujet plus digne d'elle que ces belles paroles: Non magis Deo quam regibus infensa est ista quae vocatur hodiè philosophia .
O toi, qui seras toujours compté parmi les rois les plus illustres; toi qui vois naître le long siècle des héros et des beaux-arts, et qui les conduisis tous dans les divers sentiers de la gloire; toi, que la nature avait fait pour régner, Louis XIV, petit-fils de Henri IV, plût au ciel que ta belle âme eût été assez éclairée par la philosophie pour ne point détruire l'ouvrage de ton grand-père? Tu n'aurais point vu la huitième partie de ton peuple abandonner ton royaume, porter chez tes ennemis les manufactures, les arts et l'industrie de la France. Tu n'aurais point vu des Français combattre sous les étendards de Guillaume III contre des Français, et leur disputer longtemps la victoire. Tu n'aurais point vu un prince catholique armer contre toi deux régiments de Français protestants. Tu aurais sagement prévenu le fanatisme barbare des Cévennes, et le châtiment non moins barbare que le crime. Tu le pouvais; tout t'était soumis; les deux religions t'aimaient, te révéraient également. Tu avais devant les yeux l'exemple de tant de nations chez qui les cultes différents n'altèrent point la paix qui doit régner parmi les hommes, unis par la nature. Rien ne t'était plus aisé que de soutenir et de contenir tous tes sujets. Jaloux du nom de Grand, tu ne connus pas ta grandeur. Il eût mieux valu avoir six régiments de plus de Français protestants, que de ménager encore Odescalki, Innocent XI, qui prit si hautement contre toi le parti du prince d'Orange huguenot. Il eût mieux valu te priver des jésuites, qui ne travaillaient qu'à établir la grâce suffisante, le congruisme et les lettres de cachet, que te priver de plus de quinze cent mille bras qui enrichissaient ton beau royaume, et qui combattaient pour sa défense.
Ah Louis XIV, Louis XIV que n'étais-tu philosophe! Ton siècle a été grand; mais tous les siècles lui reprocheront tant de citoyens expatriés, et Arnaud sans sépulture.
Et toi que nous voyons avec une tendresse respectueuse assis sur le trône de Henri IV et de Louis XIV, dont le sang coule dans tes veines, vainqueur à Fontenoi, à Rocou, à Fribourg, et pacificateur dans Versailles, écoute toujours la voix de la philosophie, c'est-à-dire de ta sagesse.
C'est par elle que tu as assoupi pour jamais ces disputes du jansénisme et du molinisme qui nous rendaient à la fois malheureux et ridicules. C'est elle qui t'inspira quand tu donnas la paix aux vivants et aux mourants, en nous délivrant de l'impertinence des billets pour l'autre monde, et du scandale des sacrements conférés la baïonnette au bout du fusil. Tu es un vrai philosophe, lorsque tu fermes l'oreille à la calomnie, aux bruits mensongers qui éclatent avec tant d'impudence, ou qui se glissent avec tant d'artifice. L'empereur Marc-Aurèle, dit que les hommes ne seront heureux que quand les rois seront philosophes. Pense, agis toujours comme Marc-Aurèle, et que ta vie soit plus longue que celle de ce monarque le modèle des hommes.
ST. PIERRE. [p. 247]↩
Pourquoi les successeurs de St Pierre ont-ils eu tant de pouvoir en Occident, et aucun en Orient? C'est demander pourquoi les évêques de Vurtzbourg et de Saltzbourg se sont attribués les droits régaliens dans des temps d'anarchie, tandis que les évêques grecs sont toujours restés sujets. Le temps, l'occasion, l'ambition des uns, et la faiblesse des autres, ont fait et feront tout dans ce monde. Nous faisons toujours abstraction de ce qui est divin.
A cette anarchie l'opinion s'est jointe; et l'opinion est la reine des hommes. Ce n'est pas qu'en effet ils aient une opinion bien déterminée, mais des mots leur en tiennent lieu.
Il est rapporté dans l'Evangile que Jésus dit à Pierre: ‘Je te donnerai les clefs du royaume des cieux.' Les partisans outrés de l'évêque de Rome soutinrent vers le onzième siècle, que qui donne le plus, donne le moins; que les cieux entouraient la terre; et que Pierre ayant les clefs du contenant, il avait aussi les clefs du contenu. Si on entend par les cieux toutes les étoiles et toutes les planètes, il est évident, selon Tomasius, que les clefs données à Simon Barjone surnommé Pierre, étaient un passe-partout. Si on entend par les cieux les nuées, l'atmosphère, l'éther, l'espace dans lequel roulent les planètes, il n'y a guère de serruriers, selon Mursius, qui puissent faire une clef pour ces portes-là. Mais les railleries ne sont pas des raisons.
Les clefs en Palestine étaient une cheville de bois qu'on liait avec une courroie; Jésus dit à Barjone, ‘Ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans le ciel.' Les théologiens du pape en ont conclu, que les papes avaient reçu le droit de lier et de délier les peuples du serment de fidélité fait à leurs rois, et de disposer à leur gré de tous les royaumes. C'est conclure magnifiquement. Les communes dans les états généraux de France en 1302, disent dans leur requête au roi, que ‘Boniface VIII était un B***** qui croyait que Dieu liait et emprisonnait au ciel, ce que Boniface liait sur terre'. Un fameux luthérien d'Allemagne, (c'était Mélancton) ne peut souffrir que Jésus eût dit à Simon Barjone, Cepha ou Cephas, ‘Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, mon église.' Il ne pouvait concevoir que Dieu eût employé un pareil jeu de mots, une pointe si extraordinaire, et que la puissance du pape fût fondée sur un quolibet. Cette pensée n'est permise qu'à un protestant.
Pierre a passé pour avoir été évêque de Rome; mais on sait assez qu'en ce temps-là, et longtemps après, il n'y eut aucun évêché particulier. La société chrétienne ne prit une forme que vers le milieu du second siècle.
Il y avait un saint homme à qui on avait fait payer bien chèrement un bénéfice à Rome, ce qui s'appelle une simonie; on lui demandait, s'il croyait que Simon Pierre eût été au pays? il répondit, Je ne vois pas que Pierre y ait été, mais je suis sûr de Simon.
Quant à la personne de St Pierre, il faut avouer que Paul n'est pas le seul qui ait été scandalisé de sa conduite; on lui a souvent résisté en face, à lui et à ses successeurs. St Paul lui reprochait aigrement de manger des viandes défendues, c'est-à-dire, du porc, du boudin, du lièvre, des anguilles, de l'ixion, et du griffon; Pierre se défendait en disant, qu'il avait vu le ciel ouvert vers la sixième heure, et une grande nappe qui descendait des quatre coins du ciel, laquelle était toute remplie d'anguilles, de quadrupèdes et d'oiseaux; et que la voix d'un ange avait crié: ‘Tuez et mangez.' C'est apparemment cette même voix qui a crié à tant de pontifes, ‘Tuez tout, et mangez la substance du peuple', dit Volston; mais ce reproche est beaucoup trop fort.
Casaubon ne peut approuver la manière dont Pierre traita Anania et Saphira sa femme. De quel droit, dit Casaubon, un Juif esclave des Romains ordonnait-il, ou souffrait-il que tous ceux qui croiraient en Jésus vendissent leurs héritages et en apportassent le prix à ses pieds? Si quelque anabaptiste à Londres faisait apporter à ses pieds tout l'argent de ses frères, ne serait-il pas arrêté comme un séducteur séditieux, comme un larron qu'on ne manquerait pas d'envoyer à Tyburn? N'est-il pas horrible de faire mourir Anania, parce qu'ayant vendu son fonds et en ayant donné l'argent à Pierre, il avait retenu pour lui et pour sa femme quelques écus pour subvenir à leurs nécessités sans le dire? A peine Anania est-il mort, que sa femme arrive. Pierre au lieu de l'avertir charitablement qu'il vient de faire mourir son mari d'apoplexie, pour avoir gardé quelques oboles, et de lui dire de bien prendre garde à elle, la fait tomber dans le piège. Il lui demande si son mari a donné tout son argent aux saints. La bonne femme répond, oui, et elle meurt sur-le-champ. Cela est dur.
Corringius demande, pourquoi Pierre qui tuait ainsi ceux qui lui avaient fait l'aumône, n'allait pas tuer plutôt tous les docteurs qui avaient fait mourir Jésus-Christ, et qui le firent fouetter lui-même plus d'une fois? O Pierre! dit Corringius, vous faites mourir deux chrétiens qui vous ont fait l'aumône, et vous laissez vivre ceux qui ont crucifié votre Dieu!
Nous avons eu du temps de Henri IV et de Louis XIII, un avocat général du parlement de Provence, homme de qualité, nommé d'Oraison de Torame, qui dans un livre de l'Eglise militante dédié à Henri IV, a fait un chapitre entier des arrêts rendus par St Pierre en matière criminelle. Il dit que l'arrêt prononcé par Pierre contre Anania et Saphira fut exécuté par Dieu même, aux termes et cas de la juridiction spirituelle . Tout son livre est dans ce goût. Corringius, comme on voit, ne pense pas comme notre avocat provençal. Apparemment que Corringius n'était pas en pays d'Inquisition, quand il faisait ses questions hardies.
Erasme, à propos de Pierre, remarquait une chose fort singulière; c'est que le chef de la religion chrétienne commença son apostolat par renier Jésus-Christ; et que le premier pontife des Juifs avait commencé son ministère par faire un veau d'or, et par l'adorer.
Quoi qu'il en soit, Pierre nous est dépeint comme un pauvre qui catéchisait des pauvres. Il ressemble à ces fondateurs d'ordres, qui vivaient dans l'indigence, et dont les successeurs sont devenus grands seigneurs.
Le pape successeur de Pierre a tantôt gagné, tantôt perdu; mais il lui reste encore environ cinquante millions d'hommes sur la terre, soumis en plusieurs points à ses lois, outre ses sujets immédiats.
Se donner un maître à trois ou quatre cents lieues de chez soi; attendre pour penser que cet homme ait paru penser; n'oser juger en dernier ressort un procès entre quelques-uns de ses concitoyens, que par des commissaires nommés par cet étranger; n'oser se mettre en possession des champs et des vignes qu'on a obtenus de son propre roi, sans payer une somme considérable à ce maître étranger; violer les lois de son pays qui défendent d'épouser sa nièce, et l'épouser légitimement en donnant à ce maître étranger une somme encore plus considérable; n'oser cultiver son champ le jour que cet étranger veut qu'on célèbre la mémoire d'un inconnu qu'il a mis dans le ciel de son autorité privée; c'est là en partie ce que c'est que d'admettre un pape; ce sont là les libertés de l'Eglise gallicane, si nous en croyons Dumarsais.
Il y a quelques autres peuples qui portent plus loin leur soumission. Nous avons vu de nos jours un souverain demander au pape la permission de faire juger par son tribunal royal des moines accusés de parricide, ne pouvoir obtenir cette permission, et n'oser les juger!
On sait assez qu'autrefois les droits des papes allaient plus loin; ils étaient fort au-dessus des dieux de l'antiquité; car ces dieux passaient seulement pour disposer des empires, et les papes en disposaient en effet.
Sturbinus dit qu'on peut pardonner à ceux qui doutent de la divinité et de l'infaillibilité du pape, quand on fait réflexion.
Que quarante schismes ont profané la chaire de St Pierre, et que vingt-sept l'ont ensanglantée;
Qu'Etienne VII, fils d'un prêtre, déterra le corps de Formose son prédécesseur, et fit trancher la tête à ce cadavre;
Que Sergius III convaincu d'assassinats, eut un fils de Marozie, lequel hérita de la papauté;
Que Jean X, amant de Théodora, fut étranglé dans son lit;
Que Jean XI, fils de Sergius III, ne fut connu que par sa crapule;
Que Jean XII fut assassiné chez sa maîtresse;
Que Benoît IX acheta et revendit le pontificat;
Que Grégoire VII fut l'auteur de cinq cents ans de guerres civiles soutenues par ses successeurs;
Qu'enfin parmi tant de papes, ambitieux, sanguinaires et débauchés, il y a eu un Alexandre VI, dont le nom n'est prononcé qu'avec la même horreur que ceux des Néron et des Caligula.
C'est une preuve, dit-on, de la divinité de leur caractère, qu'elle ait subsisté avec tant de crimes; mais si les califes avaient eu une conduite encore plus affreuse, ils auraient donc été encore plus divins. C'est ainsi que raisonne Dermius; on lui a répondu. Mais la meilleure réponse est dans la puissance mitigée que les évêques de Rome exercent aujourd'hui avec sagesse; dans la longue possession où les empereurs les laissent jouir, parce qu'ils ne peuvent les en dépouiller; dans le système d'un équilibre général qui est l'esprit de toutes les cours.
On a prétendu depuis peu qu'il n'y avait que deux peuples qui pussent envahir l'Italie et écraser Rome. Ce sont les Turcs et les Russes; mais ils sont nécessairement ennemis, et de plus ...
Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin.
PLAGIAT. [p. 251]↩
On dit qu'originairement ce mot vient du latin plaga , et qu'il signifiait la condamnation au fouet de ceux qui avaient vendu des hommes libres pour des esclaves. Cela n'a rien de commun avec le plagiat des auteurs, lesquels ne vendent point d'hommes, soit esclaves, soit libres. Ils se vendent seulement eux-mêmes quelquefois pour un peu d'argent.
Quand un auteur vend les pensées d'un autre pour les siennes, ce larcin s'appelle plagiat . On pourrait appeler plagiaires tous les compilateurs, tous les faiseurs de dictionnaires, qui ne font que répéter à tort et à travers, les opinions, les erreurs, les impostures, les vérités déjà imprimées dans les dictionnaires précédents; mais ce sont du moins des plagiaires de bonne foi; ils ne s'arrogent point le mérite de l'invention. Ils ne prétendent pas même à celui d'avoir déterré chez les anciens les matériaux qu'ils ont assemblés; ils n'ont fait que copier les laborieux compilateurs du seizième siècle. Ils vous vendent en in-quarto ce que vous aviez déjà en in-folio . Appelez-les, si vous voulez, libraires , et non pas auteurs. Rangez-les plutôt dans la classe des fripiers que dans celle des plagiaires.
Le véritable plagiat est de donner pour vôtres les ouvrages d'autrui; de coudre dans vos rhapsodies de longs passages d'un bon livre avec quelques petits changements. Mais le lecteur éclairé voyant ce morceau de drap d'or sur un habit de bure, reconnaît bientôt le voleur maladroit.
Ramzai qui après avoir été presbytérien dans son village d'Ecosse, ensuite anglican à Londres, puis quaker, et qui persuada enfin au célèbre Fénelon archevêque de Cambrai qu'il était catholique, et même qu'il avait beaucoup de penchant pour l'amour pur; Ramzai, dis-je, fit les Voyages de Cyrus parce que son maître avait fait voyager Télémaque. Il n'y a jusque-là que de l'imitation. Dans ces Voyages il copie les phrases, les raisonnements d'un ancien auteur anglais qui introduit un jeune solitaire disséquant sa chèvre morte, et remontant à Dieu par sa chèvre. Cela ressemble fort à un plagiat. Mais en conduisant Cyrus en Egypte, il se sert, pour décrire ce pays singulier, des mêmes expressions employées par Bossuet; il le copie mot pour mot sans le citer. Voilà un plagiat dans toutes les formes. Un de mes amis le lui reprochait un jour; Ramzai lui répondit qu'on pouvait se rencontrer, et qu'il n'était pas étonnant qu'il pensât comme Fénelon, et qu'il s'exprimât comme Bossuet. Cela s'appelle être fier comme un Ecossais .
Le plus singulier de tous les plagiats est peut-être celui du père Barre, auteur d'une grande histoire d'Allemagne en dix volumes. On venait d'imprimer l' Histoire de Charles XII , et il en prit plus de deux cents pages qu'il inséra dans son ouvrage. Il fait dire à un duc de Lorraine précisément ce que Charles XII a dit.
Il attribue à l'empereur Arnould ce qui est arrivé au monarque suédois.
Il dit de l'empereur Rodolphe ce qu'on avait dit du roi Stanislas.
Valdemar roi de Dannemarck, fait et dit précisément les mêmes choses que Charles à Bender, etc. etc. etc.
Le plaisant de l'affaire, est qu'un journaliste voyant cette prodigieuse ressemblance entre ces deux ouvrages, ne manqua pas d'imputer le plagiat à l'auteur de l' Histoire de Charles XII , qui avait pourtant écrit vingt ans avant le père Barre.
C'est surtout en poésie qu'on se permet souvent le plagiat, et c'est assurément de tous les larcins le moins dangereux pour la société.
POLIPES. [p. 253]↩
En qualité de douteur il y a longtemps que j'ai rempli ma vocation. J'ai douté quand on m'a voulu persuader que les glossopètres que j'ai vues se former dans ma campagne, étaient originairement des langues de chiens marins; que la chaux employée à ma grange n'était composée que de coquillages; que les coraux étaient le produit des excréments de certains petits poissons; que la mer par ses courants a formé le mont Cenis et le mont Taurus, et que Niobé fut autrefois changée en marbre.
Ce n'est pas que je n'aime l'extraordinaire, le merveilleux autant qu'aucun voyageur, et qu'aucun homme à système. Mais pour croire fermement, je veux voir par mes yeux, toucher par mes mains, et à plusieurs reprises. Ce n'est pas même assez; je veux encore être aidé par les yeux et par les mains des autres.
Deux de mes compagnons qui font comme moi des questions sur l'Encyclopédie, se sont longtemps amusés à considérer avec moi en tout sens plusieurs de ces petites tiges qui croissent dans des bourbiers à côté des lentilles d'eau. Ces herbes légères qu'on appelle polypes d'eau douce , ont plusieurs racines, et de là vient qu'on leur a donné le nom de polypes . Ces petites plantes parasites ne furent que des plantes jusqu'au commencement du siècle où nous sommes. Leuvenhoeck s'avisa de les faire monter au rang d'animal. Nous ne savons pas s'ils y ont beaucoup gagné.
Nous pensons que pour être réputé animal, il faut être doué de la sensation. Que l'on commence donc par nous faire voir que ces polypes d'eau douce ont du sentiment, afin que nous leur donnions parmi nous droit de bourgeoisie.
Nous n'avons pas osé accorder cette dignité à la sensitive, quoiqu'elle parût y avoir les plus grandes prétentions. Pourquoi la donnerions-nous à une espèce de petit jonc? est-ce parce qu'il revient de bouture? Mais cette propriété est commune à tous les arbres qui croissent au bord de l'eau, aux saules, aux peupliers, aux trembles, etc. C'est cela même qui démontre que le polype est un végétal. Il est si léger, qu'il change de place au moindre mouvement de la goutte d'eau qui le porte. De là on a conclu qu'il marchait. On pouvait supposer de même que les petites îles flottantes des marais de St Omer sont des animaux, car elles changent souvent de place.
On a dit, Ses racines sont ses pieds, sa tige est son corps, ses branches sont ses bras; le tuyau qui compose sa tige est percé en haut, c'est sa bouche. Il y a dans ce tuyau une légère moelle blanche, dont quelques animalcules presque imperceptibles sont très avides; ils entrent dans le creux de ce petit jonc en le faisant courber, et mangent cette pâte légère; c'est le polype qui prend ces animaux avec son museau et qui s'en nourrit, quoiqu'il n'y ait pas la moindre apparence de tête, de bouche, d'estomac.
Nous avons examiné ce jeu de la nature avec toute l'attention dont nous sommes capables. Il nous a paru que cette production appelée polype , ressemblait à un animal beaucoup moins qu'une carotte ou une asperge. En vain nous avons opposé à nos yeux tous les raisonnements que nous avions lus autrefois. Le témoignage de nos yeux l'a emporté.
Il est triste de perdre une illusion. Nous savons combien il serait doux d'avoir un animal qui se reproduirait de lui-même et par bouture, et qui ayant toutes les apparences d'une plante joindrait le règne animal au végétal.
Il serait bien plus naturel de donner le rang d'animal à la plante, nouvellement découverte dans l'Amérique anglaise, à laquelle on a donné le plaisant nom de Vénus gobe-mouche . C'est une espèce de sensitive épineuse dont les feuilles se replient. Les mouches sont prises dans ces feuilles et y périssent plus sûrement que dans une toile d'araignée. Si quelqu'un de nos physiciens veut appeler animal cette plante, il ne tient qu'à lui; il aura des partisans.
Mais, si vous voulez quelque chose de plus extraordinaire, quelque chose de plus digne de l'observation des philosophes, regardez le colimaçon qui marche un mois, deux mois entiers, après qu'on lui a coupé la tête; regardez la limace incoque à qui une tête revient. Cette vérité dont tous les enfants peuvent être témoins, vaut bien l'illusion des polypes d'eau douce. Que devient son sensorium, sa mémoire, son magasin d'idées, son âme quand on lui a coupé la tête? comment tout cela revient-il? une âme qui renaît est un phénomène bien curieux! non cela n'est pas plus étrange qu'une âme produite, une âme qui dort et qui se réveille, une âme détruite.
POLITIQUE. [p. 255]↩
La politique de l'homme consiste d'abord à tâcher d'égaler les animaux à qui la nature a donné la nourriture, le vêtement et le couvert.
Ces commencements sont longs et difficiles.
Comment se procurer le bien-être et se mettre à l'abri du mal? C'est là tout l'homme.
Ce mal est partout. Les quatre éléments conspirent à le former. La stérilité d'un quart du globe, les maladies, la multitude d'animaux ennemis, tout nous oblige de travailler sans cesse à écarter le mal.
Nul homme ne peut seul se garantir du mal, et se procurer le bien; il faut des secours. La société est donc aussi ancienne que le monde.
Cette société est tantôt trop nombreuse, tantôt trop rare. Les révolutions de ce globe ont détruit souvent des races entières d'hommes et d'autres animaux dans plusieurs pays, et les ont multipliées dans d'autres.
Pour multiplier une espèce, il faut un climat et un terrain tolérables; et avec ces avantages on peut encore être réduit à marcher tout nu, à souffrir la faim, à manquer de tout, à périr de misère.
Les hommes ne sont pas comme les castors, les abeilles, les vers à soie; ils n'ont pas un instinct sûr qui leur procure le nécessaire.
Sur cent mâles il s'en trouve à peine un qui ait du génie; sur cinq cents femelles à peine une.
Ce n'est qu'avec du génie qu'on invente les arts qui procurent à la longue un peu de ce bien-être, unique objet de toute politique.
Pour essayer ces arts il faut des secours, des mains qui vous aident, des entendements assez ouverts pour vous comprendre et assez dociles pour vous obéir. Avant de trouver et d'assembler tout cela, des milliers de siècles s'écoulent dans l'ignorance et dans la barbarie; des milliers de tentatives avortent. Enfin, un art est ébauché, et il faut encore des milliers de siècles pour le perfectionner.
POLITIQUE DU DÉHORS.
Quand la métallurgie est trouvée par une nation, il est indubitable qu'elle battra ses voisins, et en fera des esclaves.
Vous avez des flèches et des sabres, et vous êtes nés dans un climat qui vous a rendus robustes. Nous sommes faibles, nous n'avons que des massues et des pierres, vous nous tuez; et si vous nous laissez la vie c'est pour labourer vos champs, pour bâtir vos maisons; nous vous chantons quelques airs grossiers quand vous vous ennuyez, si nous avons de la voix, ou nous soufflons dans quelques tuyaux pour obtenir de vous des vêtements et du pain. Nos femmes et nos filles sont-elles jolies, vous les prenez pour vous. Monseigneur votre fils profite de cette politique établie; il ajoute de nouvelles découvertes à cet art naissant. Ses serviteurs coupent les testicules à mes enfants; il les honore de la garde de ses épouses et de ses maîtresses. Telle a été et telle est encore la politique, le grand art de faire servir les hommes à son bien-être dans la plus grande partie de l'Asie.
Quelques peuplades ayant ainsi asservi plusieurs autres peuplades, les victorieuses se battent avec le fer pour le partage des dépouilles. Chaque petite nation nourrit et soudoie des soldats. Pour encourager ces soldats et pour les contenir, chacune a ses dieux, ses oracles, ses prédictions; chacune nourrit et soudoie des devins et des sacrificateurs bouchers. Ces devins commencement par deviner en faveur des chefs de nation, ensuite ils devinent pour eux-mêmes et partagent le gouvernement. Le plus fort et le plus habile subjugue à la fin les autres après des siècles de carnage qui font frémir, et de friponneries qui font rire. C'est là le complément de la politique.
Pendant que ces scènes de brigandages et de fraudes se passent dans une partie du globe, d'autres peuplades retirées dans les cavernes des montagnes, ou dans des cantons entourés de marais inaccessibles, ou dans quelques petites contrées habitables au milieu des déserts de sable, ou des presqu'îles, ou des îles, se défendent contre les tyrans du continent. Tous les hommes enfin ayant à peu près les mêmes armes, le sang coule d'un bout du monde à l'autre.
On ne peut pas toujours tuer, on fait la paix avec son voisin, jusqu'à ce qu'on se croie assez fort pour recommencer la guerre. Ceux qui savent écrire rédigent ces traités de paix. Les chefs de chaque peuple, pour mieux tromper leurs ennemis, attestent les dieux qu'ils se sont faits; on invente les serments; l'un vous promet au nom de Sammonocodom, l'autre au nom de Jupiter, de vivre toujours avec vous en bonne harmonie, et à la première occasion ils vous égorgent au nom de Jupiter et de Sammonocodom.
Dans les temps les plus raffinés, le lion d'Esope fait un traité avec trois animaux ses voisins. Il s'agit de partager une proie en quatre parts égales. Le lion, pour de bonnes raisons qu'il déduira en temps et lieu, prend d'abord trois parts pour lui seul, et menace d'étrangler quiconque osera toucher à la quatrième. C'est là le sublime de la politique.
POLITIQUE DU DEDANS.
Il s'agit d'avoir dans votre pays le plus de pouvoir, le plus d'honneurs et le plus de plaisirs que vous pourrez. Pour y parvenir il faut beaucoup d'argent.
Cela est très difficile dans une démocratie; chaque citoyen est votre rival. Une démocratie ne peut subsister que dans un petit coin de terre. Vous aurez beau être riche par votre commerce secret, ou par celui de votre grand-père, votre fortune vous fera des jaloux et très peu de créatures. Si dans quelque démocratie une maison riche gouverne, ce ne sera pas pour longtemps.
Dans une aristocratie on peut plus aisément se procurer honneurs, plaisirs, pouvoir et argent; mais il y faut une grande discrétion. Si on abuse trop, les révolutions sont à craindre.
Ainsi dans la démocratie tous les citoyens sont égaux. Ce gouvernement est aujourd'hui rare et chétif, quoique naturel et sage.
Dans l'aristocratie l'inégalité, la supériorité se fait sentir; mais moins elle est arrogante, plus elle assure son bien-être.
Reste la monarchie; c'est là que tous les hommes sont faits pour un seul. Il accumule tous les honneurs dont il veut se décorer, goûte tous les plaisirs dont il veut jouir, exerce un pouvoir absolu; et tout cela, pourvu qu'il ait beaucoup d'argent. S'il en manque il sera malheureux au dedans comme au dehors; il perdra bientôt pouvoir, plaisirs, honneurs, et peut-être la vie.
Tant que cet homme a de l'argent non seulement il jouit, mais ses parents, ses principaux serviteurs jouissent aussi; et une foule de mercenaires travaille toute l'année pour eux dans la vaine espérance de goûter un jour dans leurs chaumières le repos que leur sultan et leurs bachas semblent goûter dans leurs sérails. Mais voici à peu près ce qui arrive.
Un gros et gras cultivateur possédait autrefois un vaste terrain de champs, prés, vignes, vergers, forêts. Cent manoeuvres cultivaient pour lui, il dînait avec sa famille, buvait et s'endormait. Ses principaux domestiques qui le volaient, dînaient après lui et mangeaient presque tout. Les manoeuvres venaient et faisaient très maigre chère. Ils murmurèrent, ils se plaignirent, ils perdirent patience; enfin, ils mangèrent le dîner du maître et le chassèrent de sa maison. Le maître dit que ces coquins-là étaient des enfants rebelles qui battaient leur père. Les manoeuvres dirent qu'ils avaient suivi la loi sacrée de la nature que l'autre avait violée. On s'en rapporta enfin à un devin du voisinage qui passait pour un homme inspiré. Ce saint homme prend la métairie pour lui, et fait mourir de faim les domestiques et l'ancien maître, jusqu'à ce qu'il soit chassé à son tour. C'est la politique du dedans.
C'est ce qu'on a vu plus d'une fois; et quelques effets de cette politique subsistent encore dans toute leur force. Il faut espérer que dans dix ou douze mille siècles, quand les hommes seront plus éclairés, les grands possesseurs des terres devenus plus politiques, traiteront mieux leurs manoeuvres, et ne se laisseront pas subjuguer par des devins et des sorciers.
POPULATION. [p. 259]↩
SECTION PREMIÈRE.
Il n'y eut que fort peu de chenilles dans mon canton l'année passée. Nous les tuâmes presque toutes. Dieu nous en a donné plus que de feuilles cette année.
N'en est-il pas ainsi à peu près des autres animaux, et surtout de l'espèce humaine? La famine, la peste et la guerre, les deux soeurs venues de l'Arabie et de l'Amérique, détruisent les hommes dans un canton. On est tout étonné de le trouver peuplé cent ans après.
J'avoue que c'est un devoir sacré de peupler ce monde, et que tous les animaux sont forcés par le plaisir à remplir cette vue du grand Demiourgos.
Pourquoi ces peuplades sur la terre? et à quoi bon former tant d'êtres destinés à se dévorer tous, et l'animal homme, qui semble né pour égorger son semblable d'un bout de la terre à l'autre? On m'assure que je saurai un jour ce secret; je le souhaite en qualité de curieux.
Il est clair que nous devons peupler tant que nous pouvons. Car que ferions-nous de notre matière séminale? ou sa surabondance nous rendrait malades; ou son émission nous rendrait coupables. Et l'alternative est triste.
Les sages Arabes, voleurs du désert, dans les traités qu'ils font avec tous les voyageurs, stipulent toujours qu'on leur donnera des filles. Quand ils conquirent l'Espagne, ils imposèrent un tribut de filles. Le pays de Médée paie les Turcs en filles. Les flibustiers firent venir des filles de Paris dans la petite île dont ils s'étaient emparés. Et on conte que Romulus, dans un beau spectacle qu'il donna aux Sabins, leur vola trois cents filles.
Je ne conçois pas pourquoi les Juifs, que d'ailleurs je révère, tuèrent tout dans Jérico jusqu'aux filles, et pourquoi ils disent dans leurs psaumes qu'il sera doux d'écraser les enfants à la mamelle , sans en excepter nommément les filles.
Tous les autres peuples, soit Tartares, soit Cannibales, soit Teutons ou Welches, ont eu toujours les filles en grande recommandation.
Avec cet heureux instinct, il semble que la terre devrait être couverte d'animaux de notre espèce. Nous avons vu que le père Petau en comptait près de sept cents milliards en deux cent quatre-vingts ans, après l'aventure du déluge. Et ce n'est pourtant pas à la Suite des Mille et une nuits qu'il a fait imprimer ce beau dénombrement.
Je compte aujourd'hui sur notre globule environ neuf cents millions de mes confrères, tant mâles que femelles. Vallace leur en accorde mille millions. Je me trompe, ou lui: et peut-être nous trompons-nous tous deux; mais c'est de peu de chose, qu'un dixième. Et dans toute l'arithmétique des historiens on se trompe bien davantage.
Je suis un peu surpris que notre arithméticien Vallace qui pousse le nombre de nos concitoyens jusqu'à un milliard, prétende dans la même page, que l'an 966 de la création, nos pères étaient au nombre de 1610 millions.
Premièrement, je voudrais qu'on m'établît bien nettement l'époque de la création; et comme nous avons dans notre Occident près de quatre-vingts systèmes sur cet événement, il est difficile de rencontrer juste.
En second lieu, les Egyptiens, les Chaldéens, les Persans, les Indiens, les Chinois, ayant tous des calculs encore plus différents, il est encore plus malaisé de s'accorder avec eux.
Troisièmement, pourquoi en 966 années le monde aurait-il été plus peuplé qu'il ne l'est de nos jours?
Pour sauver cette absurdité, on nous dit qu'il n'en allait pas autrefois comme de notre temps; que l'espèce était bien plus vigoureuse, qu'on digérait mieux, que par conséquent on était bien plus prolifique, et qu'on vivait plus longtemps. Que n'ajoutait-on que le soleil était plus chaud et la lune plus belle?
On nous allègue que du temps de César, quoique les hommes commençassent fort à dégénérer, cependant le monde était alors une fourmillière de nos bipèdes, mais qu'à présent c'est un désert. Montesquieu qui a toujours exagéré et qui a tout sacrifié à la démangeaison de montrer de l'esprit, ose croire ou veut faire accroire dans ses Lettres persanes que le monde était trente fois plus peuplé du temps de César qu'aujourd'hui.
Vallace avoue que ce calcul fait au hasard est beaucoup trop fort. Mais savez-vous quelle raison il en donne? c'est qu'avant César, le monde avait eu plus d'habitants qu'aux jours les plus brillants de la république romaine. Il remonte au temps de Sémiramis; et il exagère encore plus que Montesquieu, s'il est possible.
Ensuite se prévalant du goût qu'on a toujours attribué au Saint-Esprit pour l'hyperbole, il ne manque pas d'apporter en preuve les onze cent soixante mille hommes d'élite qui marchaient si fièrement sous les étendards du grand roi Josaphat, ou Jeozaphat roi de la province de Juda. Serrez, serrez M. Vallace; le Saint-Esprit ne peut se tromper, mais ses ayants cause et ses copistes ont mal calculé et mal chiffré. Toute votre Ecosse ne pourrait pas fournir onze cent soixante mille âmes pour assister à vos prêches; et le royaume de Juda n'était pas la vingtième partie de l'Ecosse. Voyez encore une fois ce que dit St Jérôme de cette pauvre Terre sainte dans laquelle il demeura si longtemps. Avez-vous bien calculé ce qu'il aurait fallu d'argent au grand roi Jeozaphat pour payer, nourrir, habiller, armer onze cent soixante mille soldats d'élite!
Et voilà justement comme on écrit l'histoire .
M. Vallace revient de Josaphat à César, et conclut que depuis ce dictateur de courte durée, la terre s'est dépeuplée visiblement. Voyez, dit-il, les Suisses; ils étaient, au rapport de César, au nombre de trois cent soixante et huit mille, quand ils quittèrent sagement leur pays pour aller chercher fortune à l'exemple des Cimbres.
Je ne veux que cet exemple pour faire rentrer en eux-mêmes les partisans un peu outrés du talent d'engendrer, dont ils gratifient les anciens aux dépens des modernes. Le canton de Berne par un dénombrement exact, possède seul le nombre des habitants qui désertèrent l'Helvétie entière du temps de César. L'espèce humaine est donc plus que doublée dans l'Helvétie depuis cette aventure.
Je crois de même l'Allemagne, la France, l'Angleterre bien plus peuplées qu'elles ne l'étaient alors. Ma raison est la prodigieuse extirpation des forêts et le nombre des grandes villes bâties et accrues depuis huit cents ans, et le nombre des arts augmenté en proportion. Voilà, je pense, une réponse précise à toutes les déclamations vagues qu'on répète tous les jours dans des livres où l'on néglige la vérité en faveur des saillies, et qui deviennent très inutiles à force d'esprit.
L'Ami des hommes suppose que du temps de César on comptait cinquante-deux millions d'hommes en Espagne; Strabon dit qu'elle a toujours été mal peuplée parce que le milieu des terres manque d'eau. Strabon paraît avoir raison, et l'Ami des hommes paraît se tromper.
Mais on nous effraye en nous demandant ce que sont devenues ces multitudes prodigieuses de Huns, d'Alains, d'Ostrogoths, de Visigoths, de Vandales, de Lombards, qui se répandirent comme des torrents sur l'Europe au cinquième siècle.
Je me défie de ces multitudes; j'ose soupçonner qu'il suffisait de trente ou quarante mille bêtes féroces tout au plus, pour venir jeter l'épouvante dans l'empire romain gouverné par une Pulchérie, par des eunuques et par des moines. C'était assez que dix mille barbares eussent passé le Danube, pour que dans chaque paroisse on dît au prône qu'il y en avait plus que de sauterelles dans les plaies d'Egypte; que c'était un fléau de Dieu; qu'il fallait faire pénitence et donner son argent aux couvents. La peur saisissait tous les habitants, ils fuyaient en foule. Voyez seulement quel effroi un loup jeta dans le Gévaudan en 1766.
Mandrin, suivi de cinquante gueux, met un ville entière à contribution. Dès qu'il est entré par une porte, on dit à l'autre qu'il vient avec quatre mille combattants et du canon.
Si Attila fut jamais à la tête de cinquante mille assassins affamés, ramassés de province en province, on lui en donnait cinq cent mille.
Les millions d'hommes qui suivaient les Xerxès, les Cyrus, les Thomiris, les trente ou trente-quatre millions d'Egyptiens, et la Thèbe-aux-cent-portes, et quidquid Graecia mendax audet in historia , ressemblent assez aux cinq cent mille hommes d'Attila. Cette compagnie de voyageurs aurait été difficile à nourrir sur la route.
Ces Huns venaient de la Sibérie, soit; de là je conclus qu'ils venaient en très petit nombre. La Sibérie n'était certainement pas plus fertile que de nos jours. Je doute que sous le règne de Thomiris il y eût une ville telle que Tobolsk, et que ces déserts affreux pussent nourrir un grand nombre d'habitants.
Les Indes, la Chine, la Perse, l'Asie mineure, étaient très peuplées; je le crois sans peine: et peut-être ne le sont-ils pas moins de nos jours, malgré la rage destructive des invasions et des guerres. Partout où la nature a mis des pâturages, le taureau se marie à la génisse, le bélier à la brebis, et l'homme à la femme.
Les déserts de Barca, de l'Arabie, d'Oreb, de Sinaï, de Jérusalem, de Cobi, etc., ne furent jamais peuplés, ne le sont point, et ne le seront jamais, à moins qu'il n'arrive quelque révolution qui change en bonne terre labourable ces horribles plaines de sable et de cailloux.
Le terrain de la France est assez bon, et il est suffisamment couvert de consommateurs, puisqu'en tout genre il y a plus de postulants que de places; puisqu'il y a deux cent mille fainéants qui gueusent d'un bout du pays à l'autre, et qui soutiennent leur détestable vie aux dépens des riches; enfin, puisque la France nourrit près de quatre-vingt mille moines, dont aucun n'a fait servir ses mains à produire un épi de froment.
SECTION SECONDE.
Réfutation d'un article de l'Encyclopédie.
Vous lisez dans le grand Dictionnaire encyclopédique, à l'article Population , ces paroles, dans lesquelles il n'y a pas un mot de vrai.
La France s'est accrue de plusieurs grandes provinces très peuplées; et cependant ses habitants sont moins nombreux d'un cinquième qu'ils ne l'étaient avant ces réunions: et ses belles provinces que la nature semble avoir destinées à fournir des substances à toute l'Europe, sont incultes .
1 o . Comment des provinces très peuplées étant incorporées à un royaume, ce royaume serait-il moins peuplé d'un cinquième? a-t-il été ravagé par la peste? S'il a perdu ce cinquième, le roi doit avoir perdu un cinquième de ses revenus. Cependant le revenu annuel de la couronne est porté à près de trois cent quarante millions de livres année commune, à quarante-neuf livres et demie le marc. Cette somme retourne aux citoyens par le paiement des rentes et des dépenses, et ne peut encore y suffire.
2 o . Comment l'auteur peut-il avancer que la France a perdu le cinquième de ses habitants, en hommes et en femmes, depuis l'acquisition de Strasbourg; quand il est prouvé, par les recherches de trois intendants, que la population est augmentée depuis vingt ans dans leurs généralités?
Les guerres, qui sont le plus horrible fléau du genre humain, laissent en vie l'espèce femelle qui le répare. De là vient que les bons pays sont toujours à peu près également peuplés.
Les émigrations des familles entières sont plus funestes. La révocation de l'édit de Nantes, et les dragonnades ont fait à la France une plaie cruelle. Mais cette blessure est refermée; et le Languedoc qui est la province dont il est le plus sorti de réformés, est aujourd'hui la province de France la plus peuplée, après l'Isle-de-France et la Normandie.
3 o Comment peut-on dire que les belles provinces de France sont incultes? En vérité c'est se croire damné en paradis. Il suffit d'avoir des yeux pour être persuadé du contraire. Mais sans entrer ici sans un long détail, considérons Lyon qui contient environ cent trente mille habitants, c'est-à-dire, autant que Rome, et non pas deux cent mille, comme dit l'abbé de Caveirac dans son Apologie de la dragonnade et de la St Barthélemi. [16] Il n'y a point de ville où l'on fasse meilleure chère. D'où vient cette affluence de nourritures excellentes, si ce n'est des campagnes voisines. Ces campagnes sont donc très bien cultivées; elles sont donc riches. J'en dirai autant de toutes les villes de France. L'étranger est étonné de l'abondance qu'il y trouve, et d'être servi en vaisselle d'argent dans plus d'une maison.
Il y a des terrains indomptables, comme les Landes de Bordeaux, la partie de la Champagne nommée pouilleuse . Ce n'est pas assurément la mauvaise administration qui a frappé de stérilité ces malheureux pays; ils n'étaient pas meilleurs du temps des druides.
C'est un grand plaisir de se plaindre et de censurer; je l'avoue. Il est doux après avoir mangé d'un mouton de pré-salé, d'un veau de rivière, d'un caneton de Rouen, d'un pluvier de Dauphiné, d'une gélinotte ou d'un coq de bruyère de Franche-Comté, après avoir bu du vin de Chambertin, de Silleri, d'Aï, de Frontignan; il est doux, dis-je, de plaindre dans une digestion un peu laborieuse le sort des campagnes qui ont fourni très chèrement toutes ces délicatesses. Voyagez, messieurs, et vous verrez si vous serez ailleurs mieux nourris, mieux abreuvés, mieux logés, mieux habillés et mieux voiturés.
Je crois l'Angleterre, l'Allemagne protestante, la Hollande, plus peuplées à proportion. La raison en est évidente; il n'y a point de moines dans ces pays-là qui jurent à Dieu d'être inutiles aux hommes. Les prêtres n'ayant que très peu de choses à faire, s'occupent à étudier et à propager. Ils font des enfants robustes, et leur donnent une meilleure éducation que n'en ont les enfants des marquis français et italiens.
Rome, au contraire, serait déserte sans les cardinaux, les ambassadeurs, et les voyageurs. Elle ne serait, comme le temple de Jupiter-Ammon, qu'un monument illustre. On comptait, du temps des premiers césars, des millions d'hommes dans ce territoire stérile, que les esclaves et le fumier rendaient fécond. C'était une exception à cette loi générale, que la population est d'ordinaire en raison de la bonté du sol.
La victoire avait fertilisé et peuplé cette terre ingrate. Une espèce de gouvernement la plus étrange, la plus contradictoire qui ait jamais étonné les hommes, a rendu au territoire de Romulus sa première nature. Tout le pays est dépeuplé d'Orviette à Terracine. Rome, réduite à ses citoyens, ne serait pas à Londres comme un est à douze; et en fait d'argent et de commerce, elle ne serait pas aux villes d'Amsterdam et de Londres comme un est à mille.
Ce que Rome a perdu, non seulement l'Europe l'a regagné; mais la population a triplé presque partout depuis Charlemagne.
Je dis triplé; et c'est beaucoup; car on ne propage point en progression géométrique. Tous les calculs qu'on a faits sur cette prétendue multiplication sont des chimères absurdes.
Si une famille d'hommes ou de signes multipliait en cette façon, la terre au bout de deux cents ans n'aurait pas de quoi les nourrir.
La nature a pourvu à conserver et à restreindre les espèces. Elle ressemble aux parques qui filaient et coupaient toujours. Elle n'est occupée que de naissances et de destructions.
Si elle a donné à l'animal homme, plus d'idées, plus de mémoire qu'aux autres, si elle l'a rendu capable de généraliser ses idées et de les combiner; si elle l'a avantagé du don de la parole; elle ne lui a pas accordé celui de la multiplication comme aux insectes. Il y a plus de fourmis dans telle lieue carrée de bruyères, qu'il n'y a jamais eu d'hommes sur le globe.
Quand un pays possède un grand nombre de fainéants, soyez sûr qu'il est assez peuplé, puisque ces fainéants sont logés, nourris, vêtus, amusés, respectés par ceux qui travaillent.
S'il y a trop d'habitants, si toutes les places sont prises, on va travailler et mourir à St Domingue, à la Martinique, à Philadelphie, à Boston.
Le point principal n'est pas d'avoir du superflu en hommes, mais de rendre ce que nous en avons le moins malheureux qu'il est possible.
Remercions la nature de nous avoir donné l'être dans la zone tempérée, peuplée presque partout d'un nombre plus que suffisant d'habitants qui cultivent tous les arts; et tâchons de ne pas gâter notre bonheur par nos sottises.
POSTE. [p. 267]↩
Autrefois si vous aviez eu un ami à Constantinople et un autre à Moscou, vous auriez été obligé d'attendre leur retour pour apprendre de leurs nouvelles. Aujourd'hui, sans qu'ils sortent de leur chambre, ni vous de la vôtre, vous conversez familièrement avec eux par le moyen d'une feuille de papier. Vous pouvez même leur envoyer par la poste un sachet de l'apothicaire Arnoud contre l'apoplexie; et il est reçu plus infailliblement qu'il ne les guérit.
Si l'un de vos amis a besoin de faire toucher de l'argent à Pétersbourg et l'autre à Smyrne, la poste fait votre affaire.
Votre maîtresse est-elle à Bordeaux, et vous devant Prague avec votre régiment, elle vous assure régulièrement de sa tendresse; vous savez par elle toutes les nouvelles de la ville, excepté les infidélités qu'elle vous fait.
Enfin, la poste est le lien de toutes les affaires, de toutes les négociations; les absents deviennent par elle présents; elle est la consolation de la vie.
La France où cette belle invention fut renouvelée dans nos temps barbares, a rendu ce service à toute l'Europe. Aussi n'a-t-elle jamais corrompu ce bienfait; et jamais le ministère qui a eu le département des postes n'a ouvert les lettres d'aucun particulier, excepté quand il a eu besoin de savoir ce qu'elles contenaient. Il n'en est pas ainsi, dit-on, dans d'autres pays. On a prétendu qu'en Allemagne vos lettres en passant par cinq ou six dominations différentes, étaient lues cinq ou six fois, et qu'à la fin le cachet était si rompu qu'on était obligé d'en remettre un autre.
Mr. Craigs secrétaire d'Etat en Angleterre, ne voulut jamais qu'on ouvrît les lettres dans ses bureaux; il disait que c'était violer la foi publique, qu'il n'est pas permis de s'emparer d'un secret qui ne nous est pas confié, qu'il est souvent plus criminel de prendre à un homme ses pensées que son argent; que cette trahison est d'autant plus malhonnête qu'on peut la faire sans risque, et sans en pouvoir être convaincu.
Pour dérouter l'empressement des curieux, on imagina d'abord d'écrire une partie de ses dépêches en chiffres. Mais la partie en caractères ordinaires, servait quelquefois à faire découvrir l'autre. Cet inconvénient fit perfectionner l'art des chiffres qu'on appelle sténographie .
On opposa à ces énigmes l'art de les déchiffrer; mais cet art fut très fautif et très vain. On ne réussit qu'à faire accroire à des gens peu instruits qu'on avait déchiffré leurs lettres, et on n'eut que le plaisir de leur donner des inquiétudes. Telle est la loi des probabilités que dans un chiffre bien fait il y a deux cents, trois cents, quatre cents à parier contre un, que dans chaque numéro vous ne devinerez pas la syllabe dont il est représentatif.
Le nombre des hasards augmente avec la combinaison de ces numéros; et le déchiffrement devient totalement impossible quand le chiffre est fait avec un peu d'art.
Ceux qui se vantent de déchiffrer une lettre sans être instruits des affaires qu'on y traite et sans avoir des secours préliminaires, sont de plus grands charlatans que ceux qui se vanteraient d'entendre une langue qu'ils n'ont point apprise.
Quant à ceux qui vous envoient familièrement par la poste, une tragédie en grand papier et en gros caractère avec des feuilles blanches pour y mettre vos observations, ou qui vous régalent d'un premier tome de métaphysique, en attendant le second, on peut leur dire qu'ils n'ont pas toute la discrétion requise, et qu'il y a même des pays où ils risqueraient de faire connaître au ministère qu'ils sont de mauvais poètes et de mauvais métaphysiciens.
LES POURQUOI. [p. 269]↩
Pourquoi un royaume réduit souvent aux extrémités et à quelque avilissement, s'est-il pourtant soutenu, quelques efforts que l'on ait faits pour l'écraser? c'est que la nation est active et industrieuse. Elle ressemble aux abeilles; on leur prend leur cire et leur miel, et le moment d'après elles travaillent à en faire d'autres.
Pourquoi dans la moitié de l'Europe les filles prient-elles Dieu en latin qu'elles n'entendent pas?
Pourquoi presque tous les papes et tous les évêques, au seizième siècle, ayant publiquement tant de bâtards, s'obstinèrent-ils à proscrire le mariage des prêtres, tandis que l'Eglise grecque a continué d'ordonner que ses curés eussent des femmes?
Pourquoi dans l'antiquité n'y eut-il jamais de querelle théologique, et ne distingua-t-on jamais aucun peuple par un nom de secte? Les Egyptiens n'étaient point appelés Isiaques, Osiriaques ; les peuples de Syrie n'avaient point le nom de Cibéliens . Les Crétois avaient une dévotion particulière à Jupiter, et ne s'intitulèrent jamais Jupitériens . Les anciens Latins étaient fort attachés à Saturne; il n'y eut pas un village du Latium qu'on appelât Saturnien : au contraire, les disciples du Dieu de vérité prenant le titre de leur maître même, et s'appelant oints comme lui, déclarèrent dès qu'ils le purent, une guerre éternelle à tous les peuples qui n'étaient pas oints, et se firent pendant plus de quatorze cents ans la guerre entre eux, en prenant les noms d' ariens , de manichéens , de donatistes , de hussites , de papistes , de luthériens , de calvinistes . Et même en dernier lieu, les jansénistes et les molinistes n'ont point eu de mortification plus cuisante que de n'avoir pu s'égorger en bataille rangée. D'où vient cela?
Pourquoi un marchand libraire vous vend-il publiquement le Cours d'athéisme du grand poète Lucrèce, imprimé à l'usage du dauphin fils unique de Louis XIV, par les ordres et sous les yeux du sage duc de Montausier, et de l'éloquent Bossuet évêque de Meaux, et du savant Huet évêque d'Avranches? C'est là que vous trouvez ces sublimes impiétés, ces vers admirables contre la Providence et contre l'immortalité de l'âme, qui passent de bouche en bouche à tous les siècles à venir,
Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti.
Rien ne vient du néant, rien ne s'anéantit.

Tangere enim ac tangi nisi corpus nulla potest res.
Le corps seul peut toucher et gouverner le corps.

Nec benè pro meritis capitur nec tangitur ira. (Deus.)
Rien ne peut flatter Dieu, rien ne peut l'irriter.

Tantum religio potuit suadere malorum .
C'est la religion qui produit tous les maux.

Desipere est mortale aeterno jungere et unà
Consentire putare et fungi munera posse .
Il faut être insensé pour oser joindre ensemble
Ce qui dure à jamais et ce qui doit périr.

Nil igitur mors est, ad nos, nil pertinet hilum .
Cesser d'être n'est rien; tout meurt avec le corps.

Ergo mortalem esse animam fateare necesse est .
Non il n'est point d'enfer, et notre âme est mortelle.

Inde acherusa fit stultorum denique vita .
Les vieux fous sont en proie aux superstitions.

et cent autres vers qui sont le charme de toutes les nations; productions immortelles d'un esprit qui se crut mortel.
Non seulement on vous vend ces vers latins dans la rue St Jacques, et sur le quai des Augustins; mais vous achetez hardiment les traductions faites dans tous les patois dérivés de la langue latine; traductions ornées de notes savantes qui éclaircissent la doctrine du matérialisme, qui rassemblent toutes les preuves contre la Divinité, et qui l'anéantiraient si elle pouvait être détruite. Vous trouvez ce livre relié en maroquin dans la belle bibliothèque d'un grand prince dévot, d'un cardinal, d'un chancelier, d'un archevêque, d'un président à mortier; mais on condamna les dix-huit premiers livres de l'Histoire du sage de Thou dès qu'ils parurent. Un pauvre philosophe welche ose-t-il imprimer en son propre et privé nom, que si les hommes étaient nés sans doigts, ils n'auraient jamais pu travailler en tapisserie; aussitôt un autre Welche revêtu pour son argent d'un office de robe, requiert qu'on brûle le livre et l'auteur.
Pourquoi les spectacles sont-ils anathématisés par certaines gens qui se disent du premier ordre de l'Etat, tandis qu'ils sont nécessaires à tous les ordres de l'Etat, tandis qu'ils sont payés par le souverain de l'Etat, qu'ils contribuent à la gloire de l'Etat, et que les lois de l'Etat les maintiennent avec autant de splendeur que de régularité?
Pourquoi abandonne-t-on au mépris, à l'avilissement, à l'oppression, à la rapine, le grand nombre de ces hommes laborieux et innocents qui cultivent la terre tous les jours de l'année pour vous en faire manger tous les fruits; et qu'au contraire, on respecte, on ménage, on courtise l'homme inutile et souvent très méchant qui ne vit que de leur travail, et qui n'est riche que de leur misère?
Pourquoi pendant tant de siècles, parmi tant d'hommes qui font croître le blé dont nous sommes nourris, ne s'en trouva-t-il aucun qui découvrît cette erreur ridicule, laquelle enseigne que le blé doit pourrir pour germer, et mourir pour renaître; erreur qui a produit tant d'assertions impertinentes, tant de fausses comparaisons, tant d'opinions ridicules?
Pourquoi les fruits de la terre étant si nécessaires pour la conservation des hommes et des animaux, voit-on cependant tant d'années et tant de contrées où ces fruits manquent absolument?
Pourquoi la terre est-elle couverte de poisons dans la moitié de l'Afrique et de l'Amérique?
Pourquoi n'est-il aucun territoire où il n'y ait beaucoup plus d'insectes que d'hommes?
Pourquoi un peu de sécrétion blanchâtre et puante forme-t-elle un être qui aura des os durs, des désirs et des pensées; et pourquoi ces êtres-là se persécuteront-ils toujours les uns les autres?
Pourquoi existe-t-il tant de mal, tout étant formé par un Dieu que tous les théistes se sont accordés à nommer bon ?
Pourquoi nous plaignant sans cesse de nos maux, nous occupons-nous toujours à les redoubler?
Pourquoi étant si misérables a-t-on imaginé que n'être plus est un grand mal, lorsqu'il est clair que ce n'était pas un mal de n'être point avant sa naissance?
Pourquoi pleut-il tous les jours dans la mer, tandis que tant de déserts demandent la pluie et sont toujours arides?
Pourquoi, et comment a-t-on des rêves dans le sommeil si on n'a point d'âme; et comment ces rêves sont-ils toujours si incohérents, si extravagants, si on en a une?
Pourquoi les astres circulent-ils d'occident en orient plutôt qu'au contraire?
Pourquoi existons-nous? pourquoi y a-t-il quelque chose?
PRÉTENTIONS. [p. 272]↩
Il n'y a pas dans notre Europe un seul prince qui ne s'intitule souverain d'un pays possédé par son voisin. Cette manie politique est inconnue dans le reste du monde; jamais le roi de Boutan ne s'est dit empereur de la Chine , jamais le conteish tartare ne prit le titre de roi d'Egypte .
Les plus belles prétentions ont toujours été celles des papes; deux clefs en sautoir les mettaient visiblement en possession du royaume des cieux. Ils liaient et ils déliaient tout sur la terre. Cette ligature les rendait maîtres du continent; et les filets de St Pierre leur donnaient le domaine des mers.
Plusieurs savants théologiens ont cru que ces dieux diminuèrent eux-mêmes quelques articles de leurs prétentions, lorsqu'ils furent vivement attaqués par les titans nommés luthériens, anglicans, calvinistes , etc. etc. Il est très vrai que plusieurs d'entre eux devinrent plus modestes, que leur cour céleste eut plus de décence; cependant, leurs prétentions se sont renouvelées dans toutes les occasions. Je n'en veux pour preuve que la conduite d'Aldobrandin, ClémentVIII , envers le grand Henri IV, quand il fallut lui donner une absolution dont il n'avait que faire, puisqu'il était absous par les évêques de son royaume et qu'il était victorieux.
Aldobrandin résista d'abord pendant une année entière, et ne voulut pas reconnaître le duc de Nevers pour ambassadeur de France. A la fin il consentit à ouvrir la porte du royaume des cieux à Henri, aux conditions suivantes.
1 o . Que Henri demanderait pardon de s'être fait ouvrir la porte par des sous-portiers tels que des évêques, au lieu de s'adresser au grand portier.
2 o . Qu'il s'avouerait déchu du trône de France jusqu'à ce qu'Aldobrandin le réhabilitât par la plénitude de sa puissance.
3 o . Qu'il se ferait sacrer et couronner une seconde fois, la première étant nulle, puisqu'elle avait été faite sans l'ordre exprès d'Aldobrandin.
4 o . Qu'il chasserait tous les protestants de son royaume; ce qui n'était ni honnête ni possible. La chose n'était pas honnête parce que les protestants avaient prodigué leur sang pour le faire roi de France. Elle n'était pas possible parce que ces dissidents étaient au nombre de deux millions.
5 o . Qu'il ferait au plus vite la guerre au Grand Turc, ce qui n'était ni plus honnête ni plus possible; puisque le Grand Turc l'avait reconnu roi dans le temps que Rome ne le reconnaissait pas, et que Henri n'avait ni troupes, ni argent, ni vaisseaux pour aller faire la guerre comme un fou à ce Grand Turc son allié.
6 o . Qu'il recevrait couché sur le ventre tout de son long l'absolution de M. le légat selon la forme ordinaire, c'est-à-dire, qu'il serait fustigé par M. le légat.
7 o . Qu'il rappellerait les jésuites chassés de son royaume par le parlement, pour l'assassinat commis sur sa personne par Jean Châtel leur écolier.
J'omets plusieurs autres petites prétentions. Henri en fit modérer plusieurs. Il obtint surtout avec bien de la peine qu'il ne serait fouetté que par procureur et de la propre main d'Aldobrandin.
Vous me direz que sa sainteté était forcée à exiger des conditions si extravagantes par le vieux démon du midi Philippe II, qui avait dans Rome plus de pouvoir que le pape. Vous comparerez Aldobrandin à un soldat poltron que son colonel conduit à la tranchée à coups de bâton.
Je vous répondrai qu'en effet Clément VIII craignait Philippe II, mais qu'il n'était pas moins attaché aux droits de sa tiare; que c'était un si grand plaisir pour le petit-fils d'un banquier de donner le fouet à un roi de France, que pour rien au monde Aldobrandin n'eût voulu s'en départir.
Vous me répliquerez que si un pape voulait réclamer aujourd'hui de telles prétentions, s'il voulait donner le fouet au roi de France, ou au roi d'Espagne, ou au roi de Naples, ou au duc de Parme, pour avoir chassé les révérends pères jésuites, il risquerait d'être traité comme ClémentVII le fut par Charles-Quint, et d'essuyer des humiliations beaucoup plus grandes; qu'il faut sacrifier ses prétentions à son utilité; qu'on doit céder au temps; que le shérif de la Mecque doit proclamer Ali-beg roi d'Egypte, s'il est victorieux et affermi. Je vous répondrai que vous avez raison.
PRÊTRES DES PAYENS. [p. 274]↩
Don Navarette dans une de ses lettres à Don Juan d'Autriche, rapporte ce discours du dalaï-lama à son conseil privé.
‘Mes vénérables frères; vous et moi nous savons très bien que je ne suis pas immortel; mais il est bon que les peuples le croient. Les Tartares du grand et du petit Thibet sont un peuple de col raide et de lumières courtes, qui ont besoin d'un joug pesant et de grosses erreurs. Persuadez-leur bien mon immortalité dont la gloire rejaillit sur vous, et qui vous procure honneurs et richesses.
‘Quand le temps viendra où les Tartares seront plus éclairés, on pourra leur avouer alors que les grands lamas ne sont point immortels, mais que leurs prédécesseurs l'ont été; et que ce qui était nécessaire pour la fondation de ce divin édifice, ne l'est plus quand l'édifice est affermi sur un fondement inébranlable.
‘J'ai eu d'abord quelque peine à faire distribuer aux vassaux de mon empire, les agréments de ma chaise percée, proprement enchâssés dans des cristaux ornés de cuivre doré; mais ces monuments ont été reçus avec tant de respect, qu'il a fallu continuer cet usage, lequel après tout ne répugne en rien aux bonnes moeurs, et qui fait entrer beaucoup d'argent dans notre trésor sacré.
‘Si jamais quelque raisonneur impie persuade au peuple que notre derrière n'est pas aussi divin que notre tête; si on se révolte contre nos reliques, vous en soutiendrez la valeur autant que vous le pourrez. Et si vous êtes forcés enfin d'abandonner la sainteté de notre cul, vous conserverez toujours dans l'esprit des raisonneurs le profond respect qu'on doit à notre cervelle, ainsi que dans un traité avec les Mongules nous avons cédé une mauvaise province pour être possesseurs paisibles des autres.
‘Tant que nos Tartares du grand et du petit Thibet ne sauront ni lire ni écrire, tant qu'ils seront grossiers et dévots, vous pourrez prendre hardiment leur argent, coucher avec leurs femmes et avec leurs filles, et les menacer de la colère du dieu Fo s'ils osent se plaindre.
‘Lorsque le temps de raisonner sera arrivé (car enfin il faut bien qu'un jour les hommes raisonnent) vous prendrez alors une conduite tout opposée; et vous direz le contraire de ce que vos prédécesseurs ont dit, car vous devez changer de bride à mesure que les chevaux deviennent plus difficiles à gouverner. Il faudra que votre extérieur soit plus grave, vos intrigues plus mystérieuses, vos secrets mieux gardés, vos sophismes plus éblouissants, votre politique plus fine. Vous êtes alors les pilotes d'un vaisseau qui fait eau de tous côtés. Ayez sous vous des subalternes qui soient continuellement occupés à pomper, à calfater, à boucher tous les trous. Vous voguerez avec plus de peine; mais enfin vous voguerez et vous jetterez dans l'eau ou dans le feu, selon qu'il conviendra le mieux, tous ceux qui voudront examiner si vous avez bien radoubé le vaisseau.
‘Si les incrédules sont ou le prince des Kalkas, ou le contaish des Calmouks, ou un prince de Casan, ou tel autre grand seigneur qui ait malheureusement trop d'esprit, gardez-vous bien de prendre querelle avec eux. Respectez-les, dites-leur toujours que vous espérez qu'ils rentreront dans la bonne voie. Mais pour les simples citoyens, ne les épargnez jamais; plus ils seront gens de bien, plus vous devrez travailler à les exterminer; car ce sont les gens d'honneur qui sont les plus dangereux pour vous.
‘Vous aurez la simplicité de la colombe, la prudence du serpent, et la griffe du lion selon les lieux et selon les temps.'
Le dalaï-lama avait à peine prononcé ces paroles que la terre trembla, les éclairs coururent d'un pôle à l'autre, le tonnerre gronda, une voix céleste se fit entendre, ADOREZ DIEU ET NON LE GRAND LAMA.
Tous les petits lamas soutinrent que la voix avait dit, Adorez Dieu et le grand lama . On le crut longtemps dans le royaume du Thibet; et maintenant on ne le croit plus.
PRIÈRES. [p. 276]↩
Nous ne connaissons aucune religion sans prières; les Juifs mêmes en avaient, quoiqu'il n'y eût point chez eux de formule publique jusqu'au temps où ils chantèrent leurs cantiques dans leurs synagogues, ce qui n'arriva que très tard.
Tous les hommes, dans leurs désirs et dans leurs craintes, invoquèrent le secours d'une divinité. Des philosophes, plus respectueux envers l'Etre suprême, et moins condescendants à la faiblesse humaine, ne voulurent pour toute prière que la résignation. C'est en effet tout ce qui semble convenir entre la créature et le Créateur. Mais la philosophie n'est pas faite pour gouverner le monde, elle s'élève trop au-dessus du vulgaire; elle parle un langage qu'il ne peut entendre. Ce serait proposer aux marchandes de poissons frais d'étudier les sections coniques.
Parmi les philosophes même, je ne crois pas qu'aucun autre que Maxime de Tyr ait traité cette matière. Voici la substance des idées de ce Maxime.
L'Eternel a ses desseins de toute éternité. Si la prière est d'accord avec ses volontés immuables, il est très inutile de lui demander ce qu'il a résolu de faire. Si on le prie de faire le contraire de ce qu'il a résolu, c'est le prier d'être faible, léger, inconstant; c'est croire qu'il soit tel; c'est se moquer de lui. Ou vous lui demandez une chose juste; en ce cas il la doit, et elle se fera sans qu'on l'en prie; c'est même se défier de lui que lui faire instance. Ou la chose est injuste; et alors on l'outrage. Vous êtes digne ou indigne de la grâce que vous implorez: si digne, il le fait mieux que vous; si indigne, on commet un crime de plus en demandant ce qu'on ne mérite pas.
En un mot, nous ne faisons des prières à Dieu que parce que nous l'avons fait à notre image. Nous le traitons comme un bacha, comme un sultan qu'on peut irriter et apaiser.
Enfin, toutes les nations prient Dieu: les sages se résignent et lui obéissent.
Prions avec le peuple, et résignons-nous avec les sages.
Nous avons déjà parlé des prières publiques de plusieurs nations, et de celles des Juifs. Ce peuple en a une depuis un temps immémorial, laquelle mérite toute notre attention, par sa conformité avec notre prière enseignée par Jésus-Christ même. Cette oraison juive s'appelle le Kadish, elle commence par ces mots: ‘O Dieu! que votre nom soit magnifié et sanctifié; faites régner votre règne; que la rédemption fleurisse, et que le Messie vienne promptement!'
Ce Kadish, qu'on récite en chaldéen, a fait croire qu'il était aussi ancien que la captivité; et que ce fut alors qu'ils commencèrent à espérer un Messie, un libérateur qu'ils ont demandé depuis dans les temps de leurs calamités.
Ce mot de Messie, qui se trouve dans cette ancienne prière, a fourni beaucoup de disputes sur l'histoire de ce peuple. Si cette prière est du temps de la transmigration à Babilone, il est clair qu'alors les Juifs devaient souhaiter et attendre un libérateur. Mais d'où vient que dans des temps plus funestes encore, après la destruction de Jérusalem par Titus, ni Joseph, ni Philon ne parlèrent jamais de l'attente d'un Messie? Il y a des obscurités dans l'histoire de tous les peuples; mais celle des Juifs est un chaos perpétuel. Il est triste pour les gens qui veulent s'instruire, que les Chaldéens et les Egyptiens aient perdu leurs archives, tandis que les Juifs ont conservé les leurs.
PRIVILÈGES, CAS PRIVILÉGIÉS. [p. 278]↩
L'usage qui prévaut presque toujours contre la raison, a voulu qu'on appelât privilégiés les délits des ecclésiastiques et des moines contre l'ordre civil, ce qui est pourtant très commun; et qu'on nommât délits communs ceux qui ne regardent que la discipline ecclésiastique; cas dont la police civile ne s'embarrasse pas, et qui sont abandonnés à la hiérarchie sacerdotale.
L'Eglise n'ayant de juridiction que celle que les souverains lui ont accordée, et les juges de l'Eglise n'étant ainsi que des juges privilégiés par le souverain, on devrait appeler cas privilégiés ceux qui sont de leur compétence, et délits communs ceux qui doivent être punis par les officiers du prince. Mais les canonistes qui sont très rarement exacts dans leurs expressions, surtout lorsqu'il s'agit de la juridiction royale, ayant regardé un prêtre nommé official comme étant de droit le seul juge des clercs, ils ont qualifié de privilège ce qui appartient de droit commun aux tribunaux laïcs: et les ordonnances des rois ont adopté cette expression en France.
S'il faut se conformer à cet usage, le juge d'Eglise connaît seul du délit commun; mais il ne connaît des cas privilégiés que concurremment avec le juge royal. Celui-ci se rend au tribunal de l'officialité, mais il n'y est que l'assesseur du juge d'Eglise. Tous les deux sont assistés de leur greffier, chacun rédige séparément, mais en présence l'un de l'autre, les actes de la procédure. L'official qui préside interroge seul l'accusé; et si le juge royal a des questions à lui faire, il doit requérir le juge d'Eglise de les proposer. L'instruction conjointe étant achevée, chaque juge rend séparément son jugement.
Cette procédure est hérissée de formalités, et elle entraîne d'ailleurs des longueurs qui ne devraient pas être admises dans la jurisprudence criminelle. Les juges d'Eglise qui n'ont pas fait une étude des lois et des formalités, n'instruisent guère de procédures criminelles sans donner lieu à des appels comme d'abus qui ruinent en frais le prévenu, le font languir dans les fers, ou retardent sa punition s'il est coupable.
D'ailleurs, les Français n'ont aucune loi précise qui ait déterminé quels sont les cas privilégiés. Un malheureux gémit souvent une année entière dans les cachots avant de savoir quels seront ses juges.
Les prêtres et les moines sont dans l'Etat, et sujets de l'Etat. Il est bien étrange, que lorsqu'ils ont troublé la société, ils ne soient pas jugés comme les autres citoyens, par les seuls officiers du souverain.
Chez les Juifs, les grands-prêtres même n'avaient point ce privilège, que nos lois ont accordé à de simples habitués de paroisse. Salomon déposa le grand-pontife Abiathar, sans le III liv. des Rois ch. II, v. 26 et 27. renvoyer à la synagogue pour lui faire son procès. Jésus-Christ accusé devant un juge séculier et païen, ne récusa pas sa juridiction. St Paul traduit au tribunal de Félix et de Festus, ne le déclina point.
L'empereur Constantin accorda d'abord ce privilège aux évêques. Honorius et Théodose le Jeune l'étendirent à tous les clercs, et Justinien le confirma.
En rédigeant l'ordonnance criminelle de 1670, le conseiller d'Etat Pussort et le président de Novion étaient d'avis [17] d'abolir la procédure conjointe, et de rendre aux juges royaux le droit de juger seuls les clercs accusés de cas privilégiés. Mais cet avis raisonnable fut combattu par le premier président de Lamoignon, et par l'avocat général Talon. Et une loi qui était faite pour réformer nos abus, confirma le plus ridicule de tous.
Une déclaration du roi du 26 avril 1657, défend au parlement de Paris de continuer la procédure commencée contre le cardinal de Retz accusé de crime de lèse-majesté. La même déclaration veut que les procès des cardinaux, archevêques et évêques du royaume, accusés du crime de lèse-majesté, soient instruits et jugés par les juges ecclésiastiques, comme il est ordonné par les canons.
Mais cette déclaration contraire aux usages du royaume, n'a été enregistrée dans aucun parlement, et ne serait pas suivie. Nos livres rapportent plusieurs arrêts qui ont décrété de prise de corps, déposé, confisqué les biens, et condamné à l'amende et à d'autres peines, des cardinaux, des archevêques et des évêques. Ces peines ont été prononcées contre l'évêque de Nantes par arrêt du 25 juin 1455.
Contre Jean de la Balue cardinal et évêque d'Angers, par arrêt du 29 juillet 1469.
Contre Jean Hébert évêque de Constance en 1480.
Contre Louis de Rochechouart évêque de Nantes en 1481.
Contre Géofroi de Pompadour évêque de Périgueux, et George d'Amboise évêque de Montauban en 1488.
Contre Géofroi Dintiville évêque d'Auxerre en 1531.
Contre Bernard Lordat évêque de Pamiers en 1537.
Contre le cardinal de Châtillon évêque de Beauvais le 19 mars 1569.
Contre Géofroi de la Martonie évêque d'Amiens le 9 juillet 1594.
Contre Gilbert Genebrard archevêque d'Aix le 26 janvier 1596.
Contre Guillaume Rose évêque de Senlis le 5 septembre 1598.
Contre le cardinal de Sourdis archevêque de Bordeaux le 17 novembre 1615.
Le parlement de Paris décréta de prise de corps le cardinal de Bouillon, et fit saisir ses biens par arrêt du 20 juin 1710.
Le cardinal de Mailly archevêque de Rheims, fit en 1717 un mandement tendant à détruire la paix ecclésiastique établie par le gouvernement. Le bourreau brûla publiquement le mandement par arrêt du parlement.
Le sieur Languet évêque de Soissons ayant soutenu qu'il ne pouvait être jugé par la justice du roi, même pour crime de lèse-majesté, il fut condamné à dix mille livres d'amende.
Dans les troubles honteux excités par les refus de sacrements, le simple présidial de Nantes condamna l'évêque de cette ville à six mille francs d'amende pour avoir refusé la communion à ceux qui la demandaient.
En 1764 l'archevêque d'Auch, du nom de Montillet, fut condamné à une amende; et son mandement, regardé comme un libelle diffamatoire, fut brûlé par le bourreau à Bordeaux.
Ces exemples ont été très fréquents. La maxime que les ecclésiastiques sont entièrement soumis à la justice du roi comme les autres citoyens, a prévalu dans tout le royaume. Il n'y a point de loi expresse qui l'ordonne. Mais l'opinion de tous les jurisconsultes, le cri unanime de la nation, et le bien de l'Etat sont une loi.
PROPHÊTES. [p. 281]↩
Le prophète Jurieu fut sifflé, les prophètes des Cévennes furent pendus ou roués; les prophètes qui vinrent du Languedoc et du Dauphiné à Londres furent mis au pilori; les prophètes anabaptistes furent condamnés à divers supplices; le prophète Savonarola fut cuit à Florence. Et s'il est permis de joindre à tous ceux-là les véritables prophètes juifs, on verra que leur destinée n'a pas été moins malheureuse; le plus grand de leurs prophètes, St Jean-Batiste, eut le cou coupé.
On prétend que Zacharie fut assassiné; mais heureusement cela n'est pas prouvé. Le prophète Jeddo ou Addo qui fut envoyé à Béthel à condition qu'il ne mangerait ni ne boirait, ayant malheureusement mangé un morceau de pain, fut mangé à son tour par un lion, et on trouva ses os sur le grand chemin entre ce lion et son âne. Jonas fut avalé par un poisson; il est vrai qu'il ne resta dans son ventre que trois jours et trois nuits; mais c'est toujours passer soixante et douze heures fort mal à son aise.
Habacuc fut transporté en l'air par les cheveux à Babilone. Ce n'est pas un grand malheur à la vérité; mais c'est une voiture fort incommode. On doit beaucoup souffrir quand on est suspendu par les cheveux l'espace de trois cents milles. J'aurais mieux aimé une paire d'ailes, la jument Borak ou l'hippogriffe.
Michée, fils de Jemilla, ayant vu le Seigneur assis sur son trône avec l'armée du ciel à droite et à gauche, et le Seigneur ayant demandé quelqu'un pour aller tromper le roi Achab, le diable s'étant présenté au Seigneur, et s'étant chargé de la commission, Michée rendit compte de la part du Seigneur au roi Achab de cette aventure céleste. Il est vrai que pour récompense, il ne reçut qu'un énorme soufflet de la main du prophète Sédékia; il est vrai qu'il ne fut mis dans un cachot que pour quelques jours; mais enfin il est désagréable pour un homme inspiré d'être souffleté et fourré dans un cul de basse-fosse.
On croit que le roi Amasias fit arracher les dents au prophète Amos pour l'empêcher de parler. Ce n'est pas qu'on ne puisse absolument parler sans dents; on a vu de vieilles édentées très bavardes; mais il faut prononcer distinctement une prophétie, et un prophète édenté n'est pas écouté avec le respect qu'on lui doit.
Baruch essuya bien des persécutions. Ezéchiel fut lapidé par les compagnons de son esclavage. On ne sait si Jérémie fut lapidé, ou s'il fut scié en deux.
Pour Isaïe, il passe pour constant qu'il fut scié par ordre de Manassé roitelet de Juda.
Il faut convenir que c'est un méchant métier que celui de prophète. Pour un seul qui, comme Elie, va se promener de planètes en planètes dans un beau carrosse de lumière, traîné par quatre chevaux blancs, il y en a cent qui vont à pied, et qui sont obligés d'aller demander leur dîner de porte en porte. Ils ressemblent assez à Homère qui fut obligé, dit-on, de mendier dans les sept villes qui se disputèrent depuis l'honneur de l'avoir vu naître. Ses commentateurs lui ont attribué une infinité d'allégories, auxquelles il n'avait jamais pensé. On a fait souvent le même honneur aux prophètes. Je ne disconviens pas qu'il n'y eut ailleurs des gens instruits de l'avenir. Il n'y a qu'à donner à son âme un certain degré d'exaltation, comme l'a très bien imaginé un brave philosophe ou fou de nos jours.
A l'égard des véritables prophètes juifs, il y a une très grande difficulté, c'est que plusieurs d'entre eux étaient hérétiques samaritains. Ozée était de la tribu d'Issacar, territoire samaritain; Elie et Elizée eux-mêmes en étaient. Mais il est aisé de répondre à cette objection. On sait assez que l'esprit souffle où il veut, et que la grâce tombe sur le sol le plus aride comme sur le plus fertile.
PROPHÉTIES. [p. 283]↩
SECTION PREMIÈRE.
Il est encore des prophètes, nous en avions deux à Bissêtre en 1723; l'un et l'autre se disaient Elie. On les fouetta, et il n'en fut plus question.
Avant les prophètes des Cévennes qui tiraient des coups de fusil derrière les haies au nom du Seigneur en 1704, la Hollande eut le fameux Pierre Jurieu qui publia l' Accomplissement des prophéties . Mais que la Hollande n'en soit pas trop fière. Il était né en France dans une petite ville appelée Mer, de la généralité d'Orléans. Mais il faut avouer que ce ne fut qu'à Roterdam que Dieu l'appela à la prophétie.
Tom. I, pag. 187. Ce Jurieu vit clairement, comme bien d'autres, dans l'Apocalypse que le pape était la bête, qu'elle tenait poculum aureum plenum abominationum , la coupe d'or pleine d'abominations; que les quatre premières lettres de ces quatre mots latins formaient le mot pâpâ , que par conséquent son règne allait finir, que les Juifs rentreraient dans Jérusalem, qu'ils domineraient sur le monde entier pendant mille ans, après quoi viendrait l'antéchrist, puis Jésus assis sur une nuée jugerait les vivants et les morts.
Tom. II, pag. 133 et 134. Jurieu prophétise expressément que le temps de la grande révolution et de la chute entière du papisme tombera justement sur l'an 1689, que j'estime , dit-il, être le temps de la vendange apocalyptique; car les deux témoins ressusciteront en ce temps-là. Après quoi la France doit rompre avec le pape avant la fin du siècle, ou au commencement de l'autre, et le reste de l'empire antichrétien s'abolira partout .
Cette particule disjonctive ou , ce signe du doute n'était pas d'un homme adroit. Il ne faut pas qu'un prophète hésite. Il peut être obscur, mais il doit être sûr de son fait.
La révolution du papisme n'étant point arrivée en 1689 comme Pierre Jurieu l'avait prédit, il fit faire au plus vite une nouvelle édition où il assura que c'était pour 1690. Et ce qui est étonnant, c'est que cette édition fut suivie immédiatement d'une autre. Il s'en est fallu beaucoup que le Dictionnaire de Bayle ait eu une pareille vogue; mais l'ouvrage de Bayle est resté, et Pierre Jurieu n'est pas même demeuré dans la Bibliothèque bleue avec Nostradamus.
On n'avait pas alors pour un seul prophète. Un presbytérien anglais qui étudiait à Utrecht, combattit tout ce que disait Jurieu sur les sept fioles et les sept trompettes de l'Apocalypse, sur le règne de mille ans, sur la conversion des Juifs, et même sur l'antéchrist. Chacun s'appuyait de l'autorité de Coceïus, de Coterus, de Drabicius, de Comenius grands prophètes précédents, et de la prophétesse Christine. Les deux champions se bornèrent à écrire; on espérait qu'ils se donneraient des soufflets comme Sédékia en appliqua un à Michée en lui disant, Devine comment l'esprit divin a passé de ma main sur ta joue . Mot à mot, Comment l'esprit a-t-il passé de toi à moi? Le public n'eut pas cette satisfaction, et c'est bien dommage.
SECTION SECONDE.
Il n'appartient qu'à l'Eglise infaillible de fixer le véritable sens des prophéties; car les Juifs ont toujours soutenu avec leur opiniâtreté ordinaire qu'aucune prophétie ne pouvait regarder Jésus-Christ; et les Pères de l'Eglise ne pouvaient disputer contre eux avec avantage, puisque hors St Ephrem, le grand Origène et St Jérôme, il n'y eut jamais aucun Père de l'Eglise qui sût un mot d'hébreu.
Ce ne fut qu'au neuvième siècle que Raban le Maure, depuis évêque de Mayence, apprit la langue juive. Son exemple fut suivi de quelques autres, et alors on commença à disputer avec les rabbins sur le sens des prophéties.
Raban fut étonné des blasphèmes qu'ils prononçaient contre notre Sauveur, l'appelant bâtard, impie, fils de Panther , et disant Vangesilius in proemio pag. 53. qu'il n'est pas permis de prier Dieu sans le maudire. Quod nulla oratio posset apud Deum accepta esse nisi in ea Dominum nostrum Jesum Christum maledicant. Confitentes eum esse impium et filium impii, id est nescio cujus aethnici quem nominant Pandera à quo dicunt matrem Domini adulteratam .
Ces horribles profanations se trouvent en plusieurs endroits dans le Talmud, dans les livres de Nizachon, dans la dispute de Rittangel, dans celles de Jechiel et de Nacmanides intitulées le Rempart de la foi ; et surtout dans l'abominable ouvrage du Toldos Jeschut .
C'est particulièrement dans le prétendu Rempart de la foi du rabbin Isaac, que l'on interprète toutes les prophéties qui annoncent Jésus-Christ en les appliquant à d'autres personnes.
C'est-là qu'on assure que la Trinité n'est figurée dans aucun livre hébreu, et qu'on n'y trouve pas la plus légère trace de notre sainte religion. Au contraire, ils allèguent cent endroits qui, selon eux, disent que la loi mosaïque doit durer éternellement.
Le fameux passage qui doit confondre les Juifs et faire triompher la religion chrétienne, de l'aveu de tous nos grands théologiens, est celui d'Isaïe, Voici une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel; il mangera du beurre et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. . . Et avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre que tu as en détestation sera abandonnée de ses deux rois. . . Et l'Eternel sifflera aux mouches des ruisseaux d'Egypte, et aux abeilles qui sont au pays d'Assur. . . Et en ce jour-là le Seigneur rasera avec un rasoir de louage le roi d'Assur, la tête et le poil des génitoires, et il achevera aussi la barbe. . . Et l'Eternel me dit, Prends un grand rouleau et y écris avec une touche en gros caractère, qu'on se dépêche de butiner, prenez vite les dépouilles. . . Donc je pris avec moi de fidèles témoins, savoir Urie le sacrificateur, et Zacharie fils de Jeberecia. . . Et je couchai avec la prophétesse, elle conçut et enfanta un enfant mâle; et l'Eternel me dit, Appelle l'enfant Maher-salal-has-bas. Car avant que l'enfant sache crier mon père et ma mère on enlevera la puissance de Damas, et le butin de Samarie devant le roi d'Assur .
Le rabbin Isaac affirme après tous les autres docteurs de sa loi, que le mot hébreu alma signifie tantôt une vierge, tantôt une femme mariée; que Ruth est appelée alma lorsqu'elle était mère; qu'une femme adultère est quelquefois même nommée alma ; qu'il ne s'agit ici que de la femme du prophète Isaïe; que son fils ne s'appelle point Emmanuel, mais Maher-salal-has-bas; que quand ce fils mangera du beurre et du miel, les deux rois qui assiègent Jérusalem seront chassés du pays, etc.
Ainsi ces interprètes aveugles de leur propre religion et de leur propre langue, combattent contre l'Eglise, et disent obstinément que cette prophétie ne peut regarder Jésus-Christ en aucune manière.
On a mille fois réfuté leur explication dans nos langues modernes. On a employé la force, les gibets, les roues, les flammes; cependant ils ne se rendent pas encore.
Il a porté nos maladies, et il a soutenu nos douleurs, et nous l'avons cru affligé de plaies, frappé de Dieu et affligé .
Quelque frappante que cette prédiction puisse nous paraître, ces Juifs obstinés disent qu'elle n'a nul rapport avec Jésus-Christ, et qu'elle ne peut regarder que les prophètes qui étaient persécutés pour les péchés du peuple.
Et voilà que mon serviteur prospérera, sera honoré, et élevé très haut .
Ils disent encore que cela ne regarde pas Jésus-Christ, mais David; que ce roi en effet prospéra, mais que Jésus qu'ils méconnurent, ne prospéra pas.
Voici que je ferai un nouveau pacte avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda .
Ils disent que ce passage ne signifie, selon la lettre et selon le sens, autre chose sinon, je renouvellerai mon pacte avec Juda et avec Israël. Cependant, leur pacte n'a pas été renouvelé; on ne peut faire un plus mauvais marché que celui qu'ils ont fait. N'importe, ils sont obstinés.
Et toi, Bethléem d'Ephrata, qui es petite dans les milliers de Juda, il sortira pour toi un dominateur en Israël, et sa sortie est depuis le commencement jusqu'au jour d'à jamais .
Ils osent nier encore que cette prophétie soit pour Jésus-Christ. Ils disent qu'il est évident que Michée parle de quelque capitaine natif de Bethléem, qui remportera quelque avantage à la guerre contre les Babiloniens; car il parle le moment d'après de l'histoire de Babilone et des sept capitaines qui élurent Darius. Et si on démontre qu'il s'agit du Messie, ils n'en veulent pas convenir.
Ces Juifs se trompent grossièrement sur Juda qui devait être comme un lion , et qui n'a été que comme un âne sous les Perses, sous Alexandre, sous les Seleucides, sous les Ptolomées, sous les Romains, sous les Arabes et sous les Turcs.
Ils ne savent ce qu'ils entendent par le Shilo, et par la verge , et par la cuisse de Juda . La verge n'a été dans Juda qu'un temps très court; ils disent des pauvretés; mais l'abbé Houteville n'en dit-il pas beaucoup davantage avec ses phrases, son néologisme et son éloquence de rhéteur, qui met toujours des mots à la place des choses, et qui se propose des objections très difficiles pour n'y répondre que par du verbiage?
Tout cela est donc peine perdue. Et quand l'abbé Français ferait encore un livre plus gros, quand il le joindrait aux cinq ou six mille volumes que nous avons sur cette matière, nous en serions plus fatigués sans avoir avancé d'un seul pas.
On se trouve donc plongé dans un chaos qu'il est impossible à la faiblesse de l'esprit humain de débrouiller jamais. On a besoin encore une fois d'une Eglise infaillible qui juge sans appel. Car enfin, si un Chinois, un Tartare, un Africain réduit au malheur de n'avoir que du bon sens, lisait toutes ces prophéties, il lui serait impossible d'en faire l'application ni à Jésus-Christ, ni aux Juifs, ni à personne. Il serait dans l'étonnement, dans l'incertitude, ne concevrait rien, n'aurait pas une seule idée distincte. Il ne pourrait pas faire un pas dans cet abîme; il lui faut un guide. Prenons donc l'Eglise pour notre guide, c'est le moyen de cheminer. On arrive avec ce guide non seulement au sanctuaire de la vérité, mais à de bons canonicats, à de grosses commanderies, à de très opulentes abbayes crossées et mitrées dont l'abbé est appelé monseigneur par ses moines et par ses paysans, à des évêchés qui vous donnent le titre de princes ; on jouit de la terre, et on est sûr de posséder le ciel en propre.
PROPRIÉTÉ. [p. 283]↩
Liberty and property : c'est le cri anglais. Il vaut mieux que St George et mon droit, St Denis et mon joie : c'est le cri de la nature.
De la Suisse à la Chine les paysans possèdent des terres en propre. Le droit seul de conquête a pu dans quelques pays dépouiller les hommes d'un droit si naturel.
L'avantage général d'une nation est celui du souverain, du magistrat et du peuple, pendant la paix et pendant la guerre. Cette possession des terres accordées aux paysans est-elle également utile au trône et aux sujets dans tous les temps? Pour qu'elle le soit au trône, il faut qu'elle puisse produire un revenu plus considérable et plus de soldats.
Il faut donc voir si le commerce et la population augmenteront. Il est certain que le possesseur d'un terrain cultivera beaucoup mieux son héritage que celui d'autrui. L'esprit de propriété double la force de l'homme. On travaille pour soi et pour sa famille avec plus de vigueur et de plaisir que pour un maître. L'esclave qui est dans la puissance d'un autre, a peu d'inclination pour le mariage. Il craint souvent même de faire des esclaves comme lui. Son industrie est étouffée; son âme abrutie: et ses forces ne s'exercent jamais dans toute leur élasticité. Le possesseur au contraire désire une femme qui partage son bonheur, et des enfants qui l'aident dans son travail. Son épouse et ses fils font ses richesses. Le terrain de ce cultivateur peut devenir dix fois plus fertile qu'auparavant sous les mains d'une famille laborieuse. Le commerce général sera augmenté. Le trésor du prince en profitera. La campagne fournira plus de soldats. C'est donc évidemment l'avantage du prince. La Pologne serait trois fois plus peuplée et plus riche si le paysan n'était pas esclave.
Ce n'en est pas moins l'avantage des seigneurs. Qu'un seigneur possède dix mille arpents de terre cultivés par des serfs; dix mille arpents ne lui procureront qu'un revenu très faible, souvent absorbé par les réparations, et réduit à rien par l'intempérie des saisons. Que sera-ce, si la terre est d'une plus vaste étendue, et si le terrain est ingrat? Il ne sera que le maître d'une vaste solitude. Il ne sera réellement riche qu'autant que ses vassaux le seront. Son bonheur dépend du leur. Si ce bonheur s'étend jusqu'à rendre sa terre trop peuplée, si le terrain manque à tant de mains laborieuses, (au lieu qu'auparavant les mains manquaient au terrain) alors l'excédent des cultivateurs nécessaires se répand dans les villes, dans les ports de mer, dans les ateliers des artistes, dans les armées. La population aura produit ce grand bien; et la possession des terres accordées aux cultivateurs, sous la redevance qui enrichit les seigneurs, aura produit cette population.
Il y a une autre espèce de propriété non moins utile; c'est celle qui est affranchie de toute redevance, et qui ne paie que les tributs généraux, imposés par le souverain, pour le bien et le maintien de l'Etat. C'est cette propriété qui a contribué surtout à la richesse de l'Angleterre, de la France et des villes libres d'Allemagne. Les souverains qui affranchirent les terrains dont étaient composés leurs domaines, en recueillirent d'abord un grand avantage; puisqu'on acheta chèrement ces franchises. Et ils en retirent aujourd'hui un bien plus grand, surtout en Angleterre et en France, par les progrès de l'industrie et du commerce.
L'Angleterre donna un grand exemple au seizième siècle, lorsqu'on affranchit les terres dépendantes de l'Eglise et des moines. C'était une chose bien odieuse, bien préjudiciable à un Etat de voir des hommes, voués par leur institut à l'humilité et à la pauvreté, devenus les maîtres des plus belles terres du royaume, traiter les hommes, leurs frères, comme des animaux de service, faits pour porter leurs fardeaux. La grandeur de ce petit nombre de prêtres avilissait la nature humaine. Leurs richesses particulières appauvrissaient le reste du royaume. L'abus a été détruit; et l'Angleterre est devenue riche.
Dans tout le reste de l'Europe, le commerce n'a fleuri, les arts n'ont été en honneur, les villes ne se sont accrues et embellies, que quand les serfs de la couronne et de l'Eglise ont eu des terres en propriété. Et ce qu'on doit soigneusement remarquer, c'est que si l'Eglise y a perdu des droits qui ne lui appartenaient pas, la couronne y a gagné l'extension de ses droits légitimes. Car l'Eglise, dont la première institution est d'imiter son législateur humble et pauvre, n'est point faite originairement pour s'engraisser du fruit des travaux des hommes; et le souverain, qui représente l'Etat, doit économiser le fruit de ces mêmes travaux pour le bien de l'Etat même, et pour la splendeur du trône. Partout où le peuple travaille pour l'Eglise, l'Etat est pauvre. Partout où le peuple travaille pour lui et pour le souverain, l'Etat est riche.
C'est alors que le commerce étend partout ses branches. La marine marchande devient l'école de la marine militaire. De grandes compagnies de commerce se forment. Le souverain trouve, dans les temps difficiles, des ressources auparavant inconnues. Ainsi dans les Etats autrichiens, en Angleterre, en France, vous voyez le prince emprunter facilement de ses sujets cent fois plus qu'ils n'en pouvaient arracher par la force, quand les peuples croupissaient dans la servitude.
Tous les paysans ne seront pas riches; et il ne faut pas qu'ils le soient. On a besoin d'hommes qui n'aient que leurs bras, et de la bonne volonté. Mais ces hommes mêmes, qui semblent le rebut de la fortune, participeront au bonheur des autres. Ils seront libres de vendre leur travail à qui voudra le mieux payer. Cette liberté leur tiendra lieu de propriété. L'espérance certaine d'un juste salaire les soutiendra. Ils éléveront avec gaieté leur famille dans leurs métiers laborieux et utiles. C'est surtout cette classe d'hommes si méprisables aux yeux des puissants, qui fait la pépinière des soldats. Ainsi, depuis le sceptre jusqu'à la faux et à la houlette, tout s'anime, tout prospère, tout prend une nouvelle force par ce seul ressort.
Après avoir vu s'il est avantageux à un Etat que les cultivateurs soient propriétaires, il reste à voir jusqu'où cette concession peut s'étendre. Il est arrivé dans plus d'un royaume, que le serf affranchi étant devenu riche par son industrie, s'est mis à la place de ses anciens maîtres appauvris par leur luxe. Il a acheté leurs terres, il a pris leurs noms. L'ancienne noblesse a été avilie; et la nouvelle n'a été qu'enviée et méprisée. Tout a été confondu. Les peuples qui ont souffert ces usurpations, ont été le jouet des nations qui se sont préservées de ce fléau.
Les erreurs d'un gouvernement peuvent être une leçon pour les autres. Ils profitent du bien qu'il a fait; ils évitent le mal où il est tombé.
Il est si aisé d'opposer le frein des lois à la cupidité et à l'orgueil des nouveaux parvenus; de fixer l'étendue des terrains roturiers qu'ils peuvent acheter; de leur interdire l'acquisition des grandes terres seigneuriales; que jamais un gouvernement ferme et sage ne pourra se repentir d'avoir affranchi la servitude et d'avoir enrichi l'indigence. Un bien ne produit jamais un mal que lorsque ce bien est poussé à un excès vicieux; et alors il cesse d'être bien. Les exemples des autres nations avertissent; et c'est ce qui fait que les peuples qui sont policés les derniers, surpassent souvent les maîtres dont ils ont pris les leçons.
PROVIDENCE. [p. 291]↩
J'étais à la grille lorsque soeur Fessue disait à soeur Confite, La Providence prend un soin visible de moi, vous savez comme j'aime mon moineau; il était mort, si je n'avais pas dit neuf Ave Maria pour obtenir sa guérison. Dieu a rendu mon moineau à la vie; remercions la Ste Vierge.
Un métaphysicien lui dit, Ma soeur, il n'y a rien de si bon que des Ave Maria , surtout quand une fille les récite en latin dans un faubourg de Paris; mais je ne crois pas que Dieu s'occupe beaucoup de votre moineau tout joli qu'il est; songez, je vous prie, qu'il a d'autres affaires. Il faut qu'il dirige continuellement le cours de seize planètes et de l'anneau de Saturne, au centre desquels il a placé le soleil qui est aussi gros qu'un million de nos terres. Il a des milliards de milliards d'autres soleils, de planètes et de comètes à gouverner. Ses lois immuables et son concours éternel font mouvoir la nature entière; tout est lié à son trône par une chaîne infinie dont aucun anneau ne peut jamais être hors de sa place. Si des Ave Maria avaient fait vivre le moineau de soeur Fessue un instant de plus qu'il ne devait vivre, ces Ave Maria auraient violé toutes les lois posées de toute éternité par le grand Etre; vous auriez dérangé l'univers, il vous aurait fallu un nouveau monde, un nouveau Dieu, un nouvel ordre de choses.
SOEUR FESSUE.
Quoi! vous croyez que Dieu fasse si peu de cas de soeur Fessue?
LE MÉTAPHYSICIEN.
Je suis fâché de vous dire que vous n'êtes comme moi qu'un petit chaînon imperceptible de la chaîne infinie; que vos organes, ceux de votre moineau et les miens, sont destinés à subsister un nombre déterminé de minutes dans ce faubourg de Paris.
SOEUR FESSUE.
S'il est ainsi, j'étais prédestinée à dire un nombre déterminé d' Ave Maria .
LE MÉTAPHYSICIEN.
Oui; mais ils n'ont pas forcé Dieu à prolonger la vie de votre moineau au delà de son terme. La constitution du monde portait que dans ce couvent, à une certaine heure, vous prononceriez comme un perroquet certaines paroles dans une certaine langue que vous n'entendez point; que cet oiseau né comme vous par l'action irrésistible des lois générales, ayant été malade se porterait mieux; que vous vous imagineriez l'avoir guéri avec des paroles, et que nous aurions ensemble cette conversation.
SOEUR FESSUE.
Monsieur, ce discours sent l'hérésie. Mon confesseur, le révérend père de Menou, en inférera que vous ne croyez pas à la Providence.
LE MÉTAPHYSICIEN.
Je crois la Providence générale, ma chère soeur, celle dont est émanée de toute éternité la loi qui règle toute chose, comme la lumière jaillit du soleil; mais je ne crois point qu'une Providence particulière change l'économie du monde pour votre moineau et pour votre chat.
SOEUR FESSUE.
Mais pourtant, si mon confesseur vous dit comme il me l'a dit à moi, que Dieu change tous les jours ses volontés en faveur des âmes dévotes?
LE MÉTAPHYSICIEN.
Il me dira la plus plate bêtise qu'un confesseur de filles puisse dire à un homme qui pense.
SOEUR FESSUE.
Mon confesseur une bête! sainte Vierge Marie!
LE MÉTAPHYSICIEN.
Je ne dis pas cela; je dis qu'il ne pourrait justifier que par une bêtise énorme, les faux principes qu'il vous a insinués, peut-être fort adroitement, pour vous gouverner.
SOEUR FESSUE.
Ouais! j'y penserai; cela mérite réflexion.
PUISSANCE, TOUTE-PUISSANCE. [p. 293]↩
Je suppose que celui qui lira cet article est convaincu que ce monde est formé avec intelligence, et qu'un peu d'astronomie et d'anatomie suffisent pour faire admirer cette intelligence universelle et suprême.
Encore une fois, Mens agitat molem .
Peut-il savoir par lui-même si cette intelligence est toute-puissante, c'est-à-dire infiniment puissante? a-t-il la moindre notion de l'infini pour comprendre ce que c'est qu'une puissance infinie?
Particular providence pag. 359. Le célèbre historien philosophe David Hume dit, ‘Un poids de dix onces est enlevé dans la balance par un autre poids; donc cet autre poids est de plus de dix onces; mais on ne peut apporter de raison pourquoi il doit être de cent.'
On peut dire de même, Tu reconnais une intelligence suprême assez forte pour te former, pour te conserver un temps limité, pour te récompenser, pour te punir. En sais-tu assez pour te démontrer qu'elle peut davantage?
Comment peux-tu te prouver par ta raison que cet Etre peut plus qu'il n'a fait?
La vie de tous les animaux est courte. Pouvait-il la faire plus longue?
Tous les animaux sont la pâture les uns des autres sans exception. Tout naît pour être dévoré. Pouvait-il former sans détruire?
Tu ignores quelle est sa nature. Tu ne peux donc savoir si sa nature ne l'a pas forcé de ne faire que les choses qu'il a faites.
Ce globe n'est qu'un vaste champ de destruction et de carnage. Ou le grand Etre a pu en faire une demeure éternelle de délices pour tous les êtres sensibles, ou il ne l'a pas pu. S'il l'a pu et s'il ne l'a pas fait, crains de le regarder comme malfaisant. Mais s'il ne l'a pas pu, ne crains point de le regarder comme une puissance très grande circonscrite par sa nature dans ses limites.
Qu'elle soit infinie ou non, cela ne t'importe. Il est indifférent à un sujet que son maître possède cinq cents lieues de terrain ou cinq mille, il n'en est ni plus ni moins sujet.
Lequel serait plus injurieux à cet Etre ineffable de dire, Il a fait des malheureux sans pouvoir s'en dispenser, ou il les a faits pour son plaisir?
Plusieurs sectes le représentent comme cruel; d'autres, de peur d'admettre un Dieu méchant, ont l'audace de nier son existence. Ne vaut-il pas mieux dire que probablement la nécessité de sa nature et celle des choses ont tout déterminé?
Le monde est le théâtre du mal moral et du mal physique; on ne le sent que trop; et le Tout est bien de Shaftsburi, de Bolingbroke et de Pope, n'est qu'un paradoxe de bel esprit, une mauvaise plaisanterie.
Les deux principes de Zoroastre et de Manès tant ressassés par Bayle, sont une plaisanterie plus mauvaise encore. Ce sont, comme on l'a déjà observé, les deux médecins de Molière dont l'un dit à l'autre, Passez-moi l'émétique, et je vous passerai la saignée. Le manichéisme est absurde; et voilà pourquoi il a eu un si grand parti.
J'avoue que je n'ai point été éclairé par tout ce que dit Bayle sur les manichéens et sur les pauliciens. C'est de la controverse; j'aurais voulu de la pure philosophie. Pourquoi parler de nos mystères à Zoroastre? dès que vous osez traiter nos mystères qui ne veulent que de la foi et non du raisonnement, vous vous ouvrez des précipices.
Le fatras de notre théologie scolastique n'a rien à faire avec le fatras des rêveries de Zoroastre.
Pourquoi discuter avec Zoroastre le péché originel? il n'en a jamais été question que du temps de St Augustin. Zoroastre ni aucun législateur de l'antiquité n'en avait entendu parler.
Si vous disputez avec Zoroastre, mettez sous la clef l'Ancien et le Nouveau Testament qu'il ne connaissait pas; et qu'il faut révérer sans vouloir les expliquer.
Qu'aurai-je donc dit à Zoroastre? ma raison ne peut admettre deux dieux qui se combattent, cela n'est bon que dans un poème où Minerve se querelle avec Mars. Ma faible raison est bien plus contente d'un seul grand Etre dont l'essence était de faire, et qui a fait tout ce que sa nature lui a permis, qu'elle n'est satisfaite de deux grands êtres dont l'un gâte tous les ouvrages de l'autre. Votre mauvais principe Arimane n'a pu déranger une seule des lois astronomiques et physiques du bon principe Oromaze; tout marche avec la plus grande régularité dans les cieux. Pourquoi le méchant Arimane n'aurait-il eu de puissance que sur ce petit globe de la terre?
Si j'avais été Arimane j'aurais attaqué Orosmade dans ses belles et grandes provinces de tant de soleils et d'étoiles. Je ne me serais pas borné à lui faire la guerre dans un petit village.
Il y a beaucoup de mal dans ce village. Mais d'où savons-nous que ce mal n'était pas inévitable?
Vous êtes forcé d'admettre une intelligence répandue dans l'univers; mais 1 o . Savez-vous, par exemple, si cette puissance s'étend jusqu'à prévoir l'avenir? Vous l'avez assuré mille fois; mais vous n'avez jamais pu ni le prouver, ni le comprendre. Vous ne pouvez savoir comment un être quelconque voit ce qui n'est C'est le sentiment des sociniens. pas. Or l'avenir n'est pas; donc nul être ne peut le voir. Vous vous réduisez à dire qu'il prévoit; mais prévoir c'est conjecturer.
Or un Dieu qui, selon vous, conjecture, peut se tromper. Il s'est réellement trompé dans votre système; car s'il avait prévu que son ennemi empoisonnerait ici-bas toutes ses oeuvres, il ne les aurait pas produites; il ne se serait pas préparé lui-même la honte d'être continuellement vaincu.
2 o . Ne lui fais-je pas bien plus d'honneur en disant qu'il a fait tout par la nécessité de sa nature, que vous ne lui en faites en lui suscitant un ennemi qui défigure, qui souille, qui détruit ici-bas toutes ses oeuvres?
3 o . Ce n'est point avoir de Dieu une idée indigne, que de dire qu'ayant formé des milliards de mondes où la mort et le mal n'habitent point, il a fallu que le mal et la mort habitassent dans celui-ci.
4 o . Ce n'est point rabaisser Dieu que de dire qu'il ne pouvait former l'homme sans lui donner de l'amour-propre; que cet amour-propre ne pouvait le conduire sans l'égarer presque toujours; que ses passions sont nécessaires, mais qu'elles sont funestes, que la propagation ne peut s'exécuter sans désirs; que ces désirs ne peuvent animer l'homme sans querelles, que ces querelles amènent nécessairement des guerres, etc.
5 o . En voyant une partie des combinaisons du règne végétal, animal et minéral, et ce globe percé partout comme un crible d'où tant d'exhalaisons s'échappent en foule, quel sera le philosophe assez hardi ou le scolastique assez imbécile pour voir clairement que la nature pouvait arrêter les effets des volcans, les intempéries de l'atmosphère, la violence des vents, les pestes et tous les fléaux destructeurs?
6 o . Il faut être bien puissant, bien fort, bien industrieux pour avoir formé des lions qui dévorent des taureaux, et produit des hommes qui inventent des armes pour tuer d'un seul coup non seulement les taureaux et les lions, mais encore pour se tuer les uns les autres. Il faut être très puissant pour avoir fait naître des araignées qui tendent des filets pour prendre des mouches; mais ce n'est pas être tout-puissant, infiniment puissant.
7 o . Si le grand Etre avait été infiniment puissant, il n'y a nulle raison pour laquelle il n'aurait pas fait les animaux sensibles infiniment heureux; il ne l'a pas fait, donc il ne l'a pas pu.
8 o . Toutes les sectes des philosophes ont échoué contre l'écueil du mal physique et moral. Il ne reste que d'avouer que Dieu ayant agi pour le mieux n'a pu agir mieux.
9 o . Cette nécessité tranche toutes les difficultés et finit toutes les disputes. Nous n'avons pas le front de dire tout est bien ; nous disons, Tout est le moins mal qu'il se pouvait.
10 o . Pourquoi un enfant meurt-il souvent dans le sein de sa mère? pourquoi un autre ayant eu le malheur de naître, est-il réservé à des tourments aussi longs que sa vie, terminés par une mort affreuse?
Pourquoi la source de la vie a-t-elle été empoisonnée dans toute la terre depuis la découverte de l'Amérique? pourquoi depuis le septième siècle de notre ère vulgaire la petite vérole emporte-t-elle la huitième partie du genre humain? pourquoi de tout temps les vessies ont-elles été sujettes à être des carrières de pierres? pourquoi la peste, la guerre, la famine et l'Inquisition? Tournez-vous de tous les sens, vous ne trouverez d'autre solution sinon que tout a été nécessaire.
Je parle ici aux seuls philosophes et non pas aux théologiens. Nous savons bien que la foi est le fil du labyrinthe. Nous savons que la chute d'Adam et d'Eve, le péché originel, la puissance immense donnée aux diables; la prédilection accordée par le grand Etre au peuple juif, et le baptême substitué à l'amputation du prépuce sont les réponses qui éclaircissent tout. Nous n'avons argumenté que contre Zoroastre et non contre l'université de Conimbre ou Coïmbre, à laquelle nous nous soumettons dans tous nos articles. (Voyez les Lettres de Memmius à Cicéron , et répondez-y, si vous pouvez.)
PUISSANCE, [p. 298]↩
LES DEUX PUISSANCES.
Section première.
Quiconque tient le sceptre et l'encensoir, a les deux mains fort occupées. On peut le regarder comme un homme fort habile, s'il commande à des peuples qui ont le sens commun. Mais s'il n'a à faire qu'à des imbéciles, à des espèces de sauvages, on peut le comparer au cocher de Bernier que son maître rencontra un jour dans un carrefour de Déli haranguant la populace et lui vendant de l'orviétan. Quoi! Lapierre, lui dit Bernier, tu es devenu médecin? Oui, monsieur, lui répondit le cocher, tel peuple, tel charlatan.
Le daïri des Japonais, le dalaï-lama du Thibet auraient pu en dire autant. Numa Pompilius même avec son Egérie, aurait fait la même réponse à Bernier. Melchisédec était probablement dans le cas, aussi bien que cet Anius dont parle Virgile au troisième chant de l'Enéide.
Rex Anius, rex idem hominum phoebique sacerdos
Vittis et sacra redimitus tempora lauro.
Je ne sais quel translateur du seizième siècle, a translaté ainsi ces vers de Virgile.
Anius qui fut roi tout ainsi qu'il fut prètre,
Mange à deux rateliers, et doublement est maître.
Ce charlatan Anius n'était roi que de l'île de Délos, très chétif royaume, qui après celui de Melchisédec et d'Ivetot, était un des moins considérables de la terre; mais le culte d'Apollon lui avait donné une grande réputation: il suffit d'un saint pour mettre tout un pays en crédit.
Trois électeurs allemands sont plus puissants qu'Anius, et ont comme lui le droit de mitre et de couronne, quoique subordonnés, du moins en apparence, à l'empereur romain qui n'est que l'empereur d'Allemagne. Mais de tous les pays où la plénitude du sacerdoce, et la plénitude de la royauté constitue la puissance la plus pleine qu'on puisse imaginer, c'est Rome moderne.
Le pape est regardé dans la partie de l'Europe catholique comme le premier des rois, et le premier des prêtres. Il en fut de même dans la Rome qu'on appelle païenne ; Jules César était à la fois grand pontife, dictateur, guerrier; vainqueur, très éloquent, très galant, en tout le premier des hommes; et à qui nul moderne n'a pu être comparé, excepté dans une épître dédicatoire.
Le roi d'Angleterre possède à peu près les mêmes dignités que le pape en qualité de chef de l'Eglise.
L'impératrice de Russie est aussi maîtresse absolue de son clergé dans l'empire le plus vaste qui soit sur la terre. L'idée qu'il peut exister deux puissances opposées l'une à l'autre dans un même Etat, y est regardée par le clergé même comme une chimère aussi absurde que pernicieuse.
Je dois rapporter à ce propos une lettre que l'impératrice de Russie Catherine II diagna m'écrire au mont Krapac le 22 avril 1765, et dont elle m'a permis de faire usage dans l'occasion.
‘Des capucins qu'on tolère à Moscou (car la tolérance est générale dans cet empire, il n'y a que les jésuites qui n'y sont pas soufferts) s'étant opiniâtrés cet hiver à ne pas vouloir enterrer un Français qui était mort subitement, sous prétexte qu'il n'avait pas reçu les sacrements; Abraham Chaumeix fit un factum contre eux, pour leur prouver qu'ils devaient enterrer un mort; mais ce factum, ni deux réquisitions du gouverneur ne purent porter ces pères à obéir. A la fin on leur fit dire de choisir ou de passer la frontière, ou d'enterrer ce Français; ils partirent, et j'envoyai d'ici des augustins plus dociles, qui voyant qu'il n'y avait pas à badiner, firent tout ce qu'on voulut.
‘Voilà donc Abraham Chaumeix en Russie qui devient raisonnable; il s'oppose à la persécution. S'il prenait de l'esprit, il ferait croire les miracles aux plus incrédules; mais tous les miracles du monde n'effaceront pas sa honte d'avoir été le délateur de l'Encyclopédie.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
‘Les sujets de l'Eglise souffrant des vexations souvent tyranniques, auxquelles les fréquents changements de maîtres contribuaient beaucoup, se révoltèrent vers la fin du règne de l'impératrice Elisabeth, et ils étaient à mon avènement plus de cent mille en armes. C'est ce qui fit qu'en1762 j'exécutai le projet de changer entièrement l'administration des biens du clergé, et de fixer ses revenus. Arsène évêque de Rostou, s'y opposa, poussé par quelques-uns de ses confrères, qui ne trouvèrent pas à propos de se nommer. Il envoya deux mémoires où il voulait établir le principe absurde des deux puissances. Il avait déjà fait cette tentative du temps de l'impératrice Elisabeth; on s'était contenté de lui imposer silence, mais son insolence et sa folie redoublant, il fut jugé par le métropolitain de Novogorod, et par le synode entier, condamné comme fanatique, coupable d'une entreprise contraire à la foi orthodoxe, autant qu'au pouvoir souverain; déchu de sa dignité et de la prêtrise, et livré au bras séculier. Je lui fis grâce, et je me contentai de le réduire à la condition de moine.'
Telles sont ses propres paroles; il en résulte qu'elle sait soutenir l'Eglise et la contenir; qu'elle respecte l'humanité autant que la religion; qu'elle protège le laboureur autant que le prêtre; que tous les ordres de l'Etat doivent la bénir.
J'aurai encore l'indiscrétion de transcrire ici un passage d'une de ses lettres.
‘La tolérance est établie chez nous, elle fait loi de l'Etat; il est défendu de persécuter. Nous avons, il est vrai, des fanatiques, qui faute de persécution, se brûlent eux-mêmes; mais si ceux des autres pays en faisaient autant, il n'y aurait pas grand mal, le monde en serait plus tranquille, et Calas n'aurait pas été roué.'
Ne croyez pas qu'elle écrive ainsi par un enthousiasme passager et vain qu'on désavoue ensuite dans la pratique, ni même par le désir louable d'obtenir dans l'Europe les suffrages des hommes qui pensent et qui enseignent à penser. Elle pose ces principes pour base de son gouvernement. Elle a écrit de sa main dans le conseil de législation, ces paroles qu'il faut graver aux portes de toutes les villes.
‘Dans un grand empire, qui étend sa domination sur autant de peuples divers qu'il y a de différentes croyances parmi les hommes, la faute la plus nuisible serait l'intolérance.'
Remarquez qu'elle n'hésite pas de mettre l'intolérance au rang des fautes, j'ai presque dit des délits. Ainsi une impératrice despotique détruit dans le fond du Nord la persécution et l'esclavage. Tandis que dans le Midi....
[18] Jugez après cela, monsieur, s'il se trouvera un honnête homme dans l'Europe qui ne sera pas prêt de signer le panégyrique que vous méditez. Non seulement cette princesse est tolérante, mais elle veut que ses voisins le soient. Voilà la première fois qu'on a déployé le pouvoir suprême pour établir la liberté de conscience. C'est la plus grande époque que je connaisse dans l'histoire moderne.
C'est à peu près ainsi que les anciens Persans défendirent aux Carthaginois d'immoler des hommes.
Plût à Dieu qu'au lieu des barbares qui fondirent autrefois des plaines de la Scythie et des montagnes de l'Immaüs et du Caucase vers les Alpes et les Pyrénées pour tout ravager, on vît descendre aujourd'hui des armées pour renverser le tribunal de l'Inquisition, tribunal plus horrible que les sacrifices de sang humain tant reprochés à nos pères!
Enfin, ce génie supérieur veut faire entendre à ses voisins ce que l'on commence à comprendre en Europe, que des opinions métaphysiques inintelligibles, qui sont les filles de l'absurdité, sont les mères de la discorde, et que l'Eglise au lieu de dire, Je viens apporter le glaive et non la paix, doit dire hautement, J'apporte la paix et non le glaive. Aussi l'impératrice ne veut-elle tirer l'épée que contre ceux qui veulent opprimer les dissidents.
SECTION SECONDE.
Conversation du révérend père Bouvet missionnaire de la compagnie de JESU, avec l'empereur Cam -hi, en présence de frère Attiret jésuite, tirée des mémoires secrets de la mission, en 1772.
PÉRE BOUVET.
Oui, sacrée majesté, dès que vous aurez eu le bonheur de vous faire baptiser par moi comme je l'espère, vous serez soulagé de la moitié du fardeau immense qui vous accable. Je vous ai parlé de la fable d'Atlas qui portait le ciel sur ses épaules. Hercules le soulagea et porta le ciel. Vous êtes l'Atlas, et Hercule est le pape. Il y aura deux puissances dans votre empire. Notre bon Clément XI sera la première. Ainsi vous goûterez le plus grand des biens, celui d'être oisif pendant votre vie, et d'être sauvé après votre mort.
L'EMPEREUR.
Vraiment je suis très obligé à ce cher pape qui daigne prender cette peine. Mais comment pourra-t-il gouverner mon empire à six mille lieues de chez lui?
PÉRE BOUVET.
Rien n'est plus aisé, scarée majesté impériale. Nous sommes ses vicaires apostoliques; il est vicaire de DIEU, ainsi vous serez gouverné parDIEU même.
L'EMPEREUR.
Quel paisir! je ne me sens pas d'aise. Votre vice-Dieu partagera donc avec moi les revenus de l'empire, car toute peine vaut salaire?
PÉRE BOUVET.
Notre vice-Dieu est si bon qu'il ne prendra d'ordinaire que le quart tout au-plus, excepté dans les cas de désobéissance. Notre casuel ne montera qu'à deux millions sept cent cinquante mille onces d'argent pur. C'est un bien mince object en comparaison des biens célestes.
L'EMPEREUR.
Oui, c'est marché donné. Votre Rome en tire autant apparemment du Grand Mogol mon voisin, de l'empire du Japon mon autre voisin, de l'impératrice de Russie mon autre bonne voisinne, de l'empire de Perse, de celui de Turquie.
PÉRE BOUVET.
Pas encor; mais cela viendra grâce à DIEU et à nous.
L'EMPEREUR.
Et combien vous en revient-il à vous autres?
PÉRE BOUVET.
Nous n'avons point de gages fixes; mais nous sommes comme la principale actrice d'une comédie d'un comte de Cailus mon compatriote, tout ce que je ... c'est pour moi.
L'EMPEREUR.
Mais, dites-moi, si vos princes chrétiens d'Europe paient à votre Italien à proportion de ma taxe?
PÉRE BOUVET.
Non, la moitié de cette Europe s'est séparée de lui, et ne le paie point: l'autre moitié paie le moins qu'elle peut.
L'EMPEREUR.
Vous me disiez ces jours passés qu'il était maître d'un assez joli pays.
PÉRE BOUVET.
Oui, mais ce domaine lui produit peu; il est en friche.
L'EMPEREUR.
Le pauvre homme! il ne sait pas faire cultiver sa terre et il prétend gouverner les miennes!
PÉRE BOUVET.
Autrefois dans un de nos conciles, c'est-à-dire, dans un de nos sénats de prêtres, qui se tenait dans une ville nommée Constance, notre saint père fit proposer une taxe nouvelle pour soutenir sa dignitié. L'assemblée répondit, qu'il n'avait qu'à faire labourer son domaine; mais il s'en donna bien de garde; il aima mieux vivre du produit de ceux qui labourent dans d'autres royaumes. Il lui parut que cette manière de vivre avait plus de grandeur.
L'EMPEREUR.
Oh bien, allez lui dire que non seulement je fais labourer chez moi, mais que je laboure moi-même, et je doute fort que ce soit pour lui.
PÉRE BOUVET.
Ah! sainte Vierge Marie, je suis pris pour dupe.
L'EMPEREUR.
Partez vite, j'ai été trop indulgent.
FRÈRE ATTIRET A PÉRE BOUVET.
Je vous avais bien dit que l'empereur, tout bon qu'il est, avait plus d'esprit que vous et moi.
PURGATOIRE. [p. 304]↩
Il est assez singulier que les Eglises protestantes se soient réunies à crier que le purgatoire fut inventé par les moines. Il est bien vrai qu'ils inventèrent l'art d'attraper de l'argent des vivants en priant Dieu pour les morts. Mais le purgatoire était avant tous les moines.
Ce qui peut avoir induit les doctes en erreur, c'est que ce fut le pape Jean XVI qui institua, dit-on, la fête des morts vers le milieu du dixième siècle. De cela seul je conclus qu'on priait pour eux auparavant; car si on se mit à prier pour tous, il est à croire qu'on priait déjà pour quelques-uns d'entre eux, de même qu'on n'inventa la fête de tous les saints que parce qu'on avait longtemps auparavant fêté plusieurs bienheureux. La différence entre la Toussaint et la fête des morts, c'est qu'à la première nous invoquons, et à la seconde nous sommes invoqués; à la première nous nous recommandons à tous les heureux, et à la seconde les malheureux se recommandent à nous.
Les gens les plus ignorants savent comment cette fête fut instituée d'abord à Cluni, qui était alors terre de l'empire allemand. Faut-il redire ‘que St Odilon abbé de Cluni était coutumier de délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire par ses messes et par ses prières; et qu'un jour un chevalier ou un moine revenant de la Terre-sainte, fut jeté par la tempête dans une petite île où il rencontra un ermite, lequel lui dit qu'il y avait là auprès de grandes flammes, et furieux incendies, où les trépassés étaient tourmentés, et qu'il entendait souvent les diables se plaindre de l'abbé Odilon et de ses moines, qui délivraient tous les jours quelque âme; qu'il fallait prier Odilon de continuer, afin d'accroître la joie des bienheureux au ciel, et la douleur des diables en enfer.
Tom. II, pag. 445. C'est ainsi que frère Girard jésuite, raconte la chose dans sa Fleur des saints , d'après frère Ribadeneira. Fleuri diffère un peu de cette légende, mais il en a conservé l'essentiel.
Cette révélation engagea St Odilon à instituer dans Cluni la fête des trépassés, qui ensuite fut adoptée par l'Eglise.
C'est depuis ce temps que le purgatoire valut tant d'argent à ceux qui avaient le pouvoir d'en ouvrir les portes. C'est en vertu de ce pouvoir que le roi d'Angleterre Jean ce grand terrien, surnommé sans terre , en se déclarant homme lige du pape Innocent III, et en lui soumettant son royaume, obtint la délivrance d'une âme de ses parents qui était excommuniée, pro mortuo excommunicato pro quo supplicant consanguinei .
La chancellerie romaine eut même son tarif pour l'absolution des morts; et il y eut beaucoup d'autels privilégiés, où chaque messe qu'on disait au quatorzième siècle et au quinzième, pour six liards, délivrait une âme. Les hérétiques avaient beau remontrer qu'à la vérité les apôtres avaient eu le droit de délier tout ce qui était lié sur terre, mais non pas sous terre. On leur courait sus comme à des scélérats qui osaient douter du pouvoir des clefs. Et en effet, il est à remarquer que quand le pape veut bien vous remettre cinq ou six cents ans de purgatoire, il vous fait grâce de sa pleine puissance, pro potestate à Deo accepta concedit .
DE L'ANTIQUITÉ DU PURGATOIRE.
On prétend que le purgatoire était de temps immémorial reconnu par le fameux peuple juif; et on se fonde sur le second livre des Liv. II, ch. XII, v. 42, 43 et suiv. Maccabées, qui dit expressément, ‘qu'ayant trouvé sous les habits des Juifs (au combat d'Odollam) des choses consacrées aux idoles de Jamnia, il fut manifeste que c'était pour cela qu'ils avaient péri; et ayant fait une quête de douze mille dragmes d'argent, lui qui pensait bien et religieusement de la résurrection, les envoya à Jérusalem pour les péchés des morts.
Comme nous nous sommes fait un devoir de rapporter les objections des hérétiques et des incrédules, afin de les confondre par leurs propres sentiments; nous rapporterons ici leurs difficultés sur les douze mille francs envoyés par Judas, et sur le purgatoire.
Ils disent
1 o . Que douze mille francs de notre monnaie était beaucoup pour Judas, qui soutenait une guerre de barbets contre un grand roi.
2 o . Qu'on peut envoyer un présent à Jérusalem pour les péchés des morts, afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur les vivants.
3 o . Qu'il n'était point encore question de résurrection dans ces temps-là, qu'il est reconnu que cette question ne fut agitée chez les Juifs que du temps de Gamaliel, un peu avant les prédictions de Jésus-Christ. (Voyez le Talmud tome II).
4 o . Que la loi des Juifs consistant dans le Décalogue, le Lévitique et le Deutéronome, n'ayant jamais parlé ni de l'immortalité de l'âme, ni des tourments de l'enfer; il était impossible à plus forte raison qu'elle eût jamais annoncé un purgatoire.
5 o . Les hérétiques et les incrédules font les derniers efforts pour démontrer à leur manière que tous les livres des Maccabées sont évidemment apocryphes. Voici leurs prétendues preuves.
Les Juifs n'ont jamais reconnu les livres des Maccabées pour canoniques, pourquoi les reconnaîtrions-nous?
Origène déclare formellement que l'histoire des Maccabées est à rejeter. St Jérôme juge ces livres indignes de croyance.
Le concile de Laodicée tenu en 367 ne les admit point parmi les livres canoniques; les Athanase, les Cyrille, les Hilaire les rejettent.
Les raisons pour traiter ces livres de romans, et de très mauvais romans, sont les suivantes.
L'auteur ignorant commence par la fausseté la plus reconnue Liv. I, ch. II, v. 7. de tout le monde. Il dit, Alexandre appela les jeunes nobles qui avaient été nourris avec lui dès leur enfance, et il leur partagea son royaume tandis qu'il vivait encore .
Un mensonge aussi sot et aussi grossier, ne peut venir d'un écrivain sacré et inspiré.
L'auteur des Maccabées, en parlant d'Antiochus Epiphane, dit, Ch. VI, vers. 3 et suivants. Antiochus marcha vers Elimais; il voulut la prendre et la piller, et il ne le put, parce que son discours avait été su des habitants; et ils s'élevèrent en combat contre lui. Et il s'en alla avec une tristesse grande, et retourna en Babilone. Et lorsqu'il était encore en Perse, il apprit que son armée en Juda avait pris la fuite. . . et il se mit au lit, et il mourut l'an 149 .
Liv. II, ch. IX. Le même auteur dit ailleurs tout le contraire. Il dit qu'Antiochus Epiphane voulut piller Persépolis et non pas Elimais; qu'il tomba de son chariot, qu'il fut frappé d'une plaie incurable -- qu'il fut mangé des vers -- qu'il demanda bien pardon au Dieu des Juifs, qu'il voulut se faire juif: et c'est la qu'on trouve ce verset que les fanatiques ont appliqué tant de fois à leurs ennemis, Orabat scelestus ille veniam quam non erat consecuturus . Le scélérat demandait un pardon qu'il ne devait pas obtenir. Cette phrase est bien juive. Mais il n'est pas permis à un auteur inspiré de se contredire si indignement.
Ce n'est pas tout, voici bien une autre contradiction et une Liv. I, ch. I, vers. 12. autre bévue. L'auteur fait mourir Antiochus Epiphane d'une troisième façon; on peut choisir. Il avance que ce prince fut lapidé dans le temple de Nantée. Ceux qui ont voulu excuser cette ânerie, prétendent qu'on veut parler d'Antiochus Eupator. Mais ni Epiphane, ni Eupator ne fut lapidé.
Liv. I, ch. VIII, v. 7 et 8. Ailleurs, l'auteur dit qu'un autre Antiochus (le grand) fut pris par les Romains, et qu'ils donnèrent à Eumènes les Indes et la Médie. Autant vaudrait-il dire que François I er fit prisonnier Henri VIII, et qu'il donna la Turquie au duc de Savoie. C'est insulter le Saint-Esprit d'imaginer qu'il ait dicté des absurdités si dégoûtantes.
Liv. I, ch. VIII, v. 2 et 3. Le même auteur dit que les Romains avaient conquis les Galates. Mais ils ne conquirent la Galatie que plus de cent ans après. Donc le malheureux romancier n'écrivait que plus d'un siècle après le temps où l'on suppose qu'il a écrit; et il en est ainsi de presque tous les livres juifs, à ce que disent les incrédules.
Liv. I, ch. VIII, v. 15 et 16. Le même auteur dit que les Romains nommaient tous les ans un chef du sénat. Voilà un homme bien instruit! il ne savait pas seulement que Rome avait deux consuls. Quelle foi pouvons-nous ajouter, disent les incrédules, à ces rapsodies de contes puérils, entassés sans ordre et sans choix par les plus ignorants et les plus imbéciles des hommes? Quelle honte de les croire, quelle barbarie de cannibales, d'avoir persécuté des hommes sensés pour les forcer à faire semblant de croire des pauvretés pour lesquelles ils avaient le plus profond mépris! Ainsi s'expriment des auteurs audacieux.
Notre réponse est que quelques méprises qui viennent probablement des copistes, n'empêchent point que le fond ne soit très vrai; que le Saint-Esprit à inspiré l'auteur et non les copistes; que si le concile de Laodicée a rejeté les Maccabées, ils ont été admis par le concile de Trente, dans lequel il y eut jusqu'à des jésuites; qu'ils sont reçus dans toute l'Eglise romaine, et que par conséquent nous devons les recevoir avec soumission.
DE L'ORIGINE DU PURGATOIRE.
Il est certain que ceux qui admirent le purgatoire dans la primitive Eglise, furent traités d'hérétiques; on condamna les simoniens qui admettaient la purgation des âmes. Psuken kadaron .
Liv. des Hérésies ch. XXII. St Augustin condamna depuis les origénistes qui tenaient pour ce dogme.
Mais les simoniens et les origénistes avaient-ils pris ce purgatoire dans Virgile, dans Platon, chez les Egyptiens?
Vous le trouvez clairement énoncé dans le sixième chant de Virgile, ainsi que nous l'avons déjà remarqué; et ce qui est de plus singulier, c'est que Virgile peint des âmes pendues en plein air, d'autres brûlées, et d'autres noyées.
Aliae panduntur inanes
Suspensae ad ventos, aliae sub gurgite vasto .
Infectum cluitur scelus aut exuritur igni .
L'abbé Pellegrin traduisit ainsi ces vers,
On voit ces purs esprits branler au gré des vents,
Ou noyés dans les eaux, ou brûlés dans les flammes;
C'est ainsi qu'on nettoie et qu'on purge les âmes.
Et ce qu'il y a de plus singulier encore, c'est que le pape Grégoire surnommé le Grand , non seulement adopta cette théologie de Virgile, mais dans ses dialogues il introduit plusieurs âmes qui arrivent du purgatoire, après avoir été pendues ou noyées.
Platon avait parlé du purgatoire dans son Phédon ; et il est aisé de se convaincre par la lecture du Mercure Trismégiste , que Platon avait pris chez les Egyptiens tout ce qu'il n'avait pas emprunté de Timée de Locres.
Tout cela est bien récent, tout cela est d'hier en comparaison des anciens brachmanes. Ce sont eux, il faut l'avouer, qui inventèrent le purgatoire, comme ils inventèrent aussi la révolte et la chute des génies, des animaux célestes. (Voyez l'article Brachmanes . )
C'est dans leur Shasta, ou Shastabad, écrit trois mille cent ans avant l'ère vulgaire, que mon cher lecteur trouvera le purgatoire. Ces anges rebelles dont on copia l'histoire chez les Juifs du temps du rabbin Gamaliel, avaient été condamnés par l'Eternel et par son fils, à mille ans de purgatoire; après quoi Dieu leur pardonna et les fit hommes. Nous vous l'avons déjà dit, mon cher lecteur; nous vous avons déjà représenté que les brachmanes trouvèrent l'éternité des supplices trop dure; car enfin, l'éternité est ce qui ne finit jamais. Les brachmanes pensaient comme l'abbé de Chaulieu.
Pardonne alors, Seigneur, si plein de tes bontés
Je n'ai pu concevoir que mes fragilités
Ni tous ces vains plaisirs qui passent comme un songe,
Pussent être l'objet de tes sévérités,
Et si jai pu penser que tant de cruautés'
Puniraient un peu trop la douceur d'un mensonge.
QUAKER OU QUOACRE, [p. 310]↩
OU PRIMITIF, ou MEMBRE DE LA PRIMITIVE ÉGLISE CHRÊTIENNE, OU PENSILVANIEN, OU PHILADELPHIEN.
De tous ces titres, celui que j'aime le mieux est celui de Philadelphien, ami des frères . Il y a bien des sortes de vanité; mais la plus belle est celle qui ne s'arrogeant aucun titre, rend presque tous les autres ridicules.
Je m'accoutume bientôt à voir un bon Philadelphien me traiter d'ami et de frère; ces mots raniment dans mon coeur la charité, qui se refroidit trop aisément. Mais que deux moines s'appellent, s'écrivent, votre révérence; qu'ils se fassent baiser la main en Italie et en Espagne, c'est le dernier degré d'un orgueil en démence; c'est le dernier degré de sottise dans ceux qui la baisent; c'est le dernier degré de la surprise et du rire dans ceux qui sont témoins de ces inepties. La simplicité du Philadelphien est la satire continuelle des évêques qui se monseigneurisent.
N'avez-vous point de honte, disait un laïc au fils d'un manoeuvre devenu évêque, de vous intituler monseigneur et prince? Est-ce ainsi qu'en usaient Barnabé, Philippe et Jude? Va, va, dit le prélat, si Barnabé, Philippe et Jude l'avaient pu, ils l'auraient fait; et la preuve en est, que leurs successeurs l'ont fait dès qu'ils l'ont pu.
Un autre, qui avait un jour à sa table plusieurs Gascons, disait: il faut bien que je sois monseigneur, puisque tous ces messieurs sont marquis. Vanitas vanitatum .
J'ai déjà parlé des quakers à l'article Eglise primitive , et c'est pour cela que j'en veux parler encore. Je vous prie, mon cher lecteur, de ne point dire que je me répète; car s'il y a deux ou trois pages répétées dans ces Questions sur l'Encyclopédie , ce n'est pas ma faute, c'est celle des éditeurs. Je suis malade au mont Krapac, je ne puis pas avoir l'oeil à tout. J'ai des associés qui travaillent comme moi à la vigne du Seigneur, qui cherchent à inspirer la paix et la tolérance, l'horreur pour le fanatisme, la persécution, la calomnie, la dureté de moeurs et l'ignorance insolente.
Je vous dirai sans me répéter que j'aime les quakers. Oui, si la mer ne me faisait pas un mal insupportable, ce serait dans ton sein, ô Pensilvanie! que j'irais finir le reste de ma carrière, s'il y a du reste. Tu es située au quarantième degré, dans le climat le plus doux et le plus favorable; tes campagnes sont fertiles, tes maisons commodément bâties; tes habitants industrieux, tes manufactures en honneur. Une paix éternelle règne parmi tes citoyens; les crimes y sont presque inconnus; et il n'y a qu'un seul exemple d'un homme banni du pays. Il le méritait bien; c'était un prêtre anglican qui s'étant fait quaker, fut indigne de l'être. Ce malheureux fut sans doute possédé du diable; car il osa prêcher l'intolérance; il s'appelait George Keith; on le chassa; je ne sais pas où il est allé; mais puissent tous les intolérants aller avec lui!
Aussi de trois cent mille habitants qui vivent heureux chez toi, il y a deux cent mille étrangers. On peut, pour douze guinées, acquérir cent arpents de très bonne terre; et dans ces cent arpents on est véritablement roi, car on est libre, on est citoyen, vous ne pouvez faire de mal à personne, et personne ne peut vous en faire. Vous pensez ce qu'il vous plaît, et vous le dites sans que personne vous persécute. Vous ne connaissez point le fardeau des impôts, continuellement redoublé. Vous n'avez point de cour à faire, vous ne redoutez point l'insolence d'un subalterne important. Il est vrai qu'au mont Krapac nous vivons à peu près comme vous; mais nous ne devons la tranquillité dont nous jouissons qu'aux montagnes couvertes de neiges éternelles, et aux précipices affreux qui entourent notre paradis terrestre. Encore le diable quelquefois franchit-il, comme dans Milton, ces précipices et ces monts épouvantables pour venir infecter de son haleine empoisonnée, les fleurs de notre paradis. Satan s'était déguisé en crapaud pour venir tromper deux créatures qui s'aimaient. Il est venu une fois chez nous dans sa propre figure pour apporter l'intolérance. Notre innocence a triomphé de toute la fureur du diable.
QUESTION, TORTURE. [p. 312]↩
J'ai toujours présumé que la question, la torture avait été inventée par des voleurs qui étant entrés chez un avare et ne trouvant point son trésor, lui firent souffrir mille tourments jusqu'à ce qu'il le découvrît.
On a dit souvent que la question était un moyen de sauver un coupable robuste, et de perdre un innocent trop faible; que chez les Athéniens on ne donnait la question que dans les crimes d'Etat; que les Romains n'appliquèrent jamais à la torture un citoyen romain pour savoir son secret.
Que le tribunal abominable de l'Inquisition renouvela ce supplice, et que par conséquent il doit être en horreur à toute la terre.
Qu'il est aussi absurde d'infliger la torture pour parvenir à la connaissance d'un crime, qu'il était absurde d'ordonner autrefois le duel pour juger un coupable; car souvent le coupable était vainqueur, et souvent le coupable vigoureux et opiniâtre résiste à la question tandis que l'innocent débile y succombe.
Que cependant le duel était appelé le jugement de Dieu , et qu'il ne manque plus que d'appeler la torture le jugement de Dieu .
Que la torture est un supplice plus long et plus douloureux que la mort; qu'ainsi on punit l'accusé avant d'être certain de son crime, et qu'on le punit plus cruellement qu'en le faisant mourir.
Que mille exemples funestes ont dû désabuser les législateurs de cet usage affreux.
Que cet usage est aboli dans plusieurs pays de l'Europe, et qu'on voit moins de grands crimes dans ces pays que dans le nôtre où la torture est pratiquée.
On demande après cela pourquoi la torture est toujours admise chez les Français qui passent pour un peuple doux et agréable?
On répond que cet affreux usage subsiste encore parce qu'il est établi; on avoue qu'il y a beaucoup de personnes douces et agréables en France, mais on nie que le peuple soit humain.
Si on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean Châtel, à des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera; il s'agit de la vie d'un roi et du salut de tout l'Etat. Mais que des juges d'Abbeville condamnent à la torture un jeune officier pour savoir quels sont les enfants qui ont chanté avec lui une vieille chanson, qui ont passé devant une procession de capucins sans ôter leur chapeau, j'ose presque dire que cette horreur perpétrée dans un temps de lumières et de paix, est pire que les massacres de la St Barthélemi commis dans les ténèbres du fanatisme.
Nous l'avons déjà insinué; et nous voudrions le graver bien profondément dans tous les cerveaux et dans tous les coeurs.
DU MOT QUISQUIS DE RAMUS, OU DE LA RAMÉE; [p. 313]↩
AVEC QUELQUES OBSERVATIONS UTILES SUR LES PERSÉCUTEURS, LES CALOMNIATEURS, ET LES FAISEURS DE LIBELLES.
Il vous importe fort peu, mon cher lecteur, qu'une des plus violentes persécutions excitées au seizième siècle contre Ramus, ait eu pour objet la manière dont on devait prononcer quisquis et quanquam .
Cette grande dispute partagea longtemps tous les régents de collège et tous les maîtres de pension du seizième siècle; mais elle est assoupie aujourd'hui, et probablement ne se réveillera pas.
Voulez-vous apprendre [19] si M. Gallandius Torticolis passait M. Ramus son ennemi en l'art oratoire, ou si M. Ramus passait M. Gallandius Torticolis ? Vous pourrez vous satisfaire en consultant Thomas Freigius in Vita Rami . Car Thomas Freigius est un auteur qui peut être utile aux curieux, quoi qu'en dise Banosius.
Mais que ce Ramus ou La Ramée, fondateur d'une chaire de mathématiques au Collège royal de Paris, bon philosophe dans un temps où l'on ne pouvait guère en compter que trois, Montagne, Charon, et de Thou l'historien; que ce Ramus, homme vertueux dans un siècle de crimes, homme aimable dans la société, et même si on veut bel esprit, qu'un tel homme, dis-je, ait été persécuté toute sa vie, qu'il ait été assassiné par des professeurs et des écoliers de l'université, qu'on ait traîné les lambeaux de son corps sanglant aux portes de tous les collèges comme une juste réparation faite à la gloire d'Aristote; que cette horreur, dis-je encore, ait été commise à l'édification des âmes catholiques et pieuses; ô Français! avouez que cela est un peu welche.
On me dit que depuis ces temps les choses sont bien changées en Europe, que les moeurs se sont adoucies, qu'on ne persécute plus les gens jusqu'à la mort. Quoi donc; n'avons-nous pas déjà observé dans nos Questions que le respectable Barnevelt, le premier homme de la Hollande mourut sur l'échafaud pour la plus folle et la plus impertinente dispute qui ait jamais troublé les cerveaux théologiques?
Que le procès criminel du malheureux Théophile n'eut sa source que dans quatre vers d'une ode que les jésuites Garasse et Voisin lui imputèrent, qu'ils le poursuivirent avec la fureur la plus violente et les artifices les plus noirs, qu'ils le firent brûler en effigie?
Que de nos jours cet autre procès [20] de la Cadière ne fut intenté que par la jalousie d'un jacobin contre un jésuite qui avait disputé avec lui sur la grâce?
Qu'une misérable querelle de littérature dans un café fut la première origine de ce fameux procès de Jean-Baptiste Rousseau le poète; procès, dans lequel un philosophe innocent fut sur le point de succomber par des manoeuvres bien criminelles?
N'avons-nous pas vu l'abbé Giot Desfontaines dénoncer le pauvre abbé Pellegrin comme auteur d'une pièce de théâtre, et lui faire ôter la permission de dire la messe, qui était son gagne-pain?
Le fanatique Jurieu ne persécuta-t-il pas sans relâche le philosophe Bayle; et lorsqu'il fut parvenu enfin à le faire dépouiller de sa pension et de sa place, n'eut-il pas l'infamie de le persécuter encore?
Le théologien Lange n'accusa-t-il pas Volf non seulement de ne pas croire en Dieu; mais encore d'avoir insinué dans son cours de géométrie qu'il ne fallait pas s'enrôler au service du second roi de Prusse? Et sur cette belle délation, le roi ne donna-t-il pas au vertueux Volf le choix de sortir de ses Etats dans vingt-quatre heures, ou d'être pendu? Enfin la cabale jésuitique ne voulut-elle pas perdre Fontenelle?
Je vous citerais cent exemples des fureurs de la jalousie pédantesque; et j'ose maintenir, à la honte de cette indigne passion, que si tous ceux qui ont persécuté les hommes célèbres ne les ont pas traités comme les gens de collège traitèrent Ramus, c'est qu'ils ne l'ont pas pu.
C'est surtout dans la canaille de la littérature et dans la fange de la théologie, que cette passion éclate avec le plus de rage.
Nous allons, mon cher lecteur, vous en donner quelques exemples.
EXEMPLES DES PERSECUTIONS QUE DES HOMMES DE LETTRES INCONNUS ONT EXCITÉES CONTRE DES HOMMES CONNUS.
Le catalogue de ces persécutions serait bien long; il faut se borner.
Le premier, qui éleva l'orage contre le très estimable et très regretté Helvétius, fut un petit convulsionnaire.
Si ce malheureux avait été un véritable homme de lettres, il aurait pu relever avec honnêteté les défauts du livre.
Il aurait pu remarquer que ce mot Esprit étant seul, ne signifie pas l'entendement humain, titre convenable au livre de Locke. Qu'en français le mot Esprit ne veut dire ordinairement que pensée brillante. Ainsi la manière de bien penser dans les ouvrages d' esprit signifie, dans le titre de ce livre, la manière de mettre de la justesse dans les ouvrages agréables, dans les ouvrages d'imagination. Le titre Esprit sans aucune explication, pouvait donc paraître équivoque. Et c'était assurément une bien petite faute.
Ensuite en examinant le livre, on aurait pu observer:
Que ce n'est pas parce que les singes ont les mains différentes de nous qu'ils ont moins de pensées. Car leurs mains sont comme les nôtres.
Qu'il n'est pas vrai que l'homme soit l'animal le plus multiplié sur la terre. Car dans chaque maison il y a deux ou trois mille fois plus de mouches que d'hommes.
Qu'il est faux que du temps de Néron on se plaignît de la doctrine de l'autre monde, nouvellement introduite, laquelle énervait les courages. Car cette doctrine était introduite depuis longtemps. Voyez Cicéron, Lucrèce, Virgile, etc.
Qu'il est faux que les mots nous rappellent des images ou des idées. Car les images sont des idées. Il fallait dire: des idées simples ou composées.
Qu'il est faux que la Suisse ait à proportion plus d'habitants que la France et l'Angleterre.
Qu'il est faux que le mot de libre soit le synonyme d' éclairé . Lisez le chapitre de Locke sur la puissance.
Qu'il est faux que les Romains aient accordé à César, sous le nom d' Imperator , ce qu'ils lui refusaient sous le nom de Rex . Car ils le créèrent dictateur perpétuel; et quiconque avait gagné une bataille était Imperator . Cicéron était Imperator .
Qu'il est faux que la science ne soit que le souvenir des idées d'autrui. Car Archimède et Newton inventaient.
Qu'il est faux autant que déplacé de dire que la Lecouvreur et Ninon aient eu autant d'esprit qu'Aristote et Solon. Car Solon fit des lois, Aristote quelques livres excellents; et nous n'avons rien de ces deux demoiselles.
Qu'il est faux de conclure que l'esprit soit le premier des dons, de ce que l'envie permet à chacun d'être le panégyriste de sa probité. Car premièrement, il n'est permis de parler de sa probité que quand elle est attaquée. Secondement, l'esprit est un ornement dont il est impertinent de se vanter, et la probité une chose nécessaire dont il est abominable de manquer.
Qu'il est faux que l'on devienne stupide dès qu'on cesse d'être passionné. Car au contraire, une passion violente rend l'âme stupide sur tous les autres objets.
Qu'il est faux que tous les hommes soient nés avec les mêmes talents. Car dans toutes les écoles des arts et des sciences, tous ayant les mêmes maîtres, il y en a toujours très peu qui réussissent.
Qu'enfin, sans aller plus loin, cet ouvrage d'ailleurs estimable est un peu confus, qu'il manque de méthode, et qu'il est gâté par des contes indignes d'un livre de philosophie.
Voilà ce qu'un véritable homme de lettres aurait pu remarquer. Mais de crier au déisme et à l'athéisme tout à la fois, de recourir indignement à ces deux accusations contradictoires, de cabaler pour perdre un homme d'un très grand mérite, pour le dépouiller lui et son approbateur de leurs charges, de solliciter contre lui non seulement la Sorbonne qui ne peut faire aucun mal par elle-même, mais le parlement qui en pouvait faire beaucoup; ce fut la manoeuvre la plus lâche et la plus cruelle; et c'est ce qu'ont fait deux ou trois hommes pétris de fanatisme, d'orgueil et d'envie.
DU GAZETIER ECCLÉSIASTIQUE.
Lorsque l' Esprit des lois parut, le gazetier ecclésiastique ne manqua pas de gagner de l'argent, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, en accusant dans deux feuilles absurdes le président de Montesquieu d'être déiste et athée. Sous un autre gouvernement, Montesquieu eût été perdu. Mais les feuilles du gazetier, qui, à la vérité, furent bien vendues parce qu'elles étaient calomnieuses, lui valurent aussi les sifflets et l'horreur du public.
DE PATOUILLET.
Un ex-jésuite, nommé Patouillet, s'avisa de faire en 1764 un mandement sous le nom d'un prélat, dans lequel il accusait encore deux hommes de lettres connus, d'être déistes et athées, selon la louable coutume de ces messieurs. Mais comme ce mandement attaquait aussi tous les parlements du royaume, et que d'ailleurs il était écrit d'un style de collège, il ne fut guère connu que du procureur général qui le déféra, et du bourreau qui le brûla.
DU JOURNAL CHRÊTIEN.
Quelques écrivains avaient entrepris un journal chrétien, comme si les autres journaux étaient idolâtres. Ils vendaient leur christianisme vingt sous par mois, ensuite ils le proposèrent à quinze, il tomba à douze, puis disparut à jamais. Ces bonnes gens avaient en 1760 renouvelé l'accusation ordinaire de déisme et d'athéisme contre M. de Sainte-Foy, à l'occasion de quelques faits très vrais rapportés dans l' Histoire des rues de Paris . Ils trouvèrent cette fois-là dans l'auteur qu'ils attaquaient, un homme qui se défendait mieux que Ramus: il leur fit un procès criminel au Châtelet. Ces chrétiens furent obligés de se rétracter, après quoi ils restèrent dans leur néant.
DE NONOTTE.
Un autre ex-jésuite, nommé Nonotte, dont nous avons quelquefois dit deux mots pour le faire connaître, fit encore la même manoeuvre en deux volumes, et répéta les accusations de déisme et d'athéisme contre un homme assez connu. Sa grande preuve était que cet homme avait, cinquante ans auparavant, traduit dans une tragédie deux vers de Sophocle, dans lesquels il est dit que les prêtres païens s'étaient souvent trompés. Nonotte envoya son livre à Rome au secrétaire des brefs; il espérait un bénéfice et n'en eut point; mais il obtint l'honneur inestimable de recevoir une lettre du secrétaire des brefs.
C'est une chose plaisante que tous ces dogues attaqués de la rage aient encore de la vanité. Ce Nonotte régent de collège et prédicateur de village, le plus ignorant des prédicateurs, avait imprimé dans son libelle, que Constantin fut en effet très doux et très honnête dans sa famille; qu'en conséquence le Labarum s'était fait voir à lui dans le ciel; que Dioclétien avait passé toute sa vie à massacrer des chrétiens pour son plaisir, quoiqu'il les eût protégés sans interruption pendant dix-huit années: que Clovis ne fut jamais cruel: que les rois de ce temps-là n'eurent jamais plusieurs femmes à la fois: que les confessionnaux furent en usage dès les premiers siècles de l'Eglise; que ce fut une action très méritoire de faire une croisade contre le comte de Toulouse, de lui donner le fouet, et de la dépouiller de ses Etats.
M. Damilaville daigna relever les erreurs de Nonotte, et l'avertit qu'il n'était pas poli de dire de grosses injures sans aucune raison à l'auteur de l' Essai sur les moeurs et l'esprit des nations ; qu'un critique est obligé d'avoir toujours raison, et que Nonotte avait trop rarement observé cette loi.
Comment! s'écrie Nonotte; je n'aurais pas toujours raison, moi qui suis jésuite, ou qui du moins l'ai été! Je pourrais me tromper, moi qui ai régenté en province, et qui même ai prêché! Et voilà Nonotte qui fait encore un gros livre pour prouver à l'univers que s'il s'est trompé, c'est sur la foi de quelques jésuites; que par conséquent on doit le croire. Et il entasse, il entasse bévue sur bévue, pour se plaindre à l'univers du tort qu'on lui fait; pour éclairer l'univers très peu instruit de la vanité de Nonotte et de ses erreurs.
Tous ces gens-là trouvent toujours mauvais qu'on ose se défendre contre eux. Ils ressemblent au Scaramouche de l'ancienne comédie italienne qui volait un rabat de point à Mézétin: celui-ci déchirait un peu le rabat en se défendant: et Scaramouche lui disait: Comment! insolent, vous me déchirez mon rabat!
DE LARCHET ANCIEN RÉPÉTITEUR DU COLLÈGE-MAZARIN.
Une autre lumière de collège, un nommé Larchet, pouvait, sans être un méchant homme, faire un méchant livre de critique, dans lequel il semble inviter toutes les belles dames de Paris à venir coucher pour de l'argent dans l'église Notre-Dame, avec tous les rouliers et tous les bateliers, et cela par dévotion. Il prétend que les jeunes Parisiens sont forts sujets à la sodomie; il cite pour son garant un auteur grec son favori. Il s'étend avec complaisance sur la bestialité; et il se fâche sérieusement de ce que dans un errata de son livre on a mis par mégarde, Bestialité ; lisez bêtise .
Mais ce même Larchet commence son livre comme ceux de ses confrères, par vouloir faire brûler l'abbé Bazin. Il l'accuse de déisme et d'athéisme pour avoir dit que les fléaux qui affligent la nature, viennent tous de la Providence. Et après cela M. Larchet est tout étonné qu'on se soit moqué de lui.
A présent que toutes les impostures de ces messieurs sont reconnues, que les délateurs en fait de religion, sont devenus l'opprobre du genre humain; que leurs livres, s'ils trouvent deux ou trois lecteurs n'excitent que la risée; c'est une chose divertissante de voir comment tous ces gens-là s'imaginent que l'univers a les yeux sur eux, comme ils accumulent brochures sur brochures, dans lesquelles ils prennent à témoin tout le public de leurs innombrables efforts pour inspirer les bonnes moeurs, la modération et la piété.
DES LIBELLES DE LANGLEVIEL, DIT LA BAUMELLE.
On a remarqué que tous ces écrivains subalternes de libelles diffamatoires, sont un composé d'ignorance, d'orgueil, de méchanceté et de démence. Une de leurs folies est de parler toujours d'eux-mêmes, eux qui par tant de raisons sont forcés de se cacher.
Un des plus inconcevables héros de cette espèce est un certain Langleviel de la Beaumelle, qui atteste tout le public qu'on a mal orthographié son nom. Je m'appelle Langleviel, et non pas Langlevieux, dit-il dans une de ses immortelles productions; donc, tout ce qu'on me reproche est faux, et ne peut porter sur moi.
Dans une autre lettre, voici comme il parle à l'univers attentif. [21] ‘Le six du même mois parut mon ode; on la trouva très belle, et elle l'était pour Coppenhague où je l'envoyai, et autant pour Berlin, où il y a peut-être moins de goût qu'à Coppenhague. J'avais le projet de faire imprimer les Classiques Français , mais j'en fus détourné le 27 janvier par une aventure de galanterie qui eut des suites funestes. Je fus volé par le capitaine Cocchius, [22] dont la femme m'avait fait des agaceries à l'opéra. Je fus condamné sans avoir été interrogé, ni confronté, et je fus conduit à Spandau. J'écrivis au roi. Je crois que Darget supprima mes lettres. Il écrivit à l'ingénieur Lefêvre qu'on ne cherchait qu'à me jouer un mauvais tour. Vous voyez que Darget ne me disait pas bien finement que son maître avait des impressions fâcheuses contre moi.'
Eh pauvre homme! qui dans le monde peut s'embarrasser si tu as donné une galanterie à madame Cocchius, ou si madame Cochius te l'a donnée! qu'importe que tu aies été volé par M. Cocchius ou que tu l'aies volé! qu'importe que M. Darget se soit moqué de toi! qui saura jamais que tu as fait une ode!
Le public a bien à faire que M. de la Beaumelle lui dise, qu'il partit de Gotha avec une fille qui venait de voler sa maîtresse, et qui emportait tous les effets volés. Madame la duchesse de Gotha lui fit écrire, dit-il, par un de ses ministres la lettre du monde la plus flatteuse et la plus honorable.
‘On se rapelle très bien que vous partîtes d'ici avec la gouvernante des enfants d'une dame de Gotha qui s'éclipsa furtivement après avoir volé sa maîtresse, ce dont tout le public est pleinement instruit ici; mais nous ne disons pas que vous ayez part à ce vol. A Gotha 24 juillet 1767. Signé Rousault, conseiller aulique de S. A. S.'
Ne voilà-t-il pas une belle justification, un grand titre d'honneur, aussi bien que cette autre lettre de madame la duchesse de Gotha du 15 auguste de la même année.
‘Que vous êtes aimable, mon cher ami, d'entrer si bien dans mes vues au sujet de ce misérable la Beaumelle. Croyez-moi, on ne peut rien faire de plus sage que de l'abandonner à son aventure etc.'
Est-il quelqu'un dans le monde qui s'occupe de ces aventures? est-il quelqu'un qui veuille savoir si la Beaumelle a voyagé à Gotha?
Ceux qui se nourrissent de la lecture de Cicéron, de Virgile, d'Horace, d'Ovide, ne sont pas fort empressés d'entrer dans ces détails. On s'inquiète peu si un nommé la Beaumelle a volé ou non madame Cocchius et une dame de Gotha.
Il sentit bien que s'il se bornait à faire imprimer ces belles aventures, il ne ferait pas grande fortune. Il attaqua donc dans un petit libelle intitulé Mes pensées , messieurs d'Erlac, de Sinner, de Diesbac, de Vatteville etc., et il s'en justifie en disant que c'est un ouvrage de politique. Mais dans ce même libelle qu'il appelle son Numéro XXXIII. livre de politique, il dit en propres mots, une république fondée par Cartouche aurait eu de plus sages lois que la république de Solon . Quel respect cet homme a pour les voleurs!
Numéro CLXXXIII. Le roi de Prusse ne tient son sceptre que de l'abus que l'empereur a fait de sa puissance, et de la lâcheté des autres princes . Quel juge des rois et des royaumes!
Numéro CCX. Pourquoi aurions-nous de l'horreur du régicide de Charles I er ? il serait mort aujourd'hui!
Quelle raison, ou plutôt quelle exécrable démence! Sans doute il serait mort aujourd'hui, puisque cet horrible parricide fut commis en 1648. Ainsi donc, il ne faut pas, selon Langleviel, détester Ravaillac parce que le grand Henri IV fut assassiné en 1610.
Ibid. Cromwell et Richelieu se ressemblent . Cette ressemblance est difficile à trouver: mais la folie atroce de l'auteur est aisée à reconnaître.
Il parle de messieurs de Maurepas, de Chauvelin, de Machault, de Berrier, en les nommant par leurs noms sans y mettre le M.; et il en parle avec un ton d'autorité qui fait rire.
Ensuite il fit le roman des mémoires de madame de Maintenon, dans lequel il outrage les maisons de Noailles, de Richelieu, tous les ministres de Louis XIV, tous les généraux d'armée; sacrifiant toujours la vérité à la fiction pour l'amusement des lecteurs.
Ce qui paraît son chef-d'oeuvre en ce genre, c'est sa réponse à un de nos écrivains qui avait dit en parlant de la France,
‘Je défie qu'on me montre aucune monarchie sur la terre dans laquelle les lois, la justice distributive, les droits de l'humanité aient été moins foulés aux pieds.'
Voici comme ce monsieur réfute cette assertion qui est de la plus exacte vérité.
‘Je ne puis relire ce passage sans indignation, quand je me rappelle toutes les injustices générales et particulières que commit le feu roi. Quoi! Louis XIV était juste quand il ramenait tout à lui-même, quand il oubliait (et il l'oubliait sans cesse) que l'autorité n'était confiée à un seul que pour la félicité de tous? Etait-il juste quand il armait cent mille [23] hommes pour venger l'affront fait par un fou [24] à un de ses ambassadeurs, quand en 1667 il déclarait la guerre à l'Espagne pour agrandir ses Etats malgré la légitimité d'une renonciation solennelle et libre; [25] quand il envahissait la Hollande uniquement pour l'humilier; quand il bombardait Gènes pour la punir de n'être pas son alliée; [26] quand il s'obstinait à ruiner totalement la France pour placer un de ses petits-fils sur un trône étranger? [27]
‘Etait-il juste, respectait-il les lois, était-il plein des droits de l'humanité, quand il écrasait son peuple d'impôts, [28] quand pour soutenir des entreprises imprudentes il imaginait mille nouvelles espèces de tributs, telles que le papier marqué qui excita une révolte à Rennes et à Bordeaux; quand en 1691 [29] il abîmait par quatre-vingts édits bursaux quatre-vingt mille familles; quand en 1692 [30] il extorquait l'argent de ses sujets par cinquante-cinq édits, quand en 1693 [31] il épuisait leur patience et appauvrissait leur misère par soixante autres?
‘Protégeait-il les lois, observait-il la justice distributive, respectait-il les droits de l'humanité, faisait-il de grandes choses pour le bien public, mettait-il la France au-dessus de toutes les monarchies de la terre, quand pour abattre par les fondements un édit accordé au cinquième de la nation, il sursoyait en 1676 pour trois ans les dettes des prosélytes?' [32]
Ce n'est pas le seul endroit où ce monsieur insulte avec brutalité à la mémoire d'un de nos grands rois, et qui est si chère à son successeur. Il a osé dire ailleurs que Louis XIV avait empoisonné le marquis de Louvois son ministre. [33] Que le régent avait empoisonné Tom. III, pag. 323. la famille royale, et que le père du prince de Condé d'aujourd'hui avait fait assassiner Vergier. Que la maison d'Autriche a des empoisonneurs à gages.
Une fois, il s'est avisé de faire le plaisant dans une brochure contre l'histoire de Henri IV. Quelle plaisanterie!
Page 25. ‘Je lis avec un charme infini dans l'histoire du Mogol, que le petit-fils de Sha-Abas fut bercé pendant sept ans par des femmes, qu'ensuite il fut bercé pendant huit ans par des hommes; qu'on l'accoutuma de bonne heure à s'adorer lui-même et à se croire formé d'un autre limon que ses sujets; que tout ce qui l'environnait avait ordre de lui épargner le pénible soin d'agir, de penser, de vouloir et de le rendre inhabile à toutes les fonctions du corps et de l'âme; qu'en conséquence un prêtre le dispensait de la fatigue de prier de sa bouche le grand-Etre; que certains officiers étaient préposés pour lui mâcher noblement, domme dit Rabelais, le peu de paroles qu'il avait à prononcer; que d'autres lui tâtaient le pouls trois ou quatre fois le jour comme à un agonisant; qu'à son lever, qu'à son coucher trente seigneurs accouraient, l'un pour lui dénouer l'aiguillette, l'autre pour le déconstiper, celui-ci pour l'accoutrer d'une chemise, celui-là pour l'armer d'un cimeterre, chacun pour s'emparer du membre dont il avait la surintendance. Ces particularités me plaisent, parce qu'elles me donnent une idée nette du caractère des Indiens, et que d'ailleurs elles me font assez entrevoir celui du petit-fils de Sha-Abas, de cet empereur automate.'
Cet homme est bien mal instruit de l'éducation des princes mogols. Ils sont à trois ans entre les mains des eunuques, et non entre les mains des femmes. Il n'y a point de seigneurs à leur lever et à leur coucher; on ne leur dénoue point l'aiguillette. On voit assez qui l'auteur veut désigner. Mais reconnaîtra-t-on à ce portrait le fondateur des Invalides, de l'Observatoire, de St Cyr; le protecteur généreux d'une famille royale infortunée; le conquérant de la Franche-Comté, de la Flandre française, le fondateur de la marine, le rémunérateur éclairé de tous les arts utiles ou agréables; le législateur de la France qui reçut son royaume dans le plus horrible désordre, et qui le mit au plus haut point de la gloire et de la grandeur; enfin le roi que Don Ustaris, cet homme d'Etat si estimé, appelle un homme prodigieux , malgré des défauts inséparables de la nature humaine?
Y reconnaîtra-t-on le vainqueur de Fontenoy et de Laufelt, qui donna la paix à ses ennemis étant victorieux; le fondateur de l'Ecole militaire, qui à l'exemple de son aïeul, n'a jamais manqué de tenir son conseil où est ce petit-fils automate de Sha-Abas?
Qui ne voit la délicate allusion de ce brave homme, ainsi que la profonde science de ce grand écrivain! il croit que Sha-Abas était un Mogol, et c'était un Persan de la race des Sophi. Il appelle au hasard son petit-fils automate; et ce petit-fils était Abas second fils de Saïn-Mirza, qui remporta quatre victoires contre les Turcs, et qui fit ensuite la guerre aux Mogols.
C'est ainsi que ce pauvre homme a écrit tous ses libelles. C'est ainsi qu'il fit le pitoyable roman de madame de Maintenon, parlant d'ailleurs de tout à tort et à travers, avec une suffisance qui ne serait pas permise au plus savant homme de l'Europe.
De quelle indignation n'est-on pas saisi quand on voit un misérable échappé des Cévennes, élevé par charité, et souillé des actions les plus infâmes, oser parler ainsi des rois, s'emporter jusqu'à une licence si effrénée; abuser à ce point du mépris qu'on a pour lui, et de l'indulgence qu'on a eue de ne le condamner qu'à six mois de cachot.
On ne sait pas combien de telles horreurs font tort à la littérature. C'est là pourtant ce qui lui attire des entraves rigoureuses. Ce sont ces abominables libelles dignes de la potence, qui font qu'on est si difficile sur les bons livres.
Gazetier cuirassé. Il vient de paraître un de ces ouvrages de ténèbres, où depuis le monarque jusqu'au dernier citoyen, tout le monde est insulté avec fureur; où la calomnie la plus atroce et la plus absurde distille un poison affreux sur tout ce qu'on respecte et qu'on aime. L'auteur s'est dérobé à l'exécration publique, mais La Baumelle s'y est offert.
Puissent les jeunes fous qui seraient tentés de suivre de tels exemples, et qui sans talents et sans science, ont la rage d'écrire, sentir à quoi une telle frénésie les expose. On risque la corde si on est connu; et si on ne l'est pas, on vit dans la fange et dans la crainte. La vie d'un forçat est préférable à celle d'un faiseur de libelles. Car l'un peut avoir été condamné injustement aux galères, et l'autre les mérite.
OBSERVATION SUR TOUS CES LIBELLES DIFFAMATOIRES.
Que tous ceux qui sont tentés d'écrire de telles infamies se disent: Il n'y a point d'exemple qu'un libelle ait fait le moindre bien à son auteur: jamais on ne recueillait de profit ni de gloire dans cette carrière honteuse. De tous ces libelles contre Louis XIV, il n'en est pas un seul aujourd'hui qui soit un livre de bibliothèque, et qui ne soit tombé dans un oubli profond. De cent combats meurtriers livrés dans une guerre, et dont chacun semblait devoir décider du destin d'un Etat, il en est à peine trois ou quatre qui laissent un long souvenir; les événements tombent les uns sur les autres, comme les feuilles dans l'automne pour disparaître sur la terre; et un gredin voudrait que son libelle obscur demeurât dans la mémoire des hommes? Le gredin vous répond: On se souvient des vers d'Horace contre Pantolabus, contre Nomentanus; et de ceux de Boileau contre Cotin et l'abbé de Pure. On réplique au gredin: Ce ne sont point là des libelles; si tu veux mortifier tes adversaires, tâche d'imiter Boileau et Horace. Mais quand tu auras un peu de leur bon sens et de leur génie, tu ne feras plus de libelles.
RAISON. [p. ibid .]↩
Dans le temps que toute la France était folle du système de Lass, et qu'il était contrôleur général, un homme qui avait toujours raison vint lui dire en présence d'une grande assemblée:
Monsieur, vous êtes le plus grand fou, le plus grand sot, ou le plus grand fripon qui ait encore paru parmi nous; et c'est beaucoup dire. Voici comme je le prouve. Vous avez imaginé qu'on peut décupler les richesses d'un Etat avec du papier. Mais ce papier ne pouvant représenter que l'argent représentatif des vraies richesses, qui sont les productions de la terre et les manufactures; il faudrait que vous eussiez commencé par nous donner dix fois plus de blé, de vin, de drap et de toile etc. Ce n'est pas assez; il faudrait être sûr du débit.
Or vous faites dix fois plus de billets que nous n'avons d'argent et de denrées. Donc vous êtes dix fois plus extravagant, ou plus inepte, ou plus fripon que tous les contrôleurs ou surintendants qui vous ont précédé. Voici d'abord comme je prouve ma majeure.
A peine avait-il commencé sa majeure qu'il fut conduit à St Lazare.
Quand il fut sorti de St Lazare, où il étudia beaucoup et où il fortifia sa raison, il alla à Rome; il demanda une audience publique au pape, à condition qu'on ne l'interromprait point dans sa harangue; et il lui parla en ces termes.
Saint Père, vous êtes un Antéchrist: et voici comme je le prouve à votre sainteté. J'appelle Antéchrist ou Antichrist, selon la force du mot, celui qui fait tout le contraire de ce que le Christ a fait et commandé. Or le Christ a été pauvre, et vous êtes très riche. Il a payé le tribut, et vous exigez des tributs. Il a été soumis aux puissances, et vous êtes devenu puissance. Il marchait à pied, et vous allez à Castel-Gandolphe dans un équipage somptueux. Il mangeait tout ce qu'on voulait bien lui donner, et vous voulez que nous mangions du poisson le vendredi et le samedi quand nous habitons loin de la mer et des rivières. Il a défendu à Simon Barjone de se servir de l'épée, et vous avez des épées à votre service, etc. etc. etc. Donc en ce sens votre sainteté est Antichrist. Je vous révère fort en tout autre sens, et je vous demande une indulgence in articulo mortis . On mit mon homme au château St Ange.
Quand il fut sorti du château St Ange, il courut à Venise, et demanda à parler au doge. Il faut, lui dit-il, que votre sérénité soit un grand extravagant d'épouser tous les ans la mer. Car premièrement, on ne se marie qu'une fois avec la même personne. Secondement, votre mariage ressemble à celui d'Arlequin, lequel était à moitié fait, attendu qu'il ne manquait que le consentement de la future. Troisièmement, qui vous a dit qu'un jour d'autres puissances maritimes, ne vous déclareraient pas inhabile à consommer le mariage?
Il dit; et on l'enferma dans la tour de St Marc.
Quand il fut sorti de la tour de St Marc, il alla à Constantinople; il eut audience du mufti, et lui parla en ces termes: Votre religion, quoiqu'elle ait de bonnes choses, comme l'adoration du Grand Etre et la nécessité d'être juste et charitable, n'est d'ailleurs qu'un réchauffé du judaïsme, et un ramas ennuyeux de contes de ma mère l'oie. Si l'archange Gabriel avait apporté de quelque planète les feuilles du Koran à Mahomet, toute l'Arabie aurait vu descendre Gabriel. Personne ne l'a vu. Donc Mahomet n'était qu'un imposteur hardi qui trompa des imbéciles.
A peine eut-il prononcé ces paroles qu'il fut empalé. Cependant il avait eu toujours raison.
RARE. [p. 329]↩
Rare en physqiue est opposé à dense. En morale, il est opposé à commun.
Ce dernier rare est ce qui excite l'admiration. On n'admire jamais ce qui est commun, on en jouit.
Un curieux se préfère au reste des chétifs mortels, quand il a dans son cabinet une médaille rare qui n'est bonne à rien; un livre rare que personne n'a le courage de lire, une vieille estampe d'Albert-dure, mal dessinée et mal empreinte; il triomphe s'il a dans son jardin un arbre rabougri venu d'Amérique. Ce curieux n'a point de goût, il n'a que la vanité. Il a ouï dire que le beau est rare; mais il devrait savoir que tout rare n'est point beau.
Le beau est rare dans tous les ouvrages de la nature, et dans ceux de l'art.
Quoiqu'on ait dit bien du mal des femmes, je maintiens qu'il est plus rare de trouver des femmes parfaitement belles que de passablement bonnes.
Vous rencontrerez dans les campagnes dix mille femmes attachées à leur ménage, laborieuses, sobres, nourrissant, élevant, instruisant leurs enfants; et vous en trouverez à peine une que vous puissiez montrer aux spectacles de Paris, de Londres, de Naples, ou dans les jardins publics, et qu'on puisse regarder comme une beauté.
De même, dans les ouvrages de l'art, vous avez dix mille barbouillages contre un chef-d'oeuvre.
Si tout était beau et bon, il est clair qu'on n'admirerait plus rien; on jouirait. Mais aurait-on du plaisir en jouissant? c'est une grande question?
Pourquoi les beaux morceaux du Cid , des Horaces , de Cinna , eurent-ils un succès si prodigieux? c'est que dans la profonde nuit où l'on était plongé, on vit briller tout à coup une lumière nouvelle que l'on n'attendait pas. C'est que ce beau était la chose du monde la plus rare.
Les bosquets de Versailles étaient une beauté unique dans le monde, comme l'étaient alors certains morceaux de Corneille. St Pierre de Rome est unique, et on vient du bout du monde s'extasier en le voyant.
Mais supposons que toutes les églises de l'Europe égalent St Pierre de Rome, que toutes les statues soient des Vénus de Médicis, que toutes les tragédies soient aussi belles que l' Iphigénie de Racine, tous les ouvrages de poésie aussi bien faits que l' Art poétique de Boileau, toutes les comédies aussi bonnes que le Tartuffe , et ainsi en tout genre; aurez-vous alors autant de plaisir à jouir des chefs-d'oeuvre rendus communs, qu'ils vous en faisaient goûter quand ils étaient rares? je dis hardiment que non. Et je crois qu'alors l'ancienne école a raison, elle qui l'a si rarement. Ab assuetis non fit passio . Habitude ne fait point passion.
Mais, mon cher lecteur, en sera-t-il de même dans les oeuvres de la nature? Serez-vous dégoûté si toutes les filles sont belles comme Hélène; et vous, mesdames, si tous les garçons sont des Pâris? Supposons que tous les vins soient excellents, aurez-vous moins d'envie de boire? si les perdreaux, les faisandeaux, les gelinottes sont communs en tout temps, aurez-vous moins d'appétit? je dis encore hardiment que non, malgré l'axiome de l'école, habitude ne fait point passion . Et la raison, vous le savez; c'est que tous les plaisirs que la nature nous donne sont des besoins toujours renaissants, des jouissances nécessaires, et que les plaisirs des arts ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire à l'homme d'avoir des bosquets où l'eau jaillisse jusqu'à cent pieds de la bouche d'une figure de marbre, et d'aller au sortir de ces bosquets voir une belle tragédie. Mais les deux sexes sont toujours nécessaires l'un à l'autre. La table et le lit sont nécessaires. L'habitude d'être alternativement sur ces deux trônes ne vous dégoûtera jamais.
Quand les petits Savoyards montrèrent pour la première fois la rareté, la curiosité, rien n'était plus rare en effet. C'était un chef-d'oeuvre d'optique inventé, dit-on, par Kirker; mais cela n'était pas nécessaire, et il n'y a plus de fortune à espérer dans ce grand art.
On admira dans Paris un rhinocéros il y a quelques années. S'il y avait dans une province dix mille rhinocéros, on ne courrait après eux que pour les tuer. Mais qu'il y ait cent mille belles femmes, on courra toujours après elles pour . . . les honorer.
RAVAILLAC. [p. 331]↩
J'ai connu dans mon enfance un chanoine de Péronne, âgé de quatre-vingt-douze ans, qui avait été élevé par un des plus furieux bourgeois de la Ligue. Il disait toujours, Feu monsieur de Ravaillac . Ce chanoine avait conservé plusieurs manuscrits très curieux de ces temps apostoliques, quoiqu'ils ne fissent pas beaucoup d'honneur à son parti; en voici un qu'il laissa à mon oncle.
DIALOGUE d'un page du duc de Sully, & de maître Filesac, docteur de Sorbonne , l'un des deux confesseurs de Ravaillac.
MAITRE FILESAC.
Dieu merci, mon cher enfant, Ravaillac est mort comme un saint. Je l'ai entendu en confession; il s'est repenti de son péché, et a fait un ferme propos de n'y plus retomber. Il voulait recevoir la sainte communion; mais ce n'est pas ici l'usage comme à Rome; sa pénitence lui en a tenu lieu; et il est certain qu'il est en paradis.
LE PAGE.
Lui en paradis? dans le jardin? lui! ce monstre!
MAITRE FILESAC.
Oui, mon bel enfant, dans le jardin, dans le ciel, c'est la même chose.
LE PAGE.
Je le veux croire; mais il a pris un mauvais chemin pour y arriver.
MAITRE FILESAC.
Vous parlez en jeune huguenot. Apprenez que ce que je vous dis est de foi. Il a eu l'attrition; et cette attrition jointe au sacrement de confession, opère immanquablement salvation, qui mène droit en paradis où il prie maintenant Dieu pour vous.
LE PAGE.
Je ne veux point du tout qu'il parle à Dieu de moi. Qu'il aille au diable avec ses prières et son attrition.
MAITRE FILESAC.
Dans le fond c'était une bonne âme. Son zèle l'a emporté, il a mal fait, mais ce n'était pas en mauvaise intention. Car dans tous ses interrogatoires il a répondu qu'il n'avait assassiné le roi que parce qu'il allait faire la guerre au pape, et que c'était la faire à Dieu. Ses sentiments étaient fort chrétiens. Il est sauvé, vous dis-je; il était lié, et je l'ai délié.
LE PAGE.
Ma foi, plus je vous écoute, plus vous me paraissez un homme à lier vous-même. Vous me faites horreur.
MAITRE FILESAC.
C'est que vous n'êtes pas encore dans la bonne voie; vous y serez un jour. Je vous ai toujours dit que vous n'étiez pas loin du royaume des cieux, mais le moment n'est pas encore venu.
LE PAGE.
Le moment ne viendra jamais de me faire croire que vous avez envoyé Ravaillac en paradis.
MAITRE FILESAC.
Dès que vous serez converti, comme je l'espère, vous le croirez comme moi; mais en attendant, sachez que vous et le duc de Sully votre maître, vous serez damnés à toute éternité avec Judas Iscariote et le mauvais riche, tandis que Ravaillac est dans le sein d'Abraham.
LE PAGE.
Comment coquin!
MAITRE FILESAC.
Point d'injures, petit fils; il est défendu d'appeler son frère raca . On est alors coupable de la géhenne ou gebenne du feu. Souffrez que je vous endoctrine sans vous fâcher.
LE PAGE.
Va, tu me parais si raca que je ne me fâcherai plus.
MAITRE FILESAC.
Je vous disais donc, qu'il est de foi que vous serez damné; et malheureusement notre cher Henri IV l'est déjà, comme la Sorbonne l'avait toujours prévu.
LE PAGE.
Mon cher maître damné! attends, attends, scélérat, un bâton, un bâton.
MAITRE FILESAC.
Calmez-vous, petit fils, vous m'avez promis de m'écouter patiemment. N'est-il pas vrai que le grand Henri est mort sans confession? n'est-il pas vrai qu'il était en péché mortel, étant encore amoureux de madame la princesse de Condé, et qu'il n'a pas eu le temps de demander le sacrement de pénitence; Dieu ayant permis qu'il ait été frappé à l'oreillette gauche du coeur, et que le sang l'ait étouffé en un instant? Vous ne trouverez assurément aucun bon catholique qui ne vous dise les mêmes vérités que moi.
LE PAGE.
Tais-toi, maître fou; si je croyais que tes docteurs enseignassent une doctrine si abominable, j'irais sur-le-champ les brûler dans leurs loges.
MAITRE FILESAC.
Encore une fois, ne vous emportez pas, vous l'avez promis. Monseigneur le marquis de Conchini qui est un bon catholique, saurait bien vous empêcher d'être assez sacrilège pour maltraiter mes confrères.
LE PAGE.
Mais en conscience, maître Filesac, est-il bien vrai que l'on pense ainsi dans ton parti?
MAITRE FILESAC.
Soyez-en très sûr; c'est notre catéchisme.
LE PAGE.
Ecoute; il faut que je t'avoue qu'un de tes sorboniqueurs m'avait presque séduit l'an passé. Il m'avait fait espérer une pension sur un bénéfice. Puisque le roi, me disait-il, a entendu la messe en latin, vous qui n'êtes qu'un petit gentilhomme, vous pourriez bien l'entendre aussi sans déroger. Dieu a soin de ses élus, il leur donne des mitres, des crosses, et prodigieusement d'argent. Vos réformés vont à pied, et ne savent qu'écrire. Enfin, j'étais ébranlé; mais après ce que tu viens de me dire, j'aimerais cent fois mieux me faire mahométan que d'être de ta secte.
Ce page avait tort. On ne doit point se faire mahométan parce qu'on est affligé; mais il faut pardonner à un jeune homme sensible, et qui aimait tant Henri IV.
Maître Filesac parlait suivant sa théologie, et le petit page selon son coeur.
RELIGION. [p. 335]↩
SECTION PREMIÈRE.
Les épicuriens qui n'avaient nulle religion, recommandaient l'éloignement des affaires publiques, l'étude et la concorde. Cette secte était une société d'amis; car leur principal dogme était l'amitié. Atticus, Lucrèce, Memmius et quelques hommes de cette trempe, pouvaient vivre très honnêtement ensemble, et cela se voit dans tous les pays; philosophez tant qu'il vous plaira entre vous. Je crois entendre des amateurs qui se donnent un concert d'une musique savante et raffinée; mais gardez-vous d'exécuter ce concert devant le vulgaire ignorant et brutal; il pourrait vous casser vos instruments sur vos têtes. Si vous avez une bourgade à gouverner, il faut qu'elle ait une religion.
Je ne parle point ici de la nôtre; elle est la seule bonne, la seule nécessaire, la seule prouvée, et la seconde révélée.
Aurait-il été possible à l'esprit humain, je ne dis pas d'admettre une religion qui approchât de la nôtre, mais qui fût moins mauvaise que toutes les autres religions de l'univers ensemble? et quelle serait cette religion?
Ne serait-ce point celle qui nous proposerait l'adoration de l'Etre suprême, unique, infini, éternel, formateur du monde, qui le meut et le vivifie, cui nec simile nec secundum , celle qui nous réunirait à cet Etre des êtres pour prix de nos vertus, et qui nous en séparerait pour le châtiment de nos crimes?
Celle qui admettrait très peu de dogmes inventés par la démence orgueilleuse, éternels sujets de dispute; celle qui enseignerait une morale pure, sur laquelle on ne disputa jamais?
Celle qui ne ferait point consister l'essence du culte dans des vaines cérémonies, comme de vous cracher dans la bouche, de vous ôter un bout de votre prépuce, ou de vous couper un testicule, attendu qu'on peut remplir tous les devoirs de la société avec deux testicules, et un prépuce entier, et sans qu'on vous crache dans la bouche?
Celle de servir son prochain pour l'amour de Dieu au lieu de le persécuter, de l'égorger au nom de Dieu; celle qui tolérerait toutes les autres, et qui méritant ainsi la bienveillance de toutes, serait seule capable de faire du genre humain un peuple de frères?
Celle qui aurait des cérémonies augustes dont le vulgaire serait frappé, sans avoir des mystères qui pourraient révolter les sages et irriter les incrédules?
Celle qui offrirait aux hommes plus d'encouragements aux vertus sociales, que d'expiations pour les perversités?
Celle qui assurerait à ses ministres un revenu assez honorable pour les faire subsister avec décence, et ne leur laisserait jamais usurper des dignités et un pouvoir qui pourraient en faire des tyrans? Celle qui établirait des retraites commodes pour la vieillesse et pour la maladie, mais jamais pour la fainéantise?
Une grande partie de cette religion est déjà dans le coeur de plusieurs princes, et elle sera dominante dès que les articles de paix perpétuelle que l'abbé de St Pierre a proposés seront signés de tous les potentats.
SECTION SECONDE.
Je méditais cette nuit; j'étais absorbé dans la contemplation de la nature; j'admirais l'immensité, le cours, les rapports de ces globes infinis que le vulgaire ne sait pas admirer.
J'admirais encore plus l'intelligence qui préside à ces vastes ressorts. Je me disais, il faut être aveugle pour n'être pas ébloui de ce spectacle; il faut être stupide pour n'en pas reconnaître l'auteur; il faut être fou pour ne pas l'adorer. Quel tribut d'adoration dois-je lui rendre? ce tribut ne doit-il pas être le même dans toute l'étendue de l'espace, puisque c'est le même pouvoir suprême qui règne également dans cette étendue?
Un être pensant qui habite dans une étoile de la voie lactée, ne lui doit-il pas le même hommage que l'être pensant sur ce petit globe où nous sommes? La lumière est uniforme pour l'astre de Sirius et pour nous. La morale doit être uniforme.
Si un animal sentant et pensant dans Sirius est né d'un père et d'une mère tendre qui aient été occupés de son bonheur, il leur doit autant d'amour et de soins que nous en devons ici à nos parents. Si quelqu'un dans la voie lactée voit un indigent estropié; s'il peut le soulager et s'il ne le fait pas, il est coupable envers tous les globes.
Le coeur a partout les mêmes devoirs, sur les marches du trône de Dieu, s'il a un trône, et au fond de l'abîme, s'il est un abîme.
J'étais plongé dans ces idées, quand un de ces génies qui remplissent les intermondes, descendit vers moi. Je reconnus cette même créature aérienne qui m'avait apparu autrefois pour m'apprendre combien les jugements de Dieu diffèrent des nôtres, et combien une bonne action est préférable à la controverse. (Voyez l'article Dogme .)
Il me transporta dans un désert tout couvert d'ossements entassés; et entre ces monceaux de morts il y avait des allées d'arbres toujours verts, et au bout de chaque allée un grand homme d'un aspect auguste, qui regardait avec compassion ces tristes restes.
Hélas! mon archange, lui dis-je, où m'avez-vous mené? à la désolation, me répondit-il. Et qui sont ces beaux patriarches que je vois immobiles et attendris au bout de ces allées vertes, et qui semblent pleurer sur cette foule innombrable de morts? Tu le sauras, pauvre créature humaine, me répliqua le génie des intermondes; mais auparavant il faut que tu pleures.
Il commença par le premier amas. Ceux-ci, dit-il, sont les vingt-trois mille Juifs qui dansèrent devant un veau, avec les vingt-quatre mille qui furent tués sur des filles madianites. Le nombre des massacrés pour des délits, ou des méprises pareilles, se monte à près de trois cent mille.
Aux allées suivantes sont les charniers des chrétiens égorgés les uns par les autres pour des disputes métaphysiques. Ils sont divisés en plusieurs monceaux de quatre siècles chacun. Un seul aurait monté jusqu'au ciel; il a fallu les partager.
Quoi! m'écriai-je, des frères ont traité ainsi leurs frères, et j'ai le malheur d'être dans cette confrérie!
Voici, dit l'esprit, les douze millions d'Américains tués dans leur patrie, parce qu'ils n'avaient pas été baptisés. Eh mon Dieu que ne laissiez-vous ces ossements affreux se dessécher dans l'hémisphère où leurs corps naquirent, et où ils furent livrés à tant de trépas différents? Pourquoi réunir ici tous ces monuments abominables de la barbarie et du fanatisme? -- Pour t'instruire.
Puisque tu veux m'instruire, dis-je au génie, apprends-moi s'il y a eu d'autres peuples que les chrétiens et les Juifs à qui le zèle, et la religion malheureusement tournée en fanatisme, aient inspiré tant de cruautés horribles. Oui, me dit-il; les mahométans se sont souillés des mêmes inhumanités, mais rarement; et lorsqu'on leur a demandé amman , miséricorde, et qu'on leur a offert le tribut, ils ont pardonné.
Pour les autres nations, il n'y en a aucune depuis l'existence du monde qui ait jamais fait une guerre purement de religion. Suis-moi maintenant. Je le suivis.
Un peu au delà de ces piles de morts nous trouvâmes d'autres piles; c'étaient des sacs d'or et d'argent, et chacune avait son étiquette. Substance des hérétiques massacrés au dix-huitième siècle, au dix-sept, au seizième. Et ainsi en remontant: Or et argent des Américains égorgés , etc. etc. Et toutes ces piles étaient surmontées de croix, de mitres, de crosses, de tiares enrichies de pierreries.
Quoi! mon génie, ce fut donc pour avoir ces richesses qu'on accumula ces morts? -- Oui, mon fils.
Je versai des larmes; et quand j'eus mérité par ma douleur qu'il me menât au bout des allées vertes, il m'y conduisit.
Contemple, me dit-il, les héros de l'humanité qui ont été les bienfaiteurs de la terre, et qui se sont tous réunis à bannir du monde autant qu'ils l'ont pu, la violence et la rapine. Interroge-les.
Je courus au premier de la bande; il avait une couronne sur la tête, et un petit encensoir à la main; je lui demandai humblement son nom. Je suis Numa Pompilius, me dit-il; je succédai à un brigand et j'avais des brigands à gouverner: je leur enseignai la vertu et le culte de Dieu; ils oublièrent après moi plus d'une fois l'un et l'autre; je défendis qu'il y eût dans les temples aucun simulacre, parce que la Divinité qui anime la nature ne peut être représentée. Les Romains n'eurent sous mon règne ni guerres ni séditions; et ma religion ne fit que du bien. Tous les peuples voisins vinrent honorer mes funérailles; ce qui n'est arrivé qu'à moi.
Je lui baisai la main, et j'allai au second; c'était un beau vieillard d'environ cent ans, vêtu d'une robe blanche; il mettait le doigt médium sur sa bouche; et de l'autre main il jetait des fèves derrière lui. Je reconnus Pythagore. Il m'assura qu'il n'avait jamais eu de cuisse d'or et qu'il n'avait point été coq; mais qu'il avait gouverné les Crotoniates avec autant de justice que Numa gouvernait les Romains, à peu près de son temps; et que cette justice était la chose du monde la plus nécessaire et la plus rare. J'appris que les pythagoriciens faisaient leur examen de conscience deux fois par jour. Les honnêtes gens! et que nous sommes loin d'eux! Mais nous qui n'avons été pendant treize cents ans que des assassins, nous disons que ces sages étaient des orgueilleux.
Je ne dis mot à Pythagore pour lui plaire; et je passai à Zoroastre qui s'occupait à concentrer le feu céleste dans le foyer d'un miroir concave, au milieu d'un vestibule à cent portes [34] qui toutes conduisaient à la sagesse. Sur la principale de ces portes, je lus ces paroles qui sont le précis de toute la morale, et qui abrègent toutes les disputes des casuistes:
DANS LE DOUTE SI UNE ACTION EST BONNE
OU MAUVAISE, ABSTIENS-TOI.
Certainement, dis-je à mon génie, les barbares qui ont immolé toutes les victimes dont j'ai vu les ossements, n'avaient pas lu ces belles paroles.
Nous vîmes ensuite les Zaleucus, les Thalès, les Anaximandres et tous les sages qui avaient cherché la vérité et pratiqué la vertu.
Quand nous fûmes à Socrate, je le reconnus bien vite à son nez épaté. Eh bien, lui dis-je, vous voilà donc au nombre des confidents du Très-Haut! tous les habitants de l'Europe, excepté les Turcs et les Tartares de Crimée qui ne savent rien, prononcent votre nom avec respect. On le révère, on l'aime ce grand nom, au point qu'on a voulu savoir ceux de vos persécuteurs. On connaît Melitus et Anitus à cause de vous, comme on connaît Ravaillac à cause de Henri IV. Mais je ne connais que ce nom d'Anitus. Je ne sais pas précisément quel était ce scélérat par qui vous fûtes calomnié, et qui vint à bout de vous faire condamner à la ciguë.
Je n'ai jamais pensé à cet homme depuis mon aventure, me répondit Socrate; mais puisque vous m'en faites souvenir, je le Voyez Xenophon . plains beaucoup. C'était un méchant prêtre qui faisait secrètement un commerce de cuirs, négoce réputé honteux parmi nous. Il envoya ses deux enfants dans mon école. Les autres disciples leur reprochèrent leur père le corroyeur. Ils furent obligés de sortir. Le père irrité n'eut point de cesse qu'il n'eût ameuté contre moi tous les prêtres et tous les sophistes. On persuada au conseil des cinq cents que j'étais un impie, qui ne croyait pas que la Lune, Mercure et Mars fussent des dieux. En effet, je pensais comme à présent qu'il n'y a qu'un Dieu, maître de toute la nature. Les juges me livrèrent à l'empoisonneur de la république; il accourcit ma vie de quelques jours; je mourus tranquillement à l'âge de soixante et dix ans: et depuis ce temps-là je passe une vie heureuse avec tous ces grands hommes que vous voyez et dont je suis le moindre.
Après avoir joui quelque temps de l'entretien de Socrate, je m'avançai avec mon guide dans un bosquet situé au-dessus des bocages où tous ces sages de l'antiquité semblaient goûter un doux repos.
Je vis un homme d'une figure douce et simple qui me parut âgé d'environ trente-cinq ans. Il jetait de loin des regards de compassion sur ces amas d'ossements blanchis, à travers desquels on m'avait fait passer pour arriver à la demeure des sages. Je fus étonné de lui trouver les pieds enflés et sanglants, les mains de même, le flanc percé, et les côtes écorchées de coups de fouet. Eh bon Dieu, lui dis-je, est-il possible qu'un juste, un sage soit dans cet état? je viens d'en voir un qui a été traité d'une manière bien odieuse: mais il n'y a pas de comparaison entre son supplice et le vôtre; de mauvais prêtres et de mauvais juges l'ont empoisonné. Est-ce aussi par des prêtres et par des juges que vous avez été assassiné si cruellement?
Il me répondit oui avec beaucoup d'affabilité.
Et qui étaient donc ces monstres?
C'étaient des hypocrites .
Ah! c'est tout dire, je comprends par ce seul mot qu'ils durent vous condamner au dernier supplice. Vous leur aviez donc prouvé comme Socrate que la Lune n'était pas une déesse, et que Mercure n'était pas un dieu?
Non, il n'était pas question de ces planètes. Mes compatriotes ne savaient point du tout ce que c'est qu'une planète; ils étaient tous de francs ignorants. Leurs superstitions étaient toutes différentes de celles des Grecs .
Vous voulûtes donc leur enseigner une nouvelle religion?
Point du tout; je leur disais simplement, Aimez Dieu de tout votre coeur, et votre prochain comme vous-même, car c'est là tout l'homme. Jugez si ce précepte n'est pas aussi ancien que l'univers; jugez si je leur apportais un culte nouveau. Je ne cessais de leur dire que j'etais venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir; j'avais observé tous leurs rites; circoncis comme ils l'étaient tous, baptisé comme l'étaient les plus zélés d'entre eux, je payais comme eux le corban, je faisais comme eux la pâque en mangeant debout un agneau cuit dans des laitues. Moi et mes amis nous allions prier dans le temple; mes amis mêmes fréquentèrent ce temple après ma mort; en un mot, j'accomplis toutes leurs lois sans en excepter une .
Quoi! ces misérables n'avaient pas même à vous reprocher de vous être écarté de leurs lois?
Non, sans doute .
Pourquoi donc vous ont-ils mis dans l'état où je vous vois?
Que voulez-vous que je vous dise! ils étaient fort orgueilleux et intéressés. Ils virent que je les connaissais; ils surent que je les faisais connaître aux citoyens; ils étaient les plus forts; ils m'ôtèrent la vie. Et leurs semblables en feront toujours autant, s'ils le peuvent, à quiconque leur aura trop rendu justice .
Mais, ne dîtes-vous, ne fîtes-vous rien qui pût leur servir de prétexte?
Tout sert de prétexte aux méchants .
Ne leur dîtes-vous pas une fois que vous étiez venu apporter le glaive et non la paix?
C'est une erreur de copiste; je leur dis que j'apportais la paix et non le glaive; je n'ai jamais rien écrit. On a pu changer ce que j'avais dit sans mauvaise intention .
Vous n'avez donc contribué en rien par vos discours ou mal rendus, ou mal interprétés, à ces monceaux affreux d'ossements que j'ai vus sur ma route en venant vous consulter?
Je n'ai vu qu'avec horreur ceux qui se sont rendus coupables de tous ces meurtres .
Et ces monuments de puissance et de richesse, d'orgueil et d'avarice, ces trésors, ces ornements, ces signes de grandeur que j'ai vus accumulés sur la route en cherchant la sagesse, viennent-ils de vous?
Cela est impossible; j'ai vécu moi et les miens dans la pauvreté et dans la bassesse; ma grandeur n'était que dans la vertu .
J'étais prêt de le supplier de vouloir bien me dire au juste qui il était. Mon guide m'avertit de n'en rien faire. Il me dit que je n'étais pas fait pour comprendre ces mystères sublimes. Je le conjurai seulement de m'apprendre en quoi consistait la vraie religion.
Ne vous l'ai-je pas déjà dit? aimez Dieu et votre prochain comme vous-même .
Quoi! en aimant Dieu on pourrait manger gras le vendredi?
J'ai toujours mangé ce qu'on m'a donné; car j'étais trop pauvre pour donner à dîner à personne.
En aimant Dieu, en étant juste, ne pourrait-on pas être assez prudent pour ne point confier toutes les aventures de sa vie à un inconnu?
C'est ainsi que j'en ai toujours usé .
Ne pourrai-je en faisant du bien me dispenser d'aller en pèlerinage à St Jacques de Compostelle?
Je n'ai jamais été dans ce pays-là .
Faudrait-il me confiner dans une retraite avec des sots?
Pour moi j'ai toujours fait de petits voyages de ville en ville .
Me faudrait-il prendre parti pour l'Eglise grecque ou pour la latine?
Je ne fis aucune différence entre le Juif et le Samaritain quand je fus au monde .
Eh bien, s'il est ainsi, je vous prends pour mon seul maître. Alors il me fit un signe de tête qui me remplit de consolation. La vision disparut et la bonne conscience me resta.
RESURRECTION. [p. 343]↩
SECTION PREMIÈRE.
On a prétendu que le dogme de la résurrection était fort en vogue chez les Egyptiens, et que ce fut l'origine de leurs embaumements et de leurs pyramides. Je crois même que je l'ai cru autrefois. Les uns disaient qu'on ressusciterait au bout de mille ans, d'autres voulaient que ce fût après trois mille. Cette différence dans leurs opinions théologiques semble prouver qu'ils n'étaient pas bien sûrs de leur fait.
D'ailleurs nous ne voyons aucun homme ressuscité dans l'histoire d'Egypte; mais nous en avons quelques-uns chez les Grecs. C'est donc aux Grecs qu'il faut s'informer de cette invention de ressusciter.
Mais les Grecs brûlaient souvent les corps, et les Egyptiens les embaumaient, afin que quand l'âme qui était une petite figure aérienne reviendrait dans son ancienne demeure, elle la trouvât toute prête. Cela eût été bon si elle eût retrouvé ses organes; mais l'embaumeur commençait par ôter la cervelle et vider les entrailles. Comment les hommes auraient-ils pu ressusciter sans intestins et sans la partie médullaire par où l'on pense? ou reprendre son sang, sa lymphe et ses autres humeurs?
Vous me direz qu'il était encore plus difficile de ressusciter chez les Grecs quand il ne restait de vous qu'une livre de cendres tout au plus, et encore mêlée avec la cendre du bois des aromates et des étoffes.
Votre objection est forte, et je tiens comme vous la résurrection pour une chose fort extraordinaire. Mais cela n'empêche pas qu'Athalie fils de Mercure ne mourût et ne ressuscitât plusieurs fois. Les dieux ressuscitèrent Pélops quoiqu'il eût été mis en ragoût, et que Cérès en eût déjà mangé une épaule. Vous savez qu'Esculape avait rendu la vie à Hippolite; c'était un fait avéré dont les plus incrédules ne doutaient pas. Le nom de Virbius donné à Hippolite était une preuve convaincante. Hercule avait ressuscité Alceste et Pirritoüs. Hérès, chez Platon, ne ressuscita à la vérité que pour quinze jours; mais c'était toujours une résurrection, et le temps ne fait rien à l'affaire.
Plusieurs graves scoliastes voient évidemment le purgatoire et la résurrection dans Virgile. Pour le purgatoire, je suis obligé d'avouer qu'il y est expressément au sixième chant. Cela pourra déplaire aux protestants; mais je ne sais qu'y faire.
Non tamen omne malum miseris, nec funditus omnes
Corporá excedunt pestes, etc .
Les coeurs les plus parfaits, les âmes les plus pures
Sont aux regards des dieux tout chargés de souillures;
Il faut en arracher jusqu'au seul souvenir.
Nul ne fut innocent. Il faut tous nous punir.
Chaque âme a son démon; chaque vice a sa peine;
Et dix siècles entiers nous suffisent à peine
Pour nous former un coeur qui soit digne des dieux etc.
Voilà mille ans de purgatoire bien nettement exprimés, sans même que vos parents puissent obtenir des prêtres de ce temple-là une indulgence qui abrégeât votre souffrance pour de l'argent comptant. Les anciens étaient beaucoup plus sévères et moins simoniaques que nous, eux qui d'ailleurs imputaient à leurs dieux tant de sottises. Que voulez-vous! toute leur théologie était pétrie de contradictions, comme les malins disent qu'est la nôtre.
Le purgatoire achevé, ces âmes allaient boire de l'eau du Léthé, et demandaient instamment à rentrer dans de nouveaux corps, et à revoir la lumière du jour. Mais, est-ce là une résurrection? point du tout, c'est prendre un corps entièrement nouveau, ce n'est point reprendre le sien; c'est une métempsycose qui n'a nul rapport à la manière dont nous autres ressuscitons.
Les âmes des anciens faisaient un très mauvais marché, je l'avoue, en revenant au monde. Car qu'est-ce que revenir sur la terre pendant soixante et dix ans tout au plus, et souffrir encore tout ce que vous savez qu'on souffre dans soixante et dix ans de vie, pour aller ensuite passer mille ans encore à recevoir la discipline? il n'y a point d'âme à mon gré qui ne se lassât de cette éternelle vicissitude d'une vie si courte et d'une si longue pénitence.
SECTION SECONDE.
De la résurrection des modernes.
Notre résurrection est toute différente. Chaque homme reprendra précisément le même corps qu'il avait eu; et tous ces corps seront brûlés dans toute l'éternité, excepté un sur cent mille tout au plus. C'est bien pis qu'un purgatoire de dix siècles pour revivre ici-bas quelques années.
Quand viendra le grand jour de cette résurrection générale? on ne le sait pas positivement; et les doctes sont fort partagés. Ils ne savent pas non plus comment chacun retrouvera ses membres. Ils font sur cela beaucoup de difficultés.
1 o . Notre corps, disent-ils, est pendant la vie dans un changement continuel; nous n'avons rien à cinquante ans du corps où était logée notre âme à vingt.
2 o . Un soldat breton va en Canada; il se trouve que par un hasard assez commun il manque de nourriture: il est forcé de manger d'un Iroquois qu'il a tué la veille. Cet Iroquois s'était nourri de jésuites pendant deux ou trois mois. Une grande partie de son corps était devenue jésuite. Voilà le corps de ce soldat composé d'Iroquois, de jésuites, et de tout ce qu'il a mangé auparavant. Comment chacun reprendra-t-il précisément ce qui lui appartient? et que lui appartient-il en propre?
3 o . Un enfant meurt dans le ventre de sa mère, juste au moment qu'il vient de recevoir une âme. Ressuscitera-t-il foetus ou garçon, ou homme fait? si foetus à quoi bon? si garçon ou homme, d'où lui viendra sa substance?
4 o . L'âme arrive dans un autre foetus avant qu'il soit décidé garçon ou fille. Ressuscitera-t-il fille, garçon ou foetus?
5 o . Pour ressusciter, pour être la même personne que vous étiez, il faut que vous ayez la mémoire bien fraîche et bien présente. C'est la mémoire qui fait votre identité. Si vous avez perdu la mémoire, comment serez-vous le même homme?
6 o . Il n'y a qu'un certain nombre de particules terrestres qui puissent constituer un animal. Sable, pierre, minéral, métal n'y servent de rien. Toute terre n'y est pas propre; il n'y a que les terrains favorables à la végétation qui le soient au genre animal. Quand au bout de plusieurs siècles il faudra que tout le monde ressuscite, où trouver la terre propre à former tous ces corps?
7 o . Je suppose une île dont la partie végétale puisse fournir à la fois à mille hommes, et à cinq ou six mille animaux pour la nourriture et le service de ces mille hommes; au bout de cent mille générations nous aurons un milliard d'hommes à ressusciter. La matière manque évidemment.
Materiaeque opus est ut crescant postera saecla .
8 o . Enfin quand on a prouvé ou cru prouver qu'il faut un miracle aussi grand que le déluge universel, ou les dix plaies d'Egypte pour opérer la résurrection du genre humain dans la vallée de Josaphat, on demande ce que sont devenues toutes les âmes de ces corps en attendant le moment de rentrer dans leur étui?
On pourrait faire cinquante questions un peu épineuses, mais les docteurs répondent aisément à tout cela.
RIME. [p. 346]↩
La rime n'aurait-elle pas été inventée pour aider la mémoire, et pour régler en même temps le chant et la danse? le retour des mêmes sons servait à faire souvenir promptement des mots intermédiaires entre les deux rimes. Ces rimes avertissaient à la fois le chanteur et le danseur; elles indiquaient la mesure. Ainsi les vers furent dans tous les pays le langage des dieux.
On peut donc mettre au rang des opinions probables, c'est-à-dire incertaines, que la rime fut d'abord une cérémonie religieuse. Car après tout, il se pourrait qu'on eût fait des vers et des chansons pour sa maîtresse avant d'en faire pour ses dieux; et les amants emportés vous diront que cela revient au même.
Un rabbin qui me montrait l'hébreu, lequel je n'ai jamais pu apprendre, me citait un jour plusieurs psaumes rimés que nous avions, disait-il, traduits pitoyablement. Je me souviens de deux vers que voici:
Psaume XXXIII, vers. 5. Hibbitu clarè vena haru
Uph nehem al jech pharu .Si on le regarde on en est illuminé,
Et leurs faces ne sont point confuses.
Il n'y a guère de rime plus riche que celle de ces deux vers. Cela posé, je raisonne ainsi.
Les Juifs qui parlaient un jargon moitié phénicien, moitié syriaque, rimaient; donc les grandes nations dans lesquelles ils étaient enclavés devaient rimer aussi. Il est à croire que les Juifs, qui, comme nous l'avons dit si souvent, prirent tout de leurs voisins, en prirent aussi la rime.
Tous les Orientaux riment, ils sont fidèles à leurs usages; ils s'habillent comme ils s'habillaient il y a cinq ou six mille ans. Donc il est à croire qu'ils riment depuis ce temps-là.
Quelques doctes prétendent que les Grecs commencèrent par rimer, soit pour leurs dieux, soit pour leurs héros, soit pour leurs amies; mais qu'ensuite ayant mieux senti l'harmonie de leur langue, ayant mieux connu la prosodie, ayant raffiné sur la mélodie, ils firent ces beaux vers non rimés que les Latins imitèrent, et surpassèrent bien souvent.
Pour nous autres descendants des Goths, des Vandales, des Huns, des Welches, des Francs, des Bourguignons; nous barbares, qui ne pouvons avoir la mélodie grecque et latine, nous sommes obligés de rimer. Les vers blancs chez tous les peuples modernes ne sont que de la prose sans aucune mesure; elle n'est distinguée de la prose ordinaire que par un certain nombre de syllabes égales et monotones qu'on est convenu d'appeler vers .
Nous avons dit ailleurs que ceux qui avaient écrit en vers blancs ne l'avaient fait que parce qu'ils ne savaient pas rimer; les vers blancs sont nés de l'impuissance de vaincre la difficulté, et de l'envie d'avoir plus tôt fait.
Nous avons remarqué que l'Arioste a fait quarante-huit mille rimes de suite dans son Orlando , sans ennuyer personne. Nous avons observé combien la poésie française en vers rimés entraîne d'obstacles avec elle, et que le plaisir naissait de ces obstacles mêmes. Nous avons toujours été persuadés qu'il fallait rimer pour les oreilles, non pour les yeux; et nous avons exposé nos opinions sans suffisance, attendu notre insuffisance.
Mais toute notre modération nous abandonne aux funestes nouvelles qu'on nous mande de Paris au mont Krapac. Nous apprenons qu'il s'élève une petite secte de barbares qui veut qu'on ne fasse désormais des tragédies qu'en prose. Ce dernier coup manquait à nos douleurs: c'est l'abomination de la désolation dans le temple des Muses. Nous concevons bien que Corneille ayant mis l'Imitation de Jésus-Christ en vers, quelque mauvais plaisant aurait pu menacer le public de faire jouer une tragédie en prose par Floridor et Mondori; mais ce projet ayant été exécuté sérieusement par l'abbé d'Aubignac, on sait quel succès il eut. On sait dans quel discrédit tomba la prose de l'OEdipe de La Motte-Houdart, il fut presque aussi grand que celui de son OEdipe en vers. Quel malheureux Visigoth peut oser, après Cinna et Andromaque , bannir les vers du théâtre? C'est donc à cet excès d'opprobre que nous sommes parvenus après le grand siècle! Ah! barbares, allez donc voir jouer cette tragédie en redingote à Faxhall, après quoi venez-y manger du rosbif de mouton et boire de la bière forte.
Qu'auraient dit Racine et Boileau si on leur avait annoncé cette terrible nouvelle? Bone deus! de quelle hauteur sommes-nous tombés, et dans quel bourbier sommes-nous!
Il est vrai que la rime ajoute un mortel ennui aux vers médiocres. Le poète alors est un mauvais mécanicien qui fait entendre le bruit choquant de ses poulies et de ses cordes: ses lecteurs éprouvent la même fatigue qu'il a ressentie en rimant; ses vers ne sont qu'un vain tintement de syllabes fastidieuses. Mais s'il pense heureusement, et s'il rime de même, il éprouve et il donne un grand plaisir qui n'est goûté que par les âmes sensibles et par les oreilles harmonieuses.
RIRE. [p. 349]↩
Que le rire soit le signe de la joie comme les pleurs sont le symptôme de la douleur, quiconque a ri n'en doute pas. Ceux qui cherchent des causes métaphysiques au rire ne sont pas gais: ceux qui savent pourquoi cette espèce de joie qui excite le ris, retire vers les oreilles le muscle zygomatique, l'un des treize muscles de la bouche, sont bien savants. Les animaux ont ce muscle comme nous; mais ils ne rient point de joie comme ils ne répandent point de pleurs de tristesse. Le cerf peut laisser couler une humeur de ses yeux quand il est aux abois, le chien aussi quand on le dissèque vivant; mais ils ne pleurent point leurs maîtresses, leurs amis, comme nous: ils n'éclatent point de rire comme nous à la vue d'un objet comique: l'homme est le seul animal qui pleure et qui rie.
Comme nous ne pleurons que de ce qui nous afflige, nous ne rions que de ce qui nous égaie: les raisonneurs ont prétendu que le rire naît de l'orgueil, qu'on se croit supérieur à celui dont on rit. Il est vrai que l'homme qui est un animal risible, est aussi un animal orgueilleux; mais la fierté ne fait pas rire; un enfant qui rit de tout son coeur ne s'abandonne point à ce plaisir parce qu'il se met au-dessus de ceux qui le font rire: s'il rit quand on le chatouille, ce n'est pas assurément parce qu'il est sujet au péché mortel de l'orgueil. J'avais onze ans quand je lus tout seul pour la première fois l' Amphitrion de Molière; je ris au point de tomber à la renverse; était-ce par fierté? On n'est point fier quand on est seul. Etait-ce par fierté que le maître de l'âne d'or se mit tant à rire quand il vit son âne manger son souper? Quiconque rit éprouve une joie gaie dans ce moment-là, sans avoir un autre sentiment.
Toute joie ne fait pas rire, les grands plaisirs sont très sérieux; les plaisirs de l'amour, de l'ambition, de l'avarice n'ont jamais fait rire personne.
Le rire va quelquefois jusqu'aux convulsions: on dit même que quelques personnes sont mortes de rire: j'ai peine à le croire, et sûrement il en est davantage qui sont morts de chagrin.
Les vapeurs violentes qui excitent tantôt les larmes, tantôt les symptômes du rire, tirent à la vérité les muscles de la bouche; mais ce n'est point un ris véritable, c'est une convulsion, c'est un tourment. Les larmes peuvent alors être vraies, parce qu'on souffre; mais le rire ne l'est pas; il faut lui donner un autre nom, aussi l'appelle-t-on rire sardonien .
Le ris malin, le perfidum ridens est autre chose; c'est la joie de l'humiliation d'autrui: on poursuit par des éclats moqueurs, par le cachinnum , terme qui nous manque, celui qui nous a promis des merveilles et qui ne fait que des sottises: c'est huer plutôt que rire. Notre orgueil alors se moque de l'orgueil de celui qui s'en est fait accroire. On hue notre ami Fréron dans l' Ecossaise plus encore qu'on n'en rit: j'aime toujours à parler de l'ami Fréron; cela me fait rire.
ROI. [p. 350]↩
Roi, basileus, tyrannos, rex, dux, imperator, melk, baal, bel, pharao, éli, shadai, adoni, shak, sophi, padisha, bogdan, chazan, kan, krall, king, kong, koenig , etc. etc. toutes expressions qui semblent signifier la même chose, et qui expriment des idées toutes différentes.
Dans la Grèce, ni basileus , ni tyrannos , ne donna jamais l'idée du pouvoir absolu. Saisit ce pouvoir qui peut; mais ce n'est que malgré soi qu'on le laissa prendre.
Il est clair que chez les Romains les rois ne furent point despotiques. Le dernier Tarquin mérita d'être chassé, et le fut. Nous n'avons aucune preuve que les petits chefs de l'Italie aient jamais pu faire à leur gré présent d'un lacet au premier homme de l'Etat, comme fait aujourd'hui un Turc imbécile dans son sérail, et comme de vils esclaves barbares beaucoup plus imbéciles le souffrent sans murmurer.
Nous ne voyons pas un roi au delà des Alpes et vers le Nord, dans les temps où nous commençons à connaître cette vaste partie du monde. Les Cimbres qui marchèrent vers l'Italie, et qui furent exterminés par Marius, étaient des loups affamés qui sortaient de leurs forêts avec leurs louves et leurs louveteaux. Mais de tête couronnée chez ces animaux, d'ordres intimés de la part d'un secrétaire d'Etat, d'un grand boutillier, d'un logothète, d'impôts, de taxes arbitraires, de commis aux portes, d'édits bursaux, on n'en avait pas plus de notion que de vêpres et de l'opéra.
Il faut que l'or et l'argent monnayé et même non monnayé soit une recette infaillible pour mettre celui qui n'en a pas dans la dépendance absolue de celui qui a trouvé le secret d'en amasser. C'est avec cela seul qu'il eut des postillons et des grands officiers de la couronne, des gardes, des cuisiniers, des filles, des femmes, des geôliers, des aumôniers, des pages et des soldats.
Il eût été fort difficile de se faire obéir ponctuellement si on n'avait eu à donner que des moutons et des pourpoints. Aussi il est très vraisemblable qu'après toutes les révolutions qu'éprouva notre globe, ce fut l'art de fondre les métaux qui fit les rois, comme ce sont aujourd'hui les canons qui les maintiennent.
César avait bien raison de dire, qu'avec de l'or on a des hommes, et qu'avec des hommes on a de l'or. Voilà tout le secret.
Ce secret avait été connu dès longtemps en Asie et en Egypte. Les princes et les prêtres partagèrent autant qu'ils le purent.
Le prince disait au prêtre, Tiens, voilà de l'or; mais il faut que tu affermisses mon pouvoir, et que tu prophétises en ma faveur; je serai oint, tu seras oint. Rends des oracles, fais des miracles; tu seras bien payé, pourvu que je sois toujours le maître. Le prêtre se faisait donner terres et monnaie, et il prophétisait pour lui-même, rendait des oracles pour lui-même, chassait le souverain très souvent, et se mettait à sa place. Ainsi les choen ou chotim d'Egypte, les mages de Perse, les Chaldéens devers Babilone, les chazin de Syrie, (si je me trompe de nom il n'importe guère) tous ces gens-là voulaient dominer. Il y eut des guerres fréquentes entre le trône et l'autel en tout pays, jusque chez la misérable nation juive.
Nous le savons bien depuis douze cents ans, nous autres habitants de la zone tempérée d'Europe. Nos esprits ne tiennent pas trop de cette température; nous savons ce qu'il nous en a coûté. Et l'or et l'argent sont tellement le mobile de tout, que plusieurs de nos rois d'Europe envoient encore aujourd'hui de l'or et de l'argent à Rome, où des prêtres le partagent dès qu'il est arrivé.
Lorsque dans cet éternel conflit de juridiction, les chefs des nations ont été puissants, chacun d'eux a manifesté sa prééminence à sa mode. C'était un crime, dit-on, de cracher en présence du roi des Mèdes. Il faut frapper la terre de son front neuf fois devant le roi de la Chine. Un roi d'Angleterre imagina de ne jamais boire un verre de bière si on ne le lui présentait à genoux. Un autre se fait baiser son pied droit. Les cérémonies diffèrent; mais tous en tout temps ont voulu avoir l'argent des peuples. Il y a des pays où l'on fait au krall, au chazan une pension comme en Pologne, en Suède, dans la Grande-Bretagne. Ailleurs, un morceau de papier suffit pour que le bogdan ait tout l'argent qu'il désire.
Et puis, écrivez sur le droit des gens, sur la théorie de l'impôt, sur le tarif, sur le foderum mansionaticum viaticum , faites de beaux calculs sur la taille proportionnelle, prouvez par de profonds raisonnements cette maxime si neuve que le berger doit tondre ses moutons, et non pas les écorcher.
Quelles sont les limites de la prérogative des rois et de la liberté des peuples? Je vous conseille d'aller examiner cette question dans l'hôtel de ville d'Amsterdam à tête reposée.
ROME. [p. 352]↩
COUR DE ROME.
L'évêque de Rome avant Constantin, n'était aux yeux des magistrats romains, ignorants de notre sainte religion, que le chef d'une faction secrète, souvent toléré par le gouvernement, et quelquefois puni du dernier supplice. Les noms des premiers disciples nés juifs, et de leurs successeurs, qui gouvernèrent le petit troupeau caché dans la grande ville de Rome, furent absolument ignorés de tous les écrivains latins. On sait assez que tout changea, et comment tout changea sous Constantin.
L'évêque de Rome protégé et enrichi, fut toujours sujet des empereurs, ainsi que l'évêque de Constantinople, de Nicomédie, et tous les autres évêques, sans prétendre à la moindre ombre d'autorité souveraine. La fatalité qui dirige toutes les affaires de ce monde, établit enfin la puissance de la cour ecclésiastique romaine par les mains des barbares qui détruisirent l'empire.
L'ancienne religion sous laquelle les Romains avaient été victorieux pendant tant de siècles, subsistait encore avec splendeur, quand Alaric vint assiéger Rome l'an 408 de notre ère vulgaire; et le pape Innocent I er n'empêcha pas qu'on ne sacrifiât aux dieux dans le Capitole et dans les autres temples, pour obtenir contre les Goths le secours du ciel. Mais ce pape Innocent fut du nombre des députés vers Alaric, si on en croit Zozime et Orose. Cela prouve que le pape était déjà un personnage considérable.
Lorsque Attila vint ravager l'Italie en 452, par le même droit que les Romains avaient exercé sur tant de peuples, par le droit de Clovis et des Goths, et des Vandales, et des Hérules, l'empereur envoya le pape Léon I er , assisté de deux personnages consulaires, pour négocier avec Attila. Je ne doute pas que St Léon ne fût accompagné d'un ange armé d'une épée flamboyante qui fit trembler le roi des Huns, quoiqu'il ne crût pas aux anges, et qu'une épée ne lui fît pas peur. Ce miracle est très bien peint dans le Vatican; et vous sentez bien qu'on ne l'eût jamais peint s'il n'avait été vrai. Tout ce qui me fâche, c'est que cet ange laissa prendre et saccager Aquilée et toute l'Illyrie, et qu'il n'empêcha pas ensuite Genséric de piller Rome pendant quatorze jours: ce n'était pas apparemment l'ange exterminateur.
Sous les exarques, le crédit des papes augmenta; mais ils n'eurent encore nulle ombre de puissance civile. L'évêque romain élu par le peuple demandait, selon le protocole du Diarium romanum , la protection de l'évêque de Ravenne auprès de l'exarque, qui accordait ou refusait la confirmation à l'élu.
L'exarchat ayant été détruit par les Lombards, les rois lombards voulurent se rendre maîtres aussi de la ville de Rome. Rien n'est plus naturel.
Pépin, l'usurpateur de la France, ne souffrit pas que les Lombards usurpassent cette capitale et fussent trop puissants; rien n'est plus naturel encore.
On prétend que Pépin et son fils Charlemagne donnèrent aux évêques romains plusieurs terres de l'exarchat, que l'on nomma les justices de St Pierre . Telle est la première origine de leur puissance temporelle. Il paraît que dès ce temps-là ces évêques songeaient à se procurer quelque chose de plus considérable que ces justices.
Nous avons une lettre du pape Adrien I er à Charlemagne, dans laquelle il dit: La libéralité pieuse de Constantin le Grand, empereur de sainte mémoire, éleva, et exalta du temps du bienheureux pontife romain Silvestre, la sainte Eglise romaine, et lui conféra sa puissance dans cette partie de l'Italie .
On voit que dès lors on commençait à vouloir faire croire la donation de Constantin, qui fut depuis regardée pendant cinq cents ans, non pas absolument comme un article de foi, mais comme une vérité incontestable. Ce fut à la fois un crime de lèse-majesté et un péché mortel, de former des doutes sur cette donation. (Voyez l'article Donations .)
Depuis la mort de Charlemagne, l'évêque augmenta son autorité dans Rome de jour en jour; mais il s'écoula des siècles avant qu'il y fût regardé comme souverain. Rome eut très longtemps un gouvernement patricien municipal.
Ce Jean XII que l'empereur allemand Othon I er fit déposer dans une espèce de concile en 963 comme simoniaque, incestueux, sodomite, athée et ayant fait pacte avec le diable; ce Jean XII, dis-je, était le premier homme de l'Italie en qualité de patrice et de consul avant d'être évêque de Rome; et malgré tous ces titres, malgré le crédit de la fameuse Marosie sa mère, il n'y avait qu'une autorité très contestée.
Ce Grégoire VII qui de moine étant devenu pape, voulut déposer les rois et donner les empires, loin d'être le maître à Rome, mourut le protégé, ou plutôt le prisonnier de ces princes normands conquérants des deux Siciles, dont il se croyait le seigneur suzerain.
Dans le grand schisme d'Occident, les papes qui se disputèrent l'empire du monde, vécurent souvent d'aumônes.
Un fait assez extraordinaire, c'est que les papes ne furent riches que depuis le temps où ils n'osèrent se montrer à Rome.
Bertrand de Got, Clément V le Bordelais, qui passa sa vie en France, vendait publiquement les bénéfices, et laissa des trésors immenses, selon Villani.
Jean XXII son successeur fut élu à Lyon. On prétend qu'il était le fils d'un savetier de Cahors. Il inventa plus de manières d'extorquer l'argent de l'Eglise, que jamais les traitants n'ont inventé d'impôts.
Le même Villani assure qu'il laissa à sa mort vingt-cinq millions de florins d'or. Le patrimoine de St Pierre ne lui aurait pas assurément fourni cette somme.
En un mot, jusqu'à Innocent VIII qui se rendit maître du château St Ange, les papes ne jouirent jamais dans Rome d'une souveraineté véritable.
Leur autorité spirituelle fut sans doute le fondement de la temporelle. Mais s'ils s'étaient bornés à imiter la conduite de St Pierre, dont on se persuada qu'ils remplissaient la place, ils n'auraient jamais acquis que le royaume des cieux. Ils surent toujours empêcher les empereurs de s'établir à Rome malgré ce beau nom de Roi des Romains . La faction guelfe l'emporta toujours en Italie sur la faction gibeline . On aimait mieux obéir à un prêtre italien qu'à un roi allemand.
Dans les guerres civiles que la querelle de l'empire et du sacerdoce suscita pendant plus de cinq cents années, plusieurs seigneurs obtinrent des souverainetés tantôt en qualité de vicaires de l'empire, tantôt comme vicaires du Saint-Siège. Tels furent les princes d'Est à Ferrare, les Bentivoglio à Bologne, les Malatesta à Rimini, les Manfreddi à Faenza, les Baglione à Pérouse, les Ursins dans Anguilara et dans Servetri, les Colonnes dans Ostie, les Riario à Forli, les Montefeltro dans Urbin, les Varano dans Camerino, les Gravina dans Sinigaglia.
Tous ces seigneurs avaient autant de droits aux terres qu'ils possédaient, que les papes en avaient au patrimoine de St Pierre. Les uns et les autres étaient fondés sur des donations.
On sait comme le pape Alexandre VI se servit de son bâtard César de Borgia pour envahir toutes ces principautés.
Le roi Louis XII obtint de ce pape la cassation de son mariage après dix-huit années de jouissance, à condition qu'il aiderait l'usurpateur.
Les assassinats commis par Clovis pour s'emparer des Etats des petits rois ses voisins, n'approchent pas des horreurs exécutées par Alexandre VI et par son fils.
L'histoire de Néron est bien moins abominable. Le prétexte de la religion n'augmentait pas l'atrocité de ses crimes. Observez que dans le même temps les rois d'Espagne et de Portugal demandaient à ce pape, l'un l'Amérique et l'autre l'Asie, et que ce monstre les donna au nom du Dieu qu'il représentait. Observez que cent mille pèlerins couraient à son jubilé et adoraient sa personne.
Jules II acheva ce qu'Alexandre VI avait commencé. Louis XII né pour être la dupe de tous ses voisins, aida Jules à prendre Bologne et Pérouse. Ce malheureux roi, pour prix de ses services, fut chassé d'Italie et excommunié par ce même pape que l'archevêque d'Auch son ambassadeur à Rome appelait votre méchanceté , au lieu de votre sainteté.
Pour comble de mortification, Anne de Bretagne sa femme, aussi dévote qu'impérieuse, lui disait qu'il serait damné pour avoir fait la guerre au pape.
Si Léon X et Clément VII perdirent tant d'Etats qui se détachèrent de la communion papale, ils ne restèrent pas moins absolus sur les provinces fidèles à la foi catholique.
La cour romaine excommunia Henri III, et déclara Henri IV indigne de régner.
Elle tire encore beaucoup d'argent de tous les Etats catholiques d'Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, de l'Espagne et de la France. Ses ambassadeurs ont la préséance sur tous les autres; elle n'est plus assez puissante pour faire la guerre; et sa faiblesse fait son bonheur. L'Etat ecclésiastique est le seul qui ait toujours joui des douceurs de la paix depuis le saccagement de Rome par les troupes de Charles-Quint. Il paraît que les papes avaient été souvent traités comme ces dieux des Japonais, à qui tantôt on présente des offrandes d'or, et que tantôt on jette dans la rivière.
RUSSIE. [p. 357]↩
‘Le czar Pierre n'avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fit, étaient bien, la plupart étaient déplacées. [35] Il a vu que son peuple était barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr pour la police; il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que l'aguerrir. Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais quand il fallait commencer par faire des Russes; il a empêché ses sujets de jamais devenir ce qu'ils pourraient être en leur persuadant qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur français forme son élève pour briller un moment dans son enfance, et puis n'être jamais rien. L'empire de Russie voudra subjuguer l'Europe, et sera subjugué lui-même. Les Tartares ses sujets ou ses voisins, deviendront ses maîtres et les nôtres. Cette révolution me paraît infaillible.'
Ces paroles sont tirées mot à mot de la quatre-vingt-seizième page du code d'un de ces législateurs qui gouvernent l'univers à deux sous la feuille, et qui de leur galetas donnent des ordres à tous les rois. On peut dire d'eux ce qu'Homère dit de Calcas,
Os ede ta éonta, ta tè essomena, pro t'eonta .
Il connaît le passé, le présent, l'avenir.
C'est dommage que l'auteur de ce petit paragraphe que nous venons de citer n'ait connu aucun des trois temps dont parle Homère.
Pierre le Grand , dit-il, n'avait pas le génie qui fait tout de rien . Vraiment, Jean-Jacques, je le crois sans peine, car on prétend que Dieu seul a cette prérogative.
Il n'a pas vu que son peuple n'était pas mûr pour la police ; en ce cas le czar est admirable de l'avoir fait mûrir. Il me semble que c'est Jean-Jacques qui n'a pas vu qu'il fallait se servir d'abord des Allemands et des Anglais pour faire des Russes.
Il a empêché ses sujets de jamais devenir ce qu'il pourraient être, etc .
Cependant ces mêmes Russes sont devenus les vainqueurs des Turcs et des Tartares, les conquérants et les législateurs de la Crimée et de vingt peuples différents; leur souveraine a donné des lois à des nations dont le nom même était ignoré en Europe.
Quant à la prophétie de Jean-Jacques, il se peut qu'il ait exalté son âme jusqu'à lire dans l'avenir; il a tout ce qu'il faut pour être prophète; mais pour le passé et pour le présent, on avouera qu'il n'y entend rien. Je doute que l'antiquité ait rien de comparable à la hardiesse d'envoyer quatre escadres du fond de la mer Baltique dans les mers de la Grèce, de dominer à la fois sur la mer Egée et sur le Pont-Euxin, de porter la terreur dans la Colchide et aux Dardanelles, de subjuguer la Tauride, et de forcer le vizir Azem à s'enfuir des bords du Danube jusqu'aux portes d'Andrinople.
Si Jean-Jacques compte pour rien tant de grandes actions qui étonnent la terre attentive, il doit du moins avouer qu'il y a quelque générosité dans un comte d'Orlof, qui après avoir pris un vaisseau qui portait toute la famille et tous les trésors d'un bacha, lui renvoya sa famille et ses trésors.
Si les Russes n'étaient pas mûrs pour la police du temps de Pierre le Grand, convenons qu'ils sont mûrs aujourd'hui pour la grandeur d'âme; et que Jean-Jacques n'est pas tout à fait mûr pour la vérité et pour le raisonnement.
A l'égard de l'avenir, nous le saurons quand nous aurons des Ezéchiel, des Isaïe, des Habacuc, des Michée. Mais le temps en est passé; et, si on ose le dire, il est à craindre qu'il ne revienne plus.
J'avoue que ces mensonges imprimés sur le temps présent, m'étonnent toujours. Si on se donne ces libertés dans un siècle où mille volumes, mille gazettes, mille journaux peuvent continuellement vous démentir, quelle foi pourrons-nous avoir en ces historiens des anciens temps qui recueillaient tous les bruits vagues, qui ne consultaient aucunes archives, qui mettaient par écrit ce qu'ils avaient entendu dire à leurs grands-mères dans leur enfance, bien sûrs qu'aucun critique ne releverait leurs fautes.
Nous eûmes longtemps neuf Muses, la saine critique est la dixième qui est venue bien tard. Elle n'existait point du temps de Cécrops, du premier Bacchus, de Sanchoniaton, de Thaut, de Brama, etc. etc. etc.: on écrivait alors impunément tout ce qu'on voulait. Il faut être aujourd'hui un peu plus avisé.
SALIQUE, LOI SALIQUE. [p. 359]↩
Celui qui a dit que la loi salique fut écrite avec une plume des ailes de l'aigle à deux têtes, par l'aumônier de Pharamond, au dos de la donation de Constantin, pourrait bien ne s'être pas trompé.
C'est la loi fondamentale de l'empire français, disent de braves Pag. 288 et suiv. jurisconsultes. Le grand Jérôme Bignon, dans son livre de l' Excellence de la France , dit que cette loi vient de la loi naturelle selon le grand Aristote, parce que dans les familles c'était le père qui gouvernait, et qu'on ne donnait point de dot aux filles, comme il se lit des père, mère et frères de Rebecca .
Pag. 9. Il assure que le royaume de France est si excellent, qu'il a conservé précieusement cette loi recommandée par Aristote et par l'Ancien Testament. Et, pour prouver cette excellence de la France, il remarque que l'empereur Julien trouvait le vin de Surêne admirable.
Mais, pour démontrer l'excellence de la loi salique, il s'en rapporte à Froissard, selon lequel les douze pairs de France disent que le royaume de France est de si grande noblesse, qu'il ne doit mie par succession aller à femelle .
On doit avouer que cette décision est fort incivile pour l'Espagne, pour l'Angleterre, pour Naples, pour la Hongrie, surtout pour la Russie, qui a vu sur son trône quatre impératrices de suite.
Le royaume de France est de grande noblesse; d'accord. Mais celui d'Espagne, du Mexique et du Pérou, est aussi de grande noblesse. Et grande noblesse est aussi en Russie.
On a allégué qu'il est dit dans la sainte Ecriture, que les lis ne filent point . On en a conclu que les femmes ne doivent point régner en France. C'est encore puissamment raisonner. Mais on a oublié que les léopards, qui sont (on ne sait pourquoi) les armoiries d'Angleterre, ne filent pas plus que les lis qui sont (on ne sait pourquoi) les armoiries de France. En un mot, de ce qu'on n'a jamais vu filer un lis, il n'est pas démontré que l'exclusion des filles soit une loi fondamentale des Gaules.
DES LOIX FONDAMENTALES.
La loi fondamentale de tout pays est qu'on sème du blé, si l'on veut avoir du pain; qu'on cultive le lin et le chanvre, si on veut avoir de la toile; que chacun soit le maître dans son champ, soit que ce champ appartienne à un garçon ou à une fille; que le Gaulois demi-barbare tue autant de Francs entièrement barbares, qui viendront des bords du Mein qu'ils ne savent pas cultiver, ravir ses moissons et ses troupeaux: sans quoi le Gaulois deviendra serf du Franc, ou sera assassiné par lui.
C'est sur le fondement que porte l'édifice. L'un bâtit son fondement sur un roc, et la maison dure; l'autre sur du sable, et elle s'écroule. Mais une loi fondamentale, née de la volonté changeante des hommes, et en même temps irrévocable, est une contradiction dans les termes, un être de raison, une chimère, une absurdité: qui fait les lois peut les changer. La bulle d'or fut appelée loi fondamentale de l'empire . Il fut ordonné qu'il n'y aurait jamais que sept électeurs tudesques, par la raison péremptoire qu'un certain chandelier juif n'avait eu que sept branches, et qu'il n'y a que sept dons du Saint-Esprit. Cette loi fondamentale fut qualifiée d' éternelle , par la toute-puissance et certaine science de Charles IV. Dieu ne trouva pas bon que le parchemin de Charles prît le nom d' éternel . Il a permis que d'autres empereurs germains, par leur toute-puissance et certaine science, ajoutassent deux branches au chandelier et deux présents aux sept dons du Saint-Esprit. Ainsi les électeurs sont au nombre de neuf.
C'était une loi très fondamentale, que les disciples du Seigneur Jésus n'eussent rien en propre. Ce fut ensuite une loi encore plus fondamentale, que les évêques de Rome fussent très riches, et que le peuple les choisît. La dernière loi fondamentale est qu'ils sont souverains, et élus par un petit nombre d'hommes, vêtus d'écarlate, qui étaient absolument inconnus du temps de Jésus. Si l'empereur roi des Romains toujours auguste, était maître de Rome de fait comme il l'est par le style de sa chancellerie, le pape serait son grand aumônier, en attendant quelque autre loi irrévocable à toujours qui serait détruite par une autre.
Je suppose (ce qui peut très bien arriver) qu'un empereur d'Allemagne n'ait qu'une fille, et qu'il soit un bonhomme n'entendant rien à la guerre; je suppose que si Catherine II ne détruit pas l'empire turc qu'elle a fort ébranlé dans l'an 1771 où j'écris ces rêveries, le Turc vienne attaquer mon bon prince chéri des neuf électeurs, que sa fille se mette à la tête des troupes avec deux jeunes électeurs amoureux d'elle, qu'elle batte les Ottomans comme Débora battit le capitaine Sizara et ses trois cent mille soldats, et ses trois mille chars de guerre dans un petit champ pierreux aux pieds du mont Thabor, que ma princesse chasse les musulmans jusque par delà Andrinople; que son père meure de joie ou autrement, que les deux amants de ma princesse engagent leurs sept confrères à la couronner, que tous les princes de l'empire et les villes y consentent; que deviendra la loi fondamentale et éternelle qui porte que le saint empire romain ne peut tomber de lance en quenouille, que l'aigle à deux têtes ne file point, et qu'on ne peut sans culotte s'asseoir sur le trône impérial? on se moquera de cette vieille loi, et ma princesse régnera très glorieusement.
COMMENT LA LOI SALIQUE S'EST ÉTABLIE.
On ne peut contester la coutume passée en loi, qui veut que les filles ne puissent hériter la couronne de France tant qu'il reste un mâle du sang royal. Cette question est décidée depuis longtemps, le sceau de l'antiquité y est apposé. Si elle était descendue du ciel, elle ne serait pas plus révérée de la nation française. Elle s'accommode mal avec la galanterie de cette nation: mais c'est qu'elle était en vigueur avant que cette nation fût galante.
Le président Hénault répète dans sa Chronique ce qu'on avait dit au hasard avant lui, que Clovis rédigea la loi salique en 511, l'année même de sa mort. Je veux croire qu'il avait rédigé cette loi, et qu'il savait lire et écrire, comme je veux croire qu'il avait quinze ans lorsqu'il se mit à conquérir les Gaules: mais je voudrais qu'on me montrât à la bibliothèque de St Germain-des-Prés, ou de St Martin, ce cartulaire de la loi salique signé Clovis, ou Clodvic, ou Hildovic; par là du moins on apprendrait son véritable nom que personne ne sait.
Nous avons deux éditions de cette loi salique, l'une par un nommé Hérold, l'autre par François Pithoux, et toutes deux sont différentes, ce qui n'est pas un bon signe. Quand le texte d'une loi est rapporté différemment dans deux écrits, non seulement il est clair que l'un des deux est faux, mais il est fort probable qu'ils le sont tous deux. Aucune coutume des Francs ne fut écrite dans nos premiers siècles; il serait bien étrange que la loi des Saliens l'eût été. Cette loi est en latin; et il n'y a pas d'apparence que ni Clovis, ni ses prédécesseurs parlassent latin dans leurs marais entre les Souabes et les Bataves.
On suppose que cette loi peut regarder les rois de France; et tous les savants conviennent que les Sicambres, les Francs, les Saliens n'avaient point de rois, ni même aucun chef héréditaire.
Le titre de la loi salique commence par ces mots, In Christi nomine . Elle a donc été faite hors des terres saliques, puisque le Christ n'était pas plus connu de ces barbares que du reste de la Germanie, et de tous les pays du Nord.
On fait rédiger cette loi salique par quatre grands jurisconsultes francs; ils s'appellent dans l'édition de Hérold, Visogast, Harogast, Salogast et Vindogast. Dans l'édition de Pithoux, ces noms sont un peu différents. Il se trouve malheureusement que ces noms sont les vieux noms déguisés de quelques cantons d'Allemagne.
Notre magot prend pour ce coup
Le nom d'un port pour un nom d'homme.
En quelque temps que cette loi ait été rédigée en mauvais latin, on trouve dans l'article touchant les alleux, que nulle portion de terre salique ne passe à la femme . Il est clair que cette prétendue loi ne fut point suivie. Premièrement, on voit par les formules de Marculphe qu'une père pouvait laisser ses alleux à la fille, en renonçant à certaine loi salique, impie et abominable .
Secondement, si on applique cette loi aux fiefs, il est clair que les rois d'Angleterre qui n'étaient pas de la race normande, n'avaient eu tous leurs grands fiefs en France que par les filles.
Troisièmement, si on prétend qu'il est nécessaire qu'un fief soit entre les mains d'un homme, parce qu'il doit se battre pour son seigneur, cela prouve que la loi ne pouvait être entendue des droits au trône. Tous les seigneurs de fief se seraient battus tout aussi bien pour une reine que pour un roi. Une reine n'était point obligée d'endosser une cuirasse, de se garnir de cuissards et de brassards, et d'aller au trot à l'ennemi sur un grand cheval de charrette, comme ce fut longtemps la mode.
Il est donc clair qu'originairement la loi salique ne pouvait regarder en rien la couronne, ni comme alleu ni comme fief dominant.
Mézerai dit, que l' imbécillité du sexe ne permet pas de régner . Mézerai ne parle ni en homme d'esprit ni en homme poli. L'histoire le dément assez. La reine Anne d'Angleterre qui humilia Louis XIV; l'impératrice reine de Hongrie qui résista au roi LouisXV , à Frédéric le Grand, à l'électeur de Bavière et à tant d'autres princes; Elizabeth d'Angleterre qui empêcha notre grand Henri de succomber; l'impératrice de Russie dont nous avons déjà parlé, font assez voir que Mézerai n'est pas plus véridique qu'honnête. Il devait savoir que la reine Blanche avait trop régné en France sous le nom de son fils, et Anne de Bretagne sous Louis XII.
Véli dernier écrivain de l' Histoire de France , devrait par cette raison même être le meilleur, puisqu'il avait tous les matériaux de ses devanciers: mais il n'a pas toujours su profiter de ses avantages. Il s'emporte en invectives contre le sage et profond Rapin de Toiras; il veut lui prouver que jamais aucune princesse n'a succédé à la couronne tant qu'il y a eu des mâles capables de succéder. On le sait bien; et jamais Toiras n'a dit le contraire.
Dans ce long âge de la barbarie, lorsqu'il ne s'agissait dans l'Europe que d'usurper et de soutenir ses usurpations, il faut avouer que les rois étaient fort souvent des chefs de bandits, ou des guerriers armés contre ces bandits; il n'était pas possible de se soumettre à une femme; quiconque avait un grand cheval de bataille ne voulait aller à la rapine et au meurtre que sous le drapeau d'un homme, monté comme lui sur un grand cheval. Un bouclier ou un cuir de boeuf servait de trône. Les califes gouvernaient par l'Alcoran, les papes étaient censés gouverner par l'Evangile. Le Midi ne vit aucune femme régner, jusqu'à Jeanne de Naples, qui ne dut sa couronne qu'à la tendresse des peuples pour le roi Robert son grand-père, et à leur haine pour André son mari. Cet André était à la vérité du sang royal, mais né dans la Hongrie alors barbare. Il révolta les Napolitains par ses moeurs grossières, par son ivrognerie et par sa crapule. Le bon roi Robert fut obligé de contredire l'usage immémorial, et de déclarer Jeanne seule reine par son testament approuvé de la nation.
On ne voit dans le Nord aucune femme régner de son chef jusqu'à Marguerite de Valdemar, qui gouverna quelques mois en son propre nom vers l'an 1377.
L'Espagne n'eut aucune reine de son chef jusqu'à l'habile Isabelle en 1461.
En Angleterre, la cruelle et superstitieuse Marie fille de Henri VIII, est la première qui hérita du trône, de même que la faible et coupable Marie Stuart en Ecosse au seizième siècle.
Le vaste pays de la Russie n'eut jamais de souveraine jusqu'à la veuve de Pierre le Grand.
Toute l'Europe que dis-je, toute la terre était gouvernée par des guerriers au temps où Philippe de Valois soutint son droit contre Edouard III. Ce droit d'un mâle qui succédait à un mâle, semblait la loi de toutes les nations. Vous êtes petit-fils de Philippe le Bel par votre mère, disait Valois à son compétiteur; mais comme je l'emporterais sur la mère, je l'emporte à plus forte raison sur le fils. Votre mère n'a pu vous transmettre un droit qu'elle n'avait pas.
Il fut donc reconnu en France que le prince du sang le plus éloigné, serait l'héritier de la couronne au préjudice de la fille du roi. C'est une loi sur laquelle personne ne dispute aujourd'hui. Les autres nations ont adjugé depuis le trône à des princesses. La France a conservé l'ancien usage. Le temps a donné à cet usage la force de la loi la plus sainte. En quelque temps que la loi salique ait été ou faite, ou interprétée, il n'importe; elle existe, elle est respectable, elle est utile; et son utilité l'a rendue sacrée.
EXAMEN SI LES FILLES DANS TOUS LES CAS SONT PRIVÉES DE TOUTE HÉRÉDITÉ PAR CETTE LOI SALIQUE.
J'ai déjà donné l'empire à une fille malgré la bulle d'or. Je n'aurai pas de peine à gratifier une fille du royaume de France. Je suis plus en droit de disposer de cet Etat que le pape Jules II qui en dépouilla Louis XII, et le transféra de son autorité privée à l'empereur Maximilien. Je suis plus autorisé à parler en faveur des filles de la maison de France que le pape Grégoire XIII, et le cordelier Sixte-Quint ne l'étaient à exclure du trône nos princes du sang, sous prétexte, disaient ces bons prêtres, que Henri IV et les princes de Condé étaient race bâtarde et détestable de Bourbon ; belles et saintes paroles, dont il faut se souvenir à jamais, pour être convaincu de ce qu'on doit aux évêques de Rome. Je puis donner ma voix dans les états généraux: et aucun pape n'y peut avoir de suffrage. Je donne donc ma voix sans difficulté dans trois ou quatre cents ans, à une fille de France, qui resterait seule descendante en droite ligne de Hugues Capet. Je la fais reine pourvu qu'elle soit bien élevée, qu'elle ait l'esprit juste, et qu'elle ne soit point bigote. J'interprète en sa faveur cette loi qui dit que fille ne doit mie succéder . J'entends qu'elle n'héritera mie tant qu'il y aura mâle. Mais dès que mâles défaillent, je prouve que le royaume est à elle, par nature qui l'ordonne, et pour le bien de la nation.
J'invite tous les bons Français à montrer le même respect pour le sang de tant de rois. Je crois que c'est l'unique moyen de prévenir les factions qui démembreraient l'Etat. Je propose qu'elle règne de son chef et qu'on la marie à quelque bon prince, qui prendra le nom et les armes, et qui par lui-même pourra posséder quelque canton, lequel sera annexé à la France; ainsi qu'on a conjoint Marie-Thérèse de Hongrie et François duc de Lorraine, le meilleur prince du monde.
Quel est le Welche qui refusera de la reconnaître, à moins qu'on ne déterre quelque autre belle princesse issue de Charlemagne, dont la famille fut chassée par Hugues Capet malgré la loi salique; ou bien qu'on ne trouve quelque princesse plus belle encore, qui descende évidemment de Clovis, dont la famille fut précédemment chassée par son domestique Pépin, et toujours en dépit de la loi salique?
Je n'aurai certainement nul besoin d'intrigues, pour faire sacrer ma princesse dans Rheims, ou dans Chartres, ou dans la chapelle du Louvre; car tout cela est égal; ou même pour ne la point faire sacrer du tout; car on règne tout aussi bien non sacré que sacré. Les rois, les reines d'Espagne n'observent point cette cérémonie.
Parmi toutes les famille des secrétaires du roi, il ne se trouve personne qui dispute le trône à cette princesse capétienne. Les plus illustres maisons sont si jalouses l'une de l'autre, qu'elles aiment bien mieux obéir à la fille des rois qu'à un de leurs égaux.
Reconnue aisément de toute la France, elle reçoit l'hommage de tous ses sujets avec une grâce majestueuse, qui la fait aimer autant que révérer; et tous les poètes font des vers en l'honneur de ma princesse.
SALOMON. [p. 367]↩
Plusieurs rois ont été de grands clercs, et ont fait de bons livres. Le roi de Prusse Fréderic le Grand est le dernier exemple que nous en ayons. Il sera peu imité; nous ne devons pas présumer qu'on trouve beaucoup de monarques allemands qui fassent des vers français, et qui écrivent l'histoire de leur pays. Jacques I o en Angleterre, et même Henri VIII ont écrit. Il faut en Espagne remonter jusqu'au roi Alphonse X; encore est-il douteux qu'il ait mis la main aux Tables alphonsines.
La France ne peut se vanter d'avoir eu un roi auteur. L'empire d'Allemagne n'a aucun livre de la main de ses empereurs; mais l'empire romain se glorifie de César et de Marc-Aurèle. On compte en Asie plusieurs écrivains parmi les rois. Le présent empereur de la Chine Kien-long passe surtout pour un grand poète. Mais Salomon ou Soleyman l'Hébreu a encore plus de réputation que Kien-long le Chinois.
C'est une grande question en théologie si Salomon est plus renommé par son argent comptant, ou par ses femmes, ou par ses livres. Je suis fâché qu'il ait commencé son règne à la turque en égorgeant son frère.
L'Ecriture ne dit point si Salomon disputait à Adonias la concubine de son père; mais elle dit que Salomon, sur la seule demande d'Adonias, le fit assassiner. Apparemment que Dieu, qui lui donna l'esprit de sagesse, lui refusa alors celui de justice et d'humanité, comme il lui refusa depuis le don de la continence.
Il est dit dans le même livre des Rois, qu'il était maître d'un grand royaume, qui s'étendait de l'Euphrate à la mer Rouge et à la Méditerranée; mais malheureusement il est dit en même temps que le roi d'Egypte avait conquis le pays de Gazer dans le Canaan, et qu'il donna pour dot la ville de Gazer à sa fille, qu'on prétend que Salomon épousa; il est dit qu'il y avait un roi à Damas: les royaumes de Sidon et de Tyr florissaient: entouré d'Etats puissants, il manifesta sans doute sa sagesse, en demeurant en paix avec eux tous. L'abondance extrême qui enrichit son pays ne pouvait être que le fruit de cette sagesse profonde, puisque du temps de Saül il n'y avait pas un ouvrier en fer dans son pays. Nous l'avons déjà remarqué. Ceux qui veulent raisonner trouvent difficile que David successeur de Saül vaincu par les Philistins, ait pu pendant son administration fonder un vaste empire.
Les richesses qu'il laissa à Salomon sont encore plus merveilleuses: il lui donna comptant cent trois mille talents d'or, et un million treize mille talents d'argent. Le talent d'or hébraïque vaut, selon Arbutnot, six mille livres sterling; le talent d'argent environ cinq cents livres sterling. La somme totale du legs en argent comptant, sans les pierreries et les autres effets, et sans le revenu ordinaire proportionné sans doute à ce trésor, montait suivant ce calcul à un milliard cent dix-neuf millions cinq cent mille livres sterling, ou à cinq milliards cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions d'écus d'Allemagne, ou à vingt-cinq milliards six cent quarante-huit millions de France: il n'y avait pas alors autant d'espèces circulantes dans le monde entier. Quelques érudits évaluent ce trésor un peu plus bas, mais la somme est toujours bien forte pour la Palestine.
On ne voit pas après cela pourquoi Salomon se tourmentait tant à envoyer ses flottes au pays d'Ophir pour rapporter de l'or. On devine encore moins comment ce puissant monarque n'avait pas dans ses vastes Etats un seul homme qui sût façonner du bois dans la forêt du Liban. Il fut obligé de prier Hiram roi de Tyr de lui prêter des fendeurs de bois et des ouvriers pour le mettre en oeuvre. Il faut avouer que ces contradictions exercent le génie des commentateurs.
On servait par jour pour le dîner et le souper de sa maison cinquante boeufs et cent moutons, et de la volaille et du gibier à proportion; ce qui peut aller par jour à soixante mille livres pesant de viande. Cela fait une bonne maison.
On ajoute qu'il avait quarante mille écuries et autant de remises pour ses chariots de guerre, mais seulement douze mille écuries pour sa cavalerie. Voilà bien des chariots pour un pays de montagnes, et c'était un grand appareil pour un roi dont le prédécesseur n'avait eu qu'une mule à son couronnement, et pour un terrain qui ne nourrit que des ânes.
On n'a pas voulu qu'un prince qui avait tant de chariots se bornât à un petit nombre de femmes; on lui en donne sept cents, qui portaient le nom de reines ; et ce qui est étrange, c'est qu'il n'avait que trois cents concubines, contre la coutume des rois, qui ont d'ordinaire plus de maîtresses que de femmes.
Il entretenait quatre cent douze mille chevaux, sans doute pour aller se promener avec elles le long du lac de Genézareth, ou vers celui de Sodome, ou vers le torrent de Cédron, qui serait un des endroits les plus délicieux de la terre, si ce torrent n'était pas à sec neuf mois de l'année, et si le terrain n'était pas horriblement pierreux.
Quant au temple qu'il fit bâtir, et que les Juifs ont cru le plus bel ouvrage de l'univers; si les Bramantes, les Michel-Anges et les Palladio avaient vu ce bâtiment, ils ne l'auraient pas admiré: c'était une espèce de petite forteresse carrée, qui renfermait une cour, et dans cette cour un édifice de quarante coudées de long, et un autre de vingt; et il est dit seulement que ce second édifice, qui était proprement le temple, l'oracle, le saint des saints, avait vingt coudées de large comme de long, et vingt de haut. M. Souflot n'aurait pas été fort content de ces proportions.
Les livres attribués à Salomon, ont duré plus que son temple.
Le nom seul de l'auteur a rendu ces livres respectables: ils devaient être bons, puisqu'ils étaient d'un roi, et que ce roi passait pour le plus sage des hommes.
Le premier ouvrage qu'on lui attribue, est celui des Proverbes . C'est un recueil de maximes qui paraissent à nos esprits raffinés quelquefois triviales, basses, incohérentes, sans goût, sans choix et sans dessein. Ils ne peuvent se persuader qu'un roi éclairé ait composé un recueil de sentences dans lesquelles on n'en trouve pas une seule qui regarde la manière de gouverner; la politique, les moeurs des courtisans, les usages d'une cour. Ils sont étonnés de voir des chapitres entiers où il n'est parlé que de gueuses, qui vont inviter les passants dans les rues à coucher avec elles.
Ils se révoltent contre les sentences dans ce goût.
Il y a trois choses insatiables, et une quatrième qui ne dit jamais, c'est assez; le sépulcre, la matrice, la terre, qui n'est jamais rassasiée d'eau; et le feu, qui est la quatrième, ne dit jamais, c'est assez .
Il y a trois choses difficiles, et j'ignore entièrement la quatrième. La voie d'un aigle dans l'air, la voie d'un serpent sur la pierre, la voie d'un vaisseau sur la mer, et la voie d'un homme dans une femme.
Il y a quatre choses qui sont les plus petites de la terre, et qui sont plus sages que les sages; les fourmis, petit peuple qui se prépare une nourriture pendant la moisson; le lièvre, peuple faible qui couche sur des pierres; la sauterelle, qui n'ayant pas de rois, voyage par troupes; le lézard, qui travaille de ses mains et qui demeure dans les palais des rois .
Est-ce à un grand roi, disent-ils, au plus sage des mortels, qu'on ose imputer de telles niaiseries? Cette critique est forte; il faut parler avec plus de respect.
Les Proverbes ont été attribués à Isaïe, à Elzia, à Sobna, à Eliacin, à Joaké, et à plusieurs autres. Mais qui que ce soit qui ait compilé ce recueil de sentences orientales, il n'y a pas d'apparence que ce soit un roi qui s'en soit donné la peine. Aurait-il dit, que la terreur du roi est comme le rugissement du lion ? C'est ainsi que parle un sujet ou un esclave, que la colère de son maître fait trembler. Salomon aurait-il tant parlé de la femme impudique? Aurait-il dit, ne regardez point le vin quand il paraît clair, et que sa couleur brille dans le verre ?
Je doute fort qu'on ait eu des verres à boire du temps de Salomon; c'est une invention fort récente; toute l'antiquité buvait dans des tasses de bois ou de métal; et ce seul passage indique peut-être que cette collection juive fut composée dans Alexandrie, ainsi que tant d'autres livres juifs. [36]
L'Ecclésiaste, que l'on met sur le compte de Salomon, est d'un ordre et d'un goût tout différent. Celui qui parle dans cet ouvrage semble être détrompé des illusions de la grandeur, lassé de plaisirs, et dégoûté de la science. On l'a pris pour un épicurien, qui répète à chaque page que le juste et l'impie sont sujets aux mêmes accidents, que l'homme n'a rien de plus que la bête, qu'il vaut mieux n'être pas né que d'exister, qu'il n'y a point d'autre vie, et qu'il n'y a rien de bon et de raisonnable que de jouir en paix du fruit de ses travaux avec la femme qu'on aime.
On a cru voir un matérialiste à la fois sensuel et dégoûté, qui paraissait avoir mis au dernier verset un mot édifiant sur Dieu, pour diminuer le scandale qu'un tel livre devait causer.
Les critiques ont de la peine à se persuader que ce livre soit de Salomon. Il n'est pas naturel qu'il ait dit: malheur à la terre qui a un roi enfant . Les Juifs n'avaient point eu encore de tels rois.
Il n'est pas naturel qu'il ait dit, j'observe le visage du roi . Il est bien plus vraisemblable que l'auteur ait voulu faire parler Salomon, et que par cette aliénation d'esprit, qu'on découvre dans tant de rabbins, il ait oublié souvent dans le corps du livre que c'était un roi qu'il faisait parler.
Ce qui leur paraît surprenant, c'est que l'on ait consacré cet ouvrage parmi les livres canoniques. S'il fallait établir aujourd'hui le canon de la Bible, peut-être n'y mettrait-on pas l'Ecclésiaste; mais il fut inséré dans un temps où les livres étaient très rares, où ils étaient plus admirés que lus. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de pallier autant qu'il est possible l'épicuréisme qui règne dans cet ouvrage. On a fait pour l'Ecclésiaste comme pour tant d'autres choses qui révoltent bien autrement. Elles furent établies dans des temps d'ignorance; et on est forcé, à la honte de la raison, de les soutenir dans des temps éclairés, et d'en déguiser ou l'absurdité ou l'horreur par des allégories. Ces critiques sont trop hardies.
Le Cantique des cantiques est encore attribué à Salomon, parce que le nom de roi s'y trouve en deux ou trois endroits, parce qu'on fait dire à l'amante, qu'elle est belle comme les peaux de Salomon , parce que l'amante dit qu'elle est noire , et qu'on a cru que Salomon désignait par là sa femme égyptienne.
Ces trois raisons n'ont pas persuadé. 1 o . Quand l'amante, en parlant à son amant, dit: le roi m'a menée dans ses celliers , elle parle visiblement d'un autre que de son amant: donc le roi n'est pas cet amant: c'est le roi du festin, c'est le paranymphe, c'est le maître de la maison qu'elle entend: et cette Juive est si loin d'être la maîtresse d'un roi, que dans tout le cours de l'ouvrage c'est une bergère, une fille des champs qui va chercher son amant à la campagne et dans les rues de la ville, et qui est arrêtée aux portes par les gardes qui lui volent sa robe.
2 o . Je suis belle comme les peaux de Salomon , est l'expression d'une villageoise qui dirait, Je suis belle comme les tapisseries du roi: et c'est précisément parce que le nom de Salomon se trouve dans cet ouvrage qu'il ne saurait être de lui. Quel monarque ferait une comparaison si ridicule? Voyez , dit l'amante au III e chapitre, voyez le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l'a couronné au jour de son mariage . Qui ne reconnaît à ces expressions la comparaison ordinaire que font les filles du peuple en parlant de leurs amants? Elles disent: il est beau comme un prince, il a un air de roi, etc.
3 o . Il est vrai que cette bergère qu'on fait parler dans ce cantique amoureux, dit qu'elle est hâlée du soleil, qu'elle est brune . Or si c'était là la fille du roi d'Egypte, elle n'était point si hâlée. Les filles de qualité en Egypte sont blanches. Cléopâtre l'était; et en un mot, ce personnage ne peut être à la fois une fille de village et une reine.
Il se peut qu'un monarque, qui avait mille femmes, ait dit à l'une d'elles, qu'elle me baise d'un baiser de sa bouche, car vos tétons sont meilleurs que le vin . Un roi et un berger, quand il s'agit de baiser sur la bouche, peuvent s'exprimer de la même manière. Il est vrai qu'il est assez étrange qu'on ait prétendu que c'était la fille qui parlait en cet endroit, et qui faisait l'éloge des tétons de son amant.
On avoue encore qu'un roi galant a pu dire à sa maîtresse, Mon bien-aimé est comme un bouquet de myrrhe, il demeurera entre mes tétons .
Votre nombril est comme une coupe dans laquelle il y a toujours quelque chose à boire; votre ventre est comme un boisseau de froment, vos tétons sont comme deux faons de chevreuil, et votre nez est comme la tour du mont Liban .
J'avoue que les Eglogues de Virgile sont d'un autre style; mais chacun a le sien, et un Juif n'est pas obligé d'écrire comme Virgile.
On n'a pas approuvé ce beau tour d'éloquence orientale, Notre soeur est encore petite, elle n'a point de tétons; que ferons-nous de notre soeur? Si c'est un mur, bâtissons dessus; si c'est une porte, fermons-la .
A la bonne heure que Salomon le plus sage des hommes ait parlé ainsi dans ses goguettes. Mais plusieurs rabbins ont soutenu que non seulement cette petite églogue voluptueuse n'était pas du roi Salomon, mais qu'elle n'était pas authentique. Théodore de Mopsuète était de ce sentiment, et le célèbre Grotius appelle le Cantique des cantiques un ouvrage libertin, flagitiosus ; cependant il est consacré, et on le regarde comme une allégorie perpétuelle du mariage de Jésus-Christ avec son Eglise. Il faut avouer que l'allégorie est un peu forte, et qu'on ne voit pas ce que l'Eglise pourrait entendre quand l'auteur dit que sa petite soeur n'a point de tétons.
Après tout, ce cantique est un morceau précieux de l'antiquité. C'est le seul livre d'amour qui nous soit resté des Hébreux. Il y est souvent parlé de jouissance. C'est une églogue juive. Le style est comme celui de tous les ouvrages d'éloquence des Hébreux, sans liaison, sans suite, plein de répétitions, confus, ridiculement métaphorique; mais il a des endroits qui respirent la naïveté et l'amour.
Le livre de la Sagesse est dans un goût plus sérieux; mais il n'est pas plus de Salomon que le Cantique des cantiques. On l'attribue communément à Jésus fils de Sirac, d'autres à Philon de Biblos; mais quel que soit l'auteur, on a cru que de son temps on n'avait point encore le Pentateuque, car il dit au chap.X qu'Abraham voulut immoler Isaac du temps du déluge; et dans un autre endroit, il parle du patriarche Joseph comme d'un roi d'Egypte. Du moins c'est le sens le plus naturel.
Le pis est que l'auteur dans le même chapitre, prétend qu'on voit de son temps la statue de sel en laquelle la femme de Loth fut changée. Ce que les critiques trouvent de pis encore, c'est que le livre leur paraît un amas très ennuyeux de lieux communs; mais ils doivent considérer que de tels ouvrages ne sont pas faits pour suivre les vaines règles de l'éloquence. Ils sont écrits pour édifier, et non pour plaire. Il faut même lutter contre son dégoût pour les lire.
Il y a grande apparence que Salomon était riche et savant, pour son temps et pour son peuple. L'exagération, compagne inséparable de la grossièreté, lui attribua des richesses qu'il n'avait pu posséder, et des livres qu'il n'avait pu faire. Le respect pour l'antiquité a depuis consacré ces erreurs.
Mais que ces livres aient été écrits par un Juif, que nous importe? Notre religion chrétienne est fondée sur la juive, mais non pas sur tous les livres que les Juifs ont faits.
SAMMONOCODOM. [p. 374]↩
Je me souviens que Sammonocodom, le dieu des Siamois, naquit d'une jeune vierge, et fut élevé sur une fleur. Ainsi la grand-mère de Gengis-Kan fut engrossée par un rayon du soleil. Ainsi l'empereur de la Chine, Kien-long, aujourd'hui glorieusement régnant, assure positivement dans son beau poème de Moukden que sa bisaïeule était une très jolie vierge, qui devint mère d'une race de héros pour avoir mangé des cerises. Ainsi Danaé fut mère de Persée; Rhea Silvia de Romulus. Ainsi Arlequin avait raison de dire, en voyant tout ce qui se passait dans le mondo: tutto il monde è fatto come la nostra famiglia .
La religion de ce Siamois nous prouve que jamais législateur n'enseigna une mauvaise morale. Voyez lecteur, que celle de Brama, de Zoroastre, de Numa, de Thaut, de Pythagore, de Mahomet, et même du poisson Oannès est absolument la même. J'ai dit souvent qu'on jetterait des pierres à un homme qui viendrait prêcher une morale relâchée. Et voilà pourquoi les jésuites eux-mêmes ont eu des prédicateurs si austères.
Les règles que Sammonocodom donna aux talapoins ses disciples, sont aussi sévères que celles de St Basile et de St Benoît.
‘Fuyez les chants, les danses, les assemblées, tout ce qui peut amollir l'âme.
‘N'ayez ni or ni argent.
‘Ne parlez que de justice et ne travaillez que pour elle.
‘Dormez peu, mangez peu; n'ayez qu'un habit.
‘Ne raillez jamais.
‘Méditez en secret, et réfléchissez souvent sur la fragilité des choses humaines.'
Par quelle fatalité, par quelle fureur est-il arrivé que dans tous les pays l'excellence d'une morale si sainte et si nécessaire a été toujours déshonorée par des contes extravagants, par des prodiges plus ridicules que toutes les fables des Métamorphoses? Pourquoi n'y a-t-il pas une seule religion dont les préceptes ne soient d'un sage, et dont les dogmes ne soient d'un fou? (On sent bien que j'excepte la nôtre, qui est en tout sens infiniment sage.)
N'est-ce point que les législateurs s'étant contentés de donner des préceptes raisonnables et utiles, les disciples des premiers disciples et les commentateurs ont voulu enchérir? Ils ont dit: Nous ne serons pas assez respectés, si notre fondateur n'a pas eu quelque chose de surnaturel et de divin. Il faut absolument que notre Numa ait eu des rendez-vous avec la nymphe Egérie; Qu'une des cuisses de Pythagore ait été de pur or: Que la mère de Sammonocodom ait été vierge en accouchant de lui: Qu'il soit né sur une rose, et qu'il soit devenu dieu.
Les premiers Chaldéens ne nous ont transmis que des préceptes moraux très honnêtes: cela ne suffit pas: il est bien plus beau que ces préceptes aient été annoncés par un brochet qui sortait deux fois par jour du fond de l'Euphrate pour venir faire un sermon.
Ces malheureux disciples, ces détestables commentateurs n'ont pas vu qu'ils pervetissaient le genre humain. Tous les gens raisonnables disent, Voilà des préceptes très bons; j'en aurais bien dit autant; mais voilà des doctrines impertinentes, absurdes, révoltantes, capables de décrier les meilleurs préceptes. Qu'arrive-t-il? ces gens raisonnables ont des passions tout comme les talapoins; et plus ces passions sont fortes, plus ils s'enhardissent à dire tout haut, Mes talapoins m'ont trompé sur la doctrine, ils pourraient bien m'avoir trompé sur des maximes qui contredisent mes passions. Alors ils secouent le joug, parce qu'il a été imposé maladroitement: ils ne croient plus en Dieu, parce qu'ils voient bien que Sammonocodom n'est pas dieu. J'en ai déjà averti mon cher lecteur en quelques endroits, lorsque j'étais à Siam; et je l'ai conjuré de croire en Dieu malgré les talapoins.
Le révérend père Tachard qui s'était tant amusé sur le vaisseau avec le jeune Destouches garde-marine, et depuis auteur de l'opéra d' Issé , savait bien que ce que je dis est très vrai.
D'UN FRÈRE CADET DU DIEU SAMMONOCODOM.
Voyez si j'ai eu tort de vous exhorter souvent à définir les termes, à éviter les équivoques. Un mot étranger que vous traduisez très mal par le mot dieu, vous fait tomber mille fois dans des erreurs très grossières. L'essence suprême, l'intelligence suprême, l'âme de la nature, le Grand Etre, l'Eternel géomètre qui a tout arrangé avec ordre, poids et mesure, voilà Dieu. Mais lorsqu'on donne le même nom à Mercure, aux empereurs romains, à Priape, à la divinité des tétons, à la divinité des fesses, au dieu pet, au dieu de la chaise percée, on ne s'entend plus, on ne sait plus où l'on en est. Un juge juif, une espèce de bailli est appelé dieu dans nos saintes Ecritures. Un ange est appelé dieu. On donne le nom de dieux aux idoles des petites nations voisines de la horde juive.
Sammonocodom n'est pas dieu proprement dit; et une preuve qu'il n'est pas dieu, c'est qu'il devint dieu, et qu'il avait un frère nommé Thevatat qui fut pendu et qui fut damné.
Or il n'est pas rare que dans une famille il y ait un homme habile qui fasse fortune, et un autre mal avisé qui soit repris de justice. Sammonocodom devint saint, il fut canonisé à la manière siamoise; et son frère qui fut un mauvais garnement, et qui fut mis en croix, alla dans l'enfer, où il est encore.
Nos voyageurs ont rapporté que quand nous voulûmes prêcher un dieu crucifié aux Siamois, ils se moquèrent de nous. Ils nous dirent que la croix pouvait bien être le supplice du frère d'un dieu, mais non pas d'un dieu lui-même. Cette raison paraissait assez plausible, mais elle n'est pas convaincante en bonne logique. Car puisque le vrai dieu donna pouvoir à Pilate de le crucifier, il put, à plus forte raison, donner pouvoir de crucifier son frère. En effet, Jésus-Christ avait un frère, St Jacques qui fut lapidé. Il n'en était pas moins dieu. Les mauvaises actions imputées à Thevatat frère du dieu Sammonocodom, étaient encore un faible argument contre l'abbé de Choisi et le père Tachard. Car il se pouvait très bien faire que Thevatat eût été pendu injustement, et qu'il eût mérité le ciel au lieu d'être damné: tout cela est fort délicat.
Au reste, on demande comment le père Tachard put en si peu de temps apprendre assez bien le siamois pour disputer contre les talapoins?
On répond que Tachard entendait la langue siamoise comme François Xavier entendait la langue indienne.
SAMOTRACE. [p. 377]↩
Que la fameuse île de Samotrace soit à l'embouchure de l'Hèbre, comme le disent tant de dictionnaires, ou qu'elle en soit à vingt milles, comme c'est la vérité; ce n'est pas ce que je recherche.
Cette île fut longtemps la plus célèbre de tout l'Archipel et même de toutes les îles. Ses dieux Cabires, ses hiérophantes, ses mystères lui donnèrent autant de réputation que le trou St Patrice en eut en Irlande, il n'y a pas longtemps. [37]
Cette Samotrace qu'on appelle aujourd'hui Samandrachi, est un rocher recouvert d'un peu de terre stérile, habitée par de pauvres pêcheurs. Ils seraient bien étonnés si on leur disait que leur île eut autrefois tant de gloire; et ils diraient, Qu'est-ce que la gloire?
Je demande ce qu'étaient ces hiérophantes, ces francs-maçons sacrés qui célébraient leurs mystères antiques de Samotrace, et d'où ils venaient eux et leurs dieux Cabires?
Il n'est pas vraisemblable que ces pauvres gens fussent venus de Phénicie, comme le dit Bochart avec ses étymologies hébraïques, et comme le dit après lui l'abbé Banier. Ce n'est pas ainsi que les dieux s'établissent; ils sont comme les conquérants qui ne subjuguent les peuples que de proche en proche. Il y a trop loin de la Phénicie à cette pauvre île, pour que les dieux de la riche Sidon et de la superbe Tyr soient venus se confiner dans cet ermitage. Les hiérophantes ne sont pas si sots.
Le fait est qu'il y avait des dieux Cabires, des prêtres Cabires, des mystères Cabires dans cette île chétive et stérile. Non seulement Hérodote en parle, mais le Phénicien Sanchoniaton, si antérieur à Hérodote, en parle aussi dans ses fragments heureusement conservés par Eusèbe. Et qui pis est, ce Sanchoniaton, qui vivait certainement avant le temps où l'on place Moïse, cite le grand Thaut, le premier Hermès, le premier Mercure d'Egypte; et ce grand Thaut vivait huit cents ans avant Sanchoniaton, de l'aveu même de ce Phénicien.
Les Cabires étaient donc en honneur deux mille trois ou quatre cents ans avant notre ère vulgaire.
Maintenant si vous voulez savoir d'où venaient ces dieux Cabires établis en Samotrace, n'est-il pas vraisemblable qu'ils venaient de Thrace le pays le plus voisin, et qu'on leur avait donné cette petite île pour y jouer leurs farces, et pour gagner quelque argent? Il se pourrait bien faire qu'Orphée eût été un fameux ménétrier des dieux Cabires.
Mais qui étaient ces dieux? ils étaient ce qu'ont été tous les dieux de l'antiquité, des fantômes inventés par des fripons grossiers, sculptés par des ouvriers plus grossiers encore, et adorés par des brutes appelées hommes.
Ils étaient trois Cabires; car nous avons déjà observé que dans l'antiquité tout se faisait par trois.
Il faut qu'Orphée soit venu très longtemps après l'invention de ces trois dieux; car il n'en admit qu'un seul dans ses mystères. Je prendrais volontiers Orphée pour un socinien rigide.
Je tiens les anciens dieux Cabires pour les premiers dieux des Thraces, quelques noms grecs qu'on leur ait donnés depuis.
Mais voici quelque chose de bien plus curieux pour l'histoire de Samotrace. Vous savez que la Grèce et la Thrace ont été affligées autrefois de plusieurs inondations. Vous connaissez les déluges de Deucalion et d'Ogigès. L'île de Samotrace se vantait d'un déluge plus ancien, et son déluge se rapportait assez au temps où l'on prétend que vivait cet ancien roi de Thrace nommé Xissutre, dont nous avons parlé à l'article Ararat .
Vous pouvez vous souvenir que les dieux de Xixutru, ou Xissutre, qui étaient probablement les Cabires, lui ordonnèrent de bâtir un vaisseau d'environ trente mille pieds de long sur douze cents pieds de large. Que ce vaisseau vogua longtemps sur les montagnes de l'Arménie pendant le déluge. Qu'ayant embarqué avec lui des pigeons et beaucoup d'autres animaux domestiques, il lâcha ses pigeons pour savoir si les eaux s'étaient retirées, et qu'ils revinrent tout crottés, ce qui fit prendre à Xissutre le parti de sortir enfin de son grand vaisseau.
Vous me direz qu'il est bien étrange que Sanchoniaton n'ait point parlé de cette aventure. Je vous répondrai que nous ne pouvons pas décider s'il l'inséra ou non dans son histoire; vu qu'Eusèbe qui n'a rapporté que quelques fragments de cet ancien historien, n'avait aucun intérêt à rapporter l'histoire du vaisseau et des pigeons. Mais Bérose la raconte; et il y joint du merveilleux, selon l'usage de tous les anciens.
Les habitants de Samotrace avaient érigé des monuments de ce déluge.
Ce qui est encore plus étonnant, et ce que nous avons déjà remarqué en partie, c'est que ni la Grèce, ni la Thrace, ni aucun peuple ne connut jamais le véritable déluge, le grand déluge, le déluge de Noé.
Comment encore une fois un événement aussi terrible que celui du submergement de toute la terre, put-il être ignoré des survivants? comment le nom de notre père Noé qui repeupla le monde, put-il être inconnu à tous ceux qui lui devaient la vie? c'est le plus étonnant de tous les prodiges, que de tant de petits-fils aucun n'ait parlé de son grand-père!
Je me suis adressé à tous les doctes: je leur ai dit, Avez-vous jamais lu quelque vieux livre grec, toscan, arabe, égyptien, chaldéen, indien, persan, chinois, où le nom de Noé se soit trouvé? Ils m'ont tous répondu que non. J'en suis encore tout confondu.
Mais que l'histoire de cette inondation universelle se trouve dans une page d'un livre écrit dans un désert par des fugitifs, et que cette page ait été inconnue au reste du monde entier, jusque vers l'an neuf cent de la fondation de Rome; c'est ce qui me pétrifie. Je n'en reviens pas. Mon cher lecteur, crions bien fort, O altitudo ignorantiarum !
SAMSON. [p. 380]↩
En qualité de pauvres compilateurs par alphabet, de ressasseurs d'anecdotes, d'éplucheurs de minuties, de chiffonniers qui ramassent des guenilles au coin des rues, nous nous glorifierons avec toute la fierté attachée à nos sublimes sciences d'avoir découvert qu'on joua le fort Samson , tragédie, sur la fin du seizième siècle en la ville de Rouen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Couturier. Jean ou John Milton, longtemps maître d'école à Londres, puis secrétaire pour le latin du parlement nommé le Croupion , Milton auteur du Paradis perdu , et du Paradis retrouvé , fit la tragédie de Samson agoniste ; et il est bien cruel de ne pouvoir dire en quelle année.
Mais nous savons qu'on l'imprima avec une préface, dans laquelle on vante beaucoup un de nos confrères les commentateurs, nommé Paraeus, lequel s'aperçut le premier, par la force de son génie, que l'Apocalypse est une tragédie. En vertu de cette découverte, il partagea l'Apocalypse en cinq actes, et y inséra des choeurs dignes de l'élégance et du beau naturel de la pièce. L'auteur de cette même préface nous parle des belles tragédies de St Grégoire de Nazianze. Il assure qu'une tragédie ne doit jamais avoir plus de cinq actes; et pour le prouver, il nous donne le Samson agoniste de Milton, qui n'en a qu'un. Ceux qui aiment les longues déclamations, seront satisfaits de cette pièce.
Une comédie de Samson fut jouée longtemps en Italie. On en donna une traduction à Paris en 1717, par un nommé Romagnési; on la représenta sur le théâtre français de la comédie prétendue italienne, anciennement le palais des ducs de Bourgogne. Elle fut imprimée et dédiée au duc d'Orléans régent de France.
Dans cette pièce sublime, Arlequin valet de Samson se battait contre un coq d'Inde, tandis que son maître emportait les portes de la ville de Gaza sur ses épaules.
En 1732 on voulut représenter à l'Opéra de Paris une tragédie de Samson mise en musique par le célèbre Rameau; mais on ne le permit pas. Il n'y avait ni arlequin, ni coq d'Inde, la chose parut trop sérieuse. On était bien aise d'ailleurs de mortifier Rameau qui avait de grands talents. Cependant on joua dans ce temps-là l'opéra de Jephté tiré de l'Ancien Testament, et la comédie de l' Enfant prodigue tirée du Nouveau.
Il y a une vieille édition du Samson agoniste de Milton, précédée d'un abrégé de l'histoire de ce héros; voici la traduction de cet abrégé.
Les Juifs, à qui Dieu avait promis par serment tout le pays qui est entre le ruisseau d'Egypte et l'Euphrate, et qui pour leurs péchés n'eurent jamais ce pays, étaient au contraire réduits en servitude; et cet esclavage dura quarante ans. Or il y avait un Juif de la tribu de Dan, nommé Mannué, ou Mannoa, et la femme de ce Mannué était stérile; et un ange apparut à cette femme, et lui dit: Vous aurez un fils à condition qu'il ne boira jamais de vin, qu'il ne mangera jamais de lièvre, et qu'on ne lui fera jamais les cheveux.
L'ange apparut ensuite au mari et à la femme; on lui donna un chevreau à manger; il n'en voulut point, et disparut au milieu de la fumée; et la femme dit: Certainement nous mourrons, car nous avons vu un dieu; mais ils n'en moururent pas.
L'esclave Samson naquit, fut consacré nazaréen; et dès qu'il fut grand, la première chose qu'il fit, fut d'aller dans la ville phénicienne, ou philistine de Tamnala courtiser une fille d'un de ses maîtres qu'il épousa.
En allant chez sa maîtresse, il rencontra un lion, le déchira en pièces de sa main nue comme il eût fait un chevreau. Quelques jours après il trouva un essaim d'abeilles dans la gueule de ce lion mort avec un rayon de miel, quoique les abeilles ne se reposent jamais sur des charognes.
Alors il proposa cette énigme à ses camarades: la nourriture est sortie du mangeur, et le doux est sorti du dur. Si vous devinez, je vous donnerai trente tuniques et trente robes, sinon vous me donnerez trente robes et trente tuniques. Ses camarades ne pouvant deviner le fait en quoi consistait le mot de l'énigme, gagnèrent la jeune femme de Samson; elle tira le secret de son mari, et il fut obligé de leur donner trente tuniques et trente robes: Ah! leur dit-il, si vous n'aviez pas labouré avec ma vache, vous n'auriez pas deviné.
Aussitôt le beau-père de Samson donna un autre mari à sa fille.
Samson en colère d'avoir perdu sa femme, alla prendre sur-le-champ trois cents renards, les attacha tous ensemble par la queue avec des flambeaux allumés, et ils allèrent mettre le feu dans les blés des Philistins.
Les Juifs esclaves, ne voulant point être punis par leurs maîtres pour les exploits de Samson, vinrent le surprendre dans la caverne où il demeurait, le lièrent avec de grosses cordes, et le livrèrent aux Philistins. Dès qu'il est au milieu d'eux, il rompt ses cordes; et trouvant une mâchoire d'âne, il tue en un tour de main mille Philistins avec cette mâchoire. Un tel effort l'ayant mis tout en feu, il se mourait de soif. Aussitôt Dieu fit jaillir une fontaine d'une dent de la mâchoire d'âne. Samson ayant bu s'en alla dans Gaza ville philistine; il y devint sur-le-champ amoureux d'une fille de joie. Comme il dormait avec elle, les Philistins fermèrent les portes de la ville et environnèrent la maison; il se leva, prit les portes et les emporta. Les Philistins au désespoir de ne pouvoir venir à bout de ce héros, s'adressèrent à une autre fille de joie nommée Dalila, avec laquelle il couchait pour lors. Celle-ci lui arracha enfin le secret, en quoi consistait sa force. Il ne fallait que le tondre pour le rendre égal aux autres hommes; on le tondit, il devint faible, on lui creva les yeux, on lui fit tourner la meule et jouer du violon. Un jour qu'il jouait du violon dans un temple philistin, entre deux colonnes du temple, il fut indigné que les Philistins eussent des temples à colonnade, tandis que les Juifs n'avaient qu'un tabernacle porté sur quatre bâtons. Il sentit que ses cheveux commençaient à revenir. Transporté d'un saint zèle, il jeta à terre les deux colonnes: le temple fut renversé; les Philistins furent écrasés et lui aussi.
Telle est mot à mot cette préface.
C'est cette histoire qui est le sujet de la pièce de Milton et de Romagnési: elle était faite pour la farce italienne.
SCANDALE. [p. 383]↩
Sans rechercher si le scandale était originairement une pierre qui pouvait faire tomber les gens, ou une querelle, ou une séduction, tenons-nous-en à la signification d'aujourd'hui. Un scandale est une grave indécence. On l'applique principalement aux gens d'Eglise. Les Contes de La Fontaine sont libertins, plusieurs endroits de Sanchez, de Tambourin, de Molina sont scandaleux.
On est scandaleux par ses écrits ou par sa conduite. Le siège que soutinrent les augustins contre les archers du guet au temps de la Fronde, fut scandaleux. La banqueroute du frère jésuite La Valette, fut plus que scandaleuse. Le procès des révérends pères capucins de Paris en 1764, fut un scandale très réjouissant. Il faut en dire ici un petit mot pour l'édification du lecteur.
Les révérends pères capucins s'étaient battus dans le couvent; les uns avaient caché leur argent; les autres l'avaient pris. Jusque-là, ce n'était qu'un scandale particulier, une pierre qui ne pouvait faire tomber que des capucins. Mais quand l'affaire fut portée au parlement, le scandale devint public.
Il est dit [38] au procès qu'il faut douze cents livres de pain par semaine au couvent de St Honoré, de la viande, du vin, du bois à proportion, et qu'il y a quatre quêteurs en titre d'office chargés de lever ces contributions dans la ville. Quel scandale épouvantable! douze cents livres de viande et de pain par semaine pour quelques capucins, tandis que tant d'artistes accablés de vieillesse, et tant d'honnêtes veuves sont exposés tous les jours à périr de misère!
pag. 3. Que le révérend père Dorothée se soit fait trois mille livres de rente aux dépens du couvent, et par conséquent aux dépens du public, voilà non seulement un scandale énorme, mais un vol manifeste; et un vol fait à la classe la plus indigente des citoyens de Paris. Car ce sont les pauvres qui paient la taxe imposée par les moines mendiants. L'ignorance et la faiblesse du peuple lui persuadent qu'il ne peut gagner le ciel qu'en donnant son nécessaire, dont ces moines composent leur superflu. Il a donc fallu que de ce seul chef, frère Dorothée ait extorqué vingt mille écus au moins aux pauvres de Paris pour se faire mille écus de rente.
Songez bien, mon cher lecteur, que de telles aventures ne sont pas rares dans ce dix-huitième siècle de notre ère vulgaire, qui a produit tant de bons livres. Je vous l'ai déjà dit; le peuple ne lit point. Un capucin, un récollet, un carme, un picpus qui confesse et qui prêche, est capable de faire lui seul plus de mal que les meilleurs livres ne pourront jamais faire de bien.
J'oserais proposer aux âmes bien nées, de répandre dans une capitale un certain nombre d'anti-capucins, d'anti-récollets, qui iraient de maison en maison recommander aux pères et mères d'être bien vertueux, et de garder leur argent pour l'entretien de leur famille, et le soutien de leur vieillesse; d'aimer Dieu de tout leur coeur, et de ne jamais rien donner aux moines. Mais revenons à la vraie signification du mot scandale.
pag. 43. Dans ce procès des capucins, on accuse frère Grégoire d'avoir fait un enfant à mademoiselle Bras-de-fer, et de l'avoir ensuite mariée à Moutard le cordonnier. On ne dit point si frère Grégoire a donné lui-même la bénédiction nuptiale à sa maîtresse et à ce pauvre Moutard avec dispense. S'il l'a fait, voilà la scandale le plus complet qu'on puisse donner; il renferme fornication, vol, adultère, et sacrilège. Horresco referens .
Je dis d'abord fornication, puisque frère Grégoire forniqua avec Magdelaine Bras-de-fer, qui n'avait alors que quinze ans.
Je dis vol; puisqu'il donna des tabliers et des rubans à Magdelaine, et qu'il est évident qu'il vola le couvent pour les acheter, pour payer les soupers, et les frais des couches et les mois de nourrice.
Je dis adultère; puisque ce méchant homme continua à coucher avec madame Moutard.
Je dis sacrilège; puisqu'il confessait Magdelaine. Et s'il maria lui-même sa maîtresse, figurez-vous quel homme c'était que frère Grégoire.
Un de nos collaborateurs et coopérateurs à ce petit ouvrage des Questions philosophiques et encyclopédiques , travaille à faire un livre de morale sur les scandales, contre l'opinion de frère Patouillet. Nous espérons que le public en jouira incessamment.
SCHISME. [p. 385]↩
On a inséré dans le grand Dictionnaire encyclopédique, tout ce que nous avions dit du grand schisme des Grecs et des Latins dans l' Histoire générale de l'esprit et des moeurs des nations . Nous ne voulons pas nous répéter.
Mais en songeant que schisme signifie déchirure, et que la Pologne est déchirée, nous ne pouvons que renouveler nos plaintes sur cette fatale maladie particulière aux chrétiens. Cette maladie que nous n'avons pas assez décrite, est une espèce de rage qui se porte d'abord aux yeux et à la bouche: on regarde avec un oeil enflammé celui qui ne pense pas comme nous. On lui dit les injures les plus atroces.
La rage passe ensuite aux mains; on écrit des choses qui manifestent le transport au cerveau. On tombe dans des convulsions de démoniaque, on tire l'épée, on se bat avec acharnement jusqu'à la mort. La médecine n'a pu jusqu'à présent trouver de remède à cette maladie, la plus cruelle de toutes. Il n'y a que la philosophie et le temps qui puissent la guérir.
Les Polonais sont aujourd'hui les seuls chez qui la contagion dont nous parlons fasse des ravages. Il est à croire que cette maladie horrible est née chez eux avec la plica. Ce sont deux maladies de la tête qui sont bien funestes. La propreté peut guérir la plica; la seule sagesse peut extirper le schisme.
On dit que ces deux maux étaient inconnus chez les Sarmates quand ils étaient païens. La plica n'attaque aujourd'hui que la populace. Mais tous les maux nés du schisme dévorent aujourd'hui les plus grands de la république.
L'origine de ce mal est dans la fertilité de leurs terres qui produisent beaucoup de blé. Il est bien triste que la bénédiction du ciel les ait rendus si malheureux. Quelques provinces ont prétendu qu'il fallait absolument mettre du levain dans leur pain; mais la plus grande partie du royaume, s'est obstinée à croire qu'il y a de certains jours de l'année où la pâte fermentée était mortelle. [39]
Voilà une des premières origines du schisme ou de la déchirure de la Pologne; la dispute a aigri le sang. D'autres causes s'y sont jointes.
Les uns se sont imaginés dans les convulsions de cette maladie, que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, et les autres ont crié qu'il ne procédait que du Père. Les deux partis, dont l'un s'appelle le parti romain, et l'autre le dissident, se sont regardés mutuellement comme des pestiférés; mais par un symptôme singulier de ce mal, les pestiférés dissidents ont voulu toujours s'approcher des catholiques; et les catholiques n'ont jamais voulu s'approcher d'eux.
Il n'y a point de maladie qui ne varie beaucoup. La diète qu'on croit si salutaire, a été si pernicieuse à cette nation, qu'au sortir d'une diète au mois de juin 1768, les villes de Uman, de Zablotin, de Tetiou, de Zilianka, de Zafran ont été détruites et inondées de sang; et que plus de deux cent mille malades ont péri misérablement.
D'un côté l'empire de Russie, et de l'autre l'empire de Turquie ont envoyé cent mille chirurgiens, pourvus de lancettes, de bistouris et de tous les instruments propres à couper les membres gangrenés; la maladie n'en a été que plus violente. Le transport au cerveau a été si furieux, [40] qu'une quarantaine de malades se sont assemblés pour disséquer le roi, qui n'était nullement attaqué du mal, et dont la cervelle et toutes les parties nobles étaient très saines, ainsi que nous l'avons observé à l'article Superstition . On croit que si on s'en rapportait à lui, il pourrait guérir la nation. Mais un des caractères de cette maladie si cruelle est de craindre la guérison, comme les enragés craignent l'eau.
Nous avons des savants qui prétendent que ce mal vient anciennement de la Palestine, et que les habitants de Jérusalem et de Samarie en furent longtemps attaqués. D'autres croient que le premier siège de cette peste fut l'Egypte, et que les chiens et les chats qui étaient en grande considération, étant devenus enragés, communiquèrent la rage du schisme à la plupart des Egyptiens qui avaient la tête faible.
On remarque surtout que les Grecs qui voyagèrent en Egypte, comme Timée de Locres et Platon, eurent le cerveau un peu blessé. Mais ce n'était ni la rage, ni la peste proprement dite; c'était une espèce de délire dont on ne s'apercevait même que difficilement, et qui était souvent caché sous je ne sais quelle apparence de raison. Mais les Grecs ayant avec le temps porté leur mal chez les nations de l'Occident et du Septentrion, la mauvaise disposition des cerveaux de nos malheureux pays, fit que la petite fièvre de Timée de Locres et de Platon devint chez nous une contagion effroyable, que les médecins appelèrent tantôt intolérance, tantôt persécution, tantôt guerre de religion, tantôt rage, tantôt peste.
Nous avons vu quels ravages ce fléau épouvantable a faits sur la terre. Plusieurs médecins se sont présentés de nos jours pour extirper ce mal horrible jusque dans sa racine. Mais qui le croirait! il se trouve des facultés entières de médecine, à Salamanque, à Coimbre, en Italie, à Paris même, qui soutiennent que le schisme, la déchirure, est nécessaire à l'homme; que les mauvaises humeurs s'évacuent par les blessures qu'elle fait; que l'enthousiasme qui est un des premiers symptômes du mal, exalte l'âme, et produit de très bonnes choses; que la tolérance est sujette à mille inconvénients; que si tout le monde était tolérant, les grands génies manqueraient de ce ressort qui a produit tant de beaux ouvrages théologiques; que la paix est un grand malheur pour un Etat, parce que la paix amène les plaisirs, et que les plaisirs à la longue, pourraient adoucir la noble férocité qui forme les héros; que si les Grecs avaient fait un traité de commerce avec les Troyens au lieu de leur faire la guerre, il n'y aurait eu ni d'Achille, ni d'Hector, ni d'Homère, et que le genre humain aurait croupi dans l'ignorance.
Ces raisons sont fortes, je l'avoue; je demande du temps pour y répondre.
SCHOLIASTE. [p. 388]↩
Par exemple, Dacier et son illustre épouse étaient, quoi qu'on dise, des traducteurs et des scoliastes très utiles. C'était encore une des singularités du grand siècle, qu'un savant et sa femme nous fissent connaître Homère et Horace, en nous apprenant les moeurs et les usages des Grecs et des Romains, dans le même temps où Boileau donnait son Art poétique , Racine Iphigénie et Athalie , Quinault Atys et Armide , où Fénelon écrivait son Télémaque , où Bossuet déclamait ses oraisons funèbres, où Le Brun peignait, où Girardon sculptait, où Ducange fouillait les ruines des siècles barbares pour en tirer des trésors, etc. etc.: remercions les Daciers mari et femme. J'ai plusieurs questions à leur proposer.
QUESTIONS SUR HORACE, A MR.DACIER.
Voudriez-vous, monsieur, avoir la bonté de me dire pourquoi dans la Vie d'Horace imputée à Suétone, vous traduisez le mot d'Auguste purissimum penem , par petit débauché? Il me semble que les Latins, dans le discours familier, entendaient par purus penis , ce que les Italiens modernes ont entendu par buon coglione, faceto coglione , phrase que nous traduisions à la lettre au seizième siècle, quand notre langue était un composé de welche et d'italien. Purissimus penis ne signifierait-il pas un convive agréable, un bon compagnon? le purissimus exclut le débauché. Ce n'est pas que je veuille insinuer par là qu'Horace ne fût très débauché; à Dieu ne plaise.
Remarques sur l'ode I du livre I. Je ne sais pourquoi vous dites qu'une espèce de guitare grecque, le barbyton , avait anciennement des cordes de soie. Ces cordes n'auraient point rendu de son, et les premiers Grecs ne connaissaient point la soie.
Ode IV. Il faut que je vous dise un mot sur la quatrième ode, dans laquelle le beau printemps revient avec le zéphyr; Vénus ramène les Amours, les Grâces, les Nymphes; elles dansent d'un pas léger et mesuré aux doux rayons de Diane qui les regarde, tandis que Vulcain embrase les forges des laborieux Cyclopes.
Vous traduisez, Vénus recommence à danser au clair de la lune avec les Grâces et les Nymphes, pendant que Vulcain est empressé à faire travailler ses Cyclopes .
Vous dites dans vos remarques que l'on n'a jamais vu de cour plus jolie que celle de Vénus, et qu'Horace fait ici une allégorie fort galante. Car par Vénus il entend les femmes; par les Nymphes il entend les filles; et par Vulcain il entend les sots qui se tuent du soin de leurs affaires, tandis que leurs femmes se divertissent. Mais êtes-vous bien sûr qu'Horace ait entendu tout cela?
Dans l'ode sixième, Horace dit:
Nos convivia, nos proelia virginum
Sectis in juvenes unguibus acrium
Cantamus vacui, sive quid urimur
Non praeter solitum leves .
Pour moi, soit que je sois libre, soit que j'aime, suivant ma légèreté ordinaire, je chante nos festins et les combats de nos jeunes filles qui menacent leurs amants de leurs ongles qui ne peuvent les blesser.
Vous traduisez, En quelque état que je sois, libre ou amoureux, et toujours prêt à changer, je ne m'amuse qu'à chanter les combats des jeunes filles qui se font les ongles pour mieux égratigner leurs amants .
Mais j'oserais vous dire, monsieur, qu'Horace ne parle point d'égratigner, et que mieux on coupe ses ongles, moins on égratigne.
Voici un trait plus curieux que celui des filles qui égratignent. Ode X. Il s'agit de Mercure dans l'ode dixième; vous dites qu'il est très vraisemblable qu'on n'a donné à Mercure la qualité de dieu des larrons que par rapport à Moïse, qui commanda à ses Hébreux de prendre tout ce qu'ils pourraient aux Egyptiens, comme le remarque le savant Huet évêque d'Avranches dans sa Démonstration évangélique .
Ainsi, selon vous et cet évêque, Moïse et Mercure sont les patrons des voleurs. Mais vous savez combien on se moqua du savant évêque qui fit de Moïse un Mercure, un Bacchus, un Priape, un Adonis, etc. Assurément Horace ne se doutait pas que Mercure serait un jour comparé à Moïse dans les Gaules.
Quant à cette ode à Mercure, vous croyez que c'est une hymne dans laquelle Horace l'adore; et moi je soupçonne qu'il s'en moque.
Notes sur l'ode XII. Vous croyez qu'on donna l'épithète de Liber à Bacchus, parce que les rois s'appelaient Liberi . Je ne vois dans l'antiquité aucun roi qui ait pris ce titre. Ne se pourrait-il pas que la liberté avec laquelle les buveurs parlent à table, eût valu cette épithète au dieu des buveurs?
O matre pulchra filia pulchrior .
Vous traduisez, Belle Tindaris qui pouvez seule remporter le prix de la beauté sur votre charmante mère. Horace dit seulement, Ode XVI. Votre mère est belle et vous êtes plus belle encore . Cela me paraît plus court et mieux; mais je puis me tromper.
Horace dans cette ode, dit que Prométhée ayant pétri l'homme de limon, fut obligé d'y ajouter les qualités des autres animaux, et qu'il mit dans son coeur la colère du lion.
Vous prétendez que cela est imité de Simonide qui assure que Dieu ayant fait l'homme, et n'ayant plus rien à donner à la femme, prit chez les animaux tout ce qui lui convenait, donna aux unes les qualités de pourceau, aux autres celles du renard, à celles-ci les talents du singe, à ces autres celles de l'âne. Assurément Simonide n'était pas galant, ni Dacier non plus.
Ode XIX. In me tota ruens Venus
Cyprum deseruit .
Vous traduisez, Vénus a quitté entièrement Chypre pour venir loger dans mon coeur .
N'aimez-vous pas mieux ces vers de Racine?
Ce n'est plus une ardeur en mes veines cachée,
C'est Vénus tout entière à sa proie attachée.
Ode XXII. Dulce ridentem Lalagen, amabo, dulce loquentum .
J'aimerai Lalagé qui parle et qui rit avec tant de grâce.
N'aimez-vous pas encore mieux la traduction de Sapho par Boileau?
Que l'on voit quelquefois doucement lui sourire,
Que l'on voit quelquefois tendrement lui parler.
Ode XXIII. Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capitis ?
Vous traduisez, Quelle honte peut-il y avoir à pleurer un homme qui nous était si cher ? etc. etc.
Le mot de honte ne rend pas ici celui de pudor; que peut-il y avoir , n'est pas le style d'Horace. J'aurais peut-être mis à la place, Peut-on rougir de regretter une tête si chère, peut-on sécher ses larmes?
Natis in usum laetitiae Scyphis
Pugnare tracum est .
Vous traduisez, C'est aux Thraces de se battre avec les verres qui ont été faits pour la joie .
On ne buvait point dans des verres alors, et les Thraces encore moins que les Romains.
N'aurait-il pas mieux valu dire, C'est une barbarie des Thraces d'ensanglanter des repas destinés à la joie?
Ode XXXVII. Nunc est bibendum, nunc pede libero
Pulsanda tellus .
Vous traduisez, C'est maintenant, mes chers amis, qu'il faut boire, et que sans rien craindre il faut danser de toute sa force .
Frapper la terre d'un pas libre en cadence, ce n'est pas danser de toute sa force. Cette expression même n'est ni agréable, ni noble, ni d'Horace.
Je saute par-dessus cent questions grammaticales que je voudrais vous faire pour vous demander compte du vin superbe de Cécube. Vous voulez absolument qu'Horace ait dit,
Liv. II, ode XIV. Tinget pavimentum superbo
Pontificum potiore caenis .
Vous traduisez, Il inondera ses chambres de ce vin qui nagera sur ces riches parquets, de ce vin qui aurait dû être réservé pour les festins des pontifes .
Horace ne dit rien de tout cela. Comment voulez-vous que du vin dont on fait une petite libation dans le triclinium , dans la salle à manger, inonde ces chambres? pourquoi prétendez-vous que ce vin dût être réservé pour les pontifes? J'ai d'excellent vin de Malaga et de Canarie; mais je vous réponds que je ne l'enverrai pas à mon évêque.
Horace parle d'un superbe parquet, d'une magnifique mosaïque; et vous m'allez parler d'un vin superbe, d'un vin magnifique. On lit dans toutes les éditions d'Horace, Tinget pavimentum superbum , et non pas superbo .
Vous dites que c'est un grand sentiment de religion dans Horace de ne vouloir réserver ce bon vin que pour les prêtres. Je crois, comme vous, qu'Horace était très religieux, témoin tous ses vers pour les bambins: mais je pense qu'il aurait encore mieux aimé boire ce bon vin de Cécube, que de le réserver pour les prêtres de Rome.
Motus doceri gaudet Ionicos
Matura virgo et fingitur artubus etc .
Vous traduisez, Le plus grand plaisir de nos filles à marier, est d'apprendre les danses lascives des Ioniens. A cet usage elles n'ont point de honte de se rendre les membres souples, et de les former à des postures déshonnêtes .
Que de phrases pour deux petits vers! ah, monsieur, des postures déshonnêtes! S'il y a dans le latin fingitur artubus , et non pas artibus , cela ne signifierait-il pas, Nos jeunes filles apprennent les danses et les mouvements voluptueux des Ioniennes? et rien de plus.
Liv. V, ode XIII. Je tombe sur cette ode, Horrida tempestas .
Vous dites que le vieux commentateur se trompe en pensant que contraxit caelum signifie, nous a caché le ciel; et pour montrer qu'il s'est trompé, vous êtes de son avis.
Ensuite quand Horace introduit le docteur Chiron précepteur d'Achille, annonçant à son élève, pour l'encourager, qu'il ne reviendra pas de Troye.
Unde tibi reditum parcae subtemine certo
Rupere .
Vous traduisez, Les Parques ont coupé le fil de votre vie .
Mais ce fil n'est pas coupé. Il le sera; mais Achille n'est pas encore tué; Horace ne parle point de fil; parcae est là pour fata . Cela veut dire mot à mot, Les destins s'opposent à votre retour.
Vous dites que, Chiron savait cela par lui-même, car il était grand astrologue .
Vous ne voulez pas que dulcibus alloquiis signifie de doux entretiens. Que voulez-vous donc qu'il signifie? Vous assurez positivement que rien n'est plus ridicule, et qu'Achille ne parlait jamais à personne . Mais il parlait à Patrocle, à Phoenix, à Automédon, aux capitaines thessaliens. Ensuite vous imaginez que le mot alloqui signifie consoler. Ces contradictions peuvent égarer studiosam juventutem .
Dans vos remarques sur la troisième satire du second livre, vous nous apprenez que les sirènes s'appelaient de ce nom chez les Grecs, parce que sir signifiait cantique chez les Hébreux: Est-ce Bochart qui vous l'a dit? Croyez-vous qu'Homère eût beaucoup de liaison avec les Juifs? Non, vous n'êtes pas du nombre de ces fous qui veulent faire accroire aux sots que tout nous vient de cette misérable nation juive, qui habitait un si petit pays, et qui fut si longtemps inconnue à l'Europe entière.
Je pourrais faire des questions sur chaque ode et sur chaque épître, mais ce serait un gros livre. Si jamais j'ai le temps, je vous proposerai mes doutes, non seulement sur ces Odes, mais encore sur les Satires, les Epîtres et l'Art poétique. Mais à present il faut que je parle à madame votre femme.
A MADAME DACIER, SUR HOMÈRE.
Madame, sans vouloir troubler la paix de votre ménage, je vous dirai que je vous estime et vous respecte encore plus que votre mari. Car il n'est pas le seul traducteur et commentateur, et vous êtes la seule traductrice et commentatrice. Il est si beau à une Française d'avoir fait connaître le plus ancien des poètes, que nous vous devons d'éternels remerciements.
Je commence par remarquer la prodigieuse différence du grec à notre welche, devenu latin et ensuite français.
Voici votre élégante traduction du commencement de l' Iliade .
Déesse, chantez la colère d'Achille fils de Pélée; cette colère pernicieuse qui causa tant de malheurs aux Grecs, et qui précipita dans le sombre royaume de Pluton les âmes généreuses de tant de héros, et livra leurs corps en proie aux chiens et aux vautours, depuis le jour fatal qu'une querelle d'éclat eut divisé le fils d'Atrée et le divin Achille; ainsi les décrets de Jupiter s'accomplissaient. Quel dieu les jeta dans ces dissensions? Le fils de Jupiter et de Latone, irrité contre le roi, qui avait déshonoré Chrysès son sacrificateur, envoya sur l'armée une affreuse maladie qui emportait les peuples. Car Chrysès étant allé aux vaisseaux des Grecs chargés de présents pour la rançon de sa fille, et tenant dans ses mains les bandelettes sacrées d'Apollon avec le sceptre d'or, pria humblement les Grecs, et surtout les deux fils d'Atrée leurs généraux. ‘Fils d'Atrée, leur dit-il, et vous, généreux Grecs, que les dieux qui habitent l'Olympe vous fassent la grâce de détruire la superbe ville de Priam, et de vous voir heureusement de retour dans votre patrie; mais rendez-moi ma fille en recevant ces présents, et respectez en moi le fils du grand Jupiter, Apollon, dont les traits sont inévitables.'
Tous les Grecs firent connaître par un murmure favorable, qu'il fallait respecter le ministre du dieu, et recevoir ses riches présents. Mais cette demande déplut à Agamemnon aveuglé par sa colère.
Voici la traduction mot à mot, et vers par ligne.
La colère chantez, déesse, de piliade Achille,
Funeste, qui infinis aux Akaïens maux apporta,
Et plusieurs fortes âmes à l'enfer envoya
De héros; et à l'égard d'eux, proie les fit aux chiens
Et à tous les oiseaux. S'accomplissait la volonté de dieu,
Depuis que d'abord différèrent disputants
Agamemnon chef des hommes et le divin Achille.
Qui des dieux par dispute les commit à combattre?
De Latone et de dieu le fils. Car contre le roi irrité
Il suscita dans l'armée une maladie mauvaise et mouraient les peuples.
Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Cet échantillon suffit pour montrer le différent génie des langues, et pour faire voir combien les traductions littérales sont ridicules.
Je pourrais vous demander pourquoi vous avez parlé du sombre royaume de Pluton, et des vautours dont Homère ne dit rien?
Pourquoi vous dites qu'Agamemnon avait déshonoré le prêtre d'Apollon? Déshonorer signifie ôter l'honneur. Agamemnon n'avait ôté à ce prêtre que sa fille. Il me semble que le verbe itimao ne signifie pas en cet endroit déshonorer, mais mépriser, maltraiter.
Pourquoi vous faites dire à ce prêtre, que les dieux vous fassent la grâce de détruire etc.? ces termes vous fassent la grâce semblent pris de notre catéchisme. Homère dit, que les dieux habitants de l'Olympe vous donnent de détruire la ville de Troye.
Doien Olympia domata ekontes
Ekpersai Priamoio polin .
Pourquoi vous dites que tous les Grecs firent connaître par un murmure favorable, qu'il fallait respecter le ministre des dieux? Il n'est point question dans Homère d'un murmure favorable. Il y a expressément, tous dirent pantes epiphemisan .
Vous avez partout ou retranché ou ajouté, ou changé; et ce n'est pas à moi de décider si vous avez bien ou mal fait.
Il n'y a qu'une chose dont je sois sûr, et dont vous n'êtes pas convenue; c'est que si on faisait aujourd'hui un poème tel que celui d'Homère, on serait, je ne dis pas seulement sifflé d'un bout de l'Europe à l'autre, mais je dis entièrement ignoré; et cependant l' Iliade était un poème excellent pour les Grecs. Nous avons vu combien les langues diffèrent. Les moeurs, les usages, les sentiments, les idées diffèrent bien davantage.
Si je l'osais, je comparerais l' Iliade au livre de Job; tous deux sont orientaux, fort anciens, également pleins de fictions, d'images et d'hyperboles. Il y a dans l'un et dans l'autre des morceaux qu'on cite souvent. Les héros de ces deux romans se piquent de parler beaucoup et de se répéter. Les amis s'y disent des injures: voilà bien des ressemblances.
Que quelqu'un s'avise aujourd'hui de faire un poème dans le goût de Job, vous verrez comme il sera reçu.
Vous dites dans votre préface qu'il est impossible de mettre Homère en vers français; dites que cela vous est impossible, parce que vous ne vous êtes pas adonnée à notre poésie. Les Géorgiques de Virgile sont bien plus difficiles à traduire; cependant on y est parvenu.
Je suis persuadé que nous avons deux ou trois poètes en France qui traduiraient bien Homère; mais en même temps je suis très convaincu qu'on ne les lira pas s'ils ne changent, s'ils n'adoucissent, s'ils n'élaguent presque tout. La raison en est, madame, qu'il faut écrire pour son temps, et non pour les temps passés. Il est vrai que notre froid La Motte a tout adouci, tout élagué; et qu'on ne l'en a pas lu davantage. Mais c'est qu'il a tout énervé.
Un jeune homme vint ces jours passés me montrer une traduction d'un morceau du vingt-quatrième livre de l' Iliade . Je le mets ici sous vos yeux, quoique vous ne vous connaissiez guère en vers français.
L'horizon se couvrait des ombres de la nuit;
L'infortuné Priam qu'on dieu même a conduit
Entre, et paraît soudain dans la tente d'Achille.
Le meurtrier d'Hector en ce moment tranquille,
Par un léger repas suspendait ses douleurs.
Il se détourne; il voit ce front baigné de pleurs,
Ce roi jadis heureux, ce vieillard vénérable
Que le fardeau des ans et la douleur accable,
Exhalant à ses pieds ses sanglots et ses cris,
En lui baisant la main qui fit périr son fils.
Il n'osait sur Achille encor jeter la vue.
Il voulait lui parler, et sa voix s'est perdue.
Enfin il le regarde, et parmi ses sanglots
Tremblant, pâle et sans force, il prononce ces mots. --Songez, seigneur, songez que vous avec un père. --
Il ne put achever. -- Le héros sanguinaire
Sentit que la pitié pénétrait dans son coeur.
Priam lui prend les mains. -- Ah prince, ah mon vainqueur!
J'étais père d'Hector! -- et ses généreux frères
Flattaient mes derniers jours et les rendaient prospères. --
Ils ne sont plus. -- Hector est tombé sous vos coups. --
Puisse l'heureux Pélée entre Thétis et vous
Prolonger de ses ans l'éclatante carrière!
Le seul nom de son fils remplit la terre entière,
Ce nom fait son bonheur ainsi que son appui.
Vos honneurs sont les siens, vos lauriers sont à lui.
Hélas! tout mon bonheur et toute mon attente
Est de voir de mon fils la dépouille sanglante;
De racheter de vous ces restes mutilés
Traînés devant mes yeux sous nos murs désolés.
Voilà le seul espoir, le seul bien qui me reste.
Achille, accordez-moi cette grâce funeste,
Et laissez-moi jouir de ce spectacle affreux.Le héros qu'attendrit ce discours douloureux,
Aux larmes de Priam répondit par des larmes.
Tous nos jours sont tissus de regrets et d'alarmes,
Lui dit-il; par mes mains les dieux vous ont frappé.
Dans le malheur commun moi-même enveloppé,
Mourant avant le temps loin des yeux de mon père
Je teindrai de mon sang cette terre étrangère.
J'ai vu tomber Patrocle, Hector me l'a ravi:
Vous perdez votre fils, et je perds un ami.
Tel est donc des humains le destin déplorable.
Dieu verse donc sur nous la coupe inépuisable,
La coupe des douleurs et des calamités;
Il y mêle un moment de faibles voluptés,
Mais c'est pour en aigrir la fatale amertume.
Me conseillez-vous de continuer? me dit le jeune homme. Comment! lui répondis-je, vous vous mêlez aussi de peindre! il me semble que je vois ce vieillard qui veut parler, et qui dans sa douleur ne peut d'abord que prononcer quelques mots étouffés par ses soupirs. Cela n'est pas dans Homère, mais je vous le pardonne. Je vous sais même bon gré d'avoir esquivé les deux tonneaux qui feraient un mauvais effet dans notre langue, et surtout d'avoir accourci. Oui, oui, continuez. La nation ne vous donnera pas quinze mille livres sterling comme les Anglais les ont données à Pope; mais peu d'Anglais ont eu le courage de lire toute son Iliade .
Croyez-vous de bonne foi, que depuis Versailles jusqu'à Perpignan, et jusqu'à St Malo, vous trouviez beaucoup de Grecs qui s'intéressent à Erithion tué autrefois par Nestor; à Ekopolious, fils de Thalesious, tué par Antilokous; à Simoïsious fils d'Athemion tué par Telamon; et à Pirous fils d'Ermbrasous, blessé à la cheville du pied droit? Nos vers français, cent fois plus difficiles à faire que des vers grecs, n'aiment point ces détails. J'ose vous répondre qu'aucune de nos dames ne vous lira. Et que deviendrez-vous sans elles? si elles étaient toutes des Dacier, elles vous liraient encore moins. N'est-il pas vrai, madame? on ne réussira jamais si on ne connaît bien le goût de son siècle, et le génie de sa langue.
SERPENT. [p. 398]↩
‘Je certifie que j'ai tué en diverses fois plusieurs serpents, en mouillant un peu avec ma salive un bâton ou une pierre, et en donnant sur le milieu du corps du serpent un petit coup, qui pouvait à peine occasionner une petite contusion. 19 janvier 1772. Figuier chirurgien.'
Ce chirurgien m'ayant donné ce certificat, deux témoins, qui lui ont vu tuer ainsi des serpents, m'ont attesté ce qu'ils avaient vu. Je voudrais le voir aussi; car j'ai avoué, dans plusieurs endroits de nos Questions , que j'avais pris pour mon patron St Thomas Didyme, qui voulait toujours mettre le doigt dessus.
Il y a dix-huit cents ans que cette opinion s'est perpétuée chez les peuples. Et peut-être aurait-elle dix-huit mille ans d'antiquité, si la Genèse ne nous instruisait pas au juste de la date de notre inimitié avec le serpent. Et on peut dire que si Eve avait craché, quand le serpent était à son oreille, elle eût épargné bien des maux au genre humain.
Lucrèce, au livre IV, rapporte cette manière de tuer les serpents comme une chose très connue.
Est utique ut serpens hominis contacta salivis
Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa .Crachez sur un serpent, la force l'abandonne;
Il se mange lui-même, il se dévore, il meurt.
Il y a un peu de contradiction à le peindre languissant et se dévorant lui-même. Aussi mon chirurgien Figuier n'affirme pas que les serpents qu'il a tués se soient mangés. La Genèse dit bien que nous les tuons avec le talon, mais non pas avec de la salive.
Nous sommes dans l'hiver, au 19 janvier: c'est le temps où les serpents restent chez eux. Je ne puis en trouver au mont Krapac; mais j'exhorte tous les philosophes à cracher sur tous les serpents qu'ils rencontreront en chemin, au printemps. Il est bon de savoir jusqu'où s'étend le pouvoir de la salive de l'homme.
Il est certain que Jésus-Christ lui-mê;me se servit de salive, Marc ch. VII. pour guérir un homme sourd et muet. Il le prit à part; il mit ses doigts dans ses oreilles; il cracha sur sa langue; et regardant le ciel il soupira, et s'écria effeta . Aussitôt le sourd et muet se mit à parler.
Il se peut en effet que Dieu ait permis que la salive de l'homme tue les serpents; mais il peut avoir permis aussi que mon chirurgien ait assommé des serpents à grands coups de pierre et de bâton; et il est même probable qu'ils en seraient morts, soit que le sieur Figuier eût craché, soit qu'il n'eût pas craché.
Je prie donc tous les philosophes d'examiner la chose avec attention. On peut, par exemple, quand on verra passer F. . . dans la rue, lui cracher au nez; et s'il en meurt, le fait sera constaté, malgré tous les raisonnements des incrédules.
Je saisis cette occasion de prier aussi les philosophes de couper le plus qu'ils pourront de têtes de colimaçons incoques; car j'atteste que la tête est revenue à deux limaçons à qui je l'avais très bien coupée. Mais ce n'est pas assez que j'en aie fait l'expérience, il faut que d'autres la fassent encore, pour que la chose acquière quelque degré de probabilité. Car, si j'ai fait heureusement deux fois cette expérience, je l'ai manquée trente fois: son succès dépend de l'âge du limaçon; du temps auquel on lui coupe la tête, de l'endroit où on la lui coupe, du lieu où on le garde, jusqu'à ce que la tête lui revienne.
S'il est important de savoir qu'on peut donner la mort en crachant, il est bien plus essentiel de savoir qu'il revient des têtes. L'homme vaut mieux qu'un limaçon; et je ne doute pas que dans un temps, où tous les arts se perfectionnent, on ne trouve l'art de donner une bonne tête à un homme qui n'en aura point.
SICLE. [p. 400]↩
Poids et monnaie des Juifs. Mais comme ils ne frappèrent jamais de monnaie, et qu'ils se servirent toujours à leur avantage de la monnaie des autres peuples, toute monnaie d'or qui pesait environ une guinée, et toute monnaie d'argent pesant un petit écu de France était appelée sicle ; et ce sicle était le poids du sanctuaire, et le poids de roi.
Liv. I, ch. XIV, v. 24 et 26. Il est dit dans les livres des Rois, qu'Absalon avait de très beaux cheveux, dont il faisait couper tous les ans une partie. Plusieurs grands commentateurs prétendent qu'il les faisait couper tous les mois, et qu'il y en avait pour la valeur de deux cents sicles. Si c'était des sicles d'or, la chevelure d'Absalon lui valait juste deux mille quatre cents guinées par an. Il y a peu de seigneuries qui rapportent aujourd'hui le revenu qu'Absalon tirait de sa tête.
Il est dit que lorsque Abraham acheta un antre en Hébron, du Cananéen Ephron pour enterrer sa femme, Ephron lui vendit cet antre quatre cents sicles d'argent, de monnaie valable et reçue, probatae monetae publicae .
Nous avons remarqué qu'il n'y avait point de monnaie dans ce temps-là. Ainsi ces quatre cents sicles d'argent devaient être quatre cents sicles de poids; lesquels vaudraient aujourd'hui trois livres quatre sous pièce, qui font douze cent quatre-vingts livres de France.
Il fallait que le petit champ qui fut vendu avec cette caverne, fût d'une excellente terre pour être vendu si cher.
Lorsque Eliézer serviteur d'Abraham rencontra la belle Rebecca fille de Batuel, portant une cruche d'eau sur son épaule, et qu'elle lui eut donné à boire à lui et à ses chameaux, il lui donna des Genèse ch. XXIV, v. 22. pendants d'oreille d'or qui pesaient deux sicles, et des bracelets d'or qui en pesaient dix. C'était un présent de vingt-quatre guinées.
Parmi les lois de l'Exode, il est dit que si un boeuf frappe de ses cornes un esclave mâle ou femelle, le possesseur du boeuf donnera trente sicles d'argent au maître de l'esclave, et le boeuf sera lapidé. Apparemment il était sous-entendu que le boeuf aurait fait une blessure dangereuse; sans quoi trente-deux écus auraient été une somme un peu trop forte vers le mont Sinaï, où l'argent n'était pas commun. C'est ce qui a fait soupçonner à plusieurs graves personnages, mais trop téméraires, que l'Exode ainsi que la Genèse, n'avait été écrit que dans des temps postérieurs.
Ce qui les a confirmés dans leur opinion erronée, c'est qu'il est Exode ch. XXX, v. 30 et suiv. dit dans le même Exode, Prenez d'excellente myrrhe du poids de cinq cents sicles, deux cent cinquante de cinnamome, deux cent cinquante de cannes de sucre, deux cent cinquante de casse, quatre pintes et chopine d'huile d'olive pour oindre le tabernacle; et on fera mourir quiconque s'oindra d'une pareille composition, ou en oindra un étranger.
Il est ajouté qu'à tous ces aromates on joindra du stacté, de l'onyx, du galbanum, et de l'encens brillant, et que du tout on doit faire une colature selon l'art du parfumeur.
Mais je ne vois pas ce qui a dû tant révolter les incrédules dans cette composition. Il est naturel de penser que les Juifs qui, selon le texte, volèrent aux Egyptiens tout ce qu'ils purent emporter, avaient volé de l'encens brillant, du galbanum, de l'onyx, du stacté, de l'huile d'olive, de la casse, des cannes de sucre, du cinnamome et de la myrrhe. Ils avaient aussi volé sans doute beaucoup de sicles; et nous avons vu qu'un des plus zélés partisans de cette horde hébraïque évalue ce qu'ils avaient volé seulement en or, à neuf millions. Je ne compte pas après lui.
SOLDAT. [p. 402]↩
Le ridicule faussaire qui fit ce Testament du cardinal de Richelieu, dont nous avons beaucoup plus parlé qu'il ne mérite, donne pour un beau secret d'Etat de lever cent mille soldats quand on veut en avoir cinquante mille.
Si je ne craignais d'être aussi ridicule que ce faussaire, je dirais qu'au lieu de lever cent mille mauvais soldats, il en faut engager cinquante mille bons; qu'il faut rendre leur profession honorable; qu'il faut qu'on la brigue et non pas qu'on la fuie. Que cinquante mille guerriers assujettis à la sévérité de la règle, sont bien plus utiles que cinquante mille moines.
Que ce nombre est suffisant pour défendre un Etat de l'étendue de l'Allemagne, ou de la France, ou de l'Espagne, ou de l'Italie.
Que des soldats en petit nombre dont on a augmenté l'honneur et la paie, ne déserteront point.
Que cette paie étant augmentée dans un Etat, et le nombre des engagés diminué, il faudra bien que les Etats voisins imitent celui qui aura le premier rendu ce service au genre humain.
Qu'une multitude d'hommes dangereux étant rendue à la culture de la terre ou aux métiers, et devenue utile, chaque Etat en sera plus florissant.
M. le marquis de Monteynard a donné en 1771 un exemple à l'Europe; il a donné un surcroît à la paie, et des honneurs aux soldats qui serviraient après le temps de leur engagement. Voilà comme il faut mener les hommes.
SOMNANBULES ET SONGES. [p. 403]↩
J'ai vu un somnambule, mais il se contentait de se lever, de s'habiller, de faire la révérence, de danser le menuet assez proprement, après quoi il se déshabillait, se recouchait et continuait de dormir.
Cela n'approche pas du somnambule de l'Encyclopédie. C'était un jeune séminariste qui se relevait pour composer un sermon en dormant, l'écrivait correctement, le relisait d'un bout à l'autre, ou du moins croyait le relire, y faisait des corrections, raturait des lignes, en substituait d'autres, remettait à sa place un mot oublié; composait de la musique, la notait exactement, après avoir réglé son papier avec sa canne, et plaçait les paroles sous les notes sans se tromper, etc. etc.
Il est dit qu'un archévêque de Bordeaux a été témoin de toutes ces opérations, et de beaucoup d'autres aussi étonnantes. Il serait à souhaiter que ce prélat eût donné lui-même son attestation signée de ses grands vicaires, ou du moins de M. son secrétaire.
Mais supposons que ce somnambule ait fait tout ce qu'on lui attribue, je lui ferai toujours les mêmes questions que je ferais à un simple songeur. Je lui dirais, Vous avez songé plus fortement qu'un autre, mais c'est par le même principe. Cet autre n'a eu que la fièvre, et vous avez eu le transport au cerveau. Mais enfin, vous avez reçu l'un et l'autre des idées, des sensations auxquelles vous ne vous attendiez nullement; vous avez fait tout ce que vous n'aviez nulle envie de faire.
De deux dormeurs l'un n'a pas une seule idée, l'autre en reçoit une foule; l'un est insensible comme un marbre, l'autre éprouve des désirs et des jouissances. Un amant fait en rêvant une chanson pour sa maîtresse, qui dans son délire croit lui écrire une lettre tendre, et qui en récite tout haut les paroles.
Scribit amatori meretrix dat adultera munus
In noctis spatio miserorum vulnera durant .
S'est-il passé autre chose dans votre machine pendant ce rêve si puissant sur vous, que ce qui se passe tous les jours dans votre machine éveillée?
Vous, monsieur le séminariste, né avec le don de l'imitation, vous avez écouté cent sermons, votre cerveau s'est monté à en faire; vous en avez écrit en veillant, poussé par le talent d'imiter; vous en écrivez de même en dormant. Comment s'est-il pu faire que vous soyez devenu prédicateur en rêve, vous étant couché sans aucune volonté de prêcher? ressouvenez-vous bien de la première fois que vous mîtes par écrit l'esquisse d'un sermon pendant la veille. Vous n'y pensiez pas le quart d'heure d'auparavant; vous étiez dans votre chambre livré à une rêverie vague sans aucune idée déterminée; votre mémoire vous rappelle sans que votre volonté s'en mêle, le souvenir d'une certaine fête. Cette fête vous rappelle qu'on prêche ce jour-là; vous vous souvenez d'un texte, ce texte fournit un exorde; vous avez auprès de vous encre et papier, vous écrivez des choses que vous ne pensiez pas devoir jamais écrire.
Voilà précisément ce qui vous est arrivé dans votre acte de noctambule.
Vous avez cru dans l'une et l'autre opération ne faire que ce que vous vouliez; et vous avez été dirigé sans le savoir par tout ce qui a précédé l'écriture de ce sermon.
De même lorsqu'en sortant de vêpres vous vous êtes renfermé dans votre cellule pour méditer, vous n'aviez nul dessein de vous occuper de votre voisine, cependant son image s'est peinte à vous quand vous n'y pensiez pas; votre imagination s'est allumée sans que vous ayez songé à un éteignoir; vous savez ce qui s'en est ensuivi.
Vous avez éprouvé la même aventure pendant votre sommeil.
Quelle part avez-vous eue à toutes ces modifications de votre individu? la même que vous avez à la course de votre sang dans vos artères et dans vos veines, à l'arrosement de vos vaisseaux lymphatiques, au battement de votre coeur et de votre cerveau.
J'ai lu l'article Songe dans le Dictionnaire encyclopédique, et je n'y ai rien compris. Mais quand je recherche la cause de mes idées et de mes actions dans le sommeil et dans la veille, je n'y comprends pas davantage.
Je sais bien qu'un raisonneur qui voudrait me prouver que quand je veille, et que je ne suis ni frénétique ni ivre, je suis alors un animal agent, ne laisserait pas de m'embarrasser.
Mais je l'embarrasserais bien davantage, en lui prouvant que quand il dort il est entièrement patient, pur automate.
Or, dites-moi ce que c'est qu'un animal qui est absolument machine la moitié de sa vie, et qui change de nature deux fois en vingt-quatre heures?
LETTRE AUX AUTEURS DE LA GAZETTE LITTERAIRE SUR LES SONGES. Août 1764.
Messieurs ,
Tous les objets des sciences sont de votre ressort; souffrez que les chimères en soient aussi. Nil sub sole novum : rien de nouveau sous le soleil; aussi n'est-ce pas de ce qui se fait en plein jour que je veux vous entretenir; mais de ce qui se passe pendant la nuit. Ne vous alarmez pas, il ne s'agit que de songes.
Je vous avoue, Messieurs, que je pense assez comme le médecin de votre Monsieur de Pourceaugnac; il demande à son malade de quelle nature sont ses songes, et M. de Pourceaugnac, qui n'est pas philosophe, répond qu'ils sont de la nature des songes. Il est très certain pourtant, n'en déplaise à votre Limousin, que des songes pénibles et funestes dénotent les peines de l'esprit et du corps, un estomac surchargé d'aliments, ou un esprit occupé d'idées douloureuses pendant la veille.
Le laboureur qui a bien travaillé sans chagrin, et bien mangé sans excès, dort d'un sommeil plein et tranquille, que les rêves ne troublent point. Tant qu'il est dans cet état, il ne se souvient jamais d'avoir fait aucun rêve. C'est une vérité dont je me suis assuré autant que je l'ai pu dans mon manoir de Herfordshire. Tout rêve un peu violent est produit par un excès, soit dans les passions de l'âme, soit dans la nourriture du corps; il semble que la nature alors vous en punisse en vous donnant des idées, en vous y faisant penser malgré vous. On pourrait inférer de là que ceux qui pensent le moins sont les plus heureux; mais ce n'est pas là que je veux en venir.
Il faut dire avec Pétrone, quidquid luce fuit, tenebris agit . J'ai connu des avocats qui plaidaient en songe, des mathématiciens qui cherchaient à résoudre des problèmes, des poètes qui faisaient des vers. J'en ai fait moi-même qui étaient assez passables, et je les ai retenus. Il est donc incontestable que dans le sommeil on a des idées suivies comme en veillant. Les idées nous viennent incontestablement malgré nous. Nous pensons en dormant, comme nous nous remuons dans notre lit, sans que notre volonté y ait aucune part. Votre père Mallebranche a donc très grande raison de dire que nous ne pouvons jamais nous donner des idées, car pourquoi en serions-nous les maîtres plutôt pendant la veille que pendant le sommeil? Si votre Mallebranche s'en était tenu là, il serait un très grand philosophe; il ne s'est trompé que parce qu'il a été trop loin: c'est lui dont on peut dire:
Praecessit longè flammantia maenia mundi .
Pour moi, je suis persuadé que cette réflexion que nos pensées ne viennent pas de nous, peut nous faire venir de très bonnes pensées; je n'entreprends pas de développer les miennes; de peur d'ennuyer quelques lecteurs, et d'en étonner quelques autres.
Je vous prie seulement de souffrir encore un petit mot sur les songes. Ne trouvez-vous pas, comme moi, qu'ils sont l'origine de l'opinion généralement répandue dans toute l'antiquité touchant les ombres et les mânes? Un homme profondément affligé de la mort de sa femme ou de son fils, les voit dans son sommeil, ce sont les mêmes traits, il leur parle, ils lui répondent; ils lui sont certainement apparus. D'autres hommes ont eu les mêmes rêves; il est impossible de douter que les morts ne reviennent; mais on est sûr en même temps que ces morts ou enterrés, ou réduits en cendres, ou abîmés dans les mers, n'ont pu reparaître en personne; c'est donc leur âme qu'on a vue: cette âme doit être étendue, légère, impalpable, puisqu'en lui parlant on n'a pu l'embrasser: Effugit imago par levibus ventis . Elle est moulée, dessinée sur le corps qu'elle habitait; puisqu'elle lui ressemble parfaitement; on lui donne le nom d'ombre, de mânes; et de tout cela il reste dans les têtes une idée confuse qui se perpétue d'autant mieux que personne ne la comprend.
Les songes me paraissent encore l'origine sensible des premières prédictions. Qu'y a-t-il de plus naturel et de plus commun, que de rêver à une personne chère qui est en danger de mort, et de la voir expirer en songe? Quoi de plus naturel encore, que cette personne meure après le rêve funeste de son âme? Les songes qui auront été accomplis sont des prédictions que personne ne révoque en doute. On ne tient point compte des rêves qui n'auront point eu leur effet: un seul songe accompli fait plus d'effet que cent qui ne l'auront pas été. L'antiquité est pleine de ces exemples. Combien nous sommes faits pour l'erreur! Le jour et la nuit ont servi à nous tromper.
Vous voyez bien, Messieurs, qu'en étendant ces idées on pourrait tirer quelque fruit du livre de mon compatriote le rêvasseur; mais je finis, de peur que vous ne me preniez moi-même pour un songe-creux. Je suis, Messieurs, votre etc.
JOHN DREAMER
SOPHISTE. [p. 407]↩
Un géomètre un peu dur, nous parlait ainsi. Y a-t-il rien dans la littérature de plus dangereux que des rhéteurs sophistes? parmi ces sophistes y en eut-il jamais de plus inintelligibles et de plus indignes d'être entendus que le divin Platon?
La seule idée utile qu'on puisse peut-être trouver chez lui, est l'immortalité de l'âme, qui était déjà établie chez tous les peuples policés. Mais comment prouve-t-il cette immortalité?
On ne peut trop remettre cette preuve sous nos yeux pour nous faire bien apprécier ce fameux Grec.
Il dit, dans son Phedon , que la mort est le contraire de la vie; que le mort naît du vivant et le vivant du mort, et que par conséquent les âmes vont sous terre après notre mort.
S'il est vrai que le sophiste Platon, qui se donne pour ennemi de tous les sophistes, raisonne presque toujours ainsi, qu'étaient donc ces prétendus grands hommes, et à quoi ont-ils servi?
Le grand défaut de toute la philosophie platonicienne était d'avoir pris les idées abstraites pour des choses réelles. Un homme ne peut avoir fait une belle action que parce qu'il y a un beau réellement existant, auquel cette action est conforme!
On ne peut faire aucune action sans avoir l'idée de cette action. Donc ces idées existent je ne sais où, et il faut les consulter!
Dieu avait l'idée du monde avant de le former, c'était son logos. Donc le monde était la production du logos!
Que de querelles tantôt vaines, tantôt sanglantes cette manière d'argumenter apporta-t-elle enfin sur la terre! Platon ne se doutait pas que sa doctrine pût un jour diviser une Eglise qui n'était pas encore née.
Pour concevoir le juste mépris que méritent toutes ces vaines subtilités, lisez Démosthène; voyez si dans aucune de ses harangues il emploie un seul de ces ridicules sophismes. C'est une preuve bien claire que dans les affaires sérieuses on ne faisait pas plus de cas de ces ergoteries que le conseil d'Etat n'en fait des thèses de théologie.
Vous ne trouverez pas un seul de ces sophismes dans les oraisons de Cicéron. C'était un jargon de l'école, inventé pour amuser l'oisiveté: c'était le charlatanisme de l'esprit.
STYLE. [p. 408]↩
Le style des lettres de Balzac n'aurait pas été mauvais pour des oraisons funèbres. Et nous avons quelques morceaux de physique dans le goût du poème épique et de l'ode. Il est bon que chaque chose soit à sa place.
Ce n'est pas qu'il n'y ait quelquefois un grand art, ou plutôt un très heureux naturel à mêler quelques traits d'un style majestueux dans un sujet qui demande de la simplicité; à placer à propos de la finesse, de la délicatesse dans un discours de véhémence et de force. Mais ces beautés ne s'enseignent pas. Il faut beaucoup d'esprit et de goût. Il serait difficile de donner des leçons de l'un et de l'autre.
Il est bien étrange que depuis que les Français s'avisèrent d'écrire, ils n'eurent aucun livre écrit d'un bon style jusqu'à l'année 1654 où les Lettres provinciales parurent. Pourquoi personne n'avait-il écrit l'histoire d'un style convenable jusqu'à la Conspiration de Venise de l'abbé de St Réal?
D'où vient que Pélisson eut le premier le vrai style de l'éloquence cicéronienne dans ses mémoires pour le surintendant Fouquet?
Rien n'est donc plus difficile et plus rare que le style convenable à la matière que l'on traite?
N'affectez point des tours inusités et des mots nouveaux dans un livre de religion comme l'abbé Houteville. Ne déclamez point dans un livre de physique. Point de plaisanterie en mathématique. Evitez l'enflure et les figures outrées dans un plaidoyer. Une pauvre bourgeoise ivrogne ou ivrognesse meurt d'apoplexie; vous dites qu'elle est dans la région des morts: on l'ensevelit: vous assurez que sa dépouille mortelle est confiée à la terre. Si on sonne pour son enterrement, c'est un son funèbre qui se fait entendre dans les nues. Vous croyez imiter Cicéron; et vous n'imitez que maître Petit-Jean.
J'ai entendu souvent demander si dans nos meilleures tragédies on n'avait pas trop souvent admis le style familier, qui est si voisin du style simple et naïf?
Par exemple, dans Mithridate, Seigneur, vous changez de visage , cela est simple et même naïf. Ce demi-vers placé où il est, fait un effet terrible; il tient du sublime. Au lieu que les mêmes paroles de Bérénice à Antiochus, Prince, vous vous troublez et changez de visage , ne sont que très ordinaires; c'est une transition plutôt qu'une situation.
Rien n'est si simple que ce vers,
Madame, j'ai reçu des lettres de l'armée.
mais le moment où Roxane prononce ces paroles fait trembler. Cette noble simplicité est très fréquente dans Racine, et fait une de ses principales beautés.
Mais on se récria contre plusieurs vers qui ne parurent que familiers.
Il suffit; et que fait la reine Bérénice?
A-t-on vu de ma part le roi de Comgaène.
Sait-il que je l'attends. -- J'ai couru chez la reine.
Il en était sorti lorsque j'y suis couru.
On sait qu'elle est charmante; et de si belles mains
Semblent vous demander l'empire des humains.
Comme vous je m'y perds d'autant plus que j'y pense.
Quoi! seigneur, le sultan reverra son visage.
Mais à ne point mentir
Votre amour dès longtemps a dû le pressentir.
Madame, encor un coup, c'est à vous de choisir.
Elle veut, Acomat, que je l'épouse. -- Eh bien.
Et je vous quitte. -- Et moi, je ne vous quitte pas.
Crois-tu si je l'épouse
Qu'Andromaque en son coeur n'en sera pas jalouse.
Tu vois que c'en est fait, ils se vont épouser.
Pour bien faire, il faudrait que vous les prévinssiez.
Attendez. -- Non, vois-tu, je le nierais en vain.
On a trouvé une grande quantité de pareils vers trop prosaïques, et d'une familiarité qui n'est propre que de la comédie. Mais ces vers se perdent dans la foule des bons; ce sont des fils de laiton qui servent à joindre des diamants.
Le style élégant est si nécessaire, que sans lui la beauté des sentiments est perdue. Il suffit seul pour embellir les sentiments les moins nobles et les moins tragiques.
Croirait-on qu'on pût, entre une reine incestueuse et un père qui devient parricide, introduire une jeune amoureuse, dédaignant de subjuguer un amant qui ait déjà eu d'autres maîtresses, et mettant sa gloire à triompher de l'austérité d'un homme qui n'a jamais rien aimé? C'est pourtant ce qu'Aricie ose dire dans le sujet tragique de Phèdre . Mais elle le dit dans des vers si séducteurs, qu'on lui pardonne ces sentiments d'une coquette de comédie.
Phèdre en vain s'honorait des soupirs de Thésée.
Pour moi je suis plus fière et fuis la gloire aisée,
D'obtenir un hommage à tant d'autres offert,
Et d'entrer dans un coeur de toutes parts ouvert.
Mais de faire fléchir un courage inflexible,
De porter la douleur dans une âme insensible,
D'enchaîner un captif de ses fers étonné
Contre un joug qui lui plaît vainement mutiné;
Voilà ce qui me plaît, voilà ce qui m'irrite.
Hercule à désarmer coûtait moins qu'Hippolite.
Et vaincu plus souvent et plus tôt surmonté,
Préparait moins de gloire aux yeux qui l'ont dompté.
Ces vers ne sont pas tragiques; mais tous les vers ne doivent pas l'être: et s'ils ne font aucun effet au théâtre, ils charment à la lecture, par la seule élégance du style.
Presque toujours les choses qu'on dit, frappent moins que la manière dont on les dit; car les hommes ont tous à peu près les mêmes idées de ce qui est à la portée de tout le monde. L'expression, le style fait toute la différence. Des déclarations d'amour, des jalousies, des ruptures, des raccommodements, forment le tissu de la plupart de nos pièces de théâtre, et surtout de celles de Racine, fondées sur ces petits moyens. Combien peu de génies ont-ils su exprimer ces nuances que tous les auteurs ont voulu peindre! Le style rend singulières les choses les plus communes, fortifie les plus faibles, donne de la grandeur aux plus simples.
Sans le style, il est impossible qu'il y ait un seul bon ouvrage en aucun genre d'éloquence et de poésie.
La profusion des mots est le grand vice du style de presque tous nos philosophes et anti-philosophes modernes. Le Système de la nature en est un grand exemple. Il y a dans ce livre confus quatre fois trop de paroles; et c'est en partie par cette raison qu'il est si confus.
Pag. 1. L'auteur de ce livre dit d'abord que l'homme est l'ouvrage de la nature, qu'il existe dans la nature, qu'il ne peut même sortir de la nature par la pensée etc.; que pour un être formé par la nature et circonscrit par elle, il n'existe rien au delà du grand tout dont il fait partie, et dont il éprouve les influences: qu'ainsi les êtres qu'on suppose au-dessus de la nature ou distingués d'elle-même, seront toujours des chimères.
Il ajoute ensuite, Il ne nous sera jamais possible de nous en former des idées véritables . Mais comment peut-on se former une idée soit fausse, soit véritable d'une chimère, d'une chose qui n'existe point? Ces paroles oiseuses n'ont point de sens, et ne servent qu'à l'arrondissement d'une phrase inutile.
Il ajoute encore qu'on ne pourra jamais se former des idées du lieu que ces chimères occupent, ni de leur façon d'agir . Mais comment des chimères peuvent-elles occuper une place dans l'espace? comment peuvent-elles avoir des façons d'agir? quelle serait la façon d'agir d'une chimère qui est le néant? Dès qu'on a dit chimère on a tout dit. Omne super vacuum pleno de pectore manat.
Page 2. Que l'homme apprenne les lois de la nature, qu'il se soumette à ces lois auxquelles rien ne peut le soustraire; qu'il consente à ignorer les causes entourées pour lui d'un voile impénétrable .
Cette seconde phrase n'est point du tout une suite de la première. Au contraire, elle semble la contredire visiblement. Si l'homme apprend les lois de la nature, elles ne sont point pour lui entourées d'un voile impénétrable. Ce sont des expressions triviales échappées à l'écrivain.
Qu'il subisse sans murmurer les arrêts d'une force universelle qui ne peut revenir sur ses pas, ou qui ne peut jamais s'écarter des règles que son essence lui prescrit .
Qu'est-ce qu'une force qui ne revient point sur ses pas? les pas d'une force! et non content de cette fausse image, il vous en propose une autre si vous l'aimez mieux; et cette autre est une règle prescrite par une essence. Presque tout le livre est malheureusement écrit de ce style obscur et diffus.
Tout ce que l'esprit humain a successivement inventé pour changer ou perfectionner sa façon d'être, n'est qu'une conséquence nécessaire de l'essence propre de l'homme et de celle des êtres qui agissent sur lui. Toutes nos institutions, nos réflexions, nos connaissances, n'ont pour objet que de nous procurer un bonheur vers lequel notre propre nature nous force de tendre sans cesse. Tout ce que nous faisons ou pensons, tout ce que nous sommes et que nous serons, n'est jamais qu'une suite de ce que la nature nous a faits .
Je n'examine point ici le fond de cette métaphysique; je ne recherche point comment nos inventions pour changer notre façon d'être etc. sont les effets nécessaires d'une essence qui ne change point. Je me borne au style. Tout ce que nous serons n'est jamais ; quel solécisme! Une suite de ce que la nature nous a faits ; quel autre solécisme! il fallait dire, ne sera jamais qu'une suite des lois de la nature . Mais il l'a déjà dit quatre fois en trois pages.
Il est très difficile de se faire des idées nettes sur Dieu et sur la nature; il est peut-être aussi difficile de se faire un bon style.
Voici un monument singulier de style dans un discours que nous entendîmes à Versailles en 1745.
HARANGUE AU ROI, PRONONCÉE PAR MR. LE CAMUS PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES AIDES.
Sire ,
Les conquêtes de V. M. sont si rapides, qu'il s'agit de ménager, la croyance des descendants, et d'adoucir la surprise des miracles, de peur que les héros ne se disposent de les suivre, et les peuples de les croire.
Non, Sire, il n'est plus possible qu'ils en doutent lorsqu'ils liront dans l'histoire, qu'on a vu V. M. à la tête de ses troupes, les écrire elle-même au champ de Mars sur un tambour; c'est les avoir gravées à toujours au temple de mémoire.
Les siècles les plus reculés sauront que l'Anglais, cet ennemi fier et audacieux, cet ennemi jaloux de votre gloire a été forcé de tourner autour de votre victoire; que leurs alliés ont été témoins de leur honte, et qu'ils n'ont tous accouru au combat que pour immortaliser le triomphe du vainqueur.
Nous n'osons dire à V. M. quelque amour qu'elle ait pour son peuple, qu'il n'y a plus qu'un secret d'augmenter notre bonheur, c'est de diminuer son courage, et que le ciel nous vendrait trop cher ses prodiges s'il nous en coûtait vos dangers, ou ceux du plus jeune héros qui forme nos plus chères espérances.
SUPERSTITION. [p. 414]↩
SECTION PREMIÈRE.
Je vous ai entendu dire quelquefois, Nous ne sommes plus superstitieux; la réforme du seizième siècle nous a rendus plus prudents; les protestants nous ont appris à vivre.
Et qu'est-ce donc que le sang d'un St Janvier que vous liquéfiez tous les ans quand vous l'approchez de sa tête? Ne vaudrait-il pas mieux faire gagner leur vie à dix mille gueux, en les occupant à des travaux utiles, que de faire bouillir le sang d'un saint pour les amuser? Songez plutôt à faire bouillir leur marmite.
Pourquoi bénissez-vous encore dans Rome les chevaux et les mulets à Ste Marie majeure?
Que veulent ces bandes de flagellants en Italie et en Espagne qui vont chantant et se donnant la discipline en présence des dames? pensent-ils qu'on ne va en paradis qu'à coups de fouet?
Ces morceaux de la vraie croix qui suffiraient à bâtir un vaisseau de cent pièces de canon, tant de reliques reconnues pour fausses, tant de faux miracles, sont-ils des monuments d'une piété éclairée?
La France se vante d'être moins superstitieuse qu'on ne l'est devers St Jacques de Compostelle, et devers Notre-Dame de Lorette. Cependant, que de sacristies où vous trouvez encore des pièces de la robe de la Vierge, des roquilles de son lait, de rognures de ses cheveux! et n'avez-vous pas encore dans l'église du Puy-en-Velay le prépuce de son fils conservé précieusement?
Vous connaissez tous l'abominable farce qui se joue depuis les premiers jours du quatorzième siècle dans la chapelle de St Louis, au palais de Paris, la nuit de chaque jeudi saint au vendredi. Les possédés du royaume se donnent rendez-vous dans cette église; les convulsions de St Médard n'approchent pas des horribles simagrées, des hurlements épouvantables, des tours de force que font ces malheureux. On leur donne à baiser un morceau de la vraie croix enchâssé dans trois pieds d'or, et orné de pierreries. Alors les cris et les contorsions redoublent. On apaise le diable en donnant quelques sous aux énergumènes. Mais pour les mieux contenir, on a dans l'église cinquante archers du guet, la baïonnette au bout du fusil.
La même exécrable comédie se joue à St Maur. Je vous citerais vingt exemples semblables; rougissez, et corrigez-vous.
Il est des sages qui prétendent qu'on doit laisser au peuple ses superstitions comme on lui laisse ses guinguettes, etc.
Que de tout temps il a aimé les prodiges, les diseurs de bonne aventure, les pèlerinages et les charlatans; que dans l'antiquité la plus reculée on célébrait Bacchus sauvé des eaux, portant des cornes, faisant jaillir d'un coup de sa baguette une source de vin d'un rocher, passant la mer Rouge à pied sec avec tout son peuple, arrêtant le soleil et la lune, etc.
Qu'à Lacédémone on conservait les deux oeufs dont accoucha Léda, pendant à la voûte d'un temple; que dans quelques villes de la Grèce les prêtres montraient le couteau avec lequel on avait immolé Iphigénie, etc.
Il est d'autres sages qui disent, aucune de ces superstitions n'a produit du bien; plusieurs ont fait de grands maux. Il faut donc les abolir.
SECTION SECONDE.
Je vous prie, mon cher lecteur, de jeter un coup d'oeil sur le miracle qui vient de s'opérer en Basse-Bretagne dans l'année 1771 de notre ère vulgaire. Rien n'est plus authentique; cet imprimé est revêtu de toutes les formes légales. Lisez.
RECIT surprenant sur l'apparition visible & miraculeuse de N.S.J.C. au St. Sacrement de l'autel,qui s'est faite, par la toute-puissance de DIEU, dans l'église paroissiale de Paimpole, près Treguyer en Basse-Bretagne ,le jour des Rois.
Le 6 janvier 1771, jour des Rois, pendant qu'on chantait le salut, on vit des rayons de lumière sortir du saint sacrement, et l'on aperçut à l'instant N. S. Jésus en figure naturelle, qui parut plus brillant que le soleil, et qui fut vu une demi-heure entière, pendant laquelle parut un arc-en-ciel sur le faîte de l'église. Les pieds de Jésus restèrent imprimés sur le tabernacle, où ils se voient encore, et il s'y opère tous les jours plusieurs miracles. A quatre heures du soir Jésus ayant disparu de dessus le tabernacle, le curé de ladite paroisse s'approcha de l'autel, et y trouva une lettre que Jésus y avait laissée: il voulut la prendre, mais il lui fut impossible de la pouvoir lever. Ce curé, ainsi que le vicaire, en furent avertir Mgr l'évêque de Treguyer, qui ordonna dans toutes les églises de la ville les prières des quarante heures pendant huit jours, durant lequel temps le peuple allait en foule voir cette sainte lettre. Au bout de la huitaine, Mgr l'évêque y vint en procession, accompagné de tout le clergé séculier et régulier de la ville, après trois jours de jeûne au pain et à l'eau. La procession étant entrée dans l'église, Mgr l'évêque se mit à genoux sur les degrés de l'autel; et après avoir demandé à Dieu la grâce de pouvoir lever cette lettre, il monta à l'autel, et la prit sans difficulté: s'étant ensuite tourné vers le peuple, il en fit la lecture à haute voix, et recommanda à tous ceux qui savaient lire de lire cette lettre tous les premiers vendredis de chaque mois; et à ceux qui ne savaient pas lire, de dire cinq pater et cinq ave en l'honneur des cinq plaies de Jésus-Christ, afin d'obtenir les grâces promises à ceux qui la liront dévotement, et la conservation des biens de la terre. Les femmes enceintes doivent dire, pour leur heureuse délivrance, neuf pater et neuf ave en faveur des âmes du purgatoire, afin que leurs enfants aient le bonheur de recevoir le saint sacrement de baptême.
Tout le contenu en ce récit a été approuvé par Mgr l'évêque, par M. le lieutenant général de ladite ville de Treguyer, et par plusieurs personnes de distinction, qui se sont trouvées présentes à ce miracle.
COPIE de la lettre trouvée sur l'autel, lors de l'apparition miraculeuse de N.S.J.C. au très saint sacrement de l'autel, le jour des Rois 1771.
‘Eternité de vie, éternité de châtiments, éternelles délices; rien n'en peut dispenser: il faut choisir un parti, ou celui d'aller à la gloire, ou marcher au supplice. Le nombre d'années que les hommes passent sur la terre dans toutes sortes de plaisirs sensuels et de débauches excessives, d'usurpations, de luxe, d'homicides, de larcins, de médisances et d'impuretés, blasphémant et jurant mon saint nom en vain, et mille autres crimes, ne permettant pas de souffrir plus longtemps que des créatures, créées à mon image et ressemblance, rachetées par le prix de mon sang sur l'arbre de la croix, où j'ai enduré mort et passion, m'offensent continuellement, en transgressant mes commandements et abandonnant ma loi divine; je vous avertis que si vous continuez à vivre dans le péché, et que je ne voie en vous ni remords, ni contrition, ni une sincère et véritable confession et satisfaction, je vous ferai sentir la pesanteur de mon bras divin. Si ce n'était les prières de ma chère mère, j'aurais déjà détruit la terre, pour les péchés que vous commettez les uns contre les autres. Je vous ai donné six jours pour travailler, et le septième pour vous reposer, pour sanctifier mon saint nom, pour entendre la sainte messe, et employer le reste du jour au service de Dieu mon père. Au contraire, on ne voit que blasphèmes et ivrogneries; et le monde est tellement débordé, qu'on n'y voit que vanité et mensonges. Les chrétiens, au lieu d'avoir compassion des pauvres qu'ils voient à leurs portes, et qui sont mes membres, pour parvenir au royaume céleste, ils aiment mieux mignarder des chiens et autres animaux, et laisser mourir de faim et de soif ces objets, en s'abandonnant entièrement à Satan, par leur avarice, gourmandise et autres vices: au lieu d'assister les pauvres, ils aiment mieux sacrifier tout à leurs plaisirs et débauches. C'est ainsi qu'ils me déclarent la guerre. Et vous, pères et mères pleins d'iniquités, vous souffrez vos enfants jurer et blasphémer mon saint nom: au lieu de leur donner une bonne éducation, vous leur amassez, par avarice, des biens qui sont dédiés à Satan. Je vous dis par la bouche de Dieu mon père, de ma chère mère, de tous les chérubins et séraphins, et par St Pierre le chef de mon Eglise, que si vous ne vous amendez, je vous enverrai des maladies extraordinaires qui périra tout; vous ressentirez la juste colère de Dieu mon père; vous serez réduits à un tel état, que vous n'aurez connaissance des uns des autres. Ouvrez les yeux et contemplez ma croix, que je vous ai laissée pour arme contre l'ennemi du genre humain, et pour vous servir de guide à la gloire éternelle: regardez mon chef couronné d'épines, mes pieds et mes mains percés de clous; j'ai répandu jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour votre rédemption, par un pur amour de père pour des enfants ingrats. Faites des oeuvres qui puissent vous attirer ma miséricorde; ne jurez pas mon saint nom; priez-moi dévotement; jeûnez souvent, et particulièrement faites l'aumône aux pauvres, qui sont mes membres; car c'est de toutes les bonnes oeuvres celle qui m'est la plus agréable: ne méprisez ni la veuve ni l'orphelin; restituez ce qui ne vous appartient pas; fuyez toutes les occasions de pécher; gardez soigneusement mes commandements; honorez Marie, ma très chère mère.
‘Ceux ou celles qui ne profiteront pas des avertissements que je leur donne, qui ne croiront pas mes paroles, attireront par leur obstination mon bras vengeur sur leurs têtes; ils seront accablés de malheurs, qui seront les avant-coureurs de leur fin dernière et malheureuse, après laquelle ils seront précipités dans les flammes éternelles, où ils souffriront des peines sans fin, qui sont le juste châtiment réservé à leurs crimes.
‘Au contraire, ceux ou celles qui feront un saint usage des avertissements de Dieu, qui leur sont donnés par cette lettre, apaiseront sa colère, et obtiendront de lui, après une confession sincère de leurs fautes, la rémission de leurs péchés, tant grands soient-ils.'
Il faut garder soigneusement cette lettre, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ .
Avec permission. A Bourges le 30 juillet 1771. DEBEAUVOIR , Lieut. Gén. de police.
NB. Il faut remarquer que cette sottise a été imprimée à Bourges sans qu'il y ait eu ni à Treguyer ni à Paimpole le moindre prétexte qui pût donner lieu à une pareille imposture. Cependant, supposons que dans les siècles à venir quelque cuistre à miracles veuille prouver un point de théologie par l'apparition de Jésus-Christ sur l'autel de Paimpole, ne se croira-t-il pas en droit de citer la propre lettre de Jésus imprimée à Bourges avec permission? ne traitera-t-il pas d'impies ceux qui en douteront? ne prouvera-t-il pas par les faits que Jésus opérait partout des miracles dans notre siècle? Voilà un beau champ ouvert aux Houtevilles et aux Abadies.
SECTION TROISIÉME.
Nouvel exemple de la superstition la plus horrible.
Ils avaient communié à l'autel de la Ste Vierge, ils avaient juré à la Ste Vierge de massacrer leur roi, ces trente conjurés qui se jetèrent sur le roi de Pologne, la nuit du 3 novembre de la présente année 1771.
Apparemment quelqu'un des conjurés n'était pas entièrement en état de grâce quand il reçut dans son estomac le corps du propre fils de la Ste Vierge avec son sang sous les apparences du pain, et qu'il fit serment de tuer son roi ayant son Dieu dans sa bouche; car il n'y eut que deux domestiques du roi de tués. Les fusils et les pistolets tirés contre Sa Majesté le manquèrent; il ne reçut qu'un léger coup de feu au visage, et plusieurs coups de sabre qui ne furent pas mortels.
C'en était fait de sa vie, si l'humanité n'avait pas enfin combattu la superstition dans le coeur d'un des assassins nommé Kosinsky. Quel moment quand ce malheureux dit à ce prince tout sanglant, vous êtes pourtant mon roi! Oui , lui répondit Stanislas-Auguste, et votre bon roi qui ne vous ai jamais fait de mal. Cela est vrai , dit l'autre, mais j'ai fait serment de vous tuer .
Ils avaient juré devant l'image miraculeuse de Czentoshova: c'est ainsi que les assassins des Sforce et des Médicis, et que tant d'autres saints assassins faisaient dire des messes, ou la disaient eux-mêmes pour l'heureux succès de leur entreprise.
La lettre de Varsovie qui fait le détail de cet attentat, ajoute, Les religieux qui emploient leur pieuse ardeur à faire ruisseler le sang, et ravager la patrie, ont réussi en Pologne, comme ailleurs, à inculquer à leurs affiliés qu'il est permis de tuer les rois .
En effet, les assassins s'étaient cachés dans Varsovie pendant trois jours chez les révérends pères dominicains; et quand on a demandé à ces moines complices pourquoi ils avaient gardé chez eux trente hommes armés sans en avertir le gouvernement, ils ont répondu que ces hommes étaient venus pour faire leurs dévotions et pour accomplir un voeu.
O temps des Jean Châtel, des Guignard, des Ricodovis, des Poltrot, des Ravaillac, des Damiens, des Malagrida, vous revenez donc encore! Ste Vierge, et vous son digne fils, empêchez qu'on n'abuse de vos sacrés noms pour commettre le même crime!
M. Jean-George Le Franc, évêque du Puy-en-Velay, dit, dans son immense pastorale aux habitants du Puy, pages 258 et 259, que ce sont les philosophes qui sont des séditieux. Et qui accuse-t-il de sédition? lecteurs, vous serez étonnés, c'est Locke, le sage Locke lui-même, il le rend complice des pernicieux desseins du comte de Shaftersburi, l'un des héros du parti philosophiste .
Ah! M. Jean-George, combien de méprises en peu de mots! premièrement vous prenez le petit-fils pour le grand-père. Le comte Shaftersburi l'auteur des Caractéristiques et des Recherches sur la vertu , ce héros du parti philosophiste, mort en 1713, cultiva toute sa vie les lettres dans la plus profonde retraite. Secondement, le grand chancelier Shaftersburi son grand-père, à qui vous attribuez des forfaits, passe en Angleterre pour avoir été un véritable patriote. Troisièmement, Locke est révéré dans toute l'Europe comme un sage.
Je vous défie de me montrer un seul philosophe depuis Zoroastre jusqu'à Locke qui ait jamais excité une sédition, qui ait trempé dans un attentat contre la vie des rois, qui ait troublé la société; et malheureusement je vous trouverai mille superstitieux depuis Aod jusqu'à Kosinsky, teints du sang des rois et de celui des peuples. La superstition met le monde entier en flammes; la philosophie les éteint.
Peut-être ces pauvres philosophes ne sont-ils pas assez dévots à la Ste Vierge, mais ils le sont à Dieu, à la raison, à l'humanité.
Polonais, si vous n'êtes pas philosophes, du moins ne vous égorgez pas. Français et Welches, réjouissez-vous; et ne vous querellez plus.
Espagnols, que les noms d' Inquisition et de Sainte Hermandad ne soient plus prononcés parmi vous. Turcs qui avez asservi la Grèce; moines qui l'avez abrutie, disparaissez de la terre.
SUPPLICES. [p. 411]↩
SECTION PREMIÈRE.
Oui, répétons, un pendu n'est bon à rien. Probablement quelque bourreau aussi charlatan que cruel, aura fait accroire aux imbéciles de son quartier que la graisse de pendu guérissait de l'épilepsie.
Le cardinal de Richelieu en allant à Lyon se donner le plaisir de faire exécuter Cinq-Mars et de Thou, apprit que le bourreau s'était cassé la jambe; Quel malheur , dit-il au chancelier Seguier, nous n'avons point de bourreau ! J'avoue que cela était bien triste; c'était un fleuron qui manquait à sa couronne. Mais enfin on trouva un vieux bonhomme qui abattit la tête de l'innocent et sage de Thou en douze coups de sabre. De quelle nécessité était cette mort? quel bien pouvait faire l'assassinat juridique du maréchal de Marillac?
Je dirai plus; si le duc Maximilien de Sully n'avait pas forcé le bon Henri IV à faire exécuter le maréchal de Biron couvert de blessures reçues à son service, peut-être Henri n'aurait-il pas été assassiné lui-même; peut-être cet acte de clémence si bien placé après la condamnation, aurait adouci l'esprit de la Ligue qui était encore très violent; peut-être n'aurait-on pas crié sans cesse aux oreilles du peuple, Le roi protège toujours les hérétiques, le roi maltraite les bons catholiques, le roi est un avare, le roi est un vieux débauché qui à l'âge de cinquante-sept ans est amoureux de la jeune princesse de Condé, ce qui réduit son mari à s'enfuir du royaume avec sa femme. Toutes ces flammes du mécontentement universel n'auraient pas mis le feu à la cervelle du fanatique feuillant Ravaillac.
Quant à ce qu'on appelle communément la justice , c'est-à-dire, l'usage de tuer un homme parce qu'il aura volé un écu à son maître, ou de le brûler comme Simon Morin, pour avoir dit qu'il a eu des conversations avec le Saint-Esprit, et comme on a brûlé un vieux fou de jésuite nommé Malagrida pour avoir imprimé les entretiens que la sainte Vierge Marie avait avec sa mère Ste Anne quand elle était dans son ventre, etc.: cet usage, il en faut convenir, n'est ni humain, ni raisonnable, et ne peut jamais être de la moindre utilité.
Nous avons déjà demandé à l'article Question quel avantage pouvait résulter pour l'Etat de la mort d'un pauvre homme connu sous le nom du fou de Verberie , qui, dans un souper chez des moines, avait proféré des paroles insensées, et qui fut pendu au lieu d'être purgé et saigné.
Nous avons demandé encore s'il était bien nécessaire qu'un autre fou qui était dans les gardes du corps, et qui se fit quelques taillades légères avec un couteau à l'exemple des charlatans, pour obtenir quelque récompense, fût pendu aussi par arrêt du parlement? était-ce là un grand crime? y avait-il un grand danger pour la société de laisser vivre cet homme?
En quoi était-il nécessaire qu'on coupât la main et la langue au chevalier de la Barre? qu'on l'appliquât à la torture ordinaire et extraordinaire, et qu'on le brûlât tout vif? telle fut sa sentence, prononcée par les Solons et les Lycurgues d'Abbeville. De quoi s'agissait-il? avait-il assassiné son père et sa mère? craignait-on qu'il ne mît le feu à la ville? on l'accusait de quelques irrévérences si secrètes, que la sentence même ne les articula pas. Il avait, disait-on, chanté une vieille chanson que personne ne connaît; il avait vu passer de loin une procession de capucins sans la saluer.
Il faut que chez certains peuples le plaisir de tuer son prochain en cérémonie, comme dit Boileau, et de lui faire souffrir des tourments épouvantables, soit un amusement bien agréable. Ces peuples habitent le quarante-neuvième degré de latitude; c'est précisément la position des Iroquois. Il faut espérer qu'on les civilisera un jour.
Il y a toujours dans cette nation de barbares, deux ou trois mille personnes très aimables, d'un goût délicat, et de très bonne compagnie, qui à la fin poliront les autres.
Je demanderais volontiers à ceux qui aiment tant à élever des gibets, des échafauds, des bûchers, et à faire tirer des arquebusades dans la cervelle, s'ils sont toujours en temps de famine, et s'ils tuent ainsi leurs semblables de peur d'avoir trop de monde à nourrir?
Je fus effrayé un jour en voyant la liste des déserteurs depuis huit années seulement; on en comptait soixante mille. C'était soixante mille compatriotes auxquels il fallait casser la tête au son du tambour, et avec lesquels on aurait conquis une province, s'ils avaient été bien nourris et bien conduits.
Je demanderais encore à quelques-uns de ces Dracons subalternes, si dans leur pays il n'y a pas de grandes routes, et des chemins de traverse à construire, des terrains incultes à défricher, et si les pendus et les arquebusés peuvent leur rendre ce service?
Je ne leur parlerais pas d'humanité, mais d'utilité: malheureusement ils n'entendent quelquefois ni l'un ni l'autre. Et quand M. Beccaria fut applaudi de l'Europe pour avoir démontré que les peines doivent être proportionnées aux délits, il se trouva bien vite chez les Iroquois un avocat gagé par un prêtre, qui soutint que torturer, pendre, rouer, brûler dans tous les cas, est toujours le meilleur.
SECTION SECONDE.
C'est en Angleterre, surtout, plus qu'en aucun pays, que s'est signalée la tranquille fureur d'égorger les hommes avec le glaive prétendu de la loi. Sans parler de ce nombre prodigieux de seigneurs du sang royal, de pairs du royaume, d'illustres citoyens péris sur un échafaud en place publique, il suffirait de réfléchir sur le supplice de la reine Anne Boulen, de la reine Catherine Howard, de la reine Jeanne Grai, de la reine Marie Stuart, du roi Charles I er , pour justifier celui qui a dit que c'était au bourreau d'écrire l'histoire d'Angleterre.
Après cette île, on prétend que la France est le pays où les supplices ont été les plus communs. Je ne dirai rien de celui de la reine Brunehaut; car je n'en crois rien. Je passe à travers mille échafauds, et je m'arrête à celui du comte Montécuculi qui fut écartelé en présence de François I er et de toute la cour, parce que le dauphin François était mort d'une pleurésie.
Cet événement est de 1536. Charles-Quint victorieux de tous les côtés en Europe et en Afrique, ravageait à la fois la Provence et la Picardie. Pendant cette campagne qui commençait pour lui avec avantage, le jeune dauphin âgé de dix-huit ans, s'échauffe à jouer à la paume dans la petite ville de Tournon. Tout en sueur il boit de l'eau glacée; il meurt de la pleurésie le cinquième jour. Toute la cour, toute la France crie que l'empereur Charles-Quint a fait empoisonner le dauphin de France. Cette accusation aussi horrible qu'absurde, est répétée jusqu'à nos jours. Malherbe dit dans une de ses odes:
François quand la Castille inégale à ses armes
Lui vola son dauphin,
Semblait d'un si grand coup devoir jeter des larmes
Qui n'eussent jamais fin.
Il n'est pas question d'examiner si l'empereur était inégal aux armes de François I er parce qu'il sortit de Provence après l'avoir épuisée, ou si c'est voler un dauphin que de l'empoisonner, ou si on jette des larmes d'un coup, lesquelles n'ont point fin. Ces mauvais vers font voir seulement que l'empoisonnement de François dauphin par Charles-Quint, passa toujours en France pour une vérité incontestable.
Daniel ne disculpe point l'empereur. Hénault dit dans son Abrégé, François fils aîné du roi est empoisonné, non sans soupçon de poison .
Ainsi tous les écrivains se copient les uns les autres. Enfin, l'auteur de l'Histoire de François I er , ose, comme moi, discuter le fait.
Il est vrai que le comte Montécuculi qui était au service du dauphin, fut condamné par des commissaires à être écartelé, comme coupable d'avoir empoisonné ce prince.
Les historiens disent que ce Montécuculi était son échanson. Les dauphins n'en ont point. Mais je veux qu'ils en eussent alors; comment ce gentilhomme eût-il mêlé sur-le-champ du poison dans un verre d'eau fraîche? avait-il toujours du poison tout prêt dans sa poche pour le moment où son maître demanderait à boire? il n'était pas seul avec le dauphin qu'on essuyait au sortir du jeu de paume. Les chirurgiens qui ouvrirent son corps dirent (à ce qu'on prétend) que le prince avait pris de l'arsenic. Le prince en l'avalant aurait senti dans le gosier des douleurs insupportables, l'eau aurait été colorée; on ne l'aurait pas traité d'une pleurésie. Les chirurgiens étaient des ignorants qui disaient ce qu'on voulait qu'ils dissent: cela n'est que trop commun.
Quel intérêt aurait eu cet officier à faire mourir son maître? de qui pouvait-il espérer plus de fortune?
Mais, dit-on, il avait aussi l'intention d'empoisonner le roi. Nouvelle difficulté, et nouvelle improbabilité.
Qui devait lui payer ce double crime? on répond que c'était Charles-Quint. Autre improbabilité non moins forte. Pourquoi commencer par un enfant de dix-huit ans et demi qui d'ailleurs avait deux frères? comment arriver au roi que Montécuculi ne servait point à table?
Il n'y avait rien à gagner pour Charles-Quint en donnant la mort à ce jeune dauphin qui n'avait jamais tiré l'épée, et qui aurait eu des vengeurs. C'eût été un crime honteux et inutile. Il ne craignait pas le père qui était le plus brave chevalier de sa cour, et il aurait craint le fils qui sortait de l'enfance!
Mais on nous dit que ce Montécuculi, dans un voyage à Ferrare sa patrie, fut présenté à l'empereur; que ce monarque lui demanda des nouvelles de la magnificence avec laquelle le roi était servi à table, et de l'ordre qu'il tenait dans sa maison. Voilà certes une belle preuve que cet Italien fut suborné par Charles-Quint pour empoisonner la famille royale!
Oh ce ne fut pas l'empereur qui l'engagea lui-même dans ce crime; ce furent ses généraux, Antoine de Lève et le marquis de Gonzague. Qui! Antoine de Lève âgé de quatre-vingts ans, et l'un des plus vertueux chevaliers de l'Europe! et ce vieillard eut la discrétion de lui proposer ces empoisonnements conjointement avec un prince de Gonzague! d'autres nomment le marquis del Vasto que vous appelez Du Guast. Accordez-vous donc, pauvres imposteurs. -- Vous dites que Montécuculi l'avoua à ses juges. Avez-vous vu les pièces originales du procès?
Vous avouez que cet infortuné était chimiste. Voilà vos seules preuves; voilà les seules raisons pour lesquelles il subit le plus effroyable des supplices. Il était Italien, il était chimiste, ou haïssait Charles-Quint; on se vengeait bien honteusement de sa gloire. Quoi! votre cour fait écarteler un homme de qualité sur de simples soupçons, dans la vaine espérance de déshonorer un empereur trop puissant.
Quelque temps après, vos soupçons toujours légers accusent de cet empoisonnement Catherine de Médicis, épouse de Henri II, dauphin, depuis roi de France. Vous dites que pour régner elle fit empoisonner ce premier dauphin qui était entre le trône et son mari. Imposteurs! encore une fois, accordez-vous donc. Songez-vous que Catherine de Médicis n'était alors âgée que de dix-sept ans?
On a dit que ce fut Charles-Quint lui-même qui imputa cette mort à Catherine, et on cite l'historien Vera. On se trompe; voici ses paroles:
Page 166. En este año avia muerto en Paris el delfin de Francia con senales evidentes de veneno. Attribuyeronlo los suyos a diligencia del marques de Basto, y Antonio de Leiva, y costò la vida al conde de Monte-cuculo, Francès, con quien se correspondian: indigna sospecha de tan generosos hombres, y inutil; puesto, que con matar al delfin, se grangeava poca, porque no era nada valeroso, ni sin hermanos que le sucediessen. Brevemente se passò desta presuncion a otra mas fundada, que avia sido la muerte per orden de su hermano el duque de Orliens, a persuasion de Catalina de Medicis su muger, ambiciosa de llegar a ser reyna, como lo fue. Y nota bien un autor que la muerte desgraciada que tuvo despues este Enrico, la permitiò Dios en castigo de la alevosa que Dio (si la Diò) al inocente hermano: costumbre mas que medianamente introducida en principes, deshazerse a poca costa de los que por algun camino los embaraçan; pero siempre son visiblemente castigados por Dios .
En cette année mourut à Paris le dauphin de France avec des signes évidents de poison. Les siens l'attribuèrent aux ordres du marquis del Vasto et d'Antoine de Lève, ce qui coûta la vie au comte de Montecuculo Français, qui était en correspondance avec eux. Indigne et inutile soupçon contre des hommes si généreux, puisqu'en tuant le dauphin on gagnait peu. Il n'était encore connu par sa valeur ni lui ni ses frères qui devaient lui succéder.
De cette présomption on passa à une autre; on prétendit que ce meurtre avait été commis par l'ordre du duc d'Orléans son frère, à la persuasion de Catherine Medici sa femme, qui avait l'ambition d'être reine comme elle le fut en effet. Et un auteur remarque très bien que la mort funeste de ce duc d'Orléans depuis Henri II, fut une punition divine du poison qu'il avait donné à son frère; (si pourtant il lui en fit donner) coutume trop ordinaire aux princes de se défaire à peu de frais de ceux qui les embarrassent dans leur chemin, mais souvent, et visiblement punie de Dieu.
Le Señor de Vera n'est pas, comme on voit, un Tacite. D'ailleurs, il prend Montécuculi ou Montecuculo pour un Français. Il dit que le dauphin mourut à Paris; et ce fut à Tournon. Il parle de marques évidentes de poison sur le bruit public; mais il est évident qu'il n'attribue qu'aux Français l'accusation contre Catherine de Médicis.
Cette accusation est aussi injuste et aussi extravagante que celle qui chargea Montécuculi.
Il résulte que cette légèreté particulière aux Français, a dans tous les temps produit des catastrophes bien funestes. A remonter du supplice injuste de Montécuculi jusqu'à celui des templiers, c'est une suite de supplices atroces, fondés sur les présomptions les plus frivoles. Des ruisseaux de sang ont coulé en France, parce que la nation est souvent peu réfléchissante et très prompte dans ses jugements. Ainsi tout sert à perpétuer les malheurs de la terre.
Disons un mot de ce malheureux plaisir que les hommes, et surtout les esprits faibles, ressentent en secret à parler de supplices, comme ils en ont à parler de miracles et de sortilèges. Vous trouverez dans le Dictionnaire de la Bible de Calmet plusieurs belles estampes des supplices usités chez les Hébreux. Ces figures font frémir tout honnête homme. Prenons cette occasion de dire que jamais ni les Juifs ni aucun autre peuple ne s'avisèrent de crucifier avec des clous, et qu'il n'y en a aucun exemple. C'est une fantaisie de peintre qui s'est établie sur une opinion assez erronée.
SECTION TROISIEME.
Hommes sages répandus sur la terre, (car il y en a) criez de toutes vos forces avec le sage Beccaria qu'il faut proportionner les peines aux délits.
Que si on casse la tête d'un jeune homme de vingt ans, qui aura passé six mois auprès de sa mère ou de sa maîtresse au lieu de rejoindre le régiment, il ne pourra plus servir sa patrie.
Que si vous pendez dans la place des Terraux cette jeune servante [41] qui a volé douze serviettes à sa maîtresse, elle aurait pu donner à votre ville une douzaine d'enfants que vous étouffez; qu'il n'y a nulle proportion entre douze serviettes et la vie, et qu'enfin vous encouragez le vol domestique; parce que nul maître ne sera assez barbare pour faire pendre son cocher qui lui aura volé de l'avoine, et qu'il le ferait punir pour le corriger, si la peine était proportionnée.
Que les juges et les législateurs sont coupables de la mort de tous les enfants que de pauvres filles séduites abandonnent, ou laissent périr, ou étouffent par la même faiblesse qui les a fait naître.
Et c'est sur quoi je veux vous conter ce qui vient d'arriver dans la capitale d'une sage et puissante république, qui toute sage qu'elle est, a le malheur d'avoir conservé quelques lois barbares de ces temps antiques et sauvages qu'on appelle le temps des bonnes moeurs. On trouve auprès de cette capitale un enfant nouveau-né et mort; on soupçonne une fille d'en être la mère; on la met au cachot; on l'interroge; elle répond qu'elle ne peut avoir fait cet enfant, puisqu'elle est grosse. On la fait visiter par ce qu'on appelle si mal à propos des sages-femmes, des matrones. Ces imbéciles attestent qu'elle n'est point enceinte; que ses vidanges retenues ont enflé son ventre. La malheureuse est menacée de la question; la peur trouble son esprit; elle avoue qu'elle a tué son enfant prétendu; on la condamne à la mort; elle accouche pendant qu'on lui lit sa sentence. Ses juges apprennent qu'il ne faut pas prononcer des arrêts de mort légèrement.
A l'égard de ce nombre innombrable de supplices, dans lesquels des fanatiques imbéciles ont fait périr tant d'autres fanatiques imbéciles, je n'en parlerai plus, quoiqu'on ne puisse trop en parler.
Il ne se commet guère de vols sur les grands chemins en Italie sans assassinats; parce que la peine de mort est la même pour l'un et l'autre crime.
Sans doute que M. de Beccaria en parle dans son Traité des délits et des peines.
SYMBOLE, OU CREDO. [p. 429]↩
Nous ne ressemblons point à Mlle Duclos cette célèbre comédienne, à qui on disait, Je parie, Mlle, que vous ne savez pas votre credo! Ah, ah, dit-elle, je ne sais pas mon credo! je vais vous le réciter. Pater noster qui . Aidez-moi, je ne me souviens plus du reste. Pour moi je récite mon pater et mon credo tous les matins, je ne suis point comme Broussin dont Réminiac disait:
Broussin dès l'âge le plus tendre,
Posséda la sauce Robert,
Sans que son précepteur lui pût jamais apprendre
Ni son credo ni son pater.
Le symbole ou la collation , vient du mot Symbolein , et l'Eglise latine adopte ce mot comme elle a tout pris de l'Eglise grecque. Les théologiens un peu instruits savent que ce symbole qu'on nomme des apôtres , n'est point du tout des apôtres.
On appelait symbole chez les Grecs, les paroles, les signes auxquels les initiés aux mystères de Cérès, de Cibèle, de Mithra se reconnaissaient; [42] les chrétiens avec le temps eurent leur symbole. S'il avait existé du temps des apôtres, il est à croire que St Luc en aurait parlé.
On attribue à St Augustin une histoire du symbole dans son sermon 115; on lui fait dire dans ce sermon que Pierre avait commencé le symbole en disant, Je crois en Dieu père tout-puissant ; Jean ajouta créateur du ciel et de la terre ; Jacques ajouta, Je crois en Jésus-Christ son fils notre Seigneur ; et ainsi du reste. On a retranché cette fable dans la dernière édition d'Augustin. Je m'en rapporte aux révérends pères bénédictins, pour savoir au juste s'il fallait retrancher ou non ce petit morceau qui est curieux.
Le fait est que personne n'entendit parler de ce Credo pendant plus de quatre cents années. Le peuple dit que Paris n'a pas été bâti en un jour; le peuple a souvent raison dans ses proverbes. Les apôtres eurent notre symbole dans le coeur, mais ils ne le mirent point par écrit. On en forma un du temps de St Irénée, qui ne ressemble point à celui que nous récitons. Notre symbole tel qu'il est aujourd'hui, est constamment du cinquième siècle. Il est postérieur à celui de Nicée. L'article qui dit que Jésus descendit aux enfers, celui qui parle de la communion des saints, ne se trouvent dans aucun des symboles qui précédèrent le nôtre. Et en effet, ni les Evangiles, ni les Actes des apôtres ne disent que Jésus descendit dans l'enfer. Mais c'était une opinion établie dès le troisième siècle que Jésus était descendu dans l'Hadès, dans le Tartare, mots que nous traduisons par celui d'enfer. L'enfer en ce sens n'est pas le mot hébreu Scheol , qui veut dire le souterrain, la fosse. Et c'est pourquoi St Athanase nous apprit depuis comment notre Sauveur était descendu dans les enfers. Son humanité , dit-il, ne fut ni tout entière dans le sépulcre, ni tout entière dans l'enfer. Elle fut dans le sépulcre selon la chair, et dans l'enfer selon l'âme .
St Thomas assure que les saints qui ressuscitèrent à la mort de Jésus-Christ, moururent de nouveau pour ressusciter ensuite avec lui; c'est le sentiment le plus suivi. Toutes ces opinions sont absolument étrangères à la morale; il faut être homme de bien soit que les saints soient ressuscités deux fois, soit que Dieu ne les ait ressuscités qu'une. Notre symbole a été fait tard, je l'avoue, mais la vertu est de toute éternité.
S'il est permis de citer des modernes dans une matière si grave, je rapporterai ici le Credo de l'abbé de St Pierre, tel qu'il est écrit de sa main dans son livre sur la pureté de la religion, lequel n'a point été imprimé, et que j'ai copié fidèlement.
‘Je crois en un seul Dieu et je l'aime. Je crois qu'il illumine toute âme venant au monde ainsi que le dit St Jean. J'entends par là toute âme qui le cherche de bonne foi.
‘Je crois en un seul Dieu, parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule âme du grand tout; un seul être vivifiant; un formateur unique.
‘Je crois en Dieu le père puissant, parce qu'il est père commun de la nature, et de tous les hommes qui sont également ses enfants. Je crois que celui qui les fait tous naître également, qui arrangea les ressorts de notre vie de la même manière, qui leur a donné les mêmes principes de morale, aperçue par eux dès qu'ils réfléchissent, n'a mis aucune différence entre ses enfants que celle du crime et de la vertu.
‘Je crois que le Chinois juste et bienfaisant est plus précieux devant lui qu'un docteur d'Europe pointilleux et arrogant.
‘Je crois que Dieu étant notre père commun, nous sommes tenus de regarder tous les hommes comme nos frères.
‘Je crois que le persécuteur est abominable, et qu'il marche immédiatement après l'empoisonneur et le parricide.
‘Je crois que les disputes théologiques sont à la fois la farce la plus ridicule et le fléau le plus affreux de la terre, immédiatement après la guerre, la peste, la famine et la vérole.
‘Je crois que les ecclésiastiques doivent être payés, et bien payés, comme serviteurs du public, précepteurs de morale, teneurs des registres des enfants et des morts; mais qu'on ne doit leur donner ni les richesses des fermiers généraux, ni le rang des princes, parce que l'un et l'autre corrompent l'âme; et que rien n'est plus révoltant que de voir des hommes si riches et si fiers, faire prêcher l'humilité, et l'amour de la pauvreté par leurs commis qui n'ont que cent écus de gages.
‘Je crois que tous les prêtres qui desservent une paroisse, pourraient être mariés comme dans l'Eglise grecque; non seulement pour avoir une femme honnête qui prenne soin de leur ménage, mais pour être meilleurs citoyens, donner de bons sujets à l'Etat, et pour avoir beaucoup d'enfants bien élevés.
‘Je crois qu'il faut absolument rendre plusieurs moines à la société, que c'est servir la patrie et eux-mêmes. On dit que ce sont des hommes que Circé a changés en pourceaux, le sage Ulysse doit leur rendre la forme humaine.'
Paradis aux bienfaisants !
Nous rapportons historiquement ce symbole de l'abbé de St Pierre, sans l'approuver. Nous ne le regardons que comme une singularité curieuse; et nous nous en tenons avec la foi la plus respectueuse, au véritable symbole de l'Eglise.
SYSTÉME. [p. 432]↩
Nous entendons par système une supposition; ensuite, quand cette supposition est prouvée, ce n'est plus un système, c'est une vérité. Cependant, nous disons encore par habitude le système céleste, quoique nous entendions par là la position réelle des astres.
Je crois avoir cru autrefois que Pythagore avait appris chez les Chaldéens le vrai système céleste; mais je ne le crois plus. A mesure que j'avance en âge, je doute de tout.
Cependant, Newton, Grégori et Keil font honneur à Pythagore et à ces Chaldéens du système de Copernic; et en dernier lieu M. Le Monnier est de leur avis. J'ai l'impudence de n'en plus être.
Une de mes raisons, c'est que si les Chaldéens en avaient tant su, une si belle et si importante découverte ne se serait jamais perdue; elle se serait transmise de siècle en siècle comme les belles démonstrations d'Archimède.
Une autre raison, c'est qu'il fallait être plus profondément instruit que ne l'étaient les Chaldéens pour contredire les yeux de tous les hommes et toutes les apparences célestes; qu'il eût fallu non seulement faire les expériences les plus fines, mais employer les mathématiques les plus profondes, avoir le secours indispensable des télescopes, sans lesquels il était impossible de découvrir les phases de Vénus qui démontrent son cours autour du soleil; et sans lesquels encore il était impossible de voir les taches du soleil qui démontrent sa rotation autour de son axe presque immobile.
Une raison non moins forte, c'est que de tous ceux qui ont attribué à Pythagore ces belles connaissances, aucun ne nous a dit positivement de quoi il s'agit.
Diogène de Laërce, qui vivait environ neuf cents ans après Pythagore, nous apprend que, selon ce grand philosophe, le nombre UN était le premier principe, et que de DEUX naissent tous les nombres; que les corps ont quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre; que la lumière et les ténèbres, le froid et le chaud, l'humide et le sec sont en égale quantité; qu'il ne faut point manger de fèves; que l'âme est divisée en trois parties; que Pythagore avait été autrefois AEtalide, puis Euphorbe, puis Hermotime, et que ce grand homme étudia la magie à fond. Notre Diogène ne dit pas un mot du vrai système du monde, attribué à ce Pythagore. Et il faut avouer qu'il y a loin de son aversion pour les fèves aux observations et aux calculs qui démontrent aujourd'hui le cours des planètes et de la terre.
Le fameux arien Eusèbe, évêque de Césarée, dans sa Préparation Pag. 850 édit. in-fol. évangélique s'exprime ainsi. Tous les philosophes prononcent que la terre est en repos; mais Philolaus le péripatéticien pense qu'elle se meut autour du feu dans un cercle oblique, tout comme le soleil et la lune .
Ce galimatias n'a rien de commun avec les sublimes vérités que nous ont enseignées Copernic, Galilée, Képler, et surtout Newton.
Quant au prétendu Aristarque de Samos, qu'on dit avoir développé les découvertes des Chaldéens sur le cours de la planète de la terre et des autres planètes, il est si obscur, que Wallis a été obligé de le commenter d'un bout à l'autre pour tâcher de le rendre intelligible.
Enfin il est fort douteux que le livre attribué à cet Aristarque de Samos soit de lui. On a fort soupçonné les ennemis de la nouvelle philosophie d'avoir fabriqué cette fausse pièce en faveur de leur mauvaise cause. Ce n'est pas seulement en fait de vieilles chartes que nous avons eu de pieux faussaires. Cet Aristarque de Samos est d'autant plus suspect, que Plutarque l'accuse d'avoir été un bigot, un méchant hypocrite, imbu de l'opinion contraire. Voici les paroles de Plutarque dans son fatras intitulé: La face du rond de la lune . Aristarque le Samien disait que les Grecs devaient punir Cléanthe de Samos, lequel soupçonnait que le ciel est immobile, et que c'est la terre qui se meut autour du zodiaque, en tournant sur son axe .
Mais, me dira-t-on, cela même prouve que le système de Copernic était déjà dans la tête de ce Cléanthe et de bien d'autres. Qu'importe qu'Aristarque le Samien ait été de l'avis de Cléanthe le Samien, ou qu'il ait été son délateur, comme le jésuite Skeiner a été depuis le délateur de Galilée? Il résulte toujours évidemment que le vrai système d'aujourd'hui était connu des anciens.
Je réponds que non; qu'une très faible partie de ce système fut vaguement soupçonnée par quelques têtes mieux organisées que les autres. Je réponds qu'il ne fut jamais reçu, jamais enseigné dans les écoles; que ce ne fut jamais un corps de doctrine. Lisez attentivement cette face de la lune de Plutarque, vous y trouverez, si vous voulez, la doctrine de la gravitation. Le véritable auteur d'un système est celui qui le démontre.
N'envions point à Copernic l'honneur de la découverte. Trois ou quatre mots déterrés dans un vieil auteur, et qui peuvent avoir quelque rapport éloigné avec son système, ne doivent pas lui enlever la gloire de l'invention.
Admirons la grande règle de Képler, que les carrés des révolutions des planètes autour du soleil sont proportionnels aux cubes de leurs distances.
Admirons encore davantage la profondeur, la justesse, l'invention du grand Newton, qui seul a découvert les raisons fondamentales de ces lois inconnues à toute l'antiquité, et qui a ouvert aux hommes un ciel nouveau.
Il se trouve toujours de petits compilateurs qui osent être ennemis de leur siècle: ils entassent, entassent des passages de Plutarque et d'Athénée, pour tâcher de nous prouver que nous n'avons nulle obligation aux Newtons, aux Halley, aux Bradley. Ils se font les trompettes de la gloire des anciens. Ils prétendent que ces anciens ont tout dit; et ils sont assez imbéciles pour croire partager leur gloire, parce qu'ils la publient. Ils tordent une phrase d'Hippocrate pour faire accroire que les Grecs connaissaient la circulation du sang mieux que Harvey. Que ne disent-ils aussi que les Grecs avaient de meilleurs fusils, de plus gros canons que nous; qu'ils lançaient des bombes plus loin; qu'ils avaient des livres mieux imprimés, de plus belles estampes? etc. etc.; qu'ils excellaient dans la peinture à l'huile; qu'ils avaient des miroirs de cristal, des télescopes, des microscopes, des thermomètres? Ne s'est-il pas trouvé des gens qui ont assuré que Salomon, qui ne possédait aucun port de mer, avait envoyé des flottes en Amérique? etc. etc.
Un des plus grands détracteurs de nos derniers siècles a été un nommé Dutens. Il a fini par faire un libelle aussi infâme qu'insipide contre les philosophes de nos jours. Ce libelle est intitulé Le Tocsin ; mais il a eu beau sonner sa cloche, personne n'est venu à son secours, et il n'a fait que grossir le nombre des Zoïles, qui ne pouvant rien produire, ont répandu leur venin sur ceux qui ont immortalisé leur patrie, et servi le genre humain par leurs productions.
TERELAS. [p. 435]↩
Térélas ou Ptérélas, ou Ptérélaüs, tout comme vous voudrez, était fils de Taphus ou Taphius. Que m'importe? dites-vous. Doucement, vous allez voir. Ce Térélas avait un cheveu d'or, auquel était attaché le destin de sa ville de Taphe. Il y avait bien plus; ce cheveu rendait Térélas immortel; Térélas ne pouvait mourir tant que ce cheveu serait à sa tête; aussi ne se peignait-il jamais, de peur de le faire tomber. Mais une immortalité qui ne tient qu'à un cheveu, n'est pas chose fort assurée.
Amphitrion, général de la république de Thèbes, assiégea Taphe. La fille du roi Térélas devint éperdument amoureuse d'Amphitrion en le voyant passer près des remparts. Elle alla pendant la nuit couper le cheveu de son père, et en fit présent au général. Taphe fut prise, Térélas fut tué. Quelques savants assurent que ce fut la femme de Térélas qui lui joua ce tour. Ils se fondent sur de grandes autorités: ce serait le sujet d'une dissertation utile. J'avoue que j'aurais quelque penchant pour l'opinion de ces savants: il me semble qu'une femme est d'ordinaire moins timorée qu'une fille.
Même chose advint à Nisus roi de Mégare. Minos assiégeait cette ville. Scylla fille de Nisus devint folle de Minos. Son père à la vérité n'avait point de cheveu d'or, mais il en avait un de pourpre, et l'on sait qu'à ce cheveu était attachée la durée de sa vie, et de l'empire mégarien. Scylla, pour obliger Minos, coupa ce cheveu fatal, et en fit présent à son amant.
Toute l'histoire de Minos est vraie , dit le profond Banier, [43] et elle est attestée par toute l'antiquité . Je la crois aussi vraie que celle de Térélas; mais je suis bien embarrassé entre le profond Calmet et le profond Huet. Calmet pense que l'aventure du cheveu de Nisus présenté à Minos, et du cheveu de Térélas, ou Ptérélas, offert à Amphitrion, est visiblement tirée de l'histoire véridique de Samson juge d'Israël. D'un autre côté Huet le démontreur vous démontre que Minos est visiblement Moïse, puisqu'un de ces noms est visiblement l'anagramme de l'autre en retranchant les lettres N et E.
Mais malgré la démonstration de Huet, je suis entièrement pour le délicat Dom Calmet, et pour ceux qui pensent que tout ce qui concerne les cheveux de Térélas et de Nisus, doit se rapporter aux cheveux de Samson. La plus convaincante de mes raisons victorieuses, est que sans parler de la famille de Térélas dont j'ignore la métamorphose, il est certain que Scylla fut changée en alouette, et que son père Nisus fut changé en épervier. Or Bochart ayant cru qu'un épervier s'appelle Neis en hébreu, j'en conclus que toute l'histoire de Térélas, d'Amphitrion, de Nisus, de Minos, est une copie de l'histoire de Samson.
Je sais qu'il s'est déjà élevé de nos jours une secte abominable, en horreur à Dieu et aux hommes, qui ose prétendre que les fables grecques sont plus anciennes que l'histoire juive; que les Grecs n'entendirent pas plus parler de Samson que d'Adam, d'Eve, d'Abel, de Caïn, etc. etc.; que ces noms ne sont cités dans aucun auteur grec. Ils disent, comme nous l'avons modestement insinué à l'article Bacchus , et à l'article Juif , que les Grecs n'ont pu rien prendre des Juifs, et que les Juifs ont pu prendre quelque chose des Grecs.
Je réponds avec le docteur Hayet, le docteur Gauchat, l'ex-jésuite Patouillet, l'ex-jésuite Nonotte, et l'ex-jésuite Paulian, que cette hérésie est la plus damnable opinion qui soit jamais sortie de l'enfer; qu'elle fut anathémisée autrefois en plein parlement par un réquisitoire, et condamnée au rapport du sieur P...; que si on porte l'indulgence jusqu'à tolérer ceux qui débitent ces systèmes affreux, il n'y a plus de sûreté dans le monde, et que certainement l'Antéchrist va venir, s'il n'est déjà venu.
TESTICULES. [p. 437]↩
SECTION PREMIÈRE.
Ce mot est scientifique et un peu obscène, il signifie petit témoin . Voyez dans le grand Dictionnaire encyclopédique les conditions d'un bon testicule, ses maladies, ses traitements. Sixte-Quint cordelier devenu pape, déclara en 1587 par sa lettre du 25 juin à son nonce en Espagne, qu'il fallait démarier tous ceux qui n'avaient pas de testicules. Il semble par cet ordre, lequel fut exécuté par Philippe II, qu'il y avait en Espagne plusieurs maris privés de ces deux organes. Mais comment un homme qui avait été cordelier, pouvait-il ignorer que souvent des hommes ont leurs testicules cachés dans l'abdomen, et n'en sont que plus propres à l'action conjugale? Nous avons vu en France trois frères de la plus grande naissance, dont l'un en possédait trois, l'autre n'en avait qu'un seul, et le troisième n'en avait point d'apparents; ce dernier était le plus vigoureux des frères.
IV Dist. XXXIV quest. Le docteur angélique qui n'était que jacobin, décide que deux testicules sont de essentia matrimonii , de l'essence du mariage; en quoi il est suivi par Richardus, Scotus, Durandus et Sylvius.
Si vous ne pouvez parvenir à voir le plaidoyer de l'avocat Sébastien Rouillard en 1600 pour les testicules de sa partie enfoncés dans son épigastre, consultez du moins le Dictionnaire de Bayle à l'article Quellenec ; vous y verrez que la méchante femme du client de Sébastien Rouillard, voulait faire déclarer son mariage nul, sur ce que la partie ne montrait point de testicules. La partie disait avoir fait parfaitement son devoir. Il articulait intromission et éjaculation; il offrait de recommencer en présence des chambres assemblées. La coquine répondait que cette épreuve alarmait trop sa fierté pudique, que cette tentative était superflue, puisque les testicules manquaient évidemment à l'intimé, et que Messieurs savaient très bien que les testicules sont nécessaires pour éjaculer.
J'ignore quel fut l'événement du procès; j'oserais soupçonner que le mari fut débouté de sa requête et qu'il perdit sa cause, quoique avec de très bonnes pièces, pour n'avoir pu les montrer toutes.
Ce qui me fait pencher à le croire, c'est que le même parlement de Paris, le 8 janvier 1665, rendit arrêt sur la nécessité de deux testicules apparents, et déclara que sans eux on ne pouvait contracter mariage. Cela fait voir qu'alors il n'y avait aucun membre de ce corps qui eût ses deux témoins dans le ventre, ou qui fût réduit à un témoin: il aurait montré à la compagnie qu'elle jugeait sans connaissance de cause.
Vous pouvez consulter Pontas sur les testicules comme sur bien d'autre objets; c'était un sous-pénitencier qui décidait de tous les cas: il approche quelquefois de Sanchez.
SECTION SECONDE.
Et par occasion, des hermaphrodites.
Il s'est glissé depuis longtemps un préjugé dans l'Eglise latine, qu'il n'est pas permis de dire la messe sans testicules, et qu'il faut au moins les avoir dans sa poche. Cette ancienne idée était fondée Canon IV. sur le concile de Nicée, qui défend qu'on ordonne ceux qui se sont fait mutiler eux-mêmes. L'exemple d'Origène et de quelques enthousiastes, attira cette défense. Elle fut confirmée au second concile d'Arles.
L'Eglise grecque n'exclut jamais de l'autel ceux à qui on avait fait l'opération d'Origène sans leur consentement.
Les patriarches de Constantinople, Nicétas, Ignace, Photius, Méthodius étaient eunuques. Aujourd'hui ce point de discipline a semblé demeurer indécis dans l'Eglise latine. Cependant l'opinion la plus commune est que si un eunuque reconnu se présentait pour être ordonné prêtre, il aurait besoin d'une dispense.
Le bannissement des eunuques du service des autels, paraît contraire à l'esprit même de pureté et de chasteté que ce service exige. Il semble surtout que des eunuques, qui confesseraient de beaux garçons et de belles filles, seraient moins exposés aux tentations: mais d'autres raisons de convenance et de bienséance ont déterminé ceux qui ont fait les lois.
Dans le Lévitique on exclut de l'autel tous les défauts corporels, les aveugles, les bossus, les manchots, les boiteux, les borgnes, les galeux, les teigneux, les nez trop longs, les nez camus. Il n'est point parlé des eunuques; il n'y en avait point chez les Juifs. Ceux qui servirent d'eunuques dans les sérails de leurs rois, étaient des étrangers.
On demande si un animal, un homme par exemple peut avoir à la fois des testicules et des ovaires, ou ces glandes prises pour des ovaires; une verge et un clitoris; un prépuce et un vagin; en un mot si la nature peut faire de véritables hermaphrodites; et si un hermaphrodite peut faire un enfant à une fille et être engrossé par un garçon? Je réponds, à mon ordinaire, que je n'en sais rien; et que je ne connais pas la cent millième partie des choses que la nature peut opérer. Je crois bien qu'on n'a jamais vu naître dans notre Europe de véritables hermaphrodites. Aussi n'a-t-elle jamais produit ni éléphants, ni zèbres, ni girafes, ni autruches, ni aucun de ces animaux dont l'Asie, l'Afrique, l'Amérique sont peuplées. Il est bien hardi de dire: nous n'avons jamais vu ce phénomène; donc il est impossible qu'il existe.
Consultez l'Anatomie de Cheselden, page 34, vous y verrez la figure très bien dessinée d'un animal homme et femme, nègre et négresse d'Angola, amené à Londres dans son enfance, et très soigneusement examiné par ce célèbre chirurgien aussi connu par sa probité que par ses lumières. L'estampe qu'il dessina est intitulée, Parties d'un hermaphrodite nègre, âgé de vingt-six ans, qui avait les deux sexes . Ils n'étaient pas absolument parfaits; mais c'était un mélange étonnant de l'un et de l'autre.
Cheselden m'attesta plusieurs fois la vérité de ce prodige, qui n'en est peut-être pas un dans certains cantons de l'Afrique. Les deux sexes n'étaient pas complets en tout dans cet animal: mais qui m'assurera que d'autres nègres, ou des jaunes, ou des rouges ne sont pas quelquefois entièrement mâles et femelles? J'aimerais autant dire qu'on ne peut faire de statues parfaites, parce que nous n'en aurions vu que de défectueuses. Il y a des insectes qui ont les deux sexes: pourquoi ne serait-il pas une race d'hommes qui les aurait aussi? Je n'affirme rien. Dieu m'en préserve! Je doute.
Que de choses dans l'animal homme, dont il faut douter; depuis sa glande pinéale jusqu'à sa rate, dont l'usage est inconnu; et depuis le principe de sa pensée et de ses sensations jusqu'aux esprits animaux dont tout le monde parle, et que personne ne vit jamais!
THÉOCRATIE. [p. 441]↩
GOUVERNEMENT DE DIEU OU DES DIEUX.
Il m'arrive tous les jours de me tromper; mais je soupçonne que les peuples qui ont cultivé les arts ont été tous sous une théocratie. J'excepte toujours les Chinois, qui paraissent sages dès qu'ils forment une nation. Ils sont sans superstition sitôt que la Chine est un royaume. C'est bien dommage qu'ayant été d'abord élevés si haut, ils soient demeurés au degré où ils sont depuis si longtemps dans les sciences. Il semble qu'ils aient reçu de la nature une grande mesure de bon sens, et une assez petite d'industrie. Mais aussi leur industrie s'est déployée bien plus tôt que la nôtre.
Les Japonais leurs voisins, dont on ne connaît point du tout l'origine (car quelle origine connaît-on?) furent incontestablement gouvernés par une théocratie. Leurs premiers souverains bien reconnus étaient les daïris, les grands-prêtres de leurs dieux; cette théocratie est très avérée. Ces prêtres régnèrent despotiquement environ dix-huit cents ans. Il arriva au milieu de notre douzième siècle qu'un capitaine, un imperator, un seogon partagea leur autorité; et dans notre seizième siècle les capitaines la prirent tout entière, et l'ont conservée. Les daïris sont restés les chefs de la religion; ils étaient rois; ils ne sont plus que saints; ils règlent les fêtes, ils confèrent des titres sacrés, mais ils ne peuvent donner une compagnie d'infanterie.
Les brachmanes dans l'Inde ont eu longtemps le pouvoir théocratique; c'est-à-dire qu'ils ont eu le pouvoir souverain au nom de Brama fils de Dieu: et dans l'abaissement où ils sont aujourd'hui, ils croient encore ce caractère indélébile. Voilà les deux grandes théocraties les plus certaines.
Les prêtres de Caldée, de Perse, de Syrie, de Phénicie, d'Egypte, étaient si puissants, avaient une si grande part au gouvernement, faisaient prévaloir si hautement l'encensoir sur le sceptre, qu'on peut dire que l'empire chez tous ces peuples était partagé entre la théocratie et la royauté.
Le gouvernment de Numa Pompilius fut visiblement théocratique. Quand on dit, Je vous donne des lois de la part des dieux, ce n'est pas moi, c'est un Dieu qui vous parle; alors c'est Dieu qui est roi; celui qui parle ainsi est son lieutenant général.
Chez tous les Celtes qui n'avaient que des chefs éligibles et point de rois, les druides et leurs sorcières gouvernaient tout. Mais je n'ose appeler du nom de théocratie l'anarchie de ces sauvages.
La petite nation juive ne mérite ici d'être considérée politiquement, que par la prodigieuse révolution arrivée dans le monde, dont elle fut la cause très obscure et très ignorante.
Ne considérons que l'historique de cet étrange peuple. Il a un conducteur qui doit le guider au nom de son Dieu dans la Phénicie qu'il appelle le Canaan . Le chemin était droit et uni depuis le pays de Gossen jusqu'à Tyr, sud et nord; et il n'y avait aucun danger pour six cent trente mille combattants, ayant à leur tête un général Joseph liv. II, ch. V. tel que Moïse, qui, selon Flavien Joseph, avait déjà vaincu une armée d'Ethiopiens, et même une armée de serpents.
Au lieu de prendre ce chemin aisé et court, il les conduit de Ramessès à Baal-Sephon tout à l'opposite, tout au milieu de l'Egypte en tirant droit au sud. Il passe la mer, il marche pendant quarante ans dans des solitudes affreuses, où il n'y a pas une fontaine d'eau, pas un arbre, pas un champ cultivé; ce ne sont que des sables et des rochers affreux. Il est évident qu'un Dieu seul pouvait faire prendre aux Juifs cette route par miracle, et les y soutenir par des miracles continuels.
Le gouvernement juif fut donc alors une véritable théocratie. Cependant Moïse n'était point pontife, et Aaron qui l'était ne fut point chef et législateur.
Depuis ce temps on ne voit aucun pontife régner. Josué, Jephté, Samson et les autres chefs du peuple ne furent point prêtres. La république juive réduite si souvent en servitude, était anarchique bien plutôt que théocratique.
Sous les rois de Juda et d'Israël, ce ne fut qu'une longue suite d'assassinats et de guerres civiles. Ces horreurs ne furent interrompues que par l'extinction entière de dix tribus, ensuite par l'esclavage de deux autres, et par la ruine de la ville, au milieu de la famine et de la peste. Ce n'était pas là un gouvernement divin.
Quand les esclaves juifs revinrent à Jérusalem, ils furent soumis aux rois de Perse, au conquérant Alexandre et à ses successeurs. Il paraît qu'alors Dieu ne régnait pas immédiatement sur ce peuple, puisqu'un peu avant l'invasion d'Alexandre, le pontife Jean assassina le prêtre Jesu son frère dans le temple de Jérusalem, comme Salomon avait assassiné Adonias sur l'autel.
L'administration était encore moins théocratique quand Antiochus Epiphane roi de Syrie se servit de plusieurs Juifs pour punir Liv. VII. ceux qu'il regardait comme rebelles. Il leur défendit à tous de Liv. XI. circoncire leurs enfants sous peine de mort. Il fit sacrifier des porcs dans leur temple, brûler leurs portes, détruire l'autel; et les épines remplirent toute l'enceinte.
Matathias se mit contre lui à la tête de quelques citoyens, mais il ne fut pas roi. Son fils Judas Machabée traité de Messie , périt après des efforts glorieux.
A ces guerres sanglantes succédèrent des guerres civiles. Les Jérosolimites détruisirent Samarie, que les Romains rebâtirent ensuite sous le nom de Sebaste .
Dans ce chaos de révolutions, Aristobule de la race des Machabées, fils d'un grand-prêtre, se fit roi, plus de cinq cents ans après la ruine de Jérusalem. Il signala son règne comme quelques sultans turcs, en égorgeant son frère, et en faisant périr sa mère. Ses successeurs l'imitèrent jusqu'au temps où les Romains punirent tous ces barbares. Rien de tout cela n'est théocratique.
Si quelque chose donne une idée de la théocratie, il faut convenir que c'est le pontificat de Rome; [44] il ne s'explique jamais qu'au nom de Dieu, et ses sujets vivent en paix. Depuis longtemps le Thibet jouit des mêmes avantages sous le Grand Lama; mais c'est l'erreur grossière qui cherche à imiter la vérité sublime.
Les premiers Incas, en se disant descendants en droite ligne du soleil, établirent une théocratie; tout se faisait au nom du soleil.
La théocratie devrait être partout; car tout homme ou prince, ou batelier, doit obéir aux lois naturelles et éternelles que Dieu lui a données.
THÉODOSE. [p. 444]↩
Tout prince qui se met à la tête d'un parti et qui réussit, est sûr d'être loué pendant toute l'éternité, si le parti dure ce temps-là; et ses adversaires peuvent compter qu'ils seront traités par les orateurs, par les poètes et par les prédicateurs comme des titans révoltés contre les dieux. C'est ce qui arriva à Octave-Auguste, quand sa bonne fortune l'eut défait de Brutus, de Cassius et d'Antoine.
Ce fut le sort de Constantin, quand Maxence légitime empereur élu par le sénat et le peuple romain, fut tombé dans l'eau et se fut noyé.
Théodose eut le même avantage. Malheur aux vaincus: bénis soient les victorieux! voilà la devise du genre humain.
Théodose était un officier espagnol, fils d'un soldat de fortune espagnol. Dès qu'il fut empereur, il persécuta les anti-consubstantiels. Jugez que d'applaudissements, de bénédictions, d'éloges pompeux de la part des consubstantiels! Leurs adversaires ne subsistent presque plus; leurs plaintes, leurs clameurs contre la tyrannie de Théodose ont péri avec eux; et le parti dominant prodigue encore à ce prince les noms de pieux, de juste, de clément, de sage et de grand.
Un jour, ce prince pieux et clément qui aimait l'argent à la fureur, s'avisa de mettre un impôt très rude sur la ville d'Antioche, la plus belle alors de toute l'Asie mineure; le peuple désespéré, ayant demandé une diminution légère, et n'ayant pu l'obtenir, s'emporta jusqu'à briser quelques statues, parmi lesquelles il s'en trouva une du soldat père de l'empereur. St Jean Chrysostome, ou bouche d'or, prédicateur et un peu flatteur de Théodose, ne manqua pas d'appeler cette action un détestable sacrilège, attendu que Théodose était l'image de Dieu et que son père était presque aussi sacré que lui. Mais si cet Espagnol ressemblait à Dieu, il devait songer que les Antiochiens lui ressemblaient aussi; et qu'il y eut des hommes avant qu'il y eût des empereurs.
Finxit in effigiem moderantum cuncta deorum .
Théodose envoie incontinent une lettre de cachet au gouverneur, avec ordre d'appliquer à la torture les principales images de Dieu qui avaient eu part à cette sédition passagère, de les faire périr sous des coups de cordes armées de balles de plomb, d'en faire brûler quelques-uns, et de livrer les autres au glaive. Cela fut exécuté avec la ponctualité de tout gouverneur qui fait son devoir de chrétien, qui fait bien sa cour et qui veut faire son chemin. L'Oronte ne porta que des cadavres à la mer pendant plusieurs jours; après quoi sa gracieuse majesté impériale pardonna aux Antiochiens avec sa clémence ordinaire, et doubla l'impôt.
Qu'avait fait l'empereur Julien dans la même ville, dont il avait reçu un outrage plus personnel et plus injurieux? Ce n'était pas une méchante statue de son père qu'on avait abattue; c'était à lui-même que les Antiochiens s'étaient adressés; ils avaient fait contre lui les satires les plus violentes. L'empereur philosophe leur répondit par une satire légère et ingénieuse. Il ne leur ôta ni la vie ni la bourse. Il se contenta d'avoir plus d'esprit qu'eux. C'est là cet homme que St Grégoire de Nazianze et Théodoret, qui n'étaient pas de sa communion, osèrent calomnier jusqu'à dire qu'il sacrifiait à la lune des femmes et des enfants; tandis que ceux qui étaient de la communion de Théodose ont persisté jusqu'à nos jours, en se copiant les uns les autres, à redire en cent façons que Théodose fut le plus vertueux des hommes, et à vouloir en faire un saint.
On sait assez quelle fut la douceur de ce saint dans le massacre de quinze mille de ses sujets à Thessalonique. Ses panégyristes réduisent le nombre des assassinés à sept ou huit mille; c'est peu de chose pour eux. Mais ils élèvent jusqu'au ciel la tendre piété de ce bon prince qui se priva de la messe, ainsi que son complice le détestable Rufin. J'avoue encore une fois que c'est une belle expiation, un grand acte de dévotion de ne point aller à la messe. Mais enfin cela ne rend point la vie à quinze mille innocents égorgés de sang-froid par une perfidie abominable. Si un hérétique s'était souillé d'un pareil crime, avec quelle complaisance tous les historiens déploieraient contre lui leur bavarderie! avec quelles couleurs le peindrait-on dans les chaires et dans les déclamations de collège!
Je suppose que le prince de Parme fût entré dans Paris, après avoir forcé notre cher Henri IV à lever le siège; je suppose que Philippe II eût donné le trône de la France à sa fille catholique et au jeune duc de Guise catholique, alors que de plumes et que de voix qui auraient anathématisé à jamais Henri IV et la loi salique! Ils seraient tous deux oubliés, et les Guises seraient les héros de l'Etat et de la religion.
Et cole felices, miseros fuge .
Que Hugues-Capet dépossède l'héritier légitime de Charlemagne, il devient la tige d'une race de héros. Qu'il succombe, il peut être traité comme le frère de St Louis traita depuis Conradin et le duc d'Autriche, mais à bien plus juste titre.
Pepin rebelle détrône la race mérovingienne, et enferme son roi dans un cloître; mais s'il ne réussit pas, il monte sur l'échafaud.
Si Clovis, premier roi chrétien, dans la Gaule belgique est battu dans son invasion, il court risque d'être condamné aux bêtes comme le fut un de ses ancêtres par Constantin. Ainsi va le monde sous l'empire de la fortune, qui n'est autre chose que la nécessité, la fatalité insurmontable. Fortuna saevo laeta negotio . Elle nous fait jouer en aveugles à son jeu terrible; et nous ne voyons jamais le dessous des cartes.
TOLERANCE. [p. 447]↩
SECTION PREMIÈRE.
Mes amis, quand nous avons prêché la tolérance en prose, en vers, dans quelques chaires, et dans toutes nos sociétés; quand nous avons fait retentir ces véritables voix humaines [45] dans les orgues de nos églises; nous avons servi la nature, nous avons rétabli l'humanité dans ses droits; et il n'y a pas aujourd'hui un ex-jésuite, ou un ex-janséniste qui ose dire, Je suis intolérant.
Il y aura toujours des barbares et des fourbes qui fomenteront l'intolérance; mais ils ne l'avoueront pas; et c'est avoir gagné beaucoup.
Souvenons-nous toujours, mes amis, répétons, (car il faut répéter de peur qu'on n'oublie) répétons les paroles de l'évêque de Soissons, non pas Languet, mais Fitzjames-Stuart, dans son mandement de 1757, Nous devons regarder les Turcs comme nos frères .
Songeons que dans toute l'Amérique anglaise, ce qui fait à peu près le quart du monde connu, la liberté entière de conscience est établie; et pourvu qu'on y croie un Dieu, toute religion est bien reçue, moyennant quoi le commerce fleurit, et la population augmente.
Réfléchissons toujours que la première loi de l'empire de Russie, plus grand que l'empire romain, est la tolérance de toute secte.
L'empire turc et le persan usèrent toujours de la même indulgence. Mahomet II en prenant Constantinople, ne força point les Grecs à quitter leur religion, quoiqu'il les regardât comme des idolâtres. Chaque père de famille grec en fut quitte pour cinq ou six écus par an. On leur conserva plusieurs prébendes et plusieurs évêchés; et même encore aujourd'hui le sultan turc fait des chanoines et des évêques, sans que le pape ait jamais fait un iman ou un mollah.
Mes amis, il n'y a que quelques moines et quelques protestants aussi sots et aussi barbares que ces moines, qui soient encore intolérants.
Nous avons été si infectés de cette fureur, que dans nos voyages de long cours, nous l'avons portée à la Chine, au Tunquin, au Japon. Nous avons empesté ces beaux climats. Les plus indulgents des hommes ont appris de nous à être les plus inflexibles. Nous leur avons dit d'abord pour prix de leur bon accueil, Sachez que nous sommes sur la terre les seuls qui aient raison, et que nous devons être partout les maîtres. Alors on nous a chassés pour jamais; il en a coûté des flots de sang: cette leçon a dû nous corriger.
SECTION SECONDE.
L'auteur de l'article précédent est un bon-homme qui voulait souper avec un quaker, un anabaptiste, un socinien, un musulman, etc. Je veux pousser plus loin l'honnêteté, je dirai à mon frère le Turc, Mangeons ensemble une bonne poule au riz en invoquant Allah; ta religion me paraît très respectable, tu n'adores qu'un Dieu, tu es obligé de donner en aumônes tous les ans le denier quarante de ton revenu, et de te réconcilier avec tes ennemis le jour du Baïram. Nos bigots qui calomnient la terre, ont dit mille fois, que ta religion n'a réussi que parce qu'elle est toute sensuelle. Ils en ont menti les pauvres gens, ta religion est très austère; elle ordonne la prière cinq fois par jour, elle impose le jeûne le plus rigoureux, elle te défend le vin et les liqueurs que nos directeurs savourent; et si elle ne permet que quatre femmes à ceux qui peuvent les nourrir (ce qui est bien rare), elle condamne par cette contrainte l'incontinence juive qui permettait dix-huit femmes à l'homicide David, et sept cents à Salomon, l'assassin de son frère, sans compter les concubines.
Je dirai à mon frère le Chinois, Soupons ensemble sans cérémonies, car je n'aime pas les simagrées, mais j'aime ta loi, la plus sage de toutes, et peut-être la plus ancienne. J'en dirai à peu près autant à mon frère l'Indien.
Mais que dirai-je à mon frère le Juif? lui donnerai-je à souper? oui, pourvu que pendant le repas l'âne de Balaam ne s'avise pas de braire, qu'Ezéchiel ne mêle pas son déjeuner avec notre souper, qu'un poisson ne vienne pas avaler quelqu'un des convives, et le garder trois jours dans son ventre; qu'un serpent ne se mêle pas de la conversation pour séduire ma femme; qu'un prophète ne s'avise pas de coucher avec elle après souper, comme fit le bonhomme Osée pour quinze francs et un boisseau d'orge; surtout qu'aucun Juif ne fasse le tour de ma maison en sonnant de la trompette, ne fasse tomber les murs et ne m'égorge, moi, mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mon chat et mon chien, selon l'ancien usage des Juifs. Allons, mes amis, la paix; disons notre bénédicité.
TONNERRE. [p. 449]↩
SECTION PREMIERE.
Vidi et crudeles dantem Salmonea poenas
Dum flammas Jovis et sonitus imitatur Olympi, etc .
VIRGILE , Enéide 6.
A d'éternels tourments je te vis condamnée,
Superbe impiété du tyran Salmonée.
Rival de Jupiter il crut lui ressembler,
Il imita la foudre et ne put l'égaler;
De la foudre des dieux il fut frappé lui-même, etc.
Ceux qui ont inventé et perfectionné l'artillerie sont bien d'autres Salmonées. Un canon de vingt-quatre livres de balle, peut faire, et a fait souvent plus de ravage que cent coups de tonnerre. Cependant aucun canonnier n'a été jusqu'à présent foudroyé par Jupiter pour avoir voulu imiter ce qui se passe dans l'atmosphère.
Nous avons vu que Poliphême dans une pièce d'Euripide, se vante de faire plus de bruit que le tonnerre de Jupiter quand il a bien soupé.
Boileau plus honnête que Poliphême, dit dans sa première satire,
Pour moi qu'en santé même un autre monde étonne,
Qui croit l'âme immortelle et que c'est Dieu qui tonne.
Je ne sais pourquoi il est si étonné de l'autre monde, puisque toute l'antiquité y avait cru. Etonne n'était pas le mot propre, c'était alarme . Il croit que c'est Dieu qui tonne; mais il tonne comme il grêle, comme il envoie la pluie et le beau temps, comme il opère tout, comme il fait tout; ce n'est point parce qu'il est fâché qu'il envoie le tonnerre et la pluie. Les anciens peignaient Jupiter prenant le tonnerre composé de trois flèches brûlantes dans la patte de son aigle, et le lançant sur ceux à qui il en voulait. La saine raison n'est pas d'accord avec ces idées poétiques.
Le tonnerre est comme tout le reste, l'effet nécessaire des lois de la nature, prescrites par son auteur. Il se forme des exhalaisons de la terre; Franklin l'électrise, il tombe sur le professeur Richman comme sur les rochers et sur les églises. Et s'il foudroya Ajax Oïlée, ce n'est pas assurément parce que Minerve était irritée contre lui.
S'il était tombé sur Cartouche ou sur l'abbé Desfontaines, on n'aurait pas manqué de dire, Voilà comme Dieu punit les voleurs et les sodomites. Mais c'est un préjugé utile de faire craindre le ciel aux pervers.
Aussi tous nos poètes tragiques, quand ils veulent rimer à poudre , ou à résoudre , se servent-ils immanquablement de la foudre , et font gronder le tonnerre , s'il s'agit de rimer à terre .
Thésée dans Phèdre dit à son fils:
Monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre,
Reste impur des brigands dont j'ai puni la terre.
Sévère dans Polyeucte , sans même avoir besoin de rimer, dès qu'il apprend que sa maîtresse est mariée, dit à son ami Fabian,
Soutiens-moi, Fabian, ce coup de foudre est grand.
Pour diminuer l'horrible idée d'un coup de tonnerre qui n'a nulle ressemblance à une nouvelle mariée, il ajoute que ce coup de tonnerre
Le frappe d'autant plus que plus il le surprend.
Il dit ailleurs au même Fabian,
Qu'est ceci, Fabian, quel nouveau coup de foudre
Tombe sur mon espoir et le réduit en poudre.
Un espoir réduit en poudre devait étonner le parterre.
Lusignan dans Zaïre prie Dieu
Que la foudre en éclats ne tombe que sur lui.
Agénor, en parlant de sa soeur, commence par dire,
Que pour lui livrer la guerre
Sa vertu lui suffit au défaut du tonnerre.
L'Atrée du même auteur dit, en parlant de son frère,
Mon coeur qui sans pitié lui déclare la guerre,
Ne cherche à le punir qu'au défaut du tonnerre.
Si Thieste fait un songe, il vous dit,
Que ce songe a fini par un coup de tonnerre.
Si Tidée consulte les dieux dans l'antre d'un temple, l'antre ne lui répond qu'à grands coups de tonnerre.
Enfin j'ai vu partout le tonnerre et la foudre
Mettre les vers en cendre et les rimes en poudre.
Il faudrait tâcher de tonner moins souvent.
Je n'ai jamais bien compris la fable de Jupiter et des tonnerres dans la Fontaine.
Vulcain remplit ses fourneaux
De deux sortes de carreaux,
L'un jamais ne se fourvoie,
Et c'est celui que toujours
L'Olympe en corps nous envoie.
L'autre s'écarte en son cours,
Ce n'est qu'aux monts qu'il en coûte,
Bien souvent même il se perd,
Et ce dernier en sa route
Nous vient seul de Jupiter.
Avait-on donné à la Fontaine le sujet de cette mauvaise fable qu'il mit en mauvais vers si éloignés de son genre? voulait-on dire que les ministres de Louis XIV étaient inflexibles, et que le roi pardonnait?
Crébillon dans ses discours académiques en vers étranges, dit que le cardinal de Fleuri est un sage dépositaire.
Usant en citoyen du pouvoir arbitraire,
Aigle de Jupiter, mais ami de la paix,
Il gouverne la foudre et ne tonne jamais.
Il dit que le maréchal de Villars
Fit voir qu'à Malplaquet il n'avait survécu
Que pour rendre à Denain sa valeur plus célèbre,
Et qu'un foudre, du moins Eugène était vaincu.
Ainsi l'aigle Fleuri gouvernait le tonnerre sans tonner, et Eugène le tonnerre était vaincu; voilà bien des tonnerres.
SECTION SECONDE.
Horace, tantôt le débauché et tantôt le moral a dit,
Coelum ipsum petimus stultitiâ .
Nous portons jusqu'au ciel notre folie.
On peut dire aujourd'hui: Nous portons jusqu'au ciel notre sagesse, si pourtant il est permis d'appeler ciel cet amas bleu et blanc d'exhalaisons qui forme les vents, la pluie, la neige, la grêle et le tonnerre. Nous avons décomposé la foudre, comme Newton a détissu la lumière. Nous avons reconnu que ces foudres, portés autrefois par l'aigle de Jupiter, ne sont en effet que du feu sulfureux et très électrique; qu'enfin on peut électriser le tonnerre, le conduire, le diviser, s'en rendre le maître, comme nous faisons passer les rayons de lumière par un prisme, comme nous donnons cours aux eaux qui tombent du ciel, c'est-à-dire de la hauteur d'une demi-lieue de notre atmosphère. On plante un haut sapin ébranché, dont la cime est revêtue d'un cône de fer. Les nuées sulfureuses, qui forment le tonnerre, sont peut-être les plus électriques de tous les corps; leur soufre se communique à ce cône: et un fil d'archal, qui lui est attaché, conduit la matière du tonnerre où l'on veut. Un physicien ingénieux appelle cette expérience l' inoculation du tonnerre .
Il est vrai que l'inoculation de la petite vérole, qui a conservé tant de mortels, en a fait périr quelques-uns auxquels on avait donné la petite vérole inconsidérément. De même l'inoculation du tonnerre mal faite serait dangereuse. Il y a des grands seigneurs dont il ne faut approcher qu'avec d'extrêmes précautions. Le tonnerre est de ce nombre. On sait que le professeur de mathématique Richman fut tué à Pétersbourg en 1753 de la foudre électrisée qu'il avait attirée dans sa chambre, arte sua periit . Comme il était philosophe, un professeur théologien ne manqua pas d'imprimer qu'il avait été foudroyé comme Salmonée pour avoir usurpé les droits de Dieu, et pour avoir voulu lancer le tonnerre.
Mais si le physicien avait dirigé le fil d'archal hors de la maison et non pas dans sa chambre bien fermée, il n'aurait point eu le sort de Salmonée, d'Ajax Oïlée, de l'empereur Carus, du fils d'un ministre d'Etat en France, et de plusieurs moines dans les Pyrénées.
Placez votre conducteur à quelque distance de la maison, jamais dans votre chambre, et vous n'avez rien à craindre.
Mais dans une ville les maisons se touchent; choisissez les places, les carrefours, les jardins, les parvis des églises, les cimetières, supposé que vous ayez conservé l'abominable usage d'avoir des charniers dans vos villes.
TOPHET. [p. 454]↩
Tophet était et est encore un précipice auprès de Jérusalem dans la vallée d'Hennon. Cette vallée est un lieu affreux où il n'y a que des cailloux. C'est dans cette solitude horrible que les Juifs immolèrent leurs enfants à leur dieu qu'ils appelaient alors Moloc. Car nous avons remarqué qu'ils ne donnèrent jamais à Dieu que des noms étrangers. Shadaï était syrien, Adonaï phénicien; Jeova était aussi phénicien; Eloi, Eloim, Eloa chaldéen; ainsi que tous les noms de leurs anges furent chaldéens ou persans. C'est ce que nous avons observé avec attention.
Tous ces noms différents signifiaient également le Seigneur dans le jargon des petites nations devers la Palestine. Le mot de Moloc vient évidemment de Melk. C'est la même chose que Melcom, ou Millcon qui était la divinité des mille femmes du sérail de Salomon, savoir sept cents femmes et trois cents concubines. Tous ces noms-là signifiaient Seigneur, et chaque village avait son seigneur.
Des doctes prétendent que Moloc était particulièrement le seigneur du feu, et que pour cette raison les Juifs brûlaient leurs enfants dans le creux de l'idole même de Moloc. C'était une grande statue de cuivre aussi hideuse que les Juifs la pouvaient faire. Ils faisaient rougir cette statue à un grand feu, quoiqu'ils eussent très peu de bois; et ils jetaient leurs petits enfants dans le ventre de ce dieu, comme nos cuisiniers jettent des écrevisses vivantes dans l'eau toute bouillante de leurs chaudières.
Tels étaient les anciens Welches et les anciens Tudesques quand ils brûlaient des enfants et des femmes en l'honneur de Teutatès et d'Irminsul. Telle la vertu gauloise et la franchise germanique.
Jérémie voulut en vain détourner le peuple juif de ce culte diabolique, en vain il leur reprocha d'avoir bâti une espèce de Jérémie ch. VII. temple à Moloc dans cette abominable vallée. AEdificaverunt excelsa Topheth quae est in valle filiorum Hennon, ut incenderent filios suos, et filias suas igni . Ils ont édifié des hauteurs dans Tophet qui est dans la vallée des enfants d'Hennon, pour y brûler leurs fils et leurs filles par le feu.
Les Juifs eurent d'autant moins d'égards aux remontrances de Jérémie, qu'ils lui reprochaient hautement de s'être vendu au roi de Babilone; d'avoir toujours prêché en sa faveur, d'avoir trahi sa patrie; et en effet il fut puni de la mort des traîtres, il fut lapidé.
Liv. III, ch. II. Le livre des Rois nous apprend que Salomon bâtit un temple à Moloc, mais il ne nous dit pas que ce fût dans la vallée de Tophet. Ce fut dans le voisinage, sur la montagne des Oliviers. La situation était plus belle, si pourtant il peut y avoir quelque bel aspect dans le territoire affreux de Jérusalem.
Des commentateurs prétendent qu'Achas roi de Juda, fit brûler Liv. IV, ch. XVI, v. 3. son fils à l'honneur de Moloc, et que le roi Manassé fut coupable de la même barbarie. D'autres commentateurs prétendent que ces Ch. XXI, v. 6. rois du peuple de Dieu se contentèrent de jeter leurs enfants dans les flammes, mais qu'ils ne les brûlèrent pas tout à fait. Je le souhaite. Mais il est bien difficile qu'un enfant ne soit pas brûlé quand on le met sur un bûcher enflammé.
Cette vallée de Tophet était le Clamar de Paris, c'était là qu'on jetait toutes les immondices, toutes les charognes de la ville. C'était dans cette vallée qu'on précipitait le bouc émissaire, c'était la voirie où l'on laissait pourrir les charognes des suppliciés. Ce fut là qu'on jeta les corps des deux voleurs qui furent suppliciés avec le fils de Dieu lui-même. Mais notre Sauveur ne permit pas que son corps, sur lequel il avait donné puissance aux bourreaux, fût jeté à la voirie de Tophet selon l'usage. Il est vrai qu'il pouvait ressusciter aussi bien dans Tophet que dans le Calvaire. Mais un bon Juif nommé Joseph, natif d'Arimathie, qui s'était préparé un sépulcre pour lui-même sur le mont Calvaire, y mit le corps du Sauveur, selon le témoignage de St Matthieu. Il n'était permis d'enterrer personne dans les villes: le tombeau même de David n'était pas dans Jérusalem.
Joseph d'Arimathie était riche, quidam homo dives ab Arimathia , afin que cette prophétie d'Isaïe fût accomplie, Il donnera [46] les méchants pour sa sépulture, et les riches pour sa mort .
TRINITÉ. [p. 456]↩
Le premier qui parla de la Trinité parmi les Occidentaux, fut Timée de Locres dans son Ame du monde .
Il y a d'abord l'idée, l'exemplaire perpétuel de toutes choses engendrées; c'est le premier verbe, le verbe interne et intelligible.
Ensuite la matière informe second verbe, ou verbe proféré.
Puis le fils ou le monde sensible, ou l'esprit du monde.
Ces trois qualités constituent le monde entier, lequel monde est le fils de Dieu, Monogenes . Il a une âme, il a de la raison, il est empsukos, logikos .
Dieu ayant voulu faire un Dieu très beau, a fait un Dieu engendré, Touton epoie theon genaton .
Il est difficile de bien comprendre ce système de Timée, qui peut-être le tenait des Egyptiens, peut-être des brachmanes. Je ne sais si on l'entendait bien de son temps. Ce sont de ces médailles frustes et couvertes de rouille, dont la légende est effacée. On a pu la lire autrefois, on la devine aujourd'hui comme on peut.
Il ne paraît pas que ce sublime galimatias ait fait beaucoup de fortune jusqu'à Platon. Il fut enseveli dans l'oubli, et Platon le ressuscita. Il construisit son édifice en l'air, mais sur le modèle de Timée.
Il admit trois essences divines, le père, le suprême, le producteur; le père des autres dieux, est la première essence.
La seconde est le Dieu visible, ministre du Dieu invisible, le verbe, l'entendement, le grand démon.
La troisième est le monde.
Il est vrai que Platon dit souvent des choses toutes différentes, et même toutes contraires; c'est le privilège des philosophes grecs: et Platon s'est servi de son droit plus qu'aucun des anciens et des modernes.
Un vent grec poussa ces nuages philosophiques d'Athènes dans Alexandrie, ville prodigieusement entêtée de deux choses, d'argent et de chimères. Il y avait dans Alexandrie des Juifs qui ayant fait fortune, se mirent à philosopher.
La métaphysique a cela de bon, qu'elle ne demande pas des études préliminaires bien gênantes. C'est là qu'on peut savoir tout sans avoir jamais rien appris; et pour peu qu'on ait l'esprit présent un peu subtil et bien faux, on peut être sûr d'aller loin.
Philon le Juif fut un philosophe de cette espèce; il était contemporain de Jésus-Christ; mais il eut le malheur de ne le pas connaître, non plus que Joseph l'historien. Ces deux hommes considérables employés dans le chaos des affaires d'Etat, furent trop éloignés de la lumière naissante. Ce Philon était une tête Page 4 édit. 1719. toute métaphysique, toute allégorique, toute mystique. C'est lui qui dit que Dieu devait former le monde en six jours (comme il le forma selon Zoroastre en six temps), parce que trois est la moitié de six, et que deux en est le tiers, et que ce nombre est mâle et femelle .
Ce même homme entêté des idées de Platon, dit, en parlant de l'ivrognerie, que Dieu et la sagesse se marièrent, et que la sagesse accoucha d'un fils bien-aimé. Ce fils est le monde.
Il appelle les anges les verbes de Dieu, et le monde verbe de Dieu, logon tou theou .
Pour Flavien Joseph, c'était un homme de guerre qui n'avait jamais entendu parler du Logos, et qui s'en tenait aux dogmes des pharisiens, uniquement attachés à leurs traditions.
Cette philosophie platonicienne perça des Juifs d'Alexandrie jusqu'à ceux de Jérusalem. Bientôt toute l'école d'Alexandrie qui était la seule savante, fut platonicienne; et les chrétiens qui philosophaient ne parlèrent plus que du Logos.
On sait qu'il en était des disputes de ces temps-là, comme de celles de ce temps-ci. On cousait à un passage mal entendu un passage inintelligible qui n'y avait aucun rapport. On en supposait un second, on en falsifiait un troisième; on fabriquait des livres entiers qu'on attribuait à des auteurs respectés par le troupeau. Nous en avons vu cent exemples au mot Apocryphe .
Cher lecteur, jetez les yeux de grâce sur ce passage de Clément Alexandrin, Strom. liv. V. Lorsque Platon dit qu'il est difficile de connaître le père de l'univers, non seulement il fait voir par là que le monde a été engendré, mais qu'il a été engendré comme fils de Dieu . Entendez-vous ces logomachies, ces équivoques? voyez-vous la moindre lumière dans ce chaos d'expressions obscures?
O Locke, Locke! venez, définissez les termes. Je ne crois pas que de tous ces disputeurs platoniciens il y en eût un seul qui s'entendît. On distingua deux verbes, le Logos endiathétos , le verbe en la pensée; et le verbe produit Logos proforikos . On eut l'éternité d'un verbe, et la prolation, l'émanation d'un autre verbe.
Liv. VIII, ch. XLII. Le livre des Constitutions apostoliques , ancien monument de fraude, mais aussi ancien dépôt des dogmes informes de ces temps obscurs, s'exprime ainsi:
Le père qui est antérieur à toute génération, à tout commencement, ayant tout créé par son fils unique, a engendré sans intermède ce fils par sa volonté et sa puissance .
I part. sur St Jean. Ensuite Origène avança que le Saint-Esprit a été créé par le fils, par le verbe.
Théol. liv. II, ch. VI. Puis vint Eusèbe de Césarée qui enseigna que l'esprit, paraclet, n'est ni Dieu, ni fils.
Liv. IV, ch. VIII. L'avocat Lactance fleurit en ce temps-là. Le fils de Dieu , dit-il, est le verbe, comme les autres anges sont les esprits de Dieu. Le verbe est un esprit proféré par une voix significative, l'esprit procédant du nez, et la parole de la bouche. Il s'ensuit qu'il y a différence entre le fils de Dieu et les autres anges; ceux-ci étant émanés comme esprits tacites et muets. Mais le fils étant esprit est sorti de la bouche avec son et voix pour prêcher le peuple .
On conviendra que l'avocat Lactance plaidait sa cause d'une étrange manière. C'était raisonner à la Platon; c'était puissamment raisonner.
Ce fut environ ce temps-là que parmi les disputes violentes sur la Trinité, on inséra dans la première épître de St Jean ce fameux verset, Il y en a trois qui rendent témoignage en terre, l'esprit ou le vent, l'eau et le sang, et ces trois sont un . Ceux qui prétendent que ce verset est véritablement de St Jean, sont bien plus embarrassés que ceux qui le nient; car il faut qu'ils l'expliquent.
St Augustin dit que le vent signifie le Père, l'eau le Saint-Esprit, et que le sang veut dire le Verbe. Cette explication est belle, mais elle laisse toujours un peu d'embarras.
Liv. IV, ch. XXXVII. St Irénée va bien plus loin; il dit que Rahab la prostituée de Jérico, en cachant chez elle trois espions du peuple de Dieu, cacha le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela est fort, mais cela n'est pas net.
Livre XXIV sur St Jean. D'un autre côté, le grand, le savant Origène nous confond d'une autre manière. Voici un de ses passages parmi bien d'autres. Le Fils est autant au-dessous du Père, que lui et le Saint-Esprit sont au-dessus des plus nobles créatures .
Après cela que dire? comment ne pas convenir avec douleur que personne ne s'entendait? comment ne pas avouer que depuis les premiers chrétiens ébionites, ces hommes si mortifiés et si pieux, qui révérèrent toujours Jésus quoiqu'ils le crussent fils de Joseph, jusqu'à la grande dispute d'Athanase, le platonisme de la Trinité ne fut jamais qu'un sujet de querelles. Il fallait absolument un juge suprême qui décidât; on le trouva enfin dans le concile de Nicée. Encore ce concile produisit-il de nouvelles factions et des guerres.
EXPLICATION DE LA TRINITÉ SUIVANT ABAUZIT.
‘L'on ne peut parler avec exactitude de la manière dont se fait l'union de Dieu avec Jésus-Christ, qu'en rapportant les trois sentiments qu'il y a sur ce sujet, et qu'en faisant des réflexions sur chacun d'eux.
SENTIMENS DES ORTHODOXES.
‘Le premier sentiment est celui des orthodoxes. Ils y établissent, 1 o . une distinction de trois personnes dans l'essence divine avant la venue de Jésus-Christ au monde. 2 o . Que la seconde de ces personnes s'est unie à la nature humaine de Jésus-Christ. 3 o . Que cette union est si étroite, que par là Jésus-Christ est Dieu; qu'on peut lui attribuer la création du monde et toutes les perfections divines, et qu'on peut l'adorer d'un culte suprême.
DES UNITAIRES.
‘Le second est celui des unitaires. Ne concevant point la distinction des personnes dans la divinité, ils établissent, 1 o . Que la divinité s'est unie à la nature humaine de Jésus-Christ. 2 o . Que cette union est telle que l'on peut dire que Jésus-Christ est Dieu; que l'on peut lui attribuer la création et toutes les perfections divines, et l'adorer d'un culte suprême.
SENTIMENS DES SOCINIENS.
‘Le troisième sentiment est celui des sociniens, qui, de même que les unitaires, ne concevant point de distinction de personnes dans la divinité, ils établissent, 1 o . Que la divinité s'est unie à la nature humaine de Jésus-Christ. 2 o . Que cette union est fort étroite. 3 o . Qu'elle n'est pas telle que l'on puisse appeler Jésus-Christ Dieu, ni lui attribuer les perfections divines et la création, ni l'adorer d'un culte suprême; et ils pensent pouvoir expliquer tous les passages de l'Ecriture sans être obligés d'admettre aucune de ces choses.
RÉFLEXIONS SUR LE PREMIER SENTIMENT.
‘Dans la distinction qu'on fait des trois personnes dans la divinité, ou on retient l'idée ordinaire des personnes, ou on ne la retient pas. Si on retient l'idée ordinaire des personnes, on établit trois dieux; cela est certain. Si l'on ne retient pas l'idée ordinaire des trois personnes, ce n'est plus alors qu'une distinction de propriétés, ce qui revient au second sentiment. Ou, si on ne veut pas dire que ce n'est pas une distinction des personnes proprement dites, ni une distinction de propriétés, on établit une distinction dont on n'a aucune idée. Et il n'y a point d'apparence que pour faire soupçonner en Dieu une distinction dont on ne peut avoir aucune idée, l'Ecriture veuille mettre les hommes en danger de devenir idolâtres en multipliant la divinité. Il est d'ailleurs surprenant que cette distinction de personnes ayant toujours été, ce ne soit que depuis la venue de Jésus-Christ qu'elle a été révélée, et qu'il soit nécessaire de les connaître.
RÉFLEXIONS SUR LE SECOND SENTIMENT.
‘Il n'y a pas à la vérité un si grand danger de jeter les hommes dans l'idolâtrie dans le second sentiment que dans le premier; mais il faut avouer pourtant qu'il n'en est pas entièrement exempt. En effet, comme par la nature de l'union qu'il établit entre la divinité et la nature humaine de Jésus-Christ, on peut appeler Jésus-Christ Dieu et l'adorer: voilà deux objets d'adoration, Jésus-Christ, et Dieu. J'avoue qu'on dit que ce n'est que Dieu qu'on doit adorer en Jésus-Christ. Mais qui ne sait l'extrême penchant que les hommes ont de changer les objets invisibles du culte en des objets qui tombent sous les sens, ou du moins sous l'imagination; penchant qu'ils suivront ici avec d'autant moins de scrupule, qu'on dit que la divinité est personnellement unie à l'humanité de Jésus-Christ.
RÉFLEXIONS SUR LE TROISIEME SENTIMENT.
‘Le troisième sentiment, outre qu'il est très simple et conforme aux idées de la raison, il n'est sujet à aucun semblable danger de jeter les hommes dans l'idolâtrie, quoique par ce sentiment Jésus-Christ ne soit qu'un simple homme, il ne faut pas craindre que par là il soit confondu avec les prophètes ou les saints du premier ordre. Il reste toujours dans ce sentiment une différence entre eux et lui. Comme on peut imaginer presque à l'infini des degrés d'union de la divinité avec un homme, ainsi on peut concevoir, qu'en particulier l'union de la divinité avec Jésus-Christ a un si haut degré de connaissance, de puissance, de félicité, de perfection, de dignité, qu'il y a toujours eu une distance immense entre lui et les plus grands prophètes. Il ne s'agit que de voir si ce sentiment peut s'accorder avec l'Ecriture, et s'il est vrai que le titre de Dieu, que les perfections divines, que la création, que le culte suprême ne soient jamais attribués à Jésus-Christ dans les Evangiles.'
C'était au philosophe Abauzit à voir tout cela. Pour moi, je me soumets de coeur, de bouche et de plume à tout ce que l'Eglise catholique a décidé, et à tout ce qu'elle décidera sur quelque dogme que ce puisse être. Je n'ajouterai qu'un mot sur la Trinité. C'est que nous avons une décision de Calvin sur ce mystère; la voici.
‘En cas que quelqu'un soit hétérodoxe, et qu'il se fasse scrupule de se servir des mots Trinité et Personne, nous ne croyons pas que ce soit une raison pour rejeter cet homme; nous devons le supporter sans le chasser de l'Eglise, et sans l'exposer à aucune censure comme un hérétique.'
C'est après une déclaration aussi solennelle que Jean Chauvin, dit Calvin, fils d'un tonnelier de Noyon, fit brûler dans Genève à petit feu avec des fagots verts, Michel Servet de Villa-Nueva. Cela n'est pas bien.
TYRAN. [p. 463]↩
Tyrannos , signifiait autrefois celui qui avait su s'attirer la principale autorité; comme roi, bazileus , signifiait celui qui était chargé de rapporter les affaires au sénat.
Les acceptions des mots changent avec le temps. Idiotès ne voulait dire d'abord qu'un solitaire, un homme isolé: avec le temps il devint le synonyme de sot.
On donne aujourd'hui le nom de tyran à un usurpateur, ou à un roi qui fait des actions violentes et injustes.
Cromwell était un tyran sous ces deux aspects. Un bourgeois qui usurpe l'autorité suprême; qui, malgré toutes les lois, supprime la chambre des pairs, est sans doute un tyran usurpateur. Un général qui fait couper le cou à son roi prisonnier de guerre, viole à la fois et ce qu'on appelle les lois de la guerre, et les lois des nations, et celles de l'humanité. Il est tyran, il est assassin et parricide.
Charles I er n'était point tyran, quoique la faction victorieuse lui donnât ce nom: il était, à ce qu'on dit, opiniâtre, faible et mal conseillé. Je ne l'assurerai pas; car je ne l'ai pas connu, mais j'assure qu'il fut très malheureux.
Henri VIII était tyran dans son gouvernement, comme dans sa famille, et couvert du sang de deux épouses innocentes, comme de celui des plus vertueux citoyens: il mérite l'exécration de la postérité. Cependant il ne fut point puni; et Charles I er mourut sur un échafaud.
Elisabeth fit une action de tyrannie, et son parlement une de lâcheté infâme, en faisant assassiner par un bourreau la reine Marie Stuart. Mais dans le reste de son gouvernement elle ne fut point tyrannique; elle fut adroite et comédienne, mais prudente et forte.
Richard III fut un tyran barbare; mais il fut puni.
Le pape Alexandre VI fut un tyran plus exécrable que tous ceux-là; et il fut heureux dans toutes ses entreprises.
Christiern II fut un tyran aussi méchant qu'Alexandre VI, et fut châtié; mais il ne le fut point assez.
Si on veut compter les tyrans turcs, les tyrans grecs, les tyrans romains, on en trouvera autant d'heureux que de malheureux. Quand je dis heureux, je parle selon le préjugé vulgaire, selon l'acception ordinaire du mot, selon les apparences. Car qu'ils aient été heureux réellement, que leur âme ait été contente et tranquille, c'est ce qui me paraît impossible.
Constantin le Grand fut évidemment un tyran à double titre. Il usurpa dans le nord de l'Angleterre la couronne de l'empire romain, à la tête de quelques légions étrangères, malgré toutes les lois, malgré le sénat et le peuple qui élurent légitimement Maxence. Il passa toute sa vie dans le crime, dans les voluptés, dans les fraudes, et dans les impostures. Il ne fut point puni; mais fut-il heureux? Dieu le sait. Et je sais que ses sujets ne le furent pas.
Le grand Théodose était le plus abominable des tyrans, quand, sous prétexte de donner une fête, il faisait égorger dans le cirque quinze mille citoyens romains plus ou moins, avec leurs femmes et leurs enfants; et qu'il ajoutait à cette horreur, la facétie de passer quelques mois sans aller s'ennuyer à la grand-messe. On a presque mis ce Théodose au rang des bienheureux; mais je serais bien fâché qu'il eût été heureux sur la terre. En tout cas, il sera toujours bon d'assurer aux tyrans, qu'ils ne seront jamais heureux dans ce monde, comme il est bon de faire accroire à nos maîtres d'hôtel et à nos cuisiniers qu'ils seront damnés éternellement, s'ils nous volent.
Les tyrans du bas-empire grec furent presque tous détrônés, assassinés les uns par les autres. Tous ces grands coupables furent tour à tour les exécuteurs de la vengeance divine et humaine.
Parmi les tyrans turcs, on en voit autant de déposés que de morts sur leur trône.
A l'égard des tyrans subalternes, de ces monstres en sous-ordre, qui ont fait remonter jusque sur leur maître l'exécration publique, dont ils ont été chargés, le nombre de ces Aman, de ces Séjan, est un infini du premier ordre.
VAMPIRES. [p. 465]↩
Quoi! c'est dans notre dix-huitième siècle qu'il y a eu des vampires! c'est après le règne de Locke, de Shaftersburi, des Trenchards, des Colins; c'est sous le règne des Dalembert, des Diderot, des St Lambert, des Duclos qu'on a cru aux vampires; et que le révérend père Don Augustin Calmet, prêtre, bénédictin de la congrégation de St Vannes et de St Hidulphe, abbé de Sénone, abbaye de cent mille livres de rentes, voisine de deux autres abbayes du même revenu, a imprimé et réimprimé l'histoire des vampires avec l'approbation de la Sorbonne, signée Marcilli!
Ces vampires étaient des morts qui sortaient la nuit de leurs cimetières pour venir sucer le sang des vivants soit à la gorge ou au ventre, après quoi ils allaient se remettre dans leurs fosses. Les vivants sucés maigrissaient, pâlissaient, tombaient en consomption, et les morts suceurs engraissaient, prenaient des couleurs vermeilles, étaient tout à fait appétissants. C'était en Pologne, en Hongrie, en Silésie, en Moravie, en Autriche, en Lorraine que les morts faisaient cette bonne chère. On n'entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J'avoue que dans ces deux villes il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d'affaires qui sucèrent en plein jour le sang du peuple, mais ils n'étaient point morts quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais fort agréables.
Qui croirait que la mode des vampires nous vint de la Grèce? Ce n'est pas de la Grèce d'Alexandre, d'Aristote, de Platon, d'Epicure, de Démosthène, mais de la Grèce chrétienne, malheureusement schismatique.
Depuis longtemps les chrétiens du rite grec, s'imaginent que les corps des chrétiens du rite latin, enterrés en Grèce, ne pourrissent point: parce qu'ils sont excommuniés. C'est précisément le contraire de nous autres chrétiens du rite latin. Nous croyons que les corps, qui ne se corrompent point, sont marqués du sceau de la béatitude éternelle. Et dès qu'on a payé cent mille écus à Rome pour leur faire donner un brevet de saints, nous les adorons de l'adoration de dulie.
Les Grecs sont persuadés que ces morts sont sorciers; ils les appellent broucolacas ou vroucolacas , selon qu'ils prononcent la seconde lettre de l'alphabet. Ces morts grecs vont dans les maisons sucer le sang des petits enfants, manger le souper des pères et mères, boire leur vin, et casser tous les meubles. On ne peut les mettre à la raison qu'en les brûlant, quand on les attrape. Mais il faut avoir la précaution de ne les mettre au feu qu'après leur avoir arraché le coeur que l'on brûle à part.
Tournefort tom. I, pag. 155 et suiv. Le célèbre Tournefort envoyé dans le Levant par Louis XIV, ainsi que tant d'autres virtuoses, fut témoin de tous les tours attribués à un de ces broucolacas, et de cette cérémonie.
Après la médisance rien ne se communique plus promptement que la superstition, le fanatisme, le sortilège et les contes des revenants. Il y eut des broucolacas en Valachie, en Moldavie, et bientôt chez les Polonais, lesquels sont du rite romain. Cette superstition leur manquait; elle alla dans tout l'orient de l'Allemagne. On n'entendit plus parler que de vampires, depuis 1730 jusqu'en 1735; on les guetta, on leur arracha le coeur; et on les brûla; ils ressemblaient aux anciens martyrs; plus on en brûlait, plus il s'en trouvait.
Calmet enfin devint leur historiographe, et traita les vampires, comme il avait traité l'Ancien et le Nouveau Testament, en rapportant fidèlement tout ce qui avait été dit avant lui.
C'est une chose à mon gré très curieuse, que les procès-verbaux faits juridiquement concernant tous les morts qui étaient sortis de leurs tombeaux pour venir sucer les petits garçons et les petites filles de leur voisinage. Calmet rapporte qu'en Hongrie deux officiers délégués par l'empereur CharlesVI , assistés du bailli du lieu et du bourreau, allèrent faire enquête d'un vampire, mort depuis six semaines, qui suçait tout le voisinage. On le trouva dans sa bière frais, gaillard, les yeux ouverts, et demandant à manger. Le bailli rendit sa sentence. Le bourreau arracha le coeur au vampire, et le brûla; après quoi le vampire ne mangea plus.
Qu'on ose douter après cela des morts ressuscités, dont nos anciennes légendes sont remplies, et de tous les miracles rapportés par Bollandus, et par le sincère et révérend Don Ruinart!
Vous trouvez des histoires de vampires jusque dans les Lettres juives de ce d'Argens que les jésuites, auteurs du Journal de Trévoux, ont accusé de ne rien croire. Il faut voir comme ils triomphèrent de l'histoire du vampire de Hongrie: comme ils remerciaient Dieu et la Vierge d'avoir enfin converti ce pauvre d'Argens, chambellan d'un roi qui ne croyait point aux vampires.
Voilà donc, disaient-ils, ce fameux incrédule qui a osé jeter des doutes sur l'apparition de l'ange à la Ste Vierge; sur l'étoile qui conduisit les mages; sur la guérison des possédés; sur la submersion de deux mille cochons dans un lac; sur une éclipse de soleil en pleine lune; sur la résurrection des morts qui se promenèrent dans Jérusalem; son coeur s'est amolli, son esprit s'est éclairé, il croit aux vampires.
Il ne fut plus question alors d'examiner si tous ces morts étaient ressuscités par leur propre vertu, ou par la puissance de Dieu, ou par celle du diable. Plusieurs grands théologiens de Lorraine, de Moravie et de Hongrie étalèrent leurs opinions et leur science. On rapporta tout ce que St Augustin, St Ambroise et tant d'autres saints avaient dit de plus inintelligible sur les vivants et sur les morts. On rapporta tous les miracles de St Etienne qu'on trouve au septième livre des OEuvres de St Augustin; voici un des plus curieux. Un jeune homme fut écrasé dans la ville d'Hubzal en Afrique sous les ruines d'une muraille; la veuve alla sur-le-champ invoquer St Etienne, à qui elle était très dévote. St Etienne le ressuscita. On lui demanda ce qu'il avait vu dans l'autre monde. Messieurs, dit-il, quand mon âme eut quitté mon corps, elle rencontra une infinité d'âmes qui lui faisaient plus de questions sur ce monde-ci que vous ne m'en faites sur l'autre. J'allais je ne sais où, lorsque j'ai rencontré St Etienne qui m'a dit: Rendez ce que vous avez reçu. Je lui ai répondu: Que voulez-vous que je vous rende, vous ne m'avez jamais rien donné? Il m'a répété trois fois: Rendez ce que vous avez reçu. Alors j'ai compris qu'il voulait parler du Credo . Je lui ai récité mon Credo , et soudain il m'a ressuscité.
On cita surtout les histoires rapportées par Sulpice Sévère dans la Vie de St Martin. On prouva que St Martin avait entre autres ressuscité un damné.
Mais toutes ces histoires, quelque vraies qu'elles puissent être, n'avaient rien de commun avec les vampires qui allaient sucer le sang de leurs voisins, et venaient ensuite se replacer dans leurs bières. On chercha si on ne trouverait pas dans l'Ancien Testament, ou dans la mythologie quelque vampire qu'on pût donner pour exemple; on n'en trouva point. Mais il fut prouvé que les morts buvaient et mangeaient, puisque chez tant de nations anciennes on mettait des vivres sur leurs tombeaux.
La difficulté était de savoir si c'était l'âme ou le corps du mort qui mangeait. Il fut décidé que c'était l'un et l'autre. Les mets délicats et peu substantiels comme les meringues, la crème fouettée et les fruits fondants étaient pour l'âme; les rosbifs étaient pour le corps.
Les rois de Perse furent, dit-on, les premiers qui se firent servir à manger après leur mort. Presque tous les rois d'aujourd'hui les imitent; mais ce sont les moines qui mangent leur dîner et leur souper, et qui boivent le vin. Ainsi les rois ne sont pas à proprement parler des vampires. Les vrais vampires sont les moines qui mangent aux dépens des rois et des peuples.
Il est bien vrai que St Stanislas qui avait acheté une terre considérable d'un gentilhomme polonais, et qui ne l'avait point payée, étant poursuivi devant le roi Boleslas par les héritiers, ressuscita le gentilhomme; mais ce fut uniquement pour se faire donner quittance. Et il n'est point dit qu'il ait donné seulement un pot de vin au vendeur, lequel s'en retourna dans l'autre monde, sans avoir ni bu ni mangé.
On agite ensuite la grande question, si l'on peut absoudre un vampire qui est mort excommunié. Cela va plus au fait.
Je ne suis pas assez profond dans la théologie pour dire mon avis sur cet article; mais je serais volontiers pour l'absolution; parce que dans toutes les affaires douteuses il faut toujours prendre le parti le plus doux.
Odia restringenda, favores ampliandi .
Le résultat de tout ceci est qu'une grande partie de l'Europe a été infestée de vampires pendant cinq ou six ans, et qu'il n'y en a plus: Que nous avons eu des convulsionnaires en France pendant plus de vingt ans, et qu'il n'y en a plus: Que nous avons eu des possédés pendant dix-sept cents ans, et qu'il n'y en a plus: Qu'on a toujours ressuscité des morts depuis Hippolite, et qu'on n'en ressuscite plus: Que nous avons eu des jésuites en Espagne, en Portugal, en France, dans les deux Siciles, et que nous n'en avons plus.
VENALITÉ. [p. 469]↩
Ce faussaire dont nous avons tant parlé, qui fit le Testament du cardinal de Richelieu, dit au chapitre IV, qu'il vaut mieux laisser la vénalité et le droit annuel, que d'abolir ces deux établissements difficiles à changer tout d'un coup sans ébranler l'Etat .
Toute la France répétait et croyait répéter après le cardinal de Richelieu, que la vénalité des offices de judicature était très avantageuse.
L'abbé de St Pierre fut le premier qui croyant encore que le prétendu testament était du cardinal, osa dire dans ses observations sur le ch. IV, Le cardinal s'est engagé dans un mauvais pas, en soutenant que quant à présent, la vénalité des charges peut être avantageuse à l'Etat. Il est vrai qu'il n'est pas possible de rembourser toutes les charges .
Ainsi non seulement cet abus paraissait à tout le monde irréformable, mais utile; on était si accoutumé à cet opprobre, qu'on ne le sentait pas; il semblait éternel; un seul homme en peu de mois l'a su anéantir.
Répétons donc qu'on peut tout faire, tout corriger; que le grand défaut de presque tous ceux qui gouvernent, est de n'avoir que des demi-volontés et des demi-moyens. Si Pierre le Grand n'avait pas voulu fortement, deux mille lieues de pays seraient encore barbares.
Comment donner de l'eau dans Paris à trente mille maisons qui en manquent? comment payer les dettes de l'Etat, comment se soustraire à la tyrannie révérée d'une puissance étrangère qui n'est pas une puissance, et à laquelle on paie en tribut les premiers fruits? Osez-le vouloir, et vous en viendrez à bout plus aisément que vous n'avez extirpé les jésuites, et purgé le théâtre de petits-maîtres.
VENISE, [p. 470]↩
ET PAR OCCASION DE LA LIBERTÉ.
Nulle puissance ne peut reprocher aux Vénitiens d'avoir acquis leur liberté par la révolte; nulle ne peut leur dire, Je vous ai affranchis, voilà le diplôme de votre manumission.
Ils n'ont point usurpé leurs droits comme les Césars usurpèrent l'empire, comme tant d'évêques, à commencer par celui de Rome, ont usurpé les droits régaliens; ils sont seigneurs de Venise (si l'on ose se servir de cette audacieuse comparaison) comme Dieu est seigneur de la terre, parce qu'il l'a fondée.
Attila, qui ne prit jamais le titre de fléau de Dieu , va ravageant l'Italie. Il en avait autant de droit qu'en eurent depuis Charlemagne l'Austrasien et Arnould le Bâtard Carinthien, et Gui duc de Spolète, et Bérenger marquis de Frioul, et les évêques qui voulaient se faire souverains.
Dans ce temps de brigandages militaires et ecclésiastiques, Attila passe comme un vautour, et les Vénitiens se sauvent dans la mer comme des alcyons. Nul ne les protège qu'eux-mêmes; ils font leur nid au milieu des eaux; ils l'agrandissent; ils le peuplent, ils le défendent, ils l'enrichissent. Je demande s'il est possible d'imaginer une possession plus juste? Notre père Adam qu'on suppose avoir vécu dans le beau pays de la Mésopotamie, n'était pas à plus juste titre seigneur et jardinier du paradis terrestre.
J'ai lu le Squittinio della liberta di Venezia , et j'en ai été indigné.
Quoi! Venise ne serait pas originairement libre, parce que les empereurs grecs superstitieux et méchants, et faibles, et barbares disent, Cette nouvelle ville a été bâtie sur notre ancien territoire; et parce que des Allemands ayant le titre d' empereur d'Occident disent, Cette ville étant dans l'Occident, est de notre domaine?
Il me semble voir un poisson volant, poursuivi à la fois par un faucon et par un requin, et qui échappe à l'un et à l'autre.
Sannazar avait bien raison de dire, en comparant Rome et Venise,
Illam homines dicas hanc posuisse deos .
Rome perdit par César, au bout de cinq cents ans, sa liberté acquise par Brutus. Venise a conservé la sienne pendant onze siècles, et je me flatte qu'elle la conservera toujours.
Gènes, pourquoi fais-tu gloire de montrer un diplôme d'un Bérenger qui te donna des privilèges en l'an 958? On sait que des concessions de privilèges ne sont que des titres de servitude. Et puis voilà un beau titre qu'une charte d'un tyran passager qui ne fut jamais bien reconnu en Italie, et qui fut chassé deux ans après la date de cette charte!
La véritable charte de la liberté est l'indépendance soutenue par la force. C'est avec la pointe de l'épée qu'on signe les diplômes qui assurent cette prérogative naturelle. Tu perdis plus d'une fois ton privilège et ton coffre-fort. Garde l'un et l'autre depuis 1748.
Heureuse Helvétie! à quelle pancarte dois-tu ta liberté? à ton courage, à ta fermeté, à tes montagnes. -- Mais je suis ton empereur -- mais je ne veux plus que tu le sois -- mais tes pères ont été esclaves de mon père -- c'est pour cela même que leurs enfants ne veulent point te servir -- mais j'avais le droit attaché à ma dignité -- et nous, nous avons le droit de la nature.
Quand les sept Provinces-Unies eurent-elles ce droit incontestable? au moment même où elles furent unies; et dès lors ce fut Philippe II qui fut le rebelle. Quel grand homme que ce Guillaume prince d'Orange! il trouva des esclaves, et il en fit des hommes libres.
Pourquoi la liberté est-elle si rare?
Parce qu'elle est le premier des biens.
VENTRES PARESSEUX. [p. 472]↩
St Paul a dit que les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes et des ventres paresseux . Le médecin Hequet entendait par ventres paresseux , que les Crétois allaient rarement à la selle, et qu'ainsi la matière fécale refluant dans leur sang, les rendait de mauvaise humeur et en faisait de méchantes bêtes. Il est très vrai qu'un homme qui n'a pu venir à bout de pousser sa selle, sera plus sujet à la colère qu'un autre; sa bile ne coule pas, elle est recuite, son sang est aduste.
Quand vous avez le matin une grâce à demander à un ministre ou à un premier commis de ministre, informez-vous adroitement s'il a le ventre libre. Il faut toujours prendre mollia fandi tempora .
Personne n'ignore que notre caractère et notre tour d'esprit ne dépende absolument de la garde-robe. Le cardinal de Richelieu n'était sanguinaire que parce qu'il avait des hémorroïdes internes qui occupaient son intestin rectum, et qui durcissaient ses matières. La reine Anne d'Autriche l'appelait toujours Cul pourri . Ce sobriquet redoubla l'aigreur de sa bile, et coûta probablement la vie au maréchal de Marillac, et la liberté au maréchal de Bassompierre. Mais je ne vois pas pourquoi les gens constipés seraient plus menteurs que d'autres; il n'y a nulle analogie entre le sphincter de l'anus et le mensonge, comme il y en a une très sensible entre les intestins et nos passions, notre manière de penser, notre conduite.
Je suis donc bien fondé à croire que St Paul entendait par ventres paresseux , des gens voluptueux, des espèces de prieurs, de chanoines, d'abbés commendataires, de prélats fort riches qui restaient au lit tout le matin pour se refaire des débauches de la veille, comme dit Marot,
Un gras prieur son petit-fils baisait
Et mignardait au matin dans sa couche,
Tandis rôtir la perdrix on faisait. etc. etc.
Mais on peut fort bien passer le matin au lit, et n'être ni menteur, ni méchante bête. Au contraire, les voluptueux indolents sont pour la plupart très doux dans la société, et du meilleur commerce du monde.
Quoi qu'il en soit, je suis très fâché que St Paul injurie toute une nation: il n'y a dans ce passage (humainement parlant) ni politesse, ni habileté, ni vérité. On ne gagne point les hommes en leur disant qu'ils sont de méchantes bêtes; et sûrement il aurait trouvé en Crète des hommes de mérite. Pourquoi outrager ainsi la patrie de Minos, dont l'archevêque Fénelon (bien plus poli que St Paul) fait un si pompeux éloge dans son Télémaque .
St Paul n'était-il pas difficile à vivre? d'une humeur brusque, d'un esprit fier, d'un caractère dur et impérieux? Si j'avais été l'un des apôtres, ou seulement disciple, je me serais infailliblement brouillé avec lui. Il me semble que tout le tort était de son côté dans sa querelle avec Pierre Simon Barjone. Il avait la fureur de la domination; il se vante toujours d'être apôtre, et d'être plus apôtre que ses confrères, lui qui avait servi à lapider St Etienne! lui qui avait été un valet persécuteur sous Gamaliel, et qui aurait dû pleurer ses crimes, bien plus longtemps que St Pierre ne pleura sa faiblesse, (toujours humainement parlant.)
Il se vante d'être citoyen romain né à Tarsis; et St Jérôme prétend qu'il était un pauvre Juif de province né à Giscale dans la Galilée. [47] Dans ses lettres au petit troupeau de ses frères, il parle toujours en maître très dur. Je viendrai , écrit-il à quelques Corinthiens, je viendrai à vous, je jugerai tout par deux ou trois témoins; je ne pardonnerai ni à ceux qui ont péché, ni aux autres . Ce ni aux autres est un peu dur.
Bien des gens prendraient aujourd'hui le parti de St Pierre contre St Paul, n'était l'épisode d'Ananie et de Saphire, qui a intimidé les âmes enclines à faire l'aumône.
Je reviens à mon texte des Crétois menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux; et je conseille à tous les missionnaires de ne jamais débuter avec aucun peuple par lui dire des injures.
Ce n'est pas que je regarde les Crétois comme les plus justes et les plus respectables des hommes, ainsi que le dit la fabuleuse Grèce. Je ne prétends point concilier leur prétendue vertu avec leur prétendu taureau dont la belle Pasiphaé fut si amoureuse, ni avec l'art dont le fondeur Dédale fit une vache d'airain, dans laquelle Pasiphaé se posta si habilement, que son tendre amant lui fit un minotaure, auquel le pieux et équitable Minos sacrifiait tous les ans (et non pas tous les neuf ans) sept grands garçons et sept grandes filles d'Athènes.
Ce n'est pas que je croie aux cent grandes villes de Crète; passe pour cent mauvais villages établis sur ce rocher long et étroit avec deux ou trois villes. On est toujours fâché que Rollin, dans sa compilation élégante de l'histoire ancienne, ait répété tant d'anciennes fables sur l'île de Crète et sur Minos comme sur le reste.
A l'égard des pauvres Grecs et des pauvres juifs qui habitent aujourd'hui les montagnes escarpées de cette île sous le gouvernement d'un pacha, il se peut qu'ils soient des menteurs et de méchantes bêtes. J'ignore s'ils ont le ventre paresseux, et je souhaite qu'ils aient à manger.
VERGE, [p. 474]↩
BAGUETTE DIVINATOIRE.
Les théurgites, les anciens sages avaient tous une verge avec laquelle ils opéraient.
Mercure passe pour le premier dont la verge ait fait des prodiges. On tient que Zoroastre avait une grande verge. La verge de l'antique Bacchus était son thyrse, avec lequel il sépara les eaux de l'Oronte, de l'Hydaspe et de la mer Rouge. La verge d'Hercule était son bâton, sa massue. Pythagore fut toujours représenté avec sa verge. On dit qu'elle était d'or; il n'est pas étonnant qu'ayant une cuisse d'or, il eût une verge du même métal.
Abaris, prêtre d'Apollon hyperboréen, qu'on prétend avoir été contemporain de Pythagore, fut bien plus fameux par sa verge; elle n'était que de bois; mais il traversait les airs à califourchon sur elle. Porphire et Jamblique affirment que ces deux grands théurgites, Abaris et Pythagore, se montrèrent amicalement leur verge.
La verge fut en tout temps l'instrument des sages, et le signe de leur supériorité. Les conseillers sorciers de Pharaon firent d'abord autant de prestiges avec leur verge que Moïse fit de prodiges avec la sienne. Le judicieux Calmet nous apprend dans sa Dissertation sur l'Exode, que les opérations de ces mages n'étaient pas des miracles proprement dits, mais une métamorphose fort singulière et fort difficile, qui néanmoins n'est ni contre, ni au-dessus des lois de la nature . La verge de Moïse eut la supériorité qu'elle devait avoir sur celle de ces chotim d'Egypte.
Non seulement la verge d'Aaron partagea l'honneur des prodiges de son frère Moïse; mais elle en fit en son particulier de très admirables. Personne n'ignore comment de treize verges celle d'Aaron fut la seule qui fleurit, qui poussa des boutons, des fleurs, et des amandes.
Le diable, qui, comme on sait, est un mauvais singe des oeuvres des saints, voulut avoir aussi sa verge, sa baguette, dont il gratifia tous les sorciers. Médée et Circé furent toujours armées de cet instrument mystérieux. De là vient que jamais magicienne ne paraît à l'opéra sans cette verge, et qu'on appelle ces rô.les des rô.les à baguette .
Aucun joueur de gobelets ne fait ses tours de passe-passe sans sa verge, sans sa baguette.
On trouve les sources d'eau, les trésors, au moyen d'une verge, d'une baguette de coudrier, qui ne manque pas de forcer un peu la main à un imbécile qui la serre trop; et qui tourne aisément dans celle d'un fripon. M. Formey, secrétaire de l'Académie de Berlin, explique ce phénomène par celui de l'aimant dans le grand Dictionnaire encyclopédique. Tous les sorciers du siècle passé croyaient aller au sabbat sur une verge magique, ou sur un manche à balai qui en tenait lieu; et les juges, qui n'étaient pas sorciers, les brûlaient.
Les verges de boulot sont une poignée de scions dont on frappe les malfaiteurs sur le dos. Il est honteux et abominable qu'on inflige un pareil châtiment sur les fesses à des jeunes garçons et à de jeunes filles. C'était autrefois le supplice des esclaves. J'ai vu dans des collèges, des barbares, qui faisaient dépouiller des enfants presque entièrement; une espèce de bourreau souvent ivre les déchirait avec de longues verges, qui mettaient en sang leurs aines et les faisaient enfler démesurément. D'autres les faisaient frapper avec douceur, et il en naissait un autre inconvénient. Les deux nerfs, qui vont du sphincter au pubis étant irrités, causaient des pollutions; c'est ce qui est arrivé souvent à de jeunes filles.
Par une police incompréhensible, les jésuites du Paraguai fouettaient les pères et les mères de famille sur les fesses nues. [48] Quand il n'y aurait eu que cette raison pour chasser les jésuites, elle aurait suffi.
VERITÉ. [p. 476]↩
‘Pilate lui dit alors, Vous êtes donc roi? Jésus lui répondit, Vous dites que je suis roi, c'est pour cela je suis né et que je suis venu au monde, afin de rendre témoignage à la vérité; tout homme qui est de vérité écoute ma voix.
‘Pilate lui dit, Qu'est-ce que vérité? et ayant dit cela il sortit, etc.' (Jean, chap. XVIII )
Il est triste pour le genre humain que Pilate sortit sans attendre la réponse; nous saurions ce que c'est que la vérité. Pilate était bien peu curieux. L'accusé amené devant lui dit qu'il est roi, qu'il est né pour être roi; et il ne s'informe pas comment cela peut être. Il est juge suprême au nom de César; il a la puissance du glaive; son devoir était d'approfondir le sens de ces paroles. Il devait dire, Apprenez-moi ce que vous entendez par être roi? comment êtes-vous né pour être roi et pour rendre témoignage à la vérité? on prétend qu'elle ne parvient que difficilement à l'oreille des rois. Moi qui suis juge, j'ai toujours eu une peine extrême à la découvrir. Instruisez-moi pendant que vos ennemis crient là-dehors contre vous; vous me rendrez le plus grand service qu'on ait jamais rendu à un juge; et j'aime bien mieux apprendre à connaître le vrai que de condescendre à la demande tumultueuse des Juifs qui veulent que je vous fasse pendre.
Nous n'oserons pas sans doute rechercher ce que l'auteur de toute vérité aurait pu dire à Pilate.
Aurait-il dit, la vérité est un mot abstrait que la plupart des hommes emploient indifféremment dans leurs livres et dans leurs jugements pour erreur et mensonge ? Cette définition aurait merveilleusement convenu à tous les faiseurs de systèmes. Ainsi le mot sagesse est pris souvent pour folie, et esprit pour sottise.
Humainement parlant, définissons la vérité en attendant mieux, ce qui est énoncé tel qu'il est .
Je suppose qu'on eût mis seulement six mois à enseigner à Pilate les vérités de la logique, il eût fait sans doute ce syllogisme concluant, On ne doit point ôter la vie à un homme qui n'a prêché qu'une bonne morale. Or celui qu'on m'a déféré, a de l'avis de ses ennemis mêmes prêché une morale excellente; donc, on ne doit point le punir de mort.
Il aurait pu encore tirer cet autre argument:
Mon devoir est de dissiper les attroupements d'un peuple séditieux qui demande la mort d'un homme, sans raison et sans forme juridique. Or, tels sont les Juifs dans cette occasion; donc je dois les renvoyer et rompre leur assemblée.
Nous supposons que Pilate savait l'arithmétique, ainsi nous ne parlerons pas de ces espèces de vérités.
Pour les vérités mathématiques, je crois qu'il aurait fallu trois ans pour le moins, avant qu'il pût être au fait de la géométrie transcendante. Les vérités de la physique combinées avec celles de la géométrie, auraient exigé plus de quatre ans. Nous en consumons six, d'ordinaire, à étudier la théologie; j'en demande douze pour Pilate, attendu qu'il était païen, et que six ans n'auraient pas été trop pour déraciner toutes ses vieilles erreurs, et six autres années pour le mettre en état de recevoir le bonnet de docteur.
Si Pilate avait eu une tête bien organisée, je n'aurais demandé que deux ans pour lui apprendre les vérités métaphysiques; et comme ces vérités sont nécessairement liées avec celles de la morale, je me flatte qu'en moins de neuf ans Pilate serait devenu un vrai savant et parfaitement honnête homme.
VÉRITÉS HISTORIQUES.
J'aurais dit ensuite à Pilate, Les vérités historiques ne sont que des probabilités. Si vous avez combattu à la bataille de Philippes, c'est pour vous une vérité que vous connaissez par intuition, par sentiment. Mais pour nous qui habitons tout auprès du désert de Syrie, ce n'est qu'une chose très probable, que nous connaissons par ouï-dire. Combien faut-il de ouï-dire pour former une persuasion égale à celle d'un homme, qui ayant vu la chose, peut se se vanter d'avoir une espèce de certitude?
Celui qui a entendu dire la chose à douze mille témoins oculaires, n'a que douze mille probabilités égales à une forte probabilité, laquelle n'est pas égale à la certitude.
Si vous ne tenez la chose que d'un seul des témoins, vous ne savez rien; vous devez douter. Si le témoin est mort, vous devez douter encore plus, car vous ne pouvez plus vous éclaircir. Si de plusieurs témoins morts; vous êtes dans le même cas.
Si de ceux à qui les témoins ont parlé; le doute doit encore augmenter.
De génération en génération le doute augmente, et la probabilité diminue; et bientôt la probabilité est réduite à zéro.
DES DEGRÉS DE VÉRITÉ SUIVANT LESQUELS ON JUGE LES ACCUSÉS.
On peut être traduit en justice ou pour des faits, ou pour des paroles.
Si pour des faits, il faut qu'ils soient aussi certains que le sera le supplice auquel vous condamnerez le coupable. Car si vous n'avez, par exemple, que vingt probabilités contre lui, ces vingt probabilités ne peuvent équivaloir à la certitude de sa mort. Si vous voulez avoir autant de probabilités qu'il vous en faut pour être sûr que vous ne répandez point le sang innocent, il faut qu'elles naissent de témoignages unanimes de déposants qui n'aient aucun intérêt à déposer. De ce concours de probabilités, il se formera une opinion très forte qui pourra servir à excuser votre jugement. Mais comme vous n'aurez jamais de certitude entière, vous ne pourrez vous flatter de connaître parfaitement la vérité. Par conséquent vous devez toujours pencher vers la clémence plus que vers la rigueur.
S'il ne s'agit que de faits dont il n'ait résulté ni mort d'homme, ni mutilation, il est évident que vous ne devez faire mourir ni mutiler l'accusé.
S'il n'est question que de paroles, il est encore plus évident que vous ne devez point faire pendre un de vos semblables pour la manière dont il a remué la langue; car toutes les paroles du monde n'étant que de l'air battu, à moins que ces paroles n'aient excité au meurtre, il est ridicule de condamner un homme à mourir pour avoir battu l'air. Mettez dans une balance toutes les paroles oiseuses qu'on ait jamais dites, et dans l'autre balance le sang d'un homme, ce sang l'emportera. Or celui qu'on a traduit devant vous n'étant accusé que de quelques paroles que ses ennemis ont prises en un certain sens, tout ce que vous pourriez faire serait aussi de lui dire des paroles qu'il prendra dans le sens qu'il voudra: mais livrer un innocent au plus cruel et au plus ignominieux supplice, pour des mots que ses ennemis ne comprennent pas, cela est trop barbare. Vous ne faites pas plus de cas de la vie d'un homme que de celle d'un lézard, et trop de juges vous ressemblent.
VERS ET POÉSIE. [p. 480]↩
Il est aisé d'être prosateur, très difficile et très rare d'être poète. Plus d'un prosateur a fait semblant de mépriser la poésie. Il faut leur rappeler souvent le mot de Montagne: Nous ne pouvons y atteindre, vengeons-nous par en médire .
Nous avons déjà remarqué que Montesquieu, n'ayant pu réussir en vers, s'avisa dans ses Lettres persanes de n'admettre nul mérite dans Virgile et dans Horace. L'éloquent Bossuet tenta de faire quelques vers et les fit détestables; mais il se garda bien de déclamer contre les grands poètes.
Fénelon ne fit guère de meilleurs vers que Bossuet; mais il savait par coeur presque toutes les belles poésies de l'antiquité; son esprit en est plein; il les cite souvent dans ses lettres.
Il me semble qu'il n'y a jamais eu d'homme véritablement éloquent qui n'ait aimé la poésie. Je n'en citerai pour exemples que César et Cicéron. L'un fit la tragédie d' OEdipe . Nous avons de l'autre des morceaux de poésie qui pourraient passer pour les meilleurs avant que Lucrèce, Virgile et Horace parussent.
Rien n'est plus aisé que de faire de mauvais vers en français; rien de plus difficile que d'en faire de bons. Trois choses rendent cette difficulté presque insurmontable: la gêne de la rime, le trop petit nombre de rimes nobles et heureuses; la privation de ces inversions dont le grec et le latin abondent. Aussi nous avons très peu de poètes qui soient toujours élégants et toujours corrects. Il n'y a peut-être en France que Racine et Boileau qui aient une élégance continue. Mais remarquez que les beaux morceaux de Corneille sont toujours bien écrits, à quelque chose près. On en peut dire autant des meilleures scènes en vers de Molière, des opéras de Quinault, des bonnes fables de la Fontaine. Ce sont là les seuls génies qui ont illustré la poésie en France dans le grand siècle. Presque tous les autres ont manqué de naturel, de variété, d'éloquence, d'élégance, de justesse, de cette logique secrète qui doit guider toutes les pensées sans jamais paraître; presque tous ont péché contre la langue.
Quelquefois au théâtre on est ébloui d'une tirade de vers pompeux, récités avec emphase. L'homme sans discernement applaudit, l'homme de goût condamne. Mais comment l'homme de goût fera-t-il comprendre à l'autre que les vers applaudis par lui ne valent rien? Si je ne me trompe, voici la méthode la plus sûre.
Dépouillez les vers de la cadence et de la rime, sans y rien changer d'ailleurs. Alors la faiblesse et la fausseté de la pensée, ou l'impropriété des termes, ou le solécisme, ou le barbarisme, ou l'ampoulé se manifeste dans toute sa turpitude.
Faites cette expérience sur tous les vers de la tragédie d' Iphigénie , ou d' Armide , et sur ceux de l' Art poétique ; vous n'y trouverez aucun de ces défauts, pas un mot vicieux, pas un mot hors de sa place. Vous verrez que l'auteur a toujours exprimé heureusement sa pensée et que la gêne de la rime n'a rien coûté au sens.
Prenez au hasard toute autre pièce de vers; par exemple, la tragédie de Didon qui me tombe actuellement sous la main. Voici le discours que tient Jarbe à la première scène.
Tous mes ambassadeurs irrités et confus
Trop souvent de ta reine ont subi les refus.
Voisin de ses Etats, faibles dans leur naissance,
Je croyais que Didon, redoutant ma vengeance,
Se résoudrait sans peine à l'hymen glorieux
D'un monarque puissant, fils du maître des dieux.
Je contiens cependant la fureur qui m'anime;
Et déguisant encor mon dépit légitime,
Pour la dernière fois en proie à ses hauteurs,
Je viens, sous le faux nom de mes ambassadeurs,
Au milieu de la cour d'une reine étrangère
D'un refus obstiné pénétrer le mystère:
Que sais-je! . . . n'écouter qu'un transport amoureux,
Me découvrir moi-même, et déclarer mes feux.
Otez la rime, et vous serez révolté de voir subir des refus ; parce qu'on essuie un refus, et qu'on subit une peine. Subir un refus est un barbarisme.
Je croyais que Didon, redoutant ma vengeance, se résoudrait sans peine . Si elle ne se résolvait que par la crainte de la vengeance, il est bien clair qu'alors elle ne se résoudrait pas sans peine, mais avec beaucoup de peine et de douleur. Elle se résoudrait malgré elle; elle prendrait un parti forcé. Jarbe, en parlant ainsi, fait un contresens.
Il dit qu'il est en proie aux hauteurs de la reine . On peut s'exposer à des hauteurs, comme on l'est à la colère, à la vengeance, à la cruauté. Pourquoi? c'est que la cruauté, la vengeance, la colère, poursuivent en effet l'objet de leur ressentiment; et cet objet est regardé comme leur proie. Mais des hauteurs ne poursuivent personne; les hauteurs n'ont point de proie.
Il vient sous le faux nom de ses ambassadeurs. Tous ses ambassadeurs ont subi des refus . Il est impossible qu'il vienne sous le nom de tant d'ambassadeurs à la fois. Un homme ne peut porter qu'un nom; et s'il prend le nom d'un ambassadeur, il ne peut prendre le faux nom de cet ambassadeur, il prend le véritable nom de ce ministre. Jarbe dit donc tout le contraire de ce qu'il veut dire, et ce qu'il dit ne forme aucun sens.
Il veut pénétrer le mystère d'un refus . Mais s'il a été refusé avec tant de hauteur, il n'y a nul mystère à ce refus. Il veut dire qu'il cherche à en pénétrer les raisons. Mais il y a grande différence entre raison et mystère. Sans le mot propre, on n'exprime jamais bien ce qu'on pense.
Que sais-je! . . . n'écouter qu'un transport amoureux, me découvrir moi-même, et déclarer mes feux .
Ces mots, Que sais-je! font attendre que Jarbe va se livrer à la fureur de sa passion. Point du tout: il dit qu'il parlera d'amour à sa maîtresse; ce qui n'est assurément ni extraordinaire, ni dangereux, ni tragique, et ce qu'il devrait avoir déjà fait. Observez encore que s'il se découvre, il faut bien qu'il se découvre lui-même: ce lui-même est un pléonasme.
Ce n'est pas ainsi que, dans l' Andromaque , Racine fait parler Oreste qui se trouve à peu près dans la même situation. Il dit,
Je me livre en aveugle au transport qui m'entraîne.
J'aime, je viens chercher Hermione en ces lieux,
La fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux.
Voilà comme devait s'exprimer un caractère fougueux et passionné tel qu'on peint Jarbe.
Que de fautes dans ce peu de vers dès la première scène! presque chaque mot est un défaut. Et si on voulait examiner ainsi tous nos ouvrages dramatiques, y en a-t-il un seul qui pût tenir contre un critique sévère?
L' Inès de La Motte est certainement une pièce touchante; on ne peut voir le dernier acte sans verser des larmes. L'auteur avait infiniment d'esprit, il l'avait juste, éclairé, délicat et fécond; mais dès le commencement de la pièce, quelle versification faible, languissante, décousue, obscure, et quelle impropriété de termes!
Mon fils ne me suit point: il a craint, je le vois,
D'être ici le témoin du bruit de ses exploits.
Vous, Rodrigue, le sang vous attache à sa gloire;
Votre valeur, Henrique, eut part à sa victoire.
Ressentez avec moi sa nouvelle grandeur.
Reine, de Ferdinand voici l'ambassadeur.
D'abord, on ne sait quel est le personnage qui parle, ni à qui il s'adresse, ni dans quel lieu il est, ni de quelle victoire il s'agit. Et c'est pécher contre la grande règle de Boileau et du bon sens.
Le sujet ne peut être assez tôt expliqué:
Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué:
Que dès les premiers vers l'action préparée
Sans peine du sujet aplanisse l'entrée.
Ensuite, remarquez qu'on n'est point témoin d'un bruit d'exploits. Cette expression est vicieuse. L'auteur entend que peut-être ce fils trop modeste craint de jouir de sa renommée; qu'il veut se dérober aux honneurs qu'on s'empresse à lui rendre. Ces expressions seraient plus justes et plus nobles. Il s'agit d'une ambassade envoyée pour féliciter le prince. Ce n'est pas là un bruit d'exploits.
Vous, Rodrigue. -- Vous, Henrique . Il semble que le roi aille donner ses ordres à ce Rodrigue et à ce Henrique: point du tout; il ne leur ordonne rien, il ne leur apprend rien. Il s'interrompt pour leur dire seulement, ressentez avec moi la nouvelle grandeur de mon fils . On ne ressent point une grandeur. Ce terme est absolument impropre: c'est une espèce de barbarisme. L'auteur aurait pu dire: Partagez son triomphe, ainsi que son bonheur .
Le roi s'interrompt encore pour dire: Reine, de Ferdinand voici l'ambassadeur , sans apprendre au public quel est ce Ferdinand et de quel pays cet ambassadeur est venu. Aussitôt l'ambassadeur arrive. On apprend qu'il vient de Castille; que le personnage qui vient de parler est roi de Portugal, et qu'il vient le complimenter sur les victoires de l'infant son fils. Le roi de Portugal répond au compliment de cet ambassadeur de Castille, qu'il va enfin marier son fils à la soeur de Ferdinand roi de Castille.
Allez; de mes desseins instruisez la Castille;
Faites savoir au roi cet hymen triomphant
Dont je vais couronner les exploits de l'infant.
Faire savoir un hymen est sec et sans élégance. Un hymen triomphant est très impropre et très vicieux, parce que cet hymen ne triomphe pas.
Couronner les exploits d'un hymen est trop trivial et n'est point à sa place; parce que ce mariage était conclu avant les triomphes de l'infant. Une plus grande faute est celle de dire sèchement à l'ambassadeur, allez-vous-en , comme si on parlait à un courrier. C'est manquer à la bienséance. Quand Pyrrhus donne audience à Oreste dans l' Andromaque , et lorsqu'il refuse ses propositions, il lui dit:
Vous pouvez cependant voir la fille d'Hélène.
Du sang qui vous unit je sais l'étroite chaîne.
Après cela, Seigneur, je ne vous retiens plus.
Toutes les bienséances sont observées dans le discours de Pyrrhus; c'est une règle qu'il ne faut jamais violer.
Quand l'ambassadeur a été congédié, le roi de Portugal dit à sa femme:
--- Mon fils est enfin digne que la princesse
Lui donne avec sa main l'estime et la tendresse.
Voilà un solécisme intolérable, ou plutôt un barbarisme. On ne donne point l'estime et la tendresse comme on donne le bonjour. Le pronom était absolument nécessaire; les esprits les plus grossiers sentent cette nécessité. Jamais le bourgeois le plus mal élevé n'a dit à sa maîtresse, Accordez-moi l'estime, mais votre estime. La raison en est que tous nos sentiments nous appartiennent. Vous excitez ma colère, et non pas la colère; mon indignation, et non pas l'indignation, à moins qu'on n'entende l'indignation, la colère du public. On dit, Vous avez l'estime et l'amour du peuple; vous avez mon amour et mon estime. Le vers de La Motte n'est pas français; et rien n'est peut-être plus rare que de parler français dans notre poésie.
Mais, me dira-t-on, malgré cette mauvaise versification, Inès réussit; oui, elle réussirait cent fois davantage, si elle était bien écrite. Elle serait au rang des pièces de Racine, dont le style est sans contredit le principal mérite.
Il n'y a de vraie réputation que celle qui est formée à la longue par le suffrage unanime des connaisseurs sévères. Je ne parle ici que d'après eux; je ne critique aucun mot, aucune phrase, sans en rendre une raison évidente. Je me garde bien d'en user comme ces regrattiers insolents de la littérature, ces faiseurs d'observations à tant la feuille, qui usurpent le nom de journalistes; qui croient flatter la malignité du public en disant: Cela est ridicule, cela est pitoyable, sans rien discuter, sans rien prouver. Ils débitent pour toute raison des injures, des sarcasmes, des calomnies. Ils tiennent bureau ouvert de médisance, au lieu d'ouvrir une école où l'on puisse s'instruire.
Celui qui dit librement son avis, sans outrage et sans raillerie amère; qui raisonne avec son lecteur; qui cherche sérieusement à épurer la langue et le goût, mérite au moins l'indulgence de ses concitoyens. Il y a plus de soixante ans que j'étudie l'art des vers, et peut-être suis-je en droit de dire mon sentiment. Je dis donc qu'un vers, pour être bon, doit être semblable à l'or, en avoir le poids, le titre, et le son. Le poids, c'est la pensée; le titre, c'est la pureté élégante du style; le son, c'est l'harmonie. Si l'une de ces trois qualités manque, le vers ne vaut rien.
J'avance hardiment, sans crainte d'être démenti par quiconque a du goût, qu'il y a plusieurs pièces de Corneille où l'on ne trouvera pas six vers irrépréhensibles de suite. Je mets de ce nombre Théodore, Don Sanche, Attila, Bérénice, Agésilas , et je pourrais augmenter beaucoup cette liste. Je ne parle pas ainsi pour dépriser le mâle et puissant génie de Corneille; mais pour faire voir combien la versification française est difficile, et plutôt pour excuser ceux qui l'ont imité dans ses défauts que pour les condamner. Si vous lisez le Cid , les Horaces, Cinna, Pompée, Polyeucte avec le même esprit de critique, vous y trouverez souvent douze vers de suite, je ne dis pas seulement bien faits, mais admirables.
Tous les gens de lettres savent que lorsqu'on apporta au sévère Boileau la tragédie de Rhadamiste , il n'en put achever la lecture, et qu'il jeta le livre à la moitié du second acte. Les Pradons , dit-il, dont nous nous sommes tant moqués, étaient des soleils en comparaison de ces gens-ci . L'abbé Fraguier et l'abbé Gédouin étaient présents avec Le Verrier qui lisait la pièce. Je les entendis plus d'une fois raconter cette anecdote; et Racine le fils en fait mention dans la Vie de son père. L'abbé Gédouin nous disait que ce qui les avait d'abord révoltés tous était l'obscurité de l'exposition faite en mauvais vers. En effet, disait-il, nous ne pûmes jamais comprendre ces vers de Zénobie:
A peine je touchais à mon troisième lustre,
Lorsque tout fut conclu pour cet hymen illustre.
Rhadamiste déjà sen croyait assuré;
Quand son père cruel contre nous conjuré
Entra dans nos Etats suivi de Tyridate,
Qui brûlait de s'unir au sang de Mithridate.
Et ce Parthe indigné qu'on lui ravît ma foi,
Sema partout l'horreur, le désordre et l'effroi.
Mithridate accablé par son perfide frère,
Fit tomber sur le fils les cruautés du père.
Nous sentîmes tous, dit l'abbé Gédouin, que l' hymen illustre n'était que pour rimer à troisième lustre: Que le père cruel contre nous conjuré, et entrant dans nos Etats suivi de Tyridate, qui brûlait de s'unir au sang de Mithridate , était inintelligible à des auditeurs qui ne savaient encore ni qui était ce Tyridate, ni qui était ce Mithridate; Que ce Parthe, semant partout l'horreur, le désordre et l'effroi , sont des expressions vagues rebattues qui n'apprennent rien de positif: Que les cruautés du père, tombant sur le fils , sont une équivoque; qu'on ne sait si c'est le père qui poursuit le fils, ou si c'est ce Parthe qui se venge sur le fils des cruautés du père.
Le reste de l'exposition n'est guère plus clair. Ce défaut devait choquer étrangement Boileau et ses élèves, Boileau surtout qui avait dit dans sa Poétique:
Je me ris d'un auteur qui, lent à s'exprimer,
De ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer.
Et qui débrouillant mal une pénible intrigue,
D'un divertissement me fait une fatigue.
L'abbé Gédouin ajoutait que Boileau avait arraché la pièce des mains de Le Verrier, et l'avait jetée par terre à ces vers:
Eh! que sais-je, Hiéron? furieux, incertain,
Criminel sans penchant, vertueux sans dessein,
Jouet infortuné de ma douleur extrême,
Dans l'état où je suis me connais-je moi-même?
De mille soins divers sans cesse combattu,
Ennemi du forfait, sans aimer la vertu, etc.
Ces antithèses en effet ne forment qu'un contresens inintelligible. Que signifie criminel sans penchant ? Il fallait au moins dire, sans penchant au crime. Il fallait jouter contre ces beaux vers de Quinault.
Le destin de Médée est d'être criminelle;
Mais son coeur était fait pour aimer la vertu.
Vertueux sans dessein , sans quel dessein? Est-ce sans dessein d'être vertueux? Il est impossible de tirer de ces vers un sens raisonnable.
Comment le même homme, qui vient de dire qu'il est vertueux quoique sans dessein, peut-il dire qu'il n'aime point la vertu? Avouons que tout cela est un étrange galimatias, et que Boileau avait raison.
Par un don de César je suis roi d'Arménie,
Parce qu'il croit par moi détruire l'Ibérie.
Boileau avait dit:
‘Fuyez des mauvais sons le concours odieux.'
Certes, ce vers: Parce qu'il croit par moi , devait révolter son oreille.
Le dégoût et l'impatience de ce grand critique étaient donc très excusables. Mais s'il avait entendu le reste de la pièce il y aurait trouvé des beautés, de l'intérêt, du pathétique, du neuf et plusieurs vers dignes de Corneille.
Il est vrai que dans un ouvrage de longue haleine on doit pardonner à quelques vers mal faits, à quelques fautes contre la langue; mais en général un style pur et châtié est absolument nécessaire. Ne nous lassons point de citer l' Art poétique ; il est le code, non seulement des poètes, mais même des prosateurs.
Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme,
Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.
Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin
Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.
On peut être sans doute très ennuyeux en écrivant bien; mais on l'est bien davantage en écrivant mal.
N'oublions pas de dire qu'un style froid, languissant, décousu, sans grâces et sans force, dépourvu de génie et de variété est encore pire que mille solécismes. Voilà pourquoi sur cent poètes il s'en trouve à peine un qu'on puisse lire. Songez à toutes les pièces de vers dont nos Mercures sont surchargés depuis cent ans, et voyez si de dix mille il y en a deux dont on se souvienne. Nous avons environ quatre mille pièces de théâtre: combien peu sont échappées à un éternel oubli!
Est-il possible qu'après les vers de Racine, des barbares aient osé forger des vers tels que ceux-ci!
Le lac, où vous avez cent barques toutes prêtes,
Lavant le pied des murs du palais où vous êtes,
Vous peut faire aisément regagner Tetsuco;
Ses ports nous sont ouverts d'ailleurs à Tabasco.
Vous le savez, seigneur; l'ardeur était nouvelle,
Et d'un premier butin l'espérance était belle. . .
Ne les bravons donc point, risquons moins, et que Charle
En maître désormais se présente et lui parle. --
Ce prêtre d'un grand deuil menace Tlascala,
Est-ce assez? Sa fureur n'en demeure pas là.
Nous saurons les serrer. Mais dans un temps plus calme
Le myrte ne se doit cueillir qu'après la palme.
Il apprit que le trône est l'autel éminent
D'où part du roi des rois l'oracle dominant.
Que le sceptre est la verge, etc.
Est-ce sur le théâtre d' Iphigénie et de Phèdre , est-ce chez les Hurons, chez les Illinois qu'on a fait ronfler ces vers et qu'on les a imprimés?
Il y a quelquefois des vers qui paraissent d'abord moins ridicules, mais qui le sont encore plus, pour peu qu'ils soient examinés par un sage critique.
CATILINA.
Quoi! Madame, aux autels vous devancez l'aurore!
Eh! quel soin si pressant vous y conduit encore?
Qu'il m'est doux cependant de revoir vos beaux yeux
Et de pouvoir ici rassembler tous mes dieux!
TULLIE.
Si ce sont là les dieux à qui tu sacrifies,
Apprends qu'ils ont toujours abhorré les impies,
Et que si leur pouvoir égalait leur courroux,
La foudre deviendrait le moindre de nos coups.
CATILINA.
Tullie, expliquez-moi ce que je viens d'entendre.
Il a bien raison de demander à Tullie l'explication de tout ce galimatias.
Une femme qui devance l'aurore aux autels ,
Et qu'un soin pressant y conduit encore .
Ses beaux yeux qui s'y rassemblent avec tous les dieux ,
Ces beaux yeux qui abhorrent les impies ,
Ces yeux dont la foudre deviendrait le moindre coup ,
Si leur pouvoir égalait le courroux de ces yeux , etc.
De telles tirades (et qui sont en très grand nombre) sont encore pires que le lac qui peut faire aisément regagner Tetsuco, et dont les ports sont ouverts d'ailleurs à Tabasco. Et que pouvons-nous dire d'un siècle qui a vu représenter des tragédies écrites tout entières dans ce style barbare?
Je le répète; je mets ces exemples sous les yeux pour faire voir aux jeunes gens dans quels excès incroyables on peut tomber quand on se livre à la fureur de rimer sans demander conseil. Je dois exhorter les artistes à se nourrir du style de Racine et de Boileau, pour empêcher le siècle de tomber dans la plus ignominieuse barbarie.
On dira, si l'on veut, que je suis jaloux des beaux yeux rassemblés avec les dieux, et dont la foudre est le moindre coup. Je répondrai que j'ai les mauvais vers en horreur, et que je suis en droit de le dire.
Un abbé Trublet a imprimé qu'il ne pouvait lire un poème tout de suite. Eh! M. l'abbé, que peut-on lire, que peut-on entendre, que peut-on faire longtemps et tout de suite?
VERTU. [p. 491]↩
On dit de Marcus Brutus, qu'avant de se tuer il prononça ces paroles, O vertu! j'ai cru que tu étais quelque chose! mais tu n'es qu'un vain fantôme!
Tu avais raison, Brutus, si tu mettais la vertu à être chef de parti et l'assassin de ton bienfaiteur, de ton père Jules-César; mais si tu avais fait consister la vertu à ne faire que du bien à ceux qui dépendaient de toi, tu ne l'aurais pas appelée fantôme , et tu ne te serais pas tué de désespoir.
Je suis très vertueux, dit cet excrément de théologie, car j'ai les quatre vertus cardinales, et les trois théologales. Un honnête homme lui demande, Qu'est-ce que vertu cardinale? l'autre répond, C'est force, prudence, tempérance et justice.
L'HONNÊTE HOMME.
Si tu es juste, tu as tout dit; ta force, ta prudence, ta tempérance sont des qualités utiles. Si tu les as, tant mieux pour toi; mais si tu es juste, tant mieux pour les autres. Ce n'est pas encore assez d'être juste, il faut être bienfaisant; voilà ce qui est véritablement cardinal. Et tes théologales, qui sont-elles?
L'EXCRÉMENT.
Foi, espérance, charité.
L'HONNÊTE HOMME.
Est-ce vertu de croire? ou ce que tu crois te semble vrai, et en ce cas il n'y a nul mérite à le croire; ou il te semble faux, et alors il est impossible que tu le croies.
L'espérance ne saurait être plus vertu que la crainte; on craint et on espère selon qu'on nous promet ou qu'on nous menace. Pour la charité, n'est-ce pas ce que les Grecs et les Romains entendaient par humanité, amour du prochain? cet amour n'est rien s'il n'est agissant; la bienfaisance est donc la seule vraie vertu.
L'EXCRÉMENT.
Quelque sot! vraiment oui, j'irai me donner bien du tourment pour servir les hommes, et il ne m'en reviendrait rien! chaque peine mérite salaire. Je ne prétends pas faire la moindre action honnête, à moins que je ne sois sûr du paradis.
Quis enim virtutem amplectitur ipsam
Praemia si tollas ?
Qui pourra suivre la vertu
Si vous ôtez la récompense?
L'HONNÊTE HOMME.
Ah! maître, c'est-à-dire que si vous n'espériez pas le paradis, et si vous ne redoutiez pas l'enfer, vous ne feriez jamais aucune bonne oeuvre. Vous me citez des vers de Juvénal pour me prouver que vous n'avez que votre intérêt en vue. En voici de Racine qui pourront vous faire voir au moins qu'on peut trouver dès ce monde sa récompense en attendant mieux.
Quel plaisir de penser et de dire en vous-même,
Partout en ce moment on me bénit, on m'aime!
On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer;
Le ciel dans leurs chagrins ne m'entend point nommer.
Leur sombre inimitié ne fait point mon visage,
Je vois voler partout les coeurs à mon passage.
Tels étaient vos plaisirs.
Croyez-moi, maître, il y a deux choses qui méritent d'être aimées pour elles-mêmes, Dieu, et la vertu.
L'EXCRÉMENT.
Ah! monsieur, vous êtes féneloniste.
L'HONNÊTE HOMME.
Oui, maître.
L'EXCRÉMENT.
J'irai vous dénoncer à l'official de Meaux.
L'HONNÊTE HOMME.
Va, dénonce.
VIANDE, VIANDE DÉFENDUE, VIANDE DANGEREUSE. [p. 493]↩
COURT EXAMEN DES PRÉCEPTES JUIFS ET CHRÊTIENS ET DE CEUX DES ANCIENS PHILOSOPHES.
Viande, vient sans doute de victus ; ce qui nourrit, ce qui soutient la vie: de victus on fit viventia ; de viventia viande. Ce mot devrait s'appliquer à tout ce qui se mange; mais par la bizarrerie de toutes les langues, l'usage a prévalu de refuser cette dénomination au pain, au laitage, au riz, aux légumes, aux fruits, au poisson; et de ne le donner qu'aux animaux terrestres. Cela semble contre toute raison, mais c'est l'apanage de toutes les langues et de ceux qui les ont faites.
Quelques premiers chrétiens se firent un scrupule de manger de ce qui avait été offert aux dieux, de quelque nature qu'il fût. St Paul n'approuva pas ce scrupule. Il écrit aux Corinthiens (chap. VIII), ce qu'on mange n'est pas ce qui nous rend agréables à Dieu. Si nous mangeons, nous n'aurons rien de plus devant lui, ni rien de moins, si nous ne mangeons pas . Il exhorte seulement à ne point se nourrir de viandes immolées aux dieux devant ceux des frères qui pourraient en être scandalisés. On ne voit pas après cela pourquoi il traite si mal St Pierre, et le reprend d'avoir mangé des viandes défendues avec les gentils. On voit d'ailleurs dans les Actes des apôtres que Simon-Pierre était autorisé à manger de tout indifféremment. Car il vit un jour le ciel ouvert et une grande nappe descendant par les quatre coins du ciel en terre; elle était couverte de toutes sortes d'animaux terrestres à quatre pieds, de toutes les espèces d'oiseaux et de reptiles (ou animaux qui nagent); et une voix lui cria, Tue et mange. (Actes. ch. X)
Vous remarquerez qu'alors le carême et les jours de jeûnes n'étaient point institués. Rien ne s'est jamais fait que par degrés. Nous pouvons dire ici pour la consolation des faibles que la querelle de St Pierre et de St Paul ne doit point nous effrayer. Les saints sont hommes. Paul avait commencé par être le geôlier et même le bourreau des disciples de Jésus. Pierre avait renié Jésus, et nous avons vu que l'Eglise naissante, souffrante, militante, triomphante a toujours été divisée depuis les ébionites jusqu'aux jésuites.
Je pense bien que les brachmanes, si antérieurs aux Juifs, pourraient bien avoir été divisés aussi; mais enfin ils furent les premiers qui s'imposèrent la loi de ne manger d'aucun animal. Comme ils croyaient que les âmes passaient et repassaient des corps humains dans ceux des bêtes, ils ne voulaient point manger leurs parents. Peut-être leur meilleure raison était la crainte d'accoutumer les hommes au carnage et de leur inspirer des moeurs féroces.
On sait que Pythagore, qui étudia chez eux la géométrie et la morale, embrassa cette doctrine humaine et la porta en Italie. Ses disciples la suivirent très longtemps: les célèbres philosophes Plotin, Jamblique et Porphire la recommandèrent et même la pratiquèrent, quoiqu'il soit assez rare de faire ce qu'on prêche. L'ouvrage de Porphire sur l'abstinence des viandes écrit au milieu de notre troisième siècle, très bien traduit en notre langue par M. de Burigni, est fort estimé des savants; mais il n'a pas fait plus de disciples parmi nous que le livre du médecin Héquet. C'est en vain que Porphire propose pour modèles les brachmanes et les mages persans de la première classe, qui avaient en horreur la coutume d'engloutir dans nos entrailles les entrailles des autres créatures, il n'est suivi aujourd'hui que par les pères de la Trappe. L'écrit de Porphire est adressé à un de ses anciens disciples nommé Firmus, qui se fit, dit-on, chrétien pour avoir la liberté de manger de la viande et de boire du vin.
Il remontre à Firmus qu'en s'abstenant de la viande et des liqueurs fortes, on conserve la santé de l'âme et du corps; qu'on vit plus longtemps et avec plus d'innocence. Toutes ses réfléxions sont d'un théologien scrupuleux, d'un philosophe rigide et d'une âme douce et sensible. On croirait, en le lisant, que ce grand ennemi de l'Eglise est un Père de l'Eglise.
Il ne parle point de métempsycose; mais il regarde les animaux comme nos frères; parce qu'ils sont animés comme nous, qu'ils ont les mêmes principes de vie, qu'ils ont ainsi que nous des idées, du sentiment, de la mémoire, de l'industrie. Il ne leur manque que la parole: s'ils l'avaient, oserions-nous les tuer et les manger? Oserions-nous commettre ces fratricides? Quel est le barbare qui pourrait faire rôtir un agneau, si cet agneau nous conjurait par un discours attendrissant de n'être point à la fois assassin et anthropophage?
Ce livre prouve du moins qu'il y eut chez les gentils des philosophes de la plus austère vertu; mais ils ne purent prévaloir contre les bouchers et les gourmands.
Il est à remarquer que Porphire fait un très bel éloge des esséniens. Il est rempli de vénération pour eux, quoiqu'ils mangeassent quelquefois de la viande. C'était alors à qui serait le plus vertueux des esséniens, des pythagoriciens, des stoïciens et des chrétiens. Quand les sectes ne forment qu'un petit troupeau, leurs moeurs sont pures: elles dégénèrent dès qu'elles deviennent puissantes.
La gola, il ludo e l'otrose piume
Hanno dal' mondo ogni virtu sbandita .
VIE. [p. 495]↩
On trouve ces paroles dans le Système de la nature , pag. 84, édition de Londres. Il faudrait définir la vie avant de raisonner de l'âme; mais c'est ce que j'estime impossible .
C'est ce que j'ose estimer très possible. La vie est organisation avec capacité de sentir. Ainsi on dit que tous les animaux sont en vie. On ne le dit des plantes que par extension, par une espèce de métaphore ou de catacthrèse. Elles sont organisées; elles végètent; mais n'étant point capables de sentiment, elles n'ont point proprement la vie.
On peut être en vie sans avoir un sentiment actuel; car on ne sent rien dans une apoplexie complète, dans une léthargie, dans un sommeil plein et sans rêves, mais on a encore le pouvoir de sentir. Plusieurs personnes, comme on ne le sait que trop, ont été enterrées vives comme des vestales, et c'est ce qui arrive dans tous les champs de bataille, surtout dans les pays froids; un soldat est sans mouvement et sans haleine; s'il était secouru, il les reprendrait; mais pour avoir plus tôt fait, on l'enterre.
Qu'est-ce que cette capacité de sensation? autrefois vie et âme c'était même chose, et l'une n'est pas plus connue que l'autre; le fond en est-il mieux connu aujourd'hui?
Dans les livres sacrés juifs, âme est toujours employée pour vie.
Genèse ch. XX. Dixit etiam Deus producant aquae reptile animae viventis . Et Dieu dit, que les eaux produisent des reptiles d'âme vivante.
Creavit Deus cete grandia et omnem animam viventem, atque motabilem quam produxerant aquae .
Il créa aussi de grands dragons (tannitim) tout animal ayant vie et mouvement que les eaux avaient produit.
Il est difficile d'expliquer comment Dieu créa ces dragons produits déjà par les eaux; mais la chose est ainsi, et c'est à nous de nous soumettre.
Ch. XXIV. Producat terra animam viventem in genere suo jumenta et reptilia .
Que la terre produise âme vivante en son genre des behemoths et des reptiles.
Ch. II, v. 7. Et in quibus est anima vivens, ad vescendum .
Et à toute âme vivante pour se nourrir.
Et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitae; et factus est homo in animam viventem .
Ch. XXX. Et il souffla dans ses narines souffle de vie; et l'homme eut souffle de vie (selon l'hebreu).
Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum, et de manu hominis etc .
Je redemanderai vos âmes aux mains des bêtes et des hommes. Ames signifie ici vies évidemment. Le texte sacré ne peut entendre que les bêtes auront avalé l'âme des hommes, mais leur sang qui est leur vie. Quant aux mains que ce texte donne aux bêtes, il entend leurs griffes.
En un mot, il y a plus de deux cents passages où l'âme est prise pour la vie des bêtes ou des hommes; mais il n'en est aucun qui vous dise ce que c'est que la vie et l'âme.
Si c'est la faculté de la sensation, d'où vient cette faculté? à cette question tous les docteurs répondent par des systèmes, et ces systèmes sont détruits les uns par les autres. Mais pourquoi voulez-vous savoir d'où vient la sensation? Il est aussi difficile de concevoir la cause qui fait tendre tous les corps à leur commun centre, que de concevoir la cause qui rend l'animal sensible. La direction de l'aimant vers le pôle arctique, les routes des comètes, mille autres phénomènes sont aussi incompréhensibles.
Il y a des propriétés évidentes de la matière, dont le principe ne sera jamais connu de nous. Celui de la sensation, sans laquelle il n'y a point de vie, est et sera ignoré comme tant d'autres.
Peut-on vivre sans éprouver des sensations? non; supposez un enfant qui meurt après avoir été toujours en léthargie; il a existé, mais il n'a point vécu.
Mais supposez un imbécile qui n'ait jamais eu d'idées complexes et qui ait eu du sentiment; certainement il a vécu sans penser; il n'a eu que les idées simples de ses sensations.
La pensée est-elle nécessaire à la vie? non, puisque cet imbécile n'a point pensé et a vécu.
De là, quelques penseurs pensent que la pensée n'est point l'essence de l'homme; ils disent qu'il y a beaucoup d'idiots non pensants qui sont hommes, et si bien hommes qu'ils font des hommes sans pouvoir jamais faire un raisonnement.
Les docteurs qui croient penser, répondent que ces idiots ont des idées fournies par leurs sensations.
Les hardis penseurs leur répliquent, qu'un chien de chasse qui a bien appris son métier, a des idées beaucoup plus suivies, et qu'il est fort supérieur à ces idiots. De là naît une grande dispute sur l'âme. Nous n'en parlerons pas; nous n'en avons que trop parlé à l'article Ame .
VISION. [p. 498]↩
Quand je parle de vision, je n'entends pas la manière admirable dont nos yeux aperçoivent les objets, et dont les tableaux de tout ce que nous voyons se peignent dans la rétine: peinture divine dessinée suivant toutes les lois des mathématiques, et qui par conséquent est, ainsi que tout le reste, de la main de l'éternel Géomètre, en dépit de ceux qui font les entendus, et qui feignent de croire que l'oeil n'est pas destiné à voir, l'oreille à entendre et le pied à marcher. Cette matière a été traitée si savamment par tant de grands génies, qu'il n'y a plus de grains à ramasser après leurs moissons.
Je ne prétends point parler de l'hérésie dont fut accusé le pape Jean XXII, qui prétendait que les saints ne jouiraient de la vision béatifique qu'après le jugement dernier. Je laisse là cette vision.
Mon objet est cette multitude innombrable de visions, dont tant de saints personnages ont été favorisés ou tourmentés; que tant d'imbéciles ont cru avoir; et avec lesquelles tant de fripons et de friponnes ont attrapé le monde, soit pour se faire une réputation de béats, de béates, ce qui est très flatteur; soit pour gagner de l'argent, ce qui est encore plus flatteur pour tous les charlatans.
Calmet et Langlet ont fait d'amples recueils de ces visions. La plus intéressante à mon gré, celle qui a produit les plus grands effets, puisqu'elle a servi à la réforme des trois quarts de la Suisse, est celle de ce jeune jacobin Yetzer, dont j'ai déjà entretenu mon cher lecteur. Cet Yetzer vit, comme vous savez, plusieurs fois la Ste Vierge et Ste Barbe, qui lui imprimèrent les stigmates de Jésus-Christ. Vous n'ignorez pas comment il reçut d'un prieur jacobin une hostie saupoudrée d'arsenic, et comment l'évêque de Lausanne voulut le faire brûler pour s'être plaint d'avoir été empoisonné. Vous avez vu que ces abominations furent une des causes du malheur qu'eurent les Bernois de cesser d'être catholiques, apostoliques et romains.
Je suis fâché de n'avoir point à vous parler de visions de cette force.
Cependant vous m'avouerez que la vision des révérends pères cordeliers d'Orléans en 1534, est celle qui en approche le plus, quoique de fort loin. Le procès criminel qu'elle occasionna est encore en manuscrit dans la bibliothèque du roi de France, numéro 1770.
L'illustre maison de Saint-Mémin avait fait de grands biens au couvent des cordeliers, et avait sa sépulture dans leur église. La femme d'un seigneur de Saint-Mémin prévôt d'Orléans étant morte, son mari croyant que ses ancêtres s'étaient assez appauvris en donnant aux moines, fit un présent à ces frères qui ne leur parut pas assez considérable. Ces bons franciscains s'avisèrent de vouloir déterrer la défunte, pour forcer le veuf à faire réenterrer sa femme en leur terre sainte en les payant mieux. Le projet n'était pas sensé; car le seigneur de Saint-Mémin n'aurait pas manqué de la faire inhumer ailleurs. Mais il entre souvent de la folie dans la friponnerie.
D'abord l'âme de la dame de Saint-Mémin n'apparut qu'à deux frères. Elle leur dit: [49] Je suis damnée comme Judas, parce que mon mari n'a pas donné assez . Les deux petits coquins, qui rapportèrent ces paroles, ne s'aperçurent pas qu'elles devaient nuire au couvent plutôt que lui profiter. Le but du couvent était d'extorquer de l'argent du seigneur de Saint-Mémin pour le repos de l'âme de sa femme. Or si madame de Saint-Mémin était damnée, tout l'argent du monde ne pouvait la sauver: on n'avait rien à donner; les cordeliers perdaient leur rétribution.
Il y avait dans ce temps-là très peu de bon sens en France. La nation avait été abrutie par l'invasion des Francs, et ensuite par l'invasion de la théologie scolastique. Mais il se trouva dans Orléans quelques personnes qui raisonnèrent. Elles se doutèrent que si le Grand Etre avait permis que l'âme de madame de Saint-Mémin apparût à deux franciscains, il n'était pas naturel que cette âme se fût déclarée damnée comme Judas . Cette comparaison leur parut hors d'oeuvre. Cette dame n'avait point vendu notre Seigneur Jésus-Christ trente deniers; elle ne s'était point pendue; ses intestins ne lui étaient point sortis du ventre; il n'y avait aucun prétexte pour la comparer à Judas.
Cela donna du soupçon; et la rumeur fut d'autant plus grande dans Orléans, qu'il y avait déjà des hérétiques qui ne croyaient pas à certaines visions, et qui en admettant des principes absurdes, ne laissaient pas pourtant d'en tirer d'assez bonnes conclusions. Les cordeliers changèrent donc de batterie, et mirent la dame en purgatoire.
Elle apparut donc encore, et déclara que le purgatoire était son partage: mais elle demanda d'être déterrée. Ce n'était pas l'usage qu'on exhumât les purgatoriés; mais on espérait que M. de Saint-Mémin préviendrait cet affront extraordinaire en donnant quelque argent. Cette demande d'être jetée hors de l'église augmenta les soupçons. On savait bien que les âmes apparaissaient souvent; mais elles ne demandent point qu'on les déterre.
L'âme, depuis ce temps ne parla plus, mais elle lutina tout le monde dans le couvent et dans l'église. Les frères cordeliers l'exorcisèrent. Frère Pierre d'Arras s'y prit pour la conjurer d'une manière qui n'était pas adroite. Il lui disait, Si tu es l'âme de feue madame de Saint-Mémin, frappe quatre coups; et on entendit les quatre coups. Si tu es damnée, frappe six coups; et les six coups furent frappés. Si tu es encore plus tourmentée en enfer parce que ton corps est enterré en terre sainte, frappe six autres coups; et ces six autres coups furent entendus encore plus distinctement. [50] Si nous déterrons ton corps, et si nous cessons de prier Dieu pour toi, seras-tu moins damnée? frappe cinq coups pour nous le certifier; et l'âme le certifia par cinq coups.
Cet interrogatoire de l'âme fait par Pierre d'Arras, fut signé par vingt-deux cordeliers, à la tête desquels était le révérend père provincial. Ce père provincial lui fit le lendemain les mêmes questions, et il lui fut répondu de même.
On dira que l'âme ayant déclaré qu'elle était en purgatoire, les cordeliers ne devaient pas la supposer en enfer; mais ce n'est pas ma faute si des théologiens se contredisent.
Le seigneur de Saint-Mémin présenta requête au roi contre les pères cordeliers. Ils présentèrent requête de leur côté; le roi délégua des juges, à la tête desquels était Adrien Fumée maître des requêtes.
Le procureur général de la commission requit que lesdits cordeliers fussent brûlés. Mais l'arrêt ne les condamna qu'à faire tous amende honorable la torche au poing, et à être bannis du royaume. Cet arrêt est du 18 février 1534.
Après une telle vision, il est inutile d'en rapporter d'autres: elles sont toutes ou du genre de la friponnerie, ou du genre de la folie. Les visions du premier genre sont du ressort de la justice: celles du second genre sont ou des visions de fous malades, ou des visions de fous en bonne santé. Les premières appartiennent à la médecine, et les secondes aux Petites-Maisons.
VOLONTÉ. [p. 501]↩
Des Grecs fort subtils consultaient autrefois le pape Honorius I er , pour savoir si Jésus, lorsqu'il était au monde, avait eu une volonté ou deux volontés lorsqu'il se déterminait à quelque action; par exemple, lorsqu'il voulait dormir ou veiller, manger ou aller à la garde-robe marcher ou s'asseoir.
Que vous importe? leur répondait le très sage évêque de Rome, Honorius. Il a certainement aujourd'hui la volonté que vous soyez gens de bien; cela vous doit suffire; il n'a nulle volonté que vous soyez des sophistes babillards, qui vous battez continuellement pour la chape à l'évêque, et pour l'ombre de l'âne. Je vous conseille de vivre en paix, et de ne point perdre en disputes inutiles un temps que vous pourriez employer en bonnes oeuvres.
St Père, vous avez beau dire; c'est ici la plus importante affaire du monde. Nous avons déjà mis l'Europe, l'Asie et l'Afrique en feu pour savoir si Jésus avait deux personnes et une nature, ou une nature et deux personnes, ou bien deux personnes et deux natures, ou bien une personne et une nature .
Mes chers frères, vous avez très mal fait: il fallait donner du bouillon aux malades, du pain aux pauvres.
Il s'agit bien de secourir les pauvres! voilà-t-il pas le patriarche Sergius qui vient de faire décider dans un concile à Constantinople, que Jésus avait deux natures et une volonté! et l'empereur qui n'y entend rien, est de cet avis .
Eh bien, soyez-en aussi; et surtout défendez-vous mieux contre les mahométans qui vous donnent tous les jours sur les oreilles, et qui ont une très mauvaise volonté contre vous.
C'est bien dit; mais voilà les évêques de Tunis, de Tripoli, d'Alger, de Maroc, qui tiennent fermement pour les deux volontés. Il faut avoir une opinion; quelle est la vôtre?
Mon opinion est que vous êtes des fous qui perdrez la religion chrétienne que nous avons établie avec tant de peines. Vous ferez tant, par vos sottises, que Tunis, Tripoli, Alger, Maroc dont vous me parlez, deviendront musulmans, et qu'il n'y aura pas une chapelle chrétienne en Afrique. En attendant je suis pour l'empereur et le concile, jusqu'à ce que vous ayez pour vous un autre concile et un autre empereur.
Ce n'est pas nous satisfaire. Croyez-vous deux volontés ou une?
Ecoutez; si ces deux volontés sont semblables, c'est comme s'il n'y en avait qu'une seule; si elles sont contraires, celui qui aura deux volontés à la fois, fera deux choses contraires à la fois, ce qui est absurde; par conséquent je suis pour une seule volonté.
Ah! St Père, vous êtes monothélite. A l'hérésie, à l'hérésie! au diable! à l'excommunication, à la déposition; un concile, vite un autre concile! un autre empereur, un autre évêque de Rome, un autre patriarche .
Mon Dieu! que ces pauvres Grecs sont fous avec toutes leurs vaines et interminables disputes, et que mes successeurs feront bien de songer à être puissants et riches!
A peine Honorius avait proféré ces paroles, qu'il apprit que l'empereur Héraclius était mort après avoir été bien battu par les mahométans. Sa veuve Martine empoisonna son beau-fils; le sénat fit couper la langue à Martine et le nez à un autre fils de l'empereur. Tout l'empire grec nagea dans le sang.
N'eût-il pas mieux valu ne point disputer sur les deux volontés? Et ce pape Honorius, contre lequel les jansénistes ont tant écrit, n'était-il pas un homme très sensé?
VOYAGE DE ST. PIERRE A ROME. [p. 503]↩
La fameuse dispute si Pierre fit le voyage de Rome, n'est-elle pas au fond aussi frivole que la plupart des autres grandes disputes? Les revenus de l'abbaye de St Denis en France ne dépendent ni de la vérité du voyage de St Denis l'Aréopagite d'Athènes au milieu des Gaules, ni de son martyre à Montmartre, ni de l'autre voyage qu'il fit après sa mort de Montmartre à St Denis en portant sa tête entre ses bras, et en la baisant à chaque pause.
Les chartreux ont de très grands biens, sans qu'il y ait la moindre vérité dans l'histoire du chanoine de Magdebourg qui se leva de sa bière à trois jours consécutifs, pour apprendre aux assistants qu'il était damné.
De même, il est bien sûr que les revenus et les droits du pontife romain peuvent subsister, soit que Simon Barjone surnommé Céphas ait été à Rome, soit qu'il n'y ait pas été. Tous les droits des métropolitains de Rome et de Constantinople furent établis au concile de Calcédoine en 451 de notre ère vulgaire, et il ne fut question dans ce concile d'aucun voyage fait par un apôtre à Bizance ou à Rome.
Les patriarches d'Alexandrie, de Constantinople suivirent le sort de leurs provinces. Les chefs ecclésiastiques des deux villes impériales et de l'opulente Egypte, devaient avoir naturellement plus de privilèges, d'autorité, de richesses que les évêques des petites villes.
Si la résidence d'un apôtre dans une ville avait décidé de tant de droits, l'évêque de Jérusalem aurait sans contredit été le premier évêque de la chrétienté. Il était évidemment le successeur de St Jacques frère de Jésus-Christ, reconnu pour fondateur de cette Eglise, et appelé depuis le premier de tous les évêques. Nous ajouterions que par le même raisonnement, tous les patriarches de Jérusalem devaient être circoncis, puisque les quinze premiers évêques de Jérusalem, berceau du christianisme et tombeau de Jésus-Christ, avaient tous reçu la circoncision. [51]
Il est indubitable que les premières largesses faites à l'Eglise de Rome par Constanin, n'ont pas le moindre rapport au voyage de St Pierre.
1 o . La première église élevée à Rome, fut celle de St Jean: elle en est encore la véritable cathédrale. Il est sûr qu'elle aurait été dédiée à St Pierre s'il en avait été le premier évêque; c'est la plus forte de toutes les présomptions; elle seule aurait pu finir la dispute.
2 o . A cette puissante conjecture se joignent des preuves négatives convaincantes. Si Pierre avait été à Rome avec Paul, les Actes des apôtres en auraient parlé, et ils n'en disent pas un mot.
3 o . Si St Pierre était allé prêcher l'Evangile à Rome, St Paul n'aurait pas dit dans son épître aux Galates, Quand ils virent que l'évangile du prépuce m'avait été confié, et à Pierre celui de la circoncision, ils me donnèrent les mains à moi et à Barnabé; ils consentirent que nous allassions chez les gentils, et Pierre chez les circoncis .
4 o . Dans les lettres que Paul écrit de Rome, il ne parle jamais de Pierre; donc il est évident que Pierre n'y était pas.
5 o . Dans les lettres que Paul écrit à ses frères de Rome, pas le moindre compliment à Pierre, pas la moindre mention de lui; donc Pierre ne fit un voyage à Rome ni quand Paul était en prison dans cette capitale, ni quand il en était dehors.
6 o . On n'a jamais connu aucune lettre de St Pierre datée de Rome.
7 o . Quelques-uns, comme Paul-Orose Espagnol du cinquième siècle, veulent qu'il ait été à Rome les premières années de Claude; et les Actes des apôtres disent qu'il était alors à Jérusalem, et les épîtres de Paul disent qu'il était à Antioche.
8 o . Je ne prétends point apporter en preuve, qu'à parler humainement, et selon les règles de la critique profane, Pierre ne pouvait guère aller de Jérusalem à Rome, ne sachant ni la langue latine, ni même la langue grecque, laquelle St Paul parlait, quoique assez mal. Il est dit que les apôtres parlaient toutes les langues de l'univers, ainsi je me tais.
9 o . Enfin, la première notion qu'on ait jamais eue du voyage de St Pierre à Rome, vient d'un nommé Papias qui vivait environ cent ans après St Pierre. Ce Papias était Phrygien; il écrivait dans la Phrygie, et il prétendit que St Pierre était allé à Rome, sur ce que dans une de ses lettres il parle de Babilone. Nous avons en effet une lettre attribuée à St Pierre écrite en ces temps ténébreux, dans laquelle il est dit, L'église qui est à Babilone, ma femme et mon fils Marc vous saluent . Il a plu à quelques translateurs de traduire le mot qui veut dire ma femme, par la conchoisie, Babilone la conchoisie; c'est traduire avec un grand sens.
Papias qui était (il faut l'avouer) un des grands visionnaires de ces siècles, s'imagina que Babilone voulait dire Rome. Il était pourtant tout naturel que Pierre fût parti d'Antioche pour aller visiter les frères de Babilone. Il y eut toujours des Juifs à Babilone, ils y firent continuellement le métier de courtiers et de porte-balles; il est bien à croire que plusieurs disciples s'y réfugièrent, et que Pierre alla les encourager. Il n'y a pas plus de raison à imaginer que Babilone signifie Rome, qu'à supposer que Rome signifie Babilone. Quelle idée extravagante de supposer que Pierre écrivait une exhortation à ses camarades, comme on écrit aujourd'hui en chiffre! craignait-il qu'on ouvrît sa lettre à la poste? pourquoi Pierre aurait-il craint qu'on eût connaissance de ses lettres juives, si inutiles selon le monde, et auxquelles il eût été impossible que les Romains eussent fait la moindre attention? qui l'engageait à mentir si vainement? dans quel rêve a-t-on pu songer que lorsqu'on écrivait Babilone cela signifiait Rome .
C'est d'après ces preuves assez concluantes que le judicieux Calmet conclut, que le voyage de St Pierre à Rome est prouvé par St Pierre lui-même, qui marque expressément qu'il a écrit sa lettre de Babilone, c'est-à-dire de Rome, comme nous l'expliquons avec les anciens. Encore une fois, c'est puissamment raisonner; il a probablement appris cette logique chez les vampires.
Le savant archevêque de Paris Marca, Dupin, Blondel, Spanheim, ne sont pas de cet avis; mais enfin c'était celui de Papias qui raisonnait comme Calmet, et qui fut suivi d'une foule d'écrivains si attachés à la sublimité de leurs principes, qu'ils négligèrent quelquefois la saine critique et la raison.
C'est une très mauvaise défaite des partisans du voyage, de dire que les Actes des apôtres sont destinés à l'histoire de Paul et non pas de Pierre, et que s'ils passent sous silence le séjour de Simon Barjone à Rome, c'est que les faits et gestes de Paul étaient l'unique objet de l'écrivain.
Les Actes parlent beaucoup de Simon Barjone surnommé Pierre; c'est lui qui propose de donner un successeur à Judas. On le voit frapper de mort subite Ananie et sa femme qui lui avaient donné leur bien, mais qui malheureusement n'avaient pas tout donné. On le voit ressusciter sa couturière Dorcas chez le corroyeur Simon à Joppé. Il a une querelle dans Samarie avec Simon surnommé le magicien; il va à Lippa, à Césarée, à Jérusalem, que coûtait-il de le faire aller à Rome?
Il est bien difficile que Pierre soit allé à Rome soit sous Tibère, soit sous Caligula ou sous Claude, ou sous Néron. Le voyage du temps de Tibère n'est fondé que sur de prétendus fastes de Sicile apocryphes. [52]
Un autre apocryphe intitulé Catalogue d'évêques , fait au plus vite Pierre évêque de Rome, immédiatement après la mort de son maître.
Je ne sais quel conte arabe l'envoie à Rome sous Caligula. Eusèbe, trois cents ans après, le fait conduire à Rome sous Claude par une main divine, sans dire en quelle année.
Lactance qui écrivait du temps de Constantin, est le premier auteur bien avéré, qui ait dit que Pierre alla à Rome sous Néron, et qu'il y fut crucifié.
On avouera que si dans un procès une partie ne produisait que de pareils titres, elle ne gagnerait pas sa cause; on lui conseillerait de s'en tenir à la prescription, à l'uti possidetis ; et c'est le parti que Rome a pris.
Mais, dit-on, avant Eusèbe, avant Lactance l'exact Papias avait déja conté l'aventure de Pierre et de Simon vertu de Dieu, qui se passa en présence de Néron, le parent de Néron à moitié ressuscité par Simon vertu-Dieu, et entièrement ressuscité par Pierre, les compliments de leurs chiens, le pain donné par Pierre aux chiens de Simon, le magicien qui vole dans les airs, le chrétien qui le fait tomber par un signe de croix, et qui lui casse les jambes; Néron qui fait couper la tête à Pierre pour payer les jambes de son magicien etc. etc. Le grave Marcel répète cette histoire authentique, et le grave Hégésippe la répète encore, et d'autres la répètent après eux; et moi je vous répète que si jamais vous plaidez pour un pré, fût-ce devant le juge de Vaugirard, vous ne gagnerez jamais votre procès sur de pareilles pièces.
Je ne doute pas que le fauteuil épiscopal de St Pierre ne soit encore à Rome dans la belle église. Je ne doute pas que St Pierre n'ait joui de l'évêché de Rome vingt-cinq ans, un mois et neuf jours, comme on le rapporte. Mais j'ose dire que cela n'est pas prouvé démonstrativement, et j'ajoute qu'il est à croire que les évêques romains d'aujourd'hui sont plus à leur aise que ceux de ces temps passés, temps un peu obscurs qu'il est fort difficile de bien débrouiller.
XÉNOPHANES. [p. 507]↩
Bayle a pris le prétexte de l'article Xénophanes pour faire le panégyrique du diable, comme autrefois Simonide, à l'occasion d'un lutteur qui avait remporté le prix à coups de poing aux jeux olympiques, chanta dans une belle ode les louanges de Castor et de Pollux. Mais au fond, que nous importent les rêveries de Xénophanes? Que saurons-nous en apprenant qu'il regardait la nature comme un être infini, immobile, composé d'une infinité de petits corpuscules, de petites monades douces, d'une force motrice, de petites molécules organiques; qu'il pensait d'ailleurs à peu près comme pensa depuis Spinosa, ou que plutôt il cherchait à penser et qu'il se contredit plusieurs fois, ce qui était le propre des anciens philosophes?
Si Anaximène enseigna que l'atmosphère était Dieu; si Thalès attribua à l'eau la formation de toutes choses, parce que l'Egypte était fécondée par ses inondations; si Phérécide et Héraclite donnèrent au feu tout ce que Thalès donnait à l'eau, quel bien nous revient-il de toutes ces imaginations chimériques?
Je veux que Pythagore ait exprimé, par des nombres, des rapports très mal connus, et qu'il ait cru que la nature avait bâti le monde par des règles d'arithmétique. Je consens qu'Ocellus Lucanus et Empédocle aient tout arrangé par des forces motrices antagonistes, quel fruit en recueillerai-je? quelle notion claire sera entrée dans mon faible esprit?
Venez, divin Platon, avec vos idées archétypes, vos androgynes et votre verbe; établissez ces belles connaissances en prose poétique dans votre République nouvelle, où je ne prétends pas plus avoir une maison que dans la Salente du Télémaque: mais au lieu d'être un de vos citoyens je vous enverrai, pour bâtir votre ville, toute la matière subtile de Descartes, toute sa matière globuleuse et toute sa rameuse que je vous ferai porter par Cyrano de Bergerac. [53]
Bayle a pourtant exercé toute la sagacité de sa dialectique sur vos antiques billevesées; mais c'est qu'il en tirait toujours parti pour rire des sottises qui leur succédèrent.
O philosophes! les expériences de physique bien constatées, les arts et métiers, voilà la vraie philosophie. Mon sage est le conducteur de mon moulin, lequel pince bien le vent, ramasse mon sac de blé, le verse dans la trémie, le moud également, et fournit à moi et aux miens une nourriture aisée. Mon sage est celui qui, avec la navette, couvre mes murs de tableaux de laine ou de soie, brillants des plus riches couleurs; ou bien celui qui met dans ma poche la mesure du temps en cuivre et en or. Mon sage est l'investigateur de l' Histoire natrelle ; on apprend plus dans les seules expériences de l'abbé Nollet, que dans tous les livres de l'antiquité.
XÉNOPHON, [p. 509]↩
ET LA RETRAITE DES DIX MILLE.
Quand Xénophon n'aurait eu d'autre mérite que d'être l'ami du martyr Socrate, il serait un homme recommandable; mais il était guerrier, philosophe, poète, historien, agriculteur, aimable dans la société: et il y eut beaucoup de Grecs qui réunirent tous ces mérites.
Mais pourquoi cet homme libre eut-il une compagnie grecque à la solde du jeune Cosrou, nommé Cyrus par les Grecs? Ce Cyrus était frère puîné et sujet de l'empereur de Perse Artaxerxe Mnemon, dont on a dit qu'il n'avait jamais rien oublié que ses injures. Cyrus avait déjà voulu assassiner son frère dans le temple même où l'on faisait la cérémonie de son sacre (car les rois de Perse furent les premiers qui furent sacrés), non seulement Artaxerxe eut la clémence de pardonner à ce scélérat, mais il eut la faiblesse de lui laisser le gouvernement absolu d'une grande partie de l'Asie mineure qu'il tenait de leur père, et dont il méritait au moins d'être dépouillé.
Pour prix d'une si étonnante clémence, dès qu'il put se soulever dans sa satrapie contre son frère, il ajouta ce second crime au premier. Il déclara par un manifeste, qu'il était plus digne du trône de Perse que son frère, parce qu'il était meilleur magicien, et qu'il buvait plus de vin que lui .
Je ne crois pas que ce fussent ces raisons qui lui donnèrent pour alliés les Grecs. Il en prit à sa solde treize mille, parmi lesquels se trouva le jeune Xénophon, qui n'était alors qu'un aventurier. Chaque soldat eut d'abord une darique de paie par mois. La darique valait environ une guinée, ou un louis d'or de notre temps, comme le dit très bien M. le chevalier de Jaucourt, et non pas dix francs, comme le dit Rollin.
Quand Cyrus leur proposa de se mettre en marche avec ses autres troupes pour aller combattre son frère vers l'Euphrate, ils demandèrent une darique et demie, et il fallut bien la leur accorder. C'était trente-six livres par mois, et par conséquent la plus forte paye qu'on ait jamais donnée. Les soldats de César et de Pompée n'eurent que vingt sous par jour dans la guerre civile. Outre cette solde exorbitante, dont ils se firent payer quatre mois d'avance, Cyrus leur fournissait quatre cents chariots chargés de farine et de vin.
Les Grecs étaient donc précisément ce que sont aujourd'hui les Helvétiens, qui louent leur service et leur courage aux princes leurs voisins, mais pour une somme trois fois plus modique que n'était la solde des Grecs.
Il est évident, quoi qu'on en dise, qu'ils ne s'informaient pas si la cause pour laquelle ils combattaient était juste; il suffisait que Cyrus payât bien.
Les Lacédémoniens composaient la plus grande partie de ces troupes. Ils violaient en cela leurs traités solennels avec le roi de Perse.
Qu'était devenue l'ancienne aversion de Sparte pour l'or et pour l'argent? où était la bonne foi dans les traités? où était leur vertu altière et incorruptible? C'était Cléarque, un Spartiate, qui commandait le corps principal de ces braves mercenaires.
Je n'entends rien aux manoeuvres de guerre d'Artaxerxès et de Cyrus; je ne vois pas pourquoi cet Artaxerxès qui venait à son ennemi avec douze cent mille combattants, commence par faire tirer des lignes de douze lieues d'étendue entre Cyrus et lui; et je ne comprends rien à l'ordre de bataille. J'entends encore moins comment Cyrus, suivi de six cents chevaux seulement, attaque dans la mêlée les six mille gardes à cheval de l'empereur, suivi d'ailleurs d'une armée innombrable. Enfin, il est tué de la main d'Artaxerxès, qui apparemment ayant bu moins de vin que le rebelle ingrat, se battit avec plus de sang-froid et d'adresse que cet ivrogne. Il est clair qu'il gagna complètement la bataille malgré la valeur et la résistance des treize mille Grecs, puisque la vanité grecque est obligée d'avouer qu'Artaxerxès leur fit dire de mettre bas les armes. Ils répondent qu'ils n'en feront rien; mais que si l'empereur veut les payer, ils se mettront à son service. Il leur était donc très indifférent pour qui ils combattissent, pourvu qu'on les payât. Ils n'étaient donc que des meurtriers à louer.
Il y a, outre la Suisse, des provinces d'Allemagne qui en usent ainsi. Il n'importe à ces bons chrétiens de tuer pour de l'argent, des Anglais, ou des Français, ou des Hollandais, ou d'être tués par eux. Vous les voyez réciter leurs prières et aller au carnage comme des ouvriers vont à leur atelier. Pour moi, j'avoue que j'aime mieux ceux qui s'en vont en Pensilvanie cultiver la terre avec les simples et équitables quakers, et former des colonies dans le séjour de la paix et de l'industrie. Il n'y a pas un grand savoir-faire à tuer et à être tué pour six sous par jour; mais il y en a beaucoup à faire fleurir la république des Dunkards, ces thérapeutes nouveaux, sur la frontière du pays le plus sauvage.
Artaxerxès ne regarda ces Grecs que comme des complices de la révolte de son frère; et franchement c'est tout ce qu'ils étaient. Il se croyait trahi par eux, et il les trahit, à ce que prétend Xénophon. Car après qu'un de ses capitaines eut juré en son nom de leur laisser une retraite libre, et de leur fournir des vivres; après que Cléarque et cinq autres commandants des Grecs se furent mis entre ses mains pour régler la marche, il leur fit trancher la tête, et on égorgea tous les Grecs qui les avaient accompagnés dans cette entrevue, s'il faut s'en rapporter à Xénophon.
Cet acte royal nous fait voir que le machiavélisme n'est pas nouveau. Mais aussi est-il bien vrai qu'Artaxerxès eût promis de ne pas faire un exemple des chefs mercenaires qui s'étaient vendus à son frère? ne lui était-il pas permis de punir ceux qu'il croyait si coupables?
C'est ici que commence la fameuse retraite des dix mille. Si je n'ai rien compris à la bataille, je ne comprends pas plus à la retraite.
L'empereur, avant de faire couper la tête aux six généraux grecs et à leur suite, avait juré de laisser retourner en Grèce cette petite armée réduite à dix mille hommes. La bataille s'était donnée sur le chemin de l'Euphrate; il eût donc fallu faire retourner les Grecs par la Mésopotamie occidentale, par la Syrie, par l'Asie mineure, par l'Ionie. Point du tout; on les faisait passer à l'orient, on les obligeait de traverser le Tigre sur des barques qu'on leur fournissait; ils remontaient ensuite par le chemin de l'Arménie lorsque leurs commandants furent suppliciés. Si quelqu'un comprend cette marche, dans laquelle on tournait le dos à la Grèce, il me fera plaisir de me l'expliquer.
De deux choses l'une; ou les Grecs avaient choisi eux-mêmes leur route, et en ce cas, ils ne savaient ni où ils allaient, ni ce qu'ils voulaient; ou Artaxerxès les faisait marcher malgré eux; (ce qui est bien plus probable) et en ce cas pourquoi ne les exterminait-il point?
On ne peut se tirer de ces difficultés qu'en supposant que l'empereur persan ne se vengea qu'à demi; qu'il se contenta d'avoir puni les principaux chefs mercenaires qui avaient vendu les troupes grecques à Cyrus; qu'ayant fait un traité avec ces troupes fugitives, il ne voulait pas descendre à la honte de le violer; qu'étant sûr que de ces Grecs errants il en périrait un tiers dans la route, il abandonnait ces malheureux à leur mauvais sort. Je ne vois pas d'autre jour pour éclairer l'esprit du lecteur sur les obscurités de cette marche.
On s'est étonné de la retraite des dix mille; mais on devait s'étonner bien davantage qu'Artaxerxès vainqueur à la tête de douze cent mille combattants, (du moins à ce qu'on dit) laissât voyager dans le nord de ses vastes Etats dix mille fugitifs qu'il pouvait écraser à chaque village, à chaque passage de rivière, à chaque défilé, ou qu'on pouvait faire périr de faim et de misère.
Cependant on leur fournit, comme nous l'avons vu, vingt-sept grands bateaux vers la ville d'Itace pour leur faire passer le Tigre, comme si on voulait les conduire aux Indes. De là on les escorte en tirant vers le nord, pendant plusieurs jours, dans le désert où est aujourd'hui Bagdat. Ils passent encore la rivière de Zabate, et c'est là que viennent les ordres de l'empereur de punir les chefs. Il est clair qu'on pouvait exterminer l'armée aussi facilement qu'on avait fait justice des commandants. Il est donc très vraisemblable qu'on ne le voulut pas.
On ne doit donc plus regarder les Grecs perdus dans ces pays sauvages, que comme des voyageurs égarés, à qui la bonté de l'empereur laissait achever leur route comme ils pouvaient.
Il y a une autre observation à faire, qui ne paraît pas honorable pour le gouvernement persan. Il était impossible que les Grecs n'eussent pas des querelles continuelles pour les vivres avec tous les peuples chez lesquels ils devaient passer. Les pillages, les désolations, les meurtres étaient la suite inévitable de ces désordres; et cela est si vrai, que dans une route de six cents lieues, pendant laquelle les Grecs marchèrent toujours au hasard, ces Grecs n'étant ni escortés, ni poursuivis par aucun grand corps de troupes persanes, perdirent quatre mille hommes, ou assommés par les paysans, ou morts de maladie. Comment donc Artaxerxès ne les fit-il pas escorter depuis leur passage de la rivière de Zabate, comme il l'avait fait depuis le champ de bataille jusqu'à cette rivière?
Comment un souverain si sage et si bon commit-il une faute si essentielle? Peut-être ordonna-t-il l'escorte; peut-être Xénophon, d'ailleurs un peu déclamateur, la passe-t-il sous silence pour ne pas diminuer le merveilleux de la retraite des dix mille; peut-être l'escorte fut toujours obligée de marcher très loin de la troupe grecque par la difficulté des vivres. Quoi qu'il en soit, il paraît certain qu'Artaxerxès usa d'une extrême indulgence, et que les Grecs lui durent la vie, puisqu'ils ne furent pas exterminés.
Il est dit dans le Dictionnaire encyclopédique, à l'article Retraite , que celle des dix mille se fit sous le commandement de Xénophon. On se trompe; il ne commanda jamais; il fut seulement sur la fin de la marche à la tête d'une division de quatorze cents hommes.
Je vois que ces héros, à peine arrivés après tant de fatigues sur le rivage du Pont-Euxin, pillent indifféremment amis et ennemis pour se refaire. Xénophon embarque à Héraclée sa petite troupe, et va faire un nouveau marché avec un roi de Thrace qu'il ne connaissait pas. Cet Athénien, au lieu d'aller secourir sa patrie accablée alors par les Spartiates, se vend donc encore une fois à un petit despote étranger. Il fut mal payé; je l'avoue; et c'est une raison de plus pour conclure qu'il eût mieux fait d'aller secourir sa patrie.
Il résulte de tout ce que nous avons remarqué, que l'Athénien Xénophon n'étant qu'un jeune volontaire, s'enrôla sous un capitaine lacédémonien, l'un des tyrans d'Athènes, au service d'un rebelle et d'un assassin; et qu'étant devenu chef de quatorze cents hommes, il se mit aux gages d'un barbare.
Ce qu'il y a de pis, c'est que la nécessité ne le contraignait pas à cette servitude. Il dit lui-même qu'il avait laissé en dépôt, dans le temple de la fameuse Diane d'Ephèse, une grande partie de l'or gagné au service de Cyrus.
Remarquons qu'en recevant la paye d'un roi, il s'exposait à être condamné au supplice, si cet étranger n'était pas content de lui. Voyez ce qui est arrivé au major général Doxat, homme né libre. Il se vendit à l'empereur Charles VI, qui lui fit couper le cou pour avoir rendu aux Turcs une place qu'il ne pouvait défendre.
Rollin, en parlant de la retraite des dix mille, dit que cet heureux succès remplit de mépris pour Artaxerxès les peuples de la Grèce, en leur faisant voir, que l'or, l'argent, les délices, le luxe, un nombreux sérail faisaient tout le mérite du grand roi, etc .
Rollin pouvait considérer que les Grecs ne devaient pas mépriser un souverain qui avait gagné une bataille complète; qui ayant pardonné en frère avait vaincu en héros; qui maître d'exterminer dix mille Grecs, les avait laissés vivre et retourner chez eux; et qui pouvant les avoir à sa solde, avait dédaigné de s'en servir. Ajoutez que ce prince vainquit depuis les Lacédémoniens et leurs alliés, et leur imposa des lois humiliantes; ajoutez que dans une guerre contre des Scythes nommés Cadusiens, vers la mer Caspienne, il supporta comme le moindre soldat toutes les fatigues et tous les dangers. Il vécut et mourut plein de gloire; il est vrai qu'il eut un sérail, mais son courage n'en fut que plus estimable. Gardons-nous des déclamations de collège.
Si j'osais attaquer le préjugé, j'oserais préférer la retraite du maréchal de Belle-Isle à celle des dix mille. Il est bloqué dans Prague par soixante mille hommes, il n'en a pas treize mille. Il prend ses mesures avec tant d'habileté, qu'il sort de Prague dans le froid le plus rigoureux avec son armée, ses vivres, son bagage, et trente pièces de canon, sans que les assiégeants s'en doutent. Il a déjà gagné deux marches avant qu'ils s'en soient aperçus. Une armée de trente mille combattants le poursuit sans relâche l'espace de trente lieues. Il fait face partout, il n'est jamais entamé; il brave, tout malade qu'il est, les saisons, la disette et les ennemis. Il ne perd que les soldats qui ne peuvent résister à la rigueur extrême de la saison. Que lui a-t-il manqué? une plus longue course, et des éloges exagérés à la grecque.
ZOROASTRE. [p. 515]↩
Si c'est Zoroastre qui le premier annonça aux hommes cette belle maxime, Dans le doute si une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi , Zoroastre était le premier des hommes après Confucius.
Si cette belle leçon de morale ne se trouve que dans les cent portes du Sadder, longtemps après Zoroastre, bénissons l'auteur du Sadder. On peut avoir des dogmes et des rites très ridicules avec une morale excellente.
Qui était ce Zoroastre? ce nom a quelque chose de grec, et on dit qu'il était Mède. Les Parsis d'aujourd'hui l'appellent Zerdust, ou Zerdast, ou Zaradast, ou Zarathrust. Il ne passe pas pour avoir été le premier du nom. On nous parle de deux autres Zoroastres, dont le premier a neuf mille ans d'antiquité: c'est beaucoup pour nous, quoique ce soit très peu pour le monde.
Nous ne connaissons que le dernier Zoroastre.
Les voyageurs français, Chardin et Tavernier, nous ont appris quelque chose de ce grand prophète, par le moyen des Guèbres ou Parsis qui sont encore répandus dans l'Inde et dans la Perse, et qui sont excessivement ignorants. Le docteur Hyde, professeur en arabe dans Oxford, nous en a appris cent fois davantage sans sortir de chez lui. Il a fallu que dans l'ouest de l'Angleterre il ait deviné la langue que parlaient les Perses du temps de Cyrus, et qu'il l'ait confrontée avec la langue moderne des adorateurs du feu.
C'est à lui surtout que nous devons ces cent portes du Sadder qui contiennent tous les principaux préceptes des pieux ignicoles.
Pour moi, j'avoue que je n'ai rien trouvé sur leurs anciens rites de plus curieux que ces deux vers persans de Sadi, rapportés par Hyde.
Qu'un Perse ait conservé le feu sacré cent ans,
Le pauvre homme est brûlé quand il tombe dedans.
Les savantes recherches de Hyde, allumèrent, il y a peu d'années, dans le coeur d'un jeune Français, le désir de s'instruire par lui-même des dogmes des Guèbres.
Il fit le voyage des grandes Indes pour apprendre dans Surate, chez les pauvres Parsis modernes, la langue des anciens Perses, et pour lire dans cette langue les livres de ce Zoroastre si fameux, supposé qu'en effet il ait écrit.
Les Pythagores, les Platons, les Apollonios de Thyane allèrent chercher autrefois en Orient la sagesse qui n'était pas là. Mais nul n'a couru après cette divinité cachée à travers plus de peines et de périls que le nouveau traducteur français des livres attribués à Zoroastre. Ni les maladies, ni la guerre, ni les obstacles renaissant à chaque pas, ni la pauvreté même, le premier et le plus grand des obstacles, rien n'a rebuté son courage.
Il est glorieux pour Zoroastre qu'un Anglais ait écrit sa vie au bout de tant de siècles, et qu'ensuite un Français l'ait écrite d'une manière toute différente. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que nous avons parmi les biographes anciens du prophète deux principaux auteurs arabes qui précédemment écrivirent chacun son histoire; et ces quatre histoires se contredisent merveilleusement toutes les quatre. Cela ne s'est pas fait de concert ; et rien n'est plus capable de faire connaître la vérité.
Le premier historien arabe Abu-Mohammed Moustapha avoue que le père de Zoroastre s'appelait Espintaman; mais il dit aussi qu'Espintaman n'était pas son père, mais son trisaïeul. Pour sa mère, il n'y a pas deux opinions, elle s'appelait Dogdu, ou Dodo, ou Dodu; c'était une très belle poule d'Inde: elle est fort bien dessinée chez le docteur Hyde.
Bundari le second historien, conte que Zoroastre était juif et qu'il avait été valet de Jérémie; qu'il mentit à son maître, que Jérémie pour le punir lui donna la lèpre; que le valet pour se décrasser alla prêcher une nouvelle religion en Perse, et fit adorer le soleil au lieu des étoiles.
Voici ce que le troisième historien raconte, et ce que l'Anglais Hyde a rapporté assez au long.
Le prophète Zoroastre étant venu du paradis prêcher sa religion chez le roi de Perse Gustaph, le roi dit au prophète, Donnez-moi un signe. Aussitôt le prophète fit croître devant la porte du palais un cèdre si gros, si haut, que nulle corde ne pouvait ni l'entourer ni atteindre sa cime. Il mit au haut du cèdre un beau cabinet où nul homme ne pouvait monter. Frappé de ce miracle, Gustaph crut à Zoroastre.
Quatre mages ou quatre sages (c'est la même chose), gens jaloux et méchants, empruntèrent du portier royal la clef de la chambre du prophète pendant son absence, et jetèrent parmi ses livres des os de chiens et de chats, des ongles et des cheveux de morts, toutes drogues, comme on sait, avec lesquelles les magiciens ont opéré de tout temps. Puis ils allèrent accuser le prophète d'être un sorcier, et un empoisonneur. Le roi se fit ouvrir la chambre par son portier. On y trouva les maléfices, et voilà l'envoyé du ciel condamné à être pendu.
Comme on allait pendre Zoroastre, le plus beau cheval du roi tombe malade, ses quatre jambes rentrent dans son corps, tellement qu'on n'en voit plus. Zoroastre l'apprend, il promet qu'il guérira le cheval pourvu qu'on ne le pende pas. L'accord étant fait, il fait sortir une jambe du ventre, et il dit, Sire, je ne vous rendrai pas la seconde jambe que vous n'ayez embrassé ma religion. Soit, dit le monarque. Le prophète après avoir fait paraître la seconde jambe, voulut que les fils du roi se fissent zoroastriens; et ils le furent. Les autres jambes firent des prosélytes de toute la cour. On pendit les quatre malins sages au lieu du prophète, et toute la Perse reçut la foi.
Le voyageur français raconte à peu près les mêmes miracles, mais soutenus et embellis par plusieurs autres. Par exemple, l'enfance de Zoroastre ne pouvait pas manquer d'être miraculeuse; Zoroastre se mit à rire dès qu'il fut né, du moins à ce que disent Pline et Solin. Il y avait alors, comme tout le monde le sait, un grand nombre de magiciens très puissants; et ils savaient bien qu'un jour Zoroastre en saurait plus qu'eux, et qu'il triompherait de leur magie. Le prince des magiciens se fit amener l'enfant et voulut le couper en deux, mais sa main se sécha sur-le-champ. On le jeta dans le feu, qui se convertit pour lui en bain d'eau-rose. On voulut le faire briser sous les pieds des taureaux sauvages, mais un taureau plus puissant prit sa défense. On le jeta parmi les loups; ces loups allèrent incontinent chercher deux brebis qui lui donnèrent à téter toute la nuit. Enfin, il fut rendu à sa mère Dogdo, ou Dodo, ou Dodu, femme excellente entre toutes les femmes, ou fille admirable entre toutes les filles.
Telles ont été dans toute la terre toutes les histoires des anciens temps. C'est la preuve de ce que nous avons dit souvent, que la fable est la soeur aînée de l'histoire.
Je voudrais que pour notre plaisir et pour notre instruction, tous ces grands prophètes de l'antiquité, les Zoroastres, les Mercures Trismégistes, les Abaris, les Numa même etc. etc. etc. revinssent aujourd'hui sur la terre, et qu'ils conversassent avec Locke, Newton, Bacon, Shaftsburi, Pascal, Arnaud, Bayle; que dis-je, avec les philosophes les moins savants de nos jours qui ne sont pas les moins sensés.
J'en demande pardon à l'antiquité, mais je crois qu'ils feraient une triste figure.
Hélas, les pauvres charlatans! ils ne vendraient pas leurs drogues sur le Pont-Neuf. Cependant encore une fois, leur morale est bonne. C'est que la morale n'est pas de la drogue. Comment se pourrait-il que Zoroastre eût joint tant d'énormes fadaises à ce beau précepte de s'abstenir dans le doute si on fera bien ou mal? c'est que les hommes sont toujours pétris de contradictions.
On ajoute que Zoroastre ayant affermi sa religion, devint persécuteur, Hélas! il n'y a pas de sacristain ni de balayeur d'église qui ne persécutât s'il le pouvait.
On ne peut lire deux pages de l'abominable fatras attribué à ce Zoroastre, sans avoir pitié de la nature humaine. Nostradamus et le médecin des urines sont des gens raisonnables en comparaison de cet énergumène. Et cependant on parle de lui, et on en parlera encore.
Ce qui paraît singulier, c'est qu'il y avait du temps de ce Zoroastre que nous connaissons, et probablement avant lui, des formules de prières publiques et particulières instituées. Nous avons au voyageur français l'obligation de nous les avoir traduites. Il y avait de telles formules dans l'Inde; nous n'en connaissons point de pareilles dans le Pentateuque.
Ce qui est bien plus fort, c'est que les mages, ainsi que les brames admirent un paradis, un enfer, une résurrection, un diable. [54] Il est démontré que la loi des Juifs ne connut rien de tout cela. Ils ont été tardifs en tout. C'est une vérité dont on est convaincu, pour peu qu'on avance dans les connaissances orientales.
Notes
[28] C'est ce même Eglon roi de Moab qui fut si saintement assassiné au nom du Seigneur par Aod l'ambidextre, lequel lui avait fait serment de fidélité; et c'est ce même Aod qui fut si souvent réclamé à Paris par les prédicateurs de la Ligue. Il nous faut un Aod, il nous faut un Aod; ils crièrent tant qu'ils en trouvèrent un.
[29] C'est sous ce Jabin que la bonne femme Jahel assassina le capitaine Sizara, en lui enfonçant un clou dans la cervelle, lequel clou le cloua fort avant dans la terre. Quel maître clou et quelle maîtresse femme que cette Jahel! on ne lui peut comparer que Judith, mais Judith a paru bien supérieure, car elle coupa la tête à son amant dans son lit après lui avoir donné ses tendres faveurs. Rien n'est plus héroïque et plus édifiant.
[30] Diodore de Sicile liv. I, section II, ch. XII.
[31] Plusieurs théologiens qui sont la lumière du monde ont fait des commentaires sur ces rats d'or, et sur ces anus d'or. Ils disaient que les metteurs en oeuvre philistins étaient bien adroits, qu'il est très difficile de scuplter encore un trou du cul bien reconnaissable sans y joindre deux fesses: et que c'était une étrange offrande au Seigneur qu'un trou du cul. D'autres théologiens disaient que c'était aux Sodomites à présenter cette offrande. Mais enfin ils ont abandonné cette dispute. Ils s'occupent aujourd'hui de convulsions, de billets de confession et d'extrême-onction donnés la baïonnette au bout du fusil.
[32] C'est-à-dire qu'ils ne feraient aucune fonction sacerdotale.
[33] En récompense Jérôme écrit à Augustin dans sa cent quatorzième lettre, Je n'ai point critiqué vos ouvrages, car je ne les ai jamais lus; et si je voulais les critiquer, je pourrais vous faire voir que vous n'entendez point les Pères grecs... Vous ne savez pas même ce dont vous parlez.
[34] Lettre très importante de Jérôme.
[35] Un pauvre d'esprit dans un petit écrit honnête, poli, et surtout bien raisonné, objecte que si le prince ordonne à B. de rester exposé au canon, il y restera. Oui, sans doute, s'il a plus de courage, ou plutôt plus de crainte de la honte que d'amour de la vie, comme il arrive très souvent. Premièrement, il s'agit ici d'un cas tout différent. Secondement, quand l'instinct de la crainte de la honte l'emporte sur l'instinct de la conservation de soi-même, l'homme est autant nécessité à demeurer exposé au canon, qu'il est nécessité à fuir quand il n'est pas honteux de fuir. Le pauvre d'esprit était nécessité à faire des objections ridicules, et à dire des injures; et les philosophes se sentent nécessités à se moquer un peu de lui, et à lui pardonner.
[36] Lettre de Jérôme à Pammaque.
[37] Voyez l'article Appel comme d'abus.
[38] Voyez Puissance.
[39] Quand les juges n'ont point vu le crime, quand l'accusé n'a point été saisi en flagrant délit, qu'il n'y a point de témoins oculaires, que les déposants peuvent être ennemis de l'accusé; il est démontré qu'alors le prévenu ne peut être jugé que sur des probabilités. S'il y a vingt probabilités contre lui, ce qui est excessivement rare, et une seule en sa faveur de même force que chacune des vingt, il y a du moins un contre vingt qu'il n'est point coupable. Dans ce cas, il est évident que des juges ne doivent pas jouer à vingt contre un le sang innocent. Mais si avec une seule probabilité favorable l'accusé nie jusqu'au dernier moment, ces deux probabilités fortifiées l'une par l'autre équivalent aux vingt qui le chargent. En ce dernier cas condamner un homme ce n'est pas le juger, c'est l'assassiner au hasard. Or, dans le procès de Monbailli il y avait beaucoup plus de vraisemblances de l'innocence que du crime.
[40] C'est ce qui arriva à Thamar qui, étant violée, coucha sur le grand chemin avec son beau-père Juda, dont elle fut méconnue. Elle devint grosse. Juda la condamna à être brûlée. L'arrêt était d'autant plus cruel que s'il eût été exécuté, notre Sauveur, qui descend en droite ligne de ce Juda et de cette Thamar, ne serait pas né; à moins que tous les événements de l'univers n'eussent été mis dans un autre ordre.
[1] Anciennes ordonnances de la Franche-Comté, liv. V, tit. XVIII.
[2] Quod attinet ad matrimonia ab haereticis inter se celebrata, non observata forma a Tridentino praescripta, quaeque in posterum contrahentur, dum modo non aliud obstiterit canonicum impedimentum, sanctitas sua statuit pro validis habenda esse; adeòque si contigat utrumque conjugem ad catholicae ecclesiae sinum se recipere, eodem quo anteà conjugali vinculo ipsos animo teneri; etiam si mutuus consensus coram parocho catholico non renovetur.
[3] N'est-il pas bien plaisant qu'en France le conseil même ait donné aux protestants le nom de religionnaires, comme si eux seuls avaient eu de la religion; et que les autres n'eussent été que des papistes gouvernés par des arrêts et par des bulles.
[4] Histoire critique de Jésus-Christ, ou analyse raisonnée des Evangiles, page 130, note 3.
[5] Ce qui est en lettres italiques est mot à mot dans les Actes sincères, tout le reste est entièrement conforme. On l'a seulement abrégé pour éviter l'ennui du style déclamatoire de ces actes.
[6] Le légendaire ne sait ce qu'il dit avec son Ananias.
[7] On supprima dans les dictionnaires (depuis A jusqu'à B) tout ce paragraphe concernant le prédicateur hollandais, parce qu'on le crut hors d'oeuvre.
[8] C'était un ordre de gourmets. Les ivrognes étaient alors fort à la mode; l'évêque du Mans était à leur tête.
[9] Dans St Jean, Jésus dit à Nicodème ch. III que le vent, l'esprit souffle où il veut, que personne ne sait où il va, qu'il faut renaître, qu'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu si on ne renaît par l'eau et par l'esprit. Mais il ne parle point des enfants.
[10] Epît. aux juifs de Rome appelés les Romains, ch. II.
[11] Edition des Bénédict. et dans la Cité de Dieu, liv. VI.
[12] Apostolica Historia. Lib. VI, pag. 595 et 596. Fabric. codex.
[15] On sait bien que tout n'est pas égal dans cet ouvrage immense, et qu'il n'est pas possible que tout le soit. Les articles de Cahussat et d'autres semblables intrus ne peuvent égaler ceux des Diderot, des Dalembert, des Jaucourt, des Dargis, des Venel, des Du Marsais et de tant d'autres vrais philosophes. Mais à tout prendre l'ouvrage est un service éternel rendu au genre humain, la preuve en est qu'on le réimprime partout. On ne fait pas le même honneur à ses détracteurs. Ont-ils existé? On ne le sait que par la mention que nous faisons d'eux.
[16] Caveirac a copié cette exagération de Pluche sans lui en faire honneur. Pluche dans sa Concorde (ou discorde) de la géographie page 152, donne libéralement un million d'habitants à Paris, deux cent mille à Lyon, deux cent mille à Lille qui n'en a pas vingt-cinq mille; cent mille à Nantes, à Marseille, à Toulouse. Il vous débite ces mensonges imprimés avec la même confiance qu'il parle du lac Sirbon, et qu'il démontre le déluge. Et on nourrit l'esprit de la jeunesse de ces extravagances!
[17] Procès verbal de l'ordonnance, pag. 43 et 44.
[18] Ceci est tiré d'une lettre du citoyen du mont Krapac, dans laquelle se trouve l'extrait de la lettre de l'impératrice.
[19] Voyez Brantôme, Hommes illustres, tom. II.
[20] Voyez l'article Théophile au chap. Athéisme.
[21] Lettres de La Baumelle chez Jean Nourse, pag. 197.
[22] Il ne dit pas si ce fut lui qui vola le capitaine, et si ce fut pour ce vol qu'il fut mis à Spandau.
[23] Où cet ignorant a-t-il vu que Louis XIV ait levé une armée de cent mille hommes en 1662, dans la querelle des ambassadeurs de France et d'Espagne à Londres?
[24] Où a-t-il pris que le baron de Bateville, ambassadeur d'Espagne, était fou?
[25] Où a-t-il pris qu'une renonciation d'une mineure est libre? Il ignore d'ailleurs la loi de dévolution qui adjugeait la Flandre au roi de France.
[26] Ce n'était pas pour la punir de n'être pas son alliée, mais d'avoir secouru ses ennemis étant alliée.
[27] Oublie-t-il les droits du roi d'Espagne, le testament de Charles, les voeux de la nation, l'ambassade qui vint demander à Louis XIV son petit-fils pour roi? Langleviel veut-il détrôner les souverains d'Espagne, de Naples, de Sicile et de Parme?
[28] Il remit pour quatre millions d'impôts en 1662, et il fournit du blé aux pauvres à ses dépens.
[29] Il ne mit aucun impôt sur le peuple en 1691, dans le plus fort d'une guerre très ruineuse. Il créa pour un million de rentes sur l'hôtel de ville, des augmentations de gages, de nouveaux offices, et pas une seule taxe sur les cultivateurs ni sur les marchands. Son revenu cette année ne monta qu'à cent douze millions deux cent cinquante et une mille livres.
[30] Même erreur.
[31] Même erreur. Il est donc démontré que cet ignorant est le plus infâme calomniateur, et de qui? de ses rois.
[32] Cette grâce accordée aux prosélytes n'était point à charge à l'Etat: on voit seulement dans cette observation, l'audace d'un petit huguenot qui a été apprenti prédicant à Genève, et qui n'imitant pas la sagesse de ses confrères, s'est rendu indigne de la protection qu'il a surprise en France.
[33] Tom. III, pag. 269 et 270 du Siècle de Louis XIV, qu'il falsifia, et qu'il vendit chargé de notes infâmes à un libraire de Francfort nommé Eslinger, comme il a eu l'impudence de l'avouer lui-même.
[34] Les préceptes de Zoroastre sont appelés portes, et sont au nombre de cent.
[35] Contrat social, ch. VIII, pag. 95 et 96.
[36] Un pédant a cru trouver une erreur dans ce passage: il a prétendu qu'on a mal traduit par le mot de verre le gobelet qui était, dit-il, de bois ou de métal; mais comment le vin aurait-il brillé dans un gobelet de métal ou de bois? et puis qu'importe!
[37] Ce trou St Patrice ou St Patrik, est une des portes du purgatoire. Les cérémonies et les épreuves que les moines faisaient observer aux pèlerins qui venaient visiter ce redoutable trou, ressemblaient assez aux cérémonies et aux épreuves des mystères d'Isis et de Samotrace. L'ami lecteur qui voudra un peu approfondir la plupart de nos questions, s'apercevra fort agréablement que les mêmes friponneries, les mêmes extravagances ont fait le tour de la terre; le tout pour gagner honneur et argent.
Voyez l'extrait du purgatoire de St Patrice par M. Sinner.
[38] Page 27 du mémoire contre frère Athanase, présenté au parlement.
[39] Allusion à la querelle pour le pain ordinaire avec lequel les Russes communient, et le pain azyme des Polonais du rite de Rome.
[40] Assassinat du roi de Pologne commis à Varsovie.
[41] Le cas est arrivé à Lyon en 1772.
[42] Arnobe liv. V. Simbola quae rogata sacrorum etc. Voyez aussi Clément d'Alexandrie dans son sermon protreptique, ou cohortatio ad gentes.
[43] Mythol. de Banier, liv. II, pag. 151. Tom. III édit. in-4o. Comment. littér. sur Samson ch. XVI.
[44]
Rome encor aujourd'hui consacrant ses maximes,
Joint le trône à l'autel par des noeuds légitimes.
Jean-George le Franc, évêque du Puy-en-Velay, prétend que c'est mal raisonner; il est vrai qu'on pourrait nier les noeuds légitimes. Mais il pourrait bien raisonner lui-même fort mal. Il ne voit pas que le pape ne devint souverain qu'en abusant de son titre de pasteur, qu'en changeant sa houlette en sceptre; ou plutôt il ne veut pas le voir. A l'égard de la paix des Romains modernes, c'est la tranquillité de l'apoplexie.
[45] Il y a un jeu d'orgues qu'on appelle voix humaines, quoiqu'il ne ressemble qu'à des flûtes.
[46] Le fameux rabbin Isaac, dans son Rempart de la foi, au ch. XXIII entend toutes les prophéties, et surtout celle-là, d'une manière toute contraire à la façon dont nous les entendons. Mais qui ne voit que les Juifs sont séduits par l'intérêt qu'ils ont de se tromper? en vain répondent-ils qu'ils sont aussi intéressés que nous à chercher la vérité, qu'il y va de leur salut pour eux comme pour nous; qu'ils seraient plus heureux dans cette vie et dans l'autre s'ils trouvaient cette vérité; que s'ils entendent leurs propres écritures différemment de nous, c'est qu'elles sont dans leur propre langue très ancienne et non dans nos idiomes très nouveaux; qu'un Hébreu doit mieux savoir la langue hébraïque qu'un Basque ou un Poitevin; que leur religion a deux mille ans d'antiquité plus que la nôtre; que toute leur Bible annonce les promesses de Dieu faites avec serment de ne changer jamais rien à la loi; qu'elle fait des menaces terribles contre quiconque osera jamais en altérer une seule parole; qu'elle veut même qu'on mette à mort tout prophète qui prouverait par des miracles une autre religion; qu'enfin ils sont les enfants de la maison, et nous des étrangers qui avons ravi leurs dépouilles. On sent bien que ce sont là de très mauvaises raisons qui ne méritent pas d'être réfutées.
[47] Nous l'avons déjà dit ailleurs, et nous le répétons ici. Pourquoi? parce que les jeunes Welches, pour l'édification de qui nous écrivons, lisent en courant et oublient tout ce qu'ils lisent.
[48] Voyez le voyage de M. le colonel de Bougainville, et les Lettres sur le Paraguai.
[49] Tiré d'un manuscrit de la bibliothèque de l'évêque de Blois, un Caumartin.
[50] Toutes ces particularités sont détaillées dans l'Histoire des apparitions et visions de l'abbé Langlet.
[51]
Il fallut que quinze évêques de Jérusalem fussent circoncis, et que tout le monde pensât comme eux, coopérât avec eux. St Epiphane Héres. LXX.
J'ai appris par les monuments des anciens, que jusqu'au siège de Jérusalem par Adrien, il y eut quinze évêques de suite natifs de cette ville. Eusèbe liv. IV.
[52] Voyez Spanheim Sacrae antiq. lib. III.
[53] Plaisant assez mauvais et un peu fou.
[54] Le diable chez Zoroastre est Hariman, ou si vous voulez Arimane, il avait été créé. C'était tout comme chez nous originairement; il n'était point principe; il n'obtint cette dignité de mauvais principe qu'avec le temps. Ce diable chez Zoroastre est un serpent qui produisit quarante-cinq mille envies. Le nombre s'en est accru depuis; et c'est depuis ce temps-là qu'à Rome, à Paris, chez les courtisans, dans les armées et chez les moines, nous voyons tant d'envieux.