
CHARLES LOUIS DE SECONDAT BARON MONTESQUIEU,
De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition (1777)
[4 volumes in 1]
 |
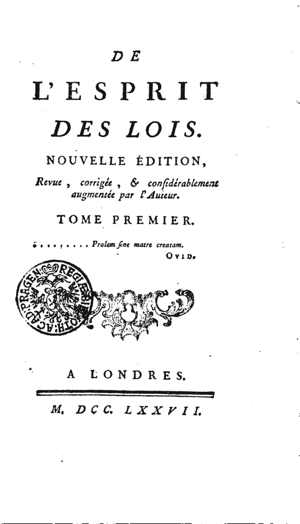 |
| Montesquieu (1689-1755) |
[Created: 29 May, 2023]
[Updated: May 31, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). 4 vols.http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Montesquieu/EspritLois/1777-Garnier/index.html
Charles Louis de Secondat baron Montesquieu, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). 4 vols.
- T1: Avertissement et al.; Livres I-XII: facs. PDF and HTML
- T2: Livres XIII-XXI: facs. PDF and HTML
- T3: Livres XXII-XXIX: facs. PDF and HTML
- T4: Livres XXX-XXXI; Défense de L’Esprit des Lois; Lysimaque; Table des matières: facs. PDF and HTML
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Montesquieu (1689-1755).
Table of Contents (brief)
- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce premier Volume.
- Avertissement sur cette nouvelle édition
- Éloge de M. le Préſident de Montesquieu, par Monſieur d’Alembert.
- Analyse de l’Eſprit des Lois, par le même.
- Discours prononcé par M. de Monteſquieu, lors de ſa réception à l’Académie Françoiſe, en 1728.
- Avertissement de l’Auteur.
- Préface.
- LIVRE PREMIER. Des Lois en général.
- LIVRE II. Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement.
- LIVRE III. Des principes des trois gouvernemens.
- LIVRE IV. Que les lois de l’éducation doivent être relatives au principe du gouvernement.
- LIVRE V. Que les lois que le légiſlateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement.
- LIVRE VI. Conſéquences des principes des divers gouvernemens, par rapport à la ſimplicité des lois civiles & criminelles, la forme des jugemens & l’établiſſement des peines.
- LIVRE VII. Conſéquences des différens principes des trois gouvernemens par rapport aux lois ſomptuaires, au luxe & à la condition des femmes.
- LIVRE VIII. De la corruption des principes des trois gouvernemens.
- LIVRE IX. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force défenſive.
- LIVRE X. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force offenſive.
- LIVRE XI. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec la conſtitution.
- LIVRE XII. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec le citoyen.
- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce ſecond Volume.
- LIVRE XIII. Des rapports que la levée des tributs & la grandeur des revenus publics ont avec la liberté.
- LIVRE XIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat.
- LIVRE XV. Comment les lois de l’eſclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.
- LIVRE XVI. Comment les lois de l’eſclavage domeſtique ont du rapport avec la nature du climat.
- LIVRE XVII. Comment les lois de la ſervitude politique ont du rapport avec la nature du climat.
- LIVRE XVIII. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrain.
- LIVRE XIX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’eſprit général, les mœurs & les manieres d’une nation.
- LIVRE XX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans ſa nature & ſes diſtinctions.
- LIVRE XXI. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.
- La Carte 1
- La Carte 2
- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce troiſieme Volume.
- LIVRE XXII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’uſage de la monnoie.
- LIVRE XXIII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.
- LIVRE XXIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, conſidérée dans ſes pratiques & en elle-même.
- LIVRE XXV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la religion de chaque pays, & ſa police extérieure.
- LIVRE XXVI. Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choſes ſur leſquelles elles ſtatuent.
- LIVRE XXVIII. De l’origine & des révolutions des lois civiles chez les François.
- LIVRE XXIX. De la maniere de compoſer les lois.
- TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce quatrieme Volume.
- LIVRE XXX. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la Monarchie.
- LIVRE XXXI. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur Monarchie.
- DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.
- LYSIMAQUE.
- Table des matières (Index).
TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce premier Volume.
- Avertissement sur cette nouvelle édition
- Éloge de M. le Préſident de Montesquieu, par Monſieur d’Alembert.
- Analyse de l’Eſprit des Lois, par le même.
- Discours prononcé par M. de Monteſquieu, lors de ſa réception à l’Académie Françoiſe, en 1728.
- Avertissement de l’Auteur.
- Préface.
- LIVRE PREMIER. Des Lois en général.
- Chapitre I. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec les divers êtres.
- Ch. II. Des lois de la nature.
- Ch. III. Des lois poſitives.
- LIVRE II. Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement.
- Chapitre I. De la nature des trois divers gouvernemens.
- Ch. II. Du gouvernement républicain & des lois relatives à la démocratie.
- Ch. III. Des lois relatives à la nature de l’ariſtocratie.
- Ch. IV. Des lois dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique.
- Ch. V. Des lois relatives à la nature de l’état deſpotique.
- LIVRE III. Des principes des trois gouvernemens.
- Chapitre I. Différence de la nature du gouvernement & de ſon principe.
- Ch. II. Du principe des divers gouvernemens.
- Ch. III. Du principe de la démocratie.
- Ch. IV. Du principe de l’ariſtocratie.
- Ch. V. Que la vertu n’eſt point le principe du gouvernement monarchique.
- Ch. VI. Comment on ſupplée à la vertu dans le gouvernement monarchique.
- Ch. VII. Du principe de la monarchie.
- Ch. VIII. Que l’honneur n’eſt point le principe des états deſpotiques.
- Ch. IX. Du principe du gouvernement deſpotique.
- Ch. X. Différence de l’obéiſſance dans les gouvernemens modérés & dans les gouvernemens deſpotiques.
- Ch. XI. Réflexions ſur tout ceci.
- LIVRE IV. Que les lois de l’éducation doivent être relatives au principe du gouvernement.
- Chapitre I. Des lois de l’éducation.
- Ch. II. De l’éducation dans les monarchies.
- Ch. III. De l’éducation dans le gouvernement deſpotique.
- Ch. IV. Différence des effets de l’éducation chez les anciens & parmi nous.
- Ch. V. De l’éducation dans le gouvernement républicain.
- Ch. VI. De quelques inſtitutions des Grecs.
- Ch. VII. En quel cas ces inſtitutions ſingulieres peuvent être bonnes.
- Ch. VIII. Explication d’un paradoxe des anciens, par rapport aux mœurs.
- LIVRE V. Que les lois que le légiſlateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement.
- Chapitre. I. Idée de ce Livre.
- Ch. II. Ce que c’eſt que la vertu dans l’état politique.
- Ch. III. Ce que c’eſt que l’amour de la république dans la démocratie.
- Ch. IV. Comment on inſpire l’amour de l’égalité & de la frugalité.
- Ch. V. Comment les lois établiſſent l’égalité dans la démocratie.
- Ch. VI. Comment les lois doivent entretenir la frugalité dans la démocratie.
- Ch. VII. Autres moyens de favoriſer le principe de la démocratie.
- Ch. VIII. Comment les lois doivent ſe rapporter au principe du gouvernement dans l’ariſtocratie.
- Ch. IX. Comment les lois ſont relatives à leur principe dans la monarchie.
- Ch. X. De la promptitude de l’exécution dans la monarchie.
- Ch. XI. De l’excellence du gouvernement monarchique.
- Ch. XII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XIII. Idée du deſpotiſme.
- Ch. XIV. Comment les lois ſont relatives aux principes du gouvernement deſpotique.
- Ch. XV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVI. De la communication du pouvoir.
- Ch. XVII. Des préſens.
- Ch. XVIII. Des récompenſes que le ſouverain donne.
- Ch. XIX. Nouvelles conſéquences des principes des trois gouvernemens.
- LIVRE VI. Conſéquences des principes des divers gouvernemens, par rapport à la ſimplicité des lois civiles & criminelles, la forme des jugemens & l’établiſſement des peines.
- Chapitre I. De la ſimplicité des lois civiles dans les divers gouvernemens.
- Ch. II. De la ſimplicité des lois criminelles dans les divers gouvernemens.
- Ch. III. Dans quels gouvernemens, & dans quels cas on doit juger ſelon un texte précis de la loi.
- Ch. IV. De la maniere de former les jugemens.
- Ch. V. Dans quels gouvernemens le Souverain peut être juge.
- Ch. VI. Que dans la monarchie les miniſtres ne doivent pas juger.
- Ch. VII. Du magiſtrat unique.
- Ch. VIII. Des accuſations dans les divers gouvernemens.
- Ch. IX. De la ſévérité des peines dans les divers gouvernemens.
- Ch. X. Des anciennes lois françoiſes.
- Ch. XI. Que lorſqu’un peuple eſt vertueux, il faut peu de peines.
- Ch. XII. De la puiſſance des peines.
- Ch. XIII. Impuiſſance des lois japonoiſes.
- Ch. XIV. De l’eſprit du Sénat de Rome.
- Ch. XV. Des lois des Romains à l’égard des peines.
- Ch. XVI. De la juſte proportion des peines avec le crime.
- Ch. XVII. De la torture ou queſtion contre les criminels.
- Ch. XVIII. Des peines pécuniaires & des peines corporelles.
- Ch. XIX. De la loi du talion.
- Ch. XX. De la punition des peres pour leurs enfans.
- Ch. XXI. De la clémence du prince.
- LIVRE VII. Conſéquences des différens principes des trois gouvernemens par rapport aux lois ſomptuaires, au luxe & à la condition des femmes.
- Chapitre I. Du luxe.
- Ch. II. Des lois ſomptuaires dans la démocratie.
- Ch. III. Des lois ſomptuaires dans l’ariſtocratie.
- Ch. IV. Des lois ſomptuaires dans les monarchies.
- Ch. V. Dans quel cas les lois ſomptuaires ſont utiles dans une monarchie.
- Ch. VI. Du luxe à la Chine.
- Ch. VII. Fatale conſéquence du luxe à la Chine.
- Ch. VIII. De la continence publique.
- Ch. IX. De la condition des femmes dans les divers gouvernemens.
- Ch. X. Du tribunal domeſtique chez les Romains.
- Ch. XI. Comment les inſtitutions changerent à Rome avec le gouvernement.
- Ch. XII. De la tutelle des femmes chez les Romains.
- Ch. XIII. Des peines établies par les Empereurs contre les débauches des femmes.
- Ch. XIV. Lois ſomptuaires chez les Romains.
- Ch. XV. Des dots & des avantages nuptiaux dans les diverſes conſtitutions.
- Ch. XVI. Belle coutume des Samnites.
- Ch. XVII. De l’adminiſtration des femmes.
- LIVRE VIII. De la corruption des principes des trois gouvernemens.
- Chapitre I. Idée générale de ce Livre.
- Ch. II. De la corruption du principe de la démocratie.
- Ch. III. De l’eſprit d’égalité extrême.
- Ch. IV. Cauſe particuliere de la corruption du peuple.
- Ch. V. De la corruption du principe de l’ariſtocratie.
- Ch. VI. De la corruption du principe de la monarchie.
- Ch. VII. Continuation du même ſujet.
- Ch. VIII. Danger de la corruption du principe du gouvernement monarchique.
- Ch. IX. Combien la nobleſſe eſt portée à défendre le trône.
- Ch. X. De la corruption du principe du gouvernement deſpotique.
- Ch. XI. Effets naturels de la bonté & de la corruption des principes.
- Ch. XII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XIII. Effet du ſerment chez un peuple vertueux.
- Ch. XIV. Comment le plus petit changement dans la conſtitution entraîne la ruine des principes.
- Ch. XV. Moyens très-efficaces pour la conſervation des trois principes.
- Ch. XVI. Propriétés diſtinctives de la république.
- Ch. XVII. Propriétés diſtinctives de la monarchie.
- Ch. XVIII. Que la monarchie d’Eſpagne étoit dans un cas particulier.
- Ch. XIX. Propriétés diſtinctives du gouvernement deſpotique.
- Ch. XX. Conſéquences des Chapitres précédens.
- Ch. XXI. De l’empire de la Chine.
- LIVRE IX. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force défenſive.
- Chapitre. I. Comment les républiques pourvoient à leur ſureté.
- Ch. II. Que la conſtitution fédérative doit être compoſée d’états de même nature, ſur-tout d’états républicains.
- Ch. III. Autres choſes requiſes dans la république fédérative.
- Ch. IV. Comment les états deſpotiques pourvoient à leur ſureté.
- Ch. V. Comment la monarchie pourvoit à ſa ſureté.
- Ch. VI. De la force défenſive des états en général.
- Ch. VII. Réflexions.
- Ch. VIII. Cas où la force défenſive d’un état eſt inférieure à ſa force offenſive.
- Ch. IX. De la force relative des états.
- Ch. X. De la foibleſſe des états voiſins.
- LIVRE X. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force offenſive.
- Chapitre. I. De la force offenſive.
- Ch. II. De la guerre.
- Ch. III. Du droit de conquête.
- Ch. IV. Quelques avantages du peuple conquis.
- Ch. V. Gélon, roi de Syracuſe.
- Ch. VI. D’une république qui conquiert.
- Ch. VII. Continuation du même ſujet.
- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. IX. D’une monarchie qui conquiert autour d’elle.
- Ch. X. D’une monarchie qui conquiert une autre monarchie.
- Ch. XI. Des mœurs du peuple vaincu.
- Ch. XII. D’une loi de Cyrus.
- Ch. XIII. Charles XII.
- Ch. XIV. Alexandre.
- Ch. XV. Nouveaux moyens de conſerver la conquête.
- Ch. XVI. D’un état deſpotique qui conquiert.
- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.
- LIVRE XI. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec la conſtitution.
- Chapitre. I. Idée générale de ce Livre.
- Ch. II. Diverſes ſignifications données au mot de liberté.
- Ch. III. Ce que c’eſt que la liberté.
- Ch. IV. Continuation du même ſujet.
- Ch. V. De l’objet des états divers.
- Ch. VI. De la conſtitution d’Angleterre.
- Ch. VII. Des monarchies que nous connoiſſons.
- Ch. VIII. Pourquoi les anciens n’avoient pas une idée bien claire de la monarchie.
- Ch. IX. Maniere de penſer d’Ariſtote.
- Ch. X. Maniere de penſer des autres politiques.
- Ch. XI. Des Rois des temps héroïques chez les Grecs.
- Ch. XII. Du gouvernement des Rois de Rome, & comment les trois pouvoirs y furent diſtribués.
- Ch. XIII. Réflexions générales ſur l’état de Rome après l’expulſion des Rois.
- Ch. XIV. Comment la diſtribution des trois pouvoirs commença à changer après l’expulſion des Rois.
- Ch. XV. Comment, dans l’état floriſſant de la république, Rome perdit tout à coup ſa liberté.
- Ch. XVI. De la puiſſance légiſlative dans la république romaine.
- Ch. XVII. De la puiſſance exécutrice dans la même république.
- Ch. XVIII. De la puiſſance de juger dans le gouvernement de Rome.
- Ch. XIX. Du gouvernement des provinces romaines.
- Ch. XX. Fin de ce Livre.
- LIVRE XII. Des lois qui forment la liberté politique dans ſon rapport avec le citoyen.
- Chapitre. I. Idée de ce Livre.
- Ch. II. De la liberté du citoyen.
- Ch. III. Continuation du même ſujet.
- Ch. IV. Que la liberté eſt favoriſée par la nature des peines & leur proportion.
- Ch. V. De certaines accuſations qui ont particuliérement beſoin de modération & de prudence.
- Ch. VI. Du crime contre nature.
- Ch. VII. Du crime de leſe-majeſté.
- Ch. VIII. De la mauvaiſe application du nom de crime de ſacrilege & de leſe-majeſté.
- Ch. IX. Continuation du même ſujet.
- Ch. X. Continuation du même ſujet.
- Ch. XI. Des penſées.
- Ch. XII. Des paroles indiſcrettes.
- Ch. XIII. Des écrits.
- Ch. XIV. Violation de la pudeur dans la punition des crimes.
- Ch. XV. De l’affranchiſſement de l’eſclave pour accuſer le maître.
- Ch. XVI. Calomnie dans le crime de leſe-majeſté.
- Ch. XVII. De la révélation des conſpirations.
- Ch. XVIII. Combien il eſt dangereux dans les républiques de trop punir le crime de leſe-majeſté.
- Ch. XIX. Comment on ſuſpend l’uſage de la liberté dans la république.
- Ch. XX. Des lois favorables à la liberté du citoyen dans la république.
- Ch. XXI. De la cruauté des lois envers les débiteurs dans la république.
- Ch. XXII. Des choſes qui attaquent la liberté dans la monarchie.
- Ch. XXIII. Des eſpions dans la monarchie.
- Ch. XXIV. Des lettres anonymes.
- Ch. XXV. De la maniere de gouverner dans la monarchie.
- Ch. XXVI. Que, dans la monarchie le prince doit être acceſſible.
- Ch. XXVII. Des mœurs du monarque.
- Ch. XXVIII. Des égards que les monarques doivent à leurs ſujets.
- Ch. XXIX. Des lois civiles propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement deſpotique.
- Ch. XXX. Continuation du même ſujet.
TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce ſecond Volume.
- LIVRE XIII. Des rapports que la levée des tributs & la grandeur des revenus publics ont avec la liberté.
- Chapitre I. Des revenus de l’état.
- Ch. II. Que c’eſt mal raiſonner, de dire que la grandeur des tributs ſoit bonne par elle-même.
- Ch. III. Des tributs, dans les pays où une partie du peuple eſt eſclave de la glebe.
- Ch. IV. D’une république en cas pareil.
- Ch. V. D’une monarchie en cas pareil.
- Ch. VI. D’un état deſpotique en cas pareil.
- Ch. VII. Des tributs, dans les pays ou l’eſclavage de la glebe n’eſt point établi.
- Ch. VIII. Comment on conferve l’illuſion.
- Ch. IX. D’une mauvaiſe ſorte d’impôt.
- Ch. X. Que la grandeur des tributs dépend de la nature du gouvernement.
- Ch. XI. Des peines fiſcales.
- Ch. XII. Rapport de la grandeur des tributs avec la liberté.
- Ch. XIII. Dans quels gouvernemens les tributs ſont ſuſceptibles d’augmentation.
- Ch. XIV. Que la nature des tributs eſt relative au gouvernement.
- Ch. XV. Abus de la liberté.
- Ch. XVI. Des conquêtes des Mahométans.
- Ch. XVII. De l’augmentation des troupes.
- Ch. XVIII. De la remiſe des tributs.
- Ch. XIX. Qu’eſt-ce qui eſt plus convenable au prince & au peuple, de la ferme ou de la régie des tributs ?
- Ch. XX. Des traitans.
- LIVRE XIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat.
- Chapitre I. Idée générale.
- Ch. II. Combien les hommes ſont différens dans les divers climats.
- Ch. III. Contradiction dans les caracteres de certains peuples du midi.
- Ch. IV. Cauſe de l’immuabilité de la religion, des mœurs, des manieres, des lois, dans les pays d’orient.
- Ch. V. Que les mauvais légiſlateurs ſont ceux qui ont favoriſé les vices du climat, & les bons ſont ceux qui s’y ſont oppoſés.
- Ch. VI. De la culture des terres dans les climats chauds.
- Ch. VII. Du monachiſme.
- Ch. VIII. Bonne coutume de la Chine.
- Ch. IX. Moyens d’encourager l’induſtrie.
- Ch. X. Des lois qui ont rapport à la ſobriété des peuples.
- Ch. XI. Des lois qui ont rapport aux maladies du climat.
- Ch. XII. Des lois contre ceux qui ſe tuent eux-mêmes.
- Ch. XIII. Effets qui réſultent du climat d’Angleterre.
- Ch. XIV. Autres effets du climat.
- Ch. XV. De la différente confiance que les lois ont dans le peuple ſelon les climats.
- LIVRE XV. Comment les lois de l’eſclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.
- Chapitre I. De l’eſclavage civil.
- Ch. II. Origine du droit de l’eſclavage chez les juriſconſultes Romains.
- Ch. III. Autre origine du droit de l’eſclavage.
- Ch. IV. Autre origine du droit de l’eſclavage.
- Ch. V. De l’eſclavage des Negres.
- Ch. VI. Véritable origine du droit de l’eſclavage.
- Ch. VII. Autre origine du droit de l’eſclavage.
- Ch. VIII. Inutilité de l’eſclavage parmi nous.
- Ch. IX. Des nations chez leſquelles la liberté civile eſt généralement établie.
- Ch. X. Diverſes eſpeces d’eſclavage.
- Ch. XI. Ce que les lois doivent faire par rapport à l’eſclavage.
- Ch. XII. Abus de l’eſclavage.
- Ch. XIII. Danger du grand nombre d’eſclaves.
- Ch. XIV. Des eſclaves armés.
- Ch. XV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVI. Précautions à prendre dans le gouvernement modéré.
- Ch. XVII. Réglemens à faire entre le maître & les eſclaves.
- Ch. XVIII. Des affranchiſſemens.
- Ch. XIX. Des affranchis & des eunuques.
- LIVRE XVI. Comment les lois de l’eſclavage domeſtique ont du rapport avec la nature du climat.
- Chapitre I. De la ſervitude domeſtique.
- Ch. II. Que dans les pays du midi il y a dans les deux ſexes une inégalité naturelles.
- Ch. III. Que la pluralité des femmes dépend beaucoup de leur entretien.
- Ch. IV. De la polygamie. Ses diverſes circonſtances.
- Ch. V. Raiſons d’une loi du Malabar.
- Ch. VI. De la polygamie en elle-même.
- Ch. VII. De l’égalité du traitement dans le cas de la pluralité des femmes.
- Ch. VIII. De la ſéparation des femmes d’avec les hommes.
- Ch. IX. Liaiſon du gouvernement domeſtique avec le politique.
- Ch. X. Principe de la morale de l’Orient.
- Ch. XI. De la ſervitude domeſtique, indépendante de la polygamie.
- Ch. XII. De la pudeur naturelle.
- Ch. XIII. De la jalouſie.
- Ch. XIV. Du gouvernement de la maiſon en Orient.
- Ch. XV. Du divorce & de la répudiation.
- Ch. XVI. De la répudiation & du divorce chez les Romains.
- LIVRE XVII. Comment les lois de la ſervitude politique ont du rapport avec la nature du climat.
- Chapitre I. De la ſervitude politique.
- Ch. II. Différence des peuples, par rapport au courage.
- Ch. III. Du climat de l’Aſie.
- Ch. IV. Conſéquence de ceci.
- Ch. V. Que quand les peuples du nord de l’Aſie & ceux du nord de l’Europe, ont conquis, les effets de la conquête n’étoient pas les mêmes.
- Ch. VI. Nouvelle cauſe phyſique de la ſervitude de l’Aſie & de la liberté de l’Europe.
- Ch. VII. De l’Afrique & de l’Amérique.
- Ch. VIII. De la capitale de l’Empire.
- LIVRE XVIII. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrain.
- Chapitre I. Comment la nature du terrain influe ſur les Lois.
- Ch. II. Continuation du même ſujet.
- Ch. III. Quels ſont les pays les plus cultivés.
- Ch. IV. Nouveaux effets de la fertilité & de la ſtérilité du pays.
- Ch. V. Des peuples des îles.
- Ch. VI. Des pays formés par l’induſtrie des hommes.
- Ch. VII. Des ouvrages des hommes.
- Ch. VIII. Rapport général des lois.
- Ch. IX. Du terrain de l’Amérique.
- Ch. X. Du nombre des hommes dans le rapport avec la maniere dont ils ſe procurent la ſubſiſtance.
- Ch. XI. Des peuples ſauvages & des peuples barbares.
- Ch. XII. Du droit des gens chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
- Ch. XIII. Des lois civiles chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
- Ch. XIV. De l’état politique des peuples qui ne cultivent point les terres.
- Ch. XV. Des peuples qui connoiſſent l’uſage de la monnoie.
- Ch. XVI. Des lois civiles chez les peuples qui ne connoiſſent point l’uſage de la monnoie.
- Ch. XVII. Des lois politiques chez les peuples qui n’ont point l’uſage de la monnoie.
- Ch. XVIII. Force de la ſuperſtition.
- Ch. XIX. De la liberté des Arabes, & de la ſervitude des Tartares.
- Ch. XX. Du droit des gens des Tartares.
- Ch. XXI. Loi civile des Tartares.
- Ch. XXII. D’une loi civile des peuples Germains.
- Ch. XXIII. De la longue chevelure des Rois Francs.
- Ch. XXIV. Des mariages des Rois Francs.
- Ch. XXV. Childeric.
- Ch. XXVI. De la majorité des Rois Francs.
- Ch. XXVII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXVIII. De l’adoption chez les Germains.
- Ch. XXIX. Eſprit ſanguinaire des Rois Francs.
- Ch. XXX. Des aſſemblées de la nation chez les Francs.
- Ch. XXXI. De l’autorité du Clergé dans la premiere race.
- LIVRE XIX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’eſprit général, les mœurs & les manieres d’une nation.
- Chapitre I. Du ſujet de ce Livre.
- Ch. II. Combien, pour les meilleurs lois, il eſt néceſſaire que les eſprits ſoient préparés.
- Ch. III. De la tyrannie.
- Ch. IV. Ce que c’eſt que l’eſprit général.
- Ch. V. Combien il faut être attentif à ne point changer l’eſprit général d’une nation.
- Ch. VI. Qu’il ne faut pas tout corriger.
- Ch. VII. Des Athéniens & des Lacédémoniens.
- Ch. VIII. Effets de l’humeur ſociable.
- Ch. IX. De la vanité & de l’orgueil des nations.
- Ch. X. Du caractere des Eſpagnols, & de celui des Chinois.
- Ch. XI. Réflexions.
- Ch. XII. Des manieres & des mœurs dans l’état deſpotique.
- Ch. XIII. Des manieres chez les Chinois.
- Ch. XIV. Quels ſont les moyens naturels de changer les mœurs & les manieres d’une nation.
- Ch. XV. Influence du gouvernement domeſtique ſur le politique.
- Ch. XVI. Comment quelques légiſlateurs ont confondu les principes qui gouvernent les hommes.
- Ch. XVII. Propriété particuliere au gouvernernent de la Chine.
- Ch. XVIII. Conſéquence du chapitre précédent.
- Ch. XIX. Comment s’eſt faite cette union de la religion, des lois, des mœurs & des manieres chez les Chinois.
- Ch. XX. Explication d’un paradoxe ſur les Chinois.
- Ch. XXI. Comment les lois doivent être relatives aux mœurs & aux manieres.
- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXIII. Comment les lois ſuivent les mœurs.
- Ch. XXIV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXVI. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXVII. Comment les lois peuvent contribuer à former les mœurs, les manieres & le caractere d’une nation.
- LIVRE XX. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans ſa nature & ſes diſtinctions.
- Chapitre I. Du Commerce.
- Ch. II. De l’eſprit du Commerce.
- Ch. III. De la pauvreté des peuples.
- Ch. IV. Du Commerce dans les divers Gouvernemens.
- Ch. V. Des peuples qui ont fait le commerce d’économie.
- Ch. VI. Quelques effets d’une grande navigation.
- Ch. VII. Eſprit de l’Angleterre ſur le commerce.
- Ch. VIII. Comment on a gêné quelquefois le commerce d’économie.
- Ch. IX. De l’excluſion en fait de commerce.
- Ch. X. Établiſſement propre au commerce d’économie.
- Ch. XI. Continuation du même ſujet.
- Ch. XII. De la liberté du commerce.
- Ch. XIII. Ce qui détruit cette liberté.
- Ch. XIV. Des lois du commerce qui emportent la confiſcation des marchandiſes.
- Ch. XV. De la contrainte par corps.
- Ch. XVI. Belle loi.
- Ch. XVII. Loi de Rhodes.
- Ch. XVIII. Des Juges pour le commerce.
- Ch. XIX. Que le prince ne doit point faire le commerce.
- Ch. XX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXI. Du commerce de la nobleſſe dans la monarchie.
- Ch. XXII. Réflexion particuliere.
- Ch. XXIII. À quelles nations il eſt déſavantageux de faire le commerce.
- LIVRE XXI. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, conſidéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.
- Chapitre I. Quelques conſidérations générales.
- Ch. II. Des peuples d’Afrique.
- Ch. III. Que les beſoins des peuples du midi ſont différent de ceux des peuples du nord.
- Ch. IV. Principale différence du commerce des anciens, d’avec celui d’aujourd’hui.
- Ch. V. Autres différences.
- Ch. VI. Du commerce des anciens.
- Ch. VII. Du commerce des Grecs.
- Ch. VIII. D’Alexandre. Sa conquête.
- Ch. IX. Du commerce des Rois Grecs après Alexandre.
- Ch. X. Du tour de l’Afrique.
- Ch. XI. Carthage & Marſeille.
- Ch. XII. Ile de Délos. Mithridate.
- Ch. XIII. Du génie des Romains pour la marine.
- Ch. XIV. Du génie des Romains pour le commerce.
- Ch. XV. Commerce des Romains avec les Barbares.
- Ch. XVI. Du commerce des Romains avec l’Arabie & les Indes.
- Ch. XVII. Du commerce après la deſtruction des Romains en Occident.
- Ch. XVIII. Réglement particulier.
- Ch. XIX. Du commerce, depuis l’affoibliſſement des Romains en Orient.
- Ch. XX. Comment le commerce ſe fit jour en Europe à travers la barbarie.
- Ch. XXI. Découverte de deux nouveaux mondes. État de l’Europe à cet égard.
- Ch. XXII. Des richeſſes que l’Eſpagne tira de l’Amérique.
- Ch. XXIII. Problême.
- La Carte 1
- La Carte 2
TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce troiſieme Volume.
- LIVRE XXII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’uſage de la monnoie.
- Chapitre I. Raison de l’uſage de la monnoie.
- Ch. II. De la nature de la monnoie.
- Ch. III. Des monnoies idéales.
- Ch. IV. De la quantité de l’or & de l’argent.
- Ch. V. Continuation du même ſujet.
- Ch. VI. Par quelle raiſon le prix de l’uſure diminua de la moitié, lors de la découverte des Indes.
- Ch. VII. Comment le prix des choſes ſe fixe par la variation des richeſſes de ſigne.
- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. IX. De la rareté relative de l’or & de l’argent.
- Ch. X. Du change.
- Ch. XI. Des opérations que les Romains firent ſur les monnoies.
- Ch. XII. Circonstances dans leſquelles les Romains firent leurs opérations ſur la monnoie.
- Ch. XIII. Opérations ſur les monnoies du temps des Empereurs.
- Ch. XIV. Comment le change gêne les états deſpotiques.
- Ch. XV. Uſage de quelques pays d’Italie.
- Ch. XVI. Du ſecours que l’état peut tirer des banquiers.
- Ch. XVII. Des dettes publiques.
- Ch. XVIII. Du payement des dettes publiques.
- Ch. XIX. Des prêts à intérêt.
- Ch. XX. Des uſures maritimes.
- Ch. XXI. Du prêt par contrat & de l’uſure chez les Romains.
- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.
- LIVRE XXIII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.
- Chapitre I. Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur eſpece.
- Ch. II. Des mariages.
- Ch. III. De la condition des enfans.
- Ch. IV. Des familles.
- Ch. V. Des divers ordres de femmes légitimes.
- Ch. VI. Des bâtards dans les divers gouvernemens.
- Ch. VII. Du conſentement des peres au mariage.
- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. IX. Des filles.
- Ch. X. Ce qui détermine au mariage.
- Ch. XI. De la dureté du gouvernement.
- Ch. XII. Du nombre des filles & des garçons dans différens pays.
- Ch. XIII. Des ports de mer.
- Ch. XIV. Des productions de la terre qui demandent plus ou moins d’hommes.
- Ch. XV. Du nombre des habitans par rapport aux arts.
- Ch. XVI. Des vues du légiſlateur ſur la propagation de l’eſpece.
- Ch. XVII. De la Grece & du nombre de ſes habitans.
- Ch. XVIII. De l’état des peuples avant les Romains.
- Ch. XIX. Dépopulation de l’univers.
- Ch. XX. Que les Romains furent dans la néceſſité de faire des lois pour la propagation de l’eſpece.
- Ch. XXI. Des lois des Romains ſur la propagation de l’eſpece.
- Ch. XXII. De l’expoſition des enfans.
- Ch. XXIII. De l’état de l’univers après la deſtruction des Romains.
- Ch. XXIV. Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans,
- Ch. XXV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXVI. Conſéquences.
- Ch. XXVII. De la loi faite en France pour encourager la propagation de l’eſpece.
- Ch. XXVIII. Comment on peut remédier à la dépopulation,
- Ch. XXIX. Des hôpitaux.
- LIVRE XXIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, conſidérée dans ſes pratiques & en elle-même.
- Chapitre I. Des religions en général.
- Ch. II. Paradoxe de Bayle.
- Ch. III. Que le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne, & le gouvernement deſpotique à la Mahométane.
- Ch. IV. Conſéquences du caractere de la religion Chrétienne, & de celui de la Mahométane.
- Ch. V. Que la religion catholique convient mieux à une monarchie, & que la proteſtante s’accommode mieux d’une république.
- Ch. VI. Autre paradoxe de Bayle.
- Ch. VII. Des lois de perfection dans la religion.
- Ch. VIII. De l’accord des lois de la morale avec celles de la religion.
- Ch. IX. Des Eſſéens.
- Ch. X. De la ſecte ſtoïque.
- Ch. XI. De la contemplation.
- Ch. XII. Des pénitences.
- Ch. XIII. Des crimes inexpiables,
- Ch. XIV. Comment la force de la religion s’applique à celle des lois civiles.
- Ch. XV. Comment les lois civiles corrigent quelquefois les fauſſes religions.
- Ch. XVI. Comment les lois de la religion corrigent les inconvéniens de la conſtitution politique.
- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVIII. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles.
- Ch. XIX. Que c’eſt moins la vérité ou la fauſſeté d’un dogme qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans l’état civil, que l’uſage ou l’abus que l’on en fait.
- Ch. XX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXI. De la métempſycoſe.
- Ch. XXII. Combien il eſt dangereux que la religion inſpire de l’horreur pour des choſes indifférentes.
- Ch. XXIII. Des fêtes.
- Ch. XXIV. Des lois de religion locales.
- Ch. XXV. Inconvénient du tranſport d’une religion d’un pays à un autre.
- Ch. XXVI. Continuation du même ſujet.
- LIVRE XXV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la religion de chaque pays, & ſa police extérieure.
- Chapitre I. Du ſentiment pour la religion.
- Ch. II. Du motif d’attachment pour les diverſes religions.
- Ch. III. Des Temples.
- Ch. IV. Des Miniſtres de la religion.
- Ch. V. Des bornes que les lois doivent mettre aux richeſſes du Clergé.
- Ch. VI. Des Monaſteres.
- Ch. VII. Du luxe de la ſuperſtition.
- Ch. VIII. Du Pontificat.
- Ch. IX. De la tolérance en fait de religion.
- Ch. X. Continuation du même ſujet.
- Ch. XI. Du changement de religion.
- Ch. XII. Des lois pénales.
- Ch. XIII. Très-humble remontrance aux Inquiſiteurs d’Eſpagne & de Portugal.
- Ch. XIV. Pourquoi la Religion chrétienne eſt ſi odieuſe au Japon.
- Ch. XV. De la propagation de religion.
- LIVRE XXVI. Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choſes ſur leſquelles elles ſtatuent.
- Chapitre I. Idée de ce Livre.
- Ch. II. Des lois divines & des lois humaines.
- Ch. III. Des lois civiles qui ſont contraires à la loi naturelle.
- Ch. IV. Continuation du même ſujet.
- Ch. V. Cas où l’on peut juger par les principes du droit civil, en modifiant les principes du droit naturel.
- Ch. VI. Que l’ordre des ſucceſſions depend des principes du droit politique ou civil & non pas des principes du droit naturel.
- Ch. VII. Qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorſqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle.
- Ch. VIII. Qu’il ne faut pas régler, par les principes du droit qu’on appelle canonique, les choſes réglées par les principes du droit civil.
- Ch. IX. Que les choſes qui doivent être réglées par les principes du droit civil, peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion.
- Ch. X. Dans quel cas il faut ſuivre la loi civile qui permet, & non pas la loi de la religion qui défend.
- Ch. XI. Qu’il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie.
- Ch. XII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XIII. Dans quel cas il faut ſuivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion ; & dans quel cas il faut ſuivre les lois civiles.
- Ch. XIV. Dans quels cas, dans les mariages entre parens, il faut ſe régler par les lois de la nature ; dans quels cas on doit ſe régler par les lois civiles.
- Ch. XV. Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique les choſes qui dépendent des principes du droit civil.
- Ch. XVI. Qu’il ne faut point décider par les regles du droit civil, quand il s’agit de décider par celles du droit politique.
- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVIII. Qu’il faut examiner ſi les lois, qui paroiſſent ſe contredire, ſont du même ordre.
- Ch. XIX. Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles les choſes qui doivent l’être par les lois domeſtiques.
- Ch. XX. Qu’il ne faut pas décider par les principes des lois civiles les choſes qui appartiennent au droit des gens.
- Ch. XXI. Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques les choſes qui appartiennent au droit des gens.
- Ch. XXII. Malheureux fort de l’Ynca Athualpa.
- Ch. XXIII. Que lorſque, par quelque circonſtance, la loi politique détruit l’état, il faut décider par la loi politique qui le conſerve, qui devient quelquefois un droit des gens.
- Ch. XXIV. Que les réglemens de police ſont d’un autre ordre que les autres lois civiles.
- Ch. XXV. Qu’il ne faut pas ſuivre les diſpoſitions générales du droit civil, lorſqu’il s’agit de choſes qui doivent être ſoumiſes à des regles particulieres tirées de leur propre nature.
- LIVRE XXVII.
- Chapitre unique. De l’origine & des révolutions des lois des Romains ſur les ſucceſſions.
- LIVRE XXVIII. De l’origine & des révolutions des lois civiles chez les François.
- Chapitre I. Du différent caractere des lois des peuples Germains.
- Ch. II. Que les lois des Barbares furent toutes perſonnelles.
- Ch. III. Différence capitale entre les lois Saliques & les lois des Wiſigoths & des Bourguignons.
- Ch. IV. Comment le droit romain ſe perdit dans le pays du domaine des Francs, & ſe conſerva dans le pays du domaine des Goths & des Bourguignons.
- Ch. V. Continuation du même ſujet.
- Ch. VI. Comment le droit romain ſe conſerva dans le domaine des Lombards.
- Ch. VII. Comment le droit romain ſe perdit en Eſpagne.
- Ch. VIII. Faux capitulaire.
- Ch. IX. Comment les codes des lois des Barbaras & les capitulaires ſe perdirent.
- Ch. X. Continuation du même ſujet.
- Ch. XI. Autres cauſes de la chute des codes des lois des Barbares, du droit romain & des Capitulaires.
- Ch. XII. Des coutumes locales ; révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit romain.
- Ch. XIII. Différence de la loi Salique ou des Francs ſaliens, d’avec celle des Francs ripuaires & des autres peuples Barbares.
- Ch. XIV. Autre différence.
- Ch. XV. Réflexion.
- Ch. XVI. De la preuve par l’eau bouillante établie par la loi Salique.
- Ch. XVII. Maniere de penſer de nos peres.
- Ch. XVIII. Comment la preuve par le combat s’étendit.
- Ch. XIX. Nouvelle raiſon de l’oubli des lois Saliques, des lois Romaines & des Capitulaires.
- Ch. XX. Origine du point d’honneur.
- Ch. XXI. Nouvelle réflexion ſur le point d’honneur chez les Germains.
- Ch. XXII. Des mœurs relatives aux combats.
- Ch. XXIII. De la juriſprudence du combat judiciaire.
- Ch. XXIV. Regles établies dans le combat judiciaire.
- Ch. XXV. Des bornes que l’on mettoit à l’uſage du combat judiciaire.
- Ch. XXVI. Du combat judiciaire, entre une des parties & un des témoins.
- Ch. XXVII. Du combat judiciaire, entre une partie & un des pairs du ſeigneur. Appel de faux jugement.
- Ch. XXVIII. De l’appel de défaute de droit.
- Ch. XXIX. Epoque du regne de ſaint Louis.
- Ch. XXX. Obſervation ſur les appels.
- Ch. XXXI. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXIV. Comment la procédure devint ſecrette.
- Ch. XXXV. Des dépens.
- Ch. XXXVI. De la partie publique.
- Ch. XXXVII. Comment les établiſſemens de ſaint Louis tomberent dans l’oubli.
- Ch. XXXVIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXIX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XL. Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.
- Ch. XLI. Flux & reflux de la juridiction Eccléſiaſtique & de la juridiction laye.
- Ch. XLII. Renaiſſance du droit romain, & ce qui en réſulta. Changemens dans les tribunaux.
- Ch. XLIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XLIV. De la preuve par témoins.
- Ch. XLV. Des coutumes de France.
- LIVRE XXIX. De la maniere de compoſer les lois.
- Chapitre I. De l’eſprit du Légiſlateur.
- Ch. II. Continuation du même ſujet.
- Ch. III. Que les lois qui paroiſſent s’éloigner des vues du Légiſlateur, y ſont ſouvent conformes.
- Ch. IV. Des lois qui choquent les vues du Légiſlateur.
- Ch. V. Continuation du même ſujet.
- Ch. VI. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, n’ont pas toujours le mêne effet.
- Ch. VII. Continuation du même ſujet. Néceſſité de bien compoſer les lois.
- Ch. VIII. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, n’ont pas toujours eu le même motif.
- Ch. IX. Que les lois Grecques & Romaines ont puni l’homicide de ſoi-même, ſans avoir le même motif.
- Ch. X. Que les lois qui paroiſſent contraires, dérivent quelquefois du même eſprit.
- Ch. XI. De quelle maniere deux lois diverſes peuvent être comparées.
- Ch. XII. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, ſont réellement quelquefois différentes.
- Ch. XIII. Qu’il ne faut point ſéparer les lois de l’objet pour lequel elles ſont faites. Des lois Romaines ſur le vol.
- Ch. XIV. Qu’il ne faut point ſéparer les lois des circonſtances dans leſquelles elles ont été faites.
- Ch. XV. Qu’il est bon quelquefois qu’une loi ſe corrige elle-même.
- Ch. XVI. Choſes à obſerver dans la compoſition des lois.
- Ch. XVII. Mauvaiſe maniere de donner des lois.
- Ch. XVIII. Des idées d’uniformité,
- Ch. XIX. Des légiſlateurs.
TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce quatrieme Volume.
- LIVRE XXX. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la Monarchie.
- Chapitre I. Des lois féodales,
- Ch. II. Des ſources des lois féodales.
- Ch. III. Origine du vaſſelage.
- Ch. IV. Continuation du même ſujet.
- Ch. V. De la conquête des Francs.
- Ch. VI. Des Goths, des Bourguignons & des Francs.
- Ch. VII. Différentes manieres de partager les terres.
- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. IX. Juſte application de la loi des Bourguignons & de celles des Wiſigoths ſur le partage des terres.
- Ch. X. Des ſervitudes.
- Ch. XI. Continuation du même ſujet.
- Ch. XII. Que les terres du partage des Barbares ne payoient point de tributs.
- Ch. XIII. Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la Monarchie des Francs.
- Ch. XIV. De ce qu’on appelloit cenſus.
- Ch. XV. Que ce que l’on appelloit cenſus, ne ſe levoit que ſur les ſerfs, & non pas ſur les hommes libres.
- Ch. XVI. Des leudes ou vaſſaux.
- Ch. XVII. Du ſervice militaire des hommes libres.
- Ch. XVIII. Du double ſervice.
- Ch. XIX. Des compoſitions chez les peuples Barbares.
- Ch. XX. De ce que l’on a appellé depuis la juſtice des ſeigneurs.
- Ch. XXI. De la juſtice territoriale des égliſes.
- Ch. XXII. Que les juſtices étoient établies avant la fin de la ſeconde race.
- Ch. XXIII. Idée générale du Livre de I’établiſſement de la Monarchie Françoiſe dans les Gaules, par M. l’abbé Dubos.
- Ch. XXIV. Continuation du même ſujet. Réflexions ſur le fond du ſyſtême.
- Ch. XXV. De la nobleſſe Françoiſe.
- LIVRE XXXI. Théorie des lois féodales chez les Francs dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur Monarchie.
- Chapitre I. Changemens dans les offices & les fiefs.
- Ch. II. Comment le gouvernement civil fut réformé.
- Ch. III. Autorité des Maires du palais.
- Ch. IV. Quel étoit, à l’égard des Maires, le génie de la nation.
- Ch. V. Comment les Maires obtinrent le commandement des armées.
- Ch. VI. Seconde époque de l’abaiſſement des rois de la premiere race.
- Ch. VII. Des grands offices & des fiefs ſous les Maires du palais.
- Ch. VIII. Comment les aleux furent changés en fiefs.
- Ch. IX. Comment les biens eccléſiaſtiques furent convertis en fiefs.
- Ch. X. Richeſſes du Clergé.
- Ch. XI. Etat de l’Europe du temps de Charles-Martel.
- Ch. XII. Etabliſſement des dîmes.
- Ch. XIII. Des élections aux Evêchés & Abbayes.
- Ch. XIV. Des fiefs de Charles-Martel.
- Ch. XV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVI. Confuſion de la royauté & de la mairerie. Seconde race.
- Ch. XVII. Choſe particuliere dans l’élection des rois de la ſeconde race.
- Ch. XVIII. Charlemagne.
- Ch. XIX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XX. Louis le Débonnaire.
- Ch. XXI. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXIV. Que les hommes libres furent rendus capables de poſſéder des fiefs.
- Cause principale de l’affoiblissement de la seconde race.
- Ch. XXV. Changement dans les aleux.
- Ch. XXVI. Changement dans les fiefs.
- Ch. XXVII. Autre changement arrivé dans les fiefs.
- Ch. XXVIII. Changements arrivés dans les grands offices & dans les fiefs.
- Ch. XXIX. De la nature des fiefs depuis le regne de Charles le Chauve.
- Ch. XXX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXI. Comment l’empire ſortit de la maiſon de Charlemagne.
- Ch. XXXII. Comment la couronne de France paſſa dans la maiſon de Hugues Capet.
- Ch. XXXIII. Quelques conſéquences de la perpétuité des fiefs.
- Ch. XXXIV. Continuation du même ſujet.
- DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.
- Premiere Partie.
- Seconde Partie.
- Idée générale.
- Des conſeils de religion.
- De la polygamie.
- Climat.
- Tolérance.
- Célibat.
- Erreur particuliere du critique.
- Mariage.
- Uſure.
- Des uſures maritimes.
- Troisieme partie.
- Eclaircissemens sur l’esprit des Lois.
- LYSIMAQUE.
- Table des matières (Index).
De l' Esprit ses Lois.
Nouvelle Édition
... Prolem sine matre creatum.
OVID.
[I-11]
AVERTISSEMENT
Sur cette nouvelle Édition.↩
Le Livre de l’Esprit des Lois a enfin franchi tous les obstacles que l’envie & la superstition avoient entrepris de lui opposer : toute l’Europe retentit des justes louanges dues à cet Ouvrage immortel ; il est pour les nations éclairées un motif de jalousie contre la France, qui a eu le bonheur de voir naître M. de Montesquieu dans son sein, & de l’y conserver jusqu’au fatal instant où la terre a perdu ce grand homme. Par-tout son Livre est cité avec vénération ; & si un Auteur croit devoir, en quelque circonstance particuliere, penser autrement que cet illustre Écrivain, il le fait avec une réserve [I-12] respectueuse ; il demande, pour ainsi dire, pardon de ce qu’il ose trouver une faute dans un Livre, que le genre humain a choisi pour y puiser ses instructions sur la saine politique.
Ce n’est point un aveugle enthousiasme qui produit des louanges si générales & si unanimes ; elles sont le juste tribut de la reconnoissance que l’univers doit à cet illustre Auteur. C’est lui qui nous a éclairés sur les vrais principes du droit public : c’est à son flambeau que se sont éclipsés les ouvrages les plus renommés sur cette matière ; c’est avec le secours de sa lumière que nous avons enfin substitué la raison & la vérité aux systèmes fondés sur les préjugés qui s’étoient transmis d’âge en âge, & que de célèbres écrivains n’avoient fait que recueillir, développer & appuyer par de nouveaux sophismes. Le Livre de [I-13] l’Esprit des Lois fait une époque à jamais mémorable dans l’histoire des connoissances humaines.
M. de Montesquieu jouit, dès son vivant, des éloges des plus grands hommes de l’Europe ; & il s’est procuré lui-même, par la Défense de l’Esprit des Lois, le triomphe le plus complet sur ces Auteurs obscurs d’ouvrages éphemères qui avoient osé s’attacher à lui, comme ces vils insectes qui nous importunent, & qu’on écrase sans effort.
Tout étoit resté dans le silence ; l’envie n’osa plus se remontrer ; elle craignit de nouveaux coups. La mort lui enleva enfin un adversaire si redoutable. Quand elle crut n’avoir plus rien à craindre, elle emprunta, pour reparoître, la plume de M. Crévier, Professeur de l’Université de Paris.
Cet écrivain, dans ses Observations sur le Livre de l’Esprit des [I-14] Lois, s’est efforcé de décrier, par tous les moyens possibles, un ouvrage qu’il n’entendoit pas, puisqu’il ne le trouvoit blâmable que par quelques détails. Il a consacré une grande partie de son libelle à chercher des inexactitudes, soit dans les faits historiques cités ou rapportés par M. de Montesquieu, soit dans l’interprétation de quelques textes des anciens écrivains. M. Crévier traite cette partie de sa critique avec cette discussion minutieuse, qui est toujours l’apanage des génies étroits, qui étouffe le goût, & arrête dans leur course ceux qui cherchent les connoissances utiles.
Il s’est délecté dans ce travail : il y a trouvé un double moyen de satisfaire sa vanité : d’un côté, il croyoit abattre un ouvrage qui fait l’objet de la vénération publique ; il se croyoit le pédagogue du genre humain ; & s’imaginoit qu’il alloit [I-15] lui seul enseigner à tous les hommes qu’ils sont ignorans, puisqu’ils ne s’étoient pas apperçus que le guide qu’ils avoient choisi pour la politique entendoit mal le Grec & le Latin. En se livrant d’ailleurs à la discussion d’une vérité qui lui paroissoit si importante, il ne manque aucune occasion de faire un fastidieux étalage d’un genre d’érudition qui convient sans doute aux personnes de sa profession ; mais dont ceux qui l’exercent avec goût, se donnent bien de garde de faire parade aux yeux du public.
Cette affectation seroit sans doute ridicule, quand celui qui se l’est permise l’auroit appuyée de l’exactitude la plus scrupuleuse : mais qu’en doit-on penser, si ce point tout essentiel qu’il est, manque à notre prétendu critique ? On ne le suivra point ici dans tous les détails auxquels il s’est livré : ce seroit [I-16] l’imiter dans le défaut qu’on lui reproche : qu’il soit seulement permis d’examiner un ou deux traits de sa critique.
« La tentation de faire une jolie phrase, dit-il, page 34 de son libelle, est un piege pour bien des écrivains ; & la supériorité du génie de M. de Montesquieu ne l’en a pas toujours garanti. Cette séduction l’a écarté de la vérité historique dans l’endroit que je vais citer. Rome, dit-il, livre III, chap. III, au lieu de se réveiller après César, Tibere, Caïus, Claude, Néron, Domitien, fut toujours plus esclave : tous les coups porterent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie. Voilà qui est agréablement dit, reprend M. Crévier ; mais le fait est-il vrai ? Je ne considere ici que Domitien. Assurément le coup qui renversa ce tyran, porta sur la tyrannie ; elle ne [I-17] parut plus dans Rome pendant un espace de plus de 80 ans. Nerva, Trajan, Adrien, Tite, Antonin, Marc-Aurele, forment la plus belle chaîne de Princes sages & modérés, qu’aucune histoire nous fournisse. Je sais qu’Adrien fut mêlé de bien & de mal ; mais si l’on excepte son entrée dans la souveraine puissance, & les deux ou trois dernieres années de sa vie, pendant lesquelles il ne jouit pas de toute sa raison, le reste de son regne peut être cité pour modele d’un bon gouvernement. »
M. Crévier vouloit-il rappeler à ses lecteurs qu’il connoissoit l’histoire des Empereurs Romains ? Il auroit peut-être agi plus sagement, s’il eût évité de réveiller l’idée de celle qu’il a écrite : mais il auroit dû au moins choisir une autre occasion d’étaler son savoir ; il se seroit épargné la honte d’une critique [I-18] qui prouve qu’il n’entend pas M. de Montesquieu.
Cet Auteur, dans l’endroit d’où M. Crévier a tiré son passage, établit que, quand la vertu, qui est le principe de la démocratie, a fait place à la corruption, l’état est perdu ; il ne peut y avoir de liberté, & jamais elle ne peut se rétablir. Ce grand homme, dont le génie pénetre les causes politiques des événemens occasionnés par la marche ordinaire des circonstances, apporte pour preuve ce qui est arrivé aux Anglois, quand ils voulurent établir parmi eux la démocratie. Tous leurs efforts furent impuissans : ceux qui avoient part aux affaires, n’avoient point de vertu ; leur ambition étoit irritée par le succès de Cromwel qui avoit tout osé : l’esprit d’une faction n’étoit réprimé que par celui d’une autre. Ainsi on avoit beau chercher la [I-19] démocratie, on ne la trouvoit nulle part ; & après bien des mouvemens, des chocs & des secousses, il fallut se reposer dans la monarchie que l’on avoit proscrite.
Rome fournit encore un exemple plus frappant. Quand la vertu commença à s’y éclipser, il se forma des factions ; Sylla réussit enfin à s’emparer de la souveraine puissance : ce coup acheva de détruire la vertu dans Rome : il n’y eut point d’ambitieux qui ne se flattât d’obtenir le même succès. Le tyran abdiqua, mais la démocratie ne put reprendre place dans un etat où il n’y avoit plus de vertu ; & comme il y en eut toujours moins, à mesure que la domination des Empereurs se prolongea, il devint de plus en plus impossible de rendre à Rome la liberté. Quelques Auteurs ont été étonnés que les Romains, excédés des injustices & des cruautés de cette chaîne de [I-20] monstres qui se sont succédés sur le trône impérial, ne se soient pas déterminés à se garantir désormais de ces fléaux, & à reprendre l’état républicain, sur-tout quand ils n’avoient pas craint de massacrer le tyran. La chose n’étoit plus possible ; la vertu, sans laquelle la démocratie ne peut exister, étoit entiérement bannie de Rome : on faisoit tomber le tyran, mais on ne détruisoit pas la tyrannie, puisque sa place existoit toujours, & se trouvoit occupée sur le champ par un successeur. Si le hasard faisoit monter sur le trône un Prince digne de l’occuper, tels qu’ont été Trajan, Tite, &c. le peuple jouissoit des douceurs de son gouvernement ; mais pour cela, la tyrannie n’étoit pas détruite : l’état étoit privé de la liberté dont il avoit joui autrefois ; un regne atroce pouvoit suivre, & suivoit quelquefois en effet celui qui [I-21] avoit procuré un bonheur momentané.
Ces vues que M. de Montesquieu a exprimées avec beaucoup de clarté, ont échappé à M. Crévier, qui, tout savant qu’il étoit en Grec & en Latin, a cru que le mot tyrannie ne signifie autre chose qu’un gouvernement injuste & cruel.
On vient de voir que le critique de M. de Montesquieu n’est pas fort intelligent, ou du moins qu’il connoît peu la véritable signification des termes : on va voir qu’il ne donne pas une grande preuve de jugement.
M. de Montesquieu, livre V, chap. XIX, met en question si l’on doit déposer sur une même tête les emplois civils & militaires. Il répond qu’il faut les unir dans la république, & les séparer dans la monarchie. Il prouve la premiere partie de cette réponse par l’intérêt [I-22] de la liberté ; & la seconde, par l’intérêt de la puissance du monarque, qui pourroit lui être ravie s’il confioit les deux emplois à la même personne. Il établit ses preuves sur les grandes vues qui sont la base de son ouvrage ; & ses preuves sont une démonstration : mais ses raisonnemens sont souvent trop élevés, pour que certaines ames y puissent atteindre.
La seconde partie de la décision de M. de Montesquieu n’a pas plu à M. Crévier ; & sans parler des raisons qui ont déterminé cette décision, voici comment il la combat, dans une note, page 42. « Il n’est point de mon plan de m’arrêter ici à prouver la fausseté de systême. Mais, comment M. de Montesquieu pouvoit-il avancer que, par la nature du gouvernement monarchique, les fonctions civiles & militaires doivent être séparées & confiées à [I-23] des ordres différens ; lui qui savoit si bien que, dans la monarchie Françoise, elles ont été pendant plusieurs siecles exercées par les mêmes personnes ; & que, suivant la loi de la féodalité, le premier engagement du vassal envers son seigneur, étoit de le servir en guerre & en plaids, dans les expéditions militaires & dans le jugement des procès ? Il nous reste encore des vestiges de l’ancien usage dans les grands baillis & les sénéchaux, qui sont tous gens d’épée. »
Si M. Crévier avoit entrepris de fortifier, par une nouvelle preuve, le systême de son adversaire, il n’auroit peut-être pas eu le bonheur de réussir aussi bien. Tout le monde sait que, tant que le gouvernement féodal a été en vigueur dans la France, l’autorité de nos Rois, quant à l’exercice, étoit presque nulle ; parce que chaque [I-24] seigneur avoit dans sa terre tout à la fois le pouvoir militaire & le pouvoir civil. Tout le monde sait encore que la puissance du monarque n’a repris son état naturel, que quand elle a pu venir à bout de diviser l’exercice de ces deux fonctions.
Si M. Crévier avoit borné sa critique à ce genre de reproches, on n’auroit fait nulle mention de son ouvrage, & on l’auroit laissé dans l’oubli qu’il mérite. Mais il n’est pas possible de lire de sang-froid les imputations atroces dont cet écrivain a essayé de charger un homme respectable pour lui à tous égards, dans un temps où nous n’étions pas encore accoutumés à soutenir les regrets que sa perte nous avoit causés, & où la mort lui avoit ôté la faculté de faire rentrer ce téméraire dans le devoir.
Il dénonce au public l’Auteur [I-25] de l’Esprit des Lois comme un petit-maître, un homme vain, mauvais citoyen, ennemi de la saine morale & de toute religion. Si les siecles passés ne fournissoient pas des exemples de pareils prodiges, pourroit-on croire que la France eût produit, en même temps, M. de Montesquieu & M. Crévier ? Mais si la Grece eut un Platon, elle eut un Zoïle.
M. de Montesquieu est un petit-maître ! Et pourquoi l’est-il ? Il a commencé son livre XXIII, par l’invocation que Lucrece adresse à Vénus. Cette déesse fabuleuse est l’emblême de la fécondité ; tous les animaux sont appelés à la population par l’attrait du plaisir. L’Auteur de l’Esprit des Lois, au lieu de rendre, par ses propres expressions, cette pensée qui entre dans son plan, a emprunté celles d’un poëte : il n’a pas cru qu’il fût indigne de son sujet d’égayer [I-26] l’imagination de son lecteur, par une image riante, sans être indécente ; & pour cela, il est un petit-maître. On riroit de l’idée ridicule de ce Professeur, s’il n’avoit excité l’indignation par les injures grossieres dont il a chargé son adversaire.
M. de Montesquieu est un homme vain ! L’Auteur de l’Esprit des Lois étoit-il donc un homme vain, pour avoir écrit cette phrase à la fin de sa préface : « Quand j’ai vu ce que tant de grands hommes, en France, en Angleterre & en Allemagne, ont écrit avant moi, j’ai été dans l’admiration, mais je n’ai point perdu le courage. Et moi aussi je suis peintre, ai-je dit avec le Correge ». Un Auteur, ne peut donc sans vanité, croire que ses ouvrages ne sont pas sans mérite ? Mais tous ceux qui ont publié leurs écrits, sans en excepter les plus grands Saints, sont donc coupables de vanité : [I-27] car, qui a jamais donné ses productions au public, sans croire qu’elles avoient au moins un degré de bonté ? Si M. Crévier n’avoit pas eu cette vanité, il ne se seroit pas érigé en censeur d’un ouvrage que tous les grands hommes ont admiré & admirent.
C’est encore, suivant M. Crévier, un trait de vanité dans M. de Montesquieu, d’avoir dit qu’il finissoit le traité des fiefs où la plupart des Auteurs l’ont commencé. Mais M. de Montesquieu a dit une vérité ; pour M. Crévier, il a prouvé son ignorance. La plupart des Auteurs qui ont écrit sur les fiefs, n’ont examiné que les droits féodaux, tels qu’ils existent aujourd’hui. Ils ont cherché les motifs de décision, sur les contestations que cette matiere occasionne, dans les dispositions recueillies par les rédacteurs des coutumes, & se sont peu [I-28] embarrassés de connoître la source de ce genre de possessions. M. de Montesquieu l’a cherchée cette source ; il a ouvert les archives des premiers âges de notre monarchie ; il a suivi graduellement les révolutions que les fiefs ont essuyées, & a descendu jusqu’au moment où ils ont commencé à prendre la forme à laquelle les coutumes les ont fixés. Il est donc vrai qu’il a fini le traité des fiefs où la plupart des Auteurs l’ont commencé ; & c’est par vanité qu’il l’a dit ! De quelle faute M. Crévier s’est-il rendu coupable, quand il a parlé en pédagogue d’une chose qu’il ne connoissoit pas ?
C’est ainsi que notre satirique prouve que M. de Montesquieu est petit-maître & vain. On s’attend sans doute que les preuves qu’il va donner des deux autres reproches, ont une force proportionnée à la nature de l’accusation.
[I-29] Personne ne se permet de déférer un citoyen comme ennemi du gouvernement & de la religion, s’il n’a en main de quoi le convaincre à la face de l’univers de deux crimes qui méritent l’animadversion de toutes les sociétés & les peines les plus graves.
Voyons comment il établit le premier. « L’opposition décidée de l’Auteur au despotisme, dit-il, sentiment louable en soi, l’emporte au-delà des bornes. À force d’être ami des hommes, il cesse d’aimer, autant qu’il le doit, sa patrie. Toute son estime, disons mieux, toute son admiration est pour le gouvernement d’une nation voisine, digne rivale de la nation Françoise ; mais qu’il n’est pas à souhaiter pour nous de prendre pour modèle à bien des égards. L’Anglois doit être flatté, en lisant l’ouvrage de l’Esprit des [I-30] Lois ; mais cette lecture n’est capable que de mortifier les bons François. »
Il faut s’arrêter sur le raisonnement de M. Crévier. Il accuse M. de Montesquieu de ne pas aimer sa patrie autant qu’il le doit, parce qu’il a une opposition décidée pour le despotisme, & parce qu’il aime beaucoup les hommes. Mais si ce grand homme étoit moins opposé au despotisme, & s’il aimoit moins les hommes, M. Crévier jugeroit donc alors qu’il aimeroit sa patrie autant qu’il la doit aimer. N’usons pas de représailles contre cet écrivain ; croyons qu’il n’a pas entendu ce qu’il a voulu dire ; & c’est une justice qu’il faut souvent lui rendre.
Mais voyons donc ce que M. de Montesquieu pense effectivement de sa patrie. Il dit, liv. XX, chap. XX, à la fin : « Si, depuis deux ou trois siecles, la France [I-31] a augmenté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté de ses lois, non pas à la fortune, qui n’a pas ces sortes de confiance. »
Rapprochons de ce passage celui où il exprime ses véritables sentimens sur le gouvernement Anglois. « Ce n’est point à moi, dit-il, à examiner si les Anglois jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs lois, & je n’en cherche pas davantage. Je ne prétends point par là ravaler les autres gouvernemens, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée. Comment dirois-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours désirable, & que les hommes s’accommodent toujours mieux des milieux, que des extrémités ? »
[I-32]
Ces deux passages ainsi placés dans le point de comparaison, font disparoître l’accusation dont M. Crévier a voulu noircir M. de Montesquieu, & ne laissent que de l’étonnement sur l’atrocité de la calomnie.
Mais il ne faut pas encore se lasser de la surprise ; l’Auteur du libelle a porté l’attentat jusqu’au comble. Si on l’en croit, M. de Montesquieu est ennemi de la religion ; mais il n’est pas de ces ennemis ordinaires qui, contens de s’affranchir eux-mêmes de son joug, s’inquietent peu des sentimens que les autres ont pour elle. Il veut la détruire : & pour mieux réussir, il l’attaque par la ruse ; mais écoutons M. Crévier. « Cet ouvrage, dit-il dans son avant-propos, prive la vertu de son motif, & délivre le vice de la terreur la plus capable de le réprimer. Il détruit les devoirs dans leur [I-33] source ; & en anéantissant ceux qui se rapportent à l’Auteur de notre être, quelle force laisse-t-il a ceux qui ne regardent que nos compagnons ?
» Et l’Auteur, continue le libelle, exécute tout cela sourdement, & sans déclarer une guerre ouverte à l’orthodoxie. Ceux qui l’ont suivi dans le même plan funeste, devenus plus audacieux par les succès de leur précurseur, ont levé le masque. Mais, par leur témérité même, ils sont de moins dangereux ennemis ; parce que, … en prenant les armes, ils nous ont avertis de les prendre de notre côté. L’Auteur de l’Esprit des Lois conduit son entreprise plus adroitement : il ne livre point l’assaut à la religion ; il va à la sappe, & mine la religion sans bruit. »
M. Crévier entre, à cet égard, dans quelques détails : ils [I-34] contiennent la moitié de son Livre. Mais, qui le croiroit ! Les prétendues preuves du crime affreux dont il charge son ennemi, ne sont que la répétition des calomnies que le Nouvelliste Ecclésiastique avoit vomies contre l’Auteur de l’Esprit des Lois, au mois d’Octobre 1749. Cet affreux libelle fut foudroyé par M. de Montesquieu lui-même dans sa Défense de l’Esprit des Lois. Il ne resta à cet Écrivain que la honte d’avoir attaqué un grand homme qui ne méritoit que des éloges, & le chagrin d’avoir fourni la matiere d’un opuscule qui transmettra cette honte à la postérité.
Tout le monde lut, & tous les gens de goût admirerent cet ouvrage ; mais il paroît qu’il est demeuré inconnu à M. Crévier. Aussi nous dit-il qu’il a travaillé sur l’édition de l’Esprit des lois de 1749. Son ouvrage est cependant de 1764, postérieur de six ans à [I-35] l’édition de 1758. Elle a été faite d’après les corrections que M. de Montesquieu avoit lui-même remises aux Libraires avant sa mort. S’il eût eu soin de se la procurer, comme il le devoit, il y auroit trouvé quelques changemens dont plusieurs tendent à éclaircir certains passages sur lesquels le Nouvelliste avoit cru trouver prise ; & que M. Crévier a relevés d’après lui, quoiqu’ils ne soient plus tels qu’ils étoient. Il y auroit lu la Défense de l’Esprit des Lois, & y auroit appris le respect qu’il devoit aux talens, aux vues de l’Auteur & à l’ouvrage.
En 1764, parut dans les pays étrangers un critique de l’Esprit des Lois d’un autre genre. Il a respecté, comme il le devoit, les qualités du cœur de M. de Montesquieu ; la calomnie n’a point sali ses écrits ; il a seulement prétendu trouver des erreurs dans l’ouvrage, & il a renfermé ses observations [I-36] dans des notes insérées dans une édition contrefaite des Œuvres de M. Montesquieu, en Hollande. L’examen d’une ou de deux de ces notes suffira pour les apprécier toutes ; & l’on va choisir entre celles qui sont les plus importantes.
M. de Montesquieu, après avoir établi la distinction qui caractérise les trois genres de gouvernement, fait voir que dans chacun de ces gouvernemens les lois doivent être relatives à leur nature ; c’est-à-dire à ce qui les constitue ; ainsi dans la démocratie, le peuple doit être, à certains égards, le monarque ; à d’autres, le sujet. Il faut, par exemple, qu’il élise ses magistrats, & qu’il les juge. Si les magistrats cessent d’être électifs, ou si quelqu’autre que le peuple a le droit de leur demander compte de leur conduite, dès lors ce n’est plus une démocratie ; les magistrats, ou les juges des magistrats, ravissent la [I-37] puissance au peuple, & se l’attribuent.
Il est de la nature de la monarchie que la nation soit gouvernée par un prince, dont le pouvoir soit modéré par les lois. Pour que ce gouvernement ne change pas de nature, & ne dégénere pas en despotisme, il faut qu’il y ait entre le monarque & le peuple beaucoup de rangs, beaucoup de pouvoirs intermédiaires. Si les ordres passoient du trône immédiatement au peuple, la terreur les feroit exécuter, & l’arbitraire s’introduiroit sur les débris des lois. Si les ordres, au contraire, ne parviennent aux extrémités de la nation que par degrés, la sphere de ceux qui les font arriver touchant immédiatement à ceux qui les doivent exécuter, la crainte ne fait plus d’impression ; c’est la loi qui parle par la bouche de ses émissaires ; ce n’est plus le monarque.
[I-38]
Il faut encore, dans une monarchie, un corps dépositaire des lois, médiateur entre les sujets & le prince. S’il n’existe point de dépôt pour les lois, si elles ne sont pas sous la main de gardiens fideles, qui pour arrêter l’effet des volontés momentanées du souverain, les placent à propos entre la nation & lui ; elles n’ont plus de stabilité ; elles n’ont plus d’effet, & le despotisme les anéantit.
Il est de la nature du gouvernement despotique, que la volonté, les caprices du tyran soient la seule loi : il faut donc qu’il exerce son autorité, ou par lui seul, ou par un seul qui le représente. Prend-il des mesures pour faire exécuter ses volontés ? se prescrit-il des regles ? ou souffre-t-il qu’on lui en rappelle ? Sa volonté n’est pas la seule loi ; il cesse d’être despote, & monte à la monarchie.
Tels sont, en général, les [I-39] établissemens que doit former un législateur qui songe à fonder ou à introduire l’un de ces trois gouvernemens. Mais s’il veut que son ouvrage soit durable, après avoir réglé la nature de son gouvernement, il faut aussi qu’il s’occupe de son principe ; c’est-à-dire, de ce qui le soutiendra & le fera agir. Ainsi il faut que, pour une république, il trouve le secret d’insinuer & de perpétuer dans le cœur des citoyens l’amour de la république, c’est-à-dire, l’amour de l’égalité ; en sorte que les magistratures n’y soient pas regardées comme un objet d’ambition, mais comme une occasion de signaler son attachement pour la patrie, & de se livrer tout entier au maintien de la liberté des citoyens & de l’égalité entr’eux.
Pour le mouvement & le maintien d’un état monarchique, il faut que le cœur des sujets soit animé par [I-40] l’honneur ; c’est-à-dire, par l’ambition & par l’amour de l’estime : ces deux passions sont nécessaires, mais elles se temperent mutuellement. Le monarque est le seul dispensateur des distinctions & des récompenses : il faut donc que l’ambition de les obtenir, inspire le désir de le servir utilement pour l’état, & de se signaler assez pour qu’il apperçoive ces services, & les récompense. Si les graces & les récompenses dépendoient d’un autre pouvoir que de celui du monarque, son autorité seroit nulle ; il n’auroit aucun ressort dans la main pour faire agir les différentes parties de l’état, soit pour les affaires du dehors, soit pour celles du dedans. Si les graces & les récompenses n’étoient pas le fruit du mérite ; si elles étoient subordonnées à l’arbitraire, & jetées au hasard, il seroit inutile de chercher à les mériter, & chacun [I-41] resteroit dans l’inertie : on ne seroit pas réveillé par la vertu, c’est-à-dire par l’amour de la patrie ; parce que dans les monarchies on est accoutumé à confondre l’état avec le monarque. On ne seroit donc rien pour un homme de qui on n’attendroit aucun retour.
Mais il faut que cette ambition soit réglée par l’amour de l’estime. Si le monarque est subjugué par ses passions ; si pour mériter les graces qu’il dispense, il faut servir ses caprices contre les lois, on craindra le mépris public, on s’abstiendra des places auxquelles sont attachées les fonctions qu’il veut faire employer à l’exécution de ses injustices, où l’on abdiquera ces places, & l’on restera dans une glorieuse oisiveté.
Si ces deux passions ne sont pas combinées dans le cœur des sujets, ou le monarque perd sa puissance, ou il devient despote.
[I-42]
Quant au gouvernement despotique, son principe est la crainte. Si les ordres du maître étoient reçus de sang-froid ; si cette passion n’interceptoit pas au moindre signal de sa volonté toute faculté de raisonner, on pourroit faire attention à leur injustice, remonter à celle qui maintient un tyran sur le trône : comme ce n’est que la loi du plus fort, en tournant ses propres forces contre lui, on l’extermineroit. Si d’ailleurs l’amour de la liberté s’emparoit subitement du peuple, comme il arriva à Rome sous Tarquin, le coup qui abattroit le tyran, abattroit la tyrannie ; le despotisme seroit anéanti, & l’on verroit naître une république.
Ces principes sont lumineux ; ils sont puisés dans l’essence même des choses. M. de Montesquieu, à l’occasion de ces réflexions, entre dans quelques détails, pour indiquer les routes qui peuvent conduire à [I-43] l’établissement & au maintien de la nature & du principe de chaque gouvernement. Mais il traite ces détails en grand homme ; il écarte toutes les minuties qui caractérisent le génie étroit.
Le faiseur de notes n’a point apperçu tout cela. Il en a placé une fort longue à la fin du quatrième Livre. Il y dit que M. de Montesquieu s’est lourdement trompé, soit qu’il ait voulu nous développer ce qui est, soit qu’il ait voulu nous développer ce qui doit être.
Dans le premier cas, cet Auteur, dit le censeur, est contredit par l’expérience. On voit, dit-il, que chaque nation, chaque souverain, est conduit par un objet particulier, vers lequel ils tournent le systême de leur gouvernement. Les uns vivent aux richesses, les autres à la conquête, les autres au commerce, &c. ; & les systêmes politiques sont plus ou moins stables, à mesure que le souverain est plus [I-44] ou moins despote ; parce que le successeur substitue ses idées à celles de celui qui l’a précédé, & change par conséquent tout le plan de gouvernement qu’il a établi. Les républiques sont moins sujettes à ces variations, qui ne peuvent arriver qu’autant que l’esprit de la nation entiere viendroit à changer.
Ces réflexions, qui sont répétées dans tous nos livres, & qu’un coup d’œil sur le cœur humain & sur son histoire nous font appercevoir, sont de la plus grande vérité ; mais que la passion dominante d’une république soit l’amour des richesses, ou la jalousie contre les états qui l’environnent ; qu’elle tourne tant qu’elle voudra ses opérations du côté de cet objet, cela fera-t-il que, pour qu’elle soit république, il soit indispensable que le peuple soit libre ; & pour qu’il reste libre, qu’il ait & qu’il conserve le droit d’élire & de juger ses magistrats ?
Qu’un monarque tourne ses vues [I-45] du côté de la conquête, ou du côté du commerce ; que son successeur change d’objet, ces variations feront-elles que l’on puisse concevoir une monarchie sans un souverain dont le pouvoir soit tempéré par les lois, si ces lois ne sont confiées à des dépositaires qui puissent les faire valoir en faveur de la nation, & s’il n’y a enfin dans l’état différens canaux qui transmettent successivement les ordres du souverain aux extrémités du peuple ? En sera-t-il moins vrai que cette sorte de gouvernement ne se maintiendra point, si le monarque n’a dans sa main des motifs qui excitent les sujets à se livrer au service de l’état ; & si ceux-ci n’en ont un qui les arrête, quand ces motifs leur sont présentés comme un appât pour se prêter à des injustices, ou pour les exécuter ?
On doit dire la même chose du despotisme. Quelles que soient les vues du despote, il ne le fera pas, [I-46] s’il y a dans ses états d’autres lois que sa volonté ; & il cessera de l’être, dès que la crainte ne sera pas la cause de l’obéissance.
Si M. de Montesquieu a voulu nous peindre ce qui doit être, le critique trouve que son erreur est encore plus grossiere ; & pour établir cette erreur, il appelle à son secours la théorie & l’expérience. Elles nous apprennent, dit-il, que la vertu, par laquelle il entend toutes les vertus morales qui nous portent à la perfection, est le seul principe de conduite pour tous les gouvernemens, quels qu’ils soient, & qui ait fait fleurir & qui fera fleurir les états.
Cette maxime est encore de toute vérité. Quand le peuple & ceux qui le gouvernent sont doués de toutes les vertus morales, l’état est nécessairement florissant : on évite avec prudence tout ce qui peut nuire, & l’on exécute de même tout ce qui est utile. Ceux [I-47] qui gouvernent sont justes envers le peuple ; le peuple est juste envers eux ; & tous sont justes envers les étrangers : on exécute avec fermeté les résolutions que la prudence a inspirées ; on oppose la même vertu à la violence & aux injustices, & toujours avec prudence ; enfin on ne désire que ce qui est possible, & on s’abstient de tout excès.
Un état ainsi composé, est sans doute une belle chimere ; & si elle se réalisoit, elle résisteroit à l’inconstance du temps. Mais, pour cela, un état où il n’y auroit point de liberté, & où les magistrats seroient indépendans du peuple, soit quant à leur élection, soit quant à leur conduite, seroit-il une république ? Un état où le prince pourroit tout ce qu’il voudroit, où aucun frein n’arrêteroit ceux qu’il chargeroit de l’exécutions de ses caprices, où l’on chercheroit à l’envi à s’en rendre l’agent aveugle [I-48] par l’espoir des récompenses ; un tel état seroit-il une monarchie ? enfin seroit-ce un despote que celui qui ne pourroit pas tout ce qu’il voudroit, & dont on pourroit examiner & discuter les volontés ?
Au surplus, en lisant la Défense de l’Esprit des Lois, on verra que cet annotateur ne connoît pas cet ouvrage, ou n’a pas voulu le connoître. Il y auroit appris à ne pas faire une crime à M. de Montesquieu d’employer les mots vertu & honneur, comme il les emploie. Il y auroit appris que l’Auteur ne s’en est servi qu’après les avoir définis : il y auroit appris que, quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage, quand il a donné son dictionnaire, il faut entendre ses paroles suivant la signification qu’il leur a donnée. C’est cependant d’après cette équivoque, que l’Auteur des notes a fait à M. de Montesquieu plusieurs reproches, qui, sans être exprimés sur le ton que [I-49] M. Crévier a choisi, ne laissent pas de produire le même effet.
Cet exemple suffiroit peut-être pour mettre le lecteur en état d’apprécier l’ouvrage dont on l’entretient ici : mais examinons encore comment l’Auteur entend un autre des principes fondamentaux de l’Esprit des Lois.
M. de Montesquieu, livre XI, chap. VI, dit qu’il y a dans chaque état trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, & corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassadeurs, établit la sureté, prévient les invasions. Par la troisieme, il punit les crimes, ou juge les [I-50] différens des particuliers. M. de Montesquieu avertit qu’il appellera cette derniere, la puissance de juger ; & l’autre simplement, la puissance exécutrice de l’état. Il est assurément le maître de ses expressions, quand il en a fixé le sens.
Rien n’est plus exact que cette distribution. Tout état, quant à son administration, est considéré sous deux points de vue : il est considéré relativement aux autres états qui l’environnent, & relativement aux sujets qui le composent. Sous le premier rapport, ce sont les lois du droit des gens qui le gouvernent : mais comme ces lois lui sont communes avec les autres états, & qu’il n’a point d’empire sur eux, il ne les peut faire exécuter, en ce qui le concerne, que par la voie de la négociation ; c’est ce qu’il fait par le canal des ambassadeur qu’il envoie & qu’il reçoit ; ou par la force, si la négociation ne suffit pas : c’est ce qu’il fait encore par le secours [I-51] des troupes qui s’opposent aux invasions que la négociation n’a pu prévenir, ou qui vont attaquer & arracher par les armes la justice que les représentations des ambassadeurs n’ont pu obtenir.
Tout état a donc essentiellement, quant au droit des gens, une puissance exécutrice, qui consiste à négocier, à se défendre, ou à attaquer. Mais dans ce sens, il n’a pas la puissance législative, parce que les lois qui forment le droit des gens régissent tous les états, & ne dépendent d’aucun.
Il n’en est pas ainsi du droit civil : tout état, quant à ce droit, a la puissance civile, parce que tout état a le droit exclusif de former les lois de son administration intérieure. Mais ce droit seroit illusoire, s’il n’étoit accompagné du pouvoir de faire exécuter ces lois. Elles sont de deux sortes ; les unes répriment les crimes ; les autres reglent les propriétés. Pour [I-52] les mettre à exécution, il faut être revêtu du pouvoir de punir les crimes, & de terminer impérativement les contestations qui naissent à l’occasion des propriétés.
M. de Montesquieu avoit présenté ces principes d’une maniere assez lumineuse pour ceux qui savent lire ; mais on a cru devoir les développer pour l’auteur des notes. Celui de l’Esprit des Lois, qui examine en quoi consiste la plus grande liberté possible des sujets, dit que, lorsque dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque, ou le même sénat, ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
Cette maxime est encore de la plus grande évidence : Si celui qui fait les lois, tient en même temps dans sa main les forces nécessaires [I-53] pour procurer à l’état l’exécution du droit des gens, & si les précautions requises par la nature du gouvernement monarchique ne dirigent pas ses volontés ; il n’y aura pas de liberté, puisqu’il pourra tout ce qu’il voudra. En effet, s’il dépendoit d’un tel prince de faire des lois de ses caprices, il tourneroit ses forces exécutrices contre ses propres sujets, & seroit un vrai despote.
C’est ainsi que raisonne M. de Montesquieu ; & il n’est pas possible de se refuser à l’évidence de ses raisonnemens. Mais l’annotateur dit qu’il faut corriger tout cela. Il n’y a point, dit-il, trois pouvoirs dans un état ; mais il y a trois especes de pouvoirs dans le pouvoir de gouverner, qui sont la puissance législative, la puissance judiciaire & la puissance exécutrice. Par la premiere, le prince ou le magistrat font des lois ; par la [I-54] seconde, il juge les actions des citoyens suivant ces lois ; par la troisieme, il exécute ses jugemens. Cet écrivain nous assure ensuite que M. de Montesquieu traite sa matiere conformément à cette division, & qu’il s’est mis en contradiction avec lui-même, lorsqu’il a distingué une puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & une puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
Il est plaisant ce voir comment ce critique prouve la contradiction qu’il annonce : il faut copier ses propres termes : « De grace, dit-il, quelle connexion la puissance de faire des lois a-t-elle avec celle d’envoyer des ambassadeurs, pour qu’on puisse regarder celle-ci comme exécutrice de ce que le législateur établit ? Comment l’acte d’envoyer des ambassadeurs peut-il opérer tyranniquement sur les lois auxquelles il ne [I-55] s’étend point ? La puissance législative dénonce une peine contre les assemblées ; supposons que ce soit une loi tyrannique, l’acte d’envoyer des ambassadeurs peut-il être un moyen d’exécuter tyranniquement cette loi ? »
II prétend ensuite que ces ridicules idées sont celles de M. de Montesquieu, qui s’est mal énoncé ; mais qui a voulu dire, que « la puissance législative défend les assemblées privées ; cette loi est supposée tyrannique. Si la puissance législative se trouvoit jointe à l’exécutrice, celle-ci pourroit exécuter tyranniquement les peines portées par cette loi ; parce qu’en ce cas la volonté se trouveroit combinée à la force. De même, si la puissance judiciaire se trouvoit jointe à la législative, les jugemens ne suivroient pas tant l’esprit de la loi, ou son équité mais la [I-56] volonté & les vues particulieres de celui qui l’a faite, le juge seroit législateur. Voilà, dit ensuite cet interprete, comment il faut entendre M. de Montesquieu ; & ce qu’il dit, prouve évidemment qu’on ne peut l’expliquer d’une autre façon, à moins d’en ôter tout le sens & de tomber dans l’absurde ».
Ainsi notre critique, pour relever M. de Montesquieu de l’absurde dans lequel il prétend que ce grand homme étoit tombé, fait disparoître la puissance qui appartient à chaque état, de se rendre ou de se faire rendre la justice qui lui est due en conséquence du droit des gens; & pour cet effet y il confond le droit des gens avec le droit civil. Il dit que, « suivant que l’objet des affaires étrangeres se rapporte à la simple volonté, ou à l’exécution, il tombe sous la puissance législative, ou sous [I-57] l’exécutrice. Par exemple, faire la paix, en tant que contracter, est un acte de simple volonté, qui ne peut tomber sous la puissance exécutrice ».
Sous quelle puissance cet acte tombe-t-il donc ? Ce n’est pas sous celle qu’il plaît à l’annotateur d’appeller judiciaire. Est-ce sous la puissance législative ? Mais elle ne peut jamais être relative qu’au droit civil. Un souverain, quel qu’il soit, ne peut jamais faire des lois que pour ses états. Reste donc la puissance exécutrice, dans le sens que Monsieur de Montesquieu l’a définie. Deux souverains contractent ensemble : ce n’est pas à l’autorité du droit civil qu’ils soumettent leur contrat : il n’y a point de lois civiles qui leur soient communes ; c’est donc le droit des gens qui doit inspirer & maintenir leurs accords : ils font donc, en traitant ensemble, usage de la puissance [I-58] exécutrice dont parle M. de Montesquieu, & dont chaque souverain est revêtu. Si l’un des deux manque à ses engagemens, celui sera lésé appellera à son secours les autres moyens qu’il tient de la puissance exécutrice.
Ces deux passages suffisent pour faire connoître l’ouvrage dont il est ici question, & pour persuader aux Libraires que le public leur saura gré de n’avoir pas chargé cette édition de notes ridicules.
Au reste, elle est entiérement conforme, quant au corps de l’ouvrage, à celle de 1758, qui avoit été faite sur les corrections de M. de Montesquieu lui-même.
[I-59]
ÉLOGE DE M. LE PRÉSIDENT DE MONTESQUIEU↩
Mis à la tête du cinquième volume de l’ENCYCLOPÉDIE, par M. D’ALEMBERT
L’Intérêt que les bons citoyens prennent à l’Encyclopédie, & le grand nombre de gens de lettres qui lui consacrent leurs travaux, semblent nous permettre de la regarder comme un des monumens les plus propres à être dépositaires des sentimens de la patrie, & des hommages qu’elle doit aux hommes célebres qui l’ont honorée. Persuadés néanmoins que M. de Montesquieu étoit en droit d’attendre d’autres panégyristes que nous, & que la douleur publique eût mérité des interpretes plus éloquens, nous eussions renfermé au-dedans de nous-mêmes nos justes regrets & notre respect pour sa mémoire : mais [I-60] l’aveu de ce que nous lui devons nous est trop précieux pour en laisser le soin à d’autres. Bienfaiteur de l’humanité par ses écrits, il a daigné l’être aussi de cet ouvrage ; & notre reconnoissance ne veut que tracer quelques lignes au pied de sa statue.
CHARLES DE SECONDAT, BARON DE LA BREDE ET DE MONTESQUIEU, ancien président à mortier au parlement de Bordeaux, de l’académie Françoise, de l’académie royale des sciences & des belles lettres de Prusse, & de la société royale de Londres, naquit au château de la Brede, près de Bordeaux, le 18 Janvier 1689, d’une famille noble de Guyenne. Son trisaïeul, Jean de Secondat, maître d’hôtel de Henri II, roi de Navarre, & ensuite de Jeanne, fille de ce roi, qui épousa Antoine de Bourbon, acquit la terre de Montesqueiu, d’une somme de 10000 liv. que cette princesse lui donna par un acte authentique, en récompense de sa probité & de ses services. Henri III, roi de Navarre, depuis Henri IV, roi de France, érigea en baronnie la terre de Montesquieu, en faveur de Jacob de Secondat, fils de Jean, d’abord gentilhomme ordinaire de la chambre de ce prince, & ensuite mestre du camp du régiment de Châtillon. Jean Gaston de Secondat, son second fils, ayant épousé la fille du premier président du [I-61] parlement de Bordeaux, acquit dans cette compagnie une charge de président à mortier. Il eut plusieurs enfans, dont un entra dans le service, s’y distingua, & le quitta de fort bonne heure : ce fut le pere de Charles de Secondat, auteur de l’esprit des lois. Ces détails paroîtront peut-être déplacés à la tête de l’éloge d’un philosophe, dont le nom a si peu besoin d’ancêtres : mais n’envions point à leur mémoire l’éclat que ce som répand sur elle.
Les succès de l’enfance, présage quelquefois si trompeur, ne le furent point dans Charles de Secondat : il annonça de bonne heure ce qu’il devoit être ; & son pere donna tous ses soins à cultiver ce génie naissant, objet de son espérance & de sa tendresse. Dès l’âge de vingt ans, le jeune Montesquieu préparoit déjà les matériaux de l’esprit des lois, par un extrait raisonné des immenses volumes qui composent le corps du droit civil : ainsi autrefois Newton avoit jeté, dès sa premiere jeunesse, les fondemens des ouvrages qui l’ont rendu immortel. Cependant l’étude de la jurisprudence, quoique moins aride pour M. de Montesquieu que pour la plupart de ceux qui s’y livrent, parce qu’il la cultivoit en philosophe, ne suffisoit pas à l’étendue & à l’activité de son génie. Il approfondissoit, dans le même temps, des [I-62] matieres encore plus importantes & plus délicates [1] , & les discutoit dans le silence avec la sagesse, la décence & l’équité qu’il a depuis montrées dans ses ouvrages.
Un oncle paternel, président à mortier au parlement de Bordeaux, juge éclairé & citoyen vertueux, l’oracle de sa compagnie & de sa province, ayant perdu un fils unique, & voulant conserver dans son corps l’esprit d’élévation qu’il avoit tâché d’y répandre, laissa ses biens & sa charge à M. de Montesquieu. Il étoit conseiller au parlement de Bordeaux depuis le 24 février 1714, & fut reçu président à mortier le 13 juillet 1716. Quelques années après, en 1722, pendant la minorité du roi, sa compagnie le chargea de présenter des remontrances à l’occasion d’un nouvel impôt. Placé entre le trône & le peuple, il remplit, en sujet respectueux & en magistrat plein de courage, l’emploi si noble & si peu envié, de faire parvenir au souverain le cri des malheureux : & la misere publique, représentée avec autant d’habileté que de force, obtint la justice qu’elle demandoit. Ce succès, il est vrai, par malheur pour l’état bien plus que pour lui, fut aussi passager que s’il eût été injuste : [I-63] à peine la voix des peuples eut-elle cessé de se faire entendre, que l’impôt supprimé fut remplacé par un autre : mais le citoyen avoit fait son devoir.
Il fut reçu le 3 avril 1716 dans l’académie de Bordeaux, qui ne faisoit que de naître. Le goût pour la musique & pour les ouvrages de pur agrément, avoit d’abord rassemblé les membres qui la formoient. M. de Montesquieu crut, avec raison, que l’ardeur naissante & les talens de ses confreres pourroient s’exercer avec encore plus d’avantages sur les objets de la physique. Il étoit persuadé que la nature, si digne d’être observée par-tout, trouvoit aussi par-tout des yeux dignes de la voir ; qu’au contraire les ouvrages de goût ne souffrant point de médiocrité, & la capitale étant en ce genre le centre des lumieres & des secours, il étoit trop difficile de rassembler loin d’elle un assez grand nombre d’écrivains distingués. Il regardoit les sociétés de bel esprit si étrangement multipliées dans nos provinces, comme une espece, ou plutôt comme une ombre de luxe littéraire, qui nuit à l’opulence réelle, sans même en offrir l’apparence. Heureusement M. le duc de la Force, par un prix qu’il venoit de fonder à Bordeaux, avoit secondé des vues si éclairées & si justes. On jugea qu’une [I-64] expérience bien faite seroit préférable à un discours foible ou à un mauvais poëme ; & Bordeaux eut une académie des sciences.
M. de Montesquieu, nullement empressé de se montrer au public, sembloit attendre, selon l’expression d’un grand génie, un âge mûr pour écrire. Ce ne fut qu’en 1721, c’est-à-dire, âgé de trente-deux ans, qu’il mit au jour les Lettres persanes. Le Siamois des amusemens sérieux & comiques pouvoit lui en avoir fourni l’idée ; mais il surpassa son modèle. La peinture des mœurs orientales, réelles ou supposées, de l’orgueil & du flegme de l’amour asiatique, n’est que le moindre objet de ces lettres ; elle n’y sert, pour ainsi dire, que de prétexte à une satire fine de nos mœurs, & à des matieres importantes que l’auteur approfondit, en paroissant glisser sur elles. Dans cette espece de tableau mouvant, Usbek expose sur-tout, avec autant de légéreté que d’énergie, ce qui a le plus frappé parmi nous ses yeux pénétrans ; notre habitude de traiter sérieusement les choses les plus futiles, & de tourner les plus importantes en plaisanterie ; nos conversations si bruyantes & si frivoles ; notre ennui dans le sein du plaisir même ; nos préjugés & nos actions en contradiction continuelle avec nos lumieres ; tant d’amour pour la gloire, joint [I-65] à tant de respect pour l’idole de la saveur ; nos courtisans si rampans & si vains ; notre politesse extérieure, & notre mépris réel pour les étrangers, ou notre prédilection affectée pour eux ; la bizarrerie de nos goûts, qui n’a rien au-dessous d’elle, que l’empressement de toute l’Europe à les adopter ; notre dédain barbare pour deux des plus respectables occupations d’un citoyen, le commerce & la magistrature ; nos disputes littéraires si vives & si inutiles ; notre fureur d’écrire avant que de penser, & de juger avant que de connoître. À cette peinture vive, mais sans fiel, il oppose dans l’apologue des Troglodites, le tableau d’un peuple vertueux, devenu sage par le malheur : morceau digne du portique. Ailleurs, il montre la philosophie long-temps étouffée, reparoissant tout-à-coup, regagnant par ses progrès, le temps qu’elle a perdu, pénétrant jusques chez les Russes à la voix d’un génie qui l’appelle ; tandis que, chez d’autres peuples de l’Europe, la superstition, semblable à une atmosphère épaisse, empêche la lumiere qui les environne de toutes parts d’arriver jusqu’à eux. Enfin, par les principes qu’il établit sur la nature des gouvernemens anciens & modernes, il présente le germe de ses idées lumineuses, développées depuis par l’auteur dans son grand ouvrage.
[I-66]
Ces différens sujets, privés aujourd’hui des graces de la nouveauté qu’ils avoient dans la naissance des lettres persanes, y conserveront toujours le mérite du caractere original qu’on a su leur donner : mérite d’autant plus réel, qu’il vient ici du génie seul de l’écrivain, & non du voile étranger dont il s’est couvert ; car Usbek a pris, durant son séjour en France, non-seulement une connoissance si parfaite de nos mœurs, mais une si forte teinture de nos manieres mêmes, que son style fait souvent oublier son pays. Ce léger défaut de vraisemblance peut n’être pas sans dessein & sans adresse : en relevant nos ridicules & nos vices, il a voulu sans doute aussi rendre justice à nos avantages. Il a senti toute la fadeur d’un éloge direct ; & il nous a plus finement loués, en prenant si souvent notre ton pour médire plus agréablement de nous.
Malgré le succès de cet ouvrage, M. de Montesquieu ne s’en étoit point déclaré ouvertement l’auteur. Peut-être croyoit-il échapper plus aisément par ce moyen à la satire littéraire, qui épargne plus volontiers les écrits anonymes, parce que c’est toujours la personne, & non l’ouvrage, qui est le but de ses traits. Peut-être craignoit-il d’être attaqué sur le prétendu contraste des lettres persanes avec [I-67] l’austérité de sa place ; espece de reproche, disoit-il, que les critiques ne manquent jamais, parce qu’il ne demande aucun effort d’esprit. Mais son secret étoit découvert, & déjà le public le montroit à l’académie françoise. L’événement fit voir combien le silence de M. de Montesquieu avoit été sage. Usbek s’exprime quelquefois assez librement, non sur le fond du christianisme, mais sur des matieres que trop de personnes affectent de confondre avec le christianisme même ; sur l’esprit de persécution dont tant de chrétiens ont été animés ; sur les usurpations temporelles de la puissance ecclésiastique ; sur la multiplication excessive des monasteres, qui enlevent des sujets à l’état, sans donner à Dieu des adorateurs ; sur quelques opinions qu’on a vainement tenté d’ériger en dogmes ; sur nos disputes de religion, toujours violentes, & souvent funestes. S’il paroît toucher ailleurs à des questions plus délicates, & qui intéressent de plus près la religion chrétienne, ses réflexions, appréciées avec justice, sont en effet très-favorables à la révélation ; puisqu’il se borne à montrer combien la raison humaine, abandonnée à elle-même, est peu éclairés sur ces objets. Enfin, parmi les véritables lettres de M. de Montesquieu, l’imprimeur étranger en avoit inséré quelques-unes [I-68] d’une autre main : & il eût fallu du moins, avant que de condamner l’auteur, démêler ce qui lui appartenoit en propre. Sans égard à ces considérations, d’un côté la haine sous le nom de zele, de l’autre le zele sans discernement ou sans lumieres, se souleverent & se réunirent contre les Lettres persanes. Des délateurs, espece d’hommes dangereuse & lâche, que même dans un gouvernement sage on a quelquefois le malheur d’écouter, alarmerent, par un extrait infidele, la piété du ministere. M. de Montesquieu, par le conseil de ses amis, soutenu de la voix publique, s’étant présenté pour la place de l’académie françoise, vacante par la mort de M. de Sacy, le ministre écrivit à cette compagnie, que sa majesté ne donneroit jamais son agrément à l’auteur des lettres persanes : qu’il n’avoit point lu ce livre ; mais que des personnes en qui il avoit confiance lui en avoient fait connoître le poison & le danger. M. de Montesquieu sentit le coup qu’une pareille accusation pouvoit porter à sa personne, à sa famille, à la tranquillité de sa vie. Il n’attachoit pas assez de prix aux honneurs littéraires, ni pour les rechercher avec avidité, ni pour affecter de les dédaigner quand ils se présenteroient à lui, ni enfin pour en regarder la simple privation comme un malheur : mais [I-69] l’exclusion perpétuelle, & sur-tout les motifs de l’exclusion, lui paroissoient une injure. Il vit le ministre, lui déclara que, par des raisons particulieres, il n’avouoit point les lettres persanes ; mais qu’il étoit encore plus éloigné de désavouer un ouvrage dont il croyoit n’avoir point à rougir ; & qu’il devoit être jugé d’après une lecture, & non sur une délation. Le ministre prit enfin le parti par où il auroit dû commencer ; il lut le livre, aima l’auteur, & apprit à mieux placer sa confiance. L’académie françoise ne fut point privée d’un de ses plus beaux ornemens ; & la France eut le bonheur de conserver un sujet que la superstition & la calomnie étoient prêtes à lui faire perdre : car M. de Montesquieu avoit déclaré au gouvernement, qu’après l’espece d’outrage qu’on alloit lui faire, il iroit chercher chez les étrangers qui lui tendoient les bras, la sureté, le repos, & peut-être les récompenses qu’il auroit dû espérer dans son pays. La nation eût déploré cette perte, & la honte en fût pourtant retombée sur elle.
Feu M. le Maréchal d’Estrées, alors directeur de l’académie françoise, se conduisit dans cette circonstance en courtisan vertueux, & d’une ame vraiment élevée : il ne craignit, ni d’abuser de son crédit, ni de le compromettre ; il soutint [I-70] son ami, & justifia Socrate. Ce trait de courage, si précieux aux lettres, si digne d’avoir aujourd’hui des imitateurs, & si honorable à la mémoire de M. de maréchal d’Estrées, n’auroit pas dû être oublié dans son éloge.
M. de Montesquieu fut reçu le 24 janvier 1728. Son discours est un des meilleurs qu’on ait prononcés dans une pareille occasion : le mérite en est d’autant plus grand, que les récipiendaires, gênés jusqu’alors par ces formules & ces éloges d’usage, ausquels une espece de prescription les assujettit, n’avoient encore osé franchir ce cercle pour traiter d’autres sujets, ou n’avoient point pensé du moins à les y renfermer. Dans cet état même de contrainte, il eut l’avantage de réussir. Entre plusieurs traits dont brille son discours [2] , on reconnoîtroit l’écrivain qui pense, au seul portrait du cardinal de Richelieu, qui apprit à la France le secret de ses forces, & à l’Espagne celui de sa foiblesse, qui ôta à l’Allemagne ses chaînes, & lui en donna de nouvelles. Il faut admirer M. de Montesquieu d’avoir su vaincre la difficulté de son sujet, & pardonner à ceux qui n’ont pas eu le même succès.
Le nouvel académicien étoit d’autant plus digne de ce titre, qu’il avoit, peu de [I-71] temps auparavant, renoncé à tout autre travail, pour se livrer entiérement à son génie & à son goût. Quelque importante que fût la place qu’il occupoit, avec quelques lumieres & quelqu’intégrité qu’il en eût rempli les devoirs, il sentoit qu’il y avoit des objets plus dignes d’occuper ses talens ; qu’un citoyen est redevable à sa nation & à l’humanité de tout le bien qu’il peut leur faire ; & qu’il seroit plus utile à l’une & à l’autre, en les éclairant par ses écrits, qu’il ne pouvoit l’être en discutant quelques contestations particulieres dans l’obscurité. Toutes ces réflexions le déterminerent à vendre sa charge. Il cessa d’être magistrat, & ne fut plus qu’homme de lettres.
Mais, pour se rendre utile par des ouvrages aux différentes nations, il étoit nécessaire qu’il les connût. Ce fut dans cette vue qu’il entreprit de voyager. Son but étoit d’examiner par tout le physique & le morale ; d’étudier les lois & la constitution de chaque pays ; de visiter les savants, les écrivains, les artistes célebres ; de chercher sur-tout ces hommes rares & singuliers, dont le commerce supplée quelquefois à plusieurs années d’observations & de séjour. M. de Montesquieu eût pu dire, comme Démocrite : « Je n’ai rien oublié pour m’instruire : j’ai quitté mon pays, & parcouru l’univers, pour mieux [I-72] connoître la vérité : j’ai vu tous les personnages illustres de mon temps ». Mais il y eut cette différence entre le Démocrite françois & celui d’Abdere, que le premier voyageoit pour instruire les hommes, & le second pour s’en moquer.
Il alla d’abord à Vienne, où il vit souvent le célebre Prince Eugene. Ce héros si funeste à la France (à laquelle il auroit pu être si utile), après avoir balancé la fortune de Louis XIV, & humilié la fierté ottomane, vivoit sans faste durant la paix, aimant & cultivant les lettres dans une cour où elles sont peu en honneur, & donnant à ses maîtres l’exemple de les protéger. M. de Montesquieu crut entrevoir dans ses discours quelques restes d’intérêt pour son ancienne patrie. Le prince Eugene en laissoit voir sur-tout, autant que le peut faire un ennemi, sur les suites funestes de cette division intestine qui trouble depuis si long temps l’église de France : l’homme d’état en prévoyoit la durée & les effets, & les prédit au philosophe.
M. de Montesquieu partit de Vienne pour voir la Hongrie, contrée opulente & fertile, habitée par une nation fiere & généreuse, le fléau de ses tyrans, & l’appui de ses souverains. Comme peu de personnes connoissent bien ce pays, il a écrit avec soin cette partie de ses voyages.
[I-73]
D’Allemagne, il passa en Italie. Il vit à Venise le fameux Law, à qui il ne restoit, de sa grandeur passée, que des projets heureusement destinés à mourir dans sa tête, & un diamant qu’il engageoit pour jouer aux jeux de hasard. Un jour la conversation rouloit sur le fameux systême que Law avoit inventé ; époque de tant de malheurs & de fortunes, & sur-tout d’une dépravation remarquable dans nos mœurs. Comme le parlement de Paris, dépositaire immédiat des lois dans les temps de minorité, avoit fait éprouver au ministre écossois quelque résistance dans cette occasion, M. de Montesquieu lui demanda pourquoi on n’avoit pas essayé de vaincre cette résistance par un moyen presque toujours infaillible en Angleterre, par le grand mobile des actions des hommes, en un mot, par l’argent ? Ce ne sont pas, répondit Law, des génies aussi ardens & aussi généreux que mes compatriotes ; mais ils sont beaucoup plus incorruptibles. Nous ajouterons, sans aucun préjugé de vanité nationale, qu’un corps libre pour quelques instans doit mieux résister à la corruption, que celui qui l’est toujours : le premier en vendant sa liberté, la perd ; le second ne fait, pour ainsi dire, que la prêter, & l’exerce même en l’engageant. Ainsi les circonstances & la nature du gouvernement sont les vices & les vertus des nations.
[I-74]
Un autre personnage non moins fameux, que M. de Montesquieu vit encore plus souvent à Venise, fut le comte de Bonneval. Cet homme si connu par les aventures qui n’étoient pas encore à leur terme, & flatté de converser avec un juge digne de l’entendre, lui faisoit avec plaisir le détail singulier de sa vie, le récit des actions militaires où il s’étoit trouvé, le portrait des généraux & des ministres qu’il avoit connus. M. de Montesquieu se rappelloit souvent ces conversations, & en racontoit différens traits à ses amis.
Il alla de Venise à Rome. Dans cette ancienne capitale du monde, qui l’est encore à certains égards, il s’appliqua sur-tout à examiner ce qui la distingue aujourd’hui le plus ; les ouvrages des Raphaël, des Titien, & des Michel-Ange. Il n’avoit point fait une étude particuliere des beaux arts ; mais l’expression, dont brillent les chefs-d’œuvres en ce genre, saisit infailliblement tout homme de génie. Accoutumé à étudier la nature, il la reconnoît quand elle est imitée, comme un portrait ressemblant frappa tous ceux à qui l’original est familier. Malheur aux productions de l’art dont toute la beauté n’est que pour les artistes !
Après avoir parcouru l’Italie, M. de Montesquieu vint en Suisse. Il examina [I-75] soigneusement les vastes pays arrosés par le Rhin. Et il ne lui resta plus rien à voir en Allemagne, car Frédéric ne régnoit pas encore. Il s’arrêta ensuite quelque temps dans les Provinces-Unies, monument admirable de ce que peut l’industrie humaine, animée par l’amour de la liberté. Enfin il se rendit en Angleterre, où il demeura deux ans. Digne de voir & d’entretenir les plus grands hommes, il n’eut à regretter que de n’avoir pas fait plutôt ce voyage. Locke & Newton étoient morts. Mais il eut souvent l’honneur de faire sa cour à leur protectrice, la célebre reine d’Angleterre, qui cultivoit la philosophie sur le trône, & qui goûta, comme elle le devoit, M. de Montesquieu. Il ne fut pas moins accueilli par la nation, qui n’avoit pas besoin, sur cela, de prendre le ton de ses maîtres. Il forma à Londres des liaisons intimes avec des hommes exercés à méditer, & à se préparer aux grandes choses par des études profondes. Il s’instruisit avec eux de la nature du gouvernement, & parvint à le bien connoître. Nous parlons ici d’après les témoignages publics que lui ont rendu les Anglois eux-mêmes, si jaloux de nos avantages, & si peu disposés à reconnoître en nous aucune supériorité.
Comme il n’avoit rien examiné, ni avec la prévention d’un enthousiaste, ni avec [I-76] l’austérité d’un cynique ; il n’avoit remporté de ses voyages, ni un dédain outrageant pour les étrangers, ni un mépris encore plus déplacé pour son propre pays. Il résultoit, de ses observations, que l’Allemagne étoit faite pour y voyager, l’Italie pour y séjourner, l’Angleterre pour y penser, & la France pour y vivre.
De retour enfin dans sa patrie, M. de Montesquieu se retira pendant deux ans à sa terre de la Brede. Il y jouit en paix de cette solitude que le spectacle & le tumulte du monde sert à rendre plus agréable : il vécut avec lui-même, après en être sorti si long-temps : & ce qui nous intéresse le plus, il mit la derniere main à son ouvrage sur la cause de la grandeur & de la décadence des Romains, qui parut en 1734.
Les empires, ainsi que les hommes, doivent croître, dépérir & s’éteindre. Mais cette révolution nécessaire a souvent des causes cachées, que la nuit des temps nous dérobe, & que le mystere ou leur petitesse apparente a même quelquefois voilées aux yeux des contemporains. Rien ne ressemble plus sur ce point à l’histoire moderne, que l’histoire ancienne. Celle des Romains mérite néanmoins, à cet égard, quelques exception : elle présente une politique raisonnée, un systême suivi d’agrandissement, qui ne permet pas d’attribuer la [I-77] fortune de ce peuple à des ressorts obscurs & subalternes. Les causes de la grandeur romaine se trouvent donc dans l’histoire ; & c’est au philosophe à les y découvrir. D’ailleurs, il n’en est pas des systêmes dans cette étude, comme dans celle de la Physique. Ceux-ci sont presque toujours précipités, parce qu’une observation nouvelle & imprévue peut les renverser en un instant ; au contraire, quand on recueille avec soin les faits que nous transmet l’histoire ancienne d’un pays, si on ne rassemble pas toujours tous les matériaux qu’on peut désirer, on ne sauroit du moins espérer d’en avoir un jour davantage. L’étude réfléchie de l’histoire, étude si importante & si difficile, consiste à combiner, de la maniere la plus parfaite, ces matériaux défectueux : tel seroit le mérite d’un architecte, qui, sur des ruines savantes, traceroit, de la maniere la plus vraisemblable, le plan d’un édifice antique ; en suppléant, par le génie & par d’heureuses conjectures, à des restes informes & tronqués.
C’est sous ce point de vue qu’il faut envisager l’ouvrage de M. de Montesquieu. Il trouve les causes de la grandeur des Romains dans l’amour de la liberté, du travail & de la patrie, qu’on leur inspiroit dès l’enfance ; dans ces dissentions intestines, qui donnoient du ressort aux esprits, [I-78] & qui cessoient tout-à-coup à la vue de l’ennemi ; dans cette constance après le malheur, qui ne désespéroit jamais de la république ; dans le principe où ils furent toujours de ne jamais faire la paix qu’après des victoires ; dans l’honneur du triomphe, sujet d’émulation pour les généraux ; dans la protection qu’ils accordoient aux peuples révoltés contre leurs rois ; dans l’excellente politique de laisser aux vaincus leurs dieux & leurs coutumes ; dans celle de n’avoir jamais deux puissans ennemis sur les bras, & de tout souffrir de l’un, jusqu’à ce qu’ils eussent anéanti l’autre. Il trouve les causes de leur décadence dans l’agrandissement même de l’état, qui changea en guerres civiles les tumultes populaires ; dans les guerres éloignées, qui, forçant les citoyens à une trop longue absence, leur faisoient perdre insensiblement l’esprit républicain ; dans le droit de bourgeoisie accordé à tant de nations, & qui ne fit plus, du peuple romain, qu’une espece de monstre à plusieurs têtes ; dans la corruption introduite par le luxe de l’Asie ; dans les proscriptions de Sylla, qui avilirent l’esprit de la nation, & la préparerent à l’esclavage ; dans la nécessité où les Romains se trouverent de souffrir des maîtres, lorsque leur liberté leur fut devenue à charge ; dans l’obligation où ils furent de [I-79] changer de maximes en changeant de gouvernement ; dans cette suite de monstres qui régnerent, presque sans interruption, depuis Tibere jusqu’à Nerva, & depuis Commode jusqu’à Constantin ; enfin, dans la translation & le partage de l’empire, qui périt d’abord en occident par la puissance des barbares ; & qui, après avoir langui plusieurs siecles en orient sous des empereurs imbécilles ou féroces, s’anéantit insensiblement, comme ces fleuves qui disparoissent dans des sables.
Un assez petit volume à suffi à M. de Montesquieu pour développer un tableau si intéressant & si vaste. Comme l’auteur ne s’appesantit point sur les détails, & ne saisit que les branches fécondes de son sujet, il a su renfermer en très-peu d’espace un grand nombre d’objets distinctement apperçus, & rapidement présentés, sans fatigue pour le lecteur. En laissant beaucoup voir, il laisse encore plus à penser : & il auroit pu intituler son livre, histoire romaine à l’usage des hommes d’état & des philosophes.
Quelque réputation que M. de Montesquieu se fût acquise par ce dernier ouvrage & par ceux qui l’avoient précédé, il n’avoit fait que se frayer le chemin à une plus grande entreprise, à celle qui doit immortaliser son nom, & le rendre respectable aux siecles futurs. Il en avoit dès [I-80] long-temps formé le dessein : il en médita pendant vingt ans l’exécution ; ou pour parler plus exactement, toute sa vie en avoit été la méditation continuelle. D’abord il s’étoit fait en quelque façon, étranger dans son propre pays, afin de le mieux connoître. Il avoit ensuite parcouru toute l’Europe, & profondément étudié les différens peuples qui l’habitent. L’île fameuse, qui se glorifie tant de ses lois, & qui en profite si mal, avoit été pour lui, dans ce long voyage, ce que l’île de Crete fut autrefois pour Lycurgue, une école où il avoit su s’instruire sans tout approuver. Enfin, il avoit, si on peut parler ainsi, interrogé & jugé les nations & les hommes célebres qui n’existent plus aujourd’hui que dans les annales du monde. Ce fut ainsi qu’il s’éleva par degrés au plus beau titre qu’un sage puisse mériter, celui de législateur des nations.
S’il étoit animé par l’importance de la matiere, il étoit effrayé en même temps par son étendue : il l’abandonna, & y revint à plusieurs reprises. Il sentit plus d’une fois, comme il l’avoue lui-même, tomber les mains paternelles. Encouragé enfin par ses amis, il ramassa toutes ses forces, & donna l’Esprit des Lois.
Dans cet important ouvrage, M. de Montesquieu, sans s’appesantir, à l’exemple de [I-81] ceux qui l’ont précédé, sur des discussions métaphysiques relatives à l’homme supposé dans un état d’abstraction ; sans se borner, comme d’autres, à considérer certains peuples dans quelques relations ou circonstances particulieres, envisage les habitans de l’univers dans l’état réel où ils sont, & dans tous les rapports qu’ils peuvent avoir entr’eux. La plupart des autres écrivains en ce genre sont presque toujours, ou de simples moralistes, ou de simples jurisconsultes, ou même quelquefois de simples théologiens. Pour lui, l’homme de tous les pays & de toutes les nations, il s’occupe moins de ce que le devoir exige de nous, que des moyens par lesquels on peut nous obliger de le remplir ; de la perfection métaphysique des lois, que de celle dont la nature humaine les rend susceptibles ; des lois qu’on a faites, que de celles qu’on a dû faire ; des lois d’un peuple particulier, que de celles de tous les peuples. Ainsi, en se comparant lui-même à ceux qui ont couru avant lui cette grande & noble carriere, il a pu dire, comme le Correge, quand il eut vu les ouvrages de ses rivaux, Et moi aussi, je suis peintre [3] .
Rempli & pénétré de son objet, l’auteur de l’esprit des lois y embrasse un si grand [I-82] nombre de matieres, & les traite avec tant de briéveté & de profondeur, qu’une lecture assidue & méditée peut seule faire sentir le mérite de ce livre. Elle servira sur-tout, nous osons le dire, à faire disparoître le prétendu défaut de méthode dont quelques lecteurs ont accusé M. de Montesquieu ; avantage qu’ils n’auroient pas dû le taxer légérement d’avoir négligé dans une matiere philosophique, & dans un ouvrage de vingt années. Il faut distinguer le désordre réel de celui qui n’est qu’apparent. Le désordre est réel quand l’analogie & la suite des idées n’est pas observée ; quand les conclusions sont érigées en principes, ou les précedent ; quand le lecteur, après des détours sans nombre, se trouve au point d’où il est parti. Le désordre n’est qu'apparent, quand l’auteur, mettant à leur véritable place les idées dont il fait usage, laisse à suppléer aux lecteurs les idées intermédiaires. Et c’est ainsi que M. de Montesquieu a cru pouvoir & devoir en user dans un livre destiné à des hommes qui pensent, dont le génie doit suppléer à des omissions volontaires & raisonnées.
L’ordre qui se fait appercevoir dans les grandes parties de l’esprit des lois ne regne pas moins dans les détails : nous croyons que plus on approfondira l’ouvrage, plus on en sera convaincu. Fidele à ses divisions [I-83] générales, l’auteur rapporte à chacune les objets qui lui appartiennent exclusivement ; & à l’égard de ceux qui par différentes branches appartiennent à plusieurs divisions à la fois, il a placé sous chaque division la branche qui lui appartient en propre. Par-là on apperçoit aisément & sans confusion l’influence que les différentes parties du sujet ont les unes sur les autres ; comme dans un arbre ou systême bien entendu des connoissances humaines, on peut voir le rapport mutuel des sciences & des arts. Cette comparaison d’ailleurs est d’autant plus juste, qu’il en est du plan qu’on peut se faire dans l’examen philosophique des lois comme de l’ordre qu’on peut observer dans un arbre encyclopédique que des sciences : il y restera toujours de l’arbitraire ; & tout ce qu’on peut exiger de l’auteur, c’est qu’il suive, sans détour & sans écart, le systême qu’il s’est une fois formé.
Nous dirons de l’obscurité que l’on peut se permettre dans un tel ouvrage, la même chose que du défaut d’ordre. Ce qui seroit obscur pour des lecteurs vulgaires ne l’est pas pour ceux que l’auteur a eus en vue. D’ailleurs, l’obscurité volontaire n’en est pas une. M. de Montesquieu ayant à présenter quelquefois des vérités importantes dont l’énoncé absolu & direct auroit [I-84] pu blesser sans fruit, a eu la prudence de les envelopper, & par cet innocent artifice, les a voilées à ceux à qui elles seroient nuisibles, sans qu’elles fussent perdues pour les sages.
Parmi les ouvrages qui lui ont fourni des secours, & quelquefois des vues pour le sien, on voit qu’il a sur-tout profité des deux historiens qui ont pensé le plus, Tacite & Plutarque : mais, quoiqu’un philosophe qui a fait ces deux lectures soit dispensé de beaucoup d’autres, il n’avoit pas cru devoir en ce genre, rien négliger ni dédaigner de ce qui pouvoit être utile à son objet. La lecture que suppose l’esprit des lois est immense ; & l’usage raisonné que l’auteur a fait de cette multitude prodigieuse de matériaux paroîtra encore plus surprenant, quand on saura qu’il étoit presqu’entiérement privé de la vue & obligé d’avoir recours à des yeux étrangers. Cette vaste lecture contribue non-seulement à l’utilité, mais à l’agrément de l’ouvrage. Sans déroger à la majesté de son sujet, monsieur de Montesquieu sait en tempérer l’austérité, & procurer aux lecteurs des momens de repos, soit par des faits singuliers & peu connus, soit par des allusions délicates, soit par ces coups de pinceau énergiques & brillans, qui peignent d’un seul trait les peuples & les hommes.
[I-85]
Enfin, car nous ne voulons pas jouer ici le rôle des commentateurs d’Homere, il y a sans doute des fautes dans l’esprit des lois, comme il y en a dans tout ouvrage de génie, dont l’auteur a le premier osé se frayer des routes nouvelles. M. de Montesquieu a été parmi nous pour l’étude des lois ce que Descartes a été pour la philosophie : il éclaire souvent & se trompe quelquefois ; & en se trompant même, il instruit ceux qui savent lire. Cette nouvelle édition montrera, par les additions & corrections qu’il y a faites, que s’il est tombé de temps en temps, il a su le reconnoître & se relever. Par là il acquerra du moins le droit à un nouvel examen dans les endroits où il n’aura pas été de l’avis de ses censeurs ; peut-être même ce qu’il aura jugé le plus digne de correction leur a-t-il absolument échappé, tant l’envie de nuire est ordinairement aveugle !
Mais ce qui est à la portée de tout le monde dans l’esprit des lois, ce qui doit rendre l’auteur cher à toutes les nations, ce qui serviroit même à couvrir des fautes plus grandes que les siennes, c’est l’esprit de citoyen qui l’a dicté. L’amour du bien public, le désir de voir les hommes heureux s’y montrent de toutes parts ; & n’eût-il que ce mérite si rare & si précieux, il seroit digne, par cet endroit seul, d’être la [I-86] lecture des peuples & des Rois. Nous voyons déjà par une heureuse expérience, que les fruits de cet ouvrage ne se bornent pas dans ses lectures à des sentimens stériles. Quoique M. de Montesquieu ait peu survécu à la publication de l’esprit des lois, il a eu la satisfaction d’entrevoir les effets qu’il commence à produire parmi nous ; l’amour naturel des François pour leur patrie, tourné vers son véritable objet ; ce goût pour le commerce, pour l’agriculture & pour les arts utiles, qui se répand insensiblement dans notre nation ; cette lumiere générale sur les principes du gouvernement, qui rend les peuples plus attachés à ce qu’il doivent aimer. Ceux qui on si indécemment attaqué cet ouvrage, lui doivent peut-être plus qu’ils ne s’imaginent. L’ingratitude au reste est le moindre reproche qu’on ait à leur faire. Ce n’est pas sans regret & sans honte pour notre siecle que nous allons les dévoiler : mais cette histoire importe trop à la gloire de M. de Montesquieu & à l’avantage de la philosophie, pour être passée sous silence. Puisse l’opprobre qui couvre enfin ses ennemis leur devenir salutaire !
À peine l’Esprit des Lois parut-il, qu’il fut recherché avec empressement sur la réputation de l’auteur : mais quoique M. de Montesquieu eût écrit pour le bien du [I-87] peuple, il ne devoit pas avoir le peuple pour juge : la profondeur de l’objet étoit une suite de son importance même. Cependant les traits qui étoient répandus dans l’ouvrage, & qui auroient été déplacés s’ils n’étoient pas nés du fond du sujet, persuaderent à trop de personnes qu’il étoit écrit pour elles. On cherchoit un livre agréable, & on ne trouvoit qu’un livre utile, dont on ne pouvoit d’ailleurs, sans quelque attention, saisir l’ensemble & les détails. On traita légérement l’esprit des lois, le titre même fut un sujet de plaisanterie ; enfin, l’un des plus beaux monumens littéraires qui soient sortis de notre nation fut regardé d’abord par elle avec assez d’indifférence. Il fallut que les véritables juges eussent eu le temps de lire : bientôt ils ramenerent la multitude toujours prompte à changer d’avis. La partie du public qui enseigne dicta à la patrie qui écoute ce qu’elle devoit penser & dire ; & le suffrage des hommes éclairés, joint aux échos qui le répéterent, ne forma plus qu’une voix dans toute l’Europe.
Ce fut alors que les ennemis publics & secrets des lettres & de la philosophie (car elles en ont de ces deux especes) réunirent leurs traits contre l’ouvrage. De là, cette foule de brochures qui lui furent lancées de toutes parts, & que nous ne tirerons pas de l’oubli où elles sont déjà plongées. Si [I-88] les auteurs n’avoient pris de bonnes mesures pour être inconnus à la postérité, elle croiroit que l’esprit des lois a été écrit au milieu d’un peuple de barbares.
M. de Montesquieu méprisa sans peine les critiques ténébreuses de ces auteurs sans talent qui, soit par une jalousie qu’ils n’ont pas droit d’avoir, soit pour satisfaire la malignité du public qui aime la satire & la méprise, outragent ce qu’ils ne peuvent atteindre ; & plus odieux par le mal qu’ils veulent faire, que redoutables par celui qu’ils font, ne réussissent pas même dans un genre d’écrire que sa facilité & son objet rendent également vil. Il mettoit les ouvrages de cette espece sur la même ligne que ces nouvelles hebdomadaires de l’Europe dont les éloges sont sans autorité & les traits sans effet, que des lecteurs oisifs parcourent sans y ajouter fois, & dans lesquelles les souverains sont insultés sans le savoir, ou sans daigner s’en venger. Il ne fut pas aussi indifférent sur les principes d’irréligion qu’on l’accusa d’avoir semé dans l’esprit des lois. En méprisant de pareils reproches, il auroit cru les mériter ; & l’importance de l’objet lui ferma les yeux sur la valeur de ses adversaires. Ces hommes également dépourvus de zele, & également empressés d’en faire paroître, également effrayés de la lumiere que les [I-89] lettres répandent, non au préjudice de la religion, mais à leur désavantage, avoient pris différentes formes pour lui porter atteinte. Les uns par un stratagême aussi puéril que pusillanime, s’étoient écrit à eux-mêmes ; les autres, après l’avoir déchiré sous le masque de l’anonyme, s’étoient ensuite déchirés entr’eux à son occasion. M. de Montesquieu, quoique jaloux de les confondre, ne jugea pas à propos de perdre un temps précieux à les combattre les uns après les autres : il se contenta de faire un exemple sur celui qui s’étoit le plus signalé par ses excès.
C’étoit l’auteur d’une feuille anonyme & périodique, qui croit avoir succédé à Pascal, parce qu’il a succédé à ses opinions ; panégyriste d’ouvrages que personne ne lit, & apologiste de miracles que l’autorité séculiere a fait cesser dès qu’elle l’a voulu ; qui appelle impiété & scandale le peu d’intérêt que les gens de lettres prennent à ses querelles, & s’est aliéné, par une adresse digne de lui, la partie de la nation qu’il avoit le plus d’intérêt de ménager. Les coups de ce redoutable athlete furent dignes des vues qui l’inspirerent : il accusa M. de Montesquieu de spinosisme & de déisme (deux imputations incompatibles) ; d’avoir suivi le systême de Pope (dont il n’y avoit pas un mot dans [I-90] l’ouvrage ; ) d’avoir cité Plutarque, qui n’est pas un auteur chrétien ; de n’avoir point parlé du péché originel & de la grace. Il prétendit enfin que l’esprit des lois étoit une production de la constitution unigenitus ; idée qu’on nous soupçonnera peut-être de prêter par dérision au critique. Ceux qui ont connu M. de Montesquieu, l’ouvrage de Clément XI. & le sien, peuvent juger, par cette accusation, de toutes les autres.
Le malheur de cet écrivain dut bien le décourager : il vouloit perdre un sage par l’endroit le plus sensible à tout citoyen, il ne fit que lui procurer une nouvelle gloire, comme homme de lettres : la défense de l’esprit des lois parut. Cet ouvrage, par la modération, la vérité, la finesse de plaisanterie qui y regnent, doit être regardé comme un modele en ce genre. M. de Montesquieu, chargé par son adversaire d’imputations atroces, pouvoit le rendre odieux sans peine ; il fit mieux, il le rendit ridicule. S’il faut tenir compte à l’agresseur d’un bien qu’il a fait sans le vouloir, nous lui devons une éternelle reconnoissance de nous avoir procuré ce chef-d’œuvre. Mais, ce qui ajoute encore au mérité de ce morceau précieux, c’est que l’auteur s’y est peint lui même sans y penser : ceux qui l’ont connu croient l’entendre ; & la postérité s’assurera, en lisant sa [I-91] défense, que sa conversation n’étoit pas inférieure à ses écrits ; éloge que bien peu de grands hommes ont mérité.
Une autre circonstance lui assure pleinement l’avantage dans cette dispute. Le critique, qui, pour preuve de son attachement à la religion, en déchire les ministres, accusoit hautement le clergé de France, & sur-tout la faculté de théologie, d’indifférence pour la cause de Dieu, en ce qu’ils ne proscrivoient pas authentiquement un si pernicieux ouvrage. La faculté étoit en droit de mépriser le reproche d’un écrivain sans aveu : mais il s’agissoit de la religion ; une délicatesse louable lui a fait prendre le parti d’examiner l’esprit des lois. Quoiqu’elle s’en occupe depuis plusieurs années elle n’a rien prononcé jusqu’ici ; &, fût-il échappé à M. de Montesquieu quelques inadvertances légeres, presque inévitables dans une carriere si vaste, l’attention longue & scrupuleuse qu’elles auroient demandé de la part du corps le plus éclairé de l’église, prouveroit au moins combien elles seroient excusables. Mais ce corps, plein de prudence, ne précipitera rien dans une si importante matiere. Il connoît les bornes de la raison & de la foi : il sais que l’ouvrage d’un homme de lettres ne doit point être examiné comme celui d’un théologien ; que les mauvaises conséquences, [I-92] auxquelles une proposition peut donner lieu par des interprétations odieuses, ne rendent point blâmable la proposition en elle-même ; que d’ailleurs nous vivons dans un siecle malheureux, où les intérêts de la religion ont besoin d’être ménagés, & qu’on peut lui nuire auprès des simples, en répandant mal-à-propos sur des génies du premier ordre, le soupçon d’incrédulité ; qu’enfin, malgré cette accusation injuste, M. de Montesquieu fut toujours estimé, recherché & accueilli par tout ce que l’église a de plus respectable & de plus grand. Eût-il conservé auprès des gens de bien la considération dont il jouissoit, s’ils l’eussent regardé comme un écrivain dangereux ?
Pendant que des insectes le tourmentoient dans son propre pays, l’Angleterre élevoit un monument à sa gloire. En 1752 M. Dassier, célebre par les médailles qu’il a frappées à l’honneur de plusieurs hommes illustres, vint de Londres à Paris pour frapper la sienne. M. de la Tour, cet artiste si supérieur par son talent, & si estimable par son désintéressement & l’élévation de son ame, avoit ardemment désiré de donner un nouveau lustre à son pinceau, en transmettant à la postérité le portrait de l’auteur de l’esprit des lois ; il ne vouloit que la satisfaction de le peindre ; & il méritoit, comme Appelle, que cet [I-93] honneur lui fût réservé : mais M. de Montesquieu, d’autant plus avare du temps de M. de la Tour que celui-ci en étoit plus prodigue, se refusa constamment & poliment à ses pressantes sollicitations. M. Dassier essuya d’abord des difficultés semblables. « Croyez-vous, dit-il enfin à M. de Montesquieu, qu’il n’y ait pas autant d’orgueil à refuser ma proposition qu’à l’accepter ? Désarmé par cette plaisanterie, il laissa faire à M. Dassier tout ce qu’il voulut.
L’auteur de l’esprit des lois jouissoit enfin paisiblement de sa gloire, lorsqu’il tomba malade au commencement de février. Sa santé, naturellement délicate, commençoit à s’altérer depuis long-temps, par l’effet lent & presque infaillible des études profondes, par les chagrins qu’on avoit cherché à lui susciter sur son ouvrage, enfin par le genre de vie qu’on le forçoit de mener à Paris, & qu’il sentoit lui être funeste. Mais l’empressement avec lequel on recherchoit sa société étoit trop vif, pour n’être pas quelquefois indiscret ; on vouloit, sans s’en appercevoir, jouir de lui aux dépens de lui-même. À peine la nouvelle du danger où il étoit se fut-elle répandue, qu’elle devint l’objet des conversations & de l’inquiétude publique. Sa maison ne désemplissoit pas de personnes de tout rang qui venoient s’informer de [I-94] son état ; les unes par un intérêt véritable, les autres pour s’en donner l’apparence, ou pour suivre la foule. Sa Majesté, pénétrée de la perte que son royaume alloit faire, en demanda plusieurs fois des nouvelles ; témoignage de bonté & de justice, qui n’honore pas moins le monarque que le sujet. La fin de M. de Montesquieu ne fut point indigne de sa vie. Accable de douleurs cruelles, éloigné d’une famille à qui il étoit cher, & qui n’a pas eu la consolation ne lui fermer les yeux, entouré de quelques amis, & d’un plus grand nombre de spectateurs, il conserva, jusqu’au dernier moment, la paix & l’égalité de son ame. Enfin, après avoir satisfait avec décence à tous les devoirs, plein de confiance en l’être éternel auquel il alloit se rejoindre, il mourut avec la tranquillité d’un homme de bien, qui n’avoit jamais consacré ses talens qu’à l’avantage de la vertu & de l’humanité. La France & l’Europe le perdirent le 10 février 1755, à l’âge de soixante-six ans révolus.
Toutes les nouvelles publiques ont annoncé cet événement comme une calamité. On pourroit appliquer à M. de Montesquieu ce qui a été dit autrefois d’un illustre Romain ; que personne, en apprenant sa mort, n’en témoigna de joie ; que personne même ne l’oublia dès qu’il ne fut [I-95] plus. Les étrangers s’empresserent de faire éclater leurs regrets, & milors Chesterfield, qu’il suffit de nommer, fit imprimer, dans un des papiers publics de Londres, un article en son honneur, article digne de l’un & de l’autre ; c’est le portrait d’Anaxagore, tracé par Périclès. [4] [I-96] L’académie royale des sciences & des belles-lettres de Prusse, quoiqu’on n’y soit point dans l’usage de prononcer l’éloge des associés étrangers, a cru devoir lui faire cet honneur, qu’elle n’a fait encore qu’à l’illustre Jean Bernoulli. M. de Maupertuis, tout malade qu’il étoit, a rendu lui-même à son ami ce dernier devoir, & n’a voulu se reposer sur personne d’un soin si cher & si triste. À tant se suffrages éclatans en faveur de M. de Montesquieu, nous croyons pouvoir joindre, sans indiscrétion, les éloges que lui a donnés en présence de l’un de nous, le monarque même auquel cette académie célebre doit son lustre, prince fait pour sentir les pertes de la philosophie, & pour l’en consoler.
Le 17 février, l’académie françoise lui fit, selon l’usage, un service solennel, auquel, malgré la rigueur de la saison, presque tous les gens de lettres de ce corps, qui n’étoient point absens de Paris, se firent un devoir d’assister. On auroit dû, dans cette triste cérémonie, placer l’esprit des lois sur son cercueil, comme on exposa autrefois, vis-à-vis le cercueil de Raphaël, son dernier tableau de la [I-97] transfiguration. Cet appareil simple & touchant eût été une belle oraison funebre.
Jusqu’ici nous n’avons considéré monsieur de Montesquieu que comme écrivain & philosophe : ce seroit lui dérober la moitié de sa gloire, que de passer sous silence ses agrémens & ses qualités personnelles.
Il étoit dans le commerce, d’une douceur & d’une gaieté toujours égales. Sa conversation étoit légère, agréable & instructive par le grand nombre d’hommes & de peuples qu’il avoit connus. Elle étoit coupée, comme son style, pleine de sel & de saillies, sans amertume & sans satire. Personne ne racontoit plus vivement, plus promptement, avec plus de grace & moins d’apprêt. Il savoit que la fin d’une histoire plaisante en est toujours le but ; il se hâtoit donc d’y arriver, & produisoit l’effet sans l’avoir promis.
Ses fréquentes distractions ne le rendoient que plus aimable ; il en sortoit toujours par quelque trait inattendu, qui réveilloit la conversation languissante : d’ailleurs, elles n’étoient jamais, ni jouées, ni choquantes, ni importunes. Le feu de son esprit, le grand nombre d’idées dont il étoit plein, les faisoient naître ; mais il n’y tomboit jamais au milieu d’un entretien intéressant ou sérieux : le désir de plaire à [I-98] ceux avec qui il se trouvoit, le rendoit alors à eux sans affectation & sans effort.
Les agrémens de son commerce tenoient non seulement à son caractere & à son esprit, mais à l’espece de régime qu’il observoit dans l’étude. Quoique capable d’une méditation profonde & soutenue, il n’épuisoit jamais ses forces ; il quittoit toujours le travail avant que d’en ressentir la moindre impression de fatigue [5] .
Il étoit sensible à la gloire ; mais il ne vouloit y parvenir qu’en la méritant. Jamais il n’a cherché à augmenter la sienne par ces manœuvres sourdes, par ces voies obscures & honteuses, qui déshonorent la personne, sans ajouter au nom de l’auteur.
Digne de toutes les distinctions & de toutes les récompenses, il ne demandoit [I-99] rien, & ne s’étonnoit point d’être oublié : mais il a osé, même dans des circonstances délicates, protéger à la cour des hommes de lettres persécutés, célebres & malheureux, & leur a obtenu des graces.
Quoiqu’il vécût avec les grands, soit par nécessité, soit par convenance, soit par goût, leur société n’étoit pas nécessaire à son honneur. Il fuyoit, dès qu’il le pouvoit, à sa terre ; il y retrouvoit, avec joie sa philosophie, ses livres, & le repos. Entouré des gens de la campagne dans ses heures de loisir, après avoir étudié l’homme dans le commerce du monde & dans l’histoire des nations, il l’étudioit encore dans ces ames simples que la nature seule a instruites, & il y trouvoit à apprendre ; il conversoit gaiement avec eux ; il leur cherchoit de l’esprit, comme Socrate ; il paroissoit se plaire autant dans leur entretien, que dans les sociétés les plus brillantes, sur-tout quand il terminoit leurs différents, & soulageoit leurs peines par ses bienfaits.
Rien n’honore plus sa mémoire que l’économie avec laquelle il vivoit, & qu’on a osé trouver excessive, dans un monde avare & fastueux, peu fait pour en pénétrer les motifs, & encore moins pour les sentir. Bienfaisant, & par conséquent juste, monsieur de Montesquieu ne vouloit [I-100] rien prendre sur sa famille, ni des secours qu’il donnoit aux malheureux, ni des dépenses considérables auxquelles ses longs voyages, la foiblesse de sa vue, & l’impression de ses ouvrages, l’avoient obligé. Il a transmis à ses enfans, sans diminution ni augmentation, l’héritage qu’il avoit reçu de ses peres ; il n’y a rien ajouté que la gloire de son nom & l’exemple de sa vie.
Il avoit épousé en 1715, demoiselle Jeanne de Lartigue, fille de Pierre de Lartigue, Lieutenant-Colonel au régiment de Maulévrier : il en a eu deux filles & un fils, qui par son caractere, ses mœurs & ses ouvrages, s’est montré digne d’un tel pere.
Ceux qui aiment la vérité & la patrie, ne seront pas fâchés de trouver ici quelques-unes de ses maximes : il pensoit,
Que chaque portion de l’état doit être également soumise aux lois ; mais que les privileges de chaque portion de l’état doivent êtres respectés, lorsque leurs effets n’ont rien de contraire au droit naturel, qui oblige tous les citoyens à concourir également au bien public : que la possession ancienne étoit, en ce genre, le premier des titres, & le plus inviolable des droits, qu’il étoit toujours injuste, & quelquefois dangereux de vouloir ébranler.
Que les magistrat, dans quelque [I-101] circonstance, & pour quelque grand intérêt de corps que ce puisse être, ne doivent jamais être que magistrats, sans parti & sans passion, comme les lois, qui absolvent & punissent sans aimer ni haïr.
Il disoit enfin, à l’occasion des disputes ecclésiastiques qui ont tant occupé les empereurs & les chrétiens grecs, que les querelles théologiques, lorsqu’elles cessent d’être renfermées dans les écoles, déshonorent infailliblement une nation aux yeux des autres : en effet, le mépris même des sages pour ces querelles ne la justifie pas ; parce que les sages faisant par-tout le moins de bruit & le plus petit nombre, ce n’est jamais sur eux qu’une nation est jugée.
L’importance des ouvrages dont nous avons eu à parler dans cet éloge, nous en a fait passer sous silence de moins considérables, qui servoient à l’auteur comme de délassement, & qui auroient suffi pour l’éloge d’un autre. Le plus remarquable est le temple de Gnide, qui suivit d’assez près les lettres persanes. M. de Montesquieu, après avoir été, dans celles-ci, Horace, Théophraste & Lucien, fut Ovide & Anacréon dans ce nouvel essai. Ce n’est plus l’amour despotique de l’orient qu’il se propose de peindre ; c’est la délicatesse & la naïveté de l’amour pastoral, tel qu’il est [I-102] dans une ame neuve que le commerce des hommes n’a point encore corrompue. L’auteur craignant peut-être qu’un tableau si étranger à nos mœurs, ne parût trop languissant & trop uniforme, a cherché à l’animer par les peintures les plus riantes. Il transporte le lecteur dans des lieux enchantés, dont à la vérité le spectacle intéresse peu l’amant heureux, mais dont la description flatte encore l’imagination, quand les désirs sont satisfaits. Emporté par son sujet, il a répandu dans sa prose ce style animé, figuré & poëtique, dont le roman de Télémaque a fourni parmi nous le premier modele. Nous ignorons pourquoi quelques censeurs du temple de Gnide ont dit à cette occasion, qu’il auroit eu besoin d’être en vers. Le style poëtique, si on entend, comme on le doit par ce mot, un style plein de chaleur & d’images, n’a pas besoin, pour être agréable, de la marche uniforme & cadencée de la versification : mais, si on ne fait consister ce style que dans une diction chargée d’épithetes oisives, dans les peintures froides & triviales des ailes & du carquois de l’amour, & de semblables objets, la versification n’ajoutera presqu’aucun mérite à ces ornemens usés : on y cherchera toujours en vain l’ame & la vie. Quoi qu’il en soit, le temple de Gnide étant une espece de poëme en prose, [I-103] c’est à nos écrivains les plus célebres en ce genre à fixer le rang qu’il doit occuper : il mérite de pareils juges. Nous croyons du moins que les peintures de cet ouvrage soutiendroient avec succès une des principales épreuves des descriptions poétiques, celle de les représenter sur la toile. Mais ce qu’on doit sur-tout remarquer dans le temple de Gnide, c’est qu’Anacréon même y est toujours observateur & philosophe. Dans le quatrieme chant, il paroît décrire les mœurs des Sibarites ; & on s’aperçoit aisément que ces mœurs sont les nôtres. La préface porte sur-tout l’empreinte de l’auteur des lettres persanes. En présentant le temple de Gnide comme la traduction d’un manuscrit grec, plaisanterie défigurée depuis par tant de mauvais copistes, il en prend occasion de peindre d’un trait de plume l’ineptie des critiques & le pédantisme des traducteurs, & finit par ces paroles dignes d’être rapportés : « Si les gens graves désiroient de moi quelque ouvrage moins frivole, je suis en état de les satisfaire. Il y a trente ans que je travaille à un livre de douze pages, qui doit contenir tout ce que nous savons sur la métaphysique, la politique & la morale, & tout ce que de très-grands auteur ont oublié dans les volumes qu’ils ont donnés sur ces sciences-là ».
[I-104]
Nous regardons comme une des plus honorables récompenses de notre travail, l’intérêt particulier que M. de Montesquieu prenoit à l’encyclopédie, dont toutes les ressources ont été jusqu’à présent dans le courage & l’émulation de ses auteurs. Tous les gens de lettres, selon lui, devoient s’empresser de concourir à l’exécution de cette entreprise utile. Il en a donné l’exemple, avec M. de Voltaire, & plusieurs autres écrivains célebres. Peut-être les traverses que cet ouvrage a essuyées, & qui lui rappelloient les siennes propres, l’intéressoient-elles en notre faveur. Peut-être étoit-il sensible, sans s’en apercevoir, à la justice que nous avions osé lui rendre dans le premier volume de l’encyclopédie, lorsque personne n’osoit encore élever sa vois pour le défendre. Il nous destinoit un article sur le goût, qui a été trouvé imparfait dans ses papiers : nous le donnerons en cet état au public, & nous le traiterons avec le même respect que l’antiquité témoigna autrefois pour les dernieres paroles de Séneque. La mort l’a empêché d’étendre plus loin ses bienfaits à notre égard, & en joignant nos propres regrets à ceux de l’Europe entiere, nous pourrions écrire sur son tombeau :
Finis vitæ ejus nobis luctuosus, PATRIÆ tristis,
extraneis etiam ignotisque non sine curâ suit.Tacit. in Agricol. c. 430
-
[↑] C’étoit un ouvrage en forme de lettres, dont le but étoit de prouver que l’idolâtrie de la plupart des païens ne paroissoit pas mériter une damnation éternelle.
-
[↑] On le trouvera à la fin de cet éloge.
-
[↑] On trouvera à la suite de cet éloge, l’analyse de l’Esprit des Lois, par le même auteur.
-
[↑] Voici cet éloge en Anglois, tel qu’on le lit dans la gazette appellée evening-post, ou poste du soir :
On the tenth of this month, died at Paris, universally and sincerely regretted, Charles Secondat, baron of Montesquieu, and President a mortier of the Parliament of Bourdeaux. His virtues did honour to human nature, his writings justice. A friend to mankind, he asserted their undoubted and inalienable rights with freedom, even in his own country, whose prejudices in matters of religion and government, (il faut se ressouvenir que c’est un Anglois qui parle) he had long lamented, and endeavoured (not without some success) to remove. He well know, and justly admired the happy constitution of this country, where fix’d and known laws equally restrain monarchy from tyranny, and liberty from licentiousness. His works will illustrate his name, and survive him as long as right reason, moral obligation, and the true spirit of laws, shall be underflood, respected and maintained. C’EST-À-DIRE :
Le 10 de février, est mort à Paris, universellement & sincérement regretté, Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, Président à mortier au Parlement de Bordeaux. Ses vertus ont fait honneur à la nature humaine ; ses écrits lui ont rendu & fait rendre justice. Ami de l’humanité, il en soutint avec force & avec vérité les droits indubitables & inaliénables… Il connoissoit parfaitement bien, & admiroit avec justice, l’heureux gouvernement de ce pays, dont les lois fixes & connues sont un frein contre la monarchie qui tendroit à la tyrannie, & contre la liberté qui dégénéreroit en licence. Ses ouvrages rendront son nom célèbre ; & lui survivront aussi long-temps que la droite raison, les obligations morales, & le vrai esprit des lois seront entendus, respectés & conservés. -
[↑] L’auteur de la feuille anonyme & périodique, dont nous avons parlé ci dessus, prétend trouver une contradiction manifeste, entre ce que nous disons ici & ce que nous avons dit un peu plus haut, que la santé de M. de Montesquieu s’étoit altérée par l’effet lent & presque infaillible des études profondes. Mais pourquoi, en rapprochant les deux endroits, a-t-il supprimé les mots lent & presque infaillible, qu’il avoit sous les yeux ? C’est évidemment parce qu’il a senti qu’un effet lent n’est pas moins réel, pour n’être pas ressenti sur le champ ; & que par conséquent ces mots détruisoient l’apparence de la contradiction qu’on prétendoit faire remarquer. Telle est la bonne foi de cet auteur dans des bagatelles, & à plus forte raison dans des matieres plus sérieuses. Note tirée de l’avertissement du sixieme volume de l’Encyclopédie.
[I-105]
ANALYSE DE L’ESPRIT DES LOIS, PAR M. D’ALEMBERT, ↩
Pour servir de suite à l’éloge de M. de MONTESQUIEU.
La plupart des gens de lettres qui ont parlé de l’esprit des lois, s’étant plus attachés à le critiquer, qu’à en donner une juste idée, nous allons tâcher de suppléer à ce qu’ils auroient dû faire, & d’en développer le plan, le caractere & l’objet. Ceux qui en trouveront l’analyse trop longue, jugeront peut-être, après l’avoir lue, qu’il n’y avoit que ce seul moyen de bien faire saisir la méthode de l’auteur. On doit se souvenir, d’ailleurs, que l’histoire des écrivains célebres n’est que celle de leurs pensées & de leurs travaux ; & que cette partie de leur éloge en est la plus essentielle & la plus utile.
Les hommes, dans l’état de nature, abstraction faite de toute religion, ne connoissant, dans les différents qu’ils peuvent avoir, d’autre loi que celle des animaux, le droit du plus fort, on doit regarder l’établissement des sociétés comme une [I-106] espece de traité contre ce droit injuste ; traité destiné à établir entre les différentes parties du genre humain une sorte de balance. Mais il en est de l’équilibre moral comme du physique ; il est rare qu’il soit parfait & durable, & les traités du genre humain sont comme les traités entre nos Princes, une semence continuelle de divisions. L’intérêt, le besoin & le plaisir ont rapproché les hommes. Mais ces mêmes motifs les poussent sans cesse à vouloir jouir des avantages de la société sans en porter les charges ; & c’est en ce sens qu’on peut dire, avec l’auteur, que les hommes, dès qu’ils sont en société, sont en état de guerre. Car la guerre suppose, dans ceux qui se la font, sinon l’égalité de force, au moins l’opinion de cette égalité ; d’où naît le désir & l’espoir mutuel de se vaincre : or dans l’état de société, si la balance n’est jamais parfaite entre les hommes, elle n’est pas non plus trop inégale : au contraire : ou ils n’auroient rien à se disputer dans l’état de nature ; ou si la nécessité les y obligeoit, on ne verroit que la foiblesse fuyant devant la force, des oppresseurs sans combat, & des opprimés sans résistance.
Voilà donc les hommes réunis & armés tout à la fois, s’embrassant d’un côté, si on peut parler ainsi ; & cherchant de l’autre à se blesser mutuellement. Les lois sont [I-107] le lien plus ou moins efficace, destiné à suspendre ou à retenir leurs coups. Mais l’étendue prodigieuse du globe que nous habitons, la nature différente des régions de la terre & des peuples qui la couvrent, ne permettant pas que tous les hommes vivent sous un seul & même gouvernement, le genre humain a dû se partager en un certain nombre d’États, distingués par la différence des lois auxquelles ils obéissent. Un seul gouvernement n’auroit fait du genre humain qu’un corps exténué & languissant, étendu sans vigueur sur la surface de la terre : les différens états sont autant de corps agiles & robustes, qui, en se donnant la main les uns aux autres, n’en forment qu’un, & dont l’action réciproque entretient par-tout le mouvement & la vie.
On peut distinguer trois sortes de gouvernemens ; le républicain, le monarchique, le despotique. Dans le républicain, le peuple en corps a la souveraine puissance. Dans le monarchique un seul gouverne par des lois fondamentales. Dans le despotique, on ne connoît d’autre loi que la volonté du maître, ou plutôt du tyran. Ce n’est pas à dire qu’il n’y ait dans l’univers que ces trois especes d’états ; ce n’est pas à dire même qu’il y ait des états qui appartiennent uniquement & rigoureusement à quelqu’une de ces formes ; la plupart sont, [I-108] pour ainsi dire, mi-partis ou nuancés les uns des autres. Ici, la monarchie incline au despotisme ; là, le gouvernement monarchique est combiné avec le républicain ; ailleurs, ce n’est pas le peuple entier, c’est seulement une partie du peuple qui fait les lois. Mais la division précédente n’en est pas moins exacte & moins juste. Les trois especes de gouvernement qu’elle renferme sont tellement distinguées, qu’elles n’ont proprement rien de commun ; & d’ailleurs, tous les états que nous connoissons participent de l’une & de l’autre. Il étoit donc nécessaire de former, de ces trois especes, des classes particulieres, & de s’appliquer à déterminer les lois qui leur sont propres. Il sera facile ensuite de modifier ces lois dans l’application à quelque gouvernement que ce soit, selon qu’il appartiendra plus ou moins à ces différentes formes.
Dans les divers états, les lois doivent être relatives à leur nature, c’est-à-dire, à ce qui les constitue ; & à leur principe, c’est-à-dire, à ce qui les soutient & les fait agir : distinction importante, la clef d’une infinité de lois, & dont l’auteur tire bien des conséquences.
Les principales lois relatives à la nature de la démocratie sont que le peuple y soit, à certains égards, le monarque ; à [I-109] d’autres, le sujet ; qu’il élise & juge ses magistrats ; & que les magistrats, en certaines occasions, décident. La nature de la monarchie demande qu’il y ait, entre le monarque & le peuple, beaucoup de pouvoirs & de rangs intermédiaires, & un corps dépositaire des lois, médiateur entre les sujets & le prince. La nature du despotisme exige que le tyran exerce son autorité, ou par lui seul, ou par un seul qui le représente.
Quant au principe des trois gouvernemens, celui de la démocratie est l’amour de la république, c’est-à-dire de l’égalité : dans les monarchies, où un seul est le dispensateur des distinctions & des récompenses, où l’on s’accoutume à confondre l’état avec ce seul homme, le principe est l’honneur, c’est-à-dire, l’ambition & l’amour de l’estime : sous le despotisme enfin, c’est la crainte. Plus ces principes sont en vigueur, plus le gouvernement est stable ; plus ils s’alterent & se corrompent, plus il incline à sa destruction. Quand l’auteur parle de l’égalité dans les démocraties, il n’entend pas une égalité extrême, absolue, & par conséquent chimérique ; il entend cet heureux équilibre qui rend tous les citoyens également soumis aux lois, & également intéressés à les observer.
Dans chaque gouvernement, les lois de [I-110] l’éducation doivent être relatives au principe. On entend ici par éducation, celle qu’on reçoit en entrant dans le monde ; & non celle des parens & des maîtres, qui souvent y est contraire, sur-tout dans certains états. Dans les monarchies, l’éducation doit avoir pour objet l’urbanité & les égards réciproques ; dans les états despotiques, la terreur & l’avilissement des esprits ; dans les républiques, on a besoin de toute la puissance de l’éducation ; elle doit inspirer un sentiment noble, mais pénible, le renoncement à soi-même, d’où naît l’amour de la patrie.
Les lois que le législateur donne doivent être conformes au principe de chaque gouvernement ; dans la république, entretenir l’égalité & la frugalité ; dans la monarchie, soutenir la noblesse, sans écraser le peuple ; sous le gouvernement despotique, tenir également tous les états dans le silence. On ne doit point accuser M. de Montesquieu d’avoir ici tracé aux souverains les principes du pouvoir arbitraire, dont le nom seul est odieux aux princes justes, & à plus forte raison, au citoyen sage & vertueux. C’est travailler à l’anéantir, que de montrer ce qu’il faut faire pour le conserver ; la perfection de ce gouvernement en est la ruine ; & le code exact de la tyrannie, tel que l’auteur le donne, est [I-111] en même temps la satire & le fléau le plus redoutable des tyrans. À l’égard des autres gouvernemens, ils ont chacun leurs avantages : Le républicain est plus propre aux petits états, le monarchique aux grands ; le républicain plus sujet aux excès, le monarchique aux abus ; le républicain apporte plus de maturité dans l’exécution des lois, le monarchique plus de promptitude.
La différence des principes des trois gouvernemens doit en produire dans le nombre & l’objet des lois, dans la forme des jugemens, & la nature des peines. La constitution des monarchies étant invariable & fondamentale, exige plus de lois civiles & de tribunaux, afin que la justice soit rendue d’une maniere plus uniforme & moins arbitraire. Dans les états modérés, soit monarchies, soit républiques, on ne sauroit apporter trop de formalités aux lois criminelles. Les peines doivent non-seulement être en proportion avec le crime, mais encore les plus douces qu’il est possible, sur-tout dans la démocratie : l’opinion attachée aux peines fera souvent plus d’effet que leur grandeur même. Dans les républiques, il faut juger selon la loi, parce qu’aucun particulier n’est le maître de l’altérer. Dans les monarchies, la clémence du souverain peut quelquefois l’adoucir ; mais les crimes ne doivent jamais y être [I-112] jugés que par les Magistrats expressément chargés d’en connoître. Enfin, c’est principalement dans les démocraties que les lois doivent être séveres contre le luxe, le relâchement des mœurs, la séduction des femmes. Leur douceur, leur foiblesse même les rend assez propres à gouverner dans les monarchies ; & l’histoire prouve que souvent elles ont porté la couronne avec gloire.
M. de Montesquieu ayant ainsi parcouru chaque gouvernement en particulier, les examine ensuite dans le rapport qu’ils peuvent avoir les uns aux autres, mais seulement sous le point de vue le plus général, c’est-à-dire, sous celui qui est uniquement relatif à leur nature & à leur principe. Envisagés de cette maniere, les états ne peuvent avoir d’autres rapports que celui de se défendre ou d’attaquer. Les républiques devant, par leur nature, renfermer un petit état, elles ne peuvent se défendre sans alliance ; mais c’est avec des républiques qu’elles doivent s’allier. La force défensive de la monarchie consiste principalement à avoir des frontieres hors d’insulte. Les états ont, comme les hommes, le droit d’attaquer pour leur propre conservation : du droit de la guerre dérive celui de conquête ; droit nécessaire, légitime & malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense pour s’acquitter envers la [I-113] nature humaine, & dont la loi générale est de faire aux vaincus le moins de mal qu’il est possible. Les républiques peuvent moins conquérir que les monarchies : des conquêtes immenses supposent le despotisme ou l’assurent. Un des grands principes de l’esprit de conquête doit être de rendre meilleure, autant qu’il est possible, la condition du peuple conquis : c’est satisfaire tout à la fois, la loi naturelle & la maxime d’état. Rien n’est plus beau que le traité de paix de Gélon avec les Carthaginois, par lequel il leur défendit d’immoler à l’avenir leurs propres enfans. Les Espagnols, en conquérant le Pérou, auroient dû obliger de même les habitans à ne plus immoler des hommes à leurs dieux ; mais ils crurent plus avantageux d’immoler ces peuples même. Ils n’eurent plus pour conquête qu’un vaste désert ; ils furent forcés à dépeupler leur pays, & s’affoiblirent pour toujours par leur propre victoire. On peut être obligé quelquefois de changer les lois du peuple vaincu ; rien ne peut jamais obliger de lui ôter ses mœurs, ou même ses coutumes, qui sont souvent toutes ses mœurs. Mais le moyen le plus sûr de conserver une conquête, c’est de mettre, s’il est possible, le peuple vaincu au niveau du peuple conquérant, de lui accorder les mêmes droits & les [I-114] mêmes privileges : c’est ainsi qu’en ont souvent usé les Romains ; c’est ainsi sur-tout qu’en usa César à l’égard des Gaulois.
Jusqu’ici, en considérant chaque gouvernement, tant en lui-même, que dans son rapport aux autres, nous n’avons eu égard ni à ce qui doit leur être commun, ni aux circonstances particulieres, tirées, ou de la nature du pays, ou du génie des peuples : C’est ce qu’il faut maintenant développer.
La loi commune de tous les gouvernemens, du moins des gouvernemens modérés, & par conséquent justes, est la liberté politique dont chaque citoyen doit jouir. Cette liberté n’est point la licence absurde de faire tout ce qu’on veut, mais le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent. Elle peut être envisagée, ou dans son rapport à la constitution, ou dans son rapport au citoyen.
Il y a, dans la constitution de chaque état, deux sortes de pouvoirs, la puissance législative & l’exécutrice ; & cette derniere a deux objets, l’intérieur de l’état, & le dehors. C’est de la distribution légitime & de la répartition convenable de ces différentes especes de pouvoirs, que dépend la plus grande perfection de la liberté politique, par rapport à la constitution. M. de Montesquieu en apporte pour [I-115] preuve la constitution de la république romaine, & celle de l’Angleterre. Il trouve le principe de celle-ci dans cette loi fondamentale dans le gouvernement des anciens Germains, que les affaires peu importantes y étoient décidées par les chefs, & que les grandes étoient portées au tribunal de la nation, après avoir auparavant été agitées par les chefs. M. de Montesquieu n’examine point si les Anglois jouissent ou non, de cette extrême liberté politique que leur constitution leur donne : il lui suffit qu’elle soit établie par leurs lois. Il est encore plus éloigné de vouloir faire la satire des autres états : il croit, au contraire, que l’excès, même dans le bien, n’est pas toujours désirable ; que la liberté extrême a ses inconvéniens, comme l’extrême servitude ; & qu’en général la nature humaine s’accommode mieux d’un état moyen.
La liberté politique, considérée par rapport au citoyen, consiste dans la sureté où il est, à l’abri des lois ; ou du moins, dans l’opinion de cette sureté, qui fait qu’un citoyen n’en craint point un autre. C’est principalement par la nature & la proportion des peines, que cette liberté s’établit ou se détruit. Les crimes contre la religion doivent être punis par la privation des biens que la religion procure ; les crimes [I-116] contre les mœurs, par la honte ; les crimes contre la tranquillité publique, par la prison ou l’exil ; les crimes contre la sureté, par les supplices. Les écrits doivent être moins punis que les actions ; jamais les simples pensées ne doivent l’être. Accusations non juridiques, espions, lettres anonymes, toutes ces ressources de la tyrannie, également honteuses à ceux qui en sont l’instrument & à ceux qui s’en servent, doivent être proscrites dans un bon gouvernement monarchique. Il n’est permis d’accuser qu’en face de la loi, qui punit toujours ou l’accusé ou le calomniateur. Dans tout autre cas, ceux qui gouvernent doivent dire, avec l’empereur Constance : Nous ne saurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu’il ne lui manquoit pas un ennemi. C’est une très-bonne institution que celle d’une partie publique qui se charge, au nom de l’état, de poursuivre les crimes ; & qui ait toute l’utilité des délateurs, sans en avoir les vils intérêts, les inconvéniens & l’infamie.
La grandeur des impôts doit être en proportion directe avec la liberté. Ainsi, dans les démocraties, ils peuvent être plus grands qu’ailleurs, sans être onéreux ; parce que chaque citoyen les regarde comme un tribut qu’il se paye à lui même, & qui [I-117] assure la tranquillité & le sort de chaque membre. De plus, dans un état démocratique, l’emploi infidelle des derniers publics est plus difficile, parce qu’il est plus aisé de le connoître & de le punir ; le dépositaire en devant compte, pour ainsi dire, au premier citoyen qui l’exige.
Dans quelque gouvernement que ce soit, l’espece de tribut la moins onéreuse est celle qui est établie sur les marchandises ; parce que le citoyen paye sans s’en appercevoir. La quantité excessive de troupes en temps de paix, n’est qu’un prétexte pour charger le peuple d’impôts, un moyen d’énerver l’état, & un instrument de servitude. La régie des tributs, qui en fait rentrer le produit en entier dans le fisc public, est sans comparaison moins à charge au peuple, & par conséquent plus avantageuse, lorsqu’elle peut avoir lieu, que la ferme de ces mêmes tributs, qui laisse toujours entre les mains de quelques particuliers une partie des revenus de l’état. Tout est perdu, sur-tout (ce sont ici les termes de l’auteur) lorsque la profession de traitant devient honorable ; & elle le devient dès que le luxe est en vigueur. Laisser quelques hommes se nourrir de la substance publique pour les dépouiller à leur tour, comme on l’a autrefois pratiqué dans certains états, c’est [I-118] réparer une injustice par une autre, & faire deux maux au lieu d’un.
Venons maintenant, avec M. de Montesquieu, aux circonstances particulieres indépendantes de la nature du gouvernement, & qui doivent en modifier les lois. Les circonstances qui viennent de la nature du pays sont de deux sortes ; les unes ont rapport au climat, les autres au terrain. Personne ne doute que le climat n’influe sur la disposition habituelle des corps, & par conséquent sue les caracteres ; c’est pourquoi les lois doivent se conformer au physique du climat dans les choses indifférentes, & au contraire le combattre dans les effets vicieux : Ainsi, dans les pays où l’usage du vin est nuisible, c’est une très-bonne loi que celle qui l’interdit : dans les pays où la chaleur du climat porte à la paresse, c’est une très-bonne loi que celle qui encourage au travail. Le gouvernement peut donc corriger les effets du climat : & cela suffit pour mettre l’esprit des lois à couvert du reproche très-injuste qu’on lui a fait d’attribuer tout au froid & à la chaleur ; car, outre que la chaleur & le froid ne sont pas la seule chose par laquelle les climats soient distingués, il seroit aussi absurde de nier certains effets du climat, que de vouloir lui attribuer tout.
L’usage des esclaves établi dans les pays [I-119] chauds de l’Asie & de l’Amérique, & réprouvé dans les climats tempérés de l’Europe, donne sujet à l’auteur de traiter de l’esclavage civil. Les hommes n’ayant pas plus de droit sur la liberté que sur la vie les uns des autres, il s’ensuit que l’esclavage, généralement parlant, est contre la loi naturelle. En effet, le droit d’esclavage ne peut venir ni de la guerre, puisqu’il ne pourroit être alors fondé que sur le rachat de la vie, & qu’il n’y a plus de droit sur la vie de ceux qui n’attaquent plus ; ni de la vente qu’un homme fait de lui-même à un autre, puisque tout citoyen, étant redevable de sa vie à l’état, lui est, à plus forte raison, redevable de sa liberté, & par conséquent n’est pas le maître de la vendre. D’ailleurs, quel seroit le prix de cette vente ? Ce ne peut être l’argent donné au vendeur, puisqu’au moment qu’on se rend esclave, toutes les possessions appartiennent au maître : or une vente sans prix est aussi chimérique qu’un contrat sans condition. Il n’y a peut-être jamais eu qu’une loi juste en faveur de l’esclavage ; c’étoit la loi romaine, qui rendoit le débiteur esclave du créancier : encore cette loi, pour être équitable, devoit borner la servitude quant au degré & quant au temps. L’esclavage peut, tout au plus, être toléré dans les [I-120] états despotiques, où les hommes libres, trop foibles contre le gouvernement, cherchent à devenir, pour leur propre utilité, les esclaves de ceux qui tyrannisent l’état ; ou bien dans les climats dont la chaleur énerve si fort le corps & affoiblit tellement le courage, que les hommes n’y sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment.
À côté de l’esclavage civil, on peut placer la servitude domestique, c’est-à-dire celle où les femmes sont dans certains climats. Elle peut avoir lieu dans ces contrées de l’Asie où elles sont en état d’habiter avec les hommes avant que de pouvoir faire usage de leur raison ; nubiles par la loi du climat, enfans par celle de la nature. Cette sujétion devient encore plus nécessaire dans les pays où la polygamie est établie : usage que M. de Montesquieu ne prétend par justifier dans ce qu’il a de contraire à la religion ; mais qui, dans les lieux où il est reçu (& à ne parler que politiquement) peut être fondée jusqu’à un certain point, ou sur la nature du pays, ou sur le rapport du nombre des femmes au nombre des hommes. M. de Montesquieu parle, à cette occasion, de la répudiation & du divorce ; & il établit, sur de bonnes raisons, que la répudiation, une fois admise, devroit être [I-121] permise aux femmes comme aux hommes.
Si le climat a tant d’influence sur la servitude domestique & civile, il n’en a pas moins sur la servitude politique, c’est-à-dire sur celle qui soumet un peuple à un autre. Les peuples du nord sont plus forts & plus courageux que ceux du midi : ceux-ci doivent donc, en général, être subjugués, ceux-là conquérans ; ceux-ci esclaves, ceux-là libres. C’est aussi ce que l’histoire confirme : l’Asie a été conquise onze fois par les peuples du nord ; l’Europe a souffert beaucoup moins de révolutions.
À l’égard des lois relatives à la nature du terrain, il est clair que la démocratie convient mieux que la monarchie aux pays stériles, où la terre a besoin de toute l’industrie des hommes. La liberté d’ailleurs est, en ce cas, une espece de dédommagement de la dureté du travail. Il faut plus de lois pour un peuple agriculteur que pour un peuple qui nourrit des troupeaux ; pour celui-ci, que pour un peuple chasseur ; pour un peuple qui fait usage de la monnoie, que pour celui qui l’ignore.
Enfin, on doit avoir égard au génie particulier de la nation. La vanité, qui grossit les objets, est un bon ressort pour le gouvernement ; l’orgueil, qui les [I-122] déprise, est un ressort dangereux. Le législateur, doit respecter, jusqu’à un certain point, les préjugés, les passions, les abus. Il doit imiter Solon, qui avoit donné aux Athéniens, non les meilleures lois en elles-mêmes, mais les meilleures qu’ils pussent avoir : le caractere gai de ces peuples demandoit des lois plus faciles ; le caractere dur des Lacédémoniens, des lois plus séveres. Les lois sont un mauvais moyen pour changer les manieres & les usages ; c’est par les récompenses & l’exemple qu’il faut tâcher d’y parvenir. Il est pourtant vrai, en même temps, que les lois d’un peuple, quand on n’affecte pas d’y choquer grossiérement & directement ses mœurs, doivent influer insensiblement sur elles, soit pour les affermir, soit pour les changer.
Après avoir approfondi de cette maniere la nature & l’esprit des lois par rapport aux différentes especes de pays & de peuples, l’auteur revient de nouveau à considérer les états, les uns par rapport aux autres. D’abord, en les comparant entr’eux d’une maniere générale, il n’avoit pu les envisager que par rapport au mal qu’ils peuvent se faire ; ici, il les envisage par rapport aux secours mutuels qu’ils peuvent se donner : or ces secours sont principalement fondés sur le [I-123] commerce. Si l’esprit de commerce produit naturellement un esprit d’intérêt opposé à la sublimité des vertus morales, il rend aussi un peuple naturellement juste, & en éloigne l’oisiveté & le brigandage. Les nations libres, qui vivent sous des gouvernemens modérés, doivent s’y livrer plus que les nations esclaves. Jamais une nation ne doit exclure de son commerce une autre nation, sans de grandes raisons. Au reste, la liberté en ce genre n’est pas une faculté absolue accordée aux négocians de faire ce qu’ils veulent, faculté qui leur seroit souvent préjudiciable ; elle consiste à ne gêner les négocians qu’en faveur du commerce. Dans la monarchie, la noblesse ne doit point s’y adonner, encore moins le prince. Enfin, il est des nations auxquelles le commerce est désavantageux : Ce ne sont pas celles qui n’ont besoin de rien, mais celles qui ont besoin de tout : paradoxe que l’auteur rend sensible par l’exemple de la Pologne, qui manque de tout, excepté de blé, & qui, par le commerce qu’elle en fait, prive les paysans de leur nourriture, pour satisfaire au luxe des seigneurs. M. de Montesquieu, à l’occasion des lois que le commerce exige, fait l’histoire de ces différentes révolutions ; & cette partie de son livre n’est ni la moins intéressante, ni la moins [I-124] curieuse. Il compare l’appauvrissement de l’Espagne, par la découverte de l’Amérique, au sort de ce prince imbécille de la fable prêt à mourir de faim, pour avoir demandé aux dieux, que tout ce qu’il toucheroit se convertît en or. L’usage de la monnoie étant une partie considérable de l’objet du commerce, & son principal instrument, il a cru devoir en conséquence traiter des opérations sur la monnoie, du change, du payement des dettes publiques, du prêt à intérêt, dont il fixe les lois & les limites, & qu’il ne confond nullement avec les excès si justement condamnés de l’usure.
La population & le nombre des habitans ont avec le commerce un rapport immédiat ; & les mariages ayant pour objet la population, M. de Montesquieu approfondit ici cette importante matiere. Ce qui favorise le plus la propagation est la continence publique : l’expérience prouve que les conjonctions illicites y contribuent peu, & même y nuisent. On a établi avec justice, pour les mariages, le consentement des peres : cependant on y doit mettre des restrictions ; car la loi doit, en général, favoriser les mariages. La loi qui défend le mariage des meres avec les fils, est (indépendamment des préceptes de la religion) une très-bonne [I-125] loi civile ; car, sans parler de plusieurs autres raisons, les contractans étant d’âge très-différent, ces sortes de mariages peuvent rarement avoir la propagation pour objet. La loi qui défend le mariage du pere avec la fille, est fondée sur les mêmes motifs : cependant (à ne parler que civilement) elle n’est pas si indispensablement nécessaire que l’autre à l’objet de la population, puisque la vertu d’engendrer finit beaucoup plus tard dans les hommes ; aussi l’usage contraire a-t-il eu lieu chez certains peuples, que la lumiere du christianisme n’a point éclairés. Comme la nature porte d’elle-même au mariage, c’est un mauvais gouvernement que celui où on aura besoin d’y encourager. La liberté, la sureté, la modération des impôts, la proscription du luxe, sont les vrais principes & les vrais soutiens de la population : cependant on peut avec succès faire des lois pour encourager les mariages, quand, malgré la corruption, il reste encore des ressorts dans le peuple qui l’attachent à sa patrie. Rien n’est plus beau que les lois d’Auguste pour favoriser la propagation de l’espece. Par malheur, il fit ces lois dans la décadence, ou plutôt dans la chute de la république ; & les citoyens découragés devoient prévoir qu’ils ne mettroient plus au monde que des esclaves : aussi [I-126] l’exécution de ces lois fut-elle bien foible durant tout le temps des empereurs païens. Constantin enfin les abolit en se faisant chrétien ; comme si le christianisme avoit pour but de dépeupler la société, en conseillant à un petit nombre la perfection du célibat.
L’établissement des hôpitaux, selon l’esprit dans lequel il est fait, peut nuire à la population, ou la favoriser. Il peut, & il doit même y avoir des hôpitaux dans un état dont la plupart des citoyens n’ont que leur industrie pour ressource, parce que cette industrie peut quelquefois être malheureuse ; mais les secours, que ces hôpitaux donnent, ne doivent être que passagers, pour ne point encourager la mendicité & la fainéantise. Il faut commencer par rendre le peuple riche, & bâtir ensuite des hôpitaux pour les besoins imprévus & pressans. Malheureux les pays où la multitude des hôpitaux & des monasteres, qui ne sont que des hôpitaux perpétuels, fait que tout le monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent !
M. de Montesquieu n’a encore parlé que des lois humaines. Il passe maintenant à celles de la religion, qui, dans presque tous les états sont un objet si essentiel du gouvernement. Par-tout il fait l’éloge du christianisme ; il en montre les avantages & la grandeur ; il cherche à le [I-127] faire aimer ; il soutient qu’il n’est pas impossible, comme Bayle l’a prétendu, qu’une société de parfaits chrétiens forme un état subsistant & durable. Mais il s’est cru permis aussi d’examiner ce que les différentes religions (humainement parlant) peuvent avoir de conforme ou de contraire au génie & à la situation des peuples qui les professent. C’est dans ce point de vue qu’il faut lire tout ce qu’il a écrit sur cette matiere, & qui a été l’objet de tant de déclamations injustes. Ils est surprenant sur-tout que, dans un siecle qui en appelle tant d’autres barbares, on lui ait fait un crime de ce qu’il dit de la tolérance ; comme si c’étoit approuver une religion, que de la tolérer ; comme si enfin l’évangile même ne proscrivoit pas tout autre moyen de la répandre, que la douceur & la persuasion. Ceux en qui la superstition n’a pas éteint tout sentiment de compassion & de justice, ne pourront lire, sans être attendris, la remontrance aux inquisiteurs, ce tribunal odieux, qui outrage la religion en paroissant la venger.
Enfin, après avoir traité en particulier des différentes especes de lois que les hommes peuvent avoir, il ne reste plus qu’à les comparer toutes ensemble, & à les examiner dans leur rapport avec les [I-128] choses sur lesquelles elles statuent. Les hommes sont gouvernés par différentes especes de lois ; par le droit naturel, commun à chaque individu ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit civil, qui est celui des membres d’une même société ; par le droit politique, qui est celui du gouvernement de cette société ; par le droit des gens, qui est celui des sociétés les unes par rapport aux autres. Ces droits ont chacun leurs objets distingués, qu’il faut bien se garder de confondre. On ne doit jamais régler par l’un ce qui appartient à l’autre, pour ne point mettre de désordre ni d’injustice dans les principes qui gouvernent les hommes. Il faut enfin que les principes qui prescrivent le genre des lois, & qui en circonscrivent l’objet, regnent aussi dans la maniere de les composer. L’esprit de modération doit, autant qu’il est possible, en dicter toutes les dispositions. Des lois bien faites seront conformes à l’esprit du législateur, même en paroissant s’y opposer. Telle étoit la fameuse loi de Solon, par laquelle tous ceux qui ne prenoient point de part dans les séditions étoient déclarés infames. Elle prévenoit les séditions, ou les rendoit utiles, en forçant tous les membres de la république à [I-129] s’occuper de ses vrais intérêts. L’ostracisme même étoit une très-bonne loi : car, d’un côté, elle étoit honorable au citoyen qui en étoit l’objet ; & prévenoit, de l’autre, les effets de l’ambition : il falloit d’ailleurs un très-grand nombre de suffrages, & on ne pouvoit bannir que tous les cinq ans. Souvent les lois qui paroissent les mêmes n’ont ni le même motif, ni le même effet, ni la même équité ; la forme du gouvernement, les conjonctures & le génie du peuple changent tout. Enfin le style des lois doit être simple & grave. Elles peuvent se dispenser de motiver, parce que le motif est supposé exister dans l’esprit du législateur ; mais quand elles motivent, ce doit être sur des principes évidens : elles ne doivent pas ressembler à cette loi qui, défendant aux aveugles de plaider, apporter pour raison qu’ils ne peuvent pas voir les ornemens de la magistrature.
M. de Montesquieu, pour montrer par des exemples l’application de ses principes, a choisi deux différens peuples, le plus célebre de la terre, & celui dont l’histoire nous intéresse le plus, les Romains & les François. Il ne s’attache qu’à une partie de la jurisprudence du premier, celle qui regarde les successions. À l’égard des François, il entre dans le [I-130] plus grand détail sur l’origine & les révolutions de leurs lois civiles, & sur les différens usages, abolis ou subsistans, qui en ont été la suite. Il s’étend principalement sur les lois féodales, cette espece de gouvernement inconnu à toute l’antiquité, qui le sera peut-être pour toujours aux siecles futurs, & qui a fait tant de biens & tant de maux. Il discute sur-tout ces lois dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement & aux révolutions de la monarchie françoise. Il prouve, contre M. l’Abbé Dubos, que les Francs sont réellement entrés en conquérans dans les Gaules ; & qu’il n’est pas vrai, comme cet Auteur le prétend, qu’ils ayent été appellés par les peuples pour succéder aux droits des Empereurs romains qui les opprimoient : détail profond, exact & curieux, mais dans lequel il nous est impossible de le suivre.
Telle est l’analyse générale, mais très-informe & très-imparfaite, de l’ouvrage de M. de Montesquieu. Nous l’avons séparée du reste de son éloge, pour ne pas trop interrompre la suite de notre récit.
[I-131]
DISCOURS prononcé le 24 Janvier 1728. ↩
Par M. le Président de MONTESQUIEU, lorsqu’il fut reçu à l’Académie françoise, à la place de feu M. de SACY
MESSIEURS,
En m’accordant la place de M. de Sacy, vous avez moins appris au public ce que je suis, que ce que je dois être.
Vous n’avez pas voulu me comparer à lui, mais me le donner pour modele.
Fait pour la société, il y étoit aimable, il y étoit utile ; il mettoit la douceur dans les manieres, & la sévérité dans les mœurs.
Il joignoit à un beau génie une ame plus belle encore : les qualités de l’esprit n’étoient chez lui que dans le second ordre : elles ornoient le mérite, mais ne le faisoient pas.
[I-132]
Il écrivoit pour instruire ; & en instruisant, il se faisoit toujours aimer. Tout respire dans ses ouvrages, la candeur & la probité ; le bon naturel s’y fait sentir ; le grand homme ne s’y montre jamais qu’avec l’honnête homme.
Il suivoit la vertu par un penchant naturel, & il s’y attachoit encore par ses réflexions. Il jugeoit qu’ayant écrit sur la morale, il devoit être plus difficile qu’un autre sur ses devoirs ; qu’il n’y avoit point pour lui de dispenses, puisqu’il avoit donné les regles ; qu’il seroit ridicule qu’il n’eût pas la force de faire des choses dont il avoit cru tous les hommes capables ; qu’il abandonnât ses propres maximes ; & que dans chaque action, il eût en même-temps à rougir de ce qu’il auroit fait & de ce qu’il auroit dit.
Avec quelle noblesse n’exerçoit-il pas sa profession ? Tous ceux qui avoient besoin de lui devenoient ses amis. Il ne trouvoit presque pour récompense à la fin de chaque jour que quelques bonnes actions de plus. Toujours moins riche, & toujours plus désintéressé, il n’a presque laissé à ses enfans que l’honneur d’avoir eu un si illustre pere.
Vous aimez, Messieurs, les hommes vertueux ; vous ne faites grace au plus beau génie d’aucune qualité du cœur ; [I-133] & vous regardez les talens, sans la vertu, comme des présens funestes, uniquement propres à donner de la force ou un plus grand jour à nos vices.
Et par-là, vous êtes bien dignes de ces grands protecteurs qui vous ont confié leur gloire, qui ont voulu aller à la postérité, mais qui ont voulu y aller avec vous.
Bien des orateurs & des poëtes les ont célébrés ; mais il n’y a que vous qui ayez été établis pour leur rendre, pour ainsi dire, un culte réglé.
Plein de zele & d’admiration pour ces grands hommes, vous les rappellez sans cesse à notre mémoire. Effet surprenant de l’art ! vos chants sont continuels, & ils nous paroissent toujours nouveaux.
Vous nous étonnez toujours, quand vous célébrez ce grand ministre, qui tira du chaos les regles de la monarchie ; qui apprit à la France le secret de ses forces, à l’Espagne celui de sa foiblesse ; ôta à l’Allemagne ses chaînes, lui en donna de nouvelles ; brisa tour à tour toutes les puissances ; & destina, pour ainsi dire, Louis le Grand aux grandes choses qu’il fit depuis.
Vous ne vous ressemblez jamais dans les éloges que vous faites de ce Chancelier, qui n’abusa ni de la confiance des Rois, ni de l’obéissance des peuples ; & [I-134] qui dans l’exercice de la magistrature ; fut sans passion, comme les lois, qui absolvent & qui punissent sans aimer ni haïr.
Mais on aime sur-tout à vous voir travailler à l’envi au portrait de Louis le Grand, ce portrait toujours commencé, & jamais fini, tous les jours plus avancé, & tous les jours plus difficile.
Nous concevons à peine le regne merveilleux que vous chantez. Quand vous nous faites voir les sciences par-tout encouragées, les arts protégés, les belles-lettres cultivées, nous croyons vous entendre parler d’un regne paisible & tranquille. Quand vous chantez les guerres & les victoires, il semble que vous nous racontiez l’histoire de quelque peuple sorti du nord, pour changer la face de la terre. Ici, nous voyons le Roi ; là, le Héros. C’est ainsi qu’un fleuve majestueux va se changer en un torrent, qui renverse tout ce qui s’oppose à son passage ; c’est ainsi que le ciel paroît au laboureur pur & serein, tandis que dans la contrée voisine il se couvre de feux, d’éclairs & de tonnerres.
Vous m’avez, Messieurs, associé à vos travaux, vous m’avez élevé jusqu’à vous ; & je vous rends graces de ce qu’il m’est permis de vous connoître mieux, & de vous admirer de plus près.
[I-135]
Je vous rends graces de ce que vous m’avez donné un droit particulier d’écrire la vie & les actions de notre jeune Monarque. Puisse-t-il aimer à entendre les éloges que l’on donne aux Princes pacifiques ! Que le pouvoir immense, que Dieu a mis entre ses mains, soit le gage du bonheur de tous ! que toute la terre repose sous son trône ! qu’il soit le Roi d’une nation & le protecteur de toutes les autres ! que tous les peuples l’aiment ; que ses sujets l’adorent ; & qu’il n’y ait pas un seul homme dans l’univers qui s’afflige de son bonheur & craigne ses prospérités ! Périssent enfin ces jalousies fatales qui rendent les hommes ennemis des hommes ! Que le sang humain, ce sang qui souille toujours la terre, soit épargné ! & que, pour parvenir à ce grand objet, ce Ministre nécessaire au monde, ce Ministre, tel que le peuple François auroit pu le demander au ciel, ne cesse de donner ces conseils, qui vont au cœur du Prince, toujours prêt de faire le bien qu’on lui propose, ou à réparer le mal qu’il n’a point fait, & que le temps a produit !
LOUIS nous a fait voir que, comme les peuples sont soumis aux lois, les Princes le sont à leur parole sacrée : que les grands Rois, qui ne sauroient être liés par une autre puissance, le sont [I-136] invinciblement par les chaînes qu’ils se sont faites, comme le Dieu qu’ils représentent, qui est toujours indépendant & toujours fidele dans ses promesses.
Que de vertus nous présage une foi si religieusement gardée ! Ce sera le destin de la France, qu’après avoir été agitée sous les Valois, affermie sous Henri, agrandie sous son successeur, victorieuse & indomptable sous Louis le Grand, elle sera entiérement heureuse sous le regne de celui qui ne sera point forcé à vaincre, & qui mettra toute sa gloire à gouverner.
[I-137]
AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR
Pour l’intelligence des quatre premiers Livres de cet Ouvrage, il faut observer que ce que j’appelle la vertu dans la République, est l’amour de la patrie, c’est-à-dire, l’amour de l’égalité. Ce n’est point une vertu morale, ni une vertu chrétienne ; c’est la vertu politique ; & celle-ci est le ressort qui fait mouvoir le gouvernement républicain, comme l’honneur est le ressort qui fait mouvoir la Monarchie. J’ai donc appellé vertu politique l’amour de la patrie & [I-138] de l’égalité. J’ai eu des idées nouvelles ; il a bien fallu trouver de nouveaux mots, ou donner aux anciens de nouvelles acceptions. Ceux qui n’ont pas compris ceci, m’ont fait dire des choses absurdes, & qui seroient révoltantes dans tous les pays du monde, parce que, dans tous les pays du monde, on veut de la morale.
2°. Il faut faire attention qu’il y a une très-grande différence entre dire qu’une certaine qualité, modification de l’ame, ou vertu, n’est pas le ressort qui fait agir un gouvernement, & dire qu’elle n’est point dans ce gouvernement. Si je disois, telle roue, tel pignon, ne sont point le ressort qui fait [I-139] mouvoir cette montre ; en concluroit-on qu’ils ne sont point dans la montre ? Tant s’en faut que les vertus morales & chrétiennes soient exclues de la Monarchie, que même la vertu politique ne l’est pas. En un mot, l’honneur est dans la République, quoique la vertu politique en soit le ressort ; la vertu politique est dans la Monarchie, quoique l’honneur en soit le ressort.
Enfin l’homme de bien, dont il est question dans le Livre III, chapitre V, n’est pas l’homme de bien chrétien, mais l’homme de bien politique, qui a la vertu politique dont j’ai parlé. C’est l’homme qui aime les lois de son pays, & qui agit par l’amour des lois de [I-140] son pays. J’ai donné un nouveau jour à toutes ces choses dans cette édition-ci, en fixant encore plus les idées ; &, dans la plupart des endroits où je me suis servi du mot de vertu, j’ai mis vertu politique.
[I-141]
PRÉFACE↩
Si dans le nombre infini de choses qui sont dans ce Livre, il y en avoit quelqu’une qui, contre mon attente, pût offenser, il n’y en a pas du moins qui y ait été mise avec mauvaise intention. Je n’ai point naturellement l’esprit désapprobateur. Platon remercioit le ciel de ce qu’il étoit né du temps de Socrate ; & moi je lui rends graces de ce qu’il m’a fait naître dans le gouvernement où je vis, & de ce qu’il a voulu que j’obéisse à ceux qu’il m’a fait aimer.
Je demande une grace que je crains qu’on ne m’accorde pas ; [I-142] c’est de ne pas juger, par la lecture d’un moment, d’un travail de vingt années ; d’approuver ou de condamner le livre entier, & non pas quelques phrases. Si l’on veut chercher le dessein de l’Auteur, on ne le peut bien découvrir que dans le dessein de l’ouvrage.
J’ai d’abord examiné les hommes, & j’ai cru que, dans cette infinie diversité de lois & de mœurs, ils n’étoient pas uniquement conduits par leurs fantaisies.
J’ai posé les principes, & j’ai vu les cas particuliers s’y plier comme d’eux-mêmes ; les histoires de toutes les nations n’en être que les suites ; & chaque loi particuliere liée avec une autre loi, ou dépendre d’une autre plus générale.
[I-143]
Quand j’ai été rappellé à l’antiquité, j’ai cherché à en prendre l’esprit, pour ne pas regarder comme semblables des cas réellement différens ; & ne pas manquer les différences de ceux qui paroissent semblables.
Je n’ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses.
Ici, bien des vérités ne se feront sentir qu’après qu’on aura vu la chaîne qui les lie à d’autres. Plus on réfléchira sur les détails, plus on sentira la certitude des principes. Ces détails même, je ne les ai pas tous donnés ; car, qui pourroit dire tout sans un mortel ennui ?
On ne trouvera point ici ces traits saillans qui semblent caractériser les ouvrages d’aujourd’hui.
[I-144]
Pour peu qu’on voie les choses avec une certaine étendue, les saillies s’évanouissent ; elles ne naissent d’ordinaire, que parce que l’esprit se jette tout d’un côté, & abandonne tous les autres.
Je n’écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes ; & on en tirera naturellement cette conséquence, qu’il n’appartient de proposer des changemens qu’à ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d’un coup de génie toute la constitution d’un état.
Il n’est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les préjugés des magistrats ont commencé par être les préjugés de la nation. Dans un temps d’ignorance, on [I-145] n’a aucun doute, même lorsqu’on fait les plus grands maux ; dans un temps de lumiere, on tremble encore, lorsqu’on fait les plus grands biens. On sent les abus anciens, on en voit la correction ; mais on voit encore les abus de la correction même. On laisse le mal, si l’on craint le pire ; on laisse le bien, si on est en doute du mieux. On ne regarde les parties que pour juger du tout ensemble ; on examine toutes les causes, pour voir les résultats.
Si je pouvois faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois ; qu’on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l’on se trouve ; je me [I-146] croirois le plus heureux des mortels.
Si je pouvois faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leurs connoissances sur ce qu’ils doivent prescrire, & que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirois le plus heureux des mortels.
Je me croirois le plus heureux des mortels, si je pouvois faire que les hommes pussent se guérir de leurs préjugés. J’appelle ici préjugés, non pas ce qui fait que l’on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu’on s’ignore soi-même.
C’est en cherchant à instruire les hommes, que l’on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l’amour de tous. L’homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées & aux impressions des autres, est [I-147] également capable de connoître sa propre nature, lorsqu’on la lui montre ; & d’en perdre jusqu’au sentiment, lorsqu’on la lui dérobe.
J’ai bien des fois commencé, & bien des fois abandonné cet ouvrage ; j’ai mille fois envoyé aux vents [1] les feuilles que j’avois écrites ; je sentois tous les jours les mains paternelles tomber [2] ; je suivois mon objet sans former de dessein ; je ne connoissois ni les regles ni les exceptions ; je ne trouvois la vérité que pour la perdre. Mais quand j’ai découvert mes principes, tout ce que je cherchois est venu à moi ; & dans le cours de vingt années, j’ai vu mon ouvrage commencer, croître, s’avancer & finir.
[I-148]
Si cet ouvrage a du succès, je le devrai beaucoup à la majesté de mon sujet ; cependant je ne crois pas avoir totalement manqué de génie. Quand j’ai vu ce que tant de grands hommes en France, en Angleterre & en Allemagne, ont écrit avant moi, j’ai été dans l’admiration ; mais je n’ai point perdu le courage : Et moi aussi, je suis peintre [3] , ai-je dit avec le Correge.
[I-175]
LIVRE PREMIER
DES LOIS EN GÉNÉRAL.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec les divers êtres.
LES Lois, dans la ſignification la plus étendue, ſont les rapports néceſſaires qui dérivent de la nature des choſes ; & dans ce ſens tous les êtres ont leurs lois, la divinité [1] a ſes lois, le monde [I-176] matériel a ſes lois, les intelligences ſupérieures à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l’homme a ſes lois.
Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande abſurdité ; car quelle plus grande abſurdité, qu’une fatalité aveugle qui auroit produit des êtres intelligens ?
Il y a donc une raiſon primitive ; & les lois ſont les rapports qui ſe trouvent entr’elle & les différens êtres, & les rapports de ces divers êtres entr’eux.
Dieu a du rapport avec l’univers, comme créateur & comme conſervateur : les lois ſelon leſquelles il a créé, ſont celles ſelon leſquelles il conſerve. Il agit ſelon ces regles, parce qu’il les connoît ; il les connoît, parce qu’il les a faites ; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec ſa ſageſſe & ſa puiſſance.
Comme nous voyons que le monde, formé par le mouvement de la matiere, & privé d’intelligence ſubſiſte toujours, il faut que ſes mouvemens ayent des lois invariables : & ſi l’on pouvoit imaginer un autre monde que celui-ci, il auroit des regles conſtantes ; ou il ſeroit détruit.
[I-177]
Ainsi la création, qui paroît être un acte arbitraire, suppose des regles aussi invariables que la fatalité des athées. Il seroit absurde de dire que le créateur, sans ces regles, pourroit gouverner le monde, puisque le monde ne subsisteroit pas sans elles.
Ces regles sont un rapport constamment établi. Entre un corps mu & un autre corps mu, c’est suivant les rapports de la masse & de la vîtesse que tous les mouvemens sont reçus, augmentés, diminués, perdus ; chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance.
Les êtres particuliers intelligens peuvent avoir des lois qu’ils ont faites : mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites. Avant qu’il y eût des êtres intelligens, ils étoient possibles, ils avoient donc des rapports possibles, & par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des lois faites, il y avoit des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives ; c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étoient pas égaux.
[I-178]
Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui les établit : comme par exemple, que supposé qu’il y eût des sociétés d’hommes, il seroit juste de se conformer à leurs lois ; que s’il y avoit des êtres intelligens qui eussent reçu quelque bienfait d’un autre être, ils devroient en avoir de la reconnoissance ; que si un être intelligent avoit créé un être intelligent, le crée devroit rester dans la dépendance qu’il a eue dès son origine ; qu’un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent, mérite de recevoir le même mal ; & ainsi du reste.
Mais il s’en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. Car quoique celui-là ait aussi des lois qui par leur nature sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes. La raison en est, que les êtres particuliers intelligens sont bornés par leur nature, & par conséquent sujets à l’erreur ; & d’un autre côté, il est de leur nature qu’ils agissent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives, & celles même qu’ils se [I-179] donnent, ils ne les suivent pas toujours.
On ne sait si les bêtes sont gouvernées par les lois générales du mouvement, ou par une motion particuliere. Quoi qu’il en soit, elles n’ont point avec Dieu de rapport plus intime que le reste du monde matériel ; & le sentiment ne leur sert que dans le rapport qu’elles ont entr’elles, ou avec elles-mêmes.
Par l’attrait du plaisir, elles conservent leur être particulier ; & par le même attrait, elles conservent leur espece. Elles ont des lois naturelles, parce qu’elles sont unies par le sentimens ; elles n’ont point de lois positives, parce qu’elles ne sont point unies par la connoissance. Elles ne suivent pourtant pas invariablement leurs lois naturelles ; les plantes, en qui nous ne remarquons ni connoissance, ni sentiment, les suivent mieux. Les bêtes n’ont point les suprêmes avantages que nous avons ; elles en ont que nous n’avons pas. Elles n’ont point nos espérances, mais elles n’ont pas nos craintes ; elles subissent comme nous la mort, mais c’est sans la connoître ; la plupart même se conservent mieux que nous, & ne font pas un aussi mauvais usage de leurs passions.
[I-180]
L’homme, comme être physique, est ainsi que les autres corps, gouverné par des lois invariables : comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies, & change celles qu’il établit lui-même. Il faut qu’il se conduise ; & cependant il est un être borné ; il est sujet à l’ignorance & à l’erreur, comme toutes les intelligences finies ; les foibles connoissances qu’il a, il les perd encore : comme créature sensible, il devient sujet à mille passions. Un tel être pouvoit à tous les instans oublier son créateur ; Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion : un tel être pouvoit à tous les instans s’oublier lui-même ; les philosophes l’ont averti par les lois de la morale : Fait pour vivre dans la société, il y pouvoit oublier les autres ; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les lois politiques & civiles.
-
[↑] La loi, dit Plutarque, eſt la reine de tous mortels & immortels. Au traité, Qu’il eſt requis qu’un Prince ſoit ſavant.
[I-180]
CHAPITRE II
Des Lois de la Nature.
Avant toutes ces lois, sont celles de la nature ; ainsi nommées, parce qu’elles dérivent uniquement de la [I-181] constitution de notre être. Pour les connoître bien, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu’il recevroit dans un état pareil.
Cette loi, qui en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles par son importance, & non pas dans l’ordre de ces lois. L’homme dans l’état de nature auroit plutôt la faculté de connoître, qu’il auroit des connoissances. Il est clair que ses premieres idées ne seroient point des idées spéculatives : il songeroit à la conservation de son être, avant de chercher l’origine de son être. Un homme pareil ne sentiroit d’abord que sa foiblesse ; sa timidité seroit extrême : & si l’on avoit là-dessus besoin de l’expérience, l’on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages [1] ; tout les fait trembler, tout les fait fuir.
Dans cet état, chacun se sent inférieur ; à peine chacun se sent-il égal. On ne chercheroit donc point à s’attaquer, [I-182] & la paix seroit la premiere loi naturelle.
Le désir que Hobbes donne d’abord aux hommes, de se subjuguer les uns les autres, n’est pas raisonnable. L’idée de l’empire & de la domination est si composée, & dépend de tant d’autres idées, que ce ne seroit pas celle qu’il auroit d’abord.
Hobbes demande pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armés ? & pourquoi ils ont des clefs pour fermer leurs maisons ? Mais on ne sent pas que l’on attribue aux hommes avant l’établissement des sociétés, ce qui ne peut leur arriver qu’après cet établissement, qui leur fait trouver des motifs pour s’attaquer & pour se défendre.
Au sentiment de sa foiblesse, l’homme joindroit le sentiment de ses besoins. Ainsi une autre loi naturelle seroit celle qui lui inspireroit de chercher à se nourrir.
J’ai dit que la crainte porteroit les hommes à se fuir : mais les marques d’une crainte réciproque les engageroient bientôt à s’approcher. D’ailleurs ils y seroient portés avec le plaisir qu’un animal sent à l’approche d’un animal de [I-183] son espece. De plus, ce charme que les deux sexes s’inspirent par leur différence, augmenteroit ce plaisir ; & la priere naturelle qu’ils se font toujours l’un à l’autre, seroit une troisieme loi.
Outre le sentiment que les hommes ont d’abord, ils parviennent encore à avoir des connoissances ; ainsi ils ont un second lien que les autres animaux n’ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s’unir, & le désir de vivre en société est une quatrieme loi naturelle.
-
[↑] Témoin le sauvage qui fut trouvé dans les forêts d’Hanover, & que l’on vit en Angleterre sous le regne de George I.
[I-183]
CHAPITRE III
Des Lois positives.
Si-tôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur foiblesse ; l’égalité qui étoit entr’eux cesse, & l’état de guerre commence.
Chaque société particuliere vient à sentir sa force ; ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force ; ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux [I-184] avantages de cette société, ce qui fait entr’eux un état de guerre.
Ces deux sortes d’état de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitans d’une si grande planete, qu’il est nécessaire qu’il y ait différens peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entr’eux, & c’est le droit des gens. Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés ; & c’est le droit politique. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entr’eux ; & c’est le droit civil.
Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe ; que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, & dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.
L’objet de la guerre, c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête, la conservation. De ce principe & du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens.
[I-185]
Toutes les nations ont un droit des gens ; & les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient & reçoivent des ambassades ; ils connoissent des droits de la guerre & de la paix : le mal est que ce droit des gens n’est pas fondé sur les vrais principes.
Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne sauroit subsister sans un gouvernement. La réunion de toutes les forces particulieres, dit très-bien Gravina, forme ce qu’on appelle l’état politique.
La force générale peut être placée entre les mains d’un seul, ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d’un seul étoit le plus conforme à la nature. Mais l’exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car si le pouvoir du pere a du rapport au gouvernement d’un seul, après la mort du pere, le pouvoir des freres, ou après la mort des freres, celui des cousins germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend [I-186] nécessairement l’union de plusieurs familles.
Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature, est celui dont la disposition particuliere se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi.
Les force particulieres ne peuvent se réunir, sans que toutes les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés, dit encore très-bien Gravina, est ce qu’on appelle l’état civil.
La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre, & les lois politiques & civiles de chaque nation, ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine.
Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très-grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre.
Il faut qu’elles se rapportent à la nature & au principe du gouvernement qui est établi, ou qu’on veut établir ; soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles.
[I-187]
Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré ; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur ; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs, ou pasteurs : elles doivent se rapporter au degré de liberté, que la constitution peut souffrir ; à la religion des habitans, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manieres. Enfin, elles ont des rapports entr’elles ; elles en ont avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C’est dans toutes ces vues qu’il faut les considérer.
C’est ce que j’entreprends de faire dans cet ouvrage. J’examinerai tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce que l’on appelle l’esprit des Lois.
Je n’ai point séparé les lois politiques des civiles : Car comme je ne traite point des lois, mais de l’esprit des lois ; & que cet esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses ; j’ai dû moins suivre l’ordre naturel des lois, que [I-188] celui de ces rapports & de ces choses.
J’examinerai d’abord les rapports que les lois ont avec la nature & avec le principe de chaque gouvernement : & comme ce principe a sur les lois une suprême influence, je m’attacherai à le bien connoître ; & si je puis une fois l’établir, on en verra couler les lois comme de leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent être plus particuliers.
[I-189]
LIVRE II.
Des Lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement.↩
CHAPITRE PREMIER.
De la nature des trois divers gouvernemens.
Il y a trois especes de gouvernement, le républicain, le monarchique, & le despotique. Pour en découvrir la nature, il suffit de l’idée qu’en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l’un que le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance : le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes & établies ; au lieu que dans le despotique, un seul, sans loi & sans regle, entraîne tout par sa volonté & par ses caprices.
[I-190]
Voilà ce que j’appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les lois qui suivent directement de cette nature, & qui par conséquent sont les premieres lois fondamentales.
[I-190]
CHAPITRE II.
Du gouvernement républicain, & des Lois relatives à la démocratie.
Lorsque dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une aristocratie.
Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque ; à certains autres, il est le sujet.
Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage, sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi les suffrages [I-191] doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, & de quelle maniere il doit gouverner.
Libanius [1] dit, qu’à Athenes un étranger qui se mêloit dans l’assemblée du peuple, étoit puni de mort. C’est qu’un tel homme usurpoit le droit de souveraineté.
Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela on pourroit ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. À Lacédémone, il falloit dix mille citoyens. À Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur ; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avoit tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l’Italie & une partie de la terre dans ses murailles, on n’avoit point fixé ce nombre [2] ; & ce fut une des grandes causes de sa ruine.
Le peuple qui a la souveraine puissance, doit faire par lui-même tout ce qu’il peut bien faire ; & ce qu’il ne [I-192] peut pas bien faire, il faut qu’il le fasse par ses ministres.
Ses ministres ne sont point à lui, s’il ne les nomme : c’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats.
Il a besoin, comme les monarques, & même plus qu’eux, d’être conduit par un conseil ou sénat. Mais pour qu’il y ait confiance, il faut qu’il en élise les membres ; soit qu’il les choisisse lui-même, comme à Athenes ; ou par quelque magistrat qu’il a établit pour les élire, comme cela se pratiquoit à Rome dans quelques occasions.
Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n’a à se déterminer que par des choses qu’il ne peut ignorer, & des faits qui tombent sous les sens. Il sait très-bien qu’un homme a été souvent à la guerre, qu’il y a eu tels ou tels succès : il est donc très-capable d’élire un général. Il sait qu’un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contens de lui, qu’on ne l’a pas convaincu de corruption ; en voilà assez pour qu’il élise un [I-193] préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d’un citoyen ; cela suffit pour qu’il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s’instruit mieux dans la place publique, qu’un monarque dans son palais. Mais, saura-t-il conduire une affaire, connoître les lieux, les occasions, les momens, en profiter ? Non : il ne le saura pas.
Si l’on pouvoit douter de la capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite, il n’y auroit qu’à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnans que firent les Athéniens & les Romains ; ce qu’on n’attribuera pas sans doute au hasard.
On sait qu’à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d’élever aux charges les plébéiens, il ne pouvoit se résoudre à les élire ; & quoiqu’à Athenes on pût, par la loi d’Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n’arriva jamais, dit Xénophon [3] , que le bas-peuple demandât celles qui pouvoient intéresser son salut ou sa gloire.
Comme la plupart des citoyens, qui [I-194] ont assez de suffisance pour élire, n’en ont pas assez pour être élus ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n’est pas propre à gérer par lui-même.
Il faut que les affaires aillent, & qu’elles ayent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vîte. Mais le peuple a toujours trop d’action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras il renverse tout ; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme les insectes.
Dans l’état populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C’est dans la maniere de faire cette division, que les grands législateurs se sont signalés ; & c’est de-là qu’ont toujours dépendu la durée de la démocratie, & sa prospérité.
Servius-Tullius suivit dans la composition de ses classes, l’esprit de l’aristocratie. Nous voyons dans Tite-Live [4] & dans Denys d’Halicarnasse [5] , comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avoit [I-195] divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formoient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premieres centuries ; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes ; il jeta toute la foule des indigens dans la derniere : & chaque centurie n’ayant qu’une voix [6] , c’étoient les moyens & les richesses qui donnoient le suffrage, plutôt que les personnes.
Solon divisa le peuple d’Athenes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devoient élire, mais ceux qui pouvoient être élus : & laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut [7] que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premieres, où étoient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats.
Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage, est dans la [I-196] république une loi fondamentale ; la maniere de le donner est une autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie.
Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.
Mais, comme il est défectueux par lui-même, c’est à le régler & à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.
Solon établit à Athenes, que l’on nommeroit par choix à tous les emplois militaires, & que les sénateurs & les juges seroient élus par le sort.
Il voulut que l’on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeoient une grande dépense, & que les autres fussent données par le sort.
Mais pour corriger le sort, il régla qu’on ne pourroit élire que dans le nombre de ceux qui se présenteroient ; que celui qui auroit été élu, seroit examiné par des juges [8] , & que chacun [I-197] pourroit l’accuser d’en être indigne [9] : cela tenoit en même temps du sort & du choix. Quand on avoit fini le temps de sa magistrature, il falloit essuyer un autre jugement sur la maniere dont on s’étoit comporté. Les gens sans capacité devoient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort.
La loi qui fixe la maniere de donner les billets de suffrage, est encore une loi fondamentale dans la démocrate. C’est une grande question, si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron [10] écrit que les lois [11] qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république Romaine, furent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu’il en faut penser.
Sans doute que, lorsque le peuple [I-198] donne ses suffrages, ils doivent être publics [12] ; & ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux & contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi dans la république Romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout ; il ne fut plus possible d’éclairer une populace qui se perdoit. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages [13] , ou dans une démocratie le sénat [14] ; comme il n’est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauroient être trop secrets.
La brigue est dangereuse dans un sénat, elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l’est pas dans le peuple, dont la nature est d’agir par passion. Dans les états où il n’a point de part au gouvernement, il s’échauffera pour un acteur, comme il auroit fait pour les affaires. Le malheur d’une république, [I-199] c’est lorsqu’il n’y a plus de brigues ; & cela arrive, lorsqu’on a corrompu le peuple à prix d’argent : il devient de sang-froid, il s’affectionne à l’argent ; mais il ne s’affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement, & de ce qu’on y propose, il attend tranquillement son salaire.
C’est encore une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est même souvent à propos d’essayer une loi avant de l’établir. La constitution de Rome & celle d’Athenes étoient très-sages. Les arrêts du sénat [15] avoient force de loi pendant un an ; ils ne devenoient perpétuels que par la volonté du peuple.
-
[↑] Déclamations 17 & 18.
-
[↑] Voyez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence, chap. IX, Paris, 1755.
-
[↑] Pages 691 & 692, édition de Wechelius, de l’an 1596.
-
[↑] Liv. I.
-
[↑] Liv. IV, art. 15 & suiv.
-
[↑] Voyez dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence, c. IX. comment cet esprit de Servius-Tullius se conserva dans la république.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, éloge d’Isocrate, p. 97. tome 2. édition de Wechelius. Pollus, liv. VIII, chap. X, art. 130.
-
[↑] Voyez l’oraison de Démosthene, de falsâ legat. & l’oraison contre Timarque.
-
[↑] On tiroit même pour chaque place deux billets ; l’un qui donnoit la place, l’autre qui nommoit celui qui devoit succéder, en cas que le premier fût rejeté.
-
[↑] Liv. I & III des Lois.
-
[↑] Elles s’appeloient lois tabulaires ; on donnoit à chaque citoyen deux tables ; la premiere marquée d’un A, pour dire antiquo ; l’autre d’un U & d’une R, uti rogas.
-
[↑] À Athenes on levoit les mains.
-
[↑] Comme à Venise.
-
[↑] Les trente tyrans d’Athenes voulurent que les suffrages des Aréopagites fussent publics, pour les diriger à leur fantaisie. Lysias, orat. contra Agorat. cap. VIII.
-
[↑] Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV & IX.
[I-199]
CHAPITRE III.
Des Lois relatives à la nature de l’aristocratie.
Dans l’aristocratie, la souveraine puissance est entre les mains d’un certain nombre de personnes. Ce sont [I-200] elles qui font les lois & qui les font exécuter ; & le reste du peuple n’est tout au plus à leur égard, que comme dans une monarchie les sujets sont à l’égard du monarque.
On n’y doit point donner le suffrage par sort ; on n’en auroit que les inconvéniens. En effet, dans un gouvernement qui a déjà établi les distinctions les plus affligeantes, quand on seroit choisi par le sort, on n’en seroit pas moins odieux ; c’est le noble qu’on envie, & non pas le magistrat.
Lorsque les nobles sont en grand nombre, il faut un sénat qui regle les affaires que le corps des nobles ne sauroit décider, & qui prépare celles dont il décide. Dans ce cas, on peut dire que l’aristocratie est en quelque sorte dans le sénat, la démocratie dans le corps des nobles, & que le peuple n’est rien.
Ce sera une chose très-heureuse dans l’aristocratie, si par quelque voie indirecte on fait sortir le peuple de son anéantissement ; ainsi à Genes la banque de Saint Georges, qui est administrée en grande partie par les principaux du peuple, donne à celui-ci une certaine [I-201] influence dans le gouvernement, qui en fait toute la prospérité [1] .
Les sénateurs ne doivent point avoir le droit de remplacer ceux qui manquent dans le sénat ; rien ne seroit plus capable de perpétuer les abus. A Rome, qui fut dans les premiers temps une espece d’aristocratie, le sénat ne se suppléoit pas lui-même ; les sénateurs nouveaux étoient nommés [2] par les censeurs.
Une autorité exorbitante, donnée tout-à-coup à un citoyen dans une république, forme une monarchie, ou plus qu’une monarchie. Dans celle-ci les lois ont pourvu à la constitution, ou s’y sont accommodées ; le principe du gouvernement arrête le monarque : mais, dans une république où un citoyen se fait donner [3] un pouvoir exorbitant, l’abus de ce pouvoir est plus grand, parce que les lois, qui ne l’ont point prévu, n’ont rien fait pour l’arrêter.
[I-202]
L’exception à cette regle, est lorsque la constitution de l’état est telle qu’il a besoin d’une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle étoit Rome avec ses dictateurs, telles est Venise avec ses inquisiteurs d’état ; ce sont des magistratures terribles, qui ramenent violemment l’état à la liberté. Mais, d’où vient que ces magistratures se trouvent si différentes dans ces deux républiques ? C’est que Rome défendoit les restes de son aristocratie contre le peuple ; au lieu que Venise se sert de ses inquisiteurs d’état pour maintenir son aristocratie contre les nobles. De-là il suivoit, qu’à Rome la dictature ne devoit durer que peu de temps, parce que le peuple agit par sa fougue & non pas par ses desseins. Il falloit que cette magistrature s’exerçat avec éclat, parce qu’il s’agissoit d’intimider le peuple, & non pas de la punir ; que le dictateur ne fût créé que pour une seule affaire, & n’eût une autorité sans bornes qu’à raison de cette affaire, parce qu’il étoit toujours créé pour un cas imprévu. À Venise, au contraire, il faut une magistrature permanente : c’est-là que les desseins peuvent être commencés, [I-203] suivis, suspendus, repris ; que l’ambition d’un seul devient celle d’une famille, & l’ambition d’une famille celle de plusieurs. On a besoin d’une magistrature cachée, parce que les crimes qu’elle punit, toujours profonds, se forment dans le secret & dans le silence. Cette magistrature doit avoir une inquisition générale, parce qu’elle n’a pas à arrêter les maux que l’on connoît, mais à prévenir même ceux qu’on ne connoît pas. Enfin cette derniere est établie pour venger les crimes qu’elle soupçonne ; & la premiere employoit plus les menaces que les punitions pour les crimes, même avoués par leurs auteurs.
Dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la briéveté de sa durée. Un an est le temps que la plupart des législateurs ont fixé ; un temps plus long seroit dangereux, un plus court seroit contre la nature de la chose. Qui est-ce qui voudroit gouverner ainsi ses affaires domestiques ? À Raguse [4] le chef de la république change tous les mois, les autres officiers toutes les semaines, le gouverneur du château tous les jours.
[I-204] Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite république [5] environnée de puissances formidables, qui corromproient aisément de petits magistrats.
La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n’a point de part à la puissance, est si petite & si pauvre, que la partie dominante n’a aucun intérêt à l’opprimer. Ainsi, quand Antipater [6] établit à Athenes que ceux qui n’auroient pas deux mille drachmes, seroient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible, parce que ce cens étoit si petit, qu’il n’excluoit que peu de gens, & personne qui eût quelque considération dans la cité.
Les familles aristocratiques doivent donc être peuple, autant qu’il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite ; & elle le deviendra moins, à mesure qu’elle approchera de la monarchie.
La plus imparfaite de toutes est celle où la partie du peuple qui obéit est dans l’esclavage civil de celle qui [I-205] commande, comme l’aristocratie de Pologne, où les paysans sont esclaves de la noblesse.
-
[↑] Voyez M. Adisson, voyage d’Italie, p. 16.
-
[↑] Ils le furent d’abord par les consuls.
-
[↑] C’est ce qui renversa la république Romaine. Voyez les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence. Paris, 1755.
-
[↑] Voyages de Tournesort.
-
[↑] À Luques, les magistrats ne sont établis que pour deux mois.
-
[↑] Diodore, liv. XVIII, pag. 601. édition de Rhodoman.
[I-205]
CHAPITRE IV.
Des lois, dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique.
Les pouvoirs intermédiaires subordonnés & dépendans constituent la nature du gouvernement monarchique, c’est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. J’ai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés & dépendans : en effet dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique & civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car s’il n’y a dans l’état que la volonté momentanée & capricieuse d’un seul, rien ne peut être fixe, & par conséquent aucune loi fondamentale.
Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel, est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l’essence de la monarchie, dont la maxime [I-206] fondamentale est, point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point de monarque ; mais on a un despote.
Il y a des gens qui avoient imaginé dans quelques états en Europe, d’abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyoient pas qu’ils vouloient faire ce que le parlement d’Angleterre a fait. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse & des villes ; vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique.
Les tribunaux d’un grand état en Europe frappent sans cesse depuis plusieurs siecles, sur la juridiction patrimoniale des seigneurs & sur l’ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages : mais nous laissons à décider jusqu’à quel point la constitution en peut être changée.
Je ne suis point entêté des privileges des ecclésiastiques : mais je voudrois qu’on fixât bien une fois leur juridiction. Il n’est point question de savoir si on a eu raison de l’établir : mais si elle est établie ; si elle fait une partie des lois du pays, & si elle y est par-tout relative ; si [I-207] entre deux pouvoirs que l’on reconnoît indépendans, les conditions ne doivent pas être réciproques ; & s’il n’est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu’elle s’est de tout temps prescrites.
Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il convenable dans une monarchie, sur-tout dans celles qui vont au despotisme. Où en seroient l’Espagne & le Portugal depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire ? Barriere toujours bonne, lorsqu’il n’y en a point d’autre : car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le limite est un bien.
Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est arrêtée par les herbes & les moindres graviers qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les monarques, dont le pouvoir paroît sans bornes, s’arrêtent par les plus petits obstacles, & soumettent leur fierté naturelle à la plainte & à la priere.
Les Anglois, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formoient leur monarchie.
[I-208] Ils ont bien raison de conserver cette liberté ; s’ils venoient à la perdre, ils seroient un des peuples les plus esclaves de la terre.
M. Law, par une ignorance égale de la constitution républicaine & de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que l’on eût encore vu en Europe. Outre les changemens qu’il fit si brusques, si inusités, si inouis ; il vouloit ôter les rangs intermédiaires, & anéantir les corps politiques : il dissolvoit [1] la monarchie par ses chimériques remboursemens, & sembloit vouloir racheter la constitution même.
Il ne suffit pas qu’il y ait dans une monarchie des rangs intermédiaires ; il faut encore un dépôt de lois. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques, qui annoncent les lois lorsqu’elles sont faites, & les rappellent lorsqu’on les oublie. L’ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil, exigent qu’il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussiere où elles [I-209] seroient ensevelies. Le conseil du prince n’est pas un dépôt convenable. Il est par sa nature le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, & non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus, le conseil du monarque change sans cesse ; il n’est point permanent ; il ne sauroit être nombreux ; il n’a point à un assez haut degré la confiance du peuple ; il n’est donc pas en état de l’éclairer dans les temps difficiles, ni de le ramener à l’obéissance.
Dans les états despotiques, où il n’y a point de lois fondamentales, il n’y a pas non plus de dépôt de lois. De-là vient que dans ces pays la religion a ordinairement tant de force ; c’est qu’elle forme une espece de dépôt & de permanence : Et si ce n’est pas la religion, ce sont les coutumes qu’on y vénere au lieu des lois.
-
[↑] Ferdinand, Roi d’Arragon, se fit grand-maître des ordres ; & cela seul altéra la constitution.
[I-210]
CHAPITRE V.
Des Lois relatives à la nature de l’état despotique.
Il résulte de la nature du pouvoir despotique, que l’homme seul qui l’exerce, le fasse de même exercer par un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu’il est tout, & que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les affaires. Mais, s’il les confioit à plusieurs, il y auroit des disputes entr’eux ; on feroit des brigues pour être le premier esclave ; le prince seroit obligé de rentrer dans l’administration. Il est donc plus simple qu’il l’abandonne à un vizir [1] qui aura d’abord la même puissance que lui. L’établissement d’un vizir est dans cet état une loi fondamentale.
On dit qu’un pape, à son élection, pénétré de son incapacité, fit d’abord des difficultés infinies. Il accepta enfin, & livra à son neveu toutes les affaires.
[I-211] Il étoit dans l’admiration, & disoit : « Je n’aurois jamais cru que cela eût été si aisé ». Il en est de même des princes d’Orient. Lorsque de cette prison, où des eunuques leur ont affoibli le cœur & l’esprit, & souvent leur ont laissé ignorer leur état même, on les tire pour les placer sur le trône, ils sont d’abord étonnés : mais quand ils ont fait un vizir, & que dans leur sérail ils se sont livrés aux passions les plus brutales ; lorsqu’au milieu d’une cour abattue, ils ont suivi leurs caprices les plus stupides, ils n’auroient jamais cru que cela eût été si aisé.
Plus l’empire est étendu, plus le sérail s’agrandit, & plus par conséquent le prince est enivré de plaisirs. Ainsi dans ces états, plus le prince a de peuples à gouverner, moins il pense au gouvernement ; plus les affaires y sont grandes, & moins on y délibere sur les affaires.
-
[↑] Les rois d’Orient ont toujours des vizirs, dit M. Chardin.
[I-212]
LIVRE III
Des principes des trois gouvernemens↩
CHAPITRE PREMIER
Différence de la nature du gouvernement & de son principe.
Après avoir examiné quelles sont les lois relatives à la nature de chaque gouvernement, il faut voir celles qui le sont à son principe.
Il y a cette différence [1] entre la nature du gouvernement & son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel, & son principe, ce qui le fait agir. L’une est sa structure particuliere, & l’autre les passions humaines qui le font mouvoir.
Or les lois ne doivent pas être moins relatives au principe de chaque gouvernement, qu’à sa nature. Il faut donc chercher quel est ce principe. C’est ce que je vais faire dans ce livre-ci.
-
[↑] Cette distinction est très importante, & j’en tirerai bien des consequences ; elle est la clef d’une infinité de lois.
[I-213]
CHAPITRE II
Du principe des divers gouvernemens
J’ai dit que la nature du gouvernement républicain, est que le peuple en corps, ou de certaines familles, y ayent la souveraine puissance : celle du gouvernement monarchique, que le prince y ait la souveraine puissance, mais qu’il l’exerce selon les lois établies : celle du gouvernement despotique, qu’un seul y gouverne selon ses volontés & ses caprices. Il ne m’en faut pas davantage pour trouver leurs trois principes ; ils en dérivent naturellement. Je commencerai par le gouvernement républicain, & je parlerai d’abord du démocratique.
[I-213]
CHAPITRE III
Du principe de la démocratie
Il ne faut pas beaucoup de probité, pour qu’un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintiennent ou se soutiennent. La [I-214] force des lois dans l’un, le bras du prince toujours levé dans l’autre, reglent ou contiennent tout. Mais, dans un état populaire, il faut un ressort de plus qui est la vertu.
Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l’histoire, & est très-conforme à la nature des choses. Car il est clair que dans une monarchie, où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire, où celui qui fait exécuter les lois sent qu’il y est soumis lui-même, & qu’il en portera le poids.
Il est clair encore que le monarque qui, par mauvais conseil ou par négligence, cesse de faire exécuter les lois, peut aisément réparer le mal ; il n’a qu’à changer de conseil, ou se corriger de cette négligence même. Mais lorsque, dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d’être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la république, l’état est déjà perdu.
Ce fut un assez beau spectacle dans le siecle passé, de voir les efforts impuissans des Anglois pour établir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui avoient [I-215] part aux affaires n’avoient point de vertu, que leur ambition étoit irritée par le succès de celui qui avoit le plus osé [1] , que l’esprit d’une faction n’étoit réprimé que par l’esprit d’une autre ; le gouvernement changeoit dans cesse ; le peuple étonné cherchoit la démocratie, & ne la trouvoit nulle part. Enfin, après bien des mouvemens, des chocs & des secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement même qu’on avoit proscrit.
Quand Sylla voulut rendre à Rome la liberté, elle ne put plus la recevoir ; elle n’avoit plus qu’un foible reste de vertu : & comme elle en eut toujours moins, au lieu de se réveiller après César, Tibere, Caïus, Claude, Néron, Domitien, elle fut toujours plus esclave ; tous les coups porterent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie.
Les politiques Grecs qui vivoient dans le gouvernement populaire, ne reconnoissoient d’autre force qui pût le soutenir, que celle de la vertu. Ceux d’aujourd'hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses & de luxe même.
[I-216]
Lorsque cette vertu cesse, l’ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir, & l’avarice entre dans tous. Les désirs changent d’objets ; ce qu’on aimoit, on ne l’aime plus ; on étoit libre avec les lois, on veut être libre contr’elles ; chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître ; ce qui étoit maxime, on l’appelle rigueur ; ce qui étoit regle, on l’appelle gêne ; ce qui étoit attention, on l’appelle crainte. C’est la frugalité qui y est l’avarice, & non pas le désir d’avoir. Autrefois le bien des particuliers faisoit le trésor public, mais pour lors le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La république est une dépouille ; & la force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens & la licence de tous.
Athenes eut dans son sein les mêmes forces pendant qu’elle domina avec tant de gloire, & pendant qu’elle servit avec tant de honte. Elle avoit vingt mille citoyens [2] , lorsqu’elle défendit les Grecs contre les Perses, qu’elle disputa l’empire à Lacédémone, & qu’elle attaqua la Sicile. Elle en avoit vingt [I-217] mille, lorsque Demetrius de Phalere les dénombra [3] , comme dans un marché l’on compte les esclaves. Quand Philippe osa dominer dans la Grece, quand il parut aux portes d’Athenes [4] , elle n’avoit encore perdu que le temps. On peut voir dans Démosthene quelle peine il fallut pour la réveiller : on y craignoit Philippe, non pas comme l’ennemi de la liberté, mais des plaisirs [5] . Cette ville, qui avoit résisté à tant de défaites, qu’on avoit vu renaître après ses destructions, fut vaincue à Chéronée, & le fut pour toujours. Qu’importe que Philippe renvoie tous les prisonniers ? Il ne renvoie pas des hommes. Il étoit toujours aussi aisé de triompher des forces d’Athenes, qu’il étoit difficile de triompher de sa vertu.
Comment Carthage auroit-elle pu se soutenir ? Lorsque Annibal, devenu préteur, voulut empêcher les magistrats de piller la république, n’allerent-ils pas [I-218] l’accuser devant les Romains ? Malheureux, qui vouloient être citoyens sans qu’il y eût de cité, & tenir leurs richesses de la main de leurs destructeurs ! Bientôt Rome leur demanda pour ôtages trois cents de leurs principaux citoyens ; elle se fit livrer les armes & les vaisseaux, & ensuite leur déclara la guerre. Par les choses que fit le désespoir dans Carthage désarmée [6] , on peut juger de ce qu’elle auroit pu faire avec sa vertu, lorsqu’elle avoit ses forces.
-
[↑] Cromwell.
-
[↑] Plutarque, in Pericle. Platon, in Critiâ.
-
[↑] Il s’y trouva vingt-un mille citoyens, dix milles étrangers, quatre cents mille esclaves. Voyez Athenée, liv. VI.
-
[↑] Elle avoit vingt mille citoyens. Voyez Démosthene, in Aristog.
-
[↑] Ils avoient fait une loi pour punir de mort celui qui proposeroit de convertir aux usages de la guerre l’argent destiné pour les théâtres.
-
[↑] Ce guerre dura trois ans.
[I-218]
CHAPITRE IV.
Du principe de l’Aristocratie.
Comme il faut de la vertu dans le gouvernement populaire, il en faut aussi dans l’aristocratique. Il est vrai qu’elle n’y est pas absolument requise.
Le peuple qui est à l’égard des nobles ce que les sujets sont à l’égard du monarque, est contenu par leurs lois. Il a donc moins besoin de vertu que le peuple de la démocratie. Mais, comment les nobles seront-ils contenus ? [I-219] Ceux qui doivent faire exécuter les lois contre leurs collegues, sentiront d’abord qu’ils agissent contre eux-mêmes. Il faut donc de la vertu dans ce corps, par la nature de la constitution.
Le gouvernement aristocratique a par lui-même une certaine force que la démocratie n’a pas. Les nobles y forment un corps, qui, par sa prérogative & pour son intérêt particulier, réprime le peuple : il suffit qu’il y ait des lois, pour qu’à cet égard elles soient exécutées.
Mais autant qu’il est aisé à ce corps de réprimer les autres, autant est-il difficile qu’il se réprime lui-même [1] . Telle est la nature de cette constitution, qu’il semble qu’elle mette les mêmes gens sous la puissance des lois, & qu’elle les en retire.
Or un corps pareil ne peut se réprimer que de deux manieres ; ou par une grande vertu, qui fait que les nobles se trouvent en quelque façon égaux à leur peuple, ce qui peut former une grande république ; ou par une vertu moindre, [I-220] qui est une certaine modération qui rend les nobles au moins égaux à eux-mêmes ; ce qui fait leur conservation.
La modération est donc l’ame de ces gouvernemens. J’entens celle qui est fondée sur la vertu, non pas celle qui vient d’une lâcheté & d’une paresse de l’ame.
-
[↑] Les crimes publics y pourront être punis, parce que c’est l’affaire de tous : les crimes particuliers n’y seront pas punis, parce que l’affaire de tous est de ne les pas punir.
[I-220]
CHAPITRE V.
Que la vertu n’est point le principe du gouvernement monarchique.
Dans les monarchies, la politique sait faire les grandes choses avec le moins de vertu qu’elle peut ; comme dans les plus belles machines, l’art emploie aussi peu de mouvemens, de forces & de roues qu’il est possible.
L’état subsiste indépendamment de l’amour pour la patrie, du désir de la vraie gloire, du renoncement à soi-même, du sacrifice de ses plus chers intérêts, & de toutes ces vertus héroïques que nous trouvons dans les anciens, & dont nous avons seulement entendu parler.
Les lois y tiennent la place de toutes ces vertus, dont on n’a aucun besoin ; [I-221] l’état vous en dispense : une action qui se fait sans bruit y est en quelque façon sans conséquence.
Quoique tous les crimes soient publics par leur nature, on distingue pourtant les crimes véritablement publics d’avec les crimes privés, ainsi appellés, parce qu’ils offensent plus un particulier, que la société entiere.
Or, dans les républiques, les crimes privés sont plus publics ; c’est-à-dire, choquent plus la constitution de l’état que les particuliers : & dans les monarchies, les crimes publics sont plus privés ; c’est-à-dire, choquent plus les fortunes particulieres que la constitution de l’état même.
Je supplie qu’on ne s’offense pas de ce que j’ai dit ; je parle après toutes les histoires. Je sais très-bien qu’il n’est pas rare qu’il y ait des princes vertueux ; mais je dis que dans une monarchie il est très-difficile que le peuple le soit [1] .
Qu’on lise ce que les historiens de tous les temps ont dit sur la cour des [I-222] monarques ; qu’on se rappelle les conversations des hommes de tous les pays sur le misérable caractere des courtisans : ce ne sont point des choses de spéculation, mais d’une triste expérience.
L’ambition dans l’oisiveté, la bassesse dans l’orgueil, le désir de s’enrichir sans travail, l’aversion pour la vérité, la flatterie, la trahison, la perfidie, l’abandon de tous ses engagemens, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l’espérance de ses foiblesses, & plus que tout cela, le ridicule perpétuel jeté sur la vertu, forment, je crois, le caractere du plus grand nombre des courtisans, marqué dans tous les lieux & dans tous les temps. Or il est très-mal-aisé que la plupart des principaux d’un état soient mal-honnêtes gens ; & que les inférieurs soient gens de bien ; que ceux-là soient trompeurs, & que ceux-ci consentent à n’être que dupes.
Que si dans le peuple il se trouve quelque malheureux honnête homme [2] , le cardinal de Richelieu, dans son testament politique, insinue qu’un monarque [I-223] doit se garder de s’en servir [3] . Tant il est vrai que la vertu n’est pas le ressort de ce gouvernement ! Certainement elle n’en est point exclue ; mais elle n’en est pas le ressort.
-
[↑] Je parle ici de la vertu politique, qui est la vertu morale dans le sens qu’elle se dirige au bien général, sort peu des vertus morales particulieres, & point du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélées. On verra bien ceci au liv. V. ch. II.
-
[↑] Entendez ceci dans le sens de la note précédente.
-
[↑] Il ne faut pas, y est-il dit, se servir de gens de bas lieu ; il sont trop austeres & trop difficiles.
[I-223]
CHAPITRE VI.
Comment on supplée à la vertu dans le gouvernement monarchique.
Je me hâte & je marche à grands pas, afin qu’on ne croie pas que je fasse une satire du gouvernement monarchique. Non : s’il manque d’un ressort, il en a un autre. L’honneur, c’est-à-dire, le préjugé de chaque personne & de chaque condition, prend la place de la vertu politique dont j’ai parlé, & la représente par-tout. Il y peut inspirer les plus belles actions ; il peut, joint à la force des lois, conduire au but du gouvernement comme la vertu même.
Ainsi dans les monarchies bien réglées, tout le monde sera à peu près bon citoyen, & on trouvera rarement [I-224] quelqu’un qui soit homme de bien ; car, pour être homme de bien [1] , il faut avoir intention de l’être [2] , & aimer l’état moins pour soi que pour lui-même.
-
[↑] Ce mot, homme de bien, ne s’entend ici que dans un sens politique.
-
[↑] Voyez la note de la page 47.
[I-224]
CHAPITRE VII.
Du principe de la Monarchie.
Le gouvernement monarchique suppose, comme nous avons dit, des prééminences, des rangs, & même une noblesse d’origine. La nature de l’honneur est de demander des préférences & des distinctions ; il est donc, par la chose même, placé dans ce gouvernement.
L’ambition est pernicieuse dans une république. Elle a de bons effets dans la monarchie ; elle donne la vie à ce gouvernement ; & on y a cet avantage, qu’elle n’y est pas dangereuse, parce qu’elle y peut être sans cesse réprimée.
Vous diriez qu’il en est comme du systême de l’univers, où il y a une force [I-225] qui éloigne sans cesse du centre tous les corps, & une force de pesanteur qui les y ramene. L’honneur fait mouvoir toutes les parties du corps politique ; il les lie par son action même ; & il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers.
Il est vrai que, philosophiquement parlant, c’est un honneur faux qui conduit toutes les parties de l’état ; mais cet honneur faux est aussi utile au public, que le vrai se feroit aux particuliers qui pourroient l’avoir.
Et n’est-ce pas beaucoup d’obliger les hommes à faire toutes les actions difficiles, & qui demandent de la force, sans autre récompense que le bruit de ces actions ?
[I-225]
CHAPITRE VIII.
Que l’honneur n’est point le principe des États despotiques.
Ce n’est point l’honneur qui est le principe des états despotiques : les hommes y étant tous égaux, on n’y peut se préférer aux autres ; les hommes y [I-226] étant tous esclaves, on n’y peut se préférer à rien.
De plus, comme l’honneur a ses lois & ses regles, & qu’il ne sauroit plier ; qu’il dépend bien de son propre caprice, & non pas de celui d’un autre ; il ne peut se trouver que dans des états où la constitution est fixe, & qui ont des lois certaines.
Comment seroit-il souffert chez le despote ? Il fait gloire de mépriser la vie, & le despote n’a de force que parce qu’il peut l’ôter. Comment pourroit-il souffrir le despote ? Il a des regles suivies, & des caprices soutenus ; le despote n’a aucune regle, & ses caprices détruisent tous les autres.
L’honneur inconnu aux états despotiques, où même souvent on n’a pas de mot pour l’exprimer [1] , regne dans les monarchies ; il y donne la vie à tout le corps politique, aux lois, & aux vertus même.
-
[↑] Voyez Perry, page 447.
[I-227]
CHAPITRE IX.
Du principe du gouvernement despotique.
Comme il faut de la vertu dans une république, & dans une monarchie de l’honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique : pour la vertu, elle n’y est point nécessaire ; & l’honneur y seroit dangereux.
Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens capables de s’estimer beaucoup eux-mêmes, seroient en état d’y faire des révolutions. Il faut donc que la crainte y abatte tous les courages, & y éteigne jusqu’au moindre sentiment d’ambition.
Un gouvernement modéré peut, tant qu’il veut, & sans périr, relâcher ses ressorts. Il se maintient par ses lois & par sa force même. Mais lorsque, dans le gouvernement despotique, le prince cesse un moment de lever le bras ; quand il ne peut pas anéantir à l’instant ceux qui ont les premieres places [1] , tout est perdu : [I-228] car le ressort du gouvernement, qui est la crainte, n’y étant plus, le peuple n’a plus de protecteur.
C’est apparemment dans ce sens que des cadis ont soutenu que le grand-seigneur n’étoit point obligé de tenir sa parole ou son serment, lorsqu’il bornoit par-là son autorité [2] .
Il faut que le peuple soit jugé par les lois, & les grands par la fantaisie du prince ; que la tête du dernier sujet soit en sureté, & celle des bachas toujours exposée. On ne peut parler sans frémir de ces gouvernemens monstrueux. Le sophi de Perse détrôné de nos jours par Mirivéis, vit le gouvernement périr avant la conquête, parce qu’il n’avoit pas versé assez de sang [3] .
L’histoire nous dit que les horribles cruautés de Domitien effrayerent les gouverneurs, au point que le peuple se rétablit un peu sous son regne [4] . C’est ainsi qu’un torrent qui ravage tout d’un côté, laisse de l’autre des campagnes où l’œil voit de loin quelques prairies.
-
[↑] Comme il arrive souvent dans l’aristocratie militaire.
-
[↑] Ricault, de l’Empire Ottoman.
-
[↑] Voyez l’histoire de cette révolution, par le P. Ducerceau.
-
[↑] Son gouvernement étoit militaire : ce qui est une des especes du gouvernement despotique.
[I-229]
CHAPITRE X.
Différence de l’obéissance dans les gouvernemens modérés & dans les gouvernemens despotiques
Dans les états despotiques, la nature du gouvernement demande une obéissance extrême ; & la volonté du prince une fois connue, doit avoir aussi infailliblement son effet, qu’une boule jetée contre une autre doit avoir le sien.
Il n’y a point de tempérament, de modification, d’accomodement, de termes, d’équivalens, de pourparlers, de remontrances ; rien d’égal ou de meilleur à proposer. L’homme est une créature qui obéit à une créature qui veut.
On n’y peut pas plus représenter ses craintes sur un événement futur, qu’excuser ses mauvais succès sur le caprice de la fortune. Le partage des hommes, comme des bêtes, y est l’instinct, l’obéissance, le châtiment.
Il ne sert de rien d’opposer les sentimens naturels, le respect pour un pere, [I-230] la tendresse pour ses enfans & ses femmes, les lois de l’honneur, l’état de sa santé ; on a reçu l’ordre, & cela suffit.
En Perse, lorsque le roi a condamné quelqu’un, on ne peut plus lui en parler, ni demander grace. S’il étoit ivre ou hors de sens, il faudroit que l’arrêt s’exécutât tout de même [1] ; sans cela il se contrediroit, & la loi ne peut se contredire. Cette maniere de penser y a été de tout temps : l’ordre que donna Assuérus d’exterminer les Juifs ne pouvant être révoqué, on prit le parti de leur donner la permission de se défendre.
Il y a pourtant une chose que l’on peut quelquefois opposer à la volonté du prince [2] ; c’est la religion. On abandonnera son pere, on le tuera même, si le prince l’ordonne : mais on ne boira pas du vin, s’il le veut & s’il l’ordonne. Les lois de la religion sont d’un précepte supérieur, parce qu’elles sont données sur la tête du prince comme sur celles des sujets. Mais quant au droit naturel, il n’en est pas de même ; le prince est supposé n’être plus un homme.
[I-231]
Dans les états monarchiques & modérés, la puissance est bornée par ce qui en est le ressort, je veux dire l’honneur, qui regne, comme un monarque, sur le prince & sur le peuple. On n’ira point lui alléguer les lois de la religion ; un courtisan se croiroit ridicule : on lui alléguera sans cesse celles de l’honneur. De-là résultent des modifications nécessaires dans l’obéissance ; l’honneur est naturellement sujet à des bizarreries, & l’obéissance les suivra toutes.
Quoique la maniere d’obéir soit différente dans ces deux gouvernemens, le pouvoir est pourtant le même. De quelque côté que le monarque se tourne, il emporte & précipite la balance, & est obéi. Toute la différence est que, dans la monarchie, le prince a des lumieres, & que les ministres y sont infiniment plus habiles & plus rompus aux affaires que dans l’état despotique.
[I-232]
CHAPITRE XI.
Réflexions sur tout ceci.
Tels sont les principes des trois gouvernemens : ce qui ne signifie pas que, dans une certaine république, on soit vertueux ; mais qu’on devroit l’être. Cela ne prouve pas non plus que, dans une certaine monarchie, on ait de l’honneur : & que, dans un état despotique particulier, on ait de la crainte ; mais qu’il faudroit en avoir : sans quoi le gouvernement sera imparfait.
[I-233]
LIVRE IV.
Que les lois de l’éducation doivent être relatives aux principes du gouvernement.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des lois de l’éducation.
Les lois de l’éducation sont les premieres que nous recevons. Et comme elles nous préparent à être citoyens, chaque famille particuliere doit être gouvernée sur le plan de la grande famille qui les comprend toutes.
Si le peuple en général a un principe, les parties qui le composent, c’est-à-dire, les familles l’auront aussi. Les lois de l’éducation seront donc différentes dans chaque espece de gouvernement. Dans les monarchies, elles auront pour objet l’honneur ; dans les républiques, la vertu ; dans le despotisme, la crainte.
[I-234]
CHAPITRE II.
De l’éducation dans les Monarchies
Ce n’est point dans les maisons publiques où l’on instruit l’enfance, que l’on reçoit dans les monarchies la principale éducation ; c’est lorsque l’on entre dans le monde, que l’éducation en quelque façon commence. Là est l’école de ce que l’on appelle l’honneur, ce maître universel qui doit par-tout nous conduire.
C’est là que l’on voit & que l’on entend toujours dire trois choses ; qu’il faut mettre dans les vertus une certaine noblesse, dans les mœurs une certaine franchise, dans les manieres une certaine politesse.
Les vertus qu’on nous y montre, sont toujours moins ce que l’on doit aux autres, que ce que l’on se doit à soi-même : elles ne sont pas tant ce qui nous appelle vers nos concitoyens, que ce qui nous en distingue.
On n’y juge pas les actions des hommes comme bonnes, mais comme belles ; comme justes, mais comme grandes ; [I-235] comme raisonnables, mais comme extraordinaires.
Dès que l’honneur y peut trouver quelque chose de noble, il est ou le juge qui les rend légitimes, ou le sophiste qui les justifie.
Il permet la galanterie, lorsqu’elle est unie à l’idée des sentimens du cœur, ou à l’idée de conquête : Et c’est la vraie raison pour laquelle les mœurs ne sont jamais si pures dans les monarchies, que dans les gouvernemens républicains.
Il permet la ruse, lorsqu’elle est jointe à l’idée de grandeur de l’esprit ou de la grandeur des affaires ; comme dans la politique, dont les finesses ne l’offensent pas.
Il ne défend l’adulation, que lorsqu’elle est séparée de l’idée d’une grande fortune, & n’est jointe qu’au sentiment de sa propre bassesse.
À l’égard des mœurs, j’ai dit que l’éducation des monarchies doit y mettre une certaine franchise. On y veut donc de la vérité dans les discours. Mais est-ce par amour pour elle ? point du tout. On la veut, parce qu’un homme qui est accoutumé à la dire, paroît être hardi & libre. En effet, un tel homme semble ne [I-236] dépendre que des choses, & non pas de la maniere dont un autre les reçoit.
C’est ce qui fait qu’autant qu’on y recommande cette espece de franchise, autant on y méprise celle du peuple, qui n’a que la vérité & la simplicité pour objet.
Enfin, l’éducation dans les monarchies exige dans les manieres une certaine politesse. Les hommes nés pour vivre ensemble, sont nés aussi pour se plaire ; & celui qui n’observeroit pas les bienséances, choquant tous ceux avec qui il vivroit, se décréditeroit au point qu’il deviendroit incapable de faire aucun bien.
Mais ce n’est pas d’une source si pure que la politesse a coutume de tirer son origine. Elle naît de l’envie de se distinguer. C’est par orgueil que nous sommes polis : nous nous sentons flattés d’avoir des manieres qui prouvent que nous ne sommes pas dans la bassesse, & que nous n’avons pas vécu avec cette sorte de gens que l’on a abandonnés dans tous les âges.
Dans les monarchies, la politesse est naturalisée à la cour. Un homme excessivement grand, rend tous les autres [I-237] petits. De-là les égards que l’on doit à tout le monde ; de-là naît la politesse, qui flatte autant ceux qui sont polis, que ceux à l’égard de qui ils le sont ; parce qu’elle fait comprendre qu’on est de la cour, ou qu’on est digne d’en être.
L’air de la cour consiste à quitter sa grandeur propre pour une grandeur empruntée. Celle-ci flatte plus un courtisan que la sienne même. Elle donne une certaine modestie superbe qui se répand au loin, mais dont l’orgueil diminue insensiblement à proportion de la distance où l’on est de la source de cette grandeur.
On trouve à la cour une délicatesse de goût en toutes choses, qui vient d’un usage continuel des superfluités d’une grande fortune, de la variété, & sur-tout de la lassitude des plaisirs, de la multiplicité, de la confusion même des fantaisies, qui, lorsqu’elles sont agréables, y sont toujours reçues.
C’est sur toutes ces choses que l’éducation se porte, pour faire ce que l’on appelle l’honnête-homme, qui a toutes les qualités & toutes les vertus que l’on demande dans ce gouvernement.
Là, l’honneur se mêlant par-tout, entre dans toutes les façons de penser [I-238] & toutes les manieres de sentir, & dirige même les principes.
Cet honneur bisarre fait que les vertus ne sont que ce qu’il veut, & comme il les veut ; il met de son chef des regles à tout ce qui nous est prescrit ; il étend ou il borne nos devoirs à sa fantaisie, soit qu’ils aient leur source dans la religion, dans la politique, ou dans la morale.
Il n’y a rien dans la monarchie que les lois, la religion & l’honneur prescrivent tant que l’obéissance aux volontés du prince : mais cet honneur nous dicte, que le prince ne doit jamais nous prescrire une action qui nous déshonore, parce qu’elle nous rendroit capable de le servir.
Crillon refusa d’assassiner le duc de Guise, mais il offrit à Henri III de se battre contre lui. Après la saint Barthelemi, Charles IX ayant écrit à tous les gouverneurs de faire massacrer les huguenots, le vicomte Dorte qui commandoit dans Bayonne, écrivit au Roi [1] : « Sire, je n’ai trouvé parmi les habitans & les gens de guerre, que de bons citoyens, de braves soldats, & pas un bourreau : ainsi, eux & moi [I-239] supplions votre Majesté d’employer nos bras & nos vies à choses faisables ». Ce grand & généreux courage regardoit une lâcheté comme une chose impossible.
Il n’y a rien que l’honneur prescrive plus à la noblesse, que de servir le prince à la guerre. En effet, c’est la profession distinguée, parce que ses hasards, ses succès & ses malheurs même conduisent à la grandeur. Mais, en imposant cette loi, l’honneur veut en être l’arbitre ; & s’il se trouve choqué, il exige ou permet qu’on se retire chez soi.
Il veut qu’on puisse indifféremment aspirer aux emplois ou les refuser ; il tient cette liberté au-dessus de la fortune même.
L’honneur a donc ses regles suprêmes, & l’éducation est obligée de s’y conformer [2] . Les principales sont, qu’il nous est bien permis de faire cas de notre fortune, mais qu’il nous est souverainement défendu d’en faire aucun de notre vie.
La seconde est, que lorsque nous [I-240] avons été une fois placés dans un rang, nous ne devons rien faire ni souffrir qui fasse voir que nous nous tenons inférieurs à ce rang même.
La troisieme, que les choses que l’honneur défend, sont plus rigoureusement défendues, lorsque les lois ne concourent point à les prescrire ; & que celles qu’il exige sont plus fortement exigées, lorsque les lois ne les demandent pas.
-
[↑] Voyez l’histoire de d’Aubigné.
-
[↑] On dit ici ce qui est, & non pas ce qui doit être : L’honneur est un préjugé, que la religion travaille tantôt à détruire, tantôt à régler.
[I-240]
CHAPITRE III.
De l’éducation dans le gouvernement despotique
Comme l’éducation dans les monarchies ne travaille qu’à élever le cœur, elle ne cherche qu’à l’abaisser dans les états despotiques. Il faut qu’elle y soit servile. Ce sera un bien, même dans le commandement, de l’avoir eue telle ; personne n’y étant tyran, sans être en même temps esclave.
L’extrême obéissance suppose de l’ignorance dans celui qui obéit ; elle en suppose même dans celui qui [I-241] commande : il n’a point à délibérer, à douter, ni à raisonner ; il n’a qu’à vouloir.
Dans les états despotiques, chaque maison est un empire séparé. L’éducation qui consiste principalement à vivre avec les autres, y est donc très-bornée : elle se réduit à mettre la crainte dans le cœur, & à donner à l’esprit la connoissance de quelques principes de religion fort simples. Le savoir y sera dangereux, l’émulation funeste ; & pour les vertus, Aristote ne peut croire qu’il y en ait quelqu’une de propre aux esclaves [1] ; ce qui borneroit bien l’éducation dans ce gouvernement.
L’éducation y est donc en quelque façon nulle. Il faut ôter tout, afin de donner quelque chose ; & commencer par faire un mauvais sujet, pour faire un bon esclave.
Eh ! pourquoi l’éducation s’attacherait-elle à y former un bon citoyen qui prît part au malheur public ? S’il aimoit l’état, il seroit tenté de relâcher les ressorts du gouvernement : s’il ne réussisoit pas, il se perdroit ; s’il réussissoit, il courroit risque de se perdre, lui, le prince & l’empire.
-
[↑] Politiq. liv. I.
[I-242]
CHAPITRE IV.
Différence des effets de l’éducation chez les anciens & parmi nous.
La plupart des peuples anciens vivoient dans des gouvernemens qui ont la vertu pour principe ; & lorsqu’elle y étoit dans sa force, on y faisoit des choses que nous ne voyons plus aujourd’hui, & qui étonnent nos petites ames.
Leur éducation avoit un autre avantage sur la nôtre ; elle n’étoit jamais démentie. Epaminondas, la derniere année de sa vie, disoit, écoutoit, voyoit, faisoit les mêmes choses que dans l’âge où il avoit commencé d’être instruit.
Aujourd'hui, nous recevons trois éducations différentes, ou contraires ; celle de nos peres, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu’on nous dit dans la derniere, renverse toutes les idées des premieres. Cela vient en quelque partie du contraste qu’il y a parmi nous entre les engagements de la religion & ceux du monde ; choses que les anciens de connoissoient pas.
[I-243]
CHAPITRE V.
De l’éducation dans le gouvernement républicain
C’est dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation. La crainte des gouvernemens despotiques naît d’elle-même parmi les menaces & les châtimens ; l’honneur des monarchies est favorisé par les passions, & les favorise à son tour : mais la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très-pénible.
On peut définir cette vertu, l’amour des lois & de la patrie. Cet amour demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulieres ; elles ne sont que cette préférence.
Cet amour est singuliérement affecté aux démocraties. Dans elles seules, le gouvernement est confié à chaque citoyen. Or le gouvernement est comme toutes les choses du monde ; pour le conserver, il faut l’aimer.
On n’a jamais oui dire que les rois [I-244] n’aimassent pas la monarchie, & que les despotes haïssent le despotisme.
Tout dépend donc d’établir dans la république cet amour ; & c’est à l’inspirer, que l’éducation doit être attentive. Mais pour que les enfants puissent l’avoir, il y a un moyen sûr ; c’est que les peres l’ayent eux-mêmes.
On est ordinairement le maître de donner à ses enfans ses connoissances ; on l’est encore plus de leur donner ses passions.
Si cela n’arrive pas, c’est que ce qui a été fait dans la maison paternelle, est détruit pas les impressions du dehors.
Ce n’est point le peuple naissant qui dégénere ; il ne se perd que lorsque les hommes faits sont déjà corrompus.
[I-244]
CHAPITRE VI.
De quelques institutions des Grecs.
Les anciens Grecs, pénétrés de la nécessité que les peuples qui vivoient sous un gouvernement populaire fussent élevés à la vertu, firent pour l’inspirer des institution singulieres. Quand vous voyez dans la vie de Lycurgue, les lois [I-245] qu’il donna aux Lacédémoniens, vous croyez lire l’histoire des Sévarambes. Les lois de Crete étoient l’original de celles de Lacédémone ; & celles de Platon en étoient la correction.
Je prie qu’on fasse un peu d’attention à l’étendue de génie qu’il fallut à ces législateurs, pour voir qu’en choquant tous les usages reçus, en confondant toutes les vertus, ils montreroient à l’univers leur sagesse. Lycurgue, mêlant le larcin avec l’esprit de justice, le plus dur esclavage avec l’extrême liberté, les sentimens les plus atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité à sa ville. Il sembla lui ôter toutes les ressources, les arts, le commerce, l’argent, les murailles : on y a de l’ambition sans espérance d’être mieux : on y a les sentimens naturels ; & on n’y est ni enfant, ni mari, ni pere : la pudeur même est ôtée à la chasteté. C’est par ces chemins que Sparte est menée à la grandeur & à la gloire ; mais avec une telle infaillibilité de ses institutions, qu’on n’obtenoit rien contr’elle en gagnant des batailles, si on ne parvenoit à lui ôter sa police [1] .
[I-246]
La Crete & la Laconie furent gouvernées par ces lois. Lacédémone céda la derniere aux Macédoniens, & la Crete [2] fut la derniere proie des Romains. Les Samnites eurent ces mêmes institutions, & elles furent pour ces Romains le sujet de vingt-quatre triomphes [3] .
Cet extraordinaire que l’on voyoit dans les institutions de la Grece, nous l’avons vu dans la lie & la corruption de nos temps modernes [4] . Un législateur honnête homme a formé un peuple, où la probité paroît aussi naturelle que la bravoure chez les Spartiates. M. Pen est un véritable Lycurgue ; & quoique le premier ait eu la paix pour objet, comme l’autre a eu la guerre, ils se ressemblent dans la voie singuliere où ils ont mis leur peuple, dans l’ascendant qu’ils ont eu sur des hommes libres, dans les préjugés qu’ils ont vaincus, dans les passions qu’ils ont soumises.
[I-247]
Le Paraguay peut nous fournir un autre exemple. On a voulu en faire un crime à la Société, qui regarde le plaisir de commander comme le seul bien de la vie : mais il sera toujours beau de gouverner les hommes en les rendant plus heureux [5] .
Il est glorieux pour elle d’avoir été la premiere qui ait montré, dans ces contrées, l’idée de la religion jointe à celle de l’humanité. En réparant les dévastations des Espagnols, elle a commencé à guérir une des grandes plaies qu’ait encore reçues le genre humain.
Un sentiment exquis qu’a cette Société pour tout ce qu’elle appelle honneur, son zele pour une religion qui humilie bien plus ceux qui l’écoutent que ceux qui la prêchent, lui ont fait entreprendre de grandes choses, & elle y a réussi. Elle a retiré des bois des peuples dispersés, elle leur a donné une subsistance assurée, elle les a vêtus ; & quand elle n’auroit fait par-là qu’augmenter l’industrie parmi les hommes, elle auroit beaucoup fait.
[I-248]
Ceux qui voudront faire des institutions pareilles, établiront la communauté des biens de la république de Platon, ce respect qu’il demandoit pour les dieux, cette séparation d’avec les étrangers pour la conservation des mœurs, & la cité faisant le commerce & non pas les citoyens ; ils donneront nos arts sans notre luxe, & nos besoins sans nos désirs.
Ils proscriront l’argent, dont l’effet est de grossir la fortune des hommes au-delà des bornes que la nature y avoit mises, d’apprendre à conserver inutilement ce qu’on avoit amassé de même, de multiplier à l’infini les désirs, & de suppléer à la nature, qui nous avoit donné des moyens très-bornés d’irriter nos passions, & de nous corrompre les uns les autres.
« Les Epidamniens [6] sentant leurs mœurs se corrompre par leur communication avec les barbares, élurent un magistrat pour faire tous les marchés au nom de la cité & pour la cité. » Pour lors le commerce ne corrompt pas la constitution, & la constitution ne prive pas la société des avantages du commerce.
-
[↑] Philopœmen contraignit les Lacédémoniens d’abandonner la maniere de nourrir leurs enfans, sachant bien que sans cela ils auroient toujours une ame grande & le cœur haut. Plutarq vie de Philopœmen. Voyez Tite Live, liv. XXXVIII.
-
[↑] Elle défendit pendant trois ans ses lois & sa liberté. Voyez les liv. XCVIII. XCIX. & C. de Tite-Live, dans l’épiteme de Florus. Elle fit plus de résistance que les plus grands rois.
-
[↑] Florus, liv. I.
-
[↑] In sece Romuli, Cicéron.
-
[↑] Les Indiens du Paraguay ne dépendent point d’un seigneur particulier, ne payent qu’un cinquieme des tributs & ont des armes à feu pour se défendre.
-
[↑] Plutarque, demande des choses Grecques.
[I-249]
CHAPITRE VII.
En quel cas ces institutions singulieres peuvent être bonnes.
Ces sortes d’institutions peuvent convenir dans les républiques, parce que la vertu politique en est le principe : mais pour porter à l’honneur dans les monarchies, ou pour inspirer de la crainte dans les états despotiques, il ne faut pas tant de soins.
Elles ne peuvent d’ailleurs avoir lieu que dans un petit état [1] , où l’on peut donner une éducation générale, & élever tout un peuple comme une famille.
Les lois de Minos, de Lycurgue & de Platon, supposent une attention singuliere de tous les citoyens les uns sur les autres. On ne peut se promettre cela dans la confusion, dans les négligences, dans l’étendue des affaires d’un grand peuple.
Il faut, comme on l’a dit, bannir l’argent dans ces institutions. Mais dans les grandes sociétés, le nombre, la [I-250] variétés, l’embarras, l’importance des affaires, la facilité des achats, la lenteur des échanges, demandent une mesure commune. Pour porter par-tout sa puissance, ou la défendre par-tout, il faut avoir ce à quoi les hommes ont attaché par-tout la puissance.
-
[↑] Comme étoient les villes de la Grece.
[I-250]
CHAPITRE VIII.
Explication d’un paradoxe des anciens, par rapport aux mœurs.
Polybe, le judicieux Polybe, nous dit que la Musique étoit nécessaire pour adoucir les mœurs des Arcades, qui habitoient un pays où l’air est triste & froid ; que ceux de Cynete, qui négligerent la musique, surpasserent en cruauté tous les Grecs, & qu’il n’y a point de ville où l’on ait vu tant de crimes. Platon ne craint point de dire que l’on ne peut faire de changement dans la musique, qui n’en soit un dans la constitution de l’état. Aristote, qui semble n’avoir fait sa politique que pour opposer ses sentimens à ceux de Platon, est pourtant d’accord avec lui touchant la puissance de la musique sur les mœurs.
[I-251] Théophraste, Plutarque [1] , Strabon [2] , tous les anciens, ont pensé de même. Ce n’est point une opinion jetée sans réflexion ; c’est un des principes de leur politique [3] . C’est ainsi qu’ils donnoient des lois, c’est ainsi qu’ils vouloient qu’on gouvernât les cités.
Je crois que je pourrois expliquer ceci. Il faut se mettre dans l’esprit que dans les villes Grecques, sur-tout celles qui avoient pour principal objet la guerre, tous les travaux & toutes les professions qui pouvoient conduire à gagner de l’argent, étoient regardées comme indignes d’un homme libre. « La plupart des arts, dit Xénophon [4] , corrompent le corps de ceux qui les exercent ; ils obligent de s’asseoir à l’ombre ou près du feu : on n’a de temps ni pour ses amis, ni pour la république. » Ce ne fut que dans la corruption de quelques démocraties que [I-252] les artisans parvinrent à être citoyens. C’est ce qu’Aristote [5] nous apprend ; & il soutient qu’une bonne république ne leur donnera jamais le droit de cité [6] .
L’agriculture étoit encore une profession servile, & ordinairement c’étoit quelque peuple vaincu qui l’exerçoit ; les Ilotes chez les Lacédémoniens, les Périéciens chez les Crétois, les Pénestes chez les Thessaliens, d’autres [7] peuples esclaves dans d’autres républiques.
Enfin tout bas commerce [8] étoit infame chez les Grecs ; il auroit fallu qu’un citoyen eût rendu des services à un esclave, à un locataire, à un étranger : cette idée choquoit l’esprit de la liberté Grecque ; aussi Platon [9] [I-253] veut-il dans ses lois qu’on punisse un citoyen qui feroit le commerce.
On étoit donc fort embarrassé dans les républiques Grecques. On ne vouloit pas que les citoyens travaillassent au commerce, à l’agriculture, ni aux arts ; on ne vouloit pas non plus qu’ils fussent oisifs [10] . Ils trouvoient une occupation dans les exercices qui dépendoient de la gymnastique, & dans ceux qui avoient du rapport à la guerre [11] . L’institution ne leur en donnoit point d’autres. Il faut donc regarder les Grecs comme une société d’athletes & de combattans. Or, ces exercices si propres à faire des gens durs & sauvages [12] , avoient besoin d’être tempérés par d’autres qui pussent adoucir les mœurs. La musique, qui tient à l’esprit par les organes du corps, étoit très-propre à cela. C’est un milieu entre les exercices du corps qui rendent les hommes durs, & les sciences de [I-254] spéculation qui les rendent sauvages. On ne peut pas dire que la musique inspirât la vertu ; cela seroit inconcevable : mais elle empêchoit l’effet de la férocité de l’institution, & faisoit que l’ame avoit dans l’éducation une part qu’elle n’y aurait point eue.
Je suppose qu’il y ait parmi nous une société de gens si passionnés pour la chasse, qu’ils s’en occupassent uniquement ; il est sûr qu’ils en contracteroient une certaine rudesse. Si ces mêmes gens venoient à prendre encore du goût pour la musique, on trouveroit bientôt de la différence dans leurs manieres & dans leurs mœurs. Enfin les exercices des Grecs n’excitoient en eux qu’un genre de passions, la rudesse, la colere, la cruauté. La musique les excite toutes, & peut faire sentir à l’ame la douceur, la pitié, la tendresse, le doux plaisir. Nos auteurs de morale, qui parmi nous, proscrivent si fort les théâtres, nous font assez sentir le pouvoir que la musique a sur nos ames.
Si à la société dont j’ai parlé, on ne donnoit que des tambours & des airs de trompette, n’est-il pas vrai que l’on parviendroit moins à son but, que si [I-255] l’on donnoit une musique tendre ? Les anciens avoient donc raison, lorsque dans certaines circonstances, ils préféroient pour les mœurs un mode à un autre.
Mais, dira-t-on, pourquoi choisir la musique par préférence ? C’est que, de tous les plaisirs des sens, il n’y en a aucun qui corrompe moins l’ame. Nous rougissons de lire dans Plutarque [13] , que les Thébains, pour adoucir les mœurs de leurs jeunes gens, établirent par les lois un amour qui devroit être proscrit par toutes les nations du monde.
-
[↑] Vie de Pélopidas.
-
[↑] Liv. I.
-
[↑] Platon, liv. IV. des lois, dit que les préfectures de la musique & de la gymnastique sont les plus importans emplois de la cité ; & dans sa république, liv. III. « Damon vous dira, dit-il, quels sont les sons capables de faire naître la bassesse de l’ame, l’insolence, & les vertus contraires. »
-
[↑] Liv. V. Dits mémorables.
-
[↑] Politiq. liv. III. chap. IV.
-
[↑] Diophante, dit Aristote, Polit. ch. VII. établit autrefois à Athenes, que les artisans seroient esclaves du public.
-
[↑] Aussi Platon & Aristote veulent-ils que les esclaves cultivent les terres. Lois, liv. VIII. Polit. liv. VII. ch. X. Il est vrai que l’agriculture n’étoit pas par-tout exercée par des esclaves : au contraire, comme dit Aristote, les meilleures républiques étoient celles où les citoyens s’y attachoient ; mais cela n’arriva que par la corruption des anciens gouvernemens devenus démocratiques ; car dans les premiers temps, les villes de Grece vivoient dans l’aristocratie.
-
[↑] Cauponatio.
-
[↑] Liv. II.
-
[↑] Aristote, Politiq. liv. X.
-
[↑] Ars corporum exercendorum gymnastica, variis certaminibus rerendorum pœdotribica. Aristore, Politiq. liv. VIII. ch. III.
-
[↑] Aristote dit que les enfans des Lacédémoniens qui commençoient ces exercices dès l’âge le plus tendre en contractoient trop de férocité, Polit. liv. VIII. chap. IV.
-
[↑] Vie de Pélopidas
[I-256]
LIVRE V.
Que les Lois que le Législateur donne, doivent être relatives au principe du gouvernement.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée de ce Livre.
Nous venons de voir que les lois de l’éducation doivent être relatives au principe de chaque gouvernement. Celles que le législateur donne à toute la société, sont de même. Ce rapport des lois avec ce principe, tend tous les ressorts du gouvernement, & ce principe en reçoit à son tour une nouvelle force. C’est ainsi que, dans les mouvemens physiques, l’action est toujours suivie d’une réaction.
Nous allons examiner ce rapport dans chaque gouvernement ; & nous commencerons par l’état républicain, qui a la vertu pour principe.
[I-257]
CHAPITRE II.
Ce que c’est que la vertu dans l’état politique.
La vertu dans une république est une chose très-simple ; c’est l’amour de la république ; c’est un sentiment, & non une suite de connoissances : le dernier homme de l’état peut avoir ce sentiment comme le premier. Quand le peuple a une fois de bonnes maximes, il s’y tient plus long-temps, que ce que l’on appelle les honnêtes gens. Il est rare que la corruption commence par lui ; souvent il a tiré de la médiocrité de ses lumieres un attachement plus fort pour ce qui est établi.
L’amour de la patrie conduit à la bonté des mœurs, & la bonté des mœurs mene à l’amour de la patrie. Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulieres, plus nous nous livrons aux générales. Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre ? C’est justement par l’endroit qui fait qu’il leur est insupportable. Leur regle les prive de toutes les choses sur lesquelles [I-258] les passions ordinaires s’appuient : reste donc cette passion pour la regle même qui les afflige. Plus elle est austere, c’est-à-dire, plus elle retranche de leurs penchans, plus elle donne de force à ceux qu’elle leur laisse.
[I-258]
CHAPITRE III.
Ce que c’est que l’amour de la république dans la démocratie.
L’amour de la république dans une démocratie est celui de la démocratie ; l’amour de la démocratie est celui de l’égalité.
L'amour de la démocratie est encore l'amour de la frugalité. Chacun devant y avoir le même bonheur & les mêmes avantages, y doit goûter les mêmes plaisirs & former les mêmes espérances ; chose qu'on ne peut attendre que de la frugalité générale.
L'amour de l'égalité dans une démocratie borne l'ambition au seul désir, au seul bonheur de rendre à sa patrie de plus grands services que les autres citoyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des services égaux : [I-259] mais ils doivent tous également lui en rendre. En naissant, on contracte envers elle une dette immense, dont on ne peut jamais s’acquitter.
Ainsi les distinctions y naissent du principe de l’égalité, lors même qu’elle paroît ôtée par des services heureux ou par des talens supérieurs.
L’amour de la frugalité borne le désir d’avoir à l’attention que demande le nécessaire pour sa famille & même le superflu pour sa patrie. Les richesses donnent une puissance dont un citoyen ne peut pas user pour lui, car il ne seroit pas égal. Elles procurent des délices, dont il ne doit pas jouir non plus, parce qu’elles choqueroient l’égalité tout de même.
Aussi les bonnes démocraties, en établissant la frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux dépenses publiques, comme on fit à Athenes & à Rome. Pour lors la magnificence & la profusion naissoient du fond de la frugalité même ; & comme la religion demande qu’on ait les mains pures pour faire des offrandes aux dieux, les lois vouloient des mœurs frugales pour que l’on pût donner à sa patrie.
[I-260]
Le bon sens & le bonheur des particuliers consiste beaucoup dans la médiocrité de leurs talens & de leurs fortunes. Une république où les lois auront formé beaucoup des gens médiocres, composée de gens sages, se gouvernera sagement ; composée de gens heureux, elle sera très-heureuse.
[I-260]
CHAPITRE IV.
Comment on inspire l’amour de l’égalité & de la frugalité.
L’amour de l’égalité & celui de la frugalité sont extrêmement excités par l’égalité & la frugalité mêmes, quand on vit dans une société où les lois ont établi l’une et l’autre.
Dans les monarchies & les états despotiques, personne n’aspire à l’égalité ; cela ne vient pas même dans l’idée ; chacun y tend à la supériorité. Les gens des conditions les plus basses ne désirent d’en sortir, que pour être les maîtres des autres.
Il en est de même de la frugalité. Pour l’aimer, il faut en jouir. Ce ne seront point ceux qui sont corrompus [I-261] par les délices, qui aimeront la vie frugale ; & si cela avoit été naturel & ordinaire, Alcibiade n’auroit pas fait l’admiration de l’univers. Ce ne seront pas non plus ceux qui envient ou qui admirent le luxe des autres, qui aimeront la frugalité ; des gens qui n’ont devant les yeux que des hommes riches ou des hommes misérables comme eux, détestent leur misere, sans aimer ou connoître ce qui fait le terme de la misere.
C’est donc une maxime très-vraie, que pour que l’on aime l’égalité & la frugalité dans une république, il faut que les lois les y ayent établies.
[I-261]
CHAPITRE V.
Comment les lois établissent l’égalité dans la démocratie.
Quelque législateurs anciens, comme Lycurgue & Romulus, partagerent également les terres. Cela ne pouvoit avoir lieu que dans la fondation d’une république nouvelle ; ou bien lorsque l’ancienne étoit si corrompue & les esprits dans une telle disposition, que les pauvres se croyoient [I-262] obligés de chercher, & les riches obligés de souffrir un pareil remede.
Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution passagere ; l’inégalité entrera par le côté que les lois n’auront pas défendu, & la république sera perdue.
Il faut donc que l’on regle dans cet objet les dots des femmes, les donations, les successions, les testamens ; enfin toutes les manieres de contracter. Car s’il étoit permis de donner son bien à qui on voudroit & comme on voudroit, chaque volonté particuliere troubleroit la disposition de la loi fondamentale.
Solon, qui permettoit à Athenes de laisser son bien à qui on vouloit par testament, pourvu qu’on n’eût point d’enfans [1] , contredisoit les lois anciennes qui ordonnoient que les biens restassent dans la famille du testateur [2] . Il contredisoit les siennes propres ; car, en supprimant les dettes, il avoit cherché l’égalité.
[I-263]
C’étoit une bonne loi pour la démocratie, que celle qui défendoit d’avoir deux hérédités [3] . Elle prenoit son origine du partage égal des terres & des portions données à chaque citoyen. La loi n’avoit pas voulu qu’un seul homme eût plusieurs portions.
La loi qui ordonnoit que le plus proche parent épousât l’héritiere, naissoit d’une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Platon [4] , qui fonde ses lois sur ce partage, la donne de même ; & c’étoit une loi Athénienne.
Il y avoit à Athenes une loi, dont je ne sache pas que personne ait connu l’esprit. Il étoit permis d’épouser sa sœur consanguine, & non pas sa sur utérine [5] . Cet usage tiroit son origine des républiques, dont l’esprit étoit de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre, & [I-264] par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousoit sa sœur du côté du pere, il ne pouvoit avoir qu’une hérédité, qui étoit celle de son pere : mais quand il épousoit sa sœur utérine, il pouvoit arriver que le pere de cette sœur n’ayant pas d’enfans mâles, lui laissât sa succession ; & que par conséquent son frere, qui l’avoit épousée, en eût deux.
Qu’on ne m’objecte pas ce que dit Philon [6] , que quoiqu’à Athenes on épousât sa sœur consanguine, & non pas sa sœur utérine, on pouvoit à Lacédémone épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon [7] , que quand à Lacédémone une sœur épousoit son frere, elle avoit pour sa dot la moitié de la portion du frere. Il est clair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la premiere. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frere, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frere.
[I-265]
Seneque [8] parlant de Silanus, qui avoit épousé sa sœur, dit qu’à Athenes la permission étoit restreinte, & qu’elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’un seul, il n’étoit guere question de maintenir le partage des biens.
Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c’étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu’un pere qui avoit plusieurs enfans, en choisît un pour succéder à sa portion [9] , & donnât les autres en adoption à quelqu’un qui n’eût point d’enfans, afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.
Phaléas de Calcédoine [10] avoit imaginé une facon de rendre égales les fortunes dans une république où elles ne l’étoient pas. Il vouloit que les riches donnassent des dots aux pauvres, & n’en reçussent pas ; & que les pauvres reçussent de l’argent pour leurs filles, & n’en donnassent pas. Mais je ne sache point qu’aucune république se soit [I-266] accommodée d’un réglement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes, qu’ils haïroient cette égalité même que l’on chercheroit à introduire. Il est bon quelquefois que les lois ne paroissent pas aller si directement au but qu’elles se proposent.
Quoique dans la démocratie l’égalité réelle soit l’ame de l’état, cependant elle est si difficile à établir, qu’une exactitude extrême à cet égard ne conviendroit pas toujours. Il suffit que l’on établisse un cens [11] qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi c’est à des lois particulieres à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les charges qu’elles imposent aux riches, & le soulagement qu’elles accordent aux pauvres. Il n’y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations ; car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu’on ne leur accorde pas de puissance [I-267] & d’honneur, elles le regardent comme une injure.
Toute inégalité dans la démocratie, doit être tirée de la nature de la démocratie & du principe même de l’égalité. Par exemple, on y peut craindre que des gens qui auroient besoin d’un travail continuel pour vivre, ne fussent trop appauvris par une magistrature, ou qu’ils n’en négligeassent les fonctions ; que des artisans ne s’enorgueillissent ; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissans que les anciens citoyens. Dans ces cas, l’égalité entre les citoyens [12] peut être ôtée dans la démocratie, pour l’utilité de la démocratie. Mais ce n’est qu’une égalité apparente que l’on ôte : car un homme ruiné par une magistrature, seroit dans une pire condition que les autres citoyens ; & ce même homme qui seroit obligé d’en négliger les fonctions, mettroit les autres citoyens dans une condition pire que la sienne ; & ainsi du reste.
-
[↑] Plutarque, vie de Solon.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Philolaüs de Corinthe établit à Athenes, que le nombre des portions de terre & celui des hérédités seroit toujours le même. Aristote, Polit. liv. II. ch. XII.
-
[↑] République, liv. VIII.
-
[↑] Cornelius Nepos, in prœsat. Cet usage étoit des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : Elle est ma sœur, fille de mon pere, & non de ma mere. Les mêmes raisons avoient fait établir une même loi chez différens peuples.
-
[↑] De specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta decalogi.
-
[↑] Lib. X.
-
[↑] Athenis dimidium licet, Alexandria totum. Seneque, de morte Claudii.
-
[↑] Platon fait une pareille loi, liv. III. des lois.
-
[↑] Aristote, Politique, liv. II. chap. VII.
-
[↑] Solon fit quatre classes ; la premiere, de ceux qui avoient cinq cents mines de revenu, tant en grains qu’en fruits liquides ; la seconde, de ceux qui en avoient trois cents, & pouvoient entretenir un cheval ; la troisieme, de ceux qui n’en avoient que deux cents ; la quatrieme, de tous ceux qui vivoient de leurs bras. Plutarque, vie de Solon.
-
[↑] Solon exclut des charges tous ceux du quatrieme cens.
[I-268]
CHAPITRE VI.
Comment les lois doivent entretenir la frugalité dans la démocratie.
Il ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terres soient égales ; il faut qu’elles soient petites, comme chez les Romains. « À Dieu ne plaise, disoit Curius à ses soldats [1] , qu’un citoyen estime peu de terre, ce qui est suffisant pour nourrir un homme. »
Comme l’égalité des fortunes entretient la frugalité, la frugalité maintient l’égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles qu’elles ne peuvent subsister l’une sans l’autre ; chacune d’elles est la cause & l’effet ; si l’une se retire de la démocratie, l’autre la suit toujours.
Il est vrai que lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y ayent de grandes richesses, & que les [I-269] mœurs n’y soient pas corrompues. C’est que l’esprit de commerce entraine avec soi celui de frugalité, d’économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d’ordre & de regle. Ainsi tandis que cet esprit subsiste, les richesses qu’il produit n’ont aucun mauvais effet. Le mal arrive, lorsque l’excès des richesses détruit cet esprit de commerce ; on voit tout à coup naître les désordres de l’inégalité, qui ne s’étoient pas encore fait sentir.
Pour maintenir l’esprit de commerce, il faut que les principaux citoyens le fassent eux-mêmes ; que cet esprit regne seul, & ne soit point croisé par un autre ; que toutes les lois le favorisent ; que ces mêmes lois, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance, pour pouvoir travailler comme les autres ; & chaque citoyen riche dans une telle médiocrité, qu’il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir.
C’est une très-bonne loi dans une république commerçante, que celle qui donne à tous les enfans une portion [I-270] égale dans la succession des peres. Il se trouve par-là que, quelque fortune que le pere ait faite, ses enfans, toujours moins riches que lui, sont portés à fuir le luxe, & à travailler comme lui. Je ne parle que des républiques commerçantes ; car pour celles qui ne le sont pas, le législateur a bien d’autres réglemens à faire [2] .
Il y avoit dans la Grece deux sortes de républiques. Les unes étoient militaires, comme Lacédémone ; d’autres étoient commerçantes, comme Athenes. Dans les unes, on vouloit que les citoyens fussent oisifs ; dans les autres, on cherchoit à donner de l’amour pour le travail. Solon fit un crime de l’oisiveté, & voulut que chaque citoyen rendît compte de la maniere dont il gagnoit sa vie. En effet, dans une bonne démocratie où l’on ne doit dépenser que pour le nécessaire, chacun doit l’avoir ; car de qui le recevroit-on ?
-
[↑] Ils demandoient une plus grande portion de la terre conquise. Plutarque, œuvres morales, vies des anciens Rois & Capitaines.
-
[↑] On y doit borner beaucoup les dots des femmes.
[I-271]
CHAPITRE VII.
Autres moyens de favoriser le principe de la démocratie.
On ne peut pas établir un partage égal des terres dans toutes les démocraties. Il y a des circonstances où un tel arrangement seroit impraticable, dangereux, & choqueroit même la constitution. On n’est pas toujours obligé de prendre les voies extrêmes. Si l’on voit dans une démocratie que ce partage, qui doit maintenir les mœurs, n’y convienne pas, il faut avoir recours à d’autres moyens.
Si l’on établit un corps fixe qui soit par lui-même la regle des mœurs, un sénat où l’âge, la vertu, la gravité, les services donnent entrée ; les sénateurs, exposés à la vue du peuple comme les simulacres des dieux, inspireront des sentimens qui seront portés dans le sein de toutes les familles.
Il faut sur-tout que ce sénat s’attache aux institutions anciennes, & fasse en sorte que le peuple & les magistrats ne s’en départent jamais.
[I-272]
Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs, à garder les coutumes anciennes. Comme les peuples corrompus font rarement de grandes choses, qu’ils n’ont guere établi de sociétés, fondé de villes, donne de lois, & qu’au contraire, ceux qui avoient des mœurs simples & austeres, ont fait la plupart des établissemens ; rappeler les hommes aux maximes anciennes, c’est ordinairement les ramener à la vertu.
De plus, s’il y a eu quelque révolution, & que l’on ait donné à l’état une forme nouvelle, cela n’a guere pu se faire qu’avec des peines & des travaux infinis, & rarement avec l’oisiveté & des mœurs corrompues. Ceux mêmes qui ont fait la révolution ont voulu la faire goûter, & ils n’ont guere pu y réussir que par de bonnes lois. Les institutions anciennes sont donc ordinairement des corrections, & les nouvelles des abus. Dans le cours d’un long gouvernement, on va au mal par une pente insensible, & on ne remonte au bien que par un effort.
On a douté si les membres du sénat dont nous parlons, doivent être à vie, ou choisis pour un temps. Sans doute qu’ils doivent être choisis pour la vie, [I-273] comme cela se pratiquoit à Rome [1] , à Lacédémone [2] & à Athenes même. Car il ne faut pas confondre ce qu’on appeloit le sénat à Athenes, qui étoit un corps qui changeoit tous les trois mois, avec l’aréopage, dont les membres étoient établis pour la vie, comme des modèles perpétuels.
Maxime générale : Dans un sénat fait pour être la regle, & pour ainsi dire le dépôt des mœurs, les sénateurs doivent être élus pour la vie ; dans un sénat fait pour préparer les affaires, les sénateurs peuvent changer.
L’esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps. Cette réflexion n’est bonne qu’à l’égard d’un magistrat unique, & ne peut être appliquée à une assemblée de sénateurs.
Outre l’aréopage, il y avoit à Athenes des gardiens des mœurs & des gardiens des lois [3] . À Lacédémone, tous les [I-274] vieillards étoient censeurs. À Rome, deux magistrats particuliers avoient la censure. Comme le sénat veille sur le peuple, il faut que des censeurs ayent les yeux sur le peuple & sur le sénat. Il faut qu’ils rétablissent dans la république tout ce qui a été corrompu, qu’ils notent la tiédeur, jugent les négligences, & corrigent les fautes, comme les lois punissent les crimes.
La loi Romaine qui vouloit que l’accusation de l’adultere fût publique, étoit admirable pour maintenir la pureté des mœurs ; elle intimidoit les femmes, elle intimidoit aussi ceux qui devoient veiller sur elles.
Rien ne maintient plus les mœurs qu’une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards. Les uns & les autres seront contenus ; ceux-là par le respect qu’ils auront pour les vieillards, & ceux-ci par le respect qu’ils auront pour eux-mêmes.
Rien ne donne plus de force aux lois, que la subordination extrême des citoyens aux magistrats. « La grande différence que Lycurgue a mise entre Lacédémone & les autres cités, dit [I-275] Xénophon [4] , consiste en ce qu’il a sur-tout fait que les citoyens obéissent aux lois ; ils courent lorsque le magsitrat les appelle. Mais à Athenes un homme riche seroit au désespoir que l’on crût qu’il dépendît du magistrat ».
L’autorité paternelle est encore très-utile pour maintenir les mœurs. Nous avons déjà dit que dans une république il n’y a pas une force si réprimante que dans les autres gouvernemens. Il faut donc que les lois cherchent à y suppléer : elles le font par l’autorité paternelle.
À Rome, les peres avoient droit de vie & de mort sur leurs enfans [5] . A Lacédémone, chaque pere avoit droit de corriger l’enfant d’un autre.
La puissance paternelle se perdit à Rome avec la république. Dans les monarchies où l’on n’a que faire de mœurs si pures, on veut que chacun vive sous la puissance des magistrats.
[I-276]
Les lois de Rome qui avoient accoutumé les jeunes gens à la dépendance, établirent une longue minorité. Peut-être avons-nous eu tort de prendre cet usage : dans une monarchie, on n’a pas besoin de tant de contrainte.
Cette même subordination dans la république, y pourroit demander que le pere restât pendant sa vie le maître des biens de ses enfans, comme il fut réglé à Rome. Mais cela n’est pas de l’esprit de la monarchie.
-
[↑] Les magistrats y étoient annuels, & les sénateurs pour la vie.
-
[↑] Lycurgue, dit Xénophon, de republ. Laedam voulut « qu’on élût les sénateurs parmi les vieillards, pour qu’ils ne se négligeassent pas même à la fin de la vie ; & en les établissant juges du courage des jeunes gens, il a rendu la vieillesse de ceux-là plus honorable que la force de ceux ci ».
-
[↑] L’aréopage lui-même étoit soumis à la censure.
-
[↑] Répub. de Lacédémone.
-
[↑] On peut voir dans l’histoire Romaine, avec quel avantage pour la république on se servit de cette puissance. Aulus Fulvius s’étoit mis en chemin pour aller trouver Catilina ; son pere le rappela & le fit mourir. Salluste, de bello Catil. Plusieurs autres citoyens firent de même. Dion, liv. XXXVII.
[I-276]
CHAPITRE VIII.
Comment les lois doivent se rapporter au principe du gouvernement dans l’aristocratie.
Si dans l’aristocratie le peuple est vertueux, on y jouira à peu près du bonheur du gouvernement populaire, & l’état deviendra puissant. Mais comme il est rare que là où les fortunes des hommes sont inégales, il y ait beaucoup de vertu ; il faut que les lois tendent à donner autant qu’elles peuvent un esprit de modération, & cherchent à rétablir cette égalité que la constitution de l’état ôte nécessairement.
[I-277]
L’esprit de modération est ce qu’on appelle la vertu dans l’aristocratie ; il y tient la place de l’esprit d’égalité dans l’état populaire.
Si le faste & la splendeur qui environnent les Rois, font une partie de leur puissance, la modestie & la simplicité des manieres font la force des nobles aristocratiques [1] . Quand ils n’affectent aucune distinction, quand ils se confondent avec le peuple, quand ils sont vêtus comme lui, quand ils lui font partager tous leurs plaisirs, il oublie sa foiblesse.
Chaque gouvernement a sa nature & son principe. Il ne faut donc pas que l’aristocratie prenne la nature & le principe de la monarchie ; ce qui arriveroit, si les nobles avoient quelques prérogatives personnelles & particulieres, distinctes de celles de leur corps : les privileges doivent être pour le sénat, & le simple respect pour les sénateurs.
Il y a deux sources principales de [I-278] désordres dans les états aristocratiques : l’inégalité extrême entre ceux qui gouvernent & ceux qui sont gouvernés ; & la même inégalité entre les différens membres du corps qui gouverne. De ces deux inégalités résultent des haines & des jalousies que les lois doivent prévenir ou arrêter.
La premiere inégalité se trouve principalement lorsque les principes des principaux ne sont honorables que parce qu’ils sont honteux au peuple. Telle fut à Rome la loi qui défendoit aux Patriciens de s’unir par mariage aux Plébéiens [2] ; ce qui n’avoit d’autre effet que de rendre d’un côté les Patriciens plus superbes, & de l’autre plus odieux. Il faut voir les avantages qu’en tirerent les tribuns dans leurs harangues.
Cette inégalité se trouvera encore, si la condition des citoyens est différente par rapport aux subsides ; ce qui arrive de quatre manieres : lorsque les nobles se donnent le privilege de n’en point payer ; lorsqu’ils font des fraudes pour s’en exempter [3] ; lorsqu’ils les [I-279] appellent à eux sous prétexte de rétributions ou d’appointemens pour les emplois qu’ils exercent ; enfin quand ils rendent le peuple tributaire, & se partagent les impôts qu’ils levent sur eux. Ce dernier cas est rare ; une aristocratie en pareil cas est le plus dur de tous les gouvernemens.
Pendant que Rome inclina vers l’aristocratie, elle évita très-bien ces inconvéniens. Les magistrats ne tiroient jamais d’appointemens de leur magistrature. Les principaux de la république furent taxés comme les autres ; ils le furent même plus, & quelquefois ils le furent seuls. Enfin, bien loin de se partager les revenus de l’état, tout ce qu’ils purent tirer du trésor public, tout ce que la fortune leur envoya de richesses, ils le distribuerent au peuple pour se faire pardonner leurs honneurs [4] .
C’est une maxime fondamentale, qu’autant que les distributions faites au peuple ont de pernicieux effets dans la démocratie, autant en ont-elles de bons dans le gouvernement [I-280] aristocratique. Les premieres font perdre l’esprit de citoyen, les autres y ramenent.
Si l’on ne distribue point les revenus au peuple, il faut lui faire voir qu’ils sont bien administrés : les lui montrer, c’est en quelque maniere l’en faire jouir. Cette chaîne d’or que l’on tendoit à Venise, les richesse que l’on portoit à Rome dans les triomphes, les trésors que l’on gardoit dans le temple de Saturne, étoient véritablement les richesses du peuple.
Il est sur-tout essentiel dans l’aristocratie, que les nobles ne levent pas les tributs. Le premier ordre de l’état ne s’en mêloit point à Rome ; on en chargea le second, & cela même eut dans la suite de grands inconvéniens. Dans une aristocratie où les nobles leveroient les tributs, tous les particuliers seroient à la discrétion des gens d’affaires ; il n’y auroit point de tribunal supérieur qui les corrigeât. Ceux d’entr’eux préposés pour ôter les abus, aimeroient mieux jouir des abus. Les nobles feroient comme les princes des états despotiques, qui confisquent les bien de qui il leur plaît.
Bientôt les profits qu’on y feroit, [I-281] seroient regardés comme un patrimoine, que l’avarice étendroit à sa fantaisie. On feroit tomber les fermes, on réduiroit à rien les revenus publics. C’est par-là que quelques états, sans avoir reçu d’échec qu’on puisse remarquer, tombent dans une foiblesse dont les voisins sont surpris, & qui étonne les citoyens mêmes.
Il faut que les lois leur défendent aussi le commerce : des marchands si accrédités feroient toutes sortes de monopoles. Le commerce est la profession des gens égaux : & parmi les états despotiques, les plus misérables sont ceux où le prince est marchand.
Les lois de Venise [5] défendent aux nobles le commerce, qui pourroit leur donner, même innocemment, des richesses exorbitantes.
Les lois doivent employer les moyens les plus efficaces pour que les nobles rendent justice au peuple. Si elles n’ont point établi un tribun, il faut qu’elles soient un tribun elles-mêmes.
Toute sorte d’asile contre l’exécution [I-282] des lois perd l’aristocratie ; & la tyrannie en est tout près.
Elles doivent mortifier dans tous les temps l’orgueil de la domination. Il faut qu’il y ait pour un temps ou pour toujours un magistrat qui fasse trembler les nobles, comme les éphores à Lacédémone, & les inquisiteurs d’état à Venise ; magistratures qui ne sont soumises à aucunes formalités. Ce gouvernement a besoin de ressorts bien violens. Une bouche de pierre [6] s’ouvre à tout délateur à Venise ; vous diriez que c’est celle de la tyrannie.
Ces magistratures tyranniques dans l’aristocratie, ont du rapport à la censure de la démocratie, qui par sa nature n’est pas moins indépendante. En effet, les censeurs n’y doivent point être recherchés sur les choses qu’ils ont faites pendant leur censure ; il faut leur donner de la confiance, jamais du découragement. Les Romains étoient admirables ; on pouvoit faire rendre à tous les magistrats [7] raison [I-283] de leur conduite, excepté aux censeurs [8] .
Deux choses sont pernicieuses dans l’aristocratie ; la pauvreté extrême des nobles, & leurs richesses exorbitantes. Pour prévenir leur pauvreté, il faut sur-tout les obliger de bonne heure à payer leurs dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des dispositions sages & insensibles ; non pas des confiscations, des lois agraires, des abolitions de dettes, qui sont des maux infinis.
Les lois doivent ôter le droit d’aînesse entre les nobles [9] , afin que par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l’égalité.
Il ne faut point de substitutions, de retraits lignagers, de majorats, d’adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les états monarchiques, ne sauroient être d’usage dans l’aristocratie [10] .
[I-284]
Quand les lois ont égalisé les familles, il leur reste à maintenir l’union entr’elles. Les différens des nobles doivent être promptement décidés ; sans cela, les contestations entre les personnes deviennent des contestations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès, ou les empêcher de naître.
Enfin, il ne faut point que les lois favorisent les distinctions que la vanité met entre les familles, sous prétexte qu’elles sont plus nobles ou plus anciennes ; cela doit être mis au rang des petitesses des particuliers.
On n’a qu’à jeter les yeux sur Lacédémone ; on verra comment les éphores surent mortifier les foiblesses des rois, celles des grands & celles du peuple.
-
[↑] De nos jours les Vénitiens, qui, à bien des égards, se sont conduits très-sagement, déciderent sur une dispute entre un noble Vénitien & un gentilhomme de Terre ferme, pour une préférence dans une église, que hors de Venise un noble Vénitien n’avoit point de prééminence sur un autre citoyen.
-
[↑] Elle fut mise par les décemvirs dans les deux dernieres tables. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. X.
-
[↑] Comme dans quelques aristocraties de nos jours. Rien n’affoiblit tant l’état.
-
[↑] Voyez dans Strabon, liv. XIV, comment les Rhodiens se conduisirent à cet égard.
-
[↑] Amelot de la Houssaye, du gouvernement de Venise, part. III. La loi Claudia défendoit aux sénateurs d’avoir en mer aucun vaisseau qui tînt plus de quarante muids. Tite-Live, liv. XXI.
-
[↑] Les délateurs y jettent leurs billets.
-
[↑] Voyez Tite-Live, liv. XLIX. Un censeur ne pouvoit pas même être troublé par un censeur : chacun faisoit sa note sans prendre l’avis de son collegue ; & quand on fit autrement, la censure fut pour ainsi dire renversée.
-
[↑] À Athenes, les logistes, qui faisoient rendre compte à tous les magistrats, ne rendoient point compte à eux-mêmes.
-
[↑] Cela est ainsi établi à Venise. Amelot de la Houssaye, pag. 30 & 31.
-
[↑] Il semble que l’objet de quelques aristocraties, soit moins de maintenir l’état, que ce qu’elles appellent leur noblesse.
[I-284]
CHAPITRE IX.
Comment les lois sont relatives à leur principe dans la monarchie.
L’honneur étant le principe de ce gouvernement, les lois doivent s’y rapporter.
Il faut qu’elles y travaillent à [I-285] soutenir cette noblesse, dont l’honneur est pour ainsi dire l’enfant & le pere.
Il faut qu’elles la rendent héréditaire, non pas pour être le terme entre le pouvoir du prince & la foiblesse du peuple, mais le lien de tous les deux.
Les substitutions qui conservent les biens dans les familles, seront très-utiles dans ce gouvernement, quoiqu’elles ne conviennent pas dans les autres.
Le retrait lignager rendra aux familles nobles les terres que la prodigalité d’un parent aura aliénées.
Les terres nobles auront des privileges comme les personnes. On ne peut pas séparer la dignité du monarque de celle du royaume ; on ne peut guere séparer non plus la dignité du noble de celle de son fief.
Toutes ces prérogatives seront particulieres à la noblesse, & ne passeront point au peuple, si l’on ne veut choquer le principe du gouvernement, si l’on ne veut diminuer la force de la noblesse & celle du peuple.
Les substitutions gênent le commerce ; le retrait lignager fait une infinité de proces nécessaires ; & tous les fonds du royaume vendus, sont au [I-286] moins en quelque façon sans maître pendant un an. Des prérogatives attachées à des fiefs, donnent un pouvoir très à charge à ceux qui les souffrent. Ce sont des inconvéniens particuliers de la noblesse, qui disparoissent devant l’utilité générale qu’elle procure. Mais quand on les communique au peuple, on choque inutilement tous les principes.
On peut dans les monarchies permettre de laisser la plus grande partie de ses biens à un seul de ses enfans ; cette permission n’est même bonne que là.
Il faut que les lois favorisent tout le commerce [1] que la constitution de ce gouvernement peut donner ; afin que les sujets puissent sans périr satisfaire aux besoins toujours renaissans du prince & de sa cour.
Il faut qu’elles mettent un certain ordre dans la maniere de lever les tributs, afin qu’elle ne soit pas plus pesante que les charges mêmes.
La pesanteur des charges produit d’abord le travail, le travail l’accablement, l’accablement l’esprit de paresse.
-
[↑] Elle ne le permet qu’au peuple. Voyez la loi troisieme, au code de comm. & mercatoribus, qui est pleine de bon sens.
[I-287]
CHAPITRE X.
De la promptitude de l’exécution dans la monarchie.
Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le républicain : les affaires étant menées par un seul, il y a plus de promptitude dans l’exécution. Mais comme cette promptitude pourroit dégénérer en rapidité, les lois y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas seulement favoriser la nature de chaque constitution, mais encore remédier aux abus qui pourroient résulter de cette même nature.
Le cardinal de Richelieu [1] veut que l’on évite dans les monarchies les épines des compagnies qui forment des difficultés sur tout. Quand cet homme n’auroit pas eu le despotisme dans le cœur, il l’auroit eu dans la tête.
Les corps qui ont le dépôt des lois, n’obéissent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, & qu’ils apportent dans les affaires du prince cette réflexion qu’on ne peut guere attendre [I-288] du défaut de lumieres de la cour sur les lois de l’état, ni de la précipitation de ses conseils [2] .
Que seroit devenue la plus belle monarchie du monde, si les magistrats, par leurs lenteurs, par leurs plaintes, par leurs prieres, n’avoient arrêté le cours des vertus mêmes de ses Rois, lorsque ces monarques, ne consultant que leur grande ame, auroient voulu récompenser sans mesure des services rendus avec un courage & une fidélité aussi sans mesure ?
-
[↑] Testament politique.
-
[↑] Barbaris candatio servilis, statim exequi regium videtur. Tacite, Annal. LV. V.
[I-288]
CHAPITRE XI.
De l’excellence du gouvernement monarchique.
Le gouvernement monarchique a un grand avantage sur le despotique. Comme il est de sa nature qu’il y ait sous le prince plusieurs ordres qui tiennent à la constitution, l’état est plus fixe, la constitution plus inébranlable, la personne de ceux qui gouvernent plus assurée.
[I-289]
Cicéron [1] croit que l’établissement des tribuns de Rome fut le salut de la république. « En effet, dit-il, la force du peuple qui n’a point de chef est plus terrible. Un chef sent que l’affaire roule sur lui, il y pense : mais le peuple dans son impétuosité ne connoît point le péril où il se jette. » On peut appliquer cette réflexion à un état despotique, qui est un peuple sans tribuns, & à une monarchie où le peuple a en quelque façon des tribuns.
En effet, on voit par-tout que dans les mouvemens du gouvernement despotique, le peuple mené par lui-même porte toujours les choses aussi loin qu’elles peuvent aller ; tous les désordres qu’il commet sont extrêmes : Au lieu que dans les monarchies, les choses sont très-rarement portées à l’excès. Les chefs craignent pour eux-mêmes, ils ont peur d’être abandonnés ; les puissances intermédiaires dépendantes [2] ne veulent pas que le peuple prenne trop le dessus. Il est rare que les ordres de l’état soient entiérement corrompus.
[I-290] Le prince tient à ces ordres ; & les séditieux qui n’ont ni la volonté ni l’espérance de renverser l’état, ne peuvent ni ne veulent renverser le prince.
Dans ces circonstances, les gens qui ont de la sagesse & de l’autorité s’entremettent ; on prend des tempéramens, on s’arrange, on se corrige ; les lois reprennent leur vigueur & se font écouter.
Aussi toutes nos histoires sont-elles pleines de guerres civiles sans révolutions ; celles des états despotiques sont pleines de révolutions sans guerres civiles.
Ceux qui ont écrit l’histoire des guerres civiles de quelques états, ceux mêmes qui les ont fomentées, prouvent assez combien l’autorité que les princes laissent à de certains ordres pour leur service, leur doit être un peu suspecte ; puisque dans l’égarement même, ils ne soupiroient qu’après les lois & leur devoir, & retardoient la fougue & l’impétuosité des factieux plus qu’ils ne pouvoient la servir [3] .
Le cardinal de Richelieu, pensant peut-être qu’il avoit trop avili les ordres [I-291] de l’état, a recours pour le soutenir aux vertus du prince & de ses ministres [4] ; & il exige d’eux tant de choses, qu’en vérité il n’y a qu’un ange qui puisse avoir tant d’attention, tant de lumieres, tant de fermeté, tant de connoissances ; & on peut à peine se flatter que d’ici à la dissolution des monarchies, il puisse y avoir un prince & des ministres pareils.
Comme les peuples qui vivent sous une bonne police, sont plus heureux que ceux qui, sans regle & sans chefs, errent dans les forêts ; aussi les monarques qui vivent sous les lois fondamentales de leur état sont-ils plus heureux que les princes despotiques, qui n’ont rien qui puisse régler le cœur de leurs peuples ni le leur.
-
[↑] Liv. III des lois.
-
[↑] Voyez ci-dessus la premiere note du liv. II. chap. IV.
-
[↑] Mémoires du cardinal de Retz, & autres histoires.
-
[↑] Testament politique.
[I-291]
CHAPITRE XII.
Continuation du même sujet.
Qu’on n’aille point chercher de la magnanimité dans les états despotiques ; le prince n’y donneroit point [I-292] une grandeur qu’il n’a pas lui-même : chez lui il n’y a pas de gloire.
C’est dans les monarchies que l’on verra autour du prince les sujets recevoir ses rayons ; c’est là que chacun tenant, pour ainsi dire, un plus grand espace, peut exercer ces vertus qui donnent à l’ame, non pas de l’indépendance, mais de la grandeur.
[I-292]
CHAPITRE XIII.
Idée du despotisme.
Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, il coupent l’arbre au pied, & cueillent le fruit. [1] . Voilà le gouvernement despotique.
-
[↑] Lettres édif. Recueil II, pag. 315.
[I-292]
CHAPITRE XIV.
Comment les lois sont relatives aux principes du gouvernement despotique.
Le gouvernement despotique a pour principe la crainte ; mais à des peuples timides, ignorans, abattus, il ne faut pas beaucoup de lois.
[I-293]
Tout y doit rouler sur deux ou trois idées ; il n’en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître, de leçon & d’allure ; vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvemens, & pas davantage.
Lorsque le prince est enfermé, il peut sortir du séjour de la volupté sans désoler tous ceux qui l’y retienent. Ils ne peuvent souffrir que sa personne & son pouvoir passent en d’autres mains. Il fait donc rarement la guerre en personne, & il n’ose guere la faire par ses lieutenans.
Un prince pareil, accoutumé dans son palais à ne trouver aucune résistance, s’indigne de celle qu’on lui fait les armes à la main ; il est donc ordinairement conduit pas la colere ou par la vengeance. D’ailleurs il ne peut avoir d’idée de la vraie gloire. Les guerres doivent donc s’y faire dans toute leur fureur naturelle, & le droit des gens y avoir moins d’étendue qu’ailleurs.
Un tel prince a tant de défauts, qu’il faudroit craindre d’exposer au grand jour sa stupidité naturelle. Il est caché, & l’on ignore l’état où il se trouve. Par [I-294] bonheur, les hommes sont tels dans ces pays, qu’ils n’ont besoin que d’un nom qui les gouverne.
Charles XII étant à Bender, trouvant quelque résistance dans le sénat de Suede, écrivit qu’il leur enverroit une de ses bottes pour commander. Cette botte auroit commandé comme un roi despotique.
Si le prince est prisonnier, il est censé être mort, & un autre monte sur le trône. Les traités que fait le prisonnier sont nuls, son successeur ne le ratifieroit pas. En effet, comme il est les lois, l’état & le prince, & que si-tôt qu’il n’est plus le prince, il n’est rien ; s’il n’étoit pas censé mort, l’état seroit détruit.
Une des choses qui détermina le plus les Turcs à faire leur paix séparée avec Pierre I, fut que les Moscovites dirent au vizir, qu’en Suede on avoit mis un autre roi sur le trône [1] .
La conservation de l’état n’est que la conservation du prince, ou plutôt du palais où il est enfermé. Tout ce qui ne menace pas directement ce palais ou la ville capitale, ne fait point d’impression sur [I-295] des esprits ignorans, orgueilleux & prévenus : & quant à l’enchaînement des événemens, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. La politique, ses ressorts & ses lois, y doivent être très-bornés ; & le gouvernement politique y est aussi simple que le gouvernement civil [2] .
Tout se réduit à concilier le gouvernement politique & civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l’état avec ceux du sérail.
Un pareil état sera dans la meilleure situation, lorsqu’il pourra se regarder comme seul dans le monde, qu’il sera environné de déserts, & séparé des peuples qu’il appellera barbares. Ne pouvant compter sur la milice, il sera bon qu’il détruise une partie de lui-même.
Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité : mais ce n’est point une paix, c’est le silence de ces villes que l’ennemi est prêt d’occuper.
La force n’étant pas dans l’état, mais dans l’armée qui l’a fondé ; il faudroit, [I-296] pour défendre l’état, conserver cette armée : mais elle est formidable au prince. Comment donc concilier la sureté de l’état avec la sureté de la personne ?
Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le gouvernement Moscovite cherche à sortir du despotisme, qui lui est plus pesant qu’aux peuples même. On a cassé les grands corps de troupes, on a diminué les peines des crimes, on a établi des tribunaux, on a commencé à connoître les lois, on a instruit les peuples. Mais il y a des causes particulieres, qui le rameneront peut-être au malheur qu’il vouloit fuir.
Dans ces états, la religion a plus d’influence que dans aucun autre ; elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les empires Mahométans, c’est de la religion que les peuples tirent en partie le respect étonnant qu’ils ont pour leur prince.
C’est la religion qui corrige un peu la constitution Turque. Les sujets qui ne sont pas attachés à la gloire & à la grandeur de l’état par honneur, le sont par la force & par le principe de la religion.
De tous les gouvernemens despotiques, il n’y en a point qui s’accable plus [I-297] lui-même, que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre & l’héritier de tous ses sujets. Il en résulte toujours l’abandon de la culture des terres ; & si d’ailleurs le prince est marchand, toute espece d’industrie est ruinée.
Dans ces états, on ne répare, on n’améliore rien [3] . on ne bâtit de maisons que pour la vie ; on ne fait point de fossés, on ne plante point d’arbres ; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ; tout est en friche, tout est désert.
Pensez-vous que des lois qui ôtent la propriété des fonds de terre & la succession des biens, diminueront l’avarice & la cupidité des grands ? Non : elles irriteront cette cupidité & cette avarice. On sera porté à faire mille vexations, parce qu’on ne croira avoir en propre que l’or ou l’argent que l’on pourra voler ou cacher.
Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l’avidité du prince soit modérée par quelque coutume. Ainsi en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur [I-298] les successions [4] des gens du peuple. Mais comme le grand-seigneur donne la plupart des terres à sa milice, & en dispose à sa fantaisie ; comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l’empire ; comme lorsqu’un homme meurt sans enfans mâles, le grand-seigneur a la propriété, & que les filles n’ont que l’usufruit ; il arrive que la plupart des biens de l’état sont possédés d’une maniere précaire.
Par la loi de Bantam [5] , le roi prend toute la succession, même la femme, les enfans & la maison. On est obligé, pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi, de marier les enfans à huit, neuf ou dix ans, & quelquefois plus jeunes, afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du pere.
Dans les états où il n’y a point de lois fondamentales, la succession à l’empire ne sauroit être fixe. La couronne y est élective par le prince dans sa famille ou [I-299] hors de sa famille. En vain seroit-il établi que l’aîné succéderoit ; le prince en pourroit toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou par une guerre civile. Ainsi cet état a une raison de dissolution de plus qu’une monarchie.
Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte sur le trône fait d’abord étrangler ses freres, comme en Turquie ; ou les fait aveugler, comme en Perse ; ou les rend fous, comme chez le Mogol ; ou si l’on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance du trône est suivie d’une affreuse guerre civile.
Par les constitutions de Moscovie [6] , le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions, & rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L’ordre de succession étant une des choses qu’il importe le plus au peuple de savoir, le [I-300] meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance, & un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues, étouffe l’ambition ; on ne captive plus l’esprit d’un prince foible, & l’on ne fait point parler les mourans.
Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, & ses freres n’ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particuliere du pere. Il n’est donc pas plus question d’arrêter ou de faire mourir le frere du roi, que quelqu’autre sujet que ce soit.
Mais dans les états despotiques, où les freres du prince sont également ses esclaves & ses rivaux, la prudence veut que l’on s’assure de leurs personnes ; sur-tout dans les pays Mahométans, où la religion regarde la victoire ou le succès comme un jugement de Dieu ; de sorte que personne n’y est souverain de droit, mais seulement de fait.
L’ambition est bien plus irritée dans des états où des princes du sang voient que, s’ils ne montent par sur le trône, [I-301] ils seront enfermés ou mis à mort, que parmi nous où les princes du sang jouissent d’une condition qui, si elle n’est pas si satisfaisante pour l’ambition, l’est peut-être plus pour les désirs modérés.
Les princes des états despotiques ont toujours abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plusieurs femmes, sur-tout dans la partie du monde où le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, qui est l’Asie. Ils en ont tant d’enfans, qu’ils ne peuvent guere avoir d’affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs freres.
La famille régnante ressemble à l’état ; elle est trop foible, & son chef est trop fort ; elle paroît étendue, & elle se réduit à rien. Artaxerxès [7] fit mourir tous ses enfans pour avoir conjuré contre lui. Il n’est pas vraisemblable que cinquante enfans conspirent contre leur pere ; & encore moins qu’ils conspirent, parce qu’il n’a pas voulu céder sa concubine à son fils aîné. Il est plus simple de croire qu’il y a là quelque intrigue de ces sérails d’Orient ; de ces lieux où l’artifice, la méchanceté, la ruse regnent dans le silence, & le couvrent d’une épaisse nuit ; où un vieux [I-302] prince, devenu tous les jours plus imbécille, est le premier prisonnier du palais.
Après tout ce que nous venons de dire, il sembleroit que la nature humaine se souleveroit sans cesse contre le gouvernement despotique. Mais, malgré l’amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuples y sont soumis. Cela est aisé à comprendre. Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir, donner, pour ainsi dire, un lest à l’une, pour la mettre en état de résister à une autre ; c’est un chef-d’œuvre de législation, que le hasard fait rarement, & que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique au contraire, saute, pour ainsi dire, aux yeux ; il est uniforme par tout ; comme il ne faut que des passions pour l’établir, tout le monde est bon pour cela.
-
[↑] Suite de Pussendorf, histoire universelle, au traité de la Suede, chap. X.
-
[↑] Selon M. Chardin, il n’y a point de conseil d’état en Perse.
-
[↑] Voyez Ricaut, état de l’empire Ottoman, page. 196.
-
[↑] Voyez, sur les successions des Turs, Lacédém0ne ancienne & moderne. Voyez aussi Ricaut, de l’empire Ottoman.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. I. La loi de Pégu est moins cruelle ; si l’on a des enfans, le roi ne succede qu’aux deux tiers. Ibid. tom. III. p. 1.
-
[↑] Voyez les différentes constitutions, sur-tout celle de 1722.
-
[↑] Voyez Justin.
[I-303]
CHAPITRE XV.
Continuation du même sujet.
Dans les climats chauds, où regne ordinairement le despotisme, les passions se font plutôt sentir, & elles sont aussi plutôt amorties [1] ; l’esprit y est plus avancé ; les périls de la dissipation des biens y sont moins grands ; il y a moins de facilité de se distinguer, moins de commerce entre les jeunes gens renfermés dans la maison ; on s’y marie de meilleure heure. On y peut donc être majeur plutôt que dans nos climats d’Europe. En Turquie, la majorité commence à quinze ans [2] .
La cession de biens n’y peut avoir lieu ; dans un gouvernement où personne n’a de fortune assurée, on prête plus à la personne qu’aux biens.
Elle entre naturellement dans les gouvernements modérés [3] , & sur-tout dans les républiques, à cause de la plus [I-304] grande confiance que l’on doit avoir dans la probité des citoyens, & de la douceur que doit inspirer une forme de gouvernement que chacun semble s’être donnée lui-même.
Si dans la république Romaine les législateurs avoient établi la cession de biens [4] , on ne seroit pas tombé dans tant de séditions & de discordes civiles, & on n’auroit point essuyé les dangers des maux, ni les périls des remedes.
La pauvreté & l’incertitude des fortunes dans les états despotiques, y naturalisent l’usure, chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu’il y a à le pénétrer. La misere vient donc de toutes parts dans ces pays malheureux ; tout y est ôté, jusqu’à la ressource des emprunts.
Il arrive de-là qu’un marchand n’y sauroit faire un grand commerce ; il vit au jour la journée : s’il se chargeoit de beaucoup de marchandises, il perdroit plus par les intérêts qu’il donneroit pour les payer, qu’il ne gagneroit sur les marchandises. Aussi les lois sur [I-305] le commerce n’y ont-elles guere de lieu ; elles se réduisent à sa simple police.
Le gouvernement ne sauroit être injuste, sans avoir des mains qui exercent ses injustices : or il est impossible que ces mains ne s’emploient pour elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les état despotiques.
Ce crime y étant le crime ordinaire, les confiscations y sont utiles. Par-là on console le peuple ; l’argent qu’on en tire est un tribut considérable, que le prince leveroit difficilement sur des sujets abymés : il n’y a même dans ce pays aucune famille qu’on veuille conserver.
Dans les états modérés, c’est toute autre chose. Les confiscations rendroient la propriété des biens incertaine ; elle dépouilleroient des enfans innocens ; elles détruiroient une famille, lorsqu’il ne s’agiroit que de punir un coupable. Dans les républiques, elles seroient le mal d’ôter l’égalité qui en fait l’ame, en privant un citoyen de son nécessaire physique [5] [I-306]
Une loi Romaine veut [6] qu’on ne confisque que dans le cas du crime de lese-Majesté au premier chef. Il seroit souvent très-sage de suivre l’esprit de cette loi, & de borner les confiscations à de certains crimes. Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres, Bodin [7] dit très-bien qu’il ne faudroit confisquer que les acquêts.
-
[↑] Voyez le livre des lois, dans le rapport avec la nature du climat.
-
[↑] La Guilletiere, Lacédémone ancienne & nouvelle, pag. 463.
-
[↑] Il en est de mêmes des atermoyemens dans les banqueroutes de bonne foi.
-
[↑] Elle ne fut établie que par la loi Julie, De cessione bonorum. On évitoit la prison & la section ignominieuse des biens.
-
[↑] Il me semble qu’on aimoit trop les confiscations dans la république d’Athenes.
-
[↑] Authent. Bona damnatorum. Cod. de bon. proscript. feu damn.
-
[↑] Liv. V. ch. III.
[I-306]
CHAPITRE XVI.
De la communication du pouvoir.
Dans le gouvernement despotique, le pouvoir passe tout entier dans les mains de celui à qui on le confie. Le vizir est le despote lui-même ; & chaque officier particulier est le vizir. Dans le gouvernement monarchique, le pouvoir s’applique moins immédiatement ; le monarque en le donnant le tempere [1] . Il fait une telle distribution de son autorité, qu’il n’en donne jamais une [I-307] partie, qu’il n’en retienne une plus grande.
Ainsi, dans les états monarchiques, les gouverneurs particuliers des villes ne relevent pas tellement du gouverneur de la province, qu’ils ne relevent du prince encore davantage ; & les officiers particuliers des corps militaires ne dépendent pas tellement du général, qu’ils ne dépendent du prince encore plus.
Dans la plupart des états monarchiques, on a sagement établi, que ceux qui ont un commandement un peu étendu, ne soient attachés à aucun corps de milice ; de sorte que n’ayant de commandement que par une volonté particuliere du prince, pouvant être employés & ne l’être pas, ils sont en quelque façon dans le service, & en quelque façon dehors.
Ceci est incompatible avec le gouvernement despotique. Car si ceux qui n’ont pas un emploi actuel, avoient néanmoins des prérogatives & des titres, il y auroit dans l’état des hommes grands par eux-mêmes ; ce qui choqueroit la nature de ce gouvernement.
Que si le gouverneur d’une ville étoit [I-308] indépendant du bacha, il faudroit tous les jours des tempéramens pour les accommoder ; chose absurde dans un gouvernement despotique. Et de plus, le gouverneur particulier pouvant ne pas obéir, comment l’autre pourroit-il répondre de sa province sur sa tête ?
Dans ce gouvernement, l’autorité ne peut être balancée ; celle du moindre magistrat ne l’est pas plus que celle du despote. Dans les pays modérés, la loi est par-tout sage, elle est par-tout connue, & les plus petits magistrats peuvent la suivre. Mais dans le despotisme, où la loi n’est que la volonté du prince, quand le prince seroit sage, comment un magistrat pourroit-il suivre une volonté qu’il ne connoît pas ? Il faut qu’il suive la sienne.
Il y a plus : c’est que la loi n’étant que ce que le prince veut, & le prince ne pouvant vouloir que ce qu’il connoît, il faut bien qu’il y ait une infinité de gens qui veuillent pour lui & comme lui.
Enfin, la loi étant la volonté momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui, veuillent subitement comme lui.
-
[↑] Ut esse Phoebi dulcius lumen folet iamjam cadentis.
[I-309]
CHAPITRE XVII.
Des présens.
C’est un usage dans les pays despotiques, que l’on n’aborde qui que ce soit au-dessus de soi, sans lui faire un présent, pas même les rois. L’empereur du Mogol [1] ne reçoit point les requêtes de ses sujets, qu’il n’en ait reçu quelque chose. Ces princes vont jusqu’à corrompre leurs propres graces.
Cela doit être ainsi dans un gouvernement où personne n’est citoyen ; dans un gouvernement où l’on est plein de l’idée, que le supérieur ne doit rien à l’inférieur ; dans un gouvernement où les hommes ne se croient liés que par les châtimens que les uns exercent sur les autres ; dans un gouvernement où il y a peu d’affaires, & où il est rare que l’on ait besoin de se présenter devant un grand, de lui faire des demandes, & encore moins des plaintes.
Dans une république, les présens sont une chose odieuse, parce que la vertu [I-310] n’en a pas besoin. Dans une monarchie, l’honneur est un motif plus fort que les présens. Mais dans l’état despotique, où il n’y a ni honneur ni vertu, on ne peut être déterminé à agir que par l’espérance des commodités de la vie.
C’est dans les idées de la république, que Platon [2] vouloit que ceux qui reçoivent des présens pour faire leur devoir, fussent punis de mort. Il n’en faut prendre, disoit-il, ni pour les choses bonnes ni pour les mauvaises.
C’étoit une mauvaise loi que cette loi Romaine [3] qui permettoit aux magistrats de prendre de petits présens, [4] pourvu qu’ils ne passassent pas cent écus dans toute l’année. Ceux à qui on ne donne rien, ne désirent rien ; ceux à qui on donne un peu, désirent bientôt un peu plus, & ensuite beaucoup. D’ailleurs, il est plus aisé de convaincre celui qui, ne devant rien prendre, prend quelque chose, que celui qui prend plus, lorsqu’il devroit prendre moins, & qui trouve toujours pour cela des prétextes, des excuses, des causes & des raisons plausibles.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. I. p. 80.
-
[↑] Liv. XII. des lois.
-
[↑] Leg. 6. §. 2. ss. ad Leg. Jul. reper.
-
[↑] Munuscula.
[I-311]
CHAPITRE XVIII.
Des récompenses que le souverain donne.
Dans les gouvernemens despotiques, où, comme nous l’avons dit, on n’est déterminé à agir que par l’espérance des commodités de la vie, le prince qui récompense n’a que de l’argent à donner. Dans une monarchie, où l’honneur regne seul, le prince ne récompenseroit que par des distinctions, si les distinctions que l’honneur établit n’étoient jointes à un luxe qui donne nécessairement des besoins : le prince y récompense donc par des honneurs qui menent à la fortune. Mais dans une république où la vertu regne, motif qui se suffit à lui-même, & qui exclut tous les autres, l’état ne récompense que par des témoignages de cette vertu.
C’est une regle générale, que les grandes récompenses, dans une monarchie & dans une république, sont un signe de leur décadence ; parce qu’elles prouvent que leurs principes sont corrompus ; que d’un côté l’idée de l’honneur n’y a plus tant de force, que de [I-312] l’autre la qualité de citoyen s’est affoiblie.
Les plus mauvais empereurs Romains ont été ceux qui ont le plus donné, par exemple, Caligula, Claude, Néron, Othon, Vitellius, Commode, Héliogabale & Caracalla. Les meilleurs, comme Auguste, Vespasien, Antonin Pie, Marc-Aurele & Pertinax, ont été économes. Sous les bons empereurs l’état reprenoit ses principes ; le trésor de l’honneur suppléoit aux autres trésors.
[I-312]
CHAPITRE XIX.
Nouvelles conséquences des principes des trois gouvernemens.
Je ne puis me résoudre à finir ce livre, sans faire encore quelques applications de mes trois principes.
Premiere question. Les lois doivent-elles forcer un citoyen à accepter les emplois publics ? Je dis qu’elles le doivent dans le gouvernement républicain, & non pas dans le monarchique. Dans le premier, les magistratures sont des témoignages de vertu, des dépôts que la partie confie à un citoyen, qui ne [I-313] doit vivre, agir & penser que pour elle ; il ne peut donc pas les refuser [1] . Dans le second, les magistratures sont des témoignages d’honneur : or telle est la bizarrerie de l’honneur, qu’il se plaît à n’en accepter aucun que quand il veut, & de la maniere qu’il veut.
Le feu roi de Sardaigne [2] punissoit ceux qui refusoient les dignités & les emplois de son état ; il suivoit, sans le savoir, des idées républicaines. Sa maniere de gouverner d’ailleurs prouve assez que ce n’étoit pas là son intention.
Seconde question. Est-ce une bonne maxime, qu’un citoyen puisse être obligé d’accepter dans l’armée une place inférieure à celle qu’il a occupée ? On voyoit souvent chez les Romains le capitaine servir l’année d’après sous son lieutenant [3] . C’est que, dans les républiques, la vertu demande qu’on fasse à [I-314] l’état un sacrifice continuel de soi-même & de ses répugnances. Mais dans les monarchies, l’honneur vrai ou faux ne peut souffrir ce qu’il appelle se dégrader.
Dans les gouvernemens despotiques, où l’on abuse également de l’honneur, des postes & des rangs, on fait indifféremment d’un prince un goujat, & d’un goujat un prince.
Troisieme question. Mettra-t-on sur une même tête les emplois civils & militaires ? Il faut les unir dans les républiques, & les séparer dans la monarchie. Dans les républiques, il seroit bien dangereux de faire de la profession des armes un état particulier, distingué de celui qui a les fonctions civiles ; & dans les monarchies, il n’y auroit pas moins de péril à donner les deux fonctions à la même personne.
On ne prend les armes dans la république qu’en qualité de défenseur des lois & de la patrie ; c’est parce que l’on est citoyen que l’on se fait pour un temps soldat. S’il y avoit deux états distingués, on feroit sentir à celui qui sous les armes se croit citoyen, qu’il n’est que soldat.
Dans les monarchies, les gens de [I-315] guerre n’ont pour objet que la gloire, ou du moins l’honneur ou la fortune. On doit bien se garder de donner les emplois civils à des hommes pareils : il faut au contraire qu’ils soient contenus par les magistrats civils ; & que les mêmes gens n’ayent pas en même temps la confiance du peuple, & la force pour en abuser [4] .
Voyez dans une nation où la république se cache sous la forme de la monarchie, combien l’on craint un état particulier de gens de guerre ; & comment le guerrier reste toujours citoyen, ou même magistrat, afin que ces qualités soient un gage pour la patrie, & qu’on ne l’oublie jamais.
Cette division de magistratures en civiles & militaires, faite par les Romains après la perte de la république, ne fut pas une chose arbitraire. Elle fut une suite du changement de la constitution de Rome : elle étoit de la nature du gouvernement monarchique ; & ce qui ne fut que commencé sous Auguste [5] [I-316] les empereurs suivans [6] furent obligés de l’achever, pour tempérer le gouvernement militaire.
Ainsi Procope, concurrent de Valens à l’empire, n’y entendoit rien, lorsque donnant à Hormisdas, prince su sang-royal de Perse, la dignité de proconsul [7] , il rendit à cette magistrature le commandement des armées qu’elle avoit autrefois ; à moins qu’il n’eût des raisons particulieres. Un homme qui aspire à la souveraineté, cherche moins ce qui est utile à l’état, que ce qui l’est à sa cause.
Quatrieme question. Convient-il que les charges soient vénales ? Elles ne doivent pas l’être dans les états despotiques, où il faut que les sujets soient placés ou déplacés dans un instant par le prince.
Cette vénalité est bonne dans les états monarchiques, parce qu’elle fait faire comme un métier de famille ce que l’on ne voudroit pas entreprendre pour la vertu ; qu’elle destine chacun à son devoir, & rend les ordres de l’état plus permanens. Suidas [8] dit très-bien [I-317] qu’Anastase avoit fait de l’empire une espece d’aristocratie, en vendant toutes les magistratures.
Platon [9] ne peut souffrir cette vénalité. « C’est, dit-il, comme si dans un navire on faisoit quelqu’un pilote ou matelot pour son argent. Seroit-il possible que la regle fût mauvaise dans quelqu’autre emploi que ce fût de la vie, & bonne seulement pour conduire une république ? » Mais Platon parle d’une république fondée sur la vertu, & nous parlons d’une monarchie. Or dans une monarchie où, quand les charges ne se vendroient pas par un réglement public, l’indigence & l’avidité des courtisans les vendroient tout de même ; le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. Enfin, la maniere de s’avancer par les richesses inspire & entretient l’industrie [10] ; chose dont cette espece de gouvernement a grand besoin.
Cinquième question. Dans quel gouvernement faut-il des censeurs ? Il en faut dans une république, où le prince [I-318] du gouvernement est la vertu. Ce ne sont pas seulement les crimes qui détruisent la vertu ; mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l’amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption ; ce qui ne choque point les lois, mais les élude ; ce qui ne les détruit pas, mais les affoiblit ; tout cela doit être corrigé par les censeurs.
On est étonné de la punition de cet Aréopagite, qui avoit tué un moineau qui, poursuivi par un épervier, s’étoit réfugié dans son sein. On est surpris que l’Aréopage ait fait mourir un enfant qui avoit crevé les yeux à son oiseau. Qu’on fasse attention qu’il ne s’agit point là d’une condamnation pour crime, mais d’un jugement de mœrs dans une république fondée sur les mœrs.
Dans les monarchies il ne faut point des censeurs : elles sont fondées sur l’honneur, & la nature de l’honneur est d’avoir pour censeur tout l’univers. Tout homme qui y manque, est soumis aux reproches de ceux mêmes qui n’en ont point.
Là, les censeurs seroient gâtés par ceux mêmes qu’ils devroient corriger.
[I-319] Ils ne seroient pas bons contre la corruption d’une monarchie ; mais la corruption d’une monarchie seroit trop forte contr’eux.
On sent bien qu’il ne faut point de censeurs dans les gouvernemens despotiques. L’exemple de la Chine semble déroger à cette regle : mais nous verrons, dans la suite de cet ouvrage, les raisons singulieres de cet établissement.
-
[↑] Platon, dans sa république, liv. VIII. met ces refus au nombre des marques de la corruption de la république. Dans ces lois, liv. VI. il veut qu’on les punisse par une amende. A Venise, on les punit par l’exil.
-
[↑] Victor Amédée.
-
[↑] Quelques centurions ayant appellé au peuple pour demander l’emploi qu’ils avoient eu : Il est juste, mes compagnons, dit un centurion, que vous regardiez comme honorables tous les postes où vous défendriez la république. Tite-Live, liv. XLII.
-
[↑] Ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militiâ vetuit Gallienus, etiam adire exercirum. Aurelius victor, de viris illustrib.
-
[↑] Auguste ôta aux sénateurs, proconsuls & gouverneurs, le droit de porter les armes. Dion, liv. XXXIII.
-
[↑] Constantin. Voyez Zozime. liv. II.
-
[↑] Ammien Marcellin, liv. XXVI. More veterum & bella recturo.
-
[↑] Fragmens tirés des ambassades de Constantin-Porphyrogenete.
-
[↑] Répub. liv. VIII.
-
[↑] Paresse de l’Espagne ; on y donne tous les emplois.
[I-320]
LIVRE VI.
Conséquences des principes des divers gouvernemens, par rapport à la simplicité des Lois civiles & criminelles, la forme des jugemens, & l’établissement des peines.↩
CHAPITRE PREMIER.
De la simplicité des lois civiles dans les divers gouvernemens.
Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions ; elles doivent être conservées ; elles doivent être apprises, pour que l’on y juge aujourd’hui comme l’on y jugea hier, & que la propriété & la vie des citoyens y soient assurées & fixes comme la constitution même de l’état.
Dans une monarchie, l’administration d’une justice qui ne décide pas seulement de la vie & des biens, mais aussi de [I-321] l’honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente à mesure qu’il a un plus grand dépôt, & qu’il prononce sur de plus grands intérêts.
Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois de ces états tant de regles, de restrictions, d’extensions, qui multiplient les cas particuliers, & semblent faire un art de la raison même.
La différence de rang, d’origine, de condition, qui est établie dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens ; & des lois, relatives à la constitution de cet état, peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi parmi nous, les biens sont propres, acquêts, ou conquêts ; dotaux, paraphernaux ; paternels & maternels ; meubles de plusieurs especes ; libres, substitués ; du lignage ou non ; nobles, en franc-aleu, ou roturiers ; rentes foncieres, ou constituées à prix d’argent. Chaque sorte de bien est soumise à des regles particulieres ; il faut les suivre pour en disposer : ce qui ôte encore de la simplicité.
Dans nos gouvernemens, les fiefs sont devenus héréditaires. Il a fallu que la [I-322] noblesse eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple, il y a des pays où l’on n’a pu partager les fiefs entre les freres ; dans d’autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d’étendue.
Le monarque, qui connoît chacune de ses provinces, peut établir diverses lois, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connoît rien, & ne peut avoir d’attention sur rien ; il lui faut une allure générale ; il gouverne par une volonté rigide qui est par-tout la même ; tout s’applanit sous ses pieds.
À mesure que les jugemens des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions, qui quelquefois se contredisent ; ou parce que les juges qui se succedent pensent différemment ; ou parce que les affaires sont tantôt bien, tantôt mal défendues ; ou enfin par une infinité d’abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C’est un mal nécessaire, que le législateur corrige de temps en temps, comme contraire même à l’esprit des gouvernemens modérés.
[I-323] Car quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution, & non pas des contradictions & de l’incertitude des lois.
Dans les gouvernemens où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu’il y ait des privileges. Cela diminue encore la simplicité, & fait mille exceptions.
Un des privileges le moins à charge à la société, & sur-tout à celui qui le donne, c’est de plaider devant un tribunal, plutôt que devant un autre. Voilà de nouvelles affaires ; c’est-à-dire, celles où il s’agit de savoir devant quel tribunal il faut plaider.
Les peuples des états despotiques sont dans un cas bien différent. Je ne sais sur quoi, dans ces pays, le législateur pourroit statuer, ou le magistrat juger. Il suit, de ce que les terres appartiennent au prince, qu’il n’y a presque point de lois civiles sur la propriété des terres. Il suit, du droit que le souverain a de succéder, qu’il n’y en pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu’il fait dans quelques pays, rend inutiles toutes sortes de lois sur le commerce. Les [I-324] mariages que l’on y contracte avec des filles esclaves, font qu’il n’y a guere de lois civiles sur les dots & sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d’esclaves, qu’il n’y a presque point de gens qui ayent une volonté propre, & qui par conséquent doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions morales, qui ne sont que les volontés du pere, du mari, du maître, se reglent par eux, & non par les magistrats.
J’oubliois de dire que ce que nous appellons l’honneur, étant à peine connu dans ces états, toutes les affaires qui regardent cet honneur, qui est un si grand chapitre parmi nous, n’y ont point de lieu. Le despotisme se suffit à lui-même ; tout est vide autour de lui.
Aussi, lorsque les voyageurs nous décrivent les pays où il regne, rarement nous parlent-ils des lois civiles [1] .
[I-325]
Toutes les occasions de dispute & de procès y sont donc ôtées. C’est ce qui fait en partie qu’on y maltraite si fort les plaideurs : l’injustice de leur demande paroît à découvert, n’étant pas cachée, palliée, ou protegée par une infinité de lois.
-
[↑] Au Mazulipatan, on n’a pu découvrir qu’il y eût de loi écrite. Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagn. des Indes, tom. IV, part. I, p. 391. Les Indiens ne se reglent, dans les jugemens, que sur de certaines coutumes. Le Vedan & autres livres pareils, ne contiennent point de lois civiles, mais des préceptes religieux. Voyez lettres édif. quatorzieme recueil.
[I-325]
CHAPITRE II.
De la simplicité des lois criminelles dans les divers gouvernemens.
On entend dire sans cesse qu’il faudroit que la justice fût rendue par-tout comme en Turquie. Il n’y aura donc que les plus ignorans de tous les peuples, qui auront vu clair dans la chose du monde qu’il importe le plus aux hommes de savoir ?
Si vous examinez les formalités de la justice, par rapport à la peine qu’a un citoyen à se faire rendre son bien ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop : Si vous les regardez dans le rapport qu’elles ont avec la liberté & la sureté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu ; & vous verrez que les peines, [I-326] les dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté.
En Turquie, où l’on fait très-peu d’attention à la fortune, à la vie, à l’honneur des sujets, on termine promptement d’une façon ou d’une autre toutes les disputes. La maniere de les finir est indifférente, pourvu qu’on les finisse. Le bacha d’abord éclairci, fait distribuer à sa fantaisie des coups de bâton sur la plante des pieds des plaideurs, & les renvoie chez eux.
Et il seroit bien dangereux que l’on y eût les passions des plaideurs ; elles supposent un désir ardent de se faire rendre justice, une haine, une action dans l’esprit, une confiance à poursuivre. Tout cela doit être évité dans un gouvernement où il ne faut avoir d’autre sentiment que la crainte, & où tout mene tout-à-coup, & sans qu’on le puisse prévoir à des révolutions. Chacun doit connoître qu’il ne faut point que le magistrat entende parler de lui, & qu’il ne tient sa sureté que de son anéantissement.
Mais dans les états modérés, où la tête du moindre citoyen est [I-327] considérable, on ne lui ôte son honneur & ses biens qu’après un long examen : on ne le prive de la vie que lorsque la patrie elle-même l’attaque ; & elle ne l’attaque qu’en lui laissant tous les moyens possibles de la défendre.
Aussi, lorsqu’un homme se rend plus absolu [1] , songe-t-il d’abord à simplifier les lois. On commence dans cet état à être plus frappé des inconvéniens particuliers, que de la liberté des sujets dont on ne se soucie point du tout.
On voit que dans les républiques il faut pour le moins autant de formalités que dans les monarchies. Dans l’un & dans l’autre gouvernement, elles augmentent en raison du cas que l’on y fait de l’honneur, de la fortune, de la vie, de la liberté des citoyens.
Les hommes sont tous égaux dans le gouvernement républicain ; ils sont égaux dans le gouvernement despotique : dans le premier, c’est parce qu’ils sont tout ; dans le second, c’est parce qu’ils ne sont rien.
-
[↑] César, Cromwell, & tant d’autres.
[I-328]
CHAPITRE III.
Dans quels gouvernemens, & dans quels cas on doit juger selon un texte précis de la Loi.
Plus le gouvernement approche de la république, plus la maniere de juger devient fixe ; & c’étoit un vice de la république de Lacédémone, que les éphores jugeassent arbitrairement, sans qu’il y eût des lois pour les diriger. À Rome, les premiers consuls jugerent comme les éphores ; on en sentit les inconvéniens, & l’on fit des lois précises.
Dans les états despotiques, il n’y a point de loi ; le juge est lui-même sa regle. Dans les états monarchiques, il y a une loi ; & là où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution, que les juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie.
À Rome, les juges prononçoient [I-329] seulement que l’accusé étoit coupable d’un certain crime, & la peine se trouvoit dans la loi, comme on le voit dans diverses lois qui furent faites. De même, en Angleterre, les jurés décident si l’accusé est coupable ou non du fait qui a été porté devant eux ; & s’il est déclaré coupable, le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce fait : & pour cela, il ne lui faut que des yeux.
[I-329]
CHAPITRE IV.
De la maniere de former les jugemens.
De là suivent les différentes manieres de former les jugemens. Dans les monarchies, les juges prennent la maniere des arbitres ; ils déliberent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient ; on modifie son avis, pour le rendre conforme à celui d’un autre ; les avis les moins nombreux sont rappellés aux deux plus grands. Cela n’est point de la nature de la république. À Rome, & dans les villes Grecques, les juges ne se communiquoient point : chacun donnoit son avis d’une de ces trois manieres, J’absous, [I-330] je condamne, il ne me paroît pas [1] : c’est que le peuple jugeoit, ou étoit censé juger. Mais le peuple n’est pas jurisconsulte, toutes ces modifications & tempéramens des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait & un seul fait, & qu’il n’ait qu’à voir s’il doit condamner, absoudre, ou remettre le jugement.
Les Romains, à l’exemple des Grecs, introduisirent des formules d’actions, [2] & établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l’action qui lui étoit propre. Cela étoit nécessaire dans leur maniere de juger ; il falloit fixer l’état de la question, pour que le peuple l’eût toujours devant les yeux. Autrement, dans le cours d’une grande affaire, cet état de la question changeroit continuellement, & on ne le reconnoîtroit plus.
De-là il suivoit que les juges, chez les Romains, n’accordoient que la demande précise, sans rien augmenter, diminuer ni modifier. Mais les préteurs imaginerent d’autres formules d’actions [I-331] qu’on appella de bonne foi [3] , où la maniere de prononcer étoit plus dans la disposition du juge. Ceci étoit plus conforme à l’esprit de la monarchie. Aussi les jurisconsultes François disent-ils : En France [4] toutes les actions sont de bonne foi.
-
[↑] Non liquet.
-
[↑] Quas actiones ne populus prout vellet instituerce, certas solemnesque esse voluerunt. Leg. 2. §. 6. digest. de orig. jar.
-
[↑] Dans lesquelles on mettoit ces mots : ex bonâ fide.
-
[↑] On y condamne aux dépens de celui-là même à qui on demande plus qu’il ne doit, s’il n’a offert & consigné ce qu’il doit.
[I-331]
CHAPITRE V.
Dans quels gouvernemens le Souverain peut être juge.
Machiavel [1] attribue la perte de la liberté de Florence à ce que le peuple ne jugeoit pas en corps, comme à Rome, des crimes de lese-majesté commis contre lui. Il y avoit pour cela huit juges établis : Mais, dit Machiavel, peu sont corrompus par peu. J’adopterois bien la maxime de ce grand homme : mais comme dans ces cas, l’intérêt politique force, pour ainsi dire, [I-332] l’intérêt civil, (car c’est toujours un inconvénient, que le peuple juge lui-même ses offenses ;) il faut, pour y remédier, que les lois pourvoient autant qu’il est en elles à la sureté des particuliers.
Dans cette idée, les législateurs de Rome firent deux choses ; ils permirent aux accusés de s’exiler [2] avant le jugement [3] : & ils voulurent que les biens des condamnés fussent consacrés, pour que le peuple n’en eût pas la confiscation. On verra dans le livre XI les autres limitations que l’on mit à la puissance que le peuple avoit de juger.
Solon sut bien prévenir l’abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l’Aréopage revît l’affaire ; que, s’il croyoit l’accusé injustement absous [4] , il l’accusât de nouveau devant le peuple ; que, s’il le croyoit injustement condamné [5] , il arrêtât l’exécution, & lui fit rejuger l’affaire : Loi admirable, [I-333] qui soumettoit le peuple à la censure de la magistrature qu’il respectoit le plus, & à la sienne même !
Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles, sur-tout du moment que l’accusé sera prisonnier, afin que le peuple puisse se calmer & juger de sang froid.
Dans les états despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution seroit détruite ; les pouvoirs intermédiaires dépendans, anéantis ; on verroit cesser toutes les formalités des jugemens ; la crainte s’empareroit de tous les esprits ; on verroit la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sureté, plus de monarchie.
Voici d’autres réflexions. Dans les états monarchiques, le prince est la partie qui poursuit les accusés, & les fait punir ou absoudre ; s’il jugeoit lui-même, il seroit le juge & la partie.
Dans ces mêmes états, le prince a souvent des confiscations ; s’il jugeoit les crimes, il seroit encore le juge & la partie.
De plus, il perdroit le plus bel attribut [I-334] de sa souveraineté, qui est celui de faire grace [6] : il seroit insensé qu’il fît & défît ses jugemens : il ne voudroit pas être en contradiction avec lui-même.
Outre que cela confondroit toutes les idées, on ne sauroit si un homme seroit absous ou s’il recevroit sa grace.
Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Valette [7] , & qu’il appella, pour cela, dans son cabinet quelques officiers du parlement & quelques conseillers d’état ; le roi les ayant forcés d’opiner sur le décret de prise de corps, le président de Believre dit : « Qu’il voyoit dans cette affaire une chose étrange, un prince opiner au procès d’un de ses sujets ; que les rois ne s’étoient réservé que les graces, & qu’ils renvoyoient les condamnations vers leurs officiers. Et votre majesté voudroit bien voir sur la sellette un homme devant elle, qui, par son jugement, iroit dans une heure à la mort ! Que la face du prince, qui porte les [I-335] graces, ne peut soutenir cela ; que sa vue seule levoit les interdits des églises ; qu’on ne devoit sortir que content de devant le prince. » Lorsqu’on jugea le fond, le même président dit dans son avis : « Cela est un jugement sans exemple, voie contre tous les exemples du passé jusqu’à huy, qu’un Roi de France ait condamné en qualité de juge, par son avis, un gentilhomme à mort [8] . »
Les jugemens rendus par le prince, seroient une source intarissable d’injustices & d’abus ; les courtisans extorqueroient, par leur importunité, ses jugemens. Quelques empereurs Romains eurent la fureur de juger ; nul regnes n’étonnerent plus l’univers par leurs injustices.
« Claude, dit Tacite [9] , ayant attiré à lui le jugement des affaires & les fonctions des magistrats, donna occasion à toutes sortes de rapines. » Aussi Néron, parvenant à l’empire après Claude, voulant se concilier les esprits, déclara-t-il : « Qu’il se garderoit bien d’être [I-336] le juge de toutes les affaires, pour que les accusateurs & les accusés, dans les murs d’un palais, ne fussent pas exposés à l’unique pouvoir de quelques affranchis [10] .
« Sous le regne d’Arcadius, dit Zozime [11] , la nation des calomniateurs se répandit, entoura la cour, & l’infecta. Lorsqu’un homme étoit mort, on supposoit qu’il n’avoit point laissé d’enfans [12] ; on donnoit ses biens par un rescrit. Car comme le prince étoit étrangement stupide, & l’impératrice entreprenante à l’excès, elle servoit l’insatiable avarice de ses domestiques & de ses confidentes ; de sorte que, pour les gens modérés, il n’y avoit rien de plus désirable que la mort.
« Il y avoit autrefois, dit Procope [13] , fort peu de gens à la cour : mais sous Justinien, comme les juges n’avoient plus la liberté de rendre justice, leurs tribunaux étoient déserts, tandis que le palais du prince retentissoit des clameurs des parties qui y sollicitoient leurs affaires. » Tout le monde sait [I-337] comment on y vendoit les jugemens & même les lois.
Les lois sont les yeux du prince ; il voit par elles ce qu’il ne pourroit pas voir sans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux ? Il travaille non pas pour lui, mais pour ses séducteurs contre lui.
-
[↑] Discours sur la premiere décade de Tite-Live, liv. I. chap. VII.
-
[↑] Cela est bien expliqué dans l’oraison de Cicéron pro Ccinnâ, à la fin.
-
[↑] C’étoit une loi d’Athenes, comme il paroît par Démosthene. Socrate refusa de s’en servir.
-
[↑] Démosthene, sur la couronne, pag. 494. édit. de Francfort, de l’an 1604.
-
[↑] Voyez Philostrate, vie des sophistes, liv. I. vie d’Eschines.
-
[↑] Platon ne pense pas que les rois, qui sont, dit-il, prêtres, puissent assister au jugement où l’on condamne à la mort, à l’exil, à la prison.
-
[↑] Voyez la relation du procès fait à M. de duc de la Vallette. Elle est imprimée dans les mémoires de Montresor, tom. II. pag. 62.
-
[↑] Cela fut changé dans la suite. Voyez la même relation.
-
[↑] Annal. liv. XI.
-
[↑] Ibid. liv. XIII.
-
[↑] Hist. liv. V.
-
[↑] Même désordre sous Théodose le jeune.
-
[↑] Histoire secrette.
[I-337]
CHAPITRE VI.
Que dans la monarchie les ministres ne doivent pas juger.
C’est encore un grand inconvénient dans la monarchie, que les ministres du prince jugent eux-mêmes les affaires contentieuses. Nous voyons encore aujourd’hui des états où il y a des juges sans nombre pour décider les affaires fiscales, & où les ministres, qui le croiroit ! veulent encore les juger. Les réflexions viennent en foule, je ne ferai que celle-ci.
Il y a par la nature des choses, une espece de contradiction entre le conseil du monarque & de ses tribunaux. Le conseil des rois doit être composé de peu de personnes, & les tribunaux de judicature en demandent beaucoup. La raison en est que dans le premier, on doit prendre les affaires avec une certaine passion, [I-338] & les suivre de même ; ce qu’on ne peut guere espérer que de quatre ou cinq hommes qui en font leur affaire. Il faut au contraire des tribunaux de judicature de sang froid, & à qui toutes les affaires soient en quelque façon indifférentes.
[I-338]
CHAPITRE VII.
Du magistrat unique.
Un tel magistrat ne peut avoir lieu que dans le gouvernement despotique. On voit dans l’histoire Romaine, à quel point un juge unique peut abuser de son pouvoir. Comment Appius, sur son tribunal, n’auroit-il pas méprisé les lois, puisqu’il viola même celle qu’il avoit faite [1] ? Tite-Live nous apprend l’inique distinction du décemvir. Il avoit aposté un homme qui réclamoit devant lui Virginie comme son esclave ; les parens de Virginie lui demanderent qu’en vertu de la loi on la leur remît jusqu’au jugement définitif. Il déclara que sa loi n’avoit été faite qu’en faveur du pere ; & que Virginius étant absent, elle ne pouvoit avoir d’application [2]
-
[↑] Voyez la loi II. §. 24. ff. de orig. jur.
-
[↑] Quod pater puellœ abessez, locum injuriœ esse ratus. Tite-Live, décade I. liv. III.
[I-339]
CHAPITRE VIII.
Des accusations dans les divers gouvernemens.
À Rome [1] , il étoit permis à un citoyen d’en accuser un autre ; cela étoit établi selon l’esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zele sans bornes, où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On suivit sous les empereurs les maximes de la république ; & d’abord on vit paroître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices & bien des talens, une ame bien basse & un esprit ambitieux, cherchoit un criminel dont la condamnation pût plaire au prince ; c’étoit la voie pour aller aux honneurs & à la fortune [2] , chose que nous ne voyons point parmi nous.
Nous avons aujourd’hui une loi admirable ; c’est celle qui veut que le prince établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal, [I-340] pour poursuivre en son nom tous les crimes : de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous ; & si ce vengeur public étoit soupçonné d’abuser de son ministere, on l’obligeroit de nommer son dénonciateur.
Dans les lois de Platon [3] , ceux qui négligent d’avertir les magistrats, ou de leur donner du secours, doivent être punis. Cela ne conviendroit point aujourd’hui. La partie publique veille pour les citoyens ; elle agit, & ils sont tranquilles.
-
[↑] Et dans bien d’autres cités.
-
[↑] Voyez dans Tacite les récompenses accordées à ces délateurs.
-
[↑] Liv. IX.
[I-340]
CHAPITRE IX.
De la sévérité des peines dans les divers gouvernemens.
La sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu’à la monarchie & à la république, qui ont pour ressort l’honneur & la vertu.
Dans les états modérés, l’amour de la patrie, la honte & la crainte du blâme, sont des motifs réprimans, qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande [I-341] peine d’une mauvaise action, sera d’en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc plus aisément, & n’auront pas besoin de tant de force.
Dans ces états, un bon législateur s’attachera moins à punir les crimes, qu’à les prévenir ; il s’appliquera plus à donner des mœurs, qu’à infliger des supplices.
C’est une remarque perpétuelle des auteurs Chinois [1] , que plus dans leur empire on voyoit augmenter les supplices, plus la révolution étoit prochaine. C’est qu’on augmentoit les supplices à mesure qu’on manquoit de mœurs.
Il seroit aisé de prouver que, dans tous ou presque tous les états d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu’on s’est plus approché ou plus éloigné de la liberté.
Dans les pays despotiques, on est si malheureux, que l’on y craint plus la mort qu’on ne regrette la vie ; les supplices y doivent donc être plus rigoureux. Dans les états modérés, on craint plus de perdre la vie qu’on ne redoute [I-342] la mort en elle-même ; les supplices qui ôtent simplement la vie y sont donc suffisans.
Les hommes extrêmement heureux, & les hommes extrêmement malheureux, sont également portés à la dureté ; témoins les moines & les conquérans. Il n’y a que la médiocrité & le mélange de la bonne & de la mauvaise fortune, qui donnent de la douceur & de la pitié.
Ce que l’on voit dans les hommes en particulier, se trouve dans les diverses nations. Chez les peuples sauvages qui menent une vie très-dure, & chez les peuples des gouvernemens despotiques où il n’y a qu’un homme exorbitamment favorisé de la fortune, tandis que tout le reste en est outragé, on est également cruel. La douceur regne dans les gouvernemens modérés.
Lorsque nous lisons dans les histoires les exemples de la justice atroce des sultans, nous sentons avec une espece de douleur les maux de la nature humaine.
Dans les gouvernemens modérés, tout pour un bon législateur, peut servir à former des peines. N’est-il pas bien [I-343] extraordinaire qu’à Sparte, une des principales fût de ne pouvoir prêter sa femme à un autre, ni recevoir celle d’un autre, de n’être jamais dans sa maison qu’avec des vierges ? En un mot, tout ce que la loi appelle une peine, est effectivement une peine.
-
[↑] Je ferai voir dans la suite que la Chine, à cet égard, est dans le cas d’une république, ou d’une monarchie.
[I-343]
CHAPITRE X.
Des anciennes lois françoises.
C’est bien dans les anciennes lois françoises que l’on trouve l’esprit de la monarchie. Dans le cas où il s’agit de peines pécuniaires, les non-nobles sont moins punis que les nobles [1] . C’est tout le contraire dans les crimes [2] ; le noble perd l’honneur & réponse en cour, pendant que le vilain qui n’a point d’honneur est puni en son corps.
-
[↑] « Si comme pour briser un arrêt, les non-nobles doivent une amende de quarante sous, & les nobles de soixante livres ». Somme rurale. liv. II. pag. 198. égit. got. de l’an 1512 ; & Beaumanoir, chap. 61. pg. 309.
-
[↑] Voyez le conseil de Pierre Desfontaines. chap. XIII. sur-tout l’art. 22.
[I-344]
CHAPITRE XI.
Que lorsqu’un peuple est vertueux, il faut peu de peines.
Le peuple Romain avoit de la probité. Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre ; il sembloit qu’au lieu d’ordonnances, il suffisoit de lui donner des conseils.
Les peines des lois royales & celles des lois des douze tables furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne [1] , soit par une conséquence de la loi Porcie [2] . On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée, & il n’en résulta aucune lésion de police.
Cette loi Valérienne, qui défendoit aux magistrats toute voie de fait contre [I-345] un citoyen qui avoit appellé au peuple, n’infligeoit à celui qui y contreviendroit, que la peine d’être réputé méchant [3] .
-
[↑] Elle fut faite pas Valerius Publicola, bientôt après l’expulsion des rois ; elle fut renouvellée deux fois, toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Live, liv. X. Il n’étoit pas question de lui donner plus de force, mais d’en perfectionner les dispositions. diligentius sanctum, dit Tite-Live, ibid.
-
[↑] Lex Porcia pro tergo civium lata ; elle fut faite en 454 de la fondation de Rome.
-
[↑] Nihil ultrà quàm improbè factum adjecit, Tite-Live.
[I-345]
CHAPITRE XII.
De la puissance des peines.
L’expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé, comme il l’est ailleurs par les grandes.
Quelqu’inconvénient se fait-il sentir dans un état ? un gouvernement violent veut soudain le corriger ; & au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur le champ. Mais on use le ressort du gouvernement ; l’imagination se fait à cette grande peine, comme elle s’étoit faite à la moindre ; & comme on diminue la crainte pour celle-ci, l’on est bientôt forcé d’établir l’autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étoient communs dans quelques états ; on voulut les arrêter : on inventa le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelque temps.
[I-346] Depuis ce temps, on a volé comme auparavant sur les grands chemins.
De nos jours, la désertion fut très-fréquente ; on établit la peine de mort contre les déserteurs, & la désertion n’est pas diminuée. La raison en est bien naturelle : un soldat accoutumé tous les jours à exposer sa vie, en méprise ou se flatte d’en mépriser le danger. Il est tous les jours accoutumé à craindre la honte ; il falloit donc laisser une peine [1] qui faisoit porter une flétrissure pendant la vie ; on a prétendu augmenter la peine, & on l’a réellement diminuée.
Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchemens, on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes, & non pas de la modération des peines.
Suivons la nature, qui a donné aux hommes la honte comme leur fléau ; & que la plus grande partie de la peine, soit l’infamie de la souffrir.
Que s’il se trouve des pays où la honte ne soit pas une suite du supplice, [I-347] cela vient de la tyrannie, qui a infligé les mêmes peines aux scélérats & aux gens de bien.
Et si vous en voyez d’autres, où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient en grande partie de la violence du gouvernement, qui a employé ces supplices pour des fautes légeres.
Souvent un législateur, qui veut corriger un mal, ne songe qu’à cette correction ; ses yeux sont ouverts sur cet objet, & fermés sur les inconvéniens. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur : mais il reste un vice dans l’état que cette dureté a produit ; les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme.
Lysandre [2] ayant remporté la victoire sur les Athéniens, on jugea les prisonniers ; on accusa les Athénienes d’avoir précipité tous les captifs de deux galeres, & résolu en pleine assemblée de couper le poing aux prisonniers qu’ils feroient. Ils furent tous égorgés, excepté Adymante, qui s’étoit opposé à ce décret. Lysandre reprocha à [I-348] Philoclès, avant de le faire mourir, qu’il avoit dépravé les esprits, & fait des leçons de cruauté à toute la Grece.
« Les Argiens, dit Plutarque [3] , ayant fait mourir quinze cens de leurs citoyens, les Athéniens firent apporter les sacrifices d’expiation, afin qu’il plût aux dieux de détourner du cœur des Athéniens une si cruelle pensée. »
Il y a deux genres de corruption ; l’un, lorsque le peuple n’observe point les lois ; l’autre, lorsqu’il est corrompu par les lois : mal incurable, parce qu’il est dans le remede même.
-
[↑] On fendoit le nez, on coupoit les oreilles.
-
[↑] Xénophon, hist. liv. II.
-
[↑] Œuvres morales, de ceux qui manient les affaires d’état.
[I-348]
CHAPITRE XIII.
Impuissance des lois Japonoises.
Les peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. Jetons les yeux sur le Japon.
On y punit de mort presque tous les crimes [1] , parce que la désobéissance à un si grand empereur que celui du Japon, est un crime énorme. Il n’est pas [I-349] question de corriger le coupable, mais de venger le prince. Ces idées sont tirées de la servitude, & viennent sur-tout de ce que l’empereur étant propriétaire de tous les biens, presque tous les crimes se font directement contre ses intérêts.
On punit de mort les mensonges qui se font devant les magistrats [2] ; chose contraire à la défense naturelle.
Ce qui n’a point l’apparence d’un crime, est là sévérement puni ; par exemple, un homme qui hasarde de l’argent au jeu, est puni de mort.
Il est vrai que le caractere étonnant ce ce peuple opiniâtre, capricieux, déterminé, bizarre, & qui brave tous les périls & tous les malheurs, semble à la premiere vue absoudre les législateurs de l’atrocité de leurs lois. Mais des gens qui naturellement méritent la mort, & qui s’ouvrent le ventre pour la moindre fantaisie, sont-ils corrigés ou arrêtés par la vue continuelle des supplices ? & ne s’y familiarisent-ils pas ?
Les relations nous disent, au sujet de l’éducation des Japonois, qu’il faut [I-350] traiter les enfans avec douceur, parce qu’ils s’obstinent contre les peines ; que les esclaves ne doivent point être trop rudement traités, parce qu’ils se mettent d’abord en défense. Par l’esprit qui doit régner dans le gouvernement domestique, n’auroit-on pas pu juger de celui qu’on devoit porter dans le gouvernement politique & civil ?
Un législateur sage auroit cherché à ramener les esprits par un juste tempérament des peines & des récompenses ; par des maximes de philosophie, de morale & de religion assorties à ces caractères ; par la juste application des regles de l’honneur ; par le supplice de la honte ; par la jouissance d’un bonheur constant & d’une douce tranquillité. Et s’il avoit craint que les esprits, accoutumés à n’être arrêtés que par une peine cruelle, ne pussent plus l’être pas une plus douce, il auroit agit [3] d’une maniere sourde & insensible ; il auroit dans les cas particuliers les plus graciables modéré la peine du crime, jusqu’à ce qu’il eût pu parvenir à la modifier dans tous les cas.
[I-351]
Mais le despotisme ne connoît point ces ressorts ; il ne mene pas par ces voies ; il peut abuser de lui, mais c’est tout ce qu’il peut faire : au Japon il a fait un effort, il est devenu plus cruel que lui-même.
Des ames par-tout effarouchées & rendues plus atroces, n’ont pu être conduites que par une atrocité plus grande.
Voilà l’origine, voilà l’esprit des lois du Japon. Mais elles ont eu plus de fureur que de force. Elles ont réussi à détruire le christianisme ; mais des efforts si inouis sont une preuve de leur impuissance. Elles ont voulu établir une bonne police, & leur foiblesse a paru encore mieux.
Il faut lire la relation de l’entrevue de l’empereur & du deyro à Meaco [4] . Le nombre de ceux qui y furent étouffés, ou tués par des garnemens, fut incroyable ; on enleva les jeunes filles & les garçons ; on les retrouvoit tous les jours exposés dans des lieux publics à des heures indues, tous nuds, cousus dans des sacs de toile, afin qu’ils ne connussent pas les lieux par où ils avoient [I-352] passé ; on vola tout ce qu’on voulut ; on fendit le ventre à des chevaux pour faire tomber ceux qui les montoient ; on renversa des voitures pour dépouiller les dames. Les Hollandois à qui l’on dit qu’ils ne pouvoient passer la nuit sur des échafauds, sans être assassinés, en descendirent, &c.
Je passerai vîte sur un autre trait. L’empereur adonné à des plaisirs infames, ne se marioit point ; il couroit risque de mourir sans successeur. Le deyro lui envoya deux filles très-belles. Il en épousa une par respect, mais il n’eut aucun commerce avec elle. Sa nourrice fit chercher les plus belles femmes de l’empire ; tout étoit inutile : la fille d’un armurier étonna son goût [5] ; il se détermina, il en eut un fils. Les dames de la cour, indignées de ce qu’il leur avoit préféré une personne d’une si basse naissance, étoufferent l’enfant. Ce crime fut caché à l’empereur, il auroit versé un torrent de sang. L’atrocité des lois en empêche donc l’exécution. Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l’impunité.
-
[↑] Voyez Kempfer.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la Compagnie des Indes, tomme III. part. 2. pag. 428.
-
[↑] Remarquez bien ceci comme une maxime de pratique, dans les cas où les esprits ont été gâtés par des peines trop rigoureuses.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la Compagnie des Indes, tome V. p. 2.
-
[↑] Ibid.
[I-353]
CHAPITRE XIV.
De l’esprit du Sénat de Rome.
Sous le consulat d’Acilius Glabrio & de Pison, on fit la loi Acilia [1] pour arrêter les brigues. Dion dit [2] que le sénat engagea les consuls à la proposer, parce que le tribun C. Cornelius avoit résolu de faire établir des peines terribles contre ce crime, à quoi le peuple étoit fort porté. Le Sénat pensoit que des peines immodérées jetteroient bien la terreur dans les esprits ; mais qu’elles auroient cet effet, qu’on ne trouveroit plus personnes pour accuser, ni pour condamner ; au lieu qu’en proposant des peines modiques, on auroit des juges & des accusateurs.
-
[↑] Les coupables étoient condamnés à une amende ; ils ne pouvoient plus être admis dans l’ordre des sénateurs & nommés à aucune magistrature : Dion, liv. XXXVI.
-
[↑] Ibid.
[I-354]
CHAPITRE XV.
Des lois des Romains à l’égard des peines.
Je me trouve fort dans mes maximes, lorsque j’ai pour moi les Romains ; & je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement, lorsque je vois ce grand peuple changer à cet égard de lois civiles, à mesure qu’il changeoit de lois politiques.
Les lois royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d’esclaves & de brigands, furent très-séveres. L’esprit de la république auroit demandé que les décemvirs n’eussent pas mis ces lois dans leurs douze tables ; mais des gens qui aspiroient à la tyrannie, n’avoient garde de suivre l’esprit de la république.
Tite-live [1] dit, sur le supplice de Métius Suffétius, dictateur d’Albe, qui fut condamné par Tullus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce fut le premier & le dernier supplice où l’on témoigna avoir perdu la mémoire de [I-355] l’humanité. Il se trompe : la loi des douze tables est pleine de dispositions très-cruelles [2] .
Celle qui découvre le mieux le dessein des décemvirs, est la peine capitale prononcée contre les auteurs des libelles & les poëtes. Cela n’est guere du génie de la république, où le peuple aime à voir les grands humiliés. Mais des gens qui vouloient renverser la liberté, craignoient des écrits qui pouvoient rappeller l’esprit de la liberté [3] .
Après l’expulsion des décemvirs, presque toutes les lois qui avoient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément : mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen Romain, elles n’eurent plus d’application.
Voilà le temps auquel on peut rapporter ce que Tite-Live [4] dit des Romains, que jamais peuple n’a plus aimé la modération des peines.
Que si l’on ajoute à la douceur des [I-356] peines, le droit qu’avoit un accusé de se retirer avant le jugement, on verra bien que les Romains avoient suivi cet esprit que j’ai dit être naturel à la république.
Sylla, qui confondit la tyrannie, l’anarchie & la liberté, fit les lois Cornéliennes. Il sembla ne faire des réglemens que pour établir des crimes. Ainsi qualifiant une infinité d’actions du nom de meurtre, il trouva par-tout des meurtriers, & par une pratique qui ne fut que trop suivie, il tendit des pieges, sema des épines, ouvrit des abymes sur le chemin de tous les citoyens.
Presque toutes les lois de Sylla ne portoient que l’interdiction de l’eau & du feu. César y ajouta la confiscation des biens, parce que les riches gardant dans l’exil leur patrimoine, ils étoient plus hardis à commettre des crimes.
Les empereurs ayant établi un gouvernement militaire, ils sentirent bientôt qu’il n’étoit pas moins terrible contr’eux que contre les sujets ; ils chercherent à le tempérer ; ils crurent avoir [I-357] besoin des dignités & du respect qu’on avoit pour elles.
On s’approcha un peu de la monarchie, & l’on divisa les peines en trois classes [5] ; celles qui regardoient les premieres personnes de l’état [6] , & qui étoient assez douces ; celles qu’on infligeoit aux personnes d’un rang [7] inférieur, & qui étoient plus séveres ; enfin celles qui ne concernoient que les conditions basses [8] , & qui furent les plus rigoureuses.
Le féroce & insensé Maximin irrita pour ainsi dire le gouvernement militaire qu’il auroit fallu adoucir. Le sénat apprenoit, dit Capitolin [9] , que les uns avoient été mis en croix, & les autres exposés aux bêtes, ou enfermés dans des peaux de bêtes récemment tuées, sans aucun égard pour les dignités. Il sembloit vouloir exercer la discipline militaire, sur le modele de laquelle il prétendoit régler les affaires civiles.
[I-358]
On trouvera dans les Considérations sur la grandeur des Romains & leur décadence, comment Constantin changea le despotisme militaire en un despotisme militaire & civil, & s’approcha de la monarchie. On y peut suivre les diverses révolutions de cet état ; & voir comment on y passa de la rigueur à l’indolence, & de l’indolence à l’impunité.
-
[↑] Livre I.
-
[↑] On y trouve le supplice du feu, des peines presque toujours capitales, le vol puni de mort, &c.
-
[↑] Sylla, animé du même esprit que les décemvirs, augmenta comme eux les peines contre les écrivains satiriques.
-
[↑] Livre I.
-
[↑] Voyez la loi 3. §. legis ad leg. Cornel. de sicarris, & un très-grand nombre d’autres au digeste & au code.
-
[↑] Sublimiores.
-
[↑] Medios.
-
[↑] Infimos. Leg. 3. §. legis ad leg. Cornell. de sicariis.
-
[↑] Jul. Cap. Maximini duo.
[I-358]
CHAPITRE XVI.
De la juste proportion des peines avec le crime.
Il est essentiel que les peines ayent de l’harmonie entr’elles, parce qu’il est essentiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre ; ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque moins.
« Un imposteur [1] , qui se disoit Constantin Ducas, suscita un grand soulevement à Constantinople. Il fut pris & condamné au fouet ; mais ayant accusé des personnes considérables, il fut condamné, comme calomniateur, à être brûlé ». Il est singulier [I-359] qu’on eût ainsi proportionné les peines entre le crime de lese-majesté & celui de calomnie.
Cela fait souvenir d’un mot de Charles II, roi d’Angleterre. Il vit en passant un homme au pilori : il demanda pourquoi il étoit là. Sire, lui dit-on, c’est parce qu’il fait des libelles contre vos ministres. Le grand sot, dit le roi, que ne les écrivoit-il contre moi ? on ne lui auroit rien fait.
« Soixante-dix personnes conspirerent contre l’empereur Basile [2] ; il les fit fustiger ; on leur brûla les cheveux & le poil. Un cerf l’ayant pris avec son bois par la ceinture, quelqu’un de sa suite tira son épée, coupa sa ceinture, & le délivra. Il lui fit trancher la tête, parce qu’il avoit, disoit-il, tiré l’épée contre lui ». Qui pourroit penser que sous le même prince ont eût rendu ces deux jugemens ?
C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, & à celui qui vole & assassine. Il est visible, que pour la sureté publique, il faudroit mettre quelque différence dans la peine.
[I-360]
À la Chine, les voleurs cruels sont coupés en morceaux [3] , les autres non : cette différence fait que l’on y vole ; mais que l’on n’y assassine pas.
En Moscovie, où la peine des voleurs & celle des assassins sont les mêmes, on assassine [4] toujours. Les morts, y dit-on, ne racontent rien.
Quand il n’y a point de différence dans la peine, il faut en mettre dans l’espérance de la grace. En Angleterre, on n’assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies, non pas les assassins.
C’est un grand ressort des gouvernemens modérés, que les lettres de grace. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. Le principe du gouvernement despotique, qui ne pardonne pas, & à qui on ne pardonne jamais, le prive de ces avantages.
-
[↑] Histoire de Nicéphore, patriarche de Constantinople.
-
[↑] Idem, ibid.
-
[↑] Du Halde, tom. I. p. 6.
-
[↑] État présent de la grande Russie, par Perry.
[I-361]
CHAPITRE XVII.
De la torture ou question contre les criminels.
Parce que les hommes sont méchans, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans la punition de tous les crimes. La loi les croit, comme s’ils parloient par la bouche de la vérité. L’on juge aussi que tout enfant conçu pendant le mariage, est légitime : la loi a confiance en la mere, comme si elle étoit la pudicité même. Mais la question contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation [1] très-bien policée la rejeter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature [2] .
[I-362]
Tant d’habiles gens & tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, que je n’ose parler après eux. J’allois dire qu’elle pourroit convenir dans les gouvernemens despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement : j’allois dire que les esclaves, chez les Grecs & chez les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.
-
[↑] La nation Angloise.
-
[↑] Les citoyens d’Athenes ne pouvoient être mis à la question, (Lysias, orat. in Argorat.) excepté dans le crime de lese-majesté. On donnoit la question trente jours après la condamnation, (Curius Fortunatus, rethor. schol. lib. II.) Il n’y avoit pas de question préparatoire. Quant aux Romains, la loi 3 & 4 ad leg. Juliam majest. fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice garantissoient de la question, si ce n’est dans le cas de crime de lese-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois des Wisigoths mettoient à cette pratique.
[I-362]
CHAPITRE XVIII.
Des peines pécuniaires, & des peines corporelles.
Nos peres les Germains n’admettoient guere que des peines pécuniaires. Ces hommes guerriers & libres estimoient que leur sang ne devoit être versé que les armes à la main. Les Japonois [1] , au contraire, rejettent ces sorte de peines, sous prétexte que les gens riches éluderoient la punition. Mais les gens riches ne craignent-ils pas de perdre leurs biens ? les peines pécuniaires ne peuvent-elles pas se [I-363] proportionner aux fortunes ? Et enfin, ne peut-on pas joindre l’infamie à ces peines ?
Un bon législateur prend un juste milieu ; il n’ordonne pas toujours des peines pécuniaires, il n’inflige pas toujours des peines corporelles.
-
[↑] Voyez Kempfer.
[I-363]
CHAPITRE XIX.
De la loi du talion.
Les états despotiques qui aiment les lois simples, usent beaucoup de la loi du talion [1] . Les états modérés la reçoivent quelquefois ; mais il y a cette différence, que les premiers la font exercer rigoureusement, & que les autres lui donnent presque toujours des tempéramens.
La loi des douze tables en admettoit deux ; elle ne condamnoit au talion que lorsqu’on n’avoit pu appaiser celui qui se plaignoit [2] . On pouvoit, après la condamnation, payer les dommages & intérêts [3] , & la peine corporelle se convertissoit en peine pécuniaire [4] .
-
[↑] Elle est établie dans l’alcoran. Voyez le chapitre de la vache.
-
[↑] Si membrum rupit, ni cum co pacit, talio esto. Aulugelle, liv. XX. chap. I.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Voyez aussi la loi des Wisigoths, liv. VI., tit. 4. §. 3 & 5.
[I-364]
CHAPITRE XX.
De la punition des peres pour leurs enfans.
On punit à la Chine les peres pour les fautes de leurs enfans. C’étoit l’usage du Pérou [1] . Ceci est encore tiré des idées despotiques.
On a beau dire qu’on punit à la Chine le pere pour n’avoir pas fait usage de ce pouvoir paternel que la nature a établi, & que les lois même y ont augmenté. Cela suppose toujours qu’il n’y a point d’honneur chez les Chinois. Parmi nous les peres dont les enfans sont condamnés au supplice, & les enfans [2] dont les peres ont subi le même sort, sont aussi punis par la honte, qu’ils le feroient à la Chine par la perte de la vie.
-
[↑] Voyez Garcillosso, histoire des guerres civiles des Espagnols.
-
[↑] Au lieu de les punir, disoit Platon, il faut les louer de ne pas ressembler à leur pere. Lix. IX. des Lois.
[I-364]
CHAPITRE XXI.
De la clémence du Prince.
La clémence est la qualité distinctive des monarques. Dans la république où l’on a pour principe la vertu, elle [I-365] est moins nécessaire. Dans l’état despotique où regne la crainte, elle est moins en usage, parce qu’il faut contenir les grands de l’état par des exemples de sévérité. Dans les monarchies où l’on est gouverné par l’honneur, qui souvent exige ce que la loi défend, elle est plus nécessaire. La disgrace y est un équivalent à la peine : les formalités même des jugemens y sont des punitions. C’est là que la honte vient de tous côtés pour former des genres particuliers de peine.
Les grands y sont si fort punis par la disgrace, par la perte souvent imaginaire de leur fortune, de leur crédit, de leurs habitudes, de leurs plaisirs, que la rigueur à leur égard est inutile ; elle ne peut servir qu’à ôter aux sujets l’amour qu’ils ont pour la personne du prince, & le respect qu’ils doivent avoir pour les places.
Comme l’instabilité des grands est de la nature du gouvernement despotique, leur sureté entre dans la nature de la monarchie.
Les monarques ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que [I-366] c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion de l’exercer ; & on le peut presque toujours dans nos contrées.
On leur disputera peut-être quelque branche de l’autorité, & presque jamais l’autorité entiere ; & si quelquefois ils combattent pour la couronne, ils ne combattent point pour la vie.
Mais, dira-t-on, quand faut-il punir ? quand faut-il pardonner ? C’est une chose qui se fait mieux sentir qu’elle ne peut se prescrire. Quand la clémence a des dangers, ces dangers sont très-visibles ; on la distingue aisément de cette foiblesse qui mene le prince au mépris, & à l’impuissance même de punir.
L’empereur Maurice [1] prit la résolution de ne verser jamais le sang de ses sujets. Anastase [2] ne punissoit point les crimes. Isaac l’Ange jura que de son regne il ne feroit mourir personne. Les empereurs Grecs avoient oublié que ce n’étoit pas en vain qu’ils portoient l’épée.
[I-367]
LIVRE VII.
Conséquences des différens principes des trois gouvernemens, par rapport aux Lois somptuaires, au luxe, & à la condition des femmes.↩
CHAPITRE PREMIER.
Du luxe.
Le luxe est toujours en proportion avec l’inégalité des fortunes. Si, dans un état, les richesses sont également partagées, il n’y aura point de luxe ; car il n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le travail des autres.
Pour que les richesses restent également partagées, il faut que la loi ne donne à chacun que le nécessaire physique. Si l’on a au-delà, les uns dépenseront, les autres acquerront, & l’inégalité s’établira.
Supposant le nécessaire physique égal à une somme donnée, le luxe de ceux [I-368] qui n’auront que le nécessaire, sera égal à zéro ; celui qui aura le double, aura un luxe égal à un ; celui qui aura le double du bien de ce dernier, aura un luxe égal à trois ; quand on aura encore le double, on aura un luxe égal à sept : de sorte que le bien du particulier qui suit, étant toujours supposé double de celui du précédent, le luxe croîtra du double plus une unité, dans cette progression 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.
Dans la république de Platon [1] , le luxe auroit pu se calculer au juste. Il y avoit quatre sortes de cens établis. Le premier étoit précisément le terme où finissoit la pauvreté, le second étoit double, le troisieme triple, le quatrieme quadruple du premier. Dans le premier cens le luxe étoit égal à zéro ; il étoit égal à un dans le second, à deux dans le troisieme, à trois dans le quatrieme ; & il suivoit ainsi la proportion arithmétique.
En considérant le luxe des divers peuples, les uns à l’égard des autres, il est dans chaque état en raison composée de l’inégalité des fortunes qui est entre [I-369] les citoyens, & de l’inégalité des richesses des divers états. En Pologne, par exemple, les fortunes sont d’une inégalité extrême ; mais la pauvreté du total empêche qu’il n’y ait autant de luxe que dans un état plus riche.
Le luxe est encore en proportion avec la grandeur des villes, & sur-tout de la capitale ; en sorte qu’il est en raison composée des richesses de l’état, de l’inégalité des fortunes des particuliers, & du nombre d’hommes qu’on assemble dans de certains lieux.
Plus il y a d’hommes ensemble, plus ils sont vains & sentent naître en eux l’envie de se signaler par de petites choses [2] . S’ils sont en si grand nombre, que la plupart soient inconnus les uns aux autres, l’envie de se distinguer redouble, parce qu’il y a plus d’espérance de réussir. Le luxe donne cette espérance ; chacun prend les marques de la condition qui précede la sienne. Mais à force de vouloir se distinguer, tout [I-370] devient égal, & on ne se distingue plus : comme tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne.
Il résulte de tout cela une incommodité générale. Ceux qui excellent dans une profession mettent à leur art le prix qu’ils veulent ; les plus petits talens suivent cet exemple ; il n’y a plus d’harmonie entre les besoins & les moyens. Lorsque je suis forcé de plaider, il est nécessaire que je puisse payer un avocat ; lorsque je suis malade, il faut que je puisse avoir un médecin.
Quelques gens ont pensé qu’en assemblant tant de peuple dans une capitale, on diminuoit le commerce, parce que les hommes ne sont plus à une certaine distance les uns des autres. Je ne le crois pas ; on a plus de désirs, plus de besoins, plus de fantaisies quand on est ensemble.
-
[↑] Le premier cens étoit le sort héréditaire en terre ; & Platon ne vouloit pas qu’on pût avoir en autres effets plus du triple du sort héréditaire. Voyez ses Lois, liv. IV.
-
[↑] Dans une grande ville, dit l’auteur de la fable des abeilles, tom. I. pag. 133. on s’habille au-dessus de sa qualité, pour être estimé plus qu’on n’est par la multitude. C’est un plaisir pour un esprit foible, presqu’aussi grand que celui de l’accomplissement de ses désirs.
[I-370]
CHAPITRE II.
Des Lois somptuaires dans la démocratie.
Je viens de dire que dans les républiques, où les richesses sont également partagées, il ne peut point y avoir de luxe ; & comme on a vu au livre [I-371] cinquieme [1] , que cette égalité de distribution faisoit l’excellence d’une république, il suit que moins il y a de luxe dans une république, plus elle est parfaite. Il n’y en avoit point chez les premiers Romains ; il n’y en avoit point chez les Lacédémoniens ; & dans les républiques où l’égalité n’est pas tout-à-fait perdue, l’esprit de commerce, de travail & de vertu, fait que chacun y peut & que chacun y veut vivre de son propre bien, & que par conséquent il y a peu de luxe.
Les lois du nouveau partage des champs, demandées avec tant d’instance dans quelques républiques, étoient salutaires par leur nature. Elles ne sont dangereuses que comme action subite. En ôtant tout-à-coup les richesses aux uns, & augmentant de même celles des autres, elles font dans chaque famille une révolution, & en doivent produire une générale dans l’état.
À mesure que le luxe s’établit dans une république, l’esprit se tourne vers l’intérêt particulier. À des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à désirer que la gloire de la patrie & la [I-372] sienne propre. Mais une ame corrompue par le luxe a bien d’autres désirs. Bientôt elle devient ennemie des lois qui la gênent. Le luxe que la garnison de Rhege commença à connoître, fit qu’elle en égorgea les habitans.
Si-tôt que les Romains furent corrompus, leurs désirs devinrent immenses. On en peut juger par le prix qu’ils mirent aux choses. Une cruche de vin de Falerne [2] se vendoit cent deniers Romains ; un baril de chair salée du Pont en coûtoit quatre cents ; un bon cuisinier quatre talens ; les jeunes garçons n’avoient point de prix. Quand par une impétuosité [3] générale tout le monde se portoit à la volupté, que devenoit la vertu ?
-
[↑] Chap. III & IV.
-
[↑] Fragment du livre 365 de Diodore, rapporté par Const. Porphyrog. Extrait des vertus & des vices.
-
[↑] Cùm maximus omnium impétus ad luxuriam esset, ibid.
[I-372]
CHAPITRE III.
Des Lois somptuaires dans l’aristocratie.
L’aristocratie mal constituée a ce malheur, que les nobles y ont les richesses, & que cependant ils ne [I-373] doivent pas dépenser ; le luxe contraire à l’esprit de modération en doit être banni. Il n’y a donc que des gens très-pauvres qui ne peuvent pas recevoir, & des gens très-riches qui ne peuvent pas dépenser.
À Venise, les lois forcent les nobles à la modestie. Il se sont tellement accoutumés à l’épargne, qu’il n’y a que les courtisanes qui puissent leur faire donner de l’argent. On se sert de cette voie pour entretenir l’industrie ; les femmes les plus méprisables y dépensent sans danger, pendant que leurs tributaires y menent la vie du monde la plus obscure.
Les bonnes républiques Grecques avoient à cet égard des institutions admirables. Les riches employoient leur argent en fêtes, en chœurs de musique, en chariots, en chevaux pour la course, en magistrature onéreuse. Les richesses y étoient aussi à charge que la pauvreté.
[I-374]
CHAPITRE IV.
Des lois somptuaires dans les monarchies.
« Les Suions, nation Germanique, rendent honneur aux richesses, dit Tacite [1] ; ce qui fait qu’ils vivent sous le gouvernement d’un seul ». Cela signifie bien que le luxe est singuliérement propre aux monarchies, & qu’il n’y faut point de lois somptuaires.
Comme par la constitution des monarchies, les richesses y sont inégalement partagées, il faut bien qu’il y ait du luxe. Si les riches n’y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l’inégalité des fortunes ; & que, comme nous avons dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulieres n’ont augmenté, que parce qu’elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique ; il faut donc qu’il leur soit rendu.
Ainsi, pour que l’état monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant [I-375] du laboureur à l’artisan, au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitans principaux, aux princes, sans quoi tout seroit perdu.
Dans le sénat de Rome, composé de graves magistrats, de jurisconsultes & d’hommes pleins de l’idée des premiers temps, on proposa sous Auguste la correction des mœurs & du luxe des femmes. Il est curieux de voir dans Dion [2] avec quel art il éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C’est qu’il fondoit une monarchie, & dissolvoit une république.
Sous Tibere, les édiles proposerent dans le sénat le rétablissement des anciennes lois somptuaires [3] . Ce prince, qui avoit des lumieres, s’y opposa : « L’état ne pourroit subsister, disoit-il, dans la situation où sont les choses. Comment Rome pourroit-elle vivre ? comment pourroient vivre les provinces ? Nous avions de la frugalité, lorsque nous étions citoyens d’une seule ville ; aujourd’hui nous consommons les richesses de tout l’univers ; on fait travailler pour nous les maîtres & les esclaves ». Il voyoit bien qu’il [I-376] ne falloit plus de lois somptuaires.
Lorsque sous le même empereur, on propora au sénat de défendre aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, à cause des déréglemens qu’elles y apportoient, cela fut rejeté. On dit, que les exemples de la dureté des anciens avoient été changés en une façon de vivre plus agréable [4] . On sentit qu’il falloit d’autres mœurs.
Le luxe est donc nécessaire dans les états monarchiques ; il l’est encore dans les états despotiques. Dans les premiers, c’est un usage que l’on fait de ce qu’on possede de liberté : dans les autres, c’est un abus qu’on fait des avantages de sa servitude, lorsqu’un esclave choisi par son maître pour tyranniser ses autres esclaves, incertain pour le lendemain de la fortune de chaque jour, n’a d’autre félicité que celle d’assouvir l’orgueil, les désirs & les voluptés de chaque jour.
Tout ceci mene à une réflexion. Les républiques finissent par le luxe ; les monarchies par la pauvreté [5]
-
[↑] De morib. German.
-
[↑] Dion Cassius, liv. LIV.
-
[↑] Tacite, Ann. liv. III.
-
[↑] Multa duritici veterum meliùs & lœtiùs mutate. Tacit. A nal. liv. III.
-
[↑] Opulentia peritura mox egcstatem. Florus, liv. III.
[I-377]
CHAPITRE V.
Dans quel cas les Lois somptuaires sont utiles dans une monarchie.
Ce fut dans l’esprit de la république, ou dans quelques cas particuliers, qu’au milieu du treizieme siecle on fit en Arragon des lois somptuaires. Jacques I ordonna que le roi ni aucun de ses sujets ne pourroient manger plus de deux sortes de viandes à chaque repas, & que chacune ne seroit préparée que d’une seule maniere, à moins que ce ne fût du gibier qu’on eût tué soi-même [1] .
On a fait aussi de nos jours, en Suede, des lois somptuaires ; mais elles ont un objet différent de celles d’Arragon.
Un état peut faire des lois somptuaires dans l’objet d’une frugalité absolue ; c’est l’esprit des lois somptuaires des républiques ; & la nature de la chose fait voir que ce fut l’objet de celles d’Arragon.
Les lois somptuaires peuvent avoit aussi pour objet une frugalité relative ; lorsqu’un état, sentant que des marchandises étrangeres d’un trop haut prix [I-378] demanderoient une telle exportation des siennes, qu’il se priveroit plus de ses besoins par celles-ci qu’il n’en satisferoit par celles-là, en défend absolument l’entrée : & c’est l’esprit des lois que l’on a faites de nos jours en Suede [2] . Ce sont les seules lois somptuaires qui conviennent aux monarchies.
En général, plus un état est pauvre, plus il est ruiné par son luxe relatif, & plus par conséquent il lui faut de lois somptuaires relatives. Plus un état est riche, plus son luxe relatif l’enrichit, & il faut bien se garder d’y faire des lois somptuaires relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le livre sur le commerce [3] . Il n’est ici question que du luxe absolu.
-
[↑] Constitution de Jacques I, de l’an 1234, art. 6, dans Marco-Il spanica, p. 1429.
-
[↑] On y a défendu les vins exquis, & autres marchandises précieuses.
-
[↑] Voyez tom. II, liv. XX, chap. XX.
[I-378]
CHAPITRE VI.
Du luxe à la Chine.
Des lois particulieres demandent des lois somptuaires dans quelques états. Le peuple, par la force du climat, [I-379] peut devenir si nombreux, & d’un autre côté les moyens de le faire subsister peuvent être si incertains, qu’il est bon de l’appliquer tout entier à la culture des terres. Dans ces états le luxe est dangereux, & les lois somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi pour savoir s’il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d’abord jeter les yeux sur le rapport qu’il y a entre le nombre du peuple, & la facilité de le faire vivre. En Angleterre, le sol produit beaucoup plus de grains qu’il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres, & ceux qui procurent les vêtemens : il peut donc y avoir des arts frivoles, & par conséquent du luxe. En France il croît assez de blé pour la nourriture des laboureurs & de ceux qui sont employés aux manufactures. De plus, le commerce avec les étrangers peut rendre pour des choses frivoles tant de choses nécessaires, qu’on n’y doit guere craindre le luxe.
À la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes, & l’espece humaine s’y multiplie à un tel point, que les terres, quelque cultivées qu’elles soient, suffisent à peine pour la nourriture des habitans. Le luxe y est donc pernicieux, & [I-380] l’esprit de travail & d’économie y est aussi requis que dans quelques républiques que ce soit [1] . Il faut qu’on s’attache aux arts nécessaires ; & qu’on fuie ceux de la volupté.
Voilà l’esprit des belles ordonnances des empereurs Chinois. « Nos anciens, dit un empereur de la famille des Tang [2] , tenoient pour maxime, que s’il y avoit un homme qui ne labourât point, une femme qui ne s’occupât point à filer, quelqu’un souffroit le froid ou la faim dans l’empire » ... Et sur ce principe il fit détruire une infinité de monasteres de bonzes.
Le troisieme empereur de la vingt-unieme dynastie [3] , à qui on apporta des pierres précieuses trouvées dans une mine, la fit fermer, ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose qui ne pouvoit ni le nourrir ni le vêtir.
« Notre luxe est si grand, dit Kiayventi [4] , que le peuple orne de broderies les souliers des jeunes garçons [I-381] & des filles, qu’il est obligé de vendre ». Tant d’hommes étant occupés à faire des habits pour un seul, le moyen qu’il n’y ait bien des gens qui manquent d’habits ? Il y a dix hommes qui mangent le revenu des terres, contre un laboureur : le moyen qu’il n’y ait bien des gens qui manquent d’alimens ?
-
[↑] Le luxe y a toujours été arrêté.
-
[↑] Dans une ordonnance rapportée par le P. du Halde, tom. II, p. 497.
-
[↑] Hist. de la Chine, vingt-unieme dynastie, dans l’ouvrage du P. du Halde, tom. I.
-
[↑] Dans un discours rapporté par le P. du Halde, tom. III, p. 418.
[I-381]
CHAPITRE VII.
Fatale conséquence du luxe à la Chine.
On voit dans l’histoire de la Chine, qu’elle a eu vingt-deux dynasties qui se sont succédées, c’est-à-dire, qu’elle a éprouvé vingt-deux révolutions générales, sans compter une infinité de particulieres. Les trois premieres dynasties durerent assez long-temps, parce qu’elles furent sagement gouvernées, & que l’empire étoit moins étendu qu’il ne le fut depuis. Mais on peut dire en général que toutes ces dynasties commencerent assez bien. La vertu, l’attention, la vigilance sont nécessaires à la Chine ; elles y étoient dans le commencement des dynasties, & elles manquoient à la fin. En effet, il étoit naturel [I-382] que des empereurs nourris dans les fatigues de la guerre, qui parvenoient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices, conservassent la vertu qu’ils avoient éprouvée si utile, & craignissent les voluptés qu’ils avoient vues si funestes. Mais après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le luxe, l’oisiveté, les délices, s’emparerent des successeurs ; ils s’enferment dans le palais, leur esprit s’affoiblit, leur vie s’accourcit, la famille décline ; les grands s’élevent, les eunuques s’accréditent, on ne met sur le trône que des enfans, le palais devient ennemi de l’empire, un peuple oisif qui l’habite ruine celui qui travaille, l’empereur est tué ou détruit par un usurpateur, qui fonde une famille, dont le troisieme ou quatrieme successeur va dans le même palais se renfermer encore.
[I-382]
CHAPITRE VIII.
De la continence publique.
Il y a tant d’imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur ame est si fort dégradée, [I-383] ce point principal ôté en fait tomber tant d’autres, que l’on peut regarder dans un état populaire l’incontinence publique comme le dernier des malheurs & la certitude d’un changement dans la constitution.
Aussi les bons législateurs y ont-ils exigés des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont proscrit de leurs républiques non-seulement le vice, mais l’apparence même du vice. Ils ont banni jusqu’à ce commerce de galanterie qui produit l’oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d’être corrompues, qui donne un prix à tous les riens, & rabaisse ce qui est important, & qui fait que l’on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule que les femmes entendent si bien à établir.
[I-383]
CHAPITRE IX.
De la condition des femmes dans les divers gouvernemens.
Les femmes ont peu de retenue dans les monarchies ; parce que la distinction des rangs les appelant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté [I-384] qui est à peu près le seul qu’on y tolere. Chacun se sert de leurs agrémens & de leurs passions pour avancer sa fortune ; & comme leur foiblesse ne leur permet pas l’orgueil, mais la vanité, le luxe y regne toujours avec elles.
Dans les états despotiques les femmes n’introduisent point le luxe ; mais elles sont elles-mêmes un objet de luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l’esprit du gouvernement, & porte chez soi ce qu’il voit établi ailleurs. Comme les lois y sont séveres & exécutées sur le champ, on a peur que la liberté des femmes n’y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs penchans, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu’ont les petites ames d’intéresser les grandes, n’y sauroient être sans grande conséquence.
De plus, comme dans ces états les princes se jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs femmes, & mille considérations les obligent de les renfermer.
Dans les républiques les femmes sont libres par les lois, & captivées par les mœurs ; le luxe en est banni, & avec lui la corruption & les vices.
[I-385]
Dans les villes Grecques, où l’on ne vivoit pas sous cette religion qui établit que chez les hommes même la pureté des mœurs est une partie de la vertu ; dans les villes Grecques, où un vice aveugle régnoit d’une maniere effrenée, où l’amour n’avoit qu’une forme que l’on n’ose dire, tandis que la seule amitié s’étoit retire dans les mariages [1] ; la vertu, la simplicité, la chasteté des femmes y étoient telles, qu’on n’a guere jamais vu de peuple qui ait eu à cet égard une meilleure police [2] .
-
[↑] Quant au vrai amour, dit Plutarque, les femmes n’y ont aucune part ». Œuvres morales, traité de l’amour, p. 600. Il parloit comme son siecle. Voyez Xénophon, au dialogue intitulé, Hieron.
-
[↑] À Athenes il y avoit un magistrat particulier, qui veilloit sur la conduite des femmes.
[I-385]
CHAPITRE X.
Du tribunal domestique chez les Romains.
Les Romains n’avoient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n’avoient l’œil sur elles que comme sur le reste de la [I-386] république. L’institution du tribunal domestique [1] suppléa à la magistrature établie chez les Grecs [2] .
Le mari assembloit les parens de la femme ; & la jugeoit devant eux [3] . Ce tribunal maintenoit les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenoient ce tribunal. Il devoit juger non-seulement de la violation des mœurs. Or pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.
Les peines de ce tribunal devoient être arbitraires, & l’étoient en effet ; car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les regles de la modestie, ne peut guere être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois [I-387] ce qu’on doit aux autres ; il est difficile d’y comprendre tout ce qu’on se doit à soi-même.
Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des femmes : mais il y avoit un crime, qui, outre l’animadversion de ce tribunal, étoit encore soumis à une accusation publique : c’étoit l’adultere ; soit que dans une république une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement, soit que le déréglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari, soit enfin que l’on craignît que les honnêtes-gens même n’aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l’ignorer que le venger.
-
[↑] Romulus institua ce tribunal, comme il paroît par Denys d’Halicarnasse, liv. II, p. 96.
-
[↑] Voyez dans Tite-Live, liv. XXXIX, l’usage que l’on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales : on appela conjuration contre la république, des assemblées où l’on corrompoit les mœurs des femmes & des jeunes gens.
-
[↑] Il paroît par Denys d’Halicarnasse, liv. II, que par l’institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeoit seul devant les parens de la femme ; & que dans les grands crimes, il la jugeoit avec cinq d’entr’eux. Aussi Ulpien, au titre 6. §. 9, 12 & 13, distingue-t-il dans les jugemens des mœurs, celles qu’il appelle grave d’avec celles qui l’étoient moins, mores graviores, mores leviores.
[I-387]
CHAPITRE XI.
Comment les institutions changerent à Rome avec le gouvernement.
Comme le tribunal domestique supposoit des mœurs, l’accusation publique en supposoit aussi, & cela fit que ces deux choses tomberent avec les [I-388] mœurs & finirent avec la république [1] .
L’établissement des questions perpétuelles, c’est-à-dire, du partage de la juridiction entre les préteurs, & la coutume qui s’introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes [2] toutes les affaires, affoiblirent l’usage du tribunal domestique ; ce qui paroît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers & comme un renouvellement de la pratique ancienne, les jugemens que Tibere fit rendre par ce tribunal.
L’établissement de la monarchie & le changement des mœurs firent encore cesser l’accusation publique. On pouvoit craindre qu’un mal honnête homme piqué des mépris d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julie ordonna qu’on ne pourroit accuser une femme d’adultere, qu’après avoir accusé son mari de favoriser ses déréglemens ; ce qui restreignit beaucoup [I-389] cette accusation, & l’anéantit pour ainsi dire [3] .
Sixte-Quint sembla vouloir renouveller l’accusation publique [4] . Mais il ne faut qu’un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, étoit encore plus déplacée que dans toute autre.
-
[↑] Judicio de moribus (quòd antcà quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur penitùs abolito. Leg. II, cod. de repud.
-
[↑] Judicia extraordinaria.
-
[↑] Constantin l’ôta entiérement : « C’est une chose indigne, disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l’audace des étrangers ».
-
[↑] Sixte V ordonna qu’un mari qui n’iroit point se plaindre à lui des débauches de sa femme, seroit puni de mort. Voyez Leti.
[I-389]
CHAPITRE XII.
De la tutelle des femmes chez les Romains.
Les institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu’elles ne fussent sous l’autorité d’un mari [1] . Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens par mâles ; & il paroît, par une expression vulgaire [2] , qu’elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la [I-390] république, & n’étoit point nécessaire dans la monarchie [3] .
Il paroît, par les divers codes des lois des barbares, que les femmes chez les premiers Germains étoient aussi dans une perpétuelle tutelle [4] . Cet usage passa dans les monarchies qu’ils fonderent ; mais il ne subsista pas.
-
[↑] Nisi convenissent in manum viri.
-
[↑] Ne sis mihi patruus oro.
-
[↑] La loi Papienne ordonna, sous Auguste, que les femmes qui auroient eu trois enfans, seroient hors de cette tutelle.
-
[↑] Cette tutelle s’appeloit chez les Germains, Mundeburdium.
[I-390]
CHAPITRE XIII.
Des peines établies par les Empereurs contre les débauches des femmes.
La loi Julie établit une peine contre l’adultere. Mais bien loin que cette loi, & celle que l’on fit depuis là-dessus, fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent au contraire une marque de leur dépravation.
Tout le systême politique à l’égard des femmes changea dans la monarchie. Il ne fut plus question d’établir chez elles la pureté des mœurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisoit de nouvelles [I-391] lois pour punir ces crimes, que parce qu’on ne punissoit plus les violations, qui n’étoient point ces crimes.
L’affreux débordement des mœurs obligeoit bien les empereurs de faire des lois pour arrêter à un certain point l’impudicité : mais leur intention ne fut pas de corriger les mœurs en général. Des faits positifs rapportés par les historiens prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauroient prouver le contraire. On peut voir dans Dion la conduite d’Auguste à cet égard ; & comment il éluda, & dans sa préture & dans sa censure, les demandes qui lui furent faites [1] .
On trouve bien dans les historiens des jugemens rigides, rendus sous Auguste & sous Tibere, contre l’impudicité de quelques dames Romaines : mais en [I-392] nous faisant connoître l’esprit de ces regnes, ils nous font connoître l’esprit de ces jugemens.
Auguste & Tibere songerent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissoient point le déréglement des mœurs, mais un certain crime d’impiété ou de lese-majesté [2] qu’ils avoient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De-là vient que les auteurs Romains s’élevent si fort contre cette tyrannie.
La peine de la loi Julie étoit légere [3] . Les empereurs voulurent que dans les jugemens on augmentât la peine de la loi qu’ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n’examinoient pas si les femmes méritoient d’être punies, mais si l’on avoit violé la loi pour les punir.
Une des principales tyrannies de Tibere [4] fut l’abus qu’il fit des anciennes [I-393] lois. Quand il voulut punir quelque dame Romaine au-delà de la peine portée par la loi Julie, il rétablit contre elles le tribunal domestique [5] .
Ces dispositions à l’égard des femmes ne regardoient que les familles des sénateurs, & non pas celles du peuple. On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands, & les déportemens des femmes en pouvoient fournir sans nombre.
Enfin ce que j’ai dit, que la bonté des mœurs n’est pas le principe du gouvernement d’un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs ; & si l’on en doutoit, on n’auroit qu’à lire Tacite, Suétone, Juvenal & Martial.
-
[↑] Comme on lui eut amené un jeune homme qui avoit épousé une femme, avec laquelle il avoit eu auparavant un mauvais commerce, il hésita longtemps, n’osant ni approuver, ni punir ces choses. Enfin reprenant ses esprits : « les séditions ont été cause de grands maux, dit-il, oublions-les ». Dion, liv. LIV. Les sénateurs lui ayant demandé des réglemens sur les mœurs des femmes, il éluda cette demande, en leur disant qu’ils corrigeassent leurs femmes, comme il corrigeoit la sienne : sur quoi ils le prierent de leur dire comment il en usoit avec sa femme : question, ce me semble, fort indiscrete.
-
[↑] Culpam inter viros & feminas vulgatam gravi nomine lsarum religionum appeliando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur. Tacite, Annal. liv. III.
-
[↑] Cette loi est rapportée au digeste ; mais on n’y a pas mis la peine. On juge qu’elle n’étoit que de la relégation, puisque celle de l’inceste n’étoit que de la déportation. Leg. si quis viduam, ss. de quest.
-
[↑] Proprium id Tiberio suit, sceiera nuper reperto priscis verbis obtegere, Tacit.
-
[↑] Adulterii graviorem pœnam deprecatus, ut exemplo majorum, propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretus, suafit. Adultero Manlio Italiâ atque Africâ interdictum est. Tacite, Annal. liv. II.
[I-393]
CHAPITRE XIV.
Lois somptuaires chez les Romains.
Nous avons parlé de l’incontinence publique, parce qu’elle est jointe avec le luxe, qu’elle en est toujours suivie, & qu’elle le fuit toujours. Si [I-394] vous laissez en liberté les mouvemens du cœur, comment pourrez-vous gêner les foiblesses de l’esprit ?
À Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire par les magistrats plusieurs lois particulieres, pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois Fanniene, Lycinienne & Oppienne eurent cet objet. Il faut voir dans Tite Live [1] comment le sénat fut agité, lorsqu’elles demanderent la révocation de la loi Oppienne. Valere-Maxime met l’époque du luxe chez les Romains à l’abrogation de cette loi.
-
[↑] Décade IV, liv. IV.
[I-394]
CHAPITRE XV.
Des dots & des avantages nuptiaux dans les diverses constitutions.
Les dots doivent être considérables dans les monarchies, afin que les maris puissent soutenir leur rang & le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas régner [1] . Elles doivent être [I-395] à peu près nulles dans les états despotiques, où les femmes sont en quelque façon esclaves.
La communauté des biens introduite par les lois Françoises entre le mari & la femme, est très-convenable dans le gouvernement monarchique ; parce qu’elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, & les rappelle comme malgré elles au soin de leur maison. Elle l’est moins dans la république, où les femmes ont plus de vertu. Elle seroit absurde dans les états despotiques, où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître.
Comme les femmes, par leur état, sont assez portées au mariage, les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles. Mais ils seroient très-pernicieux dans une république, parce que leurs richesses particulieres produisent le luxe. Dans les états despotiques, les gains de noces doivent être leur subsistance, & rien de plus.
-
[↑] Marseille fut la plus sage des républiques de son temps ; les dots ne pouvoient passer cent écus en argent, & cinq en habits, dit Strabon, liv. IV.
[I-396]
CHAPITRE XVI.
Belle coutume des Samnites.
Les Samnites avoient une coutume, qui, dans une petite république, & sur-tout dans la situation où étoit la leur, devoit produire d’admirables effets. On assembloit tous les jeunes gens, & on les jugeoit. Celui qui étoit déclaré le meilleur de tous, prenoit pour sa femme la fille qu’il vouloit ; celui qui avoit les suffrages après lui choisissoit encore ; & ainsi de suite [1] . Il étoit admirable de ne regarder entre les biens des garçons que les belles qualités & les services rendus à la patrie. Celui qui étoit le plus riche de ces sortes de biens choisissoit une fille dans toute la nation. L’amour, la beauté, la chasteté, la vertu, la naissance, les richesses même, tout cela étoit, pour ainsi dire, la dot de la vertu. Il seroit difficile d’imaginer une récompense plus noble, plus grande, moins à charge à un petit état, plus capable d’agir sur l’un & l’autre sexe.
[I-397]
Les Samnites descendoient des Lacédémoniens ; & Platon, dont les institutions ne sont que la perfection des lois de Lycurgue, donna à peu près une pareille loi [2] .
-
[↑] Fragm. de Nicolas de Damas, toré de Stobée dans le recueil de Constantin Porphyrogenete.
-
[↑] Il leur permet même de se voir plus fréquemment.
[I-397]
CHAPITRE XVII.
De l’administration des femmes.
Il est contre la raison & contre la nature, que les femmes soient maîtresses dans la maison, comme cela étoit établi chez les Egyptiens : mais il ne l’est pas qu’elles gouvernent un empire. Dans le premier cas, l’état de foiblesse où elles sont ne leur permet pas la prééminence ; dans le second, leur foiblesse même leur donne plus de douceur & de modération ; ce qui peut faire un bon gouvernement, plutôt que les vertus dures & féroces.
Dans les Indes on se trouve très-bien du gouvernement des femmes; & il est établi, que si les mâles ne viennent pas d’une mere du même sang, les filles qui ont une mere du sang royal [I-398] succedent [1] . On leur donne un certain nombre de personnes pour les aider à porter le poids du gouvernement. Selon M. Smith [2] , on se trouve aussi très-bien du gouvernement des femmes en Afrique. Si l’on ajoute à cela l’exemple de la Moscovie & de l’Angleterre, on verra qu’elles réussissent également & dans le gouvernement modéré & dans le gouvernement despotique.
-
[↑] Lettres édifiantes, recueil 14.
-
[↑] Voyage de Guinée, seconde partie, pag. 165, de la traduction, sur le royaume d’Angona sur la Côte d’Or.
[I-399]
LIVRE VIII.
De la corruption des principes des trois gouvernemens.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée générale de ce Livre.
La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes.
[I-399]
CHAPITRE II.
De la corruption du principe de la démocratie.
Le principe de la démocratie se corrompt, non-seulement lorsqu’on perd l’esprit d’égalité, mais encore quand on prend l’esprit d’égalité extrême, & que chacun veut être égal à ceux qu’il choisit pour lui commander. Pour lors le peuple ne pouvant souffrir le pouvoir [I-400] même qu’il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, & dépouiller tous les juges.
Il ne peut plus y avoir de vertu dans la république. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats ; on ne les respecte donc plus. Les délibérations du sénat n’ont plus de poids ; on n’a donc plus d’égard pour les sénateurs, & par conséquent pour les vieillards. Que si l’on n’a pas du respect pour les vieillards, on n’en aura pas non plus pour les peres ; les maris ne méritent pas plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage ; la gêne du commandement fatiguera comme celle de l’obéissance. Les femmes, les enfans, les esclaves, n’auront de soumission pour personne. Il n’y aura plus de mœurs, plus d’amour de l’ordre, enfin plus de vertu.
On voit dans le banquet de Xénophon, une peinture bien naïve d’une république où le peuple a abusé de l’égalité. Chaque convive donne à son tour la raison pourquoi il est content de lui. « Je suis content de moi, dit Chamides, à cause de ma pauvreté. Quand [I-401] j’étois riche, j’étois obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sachant bien que j’étois plus en état de recevoir du mal d’eux que de leur en faire. La république me demandoit toujours quelque nouvelle somme ; je ne pouvois m’absenter. Depuis que je suis pauvre, j’ai acquis de l’autorité ; personne ne me menace, je menace les autres ; je puis m’en aller ou rester. Déjà les riches se levent de leurs places & me cedent le pas. Je suis un roi, j’étois esclave ; je payois un tribut à la république, aujourd’hui elle me nourrit ; je ne crains plus de perdre, j’espere d’acquérir.
Le peuple tombe dans ce malheur, lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu’il ne voie pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur ; pour qu’ils n’apperçoive pas leur avarice, ils flattent sans cesse la sienne.
La corruption augmentera parmi les corrupteurs ; & elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers [I-402] publics ; & comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusemens du luxe. Mais avec sa paresse & son luxe, il n’y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui.
Il ne faudra pas s’étonner si l’on voit les suffrages se donner pour de l’argent. On ne peut donner beaucoup au peuple, sans retirer encore plus de lui : mais pour retirer de lui, il faut renverser l’état. Plus il paroîtra tirer d’avantage de sa liberté, plus il s’approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans, qui ont tous les vices d’un seul. Bientôt ce qui reste de liberté devient insupportable ; un seul tyran s’éleve, & le peuple perd tout jusqu’aux avantages de sa corruption.
La démocratie a donc deux excès à éviter ; l’esprit d’inégalité, qui la mene à l’aristocratie, ou au gouvernement d’un seul ; & l’esprit d’égalité extrême, qui la conduit au despotisme d’un seul, comme le despotisme d’un seul finit par la conquête.
Il est vrai que ceux qui corrompirent les républiques Grecques ne devinrent pas toujours tyrans. C’est qu’ils étoient [I-403] plus attachés à l’éloquence qu’à l’art militaire : outre qu’il y avoit dans le cœur de tous les Grecs une haine implacable contre ceux qui renversoient le gouvernement républicain ; ce qui fit que l’anarchie dégénéra en anéantissement, au lieu de se changer en tyrannie.
Mais Syracuse, qui se trouva placée au milieu d’un grand nombre de petites oligarchies changées en tyrannie [1] ; Syracuse qui avoit un Sénat [2] dont il n’est presque jamais fait mention dans l’histoire, essuya des malheurs que la corruption ordinaire ne donne pas. Cette ville toujours dans la licence [3] ou dans l’oppression, également travaillée par sa liberté & par sa servitude, recevant toujours l’une & l’autre comme une tempête ; & malgré sa puissance [I-404] au dehors, toujours déterminée à une révolution par la plus petite force étrangere, avoit dans son sein un peuple immense, qui n’eut jamais que cette cruelle alternative de se donner un tyran, ou de l’être lui-même.
-
[↑] Voyez Plutarque, dans les vies de Timoléon & de Dion.
-
[↑] C’est celui des six cents, donc parle Diodore.
-
[↑] Ayant chassé les tyrans, ils firent citoyens des étrangers & des soldats mercenaires, ce qui causa des guerres civiles : Aristote, Politiq. liv. V, ch. III. Le peuple ayant été cause de la victoire sur les Athéniens, la république fut changée, ibid. ch. IV. La passion de deux jeunes magistrats, dont l’un enleva à l’autre un jeune garçon, & celui-ci débaucha sa femme, fit changer la forme de cette république : ibid. Liv. VII, chap. IV.
[I-404]
CHAPITRE III.
De l’esprit d’égalité extrême.
Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d’égalité l’est-il de l’esprit d’égalité extrême. Le premier ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande, ou que personne ne soit commandé ; mais à obéir & à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n’avoir point de maître, mais à n’avoir que ses égaux pour maîtres.
Dans l’état de nature les hommes naissent bien dans l’égalité : mais ils n’y sauroient rester. La société la leur fait perdre, & ils ne redeviennent égaux que par les lois.
Telle est la différence entre la démocratie réglée & celle qui ne l’est pas ; que dans la premiere, on n’est égal que [I-405] comme citoyen ; & que dans l’autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme pere, comme mari, comme maître.
La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté : mais elle ne se trouve pas plus auprès de la liberté extrême, qu’auprès de la servitude.
[I-405]
CHAPITRE IV.
Cause particuliere de la corruption du peuple.
Les grands succès, sur-tout ceux auxquels le peuple contribue beaucoup, lui donnent un tel orgueil, qu’il n’est plus possible de le conduire. Jaloux des magistrats, il le devient de la magistrature ; ennemi de ceux qui gouvernent, il l’est bientôt de la constitution. C’est ainsi que la victoire de Salamine sur les Perses corrompit la république d’Athenes [1] ; c’est ainsi que la défaite des Athéniens perdit la république de Syracuse [2] .
Celle de Marseille n’éprouva jamais [I-406] ces grands passages de l’abaissement à la grandeur : aussi se gouverna-t-elle toujours avec sagesse, aussi conserva-t-elle ses principes.
[I-406]
CHAPITRE V.
De la corruption du principe de l’aristocratie.
L’aristocratie se corrompt lorsque le pouvoir des nobles devient arbitraire : il ne peut plus y avoir de vertu dans ceux qui gouvernent, ni dans ceux qui sont gouvernés.
Quand les familles régnantes observent les lois, c’est une monarchie qui a plusieurs monarques, & qui est très-bonne par sa nature ; presque tous ces monarques sont liés par les lois. Mais quand elles ne les observent pas, c’est un état despotique qui a plusieurs despotes.
Dans ce cas la république ne subsiste qu’à l’égard des nobles, & entr’eux seulement. Elle est dans le corps qui gouverne, & l’état despotique est dans le corps qui est gouverné ; ce qui fait les deux corps du monde les plus désunis.
[I-407]
L’extrême corruption est lorsque les nobles deviennent héréditaires [1] ; ils ne peuvent plus guere avoir de modération. S’ils sont en petit nombre, leur pouvoir est plus grand, mais leur sureté diminue ; s’ils sont en plus grand nombre, leur pouvoir est moindre, & leur sureté plus grande : en sorte que le pouvoir va croissant, & la sureté diminuant, jusqu’au despote sur la tête duquel est l’excès du pouvoir & du danger.
Le grand nombre des nobles dans l’aristocratie héréditaire rendra donc le gouvernement moins violent : mais comme il y aura peu de vertu, on tombera dans un esprit de nonchalance, de paresse, d’abandon, qui fera que l’état n’aura plus de force ni de ressort [2] .
Une aristocratie peut maintenir la force de son principe, si les lois sont telles qu’elles fassent plus sentir aux nobles les périls & les fatigues du commandement que ses délices ; & si l’état est dans une telle situation, qu’il ait quelque chose à redouter ; & que la sureté vienne du dedans, & l’incertitude du dehors.
[I-408]
Comme une certaine confiance fait la gloire & la sureté d’une monarchie, il faut au contraire qu’une république redoute quelque chose [3] . La crainte des Perses maintint les lois chez les Grecs. Carthage & Rome s’intimiderent l’une l’autre, & s’affermirent. Chose singuliere ! plus ces états ont de sureté, plus, comme des eaux trop tranquilles, ils sont sujets à se corrompre.
-
[↑] L’aristocratie se change en oligarchie.
-
[↑] Venise est une des républiques qui a le mieux corrigé par ses lois les inconvéniens de l’arsitocratie héréditaire.
-
[↑] Justin attribue à la mort d’Epaminondas l’extinction de la vertu à Athenes. N’ayant plus d’émulation, ils dépenserent leurs revenus en fêtes : frequentius cœnam quàm castra visentes. Pour lors les Macédoniens sortirent de l’obscurité. Liv. VI.
[I-408]
CHAPITRE VI.
De la corruption du principe de la monarchie.
Comme les démocraties se perdent lorsque le peuple dépouille le sénat, les magistrats & les juges de leurs fonctions ; les monarchies se corrompent lorsqu’on ôte peu à peu les prérogatives des corps, ou les privileges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous ; dans l’autre, au despotisme d’un seul.
[I-409]
« Ce qui perdit les dynasties de Tsin & de Soüi, dit un auteur Chinois, c’est qu’au lieu de se borner comme les anciens, à une inspection générale, seule digne du souverain, les princes voulurent gouverner immédiatement pas eux-mêmes [1] ». L’auteur Chinois nous donne ici la cause de la corruption de presque toutes les monarchies.
La monarchie se perd lorsqu’un prince croit qu’il montre plus sa puissance, en changeant l’ordre des choses qu’en le suivant, lorsqu’il ôte les fonctions naturelles des uns, pour les donner arbitrairement à d’autres, & lorsqu’il est plus amoureux de ses fantaisies que de ses volontés.
La monarchie se perd, lorsque le prince rapportant tout uniquement à lui, appelle l’état à sa capitale, la capitale à sa cour, & la cour à sa seule personne.
Enfin elle se perd, lorsqu’un prince méconnoît son autorité, sa situation, l’amour de ses peuples, & lorsqu’il ne sent pas bien qu’un monarque doit se juger en sureté comme un despote doit se croire en péril.
-
[↑] Compilation d’ouvrages fait sous les Ming rapportés par le Pere du Halde.
[I-410]
CHAPITRE VII.
Continuation du même sujet.
Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque les premieres dignités sont les marques de la premiere servitude, lorsqu’on ôte aux grands le respect des peuples, & qu’on les rend de vils instrumens du pouvoir arbitraire.
Il se corrompt encore plus, lorsque l’honneur a été mis en contradiction avec les honneurs, & que l’on peut être à la fois couvert d’infamie [1] & de dignités.
Il se corrompt lorsque le prince change sa justice en sévérité ; lorsqu’il met, comme les empereurs Romains, [I-411] une tête de Méduse sur sa poitrine [2] lorsqu’il prend cet air menaçant & terrible que Commode faisoit donner à ses statues [3] .
Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque des ames singuliérement lâches, tirent vanité de la grandeur que pourroit avoir leur servitude ; & qu’elles croient que ce qui fait que l’on doit tout au prince, fait que l’on ne doit rien à sa patrie.
Mais, s’il est vrai (ce que l’on a vu dans tous les temps), qu’à mesure que le pouvoir du monarque devient immense, sa sureté diminue ; corrompre ce pouvoir, jusqu’à le faire changer de nature, n’est-ce pas un crime de lese-majesté contre lui ?
-
[↑] Sous le regne de Tibere on éleva des statues & l’on donna les ornemens triomphaux aux délateurs ; ce qui avilit tellement ces honneurs, que ceux qui les avoient mérités les dédaignerent. Fragm. de dion, Liv. LVIII, tiré de l’extrait des vertus & des vices de Constant. Porphyrog. Voyez dans Tacite, comment Néron, sur la découverte & la punition d’une prétendue conjuration, donna à Petronius Turpilianus, à Nerva, à Tigellinus, les ornemens triomphaux. Annal. Liv. XIV. Voyez aussi comment les généraux dédaignerent de faire la guerre, parce qu’ils en méprisoient les honneurs, pervulgatis triumphi insignibus, Tacit. Annal. Liv. XIII.
-
[↑] Dans cet état, le prince savoit bien quel étoit le principe de son gouvernement.
-
[↑] Hérodien.
[I-411]
CHAPITRE VIII.
Danger de la corruption du principe du gouvernement monarchique.
L’inconvénient n’est pas lorsque l’état passe d’un gouvernement modéré à un gouvernement modéré ; [I-412] comme de la république à la monarchie, ou de la monarchie à la république ; mais quand il tombe & se précipite du gouvernement modéré au despotisme.
La plupart des peuples d’Europe sont encore gouvernés par les mœurs. Mais, si par un long abus du pouvoir, si par une grande conquête, le despotisme s’établissoit à un certain point, il n’y auroit pas de mœurs ni de climat qui tinssent ; & dans cette belle partie du monde la nature humaine souffriroit, au moins pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres.
[I-412]
CHAPITRE IX.
Combien la noblesse est portée à défendre le trône.
La noblesse Angloise s’ensevelit avec Charles premier sous les débris du trône ; & avant cela, lorsque Philippe second fit entendre aux oreilles des François le mot de liberté, la couronne fut toujours soutenue par cette noblesse, qui tient à honneur d’obéir à un roi, mais qui regarde comme la souveraine infamie de partager la puissance avec le peuple.
[I-413]
On a vu la maison d’Autriche travailler sans relâche à opprimer la noblesse Hongroise. Elle ignoroit de quel prix elle lui seroit quelque jour. Elle cherchoit chez ces peuples de l’argent qui n’y étoit pas ; elle ne voyoit pas des hommes qui y étoient. Lorsque tant de princes partageoit entr’eux ses états, toutes les pieces de sa monarchie immobiles & sans action tomboient, pour ainsi dire, les unes sur les autres. Il n’y avoit de vie que dans cette noblesse qui s’indigna, oublia tout pour combattre, & crut qu’il étoit de sa gloire de périr & de pardonner.
[I-413]
CHAPITRE X.
De la corruption du principe du gouvernement despotique.
Le principe du gouvernement despotique se corrompt sans cesse, parce qu’il est corrompu par sa nature. Les autres gouvernemens périssent, parce que des accidens particuliers en violent le principe ; celui-ci périt par son vice intérieur, lorsque quelques causes accidentelles n’empêchent point son principe [I-414] de se corrompre. Il ne se maintient donc que dans des circonstances tirées du climat, de la religion, de la situation, ou du génie du peuple, le forcent à suivre quelque ordre & à souffrir quelque regle. Ces choses forcent sa nature, sans la changer ; sa férocité reste ; elle est pour quelque temps apprivoisée.
[I-414]
CHAPITRE XI.
Effets naturels de la bonté & de la corruption des principes.
Lorsque les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meilleures lois deviennent mauvaises, & se tournent contre l’état ; lorsque les principes en sont sains, les mauvaises ont l’effet des bonnes ; la force du principe entraîne tout.
Les Crétois, pour tenir les premiers magistrats dans la dépendance des lois, employoient un moyen bien singulier ; c’étoit celui de l’insurrection. Une partie des citoyens se soulevoit [1] , mettoit en fuite les magistrats, & les obligeoit [I-415] de rentrer dans la condition privée. Cela étoit censé fait en conséquence de la loi. Une institution pareille, qui établissoit la sédition pour empêcher l’abus du pouvoir, sembloit devoir renverser quelque république que ce fût ; elle ne détruisit pas celle de Crete. Voici pourquoi [2] .
Lorsque les anciens vouloient parler d’un peuple qui avoit le plus grand amour pour la patrie, ils citoient les Crétois : La patrie, disoit Platon [3] , nom si tendre aux Crétois. Ils l’appeloient d’un nom qui exprime l’amour d’une mere pour ses enfans [4] . Or l’amour de la patrie corrige tout.
Les lois de Pologne ont aussi leur insurrection. Mais les inconvéniens qui en résultent, font bien voir que le seul peuple de Crete étoit en état d’employer avec succès un pareil remede.
Les exercices de la gymnastique établis chez les Grecs ne dépendirent pas moins de la bonté du principe du [I-416] gouvernement. « Ce furent les Lacédémoniens & les Crétois, dit Platon [5] , qui ouvrirent ces académies fameuses, qui leur firent tenir dans le monde un rang si distingué. La pudeur s’alarma d’abord ; mais elle céda à l’utilité publique ». Du temps de Platon, ces institutions étoient admirables [6] ; elles se rapportoient à un grand objet, qui étoit l’art militaire. Mais lorsque les Grecs n’eurent plus de vertu, elles détruisirent l’art militaire même ; on ne descendit plus sur l’arene pour se former, mais pour se corrompre [7] .
Plutarque nous dit [8] que de son temps les Romains pensoient que ces jeux avoient été la principale cause de [I-417] la servitude où étoient tombés les Grecs. C’étoit au contraire la servitude des Grecs qui avoit corrompu ces exercices. Du temps de Plutarque [9] , les parcs où l’on combattoit à nud, & les jeux de la lutte, rendoient les jeunes gens lâches, les portoient à un amour infame, & n’en faisoient que des baladins. Mais du temps d’Epaminondas, l’exercice de la lutte faisoit gagner aux Thébains la bataille de Leuctres [10] .
Il y a peu de lois qui ne soient bonnes, lorsque l’état n’a point perdu ses principes ; &, comme disoit Epicure en parlant des richesses, ce n’est point la liqueur qui est corrompue, c’est le vase.
-
[↑] Aristote, Politiq. Liv. II, ch. X.
-
[↑] On se réunissoit toujours d’abord contre les ennemis du dehors, ce qui s’appeloit syncrétismes. Plutarque, Moral. p. 88.
-
[↑] Répub. liv. IX.
-
[↑] Plutarq. Morales, au Traité, si l’homme d’âge doit se mêler des affaires publiques.
-
[↑] Républ. Liv. V.
-
[↑] La gymnastique se divisoit en deux parties, la danse & la lutte. On voyoit en Crete les danses armées de Curettes, à Lacédémone celles de Castor & de Pollux ; à Athenes, les danses armées de Pallas, très-propres pour ceux qui ne sont pas encore en âge d’aller à la guerre. La lutte est l’image de la guerre, dit Platin, des lois, liv. VII. Il loue l’antiquité de n’avoir établi que deux danses, la pacifique & la Pyrrhique. Voyez comment cette derniere danse s’appliquoit à l’art militaire. Platon, ibid.
-
[↑] Aut libidinosœ
Ledœas Lacedœmonis palœstras
Martial, lib. IV. epig. 55. -
[↑] Œuvres morales, au Traité des demandes des choses Romaines.
-
[↑] Plutarque, ibid.
-
[↑] Plutarque, Morales, propos de tables, liv. II.
[I-417]
CHAPITRE XII.
Continuation du même sujet.
On prenoit à Rome les juges dans l’ordre des sénateurs. Les Gracques transporterent cette prérogative aux chevaliers. Drufus la donna aux sénateurs & aux chevaliers ; Sylla aux sénateurs seuls ; Cotta aux sénateurs, aux [I-418] chevaliers & aux trésoriers de l’épargne. César exclut ces derniers. Antoine fit des décuries de sénateurs, de chevaliers & de centurions.
Quand une république est corrompue, on ne peut remédier à aucun des maux qui naissent, qu’en ôtant la corruption & en rappellant les principes : toute autre correction est ou inutile ou un nouveau mal. Pendant que Rome conserva ses principes, les jugemens purent être sans abus entre les mains des sénateurs : mais quand elle fut corrompue, à quelque corps que ce fût qu’on transportât les jugemens, aux sénateurs, aux chevaliers, aux trésoriers de l’épargne, à deux de ces corps, à tous les trois ensemble, à quelqu’autre corps que ce fût, on étoit toujours mal. Les chevaliers n’avoient pas plus de vertu que les sénateurs, les trésoriers de l’épargne pas plus que les chevaliers, & ceux-ci aussi peu que les centurions.
Lorsque le peuple de Rome eut obtenu qu’il auroit part aux magistratures patriciennes, il étoit naturel de penser que ses flatteurs alloient être les arbitres du gouvernement. Non : l’on vit ce peuple, qui rendoit les magistratures [I-419] communes aux plébéiens, élire toujours des patriciens. Parce qu’il étoit vertueux, il étoit magnanime ; parce qu’il étoit libre, il dédaignoit le pouvoir. Mais lorsqu’il eut perdu ses principes, plus il eut de pouvoir, moins il eut de ménagemens ; jusqu’à ce qu’enfin, devenu son propre tyran & son propre esclave, il perdit la force de la liberté pour tomber dans la foiblesse de la licence.
[I-419]
CHAPITRE XIII.
Effet du serment chez un peuple vertueux.
Il n’y a point eu de peuple, dit Tite-Live [1] , où la dissolution se soit plus tard introduite que chez les Romains, & où la modération & la pauvreté aient été plus long-temps honorées.
Le serment eut tant de force chez ce peuple, que rien ne l’attacha plus aux lois. Il fit bien des fois pour l’observer, ce qu’il n’auroit jamais fait pour la gloire ni pour la patrie.
Quintius Cincinnatus, consul, ayant voulu lever une armée dans la ville [I-420] contre les Eques & les Volsques, les tribuns s’y opposerent. « Eh bien, dit-il, que tous ceux qui ont fait serment au consul de l’année précédente marchent sous mes enseignes [2] ». En vain les tribuns s’écrierent-ils qu’on n’étoit plus lié par ce serment ; que quand on l’avoit fait, Quintius étoit un homme privé : le peuple fut plus religieux que ceux qui se mêloient de le conduire ; il n’écouta ni les distinctions ni les interprétations des tribuns.
Lorsque le même peuple voulut se retirer sur le Mont-sacré, il se sentit retenir par le serment qu’il avoit fait aux consuls de les suivre à la guerre [3] . Il forma le dessein de les tuer : on lui fit entendre que le serment n’en subsisteroit pas moins. On peut juger de l’idée qu’il avoit de la violation du serment, par le crime qu’il vouloit commettre.
Après la bataille de Cannes, le peuple effrayé voulut se retirer en Sicile ; Scipion lui fit jurer qu’il resteroit à Rome ; la crainte de violer leur serment surmonta toute autre crainte. Rome étoit un vaisseau tenu par deux ancres dans la tempête, la religion & les mœurs.
[I-421]
CHAPITRE XIV.
Comment le plus petit changement dans la constitution, entraîne la ruine des principes.
Aristote nous parle de la république de Carthage, comme d’une république très-bien réglée. Polybe nous dit qu’à la seconde guerre punique [1] il y avoit à Carthage cet inconvénient, que le sénat avoit perdu presque toute son autorité. Tite-Live nous apprend que lorsqu’Annibal retourna à Carthage, il trouva que les magistrats & les principaux citoyens détournoient à leur profit les revenus publics, & abusoient de leur pouvoir. La vertu des magistrats tomba donc avec l’autorité du sénat ; tout coula du même principe.
On connoît les prodiges de la censure chez les Romains. Il y eut un temps où elle devint pesante ; mais on la soutint, parce qu’il y avoit plus de luxe que de corruption. Claudius l’affoiblit ; & par cet affoiblissement, la corruption devint encore plus grande que le luxe ; & la [I-422] censure [2] s’abolit, pour ainsi dire, d’elle-même. Troublée, demandée, reprise, quittée, elle fut entiérement interrompue jusqu’au temps où elle devint inutile, je veux dire les regnes d’Auguste & de Claude.
-
[↑] Environ cent ans après.
-
[↑] Voyez Dion, liv. XXXVIII. la vie de Cicéron dans Plutarque : Cicéron à Atticus, liv. IV. lett. 10 & 15 : Asconius sur Cicéron De Divinatione.
[I-422]
CHAPITRE XV.
Moyens très-efficaces pour la conservation des trois principes.
Je ne pourrai me faire entendre, que lorsqu’on aura lu les quatre chapitres suivans.
[I-422]
CHAPITRE XVI.
Propriétés distinctives de la république.
Il est de la nature d’une république, qu’elle n’ait qu’un petit territoire : sans cela elle ne peut guere subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes, & par conséquent peu de modération dans les esprits ; il y a de trop grands dépôts à mettre entre les [I-423] mains d’un citoyen ; les intérêts se particularisent ; un homme sent d’abord qu’il peut être heureux, grand, glorieux dans sa patrie ; & bientôt, qu’il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie.
Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations ; il est subordonné à des exceptions ; il dépend des accidens. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen ; les abus y sont moins étendus, & par conséquent moins protégés.
Ce qui fit subsister si long-temps Lacédémone, c’est qu’après toutes ses guerres, elle resta toujours avec son territoire. Le seul but de Lacédémone étoit la liberté ; le seul avantage de sa liberté, c’étoit la gloire.
Ce fut l’esprit des Républiques Grecques de se contenter de leurs terres, comme de leurs lois. Athenes prit de l’ambition, & en donna à Lacédémone : mais ce fut plutôt pour commander à des peuples libres, que pour gouverner des esclaves ; plutôt pour être à la tête de l’union, que pour la rompre. Tout fut perdu lorsqu’une monarchie s’éleva ; gouvernement dont [I-424] l’esprit est le plus tourné vers l’agrandissement.
Sans des circonstances particulieres [1] , il est difficile que tout autre gouvernement que le républicain puisse subsister dans une seule ville. Un prince d’un si petit état chercheroit naturellement à opprimer, parce qu’il auroit une grande puissance, & peu de moyens pour en jouir ou pour la faire respecter : il fouleroit donc beaucoup ses peuples. D’un autre côté, un tel prince seroit aisément opprimé par une force étrangere, ou même par une force domestique ; le peuple pourroit à tous les instans s’assembler & se réunir contre lui. Or quand un prince d’une ville est chassé de sa ville, le procès est fini ; s’il a plusieurs villes, le procès n’est que commencé.
-
[↑] Comme quand un petit souverain se maintient entre deux grands états par leur jalousie mutuelle ; mais il n’existe que précairement
[I-424]
CHAPITRE XVII.
Propriétés distinctives de la monarchie.
Un état monarchique doit être d’une grandeur médiocre. S’il étoit petit, il se formeroit en république. S’il étoit [I-425] fort étendu, les principaux de l’état, grands par eux-mêmes, n’étant point sous les yeux du prince, ayant leur cour hors de sa cour, assurés d’ailleurs contre les exécutions promptes par les lois & par les mœurs, pourroient cesser d’obéir ; ils ne craindroient pas une punition trop lente & trop éloignée.
Aussi Charlemagne eut-il à peine fondé son empire, qu’il fallut le diviser, soit que les gouverneurs des provinces n’obéissent pas ; soit que, pour les faire mieux obéir, il fût nécessaire de partager l’empire en plusieurs royaumes.
Après la mort d’Alexandre, son empire fut partagé. Comment ces grands de Grece & de Macédoine, libres, ou du moins chefs des conquérans répandus dans cette vaste conquête, auroient-ils pu obéir ?
Après la mort d’Attila, son empire fut dissous : tant de rois qui n’étoient plus contenus, ne pouvoient point reprendre des chaînes.
Le prompt établissement du pouvoir sans bornes, est le remede qui dans ces cas peut prévenir la dissolution ; nouveau malheur après celui de l’agrandissement ! [I-426]
Les fleuves courent se mêler dans la mer ; les monarchies vont se perdre dans le despotisme.
[I-426]
CHAPITRE XVIII.
Que la monarchie d’Espagne étoit dans un cas particulier.
Qu’on ne cite point l’exemple de l’Espagne ; elle prouve plutôt ce que je dis. Pour garder l’Amérique, elle fit ce que le despotisme même ne fait pas, elle en détruisit les habitans ; il fallut, pour conserver sa colonie, qu’elle la tînt dans la dépendance de sa subsistance même.
Elle essaya le despotisme dans les Pays-Bas ; & sitôt qu’elle l’eut abandonné, ses embarras augmenterent. D’un côté, les Wallons ne vouloient pas être gouvernés par les Espagnols ; & de l’autre, les soldats Espagnols ne vouloient pas obéir aux officiers Wallons [1] .
Elle ne se maintint dans l’Italie, qu’à force de l’enrichir & de se ruiner : car ceux qui auroient voulu se défaire du [I-427] roi d’Espagne, n’étoient pas pour cela d’humeur à renoncer à son argent.
-
[↑] Voyez l’histoire des Provinces-Unies, par M. de Clerc.
[I-427]
CHAPITRE XIX.
Propriétés distinctives du gouvernement despotique.
Un grand empire suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne. Il faut que la promptitude des résolutions supplée à la distance des lieux où elles sont envoyées ; que la crainte empêche la négligence du gouverneur ou du magistrat éloigné ; que la loi soit dans une seule tête ; & qu’elle change sans cesse, comme les accidens, qui se multiplient toujours dans l’état à proportion de sa grandeur.
[I-427]
CHAPITRE XX.
Conséquences des Chapitres précédens.
Que si la propriété naturelle des petits états est d’être gouvernés en république, celle des médiocres d’être soumis à un monarque, celle des grands empires d’être dominés par [I-428] un despote ; il suit que, pour conserver les principes du gouvernement établi, il faut maintenir l’état dans la grandeur qu’il avoit déjà ; & que cet état changera d’esprit, à mesure qu’on rétrécira ou qu’on étendra ses limites.
[I-428]
CHAPITRE XXI.
De l’Empire de la Chine.
Avant de finir ce Livre, je répondrai à une objection qu’on peut faire sur tout ce que j’ai dit jusqu’ici.
Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine, comme d’un gouvernement admirable, qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l’honneur et la vertu. J’ai donc posé une distinction vaine, lorsque j’ai établi les principes des trois gouvernemens.
J’ignore ce que c’est que cet honneur dont on parle, chez des peuples à qui on ne sait rien faire qu’à coups de bâton [1] .
De plus, il s’en faut beaucoup que nos commerçans nous donnent l’idée [I-429] de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires : on peut les consulter sur les brigandages des mandarins. [2] Je prends encore à témoin le grand homme milord Anson.
D’ailleurs, les lettres du P. Parennin sur le procès que l’empereur fit faire à des princes du sang néophytes [3] qui lui avoient déplu, nous font voir un plan de tyrannie constamment suivi, & des injures faites à la nature humaine avec regle, c’est-à-dire de sang-froid.
Nous avons encore des lettres de M. de Mairan & du même P. Parennin sur le gouvernement de la Chine. Après des questions & des réponses très-sensées, le merveilleux s’est évanoui.
Ne pourroit-il pas se faire que les missionnaires auroient été trompés par une apparence d’ordre ; qu’ils auroient été frappés de cet exercice continuel de la volonté d’un seul, par lequel ils sont gouvernés eux-mêmes, & qu’ils aiment tant à trouver dans les cours des rois des Indes ! parce que n’y allant que pour y faire de grands changemens, il leur est plus aisé de convaincre les princes qu’ils [I-430] peuvent tout faire, que de persuader aux peuples qu’ils peuvent tout souffrir [4] .
Enfin, il y a souvent quelque chose de vrai dans les erreurs mêmes. Des circonstances particulieres, & peut-être uniques, peuvent faire que le gouvernement de la chine ne soit par aussi corrompu qu’il devroit l’être. Des causes, tirées la plupart du physique du climat, ont pu forcer les causes morales dans ce pays, & faire des especes de prodiges.
Le climat de la Chine est tel, qu’il favorise prodigieusement la propagation de l’espece humaine. Les femmes y sont d’une fécondité si grande, que l’on ne voit rien de pareil sur la terre. La tyrannie la plus cruelle n’y arrête point le progrès de la propagation. Le prince n’y peut pas dire, comme Pharaon, Opprimons-les avec sagesse. Il seroit plutôt réduit à former le souhait de Néron, que le genre humain n’eût qu’une tête. Malgré la tyrannie, la Chine, par la force du climat, se peuplera toujours, & triomphera de la tyrannie.
[I-431]
La Chine, comme tous les pays où croît le riz [5] , est sujette à des famines fréquentes. Lorsque le peuple meurt de faim, il se disperse pour chercher de quoi vivre ; il se forme de toutes parts des bandes de trois, quatre ou cinq voleurs. La plupart sont d’abord exterminées ; d’autres se grossisent, & sont exterminées encore. Mais dans un si grand nombre de provinces, & si éloignées, il peut arriver que quelque troupe fasse fortune. Elle se maintient, se fortifie, se forme en corps d’armée, va droit à la capitale, & le chef monte sur le trône.
Telle est la nature de la chose, que le mauvais gouvernement y est d’abord puni. Le désordre y naît soudain, parce que ce peuple prodigieux y manque de subsistance. Ce qui fait que dans d’autres pays on revient si difficilement des abus, c’est qu’ils n’y ont pas des effets sensibles ; le prince n’y est pas averti d’une maniere prompte & éclatante, comme il l’est à la Chine.
Il ne sentira point, comme nos princes, que s’il gouverne mal, il sera moins heureux dans l’autre vie, moins puissant & moins riche dans celle-ci. Il saura [I-432] que si son gouvernement n’est pas bon, il perdra l’empire & la vie.
Comme, malgré les expositions d’enfans, le peuple augmente toujours à la Chine [6] , il faut un travail infatigable pour faire produire aux terres de quoi le nourrir : cela demande une grande attention de la part du gouvernement. Il est à tous les instans intéressé à ce que tout le monde puisse travailler sans crainte d’être frustré de ses peines. Ce doit moins être un gouvernement civil, qu’un gouvernement domestique.
Voilà ce qui a produit les réglemens dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme : mais ce qui est joint avec le despotisme n’a plus de force. En vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s’enchaîner ; il s’arme de ses chaînes, & devient plus terrible encore.
La Chine est donc un état despotique, dont le principe est la crainte. Peut-être que dans les premieres dynasties, l’empire n’étant pas si étendu, le gouvernement décloinoit un peu de cet esprit. Mais aujourd’hui cela n’est pas.
-
[↑] C’est le bâton qui gouverne la Chine, dit le P. du Halde.
-
[↑] Voyez entr’autres la relation de Lange.
-
[↑] De la famille de Sourniama, Lettres édis. 18e. Recueil
-
[↑] Voyez dans le P. du Halde, comment les Missionnaires se servirent de l’autorité de Canhi, pour faire taire les Mandarins, qui disoient toujours que, par les lois du pays, un culte étranger ne pouvoit être établi dans l’empire.
-
[↑] Voyez ci-dessous, liv. XXIII. chap. 14.
-
[↑] Voyez le mémoire d’un Tsongtou, pour qu’on défriche. Lettres édif. recueil 21.
[I-433]
LIVRE IX.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec la force défensive.↩
CHAPITRE PREMIER.
Comment les Républiques pourvoient à leur sureté.
Si une république est petite, elle est détruite pas une force étrangere ; si elle est grande, elle se détruit par un vice intérieur.
Ce double inconvénient infecte également les démocraties & les aristocraties, soit qu’elles soient bonnes, soit qu’elles soient mauvaises. Le mal est dans la chose même, il n’y a aucune forme qui puisse y remédier.
Ainsi il y a grande apparence que les hommes auroient été à la fin obligés de vivre toujours sous le gouvernement d’un seul, s’ils n’avoient imaginé une maniere de constitution qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain & la force extérieure du [I-434] monarchique. Je parle de la république fédérative.
Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un état plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés, qui en font une nouvelle, qui peut s’agrandir par de nouveaux associés qui se sont unis.
Ce furent ces associations qui firent fleurir si long-temps le corps de la Grece. Par elles les Romains attaquerent l’univers, & par elles seules l’univers se défendit contr’eux ; & quand Rome fut parvenue au comble de sa grandeur, ce fut par des associations derriere le Danube & le Rhin, associations que la frayeur avoit fait faire, que les Barbares purent lui résister.
C’est par-là que la Hollande [1] , l’Allemagne, les Ligues Suisses, sont regardées en Europe comme des républiques éternelles.
Les associations des villes étoient autrefois plus nécessaires, qu’elles ne le [I-435] sont aujourd’hui. Une cité sans puissance couroit de plus grands périls. La conquête lui faisoit prendre, non-seulement la puissance exécutrice & la législative, comme aujourd’hui, mais encore tout ce qu’il y a de propriété parmi les hommes [2] .
Cette sorte de république, capable de résister à la force extérieure, peut se maintenir dans sa grandeur, sans que l’intérieur se corrompe. La forme de cette société prévient tous les inconvéniens.
Celui qui voudroit usurper ne pourroit guere être également accrédité dans tous les états confédérés. S’il se rendoit trop puissant dans l’un, il alarmeroit tous les autres ; s’il subjuguoit une partie, celle qui seroit libre encore pourroit lui résister avec des forces indépendantes de celles qu’il auroit usurpées, & l’accabler avant qu’il eût achevé de s’établir.
S’il arrive quelque sédition chez un des membres confédérés, les autres peuvent l’apaiser. Si quelques abus s’introduisent quelque part, ils sont [I-436] corrigés par les parties saines. Cet état peut périr d’un côté, sans périr de l’autre ; la confédération peut être dissoute, & les confédérés rester souverains.
Composé de petites républiques, il jouit de la bonté du gouvernement intérieur de chacune ; & à l’égard du dehors, il a par la force de l’association tous les avantages des grandes monarchies.
-
[↑] Elle est formée par environ cinquante républiques, toutes différentes les unes des autres. État des Provinces-Unies, par M. Janisson.
-
[↑] Liberté civile, biens, femmes, enfans, temples & sépultures même.
[I-436]
CHAPITRE II.
Que la constitution fédérative doit être composée d’états de même nature, sur-tout d’états républicains.
Les Cananéens furent détruits, parce que c’étoient de petites monarchies qui ne s’étoient point confédérés, & qui ne se défendirent pas en commun. C’est que la nature des petites monarchies n’est pas la confédération.
La république fédérative d’Allemagne est composée de villes libres & de petits états soumis à des princes. L’expérience fait voir qu’elle est plus imparfaite que celle de Hollande & de Suisse.
[I-437]
L’esprit de la monarchie est la guerre & l’agrandissement ; l’esprit de la république est la paix & la modération. Ces deux sortes de gouvernement ne peuvent, que d’une maniere forcée, subsister dans une république fédérative.
Aussi voyons-nous dans l’histoire Romaine, que lorsque les Véiens eurent choisi un roi, toutes les petites républiques de Toscane les abandonnerent. Tout fut perdu en Grece, lorsque les rois de Macédoine obtinrent une place parmi les amphictions.
La république fédérative d’Allemagne, composée de princes & de villes libres, subsiste parce que’elle a un chef, qui est en quelque façon le magistrat de l’union, & en quelque façon le monarque.
[I-437]
CHAPITRE III.
Autres choses requises dans la république fédérative.
Dans la république de Hollande, une province ne peut faire une alliance sans le consentement des autres. Cette loi est très-bonne, & même [I-438] nécessaire, dans la république fédérative. Elle manque dans la constitution Germanique, où elle préviendroit les malheurs qui y peuvent arriver à tous les membres, par l’imprudence, l’ambition ou l’avarice d’un seul. Une république qui s’est unie par une confédération politique, s’est donnée entiere, & n’a plus rien à donner.
Il est difficile que les états qui s’associent, soient de même grandeur, & aient une puissance égale. La république des Lyciens [1] étoit une association de vingt-trois villes ; les grandes avoient trois voix dans le conseil commun ; les médiocres, deux ; les petites, une. La république de Hollande est composée de sept provinces, grandes ou petites, qui ont chacune une voix.
Les villes de Lycie [2] payoient les charges selon la proportion des suffrages. Les provinces de Hollande ne peuvent suivre cette proportion ; il faut qu’elles suivent celle de leur puissance.
En Lycie [3] , les juges & les [I-439] magistrats des villes étoient élus par le conseil commun, & selon la proportion que nous avons dite. Dans la république de Hollande, ils ne sont point élus par le conseil commun, & chaque ville nomme ses magistrats. S’il falloit donner un modele d’une belle république fédérative, je prendrois la république de Lycie.
[I-439]
CHAPITRE IV.
Comment les états despotiques pourvoient à leur sureté.
Comme les républiques pourvoient à leur sureté en s’unissant, les états despotiques le font en se séparant, & en se tenant pour ainsi dire seuls. Ils sacrifient une partie du pays, ravagent les frontieres & les rendent désertes ; le corps de l’empire devient inaccessible.
Il est reçu en géométrie, que plus les corps ont d’étendue, plus leur circonférence est relativement petite. Cette pratique, de dévaster les frontieres, est donc plus tolérable dans les grands états que dans les médiocres.
[I-440]
Cet état fait contre lui-même tout le mal que pourroit faire un cruel ennemi, mais un ennemi qu’on ne pourroit arrêter.
L’état despotique se conserve par une autre sorte de séparation, qui se fait en mettant les provinces éloignées entre les mains d’un prince qui soit feudataire. Le Mogol, la Perse, les empereurs de la Chine ont leurs feudataires ; & les Turcs se sont très-bien trouvés d’avoir mis, entre leurs ennemis & eux, les Tartares, les Moldaves, les Valaques, & autrefois les Transilvains.
[I-440]
CHAPITRE V.
Comment la monarchie pourvoit à sa sureté.
La monarchie ne se détruit pas elle-même comme l’état despotique : mais un état d’une grandeur médiocre pourroit être d’abord envahi. Elle a donc des places fortes qui défendent ses frontieres, & des armées pour défendre ses places fortes. Le plus petit terrain s’y dispute avec art, avec courage, avec opiniâtreté. Les états [I-441] despotiques font entr’eux des invasions ; il n’y a que les monarchies qui fassent la guerre.
Les places fortes appartiennent aux monarchies ; les états despotiques craignent d’en avoir. Ils n’osent les confier à personne ; car personne n’y aime l’état & le prince.
[I-441]
CHAPITRE VI.
De la force défensive des états en général.
Pour qu’un état soit dans sa force, il faut que sa grandeur soit telle, qu’il y ait un rapport de la vîtesse avec laquelle on peut exécuter contre lui quelqu’entreprise, & la promptitude qu’il peut employer pour la rendre vaine. Comme celui qui attaque peut d’abord paroître par-tout, il faut que celui qui défend puisse se montrer par-tout aussi ; & par conséquent que l’étendue de l’état soit médiocre, afin qu’elle soit proportionnée au degré de vîtesse que la nature a donné aux hommes pour se transporter d’un lieu à un autre.
La France & l’Espagne sont [I-442] précisément de la grandeur requise. Les forces se communiquent si bien, qu’elles se portent d’abord là où l’on veut ; les armées s’y joignent & passent rapidement d’une frontiere à l’autre, & l’on n’y craint aucune des choses qui ont besoin d’un certain temps pour être exécutées.
En France, par un bonheur admirable, la capitale se trouve plus près des différentes frontieres justement à proportion de leur foiblesse ; & le prince y voit mieux chaque partie de son pays, à mesure qu’elle est plus exposée.
Mais lorsqu’un vaste état, tel que la Perse, est attaqué, il faut plusieurs mois pour que les troupes dispersées puissent s’assembler ; & on ne force pas leur marche pendant tant de temps, comme on fait pendant quinze jours. Si l’armée qui est sur la frontiere est battue, elle est surement dispersée, parce que ses retraites ne sont pas prochaines. L’armée victorieuse, qui ne trouve pas de résistance, s’avance à grandes journées, paroît devant la capitale, & en forme le siege, lorsqu’à peine les gouverneurs des provinces peuvent être avertis d’envoyer du secours. Ceux qui [I-443] jugent la révolution prochaine, la hâtent en n’obéissant pas. Car des gens fideles, uniquement parce que la punition est proche, ne le sont plus dès qu’elle est éloignée ; ils travaillent à leurs intérêts particuliers. L’empire se dissout, la capitale est prise, & le conquérant dispute les provinces avec les gouverneurs.
La vraie puissance d’un prince ne consiste pas tant dans la facilité qu’il y a à conquérir, que dans la difficulté qu’il y a à l’attaquer ; & si j’ose parler ainsi, dans l’immutabilité de sa condition. Mais l’agrandissement des états leur fait montrer de nouveaux côtés par où on peut les prendre.
Ainsi comme les monarques doivent avoir de la sagesse pour augmenter leur puissance, ils ne doivent pas avoir moins de prudence, afin de la borner. En faisant cesser les inconvéniens de la petitesse, il faut qu’ils ayent toujours l’œil sur les inconvéniens de la grandeur.
[I-444]
CHAPITRE VII.
Réflexions.
Les ennemis d’un grand prince qui a si long-temps régné, l’ont mille fois accusé, plutôt, je crois, sur leurs craintes que sur leurs raisons, d’avoir formé & conduit le projet de la monarchie universelle. S’il y avoit réussi, rien n’auroit été plus fatal à l’europe, à ses anciens sujets, à lui, à sa famille. Le ciel, qui connoît les vrais avantages, l’a mieux servi par des défaites, qu’il n’auroit fait par des victoires. Au lieu de le rendre le seul roi de l’Europe, il le favorisa plus, en le rendant le plus puissant de tous.
Sa nation, qui dans les pays étrangers, n’est jamais touchée que de ce qu’elle a quitté ; qui en partant de chez elle, regarde la gloire comme le souverain bien, & dans les pays éloignés comme un obstacle à son retour ; qui indispose par ses bonnes qualités même, parce qu’elle paroît y joindre du mépris ; qui peut supporter les blessures, les périls & les fatigues, & non pas la [I-445] perte de ses plaisirs ; qui n’aime rien tant que sa gaieté, & se console de la perte d’une bataille lorsqu’elle a chanté le général, n’auroit jamais été jusqu’au bout d’une entreprise qui ne peut manquer dans un pays sans manquer dans tous les autres, ni manquer un moment sans manquer pour toujours.
[I-445]
CHAPITRE VIII.
Cas où la force défensive d’un état est inférieure à sa force offensive.
C’étoit le mot du sire de Coucy au roi Charles V, « que les Anglois ne sont jamais si foibles, ni si aisés à vaincre que chez eux. » C’est ce qu’on disoit des Romains ; c’est ce qu’éprouverent les Carthaginois ; c’est ce qui arrivera à toute puissance qui a envoyé au loin des armées, pour réunir par la force de la discipline & du pouvoir militaire ceux qui sont divisés chez eux par des intérêts politiques ou civils. L’état se trouve foible à cause du mal qui reste toujours, & il a été encore affoibli par le remede.
[I-446]
La maxime du sire de Coucy est une exception à la regle générale, qui veut qu’on n’entreprenne point des guerres lointaines. Et cette exception confirme bien la regle, puisqu’elle n’a lieu que contre ceux qui ont eux-mêmes violé la regle.
[I-446]
CHAPITRE IX.
De la force relative des états.
Toute grandeur, toute force, toute puissance est relative. Il faut bien prendre garde qu’en cherchant à augmenter la grandeur réelle, on ne diminue la grandeur relative.
Vers le milieu du regne de Louis XIV, la France fut au plus haut point de sa grandeur relative. L’Allemagne n’avoit point encore les grands monarques qu’elle a eus depuis. L’Italie étoit dans le même cas. L’Ecosse & l’Angleterre ne formoient point un corps de monarchie. L’Arragon n’en formoit pas un avec la Castille ; les parties séparées de l’Espagne en étoient affoiblies, & l’affoiblissoient. La Moscovie n’étoit pas plus connue en Europe que la Crimée.
[I-447]
CHAPITRE X.
De la foiblesse des états voisins.
Lorsqu’on a pour voisin un état qui est dans sa décadence, on doit bien se garder de hâter sa ruine ; parce qu’on est à cet égard dans la situation la plus heureuse où l’on puisse être ; n’y ayant rien de si commode pour un prince que d’être auprès d’un autre qui reçoit pour lui tous les coups & tous les outrages de la fortune. Et il est rare que par la conquête d’un pareil état, on augmente autant en puissance réelle, qu’on a perdu en puissance relative.
[I-448]
LIVRE X.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec la force offensive.↩
CHAPITRE PREMIER.
De la force offensive.
La force offensive est réglée par le droit des gens, qui est la loi politique des nations considérées dans le rapport qu’elles ont les unes avec les autres.
[I-448]
CHAPITRE II.
De la guerre.
La vie des états est comme celle des hommes. Ceux-ci ont droit de tuer dans le cas de la défense naturelle ; ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation.
Dans le cas de la défense naturelle, j’ai droit de tuer ; parce que ma vie est [I-449] à moi, comme la vie de celui qui m’attaque est à lui : de même un état fait la guerre, parce que sa conservation est juste comme toute autre conservation.
Entre les citoyens, le droit de la défense naturelle n’emporte point avec lui la nécessité de l’attaque. Au lieu d’attaquer, il n’ont qu’à recourir aux tribunaux. Ils ne peuvent donc exercer le droit de cette défense, que dans les cas momentanés, où l’on seroit perdu si l’on attendoit le secours des lois. Mais entre les sociétés, le droit de la défense naturelle entraîne quelquefois la nécessité d’attaquer, lorsqu’un peuple voit qu’une plus longue paix en mettroit un autre en état de le détruire ; & que l’attaque est, dans ce moment, le seul moyen d’empêcher cette destruction.
Il suit de-là que les petites sociétés ont plus souvent le droit de faire la guerre que les grandes, parce qu’elles sont plus souvent dans le cas de craindre d’être détruites.
Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité & du juste rigide. Si ceux qui dirigent la conscience, ou les conseils des princes, ne se tiennent pas là, tout est perdu ; & lorsqu’on se fondera [I-450] sur des principes arbitraires de gloire, de bienséances, d’utilité, des flots de sang inonderent la terre.
Que l’on ne parle pas sur-tout de la gloire du prince ; sa gloire seroit son orgueil ; c’est une passion, & non pas un droit légitime.
Il est vrai que la réputation de sa puissance pourroit augmenter les forces de son état ; mais la réputation de sa justice les augmenteroit tout de même.
[I-450]
CHAPITRE III.
Du droit de conquête.
Du droit de la guerre dérive celui de conquête, qui en est la conséquence ; il en doit donc suivre l’esprit.
Lorsqu’un peuple est conquis, le droit que le conquérant a sur lui, suit quatre sortes de lois ; la loi de la nature, qui fait que tout tend à la conservations des especes ; la loi de la lumiere naturelle, qui veut que nous fassions à autrui ce que nous voudrions qu’on nous fît ; la loi qui forme les sociétés politiques, qui sont telles que la nature n’en a point borné la durée ; enfin la [I-451] loi tirée de la chose même. La conquête est une acquisition ; l’esprit d’acquisition porte avec lui l’esprit de conservation & d’usage, & non pas celui de destruction.
Un état qui en a conquis un autre, le traite d’une des quatre manieres suivantes. Il continue à le gouverner selon ses lois, & ne prend pour lui que l’exercice du gouvernement politique & civil ; ou il lui donne un nouveau gouvernement politique & civil, ou il détruit la société & la disperse dans d’autres, ou enfin il extermine tous les citoyens.
La premiere maniere est conforme au droit des gens que nous suivons aujourd’hui ; la quatrieme est plus conforme au droit des gens des Romains : sur quoi je laisse à juger à quel point nous sommes devenus meilleurs. Il faut rendre ici hommage à nos temps modernes, à la raison présente, à la religion d’aujourd’hui, à notre philosophie, à nos mœurs.
Les auteurs de notre droit public, fondés sur les histoires anciennes, étant sortis des cas rigides, sont tombés dans de grandes erreurs. Ils ont donné dans [I-452] l’arbitraire ; ils ont supposé dans les conquérans un droit, je ne sais quel, de tuer : ce qui leur a fait tirer des conséquences terribles comme le principe ; & établir des maximes que les conquérans eux-mêmes, lorsqu’ils ont eu le moindre sens, n’ont jamais prises. Il est clair que, lorsque la conquête est faite, le conquérant n’a plus le droit de tuer ; puisqu’il n’est plus dans le cas de la défense naturelles, & de sa propre conservation.
Ce qui les a fait penser ainsi, c’est qu’ils ont cru que le conquérant avoit droit de détruire la société : d’où ils ont conclu qu’il avoit celui de détruire les hommes qui la composent ; ce qui est une conséquence faussement tirée d’un faux principe. Car de ce que la société seroit anéantie, il ne s’en suivroit pas que les hommes qui la forment dussent aussi être anéantis. La société est l’union des hommes, & non pas les hommes ; le citoyen peut périr, & l’homme rester.
Du droit de tuer dans la conquête, les politiques ont tiré le droit de réduire en servitude ; mais la conséquence est aussi mal fondée que le principe.
[I-453]
On n’a droit de réduire en servitude, que lorsqu’elle est nécessaire pour la conservation de la conquête. L’objet de la conquête est la conservation : la servitude n’est jamais l’objet de la conquête ; mais il peut arriver qu’elle soit un moyen nécessaire pour aller à la conservation.
Dans ce cas, il est contre la nature de la chose, que cette servitude soit éternelle. Il faut que le peuple esclave puisse devenir sujet. L’esclavage dans la conquête est une chose d’accident. Lorsqu’après un certain espace de temps, toutes les parties de l’état conquérant se sont liées avec celles de l’état conquis, par des coutumes, des mariages, des lois, des associations, & une certaine conformité d’esprit, la servitude doit cesser. Car les droits du conquérant ne sont fondés que sur ce que ces choses-là ne sont pas, & qu’il y a un éloignement entre les deux nations, tel que l’une ne peut pas prendre confiance en l’autre.
Ainsi le conquérant qui réduit le peuple en servitude, doit toujours se réserver des moyens (& ces moyens sont sans nombre) pour l’en faire sortir.
[I-454]
Je ne dis point ici des choses vagues. Nos peres qui conquirent l’empire Romain en agirent ainsi. Les lois qu’ils firent dans le feu, dans l’action, dans l’impétuosité, dans l’orgueil de la victoire, ils les adoucirent ; leurs lois étoient dures, ils les rendirent impartiales. Les Bourguignons, les Goths & les Lombards vouloient toujours que les Romains fussent le peuple vaincu ; les lois d’Euric, de Gondebaud & de Rhotaris, firent du Barbare & du Romain des concitoyens [1] .
Charlemagne, pour dompter les Saxons, leur ôta l’ingénuité & la propriété des biens. Louis le Débonnaire les affranchit [2] : il ne fit rien de mieux dans tout son regne. Le temps & la servitude avoient adouci leurs mœurs ; ils lui furent toujours fideles.
-
[↑] Voyez le code des lois des Barbares, & le livre XXVIII ci-dessous.
-
[↑] Voyez l’Auteur incertain de la vie de Louis le Débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome 2, page 296.
[I-455]
CHAPITRE IV.
Quelques avantages du peuple conquis.
Au lieu de tirer du droit de conquête des conséquences si fatales, les politiques auroient mieux fait de parler des avantages que ce droit peut quelquefois apporter au peuple vaincu. Ils les auroient mieux sentis, si notre droit des gens étoit exactement suivi, & s’il étoit établi dans toute la terre.
Les états que l’on conquiert ne sont pas ordinairement dans la force de leur institution. La corruption s’y est introduite ; les lois y ont cessé d’être exécutées ; le gouvernement est devenu oppresseur. Qui peut douter qu’un état pareil ne gagnât & ne tirât quelques avantages de la conquête même, si elle n’étoit pas destructrice ? Un gouvernement parvenu au point où il ne peut plus se réformer lui-même, que perdroit-il à être refondu ? Un conquérant qui entre chez un peuple, où par mille ruses & mille artifices, le riche s’est insensiblement pratiqué une infinité de moyens d’usurper ; où le malheureux [I-456] qui gémit, voyant ce qu’il croyoit des abus, devenir des lois, est dans l’oppression, & croit avoir tort de la sentir ; un conquérant, dis-je, peut dérouter tout, & la tyrannie sourde est la premiere chose qui souffre la violence.
On a vu par exemple, des états opprimés par les traitans, être soulagés par le conquérant, qui n’avoit ni les engagemens ni les besoins qu’avoit le prince légitime. Les abus se trouvoient corrigés, sans même que le conquérant les corrigeât.
Quelquefois la frugalité de la nation conquérante, l’a mise en état de laisser aux vaincus le nécessaire, qui leur étoit ôté sous le prince légitime.
Une conquête peut détruire les préjugés jugés nuisibles ; & mettre, si j’ose parler ainsi, une nation sous un meilleur génie.
Quel bien les Espagnols ne pouvoient-ils pas faire aux Mexicains ? Ils avoient à leur donner une religion douce ; ils leur apporterent une superstition furieuse. Ils auroient pu rendre libres les esclaves, & ils rendirent esclaves les hommes libres. Ils pouvoient les éclairer sur l’abus des sacrifices humains ; au lieu de cela, ils les exterminerent. Je n’aurois [I-457] jamais fini, si je voulois raconter tous les biens qu’ils ne firent pas, & tous les maux qu’ils firent.
C’est à un conquérant à réparer une partie des maux qu’il a faits. Je définis ainsi le droit de conquête ; un droit nécessaire, légitime & malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense, pour s’acquitter envers la nature humaine.
[I-457]
CHAPITRE V.
Gélon, roi de Syracuse.
Le plus beau traité de paix dont l’histoire ait parlé, est je crois celui que Gélon fit avec les Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la coutume d’immoler leurs enfans [1] . Chose admirable ! Après avoir défait trois cents mille Carthaginois, il exigeoit une condition qui n’étoit utile qu’à eux, ou plutôt il stipuloit pour le genre humain.
Les Bactriens faisoient manger leurs peres vieux à de grands chiens. Alexandre le leur défendit [2] ; & ce fut un triomphe qu’il remporta sur la superstition.
[I-458]
CHAPITRE VI.
D’une république qui conquiert.
Il est contre la nature de la chose, que dans une constitution fédérative, un état confédéré conquiere sur l’autre, comme nous avons vu de nos jours chez les Suisses [1] . Dans les républiques fédératives mixtes, où l’association est entre de petites républiques & de petites monarchies, cela choque moins.
Il est encore contre la nature de la chose, qu’une république démocratique conquiere des villes qui ne sauroient entrer dans la sphere de la démocratie. Il faut que le peuple conquis puisse jouir des privileges de la souveraineté, comme les Romains l’établirent au commencement. On doit borner la conquête au nombre des citoyens que l’on fixera pour la démocratie.
Si une démocratie conquiert un peuple pour le gouverner comme sujet, elle exposera sa propre liberté ; parce qu’elle confiera une trop grande puissance aux magistrats qu’elle enverra dans l’état conquis.
[I-459]
Dans quel danger n’eût pas été la république de Carthage, si Annibal avoit pris Rome ? Que n’eût-il pas fait dans sa ville après la victoire, lui qui y causa tant de révolutions après sa défaite [2] ?
Hannon n’auroit jamais pu persuader au sénat de ne point envoyer de secours à Annibal, s’il n’avoit fait parler que sa jalousie. Ce sénat qu’Aristote nous dit avoir été si sage, (chose que la prospérité de cette république nous prouve si bien) ne pouvoit être déterminé que par des raisons sensées. Il auroit fallu être trop stupide pour ne pas voir qu’une armée à trois cents lieues de-là, faisoit des pertes nécessaires, qui devoient être réparées.
Le parti d’Hannon vouloit qu’on livrât Annibal aux Romains [3] . On ne pouvoit pour lors craindre les Romains ; on craignoit donc Annibal.
On ne pouvoit croire, dit-on, les succès d’Annibal : mais comment en douter ? Les Carthaginois répandus par toute la terre, ignoroient-ils ce qui se [I-460] passoit en Italie ? C’est parce qu’ils ne l’ignoroient pas, qu’on ne vouloit pas envoyer de secours à Annibal.
Hannon devient plus ferme après Trebies, après Trasimenes, après Cannes : ce n’est point son incrédulité qui augmente, c’est sa crainte.
-
[↑] Pour le Tockembourg.
-
[↑] Il étoit à la tête d’une faction.
-
[↑] Hannon vouloit livrer Annibal aux Romains, comme Caton vouloit qu’on livrât César aux Gaulois.
[I-460]
CHAPITRE VII.
Continuation du même sujet.
Il y a encore un inconvénient aux conquêtes faites par les démocraties. Leur gouvernement est toujours odieux aux états assujettis. Il est monarchique par la fiction ; mais dans la vérité, il est plus dur que le monarchique, comme l’expérience de tous les temps & de tous les pays l’a fait voir.
Les peuples conquis y sont dans un état triste ; ils ne jouissent ni des avantages de la république, ni de ceux de la monarchie.
Ce que j’ai dit de l’état populaire, se peut appliquer à l’aristocratie.
[I-461]
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
Ainsi, quand une république tient quelque peuple sous sa dépendance, il faut qu’elle cherche à réparer les inconvéniens qui naissent de la nature de la chose, en lui donnant un bon droit politique & de bonnes lois civiles.
Une république d’Italie tenoit des insulaires sous son obéissance ; mais son droit politique & civil à leur égard étoit vicieux. On se souvient de cet acte [1] d’amnistie, qui porte qu’on ne les condamneroit plus à des peines afflictives sur la conscience informée du gouverneur. On a vu souvent des peuples demander des privileges : ici le souverain accorde le droit de toutes les nations.
-
[↑] Du 18 Octobre 1738, imprimé à Genes, chez Franchelli. Vetiamo al nostro general-governato e in detta isola, do condanare in avenire salamente ex informatâ conscientiâ persona alcuna nazionale in pena afflitiva : potrà ben si sar arrestare ed incarcerare le persone che gli seranno sosperte ; salvo di renderne poi à noi sollecitamente, art. VI.
[I-462]
CHAPITRE IX.
D’une monarchie qui conquiert autour d’elle.
Si une monarchie peut agir long-temps avant que l’agrandissement l’ait affoiblie, elle deviendra redoutable, & sa force durera tout autant qu’elle sera pressée par les monarchies voisines.
Elle ne doit donc conquérir que pendant qu’elle reste dans les limites naturelles à son gouvernement. La prudence veut qu’elle s’arrête, sitôt qu’elle passe ces limites.
Il faut dans cette sorte de conquête laisser les choses comme on les a trouvées ; les mêmes tribunaux, les mêmes lois, les mêmes coutumes, les mêmes privileges, rien ne doit être changé, que l’armée & le nom du souverain.
Lorsque la monarchie a étendu ses limites par la conquête de quelques provinces voisines, il faut qu’elle les traite avec une grande douceur.
Dans une monarchie qui a travaillé long-temps à conquérir, les provinces [I-463] de son ancien domaine seront ordinairement très foulées. Elles ont à souffrir les nouveaux abus & les anciens ; & souvent une vaste capitale, qui engloutit tout, les a dépeuplées. Or si après avoir conquis autour de ce domaine, on traitoit les peuples vaincus comme on fait ses anciens sujets, l’état seroit perdu ; ce que les provinces conquises enverroient de tributs à la capitale, ne leur reviendroit plus ; les frontieres seroient ruinées, & par conséquent plus foibles ; les peuples en seroient mal affectionnés ; la subsistance des armées, qui doivent y rester & agir, seroit plus précaire.
Tel est l’état nécessaire d’une monarchie conquérante ; un luxe affreux dans la capitale, la misere dans les provinces qui s’en éloignent, l’abondance aux extrémités. Il en est comme de notre planete ; le feu est au centre, la verdure à la surface, une terre aride, froide & stérile, entre les deux.
[I-464]
CHAPITRE X.
D’une monarchie qui conquiert une autre monarchie.
Quelquefois une monarchie en conquiert une autre. Plus celle-ci sera petite, mieux on la contiendra par des forteresses ; plus elle sera grande, mieux on la conservera par des colonies.
[I-464]
CHAPITRE XI.
Des mœurs du peuple vaincu.
Dans ces conquêtes, il ne suffit pas de laisser à la nation vaincue ses lois ; il est peut-être plus nécessaire de lui laisser ses mœurs, parce qu’un peuple connoît, aime & défend toujours plus ses mœurs que ses lois.
Les François ont été chassés neuf fois de l’Italie, à cause, disent les historiens [1] , de leur insolence à l’égard des femmes & des filles. C’est trop pour une nation, d’avoir à souffrir la fierté du [I-465] vainqueur, & encore son incontinence, & encore son indiscrétion, sans doute plus fâcheuse, parce qu’elle multiplie à l’infini les outrages.
-
[↑] Parcourez l’histoire de l’univers, par M. Pusendorff.
[I-465]
CHAPITRE XII.
D’une loi de Cyrus.
Je ne regarde pas comme une bonne loi, celle que fit Cyrus, pour que les Lydiens ne pussent exercer que des professions viles, ou des professions infames. On va au plus pressé ; on songe aux révoltes, & non pas aux invasions. Mais les invasions viendront bientôt ; les deux peuples s’unissent, ils se corrompent tous les deux. J’aimerois mieux maintenant par les lois la rudesse du peuple vainqueur, qu’entretenir par elles la mollesse du peuple vaincu.
Aristodeme, tyran de Cumes [1] , chercha à énerver le courage de la jeunesse. Il voulut que les garçons laissassent croître leurs cheveux, comme les filles ; qu’ils les ornassent de fleurs, & portassent des robes de différentes couleurs jusqu’aux talons ; que, lorsqu’ils [I-466] alloient chez leurs maîtres de danse & de musique, des femmes leur portassent des parasols, des parfums & des éventails ; que, dans le bain, elles leur donnassent des peignes & des miroirs. Cette éducation duroit jusqu’à l’âge de vingt ans. Cela ne peut convenir qu’à un petit tyran, qui expose sa souveraineté pour défendre sa vie.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. VII.
[I-466]
CHAPITRE XIII.
CHARLES XII.
Ce Prince, qui ne fit usage que de ses seules forces, détermina sa chute en formant des desseins qui ne pouvoient être exécutés que par une longue guerre ; ce que son royaume ne pouvoit soutenir.
Ce n’étoit pas un état qui fût dans la décadence, qu’il entreprit de renverser, mais un empire naissant. Les Moscovites se servirent de la guerre qu’il leur faisoit, comme d’une école. À chaque défaite, ils s’approchoient de la victoire ; &, perdant au dehors, ils apprenoient à se défendre au dedans.
Charles se croyoit le maître du monde dans les déserts de la Pologne, où il [I-467] erroit, & dans lesquels la Suede étoit comme répandue ; pendant que son principal ennemi se fortifioit contre lui, le serroit, s’établissoit sur la mer Baltique, détruisoit ou prenoit la Livonie.
La Suede ressembloit à un fleuve, dont on coupoit les eaux dans sa source, pendant qu’on les détournoit dans son cours.
Ce ne fut point Pultava qui perdit Charles : s’il n’avoit pas été détruit dans ce lieu, il l’auroit été dans un autre. Les accidens de la fortune se réparent aisément : on ne peut pas parer à des évenemens qui naissent continuellement de la nature des choses.
Mais la nature ni la fortune ne furent jamais si fortes contre lui que lui-même.
Il ne se régloit point sur la disposition actuelle des choses, mais sur un certain modele qu’il avoit pris : encore le suivit-il très-mal. Il n’étoit point Alexandre ; mais il auroit été le meilleur soldat d’Alexandre.
Le projet d’Alexandre ne réussit que parce qu’il étoit sensé. Les mauvais succès des Perses dans les invasions qu’ils firent de la Grece, les conquêtes d’Agésilas, & la retraite des dix mille [I-468] avoient fait connoître au juste la supériorité des Grecs dans leur maniere de combattre, & dans le genre de leurs armes ; & l’on savoit bien que les Perses étoient trop grands pour se corriger.
Ils ne pouvoient plus affoiblir la Grece par des divisions : elle étoit alors réunie sous un chef, qui ne pouvoit avoir de meilleur moyen pour lui cacher sa servitude, que de l’éblouir par la destruction de ses ennemis éternels, & par l’espérance de la conquête de l’Asie.
Un empire cultivé par la nation du monde la plus industrieuse, & qui travailloit les terres par principe de religion, fertile & abondant en toutes choses, donnoit à un ennemi toutes sortes de facilité pour y subsister.
On pouvoit juger, par l’orgueil de ces rois, toujours vainement mortifiés par leurs défaites, qu’ils précipiteroient leur chute, en donnant toujours des batailles ; & que la flatterie ne permettroit jamais qu’ils pussent douter de leur grandeur.
Et non seulement le projet étoit sage, mais il fut sagement exécuté. Alexandre, dans la rapidité de ses actions, dans le feu de ses passions même, avoit, si j’ose [I-469] me servir de ce terme, une saillie de raison qui le conduisoit, & que ceux qui ont voulu faire un roman de son histoire, & qui avoient l’esprit plus gâté que lui, n’ont pu nous dérober. Parlons-en tout à notre aise.
[I-469]
CHAPITRE XIV.
ALEXANDRE.
Il ne partit qu’après avoir assuré la Macédoine contre les peuples barbares qui en étoient voisins, & achevé d’accabler les Grecs : il ne se servit de cet accablement que pour l’exécution de son entreprise : il rendit impuissante la jalousie des Lacédémoniens : il attaqua les provinces maritimes : il fit suivre à son armée de terre les côtes de la mer, pour n’être point séparé de sa flotte : il se servit admirablement bien de sa discipline contre le nombre : il ne manqua point de subsistances : & s’il est vrai que la victoire lui donna tout, il fit aussi tout pour se procurer la victoire.
Dans le commencement de son entreprise, c’est-à-dire, dans un temps où un échec pouvoit le renverser, il mit [I-470] peu de chose au hasard : quand la fortune le mit au-dessus des événemens, la témérité fut quelquefois un de ses moyens. Lorsqu’avant son départ il marche contre les Triballiens & les Illyriens, vous voyez une guerre [1] comme celle que César fit depuis dans les Gaules. Lorsqu’il est de retour dans la Grece [2] , c’est comme malgré lui qu’il prend & détruit Thebes : campé auprès de leur ville, il attend que les Thébains veuillent faire la paix, ils précipitent eux-mêmes leur ruine. Lorsqu’il s’agit de combattre [3] les forces maritimes des Perses, c’est plutôt Parménion qui a de l’audace ; c’est plutôt Alexandre qui a de la sagesse. Son industrie fut de séparer les Perses des côtes de la mer, & de les réduire à abandonner eux-mêmes leur marine, dans laquelle ils étoient supérieurs. Tyr étoit par principe attachée aux Perses, qui ne pouvoient se passer de son commerce & de sa marine ; Alexandre la détruisit. Il prit l’Egypte, que Darius avoit laissée dégarnie de troupes, pendant qu’ils [I-471] assembloit des armées innombrables dans un autre univers.
Le passage du Granique fit qu’Alexandre se rendit maître des colonies Grecques ; la bataille d’Issus lui donna Tyr & l’Egypte ; la bataille d’Arbelles lui donna toute la terre.
Après la bataille d’Issus, il laisse fuir Darius, & ne s’occupe qu’à affermir & à régler ses conquêtes : après la bataille d’Arbelles, il le suit de si près [4] , qu’il ne lui laisse aucune retraite dans son empire. Darius n’entre dans ses villes & dans ses provinces, que pour en sortir : les marches d’Alexandre sont si rapides, que vous croyez voir l’empire de l’univers plutôt le prix de la course, comme dans les jeux de la Grece, que le prix de la victoire.
C’est ainsi qu’il fit ses conquêtes : voyons comment il les conserva.
Il résista à ceux qui vouloient qu’il traitât [5] les Grecs comme maîtres, & les Perses comme esclaves : il ne songea qu’à unir les deux nations, & à faire perdre les distinctions du peuple [I-472] conquérant & du peuple vaincu : il abandonna, après la conquête, tous les préjugés qui lui avoient servi à la faire : il prit les murs des Perses, pour ne pas désoler les Perses, en leur faisant prendre les murs des Grecs ; c’est ce qui fit qu’il marqua tant de respect pour la femme & pour la mere de Darius, & qu’il montra tant de continence. Qu’est-ce que ce conquérant, qui est pleuré de tous les peuples qu’il a soumis ? Qu’est-ce que cet usurpateur, sur la mort duquel la famille qu’il a renversée du trône, verse des larmes ? C’est un trait de cette vie, dont les historiens ne nous disent pas que quelqu’autre conquérant puisse se vanter.
Rien n’affermit plus une conquête, que l’union qui se fait des deux peuples par les mariages. Alexandre prit des femmes de la nation qu’il avoit vaincue ; il voulut que ceux de sa cour [6] en prissent aussi ; le reste des Macédoniens suivit cet exemple. Les Francs & les Bourguignons [7] permirent ces mariages : les Wisigoths les défendirent [8] [I-473] en Espagne, & ensuite ils les permirent : les Lombards ne les permirent pas seulement, mais même les favoriserent [9] : quand les Romains voulurent affoiblir la Macédoine, ils y établirent qu’il ne pourroit se faire d’union par mariages entre les peuples des provinces.
Alexandre, qui cherchoit à unir les deux peuples, songea à faire dans la Perse un grand nombre de colonies Grecques : il bâtit une infinité de villes, & il cimenta si bien toutes les parties de ce nouvel empire, qu’après sa mort, dans le trouble & la confusion des plus affreuses guerres civiles, après que les Grecs se furent, pour ainsi dire, anéantis eux-mêmes, aucune Province de Perse ne se révolta.
Pour ne point épuiser la Grece & la Macédoine, il envoya à Alexandrie une colonie de Juifs [10] : il ne lui importoit quelles mœurs eussent ces peuples, pourvu qu’ils lui fussent fideles.
[I-474]
Il ne laissa pas seulement aux peuples vaincus leurs mœurs ; il leur laissa encore leurs lois civiles, & souvent même les rois & les gouverneurs qu’il avoit trouvés. Il mettoit les Macédoniens [11] à la tête des troupes, & les gens du pays à la tête du gouvernement ; aimant mieux courir le risque de quelqu’infidélité particuliere (ce qui lui arriva quelquefois) que d’une révolte générale. Il respecta les traditions anciennes, & tous les monumens de la gloire ou de la vanité des peuples. Les rois de Perse avoient détruit les temples des Grecs, des Babyloniens & des Egyptiens ; il les rétablit [12] : peu de nations se soumirent à lui, sur les autels desquelles il ne fît des sacrifices : il sembloit qu’il n’eût conquis, que pour être le monarque particulier de chaque nation, & le premier citoyen de chaque ville. Les Romains conquirent tout, pour tout détruire ; il voulut tout conquérir, pour tout conserver : & quelque pays qu’il parcourût, ses premieres idées, ses premiers desseins furent toujours de faire quelque chose qui pût en augmenter la [I-475] prospérité & la puissance. Il en trouva les premiers moyens dans la grandeur de son génie ; les seconds dans sa frugalité & son économie particuliere [13] ; les troisiemes dans son immense prodigalité pour les grandes choses. Sa main se fermoit pour les dépenses privées ; elle s’ouvroit pour les dépenses publiques. Falloit-il régler sa maison ? c’étoit un Macédonien ; falloit-il payer les dettes des soldats, faire part de sa conquête aux Grecs, faire la fortune de chaque homme de son armée ? il étoit Alexandre.
Il fit deux mauvaises actions ; il brûla Persépolis, & tua Clitus. Il les rendit célebres par son repentir : de sorte qu’on oublia ses actions criminelles, pour se souvenir de son respect pour la vertu ; de sorte qu’elles furent considérées plutôt comme des malheurs, que comme des choses qui lui fussent propres ; de sorte que la prospérité trouve la beauté de son ame presque à côté de ses emportemens & de ses foiblesses ; de sorte qu’il fallut le plaindre, & qu’il n’étoit plus possible de le haïr.
Je vais le comparer à César : Quand César voulut imiter les rois d’Asie, il [I-476] désespéra les Romains pour une chose de pure ostentation ; quand Alexandre voulut imiter les rois d’Asie, il fit une chose qui entroit dans le plan de sa conquête.
-
[↑] Voyez Arrien, de expedit. Alexandri, lib. I.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Voyez Arrien, de expedit. Alexandri, lib. III.
-
[↑] C’étoit le conseil d’Aristote. Plutarque, Œuvres morales : de la fortune d’Alexandre.
-
[↑] Voyez Arrien, de exped. Alex. lib. VII.
-
[↑] Voyez les loi des Bourguignons, titre XII, art. 5.
-
[↑] Voyez la loi des Wisigoths, liv. III. tit. V. §. I. qui abroge la loi ancienne, qui avoit plus d’égards, y est-il dit, à la différence des nations, que des conditions.
-
[↑] Voyez les loi des Lombards, liv. II. tit. VII. §. I & 2.
-
[↑] Les rois de Syrie, abandonnant le plan des fondateurs de l’empire, voulurent obliger les Juifs à prendre les mœurs des Grecs, ce qui donna à leur état de terribles secousses.
-
[↑] Voy. Arrien, de exped. Alex. lib. III. & autres.
-
[↑] Voyez Arrien, de exped. Alex., lib. III.
-
[↑] Ibid. lib. VII.
[I-476]
CHAPITRE XV.
Nouveaux moyens de conserver la conquête.
Lorsqu’un monarque conquiert un grand état, il y a une pratique admirable, également propre à modérer le despotisme & à conserver la conquête : les conquérans de la Chine l’ont mise en usage.
Pour ne point désespérer le peuple vaincu, & ne point enorgueillir le vainqueur ; pour empêcher que le gouvernement ne devienne militaire, & pour contenir les deux peuples dans le devoir, la famille Tartare, qui regne présentement à la Chine, a établi que chaque corps de troupes dans les provinces seroit composé de moitié Chinois & moitié Tartares, afin que la jalousie entre les deux nations les contienne dans le devoir. Les tribunaux sont aussi [I-477] moitié Chinois, moitié Tartares. Cela produit plusieurs bons effets. I°. Les deux nations se contiennent l’une l’autre ; 2°. Elles gardent toutes les deux la puissance militaire & civile, & l’une n’est pas anéantie par l’autre ; 3°. La nation conquérante peut se répandre par-tout, sans s’affoiblir & se perdre ; elle devient capable de résister aux guerres civiles & étrangeres. Institution si sensée, que c’est le défaut d’une pareille, qui a perdu presque tous ceux qui ont conquis la terre.
[I-477]
CHAPITRE XVI.
D’un état despotique qui conquiert.
Lorsque la conquête est immense, elle suppose le despotisme. Pour lors, l’armée répandue dans les provinces ne suffit pas. Il faut qu’il y ait toujours autour du prince un corps particuliérement affidé, toujours prêt à fondre sur la partie de l’empire qui pourroit s’ébranler. Cette milice doit contenir les autres, & faire trembler tous ceux à qui on a été obligé de laisser quelqu’autorité dans l’empire. Il y a [I-478] autour de l’empereur de la Chine un gros corps de Tartares toujours prêt pour le besoin. Chez le Mogol, chez les Turcs, au Japon, il y a un corps à la solde du prince, indépendamment de ce qui est entretenu du revenu des terres. Ces forces particulieres tiennent en respect les générales.
[I-478]
CHAPITRE XVII.
Continuation du même sujet.
Nous avons dit que les états que le monarque despotique conquiert, doivent être feudataires. Les historiens s’épuisent en éloges sur la générosité des conquérans qui ont rendu la couronne aux princes qu’ils avoient vaincus. Les Romains étoient donc bien généreux, qui faisoient par-tout des rois, pour avoir des instruments de servitude [1] . Une action pareille est un acte nécessaire. Si le conquérant garde l’état conquis, les gouverneurs qu’il enverra ne sauront contenir les sujets, ni lui-même ses gouverneurs. Il sera obligé de dégarnir de troupes son ancien patrimoine, pour [I-479] garantir le nouveau. Tous les malheurs des deux états seront communs ; la guerre civile de l’un sera la guerre civile de l’autre. Que si, au contraire, le conquérant rend le trône au prince légitime, il aura un allié nécessaire, qui, avec les forces qui lui seront propres, augmentera les siennes. Nous venons de voir Schah-Nadir conquérir les trésors du Mogol, & lui laisser l’Indoustan.
-
[↑] Ut haberent instrumenta servitutis & reges.
[I-480]
LIVRE XI.
Des Lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée générale.
Je distingue les lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution, d’avec celles qui la forment dans son rapport avec le citoyen. Les premieres seront le sujet de ce livre-ci ; je traiterai des secondes dans le livre suivant.
[I-480]
CHAPITRE II.
Diverses significations données au mot de liberté.
Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, & qui ait frappé les esprits de tant de manieres, que celui de liberté. Les uns l’ont pris [I-481] pour la facilité de déposer celui à qui ils avoient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils devoient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés, & de pouvoir exercer la violence ; ceux-ci, pour le privilege de n’être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lois [1] . Certain peuple a long-temps pris la liberté, pour l’usage de porter une longue barbe [2] . Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, & en ont exlu les autres. Ceux qui avoient goûté du gouvernement républicain, l’ont mise dans ce gouvernement ; ceux qui avoient joui du gouvernement monarchique, l’ont placée dans la monarchie [3] . Enfin chacun a appellé liberté le gouvernement qui étoit conforme à ses coutumes, ou à ses inclinations : Et comme dans une république on n’a pas toujours devant les yeux, & d’une maniere si présente, [I-482] les instrumens des maux dont on se plaint, & que même les lois paroissent y parler plus, & les exécuteurs de la loi y parler moins ; on la place ordinairement dans les républiques, & on l’a exclue des monarchies. Enfin, comme dans les démocraties le peuple paroît à peu près faire ce qu’il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernemens, & on a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple.
-
[↑] « J’ai, dit Cicéron, copié l’édit de Scévola, qui permet aux Grecs de terminer entr’eux leurs différents selon leurs lois ; ce qui fait qu’ils se regardent comme des peuples libres ».
-
[↑] Les Moscovites ne pouvoient souffrir que le czar Pierre la leur fît couper.
-
[↑] Les Cappadociens refuserent l’état républicain, que leur offrirent les Romains.
[I-482]
CHAPITRE III.
Ce que c’est que la liberté.
Il est vrai que dans les démocraties le peuple paroît faire ce qu’il veut : mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un état, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, & à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir.
Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, & ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; & [I-483] si un citoyen pouvoit faire ce qu’elles défendent, il n’auroit plus de liberté, parce que les autres auroient tout de même ce pouvoir.
[I-483]
CHAPITRE IV.
Continuation du même sujet.
La démocratie & l’aristocratie ne sont point des états libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernemens modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les états modérés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le diroit ! la vertu même a besoin de limites.
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, & à ne point faire celles que la loi lui permet.
[I-484]
CHAPITRE V.
De l’objet des états divers.
Quoique tous les états ayent en général un même objet, qui est de se maintenir, chaque état en a pourtant un qui lui est particulier. L’agrandissement étoit l’objet de Rome ; la guerre, celui de Lacédémone ; la religion, celui des lois Judaïques ; le commerce, celui de Marseille ; la tranquillité publique, celui des lois de la Chine [1] ; la navigation, celui des lois des Rhodiens ; la liberté naturelle, l’objet de la police des Sauvages ; en général, les délices du prince, celui des états despotiques ; sa gloire & celle de l’état, celui des monarchies ; l’indépendance de chaque particulier est l’objet des lois de Pologne, & ce qui en résulte, l’oppression de tous [2] .
Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons [I-485] examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S’ils sont bons, la liberté y paroîtra comme dans un miroir.
Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle est, si on l’a trouvée, pourquoi la chercher ?
-
[↑] Objet naturel d’un état qui n’a point d’ennemis au dehors, ou qui croit les avoir arrêtés par des barrieres.
-
[↑] Inconvénient du liberum veto.
[I-485]
CHAPITRE VI.
De la constitution d’Angleterre.
Il y a dans chaque état trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, & corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sureté, prévient les invasions. Par la troisieme il punit les crimes, ou juge les différents des particuliers. On appellera cette derniere la puissance de juger ; & l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état.
[I-486]
La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sureté ; & pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.
Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative & de l’exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie & la liberté des citoyens seroit arbitraire ; car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d’un oppresseur.
Tout seroit perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs : celui de [I-487] faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, & celui de juger les crimes ou les différents des particuliers.
Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisieme. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il regne un affreux despotisme.
Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin pour se maintenir de moyens aussi violens que le gouvernement des Turcs ; témoins les inquisiteurs d’état [1] , & le tronc où tout délateur peut à tous les momens jeter avec un billet son accusation.
Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’état par ses volontés [I-488] générales ; & comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulieres.
Toute la puissance y est une ; & quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.
Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques, ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures, & plusieurs rois d’Europe toutes les grandes charges de leur état.
Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie, ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature ; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se temperent. Ainsi à Venise le grand conseil a la législation ; le prégady, l’exécution ; les quaranties, le pouvoir de juger. Mais le mal est, que ces tribunaux différens sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait guere qu’une même puissance.
[I-489]
La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple [2] , dans certains temps de l’année, de la maniere prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.
De cette façon, la puissance de juger si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible & nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux, & l’on craint la magistrature & non pas les magistrats.
Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges ; ou du moins qu’il en puisse récuser un si grand nombre, que ceux qui restent, soient censés être de son choix.
Les deux autres pouvoirs pourroient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanens ; parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier, n’étant l’un, que la volonté générale de l’état ; [I-490] & l’autre, que l’exécution de cette volonté générale.
Mais si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugemens doivent l’être à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étoient une opinion particuliere du juge, on vivroit dans la société, sans savoir précisément les engagemens que l’on y contracte.
Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé, ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.
Si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n’y a plus de liberté ; à moins qu’ils ne soient arrêtés pour répondre sans délai à une accusation que la loi à rendue capitale ; auquel cas ils sont réellement libres, puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi.
Mais si la puissance législative se croyoit en danger par quelque conjuration secrete contre l’état, ou quelqu’intelligence avec les ennemis du dehors, [I-491] elle pourroit pour un temps court & limité permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects, qui ne perdroient leur liberté pour un temps, que pour la conserver pour toujours.
Et c’est le seul moyen conforme à la raison, de suppléer à la tyrannique magistrature des éphores, & aux inquisiteurs d’état de Venise, qui sont aussi despotiques.
Comme dans un état libre, tout homme qui est censé avoir une ame libre, doit être gouverné par lui-même ; il faudroit que le peuple en corps eût la puissance législative ; mais comme cela est impossible dans les grands états, & est sujet à beaucoup d’inconvéniens dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentans tout ce qu’il ne peut faire par lui-même.
L’on connoît beaucoup mieux les besoins de sa ville, que ceux des autres villes ; & on juge mieux de la capacité de ses voisins, que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation ; mais il convient que dans chaque lieu [I-492] principal, les habitans se choisissent un représentant.
Le grand avantage des représentans, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvéniens de la démocratie.
Il n’est pas nécessaire que les représentans, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une instruction générale, en reçoivent une particuliere sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les dietes d’Allemagne. Il est vrai que de cette maniere la parole des députés seroit plus l’expression de la voix de la nation ; mais cela jetteroit dans les longueurs infinies, rendroit chaque député le maître de tous les autres ; & dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourroit être arrêtée par un caprice.
Quand les députés, dit très-bien M. Sidney, représentent un corps de peuple comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.
[I-493]
Tous les citoyens dans les divers districts doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont réputés n’avoir point de volonté propre.
Il y avoit un grand vice dans la plupart des anciennes républiques ; c’est que le peuple avoit droit d’y prendre des résolutions actives, & qui demandent quelqu’exécution, chose dont il est entiérement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement, que pour choisir ses représentans, ce qui est très à sa portée. Car s’il y a peu de gens qui connoissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir en général, si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.
Le corps représentant ne doit pas être choisis non plus pour prendre quelque résolution active, chose qu’il ne feroit pas bien ; mais pour faire des lois, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites, chose qu’il peut très-bien faire, & qu’il n’y a même que lui qui puisse bien faire.
Il y a toujours dans un état des gens [I-494] distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs : mais s’ils étoient confondus parmi le peuple, & s’ils n’y avoient qu’une voix comme les autres, la liberté commune seroit leur esclavage, & ils n’auroient aucun intérêt à la défendre, parce que la plupart des résolutions seroient contr’eux. La part qu’ils ont à la législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’état ; ce qui arrivera, s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d’arrêter les leurs.
Ainsi la puissance législative sera confiée & au corps des nobles, & au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées & leurs délibérations à part, & des vues & des intérêts séparés.
Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il n’en reste que deux ; & comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif, qui est composé de nobles, est très-propre à produire cet effet.
Le corps des nobles doit être [I-495] héréditaire. Il l’est premiérement par sa nature ; & d’ailleurs il faut qu’il ait un très-grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, & qui dans un état libre, doivent toujours être en danger.
Mais comme une puissance héréditaire pourroit être induite à suivre ses intérêts particuliers, & à oublier ceux du peuple ; il faut que dans les choses où l’on a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les lois qui concernent la levée de l’argent, elle n’ait de part à la législation que par sa faculté d’empêcher, & non par sa faculté de statuer.
J’appelle faculté de statuer, le droit d’ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d’empêcher, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelqu’autre ; ce qui étoit la puissance des tribuns de Rome. Et quoique celui qui a la faculté d’empêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver, pour lors cette approbation n’est autre chose qu’une déclaration qu’il ne fait point d’usage de sa faculté d’empêcher, & dériver de cette faculté.
[I-496]
La puissance exécutrice doit être entre les mains d’un monarque ; parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative, est souvent mieux ordonné par plusieurs, que par un seul.
Que s’il n’y avoit point de monarque, & que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n’y auroit plus de liberté ; parce que les deux puissances seroient unies, les mêmes personnes ayant quelquefois, & pouvant toujours avoir part à l’une & à l’autre.
Si le corps législatif étoit un temps considérable sans être assemblé, il n’y auroit plus de liberté. Car il arriveroit de deux choses l’une ; ou qu’il n’y auroit plus de résolution législative, & l’état tomberoit dans l’anarchie, ou que ces résolutions seroient prises par la puissance exécutrice, & elle deviendroit absolue.
Il seroit inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela seroit incommode pour les représentans, & [I-497] d’ailleurs occuperoit trop la puissance exécutrice, qui ne penseroit point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives, & le droit qu’elle a d’exécuter.
De plus, si le corps législatif étoit continuellement assemblé, il pourroit arriver que l’on ne feroit que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourroient ; & dans ce cas, si le corps législatif étoit une fois corrompu, le mal seroit sans remede. Lorsque divers corps législatifs se succedent les uns aux autres, le peuple qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte avec raison ses espérances sur celui qui viendra après. Mais si c’étoit toujours le même corps, le peuple le voyant une fois corrompu, n’espéreroit plus rien de ses lois ; il deviendroit furieux, ou tomberoit dans l’indolence.
Le corps législatif ne doit point s’assembler lui-même. Car un corps n’est censé avoir de volontés, que lorsqu’il est assemblé ; & s’il ne s’assembloit pas unanimement, on ne sauroit dire quelle partie seroit véritablement le corps législatif, celle qui seroit assemblée, ou celle qui ne le seroit pas. Que s’il avoit [I-498] droit de se proroger lui-même, il pourroit arriver qu’il ne se prorogeroit jamais ; ce qui seroit dangereux dans les cas où il voudroit attenter contre la puissance exécutrice. D’ailleurs il y a des temps plus convenables les uns que les autres, pour l’assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui regle le temps de la tenue & de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances, qu’elle connoît.
Si la puissance exécutrice n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique : car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.
Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d’arrêter la puissance exécutrice. Car l’exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner ; outre que la puissance exécutrice s’exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome étoit vicieuse, en ce qu’elle arrêtoit non-seulement la législation, mais même l’exécution ; ce qui causoit de grands maux.
[I-499]
Mais si dans un état libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d’arrêter la puissance exécutrice, elle a droit & doit avoir la faculté d’examiner de quelle maniere les lois qu’elle a faites ont été exécutées ; & c’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur celui de Crete & de Lacédémone, où les cosmes & les éphores ne rendoient point compte de leur administration.
Mais quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit pas avoir le pouvoir de juger la personne, & par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée, parce qu’étant nécessaire à l’état pour que le corps législatif n’y devienne pas tyrannique, dès le moment qu’il seroit accusé ou jugé, il n’y auroit plus de liberté.
Dans ce cas, l’état ne seroit point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute, ne peut exécuter mal sans avoir des conseillers méchans, & qui haïssent les lois comme ministres, quoiqu’elles les favorisent comme hommes ; ceux-ci peuvent être recherchés & punis. Et c’est l’avantage de ce gouvernement sur [I-500] celui de Gnide, où la loi ne permettant point d’appeler en jugement les amimones [3] , même après leur administration [4] , le peuple ne pouvoit jamais se faire rendre raison des injustices qu’on lui avoit faites.
Quoiqu’en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions, fondées sur l’intérêt particulier de celui qui doit être jugé.
Les grands sont toujours exposés à l’envie ; & s’ils étoient jugés par le peuple, ils pourroient être en danger, & ne jouiroient pas du privilege qu’a le moindre des citoyens dans un état libre d’être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appellés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif, qui est composé de nobles.
Il pourroit arriver que la loi, qui est en même temps clair-voyante & aveugle, seroit en de certains cas trop [I-501] rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C’est donc la partie du corps législatif, que nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci ; c’est à son autorité suprême à modérer la loi, en faveur de la loi-même, en prononçant moins rigoureusement qu’elle.
Il pourroit encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires publiques, violeroit les droits du peuple, & feroit des crimes que les magistrats établis ne sauroient ou ne voudroient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger ; & elle le peut encore moins dans ce cas particulier où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu’accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle s’abaisser devant les tribunaux de la loi qui lui sont inférieurs, & d’ailleurs composés de gens, qui étant peuple comme elle, seroient entraînés par l’autorité d’un si grand [I-502] accusateur ? Non : il faut pour conserver la dignité du peuple & la sureté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles ; laquelle n’a, ni les mêmes intérêts qu’elle, ni les mêmes passions.
C’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avoit cet abus, que le peuple étoit en même temps & juge & accusateur.
La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d’empêcher, sans quoi elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais si la puissance législative prend part à l’exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.
Si le monarque prenoit part à la législation par la faculté de statuer, il n’y auroit plus de liberté. Mais comme il faut pourtant qu’il ait part à la législation pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’empêcher.
Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c’est que le sénat qui avoit une partie de la [I-503] puissance exécutrice, & les magistrats qui avoient l’autre, n’avoient pas comme le peuple la faculté d’empêcher.
Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.
Ces trois puissances devroient former un repos ou une inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert.
La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne sauroit entrer dans le débat des affaires. Il n’est pas même nécessaire qu’elle propose ; parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejetter les décisions des propositions qu’elle auroit voulu qu’on n’eût pas faites.
Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avoit le [I-504] débat des affaires, il étoit naturel que la puissance exécutrice les proposât & les débattît avec lui ; sans quoi il y auroit eu dans les résolutions une confusion étrange.
Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics, autrement que par son consentement, il n’y aura plus de liberté ; parce qu’elle deviendra législative, dans le point le plus important de la législation.
Si la puissance législative statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus d’elle ; & quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu’on le tienne de soi ou d’un autre. Il en est de même, si elle statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur les forces de terre & de mer qu’elle doit confier à la puissance exécutrice.
Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu’on lui confie soient peuple, & aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu’au temps de [I-505] Marius. Et pour que cela soit ainsi, il n’y a que deux moyens, ou que ceux que l’on emploie dans l’armée aient assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens, & qu’ils ne soient enrôlés que pour un an, comme il se pratiquoit à Rome ; ou si on a un corps de troupes permanent, & où les soldats soient une des plus viles parties de la nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt qu’elle le désire ; que les soldats habitent avec les citoyens ; & qu’il n’y ait ni camp séparé, ni casernes, ni places de guerre.
L’armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice, & cela par la nature de la chose ; son fait consistant plus en action qu’en délibération.
Il est dans la maniere de penser des hommes, que l’on fasse plus de cas du courage, que de la timidité ; de l’activité, que de la prudence ; de la force, que des conseils. L’armée méprisera toujours un sénat, & respectera ses officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d’un corps [I-506] composé de gens qu’elle croira timides, & indignes par là de lui commander. Ainsi, sitôt que l’armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire ; & si le contraire est jamais arrivé, c’est l’effet de quelques circonstances extraordinaires. C’est que l’armée y est toujours séparée ; c’est qu’elle est composée de plusieurs corps qui dépendent chacun de leur province particulière ; c’est que les villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par leur situation seule, & où il n’y a point de troupes.
La Hollande est encore plus en sureté que Venise ; elle submergeroit les troupes révoltées, elle les feroit mourir de faim ; elles ne sont point dans les villes qui pourroient leur donner la subsistance ; cette subsistance est donc précaire.
Que si dans le cas où l’armée est gouvernée par le corps législatif, des circonstances particulières empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d’autres inconvéniens ; de deux choses l’une ; ou il faudra que l’armée détruise le [I-507] gouvernement, ou que le gouvernement affoiblisse l’armée.
Et cet affoiblissement aura une cause bien fatale, il naîtra de la foiblesse même du gouvernement.
Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs [5] des Germains, on verra que c’est d’eux que les Anglois ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau systême a été trouvé dans les bois.
Comme tous les choses humaines ont une fin, l’état dont nous parlons perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone, & Carthage ont bien péri. Il périra, lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l’exécutrice.
Ce n’est point à moi à examiner si les Anglois jouissent actuellement de cette liberté, ou non. Il me suffi de dire qu’elle est établie par leurs lois, & je n’en cherche pas davantage.
Je ne prétends point par-là ravaler les autres gouvernemens, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une [I-508] modéré. Comment dirois-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours désirable ; & que les hommes s’accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités ?
Arrington, dans son Oceana, a aussi examiné quel étoit le plus haut point de liberté où la constitution d’un état peut être portée. Mais on peut dire de lui, qu’il n’a cherché cette liberté qu’après l’avoir méconnue ; & qu’il a bâti Chalcédoine, ayant le rivage de Bisance devant les yeux.
-
[↑] À Venise.
-
[↑] Comme à Athènes.
-
[↑] C’étoient des magistrats que le peuple élisoit tous les ans. Voyez Etienne de Bisance.
-
[↑] On pouvoit accuser les magistrats Romains après leur magistrature. Voyez dans Denys d’Halicarnasse, liv. IX. l’affaire du tribun Genutius.
-
[↑] De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes ; ità tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud principes partractentur.
[I-509]
CHAPITRE VII.
Des Monarchies que nous connoissons.
Les monarchies que nous connoissons n’ont pas, comme celle dont nous venons de parler, la liberté pour leur objet direct ; elles ne tendent qu’à la gloire des citoyens, de l’état & du prince. Mais de cette gloire, il résulte un esprit de liberté, qui dans ces états peut faire d’aussi grandes choses, & peut-être contribuer autant au bonheur que la liberté même.
Les trois pouvoirs n’y sont point distribués & fondus sur le modele de la constitution dont nous avons parlé ; ils ont chacun une distribution particuliere, selon laquelle ils approchent plus ou moins de la liberté politique ; & s’ils n’en approchoient pas, la monarchie dégénéreroit en despotisme.
[I-510]
CHAPITRE VIII.
Pourquoi les anciens n’avoient pas une idée bien claire de la Monarchie.
Les anciens ne connoissoient point le gouvernement fondé sur un corps de noblesse, & encore moins le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par les représentans d’une nation. Les républiques de Grece & d’Italie étoient des villes qui avoient chacune leur gouvernement, & qui assembloient leurs citoyens dans leurs murailles. Avant que les Romains eussent englouti toutes les républiques, il n’y avoit presque point de roi nulle part, en Italie, Gaule, Espagne, Allemagne ; tout cela étoit de petits peuples ou de petites républiques. L’Afrique même étoit soumise à une grande ; l’Asie mineure étoit occupée par les colonies Grecques. Il n’y avoit donc point d’exemple de députés de villes, ni d’assemblées d’états ; il falloit aller jusqu’en Perse, pour trouver le gouvernement d’un seul.
Il est vrai qu’il y avoit des [I-511] républiques fédératives ; plusieurs villes envoyoient des députés à une assemblée. Mais je dis qu’il n’y avoit point de monarchie sur ce modele-là.
Voici comment se forma le premier plan des monarchies que nous connoissons. Les Nations Germaniques qui conquirent l’empire Romain, étoient comme l’on sait très-libres. On n’a qu’à voir là-dessus Tacite sur les mœurs des Germains. Les conquérans se répandirent dans le pays ; ils habitoient les campagnes, & peu les villes. Quand ils étoient en Germanie, toute la nation pouvoit s’assembler. Lorsqu’ils furent dispersés dans la conquête, ils ne le purent plus. Il falloit pourtant que la nation délibérât sur ses affaires, comme elle avoit fait avant la conquête ; elle le fit par des représentans. Voilà l’origine du gouvernement Gothique parmi nous. Il fut d’abord mêlé de l’aristocratie & de la monarchie. Il avoit cet inconvénient, que le bas peuple y étoit esclave : c’étoit un bon gouvernement, qui avoit en soi la capacité de devenir meilleur. La coutume vint d’accorder des lettres d’affranchissement ; & bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la [I-512] noblesse & du clergé, la puissance des rois se trouverent dans un tel concert, que je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré que le fut celui de chaque partie de l’Europe dans le temps qu’il y subsista ; & il est admirable que la corruption du gouvernement d’un peuple conquérant ait formé la meilleure espece de gouvernement que les hommes ayent pu imaginer.
[I-512]
CHAPITRE IX.
Maniere de penser d’Aristote.
L’embarras d’Aristote paroît visiblement, quand il traite de la monarchie [1] . Il en établit cinq especes : il ne les distingue pas par la forme de la constitution ; mais par des choses d’accident, comme les vertus ou les vices du prince ; ou par des choses étrangeres, comme l’usurpation de la tyrannie, ou la succession à la tyrannie.
Aristote met au rang des monarchies, & l’empire des Perses & le royaume de Lacédémone. Mais qui ne voit que [I-513] l’un étoit un état despotique, & l’autre une république ?
Les anciens, qui ne connoissoient pas la distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul, ne pouvoient se faire une idée juste de la monarchie.
-
[↑] Politique, liv. III. chap. XIV.
[I-513]
CHAPITRE X.
Maniere de penser des autres politiques.
Pour tempérer le gouvernement d’un seul, Arribas [1] , roi d’Epire, n’imagina qu’une république. Les molosses, ne sachant comment borner le même pouvoir, firent deux rois [2] : par-là on affoiblissoit l’état plus que le commandement ; on vouloit des rivaux, & on avoit des ennemis.
Deux rois n’étoient tolérables qu’à Lacédémone ; ils n’y formoient pas la constitution, mais ils étoient une partie de la constitution.
[I-514]
CHAPITRE XI.
Des Rois des temps héroïques chez les Grecs.
Chez les Grecs, dans les temps héroïques, il s’établit une espece de monarchie, qui ne subsista pas [1] . Ceux qui avoient inventé des arts, fait la guerre pour le peuple, assemblé des hommes dispersés, ou qui leur avoient donné des terres, obtenoient le royaume pour eux, & le transmettoient à leurs enfans. Ils étoient rois, prêtres & juges. C’est une des cinq especes de monarchie dont nous parle Aristote [2] ; & c’est la seule qui puisse réveiller l’idée de la constitution monarchique. Mais le plan de cette constitution est opposé à celui de nos monarchies d’aujourd’hui.
Les trois pouvoirs y étoient distribués de maniere que le peuple y avoit la puissance législative [3] , & le roi la puissance exécutrice avec la puissance de juger. Au lieu que dans les monarchies [I-515] que nous connoissons, le prince a la puissance exécutrice & la législative, ou du moins une partie de la législative, mais il ne juge pas.
Dans le gouvernement des rois des temps héroïques, les trois pouvoirs étoient mal distribués. Ces monarchies ne pouvoient subsister : car dès que le peuple avoit la législation, il pouvoit au moindre caprice anéantir la royauté, comme il fit par-tout.
Chez un peuple libre, & qui avoit le pouvoir législatif ; chez un peuple renfermé dans une ville, où tout ce qu’il y a d’odieux devient plus odieux encore, le chef-d’œuvre de la législation est de savoir bien placer la puissance de juger. Mais elle ne le pouvoit être plus mal que dans les mains de celui qui avoit déjà la puissance exécutrice. Dès ce moment, le monarque devenoit terrible. Mais en même temps, comme il n’avoit pas la législation, il ne pouvoit pas se défendre contre la législation ; il avoit trop de pouvoir, & il n’en avoit pas assez.
On n’avoit pas encore découvert que la vraie fonction du prince étoit d’établir des juges, & non pas de juger [I-516] lui-même. La politique contraire rendit le gouvernement d’un seul insupportable. Tous ces rois furent chassés. Les Grecs n’imaginerent point la vraie distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul ; ils ne l’imaginerent que dans le gouvernement de plusieurs, & ils appelerent cette sorte de constitution, police [4] .
-
[↑] Aristote, Politique, liv. III, chap. XIV.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Voyez ce que dit Plutarque, vie de Thésée. Voyez aussi Thucydide, liv. I.
-
[↑] Voyez Aristote, Politiq. liv. IV, chap. VIII.
[I-516]
CHAPITRE XII.
Du gouvernement des Rois de Rome, & comment les trois pouvoirs y furent distribués.
Le gouvernement des rois de Rome avoit quelque rapport à celui des rois des temps héroïques chez les Grecs. Il tomba comme les autres par son vice général ; quoiqu’en lui-même, & dans sa nature particuliere, il fût très-bon.
Pour faire connoître ce gouvernement, je distinguerai celui des cinq premiers rois, celui de Servius Tullius, & celui de Tarquin.
La couronne étoit élective ; & sous les cinq premiers rois, le sénat eut la plus grande part à l’élection.
[I-517]
Après la mort du roi, le sénat examinoit si l’on garderoit la forme du gouvernement qui étoit établie. S’il jugeoit à propos de la garder, il nommoit un magistrat [1] , tiré de son corps, qui élisoit un roi ; le sénat devoit approuver l’élection ; le peuple, la confirmer ; les auspices, la garantir. Si une de ces trois conditions manquoit, il falloit faire une autre élection.
La constitution étoit monarchique, aristocratique & populaire ; & telle fut l’harmonie du pouvoir, qu’on ne vit ni jalousie, ni dispute, dans les premiers regnes. Le roi commandoit les armées, & avoit l’intendance des sacrifices ; il avoit la puissance de juger les affaires civiles [2] & criminelles [3] ; il convoquoit le sénat ; il assembloit le peuple ; il lui portoit de certaines affaires, & régloit les autres avec le sénat [4] .
[I-518]
Le sénat avoit une grande autorité. Les rois prenoient souvent des sénateurs pour juger avec eux ; ils ne portoient point d’affaires au peuple, qu’elles n’eussent été délibérées [5] dans le sénat.
Le peuple avoit le droit d’élire [6] les magistrats, de consentir aux nouvelles lois ; & lorsque le roi le permettoit, celui de déclarer la guerre & de faire la paix. Il n’avoit point la puissance de juger. Quand Tullus Hostilius renvoya le jugement d’Horace au peuple, il eut des raisons particulieres, que l’on trouve dans Denys d’Halicarnasse [7] .
La constitution changea sous [8] Servius Tullius. Le sénat n’eut point de part à son élection ; il se fit proclamer par le peuple. Il se dépouilla des jugemens [9] civils, & ne se réserva que [I-519] les criminels ; il porta directement au peuple toutes les affaires ; il le soulagea des taxes, & en mit tout le fardeau sur les patriciens. Ainsi à mesure qu’il affoiblissoit la puissance royale & l’autorité du sénat, il augmentoit le pouvoir du peuple [10] .
Tarquin ne se fit élire ni par le sénat ni par le peuple ; il regarda Servius Tullius comme un usurpateur, & prit la couronne comme un droit héréditaire ; il extermina la plupart des sénateurs ; il ne consulta plus ceux qui restoient, il ne les appela pas même à ses jugemens [11] . Sa puissance augmenta ; mais ce qu’il y avoit d’odieux dans cette puissance, devint plus odieux encore : il usurpa le pouvoir du peuple ; il fit des lois sans lui ; il en fit même contre lui [12] . Il auroit réuni les trois pouvoirs dans sa personne ; mais le peuple se souvint un moment qu’il étoit législateur, & Tarquin ne fut plus.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. II, pag. 120 ; & liv. IV, pag. 242 & 243.
-
[↑] Voyez le discours de Tanaquil, dans Tite-Live, liv. I, premiere décade ; & le réglement de Servius Tullius, dans Denys d’Halicarnasse, liv. IV, p. 229
-
[↑] Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. II, p. 118 ; & liv. III, pag. 171.
-
[↑] Ce fut par un sénatus-consulte, que Tullus Hostilius envoya détruire Albe ; Denys d’Halicarnasse, liv. III, pag. 167 & 172.
-
[↑] Ibid. liv. IV, p. 276.
-
[↑] Ibid. liv. II. Il falloit pourtant qu’il ne nommât pas à toutes les charges, puisque Valcrius Publicola fit la fameuse loi, qui défendoit à tout citoyen d’exercer aucun emploi, s’il ne l’avoit obtenu par le suffrage du peuple.
-
[↑] Livre III, p. 159.
-
[↑] Livre IV.
-
[↑] Il se priva de la moitié de la puissance royale, dit Denys d’Halicarnasse, liv. IV, pag. 229.
-
[↑] On croyoit que, s’il n’avoit pas été prévenu par Tarquin, il auroit établi le gouvernement populaire ; Denys d’Halicarnasse, liv. IV, p. 243.
-
[↑] Livre IV.
-
[↑] Ibid.
[I-520]
CHAPITRE XIII.
Réflexions générales sur l’état de Rome, après l’expulsion des Rois.
On ne peut jamais quitter les Romains : c’est ainsi qu’encore aujourd’hui, dans leur capitale, on laisse les nouveaux palais pour aller chercher des ruines ; c’est ainsi que l’œil qui s’est reposé sur l’émail des prairies, aime à voir les rochers & les montagnes.
Les familles patriciennes avoient eu de tout temps de grandes prérogatives. Ces distinctions, grandes sous les Rois, devinrent bien plus importantes après leur expulsion. Cela causa la jalousie des plébéiens, qui voulurent les abaisser. Les contestations frappoient sur la constitution, sans affoiblir le gouvernement : car, pourvu que les magistratures conservassent leur autorité, il étoit assez indifférent de quelle famille étoient les magistrats.
Une monarchie élective, comme étoit Rome, suppose nécessairement un corps aristocratique puissant, qui la soutienne, sans quoi elle se change d’abord en [I-521] tyrannie ou en état populaire. Mais un état populaire n’a pas besoin de cette distinction de familles pour se maintenir. C’est ce qui fit que les patriciens, qui étoient des parties nécessaires de la constitution du temps des rois, en devinrent une partie superflue du temps des consuls ; le peuple put les abaisser sans se détruire lui-même, & changer la constitution sans la corrompre.
Quand Servius Tullius eut avili les patriciens, Rome dut tomber des mains des rois dans celles du peuple. Mais le peuple, en abaissant les patriciens, ne dut point craindre de retomber dans celles des rois.
Un état peut changer de deux manieres, ou parce que la constitution se corrige, ou parce qu’elle se corrompt. S’il a conservé ses principes, & que la constitution change, c’est qu’elle se corrige : s’il a perdu ses principes, quand la constitution vient à changer, c’est qu’elle se corrompt.
Rome, après l’expulsion des Rois, devoit être une démocratie. Le peuple avoit déjà la puissance législative ; c’étoit son suffrage unanime qui avoit chassé les rois ; & s’il ne persistoit pas [I-522] dans cette volonté, les Tarquins pouvoient à tous les instans revenir. Prétendre qu’il eût voulu les chasser pour tomber dans l’esclavage de quelques familles, cela n’étoit pas raisonnable. La situation des choses demandoit donc que Rome fût une démocratie ; & cependant elle ne l’étoit pas. Il fallut tempérer le pouvoir des principaux, & que les lois inclinassent vers la démocratie.
Souvent les états fleurissent plus dans le passage insensible d’une constitution à une autre, qu’ils ne le faisoient dans l’une ou l’autre de ces constitutions. C’est pour lors que tous les ressorts du gouvernement sont tendus, que tous les citoyens ont des prétentions ; qu’on s’attaque, ou qu’on se caresse, & qu’il y a une noble émulation entre ceux qui défendent la constitution qui décline, & ceux qui mettent en avant celle qui prévaut.
[I-523]
CHAPITRE XIV.
Comment la distribution des trois pouvoirs commença à changer après l’expulsion des Rois.
Quatre choses choquoient principalement la liberté de Rome. Les patriciens obtenoient seuls tous les emplois sacrés, politiques, civils & militaires ; on avoit attaché au consulat un pouvoir exorbitant, on faisoit des outrages au peuple, enfin on ne lui laissoit presqu’aucune influence dans les suffrages. Ce furent ces quatre abus que le peuple corrigea.
I°. Il fit établir, qu’il y auroit des magistratures, où les plébéiens pourroient prétendre ; & il obtint peu à peu qu’il auroit part à toutes, excepté à celle d’entre-roi.
2°. On décomposa le consulat, & on en forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs [1] , à qui on donna la puissance de juger les affaires privées ; on nomma des questeurs [2] , pour faire [I-524] juger les crimes publics ; on établit des édiles, à qui on donna la police ; on fit des trésoriers [3] , qui eurent l’administration des deniers publics : enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui regle les moeurs des citoyens & la police momentanée des divers corps de l’état. Les principales prérogatives qui leur resterent, furent de présider aux grands [4] états du peuple, d’assembler le sénat & de commander les armées.
3°. Les lois sacrées établirent des tribuns, qui pouvoient à tous les instans arrêter les entreprises des patriciens ; & n’empêchoient pas seulement les injures particulieres, mais encore les générales.
Enfin, les plébéiens augmenterent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple Romain étoit divisé de trois manieres, par centuries, par curies & par tribus ; & quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé & formé d’une de ces trois manieres.
Dans la premiere, les patriciens, les [I-525] principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoient presque toute l’autorité ; dans la seconde, ils en avoient moins ; dans la troisieme, encore moins.
La division par centuries étoit plutôt une division de cens & de moyens, qu’une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries [5] , qui avoient chacune une voix. Les patriciens & les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premieres centuries ; le reste des citoyens étoit répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc dans cette division les maîtres des suffrages.
Dans les divisions des curies [6] , les patriciens n’avoient pas les mêmes avantages. Ils en avoient pourtant. Il falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maîtres ; on n’y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n’eût été auparavant portée au sénat, & approuvée par un sénatus-consulte. Mais dans la division par tribus, il [I-526] n’étoit question ni d’auspices, ni de sénatus-consultes, & les patriciens n’y étoient pas admis.
Or le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu’on avoit coutume de faire par centuries, & à faire par tribus les assemblées qui se faisoient par curies ; ce qui fit passer les affaires des mains des patriciens dans celles des plébéiens.
Ainsi quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les patriciens, ce qui commença lors de l’affaire de Coriolan [7] , les plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus [8] , & non par centuries ; & lorsqu’on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures [9] de tribuns & d’édiles, le peuple obtint qu’il s’assembleroit par curies pour les nommer ; & quand sa puissance fut affermie, il obtint [10] qu’ils seroient nommés dans une assemblée par tribus.
-
[↑] Tite-Live, premiere décade, liv. VI.
-
[↑] Quaestores parricidii ; Pomponius, leg. 2. § 23, ss de orig. juris..
-
[↑] Plutarque, vie de Publicola.
-
[↑] Comitiis centuriatis.
-
[↑] Voyez là-dessus Tite-Live, liv. I ; & Denys d’Halicarnasse, liv. IV & VII.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. IX, p. 598.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. VII.
-
[↑] Contre l’ancien usage, comme on le voit dans Denys d’Halicarnasse, liv. V., p. 320.
-
[↑] Liv. VI, p. 410 & 411.
-
[↑] Liv. IX, p. 605.
[I-527]
CHAPITRE XV.
Comment, dans l’état florissant de la république, Rome perdit tout à coup sa liberté.
Dans le feu des disputes entre les patriciens & les plébéiens, ceux-ci demanderent que l’on donnât des lois fixes, afin que les jugemens ne fussent plus l’effet d’une volonté capricieuse, ou d’un pouvoir arbitraire. Après bien des résistances, le sénat y acquiesça. Pour composer ces lois, on nomma des décemvirs. On crut qu’on devoit leur accorder un grand pouvoir, parce qu’ils avoient à donner des lois à des partis qui étoient presqu’incompatibles. On suspendit la nomination de tous les magistrats, & dans les comices, ils furent élus seuls administrateurs de la république. Ils se trouverent revêtus de la puissance consulaire & de la puissance tribunitienne. L’une leur donnoit le droit d’assembler le sénat ; l’autre, celui d’assembler le peuple : mais ils ne convoquerent ni le sénat ni le peuple. Dix hommes dans la république eurent [I-528] seuls toute la puissance législative, toute la puissance exécutrice, toute la puissance des jugemens. Rome se vit soumise à une tyrannie aussi cruelle que celle de Tarquin. Quand Tarquin exerçoit ses vexations, Rome étoit indignée du pouvoir qu’il avoit usurpé : quand les décemvirs exercerent les leurs, elle fut étonnée du pouvoir qu’elle avoit donné.
Mais quel étoit ce systême de tyrannie, produit par des gens qui n’avoient obtenu le pouvoir politique & militaire, que par la connoissance des affaires civiles ; & qui dans les circonstances de ces temps-là avoient besoin au-dedans de la lâcheté des citoyens, pour qu’ils se laissassent gouverner, & de leur courage au dehors, pour les défendre ?
Le spectacle de la mort de Virginie, immolée par son pere à la pudeur & à la liberté, fit évanouir la puissance des décemvirs. Chacun se trouva libre, parce que chacun fut offensé : tout le monde devint citoyen, parce que tout le monde se trouva pere. Le sénat & le peuple rentrerent dans une liberté qui avoit été confiée à des tyrans ridicules.
[I-529]
Le peuple Romain, plus qu’un autre, s’émouvoit par les spectacles. Celui du corps sanglant de Lucrece fit finir la royauté. Le débiteur, qui parut sur la place couvert de plaies, fit changer la forme de la république. La vue de Virginie fit chasser les décemvirs. Pour faire condamner Manlius, il fallut ôter au peuple la vue du capitole. La robe sanglante de César remit Rome dans la servitude.
[I-529]
CHAPITRE XVI.
De la puissance législative dans la république Romaine.
On n’avoit point de droit à se disputer sous les décemvirs : mais quand la liberté revint, on vit les jalousies renaître : tant qu’il resta quelques privileges aux patriciens, les plébéiens les leur ôterent.
Il y auroit eu peu de mal, si les plébéiens s’étoient contentés de priver les patriciens de leurs prérogatives, & s’ils ne les avoient pas offensés dans leur qualité même de citoyens. Lorsque le peuple étoit assemblé par curies ou par [I-530] centuries, il étoit composé de sénateurs, de patriciens & de plébéiens. Dans les disputes, les plébéiens gagnerent ce point [1] , que seuls, sans les patriciens & sans le sénat, ils pourroient faire des lois qu’on appela plébiscites ; & les comices où on les fit, s’appelerent comices par tribus. Ainsi il y eut des cas où les patriciens [2] n’eurent point de part à la puissance législative, & [3] où ils furent soumis à la puissance législative d’un autre corps de l’état. Ce fut un délire de la liberté. Le peuple, pour établir la démocratie, choqua les principes mêmes de la démocratie. Il sembloit qu’une puissance aussi exorbitante, auroit dû anéantir l’autorité du sénat : mais Rome avoit deux institutions admirables. Elle en avoit deux sur-tout ; par l’une, la puissance législative du [I-531] peuple étoit réglée par l’autre, elle étoit bornée.
Les censeurs, & avant eux les consuls [4] , formoient & créoient, pour ainsi dire, tous les cinq ans le corps du peuple ; ils exerçoient la législation sur le corps même qui avoit la puissance législative. « Tiberius-Gracchus, censeur, dit Cicéron, transféra les affranchis dans les tribus de la ville, non par la force de son éloquence, mais par une parole & par un geste : & s’il ne l’eût pas fait, cette république, qu’aujourd’hui nous soutenons à peine, nous ne l’aurions plus ».
D’un autre côté, le sénat avoit le pouvoir d’ôter, pour ainsi dire, la république des mains du peuple, par la création d’un dictateur, devant lequel le souverain baissoit la tête, & les lois les plus populaires restoient dans le silence [5] .
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. XI, pag. 725.
-
[↑] Par les lois sacrées, les plébéiens purent faire des plébiscites, seuls, & sans que les patriciens fussent admis dans leur assemblée ; Denys d’Halicarnasse, liv. VI, p. 410 ; & liv. VII, p. 430.
-
[↑] Par la loi faite après l’expulsion des décemvirs, les patriciens furent soumis aux plébiscites, quoiqu’ils n’eussent pu y donner leur voix. Tite-Live, liv. III ; & Denys d’Halicarnasse, liv. XI, p. 725 ; & cette loi fut confirmée par celle de Publius Philo, dictateur, l’an de Rome 416. Tite-Live, liv. VIII.
-
[↑] L’an 312 de Rome, les consuls faisoient encore le cens, comme il paroît par Denys d’Halicarnasse, liv. XI.
-
[↑] Comme celles qui permettoient d’appeler au peuple des ordonnances de tous les magistrats.
[I-532]
CHAPITRE XVII.
De la puissance exécutrice dans la même république.
Si le peuple fut jaloux de sa puissance législative, il le fut moins de sa puissance exécutrice. Il la laissa presque toute entier au sénat & aux consuls ; & il ne se réserva guere que le droit d’élire les magistrats, & de confirmer les actes du sénat & des généraux.
Rome, dont la passion étoit de commander, dont l’ambition étoit de tout soumettre, qui avoit toujours usurpé, qui usurpoit encore, avoit continuellement de grandes affaires ; ses ennemis conjuroient contre elle, ou elle conjuroit contre ses ennemis.
Obligée de se conduire, d’un côté avec un courage héroïque, & de l’autre avec une sagesse consommée, l’état des choses demandoit que le sénat eût la direction des affaires. Le peuple disputoit au sénat toutes les branches de la puissance législative, parce qu’il étoit [I-533] jaloux de sa liberté ; il ne lui disputoit point les branches de la puissance exécutrice, parce qu’il étoit jaloux de sa gloire.
La part que le sénat prenoit à la puissance exécutrice, étoit si grande, que Polybe [1] dit, que les étrangers pensoient tous que Rome étoit une aristocratie. Le sénat disposoit des deniers publics, & donnoit les revenus à ferme ; il étoit l’arbitre des affaires des alliés ; il décidoit de la guerre & de la paix, & dirigeoit à cet égard les consuls ; il fixoit le nombre des troupes Romaines & des troupes alliées, distribuoit les provinces & les armées aux consuls ou aux préteurs : & l’an du commandement expiré, il pouvoit leur donner un successeur ; il décernoit les triomphes, il recevoit des ambassades, & en envoyoit ; il nommoit les rois, les récompensoit ; les punissoit, les jugeoit, leur donnoit ou leur faisoit perdre le titre d’alliés du peuple Romain.
Les consuls faisoient la levée des troupes qu’ils devoient mener à la guerre ; ils commandoient les armées de terre ou de mer ; disposoient des [I-534] alliés : ils avoient dans les provinces toute la puissance de la république ; ils donnoient la paix aux peuples vaincus, leur en imposoient les conditions, ou renvoyoient au sénat.
Dans les premiers temps, lorsque le peuple prenoit quelque part aux affaires de la guerre & de la paix, il exerçoit plutôt sa puissance législative que sa puissance exécutrice. Il ne faisoit guere que confirmer ce que les rois, & après eux, les consuls ou le sénat avoient fait. Bien loin que le peuple fût l’arbitre de la guerre, nous voyons que les consuls ou le sénat la faisoient souvent malgré l’opposition de ses tribuns. Ainsi [2] il créa lui-même les tribuns des légions, que les généraux avoient nommés jusqu’alors ; & quelque temps avant la premier guerre Punique, il régla qu’il auroit, seul, le droit de déclarer la guerre [3] .
-
[↑] Liv. VI.
-
[↑] L’an de Rome 444. Tite-Live, premiere décade, liv. IX. La guerre contre Persée paroissant périlleuse, un sénatus-consulte ordonna que cette loi seroit suspendue ; & le peuple y consentit. Tite-Live, cinquieme décade, liv. II.
-
[↑] Il l’arracha du sénat, dit Freishemius, deuxieme décade, liv. VI.
[I-535]
CHAPITRE XVIII.
De la puissance de juger, dans le gouvernement de Rome.
La puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.
Les consuls [1] jugerent après les rois, comme les préteurs jugerent après les consuls. Servius Tullius s’étoit dépouillé du jugement des affaires civiles ; les consuls ne les jugerent pas non plus, si ce n’est dans des cas très-rares [2] , que l’on appella, pour cette raison, extraordinaires [3] . Ils se contenterent de nommer les juges, & de former les tribunaux qui devoient juger. Il paroît, par le discours d’Appius Claudius dans [I-536] Denys d’Halicarnasse [4] , que dès l’an de Rome 259, ceci étoit regardé comme une coutume établie chez les Romains ; & ce n’est pas la faire remonter bien haut, que de la rapporter à Servius Tullius.
Chaque année, le préteur formoit une liste [5] ou tableau de ceux qu’il choisissoit pour faire la fonction de juges pendant l’année de sa magistrature. On en prenoit le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui étoit très-favorable à la [6] liberté, c’est que le préteur prenoit les juges du consentement [7] des parties. Le grand nombre de récusations que l’on peut faire aujourd’hui en Angleterre, revient à peu près à cet usage.
Ces juges ne décidoient que des [I-537] questions de fait [8] : par exemple, si une somme avoit été payée, ou non ; si une action avoit été commise, ou non. Mais pour les questions de droit [9] , comme elles demandoient une certaine capacité, elles étoient portées au tribunal des centumvirs [10] .
Les rois se réserverent le jugement des affaires criminelles, & les consuls leur succéderent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité, que le consul Brutus fit mourir ses enfans & tous ceux qui avoient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils en portoient l’exercice même dans les affaires de la ville ; & leurs procédés dépouillés des formes de la justice, étoient des actions violentes, plutôt que des jugemens.
Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d’appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettoient en péril la vie d’un citoyen. Les [I-538] Consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen Romain, que par la volonté du peuple [11] .
On voit dans la premiere conjuration pour le retour des Tarquins, que le consul Brutus juge les coupables ; dans la seconde, on assemble le sénat & les comices pour juger [12] .
Les lois qu’on appella sacrées, donnerent aux plébéiens des tribuns, qui formerent un corps qui eut d’abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance & la facilité d’accorder. La loi Valérienne avoit permis les appels au peuple ; c’est-à-dire, au peuple composé de sénateurs, de patriciens & de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce seroit devant eux que les appellations seroient portées. Bientôt on mit en question, si les plébéiens pourroient juger un patricien ; cela fut le sujet d’une dispute, que l’affaire de Coriolan fit naître, & qui finit avec [I-539] cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenoit, contre l’esprit de la loi Valérienne, qu’étant patricien, il ne pouvoit être jugé que par les consuls : les plébéiens, contre l’esprit de la même loi, prétendirent qu’il ne devoit être jugé que par eux seuls, & ils le jugerent.
La loi des douze tables modifia ceci. Elle ordonna qu’on ne pourroit décider de la vie d’un citoyen, que dans les grands états du peuple [13] . Ainsi le corps des plébéiens, ou ce qui est la même chose, les comices par tribus ne jugerent plus que les crimes dont la peine n’étoit qu’une amende pécuniaire. Il falloit une loi pour infliger une peine capitale : pour condamner à une peine pécuniaire, il ne falloit qu’un plébiscite.
Cette disposition de la loi des douzes tables fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens & le sénat. Car, comme la compétence des uns & des autres dépendit de la grandeur de la peine & de [I-540] la nature du crime, il fallut qu’ils se concertassent ensemble.
La loi Valérienne ôta tout ce qui restoit à Rome du gouvernement qui avoit du rapport à celui des rois Grecs des temps héroïques. Les consuls se trouverent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entr’eux, de ceux qui intéressent plus l'état dans le rapport qu'ils a avec un citoyen. Les premiers sont appellés privés, les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; & à l’égard des privés, il nomma pour chaque crime, par une commission particuliere, un questeur, pour en faire la poursuite. C’étoit souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissoit. On l’appeloit questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des douze tables [14] .
Le questeur nommoit ce qu’on appelloit le juge de la question, qui tiroit au sort les juges, formoit le tribunal, [I-541] & présidoit sous lui au jugement [15] .
Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l’on voie comment les puissance étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur [16] ; quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu’il nommât un questeur [17] ; enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat, pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, & lui demander qu’il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion [18] , dans Tite-Live [19] .
L’an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes [20] . On divisa peu à peu toutes [I-542] les matieres criminelles en diverses parties, qu’on appella des questions perpétuelles. On créa divers préteurs, & on attribua à chacun d’eux quelqu’une de ces questions. On leur donna, pour un an, la puissance de juger les crimes qui en dépendoient ; & ensuite ils alloient gouverner leur province.
A Carthage, le sénat des cent étoit composé de juges qui étoient pour la vie [21] . Mais à Rome, les préteurs étoient annuels ; & les juges n’étoient pas même pour un an, puisqu’on les prenoit pour chaque affaire. On a vu, dans le chapitre VI de ce livre, combien, dans de certains gouvernemens, cette disposition étoit favorable à la liberté.
Les juges furent pris dans l’ordre des sénateurs, jusqu’au temps des Gracques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu’on les prendroit dans celui des chevaliers ; changement si considérable, que le tribun se vanta d’avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l’ordre des sénateurs.
Il faut remarquer que les trois [I-543] pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu’ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome, le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice, & une partie de la puissance de juger, c’étoit un grand pouvoir qu’il falloit balancer par un autre. Le sénat avoit bien une partie de la puissance exécutrice ; il avoit quelque branche de la puissance législative [22] ; mais cela ne suffisoit pas pour contrebalancer le peuple. Il falloit qu’il eût part à la puissance de juger ; & il y avoit part, lorsque les juges étoient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques priverent les sénateurs de la puissance de juger [23] , le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquerent donc la liberté de la constitution, pour favoriser la liberté du citoyen ; mais celle-ci se perdit avec celle-là.
Il en résulta des maux infinis. On [I-544] changea la constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avoit à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissoit le peuple au sénat ; & la chaîne de la constitution fut rompue.
Il y avoit même des raisons particulieres qui devoient empêcher de transporter les jugemens aux chevaliers. La constitution de Rome étoit fondée sur ce principe, que ceux-là devoient être soldats, qui avoient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république. Les chevaliers, comme les plus riches, formoient la cavalerie des légions. Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus servir dans cette milice ; il fallut lever une autre cavalerie ; Marius prit toute sorte de gens dans les légions, & la république fut perdue [24] .
De plus, les chevaliers étoient les traitans de la république ; ils étoient avides ; ils semoient les malheurs dans les malheurs, & faisoient naître les besoins publics des besoins publics. Bien [I-545] loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il auroit fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des anciennes lois Françoises ; elles ont stipulé avec les gens d’affaires, avec la méfiance que l’on garde à des ennemis. Lorsqu’à Rome les jugemens furent transportés aux traitans, il n’y eut plus de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistrature, plus de magistrats.
On trouve une peinture bien naïve de ceci, dans quelque fragment de Diodore de Sicile & de Dion. « Mutius Scévola, dit Diodore [25] , voulut rappeller les anciennes mœurs, & vivre de son bien propre avec frugalité & intégrité. Car ses prédécesseurs ayant fait une société avec les traitans, qui avoient pour lors les jugemens à Rome, ils avoient rempli la province de toutes sortes de crimes. Mais Scévola fit justice des publicains, & fit mener en prison ceux qui y traînoient les autres.
[I-546]
Dion nous dit [26] , que Publius Rutilius, son lieutenant, qui n’étoit pas moins odieux aux chevaliers, fut accusé à son tour d’avoir reçu des présens, & fut condamné à une amende. Il fit sur le champ cession de biens. Son innocence parut, en ce qu’on lui trouva beaucoup moins de bien qu’on ne l’accusoit d’en avoir volé, & il montroit les titres de sa propriété ; il ne voulut plus rester dans la ville avec de telles gens.
Les Italiens, dit encore Diodore [27] , achetoient en Sicile des troupes d’esclaves pour labourer leurs champs, & avoir soin de leurs troupeaux ; ils leur refusoient la nourriture. Ces malheureux étoient obligés d’aller voler sur les grands chemins, armés de lances & de massues, couverts de peaux de bêtes, de grands chiens autour d’eux. Toute la province fut dévastée, & les gens du pays ne pouvoient dire avoir en propre, que ce qui étoit dans l’enceinte des villes. Il n’y avoit ni proconsul, ni préteur, qui pût ou voulût s’opposer à [I-547] ce désordre, & qui osât punir ces esclaves, parce qu’ils appartenoient aux chevaliers qui avoient à Rome les jugemens [28] . Ce fut pourtant une des causes de la guerre des esclaves. Je ne dirai qu’un mot : Une profession qui n’a ni ne peut avoir d’objet que le gain ; une profession qui demandoit toujours, & à qui on ne demandoit rien ; une professions sourde & inexorable, qui appauvrissoit les richesses & la misere même, ne devoit point avoir à Rome les jugemens.
-
[↑] On ne peut douter que les consuls, avant la création des préteurs, n’eussent eu les jugemens civils. Voyez Tite-Live, premiere décade, liv. II. p. 19. Denys d’Halicarnasse, liv. X. p. 627 ; & même livre, p. 645.
-
[↑] Souvent les tribuns jugerent seuls ; rien ne les rendit plus odieux. Denys d’Halicarnasse, livre XI. pag. 700
-
[↑] Judicia extraordinaria. Voyez les institutes, liv. IV.
-
[↑] Liv. VI. pag. 360.
-
[↑] Album judicium.
-
[↑] « Nos ancêtres n’ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentio, qu’un homme dont les parties ne seroient pas convenues, pût être juge, non seulement de la réputation d’un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire. »
-
[↑] Voyez dans les fragmens de la loi Servilienne, de la Cornélienne, & autres, de quelle maniere ces lois donnoient des juges dans les crimes qu’elles se proposoient de punir. Souvent ils étoient pris par choix, quelquefois par le sort, ou enfin par le sort mêlé avec le choix.
-
[↑] Séneque, de benef. liv. III. ch. VII. in fine.
-
[↑] Voyez Quintilien, liv. IV. p. 54. in-fol. édit. de Paris, 1541.
-
[↑] Leg. 2. §. 24. ss de orig. jur. Des magistrats appellés décemvirs présidoient au jugement, le tout sous la direction d’un préteur.
-
[↑] Quoniam de capite civis Romani, in jussu populi Romani, non erat permissum consulibus jus dicere. Voyez Pomponius, leg. 2. § 16. ss de orig. Jur.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. V. p. 322.
-
[↑] Les comices par centuries. Aussi Manliux Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. Tite-Live, décade premiere, liv. VI. P. 68.
-
[↑] Dit Pomponius, dans la loi 2. au digeste de orig. jur.
-
[↑] Voyez un fragment d'Ulpien, qui en rapporter un autre de la loi Cornelienne : on le trouve dans la collation des lois Mosaiques & Romaines, titul. I. de sicariss & homicidus.
-
[↑] Cela avoit sur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, où le sénat avoit une principale inspection. Voyez Tite-Live, premiere décade, liv. IX. sur les conjurations de Capoue.
-
[↑] Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l’an 340 de Rome. Voyez Tite-Live
-
[↑] Ce jugement fut rendu l’an de Rome 567.
-
[↑] Liv. VIII.
-
[↑] Cicéron, in Bruto.
-
[↑] Cela se prouve par Tite-Live, liv. XLIII, qui dit qu’Annibal rendit leur magistrature annuelle.
-
[↑] Les senatus-consultes avoient force pendant un an, quoiqu’ils ne fussent pas confirmés par le peuple. Denys d’Halicarnasse, liv. IX. pag. 595. & liv. XI. pag. 735.
-
[↑] En l’an 630.
-
[↑] Capite censos plerosque. Salluste, guerre de Iugurtha.
-
[↑] Fragment de cet auteur, liv. XXXVI, dans le recueil de Constantin Porphyrogenete, des vertus & des vices.
-
[↑] Fragment de son histoire, tirée de l’extrait des vertus & des vices.
-
[↑] Fragment du liv. XXXIV, dans l’extrait des vertus & des vices.
-
[↑] Penes quos Romæ cùm judicia erant, atque ex equestri ordine solerent sortitò judices elegi in cassâ prætorum & proconsulum, quibus post administratum provinciam dies dicta erat.
[I-547]
CHAPITRE XIX.
Du gouvernement des provinces Romaines.
C’est ainsi que les trois pouvoirs furent distribués dans la ville : mais il s’en faut bien qu’ils le fussent de même dans les provinces. La liberté étoit dans le centre, & la tyrannie aux extrémités.
Pendant que Rome ne domina que [I-548] dans l’Italie, les peuples furent gouvernés comme des confédérés : on suivoit les lois de chaque république. Mais lorsqu’elle conquit plus loin, que le sénat n’eut pas immédiatement l’œil sur les provinces, que les magistrats qui étoient à Rome ne purent plus gouverner l’empire, il fallut envoyer des préteurs & des proconsuls. Pour lors, cette harmonie des trois pouvoirs ne fut plus. Ceux qu’on envoyoit avoient une puissance qui réunissoit celle de toutes les magistratures Romaines ; que dis-je ? celle même du sénat, celle même du peuple [1] . C’étoient des magistrats despotiques, qui convenoient beaucoup à l’éloignement des lieux où ils étoient envoyés. Ils exerçoient les trois pouvoirs ; ils étoient, si j’ose me servir de ce terme, les bachas de la république.
Nous avons dit ailleurs [2] que les mêmes citoyens, dans la république, avoient, par la nature des choses, les emplois civils & militaires. Cela fait qu’une république qui conquiert, ne [I-549] peut guere communiquer son gouvernement & régir l’état conquis selon la forme de la constitution. En effet, le magistrat qu’elle envoie pour gouverner, ayant la puissance exécutrice, civile & militaire, il faut bien qu’il ait aussi la puissance législative ; car qui est-ce qui feroit des lois sans lui ? Il faut aussi qu’il ait la puissance de juger : car qui est-ce qui jugeroit indépendamment de lui ? Il faut donc que le gouvernement qu’elle envoie ait les trois pouvoirs, comme cela fut dans les provinces Romaines.
Une monarchie peut plus aisément communiquer son gouvernement, parce que les officiers qu’elle envoie ont, les uns la puissance exécutrice civile, & les autres la puissance exécutrice militaire ; ce qui n’entraîne pas après soi le despotisme.
C’étoit un privilege d’une grande conséquence pour un citoyen Romain, de ne pouvoir être jugé que par le peuple. Sans cela, il auroit été soumis dans les provinces au pouvoir arbitraire d’un proconsul ou d’un propréteur. La ville ne sentoit point la tyrannie qui ne s’exerçoit que sur les nations assujetties.
[I-550]
Ainsi dans le monde Romain, comme à Lacédémone, ceux qui étoient libres étoient extrêmement libres, & ceux qui étoient esclaves étoient extrêmement esclaves.
Pendant que les citoyens payoient des tributs, ils étoient levés avec une équité très-grande. On suivoit l’établissement de Servius Tullius, qui avoit distribué tous les citoyens en six classes, selon l’ordre de leurs richesses, & fixé la part de l’impôt à proportion de celle que chacun avoit dans le gouvernement. Il arrivoit de-là qu’on souffroit la grandeur du tribut, à cause de la grandeur du crédit ; & que l’on se consoloit de la petitesse du crédit, par la petitesse du tribut.
Il y avoit encore une chose admirable : c’est que la division de Servius Tullius par classes étant, pour ainsi dire, le principe fondamental de la constitution ; il arrivoit que l’équité, dans la levée des tributs, tenoit au principe fondamental du gouvernement, & ne pouvoit être ôtée qu’avec lui.
Mais pendant que la ville payoit les tributs sans peine, ou n’en payoit point [I-551] du tout [3] , les provinces étoient désolées par les chevaliers qui étoient les traitans de la république. Nous avons parlé de leurs vexations, & toute l’histoire en est pleine.
« Toute l’Asie m’attend comme son libérateur, disoit Mithridate [4] ; tant ont excité de haine contre les Romains les rapines des proconsuls [5] , les exactions des gens d’affaires, & les calomnies des jugemens [6] .
Voilà ce qui fit que la force des provinces n’ajouta rien à la force de la république, & ne fit au contraire que l’affoiblir. Voilà ce qui fit que les provinces regarderent la perte de la liberté de Rome, comme l’époque de l’établissement de la leur.
-
[↑] Ils faisoient leurs édits en entrant dans les provinces.
-
[↑] Liv. V. ch. XIX. Voyez aussi les liv. II, III, IV & V.
-
[↑] Après la conquête de la Macédoine, les tributs cesserent à Rome.
-
[↑] Harangue tirée de Trogue Pompée, rapportée par Justin, liv. XXXVIII.
-
[↑] Voyez les oraisons contre Verrès.
-
[↑] On fait que ce fut le tribunal de Varus qui fit révolter les Germains.
[I-552]
CHAPITRE XX.
Fin de ce Livre.
Je voudrois rechercher dans tous les gouvernemens modérés que nous connoissons, quelle est la distribution des trois pouvoirs, & calculer par-là les degrés de liberté dont chacun d’eux peut jouir. Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu’on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s’agit pas de faire lire, mais de faire penser.
[I-553]
LIVRE XII.
Des Lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec le citoyen.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée de ce Livre.
Ce n’est pas assez d’avoir traité de la liberté politique dans son rapport avec la constitution ; il faut la faire voir dans le rapport qu’elle a avec le citoyen.
J’ai dit que dans le premier cas elle est formée par une certaine distribution des trois pouvoirs : mais, dans le second, il faut la considérer sous une autre idée. Elle consiste dans la sureté, ou dans l’opinion que l’on a de sa sureté.
Il pourra arriver que la constitution sera libre, & que le citoyen ne le sera point. Le citoyen pourra être libre, & la constitution ne l’être pas. Dans ces cas, la constitution sera libre de droit, [I-554] & non de fait ; le citoyen sera libre de fait, & non pas de droit.
Il n’y a que la disposition des lois, & même des lois fondamentales, qui forme la liberté dans son rapport avec la constitution. Mais, dans le rapport avec le citoyen, des mœurs, des manieres, des exemples reçus peuvent la faire naître ; & de certaines lois civiles la favoriser ; comme nous allons voir dans ce livre-ci.
De plus, dans la plupart des états, la liberté étant plus gênée, choquée ou abattue, que leur constitution ne le demande ; il est bon de parler des lois particulieres, qui dans chaque constitution, peuvent aider ou choquer le principe de la liberté dont chacun d’eux peut être susceptible.
[I-554]
CHAPITRE II.
De la liberté du citoyen.
La liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté, ou du moins (s’il faut parler dans tous les systêmes) dans l’opinion où l’on est que l’on exerce sa volonté. La liberté [I-555] politique consiste dans la sureté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sureté.
Cette sureté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté des lois criminelles, que dépend principalement la liberté du citoyen.
Les lois criminelles n’ont pas été perfectionnées tout d’un coup. Dans les lieux mêmes où l’on a le plus cherché la liberté, on ne l’a pas toujours trouvée. Aristote [1] nous dit qu’à Cumes, les parens de l’accusateur pouvoient être témoins. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d’Ancus Martius accusé d’avoir assassiné le roi son beau-pere [2] . Sous les premiers rois de France, Clotaire fit une loi [3] , pour qu’un accusé ne pût être condamné sans être oui ; ce qui prouve une pratique contraire dans quelque cas particulier, ou chez quelque peuple barbare. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux [I-556] témoignages [4] . Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurées, la liberté ne l’est pas non plus.
Les connoissances que l’on a acquises dans quelque pays, & que l’on acquerra dans d’autres, sur les regles les plus sures que l’on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu’aucune chose qu’il y ait au monde.
Ce n’est que sur la pratique de ces connoissances, que la liberté peut être fondée ; & dans un état qui auroit là-dessus les meilleures lois possibles, un homme à qui on feroit son procès, & qui devroit être pendu le lendemain, seroit plus libre qu’un bacha ne l’est en Turquie.
-
[↑] Politique, liv. II.
-
[↑] Tarquinius Priscus. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV.
-
[↑] De l’an 560.
-
[↑] Aristote, Politiq. liv. II. ch. XII. Il donna ses lois à Thurium, dans la quatre-vingt-quatrieme olympiade.
[I-556]
CHAPITRE III.
Continuation du même sujet.
Les lois qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fatales à la liberté. La raison en exige deux ; parce qu’un témoin qui affirme, [I-557] & un accusé qui nie, font un partage ; & il faut un tiers pour le vider.
Les Grecs [1] & les Romains [2] exigeoient une voix de plus pour condamner. Nos lois Françoises en demandent deux. Les Grecs prétendoient que leur usage avoit été établi par les dieux [3] ; mais c’est le nôtre.
-
[↑] Voyez Aristide, orat. in Minervam.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv. VII.
-
[↑] Minerva calculus
[I-557]
CHAPITRE IV.
Que la liberté est favorisée par la nature des peines, & leur proportion.
C’est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.
Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; [I-558] ceux de la quatrieme, la sureté des citoyens. Les peines, que l’on inflige, doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.
Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion, que ceux qui l’attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples. Car les crimes qui en troublent l’exercice, sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sureté, & doivent être renvoyés à ces classes.
Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature [1] de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion ; l’expulsion hors des temples ; la privation de la société des fidelles, pour un temps ou pour toujours ; la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.
Dans les choses qui troublent la tranquillité & la sureté de l’état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n’y a point d’action [I-559] publique, il n’y a point de matiere de crime : tout s’y passe entre l’homme & Dieu, qui fait la mesure & le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d’action où elle n’est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant contr’eux le zele des consciences timides, & celui des consciences hardies.
Le mal est venu de cette idée, qu’il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisoit par cette derniere idée, quelle seroit la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, & non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.
Un historien [2] de Provence rapporte un fait qui nous peint très-bien ce que peut produire sur des esprits foibles cette idée de venger la divinité. Un Juif, accusé d’avoir blasphémé contre la sainte Vierge, fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau à la [I-560] main, monterent sur l’échafaud, & en chasserent l’exécuteur, pour venger eux-mêmes l’honneur de la sainte Vierge… Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.
La seconde classe, est des crimes qui sont contre les mœurs. Telles sont la violation de la continence publique ou particuliere : c’est-à-dire, de la police sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l’usage des sens & à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose : la privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville & de la société ; enfin toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l’oubli ou le mépris de soi-même.
Il n’est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sureté publique, tels que l’enlevement & le viol, qui sont de la quatrieme espèce.
[I-561]
Les crimes de la troisieme classe, sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens : Et les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, & se rapporter à cette tranquillité, comme la privation, l’exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l’ordre établi.
Je restreins les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sureté, doivent être mises dans la quatrieme classe.
Les peines de ces derniers crimes, sont ce qu’on appelle des supplices. C’est une espece de talion, qui fait que la société refuse la sureté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, & dans les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu’il a violé la sureté au point qu’il a ôté la vie, ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remede de la société malade. Lorsqu’on viole la sureté à l’égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale : [I-562] mais il vaudroit peut-être mieux, & il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sureté des biens, fût punie par la perte des biens ; & cela devroit être ainsi, si les fortunes étoient communes ou égales. Mais, comme ce sont ceux qui n’ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire.
Tout ce que je dis est puisé dans la nature ; & est très-favorable à la liberté du citoyen.
-
[↑] Saint Louis fit des lois si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l’en avertir. Ce prince modéra son zele, & adoucit ses lois. Voyez ces ordonnances.
-
[↑] Le pere Bougerel.
[I-562]
CHAPITRE V.
De certaines accusations qui ont particuliérement besoin de modération & de prudence.
Maxime importante : il faut être très-circonspect dans la poursuite de la magie & de l’hérésie. L’accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, & être la source d’une infinité de tyrannies, si le législateur ne sait la borner. Car, comme elle ne porte pas directement sur les actions d’un citoyen, mais plutôt sur l’idée que [I-563] l’on s’est faite de son caractere, elle devient dangereuse à proportion de l’ignorance du peuple ; & pour lors un citoyen est toujours en danger, parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne sont pas des garants contre les soupçons de ces crimes.
Sous Manuel Comnene, le protestator [1] fut accusé d’avoir conspiré contre l’empereur, & de s’être servi pour cela de certains secrets qui rendent les hommes invisibles. Il est dit dans la vie de cet empereur [2] que l’on surprit Aaron lisant un livre de Salomon, dont la lecture faisoit paraître des légions de démons. Or en supposant dans la magie une puissance qui arme l’enfer, & en partant de-là, on regarde celui que l’on appelle un magicien, comme l’homme du monde le plus propre à troubler & à renverser la société, & l’on est porté à le punir sans mesure.
L’indignation croît, lorsque l’on met dans la magie le pouvoir de détruire la religion. L’histoire de Constantinople [3] [I-564] nous apprend, que sur une révélation qu’avoit eue un évêque, qu’un miracle avoit cessé à cause de la magie d’un particulier, lui & son fils furent condamnés à mort. De combien de choses prodigieuses ce crime ne dépendoit-il pas ? Qu’il ne soit pas rare qu’il y ait des révélations ; que l’évêque en ait eu une ; qu’elle fût véritable ; qu’il y eût un miracle ; que ce miracle eût cessé ; qu’il y eût de la magie ; que la magie pût renverser la religion ; que ce particulier fût magicien ; qu’il eût fait enfin cet acte de magie.
L’empereur Théodore Lascaris attribuoit la maladie à la magie. Ceux qui en étoient accusés n’avoient d’autre ressource que de manier un fer chaud sans se brûler. Il auroit été bon chez les Grecs d’être magicien, pour se justifier de la magie. Tel étoit l’excès de leur idiotisme, qu’au crime du monde le plus incertain, il joignoient les preuves les plus incertaines.
Sous le regne de Philippe-le-Long, les Juifs furent chassés de France, accusés d’avoir empoisonné les fontaines par le moyen des lépreux. Cette absurde accusation doit bien faire douter de toutes celles qui sont fondées sur la haine publique.
[I-565]
Je n’ai point dit ici qu’il ne falloit point punir l’hérésie ; je dis qu’il faut être très-circonspect à la punir.
-
[↑] Nicetas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Histoire de l’empereur Maurice, par Théophylacte, chap. XI.
[I-565]
CHAPITRE VI.
Du crime contre nature.
À Dieu ne plaise que je veuille diminuer l’horreur que l’on a pour un crime que la religion, la morale & la politique condamnent tour à tour. Il faudroit le proscrire, quand il ne feroit que donner à un sexe les foiblesses de l’autre ; & préparer à une vieillesse infame, par une jeunesse honteuse. Ce que j’en dirai lui laissera toutes les flétrissures, & ne portera que contre la tyrannie qui peut abuser de l’horreur même que l’on en doit avoir.
Comme la nature de ce crime est d’être caché, il est souvent arrivé que des législateurs l’on puni sur la déposition d’un enfant. C’étoit ouvrir une porte bien large à la calomnie. « Justinien, dit Procope [1] , publia une loi contre ce crime ; il fit rechercher ceux qui en étoient coupables, non-seulement depuis la loi, mais avant. La déposition [I-566] d’un témoin, quelquefois d’un enfant, quelquefois d’un esclave, suffisoit ; sur-tout contre les riches, & contre ceux qui étoient de la faction des verds ».
Il est singulier que parmi nous trois crimes, la magie, l’hérésie & le crime contre nature ; dont on pourroit prouver du premier qu’il n’existe pas ; du second, qu’il est susceptible d’une infinité de distinctions, interprétations, limitations ; du troisieme, qu’il est très-souvent obscur, aient été tous trois punis de la peine du feu.
Je dirai bien que le crime contre nature ne fera jamais dans une société de grands progrès, si le peuple ne s’y trouve porté d’ailleurs par quelque coutume, comme chez les Grecs, où les jeunes gens faisoient tous leurs exercices nuds ; comme chez nous, où l’éducation domestique est hors d’usage ; comme chez les Asiatiques, où des particuliers ont un grand nombre de femmes qu’ils méprisent, tandis que les autres n’en peuvent avoir. Que l’on ne prépare point ce crime, qu’on le proscrive par une police exacte, comme toutes les violations des mœurs ; & l’on verra soudain la nature, ou défendre ses droits, ou les reprendre.
[I-567] Douce, aimable, charmante, elle a répandu les plaisirs d’une main libérale ; & en nous comblant de délices, elle nous prépare, par des enfans qui nous font, pour ainsi dire, renaître, à des satisfactions plus grandes que ces délices mêmes.
-
[↑] Histoire secrete.
[I-567]
CHAPITRE VII.
Du crime de lese-majesté.
Les lois de la Chine décident, que quiconque manque de respect à l’empereur, doit être puni de mort. Comme elles ne définissent pas ce que c’est que ce manquement de respect, tout peut fournir un prétexte pour ôter la vie à qui l’on veut, & exterminer la famille que l’on veut.
Deux personnes chargées de faire la gazette de la cour, ayant mis dans quelque fait des circonstances qui ne se trouverent pas vraies ; on dit que, mentir dans une gazette de la cour, c’étoit manquer de respect à la cour ; & on les fit mourir [1] . Un prince du sang ayant mis quelque note par mégarde sur un mémorial signé du pinceau rouge par [I-568] l’empereur, on décida qu’il avoit manqué de respect à l’empereur ; ce qui causa, contre cette famille, une des terribles persécutions dont l’histoire ait jamais parlé [2] .
C’est assez que le crime de lese-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénere en despotisme. Je m’étendrai davantage là-dessus dans le livre de la composition des lois.
[I-568]
CHAPITRE VIII.
De la mauvaise application du nom de crime de sacrilege & de lese-majesté.
C’est encore un violent abus, de donner le nom de crime de lese-majesté à une action qui ne l’est pas. Une loi des empereurs [1] poursuivoit comme sacrileges ceux qui mettoient en question le jugement du prince, & doutoient du mérite de ceux qu’il avoit choisis pour quelque emploi [2] . Ce [I-569] furent bien le cabinet & les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avoit déclaré que ceux qui attentent contre les ministres & les officiers du prince sont criminels de lese-majesté, comme s’ils attentoient contre le prince même [3] . Nous devons cette loi à deux princes [4] dont la foiblesse est célebre dans l’histoire, deux princes qui furent menés par leurs ministres, comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs ; deux princes esclaves dans le palais, enfans dans le conseil, étrangers aux armées ; qui ne conservent l’empire que parce qu’ils le donnerent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conspirerent contre leurs empereurs. Ils firent plus : ils conspirerent contre l’empire, ils y appellerent les barbares : & quand on voulut les arrêter, l’état étoit si foible, qu’il fallut violer leur loi, & s’exposer au crime de lese-majesté pour les punir.
C’est pourtant sur cette loi que se fondoit le rapporteur de M. de Cinq-Mars [5] lorsque, voulant prouver qu’il [I-570] étoit coupable du crime de lese-majesté pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, il dit : « Le crime qui touche la personne des ministres des princes, est réputé, par les constitutions des empereurs, de pareil poids que celui qui touche leur personne. Un ministre sert bien son prince & son état ; on l’ôte à tous les deux ; c’est comme si l’on privoit le premier d’un bras [6] , & le second d’une partie de sa puissance ». Quand la servitude elle-même viendroit sur la terre, elle ne parleroit pas autrement.
Une autre loi de Valentinien, Théodose & Arcadius [7] , déclare les faux-monnoyeurs coupables du crime de lese-majesté. Mais, n’étoit-ce pas confondre les idées des choses ? Porter sur un autre crime le nom de lese-majesté, n’est-ce pas diminuer l’horreur du crime de lese-majesté ?
-
[↑] Gratien, Valentinien & Théodose. C’est le troisieme au code de crimin. sacril.
-
[↑] Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid. Cette loi a servi de modele à celle de Roger, dans les constitutions de Naples, tit. 4.
-
[↑] La loi cinquieme, au code ad leg. Jul. maj.
-
[↑] Arcadius & Honorius.
-
[↑] Mémoires de Montrésor, tom. I.
-
[↑] Nam ipsi pars corporis nostri sunt. Même loi au code ad. Leg. Jul. maj.
-
[↑] C’est la neuvieme au code Théod. de falsâ monetâ.
[I-571]
CHAPITRE IX.
Continuation du même sujet.
Paulin ayant mandé à l’empereur Alexandre, « qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lese-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; l’empereur lui répondit, que dans un siecle comme le sien, les crimes de lese-majesté indirects n’avoient point de lieu [1] .
Faustinien ayant écrit au même empereur, qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colere, pour ne pas se rendre coupable du crime de lese-majesté : « Vous avez pris de vaines terreurs [2] , lui répondit l’empereur ; & vous ne connoissez pas mes maximes ».
Un sénatus-consulte [3] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été [I-572] réprouvées, ne seroit point coupable de lese-majesté. Les empereurs Sévere & Antonin écrivirent à Pontius [4] que celui qui vendroit des statues de l’empereur non consacrées, ne tomberoit point dans le crime de lese-majesté. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus, que celui qui jetteroit, par hazard, une pierre contre une statue de l’empereur, ne devoit point être poursuivi comme criminel de lese-majesté [5] . La loi Julie demandoit ces sortes de modifications : car elle avoit rendu coupables de lese-majesté, non seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable [6] ; ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand on eut établi bien des crimes de lese-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes. Aussi le Jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l’accusation du crime de lese-majesté ne s’éteignoit point par la mort du coupable, ajoute-t-il, que cela ne [I-573] regarde pas tous [7] les crimes de lese-majesté établis par la loi Julie ; mais seulement celui qui contient un attentat contre l’empire, ou contre la vie de l’empereur.
-
[↑] Etiam ex aliis cuassis majestatis crimina cessant meo sæculo. Leg. I. cod. ad. leg. Jul. maj.
-
[↑] Alienam sectæ meæ solicitudinem concepisti. Leg. 2 cod. ad. Leg. Jul. maj.
-
[↑] Voyez la loi 4. §. 1. ss. ad leg. Jul. maj.
-
[↑] Voyez la loi 5. §. 1. ss. ad leg. Jul. maj.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] aliudve quid simile admiserint. Leg. 6. ss. ad leg. Jul. maj.
-
[↑] Dans la loi derniere, au ss. ad leg. Jul. de adulseriis.
[I-573]
CHAPITRE X.
Continuation du même sujet.
Une loi d’Angleterre passée sous Henri VIII, déclaroit coupables de haute-trahison tous ceux qui prédiroient la mort du roi. Cette loi étoit bien vague. Le despotisme est si terrible, qu’il se tourne même contre ceux qui l’exercent. Dans la derniere maladie de ce roi, les médecins n’oserent jamais dire qu’il fût en danger ; & ils agirent, sans doute, en conséquence [1] .
-
[↑] Voyez l’histoire de la réformation par M. Burnet.
[I-574]
CHAPITRE XI.
Des pensées.
Un Marsias songea qu’il coupoit la gorge à Denys [1] . Celui-ci le fit mourir, disant qu’il n’y auroit pas songé la nuit, s’il n’y eût pensé le jour. C’étoit une grande tyrannie : car, quand même il y auroit pensé, il n’avoit pas attenté [2] . Les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures.
[I-574]
CHAPITRE XII.
Des paroles indiscrettes.
Rien ne rend encore le crime de lese-majesté plus arbitraire, que quand des paroles indiscrettes en deviennent la matiere. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l’indiscrétion & la malice, & il y en a si peu dans les expressions qu’elles emploient, que la loi ne peut guere soumettre les paroles à une peine capitale, [I-575] à moins qu’elle ne déclare expressément celle qu’elle y soumet [1] .
Les paroles ne forment point un corps de délit ; elles ne restent que dans l’idée. La plupart du temps elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens : ce sens dépend de la liaison qu’elles ont avec d’autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n’y a rien de si équivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lese-majesté ? Partout où cette loi est établie, non-seulement la liberté n’est plus, mais son ombre même.
Dans le manifeste de la feue czarine donné contre la famille d’Olgourouki [2] , un de ces princes est condamné à mort, pour avoir proféré des paroles indécentes qui avoient du rapport à sa personne ; un autre, pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l’empire, & offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.
[I-576]
Je ne prétends point diminuer l’indignation que l’on doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la gloire de leur prince : mais je dirai bien que si l’on veut modérer le despotisme, une simple punition correctionnelle conviendra mieux dans ces occasions, qu’une accusation de lese-majesté, toujours terrible à l’innocence même [3] .
Les actions ne sont pas de tous les jours ; bien des gens peuvent les remarquer : une fausse accusation sur des faits peut être aisément éclaircie. Les paroles qui sont jointes à une action, prennent la nature de cette action. Ainsi un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte, devient coupable de lese-majesté, parce que les paroles sont jointes à l’action, & y participent. Ce ne sont point les paroles que l’on punit ; mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes, que lorsqu’elles préparent, qu’elles accompagnent, ou qu’elles suivent une action criminelle. On renverse tout, si l’on fait des paroles un crime capital, [I-577] au lieu de les regarder comme le signe d’un crime capital.
Les empereurs Théodose, Arcadius & Honorius, écrivirent à Ruffin, préfet du prétoire ; « Si quelqu’un parle mal de notre personne ou de notre gouvernement, nous ne voulons point le punir [4] : s’il a parlé par légéreté, il faut le mépriser ; si c’est par folie, il faur le plaindre ; si c’est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi laissant les choses dans leur entier, vous nous en donnerez connoissance ; afin que nous jugions des paroles par les personnes, & que nous pesions bien si nous devons les soumettre au jugement ou les négliger».
-
[↑] si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est, dit Modestinus dans la loi 7. §. 3. in fine, ss. ad leg. Jul. maj.
-
[↑] En 1740.
-
[↑] Nec lubricum linguæ ad pænam facilè trahendim est. Modestin, dans la loi 7. §. 3. ss. ad leg. Jul. maj.
-
[↑] Si id ex levitate processerit, contemnendim est ; si ex enfantâ, miseratione dignissimum ; si ab injuriâ, remissendum. Leg. Unicâ, cod. si quis imperat. maled.
[I-577]
CHAPITRE XIII.
Des écrits.
Les écrits contiennent quelque chose de plus permanent que les paroles ; mais lorsqu’ils ne préparent pas au crime de lese-majesté, ils ne sont point une matiere du crime de lese-majesté.
[I-578]
Auguste & Tibere y attacherent pourtant la peine de ce crime [1] ; Auguste, à l’occasion de certains écrits faits contre des hommes & des femmes illustres ; Tibere, à cause de ceux qu’il crut faits contre lui. Rien ne fut plus fatal à la liberté Romaine. Cremutius Cordus fut accusé, parce que dans ses annales il avoit appelé Cassius le dernier des Romains [2] .
Les écrits satiriques ne sont guere connus dans les états despotiques, où l’abattement d’un côté, & l’ignorance de l’autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d’en faire. Dans la démocratie, on ne les empêche pas, par la raison même qui, dans le gouvernement d’un seul, les fait défendre. Comme ils sont ordinairement composés contre des gens puissans, ils flattent dans la démocratie la malignité du peuple qui gouverne. Dans la monarchie, on les défend ; mais on en fait plutôt un sujet de police, que de crime. Ils peuvent amuser la malignité générale, consoler les mécontens, diminuer l’envie contre les places, donner [I-579] au peuple la patience de souffrir, & le faire rire de ses souffrances.
L’aristocratie est le gouvernement qui proscrit le plus les ouvrages satiriques. Les magistrats y sont de petits souverains, qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures. Si dans la monarchie, quelque trait va contre le monarque, il est si haut que le trait n’arrive point jusqu’à lui. Un seigneur aristocratique en est percé de part en part. Aussi les décemvirs, qui formoient une aristocratie, punirent-ils de mort les écrits satiriques [3] .
-
[↑] Tacite, Annales, liv. I. Cela continua sous les regnes suivans. Voyez la loi unique au code de samos. libellis.
-
[↑] Tacite, Annales, liv. IV.
-
[↑] La loi des douze tables.
[I-579]
CHAPITRE XIV.
Violation de la pudeur dans la punition des crimes.
Il y a des regles de pudeur observées chez presque toutes les nations du monde : il seroit absurde de les violer dans la punition des crimes, qui doit toujours avoir pour objet le rétablissement de l’ordre.
Les orientaux, qui ont exposé des [I-580] femmes à des éléphans dressés pour un abominable genre de supplice, ont-ils voulu faire violer la loi par la loi ?
Un ancien usage des Romains défendoit de faire mourir les filles qui n’étoient pas nubiles. Tibere trouva l’expédient de les faire violer par le bourreau, avant de les envoyer au supplice [1] : tyran subtil & cruel ! il détruisoit les mœurs pour conserver les coutumes.
Lorsque la magistrature Japonoise a fait exposer dans les places publiques les femmes nues, & les a obligées de marcher à la maniere des bêtes, elle a fait frémir la pudeur [2] : mais, lorsqu’elle a voulu contraindre une mere… lorsqu’elle a voulu contraindre un fils… je ne puis achever ; elle a fait frémir la nature même [3] .
-
[↑] Suetonius, in Tiberio.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. V. part. II.
-
[↑] Ibid. p. 496.
[I-581]
CHAPITRE XV.
De l’affranchissement de l’esclave, pour accuser le maître.
Auguste établit que les esclaves de ceux qui auroient conspiré contre lui, seroient vendus au public, afin qu’ils pussent déposer contre leur maître [1] . On ne doit rien négliger de ce qui mene à la découverte d’un grand crime. Ainsi, dans un état où il y a des esclaves, il est naturel qu’ils puissent être indicateurs : mais ils ne sauroient être témoins.
Vindex indiqua la conspiration faite en faveur de Tarquin : mais il ne fut pas témoin contre les enfans de Brutus. Il étoit juste de donner la liberté à celui qui avoit rendu un si grand service à sa patrie : mais on ne la lui donna pas, afin qu’il rendît ce service à sa patrie.
Aussi l’empereur Tacite ordonna-t-il que les esclaves ne seroient pas témoins contre leur maître, dans le crime même de lese-majesté [2] ; loi qui n’a pas été mise dans la compilation de Justinien.
[I-582]
CHAPITRE XVI.
Calomnie dans le crime de lese-majesté.
Il faut rendre justice aux Césars ; ils n’imaginent pas les premiers les tristes lois qu’ils firent. C’est Sylla [1] qui leur apprit qu’il ne falloit point punir les calomniateurs. Bientôt on alla jusqu’à les récompenser [2] .
-
[↑] Sylla fit une loi de majesté, dont il est parlé dans les oraisons de Cicéron, pro Cluentio, art. 3 ; in Pisonem, art. 21 ; deuxieme contre Verrès, art. 5 ; épîtres familieres, liv. III. lett. II. César & Auguste les insérerent dans les lois Julies ; d’autres y ajouterent.
-
[↑] Et quò quis distinctior accusator, eò magis honores ossequebatur, ac veluti sacrosanctus erat. Tacite.
[I-582]
CHAPITRE XVII.
De la révélation des conspirations.
« Quand ton frere, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami qui est comme ton ame, te diront en secret, Allons à d’autres dieux ; tu les lapideras : d’abord ta main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple ». Cette loi du [I-583] Deutéronome [1] ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connoissons, parce qu’elle y ouvriroit la porte à tous les crimes.
La loi qui ordonne dans plusieurs états, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n’a pas trempé, n’est guere moins dure. Lorsqu’on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindre.
Elle n’y doit être appliquée, dans toute sa sévérité, qu’au crime de lese-majesté au premier chef. Dans ces états, il est très-important de ne point confondre les différens chefs de ce crime.
Au Japon, où les lois renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non-révélation s’applique aux cas les plus ordinaires.
Une relation [2] nous parle de deux demoiselles qui furent enfermées jusqu’à la mort dans un coffre hérissé de pointes ; l’une, pour avoir eu quelqu’intrigue de galanterie ; l’autre, pour ne pas l’avoir révélée.
-
[↑] Chap. XIII. Vers. 6, 7, 8 & 9.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, p. 423, liv. V, part. 2.
[I-584]
CHAPITRE XVIII.
Combien il est dangereux, dans les républiques, de trop punir le crime de lese-majesté.
Quand une république est parvenue à détruire ceux qui vouloient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines, & aux récompenses mêmes.
On ne peut faire de grandes punitions, & par conséquent de grands changemens, sans mettre dans les mains de quelques citoyens un grand pouvoir. Il vaut donc mieux dans ce cas pardonner beaucoup, que punir beaucoup ; exiler peu, qu’exiler beaucoup ; laisser les biens, que multiplier les confiscations. Sous prétexte de la vengeance de la république, on établiroit la tyrannie des vengeurs. Il n’est pas question de détruire celui qui domine, mais la domination. Il faut rentrer le plutôt que l’on peut dans ce train ordinaire du gouvernement, où les lois protegent tout, & ne s’arment contre personne.
[I-585]
Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengeances qu’ils prirent des tyrans ou de ceux qu’ils soupçonnerent de l’être. Ils firent mourir les enfans [1] , quelquefois cinq des plus proches parens [2] . Ils chasserent une infinité de familles. Leurs républiques en furent ébranlées ; l’exil ou le retour des exilés furent toujours des époques qui marquerent le changement de la constitution.
Les Romains furent plus sages. Lorsque Cassius fut condamné pour avoir aspiré à la tyrannie, on mit en question si l’on feroit mourir ses enfans : ils ne furent condamnés à aucune peine. « Ceux qui ont voulu, dit Denys d’Halicarnasse [3] , changer cette loi à la fin de la guerre des Marses & de la guerre civile, & exclure des charges les enfans des proscrits par Sylla, sont bien criminels ».
On voit dans les guerres de Marius & de Sylla, jusqu’à quel point les ames, chez les Romains, s’étoient peu [I-586] à peu dépravées. Des choses si funestes firent croire qu’on ne les reverroit plus. Mais sous les triumvirs, on voulut être plus cruel, & le paroître moins : on est désolé de voir les sophismes qu’employa la cruauté. On trouve dans Appien [4] la formule des proscriptions. Vous diriez qu’on n’y a d’autre objet que le bien de la république, tant on y parle de sang froid, tant on y montre d’avantages, tant les moyens que l’on prend sont préférables à d’autres, tant les riches sont en sureté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on craint de mettre en danger la vie des citoyens, tant on veut appaiser les soldats, tant enfin on sera heureux [5] .
Rome étoit inondée de sang, quand Lepidus triompha de l’Espagne ; & par une absurdité sans exemple, sous peine d’être proscrit [6] , il ordonna de se réjouir.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VIII.
-
[↑] Tyranno occiso, quinque ejus proximos cognasione magistratus necato. Cicéron, de inventione, lib. II.
-
[↑] Liv. VIII. page 547.
-
[↑] Des guerres civiles, liv. IV.
-
[↑] Quod felix faustamque fit.
-
[↑] Sacris & epulis dent hunc diem : qui secius faxit icter proscriptos esto.
[I-587]
CHAPITRE XIX.
Comment on suspend l’usage de la liberté dans la république.
Il y a, dans les états où l’on fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills appellés d’atteindre [1] . Ils se rapportent à ces lois d’Athenes, qui statuoient contre un particulier [2] , pourvu qu’elle fussent faites par le suffrage de six mille citoyens. Ils se [I-588] Rapportent à ces lois qu’on faisoit à Rome contre des citoyens particuliers, & qu’on appelloit privileges [3] . Elles ne se faisoient que dans les grands états du peuple. Mais de quelque maniere que le peuple les donne, Cicéron veut qu’on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu’en ce qu’elle statue sur tout le monde [4] . J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui ayent jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux.
-
[↑] Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu’il y ait une preuve telle que les juges soient convaincus : il faut encore que cette preuve soit formelle, c’est-à-dire, légale ; & la loi demande qu’il y ait deux témoins contre l’accusé ; une autre preuve ne suffiroit pas. Or si un homme présumé coupable de ce qu’on appelle haut crime, avoit trouvé le moyen d’écarter les témoins, de sorte qu’il fût impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d’atteindre ; c’est-à-dire, faire une loi singuliere sur sa personne. On y procede comme pour tous les autres bills : il faut qu’il passe dans deux chambres, & que le roi y donne son consentement ; sans quoi il n’y a point de bill, c’est-à-dire, de jugement. L’accusé peut faire parler ses avocats contre le bill ; & on peut parler dans la chambre pour le bill.
-
[↑] Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ità visum. Ex Andocide de mysteriis : c’est l’ostracisme.
-
[↑] De privis hominibus latæ. Cicéron, de leg. liv. III.
-
[↑] Scitum est jussum in omnes. Cicéron, ibid.
[I-588]
CHAPITRE XX.
Des lois favorables à la liberté du citoyen dans la république.
Il arrive souvent dans les états populaires, que les accusations sont publiques, & qu’il est permis à tout homme d’accuser qui il veut. Cela a fait établir des lois propres à défendre [I-589] l’innocence des citoyens. A Athenes, l’accusateur qui n’avoit point pour lui la cinquieme partie des suffrages, payoit une amende de mille dragmes. Eschines, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné [1] . À Rome, l’unjuste accusateur étoit noté d’infamie [2] , on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des gardes à l’accusateur, pour qu’il fût hors d’état de corrompre les juges ou les témoins [3] .
J’ai déjà parlé de cette loi Athénienne & Romaine, qui permettoit à l’accusé de se retirer avant le jugement.
-
[↑] Voyez Philostrate, liv. I. vie des sophistes, vie d’Eschines. Voyez aussi Plutarque & Phocius.
-
[↑] Par la loi Remnia.
-
[↑] Plutarque, au traité, comment on pourroit recevoir de l’utilité de ses ennemis.
[I-589]
CHAPITRE XXI.
De la cruauté des lois envers les débiteurs dans la république.
Un citoyen s’est déjà donné une assez grande supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que celui-ci n’a emprunté que pour s’en défaire, & que par conséquent il n’a plus.
[I-590] Que sera-ce, dans une république, si les lois augmentent cette servitude encore davantage ?
À Athenes & à Rome [1] , il fut d’abord permis de vendre les débiteurs qui n’étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Ahenes [2] : il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les [3] décemvirs ne réformerent pas de même l’usage de Rome ; & quoiqu’ils eussent devant les yeux le règlement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n’est pas le seul endroit de la loi des douze tables où l’on voit le dessein des décemvirs de choquer l’esprit de la démocratie.
Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république Romaine. Un homme couvert de plaies s’échappa de la maison de son créancier, & parut dans la place [4] . Le peuple s’émut à ce spectacle. D’autres citoyens, que leurs créanciers [I-591] n’osoient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit des promesses ; on y manqua : le peuple se retira sur le Mont sacré. Il n’obtint pas l’abrogation de ces lois, mais un magistrat pour le défendre. On sortoit de l’anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, alloit retirer des mains des créanciers les citoyens qu’ils avoient réduits en esclavage [5] . On prévint les desseins de Manlius ; mais le mal restoit toujours. Des lois particulieres donnerent aux débiteurs des facilités de payer [6] : & l’an de Rome 428, les consuls porterent une loi [7] qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons [8] . Un usurier nommé Papirius avoit voulu corrompre la pudicité d’un jeune homme nommé Publius, qu’il tenoit dans les fers. Le crime de Sextus donna à Rome la liberté politique ; celui de Papirius y donna la liberté civile.
[I-592]
Ce fut le destin de cette ville, que des crimes nouveaux y confirmerent la liberté que des crimes anciens lui avoient procurée. L’attentat d’Appius sur Virginie, remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui avoit donné le malheur de Lucrece. Trente-sept ans [9] après le crime de l’infame Papirius, un crime pareil [10] fit que le peuple se retira sur le Janicule [11] , & que la loi fait pour la sureté des débiteurs reprit une nouvelle force.
Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les lois faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payées.
-
[↑] Plusieurs vendoient leurs enfans pour payer leurs dettes. Plutarque¸vie de Solon.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Il paroît, par l’histoire, que cet usage étoit établi chez les Romains avant la loi des douze tables. Tite-Live, premiere décade, liv. II.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VI.
-
[↑] Plutarque, vie de Farius Cammissus.
-
[↑] Voyez ci-dessous le ch. XXIV. Du liv. XXII.
-
[↑] Cent vingt ans après la loi des douze tables. Eo anno plebi Romanæ, velut aliad initium libertatis, factum est quid necti desierunt. Tite Live, liv. VIII.
-
[↑] Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ibid.
-
[↑] L’an de Rome 465.
-
[↑] Celui de Plautius¸qui attenta contre la pudicité de Véturius ; Valere Maxime¸liv. VI. Art. IX. On ne doit point confondre ces deux événements ; ce ne sont ni les mêmes personnes, ni les mêmes temps.
-
[↑] Voyez un fragment de Denys d’Halicarnasse, dans l’extrait des vertus & des vices ; l’épitome de Tite-Live, liv. XI ; & Freinshemius¸liv. XI.
[I-593]
CHAPITRE XXII.
Des choses qui attaquent la liberté dans la monarchie.
La chose du monde la plus inutile au prince, a souvent affoibli la liberté dans les monarchies ; les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier.
Le prince tire si peu d’utilité des commissaires, qu’il ne vaut pas la peine qu’il change l’ordre des choses pour cela. Il est moralement sûr qu’il a plus d’esprit de probité & de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur intérêt de l’état, par le choix qu’on a fait d’eux, & par leurs craintes mêmes.
Sous Henri VIII, lorsqu’on faisoit le procès à un pair, on le faisoit juger par des commissaires tirés de la chambre des pairs : avec cette méthode, on fit mourir tous les pairs qu’on voulut.
[I-594]
CHAPITRE XXIII.
Des espions dans la monarchie.
Faut-il des espions dans la monarchie ? Ce n’est pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand un homme est fidele aux lois, il a satisfait à ce qu’il doit au prince. Il faut au moins qu’il ait sa maison pour asile, & le reste de sa conduite en sureté. L’espionnage seroit peut-être tolérable, s’il pouvoit être exercé par d’honnêtes gens ; mais l’infamie nécessaire de la personne peut faire juger de l’infamie de la chose. Un prince doit agir avec ses sujets avec candeur, avec franchise, avec confiance. Celui qui a tant d’inquiétudes, de soupçons & de craintes, est un acteur qui est embarrassé à jouer son rôle. Quand il voit qu’en général les lois sont dans leur force, & qu’elles sont respectées, il peut se juger en sureté. L’allure générale lui répond de celle de tous les particuliers. Qu’il n’ait aucune crainte, il ne sauroit croire combien on est porté à l’aimer. Eh ! pourquoi ne l’aimeroit-on pas ? Il est la source de presque tout [I-595] le bien qui se fait ; & quasi toutes les punitions sont sur le compte des lois. Il ne se montre jamais au peuple qu’avec un visage serein : sa gloire même se communique à nous, & sa puissance nous soutient. Une preuve qu’on l’aime, c’est que l’on a de la confiance en lui ; & que lorsqu’un ministre refuse, on s’imagine toujours que le prince auroit accordé. Même dans les calamités publiques, on n’accuse point sa personne ; on se plaint de ce qu’il ignore, ou de ce qu’il est obsédé par des gens corrompus : Si le prince savoit ! dit le peuple. Ces paroles sont une espece d’invocation, & une preuve de la confiance qu’on a en lui.
[I-595]
CHAPITRE XXIV.
Des lettres anonymes.
Les Tartares sont obligés de mettre leur nom sur leurs fleches, afin que l’on connoisse la main dont elles partent. Philippe de Macédoine ayant été blessé au siege d’une ville, on trouva sur le javelot, Aster a porté ce coup mortel à [I-596] Philippe [1] . Si ceux qui accusent un homme, le faisoient en vue du bien public, ils ne l’accuseroient pas devant le prince, qui peut être aisément prévenu, mais devant les magistrats, qui ont des regles qui ne sont formidables qu’aux calomniateurs. Que s’ils ne veulent pas laisser les lois entr’eux & l’accusé, c’est une preuve qu’ils ont sujet de les craindre ; & la moindre peine qu’on puisse leur infliger, c’est de ne les point croire. On ne peut y faire d’attention que dans les cas qui ne sauroient souffrir les lenteurs de la justice ordinaire, & où il s’agit du salut du Prince. Pour lors on peut croire que celui qui accuse, a fait un effort qui a délié sa langue, & l’a fait parler. Mais dans les autres cas, il faut dire avec l’empereur Constance : « Nous ne saurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu’il ne lui manquoit pas un ennemi [2] ».
-
[↑] Plutarque, Œuvres morales, collation de quelques histoires Romaines & Grecques, tom. II, page 487.
-
[↑] Leg. VI, cod. Theod. de famos. libellis.
[I-597]
CHAPITRE XXV.
De la maniere de gouverner dans la monarchie.
L’autorité royale est un grand ressort, qui doit se mouvoir aisément & sans bruit. Les Chinois vantent un de leurs empereurs, qui gouverna, disent-ils, comme le ciel, c’est-à-dire, par son exemple.
Il y a des cas où la puissance doit agir dans toute son étendue ; il y en a où elle doit agir par ses limites. Le sublime de l’administration, est de bien connoître quelle est la partie du pouvoir, grande ou petite, que l’on doit employer dans les diverses circonstances.
Dans nos monarchies, toute la félicité consiste dans l’opinion que le peuple a de la douceur du gouvernement. Un ministre mal-habile veut toujours vous avertir que vous êtes esclaves. Mais si cela étoit, il devroit chercher à le faire ignorer. Il ne sait vous dire ou vous écrire, si ce n’est que le prince est fâché ; qu’il est surpris ; qu’il mettra ordre. Il y a une certaine facilité dans [I-598] le commandement : il faut que le prince encourage, & que ce soient les lois qui menacent [1] .
-
[↑] Nerva, dit Tacite, augmenta la facilité de l’empire.
[I-598]
CHAPITRE XXVI.
Que, dans la monarchie, le prince doit être accessible.
Cela se sentira beaucoup mieux par les contrastes. « Le czar Pierre premier, dit le sieur Perry [1] , a fait une nouvelle ordonnance, qui défend de lui présenter de requête, qu’après en avoir présenté deux à ses officiers. On peut, en cas de déni de justice, lui présenter la troisieme : mais celui qui a tort doit perdre la vie. Personne depuis n’a adressé de requête au czar ».
-
[↑] État de la Grande-Russie, p. 173, édition de Paris, 1717.
[I-598]
CHAPITRE XXVII.
Des mœurs du monarque.
Les mœurs du prince contribuent autant à la liberté que les lois ; il peut, comme elles, faire des hommes [I-599] des bêtes, & des bêtes faire des hommes. S’il aime les ames libres, il aura des sujets ; s’il aime les ames basses, il aura des esclaves. Veut-il savoir le grand art de régner ? qu’il approche de lui l’honneur & la vertu, qu’il appelle le mérite personnel. Il peut même jeter quelquefois les yeux sur les talens. Qu’il ne craigne point ces rivaux qu’on appelle les hommes de mérite ; il est leur égal, dès qu’il les aime. Qu’il gagne le cœur, mais qu’il ne captive point l’esprit. Qu’il se rende populaire. Il doit être flatté de l’amour du moindre de ses sujets ; ce sont toujours des hommes. Le peuple demande si peu d’égards, qu’il est juste de les lui accorder : l’infinie distance qui est entre le souverain & lui, empêche bien qu’il ne le gêne. Qu’exorable à la priere, il soit ferme contre les demandes ; & qu’il sache que son peuple jouit de ses refus, & ses courtisans de ses graces.
[I-600]
CHAPITRE XXVIII.
Des égards que les monarques doivent à leurs sujets.
Il faut qu’ils soient extrêmement retenus sur la raillerie. Elle flatte lorsqu’elle est modérée, parce qu’elle donne les moyens d’entrer dans la familiarité ; mais une raillerie piquante leur est bien moins permise qu’au dernier de leurs sujets, parce qu’ils sont les seuls qui blessent toujours mortellement.
Encore moins doivent-ils faire à un de leurs sujets une insulte marquée : ils sont établis pour pardonner, pour punir, jamais pour insulter.
Lorsqu’ils insultent leurs sujets, ils les traitent bien plus cruellement que ne traite les siens le Turc ou le Moscovite. Quand ces derniers insultent, ils humilient & ne déshonorent point ; mais pour eux, ils humilient & déshonorent.
Tel est le préjugé des Asiatiques, qu’ils regardent un affront fait par le prince, comme l’effet d’une bonté paternelle ; & telle est notre maniere de [I-601] penser, que nous joignons au cruel sentiment de l’affront, le désespoir de ne pouvoir nous en laver jamais.
Ils doivent être charmés d’avoir des sujets à qui l’honneur est plus cher que la vie, & n’est pas moins un motif de fidélité que de courage.
On peut se souvenir des malheurs arrivés aux princes pour avoir insulté leurs sujets ; des vengeances de Chéréas, de l’eunuque Narsès, & du comte Julien ; enfin de la duchesse de Montpensier, qui outrée contre Henri III, qui avoit révélé quelqu’un de ses défauts secrets, le troubla pendant toute sa vie.
[I-601]
CHAPITRE XXIX.
Des lois civiles propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement despotique.
Quoique le gouvernement despotique, dans sa nature, soit partout le même ; cependant des circonstances, une opinion de religion, un préjugé, des exemples reçus, un tour d’esprit, des manieres, des mœurs, peuvent y mettre des différences considérables.
[I-602]
Il est bon que de certaines idées s’y soient établies. Ainsi, à la Chine, le prince est regardé comme le pere du peuple ; & dans les commencemens de l’empire des Arabes, le prince en étoit le prédicateur [1] .
Il convient qu’il y ait quelque Livre sacré qui serve de regle, comme l’alcoran chez les Arabes, les livres de Zoroastre chez les Perses, le védam chez les Indiens, les livres classiques chez les Chinois. Le code religieux supplée au code civil, & fixe l’arbitraire.
Il n’est pas mal que, dans les cas douteux, les juges consultent les ministres de la religion [2] . Aussi en Turquie les cadis interrogent-ils les mollachs. Que si le cas mérite la mort, il peut être convenable que le juge particulier, s’il y en a, prenne l’avis du gouverneur, afin que le pouvoir civil & l’ecclésiastique soient encore tempérés par l’autorité politique.
[I-603]
CHAPITRE XXX.
Continuation du même sujet.
C’est la fureur despotique qui a établi que la disgrace du pere entraîneroit celle des enfans & des femmes. Ils sont déjà malheureux, sans être crmiminels : & d’ailleurs il faut que le prince laisse entre l’accusé & lui des supplians pour adoucir son courroux, ou pour éclairer la justice.
C’est une bonne coutume des Maldives [1] , que lorsqu’un seigneur est disgracié, il va tous les jours faire sa cour au roi, jusqu’à ce qu’il rentre en grace ; sa présence désarme le courroux du prince.
Il y a des états despotiques [2] où l’on pense, que de parler à un prince pour un disgracié, c’est manquer au respect qui lui est dû. Ces princes semblent faire tous leurs efforts pour se priver de la vertu de clémence.
[I-604]
Arcadius & Honorius, dans la loi [3] dont j’ai tant parlé [4] , déclarent qu’ils ne feront point de grace à ceux qui oseront les supplier pour les coupables [5] . Cette loi étoit bien mauvaise, puisqu’elle est mauvaise dans le despotisme même.
La coutume de Perse, qui permet à qui veut de sortir du royaume, est très-bonne : Et quoique l’usage contraire ait tiré son origine du despotisme, où l’on a regardé les sujets comme des [6] esclaves, & ceux qui sortent comme des esclaves fugitifs ; cependant la pratique de Perse est très-bonne pour le despotisme, où la crainte de la fuite ou de la retraite des redevables, arrête ou modere les persécutions des bachas & des exacteurs.
Fin du premier Volume.
-
[↑] Voyez François Pirard.
-
[↑] Comme aujourd’hui en Perse, au rapport de M. Chardin : cet usage est bien ancien. « On mit Cavade, dit Procope, dans le château de l’oubli ; il y a une loi qui défend de parler de ceux qui y sont enfermés, & même de prononcer leur nom ».
-
[↑] La loi V. au code ad leg. Jul. maj.
-
[↑] Au chapitre VIII de ce Livre.
-
[↑] Fridéric copia cette loi dans les constitutions de Naples, liv. I.
-
[↑] Dans les monarchies, il y a ordinairement une loi qui défend à ceux qui ont des emplois publics de sortir du royaume sans la permission du prince. Cette loi doit être encore établie dans les républiques. Mais dans celles qui ont des institutions singulieres, la défense doit être générale, pour qu’on n’y rapporte pas les mœurs étrangeres.
Volume II↩

[II-33]
LIVRE XIII
Des rapports que la levée des tributs & la grandeur des revenus publics ont avec la liberté.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des revenus de l’État.
Les revenus de l’état sont une portion que chaque citoyen donne de son bien, pour avoir la sureté de l’autre, ou pour en jouir agréablement.
Pour bien fixer ces revenus, il faut avoir égard & aux nécessités de [II-34] l’état, & aux nécessités des citoyens. Il ne faut point prendre au peuple sur ses besoins réels, pour des besoins de l’état imaginaires.
Les besoins imaginaires sont ce que demandent les passions & les foiblesses de ceux qui gouvernent, le charme d’un projet extraordinaire, l’envie malade d’une vaine gloire, & une certaine impuissance d’esprit contre les fantaisies. Souvent ceux qui avec un esprit inquiet étoient sous le prince à la tête des affaires, ont pensé que les besoins de l’état étoient les besoins de leurs petites ames.
Il n’y a rien que la sagesse & la prudence doivent plus régler, que cette portion qu’on ôte, & cette portion qu’on laisse aux sujets.
Ce n’est point à ce que le peuple peut donner, qu’il faut mesurer les revenus publics, mais à ce qu’il doit donner : Et si on les mesure à ce qu’il peut donner, il faut que ce soit du moins à ce qu’il peut toujours donner.
[II-35]
CHAPITRE II.
Que c’est mal raisonner, de dire que la grandeur des tributs soit bonne par elle même.
On a vu dans certaines monarchies que de petits pays, exempts de tributs, étoient aussi misérables que les lieux qui tout autour en étoient accablés. La principale raison est, que le petit état entouré ne peut avoir d’industrie, d’arts, ni de manufactures, parce qu’à cet égard il est gêné de mille manieres par le grand état dans lequel il est enclavé. Le grand état qui l’entoure, a l’industrie, les manufactures & les arts ; & il fait des réglements qui lui en procurent tous les avantages. Le petit état devient donc nécessairement pauvre, quelque peu d’impôts qu’on y leve.
On a pourtant conclu de la pauvreté de ces petits pays, que, pour que le peuple fût industrieux il falloit des charges pesantes. On auroit mieux fait d’en conclure qu’il n’en faut pas. Ce sont tous les misérables des environs qui se retirent dans ces lieux-là, pour ne rien [II-36] faire : déjà découragés par l’accablement du travail, ils font consister toute leur félicité dans leur paresse.
L’effet des richesse d’un pays, c’est de mettre de l’ambition dans tous les cœurs. L’effet de la pauvreté, est d’y faire naître le désespoir. La premiere s’irrite par le travail, l’autre se console par la paresse.
La nature est juste envers les hommes, elle les récompense de leurs peines ; elle les rend laborieux, parce qu’à de plus grands travaux elle attache de plus grandes récompenses. Mais si un pouvoir arbitraire ôte les récompenses de la nature, on reprend le dégout pour le travail, & l’inaction paroît être le seul bien.
[II-36]
CHAPITRE III.
Des tributs, dans les pays où une partie du peuple, est esclave de la glebe.
L’esclavage de la glebe s’établit quelquefois après une conquête. Dans ce cas, l’esclave qui cultive doit être le colon-partiaire du maitre. Il n’y a qu’une société de perte & de gain qui [II-37] puisse réconcilier ceux qui sont destinés à travailler, avec ceux qui sont destinés à jouir.
[II-37]
CHAPITRE IV.
D’une république en cas pareil.
Lorsqu’une république a réduit une nation à cultiver les terres pour elle, on n’y doit point souffrir que le citoyen puisse augmenter le tribut de l’esclave. On ne le permettoit point à Lacédémone : on pensoit que les Elotes [1] cultiveroient mieux les terres, lorsqu’ils fauroient que leur servitude n’augmenteroit pas ; on croyoit que les maîtres seroient meilleurs citoyens, lorsqu’ils ne desireroient que ce qu’ils avoient coutume d’avoir.
-
[↑] Plutarque.
[II-37]
CHAPITRE V.
D’une monarchie en cas pareil.
Lorsque, dans une monarchie, la noblesse fait cultiver les terres à son profit par le peuple conquis, il faut [II-38] encore que la redevance ne puisse augmenter [1] . De plus, il est bon que le prince se contente de son domaine & du service militaire. Mais s’il veut lever les tributs en argent sur les esclaves de sa noblesse, il faut que le seigneur soit garant [2] du tribut, qu’il le paye pour les esclaves & le reprenne sur eux : Et si l’on ne suit pas cette regle, le seigneur & ceux qui levent les revenus du prince vexeront l’esclave tour à tour, & le reprendront l’un après l’autre, jusqu’à ce qu’il perisse de misere, ou fuie dans les bois.
-
[↑] C’est ce qui fit faire à Charlemagne ses belles institutions là-dessus. Voyez le livre V des Capitulaires, art. 503.
-
[↑] Cela se pratique ainsi en Allemagne
[II-38]
CHAPITRE VI.
D’un état despotique en cas pareil.
Ce que je viens de dire est encore plus indispensable dans l’état despotique. Le seigneur qui peut à tous les instans être dépouillé de ses terres & de ses esclaves, n’est pas si porté à les conserver.
Pierre premier, voulant prendre la [II-39] pratique d’Allemagne & lever ses tributs en argent, fit un réglement très-sage que l’on fait encore en Russie. Le gentilhomme leve la taxe sur les paysans, & la paye au czar. Si le nombre des paysans diminue, il paye tout de même ; si le nombre augmente, il ne paye pas davantage : il est donc intéressé à ne point vexer ses paysans.
[II-39]
CHAPITRE VII.
Des tributs, dans les pays où l’esclavage de la glebe n’est point établi.
Lorsque dans un état tous les particuliers sont citoyens, que chacun y possede par son domaine ce que le prince y possede par son empire, on peut mettre des impôts sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises ; sur deux de ces choses, ou sur les trois ensemble.
Dans l’impôt de la personne, la proportion injuste seroit celle qui suivroit exactement la proportion des biens. On avoit divisé à Athenes [1] les citoyens en quatre classes. Ceux qui retiroient de leurs biens cinq cents mesures de fruits [II-40] liquides ou secs, payoient au public un talent ; ceux qui en retiroient trois cents mesures, devoient un demi-talent ; ceux qui avoient deux cens mesures, payoient dix mines, ou la sixieme partie d’un talent ; ceux de la quatrieme classe ne donnoient rien. La taxe étoit juste, quoiqu’elle ne fût point proportionnelle ; si elle ne suivoit pas la proportion des biens, elle suivoit la proportion des besoins. On jugea que chacun avoit un nécessaire physique égal, que ce nécessaire physique ne devoit point être taxé ; que l’utile venoit ensuite, & qu’il devoit être taxé, mais moins que le superflu ; que la grandeur de la taxe sur le superflu empêchoit le superflu.
Dans la taxe sur les terres, on fait des rôles où l’on met les diverses classes des fonds. Mais il est très-difficile de connoître ces différences, & encore plus de trouver des gens qui ne soient point intéressés à les méconnoître. Il y a donc là deux sortes d’injustices; l’injustice de l’homme, & l’injustice de la chose. Mais si en général la taxe n’est point excessive, si on laisse au peuple un nécessaire abondant, ces injustices particulieres ne feront rien. Que si au contraire on ne [II-41] laisse au peuple que ce qu’il lui faut à la rigueur pour vivre, la moindre disproportion sera de la plus grande conséquence.
Que quelques citoyens ne payent pas assez, le mal n’est pas grand ; leur aisance revient toujours au public : que quelques particuliers payent trop, leur ruine se tourne contre le public. Si l’état proportionne sa fortune à celle des particuliers, l’aisance des particuliers fera bientôt monter sa fortune. Tout dépend du moment : L’état commencera-t-il par appauvrir les sujets pour s’enrichir ? ou attendra-t-il que des sujets & leur aise l’enrichissent ? Aura-t-il le premier avantage ? ou le second ? Commencera-t-il par être riche ? ou finira-t-il par l’être ?
Les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins, parce qu’on ne leur fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés, que le peuple ignorera presque qu’il les paye. Pour cela, il est d’une grande conséquence que ce soit celui qui vend la marchandise, qui paye le droit. Il sait bien qu’il ne paye pas pour lui ; & l’acheteur, qui dans le fond paye, le confond avec le prix. Quelques auteurs [II-42] ont dit que Néron avoit ôté le droit du vingt-cinquieme des esclaves qui le vendoient [2] ; il n’avoit pourtant fait qu’ordonner que ce seroit le vendeur qui le payeroit, au lieu de l’acheteur : ce réglement qui laissoit tout l’impôt, parut l’ôter.
Il y a deux royaumes en Europe où l’on a mis des impôts très-forts sur les boissons : dans l’un le brasseur seul paye le droit ; dans l’autre, il est levé indifféremment sur tous les sujets qui consomment. Dans le premier, personne ne sent la rigueur de l’impôt ; dans le second, il est regardé comme onéreux : dans celui-là, le citoyen ne sent que la liberté qu’il y a de ne pas payer ; dans celui-ci, il ne sent que la nécessité qui l’y oblige.
D’ailleurs, pour que le citoyen paye, il faut des recherches perpétuelles dans sa maison. Rien n’est plus contraire à la liberté : & ceux qui établissent ces sortes d’impôts, n’ont pas le bonheur d’avoir à cet égard rencontré la meilleure sorte d’administration.
-
[↑] Pollux, liv. VIII. chap. X. art. 130.
-
[↑] Vectigal quintæ & vicessmæ venalium mancipiorum remissum specie magis quam vi ; quia cum venditor pendere juberetur, in partent pretii, emptoribus accrescebat. Tacite, Annales, liv. XIII.
[II-43]
CHAPITRE VIII.
Comment on conserve l’illusion.
Pour que le prix de la chose & le droit puisse se confondre dans la tête de celui qui paye, il faut qu’il y ait quelque rapport entre la marchandise & l’impôt, & que, sur une denrée de peu de valeur, on ne mette pas un droit excessif. Il y a des pays où le droit excede de dix-sept fois la valeur de la marchandise. Pour lors, le prince ôte l’illusion à ses sujets : ils voient qu’ils sont conduits d’une maniere qui n’est pas raisonnable ; ce qui leur fait sentir leur servitude au dernier point.
D’ailleurs, pour que le prince puisse lever un droit si disproportionné à la valeur de la chose, il faut qu’il vende lui-même la marchandise, & que le peuple ne puisse l’aller acheter ailleurs ; ce qui est sujet à mille inconvéniens.
La fraude étant dans ce cas très-lucrative, la peine naturelle, celle que la raison demande, qui est la confiscation de la marchandise, devient incapable de l’arrêter ; d’autant plus que cette [II-44] marchandise est pour l’ordinaire d’un prix très-vil. Il faut donc avoir recours à des peines extravagantes, & pareilles à celles que l’on inflige pour les plus grands crimes. Toute la proportion des peines est ôtée. Des gens qu’on ne sauroit regarder comme des hommes méchans, sont punis comme des scélérats ; ce qui est la chose du monde la plus contraire à l’esprit du gouvernement modéré.
J’ajoute que plus on met le peuple en occasion de frauder le traitant, plus on enrichit celui-ci, & on appauvrit celui-là. Pour arrêter la fraude, il faut donner aux traitans des moyens de vexations extraordinaires, & tout est perdu.
[II-44]
CHAPITRE IX.
D’une mauvaise sorte d’impôt.
Nous parlerons en passant, d’un impôt établi dans quelques états sur les diverses clauses des contrats civils. Il faut pour se défendre du traitant, de grandes connoissances, ces choses étant sujettes à des discussions subtiles. Pour lors, le traitant, interprete des réglemens du prince, exerce un pouvoir [II-45] arbitraire sur les fortunes. L’expérience a fait voir qu’un impôt sur le papier sur lequel le contrat doit s’écrire, vaudroit beaucoup mieux.
[II-45]
CHAPITRE X.
Que la grandeur des tributs dépend de la nature du gouvernement.
Les tributs doivent être très-légers dans le gouvernement despotique. Sans cela, qui est-ce qui voudroit prendre la peine d’y cultiver les terres ? & de plus, comment payer de gros tributs, dans un gouvernement qui ne supplée par rien à ce que le sujet a donné ?
Dans le pouvoir étonnant du prince, & l’étrange foiblesse du peuple, il faut qu’il ne puisse y avoir d’équivoques sur rien. Les tributs doivent être si faciles à percevoir, & si clairement établis, qu’ils ne puissent être augmentés ni diminués par ceux qui les levent : une portion dans les fruits de la terre, une taxe par tête, un tribut de tant pour cent sur les marchandises, sont les seuls convenables.
Il est bon, dans le gouvernement [II-46] despotique, que les marchands ayent une sauve-garde personnelle, & que l’usage les fasse respecter : sans cela ils seroient trop foibles dans les discussions qu’ils pourroient avoir avec les officiers du prince.
[II-46]
CHAPITRE XI.
Des peines fiscales.
C’est une chose particuliere aux peines fiscales, que contre la pratique générale, elles sont plus séveres en Europe qu’en Asie. En Europe, on confisque les marchandises, quelquefois même les vaisseaux & les voitures ; en Asie, on ne fait ni l’un ni l’autre. C’est qu’en Europe, le marchand a des juges qui peuvent le garantir de l’oppression ; en Asie, les juges despotiques seroient eux-mêmes les oppresseurs. Que feroit le marchand contre un bacha qui auroit résolu de confisquer ses marchandises ?
C’est la vexation qui se surmonte elle-même, & se voit contrainte à une certaine douceur. En Turquie, on ne leve qu’un seul droit d’entrée ; après quoi, tout le pays est ouvert aux marchands.
[II-47] Les déclarations fausses n’emportent ni confiscation ni augmentation de droits. On n’ouvre [1] point à la Chine les ballots des gens qui ne sont pas marchands. La fraude chez le Mogol, n’est point punie par la confiscation, mais par le doublement du droit. Les princes [2] Tartares, qui habitent des villes dans l’Asie, ne levent presque rien sur les marchandises qui passent. Que si, au Japon, le crime de fraude dans le commerce est un crime capital, c’est qu’on a des raisons pour défendre toute communication avec les étrangers ; & que la fraude [3] y est plutôt une contravention aux lois faites pour la sureté de l’état, qu’à des lois de commerce.
-
[↑] Du Halde, tome II, p. 37.
-
[↑] Histoire des Tattars, troisieme partie, p. 290.
-
[↑] Voulant avoir un commerce avec les étrangers sans se communiquer avec eux, ils ont choisi deux nations ; la Hollandoise, pour le commerce de l’Europe ; & la Chinoise, pour celui de l’Asie : ils tiennent dans une espece de prison les facteurs & les matelots, & les gênent jusqu’à faire perdre patience.
[II-48]
CHAPITRE XII.
Rapport de la grandeur des tributs avec la liberté.
Regle générale : on peut lever des tributs plus forts, à proportion de la liberté des sujets ; & l’on est forcé de les modérer, à mesure que la servitude augmente. Cela a toujours été, & cela sera toujours. C’est une regle tirée de la nature, qui ne varie point ; on la trouve par tous les pays, en Angleterre, en Hollande, & dans tous les états où la liberté va se dégradant jusqu’en Turquie. La Suisse semble y déroger, parce qu’on ne paye point de tributs : mais on en fait la raison particuliere, & même elle confirme ce que je dis. Dans ces montagnes stériles, les vivres sont si chers & le pays est si peuplé, qu’un Suisse paye quatre fois plus à la nature, qu’un Turc ne paye au Sultan.
Un peuple dominateur, tel qu’étoient les Athéniens & les Romains, peut s’affranchir de tout impôt, parce qu’il regne sur des nations sujettes. Il ne paye pas pour lors à proportion de sa liberté ; [II-49] parce qu’à cet égard il n’est pas un peuple, mais un monarque.
Mais la regle générale reste toujours. Il y a, dans les états modérés, un dédommagement pour la pesanteur des tributs ; c’est la liberté. Il y a dans les états [1] despotiques, un équivalent pour la liberté ; c’est la modicité des tributs.
Dans de certaines monarchies en Europe, on voit des provinces [2] qui, par la nature de leur gouvernement politique, sont dans un meilleur état que les autres. On s’imagine toujours qu’elles ne payent pas assez, parce que, par un effet de la bonté de leur gouvernement, elles pourroient payer davantage ; & il vient toujours dans l’esprit de leur ôter ce gouvernement même qui produit ce bien qui se communique, qui se répand au loin, & dont il vaudroit bien mieux jouir.
-
[↑] En Russie, les tributs sont médiocres : on les a augmentés depuis que le despotisme y est plus modéré. Voyez l’histoire des Tattars, deuxieme partie.
-
[↑] Les pays d’états.
[II-50]
CHAPITRE XIII.
Dans quel gouvernement les tributs sont susceptibles d’augmentation.
On peut augmenter les tributs dans la plupart des républiques ; parce que le citoyen, qui croit payer à lui-même, a la volonté de les payer, & en a ordinairement le pouvoir par l’effet de la nature du gouvernement.
Dans la monarchie on peut augmenter les tributs ; parce que la modération du gouvernement y peut procurer des richesses : c’est comme la récompense du prince, à cause du respect qu’il a pour les lois. Dans l’état despotique, on ne peut pas les augmenter ; parce qu’on ne peut pas augmenter la servitude extrême.
[II-50]
CHAPITRE XIV.
Que la nature des tributs est relative au gouvernement.
L’impôt par tête est plus naturel à la servitude ; l’impôt sur les marchandises est plus naturel à la liberté, parce [II-51] qu’il se rapporte d’une maniere moins directe à la personne.
Il est naturel au gouvernement despotique, que le prince ne donne point d’argent à sa milice ou aux gens de sa cour, mais qu’il leur distribue des terres, & par conséquent qu’on y leve peu de tributs. Que si le prince donne de l’argent, le tribut le plus naturel qu’il puisse lever est un tribut par tête. Ce tribut ne peut être que très-modique : car, comme on n’y peut pas faire diverses classes considérables, à cause des abus qui en résulteroient, vu l’injustice & la violence du gouvernement, il faut nécessairement se régler sur le taux de ce que peuvent payer les plus miserables.
Le tribut naturel au gouvernement modéré, est l’impôt sur les marchandises. Cet impôt étant réellement payé par l’acheteur, quoique le marchand l’avance, est un prêt que le marchand a déjà fait à l’acheteur : ainsi il faut regarder le négociant, & comme le débiteur général de l’état, & comme le créancier de tous les particuliers. Il avance à l’état le droit que l’acheteur lui payera quelque jour ; & il a payé, pour l’acheteur, [II-52] le droit qu’il a payé pour la marchandise. On sent donc que plus le gouvernement est modéré, que plus l’esprit de liberté regne, que plus les fortunes ont de sureté, plus il est facile au marchand d’avancer à l’état, & de prêter au particulier des droits considérables. En Angleterre, un marchand prête réellement à l’état cinquante ou soixante livres sterling à chaque tonneau de vin qu’il reçoit. Quel est le marchand qui oseroit faire une chose de cette espece dans un pays gouverné comme la Turquie ? & quand il l’oseroit faire, comment le pourroit-il, avec une fortune suspecte, incertaine, ruinée ?
[II-52]
CHAPITRE XV.
Abus de la liberté.
Ces grands avantages de la liberté ont fait que l’on a abusé de la liberté même. Parce que le gouvernement modéré a produit d’admirables effets, on a quitté cette modération : parce qu’on a tiré de grands tributs, on en a voulu tirer d’excessifs : & méconnoissant la main de la liberté qui faisoit ce present, [II-53] on s’est adressé à la servitude qui refuse tout.
La liberté a produit l’excès des tributs : mais l’effet de ces tributs excessifs est de produire à leur tour la servitude ; & l’effet de la servitude, de produire la diminution des tributs.
Les monarques de l’Asie ne font guere d’édits que pour exempter chaque année de tributs quelque province de leur empire [1] : les manifestations de leur volonté sont des bienfaits. Mais en Europe, les édits des princes affligent même avant qu’on les ait vus, parce qu’ils y parlent toujours de leurs besoins, & jamais des nôtres.
D’une impardonnable nonchalance, que les ministres de ces pays-là tiennent du gouvernement & souvent du climat, les peuples tirent cet avantage, qu’ils ne sont point sans cesse accablés par de nouvelles demandes. Les dépenses n’y augmentent point, parce qu’on n’y fait point de projets nouveaux : & si par hasard on y en fait, ce sont des projets dont on voit la fin, & non des projets commencés. Ceux qui gouvernent l’état ne le tourmentent pas, parce qu’ils [II-54] ne se tourmentent pas sans cesse eux-mêmes. Mais, pour nous, il est impossible que nous ayons jamais de regles dans nos finances, parce que nous savons toujours que nous ferons quelque chose, & jamais ce que nous ferons.
On n’appelle plus parmi nous un grand ministre celui qui est le sage dispensateur des revenus publics ; mais celui qui est homme d’industrie, & qui trouve ce qu’on appelle des expédiens.
-
[↑] C’est l’usage des empereurs de la Chine.
[II-54]
CHAPITRE XVI.
Des conquêtes des Mahométans.
Ce furent ces tributs [1] excessifs qui donnerent lieu à cette étrange facilité que trouverent les Mahométans dans leurs conquêtes. Les peuples, au lieu de cette suite continuelle de vexations que l’avarice subtile des empereurs avoit imaginées, se virent soumis à un tribut simple, payé aisément, reçu de même ; plus heureux d’obéir à une nation barbare qu’à un gouvernement [II-55] corrompu, dans lequel ils souffroient tous les inconvéniens d’une liberté qu’ils n’avoient plus, avec toutes les horreurs d’une servitude présente.
-
[↑] Voyez, dans l’histoire, la grandeur, la bizarrerie, & même la folie de ces tributs. Anastase en imagina un pour respirer l’air : ut quisque pro haustu aëris penderet.
[II-55]
CHAPITRE XVII.
De l’augmentation des troupes.
Une maladie nouvelle s’est répandue en Europe ; elle a saisi nos princes, & leur fait entretenir un nombre désordonné de troupes. Elle a ses redoublemens, & elle devient nécessairement contagieuse : car si-tôt qu’un état augmente ce qu’il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs ; de façon qu’on ne gagne rien par-là, que la ruine commune. Chaque monarque tient sur pied toutes les armées qu’il pourroit avoir, si ses peuples étoient en danger d’être exterminés ; & on nomme paix cet état [1] d’effort de tous contre tous. Aussi l’Europe est-elle si ruinée, que les particuliers qui seroient dans la situation où sont les trois [II-56] puissances de cette partie du monde les plus opulentes, n’auroient pas de quoi vivre. Nous sommes pauvres avec les richesses & le commerce de tout l’univers, & bientôt, à force d’avoir des soldats, nous n’aurons plus que des soldats, & nous serons comme des Tartares [2] .
Les grands princes, non contens d’acheter les troupes des plus petits, cherchent de tous côtés à payer des alliances ; c’est-à-dire, presque toujours à perdre leur argent.
La fuite d’une telle situation est l’augmentation perpétuelle des tributs : & ce qui prévient tous les remedes à venir, on ne compte plus sur les revenus, mais on fait la guerre avec son capital. Il n’est pas inoui de voir des états hypothéquer leur fonds pendant la paix même ; & employer pour se ruiner, des moyens qu’ils appellent extraordinaires, & qui le sont si fort que le fils de famille le plus dérangé les imagine à peine.
-
[↑] Il est vrai que c’est cet état d’effort qui maintient principalement l’équilibre, parce qu’il éreinte les grandes puissances.
-
[↑] Il ne faut pour cela, que faire valoir la nouvelle invention des milices établies dans presque toute l’Europe, & les porter au même excès que l’on a fait les troupes réglées.
[II-57]
CHAPITRE XVIII.
De la remise des tributs.
La maxime des grands empires d’orient, de remettre les tributs aux provinces qui ont souffert, devroit bien être portée dans les états monarchiques. Il y en a bien où elle est établie : mais elle accable plus que si elle n’y étoit pas, parce que le prince n’en levant ni plus ni moins, tout l’état devient solidaire. Pour soulager un village qui paye mal, on charge un autre qui paye mieux ; on ne rétablit point le premier, on détruit le second. Le peuple est désespéré entre la nécessité de payer de peur des exactions, & le danger de payer crainte des surcharges.
Un état bien gouverné doit mettre, pour le premier article de sa dépense, une somme réglée pour les cas fortuits. Il en est du public comme des particuliers, qui se ruinent lorsqu’ils dépensent exactement les revenus de leurs terres.
À l’égard de la solidité entre les habitans du même village, on a dit [1] , [II-58] qu’elle étoit raisonnable, parce qu’on pouvoit supposer un complot frauduleux de leur part : mais où a-t-on pris que, sur des suppositions, il faille établir une chose injuste par elle-même & ruineuse pour l’état ?
-
[↑] Voyez le traité des finances des Romains, ch. II. imprimé à Paris, chez Briasson, 1740.
[II-58]
CHAPITRE XIX.
Qu’est-ce qui est plus convenable au prince & au peuple, de la ferme ou de la régie des tributs ?
La régie est l’administration d’un bon pere de famille, qui leve lui-même avec économie & avec ordre ses revenus.
Par la régie, le prince est le maître de presser ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie, il épargne à l’état les profits immenses des fermiers, qui l’appauvrissent d’une infinité de manieres. Par la régie, il épargne au peuple le spectacle des fortunes subites qui l’affligent. Par la régie, l’argent levé passe par peu de mains ; il va directement au prince, & par conséquent revient plus promptement au peuple. Par la régie, le prince épargne [II-59] au peuple une infinité de mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice importune des fermiers, qui montrent un avantage présent dans des réglemens funestes pour l’avenir.
Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le prince même ; il n’est pas législateur, mais il le force à donner des lois.
J’avoue qu’il est quelquefois utile de commencer par donner à ferme un droit nouvellement établi : il y a un art & des inventions pour prévenir les fraudes, que l’intérêt des fermiers leur suggere, & que les regisseurs n’auroient pu imaginer ; or le systême de la levée étant une fois fait par le fermier, on peut avec succès établir la régie. En Angleterre, l’administration de l’accise & du revenu des postes, telle qu’elle est aujourd’hui, a été empruntée des fermiers.
Dans les républiques, les revenus de l’état sont presque toujours en régie. L’établissement contraire fut un grand vice du gouvernerment de Rome [1] .
[II-60] Dans les états despotiques, où la régie est établie, les peuples sont infiniment plus heureux ; témoin la Perse & la Chine [2] . Les plus malheureux sont ceux où le prince donne à ferme ses ports de mer & ses villes de commerce. L’histoire des monarchies est pleine des maux faits par les traitans.
Néron indigné des vexations des publicains, forma le projet impossible & magnanime d’abolir tous les impôts. Il n’imagina point la régie : il fit [3] quatre ordonnances ; que les lois faites contre les publicains, qui avoient été jusques-là tenues secretes, seroient publiées ; qu’ils ne pourroient plus exiger ce qu’ils avoient négligé de demander dans l’année ; qu’il y auroit un préteur établi pour juger leurs prétentions sans formalité ; que les marchands ne payeroient rien pour les navires. Voilà les beaux jours de cet empereur.
-
[↑] César fut obligé d’ôter les publicains de la province d’Asie, & d’y établir une autre sorte d’administration, comme nous l’apprenons de Dion. Et Tacite nous dit que la Macédoine & l’Achaïe, provinces qu’Auguste avoit laissées au peuple Romain, & qui par conséquent étoient gouvernées sur l’ancien plan, obtinrent d’être du nombre de celles que l’empereur gouvernoit par ses officiers.
-
[↑] Voyez Chardin, voyage de Perse, tom. VI.
-
[↑] Tacite, annales liv. XIII.
[II-61]
CHAPITRE XX.
Des traitans.
Tout est perdu, lorsque la profession lucrative des traitans parvient encore par ses richesses à être une profession honorée. Cela peut être bon dans les états despotiques, où souvent leur emploi est une partie des fonctions des gouverneurs eux-mêmes. Cela n’est pas bon dans la république ; & une chose pareille détruisit la république Romaine. Cela n’est pas meilleur dans la monarchie ; rien n’est plus contraire à l’esprit de ce gouvernement. Un dégoût saisit tous les autres états ; l’honneur y perd toute sa considération, les moyens lents & naturels de se distinguer ne touchent plus, & le gouvernement est frappé dans son principe.
On vit bien dans les temps passés des fortunes scandaleuses ; c’étoit une des calamités des guerres de cinquante ans : mais pour lors, ces richesses furent regardées comme ridicules ; & nous les admirons.
Il y a un lot pour chaque profession.
[II-62] Le lot de ceux qui levent les tributs est les richesses ; & les récompenses de ces richesses, sont les richesses mêmes. La gloire & l’honneur sont pour cette noblesse qui ne connoît, qui ne voit, qui ne sent de vrai bien que l’honneur & la gloire. Le respect & la considération sont pour ces ministres & ces magistrats qui, ne trouvant que le travail après le travail, veillent nuit & jour pour le bonheur de l’empire.
[II-63]
LIVRE XIV.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée générale.
S’il est vrai que le caractere de l’esprit & les passions du cœur soient extrêmement différentes dans les divers climats, les lois doivent être relatives & à la différence de ces passions & à la différence de ces caracteres.
[II-63]
CHAPITRE II.
Combien les hommes sont différent dans les divers climats.
L’air froid [1] resserre les extrémités des fibres extérieures de notre corps ; cela augmente leur ressort, & [II-64] favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. Il diminue la longueur [2] de ces mêmes fibres ; il augmente donc encore par-là leur force. L’air chaud au contraire relâche les extrémités des fibres, & les alonge ; il diminue donc leur force & leur ressort.
On a donc plus de vigueur dans les climats froids. L’action du cœur & la réaction des extrémités des fibres s’y font mieux, les liqueurs sont mieux en équilibre, le sang est plus déterminé vers le cœur, & réciproquement le cœur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets : par exemple, plus de confiance en soi-même, c’est-à-dire plus de courage ; plus de connoissance de sa supériorité, c’est-à-dire, moins de désir de la vengeance ; plus d’opinion de sa sureté, c’est-à-dire, plus de franchise, moins de soupçons, de politique & de ruses. Enfin, cela doit faire des caracteres bien différens. Mettez un homme dans un lieu chaud & enfermé ; il souffrira, par les raisons que je viens de dire, une défaillance de cœur très-grande. Si dans cette circonstance on va lui proposer une [II-65] action hardie, je crois qu’on l’y trouvera très-peu disposé ; sa foiblesse présente mettra un découragement dans son ame ; il craindra tout, parce qu’il sentira qu’il ne peut rien. Les peuples des pays chauds sont timides, comme les vieillards le sont ; ceux des pays froids sont courageux, comme le sont les jeunes gens. Si nous faisons attention aux dernieres [3] guerres, qui sont celles que nous avons le plus sous nos yeux, & dans lesquelles nous pouvons mieux voir de certains effets légers, imperceptibles de loin, nous sentirons bien que les peuples du nord transportés dans les pays du midi [4] , n’y ont pas fait d’aussi belles actions que leurs compatriotes, qui, combattant dans leur propre climat, y jouissoient de tout leur courage.
La force des fibres des peuples du nord, fait que les sucs les plus grossiers sont tirés des alimens. Il en résulte deux choses : l’une que les parties du chyle, ou de la lymphe, sont plus propres, par leur grande surface, à être appliquées sur les fibres & à les nourrir : l’autre, qu’elles [II-66] sont moins propres, par leur grossiéreté à donner une certaine subtilité au suc nerveux. Ces peuples auront donc de grands corps, & peu de vivacité.
Les nerfs qui aboutissent de tous côtés au tissu de notre peau, sont chacun un faisceau de nerfs : ordinairement ce n’est pas tout le nerf qui est remué, c’en est une partie infiniment petite. Dans les pays chauds, où le tissu de la peau est relâché, les bouts des nerfs sont épanouis, & exposés à la plus petite action des objets les plus foibles. Dans les pays froids, le tissu de la peau est resserré, & les mamelons comprimés ; les petites houpes sont en quelque façon paralytiques ; la sensation ne passe guere au cerveau, que lorsqu’elle est extrêmement forte, & qu’elle est de tout le nerf ensemble. Mais c’est d’un nombre infini de petites sensations que dépendent l’imagination, le goût, la sensibilité, la vivacité.
J’ai observé le tissu extérieur d’une langue de mouton, dans l’endroit où elle paroît à la simple vue couverte de mamelons. J’ai vu avec un microscope, sur ces mamelons, de petits poils ou une espece de duvet ; entre les [II-67] mamelons, étoient des pyramides, qui formoient par le bout comme de petits pinceaux. Il y a grande apparence que ces pyramides sont le principal organe du goût.
J’ai fait geler la moitié de cette langue ; & j’ai trouvé, à la simple vue, les mamelons considérablement diminués ; quelques rangs même de mamelons s’étoient enfoncés dans leur gaine : j’en ai examiné le tissu avec le microscope, je n’ai plus vu de pyramides. À mesure que la langue s’est dégelée, les mamelons a la simple vue ont paru se relever ; & au microscope, les petites houpes ont commencé à reparoître.
Cette observation confirme ce que j’ai dit, que, dans les pays froids, les houpes nerveuses sont moins épanouies : elles s’enfoncent dans leurs gaines, où elles sont à couvert de l’action des objets extérieurs. Les sensations sont donc moins vives.
Dans les pays froids, on aura peu de sensibilité pour les plaisirs ; elle sera plus grande dans les pays tempérés ; dans les pays chauds, elle sera extrême. Comme on distingue les climats par les degrés de latitude, on pourroit les distinguer, [II-68] pour ainsi dire, par les degrés de sensibilité. J’ai vu les opéras d’Angleterre & d’Italie ; ce sont les mêmes pièces & les mêmes acteurs : mais la même musique produit des effets si differens sur les deux nations, l’une est si calme, & l’autre si transportée, que cela paroît inconcevable.
Il en sera de même de la douleur : elle est excitée en nous par le déchirement de quelque fibre de notre corps. L’auteur de la nature a établi que cette douleur seroit plus forte, à mesure que le dérangement seroit plus grand : or il est évident que les grands corps & les fibres grossieres des peuples du nord sont moins capables de dérangement, que les fibres délicates des peuples des pays chauds ; l’ame y est donc moins sensible à la douleur. Il faut écorcher un Moscovite, pour lui donner du sentiment.
Avec cette délicatesse d’organes que l’on a dans les pays chauds, l’ame est souverainement émue par tout ce qui a du rapport à l’union des deux sexes ; tout conduit à cet objet.
Dans les climats du nord, à peine le physique de l’amour a-t-il la force de se [II-69] rendre bien sensible ; dans les climats tempérés, l’amour accompagne de mille accessoires, se rend agréable par des choses, qui d’abord semblent être lui-même, & ne sont pas encore lui ; dans les climats plus chauds, on aime l’amour pour lui-même, il est la cause unique du bonheur, il est la vie.
Dans les pays du midi, une machine délicate, foible, mais sensible, se livre à un amour qui, dans un sérail, naît & se calme sans cesse ; ou bien à un amour, qui laissant les femmes dans une plus grande indépendance, est exposé à mille troubles. Dans les pays du nord, une machine saine & bien constituée, mais lourde, trouve ses plaisirs dans tout ce qui peut remettre les esprits en mouvement, la chasse, les voyages, la guerre, le vin. Vous trouverez dans les climats du nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité & de franchise. Approchez des pays du midi, vous croirez vous éloigner de la morale même ; des passions plus vives multiplieront les crimes ; chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions. Dans les pays [II-70] tempérés, vous verrez des peuples inconstans dans leurs manieres, dans leurs vices mêmes, & dans leurs vertus : le climat n’y a pas une qualité assez déterminée pour les fixer eux-mêmes.
La chaleur du climat peut être si excessive, que le corps y sera absolument sans force. Pour lors, l’abattement passera à l’esprit même ; aucune curiosité, aucune noble entreprise, aucun sentiment généreux ; les inclinations y seront toutes passives ; la paresse y sera le bonheur ; la plupart des châtimens y seront moins difficiles à soutenir, que l’action de l’ame ; & la servitude moins insupportable, que la force d’esprit qui est nécessaire pour se conduire soi-même.
-
[↑] Cela paroît même à la vue : dans le froid on paroît plus maigre.
-
[↑] On sait qu’il raccourcit le fer.
-
[↑] Celles pour la succession d’Espagne.
-
[↑] En Espagne, pas exemple
[II-70]
CHAPITPRE III.
Contradiction dans les caracteres de certains peuples du midi.
Les Indiens [1] sont naturellement sans courage, les enfans [2] mêmes des Européens nés aux Indes, perdent [II-71] celui de leur climat. Mais comment accorder cela avec leurs actions atroces, leurs coutumes, leurs pénitences barbares ? Les hommes s’y soumettent à des maux incroyables ; les femmes s’y brûlent elles-mêmes : voilà bien de la force pour tant de foiblesse.
La nature, qui a donné à ces peuples une foiblesse qui les rend timides, leur a donné aussi une imagination si vive, que tout les frappe à l’excès. Cette même délicatesse d’organes qui leur fait craindre la mort, sert aussi à leur faire redouter mille choses plus que la mort. C’est la même sensibilité qui leur fait fuir tous les périls, & les leur fait tous braver.
Comme une bonne éducation est plus nécessaire aux enfans qu’à ceux dont l’esprit est dans sa maturité ; de même les peuples de ces climats ont plus besoin d’un législateur sage, que les peuples du nôtre. Plus on est aisément & fortement frappé, plus il importe de l’être d’une maniere convenable, de ne recevoir pas des préjugés, & d’être conduit par la raison.
[II-72] Du temps des Romains, les peuples du nord de l’Europe vivoient sans art, sans éducation, presque sans lois : & cependant, par le seul bon sens attaché aux fibres grossieres de ces climats, ils se maintinrent avec une sagesse admirable contre la puissance Romaine, jusqu’au moment où ils sortirent de leurs forêts pour la détruire.
-
[↑] « Cent soldats d’Europe, dit Tavernier, n’auroient pas grand’peine à battre mille soldats Indiens ».
-
[↑] Les Persans même qui s’établissent aux Indes, prennent, à la troisieme génération, la nonchalance & la lâcheté Indienne, Voyez Bernier, sur le Mogol, tom. I. p. 282.
[II-72]
CHAPITRE IV.
Cause de l’immutabilité de la religion, des mœurs, des manieres, des lois, dans les pays d’orient.
Si avec cette foiblesse d’organes qui fait recevoir aux peuples d’orient les impressions du monde les plus fortes, vous joignez une certaine paresse dans l’esprit naturellement liée avec celle du corps, qui fasse que cet esprit ne soit capable d’aucune action, d’aucun effort, d’aucune contention ; vous comprendrez que l’ame qui a une fois reçu des impressions ne peut plus en changer. C’est ce qui fait que les lois, les [II-73] mœurs [1] & les manieres, même celles qui paroissent indifférentes, comme la façon de se vêtir, sont aujourd’hui en orient comme elles étoient il y a mille ans.
-
[↑] On voit, par un fragment de Nicolas de Damas, recueilli par Constantin Porphyrogenete, que la coutume étoit ancienne en orient, d’envoyer étrangler un gouverneur qui déplaisoit ; elle étoit du temps des Medes.
[II-73]
CHAPITRE V.
Que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, & les bons sont ceux qui s’y sont opposés.
Les Indiens croient que le repos & le néant sont le fondement de toutes choses, & la fin où elles aboutissent. Ils regardent donc l’entiere inaction comme l’état le plus parfait & l’objet de leurs désirs. Ils donnent au souverain être [1] le surnom d’immobile. Les Siamois croient que la félicité [2] suprême consiste à n’être point obligé d’animer une machine & de faire agir un corps.
[II-74]
Dans ces pays, où la chaleur excessive énerve & accable, le repos est si délicieux, & le mouvement si pénible, que ce systême de métaphysique paroît naturel ; & [3] Foë, législateur des Indes, a suivi ce qu’il sentoit, lorsqu’il a mis les hommes dans un état extrêmement passif : mais la doctrine, née de la paresse du climat, la favorisant à son tour, a causé mille maux.
Les législateurs de la Chine furent plus sensés, lorsque considérant les hommes, non pas dans l’état paisible où ils seront quelque jour, mais dans l’action propre à leur faire remplir les devoirs de la vie, ils firent leur religion, leur philosophie & leurs lois toutes pratiques. Plus les causes physiques portent les hommes au repos, plus les causes morales les en doivent éloigner.
-
[↑] Panamanack. Voyez Kircher.
-
[↑] La Loubere, relation de Siam, p. 446.
-
[↑] Foë veut réduire le cœur au pur vide. « Nous avons des yeux & des oreilles ; mais la perfection est de ne voir ni entendre : une bouche, des mains etc. la perfection est que ces membres soient dans l’inaction. » Ceci est tiré du dialogue d’un Philosophe Chinois, rapporté par le P. du Halde, tom. III.
[II-75]
CHAPITRE VI.
De la culture des terres dans les climats chauds.
La culture des terres est le plus grand travail des hommes. Plus le climat les porte à fuir ce travail, plus la religion & les lois doivent y exciter. Ainsi les lois des Indes, qui donnent les terres aux princes, & ôtent aux particuliers l’esprit de propriété, augmentent les mauvais effets du climat, c’est-à-dire, la paresse naturelle.
[II-75]
CHAPITRE VII.
Du monachisme.
Le monachisme y fait les mêmes maux ; il est né dans les pays chauds d’Orient, où l’on est moins porté à l’action qu’à la spéculation.
En Asie le nombre des derviches ou moines semble augmenter avec la chaleur du climat ; les Indes, où elle est excessive, en sont remplies : on trouve en Europe cette même différence.
[II-76]
Pour vaincre la paresse du climat, il faudroit que les lois cherchassent à ôter tous les moyens de vivre sans travail : mais, dans le midi de l’Europe, elles font tout le contraire ; elles donnent à ceux qui veulent être oisifs des places propres à la vie spéculative, & y attachent des richesses immenses. Ces gens, qui vivent dans une abondance qui leur est à charge, donnent avec raison leur superflu au bas peuple : il a perdu la propriété des biens ; ils l’en dédommagent par l’oisiveté dont ils le font jouir ; & il parvient à aimer sa misère même.
[II-76]
CHAPITRE VIII.
Bonne coutume de la Chine.
Les relations [1] de la Chine nous parlent de la cérémonie [2] d’ouvrir les terres, que l’empereur fait tous les ans. On a voulu exciter [3] les peuples [II-77] au labourage par cet acte public & solennel.
De plus, l’Empereur est informé chaque année du laboureur qui s’est le plus distingué dans sa profession ; il le fait mandarin du huitieme ordre.
Chez les anciens Perses [4] , le huitieme jour du mois nommé Chorremruz, les rois quittoient leur faste pour manger avec les laboureurs. Ces institutions sont admirables pour encourager l’agriculture.
-
[↑] Le P. du Halde, histoire de la Chine, tom. II. pag. 72.
-
[↑] Plusieurs rois des Indes, font de même. Relation du royaume de Siam par la Loubere, p. 69.
-
[↑] Venty, troisieme empereur de la troisieme dynastie, cultiva la terre de ses propres mains, & fit travailler à la soie, dans son palais, l’impératrice & ses femmes. Histoire de la Chine.
-
[↑] M. Hyde, religion des Perses.
[II-77]
CHAPITRE IX.
Moyens d’encourager l’industrie.
Je ferai voir au livre XIX, que les nations paresseuses sont ordinairement orgueilleuses. On pourroit tourner l’effet contre la cause, & détruire la paresse par l’orgueil. Dans le midi de l’Europe, où les peuples sont si frappés par le point d’honneur, il seroit bon de donner des prix aux laboureurs qui auroient le mieux cultivé leurs champs, ou aux ouvriers qui auroient porté plus loin leur industrie. Cette pratique réussira [II-78] même par tout pays. Elle a servi de nos jours, en Irlande, à l’établissement d’une des plus importantes manufactures de toile qui soit en Europe.
[II-78]
CHAPITRE X.
Des lois qui ont rapport à la sobriété des peuples.
Dans les pays chauds, la partie aqueuse du sang se dissipe beaucoup par la transpiration [1] ; il y faut donc subsistuer un liquide pareil. L’eau y est d’un usage admirable, les liqueurs fortes y coaguleroient les globules [2] du sang qui restent après la dissipation de la partie aqueuse.
Dans les pays froids, la partie aqueuse du sang s’exhale peu par la transpiration ; elle reste en grande abondance. On y peut donc user de liqueurs spiritueuses, [II-79] sans que le sang se coagule. On y est plein d’humeurs ; les liqueurs fortes, qui donnent du mouvement au sang, y peuvent être convenables.
La loi de Mahomet, qui défend de boire du vin, est donc une loi du climat d’Arabie : aussi, avant Mahomet, l’eau étoit-elle la boisson commune des Arabes. La loi [3] qui defendoit aux Carthaginois de boire du vin, étoit aussi une loi du climat ; effectivement le climat de ses deux pays est à peu près le même.
Une pareille loi ne seroit pas bonne dans les pays froids, où le climat semble forcer à une certaine ivrognerie de nature, bien différente de celle de la personne. L’ivrognerie se trouve établie par toute la terre, dans la proportion de la froideur & de l’humidité du climat. Passez de l’équateur jusqu’à notre pôle, vous y verrez l’ivrognerie augmenter avec les degrés de latitude. Passez du même équateur au pôle opposé, vous y trouverez l’ivrognerie aller vers le midi [4] , comme de ce côté-ci elle avoit été vers le nord.
[II-80]
Il est naturel que, là où le vin est contraire au climat, & par conséquent à la santé, l’excès en soit plus sévérement puni, que dans les pays où l’ivrognerie a peu de mauvais effets pour la personne ; où elle en a peu pour la société ; où elle ne rend point les hommes furieux, mais seulement stupides. Ainsi les lois [5] qui ont puni un homme ivre, & pour la faute qu’il faisoit & pour l’ivresse, n’étoient appliquables qu’à l’ivrognerie de la personne, & non à l’ivrognerie de la nation. Un Allemand boit par coutume, un Espagnol par choix.
Dans les pays chauds, le relâchement des fibres produit une grande transpiration des liquides : mais les parties solides se dissipent moins. Les fibres, qui n’ont qu’une action très-foible & peu de ressort, ne s’usent guere ; il faut peu de suc nourricier pour les réparer : on mange donc très-peu.
Ce sont les différens besoins, dans les différens climats, qui ont formé les différentes manieres de vivre ; & ces [II-81] différentes manieres de vivre ont formé les diverses sortes de lois. Que dans une nation les hommes se communiquent beaucoup, il faut de certaines lois ; il en faut d’autres, chez un peuple où l’on ne se communique point.
-
[↑] M. Bernier faisant un voyage de Lahor à Cachemir, écrivoit : « Mon corps est un crible ; à peine ai-je avalé une pinte d’eau, que je la vois sortir comme une rosée de tous mes membres jusqu’au bout des doigts ; j’en bois dix pintes par jour, & cela ne me fait point de mal ». Voyage de Bernier, tom. II. p. 261.
-
[↑] Il y a dans le sang des globules rouges, des parties fibreuses, des globules blancs, & de l’eau dans laquelle nage tout cela.
-
[↑] Platon, liv. II. des lois : Aristote, du soin des affaires domestiques : Eusebe, prép. évang. liv. XII. ch. xvii.
-
[↑] Cela se voit dans les Hottentots & les peuples de la pointe du Chily, qui sont plus près du sud.
-
[↑] Comme fit Pittacus, selon Aristote, politiq. liv. II. ch. iii. Il vivoit dans un climat ou l’ivrognerie n’est pas un vice de nation.
[II-81]
CHAPITRE XI.
Des lois qui ont du rapport aux maladies du climat.
Hérodote [1] nous dit que les lois des Juifs sur la lepre ont été tirées de la pratique des Égyptiens. En effet, les mêmes maladies demandoient les mêmes remedes. Ces lois furent inconnues aux Grecs & aux premiers Romains aussi bien que le mal. Le climat de l’Égypte & de la Palestine les rendit nécessaires ; & la facilité qu’a cette maladie à se rendre populaire, nous doit bien faire sentir la sagesse & la prévoyance de ces lois.
Nous en avons nous-mêmes éprouvé les effets. Les croisades nous avoient apporté la lepre ; les réglemens sages [II-82] que l’on fit l’empêcherent de gagner la masse du peuple.
On voit par la loi [2] des Lombards, que cette maladie étoit répandue en Italie avant les croisades, & mérita l’attention des législateurs. Rotharis ordonna qu’un lépreux, chassé de sa maison & relégué dans un endroit particulier, ne pourroit disposer de ses biens ; parce que, dès le moment qu’il avoit été tiré de sa maison, il étoit censé mort. Pour empêcher toute communication avec les lépreux, on les rendoit incapables des effets civils.
Je pense que cette maladie fut apportée en Italie par les conquêtes des empereurs Grecs, dans les armées desquels il pouvoit y avoir des milices de la Palestine ou de l’Égypte. Quoi qu’il en soit, les progrès en furent arrêtés jusqu’au temps des croisades.
On dit que les soldats de Pompée revenant de Syrie, rapporterent une maladie à peu près pareille à la lepre. Aucun réglement, fait pour lors, n’est venu jusqu’à nous : mais il y a apparence qu’il y en eut, puisque ce mal fut suspendu jusqu’au temps des Lombards.
[II-83]
Il y a deux siecles, qu’une maladie inconnue à nos peres passa du nouveau monde dans celui-ci, & vint attaquer la nature humaine jusques dans la source de la vie & des plaisirs. On vit la plupart des plus grandes familles du midi de l’Europe périr par un mal qui devint trop commun pour être honteux, & ne fut plus que funeste. Ce fut la soif de l’or qui perpétua cette maladie : on alla sans cesse en Amérique, & on en rapporta toujours de nouveaux levains.
Des raisons pieuses voulurent demander qu’on laissât cette punition sur le crime : mais cette calamité étoit entrée dans le sein du mariage, & avoit déjà corrompu l’enfance même.
Comme il est de la sagesse des législateurs de veiller à la santé des citoyens, il eût été très-censé d’arrêter cette communication par des lois faites sur le plan des lois Mosaïques.
La peste est un mal dont les ravages sont encore plus promps & plus rapides. Son siege principal est en Égypte, d’où elle se répand par tout l’univers. On a fait dans la plupart des états de l’Europe de très-bons réglemens pour l’empêcher d’y pénétrer ; & on a [II-84] imaginé de nos jours un moyen admirable de l’arrêter : on forme une ligne de troupes autour du pays infecté, qui empêche toute communication.
Les [3] Turcs qui n’ont à cet égard aucune police, voient les Chrétiens, dans la même ville, échapper au danger, & eux seuls périr ; ils achetent les habits des pestiférés, s’en vêtissent, & vont leur train. La doctrine d’un destin rigide qui regle tout, fait du magistrat un spectateur tranquille : il pense que Dieu a déjà tout fait, & que lui n’a rien à faire.
[II-84]
CHAPITRE XII.
Des Lois contre ceux qui se tuent [1] eux-mêmes.
Nous ne voyons point dans les histoires, que les Romains se fissent mourir sans sujet : mais les Anglois se tuent sans qu’on puisse imaginer aucune raison qui les y détermine ; ils se tuent dans le sein même du bonheur. Cette [II-85] action chez les Romains étoit l’effet de l’éducation ; elle tenoit à leurs manieres de penser & à leurs coutumes : chez les Anglois, elle est l’effet d’une maladie [2] ; elle tient à l’état physique de la machine, & est indépendante de toute autre cause.
Il y a apparence que c’est un défaut de filtration du suc nerveux ; la machine dont les forces motrices se trouvent à tout moment sans action, est lasse d’elle-même ; l’ame ne sent point de douleur, mais une certaine difficulté de l’existence. La douleur est un mal local, qui nous porte au désir de voir cesser cette douleur ; le poids de la vie est un mal qui n’a point de lieu particulier, & qui nous porte au désir de voir finir cette vie.
Il est clair que les lois civiles de quelques pays, ont eu des raisons pour flétrir l’homicide de soi-même : mais en Angleterre, on ne peut pas plus le punir, qu’on ne punit les effets de la démence.
-
[↑] L’action de ceux qui se tuent eux-mêmes, est contraire à la loi naturelle, & à la religion révélée.
-
[↑] Elle pourroit bien être compliquée avec le scorbut ; qui, sur-tout dans quelques pays, rend un homme bizarre & insupportable à lui-même. Voyage de Francis Fyrard, part. II. chap. XXI.
[II-86]
CHAPITRE XIII.
Effets qui résultent du climat d’Angleterre.
Dans une nation à qui une maladie du climat affecte tellement l’ame, qu’elle pourroit porter le dégoût de toutes choses jusqu’à celui de la vie ; on voit bien que le gouvernement qui conviendroit le mieux à des gens à qui tout seroit insupportable, seroit celui où ils ne pourroient pas se prendre à un seul de ce qui causeroit leurs chagrins ; & où les lois gouvernant plutôt que les hommes, il faudroit, pour changer l’état, les renverser elles-mêmes.
Que si la même nation avoit encore reçu du climat un certain caractere d’impatience, qui ne lui permit pas de souffrir long-temps les mêmes choses, on voit bien que le gouvernement dont nous venons de parler, seroit encore le plus convenable.
Ce caractere d’impatience n’est pas grand par lui-même : mais il peut le devenir beaucoup, quand il est joint avec le courage.
[II-87]
Il est différent de la légéreté, qui fait que l’on entreprend sans sujet, & que l’on abandonne de même ; il approche plus de l’opiniâtreté, parce qu’il vient d’un sentiment des maux, si vif, qu’il ne s’affoiblit pas même par l’habitude de les souffrir.
Ce caractere dans une nation libre, seroit très-propre à déconcerter les projets de la tyrannie [1] , qui est toujours lente & foible dans ses commencemens, comme elle est prompte & vive dans sa fin ; qui ne montre d’abord qu’une main pour secourir, & opprime ensuite une infinité de bras.
La servitude commence toujours par le sommeil. Mais un peuple qui n’a de repos dans aucune situation, qui se tâte sans cesse, & trouve tous les endroits douloureux, ne pourroit guere s’endormir.
La politique est une lime sourde, qui use & qui parvient lentement à sa fin. Or, les hommes dont nous venons de parler, ne pourroient soutenir les lenteurs, les détails, le sang-froid des [II-88] négociations ; ils y réussiroient souvent moins que toute autre nation ; & ils perdroient, par leurs traités, ce qu’ils auroient obtenu par leurs armes.
-
[↑] Je prends ici ce mot pour le dessein de renverser le pouvoir établi, & sur-tout la democratie. C’est la signification que lui donnoient les Grecs & les Romains.
[II-88]
CHAPITRE XIV.
Autres effets du climat.
Nos peres, les anciens Germains, habitoient un climat où les passions étoient très-calmes. Leurs lois ne trouvoient dans les choses que ce qu’elles voyoient, & n’imaginoient rien de plus. Et comme elles jugeoient des insultes faites aux hommes par la grandeur des blessures, elles ne mettoient pas plus de raffinement dans les offenses faites aux femmes. La loi [1] des Allemands est là-dessus fort singuliere. Si l’on découvre une femme à la tête, on payera une amende de six sols, autant si c’est à la jambe jusqu’au genou ; le double depuis le genou. Il semble que la loi mesuroit la grandeur des outrages faits à la personne des femmes, comme on mesure une figure de géométrie ; elle ne punissoit point le crime de [II-89] l’imagination, elle punissoit celui des yeux. Mais lorsqu’une nation Germanique se fut transportée en Espagne, le climat trouva bien d’autres lois. La loi des Wisigoths défendit aux médecins de saigner une femme ingénue, qu’en présence de son pere ou de sa mere, de son frere, de son fils ou de son oncle. L’imagination des peuples s’alluma, celle des législateurs s’échauffa de même ; la loi soupçonna tout, pour un peuple qui pouvoit tout soupçonner.
Ces lois eurent donc une extrême attention sur les deux sexes. Mais il semble que, dans les punitions qu’elles firent, elles songerent plus à flatter la vengeance particuliere, qu’à exercer la vengeance publique. Ainsi dans la plupart des cas, elles réduisoient les deux coupables dans la servitude des parens ou du mari offensé. Une femme [2] ingénue, qui s’étoit livrée à un homme marié, étoit remise dans la puissance de sa femme, pour en disposer à sa volonté. Elles obligeoient les esclaves [3] de lier & de présenter au mari sa femme qu’ils surprenoient en adultere : elles [II-90] permettoient à ses enfans [4] de l’accuser, & de mettre à la question ses esclaves pour la convaincre. Aussi furent-elles plus propres à rafiner à l’excès un certain point d’honneur, qu’à former une bonne police. Et il ne faut pas être étonné si le comte Julien crut qu’un outrage de cette espece demandoit la perte de sa patrie & de son roi. On ne doit pas être surpris si les Maures, avec une telle conformité de mœurs, trouverent tant de facilité à s’établir en Espagne, à s’y maintenir, & à retarder la chute de leur empire.
-
[↑] Chap. LVIII. §. 1 & 2.
-
[↑] Loi des Wisigoths, liv. III. tit. 4. §. 9.
-
[↑] Ibid. liv. III, tit. 4. §. 6.
-
[↑] Ibid. liv. III. tit. 4. §. 13.
[II-90]
CHAPITRE XV.
De la différente confiance que les lois ont dans le peuple selon les climats.
Le peuple Japonois a un caractere si atroce, que ses législateurs & ses magistrats n’ont pu avoir aucune confiance en lui. Ils ne lui ont mis devant les yeux que des juges, des menaces & des châtimens : ils l’ont soumis, pour chaque démarche, à l’inquisition de la police. Ces lois qui, sur cinq chefs de [II-91] famille, en établissent un comme magistrat sur les quatre autres ; ces lois qui, pour un seul crime, punissent toute une famille ou tout un quartier ; ces lois, qui ne trouvent point d’innocens là où il peut y avoir un coupable, sont faites pour que tous les hommes se méfient les uns des autres, pour que chacun recherche la conduite de chacun, & qu’il en soit l’inspecteur, le témoin & le juge.
Le peuple des Indes au contraire est doux [1] , tendre, compatissant. Aussi ses législateurs ont-ils eu une grande confiance en lui. Ils ont établi peu [2] de peines, & elles sont peu séveres ; elles ne sont pas même rigoureusement exécutées. Ils ont donné les neveux aux oncles, les orphelins aux tuteurs, comme on les donne ailleurs à leurs peres : ils ont réglé la succession par le mérite reconnu du successeur. Il semble qu’ils ont pensé que chaque citoyen devoit se reposer sur le bon naturel des autres.
[II-92]
Ils donnent aisément la liberté [3] à leurs esclaves ; ils les marient ; ils les traitent comme leurs enfans [4] : heureux climat qui fait naître la candeur des mœurs & produit la douceur des lois !
-
[↑] Voyez Bernier, tome II. p. 140.
-
[↑] Voyez dans le quatorzieme recueil des lettres édifiantes, p. 403. les principales lois ou coutumes des peuples d’Inde de la presqu’île deçà le Gange.
-
[↑] Lettres édifiantes, neuvieme recueil, p. 378.
-
[↑] J’avois pensé que la douceur de l’esclavage aux Indes avoit fait dire à Diodore, qu’il n’y avoit dans ce pays ni maître ni esclave : mais Diodore a attribué à toute l’Inde, ce qui, selon Strabon, liv. XV. n’étoit propre qu’à une nation particuliere.
[II-93]
LIVRE XV.
Comment les Lois de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.↩
CHAPITRE PREMIER.
De l’esclavage civil.
L’esclavage, proprement dit, est l’établissement d’un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme, qu’il est le maître absolu de sa vie & de ses biens. Il n’est pas bon par sa nature ; il n’est utile ni au maître ni à l’esclave : à celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu ; à celui-là, parce qu’il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu’il s’accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu’il devient fier, prompt, dur, colere, voluptueux, cruel.
Dans les pays despotiques, où l’on est déjà sous l’esclavage politique, l’esclavage civil est plus tolérable qu’ailleurs. Chacun y doit être assez content d’y [II-94] avoir sa subsistance & la vie. Ainsi la condition de l’esclave n’y est guere plus à charge que la condition du sujet.
Mais dans le gouvernement monarchique, où il est souverainement important de ne point abattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d’esclave. Dans la démocratie où tout le monde est égal, & dans l’aristocratie où les lois doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l’esprit de la constitution ; ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance & un luxe qu’ils ne doivent point avoir.
[II-304]
CHAPITRE II.
Des peuples d’Afrique.
La plupart des peuples des côtes de l’Afrique sont sauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup de ce que des pays presqu’inhabitables séparent de petits pays qui peuvent être habités. Ils sont sans industrie ; ils n’ont point d’arts ; ils ont en abondance des métaux précieux qu’ils tiennent immédiatement des mains de la nature. Tous les peuples policés sont donc en état de négocier avec eux avec avantage ; ils peuvent leur faire estimer beaucoup des choses de nulle valeur, & en recevoir un très-grand prix.
[II-94]
CHAPITRE II.
Origine du droit de l’esclavage chez les jurisconsultes Romains.
On ne croiroit jamais que ç’eût été la pitié qui eût établi l’esclavage, & que pour cela elle s’y fût prise de trois manieres [1] .
Le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qu’on [II-95] ne les tuât pas. Le droit civil des Romains permit à des débiteurs, que leurs créanciers pouvoient maltraiter, de se vendre eux-mêmes : & le droit naturel a voulu que des enfans, qu’un pere esclave ne pouvoit plus nourrir, fussent dans l’esclavage comme leur pere.
Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sensées. Il est faux qu’il soit permis de tuer dans la guerre autrement que dans le cas de nécessité : mais dès qu’un homme en a fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs, est de s’assurer tellement de leur personne, qu’ils ne puissent plus nuire. Les homicides faits de sang froid par les soldats, & après la chaleur de l’action, sont rejettés de toutes les nations [2] du monde.
2.o Il n’est pas vrai qu’un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix : l’esclave se vendant, tous ses biens entreroient dans la propriété du [II-96] maître ; le maître ne donneroit donc rien, & l’esclave ne recevroit rien. Il auroit un pécule, dira-t-on : mais le pécule est accessoire à la personne. S’il n’est pas permis de se tuer, parce qu’on se dérobe à sa patrie, il n’est pas plus permis de se vendre. La Liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique. Cette qualité dans l’état populaire est même une partie de la souveraineté. Vendre sa qualité de citoyen est un [3] acte d’une telle extravagance, qu’on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l’achete, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n’a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devoient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s’empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.
La troisieme maniere, c’est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux [II-97] autres. Car si un homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n’étoit pas né : si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfans.
Ce qui fait que la mort d’un criminel est une chose licite, c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle lui a conservé la vie à tous les instans : il ne peut donc pas réclamer contr’elle. Il n’en est pas de même de l’esclave : la loi de l’esclavage n’a jamais pu lui être utile ; elle est dans tous les cas contre lui, sans jamais être pour lui ; ce qui est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés.
On dira qu’elle a pu lui être utile, parce que le maître lui a donné la nourriture. Il faudroit donc réduire l’esclavage aux personnes incapables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là. Quant aux enfans, la nature qui a donné du lait aux meres, a pourvu à leur nourriture ; & le reste de leur enfance est si près de l’âge où est en eux la plus grande capacité de se rendre utiles, qu’on ne pourroit pas [II-98] dire que celui qui les nourriroit, pour être leur maître, donnât rien.
L’esclavage est d’ailleurs aussi opposé au droit civil qu’au droit naturel. Quelle loi civile pourroit empêcher un esclave de fuir, lui qui n’est point dans la société, & que par conséquent aucunes lois civiles ne concernent ? Il ne peut être retenu que par une loi de famille ; c’est-à-dire, par la loi du maître.
-
[↑] Institut. de Justinien, liv. I.
-
[↑] Si l’on ne veut citer celles qui mangent leurs prisonniers.
-
[↑] Je parle de l’esclavage pris à la rigueur, tel qu’il étoit chez les Romains, & qu’il est établi dans nos colonies.
[II-98]
CHAPITRE III.
Autre origine du droit de l’esclavage.
J’aimerois autant dire que le droit de l’esclavage vient du mépris qu’une nation conçoit pour une autre, fondé sur la différence des coutumes.
Lopes de Gama [1] dit « que les Espanols trouverent près de Ste. Marthe des paniers où les habitans avoient des denrées ; c’étoient des cancres, des limaçons, des cigales, des sauterelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaincus. » L’auteur avoue que c’est là-dessus qu’on fonda le droit qui rendoit [II-99] les Américains esclaves des Espagnols ; outre qu’ils fumoient du tabac, & qu’ils ne se faisoient pas la barbe à l’Espagnole.
Les connoissances rendent les hommes doux ; la raison porte à l’humanité ; il n’y a que les préjugés qui y fassent renoncer.
-
[↑] Bibliotheque Angl. tome XIII. deuxieme partie, art. 3.
[II-99]
CHAPITRE IV.
Autre origine du droit de l’esclavage.
J’aimerois autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation.
Ce fut cette maniere de penser qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans leurs crimes [1] . C’est sur cette idée qu’ils fonderent le droit de rendre tant de peuples esclaves ; car ces brigands, qui vouloient absolument être brigands & chrétiens, étoient très-dévots.
Louis XIII [2] se fit une peine extrême de la loi qui rendoit esclaves les Negres [II-100] de ſes colonies : mais quand on lui eut bien mis dans l’eſprit que c’étoit la voie la plus ſure pour les convertir, il y conſentit.
-
[↑] Voyez l’histoire de la conquête du Mexique par Solis ; & celle du Pérou par Garcilasso de la Vega.
-
[↑] Le P. Labat, nouveau voyage aux îles de l’Amériques; tome IV, pag. 114, 1722, in-12.
[II-100]
CHAPITRE V.
De l’eſclavage des Negres.
SI j’avois à ſoutenir le droit que nous avons eu de rendre les Negres eſclaves, voici ce que je dirois :
Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en eſclavage ceux de l’Afrique, pour s’en ſervir à défricher tant de terres.
Le ſucre ſeroit trop cher, ſi l’on ne faiſoit travailler la plante qui le produit par des eſclaves.
Ceux dont il s’agit ſont noirs depuis les pieds juſqu’à la tête ; & ils ont le nez ſi écraſé, qu’il eſt preſqu’impoſſible de les plaindre.
On ne peut ſe mettre dans l’eſprit que Dieu, qui eſt un être très-ſage, ait mis une ame, ſur-tout une ame bonne, dans un corps tout noir.
Il eſt ſi naturel de penſer que c’eſt la couleur qui conſtitue l’eſſence de [II-101] l’humanité, que les peuples d’Aſie qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus marquée.
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philoſophes du monde, étoient d’une ſi grande conſéquence, qu’ils faiſoient mourir tous les hommes roux qui leur tomboient entre les mains.
Une preuve que les Negres n’ont pas le ſens commun, c’eſt qu’ils font plus de cas d’un collier de verre, que de l’or, qui chez les nations policées eſt d’une ſi grande conſéquence.
Il eſt impoſſible que nous ſuppoſions que ces gens-là ſoient des hommes ; parce que ſi nous les ſuppoſions des hommes, on commenceroit à croire que nous ne ſommes pas nous-mêmes chrétiens.
De petits eſprits exagerent trop l’injuſtice que l’on fait aux Africains. Car ſi elle étoit telle qu’ils le diſent, ne ſeroit-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entr’eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miſéricorde & de la pitié ?
[II-102]
CHAPITRE VI.
Véritable origine du droit de l’eſclavage.
IL eſt temps de chercher la vraie origine du droit de l’eſclavage. Il doit être fondé ſur la nature des choſes : voyons s’il y a des cas où il en dérive.
Dans tout gouvernement deſpotique on a une grande facilité à ſe vendre ; l’eſclavage politique y anéantit en quelque façon la liberté civile.
M. Perry [1] dit que les Moſcovites ſe vendent très-aiſément : j’en ſais bien la raiſon, c’eſt que leur liberté ne vaut rien.
À Achim, tout le monde cherche à ſe vendre. Quelques-uns des principaux ſeigneurs [2] n’ont pas moins de mille eſclaves, qui ſont des principaux marchands, qui ont auſſi beaucoup d’eſclaves ſous eux, & ceux-ci beaucoup d’autres : on en hérite, & on les fait trafiquer. Dans ces états, les hommes libres, trop foibles contre le gouvernement, [II-103] cherchent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent le gouvernement.
C’est-là l’origine juste & conforme à la raison, de ce droit d’esclavage très-doux que l’on trouve dans quelques pays ; & il doit être doux, parce qu’il est fondé sur le choix libre qu’un homme, pour son utilité, se fait d’un maître ; ce qui forme une convention réciproque entre les deux parties.
-
[↑] État préſent de la grande Ruſſie, par Jean Perry, Paris, 1717, in-12.
-
[↑] Nouveau voyage autour du monde par Guillaume Dampierre, tome III, Amſterdam, 1711.
[II-103]
CHAPITRE VII.
Autre origine du droit de l’esclavage.
Voici une autre origine du droit de l’esclavage, & même de cet esclavage cruel que l’on voit parmi les hommes.
Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, & affoiblit si fort le courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment : l’esclavage y choque donc moins la raison ; & le maître y étant aussi lâche à l’égard de son prince, que son esclave l’est à son égard, l’esclavage civil y est encore accompagné de l’esclavage politique.
[II-104]
Aristote [1] veut prouver qu’il y a des esclaves par nature, & ce qu’il dit ne le prouve guere. Je crois que, s’il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens de parler.
Mais comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle ; & il faut bien distinguer ces pays d’avec ceux où les raisons naturelles mêmes les rejettent, comme les pays d’Europe où il a été si heureusement aboli.
Plutarque nous dit, dans la vie de Numa, que du temps de Saturne, il n’y avoit ni maître ni esclave. Dans nos climats, le christianisme a ramené cet âge.
-
[↑] Politique, liv. I. ch. I.
[II-104]
CHAPITRE VIII.
Inutilité de l’esclavage parmi nous.
Il faut donc borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers de la terre. Dans tous les autres, il me semble que, quelque pénibles que soient [II-105] les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres.
Ce qui me fait penser ainsi, c’est qu’avant que le christianisme eût aboli en Europe la servitude civile, on regardoit les travaux des mines comme si pénibles, qu’on croyoit qu’ils ne pouvoient être faits que par des esclaves ou par des criminels. Mais on sait qu’aujourd’hui les hommes qui y sont employés [1] vivent heureux. On a par de petits privileges encouragé cette profession ; on a joint à l’augmentation du travail celle du gain, & on est parvenu à leur faire aimer leur condition plus que toute autre qu’ils eussent pu prendre.
Il n’y a point de travail si pénible qu’on ne puisse proportionner à la force de celui qui le fait, pourvu que ce soit la raison & non pas l’avarice qui le regle. On peut, par la commodité des machines que l’art invente ou applique, suppléer au travail forcé qu’ailleurs on fait faire aux esclaves. Les mines des Turcs, dans le bannat de Témeswar, étoient plus riches que celles de Hongrie ; & elles ne [II-106] produisoient pas tant, parce qu’ils n’imaginoient jamais que les bras de leurs esclaves.
Je ne sais si c’est l’esprit ou le cœur qui me dicte cet article ci. Il n’y a peut-être pas de climat sur la terre où l’on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les lois étoient mal faites, on a trouvé des hommes paresseux ; parce que ces hommes étoient paresseux, on les a mis dans l’esclavage.
-
[↑] On peut se faire instruire de ce qui se passe à cet égard dans les mines du Hartz dans la basse Allemagne, & dans celles de Hongrie.
[II-106]
CHAPITRE IX.
Des nations chez lesquelles la liberté civile est généralement établie.
On entend dire tous les jours, qu’il seroit bon que parmi nous il y eût des esclaves.
Mais, pour bien juger de ceci, il ne faut pas examiner s’ils seroient utiles à la petite partie riche & voluptueuse de chaque nation ; sans doute qu’ils lui seroient utiles : mais prenant un autre point de vue, je ne crois pas qu’aucun de ceux qui la composent voulût tirer au sort, pour savoir qui devroit former la partie de la nation qui seroit libre, & [II-107] celle qui seroit esclave. Ceux qui parlent le plus pour l’esclavage, l’auroient le plus en horreur, & les hommes les plus misérables en auroient horreur de même. Le cri pour l’esclavage est donc le cri du luxe & de la volupté, & non pas celui de l’amour de la félicité publique. Qui peut douter que chaque homme, en particulier, ne fût très-content d’être le maître des biens, de l’honneur & de la vie des autres ; & que toutes ses passions ne se réveillassent d’abord à cette idée ? Dans ces choses, voulez-vous savoir si les désirs de chacun sont légitimes ? examinez les désirs de tous.
[II-107]
CHAPITRE X.
Diverses especes d’esclavage.
Il y a deux sortes de servitude, la réelle & la personnelle. La réelle, est celle qui attache l’esclavage aux fonds de terre. C’est ainsi qu’étoient les esclaves chez les Germains, au rapport de Tacite [1] . Ils n’avoient point d’office dans la maison ; ils rendoient à leur maître une certaine quantité de blé, de bétail [II-108] ou d’étoffe : l’objet de leur esclavage n’alloit pas plus loin. Cette espece de servitude est encore établie en Hongrie, en Boheme, & dans plusieurs endroits de la basse-Allemagne.
La servitude personnelle regarde le ministere de la maison, & se rapporte plus à la personne du maître.
L’abus extrême de l’esclavage est lorsqu’il est en même temps personnel & réel. Telle étoit la servitude des Ilotes chez les Lacédémoniens ; ils étoient soumis à tous les travaux hors de la maison, & à toutes sortes d’insultes dans la maison : cette ilotie est contre la nature des choses. Les peuples simples n’ont qu’un esclavage réel [2] , parce que leurs femmes & leurs enfans font les travaux domestiques. Les peuples voluptueux ont un esclavage personnel, parce que le luxe demande le service des esclaves dans la maison. Or l’ilotie joint dans les mêmes personnes l’esclavage établi chez les peuples voluptueux, & celui qui est établi chez les peuples simples.
-
[↑] De moribus Germanorum.
-
[↑] Vous ne pourriez, (dit Tacite, sur les mœurs des Germains,) distinguer le maître de l’esclave, par les délices de la vie.
[II-109]
CHAPITRE XI.
Ce que les lois doivent faire par rapport à l’esclavage.
Mais de quelque nature que soit l’esclavage, il faut que les lois civiles cherchent à en ôter, d’un côté les abus, & de l’autre les dangers.
[II-109]
CHAPITRE XII.
Abus de l’esclavage.
Dans les états Mahométans [1] , on est non-seulement maître de la vie & des biens des femmes esclaves, mais encore de ce qu’on appelle leur vertu ou leur honneur. C’est un des malheurs de ces pays, que la plus grande partie de la nation n’y soit faite que pour servir à la volupté de l’autre. Cette servitude est récompensée par la paresse dont on fait jouir de pareils esclaves : ce qui est encore pour l’état un nouveau malheur.
C’est cette paresse qui rend les sérails [II-110] d’orient [2] des lieux de délices, pour ceux mêmes contre qui ils sont faits. Des gens qui ne craignent que le travail, peuvent trouver leur bonheur dans ces lieux tranquilles. Mais on voit que par-là on choque même l’esprit de l’établissement de l’esclavage.
La raison veut que le pouvoir du maître ne s’étende point au-delà des choses qui sont de son service ; il faut que l’esclavage soit pour l’utilité, & non pas pour la volupté. Les lois de la pudicité sont du droit naturel, & doivent être senties par toutes les nations du monde.
Que si la loi qui conserve la pudicité des esclaves est bonne dans les états où le pouvoir sans bornes se joue de tout, combien le sera-t-elle dans les monarchies ? combien le sera-t-elle dans les états républicains ?
Il y a une disposition de la loi [3] des Lombards, qui paroît bonne pour tous les gouvernemens. « Si un maître débauche la femme de son esclave, ceux-ci seront tous deux libres ». Tempérament admirable pour prévenir & [II-111] arrêter, sans trop de rigueur, l’incontinence des maîtres.
Je ne vois pas que les Romains ayent eu à cet égard une bonne police. Ils lâcherent la bride à l’incontinence des maîtres ; ils priverent même en quelque façon leurs esclaves du droit des mariages. C’étoit la partie de la nation la plus vile ; mais quelque vile qu’elle fût, il étoit bon qu’elle eut des mœurs : & de plus, en lui ôtant les mariages, on corrompoit ceux des citoyens.
-
[↑] Voyez Chardin, voyage de Perse.
-
[↑] Voyez Chardin, tome II. dans sa description du marché d’Izagour.
-
[↑] Livre I. tit. 32. §. 5.
[II-111]
CHAPITRE XIII.
Danger du grand nombre d’esclaves.
Le grand nombre d’esclaves a des effets différens dans les divers gouvernemens. Il n’est point à charge dans le gouvernement despotique ; l’esclavage politique établi dans le corps de l’état, fait que l’on sent peu l’esclavage civil. Ceux que l’on appelle hommes libres, ne le sont guere plus que ceux qui n’y ont pas ce titre ; & ceux-ci, en qualité d’eunuques, d’affranchis, ou d’esclaves, ayant en main presque toutes les affaires, la condition d’un homme [II-112] libre & celle d’un esclave se touchent de fort près. Il est donc presqu’indifférent que peu ou beaucoup de gens y vivent dans l’esclavage.
Mais dans les états modérés, il est très-important qu’il n’y ait point trop d’esclaves. La liberté politique y rend précieuse la liberté civile ; & celui qui est privé de cette derniere est encore privé de l’autre. Il voit une société heureuse, dont il n’est pas même partie ; il trouve la sureté établie pour les autres, & non pas pour lui ; il sent que son maître a une ame qui peut s’agrandir, & que la sienne est contrainte de s’abaisser sans cesse. Rien ne met plus près de la condition des bêtes, que de voir toujours des hommes libres & de ne l’être pas. De telles gens sont des ennemis naturels de la société ; & leur nombre seroit dangereux.
Il ne faut donc pas être étonné que dans les gouvernemens modérés l’état ait été si troublé par la révolte des esclaves, & que cela soit arrivé si rarement [1] dans les états despotiques.
-
[↑] La révolte des Mammelus étoit un cas particulier ; c’étoit un corps de milice qui usurpa l’empire.
[II-113]
CHAPITRE XIV.
Des esclaves armés.
Il est moins dangereux dans la monarchie d’armer les esclaves, que dans les républiques. Là un peuple guerrier, un corps de noblesse, contiendront assez ces esclaves armés. Dans la république des hommes uniquement citoyens ne pourront guere contenir des gens, qui ayant les armes à la main, se trouveront égaux aux citoyens.
Les Goths qui conquirent l’Espagne, se répandirent dans le pays, & bientôt se trouverent très-foibles. Ils firent trois réglemens considérables : ils abolirent l’ancienne coutume qui leur défendoit de [1] s’allier par mariage avec les Romains ; ils établirent que tous les affranchis [2] du fisc iroient à la guerre, sous peine d’être réduits en servitude ; ils ordonnerent que chaque Goth meneroit à la guerre & armeroit la dixieme [3] partie de ses esclaves. Ce nombre étoit peu [II-114] considérable en comparaison de ceux qui restoient. De plus, ces esclaves menés à la guerre par leur maître ne faisoient pas un corps séparé ; ils étoient dans l’armée, & restoient, pour ainsi dire, dans la famille.
-
[↑] Loi des Wisigoths, liv. III. tit. 1. §. 1.
-
[↑] Ibid. liv. V. tit. 7. §. 20.
-
[↑] Ibid. liv. IX. tit. 1. §. 9.
[II-114]
CHAPITRE XV.
Continuation du même sujet.
Quand toute la nation est guerriere, les esclaves armés sont encore moins à craindre.
Par la loi des Allemands, un esclave qui voloit [1] une chose qui avoit été déposée, étoit soumis à la peine qu’ont auroit infligée à un homme libre : mais s’il l’enlevoit par [2] violence, il n’étoit obligé qu’à la restitution de la chose enlevée. Chez les Allemands, les actions qui avoient pour principe le courage & la force, n’étoient point odieuses. Ils se servoient de leurs esclaves dans leurs guerres. Dans la plupart des républiques, on a toujours cherché à abattre le courage des esclaves : le peuple [II-115] Allemand, sûr de lui-même, songeoit à augmenter l’audace des siens ; toujours armé, il ne craignoit rien d’eux ; c’étoient des instrumens de ses brigandages ou de sa gloire.
[II-115]
CHAPITRE XVI.
Précaution à prendre dans le gouvernement modéré.
L’humanité que l’on aura pour les esclaves, pourra prévenir dans l’état modéré les dangers que l’on pourroit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s’accoutument à tout, & à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitoient leurs esclaves avec une grande douceur : on ne voit point qu’ils ayent troublé l’état à Athenes, comme ils ébranlerent celui de Lacédémone.
On ne voit point que les premiers Romains ayent eu des inquiétudes à l’occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu’ils eurent perdu pour eux tous les sentimens de l’humanité, que l’on vit [II-116] naître ces guerres civiles, qu’on a comparées aux guerres Puniques [1] .
Les nations simples, & qui s’attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves, que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivoient, travailloient & mangeoient avec leurs esclaves : ils avoient pour eux beaucoup de douceur & d’équité : la plus grande peine qu’ils leur infligeassent, étoit de les faire passer devant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisoient pour maintenir la fidélité des esclaves ; il ne falloit point de lois.
Mais lorsque les Romains se furent agrandis, que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de leur travail, mais les instruments de leur luxe & de leur orgueil ; comme il n’y avoit point de mœurs, on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles, pour établir la sureté de ces maîtres cruels, qui vivoient au milieu de leurs esclaves, comme au milieu de leurs ennemis.
[II-117]
On fit le sénatus-consulte Sillanien, & d’autres lois [2] qui établirent que, lorsqu’un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu’on put entendre la voix d’un homme, seroient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui dans ce cas réfugioient un esclave pour le sauver, étoient punis comme meurtriers [3] . Celui-la même à qui son maître auroit ordonné [4] de le tuer, & qui lui auroit obéi, auroit été coupable : celui qui ne l’auroit point empêché de se tuer lui-même, auroit été puni [5] . Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoit mourir [6] ceux qui étoient restés avec lui & ceux qui s’étoient enfuis. Toutes ces lois avoient lieu contre ceux mêmes dont l’innocence étoit prouvée ; elles avoient pour objet de donner aux esclaves pour [II-118] leur maître un respect prodigieux. Elles n’étoient pas dépendantes du gouvernement civil, mais d’un vice ou d’une imperfection du gouvernement civil. Elles ne dérivoient point de l’équité des lois civiles, puisqu’elles étoient contraires aux principes des lois civiles. Elles étoient proprement fondées sur le principe de la guerre, à cela près que c’étoit dans le sein de l’état qu’étoient les ennemis. Le sénatus-consulte Sillanien dérivoit du droit des gens, qui veut qu’une société, même imparfaite, se conserve.
C’est un malheur du gouvernement, lorsque la magistrature se voit contrainte de faire ainsi des lois cruelles. C’est parce qu’on a rendu l’obéissance difficile, que l’on est obligé d’aggraver la peine de la désobéissance, ou de soupçonner la fidélité. Un législateur prudent prévient le malheur de devenir un législateur terrible. C’est parce que les esclaves ne purent avoir chez les Romains de confiance dans la loi, que la loi ne put avoir de confiance en eux.
-
[↑] « La Sicile, dit Florus, plus cruellement dévastée par la guerre civile, que par la guerre Punique », Liv. III.
-
[↑] Voyez tout le titre de senat. consult. Sillan. au ff.
-
[↑] Leg. si quis, §. 12. au ff. de senat. consult. Sillan.
-
[↑] Quand Antoine commanda à Etos de le tuer, c’étoit point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même, puisque s’il lui eût obéi, il auroit été puni comme meurtrier de son maître.
-
[↑] Leg. 1. §. 22. ff. de senat. consult. Sillan.
-
[↑] Leg. 1. §. 31. ff. ibid.
[II-119]
CHAPITRE XVII.
Réglemens à faire entre le maître & les esclaves.
Le magistrat doit veiller à ce que l’esclave ait sa nourriture & son vêtement : cela doit être réglé par la loi.
Les lois doivent avoir attention qu’ils soient soignés dans leurs maladies & dans leur vieillesse. Claude [1] ordonna que les esclaves qui auroient été abandonnés par leurs maîtres étant malades, seroient libres s’ils échappoient. Cette loi assuroit leur liberté ; il auroit encore fallu assurer leur vie.
Quand la loi permet au maître d’ôter la vie à son esclave, c’est un droit qu’il doit exercer comme juge, & non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d’une action violente.
Lorsqu’à Rome, il ne fut plus permis aux peres de faire mourir leurs enfans, les magistrats infligerent [2] la peine que le pere vouloit prescrire. Un usage [II-120] pareil entre le maître & les esclaves seroit raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit de vie & de mort.
La loi de Moïse étoit bien rude. « Si quelqu’un frappe son esclave, & qu’il meure sous sa main, il sera puni : mais s’il survit un jour ou deux, il ne le sera pas, parce que c’est son argent ». Quel peuple, que celui où il falloit que la loi civile se relâchat de la loi naturelle !
Par une loi des Grecs [3] , les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres, pouvoient demander d’être vendus à un autre. Dans les derniers temps, il y eut à Rome une pareille loi [4] . Un maître irrité contre son esclave, & un esclave irrité contre son maître, doivent être séparés.
Quand un citoyen maltraite l’esclave d’un autre, il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les [5] lois de Platon & de la plupart des peuples, ôtent aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur donner la défense civile.
À Lacédémone, les esclaves ne pouvoient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures. L’excès de [II-121] leur malheur étoit tel, qu’ils n’étoient pas seulement esclaves d’un citoyen, mais encore du public ; ils appartenoient à tous & à un seul. À Rome, dans le tort fait à un esclave, on ne considéroit que [6] l’intérêt du maître. On confondoit sous l’action de la loi Aquilienne la blessure faite à une bête, & celle faite à un esclave ; on n’avoit attention qu’à la diminution de leur prix. À Athenes [7] , on punissoit sévérement, quelquefois même de mort, celui qui avoit maltraité l’esclave d’un autre. La loi d’Athenes, avec raison, ne vouloit point ajouter la perte de la sureté à celle de la liberté.
-
[↑] Xiphilin, in Claudio.
-
[↑] Voyez la loi III. au code de patriâ potestate, qui est de l’empereur Alexandre.
-
[↑] Plutarque, de la superstition.
-
[↑] Voyez la constitution d’Antonin Pie, Institus, Liv. I. tit. 7.
-
[↑] Livre IX.
-
[↑] Ce fut encore souvent l’esprit des lois des peuples qui sortirent de la Germanie comme on le peut voir dans leurs codes.
-
[↑] Demosthenes, orat. contra Mediam, page 610. édition de Francfort, de l’an 1634.
[II-121]
CHAPITRE XVIII.
Des affranchissemens.
On sent bien que quand, dans le gouvernement républicain, on a beaucoup d’esclaves, il faut en affranchir beaucoup. Le mal est que, si on a [II-122] trop d’esclaves, ils ne peuvent être contenus ; si l’on a trop d’affranchis, ils ne peuvent pas vivre, & ils deviennent à charge à la république ; outre que celle-ci peut être également en danger de la part d’un très-grand nombre d’affranchis & de la part d’un trop grand nombre d’esclaves. Il faut donc que les lois aient l’œil sur ces deux inconvéniens.
Les diverses lois & les sénatus-consultes qu’on fit à Rome pour & contre les esclaves, tantôt pour gêner, tantôt pour faciliter les affranchissemens, font bien voir l’embarras où l’on se trouva à cet égard. Il y eut même des temps où l’on n’osa pas faire des lois. Lorsque sous Néron [1] on demanda au sénat qu’il fût permis aux patrons de remettre en servitude les affranchis ingrats, l’empereur écrivit qu’il falloit juger les affaires particulieres, & ne rien statuer de général.
Je ne saurois guere dire quels sont les réglemens qu’une bonne république doit faire là-dessus ; cela dépend trop des circonstances. Voici quelques réflexions.
Il ne faut pas faire tout-à-coup & par une loi générale un nombre [II-123] considérable d’affranchissemens. On sait que chez les Voltiniens [2] , les affranchis devenus maîtres des suffrages, firent une abominable loi, qui leur donnoit le droit de coucher les premiers avec les filles qui se marioient à des ingénus.
Il y a diverses manieres d’introduire insensiblement de nouveaux citoyens dans la république. Les lois peuvent favoriser le pécule, & mettre les esclaves en état d’acheter leur liberté ; elles peuvent donner un terme à la servitude, comme celles de Moïse, qui avoient borné à six ans celle des esclaves Hébreux [3] . Il est aisé d’affranchir toutes les années un certain nombre d’esclaves, parmi ceux qui, par leur âge, leur santé, leur industrie, auront le moyen de vivre. On peut même guérir le mal dans sa racine : comme le grand nombre d’esclaves est lié aux divers emplois qu’on leur donne ; transporter aux ingénus une partie de ces emplois, par exemple, le commerce ou la navigation, c’est diminuer le nombre des esclaves.
[II-124]
Lorsqu’il y a beaucoup d’affranchis, il faut que les lois civiles fixent ce qu’ils doivent à leur patron, ou que le contrat d’affranchissement fixe ces devoirs pour elles.
On sent que leur condition doit être plus favorisée dans l’état civil que dans l’état politique ; parce que dans le gouvernement même populaire, la puissance ne doit point tomber entre les mains du bas peuple.
À Rome, où il y avoit tant d’affranchis, les lois politiques furent admirables à leur égard. On leur donna peu, & on ne les exclut presque de rien ; ils eurent bien quelque part à la législation, mais ils n’influoient presque point dans les résolutions qu’on pouvoit prendre. Ils pouvoient avoir part aux charges & au sacerdoce même [4] ; mais ce privilege étoit en quelque façon rendu vain par les désavantages qu’ils avoient dans les élections. Ils avoient droit d’entrer dans la milice ; mais pour être soldat, il falloit un certain cens. Rien n’empêchoit les affranchis [5] de s’unir par mariage avec les familles ingénues ; mais il [II-125] ne leur étoit pas permis de s’allier avec celles des sénateurs. Enfin leurs enfans étoient ingénus, quoiqu’ils ne le fussent pas eux-mêmes.
-
[↑] Tacite, annal. liv. XIII.
-
[↑] Supplément de Freinshemius ; deuxieme décade, liv. V.
-
[↑] Exod. chap. xxi.
-
[↑] Tacite, annal. liv. III.
-
[↑] Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI.
[II-125]
CHAPITRE XIX.
Des affranchis & des eunuques.
Ainsi, dans le gouvernement de plusieurs, il est souvent utile que la condition des affranchis soit peu au-dessous de celle des ingénus, & que les lois travaillent à leur ôter le dégoût de leur condition. Mais dans le gouvernement d’un seul, lorsque le luxe & le pouvoir arbitraire regnent, on n’a rien à faire à cet égard. Les affranchis se trouvent presque toujours au-dessus des hommes libres. Ils dominent à la cour du prince & dans les palais des grands : & comme ils ont étudié les foiblesses de leur maître, & non pas ses vertus, ils le font régner, non pas par ses vertus, mais par ses foiblesses. Tels étoient à Rome les affranchis du temps des empereurs.
Lorsque les principaux esclaves sont eunuques, quelque privilege qu’on leur [II-126] accorde, on ne peut guere les regarder comme des affranchis. Car comme ils ne peuvent avoir de famille, ils sont par leur nature attachés à une famille, & ce n’est que par une espece de fiction qu’on peut les considérer comme citoyens.
Cependant il y a des pays où on leur donne toutes les magistratures : « Au Tonquin [1] , dit Dampierre [2] , tous les mandarins civils & militaires sont eunuques ». Ils n’ont point de famille ; & quoiqu’ils soient naturellement avares, le maître ou le prince profitent à la fin de leur avarice même.
Le même Dampierre [3] nous dit que, dans ce pays, les eunuques ne peuvent se passer de femmes, & qu’ils se marient. La loi qui leur permet le mariage, ne peut être fondée, d’un côté, que sur la considération que l’on y a pour de pareilles gens ; & de l’autre, sur le mépris qu’on y a pour les femmes.
Ainsi l’on confie à ces gens-là les magistratures, parce qu’ils n’ont point de [II-127] famille : & d’un autre côté, on leur permet de se marier, parce qu’ils ont les magistratures.
C’est pour lorsque les sens qui restent, veulent obstinément suppléer à ceux que l’on a perdus ; & que les entreprises du désespoir sont une espece de jouissance. Ainsi, dans Milton, cet esprit à qui il ne reste que des désirs, pénétré de sa dégradation, veut faire usage de son impuissance même.
On voit dans l’histoire de la Chine un grand nombre de lois pour ôter aux eunuques tous les emplois civils & militaires ; mais ils reviennent toujours. Il semble que les eunuques, en Orient, soient un mal nécessaire.
-
[↑] C’étoit autrefois de même à la Chine. Les deux Arabes Mahométans qui y voyagerent au neuvieme siecle, disent l’eunuque, quand ils veulent parler du gouverneur d’une ville.
-
[↑] Tome III. page 91.
-
[↑] Ibid. pag. 94.
[II-128]
LIVRE XVI.
Comment les Lois de l’esclavage domestique ont du rapport avec la nature du climat.↩
CHAPITRE PREMIER.
De la servitude domestique.
Les esclaves sont plutôt établis pour la famille, qu’ils ne sont dans la famille. Ainsi je distinguerai leur servitude de celle où sont les femmes dans quelques pays, & que j’appellerai proprement la servitude domestique.
[II-128]
CHAPITRE II.
Que dans les pays du Midi il y a dans les deux sexes une inégalité naturelle.
Les femmes sont nubiles [1] dans les climats chauds à huit, neuf & dix ans : ainsi l’enfance & le mariage y [II-129] vont presque toujours ensemble. Elles sont vieilles à vingt : la raison ne se trouve donc jamais chez elles avec la beauté. Quand la beauté demande l’empire, la raison le fait refuser ; quand la raison pourroit l’obtenir, la beauté n’est plus. Les femmes doivent être dans la dépendance : car la raison ne peut leur procurer dans leur vieillesse un empire que la beauté ne leur avoit pas donné dans la jeunesse même. Il est donc très-simple qu’un homme, lorsque la religion ne s’y oppose pas, quitte sa femme pour en prendre une autre, & que la polygamie s’introduise.
Dans les pays tempérés, où les agrémens des femmes se conservent mieux, où elles sont plus tard nubiles, & où elles ont des enfans dans un âge plus avancé, la vieillesse de leur mari suit en quelque façon la leur : & comme elles y ont plus de raison & de connoissances quand elles se marient, ne fût-ce que parce qu’elles ont plus long-temps vécu, il a dû naturellement s’introduire une espece [II-130] d’égalité dans les deux sexes, & par conséquent la loi d’une seule femme.
Dans les pays froids, l’usage presque nécessaire des boissons fortes établit l’intempérance parmi les hommes. Les femmes, qui ont à cet égard une retenue naturelle, parce qu’elles ont toujours à se défendre, ont donc encore l’avantage de la raison sur eux.
La nature, qui a distingué les hommes par la force & par la raison, n’a mis à leur pouvoir de terme que celui de cette force & de cette raison. Elle a donné aux femmes les agrémens, & a voulu que leur ascendant finît avec ces agrémens : mais, dans les pays chauds, ils ne se trouvent que dans les commencemens, & jamais dans le cours de leur vie.
Ainsi la loi qui ne permet qu’une femme, se rapporte plus au physique du climat de l’Europe, qu’au physique du climat de l’Asie. C’est une des raisons qui a fait que le Mahométisme a trouvé tant de facilité à s’établir en Asie, & tant de difficulté à s’étendre en Europe ; que le Christianisme s’est maintenu en Europe, & a été détruit en Asie ; & qu’enfin les Mahométans font tant de progrès à la Chine, & les Chrétiens si peu. Les [II-131] raisons humaines sont toujours subordonnées à cette cause suprême, qui fait tout ce qu’elle veut, & se sert de tout ce qu’elle veut.
Quelques raisons, particulieres à Valentinien [2] , lui firent permettre la polygamie dans l’empire. Cette loi, violente pour nos climats, fut ôtée [3] , par Théodose, Arcadius & Honorius.
-
[↑] Mahomet épousa Cadhisja à cinq ans, coucha avec elle à huit. Dans les pays chauds d’Arabie & des Indes, les filles y sont nubiles à huit ans, & accouchent l’année d’après, Prideaux, vie de Mahomet. On voit des femmes dans les royaumes d’Alger, enfanter à neuf, dix & onze ans. Laugier de Tassy, histoire du royaume d’Alger, pag. 61.
-
[↑] Voyez Jornandès de regno & tempor. succes. & les historiens ecclésiastiques.
-
[↑] Voyez la loi VII, au code de Judœis & cœlicolis ; & la novelle 18, chap. V.
[II-131]
CHAPITRE III.
Que la pluralité des femmes dépend beaucoup de leur entretien.
Quoique, dans les pays où la polygamie est une fois établie, le grand nombre des femmes dépende beaucoup des richesses du mari ; cependant on ne peut pas dire que ce soient les richesses qui fassent établir dans un état la polygamie : la pauvreté peut faire le même effet, comme je le dirai en parlant des Sauvages.
La polygamie est moins un luxe, que l’occasion d’un grand luxe chez des [II-132] nations puissantes. Dans les climats chauds, on a moins de besoins [1] : il en coûte moins pour entretenir une femme & des enfans. On y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes.
-
[↑] À Ceylan, un homme vit pour dix sous par mois ; on n’y mange que du riz & du poisson. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. II. part. I.
[II-132]
CHAPITRE IV.
De la polygamie. Ses diverses circonstances.
Suivant les calculs que l’on fait en divers endroits de l’Europe, il y naît plus de garçons que de filles [1] : au contraire, les relations de l’Asie [2] & de l’Afrique [3] nous disent qu’il y nait beaucoup plus de filles que de garçons. La loi seule d’une femme en Europe, & celle qui en permet plusieurs en Asie [II-133] & en Afrique, ont donc un certain rapport au climat.
Dans les climats froids de l’Asie, il naît, comme en Europe, plus de garçons que de filles. C’est, disent les Lamas [4] la raison de la loi qui chez eux permet à une femme d’avoir plusieurs maris [5] .
Mais je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez grande, pour qu’elle exige qu’on y introduise la loi de plusieurs femmes ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes, s’éloigne moins de la nature dans de certains pays que dans d’autres.
J’avoue que si ce que les relations nous disent étoit vrai, qu’à Bantam [6] il y a dix femmes pour un homme, ce seroit un cas bien particulier de la polygamie.
Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages ; mais j’en rends les raisons.
-
[↑] M. Arbutnot trouve qu’en Angleterre le nombre des garçons excede celui des filles : on a eu tort d’en conclure que ce fût la meme chose dans tous les climats.
-
[↑] Voyez Kempfer, qui nous rapporte un dénombrement de Meaco, où l’on trouve 182072 mâles, & 223573 femelles.
-
[↑] Voyez le voyage de Guinée de M. Smith, partie seconde, sur le pays d’Anté.
-
[↑] Du Halde, Mém. de la Chine, tom. IV, p. 46.
-
[↑] Albuzeïr-el-hassen, un des deux mahométans Arabes qui allerent aux Indes & à la Chine au neuvieme siecle, prend cet usage pour une prostitution. C’est que rien ne choquoit tant les idées Mahométanes.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la Compagnie des Indes, tom. 1.
[II-134]
CHAPITRE V.
Raison d’une loi du Malabar.
Sur la côte du Malabar, dans la caste des Naïres [1] , les hommes ne peuvent avoir qu’une femme, & une femme au contraire peut avoir plusieurs maris. Je crois qu’on peut découvrir l’origine de cette coutume. Les Naïres sont la caste des nobles, qui sont les soldats de toutes ces nations. En Europe, on empêche les soldats de se marier : dans le Malabar, où le climat exige davantage, on s’est contenté de leur rendre le mariage aussi peu embarrassant qu’il est possible : on a donné une femme à plusieurs hommes ; ce qui diminue d’autant l’attachement pour une famille & les soins du ménage, & laisse à ces gens l’esprit militaire.
-
[↑] Voyage de François Pyrard, ch. xxvii. Lettres édifiantes, troisieme & dixieme recueil sur le Malléami dans la côte du Malabar. Cela est regardé comme un abus de la protection militaire : & comme dit Pyrard, une femme de la caste des Bramines n’épouseroit jamais plusieurs maris.
[II-135]
CHAPITRE VI.
De la polygamie en elle-même.
À regarder la polygamie en général, indépendamment des circonstances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n’est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n’est pas non plus utile aux enfans ; & un de ses grands inconvéniens, est que le pere & la mere ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfans ; un pere ne peut pas aimer vingt enfans, comme une mere en aime deux. C’est bien pis, quand une femme a plusieurs maris ; car pour lors, l’amour paternel ne tient plus qu’à cette opinion, qu’un pere peut croire, s’il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains enfans lui appartiennent.
On dit que le roi de Maroc a dans son sérail des femmes blanches, des femmes noires, des femmes jaunes. Le malheureux ! à peine a-t-il besoin d’une couleur.
[II-136]
La possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les désirs [1] pour celle d’un autre ; il en est de la luxure comme de l’avarice, elle augmente sa soif par l’acquisition des trésors.
Du temps de Justinien, plusieurs Philosophes gênés par le Christianisme, se retirerent en Perse auprès de Cosroës. Ce qui les frappa le plus, dit Agathias [2] , ce fut que la polygamie étoit permise à des gens qui ne s’abstenoient pas même de l’adultere.
La pluralité des femmes, qui le diroit ! même à cet amour que la nature désavoue : c’est qu’une dissolution en entraîne toujours une autre. À la révolution qui arriva à Constantinople, lorsqu’on déposa le sultan Achmet, les relations disoient que le peuple ayant pillé la maison du chiaya, on n’y avoit pas trouvé une seule femme. On dit qu’à Alger [3] on est parvenu à ce point, qu’on n’en a pas dans la plupart des sérails.
-
[↑] C’est ce qui fait que l’on cache avec tant de soin les femmes en orient.
-
[↑] De la vie & des actions de Justinien, pag. 403.
-
[↑] Laugier de Tassy, Histoire d’Alger.
[II-137]
CHAPITRE VII.
De l’égalité du traitement dans le cas de la pluralité des femmes.
De la loi de la pluralité des femmes, suit celle de l’égalité du traitement. Mahomet qui en permet quatre, veut que tout soit égal entr’elles ; nourriture, habits, devoir conjugal. Cette loi est aussi établie aux Maldives [1] , où on peut épouser trois femmes.
La loi de Moïse [2] veut même que si quelqu’un a marié son fils à une esclave, & qu’ensuite il épouse une femme libre, il ne lui ôte rien des vêtemens, de la nourriture & des devoirs. On pouvoit donner plus à la nouvelle épouse ; mais il falloit que la premiere n’eût pas moins.
[II-138]
CHAPITRE VIII.
De la séparation des femmes d’avec les hommes.
C’est une conséquence de la polygamie, que, dans les nations voluptueuses & riches, on ait un très-grand nombre de femmes. Leur séparation d’avec les hommes, & leur clôture, suivent naturellement de ce grand nombre. L’ordre domestique le demande ainsi ; un débiteur insolvable cherche à se mettre à couvert des poursuites de ses créanciers. Il y a de tels climats où le physique a une telle force, que la morale n’y peut presque rien. Laissez un homme avec une femme ; les tentations seront des chutes, l’attaque sure, la résistance nulle. Dans ces pays, au lieu de préceptes, il faut des verroux.
Un livre classique [1] de la Chine [II-139] regarde comme un prodige de vertu, de se trouver seul dans un appartement reculé avec une femme, sans lui faire violence.
-
[↑] « Trouver à l’écart un trésor dont on soit le maître ; ou une belle femme seule dans un appartement reculé ; entendre la voix de son ennemi qui va périr, si on ne le secourt, admirable pierre de touche ». Traduction d’un ouvrage Chinois sur la morale, dans le Pere du Halde, tom. III. pag. 151.
[II-139]
CHAPITRE IX.
Liaison du gouvernement domestique avec le politique.
Dans une république, la condition des citoyens est bornée, égale, douce, modérée ; tout s’y ressent de la liberté publique. L’empire sur les femmes n’y pourroit pas être si bien exercé ; & lorsque le climat a demandé cet empire, le gouvernement d’un seul a été le plus convenable. Voilà une des raisons qui a fait que le gouvernement populaire a toujours été difficile à établir en orient.
Au contraire, la servitude des femmes est très-conforme au génie du gouvernement despotique, qui aime à abuser de tout. Aussi a-t-on vu dans tous les temps, en Asie, marcher d’un pas égal la servitude domestique & le gouvernement despotique.
Dans un gouvernement où l’on [II-140] demande sur-tout la tranquillité, & où la subordination extrême s’appelle la paix, il faut enfermer les femmes ; leurs intrigues seroient fatales au mari. Un gouvernement qui n’a pas le temps d’examiner la conduite des sujets, la tient pour suspecte, par cela seul qu’elle paroit & qu’elle le fait sentir.
Supposons un moment que la légéreté d’esprit & les indiscrétions, les goûts & les dégoûts de nos femmes, leurs passions grandes & petites, se trouvassent transportées dans un gouvernement d’orient, dans l’activité & dans cette liberté où elles sont parmi nous ; quel est le pere de famille qui pourroit être un moment tranquille ? Par-tout des gens suspects, par-tout des ennemis ; l’état seroit ébranlé, on verroit couler des flots de sang.
[II-140]
CHAPITRE X.
Principe de la morale de l’orient.
Dans le cas de la multiplicité des femmes, plus la famille cesse d’être une, plus les lois doivent réunir à un centre ces parties détachées ; & plus les [II-141] intérêts sont divers, plus il est bon que les lois les ramenent à un intérêt.
Cela se fait sur-tout par la clôture. Les femmes ne doivent pas seulement être séparées des hommes par la clôture de la maison ; mais elles en doivent encore être séparées dans cette même clôture, en sorte qu’elles y fassent comme une famille particuliere dans la famille. De là dérive pour les femmes toute la pratique de la morale, la pudeur, la chasteté, la retenue, le silence, la paix, la dépendance, le respect, l’amour ; enfin une direction générale de sentimens à la chose du monde la meilleure par sa nature, qui est l’attachement unique à sa famille.
Les femmes ont naturellement à remplir tant de devoirs qui leur sont propres, qu’on ne peut assez les séparer de tout ce qui pourroit leur donner d’autres idées, de tout ce qu’on traite d’amusemens, & de tout ce qu’on appelle des affaires.
On trouve des mœurs plus pures dans les divers états d’orient, à proportion que la clôture des femmes y est plus exacte. Dans les grands états, il y a nécessairement de grands seigneurs. Plus [II-142] ils ont de grands moyens, plus ils sont en état de tenir les femmes dans une exacte clôture, & de les empêcher de rentrer dans la société. C’est pour cela que, dans les empires du Turc, de Perse, du Mogol, de la Chine & du Japon, les mœurs des femmes sont admirables.
On ne peut pas dire la même chose des Indes, que le nombre infini d’îles, & la situation du terrain, ont divisées en une infinité de petits états, que le grand nombre des causes que je n’ai pas le temps de rapporter ici rendent despotiques.
Là, il n’y a que des misérables qui pillent, & des misérables qui sont pillés. Ceux qu’on appelle des grands, n’ont que de très-petits moyens ; ceux que l’on appelle des gens riches, n’ont guere que leur subsistance. La clôture des femmes n’y peut être aussi exacte, l’on n’y peut pas prendre d’aussi grandes précautions pour les contenir, la corruption de leurs mœurs y est inconcevable.
C’est là qu’on voit jusqu’à quel point les vices du climat, laissés dans une grande liberté, peuvent porter le [II-143] désordre. C’est là que la nature a une force, & la pudeur une foiblesse qu’on ne peut comprendre. À Patane [1] , la lubricité [2] des femmes est si grande, que les hommes sont contraints de se faire de certaines garnitures pour se mettre à l’abri de leurs entreprises. Selon M. Smith [3] , les choses ne vont pas mieux dans les petits royaumes de Guinée. Il semble que dans ces pays-là, les deux sexes perdent jusqu’à leurs propres lois.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissementde la compagnie des Indes, tom. II, partie II, pag. 196.
-
[↑] Aux Maldives, les peres marient leurs filles à dix & onze ans, parce que c’est un grand péché, disent-ils, de leur laisser endurer nécessité d’hommes. Voyages de François Pyrard, chap. xii. À Bantam, si-tôt qu’une fille à treize ou quatorze ans, il faut la marier, si l’on ne veut qu’elle mene une vie débordée. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, pag. 348.
-
[↑] Voyage de Guinée, seconde partie, pag. 192, de la traduction. « Quand les femmes, dit-il, rencontrent un homme, elles le saisissent, & le menacent de le dénoncer à leur mari, s’il les méprise, Elles se glissent dans le lit d’un homme, elles le réveillent ; & s’il les refuse, elle le menacent de se laisser prendre sur le fait. »
[II-144]
CHAPITRE XI.
De la servitude domestique indépendante de la polygamie.
Ce n’est pas seulement la pluralité des femmes qui exige leur clôture dans de certains lieux d’orient ; c’est le climat. Ceux qui liront les horreurs, les crimes, les perfidies, les noirceurs, les poisons, les assassinats, que la liberté des femmes fait faire à Goa, & dans les établissemens des Portugais dans les Indes où la religion ne permet qu’une femme, & qui les compareront à l’innocence & à la pureté des mœurs des femmes de Turquie, de Perse, du Mogol, de la Chine & du Japon, verront bien qu’il est souvent aussi nécessaire de les séparer des hommes, lorsqu’on n’en a qu’une, que quand on en a plusieurs.
C’est le climat qui doit décider de ces choses. Que serviroit d’enfermer les femmes dans nos pays du nord, où leurs mœurs sont naturellement bonnes ; où toutes leurs passions sont calmes, peu actives, peu rafinées ; où l’amour a sur [II-145] le cœur un empire si réglé, que la moindre police suffit pour les conduire ?
Il est heureux de vivre dans ces climats qui permettent qu’on se communique ; où le sexe qui a le plus d’agrémens, semble parer la société ; & où les femmes se réservant aux plaisirs d’un seul, servent encore à l’amusement de tous.
[II-145]
CHAPITRE XII.
De la pudeur naturelle.
Toutes les nations se sont également accordées à attacher du mépris à l’incontinence des femmes : c’est que la nature a parlé à toutes les nations. Elle a établi la défense, elle a établi l’attaque ; & ayant mis des deux côtés des désirs, elle a placé dans l’un la témérité, & dans l’autre la honte. Elle a donné aux individus pour se conserver de longs espaces de temps, & ne leur a donné pour se perpétuer que des momens.
Il n’est donc pas vrai que l’incontinence suive les lois de la nature ; elle [II-146] les viole au contraire. C’est la modestie & la retenue qui suivent ces lois.
D’ailleurs il est de la nature des êtres intelligens de sentir leurs imperfections : la nature a donc mis en nous la pudeur, c’est-à-dire la honte de nos imperfections.
Quand donc la puissance physique de certains climats viole la loi naturelle des deux sexes & celle des êtres intelligens, c’est au législateur à faire des lois civiles qui forcent la nature du climat & rétablissent les lois primitives.
[II-146]
CHAPITRE XIII.
De la jalousie.
Il faut bien distinguer chez les peuples la jalousie de passion d’avec la jalousie de coutume, de mœurs, de lois. L’une est une fievre ardente qui dévore ; l’autre froide, mais quelquefois terrible, peut s’allier avec l’indifférence & le mépris.
L’une, qui est un abus de l’amour, tire sa naissance de l’amour même. L’autre tient uniquement aux mœurs, aux manieres de la nation, aux lois du pays, [II-147] à la morale, & quelquefois même à la religion [1] .
Elle est presque toujours l’effet de la force physique du climat, & elle est le remede de cette force physique.
-
[↑] Mahomet recommanda à ses sectateurs, de garder leurs femmes : un certain iman dit en mourant la même chose ; & Confucius n’a pas moins prêché cette doctrine.
[II-147]
CHAPITRE XIV.
Du gouvernement de la maison en orient.
On change si souvent de femmes en orient, qu’elles ne peuvent avoir le gouvernement domestique. On en charge donc les eunuques, on leur remet toutes les clefs, & ils ont la disposition des affaires de la maison. « En Perse, dit M. Chardin, on donne aux femmes leurs habits, comme on feroit à des enfans ». Ainsi ce soin qui semble leur convenir si bien, ce soin qui par-tout ailleurs est le premier de leurs soins, ne les regarde pas.
[II-148]
CHAPITRE XV.
Du divorce & de la répudiation.
Il y a cette différence entre le divorce & la répudiation, que le divorce se fait par un consentement mutuel à l’occasion d’une incompatibilité mutuelle ; au lieu que la répudiation se fait par la volonté & pour l’avantage d’une des deux parties, indépendamment de la volonté & de l’avantage de l’autre.
Il est quelquefois si nécessaire aux femmes de répudier, & il leur est toujours si fâcheux de le faire, que la loi est dure, qui donne ce droit aux hommes, sans le donner aux femmes. Un mari est le maître de la maison ; il a mille moyens de tenir ou de remettre ses femmes dans le devoir, & il semble que, dans ses mains, la répudiation ne soit qu’un nouvel abus de sa puissance. Mais une femme qui répudie, n’exerce qu’un triste remede. C’est toujours un grand malheur pour elle d’être contrainte d’aller chercher un second mari, lorsqu’elle a perdu la plupart de ses agrémens chez un autre. C’est un des avantages des [II-149] charmes de la jeunesse dans les femmes que, dans un âge avancé, un mari se porte à la bienveillance par le souvenir de ses plaisirs.
C’est donc une regle générale, que dans tous les pays où la loi accorde aux hommes la faculté de répudier, elle doit aussi l’accorder aux femmes. Il y a plus : dans les climats où les femmes vivent sous un esclavage domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes la répudiation, & aux maris seulement le divorce.
Lorsque les femmes sont dans un sérail, le mari ne peut répudier pour cause d’incompatibilité de mœurs : c’est la faute du mari, si les mœurs sont incompatibles.
La répudiation pour raison de la stérilité de la femme, ne sauroit avoir lieu que dans le cas d’une femme unique [1] : lorsque l’on a plusieurs femmes, cette raison n’est pour le mari d’aucune importance.
La loi des Maldives [2] permet de [II-150] reprendre une femme qu’on a répudiée. La loi du Mexique [3] défendoit de se réunir, sous peine de la vie. La loi du Mexique étoit plus sensée que celle des Maldives ; dans le temps même de la dissolution, elle songeoit à l’éternité du mariage : au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du mariage & de la répudiation.
La loi du Mexique n’accordoit que le divorce. C’étoit une nouvelle raison pour ne point permettre à des gens qui s’étoient volontairement séparés, de se réunir. La répudiation semble plutôt tenir à la promptitude de l’esprit, & à quelque passion de l’ame ; le divorce semble être une affaire de conseil.
Le divorce a ordinairement une grande utilité politique ; & quant à l’utilité civile, il est établi pour le mari & pour la femme, & n’est pas toujours favorable aux enfans.
-
[↑] Cela ne signifie pas que la répudiation pour raison de la stérilité, soit permise dans le christianisme.
-
[↑] Voyage de François Pycard. On la reprend plutôt qu’une autre ; parce que, dans ce cas, il faut moins de dépenses.
-
[↑] Histoire de sa conquête, par Solis, p. 499.
[II-151]
CHAPITRE XVI.
De la répudiation & du divorce chez les Romains.
Romulus permit au mari de répudier sa femme, si elle avoit commis un adultere, préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque [1] appelle cette loi, une loi très-dure.
Comme la loi d’Athenes [2] donnoit à la femme, aussi-bien qu’au mari, la faculté de répudier ; & que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains nonobstant la loi de Romulus ; il est clair que cette institution fut une de celles que les députés de Rome rapporterent d’Athenes, & qu’elle fut mise dans les lois des douze tables.
Cicéron [3] dit que les causes de répudiation venoient de la loi des douze tables. On ne peut donc pas douter que [II-152] cette loi n’eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.
La faculté du divorce fut encore une disposition, ou du moins une conséquence de la loi des douze tables. Car, dès le moment que la femme ou le mari avoit séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvoient-ils se quitter de concert, & par une volonté mutuelle.
La loi ne demandoit point qu’on donnât des causes pour le divorce [4] . C’est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour la répudiation, & qu’il n’en faut point pour le divorce ; parce que là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l’incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes.
Denys d’Halicarnasse [5] , Valere-Maxime [6] , & Aulugelle [7] , rapportent un fait qui ne me paroît pas vraisemblable : ils disent que, quoiqu’on eût à Rome la faculté de répudier sa femme, on eut tant de respect pour les auspices, que personne, pendant cinq cents vingt [II-153] ans [8] , n’usa de ce droit jusqu’à Carvilius Ruga, qui répudia la sienne pour cause de stérilité. Mais il suffit de connoître la nature de l’esprit humain, pour sentir quel prodige ce seroit, que la loi donnant à tout un peuple un droit pareil, personne n’en usât. Coriolan partant pour son exil, conseilla [9] à sa femme de se marier à un homme plus heureux que lui. Nous venons de voir que la loi des douze tables, & les mœurs des Romains, étendirent beaucoup la loi de Romulus. Pourquoi ces extensions, si on n’avoit jamais fait usage de la faculté de répudier ? De plus, si les citoyens eurent un tel respect pour les auspices, qu’ils ne répudierent jamais, pourquoi les législateurs de Rome en eurent-ils moins ? Comment la loi corrompit-elle sans cesse les mœurs ?
En rapprochant deux passages de Plutarque, on verra disparoître le merveilleux du fait en question. La loi royale [10] permettoit au mari de répudier dans les [II-154] trois cas dont nous avons parlé. « Et elle vouloit, dit Plutarque [11] , que celui qui répudiroit dans d’autres cas, fût obligé de donner la moitié de ses biens à sa femme, & que l’autre moitié fût consacrée à Cerès ». On pouvoit donc répudier dans tous les cas, en se soumettant à la peine. Personne ne le fit devant Carvilius Ruga [12] ; « qui, comme dit encore Plutarque [13] , répudia sa femme pour cause de stérilité, deux cents trente ans après Romulus » : c’est-à-dire, qu’il la répudia soixante & onze ans avant la loi des douze tables, qui étendit le pouvoir de répudier, & les causes de répudiation.
Les auteurs que j’ai cités, disent que Carvilius Ruga aimoit sa femme ; mais qu’à cause de sa stérilité, les censeurs lui firent faire serment qu’il la répudieroit, afin qu’il pût donner des enfans à la république ; & que cela le rendit odieux au peuple. Il faut connoître le génie du peuple Romain, pour découvrir la vraie [II-155] cause de la haine qu’il conçut pour Carvilius. Ce n’est point parce que Carvilius répudia la femme, qu’il tomba dans la disgrace du peuple : c’est une chose dont le peuple ne s’embarrassoit pas. Mais Carvilius avoit fait un serment aux censeurs, qu’attendu la stérilité de sa femme, il la répudieroit pour donner des enfans à la république. C’étoit un joug que le peuple voyoit que les censeurs alloient mettre sur lui. Je ferai voir dans la suite [14] de cet ouvrage les répugnances qu’il eut toujours pour les réglemens pareils. Mais d’où peut venir une telle contradiction entre ces auteurs ? Le voici : Plutarque a examiné un fait, & les autres ont raconté une merveille.
-
[↑] Vie de Romulus.
-
[↑] C’étoit une loi de Solon.
-
[↑] Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis caussam addidit, Philip. II.
-
[↑] Justinien changea cela, novel. 117, ch. x.
-
[↑] Liv. II.
-
[↑] Liv. II. chap. iv.
-
[↑] Liv. IV. chap. iii.
-
[↑] Selon Denys d’Halicarnasse & Valere-Maxime ; & 523, selon Aulugelle. Aussi ne mettent-ils pas les mêmes consuls.
-
[↑] Voyez le discours de Véturie, dans Denys, d’Halicarnasse, liv. VIII.
-
[↑] Plutarque, vie de Romulus.
-
[↑] Plutarque, vie de Romulus.
-
[↑] Effectivement, la cause de stérilité n’est point portée par la loi de Romulus. Il y a apparence qu’il ne fut point sujet à la confiscation, puisqu’il suivoit l’ordre des censeurs.
-
[↑] Dans la comparaison de Thésée & de Romulus.
-
[↑] Au liv. XXIII. chap. xxi.
[II-156]
LIVRE XVII.
Comment les Lois de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat.↩
CHAPITRE PREMIER.
De la servitude politique.
La servitude politique ne dépend pas moins de la nature du climat, que la civile & la domestique, comme on va le faire voir.
[II-156]
CHAPITRE II.
Différence des peuples, par rapport au courage.
Nous avons déjà dit que la grande chaleur énervoit la force & le courage des hommes ; & qu’il y avoit dans les climats froids une certaine force de corps & d’esprit, qui rendoit les hommes capables des actions longues, [II-157] pénibles, grandes & hardies. Cela se remarque non-seulement de nation à nation, mais encore dans le même pays d’une partie à une autre. Les peuples du nord de la Chine [1] sont plus courageux que ceux du midi ; les peuples du midi de la Corée [2] ne le sont pas tant que ceux du nord.
Il ne faut donc pas être étonné que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait presque toujours rendu esclaves, & que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus libres. C’est un effet qui dérive de sa cause naturelle.
Ceci s’est encore trouvé vrai dans l’Amérique ; les empires despotiques du Mexique & du Pérou étoient vers la ligne, & presque tous les petits peuples libres étoient & sont encore vers les pôles.
-
[↑] Le P. du Halde, tome I. page 112.
-
[↑] Les livres Chinois le disent ainsi. Ibid. tome IV, page 448.
[II-158]
CHAPITRE III.
Du climat de l’Asie.
Les relations nous disent [1] que « le nord de l’Asie, ce vaste continent qui va du quarantieme degré ou environ jusques au pôle, & des frontieres de la Moscovie jusqu’à la mer orientale, est dans un climat très-froid : que ce terrain immense est divisé de l’ouest à l’est par une chaine de montagnes, qui laissent au nord la Sibérie, & au midi la grande Tartarie : que le climat de la Sibérie est si froid, qu’à la réserve de quelques endroits, elle ne peut être cultivée ; & que, quoique les Russes aient des établissemens tout le long de l’Irtis, ils n’y cultivent rien ; qu’il ne vient dans ce pays que quelques petits lapins & arbrisseaux ; que les naturels du pays sont divisés en de misérables peuplades, qui sont comme celles du Canada : que la raison de cette froidure vient d’un côté de la hauteur du terrain; & de l’autre, de ce qu’à [II-159] mesure que l’on va du midi au nord, les montagnes s’applanissent ; de sorte que le vent du nord souffle par-tout sans trouver d’obstacles : que ce vent qui rend la nouvelle Zemble inhabitable, soufflant dans la Sibérie, la rend inculte. Qu’en Europe, au contraire, les montagnes de Norwege & de Laponie sont des boulevards admirables, qui couvrent de ce vent les pays du nord : que cela fait qu’à Stockholm, qui est à cinquante-neuf degrés de latitude ou environ, le terrain produit des fruits, des grains, des plantes ; & qu’autour d’Abo, qui est au soixante-unieme degré, de même que vers les soixante-trois & soixante-quatre, il y a des mines d’argent, & que le terrain est assez fertile ».
Nous voyons encore dans les relations que « la grande Tartarie, qui est au midi de la Sibérie, est aussi très-froide ; que le pays ne se cultive point, qu’on n’y trouve que des pâturages pour les troupeaux ; qu’il n’y croît point d’arbres, mais quelques broussailles, comme en Islande : qu’il y a auprès de la Chine & du Mogol quelques pays où il croît une espece de [II-160] millet, mais que le blé ni le riz n’y peuvent mûrir : qu’il n’y a guere d’endroits dans la Tartarie Chinoise, aux 43, 44 & 45me degrés, où il ne gele sept ou huit mois de l’année ; de sorte qu’elle est aussi froide que l’Islande, quoiqu’elle dût être plus chaude que le midi de la France : qu’il n’y a point de villes, excepté quatre ou cinq vers la mer orientale, & quelques-unes que les Chinois, par des raisons de politique, ont bâties près de la Chine ; que dans le reste de la grande Tartarie, il n’y en a que quelques-unes placées dans les Boucharies, Turkestan & Charisme : que la raison de cette extrême froidure vient de la nature du terrain nitreux, plein de salpêtre & sablonneux, & de plus, de la hauteur du terrain. Le P. Verbiest avoit trouvé qu’un certain endroit, à 80 lieues au nord de la grande muraille, vers la source de Kavamhuram, excédoit la hauteur du rivage de la mer près de Pekin de 3000 pas géométriques ; que cette hauteur [2] est cause que, quoique quasi toutes les grandes rivieres [II-161] de l’Asie ayent leur source dans le pays, il manque cependant d’eau, de façon qu’il ne peut être habité qu’auprès des rivieres & des lacs ».
Ces faits posés, je raisonne ainsi : L’Asie n’y a point proprement de zone tempérée ; & les lieux situés dans un climat très-froid, y touchent immédiatement ceux qui sont dans un climat très-chaud, c’est-à-dire, la Turquie, la Perse, le Mogol, la Chine, la Corée & le Japon.
En Europe, au contraire, la zone tempérée est très-étendue, quoiqu’elle soit située dans des climats très-différens entr’eux, n’y ayant point de rapport entre les climats d’Espagne & d’Italie, & ceux de Norwege & de Suede. Mais comme le climat y devient insensiblement froid en allant du midi au nord, à peu près à proportion de la latitude de chaque pays ; il y arrive que chaque pays est à peu près semblable à celui qui en est voisin ; qu’il n’y a pas une notable différence ; & que, comme je viens de le dire, la zone tempérée y est très-étendue. De-là il suit qu’en Asie, les nations sont opposées aux nations du fort au foible ; les peuples guerriers, braves, & actifs y touchent immédiatement des [II-162] peuples efféminés, paresseux, timides : il faut donc que l’un soit conquis, & l’autre conquérant. En Europe, au contraire, les nations sont opposées du fort au fort ; celles qui se touchent ont à peu près le même courage. C’est la grande raison de la foiblesse de l’Asie & de la force de l’Europe, de la liberté de l’Europe & de la servitude de l’Asie ; cause que je ne sache pas que l’on ait encore remarquée. C’est ce qui fait qu’en Asie, il n’arrive jamais que la liberté augmente ; au lieu qu’en Europe elle augmente ou diminue, selon les circonstances.
Que la noblesse Moscovite ait été réduite en servitude par un de ses princes, on y verra toujours des traits d’impatience que les climats du midi ne donnent point. N’y avons-nous pas vu le gouvernement aristocratique établi pendant quelques jours ? Qu’un autre royaume du nord ait perdu ses lois, on peut s’en fier au climat, il ne les a pas perdues d’une maniere irrévocable.
-
[↑] Voyez les voyages du Nord, tome VIII ; l’histoire des Tartares ; & le quatrieme volume de la Chine du P. du Halde.
-
[↑] La Tartarie est donc, comme une espece de montagne platte.
[II-163]
CHAPITRE IV.
Conséquence de ceci.
Ce que nous venons de dire, s’accorde avec les événemens de l’histoire. L’Asie a été subjuguée treize fois ; onze fois par les peuples du nord, deux fois par ceux du midi. Dans les temps reculés, les Scythes la conquirent trois fois ; ensuite les Medes & les Perses chacun une ; les Grecs, les Arabes, les Mogols, les Turcs, les Tartares, les Persans & les Aguans. Je ne parle que de la haute Asie, & je ne dis rien des invasions faites dans le reste du midi de cette partie du monde, qui a continuellement souffert de très-grandes révolutions.
En Europe, au contraire, nous ne connoissons, depuis l’établissement des colonies Grecques & Phéniciennes, que quatre grands changemens ; le premier, causé par les conquêtes des Romains ; le second, par les inondations des Barbares qui détruisirent ces mêmes Romains ; le troisieme, par les victoires de Charlemagne ; & le dernier, par les invasions des Normands. Et si l’on examine bien ceci, on trouvera dans ces [II-164] changemens même une force générale répandue dans toutes les parties de l’Europe. On sait la difficulté que les Romains trouverent à conquérir en Europe, & la facilité qu’ils eurent à envahir l’Asie. On connoît les peines que les peuples du nord eurent à renverser l’empire Romain, les guerres & les travaux de Charlemagne, les diverses entreprises des Normands. Les destructeurs étoient sans cesse détruits.
[II-164]
CHAPITRE V.
Que quand les peuples du nord de l’Asie, & ceux du nord de l’Europe ont conquis, les effets de la conquête n’étoient pas les mêmes.
Les peuples du nord de l’Europe l’ont conquise en hommes libres ; les peuples du nord de l’Asie l’ont conquise en esclaves, & n’ont vaincu que pour un maître.
La raison en est, que le peuple Tartare, conquérant naturel de l’Asie, est devenu esclave lui-même. Il conquiert sans cesse dans le midi de l’Asie, il forme des empires ; mais la partie de la nation [II-165] qui reste dans le pays, se trouve soumise à un grand maître, qui, despotique dans le midi, veut encore l’être dans le nord ; & avec un pouvoir arbitraire sur les sujets conquis, le prétend encore sur les sujets conquérans. Cela se voit bien aujourd’hui dans ce vaste pays, qu’on appelle la Tartarie Chinoise, que l’empereur gouverne presqu’aussi despotiquement que la Chine même, & qu’il étend tous les jours par ses conquêtes.
On peut voir encore dans l’histoire de la Chine, que les empereurs [1] ont envoyé des colonies Chinoises dans la Tartarie. Ces Chinois sont devenus Tartares, & mortels ennemis de la Chine ; mais cela n’empêche pas qu’ils n’ayent porté dans la Tartarie l’esprit du gouvernement Chinois.
Souvent une partie de la nation Tartare qui a conquis est chassée elle-même ; & elle rapporte dans ses déserts un esprit de servitude qu’elle a acquis dans le climat de l’esclavage. L’histoire de la Chine nous en fournit de grands exemples, & notre histoire ancienne aussi [2] .
[II-166]
C’est ce qui a fait que le génie de la nation Tartare ou Gétique, a toujours été semblable à celui des empires de l’Asie. Les peuples dans ceux-ci sont gouvernés par le bâton ; les peuples Tartares, par les longs fouets. L’esprit de l’Europe a toujours été contraire à ces mœurs ; & dans tous les temps, ce que les peuples d’Asie ont appellé punition, les peuples d’Europe l’ont appellé outrage [3] .
Les Tartares détruisant l’empire Grec, établirent dans les pays conquis la servitude & le despotisme : les Goths conquérant l’empire Romain, fonderent par-tout la monarchie & la liberté.
Je ne sais si le fameux Rudbeck, qui dans son Atlantique a tant loué la Scandinavie, a parlé de cette grande prérogative qui doit mettre les nations qui l’habitent au-dessus de tous les peuples du monde ; c’est qu’elles ont été la source de la liberté de l’Europe, c’est-à-dire, de presque toute celle qui est aujourd’hui parmi les hommes.
[II-167]
Le Goth Jornandez a appellé le nord de l’Europe la fabrique du genre humain [4] . Je l’appellerai plutôt la fabrique des instrumens qui brisent les fers forgés au midi. C’est là que se forment ces nations vaillantes, qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans & les esclaves, & apprendre aux hommes que la nature les ayant fait égaux, la raison n’a pu les rendre dépendans que pour leur bonheur.
-
[↑] Comme Ven-ti, cinquieme empereur de la cinquieme dynastie.
-
[↑] Les Scythes conquirent trois fois l’Afie, & en furent trois fois chassés, Justin, liv. II.
-
[↑] Ceci n’est point contraire à ce que je dirai au liv. XXVIII. ch. xx. sur la maniere de penser des peuples Germains sur le bâton : quelqu’instrument que ce fût, ils regarderent toujours comme un affront, le pouvoir ou l’action arbitraire de battre.
-
[↑] Humani generis officinam.
[II-167]
CHAPITRE VI.
Nouvelle cause physique de la servitude de l’Asie & de la liberté de l’Europe.
En Asie, on a toujours vu de grands empires : en Europe, ils n’ont jamais pu subsister. C’est que l’Asie que nous connoissons, a de plus grandes plaines ; elle est coupée en plus grands morceaux par les mers ; & comme elle est plus au midi, les sources y sont plus aisément taries, les montagnes y sont moins couvertes de neiges, & les fleuves [1] [II-168] moins grossis y forment de moindre barrieres.
La puissance doit donc être toujours despotique en Asie. Car si la servitude n’y étoit pas extrême, il se feroit d’abord un partage que la nature du pays ne peut pas souffrir.
En Europe, le partage naturel forme plusieurs états d’une étendue médiocre, dans lesquels le gouvernement des lois n’est pas incompatible avec le maintien de l’état : au contraire, il y est favorable, que sans elles, cet état tombe dans la décadence, & devient inférieur à tous les autres.
C’est ce qui y a formé un génie de liberté, qui rend chaque partie très-difficile à être subjuguée & soumise à une force étrangere, autrement que par les lois & l’utilité de son commerce.
Au contraire, il regne en Asie un esprit de servitude qui ne l’a jamais quittée, & dans toutes les histoires de ce pays, il n’est pas possible de trouver un seul trait qui marque une ame libre : on n’y verra jamais que l’héroïsme de la servitude.
-
[↑] Les eaux se perdent ou s’évaporent avant de se ramasser, ou après s’être ramassées.
[II-169]
CHAPITRE VII.
De l’Afrique & de l’Amérique.
Voila ce que je puis dire sur l’Asie & sur l’Europe. L’Afrique est dans un climat pareil à celui du midi de l’Asie, & elle est dans une même servitude. L’Amerique [1] détruite & nouvellement repeuplée par les nations de l’Europe & de l’Afrique, ne peut guere aujourd’hui montrer son propre génie : mais ce que nous savons de son ancienne histoire est très-conforme à nos principes.
-
[↑] Les petits peuples barbares de l’Amerique sont appellés Indios braves, par les Espagnols : bien plus difficiles à soumettre que les grands empires du Mexique & du Pérou.
[II-169]
CHAPITRE VIII.
De la capitale de l’Empire.
Une des conséquences de ce que nous venons de dire, c’est qu’il est important à un très-grand prince de bien choisir le siege de son empire. Celui qui [II-170] le placera au midi courra risque de perdre le nord ; & celui qui le placera au nord, conservera aisément le midi. Je ne parle pas des cas particuliers : la mécanique a bien ses frottemens, qui souvent changent ou arrêtent les effets de la théorie ; la politique a aussi les siens.
[II-171]
LIVRE XVIII.
Des Lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrain.↩
CHAPITRE PREMIER.
Comment la nature du terrain influe sur les lois.
La bonté des terres d’un pays y établit naturellement la dépendance. Les gens de la campagne qui y font la principale partie du peuple, ne sont pas si jaloux de leur liberté : ils sont trop occupés & trop pleins de leurs affaires particulieres. Une campagne qui regorge de biens, craint le pillage, elle craint une armée. Qui est-ce qui forme le bon parti, disoit Cicéron à Atticus [1] ? « Seront-ce les gens de commerce & de la campagne ? à moins que nous n’imaginions qu’ils sont opposés à la monarchie, eux, à qui tous les gouvernemens sont égaux, dès-lors qu’ils sont tranquilles ».
[II-172]
Ainsi le gouvernement d’un seul se trouve plus souvent dans les pays fertiles, & le gouvernement de plusieurs dans les pays qui ne le sont pas, ce qui est quelquefois un dédommagement.
La stérilité du terrain de l’Attique y établit le gouvernement populaire ; & la fertilité de celui de Lacédémone, le gouvernement aristocratique. Car, dans ces temps-là, on ne vouloit point dans la Grece du gouvernement d’un seul : or le gouvernement aristocratique a plus de rapport avec le gouvernement d’un seul.
Plutarque [2] nous dit que la sédition Cilonienne ayant été appaisée à Athenes, la ville retomba dans ses anciennes dissentions, & se divisa en autant de partis qu’il y avoit de sortes de territoires dans les pays de l’Attique. Les gens de la montagne vouloient à toute force le gouvernement populaire ; ceux de la plaine demandoient le gouvernement des principaux ; ceux qui étoient près de la mer, étoient pour un gouvernement mêlé des deux.
[II-173]
CHAPITRE II.
Continuation du même sujet.
Ces pays fertiles sont des plaines, où l’on ne peut rien disputer au plus fort : on se soumet donc à lui ; & quand on lui est soumis, l’esprit de liberté n’y sauroit revenir ; les biens de la campagne sont un gage de la fidélité. Mais dans les pays de montagnes, on peut conserver ce que l’on a, & l’on a peu à conserver. La liberté, c’est-à-dire le gouvernement dont on jouit, est le seul bien qui mérite qu’on le défende. Elle regne donc plus dans les pays montagneux & difficiles, que dans ceux que la nature sembloit avoir plus favorisés.
Les montagnards conservent un gouvernement plus modéré, parce qu’ils ne sont pas si fort exposés à la conquête. Ils se défendent aisément, ils sont attaqués difficilement ; les munitions de guerre & de bouche sont assemblées & portées contr’eux avec beaucoup de dépense, le pays n’en fournit point. Il est donc plus difficile de leur faire la guerre, plus dangereux de l’entreprendre ; & [II-174] toutes les lois que l’on fait pour la sureté du peuple y ont moins de lieu.
[II-174]
CHAPITRE III.
Quels sont les pays les plus cultivés.
Les pays ne sont pas cultivés en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté ; & si l’on divise la terre par la pensée, on sera étonné de voir la plupart du temps des déserts dans ses parties les plus fertiles, & de grands peuples dans celles où le terrain semble refuser tout.
Il est naturel qu’un peuple quitte un mauvais pays pour en chercher un meilleur, & non pas qu’il quitte un bon pays pour en chercher un pire. La plupart des invasions se font donc dans les pays que la nature avoit faits pour être heureux : & comme rien n’est plus près de la dévastation que l’invasion, les meilleurs pays sont le plus souvent dépeuplés, tandis que l’affreux pays du nord reste toujours habité, par la raison qu’il est presqu’inhabitable.
On voit, par ce que les historiens nous disent du passage des peuples de [II-175] la Scandinavie sur les bords du Danube, que ce n’étoit point une conquête, mais seulement une transmigration dans des terres désertes.
Ces climats heureux avoient donc été dépeuplés par d’autres transmigrations, & nous ne savons pas les choses tragiques qui s’y sont passées.
« Il paroît par plusieurs monumens, dit Aristote [1] , que la Sardaigne est une colonie Grecque. Elle étoit autrefois très-riche ; & Aristée, dont on a tant vanté l’amour pour l’agriculture, lui donna des lois. Mais elle a bien déchu depuis ; car les Carthaginois s’en étant rendus les maîtres, ils y détruisirent tout ce qui pouvoit la rendre propre à la nourriture des hommes, & défendirent, sous peine de la vie, d’y cultiver la terre ». La Sardaigne n’étoit point rétablie du temps d’Aristote ; elle ne l’est point encore aujourd’hui.
Les parties les plus tempérées de la Perse, de la Turquie, de la Moscovie & de la Pologne, n’ont pu se rétablir des dévastations des grand & des petits Tartares.
-
[↑] Ou celui qui a écrit le livre de mirabilibus.
[II-176]
CHAPITRE IV.
Nouveaux effets de la fertilité & de la stérilité du pays.
La stérilité des terres rend les hommes industrieux, sobres, endurcis au travail, courageux, propres à la guerre ; il faut bien qu’ils se procurent ce que le terrain leur refuse. La fertilité d’un pays donne, avec l’aisance, la mollesse, & un certain amour pour la conservation de la vie.
On a remarqué que les troupes d’Allemagne levées dans des lieux où les paysans sont riches, comme en Saxe, ne sont pas si bonnes que les autres. Les lois militaires pourront pourvoir à cet inconvénient par une plus sévere discipline.
[II-176]
CHAPITRE V.
Des peuples des îles.
Les peuples des îles sont plus portés à la liberté que les peuples du continent. Les îles sont ordinairement d’une [II-177] petite étendue [1] ; une partie du peuple ne peut pas être si bien employée à opprimer l’autre ; la mer les sépare des grands empires, & la tyrannie ne peut pas s’y prêter la main, les conquérans sont arrêtés par la mer ; les insulaires ne sont pas enveloppés dans la conquête, & ils conservent plus aisément leurs lois.
-
[↑] Le Japon déroge à ceci par sa grandeur & par sa servitude.
[II-177]
CHAPITRE VI.
Des pays formés par l’industrie des hommes.
Les pays que l’industrie des hommes a rendus habitables, & qui ont besoin pour exister de la même industrie, appellent à eux le gouvernement modéré. Il y en a principalement trois de cette espece ; les deux belles provinces de Kiang-nan & Tche-kiang à la Chine, l’Égypte & la Hollande.
Les anciens empereurs de la Chine n’étoient point conquérans. La premiere chose qu’ils firent pour s’agrandir, fut celle qui prouva le plus leur sagesse. On vit sortir de dessous les eaux les deux [II-178] plus belles provinces de l’empire ; elles furent faites par les hommes. C’est la fertilité inexprimable de ces deux provinces, qui a donné à l’Europe les idées de la félicité de cette vaste contrée. Mais un soin continuel & nécessaire pour garantir de la destruction une partie si considérable de l’empire, demandoit plutôt les mœurs d’un peuple sage, que celles d’un peuple voluptueux ; plutôt le pouvoir légitime d’un monarque, que la puissance tyrannique d’un despote. Il falloit que le pouvoir y fût modéré, comme il l’étoit autrefois en Égypte. Il falloit que le pouvoir y fût modéré, comme il l’est en Hollande, que la nature a faite pour avoir attention sur elle-même, & non pas pour être abandonnée à la nonchalance ou au caprice.
Ainsi, malgré le climat de la Chine, où l’on est naturellement porté à l’obéissance servile, malgré les horreurs qui suivent la trop grande étendue d’un empire, les premiers législateurs de la Chine furent obligés de faire de très-bonnes lois, & le gouvernement fut souvent obligé de les suivre.
[II-179]
CHAPITRE VII.
Des ouvrages des hommes.
Les hommes, par leurs soins & par de bonnes lois, ont rendu la terre plus propre à être leur demeure. Nous voyons couler des rivieres là où étoient des lacs & des marais : c’est un bien que la nature n’a point fait, mais qui est entretenu par la nature. Lorsque les Perses [1] étoient les maîtres de l’Asie, ils permettoient à ceux qui ameneroient de l’eau de fontaine en quelque lieu qui n’auroit point été encore arrosé, d’en jouir pendant cinq générations ; & comme il sort quantité de ruisseaux du mont Taurus, ils n’épargnerent aucune dépense pour en faire venir de l’eau. Aujourd’hui, sans savoir d’où elle peut venir, on la trouve dans les champs & dans ses jardins.
Ainsi, comme les nations destructrices font des maux qui durent plus qu’elles, il y a des nations industrieuses qui font des biens qui ne finissent pas même avec elles.
-
[↑] Polybe, liv. X.
[II-180]
CHAPITRE VIII.
Rapport général des lois.
Les lois ont un très-grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent la subsistance. Il faut un code de lois plus étendu pour un peuple qui s’attache au commerce & à la mer, que pour un peuple qui se contente de cultiver ses terres. Il en faut un plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit de sa chasse.
[II-180]
CHAPITRE IX.
Du terrain de l’Amérique.
Ce qui fait qu’il y a tant de nations sauvages en Amérique, c’est que la terre y produit d’elle-même beaucoup de fruits dont on peut se nourrir. Si les femmes y cultivent autour de la cabane un morceau de terre, le maïs y vient d’abord. La chasse & la pêche achevent de mettre les hommes dans l’abondance, De plus, les animaux qui paissent, [II-181] comme les bœufs, les buffles, &c. y réussissent mieux que les bêtes carnassieres. Celles-ci ont eu de tout temps l’empire de l’Afrique.
Je crois qu’on n’auroit point tous ces avantages en Europe, si l’on y laissoit la terre inculte ; il n’y viendroit guere que des forêts, des chênes & autres arbres stériles.
[II-181]
CHAPITRE X.
Du nombre des hommes dans le rapport avec la maniere dont ils se procurent la subsistance.
Quand les nations ne cultivent pas les terres, voici dans quelle proportion le nombre des hommes s’y trouve. Comme le produit d’un terrain inculte est au produit d’un terrain cultivé ; de même le nombre des sauvages dans un pays, est au nombre des laboureurs dans un autre : & quand le peuple qui cultive les terres, cultive aussi les arts, cela suit des proportions qui demanderoient bien des détails.
Ils ne peuvent guere former une grande nation. S’ils sont pasteurs, ils [II-182] ont besoin d’un grand pays, pour qu’ils puissent subsister en certain nombre : s’ils sont chasseurs, ils sont encore en plus petit nombre ; & forment, pour vivre, une plus petite nation.
Leur pays est ordinairement plein de forêts ; & comme les hommes n’y ont point donné de cours aux eaux, il est rempli de marécages, où chaque troupe se cantonne & forme une petite nation.
[II-182]
CHAPITRE XI.
Des peuple sauvages, & des peuples barbares.
Il y a cette différence entre les peuples sauvages & les peuples barbares, que les premiers sont de petites nations dispersées, qui, par quelques raisons particulieres, ne peuvent pas se réunir ; au lieu que les barbares sont ordinairement de petites nations qui se peuvent réunir. Les premiers sont ordinairement des peuples chasseurs ; les seconds, des peuples pasteurs. Cela se voit bien dans le nord de l’Asie. Les peuples de la Sibérie ne sauroient vivre en corps, parce qu’ils ne pourroient se nourrir ; les [II-183] Tartares peuvent vivre en corps pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux peuvent être rassemblés pendant quelque temps. Toutes les hordes peuvent donc se réunir ; & cela se fait lorsqu’un chef en a soumis beaucoup d’autres, après quoi, il faut qu’elles fassent de deux choses l’une, qu’elles se séparent, ou qu’elles aillent faire quelque grande conquête dans quelque empire du midi.
[II-183]
CHAPITRE XII.
Du droit des gens chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
Ces peuples ne vivant pas dans un terrain limité & circonscrit, auront entr’eux bien des sujets de querelle ; ils se disputeront la terre inculte, comme parmi nous les citoyens se disputent les héritages. Ainsi ils trouveront de fréquentes occasions de guerre pour leurs chasses, pour leurs pêches, pour la nourriture de leurs bestiaux, pour l’enlévement de leurs esclaves ; & n’ayant point de territoire, ils auront autant de choses à régler par le droit des gens, qu’ils en auront peu à décider par le droit civil.
[II-184]
CHAPITRE XIII.
Des lois civiles chez les peuples qui ne cultivent point les terres.
C’est le partage des terres qui grossit principalement le code civil. Chez les nations où l’on n’aura pas fait ce partage, il y aura très-peu de lois civiles.
On peut appeller les institutions de ces peuples, des mœurs plutôt que des lois.
Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se souviennent des choses passées, ont une grande autorité ; on n’y peut être distingué par les biens, mais par la main & par les conseils.
Ces peuples errent & se dispersent dans les pâturages ou dans les forêts. Le mariage n’y sera pas aussi assuré que parmi nous, où il est fixé par la demeure, & où la femme tient à une maison ; ils peuvent donc plus aisément changer de femmes, en avoir plusieurs, & quelquefois se mêler indifféremment comme les bêtes.
Les peuples pasteurs ne peuvent se séparer de leurs troupeaux qui sont leur [II-185] subsistance ; ils ne sauroient non plus se séparer de leurs femmes qui en ont soin. Tout cela doit donc marcher ensemble ; d’autant plus que vivant ordinairement dans de grandes plaines, où il y a peu de lieux forts d’assiette, leurs femmes, leurs enfans, leurs troupeaux deviendroient la proie de leurs ennemis.
Leurs lois régleront le partage du butin ; & auront, comme nos lois saliques, une attention particuliere sur les vols.
[II-185]
CHAPITRE XIV.
De l’état politique des peuples qui ne cultivent point les terres.
Ces peuples jouissent d’une grande liberté : car, comme ils ne cultivent point les terres, ils n’y sont point attachés ; ils sont errans, vagabonds ; & si un chef vouloit leur ôter leur liberté, ils l’iroient d’abord chercher chez un autre, ou se retireroient dans les bois pour y vivre avec leur famille. Chez ces peuples, la liberté de l’homme est si grande, qu’elle entraîne nécessairement la liberté du citoyen.
[II-186]
CHAPITRE XV.
Des peuples qui connoissent l’usage de la monnoie.
Aristipe ayant fait naufrage, nagea & aborda au rivage prochain ; il vit qu’on avoit tracé sur le sable des figures de géométrie : il se sentit ému de joie, jugeant qu’il étoit arrivé chez un peuple Grec, & non pas chez un peuple barbare.
Soyez seul, & arrivez par quelque accident chez un peuple inconnu ; si vous voyez une piece de monnoie, comptez que vous êtes arrivé chez une nation policée.
La culture des terres demande l’usage de la monnoie. Cette culture suppose beaucoup d’arts & de connoissances ; & l’on voit toujours marcher d’un pas égal les arts, les connoissances & les besoins. Tout cela conduit à l’établissement d’un signe de valeurs.
Les torrens & les incendies [1] nous [II-187] ont fait découvrir que les terres contenoient des métaux. Quand ils en ont été une fois séparés, il a été aisé de les employer.
-
[↑] C’est ainsi que Diodore nous dit que des bergers trouverent l’or des Pyrénées.
[II-187]
CHAPITRE XVI.
Des lois civiles, chez les peuples qui ne connoissent point l’usage de la monnoie.
Quand un peuple n’a pas l’usage de la monnoie, on ne connoît guere chez lui que les injustices qui viennent de la violence ; & les gens foibles, en s’unissant, se défendent contre la violence. Il n’y a guere là que des arrangemens politiques. Mais chez un peuple ou la monnoie est établie, on est sujet aux injustices qui viennent de la ruse ; & ces injustices peuvent être exercées de mille façons. On y est donc forcé d’avoir de bonnes lois civiles ; elles naissent avec les nouveaux moyens & les diverses manieres d’être méchant.
Dans les pays où il n’y a point de monnoie, le ravisseur n’enleve que des choses ; & les choses ne se ressemblent jamais. Dans les pays où il y a de la monnoie, le ravisseur enleve des signes ; [II-188] & les signes se ressemblent toujours. Dans les premiers pays, rien ne peut être caché, parce que le ravisseur porte toujours avec lui des preuves de sa conviction : cela n’est pas de même dans les autres.
[II-188]
CHAPITRE XVII.
Des lois politiques, chez les peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie.
Ce qui assure le plus la liberté des peuples qui ne cultivent point les terres, c’est que la monnoie leur est inconnue. Les fruits de la chasse, de la pêche, ou des troupeaux, ne peuvent s’assembler en assez grande quantité, ni se garder assez, pour qu’un homme se trouve en état de corrompre tous les autres : au lieu que, lorsque l’on a des signes de richesses, on peut faire un amas de ces signes, & les distribuer à qui l’on veut.
Chez les peuples qui n’ont point de monnoie, chacun a peu de besoins, & les satisfait aisément & également. L’égalité est donc forcée ; aussi leurs chefs ne sont-ils point despotiques.
[II-189]
CHAPITRE XVIII.
Force de la superstition.
Si ce que les relations nous disent est vrai, la constitution d’un peuple de la Louisianne, nommé les Natchés, déroge à ceci. Leur chef [1] dispose des biens de tous ses sujets, & les fait travailler à sa fantaisie ; ils ne peuvent lui refuser leur tête ; il est comme le grand-seigneur. Lorsque l’héritier présomptif vient à naître, on lui donne tous les enfans à la mamelle, pour le servir pendant sa vie. Vous diriez que c’est le grand Sésostris. Ce chef est traité dans sa cabane avec les cérémonies qu’on feroit à un empereur du Japon ou de la Chine.
Les préjugés de la superstition sont supérieurs à tous les autres préjugés, & ses raisons à toutes les autres raisons. Ainsi, quoique les peuples sauvages ne connoissent point naturellement le despotisme, ce peuple-ci le connoît. Ils adorent le soleil : & si leur chef n’avoit pas imaginé qu’il étoit le frere du soleil, ils n’auroient trouvé en lui qu’un misérable comme eux.
-
[↑] Lettres édif. vingtieme recueil.
[II-190]
CHAPITRE XIX.
De la liberté des Arabes, & de la servitude des Tartares.
Les Arabes & les Tartares sont des peuples pasteurs. Les Arabes se trouvent dans les cas généraux dont nous avons parlé, & sont libres ; au lieu que les Tartares (peuple le plus singulier de la terre) se trouvent dans l’esclavage politique [1] . J’ai déjà [2] donné quelques raisons de ce dernier fait : en voici de nouvelles.
Ils n’ont point de villes, ils n’ont point de forêts, ils ont peu de marais ; leurs rivieres sont presque toujours glacées, ils habitent une immense plaine, ils ont des pâturages & des troupeaux, & par conséquent des biens : mais ils n’ont aucune espece de retraite ni de défense. Si-tôt qu’un kan est vaincu, on lui coupe la tête [3] ; on traite de la [II-191] même maniere ses enfans ; & tous ses sujets appartiennent au vainqueur. On ne les condamne pas à un esclavage civil ; ils seroient à charge à une nation simple, qui n’a point de terres à cultiver, & n’a besoin d’aucun service domestique. Ils augmentent donc la nation. Mais au lieu de l’esclavage civil, on conçoit que l’esclavage politique a dû s’introduire.
En effet, dans un pays où les diverses hordes se font continuellement la guerre & se conquierent sans cesse les unes les autres ; dans un pays où, par la mort du chef, le corps politique de chaque horde vaincue est toujours détruit, la nation en général ne peut guere être libre : car il n’y en a pas une seule partie qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois subjuguée.
Les peuples vaincus peuvent conserver quelque liberté, lorsque, par la force de leur situation, ils sont en état de faire des traités après leur défaite. Mais les Tartares toujours sans défense, vaincus une fois, n’ont jamais pu faire des conditions.
J’ai dit, au chapitre II, que les habitans des plaines cultivées n’étoient guere [II-192] libres : des circonstances font que les Tartares, habitant une terre inculte, sont dans le même cas.
-
[↑] Lorsqu’on proclame un kan, tout le peuple s’écrie : Que sa parole lui serve de glaive.
-
[↑] Liv. XVII. chap. V.
-
[↑] Ainsi il ne faut pas être étonné si Mirivéis, s’étant rendu maître d’Ispahan, fit tuer tous les princes du sang.
[II-192]
CHAPITRE XX.
Du droit des gens des Tartares.
Les Tartares paroissent entr’eux doux & humains ; & ils sont des conquérans très-cruels : ils passent au fil de l’épée les habitans des villes qu’ils prennent ; ils croient leur faire grace lorsqu’ils les vendent ou les distribuent à leurs soldats. Ils ont détruit l’Asie depuis les Indes jusqu’à la Méditerranée ; tout le pays qui forme l’orient de la Perse en est resté désert.
Voici ce qui me paroît avoir produit un pareil droit des gens. Ces peuples n’avoient point de villes ; toutes leurs guerres se faisoient avec promptitude & avec impétuosité. Quand ils espéroient de vaincre, ils combattoient ; ils augmentoient l’armée des plus forts, quand ils ne l’espéroient pas. Avec de pareilles coutumes, ils trouvoient qu’il étoit contre leur droit des gens, qu’une ville qui ne pouvoit leur résister les arrêtât.
[II-193] Ils ne regardoient pas les villes comme une assemblée d’habitans, mais comme des lieux propres à se soustraire à leur puissance. Ils n’avoient aucun art pour les assiéger, & ils s’exposoient beaucoup en les assiégeant ; ils vengeoient par le sang tout celui qu’ils venoient de répandre.
[II-193]
CHAPITRE XXI.
Loi civile des Tartares.
Le pere du Halde dit, que chez les Tartares, c’est toujours le dernier des mâles qui est l’héritier : par la raison qu’à mesure que les aînés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec une certaine quantité de bétail que le pere leur donne, & vont former une nouvelle habitation. Le dernier des mâles, qui reste dans la maison avec son pere, est donc son héritier naturel.
J’ai ouï dire qu’une pareille coutume étoit observée dans quelques petits districts d’Angleterre : & on la trouve encore en Bretagne, dans le duché de Rohan, où elle a lieu pour les rotures.
[II-194] C’est sans doute une loi pastorale venue de quelque petit peuple Breton, ou portée par quelque peuple Germain. On sait, par César & Tacite, que ces derniers cultivoient peu les terres.
[II-194]
CHAPITRE XXII.
D’une loi civile des peuples Germains.
J’expliquerai ici comment ce texte particulier de la loi salique que l’on appelle ordinairement la loi salique, tient aux institutions d’un peuple qui ne cultivoit point les terres, ou du moins qui les cultivoit peu.
La loi salique [1] veut que, lorsqu’un homme laisse des enfans, les mâles succedent à la terre salique au préjudice des filles.
Pour savoir ce que c’étoit que les terres saliques, il faut chercher ce que c’étoit que les propriétés ou l’usage des terres chez les Francs, avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.
M. Echard a très bien prouvé que le mot salique vient du mot sala, qui signifie maison ; & qu’ainsi la terre salique [II-195] étoit la terre de la maison. J’irai plus loin ; & j’examinerai ce que c’étoit que la maison, & la terre de la maison, chez les Germains.
« Ils n’habitent point de villes, dit Tacite [2] , & ils ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres ; chacun laisse autour de sa maison un petit terrain ou espace, qui est clos & fermé ». Tacite parloit exactement. Car plusieurs lois des codes [3] barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversoient cette enceinte, & ceux qui pénétroient dans la maison même.
Nous savons, par Tacite & César, que les terres que les Germains cultivoient ne leur étoient données que pour un an ; après quoi elles redevenoient publiques. Ils n’avoient de patrimoine que la maison, & un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison [4] .
[II-196] C’est ce patrimoine particulier qui appartenoit aux mâles. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles ? Elles passoient dans une autre maison.
La terre salique étoit donc cette enceinte qui dépendait de la maison du Germain ; c’étoit la seule propriété qu’il eût. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, & on continua à les appeler des terres saliques.
Lorsque les Francs vivoient dans la Germaine, leurs biens étoient des esclaves, des troupeaux, des chevaux, des armes, etc. La maison & la petite portion de terre qui y étoit jointe, étoient naturellement données aux enfans mâles qui devoient y habiter. Mais lorsqu’après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que les filles & leurs enfans ne pussent y avoir de part. Il s’introduisit un usage, qui permettoit au pere de rappeler sa fille & les enfans de sa fille. On fit taire la loi ; & il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu’on en fit des formules [5] .
[II-197]
Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singuliere [6] . Un aïeul rappelle ses petits-enfans pour succéder avec ses fils & avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique ? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée ; ou que l’usage continuel de rappeller les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.
La loi salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d’une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n’entroit point dans la tête des Germains. C’étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, & la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l’habiter, & à qui par conséquent elle convenoit le mieux.
Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des alleus de la loi salique, ce texte si fameux, dont tant de gens ont parlé, & que si peu de gens ont lu.
1.o « Si un homme meurt sans enfans, son pere ou sa mere lui succéderont. 2.o S’il n’a ni pere ni mere, son frere ou sa sœur lui succéderont.
[II-198] 3o. S’il n’a ni frere ni sœur, la sœur de sa mere lui succédera. 4o. Si sa mere n’a point de sœur, la sœur de son pere lui succédera. 5o. Si son pere n’a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6o. Aucune portion [7] de la terre salique ne passera aux femelles ; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire que les enfans mâles succéderont à leur pere ».
Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfans ; & le sixieme, la succession de celui qui a des enfans.
Lorsqu’un homme mouroit sans enfans, la loi vouloit qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles & des femelles étoient les mêmes ; dans le troisieme & le quatrieme, les femmes avoient la préférence ; & les mâles l’avoient dans le cinquieme.
Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfans [8] des [II-199] sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme de leur propre pere. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit & même plus saint ; ils le préferent, quand ils reçoivent des otages ». C’est pour cela que nos premiers historiens [9] nous parlent tant de l’amour des rois Francs pour leur sœur & pour les enfans de leur sœur. Que si les enfans des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfans même, il étoit naturel que les enfans regardassent leur tante comme leur propre mere.
La sœur de la mere étoit préférée à la sœur du pere ; cela s’explique par d’autres textes de la loi salique : Lorsqu’une femme étoit veuve [10] , elle tomboit sous la tutelle des parens de son mari ; la loi préféroit pour cette tutelle les parens par femmes aux parens par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les [II-200] personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parens par femmes, qu’avec les parens par mâle. De plus, quand un [11] homme en avoit tué un autre, & qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, & les parens devoient suppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c’étoit la sœur de la mere qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or la parente, qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.
La loi salique vouloit qu’après la sœur du pere, le plus proche parent par mâle eût la succession : mais s’il étoit parent au-delà du cinquieme degré, il ne succédoit pas. Ainsi une femme au cinquieme degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixieme : & cela se voit dans la loi [12] des Francs Ripuaires, fidelle interprete de la loi salique dans le titre des alleus, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.
Si le pere laissoit des enfans, la loi [II-201] salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, & qu’elle appartînt aux enfans mâles.
Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des freres les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderoient rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprete & se restreint elle-même : « c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du pere ».
2.o Le texte de la loi salique est éclairci par la loi des Francs Ripuaires, qui a aussi un titre [13] des alleus très-conforme à celui de la loi salique.
3.o Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interpretent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes à peu près le même esprit. La loi des Saxons [14] veut que le pere & la mere laissent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille ; mais [II-202] que s’il n’y a que des filles, elles ayent toute l’hérédité.
4.o Nous avons deux anciennes formules [15] qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles ; c’est lorsqu’elles concourent avec leur frere.
5.o Une autre formule [16] prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils ; elle n’étoit donc exclue que par le fils.
6.o Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d’expliquer les histoires, les formules & les chartres, qui parlent continuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race.
On a eu tort de dire [17] que les terres saliques étoient des fiefs. 1.o Ce titre est intitulé des alleus. 2.o Dans les commencemens, les fiefs n’étoient point héréditaires. 3.o Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d’impie la coutume qui excluoit les femmes d’y succéder, [II-203] puisque les mâles même ne succédoient pas aux fiefs ? 4.o Les chartres que l’on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu’elles étoient des terres franches. 5.o Les fiefs ne furent établis qu’après la conquête ; & les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6.o Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l’établissement des fiefs ; mais ce fut l’établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes & aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France put venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique [18] & la loi des Bourguignons [19] ne donnerent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs freres ; elles ne succéderent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths [20] au contraire [II-204] admit les filles [21] à succéder aux terres avec leurs freres ; les femmes furrent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força [22] la loi politique.
Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique chez les Francs céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les freres succédoient également à la terre ; & c’étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres succéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & usurpations près, chez les Bourguignons.
-
[↑] Tit. 62.
-
[↑] Nullas Germanorum populis urbes habitari sotis notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes ; colunt discreti, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis & cohærentibus ædificiis : suam quisque domum spatio circumdat. De morib. Germ.
-
[↑] La loi des Allemands, ch. X ; & la loi des Bavarois, tit. 10. §. 1 & 2.
-
[↑] Cette enceinte s’appelle curtis dans les chartres.
-
[↑] Voyez Marculfe, liv. II. form. 10 & 12 ; l’appendice de Marculfe, form. 49 ; & les formules anciennes, appellées de Sirmond, form. 22.
-
[↑] Form. 55, dans le recueil de Lindembroch.
-
[↑] De terrâ verò salicâ in mulierem nulla portis hæreditatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsâ hæreditate succedunt. Tit. 62. §. 6.
-
[↑] Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, & in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquàm ii & animum firmiùs & donum latius teneant. De morib. Germ.
-
[↑] Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VIII. ch. XVIII & XX ; liv. IX. ch. XVI & XX, les fureurs de Gontran sur les mêmes traitemens faits à Ingunde sa niece par Leuvigilde : & comme Childebert, son frere, fit la guerre pour la venger.
-
[↑] Loi salique, tit. 47.
-
[↑] Ibid. tit. 61. §. 1.
-
[↑] Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hæreditatem succedat. Tit. 56. § 6.
-
[↑] Tit. 56.
-
[↑] Tit. 7. §. 1. Pater aut mater defuncti, filio non filiæ hæreditatem relinquant. §. 4. Qui defunctus, non filios, sed filias reliquerit, ad eas omnis hæreditas pertineat.
-
[↑] Dans Marculfe, liv. II. form. 12 ; & dans l’appendice de Marculfe, form. 49.
-
[↑] Dans le recueil de Lindembroch, form. 55.
-
[↑] Du Cange, Pithou, etc.
-
[↑] Tit. 62.
-
[↑] Tit. i. §. 3. tit. 14. §. 1. & tit. 51.
-
[↑] Liv. IV. tit. 2. §. 1.
-
[↑] Les nations Germaines dit Tacite, avoient des usages communs ; elles en avoient aussi de particuliers.
-
[↑] La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles ; l’une par Amalasunthe, dans la personne d’Athalarie ; & l’autre, par Amalafrede, dans la personne de Théodat. Ce n’est pas que, chez eux, les femmes ne pussent régner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d’Athalarie, régna, & régna même après l’élection de Théodat & concurremment avec lui. Voyez les lettres d’Amalasunthe & de Théodat, dans Cassiodore, liv. X.
[II-205]
CHAPITRE XXIII.
De la longue chevelure des Rois Francs.
Les peuples qui ne cultivent point les terres, n’ont pas même l’idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l’admirable simplicité des peuples Germains ; les arts ne travailloient point à leurs ornemens, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c’étoit dans cette même nature qu’ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons & des Wisigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.
[II-205]
CHAPITRE XXIV.
Des mariages des Rois Francs.
J’ai dit ci-dessus que chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, & qu’on y prenoit ordinairement plusieurs femmes. « Les Germains étoient presque les seuls [1] de tous les [II-206] barbares qui se contentassent d’une seule femme, si l’on en excepte [2] , dit Tacite, quelques personnes qui, non par dissolution, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs. »
Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d’incontinence, qu’un attribut de dignité : c’eût été les blesser dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative [3] . Cela explique comment l’exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.
-
[↑] Propè soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De morib. Germ.
-
[↑] Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid.
-
[↑] Voyez la chronique de Frédégaire, sur l’an 628.
[II-206]
CHAPITRE XXV.
Childéric.
« Les mariages chez les Germains sont séveres [1] , dit Tacite : les vices n’y sont point un sujet de ridicule : corrompre, ou être corrompu, [II-207] ne s’appelle point un usage ou une maniere de vivre : il y a peu d’exemples [2] dans une nation si nombreuse de la violation de la foi conjugale ».
Cela explique l’expulsion de Childéric : il choquoit des mœurs rigides, que la conquête n’avoit pas eu le temps de changer.
-
[↑] Severa matrimonia… Nemo illic vitia ridet ; nec corrumpere & corrumpi sæculum vocatur. De Moribus Germ.
-
[↑] Paucissima in tam numerosâ gente adulteria. Ibid.
[II-207]
CHAPITRE XXVI.
De la majorité des Rois Francs.
Les peuples barbares qui ne cultivent point les terres, n’ont point proprement de territoire ; & sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il « que les Germains [1] ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés ». Ils donnoient leur avis [2] par un signe qu’ils faisoient avec leurs [II-208] armes [3] . Si-tôt qu’ils pouvoient les porter, ils étoient présentés à l’assemblée ; on leur mettoit dans les mains un javelot [4] : dès ce moment, ils sortoient de l’enfance [5] ; ils étoient une part de la famille, ils en devenoient une de la république.
« Les aigles, disoit [6] le roi des Ostrogoths, cessent de donner la nourriture à leurs petits, si-tôt que leurs plumes & leurs ongles sont formés ; ceux-ci n’ont plus besoin du secours d’autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher une proie. Il seroit indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armées fussent censés être dans un âge trop foible pour régir leur bien, & pour régler la conduite de leur vie. C’est la vertu qui fait la majorité chez les Goths ».
Childebert II. avoit quinze [7] ans, [II-209] lorsque Gontran son oncle le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit dans la loi des Ripuaires cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. « Si un Ripuaire est mort, ou a été tué, y est-il dit [8] , & qu’il ait laissé un fils, il ne pourra poursuivre, ni être poursuivi en jugement, qu’il n’ait quinze ans complets ; pour lors il répondra lui-même, ou choisira un champion ». Il falloit que l’esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, & que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons [9] , qui avoient aussi l’usage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore a quinze ans.
Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres ; ils pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes ; & elles l’étoient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires & par nos romans. Ceux qui [10] avoient des fiefs, & qui par [II-210] conséquent devoient faire le service militaire, ne furent plus majeurs qu’à vingt-un ans [11] .
-
[↑] Nihil neque publicæ, neque privatæ rei, nisi armati agunt. Tacite, de morib. Germ.
-
[↑] Si displicuit sententia, aspernantur ; sin placuit, frameas concutiunt. Ibid.
-
[↑] Sed arma sumere non ante cuiquam moris quàm civitas suffecturum probaverit.
-
[↑] Tam in ipso concilia, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquas, scuto, frameáque juvenem ornant.
-
[↑] Hæc apud illos toga, hic primus juventæ honos ; ante hoc domni pars videntur, mox reipublicæ.
-
[↑] Théodoric, dans Cassiodorus, liv. I. lett. 38.
-
[↑] Il avoit à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V. ch. I. lorsqu’il succéda à son pere, en l’an 575 ; c’est-à-dire, qu’il avoit cinq ans. Gontrand le déclara majeur en l’an 585 : il avoit donc quinze ans.
-
[↑] Tit. 81.
-
[↑] Tit. 87.
-
[↑] Il n’y eut point de changement pour les roturiers.
-
[↑] Saint Louis ne fut majeur qu’à cet âge. Cela changea par un édit de Charles V. de l’an 1374.
[II-210]
CHAPITRE XXVII.
Continuation du même sujet.
On a vu que, chez les Germains, on n’alloit point à l’assemblée avant la majorité ; on étoit partie de la famille, & non pas de la république. Cela fit que les enfans de Clodomir, roi d’Orléans & conquérant de la Bourgogne, ne furent point déclarés rois ; parce que, dans l’âge tendre où ils étoient, ils ne pouvoient pas être présentés à l’assemblée. Ils n’étoient pas rois encore, mais ils devoient l’être lorsqu’ils seroient capables de porter les armes ; & cependant Clotilde leur aïeule gouvernoit l’état [1] . Leurs oncles Clotaire & Childebert les égorgerent, & partagerent leur royaume. Cet exemple [II-211] fut cause que dans la suite les princes pupilles furent déclarés rois, d’abord après la mort de leurs peres. Ainsi le duc Gondovalde sauva Childebert II. de la cruauté de Chilpéric, & le fit déclarer roi [2] à l’âge de cinq ans.
Mais dans ce changement même, on suivit le premier esprit de la nation ; de sorte que les actes ne se passoient pas même au nom des rois pupilles. Aussi y eut-il chez les Francs une double administration ; l’une, qui regardoit la personne du roi pupille ; & l’autre, qui regardoit le royaume ; & dans les fiefs, il y eut une différence entre la tutelle & la baillie.
-
[↑] Il paroît par Grégoire de Tours, liv. III. qu’elle choisit deux hommes de Bourgogne, qui étoit une conquête de Clodomir, pour les élever au siege de Tours, qui étoit aussi du royaume de Clodomir.
-
[↑] Grégoire de Tours, liv. V. chap. I. Vix lustro ætatis uno jam peracto qui die dominicæ Natalis regnare cœpit.
[II-211]
CHAPITRE XXVIII.
De l’adoption chez les Germains.
Comme chez les Germains on devenoit majeur en recevant les armes, on étoit adopté par le même signe. Ainsi Gontran voulant déclarer majeur son neveu Childebert, & de plus [II-212] l’adopter, il lui dit : « J’ai mis [1] ce javelot dans tes mains, comme un signe que je t’ai donné mon royaume. » Et se tournant vers l’assemblée : « Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme ; obéissez-lui. » Théodoric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit [2] : « C’est une belle chose parmi nous, de pouvoir être adopté par les armes : car les hommes courageux sont les seuls qui méritent de devenir nos enfans. Il y a une telle force dans cet acte, que celui qui en est l’objet, aimera toujours mieux mourir, que de souffrir quelque chose de honteux. Ainsi, par la coutume des nations, & parce que vous êtes un homme, nous vous adoptons par ces boucliers, ces épées, ces chevaux, que nous vous envoyons. »
[II-213]
CHAPITRE XXIX.
Esprit sanguinaire des Rois Francs.
Clovis n’avoit pas été le seul des princes chez les Francs, qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules ; plusieurs de ses parens y avoient mené des tribus particulieres : & comme il y eut de plus grands succès, & qu’il put donner des établissemens considérables à ceux qui l’avoient suivi, les Francs accoururent à lui de toutes les tribus, & les autres chefs se trouverent trop foibles pour lui résister. Il forma le dessein d’exterminer toute sa maison, & il y réussit [1] . Il craignoit, dit Grégoire de Tours [2] , que les Francs ne prissent un autre chef. Ses enfans & ses successeurs suivirent cette pratique autant qu’ils purent : on vit sans cesse le frere, l’oncle, le neveu, que dis-je ? le fils, le pere, conspirer contre toute sa famille. La loi séparoit sans cesse la monarchie ; la crainte, l’ambition & la cruauté vouloient la réunir.
[II-214]
CHAPITRE XXX.
Des assemblées de la nation chez les Francs.
On a dit ci-dessus, que les peuples qui ne cultivent point les terres, jouissoient d’une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu’ils ne donnoient à leurs rois ou chefs qu’un pouvoir très-modéré [1] ; & César [2] , qu’ils n’avoient pas de magistrat commun pendant la paix, mais que dans chaque village les princes rendoient la justice entre les leurs. Aussi les Francs dans la Germanie n’avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours [3] le prouve très-bien.
« Les princes [4] , dit Tacite, déliberent sur les petites choses, toute la [II-215] nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance, sont portées de même devant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme [5] on le voit dans tous les monumens.
Tacite [6] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, & les grands vassaux y furent jugés.
-
[↑] Nec Regibus libera aut infinita potestas. Ceterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, &c. De Morib. Germ.
-
[↑] In pace nullus est communis magistratus ; sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt. De bello Gall. lib. VI.
-
[↑] Liv. II.
-
[↑] De minoribus principes consultant, de majoribus omnes ; ità tamen ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur. De morib. Germ.
-
[↑] Lex consensu populi fit & constitutione regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an 864. art 6.
-
[↑] Licet apud concilium accusare & discrimen capitis intendere. De morib. Germ.
[II-215]
CHAPITRE XXXI.
De l’autorité du clergé dans la premiere race.
Chez les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils [II-216] mettoient la police [1] dans l’assemblée du peuple. Il n’étoit permis qu’à [2] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient, non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine, mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre,
Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres [3] des jugemens, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois, & si on leur donne tant de biens.
-
[↑] Silentium per Sacerdotes, quibus & coercendi jus est, imperatur. De morib. Germ.
-
[↑] Nec regibus libera aut infinita potestas. Ceterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid.
-
[↑] Voyez la constitution de Clotaire de l’an 560, article 6.
[II-217]
LIVRE XIX.
Des Lois, dans le rapport quelles ont avec les principes qui forment l’esprit général, les mœurs & les manieres d’une nation.↩
CHAPITRE PREMIER.
Du sujet de ce livre.
Cette maniere est d’une grande étendue. Dans cette foule d’idées qui se présentent à mon esprit, je serai plus attentif à l’ordre des choses, qu’aux choses mêmes. Il faut que j’écarte à droite & à gauche, que je perce, & que je me fasse jour.
[II-218]
CHAPITRE II.
Combien, pour les meilleures lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés.
Rien ne parut plus insupportable aux Germains [1] que le tribunal de Varus. Celui que Justinien érigea [2] chez les Laziens, pour faire le procès au meurtrier de leur Roi, leur parut une chose horrible & barbare. Mithridate [3] haranguant contre les Romains, leur reproche sur-tout les formalités [4] de leur justice. Les Parthes ne purent supporter ce Roi, qui ayant été élevé à Rome, se rendit affable [5] & accessible à tout le monde. La liberté même a paru insupportable à des peuples qui n’étoient pas accoutumés à en jouir. C’est ainsi qu’un air pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu dans des pays marécageux.
Un Vénitien nommé Baldi, étant [II-219] au [6] Pégu, fut introduit chez le roi. Quand celui-ci apprit qu’il n’y avoit point de roi à Venise, il fit un si grand éclat de rire, qu’une toux le prit, & qu’il eut beaucoup de peine à parler à ses courtisans. Quel est le législateur qui pourroit proposer le gouvernement populaire à des peuples pareils ?
-
[↑] Ils coupoient la langue aux avocats, & disoient : Vipere, cesse de siffler. Tacite.
-
[↑] Agathias, liv. IV.
-
[↑] Justin, liv. XXXVIII.
-
[↑] Columnias litium. Ibid.
-
[↑] Prompti aditus, nova comitas, ingnotæ Parthis virtutes, nova vitia. Tacite.
-
[↑] Il en a fait la description en 1596. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, Tom. III. part. I. p. 33.
[II-219]
CHAPITRE III.
De la tyrannie.
Il y a deux sortes de tyrannie ; une réelle, qui consiste dans la violence du gouvernement ; & une d’opinion, qui se fait sentir lorsque ceux qui gouvernent établissent des choses qui choquent la maniere de penser d’une nation.
Dion dit qu’Auguste voulut se faire appeler Romulus ; mais qu’ayant appris que le peuple craignoit qu’il ne voulût se faire roi, il changea de dessein. Les premiers Romains ne voulurent point de roi, parce qu’ils n’en pouvoient [II-220] souffrir la puissance : les Romains d’alors ne vouloient point de roi, pour n’en point souffrir les manieres. Car, quoique César, les Triumvirs, Auguste, fussent de véritables rois, ils avoient gardé tout l’extérieur de l’égalité, & leur vie privée contenoit une espece d’opposition avec le faste des rois d’alors : & quand ils ne vouloient point de roi, cela signifioit qu’ils vouloient garder leurs manieres, & ne pas prendre celles des peuples d’Afrique & d’Orient.
Dion [1] nous dit que le peuple Romain étoit indigné contre Auguste, à cause de certaines lois trop dures qu’il avoit faites : mais que si-tôt qu’il eut fait revenir le comédien Pylade que les factions avoient chassé de la ville, le mécontentement cessa. Un peuple pareil sentoit plus vivement la tyrannie lorsqu’on chassoit un baladin, que lorsqu’on lui ôtoit toutes ses lois.
-
[↑] Liv. LIV. pag. 532.
[II-221]
CHAPITRE IV.
Ce que c’est que l’esprit général.
Plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manieres ; d’où il se forme un esprit général qui en résulte.
À mesure que dans chaque nation une de ces causes agit avec plus de force, les autres lui cedent d’autant. La nature & le climat dominent presque seul sur les sauvages ; les manieres gouvernent les Chinois ; les lois tyrannisent le Japon ; les mœurs donnoient autrefois le ton dans Lacédémone ; les maximes du gouvernement & les mœurs anciennes le donnoient dans Rome.
[II-222]
CHAPITRE V.
Combien il faut être attentif à ne point changer l’esprit général d’une nation.
S’il y avoit dans le monde une nation qui est une humeur sociable, une ouverture de cœur, une joie dans la vie, un goût, une facilité à communiquer ses pensées, qui fut vive, agréable, enjouée, quelquefois imprudente, souvent indiscrete ; & qui eût avec cela du courage, de la générosité, de la franchise, un certain point d’honneur ; il ne faudroit point chercher à gêner par les lois ses manieres, pour ne point gêner ses vertus. Si en général le caractere est bon, qu’importe de quelques défauts qui s’y trouvent ?
On y pourroit contenir les femmes, faire des lois pour corriger leurs mœurs & borner leur luxe : mais qui sait si on n’y perdroit pas un certain goût, qui seroit la source des richesses de la nation, & une politesse qui attire chez elle les étrangers ?
C’est au législateur à suivre l’esprit de la nation, lorsqu’il n’est pas contraire [II-223] aux principes du gouvernement ; car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement, & en suivant notre génie naturel.
Qu’on donne un esprit de pédanterie à une nation naturellement gaie, l’état n’y gagnera rien, ni pour le dedans, ni pour le dehors. Laissez-lui faire les choses frivoles sérieusement, & gaiement les choses sérieuses.
[II-223]
CHAPITRE VI.
Qu’il ne faut pas tout corriger.
Qu’on nous laisse comme nous sommes, disoit un gentilhomme d’une nation qui ressemble beaucoup à celle dont nous venons de donner une idée. La nature répare tout. Elle nous a donné une vivacité capable d’offenser, & propre à nous faire manquer à tous les égards ; cette même vivacité est corrigée par la politesse qu’elle nous procure, en nous inspirant du goût pour le monde, & sur-tout pour le commerce des femmes.
Qu’on nous laisse tels que nous sommes. Nos qualités indiscrettes, jointes à [II-224] notre peu de malice, sont que les lois qui gêneroient l’humeur sociable parmi nous, ne seroient point convenables.
[II-224]
CHAPITRE VII.
Des Athéniens & des Lacédémoniens.
Les Athéniens, continuoit ce gentilhomme, étoient un peuple qui avoit quelque rapport avec le nôtre. Il mettoit de la gaieté dans les affaires ; un trait de raillerie lui plaisoit sur la tribune comme sur le théâtre. Cette vivacité qu’il mettoit dans les conseils, il la portoit dans l’exécution. Le caractere des Lacédémoniens étoit grave, sérieux, sec, taciturne. On n’auroit pas plus tiré parti d’un Athénien en l’ennuyant, que d’un Lacédémonien en le divertissant.
[II-224]
CHAPITRE VIII.
Effets de l’humeur sociable.
Plus les peuples se communiquent, plus ils changent aisément de manieres, parce que chacun est plus un spectacle pour un autre ; on voit mieux [II-225] les singularités des individus. Le climat qui fait qu’une nation aime à se communiquer, fait aussi qu’elle aime à changer ; & ce qui fait qu’une nation aime à changer, fait aussi qu’elle se forme le goût.
La société des femmes gâte les mœurs, & forme le goût : l’envie de plaire plus que les autres, établit les parures ; & l’envie de plaire plus que soi-même, établit les modes. Les modes sont un objet important : à force de se rendre l’esprit frivole, on augmente sans cesse les branches de son commerce [1] .
-
[↑] Voyez la fable des abeilles.
[II-225]
CHAPITRE IX.
De la vanité & de l’orgueil des nations.
La vanité est un aussi bon ressort pour un gouvernement, que l’orgueil en est un dangereux. Il n’y a pour cela qu’à se représenter, d’un côté, les biens sans nombre qui résultent de la vanité ; de là le luxe, l’industrie, les arts, les modes, la politesse, le goût : & d’un autre côté, les maux infinis qui naissent de l’orgueil de certaines nations ; [II-226] la paresse, la pauvreté, l’abandon de tout, la destruction des nations que le hasard a fait tomber entre leurs mains, & de la leur même. La paresse [1] est l’effet de l’orgueil ; le travail est une fuite de la vanité : L’orgueil d’un Espagnol le portera à ne pas travailler ; la vanité d’un François le portera à savoir travailler mieux que les autres.
Toute nation paresseuse est grave ; car ceux qui ne travaillent pas se regardent comme souverains de ceux qui travaillent.
Examinez toutes les nations ; & vous verrez que, dans la plupart, la gravité, l’orgueil & la paresse marchent du même pas.
Les peuples d’Achim [2] sont fiers & paresseux : ceux qui n’ont point d’esclaves en louent un, ne fût-ce que pour faire cent pas, & porter deux pintes de riz ; ils se croiroient déshonorés s’ils les portoient eux-mêmes.
[II-227]
Il y a plusieurs endroits de la terre où l’on se laisse croître les ongles, pour marquer que l’on ne travaille point.
Les femmes des Indes [3] croient qu’il est honteux pour elles d’apprendre à lire : c’est l’affaire, disent-elles, des esclaves qui chantent des cantiques dans les pagodes. Dans une caste, elles ne filent point ; dans une autre, elles ne font que des paniers & des nattes, elles ne doivent pas même piler le riz ; dans d’autres, il ne faut pas qu’elles aillent querir de l’eau. L’orgueil y a établi ses regles, & il les fait suivre. Il n’est pas nécessaire de dire que les qualités morales ont des effets différens, selon qu’elles sont unies à d’autres : ainsi l’orgueil, joint à une vaste ambition, à la grandeur des idées, etc. produisit chez les Romains les effets que l’on sait.
-
[↑] Les peuples qui suivent le Kan de Malacamber, ceux de Carnataca & de Coromandel, sont des peuples orgueilleux & paresseux ; ils consomment peu, parce qu’ils sont misérables : au lieu que les Mogols & les peuples de l’Indostan s’occupent & jouissent des commodités de la vie, comme les Européens. Recueil des voyages qui ont servi a l’établissement de la compagnie des Indes, tom. I. pag. 54.
-
[↑] Voyez Dampierre, tome III.
-
[↑] Lettres édif. douzieme recueil, p. 80.
[II-228]
CHAPITRE X.
Du caractere des Espagnols, & de celui des Chinois.
Les divers caracteres des nations sont mêlés de vertus & de vices, de bonnes & de mauvaises qualités. Les heureux mélanges sont ceux dont il résulte de grands biens, & souvent on ne les soupçonneroit pas ; il y en a dont il résulte de grands maux, & qu’on ne soupçonneroit pas non plus.
La bonne foi des Espagnols a été fameuse dans tous les temps. Justin [1] nous parle de leur fidélité à garder les dépôts ; ils ont souvent souffert la mort pour les tenir secrets. Cette fidélité qu’ils avoient autrefois, ils l’ont encore aujourd’hui. Toutes les nations qui commercent à Cadix, confient leur fortune aux Espagnols, elles ne s’en sont jamais repenties. Mais cette qualité admirable, jointe à leur paresse, forme un mélange dont il résulte des effets qui leur sont pernicieux : les peuples de l’Europe font sous leurs yeux tout le commerce de leur monarchie.
[II-229]
Le caractere des Chinois forme un autre mélange, qui est en contraste avec le caractere des Espagnols. Leur vie précaire [2] fait qu’ils ont une activité prodigieuse, & un désir si excessif du gain, qu’aucune nation commerçante ne peut se fier à eux [3] . Cette infidélité reconnue leur a conservé le commerce du Japon ; aucun négociant d’Europe n’a osé entreprendre de le faire sous leur nom, quelque facilité qu’il y eût à l’entreprendre par leurs provinces maritimes du nord.
[II-229]
CHAPITRE XI.
Réflexions.
Je n’ai point dit ceci pour diminuer rien de la distance infinie qu’il y a entre les vices & les vertus : à Dieu ne plaise ! J’ai seulement voulu faire comprendre que tous les vices politiques ne sont pas des vices moraux, & que tous les vices moraux ne sont pas des vices politiques ; & c’est ce que ne doivent point ignorer ceux qui font des lois qui choquent l’esprit général.
[II-230]
CHAPITRE XII.
Des manieres & des mœurs dans l’état despotique.
C’est une maxime capitale, qu’il ne faut jamais changer les mœurs & les manieres dans l’état despotique ; rien ne seroit plus promptement suivi d’une révolution. C’est que dans ces états il n’y a point de lois, pour ainsi dire : il n’y a que des mœurs & des manieres : & si vous renversez cela, vous renversez tout.
Les lois sont établies, les mœurs sont inspirées ; celles-ci tiennent plus à l’esprit général, celles-là tiennent plus à une institution particuliere : or il est aussi dangereux, & plus, de renverser l’esprit général, que de changer une institution particuliere.
On se communique moins dans les pays où chacun, & comme supérieur & comme inférieur, exerce & souffre un pouvoir arbitraire, que dans ceux où la liberté regne dans toutes les conditions. On y change donc moins de manieres & de mœurs ; les manieres plus fixes [II-231] approchent plus des lois : ainsi il faut qu’un prince ou un législateur y choque moins les mœurs & les manieres que dans aucun pays du monde.
Les femmes y sont ordinairement enfermées, & n’ont point de ton à donner. Dans les autres pays où elles vivent avec les hommes, l’envie qu’elles ont de plaire, & le désir que l’on a de leur plaire aussi, font que l’on change continuellement de manieres. Les deux sexes se gâtent, ils perdent l’un & l’autre leur qualité distinctive & essentielle ; il se met un arbitraire dans ce qui étoit absolu, & les manieres changent tous les jours.
[II-231]
CHAPITRE XIII.
Des manieres chez les Chinois.
Mais c’est à la Chine que les manieres sont indestructibles. Outre que les femmes y sont absolument séparées des hommes, on enseigne dans les écoles les manieres comme les mœurs. On connoît un lettré [1] à la façon aisée dont il fait la révérence. Ces choses une [II-232] fois données en préceptes & par de graves docteurs, s’y fixent comme des principes de morale, & ne changent plus.
-
[↑] dit le Pere du Halde.
[II-232]
CHAPITRE XIV.
Quels sont les moyens naturels de changer les mœurs & les manieres d’une nation.
Nous avons dit que les lois étoient des institutions particulieres & précises du législateur, & les mœurs & les manieres des institutions de la nation en général. De là il suit que, lorsque l’on veut changer les mœurs & les manieres, il ne faut pas les changer par les lois ; cela paroîtroit trop tyrannique : il vaut mieux les changer par d’autres mœurs & d’autres manieres.
Ainsi, lorsqu’un prince veut faire de grands changemens dans sa nation, il faut qu’il réforme par les lois ce qui est établi par les lois, & qu’il change par les manieres ce qui est établi par les manieres : & c’est une très-mauvaise politique, de changer par les lois ce qui doit être changé par les manieres.
La loi qui obligeoit les Moscovites à se faire couper la barbe & les habits, & [II-233] la violence de Pierre I, qui faisoit tailler jusqu’aux genoux les longues robes de ceux qui entroient dans les villes, étoient tyranniques. Il y a des moyens pour empêcher les crimes, ce sont les peines : il y en a pour faire changer les manieres, ce sont les exemples.
La facilité & la promptitude avec laquelle cette nation s’est policée, a bien montré que ce prince avoit trop mauvaise opinion d’elle ; & que ces peuples n’étoient pas des bêtes, comme il le disoit. Les moyens violens qu’il employa étoient inutiles ; il seroit arrivé tout de même à son but par la douceur.
Il éprouva lui-même la facilité de ces changemens. Les femmes étoient renfermées, & en quelques façons esclaves ; il les appella à la cour, il les fit habiller à l’Allemande, il leur envoyoit des étoffes. Ce sexe goûta d’abord une façon de vivre qui flattoit si fort son goût, sa vanité & ses passions, & la fit goûter aux hommes.
Ce qui rendit le changement plus aisé, c’est que les mœurs d’alors étoient étrangeres au climat, & y avoient été apportées par le mélange des nations & par les conquêtes. Pierre I, donnant les [II-234] mœurs & les manieres de l’Europe à une nation d’Europe, trouva des facilités qu’il n’attendoit pas lui-même. L’empire du climat est le premier de tous les empires. Il n’avoit donc pas besoin de lois pour changer les mœurs & les manieres de sa nation ; il lui eût suffi d’inspirer d’autres mœurs & d’autres manieres.
En général, les peuples sont très-attachés à leurs coutumes ; les leur ôter violemment ; c’est les rendre malheureux : il ne faut donc pas les changer, mais les engager à les changer eux-mêmes.
Toute peine qui ne dérive pas de la nécessite est tyrannique. La loi n’est pas un pur acte de puissance ; les choses indifférentes par leur nature ne sont pas son ressort.
[II-234]
CHAPITRE XV.
Influence du gouvernement domestique sur le politique.
Ce changement des mœurs des femmes influera sans doute beaucoup dans le gouvernement de Moscovie.
[II-235] Tout est extrêmement lié : le despotisme du prince s’unit naturellement avec la servitude des femmes ; la liberté des femmes avec l’esprit de la monarchie.
[II-235]
CHAPITRE XVI.
Comment quelques législateurs ont confondu les principes qui gouvernent les hommes.
Les mœurs & les manieres sont des usages que les lois n’ont point établis, ou n’ont pas pu, ou n’ont pas voulu établir.
Il y a cette différence entre les lois & les mœurs, que les lois reglent plus les actions du citoyen, & que les mœurs reglent plus les actions de l’homme. Il y a cette différence entre les mœurs & les manieres, que les premieres regardent plus la conduite intérieure, les autres l’extérieure.
Quelquefois, dans un état, ces choses [1] se confondent. Lycurgue fit un même code pour les lois, les mœurs & [II-236] les manieres ; & les législateurs de la Chine en firent de même.
Il ne faut pas être étonné si les législateurs de Lacédémone & de la Chine confondirent les lois, les mœurs & les manieres : c’est que les mœurs représentent les lois, & les manieres représentent les mœurs.
Les législateurs de la Chine avoient pour principal objet de faire vivre leur peuple tranquille. Ils voulurent que les hommes le respectassent beaucoup ; que chacun sentît à tous les instans qu’il devoit beaucoup aux autres, qu’il n’y avoit point de citoyen qui ne dépendît à quelqu’égard d’un autre citoyen : Ils donnerent donc aux regles de la civilité la plus grande étendue.
Ainsi, chez les peuples Chinois on vit les gens [2] de village observer entr’eux des cérémonies comme les gens d’une condition relevée : moyen très-propre à inspirer la douceur, à maintenir parmi le peuple la paix & le bon ordre, & à ôter tous les vices qui viennent d’un esprit dur. En effet, s’affranchir des regles de la civilité, n’est-ce pas chercher le moyen de mettre ses défauts plus à l’aise ? [II-237]
La civilité vaut mieux à cet égard que la politesse. La politesse flatte les vices des autres, & la civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour : c’est une barriere que les hommes mettent entr’eux pour s’empêcher de se corrompre.
Lycurgue, dont les institutions étoient dures, n’eut point la civilité pour objet lorsqu’il forma les manieres ; il eut en vue cet esprit belliqueux qu’il vouloit donner à son peuple. Des gens toujours corrigeans, ou toujours corrigés, qui instruisoient toujours, & étoient toujours instruits, également simples & rigides, exerçoient plutôt entr’eux des vertus qu’ils n’avoient des égards.
-
[↑] Moïse fit un même code pour les lois & la religion. Les premiers Romains confondirent les coutumes anciennes avec les lois.
-
[↑] Voyez le Pere du Halde
[II-237]
CHAPITRE XVII.
Propriété particuliere au gouvernement de la Chine.
Les législateurs de la Chine firent plus [1] : ils confondirent la religion, les lois, les mœurs & les manieres ; tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Les préceptes qui regardoient [II-238] ces quatre points, furent ce que l’on appela les rites. Ce fut dans l’observation exacte de ces rites, que le gouvernement Chinois triompha. On passa toute sa jeunesse à les apprendre, toute sa vie à les pratiquer. Les lettres les enseignerent, les magistrats les prêcherent. Et comme ils enveloppoient toutes les petites actions de la vie, lorsqu’on trouva le moyen de les faire observer exactement, la Chine fut bien gouvernée.
Deux choses ont pu aisément graver les rites dans le cœur & l’esprit des Chinois ; l’une, leur maniere d’écrire extrêmement composée, qui a fait que, pendant une très-grande partie de la vie, l’esprit a été uniquement [2] occupé de ces rites, parce qu’il a fallu apprendre à lire dans les livres, & pour les livres qui les contenoient ; l’autre, que les préceptes des rites n’ayant rien de spirituel, mais simplement des regles d’une pratique commune, il est plus aisé d’en convaincre & d’en frapper les esprits, que d’une chose intellectuelle.
Les princes qui, au lieu de gouverner par les rites, gouvernerent par la [II-239] force des supplices, voulurent faire faire aux supplices ce qui n’est pas dans leur pouvoir, qui est de donner des mœurs. Les supplices retrancheront bien de la société un citoyen qui, ayant perdu ses mœurs, viole les lois : mais si tout le monde a perdu les mœurs, les rétabliront-ils ? Les supplices arrêteront bien plusieurs conséquences du mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal. Aussi quand on abandonna les principes du gouvernement Chinois, quand la morale y fut perdue, l’état tomba-t-il dans l’anarchie, & on vit des révolutions.
-
[↑] Voyez les livres classiques, dont le P. du Halde nous a donné de si beaux morceaux.
-
[↑] C’est ce qui a établi l’émulation, la fuite de l’oisiveté & l’estime pour le savoir.
[II-239]
CHAPITRE XVIII.
Conséquence du chapitre précédent.
Il résulte de là que la Chine ne perd point ses lois par la conquête. Les manieres, les mœurs, les lois, la religion y étant la même chose, on ne peut changer tout cela à la fois. Et comme il faut que le vainqueur ou le vaincu changent, il a toujours fallu à la Chine que ce fût le vainqueur : car ses mœurs n’étant point ses manieres, ses manieres ses lois, ses lois sa religion, il a été plus [II-240] aisé qu’il se pliât peu à peu au peuple vaincu, que le peuple vaincu à lui.
Il suit encore de là une chose bien triste : c’est qu’il n’est presque pas possible que le Christianisme s’établisse jamais à la Chine [1] . Les vœux de virginité, les assemblées des femmes dans les églises, leur communication nécessaire avec les ministres de la religion, leur participation aux sacremens, la confession auriculaire, l’extrême-onction, le mariage d’une seule femme ; tout cela renverse les mœurs & les manieres du pays, & frappe encore du même coup sur la religion & sur les lois.
La religion chrétienne, par l’établissement de la charité, par un culte public, par la participation aux mêmes sacremens, semble demander que tout s’unisse : les rites des Chinois semblent ordonner que tout se sépare.
Et comme on a vu que cette séparation [2] tient en général à l’esprit du despotisme, on trouvera dans ceci une des raisons qui font que le [II-241] gouvernement monarchique & tout gouvernement modéré s’allient mieux [3] avec la religion chrétienne.
-
[↑] Voyez les raisons données par les magistrats Chinois, dans les décrets par lesquels ils proscrivent la religion Chrétienne. Let. édif. dix-septieme recueil.
-
[↑] Voyez le liv. IV. chap. iii ; & le liv. XIX. chap. xii.
-
[↑] Voyez ci-après le liv. XXIV. ch. III
[II-241]
CHAPITRE XIX.
Comment s’est faite cette union de la religion, des lois, des mœurs & des manieres, chez les Chinois.
Les législateurs de la Chine eurent pour principal objet du gouvernement la tranquillité de l’empire. La subordination leur parut le moyen le plus propre à la maintenir. Dans cette idée, ils crurent devoir inspirer le respect pour les peres, & ils rassemblerent toutes leurs forces pour cela. Ils établirent une infinité de rites & de cérémonies, pour les honorer pendant leur vie & après leur mort. Il étoit impossible de tant honorer les peres morts, sans être porté à les honorer vivans. Les cérémonies pour les peres morts avoient plus de rapport à la religion ; celles pour les peres vivans avoient plus de rapport aux lois, aux mœurs & aux manieres ; mais ce n’étoit que les parties d’un [II-242] même code, & ce code étoit très-étendu.
Le respect pour les peres étoit nécessairement lié avec tout ce qui représentoit les peres, les vieillards, les maîtres, les magistrats, l’empereur. Ce respect pour les peres supposoit un retour d’amour pour les enfans ; & par conséquent le même retour des vieillards aux jeunes gens, des magistrats à ceux qui leur étoient soumis, de l’empereur à ses sujets. Tout cela formoit les rites, & ces rites l’esprit général de la nation.
On va sentir le rapport que peuvent avoir, avec la constitution fondamentale de la Chine, les choses qui paroissent les plus indifférentes. Cet empire est formé sur l’idée du gouvernement d’une famille. Si vous diminuez l’autorité paternelle, ou même si vous retranchez les cérémonies qui expriment le respect que l’on a pour elle, vous affoiblissez le respect pour les magistrats que l’on regarde comme des peres ; les magistrats n’auront plus le même soin pour les peuples qu’ils doivent considérer comme des enfans ; ce rapport d’amour qui est entre le prince & les sujets, se perdra aussi peu à peu. Retranchez une de ces pratiques, & vous ébranlez l’état.
[II-243] Il est fort indifférent en soi, que tous les matins une belle-fille se leve pour aller rendre tels & tels devoirs à sa belle-mere : mais si l’on fait attention que ces pratiques extérieures rappellent sans cesse à un sentiment qu’il est nécessaire d’imprimer dans tous les cœurs, & qui va de tous les cœurs former l’esprit qui gouverne l’empire, l’on verra qu’il est nécessaire qu’une telle ou une telle action particuliere se fasse.
[II-243]
CHAPITRE XX.
Explication d’un paradoxe sur les Chinois.
Ce qu’il y a de singulier, c’est que les Chinois, dont la vie est entiérement dirigée par les rites, sont néanmoins le peuple le plus fourbe de la terre. Cela paroît sur-tout dans le commerce, qui n’a jamais pu leur inspirer la bonne foi qui lui est naturelle. Celui qui achete doit porter [1] sa propre balance ; chaque marchand en ayant trois, une sorte pour acheter, une légere pour [II-244] vendre, & une juste pour ceux qui sont sur leurs gardes. Je crois pouvoir expliquer cette contradiction.
Les législateurs le la Chine ont eu deux objets : ils ont voulu que le peuple fût soumis & tranquille ; & qu’il fût laborieux & industrieux. Par la nature du climat & du terrain, il a une vie précaire ; on n’y est assuré de sa vie qu’à force d’industrie & de travail.
Quand tout le monde obéit, & que tout le monde travaille, l’état est dans une heureuse situation. C’est la nécessité, & peut-être la nature du climat, qui ont donné à tous les Chinois une avidité inconcevable pour le gain ; & les lois n’ont pas songé à l’arrêter. Tout a été défendu, quand il a été question d’acquérir par violence ; tout a été permis, quand il s’est agi d’obtenir par artifice ou par industrie. Ne comparons donc pas la morale des Chinois avec celle de l’Europe. Chacun à la Chine a dû être attentif à ce qui lui étoit utile : si le fripon a veillé à ses intérêts, celui qui est dupe devoit penser aux siens. À Lacédémone, il étoit permis de voler ; à la Chine, il est permis de tromper.
-
[↑] Journal de Lange en 1721 & 1722, tom. VIII, des voyages du nord, p. 363.
[II-245]
CHAPITRE XXI.
Comment les lois doivent être relatives aux mœurs & aux manieres.
Il n’y a que des institutions singulieres qui confondent ainsi des choses naturellement séparées, les lois, les mœurs & les manieres : mais quoiqu’elles soient séparées, elles ne laissent pas d’avoir entr’elles de grands rapports.
On demanda à Solon si les lois qu’il avoit données aux Athéniens, étoient les meilleures. « Je leur ai donné, répondit-il, les meilleures de celles qu’ils pouvoient souffrir » : belle parole, qui devroit être entendue de tous les législateurs. Quand la sagesse divine dit au peuple Juif : « Je vous ai donné des préceptes qui ne sont pas bons », cela signifie qu’ils n’avoient qu’une bonté relative ; ce qui est l’éponge de toutes Les difficultés que l’on peut faire sur les lois de Moïse.
[II-246]
CHAPITRE XXII.
Continuation du même sujet.
Quand un peuple a de bonnes mœurs, les lois deviennent simples. Platon [1] dit que Radamante, qui gouvernoit un peuple extrêmement religieux, expédioit tous les procès avec célérité, déférant seulement le serment sur chaque chef. Mais, dit le même Platon [2] , quand un peuple n’est pas religieux, on ne peut faire usage du serment que dans les occasions où celui qui jure est sans intérêt, comme un juge & des témoins.
[II-246]
CHAPITRE XXIII.
Comment les lois suivent les mœurs.
Dans le temps que les mœurs des Romains étoient pures, il n’y avoit point de loi particuliere contre le péculat. Quand ce crime commença à paroître, il fut trouvé si infame, que [II-247] d’être condamné à restituer [1] ce que l’on avoit pris, fut regardé comme une grande peine ; témoin le jugement de L. Scipion [2] .
[II-247]
CHAPITRE XXIV.
Continuation du même sujet.
Les lois qui donnent la tutelle à la mere, ont plus d’attention à la conservation de la personne du pupille ; celles qui la donnent au plus proche héritier, ont plus d’attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mere. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l’héritier des biens, ou à la mere, & quelquefois à tous les deux.
Si l’on réfléchit sur les lois Romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l’on fit la loi des douze tables, les mœurs à Rome étoient admirables. On déféra la [II-248] tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devoit avoir la charge de la tutelle, qui pouvoit avoir l’avantage de la succession. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu’elle fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devoit être utile. Mais lorsque les mœurs changerent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de façon de penser. Si dans la substitution pupillaire, disent Caius [1] & Justinen [2] , le testateur craint que le substitué ne dresse des embuches au pupille, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire [3] , & mettre la pupillaire dans une partie du testament qu’on ne pourra ouvrir qu’après un certain temps. Voilà des craintes & des précautions inconnues aux premiers Romains.
-
[↑] Inst. liv. II, tit. 6, §. 2 ; la compilation d’Ozel, à Leyde, 1658.
-
[↑] Institut. liv. II, de pupil. substit. §. 3.
-
[↑] La substitution vulgaire est : Si un tel ne prend par l’hérédité, je lui substitue, etc. La pupillaire est : Si un tel meurt avant sa puberté, je lui substitue, &c.
[II-249]
CHAPITRE XXV.
Continuation du même sujet.
La loi Romaine donnoit la liberté de se faire des dons avant le mariage ; après le mariage elle ne le permettoit plus. Cela étoit fondé sur les mœurs des Romains, qui n’étoient portés au mariage que par la frugalité, la simplicité & la modestie, mais qui pouvoient se laisser séduire par les soins domestiques, les complaisances & le bonheur de toute une vie.
La loi des Wisigoths [1] vouloit que l’époux ne put donner à celle qu’il devoit épouser, au-delà du dixieme de ses biens ; & qu’il ne pût lui rien donner la premiere année de son mariage. Cela venoit encore des mœurs du pays. Les législateurs vouloient arrêter cette jactance Espagnole, uniquement portée à faire des libéralités excessives dans une action d’éclat.
Les Romains, par leurs lois, arrêterent quelques inconvéniens de l’empire du monde le plus durable, qui est celui [II-250] de la vertu : les Espagnols, par les leurs, vouloient empêcher les mauvais effets de la tyrannie du monde la plus fragile, qui est celle de la beauté.
-
[↑] Liv. III. tit. 1. §. 5.
[II-250]
CHAPITRE XXVI.
Continuation du même sujet.
La loi [1] de Théodose & de Valentinien tira les causes de répudiation des anciennes mœurs [2] & des manieres des Romains. Elle mit au nombre de ces causes, l’action d’un mari [3] qui châtieroit sa femme d’une maniere indigne d’une personne ingénue. Cette cause fut omise dans les lois suivantes [4] : c’est que les mœurs avoient changé à cet égard, les usages d’orient avoient pris la place de ceux d’Europe. Le premier eunuque de l’impératrice, femme de Justinien II, la menaça, dit l’histoire, de ce châtiment dont on punit les [II-251] enfans dans les écoles. Il n’y a que des mœurs établies, ou des mœurs qui cherchent à s’établir, qui puissent faire imaginer une pareille chose.
Nous avons vu comment les lois suivent les mœurs : voyons à présent comment les mœurs suivent les lois.
-
[↑] Leg. VIII. cod. de repudiis.
-
[↑] Et de la loi des douze tables. Voyez Cicéron, seconde Philippique.
-
[↑] Si verberibus, quæ ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit.
-
[↑] Dans la novelle 117, ch. xiv.
[II-251]
CHAPITRE XXVII.
Comment les lois peuvent contribuer & former les mœurs, les manieres & le caractere d’une nation.
Les coutumes d’un peuple esclave sont une partie de sa servitude : celles d’un peuple libre sont une partie de sa liberté.
J’ai parlé au livre XI [1] d’un peuple libre ; j’ai donné les principes de sa constitution : voyons les effets qui ont dû suivre, le caractere qui a pu s’en former, & les manieres qui en résultent.
Je ne dis point que le climat n’ait produit en grande partie les lois, les mœurs & les manieres dans cette nation ; mais je dis que les mœurs & les manieres de [II-252] cette nation devroient avoir un grand rapport à ses lois.
Comme il y auroit dans cet état deux pouvoirs visibles, la puissance législative & l’exécutrice ; & que tout citoyen y auroit sa volonté propre, & feroit valoir à son gré son indépendance ; la plupart des gens auroient plus d’affection pour une de ces puissances que pour l’autre, le grand nombre n’ayant pas ordinairement assez d’équité ni de sens pour les affectionner également toutes les deux.
Et comme la puissance exécutrice, disposant de tous les emplois, pourroit donner de grandes espérances & jamais des craintes : tous ceux qui obtiendroient d’elle seroient portés à se tourner de son côté, & elle pourroit être attaquée par tous ceux qui n’en espéreroient rien.
Toutes les passions y étant libres, la haine, l’envie, la jalousie, l’ardeur de s’enrichir & de se distinguer, paroîtroient dans toute leur étendue ; & si cela étoit autrement, l’état seroit comme un homme abattu par la maladie, qui n’a point de passions, parce qu’il n’a point de forces.
[II-253]
La haine qui seroit entre les deux partis dureroit, parce qu’elle seroit toujours impuissante.
Ces partis étant composés d’hommes libres, si l’un prenoit trop le dessus, l’effet de la liberté seroit que celui-ci seroit abaissé, tandis que les citoyens, comme les mains qui secourent le corps, viendroient relever l’autre.
Comme chaque particulier, toujours indépendant suivroit beaucoup ses caprices & ses fantaisies, on changeroit souvent de parti : on en abandonneroit un où l’on laisseroit tous ses amis, pour se lier à un autre dans lequel on trouveroit tous ses ennemis ; & souvent, dans cette nation, on pourroit oublier les lots de l’amitié & celles de la haine.
Le monarque seroit dans le cas des particuliers ; & contre les maximes ordinaires de la prudence, il seroit souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l’auroient le plus choqué, & de disgracier ceux qui l’auroient le mieux servi, faisant par nécessité ce que les autres princes font par choix.
On craint de voir échapper un bien que l’on sent, que l’on ne connoît guere, & qu’on peut nous déguiser ; & la [II-254] crainte grossit toujours les objets. Le peuple seroit inquiet sur sa situation, & croiroit être en danger dans les momens même les plus surs.
D’autant mieux que ceux qui s’opposeroient le plus vivement à la puissance exécutrice, ne pouvant avouer les motifs intéressés de leur opposition, ils augmenteroient les terreurs du peuple, qui ne sauroit jamais au juste s’il seroit en danger ou non. Mais cela même contribueroit à lui faire éviter les vrais périls où il pourroit dans la suite être exposé.
Mais le corps législatif ayant la confiance du peuple, & étant plus éclairé que lui ; il pourroit le faire revenir des mauvaises impressions qu’on lui auroit données, & calmer ses mouvemens.
C’est le grand avantage qu’auroit ce gouvernement sur les démocraties anciennes, dans lesquelles le peuple avoit une puissance immédiate ; car lorsque des orateurs l’agitoient, ces agitations avoient toujours leur effet.
Ainsi quand les terreurs imprimées n’auroient point d’objet certain, elles ne produiroient que de vaines clameurs & des injures ; & elles auroient même [II-255] ce bon effet, qu’elles tendroient tous les ressorts du gouvernement, & rendroient tous les citoyens attentifs. Mais si elles naissoient à l’occasion du renversement des lois fondamentales, elles seroient sourdes, funestes, atroces, & produiroient des catastrophes.
Bientôt on verroit un calme affreux, pendant lequel tout se réuniroit contre la puissance violatrice des lois.
Si, dans le cas où les inquiétudes n’ont pas d’objet certain, quelque puissance étrangere menaçoit l’état, & le mettoit en danger de sa fortune ou de sa gloire ; pour lors, les petits intérêts cédant aux plus grands, tout se réuniroit en faveur de la puissance exécutrice.
Que si les disputes étoient formées à l’occasion de la violation des lois fondamentales, & qu’une puissance étrangere parut ; il y auroit une révolution qui ne changeroit pas la forme du gouvernement, ni sa constitution : car les revolutions que forme la liberté ne sont qu’une confirmation de la liberté.
Une nation libre peut avoir un libérateur ; une nation subjuguée ne peut avoir qu’un autre oppresseur.
[II-256]
Car tout homme qui a assez de force pour chasser celui qui est déjà le maître absolu dans un état, en a assez pour le devenir lui-même.
Comme, pour jouir de la liberté, il faut que chacun puisse dire ce qu’il pense ; & que, pour la conserver, il faut encore que chacun puisse dire ce qu’il pense ; un citoyen, dans cet état, diroit & écriroit tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire, ou d’écrire.
Cette nation, toujours échauffée, pourroit plus aisément être conduite par ses passions que par la raison, qui ne produit jamais de grands effets sur l’esprit des hommes ; & il seroit facile à ceux qui la gouverneroient, de lui faire faire des entreprises contre ses véritables intérêts.
Cette nation aimeroit prodigieusement sa liberté, parce que cette liberté seroit vraie : & il pourroit arriver que, pour la défendre, elle sacrifieroit son bien, son aisance, ses intérêts ; qu’elle se chargeroit des impôts les plus durs, & tels que le prince le plus absolu n’oseroit les faire supporter à ses sujets.
Mais comme elle auroit une [II-257] connoissance certaine de la nécessité de s’y soumettre, qu’elle payeroit dans l’espérance bien fondée de ne payer plus ; les charges y seroient plus pesantes que le sentiment de ces charges : au lieu qu’il y a des états où le sentiment est infiniment au dessus du mal.
Elle auroit un crédit sûr, parce qu’elle emprunteroit à elle-même, & se payeroit elle-même. Il pourroit arriver qu’elle entreprendroit au dessus de ses forces naturelles, & feroit valoir contre ses ennemis d’immenses richesses de fiction, que la confiance & la nature de son gouvernement rendroient réelles.
Pour conserver la liberté, elle emprunteroit de ses sujets ; & ses sujets, qui verroient que son crédit seroit perdu si elle étoit conquise, auroient un nouveau motif de faire des efforts pour défendre sa liberté.
Si cette nation habitoit une île, elle ne seroit point conquérante, parce que des conquêtes séparées l’affoibliroient. Si le terrain de cette île étoit bon, elle le seroit encore moins, parce qu’elle n’auroit pas besoin de la guerre pour s’enrichir. Et comme aucun citoyen ne dépendroit d’un autre citoyen, chacun [II-258] feroit plus de cas de sa liberté, que de la gloire de quelques citoyens, ou d’un seul.
Là on regarderoit les hommes de guerre comme des gens d’un métier qui peut être utile & souvent dangereux, comme des gens dont les services sont laborieux pour la nation même ; & les qualités civiles y seroient plus considérées.
Cette nation, que la paix & la liberté rendroient aisée, affranchie des préjugés destructeurs, seroit portée à devenir commerçante. Si elle avoit quelqu’une de ces marchandises primitives qui servent à faire de ces choses auxquelles la main de l’ouvrier donne un grand prix, elle pourroit faire des établissemens propres à se procurer la jouissance de ce don du ciel dans toute son étendue.
Si cette nation étoit située vers le nord, & qu’elle eût un grand nombre de denrées superflues ; comme elle manqueroit ainsi d’un grand nombre de marchandises que son climat lui refuseroit, elle feroit un commerce nécessaire, mais grand, avec les peuples du midi : & choisissant les états qu’elle favoriseroit d’un commerce avantageux, elle feroit [II-259] des traités réciproquement utiles avec la nation qu’elle auroit choisie.
Dans un état où d’un côté l’opulence seroit extrême, & de l’autre les impôts excessifs, on ne pourroit guere vivre sans industrie avec une fortune bornée. Bien des gens, sous prétexte de voyages ou de santé, s’exileroient de chez eux, & iroient chercher l’abondance dans les pays de la servitude même.
Une nation commerçante a un nombre prodigieux de petis intérêts particuliers ; elle peut donc choquer & être choquée d’une infinité de manieres. Celle-ci deviendroit souverainement jalouse ; & elle s’affligeroit plus de la prospérité des autres, qu’elle ne jouiroit de la sienne.
Et ses lois d’ailleurs douces & faciles, pourroient être si rigides à l’égard du commerce & de la navigation qu’on feroit chez elle, qu’elle sembleroit ne négocier qu’avec des ennemis.
Si cette nation envoyoit au loin des colonies, elle le feroit plus pour étendre son commerce que sa domination.
Comme on aime à établir ailleurs ce qu’on trouve établi chez soi, elle donneroit aux peuples de ses colonies la [II-260] forme de son gouvernement propre ; & ce gouvernement portant avec lui la prospérité, on verroit se former de grands peuples dans les forêts mêmes qu’elle enverroit habiter.
Il pourroit être qu’elle auroit autrefois subjugué une nation voisine, qui, par sa situation, la bonté de ses ports, la nature de ses richesses, lui donneroit de la jalousie : ainsi, quoiqu’elle lui eût donné ses propres lois, elle la tiendroit dans une grande dépendance, de façon que les citoyens-y seroient libres, & que l’état lui-même seroit esclave.
L’état conquis auroit un très-bon gouvernement civil ; mais il seroit accablé par le droit des gens ; & on lui imposeroit des lois de nation à nation, qui seroient telles, que sa prospérité ne seroit que précaire & seulement en dépôt pour un maître.
La nation dominante habitant une grande île, & étant en possession d’un grand commerce, auroit toutes sortes de facilités pour avoir des forces de mer : & comme la conservation de sa liberté demanderoit qu’elle n’eût ni places, ni forteresses, ni armées de terre, elle auroit besoin d’une armée de mer [II-261] qui la garantît des invasions ; & sa marine seroit supérieure à celle de toutes les autres puissances ; qui, ayant besoin d’employer leurs finances pour la guerre de terre, n’en auroient plus assez pour la guerre de mer.
L’empire de la mer a toujours donné aux peuples qui l’ont possédé, une fierté naturelle ; parce que, se sentant capables d’insulter par-tout, ils croient que leur pouvoir n’a pas plus de bornes que l’océan.
Cette nation pourroit avoir une grande influence dans les affaires de ses voisins. Car, comme elle n’emploieroit pas sa puissance à conquérir, on rechercheroit plus son amitié, & l’on craindroit plus sa haine, que l’inconstance de son gouvernement & son agitation intérieure ne sembleroit le promettre.
Ainsi ce seroit le destin de la puissance exécutrice, d’être presque toujours inquiétée au-dedans, & respectée au-dehors.
S’il arrivoit que cette nation devînt en quelques occasions le centre des négociations de l’Europe, elle y porteroit un peu plus de probité & de bonne foi que les autres, parce que ses ministres [II-262] étant souvent obligés de justifier leur conduite devant un conseil populaire, leurs négociations ne pourrroient être secrettes, & ils seroient forcés d’être à cet égard un peu plus honnêtes gens.
De plus, comme ils seroient en quelque façon garans des événemens qu’une conduite détournée pourroit faire naître, le plus sûr pour eux seroit de prendre le plus droit chemin.
Si les nobles avoient eu dans de certains temps un pouvoir immodéré dans la nation, & que le monarque eût trouvé le moyen de les abaisser en élevant le peuple ; le point de l’extrême servitude auroit été entre le moment de l’abaissement des grands, & celui où le peuple auroit commencé à sentir son pouvoir.
Il pourroit être que cette nation ayant été autrefois soumise à un pouvoir arbitraire, en auroit en plusieurs occasions conservé le style ; de maniere que, sur le fond d’un gouvernement libre, on verroit souvent la forme d’un gouvernement absolu.
À l’égard de la religion, comme dans cet état chaque citoyen auroit sa volonté propre, & seroit par conséquent conduit [II-263] par ses propres lumieres, ou ses fantaisies ; il arriveroit, ou que chacun auroit beaucoup d’indifférence pour toutes sortes de religions de quelqu’espece qu’elles fussent, moyennant quoi tout le monde seroit porté à embrasser la religion dominante ; ou que l’on seroit zélé pour la religion en général, moyennant quoi les sectes se multiplieroient.
Il ne seroit pas impossible qu’il y eût dans cette nation des gens qui n’auroient point de religion, & qui ne voudroient pas cependant souffrir qu’on les obligeât à changer celle qu’ils auroient s’ils en avoient une : car ils sentiroient d’abord, que la vie & les biens ne sont pas plus à eux que leur maniere de penser ; & que qui veut ravir l’un peut encore mieux ôter l’autre.
Si parmi les différentes religions il y en avoit une à l’établissement de laquelle on eût tenté de parvenir par la voie de l’esclavage, elle y seroit odieuse ; parce que, comme nous jugeons des choses par les liaisons & les accessoires que nous y mettons, celle-ci ne se présenteroit jamais à l’esprit avec l’idée de liberté.
Les lois contre ceux qui professeroient cette religion, ne seroient point [II-264] sanguinaires ; car la liberté n’imagine point ces sortes de peines : mais elles seroient si réprimantes, qu’elles feroient tout le mal qui peut se faire de sang-froid.
Il pourroit arriver de mille manieres, que le clergé auroit si peu de crédit, que les autres citoyens en auroient davantage. Ainsi, au lieu de se séparer, il aimeroit mieux supporter les mêmes charges que les laïques, & ne faire à cet égard qu’un même corps : mais comme il chercheroit toujours à s’attirer le respect du peuple, il se distingueroit par une vie plus retirée, une conduite plus réservée, & des mœurs plus pures.
Ce clergé ne pouvant protéger la religion ni être protégé par elle, sans force pour contraindre, chercheroit à persuader : on verroit sortir de la plume de très-bons ouvrages, pour prouver la révélation & la providence du grand Être.
Il pourroit arriver qu’on éluderoit ses assemblées, & qu’on ne voudroit pas lui permettre de corriger ses abus mêmes ; & que, par un délire de la liberté, on aimeroit mieux laisser sa reforme imparfaite, que de souffrir qu’il fût réformateur.
Les dignités faisant partie de la constitution fondamentale, seroient plus fixes [II-265] qu’ailleurs : mais d’un autre côté, les grands, dans ce pays de liberté, s’approcheroient plus du peuple ; les rangs seroient donc plus séparés, & les personnes plus confondues.
Ceux qui gouvernent ayant une puissance qui se remonte, pour ainsi dire, & se refait tous les jours, auroient plus d’égards pour ceux qui leur sont utiles, que pour ceux qui les divertissent : ainsi on y verroit peu de courtisans, de flatteurs, de complaisans, enfin de toutes ces sortes de gens qui font payer aux grands le vide même de leur esprit.
On n’y estimeroit guere les hommes par des talens ou des attributs frivoles, mais par des qualités réelles ; & de ce genre il n’y en a que deux, les richesses & le mérite personnel.
Il y auroit un luxe solide, fondé, non pas sur le rafinement de la vanité, mais sur celui des besoins réels ; & l’on ne chercheroit guere dans les choses que les plaisirs que la nature y a mis.
On y jouiroit d’un grand superflu, & cependant les choses frivoles y seroient proscrites : ainsi plusieurs ayant plus de bien que d’occasions de dépense, l’emploieroient d’une maniere bizarre : & [II-266] dans cette nation, il y auroit plus d’esprit que de goût.
Comme on seroit toujours occupé de ses intérêts, on n’auroit point cette politesse qui est fondée sur l’oisiveté ; & réellement on n’en auroit pas le temps.
L’époque de la politesse des Romains est la même que celle de l’établissement du pouvoir arbitraire. Le gouvernement absolu produit l’oisiveté ; & l’oisiveté fait naître la politesse.
Plus il y a de gens dans une nation qui ont besoin d’avoir des ménagemens entr’eux & de ne pas déplaire, plus il y a de politesse. Mais c’est plus la politesse des mœurs que celle des manieres, qui doit nous distinguer des peuples barbares.
Dans une nation où tout homme à sa maniere prendroit part à l’administration de l’état, les femmes ne devroient guere vivre avec les hommes. Elles seroient donc modestes, c’est-à-dire, timides : cette timidité seroit leur vertu, tandis que les hommes sans galanterie se jetteroient dans une débauche qui leur laisseroit toute leur liberté & leur loisir.
Les lois n’y étant pas faites pour un particulier plus que pour un autre, chacun se regarderoit comme monarque ; & [II-267] les hommes, dans cette nation, seroient plutôt des confédérés, que des concitoyens.
Si le climat avoit donné à bien des gens un esprit inquiet & des vues étendues, dans un pays où la constitution donneroit à tout le monde une part au gouvernement & des intérêts politiques, on parleroit beaucoup de politique ; on verroit des gens qui passeroient leur vie à calculer des événemens, qui, vu la nature des choses & le caprice de la fortune, c’est-à-dire des hommes, ne sont guere soumis au calcul.
Dans une nation libre, il est très-souvent indifférent que les particuliers raisonnent bien ou mal ; il suffit qu’ils raisonnent : de là sort la liberté qui garantit des effets de ces mêmes raisonnemens.
De même, dans un gouvernement despotique, il est également pernicieux qu’on raisonne bien ou mal ; il suffit qu’on raisonne, pour que le principe du gouvernement soit choqué.
Bien des gens qui ne se soucieroient de plaire à personne, s’abandonneroient à leur humeur ; la plupart, avec de l’esprit, seroient tourmentés par leur esprit même : dans le dédain ou le dégoût de [II-268] toutes choses, ils seroient malheureux avec tant de sujets de ne l’être pas.
Aucun citoyen ne craignant aucun citoyen, cette nation seroit fiere ; car la fierté des rois n’est fondée que sur leur indépendance.
Les nations libres sont superbes, les autres peuvent plus aisément être vaines.
Mais ces hommes si fiers vivant beaucoup avec eux-mêmes, se trouveroient souvent au milieu de gens inconnus ; ils seroient timides, & l’on verroit en eux la plupart du temps un mélange bizarre de mauvaise honte & de fierté.
Le caractere de la nation paroîtroit sur-tout dans leurs ouvrages d’esprit, dans lesquels on verroit des gens recueillis, & qui auroient pensé tout seuls.
La société nous apprend à sentir les ridicules ; la retraite nous rend plus propres à sentir les vices. Leurs écrits satiriques seroient sanglans ; & l’on verroit bien des Juvenals chez eux, avant d’avoir trouvé un Horace.
Dans les monarchies extrêmement absolues, les historiens trahissent la vérité, parce qu’ils n’ont pas la liberté de la dire : dans les états extrêmement [II-269] libres, ils trahissent la vérité à cause de leur liberté même, qui produisant toujours des divisions, chacun devient aussi esclave des préjugés de sa faction, qu’il le seroit d’un despote.
Leurs poëtes auroient plus souvent cette rudesse originale de l’invention, qu’une certaine délicatesse que donne le goût ; on y trouveroit quelque chose qui approcheroit plus de la force de Michel-Ange, que de la grace de Raphaël.
-
[↑] Chapitre VI.
[II-270]
LIVRE XX.
Des lois dans le rapport qu’elles ont avec le Commerce, considéré dans sa nature & ses distinctions.↩
Docuit quæ miximus Atlas.
Virgil. Æneid.
CHAPITRE PREMIER.
Du Commerce.
Les matieres qui suivent demanderoient d’être traitées avec plus d’étendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet pas. Je voudrois couler sur une riviere tranquille, je suis entraîné par un torrent.
Le commerce guérit des préjugés destructeurs : & c’est presque une regle générale, que par-tout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce ; & que par-tout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces.
Qu’on ne s’étonne donc point si nos [II-271] mœurs sont moins féroces qu’elles ne l’étoient autrefois. Le commerce a fait que la connoissance des mœurs de toutes les nations a pénétré par-tout : on les a comparées entr’elles, & il en a résulté de grands biens.
On peut dire que les lois du commerce perfectionnent les mœurs ; par la même raison que ces mêmes lois perdent les mœurs. Le commerce corrompt les mœurs pures [1] ; c’étoit le sujet des plaintes de Platon : il polit & adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les jours.
-
[↑] César dit des Gaulois, que le voisinage & le commerce de Marseille les avoit gâtés de façon qu’eux, qui autrefois avoient toujours vaincu les Germains, leur étoient devenus inférieurs. Guerre des Gaules, liv. VI.
[II-271]
CHAPITRE II.
De l’esprit du Commerce.
L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble, se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de [II-272] vendre ; & toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels.
Mais si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays [1] où l’on n’est affecté que de l’esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines, & de toutes les vertus morales : les plus petites choses, celles que l’humanité demande, s’y font ou s’y donnent pour de l’argent.
L’esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte, opposé d’un côté au brigandage, & de l’autre à ces vertus morales qui font qu’on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité, & qu’on peut les négliger pour ceux des autres.
La privation totale du commerce produit au contraire le brigandage, qu’Aristote met au nombre des manieres d’acquérir. L’esprit n’en est point opposé à de certaines vertus morales : par exemple, l’hospitalité, très-rare dans les pays de commerce, se trouve admirablement parmi les peuples brigands.
C’est un sacrilege chez les Germains, dit Tacite, de fermer sa maison a [II-273] quelqu’homme que ce soit, connu ou inconnu. Celui qui a exercé [2] l’hospitalité envers un étranger, va lui montrer une autre maison où on l’exerce encore, & il y est reçu avec la même humanité. Mais lorsque les Germains eurent fondé des royaumes, l’hospitalité leur devint à charge. Cela paroît par deux lois du code [3] des Bourguignons, dont l’une inflige une peine à tout barbare qui iroit montrer à un étranger la maison d’un Romain ; & l’autre regle que celui qui recevra un étranger, sera dédommagé par les habitans, chacun pour sa quote-part.
-
[↑] La Hollande.
-
[↑] Et qui modò hospes suerat, moastrator hospitti. De morib. Germ. Voyez aussi César, Guerres des Gaules, liv. VI.
-
[↑] Tit. 38.
[II-273]
CHAPITRE III.
De la pauvreté des peuples.
Il y a deux sortes de peuples pauvres : ceux que la dureté du gouvernement a rendu tels ; & ces gens-là sont incapables de presque aucune vertu, parce que leur pauvreté fait une partie de leur servitude : les autres ne sont pauvres que [II-274] parce qu’ils ont dédaigné, ou parce qu’ils n’ont pas connu les commodités de la vie ; & ceux-ci peuvent faire de grandes choses, parce que cette pauvreté fait une partie de leur liberté.
[II-274]
CHAPITRE IV.
Du commerce dans les divers gouvernemens.
Le commerce a du rapport avec la constitution. Dans le gouvernement d’un seul, il est ordinairement fondé sur le luxe ; & quoiqu’il le soit aussi sur les besoins réels, son objet principal est de procurer à la nation qui le fait, tout ce qui peut servir à son orgueil, à ses délices & à ses fantaisies. Dans le gouvernement de plusieurs, il est plus souvent fondé sur l’économie. Les négocians ayant l’œil sur toutes les nations de la terre, portent à l’une ce qu’ils tirent de l’autre. C’est ainsi que les républiques de Tyr, de Carthage, d’Athenes, de Marseille, de Florence, de Venise & de Hollande ont fait le commerce.
Cette espece de trafic regarde le [II-275] gouvernement de plusieurs par sa nature, & le monarchique par occasion. Car, comme il n’est fondé que sur la pratique de gagner peu, & même de gagner moins qu’aucune autre nation, & de ne se dédommager qu’en gagnant continuellement, il n’est guere possible qu’il puisse être fait par un seul peuple chez qui le luxe est établi, qui dépense beaucoup, & qui ne voit que de grands objets.
C’est dans ces idées que Cicéron [1] disoit si bien : « Je n’aime point qu’un même peuple soit en même temps le dominateur & le facteur de l’univers ». En effet, il faudroit supposer que chaque particulier dans cet état, & tout l’état même, eussent toujours la tête pleine de grands projets, & cette même tête remplie de petits : ce qui est contradictoire.
Ce n’est pas que, dans ces états qui subsistent par le commerce d’économie, on ne fasse aussi les plus grandes entreprises, & que l’on n’y ait une hardiesse qui ne se trouve pas dans les monarchies : en voici la raison.
[II-276]
Un commerce mene à l’autre, le petit au médiocre, le médiocre au grand ; & celui qui a eu tant d’envie de gagner peu, se met dans une situation où il n’en a pas moins de gagner beaucoup.
De plus, les grandes entreprises des négocians sont toujours nécessairement mêlées avec les affaires publiques. Mais dans les monarchies, les affaires publiques sont la plupart du temps aussi suspectes aux marchands, qu’elles leur paroissent sûres dans les états républicains. Les grandes entreprises de commerce ne sont donc pas pour les monarchies, mais pour le gouvernement de plusieurs.
En un mot, une plus grande certitude de la prospérité, que l’on croit avoir dans ces états, fait tout entreprendre ; & parce qu’on croit être sûr de ce que l’on a acquis, on ose l’exposer pour acquérir davantage ; on ne court de risque que sur les moyens d’acquérir : or les hommes esperent beaucoup de leur fortune.
Je ne veux pas dire qu’il y ait aucune monarchie qui soit totalement exclue du commerce d’économie ; mais elle y est moins portée par sa nature. Je ne [II-277] veux pas dire que les républiques que nous connoissons soient entiérement privées du commerce de luxe ; mais il a moins de rapport à leur constitution.
Quant à l’état despotique, il est inutile d’en parler. Regle générale : dans une nation qui est dans la servitude, on travaille plus à conserver qu’à acquérir : dans une nation libre, on travaille plus à acquérir qu’à conserver.
-
[↑] Nolo cumdem populum, imperatorem & portitorem esse terrarum.
[II-277]
CHAPITRE V.
Des peuples qui ont fait le commerce d’économie.
Marseille, retraite nécessaire au milieu d’une mer orageuse ; Marseille, ce lieu où tous les vents, les bancs de la mer, la disposition des côtes ordonnent de toucher, fut fréquentée par les gens de mer. La stérilité [1] de son territoire détermina ses citoyens au commerce d’économie. Il fallut qu’ils fussent laborieux, pour suppléer à la nature qui se refusoit ; qu’ils fussent justes, pour vivre parmi les nations barbares qui devoient faire leur prospérité ; qu’ils fussent [II-278] modérés, pour que leur gouvernement fût toujours tranquille ; enfin qu’ils eussent des mœurs frugales, pour qu’ils pussent toujours vivre d’un commerce qu’ils conserveroient plus surement lorsqu’il seroit moins avantageux.
On a vu par-tout la violence & la vexation donner naissance au commerce d’économie, lorsque les hommes sont contraints de se réfugier dans les marais, dans les îles, les bas fonds de la mer & ses écueils mêmes. C’est ainsi que Tyr, Venise & les villes de Hollande furent fondées, les fugitifs y trouverent leur surete. Il fallut subsister ; ils tirerent leur subsistance de tout l’univers.
-
[↑] Justin, liv. XLIII. ch. III.
[II-278]
CHAPITRE VI.
Quelques effets d’une grande navigation.
Il arrive quelquefois qu’une nation qui fait le commerce d’économie, ayant besoin d’une marchandise d’un pays qui lui serve de fonds pour se procurer les marchandises d’un autre, se contente de gagner très-peu, & quelquefois rien, sur les unes, dans l’espérance ou la certitude de gagner [II-279] beaucoup sur les autres. Ainsi, lorsque la Hollande faisoit presque seule le commerce du midi au nord de l’Europe, les vins de France, qu’elle portoit au nord, ne lui servoient en quelque maniere que de fonds pour faire son commerce dans le nord.
On sait que souvent en Hollande, de certains genres de marchandise venue de loin, ne s’y vendent pas plus cher qu’ils n’ont coûté sur les lieux mêmes. Voici la raison qu’on en donne : Un capitaine, qui a besoin de lester son vaisseau, prendra du marbre ; il a besoin de bois pour l’arrimage, il en achetera : & pourvu qu’il n’y perde rien, il croira avoir beaucoup fait. C’est ainsi que la Hollande a aussi ses carrieres & ses forêts.
Non-seulement un commerce qui ne donne rien peut être utile ; un commerce même désavantageux peut l’être. J’ai oui dire en Hollande, que la pêche de la baleine, en général, ne rend presque jamais ce qu’elle coûte : mais ceux qui ont été employés à la construction du vaisseau, ceux qui ont fourni les agrès, les apparaux, les vivres, sont aussi ceux qui prennent le principal intérêt à cette pêche. Perdissent-ils sur la [II-280] pêche, ils ont gagné sur les fournitures. Ce commerce est une espece de loterie, & chacun est séduit par l’espérance d’un billet noir. Tout le monde aime à jouer ; & les gens les plus sages jouent volontiers, lorsqu’ils ne voient point les apparences du jeu, ses égaremens, ses violences, ses dissipations, la perte du temps, & même de toute la vie.
[II-280]
CHAPITRE VII.
Esprit de l’Angleterre sur le commerce.
L’Angleterre n’a guere de tarif réglé avec les autres nations ; son tarif change, pour ainsi dire, à chaque parlement, par les droits particuliers qu’elle ôte, ou qu’elle impose. Elle a voulu encore conserver sur cela son indépendance. Souverainement jalouse du commerce qu’on fait chez elle, elle se lie peu par des traités, & ne dépend que de ses lois.
D’autres nations ont fait céder des intérêts du commerce à des intérêts politiques : celle-ci a toujours fait céder ses intérêts politiques aux intérêts de son commerce.
[II-281]
C’est le peuple du monde qui a le mieux su se prévaloir à la fois de ces trois grandes choses, la religion, le commerce & la liberté.
[II-281]
CHAPITRE VIII.
Comment on a gêné quelquefois le commerce d’économie.
On a fait dans certaines monarchies des lois très-propres à abaisser les états qui font le commerce d’économie. On leur a défendu d’apporter d’autres marchandises, que celles du crû de leur pays : on ne leur a permis de venir trafiquer, qu’avec des navires de la fabrique du pays où ils viennent.
Il faut que l’état qui impose ces lois puisse aisément faire lui-même le commerce : sans cela, il se fera pour le moins un tort égal. Il vaut mieux avoir affaire à une nation qui exige peu, & que les besoins du commerce rendent en quelque façon dépendante ; à une nation qui, par l’étendue de ses vues ou de ses affaires, sait où placer toutes les marchandises superflues ; qui est riche, & peut se charger de beaucoup de [II-282] denrées ; qui les payera promptement ; qui a, pour ainsi dire, des nécessités d’être fidelle ; qui est pacifique par principe ; qui cherche à gagner, & non pas à conquérir : il vaut mieux, dis-je, avoir affaire à cette nation, qu’à d’autres toujours rivales, & qui ne donneroient pas tous ces avantages.
[II-282]
CHAPITRE IX.
De l’exclusion en fait de commerce.
La vraie maxime est de n’exclure aucune nation de son commerce sans de grandes raisons. Les Japonois ne commercent qu’avec deux nations, la Chinoise & la Hollandoise. Les Chinois [1] gagnent mille pour cent sur le sucre, & quelquefois autant sur les retours. Les Hollandois font des profits à peu près pareils. Toute nation qui se conduira sur les maximes Japonoises, sera nécessairement trompée. C’est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises, & qui établit les vrais rapport entr’elles.
Encore moins un état doit-il [II-283] s’assujettir à ne vendre ses marchandises qu’à une seule nation, sous prétexte qu’elle les prendra toutes à un certain prix. Les Polonois ont fait pour leur blé ce marché avec la ville de Dantzik ; plusieurs rois des Indes ont de pareils contrats pour les épiceries avec les [2] Hollandois. Ces conventions ne sont propres qu’à une nation pauvre, qui veut bien perdre l’espérance de s’enrichir, pourvu qu’elle ait une subsistance assurée ; ou à des nations, dont la servitude consiste à renoncer à l’usage des choses que la nature leur avoit données, ou à faire sur ces choses un commerce désavantageux.
-
[↑] Le Pere du Halde, tom. II. p. 170.
-
[↑] Cela fut premièrement établi par les Portugais. Voyages de Francois Pyrard, chap. xv, part. II.
[II-283]
CHAPITRE X.
Établissement propre au commerce d’économie.
Dans les états qui font le commerce d’économie, on a heureusement établi des banques, qui par leur crédit ont formé de nouveaux signes des valeurs. Mais on auroit tort de les transporter dans les états qui font le commerce [II-284] de luxe. Les mettre dans des pays gouvernés par un seul, c’est supposer l’argent d’un côté, & de l’autre la puissance : c’est-à-dire d’un côté, la faculté de tout avoir sans aucun pouvoir ; & de l’autre, le pouvoir avec la faculté de rien du tout. Dans un gouvernement pareil, il n’y a jamais eu que le prince qui ait eu, ou qui ait pu avoir un trésor ; & par-tout où il y en a un, dès qu’il est excessif, il devient d’abord le trésor du prince.
Par la même raison, les compagnies de négocians qui s’associent pour un certain commerce, conviennent rarement au gouvernement d’un seul. La nature de ces compagnies est de donner aux richesses particulieres la force des richesses publiques. Mais dans ces états, cette force ne peut se trouver que dans les mains du prince. Je dis plus : elles ne conviennent pas toujours dans les états où l’on fait le commerce d’économie ; & si les affaires ne sont si grandes qu’elles soient au dessus de la portée des particuliers, on fera encore mieux de ne point gêner par des privileges exclusifs la liberté du commerce.
[II-285]
CHAPITRE XI.
Continuation du même sujet.
Dans les états qui font le commerce d’économie, on peut établir un port franc. L’économie de l’état, qui suit toujours la frugalité des particuliers, donne, pour ainsi dire, l’ame à son commerce d’économie. Ce qu’il perd de tributs par l’établissement dont nous parlons, est compensé par ce qu’il peut tirer de la richesse industrieuse de la république. Mais dans le gouvernement monarchique, de pareils établissemens seroient contre la raison ; ils n’auroient d’autre effet que de soulager le luxe du poids des impôts. On se priveroit de l’unique bien que ce luxe peut procurer, & du seul frein que dans une constitution pareille il puisse recevoir.
[II-285]
CHAPITRE XII.
De la liberté du commerce.
La liberté du commerce n’est pas une faculté accordée aux negocians de faire ce qu’ils veulent ; ce seroit bien [II-286] plutôt sa servitude. Ce qui gêne le commerçant, ne gêne pas pour cela le commerce. C’est dans les pays de la liberté que le négociant trouve des contradictions sans nombre ; & il n’est jamais moins croisé par les lois, que dans les pays de la servitude.
L’Angleterre défend de faire sortir ses laines ; elle veut que le charbon soit transporté par mer dans la capitale ; elle ne permet point la sortie de ses chevaux, s’ils ne sont coupés ; les vaisseaux [1] de ses colonies qui commercent en Europe, doivent mouiller en Angleterre. Elle gêne le négociant ; mais c’est en faveur du commerce.
-
[↑] Acte de navigation de 1660. Ce n’a été qu’en temps de guerre que ceux de Boston & de Philadelphie ont envoyé leurs vaisseaux en droiture jusques dans la Méditerranée porter leurs denrées.
[II-286]
CHAPITRE XIII.
Ce qui détruit cette liberté.
Là où il y a du commerce, il y a des douanes. L’objet du commerce est l’exportation & l’importation des marchandises en faveur de l’état ; & l’objet des douanes est un certain droit sur cette [II-287] même exportation & importation, aussi en faveur de l’état. Il faut donc que l’état soit neutre entre sa douane & son commerce, & qu’il fasse ensorte que ces deux choses ne se croisent point ; & alors on y jouit de la liberté du commerce.
La finance détruit le commerce par ses injustices, par ses vexations, par l’excès de ce qu’elle impose : mais elle le détruit encore indépendamment de cela par les difficultés qu’elle fait naître, & les formalités qu’elle exige. En Angleterre, où les douanes sont en régie, il y a une facilité de négocier singuliere : un mot d’écriture fait les plus grandes affaires ; il ne faut point que le marchand perde un temps infini, & qu’il ait des commis exprès, pour faire cesser toutes les difficultés des fermiers, ou pour s’y soumettre.
[II-288]
CHAPITRE XIV.
Des lois du commerce qui emportent la confiscation des marchandises.
La grande chartre des Anglois défend de saisir & de confisquer, en cas de guerre, les marchandises des négocians étrangers, à moins que ce ne soit par représailles. Il est beau que la nation Angloise ait fait de cela un des articles de sa liberté.
Dans la guerre que l’Espagne eut contre les Anglois en 1740, elle fit une [1] loi qui punissoit de mort ceux qui introduiroient dans les états d’Espagne des marchandises d’Angleterre ; elle infligeoit la même peine à ceux qui porteroient dans les états d’Angleterre des marchandises d’Espagne. Une ordonnance pareille ne peut, je crois, trouver de modele que dans les lois du Japon. Elle choque nos mœurs, l’esprit du commerce, & l’harmonie qui doit être dans la proportion des peines ; elle confond toutes les idées, faisant un crime d’état de ce qui n’est que violation de police.
-
[↑] Publiée à Cadix au mois de mars 1740.
[II-289]
CHAPITRE XV.
De la contrainte par corps.
Solon [1] ordonna à Athenes qu’on n’obligeroit plus le corps pour dettes civiles. Il tira [2] cette loi d’Égypte ; Boccoris l’avoit faite, & Sésostris l’avoit renouvellée.
Cette loi est très-bonne pour les affaires [3] civiles ordinaires ; mais nous avons raison de ne point l’observer dans celles du commerce. Car les négocians étant obligés de confier de grandes sommes pour des temps souvent fort courts, de les donner & de les reprendre, il faut que le débiteur remplisse toujours au temps fixé ses engagemens ; ce qui suppose la contrainte par corps.
Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, parce qu’elle fait plus de cas de la liberté [II-290] d’un citoyen, que de l’aisance d’un autre. Mais dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de l’aisance publique, que de la liberté d’un citoyen ; ce qui n’empêche pas les restrictions & les limitations que peuvent demander l’humanité & la bonne police.
-
[↑] Plutarque, au traité : qu’il ne faut point emprunter à usure.
-
[↑] Diodore, liv. I. part. II. ch. III.
-
[↑] Les législateurs Grecs étoient blâmables, qui avoient défendu de prendre en gage les armes & la charrue d’un homme, & permettoient de prendre l’homme même, Diodore, liv. I. part. II. ch. III.
[II-290]
CHAPITRE XVI.
Belle loi.
La loi de Geneve qui exclut des magistratures, & même de l’entrée dans le grand conseil, les enfans de ceux qui ont vécu ou qui sont morts insolvables, à moins qu’ils n’acquittent les dettes de leur pere, est très-bonne. Elle a cet effet, qu’elle donne de la confiance pour les négocians ; elle en donne pour les magistrats ; elle en donne pour la cité même. La foi particuliere y a encore la force de la loi publique.
[II-291]
CHAPITRE XVII.
Loi de Rhodes.
Les Rhodiens allerent plus loin. Sextus Empiricus [1] dit que chez eux un fils ne pouvoit se dispenser de payer les dettes de son pere, en renonçant à sa succession. La loi de Rhodes étoit donnée à une république fondée sur le commerce : Or, je crois que la raison du commerce même y devoit mettre cette limitation, que des dettes contractées par le pere depuis que le fils avoit commence à faire le commerce, n’affecteroient point les biens acquis par celui-ci. Un négociant doit toujours connoître ses obligations, & se conduire à chaque instant suivant l’état de sa fortune.
-
[↑] Hippotiposes, liv. I. chap. xiv.
[II-291]
CHAPITRE XVIII.
Des Juges pour le commerce.
Xenophon, au livre des revenus, voudroit qu’on donnât des récompenses à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vîte les procès. Il [II-292] sentoit le besoin de notre juridiction consulaire.
Les affaires du commerce sont très-peu susceptibles de formalités. Ce sont des actions de chaque jour, que d’autres de même nature doivent suivre chaque jour. Il faut donc qu’elles puissent être décidées chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l’avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guere qu’une fois ; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testamens ; on n’est majeur qu’une fois.
Platon [1] dit que dans une ville où il n’y a point de commerce maritime, il faut la moitié moins de lois civiles ; & cela est très-vrai. Le commerce introduit dans le même pays différentes sortes de peuples, un grand nombre de conventions, d’especes de biens, & de manieres d’acquérir,
Ainsi dans une ville commerçante, il y a moins de juges, & plus de lois.
-
[↑] Des lois, liv. VIII.
[II-293]
CHAPITRE XIX.
Que le prince ne doit point faire le commerce.
Théophile [1] voyant un vaisseau où il y avoit des marchandises pour sa femme Théodora, le fit brûler. « Je suis empereur, lui dit-il, & vous me faites patron de galere. En quoi les pauvres gens pourront-ils gagner leur vie, si nous faisons encore leur métier ? » Il auroit pu ajouter : Qui pourra nous réprimer, si nous faisons des monopoles ? Qui nous obligera de remplir nos engagemens ? Ce commerce que nous faisons, les courtisans voudront le faire ; ils seront plus avides & plus injustes que nous. Le peuple a de la confiance en notre justice ; il n’en a point en notre opulence : tant d’impôts, qui font sa misere, sont des preuves certaines de la nôtre.
-
[↑] Zonare.
[II-294]
CHAPITRE XX.
Continuation du même sujet.
Lorsque les Portugais & les Castillans dominoient dans les Indes orientales, le commerce avoit des branches si riches, que leurs princes ne manquerent pas de s’en saisir. Cela ruina leurs établissemens dans ces parties-là.
Le vice-roi de Goa accordoit à des particuliers des privileges exclusifs. On n’a point de confiance en de pareilles gens ; le commerce est discontinué par le changement perpétuel de ceux à qui on le confie ; personne ne ménage ce commerce, & ne se soucie de le laisser perdu à son successeur ; le profit reste dans des mains particulieres, & ne s’étend pas assez.
[II-294]
CHAPITRE XXI.
Du commerce de la noblesse dans la monarchie.
Il est contre l’'esprit du commerce, que la noblesse le fasse dans la monarchie. « Cela seroit pernicieux aux villes, [II-295] disent [1] les empereurs Honorius & Théodose, & ôteroit entre les marchands & les plébéiens la facilité d’acheter & de vendre. »
Il est contre l’esprit de la monarchie que la noblesse y fasse le commerce. L’usage qui a permis en Angleterre le commerce à la noblesse, est une des choses qui ont le plus contribué à y affoiblir le gouvernement monarchique.
-
[↑] Leg. nobilioris, cod. de commerc. & leg. iles de rescind. vendit.
[II-295]
CHAPITRE XXII.
Réflexion particuliere.
Des gens frappés de ce qui se pratique dans quelques états, pensent qu’il faudroit qu’en France il y eût des lois qui engageassent les nobles à faire le commerce. Ce seroit le moyen d’y détruire la noblesse, sans aucune utilité pour le commerce. La pratique de ce pays est très-sage : Les négocians n’y sont pas nobles ; mais ils peuvent le devenir ; ils ont l’espérance d’obtenir la noblesse, sans en avoir [II-296] l’inconvénient actuel ; ils n’ont pas de moyen plus sûr de sortir de leur profession que de la bien faire, ou de la faire avec honneur, chose qui est ordinairement attachée à la suffisance.
Les lois qui ordonnent que chacun reste dans la profession, & la fasse passer à ses enfans, ne sont & ne peuvent être utiles que dans les états [1] despotiques, où personne ne peut, ni ne doit avoir d’émulation.
Qu’on ne dise pas que chacun fera mieux sa profession lorsqu’on ne pourra pas la quitter pour une autre. Je dis qu’on fera mieux sa profession, lorsque ceux qui y auront excellé espéreront de parvenir à une autre.
L’acquisition qu’on peut faire de la noblesse à prix d’argent, encourage beaucoup les négocians à se mettre en état d’y parvenir. Je n’examine pas si l’on fait bien de donner ainsi aux richesses le prix de la vertu : il y a tel gouvernement où cela peut être très-utile.
En France, cet état de la robe qui se trouve entre la grande noblesse & le peuple ; qui sans avoir le brillant de celle-là, en a tous les privileges ; cet état [II-297] qui laisse les particuliers dans la médiocrité, tandis que le corps dépositaire des lois est dans la gloire ; cet état encore dans lequel on n’a de moyen de se distinguer que par la suffisance & par la vertu ; profession honorable, mais qui en laisse toujours voir une plus distinguée : cette noblesse toute guerriere, qui pense qu’en quelque degré de richesses que l’on soit, il faut faire sa fortune ; mais qu’il est honteux d’augmenter son bien, si on ne commence par dissiper ; cette partie de la nation, qui sert toujours avec le capital de son bien ; qui, quand elle est ruinée, donne sa place à un autre qui servira avec son capital encore ; qui va à la guerre pour que personne n’ose dire qu’elle n’y a pas été ; qui, quand elle ne peut espérer les richesses, espere les honneurs ; & lorsqu’elle ne les obtient pas, se console, parce qu’elle a acquis de l’honneur : toutes ces choses ont nécessairement contribué à la grandeur de ce royaume. Et si depuis deux ou trois siecles, il a augmenté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté de ses lois, non pas à la fortune, qui n’a pas ces sortes de constance.
-
[↑] Effectivement cela y est souvent ainsi établi.
[II-298]
CHAPITRE XXIII.
À quelles nations il est désavantageux de faire le commerce.
Les richesses consistent en fonds de terre, ou en effets mobiliers : les fonds de terre de chaque pays sont ordinairement possédés par ses habitans. La plupart des états ont des lois qui dégoûtent les étrangers de l’acquisition de leurs terres ; il n’y a même que la présence du maître qui les fasse valoir : ce genre de richesses appartient donc à chaque état en particulier. Mais les effets mobiliers, comme l’argent, les billets, les lettres de change, les actions sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises, appartiennent au monde entier, qui dans ce rapport ne compose qu’un seul état, dont toutes les sociétés sont les membres : le peuple qui possede le plus de ces effets mobiliers de l’univers, est le plus riche. Quelques états en ont une immense quantité ; ils les acquierent chacun par leurs denrées, par le travail de leurs ouvriers, par leur industrie, par leurs découvertes, par le [II-299] hasard même. L’avarice des nations se dispute les meubles de tout l’univers. Il peut se trouver un état si malheureux, qu’il sera privé des effets des autres pays, & même encore de presque tous les siens : les propriétaires des fonds de terre n’y seront que les colons des étrangers. Cet état manquera de tout, & ne pourra rien acquérir ; il vaudroit bien mieux qu’il n’eût de commerce avec aucune nation du monde : c’est le commerce qui, dans les circonstances où il se trouvoit, l’a conduit à la pauvreté.
Un pays qui envoie toujours moins de marchandises ou de denrées qu’il n’en reçoit, se met lui-même en équilibre en s’appauvrissant : il recevra toujours moins, jusqu’à ce que, dans une pauvreté extrême, il ne reçoive plus rien.
Dans les pays de commerce, l’argent qui s’est tout-à-coup évanoui revient, parce que les états qui l’ont reçu le doivent : dans les états dont nous parlons, l’argent ne revient jamais, parce que ceux qui l’ont pris ne doivent rien.
La Pologne servira ici d’exemple. Elle n’a presqu’aucune des choses que nous appellons les effets mobiliers de l’univers, si ce n’est le blé de ses terres.
[II-300] Quelques seigneurs possedent des provinces entieres ; ils pressent le laboureur pour avoir une plus grande quantité de blé qu’ils puissent envoyer aux étrangers, & se procurer les choses que demande leur luxe. Si la Pologne ne commerçoit avec aucune nation, ses peuples seroient plus heureux. Ses grands qui n’auroient que leur blé, le donneroient à leurs paysans pour vivre ; de trop grands domaines leur seroient à charge, ils les partageroient à leurs paysans ; tout le monde, trouvant des peaux ou des laines dans ses troupeaux, il n’y auroit plus une dépense immense à faire pour les habits ; les grands qui aiment toujours le luxe, & qui ne le pourroient trouver que dans leur pays, encourageroient les pauvres au travail. Je dis que cette nation seroit plus florissante, à moins qu’elle ne devint barbare ; chose que les lois pourroient prévenir.
Considérons à présent le Japon. La quantité excessive de ce qu’il peut recevoir, produit la quantité excessive de ce qu’il peut envoyer : les choses seront en équilibre, comme si l’importation & l’exportation étoient modérées ; & d’ailleurs [II-301] cette espece d’enflure produira à l’état mille avantages : il y aura plus de consommation, plus de choses sur lesquelles les arts peuvent s’exercer, plus d’hommes employés, plus de moyens d’acquérir de la puissance : il peut arriver des cas où l’on ait besoin d’un secours prompt, qu’un état si plein peut donner plutôt qu’un autre. Il est difficile qu’un pays n’ait des choses superflues ; mais c’est la nature du commerce de rendre les choses superflues utiles, & les utiles nécessaires. L’état pourra donc donner les choses nécessaires à un plus grand nombre de sujets.
Disons donc que ce ne sont point les nations qui n’ont besoin de rien, qui perdent à faire le commerce, ce sont celles qui ont besoin de tout. Ce ne sont point les peuples qui se suffisent à eux-mêmes, mais ceux qui n’ont rien chez eux, qui trouvent de l’avantage à ne trafiquer avec personne.
[II-302]
LIVRE XXI.
Des Lois, dans le rapport quelles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.↩
CHAPITRE PREMIER.
Quelques considérations générales.
Quoique le commerce soit sujet à de grandes révolutions, il peut arriver que de certaines causes physiques, la qualité du terrain ou du climat, fixent pour jamais sa nature.
Nous ne faisons aujourd’hui le commerce des Indes, que par l’argent que nous y envoyons. Les Romains [1] y portoient toutes les années environ cinquante millions de sesterces. Cet argent, comme le nôtre aujourd’hui, étoit converti en marchandises qu’ils [II-303] rapportoient en Occident. Tous les peuples qui ont négocié aux Indes, y ont toujours porté des métaux, & en ont rapporté des marchandises.
C’est la nature même qui produit cet effet. Les Indiens ont leurs arts, qui sont adaptés à leur maniere de vivre. Notre luxe ne sauroit être le leur, ni nos besoins être leurs besoins. Leur climat ne leur demande ni ne leur permet presque rien de ce qui vient chez nous. Ils vont en grande partie nuds, les vêtemens qu’ils ont, le pays les leur fournit convenables ; & leur religion, qui a sur eux tant d’empire, leur donne de la répugnance pour les choses qui nous servent de nourriture. Ils n’ont donc besoin que de nos métaux qui sont les signes des valeurs, & pour lesquels ils donnent des marchandises, que leur frugalité & la nature de leur pays leur procure en grande abondance. Les auteurs anciens qui nous ont parlé des Indes, nous les dépeignent [2] telles que nous les voyons aujourd’hui, quant à la police, aux manieres & aux mœurs. Les Indes ont été, les Indes seront ce [II-304] qu’elles sont à présent ; & dans tous les temps, ceux qui négocieront aux Indes, y porteront de l’argent, & n’en rapporteront pas.
[II-304]
CHAPITRE II.
Des peuples d’Afrique.
La plupart des peuples des côtes de l’Afrique sont sauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup de ce que des pays presqu’inhabitables séparent de petits pays qui peuvent être habités. Ils sont sans industrie ; ils n’ont point d’arts ; ils ont en abondance des métaux précieux qu’ils tiennent immédiatement des mains de la nature. Tous les peuples policés sont donc en état de négocier avec eux avec avantage ; ils peuvent leur faire estimer beaucoup des choses de nulle valeur, & en recevoir un très-grand prix.
[II-305]
CHAPITRE III.
Que les besoins des peuples du midi sont différent de ceux des peuples du nord.
Il y a dans l’Europe une espece de balancement entre les nations du midi & celles du nord. Les premieres ont toutes sortes de commodités pour la vie, & peu de besoins ; les secondes ont beaucoup de besoins, & peu de commodités pour la vie. Aux unes, la nature a donné beaucoup, & elles ne lui demandent que peu ; aux autres, la nature donne peu, & elles lui demandent beaucoup. L’équilibre se maintient par la paresse qu’elle a donnée aux nations du midi, & par l’industrie & l’activité qu’elle a données à celles du nord. Ces dernieres sont obligées de travailler beaucoup, sans quoi elles manqueroient de tout & deviendroient barbares. C’est ce qui a naturalisé la servitude chez les peuples du midi : comme ils peuvent aisément se passer de richesses, ils peuvent encore mieux se passer de liberté. Mais les peuples du nord ont besoin de la liberté, qui leur procure plus de [II-306] moyens de satisfaire tous les besoins que la nature leur a donnés. Les peuples du nord sont donc dans un état forcé, s’ils ne sont libres ou barbares : presque tous les peuples du midi sont en quelque façon dans un état violent, s’ils ne sont esclaves.
[II-306]
CHAPITRE IV.
Principale différence du commerce des anciens, d’avec celui d’aujourd’hui.
Le monde se met de temps en temps dans des situations qui changent le commerce. Aujourd’hui le commerce de l’Europe se fait principalement du nord au midi. Pour lors la différence des climats fait que les peuples ont un grand besoin des marchandises les uns des autres. Par exemple, les boissons du midi portées au nord, forment une espece de commerce que les anciens n’avoient guere. Aussi la capacité des vaisseaux, qui se mesuroit autrefois par muids de blé, se mesure-t-elle aujourd’hui par tonneaux de liqueurs.
Le commerce ancien que nous connoissons, se faisant d’un port de la [II-307] Méditerranée à l’autre, étoit presque tout dans le midi. Or les peuples du même climat ayant chez eux à peu près les mêmes choses, n’ont pas tant de besoin de commercer entr’eux, que ceux d’un climat différent. Le commerce en Europe étoit donc autrefois moins étendu qu’il ne l’est à présent.
Ceci n’est point contradictoire avec ce que j’ai dit de notre commerce des Indes : la différence excessive du climat fait que les besoins relatifs sont nuls.
[II-307]
CHAPITRE V.
Autres différences.
Le commerce, tantôt détruit par les conquérans, tantôt gêné par les monarques, parcourt la terre, fuit d’où il est opprimé, se repose où on le laisse respirer : il regne aujourd’hui où l’on ne voyoit que des déserts, des mers & des rochers ; là où il régnoit, il n’y a que des déserts.
À voir aujourd’hui la Colchide, qui n’est plus qu’une vaste forêt, où le peuple, qui diminue tous les jours, ne défend sa liberté que pour se vendre en [II-308] détail aux Turcs & aux Persans ; on ne diroit jamais que cette contrée eût été du temps des Romains pleine de villes, où le commerce appelloit toutes les nations du monde. On n’en trouve aucun monument dans le pays ; il n’y en a de traces que dans Pline [1] & Strabon [2] .
L’histoire du commerce est celle de la communication des peuples. Leurs destructions diverses, & de certains flux & reflux de populations & de dévastations, en forment les plus grands événemens.
[II-308]
CHAPITRE VI.
Du commerce des anciens.
Les trésors immenses [1] de Sémiramis, qui ne pouvoient avoir été acquis en un jour, nous font penser que les Assyriens avoient eux-mêmes pillé d’autres nations riches, comme les autres nations les pillerent après.
L’effet du commerce sont les richesses, la suite des richesses le luxe, celle du luxe la perfection des arts. Les arts [II-309] portés au point où on les trouve du temps de Sémiramis [2] , nous marquent un grand commerce déjà établi.
Il y avoit un grand commerce de luxe dans les empires d’Asie. Ce seroit une belle partie de l’histoire du commerce que l’histoire du luxe : le luxe des Perses étoit celui des Medes, comme celui des Medes étoit celui des Assyriens.
Il est arrivé de grands changemens en Asie. La partie de la Perse qui est au nord-est, l’Hyrcanïe, la Margiane, la Bactriane, &c. étoient autrefois pleines de villes florissantes [3] qui ne sont plus ; & le nord [4] de cet empire, c’est-à-dire, l’isthme qui sépare la mer Caspienne du Pont-Euxin, étoit couvert de villes & de nations, qui ne sont plus encore.
Eratosthene [5] & Aristobule tenoient de Patrocle [6] , que les marchandises des Indes passoient par l’Oxus dans la mer du Pont. Marc Varron [7] nous dit [II-310] que l’on apprit, du temps de Pompée dans la guerre contre Mithridate, que l’on alloit en sept jours de l’Inde dans le pays des Bactriens, & au fleuve Icarus qui se jette dans l’Oxus ; que par-là les marchandises de l’Inde pouvoient traverser la mer Caspienne, entrer de-là dans l’embouchure du Cyrus ; que de ce fleuve il ne falloit qu’un trajet par terre de cinq jours pour aller au Phase qui conduisoit dans le Pont-Euxin. C’est sans doute par les nations qui peuploient ces divers pays, que les grands empires des Assyriens, des Medes & des Perses, avoient une communication avec les parties de l’orient & de l’occident les plus reculées.
Cette communication n’est plus. Tous ces pays ont été dévastés par les Tartares [8] , & cette nation destructrice les habite encore pour les infester. L’Oxus ne va plus à la mer Caspienne ; les Tartares l’ont détourné pour des [II-311] raisons particulieres [9] ; il se perd dans des sables arides.
Le Jaxarte, qui formoit autrefois une barriere entre les nations policées & les nations barbares, a été tout de même détourné [10] par les Tartares, & ne va plus jusqu’à la mer.
Séleucus Nicator forma le projet [11] de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne. Ce dessein qui eût donné bien des facilités au commerce qui se faisoit dans ce temps-là, s’évanouit à sa [12] mort. On ne sait s’il auroit pu l’exécuter dans l’isthme qui sépare les deux mers. Ce pays est aujourd’hui très-peu connu ; il est dépeuplé & plein de forêts ; les eaux n’y manquent pas, car une infinité de rivieres y descendent du Mont Caucase ; mais ce Caucase, qui forme le nord de l’isthme, & qui étend des especes de bras [13] au midi, auroit été un grand obstacle, sur-tout dans ce temps-là, où l’on n’avoit point l’art de faire des écluses.
[II-312]
On pourroit croire que Séleucus vouloit faire la jonction des deux mers dans le lieu même où le czar Pierre I. l’a faite depuis, c’est-à-dire, dans cette langue de terre où le Tanaïs s’approche du Volga : mais le nord de la mer Caspienne n’étoit pas encore découvert.
Pendant que dans les empires d’Asie il y avoit un commerce de luxe, les Tyriens faisoient par toute la terre un commerce d’économie. Bochard a employé le premier livre de son Chanaan à faire l’énumération des colonies qu’ils envoyerent dans tous les pays qui sont près de la mer ; ils passerent les colonnes d’Hercule, & tirent des établissemens [14] sur les côtes de l’océan.
Dans ces temps-là, les navigateurs étoient obligés de suivre les côtes, qui étoient, pour ainsi dire, leur boussole. Les voyages étoient longs & pénibles. Les travaux de la navigation d’Ulysse ont été un sujet fertile pour le plus beau poëme du monde, après celui qui est le premier de tous.
Le peu de connoissance que la plupart des peuples avoient de ceux qui étoient éloignés d’eux, favorisoit les nations [II-313] qui faisoient le commerce d’économie. Elles mettoient dans leur négoce les obscurités qu’elles vouloient : elles avoient tous les avantages que les nations intelligentes prennent sur les peuples ignorans.
L’Égypte éloignée par la religion & par les mœurs, de toute communication avec les étrangers, ne faisoit guere de commerce au dehors : elle jouissoit d’un terrain fertile & d’une extrême abondance. C’étoit le Japon de ces temps-là : elle se suffisoit à elle-même.
Les Égyptiens furent si peu jaloux du commerce du dehors, qu’ils laisserent celui de la mer rouge à toutes les petites nations qui y eurent quelque port. Ils souffrirent que les Iduméens, les Juifs & les Syriens y eussent des flottes. Salomon [15] employa à cette navigation des Tyriens qui connoissoient ces mers.
Josephe [16] dit que sa nation, uniquement occupée de l’agriculture, connoissoit peu la mer : aussi ne fut-ce que par occasion que les Juifs négocierent dans la mer rouge. Ils conquirent sur les [II-314] Iduméens Elath & Asiongaber, qui leur donnerent ce commerce : ils perdirent ces deux villes, & perdirent ce commerce aussi.
Il n’en fut pas de même des Phéniciens : ils ne faisoient pas un commerce de luxe, ils ne négocioient point par la conquête ; leur frugalité, leur habileté, leur industrie, leurs périls, leurs fatigues, les rendoient nécessaires à toutes les nations du monde.
Les nations voisines de la mer rouge ne négocioient que dans cette mer & celle d’Afrique. L’étonnement de l’univers à la découverte de la mer des Indes, faite sous Alexandre, le prouve assez. Nous avons [17] dit qu’on porte toujours aux Indes des métaux précieux, & que l’on n’en rapporte [18] point : les flottes Juives qui rapportoient par la mer rouge de l’or & de l’argent, revenoient d’Afrique, & non pas des Indes.
Je dis plus ; cette navigation se faisoit sur la côte orientale de l’Afrique ; & l’état où la étoit la marine pour lors, prouve [II-315] assez qu’on n’alloit pas dans des lieux bien reculés.
Je sais que les flottes de Salomon & de Jozaphat ne revenoient que la troisieme année ; mais je ne vois pas que la longueur du voyage prouve la grandeur de l’éloignement.
Pline & Strabon nous disent que le chemin qu’un navire des Indes & de la mer rouge, fabriqué de joncs, faisoit en vingt jours, un navire Grec ou Romain le faisoit en sept [19] . Dans cette proportion, un voyage d’un an pour les flottes Grecques & Romaines, étoit à peu près de trois pour celles de Salomon.
Deux navires d’une vîtesse inégale ne font pas leur voyage dans un temps proportionné à leur vîtesse : la lenteur produit souvent une plus grande lenteur. Quand il s’agit de suivre les côtes, & qu’on se trouve sans cesse dans une différente position ; qu’il faut attendre un bon vent pour sortir d’un golfe, en avoir un autre pour aller en avant, un navire bon voilier profite de tous les temps favorables, tandis que l’autre [II-316] reste dans un endroit difficile, & attend plusieurs jours un autre changement.
Cette lenteur des navires des Indes qui dans un temps égal ne pouvoient faire que le tiers du chemin que faisoient les vaisseaux Grecs & Romains, peut s’expliquer par ce que nous voyons aujourd’hui dans notre marine. Les navires des Indes qui étoient de jonc, tiroient moins d’eau que les vaisseaux Grecs & Romains qui étoient de bois, & joints avec du fer.
On peut comparer ces navires des Indes à ceux de quelques nations d’aujourd’hui dont les ports ont peu de fond : tels sont ceux de Venise, & même en général de l’Italie [20] , de la mer Baltique & de la province de Hollande [21] . Leurs navires qui doivent en sortir & y rentrer, sont d’une fabrique ronde & large de fond ; au lieu que les navires d’autres nations qui ont de bons ports, sont par le bas d’une forme qui les fait entrer profondément dans l’eau. Cette mécanique fait que ces derniers navires [II-317] naviguent plus près du vent, & que les premiers ne navigent presque que quand ils ont le vent en poupe. Un navire qui entre beaucoup dans l’eau, navige vers le même côté à presque tous les vents ; ce qui vient de la résistance que trouve dans l’eau le vaisseau poussé par le vent, qui fait un point d’appui, & de la forme longue du vaisseau qui est présenté au vent par son côté, pendant que par l’effet de la figure du gouvernail on tourne la proue vers le côté que l’on se propose ; ensorte qu’on peut aller très-près du vent, c’est-à-dire, très-près du côté d’où vient le vent. Mais quand le navire est d’une figure ronde & large du fond, & que par conséquent il enfonce peu dans l’eau, il n’y a plus de point d’appui ; le vent chasse le vaisseau, qui ne peut résister, ni guere aller que du côté opposé au vent. D’où il suit que les vaisseaux d’une construction ronde de fond, sont plus lents dans leurs voyages : 1.o ils perdent beaucoup de temps à attendre le vent, sur-tout s’ils sont obligés de changer souvent de direction : 2.o ils vont plus lentement, parce que n’ayant pas de point d’appui, ils ne sauroient porter autant de voiles que les autres. Que si [II-318] dans un temps où la marine s’est si fort perfectionnée ; dans un temps où les arts se communiquent ; dans un temps où l’on corrige par l’art & les défauts de la nature & les défauts de l’art même ; on sent ces différences, que devoit-ce être dans la marine des anciens ?
Je ne saurois quitter ce sujet. Les navires des Indes étoient petits, & ceux des Grecs & des Romains, si l’on en excepte ces machines que l’ostentation fit faire, étoient moins grands que les nôtres. Or, plus un navire est petit, plus il est en danger dans les gros temps. Telle tempête submerge un navire, qui ne feroit que le tourmenter s’il étoit plus grand. Plus un corps en surpasse un autre en grandeur, plus la surface est relativement petite ; d’où il suit que dans un petit navire il y a une moindre raison, c’est-à-dire, une plus grande différence de la surface du navire au poids ou à la charge qu’il peut porter, que dans un grand. On sait que, par une pratique à peu près générale, on met dans un navire une charge d’un poids égal à celui de la moitié de l’eau qu’il pourroit contenir. Supposons qu’un navire tînt huit cents tonneaux d’eau ; sa charge seroit de [II-319] quatre cents tonneaux ; celle d’un navire qui ne tiendroit que quatre cents tonneaux d’eau, seroit de deux cents tonneaux. Ainsi la grandeur du premier navire seroit, au poids qu’ils porteroit, comme 8 est à 4 ; & celle du second, comme 4 est à 2. Supposons que la surface du grand soit, à la surface du petit, comme 8 est à 6 ; la surface [22] de celui-ci sera, à son poids, comme 6 est à 2 ; tandis que la surface de celui-là ne sera, à son poids, que comme 8 est à 4 ; & les vents & les flots n’agissant que sur la surface, le grand vaisseau résistera plus par son poids à leur impétuosité, que le petit.
-
[↑] Diodore, Liv. II.
-
[↑] Diodore, liv II.
-
[↑] Voyez Pline, liv. VI. chap. xvi ; & Strabon, livre XI.
-
[↑] Strabon, livre XI.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] L’autorité de Patrocle est considérable, comme il paroît par un récit de Strabon, liv. II.
-
[↑] Dans Pline, liv. VI. chap. xvii. Voyez aussi Strabon, liv. XI. sur le trajet des marchandises du Phase au Cyrus.
-
[↑] Il faut que depuis le temps de Ptolomée, qui nous décrit tant de rivieres qui se jettent dans la partie orientale de la mer Caspienne, il y ait eu de grands changemens dans ce pays. La carte du czar ne met de ce côté-là que la riviere d’Astrabat ; & celle de M. Bathalsi, rien du tout.
-
[↑] Voyez la relation de Genkinson, dans le recueil des voyages du nord, tome IV.
-
[↑] Je crois que de-là s’est formé le lac Aral.
-
[↑] Claude César, dans Pline, liv. VI. chap, ii.
-
[↑] Il fut tué par Ptolomée Ceranus.
-
[↑] Voyez Strabon, liv. XI.
-
[↑] Ils fonderent Tartèse, & s’établirent à Cadix.
-
[↑] Livre III. des Rois, chap. ix ; Paralip. liv. II. chap. viii.
-
[↑] Contre Appion.
-
[↑] Au chapitre I. de ce Livre.
-
[↑] La proportion établie en Europe entre l’or & l’argent, peut quelquefois faire trouver du profit à prendre dans les Indes de l’or pour de l’argent ; mais c’est peu de chose.
-
[↑] Voyez Pline, liv. VI. chap. xxii ; & Strabon, liv. XV.
-
[↑] Elle n’a presque que des rades ; mais la Sicile a de très-bons ports.
-
[↑] Je dis de la province de Hollande ; car les ports de celle de Zélande sont assez profonds.
-
[↑] C’est-à-dire, pour comparer les grandeurs de même genre : l’action ou la prise du fluide sur le navire, sera à la résistance du même navire, comme, &c.
[II-319]
CHAPITRE VII.
Du commerce des Grecs.
Les premiers Grecs étoient tous pirates. Minos, qui avoit eu l’empire de la mer, n’avoit eu peut-être que de plus grands succès dans les brigandages : son empire étoit borné aux environs de son île. Mais lorsque les Grecs devinrent [II-320] un grand peuple, les Athéniens obtinrent le véritable empire de la mer, parce que cette nation commerçante & victorieuse donna la loi au monarque [1] le plus puissant d’alors, & abattit les forces maritimes de la Syrie, de l’île de Chypre & de la Phénicie.
Il faut que je parle de cet empire de la mer qu’eut Athenes. « Athenes, dit Xénophon [2] , a l’empire de la mer : mais comme l’Attique tient à la terre, les ennemis la ravagent, tandis qu’elle fait les expéditions au loin. Les principaux laissent détruire leurs terres, & mettent leurs biens en sureté dans quelqu’île : la populace qui n’a point de terres, vit sans aucune inquiétude. Mais si les Athéniens habitoient une île, & avoient outre cela l’empire de la mer, ils auroient le pouvoir de nuire aux autres sans qu’on pût leur nuire, tandis qu’ils seroient les maîtres de la mer ». Vous diriez que Xénophon a voulu parler de l’Angleterre.
Athenes remplie de projets de gloire ; Athenes qui augmentoit la jalousie, au lieu d’augmenter l’influence ; plus [II-321] attentive à étendre son empire maritime, qu’à en jouir ; avec un tel gouvernement politique, que le bas peuple se distribuoit les revenus publics, tandis que les riches étoient dans l’oppression ; ne fit point ce grand commerce que lui promettoient le travail de ses mines, la multitude de ses esclaves, le nombre de ses gens de mer, son autorité sur les villes Grecques, & plus que tout cela, les belles institutions de Solon. Son négoce fut presque borné à la Grece & au Pont-Euxin, d’où elle tira sa subsistance.
Corinthe fut admirablement bien située : elle sépara deux mers, ouvrit & ferma le Péloponese, & ouvrit & ferma la Grece. Elle fut une ville de la plus grande importance, dans un temps où le peuple Grec étoit un monde, & les villes Grecques des nations : elle fit un plus grand commerce qu’Athenes. Elle avoit un port pour recevoir les marchandises d’Asie ; elle en avoit un autre pour recevoir celles d’Italie ; car, comme il y avoit de grandes difficultés à tourner le promontoire Malée, où des vents [3] opposés se rencontrent & causent des naufrages, on aimoit mieux [II-322] aller à Corinthe, & l’on pouvoit même faire passer par terre ses vaisseaux d’une mer à l’autre. Dans aucune ville on ne porta si loin les ouvrages de l’art. La religion acheva de corrompre ce que son opulence lui avoit laissé de mœurs. Elle érigea un temple à Venus, où plus de mille courtisanes furent consacrées. C’est de ce séminaire que sortirent la plupart de ces beautés célebres dont Athénée a osé écrire l’histoire.
Il paroît que, du temps d’Homere, l’opulence de la Grece étoit à Rhodes, à Corinthe & à Orcomene. « Jupiter, dit-il [4] , aima les Rhodiens, & leur donna de grandes richesses ». Il donna à Corinthe [5] l’épithete de riche. De même, quand il veut parler des villes qui ont beaucoup d’or, il cite Orcomene [6] , qu’il joint à Thebes d’Égypte. Rhodes & Corinthe conserverent leur puissance, & Orcomene la perdit. La position d’Orcomene, près de l’Hellespont, de la Propontide & du Pont-Euxin, fait naturellement penser qu’elle tiroit ses richesses d’un commerce sur les [II-323] côtes de ces mers, qui avoit donné lieu à la fable de la toison d’or : Et effectivement le nom de Miniares est donné à Orcomene [7] & encore aux Argonautes. Mais comme dans la suite ces mers devinrent plus connues ; que les Grecs y établirent un très-grand nombre de colonies ; que ces colonies négocierent avec les peuples barbares ; qu’elles communiquerent avec leur métropole ; Orcomene commença à déchoir, & elle rentra dans la foule des autres villes Grecques.
Les Grecs, avant Homere, n’avoient guere négocié qu’entr’eux, & chez quelque peuple barbare ; mais ils étendirent leur domination, à mesure qu’ils formerent de nouveaux peuples. La Grece étoit une grande péninsule dont les caps sembloient avoir fait reculer les mers & les golfes s’ouvrir de tous côtés, comme pour les recevoir encore. Si l’on jette les yeux sur la Grece, on verra, dans un pays assez resserré, une vaste étendue de côtes. Ses colonies innombrables faisoient une immense circonférence autour d’elle ; & elle y voyoit, pour ainsi dire, tout le monde [II-324] qui n’étoit pas barbare. Pénétra-t-elle en Sicile & en Italie ? elle y forma des nations. Navigua-t-elle vers les mers du Pont, vers les côtes de l’Asie mineure, vers celle d’Afrique ? elle en fit de même. Ses villes acquirent de la prospérité, à mesure qu’elles se trouverent près de nouveaux peuples. Et ce qu’il y avoit d’admirable, des îles sans nombre, situées comme en premiere ligne, l’entouroient encore.
Quelle cause de prospérité pour la Grece, que des jeux qu’elle donnoit pour ainsi dire, à l’univers ; des temples, où tous les rois envoyoient des offrandes ; des fêtes, où l’on s’assembloit de toutes parts ; des oracles, qui faisoient l’attention de toute la curiosité humaine ; enfin, le goût & les arts portés à un point, que de croire les surpasser sera toujours ne les pas connoître ?
-
[↑] Le roi de Perse.
-
[↑] De republ. Athen.
-
[↑] Voyez Strabon, liv. VIII.
-
[↑] Iliade, liv. II.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid. liv. I. v. 381. Voyez Stabon, liv. IX. p. 414, édition de 1620.
-
[↑] Strabon, liv. IX, p.414.
[II-324]
CHAPITRE VIII.
D’Alexandre. Sa conquête.
Quatre événemens arrivés sous Alexandre firent dans le commerce une grande révolution ; la prise de [II-325] Tyr, la conquête de l’Égypte, celle des Indes, & la découverte de la mer qui est au midi de ce pays.
L’empire des Perses s’étendoit jusqu’à l’Indus [1] . Long-temps avant Alexandre, Darius [2] avoit envoyé des navigateurs qui descendirent ce fleuve, & allerent jusqu’à la mer rouge. Comment donc les Grecs furent-ils les premiers qui firent par le midi le commerce des Indes ? Comment les Perses ne l’avoient-ils pas fait auparavant ? Que leur servoient des mers qui étoient si proche d’eux, des mers qui baignoient leur empire ? Il est vrai qu’Alexandre conquit les Indes : mais faut-il conquérir un pays pour y négocier ? J’éxaminerai ceci.
L’Ariane [3] qui s’étendoit depuis le golfe Persique jusqu’à l’Indus, & de la mer du midi jusqu’aux montagnes des Paropamisades, dépendoit bien en quelque façon de l’empire des Perses : mais dans la partie méridionale elle étoit aride, brûlée, inculte & barbare. La tradition [4] portoit que les armées [II-326] de Sémiramis & de Cyrus avoient péri dans ces déserts ; & Alexandre, qui se fit suivre par sa flotte, ne laissa pas d’y perdre une grande partie de son armée. Les Perses laissoient toute la côte au pouvoir des Icthyophages [5] , des Orittes & autres peuples barbares. D’ailleurs les Perses [6] n’étoient pas navigateurs, & leur religion même leur ôtoit toute idée de commerce maritime. La navigation que Darius fit faire sur l’Indus & la mer des Indes, fut plutôt une fantaisie d’un prince qui veut montrer sa puissance, que le projet réglé d’un monarque qui veut l’employer. Elle n’eut de suite, ni pour le commerce, ni pour la marine ; & si l’on sortit de l’ignorance, ce fut pour y retomber.
Il y a plus : il étoit reçu [7] avant l’expédition d’Alexandre, que la partie méridionale des Indes étoit inhabitable [8] : ce qui suivoit de la tradition [II-327] que Sémiramis [9] , n’en avoit ramené que vingt hommes, & Cyrus que sept.
Alexandre entra par le nord. Son dessein étoit de marcher vers l’orient : mais ayant trouvé la partie du midi pleine de grandes nations, de villes & de rivieres, il en tenta la conquête, & la fit.
Pour lors, il forma le dessein d’unir les Indes avec l’occident par un commerce maritime, comme il les avoit unies par des colonies qu’il avoit établies dans les terres.
Il fit construire une flotte sur l’Hydaspe, descendit cette riviere, entra dans l’Indus, & navigua jusqu’à son embouchure. Il laissa son armée & sa flotte à Patale, alla lui-même avec quelques vaisseaux reconnoître la mer, marqua les lieux où il voulut que l’on construisit des ports, des havres, des arsenaux. De retour à Patale, il se sépara de sa flotte, & prit la route de terre, pour lui donner du secours, & en recevoir. La flotte suivit la côte depuis l’embouchure de l’Indus, le long du rivage des pays des Orittes, des Icthyophages, de la Caramanie & de la Perse. Il fit [II-328] creuser des puits, bâtir des villes ; il défendit aux Icthyophages [10] de vivre de poisson : il vouloit que les bords de cette mer fussent habités par des nations civilisées. Néarque & Onésicrite ont fait le journal de cette navigation, qui fut de dix mois. Ils arriverent à Suze ; ils y trouverent Alexandre qui donnoit des fêtes à son armée.
Ce conquérant avoit fondé Alexandrie, dans la vue de s’assurer de l’Égypte ; c’étoit une clef pour l’ouvrir, dans le lieu même [11] où les rois ses prédécesseurs avoient une clef pour la fermer ; & il ne songeoit point à un commerce dont la découverte de la mer des Indes pouvoit seule lui faire naître la pensée.
Il paroît même qu’après cette [II-329] découverte, il n’eut aucune vue nouvelle sur Alexandrie. Il avoit bien, en général, le projet d’établir un commerce entre les Indes & les parties occidentales de son empire : mais, pour le projet de faire ce commerce par l’Égypte, il lui manquoit trop de connoissances pour pouvoir le former. Il avoit vu l’Indus, il avoit vu le Nil ; mais il ne connoissoit pas les mers d’Arabie, qui sont entre deux. À peine fut-il arrivé des Indes, qu’il fit construire de nouvelles flottes, & navigua [12] sur l’Euleus, le Tigre, l’Euphrate & la mer : il ôta les cataractes que les Perses avoient mises sur ces fleuves : il découvrit que le sein Persique étoit un golfe de l’océan. Comme il alla reconnoître [13] cette mer, ainsi qu’il avoit reconnu celle des Indes ; comme il fit construire un port à Babylone pour mille vaisseaux, & des arsenaux ; comme il envoya cinq cents talens en Phénicie & en Syrie, pour en faire venir des nautoniers, qu’il vouloit placer dans les colonies qu’il répandoit sur les côtes ; comme enfin il fit des travaux immenses sur l’Euphrate & les [II-330] autres fleuves de l’Assyrie, on ne peut douter que son dessein ne fût de faire le commerce des Indes par Babylone & le golfe Persique.
Quelques gens, sous prétexte qu’Alexandre vouloit conquérir l’Arabie [14] , ont dit qu’il avoit formé le dessein d’y mettre le siege de son empire : mais comment auroit-il choisi un lieu qu’il ne connoissoit pas [15] ? D’ailleurs c’étoit le pays du monde le plus incommode : il se seroit séparé de son empire. Les califes, qui conquirent au loin, quitterent d’abord l’Arabie, pour s’établir ailleurs.
-
[↑] Strabon, liv. XV.
-
[↑] Hérodote, in Melpomene.
-
[↑] Strabon, liv. XV.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Pline, liv. VI, ch XXIII. Strabon, liv. XV.
-
[↑] Pour ne point souiller les élémens, ils ne naviguoient pas sur les fleuves. M. Hidde, religion des Perses. Encore aujourd’hui ils n’ont point de commerce maritime, & ils traitent d’athées ceux qui vont sur mer.
-
[↑] Strabon, liv. XV.
-
[↑] Hérodote, in Melpomene, dit que Darius, conquit les Indes. Cela ne peut-être entendu que de l’Ariane : encore fut-ce qu’une conquête en idée.
-
[↑] Srabon, liv. XV.
-
[↑] Ceci ne sauroit s’entendre de tous les Icthyophages qui habitoient une côte de dix mille stades. Comment Alexandre auroit-il pu leur donner la subsistance ? Comment se seroit-il fait obéir ? Il ne peut être ici question que de quelques peuples particuliers. Néarque, dans le livre rerum Indicarum, dit, qu’à l’extrémité de cette côte, du côté de la Perse, il avoit trouvé des peuples moins icthyophages. Je croirois que l’ordre d’Alexandre regardoit cette contrée, ou quelqu’autre encore plus voisine de la Perse.
-
[↑] Alexandrie fut fondée dans une plage appelée Recotis. Les anciens rois y tenoient une garnison, pour défendre l’entrée du pays aux étrangers, & sur-tout aux Grecs qui étoient, comme on sait, de grands pirates. Vovez Pline, liv. VI, chap. x, & Strabon, liv. XVIII.
-
[↑] Arrien, de exped. Aleandri, lib. VII.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Strabon, liv. XVI, à la fin.
-
[↑] Voyant la Babylonie inondée, il regardoit l’Arabie, qui en est proche, comme une île. Aristobule, dans Strabon, liv. XVI.
[II-330]
CHAPITRE IX.
Du commerce des rois Grecs après Alexandre.
Lorsqu’Alexandre conquit l’Égypte, on connoissoit très-peu la mer rouge, & rien de cette partie de l’océan qui se joint à cette mer, & qui baigne d’un côté la côte d’Afrique, & de l’autre celle de l’Arabie ; on crut même depuis qu’il étoit impossible de [II-331] faire le tour de la presqu’île d’Arabie. Ceux qui l’avoient tenté de chaque côté, avoient abandonné leur entreprise. On disoit [1] : « Comment seroit-il possible de naviguer au midi des côtes de l’Arabie, puisque l’armée de Cambyse, qui la traversa du côté du nord, périt presque toute ; & que celle que Ptolomée, fils de Lagus, envoya au secours de Séleucus Nicator, à Babylone, souffrit des maux incroyables, & à cause de la chaleur ne put marcher que la nuit ».
Les Perses n’avoient aucune sorte de navigation. Quand ils conquirent l’Égypte, ils y apporterent le même esprit qu’ils avoient eu chez eux ; & la négligence fut si extraordinaire, que les rois Grecs trouverent que non-seulement les navigations des Tyriens, des Iduméens & des Juifs dans l’océan, étoient ignorées ; mais que celles même de la mer rouge l’étoient. Je crois que la destruction de la premiere Tyr par Nabuchodonosor, & celle de plusieurs petites nations & villes voisines de la mer rouge, firent perdre les connoissances que l’on avoit acquises.
[II-332]
L’Égypte, du temps des Perses, ne confrontoit point à la mer rouge : elle ne contenoit [2] que cette lisiere de terre longue & étroite que le Nil couvre par ses inondations, & qui est resserrée des deux côtés par des chaînes de montagnes. Il fallut donc découvrir la mer rouge une seconde fois, & l’océan une seconde fois ; & cette découverte appartint à la curiosité des rois Grecs.
On remonta le Nil, on fit la chasse des éléphans dans les pays qui sont entre le Nil & la mer ; on découvrit les bords de cette mer par les terres : Et comme cette découverte se fit sous les Grecs, les noms en sont Grecs, & les temples sont consacrés [3] à des divinités Grecques.
Les Grecs d’Égypte purent faire un commerce très-étendu ; ils étoient maîtres des ports de la mer rouge ; Tyr, rivale de toute nation commerçante, n’étoit plus : ils n’étoient point gênés par les anciennes [4] superstitions du pays ; l’Égypte étoit devenue le centre de l’univers.
[II-333]
Les rois de Syrie laisserent à ceux d’Égypte le commerce méridional des Indes, & ne s’attacherent qu’à ce commerce septentrional qui se faisoit par l’Oxus & la mer Caspienne. On croyoit dans ces temps-là que cette mer étoit une partie de l’océan septentrional [5] : & Alexandre, quelque temps avant sa mort, avoit fait construire [6] une flotte, pour decouvrir si elle communiquoit à l’océan par le Pont-Euxin, ou par quelqu’autre mer orientale vers les Indes. Après lui Séleucus & Antiochus eurent une attention particuliere à la reconnoître : ils y entretinrent [7] des flottes. Ce que Séleucus reconnut fut appelé mer Séleucide : ce qu’Antiochus découvrit fut appelé mer Antiochide. Attentifs aux projets qu’ils pouvoient avoir de ce côté-là, ils négligerent les mers du midi ; soit que les Ptolomés, par leurs flottes sur la mer rouge, s’en fussent déjà procuré l’empire ; soit qu’ils eussent découvert dans les Perses un éloignement invincible pour la marine. La côte [II-334] du midi de la Perse ne fournissoit point de matelots ; on n’y en avoit vu que dans les derniers momens de la vie d’Alexandre, mais les rois d’Égypte, maîtres de l’île de Chypre, de la Phénicie, & d’un grand nombre de places sur les côtes de l’Asie mineure, avoient toutes sortes de moyens pour faire des entreprises de mer. Ils n’avoient point à contraindre le génie de leurs sujets ; ils n’avoient qu’à le suivre.
On a de la peine à comprendre l’obstination des anciens à croire que la mer Caspienne étoit une partie de l’océan. Les expéditions d’Alexandre, des rois de Syrie, des Parthes & des Romains, ne purent leur faire changer de pensée : c’est qu’on revient de ses erreurs le plus tard qu’on peut. D’abord on ne connut que le midi de la mer Caspienne, on la prit pour l’océan ; à mesure que l’on avança le long de ses bords du côté du nord, on crut encore que c’étoit l’océan qui entroit dans les terres : En suivant les côtes, on n’avoit reconnu du côté de l’est que jusqu’au Jaxarte, & du côté de l’ouest que jusqu’aux extrémités de l’Albanie. La mer, du côté du nord, étoit [II-335] vaseuse [8] , & par conséquent très-peu propre à la navigation. Tout cela fit que l’on ne vit jamais que l’océan.
L’armée d’Alexandre n’avoit été, du côté de l’orient, que jusqu’à l’Hypanis, qui est la derniere des rivieres qui se jettent dans l’Indus. Ainsi le premier commerce que les Grecs eurent aux Indes se fit dans une très-petite partie du pays. Séleucus Nicator pénetra jusqu’au Gange [9] : & par-là on découvrit la mer où ce fleuve se jette, c’est-à-dire, le golfe de Bengale. Aujourd’hui l’on découvre les terres par les voyages de mer ; autrefois on découvroit les mers par la conquête des terres.
Strabon [10] , malgré le témoignage d’Appollodore, paroît douter que les rois [11] Grecs de Bactriane soient allés plus loin que Séleucus & Alexandre. Quand il seroit vrai qu’ils n’auroient pas été plus loin vers l’orient que Séleucus, ils allerent plus loin vers le midi : ils découvrirent [12] Siger & des ports dans [II-336] le Malabar, qui donnerent lieu à la navigation dont je vais parler.
Pline [13] nous apprend qu’on prit successivement trois routes pour faire la navigation des Indes. D’abord on alla du promontoire de Siagre à l’île de Patalene, qui est à l’embouchure de l’Indus : on voit que c’étoit la route qu’avoit tenue la flotte d’Alexandre. On prit ensuite un chemin plus court [14] & plus sûr ; & on alla du même promontoire à Siger. Ce Siger ne peut être que le royaume de Siger dont parle Strabon [15] , que les rois Grecs de Bactriane découvrirent. Pline ne peut dire que ce chemin fût plus court, que parce qu’on le faisoit en moins de temps ; car Siger devoit être plus reculé que l’Indus, puisque les rois de Bactriane le découvrirent. Il falloit donc que l’on évitât par-là le détour de certaines côtes, & que l’on profitât de certains vents. Enfin, les marchands prirent une troisieme route : ils se rendoient à Canes ou à Océlis, ports situés à l’embouchure de la mer rouge, d’où par un vent d’ouest, [II-337] on arrivoit à Muziris, premiere étape des Indes, & de là à d’autres ports. On voit qu’au lieu d’aller de l’embouchure de la mer rouge jusqu’à Siagre en remontant la côte de l’Arabie heureuse au nord-est, on alla directement de l’ouest à l’est, d’un côté à l’autre, par le moyen des mouçons, dont on découvrit les changemens en naviguant dans ces parages. Les anciens ne quitterent les côtes, que quand ils se servirent des mouçons [16] & des vents alisés, qui étoient une espece de boussole pour eux.
Pline [17] dit, qu’on partoit pour les Indes au milieu de l’été, & qu’on en revenoit vers la fin de décembre & au commencement de janvier. Ceci est entiérement conforme aux journaux de nos navigateurs. Dans cette partie de la mer des Indes qui est entre la presqu’île d’Afrique & celle de deçà le Gange, il y a deux mouçons : la premiere, pendant laquelle les vents vont de l’ouest à l’est, commence au mois d’août & de septembre ; la deuxieme, pendant laquelle les vents vont de l’est à l’ouest, [II-338] commence en janvier. Ainsi nous partons d’Afrique pour le Malabar dans le temps que partoient les flottes de Ptolomée, & nous en revenons dans le même temps.
La flotte d’Alexandre mit sept mois pour aller de Patale à Suze. Elle partit dans le mois de juillet, c’est-à-dire, dans un temps où aujourd’hui aucun navire n’ose se mettre en mer pour revenir des Indes. Entre l’une & l’autre mouçon, il y a un intervalle de temps pendant lequel les vents varient ; & où un vent de nord se mêlant avec les vents ordinaires, cause sur-tout auprès des côtes, d’horribles tempêtes. Cela dure les mois de juin, de juillet, & d’août. La flotte d’Alexandre partant de Patale au mois de juillet, essuya bien des tempêtes, & le voyage fut long, parce qu’elle navigua dans une mouçon contraire.
Pline dit qu’on partoit pour les Indes à la fin de l’été : ainsi on employoit le temps de la variation de la mouçon à faire le trajet d’Alexandrie à la mer rouge.
Voyez, je vous prie, comment on se perfectionna peu à peu dans la [II-339] navigation. Celle que Darius fit faire, pour descendre l’Indus & aller à la mer rouge, fut de deux ans & demi [18] . La flotte d’Alexandre [19] descendant l’Indus, arriva à Suze dix mois après, ayant navigué trois mois sur l’Indus & sept sur la mer des Indes ; dans la suite, le trajet de la côte de Malabar à la mer rouge se fit en quarante jours [20] .
Strabon, qui rend raison de l’ignorance où l’on étoit des pays qui sont entre l’Hypanis & le Gange, dit que parmi les navigateurs qui vont de l’Égypte aux Indes, il y en a peu qui aillent jusqu’au Gange. Effectivement, on voit que les flottes n’y alloient pas ; elles alloient par les mouçons de l’ouest à l’est, de l’embouchure de la mer rouge à la cote de Malabar. Elles s’arrêtoient dans les étapes qui y étoient, & n’alloient point faire le tour de la presqu’île deçà le Gange par le cap de Comorin & la côte de Coromandel : le plan de la navigation des rois d’Égypte & des Romains, étoit de revenir la même année [21] .
[II-340]
Ainsi il s’en faut bien que le commerce des Grecs & des Romains aux Indes ait été aussi étendu que le nôtre ; nous qui connoissons des pays immenses qu’ils ne connoissoient pas ; nous qui faisons notre commerce avec toutes les nations Indiennes, & qui commerçons même pour elles & naviguons pour elles.
Mais ils faisoient ce commerce avec plus de facilité que nous : & si l’on ne négocioit aujourd’hui que sur la côte du Guzarat & du Malabar, & que sans aller chercher les îles du Midi, on se contentât des marchandises que les insulaires viendroient apporter, il faudroit préférer la route de l’Égypte à celle du cap de Bonne-Espérance. Strabon [22] dit que l’on négocioit ainsi avec les peuples de la Taprobane.
-
[↑] Voyez le livre rerum Indicarum.
-
[↑] Strabon, liv. XVI.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Elles leur donnoient de l’horreur pour les étrangers.
-
[↑] Pline, liv. II, ch. lxviii, & liv. VI, ch. ix & xii. Strabon, liv. XI. Arrien, de l’expéd. d’Alex, liv. III, p. 74, & liv. V. p. 104
-
[↑] Arrien, de l’expéd. d’Alex, liv. VII.
-
[↑] Pline, liv. II, ch. lxiv.
-
[↑] Voyez la carte du czar.
-
[↑] Pline, liv. VI, ch. XVII.
-
[↑] Liv. XV.
-
[↑] Les Macédoniens de la Bactriane, des Indes & de l’Ariane s’étant séparés du royaume de Syrie, formerent un grand état.
-
[↑] Apollonius Adramittin, dans Strabon, liv. XI.
-
[↑] Liv. VI, ch. xxiii.
-
[↑] Pline, liv. VI, ch. xxiii.
-
[↑] Liv. XI, Sigertidis regnum.
-
[↑] Les mouçons soufflent une partie de l’année d’un côté, & une partie de l’année de l’autre ; & les vents alisés soufflent du même côté toute l’année.
-
[↑] Liv. VI, ch. xxiii.
-
[↑] Hérodote, in Melpomene.
-
[↑] Pline, liv. VI, ch. xxiii.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Liv. XV.
[II-341]
CHAPITRE X.
Du tour de l’Afrique.
On trouve dans l’histoire, qu’avant la découverte de la boussole on tenta quatre fois de faire le tour de l’Afrique. Des Phéniciens envoyés par Nécho [1] , & Eudoxe [2] , fuyant la colere de Ptolomée-Lature, partirent de la mer rouge & réussirent. Sataspe [3] sous Xerxès, & Hannon qui fut envoyé par les Carthaginois, sortirent des colonnes d’Hercule, & ne réussirent pas.
Le point capital pour faire le tour de l’Afrique étoit de découvrir & de doubler le cap de Bonne-Espérance. Mais si l’on partoit de la mer rouge, on trouvoit ce cap de la moitié du chemin plus près qu’en partant de la méditerranée. La côte qui va de la mer rouge au cap est plus saine que [4] celle qui va du cap aux colonnes d’Hercule. Pour que [II-342] ceux qui partoient des colonnes d’Hercule ayent pu découvrir le cap, il a fallu l’invention de la boussole, qui a fait que l’on a quitté la côte d’Afrique & qu’on a navigué dans le vaste océan [5] pour aller vers l’île de Sainte-Hélene ou vers la côte du Brésil. Il étoit donc très-possible qu’on fût allé de la mer rouge dans la méditerranée, sans qu’on fût revenu de la méditerranée à la mer rouge.
Ainsi sans faire ce grand circuit, après lequel on ne pouvoit plus revenir, il étoit plus naturel de faire le commerce de l’Afrique orientale par la mer rouge, & celui de la côte occidentale par les colonnes d’Hercule.
Les rois Grecs d’Égypte découvrirent d’abord, dans la mer rouge, la partie de la côte d’Afrique qui va depuis le fond du golfe où est la cité d’Heroum, jusqu’à Dira, c’est-à-dire, jusqu’au détroit appelé aujourd’hui de Babelmandel. De là jusqu’au [II-343] promontoire des Aromates situé à l’entrée de la mer rouge [6] , la côte n’avoit point été reconnue par les navigateurs : & cela est clair par ce que nous dit Artémidore [7] , que l’on connoissoit les lieux de cette côte, mais qu’on en ignoroit les distances ; ce qui venoit de ce qu’on avoit successivement connu ces ports par les terres, & sans aller de l’un à l’autre.
Au-delà de ce promontoire où commence la côte de l’océan, on ne connoissoit rien, comme nous [8] l’apprenons d’Eratosthene & d’Artémidore.
Telles étoient les connoissances que l’on avoit des côtes d’Afrique du temps de Strabon, c’est-à-dire, du temps d’Auguste. Mais depuis Auguste, les Romains découvrirent le promontoire Raptum, & le promontoire Prassum, dont Strabon ne parle pas, parce qu’ils n’étoient pas encore connus. On voit que ces deux noms sont Romains.
[II-344]
Ptolomée le géographe vivoit sous Adrien & Antonin Pie ; & l’auteur du Périple de la mer Erythrée, quel qu’il soit, vécut peu de temps après. Cependant le premier borne l’Afrique [9] connue au promontoire Prassum, qui est environ au quatorzieme degré de latitude sud : & l’auteur du Périple [10] au promontoire Raptum, qui est à peu près au dixieme degré de cette latitude. Il y a apparence que celui-ci prenoit pour limite un lieu où l’on alloit, & Ptolomée un lieu où l’on n’alloit plus.
Ce qui me confirme dans cette idée, c’est que les peuples autour du Prassum étoient antropophages [11] . Ptolomée, qui [12] nous parle d’un grand nombre de lieux entre le port des Aromates & le promontoire Raptum, laisse un vide total depuis le Raptum jusqu’au Prassum. Les grands profits de la navigation des Indes durent faire négliger celle d’Afrique. Enfin les Romains n’eurent jamais sur cette côte de navigation réglée : ils avoient découvert ces ports [II-345] par les terres, & par des navires jetés par la tempête : Et comme aujourd’hui on connoît assez bien les côtes de l’Afrique, & très-mal l’intérieur [13] , les anciens connoissoient assez bien l’intérieur, & très-mal les côtes.
J’ai dit que des Phéniciens, envoyés par Nécho & Eudoxe sous Ptolomée Lature, avoient fait le tour de l’Afrique : il faut bien, que du temps de Ptolomée le géographe, ces deux navigations fussent regardées comme fabuleuses, puisqu’il place [14] , depuis le sinus magnus, qui est, je crois, le golfe de Siam, une terre inconnue, qui va d’Asie en Afrique, aboutir au promontoire Prassum ; de sorte que la mer des Indes n’auroit été qu’un lac. Les anciens qui reconnurent les Indes par le nord, s’étant avancés vers l’orient, placerent vers le midi cette terre inconnue.
-
[↑] Hérodote, liv. IV. Il vouloit conquérir.
-
[↑] Pline, liv. II, ch. lxvii. Pomponius Mela, liv. III, ch. ix.
-
[↑] Hérodote, in Melpomene.
-
[↑] Joignez à ceci ce que je dis au chap. xi de ce livre, sur la navigation d’Hannon.
-
[↑] On trouve dans l’océan Atlantique, aux mois d’octobre, novembre, décembre & janvier, un vent de nord-est. On passe la ligne ; & pour éluder le vent général d’est, on dirige sa route vers le sud : ou bien on entre dans la zone torride, dans les lieux où le vent souffle de l’ouest à l’est.
-
[↑] Ce golfe, auquel nous donnons aujourd’hui ce nom, étoit appelé par les anciens le sein Arabique ; ils appeloient mer rouge sa partie de l’océan voisine de ce golfe.
-
[↑] Strabon, liv. XVI.
-
[↑] Ibid. Artémidore bornoit la côte connue au lieu appelé Austricornu ; & Erastosthene ad Cinnamomiseram.
-
[↑] Liv. I, ch vii, liv. IV, ch. ix. table IV, de l’Afrique.
-
[↑] On a attribué ce Périple à Arrien.
-
[↑] Ptolomée, liv. IV, ix.
-
[↑] Liv. IV, ch. vii & viii.
-
[↑] Voyez avec quelle exactitude Strabon & Ptolomée nous décrivent les diverses parties de l’Afrique. Ces connoissances venoient des diverses guerres que les deux plus puissantes nations du monde, les Carthaginois & les Romains, avoient eues avec les peuples d’Afrique, des alliances qu’ils avoient contractées, du commerce qu’ils avoient fait dans les terres.
-
[↑] Liv. VII. ch. III.
[II-346]
CHAPITRE XI.
Carthage & Marseille.
Carthage avoit un singulier droit des gens ; elle faisoit noyer [1] tous les étrangers qui trafiquoient en Sardaigne & vers les colonnes d’Hercule : Son droit politique n’étoit pas moins extraordinaire ; elle défendit aux Sardes de cultiver la terre, sous peine de la vie. Elle accrut sa puissance par ses richesses, & ensuite ses richesses par sa puissance. Maîtresse des côtes d’Afrique que baigne la Méditerranée, elle s’étendit le long de celles de l’Océan. Hannon, par ordre du sénat de Carthage, répandit trente mille Carthaginois depuis les colonnes d’Hercule jusqu’à Cerné. Il dit que ce lieu est aussi éloigné des colonnes d’Hercule, que les colonnes d’Hercule le sont de Carthage. Cette position est très-remarquable ; elle fait voir qu’Hannon borna ses établissemens au vingt-cinquieme degré de latitude nord, c’est-à-dire, deux ou trois degrés au-delà des îles Canaries, vers le sud.
Hannon étant à Cerné, fit une autre [II-347] navigation, dont l’objet étoit de faire des découvertes plus avant vers le midi. Il ne prit presque aucune connoissance du continent. L’étendue des côtes qu’il suivit, fut de vingt-six jours de navigation, & il fut obligé de revenir faute de vivres. Il paroît que les Carthaginois ne firent aucun usage de cette entreprise d’Hannon. Scylax [2] dit qu’au-delà de Cerné, la mer n’est pas navigable [3] , parce qu’elle y est basse, pleine de limon & d’herbes marines : effectivement il y en a beaucoup dans ces parages [4] . Les marchands Carthaginois dont parle Scylax, pouvoient trouver des obstacles qu’Hannon qui avoit soixante navires de cinquante rames chacun, avoit vaincus. Les difficultés sont relatives ; & de plus, on ne doit pas confondre une entreprise qui a la hardiesse & la témérité pour objet, avec ce qui est l’effet d’une conduite ordinaire.
[II-348]
C’est un beau morceau de l’antiquité que la relation d’Hannon : le même homme qui a exécuté, a écrit, il ne met aucune orientation dans ses récits. Les grands capitaines écrivent leurs actions avec simplicité, parce qu’ils sont plus glorieux de ce qu’ils ont fait, que de ce qu’ils ont dit.
Les choses sont comme le style. Il ne donne point dans le merveilleux ; tout ce qu’il dit du climat, du terrain, des mœurs, des manieres des habitans, se rapporte à ce qu’on voit aujourd’hui dans cette côte d’Afrique ; il semble que c’est le journal d’un de nos navigateurs.
Hannon remarqua [5] sur sa flotte, que le jour il régnoit dans le continent un vaste silence ; que la nuit on entendoit les sons de divers instrumens de musique ; & qu’on voyoit par-tout des feux, les uns plus grands, les autres moindres. Nos relations confirment ceci : on y trouve que le jour ces sauvages, pour éviter l’ardeur du soleil, se retirent dans les forêts ; que la nuit ils [II-349] font de grands feux pour écarter les bêtes féroces ; & qu’ils aiment passionnément la danse & les instrumens de musique.
Hannon nous décrit un volcan avec tous les phénomenes que fait voir aujourd’hui le Vésuve ; & le récit qu’il fait de ces deux femmes velues, qui se laisserent plutôt tuer que de suivre les Carthaginois, & dont il fit porter les peaux à Carthage, n’est pas, comme on l’a dit, hors de vraisemblance.
Cette relation est d’autant plus précieuse, qu’elle est un monument Punique ; & c’est parce qu’elle est un monument Punique, qu’elle a été regardée comme fabuleuse. Car les Romains conserverent leur haine contre les Carthaginois, même après les avoir détruits. Mais ce ne fut que la victoire qui décida s’il falloit dire, la foi Punique, ou la foi Romaine.
Des modernes [6] ont suivi ce préjugé. Que sont devenues, disent-ils, les villes qu’Hannon nous décrit, & dont, même du temps de Pline, il ne restoit pas le moindre vestige ? Le merveilleux [II-350] seroit qu’il en fût resté. Étoit-ce Corinthe ou Athenes qu’Hannon alloit bâtir sur ces côtes ? Il laissoit, dans les endroits propres au commerce, des familles Carthaginoises ; & à la hâte, il les mettoit en sureté contre les hommes sauvages & les bêtes féroces. Les calamités des Carthaginois firent cesser la navigation d’Afrique ; il fallut bien que ces familles périssent, ou devinssent sauvages. Je dis plus : quand les ruines de ces villes subsisteroient encore, qui est-ce qui auroit été en faire la découverte dans les bois & dans les marais ? On trouve pourtant dans Scylax & dans Polybe, que les Carthaginois avoient de grands établissemens sur ces côtes. Voilà les vestiges des villes d’Hannon ; il n’y en a point d’autres, parce qu’à peine y en a-t-il d’autres de Carthage même.
Les Carthaginois étoient sur le chemin des richesses : Et s’ils avoient été jusqu’au quatrieme degré de latitude nord, & au quinzieme de longitude, ils auroient découvert la côte d’Or & les côtes voisines. Ils y auroient fait un commerce de toute autre importance que celui qu’on y fait aujourd’hui, que l’Amérique semble avoir avili les [II-351] richesses de tous les autres pays : ils y auroient trouvé des trésors qui ne pouvoient être enlevés par les Romains.
On a dit des choses bien surprenantes des richesses de l’Espagne. Si l’on en croit Aristote [7] , les Phéniciens, qui aborderent à Tartese, y trouverent tant d’argent que leurs navires ne pouvoient le contenir, & ils firent faire de ce métal leurs plus vils ustensiles. Les Carthaginois, au rapport de Diodore [8] , trouverent tant d’or & d’argent dans les Pyrénées, qu’ils en mirent aux ancres de leurs navires. Il ne faut point faire de fond sur ces récits populaires : voici des faits précis.
On voit, dans un fragment de Polybe cité par Strabon [9] , que les mines d’argent qui étoient à la source du Bétis, où quarante mille hommes étoient employés, donnoient au peuple Romain vingt-cinq mille drachmes par jour : cela peut faire environ cinq millions de livres par an, à cinquante francs le marc. On appelloit les montagnes où étoient ces mines, les montagnes d’argent [10] ; ce [II-352] qui fait voir que c’étoit le Potosi de ces temps-là. Aujourd’hui les mines d’Hannover n’ont pas le quart des ouvriers qu’on employoit dans celles d’Espagne, & elles donnent plus : mais les Romains n’ayant guere que des mines de cuivre, & peu de mines d’argent, & les Grecs ne connoissant que les mines d’Attique très-peu riches, ils durent être étonnés de l’abondance de celles-là.
Dans la guerre pour la succession d’Espagne, un homme appellé le marquis de Rhodes, de qui on disoit qu’il s’étoit ruinée dans les mines d’or, & enrichi dans les hôpitaux [11] proposa à la cour de France d’ouvrir les mines des Pyrénées. Il cita les Tyriens, les Carthaginois & les Romains : on lui permit de chercher, il chercha, il fouilla par-tout ; il citoit toujours, & ne trouvoit rien.
Les Carthaginois, maîtres du commerce de l’or & de l’argent, voulurent l’être encore de celui du plomb & de l’étain. Ces métaux étoient voiturés par terre depuis les ports de la Gaule sur l’océan, jusqu’à ceux de la méditerranée. Les Carthaginois voulurent les recevoir de la premiere main ; ils envoyerent [II-353] Himilcon, pour former [12] des établissemens dans les îles Cassitérides, qu’on croit être celles de Silley.
Ces voyages de la Bétique en Angleterre, ont fait penser à quelques gens que les Carthaginois avoient la boussole : mais il est clair qu’ils suivoient les côtes. Je n’en veux d’autre preuve que ce que dit Himilcon, qui demeura quatre mois à aller de l’embouchure du Bétis en Angleterre : outre que la fameuse [13] histoire de ce pilote Carthaginois, qui voyant venir un vaisseau Romain, se fit échouer pour ne lui pas apprendre la route d’Angleterre [14] , fait voir que ces vaisseaux étoient très-près des côtes lorsqu’ils se rencontrerent.
Les anciens pourroient avoir fait des voyages de mer qui feroient penser qu’ils avoient la boussole, quoiqu’ils ne l’eussent pas. Si un pilote s’étoit éloigné des côtes, & que pendant son voyage il eût eu un temps serein, que la nuit il eût toujours vu une étoile polaire, & le jour le lever & le coucher du soleil ; il est clair qu’il auroit pu se conduire [II-354] comme on fait aujourd’hui par la boussole : mais ce seroit un cas fortuit, & non pas une navigation réglée.
On voit dans le traité qui finit la premiere guerre Punique, que Carthage fut principalement attentive à se conserver l’empire de la mer, & Rome à garder celui de la terre. Hannon [15] , dans la négociation avec les Romains, déclara qu’il ne souffriroit pas seulement qu’ils se lavassent les mains dans les mers de Sicile ; il ne leur fut pas permis de naviguer au-delà du beau Promontoire ; il leur fut défendu [16] de trafiquer en Sicile [17] , en Sardaigne, en Afrique, excepté à Carthage : exception qui fait voir qu’on ne leur y préparoit pas un commerce avantageux.
Il y eut dans les premiers temps de grandes guerres entre Carthage & Marseille [18] au sujet de la pêche. Après la paix, ils firent concurremment le commerce d’économie. Marseille fut d’autant plus jalouse, qu’égalant sa rivale en industrie, elle lui étoit devenue inférieure [II-355] en puissance : voilà la raison de cette grande fidélité pour les Romains. La guerre que ceux-ci firent contre les Carthaginois en Espagne, fut une source de richesses pour Marseille qui servoit d’entrepôt. La mine de Carthage & de Corinthe augmenta encore la gloire de Marseille ; & sans les guerres civiles où il falloit fermer les yeux, & prendre un parti, elle auroit été heureuse sous la protection des Romains, qui n’avoient aucune jalousie de son commerce.
-
[↑] Erastosthene, dans Stabon, liv. XVII. p. 802.
-
[↑] Voyez son Périple, article de Carthage.
-
[↑] Voyez Hérodote, in Melpomene, sur les obstacles que Sataspe trouva.
-
[↑] Voyez les cartes & les relations, le premier volume des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, part. I. pag. 201. Cette herbe couvre tellement la surface de la mer, qu’on a de la peine à voir l’eau ; & les vaisseaux ne peuvent passer au travers que par un vent frais.
-
[↑] Pline nous dit la même chose en parlant du mont Alias : Noctibus micare crebris ignibus, tibiarum cantu timpanorumque sonitu strepere, neminem interdiù cerni.
-
[↑] M. Dodwel : voyez sa dissertation sur le Périple d’Hannon.
-
[↑] Des choses merveilleuses.
-
[↑] Liv. VI.
-
[↑] Liv. III.
-
[↑] Mons argentarius.
-
[↑] Il en avoit eu quelque part la direction.
-
[↑] Voyez Festus Avienus.
-
[↑] Strabon, liv. III. sur la fin.
-
[↑] Il en fut récompensé par le sénat de Carthage.
-
[↑] Tite-Live, supplément de Frenshemius, seconde décade, liv. VI.
-
[↑] Polybe, liv. III.
-
[↑] Dans la partie sujette aux Carthaginois.
-
[↑] Justin, liv. XLIII. ch. V.
[II-355]
CHAPITRE XII.
Île de Délos. Mithridate.
Corinthe ayant été détruite par les Romains, les marchands se retirerent à Délos : la religion & la vénération des peuples faisoit regarder cette île comme un lieu de sureté [1] : de plus, elle étoit très-bien située pour le commerce de l’Italie & de l’Asie, qui, depuis l’anéantissement de l’Afrique & l’affoiblissement de la Grece, étoit devenu plus important.
Dès les premiers temps les Grecs [II-356] envoyerent, comme nous avons dit, des colonies sur la Propontide & le Pont-Euxin : elles conserverent, sans les Perses, leurs lois & leur liberté. Alexandre, qui n’étoit parti que contre les barbares, ne les attaqua pas [2] . Il ne paroît pas même que les rois de Pont, qui en occuperent plusieurs, leur eussent [3] ôté leur gouvernement politique.
La puissance [4] de ces rois augmenta, si-tôt qu’ils les eurent soumises. Mithridate se trouva en état d’acheter par-tout des troupes ; de réparer [5] continuellement ses pertes ; d’avoir des ouvriers, des vaisseaux, des machines de guerre ; de se procurer des alliés ; de corrompre ceux des Romains, & les Romains mêmes ; de soudoyer [6] les barbares de l’Asie & de l’Europe ; de faire la [II-357] guerre long-temps, & par conséquent de discipliner les troupes : il put les armer, & les instruire dans l’art militaire [7] des Romains, & former des corps considérables de leurs transfuges, enfin il put faire de grandes pertes, & souffrir de grands échecs, sans périr : & il n’auroit point péri, si, dans les prospérités, le roi voluptueux & barbare n’avoit pas détruit ce que, dans la mauvaise fortune, avoit fait le grand prince.
C’est ainsi que, dans le temps que les Romains étoient au comble de la grandeur, & qu’ils sembloient n’avoir à craindre qu’eux-mêmes, Mithridate remit en question ce que la prise de Carthage, les défaites de Philippe, d’Antiochus & de Persée, avoient décidé. Jamais guerre ne fut plus funeste : & les deux partis ayant une grande puissance & des avantages mutuels, les peuples de la Grece & de l’Asie furent détruits, ou comme amis de Mithridate, ou comme ses ennemis. Délos fut enveloppée dans le malheur commun. Le commerce tomba de toutes parts ; il falloit bien qu’il fût détruit, les peuples mêmes l’étoient.
[II-358]
Les Romains, suivant un systême dont j’ai parlé ailleurs [8] , destructeurs pour ne pas paroître conquérans, ruinerent Carthage & Corinthe : &, par une telle pratique, ils se seroient peut-être perdus, s’ils n’avoient pas conquis toute la terre. Quand les rois de Pont se rendirent maîtres des colonies Grecques du Pont-Euxin, ils n’eurent garde de détruire ce qui devoit être la cause de leur grandeur.
-
[↑] Voyez Strabon, liv. X.
-
[↑] Il confirma la liberté de la ville d’Amise, colonie Athénienne, qui avoit joui de l’état populaire, même sous les rois de Perse. Lucullus qui prit Synope & Amise, leur rendit la liberté, & rappella les habitans qui s’étoient enfuis sur leurs vaisseaux.
-
[↑] Voyez ce qu’écrit Appien sur les Phanagoréens, les Amisiens, les Synopiens, dans son livre de la guerre contre Mithridate.
-
[↑] Voyez Appien, sur les trésors immenses que Mithridate employa dans ses guerres, ceux qu’il avoit cachés, ceux qu’il perdit si souvent par la trahison des siens, ceux qu’on trouva après sa mort.
-
[↑] Il perdit une fois 170000 hommes, & de nouvelles armées reparurent d’abord.
-
[↑] Voyez Appien, de la guerre contre Mithridate.
-
[↑] Voyez Appien, de la guerre contre Mithridate.
-
[↑] Dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains.
[II-358]
CHAPITRE XIII.
Du génie des Romains pour la marine.
Les Romains ne faisoient cas que des troupes de terre, dont l’esprit étoit de rester toujours ferme, de combattre au même lieu & d’y mourir. Ils ne pouvoient estimer la pratique des gens de mer qui se présentent au combat, fuient, reviennent, évitent toujours le danger, emploient la ruse, rarement la force. Tout cela n’étoit point du [II-359] génie des Grecs [1] , & étoit encore moins de celui des Romains.
Ils ne destinoient donc à la marine que ceux qui n’étoient pas des citoyens assez considérables [2] pour avoir place dans les légions : les gens de mer étoient ordinairement des affranchis.
Nous n’avons aujourd’hui ni la même estime pour les troupes de terre, ni le même mépris pour celles de mer. Chez les premieres [3] l’art est diminué ; chez les secondes [4] il est augmenté : or on estime les choses à proportion du degré de suffisance qui est requis pour le bien faire.
-
[↑] Comme l’a remarqué Platon, liv. IV. des lois.
-
[↑] Polybe, liv. V.
-
[↑] Voyez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains, &c.
-
[↑] Ibid.
[II-359]
CHAPITRE XIV.
Du génie des Romains pour le commerce.
On n’a jamais remarqué aux Romains de jalousie sur le commerce. Ce fut comme nation rivale, & non comme nation commerçante, qu’ils attaquerent Carthage. Ils favoriserent les [II-360] villes qui faisoient le commerce, quoiqu’elles ne fussent pas sujettes ; ainsi ils augmenterent par la cession de plusieurs pays la puissance de Marseille. Ils craignoient tout des barbares, & rien d’un peuple négociant. D’ailleurs leur génie, leur gloire, leur éducation militaire, la forme de leur gouvernement, les éloignoient du commerce.
Dans la ville, on n’étoit occupé que de guerres, d’élections, de brigues & de procès ; à la campagne, que d’agriculture ; & dans les provinces un gouvernement dur & tyrannique étoit incompatible avec le commerce.
Que si leur constitution politique y étoit opposée, leur droit des gens n’y répugnoit pas moins. « Les peuples, dit le jurisconsulte Pomponius [1] , avec lesquels nous n’avons ni amitié, ni hospitalité, ni alliance, ne sont point nos ennemis : cependant si une chose qui nous appartient, tombe entre leurs mains, ils en sont propriétaires, les hommes libres deviennent leurs esclaves ; & ils sont dans les mêmes termes à notre égard ».
[II-361]
Leur droit civil n’étoit pas moins accablant. La loi de Constantin, après avoir déclaré bâtards les enfans des personnes viles qui se sont mariées avec celles d’une condition relevée, confond les femmes qui ont une boutique [2] de marchandises, avec les esclaves, les cabaretieres, les femmes de théâtre, les filles d’un homme qui tient un lieu de prostitution, ou qui a été condamné à combattre sur l’arene : ceci descendoit des anciennes institutions des Romains.
Je sais bien que des gens pleins de ces deux idées ; l’une que le commerce est la chose du monde la plus utile à un état ; & l’autre, que les Romains avoient la meilleure police du monde, ont cru qu’ils avoient beaucoup encouragé & honoré le commerce : mais la vérité est qu’ils y ont rarement pensé.
-
[↑] Leg. V. §. 2. ff. de captivis.
-
[↑] Quæ mercimoniis publicè prœsuit. Leg. I. cod. de natural. liberis.
[II-362]
CHAPITRE XV.
Commerce des Romains avec les barbares.
Les Romains avoient fait de l’Europe, de l’Asie & de l’Afrique, un vaste empire : la foiblesse des peuples & la tyrannie du commandement unirent toutes les parties de ce corps immense. Pour lors la politique Romaine fut de se séparer de toutes les nations qui n’avoient pas été assujetties : la crainte de leur porter l’art de vaincre, fit négliger l’art de s’enrichir. Ils firent des lois pour empêcher tout commerce avec les barbares. « Que personne, disent [1] Valens & Gratien, n’envoie du vin, de l’huile ou d’autres liqueurs aux barbares, même pour en goûter ; qu’on ne leur porte point de l’or [2] , ajoutent Gratien, Valentinien & Théodose, & que même ce qu’ils en ont, on le leur ôte avec finesse ». Le transport du fer fut défendu sous peine de la vie.
[II-363]
Domitien, prince timide, fit arracher les vignes [3] dans la Gaule, de crainte sans doute que cette liqueur n’y attirât les barbares, comme elle les avoit autrefois attirés en Italie. Probus & Julien, qui ne les redouterent jamais, en rétablirent la plantation.
Je sais bien que dans la foiblesse de l’empire, les barbares obligerent les Romains d’établir des étapes [4] & de commercer avec eux. Mais cela même prouve que l’esprit des Romains étoit de ne pas commercer.
-
[↑] Leg. ad Barbarium, cod. quæ res exportari non debeant.
-
[↑] Led. II. cod. de commerc. & mercator.
-
[↑] Leg. II. quæ res exporti non debeant ; & Procope, guerre des Perses, liv. I.
-
[↑] Voyez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence. Paris, 1755.
[II-363]
CHAPITRE XVI.
Du commerce des Romains avec l’Arabie & les Indes.
Le négoce de l’Arabie heureuse & celui des Indes furent les deux branches, & presque les seules, du commerce extérieur. Les Arabes avoient de grandes richesses : ils les tiroient de leurs mers & de leurs forêts ; & comme [II-364] ils achetoient peu, & vendoient beaucoup, ils attiroient [1] à eux l’or & l’argent de leurs voisins. Auguste [2] connut leur opulence, & il résolut de les avoir pour amis, ou pour ennemis. Il fit passer Elius Gallus d’Égypte en Arabie. Celui-ci trouva des peuples oisifs, tranquilles & peu aguerris. Il donna des batailles, fit des sieges, & ne perdit que sept soldats : mais la perfidie de ses guides, les marches, le climat, la faim, la soif, les maladies, des mesures mal prises, lui firent perdre son armée.
Il fallut donc se contenter de négocier avec les Arabes comme les autres peuples avoient fait, c’est-à-dire, de leur porter de l’or & de l’argent pour leurs marchandises. On commerce encore avec eux de la même maniere ; la caravane d’Alep & le vaisseau royal de Suez y portent des sommes immenses [3] .
La nature avoit destiné les Arabes au commerce ; elle ne les avoit pas destinés [II-365] à la guerre : mais lorsque ces peuples tranquilles se trouverent sur les frontieres des Parthes & des Romains, ils devinrent auxiliaires des uns & des autres. Elius Gallus les avoit trouvés commerçans ; Mahomet les trouva guerriers : il leur donna de l’enthousiasme, & les voilà conquérans.
Le commerce des Romains aux Indes étoit considérable. Strabon [4] avoit appris en Égypte qu’ils y employoient cent vingt navires : ce commerce ne se soutenoit encore que par leur argent. Ils y envoyoient tous les ans cinquante millions de sesterces. Pline [5] dit que les marchandises qu’on en rapportoit, se vendoient à Rome le centuple. Je crois qu’il parle trop généralement : ce profit fait une fois, tout le monde aura voulu le faire, & dès ce moment personne ne l’aura fait.
On peut mettre en question s’il fut avantageux aux Romains de faire le commerce de l’Arabie & des Indes. Il falloit qu’ils y envoyassent leur argent ; & ils n’avoient pas comme nous, la ressource de l’Amérique, qui supplée à [II-366] ce que nous envoyons. Je suis persuadé qu’une des raisons qui fit augmenter chez eux la valeur numéraire des monnoies, c’est-à-dire, établir le billon, fut la rareté de l’argent, causée par le transport continuel qui s’en faisoit aux Indes. Que si les marchandises de ce pays se vendoient à Rome le centuple, ce profit des Romains se faisoit sur les Romains mêmes, & n’enrichissoit point l’empire.
On pourra dire, d’un autre côté, que ce commerce procuroit aux Romains une grande navigation, c’est-à-dire, une grande puissance ; que des marchandises nouvelles augmentoient le commerce intérieur, favorisoient les arts, entretenoient l’industrie ; que le nombre des citoyens se multiplioit à proportion des nouveaux moyens qu’on avoit de vivre ; que ce nouveau commerce produisoit le luxe que nous avons prouvé être aussi favorable au gouvernement d’un seul, que fatal à celui de plusieurs ; que cet établissement fut de même date que la chute de leur république ; que le luxe à Rome étoit nécessaire ; & qu’il falloit bien qu’une ville qui attiroit à elle toutes les richesses de l’univers, les rendit par son luxe.
[II-367]
Strabon [6] dit que le commerce des Romains aux Indes étoit beaucoup plus considérable que celui des rois d’Égypte : & il est singulier que les Romains, qui connoissoient peu le commerce, ayent eu pour celui des Indes plus d’attention que n’en eurent les rois d’Égypte, qui l’avoient, pour ainsi dire, sous les yeux. Il faut expliquer ceci.
Après la mort d’Alexandre, les rois d’Égypte établirent aux Indes un commerce maritime, & les rois de Syrie, qui eurent les provinces les plus orientales de l’empire, & par conséquent les Indes, maintinrent ce commerce dont nous avons parlé au chapitre VI, qui se faisoit par les terres & par les fleuves, & qui avoit reçu de nouvelles facilités par l’établissement des colonies Macédoniennes : de sorte que l’Europe communiquoit avec les Indes, & par l’Égypte, & par le royaume de Syrie. Le démembrement qui se fit du royaume de Syrie, d’où se forma celui de Bactriane, ne fit aucun tort à ce commerce. Marin Tyrien, cité par Ptolomée [7] , parle [II-368] des découvertes faites aux Indes par le moyen de quelques marchands Macédoniens. Celles que les expéditions des rois n’avoient pas faites, les marchands les firent. Nous voyons dans Ptolomée [8] , qu’ils allerent depuis la tour de Pierre [9] jusqu’à Sera : & la découverte faite par les marchands d’une étape si reculée, située dans la partie orientale & septentrionale de la Chine, fut une espece de prodige. Ainsi, sous les rois de Syrie & de Bactriane, les marchandises du midi de l’Inde passoient, par l’Indus, l’Oxus & la mer Caspienne, en Occident ; & celles des contrées plus orientales & plus septentrionales étoient portées depuis Sera, la tour de Pierre, & autres étapes, jusqu’à l’Euphrate. Ces marchands faisoient leur route, tenant, à peu près, le quarantieme degré de latitude nord, par des pays qui sont au couchant de la Chine, plus policés qu’ils ne sont aujourd’hui, parce que les Tartares ne les avoient pas encore infectés.
Or, pendant que l’empire de Syrie [II-369] étendoit si fort son commerce du côté des terres, l’Égypte n’augmenta pas beaucoup son commerce maritime.
Les Parthes parurent, & fonderent leur empire : & lorsque l’Égypte tomba sous la puissance des Romains, cet empire étoit dans sa force, & avoit reçu son extension.
Les Romains & les Parthes furent deux puissances rivales, qui combattirent, non pas pour savoir qui devoit regner, mais exister. Entre les deux empires, il se forma des déserts ; entre les deux empires, on fut toujours sous les armes : bien loin qu’il y eût de commerce, il n’y eut pas même de communication. L’ambition, la jalousie, la religion, la haine, les mœurs, séparerent tout. Ainsi le commerce entre l’occident & l’orient, qui avoit eu plusieurs routes, n’en eut plus qu’une ; & Alexandrie étant devenue la seule étape, cette étape grossit.
Je ne dirai qu’un mot du commerce intérieur. Sa branche principale fut celle des blés qu’on faisoit venir pour la subsistance du peuple de Rome : ce qui étoit une matiere de police, plutôt qu’un objet de commerce. À cette [II-370] occasion, les nautoniers reçurent quelques privileges [10] , parce que le salut de l’empire dépendoit de leur vigilance.
-
[↑] Pline, liv. VII. chapitre xxviii ; & Strabon, liv. XVI.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Les caravanes d’Alep & de Suez y portent deux millions de notre monnoie, & il en passe autant en fraude ; le vaisseau royal de Suez y porte aussi deux millions.
-
[↑] Liv. II. pag 81.
-
[↑] Liv. VI. ch. xxiii.
-
[↑] Il dit, au liv. XII, que les Romains y employoient cent vingt navires ; & au liv. XVII, que les rois Grecs y en envoyoient à peine vingt.
-
[↑] Liv. I. ch. II.
-
[↑] Liv. VI. ch. xiii
-
[↑] Nos meilleures cartes placent la tour de Pierre au centieme degré de longitude, & environ le quarantieme de latitude.
-
[↑] Suet. in Claudio. Leg. VII, cod. Théodos. de naviculariis.
[II-370]
CHAPITRE XVII.
Du commerce, après la destruction des Romains en Occident.
L’empire Romain fut envahi ; & l’un des effets de la calamité générale, fut la destruction du commerce. Les barbares ne le regarderent d’abord que comme un objet de leurs brigandages; & quand ils furent établis, ils ne l’honorerent pas plus que l’agriculture & les autres professions du peuple vaincu.
Bientôt il n’y eut presque plus de commerce en Europe ; la noblesse qui régnoit par-tout, ne s’en mettoit point en peine.
La loi [1] des Wisigoths permettoit aux particuliers d’occuper la moitié du lit des grands fleuves, pourvu que l’autre restât libre pour les filets & pour les bateaux ; il falloit qu’il y eût bien [II-371] peu de commerce dans les pays qu’ils avoient conquis.
Dans ce temps-là s’établirent les droits insensés d’aubaine & de naufrage : les hommes penserent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devoient d’un côté aucune sorte de justice, & de l’autre aucune sorte de pitié.
Dans les bornes étroites où se trouvoient les peuples du nord, tout leur étoit étranger : dans leur pauvreté, tout étoit pour eux un objet de richesses. Établis avant leurs conquêtes sur les côtes d’une mer resserrée & pleine d’écueils, ils avoient tiré parti de ces écueils mêmes.
Mais les Romains qui faisoient des lois pour tout l’univers, en avoient fait de très-humaines [2] sur les naufrages : ils réprimerent à cet égard les brigandages de ceux qui habitoient les côtes, & ce qui étoit plus encore, la rapacité de leur fisc [3] .
-
[↑] Liv. VIII, tit. 4. §. 9.
-
[↑] Toto titulo, ff. de incend. ruin. naufrag. & cod. de naufragiis ; & leg. III, ff. de leg. Comel. de sicariis.
-
[↑] Leg. I, cod. de naufragiis.
[II-372]
CHAPITRE XVIII.
Réglement particulier.
La loi des Wisigoths [1] fit pourtant une disposition favorable au commerce ; elle ordonna que les marchands qui venoient de delà la mer, seroient jugés dans les différens qui naissoient entr’eux, par les lois & par des juges de leur nation. Ceci étoit fondé sur l’usage établi chez tous ces peuples mêlés, que chaque homme vécut sous sa propre loi ; chose dont je parlerai beaucoup dans la suite.
-
[↑] Liv. XI, tit. 3, §. 2.
[II-372]
CHAPITRE XIX.
Du commerce depuis l’affoiblissement des Romains en Orient.
Les Mahométans parurent, conquirent, & le diviserent. L’Égypte eut ses souverains particuliers. Elle continua de faire le commerce des Indes. Maîtresse des marchandises de ce pays, elle attira les richesses de tous les autres.
[II-373] Ses Soudans furent les plus puissans princes de ces temps-là : on peut voir dans l’histoire comment, avec une force constante & bien ménagée, ils arrêterent l’ardeur, la fougue & l’impétuosité des croisés.
[II-373]
CHAPITRE XX.
Comment le commerce se fit jour en Europe à travers la barbarie.
La philosophie d’Aristote ayant été portée en Occident, elle plut beaucoup aux esprits subtils, qui dans les temps d’ignorance, sont les beaux esprits. Des scholastiques s’en infatuerent, & prirent de ce philosophe [1] bien des explications sur le prêt à intérêt, au lieu que la source en étoit si naturelle dans l’évangile ; ils le condamnerent indistinctement & dans tous les cas. Par là le commerce, qui n’étoit que la profession des gens vils, devint encore celle des mal-honnêtes gens : car toutes les fois que l’on défend une chose naturellement permise ou nécessaire, on ne fait que rendre mal-honnêtes gens ceux qui la font.
[II-374]
Le commerce passa à une nation pour lors couverte d’infamie ; & bientôt il ne fut plus distingué des usures les plus affreuses, des monopoles, de la levée des subsides, & de tous les moyens mal-honnêtes d’acquérir de l’argent.
Les Juifs [2] enrichis par leurs exactions, étoient pillés par les princes avec la même tyrannie ; chose qui consoloit les peuples, & ne les soulageoit pas.
Ce qui se passa en Angleterre donnera une idée de ce qu’on fit dans les autres pays. Le roi Jean [3] ayant fait emprisonner les Juifs pour avoir leur bien, il y en eut peu qui n’eussent au moins quelqu’œil crevé : ce roi faisoit ainsi sa chambre de justice. Un d’eux, à qui on arracha sept dents, une chaque jour, donna dix mille marcs d’argent à la huitieme. Henri III tira d’Aaron, Juif d’York, quatorze mille marcs d’argent, & dix mille pour la Reine. Dans ces temps-là on faisoit violemment ce qu’on fait aujourd’hui en Pologne avec quelque mesure. Les rois ne pouvant [II-375] fouiller dans la bourse de leurs sujets, à cause de leurs privileges, mettoient à la torture les Juifs, qu’on ne regardoit pas comme citoyens.
Enfin il s’introduisit une coutume, qui confisqua tous les biens des Juifs qui embrassoient le christianisme. Cette coutume si bizarre, nous la savons par la loi [4] qui l’abroge. On en a donné des raisons bien vaines ; on a dit qu’on vouloit les éprouver, & faire en sorte qu’il ne restât rien de l’esclavage du démon. Mais il est visible que cette confiscation étoit une espece de droit [5] d’amortissement pour le prince ou pour les seigneurs, des taxes qu’ils levoient sur les Juifs, & dont ils étoient frustrés lorsque ceux-ci embrassoient le christianisme. Dans ces temps-là on regardoit les hommes comme des terres. Et je remarquerai en passant, combien on s’est joué de cette nation d’un siecle à l’autre. On confisquoit leurs biens [II-376] lorsqu’ils vouloient être chrétiens, & bientôt après on les fit brûler lorsqu’ils ne voulurent pas l’être.
Cependant on vit le commerce sortir du sein de la vexation & du désespoir. Les Juifs, proscrits tour-à-tour de chaque pays, trouverent le moyen de sauver leurs effets. Par-là ils rendirent pour jamais leurs retraites fixes ; car tel prince qui voudroit bien se défaire d’eux, ne seroit pas pour cela d’humeur à se défaire de leur argent.
Ils inventerent les lettres [6] de change ; & par ce moyen, le commerce put éluder la violence & se maintenir par-tout ; le négociant le plus riche n’ayant que des biens invisibles, qui pouvoient être envoyés par-tout, & ne laissoient de trace nulle part.
Les théologiens furent obligés de restreindre leurs principes ; & le commerce qu’on avoit violemment lié avec la mauvaise, foi, rentra pour ainsi dire dans le sein de la probité.
[II-377]
Ainsi nous devons aux spéculations des scholastiques tous les malheurs [7] qui ont accompagné la destruction du commerce ; & à l’avarice des princes l’établissement d’une chose qui le met en quelque façon hors de leur pouvoir.
Il a fallu depuis ce temps que les princes se gouvernassent avec plus de sagesse qu’ils n’auroient eux-mêmes pensé : car, par l’événement, les grands coups d’autorité se sont trouvés si maladroits, que c’est une expérience reconnue, qu’il n’y a plus que la bonté du gouvernement qui donne de la prospérité.
On a commencé à se guérir du Machiavélisme, & on s’en guérira tous les jours. Il faut plus de modération dans les conseils. Ce qu’on appelloit autrefois des coups d’état, ne seroit aujourd’hui, indépendamment de l’horreur, que des imprudences.
Et il est heureux pour les hommes d’être dans une situation, où pendant que leurs passions leur inspirent la [II-378] pensée d’être méchant ils ont pourtant intérêt de ne pas l’être.
-
[↑] Voyez Aristote, polit. liv. I, chap ix & x.
-
[↑] Voyez dans Morca Hispanica, les constitutions d’Arragon des années 1228 & 1231 ; & dans Brussel, l’accord de l’année 1206, passé entre le Roi, la comtesse de Champagne & Gui de Dampierre.
-
[↑] Slowe, in his survey of London, liv. III, p. 54.
-
[↑] Édit donné à Baville le 4 avril 1392.
-
[↑] En France, les Juifs étoient serfs, main-mortables ; & les seigneurs leur succédoient. M. Brusset rapporte un accord de l’an 1206, entre le Roi & Thibaut, comte de Campagne, par lequel il étoit convenu que les Juifs de l’un ne prêteroient point dans les terres de l’autre.
-
[↑] On sait que sous Philippe-Auguste & sous Philippe-le-long, les Juifs, chassés de France, se réfugierent en Lombardie ; & que là ils donnerent aux negocians étrangers & aux voyageurs des lettres secrettes sur ceux à qui ils avoient confié leurs effets en France, qui furent acquittées.
-
[↑] Voyez dans le corps du droit la quatre vingt-troisieme Novelle de Léon, qui révoque la loi de Basile son pere. Cette loi de Basile est dans Herménopule, sous le nom de Léon, livre III, tit. 7. §. 27
[II-378]
CHAPITRE XXI.
Découverte de deux nouveaux mondes. État de l’Europe à cet égard.
La boussole ouvrit pour ainsi dire l’univers. On trouva l’Asie et l’Afrique dont on ne connoissoit que quelques bords, & l’Amérique dont on ne connoissoit rien du tout.
Les Portugais naviguant sur l’océan Atlantique, découvrirent la pointe la plus méridionale de l’Afrique ; ils virent une vaste mer ; elle les porta aux Indes orientales. Leurs périls sur cette mer, & la découverte de Mozambique, de Mélinde & de Calicut, ont été chantés par le Camoëns, dont le poëme fait sentir quelque chose des charmes de l’Odyssée & de la magnificence de l’Enéide.
Les Vénitiens avoient fait jusques-là le commerce des Indes par les pays des Turcs, & l’avoient poursuivi au milieu des avanies & des outrages. Par la découverte du cap de Bonne-Espérance, [II-379] & celles qu’on fit quelque temps après, l’Italie ne fut plus au centre du monde commerçant ; elle fut pour ainsi dire, dans un coin de l’univers, & elle y est encore. Le commerce même du Levant dépendant aujourd’hui de celui que les grandes nations font aux deux Indes, l’Italie ne le fait plus qu’accessoirement.
Les Portugais trafiquerent aux Indes en conquérans. Les lois gênantes [1] que les Hollandois imposent aujourd’hui aux petits princes Indiens sur le commerce, les Portugais les avoient établies avant eux.
La fortune de la maison d’Autriche fut prodigieuse. Charles-Quint recueillit la succession de Bourgogne, de Castille & d’Arragon ; il parvint à l’empire ; & pour lui procurer un nouveau genre de grandeur, l’univers s’étendit, & l’on vit paroître un monde nouveau sous son obéissance.
Christophe Colomb découvrit l’Amérique ; & quoique l’Espagne n’y envoyât point de forces qu’un petit prince de l’Europe n’eût pu y envoyer tout [II-380] de même, elle soumit deux grands empires, & d’autres grands états.
Pendant que les Espagnols découvroient & conquéroient du côté de l’Occident, les Portugais poussoient leurs conquêtes & leurs découvertes du côté de l’Orient : ces deux nations se recontrerent ; elles eurent recours au Pape Alexandre VI, qui fit la célebre ligne de démarquation, & jugea un grand procès.
Mais les autres nations de l’Europe ne les laisserent pas jouir tranquillement de leur partage : les Hollandois chasserent les Portugais de presque toutes les Indes orientales, & diverses nations firent en Amérique des établissemens.
Les Espagnols regarderent d’abord les terres découvertes comme des objets de conquête : des peuples plus rafinés qu’eux trouverent qu’elles étoient des objets de commerce, & c’est là-dessus qu’ils dirigerent leurs vues. Plusieurs peuples se sont conduits avec tant de sagesse, qu’ils ont donné l’empire à des compagnies de négocians, qui, gouvernant ces états éloignés uniquement pour le négoce, ont fait une grande puissance accessoire, sans embarrasser l’état principal.
[II-381]
Les colonies qu’on y a formées, sont sous un genre de dépendance dont on ne trouve que peu d’exemples dans les colonies anciennes, soit que celles d’aujourd’hui relevent de l’état même, ou de quelque compagnie commerçante établie dans cet état.
L’objet de ces colonies est de faire le commerce à de meilleures conditions qu’on ne le fait avec les peuples voisins, avec lesquels tous les avantages sont réciproques. On a établi que la métropole seule pourroit négocier dans la colonie ; & cela avec grande raison, parce que le but de l’établissement a été l’extension du commerce, non la fondation d’une ville ou d’un nouvel empire.
Ainsi c’est encore une loi fondamentale de l’Europe, que tout commerce avec une colonie étrangere est regardé comme un pur monopole punissable par les lois du pays : & il ne faut pas juger de cela par les lois & les exemples des anciens peuples [2] qui n’y sont guere applicables.
Il est encore reçu que le commerce établi entre les métropoles, n’entraîne [II-382] point une permission pour les colonies, qui restent toujours en état de prohibition.
Le désavantage des colonies qui perdent la liberté du commerce, est visiblement compensé par la protection de la métropole [3] , qui la défend par ses armes, ou la maintient par ses lois.
De-là suit une troisieme loi de l’Europe, que quand le commerce étranger est défendu avec la colonie, on ne peut naviguer dans ses mers, que dans les cas établis par les traités.
Les nations qui sont à l’égard de tout l’univers ce que les particuliers sont dans un état, se gouvernent comme eux par le droit naturel & par les lois qu’elles se sont faites. Un peuple peut céder à un autre la mer, comme il peut céder la terre. Les Carthaginois exigerent [4] des Romains qu’ils ne navigueroient pas au-delà de certaines limites, comme les Grecs avoient exigé du roi de Perse qu’il se tiendroit toujours éloigné des côtes de la mer [5] de la carriere d’un cheval.
[II-383]
L’extrême éloignement de nos colonies n’est point un inconvénient pour leur sureté ; car si la métropole est éloignée pour les défendre, les nations rivales de la métropole ne sont pas moins éloignées pour les conquérir.
De plus, cet éloignement fait que ceux qui vont s’y établir ne peuvent prendre la maniere de vivre d’un climat si différent ; ils sont obligés de tirer toutes les commodités de la vie du pays d’où ils sont venus. Les Carthaginois [6] , pour rendre les Sardes & les Corses plus dépendans, leur avoient défendu, sous peine de la vie, de planter, de semer & de faire rien de semblable ; ils leur envoyoient d’Afrique des vivres. Nous sommes parvenus au même point, sans faire des lois si dures. Nos colonies des îles Antilles sont admirables ; elles ont des objets de commerce que nous n’avons ni ne pouvons avoir ; elles manquent de ce qui fait l’objet du nôtre.
[II-384]
L’effet de la découverte de l’Amérique fut de lier à l’Europe l’Asie & l’Afrique ; l’Amérique fournit à l’Europe la matiere de son commerce avec cette vaste partie de l’Asie, qu’on appela les Indes Orientales. L’argent, ce métal si utile au commerce, comme signe, fut encore la base du plus grand commerce de l’univers, comme marchandise. Enfin la navigation d’Afrique devint nécessaire ; elle fournissoit des hommes pour le travail des mines & des terres de l’Amérique.
L’Europe est parvenue à un si haut degré de puissance, que l’histoire n’a rien à comparer là-dessus ; si l’on considere l’immensité des dépenses, la grandeur des engagemens, le nombre des troupes, & la continuité de leur entretien, même lorsqu’elles sont le plus inutiles, & qu’on ne les a que pour l’ostentation.
Le P. du Halde [7] dit que le commerce intérieur de la Chine est plus grand que celui de toute l’Europe. Cela pourroit être, si notre commerce extérieur n’augmentoit pas l’intérieur. L’Europe fait le commerce & la navigation [II-385] des trois autres parties du monde ; comme la France, l’Angleterre & la Hollande font à peu près la navigation & le commerce de l’Europe.
-
[↑] Voyez la relation de François Pyrard, deuxieme partie, chap. xv.
-
[↑] Excepté les Carthaginois, comme on voit par le traité qui termina la premiere guerre Punique.
-
[↑] Métropole est, dans le langage des anciens, l’état qui a fondé la colonie.
-
[↑] Polybe, liv. III.
-
[↑] Le Roi de Perse s’obligea, par un traité, de ne naviguer avec aucun vaisseau de guerre au-delà des roches Scyanées & des îles Chelidoniennes. Plutarque, vie de Cimon.
-
[↑] Aristote, des choses merveilleuses, Tite-Live, liv. VII, de la seconde décade.
-
[↑] Tome II, pag. 170.
[II-385]
CHAPITRE XXII.
Des richesses que l’Espagne tira de l’Amérique.
Si l’Europe [1] a trouvé tant d’avantage dans le commerce de l’Amérique, il seroit naturel de croire que l’Espagne en auroit reçu de plus grands. Elle tira du monde nouvellement découvert une quantité d’or & d’argent si prodigieuse, que ce que l’on en avoit eu jusqu’alors ne pouvoir y être comparé.
Mais (ce qu’on n’auroit jamais soupçonné) la misere la fit échouer presque par-tout. Philippe II qui succéda à Charles-Quint, fut obligé de faire la célebre banqueroute que tout le monde fait ; & il n’y a guere jamais eu de prince qui ait plus souffert que lui des [II-386] murmures, de l’insolence & de la révolte de ses troupes toujours mal payées.
Depuis ce temps la monarchie d’Espagne déclina sans cesse. C’est qu’il y avoit un vice intérieur & physique dans la nature de ces richesses qui les rendoit vaines ; & ce vice augmenta tous les jours.
L’or & l’argent sont une richesse de fiction ou de signe. Ces signes sont très-durables & se détruisent peu, comme il convient à leur nature. Plus ils se multiplient, plus ils perdent de leur prix, parce qu’ils représentent moins de choses.
Lors de la conquête du Mexique & du Pérou, les Espagnols abandonnerent les richesses naturelles pour avoir des richesses de signes qui s’avilissoient par elles-mêmes. L’or et l’argent étoient très-rares en Europe ; & l’Espagne maîtresse tout-à-coup d’une très-grande quantité de ces métaux, conçut des espérances qu’elle n’avoit jamais eues. Les richesses que l’on trouva dans les pays conquis, n’étoient pourtant pas proportionnées à celles de leurs mines. Les Indiens en cacherent une partie ; [II-387] & de plus, ces peuples, qui ne faisoient servir l’or & l’argent qu’à la magnificence des temples des dieux & des palais des rois, ne le cherchoient pas avec la même avarice que nous : enfin ils n’avoient pas le secret de tirer les métaux de toutes les mines; mais seulement de celles dans lesquelles la séparation se fait par le feu, ne connoissant pas la maniere d’employer le mercure, ni peut-être le mercure même.
Cependant l’argent ne laissa pas de doubler bientôt en Europe ; ce qui parut en ce que le prix de tout ce qui s’acheta fut environ du double.
Les Espagnols fouillerent les mines, creuserent les montagnes, inventerent des machines pour tirer les eaux, briser le minérai & le séparer ; & comme ils se jouoient de la vie des Indiens, ils les firent travailler sans ménagement. L’argent doubla bientôt en Europe, & le profit diminua toujours de moitié pour l’Espagne, qui n’avoit chaque année que la même quantité d’un métal qui étoit devenu la moitié moins précieux.
Dans le double du temps, l’argent [II-388] doubla encore, & le profit diminua encore de la moitié.
Il diminua même plus de la moitié : voici comment.
Pour tirer l’or des mines, pour lui donner les préparations requises, & le transporter en Europe, il falloit une dépense quelconque ; je suppose qu’elle fût comme 1 est à 64 : quand l’argent fut doublé une fois, & par conséquent la moitié moins précieux, la dépense fut comme 2 sont à 64. Ainsi les flottes qui porterent en Espagne la même quantité d’or, porterent une chose qui réellement valoit la moitié moins, & coûtoit la moitié plus.
Si l’on suit la chose de doublement en doublement, on trouvera la progression de la cause de l’impuissance des richesses de l’Espagne.
Il y a environ deux cents ans que l’on travaille les mines des Indes. Je suppose que la quantité d’argent qui est à présent dans le monde qui commerce, soit à celle qui étoit avant la découverte, comme 32 est à 1, c’est-à-dire, qu’elle ait doublé cinq fois : dans deux cents ans encore la même quantité sera à celle qui étoit avant la [II-389] découverte, comme 64 est à 1, c’est-à-dire, qu’elle doublera encore. Or à présent cinquante [2] quintaux de minérai pour l’or, donne quatre, cinq & six onces d’or ; & quand il n’y en a que deux, le mineur ne retire que ses frais. Dans deux cents ans, lorsqu’il n’y en aura que quatre, le mineur ne tirera aussi que ses frais. Il y aura donc peu de profit à tirer sur l’or. Même raisonnement sur l’argent, excepté que le travail des mines d’argent est un peu plus avantageux que celui des mines d’or.
Que si l’on découvre des mines si abondantes qu’elles donnent plus de profit ; plus elles seront abondantes, plutôt le profit finira.
Les Portugais ont trouvé tant d’or [3] dans le Brésil, qu’il faudra nécessairement que le profit des Espagnols diminue bientôt considérablement, & le leur aussi.
J’ai oui plusieurs fois déplorer [II-390] l’aveuglement du conseil de François I, qui rebuta Christophe Colomb, qui lui proposoit les Indes. En vérité, on fit peut-être par imprudence une chose bien sage. L’Espagne a fait comme ce roi insensé qui demanda que tout ce qu’il toucheroit se convertît en or, & qui fut obligé de revenir aux dieux pour les prier de finir sa misere.
Les compagnies & les banques que plusieurs nations établirent, acheverent d’avilir l’or & l’argent dans leur qualité de signe : car, par de nouvelles fictions, ils multiplierent tellement les signes des denrées, que l’or & l’argent ne firent plus cet office qu’en partie, & en devinrent moins précieux.
Ainsi le crédit public leur tint lieu de mines, & diminua encore le profit que les Espagnols tiroient des leurs.
Il est vrai que, par le commerce que les Hollandois firent dans les Indes Orientales, ils donnerent quelque prix à la marchandise des Espagnols ; car comme ils porterent de l’argent pour troquer contre les marchandises de l’Orient, ils soulagerent en Europe les Espagnols d’une partie de leurs denrées qui y abondoient trop.
[II-391]
Et ce commerce, qui ne semble regarder qu’indirectement l’Espagne, lui est avantageux comme aux nations mêmes qui le font.
Par tout ce qui vient d’être dit, on peut juger des ordonnances du conseil d’Espagne, qui défendent d’employer l’or & l’argent en dorures & autres superfluités ; décret pareil à celui que feroient les États de Hollande, s’ils défendoient la consommation de la cannelle.
Mon raisonnement ne porte pas sur toutes les mines ; celles d’Allemagne & de Hongrie, d’où l’on ne retire que peu de chose au-delà des frais, sont très-utiles. Elles se trouvent dans l’état principal, elles y occupent plusieurs milliers d’hommes qui y consomment les denrées surabondantes ; elles sont proprement une manufacture du pays.
Les mines d’Allemagne & de Hongrie font valoir la culture des terres ; & le travail de celles du Mexique & du Pérou la détruit.
Les Indes & l’Espagne sont deux puissances sous un même maître : mais les Indes sont le principal, l’Espagne n’est que l’accessoire. C’est en vain que [II-392] la politique veut ramener le principal à l’accessoire ; les Indes attirent toujours l’Espagne à elles.
D’environ cinquante millions de marchandises qui vont toutes les années aux Indes, l’Espagne ne fournit que deux millions & demi : les Indes sont donc un commerce de cinquante millions, & l’Espagne de deux millions & demi.
C’est une mauvaise espece de richesses qu’un tribut d’accident & qui ne dépend pas de l’industrie de la nation, du nombre de ses habitans, ni de la culture de ses terres. Le roi d’Espagne, qui reçoit de grandes sommes de sa douane de Cadix, n’est à cet égard qu’un particulier très-riche dans un état très-pauvre. Tout se passe des étrangers à lui, sans que ses sujets y prennent presque de part : ce commerce est indépendant de la bonne & de la mauvaise fortune de son royaume.
Si quelques provinces dans le Castille lui donnoient une somme pareille à celle de la douane de Cadix, sa puissance seroit bien plus grande : ses richesses ne pourroient être que l’effet de celles du pays ; ces provinces [II-393] animeroient toutes les autres, & elles seroient toutes ensemble plus en état de soutenir les charges respectives ; au lieu d’un grand trésor, on auroit un grand peuple.
-
[↑] Ceci parut il y a plus de vingt ans, dans un petit ouvrage manuscrit de l’Auteur, qui a été presque tout fondu dans celui-ci.
-
[↑] Voyez les voyages de Frezier.
-
[↑] Suivant Milord Anson, l’Europe reçoit du Brésil tous les ans pour deux millions sterling en or, que l’on trouve dans le sable au pied des montagnes, ou dans le lit des rivieres. Lorsque je fis le petit ouvrage dont j’ai parlé dans la premiere note de ce chapitre, il s’en falloit bien que les retours du Brésil fussent un objet aussi important qu’il l’est aujourd’hui.
[II-393]
CHAPITRE XXIII.
Problême.
Ce n’est point à moi à prononcer sur la question, si l’Espagne ne pouvant faire le commerce des Indes par elle-même, il ne vaudroit pas mieux qu’elle le rendît libre aux étrangers. Je dirai seulement qu’il lui convient de mettre à ce commerce le moins d’obstacles que sa politique pourra lui permettre. Quand les marchandises que les diverses nations portent aux Indes y sont cheres, les Indes donnent beaucoup de leur marchandise, qui est l’or & l’argent, pour peu de marchandises étrangeres : le contraire arrive lorsque celles-ci sont à vil prix. Il seroit peut-être utile que ces nations se nuisissent les unes les autres, afin que les marchandises qu’elles portent aux Indes y fussent toujours à bon marché. Voilà des [II-394] principes qu’il faut examiner, sans les séparer pourtant des autres considération ; la sureté des Indes ; l’utilité d’une douane unique ; les dangers d’un grand changement ; les inconvéniens qu’on prévoit, & qui souvent sont moins dangereux que ceux qu’on ne peut pas prévoir.
Fin du second Volume.
La Carte 1

[See a larger version of this Map - EdL2-Carte1-2500px.jpg]
La Carte 2
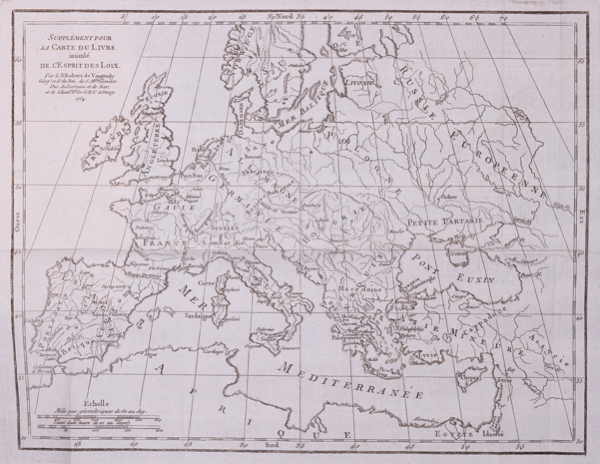
[See a larger version of this Map - EdL2-Carte2-2500px.jpg]
Volume III↩
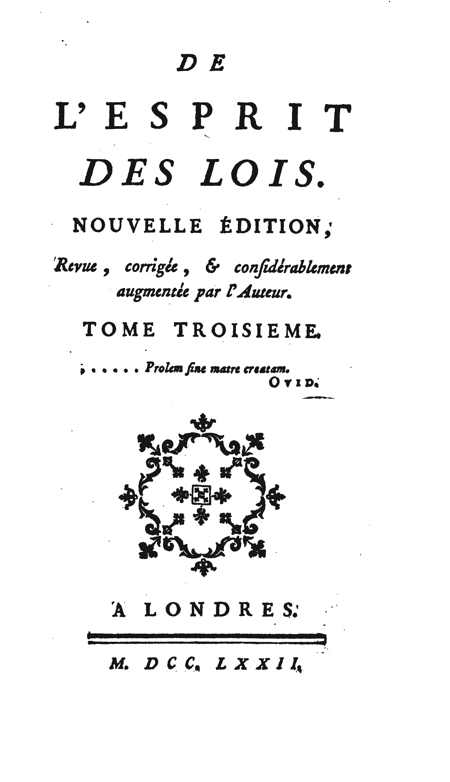
[III-31]
DE
L’ESPRIT
DES LOIS.↩
LIVRE XXII.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’usage de la monnoie.↩
CHAPITRE PREMIER.
Raison de l’usage de la monnoie.
Les peuples qui ont peu de marchandises pour le commerce, comme les sauvages, & les peuples policés qui n’en ont que deux ou trois especes, négocient par échange. Ainsi les caravanes de Maures qui vont à Tombouctou, dans le fond de l’Afrique, troquer [III-32] du sel contre de l’or, n’ont pas besoin de monnoie. Le Maure met son sel dans un monceau ; le Negre, sa poudre dans un autre : s’il n’y a pas assez d’or, le Maure retranche de son sel, ou le Negre ajoute de son or, jusqu’à ce que les parties conviennent.
Mais lorsqu’un peuple trafique sur un très-grand nombre de marchandises, il faut nécessairement une monnoie, parce qu’un métal facile à transporter épargne bien des frais, que l’on seroit obligé de faire si l’on procédoit toujours par échange.
Toutes les nations ayant des besoins réciproques, il arrive souvent que l’une veut avoir un très-grand nombre de marchandises de l’autre, & celle-ci très-peu des siennes ; tandis qu’à l’égard d’une autre nation, elle est dans un cas contraire. Mais lorsque les nations ont une monnoie, & qu’elles procedent par vente & par achat, celles qui prennent plus de marchandises se soldent ou payent l’excédent avec de l’argent : & il y a cette différence, que dans le cas de l’achat, le commerce se fait à proportion des besoins de la nation qui demande le plus ; & que dans l’échange [III-33] le commerce se fait seulement dans l’étendue des besoins de la nation qui demande le moins, sans quoi cette derniere seroit dans l’impossibilité de solder son compte.
[III-33]
CHAPITRE II.
De la nature de la monnoie.
La monnoie est un signe qui représente la valeur de toutes les marchandises. On prend quelque métal pour que le signe soit durable [1] ; qu’il se consomme peu par l’usage ; & que, sans se détruire, il soit capable de beaucoup de divisions. On choisit un métal précieux, pour que le signe puisse aisément se transporter. Un métal est très-propre à être une mesure commune, parce qu’on peut aisément le réduire au même titre. Chaque état y met son empreinte, afin que la forme réponde du titre & du poids, & que l’on connoisse l’un & l’autre par la seule inspection.
Les Athéniens n’ayant point l’usage des métaux, se servirent de bœufs [2] ; [III-34] & les Romains de brebis : mais un bœuf n’est pas la même chose qu’un autre bœuf, comme une piece de métal peut être la même qu’une autre.
Comme l’argent est le signe des valeurs des marchandises, le papier est un signe de la valeur de l’argent ; & lorsqu’il est bon, il le représente tellement, que, quant à l’effet, il n’y a point de différence.
De même que l’argent est un signe d’une chose, & la représente ; chaque chose est un signe de l’argent, & le représente : & l’état est dans la prospérité selon que d’un côté l’argent représente bien toutes choses ; & que d’un autre, toutes choses représentent bien l’argent, & qu’ils sont signes les uns des autres ; c’est-à-dire, que, dans leur valeur relative, on peut avoir l’un sitôt que l’on a l’autre. Cela n’arrive jamais que dans un gouvernement modéré, mais n’arrive pas toujours dans un gouvernement modéré : par exemple, si les lois favorisent un débiteur injuste, les choses qui lui appartiennent ne [III-35] représentent point l’argent, & n’en sont point un signe. À l’égard du gouvernement despotique, ce seroit un prodige si les choses y représentoient leur signe : la tyrannie & la méfiance font que tout le monde y enterre [3] son argent : les choses n’y représentent donc point l’argent.
Quelquefois les législateurs ont employé un tel art, que non-seulement les choses représentoient l’argent par leur nature, mais qu’elles devenoient monnoie comme l’argent même. César [4] dictateur, permit aux débiteurs de donner en payement à leurs créanciers des fonds de terre au prix qu’ils valoient avant la guerre civile. Tibere [5] ordonna que ceux qui voudroient de l’argent, en auroient du trésor public, en obligeant des fonds pour le double. Sous César, les fonds de terre furent la monnoie qui paya toutes les dettes ; sous Tibere, dix mille sesterces en fonds devinrent une monnoie commune comme cinq mille sesterces en argent.
[III-36]
La grande chartre d’Angleterre défend de saisir les terres ou les revenus d’un débiteur, lorsque ses biens mobiliers ou personnels suffisent pour le payement, & qu’il offre de les donner ; pour lors tous les biens d’un Anglois représentoient de l’argent.
Les lois des Germains apprécierent en argent les satisfactions pour les torts que l’on avoit faits, & pour les peines des crimes. Mais comme il y avoit très-peu d’argent dans le pays, elles réapprécierent l’argent en denrées ou en bétail. Ceci se trouve fixé dans la loi des Saxons, avec de certaines différences suivant l’aisance & la commodité des divers peuples. D’abord [6] la loi déclare la valeur du sou en bétail : le sou de deux trémisses se rapportoit à un bœuf de douze mois ou à une brebis avec son agneau ; celui de trois trémisses valoit un bœuf de seize mois. Chez ces peuples la monnoie devenait bétail, marchandise, ou denrée ; & ces choses devenoient monnoie.
Non-seulement l’argent est un signe des choses ; il est encore un signe de [III-37] l’argent & représente l’argent, comme nous le verrons au chapitre du change.
-
[↑] Le sel, dont on se sert en Abyssinie, a ce défaut, qu’il se consomme continuellement.
-
[↑] Hérodote, in Clio, nous dit que les Lydiens trouverent l’art de battre la monnoie ; les Grecs le prirent d’eux : les monnoies d’Athenes eurent pour empreinte leur ancien bœuf. J’ai vu une de ces monnoies dans le cabinet du Comte de Pembrocke.
-
[↑] C’est un ancien usage à Alger, que chaque pere de famille ait un trésor enterré. Logier de Tassis, histoire du royaume d’Alger.
-
[↑] Voyez César, de la guerre civile, liv. III.
-
[↑] Tacite, liv. VI.
-
[↑] Loi des Saxons, ch. xviii.
[III-37]
CHAPITRE III.
Des monnoies idéales.
Il y a des monnoies réelles & des monnoies idéales. Les peuples policés, qui se servent presque tous de monnoies idéales, ne le sont que parce qu’ils ont converti leurs monnoies réelles en idéales. D’abord leurs monnoies réelles sont un certain poids & un certain titre de quelque métal : mais bientôt la mauvaise foi ou le besoin font qu’on retranche une partie du métal de chaque piece de monnoie, à laquelle on laisse le même nom : par exemple, d’une piece du poids d’une livre d’argent, on retranche la moitié de l’argent, & on continue de l’appeler livre ; la piece qui étoit une vingtieme partie de la livre d’argent on continue de l’appeller sou, quoiqu’elle ne soit plus la vingtieme partie de cette livre. Pour lors, la livre est une livre idéale, & le sou, un sou idéal ; ainsi des autres subdivisions : & cela peut aller au point que ce qu’on [III-38] appellera livre ne ſera plus qu’une très-petite portion de la livre, ce qui la rendra encore plus idéale. Il peut même arriver que l’on ne fera plus de piece de monnoie qui vaille préciſément une livre, & qu’on ne fera pas non plus de piece qui vaille un ſou : pour lors la livre & le ſou ſeront des monnoies purement idéales. On donnera à chaque piece de monnoie la dénomination d’autant de livres & d’autant de ſous que l’on voudra ; la variation pourra être continuelle, parce qu’il eſt auſſi aiſé de donner un autre nom à une choſe, qu’il eſt difficile de changer la choſe même.
Pour ôter la ſource des abus, ce ſera une très-bonne loi dans tous les pays où l’on voudra faire fleurir le commerce, que celle qui ordonnera qu’on emploiera des monnoies réelles ; & que l’on ne fera point d’opération qui puiſſe les rendre idéales.
Rien ne doit être ſi exempt de variation, que ce qui eſt la meſure commune de tout.
Le négoce par lui-même eſt très-incertain ; & c’eſt un grand mal d’ajouter une nouvelle incertitude à celle qui eſt fondée ſur la nature de la choſe.
[III-39]
CHAPITRE IV.
De la quantité de l’or & de l’argent.
Lorsque les nations policées sont les maîtresses du monde, l’or & l’argent augmentent tous les jours, soit qu’elles le tirent de chez elles, soit qu’elles l’aillent chercher là où il est. Il diminue au contraire lorsque les nations barbares prennent le dessus. On sait quelle fut la rareté de ces métaux, lorsque les Goths & les Vandales d’un côté, les Sarrasins & les Tartares de l’autre, eurent tout envahi.
[III-39]
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
L’argent tiré des mines de l’Amérique, transporté en Europe, de là encore envoyé en Orient, a favorisé la navigation de l’Europe ; c’est une marchandise de plus que l’Europe reçoit en troc de l’Amérique, & qu’elle envoie en troc aux Indes. Une plus grande quantité d’or & d’argent est donc [III-40] favorable, lorsqu’on regarde ces métaux comme marchandise ; elle ne l’est point lorsqu’on les regarde comme signe, parce que leur abondance choque leur qualité de signe qui est beaucoup fondée sur la rareté.
Avant la premiere guerre Punique, le cuivre étoit à l’argent comme [1] 960 est à 1 ; il est aujourd’hui à peu près comme 73 ½ est à 1 [2] . Quand la proportion seroit comme elle étoit autrefois, l’argent n’en seroit que mieux sa fonction de signe.
-
[↑] Voyez ci-dessous le chap. xii.
-
[↑] En supposant l’argent à 49 livres le marc, & le cuivre à vingt sols la livre.
[III-40]
CHAPITRE VI.
Par quelle raison le prix de l’usure diminua de la moitié, lors de la découverte des Indes.
L’ynca Garcilasso [1] dit qu’en Espagne, après la conquête des Indes, les rentes qui étoient au denier dix tomberent au denier vingt. Cela devoit être ainsi. Une grande quantité d’argent fut [III-41] tout-à-coup portée en Europe : bientôt moins de personnes eurent besoin d’argent ; le prix de toutes choses augmenta, & celui de l’argent diminua : la proportion fut donc rompue, toutes les anciennes dettes furent éteintes. On peut se rappeller le temps du systême [2] où toutes les choses avoient une grande valeur, excepté l’argent. Après la conquête des Indes, ceux qui avoient de l’argent furent obligés de diminuer le prix ou le louage de leur marchandise, c’est-à-dire l’intérêt.
Depuis ce temps, le prêt n’a pu revenir à l’ancien taux, parce que la quantité de l’argent a augmenté toutes les années en Europe. D’ailleurs, les fonds publics de quelques états, fondés sur les richesses que le commerce leur a procurées, donnant un intérêt très-modique, il a fallu que les contrats des particuliers se réglassent là-dessus. Enfin le change ayant donné aux hommes une facilité singuliere de transporter l’argent d’un pays à un autre, l’argent n’a pu être rare dans un lieu, qu’il n’en vînt de tous côtés de ceux où il étoit commun.
-
[↑] Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes.
-
[↑] On appelloit ainsi le projet de M. Law en France.
[III-42]
CHAPITRE VII.
Comment le prix des richesses se fixe dans la variation des richesses de signe.
L’argent est le prix des marchandises ou denrées. Mais, comment se fixera ce prix ? c’est-à-dire, par quelle portion d’argent chaque chose sera-t-elle représentée ?
Si l’on compare la masse de l’or & de l’argent qui est dans le monde, avec la somme des marchandises qui y sont, il est certain que chaque denrée ou marchandise en particulier pourra être comparée à une certaine portion de la masse entiere de l’or & de l’argent. Comme le total de l’une est au total de l’autre, la partie de l’une sera à la partie de l’autre. Supposons qu’il n’y ait qu’une seule denrée ou marchandise dans le monde, ou qu’il n’y en ait qu’une seule qui s’achete, & qu’elle se divise comme l’argent ; cette partie de cette marchandise répondra à une partie de la masse de l’argent ; la moitié du total de l’une à la moitié du total de l’autre ; la dixieme, la centieme, la millieme de l’une, à la [III-43] dixieme, à la centieme, à la millieme de l’autre. Mais comme ce qui forme la propriété parmi les hommes, n’est pas tout à la fois dans le commerce ; & que les métaux ou les monnoies, qui en sont les signes, n’y sont pas aussi dans le même temps ; les prix se fixeront en raison composée du total des choses avec le total des signes, & de celle du total des choses qui sont dans le commerce avec le total des signes qui y sont aussi : & comme les choses qui ne sont pas dans le commerce aujourd’hui peuvent y être demain, & que les signes qui n’y sont point aujourd’hui peuvent y rentrer tout de même, l’établissement du prix des choses dépend toujours fondamentalement de la raison du total des choses au total des signes.
Ainsi le prince ou le magistrat ne peuvent pas plus taxer la valeur des marchandises, qu’établir par une ordonnance que le rapport d’un à dix est égal à celui d’un à vingt. Julien [1] ayant baissé les denrées à Antioche, y causa une affreuse famine.
-
[↑] Histoire de l’Église, par Socrate, liv. II.
[III-44]
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
Les noirs de la côte d’Afrique ont un signe des valeurs sans monnoie ; c’est un signe purement idéal, fondé sur le degré d’estime qu’ils mettent dans leur esprit à chaque marchandise, à proportion du besoin qu’ils en ont. Une certaine denrée ou marchandise vaut trois macutes ; une autre, six macutes ; une autre, dix macutes ; c’est comme s’ils disoient simplement, trois, six, dix. Le prix se forme par la comparaison qu’ils font de toutes les marchandises entr’elles ; pour lors il n’y a point de monnoie particuliere, mais chaque portion de marchandise est monnoie de l’autre.
Transportons pour un moment parmi nous cette maniere d’évaluer les choses, & joignons-la avec la nôtre : Toutes les marchandises & denrées du monde, ou bien toutes les marchandises ou denrées d’un état en particulier considéré comme séparé de tous les autres, vaudront un certain nombre de macutes ; [III-45] & divisant l’argent de cet état en autant de parties qu’il y a de macutes, une partie divisée de cet argent sera le signe d’une macute.
Si l’on suppose que la quantité de l’argent d’un état double, il faudra pour une macute le double de l’argent : mais si en doublant l’argent, vous doublez aussi les macutes, la proportion restera telle qu’elle étoit avant l’un & l’autre doublement.
Si depuis la découverte des Indes, l’or & l’argent ont augmenté en Europe à raison d’un à vingt, le prix des denrées & marchandises auroit dû monter en raison d’un à vingt : mais si d’un autre côté, le nombre des marchandises a augmenté comme un à deux, il faudra que le prix de ces marchandises & denrées ait haussé d’un côté en raison d’un à vingt, & qu’il ait baissé en raison d’un à deux, & qu’il ne soit par conséquent qu’en raison d’un à dix.
La quantité des marchandises & denrées croît par une augmentation de commerce ; l’augmentation de commerce, par une augmentation d’argent qui arrive successivement, & par de nouvelles communications avec de nouvelles [III-46] terres & de nouvelles mers, qui nous donnent de nouvelles denrées & de nouvelles marchandises.
[III-46]
CHAPITRE IX.
De la rareté relative de l’or & de l’argent.
Outre l’abondance & la rareté positive de l’or & de l’argent, il y a encore une abondance & une rareté relative d’un de ces métaux à l’autre.
L’avarice garde l’or & l’argent, parce que, comme elle ne veut pas consommer, elle aime des signes qui ne se détruisent point. Elle aime mieux garder l’or que l’argent, parce qu’elle craint toujours de perdre, & qu’elle peut mieux cacher ce qui est en plus petit volume. L’or disparoît donc quand l’argent est commun, parce que chacun en a pour le cacher ; il reparoît quand l’argent est rare, parce qu’on est obligé de le retirer de ses retraites.
C’est donc une regle : l’or est commun quand l’argent est rare, & l’or est rare quand l’argent est commun. Cela fait sentir la différence de l’abondance [III-47] & de la rareté relative, d’avec l’abondance & la rareté réelle ; chose dont je vais beaucoup parler.
[III-47]
CHAPITRE X.
Du change.
C’est l’abondance & la rareté relative des monnoies des divers pays qui forment ce qu’on appelle le change.
Le change est une fixation de la valeur actuelle & momentanée des monnoies.
L’argent, comme métal, a une valeur comme toutes les autres marchandises ; & il a encore une valeur qui vient de ce qu’il est capable de devenir le signe des autres marchandises : & s’il n’étoit qu’une simple marchandise, il ne faut pas douter qu’il ne perdît beaucoup de son prix.
L’argent, comme monnoie, a une valeur que le prince peut fixer dans quelques rapports, & qu’il ne sauroit fixer dans d’autres.
1°. Le prince établit une proportion entre une quantité d’argent comme métal, & la même quantité comme [III-48] monnoie. 2°. Il fixe celle qui est entre divers métaux employés à la monnoie. 3°. Il établit le poids & le titre de chaque piece de monnoie. Enfin il donne à chaque piece cette valeur idéale dont j’ai parlé. J’appellerai la valeur de la monnoie dans ces quatre rapports valeur positive, parce qu’elle peut être fixée par une loi.
Les monnoies de chaque état ont de plus une valeur relative, dans le sens qu’on les compare avec les monnoies des autres pays : c’est cette valeur relative que le change établit. Elle dépend beaucoup de la valeur positive. Elle est fixée par l’estime la plus générale des négocians, & ne peut l’être par l’ordonnance du prince, parce qu’elle varie sans cesse, & dépend de mille circonstances.
Pour fixer la valeur relative, les diverses nations se régleront beaucoup sur celle qui a le plus d’argent. Si elle a autant d’argent que toutes les autres ensemble, il faudra bien que chacune aille se mesurer avec elle ; ce qui fera qu’elles se régleront à peu près entr’elles comme elles se sont mesurées avec la nation principale.
[III-49]
Dans l’état actuel de l’univers, c’est la Hollande [1] qui est cette nation dont nous parlons. Examinons le change par rapport à elle.
Il y a en Hollande une monnoie qu’on appelle un florin : le florin vaut vingt sous, ou quarante demi-sous, ou gros. Pour simplifier les idées, imaginons qu’il n’y a point de florins en Hollande, & qu’il n’y ait que des gros : un homme qui aura mille florins, aura quarante mille gros, ainsi du reste. Or le change avec la Hollande, consiste à savoir combien vaudra de gros chaque piece de monnoie des autres pays ; & comme l’on compte ordinairement en France par écu de trois livres, le change demandera combien un écu de trois livres vaudra de gros. Si le change est à cinquante-quatre gros, l'écu de trois livres vaudra cinquante-quatre gros ; s’il est à soixante, il vaudra soixante gros ; si l’argent est rare en France, l’écu de trois livres vaudra plus de gros ; s’il est en abondance, il vaudra moins de gros.
Cette rareté ou cette abondance d’où [III-50] résulte la mutation du change, n’est pas la rareté ou l’abondance réelle ; c’est une rareté ou une abondance relative : par exemple, quand la France a plus besoin d’avoir des fonds en Hollande, que les Hollandois n’ont besoin d’en avoir en France, l’argent est appellé commun en France, & rare en Hollande, & vice versâ.
Supposons que le change avec la Hollande soit à cinquante-quatre. Si la France & la Hollande ne composoient qu’une ville, on feroit comme l’on fait quand on donne la monnoie d’un écu : le François tireroit de sa poche trois livres, & le Hollandois tireroit de la sienne cinquante-quatre gros. Mais comme il y a de la distance entre Paris & Amsterdam, il faut que celui qui me donne pour mon écu de trois livres cinquante-quatre gros qu’il a en Hollande, me donne une lettre de change de cinquante-quatre gros sur la Hollande. Il n’est plus ici question de cinquante-quatre gros, mais d’une lettre de cinquante-quatre gros. Ainsi pour juger [2] de la rareté [III-51] ou de l’abondance de l’argent, il faut savoir s’il y a en France plus de lettres de cinquante-quatre gros destinées pour la France, qu’il n’y a d’écus destinés pour la Hollande. S’il y a beaucoup de lettres offertes par les Hollandois & peu d’écus offerts par les François, l’argent est rare en France & commun en Hollande ; & il faut que le change hausse, & que pour mon écu on me donne plus de cinquante-quatre gros ; autrement je ne le donnerois pas, & vice versâ.
On voit que les diverses opérations du change forment un compte de recette & de dépense qu’il faut toujours solder ; & qu’un état qui doit, ne s’acquitte pas plus avec les autres par le change, qu’un particulier ne paye une dette en changeant de l’argent.
Je suppose qu’il n’y ait que trois états dans le monde, la France, l’Espagne & la Hollande ; que divers particuliers d’Espagne dussent en France la valeur de cent mille marcs d’argent, & que divers particuliers de France dussent en Espagne cent dix mille marcs ; & que quelque circonstance fît que chacun, en Espagne & en France, voulût tout-à-coup retirer son argent : que feroient les [III-52] opérations du change ? Elles acquitteroient réciproquement ces deux nations de la somme de cent mille marcs : mais la France devroit toujours dix mille marcs en Espagne, & les Espagnols auroient toujours des lettres sur la France pour dix mille marcs ; & la France n’en auroit point du tout sur l’Espagne.
Que si la Hollande étoit dans un cas contraire avec la France, & que pour solde elle lui dût dix mille marcs, la France pourroit payer l’Espagne de deux manieres, ou en donnant à ses créanciers en Espagne des lettres sur ses débiteurs de Hollande pour dix mille marcs, ou bien en envoyant dix mille marcs d’argent en especes en Espagne.
Il suit de-là, que quand un état a besoin de remettre une somme d’argent dans un autre pays, il est indifférent par la nature de la chose que l’on y voiture de l’argent, ou que l’on prenne des lettres de change. L’avantage de ces deux manieres de payer, dépend uniquement des circonstances actuelles ; il faudra voir ce qui dans ce moment, donnera plus de gros en Hollande, ou l’argent porté en especes [3] , ou une [III-53] lettre sur la Hollande, de pareille somme.
Lorsque même titre & même poids d’argent en France me rendent même poids & même titre d’argent en Hollande, on dit que le change est au pair. Dans l’état actuel des monnoies, [4] le pair est à-peu-près à cinquante-quatre gros par écu : lorsque le change sera au dessus de cinquante-quatre gros, on dira qu’il est haut ; lorsqu’il sera au dessous, on dira qu’il est bas.
Pour savoir si, dans une certaine situation du change, l’état gagne ou perd ; il faut le considérer comme débiteur, comme créancier, comme vendeur, comme acheteur. Lorsque le change est plus bas que le pair, il perd comme débiteur, il gagne comme créancier ; il perd comme acheteur, il gagne comme vendeur. On sent bien qu’il perd comme débiteur : par exemple, la France devant à la Hollande un certain nombre de gros, moins son écu vaudra de gros, plus il lui faudra d’écus pour payer : au contraire, si la France est créanciere d’un certain nombre de gros, moins chaque écu vaudra de gros, plus elle [III-54] recevra d’écus. L’état perd encore comme acheteur ; car il faut toujours le même nombre de gros pour acheter la même quantité de marchandises ; & lorsque le change baisse, chaque écu de France donne moins de gros. Par la même raison, l’état gagne comme vendeur : je vends ma marchandise en Hollande le même nombre de gros que je la vendois ; j’aurois donc plus d’écus en France, lorsqu’avec cinquante gros je me procurerai un écu, que lorsqu’il m’en faudra cinquante-quatre pour avoir ce même écu : le contraire de tout ceci arrivera à l’autre état. Si la Hollande doit un certain nombre d’écus, elle gagnera ; & si on les lui doit, elle perdra ; si elle vend, elle perdra ; si elle achete, elle gagnera.
Il faut pourtant suivre ceci : lorsque le change est au dessous du pair, par exemple, s’il est à cinquante au lieu d’être à cinquante-quatre, il devroit arriver que la France envoyant par le change cinquante-quatre mille écus en Hollande, n’acheteroit de marchandises que pour cinquante mille ; & que d’un autre côté la Hollande envoyant la valeur de cinquante mille écus en [III-55] France, en acheteroit pour cinquante-quatre mille ; ce qui ferois une différence de huit cinquante-quatriemes, c’est-à-dire, de plus d’un septieme de perte pour la France ; de sorte qu’il faudroit envoyer en Hollande un septieme de plus en argent ou en marchandises, qu’on ne faisoit lorsque le change étoit au pair : & le mal augmentant toujours, parce qu’une pareille dette feroit encore diminuer le change, la France seroit à la fin ruinée. Il semble, dis-je, que cela devoit être ; & cela n’est pas, à cause du principe que j’ai déjà établi ailleurs [5] , qui est que les états tendent toujours à se mettre dans la balance, & à se procurer leur libération ; ainsi ils n’empruntent qu’à proportion de ce qu’ils peuvent payer, & n’achetent qu’à mesure qu’ils vendent. Et en prenant l’exemple ci-dessus, si le change tombe en France de cinquante-quatre à cinquante, le Hollandois qui achetoit des marchandises de France pour mille écus, & qui les payoit cinquante-quatre mille gros, ne les payeroit plus que cinquante mille, si le François y vouloit consentir : mais la marchandises de France haussera [III-56] insensiblement, le profit se partagera entre le François & le Hollandois ; car, lorsqu’un négociant peut gagner, il partage aisément son profit ; il se fera donc une communication de profit entre le François & le Hollandois. De la même maniere, le François qui achetoit des marchandises de Hollande pour cinquante-quatre mille gros, & qui les payoit avec mille écus lorsque le change étoit à cinquante-quatre, seroit obligé d’ajouter quatre cinquante-quatriemes de plus en écus de France, pour acheter les mêmes marchandises ; mais le marchand François qui sentira la perte qu’il feroit, voudra donner moins de la marchandise de Hollande ; il se fera donc une communication de perte entre le marchand François & le marchand Hollandois, l’état se mettra insensiblement dans la balance, & l’abaissement du change n’aura pas tous les inconvéniens qu’on devoit craindre.
Lorsque le change est plus bas que le pair, un négociant peut, sans diminuer sa fortune, remettre ses fonds dans les pays étrangers, parce qu’en les faisant revenir, il regagne ce qu’il a perdu : mais un prince qui n’envoie dans les [III-57] pays étrangers qu’un argent qui ne doit jamais revenir, perd toujours.
Lorsque les négocians font beaucoup d’affaires dans un pays, le change y hausse infailliblement. Cela vient de ce qu’on y prend beaucoup d’engagemens, & qu’on y achete beaucoup de marchandises ; & l’on tire sur le pays étranger pour les payer.
Si un prince fait un grand amas d’argent dans son état, l’argent y pourra être rare réellement, & commun relativement ; par exemple, si dans le même temps cet état avoit à payer beaucoup de marchandises dans le pays étranger, le change baisseroit, quoique l’argent fût rare.
Le change de toutes les places tend toujours à se mettre à une certaine proportion, & cela est dans la nature de la chose même. Si le change de l’Irlande à l’Angleterre est plus bas que le pair, & que celui de l’Angleterre à la Hollande soit aussi plus bas que le pair, celui de l’Irlande à la Hollande sera encore plus bas, c’est-à-dire, en raison composée de celui d’Irlande à l’Angleterre, & de celui de l’Angleterre à la Hollande ; car un Hollandois qui peut faire venir ses [III-58] fonds indirectement d’Irlande par l’Angleterre, ne voudra pas payer plus cher pour les faire venir directement. Je dis que cela devroit être ainsi ; mais cela n’est pourtant pas exactement ainsi ; il y a toujours des circonstances qui font varier ces choses ; & à la différence du profit qu’il y a à tirer par une place, ou à tirer par une autre, fait l’art & l’habileté particuliere des banquiers, dont il n’est point question ici.
Lorsqu’un état hausse sa monnoie ; par exemple, lorsqu’il appelle six livres ou deux écus, ce qu’il n’appelloit que trois livres ou un écu, cette dénomination nouvelle, qui n’ajoute rien de réel à l’écu, ne doit pas procurer un seul gros de plus par le change. On ne devroit avoir pour les deux écus nouveaux que la même quantité de gros que l’on recevoit pour l’ancien ; & si cela n’est pas, ce n’est point l’effet de la fixation en elle-même, mais de celui qu’elle produit comme nouvelle, & de celui qu’elle a comme subite. Le change tient à des affaires commencées, & ne se met en regle qu’après un certain temps.
Lorsqu’un état, au lieu de hausser simplement sa monnoie par une loi, fait [III-59] une nouvelle refonte, afin de faire d’une monnoie forte une monnoie plus foible, il arrive que, pendant le temps de l’opération, il y a deux sortes de monnoie, la forte qui est la vieille, & la foible qui est la nouvelle ; & comme la forte est décriée & ne se reçoit qu’à la monnoie, & que par conséquent les lettres de change doivent se payer en especes nouvelles, il semble que le change devroit se régler sur l’espece nouvelle. Si, par exemple, l’affoiblissement en France étoit de moitié, & que l’ancien écu de trois livres donnât soixante gros en Hollande, le nouvel écu ne devroit donner que trente gros ; d’un autre côté, il semble que le change devroit se régler sur la valeur de l’espece vieille, parce que le banquier qui a de l’argent & qui prend des lettres, est obligé d’aller porter à la monnoie des especes vieilles pour en avoir de nouvelles sur lesquelles il perd : le change se mettra donc entre la valeur de l’espece nouvelle & celle de l’espece vieille ; la valeur de l’espece vieille tombe, pour ainsi dire, & parce qu’il y a déjà dans le commerce de l’espece nouvelle, & parce que le banquier ne peut pas tenir rigueur, ayant [III-60] intérêt de faire sortir promptement l’argent vieux de sa caisse pour le faire travailler, & y étant même forcé pour faire ses paiemens : d’un autre côté, la valeur de l’espece nouvelle s’éleve, pour ainsi dire, parce que le banquier avec de l’espece nouvelle se trouve dans une circonstance où nous allons faire voir qu’il peut avec un grand avantage s’en procurer de la vieille : le change se mettra donc, comme j’ai dit, entre l’espece nouvelle & l’espece vieille. Pour lors les banquiers ont du profit à faire sortir l’espece vieille de l’état, parce qu’ils se procurent par là le même avantage que donneroit un change réglé sur l’espece vieille, c’est-à-dire, beaucoup de gros en Hollande, & qu’ils ont un retour en change réglé entre l’espece nouvelle & l’espece vieille, c’est-à-dire plus bas ; ce qui procure beaucoup d’écus en France.
Je suppose que trois livres d’espece vieille rendent par le change actuel quarante-cinq gros, & qu’en transportant ce même écu en Hollande, on en ait soixante ; mais avec une lettre de quarante-cinq gros, on se procurera un écu de trois livres en France, lequel [III-61] transporté en especes vieilles en Hollande, donnera encore soixante gros : toute l’espece vieille sortira donc de l’état qui fait la refonte, & le profit en sera pour les banquiers.
Pour remédier à cela, on sera forcé de faire une opération nouvelle. L’état qui fait la refonte, enverra lui-même une grande quantité d’especes vieilles chez la nation qui regle le change ; & s’y procurant un crédit, il fera monter le change au point qu’on aura, à peu de chose près, autant de gros par le change d’un écu de trois livres, qu’on en auroit en faisant sortir un écu de trois livres en especes vieilles hors du pays. Je dis à peu de chose près, parce que, lorsque le profit sera modique, on ne sera point tenté de faire sortir l’espece, à cause des frais de la voiture, & des risques de la confiscation.
Il est bon de donner ici une idée bien claire de ceci. Le sieur Bernard, ou tout autre banquier que l’état voudra employer, propose ses lettres sur la Hollande, & les donne à un, deux, trois gros plus haut que le change actuel ; il a fait une provision dans les pays étrangers, par le moyen des especes [III-62] vieilles qu’il a fait continuellement voiturer : il a donc fait hausser le change au point que nous venons de dire : cependant, à force de donner de ses lettres, il se saisit de toutes les especes nouvelles, & force les autres banquiers qui ont des paiemens à faire, à porter leurs especes vieilles à la monnoie ; & de plus, comme il a eu insensiblement tout l’argent, il contraint à leur tour les autres banquiers à lui donner des lettres à un change très-haut : le profit de la fin l’indemnise en grande partie de la perte du commencement.
On sent que, pendant toute cette opération, l’état doit souffrir une violente crise. L’argent y deviendra très-rare ; 1°. parce qu’il faut en décrier la plus grande partie ; 2°. parce qu’il en faudra transporter une partie dans les pays étrangers ; 3°. Parce que tout le monde le resserrera, personne ne voulant laisser au prince un profit qu’on espere avoir soi-même. Il est dangereux de la faire avec lenteur : il est dangereux de la faire avec promptitude. Si le gain qu’on suppose est immodéré, les inconvéniens augmentent à mesure.
On a vu ci-dessus que, quand le [III-63] change étoit plus bas que l’espece, il y avoit du profit à faire sortir l’argent : par la même raison, lorsqu’il est plus haut que l’espece, il y a du profit à le faire revenir.
Mais il y a un cas où on trouve du profit à faire sortir l’espece, quoique le change soit au pair : c’est lorsqu’on l’envoie dans les pays étrangers, pour la faire remarquer ou refondre. Quand elle est revenue, on fait, soit qu’on l’emploie dans le pays, soit qu’on prenne des lettres pour l’étranger, le profit de la monnoie.
S’il arrivoit que dans un état on fît une compagnie qui eût un nombre très-considérable d’actions, & qu’on eût fait dans quelques mois de temps hausser ces actions vingt ou vingt-cinq fois au-delà de la valeur du premier achat, & que ce même état eût établi une banque dont les billets dussent faire la fonction de monnoie, & que la valeur numéraire de ces billets fût prodigieuse pour répondre à la prodigieuse valeur numéraire des actions (c’est le systême de M. Law), il suivroit de la nature de la chose que ces actions & billets s’anéantiroient de la même maniere qu’ils se seroient établis.
[III-64] On n’auroit pu faire monter tout-à-coup les actions vingt ou vingt-cinq fois plus haut que leur premiere valeur, sans donner à beaucoup de gens le moyen de se procurer d’immenses richesses en papier : chacun chercheroit à assurer sa fortune ; & comme le change donne la voie la plus facile pour la dénaturer, ou pour la transporter où l’on veut, on remettroit sans cesse une partie de ses effets chez la nation qui regle le change. Un projet continuel de remettre dans les pays étrangers, feroit baisser le change. Supposons que, du temps du systême, dans le rapport du titre & du poids de la monnoie d’argent, le taux du change fût de quarante gros par écu ; lorsqu’un papier innombrable fut devenu monnoie, on n’aura plus voulu donner que trente-neuf gros par écu, ensuite que trente-huit, trente-sept, &c. Cela alla si loin, que l’on ne donna plus que huit gros, & qu’enfin il n’y eut plus de change.
C’étoit le change qui devoit en ce cas régler en France la proportion de l’argent avec le papier. Je suppose que, par le poids & le titre de l’argent, l’écu de trois livres d’argent valût quarante [III-65] gros, & que le change se faisant en papier, l’écu de trois livres en papier ne valût que huit gros, la différence étoit de quatre cinquiemes. L’écu de trois livres en papier valoit donc quatre cinquiemes de moins que l’écu de trois livres en argent.
-
[↑] Les Hollandois reglent le change de presque toute l’Europe par une espece de délibération entr’eux, selon qu’il convient à leurs intérêts.
-
[↑] Il y a beaucoup d’argent dans une place, lorsqu’il y a plus d’argent que de papier ; il y en a peu, lorsqu’il y a plus de papier que d’argent.
-
[↑] Les frais de la voiture & de l’assurance déduits.
-
[↑] En 1744.
-
[↑] Voyez le livre XX. Chap. xxi.
[III-65]
CHAPITRE XI.
Des opérations que les Romains firent sur les monnoies.
Quelques coups d’autorité que l’on ait faits de nos jours en France sur les monnoies dans deux ministeres consécutifs, les romains en firent de plus grands, non pas dans le temps de cette république corrompue, ni dans celui de cette république qui n’étoit qu’une anarchie ; mais lorsque, dans la force de son institution, par sa sagesse comme par son courage, après avoir vaincu les villes d’Italie, elle disputoit l’empire aux Carthaginois.
Et je suis bien aise d’approfondir un peu cette matiere, afin qu’on ne fasse pas un exemple de ce qui n’en est point un.
[III-66]
Dans la premiere guerre Punique [1] l’as qui devoit être de douze onces de cuivre, n’en pesa plus que deux ; & dans la seconde, il ne fut plus que d’une. Ce retranchement répond à ce que nous appellons aujourd’hui augmentation des monnoies : ôter d’un écu de six livres la moitié de l’argent pour en faire deux, ou le faire valoir douze livres, c’est précisément la même chose.
Il ne nous reste point de monument de la maniere dont les Romains firent leur opération dans la premiere guerre Punique : mais ce qu’ils firent dans la seconde, nous marque une sagesse admirable. La république ne se trouvoit point en état d’acquitter ses dettes ; l’as pesoit deux onces de cuivre ; & le denier valant dix as, valoit vingt onces de cuivre. La république fit des as [2] d’une once de cuivre, elle gagna la moitié sur ses créanciers, elle paya un denier avec ces dix onces de cuivre. Cette opération donna une grande secousse à l’état, il falloit la donner la moindre qu’il étoit possible ; elle contenoit une injustice, il falloit qu’elle fut la moindre qu’il étoit [III-67] possible ; elle avoit pour objet la libération de la république envers ses citoyens, il ne falloit donc pas qu’elle eût celui de la libération des citoyens entr’eux : cela fit faire une seconde opération ; & l’on ordonna que le denier qui n’avoit été jusques-là que dix as, en contiendroit seize ; il résulta de cette double opération, que, pendant que les créanciers de la république perdoient la moitié [3] , ceux des particuliers ne perdoient qu’un cinquieme [4] , les marchandises n’augmentoient que d’un cinquieme, le changement réel dans la monnoie n’étoit que d’un cinquieme : on voit les autres conséquences.
Les Romains se conduisirent donc mieux que nous, qui dans nos opérations, avons enveloppé & les fortunes publiques & les fortunes particulieres. Ce n’est pas tout : on va voir qu’ils les firent dans des circonstances plus favorables que nous.
-
[↑] Pline, hist. Nat. XXXIII. art. 13.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ils recevoient dix onces de cuivre pour vingt.
-
[↑] Ils recevoient seize onces de cuivre pour vingt.
[III-68]
CHAPITRE XII.
Circonstances dans lesquelles les Romains firent leurs opérations sur la monnoie.
Il y avoit anciennement très-peu d’or & d’argent en Italie ; ce pays a peu ou point de mines d’or & d’argent : lorsque Rome fut prise pas les Gaulois, il ne s’y trouva que mille livres d’or [1] . Cependant les Romains avoient saccagé plusieurs villes puissantes, & ils en avoient transporté les richesses chez eux. Ils ne se servirent long-temps que de monnoie de cuivre : ce ne fut qu’après la paix de Pyrrhus, qu’ils eurent assez d’argent pour en faire de la monnoie [2] : ils firent des deniers de ce métal, qui valoient dix as [3] , ou dix livres de cuivre : pour lors la proportion de l’argent au cuivre étoit comme 1 à 960 ; car le denier Romain valant dix as ou dix livres de cuivre, il valoit cent vingt onces de cuivre ; & le même denier [III-69] valant un huitieme [4] d’once d’argent, cela faisoit la proportion que nous venons de dire.
Romme devenue maîtresse de cette partie de l’Italie la plus voisine de la Grece & de la Sicile, se trouva peu à peu entre deux peuples riches, les Grecs & les Carthaginois ; l’argent augmenta chez elle ; & la proportion de 1 à 960 entre l’argent & le cuivre ne pouvant plus se soutenir, elle fit diverses opérations sur les monnoies que nous ne connoissons pas. Nous savons seulement qu’au commencement de la seconde guerre Punique, le denier [5] Romain ne valoit plus que vingt onces de cuivre ; & qu’ainsi la proportion entre l’argent & le cuivre n’étoit plus que comme 1 à 160 ; la réduction étoit bien considérable, puisque la république gagna cinq sixiemes sur toute la monnoie de cuivre : mais on ne fit que ce que demandoit la nature des choses, & rétablir la proportion entre les métaux qui servoient la monnaie.
La paix qui termina la premiere [III-70] guerre Punique, avoit laissé les Romains maîtres de la Sicile. Bientôt ils entrerent en Sardaigne, ils commencerent à connoître l’Espagne : la masse de l’argent augmenta encore à Rome ; on y fit l’opération qui réduisit [6] le denier d’argent de vingt onces à seize ; & elle eut cet effet, qu’elle remit en proportion l’argent & le cuivre ; cette proportion étoit comme 1 est à 160, elle fut comme 1 est à 128.
Examinez les Romains, vous ne les trouverez jamais si supérieurs, que dans le choix des circonstances dans lesquelles ils firent les biens & les maux.
-
[↑] Pline, livre XXXIII. art. 5.
-
[↑] Freinshemius, liv. V. de la seconde décade.
-
[↑] Ibid. loco citato : Ils frapperent aussi, dit le même Auteur, des demis, appellés quinaires, & des quarts appellés sesterces.
-
[↑] Un huitieme selon Budée, un septieme selon d’autres Auteurs.
-
[↑] Pline, hist.nat. liv. XXXIII. art. 13.
-
[↑] Pline, hist. nat. liv. XXXIII. art. 13.
[III-70]
CHAPITRE XIII.
Opérations sur les monnoies du temps des Empereurs.
Dans les opérations que l’on fit sur les monnoies du temps de la république, on procéda par voie de retranchement : l’état confioit au peuple ses besoins, & ne prétendoit pas le séduire. Sous les empereurs, on procéda par voie d’alliage : ces princes [III-71] réduits au désespoir par leurs libéralités mêmes, se virent obligés d’altérer les monnoies ; voie indirecte qui diminuoit le mal, & sembloit ne le pas toucher : on retiroit une partie du don, & on cachoit la main ; & sans parler de diminution de la paye ou des largesses, elles se trouvoient diminuées.
On voit encore dans les cabinets [1] des médailles qu’on appelle fourrées, qui n’ont qu’une lame d’argent qui couvre le cuivre. Il est parlé de cette monnoie dans un fragment du Livre 77 de Dion [2] .
Didius Julien commença l’affoiblissement. On trouve que la monnoie [3] de Caracalla avoit plus de la moitié d’alliage, celle d’Alexandre Sévere [4] les deux tiers : l’affoiblissement continua ; & sous Gallien [5] , on ne voyoit plus que du cuivre argenté.
On sent que ces opérations violentes ne sauroient avoir lieu dans ces [III-72] temps-ci ; un prince se tromperoit lui-même, & ne tromperoit personne. Le change a appris au banquier à comparer toutes les monnoies du monde, & à les mettre à leur juste valeur ; le titre des monnoies ne peut plus être un secret. Si un prince commence le billon, tout le monde continue, & le fait pour lui ; les especes fortes sortent d’abord, & on les lui renvoie foibles. Si, comme les empereurs Romains, ils affoiblissoit l’argent sans affoiblir l’or, il verroit tout à coup disparoître l’or, & il seroit réduit à son mauvais argent. Le change, comme j’ai dit au Livre précédent [6] , a ôté les grands coups d’autorité, ou du moins le succès des grands coups d’autorité.
-
[↑] Voyez la science des médailles du P. Joubert, édition de Paris, 1730, pag. 59.
-
[↑] Extrait des vertus & des vices.
-
[↑] Voyez Savotte, part. 2. chap. xii ; & le Journal des Savans du 28 Juillzr 1681, sur une découverte de 50000 médailles.
-
[↑] Voyez Savotte, ibid.
-
[↑] Idem, ibid
-
[↑] Chapitre XVI.
[III-72]
CHAPITRE XIV.
Comment le change gêne les états despotiques.
La Moscovie voudroit descendre de son despotisme, & ne le peut. L’établissement du commerce demande celui du change ; & les opérations du change contredisent toutes ses lois.
[III-73]
En 1745, la Czarine fit une ordonnance pour chasser les Juifs, parce qu’ils avoient remis dans les pays étrangers l’argent de ceux qui étoient relégués en Sibérie, & celui des étrangers qui étoient au service. Tous les sujets de l’empire, comme des esclaves, n’en peuvent sortir, ni faire sortir leurs biens sans permission. Le change qui donne le moyen de transporter l’argent d’un pays à un autre, est donc contradictoire aux lois de Moscovie.
Le commerce même contredit ses lois. Le peuple n’est composé que d’esclaves attachés aux terres, & d’esclaves qu’on appelle ecclésiastiques ou gentilshommes, parce qu’ils sont les seigneurs de ces esclaves : il ne reste donc guere personne pour le tiers-état, qui doit former les ouvriers & les marchands.
[III-74]
CHAPITRE XV.
Usage de quelques pays d’Italie.
Dans quelques pays d’Italie on a fait des lois pour empêcher les sujets de vendre des fonds de terre pour transporter leur argent dans les pays étrangers. Ces lois pouvoient être bonnes, lorsque les richesses de chaque état étoient tellement à lui, qu’il y avoit beaucoup de difficulté à les faire passer à un autre. Mais depuis que, par l’usage du change, les richesses ne sont en quelque façon à aucun état en particulier, & qu’il y a tant de facilité à les transporter d’un pays à un autre, c’est une mauvaise loi que celle qui ne permet pas de disposer pour ses affaires de ses fonds de terre, lorsqu’on peut disposer de son argent. Cette loi est mauvaise, parce qu’elle donne de l’avantage aux effets mobiliers sur les fonds de terre, parce qu’elle dégoûte les étrangers de venir s’établir dans le pays, & enfin parce qu’on peut l’éluder.
[III-75]
CHAPITRE XVI.
Du secours que l’état peut tirer des banquiers.
Les banquiers sont faits pour changer de l’argent, & non pas pour en prêter. Si le prince ne s’en sert que pour changer son argent, comme il ne fait que de grosses affaires, le moindre profit qu’il leur donne pour leurs remises devient un objet considérable ; & si on lui demande de gros profits, il peut être sûr que c’est un défaut de l’administration. Quand au contraire ils sont employés à faire des avances, leur art consiste à se procurer de gros profits de leur argent, sans qu’on puisse les accuser d’usure.
[III-75]
CHAPITRE XVII.
Des dettes publiques.
Quelques gens ont cru qu’il étoit bon qu’un état dût à lui-même : ils ont pensé que cela multiplioit les richesses, en augmentant la circulation.
Je crois qu’on a confondu un papier [III-76] circulant qui représente la monnoie, ou un papier circulant qui est le signe des profits qu’une compagnie a faits ou fera sur le commerce, avec un papier qui représente une dette. Les deux premiers sont très-avantageux à l’état : le dernier ne peut l’être ; & tout ce qu’on peut en attendre, c’est qu’il soit un bon gage pour les particuliers de la dette de la nation, c’est-à-dire, qu’il en procure le payement. Mais voici les inconvéniens qui en résultent.
1°. Si les étrangers possedent beaucoup de papiers qui représentent une dette, ils tirent tous les ans de la nation une somme considérable pour les intérêts.
2°. Dans une nation ainsi perpétuellement débitrice, le change doit être très-bas.
3°. L’impôt levé pour le payement des intérêts de la dette, fait tort aux manufactures, en rendant la main de l’ouvrier plus chere.
4°. On ôte les revenus véritables de l’état à ceux qui ont de l’activité & de l’industrie, pour les transporter aux gens oisifs ; c’est-à-dire, qu’on donne des commodités pour travailler à ceux qui [III-77] ne travaillent point, & des difficultés pour travailler à ceux qui travaillent.
Voilà les inconvéniens ; je n’en connois point les avantages. Dix personnes ont chacune mille écus de revenu en fonds de terre ou en industrie ; cela fait pour la nation, à cinq pour cent, un capital de deux cents mille écus. Si ces dix personnes emploient la moitié de leur revenu, c’est-à-dire cinq mille écus, pour payer les intérêts de cent mille écus qu’elles ont empruntés à d’autres, cela ne fait encore pour l’état que deux cents mille écus : c’est, dans le langage des algébristes, 200000 écus - 100000 écus + 100000 écus = 200000 écus.
Ce qui peut jeter dans l’erreur, c’est qu’un papier qui représente la dette d’une nation, est un signe de richesse ; car il n’y a qu’un état riche qui puisse soutenir un tel papier sans tomber dans la décadence : que s’il n’y tombe pas, il faut que l’état ait de grandes richesses d’ailleurs. On dit qu’il n’y a point de mal, parce qu’il y a des ressources contre ce mal ; & on dit que le mal est un bien, parce que les ressources surpassent le mal.
[III-78]
CHAPITRE XVIII.
Du payement des dettes publiques.
Il faut qu’il y ait une proportion entre l’état créancier & l’état débiteur. L’état peut être créancier à l’infini, mais il ne peut être débiteur qu’à un certain degré ; & quand on est parvenu à passer ce degré, le titre de créancier s’évanouit.
Si cet état a encore un crédit qui n’ait point reçu d’atteinte, il pourra faire ce qu’on a pratiqué si heureusement dans un état [1] d’Europe ; c’est de se procurer une grande quantité d’especes, & d’offrir à tous les particuliers leur remboursement, à moins qu’ils ne veuillent réduire l’intérêt. En effet, comme, lorsque l’état emprunte, ce sont les particuliers qui fixent le taux de l’intérêt ; lorsque l’état veut payer, c’est à lui à le fixer.
Il ne suffit pas de réduire l’intérêt : il faut que le bénéfice de la réduction forme un fonds d’amortissement pour payer chaque année une partie des capitaux ; [III-79] opération d’autant plus heureuse, que le succès en augmente tous les jours.
Lorsque le crédit de l’état n’est pas entier, c’est une nouvelle raison pour chercher à former un fonds d’amortissement ; parce que ce fonds un fois établi rend bientôt la confiance.
1°. Si l’état est une république, dont le gouvernement comporte par sa nature que l’on y fasse des projets pour long-temps, le capital du fonds d’amortissement peut être peu considérable : il faut, dans une monarchie, que ce capital soit plus grand.
2°. Les réglemens doivent être tels, que tous les citoyens de l’état portent le poids de l’établissement de ce fonds, parce qu’ils ont tous les poids de l’établissement de la dette ; le créancier de l’état, par les sommes qu’il contribue, payant lui-même à lui-même.
3°. Il y a quatre classes de gens qui payent les dettes de l’état ; les propriétaires des fonds de terre, ceux qui exercent leur industrie par le négoce, les laboureurs & artisans, enfin les rentiers de l’état ou des particuliers. De ces quatre classes, la derniere, dans un cas de nécessité, sembleroit devoir être la [III-80] moins ménagée ; parce que c’est une classe entiérement passive dans l’état, tandis que ce même état est soutenu par la force active des trois autres. Mais, comme on ne peut la charger plus, sans détruire la confiance publique, dont l’état en général & ces trois classes en particulier ont un souverain besoin ; comme la foi publique ne peut manquer à un certain nombre de citoyens, sans paroître manquer à tous ; comme la classe des créanciers est toujours la plus exposée aux projets des ministres, & qu’elle est toujours sous les yeux & sous la main ; il faut que l’état lui accorde une singuliere protection, & que la partie débitrice n’ait jamais le moindre avantage sur celle qui est créanciere.
-
[↑] L’Angleterre.
[III-80]
CHAPITRE XIX.
Des prêts à intérêts.
L’argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe, doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est, que les autres choses peuvent, ou se louer, ou [III-81] s’acheter ; au lieu que l’argent, qui est le prix des choses, se loue & ne s’achete pas [1] .
C’est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt : mais on sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion, & non une loi civile.
Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l’argent ait un prix, mais que ce prix soit peu considérable. S’il est trop haut, le négociant, qui voit qu’il lui en coûteroit plus en intérêt qu’il ne pourroit gagner dans son commerce, n’entreprend rien ; si l’argent n’a point de prix, personne n’en prête, & le négociant n’entreprend rien non plus.
Je me trompe, quand je dis que personne n’en prête. Il faut toujours que les affaires de la société aillent ; l’usure s’établit, mais avec les désordres que l’on a éprouvés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond l’usure avec le prêt à intérêt. L’usure augmente dans les pays Mahométans à proportion de la sévérité de la défense : le [III-82] prêteur s’indemnise du péril de la contravention.
Dans ces pays d’Orient, la plupart des hommes n’ont rien d’assuré ; il n’y a presque point de rapport entre la possession actuelle d’une somme, & l’espérance de la ravoir après l’avoir prêtée ; l’usure y augmente donc à proportion du péril de l’insolvabilité.
-
[↑] On ne parle point des cas où l’or & l’argent sont considérés comme marchandises.
[III-82]
CHAPITRE XX.
Des usures maritimes.
La grandeur de l’usure maritime est fondée sur deux choses ; le péril de la mer, qui fait qu’on ne s’expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage, & la facilité que le commerce donne à l’emprunteur, de faire promptement de grandes affaires, & en grand nombre : au lieu que les usures de terre n’étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par les législateurs, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.
[III-83]
CHAPITRE XXI.
Du prêt par contrat, & de l’usure chez les Romains.
Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d’où résulte un intérêt ou usure.
Le peuple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats chercherent à le flatter, & à lui faire faire les lois qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux ; il diminua les intérêts ; il défendit d’en prendre ; il ôta les contraintes par corps : enfin l’abolition des dettes fut mise en question toutes les fois qu’un tribun voulut se rendre populaire.
Ces continuels changemens, soit par des lois, soit par des plébiscites, naturaliserent à Rome l’usure ; car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n’eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits ; d’autant plus que, si les lois ne [III-84] venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles & intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter & d’emprunter furent abolis à Rome, & qu’une usure affreuse, toujours foudroyée [1] & toujours renaissante, s’y établit. Le mal venoit de ce que les choses n’avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l’argent, & pour le danger des peines de la loi.
-
[↑] Tacite, annal. liv. VI.
[III-84]
CHAPITRE XXII.
Continuation du même sujet.
Les premiers Romains n’eurent point de lois pour régler le taux de [1] l’usure. Dans les démêlés qui se formerent là-dessus entre les plébéiens & les patriciens, dans la sédition [2] même du mont Sacré, on n’allégua d’un côté que la foi, & de l’autre que la dureté des contrats.
[III-85]
On suivoit donc les conventions particulieres ; & je crois que les plus ordinaires étoient de douze pour cent par an. Ma raison est que dans le langage [3] ancien chez les Romains, l’intérêt à dix pour cent étoit appellé la moitié de l’usure, l’intérêt à trois pour cent le quart de l’usure : l’usure totale étoit donc l’intérêt à douze pour cent.
Que si l’on demande comment de si grosses usures avoient pu s’établir chez un peuple qui étoit presque sans commerce, je dirai que ce peuple, très-souvent obligé d’aller sans solde à la guerre, avoit très-souvent besoin d’emprunter ; & que faisant sans cesse des expéditions heureuses, il avoit très-souvent la facilité de payer. Et cela se sent bien dans le récit des démêlés qui s’éleverent à cet égard : on n’y disconvient point de l’avarice de ceux qui prêtoient ; mais on dit que ceux qui se plaignoient, auroient pu payer s’ils avoient eu une conduite réglée [4] .
[III-86]
On faisoit donc des lois qui n’influoient que sur la situation actuelle : on ordonnoit, par exemple, que ceux qui s’enrôleroient pour la guerre que l’on avoit à soutenir, ne seroient point poursuivis par leurs créanciers ; que ceux qui étoient dans les fers seroient délivrés ; que les plus indigens seroient menés dans les colonies : quelquefois on ouvroit le trésor public. Le peuple s’appaisoit par le soulagement des maux présens ; & comme il ne demandoit rien pour la suite, le sénat n’avoit garde de le prévenir.
Dans le temps que le sénat défendoit avec tant de constance la cause des usures, l’amour de la pauvreté, de la frugalité, de la médiocrité, étoit extrême chez les Romains : mais telle étoit la constitution, que les principaux citoyens portoient toutes les charges de l’état, & que le bas peuple ne payoit rien. Quel moyen de priver ceux-là du droit de poursuivre leurs débiteurs, & de leur demander d’acquitter leurs charges, & de subvenir aux besoins pressans de la république ?
Tacite [5] dit que la loi des douze [III-87] tables fixa l’intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu’il s’est trompé, & qu’il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela, comment, dans les disputes qui s’éleverent depuis entre les créanciers & les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt : & pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne devoit point être l’ouvrage des décemvirs.
La loi Licinienne [6] faite quatre-vingt-cinq ans après la loi des douze tables, fut une de ces lois passageres dont nous avons parlé. Elle ordonna qu’on retrancheroit du capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, & que le reste seroit acquitté en trois payemens égaux.
L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Menenius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un [7] pour cent par an. C’est cette loi que Tacite [8] [III-88] confond avec la loi des douze tables, & c’est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l’intérêt. Dix ans après [9] , cette usure fut réduite à la moitié [10] ; dans la suite on l’ôta tout-à-fait [11] : & si nous en croyons quelques auteurs qu’avoit vu Tite-Live, ce fut sous le consulat [12] de C. Martius Rutilius & de Q. Servilius, l’an 413 de Rome.
Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès : on trouva un moyen de l’éluder. Il en fallut faire beaucoup d’autres pour la confirmer, corriger, tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages [13] , tantôt on quitta les usages pour suivre les lois : mais dans ce cas l’usage devoit aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a [III-89] contr’elle, & celui qu’elle secourt, & celui qu’elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis [14] aux débiteurs d’agir en conséquence des lois, fut tué par les créanciers [15] , pour avoir voulu rappeller la mémoire d’une rigidité qu’on ne pouvoit plus soutenir.
Je quitte la ville pour jeter un peu les yeux sur les provinces.
J’ai dit ailleurs [16] , que les provinces Romaines étoient désolées par un gouvernement despotique & dur. Ce n’est pas tout : elle l’étoient encore par des usures affreuses.
Cicéron dit [17] que ceux de Salamine vouloient emprunter de l’argent à Rome, & qu’ils ne le pouvoient pas à cause de la loi Gabinienne. Il faut que je cherche ce que c’étoit que cette loi.
Lorsque les prêts à intérêt eurent été défendus à Rome, on imagina [18] toutes sortes de moyens pour éluder la loi : & comme les alliés [19] & ceux de la [III-90] nation Latine n’étoient point assujettis aux lois civiles des Romains, on se servit d’un Latin, ou d’un allié, qui prêtoit son nom, & paroissoit être le créancier. La loi n’avoir donc fait que soumettre les créanciers à une formalité, & le peuple n’étoit pas soulagé.
Le peuple se plaignit de cette fraude ; & Marcus Sempronius, tribun du peuple, par l’autorité du sénat, fit faire un plébiscite [20] qui portoit, qu’en fait de prêts, les lois qui défendoient les prêts à usure entre un citoyen Romain & un autre citoyen Romain, auroient également lieu entre un citoyen & un allié, ou un Latin.
Dans ces temps-là, on appelloit alliés les peuples de l’Italie proprement dite, qui s’étendoit jusqu’à l’Arno & le Rubicon, & qui n’étoit point gouvernée en provinces Romaines.
Tacite [21] dit qu’on faisoit toujours de nouvelles fraudes aux lois faites pour arrêter les usures. Quand on ne put plus prêter ni emprunter sous le nom d’un allié, il fut aisé de faire paroître un homme des provinces qui prêtoit son nom.
[III-91]
Il falloit une nouvelle loi contre cet abus : & Gabinius [22] faisant la loi fameuse qui avoit pour objet d’arrêter la corruption dans les suffrages, dut naturellement penser que le meilleur moyen pour y parvenir, étoit de décourager les emprunts : ces deux choses étoient naturellement liées ; car les usures augmentoient [23] toujours au temps des élections, parce qu’on avoit besoin d’argent pour gagner des voix. On voit bien que la loi Gabinienne avoit étendu le sénatus-consulte Sempronien aux provinciaux, puisque les Salaminiens ne pouvoient emprunter de l’argent à Rome à cause de cette loi. Brutus, sous des noms empruntés, leur en prêta [24] à quatre pour cent par mois [25] , & obtint pour cela deux sénatus-consultes ; dans le premier desquels il étoit dit que ce prêt ne seroit pas regardé comme une fraude [26] faite à la loi, & que le [III-92] gouverneur de Silicie jugeroit en conformité des conventions portées par le billet des Salaminiens.
Le prêt à intérêt étant interdit par la loi Gabinienne entre les gens des provinces & les citoyens romain, & ceux-ci ayant pour lors tout l’argent de l’univers entre leurs mains, il fallut les tenter par des grosses usures, qui fissent disparoître aux yeux de l’avarice le danger de perdre la dette. Et comme il y avoit à Rome des gens puissans, qui intimidoient les magistrats, & faisoient taire les lois, ils furent plus hardis à prêter & plus hardis à exiger de grosses usures. Cela fit que les provinces furent tour à tour ravagées par tous ceux qui avoient du crédit à Rome ; & comme chaque gouverneur faisoit son édit [27] en entrant dans sa province, dans lequel il mettoit à l’usure le taux qu’il lui plaisoit, l’avarice prêtoit la main à la législation, & la législation à l’avarice.
[III-93]
Il faut que les affaires aillent ; & un état est perdu, si tout y est dans l’inaction. Il y avoit des occasions, où il falloit que les villes, les corps, les sociétés des villes, les particuliers empruntassent : & on n’avoit que trop besoin d’emprunter, ne fût-ce que pour subvenir aux ravages des armées, aux rapines des magistrats, aux concussions des gens d’affaires, & aux mauvais usages qui s’établissoient tous les jours ; car on ne fut jamais si riche, ni si pauvre. Le sénat, qui avoit la puissance exécutrice, donnoit, par nécessité, souvent par faveur, la permission d’emprunter des citoyens Romains, & faisoit là-dessus des sénatus-consultes. Mais ces sénatus-consultes même étoient décrédités par la loi : ces sénatus-consultes [28] pouvoient donner occasion au peuple de demander de nouvelles tables ; ce qui, augmentant le danger de la perte du capital, augmentoit encore l’usure. Je le dirai toujours ; c’est la modération qui gouverne les hommes, & non pas les excès.
[III-94]
Celui-là paye moins, dit Ulpien [29] , qui paye plus tard. C’est ce principe qui conduisit les législateurs après la destruction de la république Romaine.
-
[↑] Usure & intérêt signifioient la même chose chez les Romains.
-
[↑] Voyez Denys d’Halic. qui l’a si bien décrite.
-
[↑] Usuræ semisses, trientes, quadrantes. Voyez là-dessus les divers traités du digeste & du code de usuris ; & sur-tout la loi XVII, avec sa note, au ff. de usuris.
-
[↑] Voyez les discours d’Appius là-dessus, dans Denys d’Halicarnasse.
-
[↑] Annales, liv. VI.
-
[↑] L’an de Rome 388. Tite-Live, liv. VI.
-
[↑] Unciaria usura. Tite-Live, liv. VII. Voyez la défense de l’esprit des lois, art. usure.
-
[↑] Annal. liv. VI.
-
[↑] Sous le consulat de L. Manlius Torquatus, & de C. Plautius, selon Tite-Live, liv. VII. & c’est la loi dont parle Tacite, annal. liv. VI.
-
[↑] Semiunciaria usura.
-
[↑] Comme le dit Tacite, annal. liv. VI.
-
[↑] La loi en fut faite à la poursuite de M. Genucius, tribun du peuple : Tite-Lieve, liv. VII. à la fin.
-
[↑] Veteri jam more fænus receptum erat. Appien, de la guerre civile, liv. I.
-
[↑] Permisit eos legibus agere. Appien, de la guerre civile, livre I ; & l’épitome de Tite-Live, livre LXIV.
-
[↑] L’an de Rome 663.
-
[↑] Liv. XI. Ch. xix.
-
[↑] Lettres à Atticus, liv. V. lett. 27.
-
[↑] Tite-Live.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] L’an 561 de Rome, Voyez Tite-Live.
-
[↑] Annal. Liv. VI.
-
[↑] L’an 615 de Rome.
-
[↑] Voyez les lettres de Cicéron à Atticus, liv. IV. lett. 15 & 16
-
[↑] Cicéron à Atticus, liv. VI. lett. I.
-
[↑] Pompée, qui avoit prêté au roi Ariobarsane six cents talens, se faisoit payer trente-trois talens Attiques tous les trente jours. Cicéron à Atticus, liv. III. lett. 21 : liv. VI, lett. I.
-
[↑] Ut neque Salaminis, neque cui eis dedisset, fraudi esset. Ibid.
-
[↑] L’édit de Cicéron la fixoit à un pour cent par mois, avec l’usure de l’usure au bout de l’an. Quant aux fermiers de la république, il les engageoit à donner un délai à leurs débiteurs : Si ceux-ci ne payoient pas au temps fixé, il adjugeoit l’usure portée par le billet. Cicéron à Atticus, liv VI. lett. I.
-
[↑] Voyez ce que dit Luccéius, lett. 21 à Atticus, liv. V. Il y eut même un Sénatus-Consulte général pour fixer l’usage à un pour cent par mois. Voyez la même lettre.
-
[↑] Leg. XII. ff. de verbor. signif.
[III-95]
LIVRE XXIII.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur espece.
O Vénus ! ô mere de l’Amour !
Dès le premier jour que ton astre ramene,
Les zéphirs font sentir leur amoureuse haleine ;
La terre orne son sein de brillantes couleurs,
Et l’air est parfumé du doux esprit des fleurs.
On entend les oiseaux frappés de ta puissance,
Par mille sons lascifs célébrer ta présence :
Pour la belle génisse, on voit les fiers taureaux,
Ou bondir dans la plaine, ou traverser les eaux.
Enfin, les habitans des bois & des montagnes,
Des fleuves & des mers, & des vertes campagnes,
Brûlant à ton aspect d’amour & de désir,
S’engagent à peupler par l’attrait du plaisir :
Tant on aime à te suivre, & ce charmant empire
Que donne la beauté sur tout ce qui respire.[1]
Les femelles des animaux ont à peu-près une fécondité constante. Mais dans l’espece humaine, la maniere de [III-96] penser, le caractere, les passions, les fantaisies, les caprices, l’idée de conserver sa beauté, l’embarras de la grossesse, celui d’une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manieres.
-
[↑] Traduction du commencement de Lucrece, par le sieur d’Hesnaut.
[III-96]
CHAPITRE II.
Des mariages.
L’obligation naturelle qu’a le pere de nourrir ses enfans, a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation. Les peuples [1] dont parle Pomponius Mela [2] ne le fixoient que par la ressemblance.
Chez les peuples bien policés, le pere [3] est celui que les lois, par la cérémonie du mariage ont déclaré devoir être tel, parce qu’elles trouvent en lui la personne qu’elles cherchent.
Cette obligation, chez les animaux, est telle que la mere peut ordinairement y suffire. Elle a beaucoup plus d’étendue chez les hommes : leurs enfans ont [III-97] de la raison ; mais elle ne leur vient que par degrés : il ne suffit pas de les nourrir, il faut encore les conduire : déjà ils pourroient vivre, & ils ne peuvent pas se gouverner.
Les conjonctions illicites contribuent peu à la propagation de l’espece. Le pere, qui a l’obligation naturelle de nourrir & d’élever les enfans, n’y est point fixé ; & la mere, à qui l’obligation reste, trouve mille obstacles, par la honte, les remords, la gêne de son sexe, la rigueur des lois : la plupart du temps elle manque de moyens.
Les femmes qui se sont soumises à une prostitution publique, ne peuvent avoir la commodité d’élever leurs enfans. Les peines de cette éducation sont même incompatibles avec leur condition : & elles sont si corrompues, qu’elles ne sauroient avoir la confiance de la loi.
Il suit de tout ceci, que la continence publique est naturellement jointe à la propagation de l’espece.
[III-98]
CHAPITRE III.
De la condition des enfans.
C’est la raison qui dicte que, quand il y a un mariage, les enfans suivent la condition du pere ; & que, quand il n’y en a point, ils ne peuvent concerner que la mere [1] .
-
[↑] C’est pour cela que chez les nations qui ont des esclaves, l’enfant suit presque toujours la condition de la mere.
[III-98]
CHAPITRE IV.
Des familles.
Il est presque reçu par-tout que la femme passe dans la famille du mari. Le contraire est, dans aucun inconvénient, établi à Formose [1] , où le mari va former celle de la femme.
Cette loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup, indépendamment des premiers motifs, à la propagation de l’espece humaine. La famille est une [III-99] sorte de propriété : un homme qui a des enfans du sexe qui ne la perpétue pas, n’est jamais content qu’il n’en ait de celui qui la perpétue.
Les noms qui donnent aux hommes l’idée d’une chose qui semble ne devoir pas périr, sont très-propres à inspirer à chaque famille le désir d’étendre sa durée. Il y a des peuples chez lesquels les noms distinguent les familles : il y en a où ils ne distinguent que les personnes ; ce qui n’est pas si bien.
-
[↑] Le Pere du Halde, tome I. p. 156.
[III-99]
CHAPITRE V.
De divers ordres de femmes légitimes.
Quelquefois les lois & la religion ont établi plusieurs sortes de conjonctions civiles, & cela est ainsi chez les Mahométans, où il y a divers ordres de femmes, dont les enfans se reconnoissent par la naissance dans la maison, ou par des contrats civils, ou même par l’esclavage de la mere, & la reconnoissance subséquente du pere.
Il seroit contre la raison, que la loi flétrît dans les enfans ce qu’elle a approuvé dans le pere : tous ces enfans y [III-100] doivent donc succéder, à moins que quelque raison particuliere ne s’y oppose, comme au Japon, où il n’y a que les enfans de la femme donnée par l’empereur qui succedent. La politique y exige que les biens aue l’empereur donne, ne soient pas trop partagés, parce qu’ils sont soumis à un service, comme étoient autrefois nos fiefs.
Il y a des pays où une femme légitime jouit dans la maison, à-peu-près, des honneurs qu’a dans nos climats une femme unique : là, les enfans des concubines sont censés appartenir à la premiere femme. Cela est ainsi établi à la Chine. Le respect filial [1] , la cérémonie d’un deuil rigoureux ne sont point dus à la mere naturelle, mais à cette mere que donne la loi.
A l’aide d’une telle fiction [2] , il n’y a plus d’enfans bâtards : & dans les pays où cette fiction n’a pas lieu, on voit bien que la loi qui légitime les [III-101] enfans des concubines, est une loi forcée, car ce seroit le gros de la nation qui seroit flétri par la loi. Il n’est pas question non plus dans ces pays d’enfans adultérins. Les séparations des femmes, la clôture, les eunuques, les verroux, rendent la chose si difficile, que la loi la juge impossible. D’ailleurs, le même glaive extermineroit la mere & l’enfant.
-
[↑] Le Pere du Halde, tome II. Page 124.
-
[↑] On distingue les femmes en grandes & petites ; c’est-à-dire, en légitimes ou non ; mais il n’y a point une pareille distinction entre les enfans. C’est la grande doctrine de l’empire, est-il dit dans un ouvrage Chinois, sur la morale, traduit par le même Pere, page 140.
[III-101]
CHAPITRE VI.
Des bâtards dans les divers gouvernemens.
On ne connoît donc guere les bâtards dans les pays où la polygamie est permise ; on les connoît dans ceux où la loi d’une seule femme est établie. Il a fallu, dans ces pays, flétrir le concubinage ; il a donc fallu flétrir les enfans qui en étoient nés.
Dans les républiques où il est nécessaire que les mœurs soient pures, les bâtards doivent être encore plus odieux que dans les monarchies.
On fit peut-être à Rome des dispositions trop dures contre eux. Mais les institutions anciennes mettant tous les citoyens dans la nécessité de se marier, [III-102] les mariages étant d’ailleurs adoucis par la permission de répudier ou de faire divorce, il n’y avoit qu’une très-grande corruption de mœurs qui pût porter au concubinage.
Il faut remarquer que la qualité de citoyen étant considérable dans les démocraties où elle emportoit avec elle la souveraine puissance, il s’y faisoit souvent des lois sur l’état des bâtards, qui avoient moins de rapport à la chose même & à l’honnêteté du mariage, qu’à la constitution particuliere de la république. Ainsi le peuple a quelquefois reçu pour citoyens [1] les bâtards, afin d’augmenter sa puissance contre les grands. Ainsi, à Athenes le peuple retrancha les bâtards du nombre des citoyens, pour avoir une plus grande portion du blé que lui avoit envoyé le roi d’Égypte. Enfin, Aristote [2] nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu’il n’y avoit pas assez de citoyens, les bâtards succédoient ; & que quand il y en avoit assez, ils ne succédoient pas.
[III-103]
CHAPITRE VII.
Du consentement des peres au mariage.
Le consentement des peres est fondé sur leur puissance, c’est-à-dire, sur leur droit de propriété ; il est encore fondé sur leur amour, sur leur raison, & sur l’incertitude de celle de leurs enfans, que l’âge tient dans l’état d’ignorance, & les passions dans l’état d’ivresse.
Dans les petites républiques ou institutions singulieres dont nous avons parlé, il peut y avoir des lois qui donnent aux magistrats une inspection sur les mariages des enfans des citoyens, que la nature avoit déjà donnée aux peres. L’amour du bien public y peut être tel, qu’il égale ou surpasse tout autre amour. Ainsi Platon vouloit que les magistrats réglassent les mariages : ainsi les magistrats Lacédémoniens les dirigeoient-ils.
Mais, dans les institutions ordinaires, c’est aux peres à marier leurs enfans : leur prudence à cet égard sera toujours au-dessus de toute autre prudence. La nature donne aux peres un désir de procurer à leurs enfans des successeurs, [III-104] qu’ils sentent à peine pour eux-mêmes : dans les divers degrés de progéniture, ils se voient avancer insensiblement vers l’avenir. Mais que seroit-ce, si la vexation & l’avarice alloient au point d’usurper l’autorité des peres ? Écoutons Thomas Gage [1] , sur la conduite des Espagnols dans les Indes.
« Pour augmenter le nombre des gens qui payent le tribut, il faut que tous les Indiens qui ont quinze ans se marient ; & même on a réglé le temps du mariage des Indiens à quatorze ans pour les mâles, & à treize pour les filles. On se fonde sur un canon qui dit, que la malice peut suppléer à l’âge ». Il vit faire un de ces dénombrements : c’étoit, dit-il, une chose honteuse. Ainsi, dans l’action du monde qui doit être la plus libre, les Indiens sont encore esclaves.
-
[↑] Relation de Thomas Gage, page 171.
[III-104]
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
En Angleterre, les filles abusent souvent de la loi, pour se marier à leur fantaisie, sans consulter leurs parens. Je [III-105] ne sait pas si cet usage ne pourroit pas y être plus toléré qu’ailleurs, par la raison que les lois n’y ayant point établi un célibat monastique, les filles n’y ont d’état à prendre que celui du mariage, & ne peuvent s’y refuser. En France, au contraire, où le monachisme est établi, les filles ont toujours la ressource du célibat ; & la loi qui leur ordonne d’attendre le consentement des peres, y pourroit être plus convenable. Dans cette idée, l’usage d’Italie & d’Espagne seroit le moins raisonnable : le monachisme y est établi, & l’on peut s’y marier sans le consentement des peres.
[III-105]
CHAPITRE IX.
Des filles.
Les filles, que l’on ne conduit que par le mariage aux plaisirs & à la liberté, qui ont un esprit qui n’ose penser, un cœur qui n’ose sentir, des yeux qui n’osent voir, des oreilles qui n’osent entendre, qui ne se présentent que pour se montrer stupides, condamnées sans relâche à des bagatelles [III-106] & à des préceptes, sont assez portées au mariage : ce sont les garçons qu’il faut encourager.
[III-106]
CHAPITRE X.
Ce qui détermine au mariage.
Par-tout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage. La nature y porte assez,lorsqu’elle n’est point arrêtée par la difficulté de la subsistance.
Les peuples naissans se multiplient & croissent beaucoup. Ce seroit chez eux une grande incommodité de vivre dans le célibat : ce n’en est point une d’avoir beaucoup d’enfans. Le contraire arrive, lorsque la nation est formée.
[III-106]
CHAPITRE XI.
De la dureté du gouvernement.
Les gens qui n’ont absolument rien, comme les mendians, ont beaucoup d’enfans. C’est qu’ils sont dans le cas des peuples naissans : il n’en coûte [III-107] rien au pere, pour donner son art à ses enfans, qui même sont en naissant des instrumens de cet art. Ces gens, dans un pays riche ou superstitieux, se multiplient, parce qu’ils n’ont pas les charges de la société, mais sont eux-mêmes les charges de la société. Mais les gens qui ne sont pauvres que parce qu’ils vivent dans un gouvernement dur, qui regardent leur champ moins comme le fondement de leur subsistance, que comme un prétexte à la vexation ; ces gens-là, dis-je, font peu d’enfans : ils n’ont pas même leur nourriture ; comment pourroient-ils songer à la partager ? ils ne peuvent se soigner dans leurs maladies ; comment pourroient-ils élever des créatures, qui sont dans une maladie continuelle, qui est l’enfance ?
C’est la facilité de parler, & l’impuissance d’examiner, qui ont fait dire que plus les sujets étoient pauvres, plus les familles étoient nombreuses ; que plus on étoit chargé d’impôts, plus on se mettoit en état de les payer : deux sophismes qui ont toujours perdu, & qui perdront à jamais les monarchies.
La dureté du gouvernement peut aller jusqu’à détruire les sentimens [III-108] naturels, par les sentimens naturels mêmes. Les femmes de l’Amérique [1] ne se faisoient-elles pas avorter, pour que leurs enfans n’eussent pas des maîtres aussi cruels ?
-
[↑] Relation de Thomas Gage, page 58.
[III-108]
CHAPITRE XII.
Du nombre des filles & des garçons dans différens pays.
J’ai déjà dit [1] qu’en Europe il naît un peu plus de garçons que de filles. On a remarqué qu’au Japon [2] , il naissoit un peu plus de filles que de garçons : toutes choses égales, il y aura plus de femmes fécondes au Japon qu’en Europe, & par conséquent plus de peuple.
Des relations [3] disent qu’à Bantam, il y a dix filles pour un garçon : une disproportion pareille, qui feroit que le nombre des familles y seroit au nombre de celles des autres climats comme un est à cinq & demi, seroit excessive. Les familles y pourroient être plus grandes [III-109] à la vérité : mais il y a peu de gens assez aisés pour pouvoir entretenir une si grande famille.
-
[↑] Au livre XVI. chap. iv.
-
[↑] Voyez Kempfer, qui rapporte un dénombrement de Méaco.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la Compagnie des Indes, tome I. p. 347.
[III-109]
CHAPITRE XIII.
Des ports de mer.
Dans les ports de mer, où les hommes s’exposent à mille dangers, & vont mourir ou vivre dans des climats reculés, il y a moins d’hommes que de femmes ; cependant on y voit plus d’enfans qu’ailleurs : cela vient de la facilité de la subsistance. Peut-être même que les parties huileuses du poisson sont plus propres à fournir cette matiere qui sert à la génération. Ce seroit une des causes de ce nombre infini de peuple qui est au Japon [1] & à la Chine [2] , où l’on ne vit presque que de poisson [3] . Si cela étoit, de certaines regles monastiques, qui obligent de vivre de poisson, seroient contraires à l’esprit du législateur même.
-
[↑] Le Japon est composé d’îles ; il y a beaucoup de rivages, & la mer y est très poissonneuse.
-
[↑] La Chine est pleine de ruisseaux.
-
[↑] Voyez le Pere du Halde, tome II. Pag. 139, 142 & suivantes.
[III-110]
CHAPITRE XIV.
Des productions de la terre qui demandent plus ou moins d’hommes.
Les pays de pâturages sont peu peuplés, parce que peu de gens y trouvent de l’occupation ; les terres à blé occupent plus d’hommes, & les vignobles infiniment davantage.
En Angleterre [1] on s’est souvent plaint que l’augmentation des pâturages diminuoit les habitans ; & on observe en France, que la grande quantité de vignobles y est une des grandes causes de la multitude des hommes.
Les pays où des mines de charbon fournissent des matieres propres à brûler, ont cet avantages sur les autres, qu’il n’y faut point de forêt, & que toutes les terres peuvent être cultivées.
Dans les lieux où croît le riz, il faut de grands travaux pour ménager les [III-111] eaux : beaucoup de gens y peuvent donc être occupés. Il y a plus : il faut moins de terre pour fournir à la subsistance d’une famille, que dans ceux qui produisent d’autres grains : enfin la terre qui est employée ailleurs à la nourriture des animaux, y sert immédiatement à la subsistance des hommes ; le travail que font ailleurs les animaux, est fait là par les hommes ; & la culture des terres devient pour les hommes une immense manufacture.
-
[↑] La plupart des propriétaires des fonds de terres, dit Burnet, trouvant plus de profit en la vente de leur laine, que de leur blé, enfermerent leurs possessions ; les communes, qui mouroient de faim, se souleverent : on proposa une loi agraire ; le jeune roi écrivit même là-dessus : on fit des proclamations contre ceux qui avoient renfermé leurs terres. Abrégé de l’histoire de la réforme, pag. 44 & 83.
[III-111]
CHAPITRE XV.
Du nombre des habitans par rapport aux arts.
Lorsqu’il y a une loi agraire, & que les terres sont également partagées, le pays peut être très-peuplé, quoiqu’il y ait peu d’arts, parce que chaque citoyen trouve dans le travail de sa terre précisément de quoi se nourrir, & que tous les citoyens ensemble consomment tous les fruits du pays ; cela étoit ainsi dans quelques anciennes républiques.
Mais dans nos états d’aujourd’hui, [III-112] les fonds de terre sont inégalement distribués ; ils produisent plus de fruits que ceux qui les cultivent n’en peuvent consommer ; & si l’on y néglige les arts, & qu’on ne s’attache qu’à l’agriculture, le pays ne peut être peuplé. Ceux qui cultivent ou font cultiver, ayant des fruits de reste, rien ne les engage à travailler l’année d’ensuite : les fruits ne seroient point consommés par les gens oisifs, car les gens oisifs n’auroient pas de quoi les acheter. Il faut donc que les arts s’établissent, pour que les fruits soient consommés par les laboureurs & les artisans. En un mot, ces états ont besoin que beaucoup de gens cultivent au-delà de ce qui leur est nécessaire : pour cela, il faut leur donner envie d’avoir le superflu, mais il n’y a que les artisans qui le donnent.
Ces machines, dont l’objet est d’abréger l’art, ne sont par toujours utiles. Si un ouvrage est à un prix médiocre, & qui convienne également à celui qui l’achete & à l’ouvrier qui l’a fait, les machines qui en simplifieroient la manufacture, c’est-à-dire, qui diminueroient le nombre des ouvriers, seroient pernicieuses ; & si les moulins à eau [III-113] n’étoient pas par-tout établis, je ne les croirois pas aussi utiles qu’on le dit, parce qu’ils ont fait reposer une infinité de bras, qu’ils ont privé bien des gens de l’usage des eaux, & ont fait perdre la fécondité à beaucoup de terres.
[III-113]
CHAPITRE XVI.
Des vues du législateur sur la propagation de l’espece.
Les réglemens sur le nombre des citoyens dépendent beaucoup des circonstances. Il y a des pays où la nature a tout fait ; le législateur n’y a donc rien à faire. A quoi bon engager par des lois à la propagation, lorsque la fécondité du climat donne assez de peuple ? Quelquefois le climat est plus favorable que le terrain, le peuple s’y multiplie, & les famines le détruisent : c’est le cas où se trouve la Chine ; aussi un pere y vend-il ses filles & expose ses enfans. Les mêmes causes operent au Tonquin [1] les mêmes effets ; & il ne faut pas, comme les voyageurs Arabes dont Renaudot nous a donné la relation, [III-114] aller chercher l’opinion [2] de la métempsycose pour cela.
Les mêmes raisons font que, dans l’île Formose [3] , la religion ne permet pas aux femmes de mettre des enfans au monde qu’elles n’aient trente-cinq ans : avant cet âge, la prêtresse leur foule le ventre, & les fait avorter.
-
[↑] Voyages de Dampierre, tome II. p. 41.
-
[↑] Page 167.
-
[↑] Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome V. part. I, pag. 182 & 188.
[III-114]
CHAPITRE XVII.
De la Grece & du nombre de ses habitans.
Cet effet qui tient à des causes physiques dans de certains pays d’Orient, la nature du gouvernement le produisit dans la Grece. Les Grecs étoient une grande nation, composée de villes qui avoient chacune leur gouvernement & leurs lois. Elles n’étoient pas plus conquérantes que celles de Suisse, de Hollande & d’Allemagne ne le sont aujourd’hui : dans chaque république, le législateur avoit eu pour objet le bonheur des citoyens au-dedans, & une puissance au dehors qui ne [III-115] fût pas inférieure à celle des villes voisines [1] . Avec un petit territoire & une grande félicité, il étoit facile que le nombre des citoyens augmentât, & leur devînt à charge : aussi firent-ils sans cesse des colonies [2] ; ils se vendirent pour la guerre, comme les Suisses font aujourd’hui ; rien ne fut négligé de ce qui pouvoit empêcher la trop grande multiplication des enfans.
Il y avoit chez eux des républiques dont la constitution étoit singuliere. Des peuples soumis étoient obligés de fournir la subsistance aux citoyens : les Lacédémoniens étoient nourris par les Ilotes ; les Crétois, par les Périéciens ; les Thessaliens, par les Pénestes. Il ne devoit y avoit qu’un certain nombre d’hommes libres, pour que les esclaves fussent en état de leur fournir la subsistance. Nous disons aujourd’hui qu’il faut borner le nombre des troupes réglées ; or Lacédémone étoit une armée entretenue par des paysans, il falloit donc borner cette armée ; sans cela, les hommes libres, qui avoient tous les [III-116] avantages de la société, se seroient multipliés sans nombre, & les laboureurs auroient été accablés.
Les politiques Grecs s’attacherent donc particuliérement à régler le nombre des citoyens. Platon [3] le fixe à cinq mille quarante ; & il veut que l’on arrête ou que l’on encourage la propagation, selon le besoin, par les honneurs, par la honte & par les avertissemens des vieillards ; il veut même [4] que l’on regle le nombre des mariages, de maniere que le peuple se répare sans que la république soit surchargée.
Si la loi du pays, dit Aristote [5] , défend d’exposer les enfans, il faudra borner le nombre de ceux que chacun doit engendrer. Si l’on a des enfans au-delà du nombre défini par la loi, il conseille de faire avorter [6] la femme avant que le fœtus ait vie.
Le moyen infame qu’employoient les Crétois pour prévenir le trop grand nombre d’enfans, est rapporté par Aristote ; & j’ai senti la pudeur effrayée, quand j’ai voulu le rapporter.
[III-117]
Il y a des lieux, dit encore Aristote [7] , où la loi fait citoyens les étrangers, ou les bâtards, ou ceux qui sont seulement nés d’une mere citoyenne : mais dès qu’ils ont assez de peuple, ils ne le sont plus. Les sauvages du Canada font brûler leurs prisonniers : mais lorsqu’ils ont des cabanes vuides à leur donner, ils les reconnoissent de leur nation.
Le chevalier Petty a supposé, dans ses calculs, qu’un homme en Angleterre vaut ce qu’on le vendroit à Alger [8] . Cela ne peut être bon que pour l’Angleterre : il y a des pays où un homme ne vaut rien, il y en a où il vaut moins que rien.
-
[↑] Par la valeur, la discipline & les exercices militaires.
-
[↑] Les Gaulois, qui étoient dans le même cas, firent de même.
-
[↑] Dans ses lois, livre V.
-
[↑] République, livre V.
-
[↑] Politique, livre VII. Chap. xvi.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Politique, livre III. chap. iii.
-
[↑] Soixante livres sterling.
[III-117]
CHAPITRE XVIII.
De l’état des peuples avant les Romains.
L’Italie, la Sicile, l’Asie mineure, l’Espagne, la Gaule, la Germanie, étoient à peu près comme la Grece, pleines de petits peuples, & regorgeoient d’habitans : on n’y avoit pas besoin de lois pour en augmenter le nombre.
[III-118]
CHAPITRE XIX.
Dépopulation de l’univers.
Toutes ces petites républiques furent englouties dans une grande, & l’on vit insensiblement l’univers se dépeupler : il n’y a qu’à voir ce qu’étoit l’Italie & la Grece, avant & après les victoires des Romains.
« On me demandera, dit Tite-Live [1] , où les Volsques ont pu trouver assez de soldats pour faire la guerre, après avoir été si souvent vaincus. Il falloit qu’il y eût un peuple infini dans ces contrées, qui ne seroient aujourd’hui qu’un désert, sans quelques soldats & quelques esclaves Romains. »
« Les oracles ont cessé, dit Plutarque [2] , parce que les lieux où ils parloient sont détruits ; à peine trouveroit-on aujourd’hui dans la Grece trois mille hommes de guerre. »
« Je ne décrirai point, dit Strabon [3] , l’Epire & les lieux circonvoisins, [III-119] parce que ces pays sont entiérement déserts. Cette dépopulation, qui a commencé depuis long-temps, continue tous les jours ; de sorte que les soldats Romains ont leur camp dans les maisons abandonnées ». Il trouve la cause de ceci dans Polybe, qui dit que Paul Emile, après sa victoire, détruisit soixante & dix villes de l’Epire, & en emmena cent cinquante mille esclaves.
[III-119]
CHAPITRE XX.
Que les Romains furent dans la nécessité de faire des Lois pour la propagation de l’espece.
Les Romains, en détruisant tous les peuples, se détruisoient eux-mêmes : sans cesse dans l’action, l’effort & la violence, ils s’usoient, comme une arme dont on se sert toujours.
Je ne parlerai point ici de l’attention qu’ils eurent à se donner des citoyens à mesure qu’ils en perdroient [1] , des associations qu’ils firent, des droits de [III-120] cité qu’ils donnerent, & de cette pépiniere immense de citoyens qu’ils trouverent dans leurs esclaves. Je dirai ce qu’ils firent, non pas pour réparer la perte des citoyens, mais celle des hommes ; & comme ce fut le peuple du monde qui sut le mieux accorder ses lois avec ses projets, il n’est point indifférent d’examiner ce qu’il fit à cet égard.
-
[↑] J’ai traité ceci dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, &c.
[III-120]
CHAPITRE XXI.
Des Lois des Romains sur la propagation de l’espece.
Les anciennes lois de Rome chercherent beaucoup à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat & le peuple firent souvent des réglemens là-dessus, comme le dit Auguste dans la harangue rapportée par Dion [1] .
Denys d’Halicarnasse [2] ne peut croire, qu’après la mort des trois cents-cinq Fabiens, exterminés par les Vélens, il ne fût resté de cette race qu’un seul enfant ; parce que la loi ancienne, qui ordonnoit à chaque citoyen de se [III-121] marier & d’élever tous ses enfans, étoit encore dans sa vigueur [3] .
Indépendamment des lois, les censeurs eurent l’œil sur les mariages ; & selon les besoins de la république, ils y engagerent [4] & par la honte & par les peines.
Les mœurs qui commencerent à se corrompre, contribuerent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariage, qui n’a que des peines pour ceux qui n’ont plus de sens pour les plaisirs de l’innocence. C’est l’esprit de cette [5] harangue que Meteilus Numidicus fit au peuple dans sa censure. « S’il étoit possible de n’avoir point de femme, nous nous délivrerions de ce mal : mais comme la nature a établi que l’on ne peut guere vivre heureux avec elles, ni subsister sans elles, il faut avoir plus d’égards à notre conservation, qu’à des satisfactions passageres.
La corruption des mœurs détruisit la censure, établie elle-même pour détruire la corruption des mœurs : mais [III-122] lorsque cette corruption devient générale, la censure n’a plus de force [6] .
Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, affoiblirent plus Rome qu’aucune guerre qu’elle eût encore faite : il restoit peu de citoyens [7] , & la plupart n’étoient pas mariés. Pour remédier à ce dernier mal, César & Auguste rétablirent la censure, & voulurent [8] même être censeurs. Ils firent divers réglemens : César [9] donna des récompenses à ceux qui avoient beaucoup d’enfans ; il défendit [10] aux femmes qui avoient moins de quarante-cinq ans, & qui n’avoient ni maris ni enfans, de porter des pierreries, & de se servir de litieres : méthode excellente d’attaquer le célibat par la vanité. Les lois d’Auguste [11] furent plus pressantes : il imposa [12] des peines nouvelles à ceux [III-123] qui n’étoient point mariés, & augmenta les récompenses de ceux qui l’étoient, & de ceux qui avoient des enfans. Tacite appelle ces lois Juliennes [13] ; il y a apparence qu’on y avoit fondu les anciens réglemens faits par le sénat, le peuple & les censeurs.
La loi d’Auguste trouva mille obstacles ; & trente-quatre ans [14] après qu’elle eut été faite, les chevaliers Romains lui en demanderent la révocation. Il fit mettre d’un côté ceux qui étoient mariés, & de l’autre ceux qui ne l’étoient pas : ces derniers parurent en plus grand nombre ; ce qui étonna les citoyens & les confondit. Auguste avec la gravité des anciens censeurs, leur parla ainsi [15] .
« Pendant que les maladies & les guerres nous enlevent tant de citoyens, que deviendra la ville, si on ne contracte plus de mariages ? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques : ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne [III-124] verrez point, comme dans les fables, sortir des hommes de dessous la terre, pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point pour vivre seuls, que vous restez dans le célibat : chacun de vous a des compagnes de sa table & de son lit, & vous ne cherchez que la paix dans vos déréglemens. Citerez-vous ici l’exemple des vierges Vestales ? Donc si vous ne gardiez pas les lois de la pudicité, il faudroit vous punir comme elles. Vous êtes également mauvais citoyens, soit que tout le monde imite votre exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet est la perpétuité de la république. J’ai augmenté les peines de ceux qui n’ont point obéi ; & à l’égard des récompenses, elles sont telles que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes : il y en a de moindres, qui portent mille gens à exposer leur vie ; & celles-ci ne vous engageroient pas à prendre une femme, & à nourrir des enfans ? »
Il donna la loi qu’on nomma de son nom Julia, & Pappia Poppœa du nom des consuls [16] d’une partie de cette [III-125] année-là. La grandeur du mal paroissoit dans leur élection même : Dion [17] nous dit qu’ils n’étoient point mariés, & qu’ils n’avoient point d’enfans.
Cette loi d’Auguste fut proprement un code de lois & un corps systématique de tous les réglemens qu’on pouvoit faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes [18] , & on leur donna plus de force : elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu’elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains.
On en trouve [19] les morceaux dispersés dans les précieux fragmens d’Ulpien, dans les lois du digeste tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes, dans les historiens & les autres auteurs qui les ont citées, dans le code Théodosien qui les a abrogées, dans les Peres qui les ont censurées, sans doute avec un zele louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires des celle-ci.
Ces lois avoient plusieurs chefs, & [III-126] l’on en connoît trente-cinq [20] . Mais allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle [21] nous dit être le septieme, & qui regarde les honneurs & les récompenses accordés par cette loi.
Les Romains, sortis pour la plupart des villes Latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes [22] , & qui avoient même tiré de ces villes [23] une partie de leurs lois, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge [24] ; on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appeloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des [III-127] enfans, de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses. Il y avoit de ces privileges dont les gens mariés jouissoient toujours, comme, par exemple, une place particuliere au théâtre [25] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.
Ces privileges étoient très-étendus. Les gens mariés qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés [26] , soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs mêmes. Le consul qui avoit le plus d’enfans, prenoit le premier les faisceaux [27] ; il avoit le choix des provinces [28] ; le sénateur qui avoit le plus d’enfans, étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disoit au sénat son avis le premier [29] . L’on pouvoit parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an [30] . Si l’on avoit trois [III-128] enfans à Rome, on étoit exempt de toutes charges personnelles [31] . Les femmes ingénues qui avoient trois enfans, & les affranchis qui en avoient quatre, sortoient [32] de cette perpétuelle tutelle, où les retenoient [33] les anciennes lois de Rome.
Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines [34] . Ceux qui n’étoient point mariés, ne pouvoient rien recevoir par le testament des [35] étrangers ; & ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans, n’en recevoient que la moitié [36] . Les Romains, dit Plutarque [37] , se marioient pour être héritiers, & non pour avoir des héritiers.
Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient se faire par testament, étoient limités par la loi. Ils pouvoient se donner le tout [38] , s’ils avoient des [III-129] enfans l’un de l’autre ; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixieme partie de la succession, à cause du mariage ; & s’ils avoient des enfans d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixiemes qu’ils avoient d’enfans.
Si un mari s’absentoit [39] d’auprès de sa femme, pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.
La loi donnoit à un mari ou à une femme qui survivoit, deux ans [40] pour se remarier, & un an & demi dans le cas du divorce. Les peres qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats [41] .
On ne pouvoit faire des fiançailles lorsque le mariage devoit être différé [III-130] de plus de deux ans [42] ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement [43] , & sous prétexte de fiançailles, des privileges des gens mariés.
Il étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans [44] d’épouser une femme qui en avoit cinquante. Comme on avoit donné de grands privileges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvitien déclaroit inégal [45] le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans, avec un homme qui en avoit moins de soixante : de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier, sans encourir les peines de ces lois. Tibere ajouta [46] à la rigueur de la loi Pappienne, & défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en [III-131] avoit moins de cinquante ; de sorte qu’un homme de soixante ans ne pouvoit se marier dans aucun cas, sans encourir la peine : mais Claude [47] abrogea ce qui avoit été fait sous Tibere à cet égard.
Toutes ces dispositions étoient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du nord, où un homme de soixante ans a encore de la force, & où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.
Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix que l’on pouvoit faire, Auguste permit à tous les ingénus qui n’étoient pas sénateurs [48] d’épouser des affranchies [49] . La loi [50] Pappienne interdisoit aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’étoient produites sur le théâtre ; & du temps d’Ulpien [51] , il étoit défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avoient mené une mauvaise vie, qui étoient montées sur le théâtre, ou qui avoient été [III-132] condamnées par un jugement public. Il falloit que ce fût quelque senatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n’avoit guere fait de ces sortes de lois, parce que les censeurs corrigeoient à cet égard les désordres qui naissoient, ou les empêchoient de naitre.
Constantin [52] ayant fait une loi, par laquelle il comprenoit dans la défense de la loi Pappienne, non-seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l’état, sans parler de ceux qui étoient d’une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus, compris dans la loi de Constantin, à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien [53] abrogea encore la loi de Constantin, & permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.
Il est clair que les peines portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi, étoient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. Ces mariages ne [III-133] leur donnoient aucun avantage [54] civil : la dot [55] étoit caduque [56] après la mort de la femme.
Auguste ayant adjugé au trésor [57] public les successions & les legs de ceux que ces lois en déclaroient incapables, ces lois parurent plutôt fiscales que politiques & civiles. Le dégoût que l’on avoit déjà pour une chose qui paroissoit accablante, fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibere, on fut obligé de modifier [58] ces lois, que Néron diminua les récompenses des [59] délateurs au fisc, que Trajan [60] arrêta leurs brigandages, que Sévere [61] modifia ces lois, & que les [III-134] jurisconsultes les regarderent comme odieuses, & dans leurs décisions en abandonnerent la rigueur.
D’ailleurs les empereurs énerverent ces lois [62] par les privileges qu’ils donnerent des droits de maris, d’enfans, & de trois enfans. Ils firent plus, ils dispenserent les particuliers [63] des peines de ces lois. Mais des regles établies pour l’utilité publique, sembloient ne devoir point admettre de dispense.
Il avoit été raisonnable d’accorder le droit d’enfans aux Vestales [64] , que la religion retenoit dans une virginité nécessaire : on donna [65] de même le privilege des maris aux soldats, parce qu’ils ne pouvoient pas se marier. C’étoit la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles. Ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté [66] [III-135] d’affranchir, & de celle qui bornoit la faculté [67] de léguer. Tout cela n’étoit que des cas particuliers : mais dans la suite les dispenses furent données sans ménagement, & la regle ne fut plus qu’une exception.
Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires, qui n’auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république [68] , où tout le monde étoit occupé des arts de la guerre & de la paix. De-là une idée de perfection attachée à tout ce qui mene à une vie spéculative : de-là l’éloignement pour les soins & les embarras d’une famille. La religion chrétienne venant après la philosophie, fixa pour ainsi dire des idées que celle-ci n’avoir fait que préparer.
Le christianisme donna son caractere à la jurisprudence ; car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui n’est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens.
Un panégyriste [69] de Constantin dit [III-136] à cet empereur : « Vos lois n’ont été faites que pour corriger les vices, & régler les mœurs : vous avez ôté l’artifice des anciennes lois, qui sembloient n’avoir d’autres vues que de tendre des pieges à la simplicité ».
Il est certain que les changemens de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet, vinrent ces lois qui donnerent une telle autorité aux évêques, qu’elles ont été le fondement de la juridiction ecclésiastique : de-là ces lois qui affoiblirent l’autorité paternelle [70] , en ôtant au pere la propriété des biens de ses enfans. Pour étendre une religion nouvelle, il faut ôter l’extrême dépendance des enfans, qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.
Les lois faites dans l’objet de la perfection chrétienne, furent sur tout celles par lesquelles il ôta les peines des lois Pappiennes [71] , & en exempta, [III-137] tant ceux qui n’étoient point mariés, que ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans.
« Ces lois avoient été établies, dit un historien [72] ecclésiastique, comme si la multiplication de l’espece humaine pouvoit être un effet de nos soins ; au lieu de voir que ce nombre croît & décroît selon l’ordre de la providence ».
Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espece humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans, les Guebres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.
On ne cessa de prêcher par tout la continence, c’est-à-dire, cette vertu qui est plus parfaite, parce que par sa nature elle doit être pratiquée par très-peu de gens.
Constantin n’avoit point ôté les lois décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari & la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfans : Théodose le jeune abrogea [73] encore ces lois.
[III-138]
Justinien déclara valables [74] tous les mariages que les lois Pappiennes avoient défendus. Ces lois vouloient qu’on se remariât : Justinien [75] accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.
Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs [76] à condition de ne point se marier, lorsqu’un patron faisoit jurer [77] son affranchi, qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans, la loi Pappienne annulloit [78] & cette condition a ce serment. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.
Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des enfans : mais là où le célibat [III-139] avoit la prééminence, il ne pouvoit plus y avoir d’honneur pour le mariage ; & puisque l’on put obliger les traitans à renoncer à tant de profits par l’abolition des peines, on sent qu’il fut encore plus aisé d’ôter les récompenses.
La même raison de spiritualité qui avoit fait permettre le célibat, imposa bientôt la nécessité du célibat même. A Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion : mais qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes, se corrompant par les sentimens naturels mêmes, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celle qui les rend toujours pires ?
C’est une regle tirée de la nature, que plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.
-
[↑] Livre LVI.
-
[↑] Livre II.
-
[↑] L’an de Rome 277.
-
[↑] Voyez sur ce qu’ils firent à cet égard, Tite-Live, liv. XLV ; l’épitome de Tite-Live, liv. LIX ; Aulugelle, liv. I. ch. vi ; Valere Maxime, liv. II. ch. xix.
-
[↑] Elle est dans Aulugelle, liv. I. ch. vi.
-
[↑] Voyez ce que j’ai dit au livre V. ch. xix.
-
[↑] César, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il ne s’y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. Epitome de Florus sur Tite-Live, douzieme décade.
-
[↑] Voyez Dion, liv. XLIII. & Xiphil. In August.
-
[↑] Dion, liv. XLIII ; Suétone, vie de César, ch. xx. Appien, liv. II. de la guerre civile.
-
[↑] Eusebe dans sa chronique.
-
[↑] Dion, liv. LIV.
-
[↑] L’an 736 de Rome.
-
[↑] Julias rogationes, annal. Liv. III.
-
[↑] L’an 762 de Rome, Dion, liv. LVI.
-
[↑] J’ai abrégé cette harangue, qui est d’une longueur accablante : elle est rapportée dans Dion, liv. LVI.
-
[↑] Marcus Pappius Mutilus, & Q. Poppœus Sabigus. Dion, liv. LVI.
-
[↑] Dion, liv. LVI.
-
[↑] Le titre 14 des fragmens d’Ulpien, distingue fort bien la loi Julienne de la Pappienne.
-
[↑] Jacques Godefroi en a fait une compilation.
-
[↑] Le trente-cinquieme est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.
-
[↑] Liv. II, ch. xv.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse.
-
[↑] Les députés de Rome qui furent envoyés pour chercher des lois Grecques, allerent à Athenes & dans les villes d’Italie.
-
[↑] Aulugelle, liv. II, ch. xv.
-
[↑] Suétone, in Augusto, ch. XLIV.
-
[↑] Tacite, liv. II. Ut numerus liberorum in candidatis prœpolleret, quod lex jubebat.
-
[↑] Aulugelle, liv. II, ch. xv.
-
[↑] Tacite, annal. Liv. XV.
-
[↑] Voyez la loi VI, §. 5, ff. de decurion.
-
[↑] Voyez la loi II, ff. de minorib.
-
[↑] Loi I & II, ff. de vacatione, & excusat. muner.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 29, 6. 3.
-
[↑] Plutarque, vie de Numa.
-
[↑] Voyez les fragm. d’Ulpien, au titre 14, 15, 16, 17 & 18, qui sont un des beaux morceaux de l’ancienne jurisprudence Romaine.
-
[↑] Sozom. Liv. I, ch. IX. On recevoit de ses parens ; fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
-
[↑] Sozom. Liv. I, ch. ix., & leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœnis cœlib. & orbitat.
-
[↑] Œuvres morales, de l’amour des peres envers leurs enfans.
-
[↑] Voyez un plus long détail de ceci dans les fragmens d’Ulpien, tit. 15 & 16.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Il paroît que les premieres lois Juliennes donnerent trois ans. Harangue d’Auguste dans Dion, liv. LVI : Suétone, vie d’Auguste, ch. xxxiv. D’autres lois Juliennes n’accorderent qu’un an : enfin la loi Pappienne en donna deux. Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Ces lois n’étoient point agréables au peuple ; & Auguste les tempéroit, ou les roidissoit, selon qu’on étoit plus ou moins disposé à les souffrir.
-
[↑] C’étoit le trente-cinquieme chef de la loi Papienne, leg. 19, ff. de ritu nuptiarum.
-
[↑] Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone, in Octavio, ch. xxxiv.
-
[↑] Voyez Dion, liv. LIV ; & dans le même Dion, la harangue d’Auguste, liv. LVI.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16 ; & la loi XXVII, cod. de nuptiis.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16. §. 3.
-
[↑] Voyez Suétone, in Claudio, ch. xxiii.
-
[↑] Voyez Suétone, vie de Claude, ch. xxiii ; & les fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 3.
-
[↑] Dion, liv. LIV ; fragm. d’Ulpien, tit. 13
-
[↑] Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, ch. 13 ; & la loi XLIV, au ff. de ritu nuptierum, à la fin.
-
[↑] Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 13 & 16.
-
[↑] Voyez la loi I, au cod. de nat. lib.
-
[↑] Novel. 117.
-
[↑] Loi XXXVII, §. 7. ff. de operib. libertorum, fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 2.
-
[↑] Fragm. Ibid.
-
[↑] Voyez ci-dessous le ch. xiii, du liv. XXVI.
-
[↑] Excepté dans de certains cas. Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 18 ; & la loi unique, au cod. de caduc. tollead.
-
[↑] Relatum de moderandâ Pappiâ Poppœâ. Tacite, annal. Liv. III, p. 117.
-
[↑] Il les réduisit à la quatrieme partie. Suétone, in Nerone, ch. x.
-
[↑] Voyez le panégyrique de Pline.
-
[↑] Sévere recula jusqu’à vingt-cinq ans pour les mâles, & vingt pour les filles, le temps des dispositions de la loi Pappienne, comme on le voit en considérant les fragm. d’Ulpien, tit. 16, avec ce que dit Tertullien, apologet. ch. iv.
-
[↑] P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les mœurs, se plaint de l’abus qui s’étoit introduit, que le fils adoptif donnoit le même privilege que le fils naturel. Anlag. Liv. V. ch. xix.
-
[↑] Voyez la loi XXXI, ff. de ritu nupt.
-
[↑] Auguste, par la loi Pappienne, leur donna le même privilege qu’aux meres ; voyez Dion, liv. LVI. Numa leur avoit donné l’ancien privilege des femmes qui avoient trois enfans, qui est de n’avoir point de curateur ; Plutarque, dans la vie de Numa.
-
[↑] Claude le leur accorda. Dion, liv. LX.
-
[↑] Leg. Apud cum, ff. de manumissionib. §. I.
-
[↑] Dion, Liv. LV.
-
[↑] Voyez dans les offices de Cicéron, ces idées sur cet esprit de spéculation.
-
[↑] Nazaire, in panegyrico Constantini, anno 321.
-
[↑] Voyez la loi I, II & III, au cod. Theod. de bonis maternis, maternique generis, &c. & la loi unique, au même code, de bonis quæ filiis famil. acquiruntur.
-
[↑] Leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœn. Cœlib. & orbit
-
[↑] Sozom. p. 27.
-
[↑] Leg. II & III, cod. Theod. de jur. lib.
-
[↑] Leg. Sancimus, cod. de nuptiis.
-
[↑] Nov. 127, ch. iii. Nov. 118, ch. v.
-
[↑] Leg. LIV, ff. de condit & demonst.
-
[↑] Leg. V, §. 4. de jure patronat.
-
[↑] Paul, dans ses sentences, livre III, titre 12, §. 15.
[III-140]
CHAPITRE XXII.
De l’exposition des enfans.
Les premiers Romains eurent une assez bonne police sur l’exposition des enfans. Romulus, dit Denys d’Halicarnasse [1] , imposa à tous les citoyens la nécessité d’élever tous les enfans mâles & les aînées des filles. Si les enfans étoient difformes & monstrueux, il permettoit de les exposer, après les avoir montrés à cinq des plus proches voisins.
Romulus ne permit [2] de tuer aucun enfant qui eût moins de trois ans ; par-là il concilioit la loi qui donnoit aux peres le droit de vie & de mort sur leurs enfans, & celle qui défendoit de les exposer.
On trouve encore dans Denys d’Halicarnasse [3] , que la loi qui ordonnoit aux citoyens de se marier & d’élever tous leurs enfans, étoit en vigueur l’an 277 de Rome : on voit que l’usage avoit restreint la loi de Romulus, qui permettoit d’exposer les filles cadettes.
[III-141]
Nous n’avons de connoissance de ce que la loi des douze tables, donnée l’an de Rome 301, statua sur l’exposition des enfans, que par un passage de Cicéron [4] , qui parlant du tribunat du peuple, dit que d’abord après sa naissance, tel que l’enfant monstrueux de la loi des douze tables, il fut étouffé : les enfans qui n’étoient donc conservés, & la loi des douze tables ne changea rien aux institutions précédentes.
« Les Germains, dit Tacite [5] , n’exposent point leurs enfans ; & chez eux, les bonnes mœurs ont plus de force que n’ont ailleurs les bonnes lois ». Il y avoit donc chez les Romains des lois contre cet usage, & on ne les suivoit plus. On ne trouve aucune loi [6] Romaine, qui permette d’exposer les enfans : ce fut sans doute un abus introduit dans les derniers temps, lorsque le luxe ôta l’aisance, lorsque les richesses partagées furent appelées pauvreté, lorsque le pere crut avoir perdu [III-142] ce qu’il donna à sa famille, & qu’il distingua cette famille de sa propriété.
-
[↑] Antiquités Romaines, liv. II.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Liv. IX.
-
[↑] Liv. III, de legib.
-
[↑] De morib. Germ.
-
[↑] Il n’y a point de titre là-dessus dans le digeste, le titre du code n’en dit rien, non plus que les novelles.
[III-142]
CHAPITRE XXIII.
De l’état de l’univers, après la destruction des Romains.
Les réglemens que firent les Romains pour augmenter le nombre de leurs citoyens, eurent leur effet pendant que leur république, dans la force de son institution, n’eut à réparer que les pertes qu’elle faisoit par son courage, par son audace, par sa fermeté, par son amour pour la gloire, & par sa vertu même. Mais bientôt les lois les plus sages ne purent établir ce qu’une république mourante, ce qu’une anarchie générale, ce qu’un gouvernement militaire, ce qu’un empire dur, ce qu’un despotisme superbe, ce qu’une monarchie foible, ce qu’une cour stupide, idiote & superstitieuse, avoient successivement abattu : on eût dit qu’ils n’avoient conquis le monde que pour l’affoiblir, & le livrer sans défense aux barbares. Les nations Gothes, Géthiques, Sarrasines & Tartares, les [III-143] accablerent tour-à-tour ; bientôt les peuples barbares n’eurent à détruire que des peuples barbares. Ainsi dans le temps des fables, après les inondations & les déluges, il sortit de la terre des hommes armés qui s’exterminerent.
[III-143]
CHAPITRE XXIV.
Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans.
Dans l’état où étoit l’Europe, on n’auroit pas cru qu’elle pût se rétablir ; sur-tout lorsque, sous Charlemagne, elle ne forma plus qu’un vaste empire. Mais par la nature du gouvernement d’alors, elle se partagea en une infinité de petites souverainetés. Et comme un seigneur résidoit dans son village ou dans sa ville ; qu’il n’étoit grand, riche, puissant, que dis-je ? qu’il n’étoit en sureté que par le nombre de ses habitans, chacun s’attacha avec une attention singuliere à faire fleurir son petit pays : ce qui réussit tellement, que, malgré les irrégularités du gouvernement, le défaut des connoissances qu’on a acquises depuis sur le commerce, le grand nombre [III-144] de guerres & de querelles qui s’éleverent sans cesse, il y eut dans la plupart des contrées d’Europe plus de peuple qu’il n’y en a aujourd’hui.
Je n’ai pas le temps de traiter à fond cette matiere : mais je citerai les prodigieuses armées des croisés, composées de gens de toute espece. M. Pusendorf dit [1] , que sous Charles IX, il y avoit vingt millions d’hommes en France.
Ce sont les perpétuelles réunions de plusieurs petits états, qui ont produit cette diminution. Autrefois chaque village de France étoit une capitale, il n’y en a aujourd’hui qu’une grande : chaque partie de l’état étoit un centre de puissance ; aujourd’hui tout se rapporte à un centre ; & ce centre est pour ainsi dire l’état même.
-
[↑] Hist. De l’univ. Ch. V. de la France.
[III-144]
CHAPITRE XXV.
Continuation du même sujet.
Il est vrai que l’Europe a, depuis deux siecles, beaucoup augmenté sa navigation : cela lui a procuré des habitans, [III-145] & lui en a fait perdre. La Hollande envoie tous les ans aux Indes un grand nombre de matelots, dont il ne revient que les deux tiers ; le reste périt ou s’établit aux Indes : même chose doit à peu près arriver à toutes les autres nations qui font ce commerce.
Il ne faut point juger de l’Europe comme d’un état particulier qui y feroit seul une grande navigation. Cet état augmenteroit de peuple, parce que toutes les nations voisines viendroient prendre part à cette navigation ; il y arriveroit des matelots de tous côtés : l’Europe séparée du reste du monde par la religion [1] , par de vastes mers & par des déserts, ne se répare pas ainsi.
-
[↑] Les pays Mahométans l’entourent presque partout.
[III-145]
CHAPITRE XXVI.
Conséquences.
De tout ceci il faut conclure, que l’Europe est encore aujourd’hui dans le cas d’avoir besoin de lois qui favorisent la propagation de l’espece humaine : aussi comme les politiques [III-146] Grecs nous parlent toujours de ce grand nombre de citoyens qui travaillent la république, les politiques d’aujourd’hui ne nous parlent que des moyens propres à l’augmenter.
[III-146]
CHAPITRE XXVII.
De la loi faite en France, pour encourager la propagation de l’espece.
Louis XIV ordonna [1] de certaines pensions pour ceux qui auroient dix enfans, & de plus fortes pour ceux qui en auroient douze. Mais il n’étoit pas question de récompenser des prodiges. Pour donner un certain esprit général qui portât à la propagation de l’espece, il falloit établir, comme les Romains, des récompenses générales ou des peines générales.
-
[↑] Édit de 1666, en faveur des mariages.
[III-147]
CHAPITRE XXVIII.
Comment on peut remédier à la dépopulation.
Lorsqu’un état se trouve dépeuplé par des accidens particuliers, des guerres, des pestes, des famines, il y a des ressources. Les hommes qui restent peuvent conserver l’esprit de travail & d’industrie ; ils peuvent chercher à réparer leurs malheurs, & devenir plus industrieux par leur calamité même. Le mal presqu’incurable est lorsque la dépopulation vient de longue main, par un vice intérieur & un mauvais gouvernement. Les hommes y ont péri par une maladie insensible & habituelle : nés dans la langueur & dans la misere, dans la violence ou les préjugés du gouvernement, ils se sont vus détruire, souvent sans sentir les causes de leur destruction. Les pays désolés par le despotisme, ou par les avantages excessifs du clergé sur les laïques, en sont deux grands exemples.
Pour rétablir un état ainsi dépeuplé, on attendroit en vain des secours des [III-148] enfans qui pourroient naître. Il n’est plus temps ; les hommes dans leurs déserts sont sans courage & sans industrie. Avec des terres pour nourrir un peuple, on a à peine de quoi nourrir une famille. Le bas peuple dans ces pays n’a pas même de part à leur misere, c’est-à-dire, aux friches dont ils sont remplis. Le clergé, le prince, les villes, les grands, quelques citoyens principaux, sont devenus insensiblement propriétaires de toute la contrée : elle est inculte ; mais les familles détruites leur en ont laissé les pâtures, & l’homme de travail n’a rien.
Dans cette situation, il faudroit faire dans toute l’étendue de l’empire ce que les Romains faisoient dans une partie du leur : pratiquer, dans la disette des habitans, ce qu’ils observoient dans l’abondance ; distribuer des terres à toutes les familles qui n’ont rien ; leur procurer les moyens de les défricher & de les cultiver. Cette distribution devroit se faire à mesure qu’il y auroit un homme pour la recevoir ; de sorte qu’il n’y eût point de moment perdu pour le travail.
[III-149]
CHAPITRE XXIX.
Des Hôpitaux.
Un homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas. Celui qui n’a aucun bien & qui travaille, est aussi à son aise que celui qui a cent écus de revenu sans travailler. Celui qui n’a rien, & qui a un métier, n’est pas plus pauvre que celui qui a dix arpens de terre en propre, & qui doit les travailler pour subsister. L’ouvrier qui a donné à ses enfans son art pour héritage, leur a laissé un bien qui s’est multiplié à proportion de leur nombre. Il n’en est pas de même de celui qui a dix arpens de fonds pour vivre, & qui les partage à ses enfans.
Dans les pays de commerce, où beaucoup de gens n’ont que leur art, l’état est souvent obligé de pourvoir aux besoins des vieillards, des malades & des orphelins. Un état bien policé tire cette subsistance du fonds des arts mêmes ; il donne aux uns les travaux dont ils sont capables ; il enseigne les autres à travailler, ce qui fait déjà un travail.
[III-150]
Quelques aumônes que l’on fait à un homme nud dans les rues, ne remplissent point les obligations de l’état, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé.
Aureng-Zebe [1] à qui on demandoit pourquoi il ne bâtissoit point d’hôpitaux, dit : « Je rendrai mon empire si riche, qu’il n’aura pas besoin d’hôpitaux. » Il auroit fallu dire : Je commencerai par rendre mon empire riche, & je bâtirai des hôpitaux.
Les richesses d’un état supposent beaucoup d’industrie. Il n’est pas possible que, dans un si grand nombre de branches de commerce, il n’y en ait toujours quelqu’une qui souffre, & dont par conséquent les ouvriers ne soient dans une nécessité momentanée.
C’est pour lors que l’état a besoin d’apporter un prompt secours, soit pour empêcher le peuple de souffrir, soit pour éviter qu’il ne se révolte : c’est dans ce cas qu’il faut des hôpitaux, ou quelque règlement équivalent, qui puisse prévenir cette misere.
[III-151]
Mais quand la nation est pauvre, la pauvreté particuliere dérive de la misere générale, & elle est, pour ainsi dire, la misere générale. Tous les hôpitaux du monde ne sauroient guérir cette pauvreté particuliere ; au contraire, l’esprit de paresse qu’ils inspirent, augmente la pauvreté générale, & par conséquent la particuliere.
Henri VIII [2] voulant réformer l’église d’Angleterre, détruisit les moines, nation paresseuse elle-même, & qui entretenoit la paresse des autres, parce que pratiquant l’hospitalité, une infinité de gens oisifs, gentilshommes & bourgeois, passoient leur vie à courir de couvent en couvent. Il ôta encore les hôpitaux où le bas peuple trouvoit sa subsistance, comme les gentilshommes trouvoient la leur dans les monasteres. Depuis ce changement, l’esprit de commerce & d’industrie s’établit en Angleterre.
À Rome, les hôpitaux font que tout le monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent, excepté ceux qui ont de l’industrie, excepté ceux qui cultivent [III-152] les arts, excepté ceux qui ont des terres, excepté ceux qui font le commerce.
J’ai dit que les nations riches avoient besoin d’hôpitaux, parce que la fortune y étoit sujette à mille accidens : mais on sent que des secours passagers vaudroient bien mieux que des établissemens perpétuels. Le mal est momentané : il faut donc des secours de même nature, & qui soient applicables à l’accident particulier.
-
[↑] Voyez Chardin, voyage de Perse, tome 8.
-
[↑] Voyez l’Histoire de la réforme d’Angleterre, par M. Burnet.
[III-153]
LIVRE XXIV.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques & en elle-même.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des religions en général.
Comme on peut juger parmi les ténebres celles qui sont les moins épaisses, & parmi les abymes ceux qui sont les moins profonds ; ainsi l’on peut chercher entre les religions fausses celles qui sont les plus conformes au bien de la société ; celles qui, quoiqu’elles n’ayent pas l’effet de mener les hommes aux félicités de l’autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.
Je n’examinerai donc les divers religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil ; soit que je parle de celle qui a sa racine [III-154] dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.
Comme dans cet ouvrage je ne suis point théologien, mais écrivain politique, il pourroit y avoir des choses qui ne seroient entiérement vraies que dans une façon de penser humaine, n’ayant point été considérées dans le rapport avec des vérités plus sublimes.
À l’égard de la vraie religion, il ne faudra que très-peu d’équité pour voir que je n’ai jamais prétendu faire céder ses intérêts aux intérêts politiques, mais les unir : or, pour les unir, il faut les connoître.
La religion Chrétienne, qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques & les meilleures lois civiles, parce qu’elles sont après elle le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir.
[III-155]
CHAPITRE II.
Paradoxe de Bayle.
Mr Bayle [1] a prétendu prouver qu’il valoit mieux être athée qu’idolâtre, c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’il est moins dangereux de n’avoir point du tout de religion, que d’en avoir une mauvaise. « J’aimerois mieux, dit-il, que l’on dît de moi que je n’existe pas, que si l’on disoit que je suis un méchant homme ». Ce n’est qu’un sophisme, fondé sur ce qu’il n’est d’aucune utilité au genre humain que l’on croie qu’un certain homme existe, au lieu qu’il est très-utile que l’on croie que Dieu est. De l’idée qu’il n’est pas, suit l’idée de notre indépendance ; ou, si nous ne pouvons pas avoir cette idée, celle de notre révolte. Dire que la religion n’est pas un motif réprimant, parce qu’elle ne réprime pas toujours, c’est dire que les lois civiles ne sont pas un motif réprimant non plus. C’est mal raisonner contre la religion, de rassembler dans un grand ouvrage une longue [III-156] énumération des maux qu’elle a produits, si l’on ne fait de même celle des biens qu’elle a faits. Si je voulois raconter tous les maux qu’on produit dans le monde les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, je dirois des choses effroyables. Quand il seroit inutile que les sujets eussent une religion, il ne le seroit pas que les princes en eussent, & qu’ils blanchissent d’écume le seul frein que ceux qui ne craignent pas les lois humaines puissent avoir.
Un prince qui aime la religion & qui la craint, est un lion qui cede à la main qui le flatte, ou à la voix qui l’appaise : celui qui craint la religion & qui la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent : celui qui n’a point du tout de religion, est cet animal terrible, qui ne sent sa liberté que lorsqu’il déchire & qu’il dévore.
La question n’est pas de savoir s’il vaudroit mieux qu’un certain homme ou qu’un certain peuple n’eût point de religion, que d’abuser de celle qu’il a ; mais de savoir quel est le moindre mal, que l’on abuse quelquefois de la religion, [III-157] ou qu’il n’y en ait point du tout parmi les hommes.
Pour diminuer l’horreur de l’athéisme, on charge trop l’idolâtrie. Il n’est pas vrai que, quand les anciens élevoient des autels à quelque vice, cela signifiât qu’ils aimassent ce vice : cela signifioit au contraire qu’ils le haïssoient. Quand les Lacédémoniens érigerent une chapelle à la Peur, cela ne signifioit pas que cette nation belliqueuse lui demandât de s’emparer dans les combats des cœurs des Lacédémoniens. Il y avoit des divinités à qui on demandoit de ne pas inspirer le crime, & d’autres à qui on demandoit de le détourner.
-
[↑] Pensées sur la comete, &c.
[III-157]
CHAPITRE III.
Que le gouvernement modéré convient mieux à la religion Chrétienne, & le gouvernement despotique à la Mahométane.
La religion Chrétienne est éloignée du pur despotisme : c’est que la douceur étant si recommandée dans l’Évangile, elle s’oppose à la colere [III-158] despotique avec laquelle le prince se feroit justice, & exerceroit ses cruautés.
Cette religion défendant la pluralité des femmes, les princes y sont moins renfermés, moins séparés de leurs sujets, & par conséquent plus hommes ; ils sont plus disposés à se faire des lois, & plus capables de sentir qu’ils ne peuvent pas tout.
Pendant que les princes Mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion chez les Chrétiens rend les princes moins timides, & par conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses sujets, & les sujets sur le prince. Chose admirable ! la religion Chrétienne, qui ne semble avoir d’objet que la félicité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.
C’est la religion Chrétienne, qui, malgré la grandeur de l’empire & le vice du climat, a empêché le despotisme de s’établir en Éthiopie, & a porté au milieu de l’Afrique les mœurs de l’Europe & ses lois.
Le prince héritier d’Éthiopie jouit d’une principauté, & donne aux autres sujets l’exemple de l’amour & de l’obéissance. Tout près de là, on voit le [III-159] Mahométisme faire enfermer les enfans du [1] roi de Sennar : à sa mort, le conseil les envoie égorger, en faveur de celui qui monte sur le trône.
Que d’un côté l’on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois & des chefs Grecs & Romains, & de l’autre la destruction des peuples & des villes par ces mêmes chefs ; Thimur & Gengiskan, qui ont dévasté l’Asie ; & nous verrons que nous devons au Christianisme, & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne sauroit assez reconnoître.
C’est ce droit des gens qui fait que, parmi nous, la victoire laisse aux peuples vaincus ces grandes choses, la vie, la liberté, les lois, les biens, & toujours la religion, lorsqu’on ne s’aveugle pas soi-même.
On peut dire que les peuples de l’Europe ne sont pas aujourd’hui plus désunis que ne l’étoient, dans l’empire Romain devenu despotique & militaire, les peuples & les armées, ou que ne [III-160] l’étoient les armées entr’elles : d’un côté, les armées se faisoient la guerre ; & de l’autre, on leur donnoit le pillage des villes, & le partage ou la confiscation des terres.
-
[↑] Relation d’Éthiopie par le sieur Ponce, médecin, au quatrieme recueil des lettres édifiantes.
[III-160]
CHAPITRE IV.
Conséquences du caractere de la religion Chrétienne, & de celui de la religion Mahométane.
Sur le caractere de la religion Chrétienne & celui de la Mahométane, on doit, sans autre examen, embrasser l’une & rejeter l’autre : car il nous est bien plus évident qu’une religion doit adoucir les mœurs des hommes, qu’il ne l’est qu’une religion soit vraie.
C’est un malheur pour la nature humaine, lorsque la religion est donnée par un conquérant. La religion Mahométane, qui ne parle que de glaive, agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qui l’a fondée.
L’histoire de Sabbacon [1] , un des rois pasteurs, est admirable. Le Dieu de Thebes lui apparut en songe, & lui [III-161] ordonna de faire mourir tous les prêtres d’Égypte. Il jugea que les dieux n’avoient plus pour agréable qu’il régnât, puisqu’ils lui ordonnoient des choses si contraires à leur volonté ordinaire ; & il se retira en Éthiopie.
-
[↑] Voyez Diodore, liv. II.
[III-161]
CHAPITRE V.
Que la religion Catholique convient mieux à une monarchie, & que la Protestante s’accommode mieux d’une république.
Lorsqu’une religion naît & se forme dans un état, elle suit ordinairement le plan du gouvernement où elle est établie : car les hommes qui la reçoivent, & ceux qui la font recevoir, n’ont guere d’autres idées de police que celle de l’état dans lequel ils sont nés.
Quand la religion Chrétienne souffrit, il y a deux siecles, ce malheureux partage qui la divisa en catholique & en protestante, les peuples du nord embrasserent la protestante, & ceux du midi garderent la catholique.
C’est que les peuples du nord ont & auront toujours un esprit d’indépendance & de liberté que n’ont pas les [III-162] peuples du midi ; & qu’une religion qui n’a point de chef visible, convient mieux à l’indépendance du climat, que celle qui en a un.
Dans les pays mêmes où la religion protestante s’établit, les révolutions se firent sur le plan de l’état politique. Luther ayant pour lui de grands princes, n’auroit guere pu leur faire goûter une autorité ecclésiastique qui n’auroit point eu de prééminence extérieure ; & Calvin ayant pour lui des peuples qui vivoient dans des républiques, ou des bourgeois obscurcis dans des monarchies, pouvoit fort bien ne pas établir des prééminences & des dignités.
Chacune de ces deux religions pouvoit se croire la plus parfaite ; la Calviniste se jugeant plus conforme à ce que Jesus-Christ avoit dit, & la Luthérienne à ce que les Apôtres avoient fait.
[III-162]
CHAPITRE VI.
Autre paradoxe de Bayle.
Mr Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion Chrétienne : il ose avancer que de [III-163] véritables Chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non ? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très-grand zele pour les remplir ; ils sentiroient très-bien les droits de la défense naturelle ; plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du Christianisme bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.
Il est étonnant qu’on puisse imputer à ce grand homme d’avoir méconnu l’esprit de sa propre religion ; qu’il n’ait pas su distinguer les ordres pour l’établissement du Christianisme d’avec le Christianisme même, ni les préceptes de l’évangile d’avec ses conseils. Lorsque le législateur, au lieu de donner des lois, a donné des conseils, c’est qu’il a vu que ses conseils, s’ils étoient ordonnés comme des lois, seroient contraires à l’esprit de ses lois.
[III-164]
CHAPITRE VII.
Des lois de perfection dans la religion.
Les lois humaines faites pour parler à l’esprit, doivent donner des préceptes & point de conseils : la religion, faite pour parler au cœur, doit donner beaucoup de conseils, & peu de préceptes.
Quand, par exemple, elle donne des regles, non pas pour le bien, mais pour le meilleur ; non pas pour ce qui est bon, mais pour ce qui est parfait ; il est convenable que ce soient des conseils & non pas des lois : car la perfection ne regarde pas l’universalité des hommes ni des choses. De plus, si ce sont des lois, il en faudra une infinité d’autres pour faire observer les premieres. Le célibat fut un conseil du Christianisme : lorsqu’on en fit une loi pour un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour de nouvelles [1] pour réduire les hommes à l’observation de celle-ci. Le législateur se fatigua, il fatigua la société, pour faire exécuter aux hommes par précepte, ce que ceux qui aiment la perfection auroient exécuté comme conseil.
-
[↑] Voyez la bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du sixieme siecle, tom. V. par M. Dupin.
[III-165]
CHAPITRE VIII.
De l’accord des lois de la morale avec celles de la religion.
Dans un pays où l’on a le malheur d’avoir une religion que Dieu n’a pas donnée, il est toujours nécessaire qu’elle s’accorde avec la morale ; parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes.
Les points principaux de la religion de ceux de Pégu [1] sont de ne point tuer, de ne point voler, d’éviter l’impudicité, de ne faire aucun déplaisir à son prochain, de lui faire au contraire tout le bien qu’on peut. Avec cela ils croient qu’on se sauvera dans quelque religion que ce soit ; ce qui fait que ces peuples, quoique fiers & pauvres, ont de la douceur & de la compassion pour les malheureux.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. III. part. I. pag. 63.
[III-166]
CHAPITRE IX.
Des Esséens.
Les Esséens [1] faisoient vœu d’observer la justice envers les hommes, de ne faire de mal à personne, même pour obéir, de haïr les injustes, de garder la foi à tout le monde, de commander avec modestie, de prendre toujours le parti de la vérité, de fuir tout gain illicite.
-
[↑] Histoire des Juifs, par Prideaux.
[III-166]
CHAPITRE X.
De la secte Stoïque.
Les diverses sectes de philosophie chez les anciens pouvoient être considérées comme des especes de religion. Il n’y en a jamais eu dont les principes fussent plus dignes de l’homme, & plus propres à former des gens de bien, que celle des Stoïciens ; & si je pouvois un moment cesser de penser que je suis Chrétien, je ne pourrois m’empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon au nombre des malheurs du genre humain.
Elle n’outroit que les choses dans l’esquelles il y a de la grandeur, le mépris des plaisirs & de la douleur.
[III-167]
Elle seule savoit faire les citoyens ; elle seule faisoit les grands hommes ; elle seule faisoit les grands empereurs.
Faites pour un moment abstraction des vérités révélées ; cherchez dans toute la nature, & vous n’y trouverez pas de plus grand objet que les Antonins. Julien même, Julien, (un suffrage ainsi arraché ne me rendra point complice de son apostasie) non, il n’y a point eu après lui de prince plus digne de gouverner les hommes.
Pendant que les Stoïciens regardoient comme une chose vaine les richesses, les grandeurs humaines, la douleur, les chagrins, les plaisirs, ils n’étoient occupés qu’à travailler au bonheur des hommes, à exercer les devoirs de la société : il sembloit qu’ils regardassent cet esprit sacré qu’ils croyoient être en eux-mêmes, comme une espece de providence favorable qui veilloit sur le genre humain.
Nés pour la société, ils croyoient tous que leur destin étoit de travailler pour elle : d’autant moins à charge, que leurs récompenses étoient toutes dans eux-mêmes ; qu’heureux par leur philosophie seule, il sembloit que le seul bonheur des autres pût augmenter le leur.
[III-168]
CHAPITRE XI.
De la contemplation.
Les hommes étant faits pour se conserver, pour se nourrir, pour se vêtir, & faire toutes les actions de la société, la religion ne doit pas leur donner une vie trop contemplative [1] .
Les Mahométans deviennent spéculatifs par habitude ; ils prient cinq fois le jour, & chaque fois il faut qu’ils fassent un acte par lequel ils jettent derriere leur dos tout ce qui appartient à ce monde : cela les forme à la spéculation. Ajoutez à cela cette indifférence pour toutes choses, que donne le dogme d’un destin rigide.
Si d’ailleurs d’autres causes concourent à leur inspirer le détachement, comme si la dureté du gouvernement, si les lois concernant la propriété des terres, donnent un esprit précaire ; tout est perdu.
La religion des Guebres rendit autrefois le royaume de Perse florissant ; [III-169] elle corrigea les mauvais effets du despotisme : la religion Mahométane détruit aujourd’hui ce même empire.
-
[↑] C’est l’inconvénient de la doctrine de Foë & de Laockium.
[III-169]
CHAPITRE XII.
Des pénitences.
Il est bon que les pénitences soient jointes avec l’idée de travail, non avec l’idée d’oisiveté ; avec l’idée du bien, non avec l’idée de l’extraordinaire ; avec l’idée de frugalité, non avec l’idée d’avarice.
[III-169]
CHAPITRE XIII.
Des crimes inexpiables.
Il paroît, par un passage des livres des pontifes rapporté par Cicéron [1] , qu’il y avoit chez les Romains des crimes [2] inexpiables ; & c’est là-dessus que Zozyme fonde le récit si propre à envenimer les motifs de la conversion de Constantin, & Julien cette raillerie [III-170] amere qu’il fait de cette même conversion dans ses Césars.
La religion païenne qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main & abandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables : Mais une religion qui enveloppe toutes les passions ; qui n’est pas plus jalouse des actions que des désirs & des pensées ; qui ne nous tient point attachés par quelques chaînes, mais par un nombre innombrable de fils ; qui laisse derriere elle la justice humaine, & commence une autre justice ; qui est faite pour mener sans cesse du repentir à l’amour, & de l’amour au repentir ; qui met entre le juge & le criminel un grand médiateur, entre le juste & le médiateur un grand juge ; une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais quoiqu’elle donne des craintes & des espérance à tous, elle fait assez sentir que, s’il n’y a point de crime qui par sa nature soit inexpiable, toute une vie peut l’être ; qu’il seroit très-dangereux de tourmenter sans cesse la miséricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations ; qu’inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le Seigneur, [III-171] nous devons craindre d’en contracter de nouvelles, de combler la mesure, & d’aller jusqu’au terme où la bonté paternelle finit.
-
[↑] Liv. II. des lois.
-
[↑] Sacrum commissum, quod neque expiari poterit, impiè commissum est ; quod expiari poterit publici facet, dotes expiante.
[III-171]
CHAPITRE XIV.
Comment la force de la religion s’applique à celle des lois civiles.
Comme la religion & les lois civiles doivent tendre principalement à rendre les hommes bons citoyens, on voit que, lorsqu’une des deux s’écartera de ce but, l’autre y doit tendre davantage : moins la religion sera réprimante, plus les lois civiles doivent réprimer.
Ainsi au Japon la religion dominante n’ayant presque point de dogmes, & ne proposant point de paradis ni d’enfer, les lois, pour y suppléer, ont été faites avec une sévérité & exécutées avec une ponctualité extraordinaires.
Lorsque la religion établit le dogme de la nécessité des actions humaines, les peines des lois doivent être plus séveres & la police plus vigilante, pour que les hommes, qui sans cela s’abandonneroient eux-mêmes, soient déterminés [III-172] par ces motifs : mais si la religion établit le dogme de la liberté, c’est autre chose.
De la paresse de l’ame, naît le dogme de la prédestination Mahométane ; & du dogme de cette prédestination, naît la paresse de l’ame. On a dit : Cela est dans les décrets de Dieu ; il faut donc rester en repos. Dans un cas pareil, on doit exciter par les lois les hommes endormis dans la religion.
Lorsque la religion condamne des choses que les lois civiles doivent permettre, il est dangereux que les lois civiles ne permettent de leur côté ce que la religion doit condamner ; une de ces choses marquant toujours un défaut d’harmonie & de justesse dans les idées, qui se répand sur l’autre.
Ainsi les Tartares [1] de Gengiskan, chez lesquels c’étoit un péché, & même un crime capital, de mettre le couteau dans le feu, de s’appuyer contre un fouet, de battre un cheval avec sa bride, de rompre un os avec un autre, ne croyoient pas qu’il y eût de péché à [III-173] violer la foi, à ravir le bien d’autrui, à faire injure à un homme, à le tuer. En un mot, les lois qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ont cet inconvénient, qu’elles font considérer comme indifférent ce qui est nécessaire.
Ceux de Formose [2] croient une espece d’enfer ; mais c’est pour punir ceux qui ont manqué d’aller nuds en certaines saisons, qui ont mis des vêtemens de toile & non pas de soie, qui ont été chercher des huîtres, qui ont agi sans consulter le chant des oiseaux : aussi ne regardent-ils point comme péché l’ivrognerie & le déréglement avec les femmes ; ils croient même que les débauches de leurs enfans sont agréables à leurs dieux.
Lorsque la religion justifie pour une chose d’accident, elle perd inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les hommes. On croit chez les Indiens, que les eaux du Gange ont une vertu sanctifiante [3] ; ceux qui meurent sur ses bords, sont réputés exempts des peines de l’autre vie, & devoir habiter une [III-174] région pleine de délices : on envoie des lieux les plus reculés des urnes pleines des cendres des morts, pour les jeter dans le Gange. Qu’importe qu’on vive vertueusement, ou non ? on se fera jeter dans le Gange.
L’idée d’un lieu de récompense emporte nécessairement l’idée d’un séjour de peines ; & quand on espere l’un sans craindre l’autre, les lois civiles n’ont plus de force. Des hommes qui croient des récompenses sures dans l’autre vie, échapperont au législateur : ils auront trop de mépris pour la mort. Quel moyen de contenir par les lois un homme qui croit être sûr que la plus grande peine que les magistrats lui pourront infliger, ne finira dans un moment que pour commencer son bonheur ?
-
[↑] Voyez la relation de frere Jean Duplan Carpin, envoyé en Tartarie par le pape Innocent IV, en l’année 1246.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. V. partie I. pag. 192
-
[↑] Lettres édif. quinzieme recueil.
[III-174]
CHAPITRE XV.
Comment les lois civiles corrigent quelquefois les fausses religions.
Le respect pour les choses anciennes, la simplicité ou la superstition, ont quelquefois établi des mysteres ou des cérémonies qui pouvoient choquer la [III-175] pudeur ; & de cela les exemples n’ont pas été rares dans le monde. Aristote [1] dit que, dans ce cas, la loi permet que les peres de famille aillent au temple célébrer ces mysteres pour leurs femmes & pour leurs enfans. Loi civile admirable, qui conserve les mœurs contre la religion !
Auguste [2] défendit aux jeunes gens de l’un & l’autre sexe d’assister à aucune cérémonie nocturne, s’ils n’étoient accompagnés d’un parent plus âgé ; & lorsqu’il rétablit les fêtes [3] lupercales, il ne voulut pas que les jeunes gens courussent nuds.
[III-175]
CHAPITRE XVI.
Comment les lois de la religion corrigent les inconvéniens de la constitution politique.
D’un autre côté, la religion peut soutenir l’état politique, lorsque les lois se trouvent dans l’impuissance.
Ainsi, lorsque l’état est souvent agité [III-176] par des guerres civiles, la religion fera beaucoup, si elle établit que quelque partie de cet état reste toujours en paix. Chez les Grecs, les Eléens, comme prêtres d’Apollon, jouissoient d’une paix éternelle. Au Japon [1] , on laisse toujours en paix la ville de Méaco, qui est une ville sainte : la religion maintient ce règlement ; & cet empire, qui semble être seul sur la terre, qui n’a & qui ne veut avoir aucune ressource de la part des étrangers, a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne ruine pas.
Dans les états où les guerres ne se font pas par une délibération commune, & où les lois ne se sont laissé aucun moyen de les terminer ou de les prévenir, la religion établit des temps de paix ou de treves, pour que le peuple puisse faire les choses sans lesquelles l’état ne pourroit subsister, comme les semailles & des travaux pareils.
Chaque année, pendant quatre mois, toute hostilité cessoit entre les tribus [2] Arabes : le moindre trouble eût été une impiété. Quand chaque seigneur faisoit [III-177] en France la guerre ou la paix, la religion donna des treves, qui devoient avoir lieu dans de certaines saisons.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. IV. part. I. pag. 127.
-
[↑] Voyez Prideaux, vie de Mahomet, p. 64.
[III-177]
CHAPITRE XVII.
Continuation du même sujet.
Lorsqu’il y a beaucoup de sujets de haine dans un état, il faut que la religion donne beaucoup de moyens de réconciliation. Les Arabes, peuple brigand, se faisoient souvent des injures & des injustices. Mahomet [1] fit cette loi : « Si quelqu’un pardonne le sang de son frere [2] , il pourra poursuivre le malfaicteur pour des dommages & intérêts : mais celui qui fera tort au méchant après avoir reçu satisfaction de lui, souffrira au jour du jugement des tourmens douloureux. »
Chez les Germains, on héritoit des haines & des inimités de ses proches : mais elles n’étoient pas éternelles. On expioit l’homicide, en donnant une certaine quantité de bétail, & toute la famille recevoit la satisfaction : chose [III-178] très-utile, dit Tacite [3] , parce que les inimitiés sont fort dangereuses chez un peuple libre. Je crois bien que les ministres de la religion, qui avoient tant de crédit parmi eux, entroient dans ces réconciliations.
Chez les Malaïs [4] , où la réconciliation n’est pas établie, celui qui a tué quelqu’un, sûr d’être assassiné par les parens ou les amis du mort, s’abandonne à sa fureur, blesse & tue tout ce qu’il rencontre.
-
[↑] Dans l’alcoran, liv. I. chap. de la vache.
-
[↑] En renonçant à la loi du talion.
-
[↑] De moribus German
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. VII. pag. 303. Voyez aussi les mémoires du comte de Forbin, & ce qu’il dit sur les Macassars.
[III-178]
CHAPITRE XVIII.
Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles.
Les premiers Grecs étoient de petits peuples souvent dispersés, pirates sur la mer, injustes sur la terre, sans police & sans lois. Les belles actions d’Hercule & de Thésée font voir l’état où se trouvoit ce peuple naissant. Que pouvoit faire la religion, que ce qu’elle [III-179] fit pour donner de l’horreur du meurtre ? Elle établit qu’un homme tué par violence [1] étoit d’abord en colere contre le meurtrier, qu’il lui inspiroit du trouble & de la terreur, & vouloit qu’il lui cédât les lieux qu’il avoit fréquentés ; on ne pouvoit toucher le criminel, ni converser avec lui, sans être souillé [2] ou intestable ; la présence du meurtrier devoit être épargnée à la ville, & il falloit l’expier [3] .
-
[↑] Platon, des lois, liv. IX.
-
[↑] Voyez la tragédie d’Œdipe, à Colonne.
-
[↑] Platon, des lois, liv. IX.
[III-179]
CHAPITRE XIX.
Que c’est moins la vérité ou la fausseté d’un dogme, qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans l’état civil, que l’usage ou l’abus que l’on en fait.
Les dogmes les plus vrais & les plus saints peuvent avoir de très-mauvaises conséquences, lorsqu’on ne les lie pas avec les principes de la société ; & au contraire, les dogmes les plus faux en peuvent avoir d’admirables, [III-180] lorsqu’on sait qu’ils se rapportent aux mêmes principes.
La religion de Confucius [1] nie l’immortalité de l’ame ; & la secte de Zénon ne la croyoit pas. Qui le diroit ? ces deux sectes ont tiré de leurs mauvais principes des conséquences, non pas justes, mais admirables pour la société. La religion des Tao & des Foë croit l’immortalité de l’ame : mais de ce dogme si saint, ils ont tiré des conséquences affreuses.
Presque par tout le monde & dans tous les temps, l’opinion de l’immortalité de l’ame mal prise a engagé les femmes, les esclaves, les sujets, les amis, à se tuer, pour aller servir dans l’autre monde l’objet de leur respect ou de leur amour. Cela étoit ainsi dans les Indes occidentales ; cela étoit ainsi chez [III-181] les Danois [2] ; & cela est encore aujourd’hui au Japon [3] , à Macassar [4] & dans plusieurs autres endroits de la terre.
Ces coutumes émanent moins directement du dogme de l’immortalité de l’ame, que de celui de la résurrection des corps ; d’où l’on a tiré cette conséquence, qu’après la mort un même individu auroit les mêmes besoins, les mêmes sentimens, les mêmes passions. Dans ce point de vue, le dogme de l’immortalité de l’ame affecte prodigieusement les hommes ; parce que l’idée d’un simple changement de demeure est plus à la portée de notre esprit, & flatte plus notre cœur, que l’idée d’une modification nouvelle.
Ce n’est pas assez pour une religion d’établir un dogme ; il faut encore qu’elle le dirige. C’est ce qu’a fait admirablement bien la religion Chrétienne à l’égard des dogmes dont nous parlons : elle nous fait espérer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissions : tout, jusqu’à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.
-
[↑] Un philosophe Chinois argumente ainsi contre la doctrine de Foë. « Il est dit dans un livre de cette secte, que notre corps est notre domicile, & l’ame l’hôtesse immortelle qui y loge ; mais si le corps de nos parens n’est qu’un logement, il est naturel de le regarder avec le même mépris qu’on a pour un amas de boue & de terre. N’est-ce pas vouloir arracher du cœur la vertu de l’amour des parens ? Cela porte de même à négliger le soin du corps, & à lui refuser la compassion & l’affection si nécessaires pour sa conservation : ainsi les disciples de Foë se tuent à milliers. » Ouvrage d’un philosophe Chinois, dans le recueil du Pere du Halde, tom. III. p. 52.
-
[↑] Voyez Thomas Bartholin, antiquités Danoises.
-
[↑] Relation du Japon, dans le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes.
-
[↑] Mémoires de Forbin.
[III-182]
CHAPITRE XX.
Continuation du même sujet.
Les livres [1] sacrés des anciens Perses, disoient : « Si vous voulez être saint, instruisez vos enfans, parce que toutes les bonnes actions qu’ils feront vous seront imputées. » Ils conseilloient de se marier de bonne heure ; parce que les enfans seroient comme un pont au jour du jugement, & que ceux qui n’auroient point d’enfans ne pourroient pas passer. Ces dogmes étoient faux, mais ils étoient très-utiles.
-
[↑] M. Hyde.
[III-182]
CHAPITRE XXI.
De la métempsycose.
Le dogme de l’immortalité de l’ame se divise en trois branches, celui de l’immortalité pure, celui du simple changement de demeure, celui de la métempsycose ; c’est-à-dire, le systême des Chrétiens, le systême des Scythes, le systême des Indiens. Je [III-183] viens de parler des deux premiers ; & je dirai du troisieme que, comme il a été bien & mal digéré, il a aux Indes de bons & de mauvais effets : comme il donne aux hommes une certaine horreur pour verser le sang, il y a aux Indes très-peu de meurtres ; & quoiqu’on n’y punisse guere de mort, tout le monde y est tranquille.
D’un autre côté, les femmes s’y brûlent à la mort de leurs maris : il n’y a que les innocens qui y souffrent une mort violente.
[III-183]
CHAPITRE XXII.
Combien il est dangereux que la religion inspire de l’horreur pour des choses indifférentes.
Un certain honneur que des préjugés de religion établissent aux Indes, fait que les diverses castes ont horreur les unes des autres. Cet honneur est uniquement fondé sur la religion ; ces distinctions de famille ne forment pas des distinctions civiles : il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s’il mangeoit avec son roi.
[III-184]
Ces sortes de distinctions sont liées à une certaine aversion pour les autres hommes, bien différente des sentimens que doivent faire naître les différences des rangs, qui parmi nous contiennent l’amour pour les inférieurs.
Les lois de la religion éviteront d’inspirer d’autre mépris que celui du vice, & sur-tout d’éloigner les hommes de l’amour & de la pitié pour les hommes.
La religion Mahométane & la religion Indienne ont dans leur sein un nombre infini de peuples : les Indiens haïssent les Mahométans, parce qu’ils mangent de la vache ; les Mahométans détestent les Indiens, parce qu’ils mangent du cochon.
[III-184]
CHAPITRE XXIII.
Des fêtes.
Quand une religion ordonne la cessation du travail, elle doit avoir égard aux besoins des hommes, plus qu’à la grandeur de l’Être qu’elle honore.
C’étoit à Athenes [1] un grand inconvénient que le trop grand nombre de [III-185] fêtes. Chez ce peuple dominateur, devant qui toutes les villes de la Grece venoient porter leurs différents, on ne pouvoit suffire aux affaires.
Lorsque Constantin établit que l’on chomeroit le dimanche, il fit cette ordonnance pour les villes [2] , & non pour les peuples de la campagne : il sentoit que dans les villes étoient les travaux utiles, & dans les campagnes les travaux nécessaires.
Par la même raison, dans les pays qui se maintiennent par le commerce, le nombre des fêtes doit être relatif à ce commerce même. Les pays protestans & les pays catholiques sont situés [3] de maniere que l’on a plus besoin de travail dans les premiers que dans les seconds : la suppression des fêtes convenoit donc plus aux pays protestans qu’aux pays catholiques.
Dampierre [4] remarque que les divertissemens des peuples varient beaucoup selon les climats. Comme les climats chauds produisent quantité de [III-186] fruits délicats, les barbares, qui trouvent d’abord le nécessaire, emploient plus de temps à se divertir : les Indiens des pays froids n’ont pas tant de loisir, il faut qu’ils pêchent & chassent continuellement ; il y a donc chez eux moins de danses, de musique & de festins ; & une religion qui s’établiroit chez ces peuples, devroit avoir égard à cela dans l’institution des fêtes.
-
[↑] Xénophon, de la république d’Athenes.
-
[↑] Leg. 3. cod. de feriis. Cette loi n’étoit faite sans doute que pour les païens.
-
[↑] Les catholiques sont plus vers le midi, & les protestans vers le nord.
-
[↑] Nouveaux voyages autour du monde, tome II.
[III-186]
CHAPITRE XXIV.
Des lois de religion locales.
Il y a beaucoup de lois locales dans les diverses religions. Et quand Montésuma s’obstinoit tant à dire que la religion des Espagnols étoit bonne pour leur pays, & celle du Mexique pour le sien, il ne disoit pas une absurdité ; parce qu’en effet les législateurs n’ont pu s’empêcher d’avoir égard à ce que la nature avoir établi avant eux.
L’opinion de la métempsycose est faite pour le climat des Indes. L’excessive chaleur brûle [1] toutes les campagnes ; on n’y peut nourrir que très-peu [III-187] de bétail ; on est toujours en danger d’en manquer pour le labourage ; les bœufs ne s’y multiplient [2] que médiocrement, ils sont sujets à beaucoup de maladies : une loi de religion qui les conserve, est donc très-convenable à la police du pays.
Pendant que les prairies sont brûlées, le riz & les légumes y croissent heureusement, par les eaux qu’on y peut employer : une loi de religion qui ne permet que cette nourriture, est donc très-utile aux hommes dans ces climats.
La chair [3] des bestiaux n’y a pas de goût ; & le lait & le beurre qu’ils en tirent, fait une partie de leur subsistance : la loi qui défend de manger & de tuer des vaches, n’est donc pas déraisonnable aux Indes.
Athenes avoit dans son sein une multitude innombrable de peuple ; son territoire étoit stérile : ce fut une maxime religieuse, que ceux qui offroient aux dieux de certains petits présens, les honoroient [4] plus que ceux qui immoloient des bœufs.
-
[↑] Voyage de Bernier, tom. II. pag. 137.
-
[↑] Lett. édif. douzieme recueil, pag. 95.
-
[↑] Voyage de Bernier, tome II. pag. 137.
-
[↑] Euripide dans Athénée, liv. II. pag. 40.
[III-188]
CHAPITRE XXV.
Inconvénient du transport d’une religion d’un pays à un autre.
Il suit de là, qu’il y a très-souvent beaucoup d’inconvéniens à transporter une religion [1] d’un pays dans un autre.
« Le cochon, dit [2] M. de Boulainvilliers, doit être très-rare en Arabie, où il n’y a presque point de bois, & presque rien de propre à la nourriture de ces animaux ; d’ailleurs, la salure des eaux & des alimens, rend le peuple très-susceptible des maladies de la peau. » La loi locale qui le défend, ne sauroit être bonne pour d’autres [3] pays, où le cochon est une nourriture presqu’universelle, & en quelque façon nécessaire.
Je ferai ici une réflexion. Sanctorius a observé que la chair de cochon que l’on mange, se transpire [4] peu ; & que [III-189] même cette nourriture empêche beaucoup la transpiration des autres alimens ; il a trouvé que la diminution alloit à un tiers ; l’on sait d’ailleurs que le défaut de transpiration forme ou aigrit les maladies de la peau : la nourriture du cochon doit donc être défendue dans les climats où l’on est sujet à ces maladies, comme celui de la Palestine, de l’Arabie, de l’Égypte & de la Lybie.
-
[↑] On ne parle point ici de la religion Chrétienne, parce que, comme on a dit au liv. XXIV, chap. i. à la fin, la religion Chrétienne est le premier bien.
-
[↑] Vie de Mahomet.
-
[↑] Comme à la Chine.
-
[↑] Médec. Statiq. sect. 3. aphor. 23.
[III-189]
CHAPITRE XXVI.
Continuation du même sujet.
M. Chardin [1] dit qu’il n’y a point de fleuve navigable en Perse, si ce n’est le fleuve Kur, qui est aux extrémités de l’empire. L’ancienne loi des Guebres qui défendoit de naviguer sur les fleuves, n’avoit donc aucun inconvénient dans leur pays : mais elle auroit ruiné le commerce dans un autre.
Les continuelles lotions sont très en usage dans les climats chauds. Cela fait que la loi Mahométane & la religion [III-190] Indienne les ordonnent. C’est un acte très-méritoire aux Indes de prier [2] Dieu dans l’eau courante : mais comment exécuter ces choses dans d’autres climats ?
Lorsque la religion fondée sur le climat a trop choqué le climat d’un autre pays, elle n’a pu s’y établir ; & quand on l’y a introduite, elle en a été chassée. Il semble, humainement parlant, que ce soit le climat qui a prescrit des bornes à la religion Chrétienne & à la religion Mahométane.
Il suit de là, qu’il est presque toujours convenable qu’une religion ait des dogmes particuliers, & un culte général. Dans les lois qui concernent les pratiques de culte, il faut peu de détails ; par exemples, des mortifications, & non pas une certaine mortification. Le Christianisme est plein de bon sens : l’abstinence est de droit divin ; mais une abstinence particuliere est de droit de police, & on peut la changer.
[III-191]
LIVRE XXV.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de chaque pays, & sa police extérieure.↩
CHAPITRE PREMIER.
Du sentiment pour la religion.
L’homme pieux & l’athée parlent toujours de religion ; l’un parle de ce qu’il aime, & l’autre de ce qu’il craint.
[III-191]
CHAPITRE II.
Du motif d’attachement pour les diverses religions.
Les diverses religions du monde ne donnent pas à ceux qui les professent des motifs égaux d’attachement pour elles : cela dépend beaucoup de la maniere dont elles se concilient avec la façon de penser & de sentir des hommes.
[III-192]
Nous sommes extrêmement portés à l’idolâtrie, & cependant nous ne sommes pas fort attachés aux religions idolâtres ; nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles, & cependant nous sommes très-attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel. C’est un sentiment heureux, qui vient en partie de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d’avoir été assez intelligens pour avoir choisi une religion qui tire la divinité de l’humiliation où les autres l’avoient mise. Nous regardons l’idolâtrie comme la religion des peuples grossiers ; & la religion qui a pour objet un être spirituel, comme celle des peuples éclairés.
Quand, avec l’idée d’un être spirituel suprême, qui forme le dogme, nous pouvons joindre encore des idées sensibles qui entrent dans le culte, cela nous donne un grand attachement pour la religion ; parce que les motifs dont nous venons de parler, se trouvent joints à notre penchant naturel pour les choses sensibles. Aussi les catholiques, qui ont plus de cette sorte de culte que les protestans, sont-ils plus invinciblement attachés à leur religion que les [III-193] protestans ne le sont à la leur, & plus zélés pour sa propagations.
Lorsque [1] le peuple d’Ephese eut appris que les peres du concile avoient décidé qu’on pouvoit appeler la Vierge mere de Dieu, il fut transporté de joie ; il baisoit les mains des évêques, il embrassoit leurs genoux ; tout retentissoit d’acclamations.
Quand une religion intellectuelle nous donne encore l’idée d’un choix fait par la Divinité, & d’une distinction de ceux qui la professent d’avec ceux qui ne la professent pas, cela nous attache beaucoup à cette religion. Les Mahométans ne seroient pas si bons Musulmans, si d’un côté il n’y avoit pas de peuples idolâtres, qui leur font penser qu’ils sont les vengeurs de l’unité de Dieu ; & de l’autre des Chrétiens, pour leur faire croire qu’ils font l’objet de ses préférences.
Une religion chargée de beaucoup [2] de pratiques, attache plus à elle qu’une autre qui l’est moins : on tient beaucoup [III-194] aux choses dont on est continuellement occupé ; témoin l’obstination tenace des Mahométans [3] & des Juifs, & la facilité qu’ont de changer de religion les peuples barbares & sauvages qui, uniquement occupés de la chasse ou de la guerre, ne se chargent guere de pratiques religieuses.
Les hommes sont extrêmement portés à espérer & à craindre ; & une religion qui n’auroit ni enfer ni paradis, ne sauroit guere leur plaire. Cela se prouve par la facilité qu’ont eue les religions étrangeres à s’établir au Japon, & le zele & l’amour avec lesquels on les y a reçues [4] .
Pour qu’une religion attache, il faut qu’elle ait une morale pure. Les hommes, fripons en détail, sont en gros de très-honnêtes gens ; ils aiment la morale ; & si je ne traitois pas un sujet si grave, je dirois que cela se voit [III-195] admirablement bien sur les théâtres : on est sûr de plaire au peuple par les sentimens que la morale avoue, & on est sûr de le choquer par ceux qu’elle réprouve.
Lorsque le culte extérieur a une grande magnificence, cela nous flatte & nous donne beaucoup d’attachement pour la religion. Les richesses des temples & celles du clergé, nous affectent beaucoup. Ainsi la misere même des peuples est un motif qui les attache à cette religion qui a servi de prétexte à ceux qui ont causé leur misere.
-
[↑] Lettre de S. Cyrille.
-
[↑] Ceci n’est point contradictoire avec ce que j’ai dit au chapitre pénultieme du livre précédent ; ici je parle des motifs d’attachement pour une religion, & là des moyens de la rendre plus générale.
-
[↑] Cela se remarque par toute la terre. Voyez sur les Turcs les missions du Levant ; le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome III. part. I. pag. 201, sur les Maures de Batavia ; & le P. Labat, sur les negres Mahométans, &c.
-
[↑] La religion Chrétienne & les religions des Indes ; celles-ci ont un enfer & un paradis, au lieu que la religion des Sintos n’en a point.
[III-195]
CHAPITRE III.
Des Temples.
Presque tous les peuples policés habitent dans des maisons. De-là est venue naturellement l’idée de bâtir à Dieu une maison, où ils puissent l’adorer & l’aller chercher dans leurs craintes ou leurs espérances.
En effet, rien n’est plus consolant pour les hommes, qu’un lieu où ils trouvent la Divinité plus présente, & où tous ensemble ils font parler leur foiblesse & leur misere.
[III-196]
Mais cette idée si naturelle ne vient qu’aux peuples qui cultivent les terres ; & on ne verra pas bâtir de temple chez ceux qui n’ont pas de maisons eux-mêmes.
C’est ce qui fit que Gengis-kan marqua un si grand mépris pour les mosquées [1] . Ce prince [2] interrogea les Mahométans ; il approuva tous leurs dogmes, excepté celui qui porte la nécessité d’aller à la Mecque ; il ne pouvoit pas comprendre qu’on ne pût pas adorer Dieu par-tout : les Tartares n’habitant point de maisons, ne connoissoient point de temples.
Les peuples qui n’ont point de temples, ont peu d’attachement pour leur religion : voilà pourquoi les Tartares ont été de tout temps si tolérans [3] ; pourquoi les peuples barbares qui conquirent l’empire Romain ne balancerent pas un moment à embrasser le Christianisme ; pourquoi les sauvages de l’Amérique sont si peu attachés à leur [III-197] propre religion ; & pourquoi, depuis que nos missionnaires leur ont fait bâtir au Paraguay des églises, ils sont si fort zélés pour la nôtre.
Comme la divinité est le réfuge des malheureux, & qu’il n’y a pas de gens plus malheureux que les criminels, on a été naturellement porté à penser que les temples étoient un asile pour eux ; & cette idée parut encore plus naturelle chez les Grecs, où les meurtriers, chassés de leur ville & de la présence des hommes, sembloient n’avoir plus de maisons que les temples, ni d’autres protecteurs que les dieux.
Ceci ne regarda d’abord que les homicides involontaires : mais lorsqu’on y comprit les grands criminels, on tomba dans une contradiction grossiere : s’ils avoient offensé les hommes, ils avoient à plus forte raison offensé les dieux.
Ces asiles se multiplierent dans la Grece : les temples, dit [4] Tacite, étoient remplis de débiteurs insolvables & d’esclaves méchans ; les magistrats avoient de la peine à exercer la police ; le peuple protégeoit les crimes des hommes, comme les cérémonies des dieux ; [III-198] le sénat fut obligé d’en retrancher un grand nombre.
Les lois de Moyse furent très-sages. Les homicides involontaires étoient innocens, mais ils devoient être ôtés de devant les yeux des parens du mort : il établit donc un asyle [5] pour eux. Les grands criminels ne méritent point d’asyle, ils n’en eurent pas [6] : les Juifs n’avoient qu’un tabernacle portatif, & qui changeoit continuellement de lieu ; cela excluoit l’idée d’asyle. Il est vrai qu’ils devoient avoir un temple : mais les criminels qui y seroient venus de toutes parts, auroient pu troubler le service divin. Si les homicides avoient été chassés hors du pays, comme ils le furent chez les Grecs, il eût été à craindre qu’ils n’adorassent des dieux étrangers. Toutes ces considérations firent établir des villes d’asyle, ou l’on devoit rester jusqu’à la mort du souverain pontife.
-
[↑] Entrant dans la mosquée de Buchara, il enleva l’alcoran, & le jeta sous les pieds de ses chevaux ; histoire des Tattars, part. III. p. 273.
-
[↑] Ibid. page 342.
-
[↑] Cette disposition d’esprit a passé jusqu’aux Japonois, qui tirent leur origine des Tartares, comme il est aisé de le prouver.
-
[↑] Annal. liv. II.
-
[↑] Nomb. Chap. xxxv.
-
[↑] Ibid.
[III-199]
CHAPITRE IV.
Des Ministres de la Religion.
Les premiers hommes, dit Porphyre, ne sacrifoient que de l’herbe. Pour un culte si simple, chacun pouvoit être pontife dans sa famille.
Le désir naturel de plaire à la Divinité, multiplia les cérémonies : ce qui fit que les hommes, occupés à l’agriculture, devinrent incapables de les exécuter toutes, & d’en remplir les détails.
On consacra aux dieux des lieux particuliers ; il fallut qu’il y eût des ministres pour en prendre soin, comme chaque citoyen prend soin de sa maison & de ses affaires domestiques. Aussi les peuples qui n’ont point de prêtres, sont-ils ordinairement barbares. Tels étoient autrefois les Pédaliens [1] , tels sont encore les Wolgusky [2] .
Des gens consacrés à la divinité, devoient être honorés, sur-tout chez les [III-200] peuples qui s’étoient formé une certaine idée d’une pureté corporelle, nécessaire pour approcher des lieux les plus agréables aux dieux, & dépendante de certaines pratiques.
Le culte des dieux demandant une attention continuelle, la plupart des peuples furent portés à faire du clergé un corps séparé. Ainsi, chez les Égyptiens, les Juifs & les Perses [3] , on consacra à la divinité de certaines familles, qui se perpétuoient, & faisoient le service. Il y eut même des religions où l’on ne pensa pas seulement à éloigner les ecclésiastiques des affaires, mais encore à leur ôter l’embarras d’une famille, & c’est la pratique de la principale branche de la loi Chrétienne.
Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat : on sent qu’elle pourroit devenir nuisible, à proportion que le corps du clergé seroit trop étendu, & que par conséquent celui des laïques ne le seroit pas assez.
Par la nature de l’entendement humain, nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort ; comme en matiere de morale, nous aimons [III-201] spéculativement tout ce qui porte le caractere de la sévérité. Le célibat a été plus agréable aux peuples à qui il sembloit convenir le moins, & pour lesquels il pouvoit avoir de plus fâcheuses suites. Dans les pays du midi de l’Europe, où, par la nature du climat, la loi du célibat est plus difficile à observer, elle a été retenue ; dans ceux du nord, où les passions sont moins vives, elle a été proscrite. Il y a plus : dans les pays où il y a peu d’habitans, elle a été admise ; dans ceux où il y en a beaucoup, on l’a rejettée. On sent que toutes ces réflexions ne portent que sur la trop grande extension du célibat, & non sur le célibat même.
-
[↑] Lilius Giraldus, page 726.
-
[↑] Peuples de la Sibérie. Voyez la relation de M. Everard Isbrands-Ides, dans le recueil des voyages du nord, tome VIII.
-
[↑] Voyez M. Hyde.
[III-201]
CHAPITRE V.
Des bornes que les lois doivent mettre aux richesses du clergé.
Les familles particulieres peuvent périr : ainsi les biens n’y ont point une destination perpétuelle. Le clergé est une famille qui ne peut pas périr : les biens y sont donc attachés pour toujours, & n’en peuvent pas sortir.
[III-202]
Les familles particulieres peuvent s’augmenter : il faut donc que leurs biens puissent croître aussi. Le clergé est une famille qui ne doit point s’augmenter : les biens doivent donc y être bornés.
Nous avons retenu les dispositions du Lévitique sur les biens du clergé, excepté celles qui regardent les bornes de ces biens : effectivement, on ignorera toujours parmi nous quel est le terme après lequel il n’est plus permis à une communauté religieuse d’acquérir.
Ces acquisitions sans fin paroissent aux peuples si déraisonnables, que celui qui voudroit parler pour elles, seroit regardé comme un imbécile.
Les lois civiles trouvent quelquefois des obstacles à changer des abus établis, parce qu’ils sont liés à des choses qu’elles doivent respecter : dans ce cas, une disposition indirecte marque plus le bon esprit du législateur, qu’une autre qui frapperoit sur la chose même. Au lieu de défendre les acquisitions du clergé, il faut chercher à l’en dégoûter lui-même ; laisser le droit, & ôter le fait.
Dans quelques pays de l’Europe, la considération des droits des seigneurs a fait établir en leur faveur un droit [III-203] d’indemnité sur les immeubles acquis par les gens de main-morte. L’intérêt du prince lui a fait exiger un droit d’amortissement dans le même cas. En Castille, où il n’y a point de droit pareil, le clergé a tout envahi ; en Arragon, où il y a quelque droit d’amortissement, il a acquis moins ; en France, où ce droit & celui d’indemnité sont établis, il a moins acquis encore ; & l’on peut dire que la prospérité de cet état est due en partie à l’exercice de ces deux droits. Augmentez-les ces droits, & arrêtez la main-morte, s’il est possible.
Rendez sacré & inviolable l’ancien & nécessaire domaine du clergé ; qu’il soit fixe & éternel comme lui : mais laissez sortir de ses mains les nouveaux domaines.
Permettez de violer la regle, lorsque la regle est devenue un abus ; souffrez l’abus, lorsqu’il rentre dans la regle.
On se souvient toujours à Rome d’un mémoire qui y fut envoyé à l’occasion de quelque démêlés avec le clergé. On y avoit mis cette maxime : « Le clergé doit contribuer aux charges de l’état, quoi qu’en dise l’ancien testament ». On en conclut que l’auteur du mémoire [III-204] entendoit mieux le langage de la maltôte que celui de la religion.
[III-204]
CHAPITRE VI.
Des Monasteres.
Le moindre bon sens fait voir que ces corps qui se perpétuent sans fin, ne doivent pas vendre leurs fonds à vie, ni faire des emprunts à vie, à moins qu’on ne veuille qu’ils se rendent héritiers de tous ceux qui n’ont point de parens, & de tous ceux qui n’en veulent point avoir : ces gens jouent contre le peuple, mais ils tiennent la banque contre lui.
[III-204]
CHAPITRE VII.
Du luxe de la superstition.
Ceux-la sont impies envers les dieux, dit Platon [1] , qui nient leur existence ; ou qui l’accordent, mais soutiennent qu’ils ne se mêlent point des choses d’ici-bas ; ou enfin qui pensent qu’on les appaise aisément par des sacrifices : trois opinions [III-205] également pernicieuses ». Platon dit là tout ce que la lumiere naturelle a jamais dit de plus sensé en matiere de religion.
La magnificence du culte extérieur a beaucoup de rapport à la constitution de l’état. Dans les bonnes républiques, on n’a pas seulement réprimé le luxe de la vanité, mais encore celui de la superstition : on a fait dans la religion des lois d’épargne. De ce nombre, sont plusieurs lois de Solon, plusieurs lois de Platon sur les funérailles, que Cicéron a adoptées ; enfin quelques lois de Numa [2] sur les sacrifices.
« Des oiseaux, dit Cicéron, & des peintures faites en un jour, sont des dons très-divins. Nous offrons des choses communes, disoit un Spartiate, afin que nous ayons tous les jours le moyen d’honorer les dieux ».
Le soin que les hommes doivent avoir de rendre un culte à la divinité, est bien différent de la magnificence de ce culte. Ne lui offrons point nos trésors, si nous ne voulons lui faire voir l’estime que nous faisons des choses qu’elle veut que nous méprisions.
[III-206]
« Que doivent penser les dieux des dons des impies, dit admirablement Platon, puisqu’un homme de bien rougiroit de recevoir des présens d’un malhonnête homme ? »
Il ne faut pas que la religion, sous prétexte de dons, exige des peuples ce que les nécessités de l’état leur ont laissé ; &, comme dit Platon [3] , des hommes chastes & pieux doivent offrir des choses qui leur ressemblent.
Il ne faudroit pas non plus que la religion encourageât les dépenses des funérailles. Qu’y a-t-il de plus naturel, que d’ôter la différence des fortunes dans une chose & dans les momens qui égalisent toutes les fortunes ?
[III-206]
CHAPITRE VIII.
Du Pontificat.
Lorsque la religion a beaucoup de ministres, il est naturel qu’ils ayent un chef, & que le pontificat y soit établi. Dans la monarchie, où l’on ne sauroit trop séparer les ordres de l’état, & où l’on ne doit point assembler sur [III-207] une même tête toutes les puissances, il est bon que le pontificat soit séparé de l’empire. La même nécessité ne se rencontre pas dans le gouvernement despotique, dont la nature est de réunir sur une même tête tous les pouvoirs. Mais, dans ce cas, il pourroit arriver que le prince regarderoit la religion comme ses lois mêmes, & comme des effets de sa volonté. Pour prévenir cet inconvénient, il faut qu’il y ait des monumens de la religion, par exemple, des livres sacrés qui la fixent & qui l’établissent. Le roi de Perse est le chef de la religion ; mais l’alcoran regle la religion : l’empereur de la Chine est le souverain pontife ; mais il y a des livres qui sont entre les mains de tout le monde, auxquels il doit lui-même se conformer. En vain un empereur voulut-il les abolir, ils triompherent de la tyrannie.
[III-208]
CHAPITRE IX.
De la tolérance en fait de religion.
Nous sommes ici politiques, & non pas théologiens : & pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion & l’approuver.
Lorsque les lois d’un état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu’elles les obligent aussi à se tolérer entr’elles. C’est un principe, que toute religion qui est réprimée, devient elle-même réprimante : car sitôt que, par quelque hasard, elle peut sortir de l’oppression, elle attaque la religion qui l’a réprimée, non pas comme une religion, mais comme une tyrannie.
Il est donc utile que les lois exigent de ces diverses religions, non-seulement qu’elles ne troublent pas l’état, mais aussi qu’elles ne se troublent pas entr’elles. Un citoyen ne satisfait point aux lois, en se contentant de ne pas agiter le corps de l’état ; il faut encore qu’il ne trouble pas quelque citoyen que ce soit.
[III-209]
CHAPITRE X.
Continuation du même sujet.
Comme il n’y a guere que les religions intolérantes qui ayent un grand zele pour s’établir ailleurs, parce qu’une religion qui peut tolérer les autres ne songe guere à sa propagation ; ce sera une très-bonne loi civile, lorsque l’état est satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l’établissement [1] d’une autre.
Voici donc le principe fondamental des lois politiques en fait de religion. Quand on est maître de recevoir dans un état une nouvelle religion, ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l’y établir ; quand elle y est établie, il faut la tolérer.
-
[↑] Je ne parle point dans tout ce chapitre de la religion Chrétienne : parce que, comme j’ai dit ailleurs, la religion Chrétienne est le premier bien. Voyez la fin du chapitre I. du livre précédent, & la défense de l’esprit des lois, seconde partie.
[III-210]
CHAPITRE XI.
Du changement de religion.
Un prince qui entreprend dans son état de détruire ou de changer la religion dominante, s’expose beaucoup. Si son gouvernement est despotique, il court plus de risque de voir une révolution, que par quelque tyrannie que ce soit, qui n’est jamais dans ces sortes d’états une chose nouvelle. La révolution vient de ce qu’un état ne change pas de religion, de mœurs & de manieres dans un instant, & aussi vîte que le prince publie l’ordonnance qui établit une religion nouvelle.
De plus, la religion ancienne est liée avec la constitution de l’état, & la nouvelle n’y tient point : celle-là s’accorde avec le climat, & souvent la nouvelle s’y refuse. Il y a plus : les citoyens se dégoûtent de leurs lois ; ils prennent du mépris pour le gouvernement déjà établi ; on substitue des soupçons contre les deux religions, à une ferme croyance pour une ; en un mot, l’on donne à l’état, au moins pour [III-211] quelque temps, & de mauvais citoyens, & de mauvais fideles.
[III-211]
CHAPITRE XII.
Des lois pénales.
Il faut éviter les lois pénales en fait de religion. Elles impriment de la crainte, il est vrai : mais comme la religion a ses lois pénales aussi qui inspirent de la crainte, l’une est effacée par l’autre. Entre ces deux craintes différentes, les ames deviennent atroces.
La religion a de si grandes menaces, elle a de si grandes promesses, que lorsqu’elles sont présentes à notre esprit, quelque chose que le magistrat puisse faire pour nous contraindre à la quitter, il semble qu’on ne nous laisse rien quand on nous l’ôte, & qu’on ne nous ôte rien lorsqu’on nous la laisse.
Ce n’est donc pas en remplissant l’ame de ce grand objet, en l’approchant du moment où il lui doit être d’une plus grande importance, que l’on parvient à l’en détacher : il est plus sûr d’attaquer une religion par la faveur, par les commodités de la vie, par l’espérance de la [III-212] fortune ; non pas par ce qui avertit, mais par ce qui fait que l’on oublie ; non pas par ce qui indigne, mais par ce qui jette dans la tiédeur, lorsque d’autres passions agissent sur nos ames, & que celles que la religion inspire sont dans le silence. Regle générale : en fait de changement de religion, les invitations sont plus fortes que les peines.
Le caractere de l’esprit humain a paru dans l’ordre même des peines qu’on a employées. Que l’on se rappelle les persécutions du Japon [1] ; on se révolta plus contre les supplices cruels que contre les peines longues, qui lassent plus qu’elles n’effarouchent, qui sont plus difficiles à surmonter, parce qu’elles paroissent moins difficiles.
En un mot, l’histoire nous apprend assez que les lois pénales n’ont jamais eu d’effet que comme destruction.
-
[↑] Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome V., part. I. page 192.
[III-213]
CHAPITRE XIII.
Très-humble remontrance aux Inquisiteurs d’Espagne & de Portugal.
Une Juive de dix-huit ans, brûlée à Lisbonne au dernier auto-da-fé, donna occasion à ce petit ouvrage ; & je crois que c’est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s’agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre.
L’auteur déclare que, quoiqu’il soit Juif, il respecte la religion Chrétienne, & qu’il l’aime assez, pour ôter aux princes qui ne seront pas Chrétiens un prétexte plausible pour la persécuter.
« Vous vous plaignez, dit-il aux Inquisiteurs, de ce que l’empereur du Japon fait brûler à petit feu tous les Chrétiens qui sont dans ses états ; mais il vous répondra : Nous vous traitons, vous qui ne croyez pas comme nous, comme vous traitez vous-mêmes ceux qui ne croient pas comme vous : vous ne pouvez vous plaindre que de votre foiblesse, qui vous empêche de nous exterminer, & qui fait que nous vous exterminons.
[III-214]
» Mais il faut avouer que vous être bien plus cruels que cet empereur. Vous nous faites mourir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez, parce que nous ne croyons pas tout ce que vous croyez. Nous suivons une religion que vous savez vous-mêmes avoir autrefois été chérie de Dieu : nous pensons que Dieu l’aime encore, & vous pensez qu’il ne l’aime plus ; & parce que vous jugez ainsi, vous faites passer par le fer & par le feu ceux qui sont dans cette erreur si pardonnable, de croire que Dieu [1] aime encore ce qu’il a aimé.
» Si vous êtes cruels à notre égard, vous l’êtes bien plus à l’égard de nos enfans ; vous les faites brûler, parce qu’ils suivent les inspirations que leur ont données ceux que la loi naturelle & les lois de tous les peuples leur apprennent à respecter comme des dieux.
» Vous vous privez de l’avantage que vous a donné sur les Mahométans la maniere dont leur religion s’est établie. Quand ils se vantent du nombre de [III-215] leurs fideles, vous leur dites que la force les leur a acquis, & qu’ils ont étendu leur religion par le fer : pourquoi donc établissez-vous la vôtre par le feu ?
» Quand vous voulez nous faire venir à vous, nous vous objectons une source dont vous vous faites gloire de descendre. Vous nous répondez que votre religion est nouvelle, mais qu’elle est divine ; & vous le prouvez parce qu’elle s’est accrue par la persécution des païens & par le sang de vos martyrs : mais aujourd’hui vous prenez le rôle des Dioclétiens, & vous nous faites prendre le vôtre.
» Nous vous conjurons, non pas par le Dieu puissant que nous servons vous & nous, mais par le Christ que vous nous dites avoir pris la condition humaine pour vous proposer des exemples que vous puissiez suivre ; nous vous conjurons d’agir avec nous comme il agiroit lui-même, s’il étoit encore sur la terre. Vous voulez que nous soyons Chrétiens, & vous ne voulez pas l’être.
» Mais si vous ne voulez pas être Chrétiens, soyez au moins des hommes : traitez-nous comme vous feriez, si n’ayant que ces foibles lueurs de [III-216] justice que la nature nous donne, vous n’aviez point une religion pour vous conduire, & une révélation pour vous éclairer.
» Si le ciel vous a assez aimés pour vous faire voir la vérité, il vous a fait une grande grace : mais est-ce aux enfans qui ont l’héritage de leur pere, de haïr ceux qui ne l’ont pas eu ?
» Que si vous avez cette vérité, ne nous la cachez pas par la maniere dont vous nous la proposez. Le caractere de la vérité, c’est son triomphe sur les cœurs & les esprits, & non pas cette impuissance que vous avouez, lorsque vous voulez la faire recevoir par des supplices.
» Si vous êtes raisonnables, vous ne devez pas nous faire mourir, parce que nous ne voulons pas vous trompez. Si votre Christ est le fils de Dieu, nous espérons qu’il nous récompensera de n’avoir pas voulu profaner ses mysteres : & nous croyons que le Dieu que nous servons vous & nous, ne nous punira pas de ce que nous avons souffert la mort pour une religion qu’il nous a autrefois donnée, parce que nous croyons qu’il nous l’a encore donnée.
[III-217]
» Vous vivez dans un siecle où la lumiere naturelle est plus vive qu’elle n’a jamais été, où la philosophie a éclairé les esprits, où la morale de votre évangile a été plus connue, où les droits respectifs des hommes les uns sur les autres, l’empire qu’une conscience a sur une autre conscience, sont mieux établis. Si donc vous ne revenez pas de vos anciens préjugés, qui, si vous n’y prenez garde, sont vos passions, il faut avouer que vous êtes incorrigibles, incapables de toute lumiere & de toute instruction ; & une nation est bien malheureuse, qui donne de l’autorité à des hommes tels que vous.
» Voulez-vous que nous vous disions naïvement notre pensée ? Vous nous regardez plutôt comme vos ennemis, que comme les ennemis de votre religion ; car si vous aimiez votre religion, vous ne la laisseriez pas corrompre par une ignorance grossiere.
» Il faut que nous vous avertissions d’une chose ; c’est que, si quelqu’un dans la postérité ose jamais dire que dans le siecle où nous vivons, les peuples d’Europe étoient policés, on vous citera pour prouver qu’ils étoient [III-218] barbares ; & l’idée que l’on aura de vous, sera telle, qu’elle flétrira votre siecle, & portera la haine sur tous vos contemporains. »
-
[↑] C’est la source de l’aveuglement des Juifs, de ne pas sentir que l’économie de l’évangile est dans l’ordre des desseins de Dieu ; & qu’ainsi elle est une suite de son immutabilité même.
[III-218]
CHAPITRE XIV.
Pourquoi la religion Chrétienne est si odieuse au Japon.
J’ai parlé [1] du caractere atroce des armes Japonoises. Les magistrats regarderent la fermeté qu’inspire le Christianisme lorsqu’il s’agit de renoncer à la foi, comme très-dangereuse : on crut voir augmenter l’audace. La loi du Japon puni sévérement la moindre désobéissance : on ordonna de renoncer à la religion Chrétienne : n’y pas renoncer, c’étoit désobéir ; on châtia ce crime, & la continuation de la désobéissance parut mériter un autre châtiment.
Les punitions chez les Japonois sont regardées comme la vengeance d’une insulte faite au prince. Les chants d’alégresse de nos martyrs parurent être un attentat contre lui : le titre de martyr intimida les magistrats ; dans leur esprit, il signifioit rebelle ; ils firent tout pour [III-219] empêcher qu’on ne l’obtînt. Ce fut alors que les ames s’effaroucherent, & que l’on vit un combat horrible entre les tribunaux qui condamnerent & les accusés qui souffrirent, entre les lois civiles & celles de la religion.
-
[↑] Liv. VI. chap. xxiv.
[III-219]
CHAPITRE XV.
De la propagation de la religion.
Tous les peuples d’orient, excepté les Mahométans, croient toutes les religions en elles-mêmes indifférentes. Ce n’est que comme changement dans le gouvernement, qu’ils craignent l’établissement d’une autre religion. Chez les Japonois, où il y a plusieurs sectes, & où l’état a eu si long-temps un chef ecclésiastique, on ne dispute [1] jamais sur la religion. Il en est de même chez les Siamois [2] . Les Calmouks [3] font plus ; ils se font une affaire de conscience de souffrir toutes sortes de religions : À Calicuth [4] c’est une maxime d’état, que toute religion est bonne.
[III-220]
Mais il n’en résulte pas qu’une religion apportée d’un pays très-éloigné, & totalement différent de climat, de lois, de mœurs & de manieres, ait tout le succès que sa sainteté devroit lui promettre. Cela est sur-tout vrai dans les grands empires despotiques : on tolere d’abord les étrangers, parce qu’on ne fait point d’attention à ce qui ne paroît pas blesser la puissance du prince : on y est dans une ignorance extrême de tout. Un Européen peut se rendre agréable par de certaines connoissances qu’il procure : cela est bon pour les commencemens. Mais sitôt que l’on a quelque succès, que quelque dispute s’éleve, que les gens qui peuvent avoir quelque intérêt sont avertis ; comme cet état, par sa nature, demande sur-tout la tranquillité, & que le moindre trouble peut le renverser, on proscrit d’abord la religion nouvelle & ceux qui l’annoncent ; les disputes entre ceux qui prêchent, venant à éclater, on commence à se dégoûter d’une religion, dont ceux qui la proposent ne conviennent pas.
-
[↑] Voyez Kempfer.
-
[↑] Mémoires du comte de Forbin.
-
[↑] Histoire des Tattars, part. V.
-
[↑] Voyage de François Pyrard, ch. xxvii.
[III-221]
LIVRE XXVI.
Des Lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée de ce Livre.
Les hommes sont gouvernés par diverses sortes de lois ; par le droit naturel ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appelé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu’on peut considérer comme le droit civil de l’univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le droit de conquête, fondé sur ce qu’un peuple [III-222] a voulu, a pu, ou a dû faire violence à un autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens & sa vie contre tout autre citoyen ; enfin par le droit domestique, qui vient de ce qu’une société est divisée en diverses familles, qui ont besoin d’un gouvernement particulier.
Il y a donc différens ordres de lois ; & la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, & à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.
[III-222]
CHAPITRE II.
Des lois divines & des lois humaines.
On ne doit point statuer par les lois divines ce qui doit l’être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l’être par les lois divines.
Ces deux sortes de lois different par leur origine, par leur objet, & par leur nature.
Tout le monde convient bien que les [III-223] lois humaines sont d’une autre nature que les lois de la religion, & c’est un grand principe : mais ce principe lui-même est soumis à d’autres, qu’il faut chercher.
I°. La nature des lois humaines est d’être soumise à tous les accidens qui arrivent, & de varier à mesure que les volontés des hommes changent : au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien ; la religion sur le meilleur. Le bien peut avoir un autre objet, parce qu’il y a plusieurs biens ; mais le meilleur n’est qu’un, il ne peut donc pas changer. On peut bien changer les lois, parce qu’elles ne sont censées qu’être bonnes : mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures.
2°. Il y a des états où les lois ne sont rien, ou ne sont qu’une volonté capricieuse & transitoire du souverain. Si, dans ces états, les lois de la religion étoient de la nature des lois humaines, les lois de la religion ne seroient rien non plus : il est pourtant nécessaire à la société qu’il y ait quelque chose de fixe ; & c’est cette religion qui est quelque chose de fixe.
[III-224]
3°. La force principale de la religion vient de ce qu’on la croit ; la force des lois humaines vient de ce qu’on les craint. L’antiquité convient à la religion, parce que souvent nous croyons plus les choses à mesure qu’elles sont plus reculées : car nous n’avons pas dans la tête des idées accessoires tirées de ces temps-là, qui puissent les contredire. Les lois humaines au contraire, tirent avantage de leur nouveauté, qui annonce une attention particuliere & actuelle du législateur, pour les faire observer.
[III-224]
CHAPITRE III.
Des lois civiles qui sont contraires à la loi naturelle.
Si un esclave, dit Platon [1] , se défend & tue un homme libre, il doit être traité comme un parricide. Voilà une loi civile qui punit la défense naturelle.
La loi qui, sous Henri VIII, condamnoit un homme sans que les témoins lui eussent été confrontés, étoit [III-225] contraire à la défense naturelle : en effet, pour qu’on puisse condamner, il faut bien que les témoins sachent que l’homme contre qui ils déposent, est celui que l’on accuse, & que celui-ci puisse dire, ce n’est pas moi dont vous parlez.
La loi passée sous le même regne, qui condamnoit toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un, ne le déclareroit point au roi, avant de l’épouser, violoit la défense de la pudeur naturelle : il est aussi déraisonnable d’exiger d’une fille qu’elle fasse cette déclaration, que de demander d’un homme qu’il ne cherche pas à défendre sa vie.
La loi de Henri II, qui condamne à mort une fille dont l’enfant a péri, en cas qu’elle n’ait point déclaré au magistrat sa grossesse, n’est pas moins contraire à la défense naturelle. Il suffisoit de l’obliger d’en instruire une de ses plus proches parentes, qui veillât à la conservation de l’enfant.
Quel autre aveu pourroit-elle faire, dans ce supplice de la pudeur naturelle ? L’éducation a augmenté en elle l’idée de la conservation de cette pudeur ; & à peine dans ces momens est-il resté en elle une idée de la perte de la vie.
[III-226]
On a beaucoup parlé d’une loi d’Angleterre [2] , qui permettoit à une fille de sept ans de se choisir un mari. Cette loi étoit révoltante de deux manieres : elle n’avoit aucun égard au temps de la maturité que la nature a donné à l’esprit, ni au temps de la maturité qu’elle a donné au corps.
Un pere pouvoit, chez les Romains, obliger sa fille à répudier [3] son mari, quoiqu’il eût lui-même consenti au mariage. Mais il est contre la nature que le divorce soit mis entre les mains d’un tiers.
Si le divorce est conforme à la nature, il ne l’est que lorsque les deux parties, ou au moins une d’elles, y consentent ; & lorsque ni l’une ni l’autre n’y consentent, c’est un monstre que le divorce. Enfin la faculté du divorce ne peut être donnée qu’à ceux qui ont les incommodités du mariage, & qui sentent le moment où ils ont intérêt de les faire cesser.
-
[↑] Liv. IX, des lois.
-
[↑] M. Bayle, dans sa critique de l’histoire du Calvinisme, parle de cette loi, p. 293.
-
[↑] Voyez la loi V, au code de repudiis & judicio de moribus sublato.
[III-227]
CHAPITRE IV.
Continuation du même sujet.
Gondebaud [1] roi de bourgogne, vouloit que si la femme ou le fils de celui qui avoit volé, ne révéloit pas le crime, ils fussent réduits en esclavage. Cette loi étoit contre la nature. Comment une femme pouvoit-elle être accusatrice de son mari ? Comment un fils pouvoit-il être accusateur de son pere ? Pour venger une action criminelle, il en ordonnoit une plus criminelle encore.
La loi de [2] Recessuinde permettoit aux enfans de la femme adultere, ou à ceux de son mari, de l’accuser, & de mettre à la question les esclaves de la maison. Loi inique, qui, pour conserver les mœurs, renversoit la nature, d’où tirent leur origine les mœurs.
Nous voyons avec plaisir sur nos théâtres un jeune héros montrer autant d’horreur pour découvrir le crime de sa belle-mere, qu’il en avoit eu pour le crime même ; il ose à peine, dans sa [III-228] surprise, accusé, jugé, condamné, proscrit & couvert d’infamie, faire quelques réflexions sur le sang abominable dont Phedre est sortie : il abandonne ce qu’il a de plus cher, & l’objet le plus tendre, tout ce qui parle à son cœur, tout ce qui peut l’indigner, pour aller se livrer à la vengeance des dieux qu’il n’a point méritée. Ce sont les accens de la nature qui causent ce plaisir ; c’est la plus douce de toutes les voix.
[III-228]
CHAPITRE V.
Cas où l’on peut juger par les principes du droit civil, en modifiant les principes du droit naturel.
Une loi d’Athenes obligeoit [1] les enfans de nourrir leurs peres tombés dans l’indigence ; elle exceptoit ceux qui étoient nés [2] d’une courtisane, ceux dont le pere avoit exposé la pudicité par un trafic infame, ceux à qui [3] il n’avoit point donné de métier pour gagner leur vie.
[III-229]
La loi considéroit que, dans le premier cas, le pere se trouvant incertain, il avoit rendu précaire son obligation naturelle : que, dans le second, il avoit flétri la vie qu’il avoit donnée ; & que le plus grand mal qu’il pût faire à ses enfans, il l’avoit fait, en les privant de leur caractere : que dans le troisieme, il leur avoit rendu insupportable une vie qu’ils trouvoient tant de difficulté à soutenir. La loi n’envisageoit plus le pere & le fils que comme deux citoyens, ne statuoit plus que sur des vues politiques & civiles ; elle considéroit que, dans une bonne république, il faut sur-tout des mœurs. Je crois bien que la loi de Solon étoit bonne dans les deux premiers cas, soit celui où la nature laisse ignorer au fils quel est son pere, soit celui où elle semble même lui ordonner de le méconnoître : mais on ne sauroit l’approuver dans le troisieme, où le pere n’avoit violé qu’un règlement civil.
-
[↑] Sous peine d’infamie ; une autre sous peine de prison.
-
[↑] Plutarque, vie de Solon.
-
[↑] Plutarque, vie de Solon ; & Gallien, in exhort. ad Art. ch. viii.
[III-230]
CHAPITRE VI.
Que l’ordre des successions dépend des principes du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel.
La loi Voconienne ne permettoit point d’instituer une femme héritiere, pas même sa fille unique. Il n’y eut jamais, dit S. Augustin [1] , une loi injuste. Une formule de [2] Marculfe traite d’impie la coutume qui prive les filles de la succession de leur peres. Justinien [3] appelle barbare le droit de succéder des mâles, au préjudice des filles. Ces idées sont venues de ce que l’on a regardé le droit que les enfans ont de succéder à leurs peres, comme une conséquence de la loi naturelle ; ce qui n’est pas.
La loi naturelle ordonne aux peres de nourrir leurs enfans, mais elle n’oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage ; tout cela ne peut avoir été [III-231] réglé que par la société, & par conséquent par des lois politiques ou civiles.
Il est vrai que l’ordre politique ou civil demande souvent que les enfans succedent aux peres, mais il ne l’exige par toujours.
Les lois de nos fiefs ont pu avoir des raisons pour que l’aîné des mâles, ou les plus proches parens par mâles, eussent tout, & que les filles n’eussent rien : & les lois des Lombards [4] ont pu en avoir pour que les sœurs, les enfans naturels, les autres parens, & à leur défaut le fisc, concourussent avec les filles.
Il fut réglé dans quelques dynasties de la Chine, que les freres de l’empereur lui succéderoient, & que ses enfans ne lui succéderoient pas. Si l’on vouloit que le prince eût une certaine expérience, si l’on craignoit les minorités, s’il falloit prévenir que des eunuques ne plaçassent successivement des enfans sur le trône, on put très-bien établir un pareil ordre de succession : & quand quelques [5] écrivains ont traité ces freres d’usurpateurs, ils ont jugé sur des idées prises des lois de ce pays-ci.
[III-232]
Selon la coutume de Numidie [6] Delsace frere de Géla, succéda au royaume, non pas Massinisse son fils. Et encore aujourd’hui [7] , chez les Arabes de Barbarie, où chaque village a un chef, on choisit, selon cette anciennes coutume, l’oncle, ou quelqu’autre parent, pour succéder.
Il y a des monarchies purement électives ; & dès qu’il est clair que l’ordre des successions doit dériver des lois politiques ou civiles, c’est à elles à décider dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfans, & dans quel cas il faut la donner à d’autres.
Dans les pays où la polygamie est établie, le prince a beaucoup d’enfans ; le nombre en est plus grand dans des pays que dans d’autres. Il y a des [8] états où l’entretien des enfans du roi seroit impossible au peuple ; on a pu y établir que les enfans du roi ne lui succéderoient pas, mais ceux de sa sœur.
[III-233]
Un nombre prodigieux d’enfans exposeroit l’état à d’affreuses guerres civiles. L’ordre de succession qui donne la couronne aux enfans de la sœur, dont le nombre n’est pas plus grand que ne le seroit celui des enfans d’un prince qui n’auroit qu’une seule femme, prévient ces inconvéniens.
Il y a des nations chez lesquelles des raisons d’état ou quelque maxime de religion ont demandé qu’une certaine famille fût toujours régnante : telle est aux Indes [9] la jalousie de sa caste, & la crainte de n’en point descendre : on y a pensé que, pour avoir toujours des princes du sang royal, il falloit prendre les enfans de la sœur aînée du roi.
Maxime générale : nourrir ses enfans, est une obligation du droit naturel ; leur donner sa succession, est une obligation du droit civil ou politique. De là dérivent les différentes dispositions sur les bâtards dans les différens pays du monde ; elles suivent les lois civiles ou politiques de chaque pays.
-
[↑] De civitate Dei, liv. III.
-
[↑] Liv. II, chap. xii.
-
[↑] Novelle 21.
-
[↑] Liv. II, tit. 14, §. 6, 7 & 8.
-
[↑] Le P. du Halde, sur la seconde dynastie.
-
[↑] Tite-Live, décade 3, liv. IX.
-
[↑] Voy. Les voyages de M. Schaw, tome 1, p. 401.
-
[↑] Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, pag. 114 ; & M. Smith, voyage de Guinde, part. 2. pag. 150, sur le royaume de Julda.
-
[↑] Voyez les lett. edif. quatorzieme recueil ; & les voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome III, part. 2. pag. 644.
[III-234]
CHAPITRE VII.
Qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle.
Les Abyssins ont un carême de cinquante jours très-rude, & qui les affoiblit tellement, que de long-temps ils ne peuvent agir : les Turcs [1] ne manquent pas de les attaquer après leur carême. La religion devroit, en faveur de la défense naturelle, mettre des bornes à ces pratiques.
Le sabbat fut ordonné aux Juifs : mais ce fut une stupidité à cette nation de ne point se défendre [2] , lorsque ses ennemis choisirent ce jour pour l’attaquer.
Cambyse assiégeant Peluze, mit au premier rang un grand nombre d’animaux que les Egyptiens tenoient pour sacrés : les soldats de la garnison n’osèrent tirer. Qui ne voit que la défense naturelle est d’un ordre supérieur à tous les préceptes ?
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. IV, part. I, pages 35 & 103.
-
[↑] Comme ils firent, lorsque Pompée assiégea le temple. Voyez Dion, liv. XXXVII.
[III-235]
CHAPITRE VIII.
Qu’il ne faut pas régler par les principes du droit appelé canonique, les choses réglées par les principes du droit civil.
Par le droit [1] civil des Romains, celui qui enleve d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol : par le droit [2] canonique, il est puni du crime de sacrilege. Le droit canonique fait attention au lieu, le droit civil à la chose. Mais n’avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature & la définition du vol, ni sur la nature & la définition du sacrilege.
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois [3] à cause de l’infidélité du mari. Cet usage, contraire à la disposition des lois [4] Romaines, s’étoit introduit dans les cours [5] d’église, où l’on ne voyoit [III-236] que les maximes du droit canonique ; & effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles & dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même. Mais les lois politiques & civiles de presque tous les peuples, ont avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue & de continence, qu’elles n’exigent point des hommes ; parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus ; parce que la femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle ; parce que la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes certains ; outre que les enfans adultérins de la femme sont nécessairement au mari & à la charge du mari, au lieu que les enfans adultérins du mari ne sont pas à la femme, ni à la charge de la femme.
-
[↑] Leg. V. ff. ad leg. Juliam peculatûs.
-
[↑] Cap. Quisquis xvii, quæstione 4 ; Cujas, observat. Liv. XIII, ch. xix, tome III.
-
[↑] Beaumanoir, ancienne coutume de Beauvoisis, chap. xviii.
-
[↑] Leg. I, cod. ad leg. Jul. de adult.
-
[↑] Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses.
[III-237]
CHAPITRE IX.
Que les choses qui doivent être réglées par les principes du droit civil, peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion.
Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d’étendue.
Les lois de perfection tirées de la religion ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.
Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles ; parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.
Les Romains firent des réglemens pour conserver dans la république les mœurs des femmes ; c’étoient des institutions politiques. Lorsque la [III-238] monarchie s’établit, ils firent là-dessus des lois civiles, & ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion Chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que l’on fit eurent moins de rapport à la bonté générale des mœurs, qu’à la sainteté du mariage ; on considéra moins l’union des deux sexes dans l’état civil, que dans un état spirituel.
D’abord, par la loi [1] Romaine, un mari qui ramenoit sa femme dans sa maison après la condamnation d’adultere, fut puni comme complice de ses débauches. Justinien [2] , dans un autre esprit, ordonna qu’il pourroit pendant deux ans l’aller reprendre dans le monastere.
Lorsqu’une femme qui avoit son mari à la guerre, n’entendoit plus parler de lui, elle pouvoit dans les premiers temps aisément se remarier, parce qu’elle avoit entre ses mains le pouvoir de faire divorce. La loi de Constantin [3] voulut qu’elle attendît quatre ans, après quoi elle pouvoit envoyer le libelle de divorce au chef ; & si son mari revenoit, [III-239] il ne pouvoit plus l’accuser d’adultere. Mais Justinien [4] établit que, quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du mari, elle ne pouvoit se remarier, à moins que, par la déposition & le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari : Justinien avoit en vue l’indissolubilité du mariage ; mais on peut dire qu’il l’avoit trop en vue. Il demandoit une preuve positive, lorsqu’une preuve négative suffisoit ; il exigeoit une chose très-difficile, de rendre compte de la destinée d’un homme éloigné & exposé à tant d’accidens ; il présumoit un crime, c’est-à-dire, la désertion du mari, lorsqu’il étoit si naturel de présumer sa mort. Il choquoit le bien public, en laissant une femme sans mariage ; il choquoit l’intérêt particulier, en l’exposant à mille dangers.
La loi de Justinien [5] qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari & de la femme d’entrer dans le monastere, s’éloignoit entiérement des principes des lois civiles. Il est naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empêchemens [III-240] qu’on ne devoit pas prévoir avant le mariage : mais ce désir de garder la chasteté pouvoit être prévu, puisqu’il est en nous. Cette loi favorise l’inconstance, dans un état qui de sa nature est perpétuel ; elle choque le principe fondamental du divorce, qui ne souffre la dissolution d’un mariage que dans l’espérance d’un autre ; enfin à suivre même les idées religieuses, elle ne fait que donner des victimes à Dieu sans sacrifice.
-
[↑] Leg. XI, §. ult. ff. ad leg. Jul. de adult.
-
[↑] Nov. 134, coll. 9, ch. x, tit. 170.
-
[↑] Leg. VII, cod. de repudiis & judicio de moribus sublato.
-
[↑] Auth. Hodie quantiscumque, cod. de repud.
-
[↑] Auth. Quòd hodie, cod. de repud.
[III-240]
CHAPITRE X.
Dans quel cas il faut suivre la loi civile qui permet, & non pas la loi de la religion qui défend.
Lorsqu’une religion qui défend la polygamie, s’introduit dans un pays où elle est permise, on ne croit pas, à ne parler que politiquement, que la loi du pays doive souffrir qu’un homme qui a plusieurs femmes embrasse cette religion ; à moins que le magistrat ou le mari ne les dédommagent, en leur rendant de quelque maniere leur état civil. Sans cela, leur condition seroit déplorable ; elles n’auroient fait [III-241] qu’obéir aux lois, & elles se trouveroient privées des plus grands avantages de la société.
[III-241]
CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie.
Le tribunal de l’inquisition, formé par les moines Chrétiens, sur l’idée du tribunal de la pénitence, est contraire à toute bonne police. Il a trouvé par-tout un soulévement général ; & il auroit cédé aux contradictions, si ceux qui vouloient l’établir n’avoient tiré avantage de ces contradictions mêmes.
Ce tribunal est insupportable dans tous les gouvernemens. Dans la monarchie, il ne peut faire que des délateurs & des traîtres ; dans les républiques, il ne peut former que des malhonnêtes gens ; dans l’état despotique, il est destructeur comme lui.
[III-242]
CHAPITRE XII.
Continuation du même sujet.
C’est un des abus de ce tribunal, que de deux personnes qui y sont accusées du même crime, celle qui nie est condamnée à la mort, & celle qui avoue évite le supplice. Ceci est tiré des idées monastiques, où celui qui nie paroît être dans l’impénitence & damné, & celui qui avoue semble être dans le repentir & sauvé. Mais une pareille distinction ne peut concerner les tribunaux humains : la justice humaine, qui ne voit que les actions, n’a qu’un pacte avec les hommes, qui est celui de l’innocence ; la justice divine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l’innocence & celui du repentir.
[III-243]
CHAPITRE XIII.
Dans quel cas il faut suivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion ; & dans quel cas il faut suivre les lois civiles.
Il est arrivé, dans tous les pays & dans tous les temps, que la religion s’est mêlée des mariages. Dès que de certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, & que cependant elles étoient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion, pour les légitimer dans un cas & les réprouver dans les autres.
D’un autre côté, les mariages étant, de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la société, il a bien fallu qu’ils fussent réglés par les lois civiles.
Tout ce qui regarde le caractere du mariage, sa forme, la maniere de le contracter, la fécondité qu’il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu’il étoit l’objet d’une bénédiction particuliere, qui n’y étant pas toujours attachée, dépendoit de certaines graces [III-244] supérieures ; tout cela est du ressort de la religion.
Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître ; tout cela regarde les lois civiles.
Comme un des grands objets du mariage est d’ôter toutes les incertitudes des conjonctions illégitimes, la religion y imprime son caractere, & les lois civiles y joignent le leur, afin qu’il ait toute l’authenticité possible. Ainsi, outre les conditions que demande la religion pour que le mariage soit valide, les lois civiles en peuvent encore exiger d’autres.
Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir, c’est que ce sont des caracteres ajoutés, & non pas des caracteres contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies, & les lois civiles veulent le consentement des peres ; elles demandent en cela quelque chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire.
Il suit de là que c’est à la loi de la religion à décider si le lien sera [III-245] indissoluble, ou non : car si les lois de la religion avoient établi le lien indissoluble, & que les civiles eussent réglé qu’il se peut rompre, ce seroient deux choses contradictoires.
Quelquefois les caracteres imprimés au mariage par les lois civiles, ne sont pas d’une absolue nécessité ; tels sont ceux qui sont établis par les lois qui, au lieu de casser le mariage, se sont contentées de punir ceux qui le contractoient.
Chez les Romains, les lois Pappiennes déclarerent injustes les mariages qu’elles prohiboient, & les soumirent seulement à des peines [1] ; & le senatus-consulte rendu sur le discours de l’empereur Marc-Antonin, les déclara nuls ; il n’y eut plus [2] de mariage, de femme, de dot, de mari. La loi civile se détermine selon les circonstances : quelquefois elle est plus attentive à réparer le mal, quelquefois à le prévenir.
-
[↑] Voyez ce que j’ai dit ci-dessus au chap. xxi du livre des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.
-
[↑] Voyez les loi XVI, ff. de ritu nuptiarum ; & la loi III, §. I, aussi au digeste de donationibus inter virum & uxorem.
[III-246]
CHAPITRE XIV.
Dans quels cas, dans les mariages entre parens, il faut se régler par les lois de la nature ; dans quel cas on doit se régler par les lois civiles.
En fait de prohibition de mariage entre parens, c’est une chose très-délicate de bien poser le point auquel les lois de la nature s’arrêtent, & où les lois civiles commencent. Pour cela, il faut établir des principes.
Le mariage du fils avec la mere confond l’état des choses : le fils doit un respect sans bornes à sa mère, la femme doit un respect sans bornes à son mari ; le mariage d’une mere avec son fils renverseroit dans l’un & dans l’autre leur état naturel.
Il y a plus : la nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des enfans ; elle l’a reculé dans les hommes ; & par la même raison, la femme cesse plutôt d’avoir cette faculté, & l’homme plus tard. Si le mariage entre la mere & le fils étoit permis, il arriveroit presque toujours que, lorsque le [III-247] mari seroit capable d’entrer dans les vues de la nature, la femme n’y seroit plus.
Le mariage entre le pere & la fille répugne à la nature, comme le précédent ; mais il répugne moins, parce qu’il n’a pas ces deux obstacles. Aussi les Tartares, qui peuvent épouser leurs filles [1] , n’épousent-ils jamais leurs meres, comme nous le voyons dans les relations [2] .
Il a toujours été naturel aux peres de veiller sur la pudeur de leurs enfans. Chargés du soin de les établir, ils ont dû leur conserver & le corps le plus parfait, & l’ame la moins corrompue, tout ce qui peut mieux inspirer des désirs, & tout ce qui est le plus propre à donner de la tendresse. Des peres, toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfans, ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourroit les corrompre. Le mariage n’est point une corruption, dira-t-on : mais avant le mariage, il faut parler, il faut se faire [III-248] aimer, il faut séduire ; c’est cette séduction qui a dû faire horreur.
Il a donc fallu une barriere insurmontable entre ceux qui devoient donner l’éducation, & ceux qui devoient la recevoir ; & éviter toute sorte de corruption, même pour cause légitime. Pourquoi les peres privent-ils si soigneusement ceux qui doivent épouser leurs filles, de leur compagnie & de leur familiarité ?
L’horreur pour l’inceste du frere avec la sœur a dû partir de la même source. Il suffit que les peres & les meres ayent voulu conserver les mœurs de leurs enfans & leurs maisons pures, pour avoir inspiré à leurs enfans de l’horreur pour tout ce qui pouvoit les porter à l’union des deux sexes.
La prohibition du mariage entre cousins germains a la même origine. Dans les premiers temps, c’est-à-dire dans les temps saints, dans les âges où le luxe n’étoit point connu, tous les [3] enfans restoient dans la maison, & s’y établissoient : c’est qu’il ne falloit qu’une maison très-petite pour une grande famille.
[III-249] Les enfans [4] des deux freres, ou les cousins germains, étoient regardés & se regardoient entr’eux comme freres. L’éloignement qui étoit entre les freres & les sœurs pour le mariage étoit donc aussi [5] entre les cousins germains.
Ces causes sont si fortes & si naturelles, qu’elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment d’aucune communication. Ce ne sont point les Romains qui ont appris aux habitans de Formose [6] , que le mariage avec leurs parens au quatrieme degré étoit incestueux ; ce ne sont point les Romains qui l’ont dit aux Arabes [7] ; ils ne l’ont point enseigné aux Maldives [8] .
Que si quelques peuples n’ont point rejeté les mariages entre les peres & les enfans, les sœurs & les freres, on a vu, dans le livre premier, que les êtres [III-250] intelligens ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le diroit ! des idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égaremens. Si les Assyriens, si les Perses ont épousé leurs meres, les premiers l’ont fait par un respect religieux pour Sémiramis ; & les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnoit la préférence [9] à ces mariages. Si les Égyptiens ont épousé leurs sœurs, ce fut encore un délire de la religion Égyptienne, qui consacra ces mariages en l’honneur d’Isis. Comme l’esprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes & difficiles, il ne faut pas juger qu’une chose soit naturelle, parce qu’une religion fausse l’a consacrée.
Le principe que les mariages entre les peres & les enfans, les freres & les sœurs, sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, servira à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle, & ceux qui ne peuvent l’être que par la loi civile.
[III-251]
Comme les enfans habitent, ou sont censés habiter dans la maison de leur pere, & par conséquent le beau-fils avec la belle-mere, le beau-pere avec la belle-fille ou avec la fille de la femme ; le mariage entr’eux est défendu par la loi de la nature. Dans ce cas, l’image a le même effet que la réalité, parce qu’il a la même cause : la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces mariages.
Il y a des peuples chez lesquels, comme j’ai dit, les cousins germains sont regardés comme freres, parce qu’ils habitent ordinairement dans la même maison ; il y en a où on ne connoît guere cet usage. Chez ces peuples, le mariage entre cousins germains doit être regardé comme contraire à la nature ; chez les autres, non.
Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois locales. Ainsi quand ces mariages sont défendus ou permis, ils sont, selon les circonstances, permis ou défendus par une loi civile.
Il n’est point d’un usage nécessaire que le beau-frere & la belle-sœur habitent dans la même maison. Le mariage n’est dont pas défendu entr’eux pour [III-252] conserver la pudicité dans la maison ; & la loi qui le défend ou le permet, n’est point la loi de la nature, mais une loi civile, qui se regle sur les circonstances, & dépend des usages de chaque pays : ce sont des cas, où les lois dépendent des mœurs & des manieres.
Les lois civiles défendent les mariages, lorsque, par les usages reçus dans un certain pays, ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature ; & elles le permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable, parce qu’elle dépend d’une chose invariable ; le pere, la mere & les enfans habitant nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles, parce qu’elles dépendant d’une circonstance accidentelle ; les cousins germains & autres habitant accidentellement dans la maison.
Cela explique comment les lois de Moïse, celles des Égyptiens [10] & de plusieurs autres peuples, permettent le mariage entre le beau-frere et la [III-253] belle-sœur, pendant que ces mêmes mariages sont défendus chez d’autres nations.
Aux Indes, on a une raison bien naturelle d’admettre ces sortes de mariages. L’oncle y est regardé comme pere, & il est obligé d’entretenir & d’établir ses neveux, comme si c’étoient ses propres enfans : ceci vient du caractere de ce peuple, qui est bon & plein d’humanité. Cette loi ou cet usage en a produit un autre : si un mari a perdu sa femme, il ne manque pas d’en épouser la sœur [11] : & cela est très-naturel ; car la nouvelle épouse devient la mere des enfans de sa sœur, & il n’y a point d’injuste marâtre.
-
[↑] Cette loi est bien ancienne parmi eux. Attila, dit Priscus dans son ambassade, s’arrêta dans un certain lieu pour épouser Esca, sa fille ; chose permise, dit-il, par les lois des Scythes, page 22.
-
[↑] Hist. des Tattars, part. 3, page 256.
-
[↑] Cela fut ainsi chez les premiers Romains.
-
[↑] En effet, chez les Romains, ils avoient le même nom ; les cousins germains étoient nommés freres.
-
[↑] Ils le furent à Rome dans les premiers temps, jusqu’à ce que le peuple fît une loi pour les permettre ; il vouloit favoriser un homme extrêmement populaire, & qui s’étoit marié avec sa cousine germaine. Plutarque, au traité des demandes des choses Romaines.
-
[↑] Recueil des voyages des Indes, tome V, part. I. relation de l’état de l’île de Formose.
-
[↑] L’alcoran, chap. des femmes.
-
[↑] Voyez François Pyrard.
-
[↑] Ils étoient regardés comme plus honorables. Voyez Philon, de specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta decalogi, Paris, 1640. p. 778.
-
[↑] Voyez la loi VIII, au code de oncestis & inutilibus nuptiis.
-
[↑] Lettres édif. quatorzieme recueil, page 403.
[III-253]
CHAPITRE XV.
Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique, les choses qui dépendent des principes du droit civil.
Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle, pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens, pour vivre sous des lois civiles.
[III-254]
Ces premieres lois leur acquierent la liberté ; les secondes, la propriété. Il ne faut pas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n’est que l’empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C’est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c’est-à-dire, de la liberté du citoyen : cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.
Cicéron soutenoit que les lois agraires étoient funestes, parce que la cité n’étoit établie que pour que chacun conservât ses biens.
Posons donc pour maxime, que lorsqu’il s’agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son bien, ou même qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la propriété.
[III-255]
Ainsi lorsque le public a besoin du fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique : mais c’est là que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité même.
Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise ; le public est à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, & qu’il lui ôte ce grand privilege qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien.
Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé de leurs conquêtes même, l’esprit de liberté les rappella à celui d’équité ; les droits les plus barbares, ils les exercerent avec modération : & si l’on en doutoit, il n’y auroit qu’à lire l’admirable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivoit sur la jurisprudence dans le douzieme siecle.
On raccommodoit de son temps les grands chemins, comme l’on fait aujourd’hui. Il dit que, quand un grand [III-256] chemin ne pouvoit être rétabli, on en faisoit un autre le plus près de l’ancien qu’il étoit possible ; mais qu’on dédommageoit les propriétaires [1] aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin. On se déterminoit pour lors par la loi civile ; on s’est déterminé de nos jours par la loi politique.
-
[↑] Le seigneur nommoit des prud’hommes pour faire la levée sur le paysan ; les gentilshommes étoient contraints à la contribution par le comte, l’homme d’église par l’évêque. Beaumanoir, chap. xxii.
[III-256]
CHAPITRE XVI.
Qu’il ne faut point décider par les regles du droit civil, quand il s’agit de décider par celles du droit politique.
On verra le fond de toutes les questions, si l’on ne confond point les regles qui dérivent de la propriété de la cité, avec celles qui naissent de la liberté de la cité.
Le domaine d’un état est-il aliénable, ou ne l’est-il pas ? Cette question doit être décidée par la loi politique, & non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile, parce qu’il est aussi nécessaire qu’il y ait un [III-257] domaine pour faire subsister l’état, qu’il est nécessaire qu’il y ait dans l’état des lois civiles qui reglent la disposition des biens.
Si donc on aliene le domaine, l’état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cet expédient renverse encore le gouvernement politique ; parce que, par la nature de la chose, à chaque domaine qu’on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain retirera toujours moins ; en un mot, le domaine est nécessaire, & l’aliénation ne l’est pas.
L’ordre de succession est fondé dans les monarchies sur le bien de l’état, qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j’ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.
Ce n’est pas pour la famille régnante que l’ordre de succession est établi, mais parce qu’il est de l’intérêt de l’état qu’il y ait une famille régnante. La loi qui regle la succession des particuliers, est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers ; celle qui regle la succession à la monarchie, est une loi [III-258] politique, qui a pour objet le bien & la conservation de l’état.
Il suit de là que, lorsque la loi politique a établi dans un état un ordre de succession, & que cet ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la succession en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit. Une société particuliere ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Romains ne sont pas plus applicables que toutes autres lois civiles ; ils ne les ont point employées eux-mêmes, lorsqu’ils ont jugé les rois : & les maximes par lesquelles ils ont jugé les rois, sont si abominables, qu’il ne faut point les faire revivre.
Il suit encore de là que, lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile. Les restitutions sont dans la loi, & peuvent être bonnes contre ceux qui vivent dans la loi : mais elles ne sont pas bonnes pour ceux qui ont été établis pour la loi, & qui vivent pour la loi.
Il est ridicule de prétendre décider des droits des royaumes, des nations & de l’univers, par les mêmes maximes [III-259] sur lesquelles on décide entre particuliers d’un droit pour une gouttiere, pour me servir de l’expression de Cicéron [1] .
-
[↑] Liv. I. des Lois.
[III-259]
CHAPITRE XVII.
Continuation du même sujet.
L’ostracisme doit être examiné par les regles de la loi politique, & non par les regles de la loi civile : & bien loin que cet usage puisse flétrir le gouvernement populaire, il est au contraire très-propre à en prouver la douceur : & nous aurions senti cela, si l’exil parmi nous étant toujours une peine, nous avions pu séparer l’idée de l’ostracisme d’avec celle de la punition.
Aristote [1] nous dit, qu’il est convenu de tout le monde que cette pratique a quelque chose d’humain & de populaire. Si dans les temps & dans les lieux où l’on exerçoit ce jugement, on ne le trouvoit point odieux ; est-ce à nous, qui voyons les choses de si loin, de penser autrement que les accusateurs, les juges & l’accusé même ? [III-260]
Et si l’on fait attention que ce jugement du peuple combloit de gloire celui contre qui il étoit rendu ; que lorsqu’on en eut abusé à Athenes contre un homme sans [2] mérite, on cessa dans ce moment [3] de l’employer ; l’on verra bien qu’on en a pris une fausse idée, & que c’étoit une loi admirable que celle qui prévenoit les mauvais effets que pouvoit produire la gloire d’un citoyen, en le comblant d’une nouvelle gloire.
-
[↑] République, liv. III. chap. xiii.
-
[↑] Hyperbolus. Voyez Plutarque, vie d’Aristide.
-
[↑] Il se trouva opposé à l’esprit du législateur.
[III-260]
CHAPITRE XVIII.
Qu’il faut examiner si les lois qui paroissent se contredire, sont du même ordre.
À Rome il fut permis au mari de prêter sa femme à un autre. Plutarque nous le [1] dit formellement : on sait que Caton prêta sa [2] femme à Hortensius, & Caton n’était point homme à violer les lois de son pays.
[III-261]
D’un autre côté, un mari qui souffroit les débauches de sa femme, qui ne la mettoit pas en jugement ou qui la reprenoit [3] après la condamnation, étoit puni. Ces lois paroissent se contredire, & ne se contredisent point. La loi qui permettoit à un Romain de prêter sa femme, est visiblement une institution Lacédémonienne, établie pour donner à la république des enfans d’une bonne espece, si j’ose me servir de ce terme : l’autre avoit pour objet de conserver les mœurs. La premiere étoit une loi politique, la seconde une loi civile.
-
[↑] Plutarque, dans sa comparaison de Lycurgue & de Numa.
-
[↑] Plutarque, vie de Caton. Cela se passa de notre temps, dit Strabon, liv. XI.
-
[↑] Leg. XI, §, ult. ss. ad leg. Jul. de adult.
[III-261]
CHAPITRE XIX.
Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles les choses qui doivent l’être par les lois domestiques.
La loi des Wisigoths vouloit que les esclaves [1] fussent obligés de lier l’homme & la femme qu’ils surprenoient en adultere, & de les présenter au mari & au juge : loi terrible, qui mettoit [III-262] entre les mains de ces personnes viles le soin de la vengeance publique, domestique & particuliere !
Cette loi ne seroit bonne que dans les sérails d’orient, où l’esclave, qui est chargé de la clôture, a prévariqué sitôt qu’on prévarique. Il arrête les criminels, moins pour les faire juger, que pour se faire juger par lui-même, & obtenir que l’on cherche dans les circonstances de l’action, si l’on peut perdre le soupçon de sa négligence.
Mais dans les pays où les femmes ne sont point gardées, il est insensé que la loi civile les soumette, elles qui gouvernent la maison, à l’inquisition de leurs esclaves.
Cette inquisition pourroit être, tout au plus dans de certains cas, une loi particuliere domestique, & jamais une loi civile.
-
[↑] Lois des Wisigoths, liv. III. tit. 4. §. 6.
[III-263]
CHAPITRE XX.
Qu’il ne faut pas décider par les principes des lois civiles, les choses qui appartiennent au droit des gens.
La liberté consiste principalement à ne pouvoir être forcé à faire une chose que la loi n’ordonne pas ; & on n’est dans cet état que parce qu’on est gouverné par des lois civiles : nous sommes donc libres, parce que nous vivons sous des lois civiles.
Il suit de là que les princes qui ne vivent point entr’eux sous des lois civiles, ne sont point libres, ils sont gouvernés par la force ; ils peuvent continuellement forcer ou être forcés. De-là il suit que les traités qu’ils ont faits par force, sont aussi obligatoires que ceux qu’ils auroient faits de bon gré. Quand nous, qui vivons sous des lois civiles, sommes contraints à faire quelque contrat que la loi n’exige pas, nous pouvons, à la faveur de la loi, revenir contre la violence ; mais un prince, qui est toujours dans cet état dans lequel il force ou il est forcé, ne peut pas se plaindre [III-264] d’un traité qu’on lui a fait par violence. C’est comme s’il se plaignoit de son état naturel : c’est comme s’il vouloit être prince à l’égard des autres princes, & que les autres princes fussent citoyens à son égard ; c’est-à-dire, choquer la nature des choses.
[III-264]
CHAPITRE XXI.
Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques, les choses qui appartiennent au droit des gens.
Les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels & civils du pays où il est, & à l’animadversion du souverain.
Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambassadeurs, & la raison tirée de la nature de la chose, n’a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, & cette parole doit être libre : aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir : ils peuvent souvent déplaire, parce qu’ils parlent pour un homme indépendant : on [III-265] pourroit leur imputer des crimes, s’ils pouvoient être punis pour des crimes ; on pourroit leur supposer des dettes, s’ils pouvoient être arrêtés pour des dettes : un prince qui a une fierté naturelle, parleroit par la bouche d’un homme qui auroit tout à craindre. Il faut donc suivre, à l’égard des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens, & non pas celles qui dérivent du droit politique. Que s’ils abusent de leur être représentatif, on le fait cesser, en les renvoyant chez eux : on peut même les accuser devant leur maître, qui devient par-là leur juge ou leur complice.
[III-265]
CHAPITRE XXII.
Malheureux sort de l’Ynca Athualpa.
Les principes que nous venons d’établir, furent cruellement violés par les Espagnols. L’ynca [1] Athualpa ne pouvoit être jugé que par les droits des gens ; ils le jugerent par des lois politiques & civiles ; ils l’accuserent d’avoir fait mourir quelques-uns de ses sujets, d’avoir eu plusieurs femmes, &c. Et le [III-266] comble de la stupidité fut, qu’ils ne le condamnerent pas par les lois politiques & civiles de son pays, mais par les lois politiques & civiles du leur.
-
[↑] Voyez l’ynca Garcilasso de la Vega, page 108.
[III-266]
CHAPITRE XXIII.
Que lorsque, par quelque circonstance, la loi politique détruit l’état, il faut décider par la loi politique qui le conserver, qui devient quelquefois un droit des gens.
Quand la loi politique, qui a établi dans l’état un certain ordre de succession, devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été fait, il ne faut pas douter qu’une autre loi politique ne puisse changer cet ordre ; & bien loin que cette même loi soit opposée à la premiere, elle y sera dans le fond entiérement conforme, puisqu’elles dépendront toutes deux de ce principe : Le salut du peuple est la suprême loi.
J’ai dit [1] qu’un grand état devenu accessoire d’un autre s’affoiblissait, & [III-267] même affoiblissoit le principal. On sait que l’état a intérêt d’avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés, que sa monnoie ne sorte point pour enrichir un autre pays. Il est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes étrangeres ; elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies : d’ailleurs les hommes tiennent prodigieusement à leurs lois & à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu’on les change sans de grandes secousses & une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.
Il suit de-là que si un grand état a pour héritier le possesseur d’un grand état, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux états que l’ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie faite au commencement du regne d’Elisabeth, exclut-elle très-prudemment tout héritier qui posséderoit une autre monarchie : ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger qui seroit appellé à la couronne par le droit du sang.
[III-268]
Que si une nation peut exclure, elle a à plus forte raison le droit de faire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance ou la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractans, & ceux qui naîtront d’eux, à tous les droits qu’ils auroient sur elle ; & celui qui renonce, & ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins se plaindre, que l’état auroit pu faire une loi pour les exclure.
-
[↑] Voyez ci-dessus, liv. V. chap. xiv ; liv. VIII. chap. xvi, xvii, xviii, xix & xx ; liv. IX. chap. iv, v, vi & vii ; & liv. X. chap. ix & x.
[III-268]
CHAPITRE XXIV.
Que les réglemens de police sont d’un autre ordre que les autres lois civiles.
Il y a des criminels que le magistrat punit, il y en a d’autres qu’il corrige ; les premiers sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité ; ceux-là sont retranchés de la société ; on oblige ceux-ci de vivre selon les regles de la société.
Dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat qui punit, que la [III-269] loi ; dans les jugemens des crimes, c’est plutôt la loi qui punit, que le magistrat. Les matieres de police sont des choses de chaque instant, & où il ne s’agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guere de formalités. Les actions de la police sont promptes, & elle s’exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n’y sont donc pas propres. Elle s’occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc pas faits pour elle. Elle a plutôt des réglemens que des lois. Les gens qui relevent d’elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat ; c’est donc la faute du magistrat, s’ils tombent dans des excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des lois avec la violation de la simple police : ces choses sont d’un ordre différent.
De-là il suit qu’on ne s’est point conformé à la nature des choses de cette république d’Italie [1] où le port des armes à feu est puni comme un crime capital, & où il n’est pas plus fatal d’en faire un mauvais usage que de les porter.
[III-270]
Il suit encore que l’action tant louée de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu’il avoit surpris en fraude, est une action de sultan, qui ne sait être juste qu’en outrant la justice même.
-
[↑] Venise.
[III-270]
CHAPITRE XXV.
Qu’il ne faut pas suivre les dispositions générales du droit civil, lorsqu’il s’agit de choses qui doivent être soumises à des regles particulieres tirées de leur propre nature.
Est-ce une bonne loi, que toutes les obligations civiles passées dans le cours d’un voyage entre les matelots dans un navire, soient nulles ? François Pyrard [1] nous dit que de son temps elle n’étoit point observée par les Portugais, mais qu’elle l’étoit par les François. Des gens qui ne sont ensemble que pour peu de temps, qui n’ont aucuns besoins, puisque le prince y pourvoit, qui ne peuvent avoir qu’un objet qui est celui de leur voyage, qui ne sont plus dans la société, mais citoyens du navire, ne doivent point contracter de [III-271] ces obligations qui n’ont été introduites que pour soutenir les charges de la société civile.
C’est dans ce même esprit que la loi des Rhodiens, faite pour un temps, où l’on suivoit toujours les côtes, vouloit que ceux qui, pendant la tempête, restoient dans le vaisseau, eussent le navire & la charge ; & que ceux qui l’avoient quitté, n’eussent rien.
-
[↑] Chapitre xiv, part. 12.
[III-272]
LIVRE XXVII.↩
CHAPITRE UNIQUE.
De l’origine & des révolutions des lois des Romains sur les successions.
Cette matiere tient à des établissemens d’une antiquité très reculée ; & pour la pénétrer à fond, qu’il me soit permis de chercher dans les premieres lois des Romains ce que je ne sache pas que l’on y ait vu jusqu’ici.
On sait que Romulus [1] partagea les terres de son petit état à ses citoyens ; il me semble que c’est de-là que dérivent les lois de Rome sur les successions.
La loi de la division des terres demanda que les biens d’une famille ne passassent pas dans une autre : de-là il suivit qu’il n’y eut que deux ordres d’héritiers établis par la loi [2] ; les enfans & tous les descendans qui vivoient [III-273] sous la puissance du pere, qu’on appella héritier-siens ; & à leur défaut, les plus proches parens par mâles, qu’on appella agnats.
Il suivit encore que les parens par femmes, qu’on appella cognats, ne devoient point succéder ; ils auroient transporté les biens dans une autre famille ; & cela fut ainsi établi.
Il suivit encore de-là que les enfans ne devoient point succéder à leur mere, ni la mere à ses enfans ; cela auroit porté les biens d’une famille dans une autre. Aussi les voit-on exclus [3] dans la loi des douze tables ; elle n’appeloit à la succession que les agnats, & le fils & la mere ne l’étoient pas entr’eux.
Mais il étoit indifférent que l’héritier-sien, ou à son défaut, le plus proche agnat, fût male lui-même ou femelle ; parce que les parens du côté maternel ne succédant point, quoiqu’une femme héritiere se mariât, les biens rentroient toujours dans la famille dont ils étoient sortis. C’est pour cela que l’on ne distinguoit point dans la loi des douze [III-274] tables, si la personne [4] qui succédoit étoit mâle ou femelle.
Cela fit que, quoique les petits-enfans par le fils succédassent au grand-pere, les petits-enfans par la fille ne lui succéderent point : car, pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille, les agnats leur étoient préférés. Ainsi la fille succéda à son pere, & non pas ses enfans [5] .
Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédoient, lorsque cela s’accordoit avec la loi de la division des terres ; & elles ne succédoient point, lorsque cela pouvoit la choquer.
Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains ; & comme elles étoient une dépendance naturelle de la constitution, & qu’elles dérivoient du partage des terres, on voit bien qu’elles n’eurent pas une origine étrangere, & ne furent point du nombre de celles que rapporterent les députés que l’on envoya dans les villes Grecques.
Denys d’Halicarnasse [6] nous dit que Servius Tullius, trouvant les lois de [III-275] Romulus & de Numa, sur le partage des terres abolies, il les rétablit, & en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage, ne soient l’ouvrage de ces trois législateurs de Rome.
L’ordre de succession ayant été établi en conséquence d’une loi politique, un citoyen ne devoit pas le troubler par une volonté particuliere ; c’est-à-dire que, dans les premiers temps de Rome, il ne devoit pas être permis de faire un testament. Cependant il eût été dur qu’on eût été privé dans ses derniers momens, du commerce des bienfaits.
On trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec la volonté des particuliers. Il fut permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple ; & chaque testament fut en quelque façon un acte de la puissance législative.
La loi des douze tables permit à celui qui faisoit son testament, de choisir pour son héritier le citoyen qu’il vouloit. La raison qui fit que les lois romaines restreignirent si fort le nombre [III-276] de ceux qui pouvoient succéder ab intestat, fut la loi du partage des terres ; & la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté de tester, fut que le pere pouvant vendre ses enfans [7] , il pouvoit à plus forte raison les priver des ses biens. C’étoient donc des effets différens, puisqu’ils couloient de principes divers, & c’est l’esprit des lois Romaines à cet égard.
Les anciennes lois d’Athenes ne permirent point au citoyen de faire de testament. Solon [8] le permit, excepté à ceux qui avoient des enfans : & les législateurs de Rome, pénétrés de l’idée de la puissance paternelle, permirent de tester au préjudice même des enfans. Il faut avouer que les anciennes lois d’Athenes furent plus conséquentes que les lois de Rome. La permission indéfinie de tester, accordée chez les Romains, ruina peu à peu la disposition politique sur le partage des terres ; elle introduisit, plus que toute autre chose, la funeste différence entre les richesses [III-277] & la pauvreté ; plusieurs partages furent assemblés sur une même tête ; des citoyens eurent trop, une infinité d’autres n’eurent rien. Aussi le peuple, continuellement privé de son partage, demanda-t-il sans cesse une nouvelle distribution des terres. Il la demanda dans le temps où la frugalité, la parcimonie & la pauvreté, faisoient le caractere distinctif des Romains, comme dans les temps où leur luxe fut porté à l’excès.
Les testamens étant proprement une loi faite dans l’assemblée du peuple, ceux qui étoient à l’armée se trouvoient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir [9] de faire devant quelques-uns de leurs compagnons, les dispositions [10] qu’ils auroient faites devant lui.
Les grandes assemblées du peuple ne se faisoient que deux fois l’an ; d’ailleurs le peuple s’étoit augmenté & les affaires aussi ; on jugea qu’il convenoit de [III-278] permettre à tous les citoyens de faire [11] leur testament devant quelques citoyens Romains puberes, qui représentassent le corps du peuple ; on prit cinq [12] citoyens, devant lesquels l’héritier [13] achetoit du testateur sa famille, c’est-à-dire, son hérédité ; un autre citoyen portoit une balance pour en peser le prix ; car les Romains [14] n’avoient pas encore de monnoie.
Il y a apparence que ces cinq citoyens représentoient les cinq classes du peuple ; & qu’on ne comptoit pas la sixieme, composée de gens qui n’avoient rien.
Il ne faut pas dire, avec Justinien, que ces ventes étoient imaginaires ; elles le devinrent ; mais au commencement elles ne l’étoient pas. La plupart des lois qui réglerent dans la suite des testamens, tirent leur origine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien la preuve dans les Fragmens d’Ulpien [15] . Le [III-279] sourd, le muet, le prodigue, ne pouvoient faire de testament ; le sourd, parce qu’il ne pouvoit pas entendre les paroles de l’acheteur de la famille ; le muet, parce qu’il ne pouvoit pas prononcer les termes de la nomination : le prodigue, parce que toute gestion d’affaires lui étant interdite, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.
Les testamens se faisant dans l’assemblée du peuple, ils étoient plutôt des actes du droit politique que du droit civil, du droit public plutôt que du droit privé : de-là il suivit que le pere ne pouvoit permettre à son fils qui étoit dans sa puissance, de faire un testament.
Chez la plupart des peuples, les testamens ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires, parce que les uns & les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte, qui appartiennent également au droit privé. Mais chez les Romains, où les testamens dérivoient du droit public, ils eurent de plus grandes formalités [16] que les autres [III-280] actes ; & cela subsiste encore aujourd’hui dans les pays de France qui se régissent par le droit Romain.
Les testamens étant, comme je l’ai dit, une loi du peuple, ils devoient être faits avec la force du commandement, & par des paroles que l’on appella directes & impératives. De-là il se forma une regle, que l’on ne pourroit donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement [17] : d’où il suivit que l’on pouvoit bien, dans de certains cas, faire une substitution [18] , & ordonner que l’hérédité passât à un autre héritier ; mais qu’on ne pouvoit jamais faire de fidéicommis [19] , c’est-à-dire, charger quelqu’un en forme de priere, de remettre à un autre l’hérédité, ou une partie de l’hérédité.
Lorsque le pere n’instituoit ni exhérédoit son fils, le testament étoit rompu ; mais il étoit valable, quoiqu’il n’exhérédât ni instituât sa fille. J’en vois la raison. Quand il n’instituoit ni exhérédoit son fils, il faisoit tort à son petit-fils, qui [III-281] auroit succédé ab intestat à son pere ; mais en instituant ni exhéré dans sa fille, il ne faisoit aucun tort aux enfans de sa fille, qui n’auroient point succédé ab intestat à leur mere [20] , parce qu’ils n’étoient héritiers siens ni agnats.
Les lois des premiers Romains sur les successions, n’ayant pensé qu’à suivre l’esprit du partage des terres, elles ne restreignirent pas assez les richesses des femmes, & elles laisserent par-là une porte ouverte au luxe, qui est toujours inséparable de ces richesses. Entre la seconde & la troisieme guerre Punique, on commença à sentir le mal ; on fit la loi Voconienne [21] ; & comme de très-grandes considérations la firent taire, qu’il ne nous en reste que peu de monumens, & qu’on n’en a jusqu’ici parlé que d’une maniere très-confuse, je vais l’éclaircir.
Cicéron nous en a conservé un fragment, qui défend d’instituer une femme [III-282] héritiere [22] , soit qu’elle fût mariée, soit qu’elle ne le fût pas.
L’épitome de Tite-Live, où il est parlé de cette loi, n’en dit [23] pas davantage. Il paroît par Cicéron [24] & par S. Augustin [25] , que la fille, & même la fille unique, étoient comprises dans la prohibition.
Caton l’ancien [26] contribua de tout son pouvoir à faire recevoir cette loi. Aulugelle cite un fragment [27] de la harangue qu’il fit dans cette occasion. En empêchant les femmes de succéder, il voulut prévenir les causes de luxe ; comme, en prenant la défense de la loi Oppienne, il voulut arrêter le luxe même.
Dans les institutes de Justinien [28] & de Téophile [29] , on parle d’un chapitre de la loi Voconienne, qui restreignoit la faculté de léguer. En lisant ces auteurs, il n’y a personne qui ne pense que ce [III-283] chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs, que l’héritier refusât de l’accepter. Mais ce n’étoit point là l’esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir qu’elle avoit pour objet d’empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi qui mettoit des bornes à la faculté de léguer, entroit dans cet objet : car si on avoit pu léguer autant que l’on auroit voulu, les femmes auroient pu recevoir comme legs ce qu’elles ne pouvoient obtenir comme succession.
La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables dont il fallut les priver, & non par ce celles qui ne pouvoient entretenir le luxe. La loi fixoit une certaine somme, qui devoit être donnée aux femmes qu’elles privoit de la succession. Cicéron [30] , qui nous apprend ce fait, ne nous dit point quelle étoit cette somme ; mais Dion [31] dit qu’elle étoit de cent mille sesterces.
[III-284]
La loi Voconienne étoit faite pour régler les richesses, & non pas pour régler la pauvreté : aussi Cicéron nous dit-il [32] qu’elle ne statuoit que sur ceux qui étoient inscrits dans le cens.
Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étoient extrêmement formalistes, & nous avons dit ci-dessus que l’esprit de la république étoit de suivre la lettre de la loi. Il y eut des peres qui ne se firent point inscrire dans le cens, pour pouvoir laisser leur succession à leur fille : & les préteurs jugerent qu’on ne violoit point la loi Voconienne, puisqu’on n’en violoit point la lettre.
Un certain Anius Asellus avoit institué sa fille, unique héritiere. Il le pouvoit, dit Cicéron [33] , la loi Voconienne ne l’en empêchoit pas, parce qu’il n’étoit point dans le cens. Verrès, étant prêteur, avoit privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verrès avoit été corrompu, parce que, sans cela, il n’auroit point interverti un [III-285] ordre que les autres préteurs avoient suivi.
Qu’étoient donc ces citoyens qui n’étoient point dans le cens qui comprenoit tous les citoyens ? Mais, selon l’institution de Servius Tullius, rapportée par Denys d’Halicarnasse [34] , tout citoyen qui ne se faisoit point inscrire dans le cens étoit fait esclave : Cicéron lui-même [35] dit qu’un tel homme perdoit la liberté : Zonare dit la même chose. Il falloit donc qu’il y eût de la différence entre n’être point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne, & n’être point dans le cens selon l’esprit des institutions de Servius Tullius.
Ceux qui ne s’étoient point fait inscrire dans les cinq premieres classes, où l’on étoit placé selon la proportion de ses biens, n’étoient point dans le cens [36] selon l’esprit de la loi Voconienne : ceux qui n’étoient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n’étoient point mis par les censeurs au nombre de ceux que l’on appelloit ærarii, n’étoient [III-286] point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle étoit la force de la nature, que des peres, pour éluder la loi Voconienne, consentoient à souffrir la honte d’être confondus dans la sixieme classe avec les prolétaires & ceux qui étoient taxés pour leur tête, ou peut-être même à être renvoyés dans les tables [37] des Cérites.
Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n’admettoit point les fidéicommis. L’espérance d’éluder la loi Voconienne les introduisit : on instituoit un héritier capable de recevoir par la loi, & on le prioit de remettre la succession à une personne que la loi en avoit exclue. Cette nouvelle maniere de disposer eut des effets biens différens. Les uns rendirent l’hérédité ; & l’action de Sexus Peduceus [38] fut remarquable. On lui donna une grande succession ; il n’y avoit personne dans le monde que lui qui sût qu’il étoit prié de la remettre. Il alla trouver la veuve du testateur, & lui donna tout le bien de son mari.
Les autres garderent pour eux la succession ; & l’exemple de P. Sextilius [III-287] Rufus fut célebre encore, parce que Cicéron [39] l’emploie dans ses disputes contre les Épicuriens. « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus prié par Sextilius de l’accompagner chez ses amis, pour savoir d’eux s’il devoit remettre l’hérédité de Quintus Fadius Gallus à Fadia sa fille. Il avoit assemblé plusieurs jeunes gens, avec de très-graves personnages ; & aucun ne fut d’avis qu’il donnât plus à Fadia que ce qu’elle devoit avoir par la loi Voconienne. Sextilius eut là une grande succession, dont il n’auroit pas retenu un sesterce, s’il avoit préféré ce qui étoit juste & honnête à ce qui étoit utile. Je puis croire, ajouta-t-il, que vous auriez rendu l’hérédité ; je puis croire même qu’Épicure l’auroit rendue : mais vous n’auriez pas suivi vos principes. » Je ferai ici quelques réflexions.
C’est un malheur de la condition humaine, que les législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentimens naturels mêmes : telle fut la loi Voconienne. C’est que les législateurs statuent plus sur la société que sur le citoyen, & sur le citoyen que sur [III-288] l’homme. La loi sacrifoit & le citoyen & l’homme, & ne pensoit qu’à la république. Un homme prioit son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisoit dans le testateur, les sentimens de la nature ; elle méprisoit dans la fille, la piété filiale ; elle n’avoit aucun égard pour celui qui étoit chargé de remettre l’hérédité, qui se trouvoit dans de terribles circonstances. La remettoit-il ? il étoit un mauvais citoyen : la gardoit-il ? il étoit un mal-honnête homme. Il n’y avoit que les gens d’un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n’y avoit que les honnêtes gens qu’on pût choisir pour l’éluder : car c’est toujours un triomphe à remporter sur l’avarice & les voluptés, & il n’y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y auroit-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n’est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa foi étoit telle, qu’elle ne forçoit que les honnêtes gens à l’éluder.
Dans le temps que l’on fit la loi Voconienne, les mœurs avoient conservé quelque chose de leur ancienne pureté.
[III-289] On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi, & l’on fit jurer [40] qu’on l’observeroit : de sorte que la probité faisoit, pour ainsi dire, la guerre à la probité. Mais dans les derniers temps, les mœurs se corrompirent au point, que les fidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne, que cette loi n’en avoit pour se faire suivre.
Les guerres civiles firent périr un nombre infini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva presque déserte ; il falloit la repeupler. On fit les lois Papiennes, où l’on n’omit rien de ce qui pouvoit encourager [41] les citoyens à se marier & à avoir des enfans. Un des principaux moyens fut d’augmenter, pour ceux qui se prêtoient aux vues de la loi, les espérances de succéder, & de les diminuer pour ceux qui s’y refusoient ; & comme la loi Voconienne avoit rendu les femmes incapables de succéder, la loi Pappienne fit dans de certains cas cesser cette prohibition.
[III-290]
Les femmes [42] , sur-tout celles qui avoient des enfans, furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris ; elles purent, quand elles avoient des enfans, recevoir en vertu du testament des étrangers, tout cela contre la disposition de la loi Voconienne : & il est remarquable qu’on n’abandonna pas entiérement l’esprit de cette loi. Par exemple, la loi Pappienne [43] permettoit à un homme qui avoit un enfant [44] , de recevoir toute l’hérédité par le testament d’un étranger ; elle n’accordoit la même grace à la femme, que lorsqu’elle avoit trois [45] enfans.
Il faut remarquer que la loi Pappienne ne rendit les femmes qui avoient trois enfans, capables de succéder, qu’en vertu du testament des étrangers ; & [III-291] qu’à l’égard de la succession des parens, elle laissa les anciennes lois & la loi Voconienne [46] dans toute leur force. Mais cela ne subsista pas.
Rome abymée par les richesses de toutes les nations, avoit changé de mœurs ; il ne fut plus question d’arrêter le luxe des femmes. Aulugelle, qui vivoit sous Adrien [47] , nous dit que de son temps la loi Voconienne étoit presque anéantie ; elle fut couverte par l’opulence de la cité. Aussi trouvons-nous dans les sentences de Paul [48] qui vivoit sous Niger, & dans les fragmens d’Ulpien [49] qui étoit du temps d’Alexandre Sévere, que les sœurs du côté du pere pouvoient succéder, & qu’il n’y avoit que les parens d’un degré plus éloigné, qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.
Les anciennes lois de Rome avoient commencé à paroître dures ; & les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’équité, de modération & de bienséance.
[III-292]
Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les meres n’avoient point de part à la succession de leurs enfans. La loi Voconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l’empereur Claude donna à la mere la succession de ses enfans, comme une consolation de leur perte ; le senatus-consulte Tertullien fait sous Adrien [50] la leur donna lorsqu’elles avoient trois enfans, si elles étoient ingénues ; ou quatre, si elles étoient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n’étoit qu’une extension de la loi Pappienne, qui, dans le même cas, avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien [51] leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfans.
Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avoit gêné la succession des parens par femmes. Ces lois étoient très-conformes à l’esprit d’une bonne [III-293] république, où l’on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l’espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage à charge & coûteux, il faut y être invité, & par les richesses que les femmes peuvent donner, & par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer. Ainsi, lorsque la monarchie s’établit à Rome, tout le systême fut changé sur les successions. Les préteurs appellerent les parens par femmes au défaut des parens par mâles : au lieu que, par les anciennes lois, les parens par femmes n’étoient jamais appellés. Le sénatus-consulte Orphitien appella les enfans à la succession de leur mere ; & les empereurs Valentinien [52] , Théodose & Arcadius appellerent les petits-enfans par la fille à la succession du grand-pere. Enfin l’empereur Justinien [53] ôta jusqu’au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d’héritiers, les descendans, les ascendans, les collatéraux, sans aucune [III-294] distinction entre les mâles & les femelles, entre les parens par femmes & les parens par mâles ; & abrogea toutes celles qui restoient à cet égard. Il crut suivre la nature même, en s’écartant de ce qu’il appella les embarras de l’ancienne jurisprudence.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. II. chap. III. Plutarque, dans sa comparaison de Numa & de Lycurgue.
-
[↑] Ast si intestato moritur, cui suus hæres nec extabit, agnatus proximus familiam habeto. Fragm. de la loi des douze tables, dans Ulpien, titre dernier.
-
[↑] Voyez les Fragmens d’Ulpien, §. 8, tot. 26, inst. tit. 3, in proæmio ad Sen. Conf. Tertullianum.
-
[↑] Paul, liv. IV. de sent. tit. 8. §. 3.
-
[↑] Instit. liv. III. tit. I, §. 15.
-
[↑] Livre IV, page 276.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse prouve, par une loi de Numa, que la loi qui permettoit au pere de vendre son fils trois fois, étoit une loi de Romulus, non pas des décemvirs, livre II.
-
[↑] Voyez Plutarque, vie de Solon.
-
[↑] Ce testament appellé in procinctu, étoit différent de celui qu’on appella militaire, qui ne fut établi que par les constitutions des empereurs, leg I. ff. de militari testamento : ce fut une de leurs cajoleries envers les soldats.
-
[↑] Ce testament n’étoit point écrit, & étoit sans formalités, sine librâ & tabulis, comme dit Cicéron, livre I. de l’orateur.
-
[↑] Inst. liv. II. tit. 10, §. I ; Aulugelle, liv. XV. chap. xxvii. On appella cette sorte de testament, per as & libram.
-
[↑] Ulpien, tit. 10, §. 2.
-
[↑] Théophile, instit. liv. II. tit. 30.
-
[↑] Ils n’en eurent qu’au temps de la guerre de Pyrrhus. Tite-Live, parlant du siege de Veïes, dit : Nondum argentum signatum erat, liv. IV.
-
[↑] Titre 20, §. 13.
-
[↑] Instit. liv. II. tit. 10, §. I.
-
[↑] Titius, sois mon héritier.
-
[↑] La vulgaire, la puprilaire, l’exemplaire.
-
[↑] Auguste, par des raisons particulieres, commença à autoriser les fidéicommis. Instit. livre II. tit. 23. §. I.
-
[↑] Ad liberos matris intestatæ hæreditas, leg. XII. Tab. non pertinebat, quia fæminæ suos hæredes non habent. Ulp. fragm. tit. 26. §. 7.
-
[↑] Quintus Voconius, tribun du peuple, la proposa. Voyez Cicéron, seconde harangue contre Verrès. Dans l’épitome de Tite-Live, livre XLI, il faut lire Voconius¸au lieu de Volumnius.
-
[↑] Sanxit… ne quis hæredem virginem neve me lierem faceret. Cicéron, seconde harangue contre Verrès.
-
[↑] Legem tuliy, ne quis hæredem mulierem institue ret, liv. XLI.
-
[↑] Seconde harangue contre Verrès.
-
[↑] Livre III de la cité de Dieu.
-
[↑] Epitome de Tite-Live, liv. XLI.
-
[↑] Livre XVII. chap. vi.
-
[↑] Instit. liv. II. tit. 22.
-
[↑] Livre II. tit. 22.
-
[↑] Nemo censuit plus Fadiæ dandum, quam posses ad eam lege Voconianâ pervenire. De finibus boni & mali, liv. II.
-
[↑] Cum lege Voconianâ mulieribus prohiberetur ne quæ majorem centum millibus nummorum hæreditatem posset adire, liv. LVI.
-
[↑] Qui census esset. Harangue seconde contre Verrès.
-
[↑] Census non erat. Ibid.
-
[↑] Livre IV.
-
[↑] In oratione pro Cæcinnâ.
-
[↑] Ces cinq premieres classes étoient si considérables, que quelquefois les auteurs n’en rapportent que cinq.
-
[↑] In Cæritum tabulas referri, ærarius fieri.
-
[↑] Cicéron, de finib. boni & mali, liv. II.
-
[↑] Cicéron, de finib. boni & mali, liv. II.
-
[↑] Sextilius disoit qu’il avoit juré de l’observer. Cicéron, de finib. boni & mali, liv. II.
-
[↑] Voyez ce que j’en ai dit au liv. XXIII. ch. xxi.
-
[↑] Voyez sur ceci les fragmens d’Ulpien, tit. 15. §. 16.
-
[↑] La même différence se trouve dans plusieurs dispositions de la loi Pappienne. Voyez les fragmens d’Ulpien¸§. 4 & 5, tit. dernier ; & le même au même titre, §. 6.
-
[↑] Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur ex me,
Jura parentis habes, propter me scriberis hæres
Juvenal, sat. IX. -
[↑] Voyez la loi IX, cod. Théod. de bonis proscriptorum ; & Dion. liv. LV ; voyez les fragmens d’Ulpien, tit. derni. §. 6 ; & tit. 29, §. 3.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I ; Sozom. liv. I. chap xix.
-
[↑] Liv. XX, chap. i.
-
[↑] Liv. IV, tit. 8. §. 3.
-
[↑] Tit. 26. 6. 6.
-
[↑] C’est-à-dire, l’empereur Pie, qui prit le nom d’Adrien par adoption.
-
[↑] Leg. II, cod. de jure liberorum, instit. liv. III. tit. 3. §. 4. de senatus consult. Tertull.
-
[↑] Lege IX, cod. de suis & legitimis liberis.
-
[↑] Lege XII, cod. ibid. & les novelles 118 & 127.
[III-295]
LIVRE XXVIII.
De l’origine & des révolutions des Lois civiles chez les François.↩
In nove sert animus mutatas dicere formas
Corpora. . . . . . .Ovid. Metam
CHAPITRE PREMIER.
Des différens caracteres des Lois des peuples Germains.
Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger [1] par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Francs Ripuaires s’étant jointe sous Clovis [2] à celle des Francs Saliens, elle conserva ses usages ; & Théodoric [3] roi d’Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit [4] de [III-296] même les usages des Bavarois & des Allemands qui dépendoient de son royaume. Car la Germanie étant affoiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux, avoient fait un pas en arriere, & porté leur domination dans les forêts de leurs peres. Il y a apparence que le code [5] des Thuringiens fut donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étoient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles-Martel & Pepin, leur [6] loi n’est pas antérieure à ces princes. Charlemagne, qui le premier dompta les Saxons, leur donna la loi que nous avons. Il n’y a qu’à lire des deux derniers codes, pour voir qu’ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bourguignons, & les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.
Il y a dans les lois saliques & Ripuaires, dans celles des Allemands, des [III-297] Bavarois, des Thuringiens & des Frisons, une simplicité admirable : on y trouve une rudesse originale & un esprit qui n’avoit point été affoibli par un autre esprit. Elles changerent peu, parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, resterent dans la Germanie. Les Francs même y fonderent une grande partie de leur empire : ainsi leurs lois furent toutes Germaines. Il n’en fut pas de même des lois des Wisigoths, des Lombards & des Bourguignons ; elles perdirent beaucoup de leur caractere, parce que ces peuples, qui se fixerent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.
Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez long-temps, pour que les lois du peuple vainqueur pussent recevoir de grands changemens. Gondebaud & Sigismond, qui recueillirent leurs usages, furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des changemens. Celles de Rotharis furent suivies de celles de Grimoald, de Luitprand, de Rachis, d’Aistulphe ; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. Il n’en fut pas de même des lois de [III-298] Wisigoths [7] ; leurs rois les refondirent, & les firent refondre par le clergé.
Les rois de la première race ôterent [8] bien aux lois saliques & Ripuaires ce qui ne pouvoit absolument s’accorder avec le Christianisme : mais ils en laisserent tout le fond. C’est ce qu’on ne peut pas dire des lois des Wisigoths.
Les lois des Bourguignons, & sur-tout celles des Wisigoths, admirent les peines corporelles. Les lois saliques & Ripuaires ne les reçurent [9] ; elles conserverent mieux leur caractere.
Les Bourguignons & les Wisigoths dont les provinces étoient très-exposées, chercherent à se concilier les anciens habitans, & à leur donner des lois civiles les plus impartiales [10] : mais les rois Francs, sûrs de leur puissance, n’eurent [11] pas ces égards.
[III-299]
Les Saxons, qui vivoient sous l’empire des Francs, eurent une humeur indomptable, & s’obstinerent à se révolter. On trouve dans leurs [12] lois des duretés du vainqueur, qu’on ne voit point dans les autres codes des lois des barbares.
On y voit l’esprit des lois des Germains dans les peines pécuniaires, & celui du vainqueur dans les peines afflictives.
Les crimes qu’ils font dans leur pays, sont punis corporellement ; & on ne suit l’esprit des lois Germaniques que dans la punition de ceux qu’ils commettent hors de leur territoire.
On y déclare que pour leurs crimes ils n’auront jamais de paix, & on leur refuse l’asyle des églises mêmes.
Les évêques eurent une autorité immense à la cour des rois Wisigoths ; les affaires les plus importantes étoient décidées dans les conciles. Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous les principes & toutes les vues de l’inquisition d’aujourd’hui ; & les moines n’ont fait que copier contre [III-300] les Juifs, des lois faites autrefois par les évêques.
Du reste, les lois de Gondebaud pour les Bourguignons paroissent assez judicieuses ; celles de Rotharis & des autres princes Lombards le sont encore plus. Mais les lois des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chaindasuinde & d’Egiga, sont puériles, gauches, idiotes ; elles n’atteignent point le but : pleines de rhétorique, & vuides de sens, frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style.
-
[↑] Voyez le prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit, dans son traité de l’origine des Francs, que cette loi fut faite avant le regne de Clovis : mais elle ne put l’être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n’entendoient pas pour lors la langue Latine.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours.
-
[↑] Voyez le prologue de la loi des Bavarois & celui de la loi salique.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Lex Angliorum Werinorum, hoc est, Thuringorum.
-
[↑] Ils ne savoient point écrire.
-
[↑] Euric les donna, Leuvigilde les corrigea. Voyez la chronique d’Isidore. Chaindasuinde & Récessuinde les réformerent. Egiga fit faire le code que nous avons, & en donna la commission aux évêques ; on conserva pourtant les lois de Chaindasuinde & de Récessuinde, comme il paroît par le seizieme concile de Tolede.
-
[↑] Voyez le prologue de la loi des Bavarois.
-
[↑] On en trouve seulement quelques-unes dans le décret de Childebert.
-
[↑] Voyez le prologue du code des Bourguignons & le code même ; sur-tout le tit. 12, §. 5, & le tit. 38. Voyez aussi Grégoire de Tours, liv. II, ch. xxxiii ; & le code des Wisigoths.
-
[↑] Voyez ci-dessous, le ch. iii.
-
[↑] Voyez le chap. ii, §. 8 & 9, & le chap. iv, §. 2 & 7.
[III-300]
CHAPITRE II.
Que les lois des barbares furent toutes personnelles.
C’est un caractere particulier de ces lois des barbares, qu’elles ne furent point attachées à un certain territoire : le Franc étoit jugé par la loi des Francs, l’Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi Romaine : & bien loin qu’on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérans, on en pensa pas [III-301] même à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l’origine de cela dans les mœurs des peuples Germains. Ces nations étoient partagées par des marais, des lacs & des forêts ; on voit même dans César [1] qu’elles aimoient à se séparer. La frayeur qu’elles eurent des Romains, fit qu’elles se réunirent ; chaque homme, dans ces nations mêlées, dut être jugé par les usages & les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples dans leur particulier étoient libres & indépendans ; & quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore : la patrie étoit commune, & la république particuliere ; le territoire étoit le même, & les nations diverses. L’esprit des lois personnelles étoit donc chez ces peuples avant qu’ils partissent de chez eux, & ils le porterent dans leurs conqûetes.
On trouve cet usage établi dans les formules [2] de Marculfe, dans les codes des lois des barbares, sur-tout dans la loi des Ripuaires [3] , dans les [4] [III-302] décrets des rois de la premiere race, d’où dériverent les capitulaires que l’on fit là-dessus dans la seconde [5] . Les enfans [6] suivoient la loi de leur pere, les femmes [7] celle de leur mari ; les veuves [8] revenoient à leur loi, les affranchis [9] avoient celle de leur patron. Ce n’est pas tout : chacun pouvoit prendre la loi qu’il vouloit ; la constitution de Lothaire I [10] exigea que ce choix fût rendu public.
-
[↑] De bello Gallico, liv. VI.
-
[↑] Liv. I, form. 8.
-
[↑] Chap. xxxi.
-
[↑] Celui de Clotaire de l’an 560, dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, arr. 4 ; ibid. in fine.
-
[↑] Capitul. Ajoutés à la loi des Lombards, liv. I, tit. 25. ch. lxxi ; liv. II, tit. 41, ch. vii ; & tit. 56, chap. i & ii.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 5.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 7, ch. i.
-
[↑] Ibid. ch. ii.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 35, ch. ii.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 57.
[III-302]
CHAPITRE III.
Différence capitale entre les Lois saliques & les Lois des wisigoths & des Bourguignons.
J’ai dit [1] que la loi des Bourguignons & celle des wisigoths étoient impartiales : mais la loi salique ne le fut pas : elle établit entre les Francs & les Romains les distinctions les plus [III-303] affligeantes. Quand [2] on avoit tué un Franc, un barbare, ou un homme qui vivoit sous la loi salique, on payoit à ses parens une composition de 200 sols : on n’en payoit qu’une de 100, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur [3] ; & seulement une de 45, quand on avoit tué un Romain tributaire : la composition pour le meurtre d’un Franc vassal [4] du roi, étoit de 600 sols ; & celle du meurtre d’un Romain convive [5] du roi [6] n’étoit que de 300. Elle mettoit donc une cruelle différence entre le seigneur Franc & le seigneur Romain, & entre le Franc & le Romain qui étoient d’une condition médiocre.
Ce n’est pas tout : si l’on assembloit [7] du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, & qu’on le tuât, la loi salique ordonnoit une composition de 600 sols ; mais si on avoit assailli un Romain ou un [III-304] affranchi [8] , on ne payoit que la moitié de la composition. Par la même loi [9] , si un Romain enchaînoit un Franc, il devoit trente sous de composition ; mais si un Franc enchaînoit un Romain, il n’en devoit qu’une de quinze. Un Franc dépouillé par un Romain, avoit soixante-deux sous & demi de composition ; & un Romain dépouillé par un Franc, n’en recevoir qu’une de trente. Tout cela devoit être accablant pour les Romains.
Cependant un auteur [10] célebre forme un systême de l’établissement des Francs dans les Gaules, sur la présupposition qu’ils étoient les meilleurs amis des Romains. Les Francs étoient donc les meilleurs amis des Romains, eux qui leur firent, eux qui en reçurent [11] des maux effroyables ? Les Francs étoient amis des Romains, eux qui, après les avoir assujettis par les armes, les opprimerent de sang froid par leurs lois ? Ils étoient amis des Romains, comme les Tartares qui conquirent la Chine, étoient amis des Chinois.
[III-305]
Si quelques évêques catholiques ont voulu se servir des Francs pour détruire des rois Arriens, s’ensuit-il qu’ils ayent désiré de vivre sous des peuples barbares ? En peut-on conclure que les Francs eussent des égards particuliers pour les Romains ? J’en tirerois bien d’autres conséquences : plus les Francs furent sûrs des Romains, moins ils les ménagerent.
Mais l’Abbé Dubos a puisé dans de mauvaises sources pour un historien, les poëtes & les orateurs : ce n’est point sur des ouvrages d’ostentation qu’il faut sonder des systêmes.
-
[↑] Au chapitre premier de ce livre.
-
[↑] Loi salique, tit. 44. §. I.
-
[↑] Qui res in pago ubi remanet proprias habet. Loi salique, tit. 44, §. 15 ; voyez aussi le §. 7.
-
[↑] Qui in truste dominicâ est, ibid. tit. 44. §. 4.
-
[↑] Si Romanus homo conviva regis suerit, ibid. §. 6.
-
[↑] Les principaux Romains s’attachoient à la cour, comme on le voit par la vie de plusieurs évêques qui y furent élevés ; il n’y avoit guere que les Romains qui sussent écrire.
-
[↑] Ibid. tit. 45.
-
[↑] Lidus, dont la condition étoit meilleure que celle du serf : loi des Allemands, chap. xcv.
-
[↑] Tit. 35, §. 3 & 4.
-
[↑] L’abbé Dubos.
-
[↑] Témoin l’expédition d’Arbogaste, dans Grégoire de Tours, hist. liv. II.
[III-305]
CHAPITRE IV.
Comment le droit Romain se perdit dans le pays du domaine des Francs, & se conserva dans le pays du domaine des Goths & des Bourguigons.
Les choses que j’ai dites donnerent du jour à d’autres, qui ont été jusqu’ici pleines d’obscurités.
Le pays qu’on appelle aujourd’hui la France, fut gouverné dans la premiere race par la loi Romaine ou le code [III-306] Théodosien, & par les diverses lois des barbares [1] qui y habitoient.
Dans le pays du domaine des Francs, la loi salique étoit établie pour les Francs, & le code [2] Théodosien pour les Romains. Dans celui du domaine des Wisigoths, une compilation du code Théodosien, faite par l’ordre d’Alaric [3] , régla les différens des Romains ; les coutumes de la nation, qu’Euric [4] fit rédiger par écrit, déciderent ceux des Wisigoths. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans le pays des Francs ? Et pourquoi le droit Romain s’y perdit-il peu à peu, pendant que, dans le domaine des Wisigoths, le droit Romain s’étendit, & eut une autorité générale ?
Je dis que le droit Romain perdit son usage chez les Francs, à cause des grands avantages qu’il y avoit à être Franc [5] , [III-307] barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; tout le monde fut porté à quitter le droit Romain, pour vivre sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques [6] , parce qu’ils n’eurent point d’intérêt à changer. Les différences des conditions & des rangs ne consistoient que dans la grandeur des compositions, comme je le ferai voir ailleurs. Or, des lois [7] particulieres leur donnerent des compositions aussi favorables que celles qu’avoient les Francs : ils garderent donc le droit Romain. Ils n’en recevoient aucun préjudice ; & il leur convenoit d’ailleurs, parce qu’il étoit l’ouvrage des empereurs Chrétiens.
D’un autre côté, dans le patrimoine des Wisigoths, la loi Wisigothe [8] ne [III-308] donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains, les Romains n’eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils garderent donc leurs lois, & ne prirent point celles des Wisigoths.
Ceci se confirme à mesure qu’on va plus avant. La loi de Gondebaud fut très-impartiale, & ne fut pas plus favorable aux Bourguignons qu’aux Romains. Il paroît, par le prologue de cette loi, qu’elle fut faite pour les Bourguignons, & qu’elle fut faite encore pour régler les affaires qui pourroient naître entre les Romains & les Bourguignons ; et dans ce dernier cas, le tribunal fut mi-parti. Cela étoit nécessaire pour des raisons particulieres, tirées de l’arrangement [9] politique de ces temps-là. Le droit Romain subsista dans la Bourgogne, pour régler les différens que les Romains pourroient avoir entr’eux. Ceux-ci n’eurent point de raison pour quitter leur loi, comme ils en eurent dans le pays des Francs ; d’autant mieux que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, comme il paroît par la [III-309] fameuse lettre qu’Agobard écrivit à Louis le débonnaire.
Agobard [10] demandoit à ce prince d’établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n’y étoit donc pas établie. Ainsi le droit Romain subsista, & subsiste encore dans tant de provinces qui dépendoient autrefois de ce royaume.
Le droit Romain & la loi Gothe se maintinrent de même dans le pays de l’établissement des Goths : la loi salique n’y fut jamais reçue. Quand Pepin & Charles-Martel en chasserent les Sarrasins, les villes & les provinces qui se soumirent à ces princes [11] demanderent à conserver leurs lois, & l’obtinrent : ce qui, malgré l’usage de ces temps-là où toutes les lois étoient personnelles, fit bientôt regarder le droit Romain comme une loi réelle & territoriale dans ces pays.
[III-310]
Cela se prouve par l’édit de Charles le chauve, donné à Pistes l’an 864, qui [12] distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit Romain, d’avec ceux où l’on n’y jugeoit pas.
L’édit de Pistes prouve deux choses ; l’une, qu’il y avoit des pays où l’on jugeoit selon la loi Romaine, & qu’il y en avoit où l’on ne jugeoit point selon cette loi ; l’autre, que ces pays où l’on jugeoit par la loi Romaine, étoient précisément [13] ceux où on la suit encore aujourd’hui, comme il paroît par ce même édit : ainsi la distinction des pays de la France coutumiere, & de la France régie par le droit écrit, étoit déjà établie du temps de l’édit de Pistes.
J’ai dit que dans les commencemens de la monarchie, toutes les lois étoient personnelles : ainsi, quand l’édit de Pistes distingue les pays du droit Romain d’avec ceux qui ne l’étoient pas, cela signifie que, dans les pays qui n’étoient point pays de droit Romain, tant de gens avoient choisi de vivre sous [III-311] quelqu’une des lois des peuples barbares, qu’il n’y avoit presque plus personne dans ces contrées qui choisît de vivre sous la loi Romaine, & que, dans les pays de la loi Romaine, il y avoit peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares.
Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles : mais si elles sont vraies, elles sont très-anciennes. Qu’importe, après tout, que ce soient moi, les Valois, ou les Bignons, qui les ayent dites ?
-
[↑] Les Francs, les Wisigoths & les Bourguignons.
-
[↑] Il fut fini l’an 438.
-
[↑] La vingtieme année du regne de ce prince, & publiée deux ans après par Anian, comme il paroît par la préface de ce code.
-
[↑] L’an 504 de l’ere de l’Espagne : chronique d’Isidore.
-
[↑] Francum aut barbarum, aut hominem qui salicô lege vivit. Loi salique, tit. 445, §. 1.
-
[↑] Selon la loi Romaine, sous laquelle l’église vit, est-il dit dans la loi des Ripuaires, tit. 58, §. I. Voyez aussi les autorités sans nombre là-dessus, rapportées par M. Ducange, au mot Lex Romana.
-
[↑] Voyez les capitulaires ajoutés à la loi salique dans Lindembroc, à la fin de cette loi, & les divers codes des lois des barbares sur les privileges des ecclésiastiques à cet égard. Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pepin son fils, toi d’Italie, de l’an 807, dans l’édition de Buluze, tome I, page 452, où il est dit qu’un ecclésiastique doit recevoir une composition triple ; & le recueil des capitulaires, liv. V. art. 302, tome I, édition de Baluze.
-
[↑] Voyez cette loi.
-
[↑] J’en parlerai ailleurs liv. XXX, ch. vi, vii, viii & ix.
-
[↑] Agob. opera.
-
[↑] Voyez Gervais de Tilburi, dans le recueil de Duchesne, tome 3, p. 366 : Factâ pactione cum Francis, quòd illic Gothi patriis legibus, moribus paternis vivant. Et sic Narbone sis provincia Pippino subjicitur. Et une chronique de l’an 759, rapportée par Catel, histoire du Languedoc. Et l’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, sur la demande faite par les peuples de la Septimanie, dans l’assemblée in Carisiaco, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 316.
-
[↑] In illâ terrâ in quâ judicia secundùm legem Romanam terminantur, secundùm ipsam legem judicetur ; & in illâ in quâ, &c. art. 16. V. aussi l’art 20.
-
[↑] Voyez l’art. 12 & 16 de l’édit de Pistes, in Cavilono, in Narbonâ, &c.
[III-311]
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
La loi de Gondebaud subsista long-temps chez les Bourguignons, concurremment avec la loi Romaine : elle y étoit encore en usage du temps de Louis le débonnaire ; la lettre d’Agobard ne laisse aucun doute là-dessus. De même, quoique l’édit de Pistes appelle le pays qui avoit été occupé par les Wisigoths, le pays de la loi Romaine, la loi des Wisigoths y subsistoit toujours ; ce qui se prouve par le synode de Troyes, tenu sous Louis le begue, [III-312] l’an 878, c’est-à-dire, quatorze ans après l’édit de Pistes.
Dans la suite, les lois Gothes & Bourguignonnes périrent dans leur pays même, par les causes [1] générales qui firent par-tout disparoître les lois personnelles des peuples barbares.
-
[↑] Voyez ci-dessous les chapitres IX, X & XI.
[III-312]
CHAPITRE VI.
Comment le droit Romain se conserva dans le domaine des Lombards.
Tout se plie à mes principes. La loi des Lombards étoit impartiale, & les Romains n’eurent aucun intérêt à quitter la leur pour la prendre. Le motif qui engagea les Romains sous les Francs à choisir la loi salique, n’eut point de lieu en Italie ; le droit Romain s’y maintint avec la loi des Lombards.
Il arriva même que celle-ci céda au droit Romain ; elle cessa d’être la loi de la nation dominante ; & quoiqu’elle continuât d’être celle de la principale noblesse, la plupart des villes s’érigerent en républiques, & cette noblesse [III-313] tomba, ou fut [1] exterminée. Les citoyens des nouvelles républiques ne furent point portés à prendre une loi qui établissoit l’usage du combat judiciaire, & dont les institutions tenoient beaucoup aux coutumes & aux usages de la chevalerie. Le clergé dès-lors si puissant en Italie, vivant presque tous sous la loi Romaine, le nombre de ceux qui suivoient la loi des Lombards dut toujours diminuer.
D’ailleurs, la loi des Lombards n’avoit point cette majesté du droit Romain, qui rappelloit à l’Italie l’idée de sa domination sur toute la terre ; elle n’en avoit pas l’étendue. La loi des Lombards & la loi Romaine ne pouvoient plus servir qu’à suppléer aux statuts des villes qui s’étoient érigées en républiques : or, qui pouvoit mieux y suppléer, ou la loi des Lombards qui ne statuoit que sur quelques cas, ou la loi Romaine qui les embrassoit tous ?
-
[↑] Voyez ce que dit Machiavel, de la destruction de l’ancienne noblesse de Florence.
[III-314]
CHAPITRE VII.
Comment le droit Romain se perdit en Espagne.
Les choses allerent autrement en Espagne. La loi des Wisigoths triompha, & le droit Romain s’y perdit. Chaindasuinde [1] & Récessuinde [2] proscrivirent les lois Romaines, & ne permirent pas même de les citer dans les tribunaux. Récessuinde fut encore l’auteur de la loi [3] , qui ôtoit la prohibition des mariages entre les Goths & les Romains. Il est clair que ces deux lois avoient le même esprit : ce roi vouloit enlever les principales causes de séparation qui étoient entre les Goths & les Romains. Or, on pensoit que rien ne les séparoit plus que la défense de contracter entr’eux des mariages, & la permission de vivre sous des lois diverses.
Mais quoique les rois des Wisigoths [III-315] eussent proscrit le droit Romain, il subsista toujours dans les domaines qu’ils possédoient dans la Gaule méridionale. Ces pays éloignés du centre de la monarchie, vivoient dans une grande indépendance [4] . On voit par l’histoire de Vamba, qui monta sur le trône en 672, que les naturels du pays avoient pris le dessus [5] : ainsi la loi Romaine y avoit plus d’autorité, & la loi Gothe y en avoit moins. Les lois Espagnoles ne convenoient ni à leurs manieres, ni à leur situation actuelle ; peut-être même que le peuple s’obstina à la loi Romaine, parce qu’il y attacha l’idée de sa liberté. Il y a plus : les lois de Chaindasuinde & de Récessuinde contenoient des dispositions effroyables contre les Juifs : mais ces Juifs étoient puissans dans la Gaule méridionale. L’auteur de l’histoire du roi Vamba appelle ces provinces le [III-316] prostibule des Juifs. Lorsque les Sarrasins vinrent dans ces provinces, ils y avoient été appelés ; or, qui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Romains ? Les Goths furent les premiers opprimés, parce qu’ils étoient la nation dominante. On voit dans Procope [6] que dans leurs calamités ils se retiroient de la Gaule Nabonnoise en Espagne. Sans doute que, dans ce malheur-ci, ils se réfugierent dans les contrées de l’Espagne qui se défendoient encore ; & le nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivoient sous la loi des Wisigoths, en fut beaucoup diminué.
-
[↑] Il commença à régner en 642.
-
[↑] Nous ne voulons plus être tourmentés par les lois étrangeres, ni par les Romaines ; lois des Wisigoths, liv. II, tit. I, §. 9 & 10.
-
[↑] Ut tàm Gotho Romanam Quàm Romano Gotham, matrimonio liceat sociari. Loi des Wisigoths, liv. III, tit. I, ch. i.
-
[↑] Voyez dans Cassiodore les condescendances que Théodoric roi des Ostrogoths, prince le plus accrédité de son temps, eut pour elles, liv. IV. lett. 19 & 26.
-
[↑] La révolte de ces provinces fut une défection générale, comme il paroît par le jugement qui est à la suite de l’histoire. Paulus & ses adhérens étoient Romains, ils furent même favosirés par les Evêques. Vamba n’osa pas faire mourir les séditieux qu’il avoit vaincus. L’auteur de l’histoire appelle la Gaule Narbonoise, la nourrice de la perfidie.
-
[↑] Gothi qui cladi supersuerant, ex Galliâ cum uxoribus liberisque egressi in Hispaniam ad Teudim jàm palàm tyrannum se recepereunt, de bello Gothorum, liv. I, ch. xiii.
[III-316]
CHAPITRE VIII.
Faux Capitulaires.
Ce malheureux compilateur Benoît Lévite, n’alla-t-il pas transformer cette loi Wisigothe qui défendoit l’usage du droit Romain, en un capitulaire [1] , [III-317] qu’on attribua depuis à Charlemagne ? Il fit de cette loi particuliere une loi générale, comme s’il avoit voulu exterminer le droit Romain par tout l’univers.
-
[↑] Capitul. édit. de Baluze, liv. VI, ch. cccxliii, page 981, tome I.
[III-317]
CHAPITRE IX.
Comment les codes des lois des Barbares & des Capitulaires se perdirent.
Les lois saliques, Ripuaires, Bourguignonnes & Wisigothes, cesserent peu à peu d’être en usage chez les François : voici comment.
Les fiefs étant devenus héréditaires, & les arriere-fiefs s’étant étendus, il s’introduisit beaucoup d’usages auxquels ces lois n’étoient plus applicables. On en retint bien l’esprit, qui étoit de régler la plupart des affaires par des amendes. Mais les valeurs ayant sans doute changé, les amendes changèrent aussi ; & l’on voit beaucoup de chartres [1] où les seigneurs fixoient les amendes qui devoient être payées dans leurs petits [III-318] tribunaux. Ainsi l’on suivit l’esprit de la loi, sans suivre la loi même.
D’ailleurs la France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries, qui reconnoissoient plutôt une dépendance féodale qu’une dépendance politique, il étoit bien difficile qu’une seule loi pût être autorisée : en effet, on n’auroit pas pu la faire observer. L’usage n’étoit guere plus qu’on envoyât des officiers [2] extraordinaires dans les provinces, qui eussent l’œil sur l’administration de la justice & sur les affaires politiques ; il paroît même par les chartres, que lorsque de nouveaux fiefs s’établissoient, les rois se privoient du droit de les y envoyer. Ainsi, lorsque tout à peu près fut devenu fief, ces officiers ne purent plus être employés ; il n’y eut plus de loi commune, parce que personne ne pouvoit faire observer la loi commune.
Les lois Saliques, Bourguignonnes & Wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race ; & au commencement de la troisieme, on n’en entendit presque plus parler.
Sous les deux premieres races, on [III-319] assembla souvent la nation, c’est-à-dire, les seigneurs & les évêques : il n’étoit point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé qui étoit un corps qui se formoit, pour ainsi dire, sous les conquérans, & qui établissoit ses prérogatives ; les lois faites dans ces assemblées, sont ce que nous appellons les capitulaires. Il arriva quatre choses, les lois des fiefs s’établirent, & une grande partie des biens de l’église fut gouvernée par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparerent davantage, & négligerent [3] des lois de réforme où ils n’avoient pas été les seuls réformateurs ; on recueillit [4] les canons des conciles & les [III-320] décrétales des papes ; & le clergé reçut ces lois, comme venant d’une source plus pure. Depuis l’érection des grands fiefs, les rois n’eurent plus, comme j’ai dit, des envoyés dans les provinces, pour faire observer des lois émanées d’eux : ainsi sous la troisieme race, on n’entendit plus parler de capitulaires.
-
[↑] M. de la Thaumassiere en a recueilli plusieurs. Voyez, par exemple, les chapitres lxi, lxvi & autres.
-
[↑] Missi dominici.
-
[↑] Que les Evêques, dit Charles le chauve, dans le capitulaire de l’an 844, art. 8, sous prétexte qu’ils ont l’autorité de faire des canons, ne s’opposent pas à cette constitution, ni ne la négligent. Il semble qu’il en prévoyoit déjà la chute.
-
[↑] On inséra dans le recueil des canons un nombre infini de décrétales des papes ; il y en avoit très-peu dans l’ancienne collection. Denys le petit en mit beaucoup dans la sienne : mais celle d’Isidor Mercator fut remplie de vraies & de fausses décrétales. L’ancienne collection fut en usage des mains du pape Adrien I, la collection de Denys le petit, & la fit recevoir. La collection d’Isidor Mercator parut en France vers le regne de Charlemagne ; on s’en entêta : ensuite vint ce qu’on appelle le corps de droit canonique.
[III-320]
CHAPITRE X.
Continuation du même sujet.
On ajouta plusieurs capitulaires à la loi des Lombards, aux lois saliques, à la loi des Bavarois. On en a cherché la raison ; il faut la prendre dans la chose même. Les capitulaires étoient de plusieurs especes. Les uns avoient du rapport au gouvernement politique, d’autres au gouvernement économique, la plupart au gouvernement ecclésiastique, quelques-uns au gouvernement civil. Ceux de cette derniere espece furent ajoutés à la loi civile, c’est-à-dire aux lois personnelles de chaque nation : c’est pour cela qu’il est dit dans les capitulaires, qu’on n’y a rien stipulé [1] [III-321] contre la loi Romaine. En effet, ceux qui regardoient le gouvernement économique, ecclésiastique ou politique, n’avoient poins de rapport avec cette loi ; & ceux qui regardoient le gouvernement civil n’en eurent qu’aux lois des peuples barbares, que l’on expliquoit, corrigeoit, augmentoit & diminuoit. Mais ces capitulaires ajoutés aux lois personnelles, firent, je crois, négliger le corps même des capitulaires : dans des temps d’ignorance, l’abrégé d’un ouvrage fait souvent tomber l’ouvrage même.
-
[↑] Voyez l’édit de Pistes, art. 20.
[III-321]
CHAPITRE XI.
Autre cause de la chute des Codes des lois des Barbares, du droit Romain & des Capitulaires.
Lorsque les nations Germaines conquirent l’empire Romain, elles y trouverent l’usage de l’écriture, & à l’imitation des Romains, elles rédigerent leurs usages [1] par écrit, & en firent [III-322] des codes. Les regnes malheureux qui suivirent celui de Charlemagne, les invasions des Normands, les guerres intestines, replongerent les nations victorieuses dans les ténebres dont elles étoient sorties ; on ne sut plus lire ni écrire. Cela fit oublier en France & en Allemagne les lois barbares écrites, le droit Romain & les capitulaires. L’usage de l’écriture se conserva mieux en Italie, où régnoient les papes & les empereurs Grecs, & où il y avoit des villes florissantes & presque le seul commerce qui se fît pour lors. Ce voisinage de l’Italie fit que le droit Romain se conserva mieux dans les contrées de la Gaule, autrefois soumise aux Goths & aux Bourguignons ; d’autant plus que ce droit y étoit une loi territoriale & une espece de privilege. Il y a apparence que c’est l’ignorance de l’écriture qui fit tomber en Espagne les lois Wisigothes ; & par la chute de tant de lois, il se forma par-tout des coutumes.
Les lois personnelles tomberent. Les compositions & ce que l’on appeloit [III-323] freda [2] , se réglerent plus par la coutume que par le texte de ces lois. Ainsi, comme dans l’établissement de la monarchie on avoit passé des usages des Germains à des lois écrites, on revint, quelques siecles après, des lois écrites à des usages non écrits.
-
[↑] Cela est marqué expressément dans quelques prologues de ces codes. On voit même, dans les lois des Saxons & des Frisons, des dispositions différentes, selon les divers districts. On ajouta à ces usages quelques dispositions particulieres que les circonstances exigerent ; telles furent les lois dures contre les Saxons.
-
[↑] J’en parlerai ailleurs.
[III-323]
CHAPITRE XII.
Des coutumes locales, révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit Romain.
On voit, par plusieurs monumens, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la premiere & la seconde race. On y parle de la coutume du lieu [1] , de l’usage ancien [2] , de la coutume [3] , des lois [4] & des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples Barbares, & que ce qu’on appeloit la loi étoit le droit Romain. Je prouve que [III-324] cela ne peut être. Le roi Pepin [5] ordonna que par-tout où il n’y auroit point de loi, on suivroit la coutume ; mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi. Or, dire que le droit Romain eût la préférence sur les codes des lois des Barbares, c’est renverser tous les monumens anciens, & sur-tout ces codes des lois des Barbares qui disent perpétuellement le contraire.
Bien loin que les lois des peuples Barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes, qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple, étoit une loi personnelle : mais dans des lieux généralement ou presque généralement habités par des Francs Saliens, la loi salique, toute personnelle qu’elle étoit, devenoit, par rapport à ces Francs Saliens, une loi territoriale, & elle n’étoit personnelle que pour les Francs qui habitoient ailleurs. Or, si dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, il étoit arrivé que plusieurs Bourguignons, Allemands ou Romains même, eussent eu souvent des affaires, elles auroient été décidées par les lois de ces peuples ; [III-325] & un grand nombre de jugemens conformes à quelques-unes de ces lois, auroit dû introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. Il étoit naturel que ces usages pussent affecter les Francs même du lieu, dans les cas qui n’étoient point décidés par la loi salique ; mais il ne l’étoit pas qu’ils pussent prévoir sur la loi salique.
Ainsi il y avoit dans chaque lieu une loi dominante & des usages reçus, qui servoient de supplément à la loi dominante, lorsqu’ils ne la choquoient pas.
Il pouvoit même arriver qu’ils servissent de supplément à une loi qui n’étoit point territoriale ; & pour suivre le même exemple, si dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, un Bourguignon étoit jugé par la loi des Bourguignons, & que le cas ne se trouvât pas dans le texte de cette loi, il ne faut pas douter que l’on ne jugeât suivant la coutume du lieu.
Du temps du roi Pépin, les coutumes qui s’étoient formées, avoient moins de force que les lois ; mais bientôt les coutumes détruisirent les lois : & comme les nouveaux réglemens sont toujours [III-326] des remedes qui indiquent un mal présent, on peut croire que, du temps de Pépin, on commençoit déjà à préférer les coutumes aux lois.
Ce que j’ai dit, explique comment le droit Romain commença dès les premiers temps à devenir une loi territoriale, comme on le voit dans l’édit de Pistes ; & comment la loi Gothe ne laissa pas d’y être encore en usage, comme il paroît par le synode de Troies [6] dont j’ai parlé. La loi Romaine étoit devenue la loi personnelle générale, & la loi Gothe la loi personnelle particuliere ; & par conséquent la loi Romaine étoit la loi territoriale. Mais comment l’ignorance fit-elle tomber par-tout les lois personnelles des peuples barbares, tandis que le droit Romain subsista, comme loi territoriale, dans les provinces Wisigothes & Bourguignonnes ? Je réponds, que la loi Romaine même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela nous aurions encore le code Théodosien dans les provinces où la loi Romaine étoit loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois de Justinien. Il ne resta presque à ces provinces que [III-327] le nom de pays de droit Romain ou de droit écrit, que cet amour que les peuples ont pour leur loi, sur-tout quand ils la regardent comme un privilege, & quelques dispositions du droit Romain retenues pour lors dans la mémoire des hommes : mais c’en fut assez pour produire cet effet, que quand la compilation de Justinien parut, elle fut reçue dans les provinces du domaine des Goths & des Bourguignons comme loi écrite ; au lieu que dans l’ancien domaine des Francs, elle ne le fut que comme raison écrite.
-
[↑] Préface des formules de Marculfe.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II. tit. 58, §. 3.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II. tit. 41, §. 6.
-
[↑] Vie de S. Léger.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II, tit. 41, §. 6.
-
[↑] Voyez ci-dessus, le chap. V.
[III-327]
CHAPITRE XIII.
Différence de la loi Salique ou des Francs Saliens, d’avec celle des Francs Ripuaires & des autres peuples Barbares.
La loi salique n’admettoit point l’usage des preuves négatives ; c’est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, & qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.
[III-328]
La loi des Francs Ripuaires avoit tout un autre esprit [1] ; elle se contentoit des preuves négatives ; & celui contre qui on formoit une demande ou une accusation, pouvoit, dans la plupart des cas se justifier, en jurant avec certain nombre de témoins qu’il n’avoit point fait ce qu’on lui imputoit. Le nombre [2] des témoins qui devoient jurer, augmentoit selon l’importance de la chose ; il alloit quelquefois [3] à soixante-douze. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thiringiens, celles des Frisons, des Saxons, des Lombards & des Bourguignons, furent faites sur le même plan que celles des Ripuaires.
J’ai dit que la loi salique n’admettoit point les preuves négatives. Il y avoit pourtant un cas [4] où elle les admettoit ; mais dans ce cas elle ne les admettoit point seules & sans le concours [III-329] des preuves positives. Le demandeur faisoit [5] ouir ses témoins pour établir sa demande, le défendeur faisoit ouir les siens pour se justifier ; & le Juge cherchoit la vérité dans les uns & dans les autres [6] témoignages. Cette pratique étoit bien différente de celle des lois Ripuaires & des autres lois Barbares, où un accusé se justifoit en jurant qu’il n’étoit point coupable, & en faisant jurer ses parens qu’il avoit dit la vérité. Ces lois ne pouvoient convenir qu’à un peuple qui avoit de la simplicité & une certaine candeur naturelle ; il fallut même que les législateurs en prévinssent l’abus, comme on le va voir tout à l’heure.
-
[↑] Cela se rapporte à ce que dit Tacite, que les peuples Germains avoient des usages communs, & des usages particuliers.
-
[↑] Lois des Ripuaires, tit. §, 7, 8 & autres.
-
[↑] Ibid. tit. 11, 12 & 17.
-
[↑] C’est celui où un antrustion, c’est-à-dire, un vassal du roi, en qui on supposoit une plus grande franchise, étoit accusé : voyez le tit. 76 du Pactus legis salicæ.
-
[↑] Voyez le titre 76 du Pactus legis salicæ.
-
[↑] Comme il se pratique encore aujourd’hui en Angleterre.
[III-329]
CHAPITRE XIV.
Autre différence.
La loi salique ne permettoit point la preuve par le combat singulier ; la loi des Ripuaires [1] & presque [2] [III-330] toutes celles des peuples barbares, la recevoient. Il me paroît que la loi du combat étoit une fuite naturelle & le remede de la loi qui établissoit les preuves négatives. Quand on faisoit une demande, & qu’on voyoit qu’elle alloit être injustement éludée par un serment, que restoit-il à guerrier [3] qui se voyoit sur le point d’être confondu, qu’à demander raison du tort qu’on lui faisoit & de l’offre même du parjure ? La loi salique, qui n’admettoit point l’usage des preuves négatives, n’avoit pas besoin de la preuve par le combat, & ne la recevoit pas ; mais la loi des Ripuaires [4] & celle des autres peuples [5] barbares qui admettoient l’usage des preuves négatives, furent forcés d’établir la preuve par le combat.
Je prie qu’on lise les deux fameuses dispositions [6] de Gondebaud, roi de [III-331] Bourgogne, sur cette maniere ; on verra qu’elles sont tirées de la nature de la chose. Il falloit, selon le langage des lois des Barbares, ôter le serment des mains d’un homme qui en vouloit abuser.
Chez les Lombards, la loi de Rhotaris admit des cas où elle vouloit que celui qui s’étoit défendu par un serment, ne pût plus être fatigué par un combat. Cet usage s’étendit [7] : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, & comment il fallut revenir à l’ancienne pratique.
-
[↑] Tit. 32 ; tit. 57, §. 2 ; tit. 59, §. 4.
-
[↑] Voyez la note 1 de la page suivante.
-
[↑] Cet esprit paroît bien dans la loi des Ripuaires, tit. 59, §. 4 ; & tit. 67, §. 5 ; & le capitulaire de Louis le débonnaire, ajouté à la loi des Ripuaires, de l’an 803, art. 22.
-
[↑] Voyez cette loi.
-
[↑] La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens & des Bourguignons.
-
[↑] Dans la loi des Bourguignons, tit. 8, §. I & 2, sur les affaires criminelles ; & le titre 45, qui porte encore sur les affaires civiles. Voyez aussi la loi des Thuringiens, tit. I, §. 31 ; tit. 7, §. 6 ; & tit. 8 : & la loi des Allemands, tit. 89 : la loi des Bavarois, tit. 8. ch. ii, §. 6 ; & chap. iii, §. I ; & tit. 9, chap. iv, §. 4 : la loi des Frisons, tit. II, §. 3 ; & tit. 14, §. 4 ; la loi des Lombards, liv. I. tit. 32, §. 3 ; & tit. 35, §. I ; & liv. II. tit. 35, §. 2.
-
[↑] Voyez ci-dessous, le ch. xviii à la fin.
[III-331]
CHAPITRE XV.
Réflexion.
Je ne dis pas que, dans les changemens qui furent faits au code des lois des Barbares, dans les dispositions qui y furent ajoutées, & dans le corps [III-332] des capitulaires, on ne puisse trouver quelque texte où dans le fait la preuve du combat ne soit pas une suite de la preuve négative. Des circonstances particulieres ont pu, dans le cours de plusieurs siecles, faire établir de certaines lois particulieres. Je parle de l’esprit général des lois des Germains, de leur nature & de leur origine ; je parle des anciens usages de ces peuples, indiqués ou établis par ces lois, & il n’est ici question que de cela.
[III-332]
CHAPITRE XVI.
De la preuve par l’eau bouillante, établie par la loi salique.
La loi salique [1] admettoit l’usage de la preuve par l’eau bouillante ; & comme cette épreuve étoit fort cruelle, la loi [2] prenoit un tempérament pour en adoucir la rigueur. Elle permettoit à celui qui avoit été ajourné pour venir faire la preuve par l’eau bouillante, de racheter sa main du consentement de sa partie. L’accusateur, [III-333] moyennant une certaine somme que la loi fixoit, pouvoit se contenter du serment de quelques témoins, qui déclaroient que l’accusé n’avoit pas commis le crime : & c’étoit un cas particulier de la loi salique, dans lequel elle admettoit la preuve négative.
Cette preuve étoit une chose de convention, que la loi souffroit, mais qu’elle n’ordonnoit pas. La loi donnoit un certain dédommagement à l’accusateur qui vouloit permettre que l’accusé se défendît par une preuve négative : il étoit libre à l’accusateur de s’en rapporter au serment de l’accusé, comme il lui étoit libre de remettre le tort ou l’injure.
La loi [3] donnoit un tempérament pour qu’avant le jugement, les parties, l’une dans la crainte d’une épreuve terrible, l’autre à la vue d’un petit dédommagement présent, terminassent leurs différents & finissent leurs haines. On sent bien que cette preuve négative une fois consommée, il n’en falloit plus d’autre, & qu’ainsi la pratique du combat ne pouvoit être une suite de cette disposition particuliere de la loi salique.
[III-334]
CHAPITRE XVII.
Maniere de penser de nos peres.
On sera étonné de voir que nos peres fissent ainsi dépendre l’honneur, la fortune & la vie des citoyens, de choses qui étoient moins du ressort de la raison que du hasard ; qu’ils employassent sans cesse des preuves qui ne prouvoient point, & qui n’étoient liées, ni avec l’innocence, ni avec le crime.
Les Germains qui n’avoient jamais été subjugués [1] , jouissoient d’une indépendance extrême. Les familles se faisoient la guerre [2] pour des meurtres, des vols, des injures. On modifia cette coutume, en mettant ces guerres sous des regles ; elles se firent par ordre & sous les yeux [3] du magistrat ; ce qui étoit préférable à une licence générale de se nuire.
[III-335]
Comme aujourd’hui les Turcs, dans leurs guerres civiles, regardent la premiere victoire comme un jugement de Dieu qui décide ; ainsi les peuples Germains, dans leurs affaires particulieres, prenoient l’événement du combat pour un arrêt de la providence toujours attentive à punir le criminel ou l’usurpateur.
Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu’une nation vouloit entrer en guerre avec une autre, elle cherchoit à faire quelque prisonnier qui pût combattre avec un des siens ; & qu’on jugeoit, par l’événement de ce combat, du succès de la guerre. Des peuples qui croyoient que le combat singulier régleroit les affaires publiques, pouvoient bien penser qu’il pourroit encore régler les différents des particuliers.
Gondebaud [4] , roi de Bourgogne, fut de tous les rois celui qui autorisa le plus l’usage du combat. Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même : « C’est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus de serment sur des faits obscurs, & ne se parjurent point sur des faits certains ». Ainsi, tandis que [III-336] les ecclésiastiques [5] déclaroient impie la loi qui permettoit le combat, le roi des Bourguignons regardoit comme sacrilege celle qui établissoit le serment.
La preuve par le combat singulier avoit quelque raison fondée sur l’expérience. Dans une nation uniquement guerriere, la poltronnerie suppose d’autres vices : elle prouve qu’on a résisté à l’éducation qu’on a reçue, & que l’on n’a pas été sensible à l’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes ; elle fait voir qu’on ne craint point leur mépris, & qu’on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu’on soit bien né, on n’y manquera pas ordinairement de l’adresse qui doit s’allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage, parce que, faisant cas de l’honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerriere, où la force, le courage & la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de [III-337] la finesse & de la ruse, c’est-à-dire, de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu, après que l’accusé avoit mis la main sur un fer chaud ou dans l’eau bouillante, on enveloppoit la main dans un sac que l’on cachetoit : si trois jours après il ne paroissoit pas de marque de brûlure, on étoit déclaré innocent. Qui ne voit que chez un peuple exercé à manier les armes, la peau rude & calleuse ne devoit pas recevoir assez l’impression du fer chaud ou de l’eau bouillante, pour qu’il y parût trois jours après ? Et s’il y paroissoit, c’étoit une marque que celui qui faisoit l’épreuve étoit un effeminé. Nos paysans avec leurs mains calleuses manient le fer chaud comme ils veulent ; & quant aux femmes, les mains de celles qui travailloient, pouvoient résister au fer chaud. Les dames [6] ne manquoient point de champions pour les défendre, & dans une nation où il n’y avoit point de luxe, il n’y avoit guere d’état moyen.
Par la loi des Thuringiens [7] une [III-338] femme accusée d’adultere, n’étoit condamnée à l’épreuve de l’eau bouillante, que lorsqu’il ne se présentoit point de champion pour elle ; et la loi [8] des Ripuaires n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier. Mais une femme, qu’aucun de ses parens ne vouloit défendre, un homme qui ne pouvoit alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.
Je dis donc que, dans les circonstances des temps, où la preuve par le combat & la preuve par le fer chaud & l’eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocens que les causes ; qu’elles choquerent plus l’équité qu’elles n’en violerent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranniques.
-
[↑] Cela paroît par ce que dit Tacite : omnibus idem habitus.
-
[↑] Velleius Paterculus, liv. II. chap. cxviii, dit que les Germains décidoient toutes les affaires par le combat.
-
[↑] Voyez les codes des lois des Barbares ; & pour les temps plus modernes, Beaumanoir, sur la coutume de Beauvoisis.
-
[↑] La loi des Bourguignons, chap. xlv.
-
[↑] Voyez les œuvres d’Agobard.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, coutume de Beauvoisis, ch. lxi. Voyez aussi la loi des Angles, ch. xiv, où la preuve par l’eau bouillante n’est que subsisdiaire.
-
[↑] Titre 14.
-
[↑] Chapitre xxxi, §. 5.
[III-339]
CHAPITRE XVIII.
Comment la preuve par le combat s’étendit.
On pourroit conclure de la lettre d’Agobart à Louis le débonnaire, que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs, puisqu’après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud, il [1] demande qu’on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs. Mais comme on fait d’ailleurs que dans ce temps-là le combat judiciaire étoit en usage en France, on a été dans l’embarras. Cela s’explique par ce que j’ai dit ; la loi des Francs Saliens n’admettoit point cette preuve, & celle des Francs Ripuaires [2] la recevoit.
Mais, malgré les clameurs des ecclésiastiques, l’usage du combat judiciaire s’étendit tous les jours en France ; & je vais prouver tout-à-l’heure que ce furent eux-mêmes qui y donnerent lieu en grande partie.
[III-340]
C’est la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve. « Il s’étoit introduit depuis long temps une détestable coutume (est-il dit dans le préambule de la constitution [3] d’Othon II) ; c’est que si la charte de quelque héritage étoit attaqué de faux, celui qui la présentoit faisoit serment sur les évangiles qu’elle étoit vraie ; & sans aucun jugement préalable, il se rendoit propriétaire de l’héritage : ainsi les parjures étoient sûrs d’acquérir ». Lorsque l’empereur Othon I. se fit couronner à Rome [4] , le pape Jean XII. tenant un concile, tous les seigneurs [5] d’Italie s’écrierent qu’il falloit que l’empereur fît une loi pour corriger cet indigne abus. Le pape & l’empereur jugerent qu’il falloit renvoyer l’affaire au concile qui devoit se tenir peu de temps [6] après à Ravenne. Là les seigneurs firent les mêmes demandes, & redoublerent leurs cris ; mais sous prétexte de l’absence de quelques personnes, on [III-341] renvoya encore une fois cette affaire. Lorsqu’Othon II. & Conrad [7] roi de Bourgogne arriverent en Italie, ils eurent à Véronne [8] un colloque [9] avec les seigneurs d’Italie, & sur leurs instances réitérées, l’empereur, du consentement de tous, fit une loi qui portoit que, quand il y auroit quelque contestation sur des héritages, & qu’une des parties voudroit se servir d’une chartre, & que l’autre soutiendroit qu’elle étoit fausse, l’affaire se décideroit par le combat ; que la même regle s’observeroit lorsqu’il s’agiroit de matieres de fief ; que les églises seroient sujettes à la même loi, & qu’elles combattroient par leurs champions. On voit que la noblesse demanda la preuve par le combat, à cause de l’inconvénient de la preuve introduite dans les églises ; que, malgré les cris de cette noblesse, malgré l’abus qui crioit lui-même, & malgré l’autorité d’Othon qui arriva en Italie pour parler & agir en maître, le clergé tint ferme dans deux conciles ; que le concours de la noblesse [III-342] & des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l’usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilege de la noblesse, comme un rempart contre l’injustice, & une assurance de sa propriété ; & que, dès ce moment, cette pratique dut s’étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étoient grands & les papes petits, dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l’empire.
Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j’ai dit ci-dessus, que l’établissement des preuves négatives entraînoit après lui la jurisprudence du combat. L’abus dont on se plaignoit devant les Othons, étoit qu’un homme à qui on objectoit que sa charte étoit fausse, se défendoit par une preuve négative, en déclarant sur les évangiles qu’elle ne l’étoit pas. Que fit-on pour corriger l’abus d’une loi qui avoit été tronquée ? on rétablit l’usage du combat.
Je me suis pressé de parler de la constitution d’Othon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé & les laïques. Il y avoit eu auparavant une constitution de [10] [III-343] Lothaire I, qui, sur les mêmes plaintes & les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens, avoit ordonné que le notaire jureroit que sa chartre n’étoit pas fausse ; & que, s’il étoit mort, on feroit juger les témoins qui l’avoient signée : mais le mal restoit toujours, il falloit en venir au remede dont je viens de parler.
Je trouve qu’avant ce temps-là, dans des assemblées générales tenues par Charlemagne, la nation lui représenta [11] que dans l’état des choses il étoit très-difficile que l’accusateur ou l’accusé ne se parjurassent, & qu’il valoit mieux rétablir le combat judiciaire : ce qu’il fit.
L’usage du combat judiciaire s’étendit chez les Bourguignons, & celui du serment y fut borné. Théodoric, roi d’Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths [12] : les lois de Chaindasuinde & de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu’à l’idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la [III-344] Narbonnoise, que le combat y étoit regardé comme une prérogative [13] des Goths.
Les Lombards, qui conquirent l’Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs, y rapporterent l’usage du combat : mais leurs premieres lois le restreignirent [14] . Charlemagne [15] , Louis le débonnaire, les Othons, firent diverses constitutions générales, qu’on trouve insérées dans les lois des Lombards, & ajoutées aux lois saliques, qui étendirent le duel, d’abord dans les affaires criminelles, & ensuite dans les civiles. On ne savoit comment faire. La preuve négative par le serment avoit des inconvéniens, celle par le combat en avoit aussi : on changeoit, suivant qu’on étoit plus frappé des uns ou des autres.
D’un côté, les ecclésiastiques se plaisoient à voir, que dans toutes les affaires [III-345] séculières, on recourût aux églises [16] & aux autels ; & de l’autre, une noblesse fiere aimoit à soutenir ses droits par son épée.
Je ne dis poins que ce fut le clergé qui eût introduit l’usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l’esprit des lois des barbares, & de l’établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l’impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu’il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables & faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage & la ptratique à laquelle il étoit joint ; car d’ailleurs ils étoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir [17] que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, & [III-346] à affoiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.
Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l’usage des preuves négatives & celui du combat judiciaire dont j’ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un & l’autre, & les tribunaux clercs les rejeterent tous deux.
Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu’on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves par la croix, l’eau froide & l’eau bouillante, qu’on avoit regardées aussi comme des jugemens de Dieu.
Charlemagne ordonna que, s’il survenoit quelque différent entre ses enfans, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis [18] le débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques : son fils Lothaire l’abolit dans tous les cas ; il abolit [19] de même la preuve par l’eau froide.
Je ne dis pas, que dans un temps où il y avoit si peu d’usages universellement [III-347] reçus, ces preuves n’ayent été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartre [20] de Philippe Auguste en fait mention : mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir [21] qui vivoit du temps de Saint Louis & un peu après, faisant l’énumération des différens genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, & point du tout de celles-là.
-
[↑] Si placerec domino nostro ut eos transferret ad legem Francorum.
-
[↑] Voyez cette loi, tit. 59, §. 4, & tit. 67. §. 5.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II, tit. 55, ch. xxxiv.
-
[↑] L’an 962.
-
[↑] Ab Italiæ proceribus est proclamatum, ut imperator, sanctus mutatâ lege, facinus indignum destrueret. Loi des Lombards, liv. II, tit. 55, ch. xxxiv.
-
[↑] Il fut tenu en l’an 967, en présence du pape Jean XIII. & de l’empereur Othon I.
-
[↑] Oncle d’Othon II, fils de Rodolphe, & roi de la Bourgogne Transjurane.
-
[↑] L’an 988.
-
[↑] Cùm in hoc ab omnibus imperiales aures pulsarentur. Loi des Lombards, liv. II, tit. 55, ch. xxxiv.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 55, §. 33. Dans l’exemplaire dont s’est servi M. Muratori, elle est attribuée à l’empereur Guy.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 55, §. 23.
-
[↑] Voyez Cassiodore, liv. III, lett. 23 & 24.
-
[↑] In palatio quoque Bera comes Barcinonensis, cùm impeteretur à quodam vocato Sunial, & infidelitatis argueretur, cim eodem secundùm legem propriam, utpotè quia uterque Gothus erat, equestri prælio congressus est & victus. L’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire.
-
[↑] Voyez dans la loi des Lombards, le livre I, tit. 4 ; & tit. 9, §. 23 ; & liv. II, tit. 35, §. 4 & 5 ; & tit. 55, §. I, 2 & 3 : les réglemens de Rotharis ; & au §. 15, celui de Luitprand.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 55, §. 23.
-
[↑] Les serment judiciaire se faisoit pour lors dans les églises ; & il y avoit dans la premiere race, dans le palais des rois, une chapelle exprès pour les affaires qui s’y jugeoient. Voyez les formules de Marculse, liv. I, chap. xxxviii, les lois des Ripuaires, tit. 59, §. 4 ; tit. 65, §. 5 ; l’histoire de Grégoire de Tours ; le capitulaire de l’an 803, ajouté à la loi salique.
-
[↑] Chapitre xxxix, page 212.
-
[↑] On trouve ces constitutions insérées dans la loi des Lombards & à la suite des lois saliques.
-
[↑] Dans la constitution insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 55, §. 31.
-
[↑] De l’an 1200.
-
[↑] Coutume de Beauvoisis, ch. xxxix.
[III-347]
CHAPITRE XIX.
Nouvelle raison de l’oubli des lois Saliques, des lois Romaines & des Capitulaires.
J’ai déjà dit les raisons qui avoient fait perdre aux lois saliques, aux lois Romaines, & aux capitulaires, leur autorité ; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.
Les lois saliques, qui n’admettoient point cet usage, devinrent en quelque façon inutiles, & tomberent : les lois Romaines, qui ne l’admettoient pas [III-348] non plus, périrent de même. On ne songea plus qu’à former la loi du combat judiciaire, & à en faire une bonne jurisprudence. Les dispositions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainsi tant de lois perdirent leur autorité, sans qu’on puisse citer le moment où elles l’ont perdue ; elles furent oubliées, sans qu’on en trouve d’autres qui ayant pris leur place.
Une nation pareille n’avoit pas besoin de lois écrites, & ses lois écrites pouvoient bien aisément tomber dans l’oubli.
Y avoit-il quelque discussion entre deux parties ? on ordonnoit le combat. Pour cela il ne falloit pas beaucoup de suffisance.
Toutes les actions civiles & criminelles se réduisent en faits. C’est sur ces faits que l’on combattoit ; & ce n’étoit pas seulement le fond de l’affaire qui se jugeoit par le combat, mais encore les incidens & les interlocutoires, comme le dit Beaumanoir [1] , qui en donne des exemples.
Je trouve qu’au commencement de la troisieme race, la jurisprudence étoit [III-349] toute en procédés ; tout fut gouverné par le point-d’honneur. Si l’on n’avoit pas obéi au juge, il poursuivoit son offense. À Bourges [2] , si le prévôt avoit mandé quelqu’un, & qu’il ne fût pas venu : « Je t’ai envoyé chercher, disoit-il, tu as dédaigné de venir ; fais-moi raison de ce mépris » ; & l’on combattoit. Louis le gros réforma [3] cette coutume.
Le combat judiciaire étoit en usage [4] à Orléans dans toutes demandes de dettes. Louis le jeune déclara que cette coutume n’auroit lieu que lorsque la demande excéderoit cinq sols. Cette ordonnance étoit une loi locale ; car du temps de Saint Louis [5] , il suffisoit que la valeur fût de plus de douze deniers. Beaumanoir [6] avoit oui dire à un seigneur de loi, qu’il y avoit autrefois en France cette mauvaise coutume, qu’on pouvoit louer pendant un certain temps un champion pour combattre dans ses [III-350] affaires. Il falloit que l’usage du combat judiciaire eût pour lors une prodigieuse extension.
-
[↑] Ch. lxi, pages 309 & 310.
-
[↑] Chartre de Louis le gros, de l’an 1145, dans le recueil des ordonnances.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Chartre de Louis le jeune, de l’an 1168, dans le recueil des ordonnances.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, ch. lxiii, page 325.
-
[↑] Voyez la coutume de Beauvoisis, ch. xxviii, page 203.
[III-350]
CHAPITRE XX.
Origine du point-d’honneur.
On trouve des énigmes dans les codes des lois des barbares. La loi [1] des Frisons ne donne qu’un demi-sou de composition à celui qui a reçu des coups de bâton ; & il n’y a si petite blessure pour laquelle elle n’en donne davantage. Par la loi salique, si un ingénu donnoit trois coups de bâton à un ingénu, il payoit trois sous ; s’il avoit fait couler le sang, il étoit puni comme s’il avoit blessé avec le fer, & il payoit quinze sous ; la peine se mesuroit par la grandeur des blessures. La loi des Lombards [2] établit différentes compositions pour un coup, pour deux, pour trois, pour quatre. Aujourd’hui un coup en vaut cent mille.
La constitution de Charlemagne insérée dans la loi [3] des Lombards, veut [III-351] que ceux à qui elle permet le duel, combattent avec le bâton. Peut-être que ce fut un ménagement pour le clergé ; peut-être que comme on étendoit l’usage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire [4] de Louis le débonnaire donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans la suite il n’y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton [5] .
Déjà je vois naître & se former les articles particuliers de notre point-d’honneur. L’accusateur commençoit par déclarer devant le juge, qu’un tel avoit commis une telle action ; & celui-ci répondoit qu’il en avoit menti [6] ; sur cela le juge ordonnoit le duel. La maxime s’établit que, lorsqu’on avoit reçu un démenti, il falloit se battre.
Quand un homme [7] avoit déclaré qu’il combattroit, il ne pouvoit plus s’en départir ; & s’il le faisoit, il étoit condamné à une peine. De là suivit cette regle, que quand un homme s’étoit engagé par sa parole, l’honneur ne lui permettoit plus de la rétracter.
[III-352]
Les gentilshommes [8] se battoient entr’eux à cheval & avec leurs armes, & les villains [9] se battoient à pied & avec le bâton. De là il suivit que le bâton étoit l’instrument des outrages [10] , parce qu’un homme qui en avoit été battu, avoit été traité comme un villain.
Il n’y avoit que les villains qui combattissent à visage découvert [11] ; ainsi il n’y avoit qu’eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure, qui devoit être lavée par le sang ; parce qu’un homme qui l’avoit reçu, avoit été traité comme un villain.
Les peuples Germains n’étoient pas moins sensibles que nous au point d’honneur ; ils l’étoient même plus. Ainsi les parens les plus éloignés prenoient une part très-vive aux injures, & tous leurs codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards [12] veut que celui qui, [III-353] accompagné de ses gens, va battre un homme qui n’est point sur ses gardes, afin de le couvrir de honte & de ridicule, paye la moitié de la composition qu’il auroit due s’il l’avoit tué ; & que [13] si, par le même motif, il le lie, il paye les trois quarts de la même composition.
Disons donc que nos peres étoient extrêmement sensibles aux affronts ; mais que les affronts d’une espece particuliere, de recevoir des coups d’un certain instrument sur une certaine partie du corps, & donnés d’une certaine maniere, ne leur étoient pas encore connus. Tout cela étoit compris dans l’affront d’être battu, & dans ce cas la grandeur des excès faisoit la grandeur des outrages.
-
[↑] Additio sapientium Willemari, tit. 5.
-
[↑] Liv. I, tit. 6, §. 3.
-
[↑] Liv. II, tit. 5, §. 23.
-
[↑] Ajouté à la loi salique sur l’an 819.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, ch. lxiv, page 323.
-
[↑] Ibid. page 329.
-
[↑] Ibid. ch. iii, pages 25 & 329.
-
[↑] Voyez, sur les armes des combattans, Beaumanoir, ch. lxi, p. 308, & ch. lxiv, p. 328.
-
[↑] Ibid. ch. lxiv, page 328 : voyez aussi les chartres de Saint-Aubin d’Anjou, rapportées par Galland, page 163.
-
[↑] Chez les Romains, les coups de bâton n’étoient point infames. Lege Ictus sustium. De iis qui notantur infamiâ.
-
[↑] Ils n’avoient que l’écu & le bâton, Beaumanoir, chap. lxiv, page 328.
-
[↑] Liv. I, tit. 6. §. I.
-
[↑] Ibid. §. 2.
[III-353]
CHAPITRE XXI.
Nouvelle réflexion sur le point d’honneur chez les Germains.
« C’étoit chez les Germains, dit Tacite [1] , une grande infamie d’avoir abandonné son bouclier dans [III-354] le combat ; & plusieurs, après ce malheur, s’étoient donné la mort ». Aussi l’ancienne loi [2] salique donne-t-elle quinze sous de composition à celui à qui on avoit dit par injure qu’il avoit abandonné son bouclier.
Charlemagne [3] corrigeant la loi salique, n’établit dans ce cas que trois sous de composition. On ne peut pas soupçonner ce prince d’avoir voulu affoiblir la discipline militaire : il est clair que ce changement vint de celui des armes ; & c’est à ce changement des armes que l’on doit l’origine de bien des usages.
-
[↑] De morib. German.
-
[↑] Dans le pactus legis salicæ
-
[↑] Nous avons l’ancienne loi, & celle qui fut corrigée par ce prince.
[III-354]
CHAPITRE XXII.
Des mœurs relatives aux combats.
Notre liaison avec les femmes est fondée sur le bonheur attaché aux plaisirs des sens, sur le charme d’aimer & d’être aimé, & encore sur le désir de leur plaire, parce que ce sont des juges très-éclairés sur une partie des choses qui constituent le mérite personnel. Ce désir général de plaire produit la [III-355] galanterie, qui n’est point l’amour, mais le délicat, mais le léger, mais le perpétuel mensonge de l’amour.
Selon les circonstances différentes dans chaque nation & dans chaque siecle, l’amour se porte plus vers une de ces trois choses, que vers les deux autres. Or je dis que, dans le temps de nos combats, ce fut l’esprit de galanterie qui dut prendre des forces.
Je trouve dans la loi des Lombards, que [1] si un des deux champions avoit sur lui des herbes propres aux enchantemens, le juge les lui faisoit ôter, & le faisoit jurer qu’il n’en avoit plus. Cette loi ne pouvoit être fondée que sur l’opinion commune ; c’est la peur, qu’on a dit avoir inventé tant de choses, qui fit imaginer ces sortes de prestiges. Comme dans les combats particuliers les champions étoient armés de toutes pieces, & qu’avec des armes pesantes, offensives & défensives, celles d’une certaine trempe & d’une certaine force, donnoient des avantages infinis ; l’opinion des armes enchantées de quelques combattans dut tourner la tête à bien des gens.
[III-356]
De là naquit le systême merveilleux de la chevalerie. Tous les esprits s’ouvrirent à ces idées. On vit dans les romans des paladins, des négromans, des fées, des chevaux ailés ou intelligens, des hommes invisibles ou invulnérables, des magiciens qui s’intéressoient à la naissance ou à l’éducation des grands personnages, des palais enchantés & désenchantés ; dans notre monde un monde nouveau, & le cours ordinaire de la nature laissé seulement pour les hommes vulgaires.
Des paladins toujours armés dans une partie du monde pleine de châteaux, de forteresses & de brigands, trouvoient de l’honneur à punir l’injustice & à défendre la foiblesse. De là encore dans nos romans la galanterie fondée sur l’idée de l’amour, jointe à celle de force & de protection.
Ainsi naquit la galanterie, lorsqu’on imagina des hommes extraordinaires, qui voyant la vertu jointe à la beauté & à la foiblesse, furent portés à s’exposer pour elle dans les dangers, & à lui plaire dans les actions ordinaires de la vie.
Nos romans de chevalerie flatterent [III-357] ce désir de plaire, & donnerent à une partie de l’Europe cet esprit de galanterie que l’on peut dire avoir été peu connu par les anciens.
Le luxe prodigieux de cette immense ville de Rome, flatta l’idée des plaisirs des sens. Une certaine idée de tranquillité dans les campagnes de la Grece, fit décrire [2] les sentimens de l’amour. L’idée des paladins, protecteurs de la vertu & de la beauté des femmes, conduisit à celle de la galanterie.
Cet esprit se perpétua par l’usage des tournois, qui unissant ensemble les droits de la valeur & de l’amour, donnerent encore à la galanterie une grande importance.
[III-357]
CHAPITRE XXIII.
De la jurisprudence du combat judiciaires.
On aura peut-être de la curiosité à voir cet usage monstrueux du combat judiciaire réduit en principe, & à trouver le corps d’une jurisprudence si singuliere. Les hommes, dans le fond raisonnables, mettent sous des regles [III-358] leurs préjugés mêmes. Rien n’étoit plus contraire au bon sens que le combat judiciaire : mais ce point une fois posé, l’exécution s’en fit avec une certaine prudence.
Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence de ces temps-là, il faut lire avec attention les réglemens de Saint Louis, qui fit de si grands changemens dans l’ordre judiciaire. Défontaines étoit contemporain de ce prince : Beaumanoir écrivoit après lui [1] ; les autres ont vécu depuis lui. Il faut donc chercher l’ancienne pratique dans les corrections qu’on en a faites.
-
[↑] En l’an 1283.
[III-358]
CHAPITRE XXIV.
Regles établies dans le combat judiciaire.
Lorsqu’il [1] y avoit plusieurs accusateurs, il falloit qu’ils s’accordassent, pour que l’affaire fût poursuivie par un seul ; & s’ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisoit le plaid, nommoit un d’entr’eux qui poursuivoit la querelle.
[III-359]
Quand [2] un gentilhomme appeloit un villain, il devoit se présenter à pied, & avec l’écu & le bâton : & s’il venoit à cheval & avec les armes d’un gentilhomme, on lui ôtoit son cheval & ses armes ; il restoit en chemise, & étoit obligé de combattre en cet état contre le villain.
Avant le combat, la justice [3] faisoit publier trois bans. Par l’un, il étoit ordonné aux parens des parties de se retirer ; par l’autre, on avertissoit le peuple de garder le silence ; par le troisieme, il étoit défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, & même celle de mort, si par ce secours un des combattant avoit été vaincu.
Les gens de justice gardoient [4] le parc ; & dans le cas où des parties auroit parlé de paix, ils avoient grande attention à l’état actuel où elles se trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu’elles fussent remises [5] dans la même situation, si la paix ne se faisoit pas.
[III-360]
Quand les gages étoient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvoit se faire sans le consentement du seigneur ; & quand une des parties avoit été vaincue, il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l’aveu du comte [6] ; ce qui avoit du rapport à nos lettres de grace.
Mais si le crime étoit capital, & que le seigneur corrompu par des présens, consentît à la paix, il payoit une amende de soixante livres ; & le droit [7] qu’il avoit de faire punir le malfaiteur étoit dévolu au comte.
Il y avoit bien des gens qui n’étoient en état ni d’offrir le combat ni de le recevoir. On permettoit en connoissance de cause, de prendre un champion ; & pour qu’il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avoit le poing coupé, s’il étoit vaincu [8] .
Quand on a fait dans le siecle passé [III-361] des lois capitales contre les duels, peut-être auroit-il suffi d’ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n’y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes que de survivre à la perte de leur caractere.
Lorsque [9] dans un crime capital le combat se faisoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d’où elles ne pouvoient voir la bataille : chacune d’elles étoit ceinte de la corde qui devoit servir à son supplice, si son champion étoit vaincu.
Celui qui succomboit dans le combat, ne perdoit pas toujours la chose contestée ; si, par exemple [10] , l’on combattoit sur un interlocutoire, on ne perdoit que l’interlocutoire.
-
[↑] Beaumanoir, ch. iv, pages 40 & 41.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiv, page 328.
-
[↑] Ibid. pag. 330.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Les grands vassaux avoient des droits particuliers.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiv, pag. 330, dit : Il perdoit sa justice. Ces paroles, dans les auteurs de ces temps-là, n’ont pas une signification générale, mais restreinte à l’affaire dont il s’agit ; Défontaines, chap. xxi, art. 29.
-
[↑] Cet usage que l’on trouve dans les capitulaires subsistoit du temps de Beaumanoir : voyez le ch. lxi, page 315.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiv, page 330.
-
[↑] Ibid. , ch. lxi, page 309.
[III-361]
CHAPITRE XXV.
Des bornes que l’on mettoit à l’usage du combat judiciaire.
Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.
[III-362]
Si un fait étoit notoire [1] ; par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoin ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.
Quand dans la cour du seigneur on avoit souvent jugé de la même maniere, & qu’ainsi l’usage étoit connu [2] , le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.
On ne pouvoit demander le combat que pour [3] soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.
Quand un accusé avoit été absous [4] , un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.
Si celui dont les parens vouloient venger la mort venoit à reparoître, il n’étoit plus question du combat : il [III-363] en étoit de même [5] , si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible.
Si un homme [6] qui avoit été tué, avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, & qu’il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat ; mais s’il n’avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort : on continuoit les poursuites ; & même, entre gentilshommes, on pouvoit faire la guerre.
Quand il y avoit une guerre, & qu’un des parens donnoit ou recevoit les gages de bataille, le droit de la guerre cessoit ; on pensoit que les parties vouloient suivre le cours ordinaire de la justice ; & celle qui auroit continué la guerre, auroit été condamnée à réparer les dommages.
Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, qu’elle pouvoit changer une querelle générale en une querelle particuliere, rendre la force aux tribunaux, & remettre dans l’état civil ceux qui n’étoient plus gouvernés que par le droit des gens.
[III-364]
Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une maniere très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une maniere très-sage.
Quand [7] un homme appelé pour un crime, montroit visiblement que c’étoit l’appellant même qui l’avoit commis, il n’y avoit plus de gages de batailles ; car il n’y a point de coupable qui n’eût préféré un combat douteux à une punition certaine.
Il n’y avoit [8] point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques ; il n’y en avoit pas non plus, lorsqu’il s’agissoit du douaire des femmes.
Femme, dit Beaumanoir, ne se peut combattre. Si une femme appelloit quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu’une femme fût autorisée par son [9] baron, c’est-à-dire, son mari, pour appeller ; mais sans cette autorité elle pouvoit être appellée.
[III-365]
Si l’appellant [10] ou l’appellé avoient moins de quinze ans, il n’y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l’ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.
Il me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf ; il combattoit contre une personne franche, & même contre un gentilhomme, s’il étoit appellé ; mais s’il l’appelloit [11] , celui-ci pouvoit refuser le combat ; & même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur [12] , ou par usage, combattre contre toutes personnes franches ; & l’église [13] prétendoit ce même droit pour ses serfs, comme une marque [14] de respect pour elle.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, p. 308. Ibid. ch. xliii, page 239.
-
[↑] Ibid. ch. lxi, pag. 314 ; voyez aussi Défontaines, ch. xxii, art 24.
-
[↑] Ibid. ch. lxiii, page 322.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Beaum. ch. lxiii, page 322.
-
[↑] Ibid. page 323.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiii, page 324.
-
[↑] Ibid. page 325.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Beaum. page 323. Voyez aussi ce que j’ai dit au liv. XVIII.
-
[↑] Ibid. ch. xliii, page 322.
-
[↑] Défontaines, ch. xxii, art. 7.
-
[↑] Habeant bellandi & testificandi licentiam : chartre de Louis le gros, de l’an 1118.
-
[↑] Ibid.
[III-366]
CHAPITRE XXVI.
Du combat judiciaire entre une des parties & un des témoins.
Beaumanoir [1] dit qu’un homme qui voyoit qu’un témoin alloit déposer contre lui, pouvoit éluder le second, en disant [2] aux juges que sa partie produisoit un témoin faux & calomniateur ; & si le témoin vouloit soutenir la querelle, il donnoit les gages de bataille. Il n’étoit plus question de l’enquête ; car si le témoin étoit vaincu, il étoit décidé que la partie avoit produit un faux témoin, & elle perdoit son procès.
Il ne falloit pas laisser jurer le second témoin ; car il auroit prononcé son témoignage, & l’affaire auroit été finie par la déposition de deux témoins. Mais en arrêtant le second, la déposition du premier devenoit inutile.
Le second témoin étant ainsi rejeté, [III-367] la partie ne pouvoit en faire ouir d’autres, & elle perdoit son procès : mais, dans le cas où il n’y avoit point de gages de bataille [3] , on pouvoit produire d’autres témoins.
Beaumanoir dit [4] que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, ne à entrer en plet au mien ; mais se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; & si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps [5] , mais le témoin étoit rejeté.
Je crois que ceci étoit une modification de l’ancienne coutume ; & ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeller les témoins, se trouve établi dans la loi des Bavarois [6] , & dans celle des Bourguignons [7] , sans aucune restriction.
J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard [8] [III-368] & Saint Avit [9] se récrierent tant. « Quand l’accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu’il n’a pas commis le crime, l’accusateur pourra appeller au combat un des témoins ; car il est juste que celui qui a offert de jurer, & qui a déclaré qu’il savoit la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce Roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.
-
[↑] Ch. lxi, page 315.
-
[↑] Leur doit-on demander, avant qu’ils fassent nul serment, pour qui ils veulent témoigner ; car l’enques gist li point d’aus lever de faux témoignage. Beaumanoir, ch. xxxix, page 218.
-
[↑] Ibid. ch. lxi, page 316.
-
[↑] Ch. vi, pages 39 & 40.
-
[↑] Mais si le combat se faisoit par champions, le champion vaincu avoit le poing coupé.
-
[↑] Tit. 16, §. 2.
-
[↑] Tit. 45.
-
[↑] Lettre à Louis le débonnaire.
-
[↑] Vie de S. Avit.
[III-368]
CHAPITRE XXVII.
Du combat judiciaire entre une partie & un des pairs du seigneur. Appel de faux jugement.
La nature de la décision par le combat, étant de terminer l’affaire pour toujours, & n’étant point compatible [1] avec un nouveau jugement & de nouvelles poursuites ; l’appel, tel qu’il est établi par les lois Romaines & [III-369] par les lois canoniques, c’est-à-dire, à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France.
Une nation guerriere, uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connoissoit pas cette forme de procéder ; & suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies [2] qu’elle auroit pu employer contre les parties.
L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang ; & non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après.
Aussi S. Louis dit-il, dans ses établissemens [3] , que l’appel contient félonie & iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il, que si un homme [4] vouloit se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur, il devoit lui dénoncer qu’il abandonnoit son fief ; après quoi il l’appelloit devant son seigneur suzerain, & offroit les gages de bataille. De même le seigneur [III-370] renonçoit à l’hommage, s’il appelloit son homme devant le comte.
Appeller son seigneur de faux jugement, c’étoit dire que son jugement avoit été faussement & méchamment rendu : or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c’étoit commettre une espece de crime de félonie.
Ainsi, au lieu d’appeller pour faux jugement le seigneur qui établissoit & régloit le tribunal, on appelloit les pairs qui formoient le tribunal même : on évitoit par-là le crime de félonie ; on n’insultoit que ses pairs, à qui on pouvoit toujours faire raison de l’insulte.
On s’exposoit beaucoup [5] , en faussant le jugement des pairs. Si l’on attendoit que le jugement fût fait & prononcé, on étoit obligé de les combattre tous [6] , lorsqu’ils offroient de faire le jugement bon. Si l’on appelloit avant que tous les juges eussent donné leur avis, il falloit combattre tous ceux qui étoient convenus du même avis [7] . Pour éviter ce danger, on supplioit le seigneur [8] d’ordonner que chaque [III-371] pair dît tout haut son avis ; & lorsque le premier avoit prononcé, & que le second alloit en faire de même, on lui disoit qu’il étoit faux, méchant & calomniateur ; & ce n’étoit plus que contre lui qu’on devoit se battre.
Défontaines [9] vouloit qu’avant de fausser [10] , on laissât prononcer trois juges ; & il ne dit point qu’il fallût les combattre tous trois, & encore moins qu’il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s’étoient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent de ce que dans ce temps-là il n’y avoit guere d’usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendoit compte de ce qui se passoit dans le comté de Clermont, Défontaines de ce qui se pratiquoit en Vermandois.
Lorsqu’un [11] des pairs ou homme de fief avoit déclaré qu’il soutiendroit le jugement, le juge faisoit donner les gages de bataille, & de plus prenoit sureté de l’appellant qu’il soutiendroit son appel. Mais le pair qui étoit appellé, ne donnoit point de suretés, parce [III-372] qu’il étoit homme du seigneur, & devoit défendre l’appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.
Si celui [12] qui appelloit, ne prouvoit pas que le jugement fût mauvais, il payoit au seigneur une amende de soixante livres, la même amende [13] au pair qu’il avoit appellé, autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.
Quand un homme violemment soupçonné d’un crime qui méritoit la mort, avoit été pris & condamné, il ne pouvoit appeller [14] de faux jugement : car il auroit toujours appellé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.
Si quelqu’un [15] disoit que le jugement étoit faux & mauvais, & n’offroit pas de le faire tel, c’est-à-dire, de combattre, il étoit condamné à dix sols d’amende s’il étoit gentilhomme, & à cinq sols s’il étoit serf, pour les vilaines paroles qu’il avoit dites.
Les juges [16] ou pairs qui avoient [III-373] été vaincus, ne devoient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appelloit étoit puni de mort, lorsque l’affaire étoit capitale [17] .
Cette maniere d’appeller les hommes de fief pour faux jugement, étoit pour éviter d’appeller le seigneur même. Mais [18] si le seigneur n’avoit point de pairs, ou n’en avoit pas assez, il pouvoit à ses frais emprunter [19] des pairs de son seigneur suzerain : mais ces pairs n’étoient point obligés de juger s’ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer qu’ils n’étoient venus que pour donner leur conseil : & dans ce cas particulier [20] , le seigneur jugeant & prononçant lui-même le jugement, si l’on appelloit contre lui de faux jugement, c’étoit à lui à soutenir l’appel.
Si le seigneur [21] étoit si pauvre qu’il ne fût pas en état de prendre des pairs [III-374] de son seigneur suzerain, ou qu’il négligeât de lui en demander, ou que celui-ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul, & personne n’étant obligé de plaider devant un tribunal où l’on ne peut faire jugement, l’affaire étoit portée à la cour du seigneur suzerain.
Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d’avec le fief, d’où s’est formée la regle des jurisconsultes François : Autre chose est le fief, autre chose est la justice. Car y ayant une infinité d’hommes de fief qui n’avoient point d’hommes sous eux, ils ne furent point en état de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain ; ils perdirent le droit de justice, parce qu’ils n’eurent ni le pouvoir ni la volonté de le réclamer.
Tous les juges [22] qui avoient été du jugement, devoient être présens quand on le rendoit, afin qu’ils pussent ensuivre & dire Oïl à celui qui voulant fausser, leur demandoit s’ils ensuivoient ; « car, dit Défontaines [23] , c’est une [III-375] affaire de courtoisie & de loyauté, & il n’y a point là de suite ni de remise. » Je crois que c’est de cette maniere de penser qu’est venu l’usage que l’on suit encore aujourd’hui en Angleterre, que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.
Il falloit donc se déclarer pour l’avis de la plus grande partie : & s’il y avoit partage, on prononçoit, en cas de crime, pour l’accusé ; en cas de dettes, pour le débiteur ; en cas d’héritages, pour le défendeur.
Un pair, dit Défontaines [24] , ne pouvoit pas dire qu’il ne jugeroit pas s’ils n’étoient que quatre [25] , ou s’ils n’y étoient tous, ou si les plus sages n’y étoient ; c’est comme s’il avoit dit, dans la mêlée, qu’il ne secouroit pas son seigneur, parce qu’il n’avoit auprès de lui qu’une partie de ses hommes. Mais c’étoit au seigneur à faire honneur à sa cour, & à prendre ses plus vaillans hommes & les plus sages. Je cite ceci pour faire sentir le devoir des vassaux, combattre & juger ; & ce devoir étoit [III-376] même tel, que juger c’étoit combattre.
Un seigneur [26] qui plaidoit à sa cour contre son vassal, & qui y étoit condamné, pouvoit appeller un de ses hommes de faux jugement. Mais à cause du respect que celui-ci devoit à son seigneur pour la foi donnée, & la bienveillance que le seigneur devoit à son vassal pour la foi reçue, on faisoit une distinction : ou le seigneur disoit en général, que le jugement [27] étoit faux & mauvais ; ou il imputoit à son homme des prévarications [28] personnelles. Dans le premier cas il offensoit sa propre cour, & en quelque façon lui-même, & il ne pouvoit y avoir de gages de batailles : il y en avoit dans le second, parce qu’il attaquoit l’honneur de son vassal ; & celui des deux qui étoit vaincu, perdoit la vie & les biens, pour maintenir la paix publique.
Cette distinction nécessaire, dans ce cas particulier, fut étendue. Beaumanoir dit que, lorsque celui qui appelloit de [III-377] faux jugement, attaquoit un des hommes par des imputations personnelles, il y avoit bataille ; mais que s’il n’attaquoit que le jugement, il étoit libre [29] à celui des pairs qui étoit appellé, de faire juger l’affaire par bataille ou par droit. Mais comme l’esprit qui régnoit du temps de Beaumanoir, étoit de restreindre l’usage du combat judiciaire, & que cette liberté donnée au pair appellé, de défendre par le combat le jugement, ou non, est également contraire aux idées de l’honneur établi dans ces temps-là, & à l’engagement où l’on étoit envers son seigneur de défendre sa cour, je crois que cette distinction de Beaumanoir étoit une jurisprudence nouvelle chez les François.
Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille ; il en étoit de cet appel comme de tous les autres. On se souvient des exceptions dont j’ai parlé au chapitre XXV. Ici, c’étoit au tribunal suzerain à voir s’il falloit ôter, ou non, les gages de bataille.
On ne pouvoit point fausser les jugemens rendus dans la cour du roi ; car [III-378] le roi n’ayant personne qui lui fût égal, il n’y avoit personne qui pût l’appeller ; & le roi n’ayant point de supérieur, il n’y avoit personne qui pût appeller de sa cour.
Cette loi fondamentale, nécessaire comme loi politique, diminuoit encore, comme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignoit [30] qu’on ne faussât sa cour, ou voyoit qu’on se présentoit pour la fausser ; s’il étoit du bien de la justice qu’on ne la faussât pas, il pouvoit demander des hommes de la cour du roi, dont on ne pouvoit fausser le jugement ; & le roi Philippe, dit Défontaines [31] , envoya tout son conseil pour juger une affaire dans la cour de l’abbé de Corbie.
Mais si le seigneur ne pouvoit avoir des juges du roi, il ne pouvoit mettre sa cour dans celle du roi, s’il relevoit nuement de lui ; & s’il y avoit des seigneurs intermédiaires, il s’adressoit à son seigneur suzerain, allant de seigneur en seigneur jusqu’au roi.
Ainsi, quoiqu’on n’eût pas dans ces [III-379] temps-là, la pratique ni l’idée même des appels d’aujourd’hui, on avoit recours au roi, qui étoit toujours la source d’où tous les fleuves partoient, & la mer où ils revenoient.
-
[↑] « Car en la cour où l’on va par la raison de l’appel pour les gages maintenir, se bataille est faite, la querelle est venue à fin, si que il n’y a métier de plus d’apiaux. » Beauman. ch. ii. P. 23.
-
[↑] Ibid. ch. lxi, p. 212, & ch. lxvii, p. 338.
-
[↑] Liv. II, ch. xv.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, p. 310 & 311 ; & ch. lxvii, pag. 337.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, page 313.
-
[↑] Ibid, page 314.
-
[↑] Qui s’étoient accordés au jugement.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, page 314.
-
[↑] Chap. xxii, art. I, 10 & 11. Il dit seulement qu’on leur payoit à chacun une amende.
-
[↑] Appeller de faux jugement.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, p. 314.
-
[↑] Beaum. ibid. Défont. ch. xxii, art. 9.
-
[↑] Défont. ibid.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, p. 316, & Défontaines, ch. xxii, art. 21.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, page 314.
-
[↑] Défont. ch. xxii, art. 73.
-
[↑] Voyez Défontaines, ch. xxi, art. 11, 12 & suivants, qui distingue les cas où le fausseur perdoit la vie, la chose contestée, ou seulement l’interlocutoire.
-
[↑] Beaum. ch. lxii, page 322. Défont. ch. xxii, art. 3.
-
[↑] Le comte n’étoit pas obligé d’en prêter. Beaum, ch. lxvii, pag. 337.
-
[↑] Nul ne peut faire jugement en sa cour, dit Beaumanoir, ch. lxvii, pages 336 & 337.
-
[↑] Ibid. ch. lxii, page 322.
-
[↑] Défont. chap xxi, art. 27 & 28.
-
[↑] Ibid. art. 28.
-
[↑] Chap. xxi, art. 37.
-
[↑] Il falloit ce nombre au moins, Défontaines, chap. xxi, art. 36.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, ch. lxvii, page 337.
-
[↑] Chi jugement est faux & mauvais : Ibid. ch. lxvii, page 337.
-
[↑] Vous avez fait ce jugement faux & mauvais, comme mauvais que vous êtes, ou par lovier ou par pramesse. Beaumanoir, ch. lxvii, page 337.
-
[↑] Ibid. pages 337 & 338.
-
[↑] Défont. ch. xxii, art. 14.
-
[↑] Ibid.
[III-379]
CHAPITRE XXVIII.
De l’appel de défaute de droit.
On appelloit de défaute de droit, quand, dans la cour d’un seigneur, on différoit, on évitoit, ou l’on refusoit de rendre la justice aux parties.
Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceux-ci étoit subordonnée, mais la juridiction ne l’étoit pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites, jugeoient en dernier ressort le comte même ; toute la différence étoit dans le partage de la juridiction : par exemple, le comte [1] pouvoit condamner à mort, juger de la liberté & de la restitution des biens ; & le centenier ne le pouvoit pas.
[III-380]
Par la même raison, il y avoit des causes majeures [2] qui étoient réservées au roi ; c’étoient celles qui intéressoient directement l’ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés, les comtes & autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux [3] .
Ce qu’on dit quelques auteurs, qu’on appelloit du comte à l’envoyé du roi, ou missus dominicus, n’est pas fondé. Le comte & le missus avoient une juridiction égale & indépendante l’une de l’autre [4] : toute la différence [5] étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l’année, & le comte les huit autres.
Si quelqu’un [6] condamné dans une assise [7] , y demandoit qu’on le rejugeât, & succomboit encore, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l’affaire.
[III-381]
Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisoient donner caution [8] qu’ils se présenteroient devant le tribunal du roi : c’étoit pour juger l’affaire, & non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz [9] l’appel de faux jugement à la cour du roi établi, & toutes autres sortes d’appels proscrits & punis.
Si l’on n’acquiesçoit pas [10] au jugement des échevins [11] , & qu’on ne réclamât pas, on étoit mis en prison jusqu’à ce qu’on eût acquiscé ; & si l’on réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi, & l’affaire se discutoit à sa cour.
Il ne pouvoit guere être question de l’appel de défaute de droit. Car bien loin que dans ce temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes & [III-382] autres gens qui avoient droit de tenir des assises, ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignoit [12] au contraire qu’ils l’étoient trop ; & tout est plein d’ordonnances qui défendent aux comtes & autres officiers de justice quelconques, de tenir plus de trois assises par an. Il falloit moins corriger leur négligence, qu’arrêter leur activité.
Mais, lorsqu’un nombre innombrable de petites seigneuries se formerent, que différens degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour, donna naissance à ces sortes d’appels [13] ; d’autant plus qu’il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considérables.
L’usage du combat judiciaire s’étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d’assembler les pairs, & où par conséquent on négligea de rendre la justice. L’appel de défaute de droit s’introduisit ; & ces sortes d’appels ont été souvent des points remarquables de notre [III-383] histoire, parce que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement pour cause, ou pour prétexte, celle du droit des gens.
Beaumanoir [14] dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avoit jamais de bataille ; en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne : on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose étoit claire, & qu’il n’y avoit qu’à compter les jours des ajournemens ou des autres délais : il n’y avoit point de jugement, & on ne faussoit que sur un jugement ; enfin le délit des pairs offensoit le seigneur comme la partie ; & il étoit contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur & ses pairs.
Mais [15] , comme devant le tribunal suzerain, on prouvoit la défaute par témoins, on pouvoit appeler au combat les témoins ; & par-là on n’offensoit ni le seigneur, ni son tribunal.
1.o Dans le cas où la défaute venoit [III-384] de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient différé de rendre la justice, ou évité de faire le jugement après les délais passés, c’étoient les pairs du seigneur qu’on appelloit de défaute de droit devant le suzerain ; & s’ils succomboient [16] , ils payoient une amende à leur seigneur. Celui-ci ne pouvoit porter aucun secours à ses hommes ; au contraire il saisissoit leur fief, jusqu’à ce qu’ils lui eussent payé chacun une amende de soixante livres.
2°. Lorsque la défaute venoit de la part du Seigneur, ce qui arrivoit lorsqu’il n’y avoit pas assez d’hommes à sa cour pour faire le jugement, ou lorsqu’il n’avoit pas assemblé ses hommes, ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandoit la défaute devant le seigneur suzerain : mais à cause du respect dû au seigneur, on faisoit ajourner la partie [17] , & non pas le seigneur.
Le seigneur demandoit sa cour devant le tribunal suzerain ; & s’il gagnoit la défaute, on lui renvoyoit l’affaire, & on lui payoit une amende de soixante [III-385] livres [18] : mais si la défaute étoit prouvée, la peine [19] contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée, le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain ; en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.
3°. Si l’on plaidoit [20] à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief ; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur [21] même devant bonnes gens, & on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, car les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner [22] pour leur seigneur.
Quelquefois [23] l’appel de défaute de droit étoit suivi d’un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré [III-386] la défaute, avoit fait rendre le jugement.
Le vassal [24] qui appelloit à tort son seigneur de défaute de droit, étoit condamné à lui payer une amende à sa volonté.
Les Gantois [25] avoient appellé de défaute de droit le comte de Flandre devant le roi, sur ce qu’il avoit différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu’il avoit pris encore moins de délais que n’en donnoit la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi, pour que cette amende fût modérée ; il fut décidé que le comte pouvoit prendre cette amende, & même plus, s’il vouloit. Beaumanoir avoit assisté à ces jugemens.
4°. Dans les affaires que le seigneur pouvoit avoir contre le vassal pour raison du corps ou de l’honneur de celui-ci, ou des biens qui n’étoient pas du fief, il n’étoit point question d’appel de défaute de droit ; puisqu’on ne jugeoit [III-387] point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenoit ; les hommes, dit Défontaines [26] , n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.
J’ai travaillé à donner une idée claire de ces choses, qui, dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses & si obscures, qu’en vérité les tirer du chaos où elles sont, c’est les découvrir.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 812, art. 3, édit. de Baluze, page 497, & de Charles-le-chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 812, art. 2, édition de Baluze, page 497.
-
[↑] Cum fidelibus ; capitulaire de Louis le débonnaire, édition de Baluze, page 667.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 812, art. 8.
-
[↑] Capitulaire ajouté à la loi des Lombards, liv. II, tit. 59.
-
[↑] Placitum.
-
[↑] Cela paroît par les formules, les chartres & les capitulaires.
-
[↑] De l’an 757, édit. de Baluze, page 180, art. 9 & 10 ; & le synode apud Vernas, de l’an 755, art. 29, édit. de Baluze, pag. 175. Ces deux capitulaires furent faits sous le roi Pépin.
-
[↑] Capitulaire XI de Charlemagne, de l’an 805, édit. de Baluze, page 423 ; & loi de Lothaire, dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, art. 23.
-
[↑] Officiers sous le comte : scabini.
-
[↑] Voyez la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, art. 22.
-
[↑] On voit des appels de défaute de droit dès le temps de Philippe Auguste.
-
[↑] Chap. lxi, page 315.
-
[↑] Beaum. ibid.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. 24.
-
[↑] Ibid. ch. xxi, art. 32.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, page 312.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. I, 29.
-
[↑] Sous le regne de Louis VIII, le sire de Nele plaidoit contre Jeanne Comtesse de Flandre ; il la somma de le faire juger dans quarante jours, & il l’appella ensuite de défaute de droit à la cour du roi. Elle répondit qu’elle le feroit juger par ses pairs en Flandre. La cour du roi prononça qu’il n’y seroit point renvoyé, & que la Comtesse seroit ajournée.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. 34.
-
[↑] Ibid. art. 9.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, p. 311.
-
[↑] Ibid p. 312. Mais celui qui n’auroit été homme, ni tenant du seigneur, ne lui payoit qu’une amende de 60 livres, ibid.
-
[↑] Ibid. page 318.
-
[↑] Chapitre XXI, art. 35.
[III-387]
CHAPITRE XXIX.
Époque du regne de S. Louis.
Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribunaux de ses domaines, comme il paroît par l’ordonnance [1] qu’il fit là-dessus, & par les établissemens [2] .
Mais il ne l’ôta point dans les cours de ses barons [3] , excepté dans le cas d’appel de faux jugement.
On ne pouvoit fausser [4] la cour de [III-388] son seigneur, sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avoient prononcé le jugement. Mais S. Louis introduisit [5] l’usage de fausser sans combattre ; changement qui fut une espece de révolution.
Il déclara [6] qu’on ne pourroit point fausser les jugemens rendus dans les seigneuries de ses domaines, parce que c’étoit un crime de félonie. Effectivement, si c’étoit une espece de crime de félonie contre le seigneur, à plus forte raison en étoit-ce un contre le roi. Mais il voulut que l’on pût demander amendement [7] des jugemens rendus dans ses cours ; non pas parce qu’ils étoient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu’ils faisoient quelque préjudice [8] . Il voulut, au contraire, qu’on fût contraint de fausser [9] les jugemens des cours des barons, si l’on vouloit s’en plaindre.
On ne pouvoit point, suivant les établissemens, fausser les cours des [III-389] domaines du roi, comme on vient de le dire. Il falloit demander amendement devant le même tribunal : & en cas que le bailli ne voulût pas faire l’amendement requis, le roi permettoit de faire appel [10] à sa cour ; ou plutôt en interprétant les établissemens par eux-mêmes, de lui présenter [11] une requête ou supplication.
A l’égard des cours des seigneurs, S. Louis, en permettant de les fausser, voulut que l’affaire fût portée [12] au tribunal du roi ou du seigneur suzérain, non [13] pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des regles [14] .
Ainsi, soit qu’on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs ; soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines ; il établit qu’on pourroit appeler, sans courir le hazard d’un combat.
[III-390]
Défontaines [15] nous rapporte les deux premiers exemples qu’il ait vus, où l’on ait ainsi procédé sans combat judiciaire : l’un dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoit du domaine du roi, & l’autre dans la cour de Ponthieu, où le comte qui étoit présent, opposa l’ancienne jurisprudence : mais ces deux affaires furent jugées par droit.
On demandera peut-être pourquoi S. Louis ordonna pour les cours de ses barons une maniere de procéder différente de celle qu’il établissoit dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. S. Louis statuant pour les cours de ses domaines, ne fut point gêné dans ses vues : mais il eut des ménagemens à garder avec les seigneurs, qui jouissoient de cette ancienne prérogative, que les affaires n’étoient jamais tirées de leurs cours, à moins qu’on ne s’exposât aux dangers de les fausser. S. Louis maintint cet usage de fausser : mais il voulut qu’on pût fausser sans combattre, c’est-à-dire, que, pour que le changement se fît moins sentir, il ôta la chose, & laissa subsister les termes.
[III-391]
Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir [16] dit que de son temps il y avoit deux manieres de juger, l’une suivant l’établissement-le-roi, & l’autre suivant la pratique ancienne : que les seigneurs avoient droit de suivre l’une où l’autre de ces pratiques ; mais que, quand dans une affaire on en avoit choisi une, on ne pouvoit plus revenir à l’autre. Il ajoute [17] que le comte de Clermont suivoit la nouvelle pratique, tandis que ses vassaux se tenoient à l’ancienne : mais qu’il pourroit, quand il voudroit, rétablir l’ancienne ; sans quoi il auroit moins d’autorité que ses vassaux.
Il faut savoir que la France étoit pour lors [18] divisée en pays du domaine du roi, & en ce que l’on appelloit pays des barons ou en baronnies : & pour me servir des termes des établissemens de S. Louis, en pays de l’obéissance-le-roi, & en pays hors l’obéissance-le-roi. Quand les rois faisoient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n’employoient que leur seule [III-392] autorité : mais quand ils en faisoient qui regardoient aussi les pays de leurs barons, elles étoient faites [19] de concert avec eux, ou scellées ou souscrites d’eux : sans cela, les barons les recevoient ou ne les recevoient pas, suivant qu’elles leur paroissoient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arriere-vassaux étoient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or les établissemens ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu’ils statuassent sur des choses qui étoient pour eux d’une grande importance : ainsi ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu’il leur étoit avantageux de les recevoir. Robert, fils de S. Louis, les admit dans sa comté de Clermont ; & ses vassaux ne crurent pas qu’il leur convînt de les faire pratiquer chez eux.
-
[↑] En 1260.
-
[↑] Livre I. ch. ii & vii ; liv. II. ch. x & xi.
-
[↑] Comme il paroît par-tout dans les établissemens ; & Beaumanoir, ch. lxi, page 309.
-
[↑] C’est-à-dire, appeler de faux jugement.
-
[↑] Établissemens, liv. I. chap. vi ; & liv. II. chap. xv.
-
[↑] Ibid. liv. II. chap xv.
-
[↑] Ibid. liv. I. ch. lxxviii, & liv. II. ch. xv.
-
[↑] Ibid. liv. I. ch. lxxviii.
-
[↑] Ibid. liv. II. ch. xv.
-
[↑] Etablissemens, liv. I. chap. lxxviii.
-
[↑] Ibid. liv. II. ch. xv.
-
[↑] Mais si on ne faussoit pas, & qu’on voulût appeler, on n’étoit point reçu. Etablissemens, liv. II. ch. xv. Li sire en auroit le recort de sa cour droit faisant.
-
[↑] Ibid. liv. I. ch. vi & lxvii ; & liv. II. ch. xv ; & Beaumanoir, ch. xi, page 58.
-
[↑] Etablissemens, liv. I. ch. i, ii & iii.
-
[↑] Chapitre xxii, art. 16 & 17.
-
[↑] Chapitre lxi, page 309.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, Défontaines, & les établissemens, liv. II. ch. x, xi, xv & autres.
-
[↑] Voyez les ordonnances du commencement de la troisieme race, dans le recueil de Lauriere, sur-tout celles de Philippe-Auguste sur la juridiction ecclésiastique, é celles de Louis VIII, sur les Juifs ; & les chartres rapportées par M. Brussel, notamment celles de S. Louis sur le bail & le rachat des terres, & la majorité féodale des filles, tome II, liv. III, page 35 ; & ibid, l’ordonnance de Philippe-Auguste, page 7.
[III-393]
CHAPITRE XXX.
Observation sur les appels.
On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, devoient se faire sur le champ. « S’il se part de court sans appeller, dit Beaumanoir [1] , il perd son appel, & tient le jugement pour bon ». Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage du combat judiciaire [2] .
-
[↑] Chap. lxiii, page 327 ; Ibid. ch. lxi, p. 312.
-
[↑] Voyez les établissemens de S. Louis, liv. II. chap. xv ; l’ordonnance de Charles VII, de 1453.
[III-393]
CHAPITRE XXXI.
Continuation du même sujet.
Le villain ne pouvoit pas fausser la cour de son seigneur : nous l’apprenons de Défontaines [1] ; & cela est confirmé par les établissemens [2] . « Aussi, dit encore Défontaines [3] , n’y a-t-il entre toi seigneur & ton villain autre juge fors Dieu ».
[III-394]
C’étoit l’usage du combat judiciaire qui avoit exclus les villains de pouvoir fausser la cour de leur seigneur ; & cela est si vrai, que les villains qui, par chartre [4] ou par usage, avoient droit de combattre, avoient aussi droit de fausser la cour de leur seigneur, quand même les hommes qui avoient jugé auroient été chevaliers [5] ; & Défontaines donne des expédiens [6] pour que ce scandale du villain, qui, en faussant le jugement, combattroit contre un chevalier, n’arrivât pas.
La pratique des combats judiciaires commençant à s’abolir, & l’usage des nouveaux appels à s’introduire, on pensa qu’il étoit déraisonnable que les personnes franches eussent un remede contre l’injustice de la cour de leurs seigneurs, & que les villains ne l’eussent pas ; & le parlement reçut leurs appels comme ceux des personnes franches.
-
[↑] Chap. xxi, art. 21 & 22.
-
[↑] Liv. I. chap. cxxxvi.
-
[↑] Chap. ii, art. 8.
-
[↑] Défontaines, ch. xxii, art. 7. Cet article & le 21 du ch. xxii du même auteur, ont été jusqu’ici très-mal expliqués. Défontaines ne met point en opposition le jugement du seigneur avec celui du chevalier, puisque c’étoit le même ; mais il oppose le vaillain ordinaire à celui qui avoit le privilege de combattre.
-
[↑] Les chevaliers peuvent toujours être du nombre des juges. Défontaines, ch. xxi, art. 48.
-
[↑] Chapitre xxii, art. 14.
[III-395]
CHAPITRE XXXII.
Continuation du même sujet.
Lorsqu’on faussoit la cour de son seigneur, il venoit en personne devant le seigneur suzerain, pour défendre le jugement de sa cour. De même [1] , dans le cas d’appel de défaute de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avec elle, afin que, si la défaute n’étoit pas prouvée, il pût ravoir sa cour.
Dans la suite, ce qui n’étoit que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l’introduction de toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, & pour d’autres affaires que les siennes. Philippe de Valois [2] ordonna que les baillis seuls seroient ajournés. Et quand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre à l’appel ; le fait [3] du juge devint le fait de la partie.
[III-396]
J’ai dit [4] que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais si le seigneur étoit attaqué lui-même comme partie [5] , ce qui devint très-fréquent [6] , il payoit au roi, ou au seigneur suzérain devant qui on avoit appellé, une amende de soixante livres. De-là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformoit la sentence de son juge : usage qui subsista long-temps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon, & que son absurdité a fait périr.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. 33.
-
[↑] En 1332.
-
[↑] Voyez quel étoit l’état des choses du temps de Poutillier, qui vivoit en l’an 1402. Somme rurale, liv. I, page 19 & 20.
-
[↑] Ci-dessus, chap. xxx.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, pag. 312 & 318.
-
[↑] Ibid.
[III-396]
CHAPITRE XXXIII.
Continuation du même sujet.
Dans la pratique du combat judiciaire, le fausseur qui avoit appellé un des juges, pouvoit perdre [1] par le combat son procès, & ne pouvoit pas [III-397] le gagner. En effet, la partie qui avoit un jugement pour elle, n’en devoit pas être privée par le fait d’autrui. Il falloit donc que le fausseur qui avoit vaincu, combattît encore contre la partie, non pas pour savoir si le jugement étoit bon ou mauvais ; il ne s’agissoit plus de ce jugement, puisque le combat l’avoit anéanti ; mais pour décider si la demande étoit légitime ou non ; & c’est sur ce nouveau point que l’on combattoit. De-là doit être venue notre maniere de prononcer les arrêts : La cour met l’appel au néant ; la cour met l’appel & ce dont a été appellé au néant. En effet, quand celui qui avoit appellé de faux jugement étoit vaincu, l’appel étoit anéanti ; quand il avoit vaincu, le jugement étoit anéanti, & l’appel même : il falloit procéder à un nouveau jugement.
Ceci est si vrai, que lorsque l’affaire se jugeoit par enquêtes, cette maniere de prononcer n’avoit pas lieu. M. de la Roche-Flavin nous dit [2] que la chambre des enquêtes ne pouvoit user de cette forme dans les premiers temps de sa création.
[III-398]
CHAPITRE XXXIV.
Comment la procédure devint secrette.
Les duels avoient introduit une forme de procédure publique ; l’attaque & la défense étoient également connues. « Les témoins, dit Beaumanoir [1] , doivent dire leur témoignage devant tous ».
Le commentateur de Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens & de quelques vieux procès écrits à la main, qu’anciennement en France les procès criminels se faisoient publiquement, & en une forme non guere différente des jugemens publics des Romains. Ceci étoit lié avec l’ignorance de l’écriture, commune dans ces temps-là. L’usage de l’écriture arrête les idées, & peut faire établir le secret : mais quand on n’a point cet usage, il n’y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées.
Et comme il pouvoit y avoir de l’incertitude sur [2] ce qui avoit été jugé par hommes, ou plaidé devant [III-399] hommes, on pouvoit en rappeller la mémoire toutes les fois qu’on tenoit la cour, par ce qui s’appelloit la procédure par record [3] ; & dans ce cas, il n’étoit pas permis d’appeler les témoins au combat ; car les affaires n’auroient jamais eu de fin.
Dans la suite, il s’introduisit une forme de procéder secrette. Tout étoit public ; tout devint caché ; les interrogatoires, les informations, le récollement, la confrontion, les conclusions de la partie publique ; & c’est l’usage d’aujourd’hui. La premiere forme de procéder convenoit au gouvernement d’alors, comme la nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis.
Le commentateur de Boutillier fixe à l’ordonnance de 1539 l’époque de ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu, & qu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncerent à l’ancienne pratique de juger, & que celle tirée des établissemens de S. Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir [4] dit que ce n’étoit [III-400] que dans le cas où on pouvoit donner des gages de bataille, qu’on entendoit publiquement les témoins : dans les autres, on les oyoit en secret, & on rédigeoit leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrettes, lorsqu’il n’y eut plus de gages de bataille.
-
[↑] Chapitre lxi, page 315.
-
[↑] Comme dit Beaumanoir, ch. xxxix. p. 209.
-
[↑] On prouvoit par témoins ce qui s’étoit déjà passé, dit, ou ordonné en justice.
-
[↑] Chapitre xxxix, page 218.
[III-400]
CHAPITRE XXXV.
Des dépens.
Anciennement en France, il n’y avoit point de condamnation de dépens en cour laye [1] . La partie qui succomboit étoit assez punie par des condamnations d’amende envers le seigneur & ses pairs. La maniere de procéder par le combat judiciaire faisoit que, dans les crimes, la partie qui succomboit, & qui perdoit la vie & les biens, étoit punie autant qu’elle pouvoit l’être : & dans les autres cas du combat judiciaire, il y avoit des amendes quelques fixes, quelquefois [III-401] dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisoient assez craindre les événemens des procès. Il en étoit de même dans les affaires qui ne se décidoient que par le combat. Comme c’étoit le seigneur qui avoit les profits principaux, c’étoit lui aussi qui faisoit les principales dépenses, soit pour assembler ses pairs, soit pour les mettre en état de procéder au jugement. D’ailleurs, les affaires finissant sur le lieu même, & toujours presque sur le champ, & sans ce nombre infini d’écritures qu’on vit depuis, il n’étoit pas nécessaire de donner des dépens aux parties.
C’est l’usage des appels qui doit naturellement introduire celui de donner des dépens. Aussi Défontaines [2] dit-il que, lorsqu’un appelloit par loi écrite, c’est-à-dire quand on suivoit les nouvelles lois de S. Louis, on donnoit des dépens ; mais que, dans l’usage ordinaire, qui ne permettoit point d’appeller sans fausser, il n’y en avoit point ; on n’obtenoit qu’une amende, & la possession d’an & jour de la chose contestée, si l’affaire étoit renvoyée au seigneur.
[III-402]
Mais, lorsque de nouvelles facilités d’appeller augmenterent le nombre des appels [3] ; que, par le fréquent usage de ces appels d’un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour ; quand l’art nouveau de la procédure multiplia & éternisa les procès ; lorsque la science d’éluder les demandes les plus justes se fut rafinée ; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivre ; lorsque la demande fut ruineuse, & la défense tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles & d’écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice, qui ne devoient point rendre la justice ; que la mauvaise foi trouva des conseils, là où elle ne trouva pas des appuis : il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, & pour les moyens qu’ils avoient employés pour l’éluder. Charles le bel fit là-dessus une ordonnance générale [4] .
-
[↑] Défontaines, dans son conseil, chap. xxii, art. 3 & 8 ; & Beaumanoir, ch. xxxiii ; Établissemens, liv. I. ch. xc.
-
[↑] Chapitre xxii, art. 8.
-
[↑] A présent que l’on est si enclin à appeller, dit Boutillier, somme rurale, liv. I. tit. 3, page 16.
-
[↑] En 1324.
[III-403]
CHAPITRE XXXVI.
De la partie publique.
Comme, par les lois Saliques & Ripuaires, & par les autres lois des peuples barbares, les peines des crimes étoient pécuniaires ; il n’y avoit point pour lors, comme aujourd’hui parmi nous, de partie publique qui fût chargée de la poursuite des crimes. En effet, tout se réduisoit en réparation de dommages ; toute poursuite étoit en quelque façon civile, & chaque particulier pouvoit la faire. D’un autre côté, le droit Romain avoit des formes populaires pour la poursuite des crimes, qui ne pouvoient s’accorder avec le ministere d’une partie publique.
L’usage des combats judiciaires ne répugnoit pas moins à cette idée ; car, qui auroit être voulu être la partie publique, & se faire champion de tous contre tous ?
Je trouve dans un recueil de formules que M. Muratori a insérées dans les lois des Lombards, qu’il y avoit dans la seconde race un avoué [1] de la [III-404] partie publique. Mais si on lit le recueil entier de ces formules, on verra qu’il y avoit une différence totale entre ses officiers, & ce que nous appellons aujourd’hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi ou des seigneurs. Les premiers étoient plutôt les agens du public pour la manutention politique & domestique, que pour la manutention civile. En effet, on ne voit point, dans ces formules, qu’ils fussent chargés de la poursuite des crimes, & des affaires qui concernoient les mineurs, les églises, ou l’état des personnes.
J’ai dit que l’établissement d’une partie publique répugnoit à l’usage du combat judiciaire. Je trouve pourtant, dans une de ces formules, un avoué de la partie publique qui a la liberté de combattre. M. Muratori l’a mise à la suite de la constitution [2] d’Henri I. pour laquelle elle a été faite. Il est dit dans cette constitution, que « si quelqu’un tue son pere, son frere, son neveu, ou quelqu’autre de ses parens, il perdra leur succession, qui passera aux [III-405] autres parens ; & que la sienne propre appartiendra au fisc ». Or c’est pour la poursuite de cette succession dévolue au fisc, que l’avoué de la partie publique, qui en soutenoit les droits, avoit la liberté de combattre : ce cas rentroit dans la regle générale.
Nous voyons, dans ces formules, l’avoué de la partie publique agir contre celui [3] qui avoit pris un voleur, & ne l’avoit pas mené au comte ; contre celui [4] qui avoit fait un soulevement ou une assemblée contre le comte ; contre celui [5] qui avoit sauvé la vie à un homme que le comte lui avoit donné pour le faire mourir ; contre l’avoué des églises [6] , à qui le comte avoit ordonné de lui présenter un voleur, & qui n’avoit point obéi ; contre celui [7] qui avoit révélé le secret du roi aux étrangers ; contre celui [8] qui, à main armée, avoit poursuivi l’envoyé de l’empereur ; contre celui [9] qui avoit [III-406] méprisé les lettres de l’empereur, & il étoit poursuivi par l’avoué de l’empereur, ou par l’empereur lui-même ; contre celui [10] qui n’avoit pas voulu recevoir la monnoie du prince : enfin, cet avoué demandoit les choses que la loi adjugeoit au fisc [11] .
Mais dans la poursuite des crimes, on ne voit point d’avoué de la partie publique ; même quand on emploie les duels [12] ; même quand il s’agit d’incendie [13] ; même lorsque le juge est tué sur son tribunal [14] ; même lorsqu’il s’agit de l’état des personnes [15] , de la liberté & de la servitude [16] .
Ces formules sont faites, non seulement pour les lois des Lombards, mais pour les Capitulaires ajoutés ; ainsi il ne faut pas douter que, sur cette matiere, elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.
Il est clair que ces avoués de la partie publique durent s’éteindre avec la [III-407] seconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raison qu’il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général ; & par la raison qu’il n’y eut plus de comte dans les provinces, pour tenir les plaids ; & par conséquent plus de ces sortes d’officiers dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte.
L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisieme race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutiller, dans sa somme rurale, parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux & sergens. Voyez les établissemens [17] , & Beaumanoir [18] sur la maniere dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là.
Je trouve dans les lois [19] de Jacques II, roi de Majorque, une création de l’emploi de procureur du roi [20] , avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent [III-408] qu’après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.
-
[↑] Advocatus de parte publicâ.
-
[↑] Voyez cette constitution & cette formule dans le second volume des historiens d’Italie, page 175.
-
[↑] Recueil de Muratori, page 104, sur la loi 88 de Charlemagne, liv. I. tit. 26, §. 78.
-
[↑] Autre formule, Ibid. page 87.
-
[↑] Ibid. page 104.
-
[↑] Ibid. page 95.
-
[↑] Ibid. page 88.
-
[↑] Ibid. page 98.
-
[↑] Ibid. page 132.
-
[↑] Formule, page 132.
-
[↑] Ibid. page 137.
-
[↑] Ibid. page 147.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid. page 168.
-
[↑] Ibid. page 134.
-
[↑] Ibid. page 107.
-
[↑] Livre I. ch. i ; & liv. II. ch. xi & xiii.
-
[↑] Chapitre i. & chap. lxi.
-
[↑] Voyez ces lois dans les vies des Saints du mois de juin, tome III, page 26.
-
[↑] Qui continuè nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta & causas in ipsâ curiâ promoveat atque prosequatur.
[III-408]
CHAPITRE XXXVII.
Comment les établissemens de Saint Louis tomberent dans l’oubli.
Ce fut le destin des établissemens, qu’ils naquirent, vieillirent, & moururent en très-peu de temps.
Je ferai là-dessus quelques réflexions. Le code que nous avons sous le nom d’établissemens de S. Louis, n’a jamais été fait pour servir de loi à tout le royaume, quoique cela soit dit dans la préface de ce code. Cette compilation est un code général, qui statue sur toutes les affaires civiles, les dispositions des biens par testament ou entre-vifs, les dots & les avantages des femmes, les profits & les prérogatives des fiefs, les affaires de police, &c. Or, dans un temps où chaque ville, bourg ou village, avoit sa coutume, donner un corps général de lois civiles, c’étoit vouloir renverser dans un moment toutes les lois particulieres, sous lesquelles on vivoit dans chaque lieu du royaume. Faire une coutume générale de toutes les coutumes [III-409] particulieres, seroit une chose inconsidérée, même dans ce temps-ci, où les princes ne trouvent par-tout que de l’obéissance. Car, s’il est vrai qu’il ne faut pas changer lorsque les inconvéniens égalent les avantages, encore moins le faut-il lorsque les avantages sont petits & les inconvéniens immenses. Or, si l’on fait attention à l’état où étoit pour lors le royaume, où chacun s’enivroit de l’idée de sa souveraineté & de sa puissance, on voit bien qu’entreprendre de changer par-tout les lois & les usages reçus, c’étoit une chose qui ne pouvoit venir dans l’esprit de ceux qui gouvernoient.
Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des établissemens ne fut pas confirmé en parlement par les barons & gens de loi du royaume, comme il est dit dans un manuscrit de l’Hôtel de ville d’Amiens, cité par M. Ducange [1] . On voit, dans les autres manuscrits, que ce code fut donné par S. Louis en l’année 1270, avant qu’il partît pour Tunis : ce fait n’est pas plus vrai : car S. Louis est parti en 1269, comme l’a remarqué M. Ducange ; d’où [III-410] il conclut que ce code auroit été publié en son absence. Mais je dis que cela ne peut pas être. Comment S. Louis auroit-il pris le temps de son absence, pour faire une chose qui auroit été une semence de troubles, & qui eût pu produire, non pas des changemens, mais des révolutions ? Une pareille entreprise avoit besoin, plus qu’une autre, d’être suivie de près ; & n’étoit point l’ouvrage d’une régence foible, & même composée de seigneurs, qui avoient intérêt que la chose ne réussît pas. C’étoit Matthieu, abbé de S. Denys ; Simon de Clermont, comte de Nelle ; & en cas de mort, Philippe, évêque d’Evreux ; & Jean, comte de Ponthieu. On a vu ci-dessus [2] , que le comte de Ponthieu s’opposa dans sa seigneurie à l’exécution d’un nouvel ordre judiciaire.
Je dis en troisieme lieu, qu’il y a grande apparence que le code que nous avons, est une chose différente des établissemens de S. Louis sur l’ordre judiciaire. Ce code cite les établissemens ; il est donc un ouvrage sur les établissemens, & non pas les établissemens. De plus, Beaumanoir, qui parle souvent [III-411] des établissemens de S. Louis, ne cite que des établissemens particuliers de ce prince, & non pas cette compilation des établissemens. Défontaines [3] , qui écrivoit sous ce prince, nous parle des deux premieres fois que l’on exécuta ses établissemens sur l’ordre judiciaire, comme d’une chose reculée. Les établissemens de S. Louis étoient donc antérieures à la compilation dont je parle, qui, à la rigueur, & en adoptant les prologues erronés mis par quelques ignorans à la tête de cet ouvrage, n’auroit paru que la derniere année de la vie de S. Louis, ou même après la mort de ce prince.
[III-411]
CHAPITRE XXXVIII.
Continuation du même sujet.
Qu’est-ce donc que cette compilation que nous avons sous le nom d’établissemens de S. Louis ? Qu’est-ce que ce code obscur, confus & ambigu, où l’on mêle sans cesse la jurisprudence Françoise avec la loi Romaine ; où l’on parle comme un législateur, & [III-412] où l’on voit un juriconsulte ; où l’on trouve un corps entier de jurisprudence sur tous les cas, sur tous les points du droit civil ? Il faut se transporter dans ces temps-là.
S. Louis, voyant les abus de la jurisprudence de son temps, chercha à en dégoûter les peuples : il fit plusieurs réglemens pour les tribunaux de ses domaines, & pour ceux de ses barons ; & il eut un tel succès, que Beaumanoir [1] , qui écrivoit très-peu de temps après la mort de ce prince, nous dit que la maniere de juger établie par Saint Louis, étoit pratiquée dans un grand nombre de cours des seigneurs.
Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ses réglemens pour les tribunaux des seigneurs n’eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourroit suivre, & que chacun même auroit intérêt de suivre. Il ôta le mal, en faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux des seigneurs une maniere de procéder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la [III-413] religion, à la tranquillité publique, à la sureté de la personne & des biens, on la prit, & on abandonna l’autre.
Inviter quand il ne faut pas contraindre, conduire quand il ne faut pas commander ; c’est l’habileté suprême. La raison a un empire naturel ; elle a même un empire tyrannique : on lui résiste, mais cette résistance est son triomphe ; encore un peu de temps, & l’on sera forcé de revenir à elle.
S. Louis, pour dégoûter de la jurisprudence Françoise, fit traduire les livres du droit Romain, afin qu’ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Défontaines, qui est le premier [2] auteur de pratique que nous ayons, fit un grand usage de ces lois Romaines : son ouvrage est en quelque façon un résultat de l’ancienne jurisprudence Françoise, des lois ou établissemens de S. Louis, & de la loi Romaine. Beaumanoir fit peu d’usage de la loi Romaine, mais il concilia l’ancienne jurisprudence Françoise avec les réglemens de S. Louis.
C’est dans l’esprit de ces deux [III-414] ouvrages, & sur-tout de celui de Défontaines, que quelque bailli, je crois, fit l’ouvrage de jurisprudence que nous appelons les établissemens. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage, qu’il est fait selon l’usage de Paris & d’Orléans, & de cour de baronnie ; & dans le prologue, qu’il y est traité des usages de tout le royaume & d’Anjou, & de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans & Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir, & de Défontaines furent faits pour les comtés de Clermont & de Vermandois : & comme il paroît, par Beaumanoir, que plusieurs lois de Saint Louis avoient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage [3] regardoit aussi les cours de baronnie.
Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois & les établissemens de S. Louis. Cet ouvrage est très-précieux, [III-415] parce qu’il contient les anciennes coutumes d’Anjou, & les établissemens de S. Louis, tels qu’ils étoient alors pratiqués, & enfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne jurisprudence Françoise.
La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Défontaines & de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; & cela pouvoit être ainsi, parce qu’il étoit une compilation de coutumes écrites, & de lois.
Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence Françoise avec la loi Romaine, on rapprochoit des choses qui n’avoient jamais de rapport, & qui souvent étoient contradictoires.
Je sais bien que les tribunaux François des hommes ou des pairs, les jugemens sans appel à un autre tribunal, la maniere de prononcer par ces mots, je condamne [4] ou j’absous, avoient de la conformité avec les jugemens populaires des Romains. Mais on fit peu d’usage de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut [III-416] introduite depuis par les empereurs, qu’on employa par-tout dans cette compilation, pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence Françoise.
-
[↑] Chap. lxi, page 309.
-
[↑] Il dit lui-même dans son prologue : Nus luy enprit onques mais cette chose dont j’ay.
-
[↑] Il n’y a rien de si vague que le titre & le prologue. D’abord ce sont les usages de Paris & d’Orléans, & de cour de baronnie ; ensuite ce sont les usages de toutes les cours layes du royaume, & de la prévôté de France ; ensuite ce sont les usages de tout le royaume & d’Anjou, & de cour de baronnie.
-
[↑] Etablissemens, liv. II, chap. xv.
[III-416]
CHAPITRE XXXIX.
Continuation du même sujet.
Les formes judiciaires introduites par S. Louis cesserent d’être en usage. Ce prince avoit eu moins en vue la chose même, c’est-à-dire la meilleure maniere de juger, que la meilleure maniere de suppléer à l’ancienne pratique de juger. Le premier objet étoit de dégoûter de l’ancienne jurisprudence, & le second d’en former une nouvelle. Mais les inconvéniens de celle-ci ayant paru, on en vit bientôt succéder une autre.
Ainsi les lois de Saint-Louis changerent moins la jurisprudence Françoise, qu’elles ne donnerent des moyens pour la changer ; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver ; & quand on put parvenir aisément à celui qui avoit une autorité générale, les jugemens, qui auparavant ne faisoient que les usages d’une [III-417] seigneurie particuliere, formerent une jurisprudence universelle. On étoit parvenu par la force des établissemens, à avoir des décisions générales, qui manquoient entiérement dans le royaume : quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber l’échafaud.
Ainsi les lois que fit Saint Louis eurent des effets qu’on n’auroit pas dû attendre du chef-d’œuvre de la législation. Il faut quelquefois bien des siecles pour préparer les changemens ; les événemens mûrissent, & voilà les révolutions.
Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affaires du royaume. Auparavant il ne jugeoit que de celles qui étoient entre les ducs [1] , comtes, barons, évêques, abbés, ou entre le roi & ses vassaux [2] , plutôt dans le rapport qu’elles avoient avec l’ordre politique, qu’avec l’ordre civil. Dans la suite, on fut obligé de le rendre sédentaire, & de le tenir toujours assemblé ; & enfin, on en créa plusieurs, [III-418] pour qu’ils pussent suffire à toutes les affaires.
À peine le parlement fut-il un corps fixe, qu’on commença à compiler ses arrêts. Jean de Monluc, sous le regne de Philippe le bel, fit le recueil qu’on appelle aujourd’hui les registres Olim [3] .
-
[↑] Voyez Dutillet, sur la cour des pairs. Voyez aussi la Roche-Flavin, liv. I, ch. iii ; Budée & Paul-Emile.
-
[↑] Les autres affaires étoient décidées par les tribunaux ordinaires.
-
[↑] Voyez l’excellent ouvrage de M. le président Hénault, sur l’an 1313.
[III-418]
CHAPITRE XL.
Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.
Mais d’où vient qu’en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celle du droit canonique, plutôt que celles du droit Romain ? C’est qu’on avoit toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivoient les formes du droit canonique, & que l’on ne connoissoit aucun tribunal qui suivît celles du droit Romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique & de la séculiere étoient dans ces temps-là très-peu connues : il y avoit [1] des gens [2] qui plaidoient [III-419] indifféremment dans les deux cours ; il y avoit des matieres pour lesquelles on plaidoit de même. Il semble [3] que la juridiction laye ne se fût gardée, privativement à l’autre, que le jugement des matieres féodales, & des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquoient par la religion [4] . Car si, pour raison des conventions & des contrats, il falloit aller à la justice laye, les parties pouvoient volontairement procéder devant les tribunaux clercs, qui, n’étant pas en droit d’obliger la justice laye à faire exécuter la sentence, contraignoient d’y obéir par voie d’excommunication [5] . Dans ces circonstances, lorsque, dans les tribunaux laïques, on voulut changer de pratique, on prit celle des clercs, parce qu’on la savoit ; & on ne prit pas celle du droit Romain, parce qu’on ne la savoit point ; car, en fait de pratique, on ne sait que ce que l’on pratique.
-
[↑] Beaum. ch. xi, pag. 58.
-
[↑] Les femmes veuves, les croisés, ceux qui tenoient les biens des églises pour raison de ces biens. Ibid.
-
[↑] Voyez tout le chap. xi. de Beaumanoir.
-
[↑] Les tribunaux clercs, sous prétexte du serment, s’en étoient même saisis, comme on le voit par le fameux concordat passé entre Philippe Auguste, les clercs & les barons, qui se trouve dans les ordonnances de Lauriere.
-
[↑] Beaumanoir, chap. xi, pag. 60.
[III-420]
CHAPITRE XLI.
Flux & reflux de la juridiction ecclésiastique & de la juridiction laye.
La puissance civile étant entre les mains d’une infinité de seigneurs, il avoit été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus d’étendue : mais comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridiction des seigneurs, & contribua par-là à donner des forces à la juridiction royale, la juridiction royale restreignit peu à peu la juridiction ecclésiastique, & celle-ci recula devant la premiere. Le parlement, qui avoit pris dans sa forme de procéder tout ce qu’il y avoit de bon & d’utile dans celle des tribunaux des clercs, ne vit bientôt plus que ses abus ; & la juridiction royale se fortifiant tous les jours, elle fut toujours plus en état de corriger ces mêmes abus. En effet, ils étoient intolérables ; & sans en faire l’énumération, je renverrai à Beaumanoir [1] , [III-421] à Boutillier, aux ordonnances de nos rois. Je ne parlerai que de ceux qui intéressoient plus directement la fortune publique. Nous connoissons ces abus par les arrêts qui les réformerent. L’épaisse ignorance les avoit introduits ; une espece de clarté parut, & ils ne furent plus. On peut juger, par le silence du clergé, qu’il alla lui-même au devant de la correction ; ce qui, vu la nature de l’esprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mouroit sans donner une partie de ses biens à l’église, ce qui s’appeloit mourir déconfés, étoit privé de la communion & de la sépulture. Si l’on mouroit sans faire de testament, il falloit que les parens obtinssent de l’évêque, qu’il nommât, concuremment avec eux, des arbitres, pour fixer ce que le défunt auroit dû donner, en cas qu’il eût fait un testament. On ne pouvoit pas coucher ensemble la premiere nuit des noces, ni même les deux suivantes, sans en avoir acheté la permission : c’étoit bien ces trois nuits-là qu’il falloit choisir ; car pour les autres on [III-422] n’auroit pas donné beaucoup d’argent. Le Parlement corrigea tout cela : on trouve dans le glossaire [2] du droit françois de Ragau, l’arrêt qu’il rendit [3] contre l’évêque d’Amiens.
Je reviens au commencement de mon chapitre. Lorsque dans un siecle ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de l’état chercher à augmenter leur autorité, & à prendre les uns sur les autres de certains avantages, on se tromperoit souvent si l’on regardoit leurs entreprises comme une marque certaine de leur corruption. Par un malheur attaché à la condition humaine, les grands hommes modérés sont rares ; & comme il est toujours plus aisé de suivre sa force que de l’arrêter, peut-être, dans la classe des gens supérieurs, est-il plus facile de trouver des gens extrêmement vertueux, que des hommes extrêmement sages.
L’ame goûte tant de délices à dominer les autres ames ; ceux même qui aiment le bien s’aiment si fort eux-mêmes, qu’il n’y a personne qui ne soit assez malheureux pour avoir encore à [III-423] se défier de ses bonnes intentions : & en vérité, nos actions tiennent à tant de choses, qu’il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire.
-
[↑] Voyez Boutillier, somme rurale, tit. 9, quelles personnes ne peuvent faire demande en cour laye ; & Beaum. chap. xi, page 56 ; & les réglemens de Philippe Auguste à ce sujet ; & l’établissement de Philippe Auguste fait entre les clercs, le roi & les barons.
-
[↑] Au mot exécuteur testamentaire.
-
[↑] Du 19 mars 1409.
[III-423]
CHAPITRE XLII.
Renaissance du droit Romain, & ce qui en résulta. Changemens dans les tribunaux.
Le digeste de Justinien ayant été retrouvé vers l’an 1137, le droit romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en Italie où on l’enseignoit : on avoit déjà le code Justinien & les novelles. J’ai déjà dit que ce droit y pris une telle faveur, qu’il fit éclipser la loi des Lombards.
Des docteurs Italiens porterent le droit de Justinien en France, où l’on n’avoit connu [1] que le code Théodosien, parce que ce ne fut [2] qu’après [III-424] l’établissement des barbares dans les Gaules, que les lois de Justinien furent faites. Ce droit reçut quelques oppositions ; mais il se maintint, malgré les excommunications des papes qui protégeoient leurs canons [3] . Saint Louis chercha à l’accréditer, par les traductions qu’il fit faire des ouvrages de Justinien, que nous avons encore manuscrites dans nos bibliotheques ; & j’ai déjà dit qu’on en fit un grand usage dans les établissemens. Philippe le bel [4] fit enseigner les lois de Justinien, seulement comme raison écrite, dans les pays de la France qui se gouvernoient par les coutumes ; & elles furent adoptées comme loi, dans les pays où le droit Romain étoit la loi.
J’ai dit ci-dessus que la maniere de procéder par le combat judiciaire demandoit dans ceux qui jugeoient très-peu de suffisance ; on décidoit les affaires dans chaque lieu, selon l’usage de chaque lieu, & suivant quelques coutumes simples, qui se recevoient par tradition.
[III-425] Il y avoit du temps de Beaumanoir [5] , deux différentes manieres de rendre la justice : dans des lieux, on jugeoit par pairs [6] ; dans d’autres, on jugeoit par baillis : quand on suivoit la premiere forme, les pairs jugeoient selon l’usage de leur juridiction [7] ; dans la seconde, c’étoient des prud’hommes ou vieillards qui indiquoient au bailli le même usage. Tout ceci ne demandoit aucunes lettres, aucune capacité, aucune étude. Mais, lorsque le code obscur des établissemens & d’autres ouvrages de jurisprudence parurent ; lorsque le droit Romain fut traduit ; lorsqu’il commença à être enseigné dans les écoles ; lorsqu’un certain art de la procédure, & qu’un certain art de la jurisprudence commencerent à se former ; lorsqu’on vit naître des praticiens & des juriconsultes, les pairs & les prudh’ommes ne [III-426] furent plus en état de juger ; les pairs commencerent à se retirer des tribunaux du seigneur ; les seigneurs furent peu portés à les assembler : d’autant mieux que les jugemens, au lieu d’être une action éclatante, agréable à la noblesse, intéressante pour les gens de guerre, n’étoient plus qu’une pratique qu’ils ne savoient, ni ne vouloient savoir. La pratique de juger par pairs devint moins en usage [8] ; celle de juger par baillis s’étendit. Les baillis ne jugeoient pas [9] ; ils faisoient l’instruction, & prononçoient le jugement des [III-427] prud’hommes : mais les prud’hommes n’étant plus en état de juger, les baillis jugerent eux-mêmes.
Cela se fit d’autant plus aisément, qu’on avoit devant les yeux la pratique des juges d’église : le droit canonique & le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.
Ainsi se perdit l’usage constamment observé dans la monarchie, qu’un juge ne jugeroit jamais seul, comme on le voit par les lois saliques, les capitulaires, & par les premiers écrivains [10] de pratique de la troisieme race. L’abus contraire, qui n’a lieu que dans les justices locales, a été modéré, & en quelque façon corrigé par l’introduction en plusieurs lieux d’un lieutenant de juge, que celui-ci consulte, & qui représente les anciens prud’hommes ; par l’obligation où est le juge de prendre deux gradués, dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive ; & enfin il est devenu nul, par l’extrême facilité des appels.
-
[↑] On suivoit en Italie le code de Justinien : c’est pour cela que le pape Jean VIII, dans sa constitution donnée après le synode de Troyes, parle de ce code, non pas parce qu’il étoit connu en France, mais parce qu’il le connoissoit lui-même ; & sa constitution étoit générale.
-
[↑] Le code de cet empereur fut publié vers l’an 530.
-
[↑] Décrétales, liv. V, tit. de privilegiis¸capite super specula.
-
[↑] Par une chartre de l’an 1312, en faveur de l’université d’Orléans, rapportée par Dutillet.
-
[↑] Coutume de Beauvoisis, chap. i. de l’office des Baillis.
-
[↑] Dans la commune, les bourgeois étoient ,jugés par d’autres bourgeois, comme les hommes de fief se jugeoient entr’eux. Voyez la Thamassiere, chap. xix.
-
[↑] Aussi toutes les requêtes commençoient-elles par ces mots : « Sire juge, il est d’usage qu’en votre juridiction, &c. » comme il paroît par la formule rapportée dans Boutillier, somme rurale, livre I, titre 21.
-
[↑] Le changement fut insensible. On trouve encore les pairs employés du temps de Boutillier, qui vivoit en 1402, date de son testament, qui rapporte cette formule au liv. I, tit. 21. « Sire juge, en ma justice haute, moyenne & basse, que j’ai en tel lieu, cour, plaids, baillis, hommes féodaux & sergens ». Mais il n’y avoit plus que les matieres féodales qui se jugeassent pas pairs. Ibid. liv. I, tit. I, pag. 16.
-
[↑] Comme il paroît par la formule des lettres que le seigneur leur donnoît, rapportée par Boutillier, somme rurale, liv. I, tit. 14. Ce qui prouve encore par Beaumanoir, coutume de Beauvoisis, chap. i, des baillis. Ils ne faisoient que la procédure. « Le bailli est tenu en la présence des hommes à penre les paroles de chaux qui plaident, & doit demander as parties se ils veulent avoir droit selon les raisons que ils ont dites ; & se ils disent, Sire, oïl, le bailli doit contraindre les hommes que ils fassent le jugement ». Voyez aussi les établissemens de S. Louis, liv. I, chap.cv ; & liv. II, chap. xv : « Li juge, si ne doit pas faire le jugement ».
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxvii, page 336 ; & ch. lxi, pag. 315 & 316 : les établissemens, liv. II, ch. xv.
[III-428]
CHAPITRE XLIII.
Continuation du même sujet.
Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour ; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avoient, il n’y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce ne fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu, & par la force de la chose. La connoissance du droit Romain, des arrêts des cours, des corps des coutumes nouvellement écrites, demandoit une étude, dont les nobles & le peuple sans lettres n’étoient point capables.
La seule ordonnance que nous ayons sur cette matiere [1] , est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans l’ordre des laïques. C’est mal-à-propos qu’on l’a regardée comme la loi de leur création ; mais elle ne dit que ce qu’elle dit. De plus, elle fixe ce qu’elle prescrit par les raisons qu’elle en donne : « C’est afin, est-il dit, que les baillis [III-429] puissent être punis de leurs prévarications [2] , qu’il faut qu’ils soient pris dans l’ordre des laïques ». On sait les privileges des ecclésiastiques dans ces temps-là.
Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissoient autrefois, & dont ils ne jouissent plus aujourd’hui, lui ayent été ôtés comme des usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus par négligence ; & d’autres ont été abandonnés, parce que divers changemens s’étant introduits dans le cours de plusieurs siecles, ils ne pouvoient subsister avec ces changemens.
-
[↑] Elle est de l’an 1287.
-
[↑] Ut si ibi delinquant, superiores sui possent animadversere in cosdem.
[III-429]
CHAPITRE XLIV.
De la preuve par témoins.
Les juges qui n’avoient d’autres regles que les usages, s’en enquéroient ordinairement par témoins, dans chaque question qui se présentoit.
Le combat judiciaire devenant moins en usage, on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit [III-430] n’est jamais qu’une preuve vocale ; cela ne faisoit qu’augmenter les frais de la procédure. On fit des réglemens qui rendirent la plupart de ces enquêtes [1] inutiles ; on établit des registres publics, dans lesquels la plupart des faits se trouvoient prouvés, la noblesse, l’âge, la légitimité, le mariage. L’écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela étoit bien raisonnable : il est plus aisé d’aller chercher dans les registres de baptême, si Pierre est fils de Paul, que d’aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand, dans un pays, il y a un très-grand nombre d’usages, il est plus aisé de les écrire tous dans un code, que d’obliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin, on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres, à moins qu’il n’y eût un commencement de preuve par écrit.
-
[↑] Voyez comment on prouvoit l’âge & la parenté, établissemens, liv. I, ch. lxxi & lxxii.
[III-431]
CHAPITRE XLV.
Des coutumes de France.
La France étoit régie, comme j’ai dit, par des coutumes non écrites, & les usages particuliers de chaque seigneurie formoient le droit civil. Chaque seigneurie avoit son droit civil, comme le dit Beaumanoir [1] ; & un droit si particulier, que cet auteur, qu’on doit regarder comme la lumiere de ce temps-là, & une grande lumiere, dit qu’il ne croit pas que dans tout le royaume il y eût deux seigneuries qui fussent gouvernées de tout point par la même loi.
Cette prodigieuse diversité avoit une premiere origine, & elle en avoit une seconde. Pour la premiere, on peut se souvenir de ce que j’ai dit ci-dessus [2] au chapitre des coutumes locales ; & quant à la seconde, on la trouve dans les divers événemens des combats judiciaires ; des cas continuellement fortuits devant introduire naturellement de nouveaux usages.
[III-432]
Ces coutumes-là étoient conservées dans la mémoire des vieillards : mais il se forma peu à peu des lois ou des coutumes écrites.
1°. Dans le commencement [3] de la troisieme race, les rois donnerent des chartres particulieres, & en donnerent même de générales, de la maniere dont je l’ai expliqué ci-dessus : tels sont les établissemens de Philippe Auguste, & ceux que fit Saint Louis. De même, les grands vassaux, de concert avec les seigneurs qui tenoient d’eux, donnerent, dans les assises de leurs duchés ou comtés, de certaines chartres ou établissemens, selon les circonstances : telles furent l’assise de Geofroi, comte de Bretagne, sur le partage des nobles, les coutumes de Normandie, accordées par le duc Raoul ; les coutumes de Champagne, données par le roi Thibault ; les lois de Simon, comte de Montfort ; & autres. Cela produisit quelques lois écrites, & même plus générales que celles que l’on avoit.
2°. Dans le commencement de la troisieme race, presque tout le bas [III-433] peuple étoit serf ; plusieurs raisons obligerent les rois & les seigneurs de les affranchir.
Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, leur donnerent des biens ; il fallut leur donner des lois civiles pour régler la disposition de ces biens. Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, se priverent de leurs biens ; il fallut donc régler les droits que les seigneurs se réservoient pour l’équivalent de leur bien. L’une & l’autre de ces choses furent réglées par les chartres d’affranchissement, ces chartres formerent une partie de nos coutumes, & cette partie se trouva rédigée par écrit.
3°. Sous le regne de S. Louis & les suivans, des praticiens habiles, tels que Défontaines, Beaumanoir & autres, rédigerent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plutôt de donner une pratique judiciaire, que les usages de leurs temps sur la disposition des biens. Mais tout s’y trouve ; & quoique ces auteurs particuliers n’eussent d’autorité que par la vérité & la publicité des choses qu’ils disoient, on ne peut douter qu’elles n’ayent beaucoup servi à la renaissance de notre droit [III-434] François. Tel étoit, dans ces temps-là, notre droit coutumier écrit.
Voici la grande époque. Charles VII & ses successeurs firent rédiger par écrit dans tout le royaume les diverses coutumes locales, & prescrivirent des formalités qui devoient être observées à leur rédaction. Or, comme cette rédaction se fit par provinces ; & que, de chaque seigneurie, on venoit déposer, dans l’assemblée générale de la province, les usages écrits ou non écrits de chaque lieu ; on chercha à rendre les coutumes plus générales, autant que cela se put faire sans blesser les intérêts des particuliers qui furent réservés [4] . Ainsi nos coutumes prirent trois caracteres ; elles furent écrites, elles furent plus générales, elles reçurent le sceau de l’autorité royale.
Plusieurs de ces coutumes ayant été de nouveau rédigées, on y fit plusieurs changemens, soit en ôtant tout ce qui ne pouvoit compatir avec la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées de cette jurisprudence.
[III-435]
Quoique le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espece d’opposition avec le droit Romain, de sorte que ces deux droits divisent les territoires ; il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit Romain sont entrées dans nos coutumes, sur-tout lorsqu’on en fit de nouvelles rédactions, dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, où ce droit étoit l’objet des connoissances de tous ceux qui se destinoient aux emplois civils ; dans des temps où l’on ne faisoit pas gloire d’ignorer ce que l’on doit savoir, & de savoir ce que l’on doit ignorer ; où la facilité de l’esprit servoit plus à apprendre sa profession, qu’à la faire ; & où les amusemens continuels n’étoient pas même l’attribut des femmes.
Il auroit fallu que je m’étendisse davantage à la fin de ce livre ; & qu’entrant dans de plus grands détails, j’eusse suivi tous les changemens insensibles, qui, depuis l’ouverture des appels, ont formé le grand corps de notre jurisprudence Françoise. Mais j’aurois mis un grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je suis comme cet [III-436] antiquaire [5] qui partit de son pays, arriva en Égypte, jeta un coup d’œil sur les pyramides, & s’en retourna.
-
[↑] Prologue sur la coutume de Beauvoisis.
-
[↑] Chap. xii.
-
[↑] Voyez le recueil des ordonnances de Lautiere.
-
[↑] Cela se fit ainsi lors de la rédaction des coutumes de Berry & de Paris. Voyez la Thaumassiere, chap. iii.
-
[↑] Dans le Spectateur Anglois.
[III-437]
LIVRE XXIX.
De la maniere de composer les Lois.↩
CHAPITRE PREMIER.
De l’esprit du Législateur.
Je le dis, & il me semble que je n’ai fait cet ouvrage que pour le prouver : L’esprit de modération doit être celui du législateur ; le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites. En voici un exemple.
Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté. Mais le nombre en pourroit être si grand, qu’il choqueroit le but des lois mêmes qui les auroient établies : les affaires n’auroient point de fin ; la proriété des biens resteroit incertaine ; on donneroit à l’une des parties le bien de l’autre sans examen, ou on les ruineroit toutes les deux à force d’examiner.
[III-438]
Les citoyens perdroient leur liberté & leur sureté ; les accusateurs n’auroient plus les moyens de convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier.
[III-438]
CHAPITRE II.
Continuation du même sujet.
Cecilius, dans Aulugelle [1] , discourant sur la loi des douze tables, qui permettoit au créancier de couper en morceaux le débiteur insolvable, la justifie par son atrocité même qui empêchoit [2] qu’on n’empruntât au-delà de ses facultés. Les lois les plus cruelles seront donc les meilleures ? Le bien sera l’excès ? & tous les rapports des choses seront détruits ?
-
[↑] Livre XX, chap. i.
-
[↑] Cecilius dit qu’il n’a jamais vu ni lu que cette peine eût été infligée : mais il y a apparence qu’elle n’a jamais été établie. L’opinion de quelques jurisconsultes, que la loi des douze tables ne parloit que de la division du prix du débiteur vendu, est très-vraisemblable.
[III-439]
CHAPITRE III.
Que les lois qui paroissent s’éloigner des vues du Législateur, y sont souvent conformes.
La loi de Solon, qui déclaroit infames tous ceux qui, dans une sédition, ne prendroient aucun parti, a paru bien extraordinaire : mais il faut faire attention aux circonstances dans lesquelles la Grece se trouvoit pour lors. Elle étoit partagée en de très-petits états : il étoit à craindre, que dans une république travaillée par des dissentions civiles, les gens les plus prudens ne se missent à couvert, & que par-là les choses ne fussent portées à l’extrémité.
Dans les séditions qui arrivoient dans ces petits états, le gros de la cité entroit dans la querelle, ou la faisoit. Dans nos grandes monarchies, les partis sont formés par peu de gens, & le peuple voudroit vivre dans l’inaction. Dans ce cas, il est naturel de rappeller les séditieux au gros des citoyens, non pas le gros des citoyens aux séditieux : dans l’autre, il faut faire rentrer le petit nombre de [III-440] gens sages & tranquilles parmi les séditieux : c’est ainsi que la fermentation d’une liqueur peut être arrêtée par une seule goutte d’une autre.
[III-440]
CHAPITRE IV.
Des lois qui choquent les vues du Législateur.
Il y a des lois que le législateur a si peu connues, qu’elles sont contraires au but même qu’il s’est proposé. Ceux qui ont établi chez les François, que, lorsqu’un des deux prétendans à un bénéfice, meurt, le bénéfice reste à celui qui survit, ont cherché sans doute à éteindre les affaires ; mais il en résulte un effet contraire ; on voit les ecclésiastiques s’attaquer & se battre comme des dogues anglois jusqu’à la mort.
[III-441]
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
La loi dont je vais parler se trouve dans ce serment, qui nous a été conservé par Eschines [1] . « Je jure que je ne détruirai jamais une ville des Amphictions, & que je détournerai point ses eaux courantes : si quelque peuple ose faire quelque chose de pareil, je lui déclarerai la guerre, & je détruirai ses villes. » Le dernier article de cette loi, qui paroît confirmer le premier, lui est réellement contraire. Amphiction veut qu’on ne détruise jamais les villes Grecques, & sa loi ouvre la porte à la destruction de ces villes. Pour établir un bon droit des gens parmi les Grecs, il falloit les accoutumer à penser que c’étoit une chose atroce de détruire une ville Grecque ; il ne devoit donc pas détruire même les destructeurs. La loi d’Amphiction étoit juste, mais elle n’étoit pas prudente ; cela se prouve par l’abus même que l’on en fit. Philippe ne se fit-il pas donner le pouvoir de détruire [III-442] les villes, sous prétexte qu’elles avoient violé les lois des Grecs ? Amphiction auroit pu infliger d’autres peines : ordonner, par exemple, qu’un certain nombre de magistrats de la ville destructrice, ou de chefs de l’armée violatrice, seroient punis de mort ; que le peuple destructeur cesseroit pour un temps de jouir des privileges des Grecs ; qu’il payeroit une amende jusqu’au rétablissement de la ville. La loi devoit sur-tout porter sur la réparation du dommage.
-
[↑] De falsâ legatione.
[III-442]
CHAPITRE VI.
Que les lois qui paroissent les mêmes, n’ont pas toujours le même effet.
César défendit [1] de garder chez soi plus de soixante sesterces. Cette loi fut regardée à Rome comme très-propre à concilier les débiteurs avec les créanciers ; parce qu’en obligeant les riches à prêter aux pauvres, elle mettoit ceux-ci en état de satisfaire les riches. Une même loi faite en France, du temps du systême, fut très-funeste : c’est que la circonstance dans laquelle on la fit, [III-443] étoit affreuse. Après avoir ôté tous les moyens de placer son argent, on ôta même la ressource de le garder chez soi ; ce qui étoit égal à un enlevement fait par violence. César fit la loi pour que l’argent circulât parmi le peuple ; le ministre de France fit la sienne pour que l’argent fût mis dans une seule main. Le premier donna pour de l’argent des fonds de terre, ou des hypotheques sur des particuliers ; le second proposa pour de l’argent des effets qui n’avoient point de valeur, & qui n’en pouvoient avoir par leur nature, par la raison que sa loi obligeoit de les prendre.
-
[↑] Dion, liv. XLI.
[III-443]
CHAPITRE VII.
Continuation du même sujet. Nécessité de bien composer les lois.
La loi de l’ostracisme fut établie à Athenes, à Argos [1] & à Syracuse. À Syracuse, elle fit mille maux, parce qu’elle fut faite sans prudence. Les principaux citoyens se bannissoient les uns les autres, en se mettant une feuille [III-444] de figuier à la main [2] ; de sorte que ceux qui avoient quelque mérite, quitterent les affaires. A Athenes, où le législateur avoit senti l’extension & les bornes qu’il devoit donner à sa loi, l’ostracisme fut une chose admirable : on n’y soumettoit jamais qu’une seule personne ; il falloit un si grand nombre de suffrages, qu’il étoit difficile qu’on exilât quelqu’un dont l’absence ne fût pas nécessaire.
On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans : en effet, dès que l’ostracisme ne devoit s’exercer que contre un grand personnage, qui donneroit de la crainte à ses concitoyens, ce ne devoit pas être une affaire de tous les jours.
[III-444]
CHAPITRE VIII.
Que les lois qui paroissent les mêmes, n’ont pas toujours eu le même motif.
On reçoit en France la plupart des lois des Romains sur les substitutions ; mais les substitutions y ont tout un autre motif que chez les Romains. Chez ceux-ci, l’hérédité étoit jointe à de [III-445] certains sacrifices [1] qui devoient être faits par l’héritier, & qui étoient réglés par le droit des pontifes : cela fit qu’ils tinrent à déshonneur de mourir sans héritier, qu’ils prirent pour héritiers leurs esclaves, & qu’ils inventerent les substitutions. La substitution vulgaire, qui fut la premiere inventée, & qui n’avoit lieu que dans le cas où l’héritier institué n’accepteroit pas l’hérédité, en est une grande preuve ; elle n’avoit point pour objet de perpétuer l’héritage dans une famille du même nom, mais de trouver quelqu’un qui acceptât l’héritage.
-
[↑] Lorsque l’hérédité étoit trop chargée, on éludoit le droit des pontifes par de certaines ventes, d’où vint le mot sine sacris hæreditas.
[III-445]
CHAPITRE IX.
Que les lois Grecques & Romaines ont puni l’homicide de soi-même, sans avoir le même motif.
Un homme, dit Platon [1] , qui a tué celui qui lui est étroitement lié, c’est-à-dire lui-même, non par ordre du magistrat, ni pour éviter l’ignominie, [III-446] mais par foiblesse, sera puni. La loi Romaine punissoit cette action, lorsqu’elle n’avoit pas été faite par foiblesse d’ame, par ennui de la vie, par impuissance de souffrir la douleur, mais par le désespoir de quelque crime. La loi Romaine absolvoit dans le cas où la Grecque condamnoit, & condamnoit dans le cas où l’autre absolvoit.
La loi de Platon étoit formée sur les institutions Lacédémoniennes, où les ordres du magistrat étoient totalement absolus, où l’ignominie étoit le plus grand des malheurs, & la foiblesse le plus grand des crimes. La loi Romaine abandonnoit toutes ces belles idées ; elle n’étoit qu’une loi fiscale.
Du temps de la république, il n’y avoit point de loi à Rome qui punît ceux qui se tuoient eux-mêmes : cette action, chez les historiens, est toujours prise en bonne part, & l’on n’y voit jamais de punition contre ceux qui l’ont faite.
Du temps des premiers empereurs, les grandes familles de Rome furent sans cesse exterminées par des jugemens. La coutume s’introduisit de prévenir la condamnation par une mort [III-447] volontaire. On y trouvoit un grand avantage. On obtenoit l’honneur de la sépulture [2] , & les testamens étoient exécutés ; cela venoit de ce qu’il n’y avoit point de loi civile à Rome contre ceux qui se tuoient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs devinrent aussi avares qu’ils avoient été cruels, ils ne laisserent plus à ceux dont ils vouloient se défaire le moyen de conserver leurs biens, & ils déclarerent que ce seroit un crime de s’ôter la vie par les remords d’un autre crime.
Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai, qu’ils consentirent que les biens de ceux [3] qui se seroient tués eux-mêmes ne fussent pas confisqués, lorsque le crime pour lequel ils s’étoient tués n’assujettissoit point à la confiscation.
-
[↑] Livre IX ; des lois.
-
[↑] Eorum qui de se statuebant, humabantur corpoea, manebant testamenta, pretium festinandi. Tacite.
-
[↑] Rescrit de l’empereur Pie¸dans la loi III, §. I & 2, ss. de bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt.
[III-448]
CHAPITRE X.
Que les lois qui paroissent contraires, dérivent quelquefois du même esprit.
On va aujourd’hui dans la maison d’un homme pour l’appeler en jugement ; cela ne pouvoit se faire chez les Romains [1] .
L’appel en jugement étoit une action violente [2] , & comme une espece de contrainte par corps [3] ; & on ne pouvoit pas plus aller dans la maison d’un homme pour l’appeller en jugement, qu’on ne peut aujourd’hui aller contraindre par corps dans sa maison un homme qui n’est condamné que pour des dettes civiles.
Les lois Romaines [4] & les nôtres admettent également ce principe, que chaque citoyen a sa maison pour asyle, & qu’il n’y doit recevoir aucune violence.
-
[↑] Leg. XVIII, ff. de in jus vocando.
-
[↑] Voyez la loi des douze tables.
-
[↑] Rapit in jus, Horace, satire 9. C’est pour cela qu’on ne pouvoit appeller en jugement ceux à qui on devoit un certain respect.
-
[↑] Voyez la loi XVIII, ff. de in jus vocando.
[III-449]
CHAPITRE XI.
De quelle maniere deux lois diverses peuvent être comparées.
En France, la peine contre les faux témoins est capitale ; en Angleterre, elle ne l’est point. Pour juger laquelle de ces deux lois est la meilleure, il faut ajouter : En France, la question contre les criminels est pratiquée, en Angleterre elle ne l’est point ; & dire encore : En France, l’accusé ne produit point ses témoins, & il est très-rare qu’on y admette ce que l’on appelle les faits justificatifs : en Angleterre, l’on reçoit les témoignages de part & d’autre. Les trois lois Françoises forment un systême très-lié & très-suivi ; les trois lois Angloises en forment un qui ne l’est pas moins. La loi d’Angleterre, qui ne connoît point la question contre les criminels, n’a que peu d’espérance de tirer de l’accusé la confession de son crime ; elle appelle donc de tous côtés les témoignages étrangers, & elle n’ose les décourager par la crainte d’une peine capitale. La loi Françoise, qui a une [III-450] ressource de plus, ne craint pas tant d’intimider les témoins ; au contraire, la raison demande qu’elle les intimide : elle n’écoute que les témoins d’une part [1] ; ce sont ceux que produit la partie publique ; & le destin de l’accusé dépend de leur seul témoignage. Mais en Angleterre on reçoit les témoins des deux parts ; & l’affaire est, pour ainsi dire, discutée entr’eux ; le faux témoignage y peut donc être moins dangereux ; l’accusé y a une ressource contre le faux témoignage, au lieu de la loi Françoise n’en donne point. Ainsi, pour juger lesquelles de ces deux lois sont plus conformes à la raison, il ne faut pas comparer chacune de ces lois à chacune ; il faut les prendre toutes ensemble, & les comparer toutes ensemble.
-
[↑] Par l’ancienne jurisprudence Françoise, les témoins étoient ouis des deux parts. Aussi voit-on, dans les établissemens de Saint Louis, liv. I, chap. vii, que la peine contre les faux témoins en justice étoit pécuniaire.
[III-451]
CHAPITRE XII.
Que les lois qui paroissent les mêmes, sont réellement quelquefois différentes.
Les lois Grecques & Romaines punissoient le receleur du vol comme le voleur [1] : la loi Françoise fait de même. Celles-là étoient raisonnables, celle-ci ne l’est pas. Chez les Grecs & chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il falloit punir le receleur de la même peine : car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage, doit le réparer. Mais parmi nous, la peine du vol étant capitale, on n’a pas su, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut en mille occasions le recevoir innocemment ; celui qui vole est toujours coupable : l’un empêche la conviction d’un crime déjà commis, l’autre commet ce crime : tout est passif dans l’un, il y a une action dans l’autre : il faut que le voleur surmonte plus d’obstacles, & [III-452] que son ame se roidisse plus long-temps contre les lois.
Les Jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur [2] ; car sans eux, disent-ils, le vol ne pourroit être caché long-temps. Cela encore un fois pouvoit être bon, quand la peine étoit pécuniaire ; il s’agissoit d’un dommage, & le receleur étoit ordinairement plus en état de le réparer : mais la peine devenue capitale, il auroit fallu se régler sur d’autres principes.
[III-452]
CHAPITRE XIII.
Qu’il ne faut point séparer les lois de l’objet pour lequel elles sont faites. Des lois Romaines sur le vol.
Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant qu’il l’eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la cacher, cela étoit appellé chez les Romains un vol manifeste ; quand le voleur n’étoit découvert qu’après, c’étoit un vol non manifeste.
[III-453]
La loi des douze tables ordonnoit que le voleur manifeste fût battu de verges, & réduit en servitude, s’il étoit pubere ; ou seulement battu de verges, s’il étoit impubere : elle ne condamnoit le voleur non manifeste qu’au payement du double de la chose volée.
Lorsque la loi Porcia eut aboli l’usage de battre de verges les citoyens, & de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au quadruple [1] , & on continua à punir du double le voleur non manifeste.
Il paroît bizarre que ces lois missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, & dans la peine qu’elles infligeoient : en effet, que le voleur fût surpris avant, ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination ; c’étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime. Je ne saurois douter que toute la théorie des lois Romaines sur le vol ne fût tirée des institutions Lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l’adresse, de la ruse & de l’activité, voulut qu’on exerçât les [III-454] enfans au larcin, & qu’on fouettât rudement ceux qui s’y laisseroient surprendre : cela établit chez les Grecs, & ensuite chez les Romains une grande différence entre le vol manifeste & le vol non manifeste [2] .
Chez les Romains, l’esclave qui avoit volé, étoit précipité de la roche Tarpéienne. Là, il n’étoit point question des institutions Lacédémoniennes ; les lois de Lycurgue sur le vol n’avoient point été faites pour les esclaves ; c’étoit les suivre que de s’en écarter en ce point.
À Rome, lorsqu’un impubere avoit été surpris dans le vol, le préteur le faisoit battre de verges à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacédémoniens avoient tiré ces usages des Crétois ; & Platon [3] , qui veut prouver que les institutions des Crétois étoient faites pour la guerre, cite celle-ci : « La faculté de supporter la douleur dans les combats particuliers, & dans les larcins qui obligent de se cacher.
[III-455]
Comme les lois civiles dépendent des lois politiques, parce que c’est toujours pour une société qu’elles sont faites, il seroit bon que, quand on veut porter une loi civile d’une nation chez une autre, on examinât auparavant si elles ont toutes les deux les mêmes institutions & le même droit politique.
Ainsi, lorsque les lois sur le vol passerent des Crétois aux Lacédémoniens, comme elles y passerent avec le gouvernement & la constitution même, ces lois furent aussi sensées chez un de ces peuples qu’elles l’étoient chez l’autre. Mais lorsque de Lacédémone elles furent portées à Rome, comme elles n’y trouverent pas la même constitution, elles y furent toujours étrangeres, & n’eurent aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains.
-
[↑] Voyez ce que dit Favorinus sur A1ulugelle, liv. XX, chap. i.
-
[↑] Conférez ce que dit Plutarque¸vie de Lycurgue, avec les lois du digeste, au titre de furtis ; & les institutes, liv. IV, tit. I, §. I, 2 & 3.
-
[↑] Des lois, liv. I.
[III-456]
CHAPITRE XIV.
Qu’il ne faut point séparer les lois des circonstances dans lesquelles elles ont été faites.
Une loi d’Athenes vouloit que, lorsque la ville étoit assiégée, on fît mourir tous les gens inutiles [1] . C’étoit une abominable loi politique, qui étoit une suite d’un abominable droit des gens. Chez les Grecs, les habitans d’une ville prise perdoient la liberté civile, & étoient vendus comme esclaves. La prise d’une ville emportoit son entiere destruction ; & c’est l’origine non-seulement de ces défenses opiniâtres & de ces actions dénaturées, mais encore de ces lois atroces que l’on fit quelquefois.
Les lois Romaines [2] vouloient que les médecins pussent être punis pour leur négligence ou pour leur impéritie. Dans ces cas, elles condamnoient à la déportation le médecin d’une condition [III-457] un peu relevée, & à la mort celui qui étoit d’une condition plus basse. Par nos lois, il en est autrement. Les lois de Rome n’avoient pas été faites dans les mêmes circonstances que les nôtres : à Rome, s’ingéroit de la médecine qui vouloit ; mais parmi nous les médecins sont obligés de faire des études, & de prendre certains grades ; ils sont donc censés connoître leur art.
-
[↑] Inutilis ætas occidatur, Syrian in Hermog.
-
[↑] La loi Cornelia, de sicariis ; institut. liv. IV. tit. 3, de lege Aquiliâ, §. 7.
[III-457]
CHAPITRE XV.
Qu’il est bon quelquefois qu’une loi se corrige elle-même.
La loi des douze tables [1] permettoit de tuer le voleur de nuit, aussi bien que le voleur de jour, qui, étant poursuivi, se mettoit en défense ; mais elle vouloit que celui qui tuoit le voleur [2] , criât & appellât les citoyens ; & c’est une chose que les lois qui permettent de se faire justice soi-même, doivent toujours exiger. C’est le cri de l’innocence, qui, dans le moment de l’action, appelle des témoins, appelle [III-458] des juges. Il faut que le peuple prenne connoissance de l’action, & qu’il en prenne connoissance dans le moment qu’elle a été faite ; dans un temps où tout parle, l’air, le visage, les passions, le silence, & où chaque parole condamne ou justifie. Une loi qui peut devenir si contraire à la sureté & à la liberté des citoyens, doit être exécutée dans la présence des citoyens.
-
[↑] Voyez la loi IV, ss. ad legem Aquiliam.
-
[↑] Ibid. Voyez le décret Tassillon, ajouté à la loi des Bavarois, de popularibus leg. art. 4.
[III-458]
CHAPITRE XVI.
Choses à observer dans la composition des lois.
Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation ou à une autre, doivent faire de certaines attentions sur la maniere de les former.
Le style en doit être concis. Les lois des douze tables sont un modele de précision : les enfans les apprenoient par cœur [1] . Les novelles de Justinien sont si diffuses, qu’il fallut les abréger [2] .
[III-459]
Le style des lois doit être simple ; l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réflécie. Il n’y a point de majesté dans les lois du bas empire ; on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation.
Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal [3] de Richelieu convenoit que l’on pouvoit accuser un ministre devant le roi ; mais il vouloit que l’on fût puni si les choses qu’on prouvoit n’étoient pas considérables : ce qui devoit empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fût contre lui, puisqu’une chose considérable est entiérement relative, & que ce qui est considérable pour quelqu’un ne l’est pas pour un autre.
La loi d’Honorius punissoit de mort celui qui achetoit comme serf un affranchi, ou qui auroit voulu l’inquiéter [4] . Il ne falloit point se servir d’une expression si vague : l’inquiétude que l’on cause à [III-460] un homme dépend entiérement du degré de sa sensibilité.
Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu’on le peut, éviter de la faire à prix d’argent. Mille causes changent la valeur de la monnoie ; & avec la même dénomination, on n’a plus la même chose. On fait l’histoire de cet impertinent [5] de Rome, qui donnoit des soufflets à tous ceux qu’il rencontroit, & leur faisoit présenter les vingt-cinq sous de la loi des douze tables.
Lorsque, dans une loi, l’on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l’ordonnance criminelle [6] de Louis XIV, après qu’on a fait l’énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « Et ceux dont de tous temps les juges royaux ont jugé ; » ce qui fait rentrer dans l’arbitraire dont on venoit de sortir.
Charles VII. [7] dit qu’il apprend que des parties font appel, trois, quatre & [III-461] six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier : il ordonne qu’on appellera incontinent, à moins qu’il n’y ait fraude ou dol du procureur [8] , ou qu’il n’y ait grande & évidente cause de relever l’appellant. La fin de cette loi détruit le commencement ; & elle le détruisit si bien, que dans la suite on a appellé pendant trente ans [9] .
La loi des Lombards [10] ne veut pas qu’une femme qui a pris un habit de religieuse, quoiqu’elle ne soit pas consacrée, puisse se marier : « car, dit-elle, si un époux qui a engagé à lui une femme seulement par un anneau, ne peut pas sans crime en épouser une autre, à plus forte raison l’épouse de Dieu ou de la sainte Vierge… ». Je dis que, dans les lois, il faut raisonner de la réalité à la réalité ; & non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité.
Une loi de Constantin [11] veut que [III-462] le témoignage seul de l’évêque suffise, sans ouir d’autres témoins. Ce prince prenoit un chemin bien court ; il jugeoit des affaires par les personnes, & des personnes par les dignités.
Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un pere de famille.
Lorsque dans un loi les exceptions, limitations, modifications, ne sont point nécessaires, il vaut beaucoup mieux n’en point mettre ; de pareils détails jettent dans de nouveaux détails.
Il ne faut point faire de changement dans une loi, sans une raison suffisante. Justinien ordonna qu’un mari pourroit être répudié, sans que la femme perdît sa dot, si pendant deux ans il n’avoit pu consommer le mariage [12] . Il changea sa loi, & donna trois ans au pauvre malheureux [13] . Mais, dans un cas pareil, deux ans en valent trois, & trois n’en valent pas plus que deux.
Lorsqu’on fait tant que de rendre [III-463] raison d’une loi, il faut que cette raison soit digne d’elle. Une loi [14] Romaine décide qu’un aveugle ne peut pas plaider, parce qu’il ne voit par les ornemens de la magistrature. Il faut l’avoir fait exprès, pour donner une si mauvaise raison, quand il s’en présentoit tant de bonnes.
Le jurisconsulte Paul [15] dit que l’enfant naît parfait au septieme mois, & que la raison des nombres de Pythagore semble le prouver. Il est singulier qu’on juge ces choses sur la raison des nombres de Pythagore.
Quelques jurisconsultes François ont dit que, lorsque le roi acquéroit quelque pays, les églises y devenoient sujettes au droit de régale, parce que la couronne du roi est ronde. Je ne discuterai point ici les droits du roi, & si dans ce cas la raison de la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison de la loi politique : mais je dirai que des droits si respectables doivent être défendus par des maximes graces. Qui a jamais vu fonder sur la figure d’un signe d’une dignité, les droits réels de cette dignité ? [III-464]
Davila [16] dit que Charles IX fut déclaré majeur au Parlement de Rouen à quatorze ans commencés, parce que les lois veulent qu’on compte le temps du moment au moment, lorsqu’il s’agit de la restitution & de l’administration des biens du pupile : au lieu qu’elle regarde l’année commencée comme une années complette, lorsqu’il s’agit d’acquérir des honneurs. Je n’ai garde de censurer une disposition qui ne paroît pas avoir eu jusqu’ici d’inconvénient ; je dirai seulement que la raison alléguée par le chancelier de l’Hôpital n’étoit pas la vraie : il s’en faut bien que le gouvernement des peuples ne soit qu’un honneur.
En fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l’homme. La loi Françoise regarde [17] comme frauduleux tous les actes faits par un marchand dans les dix jours qui ont précédé sa banqueroute : c’est la présomption de la loi. La loi Romaine infligeoit des peines au mari qui gardoit sa femme après l’adultere, à moins qu’il n’y fût déterminé par la crainte de l’événement [III-465] d’un procès, ou par la négligence de sa propre honte ; & c’est la présomption de l’homme. Il falloit que le juge présumât les motifs de la conduite du mari, & qu’il se déterminât sur une maniere de penser très-obscure. Lorsque le juge présume, les jugemens deviennent arbitraires ; lorsque la loi présume, elle donne au juge une regle fixe.
La loi de Platon [18] , comme j’ai dit, vouloit qu’on punît celui qui se tueroit, non pas pour éviter l’ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vicieuse, en ce que, dans le seul cas où l’on ne pouvoit pas tirer du criminel l’aveu du motif qui l’avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déterminât sur ces motifs.
Comme les lois inutiles affoiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affoiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, & il ne faut pas permettre d’y déroger par une convention particuliere.
La loi Falcidie ordonnoit, chez les Romains, que l’héritier eût toujours la quatrieme partie de l’hérédité : une autre loi [19] permit au testateur de [III-466] défendre à l’héritier de retenir cette quatrieme partie : c’est se jouer des lois. La loi Falcidie devenoit inutile : car, si le testateur vouloit favoriser son héritier ; celui-ci n’avoit pas besoin de la loi Falcidie ; & s’il ne vouloit pas le favoriser, il lui défendoit de se servir de la loi Falcidie.
Il faut prendre garde que les lois soient conçues de maniere qu’elles ne choquent point la nature des choses. Dans la proscription du prince d’Orange, Philippe II promet à celui qui le tuera de donner à lui ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus & la noblesse ; & cela en parole de roi, & comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action ! une telle action ordonnée en qualité de serviteur de Dieu ! Tout cela renverse également les idées de l’honneur, celles de la morale, & celles de la religion.
Il est rare qu’il faille défendre une chose qui n’est pas mauvaise, sous prétexte de quelque perfection qu’on imagine.
Il faut dans les lois une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir [III-467] elles-mêmes la plus grande innocence. On peut voir dans la loi des Wisigoths [20] cette requête ridicule, par laquelle on fit obliger les Juifs à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon, pourvu qu’ils ne mangeassent point du cochon même. C’étoit une grande cruauté : on les soumettoit à une loi contraire à la leur ; on ne leur laissoit garder de la leur que ce qui pouvoit être un signe pour les reconnoître.
-
[↑] Ut carmen necessarium. Cicéron, de legibus, liv. II.
-
[↑] C’est l’ouvrage d’Irnerius.
-
[↑] Testament politique.
-
[↑] Aut quâlibet manumissione donatum inquietare voluerit. Appendice au code Théodosien, dans le premier tome des œuvres du P. Sirmond, p. 737.
-
[↑] Aulugelle liv. XX, chap. i.
-
[↑] On trouve, dans le procès-verbal de cette ordonnance, les motifs que l’on eut pour cela.
-
[↑] Dans son ordonnance de Montel-lès-Tours, l’an 1453.
-
[↑] On pouvoit punir le procureur, sans qu’il fût nécessaire de troubler l’ordre public.
-
[↑] L’ordonnance de 1667 a fait des réglemens là-dessus.
-
[↑] Liv. II. tit. 37.
-
[↑] Dans l’appendice du P. Sismond au code Théodosien, tome I.
-
[↑] Leg. I. cod. de repudiis.
-
[↑] Voyez l’authentique sed hodiè, au code de repudiis.
-
[↑] Leg. I, ff. de postulando.
-
[↑] Dans les sentences, liv. IV, tit. 9.
-
[↑] Della guerra civile di Francia, pag. 96.
-
[↑] Elle est du mois de novembre, 1702.
-
[↑] Liv. IX des Lois.
-
[↑] C’est l’authentique, sed cùm testator.
-
[↑] Liv. XII, tit. 2. §. 16.
[III-467]
CHAPITRE XVII.
Mauvaise maniere de donner des lois.
Les empereurs Romains manifestoient comme nos princes leurs volontés par des décrets & des édits : mais ce que nos princes ne font pas, ils permirent que les juges ou les particuliers, dans leurs différents, les interrogeassent par lettres ; & leurs réponses étoient appellées des rescrits. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescrits. On sent que c’est une mauvaise sorte de législation.
[III-468] Ceux qui demandent ainsi des lois sont de mauvais guides pour le législateur ; les faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules Capitolin [1] , refusa souvent de donner de ces sortes de rescrits, afin qu’on n’étendît pas à tous les cas une décision & souvent une faveur particuliere. Macrin [2] avoit résolu d’abolir tous ces rescrits ; il ne pouvoit souffrir qu’on regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla, & de tous ces autres princes pleins d’impéritie. Justinien pensa autrement, & il en remplit sa compilation.
Je voudrois que ceux qui lisent les lois Romaines distinguassent bien ces sortes d’hypotheses d’avec les sénatus-consultes, les plébiscites, les constitutions générales des empereurs, & toutes les lois fondées sur la nature des choses, sur la fragilité des femmes, la foiblesse des mineurs, & l’utilité publique.
[III-469]
CHAPITRE XVIII.
Des idées d’uniformité.
Il y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touché Charlemagne), mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu’ils reconnoissent, parce qu’il est impossible de ne le pas découvrir : les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’état, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos, sans exception ? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ? Et la grandeur du génie ne consisteroit-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l’uniformité, & dans quel cas il faut des différences ? A la Chine, les Chinois sont gouvernés par le cérémonial Chinois, & les Tartares, par le cérémonial Tartare : c’est pourtant le peuple du monde qui a le plus la tranquillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent les lois, qu’importe qu’ils suivent la même ?
[III-470]
CHAPITRE XIX.
Des Législateurs.
Aristote vouloit satisfaire, tantôt sa jalousie contre Platon, tantôt sa passion pour Alexandre. Platon étoit indigné contre la tyrannie du peuple d’Athenes. Machiavel étoit plein de son idole, le duc de Valentinois. Thomas More, qui parloit plutôt de ce qu’il avoit lu que de ce qu’il avoit pensé, vouloit [1] gouverner tous les états avec la simplicité d’une ville Grecque. Arrington ne voyoit que la république d’Angleterre, pendant qu’une foule d’écrivains trouvoient le désordre partout où ils ne voyoient point de couronne. Les lois rencontrent toujours les passions & les préjugés du législateur. Quelquefois elles passent au travers, & s’y teignent ; quelquefois elles y restent, & s’y incorporent.
Fin du troisieme volume.
-
[↑] Dans son Utopie.
Volume IV↩

[IV-19]
LIVRE XXX.
Théorie des Lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la Monarchie.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des Lois féodales.
Je croirois qu’il y auroit une imperfection dans mon ouvrage, si je passois sous silence un événement arrivé une fois dans le monde, & qui n’arrivera peut-être jamais ; si je ne parlois de [IV-20] ces lois qu’on vit paroître en un moment dans toute l’Europe, sans qu’elles tinssent à celles qu’on avoit jusqu’alors connues ; de ces lois qui ont fait des biens & des maux infinis ; qui ont laissé des droits quand on a cédé le domaine ; qui, en donnant à plusieurs personnes divers genres de seigneurie sur la même chose, ou sur les mêmes personnes, ont diminué le poids de la seigneurie entiere ; qui ont posé diverses limites dans des empires trop étendus ; qui ont produit la regle avec une inclinaison à l’anarchie, & l’anarchie avec une tendance à l’ordre & à l’harmonie.
Ceci demanderoit un ouvrage exprès ; mais, vu la nature de celui-ci, on y trouvera plutôt ces lois comme je les ai envisagées, que comme je les ai traitées.
C’est un beau spectacle que celui des lois féodales. Un chêne antique [1] s’eleve ; l’œil en voit de loin des feuillages, il approche, il en voit la tige ; mais il n’en apperçoit point les racines : il faut percer la terre pour les trouver.
-
[↑] … Quantùm vertice ad oras
Æthereas, tantùm adice ad tartara tendit.
Virgile.
[IV-21]
CHAPITRE II.
Des sources des lois féodales.
Les peuples qui conquirent l’empire Romain étoient sortis de la Germanie. Quoique peu d’auteurs anciens nous ayent décrit leurs mœurs, nous en avons deux qui sont d’un très-grand poids. César, laissant la guerre aux Germains, décrit les mœurs [1] des Germains ; & c’est sur ces mœurs qu’il a réglé quelques-unes [2] de ses entreprises. Quelques pages de César, sur cette matiere, font des volumes.
Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs des Germains. Il est court, cet ouvrage ; mais c’est l’ouvrage de Tacite, qui abrégeoit tout, parce qu’il voyoit tout.
Ces deux auteurs se trouvent dans un tel concert avec les codes des lois des peuples barbares que nous avons, qu’en lisant César & Tacite, on trouve par-tout ces codes ; & qu’en lisant ces codes, on trouve par-tout César & Tacite.
[IV-22]
Que si, dans la recherche des lois féodales, je me vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes & de détours, je crois que je tiens le bout du fil, & que je puis marcher.
[IV-22]
CHAPITRE III.
Origine du vasselage.
César dit [1] que « les Germains ne s’attachoient point à l’agriculture ; que la plupart vivoient de lait, de fromage & de chair ; que personne n’avoit de terres ni de limites qui lui fussent propres ; que les princes & les magistrats de chaque nation donnoient aux particuliers la portion de terre qu’ils vouloient, dans le lieu qu’ils vouloient, & les obligeoient l’année suivante de passer ailleurs. » Tacite dit [2] , que « chaque prince avoit une troupe de gens qui s’attachoient à lui & le suivoient ». Cet auteur qui, dans sa langue, leur donne un nom qui a du rapport avec [IV-23] leur état, les nomme compagnons [3] . Il y avoit entr’eux une émulation singuliere [4] pour obtenir quelque distinction auprès du prince & une même émulation entre les princes sur le nombre & la bravoure de leurs compagnons. « C’est, ajoute Tacite, la dignité, c’est la puissance d’être toujours entouré d’une foule de jeunes gens que l’on a choisis ; c’est un ornement dans la paix, c’est un rempart dans la guerre. On se rend célebre dans sa nation & chez les peuples voisins, si l’on surpasse les autres par le nombre & le courage de ses compagnons : on reçoit des présens ; les ambassades viennent de toutes parts. Souvent la réputation décide de la guerre. Dans le combat il est honteux au prince d’être inférieur en courage ; il est honteux à la troupe de ne point égaler la valeur du prince ; c’est une infamie éternelle de lui avoir survécu. L’engagement le plus sacré, c’est de le défendre. Si une cité est en paix, les princes vont chez celles qui font la guerre ; c’est par-là qu’ils [IV-24] conservent un grand nombre d’amis. Ceux-ci reçoivent d’eux le cheval du combat & le javelot terrible. Les repas peu délicats, mais grands, sont une espece de solde pour eux. Le prince ne soutient ses libéralités que par les guerres & les rapines. Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la terre & d’attendre l’année, que d’appeller l’ennemi & de recevoir des blessures ; ils n’acquerront pas par la sueur ce qu’ils peuvent obtenir par le sang ».
Ainsi, chez les Germains, il y avoit des vassaux & non pas des fiefs : il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avoit des vassaux, parce qu’il y avoit des hommes fideles, qui étoient liés par leur parole, qui étoient engagés pour la guerre, & qui faisoient à peu près le même service que l’on fit depuis pour les fiefs.
-
[↑] Liv. VI, de la guerre des Gaules. Tacite ajoute : Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura ; prout ad querie venêre aluntur. De morib. Germ.
-
[↑] De moribus German.
-
[↑] Comites.
-
[↑] Ibid.
[IV-25]
CHAPITRE IV.
Continuation du même sujet.
César dit [1] que « quand un des princes déclaroit à l’assemblée qu’il avoit formé le projet de quelque expédition, & demandoit qu’on le suivît, ceux qui approuvoient le chef & l’entreprise, se levoient & offroient leur secours. Ils étoient loués par la multitude. Mais s’ils ne remplissoient pas leurs engagemens, ils perdoient la confiance publique, & on les regardoit comme des déserteurs & des traîtres ».
Ce que dit ici César, & ce que nous avons dit dans le chapitre précédent après Tacite, est le germe de l’histoire de la premiere race.
Il ne faut pas être étonné que les rois ayent toujours eu à chaque expédition de nouvelles armées à refaire, d’autres troupes à persuader, de nouvelles gens à engager ; qu’il ait fallu, pour acquérir beaucoup, qu’ils répandissent beaucoup ; qu’ils acquissent sans cesse par le partage des terres & des dépouilles, & [IV-26] qu’ils donnassent sans cesse ces terres & ces dépouilles ; que leur domaine grossît continuellement, & qu’il diminuât sans cesse ; qu’un pere qui donnoit à un de ses enfans un royaume [2] , y joignît toujours un trésor ; que le trésor du roi fût regardé comme nécessaire à la monarchie ; & qu’un roi [3] ne pût même, pour la dot de sa fille, en faire part aux étrangers, sans le consentement des autres rois. La monarchie avoit son allure, par des ressorts qu’il falloit toujours remonter.
-
[↑] De bello Gallico, liv. VI.
-
[↑] Voyez la vie de Dagobert.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. VI, sur le mariage de la fille de Chilpéric. Childebert lui envoie des ambassadeurs, pour lui dire qu’il n’ait point à donner des villes du royaume de son pere à sa fille, ni de ses trésors, ni des serfs, ni des chevaux, ni des attelages de bœufs, &c.
[IV-26]
CHAPITRE V.
De la conquête des Francs.
Il n’est pas vrai que les Francs, entrant dans la Gaule, ayent occupé toutes les terres du pays pour en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé ainsi, parce qu’ils ont vu, sur la fin de la [IV-27] seconde race, presque toutes les terres devenues des fiefs, des arriere-fiefs, ou des dépendances de l’un ou de l’autre : mais cela a eu des causes particulieres qu’on expliquera dans la suite.
La conséquence qu’on en voudroit tirer, que les Barbares firent un règlement général pour établir par-tout la servitude de la glebe, n’est pas moins fausse que le principe. Si dans un temps où les fiefs étoient amovibles, toutes les terres du royaume avoient été des fiefs ou des dépendances de fiefs, & tous les hommes du royaume des vassaux ou des serfs qui dépendoient d’eux ; comme celui qui a les biens a toujours aussi la puissance, le roi, qui auroit disposé continuellement des fiefs, c’est-à-dire de l’unique propriété, auroit eu une puissance aussi arbitraire que celle du sultan l’est en Turquie ; ce qui renverse toute l’histoire.
[IV-28]
CHAPITRE VI.
Des Goths, des Bourguignons & des Francs.
Les Gaules furent envahies par les nations Germaines. Les Wisigoths occuperent la Narbonnoise & presque tout le midi ; les Bourguignons s’établirent dans la partie qui regarde l’Orient ; & les Francs conquirent à peu près le reste.
Il ne faut pas douter que ces barbares n’ayent conservé dans leurs conquêtes les mœurs, les inclinations & les usages qu’ils avoient dans leur pays ; parce qu’une nation ne change pas dans un instant de maniere de penser & d’agir. Ces peuples, dans la Germanie, cultivoient peu les terres. Il paroît, par Tacite & César, qu’ils s’appliquoient beaucoup à la vie pastorale ; aussi les dispositions des codes des lois des Barbares roulent-elles presque toutes sur les troupeaux. Roricon, qui écrivoit l’histoire chez les Francs, étoit pasteur.
[IV-29]
CHAPITRE VII.
Différentes manieres de partager les terres.
Les Goths & les Bourguignons ayant pénétré, sous divers prétextes, dans l’intérieur de l’empire, les Romains, pour arrêter leurs dévastations, furent obligés de pourvoir à leur subsistance. D’abord ils leur donnoient du blé [1] ; dans la suite, ils aimerent mieux leur donner des terres. Les empereurs, ou sous leur nom les magistrats Romains [2] , firent des conventions avec eux sur le partage du pays, comme on le voit dans les chroniques & dans les codes des Wisigoths [3] & des Bourguignons [4] .
Les Francs ne suivirent pas le même [IV-30] plan. On ne trouve, dans les lois Saliques & Ripuaires, aucune trace d’un tel partage de terres ; ils avoient conquis, ils prirent ce qu’ils voulurent, & ne firent de réglemens qu’entr’eux.
Distinguons donc le procédé des Bourguignons & des wisigoths dans la Gaule, celui de ces mêmes Wisigoths en Espagne, des soldats auxiliaires [5] sous Augustule & Odoacer en Italie, d’avec celui des Francs dans les Gaules & des Vandales en Afrique [6] . Les premiers firent des conventions avec les anciens habitans, & en conséquence un partage de terres avec eux : les seconds ne firent rien de tout cela.
-
[↑] Voyez Zozime, liv. V, sur la distribution du blé demandée par Alaric.
-
[↑] Burgundiones partem Galliæ occupaverunt, terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. Chronique de Marius, sur l’an 456.
-
[↑] Livre X, tit. I, §. 8, 9 & 16.
-
[↑] Chapitre liv, §. I & 2 ; & ce partage subsistoit du temps de Louis le débonnaire, comme il paroît par son capitulaire de l’an 829, qui a été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. 79. §. I.
-
[↑] Voyez Procope, guerre des Goths.
-
[↑] Guerre des Vandales.
[IV-30]
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
Ce qui donne l’idée d’une grande usurpation des terres des Romains par les Barbares, c’est qu’on trouve dans les lois des wisigoths & des Bourguignons, que ces deux peuples eurent les [IV-31] deux tiers des terres : mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu’on leur assigna.
Gondebaud [1] dit, dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres ; & il est dit dans le second supplément [2] à cette loi, qu’on n’en donneroit plus que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays. Toutes les terres n’avoient donc pas d’abord été partagées entre les Romains & les Bourguignons.
On trouve, dans les textes de ces deux réglemens, les mêmes expressions ; ils s’expliquent donc l’un & l’autre ; & comme on ne peut pas entendre le second d’un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.
Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons ; ils ne dépouillerent pas les Romains dans toute l’étendue de leurs conquêtes.
[IV-32] Qu’auroient-ils fait de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convinrent, & laisserent le reste.
-
[↑] Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam & duas tarrarum partes accepit, &c. loi des Bourguignons, tit. 54, §. I.
-
[↑] Ut non ampliùs à Burgundionibus qui infrà venerant, requiratur quàm ad præsens necessitas suerit, medietas terræ, art. II.
[IV-32]
CHAPITRE IX.
Juste application de la loi des Bourguignons & de celle des wisigoths sur le partage des terres.
Il faut considérer que ces partages ne furent point faits par un esprit tyrannique, mais dans l’idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui devoient habiter le même pays.
La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d’hôte chez un Romain. Cela est conforme aux mœurs des Germains, qui, au rapport de Tacite [1] , étoient le peuple de la terre qui aimoit le plus à exercer l’hospitalité.
La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, & le tiers des serfs. Elle suivoit le génie des deux peuples, & se conformoit à la maniere dont ils se procuroient la subsistance. Le Bourguignon, qui faisoit paître des [IV-33] troupeaux, avoit besoin de beaucoup de terres, & de peu de serfs ; & le grand travail de la culture de la terre exigeoit que le Romain eût moins de glebe, & un plus grand nombre de serfs. Les bois étoient partagés par moitié, parce que les besoins à cet égard étoient les mêmes.
On voit, dans le code [2] des Bourguignons, que chaque barbare fut placé chez chaque Romain. Le partage ne fut donc pas général : mais le nombre des Romains qui donnerent le partage, fut égal à celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain fut lésé le moins qu’il fut possible : le Bourguignon, guerrier, chasseur & pasteur, ne dédaignoit pas de prendre des friches ; le Romain gardoit les terres les plus propres à la culture ; les troupeaux du Bourguignon engraissoient le champ du Romain.
[IV-34]
CHAPITRE X.
Des servitudes.
Il est dit, dans la loi [1] des Bourguignons, que quand ces peuples s’etablirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres, & le tiers des serfs. La servitude de la glebe étoit donc établie dans cette partie de la Gaule, avant l’entrée des Bourguignons [2] .
La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue formellement, dans l’une & dans l’autre, les nobles, les ingénus & les serfs [3] . La servitude n’étoit donc point une chose particuliere aux Romains, ni la liberté & la noblesse une chose particuliere aux barbares.
Cette même loi dit [4] que, si un affranchi Bourguignon n’avoit point donné une certaine somme à son [IV-35] maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain, il étoit toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu’il n’étoit point dans la famille d’un autre ; il étoit libre, puisque sa portion tierce étoit un signe de liberté.
Il n’y a qu’à ouvrir les lois Saliques & Ripuaires, pour voir que les Romains ne vivoient pas plus dans la servitude chez les Francs, que chez les autres conquérans de la Gaule.
M. le comte de Boulainvilliers a manqué le point capital de son systême ; il n’a point prouvé que les Francs ayent fait un règlement général qui mît les Romains dans une espece de servitude.
Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, & qu’il y parle avec cette simplicité, cette franchise & cette ingénuité de l’ancienne noblesse dont il étoit sorti, tout le monde est capable de juger, & des belles choses qu’il dit, & des erreurs dans lesquelles il tombe. Ainsi je ne l’examinerai point. Je dirai seulement qu’il avoit plus d’esprit que de lumieres, plus de lumieres que de savoir : mais ce savoir n’étoit point méprisable, parce que, de notre histoire [IV-36] & de nos lois, il savoit très-bien les grandes choses.
M. le comte de Boulainvilliers & M. l’abbé Dubos ont fait chacun un systême, dont l’un semble être une conjuration contre le tiers-état, & l’autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil donna à Phaéton son char à conduire, il lui dit : « Si vous montez trop haut, vous brûlerez la demeure céleste ; si vous descendez trop bas, vous réduirez en cendres la terre : n’allez point trop à droite, vous tomberiez dans la constellation du Serpent ; n’allez point trop à gauche, vous iriez dans celles de l’Autel : tenez-vous entre les deux [5] . »
-
[↑] Tit. 54.
-
[↑] Cela est confirmé par tout le titre du code de agricolis & censitis & colonis.
-
[↑] Si dantem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, tit. 26, §. I ; & Si mediocribus personis ingenuis, tàm Burgundionibus quàm Romanis : ibid. §. 2.
-
[↑] Tit. 57.
-
[↑] New preme, nec summum molire per æthera currum.
Altiùus egressus, cœlestia tecta cremabis ;
Inferiùs, terras : medio tutissimus ibis.
Neu te dexterior torum declinet ad Anguem ;
Neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram :
Inter utrumque tene…
Ovid. Métam. liv. II.
[IV-37]
CHAPITRE XI.
Continuation du même sujet.
Ce qui a donné l’idée d’un règlement général fait dans le temps de la conquete, c’est qu’on a vu en France un prodigieux nombre de servitudes vers le commencement de la troisieme race ; & comme on ne s’est pas apperçu de la progression continuelle qui se fit de ces servitudes, on a imaginé dans un temps obscur une loi générale qui ne fut jamais.
Dans le commencement de la premiere race, on voit un nombre infini d’hommes libres, soit parmi les Francs, soit parmi les Romains : mais le nombre des serfs augmenta tellement, qu’au commencement de la troisieme, tous les laboureurs & presque tous les habitans des villes se trouverent serfs [1] : & au lieu que, dans le commencement de la premiere, il y avoit dans les villes à peu près la même administration que [IV-38] chez les Romains, des corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de judicature ; on ne trouve guere, vers le commencement de la troisieme, qu’un seigneur & des serfs.
Lorsque les Francs, les Bourguignons & les Goths faisoient leurs invasions, ils prenoient l’or, l’argent, les meubles, les vêtemens, les hommes, les femmes, les garçons, dont l’armée pouvoit se charger ; le tout se rapportoit en commun, & l’armée le partageoit [2] . Le corps entier de l’histoire prouve, qu’après le premier établissement, c’est-à-dire après les premiers ravages, ils reçurent à composition les habitans, & leur laisserent tous leurs droits politiques & civils. C’étoit le droit des gens de ce temps-là ; on enlevoit tout dans la guerre, on accordoit tout dans la paix. Si cela n’avoit pas été ainsi, comment trouverions-nous, dans les lois saliques & Bourguignonnes, tant de dispositions contradictoires à la servitude générale des hommes ?
Mais ce que la conquête ne fit pas, [IV-39] le même droit des gens [3] , qui subsista après la conquête, le fit. La résistance, la révolte, la prise des villes, emportoient avec elles la servitude des habitans. Et comme, outre les guerres que les différentes nations conquérantes firent entr’elles, il y eut cela de particulier chez les Francs, que les divers partages de la monarchie firent naître sans cesse des guerres civiles entre les freres ou neveux, dans lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué ; les servitudes devinrent plus générales en France que dans les autres pays : & c’est, je crois, une des causes de la différence qui est entre nos lois Françoises, & celles d’Italie & d’Espagne, sur les droits des seigneurs.
La conquête ne fut que l’affaire d’un moment ; & le droit des gens que l’on y employa, produisit quelques servitudes. L’usage du même droit des gens pendant plusieurs siecles, fit que les servitudes s’étendirent prodigieusement.
Theuderic [4] croyant que les peuples d’Auvergne ne lui étoient pas [IV-40] fideles, dit aux Francs de son partage : « Suivez-moi : je vous menerai dans un pays où vous aurez de l’or, de l’argent, des captifs, des vêtemens, des troupeaux en abondance ; & vous en transférerez tous les hommes dans votre pays. »
Après la paix [5] qui se fit entre Gontrand & Chilpéric, ceux qui assiégeoient Bourges ayant eu ordre de revenir, ils amenerent tant de butin qu’ils ne laisserent presque dans le pays ni hommes ni troupeaux.
Théodoric, roi d’Italie, dont l’esprit & la politique étoient de se distinguer toujours des autres rois barbares, envoyant son armée dans la Gaule, écrit au général [6] : « Je veux qu’on suive les lois Romaines, & que vous rendiez les esclaves fugitifs à leurs maîtres : le défenseur de la liberté ne doit point favoriser l’abandon de la servitude. Que les autres rois se plaisent dans le pillage & la ruine des villes qu’ils ont prises : nous voulons vaincre de maniere que nos sujets se plaignent d’avoir acquis trop tard la sujétion. »
[IV-41]
Il est clair qu’il vouloit rendre odieux les rois des Francs & des Bourguignons, & qu’il faisoit allusions à leur droit des gens.
Ce droit subsista dans la seconde race. L’armée de Pepin étant entrée en Aquitaine, revint en France chargée d’un nombre infini de dépouilles & de serfs, disent les annales de Metz [7] .
Je pourrois citer des autorités [8] sans nombre. Et comme, dans ces malheurs, les entrailles de la charité s’émurent ; comme plusieurs saints évêques, voyant les captifs attachés deux à deux, employerent l’argent des églises & vendirent même les vases sacrés pour en racheter ce qu’ils purent ; que de saints moines s’y employerent ; c’est dans les vies des saints [9] que l’on trouve les plus grands éclaircissemens sur cette matiere. Quoiqu’on puisse reprocher aux auteurs de ces vies d’avoir été quelquefois un peu [IV-42] trop crédules sur des choses que Dieu a certainement faites, si elles ont été dans l’ordre de ses desseins, on ne laisse pas d’en tirer de grandes lumieres sur les mœurs & les usages de ces temps-là.
Quand on jette les yeux sur les monumens de notre histoire & de nos lois, il semble que tout est mer, & que les rivages mêmes manquent à la mer [10] : tous ces écrits froids, secs, insipides & durs, il faut les lire, il faut les dévorer, comme la fable dit que Saturne dévoroit les pierres.
Une infinité de terres que des hommes libres faisoient valoir [11] , se changerent en main-mortables : quand un pays se trouva privé des hommes libres qui l’habitoient, ceux qui avoient beaucoup de serfs prirent ou se firent céder de grands territoires, & y bâtirent des villages, comme on le voit dans diverses chartres. D’un autre côté, les hommes libres, qui cultivoient les arts, se trouverent être des serfs qui devoient les exercer : les servitudes rendoient aux arts & au labourage ce qu’on leur avoit ôté.
[IV-43]
Ce fut une chose usitée, que les propriétaires des terres les donnerent aux églises pour les tenir eux-mêmes à cens, croyant participer par leur servitude à la sainteté des églises.
-
[↑] Pendant que la Gaule étoit sous la domination des Romains, ils formoient des corps particuliers : c’étoient ordinairement des affranchis ou descendans d’affranchis.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. II, ch. xxvii, Aimoin, liv. I, chap. xii.
-
[↑] Voyez les vies des Saints citées ci-après à la note [3] de la page 23.
-
[↑] Grégoire de Tours, liv. III.
-
[↑] Gragoire de Tours, liv. VI, ch. xxxi.
-
[↑] Lettre 43, liv. III, dans Cassiodore.
-
[↑] Sur l’an 763. Innumerabilibus spoliis & captivis totus ille exercitus ditatus, in Franciam reversus est.
-
[↑] Annales de Fulde, année 739 ; Paul diacre, de gestis Longobardorum, liv. III, ch. xxx : & liv. IV, ch. i : & les vies des saints citées note suivante.
-
[↑] Voyez les vies de S. Epiphane, de S. Eptadius, de S. Césaire, de S. Fidole, de S. Porcien, de S. Trévérius, de S. Eusichius & de S. Léger, les miracles de S. Julien.
-
[↑] … Deerant quoque littora Ponto. Ovid. Liv. I.
-
[↑] Les Colons mêmes n’étoient pas tous serfs : voyez la loi XVIII & XXIII, au cod. de agricolis & sensitis & colonis, & la XX du même titre.
[IV-43]
CHAPITRE XII.
Que les terres du partage des barbares ne payoient point de tributs.
Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivoient sans industrie, & ne tenoient à leurs terres que par des cases de jonc, suivoient des chefs pour faire du butin, & non pas pour payer ou lever des tributs [1] . L’art de la maltôte est toujours inventé après coup, & lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.
Le tribut passager d’une cruche de vin par arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric & de Frédégonde, ne concerna que les Romains [2] . En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirerent les rôles de ces taxes, mais les [IV-44] ecclésiastiques, qui dans ces temps-là étoient tous Romains [3] . Ce tribut affligea principalement les habitans [4] des villes : or les villes étoient presque toutes habitées par des Romains.
Grégoire de Tours [5] dit qu’un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier dans une église ; pour avoir, sous le regne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs qui, du temps de Childebert, étoient ingénus ; Multos de Francis qui, tempore Childeberti regis, ingenui fuerant, publico tributo subegit. Les Francs qui n’étoient point serfs ne payoient donc point de tributs.
Il n’y a point de grammairien qui ne pâlisse, en voyant comment ce passage a été interprété par M. l’abbé Dubos [6] . Il remarque que, dans ces temps-là, les affranchis étoient aussi appellés ingénus. Sur cela il interprete le mot latin ingenui [IV-45] par ces mots, affranchis de tributs, expression dont on peut se servir, dans la langue Françoise, comme on dit affranchis de soins, affranchis de peines : mais, dans la langue Latine, ingenui à tributis, libertini à tributis, manumissi tributorum, seroient des expressions monstrueuses.
Parthenius, dit Grégoire de Tours [7] , pensa être mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M. l’abbé Dubos [8] , pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c’étoit, dit-il, une surcharge.
On voit, dans la loi des Wisigoths [9] , que quand un barbare occupoit le fonds d’un Romain, le juge l’obligeoit de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payoient donc pas de tributs sur les terres [10] .
[IV-46]
M. l’abbé Dubos [11] , qui avoit besoin que les Wisigoths payassent des tributs, quitte le sens littéral & spirituel de la loi [12] ; & imagine, uniquement parce qu’il imagine, qu’il y avoit eu, entre l’établissement des Goths & cette loi, une augmentation de tributs qui ne concernoit que les Romains. Mais il n’est permis qu’au pere Hardouin d’exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.
M. l’abbé Dubos [13] va chercher, dans le code de Justinien [14] , des lois, pour prouver que les bénéfices militaires chez les romains étoient sujets aux tributs : d’où il conclut qu’il en étoit de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l’opinion, que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains est aujourd’hui proscrite : elle n’a eu de crédit que dans les temps où l’on connoissoit l’histoire Romaine & très-peu la nôtre, & où nos monumens [IV-47] anciens étoient ensevelis dans la poussiere.
M. l’abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, & d’employer ce qui se passoit en Italie, & dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui étoit en usage chez les Francs ; ce sont des choses qu’il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths étoit entiérement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares : & que, bien loin qu’on puisse dire qu’une chose étoit en usage chez les Francs, parce qu’elle l’étoit chez les Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de penser qu’une chose qui se pratiquoit chez les Ostrogoths ne se pratiquoit pas chez les Francs.
Ce qui coûte le plus à ceux dont l’esprit flotte dans une vaste érudition, c’est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangeres au sujet, & de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.
M. l’abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l’histoire, & comme des [IV-48] lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs ayent payé des tributs, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs [15] ; quand il veut parler de leur militaire, il applique à des serfs [16] ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. II.
-
[↑] Ibid. liv. V.
-
[↑] Ce paroît par toute l’histoire de Grégoire de Tours. Le même Grégoire demande à un certain Valfiliacus comment il avoit pu parvenir à la cléricature, lui qui étoit Lombard d’origine. Grégoire de Tours, liv. 8.
-
[↑] Quæ conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est adhibita. Vie de S. Aridius.
-
[↑] Liv. VII.
-
[↑] Etablissement de la monarchie Françoise, tome III. chap. xiv, page 515.
-
[↑] Liv. III, ch. xxxvi.
-
[↑] Tome III, page 514.
-
[↑] Judices atque præpositi terras Romanorum, ab illis qui occupatas tenent, auserant ; & Romanis suâ exactione, sine aliquâ dilatione restituant, ut nihil sisco debeat deperire. Liv. X, tit. I, ch. xiv.
-
[↑] Les Vandales n’en payoient point en Afrique. Procope, guerre des Vandales, liv. I & II ; Historia miscella, liv. XVI, page 106. Remarquez que les conquérans de l’Afrique étoient un composé de Vandales, d’Alains & de Francs. Historia miscella, liv. XIV, page 94.
-
[↑] Etablissement des Francs dans les Gaules, tom. III, chap. xiv, page 510.
-
[↑] Il s’appuie sur une autre loi des wisigoths, liv. X, tit. I, art. II, qui ne prouve absolument rien : elle dit seulement que celui qui a reçu d’un seigneur une terre, sous condition d’une redevance, doit la payer.
-
[↑] Tome III, page 511.
-
[↑] Lege III, tit. 74, lib. XI.
-
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, tom. III, chap. xiv, page 513, où il cite l’art. 28 de l’Édit de Pistes : voyez ci-après le ch. xviii.
-
[↑] Ibid. tome III, chap. iv, page 298.
[IV-48]
CHAPITRE XIII.
Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la monarchie des Francs.
Je pourrois examiner si les Gaulois & les Romains vaincus continuerent de payer les charges auxquelles ils étoient assujettis sous les empereurs. Mais, pour aller plus vîte, je me contenterai de dire que, s’ils les payerent d’abord, ils en furent bientôt exemptés, & que ces tributs furent changés en un service militaire ; & j’avoue que je ne conçois gueres comment les Francs auroient été d’abord si amis de la [IV-49] maltôte, & en auroient paru tout à coup si éloignés.
Un capitulaire [1] de Louis le débonnaire nous explique très-bien l’état où étoient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes [2] de Goths ou d’Iberes fuyant l’oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louis. La convention qui fut faite avec eux porte que, comme les autres hommes libres, ils iroient à l’armée avec leur comte ; que, dans la marche, ils feroient la garde & les patrouilles sous les ordres du même comte [3] ; & qu’ils donneroient aux envoyés du roi, & aux ambassadeurs qui partiroient de sa cour ou iroient vers lui, des chevaux & des chariots pour les voitures [4] ; que d’ailleurs ils ne pourroient être contraints à payer d’autres cens, & qu’ils seroient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de [IV-50] nouveaux usages introduits dans le commencement de la seconde race, cela devoit appartenir au moins au milieu ou à la fin de la premiere. Un capitulaire de l’an 864 [5] dit expressément que c’étoit une coutume ancienne, que les hommes libres fissent le service militaire, & payassent de plus les chevaux & les voitures dont nous avons parlé ; charges qui leur étoient particulieres, & dont ceux qui possédoient les fiefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Ce n’est pas tout, il y avoit un règlement [6] qui ne permettoit guere de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre manoirs étoit toujours obligé de marcher à la guerre [7] ; celui qui n’en avoit que [IV-51] trois étoit joint à un homme libre qui n’en avoit qu’un ; celui-ci le défrayoit pour un quart, & restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux manoirs : celui des deux qui marchoit étoit défrayé de la moitié par celui qui restoit.
Il y a plus : nous avons une infinité de chartres où l’on donne les privileges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, & dont je parlerai beaucoup dans la suite [8] . On exempte ces terres de toutes les charges qu’exigeoient sur elles les comtes & autres officiers du roi ; & comme on énumere en particulier toutes ces charges, & qu’il n’y est point question de tributs, il est visible qu’on n’en levoit pas.
Il étoit aisé que la maltôte Romaine tombât d’elle-même dans la monarchie des Francs : c’étoit un art très-compliqué, & qui n’entroit ni dans les idées ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares inondoient aujourd’hui l’Europe, il faudroit bien des affaires pour leur faire entendre ce que c’est qu’un financier parmi nous.
[IV-52]
L’auteur [9] incertain de la vie de Louis le débonnaire, parlant des comtes & autres officiers de la nation des Francs que Charlemagne établit en Aquitaine, dit qu’il leur donna la garde de la frontiere, le pouvoir militaire, & l’intendance des domaines qui appartenoient à la couronne. Cela fait voir l’état des revenus du prince dans la seconde race. Le prince avoit gardé des domaines, qu’il faisoit valoir par ses esclaves. Mais les indictions, la capitation & autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne ou les biens des hommes libres, avoient été changés en une obligation de garder la frontiere, ou d’aller à la guerre.
On voit, dans la même histoire [10] , que Louis le débonnaire ayant été trouver son pere en Allemagne, ce prince lui demanda comment il pouvoit être si pauvre, lui qui étoit roi : que Louis lui répondit qu’il n’étoit roi que de nom, & que les seigneurs tenoient presque tous ses domaines : que Charlemagne, craignant que ce jeune prince ne perdît leur affection s’il reprenoit lui-même ce [IV-53] qu’il avoit inconsidérément donné, il envoya des commissaires pour rétablir les choses.
Les évêques écrivant à Louis [11] , frere de Charles le chauve, lui disoient : « Ayez soin de vos terres, afin que vous ne soyez pas obligé de voyager sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, & de fatiguer leurs serfs par des voitures. Faites ensorte, disoient-ils encore, que vous ayez de quoi vivre & recevoir des ambassades. » Il est visible que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines [12] .
-
[↑] De l’an 815, chap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles le chauve, de l’an 844, art. I & 2.
-
[↑] Pro Hispanis in partibus Aquitaniæ, Septimaniæ & Provinciæ consistentibus. Ibid.
-
[↑] Excubias & explorationes quas wactas dicunt. Ibid.
-
[↑] Ils n’étoient pas obligés d’en donner au comte, ibid. art. 5.
-
[↑] Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cim suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux ; ut hostem sacere, & debitos paraveredos secundùm antiquam consuetudinem exsolvere possint. Edit de Pistes, dans Baluze, page 186.
-
[↑] Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, ch. i. Édit de Pistes, l’an 864. art. 27.
-
[↑] Quaturo mansos. Il me semble que ce qu’on appelloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une cense où il y avoit des esclaves ; témoin le capitulaire de l’an 853, apud Sylvacum, tit. 14, contre ceux qui chassoient les esclaves de leur mansus.
-
[↑] Voyez ci-dessous le chapitre XX de ce livre, page 66.
-
[↑] Dans Duchesne, tome II, page 287.
-
[↑] Ibid. page 89.
-
[↑] Voyez le capitulaire dans l’an 858, art. 14.
-
[↑] Ils levoient encore quelques droits sur les rivieres, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.
[IV-53]
CHAPITRE XIV.
De ce qu’on appelloit census.
Lorsque les barbares sortirent de leur pays, ils voulurent rédiger par écrit leurs usages : mais, comme on trouva de la difficulté à écrire des mots Germains avec des lettres Romaines, on donna ces lois en latin.
Dans la confusion de la conquête & [IV-54] de ses progrès, la plupart des choses changerent de nature ; il fallut, pour les exprimer, se servir des anciens mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit réveiller l’idée de l’ancien cens [1] des Romains, on le nomma census, tributum ; & quand les choses n’y eurent aucun rapport quelconque, on exprima comme on put les mots Germains avec des lettres Romaines : ainsi on forma le mot fredum, dont je parlerai beaucoup dans les chapitres suivants.
Les mots census & tributum ayant été ainsi employés d’une maniere arbitraire, cela a jeté quelqu’obscurité dans la signification qu’avoient ces mots dans la premiere & dans la seconde race : & des auteurs modernes [2] qui avoient des systêmes particuliers, ayant trouvé ce mot dans les écrits de ces temps-là, ils ont jugé que ce qu’on appelloit census [IV-55] étoit précisément le cens des romains ; & ils en ont tiré cette conséquence, que nos rois des deux premieres races s’étoient mis à la place des empereurs Romains, & n’avoient rien changé à leur administration [3] . Et comme de certains droits levés dans la seconde race ont été par quelques hasards & par de certaines modifications [4] convertis en d’autres, ils en ont conclu que ces droits étoient le cens des Romains : & comme depuis les réglemens modernes ils ont vu que le domaine de la couronne étoit absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits qui représentoient le cens des Romains, & qui ne forment pas une partie de ce domaine, étoient de pures usurpations. Je laisse les autres conséquences.
Transporter dans des siecles reculés toutes les idées du siecle où l’on vit, c’est des sources de l’erreur celle qui est la plus féconde. À ces gens qui veulent rendre modernes tous les siecles anciens, [IV-56] je dirai ce que les prêtres d’Égypte dirent à Solon : « Ô Athéniens, vous n’êtes que des enfans » !
-
[↑] Le census étoit un mot si générique, qu’on s’en servit pour exprimer les péages des rivieres, lorsqu’il y avoit un pont ou un bas à passer. Voyez le capitul. III de l’an 803, édition de Baluze, page 395, cat. I, & le V de l’an 819, p. 616. On appella encore de ce nom les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés, comme il paroît par le capitulaire de Charles le chauve, de l’an 865, art. 8.
-
[↑] M. l’abbé Dubos, & ceux qui l’ont suivi.
-
[↑] Voyez la foiblesse des raisons de M. l’abbé Dubos, établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, ch. xiv ; sur-tout l’induction qu’il tire d’un passage de Grégoire de Tours, sur un démêlé de son église avec le roi Charibert.
-
[↑] Par exemple, par les affranchissemens.
[IV-56]
CHAPITRE XV.
Que ce qu’on appelloit census ne se levoit que sur les serfs, & non pas sur les hommes libres.
Le roi, les ecclésiastiques & les seigneurs levoient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l’égard du roi, par le capitulaire de Villis ; à l’égard des ecclésiastiques, par les codes [1] des lois des Barbares ; à l’égard des seigneurs, par les réglemens [2] que Charlemagne fit là-dessus.
Ces tributs étoient appelés census : c’étoient des droits économiques & non pas fiscaux, des redevances uniquement privées & non pas des charges publiques.
Je dis que ce qu’on appeloit census étoit un tribut levé sur les serfs. Je le [IV-57] prouve par une formule de Marculse, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu’on soit ingénu [3] & qu’on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donne à un comte [4] qu’il envoya dans les contrées de Saxe ; elle contient l’affranchissement des Saxons, à cause qu’ils avoient embrassé le christianisme, & c’est proprement une chartre d’ingénuité [5] . Ce prince les rétablit dans leur premiere liberté civile, & les exempte de payer le cens [6] . C’étoit donc une même chose d’être serf & de payer le cens, d’être libre & de ne le payer pas.
Par une espece de lettres patentes du même prince [7] en faveur des Espagnols qui avoient été reçus dans la monarchie, il est défendu aux comtes d’exiger d’eux aucun cens & de [IV-58] leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivoient en France étoient traités comme des serfs ; & Charlemagne voulant qu’on les regardât comme des hommes libres, puisqu’il vouloit qu’ils eussent la propriété de leurs terres, défendoit d’exiger d’eux le cens.
Un capitulaire [8] de Charles le chauve donné en faveur des mêmes Espagnols, veut qu’on les traite comme on traitoit les autres Francs, & défend d’exiger d’eux le cens : les hommes libres ne le payoient donc pas.
L’article 30 de l’édit de Pistes réforme l’abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l’église vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, & ne se réservoient qu’une petite case ; de sorte qu’on ne pouvoit plus être payé du cens ; & il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d’esclaves.
Il résulte encore de-là qu’il n’y avoit point de cens général dans la [IV-59] monarchie ; & cela est clair par un grand nombre de textes. Car, que signifieroit ce capitulaire [9] ? « Nous voulons qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l’exigeoit légitimement [10] ». Que voudroit dire celui [11] où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement [12] été du domaine du roi ? & celui [13] où il dispose des cens payés par ceux [14] dont on les exige ? Quelle signification donner à cet autre [15] où on lit : « Si quelqu’un [16] a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le [IV-60] cens ? » à cet autre enfin [17] où Charles le chauve [18] parle des terres censuelles, dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi ?
Remarquez qu’il y a quelques textes qui paroissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, & qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n’étoient obligés qu’à fournir de certaines voitures ; le capitulaire que je viens de citer, appelle cela census [19] , & il l’oppose au cens qui étoit payé par les serfs.
De plus, l’édit de Pistes [20] parle de ces hommes Francs qui devoient payer le cens royal pour leur tête [21] & pour leurs cases, & qui s’étoient vendus pendant la famine. Le roi veut qu’ils soient rachetés. C’est que ceux [22] qui étoient affranchis par lettres du roi, [IV-61] n’acquéroient point ordinairement une pleine & entiere liberté [23] ; mais ils payoient censum in capite ; & c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général & universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appeloit cens dans la monarchie Françoise, indépendamment de l’abus que l’on a fait de ce mot, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner ; je serois plus court, si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l’établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules, de M. l’Abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances, qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célebre ; parce qu’avant d’instruire, il faut commencer par détromper.
-
[↑] Loi des Allemands, ch. xxii ; & la loi des Bavarois, tit. I, ch. xiv, où l’on trouve les réglemens que les ecclésiastiques firent sur leur état.
-
[↑] Livre V des capitulaires, ch. ccciii.
-
[↑] Si ille de capite suo benè ingenuus sit, & in puletico publico consitus non est. Livre I, formule 19.
-
[↑] De l’an 789, édition des capitulaires de Baluze, tome I, page 250.
-
[↑] Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistat, ibid.
-
[↑] Prisunæque libertati donatos, & omni nobis debito censu solutos, ibid.
-
[↑] Præceptum pro Hispanis, de l’an 812, édit. de Baluze, tome I, page 500.
-
[↑] De l’an 844, édit. de Baluze, tome II, art. I & 2, page 27.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 805, art. 20 & 22, inséré dans le recueil d’Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles le Chauve, de l’an 854. apud Attiniacum, art. 6.
-
[↑] Undecumque legitimè exigebatur, ibid.
-
[↑] De l’an 812, art. 10 & 11, édition de Baluze, tome I, page 498.
-
[↑] Undecumque antiquitùs ad partem regis venire solebant : capitulaire de l’an 812, art. 10 & 11.
-
[↑] De l’an 813, art. 6, édit de Baluze, tome I, page 508.
-
[↑] De illis unde censa exigunt, capitulaire de l’an 813, art. 6.
-
[↑] Livre IV des capitulaires, art. 37, & inséré dans la loi des Lombards.
-
[↑] Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit. Livre IV des capitulaires, art. 37.
-
[↑] De l’an 805, art. 8.
-
[↑] Unde census ad partem regis exivit antiquitùs, capitulaire de l’an 805, art. 8.
-
[↑] Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent.
-
[↑] De l’an 864, art. 34, édit. de Baluze, p. 192.
-
[↑] De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite & de suis recellis debeant, ibid.
-
[↑] L’article 28 du même édit explique bien tout cela ; il met même une distinction entre l’affranchi Romain, & l’affranchi Franc : on y voit que le cens n’étoit pas général. Il faut le lire.
-
[↑] Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne, de l’an 813, déjà cité.
[IV-62]
CHAPITRE XVI.
Des leudes ou vassaux.
J’ai parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, suivoient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons [1] : la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi [2] ; les formules de Marculse [3] par celui d’antrustions du roi [4] ; nos premiers historiens par celui de leudes [5] , de fideles ; & les suivans par celui de vassaux [6] & seigneurs.
On trouve dans les lois Saliques & Ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, & quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y regle par-tout les biens [IV-63] des Francs ; & on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, & qu’ils étoient le sort d’une armée & non le patrimoine d’une famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux [7] , des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs & dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles [8] . On voit dans Grégoire de Tours [9] , que l’on ôte à Sunegisile & à Galloman tout ce qu’ils tenoient du fisc, & qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avoient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrette avec lui, & lui indiqua ceux [10] à qui il devoit donner des fiefs, & ceux à qui [IV-64] il devoit les ôter. Dans une formule de Marculse [11] , le roi donne en échange non-seulement des bénéfices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu’un autre avoit tenus. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété [12] . Les historiens, les formules, les codes des différens peuples barbares, tous les monumens qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le livre des fiefs [13] , nous apprennent que d’abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté, qu’ensuite ils les assurerent pour un an [14] , & après les donnerent pour la vie.
-
[↑] Comites.
-
[↑] Qui sunt in trusteregis, tit. 44, art. 4.
-
[↑] Livre I, formule 18.
-
[↑] Du mot trew, qui signifie fidele chez les Allemands, & chez les Anglois true, vrai.
-
[↑] Leudes, fideles.
-
[↑] Vassalli, seniores.
-
[↑] Fiscalia. Voyez la formule 14 de Marculse, livre I. Il est dit dans la vie de Saint Maur, dedit siscum unum ; & dans les annales de Metz sur l’an 747, dedit illi comitatus & siscos plurimos. Les biens destinés à l’entretien de la famille royale étoient appelés regalia.
-
[↑] Voyez le livre I, tit. I, des fiefs ; & Cujas sur ce livre.
-
[↑] Livre IX, ch. xxxviii.
-
[↑] Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret, ibid. liv. VII.
-
[↑] Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quod cumque ille, vel siscus noster, in ipsis locis tenuisse nosestur. Livre I, formule 30.
-
[↑] Livre III, tit. 8, § 3.
-
[↑] Feudorum, lib. I, tit. I.
-
[↑] C’étoit une espece de précaire que le seigneur renouvelloit, ou ne renouvelloit pas l’année d’ensuite, comme Cujas l’a remarqué.
[IV-65]
CHAPITRE XVII.
Du service militaire des hommes libres.
Deux sortes de gens étoient tenus au service militaire ; les leudes vassaux ou arriere-vassaux, qui y étoient obligés en conséquence de leurs fiefs ; & les hommes libres Francs, Romains & Gaulois, qui servoient sous le comte, & étoient menés par lui & ses officiers.
On appeloit hommes libres ceux qui d’un côté n’avoient point de bénéfices ou fiefs, & qui de l’autre n’étoient point soumis à la servitude de la glebe ; les terres qu’ils possédoient, étoient ce qu’on appeloit des terres allodiales.
Les comtes assembloient les hommes libres, [1] , & les menoient à la guerre ; ils avoient sous eux des officiers qu’ils appeloient vicaires [2] : & comme tous les hommes libres étoient divisés en centaines, qui formoient ce que l’on [IV-66] appeloit un bourg, les comtes avoient encore sous eux des officiers qu’on appeloit centeniers, qui menoient les hommes libres du bourg [3] , ou leurs centaines, à la guerre.
Cette division par centaines est postérieure à l’établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clothaire & Childebert, dans la vue d’obliger chaque district à répondre des vols qui s’y feroient : on voit cela dans les décrets des ces princes [4] . Une pareille police s’observe encore aujourd’hui en Angleterre.
Comme les comtes menoient les hommes libres à la guerre, les leudes y menoient aussi leurs vassaux ou arriere-vassaux, & les évêques, abbés, ou leurs avoués [5] y menoient les leurs [6] .
Les évêques étoient assez embarrassés : ils ne convenoient [7] pas bien eux-mêmes de leurs faits. Ils demanderent [IV-67] à Charlemagne de ne plus les obliger d’aller à la guerre ; & quand ils l’eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu’on leur faisoit perdre la considération publique : & ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu’il en soit, dans les temps où ils n’allerent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y ayent été menés par les comtes ; on voit au contraire [8] que les rois ou les évêques choisissoient un des fideles pour les y conduire.
Dans un capitulaire [9] de Louis le débonnaire, le roi distingue trois sortes de vassaux, ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d’un leude [10] ou seigneur n’étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelqu’emploi dans la maison du roi [IV-68] empêchoit ces leudes de les mener eux-mêmes.
Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui étoit toujours à la tête de ses fideles. C’est pour cela que dans les capitulaires on voit toujours une opposition entre les vassaux [11] du roi & ceux des évêques. Nos rois courageux, fiers & magnanimes, n’étoient point dans l’armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique ; ce n’étoient point ces gens-là qu’ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux & arriere-vassaux ; & cela paroît bien par ce capitulaire [12] où Charlemagne ordonne que tout homme libre, qui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu’un, aille contre l’ennemi, ou suive son seigneur. Il est visible [IV-69] que Charlemagne veut dire que celui qui n’avoit qu’une terre en propre, entroit dans la milice du comte, & que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur, partoit avec lui.
Cependant M. l’abbé Dubos [13] prétend que, quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendoient d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs ; & il se fonde sur la loi des Wisigoths & la pratique de ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer, dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le chauve & ses freres, parle de même des hommes libres qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; & cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.
On peut donc dire qu’il y avoit trois sortes de milices ; celle des leudes ou fideles du roi, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d’autres fideles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques & de leurs vassaux ; & enfin celle du comte, qui menoit les hommes libres.
[IV-70]
Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général.
On voit même que le comte & les envoyés du roi pouvoient leur faire payer le ban, c’est-à-dire une amende, lorsqu’ils n’avoient pas rempli les engagemens de leur fief.
De même, si les vassaux [14] du roi faisoient des rapines, ils étoient soumis à la correction du comte, s’ils n’aimoient mieux se soumettre à celle du roi.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. 3 & 4, édit. de Baluze, tome I, pag. 491 ; & l’édit. de Pistes, de l’an 864, art. 26, tome II, page 186.
-
[↑] Et habebat unusquisque comes vicarios & centenarios secum, livre II des capitulaires, art. 28.
-
[↑] On les appeloit compagenses.
-
[↑] Données vers l’an 595, art. I. Voyez les capitulaires, edition de Baluze, page 20. Ces réglemens furent faits sans doute de concert.
-
[↑] Advocati.
-
[↑] Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. I & 5, édition de Baluze, tome I, p. 490.
-
[↑] Voyez le capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 408 & 410.
-
[↑] Capitulaire de Worms, de l’an 803, édition de Baluze, p. 409 ; & le concile de l’an 845, sous Charles le Chauve, in verno palatio, édition de Baluze, tom. II, p. 17, art. 8.
-
[↑] Capitulare quintum anni 819, art. 27, édit. de Baluze, p. 618.
-
[↑] De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, & tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vassailos suos casatos secum non retineant ; se cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitulaire II, de l’an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, pag. 494.
-
[↑] Capitulaire I, de l’an 812, art. 5 de hominibus nostris, & episcoporum & abbatum qui vel beneficia, vel talia propria habent, &c. édition de Baluze, tome I, pag. 490.
-
[↑] De l’an 812, ch. i., édit. de Baluze, p. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, five de alieujus beneficio, habet, ipse se præparet, & ipse in hostem pergat, five cum seniore suo.
-
[↑] Tome III, liv. VI, ch. iv, p. 299. Etablissement de la monarchie Françoise.
-
[↑] Capitulaire de l’an 882, art. 11, apud vernis palatium, édit. de Baluze, tome II, p. 17.
[IV-70]
CHAPITRE XVIII.
Du double service.
C’étoit un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu’un, étoient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire [1] de Louis le débonnaire, de l’an 815, fait-il marcher d’un pas égal la puissance [IV-71] militaire du comte, & sa juridiction civile sur les hommes libres : aussi les placites [2] du comte qui menoit à la guerre les hommes libres, étoient-ils appelés les placites [3] des hommes libres ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’étoit que dans les placites du comte, & non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvoit juger les questions sur la liberté : aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux [4] des évêques ou abbés, parce qu’ils n’étoient pas sous sa juridiction civile : aussi n’y menoit-il pas les arriere-vassaux des leudes : aussi le glossaire [5] des lois Angloises nous dit-il [6] que ceux que les Saxons appeloient coples, furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu’ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous dans tous les temps que l’obligation de tout vassal [7] envers [IV-72] son seigneur, fut de porter les armes [8] & de juger ses pairs dans sa cour.
Une des raisons qui attachoit ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, étoit que celui qui menoit à la guerre faisoit en même temps payer les droits du fisc, qui consistoient en quelques services de voiture dûs par les hommes libres, & en général en de certains profits judiciaires, dont je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; & pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns & les autres étoient gouvernés sur le même plan & sur les mêmes idées. En un mot, les comtes, dans leurs comtés, étoient des leudes ; les leudes dans leurs seigneuries, étoient des comtes.
On n’a pas eu des idées justes, lorsqu’on a regardé les comtes comme des officiers de justice, & les ducs comme [IV-73] des officiers militaires. Les uns & les autres étoient également des officiers militaires & civils [9] : toute la différence étoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes, quoiqu’il y eût des comtes qui n’avoient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégaire [10] .
On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même temps sur les sujets la puissance militaire & la puissance civile, & même la puissance fiscale ; chose que j’ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls [11] , & rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie : ils assembloient , pour juger les affaires, des especes de plaids ou d’assises [12] , où les notables étoient convoqués.
Pour qu’on puisse bien entendre ce [IV-74] qui concerne les jugemens, dans les formules, les lois des Barbares & les capitulaires, je dirai que [13] les fonctions de comte, du gravion & du centenier, étoient les mêmes ; que les juges, les rathimburges & les échevins, étoient sous différens noms les mêmes personnes ; c’étoient les adjoints du comte, & ordinairement il en avoit sept ; & comme il ne lui falloit pas moins de douze personnes pour juger [14] , il remplissoit le nombre par des notables [15] .
Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugerent jamais seuls : & cet usage qui tiroit son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore, lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.
Quant au pouvoir fiscal, il étoit tel que le comte ne pouvoit guere en abuser, [IV-75] Les droits du prince, à l’égard des hommes libres, étoient si simples, qu’ils ne consistoient, comme j’ai dit, qu’en de certaines voitures [16] exigées dans de certaines occasions publiques ; & quant aux droits judiciaires, il y avoit des lois [17] qui prévenoient les malversations.
-
[↑] Art I & 2 ; & le concile in verno palatio, de l’an 845, art. 8, édit. de Baluze, tome II, p. 17.
-
[↑] Plaids ou assises.
-
[↑] Capitulaires, liv. IV de la collection d’Anzegise, art. 57 ; & le capitul. de Louis le débonnaire, de l’an 819, art. 14, édit. de Baluze, tome I, p. 615.
-
[↑] Voyez p. 48, la note [4] ; & p. 50, la note [1].
-
[↑] Que l’on trouve dans le recueil de Guillaume Lombard : de priscis Anglorum legibus.
-
[↑] Au mot satrapia.
-
[↑] Les assises de Jérusalem, chapitres ccxxi & ccxxii, expliquent bien ceci.
-
[↑] Les avoués de l’église (advocati) étoient également à la tête de leurs plaids & de leur milice.
-
[↑] Voyez la formule viii de Marculfe, liv. I, qui contient les lettres accordées à un duc, patrice ou comte, qui leur donnent la juridiction civile & l’administration fiscale.
-
[↑] Chronique, ch. lxxviii, sur l’an 636.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ad annum 580.
-
[↑] Mallum.
-
[↑] Joignez ici que j’ai dit au livre XXVIII, chap. xxviii ; & au livre XXXI, chap. viii.
-
[↑] Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis le débonnaire, ajoutés à la loi salique, art. 2 ; & la formule des jugemens, donnée par du Cange, au mot boni homines.
-
[↑] Per bonos homines. Quelquefois il n’y avoit que des notables. Voyez l’appendice aux formules de Marculse, chap. li.
-
[↑] Et quelques droits sur les rivieres, dont j’ai parlé.
-
[↑] Voyez la loi des Ripuaires, tit. 89 ; & la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 9.
[IV-75]
CHAPITRE XIX.
Des compositions chez les peuples barbares.
Comme il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît parfaitement les lois & les mœurs des peuples Germains, je m’arrêterai un moment, pour faire la recherche de ces mœurs & de ces lois.
Il paroît, par Tacite, que les Germains ne connoissoient que deux crimes capitaux ; ils pendoient les traîtres, & noyoient les poltrons : c’étoient chez [IV-76] eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme [1] avoit fait quelque tort à un autre, les parens de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle ; & la haine s’appaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé, s’il pouvoit la recevoir ; & les parens, si l’injure ou le tort leur étoit commun ; ou si, par la mort de celui qui avoit été offensé ou lésé ; la satisfaction leur étoit dévolue.
De la maniere dont parle Tacite, ces satisfactions se faisoient par une convention réciproque entre les parties ; aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s’appellent-elles des compositions.
Je ne trouve que la loi [2] des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où chaque famille ennemie étoit, pour ainsi dire, dans l’état de nature ; & où, sans être retenue par quelque loi [IV-77] politique ou civile, elle pouvoit à sa fantaisie exercer sa vengeance, jusqu’à ce qu’elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée ; on établit [3] que celui dont on demandoit la vie, auroit la paix dans sa maison, qu’il l’auroit en allant & en revenant de l’église, & du lieu où l’on rendoit les jugemens.
Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs [4] , par lequel celui qui avoit exhumé un cadavre pour le dépouiller, étoit banni de la société des hommes, jusqu’à ce que les parens consentissent à l’y faire rentrer : & comme avant ce temps il étoit défendu à tout le monde, & à sa femme même, de lui donner du pain, ou de le recevoir dans sa maison ; un tel homme étoit à l’égard des autres, & les autres étoient à son égard, dans l’état de la nature, jusqu’à ce que cet état eût cessé par la composition.
À cela près, on voit que les sages des diverses nations barbares songerent à faire par eux-mêmes ce qu’il étoit trop long & trop dangereux d’attendre de la convention réciproque des parties.
[IV-78] Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devoit recevoir celui à qui on avoit fait quelque tort ou quelqu’injure. Toutes ces lois barbares ont là-dessus une précision admirable : on y distingue avec finesse les cas [5] , on y pese les circonstances ; la loi se met à la place de celui qui est offensé, & demande pour lui la satisfaction que, dans un moment de sang froid, il auroit demandée lui-même.
Ce fut par l’établissement de ces lois, que les peuples Germains sortirent de cet état de nature, où il semble qu’ils étoient encore du temps de Tacite.
Rhotaris déclara dans la loi des Lombards [6] , qu’il avoit augmenté les compositions de la coutume ancienne pour les blessures, afin que le blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser : en effet, les Lombards, peuple pauvre, s’étant enrichis par la conquête de l’Italie, les compositions anciennes devenoient frivoles, & les réconciliations ne se faisoient plus. Je ne doute pas que cette considération n’ait obligé les autres [IV-79] chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous avons aujourd’hui.
La principale composition étoit celle que le meurtrier devoit payer aux parens du mort. La différence [7] des conditions en mettoit une dans les compositions : ainsi, dans la loi des Angles, la composition étoit de six cents sous pour la mort d’un Adalingue, de deux cents pour celle d’un homme libre, de trente pour celle d’un serf. La grandeur de la composition établie sur la tête d’un homme, faisoit donc une de ses grandes prérogatives ; car, outre la distinction qu’elle faisoit de sa personne, elle établissoit pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sureté.
La loi des Bavarois [8] nous fait bien sentir ceci : elle donne le nom des familles Bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu’elles étoient les premieres [9] après les Agilolfingues. Les Agilolfingues étoient [IV-80] de la race ducale, & on choisissoit le duc parmi eux ; ils avoient une composition quadruple. La composition pour le duc excédoit d’un tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu’il est duc, dit la loi, on lui rend un plus grand honneur qu’à ses parens. »
Toutes ces compositions étoient fixées à prix d’argent. Mais comme ces peuples, sur-tout pendant qu’ils se tinrent dans la Germanie, n’en avoient guere ; on pouvoit donner du bétail, du blé, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres [10] , &c. Souvent même la loi [11] fixoit la valeur de ces choses ; ce qui explique comment, avec si peu d’argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.
Ces lois s’attacherent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que [IV-81] chacun connût au juste jusqu’à quel point il étoit lésé ou offensé ; qu’il fût exactement la réparation qu’il devoit recevoir, & sur-tout qu’il n’en devoit pas recevoir davantage.
Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfaction, commettoit un grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une offense publique qu’une offense particuliere : c’étoit un mépris de la loi même. C’est ce crime que les législateurs [12] ne manquerent pas de punir.
Il y avoit un autre crime qui fut sur-tout regardé comme dangereux [13] lorsque ces peuples perdirent dans le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d’indépendance, & que les rois s’attacherent à mettre dans l’état une meilleure police ; ce crime étoit de ne [IV-82] vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des barbares, que les législateurs [14] y obligeoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir la satisfaction, vouloit conserver son droit de vengeance ; celui qui refusoit de la faire, laissoit à l’offensé son droit de vengeance : & c’est ce que les gens sages avoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n’y obligeoient pas.
Je viens de parler d’un texte de la loi salique, où le législateur laissoit à la liberté de l’offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction ; c’est cette loi [15] qui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes, jusqu’à ce que les parens, acceptant la satisfaction, eussent demandé [IV-83] qu’il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigerent les lois saliques ne toucherent point à l’ancien usage.
Il auroit été injuste d’accorder une composition aux parens d’un voleur tué dans l’action du vol, ou à ceux d’une femme qui avoit été renvoyée après une séparation pour crime d’adultere. La loi des Bavarois [16] ne donnoit point de composition dans des cas pareils, & punissoit les parens qui en poursuivoient la vengeance.
Il n’est pas rare de trouver dans les codes des lois des barbares, des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours censée ; elle vouloit [17] que, dans ce cas, on composât suivant sa générosité, & que les parens ne pussent plus poursuivre la vengeance.
Clotaire II. fit un décret très-sage : il défendit [18] à celui qui avoit été volé de recevoir sa composition en secret, & [IV-84] sans l’ordonnance du juge. On va voir tout à l’heure le motif de cette loi.
-
[↑] Suscipere tàm inimicitias, seu patris, seu propinqui, quàm amicitias, nesesse est : nec iplacabiles durant ; luitur enim etiàm homicidium certo armentorum as peccrum numero, recipitque satisfactionem universa domus. Tacite, de morib. Germ.
-
[↑] Voyez cette loi, tit. 2 sur les meurtres ; & l’addition de Vullemar sur les vols.
-
[↑] Additio sapientum, tit. I, §. I.
-
[↑] Loi salique, tit. 58, §. I ; tit. 17, §. 3.
-
[↑] Voyez sur-tout les titres 3, 4, 5, 6 & 7 de la loi salique, qui regardent les vols des animaux.
-
[↑] Livre I, tit. 7, §. 15.
-
[↑] Voyez la loi des Angles, tit. I, §. I, 2, 4 ; ibid. tit. 5, §. 6 ; la loi des Bavarois, tit. I, ch. viii & ix ; & la loi des Frisons, tit. 15.
-
[↑] Tit. 2, ch. xx.
-
[↑] Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena, ibid.
-
[↑] Ainsi la loi d’Ina estimoit la vie une certaine somme d’argent, ou une certaine portion de terre. Leges Inæ regis, titulo de villico regio, de priscis Anglorum Legibus. Cambridge, 1644.
-
[↑] Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plusieurs peuples, chap. xviii. Voyez aussi la loi des Ripuaires, tit. 36, §. 11 ; la loi des Bavarois, tit. I, §. 10 & 11. Si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, &c.
-
[↑] Voyez la loi des Lombards, liv. I, tit. 25, §. 21 ; ibid. liv. I, tit. 8, §. 8 & 34 ; & le capitul. de Charlemagne, de l’an 802, ch. xxxii, contenant une instruction donnée à ceux qu’il envoyoit dans les provinces.
-
[↑] Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VII, chapitre xlvii, le détail d’un procès où une partie perd la moitié de la composition qui lui avoit été adjugée, pour s’être fait justice elle-même, au lieu de recevoir la satisfaction, quelque excès qu’elle eût souffert depuis.
-
[↑] Voyez la loi des Saxons, ch. III, §. 4 ; la loi des Lombards, liv. I, tit. 37, §. I & 2 ; & la loi des Allemands, tit. 45, §. I & 2. Cette derniere loi permettoit de se faire justice soi-même, sur le champ & dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitulaires de Charlemagne, de l’an 779, ch. xxii ; de l’an 802, chap. xxxii ; & celui du même de l’an 805, chap. v.
-
[↑] Les compilateurs des lois des Ripuaires paroissent avoir modifié ceci. Voyez le titre 85 de ces lois.
-
[↑] Voyez le décret de Tassillon, de popularibus legibus, art. 3, 4, 10, 16, 19 ; la loi des Angles, tit. 7, §. 4.
-
[↑] Liv. I, tit. 9, §. 4.
-
[↑] Pactus pro tenore pacis inter Childebertum & Clotarium, anno 593 ; & decretio Clotarii II, regis circa annam 593, ch. xi.
[IV-84]
CHAPITRE XX.
De ce que l’on a appellé depuis la justice des seigneurs.
Outre la composition qu’on devoit payer aux parens pour les meurtres, les torts & les injures, il falloit encore payer un certain droit que les codes des lois des barbares appellent fredum [1] . J’en parlerai beaucoup ; & pour en donner l’idée, je dirai que c’est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd’hui, dans la langue Suédoise, fred veut dire la paix.
Chez ces nations violentes, rendre la justice n’étoit autre chose qu’accorder, à celui qui avoit fait une offense, sa protection contre la vengeance de celui qui l’avoit reçue ; & obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui [IV-85] étoit due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendoit pour protéger le criminel contre celui qu’il avoit offensé.
Les codes des lois des barbares nous donnent le cas où ces freda devoient être exigés. Dans ceux où les parens ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum : en effet, là où il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards [2] , si quelqu’un tuoit par hasard un homme libre, il payoit la valeur de l’homme mort, sans le fredum ; parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’étoit pas le cas où les parens eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires [3] , quand un homme étoit tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étoient censés coupables, & les parens les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.
De même, quand une bête avoit tué [IV-86] un homme, la même loi [4] établissoit une composition sans le fredum, parce que les parens du mort n’étoient pas offensés.
Enfin, par la loi salique [5] , un enfant qui avoit commis quelque faute avant l’âge de douze ans, payoit la composition sans le fredum : comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n’étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parens pussent demander la vengeance.
C’étoit le coupable qui payoit le fredum, pour la paix & la sécurité que les excès qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, & qu’il pouvoit recouvrer par la protection : mais un enfant ne perdoit point cette sécurité : il n’étoit point un homme, & ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.
Ce fredum étoit un droit local pour celui qui jugeoit dans le territoire [6] .
La loi des Ripuaires [7] lui défendoit [IV-87] pourtant de l’exiger lui-même ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause, le reçût & le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.
La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la [8] protection : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte & des autres juges.
Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monumens. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des Francs ; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirerent tous les fruits & tous les émolumens : & comme un des plus considérables [9] étoient les profits judiciaires [IV-88] (freda) que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parens, & des profits au seigneur ; elle n’étoit autre chose que de faire payer les compositions de la loi, & celui d’exiger les amendes de la loi.
On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude [10] ou fidele, ou des privileges des fiefs en faveur des églises [11] , que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres [12] qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire, pour y exercer quelqu’acte de justice que ce fût, & y exiger quelqu’émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district, ils n’entroient plus [IV-89] dans ce district ; & ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions que ceux-là y avoient faites.
Il est défendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparoître devant eux : c’étoit donc à celui qui recevoit le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourroient plus demander de logement ; en effet, ils n’y avoient plus aucune fonction.
La justice fut donc, dans les fiefs anciens & dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie. C’est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi ; d’où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France.
Quelques-uns ont cru que les justices tiroient leur origine des affranchissemens que les rois & les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations Germaines, & celles qui en sont descendues, ne sont par les seules qui ayent affranchi des esclaves, & ce sont les seules qui ayent établi des justices patrimoniales. D’ailleurs, les formules de Marculfe [13] [IV-90] nous font voir des hommes libres dépendans de ces justices dans les premiers temps : les serfs ont donc été justiciables, parce qu’ils se sont trouvés dans le territoire ; & ils n’ont pas donné l’origine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le fief.
D’autres gens ont pris une voie plus courte : Les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit ; & tout a été dit. Mais n’y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie, qui ayent usurpé les droits des princes ? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains ; mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appellé les justices des seigneurs. C’étoit donc dans le fond des usages & des coutumes des Germains qu’il en falloit chercher l’origine.
Je prie de voir, dans Loyseau [14] , quelle est la maniere dont il suppose que les seigneurs procéderent pour [IV-91] former & usurper leurs diverses justices. Il faudroit qu’ils eussent été les gens du monde les plus rafinés, & qu’ils eussent volé, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village & des procureurs se volent entr’eux. Il faudroit dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulieres du royaume & dans tant de royaumes, auroient fait un systême général de politique. Loyseau les fait raisonner comme, dans son cabinet, il raisonnoit lui-même.
Je le dirai encore : si la justice n’étoit point une dépendance du fief, pourquoi voit-on par-tout [15] que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur, & dans leurs cours & dans leurs guerres ?
-
[↑] Lorsque la loi ne le fixoit pas, il étoit ordinairement le tiers de ce qu’on donnoit pour la composition, comme il paroît dans la loi des Ripuaires, ch. lxxxix, qui est expliquée par le troisieme capitulaire de l’an 813, édit. de Baluze, tome I, page 512.
-
[↑] Liv. I, tit. 9, §. 17, édit. de Lindembrock.
-
[↑] Tit. 70.
-
[↑] Tit. 46. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. xxi, §. 3, édit. de Lindembrock : si cabalus cum pede, &c.
-
[↑] Tit. 28, §. 6.
-
[↑] Comme il paroît par le décret de Clotaire II, de l’an 595. Fredus tamen judicis in cujus pago est, reservetur.
-
[↑] Tit. 89.
-
[↑] Capitulare incerti anni, ch. lvii, dans Baluze¸tome I, page 515. Et il faut remarquer que ce qu’on appelle fredum ou faida, dans les monumens de la premiere race, s’appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il paroît par le capitulaire de partibus Saxoniæ, de l’an 789.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charlemagne, de Villis, où il met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu’on appelloit villæ ou domaines du roi.
-
[↑] Voyez la formule 3, 4 & 17, livre I, de Marculse.
-
[↑] Ibid. Formule 2, 3 & 4.
-
[↑] Voyez les recueils de ces chartres, sur-tout celui qui est à la fin du cinquieme volume des historiens de France des PP. Bénédictins.
-
[↑] Voyez la 3, 4 & 14 du liv. I ; & la chartre de Charlemagne¸de l’an 771, dans Martenne, tome I. Anecdot. collect. II. Præcipientes jubemus ut ullus judex publicus… homines ipsius ecclesiæ & monasterio ipsius Morbacensis tàm ingenuos quàm & servos, & qui super eorum terras manere, &c.
-
[↑] Traité des justices de village.
-
[↑] Voyez M. du Cange au mot hominium.
[IV-91]
CHAPITRE XXI.
De la justice territoriale des églises.
Les églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnerent de grands fiscs, c’est-à-dire, de grands fiefs ; & nous [IV-92] trouvons d’abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D’où auroit pris son origine un privilege si extraordinaire ? Il étoit dans la nature de la chose donnée ; le bien ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu’on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à l’église ; & on lui laissoit les prérogatives qu’il auroit eues, si on l’avoit donné à un leude : aussi fut-il soumis au service que l’état en auroit tiré, s’il avoit été accordé au laïque, comme on l’a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, & d’en exiger le fredum ; & comme ces droits emportoient nécessairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire, pour exiger ces freda, & y exercer tous actes de justice, le droit qu’eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, fut appellé immunité, dans le style des formules [1] , des chartres & des capitulaires.
La loi des Ripuaires [2] défend aux [IV-93] affranchis [3] des églises de tenir l’assemblée [4] où la justice se rend, ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, & tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans les vies des Saints [5] , que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, & qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne ; le fond de la vie & les mensonges se rapportent aux mœurs & aux lois du temps ; & ce sont ces mœurs & ces lois [6] que l’on cherche ici.
Clotaire II. ordonne aux évêques [7] ou aux grands, qui possedent des terres dans les pays éloignés, de choisir dans [IV-94] le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émolumens.
Le même prince [8] regle la compétence entre les juges des églises & ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques & aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince [9] défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction [10] sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, & pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Rheims déclarerent [11] que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806 [12] , [IV-95] veut que les églises ayent la justice criminelle & civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin, le capitulaire de Charles le chauve [13] distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs, & celles des églises ; & je n’en dirai pas davantage.
-
[↑] Voyez la formule 3 & 4 de Marculfe, liv. I.
-
[↑] Ne aliubi nisi od ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, tit. 58, §. I. Voyez aussi le §. 19, édit. de Lindembrock.
-
[↑] Tabulariis.
-
[↑] Mallum.
-
[↑] Vita S. Germeri, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 maii.
-
[↑] Voyez aussi la vie de S. Melanius, & celle de S. Déicole.
-
[↑] Dans le concile de Paris, l’an 615. Episcopi vel potenses, qui in allis possident regionibus, judices vel missos diseussores de allis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipient & aliis reddant, art. 19. Voyez aussi l’art. 12.
-
[↑] Dans le concile de Paris, l’an 615, art. 5.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 44, chap. ii, édit. de Lindembrock.
-
[↑] Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti¸ibid.
-
[↑] Lettre de l’an 858, art. 7, dans les capitulaires, page 108. Sicut illæ res & facultates in quibus vivunt clerici, ità & illæ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassali.
-
[↑] Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7 ; voyez aussi l’art. 3 de l’édit. de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ earum justitias, & in vitâ illorum qui habitant in ipsis ecclesiis & post, tàm in pecuniis quàm & in substantiis eorum.
-
[↑] De l’an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4, édit. de Baluze, page 96.
[IV-95]
CHAPITRE XXII.
Que les justices étoient établies avant la fin de la seconde race.
On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race, que les vassaux s’attribuerent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale, que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations ; elles dérivent du premier établissement, & non pas de sa corruption.
« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois [1] , [IV-96] payera la composition à ses parens, s’il en a ; &, s’il n’en a point, il la payera au duc, ou à celui à quoi il s’étoit recommandé pendant sa vie. » On fait ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice.
« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands [2] , ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la composition.
« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Childebert [3] , trouve un voleur dans une autre centaine que la sienne ou dans les limites de nos fideles, & qu’il ne l’en chasse pas, il représentera le voleur ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers & celui des fideles.
Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire [4] de la même [IV-97] année, qui, donnée pour le même cas & sur le même fait, ne differe que dans les termes ; la constitution appellant in truste, ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. Messieurs Bignon & du Cange [5] , qui ont cru que in truste signifioit le domaine d’une autre roi, n’ont pas bien rencontré.
Dans une constitution de Pépin [6] , roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes & autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui different de la rendre, ordonne [7] que, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district [IV-98] duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; & que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.
Un capitulaire de Charlemagne [8] prouve que les rois ne levoient point par-tout les freda. Un autre du même prince [9] nous fait voir les regles féodales & la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice [10] , ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison, jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le chauve, l’un [11] de l’an 861, où l’on voit des juridictions particulieres établies, des juges & des officiers sous eux ; l’autre [12] de l’an [IV-99] 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.
On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires, que les justices, dans les commencemens, aient été attachées au fiefs : mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de la nature du fief & une de ses principales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monumens qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n’en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fideles, par deux raisons. La premiere, que la plupart des monumens qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines, pour l’utilité de leurs monasteres : la seconde, que le [IV-100] patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulieres, & une espece de dérogation à l’ordre établi, il falloit des chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avoit pas besoin d’avoir, & encore moins de conserver une chartre particuliere. Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroît par la vie de S. Maur.
Mais la troisieme formule [13] de Marculfe nous prouve assez que le privilege d’immunité, & par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques & aux séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns & pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II. [14]
-
[↑] Tit. 3, ch. xiii, édit. de Lindembrock.
-
[↑] Tit. 85.
-
[↑] De l’an 595, art. 11 & 12, édit. des capitulaires de Baluze, pag. 19. Pari conditione convenit ut si una centena in aliâ centenâ vestigium secuta suerit & invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, & ipsum in aliam centenam minimè expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, &c.
-
[↑] Si vestigiis comprobatur latronis, tamen præsentiæ nihil loagè mulctando ; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, & capitale exigat à latrone, art. 2, 3.
-
[↑] Voyez le glossaire, au mot trustis.
-
[↑] Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 14. C’est le capitulaire de l’an 793, dans Baluze, page 544, art. 10.
-
[↑] Et si forsitan Francus aut Langobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ilie judex in cujus ministerio suerit, contradicat illi beneficium suum, interim dùm ipse aut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 2, qui se rapporter au capitulaire de Charlemagne, de l’an 779, art. 21.
-
[↑] Le troisieme de l’an 812, art. 10.
-
[↑] Second capitulaire de l’an 813, art. 14 & 20, page 509.
-
[↑] Capitulare quintum, anni 819, art. 23, édit. de Baluze, page 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quemlibery honore præditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiù in co loco justitias facere debent.
-
[↑] Edictum in Carifiaco, dans Baluze, tome II, page 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de suâ advocatione… in convenientia ut cùm ministerialibus de suâ advocatione quos invenerit contrà hunc banum nostrum fecisse… castiget.
-
[↑] Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, page 181. Si in fiscum nostrum, vel in quam cumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit, &c.
-
[↑] Liv. I. Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, bonivolâ deliberatione concedimus
-
[↑] Je l’ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi vel potentes.
[IV-101]
CHAPITRE XXIII.
Idée générale du livre de l’établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules, par M. l’abbé Dubos.
Il est bon qu’avant de finir ce livre, j’examine un peu l’ouvrage de M. l’abbé Dubos, parce que mes idées sont perpétuellement contraires aux siennes ; & que, s’il a trouvé la vérité, je ne l’ai pas trouvée.
Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce qu’il est écrit avec beaucoup d’art ; parce qu’on y suppose éternellement ce qui est en question ; parce que plus on y manque de preuves, plus on y multiple les probabilités ; parce qu’une infinité de conjectures sont mises en principe, & qu’on en tire comme conséquences d’autres conjectures. Le lecteur oublie qu’il a douté, pour commencer à croire. Et comme une érudition sans fin est placée, non pas dans le systême, mais à côté du systême, l’esprit est distrait par des accessoires, & ne s’occupe plus plus principal. D’ailleurs, tant de recherches ne permettent [IV-102] pas d’imaginer qu’on n’ait rien trouvé ; la longueur du voyage fait croire qu’on est enfin arrivé.
Mais, quand on examine bien, on trouve un colosse immense qui a des pieds d’argile ; & c’est parce que les pieds sont d’argile, que le colosse est immense. Si le systême de M. l’abbé Dubos avoit eu de bons fondemens, il n’auroit pas été obligé de faire trois mortels volumes pour le prouver ; il auroit tout trouvé dans son sujet ; &, sans aller chercher de toutes parts ce qui en étoit très-loin, la raison elle-même se seroit chargée de placer cette vérité dans la chaîne des autres vérités. L’histoire & nos lois lui auroient dit : « Ne prenez pas tant de peine : nous rendrons témoignage de vous. »
[IV-102]
CHAPITRE XXIV.
Continuation du même sujet. Réflexion sur le fond du systême.
Monsieur l’abbé Dubos veut ôter toute espece d’idée que les Francs soient entrés dans les Gaules en [IV-103] conquérans : selon lui, nos rois, appellés par les peuples, n’ont fait que se mettre à la place, & succéder aux droits des empereurs Romains.
Cette prétention ne peut pas s’appliquer au temps où Clovis, entrant dans les Gaules, saccagea & prit les villes ; elle ne peut pas s’appliquer non plus au temps où il défit Syagrius, officier Romain, & conquit le pays qu’il tenoit : elle ne peut donc se rapporter qu’à celui où Clovis, devenu maître d’une grande partie des Gaules par la violence, auroit été appellé, par le choix & l’amour des peuples, à la domination du reste du pays. Et il ne suffit pas que Clovis ait été reçu, il faut qu’il ait été appellé ; il faut que M. l’abbé Dubos prouve que les peuples ont mieux aimé vivre sous la domination de Clovis, que de vivre sous la domination des Romains, ou sous leurs propres lois. Or les Romains de cette partie des Gaules qui n’avoit point encore été envahie par les barbares, étoient, selon M. l’abbé Dubos, de deux sortes ; les uns étoient de la confédération Armorique, & avoient chassé les officiers de [IV-104] l’empereur, pour se défendre eux-mêmes contre les barbares, & se gouverner par leurs propres lois ; les autres obéissoient aux officiers Romains. Or M. l’abbé Dubos prouve-t-il que les Romains qui étoient encore soumis à l’empire, ayent appellé Clovis ? point du tout. Prouve-t-il que la république des Armoriques ait appellé Clovis, & fait même quelque traité avec lui ? point du tout encore. Bien loin qu’il puisse nous dire quelle fut la destinée de cette république, il n’en sauroit pas même montrer l’existence ; & quoiqu’il la suive depuis le temps d’Honorius jusqu’à la conquête de Clovis, quoiqu’il y rapporte avec un art admirable tous les événemens de ces temps-là, elle est restée invisible dans les auteurs. Car il y a bien de la différence entre prouver, par un passage de Zozime [1] , que, sous l’empire d’Honorius, la contrée Armorique [2] & les autres provinces des Gaules se révolterent & formerent une espece de république ; & faire voir que, malgré les diverses pacifications [IV-105] des Gaules, les Armoriques formerent toujours une république particuliere, qui subsista jusqu’à la conquête de Clovis. Cependant il auroit besoin, pour établir son systême, de preuves bien fortes & bien précises. Car, quand on voit un conquérant entrer dans un état, & en soumettre une grande partie par la force & par la violence ; & qu’on voit quelque temps après l’état entier soumis, sans que l’histoire dise comment il l’a été ; on a un très-juste sujet de croire que l’affaire a fini comme elle a commencé.
Ce point une fois manqué, il est aisé de voir que tout le systême de M. l’abbé Dubos croule de fond en comble ; & toutes les fois qu’il tirera quelques conséquences de ce principe, que les Gaules n’ont pas été conquises par les Francs, mais que le Francs ont été appellés par les Romains, on pourra toujours la lui nier.
M. l’abbé Dubos prouve son principe par les dignités Romaines dont Clovis fut revêtu ; il veut que Clovis ait succédé à Childéric son pere dans l’emploi de maître de la milice. Mais ces deux charges sont purement de sa création.
[IV-106] La lettre de Saint Remy à Clovis, sur laquelle il se fonde [3] , n’est qu’une félicitation sur son avénement à la couronne. Quand l’objet d’un écrit est connu, pourquoi lui en donner un qui ne l’est pas ?
Clovis, sur la fin de son regne, fut fait consul par l’empereur Anastase : mais quel droit pouvoit lui donner une autorité simplement annale ? Il y a apparence, dit M. l’abbé Dubos, que, dans le même diplôme, l’empereur Anastase fit Clovis proconsul. Et moi, je dirai qu’il y a apparence qu’il ne le fit pas. Sur un fait qui n’est fondé sur rien, l’autorité de celui qui le nie est égale à l’autorité de celui qui l’allegue. J’ai même une raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du consulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsulat n’auroit été même que d’environ six mois. Clovis mourut un an & demi après avoir été fait consul ; il n’est pas possible de faire du proconsulat une charge héréditaire. Enfin, quand le consulat, & si l’on veut le proconsulat, lui furent donnés, il étoit déjà le [IV-107] maître de la monarchie, & tous ses droits étoient établis.
La seconde preuve que M. l’abbé Dubos allegue, c’est la cession faite par l’empereur Justinien, aux enfans & aux petits-enfans de Clovis, de tous les droits de l’empire sur les Gaules. J’aurois bien des choses à dire sur cette cession. On peut juger de l’importance que les rois des Francs y mirent, par la maniere dont ils en exécuterent les conditions. D’ailleurs, les rois des Francs étoient maîtres des Gaules ; ils étoient souverains paisibles : Justinien n’y possédoit pas un pouce de terre ; l’empire d’occident étoit détruit depuis long-temps ; & l’empereur d’orient n’avoit de droit sur les Gaules, que comme représentant l’empereur d’occident ; c’étoient des droits sur des droits. La monarchie des Francs étoit déjà fondée ; le règlement de leur établissement étoit fait ; les droits réciproques des personnes, & des diverses nations qui vivoient dans la monarchie, étoient convenus ; les lois de chaque nation étoient données, & même rédigées par écrit. Que faisoit cette cession étrangere à un établissement déjà formé ? [IV-108]
Que veut dire M. l’abbé Dubos avec les déclamations de tous ces évêques, qui dans le désordre, la confusion, la chute totale de l’état, les ravages de la conquête, cherchent à flatter le vainqueur ? Que suppose la flatterie, que la foiblesse de celui qui est obligé de flatter ? Que prouve la rhétorique & la poésie, que l’emploi même de ces arts ? Qui ne seroit étonné de voir Grégoire de Tours, qui, après avoir parlé des assassinats de Clovis, dit que cependant Dieu prosternoit tous les jours ses ennemis, parce qu’il marchoit dans ses voies ? Qui peut douter que le clergé n’ait été bien aise de la conversion de Clovis, & qu’il n’en ait même tiré de grands avantages ? Mais qui peut douter, en même temps, que les peuples n’ayent essuyé tous les malheurs de la conquête, & que le gouvernement Romain n’ait cédé au gouvernement Germanique ? Les Francs n’ont point voulu, & n’ont pas même pu tout changer ; & même peu de vainqueurs ont eu cette manie. Mais, pour que toutes les conséquences de M. l’abbé Dubos fussent vraies, il auroit fallu que non-seulement ils n’eussent rien changé [IV-109] chez les Romains, mais encore qu’ils se fussent changés eux-mêmes.
Je m’engagerois bien, en suivant la méthode de M. l’abbé Dubos, à prouver de même que les Grecs ne conquirent pas la Perse. D’abord, je parlerois des traités que quelques-unes de leurs villes firent avec les Perses : je parlerois des Grecs qui furent à la solde des Perses, comme les Francs furent à la solde des Romains. Que si Alexandre entra dans le pays des Perses, assiégea, prit & détruisit la ville de Tyr, c’étoit une affaire particuliere comme celle de Syagrius. Mais, voyez comment le pontife des Juifs vient au-devant de lui : écoutez l’oracle de Jupiter Ammon : ressouvenez-vous comment il avoit été prédit à Gordium : voyez comment toutes les villes courent, pour ainsi dire, au-devant de lui ; comment les satrapes & les grands arrivent en foule. Il s’habille à la maniere des Perses ; c’est la robe consulaire de Clovis. Darius ne lui offrit-il pas la moitié de son royaume ? Darius n’est-il pas assassiné comme un tyran ? La mere & la femme de Darius ne pleurent-elles pas la mort d’Alexandre ? Quinte-Curce, Arrien, Plutarque [IV-110] étoient-ils contemporains d’Alexandre ? L’imprimerie [4] ne nous a-t-elle pas donné des lumieres qui manquoient à ces auteurs ? Voilà l’histoire de l’établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules.
-
[↑] Hist. liv. VI.
-
[↑] Titusque tractus Armoricus, aliæque Galliarum provinciæ. Ibid.
-
[↑] Tome II, livre III, chapitre xviii, page 270.
-
[↑] Voyez le discours préliminaire de monsieur l’abbé Dubos.
[IV-110]
CHAPITRE XXV.
De la noblesse Françoise.
Monsieur l’abbé Dubos soutient que, dans les premiers temps de notre monarchie, il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang de nos premieres familles, ne le seroit pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L’origine de leur grandeur n’iroit donc point se perdre dans l’oubli, la nuit & le temps : l’histoire éclaireroit des siecles où elles auroient été des familles communes : & pour que Chilpéric, Pépin & Hugues-Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les [IV-111] Romains ou les Saxons, c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.
M. l’abbé Dubos [1] fonde son opinion sur la loi salique. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition [2] pour la mort de quelque Franc que ce fût : mais elle distinguoit chez les Romains le convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain possesseur à qui elle en donnoit cent, & du Romain tributaire à qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens ; & qu’il y en avoit trois chez les Romains.
Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs y eussent eu une composition plus grande, & y [IV-112] eussent été des personnages plus importans que les plus illustres des Francs & leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, & qu’il en eût tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares, qui prouvent qu’il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette regle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi salique ; ce qui lui est effectivement arrivé.
On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion [3] , c’est-à-dire d’un fidele ou vassal du roi, étoit de six cents sous ; & que celle pour la mort d’un Romain convive [4] du roi n’étoit que de trois cents. On y trouve [5] que la [IV-113] composition pour la mort d’un simple Franc étoit de deux cents sous [6] , & que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire n’étoit que de cent [7] . On payoit encore pour la mort d’un Romain tributaire, espece de serf ou d’affranchi, une composition de quarante-cinq sous [8] ; mais je n’en parlerai point non plus que de celle pour la mort du serf Franc, ou de l’affranchi Franc : il n’est point ici question de ce troisieme ordre de personnes.
Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les antrustions : & ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, & pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, & qu’il y en avoit trois chez les Romains.
[IV-114]
Comme, selon lui, il n’y avoit qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pieces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions [9] ; l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisieme pour ceux qui étoient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.
Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts [10] . Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, & non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, & non [IV-115] pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi ; ils pouvoient même être des Romains : mais il n'y avoit toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur [11] , ce sont des serfs ; & c’est de cette maniere qu’il interprete le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses ; l’une [12] que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des barbares, n’étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monumens ; l’autre, que tous les hommes libres étoient jugés directement & immédiatement par le roi [13] , ce qui est contredit par une infinité de passages & d’autorités qui nous font connoître [IV-116] l’ordre judiciaires de ces temps-là [14] .
Il est dit, dans ce décret fait dans une assemblée de la nation [15] , que, si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc (Francus) ; mais, si c’est une personne plus foible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior personna est un serf. J’ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus ; & je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots une personne plus foible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, & le plus petit. S’il n’étoit ici question que des hommes libres & des serfs, on auroit dit un serf, & non pas un homme [IV-117] d’une moindre puissance. Ainsi debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant : & Francus est pris ici dans cette acception, parce que, parmi les Francs, étoient toujours ceux qui avoient dans l’état une plus grande puissance, & qu’il étoit plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s’accorde avec un grand nombre de capitulaires [16] , qui donnent les cas dans lesquels les criminels pouvoient être renvoyés devant le roi, & ceux où ils ne le pouvoient pas.
On trouve dans la vie de Louis le débonnaire [17] écrite par Tégan, que les évêques furent les principaux auteurs de l’humiliation de cet empereur, sur-tout ceux qui avoient été serfs, & ceux qui étoient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avoit tiré de la servitude, [IV-118] & avoit fait archevêque de Rheims : « Quelle récompense l’empereur a-t-il reçue de tant de bienfaits ! Il t’a fait libre, & non pas noble ; il ne pouvoit pas te faire noble, après t’avoir donné la liberté [18] . »
Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n’embarrasse point M. l’abbé Dubos. Il répond ainsi [19] : « Ce passage ne veut point dire que Louis le débonnaire n’eût pas pu faire entrer Hébon dans l’odre des nobles. Hébon, comme archevêque de Rheims, eût été du premier ordre, supérieur à celui de la noblesse ». Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire ; je lui laisse à juger s’il est ici question d’une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue M. l’abbé Dubos [20] , que les citoyens nés libres étoient qualifiés de nobles-hommes : dans [IV-119] l’usage du monde, noble-homme, & homme né libre, ont signifié long-temps la même chose ». Quoi ! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles-hommes, un passage de la vie de Louis le débonnaire s’appliquera à ces sortes de gens ! « Peut-être aussi, ajoute-t-il encore [21] , qu’Hébon n’avoit point été esclave dans la nation des Francs, mais dans la nation Saxone, ou dans une autre nation Germanique, où les citoyens étoient divisés en plusieurs ordre ». Donc, à cause du peut-être de M. l’abbé Dubos, il n’y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n’a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan [22] distingue les évêques qui avoient été opposés à Louis le débonnaire, dont les uns avoient été serfs, & les autres étoient d’une nation [IV-120] barbare. Hébon étoit des premiers, & non pas des seconds. D’ailleurs, je ne sais comment on peut dire qu’un serf, tel qu’Hébon, auroit été Saxon ou Germain : un serf n’a point de famille, ni par conséquent de nation. Louis le débonnaire affranchit Hébon ; & comme les serfs affranchis prenoient la loi de leur maître, Hébon devint Franc, & non pas Saxon ou Germain.
Je viens d’attaquer ; il faut que je me défende. On me dira que le corps des antrustions formoit bien dans l’état un ordre distingué de celui des hommes libres : mais que, comme les fiefs furent d’abord amovibles, & ensuite à vie, cela ne pouvoit pas former une noblesse d’origine, puisque les prérogatives n’étoient point attachées à un fief héréditaire. C’est cette objection qui a sans doute fait penser à M. de Valois qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs : sentiment que M. l’abbé Dubos a pris de lui, & qu’il a absolument gâté à force de mauvaises preuves. Quoi qu’il en soit, ce n’est point M. l’abbé Dubos qui auroit pu faire cette objection. Car, ayant [IV-121] donné trois ordres de noblesse Romaine, & la qualité de convive du roi pour le premier, il n’auroit pas pu dire que ce titre marquât plus une noblesse d’origine que celui d’antrustion. Mais il faut une réponse directe. Les antrustions ou fideles n’étoient pas tels, parce qu’ils avoient un fief ; mais on leur donnoit un fief, parce qu’ils étoient antrustions ou fideles. On se ressouvient de ce que j’ai dit dans les premiers chapitres de ce livre : Ils n’avoient pas pour lors, comme ils eurent dans la suite, le même fief : mais, s’ils n’avoient pas celui-là, ils en avoient un autre, & parce que les fiefs se donnoient à la naissance, & parce qu’ils se donnoient souvent dans les assemblées de la nation ; & enfin, parce que, comme il étoit de l’intérêt des nobles d’en avoir, il étoit aussi de l’intérêt du roi de leur en donner. Ces familles étoient distinguées par leur dignité de fideles, & par la prérogative de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai voir, dans le livre suivant [23] , comment, par les circonstances des temps, il y [IV-122] eut des hommes libres qui furent admis à jouir de cette grande prérogative, & par conséquent à entrer dans l’ordre de la noblesse. Cela n’étoit point ainsi du temps de Gontran & de Childebert son neveu ; & cela étoit ainsi du temps de Charlemagne. Mais quoique, dès le temps de ce prince, les hommes libres ne fussent pas incapables de posséder des fiefs, il paroît, par le passage de Tégan rapporté ci-dessus, que les serfs affranchis en étoient absolument exclus. M. l’abbé Dubos [24] , qui va en Turquie pour nous donner une idée de ce qu’étoit l’ancienne noblesse Françoise, nous dira-t-il qu’on se soit jamais plaint en Turquie de ce qu’on y élevoit aux honneurs & aux dignités des gens de basse naissance, comme on s’en plaignoit sous les regnes de Louis le débonnaire & de Charles le chauve ? On ne s’en plaignoit pas du temps de Charlemagne, parce que ce prince distingua toujours les anciennes familles d’avec les nouvelles ; ce que Louis le débonnaire & Charles le chauve ne firent pas.
[IV-123]
Le public ne doit pas oublier qu’il est redevable à M. l’abbé Dubos de plusieurs compositions excellentes. C’est sur ces beaux ouvrages qu’il doit le juger, & non pas sur celui-ci. M. l’abbé Dubos y est tombé dans de grandes fautes, parce qu’il a plus eu devant les yeux M. le comte de Boulainvilliers, que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes critiques que cette réflexion : Si ce grand homme a erré, que ne dois-je pas craindre ?
-
[↑] Voyez l’établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 304.
-
[↑] Il cite le titre 44 de cette loi, & la loi des Ripuaires, titres 7 & 36.
-
[↑] Qui in truste dominicâ est, tit. 44, §. 4 ; & cela se rapporte à la formule 13 de Marculfe, de regis antrustione. Voyez aussi le titre 66 de la loi salique, §. 3 & 4 ; & le titre 74 ; & la loi des Ripuaires, tit. 11, & le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum, de l’an 877, chap. xx.
-
[↑] Loi salique, tit. 44, §. 6.
-
[↑] Ibid. §. 4.
-
[↑] Lois salique, §. I.
-
[↑] Ibid. tit. 44, §. 15.
-
[↑] Ibid. §. 7.
-
[↑] Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvere ; de mediocribus personis ingenius, tàm Burgundionibus quàm Romonis, si dens excussus suerit, decem solidis componatur ; dei serioribus personis, quinque solidos : art. I, 2 & 3, du tit. 26 de la loi des Bourguignons.
-
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv & v.
-
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, tome III, chap. v, pages 319 320.
-
[↑] Ibid. liv. VI, chap. iv, pages 307 & 308.
-
[↑] Ibid. page 309 ; & au chap. suivant pages 319 & 320.
-
[↑] Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, chap. xxviii, & livre XXXI, chap. viii
-
[↑] Itaque colonia convenit & ità bannivimus, ut uousquisque judex criminosum latronem ut audierit, ad casem suam ambulet, & ipsum ligare faciat : ità ut, si Francus sucrit, ad nostram præsentiam dirigatuer, & si debilior persona suerit, in loco pendatur. Capitulaires de l’édition de Baluze¸tome I, page 19.
-
[↑] Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage, chap. xxviii ; & le livre XXXI, chap. viii
-
[↑] Chap. xliii & xliv.
-
[↑] O qualem remunerationem reddidisti ei ! Fecit se liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem, ibid.
-
[↑] Etablissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 316.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, liv. VI, chap. iv, page 316.
-
[↑] Omnes episcopi molesti surerunt Ludovico, & maximè ii quos è servili conditione honoratos habebat, cum his qui es barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. De gestis Ludovici Pii, chap. xliii & xliv.
-
[↑] Chap. xxiii.
-
[↑] Histoire de l’établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 302.
[IV-124]
LIVRE XXXI.
Théorie des Lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu’elles ont avec les révolutions de leur monarchie.↩
CHAPITRE PREMIER.
Changemens dans les offices & les fiefs.
D’abord les comtes n’étoient envoyés dans leurs districts que pour un an ; bientôt ils acheterent la continuation de leurs offices. On en trouve un exemple dès le regne des petits-enfans de Clovis. Un certain Peonius [1] étoit comte dans la ville d’Auxerre ; il envoya son fils Mummolus porter de l’argent à Gontran, pour être continué dans son emploi ; le fils donna de l’argent pour lui-même, & obtint la place du pere. Les rois avoient déjà commencé à corrompre leurs propres graces.
[IV-125]
Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fussent amovibles, ils ne se donnoient pourtant, ni ne s’ôtoient d’une maniere capricieuse & arbitraire ; & c’étoient ordinairement une des principales choses qui se traitoient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glissa dans ce point, comme elle s’étoit glissée dans l’autre ; & que l’on continua la possession des fiefs pour de l’argent, comme on continuoit la possession des comtés.
Je ferai voir, dans la suite de ce livre [2] , qu’indépendamment des dons que les princes firent pour un temps, il y en eut d’autres qu’ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient été faits : cela mit un mécontentement général dans la nation, & l’on en vit bientôt naître cette révolution fameuse dans l’histoire de France, dont la premiere époque fut le spectacle étonnant du supplice de Brunehault.
Il paroît d’abord extraordinaire que cette reine, fille, sœur, mere de tant de rois, fameuse encore aujourd’hui [IV-126] par des ouvrages dignes d’un édile ou d’un proconsul Romain, née avec un génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avoient été si long-temps respectées, se soit vue tout-à-coup exposée à des supplices si longs, si honteux, si cruels [3] , par un roi [4] dont l’autorité étoit assez mal affermie dans sa nation, si elle n’étoit tombée, par quelque cause particuliere, dans la disgrace de cette nation. Clothaire lui reprocha la mort de dix rois [5] : mais il y en avoit deux qu’il fit lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut le crime du sort ou de la méchanceté d’une autre reine ; & une nation qui avoit laissé mourir Frédégonde dans son lit, qui s’étoit même opposée à la punition de ses épouvantables crimes [6] , devoit être bien froide sur ceux de Brunehault.
Elle fut mise sur un chameau, & on la promena dans toute l’armée ; marque certaine qu’elle étoit tombée dans la [IV-127] disgrace de cette armée. Frédégaire dit que Protaire [7] , favori de Brunehault, prenoit le bien des seigneurs, & en gorgeoit le fisc, qu’il humilioit la noblesse, & que personne ne pouvoit être sûr de garder le poste qu’il avoit. L’armée conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente ; & Brunehault, soit par les vengeances [8] quelle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse à la nation [9] .
Clotaire ambitieux de régner seul, & plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les enfans de Brunehault avoient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même ; & soit qu’il fût mal-habile, ou qu’il fût forcé par les circonstances, il se rendit accusateur de Brunehault, & fit faire de cette reine un exemple terrible.
Warnachaire avoit été l’ame de la [IV-128] conjuration contre Brunehaut ; il fut fait maire de Bourgogne ; il exigea [10] de Clotaire qu’il ne seroit jamais déplacé pendant sa vie. Par-là le maire ne put plus être dans le cas où avoient été les seigneurs François ; & cette autorité commença à se rendre indépendante de l’autorité royale.
C’étoit la funeste régence de Brunehault qui avoit sur-tout effarouché la nation. Tandis que les lois subsisterent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu’on lui ôtoit un fief, puisque la loi ne lui donnoit pas pour toujours : mais quand l’avarice, les mauvaises pratiques, la corruption firent donner des fiefs, on se plaignit de ce qu’on étoit privé par de mauvaises voies des choses que souvent on avoit acquises de même. Peut-être que, si le bien public avoit été le motif de la révocation des dons, on n’auroit rien dit : mais on montroit l’ordre, sans cacher la corruption ; on réclamoit le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisie ; les dons ne furent plus la [IV-129] récompense ou l’espérance des services. Brunehault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abus de la corruption ancienne. Ses caprices n’étoient point ceux d’un esprit foible : les leudes & les grands officiers se crurent perdus ; ils la perdirent.
Il s’en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces temps-là ; & les faiseurs de chroniques, qui savoient à peu près de l’histoire de leur temps ce que les villageois savent aujourd’hui de celle du nôtre, sont très-stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée [11] dans le concile de Paris, pour la réformation des abus [12] , qui fait voir que ce prince fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la révolution. D’un côté, il y confirme tous les dons [13] qui avoient été faits ou confirmés par les rois ses prédécesseurs ; & il ordonne [14] de [IV-130] l’autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fideles leur soit rendu.
Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile ; il voulut que ce qui avoit été fait contre les privileges des ecclésiastiques fût corrigé [15] : il modéra l’influence de la cour dans les élections aux évêchés [16] . Le roi réforma de même les affaires fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés [17] ; qu’on ne levât [18] aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert & Chilpéric ; c’est-à-dire, qu’il supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de Frédégonde & de Brunehault : il défendit que ses troupeaux [19] fussent menés dans les forêts des particuliers : & nous allons voir tout à l’heure que la réforme fut encore plus générale, & s’étendit aux affaires civiles.
-
[↑] Grégoire de Tours, liv. IV, chap. xlii.
-
[↑] Chap. vii.
-
[↑] Chronique de Frédégaire, chap. xlii.
-
[↑] Clothaire II, fils de Chilperic, & pere de Dagobert.
-
[↑] Chronique de Frédégaire, chap. xlii.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. VIII, chapitre xxxi.
-
[↑] Sæva illi suit contra personas iniquitas, sisco nimiùm tribuens, de rebus personarum ingeniosè fiscum vellens implere… ut nullus reperiretus qui gradum quam arripuerat potuisset adsumere. Chronique de Frédégaire, ch. xxvii, sur l’an 605.
-
[↑] Ibid. chap. xxviii, sur l’an 607.
-
[↑] Ibid. ch. xli, sur l’an 613. Burgundiæ farones, tàm episcopi quàm cæteri leudes, timentes Brunichildem & odium in eom habentes, consilium intentes, &c.
-
[↑] Chronique de Frédégaire, ch. xlii, sur l’an 613. Sacramento à Clotario accepto ne unquàm vitæ suæ teomporitus degradaretur.
-
[↑] Quelque temps après le supplice de Brunehault, l’an 615. Voyez l’édition des capitulaires de Baluze, p. 21.
-
[↑] Quæ contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne inantea, quod avertat divinitas, contingant, disposucrimus, Christo præsule, per hujus edicti tenorem generaliter emendare. In proœmio, ibid. art. 16.
-
[↑] Ibid. art. 16.
-
[↑] Ibid. art. 17.
-
[↑] Et quod per tempora ex hoc prætermissum est vet dehine perpetualiter observetur.
-
[↑] Ità ut episcopo decedente, in loco ipsius qui à metropolitano ordinari debet cum principalibus, à clero & populo eligatur ; & si persona condigna suerit, per ordinationem principis ordinetur ; vel certè si de palatio eligitur, per meritum personæ & doctrinæ irdinetur. Ibid. art. I.
-
[↑] Ut ubicumque census novus impiè additus est, emendetur, art. 8.
-
[↑] Ibid. art. 9.
-
[↑] Ibid. art. 21.
[IV-131]
CHAPITRE II.
Comment le gouvernement civil fut réformé.
On avoit vu jusqu’ici la nation donner des marques d’impatiens & de légéreté sur le choix ou sur la conduite de ses maîtres ; on l’avoit vu régler les différents de ses maîtres entr’eux, & leur imposer la nécessité de la paix. Mais ce qu’on n’avoit pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jeta les yeux sur sa situation actuelle ; elle examina ses lois de sang froid ; elle pourvut à leur insuffisance ; elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir.
Les régences mâles, hardies & insolentes de Frédégonde & de Brunehault, avoient moins étonné cette nation, qu’elles ne l’avoient avertie. Frédégonde avoit défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avoit justifié le poison & les assassinats par le poison & les assassinats ; elle s’étoit conduite de maniere que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics. Frédégonde fit plus de maux, [IV-132] Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal, elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci étoit encore plus corrompu que l’autre ; & cette corruption étoit d’autant plus dangereuse, qu’elle étoit plus ancienne, & tenoit plus en quelque sorte à l’abus des mœurs qu’à l’abus des lois.
L’histoire de Grégoire de Tours, & les autres monumens nous font voir, d’un côté, une nation féroce & barbare ; & de l’autre, des rois qui ne l’étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes & cruels, parce que toute la nation l’étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables : les églises se défendirent contr’eux par les miracles & les prodiges de leurs saints. Les rois n’étoient point sacrileges, parce qu’ils redoutoient les peines des sacrileges : mais d’ailleurs ils commirent, ou par colere, ou de sang froid, toutes sortes de crimes & d’injustices, parce que ces crimes & ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si [IV-133] présente. Les Francs, comme j’ai dit, souffroient des rois meurtriers, parce qu’ils étoient meurtriers eux-mêmes ; ils n’étoient point frappés des injustices & des rapines de leurs rois, parce qu’ils étoient ravisseurs & injustes comme eux. Il y avoit bien des lois établies ; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres, appellées préceptions [1] , qui renversoient ces mêmes lois : c’étoient à peu près comme les rescrits des empereurs Romains, soit que les rois eussent pris d’eux cet usage, soit qu’ils l’eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours, qu’il faisoient des meurtres de sang-froid, & faisoient mourir des accusés qui n’avoient pas seulement été entendus ; ils donnoient des préceptions [2] pour faire des mariages illicites ; ils en donnoient pour transporter les successions ; ils en donnoient pour ôter le droit des parens ; ils en [IV-134] donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, de lois de leur seul mouvement ; mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.
L’édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne [3] ne put plus être condamné sans être entendu ; les parens durent [4] toujours succéder selon l’ordre établi par la loi ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles [5] , & on punit sévérement ceux qui les obtinrent, & en firent usage. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret & les deux suivans n’avoient péri par le temps. Nous n’avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution [6] du même prince, qui [IV-135] se rapporte à son édit, & corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.
Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, & sans le nom du lieu où elle a été donnée, l’a attribuée à Clotaire I. Elle est de Clotaire II. J’en donnerai trois raisons.
1.o Il y est dit que le roi conservera les immunités [7] accordées aux églises par son pere & son aïeul. Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Childéric, aïeul de Clotaire I, lui qui n’étoit pas chrétien, & qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée ? Mais si l’on attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I lui-même, quit fit des dons immenses aux églises, pour expier la mort de son fils Cramne, qu’il avoit fait brûler avec sa femme & ses enfans.
2.o Les abus que cette constitution corrige subsisterent après la mort de Clotaire I, & furent même portés à leur comble pendant la foiblesse du regne de [IV-136] Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric, & les détestables régences de Frédégonde & de Brunehault. Or comment la nation auroit-elle pu souffrir des griefs si solennellement proscrits, sans s’être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs ? Comme n’auroit-elle pas fait pour lors ce qu’elle fit lorsque Chilpéric II [8] ayant repris les anciennes violences, elle le pressa [9] d’ordonner que, dans les jugemens, on suivît la loi & les coutumes, comme on faisoit anciennement ?
Enfin, cette constitution faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire I ; puisqu’il n’y avoit point sous son regne de plaintes dans le royaume à cet égard, & que son autorité y étoit très-affermie, sur-tout dans le temps où l’on place cette constitution ; au lieu qu’elle convient très-bien aux événemens qui arriverent sous le regne de Clotaire II, qui causerent une révolution dans l’état politique du royaume. Il faut éclairer l’histoire par les lois, & les lois par l’histoire.
-
[↑] C’étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire ou souffrir de certaines choses contre la loi.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. IV, page 227. L’histoire & les chartres sont pleines de ceci : & l’étendue de ces abus paroît sur-tout dans l’édit de Clotaire II, de l’an 615, donné pour les réformer. Voyez les capitulaires, édition de Baluze, tome I, page 22.
-
[↑] Art. 22.
-
[↑] Ibid. art. 6.
-
[↑] Ibid. art. 18.
-
[↑] Dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, page 7.
-
[↑] J’ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des concessions de droits de justice, & qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, & étoient équivalentes à l’érection ou concession d’un fief.
-
[↑] Il commença à régner vers l’an 670.
-
[↑] Voyez la vie de S. Léger.
[IV-137]
CHAPITRE III.
Autorité des Maires du Palais.
J’ai dit que Clotaire II s’étoit engagé à ne point ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa vie. La révolution eut un autre effet. Avant ce temps, le maire étoit le maire du roi, il devint le maire du royaume ; le roi le choisissoit, la nation le choisit. Protaire, avant la révolution, avoit été fait maire par Théodoric [1] , & Landéric par Frédégonde [2] ; mais depuis, la nation fut en possession d’élire [3] .
Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques Auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avoient cette dignité avant la mort de Brunehault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit, par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de [IV-138] maire n’étoit point une des premieres de l’état [4] ; elle ne fut pas non plus une des plus éminentes [5] chez les premiers rois Francs.
Clotaire rassura ceux qui possédoient des charges & des fiefs ; & après la mort de Warnachaire, ce prince [6] ayant demandé aux seigneurs assemblés à Troies, qui ils vouloient mettre en sa place, ils s’écrierent tous qu’ils n’éliroient point ; & lui demandant sa faveur, ils se mirent entre ses mains.
Dagobert réunit, comme son pere, toute la monarchie : la nation se reposa sur lui, & ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté ; & rassuré d’ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunehault. Mais cela lui réussit si mal, que les leudes d’Austrasie se laisserent [7] battre par les Sclavons, [IV-139] s’en retournerent chez eux, & les marches de l’Austrasie furent en proie aux Barbares.
Il prit le parti d’offrir aux Austrasiens de céder l’Austrasie à son fils Sigebert, avec un trésor, & de mettre le gouvernement du royaume & du palais entre les mains de Cunibert, évêque de Cologne, & du duc Adalgise. Frédégaire n’entre point dans le détail des conventions qui furent faites pour lors : mais le roi les confirma toutes par ses chartres, & d’abord [8] l’Austrasie fut mise hors de danger.
Dagobert se sentant mourir, recommanda à Æga, sa femme Nentechulde, & son fils Clovis. Les leudes de Neustrie & de Bourgogne [9] choisirent ce jeune prince pour leur roi. Æga & Nentechilde gouvernerent le palais [10] ; ils rendirent [11] tous les biens que Dagobert avoit pris ; & les plaintes cesserent en [IV-140] Neustrie & en Bourgogne, comme elles avoient cessé en Austrasie.
Après la mort d’Æga, la reine Nentechilde [12] engagea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire. Celui-ci envoya aux évêques & aux principaux seigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettoit de leur conserver pour toujours [13] , c’est-à-dire pendant leur vie, leurs honneurs & leurs dignités. Il confirma sa parole par un serment. C’est ici [14] que l’auteur du livre des maires de la maison royale met le commencement de l’administration du royaume par des maires du palais.
Frédégaire, qui étoit Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui regarde les maires de Bourgogne dans le temps de la révolution dont nous parlons, que sur les maires d’Austrasie & de Neustrie ; mais les [IV-141] conventions qui furent faites en Bourgogne, furent, par les mêmes raisons, faites en Neustrie & en Austrasie.
La nation crut qu’il étoit plus sûr de mettre la puissance entre les mains d’un maire qu’elle élisoit, & à qui elle pouvoit imposer des conditions, qu’entre celles d’un roi dont le pouvoir étoit héréditaire.
-
[↑] Instigante Brunichilde, Theoderico jubente, &c. Frédégaire, ch. xxvii, sur l’an 605.
-
[↑] Gesta regum Francorum, ch. xxxvi.
-
[↑] Voyez Frédégaire, chronique, ch. liv, sur l’an 626 ; & son continuateur anonyme, ch. ci, sur l’an 695 ; & ch. cv, sur la 715. A. moin, liv. IV, ch. xv. Eginhard, vie de Charlemagne, ch. xlviii. Gesta regum Froncorum, ch. xlv.
-
[↑] Voyez la loi des Bourguignons, in præsat. & le second supplément à cette loi, tit. 13.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. IX, ch. xxxvi.
-
[↑] Eo anno, Clotarius cum proceribus & leudibus Burgundiæ Trecossinis conjungitur : cùm eorum esset sollicitus, si vellent jàm, Warnachario discesso, alium is ejus honoris gradum sublimare : sed omnes unanimiter denegantes se nequaquàm velle majorem domûs eligere, regis gratiam obnixè perentes, cum rege transegère. Chronique de Frédégaire, ch. liv, sur l’an 626.
-
[↑] Istam victorium quam Vinidi cortra Francos nesuerent non tantùm Sclarinorum fortitudo obsinuit, quantùm dementation Austrosiorum, dùm se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse, & ossiduè expoliarentur. Chron. de Frédégaire, ch. lxviii, sur l’an 630.
-
[↑] Deinceps Austrasii eorum studio limitem & regnum Francorum contra Vinidos utiliter desensasse noscuntur. Ibid. ch. lxxv, sur l’an 632.
-
[↑] Ibid. ch. lxxix, sur l’an 638.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid. ch. lxxx, sur l’an 639.
-
[↑] Chronique de Frédégaire, chap. lxxxix, sur l’an 641.
-
[↑] Ibid. Floachatus cunctis ducibus à regno Burgundiæ, seu & pontificibus, per epistolam etiam & sacramentis firmavit unicuique gradum honoris & dignitatem, seu & amicitiam, perpetuò conservare.
-
[↑] Deinceps à temporibus Clodovci qui suit filiusDagoberti inclyti regis, pater verò Theoderici, regnum Francorum decidens per majores domûs cœpit ordinari. De majoribus domûs regiæ.
[IV-141]
CHAPITRE IV.
Quel étoit, à l’égard des Maires, le génie de la nation.
Un gouvernement, dans lequel une nation qui avoit un roi élisoit celui qui devoit exercer la puissance royale, paroît bien extraordinaire : mais, indépendamment des circonstances où l’on se trouvoit, je crois que les Francs tiroient à cet égard leurs idées de bien loin.
Ils étoient descendus des Germains, dont Tacite [1] dit que dans le choix de leur roi, ils se déterminoient par sa noblesse ; & dans le choix de leur chef [IV-142] par sa vertu. Voilà les rois de la premiere race, & les maires du palais ; les premiers étoient héréditaires ; les seconds étoient électifs.
On ne peut douter que ces princes, qui, dans l’assemblée de la nation, se levoient, & se proposoient pour chefs de quelqu’entreprise à tous ceux qui voudroient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, & l’autorité du roi & la puissance du maire. Leur noblesse leur avoit donné la royauté ; & leur vertu, les faisant suivre par plusieurs volontaires qui les prenoient pour chef, leur donnoit la puissance du maire. C’est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux & des assemblées, & donnerent des lois du consentement de ces assemblées : c’est par la dignité de duc ou de chef qu’ils firent leurs expéditions, & commanderent leurs armées.
Pour connoître le génie des premiers Francs à cet égard, il n’y a qu’à jeter les yeux sur la conduite [2] que tint Arbogaste, Franc de nation, à qui Valentinien [IV-143] avoit donné le commandement de l’armée. Il enferma l’empereur dans le palais ; il ne permit à qui que ce fût de lui parler d’aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste fit pour lors ce que les Pépins firent depuis.
-
[↑] Reges ex noblilitate, duces ex virtute sumunt. De morib. Germ.
-
[↑] Voyez Sulpicius Alexander, dans Grégoire de Tours, liv. II.
[IV-143]
CHAPITRE V.
Comment les Maires obtinrent le commandement des armées.
Pendant que les rois commanderent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un chef. Clovis & ses quatre fils furent à la tête des François, & les menerent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théodébert, prince jeune, foible & malade, fut le premier [1] des rois qui resta dans son palais. Il refusa de faire une expédition en Italie contre Narsès, & il eut le chagrin [2] de voir les Francs se choisir deux chefs qui les y menerent. Des quatre enfans de [IV-144] Clotaire I, Gontran [3] fut celui qui négligea le plus de commander les armées : d’autres rois suivirent cet exemple : Et pour remettre, sans péril, le commandement en d’autres mains, ils le donnerent à plusieurs chefs ou ducs [4] .
On en vit naître des inconvéniens sans nombre : il n’y eut plus de discipline, on ne sut plus obéir ; les armées ne furent plus funestes qu’à leur propre pays ; elles étoient chargées de dépouilles avant d’arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture [5] de tous ces maux. « Comment pourrons-nous obtenir la victoire, disoit Gontran [6] , nous qui ne conservons pas ce que nos peres ont acquis ? notre nation n’est plus la même… » Chose singuliere ! elle [IV-145] étoit dans la décadence dès le temps des petits-fils de Clovis.
Il étoit donc naturel qu’on en vînt à faire un duc unique ; un duc qui eût de l’autorité sur cette multitude infinie de seigneurs & de leudes qui ne connoissoient plus leurs engagemens ; un duc qui rétablît la discipline militaire, & qui menât contre l’ennemi une nation qui ne savoit plus faire la guerre qu’à elle-même. On donna la puissance aux maires du palais.
La premiere fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment [7] avec d’autres officiers, le gouvernement politique des fiefs ; & à la fin, ils en disposerent seuls. Ils eurent aussi l’administration des affaires de la guerre & le commandement des armées ; & ces deux fonctions se trouverent nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces temps-là il étoit plus difficile d’assembler les armées que de les commander : & quel autre que celui qui disposoit des graces, pouvoit avoir [IV-146] cette autorité ? Dans cette nation indépendante & guerriere, il falloit plutôt inviter que contraindre ; il falloit donner ou faire espérer les fiefs qui vaquoient par la mort du possesseur, récompenser sans cesse, faire craindre les préférences : celui qui avoit la surintendance du palais, devoit donc être le général de l’armée.
-
[↑] L’an 552.
-
[↑] Meutheris verò & Butilinus, tametsi id regi ipsorum minimè placebat, belii cum eis societatem inierunt. Agathias, liv. I. Grégoire de Tours, liv. IV, ch. ix.
-
[↑] Gontran ne fit pas même l’expédition contre Gondovalde, qui se disoit fils de Clotaire, & demandoit sa part du royaume.
-
[↑] Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, chap. xxvii ; liv. VIII, chap. xviii & xxx ; liv. X, chap. iii. Dagobert, qui n’avoir point de maire en Bourgogne, eut la même politique, & envoya contre les Gascons dix ducs & plusieurs comtes qui n’avoient point de ducs sur eux. Chronique de Frédégaire, ch. lxxviii, sur l’an 636.
-
[↑] Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. xxx ; & liv. X. ch. iii. Ibid. liv. VIII, ch. xxx.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons, tit. 13 ; & Grégoire de Tours, livre IX. ch. xxxvi.
[IV-146]
CHAPITRE VI.
Seconde époque de l’abaissement des Rois de la premiere race.
Depuis le supplice de Brunehault, les maires avoient été administrateurs du royaume sous les rois ; & quoiqu’ils eussent la conduite de la guerre, les rois étoient pourtant à la tête des armées, & le maire & la nation combattoient sous eux. Mais la victoire du duc Pépin [1] sur Théodéric & son maire, acheva de dégrader les rois [2] ; celle que remporta Charles Martel [3] sur Chilpéric & son maire Rainfroy, [IV-147] confirma cette dégradation. L’Austrasie triompha deux fois de la Neustrie & de la Bourgogne ; & la mairerie d’Austrasie étant comme attachée à la famille des Pépins, cette mairerie s’éleva sur toutes les autres maireries, & cette maison sur toutes les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelqu’homme accrédité ne se saisît de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent dans une maison royale, comme dans une espece de prison [4] . Une fois chaque année, ils étoient montrés au peuple. Là ils faisoient des ordonnances [5] , mais c’étoient celles du maire : ils répondoient aux ambassadeurs, mais c’étoient les réponses du maire. C’est dans ce temps que les historiens [6] nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étoient assujettis.
[IV-148]
Le délire de la nation pour la famille de Pépin alla si loin, qu’elle élut pour maire un de ses petits-fils qui étoit encore dans l’enfance [7] ; elle l’établit sur un certain Dagobert, & mit un fantôme sur un fantôme.
-
[↑] Voyez les annales de Metz, sur l’an 687 & 688.
-
[↑] Iliis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium, &c. Ibid. sur l’an 695.
-
[↑] Ibid. sur l’an 719.
-
[↑] Sedemque illi regalem sub suâ ditione concessit. Annales de Metz, sur l’an 719.
-
[↑] Ex chronico Centulensi, lib. II. Ut responsa quæ erat edoctus, vel potiùs jussus, ex suâ velut potestate redderet.
-
[↑] Annales de Metz, sur l’an 691. Anno principatûs Pippini super Theodericum… Annales de Fulde ou de Louvishan. Pippinus dux Francorum obtinuis regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjedis.
-
[↑] Posthæc Theudoaldus, filius ejus (Grimoaldi) parvulus in loco ipsius, cum prædicto rege Dagoberto, major domûs palatii effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur l’an 714, ch. civ.
[IV-148]
CHAPITRE VII.
Des grands offices & des fiefs, sous les Maires du Palais.
Les maires du palais n’eurent garde de rétablir la movibilité des charges & des offices ; ils ne régnoient que par la protection qu’ils accordoient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuerent à être donnés pour la vie, & cet usage se confirma de plus en plus.
Mais j’ai des réflexions particulieres à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n’eussent été rendus héréditaires.
Dans le traité d’Andeli [1] , Gontran, [IV-149] & son neveu Childebert, s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes & aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; & il est permis aux reines [2] , aux filles, aux veuves des rois, de disposer, par testament & pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc.
Marculse écrivoit ses formules du temps des maires [3] . On en voit plusieurs [4] où les rois donnent à la personne & aux héritiers : & comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la premiere race, une partie des fiefs passoit déjà aux héritiers. Il s’en falloit bien que l’on eût, dans ces temps-là, l’idée d’un domaine inaliénable ; c’est une chose très-moderne, & qu’on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.
On verra bientôt sur cela des preuves de fait : & si je montre un temps [IV-150] où il se trouva plus de bénéfices pour l’armée, ni aucun fonds pour son entretien ; il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avoient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel, qui fonda de nouveaux fiefs, qu’il faut bien distinguer des premiers.
Lorsque les rois commencerent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse ; il étoit naturel qu’ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de chose ; renoncer aux grands offices, c’étoit perdre la puissance même.
-
[↑] Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi l’édit de Clotaire II, de l’an 615, art. 16.
-
[↑] Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint, fixâ stabilitate perpetuò conservetur.
-
[↑] Voyez la 24 & la 34 du livre I.
-
[↑] Voyez la formule 14 du livre I, qui s’applique également à des biens fiscaux donnés directemenr pour toujours, ou donnés d’abord en bénéfice, & ensuite pour toujours : Sicut ab illo aut à fisco nostro suit possessa. Voyez aussi la formule 17, ibid.
[IV-151]
CHAPITRE VIII.
Comment les alleux furent changés en fiefs.
La maniere de changer un alleu en fief se trouve dans une formule de Marculfe [1] . On donnoit sa terre au roi ; il la rendoit au donateur en usufruit ou bénéfice, & celui-ci désignoit au roi ses héritiers.
Pour découvrir les raisons que l’on eut de dénaturer ainsi son alleu, il faut que je cherche, comme dans des abymes, les anciennes prérogatives de cette noblesse, qui depuis onze siecles est couverte de poussiere, de sang & de sueur.
Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très-grands avantages. La composition pour les torts qu’on leur faisoit étoit plus forte que celle des hommes libres. Il paroît par les formules de Marculfe, que c’étoit un privilege du vassal du roi, que celui qui le tueroit payeroit six cents sous de composition. Ce privilege étoit établi par la loi [IV-152] salique [2] & par celle des Ripuaires [3] ; &, pendant que ces deux lois ordonnoient six cents sous pour la mort du vassal du roi, elles n’en donnoient [4] que deux cents pour la mort d’un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; & que cent pour celle d’un Romain.
Ce n’étoit pas le seul privilege qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que, quand un homme [5] étoit cité en jugement, & qu’il ne se présentoit point ou n’obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appellé devant le roi ; & s’il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi [6] , & personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il étoit d’une condition ordinaire, ses biens étoient confisqués [7] ; mais, s’il étoit vassal du roi, ils ne l’étoient pas [8] . Le premier, par sa contumace, étoit [IV-153] censé convaincu du crime ; & non pas le second. Celui-là [9] , dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l’eau bouillante ; celui-ci [10] n’y étoit condamné que dans le cas du meurtre. En un vassal du roi [11] ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privileges augmenterent toujours ; & le capitulaire de Carloman [12] fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s’étoit pas rendu à l’armée, sa peine étoit de s’abstenir de chair & de vin, autant de temps qu’il avoit manqué au service : mais l’homme libre [13] , qui n’avoit pas suivi le comte, payoit une composition [14] de soixante sous, & étoit mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée.
Il est donc aisé de penser que les Francs qui n’étoient point vassaux du [IV-154] roi, & encore plus les Romains, chercherent à le devenir ; & qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l’usage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui en fief, & de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours ; & il eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d’un protecteur, & vouloit faire corps [15] avec d’autres seigneurs ; & entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, parce qu’on n’avoit plus la monarchie politique.
Ceci continua dans la troisieme race, comme on le voit par plusieurs [16] chartres ; soit qu’on donnât son alleu, & qu’on le reprît par le même acte ; soit qu’on le déclarât alleu, & qu’on le reconnût en fief. On appelloit ces fiefs, fiefs de reprise.
Cela ne signifie par que ceux qui avoient des fiefs les gouvernassent en bons peres de familles ; &, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à [IV-155] avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de biens comme on administre aujourd’hui les usufruits. C’est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, bien des réglemens [17] , pour empêcher qu’on ne dégradât les fiefs en faveurs de ses propriétés. Cela prouve seulement que de son temps, la plupart des bénéfices étoient encore à vie ; & que, par conséquent, on prenoit plus de soin des alleus que des bénéfices : mais cela n’empêche pas que l’on n’aimât encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particuliere d’un fief ; mais on ne vouloit pas perdre sa dignité même.
Je sais bien encore que Charlemagne se plaint, dans un capitulaire [18] , que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Mais je ne dis point qu’on n’aimât mieux une propriété qu’un usufruit : Je dis seulement que, lorsqu’on pouvoit [IV-156] faire d’un alleu un fief qui passât aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j’ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.
-
[↑] Liv. I, formule 13.
-
[↑] Tit. 44. Voyez aussi les titres 66, §. 3 & 4 ; & le titre 74.
-
[↑] Titre II.
-
[↑] Voyez la loi des Ripuaires, tit. 7 ; & la loi salique, tit. 44, art. I & 4.
-
[↑] Loi salique, tit. 59 & 76.>
-
[↑] Extrà sermonem regis, loi salique, tit. 59 & 76.
-
[↑] Ibid. tit. 59, §. I.
-
[↑] Ibid. tit. 76, §. I.
-
[↑] Loi salique, tit. 56 & 59.
-
[↑] Ibid. tit. 76, §. I.
-
[↑] Ibid. tit. 76, §. 2.
-
[↑] Apud vernis palatium, de l’an 883, art. 4 & II.
-
[↑] Capitul. de Charlemagne, qui est le second de l’an 812, art. I & 3.
-
[↑] Heribannum.
-
[↑] Non infirmis reliquit hæredibus, dit Lambert d’Ardres, dans du Cange, au mot alodis.
-
[↑] Voyez celles que du Cange cite au mot alodis ; & celles que rapporte Galland, traité du franc alleu, page 14 & suiv.
-
[↑] Capitulaire II, de l’an 802, art. 10 ; & le capitul. vii de l’an 803, art. 3 ; & le capitulaire I, incerti anni, art. 49 ; & le capitul. de l’an 806, art. 7.
-
[↑] Le cinquieme de l’an 806, art. 8.
[IV-156]
CHAPITRE IX.
Comment les biens ecclésiastiques furent convertis en fiefs.
Les biens fiscaux n’auroient dû avoir d’autre destination que de servir aux dons que les rois pouvoient faire pour inviter les Francs à de nouvelles entreprises, lesquelles augmentoient d’un autre côté les biens fiscaux ; & cela étoit, comme j’ai dit, l’esprit de la nation : mais les dons prirent un autre cours. Nous avons un discours [1] de Chilpéric, petit-fils de Clovis, qui se plaignoit déjà que ces biens avoient été presque tous donnés aux églises. « Notre fisc est devenu pauvre, disoit-il ; nos richesses ont été transportées aux églises [2] : Il n’y a plus que les évêques [IV-157] qui regnent ; ils sont dans la grandeur, & nous n’y sommes plus ».
Cela fit que les maires, qui n’osoient attaquer les seigneurs, dépouillerent les églises : & une des raisons qu’allégua Pépin pour entrer en Neustrie [3] , fut qu’il y avoit été invité par les ecclésiastiques, pour arrêter les entreprises des rois, c’est-à-dire des maires, qui privoient l’église de tous ses biens.
Les maires d’Austrasie, c’est-à-dire, la maison des Pépins, avoit traité l’église avec plus de modération qu’on n’avoit fait en Neustrie & en Bourgogne ; & cela est bien clair par nos chroniques [4] , où les moines ne peuvent se lasser d’admirer la dévotion & la libéralité des Pépins. Ils avoient occupé eux-mêmes les premieres places de l’église. « Un corbeau ne creve pas les yeux à un corbeau », comme disoit Chilpéric aux évêques [5] .
Pépin soumit la Neustrie & la Bourgogne : mais ayant pris, pour détruire [IV-158] les maires & les rois, le prétexte de l’oppression des églises, il ne pouvoit plus les dépouiller, sans contredire son titre, & faire voir qu’il se jouoit de la nation. Mais la conquête de deux grands royaumes & la destruction du parti opposé, lui fournirent assez de moyens de contenter ses capitaines.
Pépin se rendit maître de la monarchie, en protégeant le clergé : Charles Martel son fils ne put se maintenir qu’en l’opprimant. Ce prince, voyant qu’une partie des biens royaux & des biens fiscaux avoient été donnés à vie ou en propriété à la noblesse ; & que le clergé, recevant des mains des riches & des pauvres, avoit acquis une grande partie des allodiaux même ; il dépouilla les églises : & les fiefs du premier partage ne subsistant plus, il forma [6] une seconde fois des fiefs. Il prit, pour lui & pour ses capitaines, les biens des églises & les églises mêmes : & fit cesser un abus qui, à la différence des maux ordinaires, étoit d’autant plus facile à guérir, qu’il étoit extrême.
-
[↑] Dans Grégoire de Tours, liv. I, chap. xlvi.
-
[↑] Cela fit qu’il annulla les testamens faits en faveur des églises, & fit même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liv. VII, ch. vii.
-
[↑] Voyez les annales de Metz, sur l’an 687. Excitor imprimis querelis sacerdotum & servorum Dei, qui me sœpiùs adierunt, ut pro sublatis injustè patrimoniis, &c.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Dans Grégoire de Tours.
-
[↑] Karolus plurima juri ecclesiastico detrahens, prœdia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit, ex chronico Centulensi, liv. II.
[IV-159]
CHAPITRE X.
Richesses du Clergé.
Le clergé recevoit tant, qu’il faut que, dans les trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais si les rois, la noblesse & le peuple trouverent le moyen de leur donner tous leurs biens, ils ne trouverent pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder les églises dans la premiere race : mais l’esprit militaire les fit donner aux gens de guerre, qui les partagerent à leurs enfans : Combien ne sortit-il pas de terres de la mense du clergé ! Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains, & firent encore d’immenses libéralités ; les Normands arrivent, pillent & ravagent ; persécutent sur-tout les prêtres & les moines ; cherchent les abbayes ; regardent où ils trouveront quelque lieu religieux : car ils attribuoient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, & toutes les violences de Charlemagne, qui les avoit obligés les uns après les autres de se réfugier dans le nord. C’étoient des haines [IV-160] que quarante ou cinquante années n’avoient pu leur faire oublier. Dans cet état des choses, combien le clergé perdit-il de biens ! A peine y avoit-il des ecclésiastiques pour les redemander. Il resta donc encore à la piété de la troisieme race assez de fondations à faire, & de terres à donner : les opinions répandues & crues dans ces temps-là, auroient privé les laïques de tout leur bien, s’ils avoient été assez honnêtes gens. Mais, si les ecclésiastiques avoient de l’ambition, les laïques en avoient aussi : si le mourant donnoit, le successeur vouloit reprendre. On ne voit que querelles entre les seigneurs & les évêques, les gentilshommes & les abbés ; & il falloit qu’on pressât vivement les ecclésiastiques, puisqu’ils furent obligés de se mettre sous la protection de certains seigneurs, qui les défendoient pour un moment, & les opprimoient après.
Déjà une meilleure police, qui s’établissoit dans le cours de la troisieme race, permettoit aux ecclésiastiques d’augmenter leur bien. Les calvinistes parurent, & firent battre de la monnoie de tout ce qui se trouva d’or & d’argent dans les églises. Comment le [IV-161] clergé auroit-il été assuré de sa fortune ? Il ne l’étoit pas de son existence ; il traitoit des matieres de controverse, & l’on brûloit ses archives. Que servit-il de redemander à une noblesse, toujours ruinée, ce qu’elle n’avoit plus, ou ce qu’elle avoit hypothéqué de mille manieres ? Le clergé a toujours acquis, il a toujours rendu, & il acquiert encore.
[IV-161]
CHAPITRE XI.
État de l’Europe du temps de Charles Martel.
Charles Martel, qui entreprit de dépouiller le clergé, se trouva dans les circonstances les plus heureuses : il étoit craint & aimé des gens de guerre, & il travailloit pour eux ; il avoit le prétexte de ses guerres contre les Sarrasins [1] ; quelque haï qu’il fût du clergé, il n’en avoit aucun besoin ; le pape, à qui il étoit nécessaire, lui tendoit les bras : on sait la célebre ambassade [2] que lui envoya Grégoire III.
[IV-162] Ces deux puissances furent très-unies, parce qu’elles ne pouvoient se passer l’une de l’autre : le pape avoit besoin des Francs, pour le soutenir contre les Lombards & contre les Grecs : Charles Martel avoit besoin du pape pour humilier les Grecs, embarrasser les Lombards, se rendre plus respectable chez lui [3] , & accréditer les titres qu’il avoit, & ceux que lui ou ses enfans pourroient prendre. Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.
S. Eucher, Evêque d’Orléans, eut une vision qui étonna les princes. Il faut que je rapporte à ce sujet la lettre [4] que les évêques, assemblés à Rheims, écrivirent à Louis le Germanique, qui étoit entré dans les terres de Charles le Chauve ; parce qu’elle est très-propre à nous faire voir quel étoit, dans ces [IV-163] temps-là, l’état des choses, & la situation des esprits. Ils disent que [5] « S. Eucher ayant été ravi dans le ciel, il vit Charles Martel tourmenté dans l’enfer intérieur, par l’ordre des Saints qui doivent assister avec Jesus-Christ au jugement dernier ; qu’il avoit été condamné à cette peine avant le temps, pour avoir dépouillé les églises de leurs biens, & s’être par-là rendu coupable des péchés de tous ceux qui les avoient dotés ; que le roi Pépin fit tenir à ce sujet un concile ; qu’il fit rendre aux églises tout ce qu’il put retirer des biens ecclésiastiques ; que, comme il n’en put ravoir qu’une partie à cause de ses démêlés avec Vaifre duc d’Aquitaine, il fit faire, en faveur des églises, des lettres précaires du reste [6] ; & régla que les laïques payeroient une dîme des [IV-164] biens qu’ils tenoient des églises, & douze deniers pour chaque maison ; que Charlemagne ne donna point les biens de l’église ; qu’il fit au contraire, un capitulaire par lequel il s’engagea, pour lui & ses successeurs, de ne les donner jamais ; que tout ce qu’ils avancent est écrit ; & que même plusieurs d’entr’elles l’avoient entendu raconter à Louis le débonnaire, pere des deux rois. »
Le règlement du roi Pépin, dont parlent les évêques, fut fait dans le concile tenu à Leptines [7] . L’église y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d’une maniere précaire ; & que d’ailleurs, elle en recevoit la dîme, & douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c’étoit un remede palliatif, & le mal restoit toujours.
Cela même trouva de la contradiction, & Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire [8] , où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de [IV-165] payer cette dîme & cette redevance, & même d’entretenir les maisons de l’évêché ou du monastere, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne [9] renouvella les réglemens de Pépin.
Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui & ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince donné à Aix-la-Chapelle l’an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard : mais les donations déjà faites subsisterent toujours [10] . Les évêques ajoutent, & avec raison, que Louis le débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, & ne donna point les biens de l’église aux soldats.
[IV-166]
Cependant les anciens abus allerent si loin que, sous les enfans de Louis le débonnaire [11] , les laïques établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les chassoient, sans le consentement des évêques. Les églises se partageoient entre les héritiers [12] ; &, quand elles étoient tenues d’une maniere indécente, les évêques n’avoient d’autre ressource que d’en retirer les reliques [13] .
Le capitulaire [14] de Compiegne établit que l’envoyé du roi pourroit faire la visite de tous les monasteres avec l’évêque, de l’avis & en présence de celui qui le tenoit [15] ; & cette regle générale prouve que l’abus étoit général.
Ce n’est pas qu’on manquât de lois pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monasteres, ils écrivirent [16] à Charles [IV-167] le chauve, qu’ils n’avoient point été touchés de ce reproche, parce qu’ils n’en étoient pas coupable, & ils l’avertirent de ce qui avoit été promis, résolu & statué dans tant d’assemblées de la nation. Effectivement ils en citent neuf.
On disputoit toujours. Les Normands arriverent, & mirent tout le monde d’accord.
-
[↑] Voyez les annales de Metz.
-
[↑] Epistolam quoque, decreto Romanorum principum, sibi prædictus, prœsil Gregorius miserat, quòd sese populus Romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam defensionem & invictam clementiam convertere volusset. Annales de Metz sur l’an 741… Eo pacto patrato, ut à partibus imperatoris recederet. Frédégaine.
-
[↑] On peut voir dans les auteurs de ces temps-là, l’impression que l’autorité de tant de papes fit sur l’esprit des François. Quoique le roi Pépin eût déjà été couronné par l’archevêque de Mayenne, il regarda l’onction qu’il reçut du pape Etienne comme une chose qui le confirmoit dans tous ses droits.
-
[↑] Anno 858, epud Carisiacum, édit. de Baluze, tome II, page 101.
-
[↑] Anno 858, apud Carisiacum, édit. de Baluze, tome II, art. 7, page 109.
-
[↑] Precaria, quòd precibus utendum conceditur, dit Cujas, dans ses notes sur le livre I des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pépin, daté de la troisieme année de son regne, que ce prince n’établit pas le premier ces lettres précaires ; il en cite une faite par le maire Ebroin, & continuée depuis. Voyez le diplôme de ce roi, dans le tome V des historiens de France des Bénédictins, art. 6.
-
[↑] L’an 743. Voyez le livre V des capitulaires, art. 3, édit. de Baluze, page 825.
-
[↑] Celui de Metz, de l’an 756, art. 4.
-
[↑] Voyez son capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il regle le contrat précaire ; & celui de Francfort, de l’an 794, page 267, art. 24, sur les réparations des maisons ; & celui de l’an 800, page 330.
-
[↑] Comme il paroît par la notre précédente, & par le capitulaire de Pépin, roi d’Italie, où il est dit que le roi donnerait en fief les monasteres à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. I, §. 30, & aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Echard, pag. 195, tit. 26, art. 4.
-
[↑] Voyez la constitution de Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III, loi I, §. 43.
-
[↑] Ibid. §. 44.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Donné la vingt-huitieme année du regne de Charles le chauve, l’an 868, édit. de Baluze, p. 203.
-
[↑] Cum concilio & consensu ipsius qui locum retinet.
-
[↑] Concilium apud Bonoilum, seizieme année de Charles de chauve, l’an 856, édit. de Baluze, p. 78.
[IV-167]
CHAPITRE XII.
Établissemens des dîmes.
Les réglemens faits sous le roi Pépin avoient plutôt donné à l’église l’espérance d’un soulagement qu’un soulagement effectif : & comme Charles Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire restituer à ceux-ci ce qu’on leur avoit donné ; & les circonstances où l’on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu’elle n’étoit de sa nature. D’un autre côté, le christianisme ne devoit pas [IV-168] périr, faute de ministres [1] , de temples & d’instructions.
Cela fit que Charlemagne établit [2] les dîmes, nouveau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clergé, qu’étant singuliérement donné à l’église, il fut plus aisé dans la suite d’en reconnoître les usurpations.
On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées : mais les autorités que l’on cite, me semblent être des témoins contre ceux qui les alleguent. La constitution [3] de Clotaire dit seulement qu’on ne leveroit point de certaines dîmes [4] sur les biens [IV-169] de l’église : bien loin donc que l’église levât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention étoit de s’en faire exempter. Le second concile de Mâcon [5] , tenu l’an 585, qui ordonne que l’on paye les dîmes, dit, à la vérité, qu’on les avoit payées dans les temps anciens : mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payoit plus.
Qui doute qu’avant Charlemagne on n’eût ouvert la bible, & prêché les dons & les offrandes du lévitique ? Mais je dis qu’avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu’elles n’étoient point établies.
J’ai dit que les réglemens faits sous le roi Pépin avoient soumis au payement des dîmes, & aux réparations des églises, ceux qui possédoient en fief les biens ecclésiastiques. C’étoit beaucoup d’obliger par une loi, dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l’exemple.
Charlemagne fit plus : & on voit, par le capitulaire de Willis [6] , qu’il obligea ses propres fonds au payement des [IV-170] dîmes : c’étoit encore un grand exemple.
Mais le bas peuple n’est guere capable d’abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort [7] lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire, dans lequel il est dit que [8] , dans la derniere famine, on avoit trouvé les épis de blé vuides ; qu’ils avoient été dévorés par les démons, & qu’on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n’avoir pas payé la dîme : &, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques, de payer la dîme ; &, en conséquence encore, on l’ordonna à tous.
Le projet de Charlemagne ne réussit pas d’abord : cette charge parut accablante [9] . Le paiement des dîmes chez les Juifs étoit entré dans le plan de la [IV-171] fondation de leur république : mais ici le payement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards [10] , la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les différens canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.
Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourroit les racheter. La constitution de Louis le débonnaire [11] , & celle de l’empereur Lothaire [12] son fils, ne le permirent pas.
Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes, étoient l’ouvrage de la nécessité ; la religion seule y eut part, & la superstition n’en eut aucune.
La fameuse division [13] qu’il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l’évêque, pour les clercs, [IV-172] prouve bien qu’il vouloit donner à l’église cet état fixe & permanent qu’elle avoit perdu.
Son testament [14] fait voir qu’il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel son aïeul avoit faits. Il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire ; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole & les évêchés qui en dépendoient. Il partagea le tiers qui restoir en quatre parties ; il en donna une à ses enfans & ses petits-enfans, une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés, les deux autres furent employées en œuvres pies. Il sembloit qu’il regardât le don immense qu’il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse, que comme une dispensation politique.
-
[↑] Dans les guerres civiles qui s’éleverent du temps de Charles Martel, les biens de l’église de Rheims furent donnés aux laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourroit, est-il dit dans la vie de S. Remy Surius, tome I, page 279.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. III, tit. 3, §. 1 & 2.
-
[↑] C’est celle dont j’ai tant parlé au chapitre iv ci-dessus, que l’on trouve dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, art. 11, page 9.
-
[↑] Agraria & pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ concedimus, ità ut actor aut decimator in rebus ecclesiæ nullus accedat. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 800, édition de Baluze, p. 336, explique très-bien ce que c’étoit que cette sorte de dîme dont Clotaire exempte l’église ; c’étoit le dixieme des cochons, que l’on mettoit dans les forêts du roi pour engraisser : & Charlemagne veut que ses juges le payent comme les autres, afin de donner l’exemple. On voit que c’étoit un droit seigneurial ou économique.
-
[↑] Canone V, ex tomo I conciliorum antiquorum Galliæ, operâ Jacobi Sirmundi.
-
[↑] Art. 6, édit. de Baluze, p. 332. Il fut donné l’an 800.
-
[↑] Tenu sous Charlemagne, l’an 794.
-
[↑] Experimento enim didicimus in anno quo illo valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas à dæmonibus devoratas, & voces exprobrationis auditas, &c. édit de Baluez, page 267, art. 23.
-
[↑] Voyez entr’autres le capitulaire de Louis le débonnaire, de l’an 829, édit. de Baluze, p. 663, contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dîme, ne cultivoient point leurs terres ; &, art. 5. Nodis quidem & decimis, unde & genitor noster & nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.
-
[↑] Entr’autres, celle de Lothaire, liv. III, tit. 3, chap. 6.
-
[↑] De l’an 829, art. 7. dans Baluze, tome I. page 663.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. III, tit. 3. §. 8.
-
[↑] Ibid. §. 4.
-
[↑] C’est une espece de codicille rapporté par Eginhart, & qui est différent du testament même qu’on trouve dans Goldaste & Baluze.
[IV-173]
CHAPITRE XIII.
Des élections aux évêchés & abbayes.
Les églises étant devenues pauvres, les rois abandonnerent les élections aux évêchés & autres bénéfices ecclésiastiques [1] . Les princes s’embarrasserent moins d’en nommer les ministres, & les compétiteurs réclamerent moins leur autorité. Ainsi l’église recevoit une espece de compensation pour les biens qu’on lui avoit ôtés.
Et si Louis le débonnaire laissa au peuple Romain le droit d’élire les papes, ce fut un effet de l’esprit général de son temps [2] : on se gouverna, à l’égard du siege de Rome, comme on faisoit à l’égard des autres.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 803. art. 2. édit. de Baluze, p. 379 ; & l’édit de Louis le débonnaire, de l’an 834, dans Goldaste, constit. Impériale, tome I.
-
[↑] Cela est dit dans le fameux canon, Ego Ludovicus, qui est visiblement supposé. Il est dans l’édition de Baluze, p. 591, sur l’an 817.
[IV-174]
CHAPITRE XIV.
Des fiefs de Charles Martel.
Je ne dirai point si Charles Martel donnant les biens de l’église en fief, il les donna à vie ou à perpétuité. Tout ce que je sais, c’est que, du temps de Charlemagne [1] & de Lothaire I [2] , il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers & se partageoient entr’eux.
Je trouve de plus qu’une partie [3] fut donnée en alleu, & l’autre partie en fief.
J’ai dit que les propriétaires des alleus étoient soumis au service comme les possesseurs des fiefs. Cela fut sans doute en partie cause que Charles Martel donna en alleu aussi-bien qu’en fief.
-
[↑] Comme il paroît par son capitulaire de l’an 801, art. 17, dans Baluze, tome I, page 360.
-
[↑] Voyez sa constitution insérée dans le code des Lombards, liv. III, tit. I, §. 44.
-
[↑] Voyez la constitution ci-dessus, & le capitulaire de Charles le chauve de l’an 846, chap. xx, in villâ Sparnaco, édit. de Baluze, tome II, page 31 ; & celui de l’an 853, chap. iii & v, dans le synode de Soissons, édit. de Baluze, tome II, page 54 ; & celui de l’an 854, apud Attiniacum, ch. x, édit. de Baluze, tom. II, page 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, art. 49 & 56, édit. de Baluze, tome I, page 519.
[IV-175]
CHAPITRE XV.
Continuation du même sujet.
Il faut remarquer que les fiefs ayant été changés en biens d’église, & les biens d’église ayant été changés en fiefs, les fiefs & les biens d’église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l’un & de l’autre. Ainsi les biens d’église eurent les privileges des fiefs, & les fiefs eurent les privileges des biens d’église : tels furent les droits [1] honorifiques dans les églises, qu’on vit naître dans ces temps-là. Et comme ces droits ont toujours été attachés à la haute justice, préférablement à ce que nous appellons aujourd’hui le fief ; il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le temps même de ces droits.
-
[↑] Voyez les capitulaires, liv. V, art. 44 ; & l’édit de Pistes de l’an 866, art. 8 & 9, où l’on voit les droits honorifiques des seigneurs établis tels qu’ils sont aujourd’hui.
[IV-176]
CHAPITRE XVI.
Confusion de la royauté & de la mairerie. Seconde race.
L’ordre des matieres a fait que j’ai troublé l’ordre des temps ; de sorte que j’ai parlé de Charlemagne, avant d’avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carolovingiens faite sous le roi Pépin : chose qui, à la différence des événemens ordinaires, est peut-être plus remarquée aujourd’hui, qu’elle ne le fut dans le temps même qu’elle arriva.
Les rois n’avoient point d’autorité, mais ils avoient un nom ; le titre de roi étoit héréditaire, & celui de maire étoit électif. Quoique les maires, dans les derniers temps, eussent mis sur le trône celui des Mérovingiens qu’ils vouloient, ils n’avoient point pris de roi dans une autre famille ; & l’ancienne loi qui donnoit la couronne à une certaine famille, n’étoit point effacée du cœur des Francs. La personne du roi étoit presque inconnue dans la monarchie ; mais la royauté ne l’étoit pas. Pépin, fils de Charles Martel, [IV-177] crut qu’il étoit à propos de confondre ces deux titres ; confusion qui laisseroit toujours de l’incertitude, si la royauté nouvelle étoit héréditaire, ou non : & cela suffisoit à celui qui joignoit à la royauté une grande puissance. Pour lors, l’autorité du maire fut jointe à l’autorité royale. Dans le mélange de ces deux autorités, il se fit une espece de conciliation. Le maire avoit été électif, & le roi héréditaire : la couronne, au commencement de la seconde race, fut élective, parce que le peuple choisit ; elle fut héréditaire, parce qu’il choisit toujours dans la même famille [1] .
Le pere le Cointe, malgré la foi de tous les monumens [2] , nie [3] que le pape ait autorisé ce grand changement ; une de ses raisons est qu’il auroit fait une injustice. Et il est admirable de voir [IV-178] un historien juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu’ils auroient dû faire ! Avec cette maniere de raisonner, il n’y auroit plus d’histoire.
Quoi qu’il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pépin, sa famille fut régnante, & que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné roi, ce ne fut qu’une cérémonie de plus, & un fantôme de moins : il n’acquit rien par-là que les ornemens royaux ; il n’y eut rien de changé dans la nation.
J’ai dit ceci pour fixer le moment de la révolution ; afin qu’on ne se trompe pas, en regardent comme une révolution ce qui n’étoit qu’une conséquence de la révolution.
Quand Hugues Capet fut couronné roi au commencement de la troisieme race, il y eut un plus grand changement ; parce que l’état passa de l’anarchie à un gouvernement quelconque : mais quand Pépin prit la couronne, on passa d’un gouvernement au même gouvernement.
Quand Pépin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom : mais quand [IV-179] Hugues Capet fut couronné roi, la chose changea ; parce qu’un grand fief, uni à la couronne, fit cesser l’anarchie.
Quand Pépin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office ; quand Hugues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand fief.
-
[↑] Voyez le testament de Charlemagne ; & le partage que Louis le débonnaire fit à ses enfans dans l’assemblée des états tenue à Quierzy, rapportée par Goldaste : Quem populus eligere velit, ut patri suo succedait in regni hœreditate.
-
[↑] L’anonyme, sur l’an 752 ; & chron. Centul. sur l’an 754.
-
[↑] Fabella quæ post Pipini mortem excogitata est, æquitati ac sanctitati Zachariæ papæ plurimùm adversatur… Annales ecclésiastiques des François, tome II, page 319.
[IV-179]
CHAPITRE XVII.
Chose particuliere dans l’élection des Rois de la seconde race.
On voit dans la formule [1] de la consécration de Pépin, que Charles & Carloman furent aussi oints & bénits ; & que les seigneurs François s’obligerent, sous peine d’interdiction & d’excommunication, de n’élire [2] jamais personne d’une autre race.
Il paroît par les testamens de Charlemagne et de Louis le débonnaire, que les Francs choisissent entre les enfans des rois ; ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-dessus. Et lorsque l’empire passa dans une autre maison que celle [IV-180] de Charlemagne, la faculté d’élire, qui étoit restreinte & conditionnelle, devint pure & simple ; & on s’éloigna de l’ancienne constitution.
Pépin, se sentant près de la fin, convoqua les seigneurs [3] ecclésiastiques & laïques à S. Denys ; & partagea son royaume à ses deux fils, Charles & Carloman. Nous n’avons point les actes de cette assemblée : mais on trouve ce qui s’y passa, dans l’auteur de l’ancienne collection historique mise au jour par Canisius [4] , & celui des annales de Metz, comme l’a remarqué M. Baluze [5] . Et j’y vois deux choses en quelque façon contraires : qu’il fit le partage du consentement des grands ; & ensuite, qu’il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j’ai dit, que le droit du peuple dans cette race étoit d’élire dans la famille ; c’étoit à proprement parler, plutôt un droit d’exclure, qu’un droit d’élire.
Cette espece de droit d’élection se trouve confirmée par les monumens de la seconde race. Tel est ce capitulaire [IV-181] de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfans, où, après avoir formé leur partage, il dit [6] que : « Si un des trois freres a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succede au royaume de son pere, ses oncles y consentiront. »
Cette même disposition se trouve dans le partage [7] que Louis le débonnaire fit entre ses trois enfans, Pépin, Louis & Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; & encore dans un autre partage [8] du même empereur, fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin & Louis. On peut voir encore le serment que Louis le begue fit à Compiegne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi Louis [9] , constitué roi par la miséricorde de Dieu & l’élection du peuple, je promets… » Ce que je dis [IV-182] est confirmé par les actes du concile de Valence [10] , tenu l’an 890 pour l’élection de Louis, fils de Boson, au royaume d’Arles. On y élit Louis ; & on donne pour principales raisons de son élection, qu’il étoit de la famille impériale [11] , que Charles le gros lui avoit donné la dignité de roi, & que l’empereur Arnoul l’avoit investi par le sceptre & par le ministere de ses ambassadeurs. Le royaume d’Arles, comme les autres, démembrés ou dépendans de l’empire de Charlemagne, étoit électif & héréditaire.
-
[↑] Tome V, des historiens de France par les PP. Bénédictins, page 9.
-
[↑] Ut numquàm de alterius lumbis regem in œvo præsumant eligere, sed ex ipsorum. Ibid. page 10.
-
[↑] L’an 768.
-
[↑] Tome II, Lectionis antiquæ.
-
[↑] Edition des capitulaires, tome I, p. 188.
-
[↑] Dans le capitulaire I, de l’an 806, édition de Baluze, page 439, art. 5.
-
[↑] Dans Goldaste, contitutions impériales, tome II, page 19.
-
[↑] Edition de Baluze, page 574, art. 14. Si verà aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur ; sed potiùs populas, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus viluerit, eligat ; & hunc senior frater in loco fratris & filii suscipiat.
-
[↑] Capitulaire de l’an 877, édition de Baluze, page 272.
-
[↑] Dans Dumont, corps diplomatique, tome I, article 36.
-
[↑] Par femmes.
[IV-182]
CHAPITRE XVIII.
Charlemagne.
Charlemagne songea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, & à empêcher l’oppression du clergé & des hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l’état, qu’ils furent contrebalancés, & qu’il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement [IV-183] la noblesse d’expédition en expédition ; il ne lui laissa pas le temps de former des desseins, & l’occupa toute entiere à suivre les siens. L’empire se maintint par la grandeur du chef : le prince étoit grand, l’homme l’étoit davantage. Les rois ses enfans furent ses premiers sujets, les instrumens de son pouvoir, & les modeles de l’obéissance. Il fit d’admirables réglemens : il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes les parties de l’empire. On voit dans les lois de ce prince, un esprit de prévoyance qui comprend tout, & une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes [1] pour éluder les devoirs sont ôtés ; les négligences corrigées ; les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir ; il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans ses desseins, simple dans l’exécution, personne n’eut à un plus haut degré l’art de faire les plus grandes choses avec facilité, & les difficiles avec promptitude. Il parcouroit sans cesse son vaste empire, portant la main par-tout où il alloit tomber. Les [IV-184] affaires renaissoient de toutes parts, il les finissoit de toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver les dangers, jamais prince ne les sut mieux éviter. Il se joua de tous les périls, & particuliérement de ceux qu’éprouvent presque toujours les grands conquérans, je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrêmement modéré ; son caractere étoit doux, ses manieres simples ; il aimoit à vivre avec les gens de sa cour. Il fut peut-être trop sensible au plaisir des femmes : mais un prince qui gouverna toujours par lui-même, & qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d’excuses. Il mit une regle admirable dans sa dépense : il fit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention, avec économie ; un pere de famille pourroit [2] apprendre dans ses lois à gouverner sa maison. On voit dans ses capitulaires la source pure & sacrée d’où il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu’un mot : il ordonnoit [3] qu’on vendît les [IV-185] œufs des basses-cours de ses domaines, & les herbes inutiles de ses jardins ; & il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, & les immenses trésors de ces Huns qui avoient dépouillé l’univers.
-
[↑] Voyez son capitulaire III, de l’an 811, p. 486, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 ; & le capitulaire I, de l’an 812, p. 490, art. I ; & le capitulaire de la même année, p. 494, art. 9 & 11 ; & autres.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Willis, de l’an 800, son capitulaire II. de l’an 813, art. 6 & 19 ; & le livre V des capitulaires, art. 303.
-
[↑] Capitulaire de Willis, art. 39. Voyez tout ce capitulaire, qui est un chef-d’œuvre de prudence, de bonne administration & d’économie.
[IV-185]
CHAPITRE XIX.
Continuation du même sujet.
Charlemagne & ses premiers successeurs craignirent que ceux qu’ils placeroient dans des lieux éloignés ne fussent portés à la révolte ; ils crurent qu’ils trouveroient plus de docilité dans les ecclésiastiques : ainsi ils érigerent en Allemagne [1] un grand nombre d’évêchés, & y joignirent de grands fiefs. Il paroît, par quelques chartres, que les clauses qui contenoient les prérogatives de ces fiefs n’étoient pas différentes de celles qu’on mettoit ordinairement dans ces concessions [2] , quoiqu’on voie [IV-186] aujourd’hui les principaux ecclésiastiques d’Allemagne revêtus de la puissance souveraine. Quoi qu’il en soit, c’étoient des pieces qu’ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu’ils ne pouvoient attendre de l’indolence ou des négligences d’un leude, ils crurent qu’ils devoient l’attendre du zele & de l’attention agissante d’un évêque : outre qu’un tel vassal, bien loin de se servir contr’eux des peuples assujettis, auroit au contraire besoin d’eux pour se soutenir contre ses peuples.
-
[↑] Voyez, entr’autres, la fondation de l’archevêché de Brême, dans le capitulaire de 789, édit. de Baluze, p. 245.
-
[↑] Par exemple, la défense aux juges royaux d’entrer dans le territoire pour exiger les freda & autres droits. J’en ai beaucoup parlé au livre précédent.
[IV-186]
CHAPITRE XX.
Louis le débonnaire.
Auguste étant en Égypte, fit ouvrir le tombeau d’Alexandre : on lui demanda s’il vouloit qu’on ouvrît ceux des Ptolomées ; il dit qu’il avoit voulu voir le roi, & non pas les morts. Ainsi, dans l’histoire de cette seconde race, on cherche Pépin & Charlemagne ; on voudroit voir les rois & non pas les morts.
Un prince, jouet de ses passions & dupe de ses vertus même ; un prince [IV-187] qui ne connut jamais sa force ni sa foiblesse ; qui ne sut se concilier ni la crainte ni l’amour ; qui, avec peu de vices dans le cœur, avoit toutes sortes de défauts dans l’esprit, prit en main les rênes de l’empire que Charlemagne avoit tenues.
Dans le temps que l’univers est en larmes pour la mort de son pere ; dans cet instant d’étonnement, où tout le monde demande Charles, & ne le trouve plus ; dans le temps qu’il hâte ses pas pour aller remplir sa place, il envoie devant lui des gens affidés pour arrêter ceux qui avoient contribué au désordre de la conduite de ses sœurs. Cela causa de sanglantes tragédies [1] . C’étoient des imprudences bien précipitées. Il commença à venger les crimes domestiques, avant d’être arrivé au palais ; & à révolter les esprits avant d’être le maître.
Il fit crever les yeux à Bernard, roi d’Italie, son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence, & qui mourut quelques jours après ; cela multiplia ses [IV-188] ennemis. La crainte qu’il en eut le détermina à faire tondre ses freres ; cela en augmenta encore le nombre. Ces deux derniers articles lui furent [2] bien reprochés : on ne manqua pas de dire qu’il avoit violé son serment & les promesses solennelles [3] qu’il avoit faites à son pere le jour de son couronnement.
Après la mort de l’impératrice Hirmengarde, dont il avoit trois enfans, il épousa Judith ; il en eut un fils, & bientôt, mêlant les complaisances d’un vieux mari avec toutes les foiblesses d’un vieux roi, il mit un désordre dans sa famille, qui entraîna la chute de la monarchie.
Il changea sans cesse les partages qu’il avoit faits à ses enfans. Cependant ces partages avoient été confirmés tour à tour par ses sermens, ceux de ses enfans & ceux des seigneurs. C’étoit vouloir tenter la fidélité de ses sujets ; c’étoit chercher à mettre de la confusion, des scrupules & des équivoques dans [IV-189] l’obéissance ; c’étoit confondre les droits divers des princes, dans un temps sur-tout où, les forteresses étant rares, le premier rempart de l’autorité étoit la foi promise & la foi reçue.
Les enfans de l’empereur, pour maintenir leurs partages, solliciterent le clergé, & lui donnerent des droits inouis jusqu’alors. Ces droits étoient spécieux ; on faisoit entrer le Clergé en garantie d’une chose qu’on avoit voulu qu’il autorisât. Agobard [4] représenta à Louis le débonnaire qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur ; qu’il avoit fait des partages à ses enfans, après avoir consulté le ciel par trois jours de jeûnes & de prieres. Que pouvoit faire un prince superstitieux, attaqué d’ailleurs par la superstition même ? On sent quel échec l’autorité souveraine reçut deux fois, par la prison de ce prince & sa pénitence publique. On avoit voulu dégrader le roi, on dégrada la royauté.
On a d’abord de la peine à comprendre comment un prince, qui avoit plusieurs bonnes qualités, qui ne manquoit pas de lumieres, qui aimoit [IV-190] naturellement le bien, & pour tout dire enfin, le fils de Charlemagne, put avoir des ennemis si nombreux [5] , si violens, si irréconciliables, si ardens à l’offenser, si insolens dans son humiliation, si déterminés à le perdre : Et ils l’auroient perdu deux fois sans retour, si ses enfans, dans le fond plus honnêtes gens qu’eux, eussent pu suivre un projet & convenir de quelque chose.
-
[↑] L’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 295.
-
[↑] Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 333.
-
[↑] Il lui ordonna d’avoir, pour ses sœurs, ses freres & ses neveux, une clémence sans bornes, indeficientum misericordiam. Tégan, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 276.
-
[↑] Voyez ses lettres.
-
[↑] Voyez le proces-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 331. Voyez aussi sa vie écrite par Tégan. Tanto enim odio laborabant, ut tœderet eos vitâ ipsius, dit l’auteur incertain, dans Duchesne, tome II, p. 307.
[IV-190]
CHAPITRE XXI.
Continuation du même sujet.
La force que Charlemagne avoit mise dans la nation subsista assez sous Louis le débonnaire, pour que l’état pût se maintenir dans sa grandeur, & être respecté des étrangers. Le prince avoit l’esprit foible ; mais la nation étoit guerriere. L’autorité se perdoit au-dedans, sans que la puissance parût diminuer au dehors.
Charles Martel, Pépin & Charlemagne gouvernerent l’un après l’autre la [IV-191] monarchie. Le premier flatta l’avarice des gens de guerre : les deux autres celle de clergé ; Louis le débonnaire mécontenta tous les deux.
Dans la constitution Françoise, le roi, la noblesse & le clergé avoient dans leurs mains toute la puissance de l’état. Charles Martel, Pépin & Charlemagne, se joignirent quelquefois d’intérêts avec l’une des deux parties pour contenir l’autre, & presque toujours avec toutes les deux : mais Louis le débonnaire détacha de lui l’un & l’autre de ces corps. Il indisposa les évêques par des réglemens qui leur parurent rigides, parce qu’il alloit plus loin qu’ils ne vouloient aller eux-mêmes. Il y a de très-bonnes lois faites mal-à-propos. Les évêques, accoutumés dans ces temps-là à aller à la guerre contre les Sarrasins & les Saxons [1] , étoient bien [IV-192] éloignés de l’esprit monastique. D’un autre côté, ayant perdu toute sorte de confiance pour sa noblesse, il éleva des gens de néant [2] : il la priva de ses emplois [3] , la renvoya du palais, appella des étrangers. Il s’étoit séparé de ces deux corps, il en fut abandonné.
-
[↑] « Pour lors les évêques & les clercs commencerent à quitter les ceintures & les baudriers d’or, les couteaux enrichis de pierreries qui y étoient suspendus, les habillemens d’un goût exquis, les éperons dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l’ennemi du genre humain ne souffrit point une telle dévotion, qui souleva contr’elle les ecclésiastiques de tous les ordres, & se fit à elle-même la guerre. » L’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 298.
-
[↑] Tégan dit que ce qui se faisoit très-rarement sous Charlemagne, se fit communément sous Louis.
-
[↑] Voulant contenir la noblesse, il prit pour son chambrier un certain Benard qui acheva de la désespérer.
[IV-192]
CHAPITRE XXII.
Continuation du même sujet.
Mais ce qui affoiblit sur-tout la monarchie, c’est que ce prince en dissipa les domaines [1] . C’est ici que Nitard, un des plus judicieux historiens que nous ayons ; Nitard, petit-fils de Charlemagne, qui étoit attaché au parti de Louis le débonnaire, & qui écrivoit l’histoire par ordre de Charles le chauve, doit être écouté.
Il dit « qu’un certain Adelhard avoit eu pendant un temps un tel empire [IV-193] sur l’esprit de l’empereur, que ce prince suivoit sa volonté en toutes choses ; qu’à l’instigation de ce favori, il avoit donné les biens fiscaux [2] à tous ceux qui en avoient voulu ; & par-là avoit anéanti la république [3] . » Ainsi, il fit dans tout l’empire ce que j’ai dit qu’il avoit fait en Aquitaine [4] ; chose que Charlemagne répara, & que personne ne répara plus.
L’état fut mis dans cet épuisement où Charles Martel le trouva lorsqu’il parvint à la mairerie ; & l’on étoit dans ces circonstances, qu’il n’étoit plus question d’un coup d’autorité pour le rétablir.
Le fisc se trouva si pauvre, que, sous Charles le chauve, on ne maintenoit personne dans les honneurs [5] ; on n’accordoit la sureté à personne que pour de l’argent : quand on pouvoit détruire les Normands [6] , on les laissoit échapper pour de l’argent : & le [IV-194] premier conseil que Hincmar donne à Louis le begue, c’est de demander, dans une assemblée, de quoi soutenir les dépenses de sa maison.
-
[↑] Villas regias, quæ erant sui & avi & tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessiones sempiternas : fecit enim hoc diù tempore. Tégan. de gestis Ludovici pii.
-
[↑] Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit. Nitard, liv. IV, à la fin.
-
[↑] Rempublicam penitùs annulavit. Ibid.
-
[↑] Voyez livre XXX, chap. xiii.
-
[↑] Hincmar, lettre premiere à Louis le begue.
-
[↑] Voyez le fragment de la chronique du monastere de S. Serge d’Angers, dans Duchesne, tome II, page 401.
[IV-194]
CHAPITRE XXIII.
Continuation du même sujet.
Le clergé eut sujet de se repentir de la protection qu’il avoit accordée aux enfans de Louis le débonnaire. Ce prince, comme j’ai dit, n’avoit jamais donné de préceptions [1] des biens de l’église aux laïques : mais bientôt Lothaire en Italie, & Pépin en Aquitaine, quitterent le plan de Charlemagne, & reprirent celui de Charles Martel. Les ecclésiastiques eurent recours à l’empereur contre ses enfans ; mais ils avoient affoibli eux-mêmes l’autorité qu’ils réclamoient. En Aquitaine, on eut que condescendance ; en Italie, on n’obéit pas.
Les guerres civiles qui avoient troublé la vie de Louis le débonnaire, furent le germe de celles qui suivirent sa mort.
[IV-195] Les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, chercherent chacun de leur côté, à attirer les grands dans leur parti, & à se faire des créatures. Ils donnerent, à ceux qui voulurent les suivre, des préceptions des biens de l’église ; & pour gagner la noblesse, ils lui livrerent le clergé.
On voit, dans les capitulaires [2] , que ces princes furent obligés de céder à l’importunité des demandes, & qu’on leur arracha souvent ce qu’ils n’auroient pas voulu donner : on y voit que le clergé se croyoit plus opprimé par la noblesse que par les rois. Il paroît encore que Charles le chauve [3] fut celui [IV-196] qui attaqua le plus le patrimoine du clergé ; soit qu’il fût le plus irrité contre lui, parce qu’il avoit dégradé son pere à son occasion ; soit qu’il fût le plus timide. Quoi qu’il en soit, on voit dans les capitulaires [4] des querelles continuelles entre le clergé qui demandoit ses biens, & la noblesse qui refusoit, qui éludoit, ou qui différoit de les rendre ; & les rois entre deux.
C’est un spectacle digne de pitié, de voir l’état des choses en ces temps-là. Pendant que Louis le débonnaire faisoit aux églises des dons immenses de ses domaines, ses enfants distribuoient les biens du clergé aux laïques. Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anciennes. Le clergé n’avoit point un état fixe.
[IV-197] On lui ôtoit ; il regagnoit : mais la couronne perdoit toujours.
Vers la fin du regne de Charles le chauve, & depuis ce regne, il ne fut plus guere question des démêlés du clergé & des laïques sur la restitution des biens de l’église. Les évêques jeterent bien encore quelques soupirs dans leurs remontrances à Charles le chauve, que l’on trouve dans le capitulaire de l’an 856, & dans la lettre [5] qu’il écrivirent à Louis le Germanique l’an 858 : mais ils proposoient des choses, & ils réclamoient des promesses tant de fois éludées, que l’on voit qu’ils n’avoient aucune espérance de les obtenir.
Il ne fut plus question [6] que de réparer en général les torts faits dans l’église & dans l’état. Les rois s’engageoient de ne point ôter aux leudes leurs hommes libres, & de ne plus donner des biens ecclésiastiques par des préceptions [7] ; de sorte que le clergé & la noblesse parurent s’unir d’intérêts.
[IV-198]
Les étranges ravages des Normands, comme j’ai dit, contribuerent beaucoup à mettre fin à ces querelles.
Les rois tous les jours moins accrédités, & par les causes que j’ai dites & par celles que je dirai, crurent n’avoir d’autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des ecclésiastiques. Mais le clergé avoit affoibli les rois, & les rois avoient affoibli le clergé.
En vain Charles le chauve & des successeurs appellerent-ils le clergé [8] pour soutenir l’état, & en empêcher la chute ; en vain se servirent-ils [9] du respect que les peuples avoient pour ce corps, [IV-199] pour maintenir celui qu’on devoit avoir pour eux ; en vain chercherent-ils à donner de l’autorité à leurs lois par l’autorité des canons [10] ; en vain joignirent-ils les peines ecclésiastiques aux peines civiles [11] ; en vain, pour contrebalancer l’autorité du comte, donnerent-ils à chaque évêque la qualité de leur envoyé dans les provinces [12] : il fut impossible au clergé de réparer le mal qu’il avoit fait ; & un étrange malheur, dont je parlerai bientôt, fit tomber la couronne à terre.
-
[↑] Voyez ce que disent les évêques dans le synode de l’an 845, apud Teudonis villam, art. 4.
-
[↑] Voyez le synode de l’an 845, apud Teudonis villam, art. 3 & 4, qui décrit très-bien l’état des choses, aussi bien que celui de la même année tenu au palais de Vernes, art. 12 ; & le synode de Beauvais, encore de la même année, art. 3, 4 & 6 ; & le capitulaire in villâ Sparnaco, de l’an 846, art. 20 ; & la lettre que les évêques assemblés à Rheims écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8.
-
[↑] Voyez le capitulaire in villâ Sparnaco, de l’an 846. La noblesse avoit irrité le roi contre les évêques, de sorte qu’il les chassa de l’assemblée ; on choisit quelques canons des synodes, & on leur déclara que ce seroient les seuls qu’on observeroit ; on ne leur accorda que ce qu’il étoit impossible de leur refuser. Voyez les articles 20, 21 & 22. Voyez aussi la lettre que les évêques assemblés écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8 ; & l’édit de Pistes, de l’an 864, art. 5.
-
[↑] Voyez le même capitulaire de l’an 846, in villà Sparnaco. Voyez aussi le capitulaire de l’assemblée tenue apud Marsnam, de l’an 847, art. 4, dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu’on le remît en possession de tout ce dont il avoit joui sous le regne de Louis le débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l’an 851, apud Marsnam, art. 6 & 7, qui maintient la noblesse & le clergé dans leurs possessions : & celui apud Bozoilum, de l’en 856, qui est une remontrance des évêques au roi sur ce que les maux, après tant de lois faites, n’avoient pas été réparés : & enfin la lettre que les évêques assemblés à Rheims écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8.
-
[↑] Article 8.
-
[↑] Voyez le capitulaire de l’an 851, art. 6 & 7.
-
[↑] Charles le chauve, dans le synode de Soissons, dit « qu’il avoit promis aux évêques de ne plus donner de préceptions des biens de l’église. » Capitulaire de l’an 853, art. II, édit. de Baluze, tome II, p. 56.
-
[↑] Voyez dans Nitard, liv. IV, comment, après la fuite de Lothaire, les rois Louis & Charles consulterent les évêques, pour savoir s’ils pourroient prendre & partager le royaume qu’il avoit abandonné. En effet, comme les évêques formoient entr’eux un corps plus uni que les leudes, il convenoit à ces princes d’assurer leurs droits par une résolution des évêques, qui pourroient engager tous les autres seigneurs à les suivre.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, apud Saponarias, de l’an 859, art. 3. « Venilon, que j’avois fait archevêque de Sens, m’a sacré ; & je ne devois être chassé du royaume par personne, saltem sine audientiâ & judicio episcoporum, quorum ministerio in regem sum consecratus, & qui throni Dâ sunt dicti, in quibus Deus sedet, & per quos sua decernit judicia ; quorum paternis correctionibus & castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, & in præsenti sum subditus. »
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de Carisiaco, de l’an 857, édit. de Baluze, tome II, p. 88, art. 1, 2, 3, 4 & 7.
-
[↑] Voyez le synode de Pistes, de l’an 862, art. 4 ; & le capitulaire de Carloman & de Louis II, apud Vernis Palotium, de l’an 883, art. 4 & 5.
-
[↑] Capitulaire de l’an 876, sous Charles le chauve, in synodo Pontigonensi, édit. de Baluze, art. 12.
[IV-199]
CHAPITRE XXIV.
Que les hommes libres furent rendus capables de posséder des fiefs.
J’ai dit que les hommes libres alloient à la guerre sous leur comte, & les vassaux sous leur seigneur. Cela faisoit que les ordres de l’état se balançoient [IV-200] les uns les autres ; & quoique les leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus par le comte, qui étoit à la tête de tous les hommes de la monarchie.
D’abord [1] ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite ; & je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoula depuis le regne de Gontran jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d’Andely [2] passé entre Gontran, Childebert & la reine Brunehault, & le partage [3] fait par Charlemagne à ses enfans, & un partage pareil fait par Louis le débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux ; & comme on y regle les mêmes points, & à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit & la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard.
Mais, pour ce qui concerne les [IV-201] hommes libres, il s’y trouve une différence capitale. Le traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent se recommander pour un fief ; au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne & de Louis le débonnaire, des clauses expresses pour qu’ils pussent s’y recommander : ce qui fait voir que, depuis le traité d’Andely, un nouvel usage s’introduisit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative.
Cela dut arriver lorsque Charles Martel ayant distribué les biens de l’église à ses soldats, & les ayant donnés, partie en fief, partie en aleu, il se fit une espece de révolution dans les lois féodales. Il est vraisemblable que les nobles qui avoient déjà des fiefs trouverent plus avantageux de recevoir les nouveaux dons en aleu, & que les hommes libres se trouverent encore trop heureux de les recevoir en fief.
-
[↑] Voyez ce que j’ai dit ci-dessus au livre XXX, chapitre dernier, vers la fin.
-
[↑] De l’an 587, dans Grégoire de Tours, liv. IX.
-
[↑] Voyez le chapitre suivant, où je parle plus au long de ces partages, & les notes où ils sont cités.
[IV-202]
CHAPITRE XXV.
Cause principale de l’affoiblissement de la seconde race.
Changement dans les aleux.
Charlemagne, dans le partage [1] dont j’ai parlé au chapitre précédent, régla qu’après sa mort les hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans le royaume de leur roi, & non dans le royaume d’un autre [2] ; au lieu qu’on conserveroit ses aleux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute [3] que tout homme libre pourroit, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes, à qui il voudroit, de même que celui qui n’avoit jamais eu de seigneur. On trouve les mêmes dispositions dans le partage [4] que fit Louis le débonnaire à ses enfans, l’an 817.
[IV-203]
Mais, quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n’en étoit point affoiblie : il falloit toujours que l’homme libre contribuât pour son aleu, & préparât des gens qui en fissent le service, à raison d’un homme pour quatre manoirs ; ou bien qu’il préparât un homme qui servît pour lui le fief : & quelques abus s’étant introduits là-dessus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions de Charlemagne [5] , & par celle de Pépin [6] roi d’Italie, qui s’expliquent l’une & l’autre.
Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très-vrai : mais qu’il me soit permis de jeter un coup d’œil [IV-204] sur les funestes conséquences de cette journée.
Quelque temps après cette bataille, les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, firent un traité [7] dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l’état politique chez les François.
Dans l’annonciation [8] que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il dit que [9] tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs. Avant ce traité, l’homme libre pouvoit se recommander pour un fief : mais son aleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c’est-à-dire, sous la juridiction du comte, & il ne dépendoit du seigneur, auquel il s’étoit recommandé, qu’à raison du fief qu’il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n’est point question de [IV-205] ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, & sortoient, pour ainsi dire, de la juridiction civile, pour entrer dans la puissance du roi, ou du seigneur qu’ils vouloient choisir.
Ainsi ceux qui étoient autrefois nuement sous la puissance du roi, en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres ; puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.
2°. Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous un moment après, une loi générale [10] pour donner les fiefs aux enfans du possesseur : elle est de Charles le chauve, un des trois princes qui contracterent.
Ce que j’ai dit de la liberté qu’eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois freres, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du [IV-206] roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.
Du temps de Charlemagne [11] , lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter. Mais, sous Charles le chauve les vassaux [12] purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice : & ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu’à la restreindre. Du temps de Charlemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels ; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.
-
[↑] De l’an 806, entre Charles, Pépin & Louis. Il est rapportées par Goldaste & par Baluze, tom. I, p. 439.
-
[↑] Art. 9, p. 443. Ce qui est conforme au traité d’Andely, dans Grégoire de Tours, liv. IX.
-
[↑] Art. 10. Et il n’est point parlé de ceci dans le traité d’Andely.
-
[↑] Dans Baluze, tome I, page 174. Licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que fit le même empereur, l’an 837, art. 6, édit. de Baluze, page 686.
-
[↑] De l’an 811, édit. de Baluze, tome I. p. 486, art. 7 & 8 ; & celle de l’an 812, ibid. page 490, art. 2. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se præparet, & ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, &c. Voyez aussi le capit. de l’an 807, édit. de Baluze, tome I, page 458.
-
[↑] De l’an 793, inséré dans la loi des Lombards, liv. III, tit. 9, ch. ix.
-
[↑] En l’an 847, rapporté par Aubert le Mire & Baluze, tome II, page 42, conventus apud Marsnam.
-
[↑] Adnuntiatio.
-
[↑] Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis & in nostris fidelibus, accipiat, art. 2 de l’annonciation de Charles.
-
[↑] Capitulaire de l’an 877, tit. 53, art. 9 & 10, apud Carisiacum : Similiter & de nostris vassalis faciendum est, &c. Ce capitulaire se rapporter à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.
-
[↑] Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l’an 813, art. 16. Quòd nullus seniorem suum dimistat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum. Et le capitulaire de Pepin, de l’an 783, art. 5.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Carisiaco, de l’an 856, art. 10 & 13, édit. de Baluze, tome II, p. 83, dans lequel le roi & les seigneurs ecclésiastiques & laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de vobis sit cui suus senioratus non placet, & illi simulas ad alium seniorem meliùs quàm ad illum acaptare possit, veniat ad illum, & ipse tranquillè & pacifico animo donat illi commeatum… & qui Deus illi cupierit ad alium seniorem acaptare potuerit, pacificè habeat.
[IV-207]
CHAPITRE XXVI.
Changement dans les fiefs.
Il n’arriva pas de moindres changemens dans les fiefs que dans les aleux. On voit, par le capitulaire [1] de Compiegne, fait sous le roi Pépin, que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice donnoient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux ; mais ces parties n’étoient point distinguées du tout. Le roi les ôtoit, lorsqu’il ôtoit le tout ; & à la mort du leude, le vassal perdoit aussi son arriere-fief : un nouveau bénéficiaire venoit, qui établissoit aussi de nouveaux arriere-vassaux. Ainsi l’arriere-fief ne dépendoit point du fief ; c’étoit la personne qui dépendoit. D’un côté, l’arriere-vassal revenoit au roi, parce qu’il n’étoit pas attaché pour toujours au vassal ; & l’arriere fief revenoit de même au roi, parce qu’il étoit le fief même, & non pas une dépendance du fief.
Tel étoit l’arriere-vasselage, lorsque les fiefs étoient amovibles ; tel il étoit encore, pendant que les fiefs furent à [IV-208] vie. Cela changea, lorsque les fiefs passerent aux héritiers, & que les arriere-fiefs y passerent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n’en releva plus que médiatement ; & la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, & souvent davantage.
On voit, dans les livres des fiefs [2] , que, quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c’est-à-dire, en arriere-fief du roi, cependant, ces arriere-vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de même donner en fief ; de sorte que ce qu’ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs, une telle concession ne passoit point aux enfans comme les fiefs, parce qu’elle n’étoit point censée faite selon la loi des fiefs.
Si l’on compare l’état où étoit l’arriere-vasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arriere-fiefs conserverent plus long-temps leur nature primitive, que les fiefs.
[3] [IV-209]
Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette regle, qu’elles l’avoient presque anéantie. Car si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasseur l’avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal [4] : de même, s’il avoit donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent. Enfin, cette regle n’étoit plus suivie dans le sénat de Milan [5] .
-
[↑] De l’an 757, art. 6, édit. de Baluze, p. 181.
-
[↑] Liv. I. chap. i.
-
[↑] Au moins en Italie & en Allemagne.
-
[↑] Liv. I, des fiefs, chap. i.
-
[↑] Ibid.
[IV-209]
CHAPITRE XXVII.
Autre changement arrivé dans les fiefs.
Du temps de Charlemagne [1] , on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevoit point d’excuses ; & le comte qui auroit exempté quelqu’un, auroit [IV-210] été puni lui-même. Mais le traité des trois freres [2] mit là-dessus une restriction [3] qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un autre, fait cinq ans auparavant [4] entre les deux freres Charles le chauve & Louis roi de Germanie, par lequel ces deux freres dispenserent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu’ils fissent quelqu’entreprise l’un contre l’autre ; chose que les deux princes jurerent, & qu’ils firent jurer aux deux armées.
La mort de cent mille François à la bataille de Fontenay fit penser à ce qui restoit encore de noblesse [5] , que, par [IV-211] les querelles particulieres de ses rois sur leur partage, elle seroit enfin exterminée ; & que leur ambition & leur jalousie feroit verser tout ce qu’il y avoit encore de sang à répandre. On fit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu’il s’agiroit de défendre l’état contre une invasion étrangere. Elle fut en usage pendant plusieurs siecles.
-
[↑] Capitulaire de l’an 802, art. 7, édit. de Baluze, page 365.
-
[↑] Apud Marsnam, l’an 847, édition de Baluze, page 42.
-
[↑] Vomumus ut cujuscumque nostrûm homo, in cujuscumque regno sit, cum senioer suo in hostem, vel allis suis utilitatibus, pergat ; nisi talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat, art. 5, ibid. page 44.
-
[↑] Apud Argentoratum, dans Baluze, capitulaires, tome II, page 39.
-
[↑] Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV.
[IV-211]
CHAPITRE XXVIII.
Changemens arrivés dans les grands offices & dans les fiefs.
Il sembloit que tout prît un vice particulier, & se corrompît en même temps. J’ai dit que, dans les premiers temps, plusieurs fiefs étoient aliénés à perpétuité : mais c’étoient des cas particuliers, & les fiefs en général conservoient toujours leur propre nature ; & si la couronne avoit perdu des fiefs, elle en avoit substitué d’autres. J’ai dit encore que la couronne n’avoit [1] [IV-212] jamais aliéné les grands offices à perpétuité [2] .
Mais Charles le chauve fit un règlement général, qui affecta également é les grands offices & les fiefs : il établit, dans ses capitulaires, que les comtés [3] seroient donnés aux enfans du comte ; & il voulut que ce règlement eût encore lieu pour les fiefs.
On verra tout à l’heure que ce règlement reçut une plus grande extension ; de sorte que les grands offices & les fiefs passerent à des parens plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n’en releverent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la justice dans les plaids du roi ; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouverent entre le roi & ses hommes libres ; [IV-213] & la puissance se trouva encore reculée d’un degré.
Il y a plus : il paroît par les capitulaires [4] , que les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés, & des vassaux sous eux. Quand les comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte ne furent plus les vassaux immédiats du roi ; les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi ; les comtes devinrent plus puissans, parce que les vassaux qu’ils avoient déjà les mirent en état de s’en procurer d’autres.
Pour bien sentir l’affoiblissement qui en résulta à la fin de la seconde race, il n’y a qu’à voir ce qui arriva au commencement de la troisieme, où la multiplication des arriere-fiefs mit les grands vassaux au désespoir.
C’étoit une coutume du royaume [5] , que, quand les aînés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisoient hommage à l’aîné ; de maniere [IV-214] que le seigneur dominant ne les tenoit plus qu’en arriere-fief. Philippe Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint Paul, de Dampierre, & autres seigneurs, déclarerent [6] que dorénavant, soit que le fief fût divisé par succession ou autrement, le tout releveroit toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen. Cette ordonnance ne fut pas généralement suivie ; car, comme j’ai dit ailleurs, il étoit impossible de faire dans ces temps-là des ordonnances générales : mais plusieurs de nos coutumes se réglerent là-dessus.
-
[↑] Voyez la loi de Guy roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi salique & à celle des Lombards, tit. 6, §. 2, dans Echard.
-
[↑] Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnés par Charles Martel, & passa d’héritier en héritier jusqu’au dernier Raymond : mais, si cela est, ce fut l’effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les enfans du dernier possesseur.
-
[↑] Voyez son capitulaire, de l’an 877, tit. 53. art. 9 & 10, apud Carisiacum. Ce capitulaire se rapporter à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.
-
[↑] Le capitulaire III, de l’an 812, art. 7 ; & celui de l’an 815, art. 6, sur les Espagnols ; le recueil des capitulaires, liv. V, art. 228 ; & le capitul. de l’an 869, art. 2 ; & celui de l’an 877, art. 13, édit. de Baluze
-
[↑] Comme il paroît par Othon de Frissingue, des gestes de Frédéric, liv. II, ch. xxix.
-
[↑] Voyez l’ordonnance de Philippe Auguste, de l’an 1209, dans le nouveau recueil.
[IV-214]
CHAPITRE XXIX.
De la nature des fiefs depuis le regne de Charles le chauve.
J’ai dit que Charles le chauve voulut que, quand le possesseur d’un grand office ou d’un fief laisseroit en mourant un fils, l’office ou le fief lui fût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résulterent, & de [IV-215] l’extension qu’on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve, dans les livres [1] des fiefs, qu’au commencement du regne de l’empereur Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petits-fils ; ils passoient seulement à celui des enfans [2] du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi ; ainsi les fiefs furent donnés par une espece d’élection, que le seigneur fit entre ses enfans.
J’ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre, comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, & à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu’on prenoit toujours les rois dans cette race ; elle l’étoit encore, parce que les enfans succédoient : elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfans. Comme les choses vont toujours de proche en proche, & qu’une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, on suivit [3] , pour la succession des fiefs, le même esprit que l’on avoit suivi pour la succession à la [IV-216] couronne. Ainsi les fiefs passerent aux enfans, & par droit de succession & par droit d’élection ; & chaque fief se trouva, comme la couronne, électif & héréditaire.
Ce droit d’élection, dans la personne du seigneur, ne subsistoit [4] pas du temps des auteurs [5] des livres des fiefs, c’est-à-dire, sous le regne de l’empereur Frédéric I.
-
[↑] Liv. I, tit. I.
-
[↑] Sic progressum est, ut as filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare, ibid.
-
[↑] Au moins en Italie & en Allemagne.
-
[↑] Quod hodiè ità stabilitum est, ut as omnes æqualiter veniat, liv. I. des fiefs, tit. I.
-
[↑] Gerardus Niger, & Aubertus de Orto.
[IV-216]
CHAPITRE XXX.
Continuation du même sujet.
Il est dit, dans les livres des fiefs, que, quand l’empereur Conrad [1] partit pour Rome, les fideles qui étoient à son service, lui demanderent de faire une loi pour que les fiefs, qui passoient aux enfans, passassent aussi aux petits-enfans ; & que celui dont le frere étoit mort sans héritiers légitimes, pût succéder au fief qui avoit appartenu à leur pere commun : cela fut accordé.
[IV-217]
On y ajoute, & il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient [2] du temps de l’empereur Frédéric I, « que les anciens jurisconsultes [3] avoient toujours tenu que la succession des fiefs en ligne collatérale ne passoit point au-delà des freres germains ; quoique, dans des temps modernes, on l’eût portée jusqu’au septieme degré ; comme, par le droit nouveau, on l’avoit portée en ligne directe jusqu’à l’infini ». C’est ainsi que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.
Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l’histoire de France fera voir que la perpétuité des fiefs s’établit plutôt en France qu’en Allemagne. Lorsque l’empereur Conrad II commença à régner en 1024, les choses se trouverent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France sous le regne de Charles le chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis le regne de Charles le chauve, il se fit de tels changemens, que Charles le simple se trouva hors d’état de disputer à une maison étrangere ses droits [IV-218] incontestables à l’empire ; & qu’enfin, du temps de Hugues Capet, la maison régnante, dépouillée de tous ses domaines, ne put pas même soutenir la couronne.
La foiblesse d’esprit de Charles le chauve mit en France une égale foiblesse dans l’état. Mais, comme Louis le Germanique son frere, & quelques-uns de ceux qui lui succéderent, eurent de plus grandes qualités, la force de leur état se soutint plus long-temps.
Que dis-je ? Peut-être que l’humeur flegmatique, & si j’ose le dire, l’immutabilité de l’esprit de la nation Allemande, résista plus long-temps que celui de la nation Françoise à cette disposition des choses, qui faisoit que les fiefs, comme par une tendance naturelle, se perpétuoient dans les familles.
J’ajoute que le royaume d’Allemagne ne fut pas dévasté, & pour ainsi dire, anéanti, comme le fut celui de France, par ce genre particulier de guerre que lui firent les Normands & les Sarrasins. Il y avoit moins de richesses en Allemagne, moins de villes à saccager, moins de côtes à parcourir, [IV-219] plus de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les Princes, qui ne virent pas à chaque instant l’état prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vassaux, c’est-à-dire, en dépendirent moins. Et il y a apparence que, si les empereurs d’Allemagne n’avoient été obligés de s’aller faire couronner à Rome, & de faire des expéditions continuelles en Italie, les fiefs auroient conservé plus long-temps chez eux leur nature primitive.
[IV-219]
CHAPITRE XXXI.
Comment l’empire sortit de la maison de Charlemagne.
L’empire qui, au préjudice de la branche de Charles le chauve, avoit déjà été donné aux bâtards [1] de celle de Louis le Germanique, passa encore dans une maison étrangere, par l’élection de Conrad, duc de Franconie, l’an 912. La branche qui régnoit en France, & qui pouvoit à peine disputer des villages, étoit encore moins en état de disputer l’empire. Nous [IV-220] avons un accord passé entre Charles le simple & l’empereur Henri I, qui avoit succédé à Conrad. On l’appelle le pacte de Bonn [2] . Les deux princes se rendirent dans un navire qu’on avoit placé au milieu du Rhin, & se jurerent une amitié éternelle. On employa un mezzo termine assez bon. Charles prit le titre de roi de la France occidentale, & Henri celui de roi de la France orientale. Charles contracta avec le roi de Germanie, & non avec l’empereur.
-
[↑] Arnoul, & son fils Louis IV.
-
[↑] De l’an 916, rapporté par Aubert le Mire, cod. donationum piarum, ch. xxvii.
[IV-220]
CHAPITRE XXXII.
Comment la couronne de France passa dans la maison de Hugues Capet.
L’hérédité des fiefs, & l’établissement général des arriere-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, & formerent le gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, ils n’en eurent plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent. Les rois n’eurent presque plus [IV-221] d’autorité directe : un pouvoir qui devoit passer par tant d’autres pouvoirs, & par de si grands pouvoirs, s’arrêta ou se perdit avant d’arriver à son terme. De si grands vassaux n’obéirent plus ; & ils se servirent même de leurs arriere-vassaux pour ne plus obéir. Les rois, privés de leurs domaines, réduits aux villes de Rheims & de Laon, resterent à leur merci. L’arbre étendit trop loin ses branches, & la tête se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd’hui l’empire. On donna la couronne à un des plus puissans vassaux.
Les Normands ravageoient le royaume : ils venoient sur des especes de radeaux ou de petits bâtimens, entroient par l’embouchure des rivieres, les remontoient, & dévastoient le pays des deux côtés. Les villes d’Orléans & de Paris [1] arrêtoient ces brigands ; & ils ne pouvoient avancer ni sur la Seine, ni sur la Loire. Hugues Capet, qui possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les deux clefs [IV-222] des malheureux restes du royaume ; on lui déféra une couronne qu’il étoit seul en état de défendre. C’est ainsi que depuis on a donné l’empire à la maison qui tient immobiles les frontieres des Turcs.
L’empire étoit sorti de la maison de Charlemagne, dans le temps que l’hérédité des fiefs ne s’établissoit que comme une condescendance. Elle fut même plus tard [2] en usage chez les Allemands que chez les François : cela fit que l’empire, considéré comme un fief, fut électif. Au contraire, quand la couronne de France sortit de la maison de Charlemagne, les fiefs étoient réellement héréditaires dans ce royaume : la couronne, comme un grand fief, le fut aussi.
Du reste, on a eu grand tort de rejeter sur le moment de cette révolution tous les changemens qui étoient arrivés, ou qui arriverent depuis. Tout se réduisit à deux événemens, la famille régnante changea, & la couronne fut unie à un grand fief.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de l’an 877, apud Carisiacum, sur l’importance de Paris, de Saint-Denys, & des châteaux sur la Loire, dans ces temps-là.
-
[↑] Voyez ci-dessus le ch. xxx, page 199.
[IV-223]
CHAPITRE XXXIII.
Quelques conséquences de la perpétuité des fiefs.
Il suivit, de la perpétuité des fiefs, que le droit d’aînesse & de primogéniture s’établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la premiere race [1] ; la couronne se partageoit entre les freres, les alleus se divisoient de même ; & les fiefs, amovibles ou à vie, n’étant pas un objet de sucession, ne pouvoient pas être un objet de partage.
Dans la seconde race le titre d’empereur qu’avoit Louis le débonnaire, & dont il honora Lothaire, son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espece de primauté sur ses cadets.
Les deux rois [2] devoient aller trouver l’empereur chaque année, lui porter des présens, & en recevoir de lui [IV-224] de plus grands ; ils devoient conférer avec lui sur les affaires communes. C’est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobart [3] écrivit pour ce prince, il allégua la disposition de l’empereur même qui avoit associé Lothaire à l’empire, après que, par trois jours de jeûne & par la célébration des saints sacrifices, par des prieres & des aumônes, Dieu avoit été consulté ; que la nation lui avoit prêté serment, qu’elle ne pouvoit point se parjurer ; qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. Il pese sur tout ceci, & non pas sur le droit d’aînesse. Il dit bien que l’empereur avoit désigné un partage aux cadets, & qu’il avoit préféré l’aîné : mais, en disant qu’il avoit préféré l’aîné, c’étoit dire en même-temps qu’il auroit pu préférer les cadets.
Mais, quand les fiefs furent héréditaires, le droit d’aînesse s’établit dans la succession des fiefs ; & par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui [IV-225] formoit des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d’un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; & la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.
Les fiefs passant aux enfans du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d’en disposer ; & pour s’en dédommager, ils établirent un droit qu’on appella le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d’abord en ligne directe ; & qui par usage, ne se paya plus qu’en ligne collatérale.
Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods & ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d’abord arbitraires : mais quand la pratique d’accorder ces permissions devint générale, on le fixa dans chaque contrée.
Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d’héritier, & se paya même d’abord en ligne directe [4] .
[IV-226] La coutume la plus générale l’avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux & incommode au vassal, & affectoit, pour ainsi dire, le fief. Il obtint souvent [5] , dans l’acte d’hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu’une certaine somme d’argent, laquelle, par les changemens arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve aujourd’hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods & ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu’on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, & on continua à payer une certaine portion du prix.
Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arriere-fief ; il eût été absurde qu’un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais lorsqu’ils [IV-227] devinrent perpétuels, cela [6] fut permis, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes [7] ; ce qu’on appella se jouer de son fief.
La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme [8] . Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car, comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.
La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l’Aquitaine, & Mathilde à la Normandie ; & le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le jeune, après la dissolution de son mariage avec [IV-228] Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appelloit les femmes à la succession des fiefs, se soit introduite plus tard [9] dans la comté de Toulouse, que dans les autres provinces du royaume.
La constitution de divers royaumes de l’Europe a suivi l’état actuel où étoient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succéderent ni à la couronne de France, ni à l’empire ; parce que, dans l’établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient succéder aux fiefs : mais elles succéderent dans les royaumes dont l’établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui le furent par les conquêtes faites sur les Maures ; d’autres enfin qui, au-delà des limites de l’Allemagne, & dans des temps assez [IV-229] modernes, prirent en quelque façon une seconde naissance par l’établissement du christianisme.
Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les servir ; & il n’étoit point question des mineurs. Mais quand ils furent perpétuels [10] , les seigneurs prirent le fief jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes. C’est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d’autres principes que ceux de la tutelle, & en est entiérement distincte.
Quand les fiefs étoient à vie, on se recommandoit pour un fief ; & la tradition réelle, qui se faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd’hui l’hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, reçussent les hommages dans les provinces ; & cette [IV-230] fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquefois prêter le serment de fidélité [11] à tous les sujets ; mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu’on établit depuis, que, dans ces derniers, le serment de fidélité étoit une action jointe à l’hommage [12] , qui tantôt suivoit & tantôt précédoit l’hommage, qui n’avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que l’hommage, & en étoit entiérement distincte.
Les comtes & les envoyés du roi faisoient encore, dans les occasions, [IV-231] donner aux vassaux [13] dont la fidélité étoit suspecte une assurance qu’on appelloit firmitas ; mais cette assurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois [14] se la donnoient entr’eux.
Que si l’abbé Suger [15] parle d’une chaire de Dagobert, où, selon le rapport de l’antiquité, les rois de France avoient coutume de recevoir les hommages des seigneurs, il est clair qu’il emploie ici les idées & le langage de son temps.
Lorsque les fiefs passerent aux héritiers, la reconnoissance du vassal, qui n’étoit dans les premiers temps qu’un chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faites d’une maniere plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités ; parce qu’elle devoit porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur & du vassal dans tous les âges.
Je pourrois croire que les hommages commencerent à s’établir du temps [IV-232] du roi Pépin, qui est le temps où j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnée à perpétuité : mais je le croirois avec précaution, & dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales des Francs [16] n’ayent pas été des ignorans qui, décrivant les cérémonies de l’acte de fidélité que Tassillon, duc de Baviere, fit à Pépin, ayent parlé [17] suivant les usages qu’ils voyoient pratiquer de leur temps.
-
[↑] Voyez la loi salique & la loi des Ripuaires au titre des alleus.
-
[↑] Voyez le capitulaire de l’an 817, qui contient le premier partage que Louis le débonnaire fit entre ses enfans.
-
[↑] Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l’une a pour titre de divisione imperii.
-
[↑] Voyez l’ordonnance de Philippe-Auguste, de l’an 1209, sur les fiefs.
-
[↑] On trouve dans les chartres plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de Vendôme, & celui de l’abbaye de S. Cyprien en Poitou, dont M. Galland, page 55, a donné des extraits.
-
[↑] Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c’est-à-dire, en éteindre une portion.
-
[↑] Elles fixerent la portion dont on pouvoit se jouer.
-
[↑] C’est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier.
-
[↑] La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession particulieres. Voyez ce que M. de la Thaumassiere nous dit sur les maisons du Berri.
-
[↑] On voit dans le capitulaire de l’année 877, apud Carisiacum, art. 3, édit. de Baluze¸tome II, p. 269, le moment où les rois firent administrer les fiefs, pour les conserver aux mineurs : exemple qui fut suivi par les seigneurs, & donna l’origine à ce que nous appellons la garde-noble.
-
[↑] On en trouve la formule dans le capitulaire II de l’an 802. Voyez aussi celui de l’an 854, art. 13, & autres.
-
[↑] M. Du Cange, au mot hominium, p. 1163, & au mot fidelitas, p. 474, cite les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent, & grand nombre d’autorités qu’on peut voir. Dans l’hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, & juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles. L’hommage se faisoit à genoux ; le serment de fidélité debout. Il n’y avoit que le seigneur qui pût recevoir l’hommage ; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Litleton, sect. 91 & 92. Foi & hommage, c’est fidélité & hommage.
-
[↑] Capitulaire de Charles le chauve, de l’an 860 ; post reditum à Constuentibus, art. 3, édit. de Baluze, page 145.
-
[↑] Ibid. art. I.
-
[↑] Lib. de administratione suâ.
-
[↑] Anno 757, chap. xvii.
-
[↑] Tassillo venit in vassatico se commendans, perm anus sacramenta juravit multa & innumerabilia, reliquiis sanctorum manus imponens, & fidelitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu’il y auroit là un hommage & un serment de fidélité. Voyez à la page 212, la note 2.
[IV-233]
CHAPITRE XXXIV.
Continuation du même sujet.
Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie, ils n’appartenoient guere qu’aux lois politiques ; c’est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là, il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais, lorsqu’ils devinrent héréditaires, qu’ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent & aux lois politiques & aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenoit au droit politique ; considéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.
Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l’ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s’établit, malgré la disposition du droit Romain & de la loi salique [1] , cette regle du droit [IV-234] François, propres ne remontent point [2] . Il falloit que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette regle n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons de Boutillier [3] .
Les fiefs étant devenus héreditaires, les seigneurs qui devoient veiller à ce que le fief fût servi, exigerent que les filles [4] qui devoient succéder au fief, & je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier dans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariages devinrent, pour les nobles, une disposition féodale & une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d’abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, [IV-235] comme l’ont remarqué Boyer [5] & Aufrerius [6] .
Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l’ancien droit des parens, qui est un mystere de notre ancienne jurisprudence Françoise que je n’ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l’égard des fiefs, que lorsqu’ils devinrent perpétuels.
Italiam, Italiam… [7] . Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l’ont commencé.
Fin de l’Esprit des Lois.
-
[↑] Au titre des alleus.
-
[↑] Livre IV, de feudis, tit. 59.
-
[↑] Somme rurale, liv. I, tit. 76, pag. 447.
-
[↑] Suivant une ordonnance de S. Louis, de l’an 1246, pour constater les coutumes d’Anjou & du Maine, ceux qui auront le bail d’une fille héritiere d’un fief donneront assurance au seigneur qu’elle ne sera mariée que de son consentement.
-
[↑] Décis. 155, n°. 8 ; & 210, n°. 38.
-
[↑] In capell. Thol. décision 453.
-
[↑] Enéide, liv. III, vers 523.
[IV-239]
DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.↩
A laquelle l'on a joint quelques éclaircissemens.↩
PREMIERE PARTIE.
On a divisé cette défense en trois parties. Dans la premiere, on a répondu aux reproches généraux qui ont été faits à l’auteur de l’esprit des lois. Dans la seconde, on répond aux reproches particuliers. La troisieme, contient des réflexions sur la maniere dont on l’a critiqué. Le public va connoître l’état des choses ; il pourra juger.
[IV-240]
I.
Quoique l’esprit des lois soit un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence, l’auteur a eu souvent occasion d’y parler de la religion chrétienne : il l’a fait de maniere à en faire sentir toute la grandeur ; & s’il n’a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.
Cependant, dans deux feuilles périodiques [1] qui ont paru coup sur coup, on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s’agit pas moins que de savoir s’il est spinosiste & déiste ; & quoique ces deux accusations soient pas elles-mêmes contradictoires, on le mene sans cesse de l’une à l’autre. Toutes les deux étant incompatibles, ne peuvent pas le rendre plus coupable qu’une seule, mais toutes les deux peuvent le rendre plus odieux.
Il est donc spinosiste, lui qui, dès le premier article de son livre, a distingué le monde matériel d’avec les intelligences spirituelles.
[IV-241]
Il est donc spinosiste, lui qui, dans le second article, a attaqué l’athéisme. Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité : car, quelle plus grande absurdité, qu’une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens ?
Il est donc spinosiste, lui qui a continué par ces paroles : Dieu a du rapport à l’univers comme créateur & comme conservateur [2] : les lois selon lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces regles, parce qu’il les connoît ; il les connoît, parce qu’il les a faites ; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse & sa puissance.
Il est donc spinosiste, lui qui a ajouté : Comme nous voyons que le monde [3] formé par le mouvement de la matiere, & privé d’intelligence, subsiste toujours, &c.
Il est donc spinosiste, lui qui a démontré [4] contre Hobbes & Spinosa, que les rapports de justice & d’équité étoient antérieurs à toutes les lois positives.
Il est donc spinosiste, lui qui a dit, au commencement du chapitre second : [IV-242] Cette loi qui, en imprimant dans nous-même l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles par son importance.
Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de toutes ses forces le paradoxe de Bayle, qu’il vaut mieux être athée qu’idolâtre ? Paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses conséquences.
Que dit-on, après des passages si formels ? Et l’équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l’accusation.
Première objection.
L’auteur tombe dès le premier pas. Les lois, dans la signification la plus étendue, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Les lois des rapports ! cela se conçoit-il ? … Cependant l’auteur n’a pas changé la définition ordinaire des lois sans dessein. Quel est donc sont but ? le voici. Selon le nouveau systême, il y a entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le grand tout, un enchaînement si nécessaire, que le moindre dérangement porteroit la [IV-243] confusion jusqu’au trône du premier être. C’est ce qui fait dire à Pope, que les choses n’ont pu être autrement qu’elles ne sont, & que tout est bien comme il est dit. Cela posé, on entend la signification de ce langage nouveau, que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. À quoi l’on ajoute que, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois ; la divinité a ses lois ; le monde matériel a ses lois ; les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs lois ; l’homme a ses lois.
Réponse.
Les tenebres mêmes ne sont pas plus obscures que ceci. Le critique a oui dire, que Spinosa admettoit un principe aveugle & nécessaire qui gouvernoit l’univers ; il ne lui en faut pas davantage : dès qu’il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L’auteur a dit que les lois étoient un rapport nécessaire ; voilà donc du spinosisme, parce que voilà du nécessaire. Et ce qu’il y a de surprenant, c’est que l’auteur, chez le critique, se trouve spinosiste à cause de cet article, [IV-244] quoique cet article combatte expressément les systêmes dangereux. L’auteur a eu en vue d’attaquer le systême de Hobbes ; systême terrible qui, faisant dépendre toutes les vertus & tous les vices de l’établissement des lois que les hommes se sont faites ; & voulant prouver que les hommes naissent tous en état de guerre, & que la premiere loi naturelle est la guerre de tous contre tous, renverse, comme Spinosa, & tout religion & toute morale. Sur cela, l’auteur a établi, premiérement, qu’il y avoit des lois de justice & d’équité avant l’établissement des lois positives : il a prouvé que tous les êtres avoient des lois ; que, même avant leur création, ils avoient des lois possibles ; que Dieu lui-même avoit des lois, c’est-à-dire, les lois qu’il s’étoit faites. Il a démontré [5] , qu’il étoit faux que les hommes naquissent en état de guerre ; il a fait voir que l’état de guerre n’avoit commencé qu’après l’établissement des sociétés ; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l’auteur a attaqué les erreurs de Hobbes, & les conséquences de [IV-245] celles de Spinosa ; & qu’il lui est arrivé qu’on l’a si peu entendu, que l’on n’a pris pour des opinions de Spinosa les objections qu’il fait contre le spinosisme. Avant d’entrer en dispute, il faudroit commencer par se mettre au fait de l’état de la question ; & savoir du moins si celui qu’on attaque est ami ou ennemi.
Seconde objection.
Le critique continue : Sur quoi l’auteur cite Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels. Mais est ce d’un païen, &c.
Réponse.
Il est vrai que l’auteur a cité Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels.
Troisieme objection.
L’auteur a dit, que la création, qui paroît être un acte arbitraire, suppose des regles aussi invariables, que la fatalité des athées. De ces termes, le critique conclut que l’auteur admet la fatalité des athées.
[IV-246]
Réponse.
Un moment auparavant, il a détruit cette fatalité par ces paroles : Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle gouverne l’univers, ont dit une grande absurdité : car quelles plus grande absurdité, qu’une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens ? De plus, dans le passage qu’on censure, on ne peut faire parler l’auteur que de ce dont il parle. Il ne parle point des causes, & il ne compare point les causes ; mais il parle des effets, & il compare les effets. Tout l’article, celui qui le précede & celui qui le suit, font voir qu’il n’est question ici que des regles du mouvement, que l’auteur dit avoir été établies par Dieu : elles sont invariables, ces regles, & toute la physique le dit avec lui ; elles sont invariables, parce que Dieu a voulu qu’elles fussent telles, & qu’il a voulu conserver le monde. Il n’en dit ni plus ni moins.
Je dirai toujours que le critique n’entend jamais le sens des choses, & ne s’attache qu’aux paroles. Quand l’auteur a dit que la création, qui paroissoit être un acte arbitraire, supposoit [IV-247] des regles aussi invariables que la fatalité des athées ; on n’a pas pu l’entendre, comme s’il disoit que la création fût un acte nécessaire comme la fatalité des athées, puisqu’il a déjà combattu cette fatalité. De plus : les deux membres d’une comparaison doivent se rapporter ; ainsi il faut absolument que la phrase veuille dire : la création, qui paroît d’abord devoir produire des regles de mouvement variables, en a d’aussi invariables que la fatalité des athées. Le critique, encore une fois, n’a vu & ne voit que les mots.
II.
Il n’y a donc point de spinosisme dans l’esprit des lois. Passons à une autre accusation ; & voyons s’il est vrai que l’auteur ne reconnoisse par la religion révélée. L’auteur, à la fin du chapitre premier, parlant de l’homme, qui est une intelligence finie, sujette à l’ignorance & à l’erreur, a dit : Un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur : Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion.
[IV-248]
Il a dit au chapitre premier du livre XXIV : Je n’examinerai les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur terre.
Il ne faudra que très-peu d’équité pour voir que je n’ai jamais prétendu faire céder les intérêts de la religion aux intérêts politiques, mais les unir : or, pour les unir, il faut les connoître. La religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques & les meilleures lois civiles, parce qu’elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir.
Et au chapitre second du même livre : Un prince qui aime la religion, & qui la craint, est un lion qui cede à la main qui le flatte, ou à la voix qui l’appaise. Celui qui craint la religion, & qui la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent. Celui qui n’a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent [IV-249] sa liberté, que lorsqu’il déchire & qu’il dévore.
Au chapitre troisieme du même livre : Pendant que les princes Mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion, chez les princes chrétiens, rend les princes moins timides, & par conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses sujets, & les sujets sur le prince. Chose admirable ! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d’objet que la félicité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.
Au chapitre quatrieme du même livre : Sur le caractere de la religion chrétienne & celui de la mahométane, l’on doit, sans autre examen, embrasser l’une & rejeter l’autre. On prie de continuer.
Dans le Chapitre sixieme : M. Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne : il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non ? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très grand zele pour les remplir ; ils sentiroient très bien les droits de la défense naturelle ; plus ils croiroient [IV-250] devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.
Il est étonnant que ce grand homme n’ait pas su distinguer les ordres pour l’établissement du christianisme d’avec le christianisme même ; & qu’on puisse lui imputer d’avoir méconnu l’esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu de donner des lois, a donné des conseils ; c’est qu’il a vu que ses conseils, s’ils étoient ordonnés comme des lois, seroient contraires à l’esprit de ses lois.
Au chapitre dixieme : Si je pouvois un moment cesser de penser que je suis chrétien, je ne pourrois m’empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon au nombre des malheurs du genre humain, &c. Faites abstraction des vérités révélées ; cherchez dans toutes la nature, vous n’y trouverez pas de plus grand objet que les Amonins, &c.
Et au chapitre treizieme : La religion païenne, qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main & [IV-251] abandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. Mais une religion qui enveloppe toutes les passions ; qui n’est pas plus jalouse des actions que des désirs & des pensées ; qui ne nous tient point attachés par quelque chaîne, mais par un nombre innombrable de fils ; qui laisse derriere elle la justice humaine, & commence une autre justice ; qui est faite pour mener sans cesse du repentir à l’amour, & de l’amour au repentir ; qui met entre le juge & le criminel un grand médiateur, entre le juste & le médiateur un grand juge : une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu’elle donne des craintes & des espérances à tous, elle fait assez sentir que, s’il n’y a point de crime qui par sa nature soit inexpiable, toute une vie peut l’être ; qu’il seroit très-dangereux de tourmenter la miséricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations ; qu’inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le Seigneur, nous devons craindre d’en contracter de nouvelles, de combler la mesure, & d’aller jusqu’au terme où la bonté paternelle finit.
Dans le chapitre dix-neuvieme, à la fin, l’auteur après avoir fait sentir les [IV-252] abus de diverses religions païennes ; sur l’état des ames dans l’autre vie, dit : Ce n’est pas assez pour une religion d’établir un dogme ; il faut encore qu’elle le dirige : c’est ce qu’a fait admirablement bien la religion chrétienne, à l’égard des dogmes dont nous parlons. Elle nous fait espérer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissions : tout, jusqu’à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.
Et au chapitre vingt-sixieme, à la fin : Il suit de là qu’il est presque toujours convenable qu’une religion ait des dogmes particuliers, & un culte général. Dans les lois qui concernent les pratiques du culte, il faut peu de détails ; par exemple, des mortifications, & non pas une certaine mortification. Le christianisme est plein de bon sens : l’abstinence est de droit divin ; mais une abstinence particuliere est de droit de police, & on peut la changer.
Au chapitre dernier, livre vingt-cinquieme : Mais il n’en résulte pas qu’une religion apportée dans un pays très-éloigné, & totalement différent de climat, de lois, de mœurs & de manieres, [IV-253] ait tout le succès que sa sainteté devroit lui promettre.
Et au chapitre troisieme du livre vingt-quatrieme : C’est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l’empire & le vice du climat, a empêché le despotisme de s’établir en Ethiopie, & a porté au milieu de l’Afrique les mœurs de l’Europe & ses lois, &c. Tout près de là on voit le mahométisme faire enfermer les enfans du roi de Sennar : à sa mort, le conseil les envoie égorger, en faveur de celui qui monte sur le trône.
Que, d’un côté, l’on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois & des chefs Grecs & Romains ; & de l’autre, la destruction des peuples & des villes par ces mêmes chefs, Thimur & Gengiskan, qui ont dévasté l’Asie ; & nous verrons que nous devons au christianisme, & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne sauroit assez reconnoître. On supplie de lire tout le chapitre.
Dans le chapitre huitieme du livre ving-quatrieme : Dans un pays où l’on a le malheur d’avoir une religion que Dieu n’a pas donnée, il est toujours nécessaire [IV-254] qu’elle s’accorde avec la morale, parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes.
Ce sont des passages formels. On y voit un écrivain, qui non-seulement croit la religion chrétienne, mais qui l’aime. Que dit-on, pour prouver le contraire ? Et on avertit, encore une fois, qu’il faut que les preuves soient proportionnées à l’accusation : cette accusation n’est pas frivole, les preuves ne doivent pas l’être ; & comme ces preuves sont données dans une forme assez extraordinaire, étant toujours moitié preuves, moitié injures, & se trouvant comme enveloppées dans la suite d’un discours fort vague, je vais les chercher.
Premiere objection.
L’auteur [6] a loué les stoïciens, qui admettoient une fatalité aveugle, un enchaînement nécessaire, &c. C’est le fondement de la religion naturelle.
[IV-255]
Réponse.
Je suppose, un moment, que cette mauvaise maniere de raisonner soit bonne. L’auteur a-t-il loué la physique & la métaphysique des stoïciens ? Il a loué leur morale ; il dit que les peuples en avoient tiré de grands biens : il a dit cela, & il n’a rien dit de plus. Je me trompe ; il a dit plus : car, dès la premiere page du livre, il a attaqué cette fatalité des stoïciens : Il ne l’a donc point louée, quand il a loué les stoïciens.
Seconde objection.
L’auteur a loué Bayle [7] , en l’appellant un grand homme.
Réponse.
Je suppose encore un moment, qu’en général cette maniere de raisonner soit bonne : elle ne l’est pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que l’auteur a appellé Bayle un grand homme ; mais il a censuré ses opinions : s’il les a censurées, il ne les admet pas. Et puisqu’il [IV-256] a combattu ses opinions, il ne l’appelle pas un grand homme à cause de ses opinions. Tout le monde sait que Bayle avoit un grand esprit dont il a abusé ; mais cet esprit dont il a abusé, il l’avoit. L’auteur a combattu ses sophismes, & il plaint ses égaremens. Je n’aime point les gens qui renversent les lois de leur patrie ; mais j’aurois de la peine à croire que César & Cromwell fussent de petits esprits : Je n’aime point les conquérans ; mais on ne pourra guere me persuader qu’Alexandre & Gengiskan ayent été des génies communs. Il n’auroit pas fallu beaucoup d’esprit à l’auteur, pour dire que Bayle étoit un homme abominable ; mais il y a apparence qu’il n’aime point à dire des injures, soit qu’il tienne cette disposition de la nature, soit qu’il l’ait reçue de son éducation. J’ai lieu de croire que, s’il prenoit la plume, il n’en diroit pas même à ceux qui ont cherché à lui faire un des plus grands maux qu’un homme puisse faire à un homme, en travaillant à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent pas, & suspect à tous ceux qui le connoissent.
[IV-257]
De plus, j’ai remarqué que les déclamations des hommes furieux ne font guere d’impression que sur ceux qui sont furieux eux-mêmes. La plupart des lecteurs sont des gens modérés : on ne prend guere un livre que lorsqu’on est de sang froid ; les gens raisonnables aiment les raisons. Quand l’auteur auroit dit mille injures à Bayle, il n’en seroit résulté, ni que Bayle eût bien raisonné, ni que Bayle eût mal raisonné : tout ce qu’on en auroit pu conclure auroit été, que l’auteur savoit dire des injures.
Troisieme objection.
Elle est tirée de ce que l’auteur n’a point parlé, dans son chapitre premier, du péché originel [8] .
Réponse.
Je demande à tout homme sensé, si ce chapitre est un traité de théologie ? Si l’auteur avoit parlé du péché originel, on lui auroit pu imputer, tout de même, de n’avoir pas parlé de la rédemption : ainsi d’article en article à l’infini.
[IV-258]
Quatrieme objection.
Elle est tirée de ce que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l’auteur, & qu’il a d’abord parlé de la révélation.
Réponse.
Il est vrai que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l’auteur, & qu’il a d’abord parlé de la révélation.
Cinquieme objection.
L’auteur a suivi le systême du poëme de Pope.
Réponse.
Dans tout l’ouvrage il n’y a pas un mot du systême de Pope.
Sixieme objection.
L’auteur dit que la loi qui prescrit à l’homme ses devoirs envers Dieu, est la plus importante ; mais il nie qu’elle soit la premiere : il prétend que la premiere loi [IV-259] de la nature est la paix ; que les hommes ont commencé par avoir peur les uns des autres, &c. Que les enfans savent que la premiere loi, c’est d’aimer Dieu ; & la seconde, c’est d’aimer son prochain.
Réponse.
Voici les paroles de l’auteur : Cette loi [9] qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles, par son importance, & non pas dans l’ordre de ces lois. L’homme, dans l’état de nature, auroit plutôt la faculté de connoître, qu’il n’auroit de connoissances. Il est clair que ses premieres idées ne seroient point des idées spéculatives : il songeroit à la conservation de son être, avant de chercher l’origine de son être. Un homme pareil ne sentiroit d’abord que sa foiblesse ; sa timidité seroit extrême ; & si l’on avoit là-dessus besoin de l’expérience, l’on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages ; tout les fait trembler, tout les fait fuir. L’auteur a donc dit que la loi qui, en imprimant en nous-mêmes l’idée du créateur, nous porte vers lui, [IV-260] étoit la premiere des lois naturelles. Il ne lui a pas été défendu, plus qu’aux philosophes & aux écrivains du droit naturel, de considérer l’homme sous divers égards : il lui a été permis de supposer un homme comme tombé des nues, laissé à lui-même & sans éducation, avant l’établissement des sociétés. Eh bien ! l’auteur a dit que la premiere loi naturelle, la plus importante, & par conséquent la capitale, seroit pour lui, comme pour tous les hommes, de se porter vers son créateur : il a aussi été permis à l’auteur d’examiner quelle seroit la premiere impression qui se feroit sur cet homme, & de voir l’ordre dans lequel ces impressions seroient reçues dans son cerveau : & il a cru qu’il auroit des sentimens, avant de faire des réflexions ; que le premier, dans l’ordre du temps, seroit la peur ; ensuite, le besoin de se nourrir, &c. L’auteur a dit que la loi qui, imprimant en nous l’idée du créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles : le critique dit que la premiere loi naturelle est d’aimer Dieu. Ils ne sont divisés que par les injures.
[IV-261]
Septieme objection.
Elle est tirée du chapitre I du premier livre, où l’auteur, après avoir dit que l’homme étoit un être borné, a ajouté : Un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur ; Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion. Or, dit-on, quelle est cette religion dont parle l’auteur ? il parle sans doute de la religion naturelle ; il ne croit donc que la religion naturelle.
Réponse.
Je suppose, encore un moment, que cette maniere de raisonner soit bonne ; & que, de ce que l’auteur n’auroit parlé là que de la religion naturelle, on en pût conclure qu’il ne croit que la religion naturelle, & qu’il exclut la religion révélée. Je dis que, dans cet endroit, il a parlé de la religion révélée, & non pas de la religion naturelle : car, s’il avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un idiot. Ce seroit comme s’il disoit : Un tel être pouvoit aisément oublier son créateur, c’est-à-dire la religion naturelle ; Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion naturelle : [IV-262] de sorte que Dieu lui auroit donné la religion naturelle, pour perfectionner en lui la religion naturelle. Ainsi, pour se préparer à dire des invectives à l’auteur, on commence par ôter à ses paroles le sens du monde le plus clair, pour leur donner le sens du monde le plus absurde ; & pour avoir meilleur marché de lui, on le prive du sens commun.
Huitieme objection.
L’auteur a dit [10] , en parlant de l’homme : Un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur ; Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion : un tel être pouvoit, à tous les instans, s’oublier lui-même, les philosophes l’ont averti par les lois de la morale : fait pour vivre dans la société, il pouvoit oublier les autres ; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les lois politiques & civiles. Donc, dit le critique [11] , selon l’auteur, le gouvernement du monde est partagé entre Dieu, les philosophes & les législateurs, &c. Où les philosophes [IV-263] ont-ils appris les lois de la morale ? où les législateurs ont-ils vu ce qu’il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité ?
Réponse.
Et cette réponse est très-aisée. Ils l’ont appris dans la révélation, s’ils ont été assez heureux pour cela : ou bien dans cette loi qui, en imprimant en nous l’idée du créateur, nous porte vers lui. L’auteur de l’esprit des lois a-t-il dit comme Virgile ? César partage l’empire avec Jupiter ? Dieu, qui gouverne l’univers, n’a-t-il pas donné à de certains hommes plus de lumieres, à d’autres plus de puissance ? Vous diriez que l’auteur a dit que, parce que Dieu a voulu que des hommes gouvernassent des hommes, il n’a pas voulu qu’ils lui obéissent, & qu’il s’est démis de l’empire qu’il avoit sur eux, &c. Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de foiblesse pour raisonner, ont beaucoup de force pour déclamer.
Neuvieme objection.
Le critique continue : Remarquons encore que l’auteur, qui trouve que Dieu [IV-264] ne peut pas gouverner les êtres libres aussi bien que les autres, parce qu’étant libres, il faut qu’ils agissent par eux-mêmes ; (je remarquerai, en passant, que l’auteur ne se sert point de cette expression, que Dieu ne peut pas), ne remédie à ce désordre que par des lois qui peuvent bien montrer à l’homme ce qu’il doit faire, mais qui ne lui donnent pas de le faire : ainsi, dans le systême de l’auteur, Dieu crée des êtres dont il ne peut empêcher le désordre, ni le réparer… Aveugle, qui ne voit pas que Dieu fait ce qu’il veut de ceux mêmes qui ne font pas ce qu’il veut !
Réponse.
Le critique a déjà reproché à l’auteur de n’avoir point parlé du péché originel : il le prend encore sur le fait ; il n’a point parlé de la grace. C’est une chose triste d’avoir affaire à un homme qui censure tous les articles d’un livre, & n’a qu’une idée dominante. C’est le conte de ce curé de village, à qui des astronomes montroient la lune dans un téléscope, & qui n’y voyoit que son clocher.
L’auteur de l’esprit des lois a cru [IV-265] qu’il devoit commencer par donner quelqu’idée des lois générales, & du droit de la nature & des gens. Ce sujet étoit immense, & il l’a traité dans deux chapitres : il a été obligé d’omettre quantité de choses qui appartenoient à son sujet ; à plus forte raison a-t-il omis celles qui n’y avoient point de rapport.
Dixieme objection.
L’auteur a dit qu’en Angleterre l’homicide de soi-même étoit l’effet d’une maladie ; & qu’on ne pouvoit pas plus le punir, qu’on ne punit les effets de la démence. Un sectateur de la religion naturelle n’oublie par que l’Angleterre est le berceau de sa secte ; il passe l’éponge sur tous les crimes qu’il apperçoit.
Réponse.
L’auteur ne sait point si l’Angleterre est le berceau de la religion naturelle : mais il sait que l’Angleterre n’est pas son berceau. Parce qu’il a parlé d’un effet physique qui se voit en Angleterre, il ne pense pas sur la [IV-266] religion comme les Anglois ; pas plus qu’un Anglois, qui parleroit d’un effet physique arrivé en France, ne penseroit sur la religion comme les François. L’auteur de l’esprit des lois n’est point du tout sectateur de la religion naturelle : mais il voudroit que son critique fût sectateur de la logique naturelle.
Je crois avoir déjà fait tomber des mains du critique les armes effrayantes dont il s’est servi : je vais à présent donner une idée de son exorde, qui est tel, que je crains que l’on ne pense que ce soit par dérision que j’en parle ici.
Il dit d’abord, & ce sont ses paroles, que le livre de l’esprit des lois est une de ces productions irrégulieres… qui ne se sont si fort multipliées que depuis l’arrivée de la bulle Unigenitus. Mais, faire arriver l’esprit des lois à cause de l’arrivée de la constitution unigenitus, n’est-ce pas vouloir faire rire ? La bulle unigenitus n’est point la cause occasionnelle du livre de l’esprit des lois ; mais la bulle unigenitus & le livre de l’esprit des lois ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire au critique un [IV-267] raisonnement si puérile. Le critique continue : L’auteur dit qu’il a bien des fois commencé & abandonné son ouvrage… Cependant, quand il jetoit au feu ses premieres productions, il étoit moins éloigné de la vérité, que lorsqu’il a commencé à être content de son travail. Qu’en fait-il ? Il ajoute : Si l’auteur avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage lui auroit coûté moins de travail. Qu’en sait-il encore ? Il prononce encore cet oracle : Il ne faut pas beaucoup de pénétration, pour apercevoir que le livre de l’esprit des lois est fondé sur le systême de la religion naturelle… On a montré, dans les lettres contre le poëme de Pope, intitulé Essai sur l’homme, que le systême de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa : C’en est assez pour inspirer à un chrétien l’horreur du nouveau livre que nous annonçons. Je réponds que non-seulement c’en est assez, mais même que c’en seroit beaucoup trop. Mais je viens de prouver que le systême de l’auteur n’est pas celui de la religion naturelle ; &, en lui passant que le systême de la religion naturelle rentrât dans celui de Spinosa, le systême de l’auteur [IV-268] n’entreroit pas dans celui de Spinosa, puisqu’il n’est pas celui de la religion naturelle.
Il veut donc inspirer de l’horreur, avant d’avoir prouvé qu’on doit avoir de l’horreur.
Voici les deux formules des raisonnemens répandus dans les deux écrits auxquels je réponds : L’auteur de l’esprit des lois est un sectateur de la religion naturelle ; donc il faut expliquer ce qu’il dit ici par les principes de la religion naturelle : or, si ce qu’il dit ici est fondé sur les principes de la religion naturelle, il est un sectateur de la religion naturelle.
L’autre formule est celle-ci : L’auteur de l’esprit des lois est un sectateur de la religion naturelle : donc ce qu’il dit dans son livre en faveur de la révélation, n’est que pour cacher qu’il est un sectateur de la religion naturelle : or, s’il se cache ainsi, il est un sectateur de la religion naturelle.
Avant de finir cette premiere partie, je serois tenté de faire une objection à celui qui en a tant fait. Il a si fort effrayé les oreilles du mot de sectateur de la religion naturelle, que moi, qui [IV-269] défends l’auteur, je n’ose presque prononcer ce nom : je vais cependant prendre courage. Ses deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d’explication que celui que je défends ? Fait-il bien, en parlant de la religion naturelle & de la révélation, de se jeter perpétuellement tout d’un côté, & de faire perdre les traces de l’autre ? Fait-il bien de ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoissent que la seule religion naturelle, d’avec ceux qui reconnoissent & la religion naturelle & la révélation ? Fait-il bien de s’effaroucher toutes les fois que l’auteur considere l’homme dans l’état de la religion naturelle, & qu’il explique quelque chose sur les principes de la religion naturelle ? Fait-il bien de confondre la religion naturelle avec l’athéisme ? N’ai-je pas toujours oui dire que le christianisme étoit la perfection de la religion naturelle ? N’ai-je pas oui dire que l’on employoit la religion naturelle, pour prouver la révélation contre les déistes ? & qu’on employoit la même religion naturelle, pour prouver l’existence de Dieu contre [IV-270] les athées ? Il dit que les stoïciens étoient des sectateurs de la religion naturelle : & moi, je lui dis qu’ils étoient des athées [12] , puisqu’ils croyoient qu’une fatalité aveugle gouvernoit l’univers ; & que c’est par la religion naturelle que l’on combat les stoïciens. Il dit que le systême de la religion naturelle [13] rentre dans celui de Spinosa : & moi, je lui dis qu’ils sont contradictoires, & que c’est par la religion naturelle qu’on détruit le systême de Spinosa. Je lui dis que confondre la religion naturelle avec l’ahtéisme, c’est confondre la preuve avec la chose qu’on veut prouver, & l’objection contre l’erreur avec l’erreur même ; que c’est ôter les armes puissantes que l’on a contre cette erreur. A Dieu ne plaise que je veuille imputer aucun mauvais dessein au critique, ni faire valoir les [IV-271] conséquences que l’on pourroit tirer de ses principes : quoiqu’il ait très-peu d’ingulgence, on en veut avoir pour lui. Je dis seulement que les idées métaphysiques sont extrêmement confuses dans sa tête ; qu’il n’a point du tout la faculté de séparer ; qu’il ne sauroit porter de bons jugemens, parce que, parmi les diverses choses qu’il faut voir, il n’en voit jamais qu’une. Et cela même, je ne le dis pas pour lui faire des reproches, mais pour détruire les siens.
-
[↑] L’une du 9 octobre 1749, l’autre du 16 du même mois.
-
[↑] Livre I, chap.I.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Livre I, chap. II.
-
[↑] Page 165 de la deuxieme feuille du 16 octobre 1749.
-
[↑] Page 165 de la deuxieme feuille.
-
[↑] Feuille du 9 octobre 1749, page 162.
-
[↑] Liv. I, chap. II.
-
[↑] Livre I, chapitre I.
-
[↑] Page 162 de la feuille du 9 octobre 1749.
-
[↑] Voyez les page 165 des feuilles du 9 octobre 1749. Les stoïciens n’admettoient qu’un Dieu ; mais ce Dieu n’étoit autre chose que l’ame du monde. Ils vouloient que tous les êtres, depuis le premier, fussent nécessairement enchaînés les uns avec les autres ; une nécessité fatale entrainoît tout. Ils nioient l’immortalité de l’ame, & faisoient consister le souverain bonheur à vivre conformément à la nature. C’est le font du systême de la religion naturelle.
-
[↑] Voyez page 161 de la premiere feuille du 0 Octobre 1749, à la fin de la premiere colonne.
[IV-272]
DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.
SECONDE PARTIE.
Idée générale.
J’ai absous le livre de l’esprit des lois de deux reproches généraux dont on l’avoit chargé : il y a encore des imputations particulieres auxquelles il faut que je réponde. Mais pour donner un plus grand jour à ce que j’ai dit, & à ce que je dirai dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu, ou a servi de prétexte aux invectives.
Les gens les plus sensés de divers pays de l’Europe, les hommes les plus éclairés & les plus sages, ont regardé le livre de l’esprit des lois comme un ouvrage utile : ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes ; qu’il étoit propre à former d’honnêtes [IV-273] gens ; qu’on y détruisoit les opinions pernicieuses, qu’on y encourageoit les bonnes.
D’un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d’un livre dangereux ; il en a fait le sujet des invectives les plus outrées. Il faut que j’explique ceci.
Bien loin d’avoir entendu les endroits particuliers qu’il critiquoit dans ce livre, il n’a pas seulement su quelle étoit la matiere qui y étoit traitée : ainsi, déclamant en l’air, & combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de même espece ; il a bien critiqué le livre qu’il avoit dans la tête, il n’a pas critiqué celui de l’auteur. Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet & le but d’un ouvrage qu’on avoit devant les yeux ? Ceux qui auront quelques lumieres, verront du premier coup d’œil que cet ouvrage a pour objet les lois, les coutumes & les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense ; puisqu’il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes ; puisque l’auteur distingue ces institutions ; qu’il examine celles qui conviennent le plus à la [IV-274] société & à chaque société ; qu’il en cherche l’origine, qu’il en découvre les causes physiques & morales ; qu’il examine celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes, & celles qui n’en ont aucun ; que, de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l’est plus & celle qui l’est moins ; qu’il y discute celles qui peuvent avoir de bons effets à un certain égard, & de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion : car, y ayant sur la terre une religion vraie & une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel & une infinité d’autres qui sont nées sur la terre, il n’a pu regarder toutes les religions fausses que comme des institutions humaines ; ainsi il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et, quant à la religion chrétienne, il n’a eu qu’à l’adorer, comme étant une institution divine. Ce n’étoit point de cette religion qu’il devoit traiter ; parce que, par sa nature, elle n’est sujette à aucun examen : de sorte que, quand il en a parlé, [IV-275] il ne l’a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage, mais pour lui payer le tribut de respect & d’amour qui lui est dû par tout chrétien ; & pour que, dans les comparaisons qu’il en pouvoit faire avec les autres religions, il pût la faire triompher de toutes. Ce que je dis, se voit dans tout l’ouvrage : mais l’auteur l’a particuliérement expliqué au commencement du livre vingt-quatrieme, qui est le premier des deux livres qu’il a faits sur la religion. Il le commence ainsi : Comme on peut juger parmi les ténebres celles qui sont les moins épaisses, & parmi les abymes ceux qui sont les moins profonds ; ainsi l’on peut chercher, entre les religions fausses, celles qui sont les plus conformes au bien de la société ; celles qui, quoiqu’elles n’ayent pas l’effet de mener les hommes aux felicités de l’autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.
Je n’examinerai donc les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.
L’auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des [IV-276] institutions humaines, a dû en parler, parce qu’elles entroient nécessairement dans son plan. Il n’a point été les chercher, mais elles sont venues le chercher. Et quant à la religion chrétienne, il n’en a parlé que par occasion ; parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n’entroit point dans le plan qu’il s’étoit proposé.
Qu’a-t-on fait pour donner une ample carriere aux déclamations, & ouvrir la porte la plus large aux invectives ? On a considéré l’auteur comme si, à l’exemple de M. Abbadie, il avoit voulu faire un traité sur la religion chrétienne : on l’a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux traités de théologie chrétienne : on l’a repris comme si, parlant d’une religion quelconque, qui n’est pas la chrétienne, il avoit eu à l’examiner selon les principes & les dogmes de la religion chrétienne : on l’a jugé comme s’il s’étoit chargé, dans ses deux livres, d’établir pour les chrétiens, & de prêcher aux mahométans & aux idolâtres les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu’il a parlé de religion en général, toutes les fois qu’il a employé le mot de religion, [IV-277] on a dit : C’est la religion chrétienne. Toutes les fois qu’il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, & qu’il a dit, qu’elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays, que telle autre pratique, on a dit : Vous les approuvez donc, & abandonnez la foi chrétienne. Lorsqu’il a parlé de quelque peuple qui n’a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jesus-Christ, on lui a dit : Vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne ? Quand il a examiné, en écrivain politique, quelque pratique que ce soit, on lui a dit : C’étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte ; & je vous ferai théologien malgré vous. Vous nous donnez d’ailleurs de très-belles choses sur la religion chrétienne ; mais c’est pour vous cacher que vous les dites : car je connois votre cœur, & je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n’entends point votre livre ; il n’importe pas que j’aye démêlé bien ou mal l’objet dans lequel il a été écrit : mais je connois au fond toutes vos pensées. Je ne sais pas un [IV-278] mot de ce que vous dites ; mais j’entends très-bien ce que vous ne dites pas. Entrons à présent en matiere.
DES CONSEILS de religion.
L’auteur, dans le livre sur la religion a combattu l’erreur de Bayle. Voici ses paroles [1] : Monsieur Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non ? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très-grand zele pour les remplir. Ils sentiroient très-bien les droits de la défense naturelle. Plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans leur cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.
[IV-279]
Il est étonnant que ce grand homme n’ait pas su distinguer les ordres pour l’établissement du christianisme, d’avec le christianisme même ; & qu’on puisse lui imputer d’avoir méconnu l’esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu de donner des lois, a donné des conseils ; c’est qu’il a vu que ses conseils, s’ils étoient ordonnés comme des lois, seroient contraires à l’esprit de ses lois. Qu’a-t-on fait pour ôter à l’auteur la gloire d’avoir combattu ainsi l’erreur de Bayle ? On prend le chapitre suivant [2] , qui n’a rien à faire avec Bayle : Les lois humaines, y est-il dit, faites pour parler à l’esprit, doivent donner des préceptes, & point de conseils ; la religion, faite pour parler au cœur, doit donner beaucoup de conseils, & peu de préceptes. Et de-là on conclut que l’auteur regarde tous les préceptes de l’évangile comme des conseils. Il pourroit dire aussi que celui qui fait cette critique, regarde lui-même tous les conseils de l’évangile comme des préceptes ; mais ce n’est pas sa maniere de raisonner, & encore moins sa maniere d’agir. Allons au fait : il faut un peu alonger ce que l’auteur a raccourci. M. Bayle avoit [IV-280] soutenu qu’une société de chrétiens ne pourroit pas subsister : & il alléguoit pour cela l’ordre de l’évangile, de présenter l’autre joue, quand on reçoit un soufflet ; de quitter le monde ; de se retirer dans les déserts, &c. L’auteur a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui n’étoit que des conseils, pour des regles générales ce qui n’étoit que des regles particulieres : en cela, l’auteur a défendu la religion. Qu’arrive-t-il ? On pose, pour premier article de sa croyance, que tous les livres de l’évangile ne contiennent que des conseils.
[IV-281]
DE LA POLYGAMIE.
D’autres articles ont encore fourni des sujets commodes pour les déclamations. La polygamie en étoit un excellent. L’auteur a fait un chapitre exprès, où il l’a réprouvée : le voici.
De la Polygamie en elle-même.
A regarder la polygamie en général, indépendamment des circonstances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n’est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n’est pas non plus utile aux enfans ; & un de ses grands inconvéniens est que le pere & la mere ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfans ; un pere ne peut pas aimer vingt enfans comme une mere en aime deux. C’est bien pis, quand une femme a plusieurs maris, car pour lors l’amour paternel ne tient qu’à cette opinion, qu’un pere peut croire, s’il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains enfans lui appartiennent.
La pluralité des femmes, qui le diroit, [IV-282] mene à cet amour que la nature désavoue, c’est qu’une dissolution en entraîne toujours une autre, &c.
Il y a plus ; la possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les désirs pour celle d’un autre ; il en est de la luxure comme de l’avarice, elle augmente sa soif par l’acquisition des trésors.
Du temps de Justinien, plusieurs philosophes gênés par le christianisme, se retirerent en Perse auprès de Cosroès : ce qui les frappa le plus, dit Agathias, ce fut que la polygamie étoit permise à des gens qui ne s’abstenoient pas même de l’adultere.
L’auteur a donc établi que la polygamie étoit, par sa nature & en elle-même, une chose mauvaise : il falloit partir de ce chapitre ; & c’est pourtant de ce chapitre que l’on n’a rien dit. L’auteur a de plus examiné philosophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonstances elle avoit de moins mauvais effets ; il a comparé les climats aux climats & les pays aux pays ; & il a trouvé qu’il y avoit des pays où elle avoit des effets moins mauvais que dans d’autres ; parce que, suivant les relations, le nombre des hommes & des femmes n’étant point [IV-283] égal dans tous les pays, il est clair que s’il y a des pays où il y ait beaucoup plus de femmes que d’hommes, la polygamie, mauvaise en elle-même, l’est moins dans ceux-là que dans d’autres. L’auteur a discuté ceci dans le chapitre IV du même livre. Mais parce que le titre de ce chapitre porte ces mots, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul, on a saisi ce titre. Cependant, comme le titre d’un chapitre se rapporte au chapitre même, & ne peut dire ni plus ni moins que ce chapitre ; voyons-le.
Suivant les calculs que l’on fait en diverses parties de l’Europe, il y naît plus de garçons que de filles ; au contraire, les relations de l’Asie nous disent qu’il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. La loi d’une seule femme en Europe, & celle qui en permet plusieurs en Asie, ont donc un certain rapport au climat.
Dans les climats froids de l’Asie, il naît, comme en Europe, beaucoup plus de garçons que de filles : c’est, disent les Lamas, la raison de la loi qui chez eux permet à une femme d’avoir plusieurs maris.
Mais j’ai peine à croire qu’il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez [IV-284] grande, pour qu’elle exige qu’on y introduise la loi de plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d’autres.
J’avoue que si ce que les relations nous disent étoit vrai, qu’à Bantam il y a dix femmes pour un homme, ce seroit un cas bien particulier de la polygamie.
Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages ; mais j’en rends les raisons.
Revenons au titre : la polygamie est une affaire de calcul. Oui, elle l’est, quand on veut savoir si elle est plus ou moins pernicieuse dans de certains climats, dans de certains pays, dans de certaines circonstances que dans d’autres : elle n’est point une affaire de calcul, quand on doit décider si elle est bonne ou mauvaise par elle-même.
Elle n’est point une affaire de calcul, quand on raisonne sur sa nature ; elle peut être une affaire de calcul, quand on combine ses effets : enfin elle n’est jamais une affaire de calcul, quand on examine le but du mariage ; & elle l’est encore moins, quand on examine le [IV-285] mariage comme établi par Jesus-Christ.
J’ajouterai ici que le hasard a très-bien servi l’auteur. Il ne prévoyoit pas sans doute qu’on oublieroit un chapitre formel, pour donner des sens équivoques à un autre : il a le bonheur d’avoir fini cet autre par ces paroles : Dans tout ceci : je ne justifie point les usages ; mais j’en rends les raisons.
L’auteur vient de dire qu’il ne voyoit pas qu’il pût y avoir des climats où le nombre des femmes pût tellement excéder celui des hommes, ou le nombre des hommes celui des femmes, que cela dût engager à la polygamie dans aucun pays ; & il a ajouté [3] : Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, & même la pluralité des hommes, est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d’autres. Le critique a saisi le mot, est plus conforme à la nature, pour faire dire à l’auteur qu’il approuvoit la polygamie. Mais, si je disois que j’aime mieux la fievre que le scorbut, cela signifieroit-il que j’aime la fievre, ou seulement que le scorbut m’est plus désagréable que la fievre ? [IV-286]
Voici, mot pour mot, une objection bien extraordinaire.
La polygamie [4] d’une femme qui a plusieurs maris est un désordre monstrueux, qui n’a été permis en aucun cas, & que l’auteur ne distingue en aucune sorte de la polygamie d’un homme qui a plusieurs femmes. Ce langage, dans un sectateur de la religion naturelle, n’a pas besoin de commentaire.
Je supplie de faire attention à la liaison des idées du critique : selon lui, il suit que, de ce que l’auteur est un sectateur de la religion naturelle, il n’a point parlé de ce dont il n’avoit que faire de parler : ou bien il suit, selon lui, que l’auteur n’a point parlé de ce dont il n’avoit que faire de parler, parce qu’il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux raisonnemens sont de même espece, & les conséquences se trouvent également dans les prémices. La maniere ordinaire est de critiquer sur ce que l’on écrit ; ici le critique s’évapore sur ce que l’on n’écrit pas.
Je dis tout ceci, en supposant, avec le critique, que l’auteur n’eût point distingué la polygamie d’une femme qui a [IV-287] plusieurs maris, de celle où un mari auroit plusieurs femmes. Mais si l’auteur les a distinguées, que dira-t-il ? Si l’auteur a fait voir que dans le premier cas les abus étoient plus grands, que dira-t-il ? Je supplie le lecteur de relire le chapitre VI du livre XVI ; je l’ai rapporté ci-dessus. Le critique lui a fait des invectives, parce qu’il avoit gardé le silence sur cet article ; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu’il n’a pas gardé.
Mais voici une chose que je ne puis comprendre. Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles, page 166 : L’auteur nous a dit ci-dessus que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds, & non dans les pays froids. Mais l’auteur n’a dit cela nulle part. Il n’est plus question de mauvais raisonnemens entre le critique & lui ; il est question d’un fait. Et comme l’auteur n’a dit nulle part que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds, & non dans les pays froids ; si l’imputation est fausse comme elle est, & grave comme elle est, je prie le critique de se juger lui-même. Ce n’est pas le seul endroit sur lequel l’auteur ait à faire un cri. À la page 163, à la fin de la [IV-288] premiere feuille, il est dit : Le chapitre IV porte pour titre, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul ; c’est-à-dire que, dans les lieux où il naît plus de garçons que de filles, comme en Europe, on ne doit épouser qu’une femme : dans ceux où il naît plus de filles que de garçons, la polygamie doit y être introduite. Ainsi, lorsque l’auteur explique quelques usages, ou donne la raison de quelques pratiques, on les lui fait mettre en maximes ; & ce qui est plus triste encore, en maximes de religion : & comme il a parlé d’une infinité d’usages & de pratiques dans tous les pays du monde, on peut, avec une pareille méthode, le charger des erreurs & même des abominations de tout l’univers. Le critique dit à la fin de sa seconde feuille, que Dieu lui a donné quelque zele : Eh bien ! je réponds que Dieu ne lui a pas donné celui-là.
[IV-289]
CLIMAT.
Ce que l’auteur a dit sur le climat, est encore une matiere très-propre pour la rhétorique. Mais tous les effets quelconques ont des causes : le climat & les autres causes physiques produisent un nombre infini d’effets. Si l’auteur avoit dit le contraire, on l’auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à savoir, si dans des pays éloignés entr’eux, si sous des climats différens, il y a des caracteres d’esprit nationaux. Or qu’il y ait de telles différences, cela est établi par l’universalité presqu’entiere des livres qui ont été écrits. Et comme le caractere de l’esprit influe beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sauroit encore douter qu’il n’y ait de certaines qualités du cœur plus fréquentes dans un pays que dans un autre ; & l’on en a encore pour preuve un nombre infini d’écrivains de tous les lieux & de tous les temps. Comme ces choses sont humaines, l’auteur en a parlé d’une façon humaine. Il auroit pu joindre là bien [IV-290] des questions que l’on agite dans les écoles sur les vertus humaines & sur les vertus chrétiennes ; mais ce n’est point avec ces questions que l’on fait des livres de physique, de politique & de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits ; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines : cela choqueroit-il l’empire de celui qui a créé, ou les mérites de celui qui a racheté ?
Si l’auteur a recherché ce que les magistrats de divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la maniere la plus convenable & la plus conforme à son caractere, quel mal a-t-il fait en cela ?
On raisonnera de même à l’égard de diverses pratiques locales de religion. L’auteur n’avoit à les considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises : il a dit seulement qu’il y avoit des climats où de certaines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c’est-à-dire, étoient plus aisées à pratiquer par le peuple de ces climats que par les peuples d’un autre. De ceci, il est inutile de donner des exemples ; il y en a cent mille.
[IV-291]
Je sais bien que la religion est indépendante par elle-même de tout effet physique quelconque ; que celle qui est bonne dans un pays, est bonne dans un autre ; & qu’elle ne peut être mauvaise dans un pays, sans l’être dans tous : mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes & pour les hommes, il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans certains pays que dans d’autres, & dans de certaines circonstances que dans d’autres ; & dès que quelqu’un dira le contraire, il renoncera au bon sens.
L’auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les mœurs : mais, dit le critique, les femmes s’y brûlent à la mort de leur mari. Il n’y a guere de philosophie dans cette objection. Le critique ignore-t-il les contradictions de l’esprit humain, & comment il sait séparer les choses les plus unies, & unir celles qui sont les plus séparées ? Voyez là-dessus les réflexions de l’auteur, au chapitre III du livre XIV.
[IV-292]
TOLÉRANCE.
Tout ce que l’auteur a dit sur la tolérance, se rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre XXV : Nous sommes ici politiques, & non pas théologiens, & pour les théologiens même, il y a bien de la différence entre tolérer une religion, & l’approuver.
Lorsque les lois de l’état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu’elles les obligent aussi à se tolérer entr’elles. On prie de lire le reste du chapitre.
On a beaucoup crié sur ce que l’auteur a ajouté, au chapitre X, livre XXV : Voici le principe fondamental des lois politiques en fait de religion : quand on est le maître, dans un état, de recevoir une nouvelle religion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l’y établir ; quand elle y est établie, il faut la tolérer.
On objecte à l’auteur qu’il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs états à la religion chrétienne : Effectivement, c’est un secret qu’il a été dire à l’oreille au roi de la Cochinchine.
[IV-293] Comme cet argument a fourni matiere à beaucoup de déclamations, j’y ferai deux réponses. La premiere, c’est que l’auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétienne. Il a dit au livre XXIV, chap. I, à la fin : Le religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut, sans doute, que chaque peuple ait les meilleures lois politiques & les meilleures lois civiles ; parce qu’elles sont après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir. Si donc la religion chrétienne est le premier bien, & les lois politiques & civiles le second, il n’y a point de lois politiques & civiles, dans un état, qui puissent ou doivent y empêcher l’entrée de la religion chrétienne.
Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s’établit pas par les mêmes voies que les religions de la terre. Lisez l’histoire de l’église, & vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d’entrer dans un pays ? elle sait s’en faire ouvrir les portes ; tous les instrumens sont bons pour cela : quelquefois Dieu veut se servir de quelques pécheurs ; quelquefois [IV-294] il va prendre sur le trône un empereur, & fait plier sa tête sous le joug de l’évangile. La religion chrétienne se cache-t-elle dans les lieux souterrains ? Attendez un moment, & vous verrez la majesté impériale parler pour elle. Elle traverse, quand elle veut, les mers, les rivieres, les montagnes ; ce ne sont pas les obstacles d’ici bas qui l’empêchent d’aller. Mettez de la répugnance dans les esprits ; elle saura vaincre ces répugnances : établissez des coutumes, formez des usages, publiez des édits, faites des lois ; elle triomphera du climat, des lois qui en résultent, & des législateurs qui les auront faites. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.
On dit : C’est comme si vous alliez dire aux rois d’Orient qu’il ne faut pas qu’ils reçoivent chez eux la religion chrétienne. C’est être bien charnel, que de parler ainsi : étoit-ce donc Hérode qui devoit être le Messie ? Il semble qu’on regarde Jesus-Christ comme un roi qui, voulant conquérir un état voisin, cache ses pratiques & ses intelligences. Rendons-nous justice : la [IV-295] maniere dont nous nous conduisons dans les affaires humaines est-elle assez pure pour penser à l’employer à la conversion des peuples ?
CÉLIBAT.
Nous voici à l’article du célibat. Tout ce que l’auteur en a dit, se rapporte à cette proposition, qui se trouve au livre XXV, chapitre IV ; la voici.
Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat : on sent qu’elle pourroit devenir nuisible à proportion que le corps du clergé seroit trop étendu, & que par conséquent celui des laïques ne le seroit pas assez. Il est clair que l’auteur ne parle ici que de la plus grande ou de la moindre extension que l’on doit donner au célibat, par rapport au plus grand ou au moindre nombre de ceux qui doivent l’embrasser : &, comme l’a dit l’auteur en un autre endroit, cette loi de perfection ne peut pas être faite pour tous les hommes : on sait d’ailleurs que la loi du célibat, telle que nous l’avons, n’est qu’une loi de [IV-296] discipline. Il n’a jamais été question, dans l’esprit des lois, de la nature du célibat même & du degré de sa bonté ; & ce n’est en aucune façon une matiere qui doive entrer dans un livre de lois politiques & civiles. Le critique ne veut jamais que l’auteur traite son sujet, il veut continuellement qu’il traite le sien ; & parce qu’il est toujours théologien, il ne veut pas que, même dans un livre de droit, il soit jurisconsulte. Cependant on verra tout à l’heure qu’il est, sur le célibat, de l’opinion des théologiens, c’est-à-dire, qu’il en a reconnu la bonté. Il faut savoir que, dans le livre XXIII, où il est traité du rapport que les lois ont avec le nombre des habitans, l’auteur a donné une théorie de ce que les lois politiques & civiles de divers peuples avoient fait à cet égard. Il a fait voir, en examinant les histoires des divers peuples de la terre, qu’il y avoit eu des circonstances où ces lois furent plus nécessaires que dans d’autres, des peuples qui en avoient eu plus de besoin, de certains temps où ces peuples en avoient eu plus de besoin encore : &, comme il a pensé que les Romains furent le peuple du monde le plus sage, [IV-297] & qui, pour réparer ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles lois, il a recueilli avec exactitude les lois qu’ils avoient faites à cet égard ; il a marqué avec précision dans quelles circonstances elles avoient été faites, & dans quelles autres circonstances elles avoient été ôtées. Il n’y a point de théologie dans tout ceci, & il n’en faut point pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d’y en mettre. Voici ses paroles : A Dieu ne plaise [5] que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion ! Mais, qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes se corrompant par les sentimens naturels même, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celles qui les rendent toujours pires ?
C’est une regle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme, lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.
L’auteur n’a donc point désapprouvé le célibat qui a pour motif la religion.
[IV-298] On ne pouvoit se plaindre de ce qu’il s’élevoit contre le célibat introduit par le libertinage ; de ce qu’il désapprouvoit qu’une infinité de gens riches & voluptueux se portassent à fuir le joug du mariage, pour la commodité de leurs déréglemens ; qu’ils prissent pour eux les délices & la volupté, & laissassent les peines aux misérables : on ne pouvoit, dis-je, s’en plaindre. Mais le critique, après avoir cité ce que l’auteur a dit, prononce ces paroles : On apperçoit ici toute la malignité de l’auteur, qui veut jeter sur la religion chrétienne des désordres qu’elle déteste. Il n’y a pas d’apparence d’accuser le critique de n’avoir pas voulu entendre l’auteur : je dirai seulement qu’il ne l’a point entendu ; & qu’il lui fait dire contre la religion ce qu’il a dit contre le libertinage. Il doit en être bien fâché.
[IV-299]
ERREUR PARTICULIERE
DU CRITIQUE.
On croiroit que le critique a juré de n’être jamais au fait de l’état de la question, & de n’entendre pas un seul des passages qu’il attaque. Tout le second chapitre du livre XXV roule sur les motifs, plus ou moins puissans, qui attachent les hommes à la conservation de leur religion : le critique trouve, dans son imagination, un autre chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui obligent les hommes à passer d’une religion dans une autre. Le premier sujet emporte un état passif ; le second un état d’action : &, appliquant sur un sujet ce que l’auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à son aise.
L’auteur a dit, au second article du chapitre II du livre XXV : Nous sommes extrêmement portés à l’idolâtrie ; & cependant nous ne sommes pas fort attachés aux religions idolâtres : nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles ; & cependant nous sommes très-attachés aux [IV-300] religions qui nous font adorer un Etre spirituel. Cela vient de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d’avoir été assez intelligens pour avoir choisi une religion qui tire la divinité de l’humiliation où les autres l’avoient mise. L’auteur n’avoit fait cet article que pour expliquer pourquoi les Mahométans & les Juifs, qui n’ont pas les mêmes graces que nous, sont aussi invinciblement attachés à leur religion qu’on le fait par expérience : le critique l’entend autrement. C’est à l’orgueil, dit-il, que l’on attribue d’avoir fait passer les hommes de l’idolâtrie à l’unité d’un Dieu [6] . Mais il n’est question ici, ni dans tout le chapitre, d’aucun passage d’une religion dans une autre : &, si un chrétien sent de la satisfaction à l’idée de la gloire & à la vue de la grandeur de Dieu, & qu’on appelle cela de l’orgueil, c’est un très-bon orgueil.
[IV-301]
MARIAGE.
Voici une autre objection qui n’est pas commune. L’auteur a fait deux chapitres au livre XXIII : l’un a pour titre, des hommes & des animaux, par rapport à la propagation de l’espece ; & l’autre est intitulé, des mariages. Dans le premier, il a dit ces paroles : Les femelles des animaux ont, à peu près, une fécondité constante : mais, dans l’espece humaine, la maniere de penser, le caractere, les passions, les fantaisies, les caprices, l’idée de conserver sa beauté, l’embarras de la grossesse, celui d’une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manieres. Et dans l’autre, il a dit : L’obligation naturelle qu’a le pere de nourrir ses enfans a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation.
On dit là-dessus : Un chrétien rapporteroit l’institution du mariage à Dieu même qui donna une compagne à Adam, & qui unit le premier homme à la premiere femme, par un lien indissoluble, [IV-302] avant qu’ils eussent des enfans à nourrir : mais l’auteur évite tout ce qui a trait à la révélation. Il répondra qu’il est chrétien, mais qu’il n’est point imbécille ; qu’il adore ces vérités, mais qu’il ne veut point mettre à tort & à travers toutes les vérités qu’il croit. L’empereur Justinien étoit chrétien, & son compilateur l’étoit aussi. Eh bien ! dans leurs livres de droit, que l’on enseigne aux jeunes gens dans les écoles, ils définissent le mariage [7] , l’union de l’homme & de la femme qui forme une société de vie individuelle. Il n’est jamais venu dans la tête de personne de leur reprocher de n’avoir pas parlé de la révélation.
USURE.
Nous voici à l’affaire de l’usure. J’ai peur que le lecteur ne soit fatigué de m’entendre dire que le critique n’est jamais au fait, & ne prend jamais le sens des passages qu’il censure. Il dit, au [IV-303] sujet des usures maritimes : L’auteur ne voit rien que de juste dans les usures maritimes ; ce sont ses termes. En vérité, cet ouvrage de l’esprit des lois a un terrible interprete. L’auteur a traité des usures maritimes au chapitre XX du livre XXII ; il a donc dit dans ce chapitre, que les usures maritimes étoient justes. Voyons-le.
Des usures maritimes.
La grandeur des usures maritimes est fondées sur deux choses ; le péril de la mer, qui fait qu’on ne s’expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage ; & la facilité que le commerce donne à l’emprunteur de faire promptement de grandes affaires & en grand nombre : au lieu que les usures de terre, n’étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.
Je demande à tout homme sensé, si l’auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes ; ou s’il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l’équité [IV-304] naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connoît que les qualités positives & absolues, il ne sait ce que c’est ces termes plus ou moins. Si on lui disoit qu’un mulâtre est moins noir qu’un negre, cela signifieroit, selon lui, qu’il est blanc comme de la neige ; si on lui disoit qu’il est plus noir qu’un Européen, il croiroit encore qu’on veut dire qu’il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.
Il y a dans l’esprit des lois, au livre XXII, quatre chapitres sur l’usure. Dans les deux premiers, qui sont le XIX & celui qu’on vient de lire, l’auteur examine l’usure [8] dans le rapport qu’elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations & dans les divers gouvernemens du monde, ces deux chapitres ne s’appliquent qu’à cela : les deux suivans ne sont faits que pour expliquer les variations de l’usure chez les Romains. Mais voilà qu’on érige tout-à-coup l’auteur en casuiste, en canoniste & en théologien, uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste, canoniste & [IV-305] théologien, ou deux des trois, ou un des trois, ou peut-être dans le fond aucun des trois. L’auteur sait qu’à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matiere a des distinctions & des limitations sans fin : il sait que les jurisconsultes & plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d’accord avec les casuistes & les canonistes ; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n’exiger jamais d’intérêts, & que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces questions auroient appartenu à son sujet, ce qui n’est pas, comment auroit-il pu les traiter ? On a bien de la peine à savoir ce qu’on a beaucoup étudié, encore moins sait-on ce qu’on n’a étudié de sa vie : mais les chapitres mêmes que l’on emploie contre lui prouvent assez qu’il n’est qu’historien & jurisconsulte. Lisons le chapitre XIX [9] .
L’argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent [IV-306] ou se louer, ou s’acheter ; au lieu que l’argent, qui est le prix des choses, se loue & ne s’achete pas.
C’est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt ; mais on sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion, & non une loi civile.
Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l’argent ait un prix ; mais que ce prix soit peu considérable. S’il est trop haut, le négociant, qui voit qu’il lui en coûteroit plus en intérêts qu’il ne pourroit gagner dans son commerce, n’entreprend rien. Si l’argent n’a point de prix, personne n’en prête, & le négociant n’entreprend rien non plus.
Je me trompe, quand je dis que personne n’en prête : il faut toujours que les affaires de la société aillent ; l’usure s’établit, mais avec les désordres que l’on a éprouvés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond l’usure avec le prêt à intérêt : l’usure augmente dans les pays Mahométans à proportion de la sévérité de la défense ; le prêteur s’indemnise du péril de la contravention.
Dans ces pays d’orient, la plupart des hommes n’ont rien d’assuré ; il n’y a [IV-307] presque point de rapport entre la possession actuelle d’une somme & l’espérance de la ravoir après l’avoir prêtée. L’usure y augmente donc à proportion du péril de l’insolvabilité.
Ensuite viennent le chapitre des usures maritimes, que j’ai rapporté ci-dessus ; & le chapitre XXI qui traite du prêt par contrat, & de l’usure chez les Romains, que voici :
Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d’où résulte un intérêt ou usure.
Le peuple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats chercherent à le flatter, & à lui faire faire les lois qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux, il diminua les intérêts, il défendit d’en prendre ; il ôta les contraintes par corps : enfin l’abolition des dettes fut mise en question, toutes les fois qu’un tribun voulut se rendre populaire.
Ces continuels changemens, soit par des lois, soit par des plébiscites, naturaliserent à Rome l’usure : car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n’eurent plus [IV-308] de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits ; d’autant plus que, si les lois ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles, & intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter & d’emprunter furent abolis à Rome ; & qu’une usure affreuse, toujours foudroyée & toujours renaissante, s’y établit.
Cicéron nous dit que, de son temps, on prêtoit à Rome à trente-quatre pour cent, & à quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les lois n’avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l’argent, & pour le danger des peines de la loi. L’auteur n’a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les lois civiles des Romains ; & cela est si vrai, qu’il a distingué, au second article du chapitre XIX, les établissemens des législateurs de la religion, d’avec ceux des législateurs politiques. S’il avoit parlé là nommément de la religion [IV-309] chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d’autres termes ; & fait ordonner à la religion chrétienne ce qu’elle ordonne, & conseiller ce qu’elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers ; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établir quelquefois chez les Romains & toujours chez les Mahométans, qu’il ne faut jamais, dans aucun cas & dans aucune circonstance, recevoir d’intérêt pour de l’argent. L’auteur n’avoit pas ce sujet à traiter ; mais celui-ci, qu’une défense générale, illimitée, indistincte & sans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, & pensa perdre la république chez les Romains ; d’où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n’est point détruit chez eux, & que l’on ne voit point dans leurs états ces usures affreuses qui s’exigent chez les Mahométans, & que l’on extorquoit autrefois chez les Romains.
L’auteur a employé [10] les chapitres XXXI & XXII à examiner quelles furent [IV-310] les lois, chez les Romains, au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république : son critique quitte un moment les bancs de théologie, & se tourne du côté de l’érudition. On va voir qu’il se trompe encore dans son érudition ; & qu’il n’est pas seulement au fait de l’état des questions qu’il traite. Lisons [11] le chapitre XXII.
Tacite dit que la loi des douze tables fixa l’intérêt à un pour cent par an : il est visible qu’il s’est trompé, & qu’il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela ; comment, dans les disputes qui s’éleverent depuis entre les créanciers & les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; & pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne pouvoit point être l’ouvrage des décemvirs. Et un peu après l’auteur ajoute : L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an. C’est cette loi que Tacite [IV-311] confond avec la loi des douze tables ; & c’est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l’intérêt, &c. Voyons à présent.
L’auteur dit que Tacite s’est trompé, en disant que la loi des douze tables avoit fixé l’usure chez les Romains ; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius & Ménénius environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des douze tables ; & que cette loi fut la premiere qui fixa à Rome le taux de l’usure. Que lui dit-on ? Tacite ne s’est pas trompé ; il a parlé de l’usure à un pour cent par mois, & non pas de l’usure à un pour cent par an. Mais il n’est pas question ici du taux de l’usure ; il s’agit de savoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l’usure. L’auteur dit que Tacite s’est trompé, parce qu’il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze tables, avoient fait un règlement pour fixer le taux de l’usure : & là-dessus le critique dit que Tacite ne s’est pas trompé, parce qu’il a parlé de l’usure à un pour cent par mois, & non pas à un pour cent par an. J’avois donc [IV-312] raison de dire que le critique ne sait pas l’état de la question.
Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi quelconque, dont parle Tacite, fixa l’usure à un pour cent par an, comme l’a dit l’auteur ; ou bien à un pour cent par mois, comme le dit le critique. La prudence vouloit qu’il n’entreprît pas une dispute avec l’auteur sur les lois romaines, sans connoître les lois Romaines ; qu’il ne lui niât pas un fait qu’il ne savoit pas, & dont il ignoroit même les moyens de s’éclaircir. La question étoit de savoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots unciarum fœnus [12] : il ne lui falloit qu’ouvrir les dictionnaires ; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl [13] , que l’usure onciaire [IV-313] étoit d’un pour cent par ans, & non d’un pour cent par mois. Vouloit-il consulter les savans ? il auroit trouvé la même chose dans Saumaise [14] :
Testis mearum centimanus Gyas
Sentetiarum.Hor. ode IV, liv. IV, V. 69.
Remontoit-il aux sources ? il auroit trouvé là-dessus des textes clairs dans les livres [15] de droit ; il n’auroit point brouillé toutes les idées ; il eût distingué les temps & les occasions où l’usure onciaire signifioit un pour cent par mois, d’avec les temps & les occasions où elle signifioit un pour cent par an ; & il n’auroit pas pris le douzieme de la centésime pour la centésime.
[IV-314]
Lorsqu’il n’y avoit point de lois sur le taux de l’usure chez les Romains, l’usage le plus ordinaire étoit que les usuriers prenoient douze once de cuivre sur cent onzes qu’ils prêtoient ; c’est-à-dire, douze pour cent par an : &, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as sur cent onces ; &, comme il falloit souvent compter l’usure par mois, l’usure de six mois fut appellée semis, ou la moitié de l’as ; l’usure que quatre mois fut appellée triens, ou le tiers de l’as ; l’usure pour trois mois fut appellée quadrans, ou le quart de l’as ; & enfin, l’usure pour un mois fut appellée unciaria, ou le douzieme de l’as : de sorte que, comme on levoit une once chaque mois sur cent onces qu’on avoit prêtées, cette usure onciaire, ou d’un pour cent par mois, ou douze pour cent par an, fut appellée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette signification de l’usure centésime, & il l’a appliquée très-mal.
On voit que tout ceci n’étoit qu’une espece de méthode, de formule ou de regle entre le débiteur & le créancier, pour compter leurs usures, dans la [IV-315] supposition que l’usure fût à douze pour cent par an, ce qui étoit l’usage le plus ordinaire : &, si quelqu’un avoit prêté à dix-huit pour cent par ans, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d’un tiers l’usure de chaque mois ; de sorte que l’usure onciaire auroit été d’une once & demie par mois.
Quand les Romains firent des lois sur l’usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit servi & qui servoit encore aux débiteurs & aux créanciers pour la division du temps & la commodité du payement de leurs usures. Le législateur avoit un règlement public à faire ; il ne s’agissoit point de partager l’usure par mois, il avoit à fixer, & il fixa l’usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l’as, sans y appliquer les mêmes idées : Ainsi l’usure onciaire signifia un pour cent par an, l’usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l’usure ex triente quatre pour cent par an, l’usure semis six pour cent par ans. Et, si l’usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixerent ex quadrante, ex triente, ex [IV-316] semise, auroient fixé l’usure à trois pour cent, à quatre pour cent, à six pour cent par mois : ce qui auroit été absurde, parce que les lois, faites pour réprimer l’usure, auroient été plus cruelles que les usuriers.
Le critique a donc confondu les especes des choses. Mais j’ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, afin qu’on soit bien convaincu que l’intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne : les voici [16] : Tacite ne s’est point trompé : il parle de l’intérêt à un pour cent par mois, & l’auteur s’est imaginé qu’il parle d’un pour cent par an. Rien n’est si connu que le centésime qui se payoit à l’usurier tous les mois. Un homme qui écrit deux volumes in-4o. sur les lois devroit-il l’ignorer ?
Que cet homme ait ignoré ou n’ait pas ignoré ce centésime, c’est une chose très-indifférente : mais il ne l’a pas ignoré, puisqu’il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t-il parlé ? & où en a-t-il parlé [17] ? Je pourrois bien défier le critique de le deviner, [IV-317] parce qu’il n’y trouveroit point les mêmes termes & les mêmes expressions qu’il fait.
Il n’est pas question ici de savoir si l’auteur de l’esprit des lois a manqué d’érudition ou non, mais de défendre ses autels [18] . Cependant il a fallu faire voir au public que le critique prenant un ton si décisif sur des choses qu’il ne sait pas, & dont il doute si peu qu’il n’ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses & accusant les autres d’ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur & la fierté du ton qu’il prend par-tout n’empêchent en aucune maniere qu’il n’ait tort ? que, quand il s’échauffe, cela ne veut pas dire qu’il n’ait pas tort ? que, quand il anathématise avec ses mots d’impie & de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu’il a tort ? qu’il faut bien se garder de recevoir les impressions que pourroit donner l’activité de son esprit & l’impétuosité de son style ? que, dans ses deux écrits, il est bon de séparer [IV-318] les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvaises, après quoi il ne restera plus rien ?
L’auteur, aux chapitres du prêt à intérêt & de l’usure chez les Romains, traitant ce sujet, sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenoit tellement à la constitution qu’elle pensa mille fois en être renversée ; parlant des lois qu’ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des réglemens qui n’étoient que pour un temps, de ceux qu’ils firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre XXII : L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an… Dix ans après, cette usure fut réduite à la moitié ; dans la suite, on l’ôta tout-à fait…
Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès ; on trouva une infinité de moyens pour l’éluder ; il en fallut faire beaucoup d’autres pour la confirmer, corriger, tempérer : tantôt on quitta les lois pour suivre les usages, tantôt on quitta les usages pour suivre les lois. Mais dans ce cas, l’usage devoit aisément prévaloir. Quand [IV-319] un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur ; cette loi a contr’elle & celui qu’elle secourt & celui qu’elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis aux débiteurs d’agir en conséquence des lois, fut tué par les créanciers, pour avoir voulu rappeller la mémoire d’une rigidité qu’on ne pouvoit plus soutenir.
Sous Sylla, Lucius Valerius Flaccus fit une loi qui permettoit l’intérêt à trois pour cent par an. Cette loi, la plus équitable & la plus modérée de celles que les Romains firent à cet égard, Paterculus la désapprouve. Mais si cette loi étoit nécessaire à la république, si elle étoit utile à tous les particuliers, si elle formoit une communication d’aisance entre le débiteur & l’emprunteur, elle n’étoit point injuste.
Celui-là paye moins, dit Ulpien, qui paye plus tard. Cela décide la question si l’intérêt est légitime ; c’est à dire, si le créancier peut vendre le temps, & le débiteur l’acheter.
Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage, qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus & aux dispositions politiques des Romains. L’auteur, dit-il, en résumant tout ce qu’il [IV-320] a dit de l’usure, soutient qu’il est permis à un créancier de vendre le temps. On diroit à entendre le critique, que l’auteur vient de faire un traité de théologie, ou de droit canon, & qu’il résume ensuite ce traité de théologie & de droit canon ; pendant qu’il est clair qu’il ne parle que des dispositions politiques des Romains, de la loi de Flaccus, & de l’opinion de Paterculus : de sorte que cette loi de Flaccus, l’opinion de Paterculus, la réflexion d’Ulpien, celle de l’auteur, se tiennent & ne peuvent pas se séparer.
J’aurois encore bien des choses à dire ; mais j’aime mieux renvoyer aux feuilles mêmes. Croyez-moi, mes chers Pisons ; elles ressemblent à un ouvrage qui, comme les songes d’un malade, ne fait voir que des fantômes vains [19] .
-
[↑] Livre XXIX, chap. VI.
-
[↑] C’est le chapitre VII du livre XXIV.
-
[↑] Chapitre IV du livre XVI.
-
[↑] Page 164 de la feuille du 9 Octobre 1749.
-
[↑] Liv. XXIII, chap. XXI, à la fin.
-
[↑] Page 166 de la seconde feuille.
-
[↑] Maris & fœminæ conjunctio, individuam vitæ societatem continens.
-
[↑] Usure ou intérêt signifioit la même chose chez les Romains.
-
[↑] Liv. XXII.
-
[↑] Liv. XXII.
-
[↑] Livre XXII.
-
[↑] Nam primò duodecim tabulis sanctum, nè quis unciario fœnore ampliùs exerceret. Annales, liv. VI.
-
[↑] Usurarum species ex assis partibus denominantur : quod ut intelligatur, illud scire oporter, sortem omnem ad centenarium numerum revocari, summam autem usuram esse, cùm pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. Et quoniam istâ ratione summa hæc usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numerus jurisconsultos movit, ut assem hunc usurarium appellarent. Quemadmodùm his as, non ex menstruâ, sed ex annuâ pensione æstimandus est ; similiter omnes ejus partes ex anni ratione intelligendæ sunt : ut, si unus in centenos annuatim pendatur, unciaria usura ; si bini, sextans ; si terni, quadrans ; si quaterni, triens ; si quini, quinquax ; si seni, semis ; su septeni, septunx ; si octoni, bes ; si novem, dodrans ; si deni, dextrans ; si undeni, deunx ; si duodeni, as. Lexicon Joannis Calvini, aliàa Kahl, Coloniæ Allobrogum, anno, 1622, apud Petrum Balduinum, in verbo usura, pag. 960.
-
[↑] De modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officinâ Elseviriorum, anno 1639, pag. 269, 270 & 271 ; & sut-tout ces mots : Une verius fit unciarium fœnus eorum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellaras infrà ostendam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.
-
[↑] Argumentum legis XLVII, §. Præfectus legionis, ss. De administ. & periculo tutoris.
-
[↑] Feuille du 9 octobre 1749, page 164.
-
[↑] La troisieme & la derniere note, chap. XXII, liv. XXII, & le texte de la troisieme note.
-
[↑] Pro aris.
-
[↑] Credite, Pisones, isti tabulæ fore librum
Persimilem, cujus, velut ægri somnia vanæ
Fingentur species.
Horat. De arte poëticâ, v. 6.
[IV-321]
DÉFENSE DE L’ESPRIT DES LOIS.
TROISIEME PARTIE.
On a vu, dans les deux premieres parties, que tout ce qui résulte de tant de critiques ameres est ceci, que l’auteur de l’esprit des lois n’a point fait son ouvrage suivant le plan & les vues de ses critiques ; & que, si les critiques avoient fait un ouvrage sur le même sujet, ils y auroient mis un très-grand nombre de choses qu’ils savent. Il en résulte encore, qu’ils sont théologiens, & que l’auteur est jurisconsulte ; qu’ils se croient en état de faire son métier, & que lui ne se sent pas propre à faire le leur. Enfin, il en résulte, qu’au lieu de l’attaquer avec tant d’aigreur, ils auroient mieux fait [IV-322] de sentir eux-mêmes le prix des choses qu’il a dites en faveur de la religion, qu’il a également respectée & défendue. Il me reste à faire quelques réflexions.
Cette maniere de raisonner n’est pas bonne, qui, employée contre quelque bon livre que ce soit, peut le faire paroître aussi mauvais que quelque mauvais livre que ce soit ; & qui, pratiquée contre quelque mauvais livre que ce soit, peut le faire paroître aussi bon que quelque bon livre que ce soit.
Cette maniere de raisonner n’est pas bonne, qui, aux choses dont il s’agit, en rappelle d’autres qui ne sont point accessoires, & qui confond les diverses sciences & les idées de chaque science.
Il ne faut point argumenter sur un ouvrage fait sur une science, par des raisons qui pourroient attaquer la science même.
Quand on critique un ouvrage, & [IV-323] un grand ouvrage, il faut tâcher de se procurer une connoissance particuliere de la science qui y est traitée, & bien lire les auteurs approuvés qui ont déjà écrit sur cette science, afin de voir si l’auteur s’est écarté de la maniere reçue & ordinaire de la traiter.
Lorsqu’un auteur s’explique par ses paroles, ou par ses écrits, qui en sont l’image, il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées, pour chercher ses pensées ; parce qu’il n’y a que lui qui sache ses pensées. C’est bien pis, lorsque ses pensées sont bonnes, & qu’on lui en attribue de mauvaises.
Quand on écrit contre un auteur, & qu’on s’irrite contre lui, il faut prouver les qualifications par les choses, & non pas les choses par les qualifications.
Quand on voit, dans un auteur, une bonne intention générale, on se trompera plus rarement si, sur certains endroits qu’on croit équivoques, on juge suivant l’intention générale, [IV-324] que si on lui prête une mauvaise intention particulière.
Dans les livres faits pour l’amusement, trois ou quatre pages donnent l’idée du style & des agrémens de l’ouvrage : dans les livres de raisonnement, on ne tient rien, si on ne tient toute la chaîne.
Comme il est très-difficile de faire un bon ouvrage, & très-aisé de le critiquer, parce que l’auteur a eu tous les défilés à garder, & que le critique n’en a qu’un à forcer ; il ne faut point que celui-ci ait tort : & s’il arrivoit qu’il eût continuellement tort, il seroit inexcusable.
D’ailleurs, la critique pouvant être considérée comme une ostentation de sa supériorité sur les autres, & son effet ordinaire étant de donner des momens délicieux pour l’orgueil humain ; ceux qui s’y livrent, méritent bien toujours de l’équité, mais rarement de l’indulgence.
Et comme tous les genres d’écrire [IV-325] elle est celui dans lequel il est plus difficile de montrer un bon naturel ; il faut avoir attention à ne point augmenter, par l’aigreur des paroles, la tristesse de la chose.
Quand on écrit sur les grandes matieres, il ne suffit pas de consulter son zele ; il faut encore consulter ses lumieres ; & si le ciel ne nous a pas accordé de grands talens, on peut y suppléer par la défiance de soi-même, l’exactitude, le travail & les réflexions.
Cet art de trouver dans une chose, qui naturellement a un bon sens, tous les mauvais sens qu’un esprit qui ne raisonne pas juste peut leur donner, n’est point utile aux hommes : ceux qui le pratiquent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivans, & volent de tous côtés pour chercher des cadavres.
Une pareille maniere de critiquer produit deux grands inconvéniens. Le premier, c’est qu’elle gâte l’esprit des lecteurs, par un mélange du vrai & du [IV-326] faux, du bien & du mal : ils s’accoutument à chercher un mauvais sens dans les choses qui naturellement en ont un très-bon ; d’où il leur est aisé de passer à cette disposition, de chercher un bon sens dans les choses qui naturellement en ont un mauvais : on leur fait perdre la faculté de raisonner juste, pour les jeter dans les subtilités d’une mauvaise dialectique. Le second mal est, qu’en rendant, par cette façon de raisonner, les bons livres suspects, on n’a point d’autres armes pour attaquer les mauvais ouvrages : de sorte que le public n’a plus de regle pour les distinguer. Si l’on traite de spinosistes & de déistes ceux qui ne le sont pas, que dira-t-on à ceux qui le sont ?
Quoique nous devions penser aisément que les gens qui écrivent contre nous, sur des matieres qui intéressent tous les hommes, y sont déterminés par la force de la charité chrétienne ; cependant, comme la nature de cette vertu est de ne pouvoir guere se cacher, qu’elle se montre en nous malgré nous, & qu’elle éclate & brille de toutes parts ; s’il arrivoit que, dans deux écrits faits [IV-327] contre la même personne coup sur coup, on n’y trouvât aucune trace de cette charité, qu’elle n’y parût dans aucune phrase, dans aucun tour, aucune parole, aucune expression ; celui qui auroit écrit de pareils ouvrages, auroit un juste sujet de craindre de n’y avoir pas été porté par la charité chrétienne.
Et comme les vertus purement humaines sont en nous l’effet de ce que l’on appelle un bon naturel ; s’il étoit impossible d’y découvrir aucun vestige de ce bon naturel, le public pourroit en conclure que ces écrits ne seroient pas même l’effet des vertus humaines.
Aux yeux des hommes, les actions sont toujours plus sinceres que les motifs ; & il leur est plus facile de croire que l’action de dire des injures atroces est un mal, que de se persuader que le motif qui les a fait dire est un bien.
Quand un homme tient à un état qui fait respecter la religion, & que la religion fait respecter ; & qu’il attaque devant les gens du monde, un homme [IV-328] qui vit dans le monde ; il est essentiel qu’il maintienne, par sa maniere d’agir, la supériorité de son caractere. Le monde est très-corrompu : mais il y a de certaines passions qui s’y trouvent très-contraintes ; il y en a de favorites, qui défendent aux autres de paroître. Considérez les gens du monde entr’eux ; il n’y a rien de si timide : c’est l’orgueil qui n’ose pas dire ses secrets, & qui, dans les égards qu’il a pour les autres, se quitte pour se reprendre. Le christianisme nous donne l’habitude de soumettre cet orgueil ; le monde nous donne l’habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrons-nous, si toute notre ame se mettoit en liberté, & si nous n’étions pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres signes, aux moindres gestes ? Or, quand des hommes d’un caractere respecté manifestent des emportemens que les gens du monde n’oseroient mettre au jour, ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu’ils ne sont en effet ; ce qui est un très-grand mal.
Nous autres gens du monde, sommes si foibles, que nous méritons [IV-329] extrêmement d’être ménagés. Ainsi, lorsqu’on nous fait voir toutes les marques extérieures des passions violentes, que veut-on que nous pensions de l’intérieur ? Peut-on espérer que nous, avec notre témérité ordinaire de juger, ne jugions pas ?
On peut avoir remarqué, dans les disputes & les conversations, ce qui arrive aux gens dont l’esprit est dur & difficile : comme ils ne combattent pas pour s’aider les uns les autres, mais pour se jeter à terre, ils s’éloignent de la vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesse de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l’inflexibilité plus ou moins grande de leur caractere. Le contraire arrive à ceux à qui la nature ou l’éducation ont donné de la douceur : comme leurs disputes sont des secours mutuels, qu’ils concourent au même objet, qu’ils ne pensent différemment que pour parvenir à penser de même, ils trouvent la vérité à proportion de leurs lumieres : c’est la récompense d’un bon naturel.
Quand un homme écrit sur les [IV-330] matieres de religion, il ne faut pas qu’il compte tellement sur la piété de ceux qui le lisent, qu’il dise des choses contraires au bon sens ; parce que, pour s’accréditer auprès de ceux qui ont plus de piété que de lumieres, il se décrédite auprès de ceux qui ont plus de lumieres que de piété.
Et comme la religion se défend beaucoup par elle-même, elle perd plus lorsqu’elle est mal défendue, que lorsqu’elle n’est point du tout défendue.
S’il arrivoit qu’un homme, après avoir perdu ses lecteurs, attaquât quelqu’un qui eût quelque réputation, & trouvât par-là le moyen de se faire lire ; on pourroit peut-être soupçonner que, sous prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il la sacrifieroit à son amour propre.
La maniere de critiquer, dont nous parlons, est la chose du monde la plus capable de borner l’étendue, & de diminuer, si j’ose me servir de ce terme, la somme du génie national. La théologie a ses bornes, elle a ses formules [IV-331] parce que les vérités qu’elle enseigne étant connues, il faut que les hommes s’y tiennent ; & on doit les empêcher de s’en écarter : c’est-là qu’il ne faut pas que le génie prenne l’essor : on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une enceinte. Mais c’est se moquer du monde de vouloir mettre cette même enceinte autour de ceux qui traitent les sciences humaines. Les principes de la géométrie sont très-vrais : mais si on les appliquoit à des choses de goût, on feroit déraisonner la raison même. Rien n’étouffe plus la doctrine, que de mettre à toutes les choses une robe de docteur : les gens qui veulent toujours enseigner, empêchent beaucoup d’apprendre : il n’y a point de génie qu’on ne rétrécisse, lorsqu’on l’enveloppera d’un million de scrupules vains. Avez-vous les meilleures intentions du monde : on vous forcera vous-même d’en douter. Vous ne pouvez plus être occupé à bien dire, quand vous êtes effrayé par la crainte de dire mal, & qu’au lieu de suivre votre pensée, vous ne vous occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des critiques. On vient nous mettre un béguin [IV-332] sur la tête, pour nous dire à chaque mot : Prenez garde de tomber ; vous voulez parler comme vous, je veux que vous parliez comme moi. Va-t-on prendre l’essor ? ils vous arrêtent par la manche. A-t-on de la force & de la vie ? on vous l’ôte à coups d’épingle. Vous élevez-vous un peu ? voilà des gens qui prennent leur pied, ou leur toise, levent la tête, & vous crient de descendre pour vous mesurer. Courez-vous dans votre carriere ? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mises sur votre chemin. Il n’y a ni science, ni littérature, qui puisse résister à ce pédantisme. Notre siecle a formé des académies ; on voudra nous faire rentrer dans les écoles des siecles ténébreux. Descartes est bien propre à rassurer ceux qui, avec un génie infiniment moindre que le sien, ont d’aussi bonnes intentions que lui : ce grand homme fut sans cesse accusé d’athéisme, & l’on n’emploie pas aujourd’hui, contre les athées, de plus forts argumens que les siens.
Du reste, nous ne devons regarder les critiques comme personnelles, que [IV-333] dans les cas où ceux qui les font ont voulu les rendre telles. Il est très-permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public ; parce qu’il seroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas être éclairés être eux-mêmes. Ceux qui nous avertissent sont les compagnons de nos travaux. Si le critique & l’auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt ; car la vérité est le bien de tous les hommes : ils seront des confédérés, & non pas des ennemis.
C’est avec grand plaisir que je quitte la plume ; on auroit continué à garder le silence, si, de ce qu’on le gardoit, plusieurs personnes n’avoient conclu qu’on y étoit réduit.
[IV-334]
ÉCLAIRCISSEMENT SUR L’ESPRIT DES LOIS.
I.
Quelques personnes ont fait cette objection. Dans le livre de l’esprit des lois, c’est l’honneur ou la crainte qui sont le principe de certains gouvernemens, non pas la vertu ; & la vertu n’est le principe que de quelques autres : donc les vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la plupart des gouvernements.
Voici la réponse : L’auteur a mis cette note au chapitre V du livre troisieme : Je parle ici de la vertu politique qui est la vertu morale, dans le sens qu’elle se dirige au bien général ; fort peu des vertus morales particulieres ; & [IV-335] point du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélées. Il y a au chapitre suivant, une autre note qui renvoie à celle-ci ; & aux chapitres II & III du livre cinquieme, l’auteur a défini sa vertu, l’amour de la patrie. Il définit l’amour de la patrie, l’amour de l’égalité & de la frugalité. Tout le livre cinquieme pose sur ces principes. Quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage ; quand il a donné, pour me servir de cette expression, son dictionnaire ; ne faut-il pas entendre ses paroles suivant la signification qu’il leur a donnée ?
Le mot de vertu, comme la plupart des mots de toutes les langues, est pris dans diverses acceptions : tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tantôt les vertus païennes ; souvent une certaine vertu chrétienne, ou bien une certaine vertu païenne ; quelquefois la force ; quelquefois, dans quelques langues, une certaine capacité pour un art ou de certains arts. C’est ce qui précede, ou ce qui suit ce mot, qui en fixe la signification. Ici l’auteur a fait plus ; il a donné plusieurs fois sa définition. [IV-336] On n’a donc fait l’objection, que parce qu’on a lu l’ouvrage avec trop de rapidité.
II.
L’auteur a dit au livre second, chap. III : La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n’a point de part à la puissance est si petite & si pauvre, que la partie dominante n’a aucun intérêt à l’opprimer : Ainsi, quand Antipater [1] établit à Athenes que ceux qui n’auroient pas deux mille drachmes seroient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible ; parce que ce cens étoit si petit, qu’il n’excluoit que peu de gens, & personne qui eût quelque considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu’il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite ; & elle le deviendra moins, à mesure qu’elle approchera de la monarchie.
[IV-337]
Dans une lettre insérée dans le journal de Trévoux du mois d’avril 1749, l’on a objecté à l’auteur sa citation même. On a dit-on, devant les yeux l’endroit cité, & on y trouve qu’il n’y avoit que neuf mille personnes qui eussent le cens prescrit par Antipater ; qu’il y en avoit vingt-deux mille qui ne l’avoient pas : d’où l’on conclut que l’auteur applique mal ses citations ; puisque dans cette république d’Antipater, le petit nombre étoit dans le cens, & que le grand nombre n’y étoit pas.
Réponse.
Il eût été à désirer que celui qui a fait cette critique eût fait plus d’attention, & à ce que dit l’auteur, & à ce qu’a dit Diodore.
I°. Il n’y avoit point vingt-deux mille personnes qui n’eussent pas le cens dans la république d’Antipater : les vingt-deux mille personnes, dont parle Diodore, furent reléguées & établies dans la Thrace ; & il ne resta, pour former cette république, que les neuf mille citoyens qui avoient le cens, & ceux [IV-338] du bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la Thrace. Le lecteur peut consulter Diodore.
2°. Quand il seroit resté à Athenes vingt-deux mille personnes qui n’auroient pas eu le cens, l’objection n’en seroit pas plus juste. Les mots de grand & de petit sont relatifs. Neuf mille souverains, dans un état, sont un nombre immense ; & vingt-deux mille sujets, dans le même état, sont un nombre infiniment petit.
Fin de la Défense.
-
[↑] Diodore, livre XVIII, page 601, édition de Rhodoman.
[IV-341]
LYSIMAQUE.↩
Lorsqu’Alexandre eut détruit l’empire des Perses, il voulut que l’on crût qu’il étoit fils de Jupiter. Les Macédoniens étoient indignés de voir ce Prince rougir d’avoir Philippe pour pere : leur mécontentement s’accrut, lorsqu’ils lui virent prendre les mœurs, les habits & les manieres des Perses : & ils se reprochoient tous d’avoir tant fait pour un homme qui commençoit à les mépriser. Mais on murmuroit dans l’armée, & on ne parloit pas.
Un philosophe, nommé Callisthene, avoit suivi le roi dans son expédition. Un jour qu’il le salua à la maniere des Grecs, D’où vient, lui dit Alexandre, que tu ne m’adores pas ? « Seigneur, lui dit Callisthene, vous êtes chef de deux nations : l’une, esclave avant que vous l’eussiez soumise, ne l’est pas moins depuis que vous l’avez vaincue ; l’autre, libre avant qu’elle [IV-342] vous servit à remporter tant de victoires, l’est encore depuis que vous les avez remportées. Je suis Grec, Seigneur ; & ce nom vous l’avez élevé si haut, que, sans vous faire tort, il ne nous est plus permis de l’avilir. »
Les vices d’Alexandre étoient extrêmes, comme ses vertus : il étoit terrible dans sa colere ; elle le rendoit cruel. Il fit couper les pieds, le nez & les oreilles de Callisthene ; ordonna qu’on le mît dans une cage de fer ; & le fit porter ainsi à la suite de l’armée.
J’aimois Callisthene ; & de tout temps, lorsque mes occupations me laissoient quelques heures de loisir, je les avois employées à l’écouter : & si j’ai de l’amour pour la vertu, je le dois aux impressions que ses discours faisoient sur moi. J’allai le voir. « Je vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, que je vois dans une case de fer, comme on enferme une bête sauvage, pour avoir été le seul homme de l’armée. »
« Lysimaque, me dit-il, quand je suis dans une situation qui demande de la force & du courage, il me semble que [IV-343] je me trouve presqu’à ma place. En vérité, si les dieux ne m’avoient mis sur la terre que pour y mener une vie voluptueuse, je croirois qu’ils m’auroient donnée en vain une ame grande & immortelle. Jouir des plaisirs des sens, est une choses dont tous les hommes sont aisément capables : &, si les dieux ne nous ont fait que pour cela, ils ont fait un ouvrage plus parfait qu’ils n’ont voulu, & ils ont plus exécuté qu’entrepris. Ce n’est pas, ajouta-t-il, que je sois insensible. Vous ne me faites que trop voir que je ne le suis pas. Quand vous êtes venu à moi, j’ai trouvé d’abord quelque plaisir à vous voir faire une action de courage. Mais, au nom des dieux, que ce soit pour la derniere fois. Laissez-moi soutenir mes malheurs, & n’ayez point la cruauté d’y joindre encore les vôtres. »
« Callisthène, lui dis-je, je vous verrai tous les jours. Si le roi vous voyoit abandonné des gens vertueux, il n’auroit plus de remords : il commenceroit à croire que vous êtes coupable. Ah ! j’espere qu’il ne jouira pas du plaisir de voir que ses châtimens me feront abandonner un ami ».
[IV-344]
Un jour, Callisthène me dit, « Les dieux immortels m’ont consolé ; & depuis ce temps je sens en moi quelque chose de divin, qui m’a ôté le sentiment de mes peines. J’ai vu en songe le grand Jupiter. Vous étiez auprès de lui ; vous aviez un sceptre à la main, & un bandeau royal sur le front. Il vous a montré à moi, & m’a dit : Il te rendra plus heureux. L’émotion où j’étois m’a réveillé. Je me suis trouvé les mains élevées au ciel, & faisant des efforts pour dire : Grand Jupiter, si Lysimaque doit régner, fais qu’il regne avec justice. Lysimaque, vous régnerez : croyez un homme qui doit être agréable aux dieux, puisqu’il souffre pour la vertu ».
Cependant Alexandre ayant appris que je respectois la misere de Callisthène, que j’allois le voir, & que j’osois le plaindre, il entra dans une nouvelle fureur. « Va, dit-il, combattre contre les lions, malheureux qui te plais tant à vivre avec les bêtes féroces ». On différa mon supplice, pour le faire servir de spectacle à plus de gens.
Le jour qui le précéda, j’écrivis ces mots à Callisthène : « Je vais mourir. Toutes les idées que vous m’aviez [IV-345] données de ma future grandeur se sont évanouies de mon esprit. J’aurois souhaité d’adoucir les maux d’un homme tel que vous ».
Prexape, à qui je m’étois confié, m’apporta cette réponse : « Lysimaque, si les dieux ont résolu que vous régniez, Alexandre ne peut pas vous ôtez la vie ; car les hommes ne résistent pas à la volonté des dieux ».
Cette lettre m’encouragea : & faisant réflexion que les hommes les plus heureux & les plus malheureux sont également environnés de la main divine, je résolus de me conduire, non pas par mes espérances, mais par mon courage ; & de défendre jusqu’à la fin une vie sur laquelle il y avoit de si grandes promesses.
On me mena dans la carriere. Il y avoit autour de moi un peuple immense, qui venoit être témoin de mon courage, ou de ma frayeur. On me lâcha un lion. J’avois plié mon manteau autour de mon bras : je lui présentai ce bras : il voulut le dévorer : je lui saisis la langue, la lui arrachai, & le jetai à mes pieds.
Alexandre aimoit naturellement les actions courageuses : il admira ma [IV-346] résolution ; & ce moment fut celui du retour de sa grande ame.
Il me fit appeller ; &, me tendant la main, « Lysimaque, me dit-il, je te rend mon amitié ; rends moi la tienne. Ma colere n’a servi qu’à te faire faire une action qui manque à la vie d’Alexandre ».
Je reçus les graces du roi. J’adorai les décrets des dieux ; & j’attendois leurs promesses, sans les rechercher, ni les fuir. Alexandre mourut ; & toutes les nations furent sans maître. Les fils du roi étoient dans l’enfance : son frere Aridée n’en étoit jamais sorti : Olympias n’avoit que la hardiesse des ames foibles ; & tout ce qui étoit cruauté étoit pour elle du courage : Roxane, Eurydice, Statyre, étoient perdues dans la douleur. Tout le monde dans le palais, savoit gémir ; & personne ne savoit régner. Les capitaines d’Alexandre leverent donc les yeux sur son trône : mais l’ambition de chacun fut contenue par l’ambition de tous. Nous partageames l’empire ; & chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses fatigues.
Le sort me fit roi d’Asie : &, à présent que je puis tout, j’ai plus besoin [IV-347] que jamais des leçons de Callisthène. Sa joie m’annonce que j’ai fait quelque bonne action ; & ses soupirs me disent que j’ai quelque mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple & moi.
Je suis le roi d’un peuple qui m’aime. Les peres de famille esperent la longueur de ma vie, comme celle de leurs enfans : les enfans craignent de me perdre, comme ils craignent de perdre leur pere. Mes sujets sont heureux, & je le suis.
FIN.
[IV-348]
TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS L’ESPRIT DES LOIS, ET DANS LA DÉFENSE.↩
Le chiffre romain indique le tome ; le chiffre arabe la page le D. la défense.
A
Abbayes. Pourquoi les rois de France en abandonnerent les élections, IV. 155.
Abbés. Menoient autrefois leurs vassaux à la guerre, IV. 48. Pourquoi leurs vassaux n’étoient pas menés à la guerre par le comte , IV. 53.
Abondance & rareté de l’or & de l’argent relatives : abondance & rareté réelles, III. 16, 17.
Abyssins. Leur carème , qui leur ôte les forces nécessaires pour resister aux Turcs, est contraire a la loi naturelle, III. 204.
Accusateurs. Comment punis à Athènes, quand ils n’avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, I. 415. Cas où l’on ne doit faire aucune attention à leurs délations, I. 412. Du temps des combats judiciaires, plusieurs ne pouvoient pas se battre contre un seul accusé, III. 328. Quand étoient obligés de combattre pour leurs témoins provoqués par l’accusé, III. 337.
Accusateurs injustes. Comment punis à Rome, I. 415.
[IV-349]
Accusations. Par qui elles peuvent être faits dans les divers gouvernemens, I. 165, 166, 407. Combien on doit se défier de celles qui sont fondées sur la haine publique, I. 390. L’équité naturelle demande que le degré de preuves soit proportionné à la grandeur de l’accusation, D. 224, 236.
Accusation publique. Ce que c’est : Précautions nécessaires pour en prévenir les abus dans un état populaire, I. 414, 415. Quand & pourquoi elle cessa d’avoir lieu à Rome contre l’adultere, I. 213, 214.
Accusés. Liberté qu’ils doivent avoir dans le choix de leurs juges, I. 315. Combien il faut de voix pour leur condamnation, I. 383. Pouvoient, à Rome & à Athenes, se retirer avant le jugement, I. 415. C’est une chose injuste de condamner celui qui nie, & de sauver celui qui avoue, III. 212. Comment se justifioient, sous les lois saliques & autres lois babares, III. 298 & suiv. Du temps des combats judiciaires, un seul ne pouvoit pas se battre contre plusieurs accusateurs, III. 328. Ne produisent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre : De-là vient qu’en France les faux témoins sont punis de mort ; en Angleterre, non, III. 419, 410.
Achat (Commerce d’), II. 2.
Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, II. 70.
Acilia (La loi). Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sages qu’il y ait, I. 179.
Acquisitions des gens de main-morte. Ce seroit une imbécillité que de soutenir qu’on ne doit pas les borner, III. 172. Voyez Clergé : Monasteres.
Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monarchie, I. 60. Causes des grandes actions des anciens, I. 68.
Actions judiciaires. Pourquoi introduire à Rome & dans la Grece, I. 156.
Actions de bonne foi. Pourquoi introduites à Rome, par les préteurs, & admises parmi nous, I. 156, 157.
Actions, tant civiles que criminelles. Etoient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, III. 318 & suiv.
[IV-350]
Adalingues. Avoient, chez les Germains, la plus forte composition, IV. 61.
Adelhard. C’est ce favori de Louis le débonnaire qui a perdu ce prince, par les dissipations qu’il lui a fait faire, IV. 174, 175.
Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, I. 109. Se faisoit chez les Germains par les armes, II. 179, 180.
Adulation. Comment l’honneur l’autorise dans une monarchie, I. 61.
Adultere. Combien il est utile que l’accusation en soit publique dans une démocratie, I. 100. Etoit soumis, à Rome, à une accusation publique : pourquoi, I. 213. Quand & pourquoi il n’y fut plus soumis à Rome, I. 213, 214. Auguste & Tibere n’infligerent que dans certains cas les peines prononcées par leurs propres lois contre ce crime, I. 217, 218. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, III. 109. Il est contre la nature de permettre aux enfans d’accuser leur mere ou leur belle-mere de ce crime, III. 197. La demande en séparation pour raison de ce crime doit être accordée au mari seulement, comme fait le droit civil ; & non aux deux conjoints, comme a fait le droit canonique, III. 205, 296.
Adultérins. Il n’est point question de ces sortes d’enfans à la Chine, ni dans les autres pays de l’Orient : pourquoi, III. 71.
Ærarii. Qui l’on nommoit ainsi à Rome, III. 255, 256.
Affranchis. Inconvéniens de leur trop grand nombre, II. 89, 90. Sagesse des lois romaines à leur égard : part qu’elles leur laissoient dans le gouvernement de la république, II. 92. Loi abominable que leur grand nombre fit passer chez les Volsiniens, II. 91. Pourquoi ils dominent presque toujours à la cour des princes & chez les grands, II. 93.
Affranchissemens. Regles que l’on doit suivre à cet égard dans les différens gouvernemens, II. 89 & suiv.
Affranchissement des serfs. Est une des sources des coutumes de France, III. 402, 403.
Afrique. Il y naît plus de filles que de garçons : la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 100. Pourquoi il est & sera toujours si avantageux d’y commercer, II. [IV-351] 272. Du tour de l’Afrique, II. 309 & suiv. Description de ses côtes, ibid. Comment on y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne-espérance, II. 310. Ce que les Romains en connoissoient, II. 311. & suiv. Ce que Ptolomée le géographe en connoissoit, II. 132. Le voyage des Phéniciens & d’Eudoxe autour de l’Afrique étoit regardé comme fabuleux par Ptolomée : Erreur singuliere de ce géographe à cet égard, II. 313. Les anciens en connoissoient bien l’intérieur, & mal les côtes : nous en connoissons bien les côtes, & mal l’intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales, II. 314 & suiv. Les noirs y ont une monnoie, sans en avoir aucune, III. 14. Comparaison des mœurs de ses habitans chrétiens avec celles de ceux qui ne le sont pas, III. 128, 129.
Agilolfingues. Ce que c’étoit chez les Germains : leurs prérogatives, IV. 61, 62.
Agnats. Ce que c’étoit à Rome : leurs droits sur les successions, III. 243.
Agobard. Sa fameuse lettre à Louis le débonnaire prouve que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, III. 278, 279. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista long-temps chez les Bourguignons, III. 281. Semble prouver que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs : elle y étoit cependant en usage, III. 309.
Agraire. Voyez Loi agraire.
Agriculture. Doit-elle, dans une république, être regardé comme une profession servile ? I. 78. Etoit interdite au citoyen dans la Grece, I. 79. Honorée à la Chine, II. 44, 45.
Aïeul. Les petits-enfans succédoient à l’aïeul paternel, & non à l’aïeul maternel : raison de cette disposition des lois Romaines, III. 244.
Aînesse. (Droit d’) Ne doit pas avoir lieu entre les nobles dans l’aristocratie, I. 109. Ce droit, qui étoit inconnu sous la premiere race de nos rois, s’établit avec la perpétuité des fiefs, & passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, IV. 205.
Air de cour. Ce que c’est dans une monarchie, I. 63.
Aistulphe. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
[IV-352]
Alaric. Fit faire une compilation du code théodosien, qui servit de loi aux Romains de ses états, III. 276.
Alcibiade. Ce qui l’a rendu admirable, I. 87.
Alcoran. Ce livre n’est pas inutile à la liberté dans les pays despotiques, I. 428. Gengis-Kan le fait fouler aux pieds de ses chevaux, III. 266.
Alep (Caravane d’). Sommes immenses qu’elle porte en Arabie, II. 332.
Alexandre. Son empire fut divisé, parce qu’il étoit trop grand pour une monarchie, I. 251. Bel usage qu’il fit dans sa conquête de la Bactriane, I. 283, 284. Sagesse de sa conduite pour conquérir, & pour conserver ses conquêtes, I. 293 & suiv. Comparé à César, I. 301, 302. Sa conquête : révolution qu’elle causa dans le commerce, II. 292 & suiv. Ses découvertes, ses projets de commerce, & ses travaux, II. 293 & suiv. A-t-il voulu établie le siege de son empire dans l’Arabie ? II. 298. Commerce des rois grecs qui lui succéderent, II. 298. & s. Voyage de sa flotte, II. 306. Pourquoi il n’attaqua pas les colonies grecques établies dans l’Asie : ce qui en résulta, II. 324. Révolution que sa mort causa dans le commerce, II. 335 & suiv. On peut prouver, en suivant la méthode de M. l’abbé Dubos, qu’il n’entra point dans la Perse en conquérant, mais qu’il y fut appellé par les peuples, IV. 92.
Alexandre empereur. Ne veut pas que le crime de lese-majeté indirect ait lieu sous son regne, I. 397.
Alexandrie. Le frere y pouvoit épouser sa sœur, soit utérine, soit consanguine, I. 91. Où & pourquoi elle fut bâtie, 296, 297.
Alger. Les femmes y sont nubiles à neuf ans : elles doivent donc être esclaves, II. 97. On y est si corrompu, qu’il y a des sérails où il n’y a pas une seule femme, II. 104. La dureté du gouvernement fait que chaque pere de famille y a un trésor enterre, III. 5.
Aliénation des grands offices & des fiefs, IV. 193 & suiv.
Allemagne. République fédérative, & par-là regardée en Europe comme éternelle, I. 260. Sa république fédérative plus imparfaite que celles de Hollande & de Suisse, 262 & suiv. Pourquoî cette république fédérative subsiste, malgré le vice de sa constitution, [IV-353] I. 263. Sa situation vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, 272. Inconvénient d’un usage qui se pratique dans ses dietes, I. 318. Quelle sorte d’esclavage y est établi, II. 76. Ses mines sont utiles, parce qu’elles ne sont pas abondantes, II. 359. Pourquoi les fiefs y ont plus long-temps conservé leur constitution primitive qu’en France, IV, 199, 200. L’empire y est resté électif, parce qu’il a conservé la nature des anciens fiefs, IV. 294.
Allemands. Les lois avoient établi un tarif pour régler, chez eux, les punitions des différentes insultes que l’on pouvoit faire aux femmes, II. 56, 57. Ils tenoient toujours leurs esclabes armés, & cherchoient à leur élever le courage, II. 82, 83. Quand & par qui leurs lois furent rédigées, III. 265, 266. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III. 266, 267. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires.
Alleus. Comment furent changés en fiefs, IV. 133 & suiv. 184 & suiv.
Alliances. L’argent que les princes emploient pour en acheter est presque toujours perdu, II. 24.
Allié. Ce qu’on appelloit ainsi à Rome, III. 60.
Allodiales. (Terres). Leur origine, IV. 47.
Ambassadeurs. Ne sont soumis ni aux lois, ni au prince du pays où ils sont : comment leurs fautes doivent être punies, III. 234, 235.
Ambition. Est fort utile dans une monarchie, I. 50, 51. Celle des corps d’un état ne prouve pas toujours la corruption des membres, III. 392.
Arme. Il est également utile ou pernicieux à la société civile, de la croire mortelle ou immortelle, suivant les différentes conséquences que chaque secte tire de ses principes à ce sujet, III. 150, 151. Le dogme de son immortalité se divise en trois branches, III. 152.
Amendement des jugemens. Ce que c’étoit : par qui cette procédure fut établie : à quoi fut substituée, III. 358, 359/
Amendes. Les seigneurs en payoient autrefois une de soixante livres, quand les sentences de leurs juges [IV-354] étoient réformées sur l’appel : abolition de cet usage absurde, III. 366. Suppléoient autrefois à la condamnation des dépens, pour arrêter l’esprit processif, III. 370 & suiv.
Américains. Raisons admirables pour lesquelles les Espagnols les ont mis en esclavage, II. 66, 67. Conséquences funestes qu’ils tiroient du dogme de l’immorralité de l’ame, III. 150.
Amérique. Les crimes qu’y ont commis les Espagnols avoient la religion pour prétexte, II. 67. C’est la fertilité qui y entretient tant de nations sauvages, II. 148, 149. Sa découverte : comment on y fait le commerce, II. 346 & suiv. Sa découverte a lié les trois autres parties du monde : c’est elle qui fournit la matiere du commerce, II. 351 & suiv. L’Espagne s’est appauvrie par les richesses qu’elle en a tirées, II. 353 & suiv. Sa découverte a favorisé le commerce & la navigation de l’Europe, III. 9, 10. Pourquoi sa découverte diminua de moitié le prix de l’usure, III. 10, 11. Quel changement sa découverte a dû apporter dans le prix des marchandises, III. 15. Les femmes s’y faisoient avorter, pour épargner à leurs enfans les cruautés des Espagnols, III. 78. Pourquoi les sauvages y sont si peu attachés à leur propre religion, & sont si zélés pour la nôtre quand ils l’ont embrassée, III. 166, 167.
Amimones. Magistrats de Gnide : inconvéniens de leur indépendance, I. 326.
Amortissement. Il est essentiel, pour un état qui doit des rentes, d’avoir un fonds d’amortissement, III. 49.
Amortissement (Droit d’). Son utilité : La France doit sa prospérité à l’exercice de ce droit ; il faudroit encore l’y augmenter, III. 173.
Amphiction. Auteur d’une loi qui est en contradiction avec elle-même, III. 411, 412.
Amour. Raisons physiques de l’insensibilité des peuples du nord, & de l’emportement de ceux du midi pour ses plaisirs, II. 36, 37. A trois objets, & se porte plus ou moins vers chacun d’eux, selon les circonstances, dans chaque siecle & dans chaque nation, III. 324, 325.
Amour anti-physique. Naît souvent de la polygamie, II. 304.
[IV-355]
Amour de la patrie. Produit la bonté des mœurs, I. 83. Ce que c’est, dans la démocratie, I. 84 & suiv.
Anastase empereur. Sa clémence est portée à un excès dangereux, I. 192.
Anciens. En quoi leur éducation étoit supérieure à la nôtre, I. 168. Pourquoi ils n’avoient pas une idée claire du gouvernement monarchique, I. 336 & suiv. Leur commerce, II. 276 & suiv.
Anius Asellus. Pourquoi il put, contre la lettre de la loi voconienne, instituer sa fille unique héritiere, III. 254.
Angles. Tarif des compositions de ce peuple, IV. 61.
Angleterre. Pourquoi les emplois militaires y sont toujours unis avec les magistratures, I. 141. Comment on y juge les criminels, I. 155. Pourquoi il y a dans ce pays, moins-d’assassinats qu’ailleurs, I. 186. Peut-il y avoir du luxe dans ce royaume ? I. 205. Pourquoi la noblesse y défendit si fort Charles I. I. 238. Sa situation, vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, I. 272. Objet principal de son gouvernement, I. 310. Description de sa constitution, I. 311 & suiv. Conduite qu’y doivent tenir ceux qui y représentent le peuple, I. 318. Le systême de son gouvernement est tiré du livre des mœurs des Germains par Tacite : quand ce systême périra, I. 333. Sentiment de l’auteur sur la liberté de ses peuples, & sur la question de savoir si son gouvernement est préférable aux autres, I. 333, 334. Les jugemens s’y font à peu près, comme ils se faisoient à Rome du temps de la république, I. 362. Comment & dans quel cas on y prive un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous, I. 413. On y leve mieux les impôts sur les boissons qu’en France, II. 10. Avances que les marchands y font à l’état, II. 20. Effet du climat de ce royaume, II. 54 & suiv. Dans quelques petits districts de ce royaume, la succession appartient au dernier des mâles : raisons de cette loi, II. 161, 162. Effets qui ont dû suivre, caractere qui a dû se former, & manieres qui résultent de sa constitution, II. 219 & suiv. Le climat a produit ses lois en partie, II. 219, 220. Causes des inquiétudes du peuple, & des rumeurs qui en sont l’effet : leur utilité, II. 220 & suiv. Pourquoi le roi [IV-356] y est souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l’ont le plus choqué, & de l’ôter à ceux qui l’ont le mieux servi, II. 221, 222. Pourquoi on y voit tant d’écrits, II. 224. Pourquoi on y fait moins de cas des vertus militaires que des vertus civiles, II. 225,226. Causes de son commerce, de l’économie de ce commerce, de sa jalousie sur les autres nations, II. 226, 227. Comment elle gouverne ses colonies, II. 227, 228. Comment elle gouverne l’Irlande, II. 228. Sources & motifs de ses forces supérieures de mer, de sa fierté, de son influence dans les affaires de l’Europe, de sa probité dans les négociations : pourquoi elle n’a ni places fortes, ni armées de terre, II. 228 & suiv. Pourquoi son roi est presque toujours inquiété au-dedans, & respecté au dehors, II. 229. Pourquoi le roi, y ayant une autorité si bornée, a tout l’appareil & tout l’extérieur d’une puissance absolue, II. 230. Pourquoi il y a tant de sectes de religion : pourquoi ceux qui n’en ont aucune ne veulent pas qu’on les oblige à changer celle qu’ils auroient s’ils en avoient une : pourquoi le catholicisme y est haï : quelles sorte de persécution il y essuie, II. 230 & suiv. Pourquoi les membres du clergé y ont des mœurs plus régulieres qu’ailleurs : pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence : pourquoi on aime mieux leur laisser leurs abus, que de souffrir qu’ils deviennent réformateurs, II. 232. Les rangs y sont plus séparés, & les personnes plus confondues qu’ailleurs, II. 232, 233. Le gouvernement y fait plus de cas des personnes utiles, que de celles qui ne font qu’amuser, II. 233. Son luxe est un luxe qui lui est particulier, II. 233, 234. Il y a peu de politesse : pourquoi, II. 234. Pourquoi les femmes y sont timides & vertueuses, & les hommes débauchés, ibid. Pourquoi il y a beaucoup de politiques, II. 235. Son esprit sur le commerce, II. 248. C’est le pays du monde où l’on a mieux su se prévaloir de la religion, du commerce & de la liberté, II. 249. Entraves dans lesquelles elle met ses commerçans : liberté qu’elle donne à son commerce, II. 254. La facilité singuliere du commerce y vient de ce que les douanes y sont en régie, II. 255. Excellence de sa politique [IV-357] touchant le commerce en temps de guerre, II. 256. La faculté qu’on y a accordée à la noblesse de pouvoir faire le commerce, est ce qui a le plus contribué à affoiblir la monarchie, II. 263. Elle est ce qu’Athenes auroit dû être, II. 298. Conduite injuste & contradictoire que l’on y tint contre les Juifs, dans les siecles de barbaries, II. 342 & suiv. C’est elle qui avec la France & la Hollande fait tout le commerce de l’Europe, II. 353. Dans le temps de la rédaction de sa grande chartre, tous les biens d’un anglois représentoient de la monnoie, III. 6. La liberté qu’y ont les filles sur le mariage y est plus tolérable qu’ailleurs, III. 74, 75. L’augmentation des paturages y diminue le nombre des habitans, III. 80. Combien y vaut un homme, III. 87. L’esprit de commerce & d’industrie s’y est établi par la destruction des monasteres & des hôpitaux, III. 121. Loi de ce pays touchant les mariages, contraire à la nature, III. 195, 196. Origine de l’usage qui veut que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort, III. 344, 345. La peine des faux témoins n’y est point capitale ; elle l’est en France : motif de ces deux lois, III. 419, 420. Comment on y prévient les vols, IV. 47, 48. Est-ce être sectateur de la religion naturelle que de dire que l’homicide de soi-même, est en Angleterre l’effet d’une maladie ? D. 247, 248.
Anglois. Ce qu’ils ont fait pour favoriser leur liberté, I. 33. Ce qu’ils feroient, s’ils la perdoient, I. 34. Pourquoi ils n’ont pu introduire la démocratie chez eux, I. 40, 41. Ont rejeté l’usage de la question, sans aucun inconvénient, I. 187. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux, qu’ailleurs, I. 271. C’est le peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre : leur gouvernement doit servir de modele aux peuples qui veulent être libres, I. 414. Raisons physiques du penchant qu’ils ont à se tuer : comparaison à cet égard entr’eux & les Romains, II. 52, 53. Leur caractere : gouvernement qu’il leur faut en conséquence, II. 54, 55. Pourquoi les uns sont royalistes, & les autres parlementaires : pourquoi ces deux partis se haïssent mutuellement : & pourquoi les particuliers passent souvent de l’un à l’autre, II. 220, [IV-358] 221. On les conduit plutôt par leurs passions, que par la raison, II. 224. Pourquoi ils supportent des impôts si onéreux, II. 224, 225. Pourquoi & jusqu’à quel point ils aiment leur liberté, ibid. Sources de leur crédit, II. 225. Trouvent, dans leurs emprunts même, des ressources pour conserver leur liberté, ibid. Pourquoi ne font point & ne veulent point faire de conquêtes, 226, 227. Causes de leur humeur sombre, de leur timidité & de leur fierté, II. 235, 236. Caractere de leurs écrits, II. 236, 237.
Annibal. Les Carthaginois, en l’accusant devant les Romains, sont une preuve que lorsque la vertu est bannie de la démocratie l’état est proche de sa ruine, I. 43, 44. Véritable motif du refus que les Carthaginois firent de lui envoyer du secours en Italie, I. 285, 286. S’il eût pris Rome, sa trop grande puissance auroit perdu Carthage, ibid.
Anonymes (Lettres). Cas que l’on doit en faire, I. 421, 422.
Antilles. Nos colonies dans ces îles sont admirables, II. 351.
Antioche. Julien l’apostat y causa une affreuse famine, pour y avoir baissé le prix des denrées, III. 13.
Antipater. Forme à Athenes, par sa loi sur le droit de suffrage, la meilleure aristocratie qui fût possible, I. 30.
Antiquaire. L’auteur se compare à celui qui alla en Égypte, jeta un coup d’œil sur les pyramides, & s’en retourna, III. 405, 406.
Antonin. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus grand objet qu’il y ait eu dans la nature, III. 137.
Antropophages. Dans quelles contrées de l’Afrique il y en avoit, II. 312.
Antrustions. Etymologie de ce mot, IV. 44. On nommoit ainsi, du temps de Marculse, ce que nous nommons vassaux, ibid. Etoient distingués des Francs, par les lois même, IV. 44, 45. Ce que c’étoit : il paroît que c’est d’eux que l’auteur tire principalement l’origine de notre noblesse françoise, IV. 94 & suiv. C’étoit à eux principalement que l’on donnoit autrfois les fiefs, IV. 102 & suiv.
Appel. Celui que nous connoissons aujourd’hui n’étoit point en usage du temps de nos peres : ce qui en [IV-359] tenoit lieu, III. 338, 339. Pourquoi étoit autrefois regardé comme félonie, III. 339. Précautions qu’il falloit prendre, pour qu’il ne fût point regardé comme félonie, III. 339, 340. Devoit se faire autrefois sur le champ, & avant de sortir du lieu où le jugement avoit été prononcé, III. 363. Différentes observations sur les appels qui étoient autrefois en usage, III. 363 & suiv. Quand il fut permis aux villains d’appeller de la cour de leur seigneur, III. 363, 364. Quand on a cessé d’ajourner les seigneurs & les baillis sur les appels de leurs jugemens, III. 365, 366. Origine de cette façon de prononcer sur les appels dans les parlemens : La cour met l’appel au néant : la cour met l’appel & ce dont a été appellé au néant, III. 366, 367. C’est l’usage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux dépens, III. 371, 372. Leur extrême facilité a contribué à abolir l’usage constamment observé dans la monarchie, suivant lequel un juge ne jugeoit jamais seul, III. 397. Pourquoi Charles VII n’a pu en fixer le temps dans un bref délai ; & pourquoi ce délai s’est étendu jusqu’à trente ans, 430, 431.
Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d’être en usage, III. 351, 352. Ces sortes d’appels ont souvent été des points remarquables dans notre histoire : pourquoi, III. 352, 353. En quels cas, contre qui il avoit lieu : formalités qu’il falloit observer dans cette sorte de procédure : devant qui il se relevoit, III. 353 & suiv. Concouroit quelquefois avec l’appel de faux jugement, III. 355, 356. Usage qui s’y observoit, III. 365. Voyez Défaute de droit.
Appel de faux jugement. Ce que c’étoit : contre qui on pouvoit l’interjeter : précautions qu’il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, III. 340 & suiv. Formalités qui devoient s’y observer suivant les différens cas, ibid. Ne se décidoit pas toujours pas le combat judiciaire, III. 347. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans celle des seigneurs par les hommes de la cour du roi, III. 347, 348. Saint Louis l’abolit dans les segneuries de ses domaines, [IV-360] & en laissa subsister l’usage dans celles de ses barons, mais sans qu’il y eût de combat judiciaires, III. 357 & suiv. Usage qui s’y observoit, III. 365.
Appel de faux jugement à la cour du roi. Etoient le seul appel établi ; tous les autres proscrits & punis, III. 351.
Appel en jugement. Voyez Assignation.
Appius décemvir. Son attentat sur Virginie affermit la liberté à Rome, I. 418.
Arabes. Leur boisson, avant Mahomet, étoit de l’eau, II. 47. Leur liberté, II. 158 & suiv. Leurs richesses : d’où ils les tirent : leur commerce : leur inaptitude à la guerre : comment ils deviennent conquérans, II. 331 & suiv. Comment la religion adoucissoit, chez eux, les fureurs de la guerre, III. 146. L’atrocité de leurs mœurs fut adoucie par la religion de Mahomet, III. 147. Les mariages entre parens au quatrieme degré sont prohibés chez eux : ils ne tiennent cette loi que de la nature, III. 219.
Arabie. Alexandre a-t-il voulu y établir le siege de son empire ? II. 298. Son commerce étoit-il utile aux Romains ? II. 333 & suiv. C’est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon peut être bonne : raisons physiques, III. 158, 159.
Arbogaste. Sa conduite avec l’empereur Valentinien est un exemple du génie de la nation François à l’égard des maires du palais, IV. 124, 125.
Arcades. Ne devoient la douceur de leurs mœurs qu’à la musique, I. 76.
Arcadius. Maux qu’il causa à l’empire, en faisant la fonction de juge, 162. Ce qu’il pensoit des paroles criminelles, I. 403. appella les petits-enfans à la succession de l’aïeul maternel, III.263.
Arcadius & Honorius. Furent tyrans, parce qu’ils étoient foibles, I. 395. Lois injuste de ces princes, 429, 430.
Aréopage. Ce n’étoit pas la même chose que le sénat d’Anthènes, I. 99. Justifié d’un jugement qui paroît trop sévere, I. 144.
Aréopagite. Puni avec justice pour avoir tué un moineau, ibid.
Argent. Funestes effets qu’il produit, I. 74. Peut être [IV-361] proscrit d’une petite république : nécessaire dans un grand état, I. 75, 76. Dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût peu ; dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût beaucoup, III. 9, 10. De sa rareté relative à celle de l’or, III. 16, 17. Différens égards sous lesquels il peut être considéré : ce qui en fixe la valeur relative : dans quel cas on dit qu’il est rare ; dans quel cas on dit qu’il est abondant dans un état, III. 17 & suiv. Il est juste qu’il produise des intérêts à celui qui le prête, III. 50 & suiv. Voyez Monnoie.
Argiens. Actes de cruauté de leur part détestés par tous les autres états de la Grece, I. 174.
Argonautes. Etoient nommés aussi Miniares, II. 291.
Argos. L’ostracisme y avoit lieu, III. 413.
Ariane (l’). Sa situation. Semiramis & Cyrus y perdent leurs armées ; Alexandre une partie de la sinne, II. 293, 294.
Aristée. Donna des lois dans la Sardiange, II. 143.
Aristocratie. Ce que c’est, I. 16. Les suffrages ne doivent pas s’y donner comme dans la démocratie, I. 22. Quelles sont les lois qui en dérivent, I. 25 & suiv. Les suffrages y doivent être secret, I. 24. Entre les mains de qui y réside la souveraine puissance, I. 25, 26. Ceux qui y gouvernent sont odieux, I. 26. Combien les distinctions y sont affligeantes, ibid. Comment elle peut se rencontrer dans la démocratie, ibid. Quand elle est renfermée dans le sénat, ibid. Comment elle peut être divisée en trois classes : Autorité de chacune de ces trois classes, ibid. Il est utile que le peuple y ait une certaine influence dans le gouvernement, I. 26, 27. Quelle est la meilleure qui soit possible, I. 30. Quelle est la plus imparfaite, ibid. Quel en est le principe, I. 44. Inconvénient de ce gouvernement, I. 45. Quels crimes commis par les nobles y sont punis : quels restent impunis, ibid. Quelle est l’ame de ce gouvernement, I. 46. Comment les lois doivent rapporter au principe de ce gouvernement, I. 102. & suiv. Quelles sont les principales sources des désordres qui y arrivent, I. 104. Les distributions faites au peuple y sont utiles, I. 105, 106. Usage qu’on y doit faire des revenus de l’état, 106. Par qui les [IV-362] tributs y doivent être levés, ibid. Les lois y doivent être telles, que les nobles soient contraints de rendre justice au peuple, I. 107, 108. Les nobles ne doivent ni être ni trop pauvres ni trop riches : moyens de prévenir ces deux excès, I. 109, 110. Les nobles n’y doivent point avoir de contestations, I. 110. Le luxe en doit être banni, I. 198, 199. De quels habitans est composée, I. 199. Comment se corrompt le principe de ce gouvernement, I. 232 & suiv. Comment elle peut maintenir la force de son principe, I. 233. Plus un état aristocratique a de sureté, plus il se corrompt, I. 234. Ce n’est point un état libre par sa nature, I. 309. Pourquoi les écrits satiriques y sont punis sévérement, 405. C’est le gouvernement qui approche le plus de la monarchie : conséquences qui en résultent, II. 140.
Aristocratie héréditaire. Inconvénient de ce gouvernement, I. 233.
Aristodeme. Fausses précautions qu’il prit pour conserver son pouvoir dans Cumes, I. 291, 292.
Aristote. Refuse aux artisans le droit de cité, I. 78. Ne connoissoit pas le véritable état monarchique, I. 338, 339. Dit qu’il y a des esclaves par nature, mais ne le prouve pas, II. 72. Sa philosophie causa tous les malheurs qui accompagnerent la destruction du commerce, II. 34 & suiv. Ses préceptes sur la propagation, III. 86. Source du vice de quelques-unes de ses lois, III. 440.
Armées. De qui elles doivent être composées, pour que la liberté du peuple ne soit point écrasée : de qui leur nombre & leur existence doit dépendre : où elles doivent habiter en temps de paix : à qui le commandement en doit appartenir, I. 331 & suiv. Etoient composées de trois sortes de vassaux dans les commencemens de la monarchie, IV. 51. Comment & par qui étoient commandées sous la premiere race de nos rois : comment on les assembloit, IV. 125 & suiv.
Armes. C’est à leur changement que l’on doit l’origine de bien des usages, III. 324.
Armes à feu. (Port des). Puni trop rigoureusement à Venise : pourquoi, III. 239.
Armes enchantées. D’où est venue l’opinion qu’il y en avoit, III. 325, 326.
[IV-363]
Arragon. Pourquoi on y fit des lois somptuaires, dans le treizieme siecle, I. 203. Le Clergé y a moins acquis qu’en Castille, parce qu’il y a en Arragon quelque droit d’amortissement, III. 173.
Arrêts. Doivent être recueillis & appris dans une monarchie : causes de leur multiplicité & de leur variété, I. 46 & suiv. Origine de la formule de ceux qui se prononcent sur les appels, III. 366, 367. Quand on a commencé à en faire des compilations, III. 388.
Arribas, roi d’Epire. Se trompa dans le choix des moyens qu’il employa pour tempérer le pouvoir monarchique, I. 339.
Arriere-fiefs. Comment se sont formés, IV. 189 & suiv. Leur établissement fit passer la couronne de la maison des Carlovingiens dans celle des Capétiens, IV. 202 & suiv.
Arriere-vassaux. Etoient tenus au service militaire, en conséquence de leur fief, IV. 47 & suiv.
Arriere-vasselage. Ce que c’étoit dans les commencemens : comment est parvenu à l’état où nous le voyons, IV. 189.
Arrington. Cause de son erreur sur la liberté, I. 334. Jugement sur cet auteur Anglois, III. 440.
Artaxerxès. Pourquoi il fit mourir tous ses enfans, I. 127.
Artisans. Ne doivent point, dans une bonne démocratie, avoir le droit de cité, I. 77, 78.
Arts. Les Grecs, dans les temps héroïques, élevoient au pouvoir suprême ceux qui les avoient inventés, I. 340. C’est la vanité qui les perfectionne, II. 193, 194. Leurs causes & leurs effets, II. 276, 277. Dans nos états, ils sont nécessaires à la population, III. 81 & suiv.
As. Révolutions que cette monnoie essuya à Rome dans sa valeur, III. 36 & suiv.
Asiatiques. D’où vient leur penchant pour le crime contre nature, I. 392. Regardent comme autant de faveurs les insultes qu’ils reçoivent de leur prince, I. 426.
Asie. Pourquoi les peines fiscales y sont moins severes qu’en Europe, II. 14, 15. On n’y publie guere d’édits que pour le bien & le soulagement des [IV-364] peuples : c’est le contraire en Europe, II. 21. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II. 43. C’est le climat qui y a introduit & qui y maintient la polygamie, II. 98, 99. Il y naît beaucoup plus de filles que de garçons : la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 100. Pourquoi, dans les climats froids de ce pays, une femme peut avoir plusieurs hommes, II. 101. Causes physiques du despotisme qui la désole, II. 126 & suiv. Ses différens climats comparés avec ceux de l’Europe : cause physiques de leurs différences : conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs & le gouvernement de ses différentes nations : raisonnemens de l’auteur confirmés à cet égard par l’histoire : observations historiques fort curieuses, ibid. Quel étoit autrefois son commerce : comment & par où il se faisoit, II. 277 & suiv. Epoques & causes de sa ruine, II. 325. Quand & par qui elle fut découverte : comment on y fit le commerce, II. 346 & suiv.
Asie mineure. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87.
Assemblées du peuple. Le nombre des citoyens qui y ont voix doit être fixé dans la démocratie, I. 17. Exemple célebre des malheurs qu’entraîne ce défaut de précaution, ibid. Pourquoi, à Rome, l’on ne pouvoit pas faire de testament ailleurs, III. 245.
Assemblées de la nation, chez les Francs, II. 182, 183. Etoient fréquentes sous les deux premieres races : de qui composées : quel en étoit l’objet, III. 188, 189.
Assignations. Ne pouvoient à Rome se donner dans la maison du défendeur : en France, ne peuvent pas se donner ailleurs. Ces deux lois qui sont contraires, dérivent du même esprit, III. 418.
Assises. Peines de ceux qui y avoient été jugés ; & qui ayant demandé de l’être une seconde fois, succomboient, III. 350.
Associations de villes. Plus nécessaires autrefois qu’aujourd’hui : pourquoi, I. 260.
Assyriens. Conjectures sur la source de leur puissance & de leurs grandes richesses, II. 276. Conjectures sur leur communication avec les parties de l’orient & de l’occident les plus reculées, II. 278. Ils [IV-365] épousoient leurs meres par respect pour Sémiramis, III. 220.
Asyle. La maison d’un citoyen doit être son asyle, I. 420.
Asyles. Leur origine : les Grecs en prirent plus naturellement l’idée que les autres peuples : cet établissement qui étoit sage d’abord, dégénéra en abus, & devint pernicieux, III. 167, 168. Pour quels criminels ils doivent être ouverts, ibid. Ceux que Moïse établit étoient très-sages : pourquoi, III. 168.
Athées. Parlent toujours de religion, parce qu’ils la craignent, III. 161.
Athéisme. Vaut-il mieux que l’idolâtrie ? III. 126 & suiv. N’est pas la même chose que la religion naturelle, puisqu’elle fournit les principes pour combattre l’athéisme, D. 252.
Athenes. Les étrangers que l’on y trouvoit mêlés dans les assemblées du peuple, étoient punis de mort : pourquoi, I. 17. Le bas peuple n’y demanda jamais à être élevé aux grandes dignités, quoiqu’il eût le droit : raisons de cette retenue, I. 19. Comment le peuple y fut divisé par Solon, I. 21. Sagesse de sa contitution, I. 25. Avoit autant de citoyens du temps de son esclavage, que lors de ses succès contre les Perses, I. 42, 43. Pourquoi cette république étoit la meilleure aristocratie qui fût possible, I. 30. En perdant la vertu, elle perdit sa liberté, sans perdre ses forces, I. 42, 43. Descriptions & causes des révolutions qu’elle a essuyées, ibid. Source de ses dépenses publiques, I. 85. On y pouvoit épouser sa sœur consanguine, & non sa sœur utérine ; esprit de cette loi, I. 89. Le sénat n’y étoit pas la même chose que l’aréopage, I. 99. Contradiction dans ses lois touchant l’égalité des biens, I. 88. Il y avoit dans cette ville un magistrat particulier pour veiller sur la conduite des femmes, I. 211. La victoire de Salamine corrompit cette république, I. 231. Causes de l’extinction de la vertu dans cette ville, I. 234. Son ambition ne porta nu préjudice à la Grece, parce qu’elle cherchoit non la domination, mais la prééminence sur les autres républiques, I. 249. Comment on y punissoit les [IV-366] accusateurs qui n’avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, I. 415. Les lois y permettoient à l’accusé de se retirer avant le jugement, ibid. L’abus de vendre les débiteurs y fut aboli par Solon, I. 416. Comment on y avoit ficé les impôts sur les personnes, II. 7,8. Pourquoi les esclaves n’y causerent jamais de trouble, II. 83. Lois justes & favorables établies par cette république en faveur des esclaves, II. 89. La faculté de répudier y étoit respective entre le mari & la femme, II. 119. Son commerce, II. 242. Solon y abolit la contrainte par corps : la trop grande généralité de cette loi n’étoit pas bonne, II. 257. Eut l’empire de la mer : elle n’en profita pas : pourquoi, II. 288, 289. Son commerce fut plus borné qu’il n’auroit dû l’être, ibid. Les batard tantôt y étoient citoyens, & tantôt ils ne l’étoient pas, III. 72. Il y avoit trop de fêtes, III. 154, 155. Raisons physiques de la maxime reçue chez eux, par laquelle on croyoit honorer davantage les Dieux, en leur offrant de petits présens, qu’en immolant des bœufs, III. 157. Dans quels cas les enfans y étoient obligés de nourrir leurs peres tombés dans l’indigence : justice & injustice de cette loi, III. 198, 199. Avant Solon, aucun citoyen n’y pouvoit faire de testament : comparaison des lois de cette république à cet égard, avec celles de Rome, III. 246. L’ostracisme y étoit une chose admirable, tandis qu’il fit mille maux à Syracuse, III. 413, 414. Il y avoit une loi qui vouloit qu’on fît mourir, quand la ville étoit assiégée, tous les gens inutiles. Cette loi abominable étoit la suite d’un abominable droit des gens, III. 426, 427. L’auteur a-t-il fait une faute, en disant que le plus petit nombre y fut exclus du cens fixé par Antipater ? D. 318 & suiv.
Athéniens. Pourquoi n’augmenterent jamais les tributs qu’ils leverent sur les Elots, II. 5. Pourquoi ils pouvoient s’affranchir de tout impôt, II. 16, 17. Leur humeur & leur caractere étoient à peu près semblable à celui des François, II. 192. Quel étoit originairement leur monnoie : ses inconvéniens, III. 3, 4.
Athualpa, ynca. Traitement cruel que lui firent les Espagnols, III. 235.
[IV-367]
Attila. Son empire fut divisé, parce qu’il étoit trop grand pour une monarchie, I. 251. En épousant sa fille, il fit une chose permise par les lois scythes, III. 217.
Attique. Pourquoi la démocratie s’y établit plutôt qu’à Lacédémone, II. 140.
Avarice. Dans une démocratie où il n’y a plus de vertu, c’est la frugalité & non le désir d’avoir qui y est regardée comme avarice, I. 42. Pourquoi elle garde l’or & l’argent, & l’or plutôt que l’argent, III. 16.
Aubaine. Epoque de l’établissement de ce droit insensé : tort qu’il fit au commerce, II. 339.
Aveugles. Mauvaise raison que donne la loi romaine qui leur interdit la faculté de plaider, III. 433.
Auguste. Pourquoi refusa des lois somptuaires aux importunités du sénat, I. 201. Quand & comment il faisoit valoir les lois faites contes l’adultere, I. 217, 218. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté, I. 404. Loi injuste de ce prince, I. 407. La crainte d’être regardé comme tyran l’empêcha de se faire appeler Romulus, II. 187. Fut souffert, parce que, quoiqu’il eût la puissance d’un Roi, il n’en affectoit point le faste, II. 188. Avoit indisposé les Romains par des lois trop dures ; se les réconcilia, en leur rendant un comédien qui avoit été chassé : raisons de cette bizarrerie, ibid. Entreprend la conquête de l’Arabie, prend des villes, gagne des batailles, & perd son armée, II. 332. Moyen qu’il employa pour multiplier les mariages, III. 92 & suiv. Belle harangue qu’il fit aux chevaliers romains, qui lui demandoient la révocation des lois contre le célibat, III. 92, 93. Comment il opposa les lois civiles aux cérémonies impures de la religion, III. 145. Fut le premier qui autorisa les fidéicommis, III. 250.
Augustin (Saint). Se trompe, en trouvant injuste la loi qui ôte aux femmes la faculté de pouvoir être instituées héritieres, III. 200 & suiv.
Aumônes. Celles qui se font dans les rues ne remplissent pas les obligations de l’état : quelles sont ces obligations, III. 120.
[IV-368]
Avortement. Pourquoi les femmes de l’Amériques se faisoient avorter, III. 78.
Avoués. Menoient à la guerre les vassaux des évêques & des abbés, IV. 48.
Avoués de la partie publique. Il ne faut pas les confondre avec ce que nous appelons aujourd’hui partie publique : leurs fonctions, III. 373 & suiv. Epoque de leur extinction, III. 376.
Aurenzeb. Se trompoit, en croyant que, s’il rendoit son état riche, il n’auroit pas besoin d’hôpitaux, III. 120.
Auteurs. Ceux qui sont célebres, & qui font de mauvais ouvrages reculent prodigieusement le progrès des sciences, IV. 43.
Authentiques Hodie quantiscunque est une loi mal entendue, III. 209. Quod hodie est contraire au principe des lois civiles, III. 209, 210.
Auto-da-fé. Ce que c’est, III. 183.
Autorité royale. Comment doit agir, I. 423.
Autriche (la maison d’). Faux principe de sa conduite en Hongrie, I. 239. Fortune prodigieuse de cette maison, II. 347, 348. Pourquoi elle possede l’empire depuis si long-temps, IV. 204.
B
Bachas. Pourquoi leur tête est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est toujours en sureté, I. 54. Pourquoi absolus dans leurs gouvernemens, I. 134. Terminent les procès en faisant distribuer à leur fantaisie, des coups de bâton aux plaideurs, I. 152. Sont moins libres en Turquie qu’un homme qui, dans un pays où l’on suit les meilleurs lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l’être le lendemain, I. 383.
Bactriens. Alexandre abolit un usage barbare de ce peuple, I. 283, 284.
Baillie ou garde. Quand elle a commencé à être distinguée de la tutelle, II. 179.
Baillis. Quand ont commencé à être ajournés sur l’appel de leurs jugemens ; & quand cet usage a [IV-369] cessé, III. 365, 366. Comment rendoient la justice, III. 395. Quand & comment leur juridiction commença à s’étendre, III. 395, 396. Ne jugeoient pas d’abord ; faisoient seulement l’instruction, & prononçoient le jugement fait par les prud’hommes : quand commencerent à juger eux-mêmes, & même seuls, III. 396, 397. Ce n’est point pas une loi qu’ils ont été créés, & qu’ils ont eu le droit de juger, III. 398. L’ordonnance de 1287, que l’on regarder comme le titre de leur création, n’en dit rien : elle ordonne seulement qu’ils seront pris parmi les laïques, preuves, ibid.
Balbi. Pensa faire étouffer de rire le roi de Pégu, en lui apprenant qu’il n’y avoit point de roi à Venise, II. 186, 187.
Baleine. La pêche de ce poisson ne rend presque jamais ce qu’elle coûte : elle est cependant utile aux Hollandois, II. 247, 248.
Baluze. Erreur de cet auteur prouvée & redressée, IV. 117, 118.
Ban. Ce que c’étoit dans le commencement de la monarchie, IV. 52.
Banques. Sont un établissement propre au commerce d’économie : il n’en faut point dans une monarchie, II. 251, 252. Ont avili l’or & l’argent, II. 358.
Banque de Saint-Georges. L’influence qu’elle donne au peuple de Genes dans le gouvernement fait toute la prospérité de cet état, I. 26, 27.
Banquiers. En quoi consiste leur art & leur habileté, III. 28. Sont les seuls qui gagnent, lorsqu’un état hausse ou baisse la monnoie, III. 29 & suiv. Comment peuvent être utiles à un état, III. 45.
Bantham. Comment les successions y sont réglées, I. 124. Il y a dix femmes pour un homme : c’est un cas bien particulier de la polygamie, II. 101. On y marie les filles à treize ou quatorze ans, pour prévenir leurs débauches, II. 111. Il y naît trop de filles pour que la propagation y puisse être proportionnées à leur nombre, III. 78.
Barbares. Différence entre les barbares & les sauvages, II. 150, 151. Les Romains ne vouloient point [IV-370] de commerce avec eux, II. 330, 331. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III. 164.
Barbares qui conquirent l’empire romain. Leur conduite après la conquête des provinces romaines, doit servir de modele aux conquérants, I. 280. C’est de ceux qui ont conquis l’empire romain & apporté l’ignorance dans l’Europe, que nous vient la meilleure espece de gouvernement que l’homme ait pu imaginer, I. 337 & suiv. Ce sont eux qui ont dépeuplé la terre, III. 112. Pourquoi ils embrasserent si facilement le christianisme, III. 166. Furent appelés à l’esprit d’équité par l’esprit de liberté : faisoient les grands chemins aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III. 225, 226. Leurs lois n’étoient point attachées à un certain territoire : elles étoient toutes personnelles, III. 270 & suiv. Chaque particulier suivoit la loi de la personne à laquelle la nature l’avoit subordonné, III. 272. Etoient sortis de la Germanie : c’est dans leurs mœurs qu’il faut chercher les sources des lois féodales, IV. 3. Est-il vrai qu’après la conquête des Gaules, ils firent un règlement général pour établir partout la servitude de la glebe ? IV. 9. Pourquoi leurs lois sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu’ils n’avoient pas originairement : pourquoi on y en a forgé de nouveaux, IV. 35, 36.
Barons. C’est ainsi que l’on nommoit autrefois les maris nobles, III. 334.
Basile empereur. Bizarreries des punitions qu’il faisoit subir, I. 185.
Bâtards. Il n’y en a point à la Chine : pourquoi, III. 70, 71. Sont plus ou moins odieux, suivant les divers gouvernemens, suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, ou autres circonstances, III. 71, 72. Leurs droits aux successions, dans les différens pays, sont réglés par les lois civiles ou politiques, III. 203.
Bâton. Ç’a été pendant quelque temps la seule arme permise dans les duels ; ensuite on a permis le choix du bâton ou des armes ; enfin la qualité des combattans, a décidé, III. 320, 321. Pourquoi encore aujourd’hui regardé comme l’instrument des outrages, III. 322.
[IV-371]
Bavarois. Quand & par qui leurs lois furent rédigées, III. 265, 266. Simplicité de leurs lois : cause de cette simplicité, III. 266, 267. On ajoute plusieurs capitulaires à leurs lois : suite qu’eut cette opération, III. 290, 291. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Leurs lois permettoient aux accusés d’appeler au combat les témoinds que l’on produisoit contr’eux, III. 327.
Bayle. Paradoxes de cet auteur, III. 125 & suiv. 131, 133. Est-ce un crime de dire que c’est un grand homme ? & est-on obligé de dire que c’étoit un homme abominable ? D. 237 & suiv.
Beau-fils. Pourquoi il ne peut épouser sa belle-mere, III. 221.
Beaux-freres. Pays où il doit leur être permis d’épouser leur belle-sœur, III. 221 & suiv.
Beaumanoir. Son livre nous apprend que les barbares qui conquirent l’empire romain, exercerent avec modération les droits les plus barbares, III. 225. En quel temps il vivoit, III. 317. C’est chez lui qu’il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III. 328. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 384. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 403, 404.
Beau-pere. Pourquoi ne peut épouser sa belle-fille, III. 321.
Believre (le président de). Son discours à Louis XIII, lorsqu’on jugeoit devant ce prince le duc de la Valette, I. 160, 161.
Belle-fille. Pourquoi ne peut épouser son beau-pere, III. 221.
Belle-mere. Pourquoi ne peut épouser son beau-fils, ibid.
Belles-sœurs. Pays où il leur doit être permis d’épouser leur beau-frere, III. 221 & suiv.
Bénéfices. La loi qui, en cas de mort de l’un des deux contendans, adjuge le bénéfice au survivant, fait que les ecclésiastiques se battent comme des dogues anglois, jusqu’à la mort, III. 410.
Bénéfices. C’est ainsi que l’on nommoit autrefois les fiefs & tout ce qui se donnoit en usufruit, IV. 45. [IV-372] Ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice, IV. 78.
Bénéfices militaires. Les fiefs ne tirent point leur origine de cet établissement des Romains, IV. 28, 29. Il ne s’en trouve plus du temps de Charles-Martel ; ce qui prouve que le domaine n’étoit pas alors inaliénable, IV. 131, 132.
Bengale (Golphe de). Comment découvert, II. 303.
Benois Levite. Bévue de ce malheureux compilateur des capitulaires, III. 286, 287.
Besoins. Comment un état bien policé doit soulager ceux des pauvres, III. 119, 120.
Bêtes. Sont-elles gouvernées par les lois générales du mouvement, ou par une notion particuliere ? I. 5. Quelle sorte de rapport elles ont avec Dieu : comment elles conservent leur individu, leur espece : quelles sont leurs lois : les suivent-elles invariablement ? ibid. Leur bonheur comparé avec le nôtre, ibid.
Bétis. Combien les mines d’or qui étoient à la source de ce fleuve produisoient aux Romains, II. 319.
Bien. Il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire, II. 392, 393.
Bien (Gens de). Il est difficile que les inférieurs le soient, quand la plupart des grands d’un état sont mal-honnêtes gens, I. 48. Sont fort rares dans les monarchies : ce qu’il faut avoir pour l’être, I. 49.
Bien particulier. C’est un paralogisme de dire qu’il doit céder au bien public, III. 224.
Bien public. Il n’est vrai qu’il doit l’emporter sur le bien particulier, que quand il s’agit de la liberté du citoyen, & non quand il s’agit de la propriété des biens, III. 224 & suiv.
Biens. Combien il y en a de sortes parmi nous ; la variété dans leurs especes est une des sources de la multiplicité de nos lois, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 147. Il n’y a point d’inconvénient, dans une monarchie, qu’ils soient inégalement partagés entre les enfans, I. 112.
Biens (Cession de). Voyez Cession de biens.
Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé : Evêques.
Biens fiscaux. C’est ainsi que l’on nommoit autrefois les fiefs, IV. 45.
[IV-373]
Bienséances. Celui qui ne s’y conforme pas se rend incapable de faire aucun bien dans la société : pourquoi, I. 62.
Bigon (M.) Erreur de cet auteur, IV. 78, 79.
Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de l’Arabie & des Indes n’étoit pas avantageux aux Romains, II. 333, 334.
Bills d’atteindre. Ce que c’est en Angleterre : comparés à l’ostracisme d’Athenes, aux lois qui se faisoient à Rome contre les citoyens particuliers, I. 413, 414.
Blé. C’étoit la branche la plus considérable du commerce intérieur des Romains, II. 327, 328. Les terres fertiles en blé sont fort peuplées : pourquoi, III. 80.
Boheme. Quelle sorte d’esclavage y est établi, II. 76.
Boissons. On leve mieux en Angleterre les impôts sur les boissons, qu’en France, II. 10.
Bonne-espérance. Voyez Cap.
Bon sens. Celui des particuliers consiste beaucoup dans la médiocrité de leurs talens, I. 86.
Bonzes. Leur inutilité pour le bien public a fait fermer une infinité de leurs monasteres à la Chine, I. 206.
Bouclier. C’étoit chez les Germains une grande infamie de l’abandonner dans le combat, & une grande insulte de reprocher à quelqu’un de l’avoir fait : pourquoi cette insulte devint moins grande, III. 323, 324.
Boulangers. C’est une justice outrée que d’empaler ceux qui sont pris en fraude, III. 239.
Boulainvilliers (Le marquis de). A manqué le point capital de son systême sur l’origine des fiefs : jugement sur son ouvrage : éloge de cet auteur, IV. 17, 18.
Bourguignons. Leur loi excluoit les filles de la concurrence avec leurs freres à la succession des terres & de la couronne, II. 171. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II. 173. Leur majorité étoit fixée à quinze ans, II. 177. Quand & pour qui ils firent écrire leurs lois, III. 266. Par qui elles furent recueillies, III. 267. Pourquoi elles perdirent de leur caractere, III. 267, 268. Elles [IV-374] sont assez judicieuses, III. 270. Différences essentielles entre leurs lois & les lois saliques, III. 272 & suiv. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domaine & de celui des Goths, tandis qu’il se perdit dans celui des Francs, III. 275 & suiv. Conserverent long-temps la loi de Gondebaud, III. 281. Comment leurs lois cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Epooque de l’usage du combat judiciaire chez eux, III. 313. Leur loi permettoit aux accusés d’appeler au combat les témoins que l’on produisoit contr’eux, III. 337. S’établirent dans la partie orientale de la Gaule ; y porterent les mœurs germaines : de là les fiefs dans ces contrées, IV. 10.
Boussole. On ne pouvoit, avant son invention, naviguer que près des côtes, II. 280. C’est par son moyen qu’on a découvert le cap de Bonne-Espérance, II. 210. Les Carthaginois en avoient-ils l’usage ? II. 321, 322. Découvertes qu’on lui doit, 346 & suiv.
Brésil. Quantité prodigieuse d’or qu’il fournit à l’Europe, II. 357.
Bretagne. Les successions, dans le Duché de Rohan, appartiennent au dernier des mâles : raisons de cette loi, I. 160, 163. Les coutumes de ce duché tirent leur origine des assises du Duc Geoffroi, III. 402.
Brigues. Sont nécessaires dans un état populaire, I. 24, 25. Dangereuses dans le sénat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle le sénat de Rome les prévint, I. 179.
Brunehault. Son éloge ; ses malheurs : il en faut chercher la cause dans l’abus qu’elle faisoit de la disposition des fiefs & autres biens des nobles, IV. 107. Comparée avec Frédégonde, IV. 113, 114. Son supplice est l’époque de la grandeur des maires du palais, IV. 28.
Brutus. Par quelle autorité il condamna ses propres enfans, I. 364. Quelle part eut, dans la procédure contre les enfans de ce consul, l’esclave qui découvrit leur conspiration pour Tarquin, I. 407.
[IV-375]
Bulle Unigenitus. Est-elle la cause occasionnelle de l’esprit des lois ? D. 248, 249.
C
Cadavres. Peines chez les Germains contre ceux qui les exhumoient, III. 59, 64, 65.
Sadhisja, femme de Mahomet. Coucha avec lui, n’étant âgée que de huit ans, II. 96.
Calicuth, royaume de la côte du Coromandel. On y regarde comme une maxime d’état que toute religion est bonne, III. 189.
Calmouks, peuples de la grande Tartarie. Se font une affaire de conscience de souffrir chez eux toutes sortes de religions, ibid.
Calomniateurs. Maux qu’ils causent, lorsque le prince fait lui-même la fonction de juge, I. 162. Pourquoi accusent plutôt devant le prince que devant les magistrats, I. 422.
Calvin. Pourquoi il bannit la hiérarchie de sa religion, II. 132.
Calvinisme. Semble être plus conforme à ce que Jesus-Christ a dit, qu’à ce que les apôtres ont fait, ibid.
Calvinistes. Ont beaucoup diminué les richesses du clergé, IV. 143, 144.
Cambyse. Comment profita de la superstition des Egyptiens, III. 204.
Camoens (le) Beautés de son poëme, II. 346.
Campagne. Il y faut moins de fêtes que dans les villes, III. 155.
Canada. Les habitans de ce pays brûlent ou s’associent leurs prisonniers, suivant les circonstances, III. 87.
Cananéens. Pourquoi détruits si facilement, I. 262.
Candeur. Nécessaire dans les lois, III. 436, 437.
Canons. Différens recueils qui en ont été faits : ce qu’on inséra dans ces différens recueils : ceux qui ont été en usage en France, III. 289, 290. Le pouvoir qu’ont les évêques d’en faire, étoit pour eux un prétexte de ne pas se soumettre aux capitulaires, III. 289.
Cap de Bonne-Espérance. Cas où il seroit plus avantageux d’aller aux Indes par l’Egypte que par ce cap, [IV-376] II. 308. Sa découvete étoit le point capital pour faire le tour de l’Afrique : ce qui empêchoit de le découvrir, II. 309. Découvert par les Portugais, II. 346.
Capetiens. Leur avénement à la couronne comparé avec celui des Carlovingiens, IV. 160, 161. Comment la couronne de France passa dans leur maison, IV. 202 & suiv.
Capitale. Celle d’un grand empire est mieux placée au nord qu’au midi de l’empire, II. 137, 138.
Capitulaires. Ce malheureux compilateur Benoît Lévite n’a-t-il pas transformé une loi wisigothe en capitulaire ? III. 286, 287. Ce que nous nommons ainsi, III. 289. Pourquoi il n’en fut plus question sous la troisieme race, III. 290. De combien d’especes il y en avoit : on négligea le corps des capitulaires, parce qu’on en avoit ajouté plusieurs aux lois des barbares, III. 290, 291. Comment on leur substitua les coutumes, III. 292. Pourquoi tomberent dans l’oubli, III. 317 & suiv.
Cappadociens. Se croyoient plus libres dans l’état monarchique que dans l’état républicain, I. 307.
Captifs. Le vainqueur a-t-il droit de les tuer ? II. 63.
Caracalla. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III. 348.
Caractere. Comment celui d’une nation peut être formé par les lois, II. 219 & suiv.
Caravane d’Alep. Sommes immenses qu’elle porte en Arabie, II. 332.
Carlovingiens. Leur avénement à la couronne fut naturel, & ne fut point une révolution, IV. 159 & suiv. Leur avénement à la couronne comparé avec celui des Capétiens, IV. 160, 161. La couronne de leur temps étoit tout-à-la-fois élective & héréditaire : preuves, IV. 161 & suiv. Cause de la chute de cette maison, IV. 168 & suiv. Causes principales de leur affoiblissement, IV. 184 & suiv. Perdirent la couronne, parce qu’ils se trouverent dépouillés de tout leur domaine, IV. 199, 200. Comment la couronne passa de leur maison dans celle des Capétiens, IV. 202 & suiv.
Carthage. La perte de sa vertu la conduisit à sa ruine, [IV-377] I. 43, 44. Epoque des différentes gradations de la corruption de cette république, I. 247. Véritable motif du refus que cette république fit d’envoyer des secours à Annibal, I. 285, 286. Etoit perdue, si Annibal avoit pris Rome, ibid. A qui le pouvoit de juger y fut confié, I. 368. Nature de son commerce, II. 242. Son commerce : ses découvertes sur les côtes d’Afrique, II. 314 & suiv. Ses précautions pour empêcher les Romains de négocier sur mer, II. 322. Sa ruine augmenta la gloire de Marsilles, 323.
Carthaginois. Plus faciles à vaincre chez eux qu’ailleurs : pourquoi, I. 271. La loi qui leur défendoit de boire du vin étoit une loi de climat, II. 47. Ne réussirent pas à faire le tour de l’Afrique, II. 309. Trait d’histoire qui prouve leur zele pour leur commerce, II. 321. Avoient-ils l’usage de la boussole ? II. 321, 322. Borne qu’ils imposerent au commerce des Romains : comment tinrent les Sardes & les Corses dans la dépendance, II. 350, 351.
Carvilius Ruga. Est-il bien vrai qu’il soit le premier qui ait osé à Rome répudier sa femme ? II. 120. & suiv.
Caspienne. Voyez Mer.
Cassitérides. Quelles sont les îles que l’on nommoit ainsi, II. 321.
Cassius. Pourquoi ses enfans ne furent pas punis pour raison de la conspiration de leur pere, I. 411.
Caste. Jalousie des Indiens pour la peur, III. 203.
Castille. Le clergé y a tout envahi, parce que les droits d’indemnité & d’amortissement n’y sont point connus, III. 173.
Catholiques. Pourquoi sont plus attachés à leur religion que les protestans, III. 162, 163.
Catholicisme. Pourquoi haï en Angleterre : quelle sorte de persécution il y essuie, II. 231, 232. Il s’accommode mieux d’une monarchie que d’une république, III. 131, 132. Les pays où il domine peuvent supporter un plus grand nombre de fêtes que les pays protestant, III. 155.
Caton. Prêta sa femme à Hortensius, III. 230.
Caton l’ancien. Contribua de tout son pouvoir pour [IV-378] faire recevoir à Rome les lois voconienne & oppienne : pourquoi, III. 252.
Causes majeures. Ce que c’étoit autrefois parmi nous : elles étoient réservées au roi, III. 350.
Célibat. Comment César & Auguste entreprirent de le détruire à Rome, III. 92. Comment les lois romaines le proscrivirent : le christianisme le rappela, III. 96 & suiv. Comment & quand les lois romaines contre le célibat furent énervées, III. 104 & suiv. L’auteur ne blâme point celui qui a été adopté par la religion, mais celui qu’a formé le libertinage, III. 109. Combien il a fallu de lois pour le faire observer à de certaines gens, quand de conseil qu’il étoit, on en fit un précepte, III. 134. Pourquoi il a été agréable aux peuples à qui il sembloit convenir le moins, III. 170, 171. Il n’est pas mauvais en lui-même : il ne l’est que dans le cas où il seroit trop étendu, III. 171. Dans quel esprit l’auteur a traité cette matiere : A-t-il eu tort de blâmer celui qui a le libertinage pour principe ? & a-t-il en cela rejeté sur la religion des désordres qu’elle déteste ? D. 277 & suiv.
Cens. Comment doit être fixé dans une démocratie pour y conserver l’égalité morale entre les citoyens, I. 92. Quiconque n’y étoit pas inscrit à Rome, étoit au nombre des esclaves ; comment se faisoit-il qu’il y eût des citoyens qui n’y fussent pas inscrits ? III. 255, 256.
Cens. Voyez Census.
Censeurs. Nommoient à Rome les nouveaux sénateurs : utilité de cet usage, I. 27. Quelles sont leurs fonctions dans une démocratie, I. 100. Sagesse de leur établissement à Rome, I. 108. Dans quels gouvernemens ils sont nécessaires, I. 143 & suiv. Leur pouvoir, & utilité de ce pouvoir à Rome, I. 357. Avoient toujours à Rome l’œil sur les mariages, pour les multiplier, III. 91.
Censives. Leur origine ; leur établissement est une des sources des coutumes de France, III. 402, 403.
Censure. Qui l’exerçoit à Lacédémone, I. 99, 100. A Rome, I. 100. Sa force ou sa foiblesse dépendoit à Rome du plus ou du moins de corruption, I. 247, [IV-379] 248. Epoque de son extinction totale, I. 248. Fut détruite à Rome par la corruption des mœurs, III. 92.
Census ou Cens. Ce que c’étoit dans les commencemens de la monarchie françoise, & sur qui se levoit, IV. 35 & suiv. Ce mot est d’un usage si arbitraire dans les lois barbares, que les auteurs des sytêmes particuliers sur l’état ancien de notre monarchie, entr’autres l’abbé Dubos, y ont trouvé tout ce qui favorisoit leurs idées, IV. 36, 37. Ce qu’on appeloit ainsi dans les commencemens de la monarchie, étoit des droits économiques, & non pas fiscaux, IV. 38. Etoit, indépendamment de l’abus qu’on a fait de ce mot, un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres : preuves, ibid. & suiv. Il n’y en avoit point autrefois de général dans la monarchie qui dérivât de la police générale des Romains ; & ce n’est point de ce sens chimérique que dérivent les droits seigneuriaux : preuves, IV. 40 & suiv.
Centeniers. Etoient autrefois des officiers militaires : par qui & pourquoi furent établis, IV. 47, 48. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du comte & du gravion, IV. 56. Leur territoire n’étoit pas le même que celui des fideles, IV. 78.
Cerites (Tables des). Derniere classe du peuple romain, III. 256.
Cérémonies religieuses. Comment multipliées, III. 169.
Centuries. Ce que c’étoit ; à qui elles procuroient toute l’autorité, I. 350 & suiv. 335, 336.
Centumvirs. Quelle étoit leur compétence à Rome, I. 362, 363.
Cerné. Cette côte est au milieu des voyages que fit Hannon sur les côtes occidentales d’Afrique, II. 314.
César. Enchérit sur la rigueur des lois portées par Sylla, I. 182. Comparé à Alexandre, I. 301, 302. Fut souffert, parce que, quoiqu’il eût la puissance d’un roi, il n’en affectoit point le faste, II. 188. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie devinrent monnoie, comme la monnoie même, III. 5. Par quelle loi il multiplia [IV-380] les mariages, III. 92. La loi par laquelle il défendit de garder chez soi plus de soixante sexterces, étoit sage & juste : celle de Law, qui portoit la même défense, étoit injuste & funeste, III. 412, 413. Décrit les mœurs des Germains en quelques pages : ces pages sont des volumes : on y trouve les codes des lois barbares, IV. 3.
Césars. Ne sont point auteurs des lois qu’ils publierent pour favoriser la calomnie, I. 408.
Cession de biens. Ne peut avoir lieu dans les états despotiques ; utile dans les états modérés, I. 129, 130. Avantages qu’elle auroit procurés à Rome, si elle eût établie du temps de la république, I. 130.
Ceylan. Un homme y vit pour dix sous par mois : la polygamie est donc en sa place, II. 100.
Chaindasuinde. Fut un des réformateurs des lois des Wisigoths, III. 268. Proscrivit les lois romaines, III. 284. Veut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 313.
Champagne. Les coutumes de cette province ont été accordées par le roi Thibault, III. 402.
Champions. Chacun en louoit un pour un certain temps, pour combattre dans ses affaires, III. 319, 320. Peines que l’on infligeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonne foi, III. 330.
Change. Répand l’argent par-tout où il a lieu, III. 11. Ce qui le forme. Sa définition : ses variations ; causes de ces variations : comment il attire les richesses d’un état dans un autre : ses différentes positions & ses différens effets, III. 17 & suiv. Est un obstacle aux coups d’autorité que les princes pourroient faire sur le titre de monnoies, III. 41, 42. Comment gêne les états despotiques, III. 42, 43. Voyez Lettres de change.
Charbon de terre. Les pays qui en produisent sont plus peuplés que d’autres, III. 80.
Charges. Doivent-elles être vénales, I. 142, 143.
Charles-Martel. C’est lui qui fit rédiger les lois des Frisons, III. 266. Les nouveaux fiefs qu’il fonda prouvent que le domaine des rois n’étoit pas alors inaliénable, IV. 131, 132. Opprima par politique [IV-381] le clergé, que Pepin son pere avoit protégé par politique, IV. 140. Entreprit de dépouiller le clergé dans les circonstances les plus heureuses : la politique lui attachoit le pape, & l’attachoit au pape, IV. 143, 144. Donna les biens de l’église indifféremment en fiefs & en alleus : pourquoi, IV. 156. Trouva l’état si épuisé qu’il ne put le relever, IV. 175. A-t-il rendu la comté de Toulouse héréditaire ? IV. 194.
Charlemagne. Son empire fut divisé, parce qu’il étoit trop grand pour une monarchie, I. 251. Sa conduite vis-à-vis des Saxons, I. 280. Est le premier qui donna aux Saxons la loi que nous avons, III. 266. Faux capitulaire qu’on lui a attribué, III. 286, 287. Quelle collection de canons il introduisit en France, III. 289. Les regnes malheureux qui suivirent le sien firent perdre jusqu’à l’usage de l’écriture, & oublier les lois romaines, les lois barbares & les capitulaires, auxquelles on substitua les coutumes, III. 292. Rétablit le combat judiciaire, III. 313. Etendit le combat judiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles, III. 314. Comment il veut que les querelles qui pourroient naître entre ses enfans soient vuidées, III. 316. Veut que ceux à qui le duel est permis se servent du bâton : pourquoi, III. 320, 321. Réforme un point de loi salique : pourquoi, III. 324. Compté parmi les plus grands esprits, III. 439. N’avoit d’autres revenus que son domaine, preuves, IV. 34, 35. Accorda aux évêques la grace qu’ils lui demanderent de ne plus mener eux-mêmes leurs vassaux à la guerre : ils se plaignirent quand ils l’eurent obtenue, IV. 48, 49. Les justices seigneuriales existoient dès son temps, IV. 80. Etoit le prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, IV. 137. C’est à lui que les ecclésiastiques sont redevables de l’établissement des dîmes, IV. 149 & suiv. Sagesse & motifs de la division qu’il fit des dîmes ecclésiastiques, IV. 153, 154. Eloge de ce grand prince ; tableau admirable de sa vie, de ses mœurs, de sa sagesse, de sa bonté, de sa grandeur d’ame, de la vaste étendue de ses [IV-382] vues, & de sa sagesse dans l’exécution de ses desseins, IV. 164 & suiv. Par quel esprit de politique il fonda tant de grands évêchés en Allemagne, IV. 167, 168. Après lui, on ne trouve plus de rois dans sa race, IV. 168. La force qu’il avoit mise dans la nation subsista sous Louis le débonnaire, qui perdoit son autorité au-dedans sans que la puissance parût diminuée au dehors, IV. 172. Comment l’empire sortir de sa maison, IV. 201, 202.
Charles II, dit le chauve. Défend aux évêques de s’opposer à ses lois, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu’ils ont de faire des canons, III. 289. Trouva le fisc si pauvre, qu’il donnoit & faisoit tout pour de l’argent : il laissa même échapper pour de l’argent les Normands, qu’il pouvoit détruire, IV. 175, 176. A rendu héréditaire les grands offices, les fiefs & les comtés : combien ce changement affoiblit la monarchie, IV. 194 & suiv. Les fiefs & les grands offices devinrent après lui comme la couronne étoit sous la seconde race, électifs & héréditaires en même temps, IV. 196.
Charles IV, dit le bel. Est auteur d’une ordonnance générale concernant les dépens, III. 372.
Charles VII. Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit les coutumes de France : comment on y procéda, III. 404. Loi de ce prince inutile, parce qu’elle étoit mal rédigée, 430, 431.
Charles IX. Il y avoit sous son regne, vingt millions d’hommes en France, III. 114. Davila s’est trompé dans la raison qu’il donne de la majorité de ce prince à quatorze ans commencés, III. 434.
Charles II, roi d’Angleterre. Bon mot de ce prince, I. 185.
Charles XII, roi de Suede. Son projet de conquête étoit extravagant : causes de sa chute : comparé avec Alexandre, I. 292 & suiv.
Charles-quint. Sa grandeur, sa fortune, II. 347.
Charondas. Ce fut lui qui trouva le premier le moyen de réprimer les faux témoins, I. 381.
Chartres. Celles des premiers rois de la troisieme race, & celles de leurs grands vassaux, sont une des sources de nos coutumes, III. 402.
[IV-383]
Chartres d’affranchissement. Celles que les seigneurs donnerent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, III. 402, 403.
Chasse. Son influence sur les mœurs, I. 80.
Chemins. On ne doit jamais les constuire aux dépens du fonds des particuliers, sans les indemniser, III. 224, 225. Du temps de Baumanoir, on les faisoit aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III. 225, 226.
Chereas. Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Chevalerie. Origine de tout le merveilleux qui se trouve dans les romans qui en parlent, III. 325 & suiv.
Chevaliers Romains. Perdirent la république quand ils quitterent leurs fonctions naturelles, pour devenir juges & financiers en même temps, I. 370 & suiv.
Chicane. Belle description de celle qui est aujourd’hui en usage : elle a forcé d’introduire la condamnation aux dépens, III. 372.
Childebert. Fut déclaré majeur à quinze ans, II. 176, 177. Pourquoi il égorgea ses neveux, II. 178. Comment il fut adopté par Gontran, II. 179, 180. A établi les centeniers : pourquoi, IV. 47, 48. Son fameux décret mal interprété par l’abbé Dubos, IV. 97 & suiv.
Childeric. Pourquoi fut expulsé du trône, II. 174, 175.
Chilperic. Se plaint que les évêques seuls étoient dans la grandeur, tandis que lui roi n’y étoit plus, IV. 138, 139.
Chine.Etablissement qui paroît contraire au principe du gouvernement de cet empire, I. 145. Comment on y punit les assassinats, I. 186. On y punit les peres pour les fautes de leurs enfans : abus dans cet usage, I. 190. Le luxe en doit être banni : est la cause des différentes révolutions de cet empire : détail de ces révolutions, I. 205 & suiv. On y a fermé une mine de pierres précieuses, aussi-tôt qu’elle a été trouvée : pourquoi, 8. 206. L’honneur n’est point le principe du gouvernement de cet empire : preuves, I. 254 & suiv. Fécondité prodigieuse des femmes : elle y cause quelquefois [IV-384] des révolutions : pourquoi, I. 256, 257. Cet empire est gouverné par les lois & par le despotisme en même temps : explication de ce paradoxe, I. 257, 258. Son gouvernement est un modele de conduite pour les conquérans d’un grand état, I. 302, 303. Quel est l’objet de ses lois, I. 310. Tyrannie injuste qui s’y exerce, sous prétexte de crime de lese-majesté, I. 393, 394. L’idée qu’on a du prince y met peu de liberté, I. 428. On n’y ouvre point les ballots de ceux qui ne sont pas marchands, II. 15. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en régie, II. 28. Sagesse de ses lois qui combattent la nature du climat, II. 42. Coutume admirable de cet empire pour encourager l’agriculture, II. 44, 45. Les lois n’y peuvent pas venir à bout de bannir les eunuques des emplois civiles & militaires, II. 95. Pourquoi les mahométans y font tant de progrès, & les chrétiens si peu, II. 98. Ce qu’on y regarde comme un prodige de vertu, II. 106, 107. Les peuples y sont plus ou moins courageux, à mesure qu’ils approchent plus ou moins du midi, II. 125. Cause de la sagesse de ses lois : pourquoi on n’y sent point les horreurs qui accompagnent la trop grande étendue d’un empire, II. 145, 146. Les législateurs y ont confondu la religion, les lois, les mœurs & les manieres : pourquoi, II. 203 & suiv. Les principes qui regardent ces quatre points sont ce qu’on appelle les rites, II. 209 & suiv. Avantage qu’y produit la façon composée d’écrire, II. 206. Pourquoi les conquérans de la Chine sont obligés de prendre ses mœurs ; & pourquoi elle ne peut pas prendre les mœurs des conquérans, II. 207, 208. Il n’est presque pas possible que le christianisme s’y établisse jamais : pourquoi, II. 208, 209. Comment les choses qui paroissent de simples minuties de politesse y tiennent avec la constitution fondamentale du gouvernement, II. 210, 211. Le vil y est défendu ; la friponnerie y est permise : pourquoi, II. 211, 212. Tous les enfans d’un même homme, quoique né de diverses femmes, sont censés n’appartenir qu’à une seule : ainsi point de bâtards, [IV-385] III. 70, 71. Il n’y est point question d’enfans adultérins, III. 71. Causes physiques de la grande population de cet empire, III. 79. C’est le physique du climat qui fait que les peres y vendent leurs filles, & y exposent leurs enfans, III. 83. L’empereur y est le souverain pontife ; mais il doit se conformer aux livres de la religion : il entreprendroit en vain de les abilir, III. 177. Il y eut des dynasties où les freres de l’empereur lui succédoient, à l’exclusion de ses enfans : raisons de cet ordre, III. 201. Il n’y a point d’état plus tranquille, quoiqu’il renferme dans son sein deux peuples dont le cérémonial & la religion sont différens, III. 439. Sont gouvernés par les manieres, II. 189. Leur caractere comparé avec celui des Espagnols : leur infidélité dans le commerce leur a conservé celui du Japon : profits qu’ils tirent du privilege exclusif de ce commerce, II. 195, 196 ; 250, 251.
Chinois. Pourquoi ne changent jamais de manieres, II. 199, 200. Leur religion est favorable à la propagation, III. 107. Conséquences funestes qu’ils tirent de l’immortalité de l’ame établie par la religion de Foë, III. 150.
Chrétiens. Un état composé de vrais chrétiens pourroit fort bien subsister, quoi qu’en dise Bayle, III. 132, 133. Leur systême sur l’immortalité de l’ame, III. 152.
Christianisme. Nous a ramené l’âge de Saturne, II. 72. Pourquoi s’est maintenu en Europe, & a été détruit en Asie, II. 98, 99. A donné son esprit à la jurisprudence, III. 105. Acheva de mettre en crédit dans l’empire le célibat, que la philosophie y avoit déjà introduit, III. 105, 106. N’est pas favorable à la propagation, III. 107. Ses principes bien gravés dans le cœur seroient beaucoup plus d’effet que l’honneur des monarchies, la vertu des républiques, & la crainte des états despotiques, III. 133. Beau tableau de cette religion, III. 139. A dirigé admirablement bien pour la société les dogmes de l’immortalité de l’ame & de la résurrection des corps, III. 151. Il semble, [IV-386] humainement parlant, que le climat lui a prescrit des bornes, III. 160. Il est plein de bon sens dans les lois qui concernent les pratiques de culte : il peut se modifier suivant les climats, ibid. Pourquoi il fut si facilement embrassé par les barbares qui conquirent l’empire romain, III. 166. La fermeté qu’il inspire quand il s’agit de renoncer à la foi, est ce qui l’a rendu odieux au Japon, III. 188. Il changea les réglemens & les lois que les hommes avoient faits pour conserver les mœurs des femmes, III. 207 & suiv. Effets qu’il produisit sur l’esprit féroce des premiers rois de France, IV. 114, 115. Est la perfection de la religion naturelle : il y a donc des choses qu’on peut sans impiété expliquer sur les principes de la religion naturelle, D. 251. Voyez Religion chrétienne.
Christophe Colomb. Voyez Colomb.
Ciceron. Regarde comme une des principales causes de la chute de la république les lois qui rendirent les suffrages secrets, I. 23. Vouloit qu’on abolit l’usage de faire des lois touchant les simples particuliers, I. 414. Quels étoient selon lui les meilleurs sacrifices, III. 175. A adopté les lois d’épargne faites par Platon, sur les funérailles, ibid. Pourquoi regardoit les lois agraires comme funestes, III. 224. Trouve ridicule de vouloir décider des droits des royaumes par les lois qui décident du droit d’une gouttiere, III. 228, 229. Blâme Verrès d’avoir suivi l’esprit plutôt que la lettre de la loi voconienne, III. 254. Croit qu’il est contre l’équité de ne pas rendre un fidéïcommis, III. 256, 257.
Cinqmars (M. de) Prétexte injuste de sa condamnation, I. 395, 396.
Circonstances. Rendent les lois ou justes & sages, ou injustes & funestes, III. 412, 413.
Citation en justice. Ne pouvoit pas se faire à Rome, dans la maison du citoyen ; en France, elle ne peut pas se faire ailleurs : ces deux lois qui sont contraires, partent du même esprit, III. 418.
Citoyen. Revêtu subitement d’une autorité exorbitante devient monarque ou despote, I. 27. Quand il peut sans danger être élevé dans une république [IV-387] a un pouvoir exorbitant, I. 28. Il ne peut y en avoir dans un état despotique, I. 67. Doivent-ils être autorisés à refuser les emplois publics ? I. 138. Comment doivent se conduire dans le cas de la défense naturelle, I. 275. Cas où, de quelque naissance qu’ils soient, ils doivent être jugés par les nobles, I. 327, 328. Cas dans lesquels ils sont libres de fait, & non de droit ; & vice versâ, I. 379, 380. Ce qui attaque le plus leur sureté, I. 380. Ne peuvent vendre leur liberté pour devenir esclaves, II. 63, 64. Sont en droit d’exiger de l’état une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé : moyen que l’état peut employer pour remplir ces obligations, III. 120. Ne satisfont point aux lois en se contentant de ne pas troubler le corps de l’état ; il faut encore qu’ils ne troublent pas quelque citoyen que ce soit, III. 178.
Citoyen Romain. Par quel privilege il étoit à l’abri de la tyrannie des gouverneurs de province, I. 357. Pour l’être, il falloit être inscrit dans le cens : comment se faisoit-il qu’il y en eût qui n’y fussent pas inscrits ? III. 255, 256.
Civilité. Ce que c’est : en quoi elle differe de la politesse : elle est chez les Chinois pratiquée dans tous les états ; à Lacédémone, elle ne l’étoit nulle part ; pourquoi cette différence, II. 204, 205.
Classes. Combien il est important que celles dans lesquelles on distribue le peuple dans les états populaires soient bien faites, I. 20. Il y en avoit six à Rome : distinction entre ceux qui étoient dans la derniere : comment on abusa de cette distinction pour éluder la loi voconienne, III. 255, 256.
Claude empereur. Se fait juge de toutes les affaires, & occasionne par-là quantité de rapines, I. 161. Fut le premier qui accorda à la mere la succession de ses enfans, III. 163.
Clémence. Quel est le gouvernement où elle est le plus nécessaire, I. 190 & suiv. Fut outrée par les empereurs grecs, I. 192.
[IV-388]
Clergé. Sa juridiction est fondée en France sur les lois ; elle est nécessaire dans une monarchie : son pouvoir est dangereux dans une république, I. 33. Son pouvoir arrête le monarque dans la route du despotisme, ibid. Son autorité sous la premiere race, II. 185, 186. Pourquoi les membres de celui d’Angleterre sont plus citoyens qu’ailleurs : pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence : pourquoi on aime mieux lui laisser ses abus, que de souffrir qu’il devienne réformateur, II. 332. Ses privileges exclusifs dépeuplent un état ; & cette dépopulation est très-difficile à réparer, III. 117. La religion lui sert de prétexte pour s’enrichir aux dépens du peuple ; & la misere qui résulte de cette injustice est un motif qui attache le peuple à la religion, III. 165. Comment on est venu a en faire un corps séparé ; comment il a établi ses prérogatives, III. 170, 289. Cas où il seroit dangereux qu’il formât un corps trop étendu, ibid. Bornes que les lois doivent mettre à ses richesses, III. 171 & suiv. Pour l’empêcher d’acquérir, il ne faut pas lui défendre les acquisitions, mais l’en dégoûter : moyens d’y parvenir, III. 172, 173. Son ancien domaine doit être sacré & inviolable ; mais le nouveau doit sortir de ses mains, III. 173. La maxime qui dit qu’il doit contribuer aux charges de l’état est regardée à Rome comme une maxime de maltôte, & contraire à l’écriture, III. 173, 174. Refondit les lois des Wisigoths, & y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III. 267, 268. C’est des lois des Wisigoths qu’il a tiré en Espagne toutes celles de l’inquisition, III. 269, 270. Pourquoi continua de se gouverner par le droit romain sous la premiere race de nos rois, tandis que la loi salique gouvernoit le reste des sujets, III. 277. Par quelles lois ses biens étoient gouvernés sous les deux premieres races, III. 289, 290. Il se soumit aux décrétales, & ne voulut pas se soumettre aux capitulaires : pourquoi, ibid. La roideur avec laquelle il [IV-389] soutint la preuve négative par serment, sans autre raison que parce qu’elle se faisoit dans l’église, preuve qui faisoit commettre mille parjures, fit étendre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se déchaînoit, III. 309 & suiv. C’est peut-être par ménagement pour lui que Charlemagne voulut que le bâton fût la seule arme dont on pût se servir dans les duels, III. 321. Exemple de modération de sa part, III. 391. Moyens par lesquels il s’est enrichi, ibid. Tous les biens du royaume lui ont été donnés plusieurs fois : révolution dans sa fortune ; quelles en sont les causes, IV. 141 & suiv. Repousse les entreprises contre son temporel par des révélations de rois damnés, IV. 143 & suiv. Les troubles qu’il causa pour son temporel furent terminés par les Normands, IV. 149, 180. Assemblé à Francfort pour déterminer le peuple à payer la dîme, raconte comment le diable avoit dévoré les épis de blé lors de la derniere famine, parce qu’on ne l’avoit pas payée, IV. 152. Troubles qu’il causa après la mort de Louis le débonnaire, à l’occasion de son temporel, IV. 176 & suiv. Ne peut réparer sous Charles le chauve les maux qu’il avoit faits sous ses prédecesseurs, IV. 180, 181.
Clermont (Le comte de). Pourquoi faisoit suivre les établissemens de saint Louis son pere dans ses justices, pendant que ses vassaux ne les faisoient pas suivre dans les leurs ? III. 361, 362.
Climat. Forme la différence des caracteres & des passions des hommes : raisons physiques, II. 31 & suiv. Raisons physiques des contradictions singulieres qu’il met dans le caractere des Indiens, II. 38, 39. Les bons législateurs sont ceux qui s’opposent à ses vices, II. 41, 42. Les lois doivent avoir du rapport aux maladies qu’il cause, II. 49 & s. 219 & s. Détails curieux de quelques-uns de ces différens effets, II. 56 & suiv. Rend les femmes nubiles plus tôt ou plus tard : c’est donc de lui que dépend leur esclavage ou leur liberté, I. 96 & suiv. Il y en a où le physique a tant de force, que le moral n’y [IV-390] peut presque rien, II. 106. Jusqu’à quel point ses vices peuvent porter le désordre : exemples, I. 110, 111. Comment il influe sur le caractere des femmes, II. 112, 113. Il influe sur le courage des hommes & sur leur liberté : preuves par faits, II. 124, 125. C’est le climat presque seul, avec la nature, qui gouverne les sauvages, II. 189. Gouverne les hommes concurremment avec la religon, les lois, les mœurs, &c. De là naît l’esprut général d’une nation, ibid. C’est lui qui fait qu’une nation aime à se communiquer ; qu’elle aime par conséquent à changer ; & par la même conséquence, qu’elle se forme le goût, II. 192, 193. Il doit régler les vues du législateur au sujet de la propagation, III. 83, 84. Influe beaucoup sur le nombre & la qualité des divertissemens des peuples : raison physique, III. 155, 156. Semble, humainement parlant, avoir mis des bornes au christianisme & au mahométisme, III. 160. L’auteur ne pouvoit pas en parler autrement qu’il n’a fait, sans courir les risques d’être regardé comme un homme stupide, D. 271 & suiv.
Climats chauds. Les esprits & les tempéramens y sont plus avancés, & plutôt épuises qu’ailleurs : conséquence qui en résulte dans l’ordre législatif, I. 129. On y a moins de besoins, il en coûte moins pour vivre ; on y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes, II. 100.
Clodomir. Pourquoi ses enfans furent égorgés avant leur majorité, II. 178.
Clothaire. Pourquoi égorgea ses neveux, ibid. A établi les centeniers : pourquoi, IV. 47, 48. Pourquoi persécuta Brunehault, IV. 109. C’est sous son regne que les maires du palais devinrent perpétuels & si puissans, IV. 109, 110. Ne peut réparer les maux faits par Brunehaut & Frédégonde, qu’en laissant la possession des fiefs à vie, & en rendant aux ecclésiastiques les privileges qu’on leur avoit ôtés, IV. 111, 112. Comment réforma le gouvernement civil de la France, IV. 113 & suiv. 116, 117. Pourquoi on ne lui donna point de maire du palais, IV. 120. Fausse interprétation que les [IV-391] ecclésiastiques donnent à sa constitution, pour prouver l’ancienneté de leur dîme, IV. 150.
Clovis. Comment il devint si puissant & si cruel, II. 180, 181. Pourquoi lui & ses successeurs furent si cruels contre leur propre maison, ibid. Réunit les deux tribus de Francs, les Saliens & les Ripuaires ; & chacun conserva ses usages, III. 265. Toutes les preuves qu’apporte l’abbé Dubos, pour prouver qu’il n’entra point dans les Gaules en conquérant, sont ridicules, & démenties par l’histoire, IV. 84. A-t-il été fait proconsul, comme le prétend l’abbé Dubos ? IV. 88. La perpétuité des offices de comte, qui n’étoient qu’annuels, commença à s’acheter sous son regne : exemple à ce sujet, de la perfidie d’un fils enver son pere, IV. 106.
Cochon. Une religion qui en défend l’usage ne peut convenir que dans les pays où il est rare, & dont le climat rend le peuple susceptible des maladies de la peau, III. 158.
Code civil. C’est le partage des terres qui le grossit : il est donc fort mince chez les peuples où ce partage n’a point lieu, II. 152, 153.
Code des établissemens de S. Louis. Il fit tomber l’usage d’assembler les pairs dans les justices seigneuriales pour juger, III. 395, 396.
Code de Justinien. Comment il a pris la place du code Théodosien, dans les provinces du droit écrit, III. 296, 297. Temps de la publication de ce code, III. 393. N’est pas fait avec choix, III. 438.
Code des lois barbares. Roule presqu’entiérement sur les troupeaux : pourquoi, III. 10.
Code Théodosien. De quoi est composé, III. 105. Gouverna, avec les lois barbares, les peuples qui habitoient la France sous la premiere race, III. 275, 276. Alaric en fit faire une compilation pour régler les différends qui naissoient entre les Romains de ses états, III. 276. Pourquoi il fut connu en France avant celui de Justinien, III. 393 & suiv.
Cognats. Ce que c’étoit : pourquoi exclus de la succession, III. 243.
Cointe (le pere le). Le raisonnement de cet [IV-392] historien en faveur du pape Zacharie détruiroit l’histoire, s’il étoit adopté, IV. 159, 160.
Colchide. Pourquoi étoit autrefois si riche & si commerçante, & est aujourd’hui si pauvre & si déserte, II. 275, 276.
Colleges. Ce n’est point là que dans les monarchies on reçoit la principale éducation, I. 60.
Colomb (Christophe. Découvre l’Amérique, II. 347. François I. eut-il tort ou raison de le rebuter ? II. 357, 358.
Colonies. Comment l’Angleterre gouverne les siennes, II. 227, 228. Leur utilité, leur objet : en quoi les nôtres different de celles des anciens : comment on doit les tenir dans la dépendance, II. 348 & suiv. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que les Carthaginois tenoient les leurs, sans leur imposer des lois aussi dures, II. 351.
Combat judiciaire. Etoit admis comme une preuve par les lois barbares, excepté la loi salique, III. 299 & suiv. La loi qui l’admettoit comme preuve étoit la suite & le remede de celle qui établissoit les preuves négatives, ibid. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l’exiger de celui qui s’étoit purgé par serment, III. 301. La preuve que nos peres en tiroient dans les affaires criminelles, n’étoit pas si imparfaite qu’on le pense, III. 304 & suiv. Son origine : pourquoi devint une preuve juridique : cette preuve avoit quelques raisons fondées sur l’expérience, III. 305 & suiv. L’entêtement du clergé pour un autre usage aussi pernicieux le fit autoriser, III. 309 & suiv. Comment il fut une suite de la preuve négative, III. 312. Fut porté en Italie par les Lombards, III. 314. Charlemagne, Louis le débonnaire & les Othons, l’étendirent des affaires criminelles, aux affaires civiles, ibid. Sa grande extension est la principale cause qui fit perdre aux lois saliques, aux lois ripuaires, aux lois romaines & aux capitulaires leur autorité, III. 317 & suiv. C’étoit l’unique voie par laquelle nos peres jugeoient toutes les actions civiles & criminelles, les incidens & les interlocutoires, III. 318 & suiv. Avoit lieu dans une demande de douze sous, III. [IV-393] 319. Quelles armes on y employoit, III. 321. Mœurs qui lui étoient relatives, III. 324 & suiv. Etoit fondé sur un corps de jurisprudence, III. 327 & suiv. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, III. 328. Regles juridiques qui s’y observoient, ibid & suiv. Précautions que l’on prenoit pour maintenir l’égalité entre les combattans, III. 329, 330. Il y avoit des gens qui ne pouvoient l’offrir ni le recevoir : on leur donnoit des chamions, III. 330. Détail des cas où il ne pouvoit avoir lieu, III. 331 & suiv. Ne laissoit pas d’avoir de grands avantages, même dans l’ordre civil, III. 333. Les femmes ne pouvoient l’offrir à personne sans nommer leur champion : mais on pouvoit les y appeller sans ces formalités, III. 334. A quel âge on pouvoit y appeller & y être appellé, III. 335. L’accusé pouvoit éluder le témoignage du second témoin de l’enquête, en offrant de se battre contre le premier, 336 & suiv. De celui entre une partie & un des pairs du seigneur, III. 338 & suiv. Quand, comment & contre qui il avoit lieu en cas de défaute de droit, III. 353, 354. Saint Louis est celui qui a commencé à l’abolir, III. 357 & suiv. Epoque du temps où l’on a commencé à s’en passer dans les jugemens, III. 360. Quand il avoit pour cause l’appel de faux jugement, il ne faisoit qu’anéantir le jugement sans décider la question, III. 366, 367. Lorsqu’il étoit en usage, il n’y avoit point de condamnation de dépens, III. 370 & suiv. Répugnoit à l’idée d’une partie publique, III. 373 & suiv. Cette façon de juger demandoit très-peu de suffisance dans ceux qui jugeoient, III. 394, 395.
Comices par tribus. Leur origine : ce que c’étoit à Rome, I. 356.
Commerce. Comment une nation vertueuse le doit faire, pour ne pas se corrompre par la fréquentation des étrangers, I. 74. Les Grecs le regardoient comme indigne du citoyen, I. 78, 79. Vertus qu’il inspire au peuple qui s’y adonne : comment on en peut maintenir l’esprit dans une démocratie, I. 95. Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie, I. 107. Doit être favorisé dans une monarchie, [IV-394] mais interdit aux nobles, I. 112. II. 262 & suiv. Est nécessairement très-borné dans un état despotique, II. 130. Est-il diminué par le trop grand nombre d’habitans dans la capitale ? I. 196. Causes & économie de celui d’Angleterre, II. 226, 227. Adoucit & corrompt les mœurs, II. 238, 239. Est opposé au brigandage ; mais il entretient l’esprit d’intérêt, II. 239. Entretient la paix avec les nations ; mais n’entretient pas l’union entre les particuliers, II. 239, 240. A du rapport avec la constitution du gouvernement, II. 242 & suiv. Il y en a de deux sortes ; celui de luxe & celui d’économie, ibid. Pourquoi Marseille est devenue commerçante ; le commerce est la source de toutes les vertus de cette république, II. 245, 246. Esprit de l’Angleterre sur le commerce, II. 248, 249. Avec quelles nations il est avantageux de le faire, II. 249, 250. On ne doit, sans de grandes raisons, exclure aucune nation de son commerce, II. 250, 251. Il ne faut pas confondre la liberté du commerce avec celle du commerçant : celle du commerçant est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans les états soumis à un pouvoir absolu ; & vice versâ, II. 253, 254. Quel en est l’objet, II. 254, 255. La liberté en est détruite par les douanes, quand elles sont affermées, ibid. Des lois qui emportent la confiscation des marchandises, II. 256. Il est bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui le concernent, II. 257, 258. Des lois qui en établissent la sureté, II. 257 & suiv. Des juges pour le commerce, II. 259, 260. Dans les villes où il est établi, il faut beaucoup de lois & peu de juges, II. 260. Il ne doit point être fait pour le prince, II. 261, 262. Celui des Portugais & des Castillans dans les Indes orientales fut ruiné quand leurs princes s’en emparerent, II. 262. Il est avantageux aux nations qui n’ont besoin de rien, & onéreux à celles qui ont besoin de tout, II. 266 & suiv. Rend utiles les choses superflues ; & les choses utiles nécessaires, II. 269. Considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde, II. 270 & suiv. Pourquoi, malgré les révolutions auxquelles il est sujet, sa [IV-395] nature est irrévocablement fixée dans certains états, comme aux Indes, ibid. Pourquoi celui des Indes ne se fait & ne se fera jamais qu’avec de l’argent, II. ibid. 282. Pourquoi celui qui se fait en Afrique est é sera toujours si avantageux, II. 272. Raisons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord & ceux du midi, II. 273, 274. Différence entre celui des anciens & celui d’aujourd’hui, II. 274 & suiv. Fuit l’oppression, & cherche la liberté ; c’est une des principales causes des différences qu’on trouve entre celui des anciens & le nôtre, II. 275, 276. Sa cause & ses effets, II. 276, 277. Celui des anciens, II. 276 & suiv. Comment & par où il se faisoit autrefois dans les Indes, II. 277 & suiv. Quel étoit autrefois celui de l’Asie : comment & par où il se faisoit ibid. Nature & étendue de celui des Tyriens, II. 280, 281. Combien celui des Tyriens tiroit d’avantages de l’imperfection de la navigation des anciens, ibid. Etendue & durée de celui des Juifs, II. 281, 282. Nature & étendue de celui des Egyptiens, II. 281. — de celui des Phéniciens, II. 282. — de celui des Grecs avant & depuis Alexandre, II. 287 & suiv. Celui d’Athenes fut plus borné qu’il n’auroit dû l’être, II. 288, 289. — de Corinthe, 289, 290. — de la Grece avant Homere, II. 291, 292. Révolutions que lui occasionna la conquête d’Alexandre, II. 292 & suiv. Préjugé singulier qui empêchoit & qui empêche encore les Perses de faire celui des Indes, II. 293, 294. De celui qu’Alexandre avoit projeté d’établir, ibid. De celui des rois Grecs après Alexandre, I. 298 & suiv. Comment & par où on le fit aux Index, après Alexandre, II. 304 & suiv. Celui des Grecs & des Romains aux Indes n’étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II. 308. Celui de Carthage, II. 314 & suiv. La constitution politique, le droit civil, le droit des gens, & l’esprit de la nation, chez les Romains, étoient opposés au commerce, II. 327 & suiv. 331. Celui des Romains avec l’Arabie & les Indes, II. 331 & suiv. Révolutions qu’y causa la mort d’Alexandre, II. 335 & suiv. — intérieur des Romains, [IV-396] II. 337, 338. De celui de l’Europe, après la destruction des Romains en occident, II. 338 & suiv. Loi des Wisigoths contraire au commerce, II. 338. Autre loi du même peuple favorable au commerce, II. 340. Commet se fit jour en Europe, à travers la barbarie, II. 341 & suiv. Sa chute, & les malheurs qui l’accompagnerent dans les temps de barbarie, n’eurent autre source que la philosophie d’Aristote & les rêveries des scholastiques, II. 341 & suiv. Ce qu’il devint depuis l’affoiblissement des Romains en orient, ibid. Les lettres de change l’ont arraché des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, II. 344 & suiv. Comment se fait celui des Indes orientales & occidentales, II. 346 & suiv. Lois fondamentales de celui de l’Europe, II. 349 & suiv. Projets proposés par l’auteur sur celui des Indes, II. 361. Dans quels cas il se fait par échange, III. 1. Dans quelle proportion il se fait, suivant les différentes positions des peuples qui le font ensemble, III. 2, 3. On en devroit bannir les monnoies idéales, III. 8. Croît par une augmentation successive d’argent, & par de nouvelles découvertes de terres & de mers, III. 15, 16. Pourquoi ne peut fleurir en Moscovie, III. 42, 43. Le nombre des fêtes dans les pays qu’il maintient doit être proportionné à ses besoins, III. 155.
Commerce d’économie. Ce que c’est : dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux, II. 342 & suiv. Des peuples qui ont fait ce commercer, II. 245, 246. Doit souvent sa naissance à la violence & à la vexation, II. 246. Il faut quelquefois n’y rien gagner, & même y perdre, pour y gagner beaucoup, II. 346 & suiv. Comment on l’a quelquefois gêné, II. 249, 250. Les banques sont un établissement qui lui est propre, II. 251, 252. On peut, dans les états où il se fait, établir un port franc, II. 253.
Commerce de luxe. Ce que c’est : dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux, II. 242 & suiv. Il ne lui faut point de banques, II. 251, 252. Il ne doit avoir aucun privilege, II. 253.
[IV-397]
Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers ne sont d’aucune utilité au monarque ; sont injustes & funestes à la liberté des sujets, I. 419.
Commode. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III. 438.
Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les différens gouvernemens, I. 221.
Communes. Il n’en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premieres races de nos rois, III. 289.
Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l’église, III. 391.
Compagnies de négocians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie ; pas toujours dans les républiques, II. 252. Leur utilité, leur objet, II. 348 & suiv. Ont avili l’or & l’argent, II. 358.
Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains : c’est dans les usages & les obligations de ces compagnons qu’il faut chercher l’origine du vasselage, IV. 4 & suiv. 44.
Compositions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des lois, III. 292, 293. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différens crimes, suivant la qualité des différentes personnes, III. 372 & suiv. 320, 321. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions & des rangs, III. 277. IV. 61. L’auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, afin de nous conduire par la main à l’origine des justices seigneuriales, IV. 57 & suiv. A qui elles appartenoient : pourquoi on appeloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la personne offensée ou à ses parens, IV. 58 & suiv. Sont réglées par les lois barbares avec une précision & une finesse admirables, IV. 60. En quelles especes on les payoit, IV. 62. L’offensé étoit le maître chez les Germains de recevoir la composition ou de la refuser, & de se [IV-398] réserver sa vengeance : quand on commença à être obligé de la recevoir, IV. 63 & suiv. On en trouve dans le code des lois barbares pour les actions involontaires, IV. 65/
Composition. Celles qu’on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu’on payoit aux hommes libres, IV. 133, 134.
Comte. Etoit supérieur au seigneur, III. 330. Différence entre sa juridiction sous la seconde race, & celle de ses officiers, III. 349. Les jugemens rendus dans sa cour ne ressortissoient point devant les missi dominici, III. 350. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu’il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 351. On étoit autrefois obligé de réprimer l’ardeur qu’ils avoient de juger & de faire juger, III. 351, 352. Leurs fonctions sous les deux premieres races, IV. 34. Comment & avec qui ils alloient à la guerre dans les commencemens de la monarchie, IV. 47, 48 ; 52. Quand menoit les vassaux des leudes à la guerre, IV. 49, 50. Sa juridiction à la guerre, IV. 52. C’étoit un principe fondamental de la monarchie, que le comte réunit sur sa tête & la puissance militaire, & la juridiction civile ; & c’est dans ce double pouvoir que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, IV. 52 & suiv. Pourquoi ne menoit pas à la guerre les vassaux des évêques & des abbés, ni les arrieres-vassaux des leudes, IV. 53. Etymologie de ce mot, ibid. N’avoient pas plus de droit dans leurs terres, que les autres seigneurs dans la leur, IV. 54. Différence entr’eux & les ducs, IV. 54, 55. Quoiqu’ils réunissent sur leur tête les puissances militaires, civile & fiscale, la forme des jugemens les empêchoit d’être despotiques : quelle étoit cette forme, IV. 55 & suiv. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion & du centenier, IV. 55, 56. Commencerent dès le regne de Clovis à se procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui par leur nature n’étoient qu’annuels : exemple de la perfidie d’un fils envers son pere, IV. 106. Ne pouvoit dispenser personne d’aller à la guerre, IV. [IV-399] 191, 192. Quand leurs offices commencerent à devenir héréditaires & attachés à des fiefs, IV. 194 & suiv.
Comtés. Ne furent pas donnés à perpétuité en même temps que les fiefs, IV. 132.
Concubinage. Contribue peu à la propagation : pourquoi, III. 67. Il est plus ou moins flétri, suivant les divers gouvernemens, & suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, III. 71. Les lois romaines ne lui avoient laissé de lieu, que dans le cas d’une très-grande corruption de mœurs, III. 71, 72.
Condamnation de dépens. N’avoit point lieu autrefois en France en cour laie : pourquoi, III. 370 & suiv.
Condamnés. Leurs biens étoient consacrés à Rome : pourquoi, I. 158.
Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les Francs, III. 277.
Confesseurs des rois. Sage conseil qu’ils devroient bien suivre, I. 275.
Confiscations. Fort utiles & justes dans les états despotiques : pernicieuses & injustes dans les états modérés, I. 131, 132. Voyez Juifs.
Confiscation des marchandises. Loi excellente des Anglois sur cette matiere, II. 256.
Confrontation des témoins avec l’accusé. Est une formalité requise par la loi naturelle, III. 194, 195.
Confucius. Sa religion n’admet point l’immortalité de l’ame ; & tire de ce faux principe des conséquences admirables pour la société, III. 150.
Conquérans. Causes de la dureté de leur caractere, I. 168. Leurs droits sur le peuple conquis, I. 276 & suiv. Jugement sur la générosité prétendue de quelques uns, I. 304, 305.
Conquête. Quel en est l’objet, I. 10. Lois que doit suivre un conquérant, I. 276 & suiv. Quand elle est faite, le conquérant n’a plus de droit de tuer : pourquoi, I. 278, 279. Son objet n’est point la servitude, mais la conservation : conséquences de ce principe, I. 279. Avantages qu’elle peut apporter au peuple conquis, I. 281 & suiv. (Droit de). Sa [IV-400] définition, I. 283. Bel usage qu’en firent le roi Gélon & Alexandre, I. 283, 284.
Conquête. Quand & comment les républiques en peuvent faire, I. 284 & suiv. Les peuples conquis par une aristocratie sont dans l’état le plus triste, I. 286. Comment on doit traiter le peuple vaincu, I. 290, 291. Moyens de la conserver, I. 302, 303. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple conquis, I. 303 & suiv.
Conrad empereur. Ordonna le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits enfans ou aux freres, suivant l’ordre de succession : cette loi s’étendit peu à peu pour les successions directes à l’infini, & pour les collatérales au septieme degré, IV. 198 & suiv.
Conseil du prince. Ne peut être dépositaire des lois, I. 35. Ne doit point juger les affaires contentieuses : pourquoi, I. 163.
Conseils. Si ceux de l’évangile étoient des lois, ils seroient contraires à l’esprit des lois évangéliques, III. 133.
Conservation. C’est l’objet général de tous les états, I. 310.
Conspirations. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les lois pour la révélation des conspirations, I. 408 & suiv.
Constance. Belle loi de cet empereur, I. 422.
Constantin. Changement qu’il apporta dans la nature du gouvernement, I. 184. C’est à ses idées sur la perfection que nous sommes redevables de la juridiction ecclésiastique, III. 106. Abrogea presque toutes les lois contre le célibat, III. 106, 107. A quels motifs Zozime attribue sa conversion, III. 139. Il n’imposa qu’aux habitans des villes la nécessité de chommer le dimanche, III. 155. Respect ridicule de ce prince pour les évêques, III. 431, 432.
Constantin Ducas (le faux). Punition singuliere de ses crimes, I. 184.
Constantinople. Il y a des sérails où il ne se trouve pas une seule femme, II. 104.
Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II. 259, 260.
[IV-401]
Consuls romains. Par qui & pourquoi leur autorité fut démembrée, I. 349, 350. Leur autorité & leurs fonctions, 359, 362. Quelle étoit leur compétence dans les jugements, I. 364 & suiv. Avantage de celui qui avoit des enfans sur celui qui n’en avoit point, II. 97.
Contemplation. Il n’est pas bon pour la société que la religion donne aux hommes une vie trop contemplative, III. 138, 139.
Continence. C’est une vertu qui ne doit être pratiquée que par peu de personnes, III. 107.
Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire, I. 208.
Contrainte par corps. Il est bon qu’elle n’ait pas lieu dans les affaires civiles ; il est bon qu’elle ait lieu dans les affaires de commerce, II. 257, 258.
Contumace. Comment étoit punie dans les premiers temps de la monarchie, IV. 134, 135.
Coptes. Les Saxons appelloient ainsi ce que nos peres appelloient comtes, IV. 53.
Corinthe. Son heureuse situation : son commerce : sa richesse : la religion y corrompit les mœurs. Fut le séminaire des courtisanes, II. 289, 290. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II. 323.
Cornéliennes. Voyez Lois cornéliennes.
Corps législatif. Quand, pendant combien de temps, par qui doit être assemblé, prorogé & renvoyé dans un état libre, I. 322 & suiv.
Corruption. De combien il y en a de sortes, I. 174. Combien elle a de sources dans une démocratie : quelles sont ces sources, I. 225 & suiv. Ses effets funestes, I. 240 & suiv.
Cosmes. Magistrats de Crete. Vices dans leur institution, I. 325.
Coucy (le sire de. Ce qu’il pensoit de la force des Anglois, I. 271.
Coups de bâton. Comment punis par les lois barbares, III. 320, 321.
Couronne. Les lois & les usages de différens pays en reglent différemment la succession : & ces usages qui paroissoient injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondés en raison, [IV-402] III. 201 & suiv. Ce n’est pas pour la famille régnante qu’on y a fixé la succession, mais pour l’intérêt de l’état, III. 227, 228. Son droit ne se regle pas comme les droits des particuliers : elle est soumise au droit politique ; les droits des particuliers le sont au droit civil, ibid. On en peut changer l’ordre de succession, si celui qui est établi détruit le corps politique pour lequel il a été établi, III. 236 & suiv. La nation a droit d’en exclure, & d’y faire renoncer, II. 237, 238.
Couronne de France. C’est par la loi salique qu’elle est affectée aux mâles exclusivement, I. 171, 172. Sa figure ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi ? III. 433. Le droit d’aînesse ne s’y est établi que quand il s’est établi dans les fiefs, après qu’ils sont devenus perpétuels, IV. 205 & suiv. Pourquoi les filles en sont exclues, tandis qu’elles ont droit à celles de plusieurs autres royaumes, IV. 209 & suiv.
Cours des princes. Combien ont été corrompues dans tous les temps, I. 48.
Courtisans. Peinture admirable de leur caractere, ibid. En quoi, dans une monarchie, consiste leur politesse : cause de la délicatesse de leur goût, I. 63. Différence essentielle entr’eux & les peuples, I. 425.
Courtisanes. Il n’y a qu’elles qui soient heureuses à Venise, I. 199. Corinthe en étoit le séminaire, II. 290. Leurs enfans sont-ils obligés par le droit naturel de nourrir leurs peres indigens ? III. 198, 199.
Cousins germains. Pourquoi le mariage entr’eux n’est pas permis, III. 218, 219. Etoient autrefois regardés & se regardoient eux-mêmes comme freres, III. 219. Pourquoi & quand le mariage fut permis entr’eux à Rome, ibid. Chez quels peuples leurs mariages doivent être regardés comme incestueux, III. 221, 222.
Coutumes anciennes. Combien il est important pour les mœurs de les conserver, I. 98.
Coutumes de France. L’ignorance de l’écriture sous les regnes qui suivirent celui de Charlemagne, firent oublier les lois barbares, le droit romain & les [IV-403] capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III. 291 & suiv. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provinces voisines de l’Italie, III. 292. Il y en avoit dès la premiere & la seconde race des rois : elles n’étoient point la même chose que les lois des peuples barbares ; preuves : leur véritable origine, III. 293 & suiv. Quand commencerent à faire plier les lois sous leur autorité, III. 295, 296. Ce seroit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire en une générale, III. 378 ; 397. Leur origine ; leurs différentes sources où elles ont été puisées : comment, de particulieres qu’elles étoient pour chaque seigneurie, sont devenues générales pour chaque province : quand & comment ont été rédigées par écrit, & ensuite réformées, III. 401 & suiv. Contiennent beaucoup de dispositions tirées du droit romain, III. 405.
Coutumes de Bretagne. Tirent leur source des assises de Geoffroi, duc de cette provonce, III. 402.— de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibault, ibid. — de Montfort. Tirent leur origine des lois du comte Simon, ibid. — de Normandie. Ont été accordées par le duc Raoul, ibid.
Crainte. Est un des premiers sentimens de l’homme en état de nature, I. 7. A fait rapprocher les hommes, & a formé des sociétés, I. 8. Est le principe du gouvernement despotique, I. 53.
Créanciers. Quand commencerent à être plutôt poursuivis à Rome par leurs débiteurs, qu’ils ne poursuivoient leurs débiteurs, I. 418.
Création. Est soumise à des lois invariables, I. 3. Ce que l’auteur en dit prouve-t-il qu’il est athée ? D. 227 & suiv.
Créature. La soumission qu’elle doit au Créateur dérive d’une loi antérieure aux lois positives, I. 4.
Crédit. Moyens de conserver celui d’un état, ou de lui en procurer un ; s’il n’en a pas, III. 48 & suiv.
Cremutius Cordus injustement condamné, sous prétexte de crime de lese-majesté, I. 404.
Crete. Ses lois ont servi d’original à celles de Lacédémone, I. 71. La sagesse de ses lois la mit en état de résister long-temps aux efforts des Romains, I. 72. [IV-404] Les Lacédémoniens avoient tiré de la Crete leurs usages sur le vol, III. 423, 424.
Crétois. Moyen singulier, dont ils usoient avec succès, pour maintenir le principe de leur gouvernement : leur amour pour la patire, I. 240, 241. Moyen infame qu’ils employoient pour empêcher la trop grande population, III. 86. Leurs lois sur le vol étoient bonnes à Lacédémone, & ne valoient rien à Rome, III. 425.
Crillon. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l’obéissance à un ordre injuste de Henri III, I. 64.
Crimes. Qui sont ceux que les nobles commettent dans une aristocratie, I. 45. Quoique tous publics de leur nature, sont néanmoins distingués, relativement aux différentes especes de gouvernement, I. 47. Combien il y en avoit de sortes à Rome, & par qui y étoient jugés, I. 366. Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crime, I. 382 & s. Combien il y en a de sortes, I. 383 & suiv. Ceux qui ne font que troubler l’exercice de la religion doivent être renvoyés dans la classe de ceux qui sont contre la police, I. 384. Ceux qui choquent la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sureté : comment doivent être punis, I. 387. Peines contre ceux qui attaquent la sureté publique, I. 387, 388. Les paroles doivent-elles être mises au nombre des crimes ? I. 400 & suiv. On doit en les punissant, respecter la pudeur, I. 405, 406. Dans quelles religion on n’en doit point admettre d’inexpiables, III. 139, 140. Tarif des sommes que la loi salique imposoit pour punition, III. 272 & suiv. On s’en purgeoit dans les lois barbares, autres que la loi salique, en jurant qu’on n’étoit pas coupable, & en faisant jurer la même chose à des témoins en nombre proportionné à la grandeur du crime, III. 298. N’étoient punis par les lois barbares que par des peines pécuniaires ; il ne falloit point alors de partie publique, III. 273 & suiv. Les Germains n’en connoissoient que deux capitaux ; la poltronnerie & la trahison, IV. 57, 58.
Crimes cachés. Quels sont ceux qui doivent être poursuivis, I. 384, 385.
[IV-405]
Crimes capitaux. On en faisoit justice chez nos peres par le combat judiciaire, qui ne pouvoit se terminer par la paix, III. 330.
Crimes contre Dieu. C’est à lui seul que la vengeance en doit être réservée, I. 385.
Crimes contre la pureté. Comment doivent être punis, ibid.
Crime contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, & trop sévérement puni : moyens de le prévenir, I. 391, 392. Quelle en est la source parmi nous, I. 391.
Crime de lese-majesté. Par qui & comment doit être jugé dans une république, I. 157. Voyez Lese-Majesté.
Criminels. Pourquoi il est permis de les faire mourir, II. 65. A quels criminels on doit laisser des asiles, III. 167, 168. Les uns sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité, III. 238.
Critique. Préceptes que doivent suivre ceux qui en font profession, & sur-tout le gazetier ecclésiastique, D. 303 & suiv.
Croisades. Apporterent la lepre dans nos climats : comment on l’empêcha de gagner la masse du peuple, II. 49, 50. Servirent de prétextes aux ecclésiastiques pour attirer toutes sortes de matieres & de personnes à leurs tribunaux, III. 389.
Cromwell. Ses succès empêcherent la démocratie de s’établir en Angleterre, I. 40, 41.
Cuivre. Différentes proportions de la valeur du cuivre à celle de l’argent, III. 10 ; 38 & suiv.
Culte. Le soin de rendre un culte à Dieu est bien différent de la magnificence de ce culte, III. 175.
Culte extérieur. Sa magnificence attache à la religion, III. 165. A beaucoup de rapport avec la magnificence de l’état, III. 175.
Culture des terres. N’est pas en raison de la fertilité ; mais en raison de la liberté, II. 142 & suiv. La population est en raison de la culture des terres & des arts, II. 149, 150. Suppose des arts, des connoissances, & la monnoie, II. 154, 155.
Cumes. Fausses précautions que prit Aristodeme pour se conserver la tyrannie de cette ville, I. 291, 292. [IV-406] Combien les lois criminelles y étoient imparfaites, I. 381.
Curies. Ce que c’étoit à Rome : à qui elles donnoient le plus d’autorité, I. 360 & suiv. 355, 356.
Cynete. Les peuples y étoient plus cruels que dans tout le reste de la Grece, parce qu’ils ne cultivoient pas la musique, I. 76.
Cyrus. Fausses précautions qu’il prit pour conserver ses conquêtes, I. 291.
Czar. Voyez Pierre I.
Czarine (la feue) Injustice qu’elle commit, sous prétexte du crime de lese-majesté, I. 401, 402.
D
Dagobert. Pourquoi fut obligé de se défaire de l’Austrasie en faveur de son fils, IV. 121. Ce que c’étoit que sa chaire, IV. 213.
Danois. Conséquences funestes qu’ils tiroient du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 150, 151.
Dantzic. Profit que cette ville tire du commerce de blé qu’elle fait avec la Plogne, II. 251.
Darius. Ses découvertes maritimes ne lui furent d’aucune utilité pour le commerce, II. 293 & suiv.
Davila. Mauvaise raison de cet auteur touchant la majorité de Charles IX, III. 434.
Débiteurs. Comment devroient être traités dans une république, I. 415 & suiv. Epoque de leur affranchissement de la servitude à Rome : révolution qui en pensa résulrer, I. 417, 418.
Décemvirs. Pourquoi établirent des peines capitales contre les auteurs de libelles & contre les poëtes, I. 181. Leur origine, leur mal-adresse & leur injustice dans le gouvernement : causes de leur chute, I. 353 & suiv. Il y a dans la loi des douze tables, plus d’en endroit qui prouve leur dessein de choquer l’esprit de la démocratie, I. 416.
Décimaires. Voyez Lois décimaires.
Déconfés. Ce que c’étoit : étoient punis par la privation de la communions & de la sépulture, III. 391.
Décrétales. On en a beaucoup inséré dans les recueils des canons, III. 289. Comment on en prit les [IV-407] formes judiciaires, plutôt que celles du droit romain, III. 388, 389. Sont, à proprement parler, des rescrits des papes ; & les rescrits sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 437, 438.
Défautes de droit. Ce que c’étoit, III. 349. Quand, comment & contre qui donnoit lieu au combat judiciaire, III. 353, 354. Voyez Appel de défaute de droit.
Défontaines. C’est chez lui qu’il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III. 328. Passage de cet auteur mal entendu jusqu’ici expliqué, III. 364. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 384. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 403, 404.
Déisme. Quoiqu’il soit incompatible avec le spinosisme, le gazetier ecclésiastique ne laisse pas de les cumuler sans cesse sur la tête de l’auteur : preuves qu’il n’est ni déiste, ni athée, D. 222 & suiv.
Délateurs. Comment à Venise ils font parvenir leurs délations, I. 108. Ce qui donna naissance à Rome à ce genre d’hommes funestes, I. 165. Etablissement sage parmi nous à cet égard, I. 165, 166.
Délos. Son commerce : sources de ce commerce : époques de sa grandeur & de sa chute, II. 322 & suiv.
Délicatesse de goût. Source de celle des courtisans, I. 63.
Démétrius de Phalere. Dans le dénombrement qu’il fit des citoyens d’Athenes, en trouve autant dans cette ville esclave, qu’elle en avoit lorsqu’elle défendit la Grece contre les Perses, I. 42, 43.
Démenti. Origine de la maxime qui impose à celui qui en a reçu un, la nécessité de se battre, III. 321.
Démocratie. Quelles sont les lois qui dérivent de sa nature, I. 16 & suiv. Ce que c’est, ibid. Quelles en sont les lois fondamentales, I. 16 ; 18 ; 22 ; 24, 25. Quel est l’état du peuple dans ce gouvernement, I. 16. Le peuple y doit nommer ses magistrats & le sénat, I. 18. D’où dépend sa durée & sa prospérité, I. 20. Les suffrages ne doivent pas s’y donner comme dans l’aristocratie, I. 22. Les suffrages du peuple y doivent être publics ; ceux du [IV-408] sénat secrets : pourquoi cette différence, I. 23, 24. Comment l’aristocratie peut s’y trouver mêlée, I. 26. Quand elle est renfermée dans le corps des nobles, ibid. Quel en est le principe, I. 39 & suiv. Pourquoi n’a pu s’introduire en Angleterre, I. 40, 41. La vertu est singuliérement affectée à ce gouvernement, I. 69. Quels sont les attachemens qui doivent y régner sur le cœur des citoyens, I. 84 & suiv. Comment on y peut établir l’égalité, I. 87 & suiv. Comment on y doit fixer le cens pour conserver l’égalité morale, I. 92, 93. Comment les lois y doivent entretenir la frugalité, I. 94 & suiv. Dans quel cas les fortunes peuvent y être inégales sans inconvénient, I. 94. Moyens de favoriser le principe de ce gouvernement, I. 97 & suiv. Les distributions faites au peuple y sont pernicieuses, I. 105. Le luxe y est pernicieux, I. 196, 197. Causes de la corruption de son principe, I. 225 & suiv. Dans quel sens tout le monde doit y être égal, I. 230, 231. Un état démocratique peut-il faire des conquêtes ? quel usage doit-il faire de celles qu’il a faites ? I. 285. Le gouvernement y est plus dur que dans une monarchie : conséquences de ce principe, I. 286. On croit communément que c’est le gouvernement où le peuple est & le plus libre, I. 308. Ce n’est point un état libre par sa nature, I. 309. Pourquoi on n’y empêche pas les écrits satiriques, I. 404. Il n’y faut point d’esclaves, II. 62. On y change les lois touchant les bâtards, suivant les différentes circonstances, III. 71.
Denier. Révolutions que cette monnoie essuya dans sa valeur, à Rome, III. 36 & suiv.
Deniers publics. Qui, de la puissance exécutrice, ou de la puissance législative, en doit fixer la quotité, & en régler la régie dans un état libre, I. 330 & suiv.
Denys. Injustice de ce tyran, I. 400.
Denys le Petit. Sa collection des canons, III. 289.
Denrées. En peut-on fixer le prix ? II. 12, 13.
Dépens. Il n’y avoit point autrefois de condamnation & de dépens en cour laie, III. 370 & suiv.
Dépopulation. Comment on peut y remédier, III. 117.
[IV-409]
Dépôt des lois. Nécessaire dans une monarchie : à qui doit être confié, I. 34, 35.
Derviches. Pourquoi sont en si grand nombre aux Indes, II. 43.
Descartes. Fut accusé, ainsi que l’auteur de l’esprit des Lois, d’athéisme, contre lequel il avoit fourni les plus fortes armes, D. 314.
Desirs. Regle sure pour en connoître la légitimité, II. 75.
Déserteurs. La peine de mort n’en a point diminué le nombre : ce qu’il y faudroit substituer, I. 172.
Despote. Son état : comment il regne, I. 36. Plus son empire est étendu, moins il s’occupe des affaires, I. 37. En quoi consiste sa principales force : pourquoi ne peut pas souffrir qu’il y ait de l’honneur dans ses états, I. 52. Quel pouvoir il transmet à ses ministres, I. 53. Avec quelle rigueur il doit gouverner, ibid. Pourquoi n’est point obligé de tenir son serment, I. 53, 54. Pourquoi ses ordres ne peuvent jamais être révoqués, I. 56. La religion peut être opposée à ses volontés, ibid. Est moins heureux qu’un monarque, I. 117. Il est des lois, l’état & le prince, I. 120. Son pouvoir passe tout entier à ceux à qui il le confie, I. 132. Ne peut récompenser ses sujets qu’en argent, I. 137. Sa volonté ne doit trouver aucun obstacle, I. 148. Il peut être juge des crimes de ses sujets, I. 159. Peut réunir sur sa tête le pontificat & l’empire : barrieres qui doivent être opposées à son pouvoir spirituel, III. 177.
Despotisme. Le mal qui le limite est un bien, I. 33. Quelles sont les lois qui dérivent de sa nature, I. 36, 37. Pourquoi, dans les états où il regne, la religion a tant de force, I. 35. Comment est exercé par le prince qui en est saisi, ibid. Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, I. 36. Quel en est le principe, 39, 52 & suiv. 118. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, I. 39. État déplorable où il réduit les hommes, I. 51. Horreur qu’inspire ce gouvernement, I. 54. Ne se soutient souvent qu’à force de répandre du sang, ibid. Quelle sorte d’obéissance il exige de la part des [IV-410] sujets, I. 55 & suiv. La volonté du prince y est subordonnée à la religion, I. 56. Quelle doit être l’éducation dans les états où il regne, I. 66, 67. L’autorité du despote & l’obéissance aveugle du sujet supposent de l’ignorance dans l’un & dans l’autre, I. 66. Les sujets d’un état où il regne n’ont aucune vertu qui leur soit propre, I. 67. Comparé avec l’état monarchique, I. 115 & suiv. La magnanimité en est bannie : belle description de ce gouvernement, I. 117, 118. Comment les lois sont relatives à ses principes, I. 118 & suiv. Portrait hideux & fidelle de ce gouvernement, du prince qui le tient en main, & des peuples qui y sont soumis, I. 128. Il regne plus dans les climats chauds qu’ailleurs, I. 129. La cession de biens ne peut y être autorisée, I. 130. L’usage y est comme naturalisée, ibid. La misere arrive de toutes parts dans les états qu’il désole, ibid. Le péculat y est comme naturel, I. 131. L’autorité du moindre magistrat y doit être absolue, I. 134. La vénalité des charges y est impossible, 142. Il n’y faut point de censeurs, I. 145. Cause de la simplicité des lois dans les états où il regne, I. 149 & suiv. Il n’y a point de loi, I. 154. La sévérité des peines y convient mieux qu’ailleurs, I. 166, 167. Outre tout, & ne connoît point de tempérament, I. 177. Désavantage de ce gouvernement, I. 186. La question ou torture peut convenir dans ce gouvernement, I. 188. La loi du talion y est fort en usage, I. 189. La clémence y est moins nécessaire qu’ailleurs, I. 191. Le luxe y est nécessaire, I. 202. Pourquoi les femmes y doivent être esclaves, I. 210 ; II. 107, 108 ; 203. Les dots des femmes y doivent être à peu près nulles, I. 220, 221. La communauté de biens y seroit absurde, I. 221. Les gains nuptiaux des femmes y doivent être très-modiques, ibid. C’est un crime contre le genre humain de vouloir l’introduire en Europe, I. 238. Son principe, même lorsqu’il ne se corrompt pas, est la cause de sa ruine, I. 239. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 253. [IV-411] Comment les états où il regne pourvoient à leur sureté, I. 265, 266. Les places fortes sont pernicieuses dans les états despotiques, I. 267. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple vaincu, I. 303 & suiv. Objet général de ce gouvernement, I. 310. Moyen d’y parvenir, I. 314. Il n’y a point d’écrits satiriques dans les états où il regne : pourquoi, I. 404. Des lois civiles qui peuvent y mettre un peu de liberté, I. 427 & suiv. Tributs que le despote doit lever sur les peuples qu’il a rendus esclaves de la glebe, II. 6, 7. Les tributs y doivent être très-légers : les marchands y doivent avoir une sauve-garde personnelle, II. 13, 14. On n’y peut pas augmenter les tributs, II. 18. Nature des présens que le prince y peut faire à ses sujets ; tributs qu’il peut lever, II. 19. Les marchands n’y peuvent pas faire de grosses avances, II. 20. La régie des impôts y rend les peuples plus heureux que dans les états modérés où ils sont affermés, II. 28. Les traitans y peuvent être honorés ; mais ils ne le voient être nulle par ailleurs, II. 29. C’est le gouvernement où l’esclavage civil est le plus tolérable, II. 61, 62. Pourquoi on y a une grande facilité à se vendre, II. 70. Le grand nombre d’esclaves n’y est point dangereux, II. 79, 80. N’avoit lieu en Amérique que dans les climats situés vers la ligne : pourquoi, II. 125. Pourquoi regne dans l’Asie & dans l’Afrique, II. 126 & suiv. On n’y voit point changer les mœurs & les manieres, II. 198, 199. Peut s’allier très-difficilement avec la religion chrétienne : très-bien avec la mahométane, II. 208, 209, III. 127 & suiv. Il n’est pas permis d’y raisonner bien ou mal, II. 235. Ce n’est que dans ce gouvernement que l’on peut forcer les enfans à n’avoir d’autre profession que celle de leur pere, II. 264. Les choses n’y représentent jamais la monnoie qui en devoit être le signe, III. 4, 5. Comment est gêné par le change, III. 42, 43. La dépopulation qu’il cause est très-difficile à réparer, III. 117. S’il est joint à une religion contemplative, tout est perdu, III. 138, 139. Il est difficile d’établir une nouvelle religion dans un grand empire où il regne, III. 190, [IV-412] Les lois n’y sont rien, ou ne sont qu’une volonté capricieuse & transitoire du souverain : il y faut donc quelque chose de fixe ; & c’est la religion qui est quelque chose de fixe, III. 193. L’inquisition y est destructrice, comme le gouvernement, III. 211. Les malheurs qu’il cause, viennent de ce que tout y est incertain, III. 227.
Dettes. Toutes les demandes qui s’en faisoient à Orléans se vidoient par le combat judiciaire, III. 319. Il suffisoit, du temps de S. Louis, qu’une dette fût de douze deniers, pour que le demandeur & le défendeur pussent terminer leurs différens par le combat judiciaire, ibid. Voyez Débiteurs. Lois. Republiques. Rome. Solon.
Dettes de l’état. Sont payées par quatre classes de gens : quelle est celle qui doit être la moins ménagées, III. 49, 50.
Dettes publiques. Il est pernicieux pour un état d’être chargé de dettes envers les particuliers : inconvénient de ces dettes, III. 45, 46. Moyens de les payer, sans fouler ni l’état, ni les particuliers, III. 48 & suiv.
Deutéronome. Contient une loi qui ne peut pas être admise chez beaucoup de peuples, I. 408, 409.
Dictateurs. Quand ils étoient utiles : leur autorité : comment ils l’exerçoient : sur qui elle s’étendoit : quelle étoit sa durée, I. 28 ; 357. Comparés aux inquisiteurs d’état de Venise, I. 28.
Dictionnaire. On ne doit point chercher celui d’un auteur ailleurs que dans son livre même, D. 317.
Dieu. Ses rapports avec l’univers, I. 2. Motifs de sa conduite, ibid. Les lois humaines doivent le faire honorer, & jamais le venger, I. 385. Les raisons humaines sont toujours subordonnées à sa volonté, II. 98, 99. C’est être également impie que de croire qu’il n’existe pas, qu’il ne se mêle point des choses d’ici-bas, ou qu’il s’appaise par des sacrifices, III. 174, 175. Veut que nous méprisions les richesses : nous ne devons donc pas lui prouver que nous les estimons, en lui offrant nos trésors, III. 175. Ne peut pas avoir pour agréable les dons des impies, III. 176. Ne trouve [IV-413] d’obstacles nulle part où il veut établir la religion chrétienne, D. 275, 276.
Digeste. Epoque de la découverte de cet ouvrage : changement qu’il opéra dans les tribunaux, III. 393 & suiv.
Dignités. Avec quelles précautions doivent être dispensées dans la monarchie, I. 236.
Dimanche. La nécessité de le chômer ne fut d’abord imposée qu’aux habitans des villes, III. 155.
Dîmes ecclésiastiques. Pepin en jeta les fondemens : mais leur établissement ne remonte pas plus haut que Charlemagne, IV. 419 & suiv. A quelle condition le peuple consentit de les payer, IV. 153.
Distinctions. Celles des rangs établies parmi nous sont utiles ; celles qui sont établies aux Indes par la religion sont pernicieuses, III. 154.
Distributions faites au peuple. Autant elles sont pernicieuses dans la démocratie, autant elles sont utiles dans l’aristocratie, I. 105.
Divinité. Voyez Dieu.
Division du peuple en classes. Combien il est important qu’elle soit bien faite dans les états populaires, I. 20.
Divorce. Différence entre le divorce & la répudiation, II. 116. Les lois des Maldives & celles du Mexique font voir l’usage qu’on en doit faire, II. 117, 118. A une grande utilité politique, & peu d’utilité civile, II. 118. Lois & usages de Rome & d’Athenes sur cette matiere, II. 119 & suiv. N’est conforme à la nature que quand les deux parties, ou l’une d’elles, y consentent, III. 196. C’est s’éloigner des principes des lois civiles, que de l’autoriser pour cause de vœux en religion, III. 209, 210.
Dogmes. Ce n’est point leur vérité ou leur fausseté qui les rend utiles ou pernicieux ; c’est l’usage ou l’abus que l’on en fait, III. 149 & suiv. Ce n’est point assez qu’un dogme soit établi par une religion ; il faut qu’elle le dirige, III. 151.
Domaine. Doit être inaliénable : pourquoi, III. 226, 227. Etoit autrefois le seul revenu des rois : preuves, IV. 34, 35. Comment ils le faisoient [IV-414] valoit, ibid. On étoit bien éloigné autrefois de le regarder comme inaliénable, IV. 131, 132. Louis le débonnaire s’est perdu, parce qu’il l’a dissipé, IV. 174, 175.
Domat (M.) Il est vrai que l’auteur a commencé son livre autrement que M. Domat n’a commencé le sien, D. 240.
Domination. Les hommes n’en auroient même pas l’idée, s’ils n’étoient pas en société, I. 8.
Domination (Esprit de). Gâte presque toutes les meilleures actions, III. 392, 393.
Domitien. Ses cruautés soulagerent un peu les peuples, I. 54. Pourquoi fit arracher les vignes dans la Gaules, II. 230, 231.
Donation à cause de noces. Les différens peuples y ont apposé différentes restrictions, suivant leurs différentes mœurs, II. 217, 218.
Dorte (Le vicomte). Refuse par honneur d’obéir à son roi, I. 64.
Dots. Quelles elles doivent être dans les différens gouvernemens, I. 220, 221.
Douaire. Les questions qu’il faisoit naître ne se décidoient point par le combat judiciaire, III. 191, 192. Voyez Gains nuptiaux.
Douanes. Lorsqu’elles sont en fermes, elles détruisent la liberté du commerce & le commerce même, II. 254, 255. Celle de Cadix rend le roi d’Espagne un particulier très-riche dans un état très-pauvre, II. 360.
Droit. Diverses classes détaillées de celui qui gouverne les hommes : c’est dans ce détail qu’il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 191, 192.
Droit canonique. On ne doit pas régler sur ses principes ce qui est réglé par ceux du droit civil, III. 205, 206. Concourut avec le droit civil, à abolir les pairs, III. 396.
Droit civil. Ce que c’est, I. 10. Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, II. 151, 175. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les [IV-415] terres, II. 151, 162. Gouverne les nations & les particuliers, II. 350. Cas où l’on peut juger par ses principes, en modifiant ceux du droit naturel, III. 198, 199. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l’être par ceux du droit canonique, & rarement par les principes des lois de la religion : elles ne doivent point l’être non plus par celles du droit politiques, III. 205 & suiv. 223 & suiv. 226 & suiv. On ne doit pas suivre ses dispositions générales, quand il s’agit de choses soumises à des regles particulieres tirées de leur propre nature, III. 240, 241.
Droit coutumier. Contient plusieurs dispositions tirées du droit romain, III. 405.
Droit de conquête. D’où il dérive : quel en doit être l’esprit, 276 & suiv. Sa définition, I. 284.
Droit de la guerre. D’où il dérive, I. 274 & suiv.
Droit des gens. Quel il est, & quel en est le principe, I. 10. Les nations les plus féroces en ont un, I. 11. Ce que c’est, I. 274. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II. 151, 152. Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit civil, II. 151 ; 175. De celui des Tartares : causes de la cruauté, qui paroît contradictoire avec leur caractere, II. 160, 161. Celui de Carthage étoit singulier, II. 314. Les choses qui lui appartiennent ne doivent pas être décidées par les lois civiles, & par les lois politiques, III. 233 & suiv. La violation de ce droit est aujourd’hui le prétexte le plus ordinaire des guerres, III. 353.
Droit des maries. Ce que c’étoit à Rome, III. 96 & suiv.
Droit écrit. (Pays de) Dès le temps de l’édit de Pistes, ils étoient distingués de la France coutumiere, III. 280, 281. Voyez Pays de droit écrit.
Droit naturel. Il est dans les états despotiques subordonné à la volonté du prince, I. 55, 56. Gouverne les nations & les particuliers, II. 350. Cas où l’on peut modifier ses principes, en jugeant par ceux du droit civil, III. 198, 199.
Droit politique. En qui consiste, I. 11. Il ne faut [IV-416] point régler par ses principes les choses qui dépendent des principes du droit civil, & vice versâ, III, 223 & suiv. 226 & suiv. Soumet tout homme aux tribunaux civils & criminels du pays où il est : exception en faveur des ambassadeurs, III. 234, 235. La violation de ce droit étoit un sujet fréquent de guerres, III. 352, 353.
Droit public. Les auteurs qui en ont traité sont tombés dans de grandes erreurs : cause de ces erreurs, I. 277, 278.
Droit romain. Pourquoi à ses formes judiciaires on substitua celles des décrétales, III. 388, 389. Sa renaissance, & ce qui en résulta : changement qu’il opéra dans les tribunaux, III. 393 & suiv. Comment fur apporté en France : autorité qu’on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. Saint Louis le fit traduire, pour l’accréditer dans ses états : en fit beaucoup usage dans ses établissemens, III. 394. Lorsqu’il commença à être enseigné dans les écoles. Les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. On en a inséré beaucoup de dispositions dans nos coutumes, III. 405. Voyez Lois romaines. Rome. Romains.
Droits honorifiques dans les églises. Leur origine, IV. 157.
Droits seigneuriaux. Ceux qui existoient autrefois, & qui n’existent plus, n’ont point été abolis comme des usurpations ; mais se sont perdus par négligence ou par les circonstances, III. 399. Ne dérivent point par usurpation de ce cens chimérique que l’on prétend venir de la police générale des Romains : preuves, IV. 40 & suiv.
Dubos (M. l’Abbé). Fausseté de son sytême sur l’établissement des Francs dans les Gaules : causes de cette fausseté, III. 274, 275. Son ouvrage sur l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules semble être une conjuration contre la noblesse, IV. 18. Donne aux mots une fausse signification, & imagine des faits pour appuyer son faux systême, IV. 26 & suiv. Abuse des capitulaires, de l’histoire & des lois, pour établir son faux systême, IV. 29, 30. Trouve tout ce qu’il veut dans le mot [IV-417] census, & en tire toutes les conséquences qui lui plaisent, IV. 36, 37. Idée générale de son livre : pourquoi étant mauvais il a séduit beaucoup de gens : pourquoi il est si gros, IV. 83, 84. Tout son livre roule sur un faux sytême : réfutation de ce systême, IV. 84 & suiv. Son systême sur l’origine de notre noblesse françoise est faux & injurieux au sang de nos premieres familles, & aux trois grandes maisons qui ont régné successivement sur nous, IV. 92 & suiv. Fausse interprétation qu’il donne au décret de Childebert, IV. 97 & suiv. Son éloge, & celui de ses autres ouvrages, IV. 104, 105.
Ducs. En quoi différoient des comtes : leurs fonctions, IV. 54, 55. Où on les prenoit chez les Germains : leurs prérogatives, IV. 61, 62. C’étoit en cette qualité, plutôt qu’en qualité de rois, que nos premiers monarques commandoient les armées, IV. 1234.
Ducange (M.). Erreur de cet auteur relevée, IV. 78.
Duels. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa parole à celui qui a promis de se battre, III. 321. Moyen plus simple d’en abolir l’usage que ne font les peines capitales, III. 331. Voyez Combat judiciaire.
E
Eau bouillante. Voyez Preuve par l’eau bouillante. Echange. Dans quel cas on commence par échange, III. 1.
Echevins. Ce que c’étoit autrefois : respect qui étoit dû à leurs décisions, III. 351. Etoient les mêmes personnes que les juges & les rathimburges, sous différens noms, IV. 56.
Ecclésiastiques. La roideur avec laquelle ils soutinrent la preuve négative par serment, par la seule raison qu’elle se faisoit dans les églises, fit étendre la preuve par le combat contre laquelle ils étoient déchaînés, III. 309 & suiv. Leurs entreprises sur la juridiction laye, III. 388, 389. Moyens par lesquels ils se sont enrichis, III. 391. Vendoient aux [IV-418] nouveaux mariés la permission de coucher ensemble les trois premieres nuits de leurs noces. Pourquoi ils s’étoient réservé ces trois nuits plutôt que d’autres, III. 391, 392. Les privileges dont ils jouissoient autrefois sont la cause de la loi qui ordonne de ne prendre des baillis que parmi les laïques, III. 398, 399. Loi qui les fait se battre entr’eux, comme des dogues anglois, jusqu’à la mort, III. 410. Déchiroient dans les commencemens de la monarchie, les rôles des taxes, IV. 25, 26. Levoient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines ; & ces tributs se nommoient census, ou cens, IV. 38. Les maux causés par Brunehaut & par Frédégonde ne purent être réparés qu’en rendant aux ecclésiastiques leurs privileges, IV. 112. Voyez Clergé. Roi de France. Seigneurs.
Ecole de l’honneur. Où elle se trouve dans les monarchies, I. 60.
Ecrits. Quand & dans quels gouvernemens peuvent être mis au nombre des crimes de lese-majesté, I. 403 & suiv.
Ecriture. L’usage s’en conserva en Italie, lorsque la barbarie l’avoit bannie de par-tout ailleurs ; de là vient que les coutumes ne purent prévaloir dans certaines provinces sur le droit romain, III. 292. Quand la barbarie en fit perdre l’usage, on oublia le droit romain, les lois barbares & les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III. 292, 293. Dans les siecles où l’usage en étoit ignoré, on étoit forcé de rendre publiques les procédures criminelles, III. 368 & suiv. C’est le témoin le plus sûr dont on puisse faire usage, 399, 400.
Edifices publics. Ne doivent jamais être élevés sur le fonds des particuliers, sans indemnité, III. 224.
Edile. Qualités qu’il doit avoir, I. 19.
Edit de Pistes. Par qui, en quelle année il fut donné : on y trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s’est conservé dans les provinces qu’il gouverne encore, & a été aboli dans les autres, III. 280, 281.
Education. Les lois de l’éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, I. 59 & suiv. [IV-419] Ce n’est point au college que se donne la principale éducation dans une monarchie, I. 60. Quels en sont les trois principes dans une monarchie, ibid. Sur quoi elle porte dans une monarchie, I. 63. Doit, dans une monarchie, être conforme aux regles de l’honneur, I. 65. Quelle elle doit être dans les états despotiques, I. 66, 67. Différence de ses effets, chez les anciens & parmi nous, I. 68. Nous en recevons trois aujourd’hui : causes des inconséquences qu’elles mettent dans notre conduite, ibid. Quelle elle doit être dans une république, I. 69. Combien il dépend des peres qu’elle soit bonne ou mauvaise, I. 70. Combien les Grecs ont pris de soins pour la diriger du côté de la vertu, I. 70, 71. Comment Aristodeme faisoit élever les jeunes gens de Cumes, afin de leur énerver le courage, I. 291, 292. Les Perses avoient, sur l’éducation, un dogme faux, mais fort utile, III. 132.
Egalité. Doit être l’objet de la principale passion des citoyens d’une démocratie : effets qu’elle y produit, I. 84 & suiv. Comment on en inspire l’amour dans une république, I. 86. Personne n’y aspire dans une monarchie, ni dans les états despotiques, ibid. Comment doit être établie dans une démocratie, I. 87 & suiv. Il y a des lois qui, en cherchant à l’établir, la rendent odieuse, 91, 92. On ne doit pas chercher à l’établir strictement dans une démocratie, I. 92. Dans quel cas peut être ôtée dans la démocratie pour le bien de la démocratie, I. 93. Doit être établie & maintenue dans une aristocratie entre les familles qui gouvernent : moyens d’y réussir, I. 109, 110. Dans quelles bornes doit être maintenue dans une démocratie, I. 225 & suiv. 230. Ce que c’est : cesse entre les hommes, dès qu’ils sont en société, I. 230.
Egalité réelle. Est l’ame de la démocratie très-difficile à établir : comment y suppléer, I. 92, 93.
Egiga. Fit dresser par le clergé le code que nous avons des lois des Wisigoths, III. 268.
Eglise. A quelle superstition est redevable des fiefs qu’elle acquit autrefois, IV. 24. Quand commença à avoir des justices territoriales : comment elle les [IV-420] acquit, IV. 73 & suiv. Comment ses biens furent convertis en fiefs, IV. 138 & suiv.
Eglises. La piété les fonda ; & l’esprit militaire les fit passer entre les mains des gens de guerre, IV. 141. Les laïques s’en étoient emparés, sans que les évêques pussent faire usage des lois qui proscrivoient cet abus : autorité qui étoit restée aux évêques de ce temps-là : source de toutes ces choses, IV. 143 & suiv.
Egypte. Est le principal siege de la peste, II. 51, 52. Est un pays formé par l’industrie des hommes, II. 143. Quand & comment devint le centre de l’univers, II. 300 & suiv. Plan de la navigation de ses rois, II. 307. Par où il seroit avantageux d’en préférer la route à celle du cap de Bonne-Espérance, II. 308. Pourquoi son commerce aux Indes fut moins considérable que celui des Romains, II. 335 & suiv. Son commerce & sa richesse après l’affoiblissement des Romains en orient, II. 340. C’est le seul pays & ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon puisse être bonne : raisons physiques, III. 158, 159.
Egyptiens. Leur pratique sur la lepre a servi de modele aux lois des Juifs touchant cette maladie, II. 49. Nature & étendue de leur commerce, II. 281. Ce qu’ils connoissoient des côtes orientales de l’Afrique, du temps de leurs rois grecs, II. 310. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III. 170. Leur stupide superstition, lorsque Cambyse les attaqua, prouve qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, III. 204. Epousoient leurs sœurs en l’honneur d’Isis, III. 220. Pourquoi le mariage entre le beau-frere & la belle-sœur étoit permis chez eux, III. 222, 223. Le jugement qu’ils porterent de Solon, en sa présence, appliqué à ceux qui rendent modernes les siecles anciens, IV. 37, 38.
Elections. Avantages de celles qui se font par le sort dans les démocraties, I. 22. Comment Solon a corrigé les défectuosités du sort, ibid. Pourquoi les rois ont abandonné pendant quelque temps le [IV-421] droit qu’ils ont d’élire les évêques & les abbés, IV. 155.
Election à la couronne de France. Appartenoit sous la seconde race aux grands du royaume : comment en usoient, IV. 161 & suiv.
Election des Papes. Pourquoi abandonnée par les empereurs au peuple de Rome, IV. 155.
Eléens. Comme prêtres d’Apollon, jouissoient d’une paix éternelle : sagesse de cette constitution religieuses, III. 146.
Elotes. Pourquoi les Athéniens n’augmenterent jamais les tributs qu’ils levoient sur eux, II. 5.
Empereurs romains. Les plus mauvais étoient les plus prodigues en récompenses, I. 138. Maux qu’ils causerent quand ils furent juges eux-mêmes, I. 161. Proportionnerent la rigueur des peines au rang des coupables, I. 183. N’infligerent des peines contre le suicide que quand ils furent devenus aussi avares qu’ils avoient été cruels, III. 417. Leurs rescrits sont une mauvaise sorte de législation, III. 437, 438.
Empire. (l’) A toujours du rapport avec le sacerdoce, III. 105.
Empire d’Allemagne. Pourquoi sortant de la maison de Charlemagne, est devenu électif purement & simplement, IV. 161, 162. Comment en sortit, IV. 201, 202. Est resté électif, parce qu’il a conservé la nature des anciens fiefs, IV. 204.
Empire romain. Les peuples qui le conquirent étoient sortis de la Germanie. C’est dans leurs mœurs qu’il faut chercher les sources des lois féodales, IV. 3, 4.
Emplois militaires. Doit-on forcer un citoyen d’en accepter un inférieur à celui qu’il occupe ? I. 139, 140. Sont-ils compatibles sur la même tête, avec les emplois civils ? I. 140 & suiv.
Emplois publics. Doit-on souffrir que les citoyens les refusent ? I. 138.
Emulation. Est funeste dans un état despotique, I. 67.
Enchantement. Source du préjugé où l’on étoit autrefois qu’il y avoit des gens qui usoient d’enchantement dans les combats, III. 325, 326. Origine de ceux dont il est parlé dans les livres de chevalerie, III. 325 & suiv.
[IV-422]
Enfans. Il n’est bon que dans les états despotiques de les forcer à suivre la profession de leur pere, II. 264. Quand doivent suivre la condition du pere ; quand doivent suivre celle de la mere, III. 58. Comment se reconnoissent dans les pays où il y a plusieurs ordres de femmes légitimes, III. 69. Il n’est point incommode d’en avoir dans un peuple naissant ; il l’est d’en avoir dans un peuple formé, III. 76. Privilege qu’ils donnoient à Rome à ceux qui en avoient un certain nombre, III. 96 & suiv. L’usage des les exposer est-il utile ? lois & usages des Romains sur cette matiere, 110 & suiv. Les Perses avoient, au sujet de l’éducation de leurs enfans, un dogme faux, mais fort utile, III. 152. Il est contre la loi de nature de les forcer à se porter accusateurs contre leur pere & leur mere, III. 197. Dans quel cas le droit naturel leur impose la loi de nourrir leurs peres indigens, III. 198, 199. La loi naturelle les autorise à exiger des alimens de leur pere, mais non pas sa succession : elle leur est due en vertu du droit civil ou politique, III. 200 & suiv. 203. L’ordre politique demande souvent, non pas toujours, que les enfans succedent aux peres, III. 201 & suiv. Pourquoi ne peuvent épouser ni leurs peres, ni leurs meres, III. 216, 217. Habitoient tous, & s’établissoient dans la maison du pere : de là l’origine de la prohibition des mariages entre parens, III. 218 & suiv. Dans l’ancienne Rome, ne succédoient point à leur mere, & vice versâ : motifs de cette loi, III. 243. Pouvoient être vendus à Rome par leur pere : de là la faculté sans bornes de tester, III. 245, 246. S’ils naissant parfait à sept mois, est-ce par la raison des nombres de Pythagore, 433.
Enquête. L’accusé pouvoit arrêter celle qui se préparoit contre lui, en offrant le combat au premier témoin que l’on produisoit, III. 336 & suiv. C’est par la voix des enquêtes que l’on décidoit autrefois toutes sortes de questions, tant de fait que de droit : comment on a suppléé à une voie si peu sure, III. 399, 400/
Enquêtes. (Chambres des) Ne pouvoient autrefois, [IV-423] dans leurs arrêts, employer cette forme, l’appel au néant ; l’appel & ce dont a été appellé au néant : pourquoi, III. 367.
Envoyés du roi. Voyez Missi dominici.
Epaminondas. Est une preuve de la supériorité de l’éducation des anciens sur la nôtre, I. 68. Sa mort entraîna la ruine de la vertu à Athenes, I. 234.
Esphese. Cause des transports du peuple de cette ville, quand il sut qu’il pouvoit appeller la sainte Vierge mere de Dieu, III. 163.
Ephores. Moyen de suppléer à cette magistrature tyrannique, I. 316, 317. Vice dans l’institution de ceux de Lacédémone, I. 324.
Epidammiens. Précautions qu’ils prirent contre la corruption que les barbares auroient pu leur communiquer par la voie du commerce, I. 74.
Epoux. Ne pouvoient à Rome se faire des dons, autrement qu’avant le mariage, II. 217. Ce qu’ils pouvoient se donner par testament, III. 98, 99. Ce qu’ils pouvoient se donner chez les Wisigoths ; & quand pouvoient se donner, II. 217.
Epreuve par le fer. Quand avoit lieu chez les Ripuaires, III. 308.
Equilibre. Ce qui le maintient entre les puissances de l’Europe, II. 23.
Equité. Il y a des rapports d’équité qui sont antérieurs à la loi positive qui les établit : quels ils sont, I. 4.
Erreur. Quelle en est la source la plus féconde, IV. 37, 38.
Erudition. Embarras qu’elle cause à ceux chez qui elle est trop vaste, IV. 29.
Eschines. Pourquoi condamné à l’amende, I. 415.
Esclavage. Pourquoi plus commun dans le midi que dans le nord, II. 38. Les jurisconsultes romains se sont trompés sur l’origine de l’esclavage : preuves de leurs erreurs, II. 62 & suiv. Est contraire au droit naturel & au droit civil, ibid. Peut-il dériver du droit de la guerre ? II. 63. Peut-il venir du mépris étant fondé sur la différence des usages ? Raison admirable des Espagnols, pour tenir les [IV-424] Américains en esclavage, II. 66, 67. Raisons admirables du droit que nous avons de tenir les negres en esclavage, II. 68 & suiv. Sa véritable origine, II. 70. Origine de cet esclavage très-doux que l’on trouve dans quelques pays, II. 70, 71. Est contre la nature ; mais il y a des pays où il est fondé sur une raison naturelle, II. 71, 72. Est inutile parmi nous, II. 72 & suiv. Ceux qui voudroient qu’il pût s’établir parmi nous, sont bien injustes, & ont les vues bien courtes, II. 72 ; 75. Combien il y en a de sortes : le réel & le personnel : leurs définitions, II. 75, 76. Ce que les lois doivent faire par rapport à l’esclavage, II. 77. Ses abus, ibid & suiv. Est une partie des coutumes du peuple esclave, II. 210. Voyez Esclaves. Servitude.
Esclavage civil. Ce que c’est : il est pernicieux au maître & à l’esclave : dans quel pays il est le plus tolérable, II. 61, 62.
Esclavage de la glebe. Quels tributs doivent se payer dans les pays où il a lieu, II. 4 & suiv. Quelle en est ordinairement l’origine, II. 4.
Esclavage domestique. Ce que l’auteur appelle ainsi, II. 96.
Esclaves. Ne doivent point être affranchis pour accuser leurs maîtres, I. 407, 408. Quelle part doivent avoir dans les accusations, ibid. Il est absurde qu’on le soit par naissance, II. 64, 65. Leur grand nombre est plus ou moins dangereux, suivant la nature du gouvernement, II. 79 & suiv. Il est plus ou moins dangereux qu’ils soient armés, suivant la nature du gouvernement, II. 81 & suiv. La douceur des lois qui les concernent, & des maîtres à qui ils appartiennent, est le vrai moyen de les tenir dans le devoir, II. 83 & suiv. Réglemens à faire entre leurs maîtres & eux, II. 87 & suiv. Etoient mis à Rome au niveau des bêtes, II. 89. Il est contre la loi naturelle de les condamner comme parricides, lorsqu’ils tuent un homme libre en se défendant contre lui, III. 194. Hors des sérails, il est absurde que la loi civile leur mette entre les mains le soin de la vengeance publique, domestique & particulière, III. 232, 232. Voyez Esclavage. Servitude.
[IV-425]
Esclaves (Guerre des). Principale cause de cette guerre attribuée aux traitans, I. 372.
Espagne. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I. 33. Moyens étrangers & absurdes qu’elle employa pour conserver sa vaste monarchie, I. 252, 253. Heureuse étendue de ce royaume, I. 268. Sa situation contribua, vers le milieu du regne de Louis XIV, à la grandeur relative de la France, I. 272. Singularité des lois que les Wisigoths y avoient établies : elles provenoient du climat, II. 57, 58. Mauvaise politique de cette monarchie touchant le commerce en temps de guerre, II. 256. Opinion des anciens sur ses richesses : ce qu’il faut en croire : ses mines d’or & d’argent, II. 319, 320. S’est appauvrie par les richesses qu’elle a tirées de l’Amérique, II. 353 & suiv. Absurdité de ses lois sur l’emploi de l’or & de l’argent, II. 359. N’est qu’un accessoire, dont les Indes sont le principal, II. 360. C’est un mauvais tribut pour son roi que celui qu’il tire de la douane de Cadix, ibid. Pourquoi l’intérêt de l’argent y diminua de moitié aussi-tôt après la découverte des Indes, III. 10 & suiv. La liberté sans bornes qu’y ont les enfans de se marier à leur goût, est moins raisonnable qu’elle ne le seroit ailleurs, III. 75. Etoit pleine de petits peuples & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87. Comment le droit romain s’y est perdu, III. 284 & suiv. C’est l’ignorance de l’écriture qui y a fait tomber les lois wisigothes, III. 292. Pourquoi ses lois féodales ne sont pas les mêmes que celles de France, IV. 21.
Espagnols. Biens qu’ils pouvoient faire aux Mexicains : maux qu’ils leur ont fait, I. 282, 283. Raisons admirables pour lesquelles ils ont mis les Américains en esclavage, II. 66, 67. La religion a été le prétexte de tous leurs crimes en Amérique, II. 67. Maux qu’ils font à eux & aux autres, par leur orgueil, II. 193, 194. Leur caractere comparé avec celui des Chinois : leur bonne foi éprouvée dans tous les temps : cette bonne foi, jointe à leur paresse, leur est pernicieuse, II. 195, 196. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur [IV-426] différent avec les Portugais : par qui jugé, II. 347 & suiv. Ne feroient-ils pas mieux de rendre le commerce des Indes libres aux autres nations ? II. 361. Leur tyrannie sur les Indiens s’étend jusques sur les mariages, III. 74. Leurs cruautés déterminoient les femmes de l’Amérique à se procurer l’avortement, III. 76. Ont violé cruellement & stupidement le droit des gens en Amérique, III. 135, 136. Ce n’est pas une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays, que pour le Mexique, III. 156.
Espagnols ou Wisigoths. Motifs de leurs lois au sujet des donations à cause de noces, II. 217, 218.
Espions. Leur portrait : il ne doit point y en avoir dans la monarchie, I. 420, 421.
Esprit des lois. Ce que c’est, I. 13. Comment & dans quel ordre cette matiere est traitée dans cet ouvrage, I. 13, 14. La nature de cet ouvrage n’a pas dû engager l’auteur à travailler pour faire croire la religion chrétienne : mais il a cherché à la faire aimer, D. 221, 222. Est-ce la bille unigenitus qui est la cause occasionnelle de cet ouvrage ? D. 248. Cet ouvrage a été approuvé de toute l’Europe. Quel en est le but ; ce qu’il contient. Pourquoi le gazetier ecclésiastique l’a si fort blâmé, & comment il a raisonné pour le blâmer, D. 254 & suiv.
Esprit général d’une nation. Ce que c’est, II. 189. Combien il faut être attentif à ne le point changer, II. 190, 191.
Esséens. Sont une preuve que les lois d’une religion, quelle qu’elle soit, doivent être conformes à celles de la morale, III. 136 & suiv.
Etablissemens de Philippe-Auguste & ceux de S. Louis sont une des sources des coutumes de France, III. 402.
Etablissemens de S. Louis. Révolutions qu’ils apporterent dans la jurisprudence, III. 357 & suiv. Pourquoi admis dans les tribunaux, & rejetés dans d’autres, III. 361, 362. Sont l’origine de la procédure secrette, III. 369. Comment tomberent dans l’oubli, III. 387 & suiv. Ce qu’il faut penser du code que nous avons sous ce nom, ibid. Ne furent point [IV-427] confirmés en parlement, III. 279. Le code que nous avons sous ce nom est un ouvrage sur les établissemens, & non pas les établissemens même, III. 380, 381. Ce que c’est, comment, par qui a été fait ce code, & d’où il a été tiré, III. 281 & suiv.
Établissement-le-roi. Ce que c’étoit du temps de Saint Louis, III. 361. Ce code est un ouvrage très-précieux ; pourquoi : ses défauts, sa forme, III. 384, 385.
Établissemens de la monarchie françoise. Voy. Dubos.
État. Comment les états se sont formés, & comment subsistent, I. 12. Quelle en doit être la grandeur, pour qu’ils soient dans leur force, I. 267 & suiv. Plus un état est vaste, plus il est facile de le conquérir, I. 268, 269. Vie des états comparée avec celle de hommes : de cette comparaison dérive le droit de la guerre, I. 274 & suiv. Chaque état, outre la conservation, qui est leur objet général, en a un particulier, I. 310, 311. De combien de manieres un état peut changer, 347. Quel est l’instant où il est le plus florissant, I. 348. Sa richesse dépend de celle des particuliers : conduite qu’il doit tenir à cet égard, II. 8, 9. Doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé, III. 120. Un grand, devenu accessoire d’un autre, s’affoiblit, & affoiblit le principal : conséquences de ce principe, au sujet de la succession à la couronne, III. 236, 237.
État civil. Ce que c’est, II. 12.
État modéré. Quelles y doivent être les punitions, I. 167.
État politique. De quoi est formé, I. 11.
États. Étoient fréquemment assemblés sous les deux premieres races : de qui composés, quel en étoit l’objet, III. 288, 289.
États (Pays d’). On ne connoît pas assez en France la bonté de leur gouvernement, II. 17.
Éthiopie. C’est la religion chrétienne qui en a banni le despotisme, III. 128.
Étrangers. Ceux qui arrivoient autrefois en France étoient traités comme des serfs : de ce fait, l’auteur [IV-428] prouve que ce qu’on appelloit census ou cens, ne se levoit que sur les serfs, IV. 39, 40
Etres. On tous leurs lois, I. 1.
Etres intelligens. Pourquoi sujets à l’erreur : pourquoi s’écartent de leurs lois primitives, & de celles qu’ils se prescrivent eux-mêmes, I. 43. III. 219, 220.
Évangile. Est l’unique source où il faut chercher les regles de l’usure, & non pas dans les rêveries des scholastiques, II. 341, 342. Est-il vrai que l’auteur en regarde les préceptes comme de simples conseils ? D. 260 & suiv.
Eucher (Saint). Songe qu’il est ravi dans le paradis, d’où il voit Charles Martel tourmenté dans l’enfer, dès son vivant, parce qu’il entreprit sur le temporel du clergé, IV. 144 & suiv.
Évêchés. Pourquoi les rois en ont abandonné les élections pendant un temps, IV. 153.
Évêques. Comment sont devenus si considérables, & ont acquis tant d’autorité dès le commencement de la monarchie, II. 184. Ont refondu les lois des Wisigoths, desquelles viennent toutes les maximes, tous les principes & toutes les vues de l’inquisition, III. 268 & suiv. Charles le chauve leur défend de s’opposer à ses lois, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu’ils ont de faire des canons, III. 289. Parce qu’ils sont évêques, sont-ils plus croyables que les autres hommes ? III. 431, 432. Ceux d’autrefois avoient la charité de racheter des captifs, IV. 23. Leçons d’économie qu’ils donnent à Louis frere de Charles le chauve, afin qu’il n’incommode point les ecclésiastiques, IV.35. Menoient anciennement leurs vassaux à la guerre : demanderent la dispense de les y mener, & se plaignirent quand ils l’eurent obtenue, IV. 48, 49. Pourquoi leurs vassaux n’étoient pas menés à la guerre par le comte, IV. 53. Furent les principaux auteurs de l’humiliation de Louis le débonnaire, & principalement ceux qu’il avoit tirés de la servitude, IV. 99, 100. Du temps de Chilpéric, leurs richesses les mettoient plus dans la grandeur, que le roi même, IV. 138, 139. Lettre singuliere qu’ils écrivirent à Louis le germanique, IV. 144 & s. [IV-429] Par quel esprit de politique Charlemagne les multiplia & les rendit si puissans en Allemagne, IV. 167, 168. Quand quitterent les habits mondains & cesserent d’aller à la guerre, IV. 173.
Eunuques. Pourquoi on leur confie en orient des magistratures ; pourquoi on y souffre qu’ils se marient : usage qu’ils peuvent faire du mariage, II. 93 & suiv. Il semble qu’ils sont un mal nécessaire en orient, II. 94, 95. Sont chargés en orient du gouvernement intérieur de la maison, II. 115.
Europe. Se gouverne par les mœurs ; d’où il suit que c’est un crime contre le genre humain d’y vouloir introduire le despotisme, I. 238. Pourquoi le gouvernement de la plupart des états qui la composent est modéré, I. 313. Pourquoi les peines fiscales y sont plus séveres qu’en Asie, II. 14, 15. Les monarques n’u publient guere d’édits qui n’affligent avant qu’on les ait vus ; c’est le contraire en Asie, II. 21. La rigueur des tributs que l’on y paye vient de la petitesse des vues des ministres, II. 21, 22. Le grand nombre de troupes qu’elle entretient en temps de paix comme en temps de guerre, ruine les princes & les peuples, II. 23, 24. Le monachisme y est multiplié dans les différens climats, en raison de leur chaleur, II. 43. Sages précautions qu’on y a prises contre la peste, II. 51, 52. Le climat ne permet guere d’y établir la polygamie, II. 98, 99. Il y naît plus de garçons que de filles : la polygamie ne doit donc pas y avoir lieu : c’est aussi ce qui la rend moins peuplée que d’autres pays, II. 100. III. 78. Ses différens climats comparés avec ceux de l’Asie : causes physiques de leurs différences : conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs & pour le gouvernement des différentes nations : raisonnemens de l’auteur confirmés à cet égard par l’histoire : observations historiques curieuses, II. 126 & suiv. Inculte, ne seroit pas si fertile que l’Amérique, II. 149. Pourquoi est plus commerçante aujourd’hui qu’elle ne l’étoit autrefois, II. 274, 275. Le commerce y fut détruit avec l’empire d’occident, II. 338 & suiv. Comment le commerce s’y fit jour à travers la barbarie, II. [IV-430] 341 & suiv. Son état, relativement à la découverte des Indes orientales & occidentales, II. 346 & suiv. Lois fondamentales de son commerce, II. 349 & suiv. Sa puissance & son commerce, depuis la découverte de l’Amérique, II. 352. Quantité prodigieuse d’or qu’elle tire du Bresil, II. 357. Révolutions qu’elle a essuyées, par rapport au nombre de ses habitans, III. 113. Ses progrès dans la navigation n’ont point augmenté sa population, III. 114, 115. Est actuellement dans le cas d’avoir besoin des lois qui favorisent la population, III. 115, 116. Ses mœurs depuis qu’elle est chrétienne comparées avec celles qu’elle avoit auparavant, III. 129, 130. Les peuples du midi de l’Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difficile à observer qu’à ceux du nord, qui l’ont rejeté : raisons de cette bizarrerie, III. 170, 171.
Européens. Raisons pour lesquelles leur religion prend si peu dans certains pays, III. 190.
Euric. C’est lui qui a donné les lois, & fait rédiger les coutumes des Wisigoths, III. 268 ; 276.
Exclusion de la succession à la couronne. Quand peut avoir lieu contre l’héritier présomptif, III. 236, 237.
Excommunications. Les papes en firent usage pour arrêter les progrès du droit romain, III. 394.
Exécutrice. Voyez Puissance exécutrice.
Exemples. Ceux des choses passées gouvernent les hommes, concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189.
Exhérédation. Peut être permise dans une monarchie, I. 112.
F
Fabiens. Il est assez difficile de croire qu’il n’en échappa qu’un enfant, quand ils furent exterminés par les Véiens, III. 90.
Faculté d’empêcher. Ce que c’est en matiere de loi, I. 321.
Faculté de statuer. Ce que c’est, & à qui doit être confiée dans un état libre, ibid.
[IV-431]
Famille. Comment chacune doit être gouvernée, I. 59. La loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup à la propagation, III. 68, 69.
Famille. (Noms de) Leur avantage sur les autres noms, III. 69.
Famille régnante. Ce n’est pas pour elle qu’on a établi l’ordre de succession à la couronne ; c’est pour l’état, III. 227, 228.
Familles particulieres. Comparées au clergé : il résulte de cette comparaison, qu’il est nécessaire de mettre des bornes aux acquisitions du clergé, III. 172.
Famines. Sont fréquentes à la Chine ; pourquoi : y causent des révolutions, I. 256, 257.
Fatalité des matérialistes. Absurde : pourquoi, I. 2. Une religion qui admet ce dogme doit être soutenue par des lois civiles très-séveres & très-sévérement exécutées, III. 141, 142.
Fausser la cour de son seigneur. Ce que c’étoit : saint Louis abolit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines ; & introduisit dans ceux des seigneurs l’usage de fausser sans se battre, III. 307 & suiv.
Fausser le jugement. Ce que c’étoit, III. 340 & suiv.
Faux-monnoyeurs. Sont-ils coupables de lese-majesté ? I. 396.
Fécondité. Plus constante dans les brutes que dans l’espece humaine : pourquoi, III. 65, 66.
Félonie. Pourquoi l’appel étoit autrefois une branche de ce crime, III. 339.
Femmes. Pourquoi Tibere ne voulut pas défendre à celles des gouverneurs d’aller porter leurs déréglemens dans les provinces, I. 202. Leur fécondité à la Chine doit faire bannir le luxe de cet empire, I. 205 & suiv. Combien elles sont dégradées par la perte de leur vertu, I. 208. Leur condition dans les différens gouvernemens, I. 209 & suiv. Pourquoi elles étoient si sages dans la Grece, I. 210, 211. Etoient comptables à Rome de leur conduite, devant un tribunal domestique, I. 211, 212. Etoient à Rome & chez les Germains dans une tutelle perpétuelle : cet usage fut aboli ; pourquoi : étoient [IV-432] affranchies de cette tutelle à Rome en devenant meres, I. 215, 216. III. 98. Peines établies par les empereurs romains contre leurs débauches, I. 216 & suiv. Quelles doivent être leurs dots & leurs gains nuptiaux dans les différens gouvernemens, I. 220, 221. Ne peuvent pas être maîtresses dans la maison ; mais peuvent gouverner un état, I. 223, 224. Le pouvoir qu’on donne en orient aux eunuques de se marier, est une preuve du mépris que l’on y fait des femmes, II. 94. Dans les pays chauds elles sont nubiles dès l’enfance : elles y doivent donc être esclaves, II. 96, 97. Doivent, dans les pays tempérés, être libres : pourquoi, II. 97, 98. Doivent, dans les pays froids, avoir une liberté égale à celle des hommes, II. 98. Leur pluralité dépend beaucoup de leur entretien, II. 99, 100. Pourquoi une seule peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l’Asie, II. 101. Il y a des sérails à Constantinople où il n’y en a pas une. On dit qu’il n’y en a point du tout dans les sérails d’Alger, II. 104. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d’avec les hommes, II. 106. On ne pourroit pas les tenir en servitude dans une république, II. 107. Leur liberté seroit funeste dans les états despotiques, II. 107, 108. Leur clôture dans les pays orientaux est la source de toutes leurs vertus, 108 & suiv. Les devoirs qu’elles ont à remplir sont nombreux : elles ne les remplissent qu’autant qu’on écarte d’elles les amusemens, & ce qu’on appelle des affaires, II. 109 Leur extrême lubricité dans les Indes : causes de ce désordre, II. 110, 111. Il y a des climats où l’on est forcé de les tenir enfermées, quoique la polygamie n’y ait point lieu : leur horrible caractere dans ces climats, II. 112. Eloge galant de celles de nos climats, II. 112, 113. Pourquoi la nature leur a donné plus de pudeur qu’aux hommes, II. 113, 114. Doivent, dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes, II. 116 & suiv. Seroit-il bon de faire des lois en France pour corriger leurs mœurs & borner leur luxe ? II. 190. Gâtent les mœurs, mais [IV-433] forment le goût, II. 193. Leur orgueil ridicule dans les Indes, II. 194, 195. Les mœurs ne changent point dans les pays où elles sont enfermées : c’est le contraire dans ceux où elles vivent avec les hommes, II. 199. Leurs mœurs influent sur le gouvernement : exemple tiré de la Moscovie, II. 202, 203. Pourquoi sont modestes en Angleterre, II. 234. Passent dans la famille du mari : le contraire pouvoit être établi sans inconvénient, III. 58. Les lois & la religion dans certains pays ont établi divers ordres de femmes légitimes, III. 69, 70. Chaque homme dans la Chine n’en a qu’une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfans des concubines de son mari, III. 70, 71. Métellus Numidius les regardoit comme un mal nécessaire, III. 91. C’est un bon moyen pour les réduire, que de les attaquer par la vanité, III. 92. Il est contre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices contre leur mari, III. 197. Est-il juste de les priver de la faculté de pouvoir être instituées héritieres ? III. 200 & suiv. Pourquoi doivent être plus retenues que les hommes, III. 206. Il est injuste, contraire au bien public & à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis long-temps, quand elles n’en ont point de nouvelles, III. 208, 209. On doit pourvoir à leur état civil dans les pays où la polygamie est permise, quand il s’y introduit une religion qui la défend, III. 210, 211. Le respect qu’elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empêchent que les meres puissent épouser leurs fils : leur fécondité prématurée en est une autre, III. 216, 217. La loi civile qui, dans les pays où il n’y a point de sérails, les soumet à l’inquisition de leurs esclaves, est absurde, III. 231, 232. Cas où la loi, chez les premiers Romains, les appelloit à la succession : cas où elle les en excluoit, III. 243, 244. Comment on chercha à Rome à réprimer leur luxe, auquel les premieres lois avoient laissé une porte ouverte, III. 251 & suiv. Pourquoi, & dans quel cas la loi pappienne, contre la disposition de la loi voconienne, les rendit capables [IV-434] d’être légataires, tant de leurs maris que des étrangers, III. 260, 261. On doit, dans une république faire ensorte qu’elles ne puissent se prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l’espérance de leurs richesses ; c’est le contraire dans une monarchie, III. 262, 263. Du temps des lois barbares, on ne les faisoit passer par l’épreuve du feu, que quand elles n’avoient point de champions pour les défendre, III. 307, 308. Sur quoi notre liaison avec elles est fondée, III. 324, 325. Ne pouvoient appeller en combat judiciaire, sans nommer leur champion, & sans être autorisées de leur mari ; mais on pouvoit les appeller sans ces formalités, III. 334. Etoient autrefois soumises à la juridiction ecclésiastique, III. 389.
Femme adultere. Son mari ne pouvoit autrefois la reprendre ; Justinien changea cette loi : il songea plus en cela à la religion qu’à la pureté des mœurs, III. 208.
Fer chaud. Voyez Preuves.
Fermes & revenus du Roi. La régie leur est préférable, elles ruinent le roi, affligent & appauvrissent le peuple, & ne sont utiles qu’aux fermiers, qu’elles enrichissent indécemment, III. 26 & suiv.
Fermiers. Leurs richesses énormes les mettent, en quelque sorte, au-dessus du législateur, II. 27.
Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu’elle favorise, II. 142, 143. Amollit les hommes, II. 144.
Fêtes. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux besoins des hommes, qu’à la grandeur de l’être que l’on honore, III. 154 & suiv.
Féodales. Voyez Lois féodales.
Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire à Rome, III. 99, 100.
Fidéicommis. Pourquoi n’étoient pas permis dans l’ancien droit romain : Auguste fut le premier qui les autorisa, III. 250. Furent introduits d’abord pour éluder la loi voconienne : ce que c’étoit : il y eut des fidéicommissaires qui rendirent la succession ; d’autres la garderent, III. 256, 257. Ne peuvent être faits que par des gens d’un bon naturel : ne peuvent être confiés qu’à d’honnêtes gens ; & il y [IV-435] auroit de la rigueur à regarder ces honnêtes-gens comme de mauvais citoyens, II. 258. Il est dangereux de les confier des gens qui vivent dans un siecle où les mœurs sont corrompues, III. 258, 259.
Fideles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux. Voyez Vassaux.
Fiefs. Il en faut dans une monarchie : doivent avoir les mêmes privileges que les nobles qui les possedent, I. 111. Sont une des sources de la multiplicité de nos lois, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 147, 148. Dans les commencemens, ils n’étoient point héréditaires, II. 170. Ce n’étoit point la même chose que les terres saliques, ibid. & suiv. Leur établissement est postérieur à la loi salique, II. 171. Ce n’est point la loi salique qui en a formé l’établissement ; c’est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II. 179. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, III. 113, 114. C’est peut-être avec raison qu’on a exclu les filles du droit de succéder, III. 201. En les rendant héréditaires, on fut obligé d’introduire plusieurs usages auxquels les lois saliques, ripuaires, &c. n’étoient plus applicables, III. 288. Origine de la regle qui dit : autre chose est le fief, autre chose est la justice, III. 343, 344. Leur origine ; théorie de leurs lois ; & causes des révolutions qu’elles ont essuyées, IV. 1---217. Il n’y en avait point d’autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes & des repas, mais il y avoit des vassaux, IV. 6. Est-il vrai que les Francs les ont établis en rentrant dans la Gaule ? IV. 8, 9. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des fiefs, IV. 11 & suiv.
[IV-436]
Fiefs. Leur origine est la même que celle de la servitude de la glebe : quelle est cette origine, IV. 20 & suiv. Par quelle superstition l’église en a acquis, IV. 24. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des romains, IV. 28, 29. On en accordoit souvent les privileges à des terres possédées par des hommes libres, IV. 33. Differens noms que l’on a donnés à cette espece de bien, dans différens temps, IV. 45. Furent d’abord amovibles : preuves, IV. 45, 46. Le fredum ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi ; d’où il suit que la justice ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, IV. 69 & suiv. Celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, IV. 70 & suiv. Au défaut des contrats originaires de concession, où trouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement attachés aux fiefs ? IV. 81, 82. Ne de donnoient originairement qu’aux antrustions & aux nobles, IV. 102. Quoiqu’amovibles, ne de donnoient & ne s’ôtoient pas par caprice : comment se donnoient : On commença à s’en assurer la possession à vie, par argent, dès avant le regne de la reine Brunehault, IV. 107 & suiv. Etoient héréditaires, dès le temps de la fin de la premiere race, IV. 130 & suiv. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créée par Charles Martel, avec ceux qui existoient avant, IV. 132. Ceux qui les possédoient autrefois s’embarrassoient peu de les dégrader : pourquoi, IV. #26, 137. N’étoient destinés, dans le principe, que pour la récompense des services ; la dévotion en fit un autre usage, IV. 138 & suiv. Comment les biens de l’église furent convertis en fiefs, ibid. Les biens d’église, que Charles Martel donna en fief, étoient-ils à vie ou à perpétuité ? IV. 156. Quand tout le monde devint capable d’en posséder, IV. 181 & suiv. Quand & comment les fiefs se formerent des alleux, IV. 184 & suiv. Quand & comment il s’en forma qui ne relevoient point du roi, IV. 189 & suiv. Quand & dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient dispensés d’aller à la guerre, IV. 191 & suiv. Quand commencerent à devenir absolument héréditaires, IV. 139 & suiv. [IV-437] Quand le partage a commencé d’y avoir lieu, IV. 195, 196. Devinrent, sous la seconde race des rois, comme la couronne, électifs & héréditaires en même temps : qui est-ce qui héritoit ? qui est-ce qui élisoit ? IV. 197 & suiv. Dans quels temps vivoient les auteurs des livres des fiefs, IV. 198, 199. L’empereur Conrad établit le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits-enfans, ou aux freres, suivant l’ordre de succession : cette loi s’étendit peu à peu, pour les successions directes, à l’infini ; & pour les collatérales au septieme degré, IV. 198 & suiv. Pourquoi leur constitution primitive s’est plus long-temps conservée en Allemagne qu’en France, IV. 199, 200. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gouvernement féodal, & fit passer la couronne dans la maison de Hugues Capet, IV. 202 & suiv. C’est de leur perpétuité que sont venus le droit d’aînesse, le rachat, les lods & ventes &c. IV. 205 & suiv. Origine des lois civiles sur cette matiere, IV. 215.
Fiefs de reprise. Ce que nos peres appeloient ainsi, IV. 136.
Filles. Quand commencerent chez les Francs à être regardées comme capables de succéder : effets de ce changement, II. 165, 166. N’étoient pas généralement excluses de la succession des terres, par la loi salique, II. 170. La liberté qu’elles ont en Angleterre, au sujet du mariage, y est plus tolérable qu’ailleurs, III. 74, 75. Sont assez portées au mariage : pourquoi, III. 75, 76. Leur nombre relatif à celui des garçons influe sur la propagation, III. 78, 79. Vendues à la chine par leurs peres, par raison de climat, III. 83. Il est contraire à la loi naturelle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, III. 195. Il est contre la loi naturelle de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, III. 195, 196. C’est peut-être avec raison qu’on les a exclues de la succession aux fiefs, III. 201. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs peres, III. 217, 218. pourquoi pouvoient être prétérites dans le testament du pere ; & les garçons ne le pouvoient pas être, III. 250, 251. Pourquoi ne succedent point à la [IV-438] couronne de France, & succedent à plusieurs autres de l’Europe, IV. 209 & suiv. Celles qui, du temps de Saint Louis, succédoient aux fiefs, ne pouvoient se marier sans le consentement du seigneur, IV. 216.
Fils. Pourquoi ne pouvoient épouser leur mere, III. 216, 217. Pourquoi ne pouvoient pas être prétérits dans le testament de leur pere, tandis que les filles pouvoient l’être, III. 250, 251.
Fils de famille. Pourquoi ne pouvoit pas tester, même avec la permission de son pere, en la puissance de qui il étoit, III. 249.
Finances. Causes de leur désordre dans nos état, II. 21 & suiv. 24. Détruisent le commerce, II. 255.
Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d’imaginer & de comprendre ce que c’est qu’un tel homme, IV. 33.
Firmitas. Ce que c’étoit autrefois en matiere féodale, IV. 212, 213.
Fisc. Comment les lois romaines en avoient arrêté la rapacité, II. 339. Ce mot, dans l’ancien langage, étoit synonyme avec fief, IV. 74, 77.
Fiscaux. Voyez Biens fiscaux.
Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, I. 157. Quel commerce elle faisoit, II. 242.
Florins. Monnoie de Hollande : l’auteur explique, par cette monnoie, ce que c’est que le change, III. 19.
Foé. Son systême : ses lois en se prêtant à la nature du climat, ont causé mille maux dans les Indes, II. 42. Sa doctrine engage trop dans la vie contemplative, III. 138. Conséquences funestes que les Chinois prêtent au dogme de l’immortalité de l’ame établi par ce législateur, III. 150.
Foi & hommage. Origine de ce droit féodal, IV. 211 & suiv.
Foi punique. La victoire seule a décidé si l’on devoit dire la foi punique ou la foi romaine, II. 317.
Foiblesse. Est le premier sentiment de l’homme dans l’état de nature, I. 7. On doit bien se garder de profiter de celle d’un état voisin pour l’écraser, I. 273. Etoit à Lacédémone le plus grand des crimes, III. 416.
[IV-439]
Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d’une maniere fort sage, III. 334.
Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés, II. 266. C’est une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays étrangers, III. 44.
Fontenay (Bataille de). Causa la ruine de la monarchie, IV. 185 ; 192.
Force défensive des états, relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être, I. 267 & suiv.
Force défensive d’un état. Cas où elle est inférieure à la force offensive, I. 271, 272.
Force des états. Est relative, I. 272.
Force générale d’un état. En quelles mains peut être placée, I. 11.
Force offensive. Par qui doit être réglée, I. 274.
Forces particulieres des hommes. Comment peuvent se réunir, I. 12.
Formalités de justice. Sont nécessaires dans les monarchies & dans les républiques ; pernicieuses dans le despotisme, I. 151 & suiv. Fournissoient aux Romains, qui y étoient fort attachés, des prétextes pour éluder les lois, III. 254 & suiv. sont pernicieuses, quand il y en a trop, III. 407, 408.
Formose. Dans cette île c’est le mari qui entre dans la famille de la femme, III. 68. C’est le physique du climat qui y a établi le précepte de religion qui défend aux femmes d’être meres avant trente-cinq ans, III. 84. La débauche y est autorisée, parce que la religion y fait regarder ce qui est nécessaire comme indifférent, & comme nécessaire ce qui est indifférent, III. 143. Les mariages entre parens, au quatrieme degré, y sont prohibés : cette loi n’est point prise ailleurs que dans la nature, III. 219.
Fortune. L’honneur prescrit, dans une monarchie, d’en faire plus de cas que de la vie, I. 65.
France. Les peines n’y sont pas assez proportionnées aux crimes, I. 185. Y doit-on souffrir le luxe ? I. 205. Heureuse étendue de ce royaume : heureuse situation de sa capitale, II. 268. Fut, vers le milieu du regne de Louis XIV, au plus haut point de sa [IV-440] grandeur relative, I. 272. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites sous les premiers rois, I. 381. Combien il y faut de voix pour condamner un accusé, I. 383. On y leve mal les impôts sur les boissons, II. 10. On n’y connoît pas assez la bonté du gouvernement des pays d’états, II. 17. Il ne seroit pas avantageux à ce royaume que la noblesse y pût faire le commerce, II. 263 & suiv. A quoi elle doit la constance de sa grandeur, ibid. Quelle y est la fortune & la récompense des magistrats, ibid. C’est elle qui, avec l’Angleterre & la Hollande, fait tout le commerce de l’Europe, II. 353. Les filles ne peuvent pas y avoir tant de liberté sur les mariages qu’elles ont en Angleterre, III. 74. Nombre de ses habitans sous Charles IX, III. 114. Sa constitution actuelle n’est pas favorable à la population, ibid. Comment la religion du temps de nos peres y adoucissait les fureurs de la guerre, III. 147. Doit sa prospérité à l’exercice des droits d’amortissement & d’indemnité, III. 173. Par quelles lois fut gouvernée pendant la premiere race de ses rois, III. 275, 276. Etoit, dès le temps de l’édit de Pistes, distinguée en France coutumiere, & en pays de droit écrit, III. 280, 281. Les fiefs, devenus héréditaires, s’y multiplierent tellement, qu’elle fut gouvernée plutôt par la dépendance féodale, que par la dépendance politique, III. 288. Etoit autrefois distinguée en pays de l’obéissance-le-roi, & en pays hors l’obéissance-le-roi, III. 361, 362. Comment le droit romain y fut apporté : autorité qu’on lui donna, III. 393 & suiv. On y rendoit autrefois la justice de deux différentes manieres, III. 394, 395. Presque tout le petit peuple y étoit autrefois serf. L’affranchissement de ces serfs est une des sources de nos coutumes, III. 402, 403. On y admet la plupart des lois romaines sur les substitutions, quoique les substitutions eussent chez les Romains tout un autre motif que celui qui les a introduites en France, III. 414, 415. La peine contre les faux témoins y est capitale : elle ne l’est point en Angleterre. Motifs de ces deux lois, III. 419, 420. On y punit le receleur de la [IV-441] même peine que le voleur ; cela est injuste, quoique cela fût juste dans la Grece & à Rome, III. 421, 422. Causes des révolutions dans les richesses de ses rois de la premiere race, IV. 8. L’usage où étoient ses rois de partager leur royaume entre leurs enfans, est une des sources de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 21. Comment la nation reforma elle-même le gouvernement civil sous Clotaire, IV. 113 & suiv. Pourquoi fut dévastée par les Normands & les Sarrasins, plutôt que l’Allemagne, IV. 200, 201. Pourquoi les filles n’y succedent à plusieurs autres couronnes de l’Europe, IV. 29 & suiv.
Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie, I. 61, 62.
François. Pourquoi ont toujours été chassées de l’Italie, I. 290, 291. Leur portrait : leurs manieres ne doivent point être gênées par des lois : on gêneroit leurs vertus, I. 270, 271 ; II. 190 & suiv. Seroit-il bon de leur donner un esprit de pédanterie ? II. 191. Mauvaise loi maritime des François, III. 240. Origine & révolutions de leurs lois civiles, III. 265 ; 406. Comment les lois saliques, ripuaires, bourguignonnes & wisigothes cesserent d’être en usage chez les François, III. 297 & suiv. Férocité, tant des rois que des peuples de la premiere race, IV. 113 & suiv.
François I. C’est par une sage imprudence qu’il refusa la conquête de l’Amérique, II. 358.
Francs. Leur origine : usage & propriétés des terres chez eux avant qu’ils fussent sortis de la Germanie, I. 162 & suiv. 169. Quels étoient leurs biens & l’ordre de leurs successions lorsqu’ils vivoient dans la Germanie : changemens qui s’introduisirent dans leurs usages, lorsqu’ils eurent fait la conquête des Gaules ; causes de ces changemens, II. 164 & suiv. En vertu de la loi salique, tous les enfans mâles succédoient chez eux à la couronne par portions égales, II. 172.? Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II. 173. Pourquoi leurs rois avoient plusieurs femmes, tandis que les sujets n’en avoient qu’une, II. 173, 174. Majorité de leurs [IV-442] rois : elle a varié : pourquoi, II. 175 & suiv. Raisons de l’esprit sanguinaire de leurs rois, II. 180, 181. Assemblées de leur nation, II. 182, 183. N’avoient point de rois dans la Germanie avant la conquête des Gaules, ibid. Avant & après la conquête des Gaules, ils laissoient aux principaux d’entr’eux le droit de délibérer sur les petites choses, & réservoient à toute la nation la délibération des choses importantes, ibid. N’ont pas pu faire rédiger la loi salique, avant que d’être sortis de la Germanie leur pays, III. 265. Il y en avoit deux tribus ; celle des Ripuaires, & celle des Saliens : réunies sous Clovis, elles conserverent chacune leurs usage, ibid. Reconquirent la Germanie, après en être sortis, III. 266. Prérogatives que la loi salique leur donnoit sur les Romains : tarif de cette différence, III. 272 & suiv. Comment le droit romain se perdit dans le pays de leur domaine, & se conserva chez les Goths, les Bourguignons & les Wisigoths, III. 275 & suiv. La preuve par le combat étoit en usage chez eux, III. 309. Est-il vrai qu’ils aient occupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des fiefs ? IV. 8, 9. Occuperent dans les Gaules les pays dont les Wisigoths & les Bourguignons ne s’étoient pas emparés : ils y porterent les mœurs des Germains ; de là les fiefs dans ces contrées, IV. 10. Ne payoient point de tributs dans les commencemens de la monarchie : les seuls Romains en payoient pour les terres qu’ils possédoient : traits d’histoire & passages qui le prouvent, IV. 25 & suiv. Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la monarchie françoise, IV. 30 & suiv. Toutes les preuves qu’emploie M. l’Abbé Dubos, pour établir que les Francs n’entrerent point dans les Gaules en conquérans, mais qu’ils y furent appellés par les peuples, sont ridicules, & démenties par l’histoire, IV. 84 & suiv.
Francs-aleux. Leur origine, IV. 47.
Francs-ripuaires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, II. 168, 169. Viennent de la Germanie, II. 169. En quoi leur loi & celles des autres peuples [IV-443] barbares différoient de la loi salique, III. 297 & suiv.
Fraude. Est occasionnées par les droits excessifs sur les marchandises : est pernicieuse à l’état : est la source d’injustices criantes, & est utile aux traitans, II. 11, 12. Comment punie chez le Mogol & au Japon, II. 15.
Frédégonde. Pourquoi elle mourut dans son lit, tandis que Brunehault mourut dans les supplices, IV. 108. Comparée à Brunehault, IV. 113, 114.
Fred. Ce que signifie ce mot en langue Suédoise, IV. 66. Voyez Fredum.
Freda. Quand on commença à les régler plus par la coutume que par le texte des lois, III. 192, 193.
Fredum. Comment ce mot, qui se trouve dans les lois barbares, a été forgé, IV. 36. Ce que c’étoit : ce droit est la vraie cause de l’établissement des justices seigneuriales : cas où il étoit exigé : par qui il l’étoit, IV. 66 & suiv. Sa grandeur se proportionnoit à celle de la protection que recevoit celui que le payoit, IV. 69. Nom que l’on donna à ce droit sous la seconde race, ibid. Ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi : de-là la justice ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, ibid & suiv.
Freres. Pourquoi il ne leur est pas permis d’épouser leurs sœurs, III. 218. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés : pourquoi, III. 220.
Frisons. Quand, & par qui leurs lois furent rédigées, III. 266. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III. 266, 267. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Tarif de leurs compositions, III. 320.
Frugalité. Dans une démocratie où il n’y a plus de vertu, c’est la frugalité, & non le désir d’avoir, qui passe pour avarice, I. 42. Doit être générale dans une démocratie : effets admirables qu’elle y produit, I. 84. Ne doit, dans une démocratie, régner que dans les familles, & non dans l’état, I. 85. Comment on en inspire l’amour, I. 86. Ne peut pas régner dans une monarchie, I. 86, 87. Combien est nécessaire dans une démocratie : comment les lois doivent l’y entretenir, I. 94 & suiv.
[IV-444]
Funérailles. Platon a fait des lois d’épargne sur les funérailles : Cicéron les a adoptées, III. 175. La religion ne doit pas encourager les dépenses funéraires, III. 176.
G
Gabelles. Celles qui sont établies en France sont injustes & funestes, II. 11, 12.
Gages de batailles. Quand ils étoient reçus, on ne pouvoit faire la paix sans le consentement du seigneur, III. 330.
Gains nuptiaux. Quels doivent être ceux des femmes, dans les différens gouvernemens, I. 221.
Galanterie. Dans quel sens est permise dans une monarchie, I. 61. Suites fâcheuses qu’elle entraîne, I. 209. D’où elle tire sa source ; ce que ce n’est point : ce que c’est, comment s’est accrue, III. 324, 325. Origine de celle de nos chevaliers errans, III. 325 & suiv. Pourquoi celle de nos chevaliers ne s’est point introduite à Rome ni dans la Grece, III. 327. Tira une grande importance des tournois, III. 326, 327.
Gange. C’est une doctrine pernicieuse, que celle des Indiens qui croient que les eaux de ce fleuve sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, III. 143, 144.
Gantois. Punis pour avoir mal-à-propos appellé de défaute de droit le comte de Flandres, III. 356.
Garçons. Sont moins portés pour le mariage que les filles : pourquoi, III. 75, 76. Leur nombre, relatif à celui des filles, influe beaucoup sur la propagation, III. 78, 79.
Garde-noble. Son origine, IV. 211. Voyez Baillie.
Gardiens des mœurs à Athenes, I. 99.
Gardiens des lois, ibid.
Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien, & replantées par Juilien, II. 330, 331. Etoient pleines de petits peuples, & regorgeoient d’habitans avant les Romains, III. 87. Ont été conquises par des peuples de la Germanie, desquels les François tirent leur origine, IV. 3 ; 10.
Gaule méridionale. Les lois romaines y subsisterent toujours, quoique proscrites par les Wisigoths, III. 284, 285.
[IV-445]
Gaulois. Le commerce corrompit leurs mœurs, II. 239. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, IV. 30 & suiv. Ceux qui sous la domination Françoise étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, IV. 47.
Gazetier ecclésiastique. Voyez Nouvelliste ecclésiastique.
Gengis-Kan. S’il eût été chrétien, il n’eût pas été si cruel, III. 129. Pourquoi, approuvant tous les dogmes mahométans, il méprisa si fort les mosquées, III. 166. Fait fouler l’alcoran aux pieds de ses chevaux, ibid. Trouvoit le voyage de la Mecque absurde, ibid.
Gelon. Beau traité de paix qu’il fit avec les Carthaginois, I. 283.
Genes. Comment le peuple a part au gouvernement de cette république, I. 26, 27. Edit par lequel cette république corrige ce qu’il y avoit de vicieux dans son droit politique & civil à l’égard de l’île Corse, I. 287. Belle loi de cette république touchant le commerce, II. 258.
Gentilshommes. La destruction des hôpitaux en Angleterre les a tirés de la paresse où ils vivoient, III. 121. Comment se battoient en combat judiciaire, III. 322. Comment contre un villain, III. 329. Vuidoient leurs différens par la guerre ; & leurs guerres se terminoient souvent pas un combat judiciaire, III. 333.
Geoffroi, duc de Bretagne. Son assise est la source de la coutume de cette province, III. 402.
Germains. C’est d’eux que les Francs tirent leur origine, I. 188. Ne connoissoient guere d’autres peines que les pécuniaires, ibid. Les femmes étoient chez eux dans une perpétuelle tutelle, I. 216. Simplicité singuliere de leurs lois en matiere d’insultes faites tant aux hommes qu’aux femmes : cette simplicité provenoit du climat, II. 56. Ceux qui ont changé de climat, ont changé de lois & de mœurs, II. 57. Quelle sorte d’esclaves ils avoient, II. 75, 76. Loi civile de ces peuples, qui est la source de ce que nous appellons loi salique, II. 162 & suiv. Ce que c’étoit chez eux, que la maison & la terre de la maison, II. 163, 164. Quel étoit [IV-446] leur patrimoine, & pourquoi il n’appartenoit qu’aux mâles, ibid. Ordre bizarre dans leurs successions : raisons & source de cette bizarrerie, I. 166 & suiv. Gradation bizarre qu’ils mettoient dans leur attachement pour leurs parens, ibid. Comment punissoient l’homicide, II. 168. Etoient le seul peuple barbare qui n’eût qu’une femme : les grands en avoient plusieurs, II. 173, 174. Austérité de leurs mœurs, II. 174, 175. Ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés, II. 175. A quel âge eux & leurs rois étoient majeurs, ibid. & suiv. On ne parvenoit chez eux à la royaute, qu’après la majorité : inconvéniens qui firent changer cet usage ; & de ce changement naquit la différence entre la tutelle & la baillie ou garde, II. 178, 179. L’adoption se faisoit chez eux par les armes, II. 179, 180. Etoient fort libres ; pourquoi, II. 182. Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupportable, II. 186. Combien ils étoient hospitaliers, II. 240, 241. Comment punissoient les crimes. La monnoie chez eux devenoit bétail, marchandise ou denrée ; & ces choses devenoient monnoie, III. 6. N’exposoient point leurs enfans, III. 111. Leurs inimitiés, quoiqu’héréditaires, n’étoient pas éternelles : les prêtres avoient vraisemblablement beaucoup de part aux réconciliations, III. 147, 148. Différens caracteres de leurs lois, III. 265 & suiv. Etoient divisés en plusieurs nation qui n’avoient qu’un même territoire ; & chacune de ces nations, quoique confondues, avoit ses lois, III. 271. Avoient l’esprit des lois personnelles avant leurs conquêtes, & le conserverent après, ibid. Quand rédigerent leurs usages par écrit pour en faire des codes, III. 291, 292. Esquisse de leurs mœurs : c’est dans ces mœurs que l’on trouve les raisons de ces preuves que nos peres employoient par le fer ardent, l’eau bouillante & le combat singulier, III. 304 & suiv. La façon dont ils terminoient leurs guerres intestines est l’origine du combat judiciaire, III. 305. Leurs maximes sur les outrages, III. 322, 323. C’étoit chez eux une grande infamie d’avoir abandonné [IV-447] son bouclier dans le combat, III. 323, 324. C’est d’eux que sont sortis les peuples qui conquirent l’empire romain : c’est dans leurs mœurs qu’il faut chercher les sources des lois féodales, IV. 3, 4. C’est dans leur façon de se nourrir, dans la variation de leurs possessions, & dans l’usage où étoient les princes de se faire suivre par une troupe de gens attachés à eux, qu’il faut chercher l’origine du vasselage, IV. 4 & suiv. Il y avoit chez eux des vassaux, mais il n’y avoit point de fiefs : ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes & des repas, IV. 6. Leur vie étoit presque toute pastorale ; c’est de là que presque toutes les lois barbares roulent sur les troupeaux, IV. 10. Il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît les lois & les mœurs des Germains ; & pour nous conduire à l’origine des justices seigneuriales, l’auteur entre dans le détail de la nature des compositions qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, IV. 57 & suiv. Ce qui les a arrachés à l’état de où ils sembloient être encore du temps de Tacite, IV. 60. Pourquoi, étant si pauvres, ils avoient tant de peines pécuniaires, IV. 62. Entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, IV. 66, 67. Comment punissoient les meurtres involontaires, IV. 67. C’est dans meurs mœurs qu’il faut chercher la source des maires du palais & de la foiblesse des rois, IV. 123 & suiv.
Germanie. Est le berceau des Francs, des Francs-ripuaires & des Saxons, II. 169. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87. Fut reconquise par les Francs, après qu’ils en furent sortis, III. 266.
Glebe (Servitude de la). Quelle en est, la plupart du temps, l’origine, IV. 4, 5. N’a point été établie par les Francs entrant dans la Gaule avant l’arrivée des Bourguignons : conséquences que l’auteur tire de ce fait, IV. 16, 17.
[IV-448]
Gloire. Celle du prince est son orgueil : elle ne doit jamais être le motif d’aucune guerre, I. 276.
Gloire ou magnanimité. Il n’y en a ni dans un despote, ni dans ses sujets, I. 117, 118.
Gnide. Vice dans son gouvernement, I. 316.
Goa. Noirceur horrible du caractere des habitans de ce pays, II. 112.
Gondebaud. Loi injuste de ce roi de Bourgogne, III. 197. Est un de ceux qui recueillit les lois des Bourguignons, III. 267. Caractere de sa loi : son objet ; pour qui elle fut faire, III. 278. Sa loi subsista long-temps chez les Bourguignons, III. 281. Fameuses dispositions de ce prince qui ôtoient le serment des mains d’un homme qui en vouloit abuser, III. 300, 301. Raison qu’il alleque pour substituer le combat singulier à la preuve par serment, III. 305, 306. Loi de ce prince qui permet aux accusés d’appeller au combat les témoins que l’on produisoit contr’eux, III. 338.
Gontran. Comment adopta Childebert, II. 179.
Goths. Leur exemple lors de la conquête d’Espagne, prouve que les esclaves armés ne sont pas si dangereux dans une monarchie, II. 81, 82. La vertu faisoit chez eux la majorité, II. 176. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domination & de celle des Bourguignons, & se perdit dans le domaine des Francs, III. 275 & suiv. La loi salique ne fut jamais reçue chez eux, III. 279. La prohibition de leurs mariages avec les Romains fut levée par Récessuinde : pourquoi, III. 284. Persécutés dans la Gaule méridionale par les Sarrasins, se retirent en Espagne : effets que cette émigration produisit dans leurs lois, III. 286.
Goût. Se forme dans une nation, par l’inconstance même de cette nation, II. 192, 193. Naît de la vanité, 193, 194.
Gouvernement. Il y en a de trois sortes : quelle est la nature de chacune, I. 15, 16. Exemple d’un pape qui abandonna le gouvernement à un ministre, & trouva que rien n’étoit si aisé que de gouverner, I. 36, 37. Différence entre sa nature & son principe, 38. Quels en sont les principes, II. 39. [IV-449] Ce qui le rend imparfait, I. 58. Ne se conserve qu’autant qu’on l’aime, I. 69, 70. Sa corruption commence presque toujours par celle des principes, I. 225 & suiv. Quelles sont les révolutions qu’il peut essuyer sans inconvénient, I. 237, 238. Suites funestes de la corruption de son principe, I. 240 & suiv. Quand le principe en est bon, les lois qui semblent les moins conformes aux vraies regles & aux bonnes mœurs, y sont bonne : exemples, ibid. Le moindre changement dans sa constitution entraîne la ruine des principes, I. 247, 248. Cas où de libre & de modéré qu’il étoit, il devient militaire, I. 332, 333. Liaison du gouvernement domestique avec le politique, II. 107. Ses maximes gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 182. Sa dureté est un obstacle à la propagation, III. 76 & suiv.
Gouvernement d’un seul. Ne dérive point du gouvernement paternel, I. 11.
Gouvernement gothique. Son origine, ses défauts : est la source des bons gouvernemens que nous connoissons, I. 337, 338.
Gouvernement militaire. Les empereurs qui l’avoient établi, sentant qu’il ne leur étoit pas moins funeste qu’aux sujets, chercherent à le tempérer, I. 182.
Gouvernement modéré. Combien il est difficile à former, I. 128. Le tribut qui est le plus naturel, est l’impôt sur les marchandises, II. 19, 20. Convient dans les pays formés par l’industrie des hommes, II. 145, 146. Voyez Monarchie. République.
Gouverneurs des provinces romaines. Leur pouvoir, leurs injustices, I. 373 & suiv.
Tiberius Gracchus. Coup mortel qu’il porte à l’autorité su sénat, I. 368.
Grace. On ne peut pas demander en Perse celle d’un homme que le roi a une fois condamné, I. 56. Le droit de la faire aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d’un monarque ; il ne doit donc pas être leur juge, I. 159, 160.
Grace (Lettres de). Sont un grand ressort dans un gouvernement modéré, I. 186.
[IV-450]
Grace (la). L’auteur de l’esprit des lois étoit-il obligé d’en parler ? D. 245 & suiv.
Gradués. Les deux, dont le juge est obligé de se faire assister dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive, représentent les anciens prud’hommes qu’il étoit obligé de consulter, III. 397.
Grandeur réelle des états. Pour l’augmenter, il ne faut pas diminuer la grandeur relative, I. 272.
Grandeur relative des états. Pour l’augmenter, il ne faut pas écraser un état voisin qui est dans la décadence, I. 273.
Grands. Leur situation dans les états despotiques, I. 54. Comment doivent être punis dans une monarchie, I. 191.
Gravina. Comment définit l’état civil, I. 12.
Gravion. Ses fonctions étoient les mêmes que celles du comte & du centenier, IV. 56.
Grece. Combien elle renfermoit de sortes de républiques, I. 96. Par quel usage on y avoit prévenu la luxe des richesses, si pernicieux dans les républiques, I. 199. Pourquoi les femmes y étoient si sages, II. 210, 211. Son gouvernement fédératif est ce qui la fit fleurir si long-temps, I. 260. Ce qui fut cause de sa perte, I. 263. On n’y pouvoit souffrir le gouvernement d’un seul, II. 140. Belle description des ses richesses, de son commerce, de ses arts, de sa réputation, des biens qu’elle recevoit de l’univers, & de ceux qu’elle lui faisoit, II. 291, 292. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans, avant les Romains, III. 87. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s’y est point introduite, III. 327. Sa constitution demandoit que l’on punît ceux qui ne prenoient pas de parti dans les séditions, III. 409, 410. Vice dans son droit des gens ; il étoit abominable, & étoit la source des lois abominables : comment il auroit dû être corrigé, III. 411, 412 ; 426, 427. On n’y punissoit pas le suicide par les mêmes motifs qu’à Rome, III. 415, 416. On y punissoit le receleur comme le voleur : cela étoit juste en Grece ; cela est injuste en France : pourquoi, III. 421, 422.
Grecs. Différence entre leur politique & celle [IV-451] d’aujourd’hui, I. 41. Combien on fait d’efforts pour diriger l’éducation du côté de la vertu, I. 70. Regardoient le commerce comme indigne d’un citoyen, I. 78. La nature de leurs occupations leur rendoit la musique nécessaire, I. 79, 80. La crainte des Perses maintint leurs lois, I. 234. Pourquoi se croyoient libres du temps de Cicéron, I. 307. Quel étoit leur gouvernement dans les temps héroïques, I. 340 & suiv. Ne surent jamais quelle est la vraie fonction du prince : cette ignorance leur fit chasser tous leurs rois, I. 341, 342. Ce qu’ils appelloient police, I. 342. Combien il falloit de voix chez eux pour condamner un accusé, I. 383. D’où venoit leur penchant pour le crime contre nature, I. 392. La trop grande sévérité avec laquelle ils punissoient les tyrans, occasionna chez eux beaucoup de révolutions, I. 411. La lepre leur étoit inconnue, II. 49. Loi sage qu’ils avoient établie en faveur des esclaves, II. 88. Pourquoi leurs navires étoient plus vites que ceux des Indes, II. 285, 286. Leur commerce avant & depuis Alexandre, II. 287 & suiv. 298 & suiv. – avant Homère, II. 291, 292. Pourquoi firent le commerce des Indes avant les Perses qui en étoient bien plus à portée, II. 193 & suiv. Leur commerce aux Indes n’étoit pas si étendu, mais plus facile que le nôtre, II. 308. Leurs colonies, II. 324. Pourquoi estimoient plus les troupes de terre que celles de mer, II. 326, 327. Loi qu’ils imposerent aux Perses, II. 350. Leurs différentes constitutions sur la propagation, suivant le plus grand ou le plus petit nombre d’habitans, III. 84 & suiv. N’auroient pas commis les massacres & les ravages qu’on leur reproche, s’ils eussent été chrétiens, III. 229. Leurs prêtres d’Apollon jouissoient d’une paix éternelle : sagesse de ce réglement religieux, III. 146. Comment, dans le temps de leur barbarie, ils employerent la religion pour arrêter les meurtres, III. 148, 149. L’idée des asiles devoit leur venir plus naturellement qu’aux autres peuples ; ils restreignirent d’abord l’usage qu’ils en firent dans de justes bornes ; mais ils les laisserent devenir abusifs & pernicieux, III. 167, 168.
[IV-452]
Grecs du bas empire. Combien étoient idiots, I. 396.
Grimoald. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
Guebres. Leur religion est favorable à la propagation, III. 107. Leur religion rendit autrefois le royaume de Perse florissant, parce qu’elle n’est point contemplative : celle de Mahomet l’a détruit, III. 138, 139. Leur religion ne pouvoit convenir que dans la Perse, III. 159.
Guerre. Quel en est l’objet, I. 10. On ne doit point en entreprendre de lointaines, I. 272. Dans quel cas on a droit de la faire : d’où dérive ce droit, I. 174 & suiv. Donne-t-elle droit de tuer les captifs ? II. 63. C’est le christianisme qui l’a purgée de presque toutes les cruautés, III. 129. Comment la religion peut en adoucir les fureurs, III. 145. Etoit souvent terminée par le combat judiciaire, III. 333. Avoit souvent autrefois pour motif la violation du droit politique, comme celles d’aujourd’hui ont pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens, III. 352, 353. Tout le monde, du temps de Charlemagne, étoit obligé d’y aller, IV. 191, 192.
Guerre civile. N’est pas toujours suivie de révolutions, I. 116. Celles qui ravagerent les Gaules, après la conquête des barbares, sont la principale source de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 20 & suiv.
Guerre (Etat de). Comment les nations se sont trouvées en état de guerre, I. 9. Comment les particuliers sont parvenus à être en état de guerre les uns vis-à-vis des autres, I. 10. Est la source des lois humaines, ibid.
Guinée. Causes de l’extrême lubricité des femmes de ce pays, II. 111.
Gymnastique. Ce que c’étoit ; combien il y en avoit de sortes. Pourquoi de très-utiles qu’étoient d’abord ces exercices, ils devinrent dans la suite funestes aux mœurs, I. 241, 242.
[IV-453]
H
Habit de religieuses. Doit-il être un obstacle au mariage d’une femme qui l’a pris sans se consacrer ? III. 431.
Hannon. Véritables motifs du refus qu’il vouloit que l’on fit envoyer du secours à Annibal en Italie, I. 285, 286. Ses voyages, ses découvertes sur les côtes de l’Afrique, II. 314 & suiv. La relation qu’il a donnée de ses voyages est un morceau précieux de l’antiquité. Est-elle fabuleuse ? II. 316 & suiv.
Hardouin (le pere). Il n’appartient qu’à lui d’exercer un pouvoir arbitraire sur les faits, IV. 28.
Harmonie. Nécessaire entre les lois de la religion, & les lois civiles du même pays, III. 142.
Hébon, archevêque de Rheims. Son ingratitude envers Louis le débonnaire. Qui étoit ce Hébon, IV. 99, 100.
Henri II. Sa loi contre les filles qui ne déclarent pas leur grossesse au magistrat, est contraire à la loi naturelle, III. 195.
Henri III. Ses malheurs sont une preuve bien sensible qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Henri VIII, roi d’Angleterre. Dut vraisemblablement sa mort à une loi trop dure qu’il fit publier contre le crime de lese-majesté, I. 399. Ce fut par le moyen des commissaires qu’il se défit des pairs qui lui déplaisoient, I. 419. A établi l’esprit d’industrie & de commerce en Angleterre, en y détruisant les monasteres & les hôpitaux, III. 121. En défendant la confrontation des témoins avec l’accusé, il fit une loi contraire à la loi naturelle, III. 194, 195. La loi par laquelle il condamnoit à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un, ne le déclaroit pas au roi avant d’épouser son amant, étoit contre la loi naturelle, III. 195.
Hercule. Ses travaux prouvent que la Grece étoit encore barbare de son temps, III. 148.
Hérédité. La même personne n’en doit pas recueillir [IV-454] deux, dans une démocratie où l’on veut conserver l’égalité, I. 89.
Hérésie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonspection, I. 388 & suiv. Combien ce crime est susceptible de distinctions, I. 392.
Héritiers. Les cadets, chez les Tartares, en quelques districts de l’Angleterre, & dans le duché de Rohan, sont héritiers exclusivement aux aînés, II. 161. Il n’y avoit à Rome que deux sortes d’héritiers : les héritiers-siens, & les agnats. D’où venoit l’exclusion des cognats, III. 242 & suiv. C’étoit un déshonneur à Rome, de mourir sans héritiers : pourquoi, III. 414, 415.
Héritier-siens. Ce que c’étoit, III. 242, 243. D ans l’ancienne Rome, ils étoient tout appellés à la succession, mâles & femelles, III. 243, 244.
Héroïsme. Celui des anciens étonne nos petites ames, I. 68.
Héros. Ecrivent toujours leurs propres actions avec simplicité, II. 316.
Hiérarchie. Pourquoi Luther la conserva dans sa religion, tandis que Calvin la bannit de la sienne, III. 132.
Himilcon, pilote des Carthaginois. Ses voyages, ses établissemens : se fait échouer pour ne pas apprendre aux Romains la route d’Angleterre, III. 321.
Histoire. Les monumens qui nous restent de celle de France, sont une mer, & une mer à qui les rivages même manquent, IV. 24. Germe de celle des rois de la premiere race, IV. 7, 8.
Historiens. Trahissent la vérité dans les états libres comme dans ceux qui ne le sont pas, II. 236, 237. Doivent-ils juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu’ils auroient dû faire ? IV. 159, 160. Source d’une erreur dans laquelle sont tombés ceux de France, IV. 19 & suiv.
Hobbes. Son erreur sur les premiers sentimens qu’il attribue à l’homme, I. 8. Le nouvelliste ecclésiastique que prend pour des preuves d’athéisme les raisonnemens que l’auteur de l’esprit des lois emploi pour détruire le systême de Hobbes & celui de Spinosa, D. 224.
[IV-455]
Hollande (la). Est une république fédérative ; & par-là regardée en Europe comme éternelle, I. 260. Cette république fédérative est plus parfaite que celle d’Allemagne : en quoi, I. 262. Comparée comme république fédérative avec celle de Lycie, I. 264. Ce que doivent faire ceux qui représentent le peuple, I. 318. Pourquoi n’est pas subjuguée par ses propres armées, I. 332. Pourquoi le gouvernement modéré y convient mieux qu’un autre, II. 145. Quel est son commerce, II. 242. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 246. Fait tel commerce sur lequel elle perd, & qui ne laisse pas de lui être fort utile, ibid. & suiv. Pourquoi les vaisseaux n’y sont pas si bons qu’ailleurs, II. 284. C’est elle qui, avec la France & l’Angleterre, fait tout le commerce de l’Europe, II. 253. C’est elle qui présentement regle le prix du change, III. 18.
Hollandois. Profit qu’ils tirent du privilege exclusif qu’ils ont de commercer au Japon & dans quelques autres royaumes des Indes, II. 250, 251. Font le commerce sur les erremens des Portugais, II. 347. C’est leur commerce qui a donné quelque prix à la marchandise des Espagnols, II. 358. Voyez Hollande.
Homere. Quelles étoient de son temps les villes les plus riches de la Grece, II. 290, 291. Commerce des Grecs avant lui, II. 291, 292.
Homicides. Doit-il y avoir des asiles pour eux ? III. 167, 168.
Hommage. Origine de celui que doivent les vassaux, III. 212.
Hommes. Leur bonheur comparé avec celui des bêtes, I. 5. Comme êtres physiques, sujets à des lois invariables ; comme être intelligens, violant toutes les lois : pourquoi. Comment rappellés sans cesse à l’observation des lois, I. 6. Quels ils seroient dans l’état de pure nature, I. 7, 8. Par quelles gradations se sont unis en société, I. 8, 9. Leur état relatif à chacun d’eux en particulier, & [IV-456] relatifs aux différens peuples quand ils ont été en société, I. 9, 10. Leur situation déplorable & vile dans les états despotiques, I. 51 ; 55. Leur vanité augmente à proportion du nombre de ceux qui vivent ensemble, I. 195. Leur penchant à abuser de leur pouvoir. Suites funestes de cette inclination, I. 309. Quelle est la connoissance qui les intéresse le plus, I. 382. Leurs caracteres & leurs passions dépendent des différens climats : raisons physiques, II. 31 & suiv. Plus les causes physiques les portent au repos, plus les causes morales doivent les en éloigner, II. 42. Naissent tous égaux : l’esclavage est donc contre nature, II. 72. Beauté & utilité de leurs ouvrages, II. 147. De leur nombre dans leur rapport avec la maniere dont ils se procurent la subsistance, II. 149, 150. Ce qui les gouverne, ce qui forme l’esprit général qui résulte des choses qui les gouvernent, II. 189. Leur propagation est troublée en mille manieres par les passions, par les fantaisies & par le luxe, III. 65, 66. Combien vaut un homme en Angleterre. Il y a des pays où un homme vaut moins que rien, III. 87. Sont portés à craindre ou à espérer. Sont fripons en détail, & en gros de très-honnêtes gens. De là le plus ou moins d’attachement qu’ils ont pour leur religion, III. 164. Aiment en matiere de religion tout ce qui suppose un effort ; comme en matière de morale, tout ce qui suppose la sévérité, III. 170, 171. Ont sacrifié leur indépendance naturelle aux lois politiques, & la communauté des biens aux lois civiles : ce qui en résulte, III. 223 & suiv. Il leur est plus aisé d’être extrêmement sages, III. 392. Est-ce être sectateur de la religion naturelle, que de dire que l’homme pouvoit à tous les instans oublier son créateur : & que Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion ? D. 243, 244.
Hommes de bien. Ce que c’est : il y en a fort peu dans les monarchies, I. 49, 50.
Hommes libres. Qui on appelloit ainsi dans les commencemens de la monarchie. Comment & sous qui ils marchoient à la guerre, IV. 47.
[IV-457]
Hommes qui sont sous la foi du roi. C’est ainsi que la loi salique désigne ceux que nous appellons aujourd’hui vassaux, IV. 44.
Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maison d’Autriche qui avoit travaillé sans cesse à l’opprimer, I. 239. Quelle sorte d’esclavage y est établi, II. 76. Ses mines sont utiles, parce qu’elles ne sont pas abondantes, II. 359.
Honnêtes gens. Ceux qu’on nomme ainsi tiennent moins aux bonnes maximes que le peuple, I. 83.
Honnête homme. Le cardinal de Richelieu l’exclut de l’administration des affaires dans une monarchie, I. 48. Ce qu’on entend par ce mot, dans une monarchie, I. 63.
Honneur. Ce que c’est : il tient lieu de la vertu dans les monarchies, I. 49. Est essentiellement placé dans l’état monarchique, I. 50. Effets admirables qu’il produit dans une monarchie, I. 51, 52. Quoique faux, il produit dans une monarchie les mêmes effets que s’il étoit véritable, I. 51. N’est point le principe des états despotiques, I. 51, 52. Quoique dépendant de son propre caprice, il a des regles fixes, dont il ne peut s’écarter, I. 52. Est tellement inconnu dans les états despotiques, que souvent il n’y a pas de mot pour l’exprimer, ibid. Seroit dangereux dans un état despotique, I. 53. Met des bornes à la puissance du monarque, I. 57. C’est dans le monde, & non au college que l’on en apprend les principes, I. 60. C’est lui qui fixe la qualité des actions dans une monarchie, I. 61. Dirige toutes les actions & les façons de penser dans une monarchie, I. 63, 64. Empêche Crillon & Dorte d’obéir à des ordres injustes du monarque, I. 64. C’est lui qui conduit les nobles à la guerre ; c’est lui qui la leur fait quitter, I. 65. Quelles en sont les principales regles, I. 65, 66. Ses lois ont plus de force dans une monarchie, que les lois positives, I. 66. Bizarrerie de l’honneur, I. 139, 140. Tient lieu de censeurs dans une monarchie, I. 144. Voyez Point d’honneur.
Honneur. C’est ainsi que l’on a nommé quelquefois les fiefs, IV. 45.
[IV-458]
Honorifiques. Voyez Droits honorifiques.
Honorius. Ce qu’il pensoit des paroles criminelles, I. 403. Mauvaise loi de ce prince, III. 429, 430.
Honte. Prévient plus de crimes que les peines atroces, I. 172 & suiv. Punit plus le pere d’un enfant condamné au supplice, & vice versâ, que toute autre peine, I. 190.
Hôpital (Le chancelier de l’). Erreur dans laquelle il est tombé, III. 434.
Hôpitaux. Dans quelles circonstances ils sont utiles ; usage qu’on en doit faire, III. 319 & suiv. La richesse d’un état n’empêche pas qu’ils ne soient nécessaires, III. 120. Sont pernicieux dans un état pauvre, III. 121. Leur destruction en Angleterre a contribué à y établir l’esprit de commerce & d’industrie, ibid. Mettent à Rome tout le monde à son aise, excepté ceux qui ont de l’industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, III. 121, 122.
Hortensius. Emprunta la femme de Caton, III. 230.
Hospitalité. C’est le commerce qui l’a bannie, II. 240, 241. Jusqu’à quel point observée par les Germains, ibid.
Hugues-Capet. Son avénement à la couronne fut un plus grand changement que celui de Pepin, IV. 160, 161. Comment la couronne de France passa dans sa maison, IV. 202 & suiv.
Humeur sociable. Ses effets, II. 192, 193.
J
Jacques I. Pourquoi fit des lois somptuaires en Arregon. Quelles en furent, I. 203.
Jacques II, roi de Marjorque. Paroît être le premier qui ait été créé une patie publique, III. 377.
Jalousie. Il y en a de deux sortes ; l’une de passion ; l’autre de coutume & de mœurs ou de lois : leur nature ; leurs effets, II. 114, 115.
Janicule. Voyez Mont Janicule.
Japon. Les lois y sont impuissantes, parce qu’elles sont trop séveres, I. 174 & suiv. Exemple des lois [IV-459] atroces de cet empire, I. 409, 410. Pourquoi la fraude y est un crime capital, II. 15. Est tyrannisé par les lois, II. 189. Pertes que lui cause sur son commerce le privilege exclusif qu’il a accordé aux Hollandois & aux Chinois, II. 250. Pourquoi le commerce lui est utile, II. 268, 269. Quoiqu’un homme y ait plusieurs femmes, il n’ a que les enfans d’une seule qui soient légitimes, III. 70. Il y naît plus de filles que de garçons ; il doit donc être plus peuplé que l’Europe, III. 78. Cause physique de la grande population de cet empire, III. 79. C’est parce que la religion dominante dans cet empire n’a presque point de dogmes, & qu’elle ne présente aucun avenir, que les lois y sont si séveres & si sévérement exécutées, III. 141. Il y a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne ruine pas, III. 146. Pourquoi les religions étrangeres s’y sont établies avec tant de facilité, III. 164. Lors de la persécution du christianisme, on s’y révolta plus contre la cruauté des supplices, que contre la durée des peines, III. 182. On y est autant autorisé à faire mourir les Chrétiens à petit feu, que l’inquisition à faire brûler les Juifs, III. 183, 184. C’est l’atrocité du caractere des peuples, & la soumission rigoureuse que le prince exige à ses volontés, qui rendent la religion chrétienne si odieuse dans ce pays, III. 188, 189. On n’y dispute jamais sur la religion. Toutes, hors celle des chrétiens, y sont indifférentes, III. 189.
Japonois. Leur caractere bizarre & atroce. Quelles lois il auroit fallu leur donner, I. 175 & suiv. Exemple de la cruauté de ce peuple, I. 177, 178. Ont des supplices qui font frémir la pudeur & la nature, I. 406. L’atrocité de leur caractere est la cause de la rigueur de leurs lois. Détail abrégé de ces lois, II. 58, 59. Conséquences funestes qu’ils tirent du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 151. Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi sont tolérans en fait de religion, III. 166. Voyez Japon.
Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va plus jusqu’à la mer, II. 279.
[IV-460]
Icthyophages. Alexandre les avoit-ils tous subjugués ? II. 296.
Idolâtire. Nous y sommes fort portés, mais nous n’y sommes point attachés, III. 162, 163. Est-il vrai que l’auteur ait dit que c’est par orgueil que les hommes l’ont quittée ? D. 281, 282.
Jésuites. Leur ambition : leur éloge par rapport au Paraguay, I. 73.
Jeu de fiefs. Origine de cet usage, IV. 208, 209.
Ignorance. Dans les siecles où elle regne, l’abrégé d’un ouvrage fait tomber l’ouvrage même, III. 291.
Ignominie. Etoit à Lacédémone le plus grand des malheurs, III. 416.
Illusion. Est utile en matiere d’impôt. Moyens de l’entretenir, II. 9 & suiv.
Ilotes. Condamnés chez les Lacédémoniens à l’agriculture, comme à une profession servile, I. 78.
Ilotie. Ce que c’est : elle est contre la nature des choses, II. 76.
Immortalité de l’ame. Ce dogme est utile ou funeste à la société, selon les conséquences que l’on en tire, III. 150. Ce dogme se divise en trois branches, III. 152.
Immunité. On appella ainsi d’abord le droit qu’acquirent les Ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, IV. 74.
Impôts. Comment & par qui doivent être réglés dans un état libre, I. 330, 331. Peuvent être mis sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises, ou sur deux de ces choses, ou sur les trois à la fois. Proportions qu’il faut garder dans tous ces cas, II. 7 & suiv. On peut les rendre moins onéreux, en faisant illusion à celui qui les paye : comment on conserve cette illusion, II. 9 & suiv. Doivent être proportionnés à la valeur intrinseque de la marchandise sur laquelle on le leve, II. 11, 12. Celui sur le sel est injuste & funeste en France, ibid. Ceux qui mettent le peuple dans l’occasion de faire la fraude enrichissent le traitant, qui vexe le peuple & ruine l’état, II. 12. Ceux qui se perçoivent sur les différentes clauses des contrats civils sont funestes au peuple, & ne sont utiles qu’aux [IV-461] traitans. Ce qu’on y pourroit substituer, II. 12, 13. L’impôt par tête est plus naturel à la servitude : celui sur la marchandise est plus naturel à la liberté, II. 18 & suiv. Pourquoi les Anglois en supportent de si énormes, II. 224, 225. C’est une absurdité que de dire, que plus on est chargé d’impôts, plus on se met en état de les payer, III. 77.
Impuissance. Au bout de quel temps on doit permettre à une femme de répudier son mari, qui ne peut pas consommer son mariage, III. 432.
Impureté. Comment ce crime doit être puni. Dans quelle classe il doit être rangé, I. 386.
Inceste. Raisons de l’horreur que cause ce crime, dans ses différens degrés, à tous les peuples, III. 216 & suiv.
Incidens. Ceux des procès, tant civils que criminels, se décidoient par la voix du combat judiciaire, III. 318 & suiv.
Incontinence. Ne suit pas les lois de la nature : elle les viole, II. 113, 114.
Incontinence publique. Est une suite du luxe, I. 219.
Indemnité. Est due aux particuliers, quand on prend sur leurs fonds pour bâtir un édifice public ou pour faire un grand chemin, III. 225, 226.
Indemnité (Droit d’). Son utilité. La France lui doit une partie de sa prospérité : il faudroit encore y augmenter ce droit, III. 172, 173.
Indes. On s’y trouve très-bien du gouvernement des femmes. Cas où on leur défere la couronne, à l’exclusion des hommes, I. 223. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II. 43. Extrême lubricité des femmes indiennes. Causes de ce désordre, II. 110, 111. Caracteres des différens peuples indiens, II. 194, 195. Pourquoi on n’y a jamais commercé, & on n’y commercera jamais qu’avec de l’argent, II. 270 & suiv. 282. Comment, & par où le commerce s’y faisoit autrefois, II. 271 & suiv. Pourquoi les navires indiens étoient moins vîtes que ceux des Grecs & des Romains, II. 284, 285. Comment, & par où on y faisoit le commerce après Alexandre, II. 304 & suiv. 335 & suiv. Les anciens les croyoient jointes à l’Afrique par [IV-462] une terre inconnue, & ne regardoient la mer des Indes que comme un lac, II. 313. Leur commerce avec les Romains étoit-il avantageux ? II. 333 & suiv. Projets proposés par l’auteur sur le commerce qu’on y pourroit faire, II. 361. Si on y établissoit une religion, il faudroit, quant au nombre de fêtes, se conformer au climat, III. 156. Le dogme de la métempsycose y est utile : raisons physiques, III. 156, 157. Préceptes de la religion de ce pays, qui ne pourroient pas être exécutés ailleurs, III. 159, 160. Jalousie que l’on y a pour sa caste. Quels y sont les successeurs à la couronne, III. 203. Pourquoi les mariages entre beau-frere & belle-sœur y sont permis, III. 223. De ce que les femmes s’y brûlent, s’ensuit-il qu’il n’y ait pas de douceur dans le caractere des Indiens ? D. 277
Indiens. Raisons physiques de la force & de la foiblesse qui se trouvent tout à la fois dans le caractere de ces peuples, II. 38, 39. Font consister le souverain bien dans le repos : raisons physiques de ce sytême. Les législateurs le doivent combattre, en y établissant des lois toutes pratiques, II. 41, 52. La douceur de leur caractere a produit la douceur de leurs lois. Détail de quelques-unes de ces lois : conséquences qui résultent de cette douceur pour leurs mariages, II. 59, 60. III. 223. La croyance où ils sont que les eaux du Gange sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, est très-pernicieuse, III. 143, 144. Leur systême sur l’immortalité de l’ame. Ce systême est cause qu’il n’y a chez eux que les innocens qui souffrent une mort violente, III. 152, 153. Leur religion est mauvaise, en ce qu’elle inspire de l’horreur aux castes les unes pour les autres ; & qu’il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s’il mangeoit avec son roi, III. 153, 154. Raison singuliere qui leur fait détester les mahométans, III. 154. Ceux des pays froids ont moins de divertissemens que les autres : raisons physiques, III. 156.
Indus. Comment les anciens on fait usage de ce fleuve pour le commerce, II. 293, 294.
Industrie. Moyens de l’encourager, II. 45, 46. Celle d’une nation vient de sa vanité, II. 193.
[IV-463]
Informations. Quand commencerent à devenir secrettes, III. 369.
Ingénus. Quelles femmes pouvoient épouser à Rome, III. 101.
Injures. Celles qui sont dans les livres ne font nulle impression sur les gens sages ; & prouvent seulement que celui qui les a écrites fait dire des injures, D. 238, 239.
Inquisiteurs. Persécutent les Juifs plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, III. 187. Voyez Inquisition.
Inquisiteurs d’état. Leur utilité à Venise, I. 28 ; 108. durée de cette magistrature. Comment elle s’exerce : sur quels crimes elle s’exerce, I. 28, 29. Pourquoi il y en a à Venise, I. 313. Moyen de suppléer à cette magistrature despotique, I. 316, 317.
Inquisition. A tort de se plaindre de ce qu’au Japon on fait mourir les chrétiens à petit feu, III. 183, 184. Son injuste cruauté démontrée dans les remontrances adressées aux inquisiteurs d’Espagne & de Portugal, III. 183 & suiv. Ne doit pas faire brûler les Juifs, parce qu’ils suivent une religion qui leur a été inspirée par leurs peres, que toutes les lois les obligent de regarder comme des dieux sur la terre, III. 184. En voulant établir la religion chrétienne par le feu, elle lui a ôté l’avantage qu’elle a sur le mahométisme, qui s’est établi par le fer, III. 184, 185. Fait jouer aux Chrétiens le rôle des Dioclétiens ; & aux Juifs celui des Chrétiens, III. 185. Est contraire à la religion de Jesus-Christ, à l’humanité & à la justice, III. 185, 186. Il semble qu’elle veut cacher la vérité, en la proposant par des supplices, III. 186. Ne doit pas faire brûler les Juifs, parce qu’ils ne veulent pas feindre une abjuration, & profaner nos mysteres, ibid. Ne doit pas faire mourir les Juifs, parce qu’ils professent une religion que Dieu leur a donnée, & qu’ils croient qu’il leur donne encore, ibid. Déshonore un siecle éclairé comme le nôtre, & le fera placer par la postérité au nombre des siecles barbares, III. 187. Par qui, comment établie, [IV-464] ce tribunal est insupportable dans toutes sortes de gouvernemens, III. 201. Abus injuste de ce tribunal, III. 212. Ses lois ont toutes été tirées de celles des Wisigoths, que le clergé avoit rédigées, & que les moines n’ont fait que copier, III. 269, 270.
Insinuation. Le droit d’insinuation est funeste aux peuples, & n’est utile qu’aux traitans, II. 12, 13.
Institutes. Celles de Justinien donnent une fausse origine de l’esclavage, II. 62 & suiv.
Institutions. Regles que doivent se prescrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, I. 74. Il y a des cas où les institutions singulieres peuvent être bonnes, I. 75, 76.
Insulaires. Voyez Iles.
Insulte. Un monarque doit toujours s’en abstenir : preuves par faits, I. 426, 427.
Insurrection. Ce que c’étoit, & quel avantage en retiroient les Crétois, I. 240, 241. On s’en sert en Pologne avec moins d’avantage que l’on ne faisoit en Crete, I. 241.
Intérêts. Dans quel cas l’état peut diminuer ceux de l’argent qu’il a emprunté : usage qu’il doit faire du profit de cette diminution, III. 48 & suiv. Il est juste que l’argent prêté en produise : si l’intérêt est top fort, il ruine le commerce : s’il est trop foible, s’il n’est pas du tout permis, l’usure s’introduit, & le commerce est encore ruiné, III. 50 & suiv. Pourquoi les intérêts maritimes sont plus forts que les autres, III. 52. De ceux qui sont stipulés par contrat, III. 53 & suiv. Voyez Usure.
Interprétation des lois. Dans quel gouvernement peut être laissée aux juges, & dans quel gouvernement elle doit leur être interdite, I. 154.
Intolérance morale. Ce dogme donne beaucoup d’attachement pour une religion qui l’enseigne, III. 163.
In truste. Explication de cette expression mal entendue par Mrs. Bignon & Ducange, IV. 78, 79.
Irlande. Les moyens qu’on y a employés pour l’établissement d’une manufacture, devroient servir de modele à tous les autres peuples pour encourager [IV-465] l’industrie, II. 45, 46. État dans lequel l’Angleterre la contient, II. 228.
Isaac l’Ange, Empereur. Outra la clémence, I. 192.
Isis. C’étoit en son honneur que les Egyptiens épousoient leurs sœurs, III. 220.
Isles. Les peuples qui les habitent sont plus portés à la liberté que ceux du continent, II. 144.
Italie. Sa situation vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua beaucoup à la grandeur relative de la France, I. 272. Il y a moins de liberté dans ses républiques, que dans nos monarchies : pourquoi, I. 313, 314. La multitude des moines y vient de la nature du climat : comment on devroit arrêter les progrès d’un mal si pernicieux, II. 44. La lepre y étoit avant les croisades : comment elle s’y étoit communiquée ; comment on y en arrêta les progrès, II. 50. Pourquoi les navires n’y sont pas si bons qu’ailleurs, II. 284. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérance, II. 346, 347. Loi contraire au bien du commerce, dans quelques états d’Italie, III. 44. La liberté sans bornes qu’y ont les enfans de se marier à leur goût, y est moins raisonnable qu’ailleurs, III. 75. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87. Les hommes & les femmes y sont plutôt stériles que dans le nord, III. 100. L’usage de l’écriture s’y conserva, malgré la barbarie qui le fit perdre par-tout ailleurs ; c’est ce qui empêcha les coutumes de prévaloir sur les lois romaines dans les pays de droit écrit, III. 292. L’usage du combat judiciaire y fut porté par les Lombards, III. 314. On y suivit le code de Justinien dès qu’il fut retrouvé, III. 393. Pourquoi ses lois féodales sont différentes de celles de France, IV. 21.
Juges. La corruption du principe du gouvernement à Rome empêcha d’en trouver dans aucun corps qui fussent integres, I. 243 & suiv. 361 & suiv. De quel corps doivent être pris dans un état libre, I. 315. Doivent, dans un état libre, être de la condition de l’accusé, I. 316. Ne doivent point dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen [IV-466] qui peut répondre de sa personne : exception, I. 316, 317. Se battoient, au commencement de la troisieme race, contre ceux qui ne s’étoient pas soumis à leurs ordonnances, III. 319. Terminoient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre, III. 321. Quand commencerent à juger seuls, contre l’usage constamment observé dans la monarchie, III. 396, 397. N’avoient autrefois d’autre moyen de connoître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes : comment a suppléé à une voie si peu sure, III. 399, 400. Etoient les mêmes personnes que les rathimburges & les échevins, IV. 56.
Juges de la question. Ce que c’étoit à Rome, & par qui ils étoient nommés, I. 366.
Juges royaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief pour y faire aucunes fonctions, IV. 70, 71.
Jugemens. Comment se prononçoient à Rome, I. 154, 155. Comment se prononcent en Angleterre, I. 155. Manieres dont ils se forment dans les différens gouvernemens, I. 155 & suiv. Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d’abus, I. 161, 162. Ne doivent être, dans un état libre, qu’un texte précis de la loi : inconvéniens des jugemens arbitraires, I. 316. Détail des différentes especes de jugemens qui étoient en usage à Rome, I. 361 & suiv. Ce que c’étoit que fausser le jugement, III. 340 & suiv. En cas de partage, on prononçoit autrefois pour l’accusé, ou pour le débiteur, ou pour le défendeur, III. 345. Quelle en étoit la formule, dans les commencemens de la monarchie, IV. 55 & suiv. Ne pouvoient jamais, dans les commencemens de la monarchie, être rendus par un homme seul, IV. 56.
Jugement de la croix. Etabli par Charlemagne, limité par Louis le débonnaire, & aboli par Lothaire, III. 316.
Juger. C’étoit dans les mœurs de nos peres, la même chose que combattre, III. 345, 346.
Juger (Puissance de). A qui doit être confiée dans un état libre, I. 315. Comment peut être adoucie, [IV-467] I. 315 & suiv. Dans quel cas peut être unie au pouvoir législatif, I. 337 & suiv.
Juifs (anciens). Loi qui maintenoit l’égalité entr’eux, I. 89. Quel étoit l’objet de leurs lois, I. 310. Leurs lois sur la lepre étoient tirées de la pratique des Egyptiens, II. 49. Leurs lois sur la lepre auroient dû nous servir de modele pour arrêter la communication du mal vénérien, II. 51. La férocité de leur caractere a quelquefois obligé Moïse de s’écarter, dans ses lois, de la loi naturelle, II. 88. Comment ceux qui avoient plusieurs femmes devoient se comporter avec elles, II. 105. Etendue & durée de leur commerce, II. 281, 282. Leur religion encourageoit la propagation, III. 107. Pourquoi mirent leurs asiles dans les villes, plutôt que dans leurs tabernacles ou dans leur temple, III. 168. Pourquoi avoient consacré une certaine famille au sacerdoce, III. 170. Ce fut une stupidité de leur part, de ne pas vouloir se défendre contre leurs ennemis un jour du sabbat, III. 204.
Juifs (modernes). Chassés de France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, III. 390. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe dans les temps de barbarie : traitemens injustes & cruels qu’ils ont essuyés : sont inventeurs des lettres de change, II. 342 & suiv. L’ordonnance qui, en 1745, les chassoit de Moscovie, prouve que cet état ne peut cesser d’être despotique, III. 164. Réfutation du raisonnement qu’ils emploient pour persister dans leur aveuglement, III. 184. L’inquisition commet une très-grande injustice en les persécutant, ibid & 186. Les inquisiteurs les persécutent plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, III. 187. La Gaule méridionale étoit regardée comme leur prostibule : leur puissance empêcha les lois des Wisigoths de s’y établir, III. 285, 286. Traités cruellement par les Wisigoths, III. 437.
Julia (la loi). Avoit rendu le crime de lese-majesté arbitraire, I. 398, 399.
Julien l’apostat. Par une fausse combinaison, causa [IV-468] une affreuse famine à Antioche, III. 13. On peut, sans se rendre complice de son apostasie, le regarder comme le prince le plus digne de gouverner les hommes, III. 137. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, III. 139.
Julien (le comte). Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427. Pourquoi entreprit de perdre sa patrie & son roi, II. 58.
Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l’origine de l’esclavage, II. 62 & suiv.
Juridiction civile. C’étoit une des maximes fondamentales de la monarchie françoise, que cette juridiction résidoit toujours sur la même tête que la puissance militaire ; & c’est dans ce double service que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, IV. 52 & suiv.
Juridiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, I. 32. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, III. 106. Ses entreprises sur la juridiction laie, III. 388, 389. Flux & reflux de la juridiction ecclésiastique & de la juridiction laie, III. 390 & suiv.
Juridiction laie. Voyez Juridiction ecclésiastique.
Juridiction royale. Comment elle recula les bornes de la juridiction ecclésiastique, & de celle des seigneurs ; bien que causa cette révolution, III. 390, 391.
Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monarchie : inconvéniens de ses variations : remedes, I. 148, 149. Est-ce cette science, ou la théologie, qu’il faut traiter dans les livres de jurisprudence ? D. 279.
Jurisprudence françoise. Consistoit toute en procédés, au commencement de la troisieme race, III. 318. Quelle étoit celle du combat judiciaire, III. 327 & suiv. Varioit, du temps de Saint Louis, selon la différente nature des tribunaux, III. 357 & suiv. Comment on en conservoit la mémoire du temps où l’écriture n’étoit point en usage, III. 368, 369. Comment Saint Louis en introduisit une uniforme par-tout le royaume, III. 386 & suiv. Lorsqu’elle commença à devenir un art, les seigneurs [IV-469] perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. Pourquoi l’auteur n’est pas entré dans le détail des changemens insensibles qui en ont formé le corps, III. 405, 406.
Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république ou de celle des empereurs, étoit en usage en France du temps de Saint Louis, III. 385, 386.
Justice. Ses rapports sont antérieurs aux lois, I. 3. Il ne doit jamais être permis de se la faire soi-même, I. 408, 409. Les sultans ne l’exercent qu’en l’outrant, III. 239. Précaution que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire à soi-même, III. 427, 428. Nos peres entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, IV. 66, 67. Ce que nos peres appelloient rendre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu’à celui qui avoit le fief, à l’exclusion même du roi : pourquoi, IV. 70.
Justice divine. A deux pactes avec les hommes, III. 212.
Justice humaine. N’a qu’un pacte avec les hommes, ibid.
Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, I. 32. De qui ces tribunaux étoient composés : comment on appelloit des jugemens qui s’y rendoient, III. 339 & suiv. De quelle qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matieres qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, III. 349. Ne ressortissoient point aux missi dominici, III. 350. Pourquoi n’avoient pas toutes, du temps de Saint Louis, la même jurisprudence, III. 361, 362. L’auteur en trouve l’origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans les commencemens de la monarchie, IV. 52 & suiv. L’auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, IV. 52 & suiv. Ce qu’on appelloit ainsi du temps de nos peres, IV. 66 & s. D’où vient le principe qui dit qu’elles sont [IV-470] patrimoniales en France, IV. 70, 71. Ne tirent point leur origine des affranchissemens que les rois & les seigneurs firent de leurs serfs, ni de l’usurpation des seigneurs sur les droits de la couronne : preuves, IV. 71 & suiv. 77 & suiv. Comment, & dans quel temps les églises commencerent à en posséder, IV. 73 & suiv. Etoient établies avant la fin de la seconde race, IV. 77 & suiv. Où trouve-ton la preuve, au défaut des contrats originaires de concession, qu’elles étoient originairement attachées aux fiefs ? IV. 81, 82.
Justinien. Maux qu’il causa à l’empire, en faisant la fonction de juge, I. 162. Pourquoi le tribunal qu’il établit chez les Laziens leur parut insupportable, II. 186. Coup qu’il porta à la propagation, III. 107. A-t-il raison d’appeller barbare le droit qu’ont les mâles, de succéder au préjudice des filles ? III. 200 & suiv. En permettant au mari de reprendre sa femme, condamnée pour adultere, songea plus à la religion qu’à la pureté des mœurs, III. 208. Avoit trop en vue l’indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui des femmes qui se remarioient pendant l’absence de leur mari, dont elles n’ont point de nouvelles, III. 208, 209. En permettant le divorce pour entrer en religion, s’éloignoit entiérement des principes des lois civiles, III. 209, 210. S’est trompé sur la nature des testamens per as & libram, III. 244. Contre l’esprit de toutes les anciennes lois, accorda aux meres la succession de leurs enfans, III. 262. Ota jusqu’au moindre vestige du droit ancien touchant les successions : il crut suivre la nature, & se trompa, en écartant ce qu’il appella les embarras de l’ancienne jurisprudence, III. 263, 264. Temps de la publication de son code, III. 399. Comment son droit fut apporté en France : autorité qu’on lui attribua dans les différentes provinces, III. 393 & suiv. Epoques de la découverte de son digeste : ce qui en résulta : changemens qu’il opéra dans les tribunaux, ibid. Loi inutile de ce prince, III. 432. Sa compilation n’est pas faite avec assez de choix, III. 438.
[IV-471]
K
Kan des Tartares. Comment il est proclamé : ce qu’il devient quand il est vaincu, II. 158, 159.
Kur. C’est le seul fleuve en Perse qui soit navigable, III. 159.
L
Lacédémone. Sur quel original les lois de cette république avoient été copiées, I. 71. La sagesse de ses lois la mit en état de résister aux Macédoniens plus long-temps que les autres villes de la Grece, I. 72. On y pouvoit épouser sa sœur utérine, & non sa sœur consanguine, I. 90. Tous les vieillards y étoient censeurs, I. 99, 100. Différence essentielle entre cette république & celle d’Athenes, quant à la subordination aux magistrats, I. 100, 101. Les éphores y maintenoient tous les états dans l’égalité, I. 110. Vice essentiel dans la constitution de cette république, I. 154. Ne subsista long-temps, que parce qu’elle n’étendit point son territoire, I. 249. Quel étoit l’objet de son gouvernement, I. 310. C’étoit une république que les anciens prenoient pour une monarchie, I. 338. C’est le seul état où deux rois aient été supportables, I. 339. Excès de liberté & d’esclavage en même temps dans cette république, I. 376. Pourquoi les esclaves y ébranlerent le gouvernement, II. 83. État injuste & cruel des esclaves, dans cette république, II. 88. Pourquoi l’aristocratie s’y établit plutôt qu’à Athenes, II. 140. Les mœurs y donnoient le ton, II. 189. Les magistrats y régloient les mariages, III. 73, 74. Les ordres du magistrat y étoient totalement absolus, III. 416. L’ignominie y étoit le plus grand des malheurs, & la foiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exerçoit les enfans au larcin ; & l’on ne punissoit que ceux qui se laissoient surprendre en flagrant délit, III. 423, 424. Ses usages sur le vol avoient été tirés de Crete, & furent la source des lois romaines sur la même matiere, III. 423 & suiv. Ses lois sur le vol étoient [IV-472] bonnes pour elle, & ne valoient rien ailleurs, III. 425.
Lacédémoniens. Leur humeur & leur caractere étoient opposés à ceux des Atheniens, II. 192. Ce n’étoit pas pour invoquer la peur, que ce peuple belliqueux lui avoit élevé un autel, III. 127.
Lamas. Comment justifient la loi qui, chez eux, permet à une femme d’avoir plusieurs maris, II. 101.
Laockium. Sa doctrine entraîne trop dans la vie contemplative, III. 138.
Larcin. Pourquoi on exerçoit les enfans de Lacédémone à ce crime, III. 423, 424.
Latins. Qui étoient ceux que l’on nommoit ainsi à Rome, III. 62.
Law. Bouleversement que son ignorance pensa causer, I. 34. Son systême fit diminuer le prix de l’argent, III. 11. Danger de son systême, III. 33 & suiv. La loi par laquelle il défendit d’avoir chez soi au-delà d’une certaine somme en argent, étoit injuste & funeste. Celle de César, qui portoit la même défense, étoit juste & sage, III. 412, 413.
Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux leur parut insupportable, II. 186.
Législateurs. En quoi les plus grands se sont principalement signalés, I. 20, 21. Doivent conformer leurs lois au principe du gouvernement, I. 82. Ce qu’ils doivent avoir principalement en vue, I. 167. Suites funestes de leur dureté, I. 173. Comment doivent ramener les esprits d’un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce, I. 176. Comment doivent user des peines pécuniaires, & des peines corporelles, I. 189. Ont plus besoin de sagesse dans les pays chauds, & sur-tout aux Indes, que dans nos climats, II. 39, 40. Les mauvais sont ceux qui ont favorisé le vice du climat ; les bons sont ceux qui ont lutté contre le climat, II. 41, 42. Belle regle qu’ils doivent suivre, II. 86. Doivent forcer la nature du climat, quand il viole la loi naturelle des deux sexes, II. 114. Doivent se conformer à l’esprit d’une nation, quand il n’est pas contraire à l’esprit du gouvernement, II. 190, 191. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices [IV-473] moraux & les vices politiques, II. 197. Regles qu’ils doivent se prescrire pour un état despotique, II. 198, 199. Comment quelques-uns ont confondu les principes qui gouvernent les hommes, II. 203 & suiv. Devroient prendre Solon pour modele, II. 213. Doivent, par rapport à la propagation, régler leurs vues sur le climat, III. 83, 84. Sont obligés de faire des lois qui combattent les sentimens naturels même, III. 257, 258. Comment doivent introduire les lois utiles qui choquent les préjugés & les usages généraux, III. 383. De quel esprit doivent être animés, III. 407, 408. Leurs lois se sentent toujours de leurs passions & de leurs préjugés, III. 440. Où ont-ils appris ce qu’il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité ? D. 244,245.
Législateurs romains. Sur quelles maximes ils réglerent l’usure, après la destruction de la république, III. 64.
Législatif (Corps). Doit-il être long-temps sans être assemblé ? I. 322. Doit-il être toujours assemblé ? I. 323. Doit-il avoir la faculté de s’assembler lui-même ? I. 323, 324. Quel doit être son pouvoir vis-à-vis la puissance exécutrice, I. 324 & suiv.
Législative (Puissance). Voyez Puissance législative.
Legs. Pourquoi la loi voconienne y mit des bornes, III. 152, 153.
Lepidus. L’injustice de ce triumvir est une grande preuve de l’injustice des Romains de son temps, I. 412.
Lepre. Dans quels pays elle s’est étendue, II. 49, 50.
Lépreux. Étoient morts civilement par les lois des Lombards, II. 50.
Lese-majesté (Crime de). Précaution que l’on doit apporter dans la punition de ce crime, I. 393 & suiv. Lorsqu’il est vague, le gouvernement dégénere en despotisme, I. 394. C’est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le sont pas. Tyrannie monstrueuse exercée par les empereurs romains, sous prétexte de ce crime, I. 394 & suiv. N’avoit point lieu sous les bons empereurs, quand il n’étoit pas direct, I. 397 & suiv. Ce que c’est proprement, suivant Ulpien, I. 398, 399. Les pensées ne doivent point être regardées comme faisant [IV-474] partie de ce crime, I. 400. ― ni les paroles indiscrettes, ibid. & suiv. Quand, & dans quels gouvernemens, les écrits doivent être regardés comme crime de lese-majesté, I. 403 & suiv. Calmonie dans ce crime, I. 408. Il est dangereux de le trop punir dans une république, I. 410 & suiv.
Lettres anonymes. Sont odieuses, & ne méritent attention que quand il s’agit du salut du prince, I. 421, 422.
Lettres de change. Epoque & auteurs de leur établissement, II. 344 & suiv. C’est à elles que nous sommes redevables de la modération des gouvernemens d’aujourd’hui, & de l’anéantissement du machiavélisme, ibid. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, ibid.
Lettres de grace. Leur utilité dans une monarchie, I. 186.
Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux : leur origine, IV. 44 & suiv. Il paroît, par tout ce qu’en dit l’auteur, que ce mot étoit proprement dit des vassaux du roi, ibid. & suiv. Par qui étoient menés à la guerre, & qui ils y menoient, IV. 51. Pourquoi leurs arriere-vassaux n’étoient pas menés à la guerre par les comtes, IV. 53. Étoient des comtes, dans leurs seigneureries, IV. 54. Voyez vassaux.
Lévitique. Nous avons conservé ses dispositions sur les biens du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, III. 172.
Leuvigilde. Corrigea les lois des wisigots, III. 268.
Libelles. Voyez Écrits.
Liberté. Diverses significations données à ce mot, I. 306 & suiv. On croit communément que c’est dans la démocratie qu’elle se trouve le plus, I. 308. Ce que c’est, I. 308, 309 ; III. 224. Ne doit pas être confondue avec l’indépendance, I. 308, 309. Dans quel gouvernement elle se trouve, I. 309. Existe principalement en Angleterre, I. 310 & suiv. Il n’y en a point dans les états où la puissance législative & la puissance exécutrice sont dans la même main, I. 322. Il n’y en a point où la [IV-475] puissance de juger est réunie à la législative & à l’exécutrice, ibid. & suiv. Ce qui la forme dans son rapport avec la constitution de l’état, I. 379. Considérée dans le rapport qu’elle a avec le citoyen : en quoi elle consiste, ibid. Sur quoi est principalement fondée, I. 381, 382. Un homme qui, dans un pays où l’on suit les meilleures lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l’être le lendemain, est plus libre qu’un bacha ne l’est en Turquie, I. 382. Est favorisée par la nature des peines & leur proportion, I. 383 & suiv. Comment on en suspend l’usage dans une république, I. 413, 414. On doit quelquefois, même dans les états les plus libres, jeter un voile dessus, I. 414. Des choses qui l’attaquent dans la monarchie, I. 419 & suiv. Ses rapports avec la levée des tributs & la grandeur des revenus publics, II. I. & suiv. 16. & suiv. Est mortellement attaquée en France, par la façon dont on y leve les impôts sur les boissons, II. 10. L’impôt qui lui est le plus naturel, est celui sur les marchandises, II. 18, 19. Quand on en abuse pour rendre les tributs excessifs, elle dégénere en servitude ; & l’on est obligé de diminuer les tributs, II. 20 & suiv. Causes physiques, qui font qu’il y en a plus en Europe, que dans toutes les autres parties du monde, II. 126 & suiv. Se conserve mieux dans les montagnes qu’ailleurs, II. 141, 142. Les terres sont cultivées en raison de la liberté, & non de la fertilité, II. 142 & suiv. Se maintient mieux dans les îles, que dans le continent, II. 144. Convient dans les pays formés par l’industrie des hommes, II. 145, 146. Celle dont jouissent les peuples qui ne cultivent point les terres est très-grande, II. 153, 154 ; 182. Les Tartares sont une exception à la regle précédente : pourquoi, II. 158 & suiv. Est très-grande chez les peuples qui n’ont pas l’usage de la monnoie, II. 156. Exception à la regle précédente, II. 157. De celle dont jouissent les Arabes, II. 158, 159. Est quelquefois insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumés à en jouir : causes & exemples de cette bizarrerie, II. 186, [IV-476] 187. Est une partie des coutumes d’un peuple libre, II. 219. Effets bizarres & utiles qu’elle produit en Angleterre, II. 220, 221. Facultés que doivent avoir ceux qui en jouissent, II. 224. Celle des Anglois se soutient quelquefois par les emprunts de la nation, II. 225. Ne s’accommode guere de la politesse, II. 234. Rend superbes les nations qui en jouissent, les autres ne sont que vaines, 236. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l’esclavage : pourquoi, II. 236, 237. Est naturelle aux peuples du nord, II. 273, 274. Est acquise aux hommes par les lois politiques : conséquences qui en résultent, III. 224 & suiv. On ne doit point décider par ces lois ce qui ne doit l’être que par celles qui concernent la propriété : conséquences de ce principe, ibid. En quoi elle consiste principalement, III. 233. Dans les commencemens de la monarchie, les question sur la liberté ne pouvoient être jugées que dans les placites du comte,& non dans ceux de ses officiers, IV. 52.
Liberté civile. Époque de sa naissance à Rome, I. 417.
Liberté de sortir du royaume. Devroit être accordée à tous les sujets d’un état despotique, I. 430.
Liberté d’un citoyen. En quoi elle consiste, I. 312 ; 380 & suiv. Il faut quelquefois priver un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous. Cela ne se doit faire que par une loi particuliere & authentique : exemple tiré de l’Angleterre, I. 413. Lois qui y sont favorables, dans la république, I. 414, 415. Un citoyen ne la peut vendre, pour devenir esclave d’un autre, II. 63, 64.
Liberté du commerçant. Est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans ceux où le pouvoir est absolu ; & vice versâ : pourquoi, ibid.
Liberté philosophique. En quoi elle consiste, I. 380.
Liberté politique. En quoi elle consiste, ibid &. 381. Époque de sa naissance à Rome, I. 417.
Libre arbitre. Une religion qui admet ce dogme, a [IV-477] besoin d’être soutenue par des lois moins austeres qu’une autre, III. 141, 142.
Lieutenant. Celui du juge représente les anciens prud’hommes, qu’il étoit obligé de consulter autrefois, III. 397.
Ligne de démarquation. Par qui, & pourquoi établie. N’a pas eu lieu, II. 348.
Lods & ventes. Origine de ce droit, IV. 207.
LOI. Ce mot est celui pour lequel tout l’ouvrage a été composé. Il y est donc présenté sous un très-grand nombre de faces, & sous un très-grand nombre de rapports. On le trouvera ici divisé en autant de classes que l’on a pu apercevoir de différentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement, dans l’ordre qui suit : Loi acilia. Loi de Bondebaud. Loi de Valentinien. Loi des douze tables. Loi du talion. Loi gabinienne. Loi oppienne. Loi poppienne. Loi porcia. Loi salique. Loi valérienne. Loi voconienne. Lois (ce mot pris dans sa signification générique). Lois agraires. Lois barbares. Lois civiles. Lois civiles des François. Lois civiles sur les fiefs. Lois (clergé). Lois (climat). Lois (commerce). Lois (conspiration). Lois cornéliennes. Lois criminelles. Lois d’Angleterre. Lois de Crete. Lois de la Grece. Lois de morale. Lois de l’éducation. Lois de Lycurgue. Lois de Moïse. Lois de M. Pen. Lois de Platon. Lois des Bavarois. Lois des Bourguignons. Lois des Lombards. Lois (despotisme). Lois des Saxons. Lois des Wisigoths. Lois divines. Lois domestiques. Lois du mouvement. Lois (égalité). Lois (esclavage). Lois (Espagne). Lois [IV-478] féodales. Lois (France). Lois humaines. Lois (Japon). Lois juliennes. Lois (liberté). Lois (mariage). Lois (mœurs). Lois (monarchie). Lois (monnoie). Lois naturelles. Lois (Orient). Lois politiques. Lois positives. Lois (république). Lois (religion). Lois ripuaires. Lois romaines. Lois sacrées. Lois (sobriété). Lois somptuaires. Lois (suicide). Lois (terrein).
Loi acilia. Les circonstances où elle a été rendue, en font une des plus sages lois qu’il y ait, I. 179.
Lois de Gondebaud. Quel en étoit le caractere, l’objet, III. 278.
Lois de Valentinien. Permettant la polygamie dans l’empire, pourquoi ne réussit pas, II. 98, 99.
Loi des douze tables. Pourquoi imposoit des peines trop séveres, I. 181. Dans quel cas admettoit la loi du talion, I. 189. Changement sage qu’elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome, I. 365. Ne contenoit aucune disposition touchant les usures, III. 56 & suiv. A qui elle déféroit la succession, III. 243. Pourquoi permettoit à un testateur de se choisir tel citoyen qu’il jugeoit à propos pour héritier, contre toutes les précautions que l’on avoit prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une autre, III. 245, 246. Est-il vrai qu’elle ait autorisé le créancier à couper par morceaux le débiteur insolvable ? III. 408. La différence qu’elle mettoit entre le voleur manifeste, & le voleur non manifeste, n’avoit aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains : d’où cette disposition avoit été tirée, III. 423 & suiv. Comment avoit ratifié la disposition par laquelle elle permettoit de tuer un voleur qui se mettoit en défense, III. 427, 428. Est un modele de précision, III. 428.
Loi du talion. Voyez Talion.
Loi gabinienne. Ce que c’étoit, III. 59, 60.
Loi oppienne. Pourquoi Caton fit des effors pour [IV-479] la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, III. 252.
Loi poppienne. Ses dispositions touchant les mariages, III. 215. Dans quel temps, par qui, & dans quelle vue elle fut faite, III. 259 & suiv.
Loi porcia. Comment rendit sans application celles qui avoient fixé des peines, I. 181.
Loi salique. Origine & explication de celle que nous nommons ainsi, II. 162 & suiv. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N’a jamais eu pour objet les préférences d’un sexe, sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, &c. Elle n’étoit qu’économique : preuves tirées du texte même de cette loi, II. 165 & suiv. Ordre qu’elle avoit établi dans les successions : elle n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, II. 168 & suiv. S’explique par celles des Francs-ripuaires & des Saxons, II. 169 & suiv. C’est elle qui a affecté la couronne aux mâles exclusivement, II. 171, 172. C’est en vertu de sa disposition que tous les freres succédoient également à la couronne, II. 172. Elle ne peut être rédigée qu’après que les Francs furent sortis de la Germanie leur pays, III. 265. Les rois de la premiere race en retrancherent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, & en laisserent subsister tout le fonds, III. 268. Le clergé n’y a point mis la main, comme aux autres lois barbares ; & elle n’a point admis de peines corporelles, ibid. Différence capitale entr’elle & celle des Wisigoths & des Bourguignons, III. 272 & suiv. 297 & suiv. Tarif des sommes qu’elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu’elle mettoit à cet égard entre les Francs & les Romains, ibid. 320. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans les pays des Francs, tandis que le droit romain s’y perdit peu à peu ? III. 276 & suiv. N’avoit point lieu en Bourgogne : preuves, III. 278, 279. Ne fut jamais reçue dans le pays de l’établissement des Goths, III. 279. Comment cessa d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. On y ajouta plusieurs capitulaires, III. 290, 291. Etoit [IV-480] personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l’un & l’autre à la fois, suivant les circonstances ; & c’est cette variation qui est la source de nos coutumes, III. 294 & suiv. N’admit point l’usage des preuves négatives, III. 97 & suiv. Exception à ce qui vient d’être dit, 298, 299 ; 302, 303. N’admit point la preuve par le combat judiciaire, III. 299 & suiv. Admettoit la preuve par l’eau bouillante ? tempérament dont elle usoit pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, III. 302, 303. Pourquoi tomba dans l’oubli, III. 317 & suiv. Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d’avoir laissé son bouclier : reformée à cet égard par Charlemagne, III. 323, 324. Appelle hommes qui sont sous la loi du roi, ce que nous appellons vassaux, IV. 44.
Loi valérienne. Quelle en fut l’occasion ; ce qu’elle contenoit, I. 363 & suiv.
Loi voconienne. Etoit-ce une injustice, dans cette loi, de ne pas permettre d’instituer une femme héritiere, pas même sa fille unique ? III. 200 & suiv. Dans quel temps & à quelle occasion elle fut faite : éclaircissemens sur cette loi, III. 251 & suiv. Comment on trouva, dans les formes judiciaires, le moyen de l’éluder, III. 254 & suiv. Sacrifioit le citoyen & l’homme, & ne s’occupoit que de la république, III. 257, 258. Cas où la loi poppienne en fit cesser la prohibition, en faveur de la propagation, III. 259 & suiv. Pas quel degré on parvint à l’abolir tout-à-fait, III. 260 & suiv.
Lois. Leur définition, I. 1, 2 ; 12. Tous les êtres ont des lois relatives à leur nature ; ce qui prouve l’absurdité de la fatalité imaginée par les matérialistes, ibid. Dérivent de la raison primitive, I. 2. Celles de la création sont les mêmes que celles de la conservation, ibid. Entre celles qui gouvernent les êtres intelligens, il y en a qui sont éternelles : qui elles sont, I. 3, 4. La loi qui prescrit de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antérieure à la loi positive, I. 4. Sont suivies plus constamment par le monde physique, que par le monde intelligent : pourquoi, ibid. [IV-481] Considérées dans le rapport que les peuples ont entr’eux, forment le droit des gens ; dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique ; dans le rapport que tous les citoyens ont entr’eux, forment le droit civil, I. 10. Les rapports qu’elles ont entr’elles, I. 13. Leur rapport avec la force défensive, I. 259 & s. — avec la force offensive, I. 274 & suiv. Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes : 1°. le droit naturel ; 2°. le droit divin ; 3°. le droit ecclésiastique ou canonique ; 4°. le droit des gens ; 5°. le droit politique général ; 6°. le droit politique particulier ; 7°. le droit de conquête ; 8°. le droit civil ; 9°. le droit domestique. C’est dans ces diverses classes qu’il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 191-241. Les êtres intelligens ne suivent pas toujours les leurs, III. 219, 220. Le salut du peuple est la suprême loi. Conséquences qui découlent de cette maxime, III. 236. Le nouvelliste ecclésiastique a donné dans une grande absurdité, en croyant trouver, dans la définition des lois telle que l’auteur la donne, la preuve qu’il est spinosiste ; tandis que cette définition même, & ce qui suit, détruit le systême de Spinosa, D. 224 & suiv.
Lois agraires. Sont utiles dans une démocratie, I. 197. Au défaut d’arts, sont utiles à la propagation, III. 81. Pourquoi Cicéron les regardoit comme funestes, III. 224. Par qui faites à Rome, III. 244, 245.
Lois agraires. Pourquoi le peuple ne cessa de les demander à Rome tous les deux ans, III. 247.
Lois barbares. Doivent servir de modele aux conquérans, I. 280. Quand, & par qui furent rédigées celles des Saliens, Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons & Lombards : simplicité admirable de celles des six premiers de ces peuples ; causes de cette simplicité : pourquoi celles des quatre autres n’en eurent pas tant, III. 265. N’étoient point attachés à un certain territoire ; elles étoient [IV-482] toutes personnelles : pourquoi, III. 270 & suiv. Comment on leur substitua les coutumes, III. 292. En quoi différoient de la loi salique, III. 297 & suiv. Celles qui concernoient les crimes ne pouvoient convenir qu’à des peuples simples & qui avoient une certaine candeur, III. 299. Admettoient toutes, excepté la loi salique, la preuve par le combat singulier, ibid. & suiv. On y trouve des énigmes à chaque pas, III. 320, 321. Les peines qu’elles infligeoient aux criminels étoient toutes pécuniaires, & ne demandoient point de partie publique, III. 373 & suiv. Pourquoi roulent presque toutes sur les troupeaux, IV. 10. Pourquoi sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu’ils n’avoient pas originairement : pourquoi on en a forgé de nouveaux, IV. 35, 36. Ont réglé les compositions avec une précision & une sagesse admirables, IV. 60.
Lois civiles. Celles d’une nation peuvent difficilement convenir à une autre, I. 12. Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites, & relatives au principe & à la nature de son gouvernement : au physique & au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations & à la religion des habitans, I. 12, 13 ; 38 ; 82. & suiv. 102 & suiv. Qui sont celles qui dérivent de la nature du gouvernement, I. 15 & suiv. Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement, I. 113. Différens degrés de simplicité qu’elles doivent avoir dans les différens gouvernemens, I. 146. Dans quel gouvernement & dans quel cas on en doit suivre le texte dans les jugemens, 154. A force d’être séveres, elles deviennent impuissantes : exemple tiré du Japon, I. 174 & suiv. Dans quel cas, & pourquoi elles donnent leur confiance aux hommes, I. 187. Peuvent régler ce qu’on doit aux autres, non tout ce qu’on se doit à soi même, I. 213. Sont tout à la fois clair-voyantes & aveugles : quand, & par qui leur rigidité doit être modérée, I. 327. Les prétextes spécieux que l’on emploie pour faire paroître justes celles qui sont les plus injustes, sont [IV-483] la preuve de la dépravation d’une nation, I. 411. Doivent être différentes chez les différens peuples, suivant qu’ils sont plus ou moins communicatifs, II. 48, 49. De celles des peuples qui ne cultivent point les terres, II. 152. Celles des peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie, II. 155, 156. Celles des Tartares, au sujet des successions, II. 161, 162. Quelle est celle des Germains d’où l’on a tiré ce que nous appellons la loi salique, II. 162 & suiv. Considérées dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’esprit général, les mœurs & les manieres d’une nation, II. 185-237. Combien, pour les meilleurs lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés, II. 186, 187. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, les mœurs, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189. Differences entre leurs effets, & ceux des mœurs, II. 198, 199. Ce que c’est, II. 200. Ce n’est point par leur moyen que l’on doit changer les mœurs & les manieres d’une nation, II. 200 & suiv. Différence entre les lois & les mœurs, II. 203. Ce ne sont point les lois qui ont établi les mœurs, ibid. & suiv. Comment doivent être relatives aux mœurs & aux manieres, II. 213. Comment peuvent contribuer à former les mœurs, les manieres & le caractere d’une nation, II. 19 & suiv. Considérées dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans, III. 62, 122. Celles qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, III. 143. Rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 191-241. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle : exemples, III. 194 & suiv. Reglent seules les successions & le partage des biens, III. 200 & suiv. Seules, avec les lois politiques, décident, dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d’autres, III. 202. Seules, avec les lois politiques reglent les droits des bâtards, III. 203. Leur objet, III. 207. Dans quel cas doivent être suivies lorsqu’elles [IV-484] permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 210, 211. Cas d’où elles dépendent des mœurs & des manieres, III. 222. Leurs défenses sont accidentelles, ibid. Les hommes leur ont sacrifié la communauté naturelle des biens : conséquences qui en résultent, III. 223 & suiv. Sont le palladium de la propriété, III. 224. Il est absurde de réclamer celle de quelque peuple que ce soit, quand il s’agit de régler la succession à la couronne, III. 227, 228. Il faut examiner si celles qui paroissent se contredire sont du même ordre, III. 230, 231. Ne doivent pas décider les choses qui sont du ressort des lois domestiques, III. 231, 232. Ne doivent pas décider les choses qui dépendent du droit des gens, III. 233, 234. On est libre, quand c’est elles qui gouvernent, III. 233. Leur puissance & leur autorité ne sont pas la même chose, III. 238. Il y en a d’un ordre particulier, qui sont celles de la police, III. 238, 239. Il ne faut pas confondre leur violation avec celles de la simple police, ibid. Il n’est pas impossible qu’elles n’obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles sont telles qu’elles ne forcent que les honnêtes gens à les éluder, III. 258. De la maniere de les composer, III. 407-440. Celles qui paroissent s’éloigner des vues du législateur y sont souvent conformes, III. 409, 410. De celles qui choquent les vues du législateur, III. 410 & suiv. Exemple d’une loi qui est en contradiction avec elle-même, III. 411, 412. Celles qui paroissent les mêmes n’ont pas toujours le même effet, ni le même motif, III. 412 & suiv. Nécessité des les bien composer, III. 413, 414. Celles qui paroissent contraires, dérivent quelquefois du même esprit, III. 418. De quelle maniere celles qui sont diverses peuvent être comparées, III. 419, 420. Celles qui paroissent les mêmes sont quelquefois réellement différentes, III. 421, 422. Ne doivent point être séparées de l’objet pour lequel elles sont faites, III. 422 & suiv. Dépendent des lois politiques : pourquoi, III. 424, 425. Ne doivent point être séparées des circonstances dans lesquelles elles [IV-485] ont été faites, III. 426, 427. Il est bon quelquefois qu’elles se corrigent elles-mêmes, III. 427, 428. Précautions que doivent apporter celles qui permettent de se faire justice à soi-même, ibid. Comment doivent être composées quant au style, & quant au fond des choses, III. 428 & suiv. Leur présomption vaut mieux que celle de l’homme, III. 434, 435. On n’en doit point faire d’inutiles : exemple tiré de la loi salcidie, III. 435, 436. C’est une mauvaise maniere de les faire par des rescrits, comme faisoient les empereurs romains : pourquoi, III. 437, 438. Est-il nécessaire qu’elles soient uniformes dans un état ? III. 439. Se sentent toujours des passions & des préjugés du législateur, III. 440.
Lois civiles des François. Leur origine & leurs révolutions, III. 265-406.
Lois civiles sur les fiefs. Leur origine, IV. 215.
Lois (clergé). Bornes qu’elles doivent mettre aux richesses du clergé, III. 271 & suiv.
Loi (climat). Leur rapport avec la nature du climat, II. 31-60. Doivent exciter les hommes à la culture des terres, dans les climats chauds : pourquoi, II. 43. De celles qui ont rapport aux maladies du climat, II. 49 & suiv. La confiance qu’elles ont dans le peuple est différente, selon les climats, II. 58 & suiv. Comment celles de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 61 & suiv.
Loi (commerce). Des lois considérées dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature & ses distinctions, II. 238-269. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, II. 256. De celles qui établissent la sureté du commerce, II. 257 & suiv. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde, II. 270-362. Des lois du commerce aux Indes, II. 348. Lois fondamentales du commerce de l’Europe, II. 349.
Lois (conspiration). Précautions que l’on doit apporter dans les lois qui regardent la révélation des conspirations, I. 408, 409.
[IV-486]
Lois cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs, I. 182.
Lois criminelles. Les différens degrés de simplicité qu’elles doivent avoir dans les différens gouvernemens, I. 151 & suiv. Combien on a été de temps à les perfectionner ; combien elles étoient imparfaites à Cumes, à Rome sous les premiers rois, en France sous les premiers rois, I. 381. La liberté du citoyen dépend principalement de leur bonté, I. 381, 382. Un homme qui, dans un état où l’on suit les meilleures lois criminelles qui soient possibles, est condamné à être pendu, & doit l’être le lendemain, est plus libre qu’un bacha en Turquie, I. 382. Comment on peut parvenir à faire les meilleures qu’il soit possible, ibid. Doivent tirer chaque peine de la nature du crime, I. 383 & suiv. Ne doivent punir que les actions extérieures, I. 400. Le criminel qu’elles font mourir ne peut réclamer contre elles, puisque c’est parce qu’elles le font mourir qu’elles lui ont sauvé la vie à tous les instans, III. 65. En fait de religion, les lois criminelles n’ont d’effets que comme destruction, III. 181, 182. Celle qui permet aux enfans d’accuser leur pere de vol ou d’adultere, est contraire à la nature, III. 197. Celles qui sont les plus cruelles peuvent-elle être les meilleures ? III. 408.
Lois d’Angleterre. Ont été produites en partie par le climat, II. 219, 220. Voyez Angleterre.
Lois de Crete. Sont l’original sur lequel on a copié celles de Lacédémone, I. 71.
Lois de la Grece. Celles de Minos, de Lycurgue & de Platon ne peuvent subsister que dans un petit état, I. 75. Ont puni, ainsi que les lois romaines, l’homicide de soi-même, sans avoir le même objet, III. 415 & suiv. Source de plusieurs lois abominables de la Grece, III. 426, 427.
Lois de la morale. Quel en est le principal effet, I. 6.
Lois de l’éducation. Doivent être relatives aux principes du gouvernement, I. 59 & suiv.
Lois de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent la grandeur de son génie, I. 71, 72. [IV-487] Ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 75.
Lois de Moïse. Leur sagesse, au sujet des asiles, III. 168.
Lois de M. Pen. Comparées avec celles de Lycurgue, I. 72.
Lois de Platon. Étoient la correction de celles de Lacédémone, I. 71.
Lois des Bavarois. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu’eut cette opération, III. 290, 291.
Lois des Bourguignons. Sont assez judicieuses, III. 270. Comment cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv.
Lois des Lombards. Les changemens qu’elles essuyerent furent plutôt des additions que des changemens, III. 267. Sont assez judicieuses, III. 270. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu’eut cette opération, III. 290, 291.
Lois (despotisme). Il n’y a point de lois fondamentales dans les états despotiques, I. 35. Qui sont celles qui dérivent de l’état despotique, I. 36, 37. Il en faut un très-petit nombre dans un état despotique, I. 118. Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, ibid. La volonté du prince est la seule loi dans les états despotiques, I. 120 ; 134. Causes de leur simplicité dans les états despotiques, I. 149 & suiv. Celles qui ordonnent aux enfans de n’avoir d’autre profession que celle de leur pere, ne sont bonnes que dans un état despotique, II. 264.
Lois des Saxons. Causes de leur dureté, III. 269.
Lois des Wisigoths. Furent refondues par leurs rois, & par le clergé. Ce fut le clergé qui y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III. 267, 268. C’est de ces lois qu’ont été tirées toutes celles de l’inquisition : les moines n’ont fait que les copier, III. 269, 270. Sont idiotes, n’atteignent point le but, frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style, III. 270. Triompherent en Espagne, & le droit romain s’y perdit, III. 284. Il y en a une qui fut [IV-488] transformée en capitulaire par un malheureux compilateur, III. 286, 287. Comment cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. L’ignorance de l’écriture les a fait tomber en Espagne, III. 292.
Lois divines. Rappellent sans cesse l’homme à Dieu, qu’il auroit oublié à tous les instants, I. 6. C’est un grand principe qu’elles sont d’une autre nature que les lois humaines.
Autres principes auxquels celui-là est soumis : 1°. Les lois divines sont invariables : les lois humaines sont variables. 2°. La principale force des lois divines vient de ce qu’on croit la religion ; elles doivent donc être anciennes : la principale force des lois humaines vient de la crainte ; elles peuvent donc être nouvelles, III. 193, 194.
Lois domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur ressort par les lois civiles, III. 231, 232.
Lois du mouvement. Son invariables, I. 2.
Lois (égalité). Loi singuliere qui, en introduisant l’égalité, la rend odieuse, I. 91.
Lois (esclavage). Comment celles de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 61-95. Ce qu’elles doivent faire par rapport à l’esclavage, II. 77. Comment celles de l’esclavage domestique ont du rapport avec celles du climat, II. 96-123. Comment celles de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat, II. 124-138.
Lois (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur l’emploi de l’or & de l’argent, II. 359.
Lois féodales. Ont pu avoir des raisons pour appeler les mâles à la succession, à l’exclusion des filles, III. 201. Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les lois féodales que par les lois politiques, III. 288. Quand s’établirent, III. 289. Théorie de ces lois, dans le rapport qu’elles ont avec la monarchie, IV. 1-107. Leurs effets : comparés à un chêne antique, IV. 2. Leurs sources, IV. 3, 4.
Lois (France). Les anciennes lois de France étoient parfaitement dans l’esprit de la monarchie, I. 169. [IV-489] Ne doivent point, en France, gêner les manieres ; elles gêneroient les vertus, II. 190, 191. Quand commencerent, en France, à plier sous l’autorité des coutumes, III. 295, 296.
Lois (Germains). Leurs différens caracteres, III. 265 & suiv.
Lois humaines. Tirent leur principal avantage de leur nouveauté, III. 194. Voyez Lois divines.
Lois (Japon). Pourquoi sont si séveres au Japon, II. 58, 59. Tyrannisent le Japon, II. 189. Punissent au Japon la moindre désobéissance ; c’est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse, III. 188.
Lois juliennes. Avoient rendu le crime de lese-majesté arbitraire, I. 398, 399. Ce que c’étoit, III. 92 & suiv. On n’en a plus que des fragmens : où se trouvent ces fragmens : détail de leurs dispositions contre le célibat, III. 95 & suiv.
Lois (liberté). De celles qui forment la liberté publique dans son rapport avec la contribution, I. 306-378. De celles qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, I. 379-430. Comment forment la liberté du citoyen, I. 380. Paradoxe sur la liberté, I. 382. Authenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que c’est pour conserver celle de tous, I. 413, 414. De celles qui sont favorables à la liberté des citoyens, dans une république, I. 414, 415. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques, I. 427 & suiv. N’ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, II. 64. Peuvent être telles, que les travaux les plus pénibles soient faits par des hommes libres & heureux, II. 73, 74.
Lois (mariage). Ont, dans certains pays, établi divers ordres de femmes légitimes, III. 69, 70. Dans quel cas il faut suivre les lois civiles, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, III. 213 & suiv. Dans quel cas les lois civiles doivent régler les mariages entre parens ; dans quel cas ils doivent être par les lois de la nature, III. 216 & suiv. [IV-490] Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages incestueux : quels ils sont, III. 221. Permettent ou défendent les mariages, selon qu’ils paroissent conformes ou contraires à la loi naturelle, dans les différens pays, ibid. & suiv.
Lois (mœurs). Les lois touchant la pudicité sont du droit naturel : elles doivent, dans tous les états, protéger l’honneur des femmes esclaves, comme celui des femmes libres, II. 78. Leur simplicité dépend de la bonté des mœurs du peuple, II. 214. Comment suivent les mœurs, ibid. & suiv.
Lois (monarchie). Arrêtent les entreprises tyranniques des monarques, n’ont aucun pouvoir sur celles d’un citoyen subitement revêtu d’une autorité qu’elles n’ont pas prévue, I. 27. La monarchie a pour base les lois fondamentales de l’état, II. 31 ; 49. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement monarchique, ibid. & suiv. Doivent, dans une monarchie, avoir un dépôt fixe : quel est ce dépôt, I. 34, 35. Tiennent lieu de vertu dans une monarchie, I. 46, 49. Jointes à l’honneur, produisent dans une monarchie le même effet que la vertu, I. 49. L’honneur leur donne la vie, dans une monarchie, I. 52. Combien sont relatives à leur principe, dans une monarchie, I. 110 & suiv. Doivent-elles contraindre les citoyens d’accepter les emplois ? I. 138. Le monarque ne peut les enfreindre sans danger, I. 162, 163. Leur exécution, dans la monarchie, fait la sureté & le bonheur du monarque, II. 420, 421. Doivent menacer, & le prince encourager, I. 424.
Lois (monnoie). Leur rapport avec l’usage de la monnoie, II. 1-64.
Lois naturelles. Regles pour les discerner d’avec les autres, I. 6, 7. Quelle est la premiere de ces lois : son importance, I. 7. Quelles sont les premieres dans l’ordre de la nature même, I. 8, 9. Obligent les peres à nourrir leurs enfants ; mais non pas à les faire héritiers, III. 200 & suiv. C’est par elles qu’il faut décider, dans les cas qui les regardent, & non pas les préceptes de la religion, III. 304. Dans quel cas doivent régler les mariages entre parens ; [IV-491] dans quel cas ils doivent l’être par les lois civiles, III. 216 & suiv. Ne peuvent être locales, III. 221. Leur défense est invariable, III. 222. Est-ce un crime de dire que la premiere loi de la nature est la paix ; & que la plus importante est celle qui prescrit à l’home ses devoirs envers Dieu ? D. 240 & suiv.
Lois (orient). Raisons physiques de leur immutabilité en orient, II. 40, 41.
Lois politiques. Quel est leur principal effet, I. 6. De celles des peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie, II. 156. La religion chrétienne veut que les hommes ayent les meilleures qui sont possibles, III. 124. Principe fondamental de celles qui concernent la religion, III. 179. Elles seules, avec les lois civiles, reglent les successions & le partage des biens, III. 200 & suiv. Seules, avec les lois civiles, décident dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d’autres, III. 202. Seules, avec les lois civiles, reglent les successions des bâtards, III. 203. Les hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle : conséquences qui en résultent, III. 223 & suiv. Reglent seules la succession à la couronne, III. 227, 228. Ce n’est point par ces lois que l’on doit décider ce qui est du droit des gens, III. 234 & suiv. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l’état, doit être changée, III. 236 & suiv. Les lois civiles en dépendent : pourquoi, III. 424, 425.
Lois positives. Leur origine, I. 9 & suiv. Ont moins de force dans une monarchie que les lois de l’honneur, I. 66.
Lois (républiques). Celles qui établissent le droit de suffrage dans la démocratie sont fondamentales, I. 16. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain ; & premiérement de la démocratie, ibid. & suiv. Par qui doivent être faites dans une démocratie, I. 25. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement aristocratique, ibid? & suiv. Qui sont ceux qui les font, & qui les font [IV-492] exécuter dans l’aristocratie, I. 26. Avec quelle exactitude elles doivent être maintenues dans une république, I. 40. Modeles de celles qui peuvent maintenir l’égalité dans une démocratie, I. 89 ; 91. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à forcer les nobles de rendre justice au peuple, I. 107, 108. De leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, I. 415 & suiv.
Lois (religion). Quel en est l’effet principal, I. 6. Quelles sont les principales qui furent faites dans l’objet de la perfection chrétienne, III. 106, 107. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses principes & en elle-même, III. 123-160. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures lois civiles qui soient possibles, III. 124. Celles d’une religion qui n’ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doivent être des conseils, & non des préceptes, III. 134. Celles d’une religion, quelle qu’elle soit, doivent s’accorder avec celles de la morale, III. 135 & suiv. Comment la force de la religion doit s’appliquer à la leur, III. 141 & suiv. Il est bien dangereux que les lois civiles ne permettent ce que la religion devroit défendre, quand celle-ci défend ce qu’elle devroit permettre, III. 142, 143. Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses, & point de peines, III. 144. Comment corrigent quelquefois les fausses religions, III. 144, 145. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles, III. 148, 149. Du rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de chaque pays, & sa police extérieure, III. 161-190. Il faut dans la religion des lois d’épargne, III. 175. Comment doivent être dirigées celles d’un état qui tolere plusieurs religions, III. 178, 179. Dans quels cas les lois civiles doivent être suivies lorsqu’elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 210, 211. Quand doit-on, à l’égard des mariages suivre les lois civiles plutôt que celles de la religion, III. 213 & suiv.
[IV-493]
Lois ripuaires. Fixoient la majorité à quinze ans, II. 176. Les rois de la premiere race en ôterent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, & en laisserent tout le fond, III. 268. Le clergé n’y a point mis la main, & elles n’ont point admis de peines corporelles, ibid. Comment cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Se contentoient de la preuve négative : en quoi consistoit cette preuve, III. 298.
Lois romaines. Histoire, & causes de leurs révolutions, I. 180 & suiv. Celles qui avoient pour objet de maintenir les femmes dans la frugalité, I. 219, 220. La dureté des lois romaines contre les esclaves rendit les esclaves plus à craindre, II. 83 & suiv. Leur beauté : leur humanité, II. 339. Comment on éludoit celles qui étoient contre l’usure, III. 53 & suiv. Mesures qu’elles avoient prises pour prévenir le concubinage, III. 71, 72. — pour la propagation de l’espece, III. 90 & suiv. — touchant l’exposition des enfans, III. 110 & suiv. Leur origine & leurs révolutions sur les successions, III. 242-264. De celles qui regardoient les testamens. De la vente que le testateur faisoit de sa famille, à celui qu’il instituoit son héritier, III. 248 & suiv. Les premieres ne restreignirent pas assez les richesses des femmes, laisserent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remédier, III. 251 & suiv. Comment se perdirent dans le domaine des Francs, & se conserverent dans celui des Goths & des Bourguignons, III. 275 & suiv. Pourquoi, sous la premiere race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernoit par la loi salique, III. 277. Comment se conserverent dans le domaine des Lombards, III. 282, 283. Comment se perdirent en Espagne, III. 284 & suiv. Subsisterent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois wisigoths : pourquoi, III. 285 & suiv. Pourquoi, dans les pays de droit écrit, elles ont résisté aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparoître les lois barbares, III. 292. Révolutions qu’elles ont essuyées dans les pays de droit écrit, [IV-494] III. 296, 297. Comment résisterent, dans les pays de droit écrit, à l’ignorance qui fit périr par-tout ailleurs les lois personnelles & territoriales, ibid. Pourquoi tomberent dans l’oubli, III. 317 & suiv. Saint Louis les fit traduire : dans quelles vue, III. 383. Motifs de leurs dispositions touchant les substitutions, III. 414, 415. Quand, & dans quel cas elles ont commencé à punir le suicide, III. 415 & suiv. Celles qui concernoient le vol n’avoient aucune liaison avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Punissoient par la déportation ou même par la mort la négligence ou l’impéritie des médecins, III. 426, 427. Celles du bas empire font parler les princes comme des rhéteurs, III. 429. Précaution que doivent prendre ceux qui les lisent, III. 438. Voyez Droit romain. Romains. Rome.
Lois sacrées. Avantages qu’elles procurerent aux plébéiens à Rome, I. 364.
Lois (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, II. 46 & suiv. Regles que l’on doit suivre dans celles qui concernent l’ivrognerie, II. 47, 48.
Lois somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, I. 196, 197. — dans une aristocratie, I. 198, 199. Il n’en faut point dans une monarchie, I. 200 & suiv. Dans quel cas sont utiles dans une monarchie, I. 203. Regles qu’il faut suivre pour les admettre, ou pour les rejetter, I. 205. Quelles elles étoient chez les Romains, I. 219, 220.
Lois (suicide). De celles contre ceux qui se tuent eux-mêmes, I. 52, 53.
Lois (terrein). Leur rapport avec la nature du terrein, II. 139-184. Celle que l’on fait pour la sureté du peuple ont moins lieu dans les montagnes qu’ailleurs, II. 141, 142. Se conservent plus aisément dans les îles, que dans le continent, II. 144. Doivent être plus ou moins multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsistance, II. 148.
[IV-495]
Lombards. Avoient une loi en faveur de la pudeur des femmes esclaves, qui seroit bonne pour tous les gouvernements, II. 78, 79. Quand, & pourquoi firent écrire leurs lois, III. 266. Pourquoi leur lois perdirent de leur caractere, III. 267. Leurs lois reçurent plutôt des additions que des changemens : pourquoi ces additions furent faites, ibid. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, III. 282, 283. On ajouta plusieurs capitulaires à leurs lois : suites qu’eut cette opération, III. 290, 291. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Suivant leurs lois, quand on s’étoit défendu par un serment, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat, III. 301. Porterent l’usage du combat judiciaire en Italie, III. 314. Leurs lois portoient différentes compositions pour les différentes insultes, III. 320. Leurs lois défendoient aux combattans d’avoir sur eux des herbes propres pour les enchantemens, III. 325. Loi absurde parmi eux, III. 431. Pourquoi augmenterent en Italie les compositions qu’ils avoient apportées de la Germanie, IV. 60. Leurs lois sont sensées, IV. 65.
Louis I, dit le débonnaire. Ce qu’il fit de mieux dans tout son regne, I. 280. La fameuse lettre qui lui est adressée par Agobard prouve que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, III. 278, 279. Etendit le combat judiciaire, des affaires criminelles, aux affaires civiles, III. 314. Permit de choisir, pour se battre en duel, le bâton ou les armes, III. 321. Son humiliation lui fut causée par les évêques, & sur-tout par ceux qu’il avoit tirés de la servitude, IV. 99, 100. Pourquoi laissa au peuple romain le droit d’élire les papes, IV. 155. Portrait de ce prince. Causes de ses disgraces, IV. 168 & suiv. Son gouvernement comparé avec ceux de Charles Martel, de Pépin & de Charlemagne. Comment perdit son autorité, IV. 172 & suiv. Perdit la monarchie & son autorité, principalement par la dissipation de ses domaines, IV. 174 & suiv. Causes des troubles qui suivirent sa mort, IV. 176 & suiv.
[IV-496]
Louis VI. dit le gros. Réforme la coutume où étoient les juges de se battre contre ceux qui refusoient de se soumettre à leurs ordonnances, III. 319.
Louis VII, dit le jeune. Défendit de se battre pour moins de cinq sols, III. 319.
Louis IX. (saint) Il suffisoit, de son temps, qu’une dette montâte à douze deniers, pour que le demandeur & le défendeur terminassent leur querelles par le combat judiciaire, ibid. C’est dans la lecture de ses établissements qu’il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, III. 328. Est le premier qui ait contribué à l’abolition du combat judiciaire, III. 357 & suiv. État & variété de la jurisprudence de son temps, ibid. N’a pas pu avoir intention de faire de ses établissemens une loi générale pour tout son royaume, III. 378, 379. Comment ses établissemens tomberent dans l’oubli, III. 377 & suiv. La date de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons, sous le nom de ses établissemens, est plein de faussetés, III. 379, 380. Sagesse adroite avec laquelle il travailla à réformer les abus de la jurisprudence de son temps, III. 382 & suiv. Fit traduire les lois romaines : dans quelle vue : cette traduction existe encore en manuscrit : il en fit beaucoup usage dans ses établissemens, III. 383 ; 394. Comment il fut cause qu’il s’établit une jurisprudence universelle dans le royaume, III. 386 & suiv. Ses établissemens sont une des sources de nos coutumes en France, III. 402. Les ouvrages des habiles praticiens de son temps, sont une des sources des coutumes de France, III. 403, 404.
Louis XIII. Repris en face par le président de Bellievre, lorsque ce prince étoit du nombre des juges du duc de la Vallette, I. 160, 161. Motif singulier qui le détermina à souffrir que les negres de ses colonies fussent esclaves, II. 67, 68.
Louis XIV. Le projet de la monarchie universelle, qu’on lui attribue sans fondement, ne pouvoit réussir sans ruiner l’Europe, ses anciens sujets, lui & sa famille, I. 270, 271. La France fut vers le milieu de son regne, au plus haut point de sa [IV-497] grandeur relative, I. 272/ Son édit en faveur des mariages n’étoit pas suffisant pour favoriser la population, III. 116.
Loyseau. Erreur de cet auteur sur l’origine des justices seigneuriales, IV. 72, 73.
Luques. Combien y durent les magistratures, I. 30.
Luther. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion, III. 132. Il semble s’être plus conformé à ce que les Apôtres ont fait, qu’à ce que Jesus-Christ a dit, ibid.
Luxe. Quand les fortunes sont égales dans un état, il n’y a point de luxe : il augmente à proportion de leur inégalité : preuves, I. 193 & suiv. Ses différentes causes, ibid. Comment on en peut calculer les proportions, I. 194. Est en proportion avec la grandeur des villes, I. 195. Confond toutes les conditions : comment, I. 195, 196. Incommodités qu’il cause, I. 196. Perdit Rome, I. 198. Doit être banni d’une aristocratie, I. 198, 199. Par quel usage on avoit prévenu, dans la Grece, celui des riches, I. 199. Est nécessaire dans une monarchie, I. 200 & suiv. Est nécessaire dans les états despotiques, I. 202. Fait finir les républiques, ibid. Quelles regles il faut suivre pour l’encourager, ou pour le proscrire, I. 205, 206. Peut-il y en avoir en Angleterre ? . 205. — en France ? ibid. — à la chine ? ibid. & suiv. Entraîne toujours après lui l’incontinence publique, I. 219, 220. Quelle est l’époque de son entrée à Rome, I. 220. Vient de la vanité, II. 193, 194. Celui d’Angleterre n’est pas comme celui des autres états, II. 233, 234. Sa cause & ses effets, II. 276, 277. Comment celui des femmes peut être arrêté dans une république, III. 263.
Luxe de la superstition. Doit être réprimé, III. 174 & suiv.
Lybie. C’est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon puisse être bonne : raisons physiques, III. 159.
Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hollande : c’est le modele d’une bonne république fédérative, I. 264, 265.
[IV-498]
Lycurgue. Comparé avec M. Pen, I. 72. Les contradictions apparentes, qui se trouvent dans ses lois, prouvent la grandeur de son génie, I. 71, 72. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 75. Pourquoi voulut qu’on ne choisît les sénateurs que parmi les vieillards, I. 99. A confondu les lois, les mœurs & les manieres, pourquoi, II. 203 & suiv. Pourquoi avoit ordonné que l’on exerçat les enfans au larcin, III. 423, 424.
Lydiens. Le traitement qu’ils reçurent de Cyrus n’étoit pas conforme aux vraies maximes de la politique, I. 291. Furent les premiers qui trouverent l’art de battre la monnoie, III. 3, 4.
Lysandre. Fit éprouver aux Athéniens qu’il faut toujours mettre de la douceur dans les punitions, I. 173.
M
Macassar. Conséquences funestes que l’on tire du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 151.
Machiavel. Veut que le peuple, dans une république, juge les crimes de lese-majesté : inconvéniens de cette opinion, I. 157 & suiv. Source de la plupart de ses erreurs, III. 440.
Machiavélisme. C’est aux lettres de change que l’on en doit l’abolissement, II. 345.
Machines. Celles dont l’objet est d’abréger l’art ne sont pas toujours utiles, II. 82, 83.
Macure. Ce que c’est que cette monnoie chez les Africains, III. 14.
Magie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonspection : exemples d’injustices commises sous ce prétexte, I. 388 & suiv. Il seroit aisé de prouver que ce crime n’existe point, I. 392.
Magistrat de police. C’est sa faute si ceux qui relevent de lui tombent dans des excès, III. 239, 240.
Magistrat unique. Dans quel gouvernement il peut y en avoir, I. 164.
Magistrats. Par qui doivent être nommés dans la démocratie, I. 18. Comment élus à Athenes : on les examinoit avant & après leur magistrature, I. 22, [IV-499] 23. Quelles doivent être, dans une république, la proportion de leur puissance, & la durée de leurs charges, I. 29. Jusqu’à quel point les citoyens leur doivent être subordonnés dans une démocratie, I. 100. Ne doivent recevoir aucun présent, I. 136. Ne doivent jamais être dépositaires des trois pouvoirs à la fois, I. 313, 314. Ne sont point propres à gouverner une armée ; exception pour la Hollande, I. 131 & suiv. Sont plus formidables aux calomniateurs que le prince, I. 422. Le respect & la considération sont leur unique récompense, II. 30. Leur fortune & leur récompense en France, II. 263 & suiv. Les mariages doivent-ils dépendre de leur consentement ? III. 73, 64.
Magistrature. Comment & à qui se donnoient, à Athenes, I. 22, 23. Comment Solon en éloigna ceux qui en étoient indignes, sans gêner les suffrages, ibid. Ceux qui avoient des enfans y parvenoient plus facilement à Rome, que ceux qui n’en avoient point, III. 97 & suiv. Voyez Magistrats.
Mahomet. La loi par laquelle il défend de boire du vin, est une loi de climat, II. 47. Coucha avec sa femme lorsquelle n’avoit que huir ans, II. 96. Veut que l’égalité soit entiere, à tous égards, entre les quatre femmes qu’il permet, II. 105. Comment rendit les Arabes conquérans, II. 352. A confondu l’usure avec l’intérêt : maux que produit cette erreur dans les pays soumis à sa loi, III. 51, 52. Sa doctrine sur la spéculation, & le penchant que sa religion inspire pour la spéculation, sont funestes à la société, III. 138, 139. Source & effet de sa prédestination, III. 141, 142. C’est par le secours de la religion qu’il réprima les injures & les injustices des Arabes, III. 147. Dans tout autre pays que le sien, il n’auroit pas fait un précepte des fréquentes lotions, III. 159. L’inquisition met sa religion de pair avec la religion chrétienne, III. 184, 185.
Mahométans. Furent redevables de l’étrange facilité de leurs conquêtes aux tributs que les empereurs levoient sur leurs peuples, II. 22, 23. Sont [IV-500] maîtres de la vie, & même de ce qu’on appelle la vertu ou l’honneur de leurs femmes esclaves : c’est un abus de l’esclavage, contraire à l’esprit de l’esclavage même, II. 77, 78. Sont jaloux par principe de religion, II. 114, 115. Il y a chez eux plusieurs ordres de femmes légitimes, III. 69. Leur religion est favorable à la propagation, III. 107. Pourquoi sont contemplatifs, III. 138. Raison singuliere qui leur fait détester les Indiens, III. 154. Motifs qui les attachent à leur religion, III. 163, 164. Pourquoi Gengis-kan, approuvant leurs dogmes, méprisa si fort leurs mosquées, III. 166. Sont les seuls orientaux intolérans en fait de religion, III. 189.
Mahométisme. Maxime funeste de cette religion, I. 126. Pourquoi a trouvé tant de facilité à s’établir en Asie, & si peu en Europe, II. 98, 99. Le despotisme lui convient mieux que le gouvernement modéré, II. 127 & suiv. Maux qu’il cause comparés avec les biens que cause le christianisme, III. 128, 129. Il semble que le climat lui a prescrit des bornes, III. 160.
Mainmortables. Comment les terres, de libres, sont devenues mainmortables, IV. 24.
Mainmorte. Voyez Clergé. Monasteres.
Majorats. Pernicieux dans une aristocratie, I. 109.
Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds, & dans les états despotiques, qu’ailleurs, I. 129. A quel âge les Germains & leurs rois étoient majeurs, II. 175 & suiv. S’acquéroit chez les Germains par les armes, II. 175 & suiv. 179. C’est la vertu qui faisoit la majorité chez les Goths, II. 176. Etoit fixée par la loi des Ripuaires, à quinze ans, ibid — & chez les Bourguignos, II. 177. L’âge où elle étoit acquise chez les Francs a varié, ibid.
Maires du palais. Leur autorité & leur perpétuité commença à s’établir sous Clotaire, IV. 109, 110. De maires du roi, ils devinrent maires du royaume : le roi les choisissoit d’abord ; la nation les choisit. On eut plus de confiance dans une autorité qui mouroit avec la personne, que dans celle [IV-501] qui étoit héréditaire. Tel est le progrès de leur grandeur, IV. 119 & suiv. C’est dans les mœurs des Germains qu’il faut chercher la raison de leur autorité, & de la foiblesse du roi, IV. 123 & suiv. Comment parvinrent au commandement des armées, IV. 125. & suiv. Epoque de leur grandeur, IV. 128 & suiv. Il étoit de leur intérêt de laisser les grands offices de la couronne inamovibles, comme ils les avoient trouvés, IV. 130 & suiv. La royauté & la mairerie furent confondues à l’avénement de Pépin à la couronne, IV. 158 & suiv.
Mal vénérien. D’où il nous est venu : comment on auroit dû en arrêter la communication, II. 52.
Malabar. Motif de la loi qui y permet à une seule femme d’avoit plusieurs maris, II. 102.
Malais. Causes de la fureur de ceux qui, chez eux, sont coupables d’un homicide, III. 148.
Maldives. Excellente coutume pratiquée dans ces îles, I. 429. L’égalité doit être entiere entre les trois femmes qu’on y peut épouser, II. 105. On y marie les filles à dix & oner ans, pour ne pas leur laisser endurer nécessité d’hommes, II. 111. On y peut reprendre une femme qu’on a répudiée : cette loi n’est pas censée, II. 117, 118. Les mariages entre parens au quatrieme degré y sont prohibé : on n’y tient cette loi que de la nature, III. 210.
Maltôte. C’est un art qui ne se montre que quand les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts, IV. 25. Cet art n’entre point dans les idées d’un peuple simple, IV. 33.
Mammelus. Leur exemple ne prouve pas que le grand nombre d’esclaves est dangereux dans un état despotique, II. 80.
Mandarins chinois. Leurs brigandages, I. 255.
Manieres. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. De là naît l’esprit général d’une nation, II. 189?. Gouvernent les Chinois, ibid. Changent chez eux un peuple à mesure qu’il est sociable, II. 192, 193. Celles d’un état despotique ne doivent jamais être changées ; pourquoi, II. 198, 199. Différence [IV-502] qu’il y a entre les mœurs & les manieres, II. 203. Comment celles d’une nation peuvent être formées par les lois, II. 219 & suiv. Cas où les lois en dépendent, II. 222 & suiv.
Manlius. Moyens qu’il employoit pour réussir dans ses desseins ambitieux, I. 417.
Mansus. Ce que signifie ce mot dans le langage des capitulaires, IV. 32.
Manuel Commene. Injustices commises sous son regne, sous prétexte de magie, I. 389.
Manufactures. Sont nécessaires dans nos gouvernemens ; doit-on chercher à en simplifier les machines ? III. 81 & suiv.
Marc Antonin. Sénatus-consulte qu’il fit prononcer touchant les mariages, III. 215.
Marchands. Il est bon, dans les gouvernemens despotiques, qu’ils ayent une sauvegarde personnelle, II. 14. Leurs fonctions & leur utilité dans un état modéré, II. 19, 20. Ne doivent point être gênés par les difficultés des fermiers, II. 255. Les Romains les rangeoient dans la classe des plus vils habitans, II. 329.
Marchandises. Les impôts que l’on met sur les marchandises sont les plus commodes & les moins onéreux, II. 9, 10. Ne doivent point être confisquées, même en temps de guerre, si ce n’est par représailles : bonne politique des Anglois ; mauvaise politique des Espagnols sur cette matiere, II. 256. En peut-on fixer le prix ? III. 12, 13. Comment on en fixe le prix dans la variation des richesses de signe, III. 12 & suiv. Leur quantité croît par une augmentation de commerce, III. 15.
Marculphe. La formule qu’il rapporte & qui traite d’impie la coutume qui prive les filles de la succession de leurs peres, est-elle juste ? III. 200 & suiv. Appelle antrustions du roi, ce que nous appellons ses vassaux, IV. 44.
Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent avec l’héritier est ordonné chez quelques peuples, I. 89. Il étoit permis à Athenes d’épouser sa sœur consanguine & non pas sa sœur utérine : esprit de [IV-503] cette loi, ibid. À Lacédémone, il étoit permis d’épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consaguine, I. 90. À Alexandrie, on pouvoit épouser sa sœur, soit consanguine, soit utérine, I. 91. Comment se faisoit chez les Samnites, I. 222. Utilité des mariages entre le peuple vainqueur & le peuple vaincu, I. 298, 299. Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n’est point indissoluble ; on y a plusieurs femmes à la fois ; ou personne n’a de femmes, & tous les hommes usent de toutes, II. 152 ; 173. A été établi par la nécessité de trouver un pere aux enfans, pour les nourrir & les élever, III. 66, 67. Est-il juste que les mariages des enfans dépendent des peres ? III. 73, 74. Etoient réglés à Lacédémone par les seuls magistrats, ibid. La liberté des enfans, à l’égard des mariages, doit être plus gênée dans les pays où le monachisme est établi, qu’ailleurs, III. 74, 75. Les filles y sont plus portées que les garçons : pourquoi, III. 75, 76. Motifs qui y déterminent, III. 76. Détail des lois romaines sur cette matiere, III. 90-109. Etoient défendus à Rome entre gens trop âgés pour faire des enfans, III. 100. Etoient défendus à Rome entre gens de condition trop inégale : quand ont commencé d’y être tolérés : d’où vient notre fatale liberté à cet égard, III. 101 & suiv. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d’adulteres, III. 109. Il est contre la nature de permettre aux filles de se choisir un mari à sept ans, III. 196, 197. Il est injuste, contraire au bien public & à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage aux femmes dont les maris sont absens depuis long-temps, & dont elles n’ont point eu de nouvelles, III. 208, 209. Dans quel cas il faut suivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion, & dans quel cas il faut suivre les lois civiles, III. 213 & suiv. Dans quel cas les mariages entre parens doivent se régler par les lois de la nature ; dans quel cas ils doivent se régler par les lois civiles, III. 216 & suiv. Les idées de religion en font contracter d’incestueux à certains peuples, III. 219, 220. Le [IV-504] principe qui le fait défendre entre les peres & les enfans, les freres & les sœurs, sert à découvrir à quel degré la loi naturelle le défend, III. 220 & suiv. Est permis ou défendu par la loi civile dans les différens pays, selon qu’ils paroissent conformes ou contraires à la loi de nature, III. 221 & suiv. Pourquoi permis entre le beau-frere & la belle-sœur, chez des peuples, & défendu chez d’autres, III. 222, 223. Doit-il être interdit à une femme qui a pris l’habit re religieuse sans s’être consacrée ? III. 431. Toutes les fois qu’on parle de mariage, doit-on parler de la révélation ? D. 273, 274.
Marine Pourquoi celle des Anglois est supérieure à celle des autres nations, II. 228, 229. Du génie des Romains pour la marine, II. 326, 327.
Maris. Comment on les nommoit autrefois, III. 334.
Marius. Coup mortel qu’il porta à la république, I. 370.
Maroc. Causes des guerres civiles qui affligent ce royaume à chaque vacance du trône, I. 125.
Maroc (le roi de). A dans son sérail des femmes de toutes couleurs. Le malheureux ! II. 103.
Marseille. Pourquoi cette république n’éprouva jamais les passages de l’abaissement à la grandeur, I. 231. Quel étoit l’objet du gouvernement de cette république, I. 310. Quelle sorte de commerce on y faisoit, II. 242. Ce qui détermina cette ville au commerce : c’est le commerce qui fut la source de toutes ses vertus, II. 245, 246. Son commerce, ses richesses, source de ses richesses : étoit rivale de Carthage, II. 322, 323. Pourquoi si constamment fidelle aux Romains, ibid. La ruine de Carthage & de Corinthe augmenta sa gloire, II. 323.
Martyr. Ce mot, dans l’esprit des magistrats japonois, signifioit rebelle ; c’est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse au Japon, III. 188.
Matelots. Les obligations civiles qu’ils contractent dans les navires entr’eux, doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 240, 241.
Maures. Comment trafiquent avec les negres, III.
[IV-505]
Maurice, empereur. Outra la clémence, I. 192. Injustice faite sous son regne, sous prétexte de magie, I. 389, 390.
Maximin. Sa cruauté étoit mal entendue, I. 183.
Méaco. Est une ville sainte au Japon, qui entretient toujours le commerce dans cet empire, malgré les fureurs de la guerre, III. 146.
Mecque. Gengis-kan en trouvoit le pélérinage absurde, III. 166.
Médailles fourées. Ce que c’est, III. 41.
Médecins. Pourquoi étoient punis de mort à Rome ; pour négligence ou pour impéritie, & ne le sont pas parmi nous, III. 426, 427.
Mendians. Pourquoi ont beaucoup d’enfans : pourquoi se multiplient dans les pays riches ou superstitieux, III. 76, 77.
Mensonges. Ceux qui se font au Japon, devant les magistrats, sont punis de mort. Cette loi est-elle bonne ? I. 175.
Mer antiochide. Ce que l’on appelloit ainsi, II. 301.
Mer caspienne. Pourquoi les anciens se sont si fort obstinés à croire que c’étoit une partie de l’océan, II. 302, 303.
Mer des Indes. Sa découverte, II. 282.
Mer rouge. Les Egyptiens en abandonnoient le commerce à tous les petits peuples qui y avoient des ports, II. 281. Quand, & comment on en fit la découverte, II. 300 ; 309, 310.
Mer séleucide. Ce que l’on appelloit ainsi, II. 301.
Mercator (Isidore. Sa collection de canons, III. 289.
Meres. Il est contre nature qu’elles puissent être accusées d’adultere par leurs enfans, III. 197. Pourquoi une mere ne peut pas épouser son fils, III. 216, 217. Dans l’ancienne Rome, ne succédoient point à leurs enfans, & les enfans ne leur succédoient point : quand & pourquoi cette disposition fut abolie, III. 243 ; 262.
Mérovingiens. Leur chute du trône ne fut point une révolution, IV. 159 & suiv.
Mesures. Est-il nécessaire de les rendre uniformes dans toutes les provinces du royaume ? III. 439.
[IV-506]
Métal. C’est la matiere la plus propre pour la monnoie, III. 3.
Metellus Numidicus. Regardoit les femmes comme un mal nécessaire, III. 92.
Métempsycose. Ce dogme est utile ou funeste, quelquefois l’un & l’autre en même temps, suivant qu’il est dirigé, III. 153. Est utile aux Indes, raisons physiques, III. 156, 157.
Métier. Les enfans, à qui leur pere n’en a point donné pour gagner leur vie, sont-ils obligés par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l’indigence ? III. 198, 199.
Metius Suffetius. Supplice auquel il fut condamné, I. 180.
Métropoles. Comment doivent commercer entr’elles, & avec les colonies, I. 349 & suiv.
Meurtres. Punition de ceux qui étoient involontaires chez les Germains, IV. 67.
Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d’avoit été conquis par les Espagnols : maux qu’ils en ont reçus, I. 282.
Mexique. On ne pouvoit pas, sous peine de la vie, y reprendre une femme qu’on avoit répudiée : cette loi est plus sensée que celle des Maldives, II. 118. Ce n’est point une absurdité de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, & n’est pas bonne pour le Mexique, III. 156.
Midi. Raisons physiques des passions & de la foiblesse du corps des peuples du midi, II. 31 & suiv. Contradictions dans les caracteres de certains peuples du midi, II. 38 & suiv. Il y a dans les pays du midi, une inégalité entre les deux sexes : conséquences tirées de cette vérité touchant la liberté qu’on y doit accorder aux femmes, II. 96 & suiv. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le nord, II. 273, 274. Pourquoi le catholicisme s’y est maintenu contre le protestantisme, plutôt que dans le nord, III. 131, 132.
Milices. Il y en a eu de trois sortes dans les commencemens de la monarchie, IV. 51.
Militaire (Gouvernement). Les empereurs qui l’avoient établi, sentant qu’il ne leur étoit pas moins [IV-507] funestes qu’aux sujets, chercherent à le tempérer, I. 182, 183.
Militaires. Leur fortune & leurs récompenses en France, II. 263 & suiv.
Militaires (Emplois). Doivent-ils être mis sur la même tête que les emplois civils ? I. 140 & suiv.
Mine de pierres précieuses. Pourquoi fermée à la Chine, aussi-tôt que trouvée, I. 206.
Mines. Profitent davantage travaillées par des esclaves, que par des hommes libres, II. 73. Y en avoit-il en Espagne autant qu’Aristote le dit ? II. 419. Quand celles d’or & d’argent sont trop abondantes, elles appauvrissent la puissance qui les travaille : preuves par le calcul du produit de celles de l’Amérique, II. 353 & suiv. Celles d’Allemagne & de Hongrie sont utiles, parce qu’elles ne sont pas abondantes, II. 359.
Miniares. Nom donné aux Argonautes & à la ville d’Orcomene, II. 291.
Ministres. Sont plus rompus aux affaires dans une monarchie, que dans un état despotique, I. 57. Ne doivent point être juges dans une monarchie, I. 163. Sont coupables de lese-majesté au premier chef, quand ils corrompent le principe de la monarchie, pour le tourner au despotisme, I. 237. Quand doivent entreprendre la guerre, I. 275. Ceux qui conseillent mal leur maître doivent être recherchés & punis, I. 326. Est-ce un crime de lese-majesté, que d’attenter contr’eux ? I. 394, 395. Portrait, conduite & bévues de ceux qui sont mal-habiles, I. 423. Leur nonchalance en Asie est avantageuse au peuple : la petitesse de leurs vues en Europe est cause de la rigueur des tributs que l’on y paye, II. 21, 22. Qui sont ceux que l’on a la folie, parmi nous, de regarder comme grands, II. 22. Le respect & la considération sont leur récompense, II. 30. Pourquoi ceux d’Angleterre sont plus honnêtes gens que ceux des autres nations, II. 229, 230.
Minorité. Pourquoi si longue à Rome : devroit-elle l’être autant parmi nous ? I. 102.
Minos. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un [IV-508] petit état, I. 75. Ses succès, sa puissance, I. 187.
Missi dominici. Quand, & pourquoi on cessa de les envoyer dans les provinces, III. 288. On n’appelloit point devant eux des jugemens rendus dans la cour du comte : différence de ces deux juridictions, III. 350. Renvoyoient au jugement du roi les grands qu’ils prévoyoient ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 351. Epoque de leur extinction, III. 376.
Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouvernement de la Chine, I. 255, 256. Leurs disputes entr’eux dégoûtent les peuples chez qui ils prêchent, d’une religion dont ceux qui la proposent ne conviennent pas, III. 190.
Mithridate. Regardé comme le libérateur de l’Asie, I. 377. Profitoit de la disposition des esprits, pour reprocher aux Romains, dans ses harangues, les formalités de leur justice, II. 186. Source de sa grandeur, de ses forces & de sa chute, II. 324 & suiv.
Mobilier. Les effets mobiliers appartenoient à tout l’univers, II. 266.
Modération. De quel temps on parle, quand on dit que les Romains étoient le peuple qui aimoit le plus la modération dans les peines, I. 181. Est une vertu bien rare, III. 392. C’est de cette vertu que doit principalement être animé un législateur, III. 405.
Modération dans le gouvernement. Combien il y en a de sortes : est l’ame du gouvernement aristocratique, I. 46. En quoi consiste dans une aristocratie, I. 103.
Modes. Sont fort utiles au commerce d’une nation, II. 193. Tirent leur source de la vanité, II. 193, 194.
Mœurs. Doivent dans une monarchie, avoir une certaine franchise, I. 61. Par combien de causes elles se corrompent, I. 174. Quels sont les crimes qui les choquent ; comment doivent être punis, I. 380. Peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques, I. 427. Raisons physiques de leur immutabilité en orient, II. 40, 41. Sont [IV-509] différentes, suivant les différens besoins, dans les différens climats, II. 48, 49. C’est elles, plutôt que les lois, qui gouvernent les peuples chez qui le partage des terres n’a pas lieu, II. 152. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189. Donnoient le ton à Lacédémone, ibid. On ne doit point changer celles d’un état despotique, II. 198, 199. Différences entre leurs effets & ceux des lois, ibid. Maniere de changer celles d’une nation, II. 200 & suiv. Ce que c’est que les mœurs des nations, II. 203 & suiv. Différence entre les mœurs & les lois, II. 203. Différence entre les mœurs & les manieres, ibid. Combien elles influent sur les lois, II. 214 & suiv. Comment celles d’une nation peuvent être formées par les lois, II. 219 & suiv. Le commerce les adoucit & les corrompt, II. 238, 239. Pour les conserver, il ne faut pas renverser la nature, de laquelle elles tirent leur origine, III. 197. La pureté des mœurs, que les parens doivent inspirer à leurs enfans, est la source de la prohibition des mariages entre proches, III. 217 & suiv. Cas où les lois en dépendent, III. 222 & suiv. De celles qui étoient relatives aux combats, III. 324 & suiv. Description de celles de la France, lors de la réformation des coutumes, III. 405.
Mogol. Comment il s’assure la couronne, I. 125. Ne reçoit aucune requête, si elle n’est accompagnée d’un présent, I. 135. Comment la fraude est punie dans ses états, II. 15.
Moines. Sont attachés à leur ordre par l’endroit qui le leur rend insupportable, I. 83. Cause de la dureté de leur caractere, I. 168. L’institut de quelques-uns est ridicule, si le poisson est, comme on le croit, utile à la génération, III. 79. Sont une nation paresseuse, & qui entretenoit en Angleterre la paresse des autres : chassés d’Angleterre pas Henri VIII. III. 121. C’est eux qui ont formé l’inquisition, III. 211. Maximes injustes qu’ils y ont introduites, III. 212. N’ont fait que copier, pour l’inquisition contre les Juifs, les lois faites autrefois par les [IV-510] évêques, pour les Wisigoths, III. 269, 270. La charité de ceux d’autrefois leur faisoit racheter des captifs, IV. 23. Ne cessent de louer la dévotion de Pépin, à cause des libéralités que sa politique lui fit faire aux églises, IV. 139.
Moïse. On auroit dû, pour arrêter la communication du mal vénérien, prendre pour modele les lois de Moïse sur la lepre, II. 51. Le caractere des Juifs l’a souvent forcé, dans ses lois, de se relâcher de la loi naturelle, II. 88. Avoit réglé qu’aucun Hébreu ne pourroit être esclave que six ans : cette loi étoit fort sage ; pourquoi, II. 91. Comment veut que ceux des Juifs qui avoient plusieurs femmes les traitassent, II. 105. Réflexion, qui est l’éponge de toutes les difficultés que l’on peut opposer à ces lois, II. 213. Sagesse de ses lois au sujet des asiles, III. 168. Pourquoi a permis le mariage entre le beau-frere & la belle-sœur, III. 222, 223.
Molosses. Se tromperent dans le choix des moyens qu’ils employerent pour tempérer le pouvoir monarchique, I. 339.
Monachisme. Quelles sont les lois qui en dérivent, I. 31 & suiv. Ce que c’est, & ce qui en constitue la nature, ibid. Quelle en est la maxime fondamentale, I. 32. Les justices seigneuriales & ecclésiastiques y sont nécessaires, ibid. Ce qui, outre les pouvoirs intermédiaires, est essentiel à sa constitution, I. 34, 35. Quel en est le principe, I. 39 ; 50, 51. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, ibid. La vertu n’est point le principe de ce gouvernement, I. 46 & suiv. Comment elle subsiste, ibid. Les crimes publics y sont plus privés que dans une république, I. 47. Comment on y supplée à la vertu, I. 49. L’ambition y est fort utile : [IV-511] pourquoi, I. 50, 51. Illusions qui y est utile, & à laquelle on doit se prêter, I. 51. Pourquoi les mœurs n’y sont jamais si pures que dans une république, I. 61. Les mœurs y doivent avoir une certaine franchise, ibid. Dans quel sens on y fait cas de la vérité, I. 61, 62. La politesse y est essentielle, I. 62. L’honneur y dirige toutes les façons de penser, & toutes les actions, I. 63, 64. L’obéissance au souverain y est prescrite par les lois de toute espece : l’honneur y met des bornes, I. 64. L’éducation y doit être conforme aux regles de l’honneur, I. 65. Comment les lois y sont relatives au gouvernement, I. 110 & suiv. Les tributs y doivent être levés de façon que l’exaction ne soit point onéreuse au peuple, I. 112. Les affaires y doivent-elles être exécutés promptement ? I. 113, 114. Ses avantages sur l’état républicain, ibid. — sur le despotisme, I. 114. Son excellence, ibid. & suiv. La sureté du prince y est attachée, dans les secousses, à l’incorruptibilité des différens ordres de l’état, I. 115, 116. Comparée avec le despotisme, ibid. & suiv. Le prince y retient plus de pouvoir qu’il n’en communique à ses officiers, I. 132 & suiv. Y doit-on souffrir que les citoyens refusent les emplois publics ? I. 138. Les emplois militaires n’y doivent pas être réunis avec les civils, I. 140 & suiv. La vénalité des charges y est utile, I. 142, 143. Il n’y faut point de censeurs, I. 143 & suiv. Les lois y sont nécessairement multipliées, I. 146 & suiv. Causes de la multiplicité & de la variation des jugemens qui s’y rendent, ibid. Les formalités de justice y sont nécessaires, I. 151 & suiv. Comment s’y forment les jugemens, I. 155. Les ministres ne doivent point y être juges, I. 163. La clémence y est plus nécessaire qu’ailleurs, I. 191 & suiv. Il n’ faut point de lois somptuaires : dans quel cas elles y sont utiles, I. 200 & suiv. Finit par la pauvreté, I. 202. Pourquoi les femmes y ont peu de retenue, I. 209, 210. N’a pas la bonté des mœurs pour principe, I. 219. Les dots des femmes y doivent être considérables, I. 220. La communauté des biens entre mari & femme y est utile, ibid. Les gains nuptiaux [IV-512] des femmes y sont inutiles, I. 221. Ce qui fait sa gloire & sa sureté, I. 234. Causes de la corruption de son principe, ibid. & suiv. Danger de la corruption de son principe, I. 237, 238. Ne peut subsister dans un état composé d’une seule ville, I. 250. Propriétés distinctives de ce gouvernement, ibid. & suiv. Moyen unique, mais funeste, pour la conserver, quand elle est trop étendue, I. 251. Esprit de ce gouvernement, I. 263. Comment elle pourvoit à sa sureté, I. 266. Quand doit faire des conquêtes ; comment doit se conduire avec les peuples conquis & ceux de l’ancien domaine. Beau tableau d’une monarchie conquérante, I. 288, 289. Précautions qu’elle doit prendre pour en conserver une autre qu’elle a conquise, I. 290. Conduite qu’elle doit tenir vis-a-vis d’un grand état qu’elle a conquis, I. 302, 303. Objet principal de ce gouvernement, I. 310. Tableau raccourci de celles que nous connoissons, I. 335. Pourquoi les anciens n’avoient pas une idée claire de ce gouvernement, I. 336 & suiv. Le premier plan de celle que nous connoissons fut formé par les barbares qui conquirent l’empire romain, I. 337 & suiv. Ce que les Grecs appelloient ainsi dans les temps héroïques, I. 340 & suiv. Celles des temps héroïques des Grecs comparées avec celles que nous connoissons aujourd’hui, ibid. Quelle étoit la nature de celle de Rome sous ses rois, I. 342 & suiv. Pourquoi peut apporter plus de modération qu’une république, dans le gouvernement des peuples conquis, I. 375. Les écrits satyriques ne doivent pas y être punis sévérement ; ils y ont leur utilité, I. 404, 405. Mesures que l’on doit y garder dans les lois qui concernent la révélation des conspirations, I. 409. Des choses qui y attaquent la liberté, I. 419 & suiv. Il ne doit point y avoir d’espions, I. 420, 421. Comment doit être gouvernée, I. 423 & suiv. En quoi y consiste la félicité des peuples, ibid. Quel est le point de perfection dans le gouvernement monarchique, I. 423, 424. Le prince y doit être accessible, I. 424. Tous les sujets d’un état monarchique doivent avoir la liberté d’en sortir, I. 430. Tributs qu’on y doit [IV-513] lever sur les peuples que l’on a rendus esclaves de la glebe, II. 5, 6. On peut y augmenter les tributs, II. 18. Quel impôt y est le plus naturel, II. 19, 20. Tout est perdu, quand la profession y est honorée, II. 29. Il n’y faut point d’esclaves, II. 62. Quand il y a des esclaves, la pudeur des femmes esclaves doit être à couvert de l’incontinence de leurs maîtres, II. 78, 79. Le grand nombre d’esclaves y est dangereux, II. 80. Il est moins dangereux d’y armer les esclaves, que dans une république, II. 81. S’établit plus facilement dans les pays fertiles qu’ailleurs, II. 139 & suiv. — dans les plaines, II. 141, 142. S’unit naturellement avec la liberté des femmes, II. 203. S’allie très-facilement avec la religion chrétienne, II. 208, 209. Le commerce de luxe y convient mieux que celui d’économie, II. 242 & suiv. Il n’y faut point de banque : les particuliers n’y peuvent avoir de trésors, II. 251, 252. On n’y doit point établir de ports francs, II. 253. Il n’est pas utile au monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, II. 262 & suiv. Comment doit acquitter ses dettes, III. 49. Les bâtards y doivent être moins odieux que dans une république, III. 71. Deux sophismes ont toujours perdu, & perdront toujours toutes les monarchies. Quels sont ces sophismes, III. 77. S’accommode mieux de la religion catholique que de la protestante, III. 131, 132. Le pontificat y doit être séparé de l’empire, III. 176, 177. L’inquisition n’y peut faire autre chose que des délateurs & des traîtres, III. 211. L’ordre de succession à la couronne y doit être fixé, III. 227. On y doit encourager les mariages, & par les richesses que les femmes peuvent donner, & par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer, III. 263. On y doit punir ceux qui prennent parti dans les séditions, III. 409, 410.
Monarchie élective. Doit être soutenue par un corps aristocratique, I. 346, 347. C’est aux lois politiques & civiles à y décider dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans ou à d’autres, III. 202.
[IV-514]
Monarque. Comment doit gouverner. Quelle doit être la regle de ses volontés, I. 31 ; 39. Ce qui arrête le monarque qui marche au despotisme, I. 33. L’honneur met des bornes à sa puissance, I. 57. Son pouvoir, dans le fond, est le même que celui du despote, ibid. Est plus heureux qu’un despote, I. 117. Ne doit récompenser ses sujets qu’en honneurs qui conduisent à la fortune, I. 137. Ne peut être juge des crimes de ses sujets : pourquoi, I. 159 & suiv. Quand il enfreint les lois, il travaille pour les séducteurs contre lui-même, I. 163. Combien la clémence lui est utile, I. 191, 192. Ce qu’il doit éviter pour gouverner sagement & heureusement, I. 234 & suiv. En quoi consiste sa puissance, & ce qu’il doit faire pour la conserver, I. 269. Il faut un monarque dans un état vraiment libre, I. 322. Comment dans un état libre il doit prendre part à la puissance législative, I. 328, 329. Les anciens n’ont imaginé que de faux moyens pour tempérer son pouvoir, I. 319. Quelle est sa vraie fonction, I. 341, 342. Il a toujours plus d’esprit de probité que les commissaires qu’il nomme pour juger ses sujets, I. 419. Bonheur des bons monarques : pour l’être, ils n’ont qu’à laisser les lois dans leur force, I. 420. On ne s’en prend jamais à lui des calamités publiques ; on les impute aux gens corrompus qui l’obsedent, I. 421. Comment doit manier sa puissance, I. 423. Doit encourager, & les lois doivent menacer, I. 424. Doit être accessible, ibid. Ses mœurs, description admirables de la conduite qu’il doit tenir avec ses sujets, I. 424, 425. Egards qu’il doit à ses sujets, I. 426, 427.
Monasteres. Comment entretenoient la paresse en Angleterre : leur destruction y a contribué à établir l’esprit de commerce & d’industrie, III. 121. Ceux qui vendent leurs fonds à vie, ou qui font des emprunts à vie jouent contre le peuple, mais tiennent la banque contre lui : le moindre bon sens fait voir que cela ne doit pas être permis, III. 174.
Monde. Ses lois sont nécessairement invariables, I. 2.
Monde physique. Mieux gouverné que le monde intelligent : pourquoi, I. 4.
[IV-515]
Monluc (Jean de). Auteur du registre Olim, III. 388.
Monnoie. Est, comme les figures de géométrie, un signe certain que la pays où l’on en trouve est habité par un peuple policé, II. 154, 155. Lois civiles des peuples qui ne la connoissent point, II. 155, 156. Est la source des lois civiles, parce qu’elle est la source des injustices qui viennent de la ruse, ibid. Est la destructrice de la liberté, II. 156. Raison de son usage, III. 1 & suiv. Dans quel cas est nécessaire, 2, 3. Quelle en doit être la nature & la forme, III. 3 & suiv. Les Lydiens sont les premiers qui ayent trouvé l’art de la battre, III. 3, 4. Quelle étoit originairement celle des Athéniens, des Romains : ses inconvéniens, ibid. Dans quel rapport elle doit être pour la prospérité de l’état, avec les choses qu’elle représente, III. 4, 5. Etoit autrefois représentée en Angleterre par tous les biens d’un Anglois, III. 6. Chez les Germains elle devenoit bétail, marchandise ou denrée ; & ces choses devenoient monnoie, ibid. Est un signe des choses, & un signe de la monnoie même, III. 6, 7. Combien il y en a de sortes, III. 7, 8. Augmente chez les nations policées, & diminue chez les nations barbares, III. 9. Il seroit utile qu’elle fût rare, III. 10. C’est en raison de sa quantité que le prix de l’usure diminue, III. 11. Comment, dans sa variation le prix des choses se fixe, III. 12 & suiv. Les Africains en ont une, sans en avoir aucune, III. 14. Preuves par le calcul qu’il est dangereux à un état de hausser ou baisser la monnoie, III. 28 & suiv. Quand les Romains firent des changemens à la leur pendant les guerres puniques, ce fut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous, 35 & suiv. A haussé ou baissé à Rome, à mesure que l’or & l’argent y sont devenus plus ou moins communs, III. 38 & suiv. Epoque & progression de l’altération qu’elle éprouva sous les empereurs romains, III. 40 & suiv. Le change empêche qu’on ne la puisse altérer jusqu’à un certain point, III. 41, 42.
Monnoie idéale. Ce que c’est, III. 78.
[IV-516]
Monnoie réelle. Ce que c’est, ibid. Pour le bien du commerce, on ne devroit se servir que de monnoie réelle, ibid.
Monnoyeurs (Faux). La loi qui les déclaroit coupables de lese-majesté, étoit une mauvaise loi, I. 396.
Montagnes. La liberté s’y conserve mieux qu’ailleurs, II. 141, 142.
Montagnes d’argent. Ce que l’on appelloit ainsi, II. 319.
Montesquieu (M. de. Vingt ans avant la publication de l’Esprit des Lois, avait composé un petit ouvrage qui y est confondu, II. 353. Peu importe que ce soit lui, ou d’anciens & célebres jurisconsultes, qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, III. 281. Promet un ouvrage particulier sur la monarchie des Ostrogoths, IV. 29. Preuves qu’il n’est ni déiste ni spinosiste, D. 222 & suiv. Admet une religion révélée : croit & aime la religion chrétienne, D. 229 & suiv. N’aime point à dire des injures, même à ceux qui cherchent à lui faire les plus grands maux, D. 238, 239. Obligé d’omettre quantité de choses qui étoient de son sujet, a-t-il dû parler de la grace, qui n’étoit point de son sujet ? D. 246, 247. Son indulgence pour le nouvelliste ecclésiastique, D. 252, 253. Est-il vrai qu’il regarde les préceptes de l’évangile comme des conseils ? D. 260 & suiv. Pourquoi il a répondu au nouvellistes ecclésiastique, D. 315.
Montésuma. Ne disoit pas une absurdité, quand il soutenoit que la religion des Espagnols est bonne pour leur payx, & celle du Mexique pour le Mexique, III. 156.
Montfort. Les coutumes de ce comté tirent leur origine des lois du comte Simon, III. 402.
Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s’y retira : ce qui en résulta, I. 418.
Montpensier (la duchesse de). Les malheurs qu’elle attira sur Henri III prouvent qu’un monarque ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Mont sacré. Pourquoi le peuple de Rome s’y retira, I. 416, 417.
[IV-517]
Morale. Ses lois empêchent à chaque instant l’homme de s’oublier lui-même, I. 6. Ses regles doivent être celles de toutes les fausses religions, III. 135. On est attaché à une religion, à proportion de la pureté de sa morale, III. 164, 165. Nous aimons spéculativement en matiere de morale tout ce qui porte le caractere de sévérité, III. 170, 171.
Mort civile. Etoit encourue chez les Lombards pour la lepre, II. 50.
Moscovie. Les empereurs même y travaillent à détruire le despotisme, I. 122. Le czar y choisit qui il veut pour son successeur, I. 125. Le défaut de proportion dans les peines y cause beaucoup d’assassinats, I. 186. L’obscurité où elle avoit toujours été dans l’Europe contribua à la grandeur relative de la France sous Louis XIV, I. 272. Loi bien sage établie dans cet empire par Pierre I. II. 6, 7. Ne peut descendre du despotisme, parce que ses lois sont contraires au commerce & aux opérations du change, III. 42, 43.
Moscovites. Idée plaisante qu’ils avoient de la liberté, I. 307. Combien ils sont insensibles à la douleur : raison physique de cette insensibilité, II. 36. Pourquoi se vendent si facilement, II. 170. Pourquoi ont changé si facilement de mœurs & de manieres, II. 200 & suiv.
Mosquées. Pourquoi Gengis-kan les méprisa si fort, quoiqu’il approuvât tous les dogmes des mahométans, III. 166.
Mouçons. La découverte de ces vents est l’époque de la navigation en pleine mer. Ce que c’est ; temps où ils regnent ; leurs effets, II. 305, 306.
Moulins. Il seroit peut-être utile qu’ils n’eussent point été inventés, III. 82, 83.
Muet. Pourquoi ne peut pas tester, III. 248, 249.
Multiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples naissans, que chez les peuples formés, III. 76.
Mummolus. L’abus qu’il fit de la confiance de son pere, prouve que les comtes, à force d’argent, rendoient perpétuels leurs offices qui n’étoient qu’annuels, IV. 109.
[IV-518]
Musique. Les anciens la regardoient comme une science nécessaire aux bonnes mœurs, I. 76 & suiv. Différence des effets qu’elle produit en Angleterre & en Italie. Raisons physiques de cette différence, tirées de la différence des climats, II. 36.
Mutius Scevola. Punit les traitans, pour rappeller les bonnes mœurs, I. 371.
N
Naïres. Ce que c’est dans le Malabar, II. 102.
Naissance. Les registres publics sont la meilleure voie pour la prouver, III. 400.
Narbonnoise. Le combat judiciaire s’ maintint, malgré toutes les lois qui l’abolissent, III. 314.
Narsès (l’eunuque). Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Natchès. La superstition force ce peuple de la Louisianne à déroger à la constitution essentielle de ses mœurs. Ils sont esclaves, quoiqu’ils n’ayant pas de monnoie, II. 157, 158.
Nations. Comment doivent se traiter mutuellement, tant en paix qu’en guerre, I. 10. Ont toutes, même les plus féroces, un droit des gens, I. 11. Celle qui est libre peut avoir un libérateur ; celle qui est subjuguée ne peut avoir qu’un oppresseur, II. 223, 224. Comparées aux particuliers : quel droit les gouverne, II. 350.
Nature. Les sentimens qu’elle inspire sont subordonnés, dans les états despotiques, aux volontés du prince, I. 55, 56. Douceur & grandeur des délices qu’elle prépare à ceux qui écoutent sa voix, I. 392, 393. Elle compense avec justesse les biens & les maux, II. 4. Les mesures qu’elle a prises pour assurer la nourriture aux enfans détruisent toutes les raisons sur lesquelles on fonde l’esclavage de naissance, II. 65, 66. C’est elle qui entretient les commodités que les hommes ne tiennent que de l’art, II. 147. C’est elle presque seule, avec le climat, qui gouverne les sauvages, II. 189. Sa voix est la plus douce de toutes les voix, III. 198. Ses lois [IV-519] ne peuvent être locales ; & son invariables, III. 222, 223.
Nature du gouvernement. Ce que c’est ; en quoi differe du principe du gouvernement, I. 38.
Naufrage (Droit de). Epoque de l’établissement de ce droit insensé : tort qu’il fait au commerce, II. 339.
Navigation. Effets d’une grande navigation, II. 246 & suiv. Combien l’imperfection de celle des anciens étoit utile au commerce de Tyriens, II. 280, 281. Pourquoi celle des anciens étoit plus lente que la nôtre, II. 283 & suiv. Comment fut perfectionnée par les anciens, II. 306, 307. N’a point contribué à la population de l’Europe, III. 114, 115. Défendue sur les fleuves par les Guebres. Cette loi, qui par-tout ailleurs auroit été funeste, n’avoit nul inconvénient chez eux, III. 159.
Navires. Pourquoi leur capacité se mesuroit-elle autrefois par muids de blé ; & se mesure-t-elle aujourd’hui par tonneaux de liqueurs ? II. 274. Causes physiques de leurs différens degrés de vîtesse, suivant leurs différentes grandeurs & leurs différentes formes, II. 283 & suiv. Pourquoi les nôtres vont presque à tous vents ; & ceux des anciens n’alloient presque qu’à un seul, II. 284, 285. Comment on mesure la charge qu’ils peuvent porter, II. 286, 287. Les obligations civiles que les matelots y passent entr’eux, doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 240, 241.
Négocians. Dans quel gouvernement ils peuvent faire de plus grandes entreprises, II. 244. Il est bon qu’ils puissent acquérir la noblesse, II. 264.
Négocians (Compagnie de). Ne conviennent jamais dans le gouvernement d’un seul, & rarement dans les autres, II. 252.
Negres. Motif singulier qui détermina Louis XII. à souffrir que ceux de ses colonies fussent esclaves, II. 67, 68. Raisons admirables qui sont le fondement du droit que nous avons de les rendre esclaves, II. 68 & suiv. Comment trafiquent avec les Maures, III. 1, 2. Monnoie de ceux des côtes de l’Afrique, III. 14.
[IV-520]
Néron. Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, I. 161. Loi adroite & utile de cet empereurs, II. 10. Dans les beaux jours de son empire, il voulut détruire les fermiers & les traitans, II. 28. Comment il éluda de faire une loi touchant les affranchis, II. 90.
Neveux. Sont regardés aux Indes comme les enfans de leurs oncles. De là le mariage entre le beau-frere et la belle-sœur y est permis, III. 223.
Nitard. Témoignage que cet historien, témoin oculaire, nous rend du regne de Louis le débonnaire, IV. 174, 175.
Nobles. Sont l’objet de l’envie dans l’aristocratie, I. 26. Quand ils sont en grand nombre dans une démocratie, police qu’ils doivent mettre dans le gouvernement, ibid. Répriment facilement le peuple dans une aristocratie, & se répriment difficilement eux-mêmes, I. 45. Doivent être populaires dans une démocratie, I. 103. Doivent être tous égaux dans une aristocratie, I. 109, 110. Ne doivent dans une aristocratie, être ni trop pauvres, ni trop riches : moyens de prévenir ces deux excès, ibid. — N’y doivent point avoir de contestations, I. 110. Comment punis autrefois en France, I. 169. Quelle est leur unique dépense à Venise, I. 100. Quelle part ils doivent avoir dans un état libre aux trois pouvoirs, I. 320. Doivent, dans un état libre, être jugés par leurs pairs, I. 326, 327. Cas où, dans un état libre, ils doivent être juges des citoyens de tout étage, I. 327, 328.
Noblesse. Doit naturellement, dans une monarchie, être dépositaire du pouvoir intermédiaire, I. 31, 32. Son ignorance l’empêche, dans une monarchie, de pouvoir être dépositaire des lois, I. 34. Sa profession est la guerre. L’honneur l’y entraîne ; l’honneur l’en arrache, I. 65. Doit être soutenue dans une monarchie : moyens d’y réussir, I. 111, 112. Doit seule posséder les fiefs dans une monarchie. Ses provileges ne doivent point passer au peuple, ibid. Causes des différences dans les partages des biens qui lui sont destinés, I. 147. Est toujours [IV-521] portée à défendre le trône : exemple, I. 238, 239. Doit, dans un état libre, former un corps distingué, qui ait part à la législation : doit y être héréditaire. Comment sa part, dans le pouvoir législatif, doit être limitée, I. 320, 321. La gloire & l’honneur sont sa récompense, II. 29, 30. Le commerce ne lui doit-il être permis dans une monarchie ? II. 262 & suiv. Est-il utile qu’on la puisse acquérir à prix d’argent ? II. 264. Celle de robe comparée avec celle d’épée, ibid. & suiv. Quand commença à quitter, même à mépriser la fonction de juge, III. 295, 396.
Noblesse françoise. Le systême de M. l’abbé Dubos, sur l’origine de notre noblesse françoise, est faux & injurieux au sang de nos premieres familles, & aux trois grandes maisons qui ont régné sur nous, IV. 92 & suiv. Quand, & dans quelle occasion elle commença à refuser de suivre les rois dans toutes sortes de guerres, IV. 92, 93.
Noces (Secondes). Etoient favorisées, & même prescrites par les anciennes lois romaines : le christianisme les rendit défavorables, III. 98 & suiv.
Noirs. Voyez Negres.
Noms. Contribuent beaucoup à la propagation. Il vaut mieux qu’ils distinguent les familles, que les personnes seulement, III. 69.
Nord. Raisons physiques de la force du corps, du courage, de la franchise, &c. des peuples du nord, II. 31 & suiv. Les peuples y sont fort peu sensibles à l’amour, II. 36, 37. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle ses peuples se maintinrent contre la puissance romaine, II. 40. Les passions des femmes y sont fort tranquilles, II. 112. Est toujours habité, parce qu’il est presqu’inhabitable, II. 142. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le midi, II. 273, 274. Les femmes & les hommes y sont plus long-temps propres à la génération qu’en Italie, III. 100. Pourquoi le protestantisme y a été mieux reçu que dans le midi, III. 131, 132.
Normandie. Les coutumes de cette province ont été accordées par le duc Raoul, III. 402.
Normands. Leurs ravages causerent une telle barbarie, que l’on perdit jusqu’à l’usage de l’écriture, & que [IV-522] l’on perdit toutes les lois auxquelles on substitua les coutumes, III. 292. Pourquoi persécutoient sur-tout, les prêtres & les moines, IV. 141, 142. Terminerent les querelles que le clergé faisoit aux rois & au peuple pour son temporel, IV. 149 ; 180. Charles le chauve, qui auroit pu les détruire, les laissa aller pour de l’argent, IV. 175, 176. Pourquoi dévasterent la France, & non pas l’Allemagne, IV. 200, 201. Leurs ravages ont fait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, qui pouvoit seul la défendre, IV. 203, 204.
Notoriété de fait. Suffisoit autrefois, sans autre preuve ni procédure, pour asseoir un jugement, III. 332.
Novelles de Justinien. Sont trop diffuses, III. 428.
Nouvelles ecclésiastiques. Les imputations dont elles cherchent à noircir l’auteur de l’esprit des lois, sont des calomnies atroces. Preuves sans replique, D. 221 & suiv.
Nouvelliste ecclésiastique. N’entend jamais le sens des choses, D. 228, 229. Méthode singuliere dont il se sert, pour s’autoriser à dire des invectives à l’auteur, D. 244. Jugemens & raisonnemens absurdes & ridicules de cet écrivain, D. 249 & suiv. Quoiqu’il n’ait d’indulgence pour personne, l’auteur en a beaucoup pour lui, D. 252, 253. Pourquoi a déclamé contre l’esprit des lois, qui a l’approbation de toute l’Europe ; & comment il s’y est pris pour déclamer ainsi, D. 254 & suiv. Sa mauvaise foi, D. 260 & suiv. Sa stupidité ou sa mauvaise foi, dans les reproches qu’il fait à l’auteur, touchant la polygamie, ibid. Veut que dans un livre de jurisprudence on ne parle que de théologie, D. 279. Imputation stupide ou méchante de cet écrivain, D. 281, 282. Juste appréciation de ses talens & de son ouvrage, D. 299 ; 302. Sa critique sur l’esprit des lois est pernicieuse ; pleine d’ignorance, de passion, d’inattention, d’orgueil, d’aigreur : n’est ni travaillée, ni réfléchie : est inutile, dangereuse, calomnieuse, contraire à la charité chrétienne, même aux vertus simplement humaines : pleine d’injures atroces, pleine de ces emportemens que les gens du monde ne se [IV-523] permettent jamais : elle annonce un méchant caractere : est contraire au bon sens, à la religion ; capable de rétrécir l’esprit des lecteurs ; pleine d’un pédantisme qui va à détruire toutes les sciences, D. 303 & suiv.
Numa. Fit des lois d’épargne sur les sacrifices, III. 175. Ses lois, sur le partage des terres, furent rétablies pas Servius Tullius, III. 244, 245.
Numidie. Les freres du roi succédoient à la couronne, à l’exclusion de ses enfans, III. 202.
O
Obéissance. Différence entre celle qui est due dans les états modérés, & celle qui est dure dans les états despotiques, I. 55 & suiv. L’honneur met des bornes à celle qui est due au souverain, dans une monarchie, I. 64.
Obligations. Celles que les matelots passent entr’eux, dans un navire, doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 240, 241.
Offices. Les maires du palais contribuerent de tout leur pouvoir à les rendre inamovibles : pourquoi, IV. 130, 131. Quand les grands commencerent à devenir héréditaires, IV. 193 & suiv.
Officiers généraux. Pourquoi dans les états monarchiques, ils ne sont attachés à aucun corps de milice, I. 133. Pourquoi il n’y en a point en titre dans les états despotiques, ibid.
Offrandes. Raison physique de la maxime religieuse d’Athenes, qui disoit qu’une petite offrande honoroit plus les dieux que le sacrifice d’un bœuf, III. 157. Bornes qu’elles doivent avoir : on n’y doit rien admettre de tout ce qui approche du luxe, III. 174 & suiv.
Olim. Ce que c’est que les registres que l’on appelle ainsi, III. 338.
Oncles. Sont regardés aux Indes, comme les peres de leurs neveux : c’est ce qui fait que les mariages entre beau-frere & belle-sœur y sont permis, III. 223.
[IV-524]
Oppienne. Voyez Loi oppienne.
Or. Plus il y en a dans un état, plus cet état est pauvre, II. 354. La loi qui défend en Espagne de l’employer en superfluité, est absurde, I. 359. Cause de la quantité plus ou moins grande de l’or & de l’argent, III. 9. Dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût beaucoup ; & dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût peu, III. 9, 10. De sa rareté relative à celle de l’argent, III. 16, 17.
Or, (Côte d’) Si les Carthaginois avoient pénétré jusques là, ils y auroient fait un commerce bien plus important que celui que l’on y fait aujourd’hui, II. 318, 319.
Oracles. À quoi Plutarque attribue leur cessation, III. 89.
Orange. (Le prince d’) Sa proscription, III. 436.
Orcomene. A été une des villes les plus opulentes de la Grece : pourquoi, II. 290, 291. Sous quel autre nom cette ville est connue, II. 291.
Ordonnance de 1287. C’est à tort qu’on la regarde comme le titre de création des baillis : elle porte seulement qu’ils seront pris parmi les laïques, III. 398, 399.
Ordonnance de 1670. Faute que l’auteur attribue mal à propos à ceux qui l’ont rédigée, III. 430.
Ordonnances. Les barons, du temps de S. Louis, n’étoient soumis qu’à celles qui s’étoient faites de concert avec eux, III. 360 & suiv.
Ordres. Ceux du despote ne peuvent être ni contredits, ni éludés, I. 55, 56.
Orgueil. Est la source ordinaire de notre politesse, I. 62. Source de celui des courtisans ; ses différens degres, I. 63. Est pernicieux dans une nation, I. 193, 194. Est toujours accompagné de la gravité & de la paresse, I. 194. Peut être utile quand il est joint à d’autres qualités morales : les Romains en sont une preuve, II. 195.
Orient. Il semble que les eunuques y sont un mal nécessaire, II. 94, 95. Une des raisons qui a fait que le gouvernement populaire y a toujours été difficile à établir, est que le climat demande que les hommes y ayent un empire absolu sur les [IV-525] femmes, II. 107. Principe de la morale orientale, II. 108 & suiv. Les femmes n’y ont pas le gouvernement intérieur de la maison ; ce sont les eunuques, II. 115. Il n’y est point question d’enfans adultérins, III. 71.
Orientaux. Absurdité d’un de leurs supplices, I. 406. Raisons physiques de l’immutabilité de leur religion, de leurs mœurs, de leurs manieres, & de leurs lois, II. 40, 41. Tous, excepté les mahométans, croient que toutes les religions sont indifférentes en elles-mêmes, III. 189.
Orléans. Le combat judiciaire y étoit en usage dans toutes les demandes pour dettes, III. 319.
Orphelins. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, III. 119.
Orphitien. Voyez Sénatusconsulte.
Ostracisme. Prouve la douceur du gouvernement populaire qui l’employoit, III. 229. Pourquoi nous le regardons comme une peine, tandis qu’il couvroit d’une nouvelle gloire celui qui y étoit condamné, III. 229, 230. On cessa de l’employer, dès qu’on en eut abusé contre un homme sans mérite, III. 230. Fit mille maux à Syracuse, & fut une chose admirable à Athenes, III. 413, 414.
Ostrogoths. Les femmes chez eux succédoient à la couronne, & pouvoient régner par elles-mêmes, II. 372. Théodoric abolit chez eux l’usage du combat judiciaire, III. 313. L’auteur promet un ouvrage particulier sur leur monarchie, IV. 29.
Othons. Autorisoient le combat judiciaire, d’abord dans les affaires criminelles, ensuite dans les affaires civiles, III. 314.
Ouvriers. On doit chercher à en augmenter, & non pas à en diminuer le nombre, III. 82, 83. Laissent plus de biens à leurs enfans, que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres, III. 119.
Oxus. Pourquoi ce fleuve ne se jette plus dans la mer caspienne, II. 278, 279.
[IV-526]
P
Paganisme. Pourquoi il y avoit, & il pouvoit y avoir dans cette religion des crimes inexpiables, III. 139.
Païens. De ce qu’ils élevoient des autels aux vices, s’ensuite-il qu’ils aimoient les vices ? III. 127.
Pairs. Henri VIII. se défit de ceux qui lui déplaisoient par le moyen des commissaires, I. 419. Étoient les vassaux d’un même seigneur, qui l’assistoient dans les jugemens qu’il rendoit pour ou contre chacun d’eux, III. 338 & suiv. Afin d’éviter le crime de félonie, on les appelloit de faux jugement, & non pas le seigneur, III. 340. Leur devoit étoit de combattre & de juger, III. 345, 346. Comment rendoient la justice, III. 395. Quand commencerent à ne plus être assemblés par le seigneur, pour juger, III. 395, 396. Ce n’est point une loi qui a aboli les fonctions des pairs dans les cours des seigneurs ; cela s’est fait peu à peu, III. 398, 399.
Paix. Est la premiere loi naturelle de l’homme qui ne seroit point en société, I. 7, 8. Est l’effet naturel du commerce, II. 239.
Paladins. Quelle étoit leur occupation, III. 326.
Palestine. C’est le seul pays & ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon, puisse être bonne : raisons physiques, III. 158, 159.
Papes. Employerent les excommunications pour empêcher que le droit romain ne s’accréditât au préjudice de leurs canons, III. 394. Les décrétales sont, à proprement parler, leurs rescrits, & les rescrits sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 437, 438. Pourquoi Louis le débonnaire abandonna leur élection au peuple romain, IV. 155.
Papier. Un impôt sur le papier destiné à écrire les actes, seroit plus commode que celui qui se prend sur les diverses clauses des actes, II. 12, 13.
Papiers circulans. Combien il y en a de sortes : qui sont ceux qu’il est utile à un état de faire circuler, III. 45 & suiv.
[IV-527]
Papirius. Son crime, qui ne doit pas être confondu avec celui de Plautius, fut utile à la liberté, I. 147.
Parage. Quand il a commencé à s’établir en matiere de fiefs, IV. 195, 196.
Paraguay. Sagesse des lois que les jésuites y ont établies, I. 73. Pourquoi les peuples y sont si fort attachés à la religion chrétienne, tandis que les autres sauvages le sont si peu à la leur, III. 166, 167.
Paresse. Celle d’une nation vient de son orgueil, II. 193, 194. Dédommage les peuples des maux que leur fait souffrir le pouvoir arbitraire, II. 4.
Paresse de l’ame. Sa cause est son effet, III. 142.
Parlement. Ne devroit jamais frapper ni sur la juridiction des seigneurs, ni sur la juridiction ecclésiastique, I. 32. Il en faut dans une monarchie, I. 34, 35. Plus il délibere sur les ordres du prince, mieux il lui obéit, I. 113. A souvent, par sa fermeté, préservé le royaume de sa chute, I. 114. Son attachement aux loi est la sureté du prince, dans les mouvemens de la monarchie, I. 115, 116. La maniere de prononcer des enquêtes, dans le temps de leur création, n’étoit pas la même que celle de la grand’chambre : pourquoi, III. 367. Ses jugemens avoient autrefois plus de rapport à l’ordre politique, qu’à l’ordre civil : quand & comment il descendit dans le détail civil, III. 387, 388. Rendu sédentaire, il fut divisé en plusieurs classes, ibid. A réformé les abus intolérables de la juridiction ecclésiastique, III. 390, 391. A mis, par un arrêt, des bornes à la cupidité des ecclésiastiques, III. 392. Voyez Corps législatif.
Paroles. Quand sont crimes, & quand ne le sont pas, I. 400 & suiv.
Parricide. Quelle étoit leur peine, du temps de Henri I. III. 374.
Partage des biens. Est réglé par les seules lois civiles ou politiques, III. 200 & suiv.
Partage des terres. Quand, & comment doit se faire : précautions nécessaires pour en maintenir l’égalité, I. 88 & suiv. 91. Celui que fit Romulus est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III. [IV-528] 242 & suiv. Celui qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des serfs, & l’origine des fiefs, IV. && & suiv. Voyez Terres.
Parthes. L’affabilité de Mithridate leur rendit ce roi insupportable : cause de cette bizarrerie, II. 186. Révolutions que leurs guerres avec les Romains apporterent dans le commerce, II. 337.
Partie publique. Il ne pouvoit y en avoir dans le temps que les lois des barbares étoient en vigueur : il ne faut pas prendre les avoués pour ce que nous appellons aujourd’hui partie publique ; quand a été établie, III. 373 & suiv.
Passions. Les peres peuvent plis aisément donner à leurs enfans, leurs passions que leurs connoissances : parti que les républiques doivent tirer de cette regle, I. 69, 70. Moins nous pouvons donner carriere à nos passions particulieres, plus nous nous livrons aux générales ; de là l’attachement des moines pour leur ordre, I. 83, 84.
Pasteurs. Mœurs & lois des peuples pasteurs, II. 152, 153.
Patane. Combien la lubricité des femmes y est grande : causes, II. 111.
Patriciens. Comment leurs prérogatives influoient sur la tranquillité de Rome : nécessaires sous les Rois, inutiles pendant la république, II. 346, 347. Dans quelles assemblées du peuple ils avoient le plus de pouvoir, II. 350. Comment ils devinrent subordonnés aux plébéiens, II. 355, 356.
Patrie (Amour de la). C’est ce que l’auteur appelle vertu : en quoi consiste ; à quel gouvernement est principalement affecté, II. 69. Ses effets, I. 83.
Pâturages. Les pays où il y en a beaucoup sont peu peuplés, III. 80.
Paul. Raisonnement absurde de ce jurisconsultes, III. 433.
Pauvreté. Fait finir les monarchies, I. 202. Celle d’un petit état, qui ne paye point de tribus, est-elle [IV-529] une preuve que pour rendre un peuple industrieux il faut le surcharger d’impôts ? II. 3, 4. Effets funestes de celle d’un pays, II. 4. Celle des peuples peut avoir deux causes : Leurs différens effets, II. 241, 242. C’est une absurdité de dire qu’elle est favorable à la propagation, III. 77. Ne vient pas du défaut de propriété, mais du défaut de travail, III. 119.
Pays de droit écrit. Pourquoi les coutumes n’ont pu y prévaloir sur les lois romaines, III. 292. Révolutions que les lois romaines y ont essuyées, III. 296, 297.
Pays formés par l’industrie des hommes. La liberté y convient, II. 145, 146.
Paysans. Lorsqu’ils sont à leur aise, la nature du gouvernement leur est indifférentes, II. 139 & suiv.
Péché originel. L’auteur étoit-il obligé d’en parler dans son chapitre premier ? D. 239.
Péculat. Ce crime est naturel dans les états despotiques, I. 131. La peine dont on le punit à Rome, quand il y parut, prouve que les lois suivent les mœurs, II. 214, 215.
Pédaliens. N’avoient point de prêtres, & étoient barbares, III. 169.
Pédanterie. Seroit-il bon d’en introduire l’esprit en France ? II. 191.
Pégu. Comment les successions y sont réglées, I. 124. Un roi de ce pays pensa étouffer de rire en apprenant qu’il n’y avoit point de roi à Venise, II. 186, 187. Les points principaux de la religion de ses habitans sont la pratique des principales vertus morales, & la tolérance de toutes les autres religions, III. 135.
Peine de mort. Dans quel cas est juste, II. 387, 388.
Peine du talion. Dérive d’une loi antérieure aux lois positives, I. 4.
Peines. Doivent être plus ou moins séveres, suivant la nature des gouvernemens, I. 166 & suiv. Augmentent ou diminuent dans un état, à mesure qu’on s’approche ou qu’on s’éloigne de la liberté, I. 167. Tout ce que la loi appelle peine, dans un état modéré, en est une : exemple singulier, I. 168, [IV-530] 169. Comment on doit ménager l’empire qu’elles ont sur les esprits, II. 171 & suiv. Quand elles sont outrées, elles corrompent le despotisme même, II. 174 & suiv. Le sénat de Rome préféroit celles qui sont modérées : exemple, I. 179. Les empereurs romains en proportionnerent la rigueur au rang des coupables, I. 183. Doivent être dans une juste proportion avec les crimes : la liberté dépend de cette proportion, I. 184 & suiv. 383 & suiv. C’est un grand mal en France qu’elles ne soient pas proportionnées aux crimes, I. 185. Pourquoi celles que les empereurs romains avoient prononcées contre l’adultere ne furent pas suivies, I. 216 & suiv. Doivent être tirées de la nature de chaque crime, I. 183 & suiv. Quelles doivent être celles des sarileges, I. 384. — des crimes qui sont contre les mœurs ou contre la pureté, I. 386. — des crimes contre la police, I. 386, 387. — des crimes qui troublent la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sureté, I. 387. — Des crimes qui attaquent la sureté publique, I. 387, 388. Quel doit être leur objet, 405, 406. On ne doit point en faire subir qui violent la pudeur, ibid. On en doit faire usage pour arrêter les crimes, & non pour faire changer les manieres d’une nation, II. 201. Imposées par les lois romaines contre les célibataires, III. 98 & suiv. Une religion qui n’en annonceroit point pour l’autre vie, n’attacheroit pas beaucoup, III. 164. Celles des lois barbares étoient toutes pécuniaires ; ce qui rendoit la partie publique inutile, III. 373 & suiv. Pourquoi il y en avoit tant de pécuniaires chez les Germains qui étoient si pauvres, IV. 62.
Peines fiscales. Pourquoi plus grandes en Europe, qu’en Asie, II. 14, 15.
Peines pécuniaires. Sont préférables aux autres, 188. On peut les aggraver par l’infamie, ibid.
Pélerinage de la Mecque. Gengis-kan le trouvoit absurde : pourquoi, III. 166.
Pen (M.). Comparé à Lycurgue, I. 72.
Pénestes. Peuple vaincu par les Thessaliens. Étoient condamnés à exercer l’agriculture, regardée comme une profession servile, I. 78.
[IV-531]
Pénitences. Regles, puisées dans le bon sens, que l’on doit suivre quand on impose des pénitences aux autres ou à soi-même, III. 139.
Pensées. Ne doivent point être punies, I. 264.
Péonius. La perfidie qu’il fit à son pere prouve que les offices des comtes étoient annuels, & qu’ils les rendoient perpétuels à force d’argent, IV. 106.
Pépin. Fit rédiger les lois des Frisons, III. 266. Constitution de ce prince qui ordonne de suivre la coutume par-tout où il n’y a pas de loi ; mais de ne pas préférer la coutume à la loi, III. 294. Explication de cette constitution, III. 295. De son temps, les coutumes avoient moins de force que les lois : on préféroit cependant les coutumes ; enfin elles prirent entiérement le dessus, III. 295, 296. Comment sa maison devint puissante : attachement singulier de la nation pour elle, IV. 128 & suiv. Se rendit maître de la monarchie en protégeant le clergé, IV. 140. Précautions qu’il prit pour faire rentrer les ecclésiastiques dans leurs biens, IV. 146, 147. Fait oindre & bénir ses deux fils en même temps que lui : fait obliger les seigneurs à n’élire jamais personne d’une autre race. Ces faits, avec plusieurs autres qui suivent, prouvent que pendant la seconde race la couronne étoit élective, IV. 161, 162. Partage son royaume entre ses deux fils, ibid. La foi & hommage a-t-elle commencé à s’établir de son temps ? IV. 213, 214.
Peres. Doivent-ils être punis pour leurs enfans ? I. 190. C’est le comble de la fureur despotique, que leur disgrace entraîne celle de leurs enfans & de leur femme, I. 429. Sont dans l’obligation naturelle d’élever & de nourrir leurs enfans : & c’est pour trouver celui que cette obligation regarde, que le mariage est établi, III. 66, 67. Est-il juste que le mariage de leurs enfans dépende de leur consentement ? III. 73, 74. Il est contre la nature qu’un pere puisse obliger sa fille à répudier son mari, sur-tout s’il a consenti au mariage, III. 296. Dans quel cas sont autorisés, par le droit naturel, à exiger de leurs enfans qu’ils le nourrissent, III. 198, 199. Sont-ils obligés, par le droit naturel, [IV-532] de donner à leurs enfans un métier pour gagner leur vie ? ibid. La loi naturelle leur ordonne de nourrir leurs enfans ; mais non pas de les faire héritiers, III. 200 & suiv. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs filles, III. 217, 218. Pouvoient vendre leurs enfans. De là la faculté sans bornes que les Romains avoient de tester, III. 245, 246. La force du naturel leur faisoit souffrir à Rome d’être confondus dans la sixieme classe, pour éluder la loi voconienne en faveur de leurs enfans, III. 255, 256.
Pere de famille. Pourquoi ne pouvoit pas permettre à son fils, qui étoit en sa puissance, de tester, III.249.
Peres de l’Église. Le zele avec lequel ils ont combattu les lois Juliennes est pieux, mais mal entendu, III. 95 & suiv.
Périéciens. Peuple vaincu par les Crétois. Étoient condamnés à exercer l’agriculture, regardée comme un profession servile, I. 78.
Perse. Les ordres du roi y sont irrévocables, I. 56. Comment le prince s’y assure la couronne, I. 125. Bonne coutume de cet état, qui permet à qui veut de sortir du Royaume, I. 430. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en régie, II. 28. La polygamie, du temps de Justinien, n’y empêchoit pas les adulteres, II. 104. Les femmes n’y sont pas même chargées du soin de leurs habillemens, II. 115. La religion des Guebres a rendu ce royaume florissant ; celle de Mahomet le détruit : pourquoi, III. 138, 139. C’est le seul pays où la religion des Guebres pût convenir, III. 159. Le roi y est chef de la religion : l’alcoran borne son pouvoir spirituel, III. 177. Il est aisé, en suivant la méthode de M. l’Abbé Dubos, de prouver qu’elle ne fut point conquise par Alexandre, mais qu’il y fut appellé par les peuples, IV. 91.
Perses. Leur empire étoit despotique, & les anciens le prenoient pour une monarchie, I. 338. Coutume excellente chez eux pour encourager l’Agriculture, II. 45. Comment vinrent à bout de rendre leur pays fertile & agréable, II. 147. Étendue de leur empire : [IV-533] en surent-ils profiter pour le commercer ? II. 293 & suiv. Préjugé singulier qui les a toujours empêché de faire le commerce des Indes, ibid. & 294. Pourquoi ne profiterent pas de la conquête de l’Égypte pour leur commerce, II. 299. Avoient des dogmes faux, mais très-utiles, III. 152. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III. 170. Épousoient leur mere, en conséquence du précepte de Zoroastre, III. 220.
Personnes. Dans quelle proportion doivent être taxées, II. 7, 8.
Peste. L’Égypte en est le siege principal : sages précautions prises en Europe pour en empêcher la communication, II. 51, 52. Pourquoi les Turcs prennent si peu de précautions contre cette maladie, II. 52.
Petits-Enfans. Succédoient, dans l’ancienne Rome, à l’aïeul paternel, & non à l’aïeul maternel : raison de cette disposition, III. 244.
Peuple. Quand il est souverain, comment peut user de sa souveraineté, I. 16. Ce qu’il doit faire par lui-même quand il est souverain ; ce qu’il doit faire par ses ministres, I. 17, 18. Doit, quand il a la souveraineté, nommer ses ministres & son sénat, I. 18. Son discernement dans le choix des généraux & des magistrats, ibid. Quand il est souverain, par qui doit être conduit, ibid. Son incapacité dans la conduite de certaines affaires, I. 20. De quelle importance il est que, dans les états populaires, la division que l’on en fait par classes soit bien faite, ibid. Ses suffrages doivent être publics, I. 23, 24. Son caractere, I. 24, 25. Doit faire les lois dans une démocratie, I. 25. Quel est son état dans l’aristocratie, I. 26. Il est utile que dans une aristocratie il ait quelque influence dans le gouvernement, I. 26, 27. Il est difficile que dans une monarchie, il soit ce que l’auteur appelle vertueux : pourquoi, I. 47, 48. Comment, dans les états despotiques, il est à l’abri des ravages des ministres, I. 53. Ce qui fait sa sureté dans les états despotiques, I. 54. La cruauté du souverain le soulage quelquefois, ibid. Pourquoi on méprise sa franchise dans une [IV-534] monarchie, I. 62. Tient long-temps aux bonnes maximes qu’il a une fois embrassées, I. 83. Peut-il, dans une république, être juge des crimes de lese-majesté ? I. 157. Les lois doivent mettre un frein à la cupidité qui le guideroit dans les jugemens des crimes de lese-majesté, I. 158. Cause de sa corruption, I. 231. Ne doit pas, dans un état libre, avoir la puissance législative : à qui doit la confier, I. 317. é suiv. Son attachement pour les bons monarques, I. 420, 421. Jusqu’à quel point on doit le charger d’impôt, II. 8, 9. Veut qu’on lui fasse illusion dans la levée des impôts : comment on peut conserver cette illusion, II. 10 & suiv. Est plus heureux sous un gouvernement barbare, que sous un gouvernement corrompu, II. 22, 23. Son salut est la première loi, III. 236.
Peuple d’Athenes. Comment fut divisé par Solon, I. 21.
Peuple de Rome. Son pouvoir sous les cinq premiers rois, I. 343 & suiv. Comment il établit sa liberté, I. 349 & suiv. Sa trop grande puissance étoit cause de l’énormité de l’usure, III. 53 & suiv.
Peuple naissant. Il est incommode d’y vivre dans le célibat ; il ne l’est point d’y avoir des enfans : c’est le contraire dans un peuple formé, III. 76.
Peuple romain. Comment fut divisé par Servius Tullius, I. 20, 21. Comment étoit divisé du temps de la république, & comment s’assembloit, I. 350 & suiv.
Peuples. Ceux qui ne cultivent point les terres sont plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil, II. 151 ; 175 — Leur gouvernement, leurs mœurs, II. 152, 152. — Ne tirent point leur ornement de l’art, mais de la nature ; de là la longue chevelure des rois francs, II. 173. Leur pauvreté peut dériver de deux causes qui ont différens effets, I. 241, 242.
Phaleas de Calcédoine. En voulant établir l’égalité, il la rendit odieuse, I. 91.
Phéniciens. Nature & étendue de leur commerce, II. 282. Réussirent à faire le tour de l’Afrique, II. 309. Ptolomée regardoit ce voyage comme fabuleux, II. 313.
[IV-535]
Philippe de Macédoine. Blessé par un calomniateur, II. 421, 422. Comment profita d’une loi de la Grece, qui étoit juste, mais imprudente, III. 411, 412.
Philippe II. dit Auguste. Ses établissemens sont une des sources des coutumes de France, III. 402.
Philippe IV. dit le bel. Quelle autorité il donna aux lois de Justinien, III. 394.
Philippe VI. dit de Valois. Abolit l’usage d’ajourner les seigneurs sur les appels des sentences de leurs juges, & soumit leurs baillis à cet ajournement, III. 365.
Philippe II. roi d’Espagne. Ses richesses furent cause de sa banqueroute & de sa misere, II. 253, 254. Absurdité dans laquelle il tomba, quand il proscrivit le prince d’Orange, II. 436.
Philon. Explication d’un passage de cet auteur touchant les mariages des Athéniens & des Lacédémoniens, I. 90.
Philosophes. Où ont-ils appris les lois de la morale ? D. 244, 245.
Philosophie. Commença à introduire le célibat dans l’empire ; le christianisme acheva de l’y mettre en crédit, III. 105, 106.
Phedre & Hippolyte. Ce sont les accens de la nature qui causent le plaisir que fait cette tragédie aux spectateurs, III. 197, 198.
Pierre I. (le Czar). Mauvaise loi de ce prince, I. 424. Loi sage de ce prince, II. 6, 7. S’y prit mal pour changer les mœurs & les manieres des Moscovites, II. 200 & suiv. Comment a joint le Pont-Euxin à la mer Caspienne, II. 279, 280.
Piété. Ceux que cette vertu inspire parlent toujours de religion, parce qu’ils l’aiment, III. 161.
Pistes. Voyez Édit de Pistes.
Places fortes. Sont nécessaires sur les frontieres d’une monarchie ; pernicieuses dans un état despotique, I. 267.
Placites des hommes libres. Ce qu’on appelloit ainsi dans les temps reculés dans la monarchie, IV. 53.
Plaideurs. Comment traités en Turquie, I. 152. Passions funestes dont ils sont animés, ibid.
[IV-536]
Plaines. La monarchie s’y établit mieux qu’ailleurs, II. 141, 142.
Plantes. Pourquoi suivent mieux les lois naturelles, que les bêtes, I. 5.
Platon. Ses lois étoient la correction de celles de Lacédémone, I. 71. Doit servir de modele à ceux qui voudront faire des institutions nouvelles, I. 74. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 75. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I. 76. Vouloit qu’on punît un citoyen qui faisoit le commerce, I. 78, 79. Vouloit qu’on punît de mort ceux qui recevoient des présens pour faire leur devoir, I. 136. Compare la vénalité des charges à la vénalité de la place de pilote dans un vaisseau, I. 143. Ses lois ôtoient aux esclaves la défense naturelle : on leur doit même la défense civile, II. 88. Pourquoi il vouloit qu’il y eût moins de lois dans une ville où il n’y a point de commerce maritime, que dans une ville où il y en a, II. 260. Ses préceptes sur la propagation, III. 86. Regardoit, avec raison, comme également impies, ceux qui nient l’existence de Dieu, ceux qui croient qu’il ne se mêle point des choses d’ici-bas, & ceux qui croient qu’on l’appaise par des présens, III. 174, 175. A fait des lois d’épargne sur les funérailles, III. 175. Dit que les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des impies pour agréables, puisqu’un homme de bien rougiroit de recevoir des présens d’un mal-honnête homme, III. 176. Lois de ce philosophe contraire à la loi naturelle, III. 194. Dans quel cas il vouloit qu’on punît le suicide, III. 415, 416. Loi vicieuse de ce philosophe, III. 435. Source du vice de quelques-unes de ses lois, III. 440.
Plautius. Son crime, qu’il ne faut pas confondre avec celui de Papirius, affermit la liberté de Rome, I. 418.
Plébéiens. Pourquoi on eut tant de peine à Rome à les élever aux grandes charges : pourquoi ils ne le furent jamais à Athenes, quoiqu’ils eussent droit d’y prétendre dans l’une & dans l’autre ville, I. 19. Comment ils devinrent plus puissans que les [IV-537] patriciens, I. 355, 356. À quoi ils bornerent leur puissance à Rome, I. 358. Leur pouvoir & leurs fonctions à Rome, sous les rois & pendant la république, I. 360. Leurs usurpations sur l’autorité du sénat, I. 264, 265. Voyez Peuple de Rome.
Plébiscites. Ce que c’étoit ; leur origine, & dans quelles assemblées ils se faisoient, I. 356.
Plutarque. Dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels, I. 1. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I. 77. Trait horrible qu’il rapporte des Thébains, I. 81. Le nouvelliste ecclésiastique accuse l’auteur d’avoir cité Plutarque ; & il est vrai qu’il a cité Plutarque, D. 227.
Poëtes. Les décemvirs avoient prononcé à Rome, la peine de mort contr’eux, I. 181. Caractere de ceux d’Angleterre, I. 237.
Poids. Est-il nécessaire de les rendre uniformes par-tout le royaume ? III. 439.
Point d’honneur. Gouvernoit tout au commencement de la troisieme race, III. 319. Son origine, III. 320 & suiv. Comment s’en sont formés les différens articles, III. 321.
Poissons. S’il est vrai, comme on le prétend, que ses parties huileuses soient propres à la génération, l’institut de certains ordres monastiques est ridicule, III. 79.
Police. Ce que les Grecs nommoient ainsi, I. 342. Quels sont les crimes contre la police ; quelles en sont les peines, I. 386, 387. Ses réglemens sont d’un autre ordre que les autres lois civiles, III. 238 & suiv. Dans l’exercice de la police, c’est le magistrat, plutôt que la loi, qui punit ; il n’y faut gueres de formalités, point de grandes punitions, point de grands exemples ; des réglemens, plutôt que des lois : pourquoi, III. 238, 239.
Politesse. Ce que c’est en elle-même : quelles est la source de celle qui est en usage dans une monarchie, I. 62. Flatte autant ceux qui sont polis, que ceux envers qui ils le sont, ibid. Est essentielle dans une monarchie : d’où elle tire sa source, I. 193. Est utile en France : quelle y en est la source, II. 191. [IV-538] Ce que c’est ; en quoi elle differe de la civilité, I. 204, 205. Il y en a peu en Angleterre : elle n’est entrée à Rome, que quand la liberté en est sortie, II. 234. C’est celle des mœurs, plus que celle des manieres, qui doit nous distinguer des peuples barbares, ibid. Naît du pouvoir absolu, ibid.
Politique. Emploie dans les monarchies le moins de vertu qu’il est possible, I. 46. Ce que c’est : le caractere des Anglois les empêche d’en avoir, II. 57. Est autorisée par la religion chrétienne, III. 124.
Politiques. Sources des faux raisonnemens qu’ils ont faits sur le droit de la guerre, I. 277, 278.
Pologne. Pourquoi l’aristocratie de cet état est la plus imparfaite de toutes, I. 30. Pourquoi il y a moins de luxe que dans d’autres états, I. 195. L’insurrection y est bien moins utile qu’elle ne l’étoit en Crete, I. 241. Objet principal des lois de cet état, I. 310. Il lui seroit plus avantageux de ne faire aucun commerce, que d’en faire un quelconque, II. 267, 268.
Polonois. Pertes qu’ils font sur leur commerce en blé, II. 251.
Poltronerie. Ce vice, dans un particulier membre d’une nation guerriere, en suppose d’autres : la preuve par le combat singulier avoit donc une raison fondée sur l’expérience, III. 306, 307.
Poltrons. Comment étoient punis chez les Germains, IV. 57, 58.
Polybe. Regardoit la musique comme nécessaire dans un état, I. 75.
Polygamie. Inconvénient de la polygamie dans les familles des princes d’Asie, I. 127. Quand la religion ne s’y oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds : raisons de cela, II. 96, 97. Raisons de religion à part, elle ne doit pas avoir lieu dans les pays tempérés, II. 97, 98. La loi qui la défend se rapporte plus au physique du climat de l’Europe, qu’au physique du climat de l’Asie, II. 98, 99. Ce n’est point la richesse qui l’introduit dans un état ; la pauvreté peut faire le même effet, II. 99, 100. N’est point un luxe, mais une occasion de luxe, ibid. Ses diverses circonstances, II. 100, [IV-539] 101. A rapport au climat, ibid. La disproportion dans le nombre des hommes & des femmes peut-elle être assez grande pour autoriser la pluralité des femmes, ou celle des maris ? II. 101. Ce que l’auteur en dit n’est pas pour en justifier l’usage, mais pour en rendre raison, ibid. Considérée en elle-même, II. 103. N’est utile ni au genre humain, ni à aucun des deux sexes, ni aux enfans qui en sont le fruit, I. 103, 104. Quelqu’abus qu’on en fasse, elle ne prévient pas toujours les désirs pour la femme d’un autre, II. 104. Mene à cet amour que la nature désavoue, ibid. Ceux qui en usent dans les pays où elle est permise, doivent rendre tout égal entre leurs femmes, II. 105. Dans les pays où elle a lieu, les femmes doivent être séparées d’avec les hommes, II. 106. On ne connoît guere les bâtards dans les pays où elle est permise, III. 71. Elle a pu faire déférer la couronne aux enfans de la sœur, à l’exclusion de ceux du roi, III. 202, 203. Regle qu’il faut suivre dans un état où elle est permise, quand il s’y introduit une religion qui la défend, III. 210, 211. Mauvaise foi ou stupidité du nouvelliste, dans les reproches qu’il fait à l’auteur sur la polygamie, D. 260 & suiv.
Pompée. Ses soldats apportent de Syrie une maladie à peu près semblable à la lepre : elle n’eut pas de suites, II. 50.
Pont-Euxin. Comment Séleucus Nicator auroit pu exécuter le projet qu’il avoit de le joindre à la mer caspienne. Comment Pierre I. l’a exécuté, II. 279, 280.
Pontife. Il en faut un dans une religion qui a beaucoup de ministres, III. 176. Droit qu’il avoit à Rome, sur les hérédités : comment on l’éludoit, III. 415.
Pontificat. En quelles mains doit être déposé, III. 176, 177.
Pope. L’auteur n’a pas dit un mot du systême de Pope, D. 240.
Population. Elle est en raison de la culture des terres & des arts, II. 149, 150. Les petits états lui sont plus favorables que les grands, III. 113. Moyens que l’on employa sous Auguste pour la favoriser, III. 259 & suiv. [IV-540] Voyez propagation.
Port d’armes. Ne doit pas être puni comme un crime capital, III. 239.
Port franc. Il en faut un dans un état qui fait le commerce d’économie, II. 253.
Port de mer. Raison morale & physique de la population que l’on y remarque, malgré l’absence des hommes, III. 79.
Portugais. Découvrent le cap de Bonne-Espérance, II. 346. Comment ils trafiquerent aux Indes, II. 347. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur différent avec les Espagnols : par qui jugé, ibid & suiv. L’or qu’ils ont trouvé dans le Bresil les appauvrira, & achevera d’appauvrir les Espagnols, II. 357. Bonne loi maritime de ce peuple, III. 240.
Portugal. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I. 33. Tout étranger que le droit du sang y appelleroit à la couronne, est rejeté, III. 237.
Pouvoir. Comment on en peut réprimer l’abus, I. 309.
Pouvoir arbitraire. Maux qu’il fait dans un état, II. 4.
Pouvoir paternel. N’est point l’origine du gouvernement d’un seul, I. 11.
Pouvoirs. Il y en a de trois sortes en chaque état, I. 311. Comment son distribués en Angleterre, ibid. Il est important qu’ils ne soient pas réunis dans la même personne ou dans le même corps, I. 312. Effets salutaires de la division des trois pouvoirs, I. 315 & suiv. À qui doivent être confiés, I. 319 & suiv. Comment furent distribués à Rome, I. 349 & suiv. 361 & suiv. — dans les provinces de la domination romaine, I. 372 & suiv.
Pouvoirs intermédiaires. Quelle est leur nécessité & quel doit être leur usage dans une monarchie, I. 31. Quel corps doit plus naturellement en être dépositaire, I. 31, 32.
Praticiens. Lorsqu’ils commencerent à se former, les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs, pour juger, III. 395, 396. Les ouvrages de ceux qui vivoient du temps de S. Louis sont une des sources de nos coutumes de France, III. 403, 404.
Pratiques religieuses. Plus une religion en est chargée, [IV-541] plus elle attache ses sectateurs, III. 163, 163.
Préceptes. La religion en doit moins donner, que de conseils, III. 134.
Préceptions. Ce que c’étoit sous la premiere race de nos rois ; par qui & quand l’usage en fut aboli, IV. 115 & suiv. Abus qu’on en fit, IV. 176 & suiv.
Prédestination. Le dogme de Mahomet sur cet objet, est pernicieux à la société, III. 138. Une religion qui admet ce dogme a besoin d’être soutenue par des lois civiles severes, & sévérement exécutées. Source & effets de la prédestination mahométane, III. 141, 142. Ce dogme donne beaucoup d’attachement pour la religion qui l’enseigne, III. 163.
Prérogatives. Celles des nobles ne doivent point passer au peuple, I. 111.
Présens. On est obligé, dans les états despotiques, d’en faire à ceux à qui on demande des graces, I. 135. Sont odieux dans une république & dans une monarchie, I. 135, 136. Les magistrats n’en doivent recevoir aucun, I. 136. C’est une grande impiété de croire qu’ils appaisent aisément la divinité, III. 174 & suiv.
Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l’homme, III. 434, 435.
Prêt. Du prêt par contrat, III. 53 & suiv.
Prêt à intérêt. C’est dans l’évangile, & non dans les rêveries des scholastiques, qu’il en faut chercher la source, II. 341, 342.
Préteurs. Qualités qu’ils doivent avoir, I. 18. Pourquoi introduisent à Rome les actions de bonne foi, I. 156, 157. Leurs principales fonctions à Rome, I. 362. Temps de leur création : leurs fonctions : durée de leur pouvoir à Rome, I. 368. Suivoient la lettre plutôt que l’esprit des lois, III. 254, 255. Quand commencerent à être plus touchés des raisons d’équité, que de l’esprit de la loi, III. 261.
Prêtres. Sources de l’autorité qu’ils ont ordinairement chez les peuples barbares, II. 185, 186. Les peuples qui n’en ont point sont ordinairement barbares, III. 169. Leur origine, ibid. Pourquoi on s’est accoutumé à les honorer, III. 169, 170. Pourquoi son devenus un corps séparé, III. 170. Dans quel [IV-542] cas il seroit dangereux qu’il y en eût trop, ibid. Pourquoi il y a des religions qui leur ont ôté non-seulement l’embarras des affaires, mais même celui d’une famille, ibid.
Preuves. L’équité naturelle demande que leur évidence soit proportionnée à la gravité de l’accusation, D. 224 ; 236. Celles que nos peres tiroient de l’eau bouillante, du fer chaud & du combat singulier, n’étoient pas si imparfaites qu’on le pense, III. 304 & suiv.
Preuves négatives. N’étoient point admises par la loi salique ; elles l’étoient pas les autres lois barbares, III. 297 & suiv. En quoi consistoient, ibid. Les inconvéniens de la loi qui les admettoit étoient réparés par celle qui admettoit le combat singulier, III. 299 & suiv. Exception de la loi salique à cet égard, III. 298, 299. Autre exception, III. 302, 303. Inconvéniens de celles qui étoient en usage chez nos peres, III. 310 & suiv. Comment entraînoient la jurisprudence du combat judiciaire, III. 312. Ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques, III. 315, 316.
Preuves par l’eau bouillante. Admises par la loi salique. Tempérament qu’elle prenoit, pour en adoucir la rigueur, III. 302, 303. Comment se faisoit, III. 307. Dans quel cas on y avoit recours, III. 307, 308.
Preuves par l’eau froide. Abolies par Lothaire, III. 316.
Preuves par le combat. Par quelles lois admises, III. 299, 300 ; 309. Leur origine, III. 299 & suiv. Lois particulieres à ce sujet, III. 301, 302. Étoient en usage chez les Francs : preuves, III. 309. Comment s’étendirent, ibid & suiv. Voyez Combat judiciaire.
Preuves par le feu. Comment se faisoient. Ceux qui y succomboient étoient des efféminés, qui dans une nation guerriere, méritoient d’être punis, III. 307.
Preuves par témoins. Révolutions qu’a essuyées cette espece de preuves, III. 399, 400.
Priere. Quand elle est réitérée un certain nombre [IV-543] de fois par jour, elle porte trop à la contemplation, III. 138, 139.
Prince. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doit être la regle de ses volontés, I. 31. Est la source de tout pouvoir dans une monarchie, ibid. Il y en a de vertueux, I. 47. Sa sureté dans les mouvemens de la monarchie dépend de l’attachement des corps intermédiaires pour les lois, I. 115, 116. En quoi consiste sa vraie puissance, I. 269. Quelle réputation lui est le plus utile, I. 276. Souvent ne sont tyrans que parce qu’ils sont foibles, I. 395. Ne doit point empêcher qu’on lui parle des sujets disgraciés, I. 429. La plupart de ceux de l’Europe emploient, pour se ruiner, des moyens que le fils de famille le plus dérangé imagineroit à peine, II. 24. Doit toujours avoir une somme de réserve : il se ruine quand il dépense exactement ses revenus, II. 25, 26. Regles qu’il doit suivre, quand il veut faire de grands changemens dans sa nation, II. 200, 201. Ne doit point faire le commerce, II. 261. Dans quel rapport peut fixer la valeur de la monnoie, III. 17, 18. Il est nécessaire qu’il croie qu’il aime, ou qu’il craigne la religion, III. 126. N’est pas libre relativement aux princes des autres états voisins, III. 233, 234. Les traités qu’il a été forcé de faire sont autant obligatoires, que ceux qu’il a fait de bon gré, ibid. Il est important qu’il soit né dans le pays qu’il gouverne ; & qu’il n’ait point d’états étrangers, III. 237.
Prince du sang royal. Usages des Indiens pour s’assurer que leur roi est de ce sang, III. 203.
Principe du Gouvernement. Ce que c’est ; en quoi differe du gouvernement, I. 34. Quel est celui des divers gouvernemens, I. 39. Sa corruption entraîne presque toujours celle du gouvernement, I. 225 & suiv. Moyens très-efficaces pour conserver celui de chacun des trois gouvernemens, I. 248 & suiv.
Privileges. Sont une des sources de la variété des lois dans une monarchie, I. 149. Ce que l’on nommoit ainsi à Rome du temps de la république, I.
[IV-544]
Privileges exclusifs. Doivent rarement être accordés pour le commerce, I. 252 ; 262.
Prix. Comment celui des choses se fixent dans la variation des richesses de signe, III. 12 & suiv.
Probité. N’est pas nécessaire pour le maintien d’une monarchie ou d’un état despotique, I. 39. Combien avoit de force sur le peuple romain, I. 170, 171.
Procédés. Faisoient, au commencement de la troisieme race, toute la jurisprudence, III. 318 & suiv.
Procédure. Le combat judiciaire l’avoit rendue publique, III. 368. Comment devint secrette, III. 368, 369. Lorsqu’elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs, pour juger, III. 395, 396.
Procédure par record. Ce que c’étoit, III. 368, 369.
Procès entre les Portugais & les Espagnols. À quelle occasion : par qui jugé, II. 348.
Procès criminels. Se faisoient autrefois en public : pourquoi : abrogation de cet usage, III. 368 & suiv.
Procope. Faute commise par cet usurpateur de l’empire, I. 142.
Proconsuls. Leurs injustices dans les provinces, I. 373 & suiv.
Procureurs du roi. Utilité de ces magistrats, I. 165, 166. Établis à Majorque par Jacques II. III. 377, 378.
Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce que l’on appelloit autrefois avoués : différence de leurs fonctions, III. 374 & suiv.
Prodigues. Pourquoi ne pouvoient pas tester, III. 248.
Professions. Ont toutes leur lot. Les richesses seulement pour les traitans ; la gloire & l’honneur pour la noblesse ; le respect & la considération pour les ministres & pour les magistrats, II. 29, 30. Est-il bon d’obliger les enfans de n’en point prendre d’autre que celle de leur pere ? II. 264.
Prolétaires. Ce que c’étoit à Rome, III. 256.
Propagation. Lois qui y ont rapport, III. 65 & suiv. Celle des bêtes est toujours constante : celle des hommes est troublée par les passions, par les fantaisies & par le luxe, idib. Est naturellement jointe à la continence publique, III. 67. Est très-favorisée [IV-545] par une loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, III. 68, 69. La dureté du gouvernement y apporte un grand obstacle, III. 77, 78. Dépend beaucoup du nombre relatif des filles & des garçons, III. 78, 79. Raison morale & physique de celle que l’on remarque dans les ports de mer, malgré l’absence des hommes, III. 79. Est plus ou moins grande, suivant les différentes productions de la terre, III. 80, 81. Les vues du législateur doivent à cet égard se conformer au climat, III. 83, 84. Comment étoit réglée dans la Grece, III. 85 & suiv. Lois romaines sur cette matiere, III. 90 & suiv. Dépend beaucoup des principes de la religion, III. & suiv. Est fort gênée par le christianisme, ibid. A besoin d’être favorisée en Europe, III. 115, 116. N’étoit pas suffisamment favorisée par l’édit de Louis XIV. en faveur des mariages, III. 116. Moyens de la rétablir dans un état dépeuplé : il est difficile d’en trouver, si la dépopulation vient du despotisme ou des privileges excessifs du clergé, III. 117, 118. Les Perses avoient, pour la favoriser, des dogmes faux, mais très-utiles, III. 152. Voyez Population.
Propagation de la religion. Est difficile, sur-tout dans des pays éloignés, dont le climat, les lois, les mœurs & les manieres sont différentes de ceux où elle est née ; & encore plus dans les grands empires despotiques, III. 189, 190.
Propres ne remontent point. Origine de cette maxime, qui n’eut lieu d’abord que pour les fiefs, IV. 215.
Propréteurs. Leurs injustices dans les provinces, I. 373 & suiv.
Propriété. Est fondée sur les lois civiles : conséquences qui en résultent, III. 224 & suiv. Le bien public veut que chacun conserve invariablement celle qu’il tient des lois, ibid. La loi civile est son palladium, III. 224.
Proscription. Absurdité dans la récompense promise à celui qui assassineroit le prince d’Orange, III. 436. Avec quel art les triumvirs trouvoient des prétextes pour les faire croire utiles au bien public, I. 412.
[IV-546]
Prostitution. Les enfans, dont le pere a trafiqué la pudicité, sont-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l’indigence ? III. 198, 199.
Prostitution publique. Contribue peu à la propagation : pourquoi, III. 67.
Protaire. Favori de Brunehault, fut cause de la perte de cette princesse, en indisposant la noblesse contr’elle, par l’abus qu’il faisoit des fiefs, IV. 109.
Protestans. Sont moins attachés à leur religion que les catholiques : pourquoi, III. 162, 163.
Protestantisme. S’accommode mieux d’une république, que d’une monarchie, III. 131, 132. Les pays où il est établi sont moins susceptibles de fêtes, que ceux où regne le catholicisme, III. 155.
Provinces romaines. Comment étoient gouvernées, I. 373 & suiv. Étoient désolées par les traitans, I. 376, 377.
Ptolomée. Ce que ce géographe connoissoit de l’Afrique, II. 312. Regardoit le voyage des Phéniciens autour de l’Afrique comme fabuleux : joignoit l’Asie à l’Afrique par une terre qui n’exista jamais : la mer des Indes, selon lui, n’étoit qu’un grand lac, II. 313.
Public (Bien). C’est un paralogisme de dire qu’il doit l’emporter sur le bien particulier, III. 224.
Publicain. Voyez Impôts. Tributs. Fermes. Fermiers. Traitans.
Pudeur. Doit être respectée dans la punition des crimes, II. 405, 406. Pourquoi la nature l’a donnée à un sexe, plutôt qu’à un autre, II. 113, 114.
Puissance. Combien il y en a de sortes dans un état : entre quelles mains le bien de l’état demande qu’elles soient déposées, I. 311 & suiv. Comment, dans un état libre, les trois puissances, celles de juger, l’exécutrice & la législative, doivent se contrebalancer, I. 329 & suiv.
Puissance de juger. Ne doit jamais, dans un état libre, être réunie avec la puissance législative ; exceptions, I. 326 & suiv.
Puissanc exécutrice. Doit, dans un état vraiement libre, [IV-547] être entre les mains d’un monarque, I. 322. Comment doit être tempérée par la puissance législative, I. 324 & suiv.
Puissance législative. En quelles mains doit être déposée, I. 317, 318. Comment doit tempérer la puissance exécutrice, I. 324 & suiv. Ne peut dans aucun cas être accusatrice, I. 327, 328. À qui étoit confiée à Rome, I. 355.
Puissance militaire. C’étoit un principe fondamental de la monarchie, qu’elle fût toujours réunie à la juridiction civile : pourquoi, IV. 52 & suiv.
Puissance paternelle. Combien est utile dans une démocratie : pourquoi on l’abolit à Rome, I. 101. Jusqu’où elle doit s’étendre, 101, 102.
Puissance politique. Ce que c’est, I. 12.
Punition. Avec quelle modération on en doit faire usage dans une république. Cause du danger de leur multiplicité & de leur sévérité, I. 410, 411. Voyez Peines.
Pupiles. Dans quel cas on pouvoit ordonner le combat judiciaire dans les affaires qui les regardoient, III. 335.
Pureté corporelle. Les peuples qui s’en sont formé une idée, ont respecté les prêtres, III. 169, 170.
Pyrénées. Renferment-elles des mines précieuses ? I. 320.
Pythagore. Est)ce dans ses nombres qu’il faut chercher la raison pourquoi un enfant naît à sept mois ? III. 433.
Q
Questeur du parricide. Par qui étoit nommé, & quelles étoient ses fonctions à Rome, I. 366, 367.
Question ou torture. L’usage en doit être aboli : exemples qui le prouvent, I. 187, 188. Peut subsister dans les états despotiques, II. 188. C’est l’usage de ce supplice qui rend la peine des faux témoins capitale en France ; elle ne l’est point en Angleterre, parce qu’on n’y fait point usage de la question, III. 419, 420.
Questions de droit. Par qui étoient jugées à Rome, I. 263.
[IV-548]
Questions de fait. Par qui ? I. 262, 263.
Questions perpétuelles. Ce que c’étoit. Changemens qu’elles causerent à Rome, I. 214 ; 367, 368.
Quintilius Cincinnatus. La maniere dont il vint à bout de lever une armée à Rome, malgré les tribuns, prouve combien les Romains étoient religieux & vertueux, I. 245, 246.
R
Rachat. Origine de ce droit féodal, IV. 207, 208.
Rachis. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
Radamante. Pourquoi expédioit-il les procès avec célérité ? II. 214.
Raguse. Durée des magistratures de cette république, I. 29.
Raillerie. Le monarque doit toujours s’en abstenir, I. 426.
Raison. Il y en a une primitive, I. 2. Ce que l’auteur pense de la raison portée à l’excès, I. 234. Ne produit jamais de grands effets sur l’esprit des hommes, II. 224. La résistance qu’on lui oppose est son triomphe, III. 383.
Rangs. Ceux qui sont établis parmi nous sont utiles : ceux qui sont établis aux Indes par la religion sont pernicieux, III. 154. En quoi consistoit leur différence chez les anciens Francs ? III. 277.
Raoul, duc de Normandie. A accordé les coutumes de cette province, III. 402.
Rappel. Voyez Successions.
Rapport. Les lois sont les rapports qui dérivent de la nature des choses, I. 1. Celui de Dieu avec l’univers, I. 2. — de ses lois avec sa sagesse & sa puissance, ibid. Les rapports de l’équité sont antérieurs à la loi positive qui les établit, I. 3, 4.
Rapt. De quelle nature est ce crie, I. 386.
Rareté de l’or & de l’argent. Sous combien d’acceptions on peut prendre cette expression : Ce que c’est, relativement au change : ses effets, III. 16, & suiv.
Rathimburges. Étoient la même chose que les juges ou les échevins, IV. 56.
[IV-549]
Receleurs. Punis en Grece, à Rome & en France, de la même peine que le voleur : cette loi qui étoit juste en Grece & à Rome, est injuste en France : pourquoi, III. 421, 422.
Recessuinde. La loi par laquelle il permettoit aux enfans d’une femme adultere d’accuser leur mere, étoit contraire à la nature, III. 197. Fut un des réformateurs des lois des Wisigoths, III. 268. Proscrivit les lois romaines, III. 284. Leva la prohibitions des mariages entre les Goths & les Romains : pourquoi, ibid. Voulut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 313.
Recommander. Ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice, IV. 78.
Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décadence d’un état, I. 137. Le despote n’en peut donner à ses sujets qu’en argent ; le monarque en honneurs qui conduisent à la fortune ; & la république en honneurs seulement, I. 137, 138. Une religion qui n’en promettoit point pour l’autre vie, n’attacheroit pas beaucoup, III. 164.
Réconciliation. La religion en doit fournir un grand nombre de moyens, lorsqu’il y a beaucoup de sujets de haine dans un état, III. 147.
Reconnoissance. Ce devoir dérive d’une loi antérieure aux lois positives, I. 4.
Régale. Ce droit s’étend-il sur les églises des payes nouvellemens conquis, parce que la couronne du roi est ronde ? III. 433.
Régie des revenus de l’état. Ce que c’est : ses avantages sur les fermes : exemples tirés des grands états, II. 26 & suiv.
Registre Olim. Ce que c’est, III. 388.
Registres publics. À quoi ont succédé : leur utilisé, III. 399, 400.
Reines régnantes & douairieres. Il leur étoit permis, du temps de Gontran & de Childebert, d’aliéner, pour toujours, même par testament, les choses qu’elles tenoient du fisc, IV. 131.
Religion. L’auteur en parle, non comme théologien, mais comme politique : il ne veut qu’unir les intérêts de la vraie religion avec la politique : c’est [IV-550] être fort injuste, que de lui prêter d’autres vues, III. 123, 124. C’est par ses lois que Dieu rappelle sans cesse l’homme à lui, I. 6. Pourquoi a tant de force dans les états despotiques, I. 35 ; 80, 81. Est dans les états despotiques supérieure aux volontés du prince, I. 56. Ne borne point dans une monarchie les volontés du prince, I. 57. Ses engagemens ne sont point conformes à ceux du monde : & c’est-là une des principales sources de l’inconséquence de notre conduite, I. 68. Quels sont les crimes qui l’intéressent, I. 384. Peut mettre un peu de liberté dans les états despotiques, I. 426, 427. Raisons physiques de son immutabilité en orient, II. 40, 41. Doit dans les climats chauds exciter les hommes à la culture des terres, II. 43. A-t-on droit, pour travailler à sa propagation, de réduire en esclavage ceux qui ne professent pas ? C’est cette idée qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans leurs crimes, II. 67. Gouverne les hommes concurremment avec le climat, les lois, les mœurs, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189. Corrompit les mœurs à Corinthe, II. 290. A établi dans certains pays divers ordres de femmes légitimes, III. 69, 70. C’est par raison de climat qu’elle veut à Formose que la prêtresse fasse avorter les femmes qui accoucheroient avant l’âge de trente-cinq ans, III. 84. Les princes des différentes religions tantôt choquent, tantôt favorisent la propagation, III. 107. Entre les fausses, la moins mauvaise est celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans cette vie, III. 123. Vaut-il mieux n’en avoit point du tout, que d’en avoir une mauvaise ? III. 125. Est-elle un motif réprimant ? Les maux qu’elle a faits sont-ils comparables aux biens qu’elle a faits, III. 125, 126. Doit donner plus de conseils de que lois, III. 134. Quelle qu’elle soit, elle doit s’accorder avec les lois de la morale, III. 135 & suiv. Ne doit pas trop porter à la contemplation, III. 138, 139. Quelle est celle qui ne doit point avoir de crimes inexpiables, III. 139, 140. Comment sa force s’applique à celle des lois civiles. Son principal but [IV-551] doit être de rendre les hommes bons citoyens, III. 141 & suiv. Celle qui admet la fatalité absolue doit être soutenue par des lois séveres, & sévérement exécutées, III. 141, 142. Quand elle défend ce que les lois civiles doivent permettre, il est dangereux que de leur côté elles ne permettent ce qu’elle doit condamner, III. 142, 143. C’est une chose bien funeste quand elle attache la justification à une chose d’accident, III. 143, 144. Celle qui ne promettroit dans l’autre monde que des récompenses & des punitions, seroit funeste, III. 144. Comment celles qui sont fausses sont quelquefois corrigées par les lois civiles, III. 144, 145. Comment ses lois corrigent les inconvéniens de la constitution politique, 145 & suiv. Comment ses ois ont l’effet des lois civiles, III. 148, 149. Ce n’est pas la vérité ou la fausseté des dogmes qui les rend utiles ou pernicieuses ; c’est l’usage ou l’abus qu’on fait de ces dogmes, III. 149 & suiv. Ce n’est pas assez qu’elle établisse un dogme ; il faut qu’elle le dirige, III. 151. Ne doit jamais inspirer d’aversion pour les choses indifférentes, III. 153, 154. Ne doit inspirer de mépris pour rien que pour les vices, III. 154. Si on en établissoit une nouvelle dans les Indes, il faudroit, quant au nombre des fêtes, se conformer au climat, III. 156. Est susceptible de lois locales, ibid. & suiv. Moyens de la rendre plus générale, ibid. Il y a de l’inconvénient à transporter une religion d’un pays à un autre, III. 158 & suiv. Celle qui est fondée sur le climat ne peut sortir de son pays, III. 160. Toute religion doit avoir des dogmes particuliers, & un culte général, ibid. Quelles sont celles qui attachent le plus leurs sectateurs, III. 161 & suiv. Nous sommes fort portés aux religions idolâtres, sans y être attachés : nous ne sommes guere portés aux religions spirituelles, & nous y sommes fort attachés, III. 162, 163. Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort, III. 170. Il y faut faire des lois d’épargne, III. 175. Ne doit pas, sous prétexte de dons, exiger ce que les nécessités de l’état ont laissé aux peuples, III. 176. Ne doit [IV-552] pas encourager les dépenses des funérailles, ibid. Celle qui a beaucoup de ministres doit avoir un pontife, ibid. Quand on en tolere plusieurs dans un état, on doit les obliger de se tolérer entr’elles, III. 178. Celle qui est opprimée devient elle-même tôt ou tard réprimante, ibid. Il n’y a que celles qui sont intolérables qui ayent du zele pour leur propagation, III. 179. C’est une entreprise fort dangereuse pour un prince, même despotique, de vouloir changer celle de son état : pourquoi, III. 180. Pour en faire changer, les invitations telles que sont la faveur, l’espérance de la fortune, &c. sont plus fortes que les peines, III. 181, 182. Sa propagation est difficile, sur-tout dans les pays éloignés, dont le climat, les lois, les mœurs & les manieres sont différens de ceux où elle est née, & encore plus dans les grands empires despotiques, III. 189, 190. Les Européens insinuent la leur dans les pays étrangers par le moyen des connoissances qu’ils y portent : les disputes s’élevent entr’eux ; ceux qui ont quelqu’intérêt sont avertis ; on proscrit la religion & ceux qui la prêchent, III. 190. C’est la seule chose fixe qu’il y ait dans un état despotique, III. 193. D’où vient sa principale force, III. 194. C’est elle qui dans certains états fixe le trône dans certaines familles, III. 203. On ne doit point décider par ses préceptes lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, III. 204. Ses lois ont plus de sublimité, mais moins d’étendue que les lois civiles, III. 207. Objet de ses lois, ibid. Les principes de ses lois peuvent rarement régler ce qui doit l’être par les principes du droit civil, ibid. Dans quel cas il faut suivre ses lois à l’égard des mariages, & dans quel cas il faut suivre les lois civiles, III. 213 & suiv. Les idées de religion ont souvent jeté les hommes dans de grands égaremens, III. 219, 220. Quel est sont esprit, III. 220. De ce qu’elle a consacré un usage, il ne faut pas conclure que cet usage soit naturel, ibid. Est-il nécessaire de la rendre uniforme dans toutes les parties de [IV-553] l’état ? III. 439. Dans quelles vues l’auteur a parlé de la vraie, & dans quelles vues il a parlé des fausses, D. 256 & suiv.
Religion catholique. Convient mieux à une monarchie que la protestante, III. 131, 132.
Religion chrétienne. Combien nous a rendus meilleurs, I. 277. Il est presqu’impossible qu’elle s’établisse jamais à la Chine, II. 208, 209. Peut s’allier très-difficilement avec le despotisme, facilement avec la monarchie & le gouvernement républicain, ibid. III. 127 & suiv. Separe l’Europe du reste de l’univers ; s’oppose à la réparation des pertes qu’elle fait du côté de la population, III. 115. A pour objet le bonheur éternel & temporel des hommes : elle veut donc qu’ils ayent les meilleures lois politiques & civiles, III. 124. Avantages qu’elle a sur toutes les autres religions, même par rapport à cette vie, III. 127. N’a pas seulement pour objet notre félicité future, mais elle fait notre bonheur dans ce monde : preuves par faits, III. 128 & suiv. Pourquoi n’a point de crimes inexpiables ; beau tableau de cette religion, III. 140.
L’esprit des Lois n’étant qu’un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence, l’auteur n’a pas eu pour objet de faire croire la religion chrétienne, mais il a cherché à la faire aimer, D. 221, 222. Preuves que M. de Montesquieu la croyoit & l’aimoit, D. 229 & suiv. Ne trouve d’obstacle nulle part où Dieu la veut établir, D. 275, 276. Voyez Christianisme.
Religion de l’île Formose. La singularité de ses dogmes prouve qu’il est dangereux qu’une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, III. 143.
Religion des Indes. Prouve qu’une religion qui justifie par une chose d’accident, perd inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les hommes, ibid.
Religion des Tartares de Gengis-kan. Ses dogmes singuliers prouvent qu’il est dangereux qu’une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, III. 142, 143.
Religion juive a été autrefois chérie de Dieu ; elle doit [IV-554] donc l’être encore ; réfutation de ce raisonnement, qui est la source de l’aveuglement des Juifs ? III. 184.
Religion naturelle. Est-ce en être sectateur de dire que l’homme pouvoit à tous les instans oublier son créateur, & que Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion ? D. 243, 244. — que le suicide est en Angleterre l’effet d’une maladie ? D. 247, 248. — que d’expliquer quelque chose de ses principes ? D. 251 & suiv. Loin d’être la même chose que l’athéisme, c’est elle qui fournit les raisonnemens pour le combattre, D. 252.
Religion protestante. Pourquoi est-elle plus répandue dans le nord ? III. 131, 132.
Religion révélée. L’auteur en reconnoît une : preuves, D. 229 & suiv.
Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le despotisme, I. 55. Leur utilité dans une monarchie, I. 114.
Remontrances aux inquisiteurs d’Espagne & de Portugal, où l’injuste cruauté de l’inquisition est démontrée, III. 183 & suiv.
Renonciation à la couronne. Il est absurde de revenir contre par les restrictions tirées de la loi civile, III. 228. Celui qui la fait, & ses descendans contre qui elle est faite, peuvent d’autant moins se plaindre, que l’état auroit pu faire une loi pour les exclure, III. 237, 238.
Rentes. Pourquoi elles baisserent après la découverte de l’Amérique, III. 10, 11.
Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l’état & sur les particuliers, sont-ils ceux de tous les citoyens qui, comme les moins utiles à l’état, doivent être les moins ménagés ? II. 49, 50.
Repos. Plus les causes physiques y portent les hommes, plus les causes morales les en doivent éloigner, II. 42.
Représentans le peuple dans un état libre. Quels ils doivent être, par qui choisis, & pour quel objet, I. 317 & suiv. Quelles doivent être leurs fonctions, I. 319.
République. Combien il y en a de sortes, I. 16. [IV-555] Comment se change en état monarchique, ou même despotique, I. 27. Nul citoyen n’y doit être revêtu d’un pouvoir exorbitant, ibid. Exception à cette regle, ibid. Quelle y doit être la durée des magistratures, I. 19. Quel en est le principe, I. 39. Peinture exacte de son état, quand la vertu n’y regne plus, I. 42. Les crimes privés y sont plus publics que dans une monarchie, I. 47. L’ambition y est pernicieuse, I. 50. Pourquoi les mœurs y sont plus pures que dans une monarchie, I. 61. Combien l’éducation y est essentielle, I. 69. Comment peut être gouvernée sagement, & être heureuse, I. 86. Les récompenses n’y doivent consister qu’en honneurs, I. 137. Y doit-on contraindre les citoyens d’accepter les emplois publics ? I. 138. Les emplois civils & militaires doivent y être réunis, I. 140. La vénalité des charges y seroit pernicieuse, I. 142, 143. Il y faut des censeurs, I. 143 & suiv. Les fautes y doivent être punies comme les crimes, I. 144. Les formalités de justice y sont nécessaires, I. 151 & suiv. Dans les jugemens, on y doit suivre le texte précis de la loi, I. 154 & suiv. Comment les jugemens doivent s’y former, I. 155. À qui le jugement des crimes de lese-majesté doit être confié ; & comment on y doit mettre un frein à la cupidité du peuple dans ses jugemens, I. 157 & suiv. La clémence y est moins nécessaire que dans la monarchie, I. 190, 191. Les républiques finissent par le luxe, I. 202. La continence publique y est nécessaire, I. 208. Pourquoi les mœurs des femmes y sont austeres, I. 210, 211. Les dots des femmes y doivent être médiocres, I. 220. La communauté de biens entre mari & femme, n’y est pas si utile que dans une monarchie, I. 221. Les gains nuptiaux des femmes y seroient pernicieux, ibid. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 248 & suiv. Comment pourvoit à sa sureté, I. 259 & suiv. Il y a dans ce gouvernement un vice intérieur, auquel il n’y a point de remede, & qui le détruit tôt ou tard, I. 259. Esprit de ce gouvernement, I. 263. Quand & comment peut faire des conquêtes, I. 284. Conduite qu’elle doit tenir avec les peuples [IV-556] conquis, I. 287. On croit communément que c’est l’état où il y a le plus de liberté, I. 307, 308. Quel est le chef-d’œuvre de législation dans une petite république, I. 341. Pourquoi, quand elle conquiert, elle ne peut pas gouverner les provinces conquises autrement que despotiquement ? I. 375. Il est dangereux d’y trop punir le crime de lese-majesté, I. 410 & suiv. Comment on y suspend l’usage de la liberté, I. 413, 414. Lois qui y sont favorables à la liberté des citoyens, I. 414, 415. Quelles y doivent être les lois contre les débiteurs, I. 415 & suiv. Tous les citoyens y doivent-ils avoir la liberté de sortir des terres de la république ? I. 430. Quels tributs elle peut lever sur les peuples qu’elle a rendus esclaves de la glebe, II. 5. On y peut augmenter les tributs, II. 18. Quel impôt y est le plus naturel, II. 19, 20. Ses revenus sont presque toujours en régie, II. 27, 28. La profession des traitans n’y doit pas être honorée, II. 29. La pudeur des femmes esclaves y doit être à couvert de l’incontinence de leurs maîtres, II. 78, 79. Le grand nombre d’esclaves y est dangereux, II. 80. Il est plus dangereux d’y armer les esclaves, que dans une monarchie, II. 81. Réglemens qu’elle doit faire touchant l’affranchissement des esclaves, II. 90 & suiv. L’empire sur les femmes n’y pourroit pas être bien exercé, II. 107. Il s’en trouve plus souvent dans les pays stériles, que dans les pays fertiles, II. 139 & suiv. Il y a des pays où il seroit impossible d’établir ce gouvernement, II. 186, 187. S’allie très-facilement avec la Religion chrétienne, II. 208, 209. Le commerce d’économie y convient mieux que celui de luxe, II. 242 & suiv. On y peut établir un port franc, II. 253. Comment doit acquitter ses dettes, III. 49. Les bâtards y doivent être plus odieux que dans les monarchies, III. 71. Il y en a où il est bon de faire dépendre les mariages des magistrats, III. 73. On y réprime également le luxe de vanité, & celui de superstition, III. 175. L’inquisition n’y peut former que de mal-honnêtes gens, III. 211. On y doit faire ensorte que les femmes ne puissent [IV-557] s’y prévaloir pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l’espérance de leurs richesses, III. 262, 263. Il y a certaines républiques où l’on doit punir ceux qui ne prennent aucun parti dans les séditions, III. 409, 410.
République fédérative. Ce que c’est : cette espece de corps ne peut être détruit : pourquoi, I. 259 & suiv. De quoi doit être composée, I. 262, 263. Ne peut que très-difficilement subsister, si elle est composée de républiques & de monarchies : raisons & preuves, I. 263. Les états qui la composent ne doivent pas conquérir les uns sur les autres, I. 284.
Républiques anciennes. Vice essentiel qui les travailloit, I. 319 ; 328. Tableau de celles qui existoient dans le monde avant la conquête des Romains. Tous les peuples connus, hors la Perse, étoient alors en républiques, I. 336.
Républiques d’Italie. Les peuples y sont moins libres que dans nos monarchies : pourquoi, I. 313, 314. Touchent presque au despotisme : ce qui les empêche de s’y précipiter, I. 314.
Républiques grecques. Dans les meilleures, les richesses étoient aussi onéreuses que la pauvreté, I. 199. Leur esprit étoit de se contenter de leurs territoires : c’est ce qui les fit subsister si long-temps, I. 249.
Répudiation. La faculté d’en user en étoit accordée à Athenes, à la femme comme à l’homme, II. 116. Différence entre le divorce & la répudiation : la faculté de répudier doit être accordée par-tout où elle a lieu aux femmes comme aux hommes ; pourquoi, II. 119 & suiv. Est-il vrai que pendant cinq cent vingt ans personne n’osa à Rome user du droit de répudier accordé par la loi ? II. 219 & suiv. Les lois sur cette matiere changerent à Rome, à mesure que les mœurs y changerent, II. 218, 219.
Rescrits. Sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 437, 438.
Restitution. Il est absurde de vouloir employer contre la renonciation à une couronne, celles qui sont tirées de la loi civile, III. 228.
Résurrection des corps. Ce dogme, mal dirigé, peut avoir des conséquences funestes, III. 151.
[IV-558]
Retrait lignager. Pernicieux dan une aristocratie, I. 109. Utile dans une monarchie, s’il n’étoit accordé qu’aux nobles, I. 111. Quand il a pu commencer à avoir lieu à l’égard des fiefs, IV. 217.
Revenus publics. Usage qu’on en doit faire dans une aristocratie, I. 106. Leur rapport avec la liberté : en quoi ils consistent : comment on les peut & on les doit fixer, II. 1 & suiv.
Révolutions. Ne peuvent se faire qu’avec des travaux infinis, & de bonnes mœurs ; & ne peuvent se soutenir qu’avec de bonnes lois, I. 98, 99. Difficiles & rares dans les monarchies ; faciles & fréquentes dans les états despotiques, I. 115, 116. Ne sont pas toujours accompagnées de guerres, I. 116. Remettent quelquefois les lois en vigueur, I. 348.
Rhodes. On y avoit outré les lois touchant la sureté du commerce, II. 259. A été une des villes les plus commerçantes de la Grece, II. 290, 291.
Rhodes (Le marquis de). Ses rêveries sur les mines des Pyrénées, II. 320.
Rhodiens. Quel étoit l’objet de leurs lois, II. 207. Leurs lois donnoient le navire & sa charge à ceux qui restoient dedans pendant la tempête ; & ceux qui l’avoient quitté n’avoient rien, III. 340, 341.
Richelieu (Le cardinal de). Pourquoi exclut les gens de bas lieu de l’administrations des affaires, dans une monarchie, I. 48. Preuve de son amour pour le despotisme, I. 113. Suppose, dans le prince & dans ses ministres, une vertu impossible, I. 116, 117. Donne dans son testament un conseil impraticable, III. 429.
Richesses. Combien, quand elles sont excessives, rendent injustes ceux qui les possedent, I. 92, 92. Comment peuvent demeurer également partagées dans un état, I. 193. Étoient aussi onéreuses dans les bonnes républiques grecques, que la pauvreté, I. 199. Effets bienfaisans de celles d’un pays, II. 4. En quoi les richesses consistent, II. 266. Leurs causes & leurs effets, II. 276, 277. Dieu veut que nous les méprisions : ne lui faisons donc pas voir, en lui offrant nos trésors, que nous les estimons, III. 175.
[IV-559]
Ripuaires. La majorité étoit fixée par leur loi, III. 176. Réunis avec les Saliens sous Clovis, conserverent leurs usages, III. 265. Quand & par qui leurs usages furent mis par écrit, ibid. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III. 266, 267. Comment leurs lois cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Leurs lois se contentoient de la preuve négative, III. 298. — & toutes les lois barbares, hors la loi salique, admettoient la preuve par le combat singulier, III. 299. Cas où ils admettoient l’épreuve par le fer, III. 308. Voyez Francs ripuaires.
Rites. Ce que c’est à la Chine, II. 205, 206.
Riz. Les pays qui en produisent sont beaucoup plus peuplés que d’autres, III. 80, 81.
Robe (Gens de). Quel rang tiennent en France : leur état ; leurs fonctions, II. 264, 265.
Rohan (Duché de). La succession des rotures y appartient au dernier des mâles : raisons de cette loi, I. 161, 162.
Rois. Ne doivent rien ordonner à leurs sujets qui soit contraire à l’honneur, I. 64. Leur personne doit être sacrée, même dans les états les plus libres, I. 325. Il vaut mieux qu’un roi soit pauvre, & son état riche, que de voir l’état pauvre, & le roi riche, II. 360. Leurs droits à la couronne ne doivent se régler par la loi civile d’aucun peuple, mais par la loi politique seulement, III. 227, 228.
Rois d’Angleterre. Sont presque toujours respectés au dehors, & inquiétés au dedans, II. 229. Pourquoi, ayant une autorité si bornée, ont tout l’appareil & l’extérieur d’une puissance si absolue, I. 230.
Rois de France. Sont la source de toute justice dans leur royaume, III. 347, 348. On ne pouvoit fausser les jugemens rendus en leur cour, ou rendus dans celle des seigneurs par des hommes de la cour royale, ibid. Ne pouvoient, dans le siecle de Saint Louis, faire des ordonnances générales pour tout le royaume, sans le consentement des barons, III. 360 & suiv. Germe de l’histoire de ceux de la premiere race, IV. 7, 8. L’usage où ils étoient autrefois de partager leur royaume entre leurs enfans, [IV-560] Est une des sources de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 21. Leurs revenus étoient bornée autrefois à leur domaine, qu’ils faisoient valoir par leurs esclaves : preuves, IV. 34, 35. Dans les commencemens de la monarchie, ils levoient des tributs sur les serfs de leurs domaines seulement ; & ces tributs se nommoient census ou cens, IV. 38. Voyez Ecclésiastiques. Seigneurs.
— Bravoure de ceux qui régnerent dans le commencement de la monarchie, IV. 50. En quoi consistoient leurs droits sur les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, IV. 56, 57. Ne pouvoient rien lever sur les terres des Francs : c’est pourquoi la justice ne pouvoit pas leur appartenir dans les fiefs, mais aux seigneurs seulement, IV. 69 & suiv. Leurs juges ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief pour y faire aucunes fonctions, IV. 70, 71. Férocité de ceux de la premiere race : ils ne faisoient pas les lois, mais suspendoient l’usage de celles qui étoient faites, IV. 113 & suiv. En quelle qualité ils présidoient dans les commencemens de la monarchie aux tribunaux & aux assemblées où se faisoient les lois ; & en quelle qualité ils commandoient leurs armées, IV. 124. Époque de l’abaissement de ceux de la premiere race, IV. 128. Quand, & pourquoi les maires les tinrent enfermés dans leurs palais, IV. 129. Ceux de la seconde race furent électifs & héréditaires en même temps, IV. 159 & suiv. Leur puissance directe sur les fiefs. Comment & quand ils l’ont perdue, IV. 189 & suiv.
Rois de Rome. Étoient électifs-confirmatifs, I. 343. Quel étoit le devoir des cinq premiers, ibid & suiv. Quel étoit leur compétence dans les jugemens, I. 363.
Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue chevelure, II. 173. Pourquoi avoient plusieurs femmes, & leurs sujets n’en avoient qu’une, II. 173, 174. Leur majorité, II. 175 & suiv. Raisons de leur esprit sanguinaire, II. 180, 181.
Rois des Germains. On ne pouvoit l’être avant la majorité. Inconvéniens qui firent changer cet usage, [IV-561] I. 178, 179. Étoient différens des chefs ; & c’est dans cette différence que l’on trouve celle qui étoit entre le roi & le maire du palais, IV. 123 & suiv.
Romains. Pourquoi introduisirent les actions dans leurs jugemens, I. 156. Ont été long-temps réglés dans leurs mœurs, sobres & pauvres, I. 245. Avec quelle religion ils étoient liés par la foi du serment : exemples singuliers, I. 245, 246. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu’ailleurs, I. 271. Leur injuste barbarie dans les conquêtes, I. 277. Leurs usages ne permettoient pas de faire mourir une fille qui n’étoit pas nubile : comment Tibere concilia cet usage avec sa cruauté, I. 406. Leur sage modération dans la punition des conspirations, I. 411, 412. Époque de la dépravation de leurs ames, ibid. Avec quelles précautions ils privoient un citoyen de sa liberté, I. 414. Pourquoi pouvoient s’affranchir de tout impôt, II. 16, 17. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle les peuples du nord se maintinrent contre leur puissance, II. 40. La lepre étoit inconnue aux premiers Romains, II. 49. Ne se tuoient point sans sujet : différence à cet égard entr’eux & les Anglois, II. 52, 53. Leur police touchant les esclaves n’étoit pas bonne, II. 79. Leurs esclaves sont devenus redoutables à mesure que les mœurs se sont corrompues, & qu’ils ont fait contr’eux des lois plus dures. Détail de ces lois, II. 83 & suiv. Mithridate profitoit de la disposition des esprits pour leur reprocher les formalités de leur justice, II. 186. Les premiers ne vouloient point de roi, parce qu’ils n’en pouvoient souffrir les manieres, II. 187, 188. Trouvoient, du temps des empereurs, qu’il y avoit plus de tyrannie à les priver d’un baladin, qu’à leur imposer des lois trop dures, II. 188. Idée bizarre qu’ils avoient de la tyrannie sous les empereurs, ibid. Étoient gouvernés par les maximes du gouvernement & les mœurs anciennes, II. 189. Leur orgueil leur fut utile, parce qu’il étoit joint à d’autres qualités morales, II. 195. Motifs de leurs [IV-562] lois au sujet des donations à cause de noces, II. 217, 218. Pourquoi leurs navires étoient plus vîtes que ceux des Indes, II. 284, 285. Plan de leur navigation : leur commerce aux Indes n’étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II. 307, 308. Ce qu’ils connoissoient de l’Afrique, II. 311 & suiv. Où étoient les mines d’où ils tiroient l’or & l’argent, II. 319, 320. Leur traité avec les Carthaginois touchant le commerce maritime, II. 322. Belle description du danger auquel Mithridate les exposa, II. 324 & suiv. Pour ne pas paroître conquérans, ils étoient destructeurs : conséquences de ce systême, II. 326. Leur génie pour la marine, II. 326, 327. La constitution politique de leur gouvernement, leur droit des gens & leur droit civil, étoient opposés au commerce, II. 327 & suiv. Comment réussirent à faire un corps d’empire de toutes les nations conquises, II. 330. Ne vouloient point de commerce avec les barbares, ibid. N’avoient pas l’esprit de commerce, II. 331. Leur commerce avec l’Arabie & les Indes, ibid. & suiv. Pourquoi le leur fut plus considérable que celui des rois d’Égypte, II. 335 & suiv. Leur commerce intérieur, II. 337, 338. Beauté & humanité de leurs lois, II. 339. Ce que devint le commerce après leur affoiblissement en orient, II. 340 & suiv. Quelle étoit originairement leur monnoie ; ses inconvéniens, III. 4. Les changemens qu’ils firent dans leur monnoie sont des coups de sagesse qui ne doivent pas être imités, III. 35 & suiv. On ne les trouve jamais si supérieurs, que dans le choix des circonstances où ils ont fait les biens & les maux, III. 40. Changemens que leurs monnoies essuyerent sous les empereurs, III. 40 & suiv. Taux de l’usure dans les différens temps de la république : comment on éludoit les lois contre l’usure ; ravages qu’elle fit, III. 53 & suiv. État des peuples avant qu’il y eût des Romains, III. 87, 88. Ont englouti tous les états, & dépeuplé l’univers, III. 88. Furent dans la nécessité de faire des lois pour la propagation de l’espece : détails de ces lois, III. 89 & suiv. Leur respect pour les vieillards, III. 96. Leurs lois [IV-563] & leurs usages sur l’exposition des enfans, III. 110 & suiv. Tableau de leur empire dans le temps de sa décadence : c’est eux qui sont cause de la dépopulation de l’univers, III. 112. N’auroient pas commis les ravages & les massacres qu’on leur reproche, s’ils eussent été chrétiens, III. 128. Loi injuste de ce peuple touchant le divorce, III. 196. Leurs réglemens & leurs lois civiles pour conserver les mœurs des femmes, furent changées quand la religion chrétienne eut pris naissance, III. 207 & suiv. Leurs lois défendoient certains mariages, & mêmes les annulloient, III. 215. Désignoient les freres & les cousins germains par le même mot, III. 219. Quand il s’agit de décider du droit à une couronne, leurs lois civiles ne sont pas plus applicables que celles d’aucun peuple, III. 228. Origine & révolutions de leurs lois sur les successions, III. 242-264. Pourquoi leurs testamens étoient soumis à des formalités plus nombreuses que ceux des autres peuples, 249, 250. Par quels moyens ils chercherent à réprimer le luxe de leurs femmes, auquel leurs premieres lois avoient laissé une porte ouverte, III. 251 & suiv. Comment les formalités leur fournissoient des moyens d’éluder la loi, III. 254 & suiv. Tarif de la différence que la loi salique mettoit entr’eux & les Francs, III. 272 & suiv. Ceux qui habitoient dans le territoire des Wisigoths étoient gouvernés par le code Théodosien, III. 276. La prohibition de leurs mariages avec les Goths fut levée par Récessuinde : pourquoi, III. 284. Pourquoi n’avoient point de partie publique, III. 373. Pourqoi regardoient comme un déshonneur de mourir sans héritier, III. 414, 415. Pourquoi ils inventerent les substitutions, ibid. Il n’est pas vrai qu’ils furent tous mis en servitude lors de la conquête des Gaules par les barbares : ce n’est donc pas dans cette prétendue servitude qu’il faut chercher l’origine des fiefs, IV. 11 & suiv. Ce qui a donné lieu à cette fable, IV. 19, 20. Leurs révoltes dans les Gaules contre les peuples barbares conquérans, sont la principale source de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 20 & suiv. Payoient [IV-564] seuls des tributs dans les commencemens de la monarchie françoise : traits d’histoire & passages qui le prouvent, IV. 25 & suiv. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, IV. 30 & suiv. Ce n’est point de leur police générale que dérive ce qu’on appelloit autrefois dans la monarchie census ou cens : ce n’est point de ce cens chimérique que dérivent les droits des seigneurs : preuves, IV. 40 & suiv. Ceux qui, dans la domination françoise étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, IV. 47. Leurs usages sur l’usure, D. 297 & suiv. Voyez Droit romain. Lois romaines. Rome.
Romans de chevalerie. Leur origine, IV. 325.
Rome ancienne. Une des principales causes de sa ruine fut de n’avoit pas fixé le nombre des citoyens qui devoient former les assemblées, I. 17. Tableau raccourci des différentes révolutions qu’elle a essuyées, ibid. Pourquoi on s’y détermina si difficilement à élever les Plébéiens aux grandes charges, I. 19. Les suffrages secrets furent une des grands causes de sa chute, I. 23, 24. Sagesse de sa constitution, I. 25. Comment défendoit son aristocratie contre le peuple, I. 28. Utilité de ses dictateurs, ibid. Pourquoi ne put rester libre après Sylla, I. 41. Source de ses dépenses publiques, I. 85. Par qui la censure y étoit exercée, I. 100. Loi funeste qui y fut établie par les décemvirs, I. 104. Sagesse de sa conduite pendant qu’elle inclina vers l’aristocratie, I. 105. Est admirable dans l’établissement de ses censeurs, I. 108. Pourquoi, sous les empereurs, les magistratures y furent distinguées des emplois militaires, I. 141. Combien les lois y influoient dans les jugemens, I. 154, 155. Comment les lois y mirent un frein à la cupidité qui auroit pu diriger les jugemens du peuple, I. 158. Exemples de l’excès du luxe qui s’y introduisit, I. 198. Comment les institutions y changerent avec le gouvernement, I. 213, 214. Les femmes y étoient dans une perpétuelle tutelle. Cet usage fut abrogé : pourquoi, I. 215, 216. La crainte de Carthage l’affermit, I. 234. Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel on pût trouver des juges integres, [IV-565] I. 243 & suiv. Pendant qu’elle fut vertueuse, les plébéiens eurent la magnanimité d’élever toujours les patriciens aux dignités qu’ils s’étoient rendues communes avec eux, I. 144, 145. Les associations les mirent en état d’attaquer l’univers, & mirent les barbares en état de lui résister, I. 260. Si Annibal l’eût prise, c’étoit fait de la république de Carthage, I. 285, 286. Quel étoit l’objet de son gouvernement, I. 320. On y pouvoit accuser les magistrats : utilité de cet usage, I. 326. Ce qui fut cause que le gouvernement changea dans cette république, I. 329. Pourquoi cett république, jusqu’au temps de Marius, n’a point été subjuguée par ses propres armées, I. 331. Description & causes des révolutions arrivées dans le gouvernement de cet état, I. 342 & suiv. Quelle étoit la nature de son gouvernement sous ses rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea sous ses deux derniers rois, I. 344. Ne prit pas, après l’expulsion de ses rois, le gouvernement qu’elle devoit naturellement prendre, I. 347, 348. Par quel moyen le peuple y établit sa liberté. Temps & motifs de l’établissement des différentes magistratures, I. 349, 350. Comment le peuple s’y assembloit, & quel étoit le temps de ses assemblées, 350 & suiv. Comment, dans l’état le plus florissant de la république, elle perdit tout-à-coup sa liberté, I. 363 & suiv. Révolutions qui y furent causées par l’impression que les spectacles y faisoient sur le peuple, I. 354, 355. Puissance législative dans cette république, I. 355. Ses institutions la sauverent de la ruine où les plébéiens l’entraînoient par l’abus qu’ils faisoient de leur puissance, I. 356, 357. Puissance exécutrice dans cette république, I. 358 & suiv. Belle description des passions qui animoient cette république, de ses occupations ; & comment elles étoient partagées entre les différens corps, I. 358, 359. Détail des différens corps & tribunaux qui y eurent successivement la puissance de juger. Maux occasionnés par ces variations. Détail des différentes especes de jugemens qui y étoient en usage, I. 361 & suiv. Maux qu’y causerent les traitans, I. [IV-566] 369 & suiv. Comment gouverna les provinces dans les différens degrés de son accroissement, I. 373 & suiv. Comment on y levoit les tributs, I. 376, 377. Pourquoi la force des provinces conquises ne fit que l’affoiblir, I. 377. Combien les lois criminelles étoient imparfaites sous ses rois, I. 381. Combien il y falloit de voix pour condamner un accusé, I. 383. Ce que l’on y nommoit privilege du temps de la république, I. 414. Comment on y punissoit un accusateur injuste. Précautions pour l’empêcher de corrompre ses juges, I. 415. L’accusé pouvoit se retirer avant le jugement, ibid. La dureté des lois contre les débiteurs a pensé plusieurs fois être funeste à la république : tableau abrégé des événemens qu’elle occasionna, I. 416 & suiv. Sa liberté lui fut procurée par des crimes, & confirmée par des crimes, I. 418. C’étoit un grand vice dans son gouvernement d’affermer ses revenus, II. 27. La république périt, parce que la profession des traitans y fut honorée, II. 29. Comment on y punissoit les enfans, quand on eut ôté aux peres le pouvoir de les faire mourir, II. 87, 88. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, II. 89. Les diverses lois touchant les esclaves & les affranchis prouvent son embarras à cet égard, II. 90. Ses lois politiques au sujet des affranchis étoient admirables, II. 92, 93. Est-il vrai que pendant cinq cent vingt ans personne n’osa user du droit de répudier, accordé par la loi ? II. 119 & suiv. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu’on lui imposa prouve que les lois suivent les mœurs, II. 214, 215. On y changea les lois, à mesure que les mœurs y changerent, ibid. & suiv. La politesse n’y est entrée que quand la liberté en est sortie, II. 234. Différentes époques de l’augmentation de la somme d’or & d’argent qui y étoit, & du rabais des monnoies qui s’y est toujours fait en proportion de cette augmentation, III. 38 & suiv. Sur quelle maxime l’usure y fut réglée après la destruction de la république, III. 64. Les lois y furent peut-être trop dures contre les bâtards, III. 71, 72. Fut plus affoiblie par les [IV-567] discordes civiles, les triumvirats & les proscriptions que par aucune autre guerre, III. 92. Il y étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre ; & on le punissoit, s’il la souffroit vivre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction apparente, III. 230, 231. Par qui les lois, sur le partage des terres, y furent faites, III. 244, 245. On n’y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple : pourquoi, III. 245. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de tester sur la source de bien des maux, III. 246, 247. Pourquoi le peuple y demande sans cesse les lois agraires, III. 347. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s’y est point introduite, III. 327. On ne pouvoit entrer dans la maison d’aucun citoyen pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs : ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, III. 418. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur : cela étoit juste à Rome ; cela est injuste en France, III. 421, 422. Comment le vol y étoit puni. Les lois sur cette matiere, n’avoient nul rapport avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritie, III. 426, 427. On y pouvoit tuer le voleur qui se mettoit en défense. Correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III. 427, 428. Voyez Droit romain. Lois romaines. Romains.
Rome moderne. Tout le monde y est à son aise, excepté ceux qui ont de l’industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, III. 121, 122. On y regarde comme conforme au langage de la maltôte, & contraire à celui de l’écriture, la maxime qui dit que le clergé doit contribuer aux charges de l’état, III. 173, 174.
Romulus. La crainte d’être regardé comme tyran, empêcha Auguste de prendre ce nom, II. 187. Ses lois touchant la conservation des enfans, III. 110. Le partage qu’il fit des terres est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III. 242. [IV-568] & suiv. Ses lois sur le partage des terres furent rétablies par Servius Tullius, III. 244, 245.
Roricon, historien franc. Étoit pasteur, IV. 10.
Rotharis, roi des Lombards. Déclare par une loi que les lépreux sont morts civilement, II. 50. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
Royauté. Ce n’est pas un honneur seulement, III. 434.
Ruse. Comment l’honneur l’autorise dans une monarchie, I. 61.
Russie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, II. 17. On y a très-prudemment exclu de la couronne tout héritier qui possede une autre monarchie, III. 236.
S
Sabbat. La stupidité des Juifs dans l’observation de ce jour prouve qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, III. 204.
Sacerdoce. L’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce, III. 105.
Sacremens. Étoient autrefois refusés à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l’église, III. 391.
Sacrifices. Quels étoient ceux des premiers hommes, selon Porphyre, III. 169.
Sacrilege. Le droit civil entend mieux ce que c’est que ce crime, que le droit canonique, III. 205.
Sacrilege caché. Ne doit point être poursuivi, I. 384, 385.
Sacrileges simples. Sont les seuls crimes contre la religion, I. 384. Quelles en doivent être les peines, ibid. Excès monstrueux où la superstition peut supporter, si les lois humaines se chargent de les punir, I. 385.
Saliens. Réunis avec les Ripuaires sous Clovis, conserverent leurs usages, III. 265.
Salique. Étymologie de ce mot. Explication de la loi que nous nommons ainsi, II. 162 & suiv. Voyez Loi salique. Terre salique.
Salomon. De quels navigateurs se servit, II. 281. La longueur du voyage de ses flottes prouvoit-elle la grandeur de l’éloignement ? II. 283.
[IV-569]
Samnites. Cause de leur longue résistance aux efforts des Romains, I. 72. Coutume de ce peuple sur les mariages, II. 222. Leur origine, 223.
Sardaigne (le feu roi de). Conduite contradictoire de ce prince, I. 139. État ancien de cette île. Quand & pourquoi elle a été ruinée, III. 143.
Sarrasins. Chassés par Pepin & par Charles-Martel, III. 279. Pourquoi furent appellés dans la Gaule méridionale. Révolution qu’ils y occasionnerent dans les lois, III. 286. Pourquoi dévasterent la France, & non pas l’Allemagne, IV. 200, 201.
Satisfaction. Voyez Composition.
Sauvages. Objet de leur police, I. 310. Différence qui est entre les sauvages & les barbares, II. 150, 151. C’est la nature & le climat presque seuls qui les gouvernent, II. 189. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III. 164.
Saxons. Sont originairement de la Germanie, II. 169. De qui ils reçurent d’abord les lois, III. 266. Causes de la dureté de leurs lois, III. 269. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que celle des Ripuaires, III. 298.
Science. Est dangereuse dans un état despotique, I. 67.
Scipion. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille de Cannes, I. 246. Par qui fut jugé, I. 367.
Scholastiques. Leurs rêveries ont causé tous les malheurs qui accompagnerent la ruine du commerce, I. 341 & suiv.
Scythes. Leur systême sur l’immortalité de l’ame, III. 152. Il leur étoit permis d’épouser leurs filles, III. 217.
Secondes noces. Voyez Noces.
Séditions. Faciles à appaiser dans une république fédérative, II. 261, 262. Il est des gouvernemens où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, III. 409, 410.
Seigneurs. Étoient subordonnés au comte, III. 330. Étoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c’est-à-dire de leurs vasseaux, III. 338 & suiv. Ne pouvoient appeller un de leur hommes sans avoir renoncé à l’hommage, II. 339, 340. [IV-570] Conduite qu’un seigneur devoit tenir, quand sa propre justice l’avoit condamné contre un de ses vassaux, III. 346. Moyens dont ils se servoient pour prévenir l’appel de faux jugement, III. 348. On étoit obligé autrefois de réprimer l’ardeur qu’ils avoient de juger & de faire juger, III. 351, 352. Dans quel cas on pouvoit plaider contr’eux dans leur cour, III. 355. Comment S. Louis vouloit que l’on pût se pourvoir contre le jugemens rendus dans les tribunaux de leurs justices, III. 358, 359. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s’exposer aux dangers de les fausser, III. 360. N’étoient obligés, du temps de S. Louis, de faire observer dans leurs justices que les ordonnances royaux, qu’ils avoient scellées ou souscrites eux-mêmes, ou auxquelles ils avoient donné leur consentement, III. 361, 362. Étoient autrefois obligés de soutenir eux-mêmes les appels de leurs jugemens : époque de l’abolition de cet usage, III. 365, 366. Tous les frais des procès rouloient autrefois sur eux ; il n’y avoit point alors de condamnation aux dépens, III. 170 & suiv. Quand commencerent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. Ce n’est point une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur cour, ou de juger : cela s’est fait peu à peu, III. 398, 399. Les droits dont ils jouissent autrefois, & dont ils ne jouissent plus, ne leur ont point été ôtés comme usurpations : ils les ont perdus par négligence, ou par les circonstances, III. 399. Les chartres d’affranchissement qu’ils donnerent à leurs serfs sont une des sources de nos coutumes, III. 402, 403. Levoient, dans les commencemens de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines ; & ces tributs se nommoient census ou cens, IV. 38. Voyez Roi de France. Leurs droits de dérivent point par usurpation de ce sens chimérîque que l’on prétend venir de la police générale des Romains, IV. 40 & suiv. Sont la même chose que vassaux : étymologie de ce mot, IV. 44. Le droit qu’ils avoient de rendre la justice dans leurs terres, avoit la même source que celui qu’avoient les [IV-571] comtes dans la leur, IV. 54. Quelle est précisément la source de leurs injustices, IV. 66 & suiv. Ne doivent point leurs justices à l’usurpation : preuves, IV. 72, 73, 77 & suiv.
Sel. L’impôt sur le sel, tel qu’on le leve en France, est injuste & funeste, I. 11, 12. Comment s’en fait le commerce en Afrique, III. &, 2.
Seleucus Nicator. Auroit-il pu exécuter le projet qu’il avoit de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne, II. 279, 280.
Sémiramis. Source de ses grandes richesses, II. 276, 277.
Sénat, dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, I. 26.
Sénat, dans une démocratie. Est nécessaire, I. 18. Doit-il être nommé par le peuple ? ibid. Ses suffrages doivent être secrets, I. 24. Quel doit être son pouvoir en matiere de législation, I. 25. Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, I. 27.
Sénat d’Athenes. Pendant quel temps ses arrêts avoient force de loi, I. 25. N’étoit pas la même chose que l’Aréopage, I. 99.
Sénat de Rome. Pendant combien de temps ses arrêts avoient force de loi, I. 25. Pensoit que les peines immodérées ne produisoient leur effet, I. 179. Son pouvoir sous les cinq premiers rois, I. 342 & suiv. Étendue de ses fonctions & de son autorité, après l’expulsion des rois, I. 259.
Sénat de Rome. Sa lâche complaisance pour les prétentions ambitieuses du peuple, I. 364, 365. Époque funeste de la perte de son autorité, I. 369.
Sénateurs, dans une aristocratie. Ne doivent point nommer aux places vacantes dans le sénat, I. 27.
Sénateurs, dans une démocratie. Doivent-ils être à vie ou pour un temps ? I. 98, 99. Ne doivent être choisis que parmi les vieillards ; pourquoi, I. 99.
Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nommés, I. 27. Avantages de ceux qui avoient des enfans sur ceux qui n’en avoient pas, III. 97. Quels mariages pouvoient contracter, III. 101, 102.
Sénatusconsulte orphitien. Appella les enfans à la succession de leur mere, III. 263. — Justinien. Cas [IV-572] dans lesquelles il accorda aux meres la succession de leurs enfans, ibid.
Sennar. Injustices cruelles qu’y fait commettre la religion mahométane, III. 129.
Sens. Influent beaucoup sur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sont jointes à des idées spirituelles, III. 162.
Séparation entre mari et femme pour cause d’adultere. Le droit civil, qui n’accorde qu’au mari le droit de la demander, est mieux entendu que le droit canonique qui l’accorde aux deux conjoints, III. 205, 206.
Sépulture. Étoit refusée à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l’église, III. 391. Étoit accordée à Rome à ceux qui s’étoient tués eux-mêmes, III. 417.
Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, III. 321. Quand, & contre qui pouvoient se battre, III. 335. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France, III. 402, 403. Étoient fort communs vers le commencement de la troisieme race. Erreur des historiens à cet égard, IV. 19 & suiv. Ce qu’on appelloit census ou cens, ne se levoit que sur eux dans les commencemens de la monarchie, IV. 38 & suiv. Ceux qui n’étoient affranchis que par lettres du roi, n’acquéroient point une pleine & entiere liberté, IV. 42, 43.
Serfs de la glebe. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des serfs de la glebe, IV. 11 & suiv. Voyez Servitude de la glebe.
Serment. Combien lie un peuple vertueux, I. 245, 246. Quand on doit y avoir recours en jugement, I. 254. Servoit de prétexte aux clercs pour saisir leurs tribunaux, même des matieres féodales, III. 389.
Serment judiciaire. Celui de l’accusé, accompagné de plusieurs témoins, qui juroient aussi, suffisoit dans [IV-573] les lois barbares, excepté dans la loi salique, pour le purger, III. 298 & suiv. Remede que l’on employoit contre ceux que l’on prévoyoit devoir en abuser, III. 300. Celui qui, chez les Lombards, l’avoit prêté pour se défendre d’une accusation, ne pouvoit plus être forcé de combattre, III. 301. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par le combat singulier, III. 305, 306. Où, & comment il se faisoit, III. 315.
Sérails. Ce que c’est, I. 127, 128. Ce sont des lieux de délices qui choquent l’esprit même de l’esclavage, qui en est le principe, II. 77, 78.
Service. Les vassaux dans les commencemens de la monarchie, étoient tenus d’un double service ; & c’est dans cette obligation que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, IV. 52 & suiv.
Service militaire. Comment se faisoit dans les commencemens de la monarchie, IV. 47 & suiv.
Servitude. N’est point l’objet de la conquête. Cas où le conquérant peut en faire usage. Temps qu’il doit la faire subir, I. 278, 279. L’impôt par tête est celui qui lui est le plus naturel, II. 18. Sa marche est un obstacle à son établissement en Angleterre, II. 55. Combien il y en a de sortes, II. 75, 76. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, II. 187. Pourquoi regne en Asie, & la liberté en Europe, II. 135 & suiv. Est naturelle aux peuples du midi, II. 273, 274. Voyez Esclavage.
Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que les barbares qui conquirent l’empire romain, firent un réglement général qui imposoit cette servitude. Ce réglement, qui n’exista jamais, n’en est point l’origine : où il la faut chercher, IV. 19 & suiv.
Servitude domestique. Ce que l’auteur entend par ces mots, II. 96. Indépendance de la polygamie, II. 112, 113.
Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme la civile & la domestique, II. 124 & suiv.
{{sc|Servius Tullius. Comment divisa le peuple romain : ce qui résulta de cette division, I. 20, 21. Comment monta au trône. Changement qu’il apporta [IV-574] dans le gouvernement de Rome, I. 344, 345. Sage établissement de ce prince pour la levée des impôts à Rome, I. 376, 377. Rétablit les lois de Romulus & de Numa sur le partage des terres ; & en fit de nouvelles, III. 244, 245. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens, seroit esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisoit-il donc qu’il y eût des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens ? III. 255, 256.
Sévere, empereur. Ne voulut pas que le crime de lese-majesté indirect eût lieu sous son regne, I. 397, 398.
Sexes. Le charme que les deux sexes s’inspirent est une des lois de la nature, I. 9. L’avancement de leur puberté & de leur vieillesse dépend des climats ; & cet avancement est une des regles de la polygamie, II. 96 & suiv.
Sextilius Rufus. Blâmé par Cicéron, de n’avoir pas rendu une succession dont il étoit fidéicommissaire, III. 256, 257.
Sextus. Son crime fut utile à la liberté, I. 417.
Sextus Peduceus. S’est rendu fameux pour n’avoir pas abusé d’un fidéicommis, III. 256.
Siamois. Font consister le souverain bien dans le repos : raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des lois toutes pratiques, I. 41, 42. Toutes les religions leur son indifférentes. On ne dispute jamais chez eux sur cette matiere, III. 189.
Sibérie. Les peuples qui l’habitent sont sauvages & non barbares, II. 150, 151. Voyez Barbares.
Sicile. Étoit pleine de petits peuples & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87.
Sidney (Monsieur). Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent le corps d’un peuple, I. 318.
Sieges. Causes de ces défenses opiniâtres & de ces actions dénaturées que l’on voit dans l’histoire de la Grece, III. 426, 427.
Sigismond. Est un de ceux qui recueillit les lois des Bourguignons, III. 267.
Simon, comte de Monfort. Est auteur des coutumes de ce comté, III. 402.
[IV-575]
Sixte V. Sembla vouloir renouveller l’accusation publique contre l’adultere, I. 215.
Société. Comment les homme se sont portés à vivre en société, I. 8, 9. Ne peut subsister sans gouvernement, I. 11. C’est l’union des hommes & non pas les hommes même : d’où il suit que, quand un conquérant auroit le droit de détruire une société conquise, il n’auroit pas celui de tuer les hommes qui la composent, I. 278. Il lui faut même dans les états despotiques quelque chose de fixe : ce quelque chose est la religion, III. 193.
Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, I. 275.
Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succession à la couronne aux enfans de la sœeur du roi à l’exclusion de ceux du roi même, III. 202, 203. Pourquoi il n’est pas permis à une sœur d’épouser son frère, III. 218. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés : pourquoi, III. 220.
Soldats. Quoique vivant dans le célibat, avoient à Rome le privilege des gens mariés, III. 104.
Solon. Comment divisa le peuple d’Athenes, I. 21. Comment corrigea les défectuosités des suffrages données par le sort, I. 22, 23. Contradiction qui se trouve dans ses lois, I. 88. Comment bannit l’oisiveté, I. 96. Loi admirable, par laquelle il prévoit l’abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes, I. 158. Corrige à Athenes l’abus de vendre les débiteurs, I. 416. Ce qu’il pensoit de ses lois devroit servir de modele à tous les législateurs, II. 213. Abolit la contrainte par corps à Athenes : la trop grande généralité de cette loi n’étoit pas bonne, II. 257. A fait plusieurs lois d’épargne dans la religion, III. 175. La loi par laquelle il autorisoit dans certains cas les enfans à refuser la subsistance à leurs peres indigens n’étoit bonne qu’en partie, III. 199. À quels citoyens il accorda le pouvoir de tester ; pouvoir qu’aucun n’avoit avant lui, III. 246. Justification d’une de ses lois qui paroît bien extraordinaire, III. 409, 410. Cas que les prêtres Égyptiens faisoient de sa science, IV. 37, 38.
[IV-576]
Somptuaires. Voyez Lois somptuaires.
Sophi de Perse. Détrôné de nos jours pour n’avoir pas assez versé de sang, I. 54.
Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie ; est défectueux : comment Solon l’avoit rectifié à Athenes, I. 22, 23. Ne doit point avoir lieu dans une aristocratie, I. 17.
Sortie du royaume. Devroit être permise à tous les sujets d’un prince despotique, I. 430.
Soudans. Leur commerce, leurs richesses & leur force, après la chute des Romains en Orient, II. 340.
Soufflet. Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, III. 322.
Sourd. Pourquoi ne pouvoit pas tester, III. 248, 249.
Souverain. Dans quel gouvernement peut être juge, I. 157 & suiv.
Sparte. Peine fort singuliere en usage dans cette république, I. 111. Voyez Lacédémone.
Spartiates. N’offroient aux dieux que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, III. 174. Voyez Lacédémone.
Spectacles. Révolutions qu’ils causerent à Rome par l’impression qu’ils faisoient sur le peuple, I. 354, 355.
Spiritualité. Nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles, & nous sommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, III. 162, 163.
Spinosa. Son systême est contradictoire avec la religion naturelle, D. 252.
Spinosisme. Quoiqu’il soit incompatible avec le déisme, le nouvelliste ecclésiastique les cumule sans cesse sur la tête de M. de Montesquieu : preuves qu’il n’estni spinosiste ni déiste, D. 222 & suiv.
Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs, I. 144.
Stoïciens. Leur morale étoit, après celle des chrétiens, la plus propre pour rendre le genre humain heureux : détail abrégé de leurs principales [IV-577] maximes, III. 136. Nioient l’immortalité de l’ame : de ce faux principe ils tiroient des conséquences admirables pour la société, III. 150. L’auteur a loué leur morale ; mais il a combattu leur fatalité, D. 236, 237. Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la religion naturelle, tandis qu’ils étoient athées, D. 352.
Subordination des citoyens aux magistrats. Donne de la force aux lois, I. 100, 101. — des enfans à leurs pere. Utile aux mœurs, I. 101, 102. — des jeunes aux vieillards. Maintient les mœurs, I. 100.
Subsides. Ne doivent point dans une aristocratie mettre de différence dans la condition des citoyens, I. 104, 105.
Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, I. 109. Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu’elles ne soient permises qu’aux nobles, I. 111. Gênent le commerce, ibid. Quand on fut obligé de prendre à Rome des précautions pour préserver la vie du pupille des embûches du substitué, II. 215, 216. Pourquoi étoient permises dans l’ancien droit romain & non pas les fidéicommis, III. 250. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome, III. 414, 415.
Substitutions pupillaires. Ce que c’est, II. 216.
Substitutions vulgaires. Ce que c’est, ibid. En quel cas avoient lieu, III. 415.
Subtilité. Est un défaut qu’il faut éviter dans la composition des lois, III. 432.
Successions. Un pere peut dans une monarchie donner la plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfans, I. 122. Comment sont réglées en Turquie, I. 124. — à Bantam, ibid. — à Pégu, ibid. Appartiennent au dernier des mâles chez les Tartares, dans quelques petits districts de l’Angleterre, & dans le duché de Rohan en Bretagne : raisons de cette loi, I. 261, 262. Quand l’usage d’y rappeller la fille & les enfans de la fille s’introduisit parmi les Francs : motifs de ces rappels, II. 164 & suiv. Ordre bizarre établi par la loi salique sur l’ordre des successions : raisons & source de cette bizarrerie, II. 165 & suiv. Leur ordre [IV-578] dépend des principes du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel, III. 200 & suiv. Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare le droit qu’on les mâles de succéder au préjudice des filles ? ibid. L’ordre en doit être fixé dans une monarchie, III. 226, 227. Origine & révolutions des lois romaines sur cette maniere, III. 242-264. On en étendit le droit à Rome en faveur de ceux qui se prêtoient aux vues des lois faites pour augmenter la population, III. 159 & suiv. Quand commencerent à ne plus être régies par la loi Voconienne, III. 261. Leur ordre à Rome fut tellement changé sous les empereurs, qu’on ne reconnoît plus l’ancien, III. 262 & suiv. Origine de l’usage qui a permis de disposer par contrat de mariage de celles qui ne sont pas ouvertes, IV. 216, 217.
Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, & les successions testamentaires si étendues, III. 245, 246.
Succession au trône. Par qui réglée dans les états despotiques, I. 124 & suiv. Comment réglée en Moscovie, 125. Quelles est la meilleure façon de la régler, I. 125, 126. Les lois & les usages des différens pays les reglent différemment ; & ces lois & usages qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondées en raison, III. 201 & suiv. Ne doivent pas se régler par les lois civiles, III. 227, 228. Peut être changée si elle devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été établie, III. 236 & suiv. Cas où l’état en peut changer l’ordre, III. 237, 238.
Successions testamentaires. Voyez Successions ab intestat.
Suede. Pourquoi on y fait des lois somptuaires, I. 203.
Suès. Sommes immenses que le vaisseau royal le Suès porte en Arabie, II. 332.
Suffrages. Ceux d’un peuple souverain sont ses volontés, I. 16. Combien il est important que la maniere de les donner dans une démocratie soit fixée par les lois, ibid. Doivent se donner différemment dans la démocratie & dans l’aristocratie, [IV-579] I. 21, 22. De combien de manieres ils peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, sans gêner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, I. 21, 22. Doivent-ils être publics ou secrets, soit dans une aristocratie, soit dans une démocratie ? I. 23, 24. Ne doivent point être donnés par le sort dans une aristocratie, I. 26.
Suicide. Est contraire à la loi naturelle & à la religion révélée. De celui des Romains : de celui des Anglois : peut-il être puni chez ces derniers ? II. 52, 53. Les Grecs & les Romains le punissoient ; mais dans des cas différens, III. 415 & suiv. Il n’y avoit point de loi à Rome du temps de la république qui punît ce crime ; il étoit même regardé comme une bonne action, ainsi que sous les premiers empereurs : les empereurs ne commencerent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu’ils avoient été cruels, ibid. La loi qui punissoit celui qui se tuoit par foiblesse étoit vicieuse, III. 435. Est-ce être sectateur de la loi naturelle, que de dire que le suicide est en Angleterre l’effet d’une maladie, D. 247, 248.
Sujets. Sont portés dans la monarchie à aimer leur prince, I. 420, 421.
Suions, nation Germaine. Pourquoi vivoient sous le gouvernement d’un seul, I. 200.
Suisse. Quoiqu’on n’y paye point de tributs, un Suisse y paye quatre fois plus à la nature, qu’un Turc ne paye au Sultan, II. 16.
Suisses (Ligues). Sont une république fédérative, & par-là regardée en Europe comme éternelle, I. 260. Leur république fédérative est plus parfaite que celle d’Allemagne, I. 262.
Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole quand leur autorité est compromise, I. 53, 54. Droits qu’ils prennent ordinairement sur la valeur des successions des gens du peuple, I. 123, 124. Ne savent être justes qu’en outrant la justice, III. 239.
Superstition. Excès monstrueux où elle peut porter, I. 385. Sa force & ses effets, II. 157, 158. Est [IV-580] chez les peuples barbares une des sources de l’autorité des prêtres, II. 185, 186. Son luxe doit être réprimé : il est impie, III. 174 & suiv.
Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard suivant la nature des gouvernemens, I. 167 & suiv. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l’état, ibid. À quelle occasion celui de la roue a été inventé : n’a pas eu son effet : pourquoi, I. 171. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, I. 186. Ce que c’est, & à quels crimes doivent être appliqués, I. 387, 388. Ne rétablissent point les mœurs, n’arrêtent point un mal général, II. 207.
Sureté du citoyen. Ce qui l’attaque le plus, I. 381. Peine que méritent ceux qui la troublent, I. 387, 388.
Suzerain. Voyez Seigneur.
Sylla. Établit des peines cruelles : pourquoi, I. 182. Loin de punir, il récompensa les calomniateurs, I. 408.
Synode. Voyez Troies.
Syracuse. Cause des révolutions de cette république, I. 229, 230. Dut sa perte à la défait des Athéniens, I. 231. L’ostracisme y fit mille maux, tandis qu’il étoit une chose admirable à Athenes, III. 413, 414.
Syrie. Commerce de ses rois après Alexandre, II. 301, 302.
Systême de Law. Fit diminuer le prix de l’a rgent, III. 111. A pensé ruiner la France, III. 33 & suiv. Occasionna une loi injuste & funeste, qui avoit été sage & juste du temps de César, III. 412, 413.
T
Tacite, empereur. Loi sage de ce prince au sujet du crime de lese-majesté, I. 407.
Tacite. Erreur de cet auteur prouvée, III. 57. Son ouvrage sur les mœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrege tout. On y trouve [IV-581] les codes des lois barbares, IV. 3. Appelle comites ce que nous appellons aujourd’hui vassaux, IV. 4, 44.
Talion (la loi du). Est fort en usage dans les états despotiques : comment on en use dans les états modérés, I. 189. Voyez Peine du talion.
Tao. Conséquences affreuses qu’il tire du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 150.
Tarquin. Comment monta sur le trône : changemens qu’il apporta dans le gouvernement : causes sur sa chute, I. 345. L’esclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur, fut dénonciateur seulement & non témoin, I. 407.
Tartares. Leur conduite avec les Chinoins est un modele de conduite pour les conquérans d’un grand état, I. 302, 303. Pourquoi obligés de mettre leur nom sur leurs fleches : cet usage peut avoir des suites funestes, I. 421, 422. Ne levoient presque point de taxes sur les marchandises qui passent, II. 15. Les pays qu’ils ont désolés ne sont pas encore rétablis, II. 143. Sont barbares & non sauvages, II. 151. Leur servitude, I. 158 & suiv. Devroient être libres ; sont cependant dans l’esclavage politique : raison de cette singularité, ibid. Quel est leur droit des gens : pourquoi, ayant des mœurs si douces entr’eux, ce droit est cruel, II. 160, 161. La succession appartient chez eux au dernier des mâles : raisons de cette loi, II. 161, 162. Ravages qu’ils ont faits dans l’Asie, & comment ils y ont détruit le commerce, II. 278, 279. Les vices de ceux de Gengis kan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu’elle auroit dû permettre, & de ce que leurs lois civiles permettoient ce que la religion auroit dû défendre, III. 142, 143. Pourquoi n’ont point de temples : pourquoi si tolérans en fait de religion, III. 166. Pourquoi peuvent épouser leurs filles, & non pas leur mere, III. 217.
Taxes sur les marchandises. Sont les plus commodes & les moins onéreuses, II. 9, 10. Il est quelquefois dangereux de taxer le prix des marchandises, III. 13. — sur les personnes. Dans quelles [IV-582] proportion doivent être imposées, II. 7, 8. — sur les terres. Bornes qu’elles doivent avoir, II. 8, 9.
Témoins.Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un accusé, I. 382, 383. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les lois Romaines, pour assister à la confection d’un testament, fut fixé à cinq, III. 247, 248. Dans les lois barbares, autres que la loi salique, les témoins formoient une preuve négative complette, en jurant que l’accusé n’étoit pas coupable, III. 298. L’accusé pouvoit, avant qu’ils eussent été entendus en justice, leur offrir le combat judiciaire : quand & comment ils pouvoient le refuser, III. 336 & suiv. Déposoient en public : abrogation de cet usage, III. 368 & suiv. La peine contre les faux témoins est capitale en France : elle ne l’est point en Angleterre : motifs de ces deux lois, III. 419, 420.
Temples. Leurs richesses attachent à la religion, III. 165. Leur origine, ibid. Les peuples qui n’ont point de maisons ne bâtissent point de temples, III. 166. Les peuples qui n’ont point de temple ont peu d’attachement pour leur religion, ibid.
Terre. C’est par le soin des hommes qu’elle est devenue plus propre à être leur demeure, II. 147. Ses parties sont plus ou moins peuplées suivant ses différentes productions, III. 80, 81.
Terre salique. Ce que c’étoit chez les Germains, II. 162 & suiv. Ce n’étoit point des fiefs, II. 170 & suiv.
Terrein. Comment sa nature influe sur les lois, II. 139 & suiv. Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, ibid.
Terres. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, I. 87, 88. Comment doivent être partagées entre les citoyens d’une démocratie, I. 94. Peuvent-elles être partagées également dans toutes les démocraties ? I. 97. Est-il à propos dans une république d’en faire un nouveau partage lorsque l’ancien est confondu ? I. 197. Bornes que l’on doit mettre aux taxes sur les terres, II. 8, 9. Rapport de leur culture avec la liberté, II. [IV-583] 141, 142. C’est une mauvaise loi que celle qui défend de les vendre, III. 44. Quelles sont les plus peuplées, III. 80, 81. Leur partage fut rétabli à Rome par Servius Tullius, III. 244, 245. Comment furent partagées dans les Gaules entre les Barbares & les Romains, IV. 11. & suiv.
Terres censuelles. Ce que c’étoit autrefois, IV. 42.
Tertullien. Voyez Sénatusconsulte tertullien.
Testament. Les anciennes lois Romaines sur cette matiere, n’avoient pour objet que de proscrire le célibat, III. 98 & suiv. On n’en pouvoit faire dans l’ancienne Rime que dans une assemblée du peuple : pourquoi, III. 245. Pourquoi les lois Romaines accordoient-elles la faculté de se choisir par testament tel héritier que l’on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l’on avoit prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une autre ? III. 245, 246. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, III. 246, 247. Pourquoi quand on cessa de les faire dans les assemblées du peuple il fallut y appeller cinq témoins, III. 247, 248. Toutes les lois Romaines sur cette matiere dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois de sa famille à celui qu’il instituoit son héritier, III. 248, 249. Pourquoi la faculté de tester étoit interdite aux sourds, aux muets & aux prodigues, III. 249. Pourquoi le fils de famille n’en pouvoit pas faire, même avec l’agrément de son pere en la puissance duquel il étoit, III. 249. Pourquoi soumis chez les Romains à de plus grandes formalités que chez les autres peuples, III. 249, 250. Pourquoi devoit être conçu en paroles directes & impératives. Cette loi donnoit la faculté de substituer ; mais ôtoit celle de faire des fidéicommis, III. 250. Pourquoi celui du pere étoit nul quand le fils étoit prétérit ; & valable quoique la fille le fût, III. 250, 251. Les parens du défunt étoient obligés autrefois en France d’en faire un en sa place, quand il n’avoit pas testé en faveur de l’église, III. 391. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome, III. 417.
Testament in procinctu. Ce que c’étoit : il ne faut [IV-584] pas le confondre avec le testament militaire, III. 247.
Testament militaire. Quand, par qui & pourquoi il fut établi, ibid.
Testament per as & libram. Ce que c’étoit, III. 248.
Thébains. Ressource monstrueuse à laquelle ils eurent recours pour adoucir les mœurs des jeunes gens, I. 81.
Théodore Lascaris. Injustice commise sous son regne, sous prétexte de magie, I. 390.
Théodoric, roi d’Austrasie. Fit rédiger les lois des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands & des Thuringiens, III. 265, 266.
Théodoric, roi d’Italie. Comment adopte le roi des Hérules, II. 180. Abolit le combat judiciaire chez les Ostrogoths, III. 313.
Théodose, empereur. Ce qu’il pensoit des paroles criminelles, I. 403. Appella les petits-enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 263.
Théologie. Est-ce cette science ou la jurisprudence qu’il faut traiter dans un livre de jurisprudence ? D. 279.
Théologiens. Maux qu’ils ont faits au commerce, II. 344 & suiv.
Théophile, empereur. Pourquoi ne vouloit pas & ne devoit pas vouloir que sa femme fît le commerce, II. 261.
Théophraste. Son sentiment sur la musique, I. 50, 51.
Thésée. Ses belles actions prouvent que la Grece étoit encore barbare de son temps, III. 148.
Thibault. C’est ce roi qui a accordé les coutumes de Champagne, III. 402.
Thimur. S’il eût été chrétien, il n’eût pas été si cruel, III. 129.
Thomas More. Petitesse de ses vues en matiere de législation, III. 440.
Thuringiens. Simplicité de leurs lois : par qui furent rédigées, III. 266, 267. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les ripuaires, III. 298. Leur façon de procéder contre les femmes, III. 307, 308.
[IV-585]
Tibere. Pourquoi refusa de renouveller les anciennes lois somptuaires de la république, I. 201. Pourquoi ne voulut pas qu’on défendît aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, I. 202. Quand & comment faisoit valoir les lois faites contre l’adultere, I. 217, 218. Dans quelles occasions il rétablissoit le tribunal domestique, I. 218, 219. Abus énorme qu’il commit dans la distribution des honneurs & des dignités, I. 236. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté, I. 404. Rafinement de cruauté de ce tyran, I. 406. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie devinrent la monnoie même, III. 5. Ajouta à la loi Poppienne, III. 101, 102.
Tite-Live. Erreur de cet historien, I. 180, 181.
Toison-d’or. Origine de cette fable, II. 290, 291.
Tolérance. L’auteur n’en parle que comme politique, & non comme théologien, III. 178. Les théologiens même distinguent entre tolérer une religion & l’approuver, ibid. Quand elle est accompagnée des vertus morales, elle forme le caractere le plus sociale, III. 135. Quand plusieurs religions sont tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entr’elles, III. 179.
Tolérance. On doit tolérer les religions qui sont établies dans un état, & empêcher les autres de s’y établir. Dans cette regle n’est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien, ibid. Ce que l’auteur a dit sur cette matiere est-il un avis au roi de la Cochinchine pour fermer la porte de ses états à la religion chrétienne ? D. 274 & suiv.
Tonquin. Toutes les magistratures y sont occupées par des eunuques, II. 94. C’est le physique du climat qui fait que les peres y vendent leurs filles & y exposent leurs enfans, III. 83.
Toulouse. Cette comté devint-elle héréditaire sous Charles Martel ? IV. 194.
Tournois. Donnerent une grande importance à la galanterie, III. 327.
Trajan. Refusa de donner des rescrits : pourquoi, III. 439.
[IV-586]
Traitans. Leur portrait, I. 370 & suiv. 373. Comment regardés autrefois en France : danger qu’il y a de leur donner trop de crédit, I. 370 & suiv. Leur injustice détermina Publius Rutilius à quitter Rome, I. 372. On ne doit jamais leur confier les jugemens, I. 373. Les impôts qui donnent occasion au peuple de frauder, enrichissent les traitans, ruinent le peuple & perdent l’état, II. 12. Tout est perdu lorsque leur profession qui ne doit être que lucrative, vient à être honorée, II. 29, 30. Les richesses doivent être leur unique récompense, ibid.
Traités. Ceux que les princes font par force sont aussi obligatoires que ceux qu’ils font de bon gré, III. 233, 234.
Traîtres. Comment étoient punis chez les Germains, IV. 57, 58.
Tranquillité des citoyens. Comment les crimes qui la troublent doivent être punis, I. 387, 388.
Transmigration. Causes & effets de celles de différens peuples, II. 142, 143.
Transpiration. Son abondance dans les pays chauds y rend l’eau d’un usage admirable, II. 46.
Travail. On peut par de bonnes lois faire faire les travaux les plus rudes à des hommes libres, & les rendre heureux, II. 73, 74. Les pays qui par leurs productions fournissent du travail à un plus grand nombre d’hommes, sont plus peuplés que les autres, III. 80, 81. Est le moyen qu’un état bien policé emploie pour le soulagement des pauvres, III. 119.
Trésors. Il n’y a jamais dans une monarchie que le prince qui puisse en avoir un, II. 252. En les offrant à Dieu, nous prouvons que nous estimons les richesses qu’il veut que nous méprisons, III. 175. Pourquoi sous les rois de la premiere race, celui du roi étoit regardé comme nécessaire à la monarchie, IV. 8.
Tribunal domestique. De qui il étoit composé à Rome. Quelles matieres, quelles personnes étoient de sa compétence ; & quelles peines il infligeoit, I. 211 & suiv. Quand & pourquoi fut aboli, I. 213, 214.
[IV-587]
Tribunaux. Cas où l’on doit être obligé d’y recourir dans les monarchies, I. 149. Ceux de judicature doivent être composés de beaucoup de personnes : pourquoi, I. 163. Sur quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre les conseils des princes & les tribunaux ordinaires, I. 163, 164. Quoiqu’ils ne soient pas fixes dans un état libre, les jugemens doivent l’être, I. 316.
Tribunaux humains. Ne doivent pas se régler par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie, III. 211, 212.
Tribuns des légions. En qul temps & par qui furent réglés, I. 360.
Tribuns du peuple. Nécessaires dans une aristocratie, I. 107. Leur établissement fut le salut de la république romaine, I. 115. Occasion de leur établissement, 416, 417.
Tribus. Ce que c’étoit à Rome & à qui elles donnerent le plus d’autorité : quand commencerent à avoir lieu, I. 351 & suiv. 355, 356.
Tributs. Par qui doivent être levés dans une aristocratie, I. 106. Doivent être levés dans une monarchie de façon que le peuple ne soit point foulé de l’exécution, I. 112. Comment se levoient à Rome, I. 376, 377. Rapports de leur levée avec la liberté, II. 1 & suiv. Sur quoi & pour quels usages doivent être levés, ibid. Leur grandeur n’est pas bonne par elle-même, II. 3, 4. Pourquoi un petit état qui ne paye point de tributs, enclavé dans un grand qui en paye beaucoup, est plus misérable que le grand ? Fausse conséquence que l’on a tirée de ce fait, ibid. Quels tributs doivent payer les peuples esclaves de la glebe, II. 4 & suiv. Quels doivent être levés dans un pays où tous les particuliers sont citoyens, II. 7 & suiv. Leur grandeur dépend de la nature du gouvernement, II. 13 & suiv. Leur rapport avec la liberté, I. 16 & suiv. Dans quels états sont susceptibles d’augmentation, I. 18. Leur nature est relative au gouvernement, II. 18 & suiv. Quand on abuse de la liberté pour les rendre excessifs, elle dégénere en servitude, & on est obligé de diminuer les tributs, [IV-588] II. 20 & suiv. Leur rigueur en Europe n’a d’autre cause que la petitesse des vues des ministres, II. 21, 22. Cause de leur augmentation perpétuelle en Europe, II. 21 ; 24. Les tributs excessifs que levoient les empereurs, donnerent lieu à cette étrangé facilité que trouverent les mahométans dans leurs conquêtes, II. 22, 23. Quand on est forcé de les remettre à une partie du peuple, la remise doit être absolue, & ne pas être rejettée sur le reste du peuple. L’usage contraire ruine le roi & l’état, I. 25, 26. La redevance solidaire des tributs entre les différens sujets du prince, est injuste & pernicieuse à l’état, ibid. Ceux qui ne sont qu’accidentales & qui ne dépendent pas de l’indiustrie, sont une mauvaise sorte de richesse, II. 360. Les Francs n’en payoient aucun dans les commencemens de la monarchie. Traits d’histoire & passages qui le prouvent, IV. 25 & suiv. Les hommes libres dans les commencemens de la monarchie françoise, tant Romains que Gaulois, pour tout tribut, étoient chargés d’aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans lesquelles ils supportoient ces charges, IV. 30 & suiv. Voyez Impôts, Taxes.
Tributum. Ce que signifie ce mot dans les lois barbares, IV. 36, 37.
Triumvirs. Leur adresse à couvrir leur cruauté sous des sophismes, I. 412. Réussirent, parce que, quoiqu’ils eussent l’autorité royale, ils n’en avoient pas le faste, I. 188.
Troies. Le synode qui s’y tint en 878, prouve que la loi des Romains & celle des Wisigoths existoient concurremment dans le pays des Wisigoths, III. 281, 282.
Troupes. Leur augmentation en Europe est une maladie qui mine les états, II. 23, 24. Est-il avantageux d’en avoir sur pied en temps de paix comme en temps de guerre ? II. 23, 24. Pourquoi les Grecs & les Romains n’estimoient pas beaucoup celles de mer, II. 326, 327.
Turcs. Cause du despotisme affreux qui regne chez eux, I. 313. N’ont aucune précaution contre la [IV-589] peste : pourquoi, II. 52. Le temps qu’ils prennent pour attaquer les Abyssins, prouve qu’on ne doit point décider par les principes de la religion ce qui est du ressort des lois naturelles, III. 204. La premiere victoire dans une guerre civile est pour eux un jugement de Dieu qui décide, III. 305.
Turquie. Comment les successions y sont réglées : inconvéniens de cet ordre, I. 124. Comment le prince s’y assure la couronne, I. 125. Le despotisme en a banni les formalités de justice, I. 151 & suiv. La justice y est-elle mieux rendue qu’ailleurs ? ibid. Droits qu’on y leve pour les entrées des marchandises, II. 14, 15. Les marchands n’y peuvent pas faire de grosses avances, II. 20.
Tutelle. Quand a commencé en France à être distinguée de la baillie ou garde, II. 179. La jurisprudence romaine changea sur cette matiere à mesure que les mœurs changerent, II. 215, 216. Les mœurs de la nation doivent déterminer les législateurs à préférer la mere au plus proche parent, ou le plus proche parent à la mere, ibid.
Tuteurs. Étoient les maîtres d’accepter ou de refuser le combat judiciaire pour les affaires de leurs pupilles, III. 335.
Tyr. Nature de son commerce, II. 242 ; 280. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 246. Ses colonies, ses établissemens sur les côtes de l’océan, II. 280. Étoit rivale de toute nation commerçante, II. 300.
Tyrans. Comment s’élevent sur les ruines d’une république, I. 228. Sévérité avec laquelle les Grecs les punissoient, II. 271.
Tyrannie. Les Romains se sont défaits de leurs tyrans, sans pouvoir secouer le joug de la tyrannie, I. 41. Ce que l’auteur entend par ce mot : routes par lesquelles elle parvient à ses fins, II. 55. Combien il y en a de sortes, II. 187, 188.
Tyriens. Avantages qu’ils tiroient pour leur commerce de l’imperfection de la navigation des anciens, II. 280, 281. Nature & étendue de leur commerce, ibid.
[IV-590]
V
Vaisseau. Voyez Navire.
Valentinien. Appella les petits-enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 263. La conduite d’Arbogaste envers cet empereur est un exemple du génie de la nation françoise, par rapport aux maires du palais, IV. 124, 125.
Valentinien. Appella les petits-enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 263. La conduite d’Arbogaste envers cet empereur est un exemple du génie de la nation françoise, par rapport aux maires du palais, IV. 124, 125.
Valette (le duc de la). Condamné par Louis XIII. en personne, I. 160, 161.
Valeur réciproque de l’argent & des choses qu’il signifie, III. 4 & suiv. L’argent en a deux ; l’une positive, & l’autre relative : maniere de fixer la relative, III. 17, 18.
Valeur d’un homme en Angleterre, III. 87.
Valois (M. de. Erreur de cet auteur sur la noblesse des Francs, IV. 102.
Vamba. Son histoire prouve que la loi romaine avoit plus d’autorité dans la Gaule méridionale que la loi gothe, III. 284, 285.
Vanité. Augmente à proportion du nombre des hommes qui vivent ensemble, I. 195. Est très-utile dans une nation, II. 193, 194. Les biens qu’elle fait comparés avec les maux que cause l’orgueil, ibid.
Varus. Pourquoi son tribunal parut insupportable aux Germains, II. 186.
Vassaux. Leur devoit étoit de combattre & de juger, III. 345, 346. Pourquoi n’avoient pas toujours dans leurs justices la même jurisprudence que dans les justices royales, ou même dans celles de leurs seigneurs suzerains, III. 361, 362. Les chartres des vassaux de la couronne sont une des sources de nos coutumes de France, III. 402. Il y en avoit chez les Germains, quoiqu’il n’y eût point de fiefs : comment cela, IV. 6. Différens noms sous lesquels ils sont désignés dans les anciens monumens, IV. 14 & suiv. Leur origine, ibid. N’étoient pas comptés au nombre des hommes libres dans les commencemens de la monarchie, IV. 47. Menoient autrefois leurs arrieres-vassaux à la guerre, IV. 47. On en distinguoit de trois sortes : par qui ils étoient [IV-591] menés à la guerre, ib. 49, 50. Ceux du roi étoient fournis à la correction du comte, IV. 52. Étoient obligés, dans les commencemens de la monarchie, à un double service ; & c’est dans ce double service que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, ibid & suiv. Pourquoi ceux des évêques & abbés étoient menés à la guerre par la comte, IV. 53. Les prérogatives de ceux du roi ont fait changer presque tous les alleux en fiefs : quelles étoient ces prérogatives, IV. 133 & suiv. Quand ceux qui tenoient immédiatement du roi commencerent à en tenir médiatement, IV. 193 & suiv.
Vasselage. Son origine, IV. 193 suiv.
Vénalité des charges. Est-elle utile ? I. 142, 143.
Vengeance. Étoit punie chez les Germains quand celui qui l’exerçoit avoit reçu la composition, IV. 63 & suiv.
Venise. Comment maintient son aristocratie contre les nobles, I. 28. Utilité de ses inquisiteurs d’état, I. 28, 29. En quoi ils different des dictateurs romains, ibid. Sagesse d’un jugement qui y fut rendu entre un noble vénitien & un simple gentilhomme, I. 103. Le commerce y est défendu aux nobles, I. 107. Il n’y a que les courtisanes qui puissent y tirer de l’argent des nobles, I. 199. On y a connu & corrigé par les lois les inconvéniens d’une aristocratie héréditaire, I. 233. Pourquoi il y a des inquisiteurs d’état : différens tribunaux dans cette république, I. 313, 314. Pourroit plus aisément être subjuguée par ses propres troupes, que la Hollande, I. 332. Quel étoit son commerce, II. 242. Dut son commerce à la viooence & à la vexation, II. 246. Pourquoi les vaisseaux n’y sont pas si bons qu’ailleurs, II. 284. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérence, II. 346, 347. Loi de cette république contraire à la nature des choses, III. 259.
Vents alisés. Étoient une espece de boussole pour les anciens, II. 305.
Vérité. Dans quel sens on en fait cas dans une monarchie, I. 61, 62. C’est pas la persuasion, & non par les supplices, qu’on la doit faire recevoir, III. 186.
[IV-592]
Verrès. Blâmé par Cicéron de ce qu’il avoit suivi l’esprit plutôt que la lettre de la loi Voconienne, III. 254.
Vertu. Ce que l’auteur entend par ce mot, I. 47 ; 69. Est nécessaire dans un état populaire : elle en est le principe, I. 40. Est moins nécessaire dans une monarchie, que dans une république, I. 40, 41. On perdit la liberté à Rome en perdant la vertu, I. 41. Étoit la seule force pour soutenir un état, que les législateurs grecs connussent, ibid. Effet que produit son absence dans une république, I. 42. Abandonnée par les Carthaginois, entraîna leur chute, I. 43, 44. Est moins nécessaire dans une aristocratie, pour le peuple, que dans une démocratie, I. 44. Est nécessaire dans une aristocratie pour maintenir les nobles qui gouvernent, I. 45. N’est point le principe du gouvernement monarchique, I. 46 & suiv. Les vertus héroïques des anciens, inconnues parmi nous, inutiles dans une monarchie, ibid. Peut se trouver dans une monarchie : mais elle n’en est pas le ressort, I. 48, 49. Comment on y supplée dans le gouvernement monarchique, I. 49. N’est point nécessaire dans un état despotique, I. 53. Quelles sont les vertus en usage dans une monarchie, I. 60. L’amour de soi-même est la base des vertus en usage dans une monarchie, ibid. Les vertus ne sont dans une monarchie que ce que l’honneur veut qu’elles soient, I. 64. Il n’y en a aucune qui soit propre aux esclaves, & par conséquent aux sujets d’un despote, I. 67. Étoit le principe de la plupart des gouvernemens anciens, I. 68. Combien la pratique en est difficile, I. 69. Ce que c’est dans l’état politique, I. 83. Ce que c’est dans un gouvernement aristocratique, I. 103. Quelle est celle d’un citoyen dans une république, I. 138. Quand un peuple est vertueux, il faut peu de peines : exemples tirés des lois romaines, I. 170. Les femmes perdent tout en la perdant, I. 208. Ne se trouve qu’avec la liberté bien entendue, I. 231. Réponse à une objection tirée de ce que l’auteur a dit, qu’il ne faut point de vertu dans une monarchie, D. 316 & suiv.
[IV-593]
Vestales. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d’enfans, III. 104.
Vicaires. Étoient dans le commencement de la monarchie des officiers militaires subordonnés aux comtes, IV. 47, 48.
Vices. Les vices pollitiques & les vices moraux ne sont pas les mêmes ; c’est ce que doivent savoir les législateurs, II. 197.
Victoire (la). Quel en est l’objet, I. 10. C’est le christianisme qui empêche qu’on n’en abuse, III. 129.
Victor Amédée, roi de Sardaigne. Contradiction dans sa conduite, I. 139.
Vie. L’honneur défend dans une monarchie d’en faire aucun cas, I. 65.
Vies des Saints. Si elles ne sont pas véridiques sur les miracles, elles fournissent les plus grands éclaircissemens sur l’origine des servitudes de la glebe & des fiefs, IV. 23, 24. Les mensonges qui y sont peuvent apprendre les mœurs & les lois du temps, parce qu’ils sont relatifs à ces mœurs & à ces lois, IV. 75.
Vieillards. Combien il importe dans une démocratie que les jeunes gens leur soient subordonnés, I. 100. Leurs privileges à Rome furent communiqués aux gens mariés qui avoient des enfans, III. 96. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, III. 119.
Vignes. Pourqoi furent arrachées dans les Gaules par Domitien, & replantées par Probus & Julien, II. 230, 231.
Vignobles. Son beaucoup plus peuplés que les pâturages & les terres à blé : pourquoi, III. 80.
Vilains. Comment punis autrefois en France, I. 169. Comment se battoient, III. 322. Ne pouvoient fausser la cour de leurs seigneurs, ou appeller de ses jugemens. Quand commencerent à avoir cette faculté, III. 363, 364.
Villes. Leurs associations sont aujourd’hui moins nécessaires qu’autrefois, I. 260, 261. Il y faut moins de fêtes qu’à la campagne, III. 155.
Vin. C’est par raison de climat que Mahomet l’a défendu. À quel pays il convient, II. 47, 48.
[IV-594]
Vindex. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur de Tarquin. Quel rôle il joua dans la procédure, & quelle fut sa récompense, I. 407.
Viol. Quelle est la nature de ce crime, I. 386.
Violence. Est un moyen de rescision pour les particuliers : ce n’en est pas un pour les princes, III. 133, 134.
Virginie. Révolutions que causerent à Rome son déshonneur & sa mort, I. 234. Son malheur affermit la liberté de Rome, I. 418.
Visir. Est essentiel dans un état despotique, I. 36.
Ulpien. En quoi faisoit consister le crime de lese-majesté, I. 398, 399.
Uniformité de lois. Saisit quelquefois les grands génies, & frappe infailliblement les petits, III. 439.
Union. Nécessaire entre les familles nobles dans une aristocratie, I. 111.
Vœux en religion. C’est s’éloigner des principes des lois civiles, que de les regarder comme une juste cause de divorce, III. 209.
Vol. Comment puni à la Chine quand il est accompagné de l’assassinat, 186. Ne devroit pas être puni de mort. Pourquoi il l’est, I. 387, 388. Comment étoit puni à Rome. Les lois sur cette matiere n’avoient nul rapport avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Comment Clothaire & Childebert avoient imaginé de prévenir ce crime, IV. 47, 48. Celui qui avoit été volé ne pouvoit pas, du temps de nos peres, recevoir sa composition en secret & sans l’ordonnance du juge, III. 65, 66.
Vol manifeste. Voyez Voleur manifeste.
Voleur. Est-il plus coupable que le receleur ? III. 421, 422. Il étoit permis à Rome de tuer celui qui se mettoit en défense : correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III. 427, 428. Ses parens n’avoient point de composition quand il étoit tué dans le vil même, IV. 65.
Voleur manifeste, & Voleur non manifeste. Ce que c’étoit à Rome ; cette distinction étoit pleine d’inconséquences, III. 422 & suiv.
[IV-595]
Volonté. La réunion des volontés de tous les habitans est nécessaire pour former un état civil, I. 12.
Volonté. Celle du souverain est le souverain lui-même, I. 16. Celle du despote doit avoir un effet toujours infaillible., II. 55.
Volsiniens. Loi abominable que le trop grand nombre d’esclaves les força d’adopter, II. 91.
Usages. Il y en a beaucoup dont l’origine vient du changement des armes, III. 324.
Usure. Est comme naturalisée dans les états despotiques : pourquoi, I. 130. C’est dans l’évangile & non dans les rêveries des scholastiques qu’il en faut puiser les regles, II. 341, 342. Pourquoi le prix en diminua de moitié lors de la découverte de l’Amérque, III. 10, 11. Il ne faut pas la confondre avec l’intérêt : elle s’introduit nécessairement dans les pays où il est défendu de prêter à intérêt, III. 51. Pourquoi l’usure maritime est plus forte que l’autre, III. 52. Ce qui l’a introduite & comme naturalisée à Rome, III. 53, 54. Son taux dans les différens temps de la république romaines : ravages qu’elle fit, III. 53 & s. Sur quelle maxime elle fut réglée à Rome après la destruction de la république, III. 64. Justification de l’auteur par rapport à ses sentimens sur cette matiere, D. 284 & suiv. — par rapport à l’érudition, D. 291 & suiv. Usage des Romains sur cette matiere, D. 297 & suiv.
Usurpateurs. Ne peuvent réussir dans une république fédérative, I. 261.
W
Warnachaire. Établit sous Clothaire la perpétuité & l’autorité des maires du palais, IV. 109, 110.
Wisigoths. Singularité de leurs lois sur la pudeur : elles venoient du climat, II. 57, 58. Les filles étoient capables chez eux de succéder aux terres & à la couronne, II. 171, 172. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, I. 173. Motifs [IV-596] des lois de ceux d’Espagne au sujet des donations à cause de noces, II. 217, 218. Loi de ces barbares qui détruisoit le commerce, II. 338, 339. Autre loi favorable au commerce, II. 340. Loi terrible de ces peuples touchant les femmes adulteres, III. 231, 232. Quand & pourquoi firent écrire leurs lois, III. 266. Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractere, III. 267. Le clergé refondit leurs lois, & y introduisit les peines corporelles qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III. 267, 268. C’est de leurs lois qu’ont été tirées toutes celles de l’inquisition ; les moines n’ont fait que les copier, III. 269, 270. Leurs lois sont idiotes & n’atteignent point le but ; frivoles dans le fond & gigantesques dans le style, III. 270. Différence essentielle entre leurs lois & les lois saliques, III. 202 & suiv. Leurs coutumes furent rédigées par ordre d’Euric, III. 276. Pourquoi le droit romain s’étendit, & eut une si grande autorité chez eux, tandis qu’ils se perdoit peu à peu chez les Francs, III. 276 & suiv. Leur loi ne leur donnoit dans leur patrimoine aucun avantage civil sur les Romains, III. 277, 278. Leur loi triompha en Espagne, & le droit romain s’y perdit, III. 284. Loi cruelle de ces peuples, III. 437. S’établirent dans la Gaule Narbonnoire : ils y porterent les mœurs germaines ; & de-là les fiefs dans ces contrées, IV. 10.
Wolguski. Peuples de la Sybérie : n’ont point de prêtres, & son barbares, III. 169.
X
Xénophon. Regardoit les arts comme la source de la corruption du corps, I. 77. Sentoit la nécessité de nos juges-consuls, II. 259, 260. En parlant d’Athenes, semble parler de l’Angleterre, II. 288.
[IV-597]
Y
Ynca (l’) Atualpa. Traitement cruel qu’il reçut des Espagnols, III. 235, 236.
Yvrognerie. Raisons physiques du penchant des peuples du nord pour le vin, II. 37. Est établie par toute la terre en proportion de la froideur & de l’humidité du climat, II. 47, 48. Pays où elle doit être sévérement punie ; pays où elle peut être tolérée, II. 48.
Z
Zacharie. Faut-il en croire le P. le Cointe, qui nie que ce pape ait favorisé l’avénement des Carlovingiens à la couronne ? IV. 159, 160.
Zénon. Nioit l’immortalité de l’ame ; & de ce faux principe, il tiroit des conséquences admirables pour la société, III. 150.
Zoroastre. Avoit fait un précepte aux Perses d’épouser leur mere préférablement, III. 220.
Zozyme. À quel motif il attribuoit la conversion de Constantin, III. 139.