
CHARLES LOUIS DE SECONDAT BARON MONTESQUIEU,
De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition (1777)
[Volume 3]
 |
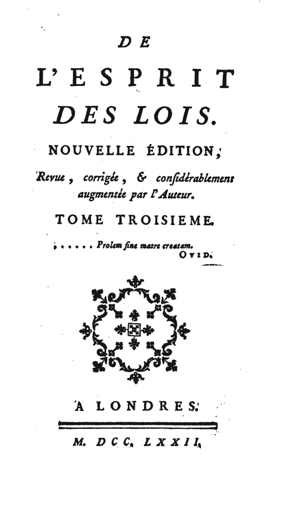 |
| Montesquieu (1689-1755) |
[Created: 31 May, 2023]
[Updated: May 31, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). Vol. 3.http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Montesquieu/EspritLois/1777-Garnier/EdL3.html
Charles Louis de Secondat baron Montesquieu, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). Vol. 3.
- T1: Avertissement et al.; Livres I-XII: facs. PDF and HTML
- T2: Livres XIII-XXI: facs. PDF and HTML
- T3: Livres XXII-XXIX: facs. PDF and HTML
- T4: Livres XXX-XXXI; Défense de L’Esprit des Lois; Lysimaque; Table des matières: facs. PDF and HTML
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
See also the "four volumes in 1" HTML version.
This book is part of a collection of works by Montesquieu (1689-1755).
TABLE des LIVRES ET CHAPITRES Contenus en ce troiſieme Volume.
- LIVRE XXII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’uſage de la monnoie.
- Chapitre I. Raison de l’uſage de la monnoie.
- Ch. II. De la nature de la monnoie.
- Ch. III. Des monnoies idéales.
- Ch. IV. De la quantité de l’or & de l’argent.
- Ch. V. Continuation du même ſujet.
- Ch. VI. Par quelle raiſon le prix de l’uſure diminua de la moitié, lors de la découverte des Indes.
- Ch. VII. Comment le prix des choſes ſe fixe par la variation des richeſſes de ſigne.
- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. IX. De la rareté relative de l’or & de l’argent.
- Ch. X. Du change.
- Ch. XI. Des opérations que les Romains firent ſur les monnoies.
- Ch. XII. Circonstances dans leſquelles les Romains firent leurs opérations ſur la monnoie.
- Ch. XIII. Opérations ſur les monnoies du temps des Empereurs.
- Ch. XIV. Comment le change gêne les états deſpotiques.
- Ch. XV. Uſage de quelques pays d’Italie.
- Ch. XVI. Du ſecours que l’état peut tirer des banquiers.
- Ch. XVII. Des dettes publiques.
- Ch. XVIII. Du payement des dettes publiques.
- Ch. XIX. Des prêts à intérêt.
- Ch. XX. Des uſures maritimes.
- Ch. XXI. Du prêt par contrat & de l’uſure chez les Romains.
- Ch. XXII. Continuation du même ſujet.
- LIVRE XXIII. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.
- Chapitre I. Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur eſpece.
- Ch. II. Des mariages.
- Ch. III. De la condition des enfans.
- Ch. IV. Des familles.
- Ch. V. Des divers ordres de femmes légitimes.
- Ch. VI. Des bâtards dans les divers gouvernemens.
- Ch. VII. Du conſentement des peres au mariage.
- Ch. VIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. IX. Des filles.
- Ch. X. Ce qui détermine au mariage.
- Ch. XI. De la dureté du gouvernement.
- Ch. XII. Du nombre des filles & des garçons dans différens pays.
- Ch. XIII. Des ports de mer.
- Ch. XIV. Des productions de la terre qui demandent plus ou moins d’hommes.
- Ch. XV. Du nombre des habitans par rapport aux arts.
- Ch. XVI. Des vues du légiſlateur ſur la propagation de l’eſpece.
- Ch. XVII. De la Grece & du nombre de ſes habitans.
- Ch. XVIII. De l’état des peuples avant les Romains.
- Ch. XIX. Dépopulation de l’univers.
- Ch. XX. Que les Romains furent dans la néceſſité de faire des lois pour la propagation de l’eſpece.
- Ch. XXI. Des lois des Romains ſur la propagation de l’eſpece.
- Ch. XXII. De l’expoſition des enfans.
- Ch. XXIII. De l’état de l’univers après la deſtruction des Romains.
- Ch. XXIV. Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans,
- Ch. XXV. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXVI. Conſéquences.
- Ch. XXVII. De la loi faite en France pour encourager la propagation de l’eſpece.
- Ch. XXVIII. Comment on peut remédier à la dépopulation,
- Ch. XXIX. Des hôpitaux.
- LIVRE XXIV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, conſidérée dans ſes pratiques & en elle-même.
- Chapitre I. Des religions en général.
- Ch. II. Paradoxe de Bayle.
- Ch. III. Que le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne, & le gouvernement deſpotique à la Mahométane.
- Ch. IV. Conſéquences du caractere de la religion Chrétienne, & de celui de la Mahométane.
- Ch. V. Que la religion catholique convient mieux à une monarchie, & que la proteſtante s’accommode mieux d’une république.
- Ch. VI. Autre paradoxe de Bayle.
- Ch. VII. Des lois de perfection dans la religion.
- Ch. VIII. De l’accord des lois de la morale avec celles de la religion.
- Ch. IX. Des Eſſéens.
- Ch. X. De la ſecte ſtoïque.
- Ch. XI. De la contemplation.
- Ch. XII. Des pénitences.
- Ch. XIII. Des crimes inexpiables,
- Ch. XIV. Comment la force de la religion s’applique à celle des lois civiles.
- Ch. XV. Comment les lois civiles corrigent quelquefois les fauſſes religions.
- Ch. XVI. Comment les lois de la religion corrigent les inconvéniens de la conſtitution politique.
- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVIII. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles.
- Ch. XIX. Que c’eſt moins la vérité ou la fauſſeté d’un dogme qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans l’état civil, que l’uſage ou l’abus que l’on en fait.
- Ch. XX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXI. De la métempſycoſe.
- Ch. XXII. Combien il eſt dangereux que la religion inſpire de l’horreur pour des choſes indifférentes.
- Ch. XXIII. Des fêtes.
- Ch. XXIV. Des lois de religion locales.
- Ch. XXV. Inconvénient du tranſport d’une religion d’un pays à un autre.
- Ch. XXVI. Continuation du même ſujet.
- LIVRE XXV. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établiſſement de la religion de chaque pays, & ſa police extérieure.
- Chapitre I. Du ſentiment pour la religion.
- Ch. II. Du motif d’attachment pour les diverſes religions.
- Ch. III. Des Temples.
- Ch. IV. Des Miniſtres de la religion.
- Ch. V. Des bornes que les lois doivent mettre aux richeſſes du Clergé.
- Ch. VI. Des Monaſteres.
- Ch. VII. Du luxe de la ſuperſtition.
- Ch. VIII. Du Pontificat.
- Ch. IX. De la tolérance en fait de religion.
- Ch. X. Continuation du même ſujet.
- Ch. XI. Du changement de religion.
- Ch. XII. Des lois pénales.
- Ch. XIII. Très-humble remontrance aux Inquiſiteurs d’Eſpagne & de Portugal.
- Ch. XIV. Pourquoi la Religion chrétienne eſt ſi odieuſe au Japon.
- Ch. XV. De la propagation de religion.
- LIVRE XXVI. Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choſes ſur leſquelles elles ſtatuent.
- Chapitre I. Idée de ce Livre.
- Ch. II. Des lois divines & des lois humaines.
- Ch. III. Des lois civiles qui ſont contraires à la loi naturelle.
- Ch. IV. Continuation du même ſujet.
- Ch. V. Cas où l’on peut juger par les principes du droit civil, en modifiant les principes du droit naturel.
- Ch. VI. Que l’ordre des ſucceſſions depend des principes du droit politique ou civil & non pas des principes du droit naturel.
- Ch. VII. Qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorſqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle.
- Ch. VIII. Qu’il ne faut pas régler, par les principes du droit qu’on appelle canonique, les choſes réglées par les principes du droit civil.
- Ch. IX. Que les choſes qui doivent être réglées par les principes du droit civil, peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion.
- Ch. X. Dans quel cas il faut ſuivre la loi civile qui permet, & non pas la loi de la religion qui défend.
- Ch. XI. Qu’il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie.
- Ch. XII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XIII. Dans quel cas il faut ſuivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion ; & dans quel cas il faut ſuivre les lois civiles.
- Ch. XIV. Dans quels cas, dans les mariages entre parens, il faut ſe régler par les lois de la nature ; dans quels cas on doit ſe régler par les lois civiles.
- Ch. XV. Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique les choſes qui dépendent des principes du droit civil.
- Ch. XVI. Qu’il ne faut point décider par les regles du droit civil, quand il s’agit de décider par celles du droit politique.
- Ch. XVII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XVIII. Qu’il faut examiner ſi les lois, qui paroiſſent ſe contredire, ſont du même ordre.
- Ch. XIX. Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles les choſes qui doivent l’être par les lois domeſtiques.
- Ch. XX. Qu’il ne faut pas décider par les principes des lois civiles les choſes qui appartiennent au droit des gens.
- Ch. XXI. Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques les choſes qui appartiennent au droit des gens.
- Ch. XXII. Malheureux fort de l’Ynca Athualpa.
- Ch. XXIII. Que lorſque, par quelque circonſtance, la loi politique détruit l’état, il faut décider par la loi politique qui le conſerve, qui devient quelquefois un droit des gens.
- Ch. XXIV. Que les réglemens de police ſont d’un autre ordre que les autres lois civiles.
- Ch. XXV. Qu’il ne faut pas ſuivre les diſpoſitions générales du droit civil, lorſqu’il s’agit de choſes qui doivent être ſoumiſes à des regles particulieres tirées de leur propre nature.
- LIVRE XXVII.
- Chapitre unique. De l’origine & des révolutions des lois des Romains ſur les ſucceſſions.
- LIVRE XXVIII. De l’origine & des révolutions des lois civiles chez les François.
- Chapitre I. Du différent caractere des lois des peuples Germains.
- Ch. II. Que les lois des Barbares furent toutes perſonnelles.
- Ch. III. Différence capitale entre les lois Saliques & les lois des Wiſigoths & des Bourguignons.
- Ch. IV. Comment le droit romain ſe perdit dans le pays du domaine des Francs, & ſe conſerva dans le pays du domaine des Goths & des Bourguignons.
- Ch. V. Continuation du même ſujet.
- Ch. VI. Comment le droit romain ſe conſerva dans le domaine des Lombards.
- Ch. VII. Comment le droit romain ſe perdit en Eſpagne.
- Ch. VIII. Faux capitulaire.
- Ch. IX. Comment les codes des lois des Barbaras & les capitulaires ſe perdirent.
- Ch. X. Continuation du même ſujet.
- Ch. XI. Autres cauſes de la chute des codes des lois des Barbares, du droit romain & des Capitulaires.
- Ch. XII. Des coutumes locales ; révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit romain.
- Ch. XIII. Différence de la loi Salique ou des Francs ſaliens, d’avec celle des Francs ripuaires & des autres peuples Barbares.
- Ch. XIV. Autre différence.
- Ch. XV. Réflexion.
- Ch. XVI. De la preuve par l’eau bouillante établie par la loi Salique.
- Ch. XVII. Maniere de penſer de nos peres.
- Ch. XVIII. Comment la preuve par le combat s’étendit.
- Ch. XIX. Nouvelle raiſon de l’oubli des lois Saliques, des lois Romaines & des Capitulaires.
- Ch. XX. Origine du point d’honneur.
- Ch. XXI. Nouvelle réflexion ſur le point d’honneur chez les Germains.
- Ch. XXII. Des mœurs relatives aux combats.
- Ch. XXIII. De la juriſprudence du combat judiciaire.
- Ch. XXIV. Regles établies dans le combat judiciaire.
- Ch. XXV. Des bornes que l’on mettoit à l’uſage du combat judiciaire.
- Ch. XXVI. Du combat judiciaire, entre une des parties & un des témoins.
- Ch. XXVII. Du combat judiciaire, entre une partie & un des pairs du ſeigneur. Appel de faux jugement.
- Ch. XXVIII. De l’appel de défaute de droit.
- Ch. XXIX. Epoque du regne de ſaint Louis.
- Ch. XXX. Obſervation ſur les appels.
- Ch. XXXI. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXIV. Comment la procédure devint ſecrette.
- Ch. XXXV. Des dépens.
- Ch. XXXVI. De la partie publique.
- Ch. XXXVII. Comment les établiſſemens de ſaint Louis tomberent dans l’oubli.
- Ch. XXXVIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XXXIX. Continuation du même ſujet.
- Ch. XL. Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.
- Ch. XLI. Flux & reflux de la juridiction Eccléſiaſtique & de la juridiction laye.
- Ch. XLII. Renaiſſance du droit romain, & ce qui en réſulta. Changemens dans les tribunaux.
- Ch. XLIII. Continuation du même ſujet.
- Ch. XLIV. De la preuve par témoins.
- Ch. XLV. Des coutumes de France.
- LIVRE XXIX. De la maniere de compoſer les lois.
- Chapitre I. De l’eſprit du Légiſlateur.
- Ch. II. Continuation du même ſujet.
- Ch. III. Que les lois qui paroiſſent s’éloigner des vues du Légiſlateur, y ſont ſouvent conformes.
- Ch. IV. Des lois qui choquent les vues du Légiſlateur.
- Ch. V. Continuation du même ſujet.
- Ch. VI. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, n’ont pas toujours le mêne effet.
- Ch. VII. Continuation du même ſujet. Néceſſité de bien compoſer les lois.
- Ch. VIII. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, n’ont pas toujours eu le même motif.
- Ch. IX. Que les lois Grecques & Romaines ont puni l’homicide de ſoi-même, ſans avoir le même motif.
- Ch. X. Que les lois qui paroiſſent contraires, dérivent quelquefois du même eſprit.
- Ch. XI. De quelle maniere deux lois diverſes peuvent être comparées.
- Ch. XII. Que les lois qui paroiſſent les mêmes, ſont réellement quelquefois différentes.
- Ch. XIII. Qu’il ne faut point ſéparer les lois de l’objet pour lequel elles ſont faites. Des lois Romaines ſur le vol.
- Ch. XIV. Qu’il ne faut point ſéparer les lois des circonſtances dans leſquelles elles ont été faites.
- Ch. XV. Qu’il est bon quelquefois qu’une loi ſe corrige elle-même.
- Ch. XVI. Choſes à obſerver dans la compoſition des lois.
- Ch. XVII. Mauvaiſe maniere de donner des lois.
- Ch. XVIII. Des idées d’uniformité,
- Ch. XIX. Des légiſlateurs.
Volume III↩
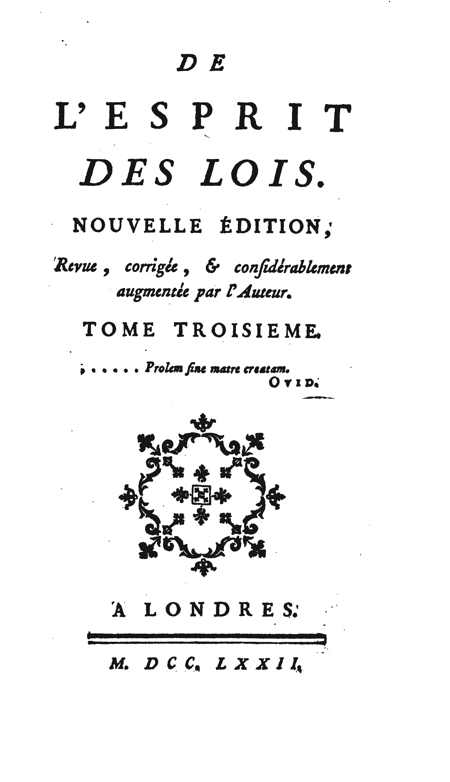
[III-31]
DE
L’ESPRIT
DES LOIS.↩
LIVRE XXII.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’usage de la monnoie.↩
CHAPITRE PREMIER.
Raison de l’usage de la monnoie.
Les peuples qui ont peu de marchandises pour le commerce, comme les sauvages, & les peuples policés qui n’en ont que deux ou trois especes, négocient par échange. Ainsi les caravanes de Maures qui vont à Tombouctou, dans le fond de l’Afrique, troquer [III-32] du sel contre de l’or, n’ont pas besoin de monnoie. Le Maure met son sel dans un monceau ; le Negre, sa poudre dans un autre : s’il n’y a pas assez d’or, le Maure retranche de son sel, ou le Negre ajoute de son or, jusqu’à ce que les parties conviennent.
Mais lorsqu’un peuple trafique sur un très-grand nombre de marchandises, il faut nécessairement une monnoie, parce qu’un métal facile à transporter épargne bien des frais, que l’on seroit obligé de faire si l’on procédoit toujours par échange.
Toutes les nations ayant des besoins réciproques, il arrive souvent que l’une veut avoir un très-grand nombre de marchandises de l’autre, & celle-ci très-peu des siennes ; tandis qu’à l’égard d’une autre nation, elle est dans un cas contraire. Mais lorsque les nations ont une monnoie, & qu’elles procedent par vente & par achat, celles qui prennent plus de marchandises se soldent ou payent l’excédent avec de l’argent : & il y a cette différence, que dans le cas de l’achat, le commerce se fait à proportion des besoins de la nation qui demande le plus ; & que dans l’échange [III-33] le commerce se fait seulement dans l’étendue des besoins de la nation qui demande le moins, sans quoi cette derniere seroit dans l’impossibilité de solder son compte.
[III-33]
CHAPITRE II.
De la nature de la monnoie.
La monnoie est un signe qui représente la valeur de toutes les marchandises. On prend quelque métal pour que le signe soit durable [1] ; qu’il se consomme peu par l’usage ; & que, sans se détruire, il soit capable de beaucoup de divisions. On choisit un métal précieux, pour que le signe puisse aisément se transporter. Un métal est très-propre à être une mesure commune, parce qu’on peut aisément le réduire au même titre. Chaque état y met son empreinte, afin que la forme réponde du titre & du poids, & que l’on connoisse l’un & l’autre par la seule inspection.
Les Athéniens n’ayant point l’usage des métaux, se servirent de bœufs [2] ; [III-34] & les Romains de brebis : mais un bœuf n’est pas la même chose qu’un autre bœuf, comme une piece de métal peut être la même qu’une autre.
Comme l’argent est le signe des valeurs des marchandises, le papier est un signe de la valeur de l’argent ; & lorsqu’il est bon, il le représente tellement, que, quant à l’effet, il n’y a point de différence.
De même que l’argent est un signe d’une chose, & la représente ; chaque chose est un signe de l’argent, & le représente : & l’état est dans la prospérité selon que d’un côté l’argent représente bien toutes choses ; & que d’un autre, toutes choses représentent bien l’argent, & qu’ils sont signes les uns des autres ; c’est-à-dire, que, dans leur valeur relative, on peut avoir l’un sitôt que l’on a l’autre. Cela n’arrive jamais que dans un gouvernement modéré, mais n’arrive pas toujours dans un gouvernement modéré : par exemple, si les lois favorisent un débiteur injuste, les choses qui lui appartiennent ne [III-35] représentent point l’argent, & n’en sont point un signe. À l’égard du gouvernement despotique, ce seroit un prodige si les choses y représentoient leur signe : la tyrannie & la méfiance font que tout le monde y enterre [3] son argent : les choses n’y représentent donc point l’argent.
Quelquefois les législateurs ont employé un tel art, que non-seulement les choses représentoient l’argent par leur nature, mais qu’elles devenoient monnoie comme l’argent même. César [4] dictateur, permit aux débiteurs de donner en payement à leurs créanciers des fonds de terre au prix qu’ils valoient avant la guerre civile. Tibere [5] ordonna que ceux qui voudroient de l’argent, en auroient du trésor public, en obligeant des fonds pour le double. Sous César, les fonds de terre furent la monnoie qui paya toutes les dettes ; sous Tibere, dix mille sesterces en fonds devinrent une monnoie commune comme cinq mille sesterces en argent.
[III-36]
La grande chartre d’Angleterre défend de saisir les terres ou les revenus d’un débiteur, lorsque ses biens mobiliers ou personnels suffisent pour le payement, & qu’il offre de les donner ; pour lors tous les biens d’un Anglois représentoient de l’argent.
Les lois des Germains apprécierent en argent les satisfactions pour les torts que l’on avoit faits, & pour les peines des crimes. Mais comme il y avoit très-peu d’argent dans le pays, elles réapprécierent l’argent en denrées ou en bétail. Ceci se trouve fixé dans la loi des Saxons, avec de certaines différences suivant l’aisance & la commodité des divers peuples. D’abord [6] la loi déclare la valeur du sou en bétail : le sou de deux trémisses se rapportoit à un bœuf de douze mois ou à une brebis avec son agneau ; celui de trois trémisses valoit un bœuf de seize mois. Chez ces peuples la monnoie devenait bétail, marchandise, ou denrée ; & ces choses devenoient monnoie.
Non-seulement l’argent est un signe des choses ; il est encore un signe de [III-37] l’argent & représente l’argent, comme nous le verrons au chapitre du change.
-
[↑] Le sel, dont on se sert en Abyssinie, a ce défaut, qu’il se consomme continuellement.
-
[↑] Hérodote, in Clio, nous dit que les Lydiens trouverent l’art de battre la monnoie ; les Grecs le prirent d’eux : les monnoies d’Athenes eurent pour empreinte leur ancien bœuf. J’ai vu une de ces monnoies dans le cabinet du Comte de Pembrocke.
-
[↑] C’est un ancien usage à Alger, que chaque pere de famille ait un trésor enterré. Logier de Tassis, histoire du royaume d’Alger.
-
[↑] Voyez César, de la guerre civile, liv. III.
-
[↑] Tacite, liv. VI.
-
[↑] Loi des Saxons, ch. xviii.
[III-37]
CHAPITRE III.
Des monnoies idéales.
Il y a des monnoies réelles & des monnoies idéales. Les peuples policés, qui se servent presque tous de monnoies idéales, ne le sont que parce qu’ils ont converti leurs monnoies réelles en idéales. D’abord leurs monnoies réelles sont un certain poids & un certain titre de quelque métal : mais bientôt la mauvaise foi ou le besoin font qu’on retranche une partie du métal de chaque piece de monnoie, à laquelle on laisse le même nom : par exemple, d’une piece du poids d’une livre d’argent, on retranche la moitié de l’argent, & on continue de l’appeler livre ; la piece qui étoit une vingtieme partie de la livre d’argent on continue de l’appeller sou, quoiqu’elle ne soit plus la vingtieme partie de cette livre. Pour lors, la livre est une livre idéale, & le sou, un sou idéal ; ainsi des autres subdivisions : & cela peut aller au point que ce qu’on [III-38] appellera livre ne ſera plus qu’une très-petite portion de la livre, ce qui la rendra encore plus idéale. Il peut même arriver que l’on ne fera plus de piece de monnoie qui vaille préciſément une livre, & qu’on ne fera pas non plus de piece qui vaille un ſou : pour lors la livre & le ſou ſeront des monnoies purement idéales. On donnera à chaque piece de monnoie la dénomination d’autant de livres & d’autant de ſous que l’on voudra ; la variation pourra être continuelle, parce qu’il eſt auſſi aiſé de donner un autre nom à une choſe, qu’il eſt difficile de changer la choſe même.
Pour ôter la ſource des abus, ce ſera une très-bonne loi dans tous les pays où l’on voudra faire fleurir le commerce, que celle qui ordonnera qu’on emploiera des monnoies réelles ; & que l’on ne fera point d’opération qui puiſſe les rendre idéales.
Rien ne doit être ſi exempt de variation, que ce qui eſt la meſure commune de tout.
Le négoce par lui-même eſt très-incertain ; & c’eſt un grand mal d’ajouter une nouvelle incertitude à celle qui eſt fondée ſur la nature de la choſe.
[III-39]
CHAPITRE IV.
De la quantité de l’or & de l’argent.
Lorsque les nations policées sont les maîtresses du monde, l’or & l’argent augmentent tous les jours, soit qu’elles le tirent de chez elles, soit qu’elles l’aillent chercher là où il est. Il diminue au contraire lorsque les nations barbares prennent le dessus. On sait quelle fut la rareté de ces métaux, lorsque les Goths & les Vandales d’un côté, les Sarrasins & les Tartares de l’autre, eurent tout envahi.
[III-39]
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
L’argent tiré des mines de l’Amérique, transporté en Europe, de là encore envoyé en Orient, a favorisé la navigation de l’Europe ; c’est une marchandise de plus que l’Europe reçoit en troc de l’Amérique, & qu’elle envoie en troc aux Indes. Une plus grande quantité d’or & d’argent est donc [III-40] favorable, lorsqu’on regarde ces métaux comme marchandise ; elle ne l’est point lorsqu’on les regarde comme signe, parce que leur abondance choque leur qualité de signe qui est beaucoup fondée sur la rareté.
Avant la premiere guerre Punique, le cuivre étoit à l’argent comme [1] 960 est à 1 ; il est aujourd’hui à peu près comme 73 ½ est à 1 [2] . Quand la proportion seroit comme elle étoit autrefois, l’argent n’en seroit que mieux sa fonction de signe.
-
[↑] Voyez ci-dessous le chap. xii.
-
[↑] En supposant l’argent à 49 livres le marc, & le cuivre à vingt sols la livre.
[III-40]
CHAPITRE VI.
Par quelle raison le prix de l’usure diminua de la moitié, lors de la découverte des Indes.
L’ynca Garcilasso [1] dit qu’en Espagne, après la conquête des Indes, les rentes qui étoient au denier dix tomberent au denier vingt. Cela devoit être ainsi. Une grande quantité d’argent fut [III-41] tout-à-coup portée en Europe : bientôt moins de personnes eurent besoin d’argent ; le prix de toutes choses augmenta, & celui de l’argent diminua : la proportion fut donc rompue, toutes les anciennes dettes furent éteintes. On peut se rappeller le temps du systême [2] où toutes les choses avoient une grande valeur, excepté l’argent. Après la conquête des Indes, ceux qui avoient de l’argent furent obligés de diminuer le prix ou le louage de leur marchandise, c’est-à-dire l’intérêt.
Depuis ce temps, le prêt n’a pu revenir à l’ancien taux, parce que la quantité de l’argent a augmenté toutes les années en Europe. D’ailleurs, les fonds publics de quelques états, fondés sur les richesses que le commerce leur a procurées, donnant un intérêt très-modique, il a fallu que les contrats des particuliers se réglassent là-dessus. Enfin le change ayant donné aux hommes une facilité singuliere de transporter l’argent d’un pays à un autre, l’argent n’a pu être rare dans un lieu, qu’il n’en vînt de tous côtés de ceux où il étoit commun.
-
[↑] Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes.
-
[↑] On appelloit ainsi le projet de M. Law en France.
[III-42]
CHAPITRE VII.
Comment le prix des richesses se fixe dans la variation des richesses de signe.
L’argent est le prix des marchandises ou denrées. Mais, comment se fixera ce prix ? c’est-à-dire, par quelle portion d’argent chaque chose sera-t-elle représentée ?
Si l’on compare la masse de l’or & de l’argent qui est dans le monde, avec la somme des marchandises qui y sont, il est certain que chaque denrée ou marchandise en particulier pourra être comparée à une certaine portion de la masse entiere de l’or & de l’argent. Comme le total de l’une est au total de l’autre, la partie de l’une sera à la partie de l’autre. Supposons qu’il n’y ait qu’une seule denrée ou marchandise dans le monde, ou qu’il n’y en ait qu’une seule qui s’achete, & qu’elle se divise comme l’argent ; cette partie de cette marchandise répondra à une partie de la masse de l’argent ; la moitié du total de l’une à la moitié du total de l’autre ; la dixieme, la centieme, la millieme de l’une, à la [III-43] dixieme, à la centieme, à la millieme de l’autre. Mais comme ce qui forme la propriété parmi les hommes, n’est pas tout à la fois dans le commerce ; & que les métaux ou les monnoies, qui en sont les signes, n’y sont pas aussi dans le même temps ; les prix se fixeront en raison composée du total des choses avec le total des signes, & de celle du total des choses qui sont dans le commerce avec le total des signes qui y sont aussi : & comme les choses qui ne sont pas dans le commerce aujourd’hui peuvent y être demain, & que les signes qui n’y sont point aujourd’hui peuvent y rentrer tout de même, l’établissement du prix des choses dépend toujours fondamentalement de la raison du total des choses au total des signes.
Ainsi le prince ou le magistrat ne peuvent pas plus taxer la valeur des marchandises, qu’établir par une ordonnance que le rapport d’un à dix est égal à celui d’un à vingt. Julien [1] ayant baissé les denrées à Antioche, y causa une affreuse famine.
-
[↑] Histoire de l’Église, par Socrate, liv. II.
[III-44]
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
Les noirs de la côte d’Afrique ont un signe des valeurs sans monnoie ; c’est un signe purement idéal, fondé sur le degré d’estime qu’ils mettent dans leur esprit à chaque marchandise, à proportion du besoin qu’ils en ont. Une certaine denrée ou marchandise vaut trois macutes ; une autre, six macutes ; une autre, dix macutes ; c’est comme s’ils disoient simplement, trois, six, dix. Le prix se forme par la comparaison qu’ils font de toutes les marchandises entr’elles ; pour lors il n’y a point de monnoie particuliere, mais chaque portion de marchandise est monnoie de l’autre.
Transportons pour un moment parmi nous cette maniere d’évaluer les choses, & joignons-la avec la nôtre : Toutes les marchandises & denrées du monde, ou bien toutes les marchandises ou denrées d’un état en particulier considéré comme séparé de tous les autres, vaudront un certain nombre de macutes ; [III-45] & divisant l’argent de cet état en autant de parties qu’il y a de macutes, une partie divisée de cet argent sera le signe d’une macute.
Si l’on suppose que la quantité de l’argent d’un état double, il faudra pour une macute le double de l’argent : mais si en doublant l’argent, vous doublez aussi les macutes, la proportion restera telle qu’elle étoit avant l’un & l’autre doublement.
Si depuis la découverte des Indes, l’or & l’argent ont augmenté en Europe à raison d’un à vingt, le prix des denrées & marchandises auroit dû monter en raison d’un à vingt : mais si d’un autre côté, le nombre des marchandises a augmenté comme un à deux, il faudra que le prix de ces marchandises & denrées ait haussé d’un côté en raison d’un à vingt, & qu’il ait baissé en raison d’un à deux, & qu’il ne soit par conséquent qu’en raison d’un à dix.
La quantité des marchandises & denrées croît par une augmentation de commerce ; l’augmentation de commerce, par une augmentation d’argent qui arrive successivement, & par de nouvelles communications avec de nouvelles [III-46] terres & de nouvelles mers, qui nous donnent de nouvelles denrées & de nouvelles marchandises.
[III-46]
CHAPITRE IX.
De la rareté relative de l’or & de l’argent.
Outre l’abondance & la rareté positive de l’or & de l’argent, il y a encore une abondance & une rareté relative d’un de ces métaux à l’autre.
L’avarice garde l’or & l’argent, parce que, comme elle ne veut pas consommer, elle aime des signes qui ne se détruisent point. Elle aime mieux garder l’or que l’argent, parce qu’elle craint toujours de perdre, & qu’elle peut mieux cacher ce qui est en plus petit volume. L’or disparoît donc quand l’argent est commun, parce que chacun en a pour le cacher ; il reparoît quand l’argent est rare, parce qu’on est obligé de le retirer de ses retraites.
C’est donc une regle : l’or est commun quand l’argent est rare, & l’or est rare quand l’argent est commun. Cela fait sentir la différence de l’abondance [III-47] & de la rareté relative, d’avec l’abondance & la rareté réelle ; chose dont je vais beaucoup parler.
[III-47]
CHAPITRE X.
Du change.
C’est l’abondance & la rareté relative des monnoies des divers pays qui forment ce qu’on appelle le change.
Le change est une fixation de la valeur actuelle & momentanée des monnoies.
L’argent, comme métal, a une valeur comme toutes les autres marchandises ; & il a encore une valeur qui vient de ce qu’il est capable de devenir le signe des autres marchandises : & s’il n’étoit qu’une simple marchandise, il ne faut pas douter qu’il ne perdît beaucoup de son prix.
L’argent, comme monnoie, a une valeur que le prince peut fixer dans quelques rapports, & qu’il ne sauroit fixer dans d’autres.
1°. Le prince établit une proportion entre une quantité d’argent comme métal, & la même quantité comme [III-48] monnoie. 2°. Il fixe celle qui est entre divers métaux employés à la monnoie. 3°. Il établit le poids & le titre de chaque piece de monnoie. Enfin il donne à chaque piece cette valeur idéale dont j’ai parlé. J’appellerai la valeur de la monnoie dans ces quatre rapports valeur positive, parce qu’elle peut être fixée par une loi.
Les monnoies de chaque état ont de plus une valeur relative, dans le sens qu’on les compare avec les monnoies des autres pays : c’est cette valeur relative que le change établit. Elle dépend beaucoup de la valeur positive. Elle est fixée par l’estime la plus générale des négocians, & ne peut l’être par l’ordonnance du prince, parce qu’elle varie sans cesse, & dépend de mille circonstances.
Pour fixer la valeur relative, les diverses nations se régleront beaucoup sur celle qui a le plus d’argent. Si elle a autant d’argent que toutes les autres ensemble, il faudra bien que chacune aille se mesurer avec elle ; ce qui fera qu’elles se régleront à peu près entr’elles comme elles se sont mesurées avec la nation principale.
[III-49]
Dans l’état actuel de l’univers, c’est la Hollande [1] qui est cette nation dont nous parlons. Examinons le change par rapport à elle.
Il y a en Hollande une monnoie qu’on appelle un florin : le florin vaut vingt sous, ou quarante demi-sous, ou gros. Pour simplifier les idées, imaginons qu’il n’y a point de florins en Hollande, & qu’il n’y ait que des gros : un homme qui aura mille florins, aura quarante mille gros, ainsi du reste. Or le change avec la Hollande, consiste à savoir combien vaudra de gros chaque piece de monnoie des autres pays ; & comme l’on compte ordinairement en France par écu de trois livres, le change demandera combien un écu de trois livres vaudra de gros. Si le change est à cinquante-quatre gros, l'écu de trois livres vaudra cinquante-quatre gros ; s’il est à soixante, il vaudra soixante gros ; si l’argent est rare en France, l’écu de trois livres vaudra plus de gros ; s’il est en abondance, il vaudra moins de gros.
Cette rareté ou cette abondance d’où [III-50] résulte la mutation du change, n’est pas la rareté ou l’abondance réelle ; c’est une rareté ou une abondance relative : par exemple, quand la France a plus besoin d’avoir des fonds en Hollande, que les Hollandois n’ont besoin d’en avoir en France, l’argent est appellé commun en France, & rare en Hollande, & vice versâ.
Supposons que le change avec la Hollande soit à cinquante-quatre. Si la France & la Hollande ne composoient qu’une ville, on feroit comme l’on fait quand on donne la monnoie d’un écu : le François tireroit de sa poche trois livres, & le Hollandois tireroit de la sienne cinquante-quatre gros. Mais comme il y a de la distance entre Paris & Amsterdam, il faut que celui qui me donne pour mon écu de trois livres cinquante-quatre gros qu’il a en Hollande, me donne une lettre de change de cinquante-quatre gros sur la Hollande. Il n’est plus ici question de cinquante-quatre gros, mais d’une lettre de cinquante-quatre gros. Ainsi pour juger [2] de la rareté [III-51] ou de l’abondance de l’argent, il faut savoir s’il y a en France plus de lettres de cinquante-quatre gros destinées pour la France, qu’il n’y a d’écus destinés pour la Hollande. S’il y a beaucoup de lettres offertes par les Hollandois & peu d’écus offerts par les François, l’argent est rare en France & commun en Hollande ; & il faut que le change hausse, & que pour mon écu on me donne plus de cinquante-quatre gros ; autrement je ne le donnerois pas, & vice versâ.
On voit que les diverses opérations du change forment un compte de recette & de dépense qu’il faut toujours solder ; & qu’un état qui doit, ne s’acquitte pas plus avec les autres par le change, qu’un particulier ne paye une dette en changeant de l’argent.
Je suppose qu’il n’y ait que trois états dans le monde, la France, l’Espagne & la Hollande ; que divers particuliers d’Espagne dussent en France la valeur de cent mille marcs d’argent, & que divers particuliers de France dussent en Espagne cent dix mille marcs ; & que quelque circonstance fît que chacun, en Espagne & en France, voulût tout-à-coup retirer son argent : que feroient les [III-52] opérations du change ? Elles acquitteroient réciproquement ces deux nations de la somme de cent mille marcs : mais la France devroit toujours dix mille marcs en Espagne, & les Espagnols auroient toujours des lettres sur la France pour dix mille marcs ; & la France n’en auroit point du tout sur l’Espagne.
Que si la Hollande étoit dans un cas contraire avec la France, & que pour solde elle lui dût dix mille marcs, la France pourroit payer l’Espagne de deux manieres, ou en donnant à ses créanciers en Espagne des lettres sur ses débiteurs de Hollande pour dix mille marcs, ou bien en envoyant dix mille marcs d’argent en especes en Espagne.
Il suit de-là, que quand un état a besoin de remettre une somme d’argent dans un autre pays, il est indifférent par la nature de la chose que l’on y voiture de l’argent, ou que l’on prenne des lettres de change. L’avantage de ces deux manieres de payer, dépend uniquement des circonstances actuelles ; il faudra voir ce qui dans ce moment, donnera plus de gros en Hollande, ou l’argent porté en especes [3] , ou une [III-53] lettre sur la Hollande, de pareille somme.
Lorsque même titre & même poids d’argent en France me rendent même poids & même titre d’argent en Hollande, on dit que le change est au pair. Dans l’état actuel des monnoies, [4] le pair est à-peu-près à cinquante-quatre gros par écu : lorsque le change sera au dessus de cinquante-quatre gros, on dira qu’il est haut ; lorsqu’il sera au dessous, on dira qu’il est bas.
Pour savoir si, dans une certaine situation du change, l’état gagne ou perd ; il faut le considérer comme débiteur, comme créancier, comme vendeur, comme acheteur. Lorsque le change est plus bas que le pair, il perd comme débiteur, il gagne comme créancier ; il perd comme acheteur, il gagne comme vendeur. On sent bien qu’il perd comme débiteur : par exemple, la France devant à la Hollande un certain nombre de gros, moins son écu vaudra de gros, plus il lui faudra d’écus pour payer : au contraire, si la France est créanciere d’un certain nombre de gros, moins chaque écu vaudra de gros, plus elle [III-54] recevra d’écus. L’état perd encore comme acheteur ; car il faut toujours le même nombre de gros pour acheter la même quantité de marchandises ; & lorsque le change baisse, chaque écu de France donne moins de gros. Par la même raison, l’état gagne comme vendeur : je vends ma marchandise en Hollande le même nombre de gros que je la vendois ; j’aurois donc plus d’écus en France, lorsqu’avec cinquante gros je me procurerai un écu, que lorsqu’il m’en faudra cinquante-quatre pour avoir ce même écu : le contraire de tout ceci arrivera à l’autre état. Si la Hollande doit un certain nombre d’écus, elle gagnera ; & si on les lui doit, elle perdra ; si elle vend, elle perdra ; si elle achete, elle gagnera.
Il faut pourtant suivre ceci : lorsque le change est au dessous du pair, par exemple, s’il est à cinquante au lieu d’être à cinquante-quatre, il devroit arriver que la France envoyant par le change cinquante-quatre mille écus en Hollande, n’acheteroit de marchandises que pour cinquante mille ; & que d’un autre côté la Hollande envoyant la valeur de cinquante mille écus en [III-55] France, en acheteroit pour cinquante-quatre mille ; ce qui ferois une différence de huit cinquante-quatriemes, c’est-à-dire, de plus d’un septieme de perte pour la France ; de sorte qu’il faudroit envoyer en Hollande un septieme de plus en argent ou en marchandises, qu’on ne faisoit lorsque le change étoit au pair : & le mal augmentant toujours, parce qu’une pareille dette feroit encore diminuer le change, la France seroit à la fin ruinée. Il semble, dis-je, que cela devoit être ; & cela n’est pas, à cause du principe que j’ai déjà établi ailleurs [5] , qui est que les états tendent toujours à se mettre dans la balance, & à se procurer leur libération ; ainsi ils n’empruntent qu’à proportion de ce qu’ils peuvent payer, & n’achetent qu’à mesure qu’ils vendent. Et en prenant l’exemple ci-dessus, si le change tombe en France de cinquante-quatre à cinquante, le Hollandois qui achetoit des marchandises de France pour mille écus, & qui les payoit cinquante-quatre mille gros, ne les payeroit plus que cinquante mille, si le François y vouloit consentir : mais la marchandises de France haussera [III-56] insensiblement, le profit se partagera entre le François & le Hollandois ; car, lorsqu’un négociant peut gagner, il partage aisément son profit ; il se fera donc une communication de profit entre le François & le Hollandois. De la même maniere, le François qui achetoit des marchandises de Hollande pour cinquante-quatre mille gros, & qui les payoit avec mille écus lorsque le change étoit à cinquante-quatre, seroit obligé d’ajouter quatre cinquante-quatriemes de plus en écus de France, pour acheter les mêmes marchandises ; mais le marchand François qui sentira la perte qu’il feroit, voudra donner moins de la marchandise de Hollande ; il se fera donc une communication de perte entre le marchand François & le marchand Hollandois, l’état se mettra insensiblement dans la balance, & l’abaissement du change n’aura pas tous les inconvéniens qu’on devoit craindre.
Lorsque le change est plus bas que le pair, un négociant peut, sans diminuer sa fortune, remettre ses fonds dans les pays étrangers, parce qu’en les faisant revenir, il regagne ce qu’il a perdu : mais un prince qui n’envoie dans les [III-57] pays étrangers qu’un argent qui ne doit jamais revenir, perd toujours.
Lorsque les négocians font beaucoup d’affaires dans un pays, le change y hausse infailliblement. Cela vient de ce qu’on y prend beaucoup d’engagemens, & qu’on y achete beaucoup de marchandises ; & l’on tire sur le pays étranger pour les payer.
Si un prince fait un grand amas d’argent dans son état, l’argent y pourra être rare réellement, & commun relativement ; par exemple, si dans le même temps cet état avoit à payer beaucoup de marchandises dans le pays étranger, le change baisseroit, quoique l’argent fût rare.
Le change de toutes les places tend toujours à se mettre à une certaine proportion, & cela est dans la nature de la chose même. Si le change de l’Irlande à l’Angleterre est plus bas que le pair, & que celui de l’Angleterre à la Hollande soit aussi plus bas que le pair, celui de l’Irlande à la Hollande sera encore plus bas, c’est-à-dire, en raison composée de celui d’Irlande à l’Angleterre, & de celui de l’Angleterre à la Hollande ; car un Hollandois qui peut faire venir ses [III-58] fonds indirectement d’Irlande par l’Angleterre, ne voudra pas payer plus cher pour les faire venir directement. Je dis que cela devroit être ainsi ; mais cela n’est pourtant pas exactement ainsi ; il y a toujours des circonstances qui font varier ces choses ; & à la différence du profit qu’il y a à tirer par une place, ou à tirer par une autre, fait l’art & l’habileté particuliere des banquiers, dont il n’est point question ici.
Lorsqu’un état hausse sa monnoie ; par exemple, lorsqu’il appelle six livres ou deux écus, ce qu’il n’appelloit que trois livres ou un écu, cette dénomination nouvelle, qui n’ajoute rien de réel à l’écu, ne doit pas procurer un seul gros de plus par le change. On ne devroit avoir pour les deux écus nouveaux que la même quantité de gros que l’on recevoit pour l’ancien ; & si cela n’est pas, ce n’est point l’effet de la fixation en elle-même, mais de celui qu’elle produit comme nouvelle, & de celui qu’elle a comme subite. Le change tient à des affaires commencées, & ne se met en regle qu’après un certain temps.
Lorsqu’un état, au lieu de hausser simplement sa monnoie par une loi, fait [III-59] une nouvelle refonte, afin de faire d’une monnoie forte une monnoie plus foible, il arrive que, pendant le temps de l’opération, il y a deux sortes de monnoie, la forte qui est la vieille, & la foible qui est la nouvelle ; & comme la forte est décriée & ne se reçoit qu’à la monnoie, & que par conséquent les lettres de change doivent se payer en especes nouvelles, il semble que le change devroit se régler sur l’espece nouvelle. Si, par exemple, l’affoiblissement en France étoit de moitié, & que l’ancien écu de trois livres donnât soixante gros en Hollande, le nouvel écu ne devroit donner que trente gros ; d’un autre côté, il semble que le change devroit se régler sur la valeur de l’espece vieille, parce que le banquier qui a de l’argent & qui prend des lettres, est obligé d’aller porter à la monnoie des especes vieilles pour en avoir de nouvelles sur lesquelles il perd : le change se mettra donc entre la valeur de l’espece nouvelle & celle de l’espece vieille ; la valeur de l’espece vieille tombe, pour ainsi dire, & parce qu’il y a déjà dans le commerce de l’espece nouvelle, & parce que le banquier ne peut pas tenir rigueur, ayant [III-60] intérêt de faire sortir promptement l’argent vieux de sa caisse pour le faire travailler, & y étant même forcé pour faire ses paiemens : d’un autre côté, la valeur de l’espece nouvelle s’éleve, pour ainsi dire, parce que le banquier avec de l’espece nouvelle se trouve dans une circonstance où nous allons faire voir qu’il peut avec un grand avantage s’en procurer de la vieille : le change se mettra donc, comme j’ai dit, entre l’espece nouvelle & l’espece vieille. Pour lors les banquiers ont du profit à faire sortir l’espece vieille de l’état, parce qu’ils se procurent par là le même avantage que donneroit un change réglé sur l’espece vieille, c’est-à-dire, beaucoup de gros en Hollande, & qu’ils ont un retour en change réglé entre l’espece nouvelle & l’espece vieille, c’est-à-dire plus bas ; ce qui procure beaucoup d’écus en France.
Je suppose que trois livres d’espece vieille rendent par le change actuel quarante-cinq gros, & qu’en transportant ce même écu en Hollande, on en ait soixante ; mais avec une lettre de quarante-cinq gros, on se procurera un écu de trois livres en France, lequel [III-61] transporté en especes vieilles en Hollande, donnera encore soixante gros : toute l’espece vieille sortira donc de l’état qui fait la refonte, & le profit en sera pour les banquiers.
Pour remédier à cela, on sera forcé de faire une opération nouvelle. L’état qui fait la refonte, enverra lui-même une grande quantité d’especes vieilles chez la nation qui regle le change ; & s’y procurant un crédit, il fera monter le change au point qu’on aura, à peu de chose près, autant de gros par le change d’un écu de trois livres, qu’on en auroit en faisant sortir un écu de trois livres en especes vieilles hors du pays. Je dis à peu de chose près, parce que, lorsque le profit sera modique, on ne sera point tenté de faire sortir l’espece, à cause des frais de la voiture, & des risques de la confiscation.
Il est bon de donner ici une idée bien claire de ceci. Le sieur Bernard, ou tout autre banquier que l’état voudra employer, propose ses lettres sur la Hollande, & les donne à un, deux, trois gros plus haut que le change actuel ; il a fait une provision dans les pays étrangers, par le moyen des especes [III-62] vieilles qu’il a fait continuellement voiturer : il a donc fait hausser le change au point que nous venons de dire : cependant, à force de donner de ses lettres, il se saisit de toutes les especes nouvelles, & force les autres banquiers qui ont des paiemens à faire, à porter leurs especes vieilles à la monnoie ; & de plus, comme il a eu insensiblement tout l’argent, il contraint à leur tour les autres banquiers à lui donner des lettres à un change très-haut : le profit de la fin l’indemnise en grande partie de la perte du commencement.
On sent que, pendant toute cette opération, l’état doit souffrir une violente crise. L’argent y deviendra très-rare ; 1°. parce qu’il faut en décrier la plus grande partie ; 2°. parce qu’il en faudra transporter une partie dans les pays étrangers ; 3°. Parce que tout le monde le resserrera, personne ne voulant laisser au prince un profit qu’on espere avoir soi-même. Il est dangereux de la faire avec lenteur : il est dangereux de la faire avec promptitude. Si le gain qu’on suppose est immodéré, les inconvéniens augmentent à mesure.
On a vu ci-dessus que, quand le [III-63] change étoit plus bas que l’espece, il y avoit du profit à faire sortir l’argent : par la même raison, lorsqu’il est plus haut que l’espece, il y a du profit à le faire revenir.
Mais il y a un cas où on trouve du profit à faire sortir l’espece, quoique le change soit au pair : c’est lorsqu’on l’envoie dans les pays étrangers, pour la faire remarquer ou refondre. Quand elle est revenue, on fait, soit qu’on l’emploie dans le pays, soit qu’on prenne des lettres pour l’étranger, le profit de la monnoie.
S’il arrivoit que dans un état on fît une compagnie qui eût un nombre très-considérable d’actions, & qu’on eût fait dans quelques mois de temps hausser ces actions vingt ou vingt-cinq fois au-delà de la valeur du premier achat, & que ce même état eût établi une banque dont les billets dussent faire la fonction de monnoie, & que la valeur numéraire de ces billets fût prodigieuse pour répondre à la prodigieuse valeur numéraire des actions (c’est le systême de M. Law), il suivroit de la nature de la chose que ces actions & billets s’anéantiroient de la même maniere qu’ils se seroient établis.
[III-64] On n’auroit pu faire monter tout-à-coup les actions vingt ou vingt-cinq fois plus haut que leur premiere valeur, sans donner à beaucoup de gens le moyen de se procurer d’immenses richesses en papier : chacun chercheroit à assurer sa fortune ; & comme le change donne la voie la plus facile pour la dénaturer, ou pour la transporter où l’on veut, on remettroit sans cesse une partie de ses effets chez la nation qui regle le change. Un projet continuel de remettre dans les pays étrangers, feroit baisser le change. Supposons que, du temps du systême, dans le rapport du titre & du poids de la monnoie d’argent, le taux du change fût de quarante gros par écu ; lorsqu’un papier innombrable fut devenu monnoie, on n’aura plus voulu donner que trente-neuf gros par écu, ensuite que trente-huit, trente-sept, &c. Cela alla si loin, que l’on ne donna plus que huit gros, & qu’enfin il n’y eut plus de change.
C’étoit le change qui devoit en ce cas régler en France la proportion de l’argent avec le papier. Je suppose que, par le poids & le titre de l’argent, l’écu de trois livres d’argent valût quarante [III-65] gros, & que le change se faisant en papier, l’écu de trois livres en papier ne valût que huit gros, la différence étoit de quatre cinquiemes. L’écu de trois livres en papier valoit donc quatre cinquiemes de moins que l’écu de trois livres en argent.
-
[↑] Les Hollandois reglent le change de presque toute l’Europe par une espece de délibération entr’eux, selon qu’il convient à leurs intérêts.
-
[↑] Il y a beaucoup d’argent dans une place, lorsqu’il y a plus d’argent que de papier ; il y en a peu, lorsqu’il y a plus de papier que d’argent.
-
[↑] Les frais de la voiture & de l’assurance déduits.
-
[↑] En 1744.
-
[↑] Voyez le livre XX. Chap. xxi.
[III-65]
CHAPITRE XI.
Des opérations que les Romains firent sur les monnoies.
Quelques coups d’autorité que l’on ait faits de nos jours en France sur les monnoies dans deux ministeres consécutifs, les romains en firent de plus grands, non pas dans le temps de cette république corrompue, ni dans celui de cette république qui n’étoit qu’une anarchie ; mais lorsque, dans la force de son institution, par sa sagesse comme par son courage, après avoir vaincu les villes d’Italie, elle disputoit l’empire aux Carthaginois.
Et je suis bien aise d’approfondir un peu cette matiere, afin qu’on ne fasse pas un exemple de ce qui n’en est point un.
[III-66]
Dans la premiere guerre Punique [1] l’as qui devoit être de douze onces de cuivre, n’en pesa plus que deux ; & dans la seconde, il ne fut plus que d’une. Ce retranchement répond à ce que nous appellons aujourd’hui augmentation des monnoies : ôter d’un écu de six livres la moitié de l’argent pour en faire deux, ou le faire valoir douze livres, c’est précisément la même chose.
Il ne nous reste point de monument de la maniere dont les Romains firent leur opération dans la premiere guerre Punique : mais ce qu’ils firent dans la seconde, nous marque une sagesse admirable. La république ne se trouvoit point en état d’acquitter ses dettes ; l’as pesoit deux onces de cuivre ; & le denier valant dix as, valoit vingt onces de cuivre. La république fit des as [2] d’une once de cuivre, elle gagna la moitié sur ses créanciers, elle paya un denier avec ces dix onces de cuivre. Cette opération donna une grande secousse à l’état, il falloit la donner la moindre qu’il étoit possible ; elle contenoit une injustice, il falloit qu’elle fut la moindre qu’il étoit [III-67] possible ; elle avoit pour objet la libération de la république envers ses citoyens, il ne falloit donc pas qu’elle eût celui de la libération des citoyens entr’eux : cela fit faire une seconde opération ; & l’on ordonna que le denier qui n’avoit été jusques-là que dix as, en contiendroit seize ; il résulta de cette double opération, que, pendant que les créanciers de la république perdoient la moitié [3] , ceux des particuliers ne perdoient qu’un cinquieme [4] , les marchandises n’augmentoient que d’un cinquieme, le changement réel dans la monnoie n’étoit que d’un cinquieme : on voit les autres conséquences.
Les Romains se conduisirent donc mieux que nous, qui dans nos opérations, avons enveloppé & les fortunes publiques & les fortunes particulieres. Ce n’est pas tout : on va voir qu’ils les firent dans des circonstances plus favorables que nous.
-
[↑] Pline, hist. Nat. XXXIII. art. 13.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ils recevoient dix onces de cuivre pour vingt.
-
[↑] Ils recevoient seize onces de cuivre pour vingt.
[III-68]
CHAPITRE XII.
Circonstances dans lesquelles les Romains firent leurs opérations sur la monnoie.
Il y avoit anciennement très-peu d’or & d’argent en Italie ; ce pays a peu ou point de mines d’or & d’argent : lorsque Rome fut prise pas les Gaulois, il ne s’y trouva que mille livres d’or [1] . Cependant les Romains avoient saccagé plusieurs villes puissantes, & ils en avoient transporté les richesses chez eux. Ils ne se servirent long-temps que de monnoie de cuivre : ce ne fut qu’après la paix de Pyrrhus, qu’ils eurent assez d’argent pour en faire de la monnoie [2] : ils firent des deniers de ce métal, qui valoient dix as [3] , ou dix livres de cuivre : pour lors la proportion de l’argent au cuivre étoit comme 1 à 960 ; car le denier Romain valant dix as ou dix livres de cuivre, il valoit cent vingt onces de cuivre ; & le même denier [III-69] valant un huitieme [4] d’once d’argent, cela faisoit la proportion que nous venons de dire.
Romme devenue maîtresse de cette partie de l’Italie la plus voisine de la Grece & de la Sicile, se trouva peu à peu entre deux peuples riches, les Grecs & les Carthaginois ; l’argent augmenta chez elle ; & la proportion de 1 à 960 entre l’argent & le cuivre ne pouvant plus se soutenir, elle fit diverses opérations sur les monnoies que nous ne connoissons pas. Nous savons seulement qu’au commencement de la seconde guerre Punique, le denier [5] Romain ne valoit plus que vingt onces de cuivre ; & qu’ainsi la proportion entre l’argent & le cuivre n’étoit plus que comme 1 à 160 ; la réduction étoit bien considérable, puisque la république gagna cinq sixiemes sur toute la monnoie de cuivre : mais on ne fit que ce que demandoit la nature des choses, & rétablir la proportion entre les métaux qui servoient la monnaie.
La paix qui termina la premiere [III-70] guerre Punique, avoit laissé les Romains maîtres de la Sicile. Bientôt ils entrerent en Sardaigne, ils commencerent à connoître l’Espagne : la masse de l’argent augmenta encore à Rome ; on y fit l’opération qui réduisit [6] le denier d’argent de vingt onces à seize ; & elle eut cet effet, qu’elle remit en proportion l’argent & le cuivre ; cette proportion étoit comme 1 est à 160, elle fut comme 1 est à 128.
Examinez les Romains, vous ne les trouverez jamais si supérieurs, que dans le choix des circonstances dans lesquelles ils firent les biens & les maux.
-
[↑] Pline, livre XXXIII. art. 5.
-
[↑] Freinshemius, liv. V. de la seconde décade.
-
[↑] Ibid. loco citato : Ils frapperent aussi, dit le même Auteur, des demis, appellés quinaires, & des quarts appellés sesterces.
-
[↑] Un huitieme selon Budée, un septieme selon d’autres Auteurs.
-
[↑] Pline, hist.nat. liv. XXXIII. art. 13.
-
[↑] Pline, hist. nat. liv. XXXIII. art. 13.
[III-70]
CHAPITRE XIII.
Opérations sur les monnoies du temps des Empereurs.
Dans les opérations que l’on fit sur les monnoies du temps de la république, on procéda par voie de retranchement : l’état confioit au peuple ses besoins, & ne prétendoit pas le séduire. Sous les empereurs, on procéda par voie d’alliage : ces princes [III-71] réduits au désespoir par leurs libéralités mêmes, se virent obligés d’altérer les monnoies ; voie indirecte qui diminuoit le mal, & sembloit ne le pas toucher : on retiroit une partie du don, & on cachoit la main ; & sans parler de diminution de la paye ou des largesses, elles se trouvoient diminuées.
On voit encore dans les cabinets [1] des médailles qu’on appelle fourrées, qui n’ont qu’une lame d’argent qui couvre le cuivre. Il est parlé de cette monnoie dans un fragment du Livre 77 de Dion [2] .
Didius Julien commença l’affoiblissement. On trouve que la monnoie [3] de Caracalla avoit plus de la moitié d’alliage, celle d’Alexandre Sévere [4] les deux tiers : l’affoiblissement continua ; & sous Gallien [5] , on ne voyoit plus que du cuivre argenté.
On sent que ces opérations violentes ne sauroient avoir lieu dans ces [III-72] temps-ci ; un prince se tromperoit lui-même, & ne tromperoit personne. Le change a appris au banquier à comparer toutes les monnoies du monde, & à les mettre à leur juste valeur ; le titre des monnoies ne peut plus être un secret. Si un prince commence le billon, tout le monde continue, & le fait pour lui ; les especes fortes sortent d’abord, & on les lui renvoie foibles. Si, comme les empereurs Romains, ils affoiblissoit l’argent sans affoiblir l’or, il verroit tout à coup disparoître l’or, & il seroit réduit à son mauvais argent. Le change, comme j’ai dit au Livre précédent [6] , a ôté les grands coups d’autorité, ou du moins le succès des grands coups d’autorité.
-
[↑] Voyez la science des médailles du P. Joubert, édition de Paris, 1730, pag. 59.
-
[↑] Extrait des vertus & des vices.
-
[↑] Voyez Savotte, part. 2. chap. xii ; & le Journal des Savans du 28 Juillzr 1681, sur une découverte de 50000 médailles.
-
[↑] Voyez Savotte, ibid.
-
[↑] Idem, ibid
-
[↑] Chapitre XVI.
[III-72]
CHAPITRE XIV.
Comment le change gêne les états despotiques.
La Moscovie voudroit descendre de son despotisme, & ne le peut. L’établissement du commerce demande celui du change ; & les opérations du change contredisent toutes ses lois.
[III-73]
En 1745, la Czarine fit une ordonnance pour chasser les Juifs, parce qu’ils avoient remis dans les pays étrangers l’argent de ceux qui étoient relégués en Sibérie, & celui des étrangers qui étoient au service. Tous les sujets de l’empire, comme des esclaves, n’en peuvent sortir, ni faire sortir leurs biens sans permission. Le change qui donne le moyen de transporter l’argent d’un pays à un autre, est donc contradictoire aux lois de Moscovie.
Le commerce même contredit ses lois. Le peuple n’est composé que d’esclaves attachés aux terres, & d’esclaves qu’on appelle ecclésiastiques ou gentilshommes, parce qu’ils sont les seigneurs de ces esclaves : il ne reste donc guere personne pour le tiers-état, qui doit former les ouvriers & les marchands.
[III-74]
CHAPITRE XV.
Usage de quelques pays d’Italie.
Dans quelques pays d’Italie on a fait des lois pour empêcher les sujets de vendre des fonds de terre pour transporter leur argent dans les pays étrangers. Ces lois pouvoient être bonnes, lorsque les richesses de chaque état étoient tellement à lui, qu’il y avoit beaucoup de difficulté à les faire passer à un autre. Mais depuis que, par l’usage du change, les richesses ne sont en quelque façon à aucun état en particulier, & qu’il y a tant de facilité à les transporter d’un pays à un autre, c’est une mauvaise loi que celle qui ne permet pas de disposer pour ses affaires de ses fonds de terre, lorsqu’on peut disposer de son argent. Cette loi est mauvaise, parce qu’elle donne de l’avantage aux effets mobiliers sur les fonds de terre, parce qu’elle dégoûte les étrangers de venir s’établir dans le pays, & enfin parce qu’on peut l’éluder.
[III-75]
CHAPITRE XVI.
Du secours que l’état peut tirer des banquiers.
Les banquiers sont faits pour changer de l’argent, & non pas pour en prêter. Si le prince ne s’en sert que pour changer son argent, comme il ne fait que de grosses affaires, le moindre profit qu’il leur donne pour leurs remises devient un objet considérable ; & si on lui demande de gros profits, il peut être sûr que c’est un défaut de l’administration. Quand au contraire ils sont employés à faire des avances, leur art consiste à se procurer de gros profits de leur argent, sans qu’on puisse les accuser d’usure.
[III-75]
CHAPITRE XVII.
Des dettes publiques.
Quelques gens ont cru qu’il étoit bon qu’un état dût à lui-même : ils ont pensé que cela multiplioit les richesses, en augmentant la circulation.
Je crois qu’on a confondu un papier [III-76] circulant qui représente la monnoie, ou un papier circulant qui est le signe des profits qu’une compagnie a faits ou fera sur le commerce, avec un papier qui représente une dette. Les deux premiers sont très-avantageux à l’état : le dernier ne peut l’être ; & tout ce qu’on peut en attendre, c’est qu’il soit un bon gage pour les particuliers de la dette de la nation, c’est-à-dire, qu’il en procure le payement. Mais voici les inconvéniens qui en résultent.
1°. Si les étrangers possedent beaucoup de papiers qui représentent une dette, ils tirent tous les ans de la nation une somme considérable pour les intérêts.
2°. Dans une nation ainsi perpétuellement débitrice, le change doit être très-bas.
3°. L’impôt levé pour le payement des intérêts de la dette, fait tort aux manufactures, en rendant la main de l’ouvrier plus chere.
4°. On ôte les revenus véritables de l’état à ceux qui ont de l’activité & de l’industrie, pour les transporter aux gens oisifs ; c’est-à-dire, qu’on donne des commodités pour travailler à ceux qui [III-77] ne travaillent point, & des difficultés pour travailler à ceux qui travaillent.
Voilà les inconvéniens ; je n’en connois point les avantages. Dix personnes ont chacune mille écus de revenu en fonds de terre ou en industrie ; cela fait pour la nation, à cinq pour cent, un capital de deux cents mille écus. Si ces dix personnes emploient la moitié de leur revenu, c’est-à-dire cinq mille écus, pour payer les intérêts de cent mille écus qu’elles ont empruntés à d’autres, cela ne fait encore pour l’état que deux cents mille écus : c’est, dans le langage des algébristes, 200000 écus - 100000 écus + 100000 écus = 200000 écus.
Ce qui peut jeter dans l’erreur, c’est qu’un papier qui représente la dette d’une nation, est un signe de richesse ; car il n’y a qu’un état riche qui puisse soutenir un tel papier sans tomber dans la décadence : que s’il n’y tombe pas, il faut que l’état ait de grandes richesses d’ailleurs. On dit qu’il n’y a point de mal, parce qu’il y a des ressources contre ce mal ; & on dit que le mal est un bien, parce que les ressources surpassent le mal.
[III-78]
CHAPITRE XVIII.
Du payement des dettes publiques.
Il faut qu’il y ait une proportion entre l’état créancier & l’état débiteur. L’état peut être créancier à l’infini, mais il ne peut être débiteur qu’à un certain degré ; & quand on est parvenu à passer ce degré, le titre de créancier s’évanouit.
Si cet état a encore un crédit qui n’ait point reçu d’atteinte, il pourra faire ce qu’on a pratiqué si heureusement dans un état [1] d’Europe ; c’est de se procurer une grande quantité d’especes, & d’offrir à tous les particuliers leur remboursement, à moins qu’ils ne veuillent réduire l’intérêt. En effet, comme, lorsque l’état emprunte, ce sont les particuliers qui fixent le taux de l’intérêt ; lorsque l’état veut payer, c’est à lui à le fixer.
Il ne suffit pas de réduire l’intérêt : il faut que le bénéfice de la réduction forme un fonds d’amortissement pour payer chaque année une partie des capitaux ; [III-79] opération d’autant plus heureuse, que le succès en augmente tous les jours.
Lorsque le crédit de l’état n’est pas entier, c’est une nouvelle raison pour chercher à former un fonds d’amortissement ; parce que ce fonds un fois établi rend bientôt la confiance.
1°. Si l’état est une république, dont le gouvernement comporte par sa nature que l’on y fasse des projets pour long-temps, le capital du fonds d’amortissement peut être peu considérable : il faut, dans une monarchie, que ce capital soit plus grand.
2°. Les réglemens doivent être tels, que tous les citoyens de l’état portent le poids de l’établissement de ce fonds, parce qu’ils ont tous les poids de l’établissement de la dette ; le créancier de l’état, par les sommes qu’il contribue, payant lui-même à lui-même.
3°. Il y a quatre classes de gens qui payent les dettes de l’état ; les propriétaires des fonds de terre, ceux qui exercent leur industrie par le négoce, les laboureurs & artisans, enfin les rentiers de l’état ou des particuliers. De ces quatre classes, la derniere, dans un cas de nécessité, sembleroit devoir être la [III-80] moins ménagée ; parce que c’est une classe entiérement passive dans l’état, tandis que ce même état est soutenu par la force active des trois autres. Mais, comme on ne peut la charger plus, sans détruire la confiance publique, dont l’état en général & ces trois classes en particulier ont un souverain besoin ; comme la foi publique ne peut manquer à un certain nombre de citoyens, sans paroître manquer à tous ; comme la classe des créanciers est toujours la plus exposée aux projets des ministres, & qu’elle est toujours sous les yeux & sous la main ; il faut que l’état lui accorde une singuliere protection, & que la partie débitrice n’ait jamais le moindre avantage sur celle qui est créanciere.
-
[↑] L’Angleterre.
[III-80]
CHAPITRE XIX.
Des prêts à intérêts.
L’argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe, doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est, que les autres choses peuvent, ou se louer, ou [III-81] s’acheter ; au lieu que l’argent, qui est le prix des choses, se loue & ne s’achete pas [1] .
C’est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt : mais on sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion, & non une loi civile.
Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l’argent ait un prix, mais que ce prix soit peu considérable. S’il est trop haut, le négociant, qui voit qu’il lui en coûteroit plus en intérêt qu’il ne pourroit gagner dans son commerce, n’entreprend rien ; si l’argent n’a point de prix, personne n’en prête, & le négociant n’entreprend rien non plus.
Je me trompe, quand je dis que personne n’en prête. Il faut toujours que les affaires de la société aillent ; l’usure s’établit, mais avec les désordres que l’on a éprouvés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond l’usure avec le prêt à intérêt. L’usure augmente dans les pays Mahométans à proportion de la sévérité de la défense : le [III-82] prêteur s’indemnise du péril de la contravention.
Dans ces pays d’Orient, la plupart des hommes n’ont rien d’assuré ; il n’y a presque point de rapport entre la possession actuelle d’une somme, & l’espérance de la ravoir après l’avoir prêtée ; l’usure y augmente donc à proportion du péril de l’insolvabilité.
-
[↑] On ne parle point des cas où l’or & l’argent sont considérés comme marchandises.
[III-82]
CHAPITRE XX.
Des usures maritimes.
La grandeur de l’usure maritime est fondée sur deux choses ; le péril de la mer, qui fait qu’on ne s’expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage, & la facilité que le commerce donne à l’emprunteur, de faire promptement de grandes affaires, & en grand nombre : au lieu que les usures de terre n’étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par les législateurs, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.
[III-83]
CHAPITRE XXI.
Du prêt par contrat, & de l’usure chez les Romains.
Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d’où résulte un intérêt ou usure.
Le peuple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats chercherent à le flatter, & à lui faire faire les lois qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux ; il diminua les intérêts ; il défendit d’en prendre ; il ôta les contraintes par corps : enfin l’abolition des dettes fut mise en question toutes les fois qu’un tribun voulut se rendre populaire.
Ces continuels changemens, soit par des lois, soit par des plébiscites, naturaliserent à Rome l’usure ; car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n’eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits ; d’autant plus que, si les lois ne [III-84] venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles & intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter & d’emprunter furent abolis à Rome, & qu’une usure affreuse, toujours foudroyée [1] & toujours renaissante, s’y établit. Le mal venoit de ce que les choses n’avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l’argent, & pour le danger des peines de la loi.
-
[↑] Tacite, annal. liv. VI.
[III-84]
CHAPITRE XXII.
Continuation du même sujet.
Les premiers Romains n’eurent point de lois pour régler le taux de [1] l’usure. Dans les démêlés qui se formerent là-dessus entre les plébéiens & les patriciens, dans la sédition [2] même du mont Sacré, on n’allégua d’un côté que la foi, & de l’autre que la dureté des contrats.
[III-85]
On suivoit donc les conventions particulieres ; & je crois que les plus ordinaires étoient de douze pour cent par an. Ma raison est que dans le langage [3] ancien chez les Romains, l’intérêt à dix pour cent étoit appellé la moitié de l’usure, l’intérêt à trois pour cent le quart de l’usure : l’usure totale étoit donc l’intérêt à douze pour cent.
Que si l’on demande comment de si grosses usures avoient pu s’établir chez un peuple qui étoit presque sans commerce, je dirai que ce peuple, très-souvent obligé d’aller sans solde à la guerre, avoit très-souvent besoin d’emprunter ; & que faisant sans cesse des expéditions heureuses, il avoit très-souvent la facilité de payer. Et cela se sent bien dans le récit des démêlés qui s’éleverent à cet égard : on n’y disconvient point de l’avarice de ceux qui prêtoient ; mais on dit que ceux qui se plaignoient, auroient pu payer s’ils avoient eu une conduite réglée [4] .
[III-86]
On faisoit donc des lois qui n’influoient que sur la situation actuelle : on ordonnoit, par exemple, que ceux qui s’enrôleroient pour la guerre que l’on avoit à soutenir, ne seroient point poursuivis par leurs créanciers ; que ceux qui étoient dans les fers seroient délivrés ; que les plus indigens seroient menés dans les colonies : quelquefois on ouvroit le trésor public. Le peuple s’appaisoit par le soulagement des maux présens ; & comme il ne demandoit rien pour la suite, le sénat n’avoit garde de le prévenir.
Dans le temps que le sénat défendoit avec tant de constance la cause des usures, l’amour de la pauvreté, de la frugalité, de la médiocrité, étoit extrême chez les Romains : mais telle étoit la constitution, que les principaux citoyens portoient toutes les charges de l’état, & que le bas peuple ne payoit rien. Quel moyen de priver ceux-là du droit de poursuivre leurs débiteurs, & de leur demander d’acquitter leurs charges, & de subvenir aux besoins pressans de la république ?
Tacite [5] dit que la loi des douze [III-87] tables fixa l’intérêt à un pour cent par an. Il est visible qu’il s’est trompé, & qu’il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela, comment, dans les disputes qui s’éleverent depuis entre les créanciers & les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt : & pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne devoit point être l’ouvrage des décemvirs.
La loi Licinienne [6] faite quatre-vingt-cinq ans après la loi des douze tables, fut une de ces lois passageres dont nous avons parlé. Elle ordonna qu’on retrancheroit du capital ce qui avoit été payé pour les intérêts, & que le reste seroit acquitté en trois payemens égaux.
L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Menenius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un [7] pour cent par an. C’est cette loi que Tacite [8] [III-88] confond avec la loi des douze tables, & c’est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l’intérêt. Dix ans après [9] , cette usure fut réduite à la moitié [10] ; dans la suite on l’ôta tout-à-fait [11] : & si nous en croyons quelques auteurs qu’avoit vu Tite-Live, ce fut sous le consulat [12] de C. Martius Rutilius & de Q. Servilius, l’an 413 de Rome.
Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès : on trouva un moyen de l’éluder. Il en fallut faire beaucoup d’autres pour la confirmer, corriger, tempérer. Tantôt on quitta les lois pour suivre les usages [13] , tantôt on quitta les usages pour suivre les lois : mais dans ce cas l’usage devoit aisément prévaloir. Quand un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur : cette loi a [III-89] contr’elle, & celui qu’elle secourt, & celui qu’elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis [14] aux débiteurs d’agir en conséquence des lois, fut tué par les créanciers [15] , pour avoir voulu rappeller la mémoire d’une rigidité qu’on ne pouvoit plus soutenir.
Je quitte la ville pour jeter un peu les yeux sur les provinces.
J’ai dit ailleurs [16] , que les provinces Romaines étoient désolées par un gouvernement despotique & dur. Ce n’est pas tout : elle l’étoient encore par des usures affreuses.
Cicéron dit [17] que ceux de Salamine vouloient emprunter de l’argent à Rome, & qu’ils ne le pouvoient pas à cause de la loi Gabinienne. Il faut que je cherche ce que c’étoit que cette loi.
Lorsque les prêts à intérêt eurent été défendus à Rome, on imagina [18] toutes sortes de moyens pour éluder la loi : & comme les alliés [19] & ceux de la [III-90] nation Latine n’étoient point assujettis aux lois civiles des Romains, on se servit d’un Latin, ou d’un allié, qui prêtoit son nom, & paroissoit être le créancier. La loi n’avoir donc fait que soumettre les créanciers à une formalité, & le peuple n’étoit pas soulagé.
Le peuple se plaignit de cette fraude ; & Marcus Sempronius, tribun du peuple, par l’autorité du sénat, fit faire un plébiscite [20] qui portoit, qu’en fait de prêts, les lois qui défendoient les prêts à usure entre un citoyen Romain & un autre citoyen Romain, auroient également lieu entre un citoyen & un allié, ou un Latin.
Dans ces temps-là, on appelloit alliés les peuples de l’Italie proprement dite, qui s’étendoit jusqu’à l’Arno & le Rubicon, & qui n’étoit point gouvernée en provinces Romaines.
Tacite [21] dit qu’on faisoit toujours de nouvelles fraudes aux lois faites pour arrêter les usures. Quand on ne put plus prêter ni emprunter sous le nom d’un allié, il fut aisé de faire paroître un homme des provinces qui prêtoit son nom.
[III-91]
Il falloit une nouvelle loi contre cet abus : & Gabinius [22] faisant la loi fameuse qui avoit pour objet d’arrêter la corruption dans les suffrages, dut naturellement penser que le meilleur moyen pour y parvenir, étoit de décourager les emprunts : ces deux choses étoient naturellement liées ; car les usures augmentoient [23] toujours au temps des élections, parce qu’on avoit besoin d’argent pour gagner des voix. On voit bien que la loi Gabinienne avoit étendu le sénatus-consulte Sempronien aux provinciaux, puisque les Salaminiens ne pouvoient emprunter de l’argent à Rome à cause de cette loi. Brutus, sous des noms empruntés, leur en prêta [24] à quatre pour cent par mois [25] , & obtint pour cela deux sénatus-consultes ; dans le premier desquels il étoit dit que ce prêt ne seroit pas regardé comme une fraude [26] faite à la loi, & que le [III-92] gouverneur de Silicie jugeroit en conformité des conventions portées par le billet des Salaminiens.
Le prêt à intérêt étant interdit par la loi Gabinienne entre les gens des provinces & les citoyens romain, & ceux-ci ayant pour lors tout l’argent de l’univers entre leurs mains, il fallut les tenter par des grosses usures, qui fissent disparoître aux yeux de l’avarice le danger de perdre la dette. Et comme il y avoit à Rome des gens puissans, qui intimidoient les magistrats, & faisoient taire les lois, ils furent plus hardis à prêter & plus hardis à exiger de grosses usures. Cela fit que les provinces furent tour à tour ravagées par tous ceux qui avoient du crédit à Rome ; & comme chaque gouverneur faisoit son édit [27] en entrant dans sa province, dans lequel il mettoit à l’usure le taux qu’il lui plaisoit, l’avarice prêtoit la main à la législation, & la législation à l’avarice.
[III-93]
Il faut que les affaires aillent ; & un état est perdu, si tout y est dans l’inaction. Il y avoit des occasions, où il falloit que les villes, les corps, les sociétés des villes, les particuliers empruntassent : & on n’avoit que trop besoin d’emprunter, ne fût-ce que pour subvenir aux ravages des armées, aux rapines des magistrats, aux concussions des gens d’affaires, & aux mauvais usages qui s’établissoient tous les jours ; car on ne fut jamais si riche, ni si pauvre. Le sénat, qui avoit la puissance exécutrice, donnoit, par nécessité, souvent par faveur, la permission d’emprunter des citoyens Romains, & faisoit là-dessus des sénatus-consultes. Mais ces sénatus-consultes même étoient décrédités par la loi : ces sénatus-consultes [28] pouvoient donner occasion au peuple de demander de nouvelles tables ; ce qui, augmentant le danger de la perte du capital, augmentoit encore l’usure. Je le dirai toujours ; c’est la modération qui gouverne les hommes, & non pas les excès.
[III-94]
Celui-là paye moins, dit Ulpien [29] , qui paye plus tard. C’est ce principe qui conduisit les législateurs après la destruction de la république Romaine.
-
[↑] Usure & intérêt signifioient la même chose chez les Romains.
-
[↑] Voyez Denys d’Halic. qui l’a si bien décrite.
-
[↑] Usuræ semisses, trientes, quadrantes. Voyez là-dessus les divers traités du digeste & du code de usuris ; & sur-tout la loi XVII, avec sa note, au ff. de usuris.
-
[↑] Voyez les discours d’Appius là-dessus, dans Denys d’Halicarnasse.
-
[↑] Annales, liv. VI.
-
[↑] L’an de Rome 388. Tite-Live, liv. VI.
-
[↑] Unciaria usura. Tite-Live, liv. VII. Voyez la défense de l’esprit des lois, art. usure.
-
[↑] Annal. liv. VI.
-
[↑] Sous le consulat de L. Manlius Torquatus, & de C. Plautius, selon Tite-Live, liv. VII. & c’est la loi dont parle Tacite, annal. liv. VI.
-
[↑] Semiunciaria usura.
-
[↑] Comme le dit Tacite, annal. liv. VI.
-
[↑] La loi en fut faite à la poursuite de M. Genucius, tribun du peuple : Tite-Lieve, liv. VII. à la fin.
-
[↑] Veteri jam more fænus receptum erat. Appien, de la guerre civile, liv. I.
-
[↑] Permisit eos legibus agere. Appien, de la guerre civile, livre I ; & l’épitome de Tite-Live, livre LXIV.
-
[↑] L’an de Rome 663.
-
[↑] Liv. XI. Ch. xix.
-
[↑] Lettres à Atticus, liv. V. lett. 27.
-
[↑] Tite-Live.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] L’an 561 de Rome, Voyez Tite-Live.
-
[↑] Annal. Liv. VI.
-
[↑] L’an 615 de Rome.
-
[↑] Voyez les lettres de Cicéron à Atticus, liv. IV. lett. 15 & 16
-
[↑] Cicéron à Atticus, liv. VI. lett. I.
-
[↑] Pompée, qui avoit prêté au roi Ariobarsane six cents talens, se faisoit payer trente-trois talens Attiques tous les trente jours. Cicéron à Atticus, liv. III. lett. 21 : liv. VI, lett. I.
-
[↑] Ut neque Salaminis, neque cui eis dedisset, fraudi esset. Ibid.
-
[↑] L’édit de Cicéron la fixoit à un pour cent par mois, avec l’usure de l’usure au bout de l’an. Quant aux fermiers de la république, il les engageoit à donner un délai à leurs débiteurs : Si ceux-ci ne payoient pas au temps fixé, il adjugeoit l’usure portée par le billet. Cicéron à Atticus, liv VI. lett. I.
-
[↑] Voyez ce que dit Luccéius, lett. 21 à Atticus, liv. V. Il y eut même un Sénatus-Consulte général pour fixer l’usage à un pour cent par mois. Voyez la même lettre.
-
[↑] Leg. XII. ff. de verbor. signif.
[III-95]
LIVRE XXIII.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des hommes & des animaux, par rapport à la multiplication de leur espece.
O Vénus ! ô mere de l’Amour !
Dès le premier jour que ton astre ramene,
Les zéphirs font sentir leur amoureuse haleine ;
La terre orne son sein de brillantes couleurs,
Et l’air est parfumé du doux esprit des fleurs.
On entend les oiseaux frappés de ta puissance,
Par mille sons lascifs célébrer ta présence :
Pour la belle génisse, on voit les fiers taureaux,
Ou bondir dans la plaine, ou traverser les eaux.
Enfin, les habitans des bois & des montagnes,
Des fleuves & des mers, & des vertes campagnes,
Brûlant à ton aspect d’amour & de désir,
S’engagent à peupler par l’attrait du plaisir :
Tant on aime à te suivre, & ce charmant empire
Que donne la beauté sur tout ce qui respire.[1]
Les femelles des animaux ont à peu-près une fécondité constante. Mais dans l’espece humaine, la maniere de [III-96] penser, le caractere, les passions, les fantaisies, les caprices, l’idée de conserver sa beauté, l’embarras de la grossesse, celui d’une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manieres.
-
[↑] Traduction du commencement de Lucrece, par le sieur d’Hesnaut.
[III-96]
CHAPITRE II.
Des mariages.
L’obligation naturelle qu’a le pere de nourrir ses enfans, a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation. Les peuples [1] dont parle Pomponius Mela [2] ne le fixoient que par la ressemblance.
Chez les peuples bien policés, le pere [3] est celui que les lois, par la cérémonie du mariage ont déclaré devoir être tel, parce qu’elles trouvent en lui la personne qu’elles cherchent.
Cette obligation, chez les animaux, est telle que la mere peut ordinairement y suffire. Elle a beaucoup plus d’étendue chez les hommes : leurs enfans ont [III-97] de la raison ; mais elle ne leur vient que par degrés : il ne suffit pas de les nourrir, il faut encore les conduire : déjà ils pourroient vivre, & ils ne peuvent pas se gouverner.
Les conjonctions illicites contribuent peu à la propagation de l’espece. Le pere, qui a l’obligation naturelle de nourrir & d’élever les enfans, n’y est point fixé ; & la mere, à qui l’obligation reste, trouve mille obstacles, par la honte, les remords, la gêne de son sexe, la rigueur des lois : la plupart du temps elle manque de moyens.
Les femmes qui se sont soumises à une prostitution publique, ne peuvent avoir la commodité d’élever leurs enfans. Les peines de cette éducation sont même incompatibles avec leur condition : & elles sont si corrompues, qu’elles ne sauroient avoir la confiance de la loi.
Il suit de tout ceci, que la continence publique est naturellement jointe à la propagation de l’espece.
[III-98]
CHAPITRE III.
De la condition des enfans.
C’est la raison qui dicte que, quand il y a un mariage, les enfans suivent la condition du pere ; & que, quand il n’y en a point, ils ne peuvent concerner que la mere [1] .
-
[↑] C’est pour cela que chez les nations qui ont des esclaves, l’enfant suit presque toujours la condition de la mere.
[III-98]
CHAPITRE IV.
Des familles.
Il est presque reçu par-tout que la femme passe dans la famille du mari. Le contraire est, dans aucun inconvénient, établi à Formose [1] , où le mari va former celle de la femme.
Cette loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup, indépendamment des premiers motifs, à la propagation de l’espece humaine. La famille est une [III-99] sorte de propriété : un homme qui a des enfans du sexe qui ne la perpétue pas, n’est jamais content qu’il n’en ait de celui qui la perpétue.
Les noms qui donnent aux hommes l’idée d’une chose qui semble ne devoir pas périr, sont très-propres à inspirer à chaque famille le désir d’étendre sa durée. Il y a des peuples chez lesquels les noms distinguent les familles : il y en a où ils ne distinguent que les personnes ; ce qui n’est pas si bien.
-
[↑] Le Pere du Halde, tome I. p. 156.
[III-99]
CHAPITRE V.
De divers ordres de femmes légitimes.
Quelquefois les lois & la religion ont établi plusieurs sortes de conjonctions civiles, & cela est ainsi chez les Mahométans, où il y a divers ordres de femmes, dont les enfans se reconnoissent par la naissance dans la maison, ou par des contrats civils, ou même par l’esclavage de la mere, & la reconnoissance subséquente du pere.
Il seroit contre la raison, que la loi flétrît dans les enfans ce qu’elle a approuvé dans le pere : tous ces enfans y [III-100] doivent donc succéder, à moins que quelque raison particuliere ne s’y oppose, comme au Japon, où il n’y a que les enfans de la femme donnée par l’empereur qui succedent. La politique y exige que les biens aue l’empereur donne, ne soient pas trop partagés, parce qu’ils sont soumis à un service, comme étoient autrefois nos fiefs.
Il y a des pays où une femme légitime jouit dans la maison, à-peu-près, des honneurs qu’a dans nos climats une femme unique : là, les enfans des concubines sont censés appartenir à la premiere femme. Cela est ainsi établi à la Chine. Le respect filial [1] , la cérémonie d’un deuil rigoureux ne sont point dus à la mere naturelle, mais à cette mere que donne la loi.
A l’aide d’une telle fiction [2] , il n’y a plus d’enfans bâtards : & dans les pays où cette fiction n’a pas lieu, on voit bien que la loi qui légitime les [III-101] enfans des concubines, est une loi forcée, car ce seroit le gros de la nation qui seroit flétri par la loi. Il n’est pas question non plus dans ces pays d’enfans adultérins. Les séparations des femmes, la clôture, les eunuques, les verroux, rendent la chose si difficile, que la loi la juge impossible. D’ailleurs, le même glaive extermineroit la mere & l’enfant.
-
[↑] Le Pere du Halde, tome II. Page 124.
-
[↑] On distingue les femmes en grandes & petites ; c’est-à-dire, en légitimes ou non ; mais il n’y a point une pareille distinction entre les enfans. C’est la grande doctrine de l’empire, est-il dit dans un ouvrage Chinois, sur la morale, traduit par le même Pere, page 140.
[III-101]
CHAPITRE VI.
Des bâtards dans les divers gouvernemens.
On ne connoît donc guere les bâtards dans les pays où la polygamie est permise ; on les connoît dans ceux où la loi d’une seule femme est établie. Il a fallu, dans ces pays, flétrir le concubinage ; il a donc fallu flétrir les enfans qui en étoient nés.
Dans les républiques où il est nécessaire que les mœurs soient pures, les bâtards doivent être encore plus odieux que dans les monarchies.
On fit peut-être à Rome des dispositions trop dures contre eux. Mais les institutions anciennes mettant tous les citoyens dans la nécessité de se marier, [III-102] les mariages étant d’ailleurs adoucis par la permission de répudier ou de faire divorce, il n’y avoit qu’une très-grande corruption de mœurs qui pût porter au concubinage.
Il faut remarquer que la qualité de citoyen étant considérable dans les démocraties où elle emportoit avec elle la souveraine puissance, il s’y faisoit souvent des lois sur l’état des bâtards, qui avoient moins de rapport à la chose même & à l’honnêteté du mariage, qu’à la constitution particuliere de la république. Ainsi le peuple a quelquefois reçu pour citoyens [1] les bâtards, afin d’augmenter sa puissance contre les grands. Ainsi, à Athenes le peuple retrancha les bâtards du nombre des citoyens, pour avoir une plus grande portion du blé que lui avoit envoyé le roi d’Égypte. Enfin, Aristote [2] nous apprend que, dans plusieurs villes, lorsqu’il n’y avoit pas assez de citoyens, les bâtards succédoient ; & que quand il y en avoit assez, ils ne succédoient pas.
[III-103]
CHAPITRE VII.
Du consentement des peres au mariage.
Le consentement des peres est fondé sur leur puissance, c’est-à-dire, sur leur droit de propriété ; il est encore fondé sur leur amour, sur leur raison, & sur l’incertitude de celle de leurs enfans, que l’âge tient dans l’état d’ignorance, & les passions dans l’état d’ivresse.
Dans les petites républiques ou institutions singulieres dont nous avons parlé, il peut y avoir des lois qui donnent aux magistrats une inspection sur les mariages des enfans des citoyens, que la nature avoit déjà donnée aux peres. L’amour du bien public y peut être tel, qu’il égale ou surpasse tout autre amour. Ainsi Platon vouloit que les magistrats réglassent les mariages : ainsi les magistrats Lacédémoniens les dirigeoient-ils.
Mais, dans les institutions ordinaires, c’est aux peres à marier leurs enfans : leur prudence à cet égard sera toujours au-dessus de toute autre prudence. La nature donne aux peres un désir de procurer à leurs enfans des successeurs, [III-104] qu’ils sentent à peine pour eux-mêmes : dans les divers degrés de progéniture, ils se voient avancer insensiblement vers l’avenir. Mais que seroit-ce, si la vexation & l’avarice alloient au point d’usurper l’autorité des peres ? Écoutons Thomas Gage [1] , sur la conduite des Espagnols dans les Indes.
« Pour augmenter le nombre des gens qui payent le tribut, il faut que tous les Indiens qui ont quinze ans se marient ; & même on a réglé le temps du mariage des Indiens à quatorze ans pour les mâles, & à treize pour les filles. On se fonde sur un canon qui dit, que la malice peut suppléer à l’âge ». Il vit faire un de ces dénombrements : c’étoit, dit-il, une chose honteuse. Ainsi, dans l’action du monde qui doit être la plus libre, les Indiens sont encore esclaves.
-
[↑] Relation de Thomas Gage, page 171.
[III-104]
CHAPITRE VIII.
Continuation du même sujet.
En Angleterre, les filles abusent souvent de la loi, pour se marier à leur fantaisie, sans consulter leurs parens. Je [III-105] ne sait pas si cet usage ne pourroit pas y être plus toléré qu’ailleurs, par la raison que les lois n’y ayant point établi un célibat monastique, les filles n’y ont d’état à prendre que celui du mariage, & ne peuvent s’y refuser. En France, au contraire, où le monachisme est établi, les filles ont toujours la ressource du célibat ; & la loi qui leur ordonne d’attendre le consentement des peres, y pourroit être plus convenable. Dans cette idée, l’usage d’Italie & d’Espagne seroit le moins raisonnable : le monachisme y est établi, & l’on peut s’y marier sans le consentement des peres.
[III-105]
CHAPITRE IX.
Des filles.
Les filles, que l’on ne conduit que par le mariage aux plaisirs & à la liberté, qui ont un esprit qui n’ose penser, un cœur qui n’ose sentir, des yeux qui n’osent voir, des oreilles qui n’osent entendre, qui ne se présentent que pour se montrer stupides, condamnées sans relâche à des bagatelles [III-106] & à des préceptes, sont assez portées au mariage : ce sont les garçons qu’il faut encourager.
[III-106]
CHAPITRE X.
Ce qui détermine au mariage.
Par-tout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage. La nature y porte assez,lorsqu’elle n’est point arrêtée par la difficulté de la subsistance.
Les peuples naissans se multiplient & croissent beaucoup. Ce seroit chez eux une grande incommodité de vivre dans le célibat : ce n’en est point une d’avoir beaucoup d’enfans. Le contraire arrive, lorsque la nation est formée.
[III-106]
CHAPITRE XI.
De la dureté du gouvernement.
Les gens qui n’ont absolument rien, comme les mendians, ont beaucoup d’enfans. C’est qu’ils sont dans le cas des peuples naissans : il n’en coûte [III-107] rien au pere, pour donner son art à ses enfans, qui même sont en naissant des instrumens de cet art. Ces gens, dans un pays riche ou superstitieux, se multiplient, parce qu’ils n’ont pas les charges de la société, mais sont eux-mêmes les charges de la société. Mais les gens qui ne sont pauvres que parce qu’ils vivent dans un gouvernement dur, qui regardent leur champ moins comme le fondement de leur subsistance, que comme un prétexte à la vexation ; ces gens-là, dis-je, font peu d’enfans : ils n’ont pas même leur nourriture ; comment pourroient-ils songer à la partager ? ils ne peuvent se soigner dans leurs maladies ; comment pourroient-ils élever des créatures, qui sont dans une maladie continuelle, qui est l’enfance ?
C’est la facilité de parler, & l’impuissance d’examiner, qui ont fait dire que plus les sujets étoient pauvres, plus les familles étoient nombreuses ; que plus on étoit chargé d’impôts, plus on se mettoit en état de les payer : deux sophismes qui ont toujours perdu, & qui perdront à jamais les monarchies.
La dureté du gouvernement peut aller jusqu’à détruire les sentimens [III-108] naturels, par les sentimens naturels mêmes. Les femmes de l’Amérique [1] ne se faisoient-elles pas avorter, pour que leurs enfans n’eussent pas des maîtres aussi cruels ?
-
[↑] Relation de Thomas Gage, page 58.
[III-108]
CHAPITRE XII.
Du nombre des filles & des garçons dans différens pays.
J’ai déjà dit [1] qu’en Europe il naît un peu plus de garçons que de filles. On a remarqué qu’au Japon [2] , il naissoit un peu plus de filles que de garçons : toutes choses égales, il y aura plus de femmes fécondes au Japon qu’en Europe, & par conséquent plus de peuple.
Des relations [3] disent qu’à Bantam, il y a dix filles pour un garçon : une disproportion pareille, qui feroit que le nombre des familles y seroit au nombre de celles des autres climats comme un est à cinq & demi, seroit excessive. Les familles y pourroient être plus grandes [III-109] à la vérité : mais il y a peu de gens assez aisés pour pouvoir entretenir une si grande famille.
-
[↑] Au livre XVI. chap. iv.
-
[↑] Voyez Kempfer, qui rapporte un dénombrement de Méaco.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la Compagnie des Indes, tome I. p. 347.
[III-109]
CHAPITRE XIII.
Des ports de mer.
Dans les ports de mer, où les hommes s’exposent à mille dangers, & vont mourir ou vivre dans des climats reculés, il y a moins d’hommes que de femmes ; cependant on y voit plus d’enfans qu’ailleurs : cela vient de la facilité de la subsistance. Peut-être même que les parties huileuses du poisson sont plus propres à fournir cette matiere qui sert à la génération. Ce seroit une des causes de ce nombre infini de peuple qui est au Japon [1] & à la Chine [2] , où l’on ne vit presque que de poisson [3] . Si cela étoit, de certaines regles monastiques, qui obligent de vivre de poisson, seroient contraires à l’esprit du législateur même.
-
[↑] Le Japon est composé d’îles ; il y a beaucoup de rivages, & la mer y est très poissonneuse.
-
[↑] La Chine est pleine de ruisseaux.
-
[↑] Voyez le Pere du Halde, tome II. Pag. 139, 142 & suivantes.
[III-110]
CHAPITRE XIV.
Des productions de la terre qui demandent plus ou moins d’hommes.
Les pays de pâturages sont peu peuplés, parce que peu de gens y trouvent de l’occupation ; les terres à blé occupent plus d’hommes, & les vignobles infiniment davantage.
En Angleterre [1] on s’est souvent plaint que l’augmentation des pâturages diminuoit les habitans ; & on observe en France, que la grande quantité de vignobles y est une des grandes causes de la multitude des hommes.
Les pays où des mines de charbon fournissent des matieres propres à brûler, ont cet avantages sur les autres, qu’il n’y faut point de forêt, & que toutes les terres peuvent être cultivées.
Dans les lieux où croît le riz, il faut de grands travaux pour ménager les [III-111] eaux : beaucoup de gens y peuvent donc être occupés. Il y a plus : il faut moins de terre pour fournir à la subsistance d’une famille, que dans ceux qui produisent d’autres grains : enfin la terre qui est employée ailleurs à la nourriture des animaux, y sert immédiatement à la subsistance des hommes ; le travail que font ailleurs les animaux, est fait là par les hommes ; & la culture des terres devient pour les hommes une immense manufacture.
-
[↑] La plupart des propriétaires des fonds de terres, dit Burnet, trouvant plus de profit en la vente de leur laine, que de leur blé, enfermerent leurs possessions ; les communes, qui mouroient de faim, se souleverent : on proposa une loi agraire ; le jeune roi écrivit même là-dessus : on fit des proclamations contre ceux qui avoient renfermé leurs terres. Abrégé de l’histoire de la réforme, pag. 44 & 83.
[III-111]
CHAPITRE XV.
Du nombre des habitans par rapport aux arts.
Lorsqu’il y a une loi agraire, & que les terres sont également partagées, le pays peut être très-peuplé, quoiqu’il y ait peu d’arts, parce que chaque citoyen trouve dans le travail de sa terre précisément de quoi se nourrir, & que tous les citoyens ensemble consomment tous les fruits du pays ; cela étoit ainsi dans quelques anciennes républiques.
Mais dans nos états d’aujourd’hui, [III-112] les fonds de terre sont inégalement distribués ; ils produisent plus de fruits que ceux qui les cultivent n’en peuvent consommer ; & si l’on y néglige les arts, & qu’on ne s’attache qu’à l’agriculture, le pays ne peut être peuplé. Ceux qui cultivent ou font cultiver, ayant des fruits de reste, rien ne les engage à travailler l’année d’ensuite : les fruits ne seroient point consommés par les gens oisifs, car les gens oisifs n’auroient pas de quoi les acheter. Il faut donc que les arts s’établissent, pour que les fruits soient consommés par les laboureurs & les artisans. En un mot, ces états ont besoin que beaucoup de gens cultivent au-delà de ce qui leur est nécessaire : pour cela, il faut leur donner envie d’avoir le superflu, mais il n’y a que les artisans qui le donnent.
Ces machines, dont l’objet est d’abréger l’art, ne sont par toujours utiles. Si un ouvrage est à un prix médiocre, & qui convienne également à celui qui l’achete & à l’ouvrier qui l’a fait, les machines qui en simplifieroient la manufacture, c’est-à-dire, qui diminueroient le nombre des ouvriers, seroient pernicieuses ; & si les moulins à eau [III-113] n’étoient pas par-tout établis, je ne les croirois pas aussi utiles qu’on le dit, parce qu’ils ont fait reposer une infinité de bras, qu’ils ont privé bien des gens de l’usage des eaux, & ont fait perdre la fécondité à beaucoup de terres.
[III-113]
CHAPITRE XVI.
Des vues du législateur sur la propagation de l’espece.
Les réglemens sur le nombre des citoyens dépendent beaucoup des circonstances. Il y a des pays où la nature a tout fait ; le législateur n’y a donc rien à faire. A quoi bon engager par des lois à la propagation, lorsque la fécondité du climat donne assez de peuple ? Quelquefois le climat est plus favorable que le terrain, le peuple s’y multiplie, & les famines le détruisent : c’est le cas où se trouve la Chine ; aussi un pere y vend-il ses filles & expose ses enfans. Les mêmes causes operent au Tonquin [1] les mêmes effets ; & il ne faut pas, comme les voyageurs Arabes dont Renaudot nous a donné la relation, [III-114] aller chercher l’opinion [2] de la métempsycose pour cela.
Les mêmes raisons font que, dans l’île Formose [3] , la religion ne permet pas aux femmes de mettre des enfans au monde qu’elles n’aient trente-cinq ans : avant cet âge, la prêtresse leur foule le ventre, & les fait avorter.
-
[↑] Voyages de Dampierre, tome II. p. 41.
-
[↑] Page 167.
-
[↑] Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome V. part. I, pag. 182 & 188.
[III-114]
CHAPITRE XVII.
De la Grece & du nombre de ses habitans.
Cet effet qui tient à des causes physiques dans de certains pays d’Orient, la nature du gouvernement le produisit dans la Grece. Les Grecs étoient une grande nation, composée de villes qui avoient chacune leur gouvernement & leurs lois. Elles n’étoient pas plus conquérantes que celles de Suisse, de Hollande & d’Allemagne ne le sont aujourd’hui : dans chaque république, le législateur avoit eu pour objet le bonheur des citoyens au-dedans, & une puissance au dehors qui ne [III-115] fût pas inférieure à celle des villes voisines [1] . Avec un petit territoire & une grande félicité, il étoit facile que le nombre des citoyens augmentât, & leur devînt à charge : aussi firent-ils sans cesse des colonies [2] ; ils se vendirent pour la guerre, comme les Suisses font aujourd’hui ; rien ne fut négligé de ce qui pouvoit empêcher la trop grande multiplication des enfans.
Il y avoit chez eux des républiques dont la constitution étoit singuliere. Des peuples soumis étoient obligés de fournir la subsistance aux citoyens : les Lacédémoniens étoient nourris par les Ilotes ; les Crétois, par les Périéciens ; les Thessaliens, par les Pénestes. Il ne devoit y avoit qu’un certain nombre d’hommes libres, pour que les esclaves fussent en état de leur fournir la subsistance. Nous disons aujourd’hui qu’il faut borner le nombre des troupes réglées ; or Lacédémone étoit une armée entretenue par des paysans, il falloit donc borner cette armée ; sans cela, les hommes libres, qui avoient tous les [III-116] avantages de la société, se seroient multipliés sans nombre, & les laboureurs auroient été accablés.
Les politiques Grecs s’attacherent donc particuliérement à régler le nombre des citoyens. Platon [3] le fixe à cinq mille quarante ; & il veut que l’on arrête ou que l’on encourage la propagation, selon le besoin, par les honneurs, par la honte & par les avertissemens des vieillards ; il veut même [4] que l’on regle le nombre des mariages, de maniere que le peuple se répare sans que la république soit surchargée.
Si la loi du pays, dit Aristote [5] , défend d’exposer les enfans, il faudra borner le nombre de ceux que chacun doit engendrer. Si l’on a des enfans au-delà du nombre défini par la loi, il conseille de faire avorter [6] la femme avant que le fœtus ait vie.
Le moyen infame qu’employoient les Crétois pour prévenir le trop grand nombre d’enfans, est rapporté par Aristote ; & j’ai senti la pudeur effrayée, quand j’ai voulu le rapporter.
[III-117]
Il y a des lieux, dit encore Aristote [7] , où la loi fait citoyens les étrangers, ou les bâtards, ou ceux qui sont seulement nés d’une mere citoyenne : mais dès qu’ils ont assez de peuple, ils ne le sont plus. Les sauvages du Canada font brûler leurs prisonniers : mais lorsqu’ils ont des cabanes vuides à leur donner, ils les reconnoissent de leur nation.
Le chevalier Petty a supposé, dans ses calculs, qu’un homme en Angleterre vaut ce qu’on le vendroit à Alger [8] . Cela ne peut être bon que pour l’Angleterre : il y a des pays où un homme ne vaut rien, il y en a où il vaut moins que rien.
-
[↑] Par la valeur, la discipline & les exercices militaires.
-
[↑] Les Gaulois, qui étoient dans le même cas, firent de même.
-
[↑] Dans ses lois, livre V.
-
[↑] République, livre V.
-
[↑] Politique, livre VII. Chap. xvi.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Politique, livre III. chap. iii.
-
[↑] Soixante livres sterling.
[III-117]
CHAPITRE XVIII.
De l’état des peuples avant les Romains.
L’Italie, la Sicile, l’Asie mineure, l’Espagne, la Gaule, la Germanie, étoient à peu près comme la Grece, pleines de petits peuples, & regorgeoient d’habitans : on n’y avoit pas besoin de lois pour en augmenter le nombre.
[III-118]
CHAPITRE XIX.
Dépopulation de l’univers.
Toutes ces petites républiques furent englouties dans une grande, & l’on vit insensiblement l’univers se dépeupler : il n’y a qu’à voir ce qu’étoit l’Italie & la Grece, avant & après les victoires des Romains.
« On me demandera, dit Tite-Live [1] , où les Volsques ont pu trouver assez de soldats pour faire la guerre, après avoir été si souvent vaincus. Il falloit qu’il y eût un peuple infini dans ces contrées, qui ne seroient aujourd’hui qu’un désert, sans quelques soldats & quelques esclaves Romains. »
« Les oracles ont cessé, dit Plutarque [2] , parce que les lieux où ils parloient sont détruits ; à peine trouveroit-on aujourd’hui dans la Grece trois mille hommes de guerre. »
« Je ne décrirai point, dit Strabon [3] , l’Epire & les lieux circonvoisins, [III-119] parce que ces pays sont entiérement déserts. Cette dépopulation, qui a commencé depuis long-temps, continue tous les jours ; de sorte que les soldats Romains ont leur camp dans les maisons abandonnées ». Il trouve la cause de ceci dans Polybe, qui dit que Paul Emile, après sa victoire, détruisit soixante & dix villes de l’Epire, & en emmena cent cinquante mille esclaves.
[III-119]
CHAPITRE XX.
Que les Romains furent dans la nécessité de faire des Lois pour la propagation de l’espece.
Les Romains, en détruisant tous les peuples, se détruisoient eux-mêmes : sans cesse dans l’action, l’effort & la violence, ils s’usoient, comme une arme dont on se sert toujours.
Je ne parlerai point ici de l’attention qu’ils eurent à se donner des citoyens à mesure qu’ils en perdroient [1] , des associations qu’ils firent, des droits de [III-120] cité qu’ils donnerent, & de cette pépiniere immense de citoyens qu’ils trouverent dans leurs esclaves. Je dirai ce qu’ils firent, non pas pour réparer la perte des citoyens, mais celle des hommes ; & comme ce fut le peuple du monde qui sut le mieux accorder ses lois avec ses projets, il n’est point indifférent d’examiner ce qu’il fit à cet égard.
-
[↑] J’ai traité ceci dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, &c.
[III-120]
CHAPITRE XXI.
Des Lois des Romains sur la propagation de l’espece.
Les anciennes lois de Rome chercherent beaucoup à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat & le peuple firent souvent des réglemens là-dessus, comme le dit Auguste dans la harangue rapportée par Dion [1] .
Denys d’Halicarnasse [2] ne peut croire, qu’après la mort des trois cents-cinq Fabiens, exterminés par les Vélens, il ne fût resté de cette race qu’un seul enfant ; parce que la loi ancienne, qui ordonnoit à chaque citoyen de se [III-121] marier & d’élever tous ses enfans, étoit encore dans sa vigueur [3] .
Indépendamment des lois, les censeurs eurent l’œil sur les mariages ; & selon les besoins de la république, ils y engagerent [4] & par la honte & par les peines.
Les mœurs qui commencerent à se corrompre, contribuerent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariage, qui n’a que des peines pour ceux qui n’ont plus de sens pour les plaisirs de l’innocence. C’est l’esprit de cette [5] harangue que Meteilus Numidicus fit au peuple dans sa censure. « S’il étoit possible de n’avoir point de femme, nous nous délivrerions de ce mal : mais comme la nature a établi que l’on ne peut guere vivre heureux avec elles, ni subsister sans elles, il faut avoir plus d’égards à notre conservation, qu’à des satisfactions passageres.
La corruption des mœurs détruisit la censure, établie elle-même pour détruire la corruption des mœurs : mais [III-122] lorsque cette corruption devient générale, la censure n’a plus de force [6] .
Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, affoiblirent plus Rome qu’aucune guerre qu’elle eût encore faite : il restoit peu de citoyens [7] , & la plupart n’étoient pas mariés. Pour remédier à ce dernier mal, César & Auguste rétablirent la censure, & voulurent [8] même être censeurs. Ils firent divers réglemens : César [9] donna des récompenses à ceux qui avoient beaucoup d’enfans ; il défendit [10] aux femmes qui avoient moins de quarante-cinq ans, & qui n’avoient ni maris ni enfans, de porter des pierreries, & de se servir de litieres : méthode excellente d’attaquer le célibat par la vanité. Les lois d’Auguste [11] furent plus pressantes : il imposa [12] des peines nouvelles à ceux [III-123] qui n’étoient point mariés, & augmenta les récompenses de ceux qui l’étoient, & de ceux qui avoient des enfans. Tacite appelle ces lois Juliennes [13] ; il y a apparence qu’on y avoit fondu les anciens réglemens faits par le sénat, le peuple & les censeurs.
La loi d’Auguste trouva mille obstacles ; & trente-quatre ans [14] après qu’elle eut été faite, les chevaliers Romains lui en demanderent la révocation. Il fit mettre d’un côté ceux qui étoient mariés, & de l’autre ceux qui ne l’étoient pas : ces derniers parurent en plus grand nombre ; ce qui étonna les citoyens & les confondit. Auguste avec la gravité des anciens censeurs, leur parla ainsi [15] .
« Pendant que les maladies & les guerres nous enlevent tant de citoyens, que deviendra la ville, si on ne contracte plus de mariages ? La cité ne consiste point dans les maisons, les portiques, les places publiques : ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne [III-124] verrez point, comme dans les fables, sortir des hommes de dessous la terre, pour prendre soin de vos affaires. Ce n’est point pour vivre seuls, que vous restez dans le célibat : chacun de vous a des compagnes de sa table & de son lit, & vous ne cherchez que la paix dans vos déréglemens. Citerez-vous ici l’exemple des vierges Vestales ? Donc si vous ne gardiez pas les lois de la pudicité, il faudroit vous punir comme elles. Vous êtes également mauvais citoyens, soit que tout le monde imite votre exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet est la perpétuité de la république. J’ai augmenté les peines de ceux qui n’ont point obéi ; & à l’égard des récompenses, elles sont telles que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes : il y en a de moindres, qui portent mille gens à exposer leur vie ; & celles-ci ne vous engageroient pas à prendre une femme, & à nourrir des enfans ? »
Il donna la loi qu’on nomma de son nom Julia, & Pappia Poppœa du nom des consuls [16] d’une partie de cette [III-125] année-là. La grandeur du mal paroissoit dans leur élection même : Dion [17] nous dit qu’ils n’étoient point mariés, & qu’ils n’avoient point d’enfans.
Cette loi d’Auguste fut proprement un code de lois & un corps systématique de tous les réglemens qu’on pouvoit faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes [18] , & on leur donna plus de force : elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu’elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains.
On en trouve [19] les morceaux dispersés dans les précieux fragmens d’Ulpien, dans les lois du digeste tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes, dans les historiens & les autres auteurs qui les ont citées, dans le code Théodosien qui les a abrogées, dans les Peres qui les ont censurées, sans doute avec un zele louable pour les choses de l’autre vie, mais avec très-peu de connoissance des affaires des celle-ci.
Ces lois avoient plusieurs chefs, & [III-126] l’on en connoît trente-cinq [20] . Mais allant à mon sujet le plus directement qu’il me sera possible, je commencerai par le chef qu’Aulugelle [21] nous dit être le septieme, & qui regarde les honneurs & les récompenses accordés par cette loi.
Les Romains, sortis pour la plupart des villes Latines, qui étoient des colonies Lacédémoniennes [22] , & qui avoient même tiré de ces villes [23] une partie de leurs lois, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse, ce respect qui donne tous les honneurs & toutes les préséances. Lorsque la république manqua de citoyens, on accorda au mariage & au nombre des enfans les prérogatives que l’on avoit données à l’âge [24] ; on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourroient naître : cela s’appeloit le droit des maris. On en donna d’autres à ceux qui avoient des [III-127] enfans, de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses. Il y avoit de ces privileges dont les gens mariés jouissoient toujours, comme, par exemple, une place particuliere au théâtre [25] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.
Ces privileges étoient très-étendus. Les gens mariés qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés [26] , soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs mêmes. Le consul qui avoit le plus d’enfans, prenoit le premier les faisceaux [27] ; il avoit le choix des provinces [28] ; le sénateur qui avoit le plus d’enfans, étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disoit au sénat son avis le premier [29] . L’on pouvoit parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an [30] . Si l’on avoit trois [III-128] enfans à Rome, on étoit exempt de toutes charges personnelles [31] . Les femmes ingénues qui avoient trois enfans, & les affranchis qui en avoient quatre, sortoient [32] de cette perpétuelle tutelle, où les retenoient [33] les anciennes lois de Rome.
Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines [34] . Ceux qui n’étoient point mariés, ne pouvoient rien recevoir par le testament des [35] étrangers ; & ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans, n’en recevoient que la moitié [36] . Les Romains, dit Plutarque [37] , se marioient pour être héritiers, & non pour avoir des héritiers.
Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient se faire par testament, étoient limités par la loi. Ils pouvoient se donner le tout [38] , s’ils avoient des [III-129] enfans l’un de l’autre ; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixieme partie de la succession, à cause du mariage ; & s’ils avoient des enfans d’un autre mariage, ils pouvoient se donner autant de dixiemes qu’ils avoient d’enfans.
Si un mari s’absentoit [39] d’auprès de sa femme, pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvoit en être l’héritier.
La loi donnoit à un mari ou à une femme qui survivoit, deux ans [40] pour se remarier, & un an & demi dans le cas du divorce. Les peres qui ne vouloient pas marier leurs enfans, ou donner de dot à leurs filles, y étoient contraints par les magistrats [41] .
On ne pouvoit faire des fiançailles lorsque le mariage devoit être différé [III-130] de plus de deux ans [42] ; & comme on ne pouvoit épouser une fille qu’à douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’à dix. La loi ne vouloit pas que l’on pût jouir inutilement [43] , & sous prétexte de fiançailles, des privileges des gens mariés.
Il étoit défendu à un homme qui avoit soixante ans [44] d’épouser une femme qui en avoit cinquante. Comme on avoit donné de grands privileges aux gens mariés, la loi ne vouloit point qu’il y eût des mariages inutiles. Par la même raison, le sénatus-consulte Calvitien déclaroit inégal [45] le mariage d’une femme qui avoit plus de cinquante ans, avec un homme qui en avoit moins de soixante : de sorte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit se marier, sans encourir les peines de ces lois. Tibere ajouta [46] à la rigueur de la loi Pappienne, & défendit à un homme de soixante ans d’épouser une femme qui en [III-131] avoit moins de cinquante ; de sorte qu’un homme de soixante ans ne pouvoit se marier dans aucun cas, sans encourir la peine : mais Claude [47] abrogea ce qui avoit été fait sous Tibere à cet égard.
Toutes ces dispositions étoient plus conformes au climat d’Italie qu’à celui du nord, où un homme de soixante ans a encore de la force, & où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.
Pour que l’on ne fût pas inutilement borné dans le choix que l’on pouvoit faire, Auguste permit à tous les ingénus qui n’étoient pas sénateurs [48] d’épouser des affranchies [49] . La loi [50] Pappienne interdisoit aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies, ou qui s’étoient produites sur le théâtre ; & du temps d’Ulpien [51] , il étoit défendu aux ingénus d’épouser des femmes qui avoient mené une mauvaise vie, qui étoient montées sur le théâtre, ou qui avoient été [III-132] condamnées par un jugement public. Il falloit que ce fût quelque senatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n’avoit guere fait de ces sortes de lois, parce que les censeurs corrigeoient à cet égard les désordres qui naissoient, ou les empêchoient de naitre.
Constantin [52] ayant fait une loi, par laquelle il comprenoit dans la défense de la loi Pappienne, non-seulement les sénateurs, mais encore ceux qui avoient un rang considérable dans l’état, sans parler de ceux qui étoient d’une condition inférieure ; cela forma le droit de ce temps-là : il n’y eut plus que les ingénus, compris dans la loi de Constantin, à qui de tels mariages fussent défendus. Justinien [53] abrogea encore la loi de Constantin, & permit à toutes sortes de personnes de contracter ces mariages : c’est par-là que nous avons acquis une liberté si triste.
Il est clair que les peines portées contre ceux qui se marioient contre la défense de la loi, étoient les mêmes que celles portées contre ceux qui ne se marioient point du tout. Ces mariages ne [III-133] leur donnoient aucun avantage [54] civil : la dot [55] étoit caduque [56] après la mort de la femme.
Auguste ayant adjugé au trésor [57] public les successions & les legs de ceux que ces lois en déclaroient incapables, ces lois parurent plutôt fiscales que politiques & civiles. Le dégoût que l’on avoit déjà pour une chose qui paroissoit accablante, fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l’avidité du fisc. Cela fit que, sous Tibere, on fut obligé de modifier [58] ces lois, que Néron diminua les récompenses des [59] délateurs au fisc, que Trajan [60] arrêta leurs brigandages, que Sévere [61] modifia ces lois, & que les [III-134] jurisconsultes les regarderent comme odieuses, & dans leurs décisions en abandonnerent la rigueur.
D’ailleurs les empereurs énerverent ces lois [62] par les privileges qu’ils donnerent des droits de maris, d’enfans, & de trois enfans. Ils firent plus, ils dispenserent les particuliers [63] des peines de ces lois. Mais des regles établies pour l’utilité publique, sembloient ne devoir point admettre de dispense.
Il avoit été raisonnable d’accorder le droit d’enfans aux Vestales [64] , que la religion retenoit dans une virginité nécessaire : on donna [65] de même le privilege des maris aux soldats, parce qu’ils ne pouvoient pas se marier. C’étoit la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles. Ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté [66] [III-135] d’affranchir, & de celle qui bornoit la faculté [67] de léguer. Tout cela n’étoit que des cas particuliers : mais dans la suite les dispenses furent données sans ménagement, & la regle ne fut plus qu’une exception.
Des sectes de philosophie avoient déjà introduit dans l’empire un esprit d’éloignement pour les affaires, qui n’auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république [68] , où tout le monde étoit occupé des arts de la guerre & de la paix. De-là une idée de perfection attachée à tout ce qui mene à une vie spéculative : de-là l’éloignement pour les soins & les embarras d’une famille. La religion chrétienne venant après la philosophie, fixa pour ainsi dire des idées que celle-ci n’avoir fait que préparer.
Le christianisme donna son caractere à la jurisprudence ; car l’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui n’est qu’une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens.
Un panégyriste [69] de Constantin dit [III-136] à cet empereur : « Vos lois n’ont été faites que pour corriger les vices, & régler les mœurs : vous avez ôté l’artifice des anciennes lois, qui sembloient n’avoir d’autres vues que de tendre des pieges à la simplicité ».
Il est certain que les changemens de Constantin furent faits, ou sur des idées qui se rapportoient à l’établissement du christianisme, ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premier objet, vinrent ces lois qui donnerent une telle autorité aux évêques, qu’elles ont été le fondement de la juridiction ecclésiastique : de-là ces lois qui affoiblirent l’autorité paternelle [70] , en ôtant au pere la propriété des biens de ses enfans. Pour étendre une religion nouvelle, il faut ôter l’extrême dépendance des enfans, qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.
Les lois faites dans l’objet de la perfection chrétienne, furent sur tout celles par lesquelles il ôta les peines des lois Pappiennes [71] , & en exempta, [III-137] tant ceux qui n’étoient point mariés, que ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans.
« Ces lois avoient été établies, dit un historien [72] ecclésiastique, comme si la multiplication de l’espece humaine pouvoit être un effet de nos soins ; au lieu de voir que ce nombre croît & décroît selon l’ordre de la providence ».
Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l’espece humaine : tantôt ils l’ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans, les Guebres, les Chinois : tantôt ils l’ont choquée, comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.
On ne cessa de prêcher par tout la continence, c’est-à-dire, cette vertu qui est plus parfaite, parce que par sa nature elle doit être pratiquée par très-peu de gens.
Constantin n’avoit point ôté les lois décimaires, qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari & la femme pouvoient se faire à proportion du nombre de leurs enfans : Théodose le jeune abrogea [73] encore ces lois.
[III-138]
Justinien déclara valables [74] tous les mariages que les lois Pappiennes avoient défendus. Ces lois vouloient qu’on se remariât : Justinien [75] accorda des avantages à ceux qui ne se remarieroient pas.
Par les lois anciennes, la faculté naturelle que chacun a de se marier, & d’avoir des enfans, ne pouvoit être ôtée : ainsi, quand on recevoit un legs [76] à condition de ne point se marier, lorsqu’un patron faisoit jurer [77] son affranchi, qu’il ne se marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans, la loi Pappienne annulloit [78] & cette condition a ce serment. Les clauses, en gardant viduité, établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, & descendent des constitutions des empereurs, faites sur les idées de la perfection.
Il n’y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privileges & des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages & au nombre des enfans : mais là où le célibat [III-139] avoit la prééminence, il ne pouvoit plus y avoir d’honneur pour le mariage ; & puisque l’on put obliger les traitans à renoncer à tant de profits par l’abolition des peines, on sent qu’il fut encore plus aisé d’ôter les récompenses.
La même raison de spiritualité qui avoit fait permettre le célibat, imposa bientôt la nécessité du célibat même. A Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion : mais qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes, se corrompant par les sentimens naturels mêmes, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celle qui les rend toujours pires ?
C’est une regle tirée de la nature, que plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.
-
[↑] Livre LVI.
-
[↑] Livre II.
-
[↑] L’an de Rome 277.
-
[↑] Voyez sur ce qu’ils firent à cet égard, Tite-Live, liv. XLV ; l’épitome de Tite-Live, liv. LIX ; Aulugelle, liv. I. ch. vi ; Valere Maxime, liv. II. ch. xix.
-
[↑] Elle est dans Aulugelle, liv. I. ch. vi.
-
[↑] Voyez ce que j’ai dit au livre V. ch. xix.
-
[↑] César, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il ne s’y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. Epitome de Florus sur Tite-Live, douzieme décade.
-
[↑] Voyez Dion, liv. XLIII. & Xiphil. In August.
-
[↑] Dion, liv. XLIII ; Suétone, vie de César, ch. xx. Appien, liv. II. de la guerre civile.
-
[↑] Eusebe dans sa chronique.
-
[↑] Dion, liv. LIV.
-
[↑] L’an 736 de Rome.
-
[↑] Julias rogationes, annal. Liv. III.
-
[↑] L’an 762 de Rome, Dion, liv. LVI.
-
[↑] J’ai abrégé cette harangue, qui est d’une longueur accablante : elle est rapportée dans Dion, liv. LVI.
-
[↑] Marcus Pappius Mutilus, & Q. Poppœus Sabigus. Dion, liv. LVI.
-
[↑] Dion, liv. LVI.
-
[↑] Le titre 14 des fragmens d’Ulpien, distingue fort bien la loi Julienne de la Pappienne.
-
[↑] Jacques Godefroi en a fait une compilation.
-
[↑] Le trente-cinquieme est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.
-
[↑] Liv. II, ch. xv.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse.
-
[↑] Les députés de Rome qui furent envoyés pour chercher des lois Grecques, allerent à Athenes & dans les villes d’Italie.
-
[↑] Aulugelle, liv. II, ch. xv.
-
[↑] Suétone, in Augusto, ch. XLIV.
-
[↑] Tacite, liv. II. Ut numerus liberorum in candidatis prœpolleret, quod lex jubebat.
-
[↑] Aulugelle, liv. II, ch. xv.
-
[↑] Tacite, annal. Liv. XV.
-
[↑] Voyez la loi VI, §. 5, ff. de decurion.
-
[↑] Voyez la loi II, ff. de minorib.
-
[↑] Loi I & II, ff. de vacatione, & excusat. muner.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 29, 6. 3.
-
[↑] Plutarque, vie de Numa.
-
[↑] Voyez les fragm. d’Ulpien, au titre 14, 15, 16, 17 & 18, qui sont un des beaux morceaux de l’ancienne jurisprudence Romaine.
-
[↑] Sozom. Liv. I, ch. IX. On recevoit de ses parens ; fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
-
[↑] Sozom. Liv. I, ch. ix., & leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœnis cœlib. & orbitat.
-
[↑] Œuvres morales, de l’amour des peres envers leurs enfans.
-
[↑] Voyez un plus long détail de ceci dans les fragmens d’Ulpien, tit. 15 & 16.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Il paroît que les premieres lois Juliennes donnerent trois ans. Harangue d’Auguste dans Dion, liv. LVI : Suétone, vie d’Auguste, ch. xxxiv. D’autres lois Juliennes n’accorderent qu’un an : enfin la loi Pappienne en donna deux. Fragm. d’Ulpien, tit. 14. Ces lois n’étoient point agréables au peuple ; & Auguste les tempéroit, ou les roidissoit, selon qu’on étoit plus ou moins disposé à les souffrir.
-
[↑] C’étoit le trente-cinquieme chef de la loi Papienne, leg. 19, ff. de ritu nuptiarum.
-
[↑] Voyez Dion, liv. LIV, anno 736 ; Suétone, in Octavio, ch. xxxiv.
-
[↑] Voyez Dion, liv. LIV ; & dans le même Dion, la harangue d’Auguste, liv. LVI.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16 ; & la loi XXVII, cod. de nuptiis.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16. §. 3.
-
[↑] Voyez Suétone, in Claudio, ch. xxiii.
-
[↑] Voyez Suétone, vie de Claude, ch. xxiii ; & les fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 3.
-
[↑] Dion, liv. LIV ; fragm. d’Ulpien, tit. 13
-
[↑] Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, ch. 13 ; & la loi XLIV, au ff. de ritu nuptierum, à la fin.
-
[↑] Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 13 & 16.
-
[↑] Voyez la loi I, au cod. de nat. lib.
-
[↑] Novel. 117.
-
[↑] Loi XXXVII, §. 7. ff. de operib. libertorum, fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. 2.
-
[↑] Fragm. Ibid.
-
[↑] Voyez ci-dessous le ch. xiii, du liv. XXVI.
-
[↑] Excepté dans de certains cas. Voyez les fragm. d’Ulpien, tit. 18 ; & la loi unique, au cod. de caduc. tollead.
-
[↑] Relatum de moderandâ Pappiâ Poppœâ. Tacite, annal. Liv. III, p. 117.
-
[↑] Il les réduisit à la quatrieme partie. Suétone, in Nerone, ch. x.
-
[↑] Voyez le panégyrique de Pline.
-
[↑] Sévere recula jusqu’à vingt-cinq ans pour les mâles, & vingt pour les filles, le temps des dispositions de la loi Pappienne, comme on le voit en considérant les fragm. d’Ulpien, tit. 16, avec ce que dit Tertullien, apologet. ch. iv.
-
[↑] P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les mœurs, se plaint de l’abus qui s’étoit introduit, que le fils adoptif donnoit le même privilege que le fils naturel. Anlag. Liv. V. ch. xix.
-
[↑] Voyez la loi XXXI, ff. de ritu nupt.
-
[↑] Auguste, par la loi Pappienne, leur donna le même privilege qu’aux meres ; voyez Dion, liv. LVI. Numa leur avoit donné l’ancien privilege des femmes qui avoient trois enfans, qui est de n’avoir point de curateur ; Plutarque, dans la vie de Numa.
-
[↑] Claude le leur accorda. Dion, liv. LX.
-
[↑] Leg. Apud cum, ff. de manumissionib. §. I.
-
[↑] Dion, Liv. LV.
-
[↑] Voyez dans les offices de Cicéron, ces idées sur cet esprit de spéculation.
-
[↑] Nazaire, in panegyrico Constantini, anno 321.
-
[↑] Voyez la loi I, II & III, au cod. Theod. de bonis maternis, maternique generis, &c. & la loi unique, au même code, de bonis quæ filiis famil. acquiruntur.
-
[↑] Leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœn. Cœlib. & orbit
-
[↑] Sozom. p. 27.
-
[↑] Leg. II & III, cod. Theod. de jur. lib.
-
[↑] Leg. Sancimus, cod. de nuptiis.
-
[↑] Nov. 127, ch. iii. Nov. 118, ch. v.
-
[↑] Leg. LIV, ff. de condit & demonst.
-
[↑] Leg. V, §. 4. de jure patronat.
-
[↑] Paul, dans ses sentences, livre III, titre 12, §. 15.
[III-140]
CHAPITRE XXII.
De l’exposition des enfans.
Les premiers Romains eurent une assez bonne police sur l’exposition des enfans. Romulus, dit Denys d’Halicarnasse [1] , imposa à tous les citoyens la nécessité d’élever tous les enfans mâles & les aînées des filles. Si les enfans étoient difformes & monstrueux, il permettoit de les exposer, après les avoir montrés à cinq des plus proches voisins.
Romulus ne permit [2] de tuer aucun enfant qui eût moins de trois ans ; par-là il concilioit la loi qui donnoit aux peres le droit de vie & de mort sur leurs enfans, & celle qui défendoit de les exposer.
On trouve encore dans Denys d’Halicarnasse [3] , que la loi qui ordonnoit aux citoyens de se marier & d’élever tous leurs enfans, étoit en vigueur l’an 277 de Rome : on voit que l’usage avoit restreint la loi de Romulus, qui permettoit d’exposer les filles cadettes.
[III-141]
Nous n’avons de connoissance de ce que la loi des douze tables, donnée l’an de Rome 301, statua sur l’exposition des enfans, que par un passage de Cicéron [4] , qui parlant du tribunat du peuple, dit que d’abord après sa naissance, tel que l’enfant monstrueux de la loi des douze tables, il fut étouffé : les enfans qui n’étoient donc conservés, & la loi des douze tables ne changea rien aux institutions précédentes.
« Les Germains, dit Tacite [5] , n’exposent point leurs enfans ; & chez eux, les bonnes mœurs ont plus de force que n’ont ailleurs les bonnes lois ». Il y avoit donc chez les Romains des lois contre cet usage, & on ne les suivoit plus. On ne trouve aucune loi [6] Romaine, qui permette d’exposer les enfans : ce fut sans doute un abus introduit dans les derniers temps, lorsque le luxe ôta l’aisance, lorsque les richesses partagées furent appelées pauvreté, lorsque le pere crut avoir perdu [III-142] ce qu’il donna à sa famille, & qu’il distingua cette famille de sa propriété.
-
[↑] Antiquités Romaines, liv. II.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Liv. IX.
-
[↑] Liv. III, de legib.
-
[↑] De morib. Germ.
-
[↑] Il n’y a point de titre là-dessus dans le digeste, le titre du code n’en dit rien, non plus que les novelles.
[III-142]
CHAPITRE XXIII.
De l’état de l’univers, après la destruction des Romains.
Les réglemens que firent les Romains pour augmenter le nombre de leurs citoyens, eurent leur effet pendant que leur république, dans la force de son institution, n’eut à réparer que les pertes qu’elle faisoit par son courage, par son audace, par sa fermeté, par son amour pour la gloire, & par sa vertu même. Mais bientôt les lois les plus sages ne purent établir ce qu’une république mourante, ce qu’une anarchie générale, ce qu’un gouvernement militaire, ce qu’un empire dur, ce qu’un despotisme superbe, ce qu’une monarchie foible, ce qu’une cour stupide, idiote & superstitieuse, avoient successivement abattu : on eût dit qu’ils n’avoient conquis le monde que pour l’affoiblir, & le livrer sans défense aux barbares. Les nations Gothes, Géthiques, Sarrasines & Tartares, les [III-143] accablerent tour-à-tour ; bientôt les peuples barbares n’eurent à détruire que des peuples barbares. Ainsi dans le temps des fables, après les inondations & les déluges, il sortit de la terre des hommes armés qui s’exterminerent.
[III-143]
CHAPITRE XXIV.
Changemens arrivés en Europe, par rapport au nombre des habitans.
Dans l’état où étoit l’Europe, on n’auroit pas cru qu’elle pût se rétablir ; sur-tout lorsque, sous Charlemagne, elle ne forma plus qu’un vaste empire. Mais par la nature du gouvernement d’alors, elle se partagea en une infinité de petites souverainetés. Et comme un seigneur résidoit dans son village ou dans sa ville ; qu’il n’étoit grand, riche, puissant, que dis-je ? qu’il n’étoit en sureté que par le nombre de ses habitans, chacun s’attacha avec une attention singuliere à faire fleurir son petit pays : ce qui réussit tellement, que, malgré les irrégularités du gouvernement, le défaut des connoissances qu’on a acquises depuis sur le commerce, le grand nombre [III-144] de guerres & de querelles qui s’éleverent sans cesse, il y eut dans la plupart des contrées d’Europe plus de peuple qu’il n’y en a aujourd’hui.
Je n’ai pas le temps de traiter à fond cette matiere : mais je citerai les prodigieuses armées des croisés, composées de gens de toute espece. M. Pusendorf dit [1] , que sous Charles IX, il y avoit vingt millions d’hommes en France.
Ce sont les perpétuelles réunions de plusieurs petits états, qui ont produit cette diminution. Autrefois chaque village de France étoit une capitale, il n’y en a aujourd’hui qu’une grande : chaque partie de l’état étoit un centre de puissance ; aujourd’hui tout se rapporte à un centre ; & ce centre est pour ainsi dire l’état même.
-
[↑] Hist. De l’univ. Ch. V. de la France.
[III-144]
CHAPITRE XXV.
Continuation du même sujet.
Il est vrai que l’Europe a, depuis deux siecles, beaucoup augmenté sa navigation : cela lui a procuré des habitans, [III-145] & lui en a fait perdre. La Hollande envoie tous les ans aux Indes un grand nombre de matelots, dont il ne revient que les deux tiers ; le reste périt ou s’établit aux Indes : même chose doit à peu près arriver à toutes les autres nations qui font ce commerce.
Il ne faut point juger de l’Europe comme d’un état particulier qui y feroit seul une grande navigation. Cet état augmenteroit de peuple, parce que toutes les nations voisines viendroient prendre part à cette navigation ; il y arriveroit des matelots de tous côtés : l’Europe séparée du reste du monde par la religion [1] , par de vastes mers & par des déserts, ne se répare pas ainsi.
-
[↑] Les pays Mahométans l’entourent presque partout.
[III-145]
CHAPITRE XXVI.
Conséquences.
De tout ceci il faut conclure, que l’Europe est encore aujourd’hui dans le cas d’avoir besoin de lois qui favorisent la propagation de l’espece humaine : aussi comme les politiques [III-146] Grecs nous parlent toujours de ce grand nombre de citoyens qui travaillent la république, les politiques d’aujourd’hui ne nous parlent que des moyens propres à l’augmenter.
[III-146]
CHAPITRE XXVII.
De la loi faite en France, pour encourager la propagation de l’espece.
Louis XIV ordonna [1] de certaines pensions pour ceux qui auroient dix enfans, & de plus fortes pour ceux qui en auroient douze. Mais il n’étoit pas question de récompenser des prodiges. Pour donner un certain esprit général qui portât à la propagation de l’espece, il falloit établir, comme les Romains, des récompenses générales ou des peines générales.
-
[↑] Édit de 1666, en faveur des mariages.
[III-147]
CHAPITRE XXVIII.
Comment on peut remédier à la dépopulation.
Lorsqu’un état se trouve dépeuplé par des accidens particuliers, des guerres, des pestes, des famines, il y a des ressources. Les hommes qui restent peuvent conserver l’esprit de travail & d’industrie ; ils peuvent chercher à réparer leurs malheurs, & devenir plus industrieux par leur calamité même. Le mal presqu’incurable est lorsque la dépopulation vient de longue main, par un vice intérieur & un mauvais gouvernement. Les hommes y ont péri par une maladie insensible & habituelle : nés dans la langueur & dans la misere, dans la violence ou les préjugés du gouvernement, ils se sont vus détruire, souvent sans sentir les causes de leur destruction. Les pays désolés par le despotisme, ou par les avantages excessifs du clergé sur les laïques, en sont deux grands exemples.
Pour rétablir un état ainsi dépeuplé, on attendroit en vain des secours des [III-148] enfans qui pourroient naître. Il n’est plus temps ; les hommes dans leurs déserts sont sans courage & sans industrie. Avec des terres pour nourrir un peuple, on a à peine de quoi nourrir une famille. Le bas peuple dans ces pays n’a pas même de part à leur misere, c’est-à-dire, aux friches dont ils sont remplis. Le clergé, le prince, les villes, les grands, quelques citoyens principaux, sont devenus insensiblement propriétaires de toute la contrée : elle est inculte ; mais les familles détruites leur en ont laissé les pâtures, & l’homme de travail n’a rien.
Dans cette situation, il faudroit faire dans toute l’étendue de l’empire ce que les Romains faisoient dans une partie du leur : pratiquer, dans la disette des habitans, ce qu’ils observoient dans l’abondance ; distribuer des terres à toutes les familles qui n’ont rien ; leur procurer les moyens de les défricher & de les cultiver. Cette distribution devroit se faire à mesure qu’il y auroit un homme pour la recevoir ; de sorte qu’il n’y eût point de moment perdu pour le travail.
[III-149]
CHAPITRE XXIX.
Des Hôpitaux.
Un homme n’est pas pauvre parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas. Celui qui n’a aucun bien & qui travaille, est aussi à son aise que celui qui a cent écus de revenu sans travailler. Celui qui n’a rien, & qui a un métier, n’est pas plus pauvre que celui qui a dix arpens de terre en propre, & qui doit les travailler pour subsister. L’ouvrier qui a donné à ses enfans son art pour héritage, leur a laissé un bien qui s’est multiplié à proportion de leur nombre. Il n’en est pas de même de celui qui a dix arpens de fonds pour vivre, & qui les partage à ses enfans.
Dans les pays de commerce, où beaucoup de gens n’ont que leur art, l’état est souvent obligé de pourvoir aux besoins des vieillards, des malades & des orphelins. Un état bien policé tire cette subsistance du fonds des arts mêmes ; il donne aux uns les travaux dont ils sont capables ; il enseigne les autres à travailler, ce qui fait déjà un travail.
[III-150]
Quelques aumônes que l’on fait à un homme nud dans les rues, ne remplissent point les obligations de l’état, qui doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé.
Aureng-Zebe [1] à qui on demandoit pourquoi il ne bâtissoit point d’hôpitaux, dit : « Je rendrai mon empire si riche, qu’il n’aura pas besoin d’hôpitaux. » Il auroit fallu dire : Je commencerai par rendre mon empire riche, & je bâtirai des hôpitaux.
Les richesses d’un état supposent beaucoup d’industrie. Il n’est pas possible que, dans un si grand nombre de branches de commerce, il n’y en ait toujours quelqu’une qui souffre, & dont par conséquent les ouvriers ne soient dans une nécessité momentanée.
C’est pour lors que l’état a besoin d’apporter un prompt secours, soit pour empêcher le peuple de souffrir, soit pour éviter qu’il ne se révolte : c’est dans ce cas qu’il faut des hôpitaux, ou quelque règlement équivalent, qui puisse prévenir cette misere.
[III-151]
Mais quand la nation est pauvre, la pauvreté particuliere dérive de la misere générale, & elle est, pour ainsi dire, la misere générale. Tous les hôpitaux du monde ne sauroient guérir cette pauvreté particuliere ; au contraire, l’esprit de paresse qu’ils inspirent, augmente la pauvreté générale, & par conséquent la particuliere.
Henri VIII [2] voulant réformer l’église d’Angleterre, détruisit les moines, nation paresseuse elle-même, & qui entretenoit la paresse des autres, parce que pratiquant l’hospitalité, une infinité de gens oisifs, gentilshommes & bourgeois, passoient leur vie à courir de couvent en couvent. Il ôta encore les hôpitaux où le bas peuple trouvoit sa subsistance, comme les gentilshommes trouvoient la leur dans les monasteres. Depuis ce changement, l’esprit de commerce & d’industrie s’établit en Angleterre.
À Rome, les hôpitaux font que tout le monde est à son aise, excepté ceux qui travaillent, excepté ceux qui ont de l’industrie, excepté ceux qui cultivent [III-152] les arts, excepté ceux qui ont des terres, excepté ceux qui font le commerce.
J’ai dit que les nations riches avoient besoin d’hôpitaux, parce que la fortune y étoit sujette à mille accidens : mais on sent que des secours passagers vaudroient bien mieux que des établissemens perpétuels. Le mal est momentané : il faut donc des secours de même nature, & qui soient applicables à l’accident particulier.
-
[↑] Voyez Chardin, voyage de Perse, tome 8.
-
[↑] Voyez l’Histoire de la réforme d’Angleterre, par M. Burnet.
[III-153]
LIVRE XXIV.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques & en elle-même.↩
CHAPITRE PREMIER.
Des religions en général.
Comme on peut juger parmi les ténebres celles qui sont les moins épaisses, & parmi les abymes ceux qui sont les moins profonds ; ainsi l’on peut chercher entre les religions fausses celles qui sont les plus conformes au bien de la société ; celles qui, quoiqu’elles n’ayent pas l’effet de mener les hommes aux félicités de l’autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.
Je n’examinerai donc les divers religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil ; soit que je parle de celle qui a sa racine [III-154] dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.
Comme dans cet ouvrage je ne suis point théologien, mais écrivain politique, il pourroit y avoir des choses qui ne seroient entiérement vraies que dans une façon de penser humaine, n’ayant point été considérées dans le rapport avec des vérités plus sublimes.
À l’égard de la vraie religion, il ne faudra que très-peu d’équité pour voir que je n’ai jamais prétendu faire céder ses intérêts aux intérêts politiques, mais les unir : or, pour les unir, il faut les connoître.
La religion Chrétienne, qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques & les meilleures lois civiles, parce qu’elles sont après elle le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir.
[III-155]
CHAPITRE II.
Paradoxe de Bayle.
Mr Bayle [1] a prétendu prouver qu’il valoit mieux être athée qu’idolâtre, c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’il est moins dangereux de n’avoir point du tout de religion, que d’en avoir une mauvaise. « J’aimerois mieux, dit-il, que l’on dît de moi que je n’existe pas, que si l’on disoit que je suis un méchant homme ». Ce n’est qu’un sophisme, fondé sur ce qu’il n’est d’aucune utilité au genre humain que l’on croie qu’un certain homme existe, au lieu qu’il est très-utile que l’on croie que Dieu est. De l’idée qu’il n’est pas, suit l’idée de notre indépendance ; ou, si nous ne pouvons pas avoir cette idée, celle de notre révolte. Dire que la religion n’est pas un motif réprimant, parce qu’elle ne réprime pas toujours, c’est dire que les lois civiles ne sont pas un motif réprimant non plus. C’est mal raisonner contre la religion, de rassembler dans un grand ouvrage une longue [III-156] énumération des maux qu’elle a produits, si l’on ne fait de même celle des biens qu’elle a faits. Si je voulois raconter tous les maux qu’on produit dans le monde les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, je dirois des choses effroyables. Quand il seroit inutile que les sujets eussent une religion, il ne le seroit pas que les princes en eussent, & qu’ils blanchissent d’écume le seul frein que ceux qui ne craignent pas les lois humaines puissent avoir.
Un prince qui aime la religion & qui la craint, est un lion qui cede à la main qui le flatte, ou à la voix qui l’appaise : celui qui craint la religion & qui la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent : celui qui n’a point du tout de religion, est cet animal terrible, qui ne sent sa liberté que lorsqu’il déchire & qu’il dévore.
La question n’est pas de savoir s’il vaudroit mieux qu’un certain homme ou qu’un certain peuple n’eût point de religion, que d’abuser de celle qu’il a ; mais de savoir quel est le moindre mal, que l’on abuse quelquefois de la religion, [III-157] ou qu’il n’y en ait point du tout parmi les hommes.
Pour diminuer l’horreur de l’athéisme, on charge trop l’idolâtrie. Il n’est pas vrai que, quand les anciens élevoient des autels à quelque vice, cela signifiât qu’ils aimassent ce vice : cela signifioit au contraire qu’ils le haïssoient. Quand les Lacédémoniens érigerent une chapelle à la Peur, cela ne signifioit pas que cette nation belliqueuse lui demandât de s’emparer dans les combats des cœurs des Lacédémoniens. Il y avoit des divinités à qui on demandoit de ne pas inspirer le crime, & d’autres à qui on demandoit de le détourner.
-
[↑] Pensées sur la comete, &c.
[III-157]
CHAPITRE III.
Que le gouvernement modéré convient mieux à la religion Chrétienne, & le gouvernement despotique à la Mahométane.
La religion Chrétienne est éloignée du pur despotisme : c’est que la douceur étant si recommandée dans l’Évangile, elle s’oppose à la colere [III-158] despotique avec laquelle le prince se feroit justice, & exerceroit ses cruautés.
Cette religion défendant la pluralité des femmes, les princes y sont moins renfermés, moins séparés de leurs sujets, & par conséquent plus hommes ; ils sont plus disposés à se faire des lois, & plus capables de sentir qu’ils ne peuvent pas tout.
Pendant que les princes Mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion chez les Chrétiens rend les princes moins timides, & par conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses sujets, & les sujets sur le prince. Chose admirable ! la religion Chrétienne, qui ne semble avoir d’objet que la félicité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.
C’est la religion Chrétienne, qui, malgré la grandeur de l’empire & le vice du climat, a empêché le despotisme de s’établir en Éthiopie, & a porté au milieu de l’Afrique les mœurs de l’Europe & ses lois.
Le prince héritier d’Éthiopie jouit d’une principauté, & donne aux autres sujets l’exemple de l’amour & de l’obéissance. Tout près de là, on voit le [III-159] Mahométisme faire enfermer les enfans du [1] roi de Sennar : à sa mort, le conseil les envoie égorger, en faveur de celui qui monte sur le trône.
Que d’un côté l’on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois & des chefs Grecs & Romains, & de l’autre la destruction des peuples & des villes par ces mêmes chefs ; Thimur & Gengiskan, qui ont dévasté l’Asie ; & nous verrons que nous devons au Christianisme, & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne sauroit assez reconnoître.
C’est ce droit des gens qui fait que, parmi nous, la victoire laisse aux peuples vaincus ces grandes choses, la vie, la liberté, les lois, les biens, & toujours la religion, lorsqu’on ne s’aveugle pas soi-même.
On peut dire que les peuples de l’Europe ne sont pas aujourd’hui plus désunis que ne l’étoient, dans l’empire Romain devenu despotique & militaire, les peuples & les armées, ou que ne [III-160] l’étoient les armées entr’elles : d’un côté, les armées se faisoient la guerre ; & de l’autre, on leur donnoit le pillage des villes, & le partage ou la confiscation des terres.
-
[↑] Relation d’Éthiopie par le sieur Ponce, médecin, au quatrieme recueil des lettres édifiantes.
[III-160]
CHAPITRE IV.
Conséquences du caractere de la religion Chrétienne, & de celui de la religion Mahométane.
Sur le caractere de la religion Chrétienne & celui de la Mahométane, on doit, sans autre examen, embrasser l’une & rejeter l’autre : car il nous est bien plus évident qu’une religion doit adoucir les mœurs des hommes, qu’il ne l’est qu’une religion soit vraie.
C’est un malheur pour la nature humaine, lorsque la religion est donnée par un conquérant. La religion Mahométane, qui ne parle que de glaive, agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qui l’a fondée.
L’histoire de Sabbacon [1] , un des rois pasteurs, est admirable. Le Dieu de Thebes lui apparut en songe, & lui [III-161] ordonna de faire mourir tous les prêtres d’Égypte. Il jugea que les dieux n’avoient plus pour agréable qu’il régnât, puisqu’ils lui ordonnoient des choses si contraires à leur volonté ordinaire ; & il se retira en Éthiopie.
-
[↑] Voyez Diodore, liv. II.
[III-161]
CHAPITRE V.
Que la religion Catholique convient mieux à une monarchie, & que la Protestante s’accommode mieux d’une république.
Lorsqu’une religion naît & se forme dans un état, elle suit ordinairement le plan du gouvernement où elle est établie : car les hommes qui la reçoivent, & ceux qui la font recevoir, n’ont guere d’autres idées de police que celle de l’état dans lequel ils sont nés.
Quand la religion Chrétienne souffrit, il y a deux siecles, ce malheureux partage qui la divisa en catholique & en protestante, les peuples du nord embrasserent la protestante, & ceux du midi garderent la catholique.
C’est que les peuples du nord ont & auront toujours un esprit d’indépendance & de liberté que n’ont pas les [III-162] peuples du midi ; & qu’une religion qui n’a point de chef visible, convient mieux à l’indépendance du climat, que celle qui en a un.
Dans les pays mêmes où la religion protestante s’établit, les révolutions se firent sur le plan de l’état politique. Luther ayant pour lui de grands princes, n’auroit guere pu leur faire goûter une autorité ecclésiastique qui n’auroit point eu de prééminence extérieure ; & Calvin ayant pour lui des peuples qui vivoient dans des républiques, ou des bourgeois obscurcis dans des monarchies, pouvoit fort bien ne pas établir des prééminences & des dignités.
Chacune de ces deux religions pouvoit se croire la plus parfaite ; la Calviniste se jugeant plus conforme à ce que Jesus-Christ avoit dit, & la Luthérienne à ce que les Apôtres avoient fait.
[III-162]
CHAPITRE VI.
Autre paradoxe de Bayle.
Mr Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion Chrétienne : il ose avancer que de [III-163] véritables Chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non ? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très-grand zele pour les remplir ; ils sentiroient très-bien les droits de la défense naturelle ; plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du Christianisme bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.
Il est étonnant qu’on puisse imputer à ce grand homme d’avoir méconnu l’esprit de sa propre religion ; qu’il n’ait pas su distinguer les ordres pour l’établissement du Christianisme d’avec le Christianisme même, ni les préceptes de l’évangile d’avec ses conseils. Lorsque le législateur, au lieu de donner des lois, a donné des conseils, c’est qu’il a vu que ses conseils, s’ils étoient ordonnés comme des lois, seroient contraires à l’esprit de ses lois.
[III-164]
CHAPITRE VII.
Des lois de perfection dans la religion.
Les lois humaines faites pour parler à l’esprit, doivent donner des préceptes & point de conseils : la religion, faite pour parler au cœur, doit donner beaucoup de conseils, & peu de préceptes.
Quand, par exemple, elle donne des regles, non pas pour le bien, mais pour le meilleur ; non pas pour ce qui est bon, mais pour ce qui est parfait ; il est convenable que ce soient des conseils & non pas des lois : car la perfection ne regarde pas l’universalité des hommes ni des choses. De plus, si ce sont des lois, il en faudra une infinité d’autres pour faire observer les premieres. Le célibat fut un conseil du Christianisme : lorsqu’on en fit une loi pour un certain ordre de gens, il en fallut chaque jour de nouvelles [1] pour réduire les hommes à l’observation de celle-ci. Le législateur se fatigua, il fatigua la société, pour faire exécuter aux hommes par précepte, ce que ceux qui aiment la perfection auroient exécuté comme conseil.
-
[↑] Voyez la bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du sixieme siecle, tom. V. par M. Dupin.
[III-165]
CHAPITRE VIII.
De l’accord des lois de la morale avec celles de la religion.
Dans un pays où l’on a le malheur d’avoir une religion que Dieu n’a pas donnée, il est toujours nécessaire qu’elle s’accorde avec la morale ; parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes.
Les points principaux de la religion de ceux de Pégu [1] sont de ne point tuer, de ne point voler, d’éviter l’impudicité, de ne faire aucun déplaisir à son prochain, de lui faire au contraire tout le bien qu’on peut. Avec cela ils croient qu’on se sauvera dans quelque religion que ce soit ; ce qui fait que ces peuples, quoique fiers & pauvres, ont de la douceur & de la compassion pour les malheureux.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. III. part. I. pag. 63.
[III-166]
CHAPITRE IX.
Des Esséens.
Les Esséens [1] faisoient vœu d’observer la justice envers les hommes, de ne faire de mal à personne, même pour obéir, de haïr les injustes, de garder la foi à tout le monde, de commander avec modestie, de prendre toujours le parti de la vérité, de fuir tout gain illicite.
-
[↑] Histoire des Juifs, par Prideaux.
[III-166]
CHAPITRE X.
De la secte Stoïque.
Les diverses sectes de philosophie chez les anciens pouvoient être considérées comme des especes de religion. Il n’y en a jamais eu dont les principes fussent plus dignes de l’homme, & plus propres à former des gens de bien, que celle des Stoïciens ; & si je pouvois un moment cesser de penser que je suis Chrétien, je ne pourrois m’empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon au nombre des malheurs du genre humain.
Elle n’outroit que les choses dans l’esquelles il y a de la grandeur, le mépris des plaisirs & de la douleur.
[III-167]
Elle seule savoit faire les citoyens ; elle seule faisoit les grands hommes ; elle seule faisoit les grands empereurs.
Faites pour un moment abstraction des vérités révélées ; cherchez dans toute la nature, & vous n’y trouverez pas de plus grand objet que les Antonins. Julien même, Julien, (un suffrage ainsi arraché ne me rendra point complice de son apostasie) non, il n’y a point eu après lui de prince plus digne de gouverner les hommes.
Pendant que les Stoïciens regardoient comme une chose vaine les richesses, les grandeurs humaines, la douleur, les chagrins, les plaisirs, ils n’étoient occupés qu’à travailler au bonheur des hommes, à exercer les devoirs de la société : il sembloit qu’ils regardassent cet esprit sacré qu’ils croyoient être en eux-mêmes, comme une espece de providence favorable qui veilloit sur le genre humain.
Nés pour la société, ils croyoient tous que leur destin étoit de travailler pour elle : d’autant moins à charge, que leurs récompenses étoient toutes dans eux-mêmes ; qu’heureux par leur philosophie seule, il sembloit que le seul bonheur des autres pût augmenter le leur.
[III-168]
CHAPITRE XI.
De la contemplation.
Les hommes étant faits pour se conserver, pour se nourrir, pour se vêtir, & faire toutes les actions de la société, la religion ne doit pas leur donner une vie trop contemplative [1] .
Les Mahométans deviennent spéculatifs par habitude ; ils prient cinq fois le jour, & chaque fois il faut qu’ils fassent un acte par lequel ils jettent derriere leur dos tout ce qui appartient à ce monde : cela les forme à la spéculation. Ajoutez à cela cette indifférence pour toutes choses, que donne le dogme d’un destin rigide.
Si d’ailleurs d’autres causes concourent à leur inspirer le détachement, comme si la dureté du gouvernement, si les lois concernant la propriété des terres, donnent un esprit précaire ; tout est perdu.
La religion des Guebres rendit autrefois le royaume de Perse florissant ; [III-169] elle corrigea les mauvais effets du despotisme : la religion Mahométane détruit aujourd’hui ce même empire.
-
[↑] C’est l’inconvénient de la doctrine de Foë & de Laockium.
[III-169]
CHAPITRE XII.
Des pénitences.
Il est bon que les pénitences soient jointes avec l’idée de travail, non avec l’idée d’oisiveté ; avec l’idée du bien, non avec l’idée de l’extraordinaire ; avec l’idée de frugalité, non avec l’idée d’avarice.
[III-169]
CHAPITRE XIII.
Des crimes inexpiables.
Il paroît, par un passage des livres des pontifes rapporté par Cicéron [1] , qu’il y avoit chez les Romains des crimes [2] inexpiables ; & c’est là-dessus que Zozyme fonde le récit si propre à envenimer les motifs de la conversion de Constantin, & Julien cette raillerie [III-170] amere qu’il fait de cette même conversion dans ses Césars.
La religion païenne qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main & abandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables : Mais une religion qui enveloppe toutes les passions ; qui n’est pas plus jalouse des actions que des désirs & des pensées ; qui ne nous tient point attachés par quelques chaînes, mais par un nombre innombrable de fils ; qui laisse derriere elle la justice humaine, & commence une autre justice ; qui est faite pour mener sans cesse du repentir à l’amour, & de l’amour au repentir ; qui met entre le juge & le criminel un grand médiateur, entre le juste & le médiateur un grand juge ; une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais quoiqu’elle donne des craintes & des espérance à tous, elle fait assez sentir que, s’il n’y a point de crime qui par sa nature soit inexpiable, toute une vie peut l’être ; qu’il seroit très-dangereux de tourmenter sans cesse la miséricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations ; qu’inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le Seigneur, [III-171] nous devons craindre d’en contracter de nouvelles, de combler la mesure, & d’aller jusqu’au terme où la bonté paternelle finit.
-
[↑] Liv. II. des lois.
-
[↑] Sacrum commissum, quod neque expiari poterit, impiè commissum est ; quod expiari poterit publici facet, dotes expiante.
[III-171]
CHAPITRE XIV.
Comment la force de la religion s’applique à celle des lois civiles.
Comme la religion & les lois civiles doivent tendre principalement à rendre les hommes bons citoyens, on voit que, lorsqu’une des deux s’écartera de ce but, l’autre y doit tendre davantage : moins la religion sera réprimante, plus les lois civiles doivent réprimer.
Ainsi au Japon la religion dominante n’ayant presque point de dogmes, & ne proposant point de paradis ni d’enfer, les lois, pour y suppléer, ont été faites avec une sévérité & exécutées avec une ponctualité extraordinaires.
Lorsque la religion établit le dogme de la nécessité des actions humaines, les peines des lois doivent être plus séveres & la police plus vigilante, pour que les hommes, qui sans cela s’abandonneroient eux-mêmes, soient déterminés [III-172] par ces motifs : mais si la religion établit le dogme de la liberté, c’est autre chose.
De la paresse de l’ame, naît le dogme de la prédestination Mahométane ; & du dogme de cette prédestination, naît la paresse de l’ame. On a dit : Cela est dans les décrets de Dieu ; il faut donc rester en repos. Dans un cas pareil, on doit exciter par les lois les hommes endormis dans la religion.
Lorsque la religion condamne des choses que les lois civiles doivent permettre, il est dangereux que les lois civiles ne permettent de leur côté ce que la religion doit condamner ; une de ces choses marquant toujours un défaut d’harmonie & de justesse dans les idées, qui se répand sur l’autre.
Ainsi les Tartares [1] de Gengiskan, chez lesquels c’étoit un péché, & même un crime capital, de mettre le couteau dans le feu, de s’appuyer contre un fouet, de battre un cheval avec sa bride, de rompre un os avec un autre, ne croyoient pas qu’il y eût de péché à [III-173] violer la foi, à ravir le bien d’autrui, à faire injure à un homme, à le tuer. En un mot, les lois qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, ont cet inconvénient, qu’elles font considérer comme indifférent ce qui est nécessaire.
Ceux de Formose [2] croient une espece d’enfer ; mais c’est pour punir ceux qui ont manqué d’aller nuds en certaines saisons, qui ont mis des vêtemens de toile & non pas de soie, qui ont été chercher des huîtres, qui ont agi sans consulter le chant des oiseaux : aussi ne regardent-ils point comme péché l’ivrognerie & le déréglement avec les femmes ; ils croient même que les débauches de leurs enfans sont agréables à leurs dieux.
Lorsque la religion justifie pour une chose d’accident, elle perd inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les hommes. On croit chez les Indiens, que les eaux du Gange ont une vertu sanctifiante [3] ; ceux qui meurent sur ses bords, sont réputés exempts des peines de l’autre vie, & devoir habiter une [III-174] région pleine de délices : on envoie des lieux les plus reculés des urnes pleines des cendres des morts, pour les jeter dans le Gange. Qu’importe qu’on vive vertueusement, ou non ? on se fera jeter dans le Gange.
L’idée d’un lieu de récompense emporte nécessairement l’idée d’un séjour de peines ; & quand on espere l’un sans craindre l’autre, les lois civiles n’ont plus de force. Des hommes qui croient des récompenses sures dans l’autre vie, échapperont au législateur : ils auront trop de mépris pour la mort. Quel moyen de contenir par les lois un homme qui croit être sûr que la plus grande peine que les magistrats lui pourront infliger, ne finira dans un moment que pour commencer son bonheur ?
-
[↑] Voyez la relation de frere Jean Duplan Carpin, envoyé en Tartarie par le pape Innocent IV, en l’année 1246.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. V. partie I. pag. 192
-
[↑] Lettres édif. quinzieme recueil.
[III-174]
CHAPITRE XV.
Comment les lois civiles corrigent quelquefois les fausses religions.
Le respect pour les choses anciennes, la simplicité ou la superstition, ont quelquefois établi des mysteres ou des cérémonies qui pouvoient choquer la [III-175] pudeur ; & de cela les exemples n’ont pas été rares dans le monde. Aristote [1] dit que, dans ce cas, la loi permet que les peres de famille aillent au temple célébrer ces mysteres pour leurs femmes & pour leurs enfans. Loi civile admirable, qui conserve les mœurs contre la religion !
Auguste [2] défendit aux jeunes gens de l’un & l’autre sexe d’assister à aucune cérémonie nocturne, s’ils n’étoient accompagnés d’un parent plus âgé ; & lorsqu’il rétablit les fêtes [3] lupercales, il ne voulut pas que les jeunes gens courussent nuds.
[III-175]
CHAPITRE XVI.
Comment les lois de la religion corrigent les inconvéniens de la constitution politique.
D’un autre côté, la religion peut soutenir l’état politique, lorsque les lois se trouvent dans l’impuissance.
Ainsi, lorsque l’état est souvent agité [III-176] par des guerres civiles, la religion fera beaucoup, si elle établit que quelque partie de cet état reste toujours en paix. Chez les Grecs, les Eléens, comme prêtres d’Apollon, jouissoient d’une paix éternelle. Au Japon [1] , on laisse toujours en paix la ville de Méaco, qui est une ville sainte : la religion maintient ce règlement ; & cet empire, qui semble être seul sur la terre, qui n’a & qui ne veut avoir aucune ressource de la part des étrangers, a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne ruine pas.
Dans les états où les guerres ne se font pas par une délibération commune, & où les lois ne se sont laissé aucun moyen de les terminer ou de les prévenir, la religion établit des temps de paix ou de treves, pour que le peuple puisse faire les choses sans lesquelles l’état ne pourroit subsister, comme les semailles & des travaux pareils.
Chaque année, pendant quatre mois, toute hostilité cessoit entre les tribus [2] Arabes : le moindre trouble eût été une impiété. Quand chaque seigneur faisoit [III-177] en France la guerre ou la paix, la religion donna des treves, qui devoient avoir lieu dans de certaines saisons.
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. IV. part. I. pag. 127.
-
[↑] Voyez Prideaux, vie de Mahomet, p. 64.
[III-177]
CHAPITRE XVII.
Continuation du même sujet.
Lorsqu’il y a beaucoup de sujets de haine dans un état, il faut que la religion donne beaucoup de moyens de réconciliation. Les Arabes, peuple brigand, se faisoient souvent des injures & des injustices. Mahomet [1] fit cette loi : « Si quelqu’un pardonne le sang de son frere [2] , il pourra poursuivre le malfaicteur pour des dommages & intérêts : mais celui qui fera tort au méchant après avoir reçu satisfaction de lui, souffrira au jour du jugement des tourmens douloureux. »
Chez les Germains, on héritoit des haines & des inimités de ses proches : mais elles n’étoient pas éternelles. On expioit l’homicide, en donnant une certaine quantité de bétail, & toute la famille recevoit la satisfaction : chose [III-178] très-utile, dit Tacite [3] , parce que les inimitiés sont fort dangereuses chez un peuple libre. Je crois bien que les ministres de la religion, qui avoient tant de crédit parmi eux, entroient dans ces réconciliations.
Chez les Malaïs [4] , où la réconciliation n’est pas établie, celui qui a tué quelqu’un, sûr d’être assassiné par les parens ou les amis du mort, s’abandonne à sa fureur, blesse & tue tout ce qu’il rencontre.
-
[↑] Dans l’alcoran, liv. I. chap. de la vache.
-
[↑] En renonçant à la loi du talion.
-
[↑] De moribus German
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. VII. pag. 303. Voyez aussi les mémoires du comte de Forbin, & ce qu’il dit sur les Macassars.
[III-178]
CHAPITRE XVIII.
Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles.
Les premiers Grecs étoient de petits peuples souvent dispersés, pirates sur la mer, injustes sur la terre, sans police & sans lois. Les belles actions d’Hercule & de Thésée font voir l’état où se trouvoit ce peuple naissant. Que pouvoit faire la religion, que ce qu’elle [III-179] fit pour donner de l’horreur du meurtre ? Elle établit qu’un homme tué par violence [1] étoit d’abord en colere contre le meurtrier, qu’il lui inspiroit du trouble & de la terreur, & vouloit qu’il lui cédât les lieux qu’il avoit fréquentés ; on ne pouvoit toucher le criminel, ni converser avec lui, sans être souillé [2] ou intestable ; la présence du meurtrier devoit être épargnée à la ville, & il falloit l’expier [3] .
-
[↑] Platon, des lois, liv. IX.
-
[↑] Voyez la tragédie d’Œdipe, à Colonne.
-
[↑] Platon, des lois, liv. IX.
[III-179]
CHAPITRE XIX.
Que c’est moins la vérité ou la fausseté d’un dogme, qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans l’état civil, que l’usage ou l’abus que l’on en fait.
Les dogmes les plus vrais & les plus saints peuvent avoir de très-mauvaises conséquences, lorsqu’on ne les lie pas avec les principes de la société ; & au contraire, les dogmes les plus faux en peuvent avoir d’admirables, [III-180] lorsqu’on sait qu’ils se rapportent aux mêmes principes.
La religion de Confucius [1] nie l’immortalité de l’ame ; & la secte de Zénon ne la croyoit pas. Qui le diroit ? ces deux sectes ont tiré de leurs mauvais principes des conséquences, non pas justes, mais admirables pour la société. La religion des Tao & des Foë croit l’immortalité de l’ame : mais de ce dogme si saint, ils ont tiré des conséquences affreuses.
Presque par tout le monde & dans tous les temps, l’opinion de l’immortalité de l’ame mal prise a engagé les femmes, les esclaves, les sujets, les amis, à se tuer, pour aller servir dans l’autre monde l’objet de leur respect ou de leur amour. Cela étoit ainsi dans les Indes occidentales ; cela étoit ainsi chez [III-181] les Danois [2] ; & cela est encore aujourd’hui au Japon [3] , à Macassar [4] & dans plusieurs autres endroits de la terre.
Ces coutumes émanent moins directement du dogme de l’immortalité de l’ame, que de celui de la résurrection des corps ; d’où l’on a tiré cette conséquence, qu’après la mort un même individu auroit les mêmes besoins, les mêmes sentimens, les mêmes passions. Dans ce point de vue, le dogme de l’immortalité de l’ame affecte prodigieusement les hommes ; parce que l’idée d’un simple changement de demeure est plus à la portée de notre esprit, & flatte plus notre cœur, que l’idée d’une modification nouvelle.
Ce n’est pas assez pour une religion d’établir un dogme ; il faut encore qu’elle le dirige. C’est ce qu’a fait admirablement bien la religion Chrétienne à l’égard des dogmes dont nous parlons : elle nous fait espérer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissions : tout, jusqu’à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.
-
[↑] Un philosophe Chinois argumente ainsi contre la doctrine de Foë. « Il est dit dans un livre de cette secte, que notre corps est notre domicile, & l’ame l’hôtesse immortelle qui y loge ; mais si le corps de nos parens n’est qu’un logement, il est naturel de le regarder avec le même mépris qu’on a pour un amas de boue & de terre. N’est-ce pas vouloir arracher du cœur la vertu de l’amour des parens ? Cela porte de même à négliger le soin du corps, & à lui refuser la compassion & l’affection si nécessaires pour sa conservation : ainsi les disciples de Foë se tuent à milliers. » Ouvrage d’un philosophe Chinois, dans le recueil du Pere du Halde, tom. III. p. 52.
-
[↑] Voyez Thomas Bartholin, antiquités Danoises.
-
[↑] Relation du Japon, dans le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes.
-
[↑] Mémoires de Forbin.
[III-182]
CHAPITRE XX.
Continuation du même sujet.
Les livres [1] sacrés des anciens Perses, disoient : « Si vous voulez être saint, instruisez vos enfans, parce que toutes les bonnes actions qu’ils feront vous seront imputées. » Ils conseilloient de se marier de bonne heure ; parce que les enfans seroient comme un pont au jour du jugement, & que ceux qui n’auroient point d’enfans ne pourroient pas passer. Ces dogmes étoient faux, mais ils étoient très-utiles.
-
[↑] M. Hyde.
[III-182]
CHAPITRE XXI.
De la métempsycose.
Le dogme de l’immortalité de l’ame se divise en trois branches, celui de l’immortalité pure, celui du simple changement de demeure, celui de la métempsycose ; c’est-à-dire, le systême des Chrétiens, le systême des Scythes, le systême des Indiens. Je [III-183] viens de parler des deux premiers ; & je dirai du troisieme que, comme il a été bien & mal digéré, il a aux Indes de bons & de mauvais effets : comme il donne aux hommes une certaine horreur pour verser le sang, il y a aux Indes très-peu de meurtres ; & quoiqu’on n’y punisse guere de mort, tout le monde y est tranquille.
D’un autre côté, les femmes s’y brûlent à la mort de leurs maris : il n’y a que les innocens qui y souffrent une mort violente.
[III-183]
CHAPITRE XXII.
Combien il est dangereux que la religion inspire de l’horreur pour des choses indifférentes.
Un certain honneur que des préjugés de religion établissent aux Indes, fait que les diverses castes ont horreur les unes des autres. Cet honneur est uniquement fondé sur la religion ; ces distinctions de famille ne forment pas des distinctions civiles : il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s’il mangeoit avec son roi.
[III-184]
Ces sortes de distinctions sont liées à une certaine aversion pour les autres hommes, bien différente des sentimens que doivent faire naître les différences des rangs, qui parmi nous contiennent l’amour pour les inférieurs.
Les lois de la religion éviteront d’inspirer d’autre mépris que celui du vice, & sur-tout d’éloigner les hommes de l’amour & de la pitié pour les hommes.
La religion Mahométane & la religion Indienne ont dans leur sein un nombre infini de peuples : les Indiens haïssent les Mahométans, parce qu’ils mangent de la vache ; les Mahométans détestent les Indiens, parce qu’ils mangent du cochon.
[III-184]
CHAPITRE XXIII.
Des fêtes.
Quand une religion ordonne la cessation du travail, elle doit avoir égard aux besoins des hommes, plus qu’à la grandeur de l’Être qu’elle honore.
C’étoit à Athenes [1] un grand inconvénient que le trop grand nombre de [III-185] fêtes. Chez ce peuple dominateur, devant qui toutes les villes de la Grece venoient porter leurs différents, on ne pouvoit suffire aux affaires.
Lorsque Constantin établit que l’on chomeroit le dimanche, il fit cette ordonnance pour les villes [2] , & non pour les peuples de la campagne : il sentoit que dans les villes étoient les travaux utiles, & dans les campagnes les travaux nécessaires.
Par la même raison, dans les pays qui se maintiennent par le commerce, le nombre des fêtes doit être relatif à ce commerce même. Les pays protestans & les pays catholiques sont situés [3] de maniere que l’on a plus besoin de travail dans les premiers que dans les seconds : la suppression des fêtes convenoit donc plus aux pays protestans qu’aux pays catholiques.
Dampierre [4] remarque que les divertissemens des peuples varient beaucoup selon les climats. Comme les climats chauds produisent quantité de [III-186] fruits délicats, les barbares, qui trouvent d’abord le nécessaire, emploient plus de temps à se divertir : les Indiens des pays froids n’ont pas tant de loisir, il faut qu’ils pêchent & chassent continuellement ; il y a donc chez eux moins de danses, de musique & de festins ; & une religion qui s’établiroit chez ces peuples, devroit avoir égard à cela dans l’institution des fêtes.
-
[↑] Xénophon, de la république d’Athenes.
-
[↑] Leg. 3. cod. de feriis. Cette loi n’étoit faite sans doute que pour les païens.
-
[↑] Les catholiques sont plus vers le midi, & les protestans vers le nord.
-
[↑] Nouveaux voyages autour du monde, tome II.
[III-186]
CHAPITRE XXIV.
Des lois de religion locales.
Il y a beaucoup de lois locales dans les diverses religions. Et quand Montésuma s’obstinoit tant à dire que la religion des Espagnols étoit bonne pour leur pays, & celle du Mexique pour le sien, il ne disoit pas une absurdité ; parce qu’en effet les législateurs n’ont pu s’empêcher d’avoir égard à ce que la nature avoir établi avant eux.
L’opinion de la métempsycose est faite pour le climat des Indes. L’excessive chaleur brûle [1] toutes les campagnes ; on n’y peut nourrir que très-peu [III-187] de bétail ; on est toujours en danger d’en manquer pour le labourage ; les bœufs ne s’y multiplient [2] que médiocrement, ils sont sujets à beaucoup de maladies : une loi de religion qui les conserve, est donc très-convenable à la police du pays.
Pendant que les prairies sont brûlées, le riz & les légumes y croissent heureusement, par les eaux qu’on y peut employer : une loi de religion qui ne permet que cette nourriture, est donc très-utile aux hommes dans ces climats.
La chair [3] des bestiaux n’y a pas de goût ; & le lait & le beurre qu’ils en tirent, fait une partie de leur subsistance : la loi qui défend de manger & de tuer des vaches, n’est donc pas déraisonnable aux Indes.
Athenes avoit dans son sein une multitude innombrable de peuple ; son territoire étoit stérile : ce fut une maxime religieuse, que ceux qui offroient aux dieux de certains petits présens, les honoroient [4] plus que ceux qui immoloient des bœufs.
-
[↑] Voyage de Bernier, tom. II. pag. 137.
-
[↑] Lett. édif. douzieme recueil, pag. 95.
-
[↑] Voyage de Bernier, tome II. pag. 137.
-
[↑] Euripide dans Athénée, liv. II. pag. 40.
[III-188]
CHAPITRE XXV.
Inconvénient du transport d’une religion d’un pays à un autre.
Il suit de là, qu’il y a très-souvent beaucoup d’inconvéniens à transporter une religion [1] d’un pays dans un autre.
« Le cochon, dit [2] M. de Boulainvilliers, doit être très-rare en Arabie, où il n’y a presque point de bois, & presque rien de propre à la nourriture de ces animaux ; d’ailleurs, la salure des eaux & des alimens, rend le peuple très-susceptible des maladies de la peau. » La loi locale qui le défend, ne sauroit être bonne pour d’autres [3] pays, où le cochon est une nourriture presqu’universelle, & en quelque façon nécessaire.
Je ferai ici une réflexion. Sanctorius a observé que la chair de cochon que l’on mange, se transpire [4] peu ; & que [III-189] même cette nourriture empêche beaucoup la transpiration des autres alimens ; il a trouvé que la diminution alloit à un tiers ; l’on sait d’ailleurs que le défaut de transpiration forme ou aigrit les maladies de la peau : la nourriture du cochon doit donc être défendue dans les climats où l’on est sujet à ces maladies, comme celui de la Palestine, de l’Arabie, de l’Égypte & de la Lybie.
-
[↑] On ne parle point ici de la religion Chrétienne, parce que, comme on a dit au liv. XXIV, chap. i. à la fin, la religion Chrétienne est le premier bien.
-
[↑] Vie de Mahomet.
-
[↑] Comme à la Chine.
-
[↑] Médec. Statiq. sect. 3. aphor. 23.
[III-189]
CHAPITRE XXVI.
Continuation du même sujet.
M. Chardin [1] dit qu’il n’y a point de fleuve navigable en Perse, si ce n’est le fleuve Kur, qui est aux extrémités de l’empire. L’ancienne loi des Guebres qui défendoit de naviguer sur les fleuves, n’avoit donc aucun inconvénient dans leur pays : mais elle auroit ruiné le commerce dans un autre.
Les continuelles lotions sont très en usage dans les climats chauds. Cela fait que la loi Mahométane & la religion [III-190] Indienne les ordonnent. C’est un acte très-méritoire aux Indes de prier [2] Dieu dans l’eau courante : mais comment exécuter ces choses dans d’autres climats ?
Lorsque la religion fondée sur le climat a trop choqué le climat d’un autre pays, elle n’a pu s’y établir ; & quand on l’y a introduite, elle en a été chassée. Il semble, humainement parlant, que ce soit le climat qui a prescrit des bornes à la religion Chrétienne & à la religion Mahométane.
Il suit de là, qu’il est presque toujours convenable qu’une religion ait des dogmes particuliers, & un culte général. Dans les lois qui concernent les pratiques de culte, il faut peu de détails ; par exemples, des mortifications, & non pas une certaine mortification. Le Christianisme est plein de bon sens : l’abstinence est de droit divin ; mais une abstinence particuliere est de droit de police, & on peut la changer.
[III-191]
LIVRE XXV.
Des Lois, dans le rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de chaque pays, & sa police extérieure.↩
CHAPITRE PREMIER.
Du sentiment pour la religion.
L’homme pieux & l’athée parlent toujours de religion ; l’un parle de ce qu’il aime, & l’autre de ce qu’il craint.
[III-191]
CHAPITRE II.
Du motif d’attachement pour les diverses religions.
Les diverses religions du monde ne donnent pas à ceux qui les professent des motifs égaux d’attachement pour elles : cela dépend beaucoup de la maniere dont elles se concilient avec la façon de penser & de sentir des hommes.
[III-192]
Nous sommes extrêmement portés à l’idolâtrie, & cependant nous ne sommes pas fort attachés aux religions idolâtres ; nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles, & cependant nous sommes très-attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel. C’est un sentiment heureux, qui vient en partie de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d’avoir été assez intelligens pour avoir choisi une religion qui tire la divinité de l’humiliation où les autres l’avoient mise. Nous regardons l’idolâtrie comme la religion des peuples grossiers ; & la religion qui a pour objet un être spirituel, comme celle des peuples éclairés.
Quand, avec l’idée d’un être spirituel suprême, qui forme le dogme, nous pouvons joindre encore des idées sensibles qui entrent dans le culte, cela nous donne un grand attachement pour la religion ; parce que les motifs dont nous venons de parler, se trouvent joints à notre penchant naturel pour les choses sensibles. Aussi les catholiques, qui ont plus de cette sorte de culte que les protestans, sont-ils plus invinciblement attachés à leur religion que les [III-193] protestans ne le sont à la leur, & plus zélés pour sa propagations.
Lorsque [1] le peuple d’Ephese eut appris que les peres du concile avoient décidé qu’on pouvoit appeler la Vierge mere de Dieu, il fut transporté de joie ; il baisoit les mains des évêques, il embrassoit leurs genoux ; tout retentissoit d’acclamations.
Quand une religion intellectuelle nous donne encore l’idée d’un choix fait par la Divinité, & d’une distinction de ceux qui la professent d’avec ceux qui ne la professent pas, cela nous attache beaucoup à cette religion. Les Mahométans ne seroient pas si bons Musulmans, si d’un côté il n’y avoit pas de peuples idolâtres, qui leur font penser qu’ils sont les vengeurs de l’unité de Dieu ; & de l’autre des Chrétiens, pour leur faire croire qu’ils font l’objet de ses préférences.
Une religion chargée de beaucoup [2] de pratiques, attache plus à elle qu’une autre qui l’est moins : on tient beaucoup [III-194] aux choses dont on est continuellement occupé ; témoin l’obstination tenace des Mahométans [3] & des Juifs, & la facilité qu’ont de changer de religion les peuples barbares & sauvages qui, uniquement occupés de la chasse ou de la guerre, ne se chargent guere de pratiques religieuses.
Les hommes sont extrêmement portés à espérer & à craindre ; & une religion qui n’auroit ni enfer ni paradis, ne sauroit guere leur plaire. Cela se prouve par la facilité qu’ont eue les religions étrangeres à s’établir au Japon, & le zele & l’amour avec lesquels on les y a reçues [4] .
Pour qu’une religion attache, il faut qu’elle ait une morale pure. Les hommes, fripons en détail, sont en gros de très-honnêtes gens ; ils aiment la morale ; & si je ne traitois pas un sujet si grave, je dirois que cela se voit [III-195] admirablement bien sur les théâtres : on est sûr de plaire au peuple par les sentimens que la morale avoue, & on est sûr de le choquer par ceux qu’elle réprouve.
Lorsque le culte extérieur a une grande magnificence, cela nous flatte & nous donne beaucoup d’attachement pour la religion. Les richesses des temples & celles du clergé, nous affectent beaucoup. Ainsi la misere même des peuples est un motif qui les attache à cette religion qui a servi de prétexte à ceux qui ont causé leur misere.
-
[↑] Lettre de S. Cyrille.
-
[↑] Ceci n’est point contradictoire avec ce que j’ai dit au chapitre pénultieme du livre précédent ; ici je parle des motifs d’attachement pour une religion, & là des moyens de la rendre plus générale.
-
[↑] Cela se remarque par toute la terre. Voyez sur les Turcs les missions du Levant ; le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome III. part. I. pag. 201, sur les Maures de Batavia ; & le P. Labat, sur les negres Mahométans, &c.
-
[↑] La religion Chrétienne & les religions des Indes ; celles-ci ont un enfer & un paradis, au lieu que la religion des Sintos n’en a point.
[III-195]
CHAPITRE III.
Des Temples.
Presque tous les peuples policés habitent dans des maisons. De-là est venue naturellement l’idée de bâtir à Dieu une maison, où ils puissent l’adorer & l’aller chercher dans leurs craintes ou leurs espérances.
En effet, rien n’est plus consolant pour les hommes, qu’un lieu où ils trouvent la Divinité plus présente, & où tous ensemble ils font parler leur foiblesse & leur misere.
[III-196]
Mais cette idée si naturelle ne vient qu’aux peuples qui cultivent les terres ; & on ne verra pas bâtir de temple chez ceux qui n’ont pas de maisons eux-mêmes.
C’est ce qui fit que Gengis-kan marqua un si grand mépris pour les mosquées [1] . Ce prince [2] interrogea les Mahométans ; il approuva tous leurs dogmes, excepté celui qui porte la nécessité d’aller à la Mecque ; il ne pouvoit pas comprendre qu’on ne pût pas adorer Dieu par-tout : les Tartares n’habitant point de maisons, ne connoissoient point de temples.
Les peuples qui n’ont point de temples, ont peu d’attachement pour leur religion : voilà pourquoi les Tartares ont été de tout temps si tolérans [3] ; pourquoi les peuples barbares qui conquirent l’empire Romain ne balancerent pas un moment à embrasser le Christianisme ; pourquoi les sauvages de l’Amérique sont si peu attachés à leur [III-197] propre religion ; & pourquoi, depuis que nos missionnaires leur ont fait bâtir au Paraguay des églises, ils sont si fort zélés pour la nôtre.
Comme la divinité est le réfuge des malheureux, & qu’il n’y a pas de gens plus malheureux que les criminels, on a été naturellement porté à penser que les temples étoient un asile pour eux ; & cette idée parut encore plus naturelle chez les Grecs, où les meurtriers, chassés de leur ville & de la présence des hommes, sembloient n’avoir plus de maisons que les temples, ni d’autres protecteurs que les dieux.
Ceci ne regarda d’abord que les homicides involontaires : mais lorsqu’on y comprit les grands criminels, on tomba dans une contradiction grossiere : s’ils avoient offensé les hommes, ils avoient à plus forte raison offensé les dieux.
Ces asiles se multiplierent dans la Grece : les temples, dit [4] Tacite, étoient remplis de débiteurs insolvables & d’esclaves méchans ; les magistrats avoient de la peine à exercer la police ; le peuple protégeoit les crimes des hommes, comme les cérémonies des dieux ; [III-198] le sénat fut obligé d’en retrancher un grand nombre.
Les lois de Moyse furent très-sages. Les homicides involontaires étoient innocens, mais ils devoient être ôtés de devant les yeux des parens du mort : il établit donc un asyle [5] pour eux. Les grands criminels ne méritent point d’asyle, ils n’en eurent pas [6] : les Juifs n’avoient qu’un tabernacle portatif, & qui changeoit continuellement de lieu ; cela excluoit l’idée d’asyle. Il est vrai qu’ils devoient avoir un temple : mais les criminels qui y seroient venus de toutes parts, auroient pu troubler le service divin. Si les homicides avoient été chassés hors du pays, comme ils le furent chez les Grecs, il eût été à craindre qu’ils n’adorassent des dieux étrangers. Toutes ces considérations firent établir des villes d’asyle, ou l’on devoit rester jusqu’à la mort du souverain pontife.
-
[↑] Entrant dans la mosquée de Buchara, il enleva l’alcoran, & le jeta sous les pieds de ses chevaux ; histoire des Tattars, part. III. p. 273.
-
[↑] Ibid. page 342.
-
[↑] Cette disposition d’esprit a passé jusqu’aux Japonois, qui tirent leur origine des Tartares, comme il est aisé de le prouver.
-
[↑] Annal. liv. II.
-
[↑] Nomb. Chap. xxxv.
-
[↑] Ibid.
[III-199]
CHAPITRE IV.
Des Ministres de la Religion.
Les premiers hommes, dit Porphyre, ne sacrifoient que de l’herbe. Pour un culte si simple, chacun pouvoit être pontife dans sa famille.
Le désir naturel de plaire à la Divinité, multiplia les cérémonies : ce qui fit que les hommes, occupés à l’agriculture, devinrent incapables de les exécuter toutes, & d’en remplir les détails.
On consacra aux dieux des lieux particuliers ; il fallut qu’il y eût des ministres pour en prendre soin, comme chaque citoyen prend soin de sa maison & de ses affaires domestiques. Aussi les peuples qui n’ont point de prêtres, sont-ils ordinairement barbares. Tels étoient autrefois les Pédaliens [1] , tels sont encore les Wolgusky [2] .
Des gens consacrés à la divinité, devoient être honorés, sur-tout chez les [III-200] peuples qui s’étoient formé une certaine idée d’une pureté corporelle, nécessaire pour approcher des lieux les plus agréables aux dieux, & dépendante de certaines pratiques.
Le culte des dieux demandant une attention continuelle, la plupart des peuples furent portés à faire du clergé un corps séparé. Ainsi, chez les Égyptiens, les Juifs & les Perses [3] , on consacra à la divinité de certaines familles, qui se perpétuoient, & faisoient le service. Il y eut même des religions où l’on ne pensa pas seulement à éloigner les ecclésiastiques des affaires, mais encore à leur ôter l’embarras d’une famille, & c’est la pratique de la principale branche de la loi Chrétienne.
Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat : on sent qu’elle pourroit devenir nuisible, à proportion que le corps du clergé seroit trop étendu, & que par conséquent celui des laïques ne le seroit pas assez.
Par la nature de l’entendement humain, nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort ; comme en matiere de morale, nous aimons [III-201] spéculativement tout ce qui porte le caractere de la sévérité. Le célibat a été plus agréable aux peuples à qui il sembloit convenir le moins, & pour lesquels il pouvoit avoir de plus fâcheuses suites. Dans les pays du midi de l’Europe, où, par la nature du climat, la loi du célibat est plus difficile à observer, elle a été retenue ; dans ceux du nord, où les passions sont moins vives, elle a été proscrite. Il y a plus : dans les pays où il y a peu d’habitans, elle a été admise ; dans ceux où il y en a beaucoup, on l’a rejettée. On sent que toutes ces réflexions ne portent que sur la trop grande extension du célibat, & non sur le célibat même.
-
[↑] Lilius Giraldus, page 726.
-
[↑] Peuples de la Sibérie. Voyez la relation de M. Everard Isbrands-Ides, dans le recueil des voyages du nord, tome VIII.
-
[↑] Voyez M. Hyde.
[III-201]
CHAPITRE V.
Des bornes que les lois doivent mettre aux richesses du clergé.
Les familles particulieres peuvent périr : ainsi les biens n’y ont point une destination perpétuelle. Le clergé est une famille qui ne peut pas périr : les biens y sont donc attachés pour toujours, & n’en peuvent pas sortir.
[III-202]
Les familles particulieres peuvent s’augmenter : il faut donc que leurs biens puissent croître aussi. Le clergé est une famille qui ne doit point s’augmenter : les biens doivent donc y être bornés.
Nous avons retenu les dispositions du Lévitique sur les biens du clergé, excepté celles qui regardent les bornes de ces biens : effectivement, on ignorera toujours parmi nous quel est le terme après lequel il n’est plus permis à une communauté religieuse d’acquérir.
Ces acquisitions sans fin paroissent aux peuples si déraisonnables, que celui qui voudroit parler pour elles, seroit regardé comme un imbécile.
Les lois civiles trouvent quelquefois des obstacles à changer des abus établis, parce qu’ils sont liés à des choses qu’elles doivent respecter : dans ce cas, une disposition indirecte marque plus le bon esprit du législateur, qu’une autre qui frapperoit sur la chose même. Au lieu de défendre les acquisitions du clergé, il faut chercher à l’en dégoûter lui-même ; laisser le droit, & ôter le fait.
Dans quelques pays de l’Europe, la considération des droits des seigneurs a fait établir en leur faveur un droit [III-203] d’indemnité sur les immeubles acquis par les gens de main-morte. L’intérêt du prince lui a fait exiger un droit d’amortissement dans le même cas. En Castille, où il n’y a point de droit pareil, le clergé a tout envahi ; en Arragon, où il y a quelque droit d’amortissement, il a acquis moins ; en France, où ce droit & celui d’indemnité sont établis, il a moins acquis encore ; & l’on peut dire que la prospérité de cet état est due en partie à l’exercice de ces deux droits. Augmentez-les ces droits, & arrêtez la main-morte, s’il est possible.
Rendez sacré & inviolable l’ancien & nécessaire domaine du clergé ; qu’il soit fixe & éternel comme lui : mais laissez sortir de ses mains les nouveaux domaines.
Permettez de violer la regle, lorsque la regle est devenue un abus ; souffrez l’abus, lorsqu’il rentre dans la regle.
On se souvient toujours à Rome d’un mémoire qui y fut envoyé à l’occasion de quelque démêlés avec le clergé. On y avoit mis cette maxime : « Le clergé doit contribuer aux charges de l’état, quoi qu’en dise l’ancien testament ». On en conclut que l’auteur du mémoire [III-204] entendoit mieux le langage de la maltôte que celui de la religion.
[III-204]
CHAPITRE VI.
Des Monasteres.
Le moindre bon sens fait voir que ces corps qui se perpétuent sans fin, ne doivent pas vendre leurs fonds à vie, ni faire des emprunts à vie, à moins qu’on ne veuille qu’ils se rendent héritiers de tous ceux qui n’ont point de parens, & de tous ceux qui n’en veulent point avoir : ces gens jouent contre le peuple, mais ils tiennent la banque contre lui.
[III-204]
CHAPITRE VII.
Du luxe de la superstition.
Ceux-la sont impies envers les dieux, dit Platon [1] , qui nient leur existence ; ou qui l’accordent, mais soutiennent qu’ils ne se mêlent point des choses d’ici-bas ; ou enfin qui pensent qu’on les appaise aisément par des sacrifices : trois opinions [III-205] également pernicieuses ». Platon dit là tout ce que la lumiere naturelle a jamais dit de plus sensé en matiere de religion.
La magnificence du culte extérieur a beaucoup de rapport à la constitution de l’état. Dans les bonnes républiques, on n’a pas seulement réprimé le luxe de la vanité, mais encore celui de la superstition : on a fait dans la religion des lois d’épargne. De ce nombre, sont plusieurs lois de Solon, plusieurs lois de Platon sur les funérailles, que Cicéron a adoptées ; enfin quelques lois de Numa [2] sur les sacrifices.
« Des oiseaux, dit Cicéron, & des peintures faites en un jour, sont des dons très-divins. Nous offrons des choses communes, disoit un Spartiate, afin que nous ayons tous les jours le moyen d’honorer les dieux ».
Le soin que les hommes doivent avoir de rendre un culte à la divinité, est bien différent de la magnificence de ce culte. Ne lui offrons point nos trésors, si nous ne voulons lui faire voir l’estime que nous faisons des choses qu’elle veut que nous méprisions.
[III-206]
« Que doivent penser les dieux des dons des impies, dit admirablement Platon, puisqu’un homme de bien rougiroit de recevoir des présens d’un malhonnête homme ? »
Il ne faut pas que la religion, sous prétexte de dons, exige des peuples ce que les nécessités de l’état leur ont laissé ; &, comme dit Platon [3] , des hommes chastes & pieux doivent offrir des choses qui leur ressemblent.
Il ne faudroit pas non plus que la religion encourageât les dépenses des funérailles. Qu’y a-t-il de plus naturel, que d’ôter la différence des fortunes dans une chose & dans les momens qui égalisent toutes les fortunes ?
[III-206]
CHAPITRE VIII.
Du Pontificat.
Lorsque la religion a beaucoup de ministres, il est naturel qu’ils ayent un chef, & que le pontificat y soit établi. Dans la monarchie, où l’on ne sauroit trop séparer les ordres de l’état, & où l’on ne doit point assembler sur [III-207] une même tête toutes les puissances, il est bon que le pontificat soit séparé de l’empire. La même nécessité ne se rencontre pas dans le gouvernement despotique, dont la nature est de réunir sur une même tête tous les pouvoirs. Mais, dans ce cas, il pourroit arriver que le prince regarderoit la religion comme ses lois mêmes, & comme des effets de sa volonté. Pour prévenir cet inconvénient, il faut qu’il y ait des monumens de la religion, par exemple, des livres sacrés qui la fixent & qui l’établissent. Le roi de Perse est le chef de la religion ; mais l’alcoran regle la religion : l’empereur de la Chine est le souverain pontife ; mais il y a des livres qui sont entre les mains de tout le monde, auxquels il doit lui-même se conformer. En vain un empereur voulut-il les abolir, ils triompherent de la tyrannie.
[III-208]
CHAPITRE IX.
De la tolérance en fait de religion.
Nous sommes ici politiques, & non pas théologiens : & pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion & l’approuver.
Lorsque les lois d’un état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu’elles les obligent aussi à se tolérer entr’elles. C’est un principe, que toute religion qui est réprimée, devient elle-même réprimante : car sitôt que, par quelque hasard, elle peut sortir de l’oppression, elle attaque la religion qui l’a réprimée, non pas comme une religion, mais comme une tyrannie.
Il est donc utile que les lois exigent de ces diverses religions, non-seulement qu’elles ne troublent pas l’état, mais aussi qu’elles ne se troublent pas entr’elles. Un citoyen ne satisfait point aux lois, en se contentant de ne pas agiter le corps de l’état ; il faut encore qu’il ne trouble pas quelque citoyen que ce soit.
[III-209]
CHAPITRE X.
Continuation du même sujet.
Comme il n’y a guere que les religions intolérantes qui ayent un grand zele pour s’établir ailleurs, parce qu’une religion qui peut tolérer les autres ne songe guere à sa propagation ; ce sera une très-bonne loi civile, lorsque l’état est satisfait de la religion déjà établie, de ne point souffrir l’établissement [1] d’une autre.
Voici donc le principe fondamental des lois politiques en fait de religion. Quand on est maître de recevoir dans un état une nouvelle religion, ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l’y établir ; quand elle y est établie, il faut la tolérer.
-
[↑] Je ne parle point dans tout ce chapitre de la religion Chrétienne : parce que, comme j’ai dit ailleurs, la religion Chrétienne est le premier bien. Voyez la fin du chapitre I. du livre précédent, & la défense de l’esprit des lois, seconde partie.
[III-210]
CHAPITRE XI.
Du changement de religion.
Un prince qui entreprend dans son état de détruire ou de changer la religion dominante, s’expose beaucoup. Si son gouvernement est despotique, il court plus de risque de voir une révolution, que par quelque tyrannie que ce soit, qui n’est jamais dans ces sortes d’états une chose nouvelle. La révolution vient de ce qu’un état ne change pas de religion, de mœurs & de manieres dans un instant, & aussi vîte que le prince publie l’ordonnance qui établit une religion nouvelle.
De plus, la religion ancienne est liée avec la constitution de l’état, & la nouvelle n’y tient point : celle-là s’accorde avec le climat, & souvent la nouvelle s’y refuse. Il y a plus : les citoyens se dégoûtent de leurs lois ; ils prennent du mépris pour le gouvernement déjà établi ; on substitue des soupçons contre les deux religions, à une ferme croyance pour une ; en un mot, l’on donne à l’état, au moins pour [III-211] quelque temps, & de mauvais citoyens, & de mauvais fideles.
[III-211]
CHAPITRE XII.
Des lois pénales.
Il faut éviter les lois pénales en fait de religion. Elles impriment de la crainte, il est vrai : mais comme la religion a ses lois pénales aussi qui inspirent de la crainte, l’une est effacée par l’autre. Entre ces deux craintes différentes, les ames deviennent atroces.
La religion a de si grandes menaces, elle a de si grandes promesses, que lorsqu’elles sont présentes à notre esprit, quelque chose que le magistrat puisse faire pour nous contraindre à la quitter, il semble qu’on ne nous laisse rien quand on nous l’ôte, & qu’on ne nous ôte rien lorsqu’on nous la laisse.
Ce n’est donc pas en remplissant l’ame de ce grand objet, en l’approchant du moment où il lui doit être d’une plus grande importance, que l’on parvient à l’en détacher : il est plus sûr d’attaquer une religion par la faveur, par les commodités de la vie, par l’espérance de la [III-212] fortune ; non pas par ce qui avertit, mais par ce qui fait que l’on oublie ; non pas par ce qui indigne, mais par ce qui jette dans la tiédeur, lorsque d’autres passions agissent sur nos ames, & que celles que la religion inspire sont dans le silence. Regle générale : en fait de changement de religion, les invitations sont plus fortes que les peines.
Le caractere de l’esprit humain a paru dans l’ordre même des peines qu’on a employées. Que l’on se rappelle les persécutions du Japon [1] ; on se révolta plus contre les supplices cruels que contre les peines longues, qui lassent plus qu’elles n’effarouchent, qui sont plus difficiles à surmonter, parce qu’elles paroissent moins difficiles.
En un mot, l’histoire nous apprend assez que les lois pénales n’ont jamais eu d’effet que comme destruction.
-
[↑] Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome V., part. I. page 192.
[III-213]
CHAPITRE XIII.
Très-humble remontrance aux Inquisiteurs d’Espagne & de Portugal.
Une Juive de dix-huit ans, brûlée à Lisbonne au dernier auto-da-fé, donna occasion à ce petit ouvrage ; & je crois que c’est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s’agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre.
L’auteur déclare que, quoiqu’il soit Juif, il respecte la religion Chrétienne, & qu’il l’aime assez, pour ôter aux princes qui ne seront pas Chrétiens un prétexte plausible pour la persécuter.
« Vous vous plaignez, dit-il aux Inquisiteurs, de ce que l’empereur du Japon fait brûler à petit feu tous les Chrétiens qui sont dans ses états ; mais il vous répondra : Nous vous traitons, vous qui ne croyez pas comme nous, comme vous traitez vous-mêmes ceux qui ne croient pas comme vous : vous ne pouvez vous plaindre que de votre foiblesse, qui vous empêche de nous exterminer, & qui fait que nous vous exterminons.
[III-214]
» Mais il faut avouer que vous être bien plus cruels que cet empereur. Vous nous faites mourir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez, parce que nous ne croyons pas tout ce que vous croyez. Nous suivons une religion que vous savez vous-mêmes avoir autrefois été chérie de Dieu : nous pensons que Dieu l’aime encore, & vous pensez qu’il ne l’aime plus ; & parce que vous jugez ainsi, vous faites passer par le fer & par le feu ceux qui sont dans cette erreur si pardonnable, de croire que Dieu [1] aime encore ce qu’il a aimé.
» Si vous êtes cruels à notre égard, vous l’êtes bien plus à l’égard de nos enfans ; vous les faites brûler, parce qu’ils suivent les inspirations que leur ont données ceux que la loi naturelle & les lois de tous les peuples leur apprennent à respecter comme des dieux.
» Vous vous privez de l’avantage que vous a donné sur les Mahométans la maniere dont leur religion s’est établie. Quand ils se vantent du nombre de [III-215] leurs fideles, vous leur dites que la force les leur a acquis, & qu’ils ont étendu leur religion par le fer : pourquoi donc établissez-vous la vôtre par le feu ?
» Quand vous voulez nous faire venir à vous, nous vous objectons une source dont vous vous faites gloire de descendre. Vous nous répondez que votre religion est nouvelle, mais qu’elle est divine ; & vous le prouvez parce qu’elle s’est accrue par la persécution des païens & par le sang de vos martyrs : mais aujourd’hui vous prenez le rôle des Dioclétiens, & vous nous faites prendre le vôtre.
» Nous vous conjurons, non pas par le Dieu puissant que nous servons vous & nous, mais par le Christ que vous nous dites avoir pris la condition humaine pour vous proposer des exemples que vous puissiez suivre ; nous vous conjurons d’agir avec nous comme il agiroit lui-même, s’il étoit encore sur la terre. Vous voulez que nous soyons Chrétiens, & vous ne voulez pas l’être.
» Mais si vous ne voulez pas être Chrétiens, soyez au moins des hommes : traitez-nous comme vous feriez, si n’ayant que ces foibles lueurs de [III-216] justice que la nature nous donne, vous n’aviez point une religion pour vous conduire, & une révélation pour vous éclairer.
» Si le ciel vous a assez aimés pour vous faire voir la vérité, il vous a fait une grande grace : mais est-ce aux enfans qui ont l’héritage de leur pere, de haïr ceux qui ne l’ont pas eu ?
» Que si vous avez cette vérité, ne nous la cachez pas par la maniere dont vous nous la proposez. Le caractere de la vérité, c’est son triomphe sur les cœurs & les esprits, & non pas cette impuissance que vous avouez, lorsque vous voulez la faire recevoir par des supplices.
» Si vous êtes raisonnables, vous ne devez pas nous faire mourir, parce que nous ne voulons pas vous trompez. Si votre Christ est le fils de Dieu, nous espérons qu’il nous récompensera de n’avoir pas voulu profaner ses mysteres : & nous croyons que le Dieu que nous servons vous & nous, ne nous punira pas de ce que nous avons souffert la mort pour une religion qu’il nous a autrefois donnée, parce que nous croyons qu’il nous l’a encore donnée.
[III-217]
» Vous vivez dans un siecle où la lumiere naturelle est plus vive qu’elle n’a jamais été, où la philosophie a éclairé les esprits, où la morale de votre évangile a été plus connue, où les droits respectifs des hommes les uns sur les autres, l’empire qu’une conscience a sur une autre conscience, sont mieux établis. Si donc vous ne revenez pas de vos anciens préjugés, qui, si vous n’y prenez garde, sont vos passions, il faut avouer que vous êtes incorrigibles, incapables de toute lumiere & de toute instruction ; & une nation est bien malheureuse, qui donne de l’autorité à des hommes tels que vous.
» Voulez-vous que nous vous disions naïvement notre pensée ? Vous nous regardez plutôt comme vos ennemis, que comme les ennemis de votre religion ; car si vous aimiez votre religion, vous ne la laisseriez pas corrompre par une ignorance grossiere.
» Il faut que nous vous avertissions d’une chose ; c’est que, si quelqu’un dans la postérité ose jamais dire que dans le siecle où nous vivons, les peuples d’Europe étoient policés, on vous citera pour prouver qu’ils étoient [III-218] barbares ; & l’idée que l’on aura de vous, sera telle, qu’elle flétrira votre siecle, & portera la haine sur tous vos contemporains. »
-
[↑] C’est la source de l’aveuglement des Juifs, de ne pas sentir que l’économie de l’évangile est dans l’ordre des desseins de Dieu ; & qu’ainsi elle est une suite de son immutabilité même.
[III-218]
CHAPITRE XIV.
Pourquoi la religion Chrétienne est si odieuse au Japon.
J’ai parlé [1] du caractere atroce des armes Japonoises. Les magistrats regarderent la fermeté qu’inspire le Christianisme lorsqu’il s’agit de renoncer à la foi, comme très-dangereuse : on crut voir augmenter l’audace. La loi du Japon puni sévérement la moindre désobéissance : on ordonna de renoncer à la religion Chrétienne : n’y pas renoncer, c’étoit désobéir ; on châtia ce crime, & la continuation de la désobéissance parut mériter un autre châtiment.
Les punitions chez les Japonois sont regardées comme la vengeance d’une insulte faite au prince. Les chants d’alégresse de nos martyrs parurent être un attentat contre lui : le titre de martyr intimida les magistrats ; dans leur esprit, il signifioit rebelle ; ils firent tout pour [III-219] empêcher qu’on ne l’obtînt. Ce fut alors que les ames s’effaroucherent, & que l’on vit un combat horrible entre les tribunaux qui condamnerent & les accusés qui souffrirent, entre les lois civiles & celles de la religion.
-
[↑] Liv. VI. chap. xxiv.
[III-219]
CHAPITRE XV.
De la propagation de la religion.
Tous les peuples d’orient, excepté les Mahométans, croient toutes les religions en elles-mêmes indifférentes. Ce n’est que comme changement dans le gouvernement, qu’ils craignent l’établissement d’une autre religion. Chez les Japonois, où il y a plusieurs sectes, & où l’état a eu si long-temps un chef ecclésiastique, on ne dispute [1] jamais sur la religion. Il en est de même chez les Siamois [2] . Les Calmouks [3] font plus ; ils se font une affaire de conscience de souffrir toutes sortes de religions : À Calicuth [4] c’est une maxime d’état, que toute religion est bonne.
[III-220]
Mais il n’en résulte pas qu’une religion apportée d’un pays très-éloigné, & totalement différent de climat, de lois, de mœurs & de manieres, ait tout le succès que sa sainteté devroit lui promettre. Cela est sur-tout vrai dans les grands empires despotiques : on tolere d’abord les étrangers, parce qu’on ne fait point d’attention à ce qui ne paroît pas blesser la puissance du prince : on y est dans une ignorance extrême de tout. Un Européen peut se rendre agréable par de certaines connoissances qu’il procure : cela est bon pour les commencemens. Mais sitôt que l’on a quelque succès, que quelque dispute s’éleve, que les gens qui peuvent avoir quelque intérêt sont avertis ; comme cet état, par sa nature, demande sur-tout la tranquillité, & que le moindre trouble peut le renverser, on proscrit d’abord la religion nouvelle & ceux qui l’annoncent ; les disputes entre ceux qui prêchent, venant à éclater, on commence à se dégoûter d’une religion, dont ceux qui la proposent ne conviennent pas.
-
[↑] Voyez Kempfer.
-
[↑] Mémoires du comte de Forbin.
-
[↑] Histoire des Tattars, part. V.
-
[↑] Voyage de François Pyrard, ch. xxvii.
[III-221]
LIVRE XXVI.
Des Lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent.↩
CHAPITRE PREMIER.
Idée de ce Livre.
Les hommes sont gouvernés par diverses sortes de lois ; par le droit naturel ; par le droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appelé canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu’on peut considérer comme le droit civil de l’univers, dans le sens que chaque peuple en est un citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le droit de conquête, fondé sur ce qu’un peuple [III-222] a voulu, a pu, ou a dû faire violence à un autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens & sa vie contre tout autre citoyen ; enfin par le droit domestique, qui vient de ce qu’une société est divisée en diverses familles, qui ont besoin d’un gouvernement particulier.
Il y a donc différens ordres de lois ; & la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, & à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes.
[III-222]
CHAPITRE II.
Des lois divines & des lois humaines.
On ne doit point statuer par les lois divines ce qui doit l’être par les lois humaines, ni régler par les lois humaines ce qui doit l’être par les lois divines.
Ces deux sortes de lois different par leur origine, par leur objet, & par leur nature.
Tout le monde convient bien que les [III-223] lois humaines sont d’une autre nature que les lois de la religion, & c’est un grand principe : mais ce principe lui-même est soumis à d’autres, qu’il faut chercher.
I°. La nature des lois humaines est d’être soumise à tous les accidens qui arrivent, & de varier à mesure que les volontés des hommes changent : au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien ; la religion sur le meilleur. Le bien peut avoir un autre objet, parce qu’il y a plusieurs biens ; mais le meilleur n’est qu’un, il ne peut donc pas changer. On peut bien changer les lois, parce qu’elles ne sont censées qu’être bonnes : mais les institutions de la religion sont toujours supposées être les meilleures.
2°. Il y a des états où les lois ne sont rien, ou ne sont qu’une volonté capricieuse & transitoire du souverain. Si, dans ces états, les lois de la religion étoient de la nature des lois humaines, les lois de la religion ne seroient rien non plus : il est pourtant nécessaire à la société qu’il y ait quelque chose de fixe ; & c’est cette religion qui est quelque chose de fixe.
[III-224]
3°. La force principale de la religion vient de ce qu’on la croit ; la force des lois humaines vient de ce qu’on les craint. L’antiquité convient à la religion, parce que souvent nous croyons plus les choses à mesure qu’elles sont plus reculées : car nous n’avons pas dans la tête des idées accessoires tirées de ces temps-là, qui puissent les contredire. Les lois humaines au contraire, tirent avantage de leur nouveauté, qui annonce une attention particuliere & actuelle du législateur, pour les faire observer.
[III-224]
CHAPITRE III.
Des lois civiles qui sont contraires à la loi naturelle.
Si un esclave, dit Platon [1] , se défend & tue un homme libre, il doit être traité comme un parricide. Voilà une loi civile qui punit la défense naturelle.
La loi qui, sous Henri VIII, condamnoit un homme sans que les témoins lui eussent été confrontés, étoit [III-225] contraire à la défense naturelle : en effet, pour qu’on puisse condamner, il faut bien que les témoins sachent que l’homme contre qui ils déposent, est celui que l’on accuse, & que celui-ci puisse dire, ce n’est pas moi dont vous parlez.
La loi passée sous le même regne, qui condamnoit toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un, ne le déclareroit point au roi, avant de l’épouser, violoit la défense de la pudeur naturelle : il est aussi déraisonnable d’exiger d’une fille qu’elle fasse cette déclaration, que de demander d’un homme qu’il ne cherche pas à défendre sa vie.
La loi de Henri II, qui condamne à mort une fille dont l’enfant a péri, en cas qu’elle n’ait point déclaré au magistrat sa grossesse, n’est pas moins contraire à la défense naturelle. Il suffisoit de l’obliger d’en instruire une de ses plus proches parentes, qui veillât à la conservation de l’enfant.
Quel autre aveu pourroit-elle faire, dans ce supplice de la pudeur naturelle ? L’éducation a augmenté en elle l’idée de la conservation de cette pudeur ; & à peine dans ces momens est-il resté en elle une idée de la perte de la vie.
[III-226]
On a beaucoup parlé d’une loi d’Angleterre [2] , qui permettoit à une fille de sept ans de se choisir un mari. Cette loi étoit révoltante de deux manieres : elle n’avoit aucun égard au temps de la maturité que la nature a donné à l’esprit, ni au temps de la maturité qu’elle a donné au corps.
Un pere pouvoit, chez les Romains, obliger sa fille à répudier [3] son mari, quoiqu’il eût lui-même consenti au mariage. Mais il est contre la nature que le divorce soit mis entre les mains d’un tiers.
Si le divorce est conforme à la nature, il ne l’est que lorsque les deux parties, ou au moins une d’elles, y consentent ; & lorsque ni l’une ni l’autre n’y consentent, c’est un monstre que le divorce. Enfin la faculté du divorce ne peut être donnée qu’à ceux qui ont les incommodités du mariage, & qui sentent le moment où ils ont intérêt de les faire cesser.
-
[↑] Liv. IX, des lois.
-
[↑] M. Bayle, dans sa critique de l’histoire du Calvinisme, parle de cette loi, p. 293.
-
[↑] Voyez la loi V, au code de repudiis & judicio de moribus sublato.
[III-227]
CHAPITRE IV.
Continuation du même sujet.
Gondebaud [1] roi de bourgogne, vouloit que si la femme ou le fils de celui qui avoit volé, ne révéloit pas le crime, ils fussent réduits en esclavage. Cette loi étoit contre la nature. Comment une femme pouvoit-elle être accusatrice de son mari ? Comment un fils pouvoit-il être accusateur de son pere ? Pour venger une action criminelle, il en ordonnoit une plus criminelle encore.
La loi de [2] Recessuinde permettoit aux enfans de la femme adultere, ou à ceux de son mari, de l’accuser, & de mettre à la question les esclaves de la maison. Loi inique, qui, pour conserver les mœurs, renversoit la nature, d’où tirent leur origine les mœurs.
Nous voyons avec plaisir sur nos théâtres un jeune héros montrer autant d’horreur pour découvrir le crime de sa belle-mere, qu’il en avoit eu pour le crime même ; il ose à peine, dans sa [III-228] surprise, accusé, jugé, condamné, proscrit & couvert d’infamie, faire quelques réflexions sur le sang abominable dont Phedre est sortie : il abandonne ce qu’il a de plus cher, & l’objet le plus tendre, tout ce qui parle à son cœur, tout ce qui peut l’indigner, pour aller se livrer à la vengeance des dieux qu’il n’a point méritée. Ce sont les accens de la nature qui causent ce plaisir ; c’est la plus douce de toutes les voix.
[III-228]
CHAPITRE V.
Cas où l’on peut juger par les principes du droit civil, en modifiant les principes du droit naturel.
Une loi d’Athenes obligeoit [1] les enfans de nourrir leurs peres tombés dans l’indigence ; elle exceptoit ceux qui étoient nés [2] d’une courtisane, ceux dont le pere avoit exposé la pudicité par un trafic infame, ceux à qui [3] il n’avoit point donné de métier pour gagner leur vie.
[III-229]
La loi considéroit que, dans le premier cas, le pere se trouvant incertain, il avoit rendu précaire son obligation naturelle : que, dans le second, il avoit flétri la vie qu’il avoit donnée ; & que le plus grand mal qu’il pût faire à ses enfans, il l’avoit fait, en les privant de leur caractere : que dans le troisieme, il leur avoit rendu insupportable une vie qu’ils trouvoient tant de difficulté à soutenir. La loi n’envisageoit plus le pere & le fils que comme deux citoyens, ne statuoit plus que sur des vues politiques & civiles ; elle considéroit que, dans une bonne république, il faut sur-tout des mœurs. Je crois bien que la loi de Solon étoit bonne dans les deux premiers cas, soit celui où la nature laisse ignorer au fils quel est son pere, soit celui où elle semble même lui ordonner de le méconnoître : mais on ne sauroit l’approuver dans le troisieme, où le pere n’avoit violé qu’un règlement civil.
-
[↑] Sous peine d’infamie ; une autre sous peine de prison.
-
[↑] Plutarque, vie de Solon.
-
[↑] Plutarque, vie de Solon ; & Gallien, in exhort. ad Art. ch. viii.
[III-230]
CHAPITRE VI.
Que l’ordre des successions dépend des principes du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel.
La loi Voconienne ne permettoit point d’instituer une femme héritiere, pas même sa fille unique. Il n’y eut jamais, dit S. Augustin [1] , une loi injuste. Une formule de [2] Marculfe traite d’impie la coutume qui prive les filles de la succession de leur peres. Justinien [3] appelle barbare le droit de succéder des mâles, au préjudice des filles. Ces idées sont venues de ce que l’on a regardé le droit que les enfans ont de succéder à leurs peres, comme une conséquence de la loi naturelle ; ce qui n’est pas.
La loi naturelle ordonne aux peres de nourrir leurs enfans, mais elle n’oblige pas de les faire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage ; tout cela ne peut avoir été [III-231] réglé que par la société, & par conséquent par des lois politiques ou civiles.
Il est vrai que l’ordre politique ou civil demande souvent que les enfans succedent aux peres, mais il ne l’exige par toujours.
Les lois de nos fiefs ont pu avoir des raisons pour que l’aîné des mâles, ou les plus proches parens par mâles, eussent tout, & que les filles n’eussent rien : & les lois des Lombards [4] ont pu en avoir pour que les sœurs, les enfans naturels, les autres parens, & à leur défaut le fisc, concourussent avec les filles.
Il fut réglé dans quelques dynasties de la Chine, que les freres de l’empereur lui succéderoient, & que ses enfans ne lui succéderoient pas. Si l’on vouloit que le prince eût une certaine expérience, si l’on craignoit les minorités, s’il falloit prévenir que des eunuques ne plaçassent successivement des enfans sur le trône, on put très-bien établir un pareil ordre de succession : & quand quelques [5] écrivains ont traité ces freres d’usurpateurs, ils ont jugé sur des idées prises des lois de ce pays-ci.
[III-232]
Selon la coutume de Numidie [6] Delsace frere de Géla, succéda au royaume, non pas Massinisse son fils. Et encore aujourd’hui [7] , chez les Arabes de Barbarie, où chaque village a un chef, on choisit, selon cette anciennes coutume, l’oncle, ou quelqu’autre parent, pour succéder.
Il y a des monarchies purement électives ; & dès qu’il est clair que l’ordre des successions doit dériver des lois politiques ou civiles, c’est à elles à décider dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfans, & dans quel cas il faut la donner à d’autres.
Dans les pays où la polygamie est établie, le prince a beaucoup d’enfans ; le nombre en est plus grand dans des pays que dans d’autres. Il y a des [8] états où l’entretien des enfans du roi seroit impossible au peuple ; on a pu y établir que les enfans du roi ne lui succéderoient pas, mais ceux de sa sœur.
[III-233]
Un nombre prodigieux d’enfans exposeroit l’état à d’affreuses guerres civiles. L’ordre de succession qui donne la couronne aux enfans de la sœur, dont le nombre n’est pas plus grand que ne le seroit celui des enfans d’un prince qui n’auroit qu’une seule femme, prévient ces inconvéniens.
Il y a des nations chez lesquelles des raisons d’état ou quelque maxime de religion ont demandé qu’une certaine famille fût toujours régnante : telle est aux Indes [9] la jalousie de sa caste, & la crainte de n’en point descendre : on y a pensé que, pour avoir toujours des princes du sang royal, il falloit prendre les enfans de la sœur aînée du roi.
Maxime générale : nourrir ses enfans, est une obligation du droit naturel ; leur donner sa succession, est une obligation du droit civil ou politique. De là dérivent les différentes dispositions sur les bâtards dans les différens pays du monde ; elles suivent les lois civiles ou politiques de chaque pays.
-
[↑] De civitate Dei, liv. III.
-
[↑] Liv. II, chap. xii.
-
[↑] Novelle 21.
-
[↑] Liv. II, tit. 14, §. 6, 7 & 8.
-
[↑] Le P. du Halde, sur la seconde dynastie.
-
[↑] Tite-Live, décade 3, liv. IX.
-
[↑] Voy. Les voyages de M. Schaw, tome 1, p. 401.
-
[↑] Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome IV, part. I, pag. 114 ; & M. Smith, voyage de Guinde, part. 2. pag. 150, sur le royaume de Julda.
-
[↑] Voyez les lett. edif. quatorzieme recueil ; & les voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome III, part. 2. pag. 644.
[III-234]
CHAPITRE VII.
Qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle.
Les Abyssins ont un carême de cinquante jours très-rude, & qui les affoiblit tellement, que de long-temps ils ne peuvent agir : les Turcs [1] ne manquent pas de les attaquer après leur carême. La religion devroit, en faveur de la défense naturelle, mettre des bornes à ces pratiques.
Le sabbat fut ordonné aux Juifs : mais ce fut une stupidité à cette nation de ne point se défendre [2] , lorsque ses ennemis choisirent ce jour pour l’attaquer.
Cambyse assiégeant Peluze, mit au premier rang un grand nombre d’animaux que les Egyptiens tenoient pour sacrés : les soldats de la garnison n’osèrent tirer. Qui ne voit que la défense naturelle est d’un ordre supérieur à tous les préceptes ?
-
[↑] Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. IV, part. I, pages 35 & 103.
-
[↑] Comme ils firent, lorsque Pompée assiégea le temple. Voyez Dion, liv. XXXVII.
[III-235]
CHAPITRE VIII.
Qu’il ne faut pas régler par les principes du droit appelé canonique, les choses réglées par les principes du droit civil.
Par le droit [1] civil des Romains, celui qui enleve d’un lieu sacré une chose privée, n’est puni que du crime de vol : par le droit [2] canonique, il est puni du crime de sacrilege. Le droit canonique fait attention au lieu, le droit civil à la chose. Mais n’avoir attention qu’au lieu, c’est ne réfléchir, ni sur la nature & la définition du vol, ni sur la nature & la définition du sacrilege.
Comme le mari peut demander la séparation à cause de l’infidélité de sa femme, la femme la demandoit autrefois [3] à cause de l’infidélité du mari. Cet usage, contraire à la disposition des lois [4] Romaines, s’étoit introduit dans les cours [5] d’église, où l’on ne voyoit [III-236] que les maximes du droit canonique ; & effectivement, à ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles & dans le rapport aux choses de l’autre vie, la violation est la même. Mais les lois politiques & civiles de presque tous les peuples, ont avec raison distingué ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue & de continence, qu’elles n’exigent point des hommes ; parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus ; parce que la femme, en violant les lois du mariage, sort de l’état de sa dépendance naturelle ; parce que la nature a marqué l’infidélité des femmes par des signes certains ; outre que les enfans adultérins de la femme sont nécessairement au mari & à la charge du mari, au lieu que les enfans adultérins du mari ne sont pas à la femme, ni à la charge de la femme.
-
[↑] Leg. V. ff. ad leg. Juliam peculatûs.
-
[↑] Cap. Quisquis xvii, quæstione 4 ; Cujas, observat. Liv. XIII, ch. xix, tome III.
-
[↑] Beaumanoir, ancienne coutume de Beauvoisis, chap. xviii.
-
[↑] Leg. I, cod. ad leg. Jul. de adult.
-
[↑] Aujourd’hui, en France, elles ne connoissent point de ces choses.
[III-237]
CHAPITRE IX.
Que les choses qui doivent être réglées par les principes du droit civil, peuvent rarement l’être par les principes des lois de la religion.
Les lois religieuses ont plus de sublimité, les lois civiles ont plus d’étendue.
Les lois de perfection tirées de la religion ont plus pour objet la bonté de l’homme qui les observe, que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au contraire, ont plus pour objet la bonté morale des hommes en général, que celle des individus.
Ainsi, quelque respectables que soient les idées qui naissent immédiatement de la religion, elles ne doivent pas toujours servir de principe aux lois civiles ; parce que celles-ci en ont un autre, qui est le bien général de la société.
Les Romains firent des réglemens pour conserver dans la république les mœurs des femmes ; c’étoient des institutions politiques. Lorsque la [III-238] monarchie s’établit, ils firent là-dessus des lois civiles, & ils les firent sur les principes du gouvernement civil. Lorsque la religion Chrétienne eut pris naissance, les lois nouvelles que l’on fit eurent moins de rapport à la bonté générale des mœurs, qu’à la sainteté du mariage ; on considéra moins l’union des deux sexes dans l’état civil, que dans un état spirituel.
D’abord, par la loi [1] Romaine, un mari qui ramenoit sa femme dans sa maison après la condamnation d’adultere, fut puni comme complice de ses débauches. Justinien [2] , dans un autre esprit, ordonna qu’il pourroit pendant deux ans l’aller reprendre dans le monastere.
Lorsqu’une femme qui avoit son mari à la guerre, n’entendoit plus parler de lui, elle pouvoit dans les premiers temps aisément se remarier, parce qu’elle avoit entre ses mains le pouvoir de faire divorce. La loi de Constantin [3] voulut qu’elle attendît quatre ans, après quoi elle pouvoit envoyer le libelle de divorce au chef ; & si son mari revenoit, [III-239] il ne pouvoit plus l’accuser d’adultere. Mais Justinien [4] établit que, quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du mari, elle ne pouvoit se remarier, à moins que, par la déposition & le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari : Justinien avoit en vue l’indissolubilité du mariage ; mais on peut dire qu’il l’avoit trop en vue. Il demandoit une preuve positive, lorsqu’une preuve négative suffisoit ; il exigeoit une chose très-difficile, de rendre compte de la destinée d’un homme éloigné & exposé à tant d’accidens ; il présumoit un crime, c’est-à-dire, la désertion du mari, lorsqu’il étoit si naturel de présumer sa mort. Il choquoit le bien public, en laissant une femme sans mariage ; il choquoit l’intérêt particulier, en l’exposant à mille dangers.
La loi de Justinien [5] qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari & de la femme d’entrer dans le monastere, s’éloignoit entiérement des principes des lois civiles. Il est naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empêchemens [III-240] qu’on ne devoit pas prévoir avant le mariage : mais ce désir de garder la chasteté pouvoit être prévu, puisqu’il est en nous. Cette loi favorise l’inconstance, dans un état qui de sa nature est perpétuel ; elle choque le principe fondamental du divorce, qui ne souffre la dissolution d’un mariage que dans l’espérance d’un autre ; enfin à suivre même les idées religieuses, elle ne fait que donner des victimes à Dieu sans sacrifice.
-
[↑] Leg. XI, §. ult. ff. ad leg. Jul. de adult.
-
[↑] Nov. 134, coll. 9, ch. x, tit. 170.
-
[↑] Leg. VII, cod. de repudiis & judicio de moribus sublato.
-
[↑] Auth. Hodie quantiscumque, cod. de repud.
-
[↑] Auth. Quòd hodie, cod. de repud.
[III-240]
CHAPITRE X.
Dans quel cas il faut suivre la loi civile qui permet, & non pas la loi de la religion qui défend.
Lorsqu’une religion qui défend la polygamie, s’introduit dans un pays où elle est permise, on ne croit pas, à ne parler que politiquement, que la loi du pays doive souffrir qu’un homme qui a plusieurs femmes embrasse cette religion ; à moins que le magistrat ou le mari ne les dédommagent, en leur rendant de quelque maniere leur état civil. Sans cela, leur condition seroit déplorable ; elles n’auroient fait [III-241] qu’obéir aux lois, & elles se trouveroient privées des plus grands avantages de la société.
[III-241]
CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point régler les tribunaux humains par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie.
Le tribunal de l’inquisition, formé par les moines Chrétiens, sur l’idée du tribunal de la pénitence, est contraire à toute bonne police. Il a trouvé par-tout un soulévement général ; & il auroit cédé aux contradictions, si ceux qui vouloient l’établir n’avoient tiré avantage de ces contradictions mêmes.
Ce tribunal est insupportable dans tous les gouvernemens. Dans la monarchie, il ne peut faire que des délateurs & des traîtres ; dans les républiques, il ne peut former que des malhonnêtes gens ; dans l’état despotique, il est destructeur comme lui.
[III-242]
CHAPITRE XII.
Continuation du même sujet.
C’est un des abus de ce tribunal, que de deux personnes qui y sont accusées du même crime, celle qui nie est condamnée à la mort, & celle qui avoue évite le supplice. Ceci est tiré des idées monastiques, où celui qui nie paroît être dans l’impénitence & damné, & celui qui avoue semble être dans le repentir & sauvé. Mais une pareille distinction ne peut concerner les tribunaux humains : la justice humaine, qui ne voit que les actions, n’a qu’un pacte avec les hommes, qui est celui de l’innocence ; la justice divine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l’innocence & celui du repentir.
[III-243]
CHAPITRE XIII.
Dans quel cas il faut suivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion ; & dans quel cas il faut suivre les lois civiles.
Il est arrivé, dans tous les pays & dans tous les temps, que la religion s’est mêlée des mariages. Dès que de certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites, & que cependant elles étoient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion, pour les légitimer dans un cas & les réprouver dans les autres.
D’un autre côté, les mariages étant, de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la société, il a bien fallu qu’ils fussent réglés par les lois civiles.
Tout ce qui regarde le caractere du mariage, sa forme, la maniere de le contracter, la fécondité qu’il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu’il étoit l’objet d’une bénédiction particuliere, qui n’y étant pas toujours attachée, dépendoit de certaines graces [III-244] supérieures ; tout cela est du ressort de la religion.
Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître ; tout cela regarde les lois civiles.
Comme un des grands objets du mariage est d’ôter toutes les incertitudes des conjonctions illégitimes, la religion y imprime son caractere, & les lois civiles y joignent le leur, afin qu’il ait toute l’authenticité possible. Ainsi, outre les conditions que demande la religion pour que le mariage soit valide, les lois civiles en peuvent encore exiger d’autres.
Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir, c’est que ce sont des caracteres ajoutés, & non pas des caracteres contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies, & les lois civiles veulent le consentement des peres ; elles demandent en cela quelque chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire.
Il suit de là que c’est à la loi de la religion à décider si le lien sera [III-245] indissoluble, ou non : car si les lois de la religion avoient établi le lien indissoluble, & que les civiles eussent réglé qu’il se peut rompre, ce seroient deux choses contradictoires.
Quelquefois les caracteres imprimés au mariage par les lois civiles, ne sont pas d’une absolue nécessité ; tels sont ceux qui sont établis par les lois qui, au lieu de casser le mariage, se sont contentées de punir ceux qui le contractoient.
Chez les Romains, les lois Pappiennes déclarerent injustes les mariages qu’elles prohiboient, & les soumirent seulement à des peines [1] ; & le senatus-consulte rendu sur le discours de l’empereur Marc-Antonin, les déclara nuls ; il n’y eut plus [2] de mariage, de femme, de dot, de mari. La loi civile se détermine selon les circonstances : quelquefois elle est plus attentive à réparer le mal, quelquefois à le prévenir.
-
[↑] Voyez ce que j’ai dit ci-dessus au chap. xxi du livre des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans.
-
[↑] Voyez les loi XVI, ff. de ritu nuptiarum ; & la loi III, §. I, aussi au digeste de donationibus inter virum & uxorem.
[III-246]
CHAPITRE XIV.
Dans quels cas, dans les mariages entre parens, il faut se régler par les lois de la nature ; dans quel cas on doit se régler par les lois civiles.
En fait de prohibition de mariage entre parens, c’est une chose très-délicate de bien poser le point auquel les lois de la nature s’arrêtent, & où les lois civiles commencent. Pour cela, il faut établir des principes.
Le mariage du fils avec la mere confond l’état des choses : le fils doit un respect sans bornes à sa mère, la femme doit un respect sans bornes à son mari ; le mariage d’une mere avec son fils renverseroit dans l’un & dans l’autre leur état naturel.
Il y a plus : la nature a avancé dans les femmes le temps où elles peuvent avoir des enfans ; elle l’a reculé dans les hommes ; & par la même raison, la femme cesse plutôt d’avoir cette faculté, & l’homme plus tard. Si le mariage entre la mere & le fils étoit permis, il arriveroit presque toujours que, lorsque le [III-247] mari seroit capable d’entrer dans les vues de la nature, la femme n’y seroit plus.
Le mariage entre le pere & la fille répugne à la nature, comme le précédent ; mais il répugne moins, parce qu’il n’a pas ces deux obstacles. Aussi les Tartares, qui peuvent épouser leurs filles [1] , n’épousent-ils jamais leurs meres, comme nous le voyons dans les relations [2] .
Il a toujours été naturel aux peres de veiller sur la pudeur de leurs enfans. Chargés du soin de les établir, ils ont dû leur conserver & le corps le plus parfait, & l’ame la moins corrompue, tout ce qui peut mieux inspirer des désirs, & tout ce qui est le plus propre à donner de la tendresse. Des peres, toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfans, ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourroit les corrompre. Le mariage n’est point une corruption, dira-t-on : mais avant le mariage, il faut parler, il faut se faire [III-248] aimer, il faut séduire ; c’est cette séduction qui a dû faire horreur.
Il a donc fallu une barriere insurmontable entre ceux qui devoient donner l’éducation, & ceux qui devoient la recevoir ; & éviter toute sorte de corruption, même pour cause légitime. Pourquoi les peres privent-ils si soigneusement ceux qui doivent épouser leurs filles, de leur compagnie & de leur familiarité ?
L’horreur pour l’inceste du frere avec la sœur a dû partir de la même source. Il suffit que les peres & les meres ayent voulu conserver les mœurs de leurs enfans & leurs maisons pures, pour avoir inspiré à leurs enfans de l’horreur pour tout ce qui pouvoit les porter à l’union des deux sexes.
La prohibition du mariage entre cousins germains a la même origine. Dans les premiers temps, c’est-à-dire dans les temps saints, dans les âges où le luxe n’étoit point connu, tous les [3] enfans restoient dans la maison, & s’y établissoient : c’est qu’il ne falloit qu’une maison très-petite pour une grande famille.
[III-249] Les enfans [4] des deux freres, ou les cousins germains, étoient regardés & se regardoient entr’eux comme freres. L’éloignement qui étoit entre les freres & les sœurs pour le mariage étoit donc aussi [5] entre les cousins germains.
Ces causes sont si fortes & si naturelles, qu’elles ont agi presque par toute la terre, indépendamment d’aucune communication. Ce ne sont point les Romains qui ont appris aux habitans de Formose [6] , que le mariage avec leurs parens au quatrieme degré étoit incestueux ; ce ne sont point les Romains qui l’ont dit aux Arabes [7] ; ils ne l’ont point enseigné aux Maldives [8] .
Que si quelques peuples n’ont point rejeté les mariages entre les peres & les enfans, les sœurs & les freres, on a vu, dans le livre premier, que les êtres [III-250] intelligens ne suivent pas toujours leurs lois. Qui le diroit ! des idées religieuses ont souvent fait tomber les hommes dans ces égaremens. Si les Assyriens, si les Perses ont épousé leurs meres, les premiers l’ont fait par un respect religieux pour Sémiramis ; & les seconds, parce que la religion de Zoroastre donnoit la préférence [9] à ces mariages. Si les Égyptiens ont épousé leurs sœurs, ce fut encore un délire de la religion Égyptienne, qui consacra ces mariages en l’honneur d’Isis. Comme l’esprit de la religion est de nous porter à faire avec effort des choses grandes & difficiles, il ne faut pas juger qu’une chose soit naturelle, parce qu’une religion fausse l’a consacrée.
Le principe que les mariages entre les peres & les enfans, les freres & les sœurs, sont défendus pour la conservation de la pudeur naturelle dans la maison, servira à nous faire découvrir quels sont les mariages défendus par la loi naturelle, & ceux qui ne peuvent l’être que par la loi civile.
[III-251]
Comme les enfans habitent, ou sont censés habiter dans la maison de leur pere, & par conséquent le beau-fils avec la belle-mere, le beau-pere avec la belle-fille ou avec la fille de la femme ; le mariage entr’eux est défendu par la loi de la nature. Dans ce cas, l’image a le même effet que la réalité, parce qu’il a la même cause : la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces mariages.
Il y a des peuples chez lesquels, comme j’ai dit, les cousins germains sont regardés comme freres, parce qu’ils habitent ordinairement dans la même maison ; il y en a où on ne connoît guere cet usage. Chez ces peuples, le mariage entre cousins germains doit être regardé comme contraire à la nature ; chez les autres, non.
Mais les lois de la nature ne peuvent être des lois locales. Ainsi quand ces mariages sont défendus ou permis, ils sont, selon les circonstances, permis ou défendus par une loi civile.
Il n’est point d’un usage nécessaire que le beau-frere & la belle-sœur habitent dans la même maison. Le mariage n’est dont pas défendu entr’eux pour [III-252] conserver la pudicité dans la maison ; & la loi qui le défend ou le permet, n’est point la loi de la nature, mais une loi civile, qui se regle sur les circonstances, & dépend des usages de chaque pays : ce sont des cas, où les lois dépendent des mœurs & des manieres.
Les lois civiles défendent les mariages, lorsque, par les usages reçus dans un certain pays, ils se trouvent être dans les mêmes circonstances que ceux qui sont défendus par les lois de la nature ; & elles le permettent lorsque les mariages ne se trouvent point dans ce cas. La défense des lois de la nature est invariable, parce qu’elle dépend d’une chose invariable ; le pere, la mere & les enfans habitant nécessairement dans la maison. Mais les défenses des lois civiles sont accidentelles, parce qu’elles dépendant d’une circonstance accidentelle ; les cousins germains & autres habitant accidentellement dans la maison.
Cela explique comment les lois de Moïse, celles des Égyptiens [10] & de plusieurs autres peuples, permettent le mariage entre le beau-frere et la [III-253] belle-sœur, pendant que ces mêmes mariages sont défendus chez d’autres nations.
Aux Indes, on a une raison bien naturelle d’admettre ces sortes de mariages. L’oncle y est regardé comme pere, & il est obligé d’entretenir & d’établir ses neveux, comme si c’étoient ses propres enfans : ceci vient du caractere de ce peuple, qui est bon & plein d’humanité. Cette loi ou cet usage en a produit un autre : si un mari a perdu sa femme, il ne manque pas d’en épouser la sœur [11] : & cela est très-naturel ; car la nouvelle épouse devient la mere des enfans de sa sœur, & il n’y a point d’injuste marâtre.
-
[↑] Cette loi est bien ancienne parmi eux. Attila, dit Priscus dans son ambassade, s’arrêta dans un certain lieu pour épouser Esca, sa fille ; chose permise, dit-il, par les lois des Scythes, page 22.
-
[↑] Hist. des Tattars, part. 3, page 256.
-
[↑] Cela fut ainsi chez les premiers Romains.
-
[↑] En effet, chez les Romains, ils avoient le même nom ; les cousins germains étoient nommés freres.
-
[↑] Ils le furent à Rome dans les premiers temps, jusqu’à ce que le peuple fît une loi pour les permettre ; il vouloit favoriser un homme extrêmement populaire, & qui s’étoit marié avec sa cousine germaine. Plutarque, au traité des demandes des choses Romaines.
-
[↑] Recueil des voyages des Indes, tome V, part. I. relation de l’état de l’île de Formose.
-
[↑] L’alcoran, chap. des femmes.
-
[↑] Voyez François Pyrard.
-
[↑] Ils étoient regardés comme plus honorables. Voyez Philon, de specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta decalogi, Paris, 1640. p. 778.
-
[↑] Voyez la loi VIII, au code de oncestis & inutilibus nuptiis.
-
[↑] Lettres édif. quatorzieme recueil, page 403.
[III-253]
CHAPITRE XV.
Qu’il ne faut point régler par les principes du droit politique, les choses qui dépendent des principes du droit civil.
Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle, pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens, pour vivre sous des lois civiles.
[III-254]
Ces premieres lois leur acquierent la liberté ; les secondes, la propriété. Il ne faut pas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n’est que l’empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C’est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n’a lieu que dans les cas où il s’agit de l’empire de la cité, c’est-à-dire, de la liberté du citoyen : cela n’a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.
Cicéron soutenoit que les lois agraires étoient funestes, parce que la cité n’étoit établie que pour que chacun conservât ses biens.
Posons donc pour maxime, que lorsqu’il s’agit du bien public, le bien public n’est jamais que l’on prive un particulier de son bien, ou même qu’on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la propriété.
[III-255]
Ainsi lorsque le public a besoin du fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique : mais c’est là que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité même.
Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise ; le public est à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, & qu’il lui ôte ce grand privilege qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aliéner son bien.
Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé de leurs conquêtes même, l’esprit de liberté les rappella à celui d’équité ; les droits les plus barbares, ils les exercerent avec modération : & si l’on en doutoit, il n’y auroit qu’à lire l’admirable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivoit sur la jurisprudence dans le douzieme siecle.
On raccommodoit de son temps les grands chemins, comme l’on fait aujourd’hui. Il dit que, quand un grand [III-256] chemin ne pouvoit être rétabli, on en faisoit un autre le plus près de l’ancien qu’il étoit possible ; mais qu’on dédommageoit les propriétaires [1] aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin. On se déterminoit pour lors par la loi civile ; on s’est déterminé de nos jours par la loi politique.
-
[↑] Le seigneur nommoit des prud’hommes pour faire la levée sur le paysan ; les gentilshommes étoient contraints à la contribution par le comte, l’homme d’église par l’évêque. Beaumanoir, chap. xxii.
[III-256]
CHAPITRE XVI.
Qu’il ne faut point décider par les regles du droit civil, quand il s’agit de décider par celles du droit politique.
On verra le fond de toutes les questions, si l’on ne confond point les regles qui dérivent de la propriété de la cité, avec celles qui naissent de la liberté de la cité.
Le domaine d’un état est-il aliénable, ou ne l’est-il pas ? Cette question doit être décidée par la loi politique, & non pas par la loi civile. Elle ne doit pas être décidée par la loi civile, parce qu’il est aussi nécessaire qu’il y ait un [III-257] domaine pour faire subsister l’état, qu’il est nécessaire qu’il y ait dans l’état des lois civiles qui reglent la disposition des biens.
Si donc on aliene le domaine, l’état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cet expédient renverse encore le gouvernement politique ; parce que, par la nature de la chose, à chaque domaine qu’on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain retirera toujours moins ; en un mot, le domaine est nécessaire, & l’aliénation ne l’est pas.
L’ordre de succession est fondé dans les monarchies sur le bien de l’état, qui demande que cet ordre soit fixé, pour éviter les malheurs que j’ai dit devoir arriver dans le despotisme, où tout est incertain, parce que tout y est arbitraire.
Ce n’est pas pour la famille régnante que l’ordre de succession est établi, mais parce qu’il est de l’intérêt de l’état qu’il y ait une famille régnante. La loi qui regle la succession des particuliers, est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers ; celle qui regle la succession à la monarchie, est une loi [III-258] politique, qui a pour objet le bien & la conservation de l’état.
Il suit de là que, lorsque la loi politique a établi dans un état un ordre de succession, & que cet ordre vient à finir, il est absurde de réclamer la succession en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit. Une société particuliere ne fait point de lois pour une autre société. Les lois civiles des Romains ne sont pas plus applicables que toutes autres lois civiles ; ils ne les ont point employées eux-mêmes, lorsqu’ils ont jugé les rois : & les maximes par lesquelles ils ont jugé les rois, sont si abominables, qu’il ne faut point les faire revivre.
Il suit encore de là que, lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile. Les restitutions sont dans la loi, & peuvent être bonnes contre ceux qui vivent dans la loi : mais elles ne sont pas bonnes pour ceux qui ont été établis pour la loi, & qui vivent pour la loi.
Il est ridicule de prétendre décider des droits des royaumes, des nations & de l’univers, par les mêmes maximes [III-259] sur lesquelles on décide entre particuliers d’un droit pour une gouttiere, pour me servir de l’expression de Cicéron [1] .
-
[↑] Liv. I. des Lois.
[III-259]
CHAPITRE XVII.
Continuation du même sujet.
L’ostracisme doit être examiné par les regles de la loi politique, & non par les regles de la loi civile : & bien loin que cet usage puisse flétrir le gouvernement populaire, il est au contraire très-propre à en prouver la douceur : & nous aurions senti cela, si l’exil parmi nous étant toujours une peine, nous avions pu séparer l’idée de l’ostracisme d’avec celle de la punition.
Aristote [1] nous dit, qu’il est convenu de tout le monde que cette pratique a quelque chose d’humain & de populaire. Si dans les temps & dans les lieux où l’on exerçoit ce jugement, on ne le trouvoit point odieux ; est-ce à nous, qui voyons les choses de si loin, de penser autrement que les accusateurs, les juges & l’accusé même ? [III-260]
Et si l’on fait attention que ce jugement du peuple combloit de gloire celui contre qui il étoit rendu ; que lorsqu’on en eut abusé à Athenes contre un homme sans [2] mérite, on cessa dans ce moment [3] de l’employer ; l’on verra bien qu’on en a pris une fausse idée, & que c’étoit une loi admirable que celle qui prévenoit les mauvais effets que pouvoit produire la gloire d’un citoyen, en le comblant d’une nouvelle gloire.
-
[↑] République, liv. III. chap. xiii.
-
[↑] Hyperbolus. Voyez Plutarque, vie d’Aristide.
-
[↑] Il se trouva opposé à l’esprit du législateur.
[III-260]
CHAPITRE XVIII.
Qu’il faut examiner si les lois qui paroissent se contredire, sont du même ordre.
À Rome il fut permis au mari de prêter sa femme à un autre. Plutarque nous le [1] dit formellement : on sait que Caton prêta sa [2] femme à Hortensius, & Caton n’était point homme à violer les lois de son pays.
[III-261]
D’un autre côté, un mari qui souffroit les débauches de sa femme, qui ne la mettoit pas en jugement ou qui la reprenoit [3] après la condamnation, étoit puni. Ces lois paroissent se contredire, & ne se contredisent point. La loi qui permettoit à un Romain de prêter sa femme, est visiblement une institution Lacédémonienne, établie pour donner à la république des enfans d’une bonne espece, si j’ose me servir de ce terme : l’autre avoit pour objet de conserver les mœurs. La premiere étoit une loi politique, la seconde une loi civile.
-
[↑] Plutarque, dans sa comparaison de Lycurgue & de Numa.
-
[↑] Plutarque, vie de Caton. Cela se passa de notre temps, dit Strabon, liv. XI.
-
[↑] Leg. XI, §, ult. ss. ad leg. Jul. de adult.
[III-261]
CHAPITRE XIX.
Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles les choses qui doivent l’être par les lois domestiques.
La loi des Wisigoths vouloit que les esclaves [1] fussent obligés de lier l’homme & la femme qu’ils surprenoient en adultere, & de les présenter au mari & au juge : loi terrible, qui mettoit [III-262] entre les mains de ces personnes viles le soin de la vengeance publique, domestique & particuliere !
Cette loi ne seroit bonne que dans les sérails d’orient, où l’esclave, qui est chargé de la clôture, a prévariqué sitôt qu’on prévarique. Il arrête les criminels, moins pour les faire juger, que pour se faire juger par lui-même, & obtenir que l’on cherche dans les circonstances de l’action, si l’on peut perdre le soupçon de sa négligence.
Mais dans les pays où les femmes ne sont point gardées, il est insensé que la loi civile les soumette, elles qui gouvernent la maison, à l’inquisition de leurs esclaves.
Cette inquisition pourroit être, tout au plus dans de certains cas, une loi particuliere domestique, & jamais une loi civile.
-
[↑] Lois des Wisigoths, liv. III. tit. 4. §. 6.
[III-263]
CHAPITRE XX.
Qu’il ne faut pas décider par les principes des lois civiles, les choses qui appartiennent au droit des gens.
La liberté consiste principalement à ne pouvoir être forcé à faire une chose que la loi n’ordonne pas ; & on n’est dans cet état que parce qu’on est gouverné par des lois civiles : nous sommes donc libres, parce que nous vivons sous des lois civiles.
Il suit de là que les princes qui ne vivent point entr’eux sous des lois civiles, ne sont point libres, ils sont gouvernés par la force ; ils peuvent continuellement forcer ou être forcés. De-là il suit que les traités qu’ils ont faits par force, sont aussi obligatoires que ceux qu’ils auroient faits de bon gré. Quand nous, qui vivons sous des lois civiles, sommes contraints à faire quelque contrat que la loi n’exige pas, nous pouvons, à la faveur de la loi, revenir contre la violence ; mais un prince, qui est toujours dans cet état dans lequel il force ou il est forcé, ne peut pas se plaindre [III-264] d’un traité qu’on lui a fait par violence. C’est comme s’il se plaignoit de son état naturel : c’est comme s’il vouloit être prince à l’égard des autres princes, & que les autres princes fussent citoyens à son égard ; c’est-à-dire, choquer la nature des choses.
[III-264]
CHAPITRE XXI.
Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques, les choses qui appartiennent au droit des gens.
Les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels & civils du pays où il est, & à l’animadversion du souverain.
Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambassadeurs, & la raison tirée de la nature de la chose, n’a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, & cette parole doit être libre : aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir : ils peuvent souvent déplaire, parce qu’ils parlent pour un homme indépendant : on [III-265] pourroit leur imputer des crimes, s’ils pouvoient être punis pour des crimes ; on pourroit leur supposer des dettes, s’ils pouvoient être arrêtés pour des dettes : un prince qui a une fierté naturelle, parleroit par la bouche d’un homme qui auroit tout à craindre. Il faut donc suivre, à l’égard des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens, & non pas celles qui dérivent du droit politique. Que s’ils abusent de leur être représentatif, on le fait cesser, en les renvoyant chez eux : on peut même les accuser devant leur maître, qui devient par-là leur juge ou leur complice.
[III-265]
CHAPITRE XXII.
Malheureux sort de l’Ynca Athualpa.
Les principes que nous venons d’établir, furent cruellement violés par les Espagnols. L’ynca [1] Athualpa ne pouvoit être jugé que par les droits des gens ; ils le jugerent par des lois politiques & civiles ; ils l’accuserent d’avoir fait mourir quelques-uns de ses sujets, d’avoir eu plusieurs femmes, &c. Et le [III-266] comble de la stupidité fut, qu’ils ne le condamnerent pas par les lois politiques & civiles de son pays, mais par les lois politiques & civiles du leur.
-
[↑] Voyez l’ynca Garcilasso de la Vega, page 108.
[III-266]
CHAPITRE XXIII.
Que lorsque, par quelque circonstance, la loi politique détruit l’état, il faut décider par la loi politique qui le conserver, qui devient quelquefois un droit des gens.
Quand la loi politique, qui a établi dans l’état un certain ordre de succession, devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été fait, il ne faut pas douter qu’une autre loi politique ne puisse changer cet ordre ; & bien loin que cette même loi soit opposée à la premiere, elle y sera dans le fond entiérement conforme, puisqu’elles dépendront toutes deux de ce principe : Le salut du peuple est la suprême loi.
J’ai dit [1] qu’un grand état devenu accessoire d’un autre s’affoiblissait, & [III-267] même affoiblissoit le principal. On sait que l’état a intérêt d’avoir son chef chez lui, que les revenus publics soient bien administrés, que sa monnoie ne sorte point pour enrichir un autre pays. Il est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes étrangeres ; elles conviennent moins que celles qui sont déjà établies : d’ailleurs les hommes tiennent prodigieusement à leurs lois & à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu’on les change sans de grandes secousses & une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.
Il suit de-là que si un grand état a pour héritier le possesseur d’un grand état, le premier peut fort bien l’exclure, parce qu’il est utile à tous les deux états que l’ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie faite au commencement du regne d’Elisabeth, exclut-elle très-prudemment tout héritier qui posséderoit une autre monarchie : ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger qui seroit appellé à la couronne par le droit du sang.
[III-268]
Que si une nation peut exclure, elle a à plus forte raison le droit de faire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des suites qui puissent lui faire perdre son indépendance ou la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractans, & ceux qui naîtront d’eux, à tous les droits qu’ils auroient sur elle ; & celui qui renonce, & ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins se plaindre, que l’état auroit pu faire une loi pour les exclure.
-
[↑] Voyez ci-dessus, liv. V. chap. xiv ; liv. VIII. chap. xvi, xvii, xviii, xix & xx ; liv. IX. chap. iv, v, vi & vii ; & liv. X. chap. ix & x.
[III-268]
CHAPITRE XXIV.
Que les réglemens de police sont d’un autre ordre que les autres lois civiles.
Il y a des criminels que le magistrat punit, il y en a d’autres qu’il corrige ; les premiers sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité ; ceux-là sont retranchés de la société ; on oblige ceux-ci de vivre selon les regles de la société.
Dans l’exercice de la police, c’est plutôt le magistrat qui punit, que la [III-269] loi ; dans les jugemens des crimes, c’est plutôt la loi qui punit, que le magistrat. Les matieres de police sont des choses de chaque instant, & où il ne s’agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guere de formalités. Les actions de la police sont promptes, & elle s’exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions n’y sont donc pas propres. Elle s’occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc pas faits pour elle. Elle a plutôt des réglemens que des lois. Les gens qui relevent d’elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat ; c’est donc la faute du magistrat, s’ils tombent dans des excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des lois avec la violation de la simple police : ces choses sont d’un ordre différent.
De-là il suit qu’on ne s’est point conformé à la nature des choses de cette république d’Italie [1] où le port des armes à feu est puni comme un crime capital, & où il n’est pas plus fatal d’en faire un mauvais usage que de les porter.
[III-270]
Il suit encore que l’action tant louée de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu’il avoit surpris en fraude, est une action de sultan, qui ne sait être juste qu’en outrant la justice même.
-
[↑] Venise.
[III-270]
CHAPITRE XXV.
Qu’il ne faut pas suivre les dispositions générales du droit civil, lorsqu’il s’agit de choses qui doivent être soumises à des regles particulieres tirées de leur propre nature.
Est-ce une bonne loi, que toutes les obligations civiles passées dans le cours d’un voyage entre les matelots dans un navire, soient nulles ? François Pyrard [1] nous dit que de son temps elle n’étoit point observée par les Portugais, mais qu’elle l’étoit par les François. Des gens qui ne sont ensemble que pour peu de temps, qui n’ont aucuns besoins, puisque le prince y pourvoit, qui ne peuvent avoir qu’un objet qui est celui de leur voyage, qui ne sont plus dans la société, mais citoyens du navire, ne doivent point contracter de [III-271] ces obligations qui n’ont été introduites que pour soutenir les charges de la société civile.
C’est dans ce même esprit que la loi des Rhodiens, faite pour un temps, où l’on suivoit toujours les côtes, vouloit que ceux qui, pendant la tempête, restoient dans le vaisseau, eussent le navire & la charge ; & que ceux qui l’avoient quitté, n’eussent rien.
-
[↑] Chapitre xiv, part. 12.
[III-272]
LIVRE XXVII.↩
CHAPITRE UNIQUE.
De l’origine & des révolutions des lois des Romains sur les successions.
Cette matiere tient à des établissemens d’une antiquité très reculée ; & pour la pénétrer à fond, qu’il me soit permis de chercher dans les premieres lois des Romains ce que je ne sache pas que l’on y ait vu jusqu’ici.
On sait que Romulus [1] partagea les terres de son petit état à ses citoyens ; il me semble que c’est de-là que dérivent les lois de Rome sur les successions.
La loi de la division des terres demanda que les biens d’une famille ne passassent pas dans une autre : de-là il suivit qu’il n’y eut que deux ordres d’héritiers établis par la loi [2] ; les enfans & tous les descendans qui vivoient [III-273] sous la puissance du pere, qu’on appella héritier-siens ; & à leur défaut, les plus proches parens par mâles, qu’on appella agnats.
Il suivit encore que les parens par femmes, qu’on appella cognats, ne devoient point succéder ; ils auroient transporté les biens dans une autre famille ; & cela fut ainsi établi.
Il suivit encore de-là que les enfans ne devoient point succéder à leur mere, ni la mere à ses enfans ; cela auroit porté les biens d’une famille dans une autre. Aussi les voit-on exclus [3] dans la loi des douze tables ; elle n’appeloit à la succession que les agnats, & le fils & la mere ne l’étoient pas entr’eux.
Mais il étoit indifférent que l’héritier-sien, ou à son défaut, le plus proche agnat, fût male lui-même ou femelle ; parce que les parens du côté maternel ne succédant point, quoiqu’une femme héritiere se mariât, les biens rentroient toujours dans la famille dont ils étoient sortis. C’est pour cela que l’on ne distinguoit point dans la loi des douze [III-274] tables, si la personne [4] qui succédoit étoit mâle ou femelle.
Cela fit que, quoique les petits-enfans par le fils succédassent au grand-pere, les petits-enfans par la fille ne lui succéderent point : car, pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille, les agnats leur étoient préférés. Ainsi la fille succéda à son pere, & non pas ses enfans [5] .
Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédoient, lorsque cela s’accordoit avec la loi de la division des terres ; & elles ne succédoient point, lorsque cela pouvoit la choquer.
Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains ; & comme elles étoient une dépendance naturelle de la constitution, & qu’elles dérivoient du partage des terres, on voit bien qu’elles n’eurent pas une origine étrangere, & ne furent point du nombre de celles que rapporterent les députés que l’on envoya dans les villes Grecques.
Denys d’Halicarnasse [6] nous dit que Servius Tullius, trouvant les lois de [III-275] Romulus & de Numa, sur le partage des terres abolies, il les rétablit, & en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage, ne soient l’ouvrage de ces trois législateurs de Rome.
L’ordre de succession ayant été établi en conséquence d’une loi politique, un citoyen ne devoit pas le troubler par une volonté particuliere ; c’est-à-dire que, dans les premiers temps de Rome, il ne devoit pas être permis de faire un testament. Cependant il eût été dur qu’on eût été privé dans ses derniers momens, du commerce des bienfaits.
On trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec la volonté des particuliers. Il fut permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple ; & chaque testament fut en quelque façon un acte de la puissance législative.
La loi des douze tables permit à celui qui faisoit son testament, de choisir pour son héritier le citoyen qu’il vouloit. La raison qui fit que les lois romaines restreignirent si fort le nombre [III-276] de ceux qui pouvoient succéder ab intestat, fut la loi du partage des terres ; & la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté de tester, fut que le pere pouvant vendre ses enfans [7] , il pouvoit à plus forte raison les priver des ses biens. C’étoient donc des effets différens, puisqu’ils couloient de principes divers, & c’est l’esprit des lois Romaines à cet égard.
Les anciennes lois d’Athenes ne permirent point au citoyen de faire de testament. Solon [8] le permit, excepté à ceux qui avoient des enfans : & les législateurs de Rome, pénétrés de l’idée de la puissance paternelle, permirent de tester au préjudice même des enfans. Il faut avouer que les anciennes lois d’Athenes furent plus conséquentes que les lois de Rome. La permission indéfinie de tester, accordée chez les Romains, ruina peu à peu la disposition politique sur le partage des terres ; elle introduisit, plus que toute autre chose, la funeste différence entre les richesses [III-277] & la pauvreté ; plusieurs partages furent assemblés sur une même tête ; des citoyens eurent trop, une infinité d’autres n’eurent rien. Aussi le peuple, continuellement privé de son partage, demanda-t-il sans cesse une nouvelle distribution des terres. Il la demanda dans le temps où la frugalité, la parcimonie & la pauvreté, faisoient le caractere distinctif des Romains, comme dans les temps où leur luxe fut porté à l’excès.
Les testamens étant proprement une loi faite dans l’assemblée du peuple, ceux qui étoient à l’armée se trouvoient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir [9] de faire devant quelques-uns de leurs compagnons, les dispositions [10] qu’ils auroient faites devant lui.
Les grandes assemblées du peuple ne se faisoient que deux fois l’an ; d’ailleurs le peuple s’étoit augmenté & les affaires aussi ; on jugea qu’il convenoit de [III-278] permettre à tous les citoyens de faire [11] leur testament devant quelques citoyens Romains puberes, qui représentassent le corps du peuple ; on prit cinq [12] citoyens, devant lesquels l’héritier [13] achetoit du testateur sa famille, c’est-à-dire, son hérédité ; un autre citoyen portoit une balance pour en peser le prix ; car les Romains [14] n’avoient pas encore de monnoie.
Il y a apparence que ces cinq citoyens représentoient les cinq classes du peuple ; & qu’on ne comptoit pas la sixieme, composée de gens qui n’avoient rien.
Il ne faut pas dire, avec Justinien, que ces ventes étoient imaginaires ; elles le devinrent ; mais au commencement elles ne l’étoient pas. La plupart des lois qui réglerent dans la suite des testamens, tirent leur origine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien la preuve dans les Fragmens d’Ulpien [15] . Le [III-279] sourd, le muet, le prodigue, ne pouvoient faire de testament ; le sourd, parce qu’il ne pouvoit pas entendre les paroles de l’acheteur de la famille ; le muet, parce qu’il ne pouvoit pas prononcer les termes de la nomination : le prodigue, parce que toute gestion d’affaires lui étant interdite, il ne pouvoit pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.
Les testamens se faisant dans l’assemblée du peuple, ils étoient plutôt des actes du droit politique que du droit civil, du droit public plutôt que du droit privé : de-là il suivit que le pere ne pouvoit permettre à son fils qui étoit dans sa puissance, de faire un testament.
Chez la plupart des peuples, les testamens ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires, parce que les uns & les autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte, qui appartiennent également au droit privé. Mais chez les Romains, où les testamens dérivoient du droit public, ils eurent de plus grandes formalités [16] que les autres [III-280] actes ; & cela subsiste encore aujourd’hui dans les pays de France qui se régissent par le droit Romain.
Les testamens étant, comme je l’ai dit, une loi du peuple, ils devoient être faits avec la force du commandement, & par des paroles que l’on appella directes & impératives. De-là il se forma une regle, que l’on ne pourroit donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement [17] : d’où il suivit que l’on pouvoit bien, dans de certains cas, faire une substitution [18] , & ordonner que l’hérédité passât à un autre héritier ; mais qu’on ne pouvoit jamais faire de fidéicommis [19] , c’est-à-dire, charger quelqu’un en forme de priere, de remettre à un autre l’hérédité, ou une partie de l’hérédité.
Lorsque le pere n’instituoit ni exhérédoit son fils, le testament étoit rompu ; mais il étoit valable, quoiqu’il n’exhérédât ni instituât sa fille. J’en vois la raison. Quand il n’instituoit ni exhérédoit son fils, il faisoit tort à son petit-fils, qui [III-281] auroit succédé ab intestat à son pere ; mais en instituant ni exhéré dans sa fille, il ne faisoit aucun tort aux enfans de sa fille, qui n’auroient point succédé ab intestat à leur mere [20] , parce qu’ils n’étoient héritiers siens ni agnats.
Les lois des premiers Romains sur les successions, n’ayant pensé qu’à suivre l’esprit du partage des terres, elles ne restreignirent pas assez les richesses des femmes, & elles laisserent par-là une porte ouverte au luxe, qui est toujours inséparable de ces richesses. Entre la seconde & la troisieme guerre Punique, on commença à sentir le mal ; on fit la loi Voconienne [21] ; & comme de très-grandes considérations la firent taire, qu’il ne nous en reste que peu de monumens, & qu’on n’en a jusqu’ici parlé que d’une maniere très-confuse, je vais l’éclaircir.
Cicéron nous en a conservé un fragment, qui défend d’instituer une femme [III-282] héritiere [22] , soit qu’elle fût mariée, soit qu’elle ne le fût pas.
L’épitome de Tite-Live, où il est parlé de cette loi, n’en dit [23] pas davantage. Il paroît par Cicéron [24] & par S. Augustin [25] , que la fille, & même la fille unique, étoient comprises dans la prohibition.
Caton l’ancien [26] contribua de tout son pouvoir à faire recevoir cette loi. Aulugelle cite un fragment [27] de la harangue qu’il fit dans cette occasion. En empêchant les femmes de succéder, il voulut prévenir les causes de luxe ; comme, en prenant la défense de la loi Oppienne, il voulut arrêter le luxe même.
Dans les institutes de Justinien [28] & de Téophile [29] , on parle d’un chapitre de la loi Voconienne, qui restreignoit la faculté de léguer. En lisant ces auteurs, il n’y a personne qui ne pense que ce [III-283] chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs, que l’héritier refusât de l’accepter. Mais ce n’étoit point là l’esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir qu’elle avoit pour objet d’empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi qui mettoit des bornes à la faculté de léguer, entroit dans cet objet : car si on avoit pu léguer autant que l’on auroit voulu, les femmes auroient pu recevoir comme legs ce qu’elles ne pouvoient obtenir comme succession.
La loi Voconienne fut faite pour prévenir les trop grandes richesses des femmes. Ce fut donc des successions considérables dont il fallut les priver, & non par ce celles qui ne pouvoient entretenir le luxe. La loi fixoit une certaine somme, qui devoit être donnée aux femmes qu’elles privoit de la succession. Cicéron [30] , qui nous apprend ce fait, ne nous dit point quelle étoit cette somme ; mais Dion [31] dit qu’elle étoit de cent mille sesterces.
[III-284]
La loi Voconienne étoit faite pour régler les richesses, & non pas pour régler la pauvreté : aussi Cicéron nous dit-il [32] qu’elle ne statuoit que sur ceux qui étoient inscrits dans le cens.
Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On sait que les Romains étoient extrêmement formalistes, & nous avons dit ci-dessus que l’esprit de la république étoit de suivre la lettre de la loi. Il y eut des peres qui ne se firent point inscrire dans le cens, pour pouvoir laisser leur succession à leur fille : & les préteurs jugerent qu’on ne violoit point la loi Voconienne, puisqu’on n’en violoit point la lettre.
Un certain Anius Asellus avoit institué sa fille, unique héritiere. Il le pouvoit, dit Cicéron [33] , la loi Voconienne ne l’en empêchoit pas, parce qu’il n’étoit point dans le cens. Verrès, étant prêteur, avoit privé la fille de la succession : Cicéron soutient que Verrès avoit été corrompu, parce que, sans cela, il n’auroit point interverti un [III-285] ordre que les autres préteurs avoient suivi.
Qu’étoient donc ces citoyens qui n’étoient point dans le cens qui comprenoit tous les citoyens ? Mais, selon l’institution de Servius Tullius, rapportée par Denys d’Halicarnasse [34] , tout citoyen qui ne se faisoit point inscrire dans le cens étoit fait esclave : Cicéron lui-même [35] dit qu’un tel homme perdoit la liberté : Zonare dit la même chose. Il falloit donc qu’il y eût de la différence entre n’être point dans le cens selon l’esprit de la loi Voconienne, & n’être point dans le cens selon l’esprit des institutions de Servius Tullius.
Ceux qui ne s’étoient point fait inscrire dans les cinq premieres classes, où l’on étoit placé selon la proportion de ses biens, n’étoient point dans le cens [36] selon l’esprit de la loi Voconienne : ceux qui n’étoient point inscrits dans le nombre des six classes, ou qui n’étoient point mis par les censeurs au nombre de ceux que l’on appelloit ærarii, n’étoient [III-286] point dans le cens suivant les institutions de Servius Tullius. Telle étoit la force de la nature, que des peres, pour éluder la loi Voconienne, consentoient à souffrir la honte d’être confondus dans la sixieme classe avec les prolétaires & ceux qui étoient taxés pour leur tête, ou peut-être même à être renvoyés dans les tables [37] des Cérites.
Nous avons dit que la jurisprudence des Romains n’admettoit point les fidéicommis. L’espérance d’éluder la loi Voconienne les introduisit : on instituoit un héritier capable de recevoir par la loi, & on le prioit de remettre la succession à une personne que la loi en avoit exclue. Cette nouvelle maniere de disposer eut des effets biens différens. Les uns rendirent l’hérédité ; & l’action de Sexus Peduceus [38] fut remarquable. On lui donna une grande succession ; il n’y avoit personne dans le monde que lui qui sût qu’il étoit prié de la remettre. Il alla trouver la veuve du testateur, & lui donna tout le bien de son mari.
Les autres garderent pour eux la succession ; & l’exemple de P. Sextilius [III-287] Rufus fut célebre encore, parce que Cicéron [39] l’emploie dans ses disputes contre les Épicuriens. « Dans ma jeunesse, dit-il, je fus prié par Sextilius de l’accompagner chez ses amis, pour savoir d’eux s’il devoit remettre l’hérédité de Quintus Fadius Gallus à Fadia sa fille. Il avoit assemblé plusieurs jeunes gens, avec de très-graves personnages ; & aucun ne fut d’avis qu’il donnât plus à Fadia que ce qu’elle devoit avoir par la loi Voconienne. Sextilius eut là une grande succession, dont il n’auroit pas retenu un sesterce, s’il avoit préféré ce qui étoit juste & honnête à ce qui étoit utile. Je puis croire, ajouta-t-il, que vous auriez rendu l’hérédité ; je puis croire même qu’Épicure l’auroit rendue : mais vous n’auriez pas suivi vos principes. » Je ferai ici quelques réflexions.
C’est un malheur de la condition humaine, que les législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentimens naturels mêmes : telle fut la loi Voconienne. C’est que les législateurs statuent plus sur la société que sur le citoyen, & sur le citoyen que sur [III-288] l’homme. La loi sacrifoit & le citoyen & l’homme, & ne pensoit qu’à la république. Un homme prioit son ami de remettre sa succession à sa fille : la loi méprisoit dans le testateur, les sentimens de la nature ; elle méprisoit dans la fille, la piété filiale ; elle n’avoit aucun égard pour celui qui étoit chargé de remettre l’hérédité, qui se trouvoit dans de terribles circonstances. La remettoit-il ? il étoit un mauvais citoyen : la gardoit-il ? il étoit un mal-honnête homme. Il n’y avoit que les gens d’un bon naturel qui pensassent à éluder la loi ; il n’y avoit que les honnêtes gens qu’on pût choisir pour l’éluder : car c’est toujours un triomphe à remporter sur l’avarice & les voluptés, & il n’y a que les honnêtes gens qui obtiennent ces sortes de triomphes. Peut-être même y auroit-il de la rigueur à les regarder en cela comme de mauvais citoyens. Il n’est pas impossible que le législateur eût obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa foi étoit telle, qu’elle ne forçoit que les honnêtes gens à l’éluder.
Dans le temps que l’on fit la loi Voconienne, les mœurs avoient conservé quelque chose de leur ancienne pureté.
[III-289] On intéressa quelquefois la conscience publique en faveur de la loi, & l’on fit jurer [40] qu’on l’observeroit : de sorte que la probité faisoit, pour ainsi dire, la guerre à la probité. Mais dans les derniers temps, les mœurs se corrompirent au point, que les fidéicommis durent avoir moins de force pour éluder la loi Voconienne, que cette loi n’en avoit pour se faire suivre.
Les guerres civiles firent périr un nombre infini de citoyens. Rome, sous Auguste, se trouva presque déserte ; il falloit la repeupler. On fit les lois Papiennes, où l’on n’omit rien de ce qui pouvoit encourager [41] les citoyens à se marier & à avoir des enfans. Un des principaux moyens fut d’augmenter, pour ceux qui se prêtoient aux vues de la loi, les espérances de succéder, & de les diminuer pour ceux qui s’y refusoient ; & comme la loi Voconienne avoit rendu les femmes incapables de succéder, la loi Pappienne fit dans de certains cas cesser cette prohibition.
[III-290]
Les femmes [42] , sur-tout celles qui avoient des enfans, furent rendues capables de recevoir en vertu du testament de leurs maris ; elles purent, quand elles avoient des enfans, recevoir en vertu du testament des étrangers, tout cela contre la disposition de la loi Voconienne : & il est remarquable qu’on n’abandonna pas entiérement l’esprit de cette loi. Par exemple, la loi Pappienne [43] permettoit à un homme qui avoit un enfant [44] , de recevoir toute l’hérédité par le testament d’un étranger ; elle n’accordoit la même grace à la femme, que lorsqu’elle avoit trois [45] enfans.
Il faut remarquer que la loi Pappienne ne rendit les femmes qui avoient trois enfans, capables de succéder, qu’en vertu du testament des étrangers ; & [III-291] qu’à l’égard de la succession des parens, elle laissa les anciennes lois & la loi Voconienne [46] dans toute leur force. Mais cela ne subsista pas.
Rome abymée par les richesses de toutes les nations, avoit changé de mœurs ; il ne fut plus question d’arrêter le luxe des femmes. Aulugelle, qui vivoit sous Adrien [47] , nous dit que de son temps la loi Voconienne étoit presque anéantie ; elle fut couverte par l’opulence de la cité. Aussi trouvons-nous dans les sentences de Paul [48] qui vivoit sous Niger, & dans les fragmens d’Ulpien [49] qui étoit du temps d’Alexandre Sévere, que les sœurs du côté du pere pouvoient succéder, & qu’il n’y avoit que les parens d’un degré plus éloigné, qui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Voconienne.
Les anciennes lois de Rome avoient commencé à paroître dures ; & les préteurs ne furent plus touchés que des raisons d’équité, de modération & de bienséance.
[III-292]
Nous avons vu que, par les anciennes lois de Rome, les meres n’avoient point de part à la succession de leurs enfans. La loi Voconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais l’empereur Claude donna à la mere la succession de ses enfans, comme une consolation de leur perte ; le senatus-consulte Tertullien fait sous Adrien [50] la leur donna lorsqu’elles avoient trois enfans, si elles étoient ingénues ; ou quatre, si elles étoient affranchies. Il est clair que ce sénatus-consulte n’étoit qu’une extension de la loi Pappienne, qui, dans le même cas, avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien [51] leur accorda la succession, indépendamment du nombre de leurs enfans.
Les mêmes causes qui firent restreindre la loi qui empêchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avoit gêné la succession des parens par femmes. Ces lois étoient très-conformes à l’esprit d’une bonne [III-293] république, où l’on doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe, ni de ses richesses, ni de l’espérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage à charge & coûteux, il faut y être invité, & par les richesses que les femmes peuvent donner, & par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer. Ainsi, lorsque la monarchie s’établit à Rome, tout le systême fut changé sur les successions. Les préteurs appellerent les parens par femmes au défaut des parens par mâles : au lieu que, par les anciennes lois, les parens par femmes n’étoient jamais appellés. Le sénatus-consulte Orphitien appella les enfans à la succession de leur mere ; & les empereurs Valentinien [52] , Théodose & Arcadius appellerent les petits-enfans par la fille à la succession du grand-pere. Enfin l’empereur Justinien [53] ôta jusqu’au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d’héritiers, les descendans, les ascendans, les collatéraux, sans aucune [III-294] distinction entre les mâles & les femelles, entre les parens par femmes & les parens par mâles ; & abrogea toutes celles qui restoient à cet égard. Il crut suivre la nature même, en s’écartant de ce qu’il appella les embarras de l’ancienne jurisprudence.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse, liv. II. chap. III. Plutarque, dans sa comparaison de Numa & de Lycurgue.
-
[↑] Ast si intestato moritur, cui suus hæres nec extabit, agnatus proximus familiam habeto. Fragm. de la loi des douze tables, dans Ulpien, titre dernier.
-
[↑] Voyez les Fragmens d’Ulpien, §. 8, tot. 26, inst. tit. 3, in proæmio ad Sen. Conf. Tertullianum.
-
[↑] Paul, liv. IV. de sent. tit. 8. §. 3.
-
[↑] Instit. liv. III. tit. I, §. 15.
-
[↑] Livre IV, page 276.
-
[↑] Denys d’Halicarnasse prouve, par une loi de Numa, que la loi qui permettoit au pere de vendre son fils trois fois, étoit une loi de Romulus, non pas des décemvirs, livre II.
-
[↑] Voyez Plutarque, vie de Solon.
-
[↑] Ce testament appellé in procinctu, étoit différent de celui qu’on appella militaire, qui ne fut établi que par les constitutions des empereurs, leg I. ff. de militari testamento : ce fut une de leurs cajoleries envers les soldats.
-
[↑] Ce testament n’étoit point écrit, & étoit sans formalités, sine librâ & tabulis, comme dit Cicéron, livre I. de l’orateur.
-
[↑] Inst. liv. II. tit. 10, §. I ; Aulugelle, liv. XV. chap. xxvii. On appella cette sorte de testament, per as & libram.
-
[↑] Ulpien, tit. 10, §. 2.
-
[↑] Théophile, instit. liv. II. tit. 30.
-
[↑] Ils n’en eurent qu’au temps de la guerre de Pyrrhus. Tite-Live, parlant du siege de Veïes, dit : Nondum argentum signatum erat, liv. IV.
-
[↑] Titre 20, §. 13.
-
[↑] Instit. liv. II. tit. 10, §. I.
-
[↑] Titius, sois mon héritier.
-
[↑] La vulgaire, la puprilaire, l’exemplaire.
-
[↑] Auguste, par des raisons particulieres, commença à autoriser les fidéicommis. Instit. livre II. tit. 23. §. I.
-
[↑] Ad liberos matris intestatæ hæreditas, leg. XII. Tab. non pertinebat, quia fæminæ suos hæredes non habent. Ulp. fragm. tit. 26. §. 7.
-
[↑] Quintus Voconius, tribun du peuple, la proposa. Voyez Cicéron, seconde harangue contre Verrès. Dans l’épitome de Tite-Live, livre XLI, il faut lire Voconius¸au lieu de Volumnius.
-
[↑] Sanxit… ne quis hæredem virginem neve me lierem faceret. Cicéron, seconde harangue contre Verrès.
-
[↑] Legem tuliy, ne quis hæredem mulierem institue ret, liv. XLI.
-
[↑] Seconde harangue contre Verrès.
-
[↑] Livre III de la cité de Dieu.
-
[↑] Epitome de Tite-Live, liv. XLI.
-
[↑] Livre XVII. chap. vi.
-
[↑] Instit. liv. II. tit. 22.
-
[↑] Livre II. tit. 22.
-
[↑] Nemo censuit plus Fadiæ dandum, quam posses ad eam lege Voconianâ pervenire. De finibus boni & mali, liv. II.
-
[↑] Cum lege Voconianâ mulieribus prohiberetur ne quæ majorem centum millibus nummorum hæreditatem posset adire, liv. LVI.
-
[↑] Qui census esset. Harangue seconde contre Verrès.
-
[↑] Census non erat. Ibid.
-
[↑] Livre IV.
-
[↑] In oratione pro Cæcinnâ.
-
[↑] Ces cinq premieres classes étoient si considérables, que quelquefois les auteurs n’en rapportent que cinq.
-
[↑] In Cæritum tabulas referri, ærarius fieri.
-
[↑] Cicéron, de finib. boni & mali, liv. II.
-
[↑] Cicéron, de finib. boni & mali, liv. II.
-
[↑] Sextilius disoit qu’il avoit juré de l’observer. Cicéron, de finib. boni & mali, liv. II.
-
[↑] Voyez ce que j’en ai dit au liv. XXIII. ch. xxi.
-
[↑] Voyez sur ceci les fragmens d’Ulpien, tit. 15. §. 16.
-
[↑] La même différence se trouve dans plusieurs dispositions de la loi Pappienne. Voyez les fragmens d’Ulpien¸§. 4 & 5, tit. dernier ; & le même au même titre, §. 6.
-
[↑] Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur ex me,
Jura parentis habes, propter me scriberis hæres
Juvenal, sat. IX. -
[↑] Voyez la loi IX, cod. Théod. de bonis proscriptorum ; & Dion. liv. LV ; voyez les fragmens d’Ulpien, tit. derni. §. 6 ; & tit. 29, §. 3.
-
[↑] Fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I ; Sozom. liv. I. chap xix.
-
[↑] Liv. XX, chap. i.
-
[↑] Liv. IV, tit. 8. §. 3.
-
[↑] Tit. 26. 6. 6.
-
[↑] C’est-à-dire, l’empereur Pie, qui prit le nom d’Adrien par adoption.
-
[↑] Leg. II, cod. de jure liberorum, instit. liv. III. tit. 3. §. 4. de senatus consult. Tertull.
-
[↑] Lege IX, cod. de suis & legitimis liberis.
-
[↑] Lege XII, cod. ibid. & les novelles 118 & 127.
[III-295]
LIVRE XXVIII.
De l’origine & des révolutions des Lois civiles chez les François.↩
In nove sert animus mutatas dicere formas
Corpora. . . . . . .Ovid. Metam
CHAPITRE PREMIER.
Des différens caracteres des Lois des peuples Germains.
Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger [1] par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Francs Ripuaires s’étant jointe sous Clovis [2] à celle des Francs Saliens, elle conserva ses usages ; & Théodoric [3] roi d’Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit [4] de [III-296] même les usages des Bavarois & des Allemands qui dépendoient de son royaume. Car la Germanie étant affoiblie par la sortie de tant de peuples, les Francs, après avoir conquis devant eux, avoient fait un pas en arriere, & porté leur domination dans les forêts de leurs peres. Il y a apparence que le code [5] des Thuringiens fut donné par le même Théodoric, puisque les Thuringiens étoient aussi ses sujets. Les Frisons ayant été soumis par Charles-Martel & Pepin, leur [6] loi n’est pas antérieure à ces princes. Charlemagne, qui le premier dompta les Saxons, leur donna la loi que nous avons. Il n’y a qu’à lire des deux derniers codes, pour voir qu’ils sortent des mains des vainqueurs. Les Wisigoths, les Bourguignons, & les Lombards ayant fondé des royaumes, firent écrire leurs lois, non pas pour faire suivre leurs usages aux peuples vaincus, mais pour les suivre eux-mêmes.
Il y a dans les lois saliques & Ripuaires, dans celles des Allemands, des [III-297] Bavarois, des Thuringiens & des Frisons, une simplicité admirable : on y trouve une rudesse originale & un esprit qui n’avoit point été affoibli par un autre esprit. Elles changerent peu, parce que ces peuples, si on en excepte les Francs, resterent dans la Germanie. Les Francs même y fonderent une grande partie de leur empire : ainsi leurs lois furent toutes Germaines. Il n’en fut pas de même des lois des Wisigoths, des Lombards & des Bourguignons ; elles perdirent beaucoup de leur caractere, parce que ces peuples, qui se fixerent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur.
Le royaume des Bourguignons ne subsista pas assez long-temps, pour que les lois du peuple vainqueur pussent recevoir de grands changemens. Gondebaud & Sigismond, qui recueillirent leurs usages, furent presque les derniers de leurs rois. Les lois des Lombards reçurent plutôt des additions que des changemens. Celles de Rotharis furent suivies de celles de Grimoald, de Luitprand, de Rachis, d’Aistulphe ; mais elles ne prirent point de nouvelle forme. Il n’en fut pas de même des lois de [III-298] Wisigoths [7] ; leurs rois les refondirent, & les firent refondre par le clergé.
Les rois de la première race ôterent [8] bien aux lois saliques & Ripuaires ce qui ne pouvoit absolument s’accorder avec le Christianisme : mais ils en laisserent tout le fond. C’est ce qu’on ne peut pas dire des lois des Wisigoths.
Les lois des Bourguignons, & sur-tout celles des Wisigoths, admirent les peines corporelles. Les lois saliques & Ripuaires ne les reçurent [9] ; elles conserverent mieux leur caractere.
Les Bourguignons & les Wisigoths dont les provinces étoient très-exposées, chercherent à se concilier les anciens habitans, & à leur donner des lois civiles les plus impartiales [10] : mais les rois Francs, sûrs de leur puissance, n’eurent [11] pas ces égards.
[III-299]
Les Saxons, qui vivoient sous l’empire des Francs, eurent une humeur indomptable, & s’obstinerent à se révolter. On trouve dans leurs [12] lois des duretés du vainqueur, qu’on ne voit point dans les autres codes des lois des barbares.
On y voit l’esprit des lois des Germains dans les peines pécuniaires, & celui du vainqueur dans les peines afflictives.
Les crimes qu’ils font dans leur pays, sont punis corporellement ; & on ne suit l’esprit des lois Germaniques que dans la punition de ceux qu’ils commettent hors de leur territoire.
On y déclare que pour leurs crimes ils n’auront jamais de paix, & on leur refuse l’asyle des églises mêmes.
Les évêques eurent une autorité immense à la cour des rois Wisigoths ; les affaires les plus importantes étoient décidées dans les conciles. Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous les principes & toutes les vues de l’inquisition d’aujourd’hui ; & les moines n’ont fait que copier contre [III-300] les Juifs, des lois faites autrefois par les évêques.
Du reste, les lois de Gondebaud pour les Bourguignons paroissent assez judicieuses ; celles de Rotharis & des autres princes Lombards le sont encore plus. Mais les lois des Wisigoths, celles de Recessuinde, de Chaindasuinde & d’Egiga, sont puériles, gauches, idiotes ; elles n’atteignent point le but : pleines de rhétorique, & vuides de sens, frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style.
-
[↑] Voyez le prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit, dans son traité de l’origine des Francs, que cette loi fut faite avant le regne de Clovis : mais elle ne put l’être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n’entendoient pas pour lors la langue Latine.
-
[↑] Voyez Grégoire de Tours.
-
[↑] Voyez le prologue de la loi des Bavarois & celui de la loi salique.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Lex Angliorum Werinorum, hoc est, Thuringorum.
-
[↑] Ils ne savoient point écrire.
-
[↑] Euric les donna, Leuvigilde les corrigea. Voyez la chronique d’Isidore. Chaindasuinde & Récessuinde les réformerent. Egiga fit faire le code que nous avons, & en donna la commission aux évêques ; on conserva pourtant les lois de Chaindasuinde & de Récessuinde, comme il paroît par le seizieme concile de Tolede.
-
[↑] Voyez le prologue de la loi des Bavarois.
-
[↑] On en trouve seulement quelques-unes dans le décret de Childebert.
-
[↑] Voyez le prologue du code des Bourguignons & le code même ; sur-tout le tit. 12, §. 5, & le tit. 38. Voyez aussi Grégoire de Tours, liv. II, ch. xxxiii ; & le code des Wisigoths.
-
[↑] Voyez ci-dessous, le ch. iii.
-
[↑] Voyez le chap. ii, §. 8 & 9, & le chap. iv, §. 2 & 7.
[III-300]
CHAPITRE II.
Que les lois des barbares furent toutes personnelles.
C’est un caractere particulier de ces lois des barbares, qu’elles ne furent point attachées à un certain territoire : le Franc étoit jugé par la loi des Francs, l’Allemand par la loi des Allemands, le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi Romaine : & bien loin qu’on songeât dans ces temps-là à rendre uniformes les lois des peuples conquérans, on en pensa pas [III-301] même à se faire législateur du peuple vaincu.
Je trouve l’origine de cela dans les mœurs des peuples Germains. Ces nations étoient partagées par des marais, des lacs & des forêts ; on voit même dans César [1] qu’elles aimoient à se séparer. La frayeur qu’elles eurent des Romains, fit qu’elles se réunirent ; chaque homme, dans ces nations mêlées, dut être jugé par les usages & les coutumes de sa propre nation. Tous ces peuples dans leur particulier étoient libres & indépendans ; & quand ils furent mêlés, l’indépendance resta encore : la patrie étoit commune, & la république particuliere ; le territoire étoit le même, & les nations diverses. L’esprit des lois personnelles étoit donc chez ces peuples avant qu’ils partissent de chez eux, & ils le porterent dans leurs conqûetes.
On trouve cet usage établi dans les formules [2] de Marculfe, dans les codes des lois des barbares, sur-tout dans la loi des Ripuaires [3] , dans les [4] [III-302] décrets des rois de la premiere race, d’où dériverent les capitulaires que l’on fit là-dessus dans la seconde [5] . Les enfans [6] suivoient la loi de leur pere, les femmes [7] celle de leur mari ; les veuves [8] revenoient à leur loi, les affranchis [9] avoient celle de leur patron. Ce n’est pas tout : chacun pouvoit prendre la loi qu’il vouloit ; la constitution de Lothaire I [10] exigea que ce choix fût rendu public.
-
[↑] De bello Gallico, liv. VI.
-
[↑] Liv. I, form. 8.
-
[↑] Chap. xxxi.
-
[↑] Celui de Clotaire de l’an 560, dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, arr. 4 ; ibid. in fine.
-
[↑] Capitul. Ajoutés à la loi des Lombards, liv. I, tit. 25. ch. lxxi ; liv. II, tit. 41, ch. vii ; & tit. 56, chap. i & ii.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 5.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 7, ch. i.
-
[↑] Ibid. ch. ii.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 35, ch. ii.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 57.
[III-302]
CHAPITRE III.
Différence capitale entre les Lois saliques & les Lois des wisigoths & des Bourguignons.
J’ai dit [1] que la loi des Bourguignons & celle des wisigoths étoient impartiales : mais la loi salique ne le fut pas : elle établit entre les Francs & les Romains les distinctions les plus [III-303] affligeantes. Quand [2] on avoit tué un Franc, un barbare, ou un homme qui vivoit sous la loi salique, on payoit à ses parens une composition de 200 sols : on n’en payoit qu’une de 100, lorsqu’on avoit tué un Romain possesseur [3] ; & seulement une de 45, quand on avoit tué un Romain tributaire : la composition pour le meurtre d’un Franc vassal [4] du roi, étoit de 600 sols ; & celle du meurtre d’un Romain convive [5] du roi [6] n’étoit que de 300. Elle mettoit donc une cruelle différence entre le seigneur Franc & le seigneur Romain, & entre le Franc & le Romain qui étoient d’une condition médiocre.
Ce n’est pas tout : si l’on assembloit [7] du monde pour assaillir un Franc dans sa maison, & qu’on le tuât, la loi salique ordonnoit une composition de 600 sols ; mais si on avoit assailli un Romain ou un [III-304] affranchi [8] , on ne payoit que la moitié de la composition. Par la même loi [9] , si un Romain enchaînoit un Franc, il devoit trente sous de composition ; mais si un Franc enchaînoit un Romain, il n’en devoit qu’une de quinze. Un Franc dépouillé par un Romain, avoit soixante-deux sous & demi de composition ; & un Romain dépouillé par un Franc, n’en recevoir qu’une de trente. Tout cela devoit être accablant pour les Romains.
Cependant un auteur [10] célebre forme un systême de l’établissement des Francs dans les Gaules, sur la présupposition qu’ils étoient les meilleurs amis des Romains. Les Francs étoient donc les meilleurs amis des Romains, eux qui leur firent, eux qui en reçurent [11] des maux effroyables ? Les Francs étoient amis des Romains, eux qui, après les avoir assujettis par les armes, les opprimerent de sang froid par leurs lois ? Ils étoient amis des Romains, comme les Tartares qui conquirent la Chine, étoient amis des Chinois.
[III-305]
Si quelques évêques catholiques ont voulu se servir des Francs pour détruire des rois Arriens, s’ensuit-il qu’ils ayent désiré de vivre sous des peuples barbares ? En peut-on conclure que les Francs eussent des égards particuliers pour les Romains ? J’en tirerois bien d’autres conséquences : plus les Francs furent sûrs des Romains, moins ils les ménagerent.
Mais l’Abbé Dubos a puisé dans de mauvaises sources pour un historien, les poëtes & les orateurs : ce n’est point sur des ouvrages d’ostentation qu’il faut sonder des systêmes.
-
[↑] Au chapitre premier de ce livre.
-
[↑] Loi salique, tit. 44. §. I.
-
[↑] Qui res in pago ubi remanet proprias habet. Loi salique, tit. 44, §. 15 ; voyez aussi le §. 7.
-
[↑] Qui in truste dominicâ est, ibid. tit. 44. §. 4.
-
[↑] Si Romanus homo conviva regis suerit, ibid. §. 6.
-
[↑] Les principaux Romains s’attachoient à la cour, comme on le voit par la vie de plusieurs évêques qui y furent élevés ; il n’y avoit guere que les Romains qui sussent écrire.
-
[↑] Ibid. tit. 45.
-
[↑] Lidus, dont la condition étoit meilleure que celle du serf : loi des Allemands, chap. xcv.
-
[↑] Tit. 35, §. 3 & 4.
-
[↑] L’abbé Dubos.
-
[↑] Témoin l’expédition d’Arbogaste, dans Grégoire de Tours, hist. liv. II.
[III-305]
CHAPITRE IV.
Comment le droit Romain se perdit dans le pays du domaine des Francs, & se conserva dans le pays du domaine des Goths & des Bourguigons.
Les choses que j’ai dites donnerent du jour à d’autres, qui ont été jusqu’ici pleines d’obscurités.
Le pays qu’on appelle aujourd’hui la France, fut gouverné dans la premiere race par la loi Romaine ou le code [III-306] Théodosien, & par les diverses lois des barbares [1] qui y habitoient.
Dans le pays du domaine des Francs, la loi salique étoit établie pour les Francs, & le code [2] Théodosien pour les Romains. Dans celui du domaine des Wisigoths, une compilation du code Théodosien, faite par l’ordre d’Alaric [3] , régla les différens des Romains ; les coutumes de la nation, qu’Euric [4] fit rédiger par écrit, déciderent ceux des Wisigoths. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans le pays des Francs ? Et pourquoi le droit Romain s’y perdit-il peu à peu, pendant que, dans le domaine des Wisigoths, le droit Romain s’étendit, & eut une autorité générale ?
Je dis que le droit Romain perdit son usage chez les Francs, à cause des grands avantages qu’il y avoit à être Franc [5] , [III-307] barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; tout le monde fut porté à quitter le droit Romain, pour vivre sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques [6] , parce qu’ils n’eurent point d’intérêt à changer. Les différences des conditions & des rangs ne consistoient que dans la grandeur des compositions, comme je le ferai voir ailleurs. Or, des lois [7] particulieres leur donnerent des compositions aussi favorables que celles qu’avoient les Francs : ils garderent donc le droit Romain. Ils n’en recevoient aucun préjudice ; & il leur convenoit d’ailleurs, parce qu’il étoit l’ouvrage des empereurs Chrétiens.
D’un autre côté, dans le patrimoine des Wisigoths, la loi Wisigothe [8] ne [III-308] donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains, les Romains n’eurent aucune raison de cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre : ils garderent donc leurs lois, & ne prirent point celles des Wisigoths.
Ceci se confirme à mesure qu’on va plus avant. La loi de Gondebaud fut très-impartiale, & ne fut pas plus favorable aux Bourguignons qu’aux Romains. Il paroît, par le prologue de cette loi, qu’elle fut faite pour les Bourguignons, & qu’elle fut faite encore pour régler les affaires qui pourroient naître entre les Romains & les Bourguignons ; et dans ce dernier cas, le tribunal fut mi-parti. Cela étoit nécessaire pour des raisons particulieres, tirées de l’arrangement [9] politique de ces temps-là. Le droit Romain subsista dans la Bourgogne, pour régler les différens que les Romains pourroient avoir entr’eux. Ceux-ci n’eurent point de raison pour quitter leur loi, comme ils en eurent dans le pays des Francs ; d’autant mieux que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, comme il paroît par la [III-309] fameuse lettre qu’Agobard écrivit à Louis le débonnaire.
Agobard [10] demandoit à ce prince d’établir la loi salique dans la Bourgogne : elle n’y étoit donc pas établie. Ainsi le droit Romain subsista, & subsiste encore dans tant de provinces qui dépendoient autrefois de ce royaume.
Le droit Romain & la loi Gothe se maintinrent de même dans le pays de l’établissement des Goths : la loi salique n’y fut jamais reçue. Quand Pepin & Charles-Martel en chasserent les Sarrasins, les villes & les provinces qui se soumirent à ces princes [11] demanderent à conserver leurs lois, & l’obtinrent : ce qui, malgré l’usage de ces temps-là où toutes les lois étoient personnelles, fit bientôt regarder le droit Romain comme une loi réelle & territoriale dans ces pays.
[III-310]
Cela se prouve par l’édit de Charles le chauve, donné à Pistes l’an 864, qui [12] distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit Romain, d’avec ceux où l’on n’y jugeoit pas.
L’édit de Pistes prouve deux choses ; l’une, qu’il y avoit des pays où l’on jugeoit selon la loi Romaine, & qu’il y en avoit où l’on ne jugeoit point selon cette loi ; l’autre, que ces pays où l’on jugeoit par la loi Romaine, étoient précisément [13] ceux où on la suit encore aujourd’hui, comme il paroît par ce même édit : ainsi la distinction des pays de la France coutumiere, & de la France régie par le droit écrit, étoit déjà établie du temps de l’édit de Pistes.
J’ai dit que dans les commencemens de la monarchie, toutes les lois étoient personnelles : ainsi, quand l’édit de Pistes distingue les pays du droit Romain d’avec ceux qui ne l’étoient pas, cela signifie que, dans les pays qui n’étoient point pays de droit Romain, tant de gens avoient choisi de vivre sous [III-311] quelqu’une des lois des peuples barbares, qu’il n’y avoit presque plus personne dans ces contrées qui choisît de vivre sous la loi Romaine, & que, dans les pays de la loi Romaine, il y avoit peu de gens qui eussent choisi de vivre sous les lois des peuples barbares.
Je sais bien que je dis ici des choses nouvelles : mais si elles sont vraies, elles sont très-anciennes. Qu’importe, après tout, que ce soient moi, les Valois, ou les Bignons, qui les ayent dites ?
-
[↑] Les Francs, les Wisigoths & les Bourguignons.
-
[↑] Il fut fini l’an 438.
-
[↑] La vingtieme année du regne de ce prince, & publiée deux ans après par Anian, comme il paroît par la préface de ce code.
-
[↑] L’an 504 de l’ere de l’Espagne : chronique d’Isidore.
-
[↑] Francum aut barbarum, aut hominem qui salicô lege vivit. Loi salique, tit. 445, §. 1.
-
[↑] Selon la loi Romaine, sous laquelle l’église vit, est-il dit dans la loi des Ripuaires, tit. 58, §. I. Voyez aussi les autorités sans nombre là-dessus, rapportées par M. Ducange, au mot Lex Romana.
-
[↑] Voyez les capitulaires ajoutés à la loi salique dans Lindembroc, à la fin de cette loi, & les divers codes des lois des barbares sur les privileges des ecclésiastiques à cet égard. Voyez aussi la lettre de Charlemagne à Pepin son fils, toi d’Italie, de l’an 807, dans l’édition de Buluze, tome I, page 452, où il est dit qu’un ecclésiastique doit recevoir une composition triple ; & le recueil des capitulaires, liv. V. art. 302, tome I, édition de Baluze.
-
[↑] Voyez cette loi.
-
[↑] J’en parlerai ailleurs liv. XXX, ch. vi, vii, viii & ix.
-
[↑] Agob. opera.
-
[↑] Voyez Gervais de Tilburi, dans le recueil de Duchesne, tome 3, p. 366 : Factâ pactione cum Francis, quòd illic Gothi patriis legibus, moribus paternis vivant. Et sic Narbone sis provincia Pippino subjicitur. Et une chronique de l’an 759, rapportée par Catel, histoire du Languedoc. Et l’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, sur la demande faite par les peuples de la Septimanie, dans l’assemblée in Carisiaco, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 316.
-
[↑] In illâ terrâ in quâ judicia secundùm legem Romanam terminantur, secundùm ipsam legem judicetur ; & in illâ in quâ, &c. art. 16. V. aussi l’art 20.
-
[↑] Voyez l’art. 12 & 16 de l’édit de Pistes, in Cavilono, in Narbonâ, &c.
[III-311]
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
La loi de Gondebaud subsista long-temps chez les Bourguignons, concurremment avec la loi Romaine : elle y étoit encore en usage du temps de Louis le débonnaire ; la lettre d’Agobard ne laisse aucun doute là-dessus. De même, quoique l’édit de Pistes appelle le pays qui avoit été occupé par les Wisigoths, le pays de la loi Romaine, la loi des Wisigoths y subsistoit toujours ; ce qui se prouve par le synode de Troyes, tenu sous Louis le begue, [III-312] l’an 878, c’est-à-dire, quatorze ans après l’édit de Pistes.
Dans la suite, les lois Gothes & Bourguignonnes périrent dans leur pays même, par les causes [1] générales qui firent par-tout disparoître les lois personnelles des peuples barbares.
-
[↑] Voyez ci-dessous les chapitres IX, X & XI.
[III-312]
CHAPITRE VI.
Comment le droit Romain se conserva dans le domaine des Lombards.
Tout se plie à mes principes. La loi des Lombards étoit impartiale, & les Romains n’eurent aucun intérêt à quitter la leur pour la prendre. Le motif qui engagea les Romains sous les Francs à choisir la loi salique, n’eut point de lieu en Italie ; le droit Romain s’y maintint avec la loi des Lombards.
Il arriva même que celle-ci céda au droit Romain ; elle cessa d’être la loi de la nation dominante ; & quoiqu’elle continuât d’être celle de la principale noblesse, la plupart des villes s’érigerent en républiques, & cette noblesse [III-313] tomba, ou fut [1] exterminée. Les citoyens des nouvelles républiques ne furent point portés à prendre une loi qui établissoit l’usage du combat judiciaire, & dont les institutions tenoient beaucoup aux coutumes & aux usages de la chevalerie. Le clergé dès-lors si puissant en Italie, vivant presque tous sous la loi Romaine, le nombre de ceux qui suivoient la loi des Lombards dut toujours diminuer.
D’ailleurs, la loi des Lombards n’avoit point cette majesté du droit Romain, qui rappelloit à l’Italie l’idée de sa domination sur toute la terre ; elle n’en avoit pas l’étendue. La loi des Lombards & la loi Romaine ne pouvoient plus servir qu’à suppléer aux statuts des villes qui s’étoient érigées en républiques : or, qui pouvoit mieux y suppléer, ou la loi des Lombards qui ne statuoit que sur quelques cas, ou la loi Romaine qui les embrassoit tous ?
-
[↑] Voyez ce que dit Machiavel, de la destruction de l’ancienne noblesse de Florence.
[III-314]
CHAPITRE VII.
Comment le droit Romain se perdit en Espagne.
Les choses allerent autrement en Espagne. La loi des Wisigoths triompha, & le droit Romain s’y perdit. Chaindasuinde [1] & Récessuinde [2] proscrivirent les lois Romaines, & ne permirent pas même de les citer dans les tribunaux. Récessuinde fut encore l’auteur de la loi [3] , qui ôtoit la prohibition des mariages entre les Goths & les Romains. Il est clair que ces deux lois avoient le même esprit : ce roi vouloit enlever les principales causes de séparation qui étoient entre les Goths & les Romains. Or, on pensoit que rien ne les séparoit plus que la défense de contracter entr’eux des mariages, & la permission de vivre sous des lois diverses.
Mais quoique les rois des Wisigoths [III-315] eussent proscrit le droit Romain, il subsista toujours dans les domaines qu’ils possédoient dans la Gaule méridionale. Ces pays éloignés du centre de la monarchie, vivoient dans une grande indépendance [4] . On voit par l’histoire de Vamba, qui monta sur le trône en 672, que les naturels du pays avoient pris le dessus [5] : ainsi la loi Romaine y avoit plus d’autorité, & la loi Gothe y en avoit moins. Les lois Espagnoles ne convenoient ni à leurs manieres, ni à leur situation actuelle ; peut-être même que le peuple s’obstina à la loi Romaine, parce qu’il y attacha l’idée de sa liberté. Il y a plus : les lois de Chaindasuinde & de Récessuinde contenoient des dispositions effroyables contre les Juifs : mais ces Juifs étoient puissans dans la Gaule méridionale. L’auteur de l’histoire du roi Vamba appelle ces provinces le [III-316] prostibule des Juifs. Lorsque les Sarrasins vinrent dans ces provinces, ils y avoient été appelés ; or, qui put les y avoir appelés, que les Juifs ou les Romains ? Les Goths furent les premiers opprimés, parce qu’ils étoient la nation dominante. On voit dans Procope [6] que dans leurs calamités ils se retiroient de la Gaule Nabonnoise en Espagne. Sans doute que, dans ce malheur-ci, ils se réfugierent dans les contrées de l’Espagne qui se défendoient encore ; & le nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivoient sous la loi des Wisigoths, en fut beaucoup diminué.
-
[↑] Il commença à régner en 642.
-
[↑] Nous ne voulons plus être tourmentés par les lois étrangeres, ni par les Romaines ; lois des Wisigoths, liv. II, tit. I, §. 9 & 10.
-
[↑] Ut tàm Gotho Romanam Quàm Romano Gotham, matrimonio liceat sociari. Loi des Wisigoths, liv. III, tit. I, ch. i.
-
[↑] Voyez dans Cassiodore les condescendances que Théodoric roi des Ostrogoths, prince le plus accrédité de son temps, eut pour elles, liv. IV. lett. 19 & 26.
-
[↑] La révolte de ces provinces fut une défection générale, comme il paroît par le jugement qui est à la suite de l’histoire. Paulus & ses adhérens étoient Romains, ils furent même favosirés par les Evêques. Vamba n’osa pas faire mourir les séditieux qu’il avoit vaincus. L’auteur de l’histoire appelle la Gaule Narbonoise, la nourrice de la perfidie.
-
[↑] Gothi qui cladi supersuerant, ex Galliâ cum uxoribus liberisque egressi in Hispaniam ad Teudim jàm palàm tyrannum se recepereunt, de bello Gothorum, liv. I, ch. xiii.
[III-316]
CHAPITRE VIII.
Faux Capitulaires.
Ce malheureux compilateur Benoît Lévite, n’alla-t-il pas transformer cette loi Wisigothe qui défendoit l’usage du droit Romain, en un capitulaire [1] , [III-317] qu’on attribua depuis à Charlemagne ? Il fit de cette loi particuliere une loi générale, comme s’il avoit voulu exterminer le droit Romain par tout l’univers.
-
[↑] Capitul. édit. de Baluze, liv. VI, ch. cccxliii, page 981, tome I.
[III-317]
CHAPITRE IX.
Comment les codes des lois des Barbares & des Capitulaires se perdirent.
Les lois saliques, Ripuaires, Bourguignonnes & Wisigothes, cesserent peu à peu d’être en usage chez les François : voici comment.
Les fiefs étant devenus héréditaires, & les arriere-fiefs s’étant étendus, il s’introduisit beaucoup d’usages auxquels ces lois n’étoient plus applicables. On en retint bien l’esprit, qui étoit de régler la plupart des affaires par des amendes. Mais les valeurs ayant sans doute changé, les amendes changèrent aussi ; & l’on voit beaucoup de chartres [1] où les seigneurs fixoient les amendes qui devoient être payées dans leurs petits [III-318] tribunaux. Ainsi l’on suivit l’esprit de la loi, sans suivre la loi même.
D’ailleurs la France se trouvant divisée en une infinité de petites seigneuries, qui reconnoissoient plutôt une dépendance féodale qu’une dépendance politique, il étoit bien difficile qu’une seule loi pût être autorisée : en effet, on n’auroit pas pu la faire observer. L’usage n’étoit guere plus qu’on envoyât des officiers [2] extraordinaires dans les provinces, qui eussent l’œil sur l’administration de la justice & sur les affaires politiques ; il paroît même par les chartres, que lorsque de nouveaux fiefs s’établissoient, les rois se privoient du droit de les y envoyer. Ainsi, lorsque tout à peu près fut devenu fief, ces officiers ne purent plus être employés ; il n’y eut plus de loi commune, parce que personne ne pouvoit faire observer la loi commune.
Les lois Saliques, Bourguignonnes & Wisigothes furent donc extrêmement négligées à la fin de la seconde race ; & au commencement de la troisieme, on n’en entendit presque plus parler.
Sous les deux premieres races, on [III-319] assembla souvent la nation, c’est-à-dire, les seigneurs & les évêques : il n’étoit point encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé qui étoit un corps qui se formoit, pour ainsi dire, sous les conquérans, & qui établissoit ses prérogatives ; les lois faites dans ces assemblées, sont ce que nous appellons les capitulaires. Il arriva quatre choses, les lois des fiefs s’établirent, & une grande partie des biens de l’église fut gouvernée par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparerent davantage, & négligerent [3] des lois de réforme où ils n’avoient pas été les seuls réformateurs ; on recueillit [4] les canons des conciles & les [III-320] décrétales des papes ; & le clergé reçut ces lois, comme venant d’une source plus pure. Depuis l’érection des grands fiefs, les rois n’eurent plus, comme j’ai dit, des envoyés dans les provinces, pour faire observer des lois émanées d’eux : ainsi sous la troisieme race, on n’entendit plus parler de capitulaires.
-
[↑] M. de la Thaumassiere en a recueilli plusieurs. Voyez, par exemple, les chapitres lxi, lxvi & autres.
-
[↑] Missi dominici.
-
[↑] Que les Evêques, dit Charles le chauve, dans le capitulaire de l’an 844, art. 8, sous prétexte qu’ils ont l’autorité de faire des canons, ne s’opposent pas à cette constitution, ni ne la négligent. Il semble qu’il en prévoyoit déjà la chute.
-
[↑] On inséra dans le recueil des canons un nombre infini de décrétales des papes ; il y en avoit très-peu dans l’ancienne collection. Denys le petit en mit beaucoup dans la sienne : mais celle d’Isidor Mercator fut remplie de vraies & de fausses décrétales. L’ancienne collection fut en usage des mains du pape Adrien I, la collection de Denys le petit, & la fit recevoir. La collection d’Isidor Mercator parut en France vers le regne de Charlemagne ; on s’en entêta : ensuite vint ce qu’on appelle le corps de droit canonique.
[III-320]
CHAPITRE X.
Continuation du même sujet.
On ajouta plusieurs capitulaires à la loi des Lombards, aux lois saliques, à la loi des Bavarois. On en a cherché la raison ; il faut la prendre dans la chose même. Les capitulaires étoient de plusieurs especes. Les uns avoient du rapport au gouvernement politique, d’autres au gouvernement économique, la plupart au gouvernement ecclésiastique, quelques-uns au gouvernement civil. Ceux de cette derniere espece furent ajoutés à la loi civile, c’est-à-dire aux lois personnelles de chaque nation : c’est pour cela qu’il est dit dans les capitulaires, qu’on n’y a rien stipulé [1] [III-321] contre la loi Romaine. En effet, ceux qui regardoient le gouvernement économique, ecclésiastique ou politique, n’avoient poins de rapport avec cette loi ; & ceux qui regardoient le gouvernement civil n’en eurent qu’aux lois des peuples barbares, que l’on expliquoit, corrigeoit, augmentoit & diminuoit. Mais ces capitulaires ajoutés aux lois personnelles, firent, je crois, négliger le corps même des capitulaires : dans des temps d’ignorance, l’abrégé d’un ouvrage fait souvent tomber l’ouvrage même.
-
[↑] Voyez l’édit de Pistes, art. 20.
[III-321]
CHAPITRE XI.
Autre cause de la chute des Codes des lois des Barbares, du droit Romain & des Capitulaires.
Lorsque les nations Germaines conquirent l’empire Romain, elles y trouverent l’usage de l’écriture, & à l’imitation des Romains, elles rédigerent leurs usages [1] par écrit, & en firent [III-322] des codes. Les regnes malheureux qui suivirent celui de Charlemagne, les invasions des Normands, les guerres intestines, replongerent les nations victorieuses dans les ténebres dont elles étoient sorties ; on ne sut plus lire ni écrire. Cela fit oublier en France & en Allemagne les lois barbares écrites, le droit Romain & les capitulaires. L’usage de l’écriture se conserva mieux en Italie, où régnoient les papes & les empereurs Grecs, & où il y avoit des villes florissantes & presque le seul commerce qui se fît pour lors. Ce voisinage de l’Italie fit que le droit Romain se conserva mieux dans les contrées de la Gaule, autrefois soumise aux Goths & aux Bourguignons ; d’autant plus que ce droit y étoit une loi territoriale & une espece de privilege. Il y a apparence que c’est l’ignorance de l’écriture qui fit tomber en Espagne les lois Wisigothes ; & par la chute de tant de lois, il se forma par-tout des coutumes.
Les lois personnelles tomberent. Les compositions & ce que l’on appeloit [III-323] freda [2] , se réglerent plus par la coutume que par le texte de ces lois. Ainsi, comme dans l’établissement de la monarchie on avoit passé des usages des Germains à des lois écrites, on revint, quelques siecles après, des lois écrites à des usages non écrits.
-
[↑] Cela est marqué expressément dans quelques prologues de ces codes. On voit même, dans les lois des Saxons & des Frisons, des dispositions différentes, selon les divers districts. On ajouta à ces usages quelques dispositions particulieres que les circonstances exigerent ; telles furent les lois dures contre les Saxons.
-
[↑] J’en parlerai ailleurs.
[III-323]
CHAPITRE XII.
Des coutumes locales, révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit Romain.
On voit, par plusieurs monumens, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la premiere & la seconde race. On y parle de la coutume du lieu [1] , de l’usage ancien [2] , de la coutume [3] , des lois [4] & des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples Barbares, & que ce qu’on appeloit la loi étoit le droit Romain. Je prouve que [III-324] cela ne peut être. Le roi Pepin [5] ordonna que par-tout où il n’y auroit point de loi, on suivroit la coutume ; mais que la coutume ne seroit pas préférée à la loi. Or, dire que le droit Romain eût la préférence sur les codes des lois des Barbares, c’est renverser tous les monumens anciens, & sur-tout ces codes des lois des Barbares qui disent perpétuellement le contraire.
Bien loin que les lois des peuples Barbares fussent ces coutumes, ce furent ces lois mêmes, qui, comme lois personnelles, les introduisirent. La loi salique, par exemple, étoit une loi personnelle : mais dans des lieux généralement ou presque généralement habités par des Francs Saliens, la loi salique, toute personnelle qu’elle étoit, devenoit, par rapport à ces Francs Saliens, une loi territoriale, & elle n’étoit personnelle que pour les Francs qui habitoient ailleurs. Or, si dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, il étoit arrivé que plusieurs Bourguignons, Allemands ou Romains même, eussent eu souvent des affaires, elles auroient été décidées par les lois de ces peuples ; [III-325] & un grand nombre de jugemens conformes à quelques-unes de ces lois, auroit dû introduire dans le pays de nouveaux usages. Et cela explique bien la constitution de Pépin. Il étoit naturel que ces usages pussent affecter les Francs même du lieu, dans les cas qui n’étoient point décidés par la loi salique ; mais il ne l’étoit pas qu’ils pussent prévoir sur la loi salique.
Ainsi il y avoit dans chaque lieu une loi dominante & des usages reçus, qui servoient de supplément à la loi dominante, lorsqu’ils ne la choquoient pas.
Il pouvoit même arriver qu’ils servissent de supplément à une loi qui n’étoit point territoriale ; & pour suivre le même exemple, si dans un lieu où la loi salique étoit territoriale, un Bourguignon étoit jugé par la loi des Bourguignons, & que le cas ne se trouvât pas dans le texte de cette loi, il ne faut pas douter que l’on ne jugeât suivant la coutume du lieu.
Du temps du roi Pépin, les coutumes qui s’étoient formées, avoient moins de force que les lois ; mais bientôt les coutumes détruisirent les lois : & comme les nouveaux réglemens sont toujours [III-326] des remedes qui indiquent un mal présent, on peut croire que, du temps de Pépin, on commençoit déjà à préférer les coutumes aux lois.
Ce que j’ai dit, explique comment le droit Romain commença dès les premiers temps à devenir une loi territoriale, comme on le voit dans l’édit de Pistes ; & comment la loi Gothe ne laissa pas d’y être encore en usage, comme il paroît par le synode de Troies [6] dont j’ai parlé. La loi Romaine étoit devenue la loi personnelle générale, & la loi Gothe la loi personnelle particuliere ; & par conséquent la loi Romaine étoit la loi territoriale. Mais comment l’ignorance fit-elle tomber par-tout les lois personnelles des peuples barbares, tandis que le droit Romain subsista, comme loi territoriale, dans les provinces Wisigothes & Bourguignonnes ? Je réponds, que la loi Romaine même eut à peu près le sort des autres lois personnelles : sans cela nous aurions encore le code Théodosien dans les provinces où la loi Romaine étoit loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois de Justinien. Il ne resta presque à ces provinces que [III-327] le nom de pays de droit Romain ou de droit écrit, que cet amour que les peuples ont pour leur loi, sur-tout quand ils la regardent comme un privilege, & quelques dispositions du droit Romain retenues pour lors dans la mémoire des hommes : mais c’en fut assez pour produire cet effet, que quand la compilation de Justinien parut, elle fut reçue dans les provinces du domaine des Goths & des Bourguignons comme loi écrite ; au lieu que dans l’ancien domaine des Francs, elle ne le fut que comme raison écrite.
-
[↑] Préface des formules de Marculfe.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II. tit. 58, §. 3.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II. tit. 41, §. 6.
-
[↑] Vie de S. Léger.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II, tit. 41, §. 6.
-
[↑] Voyez ci-dessus, le chap. V.
[III-327]
CHAPITRE XIII.
Différence de la loi Salique ou des Francs Saliens, d’avec celle des Francs Ripuaires & des autres peuples Barbares.
La loi salique n’admettoit point l’usage des preuves négatives ; c’est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, & qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.
[III-328]
La loi des Francs Ripuaires avoit tout un autre esprit [1] ; elle se contentoit des preuves négatives ; & celui contre qui on formoit une demande ou une accusation, pouvoit, dans la plupart des cas se justifier, en jurant avec certain nombre de témoins qu’il n’avoit point fait ce qu’on lui imputoit. Le nombre [2] des témoins qui devoient jurer, augmentoit selon l’importance de la chose ; il alloit quelquefois [3] à soixante-douze. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thiringiens, celles des Frisons, des Saxons, des Lombards & des Bourguignons, furent faites sur le même plan que celles des Ripuaires.
J’ai dit que la loi salique n’admettoit point les preuves négatives. Il y avoit pourtant un cas [4] où elle les admettoit ; mais dans ce cas elle ne les admettoit point seules & sans le concours [III-329] des preuves positives. Le demandeur faisoit [5] ouir ses témoins pour établir sa demande, le défendeur faisoit ouir les siens pour se justifier ; & le Juge cherchoit la vérité dans les uns & dans les autres [6] témoignages. Cette pratique étoit bien différente de celle des lois Ripuaires & des autres lois Barbares, où un accusé se justifoit en jurant qu’il n’étoit point coupable, & en faisant jurer ses parens qu’il avoit dit la vérité. Ces lois ne pouvoient convenir qu’à un peuple qui avoit de la simplicité & une certaine candeur naturelle ; il fallut même que les législateurs en prévinssent l’abus, comme on le va voir tout à l’heure.
-
[↑] Cela se rapporte à ce que dit Tacite, que les peuples Germains avoient des usages communs, & des usages particuliers.
-
[↑] Lois des Ripuaires, tit. §, 7, 8 & autres.
-
[↑] Ibid. tit. 11, 12 & 17.
-
[↑] C’est celui où un antrustion, c’est-à-dire, un vassal du roi, en qui on supposoit une plus grande franchise, étoit accusé : voyez le tit. 76 du Pactus legis salicæ.
-
[↑] Voyez le titre 76 du Pactus legis salicæ.
-
[↑] Comme il se pratique encore aujourd’hui en Angleterre.
[III-329]
CHAPITRE XIV.
Autre différence.
La loi salique ne permettoit point la preuve par le combat singulier ; la loi des Ripuaires [1] & presque [2] [III-330] toutes celles des peuples barbares, la recevoient. Il me paroît que la loi du combat étoit une fuite naturelle & le remede de la loi qui établissoit les preuves négatives. Quand on faisoit une demande, & qu’on voyoit qu’elle alloit être injustement éludée par un serment, que restoit-il à guerrier [3] qui se voyoit sur le point d’être confondu, qu’à demander raison du tort qu’on lui faisoit & de l’offre même du parjure ? La loi salique, qui n’admettoit point l’usage des preuves négatives, n’avoit pas besoin de la preuve par le combat, & ne la recevoit pas ; mais la loi des Ripuaires [4] & celle des autres peuples [5] barbares qui admettoient l’usage des preuves négatives, furent forcés d’établir la preuve par le combat.
Je prie qu’on lise les deux fameuses dispositions [6] de Gondebaud, roi de [III-331] Bourgogne, sur cette maniere ; on verra qu’elles sont tirées de la nature de la chose. Il falloit, selon le langage des lois des Barbares, ôter le serment des mains d’un homme qui en vouloit abuser.
Chez les Lombards, la loi de Rhotaris admit des cas où elle vouloit que celui qui s’étoit défendu par un serment, ne pût plus être fatigué par un combat. Cet usage s’étendit [7] : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, & comment il fallut revenir à l’ancienne pratique.
-
[↑] Tit. 32 ; tit. 57, §. 2 ; tit. 59, §. 4.
-
[↑] Voyez la note 1 de la page suivante.
-
[↑] Cet esprit paroît bien dans la loi des Ripuaires, tit. 59, §. 4 ; & tit. 67, §. 5 ; & le capitulaire de Louis le débonnaire, ajouté à la loi des Ripuaires, de l’an 803, art. 22.
-
[↑] Voyez cette loi.
-
[↑] La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens & des Bourguignons.
-
[↑] Dans la loi des Bourguignons, tit. 8, §. I & 2, sur les affaires criminelles ; & le titre 45, qui porte encore sur les affaires civiles. Voyez aussi la loi des Thuringiens, tit. I, §. 31 ; tit. 7, §. 6 ; & tit. 8 : & la loi des Allemands, tit. 89 : la loi des Bavarois, tit. 8. ch. ii, §. 6 ; & chap. iii, §. I ; & tit. 9, chap. iv, §. 4 : la loi des Frisons, tit. II, §. 3 ; & tit. 14, §. 4 ; la loi des Lombards, liv. I. tit. 32, §. 3 ; & tit. 35, §. I ; & liv. II. tit. 35, §. 2.
-
[↑] Voyez ci-dessous, le ch. xviii à la fin.
[III-331]
CHAPITRE XV.
Réflexion.
Je ne dis pas que, dans les changemens qui furent faits au code des lois des Barbares, dans les dispositions qui y furent ajoutées, & dans le corps [III-332] des capitulaires, on ne puisse trouver quelque texte où dans le fait la preuve du combat ne soit pas une suite de la preuve négative. Des circonstances particulieres ont pu, dans le cours de plusieurs siecles, faire établir de certaines lois particulieres. Je parle de l’esprit général des lois des Germains, de leur nature & de leur origine ; je parle des anciens usages de ces peuples, indiqués ou établis par ces lois, & il n’est ici question que de cela.
[III-332]
CHAPITRE XVI.
De la preuve par l’eau bouillante, établie par la loi salique.
La loi salique [1] admettoit l’usage de la preuve par l’eau bouillante ; & comme cette épreuve étoit fort cruelle, la loi [2] prenoit un tempérament pour en adoucir la rigueur. Elle permettoit à celui qui avoit été ajourné pour venir faire la preuve par l’eau bouillante, de racheter sa main du consentement de sa partie. L’accusateur, [III-333] moyennant une certaine somme que la loi fixoit, pouvoit se contenter du serment de quelques témoins, qui déclaroient que l’accusé n’avoit pas commis le crime : & c’étoit un cas particulier de la loi salique, dans lequel elle admettoit la preuve négative.
Cette preuve étoit une chose de convention, que la loi souffroit, mais qu’elle n’ordonnoit pas. La loi donnoit un certain dédommagement à l’accusateur qui vouloit permettre que l’accusé se défendît par une preuve négative : il étoit libre à l’accusateur de s’en rapporter au serment de l’accusé, comme il lui étoit libre de remettre le tort ou l’injure.
La loi [3] donnoit un tempérament pour qu’avant le jugement, les parties, l’une dans la crainte d’une épreuve terrible, l’autre à la vue d’un petit dédommagement présent, terminassent leurs différents & finissent leurs haines. On sent bien que cette preuve négative une fois consommée, il n’en falloit plus d’autre, & qu’ainsi la pratique du combat ne pouvoit être une suite de cette disposition particuliere de la loi salique.
[III-334]
CHAPITRE XVII.
Maniere de penser de nos peres.
On sera étonné de voir que nos peres fissent ainsi dépendre l’honneur, la fortune & la vie des citoyens, de choses qui étoient moins du ressort de la raison que du hasard ; qu’ils employassent sans cesse des preuves qui ne prouvoient point, & qui n’étoient liées, ni avec l’innocence, ni avec le crime.
Les Germains qui n’avoient jamais été subjugués [1] , jouissoient d’une indépendance extrême. Les familles se faisoient la guerre [2] pour des meurtres, des vols, des injures. On modifia cette coutume, en mettant ces guerres sous des regles ; elles se firent par ordre & sous les yeux [3] du magistrat ; ce qui étoit préférable à une licence générale de se nuire.
[III-335]
Comme aujourd’hui les Turcs, dans leurs guerres civiles, regardent la premiere victoire comme un jugement de Dieu qui décide ; ainsi les peuples Germains, dans leurs affaires particulieres, prenoient l’événement du combat pour un arrêt de la providence toujours attentive à punir le criminel ou l’usurpateur.
Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu’une nation vouloit entrer en guerre avec une autre, elle cherchoit à faire quelque prisonnier qui pût combattre avec un des siens ; & qu’on jugeoit, par l’événement de ce combat, du succès de la guerre. Des peuples qui croyoient que le combat singulier régleroit les affaires publiques, pouvoient bien penser qu’il pourroit encore régler les différents des particuliers.
Gondebaud [4] , roi de Bourgogne, fut de tous les rois celui qui autorisa le plus l’usage du combat. Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même : « C’est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus de serment sur des faits obscurs, & ne se parjurent point sur des faits certains ». Ainsi, tandis que [III-336] les ecclésiastiques [5] déclaroient impie la loi qui permettoit le combat, le roi des Bourguignons regardoit comme sacrilege celle qui établissoit le serment.
La preuve par le combat singulier avoit quelque raison fondée sur l’expérience. Dans une nation uniquement guerriere, la poltronnerie suppose d’autres vices : elle prouve qu’on a résisté à l’éducation qu’on a reçue, & que l’on n’a pas été sensible à l’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes ; elle fait voir qu’on ne craint point leur mépris, & qu’on ne fait point de cas de leur estime : pour peu qu’on soit bien né, on n’y manquera pas ordinairement de l’adresse qui doit s’allier avec la force, ni de la force qui doit concourir avec le courage, parce que, faisant cas de l’honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l’obtenir. De plus, dans une nation guerriere, où la force, le courage & la prouesse sont en honneur, les crimes véritablement odieux sont ceux qui naissent de la fourberie, de [III-337] la finesse & de la ruse, c’est-à-dire, de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu, après que l’accusé avoit mis la main sur un fer chaud ou dans l’eau bouillante, on enveloppoit la main dans un sac que l’on cachetoit : si trois jours après il ne paroissoit pas de marque de brûlure, on étoit déclaré innocent. Qui ne voit que chez un peuple exercé à manier les armes, la peau rude & calleuse ne devoit pas recevoir assez l’impression du fer chaud ou de l’eau bouillante, pour qu’il y parût trois jours après ? Et s’il y paroissoit, c’étoit une marque que celui qui faisoit l’épreuve étoit un effeminé. Nos paysans avec leurs mains calleuses manient le fer chaud comme ils veulent ; & quant aux femmes, les mains de celles qui travailloient, pouvoient résister au fer chaud. Les dames [6] ne manquoient point de champions pour les défendre, & dans une nation où il n’y avoit point de luxe, il n’y avoit guere d’état moyen.
Par la loi des Thuringiens [7] une [III-338] femme accusée d’adultere, n’étoit condamnée à l’épreuve de l’eau bouillante, que lorsqu’il ne se présentoit point de champion pour elle ; et la loi [8] des Ripuaires n’admet cette épreuve que lorsqu’on ne trouve pas de témoins pour se justifier. Mais une femme, qu’aucun de ses parens ne vouloit défendre, un homme qui ne pouvoit alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.
Je dis donc que, dans les circonstances des temps, où la preuve par le combat & la preuve par le fer chaud & l’eau bouillante furent en usage, il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les effets furent plus innocens que les causes ; qu’elles choquerent plus l’équité qu’elles n’en violerent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranniques.
-
[↑] Cela paroît par ce que dit Tacite : omnibus idem habitus.
-
[↑] Velleius Paterculus, liv. II. chap. cxviii, dit que les Germains décidoient toutes les affaires par le combat.
-
[↑] Voyez les codes des lois des Barbares ; & pour les temps plus modernes, Beaumanoir, sur la coutume de Beauvoisis.
-
[↑] La loi des Bourguignons, chap. xlv.
-
[↑] Voyez les œuvres d’Agobard.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, coutume de Beauvoisis, ch. lxi. Voyez aussi la loi des Angles, ch. xiv, où la preuve par l’eau bouillante n’est que subsisdiaire.
-
[↑] Titre 14.
-
[↑] Chapitre xxxi, §. 5.
[III-339]
CHAPITRE XVIII.
Comment la preuve par le combat s’étendit.
On pourroit conclure de la lettre d’Agobart à Louis le débonnaire, que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs, puisqu’après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud, il [1] demande qu’on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs. Mais comme on fait d’ailleurs que dans ce temps-là le combat judiciaire étoit en usage en France, on a été dans l’embarras. Cela s’explique par ce que j’ai dit ; la loi des Francs Saliens n’admettoit point cette preuve, & celle des Francs Ripuaires [2] la recevoit.
Mais, malgré les clameurs des ecclésiastiques, l’usage du combat judiciaire s’étendit tous les jours en France ; & je vais prouver tout-à-l’heure que ce furent eux-mêmes qui y donnerent lieu en grande partie.
[III-340]
C’est la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve. « Il s’étoit introduit depuis long temps une détestable coutume (est-il dit dans le préambule de la constitution [3] d’Othon II) ; c’est que si la charte de quelque héritage étoit attaqué de faux, celui qui la présentoit faisoit serment sur les évangiles qu’elle étoit vraie ; & sans aucun jugement préalable, il se rendoit propriétaire de l’héritage : ainsi les parjures étoient sûrs d’acquérir ». Lorsque l’empereur Othon I. se fit couronner à Rome [4] , le pape Jean XII. tenant un concile, tous les seigneurs [5] d’Italie s’écrierent qu’il falloit que l’empereur fît une loi pour corriger cet indigne abus. Le pape & l’empereur jugerent qu’il falloit renvoyer l’affaire au concile qui devoit se tenir peu de temps [6] après à Ravenne. Là les seigneurs firent les mêmes demandes, & redoublerent leurs cris ; mais sous prétexte de l’absence de quelques personnes, on [III-341] renvoya encore une fois cette affaire. Lorsqu’Othon II. & Conrad [7] roi de Bourgogne arriverent en Italie, ils eurent à Véronne [8] un colloque [9] avec les seigneurs d’Italie, & sur leurs instances réitérées, l’empereur, du consentement de tous, fit une loi qui portoit que, quand il y auroit quelque contestation sur des héritages, & qu’une des parties voudroit se servir d’une chartre, & que l’autre soutiendroit qu’elle étoit fausse, l’affaire se décideroit par le combat ; que la même regle s’observeroit lorsqu’il s’agiroit de matieres de fief ; que les églises seroient sujettes à la même loi, & qu’elles combattroient par leurs champions. On voit que la noblesse demanda la preuve par le combat, à cause de l’inconvénient de la preuve introduite dans les églises ; que, malgré les cris de cette noblesse, malgré l’abus qui crioit lui-même, & malgré l’autorité d’Othon qui arriva en Italie pour parler & agir en maître, le clergé tint ferme dans deux conciles ; que le concours de la noblesse [III-342] & des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l’usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilege de la noblesse, comme un rempart contre l’injustice, & une assurance de sa propriété ; & que, dès ce moment, cette pratique dut s’étendre. Et cela se fit dans un temps où les empereurs étoient grands & les papes petits, dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l’empire.
Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j’ai dit ci-dessus, que l’établissement des preuves négatives entraînoit après lui la jurisprudence du combat. L’abus dont on se plaignoit devant les Othons, étoit qu’un homme à qui on objectoit que sa charte étoit fausse, se défendoit par une preuve négative, en déclarant sur les évangiles qu’elle ne l’étoit pas. Que fit-on pour corriger l’abus d’une loi qui avoit été tronquée ? on rétablit l’usage du combat.
Je me suis pressé de parler de la constitution d’Othon II, afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé & les laïques. Il y avoit eu auparavant une constitution de [10] [III-343] Lothaire I, qui, sur les mêmes plaintes & les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens, avoit ordonné que le notaire jureroit que sa chartre n’étoit pas fausse ; & que, s’il étoit mort, on feroit juger les témoins qui l’avoient signée : mais le mal restoit toujours, il falloit en venir au remede dont je viens de parler.
Je trouve qu’avant ce temps-là, dans des assemblées générales tenues par Charlemagne, la nation lui représenta [11] que dans l’état des choses il étoit très-difficile que l’accusateur ou l’accusé ne se parjurassent, & qu’il valoit mieux rétablir le combat judiciaire : ce qu’il fit.
L’usage du combat judiciaire s’étendit chez les Bourguignons, & celui du serment y fut borné. Théodoric, roi d’Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths [12] : les lois de Chaindasuinde & de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu’à l’idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la [III-344] Narbonnoise, que le combat y étoit regardé comme une prérogative [13] des Goths.
Les Lombards, qui conquirent l’Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs, y rapporterent l’usage du combat : mais leurs premieres lois le restreignirent [14] . Charlemagne [15] , Louis le débonnaire, les Othons, firent diverses constitutions générales, qu’on trouve insérées dans les lois des Lombards, & ajoutées aux lois saliques, qui étendirent le duel, d’abord dans les affaires criminelles, & ensuite dans les civiles. On ne savoit comment faire. La preuve négative par le serment avoit des inconvéniens, celle par le combat en avoit aussi : on changeoit, suivant qu’on étoit plus frappé des uns ou des autres.
D’un côté, les ecclésiastiques se plaisoient à voir, que dans toutes les affaires [III-345] séculières, on recourût aux églises [16] & aux autels ; & de l’autre, une noblesse fiere aimoit à soutenir ses droits par son épée.
Je ne dis poins que ce fut le clergé qui eût introduit l’usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l’esprit des lois des barbares, & de l’établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l’impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu’il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables & faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage & la ptratique à laquelle il étoit joint ; car d’ailleurs ils étoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir [17] que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, & [III-346] à affoiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.
Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l’usage des preuves négatives & celui du combat judiciaire dont j’ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l’un & l’autre, & les tribunaux clercs les rejeterent tous deux.
Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu’on établissoit le combat comme un jugement de Dieu, on abolissoit les preuves par la croix, l’eau froide & l’eau bouillante, qu’on avoit regardées aussi comme des jugemens de Dieu.
Charlemagne ordonna que, s’il survenoit quelque différent entre ses enfans, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis [18] le débonnaire borna ce jugement aux affaires ecclésiastiques : son fils Lothaire l’abolit dans tous les cas ; il abolit [19] de même la preuve par l’eau froide.
Je ne dis pas, que dans un temps où il y avoit si peu d’usages universellement [III-347] reçus, ces preuves n’ayent été reproduites dans quelques églises, d’autant plus qu’une chartre [20] de Philippe Auguste en fait mention : mais je dis qu’elles furent de peu d’usage. Beaumanoir [21] qui vivoit du temps de Saint Louis & un peu après, faisant l’énumération des différens genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, & point du tout de celles-là.
-
[↑] Si placerec domino nostro ut eos transferret ad legem Francorum.
-
[↑] Voyez cette loi, tit. 59, §. 4, & tit. 67. §. 5.
-
[↑] Loi des Lombards, liv. II, tit. 55, ch. xxxiv.
-
[↑] L’an 962.
-
[↑] Ab Italiæ proceribus est proclamatum, ut imperator, sanctus mutatâ lege, facinus indignum destrueret. Loi des Lombards, liv. II, tit. 55, ch. xxxiv.
-
[↑] Il fut tenu en l’an 967, en présence du pape Jean XIII. & de l’empereur Othon I.
-
[↑] Oncle d’Othon II, fils de Rodolphe, & roi de la Bourgogne Transjurane.
-
[↑] L’an 988.
-
[↑] Cùm in hoc ab omnibus imperiales aures pulsarentur. Loi des Lombards, liv. II, tit. 55, ch. xxxiv.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 55, §. 33. Dans l’exemplaire dont s’est servi M. Muratori, elle est attribuée à l’empereur Guy.
-
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 55, §. 23.
-
[↑] Voyez Cassiodore, liv. III, lett. 23 & 24.
-
[↑] In palatio quoque Bera comes Barcinonensis, cùm impeteretur à quodam vocato Sunial, & infidelitatis argueretur, cim eodem secundùm legem propriam, utpotè quia uterque Gothus erat, equestri prælio congressus est & victus. L’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire.
-
[↑] Voyez dans la loi des Lombards, le livre I, tit. 4 ; & tit. 9, §. 23 ; & liv. II, tit. 35, §. 4 & 5 ; & tit. 55, §. I, 2 & 3 : les réglemens de Rotharis ; & au §. 15, celui de Luitprand.
-
[↑] Ibid. liv. II, tit. 55, §. 23.
-
[↑] Les serment judiciaire se faisoit pour lors dans les églises ; & il y avoit dans la premiere race, dans le palais des rois, une chapelle exprès pour les affaires qui s’y jugeoient. Voyez les formules de Marculse, liv. I, chap. xxxviii, les lois des Ripuaires, tit. 59, §. 4 ; tit. 65, §. 5 ; l’histoire de Grégoire de Tours ; le capitulaire de l’an 803, ajouté à la loi salique.
-
[↑] Chapitre xxxix, page 212.
-
[↑] On trouve ces constitutions insérées dans la loi des Lombards & à la suite des lois saliques.
-
[↑] Dans la constitution insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 55, §. 31.
-
[↑] De l’an 1200.
-
[↑] Coutume de Beauvoisis, ch. xxxix.
[III-347]
CHAPITRE XIX.
Nouvelle raison de l’oubli des lois Saliques, des lois Romaines & des Capitulaires.
J’ai déjà dit les raisons qui avoient fait perdre aux lois saliques, aux lois Romaines, & aux capitulaires, leur autorité ; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cause.
Les lois saliques, qui n’admettoient point cet usage, devinrent en quelque façon inutiles, & tomberent : les lois Romaines, qui ne l’admettoient pas [III-348] non plus, périrent de même. On ne songea plus qu’à former la loi du combat judiciaire, & à en faire une bonne jurisprudence. Les dispositions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainsi tant de lois perdirent leur autorité, sans qu’on puisse citer le moment où elles l’ont perdue ; elles furent oubliées, sans qu’on en trouve d’autres qui ayant pris leur place.
Une nation pareille n’avoit pas besoin de lois écrites, & ses lois écrites pouvoient bien aisément tomber dans l’oubli.
Y avoit-il quelque discussion entre deux parties ? on ordonnoit le combat. Pour cela il ne falloit pas beaucoup de suffisance.
Toutes les actions civiles & criminelles se réduisent en faits. C’est sur ces faits que l’on combattoit ; & ce n’étoit pas seulement le fond de l’affaire qui se jugeoit par le combat, mais encore les incidens & les interlocutoires, comme le dit Beaumanoir [1] , qui en donne des exemples.
Je trouve qu’au commencement de la troisieme race, la jurisprudence étoit [III-349] toute en procédés ; tout fut gouverné par le point-d’honneur. Si l’on n’avoit pas obéi au juge, il poursuivoit son offense. À Bourges [2] , si le prévôt avoit mandé quelqu’un, & qu’il ne fût pas venu : « Je t’ai envoyé chercher, disoit-il, tu as dédaigné de venir ; fais-moi raison de ce mépris » ; & l’on combattoit. Louis le gros réforma [3] cette coutume.
Le combat judiciaire étoit en usage [4] à Orléans dans toutes demandes de dettes. Louis le jeune déclara que cette coutume n’auroit lieu que lorsque la demande excéderoit cinq sols. Cette ordonnance étoit une loi locale ; car du temps de Saint Louis [5] , il suffisoit que la valeur fût de plus de douze deniers. Beaumanoir [6] avoit oui dire à un seigneur de loi, qu’il y avoit autrefois en France cette mauvaise coutume, qu’on pouvoit louer pendant un certain temps un champion pour combattre dans ses [III-350] affaires. Il falloit que l’usage du combat judiciaire eût pour lors une prodigieuse extension.
-
[↑] Ch. lxi, pages 309 & 310.
-
[↑] Chartre de Louis le gros, de l’an 1145, dans le recueil des ordonnances.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Chartre de Louis le jeune, de l’an 1168, dans le recueil des ordonnances.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, ch. lxiii, page 325.
-
[↑] Voyez la coutume de Beauvoisis, ch. xxviii, page 203.
[III-350]
CHAPITRE XX.
Origine du point-d’honneur.
On trouve des énigmes dans les codes des lois des barbares. La loi [1] des Frisons ne donne qu’un demi-sou de composition à celui qui a reçu des coups de bâton ; & il n’y a si petite blessure pour laquelle elle n’en donne davantage. Par la loi salique, si un ingénu donnoit trois coups de bâton à un ingénu, il payoit trois sous ; s’il avoit fait couler le sang, il étoit puni comme s’il avoit blessé avec le fer, & il payoit quinze sous ; la peine se mesuroit par la grandeur des blessures. La loi des Lombards [2] établit différentes compositions pour un coup, pour deux, pour trois, pour quatre. Aujourd’hui un coup en vaut cent mille.
La constitution de Charlemagne insérée dans la loi [3] des Lombards, veut [III-351] que ceux à qui elle permet le duel, combattent avec le bâton. Peut-être que ce fut un ménagement pour le clergé ; peut-être que comme on étendoit l’usage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire [4] de Louis le débonnaire donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans la suite il n’y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton [5] .
Déjà je vois naître & se former les articles particuliers de notre point-d’honneur. L’accusateur commençoit par déclarer devant le juge, qu’un tel avoit commis une telle action ; & celui-ci répondoit qu’il en avoit menti [6] ; sur cela le juge ordonnoit le duel. La maxime s’établit que, lorsqu’on avoit reçu un démenti, il falloit se battre.
Quand un homme [7] avoit déclaré qu’il combattroit, il ne pouvoit plus s’en départir ; & s’il le faisoit, il étoit condamné à une peine. De là suivit cette regle, que quand un homme s’étoit engagé par sa parole, l’honneur ne lui permettoit plus de la rétracter.
[III-352]
Les gentilshommes [8] se battoient entr’eux à cheval & avec leurs armes, & les villains [9] se battoient à pied & avec le bâton. De là il suivit que le bâton étoit l’instrument des outrages [10] , parce qu’un homme qui en avoit été battu, avoit été traité comme un villain.
Il n’y avoit que les villains qui combattissent à visage découvert [11] ; ainsi il n’y avoit qu’eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure, qui devoit être lavée par le sang ; parce qu’un homme qui l’avoit reçu, avoit été traité comme un villain.
Les peuples Germains n’étoient pas moins sensibles que nous au point d’honneur ; ils l’étoient même plus. Ainsi les parens les plus éloignés prenoient une part très-vive aux injures, & tous leurs codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards [12] veut que celui qui, [III-353] accompagné de ses gens, va battre un homme qui n’est point sur ses gardes, afin de le couvrir de honte & de ridicule, paye la moitié de la composition qu’il auroit due s’il l’avoit tué ; & que [13] si, par le même motif, il le lie, il paye les trois quarts de la même composition.
Disons donc que nos peres étoient extrêmement sensibles aux affronts ; mais que les affronts d’une espece particuliere, de recevoir des coups d’un certain instrument sur une certaine partie du corps, & donnés d’une certaine maniere, ne leur étoient pas encore connus. Tout cela étoit compris dans l’affront d’être battu, & dans ce cas la grandeur des excès faisoit la grandeur des outrages.
-
[↑] Additio sapientium Willemari, tit. 5.
-
[↑] Liv. I, tit. 6, §. 3.
-
[↑] Liv. II, tit. 5, §. 23.
-
[↑] Ajouté à la loi salique sur l’an 819.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, ch. lxiv, page 323.
-
[↑] Ibid. page 329.
-
[↑] Ibid. ch. iii, pages 25 & 329.
-
[↑] Voyez, sur les armes des combattans, Beaumanoir, ch. lxi, p. 308, & ch. lxiv, p. 328.
-
[↑] Ibid. ch. lxiv, page 328 : voyez aussi les chartres de Saint-Aubin d’Anjou, rapportées par Galland, page 163.
-
[↑] Chez les Romains, les coups de bâton n’étoient point infames. Lege Ictus sustium. De iis qui notantur infamiâ.
-
[↑] Ils n’avoient que l’écu & le bâton, Beaumanoir, chap. lxiv, page 328.
-
[↑] Liv. I, tit. 6. §. I.
-
[↑] Ibid. §. 2.
[III-353]
CHAPITRE XXI.
Nouvelle réflexion sur le point d’honneur chez les Germains.
« C’étoit chez les Germains, dit Tacite [1] , une grande infamie d’avoir abandonné son bouclier dans [III-354] le combat ; & plusieurs, après ce malheur, s’étoient donné la mort ». Aussi l’ancienne loi [2] salique donne-t-elle quinze sous de composition à celui à qui on avoit dit par injure qu’il avoit abandonné son bouclier.
Charlemagne [3] corrigeant la loi salique, n’établit dans ce cas que trois sous de composition. On ne peut pas soupçonner ce prince d’avoir voulu affoiblir la discipline militaire : il est clair que ce changement vint de celui des armes ; & c’est à ce changement des armes que l’on doit l’origine de bien des usages.
-
[↑] De morib. German.
-
[↑] Dans le pactus legis salicæ
-
[↑] Nous avons l’ancienne loi, & celle qui fut corrigée par ce prince.
[III-354]
CHAPITRE XXII.
Des mœurs relatives aux combats.
Notre liaison avec les femmes est fondée sur le bonheur attaché aux plaisirs des sens, sur le charme d’aimer & d’être aimé, & encore sur le désir de leur plaire, parce que ce sont des juges très-éclairés sur une partie des choses qui constituent le mérite personnel. Ce désir général de plaire produit la [III-355] galanterie, qui n’est point l’amour, mais le délicat, mais le léger, mais le perpétuel mensonge de l’amour.
Selon les circonstances différentes dans chaque nation & dans chaque siecle, l’amour se porte plus vers une de ces trois choses, que vers les deux autres. Or je dis que, dans le temps de nos combats, ce fut l’esprit de galanterie qui dut prendre des forces.
Je trouve dans la loi des Lombards, que [1] si un des deux champions avoit sur lui des herbes propres aux enchantemens, le juge les lui faisoit ôter, & le faisoit jurer qu’il n’en avoit plus. Cette loi ne pouvoit être fondée que sur l’opinion commune ; c’est la peur, qu’on a dit avoir inventé tant de choses, qui fit imaginer ces sortes de prestiges. Comme dans les combats particuliers les champions étoient armés de toutes pieces, & qu’avec des armes pesantes, offensives & défensives, celles d’une certaine trempe & d’une certaine force, donnoient des avantages infinis ; l’opinion des armes enchantées de quelques combattans dut tourner la tête à bien des gens.
[III-356]
De là naquit le systême merveilleux de la chevalerie. Tous les esprits s’ouvrirent à ces idées. On vit dans les romans des paladins, des négromans, des fées, des chevaux ailés ou intelligens, des hommes invisibles ou invulnérables, des magiciens qui s’intéressoient à la naissance ou à l’éducation des grands personnages, des palais enchantés & désenchantés ; dans notre monde un monde nouveau, & le cours ordinaire de la nature laissé seulement pour les hommes vulgaires.
Des paladins toujours armés dans une partie du monde pleine de châteaux, de forteresses & de brigands, trouvoient de l’honneur à punir l’injustice & à défendre la foiblesse. De là encore dans nos romans la galanterie fondée sur l’idée de l’amour, jointe à celle de force & de protection.
Ainsi naquit la galanterie, lorsqu’on imagina des hommes extraordinaires, qui voyant la vertu jointe à la beauté & à la foiblesse, furent portés à s’exposer pour elle dans les dangers, & à lui plaire dans les actions ordinaires de la vie.
Nos romans de chevalerie flatterent [III-357] ce désir de plaire, & donnerent à une partie de l’Europe cet esprit de galanterie que l’on peut dire avoir été peu connu par les anciens.
Le luxe prodigieux de cette immense ville de Rome, flatta l’idée des plaisirs des sens. Une certaine idée de tranquillité dans les campagnes de la Grece, fit décrire [2] les sentimens de l’amour. L’idée des paladins, protecteurs de la vertu & de la beauté des femmes, conduisit à celle de la galanterie.
Cet esprit se perpétua par l’usage des tournois, qui unissant ensemble les droits de la valeur & de l’amour, donnerent encore à la galanterie une grande importance.
[III-357]
CHAPITRE XXIII.
De la jurisprudence du combat judiciaires.
On aura peut-être de la curiosité à voir cet usage monstrueux du combat judiciaire réduit en principe, & à trouver le corps d’une jurisprudence si singuliere. Les hommes, dans le fond raisonnables, mettent sous des regles [III-358] leurs préjugés mêmes. Rien n’étoit plus contraire au bon sens que le combat judiciaire : mais ce point une fois posé, l’exécution s’en fit avec une certaine prudence.
Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence de ces temps-là, il faut lire avec attention les réglemens de Saint Louis, qui fit de si grands changemens dans l’ordre judiciaire. Défontaines étoit contemporain de ce prince : Beaumanoir écrivoit après lui [1] ; les autres ont vécu depuis lui. Il faut donc chercher l’ancienne pratique dans les corrections qu’on en a faites.
-
[↑] En l’an 1283.
[III-358]
CHAPITRE XXIV.
Regles établies dans le combat judiciaire.
Lorsqu’il [1] y avoit plusieurs accusateurs, il falloit qu’ils s’accordassent, pour que l’affaire fût poursuivie par un seul ; & s’ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisoit le plaid, nommoit un d’entr’eux qui poursuivoit la querelle.
[III-359]
Quand [2] un gentilhomme appeloit un villain, il devoit se présenter à pied, & avec l’écu & le bâton : & s’il venoit à cheval & avec les armes d’un gentilhomme, on lui ôtoit son cheval & ses armes ; il restoit en chemise, & étoit obligé de combattre en cet état contre le villain.
Avant le combat, la justice [3] faisoit publier trois bans. Par l’un, il étoit ordonné aux parens des parties de se retirer ; par l’autre, on avertissoit le peuple de garder le silence ; par le troisieme, il étoit défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, & même celle de mort, si par ce secours un des combattant avoit été vaincu.
Les gens de justice gardoient [4] le parc ; & dans le cas où des parties auroit parlé de paix, ils avoient grande attention à l’état actuel où elles se trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu’elles fussent remises [5] dans la même situation, si la paix ne se faisoit pas.
[III-360]
Quand les gages étoient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvoit se faire sans le consentement du seigneur ; & quand une des parties avoit été vaincue, il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l’aveu du comte [6] ; ce qui avoit du rapport à nos lettres de grace.
Mais si le crime étoit capital, & que le seigneur corrompu par des présens, consentît à la paix, il payoit une amende de soixante livres ; & le droit [7] qu’il avoit de faire punir le malfaiteur étoit dévolu au comte.
Il y avoit bien des gens qui n’étoient en état ni d’offrir le combat ni de le recevoir. On permettoit en connoissance de cause, de prendre un champion ; & pour qu’il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avoit le poing coupé, s’il étoit vaincu [8] .
Quand on a fait dans le siecle passé [III-361] des lois capitales contre les duels, peut-être auroit-il suffi d’ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n’y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes que de survivre à la perte de leur caractere.
Lorsque [9] dans un crime capital le combat se faisoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d’où elles ne pouvoient voir la bataille : chacune d’elles étoit ceinte de la corde qui devoit servir à son supplice, si son champion étoit vaincu.
Celui qui succomboit dans le combat, ne perdoit pas toujours la chose contestée ; si, par exemple [10] , l’on combattoit sur un interlocutoire, on ne perdoit que l’interlocutoire.
-
[↑] Beaumanoir, ch. iv, pages 40 & 41.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiv, page 328.
-
[↑] Ibid. pag. 330.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Les grands vassaux avoient des droits particuliers.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiv, pag. 330, dit : Il perdoit sa justice. Ces paroles, dans les auteurs de ces temps-là, n’ont pas une signification générale, mais restreinte à l’affaire dont il s’agit ; Défontaines, chap. xxi, art. 29.
-
[↑] Cet usage que l’on trouve dans les capitulaires subsistoit du temps de Beaumanoir : voyez le ch. lxi, page 315.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiv, page 330.
-
[↑] Ibid. , ch. lxi, page 309.
[III-361]
CHAPITRE XXV.
Des bornes que l’on mettoit à l’usage du combat judiciaire.
Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.
[III-362]
Si un fait étoit notoire [1] ; par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoin ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.
Quand dans la cour du seigneur on avoit souvent jugé de la même maniere, & qu’ainsi l’usage étoit connu [2] , le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.
On ne pouvoit demander le combat que pour [3] soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.
Quand un accusé avoit été absous [4] , un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.
Si celui dont les parens vouloient venger la mort venoit à reparoître, il n’étoit plus question du combat : il [III-363] en étoit de même [5] , si, par une absence notoire, le fait se trouvoit impossible.
Si un homme [6] qui avoit été tué, avoit, avant de mourir, disculpé celui qui étoit accusé, & qu’il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat ; mais s’il n’avoit nommé personne, on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort : on continuoit les poursuites ; & même, entre gentilshommes, on pouvoit faire la guerre.
Quand il y avoit une guerre, & qu’un des parens donnoit ou recevoit les gages de bataille, le droit de la guerre cessoit ; on pensoit que les parties vouloient suivre le cours ordinaire de la justice ; & celle qui auroit continué la guerre, auroit été condamnée à réparer les dommages.
Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, qu’elle pouvoit changer une querelle générale en une querelle particuliere, rendre la force aux tribunaux, & remettre dans l’état civil ceux qui n’étoient plus gouvernés que par le droit des gens.
[III-364]
Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d’une maniere très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d’une maniere très-sage.
Quand [7] un homme appelé pour un crime, montroit visiblement que c’étoit l’appellant même qui l’avoit commis, il n’y avoit plus de gages de batailles ; car il n’y a point de coupable qui n’eût préféré un combat douteux à une punition certaine.
Il n’y avoit [8] point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques ; il n’y en avoit pas non plus, lorsqu’il s’agissoit du douaire des femmes.
Femme, dit Beaumanoir, ne se peut combattre. Si une femme appelloit quelqu’un sans nommer son champion, on ne recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu’une femme fût autorisée par son [9] baron, c’est-à-dire, son mari, pour appeller ; mais sans cette autorité elle pouvoit être appellée.
[III-365]
Si l’appellant [10] ou l’appellé avoient moins de quinze ans, il n’y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l’ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.
Il me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf ; il combattoit contre une personne franche, & même contre un gentilhomme, s’il étoit appellé ; mais s’il l’appelloit [11] , celui-ci pouvoit refuser le combat ; & même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur [12] , ou par usage, combattre contre toutes personnes franches ; & l’église [13] prétendoit ce même droit pour ses serfs, comme une marque [14] de respect pour elle.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, p. 308. Ibid. ch. xliii, page 239.
-
[↑] Ibid. ch. lxi, pag. 314 ; voyez aussi Défontaines, ch. xxii, art 24.
-
[↑] Ibid. ch. lxiii, page 322.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Beaum. ch. lxiii, page 322.
-
[↑] Ibid. page 323.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxiii, page 324.
-
[↑] Ibid. page 325.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Beaum. page 323. Voyez aussi ce que j’ai dit au liv. XVIII.
-
[↑] Ibid. ch. xliii, page 322.
-
[↑] Défontaines, ch. xxii, art. 7.
-
[↑] Habeant bellandi & testificandi licentiam : chartre de Louis le gros, de l’an 1118.
-
[↑] Ibid.
[III-366]
CHAPITRE XXVI.
Du combat judiciaire entre une des parties & un des témoins.
Beaumanoir [1] dit qu’un homme qui voyoit qu’un témoin alloit déposer contre lui, pouvoit éluder le second, en disant [2] aux juges que sa partie produisoit un témoin faux & calomniateur ; & si le témoin vouloit soutenir la querelle, il donnoit les gages de bataille. Il n’étoit plus question de l’enquête ; car si le témoin étoit vaincu, il étoit décidé que la partie avoit produit un faux témoin, & elle perdoit son procès.
Il ne falloit pas laisser jurer le second témoin ; car il auroit prononcé son témoignage, & l’affaire auroit été finie par la déposition de deux témoins. Mais en arrêtant le second, la déposition du premier devenoit inutile.
Le second témoin étant ainsi rejeté, [III-367] la partie ne pouvoit en faire ouir d’autres, & elle perdoit son procès : mais, dans le cas où il n’y avoit point de gages de bataille [3] , on pouvoit produire d’autres témoins.
Beaumanoir dit [4] que le témoin pouvoit dire à sa partie avant de déposer : « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, ne à entrer en plet au mien ; mais se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; & si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps [5] , mais le témoin étoit rejeté.
Je crois que ceci étoit une modification de l’ancienne coutume ; & ce qui me le fait penser, c’est que cet usage d’appeller les témoins, se trouve établi dans la loi des Bavarois [6] , & dans celle des Bourguignons [7] , sans aucune restriction.
J’ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard [8] [III-368] & Saint Avit [9] se récrierent tant. « Quand l’accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu’il n’a pas commis le crime, l’accusateur pourra appeller au combat un des témoins ; car il est juste que celui qui a offert de jurer, & qui a déclaré qu’il savoit la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce Roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.
-
[↑] Ch. lxi, page 315.
-
[↑] Leur doit-on demander, avant qu’ils fassent nul serment, pour qui ils veulent témoigner ; car l’enques gist li point d’aus lever de faux témoignage. Beaumanoir, ch. xxxix, page 218.
-
[↑] Ibid. ch. lxi, page 316.
-
[↑] Ch. vi, pages 39 & 40.
-
[↑] Mais si le combat se faisoit par champions, le champion vaincu avoit le poing coupé.
-
[↑] Tit. 16, §. 2.
-
[↑] Tit. 45.
-
[↑] Lettre à Louis le débonnaire.
-
[↑] Vie de S. Avit.
[III-368]
CHAPITRE XXVII.
Du combat judiciaire entre une partie & un des pairs du seigneur. Appel de faux jugement.
La nature de la décision par le combat, étant de terminer l’affaire pour toujours, & n’étant point compatible [1] avec un nouveau jugement & de nouvelles poursuites ; l’appel, tel qu’il est établi par les lois Romaines & [III-369] par les lois canoniques, c’est-à-dire, à un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement d’un autre, étoit inconnu en France.
Une nation guerriere, uniquement gouvernée par le point d’honneur, ne connoissoit pas cette forme de procéder ; & suivant toujours le même esprit, elle prenoit contre les juges les voies [2] qu’elle auroit pu employer contre les parties.
L’appel, chez cette nation, étoit un défi à un combat par armes, qui devoit se terminer par le sang ; & non pas cette invitation à une querelle de plume qu’on ne connut qu’après.
Aussi S. Louis dit-il, dans ses établissemens [3] , que l’appel contient félonie & iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il, que si un homme [4] vouloit se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur, il devoit lui dénoncer qu’il abandonnoit son fief ; après quoi il l’appelloit devant son seigneur suzerain, & offroit les gages de bataille. De même le seigneur [III-370] renonçoit à l’hommage, s’il appelloit son homme devant le comte.
Appeller son seigneur de faux jugement, c’étoit dire que son jugement avoit été faussement & méchamment rendu : or, avancer de telles paroles contre son seigneur, c’étoit commettre une espece de crime de félonie.
Ainsi, au lieu d’appeller pour faux jugement le seigneur qui établissoit & régloit le tribunal, on appelloit les pairs qui formoient le tribunal même : on évitoit par-là le crime de félonie ; on n’insultoit que ses pairs, à qui on pouvoit toujours faire raison de l’insulte.
On s’exposoit beaucoup [5] , en faussant le jugement des pairs. Si l’on attendoit que le jugement fût fait & prononcé, on étoit obligé de les combattre tous [6] , lorsqu’ils offroient de faire le jugement bon. Si l’on appelloit avant que tous les juges eussent donné leur avis, il falloit combattre tous ceux qui étoient convenus du même avis [7] . Pour éviter ce danger, on supplioit le seigneur [8] d’ordonner que chaque [III-371] pair dît tout haut son avis ; & lorsque le premier avoit prononcé, & que le second alloit en faire de même, on lui disoit qu’il étoit faux, méchant & calomniateur ; & ce n’étoit plus que contre lui qu’on devoit se battre.
Défontaines [9] vouloit qu’avant de fausser [10] , on laissât prononcer trois juges ; & il ne dit point qu’il fallût les combattre tous trois, & encore moins qu’il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s’étoient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent de ce que dans ce temps-là il n’y avoit guere d’usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendoit compte de ce qui se passoit dans le comté de Clermont, Défontaines de ce qui se pratiquoit en Vermandois.
Lorsqu’un [11] des pairs ou homme de fief avoit déclaré qu’il soutiendroit le jugement, le juge faisoit donner les gages de bataille, & de plus prenoit sureté de l’appellant qu’il soutiendroit son appel. Mais le pair qui étoit appellé, ne donnoit point de suretés, parce [III-372] qu’il étoit homme du seigneur, & devoit défendre l’appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.
Si celui [12] qui appelloit, ne prouvoit pas que le jugement fût mauvais, il payoit au seigneur une amende de soixante livres, la même amende [13] au pair qu’il avoit appellé, autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.
Quand un homme violemment soupçonné d’un crime qui méritoit la mort, avoit été pris & condamné, il ne pouvoit appeller [14] de faux jugement : car il auroit toujours appellé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.
Si quelqu’un [15] disoit que le jugement étoit faux & mauvais, & n’offroit pas de le faire tel, c’est-à-dire, de combattre, il étoit condamné à dix sols d’amende s’il étoit gentilhomme, & à cinq sols s’il étoit serf, pour les vilaines paroles qu’il avoit dites.
Les juges [16] ou pairs qui avoient [III-373] été vaincus, ne devoient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appelloit étoit puni de mort, lorsque l’affaire étoit capitale [17] .
Cette maniere d’appeller les hommes de fief pour faux jugement, étoit pour éviter d’appeller le seigneur même. Mais [18] si le seigneur n’avoit point de pairs, ou n’en avoit pas assez, il pouvoit à ses frais emprunter [19] des pairs de son seigneur suzerain : mais ces pairs n’étoient point obligés de juger s’ils ne le vouloient ; ils pouvoient déclarer qu’ils n’étoient venus que pour donner leur conseil : & dans ce cas particulier [20] , le seigneur jugeant & prononçant lui-même le jugement, si l’on appelloit contre lui de faux jugement, c’étoit à lui à soutenir l’appel.
Si le seigneur [21] étoit si pauvre qu’il ne fût pas en état de prendre des pairs [III-374] de son seigneur suzerain, ou qu’il négligeât de lui en demander, ou que celui-ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul, & personne n’étant obligé de plaider devant un tribunal où l’on ne peut faire jugement, l’affaire étoit portée à la cour du seigneur suzerain.
Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d’avec le fief, d’où s’est formée la regle des jurisconsultes François : Autre chose est le fief, autre chose est la justice. Car y ayant une infinité d’hommes de fief qui n’avoient point d’hommes sous eux, ils ne furent point en état de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain ; ils perdirent le droit de justice, parce qu’ils n’eurent ni le pouvoir ni la volonté de le réclamer.
Tous les juges [22] qui avoient été du jugement, devoient être présens quand on le rendoit, afin qu’ils pussent ensuivre & dire Oïl à celui qui voulant fausser, leur demandoit s’ils ensuivoient ; « car, dit Défontaines [23] , c’est une [III-375] affaire de courtoisie & de loyauté, & il n’y a point là de suite ni de remise. » Je crois que c’est de cette maniere de penser qu’est venu l’usage que l’on suit encore aujourd’hui en Angleterre, que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.
Il falloit donc se déclarer pour l’avis de la plus grande partie : & s’il y avoit partage, on prononçoit, en cas de crime, pour l’accusé ; en cas de dettes, pour le débiteur ; en cas d’héritages, pour le défendeur.
Un pair, dit Défontaines [24] , ne pouvoit pas dire qu’il ne jugeroit pas s’ils n’étoient que quatre [25] , ou s’ils n’y étoient tous, ou si les plus sages n’y étoient ; c’est comme s’il avoit dit, dans la mêlée, qu’il ne secouroit pas son seigneur, parce qu’il n’avoit auprès de lui qu’une partie de ses hommes. Mais c’étoit au seigneur à faire honneur à sa cour, & à prendre ses plus vaillans hommes & les plus sages. Je cite ceci pour faire sentir le devoir des vassaux, combattre & juger ; & ce devoir étoit [III-376] même tel, que juger c’étoit combattre.
Un seigneur [26] qui plaidoit à sa cour contre son vassal, & qui y étoit condamné, pouvoit appeller un de ses hommes de faux jugement. Mais à cause du respect que celui-ci devoit à son seigneur pour la foi donnée, & la bienveillance que le seigneur devoit à son vassal pour la foi reçue, on faisoit une distinction : ou le seigneur disoit en général, que le jugement [27] étoit faux & mauvais ; ou il imputoit à son homme des prévarications [28] personnelles. Dans le premier cas il offensoit sa propre cour, & en quelque façon lui-même, & il ne pouvoit y avoir de gages de batailles : il y en avoit dans le second, parce qu’il attaquoit l’honneur de son vassal ; & celui des deux qui étoit vaincu, perdoit la vie & les biens, pour maintenir la paix publique.
Cette distinction nécessaire, dans ce cas particulier, fut étendue. Beaumanoir dit que, lorsque celui qui appelloit de [III-377] faux jugement, attaquoit un des hommes par des imputations personnelles, il y avoit bataille ; mais que s’il n’attaquoit que le jugement, il étoit libre [29] à celui des pairs qui étoit appellé, de faire juger l’affaire par bataille ou par droit. Mais comme l’esprit qui régnoit du temps de Beaumanoir, étoit de restreindre l’usage du combat judiciaire, & que cette liberté donnée au pair appellé, de défendre par le combat le jugement, ou non, est également contraire aux idées de l’honneur établi dans ces temps-là, & à l’engagement où l’on étoit envers son seigneur de défendre sa cour, je crois que cette distinction de Beaumanoir étoit une jurisprudence nouvelle chez les François.
Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille ; il en étoit de cet appel comme de tous les autres. On se souvient des exceptions dont j’ai parlé au chapitre XXV. Ici, c’étoit au tribunal suzerain à voir s’il falloit ôter, ou non, les gages de bataille.
On ne pouvoit point fausser les jugemens rendus dans la cour du roi ; car [III-378] le roi n’ayant personne qui lui fût égal, il n’y avoit personne qui pût l’appeller ; & le roi n’ayant point de supérieur, il n’y avoit personne qui pût appeller de sa cour.
Cette loi fondamentale, nécessaire comme loi politique, diminuoit encore, comme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignoit [30] qu’on ne faussât sa cour, ou voyoit qu’on se présentoit pour la fausser ; s’il étoit du bien de la justice qu’on ne la faussât pas, il pouvoit demander des hommes de la cour du roi, dont on ne pouvoit fausser le jugement ; & le roi Philippe, dit Défontaines [31] , envoya tout son conseil pour juger une affaire dans la cour de l’abbé de Corbie.
Mais si le seigneur ne pouvoit avoir des juges du roi, il ne pouvoit mettre sa cour dans celle du roi, s’il relevoit nuement de lui ; & s’il y avoit des seigneurs intermédiaires, il s’adressoit à son seigneur suzerain, allant de seigneur en seigneur jusqu’au roi.
Ainsi, quoiqu’on n’eût pas dans ces [III-379] temps-là, la pratique ni l’idée même des appels d’aujourd’hui, on avoit recours au roi, qui étoit toujours la source d’où tous les fleuves partoient, & la mer où ils revenoient.
-
[↑] « Car en la cour où l’on va par la raison de l’appel pour les gages maintenir, se bataille est faite, la querelle est venue à fin, si que il n’y a métier de plus d’apiaux. » Beauman. ch. ii. P. 23.
-
[↑] Ibid. ch. lxi, p. 212, & ch. lxvii, p. 338.
-
[↑] Liv. II, ch. xv.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, p. 310 & 311 ; & ch. lxvii, pag. 337.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, page 313.
-
[↑] Ibid, page 314.
-
[↑] Qui s’étoient accordés au jugement.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, page 314.
-
[↑] Chap. xxii, art. I, 10 & 11. Il dit seulement qu’on leur payoit à chacun une amende.
-
[↑] Appeller de faux jugement.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, p. 314.
-
[↑] Beaum. ibid. Défont. ch. xxii, art. 9.
-
[↑] Défont. ibid.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, p. 316, & Défontaines, ch. xxii, art. 21.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, page 314.
-
[↑] Défont. ch. xxii, art. 73.
-
[↑] Voyez Défontaines, ch. xxi, art. 11, 12 & suivants, qui distingue les cas où le fausseur perdoit la vie, la chose contestée, ou seulement l’interlocutoire.
-
[↑] Beaum. ch. lxii, page 322. Défont. ch. xxii, art. 3.
-
[↑] Le comte n’étoit pas obligé d’en prêter. Beaum, ch. lxvii, pag. 337.
-
[↑] Nul ne peut faire jugement en sa cour, dit Beaumanoir, ch. lxvii, pages 336 & 337.
-
[↑] Ibid. ch. lxii, page 322.
-
[↑] Défont. chap xxi, art. 27 & 28.
-
[↑] Ibid. art. 28.
-
[↑] Chap. xxi, art. 37.
-
[↑] Il falloit ce nombre au moins, Défontaines, chap. xxi, art. 36.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, ch. lxvii, page 337.
-
[↑] Chi jugement est faux & mauvais : Ibid. ch. lxvii, page 337.
-
[↑] Vous avez fait ce jugement faux & mauvais, comme mauvais que vous êtes, ou par lovier ou par pramesse. Beaumanoir, ch. lxvii, page 337.
-
[↑] Ibid. pages 337 & 338.
-
[↑] Défont. ch. xxii, art. 14.
-
[↑] Ibid.
[III-379]
CHAPITRE XXVIII.
De l’appel de défaute de droit.
On appelloit de défaute de droit, quand, dans la cour d’un seigneur, on différoit, on évitoit, ou l’on refusoit de rendre la justice aux parties.
Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceux-ci étoit subordonnée, mais la juridiction ne l’étoit pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites, jugeoient en dernier ressort le comte même ; toute la différence étoit dans le partage de la juridiction : par exemple, le comte [1] pouvoit condamner à mort, juger de la liberté & de la restitution des biens ; & le centenier ne le pouvoit pas.
[III-380]
Par la même raison, il y avoit des causes majeures [2] qui étoient réservées au roi ; c’étoient celles qui intéressoient directement l’ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés, les comtes & autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux [3] .
Ce qu’on dit quelques auteurs, qu’on appelloit du comte à l’envoyé du roi, ou missus dominicus, n’est pas fondé. Le comte & le missus avoient une juridiction égale & indépendante l’une de l’autre [4] : toute la différence [5] étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l’année, & le comte les huit autres.
Si quelqu’un [6] condamné dans une assise [7] , y demandoit qu’on le rejugeât, & succomboit encore, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l’affaire.
[III-381]
Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisoient donner caution [8] qu’ils se présenteroient devant le tribunal du roi : c’étoit pour juger l’affaire, & non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz [9] l’appel de faux jugement à la cour du roi établi, & toutes autres sortes d’appels proscrits & punis.
Si l’on n’acquiesçoit pas [10] au jugement des échevins [11] , & qu’on ne réclamât pas, on étoit mis en prison jusqu’à ce qu’on eût acquiscé ; & si l’on réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi, & l’affaire se discutoit à sa cour.
Il ne pouvoit guere être question de l’appel de défaute de droit. Car bien loin que dans ce temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes & [III-382] autres gens qui avoient droit de tenir des assises, ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignoit [12] au contraire qu’ils l’étoient trop ; & tout est plein d’ordonnances qui défendent aux comtes & autres officiers de justice quelconques, de tenir plus de trois assises par an. Il falloit moins corriger leur négligence, qu’arrêter leur activité.
Mais, lorsqu’un nombre innombrable de petites seigneuries se formerent, que différens degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour, donna naissance à ces sortes d’appels [13] ; d’autant plus qu’il en revenoit au seigneur suzerain des amendes considérables.
L’usage du combat judiciaire s’étendant de plus en plus, il y eut des lieux, des cas, des temps, où il fut difficile d’assembler les pairs, & où par conséquent on négligea de rendre la justice. L’appel de défaute de droit s’introduisit ; & ces sortes d’appels ont été souvent des points remarquables de notre [III-383] histoire, parce que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour motif la violation du droit politique, comme nos guerres d’aujourd’hui ont ordinairement pour cause, ou pour prétexte, celle du droit des gens.
Beaumanoir [14] dit que, dans le cas de défaute de droit, il n’y avoit jamais de bataille ; en voici les raisons. On ne pouvoit pas appeler au combat le seigneur lui-même, à cause du respect dû à sa personne : on ne pouvoit pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose étoit claire, & qu’il n’y avoit qu’à compter les jours des ajournemens ou des autres délais : il n’y avoit point de jugement, & on ne faussoit que sur un jugement ; enfin le délit des pairs offensoit le seigneur comme la partie ; & il étoit contre l’ordre qu’il y eût un combat entre le seigneur & ses pairs.
Mais [15] , comme devant le tribunal suzerain, on prouvoit la défaute par témoins, on pouvoit appeler au combat les témoins ; & par-là on n’offensoit ni le seigneur, ni son tribunal.
1.o Dans le cas où la défaute venoit [III-384] de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avoient différé de rendre la justice, ou évité de faire le jugement après les délais passés, c’étoient les pairs du seigneur qu’on appelloit de défaute de droit devant le suzerain ; & s’ils succomboient [16] , ils payoient une amende à leur seigneur. Celui-ci ne pouvoit porter aucun secours à ses hommes ; au contraire il saisissoit leur fief, jusqu’à ce qu’ils lui eussent payé chacun une amende de soixante livres.
2°. Lorsque la défaute venoit de la part du Seigneur, ce qui arrivoit lorsqu’il n’y avoit pas assez d’hommes à sa cour pour faire le jugement, ou lorsqu’il n’avoit pas assemblé ses hommes, ou mis quelqu’un à sa place pour les assembler, on demandoit la défaute devant le seigneur suzerain : mais à cause du respect dû au seigneur, on faisoit ajourner la partie [17] , & non pas le seigneur.
Le seigneur demandoit sa cour devant le tribunal suzerain ; & s’il gagnoit la défaute, on lui renvoyoit l’affaire, & on lui payoit une amende de soixante [III-385] livres [18] : mais si la défaute étoit prouvée, la peine [19] contre lui étoit de perdre le jugement de la chose contestée, le fond étoit jugé dans le tribunal suzerain ; en effet, on n’avoit demandé la défaute que pour cela.
3°. Si l’on plaidoit [20] à la cour de son seigneur contre lui, ce qui n’avoit lieu que pour les affaires qui concernoient le fief ; après avoir laissé passer tous les délais, on sommoit le seigneur [21] même devant bonnes gens, & on le faisoit sommer par le souverain, dont on devoit avoir permission. On n’ajournoit point par pairs, car les pairs ne pouvoient ajourner leur seigneur ; mais ils pouvoient ajourner [22] pour leur seigneur.
Quelquefois [23] l’appel de défaute de droit étoit suivi d’un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré [III-386] la défaute, avoit fait rendre le jugement.
Le vassal [24] qui appelloit à tort son seigneur de défaute de droit, étoit condamné à lui payer une amende à sa volonté.
Les Gantois [25] avoient appellé de défaute de droit le comte de Flandre devant le roi, sur ce qu’il avoit différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu’il avoit pris encore moins de délais que n’en donnoit la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés ; il fit saisir de leurs biens jusqu’à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi, pour que cette amende fût modérée ; il fut décidé que le comte pouvoit prendre cette amende, & même plus, s’il vouloit. Beaumanoir avoit assisté à ces jugemens.
4°. Dans les affaires que le seigneur pouvoit avoir contre le vassal pour raison du corps ou de l’honneur de celui-ci, ou des biens qui n’étoient pas du fief, il n’étoit point question d’appel de défaute de droit ; puisqu’on ne jugeoit [III-387] point à la cour du seigneur, mais à la cour de celui de qui il tenoit ; les hommes, dit Défontaines [26] , n’ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.
J’ai travaillé à donner une idée claire de ces choses, qui, dans les auteurs de ces temps-là, sont si confuses & si obscures, qu’en vérité les tirer du chaos où elles sont, c’est les découvrir.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 812, art. 3, édit. de Baluze, page 497, & de Charles-le-chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 812, art. 2, édition de Baluze, page 497.
-
[↑] Cum fidelibus ; capitulaire de Louis le débonnaire, édition de Baluze, page 667.
-
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3.
-
[↑] Capitulaire III, de l’an 812, art. 8.
-
[↑] Capitulaire ajouté à la loi des Lombards, liv. II, tit. 59.
-
[↑] Placitum.
-
[↑] Cela paroît par les formules, les chartres & les capitulaires.
-
[↑] De l’an 757, édit. de Baluze, page 180, art. 9 & 10 ; & le synode apud Vernas, de l’an 755, art. 29, édit. de Baluze, pag. 175. Ces deux capitulaires furent faits sous le roi Pépin.
-
[↑] Capitulaire XI de Charlemagne, de l’an 805, édit. de Baluze, page 423 ; & loi de Lothaire, dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, art. 23.
-
[↑] Officiers sous le comte : scabini.
-
[↑] Voyez la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, art. 22.
-
[↑] On voit des appels de défaute de droit dès le temps de Philippe Auguste.
-
[↑] Chap. lxi, page 315.
-
[↑] Beaum. ibid.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. 24.
-
[↑] Ibid. ch. xxi, art. 32.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, page 312.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. I, 29.
-
[↑] Sous le regne de Louis VIII, le sire de Nele plaidoit contre Jeanne Comtesse de Flandre ; il la somma de le faire juger dans quarante jours, & il l’appella ensuite de défaute de droit à la cour du roi. Elle répondit qu’elle le feroit juger par ses pairs en Flandre. La cour du roi prononça qu’il n’y seroit point renvoyé, & que la Comtesse seroit ajournée.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. 34.
-
[↑] Ibid. art. 9.
-
[↑] Beaum. ch. lxi, p. 311.
-
[↑] Ibid p. 312. Mais celui qui n’auroit été homme, ni tenant du seigneur, ne lui payoit qu’une amende de 60 livres, ibid.
-
[↑] Ibid. page 318.
-
[↑] Chapitre XXI, art. 35.
[III-387]
CHAPITRE XXIX.
Époque du regne de S. Louis.
Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribunaux de ses domaines, comme il paroît par l’ordonnance [1] qu’il fit là-dessus, & par les établissemens [2] .
Mais il ne l’ôta point dans les cours de ses barons [3] , excepté dans le cas d’appel de faux jugement.
On ne pouvoit fausser [4] la cour de [III-388] son seigneur, sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avoient prononcé le jugement. Mais S. Louis introduisit [5] l’usage de fausser sans combattre ; changement qui fut une espece de révolution.
Il déclara [6] qu’on ne pourroit point fausser les jugemens rendus dans les seigneuries de ses domaines, parce que c’étoit un crime de félonie. Effectivement, si c’étoit une espece de crime de félonie contre le seigneur, à plus forte raison en étoit-ce un contre le roi. Mais il voulut que l’on pût demander amendement [7] des jugemens rendus dans ses cours ; non pas parce qu’ils étoient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu’ils faisoient quelque préjudice [8] . Il voulut, au contraire, qu’on fût contraint de fausser [9] les jugemens des cours des barons, si l’on vouloit s’en plaindre.
On ne pouvoit point, suivant les établissemens, fausser les cours des [III-389] domaines du roi, comme on vient de le dire. Il falloit demander amendement devant le même tribunal : & en cas que le bailli ne voulût pas faire l’amendement requis, le roi permettoit de faire appel [10] à sa cour ; ou plutôt en interprétant les établissemens par eux-mêmes, de lui présenter [11] une requête ou supplication.
A l’égard des cours des seigneurs, S. Louis, en permettant de les fausser, voulut que l’affaire fût portée [12] au tribunal du roi ou du seigneur suzérain, non [13] pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des regles [14] .
Ainsi, soit qu’on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs ; soit qu’on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines ; il établit qu’on pourroit appeler, sans courir le hazard d’un combat.
[III-390]
Défontaines [15] nous rapporte les deux premiers exemples qu’il ait vus, où l’on ait ainsi procédé sans combat judiciaire : l’un dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoit du domaine du roi, & l’autre dans la cour de Ponthieu, où le comte qui étoit présent, opposa l’ancienne jurisprudence : mais ces deux affaires furent jugées par droit.
On demandera peut-être pourquoi S. Louis ordonna pour les cours de ses barons une maniere de procéder différente de celle qu’il établissoit dans les tribunaux de ses domaines : en voici la raison. S. Louis statuant pour les cours de ses domaines, ne fut point gêné dans ses vues : mais il eut des ménagemens à garder avec les seigneurs, qui jouissoient de cette ancienne prérogative, que les affaires n’étoient jamais tirées de leurs cours, à moins qu’on ne s’exposât aux dangers de les fausser. S. Louis maintint cet usage de fausser : mais il voulut qu’on pût fausser sans combattre, c’est-à-dire, que, pour que le changement se fît moins sentir, il ôta la chose, & laissa subsister les termes.
[III-391]
Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir [16] dit que de son temps il y avoit deux manieres de juger, l’une suivant l’établissement-le-roi, & l’autre suivant la pratique ancienne : que les seigneurs avoient droit de suivre l’une où l’autre de ces pratiques ; mais que, quand dans une affaire on en avoit choisi une, on ne pouvoit plus revenir à l’autre. Il ajoute [17] que le comte de Clermont suivoit la nouvelle pratique, tandis que ses vassaux se tenoient à l’ancienne : mais qu’il pourroit, quand il voudroit, rétablir l’ancienne ; sans quoi il auroit moins d’autorité que ses vassaux.
Il faut savoir que la France étoit pour lors [18] divisée en pays du domaine du roi, & en ce que l’on appelloit pays des barons ou en baronnies : & pour me servir des termes des établissemens de S. Louis, en pays de l’obéissance-le-roi, & en pays hors l’obéissance-le-roi. Quand les rois faisoient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n’employoient que leur seule [III-392] autorité : mais quand ils en faisoient qui regardoient aussi les pays de leurs barons, elles étoient faites [19] de concert avec eux, ou scellées ou souscrites d’eux : sans cela, les barons les recevoient ou ne les recevoient pas, suivant qu’elles leur paroissoient convenir ou non au bien de leurs seigneuries. Les arriere-vassaux étoient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or les établissemens ne furent pas donnés du consentement des seigneurs, quoiqu’ils statuassent sur des choses qui étoient pour eux d’une grande importance : ainsi ils ne furent reçus que par ceux qui crurent qu’il leur étoit avantageux de les recevoir. Robert, fils de S. Louis, les admit dans sa comté de Clermont ; & ses vassaux ne crurent pas qu’il leur convînt de les faire pratiquer chez eux.
-
[↑] En 1260.
-
[↑] Livre I. ch. ii & vii ; liv. II. ch. x & xi.
-
[↑] Comme il paroît par-tout dans les établissemens ; & Beaumanoir, ch. lxi, page 309.
-
[↑] C’est-à-dire, appeler de faux jugement.
-
[↑] Établissemens, liv. I. chap. vi ; & liv. II. chap. xv.
-
[↑] Ibid. liv. II. chap xv.
-
[↑] Ibid. liv. I. ch. lxxviii, & liv. II. ch. xv.
-
[↑] Ibid. liv. I. ch. lxxviii.
-
[↑] Ibid. liv. II. ch. xv.
-
[↑] Etablissemens, liv. I. chap. lxxviii.
-
[↑] Ibid. liv. II. ch. xv.
-
[↑] Mais si on ne faussoit pas, & qu’on voulût appeler, on n’étoit point reçu. Etablissemens, liv. II. ch. xv. Li sire en auroit le recort de sa cour droit faisant.
-
[↑] Ibid. liv. I. ch. vi & lxvii ; & liv. II. ch. xv ; & Beaumanoir, ch. xi, page 58.
-
[↑] Etablissemens, liv. I. ch. i, ii & iii.
-
[↑] Chapitre xxii, art. 16 & 17.
-
[↑] Chapitre lxi, page 309.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Voyez Beaumanoir, Défontaines, & les établissemens, liv. II. ch. x, xi, xv & autres.
-
[↑] Voyez les ordonnances du commencement de la troisieme race, dans le recueil de Lauriere, sur-tout celles de Philippe-Auguste sur la juridiction ecclésiastique, é celles de Louis VIII, sur les Juifs ; & les chartres rapportées par M. Brussel, notamment celles de S. Louis sur le bail & le rachat des terres, & la majorité féodale des filles, tome II, liv. III, page 35 ; & ibid, l’ordonnance de Philippe-Auguste, page 7.
[III-393]
CHAPITRE XXX.
Observation sur les appels.
On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, devoient se faire sur le champ. « S’il se part de court sans appeller, dit Beaumanoir [1] , il perd son appel, & tient le jugement pour bon ». Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage du combat judiciaire [2] .
-
[↑] Chap. lxiii, page 327 ; Ibid. ch. lxi, p. 312.
-
[↑] Voyez les établissemens de S. Louis, liv. II. chap. xv ; l’ordonnance de Charles VII, de 1453.
[III-393]
CHAPITRE XXXI.
Continuation du même sujet.
Le villain ne pouvoit pas fausser la cour de son seigneur : nous l’apprenons de Défontaines [1] ; & cela est confirmé par les établissemens [2] . « Aussi, dit encore Défontaines [3] , n’y a-t-il entre toi seigneur & ton villain autre juge fors Dieu ».
[III-394]
C’étoit l’usage du combat judiciaire qui avoit exclus les villains de pouvoir fausser la cour de leur seigneur ; & cela est si vrai, que les villains qui, par chartre [4] ou par usage, avoient droit de combattre, avoient aussi droit de fausser la cour de leur seigneur, quand même les hommes qui avoient jugé auroient été chevaliers [5] ; & Défontaines donne des expédiens [6] pour que ce scandale du villain, qui, en faussant le jugement, combattroit contre un chevalier, n’arrivât pas.
La pratique des combats judiciaires commençant à s’abolir, & l’usage des nouveaux appels à s’introduire, on pensa qu’il étoit déraisonnable que les personnes franches eussent un remede contre l’injustice de la cour de leurs seigneurs, & que les villains ne l’eussent pas ; & le parlement reçut leurs appels comme ceux des personnes franches.
-
[↑] Chap. xxi, art. 21 & 22.
-
[↑] Liv. I. chap. cxxxvi.
-
[↑] Chap. ii, art. 8.
-
[↑] Défontaines, ch. xxii, art. 7. Cet article & le 21 du ch. xxii du même auteur, ont été jusqu’ici très-mal expliqués. Défontaines ne met point en opposition le jugement du seigneur avec celui du chevalier, puisque c’étoit le même ; mais il oppose le vaillain ordinaire à celui qui avoit le privilege de combattre.
-
[↑] Les chevaliers peuvent toujours être du nombre des juges. Défontaines, ch. xxi, art. 48.
-
[↑] Chapitre xxii, art. 14.
[III-395]
CHAPITRE XXXII.
Continuation du même sujet.
Lorsqu’on faussoit la cour de son seigneur, il venoit en personne devant le seigneur suzerain, pour défendre le jugement de sa cour. De même [1] , dans le cas d’appel de défaute de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avec elle, afin que, si la défaute n’étoit pas prouvée, il pût ravoir sa cour.
Dans la suite, ce qui n’étoit que deux cas particuliers étant devenu général pour toutes les affaires, par l’introduction de toutes sortes d’appels, il parut extraordinaire que le seigneur fût obligé de passer sa vie dans d’autres tribunaux que les siens, & pour d’autres affaires que les siennes. Philippe de Valois [2] ordonna que les baillis seuls seroient ajournés. Et quand l’usage des appels devint encore plus fréquent, ce fut aux parties à défendre à l’appel ; le fait [3] du juge devint le fait de la partie.
[III-396]
J’ai dit [4] que, dans l’appel de défaute de droit, le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger l’affaire en sa cour. Mais si le seigneur étoit attaqué lui-même comme partie [5] , ce qui devint très-fréquent [6] , il payoit au roi, ou au seigneur suzérain devant qui on avoit appellé, une amende de soixante livres. De-là vint cet usage, lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer l’amende au seigneur lorsqu’on réformoit la sentence de son juge : usage qui subsista long-temps, qui fut confirmé par l’ordonnance de Roussillon, & que son absurdité a fait périr.
-
[↑] Défont. ch. xxi, art. 33.
-
[↑] En 1332.
-
[↑] Voyez quel étoit l’état des choses du temps de Poutillier, qui vivoit en l’an 1402. Somme rurale, liv. I, page 19 & 20.
-
[↑] Ci-dessus, chap. xxx.
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxi, pag. 312 & 318.
-
[↑] Ibid.
[III-396]
CHAPITRE XXXIII.
Continuation du même sujet.
Dans la pratique du combat judiciaire, le fausseur qui avoit appellé un des juges, pouvoit perdre [1] par le combat son procès, & ne pouvoit pas [III-397] le gagner. En effet, la partie qui avoit un jugement pour elle, n’en devoit pas être privée par le fait d’autrui. Il falloit donc que le fausseur qui avoit vaincu, combattît encore contre la partie, non pas pour savoir si le jugement étoit bon ou mauvais ; il ne s’agissoit plus de ce jugement, puisque le combat l’avoit anéanti ; mais pour décider si la demande étoit légitime ou non ; & c’est sur ce nouveau point que l’on combattoit. De-là doit être venue notre maniere de prononcer les arrêts : La cour met l’appel au néant ; la cour met l’appel & ce dont a été appellé au néant. En effet, quand celui qui avoit appellé de faux jugement étoit vaincu, l’appel étoit anéanti ; quand il avoit vaincu, le jugement étoit anéanti, & l’appel même : il falloit procéder à un nouveau jugement.
Ceci est si vrai, que lorsque l’affaire se jugeoit par enquêtes, cette maniere de prononcer n’avoit pas lieu. M. de la Roche-Flavin nous dit [2] que la chambre des enquêtes ne pouvoit user de cette forme dans les premiers temps de sa création.
[III-398]
CHAPITRE XXXIV.
Comment la procédure devint secrette.
Les duels avoient introduit une forme de procédure publique ; l’attaque & la défense étoient également connues. « Les témoins, dit Beaumanoir [1] , doivent dire leur témoignage devant tous ».
Le commentateur de Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens & de quelques vieux procès écrits à la main, qu’anciennement en France les procès criminels se faisoient publiquement, & en une forme non guere différente des jugemens publics des Romains. Ceci étoit lié avec l’ignorance de l’écriture, commune dans ces temps-là. L’usage de l’écriture arrête les idées, & peut faire établir le secret : mais quand on n’a point cet usage, il n’y a que la publicité de la procédure qui puisse fixer ces mêmes idées.
Et comme il pouvoit y avoir de l’incertitude sur [2] ce qui avoit été jugé par hommes, ou plaidé devant [III-399] hommes, on pouvoit en rappeller la mémoire toutes les fois qu’on tenoit la cour, par ce qui s’appelloit la procédure par record [3] ; & dans ce cas, il n’étoit pas permis d’appeler les témoins au combat ; car les affaires n’auroient jamais eu de fin.
Dans la suite, il s’introduisit une forme de procéder secrette. Tout étoit public ; tout devint caché ; les interrogatoires, les informations, le récollement, la confrontion, les conclusions de la partie publique ; & c’est l’usage d’aujourd’hui. La premiere forme de procéder convenoit au gouvernement d’alors, comme la nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut établi depuis.
Le commentateur de Boutillier fixe à l’ordonnance de 1539 l’époque de ce changement. Je crois qu’il se fit peu à peu, & qu’il passa de seigneurie en seigneurie, à mesure que les seigneurs renoncerent à l’ancienne pratique de juger, & que celle tirée des établissemens de S. Louis vint à se perfectionner. En effet, Beaumanoir [4] dit que ce n’étoit [III-400] que dans le cas où on pouvoit donner des gages de bataille, qu’on entendoit publiquement les témoins : dans les autres, on les oyoit en secret, & on rédigeoit leurs dépositions par écrit. Les procédures devinrent donc secrettes, lorsqu’il n’y eut plus de gages de bataille.
-
[↑] Chapitre lxi, page 315.
-
[↑] Comme dit Beaumanoir, ch. xxxix. p. 209.
-
[↑] On prouvoit par témoins ce qui s’étoit déjà passé, dit, ou ordonné en justice.
-
[↑] Chapitre xxxix, page 218.
[III-400]
CHAPITRE XXXV.
Des dépens.
Anciennement en France, il n’y avoit point de condamnation de dépens en cour laye [1] . La partie qui succomboit étoit assez punie par des condamnations d’amende envers le seigneur & ses pairs. La maniere de procéder par le combat judiciaire faisoit que, dans les crimes, la partie qui succomboit, & qui perdoit la vie & les biens, étoit punie autant qu’elle pouvoit l’être : & dans les autres cas du combat judiciaire, il y avoit des amendes quelques fixes, quelquefois [III-401] dépendantes de la volonté du seigneur, qui faisoient assez craindre les événemens des procès. Il en étoit de même dans les affaires qui ne se décidoient que par le combat. Comme c’étoit le seigneur qui avoit les profits principaux, c’étoit lui aussi qui faisoit les principales dépenses, soit pour assembler ses pairs, soit pour les mettre en état de procéder au jugement. D’ailleurs, les affaires finissant sur le lieu même, & toujours presque sur le champ, & sans ce nombre infini d’écritures qu’on vit depuis, il n’étoit pas nécessaire de donner des dépens aux parties.
C’est l’usage des appels qui doit naturellement introduire celui de donner des dépens. Aussi Défontaines [2] dit-il que, lorsqu’un appelloit par loi écrite, c’est-à-dire quand on suivoit les nouvelles lois de S. Louis, on donnoit des dépens ; mais que, dans l’usage ordinaire, qui ne permettoit point d’appeller sans fausser, il n’y en avoit point ; on n’obtenoit qu’une amende, & la possession d’an & jour de la chose contestée, si l’affaire étoit renvoyée au seigneur.
[III-402]
Mais, lorsque de nouvelles facilités d’appeller augmenterent le nombre des appels [3] ; que, par le fréquent usage de ces appels d’un tribunal à un autre, les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour ; quand l’art nouveau de la procédure multiplia & éternisa les procès ; lorsque la science d’éluder les demandes les plus justes se fut rafinée ; quand un plaideur sut fuir, uniquement pour se faire suivre ; lorsque la demande fut ruineuse, & la défense tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles & d’écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice, qui ne devoient point rendre la justice ; que la mauvaise foi trouva des conseils, là où elle ne trouva pas des appuis : il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, & pour les moyens qu’ils avoient employés pour l’éluder. Charles le bel fit là-dessus une ordonnance générale [4] .
-
[↑] Défontaines, dans son conseil, chap. xxii, art. 3 & 8 ; & Beaumanoir, ch. xxxiii ; Établissemens, liv. I. ch. xc.
-
[↑] Chapitre xxii, art. 8.
-
[↑] A présent que l’on est si enclin à appeller, dit Boutillier, somme rurale, liv. I. tit. 3, page 16.
-
[↑] En 1324.
[III-403]
CHAPITRE XXXVI.
De la partie publique.
Comme, par les lois Saliques & Ripuaires, & par les autres lois des peuples barbares, les peines des crimes étoient pécuniaires ; il n’y avoit point pour lors, comme aujourd’hui parmi nous, de partie publique qui fût chargée de la poursuite des crimes. En effet, tout se réduisoit en réparation de dommages ; toute poursuite étoit en quelque façon civile, & chaque particulier pouvoit la faire. D’un autre côté, le droit Romain avoit des formes populaires pour la poursuite des crimes, qui ne pouvoient s’accorder avec le ministere d’une partie publique.
L’usage des combats judiciaires ne répugnoit pas moins à cette idée ; car, qui auroit être voulu être la partie publique, & se faire champion de tous contre tous ?
Je trouve dans un recueil de formules que M. Muratori a insérées dans les lois des Lombards, qu’il y avoit dans la seconde race un avoué [1] de la [III-404] partie publique. Mais si on lit le recueil entier de ces formules, on verra qu’il y avoit une différence totale entre ses officiers, & ce que nous appellons aujourd’hui la partie publique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi ou des seigneurs. Les premiers étoient plutôt les agens du public pour la manutention politique & domestique, que pour la manutention civile. En effet, on ne voit point, dans ces formules, qu’ils fussent chargés de la poursuite des crimes, & des affaires qui concernoient les mineurs, les églises, ou l’état des personnes.
J’ai dit que l’établissement d’une partie publique répugnoit à l’usage du combat judiciaire. Je trouve pourtant, dans une de ces formules, un avoué de la partie publique qui a la liberté de combattre. M. Muratori l’a mise à la suite de la constitution [2] d’Henri I. pour laquelle elle a été faite. Il est dit dans cette constitution, que « si quelqu’un tue son pere, son frere, son neveu, ou quelqu’autre de ses parens, il perdra leur succession, qui passera aux [III-405] autres parens ; & que la sienne propre appartiendra au fisc ». Or c’est pour la poursuite de cette succession dévolue au fisc, que l’avoué de la partie publique, qui en soutenoit les droits, avoit la liberté de combattre : ce cas rentroit dans la regle générale.
Nous voyons, dans ces formules, l’avoué de la partie publique agir contre celui [3] qui avoit pris un voleur, & ne l’avoit pas mené au comte ; contre celui [4] qui avoit fait un soulevement ou une assemblée contre le comte ; contre celui [5] qui avoit sauvé la vie à un homme que le comte lui avoit donné pour le faire mourir ; contre l’avoué des églises [6] , à qui le comte avoit ordonné de lui présenter un voleur, & qui n’avoit point obéi ; contre celui [7] qui avoit révélé le secret du roi aux étrangers ; contre celui [8] qui, à main armée, avoit poursuivi l’envoyé de l’empereur ; contre celui [9] qui avoit [III-406] méprisé les lettres de l’empereur, & il étoit poursuivi par l’avoué de l’empereur, ou par l’empereur lui-même ; contre celui [10] qui n’avoit pas voulu recevoir la monnoie du prince : enfin, cet avoué demandoit les choses que la loi adjugeoit au fisc [11] .
Mais dans la poursuite des crimes, on ne voit point d’avoué de la partie publique ; même quand on emploie les duels [12] ; même quand il s’agit d’incendie [13] ; même lorsque le juge est tué sur son tribunal [14] ; même lorsqu’il s’agit de l’état des personnes [15] , de la liberté & de la servitude [16] .
Ces formules sont faites, non seulement pour les lois des Lombards, mais pour les Capitulaires ajoutés ; ainsi il ne faut pas douter que, sur cette matiere, elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.
Il est clair que ces avoués de la partie publique durent s’éteindre avec la [III-407] seconde race, comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raison qu’il n’y eut plus de loi générale, ni de fisc général ; & par la raison qu’il n’y eut plus de comte dans les provinces, pour tenir les plaids ; & par conséquent plus de ces sortes d’officiers dont la principale fonction étoit de maintenir l’autorité du comte.
L’usage des combats, devenu plus fréquent dans la troisieme race, ne permit pas d’établir une partie publique. Aussi Boutiller, dans sa somme rurale, parlant des officiers de justice, ne cite-t-il que les baillis, hommes féodaux & sergens. Voyez les établissemens [17] , & Beaumanoir [18] sur la maniere dont on faisoit les poursuites dans ces temps-là.
Je trouve dans les lois [19] de Jacques II, roi de Majorque, une création de l’emploi de procureur du roi [20] , avec les fonctions qu’ont aujourd’hui les nôtres. Il est visible qu’ils ne vinrent [III-408] qu’après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.
-
[↑] Advocatus de parte publicâ.
-
[↑] Voyez cette constitution & cette formule dans le second volume des historiens d’Italie, page 175.
-
[↑] Recueil de Muratori, page 104, sur la loi 88 de Charlemagne, liv. I. tit. 26, §. 78.
-
[↑] Autre formule, Ibid. page 87.
-
[↑] Ibid. page 104.
-
[↑] Ibid. page 95.
-
[↑] Ibid. page 88.
-
[↑] Ibid. page 98.
-
[↑] Ibid. page 132.
-
[↑] Formule, page 132.
-
[↑] Ibid. page 137.
-
[↑] Ibid. page 147.
-
[↑] Ibid.
-
[↑] Ibid. page 168.
-
[↑] Ibid. page 134.
-
[↑] Ibid. page 107.
-
[↑] Livre I. ch. i ; & liv. II. ch. xi & xiii.
-
[↑] Chapitre i. & chap. lxi.
-
[↑] Voyez ces lois dans les vies des Saints du mois de juin, tome III, page 26.
-
[↑] Qui continuè nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta & causas in ipsâ curiâ promoveat atque prosequatur.
[III-408]
CHAPITRE XXXVII.
Comment les établissemens de Saint Louis tomberent dans l’oubli.
Ce fut le destin des établissemens, qu’ils naquirent, vieillirent, & moururent en très-peu de temps.
Je ferai là-dessus quelques réflexions. Le code que nous avons sous le nom d’établissemens de S. Louis, n’a jamais été fait pour servir de loi à tout le royaume, quoique cela soit dit dans la préface de ce code. Cette compilation est un code général, qui statue sur toutes les affaires civiles, les dispositions des biens par testament ou entre-vifs, les dots & les avantages des femmes, les profits & les prérogatives des fiefs, les affaires de police, &c. Or, dans un temps où chaque ville, bourg ou village, avoit sa coutume, donner un corps général de lois civiles, c’étoit vouloir renverser dans un moment toutes les lois particulieres, sous lesquelles on vivoit dans chaque lieu du royaume. Faire une coutume générale de toutes les coutumes [III-409] particulieres, seroit une chose inconsidérée, même dans ce temps-ci, où les princes ne trouvent par-tout que de l’obéissance. Car, s’il est vrai qu’il ne faut pas changer lorsque les inconvéniens égalent les avantages, encore moins le faut-il lorsque les avantages sont petits & les inconvéniens immenses. Or, si l’on fait attention à l’état où étoit pour lors le royaume, où chacun s’enivroit de l’idée de sa souveraineté & de sa puissance, on voit bien qu’entreprendre de changer par-tout les lois & les usages reçus, c’étoit une chose qui ne pouvoit venir dans l’esprit de ceux qui gouvernoient.
Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des établissemens ne fut pas confirmé en parlement par les barons & gens de loi du royaume, comme il est dit dans un manuscrit de l’Hôtel de ville d’Amiens, cité par M. Ducange [1] . On voit, dans les autres manuscrits, que ce code fut donné par S. Louis en l’année 1270, avant qu’il partît pour Tunis : ce fait n’est pas plus vrai : car S. Louis est parti en 1269, comme l’a remarqué M. Ducange ; d’où [III-410] il conclut que ce code auroit été publié en son absence. Mais je dis que cela ne peut pas être. Comment S. Louis auroit-il pris le temps de son absence, pour faire une chose qui auroit été une semence de troubles, & qui eût pu produire, non pas des changemens, mais des révolutions ? Une pareille entreprise avoit besoin, plus qu’une autre, d’être suivie de près ; & n’étoit point l’ouvrage d’une régence foible, & même composée de seigneurs, qui avoient intérêt que la chose ne réussît pas. C’étoit Matthieu, abbé de S. Denys ; Simon de Clermont, comte de Nelle ; & en cas de mort, Philippe, évêque d’Evreux ; & Jean, comte de Ponthieu. On a vu ci-dessus [2] , que le comte de Ponthieu s’opposa dans sa seigneurie à l’exécution d’un nouvel ordre judiciaire.
Je dis en troisieme lieu, qu’il y a grande apparence que le code que nous avons, est une chose différente des établissemens de S. Louis sur l’ordre judiciaire. Ce code cite les établissemens ; il est donc un ouvrage sur les établissemens, & non pas les établissemens. De plus, Beaumanoir, qui parle souvent [III-411] des établissemens de S. Louis, ne cite que des établissemens particuliers de ce prince, & non pas cette compilation des établissemens. Défontaines [3] , qui écrivoit sous ce prince, nous parle des deux premieres fois que l’on exécuta ses établissemens sur l’ordre judiciaire, comme d’une chose reculée. Les établissemens de S. Louis étoient donc antérieures à la compilation dont je parle, qui, à la rigueur, & en adoptant les prologues erronés mis par quelques ignorans à la tête de cet ouvrage, n’auroit paru que la derniere année de la vie de S. Louis, ou même après la mort de ce prince.
[III-411]
CHAPITRE XXXVIII.
Continuation du même sujet.
Qu’est-ce donc que cette compilation que nous avons sous le nom d’établissemens de S. Louis ? Qu’est-ce que ce code obscur, confus & ambigu, où l’on mêle sans cesse la jurisprudence Françoise avec la loi Romaine ; où l’on parle comme un législateur, & [III-412] où l’on voit un juriconsulte ; où l’on trouve un corps entier de jurisprudence sur tous les cas, sur tous les points du droit civil ? Il faut se transporter dans ces temps-là.
S. Louis, voyant les abus de la jurisprudence de son temps, chercha à en dégoûter les peuples : il fit plusieurs réglemens pour les tribunaux de ses domaines, & pour ceux de ses barons ; & il eut un tel succès, que Beaumanoir [1] , qui écrivoit très-peu de temps après la mort de ce prince, nous dit que la maniere de juger établie par Saint Louis, étoit pratiquée dans un grand nombre de cours des seigneurs.
Ainsi ce prince remplit son objet, quoique ses réglemens pour les tribunaux des seigneurs n’eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume, mais comme un exemple que chacun pourroit suivre, & que chacun même auroit intérêt de suivre. Il ôta le mal, en faisant sentir le meilleur. Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux des seigneurs une maniere de procéder plus naturelle, plus raisonnable, plus conforme à la morale, à la [III-413] religion, à la tranquillité publique, à la sureté de la personne & des biens, on la prit, & on abandonna l’autre.
Inviter quand il ne faut pas contraindre, conduire quand il ne faut pas commander ; c’est l’habileté suprême. La raison a un empire naturel ; elle a même un empire tyrannique : on lui résiste, mais cette résistance est son triomphe ; encore un peu de temps, & l’on sera forcé de revenir à elle.
S. Louis, pour dégoûter de la jurisprudence Françoise, fit traduire les livres du droit Romain, afin qu’ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Défontaines, qui est le premier [2] auteur de pratique que nous ayons, fit un grand usage de ces lois Romaines : son ouvrage est en quelque façon un résultat de l’ancienne jurisprudence Françoise, des lois ou établissemens de S. Louis, & de la loi Romaine. Beaumanoir fit peu d’usage de la loi Romaine, mais il concilia l’ancienne jurisprudence Françoise avec les réglemens de S. Louis.
C’est dans l’esprit de ces deux [III-414] ouvrages, & sur-tout de celui de Défontaines, que quelque bailli, je crois, fit l’ouvrage de jurisprudence que nous appelons les établissemens. Il est dit, dans le titre de cet ouvrage, qu’il est fait selon l’usage de Paris & d’Orléans, & de cour de baronnie ; & dans le prologue, qu’il y est traité des usages de tout le royaume & d’Anjou, & de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orléans & Anjou, comme les ouvrages de Beaumanoir, & de Défontaines furent faits pour les comtés de Clermont & de Vermandois : & comme il paroît, par Beaumanoir, que plusieurs lois de Saint Louis avoient pénétré dans les cours de baronnie, le compilateur a eu quelque raison de dire que son ouvrage [3] regardoit aussi les cours de baronnie.
Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois & les établissemens de S. Louis. Cet ouvrage est très-précieux, [III-415] parce qu’il contient les anciennes coutumes d’Anjou, & les établissemens de S. Louis, tels qu’ils étoient alors pratiqués, & enfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne jurisprudence Françoise.
La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Défontaines & de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; & cela pouvoit être ainsi, parce qu’il étoit une compilation de coutumes écrites, & de lois.
Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence Françoise avec la loi Romaine, on rapprochoit des choses qui n’avoient jamais de rapport, & qui souvent étoient contradictoires.
Je sais bien que les tribunaux François des hommes ou des pairs, les jugemens sans appel à un autre tribunal, la maniere de prononcer par ces mots, je condamne [4] ou j’absous, avoient de la conformité avec les jugemens populaires des Romains. Mais on fit peu d’usage de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut [III-416] introduite depuis par les empereurs, qu’on employa par-tout dans cette compilation, pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence Françoise.
-
[↑] Chap. lxi, page 309.
-
[↑] Il dit lui-même dans son prologue : Nus luy enprit onques mais cette chose dont j’ay.
-
[↑] Il n’y a rien de si vague que le titre & le prologue. D’abord ce sont les usages de Paris & d’Orléans, & de cour de baronnie ; ensuite ce sont les usages de toutes les cours layes du royaume, & de la prévôté de France ; ensuite ce sont les usages de tout le royaume & d’Anjou, & de cour de baronnie.
-
[↑] Etablissemens, liv. II, chap. xv.
[III-416]
CHAPITRE XXXIX.
Continuation du même sujet.
Les formes judiciaires introduites par S. Louis cesserent d’être en usage. Ce prince avoit eu moins en vue la chose même, c’est-à-dire la meilleure maniere de juger, que la meilleure maniere de suppléer à l’ancienne pratique de juger. Le premier objet étoit de dégoûter de l’ancienne jurisprudence, & le second d’en former une nouvelle. Mais les inconvéniens de celle-ci ayant paru, on en vit bientôt succéder une autre.
Ainsi les lois de Saint-Louis changerent moins la jurisprudence Françoise, qu’elles ne donnerent des moyens pour la changer ; elles ouvrirent de nouveaux tribunaux, ou plutôt des voies pour y arriver ; & quand on put parvenir aisément à celui qui avoit une autorité générale, les jugemens, qui auparavant ne faisoient que les usages d’une [III-417] seigneurie particuliere, formerent une jurisprudence universelle. On étoit parvenu par la force des établissemens, à avoir des décisions générales, qui manquoient entiérement dans le royaume : quand le bâtiment fut construit, on laissa tomber l’échafaud.
Ainsi les lois que fit Saint Louis eurent des effets qu’on n’auroit pas dû attendre du chef-d’œuvre de la législation. Il faut quelquefois bien des siecles pour préparer les changemens ; les événemens mûrissent, & voilà les révolutions.
Le parlement jugea en dernier ressort de presque toutes les affaires du royaume. Auparavant il ne jugeoit que de celles qui étoient entre les ducs [1] , comtes, barons, évêques, abbés, ou entre le roi & ses vassaux [2] , plutôt dans le rapport qu’elles avoient avec l’ordre politique, qu’avec l’ordre civil. Dans la suite, on fut obligé de le rendre sédentaire, & de le tenir toujours assemblé ; & enfin, on en créa plusieurs, [III-418] pour qu’ils pussent suffire à toutes les affaires.
À peine le parlement fut-il un corps fixe, qu’on commença à compiler ses arrêts. Jean de Monluc, sous le regne de Philippe le bel, fit le recueil qu’on appelle aujourd’hui les registres Olim [3] .
-
[↑] Voyez Dutillet, sur la cour des pairs. Voyez aussi la Roche-Flavin, liv. I, ch. iii ; Budée & Paul-Emile.
-
[↑] Les autres affaires étoient décidées par les tribunaux ordinaires.
-
[↑] Voyez l’excellent ouvrage de M. le président Hénault, sur l’an 1313.
[III-418]
CHAPITRE XL.
Comment on prit les formes judiciaires des décrétales.
Mais d’où vient qu’en abandonnant les formes judiciaires établies, on prit celle du droit canonique, plutôt que celles du droit Romain ? C’est qu’on avoit toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui suivoient les formes du droit canonique, & que l’on ne connoissoit aucun tribunal qui suivît celles du droit Romain. De plus, les bornes de la juridiction ecclésiastique & de la séculiere étoient dans ces temps-là très-peu connues : il y avoit [1] des gens [2] qui plaidoient [III-419] indifféremment dans les deux cours ; il y avoit des matieres pour lesquelles on plaidoit de même. Il semble [3] que la juridiction laye ne se fût gardée, privativement à l’autre, que le jugement des matieres féodales, & des crimes commis par les laïques dans les cas qui ne choquoient par la religion [4] . Car si, pour raison des conventions & des contrats, il falloit aller à la justice laye, les parties pouvoient volontairement procéder devant les tribunaux clercs, qui, n’étant pas en droit d’obliger la justice laye à faire exécuter la sentence, contraignoient d’y obéir par voie d’excommunication [5] . Dans ces circonstances, lorsque, dans les tribunaux laïques, on voulut changer de pratique, on prit celle des clercs, parce qu’on la savoit ; & on ne prit pas celle du droit Romain, parce qu’on ne la savoit point ; car, en fait de pratique, on ne sait que ce que l’on pratique.
-
[↑] Beaum. ch. xi, pag. 58.
-
[↑] Les femmes veuves, les croisés, ceux qui tenoient les biens des églises pour raison de ces biens. Ibid.
-
[↑] Voyez tout le chap. xi. de Beaumanoir.
-
[↑] Les tribunaux clercs, sous prétexte du serment, s’en étoient même saisis, comme on le voit par le fameux concordat passé entre Philippe Auguste, les clercs & les barons, qui se trouve dans les ordonnances de Lauriere.
-
[↑] Beaumanoir, chap. xi, pag. 60.
[III-420]
CHAPITRE XLI.
Flux & reflux de la juridiction ecclésiastique & de la juridiction laye.
La puissance civile étant entre les mains d’une infinité de seigneurs, il avoit été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus d’étendue : mais comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridiction des seigneurs, & contribua par-là à donner des forces à la juridiction royale, la juridiction royale restreignit peu à peu la juridiction ecclésiastique, & celle-ci recula devant la premiere. Le parlement, qui avoit pris dans sa forme de procéder tout ce qu’il y avoit de bon & d’utile dans celle des tribunaux des clercs, ne vit bientôt plus que ses abus ; & la juridiction royale se fortifiant tous les jours, elle fut toujours plus en état de corriger ces mêmes abus. En effet, ils étoient intolérables ; & sans en faire l’énumération, je renverrai à Beaumanoir [1] , [III-421] à Boutillier, aux ordonnances de nos rois. Je ne parlerai que de ceux qui intéressoient plus directement la fortune publique. Nous connoissons ces abus par les arrêts qui les réformerent. L’épaisse ignorance les avoit introduits ; une espece de clarté parut, & ils ne furent plus. On peut juger, par le silence du clergé, qu’il alla lui-même au devant de la correction ; ce qui, vu la nature de l’esprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mouroit sans donner une partie de ses biens à l’église, ce qui s’appeloit mourir déconfés, étoit privé de la communion & de la sépulture. Si l’on mouroit sans faire de testament, il falloit que les parens obtinssent de l’évêque, qu’il nommât, concuremment avec eux, des arbitres, pour fixer ce que le défunt auroit dû donner, en cas qu’il eût fait un testament. On ne pouvoit pas coucher ensemble la premiere nuit des noces, ni même les deux suivantes, sans en avoir acheté la permission : c’étoit bien ces trois nuits-là qu’il falloit choisir ; car pour les autres on [III-422] n’auroit pas donné beaucoup d’argent. Le Parlement corrigea tout cela : on trouve dans le glossaire [2] du droit françois de Ragau, l’arrêt qu’il rendit [3] contre l’évêque d’Amiens.
Je reviens au commencement de mon chapitre. Lorsque dans un siecle ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de l’état chercher à augmenter leur autorité, & à prendre les uns sur les autres de certains avantages, on se tromperoit souvent si l’on regardoit leurs entreprises comme une marque certaine de leur corruption. Par un malheur attaché à la condition humaine, les grands hommes modérés sont rares ; & comme il est toujours plus aisé de suivre sa force que de l’arrêter, peut-être, dans la classe des gens supérieurs, est-il plus facile de trouver des gens extrêmement vertueux, que des hommes extrêmement sages.
L’ame goûte tant de délices à dominer les autres ames ; ceux même qui aiment le bien s’aiment si fort eux-mêmes, qu’il n’y a personne qui ne soit assez malheureux pour avoir encore à [III-423] se défier de ses bonnes intentions : & en vérité, nos actions tiennent à tant de choses, qu’il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire.
-
[↑] Voyez Boutillier, somme rurale, tit. 9, quelles personnes ne peuvent faire demande en cour laye ; & Beaum. chap. xi, page 56 ; & les réglemens de Philippe Auguste à ce sujet ; & l’établissement de Philippe Auguste fait entre les clercs, le roi & les barons.
-
[↑] Au mot exécuteur testamentaire.
-
[↑] Du 19 mars 1409.
[III-423]
CHAPITRE XLII.
Renaissance du droit Romain, & ce qui en résulta. Changemens dans les tribunaux.
Le digeste de Justinien ayant été retrouvé vers l’an 1137, le droit romain sembla prendre une seconde naissance. On établit des écoles en Italie où on l’enseignoit : on avoit déjà le code Justinien & les novelles. J’ai déjà dit que ce droit y pris une telle faveur, qu’il fit éclipser la loi des Lombards.
Des docteurs Italiens porterent le droit de Justinien en France, où l’on n’avoit connu [1] que le code Théodosien, parce que ce ne fut [2] qu’après [III-424] l’établissement des barbares dans les Gaules, que les lois de Justinien furent faites. Ce droit reçut quelques oppositions ; mais il se maintint, malgré les excommunications des papes qui protégeoient leurs canons [3] . Saint Louis chercha à l’accréditer, par les traductions qu’il fit faire des ouvrages de Justinien, que nous avons encore manuscrites dans nos bibliotheques ; & j’ai déjà dit qu’on en fit un grand usage dans les établissemens. Philippe le bel [4] fit enseigner les lois de Justinien, seulement comme raison écrite, dans les pays de la France qui se gouvernoient par les coutumes ; & elles furent adoptées comme loi, dans les pays où le droit Romain étoit la loi.
J’ai dit ci-dessus que la maniere de procéder par le combat judiciaire demandoit dans ceux qui jugeoient très-peu de suffisance ; on décidoit les affaires dans chaque lieu, selon l’usage de chaque lieu, & suivant quelques coutumes simples, qui se recevoient par tradition.
[III-425] Il y avoit du temps de Beaumanoir [5] , deux différentes manieres de rendre la justice : dans des lieux, on jugeoit par pairs [6] ; dans d’autres, on jugeoit par baillis : quand on suivoit la premiere forme, les pairs jugeoient selon l’usage de leur juridiction [7] ; dans la seconde, c’étoient des prud’hommes ou vieillards qui indiquoient au bailli le même usage. Tout ceci ne demandoit aucunes lettres, aucune capacité, aucune étude. Mais, lorsque le code obscur des établissemens & d’autres ouvrages de jurisprudence parurent ; lorsque le droit Romain fut traduit ; lorsqu’il commença à être enseigné dans les écoles ; lorsqu’un certain art de la procédure, & qu’un certain art de la jurisprudence commencerent à se former ; lorsqu’on vit naître des praticiens & des juriconsultes, les pairs & les prudh’ommes ne [III-426] furent plus en état de juger ; les pairs commencerent à se retirer des tribunaux du seigneur ; les seigneurs furent peu portés à les assembler : d’autant mieux que les jugemens, au lieu d’être une action éclatante, agréable à la noblesse, intéressante pour les gens de guerre, n’étoient plus qu’une pratique qu’ils ne savoient, ni ne vouloient savoir. La pratique de juger par pairs devint moins en usage [8] ; celle de juger par baillis s’étendit. Les baillis ne jugeoient pas [9] ; ils faisoient l’instruction, & prononçoient le jugement des [III-427] prud’hommes : mais les prud’hommes n’étant plus en état de juger, les baillis jugerent eux-mêmes.
Cela se fit d’autant plus aisément, qu’on avoit devant les yeux la pratique des juges d’église : le droit canonique & le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.
Ainsi se perdit l’usage constamment observé dans la monarchie, qu’un juge ne jugeroit jamais seul, comme on le voit par les lois saliques, les capitulaires, & par les premiers écrivains [10] de pratique de la troisieme race. L’abus contraire, qui n’a lieu que dans les justices locales, a été modéré, & en quelque façon corrigé par l’introduction en plusieurs lieux d’un lieutenant de juge, que celui-ci consulte, & qui représente les anciens prud’hommes ; par l’obligation où est le juge de prendre deux gradués, dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive ; & enfin il est devenu nul, par l’extrême facilité des appels.
-
[↑] On suivoit en Italie le code de Justinien : c’est pour cela que le pape Jean VIII, dans sa constitution donnée après le synode de Troyes, parle de ce code, non pas parce qu’il étoit connu en France, mais parce qu’il le connoissoit lui-même ; & sa constitution étoit générale.
-
[↑] Le code de cet empereur fut publié vers l’an 530.
-
[↑] Décrétales, liv. V, tit. de privilegiis¸capite super specula.
-
[↑] Par une chartre de l’an 1312, en faveur de l’université d’Orléans, rapportée par Dutillet.
-
[↑] Coutume de Beauvoisis, chap. i. de l’office des Baillis.
-
[↑] Dans la commune, les bourgeois étoient ,jugés par d’autres bourgeois, comme les hommes de fief se jugeoient entr’eux. Voyez la Thamassiere, chap. xix.
-
[↑] Aussi toutes les requêtes commençoient-elles par ces mots : « Sire juge, il est d’usage qu’en votre juridiction, &c. » comme il paroît par la formule rapportée dans Boutillier, somme rurale, livre I, titre 21.
-
[↑] Le changement fut insensible. On trouve encore les pairs employés du temps de Boutillier, qui vivoit en 1402, date de son testament, qui rapporte cette formule au liv. I, tit. 21. « Sire juge, en ma justice haute, moyenne & basse, que j’ai en tel lieu, cour, plaids, baillis, hommes féodaux & sergens ». Mais il n’y avoit plus que les matieres féodales qui se jugeassent pas pairs. Ibid. liv. I, tit. I, pag. 16.
-
[↑] Comme il paroît par la formule des lettres que le seigneur leur donnoît, rapportée par Boutillier, somme rurale, liv. I, tit. 14. Ce qui prouve encore par Beaumanoir, coutume de Beauvoisis, chap. i, des baillis. Ils ne faisoient que la procédure. « Le bailli est tenu en la présence des hommes à penre les paroles de chaux qui plaident, & doit demander as parties se ils veulent avoir droit selon les raisons que ils ont dites ; & se ils disent, Sire, oïl, le bailli doit contraindre les hommes que ils fassent le jugement ». Voyez aussi les établissemens de S. Louis, liv. I, chap.cv ; & liv. II, chap. xv : « Li juge, si ne doit pas faire le jugement ».
-
[↑] Beaumanoir, ch. lxvii, page 336 ; & ch. lxi, pag. 315 & 316 : les établissemens, liv. II, ch. xv.
[III-428]
CHAPITRE XLIII.
Continuation du même sujet.
Ainsi ce ne fut point une loi qui défendit aux seigneurs de tenir eux-mêmes leur cour ; ce ne fut point une loi qui abolit les fonctions que leurs pairs y avoient, il n’y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce ne fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu, & par la force de la chose. La connoissance du droit Romain, des arrêts des cours, des corps des coutumes nouvellement écrites, demandoit une étude, dont les nobles & le peuple sans lettres n’étoient point capables.
La seule ordonnance que nous ayons sur cette matiere [1] , est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans l’ordre des laïques. C’est mal-à-propos qu’on l’a regardée comme la loi de leur création ; mais elle ne dit que ce qu’elle dit. De plus, elle fixe ce qu’elle prescrit par les raisons qu’elle en donne : « C’est afin, est-il dit, que les baillis [III-429] puissent être punis de leurs prévarications [2] , qu’il faut qu’ils soient pris dans l’ordre des laïques ». On sait les privileges des ecclésiastiques dans ces temps-là.
Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissoient autrefois, & dont ils ne jouissent plus aujourd’hui, lui ayent été ôtés comme des usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus par négligence ; & d’autres ont été abandonnés, parce que divers changemens s’étant introduits dans le cours de plusieurs siecles, ils ne pouvoient subsister avec ces changemens.
-
[↑] Elle est de l’an 1287.
-
[↑] Ut si ibi delinquant, superiores sui possent animadversere in cosdem.
[III-429]
CHAPITRE XLIV.
De la preuve par témoins.
Les juges qui n’avoient d’autres regles que les usages, s’en enquéroient ordinairement par témoins, dans chaque question qui se présentoit.
Le combat judiciaire devenant moins en usage, on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit [III-430] n’est jamais qu’une preuve vocale ; cela ne faisoit qu’augmenter les frais de la procédure. On fit des réglemens qui rendirent la plupart de ces enquêtes [1] inutiles ; on établit des registres publics, dans lesquels la plupart des faits se trouvoient prouvés, la noblesse, l’âge, la légitimité, le mariage. L’écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela étoit bien raisonnable : il est plus aisé d’aller chercher dans les registres de baptême, si Pierre est fils de Paul, que d’aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand, dans un pays, il y a un très-grand nombre d’usages, il est plus aisé de les écrire tous dans un code, que d’obliger les particuliers à prouver chaque usage. Enfin, on fit la fameuse ordonnance qui défendit de recevoir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent livres, à moins qu’il n’y eût un commencement de preuve par écrit.
-
[↑] Voyez comment on prouvoit l’âge & la parenté, établissemens, liv. I, ch. lxxi & lxxii.
[III-431]
CHAPITRE XLV.
Des coutumes de France.
La France étoit régie, comme j’ai dit, par des coutumes non écrites, & les usages particuliers de chaque seigneurie formoient le droit civil. Chaque seigneurie avoit son droit civil, comme le dit Beaumanoir [1] ; & un droit si particulier, que cet auteur, qu’on doit regarder comme la lumiere de ce temps-là, & une grande lumiere, dit qu’il ne croit pas que dans tout le royaume il y eût deux seigneuries qui fussent gouvernées de tout point par la même loi.
Cette prodigieuse diversité avoit une premiere origine, & elle en avoit une seconde. Pour la premiere, on peut se souvenir de ce que j’ai dit ci-dessus [2] au chapitre des coutumes locales ; & quant à la seconde, on la trouve dans les divers événemens des combats judiciaires ; des cas continuellement fortuits devant introduire naturellement de nouveaux usages.
[III-432]
Ces coutumes-là étoient conservées dans la mémoire des vieillards : mais il se forma peu à peu des lois ou des coutumes écrites.
1°. Dans le commencement [3] de la troisieme race, les rois donnerent des chartres particulieres, & en donnerent même de générales, de la maniere dont je l’ai expliqué ci-dessus : tels sont les établissemens de Philippe Auguste, & ceux que fit Saint Louis. De même, les grands vassaux, de concert avec les seigneurs qui tenoient d’eux, donnerent, dans les assises de leurs duchés ou comtés, de certaines chartres ou établissemens, selon les circonstances : telles furent l’assise de Geofroi, comte de Bretagne, sur le partage des nobles, les coutumes de Normandie, accordées par le duc Raoul ; les coutumes de Champagne, données par le roi Thibault ; les lois de Simon, comte de Montfort ; & autres. Cela produisit quelques lois écrites, & même plus générales que celles que l’on avoit.
2°. Dans le commencement de la troisieme race, presque tout le bas [III-433] peuple étoit serf ; plusieurs raisons obligerent les rois & les seigneurs de les affranchir.
Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, leur donnerent des biens ; il fallut leur donner des lois civiles pour régler la disposition de ces biens. Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, se priverent de leurs biens ; il fallut donc régler les droits que les seigneurs se réservoient pour l’équivalent de leur bien. L’une & l’autre de ces choses furent réglées par les chartres d’affranchissement, ces chartres formerent une partie de nos coutumes, & cette partie se trouva rédigée par écrit.
3°. Sous le regne de S. Louis & les suivans, des praticiens habiles, tels que Défontaines, Beaumanoir & autres, rédigerent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plutôt de donner une pratique judiciaire, que les usages de leurs temps sur la disposition des biens. Mais tout s’y trouve ; & quoique ces auteurs particuliers n’eussent d’autorité que par la vérité & la publicité des choses qu’ils disoient, on ne peut douter qu’elles n’ayent beaucoup servi à la renaissance de notre droit [III-434] François. Tel étoit, dans ces temps-là, notre droit coutumier écrit.
Voici la grande époque. Charles VII & ses successeurs firent rédiger par écrit dans tout le royaume les diverses coutumes locales, & prescrivirent des formalités qui devoient être observées à leur rédaction. Or, comme cette rédaction se fit par provinces ; & que, de chaque seigneurie, on venoit déposer, dans l’assemblée générale de la province, les usages écrits ou non écrits de chaque lieu ; on chercha à rendre les coutumes plus générales, autant que cela se put faire sans blesser les intérêts des particuliers qui furent réservés [4] . Ainsi nos coutumes prirent trois caracteres ; elles furent écrites, elles furent plus générales, elles reçurent le sceau de l’autorité royale.
Plusieurs de ces coutumes ayant été de nouveau rédigées, on y fit plusieurs changemens, soit en ôtant tout ce qui ne pouvoit compatir avec la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées de cette jurisprudence.
[III-435]
Quoique le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espece d’opposition avec le droit Romain, de sorte que ces deux droits divisent les territoires ; il est pourtant vrai que plusieurs dispositions du droit Romain sont entrées dans nos coutumes, sur-tout lorsqu’on en fit de nouvelles rédactions, dans des temps qui ne sont pas fort éloignés des nôtres, où ce droit étoit l’objet des connoissances de tous ceux qui se destinoient aux emplois civils ; dans des temps où l’on ne faisoit pas gloire d’ignorer ce que l’on doit savoir, & de savoir ce que l’on doit ignorer ; où la facilité de l’esprit servoit plus à apprendre sa profession, qu’à la faire ; & où les amusemens continuels n’étoient pas même l’attribut des femmes.
Il auroit fallu que je m’étendisse davantage à la fin de ce livre ; & qu’entrant dans de plus grands détails, j’eusse suivi tous les changemens insensibles, qui, depuis l’ouverture des appels, ont formé le grand corps de notre jurisprudence Françoise. Mais j’aurois mis un grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je suis comme cet [III-436] antiquaire [5] qui partit de son pays, arriva en Égypte, jeta un coup d’œil sur les pyramides, & s’en retourna.
-
[↑] Prologue sur la coutume de Beauvoisis.
-
[↑] Chap. xii.
-
[↑] Voyez le recueil des ordonnances de Lautiere.
-
[↑] Cela se fit ainsi lors de la rédaction des coutumes de Berry & de Paris. Voyez la Thaumassiere, chap. iii.
-
[↑] Dans le Spectateur Anglois.
[III-437]
LIVRE XXIX.
De la maniere de composer les Lois.↩
CHAPITRE PREMIER.
De l’esprit du Législateur.
Je le dis, & il me semble que je n’ai fait cet ouvrage que pour le prouver : L’esprit de modération doit être celui du législateur ; le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites. En voici un exemple.
Les formalités de la justice sont nécessaires à la liberté. Mais le nombre en pourroit être si grand, qu’il choqueroit le but des lois mêmes qui les auroient établies : les affaires n’auroient point de fin ; la proriété des biens resteroit incertaine ; on donneroit à l’une des parties le bien de l’autre sans examen, ou on les ruineroit toutes les deux à force d’examiner.
[III-438]
Les citoyens perdroient leur liberté & leur sureté ; les accusateurs n’auroient plus les moyens de convaincre, ni les accusés le moyen de se justifier.
[III-438]
CHAPITRE II.
Continuation du même sujet.
Cecilius, dans Aulugelle [1] , discourant sur la loi des douze tables, qui permettoit au créancier de couper en morceaux le débiteur insolvable, la justifie par son atrocité même qui empêchoit [2] qu’on n’empruntât au-delà de ses facultés. Les lois les plus cruelles seront donc les meilleures ? Le bien sera l’excès ? & tous les rapports des choses seront détruits ?
-
[↑] Livre XX, chap. i.
-
[↑] Cecilius dit qu’il n’a jamais vu ni lu que cette peine eût été infligée : mais il y a apparence qu’elle n’a jamais été établie. L’opinion de quelques jurisconsultes, que la loi des douze tables ne parloit que de la division du prix du débiteur vendu, est très-vraisemblable.
[III-439]
CHAPITRE III.
Que les lois qui paroissent s’éloigner des vues du Législateur, y sont souvent conformes.
La loi de Solon, qui déclaroit infames tous ceux qui, dans une sédition, ne prendroient aucun parti, a paru bien extraordinaire : mais il faut faire attention aux circonstances dans lesquelles la Grece se trouvoit pour lors. Elle étoit partagée en de très-petits états : il étoit à craindre, que dans une république travaillée par des dissentions civiles, les gens les plus prudens ne se missent à couvert, & que par-là les choses ne fussent portées à l’extrémité.
Dans les séditions qui arrivoient dans ces petits états, le gros de la cité entroit dans la querelle, ou la faisoit. Dans nos grandes monarchies, les partis sont formés par peu de gens, & le peuple voudroit vivre dans l’inaction. Dans ce cas, il est naturel de rappeller les séditieux au gros des citoyens, non pas le gros des citoyens aux séditieux : dans l’autre, il faut faire rentrer le petit nombre de [III-440] gens sages & tranquilles parmi les séditieux : c’est ainsi que la fermentation d’une liqueur peut être arrêtée par une seule goutte d’une autre.
[III-440]
CHAPITRE IV.
Des lois qui choquent les vues du Législateur.
Il y a des lois que le législateur a si peu connues, qu’elles sont contraires au but même qu’il s’est proposé. Ceux qui ont établi chez les François, que, lorsqu’un des deux prétendans à un bénéfice, meurt, le bénéfice reste à celui qui survit, ont cherché sans doute à éteindre les affaires ; mais il en résulte un effet contraire ; on voit les ecclésiastiques s’attaquer & se battre comme des dogues anglois jusqu’à la mort.
[III-441]
CHAPITRE V.
Continuation du même sujet.
La loi dont je vais parler se trouve dans ce serment, qui nous a été conservé par Eschines [1] . « Je jure que je ne détruirai jamais une ville des Amphictions, & que je détournerai point ses eaux courantes : si quelque peuple ose faire quelque chose de pareil, je lui déclarerai la guerre, & je détruirai ses villes. » Le dernier article de cette loi, qui paroît confirmer le premier, lui est réellement contraire. Amphiction veut qu’on ne détruise jamais les villes Grecques, & sa loi ouvre la porte à la destruction de ces villes. Pour établir un bon droit des gens parmi les Grecs, il falloit les accoutumer à penser que c’étoit une chose atroce de détruire une ville Grecque ; il ne devoit donc pas détruire même les destructeurs. La loi d’Amphiction étoit juste, mais elle n’étoit pas prudente ; cela se prouve par l’abus même que l’on en fit. Philippe ne se fit-il pas donner le pouvoir de détruire [III-442] les villes, sous prétexte qu’elles avoient violé les lois des Grecs ? Amphiction auroit pu infliger d’autres peines : ordonner, par exemple, qu’un certain nombre de magistrats de la ville destructrice, ou de chefs de l’armée violatrice, seroient punis de mort ; que le peuple destructeur cesseroit pour un temps de jouir des privileges des Grecs ; qu’il payeroit une amende jusqu’au rétablissement de la ville. La loi devoit sur-tout porter sur la réparation du dommage.
-
[↑] De falsâ legatione.
[III-442]
CHAPITRE VI.
Que les lois qui paroissent les mêmes, n’ont pas toujours le même effet.
César défendit [1] de garder chez soi plus de soixante sesterces. Cette loi fut regardée à Rome comme très-propre à concilier les débiteurs avec les créanciers ; parce qu’en obligeant les riches à prêter aux pauvres, elle mettoit ceux-ci en état de satisfaire les riches. Une même loi faite en France, du temps du systême, fut très-funeste : c’est que la circonstance dans laquelle on la fit, [III-443] étoit affreuse. Après avoir ôté tous les moyens de placer son argent, on ôta même la ressource de le garder chez soi ; ce qui étoit égal à un enlevement fait par violence. César fit la loi pour que l’argent circulât parmi le peuple ; le ministre de France fit la sienne pour que l’argent fût mis dans une seule main. Le premier donna pour de l’argent des fonds de terre, ou des hypotheques sur des particuliers ; le second proposa pour de l’argent des effets qui n’avoient point de valeur, & qui n’en pouvoient avoir par leur nature, par la raison que sa loi obligeoit de les prendre.
-
[↑] Dion, liv. XLI.
[III-443]
CHAPITRE VII.
Continuation du même sujet. Nécessité de bien composer les lois.
La loi de l’ostracisme fut établie à Athenes, à Argos [1] & à Syracuse. À Syracuse, elle fit mille maux, parce qu’elle fut faite sans prudence. Les principaux citoyens se bannissoient les uns les autres, en se mettant une feuille [III-444] de figuier à la main [2] ; de sorte que ceux qui avoient quelque mérite, quitterent les affaires. A Athenes, où le législateur avoit senti l’extension & les bornes qu’il devoit donner à sa loi, l’ostracisme fut une chose admirable : on n’y soumettoit jamais qu’une seule personne ; il falloit un si grand nombre de suffrages, qu’il étoit difficile qu’on exilât quelqu’un dont l’absence ne fût pas nécessaire.
On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans : en effet, dès que l’ostracisme ne devoit s’exercer que contre un grand personnage, qui donneroit de la crainte à ses concitoyens, ce ne devoit pas être une affaire de tous les jours.
[III-444]
CHAPITRE VIII.
Que les lois qui paroissent les mêmes, n’ont pas toujours eu le même motif.
On reçoit en France la plupart des lois des Romains sur les substitutions ; mais les substitutions y ont tout un autre motif que chez les Romains. Chez ceux-ci, l’hérédité étoit jointe à de [III-445] certains sacrifices [1] qui devoient être faits par l’héritier, & qui étoient réglés par le droit des pontifes : cela fit qu’ils tinrent à déshonneur de mourir sans héritier, qu’ils prirent pour héritiers leurs esclaves, & qu’ils inventerent les substitutions. La substitution vulgaire, qui fut la premiere inventée, & qui n’avoit lieu que dans le cas où l’héritier institué n’accepteroit pas l’hérédité, en est une grande preuve ; elle n’avoit point pour objet de perpétuer l’héritage dans une famille du même nom, mais de trouver quelqu’un qui acceptât l’héritage.
-
[↑] Lorsque l’hérédité étoit trop chargée, on éludoit le droit des pontifes par de certaines ventes, d’où vint le mot sine sacris hæreditas.
[III-445]
CHAPITRE IX.
Que les lois Grecques & Romaines ont puni l’homicide de soi-même, sans avoir le même motif.
Un homme, dit Platon [1] , qui a tué celui qui lui est étroitement lié, c’est-à-dire lui-même, non par ordre du magistrat, ni pour éviter l’ignominie, [III-446] mais par foiblesse, sera puni. La loi Romaine punissoit cette action, lorsqu’elle n’avoit pas été faite par foiblesse d’ame, par ennui de la vie, par impuissance de souffrir la douleur, mais par le désespoir de quelque crime. La loi Romaine absolvoit dans le cas où la Grecque condamnoit, & condamnoit dans le cas où l’autre absolvoit.
La loi de Platon étoit formée sur les institutions Lacédémoniennes, où les ordres du magistrat étoient totalement absolus, où l’ignominie étoit le plus grand des malheurs, & la foiblesse le plus grand des crimes. La loi Romaine abandonnoit toutes ces belles idées ; elle n’étoit qu’une loi fiscale.
Du temps de la république, il n’y avoit point de loi à Rome qui punît ceux qui se tuoient eux-mêmes : cette action, chez les historiens, est toujours prise en bonne part, & l’on n’y voit jamais de punition contre ceux qui l’ont faite.
Du temps des premiers empereurs, les grandes familles de Rome furent sans cesse exterminées par des jugemens. La coutume s’introduisit de prévenir la condamnation par une mort [III-447] volontaire. On y trouvoit un grand avantage. On obtenoit l’honneur de la sépulture [2] , & les testamens étoient exécutés ; cela venoit de ce qu’il n’y avoit point de loi civile à Rome contre ceux qui se tuoient eux-mêmes. Mais lorsque les empereurs devinrent aussi avares qu’ils avoient été cruels, ils ne laisserent plus à ceux dont ils vouloient se défaire le moyen de conserver leurs biens, & ils déclarerent que ce seroit un crime de s’ôter la vie par les remords d’un autre crime.
Ce que je dis du motif des empereurs est si vrai, qu’ils consentirent que les biens de ceux [3] qui se seroient tués eux-mêmes ne fussent pas confisqués, lorsque le crime pour lequel ils s’étoient tués n’assujettissoit point à la confiscation.
-
[↑] Livre IX ; des lois.
-
[↑] Eorum qui de se statuebant, humabantur corpoea, manebant testamenta, pretium festinandi. Tacite.
-
[↑] Rescrit de l’empereur Pie¸dans la loi III, §. I & 2, ss. de bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt.
[III-448]
CHAPITRE X.
Que les lois qui paroissent contraires, dérivent quelquefois du même esprit.
On va aujourd’hui dans la maison d’un homme pour l’appeler en jugement ; cela ne pouvoit se faire chez les Romains [1] .
L’appel en jugement étoit une action violente [2] , & comme une espece de contrainte par corps [3] ; & on ne pouvoit pas plus aller dans la maison d’un homme pour l’appeller en jugement, qu’on ne peut aujourd’hui aller contraindre par corps dans sa maison un homme qui n’est condamné que pour des dettes civiles.
Les lois Romaines [4] & les nôtres admettent également ce principe, que chaque citoyen a sa maison pour asyle, & qu’il n’y doit recevoir aucune violence.
-
[↑] Leg. XVIII, ff. de in jus vocando.
-
[↑] Voyez la loi des douze tables.
-
[↑] Rapit in jus, Horace, satire 9. C’est pour cela qu’on ne pouvoit appeller en jugement ceux à qui on devoit un certain respect.
-
[↑] Voyez la loi XVIII, ff. de in jus vocando.
[III-449]
CHAPITRE XI.
De quelle maniere deux lois diverses peuvent être comparées.
En France, la peine contre les faux témoins est capitale ; en Angleterre, elle ne l’est point. Pour juger laquelle de ces deux lois est la meilleure, il faut ajouter : En France, la question contre les criminels est pratiquée, en Angleterre elle ne l’est point ; & dire encore : En France, l’accusé ne produit point ses témoins, & il est très-rare qu’on y admette ce que l’on appelle les faits justificatifs : en Angleterre, l’on reçoit les témoignages de part & d’autre. Les trois lois Françoises forment un systême très-lié & très-suivi ; les trois lois Angloises en forment un qui ne l’est pas moins. La loi d’Angleterre, qui ne connoît point la question contre les criminels, n’a que peu d’espérance de tirer de l’accusé la confession de son crime ; elle appelle donc de tous côtés les témoignages étrangers, & elle n’ose les décourager par la crainte d’une peine capitale. La loi Françoise, qui a une [III-450] ressource de plus, ne craint pas tant d’intimider les témoins ; au contraire, la raison demande qu’elle les intimide : elle n’écoute que les témoins d’une part [1] ; ce sont ceux que produit la partie publique ; & le destin de l’accusé dépend de leur seul témoignage. Mais en Angleterre on reçoit les témoins des deux parts ; & l’affaire est, pour ainsi dire, discutée entr’eux ; le faux témoignage y peut donc être moins dangereux ; l’accusé y a une ressource contre le faux témoignage, au lieu de la loi Françoise n’en donne point. Ainsi, pour juger lesquelles de ces deux lois sont plus conformes à la raison, il ne faut pas comparer chacune de ces lois à chacune ; il faut les prendre toutes ensemble, & les comparer toutes ensemble.
-
[↑] Par l’ancienne jurisprudence Françoise, les témoins étoient ouis des deux parts. Aussi voit-on, dans les établissemens de Saint Louis, liv. I, chap. vii, que la peine contre les faux témoins en justice étoit pécuniaire.
[III-451]
CHAPITRE XII.
Que les lois qui paroissent les mêmes, sont réellement quelquefois différentes.
Les lois Grecques & Romaines punissoient le receleur du vol comme le voleur [1] : la loi Françoise fait de même. Celles-là étoient raisonnables, celle-ci ne l’est pas. Chez les Grecs & chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il falloit punir le receleur de la même peine : car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage, doit le réparer. Mais parmi nous, la peine du vol étant capitale, on n’a pas su, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut en mille occasions le recevoir innocemment ; celui qui vole est toujours coupable : l’un empêche la conviction d’un crime déjà commis, l’autre commet ce crime : tout est passif dans l’un, il y a une action dans l’autre : il faut que le voleur surmonte plus d’obstacles, & [III-452] que son ame se roidisse plus long-temps contre les lois.
Les Jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le receleur comme plus odieux que le voleur [2] ; car sans eux, disent-ils, le vol ne pourroit être caché long-temps. Cela encore un fois pouvoit être bon, quand la peine étoit pécuniaire ; il s’agissoit d’un dommage, & le receleur étoit ordinairement plus en état de le réparer : mais la peine devenue capitale, il auroit fallu se régler sur d’autres principes.
[III-452]
CHAPITRE XIII.
Qu’il ne faut point séparer les lois de l’objet pour lequel elles sont faites. Des lois Romaines sur le vol.
Lorsque le voleur étoit surpris avec la chose volée, avant qu’il l’eût portée dans le lieu où il avoit résolu de la cacher, cela étoit appellé chez les Romains un vol manifeste ; quand le voleur n’étoit découvert qu’après, c’étoit un vol non manifeste.
[III-453]
La loi des douze tables ordonnoit que le voleur manifeste fût battu de verges, & réduit en servitude, s’il étoit pubere ; ou seulement battu de verges, s’il étoit impubere : elle ne condamnoit le voleur non manifeste qu’au payement du double de la chose volée.
Lorsque la loi Porcia eut aboli l’usage de battre de verges les citoyens, & de les réduire en servitude, le voleur manifeste fut condamné au quadruple [1] , & on continua à punir du double le voleur non manifeste.
Il paroît bizarre que ces lois missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, & dans la peine qu’elles infligeoient : en effet, que le voleur fût surpris avant, ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination ; c’étoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime. Je ne saurois douter que toute la théorie des lois Romaines sur le vol ne fût tirée des institutions Lacédémoniennes. Lycurgue, dans la vue de donner à ses citoyens de l’adresse, de la ruse & de l’activité, voulut qu’on exerçât les [III-454] enfans au larcin, & qu’on fouettât rudement ceux qui s’y laisseroient surprendre : cela établit chez les Grecs, & ensuite chez les Romains une grande différence entre le vol manifeste & le vol non manifeste [2] .
Chez les Romains, l’esclave qui avoit volé, étoit précipité de la roche Tarpéienne. Là, il n’étoit point question des institutions Lacédémoniennes ; les lois de Lycurgue sur le vol n’avoient point été faites pour les esclaves ; c’étoit les suivre que de s’en écarter en ce point.
À Rome, lorsqu’un impubere avoit été surpris dans le vol, le préteur le faisoit battre de verges à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacédémoniens avoient tiré ces usages des Crétois ; & Platon [3] , qui veut prouver que les institutions des Crétois étoient faites pour la guerre, cite celle-ci : « La faculté de supporter la douleur dans les combats particuliers, & dans les larcins qui obligent de se cacher.
[III-455]
Comme les lois civiles dépendent des lois politiques, parce que c’est toujours pour une société qu’elles sont faites, il seroit bon que, quand on veut porter une loi civile d’une nation chez une autre, on examinât auparavant si elles ont toutes les deux les mêmes institutions & le même droit politique.
Ainsi, lorsque les lois sur le vol passerent des Crétois aux Lacédémoniens, comme elles y passerent avec le gouvernement & la constitution même, ces lois furent aussi sensées chez un de ces peuples qu’elles l’étoient chez l’autre. Mais lorsque de Lacédémone elles furent portées à Rome, comme elles n’y trouverent pas la même constitution, elles y furent toujours étrangeres, & n’eurent aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains.
-
[↑] Voyez ce que dit Favorinus sur A1ulugelle, liv. XX, chap. i.
-
[↑] Conférez ce que dit Plutarque¸vie de Lycurgue, avec les lois du digeste, au titre de furtis ; & les institutes, liv. IV, tit. I, §. I, 2 & 3.
-
[↑] Des lois, liv. I.
[III-456]
CHAPITRE XIV.
Qu’il ne faut point séparer les lois des circonstances dans lesquelles elles ont été faites.
Une loi d’Athenes vouloit que, lorsque la ville étoit assiégée, on fît mourir tous les gens inutiles [1] . C’étoit une abominable loi politique, qui étoit une suite d’un abominable droit des gens. Chez les Grecs, les habitans d’une ville prise perdoient la liberté civile, & étoient vendus comme esclaves. La prise d’une ville emportoit son entiere destruction ; & c’est l’origine non-seulement de ces défenses opiniâtres & de ces actions dénaturées, mais encore de ces lois atroces que l’on fit quelquefois.
Les lois Romaines [2] vouloient que les médecins pussent être punis pour leur négligence ou pour leur impéritie. Dans ces cas, elles condamnoient à la déportation le médecin d’une condition [III-457] un peu relevée, & à la mort celui qui étoit d’une condition plus basse. Par nos lois, il en est autrement. Les lois de Rome n’avoient pas été faites dans les mêmes circonstances que les nôtres : à Rome, s’ingéroit de la médecine qui vouloit ; mais parmi nous les médecins sont obligés de faire des études, & de prendre certains grades ; ils sont donc censés connoître leur art.
-
[↑] Inutilis ætas occidatur, Syrian in Hermog.
-
[↑] La loi Cornelia, de sicariis ; institut. liv. IV. tit. 3, de lege Aquiliâ, §. 7.
[III-457]
CHAPITRE XV.
Qu’il est bon quelquefois qu’une loi se corrige elle-même.
La loi des douze tables [1] permettoit de tuer le voleur de nuit, aussi bien que le voleur de jour, qui, étant poursuivi, se mettoit en défense ; mais elle vouloit que celui qui tuoit le voleur [2] , criât & appellât les citoyens ; & c’est une chose que les lois qui permettent de se faire justice soi-même, doivent toujours exiger. C’est le cri de l’innocence, qui, dans le moment de l’action, appelle des témoins, appelle [III-458] des juges. Il faut que le peuple prenne connoissance de l’action, & qu’il en prenne connoissance dans le moment qu’elle a été faite ; dans un temps où tout parle, l’air, le visage, les passions, le silence, & où chaque parole condamne ou justifie. Une loi qui peut devenir si contraire à la sureté & à la liberté des citoyens, doit être exécutée dans la présence des citoyens.
-
[↑] Voyez la loi IV, ss. ad legem Aquiliam.
-
[↑] Ibid. Voyez le décret Tassillon, ajouté à la loi des Bavarois, de popularibus leg. art. 4.
[III-458]
CHAPITRE XVI.
Choses à observer dans la composition des lois.
Ceux qui ont un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation ou à une autre, doivent faire de certaines attentions sur la maniere de les former.
Le style en doit être concis. Les lois des douze tables sont un modele de précision : les enfans les apprenoient par cœur [1] . Les novelles de Justinien sont si diffuses, qu’il fallut les abréger [2] .
[III-459]
Le style des lois doit être simple ; l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réflécie. Il n’y a point de majesté dans les lois du bas empire ; on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des lois est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation.
Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. Le cardinal [3] de Richelieu convenoit que l’on pouvoit accuser un ministre devant le roi ; mais il vouloit que l’on fût puni si les choses qu’on prouvoit n’étoient pas considérables : ce qui devoit empêcher tout le monde de dire quelque vérité que ce fût contre lui, puisqu’une chose considérable est entiérement relative, & que ce qui est considérable pour quelqu’un ne l’est pas pour un autre.
La loi d’Honorius punissoit de mort celui qui achetoit comme serf un affranchi, ou qui auroit voulu l’inquiéter [4] . Il ne falloit point se servir d’une expression si vague : l’inquiétude que l’on cause à [III-460] un homme dépend entiérement du degré de sa sensibilité.
Lorsque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu’on le peut, éviter de la faire à prix d’argent. Mille causes changent la valeur de la monnoie ; & avec la même dénomination, on n’a plus la même chose. On fait l’histoire de cet impertinent [5] de Rome, qui donnoit des soufflets à tous ceux qu’il rencontroit, & leur faisoit présenter les vingt-cinq sous de la loi des douze tables.
Lorsque, dans une loi, l’on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l’ordonnance criminelle [6] de Louis XIV, après qu’on a fait l’énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « Et ceux dont de tous temps les juges royaux ont jugé ; » ce qui fait rentrer dans l’arbitraire dont on venoit de sortir.
Charles VII. [7] dit qu’il apprend que des parties font appel, trois, quatre & [III-461] six mois après le jugement, contre la coutume du royaume en pays coutumier : il ordonne qu’on appellera incontinent, à moins qu’il n’y ait fraude ou dol du procureur [8] , ou qu’il n’y ait grande & évidente cause de relever l’appellant. La fin de cette loi détruit le commencement ; & elle le détruisit si bien, que dans la suite on a appellé pendant trente ans [9] .
La loi des Lombards [10] ne veut pas qu’une femme qui a pris un habit de religieuse, quoiqu’elle ne soit pas consacrée, puisse se marier : « car, dit-elle, si un époux qui a engagé à lui une femme seulement par un anneau, ne peut pas sans crime en épouser une autre, à plus forte raison l’épouse de Dieu ou de la sainte Vierge… ». Je dis que, dans les lois, il faut raisonner de la réalité à la réalité ; & non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité.
Une loi de Constantin [11] veut que [III-462] le témoignage seul de l’évêque suffise, sans ouir d’autres témoins. Ce prince prenoit un chemin bien court ; il jugeoit des affaires par les personnes, & des personnes par les dignités.
Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement : elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un pere de famille.
Lorsque dans un loi les exceptions, limitations, modifications, ne sont point nécessaires, il vaut beaucoup mieux n’en point mettre ; de pareils détails jettent dans de nouveaux détails.
Il ne faut point faire de changement dans une loi, sans une raison suffisante. Justinien ordonna qu’un mari pourroit être répudié, sans que la femme perdît sa dot, si pendant deux ans il n’avoit pu consommer le mariage [12] . Il changea sa loi, & donna trois ans au pauvre malheureux [13] . Mais, dans un cas pareil, deux ans en valent trois, & trois n’en valent pas plus que deux.
Lorsqu’on fait tant que de rendre [III-463] raison d’une loi, il faut que cette raison soit digne d’elle. Une loi [14] Romaine décide qu’un aveugle ne peut pas plaider, parce qu’il ne voit par les ornemens de la magistrature. Il faut l’avoir fait exprès, pour donner une si mauvaise raison, quand il s’en présentoit tant de bonnes.
Le jurisconsulte Paul [15] dit que l’enfant naît parfait au septieme mois, & que la raison des nombres de Pythagore semble le prouver. Il est singulier qu’on juge ces choses sur la raison des nombres de Pythagore.
Quelques jurisconsultes François ont dit que, lorsque le roi acquéroit quelque pays, les églises y devenoient sujettes au droit de régale, parce que la couronne du roi est ronde. Je ne discuterai point ici les droits du roi, & si dans ce cas la raison de la loi civile ou ecclésiastique doit céder à la raison de la loi politique : mais je dirai que des droits si respectables doivent être défendus par des maximes graces. Qui a jamais vu fonder sur la figure d’un signe d’une dignité, les droits réels de cette dignité ? [III-464]
Davila [16] dit que Charles IX fut déclaré majeur au Parlement de Rouen à quatorze ans commencés, parce que les lois veulent qu’on compte le temps du moment au moment, lorsqu’il s’agit de la restitution & de l’administration des biens du pupile : au lieu qu’elle regarde l’année commencée comme une années complette, lorsqu’il s’agit d’acquérir des honneurs. Je n’ai garde de censurer une disposition qui ne paroît pas avoir eu jusqu’ici d’inconvénient ; je dirai seulement que la raison alléguée par le chancelier de l’Hôpital n’étoit pas la vraie : il s’en faut bien que le gouvernement des peuples ne soit qu’un honneur.
En fait de présomption, celle de la loi vaut mieux que celle de l’homme. La loi Françoise regarde [17] comme frauduleux tous les actes faits par un marchand dans les dix jours qui ont précédé sa banqueroute : c’est la présomption de la loi. La loi Romaine infligeoit des peines au mari qui gardoit sa femme après l’adultere, à moins qu’il n’y fût déterminé par la crainte de l’événement [III-465] d’un procès, ou par la négligence de sa propre honte ; & c’est la présomption de l’homme. Il falloit que le juge présumât les motifs de la conduite du mari, & qu’il se déterminât sur une maniere de penser très-obscure. Lorsque le juge présume, les jugemens deviennent arbitraires ; lorsque la loi présume, elle donne au juge une regle fixe.
La loi de Platon [18] , comme j’ai dit, vouloit qu’on punît celui qui se tueroit, non pas pour éviter l’ignominie, mais par foiblesse. Cette loi étoit vicieuse, en ce que, dans le seul cas où l’on ne pouvoit pas tirer du criminel l’aveu du motif qui l’avoit fait agir, elle vouloit que le juge se déterminât sur ces motifs.
Comme les lois inutiles affoiblissent les lois nécessaires, celles qu’on peut éluder affoiblissent la législation. Une loi doit avoir son effet, & il ne faut pas permettre d’y déroger par une convention particuliere.
La loi Falcidie ordonnoit, chez les Romains, que l’héritier eût toujours la quatrieme partie de l’hérédité : une autre loi [19] permit au testateur de [III-466] défendre à l’héritier de retenir cette quatrieme partie : c’est se jouer des lois. La loi Falcidie devenoit inutile : car, si le testateur vouloit favoriser son héritier ; celui-ci n’avoit pas besoin de la loi Falcidie ; & s’il ne vouloit pas le favoriser, il lui défendoit de se servir de la loi Falcidie.
Il faut prendre garde que les lois soient conçues de maniere qu’elles ne choquent point la nature des choses. Dans la proscription du prince d’Orange, Philippe II promet à celui qui le tuera de donner à lui ou à ses héritiers, vingt-cinq mille écus & la noblesse ; & cela en parole de roi, & comme serviteur de Dieu. La noblesse promise pour une telle action ! une telle action ordonnée en qualité de serviteur de Dieu ! Tout cela renverse également les idées de l’honneur, celles de la morale, & celles de la religion.
Il est rare qu’il faille défendre une chose qui n’est pas mauvaise, sous prétexte de quelque perfection qu’on imagine.
Il faut dans les lois une certaine candeur. Faites pour punir la méchanceté des hommes, elles doivent avoir [III-467] elles-mêmes la plus grande innocence. On peut voir dans la loi des Wisigoths [20] cette requête ridicule, par laquelle on fit obliger les Juifs à manger toutes les choses apprêtées avec du cochon, pourvu qu’ils ne mangeassent point du cochon même. C’étoit une grande cruauté : on les soumettoit à une loi contraire à la leur ; on ne leur laissoit garder de la leur que ce qui pouvoit être un signe pour les reconnoître.
-
[↑] Ut carmen necessarium. Cicéron, de legibus, liv. II.
-
[↑] C’est l’ouvrage d’Irnerius.
-
[↑] Testament politique.
-
[↑] Aut quâlibet manumissione donatum inquietare voluerit. Appendice au code Théodosien, dans le premier tome des œuvres du P. Sirmond, p. 737.
-
[↑] Aulugelle liv. XX, chap. i.
-
[↑] On trouve, dans le procès-verbal de cette ordonnance, les motifs que l’on eut pour cela.
-
[↑] Dans son ordonnance de Montel-lès-Tours, l’an 1453.
-
[↑] On pouvoit punir le procureur, sans qu’il fût nécessaire de troubler l’ordre public.
-
[↑] L’ordonnance de 1667 a fait des réglemens là-dessus.
-
[↑] Liv. II. tit. 37.
-
[↑] Dans l’appendice du P. Sismond au code Théodosien, tome I.
-
[↑] Leg. I. cod. de repudiis.
-
[↑] Voyez l’authentique sed hodiè, au code de repudiis.
-
[↑] Leg. I, ff. de postulando.
-
[↑] Dans les sentences, liv. IV, tit. 9.
-
[↑] Della guerra civile di Francia, pag. 96.
-
[↑] Elle est du mois de novembre, 1702.
-
[↑] Liv. IX des Lois.
-
[↑] C’est l’authentique, sed cùm testator.
-
[↑] Liv. XII, tit. 2. §. 16.
[III-467]
CHAPITRE XVII.
Mauvaise maniere de donner des lois.
Les empereurs Romains manifestoient comme nos princes leurs volontés par des décrets & des édits : mais ce que nos princes ne font pas, ils permirent que les juges ou les particuliers, dans leurs différents, les interrogeassent par lettres ; & leurs réponses étoient appellées des rescrits. Les décrétales des papes sont, à proprement parler, des rescrits. On sent que c’est une mauvaise sorte de législation.
[III-468] Ceux qui demandent ainsi des lois sont de mauvais guides pour le législateur ; les faits sont toujours mal exposés. Trajan, dit Jules Capitolin [1] , refusa souvent de donner de ces sortes de rescrits, afin qu’on n’étendît pas à tous les cas une décision & souvent une faveur particuliere. Macrin [2] avoit résolu d’abolir tous ces rescrits ; il ne pouvoit souffrir qu’on regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla, & de tous ces autres princes pleins d’impéritie. Justinien pensa autrement, & il en remplit sa compilation.
Je voudrois que ceux qui lisent les lois Romaines distinguassent bien ces sortes d’hypotheses d’avec les sénatus-consultes, les plébiscites, les constitutions générales des empereurs, & toutes les lois fondées sur la nature des choses, sur la fragilité des femmes, la foiblesse des mineurs, & l’utilité publique.
[III-469]
CHAPITRE XVIII.
Des idées d’uniformité.
Il y a de certaines idées d’uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits (car elles ont touché Charlemagne), mais qui frappent infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu’ils reconnoissent, parce qu’il est impossible de ne le pas découvrir : les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’état, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos, sans exception ? Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ? Et la grandeur du génie ne consisteroit-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l’uniformité, & dans quel cas il faut des différences ? A la Chine, les Chinois sont gouvernés par le cérémonial Chinois, & les Tartares, par le cérémonial Tartare : c’est pourtant le peuple du monde qui a le plus la tranquillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent les lois, qu’importe qu’ils suivent la même ?
[III-470]
CHAPITRE XIX.
Des Législateurs.
Aristote vouloit satisfaire, tantôt sa jalousie contre Platon, tantôt sa passion pour Alexandre. Platon étoit indigné contre la tyrannie du peuple d’Athenes. Machiavel étoit plein de son idole, le duc de Valentinois. Thomas More, qui parloit plutôt de ce qu’il avoit lu que de ce qu’il avoit pensé, vouloit [1] gouverner tous les états avec la simplicité d’une ville Grecque. Arrington ne voyoit que la république d’Angleterre, pendant qu’une foule d’écrivains trouvoient le désordre partout où ils ne voyoient point de couronne. Les lois rencontrent toujours les passions & les préjugés du législateur. Quelquefois elles passent au travers, & s’y teignent ; quelquefois elles y restent, & s’y incorporent.
Fin du troisieme volume.
-
[↑] Dans son Utopie.